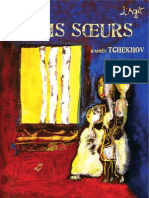Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Skenegraphie 1262
Transféré par
tamereeuTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Skenegraphie 1262
Transféré par
tamereeuDroits d'auteur :
Formats disponibles
Skén&graphie
Coulisses des arts du spectacle et des scènes
émergentes
4 | Automne 2016
Médée à l’opéra
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/skenegraphie/1262
DOI : 10.4000/skenegraphie.1262
ISSN : 2553-1875
Éditeur
Presses universitaires de Franche-Comté
Édition imprimée
Date de publication : 31 décembre 2016
ISBN : 978-2-84867-584-8
ISSN : 1150-594X
Référence électronique
Skén&graphie, 4 | Automne 2016, « Médée à l’opéra » [En ligne], mis en ligne le 06 décembre 2016,
consulté le 18 mai 2020. URL : http://journals.openedition.org/skenegraphie/1262 ; DOI : https://
doi.org/10.4000/skenegraphie.1262
Ce document a été généré automatiquement le 18 mai 2020.
Presses universitaires de Franche-Comté
1
SOMMAIRE
Édito
Claire Lechevalier, Julia Peslier et Romain Piana
Carnet critique
La femme aux trois visages : plasticité de la figure théâtrale de Médée
Zoé Schweitzer
Quels tragiques pour Médée ?
Tiphaine Karsenti
Scénographier Médée
Marie-Noëlle Semet
Entre Grand Siècle et pop art, trois mises en scène de la Médée de Charpentier
Fabien Cavaillé
La femme puissante. Entretien avec Emmanuelle Haïm
Propos recueillis par Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier
Emmanuelle Haïm, Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier
La « survivance » du mythe de Médée dans Médée-matériau de Heiner Müller
Florence Baillet
Les chœurs dansants de Sasha Waltz. Medea, d’après l’opéra Medeamaterial de Pascal
Dusapin
Cécile Schenck
« Je crois que Médée n’est rien d’autre qu’une femme ». Entretien avec Krzysztof
Warlikowski
Propos recueillis par Leyli Daryoush & Romain Piana
Krzysztof Warlikowski, Leyli Daryoush et Romain Piana
Carnet photographique
Trois Médée au Théâtre des Champs-Élysées. Krzysztof Warlikowski, Pierre Audi & Sasha
Waltz
Ruth Walz, Sebastian Bolesch et Vincent Pontet
Carnet de la création
Inédit
Littérature francophone
Présentation. Carlotta de Gilles Laubert
Julia Peslier et Pascal Lécroart
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
2
Carlotta (soliloque), 2008
Pièce issue de la trilogie Elles parlent aux animaux. Extraits
Gilles Laubert
Traduction
Santa Cecilia [Santa Cécilia]. Note introductive de l’auteur
Abilio Estévez
Santa Cecilia [Santa Cécilia], 1993
Extrait
Abilio Estévez
Carnet des spectacles et des professionnels
Chroniques des spectacles
Vers l’antique. Verso Medea, spectacle-concert d’après Euripide, mise en scène d’Emma
Dante
Zoé Schweitzer
L’écriture au scalpel : La Dictadura de lo cool de Marco Layera
Margot Dacheux
Portraits de compagnies
« Le rire est le meilleur remède contre la peur ». Constantin Bogomolov, « enfant terrible »
de la scène russe
Christine Hamon-Sirejols
Vie de festivals
Entretien avec Guillaume Dujardin, directeur du « Festival de caves »
Propos recueillis par David Ball
Guillaume Dujardin et David Ball
Les Rencontres internationales du Théâtre universitaire de Franche-Comté
David Ball et Axelle Baux
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
3
Édito
Claire Lechevalier, Julia Peslier et Romain Piana
1 Résolument voué à de sensibles, brûlants et lumineux portraits de femmes, jusque dans
leurs épreuves les plus noires qu’elles dévoilent et contiennent tout à la fois sur scène, ce
quatrième numéro fait la part belle aux monologues incisifs et aux lamentations
féminines, celles des filles et des mères, des épouses congédiées, des prostituées et des
actrices exploitées, aux quatre coins de la rose des temps, du monde grec antique aux
créations les plus contemporaines. Explorant à l’opéra comme au théâtre la douleur qu’il
y a à habiter le monde dans ses révolutions permanentes et ses bouleversements de
paradigmes, ces figures déchues, minées par le secret, le remords ou la rage de vivre,
prennent la parole pour mettre au jour leur « vitalité désespérée » selon la magnifique
expression de Pier Paolo Pasolini, lui aussi créateur de telles figures. On se souvient avec
émotion du visage si douloureux, humain et tellement expressif de Maria Callas, dans
Medea, et de son déracinement radical. Ce serait lui, supplique sublime et rageuse, qui
serait à lire en filigranes de ce numéro.
2 Du côté du carnet de la création, c’est le personnage flamboyant et terriblement
émouvant de Carlotta Carlotto, dans une pièce inédite de Gilles Laubert, inscrite dans la
trilogie Elles parlent aux animaux, qui raconte l’histoire d’une actrice déclassée qu’on fait
entrer de force aux Variétés dans une décadence voyeuriste. L’exhortation à tout dire
entre en lutte avec la pudeur et la dignité à ne pas céder au protocole spectaculaire et
racoleur, ce qui déséquilibre et désarme le récit… C’est aussi Santa Cecilia, prostituée à la
Havane, rôle créé pour l’actrice Vivian Acosta par l’écrivain Abilio Estévez, en un temps
qui semble se suspendre dans sa voix, dans son souffle de noyée, dans sa logorrhée
poignante et étincelante. « Une vieille femme parle d’une ville mythique qui n’est plus.
Une pauvre folle dit qu’elle s’est noyée et que La Havane s’est dissoute comme du
papier », écrit l’auteur. À travers elle, le portrait de la ville et de sa désespérance, de ses
senteurs et de ses mœurs : on le lira dans une édition bilingue dont la traduction,
proposée par Laure Gauzé et Audrey Aubou, a été mise en scène par Iván Jiménez avec
Linnett Hernández Valdés dans le rôle-titre, réalisée suite à une journée d’étude
consacrée à l’œuvre de l’auteur à l’École normale supérieure en 2012. Abilio Estévez
retrace pour nous la genèse de ce texte qui « sortait pratiquement de [sa] vieille Olivetti
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
4
pour prendre corps dans cette actrice si puissante ». Comme postés respectivement il y a
une dizaine et vingtaine d’années, ces deux textes aujourd’hui publiés croisent nos temps
déroutés, les hantent en amont : depuis les migrances et les noyades sans fins que la
littérature met au jour en différents lieux du globe, telle la baroque Anguille sous roche
d’Ali Zamir (éd. Tripode, prix Senghor du premier roman francophile et mention spéciale
du prix Wepler 2016) ou les très déterminés Tropiques de la violence de Natacha Appanah
pour les Comores, au marquage de la fin d’une époque alors qu’une autre s’ouvre avec la
mort de Fidel Castro et ses incertitudes à venir, ou encore au ravivement des haines, des
attaques et des volontés de répression et d’humiliation contre les homosexuels.
3 Et puis c’est Médée… Médée baroque, Médée plurielle, Médée contemporaine, Médée
opératique, mise à l’honneur dans le dossier coordonné et présenté dans les lignes
suivantes par Claire Lechevalier et Romain Piana.
Médée à l’opéra
4 La fascination suscitée par la figure de Médée aujourd’hui, mais aussi la fécondité du
renouvellement d’interprétation qu’elle engendre ne cessent de s’incarner, ces dernières
années, à travers sa présence récurrente sur les scènes contemporaines1. Par son acte en
effet, le personnage de Médée remet en question les fondements de notre humanité, dont
elle fait éprouver les limites à celui qui la contemple, dans une expérience plurielle de la
transgression : le socle de l’humain (moral, affectif, civique…) en paraît ébranlé, tandis
que l’humanité même du personnage se trouve parallèlement constamment réaffirmée.
Donner à voir ou à entendre Médée, c’est donc inviter – ou davantage pourrait-on dire,
forcer – le spectateur à s’interroger sur l’ambivalence des liens qui lui apparaissaient
comme les plus solides, mais c’est aussi lui faire vivre une expérience d’une violence
inouïe, aux limites de l’irreprésentable.
5 Le projet de ce dossier a plus précisément trouvé sa source dans la richesse, la variété et
le caractère exceptionnel de la programmation, dans une même maison (le Théâtre des
Champs-Élysées), en quelques mois (l’automne 2012), de trois opéras, mais aussi de trois
directions d’orchestre et de trois mises en scènes récentes, avec une esthétique affirmée,
autour de la figure de Médée : Médée de Charpentier (Emmanuelle Haïm, Pierre Audi,
Jonathan Meese), Médée de Cherubini (Christophe Rousset, Krzysztof Warlikowski), Medea
de Pascal Dusapin (création chorégraphique de Sasha Waltz)2. Or, si Médée, héroïne de
fureur et d’ensorcellements, a pu incarner parfaitement le pouvoir d’enchantement de
l’opéra naissant, si les multiples nuances de la voix comme le jeu des différents timbres de
l’orchestre ont pu apparaître comme particulièrement propices à faire naître ce plaisir
mêlé de l’horreur et de la volupté, en quoi sa représentation contemporaine peut-elle
encore nous choquer ou nous bouleverser ? Comment son destin ou sa revendication
interrogent-ils de façon nouvelle et radicale notre monde contemporain ? Comment
croiser les différentes problématiques qu’elle soulève : qu’il s’agisse, entre autres, de
l’opposition du masculin et du féminin (ou pourrait-on dire, de la guerre des sexes), de la
révolte de l’individu contre le pouvoir, de la place de l’étranger (voire de la barbare) dans
la cité ?
6 Enfin et surtout, comment la scène contemporaine de l’opéra, à travers les différentes
strates historiques dont elle se compose et la multiplicité des voix qu’elle fait se mêler,
apporte-t-elle une réponse singulière à l’ensemble de ces interrogations ? Il s’agira ici
d’analyser les différents enjeux (mythique, textuel, opératique), mais aussi les différents
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
5
projets (orchestral, scénique, chorégraphique), qui viennent se confronter à la réalité de
la scène et se croiser au sein de ce processus pluriel et par là-même mouvant – voire
organique –, que constitue la création opératique. Et pour cela, il a semblé fécond de faire
se côtoyer la parole des artistes et celle des chercheurs, afin d’éclairer les œuvres dans la
multiplicité et la variété de leurs dimensions.
7 C’est pourquoi, si l’accent est mis ici sur trois représentations singulières, nous avons
aussi voulu reconstruire l’histoire de la réception au sein de laquelle ces dernières
trouvent leur place : seront ainsi évoquées au cours de ces pages la mémoire de la Médée
de Pasolini ou celle des versions de Médée de Charpentier réinventées par Robert Wilson
ou par William Christie et Jean-Marie Villégier. Mais la comparaison pourrait s’élargir
bien au-delà, tant la figure de Médée hante la scène contemporaine. On pourrait ainsi
évoquer la production récente de l’œuvre de Marc-Antoine Charpentier à Bâle dans la
mise en scène de Nicolas Brieger et sous la direction d’Andrea Marton3, ou, naguère,
l’opéra que la compositrice Michèle Reverdy créa, sur un livret de Kaï Stefan Fritsch et
Bernard Banoun, d’après Medea-Stimmen, le roman de Christa Wolff4. Une fois encore, et
ce même si la référence à l’Allemagne contemporaine, inhérente au roman, se trouve
atténuée, la solitude de Médée s’incarne dans les différents gestes de la scène actuelle, de
la voix de Françoise Masset aux images méditerranéennes projetées par Raoul Ruiz sur le
décor5.
8 De Marc-Antoine Charpentier à Pascal Dusapin, l’évolution de la représentation de la
figure de Médée est d’abord affaire de dramaturgie. Les livrets de Thomas Corneille pour
Charpentier, de François-Benoit Hoffmann pour Cherubini, la Medea-Material de Heiner
Müller que Dusapin met en musique, travaillent chacun à leur manière, dans le cadre
d’esthétiques dramatiques et opératiques distinctes, un modèle antique lui-même double.
Zoé Schweitzer analyse ces variations, que prolongent les mises en scène, en partant des
origines grecques (Euripide) et latine (Sénèque) de la représentation du mythe. Tiphaine
Karsenti en dégage, pour sa part, le substrat tragique, en confrontant les textes à la
réflexion des théoriciens, pour montrer qu’il est à l’œuvre de la façon la plus affirmée
– paradoxalement – dans la version la plus déconstruite et la plus éloignée du modèle
formel de la tragédie, celle de Müller. Ces variations sur les mythes, à l’autre bout de la
chaîne, font l’objet d’une mise en forme plastique et spatiale qu’étudie Marie-Noëlle
Semet, explorant le travail scénographique de Jonathan Meese pour Pierre Audi, de Pia
Maier Schriever, Thomas Schenk et Heike Schuppelius avec Sasha Waltz, de Malgorzata
Szczesniak avec Krzysztof Warlikowski.
9 À ce paysage d’ensemble succèdent des éclairages sur les œuvres singulières.
Emmanuelle Haïm, fondatrice du Concert d’Astrée, interrogée par Claire Lechevalier et
Fabien Cavaillé, évoque, du point de vue du chef d’orchestre, les enjeux de la production
de la Médée de Charpentier, tandis que Fabien Cavaillé met en perspective la mise en
scène de Pierre Audi avec deux de ses devancières, celles de Robert Wilson (1984) et de
Jean-Marie Villégier (1993). Cécile Schenck propose une analyse du travail
chorégraphique de Sasha Waltz en relation avec la mémoire d’autres rêveries dansées sur
l’antique, de Pina Bausch à Martha Graham, Béjart et Nijinsky. Aby Warburg, qu’elle
convoque, accompagne également la réflexion de Florence Baillet sur « Médée-
Matériau » de Heiner Müller, dont le texte sert de livret à l’œuvre de Dusapin. C’est enfin
Krzysztof Warlikowski qui livre, dans un entretien mené par Leyli Daryoush et Romain
Piana, sa vision de l’œuvre de Cherubini et du personnage de Médée, figure d’une altérité
qui frappe également par sa proximité.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
6
Autres explorations des compagnies, festivals et
spectacles
10 Face à ces femmes et à leurs chants d’envoûtement et de protestation, le troisième cahier
de ce numéro, consacré aux chroniques, aux entretiens, aux portraits de compagnie, de
professionnels et de metteurs en scènes, offre l’occasion de découvrir le local et
l’universel, en une diversité bienvenue. De la Russie contemporaine de Constantin
Bogomolov aux Caves et à leur festival né à Besançon en 2005 sur une idée de Guillaume
Dujardin aujourd’hui déployée dans de nombreuses villes, du Théâtre universitaire de
Franche-Comté et de leurs rencontres internationales au Chili de Marco Layera et à la
société de spectacle qui y gronde (spectacle présenté à Avignon en 2016), voilà quelques-
unes des coordonnées que l’on parcourra avec nos chroniqueurs et chroniqueuses.
11 On retrouvera d’abord Médée sur une scène de théâtre, celle d’Euripide, mais
défamiliarisée et mise en scène par Emma Dante, avec la belle chronique de Zoé
Schweitzer, « Vers l’antique. Verso Medea, spectacle-concert d’après Euripide ». Puis l’on
votera, jouera, se scandalisera ou se fondra dans la masse avec « l’écriture au scalpel. La
Dictatura de lo cool de Marco Layera » que Margot Dacheux nous raconte. Entre
transgression, liberté et rire, Christine Hamon-Sirejols reviendra sur la trajectoire de
Constantin Bogomolov, son « art de “faire rendre gorge” aux classiques » et tout
particulièrement sur le spectacle Un mari idéal qui transpose la pièce d’Oscar Wilde dans la
Russie contemporaine, en y montant toute sortes de références très imprévisibles.
Fondateur du festival de Caves, Guillaume Dujardin dans son entretien avec David Ball,
revient sur sa genèse, ses modalités et son arborescence. Enfin, par une réactivation du
partenaire historique de Skén&graphie – d’où partait il y a près de trente ans l’aventure de
Coulisses, revue qui a précédée Skén&graphie –, le Théâtre Universitaire de Franche-Comté
reprend la plume avec David Ball et Axelle Baux et présente ses Rencontres
Internationales (les RITUFC 2015), à travers cinq spectacles européens représentant les
universités de Besançon, de Brno, de Saint Pétersbourg, de Vilinus, de Riga et les mises en
scène respectives de Joseph Melcore (France), Kamila Kostricova (République Tchèque),
Andrius Pulkauninkas (Lituanie), Jonathan Durandin (Lettonie).
12 Ce numéro quatre accompagne par ailleurs le lancement du site web de la revue, ainsi que
celui du Fonds Coulisses, tous deux hébergés par le portail de ressources revues.org. Le
travail a été préparé en amont depuis deux ans avec François Grosdemouge, Sandra
Guigonis, Ghislaine Gautier et Nicolas Coquet. Qu’ils en soient tous remerciés
chaleureusement ici. Les deux sites, liés entre eux, sont consultables par ces liens :
13 Skén&graphie https://skenegraphie.revues.org/
14 Coulisses https://coulisses.revues.org/
15 On annonce pour finir la préparation des prochains dossiers critiques : à l’occasion de
l’anniversaire des quatre cent cinquante ans de la naissance de Shakespeare, un ensemble
sur « nos Shakespeare au musée », une réflexion collective sur la « tradition réadaptée en
création contemporaine – entre monde, voyage et transfert », des variations plurielles sur
« Lagarce génétique, Lagarce cinématographique à propos de Juste la fin du monde »… Qui
sait, si l’un d’eux retiendra votre attention, au point de vous faire devenir contributeur de
notre aventure skén&graphique ?
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
7
NOTES
1. Parmi les spectacles récents inspirés par le mythe, on peut mentionner la Medea du metteur en
scène australien Simon Stone, créée à Amsterdam avec la troupe du Toneelgroep Amsterdam en
décembre 2014, et en tournée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe en juin 2017.
2. Le présent dossier a pour point de départ une journée d’études et de rencontres tenue, le 11
décembre 2012, au Théâtre des Champs-Élysées. Le directeur du TCE, Michel Franck, avait conçu,
pour le centenaire du lieu, une « Trilogie Médée » s’ouvrant sur la création de la Médée de
Charpentier (Haïm-Audi-Meese, 12-21 octobre) et comportant les reprises de la version de Sasha
Waltz (9-10 novembre) et de l’opéra de Chérubini dans la production du Théâtre de la Monnaie
(Rousset – Warlikowski, 10-16 décembre).
3. Theater Basel, 15 janvier 2015. Le rôle-titre est tenu par Magdalena Kožená.
4. L’œuvre, commandée par l’Opéra de Lyon, y est créée le 23 janvier 2003 sous la direction de
Pascal Rophé, dans une mise en scène de Raoul Ruiz. Michèle Reverdy en donne une analyse
détaillée – accompagnée d’extraits – dans la Notice qu’elle y consacre sur son site personnel (
http://www.michelereverdy.com/oeuvres_detail.php ?id =55).
5. Voir la présentation de l’œuvre par Emmanuel Reibel et Yves Balmer, Michèle Reverdy
compositrice intranquille, Paris, Vrin, 2014, p. 50-51 notamment.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
8
Carnet critique
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
9
La femme aux trois visages :
plasticité de la figure théâtrale de
Médée
Zoé Schweitzer
1 Longtemps, la femme a été déterminée comme fille ou sœur, comme épouse ou bien mère
de tel ou tel homme ; définie par son lignage et ses parentés, elle n’existe que par, et au
travers, des relations. Or toutes ces identités, qui traduisent l’idéologie qu’elles mettent
en œuvre, sont menacées, sinon détruites par la Corinthienne Médée, meurtrière des
hommes de sa famille et destructrice des liens du sang. Il serait erroné de croire que cette
approche de couleur sociologique qui indique ce qu’ont de polémique les actions du
personnage et qui invite à s’interroger sur leur potentialité subversive au regard des
normes est anachronique, ou, pire, relève d’un placage interprétatif intempestif. Cette
réflexion, qu’aujourd’hui on rapprocherait des études de genre, se déploie dans les
ouvrages de mythographie ou les essais sur les femmes. Les uns et les autres s’interrogent
sur ces forfaits qui mettent à mal plusieurs a priori philosophiques, médicaux ou
idéologiques.
Médée, héroïne tragique, héroïne de fiction
2 Afin de cerner la spécificité de ce mythe et de comprendre l’originalité du travail des
dramaturges, il est important de rappeler que les deux tragédies antiques, matériau
largement exploité par les œuvres scéniques modernes (XVIe-XXIe siècles), sont déjà les
actualisations d’un substrat mythologique, qu’elles ont modifié en profondeur.
3 Euripide a inventé de dénouer l’épisode corinthien par l’infanticide, alors que dans les
versions antérieures les Corinthiens vengeaient la mort de leur roi et de sa fille en
assassinant les enfants de la coupable. Il compose un personnage féminin victime de la
cruauté masculine et de la tyrannie phallocrate, d’un Jason ambitieux et d’un Créon
abusif, déchiré entre la légitime colère d’une épouse bafouée et l’affection d’une mère
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
10
dévouée. Certes Médée tue ses enfants pour faire souffrir le traître, mais elle ne se résout
à ce crime inimaginable qu’après une délibération pathétique qui montre le triomphe du
thymos sur les bouleumata1. C’est à la faveur d’une invention scénique que le personnage
conquiert sa fortune mythologique qui trouve, logiquement, son expansion dans les arts
de la scène qui l’ont fait naître. Médée montre ainsi tout le bénéfice d’une approche en
termes de mythopoétique, seule à même d’expliquer à la fois l’émergence d’un
personnage atypique et son succès variable selon les genres.
4 Après l’invention du crime par Euripide, c’est à Sénèque qu’il revient d’en imaginer la
représentation la plus surprenante, et pour tout dire, la plus radicale et la plus brutale :
Médée tue ses enfants sur scène, le premier aux yeux d’un spectateur sidéré, le second
sous le regard conjugué du père qui implore un châtiment bref après avoir échoué à
épargner son fils. Si la pièce latine frappe les spectateurs, cela tient en particulier à la
force incantatoire de ses propos dont la violence s’exprime sans mesure. Outre le char ailé
dont la vision s’impose au dénouement, le traitement de la magie et de l’infanticide font
de Médée une tragédie spectaculaire. Sénèque a adapté le sujet et son personnage
principal au goût des spectateurs romains contemporains ; l’Antiquité déjà n’est pas avare
de modifications motivées par le goût du public.
5 Dans ces deux tragédies antiques, où l’amour maternel est défait et où l’épouse a
triomphé de la mère, les poètes ont rivalisé d’inventivité dramatique et dramaturgique
afin de composer un personnage terrifiant et néanmoins séduisant, scandaleux,
fantasmatique peut-être, dont les forfaits soient à la fois motivés et insoutenables.
6 La notion de plasticité, si souvent galvaudée, trouve avec Médée une illustration
exemplaire. Le personnage mythologique est par nature malléable et mobile ; si Médée
s’avère spécifiquement plastique c’est qu’elle est tributaire des normes de l’époque qui la
représente et se trouve infléchie, modifiée, informée au gré des idées qui régissent la
conception du public et du dramaturge, notamment en matière de rôle des femmes.
Comme elle menace l’identité traditionnelle de la femme, chaque époque se trouve
comme assignée à réfléchir à ses propres schémas identificatoires avec ce personnage
problématique dont la représentation est comme un révélateur des idées de son temps
dans ces domaines idéologiques que l’action de Médée bouleverse, voire met en péril.
Représenter Médée, c’est faire l’expérience de l’adaptabilité du personnage nécessaire à
sa réception. Si l’adaptabilité, au sens des modifications apportées au caractère ou aux
actions du personnage, est un gage de sa pérennité sur la scène européenne, la plasticité
de l’héroïne et du sujet du point de vue générique explique aussi son succès car des
genres nouveaux et des artistes modernes peuvent se les approprier, sans être gênés par
l’ancienneté du personnage et sa représentation tragique antique. La plasticité de Médée
est donc double, à la fois sur le terrain du caractère et de l’intrigue et sur celui des formes
artistiques.
7 Les réécritures peuvent être analysées en fonction du portrait qu’elles donnent de Médée
parmi les trois visages qui dominent de la Renaissance à l’époque contemporaine : la
magicienne, la femme et la barbare ; chacun est présent avec une importance relative
selon l’œuvre et l’époque, ce qui n’exclut pas qu’il soit mâtiné d’un autre.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
11
« Connaissez tout ce que je suis » (V, 4) : la
magicienne toute puissante de la tragédie lyrique de
Charpentier et Corneille (1694)
8 Avec l’élaboration des règles et normes classiques, l’histoire de cette femme criminelle
devient impropre à la scène tragique2 : la violence des actions, un dénouement
spectaculaire qui consacre la fuite de la criminelle impunie sont quelques-uns des
éléments qui contribuent au déficit de vraisemblance et de bienséances de l’aventure
corinthienne. Elle réapparaît sur la scène lyrique pour les mêmes raisons : ce personnage
de magicienne jalouse qui accomplit des sortilèges extraordinaires sied à un genre qui se
construit comme le symétrique inversé de la tragédie parlée. Le personnage de Médée est
non seulement un personnage archétypal de ce genre en Italie et en France, mais
contribue à son élaboration3.
9 Dans ces œuvres lyriques, plutôt qu’une barbare intrépide ou inhumaine, Médée est une
femme passionnée, plutôt qu’une criminelle une amoureuse : l’intrigue se dote d’une
couleur galante et la cruauté est largement évacuée, notamment avec l’éviction du plaisir
intense que procure la vengeance, à la différence notamment des œuvres antiques.
Surtout, la magie est développée pour devenir l’un des traits dominants du personnage et
l’un des ressorts du plaisir des spectateurs. En ce sens Thomas Corneille renoue avec
Sénèque et s’inscrit dans la continuité du Corneille baroque de Médée, mais délaisse la
tradition théâtrale classique qui s’illustre l’année d’après, en 1694, dans la version
tragique que donne de ce sujet le racinien Longepierre. Cette magie favorise et justifie des
effets spectaculaires ambitieux, dépourvus de prétention à une quelconque illusion
fictionnelle. De brusques changements de décor aboutissent à de véritables tableaux
vivants qui sont propices à des duos ou à des trios lyriques particulièrement virtuoses. La
fin de l’acte III de la Médée de Thomas Corneille offre une illustration très réussie des
possibilités de ce vraisemblable extraordinaire : la préparation du poison qui exterminera
Créuse justifie qu’apparaissent une troupe de démons et des allégories de la Vengeance et
de la Jalousie, tandis que Médée mêle des objets étranges et des herbes rares dans un
chaudron. La scène toute entière est comme ensorcelée ; c’est un monde de sons inouïs et
d’objets invisibles qui est offert aux spectateurs.
10 Le décor imaginé par l’artiste Jonathan Meese dans la version présentée au Théâtre des
Champs-Élysées fait la part belle à cette préparation, tout en soulignant ce que peut avoir
de plaisant, pour nous modernes, cette confiance dans les pouvoirs de la magie. Comme
un magicien, le scénographe transforme les matières : il joue de la proximité entre
poisons et potions, chaudrons et casseroles grâce à un décor qui évoque une immense
cuisine dans laquelle règne une magicienne devenue maîtresse-queue. L’art terrible de la
magie est métamorphosé ici en art culinaire. Le spectaculaire est déplacé sur un terrain
strictement esthétique : la disproportion des accessoires culinaires, les couleurs
éclatantes du décor, voire criardes, frappent le regard. Ce jeu de défamiliarisation peut
être envisagé comme une solution pour retrouver le vraisemblable extraordinaire de la
tragédie lyrique. Toutefois cette magie n’est pas seulement fictionnalisée et distanciée,
comme elle l’était déjà dans la tragédie lyrique, elle est aussi, par le déplacement dans le
champ domestique, caricaturée et risible, si bien que la scène d’enchantement ne saurait
susciter le moindre effroi.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
12
11 Le traitement de cette scène laisse penser que l’interprétation du double régicide de
Médée est résolument dépolitisée et que l’opéra est conçu comme un divertissement
plaisant sans ambiguïté. Toute criminelle que soit l’héroïne de Corneille et Charpentier,
elle n’est pas véritablement tragique dans cette œuvre qui privilégie le spectaculaire et la
virtuosité des effets scéniques et vocaux.
« Mère dénaturée » et « épouse bafouée » : Médée en
femme outragée dans l’opéra de Cherubini et Hoffman
(1797)
12 Pour le livret de la Médée mise en musique par Cherubini, créée en 1797, le librettiste
Hoffman s’inscrit dans la double filiation d’Euripide et de Sénèque. Il emprunte au Grec
une Corinthienne victime d’un pouvoir abusif, tiraillée entre son amour de mère et sa
colère d’épouse, mais puise chez le Latin la force incantatoire et la joie cruelle de son
héroïne. Le librettiste explore avec ce personnage les contradictions qui peuvent
apparaître entre les différentes identités de la femme, en particulier entre l’épouse et la
mère, lorsqu’elle se trouve dans une situation singulière et inhabituelle qui fait vaciller
un équilibre supposé inné et intangible. La transformation du banal en extraordinaire, à
la faveur notamment du personnage très puissant et imprévisible de Médée, permet la
progression de l’intrigue tragique qui exploite les dissonances entre les caractères et
entre les situations.
13 Ouvrir l’opéra sur la vision de Néris, princesse de Corinthe, inquiète d’épouser un homme
qui trahit sa femme, et affligée des réactions de l’épouse délaissée est assurément une
trouvaille originale du librettiste. Elle permet de créer un contre-point dramatique et
lyrique à Médée, qui régnait sans partage dans les œuvres lyriques antérieures ; cette
inquiétude mêlée d’empathie confère au personnage de la rivale une chaleur nouvelle, qui
contribue à marginaliser l’héroïne. Cette invention du librettiste met aussi en lumière le
motif de la trahison conjugale, placée désormais au centre de l’histoire, l’aventure
corinthienne se trouve du côté du drame conjugal. Les appréhensions de la jeune
princesse colorent également la suite des événements : la violence des crimes et le
dénouement sanglant ne s’expliquent pas seulement par la personnalité exceptionnelle
des protagonistes, mais aussi par la nature des événements et leurs conséquences
inhérentes. Est-ce à dire que les malheurs des personnages mythologiques ne diffèrent
pas de ceux de l’humanité commune ou bien, à l’inverse, que les héros de la scène sont
foncièrement analogues aux spectateurs ? Quoi qu’il en soit, tout est fait pour éviter une
solution de continuité dramatique entre la scène et la salle dans cet opéra qui invite à une
réflexion sur les passions.
14 Une même richesse interprétative se trouve au cœur de la longue scène de délibération
de Médée à l’acte III et permet de renouveler avec succès cette scène attendue. La mère
éplorée se déplace d’un enfant à l’autre au gré de ses hésitations, tantôt haï, tantôt adoré,
avec un pathétique qui va crescendo jusqu’à la résolution funeste. Le librettiste reprend ici
l’une des scènes les plus efficaces et les plus célèbres de la tragédie d’Euripide, où Médée
délibère de l’infanticide après avoir exhorté ses jeunes fils dont elle ne supporte plus la
vue à rentrer dans la maison, mais pour proposer une interprétation sensiblement
différente de l’héroïne et de son geste scandaleux. Les hésitations sont amplifiées pour
donner au personnage une profondeur psychologique supplémentaire, qui est plus
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
13
conforme à l’époque, et peindre cette mère criminelle sous un jour pleinement
pathétique. Médée peut ainsi être à la fois mère et infanticide, condition sine qua non de
son acceptabilité pour des spectateurs des Lumières pour qui la femme est d’abord une
mère.
15 En décidant de changer les récitatifs – ce qui a pu surprendre les pieux amateurs de
Cherubini et Hoffman –, Krzysztof Warlikowski et Christian Longchamp s’inscrivent dans
la continuité du librettiste, qui lui-même réécrit Euripide, et s’avèrent finalement fidèles
à l’esprit du mythe antique qui n’a cessé d’être modifié, aménagé au gré des reprises qui
sont autant de réactualisations. Défendre Médée, c’est éprouver la nécessité d’adapter le
personnage à son époque, sous peine de le discréditer. La fidélité n’est pas la reproduction
et l’imitation n’est pas la copie.
16 Les modifications apportées au livret éclairent leur interprétation de l’œuvre, tout en
révélant ce qui les intéresse dans cette version spécifique, créée en 1797, du mythe de
Médée. Lorsque débute l’opéra, c’est une femme superbe, dans tous les sens du terme, une
icône de la modernité. Elle rappelle la sulfureuse chanteuse Amy Winehouse par son
maquillage et sa coiffure ostentatoires, sa robe noire moulante, ses tatouages ou son
addiction à l’alcool, puis ces signes disparaissent pour laisser place à une femme
commune, si l’on peut dire : son dénuement, ses postures et ses gestes évoquent la
douleur féminine telle qu’elle est représentée dans toute une tradition dont on trouve
trace déjà dans les tableaux renaissants. Les vidéos qui montrent une succession de vies
féminines marquées par les mêmes étapes rituelles – séduction, mariage, naissance et
éducation des enfants – contribuent également à inscrire Médée dans un universel
féminin.
17 Si l’héroïne est contemporanéisée, à la faveur notamment du décor, l’interprétation n’est
cependant pas une actualisation, au sens où le metteur en scène traiterait Médée comme
une femme de notre époque, opération à la fois d’embourgeoisement et de banalisation de
l’héroïne antique. Deux raisons, au moins, à cela : la musique de Cherubini et le
traitement de l’infanticide. Cherubini confère à la soprane un rôle écrasant, par sa
présence continuelle sur scène et la difficulté de la partition. Sa musique, aux couleurs
vives et fortes, vise à susciter des émotions intenses qui parviennent aux spectateurs
grâce à l’interprétation des chanteurs, exaltés par la mise en scène qui leur confère une
dignité tragique et majestueuse. La mort des enfants n’est en rien édulcorée par
K. Warlikowski : la criminelle est maculée de sang, sa tunique en est inondée tandis
qu’elle brandit le poignard sanglant, dans ce qui semble un hommage à ce parangon de
violence qu’est la Médée de Sénèque qui imaginait de fouiller ses entrailles d’un glaive
pour en extraire un éventuel fœtus. Renouer avec l’antique permet à l’interprétation de
K. Warlikowski d’exhaler la force et la modernité de cet opéra, qui est, paradoxalement,
une œuvre à la fois patrimoniale, fameuse et méconnue.
« Moi ta chienne ta putain moi » : la matière de
l’héroïne dans Médée-matériau de Heiner Muller (1982)
4
18 Chez Heiner Müller, la tragédie prend la forme d’un texte de moins de dix pages, qui
débute par un bref échange entre les deux époux séparés pour laisser ensuite à Médée la
parole jusqu’à l’accomplissement de ses crimes. Jason revient une fois que tout est
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
14
accompli, profère le nom de la criminelle, qui répond seulement : « Nourrice Connais-tu
cet homme5 ? ». L’héroïne à la mémoire hypertrophiée, qui énumérait les nombreuses
actions accomplies pour l’époux oublieux, est désormais amnésique.
19 Tout en écrivant une version très originale de l’histoire de Médée, tant par sa brièveté et
sa forme quasiment monologuée, que par l’orientation politique manifeste du
personnage, Heiner Müller emprunte aux deux sources antiques. La Grèce civilisatrice
dont se vantait le Jason d’Euripide s’apparente ici à une puissance colonisatrice dont
Médée dénonce le rôle destructeur lorsqu’elle évoque « les bottes de [s]a troupe »6. Ces
critiques politiques sont reprises et amplifiées par Médée qui, dans un renversement
ironique, se définit comme « barbare7 » pour mieux dénoncer la véritable barbarie que lui
imposent Corinthe et la Grèce. Créon a certes disparu du discours, mais cette éviction
semble finalement superficielle, permettant à Médée de concentrer ses attaques contre
un Jason représentatif d’une pratique politique et d’une conception du monde fondées sur
la violence et la trahison. Si les crimes de Médée visent comme dans les versions antiques
à réparer l’offense, l’infanticide se voit doté en plus d’une signification tout à fait
originale. Il ne s’agit pas de retrouver une virginité perdue, comme chez Sénèque, mais de
réintégrer ses corps un temps séparés, comme si le crime était fusion des corps –
« Réintégrez mon corps vous entrailles ». L’infanticide est un geste qui « déchir[e]
l’humanité en deux » et laisse la mère anéantie, « dans le vide du milieu » redéfinie en un
« Moi » qui n’est « ni femme ni homme »8. Et pourtant cette Médée est encore mère,
encore épouse, encore sous le coup de l’égarement, lorsqu’elle injurie ses fils innocents et
néanmoins coupables pour et par leur père.
20 L’efficacité du texte de Müller tient notamment à cette Médée qui est à la fois sur le
modèle antique et foncièrement nouvelle. Le personnage dessine une trajectoire qui va du
rappel obstiné du passé, dont elle est dépositaire, à une négation de la temporalité, c’est-
à-dire finalement une manière d’incarner le mythe conçu comme présence et parole vive.
21 Dans la version mise en musique par Pascal Dusapin (création en 1992) et chorégraphiée
par Sasha Waltz (création en 2007), seule Médée chante ; les répliques de Jason et de la
nourrice sont entendues en voix off. Ainsi l’héroïne lyrique règne, conviant les
spectateurs à une représentation qui est tout à la fois intime, grâce au chant de la barbare
éplorée, que relaient quatre « voix », et spectaculaire, grâce à une chorégraphie très
vigoureuse et construite. Le ballet commence de manière majestueuse par la vision de
plusieurs panneaux du grand autel de Pergame (la frise, conservée au musée du
Pergamon à Berlin, représente une gigantomachie) qui se met en mouvement
progressivement selon un jeu d’illusion entre sculpture, cinéma et corps réels. En
renouant avec l’antique, Sasha Waltz retrouve le geste initial d’Heiner Müller et le
prolonge sous les yeux des spectateurs : Médée chante, les géants marmoréens s’animent,
comme l’Antiquité renaît sous nos yeux et à nos oreilles.
22 La scénographie et la chorégraphie réussissent à restituer la dimension tragique de
l’épisode par le traitement des morts qui jalonnent l’épisode, non seulement les deux
enfants, mais aussi Créuse. Il ne s’agit pas d’inventer un quelconque artifice spectaculaire
pour figurer le feu magique qui embrase la princesse ; le metteur en scène a imaginé une
solution très simple et visible : la mort se répand au fur et à mesure que se brisent les
perles du lourd collier de Médée qu’a revêtu la jeune femme. Le poison se répand au
rythme des perles brisées dans la danse, le mouvement du corps devient celui de la mort
triomphante et la vierge tombe lorsqu’est entièrement rougie la robe, linceul inattendu.
Le sang, banni de la scène classique, est répandu dans cette mort lente, intensément
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
15
pathétique. En parvenant à faire du meurtre de Créuse un événement tragique et
bouleversant, sans pour autant désintéresser de Médée, la chorégraphe réussit ce que
Pierre Corneille disait avoir échoué à faire9. Il est piquant d’observer que d’une réécriture
l’autre, d’une mise en scène l’autre, il existe ainsi comme un dialogue discontinu entre les
versions théâtrales du mythe.
23 Les éléments très contemporains imaginés par Müller permettent, à mon sens, de renouer
avec la violence première, scandaleuse, de la figure antique. C’est dans la tension entre
des univers culturels, qui redouble la tension entre Grèce et Colchide et entre hommes et
femmes, que le texte et le personnage trouvent leur efficacité dramatique. À l’opposé d’un
affadissement ou d’une dégradation, la transformation vivifie le mythe pour lui
permettre de rester fidèle à lui-même, parole vive en écho à un monde complexe.
24 Ce qui ne peut manquer de frapper le lecteur, et a fortiori le spectateur, c’est qu’en dépit
des changements de visage, Médée est affirmation d’un je tout-puissant, supérieure à ses
adversaires, dont la force réside en son seul pouvoir. Et là se trouve le bénéfice, et la
gageure, pour la comédienne ou la cantatrice, comme si le rôle de Médée était d’une
certaine façon un paradigme dramatique, à la fois parce que le personnage procède à la
manière d’une metteure en scène qui serait aussi actrice et spectatrice de son œuvre, et
parce que le talent de l’interprète rejaillit sur l’œuvre toute entière. Maria Callas10 comme
Lorraine Hunt11 en témoignent. Médée, actrice en son miroir ? C’est là l’un des autres
traits récurrents du personnage que la présence des commentaires et des interprétations,
si bien que la réflexivité paraît inhérente au rôle, et ce indépendamment de l’époque des
œuvres12. On comprend ainsi que la plasticité du caractère se décline en une plasticité
générique (tragédie, opéra, monologue) dont elle est, me semble-t-il, indissociable car
l’évolution du caractère épouse la recherche des formes.
25 Médée n’est pas seulement cette magicienne jalouse, cette barbare antique ou cette mère
cruelle, mais une figure archaïque et familière, antique et contemporaine tout à la fois,
c’est-à-dire précisément un mythe, donc une parole vive qui répond pour nous aux
questions de ce temps. Représenter Médée est assurément un défi, hier comme
aujourd’hui. Et, in fine, ce sont peut-être les enjeux esthétiques plus que tous les autres
qui contribuent à la fortune de cette histoire sur la scène théâtrale, classique ou moderne.
NOTES
1. EURIPIDE, Médée, v. 1078-1080.
2. Le jugement de Corneille est particulièrement intéressant : alors qu’il consacre sa première
tragédie en 1635 à la barbare corinthienne, qu’il représente comme la victime d’un pouvoir
inique et tyrannique, il est beaucoup plus réservé en 1660 sur la possibilité que pareil sujet
obtienne quelque succès. Certes, Médée n’est pas tout à fait Thyeste ; néanmoins c’est au risque de
justifier le crime et de légitimer le régicide (CORNEILLE, Discours du poème dramatique, dans Œuvres
complètes, éd. G. Couton, Paris, Gallimard, t. III, 1987, p. 122).
3. Voir l’ouvrage de Catherine KINTZLER, Poétique de l’opéra français de Corneille à Rousseau, Paris,
Minerve, 1991. Concernant le personnage de Médée plus spécifiquement et sa fortune dans le
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
16
genre lyrique, je me permets de renvoyer à mon article « De la tragédie à la tragédie lyrique : les
enjeux d’un changement générique pour le personnage. L’exemple de Médée », La Fabrique du
personnage, éd. F. Lavocat, C. Murcia et R. Salado, Paris, Champion, 2007, p. 335-348.
4. Heiner MÜLLER, Médée-Matériau [1982], dans Germania. Mort à Berlin, trad. Jean Jourdheuil et
Heinz Schwarzinger, Paris, Les Éditions de Minuit, 1995, p. 10-17, p. 12.
5. Ibid., p. 17.
6. Ibid., p. 13.
7. Ibid., p. 14 et p. 15.
8. Ibid., p. 16.
9. Voir l’analyse rétrospective que donne, en 1660, le dramaturge dans l’« Examen » de sa Médée
publiée en 1639.
10. Maria Callas interprète le rôle de Medea pour la première fois en 1953 et permet la
redécouverte de l’opéra de Cherubini.
11. Lorraine Hunt tient le rôle titre de l’opéra de Charpentier en 1993, qui n’avait pas été repris,
sous la direction de William Christie (http://www.arts-florissants.com/audio-cd/medee.html).
12. « J’écris mon spectacle » proclame le personnage d’Heiner Müller (op. cit., p. 15).
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
17
Quels tragiques pour Médée ?
Tiphaine Karsenti
1 La figure de Médée est traditionnellement associée à la notion de tragique parce qu’elle a
souvent inspiré les auteurs de tragédie, depuis Euripide et Sénèque jusqu’à Corneille
notamment. Pourtant, toutes les dimensions et toutes les interprétations du mythe ne
sont pas tragiques : Médée est une femme trompée par son mari, qui se venge. On a là
tout autant le scénario d’un vaudeville que la trame d’une tragédie.
2 Nous allons donc analyser ici les aspects du mythe de Médée qui peuvent être considérés
comme tragiques, avant d’esquisser une réflexion sur le tragique dans la Médée de Sasha
Waltz.
Définir le tragique : un problème
3 En préambule, il nous faut poser un problème de définition. Qu’entend-on en effet par
« tragique » ? L’adjectif fait-il référence à des éléments formels, tout ce qui relève des
formes dramatiques qu’on a appelées, à différentes périodes de l’histoire, « tragédies », ou
bien fait-il référence à une vision du monde ou à une conception de l’homme, telles que
les ont proposées des philosophes, depuis Schelling jusqu’à Clément Rosset ?
4 Car la réflexion sur le tragique se trouve à l’intersection de deux traditions, nées à peu
près en même temps en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, qui ont évolué parallèlement,
prenant appui sur le même corpus de pièces sans jamais véritablement se croiser 1 : une
tradition philologique, attentive à situer les textes dans leur contexte historique et
méfiante à l’égard de toute interprétation anachronique, limitant la définition du
tragique à ses aspects formels, à ce qui, au sens strict, relève de la forme dramatique
qu’est la tragédie ; et une tradition philosophique qui a vu dans les tragédies grecques la
mise en forme symbolique d’un contenu de vérité universel, concernant la lutte en
l’homme de deux principes, diversement appelés selon les théories. Comme l’écrit Pierre
Judet de la Combe : « S’est alors instaurée, en Allemagne, puis en Italie et en France, une
relation conflictuelle entre philosophie et philologie […] : les philologues-historiens ont
cherché à se détacher d’une conception spéculative de leur objet, et ont fait de la
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
18
tragédie, du mythe, de la langue, du droit, autant de domaines qui tirent leur sens de leur
propre histoire et non d’une idée sous-jacente2. »
5 Or lorsqu’un metteur en scène aborde aujourd’hui un texte de tragédie, il est nourri à des
degrés divers et avec plus ou moins de conscience, de cette double tradition ou du moins
d’une forme de vulgate à la fois philologique et philosophique, mêlant les interprétations
de la théorie aristotélicienne (notamment de l’idée de catharsis) avec des approches
conceptuelles du tragique, comme vérité fondamentale de la condition humaine. En
posant la question du tragique dans des Médée d’aujourd’hui, nous nous imposons donc
une sorte de défi, qui consiste à penser à l’intersection de ces deux approches, en se
demandant de quelles idées la forme tragique peut être porteuse pour nos
contemporains. Or la forme tragique se caractérise à la fois par une structure
dramaturgique – un certain type de personnages, entretenant entre eux un certain type
de rapports, pris dans une action dont la structure répond à certaines constantes, dans un
certain type d’espace avec une certaine étendue chronologique –, et par un dispositif
d’adresse, qui suppose que le texte soit prononcé par des acteurs/chanteurs vivants sur
une scène devant un public. Nous allons donc aborder la tragédie mise en scène, le
spectacle tragique, d’une part comme une forme-sens – une forme qui, par sa structure
même, porte une vision de l’homme et du monde –, mais aussi d’autre part comme une
expérience qui suscite chez le spectateur un type singulier d’émotion, que l’on pourra
appeler l’effet tragique.
6 Parce qu’elle est une forme construite autour de l’action d’un protagoniste, adressée à des
spectateurs dans un dispositif mêlant dialogues, musique, mouvement des corps et
structuration de l’espace, la tragédie propose une représentation de l’homme et, en même
temps, procure des émotions, des sensations.
7 Le héros tragique accomplit un trajet qui mène le plus souvent à une catastrophe, et cette
catastrophe produit un effet paradoxal dans la mesure où le spectateur ressent à la fois
des émotions violentes, désagréables, et aussi une forme de plaisir, qui peut être
esthétique, moral, psychologique selon les interprétations que l’on fera de cet effet
tragique qu’Aristote appelait la catharsis. Un plaisir paradoxal donc, qu’il faut cependant
distinguer de l’effet pathétique produit par le drame ou le mélodrame : on peut pleurer
avec plaisir face à un mélodrame, mais ce plaisir-là est différent du plaisir tragique. Dans
la tragédie, l’horreur de la catastrophe, la grandeur des enjeux évoqués (qui ont souvent à
voir avec le pouvoir, avec le savoir ou l’identité) créent une tension propre à la tragédie
entre une émotion pathétique (la pitié aristotélicienne) et une émotion plus distanciée (la
crainte, l’horreur, le sentiment de la transgression). S’il y a du tragique dans le spectacle
contemporain, c’est donc dans l’articulation entre cette émotion singulière, qui n’est pas
seulement pathétique, et la trajectoire funeste d’un héros, dont l’interprétation
symbolique et philosophique repose sur la façon dont elle s’inscrit dans l’ensemble d’un
dispositif dramaturgique, à la fois dans le texte et sur le plateau. C’est donc dans la
présence conjointe d’effets signifiants tendant à l’universalité et d’effets émotionnels
singuliers, propres à la forme que l’on nomme tragédie, que nous chercherons les traces
d’un éventuel tragique contemporain à partir du corpus ici proposé à notre réflexion
commune.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
19
En quoi le mythe de Médée renferme-t-il des
potentialités tragiques ?
8 Interrogeons-nous maintenant sur les potentialités tragiques du mythe de Médée. En quoi
cette histoire, telle qu’elle a été fondamentalement modifiée par Euripide, est-elle
porteuse de virtualités tragiques ?
9 Dans la plupart des versions dramatiques de la légende, Médée accomplit un trajet qui la
mène de la trahison de Jason vers l’infanticide. Par sa violence et son caractère contre-
nature, l’infanticide semble certes suffire à produire cette émotion mêlée de pitié et
d’horreur que suppose la tragédie si l’on suit Aristote, mais selon la façon dont on l’insère
dans la chaîne causale qui mène de l’ouverture au dénouement de la tragédie, il prend en
fait des significations différentes et peut produire des effets variés. Stendhal, par
exemple, voit dans Médée une incarnation de la psychologie féminine : « Le sujet de
Médée est superbe et non encore traité. C’est le combat des deux plus fortes passions qui
existent peut-être chez les femmes, l’amour maternel et la vengeance3. » Le tragique est
ici réduit au conflit entre deux passions contradictoires dans le cœur des femmes, et il n’a
d’universalité qu’à condition d’adhérer à la vision de la femme sous-jacente au propos, ce
que les tenants des études sur le genre invitent à mettre en question. L’infanticide ne
suffit donc pas à produire cet effet tragique, articulant universalité de la signification et
singularité de l’émotion suscitée chez le spectateur. Il faut qu’il soit intégré dans un
système dramaturgique qui lui confère ce double pouvoir. C’est ce que Peter Szondi s’est
efforcé de préciser dans son Essai sur le tragique, en décrivant le schéma d’action qui, selon
lui, est à même de porter une signification tragique au sens philosophique :
« [L]’anéantissement n’est pas tragique en soi ; il faut la transformation du salut en
anéantissement ; la tragédie ne s’accomplit pas avec la chute du héros, mais dans le fait
que l’homme s’effondre sur le chemin où il s’était engagé pour ne pas tomber4. » Médée
serait alors tragique à condition que l’on représente l’infanticide, et donc la souffrance
que Médée s’inflige à elle-même, cette « chute » qu’est la catastrophe de la tragédie,
comme l’aboutissement d’un processus de libération : en tuant ses enfants, Médée se
libère de l’emprise de Jason sur elle, de ce que son amour pour Jason a fait d’elle. La
nécessité où se trouve l’héroïne de se perdre pour se sauver acquiert une dimension
tragique, au sens philosophique, en ce qu’elle met en scène une dimension universelle de
l’humain, pris dans des contradictions insolubles. Médée n’est plus une figure
psychologique, représentant une vision datée de la psyché féminine, mais une
incarnation de l’humanité.
10 Cette tension entre deux pôles contradictoires, salut et anéantissement chez Szondi, se
retrouve dans les propos des spécialistes de la tragédie grecque, qui caractérisent
volontiers la forme tragique comme ambiguë (c’est le terme de Jean-Pierre Vernant 5)
quand ils sont amenés à définir le propre de la tragédie : le héros tragique se caractérise
par son ambivalence, entre culpabilité et innocence, entre savoir et ignorance, etc. La
tragédie grecque traduit une « crise du sens », une mise en question des normes, et la
contradiction est l’un des moyens qu’elle emploie pour donner à voir la complexité
politique ou métaphysique.
11 Le potentiel tragique du mythe de Médée repose donc sur le fait que l’héroïne affronte
une crise, la trahison de Jason, qui recouvre à la fois une dimension individuelle
subjective (Médée est abandonnée) et une dimension plus « objective » (la trahison de
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
20
Jason remet en cause un système de valeurs). La notion de crise est en effet la pierre
angulaire des théories philosophiques du tragique, qui se distinguent ensuite selon
qu’elles considèrent que cette crise est soluble ou insoluble. Dans le cas de Médée,
l’héroïne trouve une forme de solution problématique, dont la valeur se déploie aux deux
niveaux, subjectif et objectif : elle tue ses propres enfants et propose donc un
dépassement de la crise qui n’est pas un retour à l’état antérieur, mais provoque un autre
bouleversement de valeurs. Le monde ouvert par la catastrophe de la tragédie est un
monde ambigu que les adaptateurs du mythe, librettistes ou metteurs en scène
notamment, pourront infléchir dans un sens ou un autre. Il y a donc bien, dans l’histoire
de Médée depuis son traitement par Euripide, la possibilité d’un contenu tragique, dans le
sens philosophique du terme.
12 Mais la figure de Médée est aussi associée à une réflexion sur les effets du discours, qui
peut nous aider à établir en quoi le personnage et son histoire sont également
susceptibles de produire un certain type d’émotion, que l’on pourra désigner comme
tragique. Médée a en effet servi de modèle et de référence pour les réflexions sur le
sublime, qui se sont développées en France, en Angleterre et en Allemagne à partir de la
traduction du traité du Pseudo-Longin par Boileau en 1674. Comme le tragique, le sublime
a reçu de nombreuses définitions et fait l’objet de débats complexes tout au long du XVIIIe
siècle en Europe. Ce qui importe pour notre propos est que, dans toutes ses formes, cette
théorie associe dans l’effet sublime des aspects rhétoriques et des aspects éthiques : si
Médée est sublime, chez Boileau, c’est parce qu’elle rend compte de la grandeur de son
caractère, en tant qu’il est indépendant, fort, détaché, sans limites, dans une formule
concise, concentrant en quelques mots l’immensité de sa grandeur morale. Boileau choisit
en effet comme exemple de sublime une réplique de Médée dans la pièce de Corneille, qui
reprend en fait le texte de Sénèque :
Nérine : contre tant d’ennemis, que vous reste-t-il ?
Médée : Moi, dis-je, et c’est assez6.
13 Médée est sublime parce qu’elle manifeste un caractère grandiose dans une forme
ramassée. C’est ce contraste entre l’économie des moyens rhétoriques et l’immensité
éthique qui caractérise le sublime et ses effets, que le Pseudo-Longin, dans son traité du I
er
siècle, décrivait en ces termes : « il ne persuade pas proprement, mais il ravit, il
transporte, et produit en nous une certaine admiration mêlée d’étonnement et de
surprise, qui est toute autre chose que de plaire seulement, ou de persuader7. » Cette
admiration mêlée d’étonnement et de surprise contient une forme de paradoxe
qu’Edmund Burke8, célèbre penseur anglais du sublime, a associée au plaisir paradoxal de
la tragédie. Est sublime selon Burke une personne caractérisée par son exclusion de la
société, son potentiel dangereux, et sa puissance infinie. Médée est potentiellement
sublime parce qu’en elle sont associées la menace et la grandeur, le danger et la
puissance.
14 Médée est donc susceptible d’un traitement tragique pour deux raisons : elle est prise
dans un mécanisme contradictoire qui la contraint à se perdre pour se sauver, donc son
histoire peut se lire comme la métaphore d’une vision de l’homme ou du monde ; et il y a
dans son caractère une radicalité lui conférant une grandeur infinie qui peut contraster à
la fois avec l’horreur qu’elle inspire, et avec une forme maîtrisée, concise et ramassée,
pour produire une émotion mêlant stupeur et admiration qui ne se limite pas au
pathétique.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
21
La Médée tragique de Sasha Walz
15 Les productions de Pierre Audi, Sasha Waltz et Krzysztof Warlikowski ne sont pas toutes
tragiques au même degré, et ce phénomène tient d’abord à la différence des livrets. Les
tragédies lyriques de Charpentier/Corneille, d’une part, et de Cherubini/Hoffmann de
l’autre, tendent en effet plus vers le pathétique que vers le tragique, en insistant sur la
dimension humaine de Médée, hésitant à tuer ses enfants, et le faisant par dépit
amoureux. Chez Heiner Müller au contraire, l’infanticide apparaît bien plus comme un
rituel de libération que comme un acte de vengeance. Le texte mis en musique par Pascal
Dusapin contient un potentiel tragique plus évident que les livrets des XVIIe et XVIIIe
siècles. Sans doute cette orientation psychologique des livrets tient-elle très largement
au genre de la tragédie lyrique qui appuie les développements musicaux sur l’expression
des passions et des sentiments, ce qui conduit les librettistes à étoffer cet aspect du
mythe. Là où ces versions que l’on pourrait appeler dramatiques plutôt que tragiques
résolvent la contradiction de l’acte de Médée dans une explication psychologique, Heiner
Müller retrouve la tragédie en laissant le conflit en Médée largement irrésolu : « Je veux
déchirer l’humanité en deux / et rester dans le vide au milieu Moi / Ni femme ni homme »
9, dit-elle peu avant la fin. Indétermination du vide, et maintien dans un espace scindé
caractérisent l’aboutissement du parcours de la figure mise en scène par Müller et Sasha
Waltz.
16 L’un des aspects du tragique dans la chorégraphie de Sasha Waltz est le contraste entre la
profondeur des enjeux soulevés par le dialogue et l’économie de la forme spectaculaire :
le plateau est vide, à l’exception des corps et des ventilateurs qui l’occupent ; la musique
cohabite avec le silence et le bruit des ventilateurs ; le noir et le blanc contrastent avec le
rouge ; la mort est stylisée, esthétisée même dans le cas de la danse de Créuse. La violence
insondable de Médée se heurte au dépouillement des moyens, et à une esthétique de
l’épure. Le contraste produit un choc émotionnel renforcé, qui n’est pas purement
pathétique. Mis à distance par la forme non narrative de la chorégraphie et du discours,
touché par la beauté des constructions physiques et sonores, le spectateur est à la fois
sensible à l’horreur de l’infanticide, à la violence de la souffrance de Médée, et touché par
des aspects non narratifs du spectacle : le rythme et les formes prises par les corps, les
images qu’ils suscitent, les intensités induites par la musique, notamment, ont un effet
physique et émotionnel sur lui qui s’ajoute et se mêle aux affects pathétiques suscités par
l’histoire de Médée. Par ailleurs, le bas-relief en mouvement dans la deuxième partie du
prologue constitue une référence plastique à l’Antiquité et invite à voir cette Medea
comme un avatar contemporain se détachant sur un fond culturel immémorial associant
brutalité et pureté esthétique.
17 En outre, parce qu’aucune mise en situation ne vient préciser les contours dans lesquels
évoluent les figures, le corps de Médée est à la fois l’un des éléments ou peut-être la
source d’une matière organique collective incarnée par les danseurs dès le prologue, et en
même temps une entité isolée telle qu’elle apparaît dans la dernière image du spectacle.
Après qu’elle a affirmé son désir d’indétermination, les autres corps sont balayés par le
vent et elle reste seule comme elle le fut à son entrée. Figure chorale et individuelle à la
fois, foyer de profusion de corps en même temps que silhouette unique, élément d’une
matière corporelle en lien avec la nature et figure cérébrale tout autant, Médée apparaît
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
22
comme problématique, cœur d’un réseau de contradictions sans résolution, figure d’une
humanité que l’on pourrait qualifier de postmoderne.
18 Le tragique apparaît ainsi comme l’un des outils possibles d’un théâtre d’aujourd’hui qui
refuse les grands récits explicatifs du monde sans pour autant renoncer à l’ambition de
s’articuler à une pensée du réel. Il donne à voir l’opacité du monde à travers un dispositif
qui mêle forme-sens et forme-affect, et traduit ainsi le double aspect de l’expérience
métaphysique contemporaine : lucidité d’une part, angoisse de l’autre. Or le spectacle
tragique a cette vertu, depuis l’Antiquité grecque, de donner à voir ce qui résiste à la
compréhension et déborde les limites de l’émotion soutenable dans un cadre qui met à
distance le pathétique et lui superpose une émotion esthétique : en tant qu’il propose
conjointement au spectateur une vision du monde et une expérience sensible, le tragique
donne à éprouver et à supporter la violence, qu’elle soit morale, politique ou
métaphysique.
NOTES
1. Pour une synthèse de ces différentes traditions, voir Pierre JUDET DE LA COMBE , Les Tragédies
grecques sont-elles tragiques ?, Paris, Bayard, 2010.
2. Pierre JUDET DE LA COMBE , « Euripide et le tragique du non-tragique », Europe, janvier-février
1999, p. 185.
3. STENDHAL, Journal littéraire [1804], dans Œuvres complètes, t. 34, Genève, Cercle du Bibliophile,
1970, p. 89.
4. Peter SZONDI, Essai sur le tragique, Paris, Circé, 2003 [pour la traduction française], p. 81.
5. Jean-Pierre VERNANT et Pierre VIDAL-NAQUET , Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris, F.
Maspero, 1972.
6. Pierre CORNEILLE, Médée, acte I, scène 5, v. 320-321. Boileau cite ces vers dans une addition de
1701 à la préface de sa traduction de Longin et dans sa « Réflexion X », publiée de façon posthume
en 1713.
7. Nicolas BOILEAU DESPRÉAUX , Le Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours, traduit du grec
de Longin, Paris, Denys Thierry, 1674, chapitre I.
8. Edmund BURKE, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, 1757.
9. Heiner MÜLLER, Rivage à l’abandon Matériau-Médée Paysage avec Argonautes, traduit de l’allemand
par Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger, in Germania Mort à Berlin, Paris, Éditions de Minuit,
1985, p. 16.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
23
Scénographier Médée
Marie-Noëlle Semet
1 Présentées à quelques semaines de distance sur le même plateau du Théâtre des Champs-
Élysées, à l’automne 2012, trois versions du mythe de Médée, celles de Marc-Antoine
Charpentier (1693), Pascal Dusapin (1992) et Luigi Cherubini (1797), ont dessiné, par leur
radicale altérité, une programmation en forme de manifeste, qui traçait la ligne à suivre
pour les cent ans du TCE : « diversité, modernité, continuité, excellence »1.
2 Les trois œuvres, également puissantes mais radicalement autres, offrirent l’occasion
d’explorer un même mythe selon trois approches musicales et scéniques différentes, dont
nous tenterons d’apprécier les variations à travers l’étude de leurs scénographies
respectives, tant l’engagement visuel de chacune d’elles participa de leur esthétique. Il ne
sera donc pas question ici de l’interprétation dramatique, musicale ou scénique de ces
Médée, ni de leur adaptation au monde contemporain, mais de leur seule mise en forme
plastique et spatiale.
Pour Médée de Marc-Antoine Charpentier, un décor de
Jonathan Meese
3 Pierre Audi, metteur en scène bien connu des mélomanes d’opéra, fit appel, pour sa
version de la Médée de Charpentier, à un artiste allemand trouble-fête, trublion de la
scène artistique contemporaine, Jonathan Meese. Célèbre dans les milieux autorisés pour
ses performances provocantes, ses peintures déjantées ou autres installations
débordantes, même s’il n’en était pas à son premier essai à l’opéra ni au théâtre, sa
réputation était à faire auprès du public du TCE. Le choix de ce plasticien avait de quoi
surprendre, mais le théâtre est un lieu de tentation pour nombre d’artistes qui, loin de
leur atelier, peuvent y faire l’expérience d’une confrontation directe avec le public,
éprouver un autre rapport au temps, apprendre à gérer les contraintes du collectif et un
cahier des charges qui leur est inhabituel, eux qui œuvrent généralement avec pour
seules lois celles qu’ils se sont données. Sur scène, l’artiste saisit ainsi une occasion de
mettre sa pratique à l’épreuve.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
24
4 Meese pratique un art de l’excès. Puisant à tout va dans des iconographies de registres
divers, allant de la religion à la politique, de la philosophie à l’histoire ou de l’histoire de
l’art à la culture de masse, il dérange. Car il pille dans ces univers des images et des
symboles qu’il mixe sans complexe et de façon provocatrice, sans craindre les
contradictions, les forçant même. Ainsi se plaît-il à reprendre des signes teutoniques,
comme la croix de fer pattée, ou à faire usage du salut hitlérien, tout en affichant une
allure christique immuable, très peu « aryenne » : barbe et cheveux longs, lunettes
fumées et veste de survêtement Adidas. Si Meese prétend user de ces signes de façon
purement formelle – ainsi des immenses croix teutoniques suspendues en fond de scène
de Médée qui, parce qu’argentées et réfléchissantes, perdraient de leur brutalité –, la
réception du travail de Meese montre que le public a souvent du mal à le suivre sur ce
point. Toutefois, cet usage déplacé, voire contradictoire, et l’altération plastique de ces
insignes à forte charge émotionnelle, participent du goût de l’artiste pour les quiproquos,
qui sont, selon lui, une aubaine pour l’art et qui font partie du métier : tout est possible,
tout est ouvert, il ne faut pas entraver la liberté de l’art. La pratique anarchique de Meese,
dans la mouvance du néo-expressionnisme allemand des années 1980 et de la punk attitude,
se déploie dans un laisser faire apparent, lequel relève toutefois d’un réel savoir faire : en
matière de peinture, graphisme et photomontage, l’artiste connaît l’art de brouiller les
pistes. Enfreignant toutes les règles, son travail envahit l’espace où il se développe, dans
un débordement chaotique ; les modes d’expression s’entremêlent pour une œuvre
protéiforme, en prolongement de son être qu’il met par ailleurs volontiers en scène. En
toute logique, le théâtre participe de ce chaos : au cœur de la grande exposition qui lui
avait été consacrée à Hambourg en 2006, Meese avait dressé une scène tournante sur
laquelle se rejouait Cocaïne, une pièce mise en scène par Frank Castorf en 2004 à la
Volksbühne de Berlin, dont il avait réalisé la scénographie2. Selon une logique et une
tradition toutes germaniques, Meese vise « l’œuvre d’art totale » (la Gesamtkunstwerk) ;
d’où son attirance pour l’opéra, cet art qui convoque tous les autres, où son goût du
spectaculaire pourrait, a priori, se déployer pleinement.
5 Médée : dans des élans messianiques, Meese, qui voit dans l’art un pouvoir utopique global
et qui prédit une « dictature de l’art »3, annonçait sur le programme de la représentation
une révolution par l’art, telle qu’à l’issue de la représentation, le spectateur sortirait en se
disant que demain, l’art gouvernerait le monde ! S’il faut certainement relativiser ses
propos et les replacer dans le contexte plus général d’une pratique artistique « exaltée »,
s’il n’est par ailleurs pas certain que cette représentation ait conduit le public à un tel
degré d’utopie révolutionnaire, force est de constater que la scénographie de Meese est
restée en deçà de cette prédication emphatique.
6 Il reste toutefois de son travail le souvenir d’une énergie singulière, celle que traduisait la
première image du rideau de scène, radicale, simple et efficace, produit d’un collage
surdimensionné de bouches sexuées et yeux dévorants4 où était « graffé » « l’amour c’est
moi » et qui promettait un spectacle alerte et cinglant. Cependant, très vite, le spectateur
averti s’étonna du côté réservé de ce qui suivit. Au-delà du fait, consensuel aujourd’hui,
de représenter les personnages d’un opéra baroque dans des costumes et un univers
contemporains, la scénographie se révéla relativement conventionnelle. Les aspérités et
le piquant, la provocation et la violence caractéristiques de l’art de Meese, à l’épreuve de
la scène, avaient été quelque peu rabotés5. Il manquait cette dimension d’œuvre totale à
laquelle l’artiste dit aspirer et qu’acquiert en partie son travail lorsqu’il « joue » seul. Il
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
25
faut peut-être voir, dans cette relative « fadeur », le contrecoup d’une difficulté de Meese
à remplir l’une des conditions premières de l’acte théâtral, à savoir le travail d’équipe.
7 Meese avait pris comme point de départ de sa scénographie l’intérieur d’un appareil
photographique, dans lequel les personnages apparaissent comme des poupées, et son
système de lentilles, qui permet de jouer sur la focalisation et le hors champ. Cette
référence n’est explicite que ponctuellement, par exemple lorsque Médée, ayant accompli
son triple meurtre, est prise dans un diaphragme solaire ; elle ne structure pas l’ensemble
de la représentation, où d’autres tableaux adviennent sans lien évident de causalité6,
selon le principe classique généré par la scène à l’italienne. Les quelques moments où les
chanteurs sont pris dans ce dispositif ne suffisent pas à en faire une machine à jouer, qui
pourrait justifier ce parti pris. Ce principe formel et fonctionnel semble par conséquent
des plus aléatoires et sans prégnance sur le contenu du drame ou sa forme musicale,
auxquels Meese paraît avoir été quelque peu indifférent ; il pourrait être appliqué à
n’importe quelle autre pièce ou opéra. De façon un peu provocatrice, mais en tout cas
révélatrice, l’artiste affirme n’avoir pas voulu plonger dans l’étude du texte de Médée
avant de se mettre au travail. Ceci explique cela : le principe de l’appareil photographique
censé structurer et générer la scénographie était par trop extérieur au propos de l’opéra
pour ne pas lui nuire et créer un décalage entre le fond et la forme. Pourtant, Meese
aurait pu arguer que le mécanisme de l’appareil photo, parce qu’en corrélation étroite
avec celui de la machine théâtrale à l’italienne, dont il dérive7, était à même de la servir.
Mais il aurait fallu que celui-ci engendre toute la scénographie ; or il n’apparaît ici que
comme un clin d’œil dans une suite de tableaux (de châssis), sans rapports visuels forts
les uns aux autres. L’absence d’un parti pris dramaturgique et scénique clair, lié au désir
de Pierre Audi de laisser toute sa liberté à l’artiste8, participe de cette mollesse du propos
et de l’indifférence entre le fond (le jeu) et la forme (le décor). Les chanteurs et danseurs
faisaient effectivement figures de « poupées », l’espace n’était pas à habiter : les châssis
fonctionnaient comme des écrans devant lesquels se mouvoir. Une ligne dramaturgique
forte aurait pu donner un sens à cette proposition, mais il ne semble pas y avoir eu de
réflexion là-dessus. Il en allait comme s’il manquait une rencontre intellectuelle entre le
metteur en scène et son scénographe9. Ce décor paraissait avoir été conçu de façon
totalement autonome, dans le secret de l’atelier, avant tout travail de plateau. La pratique
est relativement courante à l’opéra, moins au théâtre où la scénographie, mise à l’épreuve
des répétitions, évolue dans le temps de l’élaboration du spectacle ; s’agissant d’un artiste
tel que Meese, l’on était en droit d’attendre une démarche plus innovante. Autre élément
qui laissait supposer cette absence de collaboration : l’écart très mince existant entre la
maquette, que Messe exhibait fièrement sur un flyer annonçant la représentation et sur
son site, bras en croix et bouche ouverte, comme annonciatrice des plus grands remous,
et sa réalisation, qui n’en était qu’un agrandissement très fidèle. Rien ni personne n’avait
interféré sur la proposition initiale de l’artiste démiurge : nul metteur en scène, chef,
chorégraphe, comédien, chanteur ou danseur ; son travail évita l’affrontement des autres
et, à rebours, ne provoqua guère d’incidences sur la mise en scène, le jeu, le chant et la
danse.
8 Néanmoins, certaines images, perçues hors de leur fonction scénique, s’avérèrent
prégnantes et résistèrent au laminage de leur exécution, de leur agrandissement. Le
changement d’échelle, très important, produisait une démesure intéressante.
Rudimentaires dans leur propos et leur exécution (exemple un cercle jaune sur un fond
noir), les peintures et collages s’exhibaient comme tels, barbouillés à la va-vite, et pour ce
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
26
qu’ils étaient, des simulacres. Ils renvoyaient au geste pictural autant qu’à l’objet qu’ils
représentaient (un soleil). Par un effet de loupe, le coup de ciseau de l’artiste et son geste
se donnaient à voir de façon manifeste, la gaucherie apparente et le ratage revendiqué
étaient magnifiés, devenaient « énormes ». C’est là que le travail de Meese prit corps : car
la démesure « sublime » le grotesque ! Le « coup de patte » de l’artiste, agrandi, produisait
un effet plaisant, en plongeant le spectateur dans le faire d’une technique de barbouilleur
et de découpeur iconoclaste et désinvolte, que tout un chacun pouvait reconnaître, pour
l’avoir expérimentée sans complexes lui-même, quand il était enfant. Meese nous
renvoyait ainsi à nos propres expériences. De là naissait la force d’appel de ses images : de
la manière affective avec laquelle il sollicitait la mémoire sensorielle du public. Le passage
de la maquette à la réalisation, du faire au faire faire, sa reproduction et son
agrandissement, non seulement n’avaient pas épuisé l’énergie première ni détruit l’aura
de l’œuvre, mais ils lui en avaient conféré une autre. Malgré tout, Meese, en déployant sur
scène les ingrédients de son langage pictural plus qu’en se « rendant » à l’œuvre de Marc-
Antoine Charpentier, réalisa un théâtre d’illusion et de faux-semblants bidimensionnel
sans grande incidence. La cage, le cadre de scène et l’enveloppe majestueuse du Théâtre
des Champs-Élysées continrent sagement son travail, rien ne déborda. Reprenant le
principe du théâtre à l’italienne, l’effet carton-pâte de ses châssis peints, malgré leur
dimension attractive, affective et sensuelle, maintinrent le spectateur à distance et le
laissèrent aux prises de deux sentiments contradictoires : d’une part un agacement, dû à
une déception devant le manque d’audace des partis pris de l’artiste et l’effet plaqué de
son décor sur le jeu et la musique, de l’autre un contentement lié à une certaine
fascination sensuelle.
9 Depuis ses collaborations avec le metteur en scène Frank Castorf, certainement plus
remarquables étant donné les accointances esthétiques des deux artistes, Meese tente de
réitérer. Il avait déjà réalisé pour Pierre Audi, en 2010, la scénographie de Dionysos de
Wolfgang Rihm, au Festival de Salzburg. Après Médée, il s’engagea dans le projet d’un
Parsifal pour le festival de Bayreuth 2016, dont il comptait assurer la mise en scène et la
scénographie. Pour une œuvre d’art « totale », il ne fallait pas moins qu’un Wagner, mais
le projet capota, officiellement pour des raisons financières (un budget faramineux), plus
vraisemblablement – même si Meese avait promis de n’utiliser aucune image à
consonance nazie –, par crainte d’une possible et nouvelle assimilation de l’œuvre de
Wagner au fascisme. Il faudra donc attendre pour savoir si le passage de Meese vers une
maîtrise « totale » des tenants et aboutissants d’un spectacle permettra à son art d’être à
la hauteur des ambitions de l’artiste, ou si ce désir ne trahit là qu’une difficulté à se plier
aux limites imposées par le partage du pouvoir au théâtre.
Pour Medea de Pascal Dusapin, une chorégraphie
picturale
10 Cette dernière remarque servira de tremplin pour aborder Medea, l’opéra de Pascal
Dusapin, mis en scène et chorégraphié par Sasha Waltz, dont la scénographie, signée
conjointement par Pia Maier Schriever, Thomas Schenk et Heike Schuppelius, relevait, au
contraire, d’un travail d’équipe en étroite collaboration avec Waltz, laquelle signait de
surcroît la mise en scène de la vidéo projetée durant le spectacle.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
27
11 Les arts plastiques sont au fondement de la démarche de Waltz, au cœur de ses créations,
qu’ils irriguent, dans la trame desquelles ils infiltrent nombre de références plus ou
moins explicites en provenance de la peinture, la performance, la sculpture ou
l’architecture, qui traversent l’histoire de l’art et des cultures : les fresques du Jugement
dernier de Signorelli (Chapelle San Brizio de la cathédrale d’Orvieto,1499-1504) et de
Michel-Ange (Chapelle Sixtine, Rome, 1532-1541) innervent sa « trilogie du corps », Körper
/ S / No-body (2000-2002), les Impromptus (2004) mettent en scène l’acte pictural, en 2009
ses danseurs dialoguent avec l’architecture du Neues Museum de Berlin (Dialoge 09), etc.
Les Beaux-Arts comme les pratiques artistiques contemporaines, installations ou formes
performatives, par ramifications et interactions, déterminent la nature des spectacles de
Sasha Waltz. En témoigna l’imposante présentation-exposition du travail de la
chorégraphe, Sasha Waltz. Installations Objets Performances, qui se tint à Karlsruhe en 2013,
un an après Medea.
12 La danse, sculpture des corps, dessine l’espace, décide de la scénographie10. Ceci était
sensible dès l’ouverture de Medea : après un majestueux tomber de rideau rouge, au bruit
angoissant des pâles d’énormes ventilateurs posés sur les côtés de la scène, une ligne de
danseurs, agrippés les uns aux autres, roulait au sol, du fond à l’avant-scène, dessinant un
cercle qui se brisait pour une série de duos fabriquant des sculptures hybrides. Un
deuxième cercle se refermait, les corps s’aggloméraient en tas puis sortaient, toujours en
roulant. Un bas-relief représentant des groupes d’hommes, femmes et enfants à demi-
nus, terreux, agencés comme sur le fronton d’un temple ou le flanc d’un sarcophage
gréco-romain, s’éclairait alors en flottant dans la cage de scène, toujours sur le bruit
lancinant des ventilateurs. Lentement, imperceptiblement, ces corps bougeaient, les
groupes se défaisaient pour se reconstituer autrement, racontant une histoire (celle de
Médée ?). Il fallait quelques secondes pour saisir qu’il s’agissait là d’une projection vidéo
de danseurs couverts d’argile. Pour créer, répéter et tester ses spectacles, Waltz choisit
souvent un lieu en résonance avec son sujet11 ; la danse de Medea naquit dans les salles de
statuaire antique du Musée Pergamon de Berlin12, dont l’influence se combina à d’autres
sources, orientales, africaines, décelables dans certaines gestuelles des danseurs, mais
aussi dans la forme de leurs costumes. Peinture et dessin œuvraient également en
sourdine. À l’extinction du bas-relief, sur la scène nue, noire, dans une longue robe
sombre, les cheveux défaits, au cou un lourd collier blanc (souvenir de la Médée-Callas de
Pasolini), Médée (la soprano Caroline Stein) faisait son entrée. Derrière elle, deux pavés
lumineux diffus dessinaient des nuages lourds de menaces, quelque tableau à la manière
d’un Rothko, dont la peinture mystique entrait en résonance avec la musique de Dusapin.
Plus tard, Médée, portée par les danseurs, décrivait un cercle à la craie au sol (cercle
magique ?). La couleur jouait également de sa valeur symbolique : rouge du rideau de
scène de l’ouverture, rouge du sang de Dircé qui se répandait sur sa robe par le collier
meurtrier offert par Médée. Formes et couleurs servaient un langage symbolique et allusif
qui éclairait le drame, et la scénographie naissait de ces deux pôles référents : sculpture
antique et peinture abstraite.
Pour Médée de Luigi Cherubini, une architecture
scénique
13 Pour la Médée de Cherubini, celle qui des trois œuvres présentées au TCE, a suscité le plus
de vague dans la critique en raison des partis pris audacieux de Krzysztof Warlikowski,
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
28
nous avions affaire à une collaboration beaucoup plus classique entre le metteur en scène
et sa scénographe, Malgorzata Szczesniak, avec qui il collabore de longue date. La
scénographie s’exerçait là en pleine puissance, comme acteur et moteur de la mise en
scène.
14 Sur des musiques populaires, durant l’installation des spectateurs, étaient projetés sur
toute la hauteur du rideau de fer baissé, des films de famille super 8 (anniversaire,
communion, mariage), films d’amateur qui nous renvoyaient, nous, spectateurs, à notre
propre passé. En avant-scène, deux enfants en costume gris discutaient sagement,
dansaient, attendaient. Quand l’orchestre attaquait Cherubini, donnant soudainement un
poids à ces souvenirs, les lestant d’une dimension tragique, le rideau se levait sur une
image majestueuse, en rupture avec celles, malhabiles, de la projection. Au centre du
plateau, recouvert d’un plancher de couleur acajou, avançait, perpendiculaire au mur de
fond, une allée de sable clair. Les côtés latéraux de la scène étaient fermés par des parois
moitié en « parpaings », moitié en miroirs. Un troisième pan miroitant barrait la scène
longitudinalement aux deux tiers, délimitant un espace postérieur que la lumière par
moments révélait, comme une deuxième aire de jeu. Parfois cet écran montait dans les
cintres pour agrandir le plateau. Les trois murs s’arrêtaient verticalement en-dessous des
limites du cadre de scène, de sorte qu’à partir du premier balcon, le spectateur pouvait
percevoir au fond les murs réels du théâtre. Les miroirs, selon l’éclairage, réfléchissaient
le public, l’orchestre ou la salle, qu’ils renvoyaient à l’infini. De la sorte, la construction de
Szczesniak s’inscrivait dans le lieu théâtral au point de faire corps avec lui. Il y avait là un
réel parti pris de scénographe, en phase avec l’espace global de la représentation.
Szczesniak agrafait scène et salle, incluant l’un dans l’autre et donnait au public la
possibilité de se projeter dans l’espace de la représentation, tout en gardant une distance
critique, d’autant que les éléments constituant cette architecture se donnaient à voir sans
tricher, dans leur matérialité même : plastique miroitant, métal de la structure et des
rails au sol, sable, bois du parquet. Pas de simulacre, d’artefact, la scénographe jouait avec
des matériaux concrets, qui s’inscrivaient dans le réel du spectateur davantage que ne le
fera jamais n’importe quel châssis peint (d’où le pari impossible du décor de Meese),
auquel il est difficile aujourd’hui de porter crédit.
15 Sur scène, des chaises pliantes en bois clair permettaient au chœur d’assister au
déroulement du drame, dans une logique brechtienne, mais aussi d’évoquer une église
lors du mariage de Jason et Dircé. Rien n’était univoque dans ce fonctionnement de la
scénographie qui jouait également de contrastes entre l’élégance des matériaux et la
brutalité d’inscriptions graffées à la hâte sur les parties basses des murs : « fuck », « casse-
toi ». Après la chanson Oh Carol, une musique pop insérée dans celle de Cherubini, acte
« blasphématoire » qui déclencha l’ire de certains spectateurs, sur une ambiance disco
(lumière aux néons violets), le chœur sorti en emportant les chaises, des perches
descendaient des cintres pour rayer l’espace de la scène de traits noirs, redoublés par
leurs ombres projetées au sol.
16 L’éclairage participait grandement à la cohésion du travail de Szczesniak : jouant sur les
possibilités de transparences et de reflets offertes par le dispositif, il créait des
continuités, des imbrications et des mises en abîme de l’espace de la scène et celui de la
salle. Des ombres franches au sol, venant du lointain vers le public, tantôt rapprochaient
la scène de la salle, tantôt, par des contrastes appuyés, dessinaient une aire de jeu, la nef
d’une église, disloquaient l’agencement de la construction ou la propulsaient dans
l’espace du théâtre. À la palette générale du décor et des costumes, beige, grise et
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
29
argentée, la lumière apporta ponctuellement des notes stridentes, oranges, jaunes, vertes,
violettes, acidulées, qui faisaient éclater et basculer l’architecture dans un monde irréel.
Felice Ross effectua un travail de lumière en parfaite adéquation et intelligence avec celui
de la scénographe et du metteur en scène.
17 Les costumes, également œuvre de Malgorzata Szczesniak, suivaient une même ligne
dramaturgique claire. Médée (Nadja Michael) faisait son apparition en sosie d’Amy
Winehouse ; petit à petit, elle se défaisait de sa perruque, puis de ses chaussures, de ses
bas, de sa robe, jusqu’à se trouver jambes et pieds nus, en petite combinaison noire,
dépossédée, déchue ; pour faire son retour en magicienne et préparer le sacrifice de ses
enfants, elle se drapait dans un grand tissu bleu roi, virginal13 ; et revenait, après
l’infanticide et le meurtre de Circé, en tenue d’intérieur négligée, tee-shirt blanc grossier
et pantalon de jogging, femme ordinaire d’aujourd’hui, libre et irresponsable, notre
contemporaine.
18 La scénographie de Szczesniak, le travail de la lumière et celui des costumes, toute la
conception visuelle du spectacle appuyait et servait le parti pris premier de Warlikowski,
de faire de cette tragédie une histoire actuelle, presque un fait-divers : « je voulais
rapprocher cette histoire de nous. […] Je ne pouvais donc pas parler d’une Médée
mythologique14 ». Le spectateur appartenait au même espace-temps que celui de Médée,
en qui il pouvait voir sa semblable. Mais la concrétude, l’ambigüité et l’ambivalence de la
scénographie, le ramenant toujours à sa condition de spectateur, l’empêchaient par
ailleurs de perdre sa distance critique pour trop plonger dans l’illusion. Le claquement de
porte de Médée, à la fin du spectacle, qui n’est pas sans rappeler celui de la Nora d’Ibsen
dans la version de Thomas Ostermeier, signait l’accord de la scénographie et de la mise en
scène : Médée sortait sur le proscénium par celle du rideau de fer, doré, du théâtre,
abaissé, dans un geste brechtien.
19 Médée, Medea, Médée. Peinture, sculpture, architecture. À travers ces trois esthétiques se
décèlent trois modes de collaborations qui montrent à quel point le travail
scénographique peut tenir le premier rôle dans le spectacle vivant. L’opéra, d’un langage
plus abstrait que le théâtre, se prête à cette prise de pouvoir esthétique, d’où le nombre
de plasticiens qui, aujourd’hui, répondent aux invitations de metteurs en scène tel Pierre
Audi, lequel, avant Jonathan Meese, avait fait appel à Jannis Kounellis (pour Von Heute auf
Morgen d’Arnold Schoenberg en 1995), Karel Appels (pour Die Zauberflöte de Mozart en
2006) ou Anish Kapoor (pour Pelléas et Mélisande en 2008). De Bill Viola à Pierrick Sorin, en
passant par Oleg Kulik ou Miquel Barceló, la liste n’est pas exhaustive.
NOTES
1. Tels sont les « fondamentaux » que le Directeur du TCE, Michel Franck, brandissait comme
mots d’ordre de sa politique théâtrale en ce début de saison.
2. Toujours avec Castorf, il réalisa celle des Maîtres chanteurs de Nuremberg, d’après Richard
Wagner et Ernst Toller, que l’on put voir au Théâtre national de Chaillot à Paris en janvier 2007.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
30
3. Voir les propos sans retenue de l’artiste dans une interview de Christophe Menager en 2012 :
http://dedicatedigital.com/jonathan-meese/
4. Ceux de Claudia Schiffer et de Scarlett Johansson, découpés dans des magazines.
5. Ce ne sont certes pas les lingots d’or comme autant de cercueils semés sur le plateau pour
signifier l’empire de Créon qui pourraient nous offusquer.
6. L’effet bidimensionnel prédominant, celui-là même qui est à la base de la technique de la
photographie, résulte moins du choix de l’appareil photographique comme modèle structurant,
que de l’impossibilité pour celui-ci de créer un espace à jouer.
7. Dans la mesure où la photographie s’est calquée sur les principes de représentation du monde
en perspective, eux-mêmes à l’origine de la configuration des salles à l’italienne et exploités par
elles.
8. Comme, dit le metteur en scène qui travaille régulièrement avec des artistes de renom (http://
www.lamonnaie.be/fr/mymm/article/79/Entretien-Pierre-Audi/), il le fait à chaque fois.
9. Deuxième contrecoup de cette liberté accordée à l’artiste-scénographe. Par ailleurs, bien
qu’Audi se félicite de sa collaboration avec Meese, l’urgence dans laquelle se monte généralement
ce genre de productions, d’une part, et les propos du metteur en scène sur sa première
collaboration avec Meese, pour un opéra de Wolfgang Rihm, Dionysos, au Festival de Salzburg en
2010, de l’autre, où il rapporte que, « le compositeur ayant livré sa partition avec retard, Meese a
conçu un décor sans avoir entendu une note de musique », autorisent à envisager cela (http://
www.lamonnaie.be/fr/mymm/article/79/Entretien-Pierre-Audi/).
10. Comme elle renvoie à la musique ; par exemple dans cet instant où les danseurs de Medea, par
leurs postures, semblaient écrire la partition qui se jouait dans le même temps.
11. Ainsi, pour Körper, avait-elle réalisé un travail sur l’Holocauste au Musée juif de Berlin, en
1999.
12. Où, dans le cadre de la « Nuit européenne de la Beauté » en 2007, elle présenta « Dialogues au
Musée Pergamon », cette « Frise Médée », en avant-première de la création de Medea au Staatsoper
Unter den Linden de Berlin.
13. Le théâtre de Warlikowski est empreint de clins d’œil et d’atteintes plus ou moins fortes à la
religion catholique, encore très présente en Pologne (pays d’origine du metteur en scène), et
même active au niveau des rouages de l’état.
14. « Krzysztof Warlikowski dans l’intimité du mythe », entretien avec Mehdi Mahdavi, réalisé le
6 décembre 2012, en ligne, Altamusica.com [consulté le 20/07/2016] :
http://www.altamusica.com/entretiens/document.php?
action=MoreDocument&DocRef=5063&DossierRef=4643
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
31
Entre Grand Siècle et pop art, trois
mises en scène de la Médée de
Charpentier
Fabien Cavaillé
1 Parce que les inventeurs de la tragédie lyrique espèrent ressusciter le genre antique, le
sujet de Médée s’impose à eux. Il a la gravité nécessaire à ce spectacle qui entend
atteindre le comble du tragique ; le merveilleux en constitue une des caractéristiques
remarquables et permet de déployer le grand jeu des machines ; enfin, à Colchos,
Corinthe ou Athènes, l’amour entre dans les motivations de Médée : or, la tragédie lyrique
est là pour faire chanter les passions humaines. Dès 1675, pour leur troisième opéra
Thésée, Lully et Quinault détachent un épisode du cycle légendaire de Médée et font
entrer l’héroïne sur la scène lyrique française. Lorsqu’en 1693 Charpentier commande à
Thomas Corneille un livret sur l’histoire de Médée, il entend donner à l’héroïne le rôle
lyrique qui lui convient et rivaliser du même coup avec Lully. Ce nouveau couple adapte
l’épisode le plus connu de la légende qu’Euripide et Sénèque avaient contribué à rendre
célèbre : la trahison de Jason, la vengeance de Médée, l’assassinat magique de la rivale et
le double infanticide. C’est prendre le parti de la tragédie, confrontant le spectateur à une
héroïne à la fois malheureuse et violente. Alors que la fin heureuse est souvent de mise
dans le modèle inventé par Lully et Quinault, Charpentier et Corneille font le pari de la
noirceur, du sang et des larmes, sans espoir de consolation. Monter la Médée de
Charpentier aujourd’hui implique d’écouter le choix en faveur de la tragédie, du
déchirement des passions et de la violence vindicative qu’ont fait compositeur et
librettiste.
2 Mais c’est aussi se confronter à la tragédie lyrique en tant que forme spectaculaire
éloignée de nous. Disparue des scènes lyriques dès le milieu du XVIIIe siècle et ressuscitée
dans les années 1980, au cours de ce moment « baroqueux » qui a renouvelé notre rapport
au répertoire, la tragédie lyrique n’a pas de continuité d’interprétation. Il revient aux
équipes artistiques d’inventer ou de retrouver une manière de jouer, chanter, danser le
prologue, les cinq actes et leurs divertissements, de concevoir une forme, des corps et des
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
32
images pour les figures allégoriques, mythologiques ou grotesques dont Corneille et
Charpentier émaillent leur œuvre : l’Amour et ses captifs, les Démons des Enfers, la
Gloire, la Victoire et leurs bergers héroïques, etc. Quel rapport instaurer avec le XVIIe
siècle, avec le mythe du Grand Siècle et de Louis XIV, avec le temps révolu et lointain du
classicisme ? L’histoire des mises en scène de Médée témoigne des choix, des conciliations
ou des hésitations des artistes entre leur fascination pour la fable et l’attrait non moins
puissant pour la tragédie lyrique en tant que forme ou pour le XVIIe siècle français. Courte
histoire sans doute que celle de ces mises en scène et néanmoins parlante : elle dessine
l’évolution de nos rapports au patrimoine spectaculaire français comme la fascination
persistante pour la violence de Médée.
Médée et l’univers wilsonien (Lyon, 1984)
3 Le retour de Médée sur la scène française est d’abord le fait de Robert Wilson, qui crée le
spectacle à l’Opéra de Lyon à l’automne 1984, en diptyque avec la Medea de Gavin Bryars,
opéra contemporain d’après la tragédie d’Euripide. Si Wilson répond à une commande de
Jean-Pierre Brossmann pour l’Opéra de Lyon, la figure de Médée est ancrée dans son
œuvre. Dès 1979, il commande à Bryars une musique pour accompagner une mise en
scène qu’il aimerait faire de la Médée d’Euripide. Le projet, d’abord porté par la Fenice de
Venise, se transforme en opéra de sorte que Brossmann a l’idée de lui apparier une œuvre
jumelle, bien plus ancienne et d’un style différent : c’est la Médée de Charpentier. La
double Médée wilsonienne de 1984 n’est pas un hasard de programmation car, dès le
Regard du sourd en 1971, sa figure hante les réalisations de Wilson : « Une femme tue un
enfant… Tout, ou presque, commence avec cette scène du Regard du sourd, scène primitive
de l’œuvre de Robert Wilson, matrice rayonnante et point aveugle tout ensemble1. »
Image mythique et hypnotique à force de ralentissement et d’étirement du temps,
l’infanticide maternel et, avec lui, la silhouette de Sheryl Sutton en robe noire traversent
l’œuvre. Ce n’est donc pas un hasard si Wilson imagine sa mise en scène de Médée pour
Jessye Norman qui ne peut malheureusement tenir le rôle et qui est remplacée par Esther
Hinds, autre soprano afro-américaine. D’autres archétypes de l’univers wilsonien hantent
l’opéra de Charpentier : la statue de Robert E. Lee, le général confédéré de la guerre de
Sécession ; les chaises ; deux femmes en costume des années 40 accomplissant en avant-
scène mille petites actions ordinaires tandis que le drame se déroule derrière elles.
L’appropriation de la tragédie lyrique passe aussi par la transformation du prologue.
Alors que d’autres productions ultérieures supprimeront cette ouverture à la gloire de
Louis XIV, Wilson la réinvente. La célébration des victoires royales disparaît ; la musique
de Charpentier n’existe que par fragments enregistrés, mélangés à des bruits quotidiens,
à la sirène d’une ambulance ou au chant d’un kaddish. Tout un monde d’images sans
rapport direct avec la tragédie lyrique défile sur la scène et mêle l’Antiquité au monde
contemporain, le XVIIe siècle à la mythologie personnelle de Wilson. Le spectacle repose
sur la confrontation de ces univers qui produit des associations d’idées et ouvre les sens
de l’opéra. Si marqué qu’il soit par l’imaginaire du metteur en scène, à aucun moment,
pourtant, la Médée n’apparaît comme contemporaine : Wilson l’inscrit dans une
temporalité mythique, sans commune mesure avec le nôtre, comme une « abstraction
immémoriale2 ». Le spectacle n’est jamais froid et la critique journalistique souligne la
finesse des détails, la mesure de la composition, la beauté qui se dégage de tout le
spectacle. Sans jamais être jolies ou décoratives, les images inventées par Wilson
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
33
conviennent à la musique de Charpentier et à la grandeur tragique de l’œuvre. Certaines
scènes restent dans les mémoires : ainsi de l’envol de Médée, une fois ses crimes commis.
L’héroïne s’élève dans les airs tandis que sa robe tendue jusqu’aux deux côtés de la scène
se déplie et tombe au sol, comme une pyramide démesurée du haut de laquelle elle
humilie Jason.
La Médée « baroque » de Jean-Marie Villégier et
William Christie (Paris, 1993)
4 Il faut attendre près de dix ans pour que la tragédie de Charpentier retrouve le chemin de
la scène. La production des Arts florissants mise en scène par Jean-Marie Villégier entend
renouveler le succès d’Atys dont les représentations entre 1986 et 1992 ont assuré une
reconnaissance mondiale au mouvement « baroqueux » : le spectacle a prouvé que la
forme de la tragédie lyrique, l’alternance des airs et des danses, la tension entre le code
dramatique et l’expression des passions faisaient le plaisir même de la représentation.
C’est à peu près la même équipe qui travaille sur Médée, avec des principes similaires :
William Christie et les Arts florissants, Jean-Marie Villégier pour la mise en scène,
Béatrice Massin pour la chorégraphie des divertissements. L’interprétation musicale et
chorégraphique est historiquement fondée, sans chercher à reconstituer le spectacle
originel. Comme dans Atys, Jean-Marie Villégier met en scène le contexte de l’œuvre : une
cour royale de la fin du XVIIe siècle, prise entre la rigueur du protocole et la dissipation
hédoniste, entre l’or de la gloire monarchique et les ténèbres des affaires de sorcellerie.
Carlo Tommasi imagine un décor unique, une salle de palais circulaire aux murs de
brique, couronnée d’une galerie où les courtisans surprennent les entretiens des
personnages ou observent les cérémonies qui rythment la tragédie. Selon Tiphaine
Karsenti, le spectacle repose sur un enchaînement de rituels. Tout en conservant musique
et paroles du prologue, Villégier imagine que cette célébration initiale soit liée au
baptême des enfants de Médée et de Jason. À la fin de l’œuvre, le rite funéraire de la mort
des enfants répond à cette première fête et clôt la suite de cérémonies qui a scandé
l’avancée du drame : bals et banquets de la cour, messe noire de Médée et de ses
compagnes. Alors que les divertissements éclatent d’une joie insouciante où
s’étourdissent les courtisans, l’acte III est le cadre d’une cérémonie nocturne et secrète où
Médée est rejointe par un chœur de femmes, la tête couverte de leur chaperon, serrant
dans leur main une faible bougie. Tiphaine Karsenti montre comment le spectacle de
Villégier oppose deux conceptions du sacré : celui que la cour de Créon dénature par trop
de profane, celui que Médée incarne, archaïque et violent, mais pur et efficace. Ainsi la
tragédie lyrique de Charpentier, la forme la plus élaborée des plaisirs du XVIIe siècle,
représente sa propre dénonciation par le biais de Médée, seule à aspirer à l’absolu du
sacré3.
5 Comme dans Atys, Villégier choisit de donner une représentation critique du XVIIe siècle,
de lire à travers la fable de Médée les tensions propres à la société de la fin du règne de
Louis XIV : la radicalité d’un sacré austère et pur contre la sécularisation du monde et la
quête de plaisirs. La tragédie lyrique est alors prise à rebours, sans tomber dans le piège
fastueux des machines et le déploiement magnifique d’images qui donneraient du Grand
Siècle une représentation sans ombres. Avec Médée, Villégier poursuit son archéologie du
patrimoine spectaculaire français – archéologie au sens propre puisqu’il retrouve des
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
34
formes oubliées et les remet sur la scène, archéologie au sens de Foucauld en ce qu’il
aborde la mémoire théâtrale, et à travers elle la mémoire nationale, comme des
productions idéologiques dont il faut défaire la dimension mythique.
La Médée « pop » de Pierre Audi et de Jonathan Meese
(Paris, 2012)
6 La Médée des Champs-Élysées se construit contre la grande production de Villégier et
Christie, non pas seulement parce que Pierre Audi a cherché une autre voie mais parce
que, de manière plus profonde, notre rapport au répertoire et à sa mise en scène a
changé. La Médée de Christie et Villégier était représentative d’une certaine conception de
la mise en scène des classiques : lecture critique des œuvres anciennes, travail de
l’historicité et des processus mémoriels du répertoire mais aussi quête de la beauté
théâtrale, du faste et de la sensualité de la représentation. Face à la Médée des Arts
florissants, le spectacle conçu par Pierre Audi et Jonathan Meese efface toute référence au
XVIIe siècle et ne cherche aucune interprétation de la fable. La mise en scène se contente
de placer avec justesse les interprètes, mettant en avant le rôle de Médée qui hante le
plateau plus souvent que dans le livret. Il faut aussi ordonner les positions et les
mouvements des chœurs, créer un déroulement fluide et évident des cinq actes. Audi
soigne la narration du spectacle et rapporte tout à l’intrigue. L’identification de certains
personnages se limite à l’accessoire ou au costume : blondeur de Créüse, élégance sobre
de Jason, cape dorée de Créon, imperméable de plastique rouge aux plis cassants pour
Médée. Exception faite de quelques symboles évidents (croix de fer pour la guerre, lingots
d’or qui jonchent le sol), toute la dimension allégorique et mythologique de l’œuvre
disparaît ou presque. La Victoire, les Argiens, les Démons portent des costumes
minimaux, voire abstraits ; l’Amour a bien ses ailes mais il est difficile de reconnaître les
longs fils qui partent de sa machine comme les chaînes qui emprisonnent ses Captifs. Le
seul geste marquant concerne le prologue : la célébration monarchique est assumée par
les trois personnages principaux du drame – Médée, Jason, Créüse qui chantent la gloire
de Louis XIV sous le regard d’un Créon en manteau royal. Créüse/la Victoire apparaît
d’emblée comme la femme convoitée ; Jason chante le rôle du berger héroïque et
inconstant, tandis que Michèle Losier (Médée/la Gloire) rôde et contemple les duos entre
Sophie Karthäuser (Créüse) et Anders Dahlin (Jason). Dès l’ouverture de la tragédie, le
triangle amoureux est mis en place et ironise le texte du prologue. Mais cette
réinterprétation se fait au profit de la clarté narrative du spectacle. De même, les
passages chorégraphiés sont toujours une représentation de la situation dramatique en
cours, et non des divertissements autonomes.
7 Le minimalisme de la mise en scène répond à la scénographie de Jonathan Meese. Si la
critique s’est beaucoup arrêtée à son inspiration pop, aux découpages de visage féminin,
aux inscriptions provocantes (« L’Amour c’est moi », « SOS », « La Cuisine »), elle a moins
souvent relevé le mouvement incessant des châssis, des éclairages et des filtres. Tout en
n’étant jamais historique, le spectacle retrouve par là la part que jouent les machines
dans la tragédie lyrique française. La dimension plastique du spectacle s’affirme par la
succession rapide des tableaux : les châssis sont des à-plats colorés, des formes découpées
dans la couleur saturée, tantôt écrans où se projettent les ombres des chanteurs, tantôt
grilles dans lesquelles sont collés les fragments d’un corps féminin désiré et découpé
(yeux, bouche). Comme chez Wilson, et sans doute comme en 1693, dans le spectacle
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
35
imaginé par Jean Bérain, la Médée des Champs-Élysées frappe par sa façon de contenter et
l’oreille et l’œil, dans une union des sens caractéristique du projet de la tragédie lyrique.
Le travail plastique de Jonathan Meese, comme la mise en scène de Pierre Audi, cherche
un vocabulaire contemporain pour représenter la part tragique de l’œuvre. Dès l’acte II,
une silhouette voilée de noir se glisse dans le divertissement italien pour chanter les
souffrances de l’amour ; d’autres formes voilées de noir envahissent peu à peu le
spectacle à l’acte III, à mesure que la mort s’approche. Dans cette scénographie qui exalte
la couleur et la forme nette, la tragédie s’incarne dans l’informe et dans l’obscur. Par
contraste, le spectacle se clôt sur une véritable épiphanie du mal : Médée au sommet
d’une pyramide de praticables, entourée d’un obturateur doré et dentelé qui est tout à la
fois char du Soleil, gloire rayonnante et scie sauteuse.
8 Ces trois mises en scène de la Médée de Charpentier témoignent de la progressive
assimilation de la tragédie lyrique du XVIIe siècle par la scène contemporaine comme de
l’évolution de notre rapport aux œuvres anciennes : primat de la fable et de l’expérience
sensible du spectateur, « présentisme »4 sans failles et effacement du passé. Pourtant,
quelles que soient les options artistiques, la fascination pour Médée et la radicalité de son
geste perdure : nous n’en avons pas fini avec la tragédie.
NOTES
1. Frédéric MAURIN, Robert Wilson. Le temps pour voir, l’espace pour écouter, deuxième édition revue
et augmentée, Arles, Actes Sud, « Le temps du théâtre », 2010 [1998], p. 19.
2. Id., p. 240.
3. Tiphaine KARSENTI, « Éclairer l’obscur – la Médée de Thomas Corneille mise en scène par Jean-
Marie Villégier », in Magia, Gelosia, Vendetta. Il mito di Medea nelle lettere francesi, Milano, Cisalpino-
Istituto editoriale universitario, 2006, p. 373.
4. Anne-Françoise Benhamou emprunte le terme à l’historien François Hartog. Voir Anne-
Françoise BENHAMOU, « Classiques intempestifs », Dialogue avec les classiques. Outre-scène, n o 5, 2005,
p. 5.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
36
La femme puissante. Entretien avec
Emmanuelle Haïm
Propos recueillis par Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier
Emmanuelle Haïm, Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier
NOTE DE L’ÉDITEUR
L’entretien a été réalisé le 11 décembre 2012 au Théâtre des Champs-Élysées par Fabien
Cavaillé et Claire Lechevalier.
Claire Lechevalier : Pourquoi avoir choisi de diriger Médée ?
Emmanuelle Haïm : J’ai voulu aborder ce chef-d’œuvre absolu qu’est la tragédie
lyrique de Charpentier (qui ne nous en a laissé que deux), notamment en raison de la
force de la pièce, qui est entièrement construite autour du personnage principal,
Médée. Ce qui m’intéressait, c’était la sympathie croissante que l’on peut éprouver pour
le personnage, malgré sa monstruosité, sa duplicité, ou pourrait-on dire, le mélange,
entre l’humain et l’inhumain, ou le barbare. Le travail que fait Charpentier sur les
tonalités, sur les modes et sur leurs oppositions, sur leurs rapports à nos sentiments et
à nos humeurs, permet de ressentir cette évolution, et d’être emporté par la violence,
l’ouragan de ce que Médée va commettre.
Fabien Cavaillé : Avez-vous un attachement, un goût pour les héroïnes tragiques et Médée
est-elle une forme d’aboutissement ? Vous avez abordé auparavant le personnage de
Médée dans Thésée, celui de Didon aussi. Avez-vous une familiarité particulière avec les
héroïnes tragiques ?
Ce sont des sujets qui occupent beaucoup les librettistes de l’époque en tous les cas.
Sans utiliser l’expression de « la défaite des femmes », pour reprendre le titre d’un
ouvrage d’aujourd’hui sur le sujet1, je dirais qu’il est complexe pour ces femmes d’être
puissantes et heureuses. Donc, le sujet m’intéresse.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
37
Claire Lechevalier : Comment s’est construite votre interprétation du personnage de
Médée ?
Il n’y a pas que Médée dans Médée ; nombre de personnages sont intéressants, en tout
cas dans la façon dont Thomas Corneille les a mis en scène dans la pièce, puis dont
Charpentier les a interprétés. La relation entre Jason et Médée, par exemple, est
passionnante, de même que le personnage de Créuse et la lecture qu’en propose Pierre
Audi. J’avais imaginé une Créuse plus transparente, moins présente que cela et il en a
fait une résistante, quelqu’un qui se fait totalement manipuler par son père, bien que
cela ne soit pas véritablement visible.
Lorsque l’on travaille sur une pièce telle que celle-là, on apporte certes sa réflexion
personnelle, mais les choix que l’on fait (le choix d’une distribution, le travail avec un
metteur en scène…) vont engendrer une lecture finale qui ne sera plus seulement la
vôtre : tous (les chanteurs, le metteur en scène) partagent cette traversée de l’œuvre avec
vous, de sorte que l’évolution sera commune.
Par ailleurs, dans une tragédie lyrique de la France du XVIIe siècle, la séparation entre
musique et texte n’existe pas vraiment. Une grande partie de la pièce est écrite en
récitatifs, ce qui offre une liberté très importante : à quelle vitesse va-t-on déclamer ?
doit-on se laisser guider par la musique ou par le sentiment ? Mais le sentiment, est-ce
le théâtre ou est-ce la musique qui le guide ? Évidemment, ce sont les deux ensemble, et
cela relève aussi du choix du chanteur. Donc, c’est au moment où il s’est agi de choisir
la chanteuse qui allait incarner Médée que s’est construit mon imaginaire du
personnage. J’ai envisagé des options extrêmement différentes, jusqu’à ce que, après
discussion avec Michel Franck, le directeur du théâtre (Pierre Audi n’était pas encore
associé au projet), je choisisse Michèle Losier. L’attribution du rôle de Médée a
déterminé le reste de la distribution ; le choix des autres voix s’est fait selon une
logique d’équilibre, en termes de couples et d’oppositions : il fallait penser Créuse par
rapport à Médée, ou Oronte par rapport à Créon.
Fabien Cavaillé : Vous dites assez souvent que vous aimez bien raconter des histoires
par la musique. Comment peut-on raconter une histoire depuis l’orchestre ?
La musique est liée à une histoire qui se déroule et qui se raconte, et ce même si aucun
mot n’est prononcé. Dans le cas de Médée, l’histoire qui se vit est déjà là, à travers les
mots écrits notamment. Mais il y a aussi beaucoup de mots à entendre derrière ces mots
écrits. C’est avec les acteurs que l’on va en faire l’expérience. Nous avons travaillé
pendant presque un an, selon plusieurs degrés d’approfondissement, qui évoluaient à
chaque fois. Je sais ce que les chanteurs ont traversé, et je suis en adéquation avec cela.
Cette trajectoire-là, on la fait ensemble comme un film qui se raconte à plusieurs,
parfois aussi presque en dehors de nous.
Ce que j’aime dans la partie orchestrale, c’est certainement de faire des liaisons.
L’orchestre ne voit pas forcément toujours le plateau. Les musiciens viennent aux
générales de continuo pour voir ce qui se joue, ce qui se danse pendant qu’ils jouent. Je
trouve cela très important que l’orchestre ne soit pas coupé de cette vie théâtrale,
d’autant plus que ce sont des artistes qui veulent être impliqués. Les uns et les autres
vont vivre cette histoire un peu différemment, mais ce rapport commun au plateau est
absolument fondamental. Et c’est d’essayer de faire tous ces liens-là qui me semble
important dans un opéra, pour qu’en effet l’histoire puisse se raconter.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
38
Claire Lechevalier : Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule le processus
d’orchestration ?
La question des sources, en musique ancienne, est très importante : on a moins de
publications que pour beaucoup de répertoires plus récents, et cette œuvre précise est
relativement peu jouée. La fois précédente que Médée a été jouée sur scène ici, à Paris
c’était il y a vingt ans, avec la production Christie-Villégier ; il y a eu quelques versions
concert, une version au Canada.
L’œuvre a été jouée à partir de manuscrits, ou de l’édition Balard qui est contemporaine
de la création (1693). C’est une source riche, qui donne un certain nombre d’indications
sur la répartition des instruments à tel ou tel moment : par exemple, le moment où
Médée confie ses enfants à sa rivale est illustré par les flûtes traversières. Mais nombre
de choix restent aussi à faire : les hautbois étaient-ils majoritairement des dessus de
hautbois, ou avait-on toute la déclinaison de la famille de hautbois ? La partition a été
écrite à cinq parties, était-ce décliné pour les cinq parties de hautbois ? On ne le sait pas
nécessairement.
Par ailleurs, nous connaissons les effectifs, les habitudes de l’époque, mais nous devons
aussi être pragmatiques : dans une représentation comme celle d’aujourd’hui, il faut
que l’effectif corresponde à la taille du théâtre. Dans cette musique, qui est beaucoup
moins écrite que les musiques ultérieures, tout est donc affaire de choix, et ces choix
s’élaborent pendant les répétitions, avec les musiciens de l’orchestre.
Claire Lechevalier : Au moment des répétitions, lorsqu’arrivent les chanteurs et que vous
commencez le travail sur le lien entre le texte, la musique et la voix, quelles sont les
interrogations auxquelles vous pouvez être sensible ?
Il y a toute une partie de travail avec les chanteurs qui est un travail déclamatoire et
qui se fait sur le plateau. La plupart des traités de chant de l’époque, en particulier des
années qui précèdent la composition de Médée, ne sont autres que des traités de
déclamation. Les compositeurs, en écrivant le récitatif français – en particulier Lully,
dans son travail avec Quinault – tentent de se rapprocher de ce naturel, de l’art de
l’orateur, du rythme de la parole, qui est en même temps théâtralisé. Ce n’est pas une
parole anodine, ni une parole « de la rue », mais c’est une parole théâtralisée.
Lully allait écouter la Champmeslé déclamer pour écrire ces annotations, puis il
essayait de retranscrire cela dans un récitatif élaboré selon une certaine mesure. Mais
cette mesure ne devrait pas s’entendre. Il y a donc une sorte de hiatus entre la notation
musicale de la partition – qui est imparfaite – et la volonté de reproduire une parole qui
soit la plus naturelle possible.
Par ailleurs, pour les chanteurs, la syntaxe de Corneille est souvent complexe. Au
moment du travail préparatoire de lecture, comme les acteurs feraient à la table,
plusieurs niveaux de compréhension apparaissent. Progressivement se met en place un
chant, qui relève plutôt du parlé-chanté. L’on cherche, et c’est un travail difficile, à
parvenir à la déclamation la plus naturelle possible, dont le rythme ne semble pas
relever de l’écrit.
Fabien Cavaillé : Comment travaillez-vous plus précisément l’ornementation ?
En général le jeu des compositeurs de livret de l’époque était d’écrire avec un minimum
de mots. C’est pour cela que tous les mots, qui reviennent sans cesse, sont répertoriés
dans les traités de déclamation : dépit, rage, haine, jaloux ; amour, toujours ; ou
comment écrire une tragédie en cinq cents mots ! Ensuite il faut se demander comment
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
39
on prononce ces mots-là. Les ornements sont faits pour attirer l’attention sur une
syllabe, pour exciter l’oreille par une dissonance. Si l’ornementation est complètement
codifiée en France, on peut choisir d’introduire une dissymétrie, parce qu’on préfère
l’impair…
Claire Lechevalier : Tout cela donc relève d’un travail de reconstitution, d’un mélange
entre la dimension historique et l’actualité des chanteurs, du plateau et des musiciens.
Comment croise-t-on ces différentes perspectives quand on est chef d’orchestre ?
Théâtralement, même si c’est un langage qui est un peu loin de nous (« quel prix de
mon amour, quel prix de mes forfaits… »), le sujet est actuel et les propositions que
m’ont faites Pierre Audi et Jonathan Meese allaient dans ce sens-là. Je connais Pierre
Audi depuis très longtemps et j’apprécie beaucoup son travail qui est extrêmement
varié. J’apprécie énormément l’écoute qu’il a de la musique sur un texte, de la relation
de l’un par rapport à l’autre. Pour Médée, Pierre Audi a proposé à un travail avec
Jonathan Meese à partir de l’idée très contemporaine de la violence des affrontements,
des couleurs et des espaces, dans une perspective un peu onirique ; et je m’y suis tout à
fait retrouvée. Cela me semblait entrer en résonance avec cette œuvre précise,
particulièrement moderne et inclassable. Je ne trouve pas qu’elle rende nécessaire le
moule de la représentation historique.
De façon générale, cela m’intéresse de travailler sur cette question : lorsque j’ai dirigé
Hippolyte et Aricie, la collaboration avec le metteur en scène Ivan Alexandre se
construisait davantage dans une perspective historique, plus soucieuse de l’époque de
composition de la pièce, mais le lien avec le monde d’aujourd’hui m’intéresse tout
autant. Il y a plusieurs approches du public et je trouve qu’il est important que le lien
avec le monde d’aujourd’hui soit maintenu.
Claire Lechevalier : Et qu’en est-il dans l’approche plus proprement orchestrale ?
Là non plus, on ne peut pas parler de reconstitution. Ce travail relève quoiqu’il arrive
de la recréation. Les facteurs de clavecins d’aujourd’hui, par exemple, qui vont étudier
de près les instruments ou les traités de facture que l’on peut avoir, sont malgré tout
des artistes qui mettent en œuvre une réalisation personnelle et créent un instrument
d’aujourd’hui, même si l’approche est historienne.
Public : Vous êtes associée à la musique baroque. Et nous avons vu ici trois Médée
(Charpentier, Cherubini, Dusapin) une baroque, une de la fin du XVIIIe siècle, et une
contemporaine. Auriez-vous pu envisager de diriger les trois, et de vous orienter aussi vers
la musique contemporaine. Quel est votre rapport à cette création-là ?
En l’occurrence, ma formation c’est le clavecin. Et donc mon univers commence là où
commence le clavecin et s’arrête là où s’arrête le clavecin, ce qui limite un peu le
répertoire. Certes, il existe de la musique contemporaine pour le clavecin, qui peut être
fort belle et très intéressante. Souvent les musiciens qui se spécialisent dans les
recherches sur instruments historiques sont des improvisateurs. Ils ont un lien
particulier avec la musique contemporaine ; ce sont donc des mondes qui peuvent
complètement se rencontrer. Avec le Concert d’Astrée, j’ai prévu de créer des
passerelles avec la musique contemporaine, autour des ballets de Rameau notamment,
dans lesquels les intermèdes vont être improvisés et joués par des musiciens croisés de
l’ensemble Ictus et du nôtre. Mais en ce qui me concerne, mon répertoire est tellement
vaste qu’il me faudrait déjà au moins deux ou trois vies pour l’explorer…
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
40
Public : Vous venez de parler de vos projets : vous est-il arrivé d’être appelée en tant que
chef d’orchestre à choisir vous-même le spectacle que vous souhaitiez diriger ?
Oui, cela peut arriver. Et c’est fantastique d’avoir la chance que l’on vous demande ce
que vous imaginez, ce que vous aimeriez faire. Aujourd’hui j’ai cette chance-là de
pouvoir proposer des projets dans leur globalité, de les penser dans leur globalité, ce
qui donne une liberté créatrice extraordinaire. Mais parfois, des directeurs ou des
directrices très enthousiastes peuvent me contacter avec des suggesti !ons que je
n’aurais pas imaginé me convenir, et cela peut être formidable aussi…
NOTES
1. Catherine CLÉMENT, L’Opéra ou la défaite des femmes, Grasset, 1979.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
41
La « survivance » du mythe de
Médée dans Médée-matériau de
Heiner Müller
Florence Baillet
1 Nous souhaitons nous pencher sur le texte de Heiner Müller, « Médée-matériau »1, qui a
servi de point de départ à l’opéra Medeamaterial de Pascal Dusapin, chorégraphié par
Sasha Waltz et présenté dans le spectacle Medea au Théâtre des Champs-Elysées les 9 et 10
novembre 20122 : nous nous proposons d’aborder cette œuvre müllérienne en
empruntant le terme de « survivance » (Nachleben) à l’historien de l’art allemand Aby
Warburg, lequel a cherché à cerner de la sorte ce qui nous parvenait de l’Antiquité, à
travers les siècles3. À la lumière du spectacle Medea, il nous a semblé en effet intéressant
de reconsidérer le texte de Müller en nous appuyant sur la pensée de Warburg, dans la
mesure où cette dernière a déjà été mobilisée au sujet de la danse moderne et
contemporaine, notamment dans les travaux de recherche de Gabriele Brandstetter4. Il
s’agirait ainsi de souligner les apports que sont susceptibles de fournir l’histoire de l’art et
les études visuelles à la recherche müllérienne, voire plus généralement aux études
théâtrales.
Réécriture et « survivance »
2 Le terme consacré, habituellement utilisé pour désigner ce que Müller reprend des
mythes antiques, est celui de « réécriture »5. De fait, « Médée-matériau », qui est en
réalité le volet central d’un triptyque intitulé Rivage à l’abandon Médée-Matériau Paysage
avec Argonautes, comprend lui-même plusieurs strates d’écritures, puisqu’il a été rédigé et
remanié à plusieurs reprises par l’auteur dramatique entre 1949 et 1982. De plus, Müller y
cite et y varie à sa manière différents textes, à la fois la Médée d’Euripide, celle de Sénèque
ou encore, pour le XXe siècle, celle de Hans Henny Jahnn6. Comme à l’accoutumée chez
l’écrivain est-allemand et comme dans ses autres œuvres inspirées de l’Antiquité (qu’il
s’agisse de Philoctète, d’Héraclès ou d’Œdipe), le texte dramatique, multipliant les
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
42
références intertextuelles, semble s’inscrire ainsi dans une lignée d’écritures et de
réécritures.
3 Il paraît cependant nécessaire de préciser les modalités de la réécriture müllérienne des
mythes grecs. En particulier, il ne s’agit pas pour Müller d’utiliser les masques antiques
afin de passer en quelque sorte en contrebande, sur le mode de l’allégorie ou de la pièce à
clé, des questionnements concernant la RDA, qu’il ne pourrait dire que par le biais d’une
telle réécriture, en raison de la censure7. Dans un entretien de 1984, il s’opposera
nettement à une pareille interprétation, expliquant qu’en aucun cas, son « appropriation
de l’Antiquité n’aurait relevé d’un mouvement de fuite » ou de l’idée « qu’une
allégorisation serait nécessaire » : « Je n’arrive de toute façon pas à faire ce genre de
choses, à habiller à la mode antique un problème actuel8. » Müller a pour sa part décrit,
dans un texte de 1988 intitulé « Shakespeare une différence », la manière dont il puise
dans les mythes de l’Antiquité, en les qualifiant d’« agrégat[s] », qui « transporte[nt] de
l’énergie »9. Dans les pages de son autobiographie Guerre sans bataille consacrées à la pièce
Rivage à l’abandon Médée-Matériau Paysage avec Argonautes, il parle en outre de ces mêmes
mythes en termes d’« expériences collectives coagulées »10, autrement dit condensées,
intensifiées. De fait, au moment où il termine la rédaction de « Médée-matériau », au
début des années 1980, l’écrivain est-allemand est avant tout à la recherche de
potentielles sources de révoltes, dont il voit des germes possibles notamment dans les
pays en voie de développement, comme autant de forces susceptibles selon lui
d’interrompre la continuité d’une histoire qui, en RDA, se serait figée, pétrifiée. Or sur le
mode de la « survivance » de l’Antiquité, c’est justement la transmission et la reprise
d’une énergie, en l’occurrence d’un affect intensifié que décrit Warburg, en utilisant
l’expression de « formule de pathos » (Pathosformel en allemand) : d’après cet historien de
l’art, il faut rechercher dans la tragédie antique, voire dans les transes orgiaques, en
adoptant une perspective d’anthropologie culturelle, « la frappe qui a imprimé dans la
mémoire les formes expressives des émotions les plus profondes, pour autant qu’elles
peuvent se traduire gestuellement, avec une intensité telle que ces engrammes d’une
expérience passionnée survivent comme patrimoine […] gravé dans la mémoire et
déterminent exemplairement les contours de la main de l’artiste quand les valeurs
suprêmes du langage gestuel cherchent à prendre forme et à paraître au grand jour par la
voie de la création artistique »11.
4 Il nous semble que le « Médée-matériau » de Müller relève d’une conception analogue de
la « survivance » de l’Antiquité, autrement dit non pas tant la réécriture de quelque
histoire ou mythe que la résurgence d’une charge émotive, la revenance d’une
cristallisation sensible. Il est vrai que Warburg repère de pareilles survivances avant tout
dans les compositions visuelles, mais c’est bel et bien autour d’un matériau pulsionnel
que se condense le texte « Médée-matériau » si compact de Müller, lequel écrivit
également, en 1974, sous le titre « Medeaspiel », de manière symptomatique, une
pantomime autour de la figure de Médée. Et ce sont bien ces « traces » de l’Antiquité sous
la forme de gestes intensifiés que déploie la chorégraphie de Sasha Waltz lors du
spectacle Medea, en débutant le spectacle par la vision de bas-reliefs antiques dont la
gestuelle figée, tout à coup, s’anime, prend vie, ou encore en faisant ressurgir sur la scène,
dans le tournoiement des vêtements et les tourbillons des cheveux emportés par le vent
violent et par la danse, l’image dionysiaque d’une Médée « ménade » infanticide.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
43
Contre la conception de « l’héritage », pour une autre
appréhension de l’Antiquité
5 En s’emparant de la sorte de l’héritage antique, en proposant une vision pulsionnelle et
passionnelle de l’histoire, l’auteur dramatique est-allemand qu’était Müller accomplissait
lui-même un geste radical, une rupture, par rapport à la réception de l’Antiquité tolérée
en RDA, selon la ligne officielle, et à la conception de l’histoire qui lui était liée. Le régime
est-allemand mettait en effet l’accent sur l’héritage classique, par conséquent sur une
Antiquité à la Winckelmann, placée par les Lumières puis par le classicisme weimarien
sous le signe de la beauté idéale et de l’harmonie : la RDA pouvait ainsi, d’une part,
revendiquer sa légitimité et son identité en se présentant comme l’héritière de ce
patrimoine et, d’autre part, affirmer une représentation de l’histoire linéaire, progressant
vers son telos, vers l’harmonie et la société idéale qu’était censé incarner au bout du
compte le socialisme réel12. Or toute l’œuvre müllérienne s’emploie à interrompre cette
continuité d’une prétendue filiation, autrement dit à opérer le démontage d’une pareille
vision du temps historique et de « l’héritage » (Erbe). Là où Lessing, en 1769, avait traduit,
dans sa Dramaturgie de Hambourg, les effets produits par la tragédie selon Aristote, eleos et
phobos, respectivement par la « pitié » (Mitleid en allemand) et la « crainte » (Furcht en
allemand), Müller refuse la version adoucie proposée par l’homme des Lumières et
réintroduit la notion de « terreur », d’« effroi » (Schrecken)13, notamment en plaidant,
dans un entretien daté de 1981, pour une « pédagogie de l’effroi » au théâtre : « Jamais
encore un grand nombre d’hommes n’a appris quelque chose sans effroi, sans choc 14. »
6 Le texte « Médée-matériau » présente en ce sens, en quelques cinq ou six pages, sous une
forme extrêmement ramassée et donc de manière d’autant plus percutante, voire
violente, l’enchaînement des crimes commis par Médée : son frère a été « dépecé » de ses
propres mains, ainsi qu’elle le décrit elle-même, tandis que la nouvelle épouse de Jason se
retrouve « en flammes », puisque sa robe de jeune mariée, offerte par sa rivale, la
transforme en « torche nuptiale »15. À ses enfants, Médée va en outre jusqu’à reprendre la
vie qu’elle leur a donnée : « Je veux de mon cœur vous arracher vous / La chair de mon
cœur Ma mémoire Mes chéris / Le sang de vos veines rendez-le moi / Réintégrez mon
corps vous entrailles16 ». Müller dépeint ainsi une histoire cruelle, sans cesse en proie à la
destruction et à l’autodestruction17, si bien que le texte « Médée-matériau » se peuple
d’images de sang et de mort, convoquant le corps, omniprésent, dans sa matérialité. Dans
les propos de Médée, tout se joue en effet à même la chair et la peau : « Veux-tu boire
mon sang Jason […] Suivant ta trace sanglante du sang des miens […] Sur la peau rien que
ma sueur […] Voici l’or de Colchide qui obstrue les pores de sa peau / Plante dans sa chair
une forêt de couteaux18. » Avec le bruit et la fureur envahissant la scène, c’est par ailleurs
le cri, le langage non articulé, qui fait irruption dans « Médée-matériau » : « Les cris des
écorchés […] La voici qui crie Avez-vous des oreilles pour ce cri / Ainsi criait la Colchide
quand vous étiez dans mes entrailles / Elle crie toujours Avez-vous des oreilles pour ce cri
[…] Qu’avez-vous à crier19. » Et Médée d’ajouter à la fin de son monologue, après qu’elle a
multiplié les comparaisons animales : « Ça aboie couine siffle20. » Le fil que Müller
s’emploie à renouer avec l’Antiquité est par conséquent bel et bien celui du « pathos »,
au-delà ou en deçà du « logos ».
7 Pareil théâtre se placerait alors sous le signe de la présence éprouvée tout autant que de
la représentation élaborée. De fait, le monologue de Médée, qui sombre dans la folie,
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
44
n’identifiant pas ses enfants morts, finit par interroger la représentation elle-même, la
désignant comme telle, en mentionnant la présence de « comédiens », lesquels ne
disparaissent plus complètement derrière leur rôle : « Qui êtes-vous Qui vous a / Revêtus
du corps de mes enfants […] Des comédiens voilà ce que vous êtes21. » Müller convoque en
somme l’Antiquité à la façon d’un symptôme, susceptible d’émerger de nouveau, tel un
retour du refoulé : non pas quelque objet mort d’un passé achevé à figurer, mais, selon le
modèle warburgien, la puissance encore agissante d’une « survivance », dont on (re)fait
l’expérience, d’une manière à chaque fois singulière, au présent. Face au modèle
historique téléologique et linéaire qu’imposait le discours officiel du régime est-allemand,
l’histoire, telle que Müller l’envisage, relève, au contraire, d’un temps des plus complexes,
une temporalité hétérogène, qui se tisse à partir de résurgences et d’anachronismes, si
bien que le théâtre müllérien est souvent peuplé de fantômes. On notera que le
monologue « Médée-matériau » se présente lui-même sur le mode de la remémoration,
témoignant de la hantise du passé dans le présent : Médée s’adresse à la nourrice, pour sa
part habitée par « les fantômes de sa jeunesse »22, puis, à Jason, avant d’égrener son
histoire, les différents meurtres qu’elle commet et qui semblent, de la sorte, s’accomplir,
sous nos yeux, alors qu’elle paraît, là aussi de manière quasi performative, perdre la
raison. Dans ce récit entremêlant les temps, le passé, le présent et le futur, l’« héritage »
de l’Antiquité, pour la civilisation occidentale, loin d’être scellé, poursuit son travail, sous
nos yeux.
La révolte de Médée : des « affects intensifiés »
8 Müller appréhendait en fait l’Antiquité à travers le prisme d’un ouvrage particulier, celui
de l’historien anglais George Thomson, intitulé Eschyle et Athènes et paru en 1957 en RDA23.
Est dépeinte dans ce livre la mise en place, au sein du monde grec au VIe siècle avant J.-C.,
des fondements de la culture occidentale, soit d’un nouveau type de rationalité, qui
reposerait sur le calcul et la pure abstraction (avec une scission entre théorie et pratique),
et qui survivrait, d’une manière ou d’une autre, jusqu’à nos jours24. Thomson avait
élaboré son interprétation de l’Antiquité dans la mouvance de l’ouvrage de Max
Horkheimer et Theodor Adorno, La Dialectique de la Raison, paru en 1947, qui effectuait une
critique de la rationalité occidentale, notamment de la « raison instrumentale », et
montrait comment le projet des Lumières, visant l’émancipation et le progrès d’une
humanité affranchie du mythe et de la pensée magique, était susceptible de régresser, se
retourner en son contraire et de sombrer dans la barbarie. Or pour Müller, le mythe de
Médée témoignerait justement d’une pareille « dialectique de la raison » : dans « Médée-
matériau », Médée, la magicienne, a été utilisée, instrumentalisée par Jason, le
conquérant, le colonisateur, qui l’a poussée à trahir les siens, « la Colchide [sa] patrie 25 ».
Comme le personnage d’Ulysse dans la pièce Philoctète de Müller, Jason est à l’image d’une
rationalité calculatrice et réifiante : « Pour un frère je t’ai donné deux fils26 » répond-il, en
guise de compensation, à Médée, laquelle n’a de cesse de souligner la mort de son frère.
Les phrases de Médée « Tu me dois un frère Jason » et « Veux-tu les ravoir tes fils »
reviennent alors comme un refrain, témoignant d’une dette impossible à combler et
dénonçant de la sorte les calculs de Jason27.
9 La Médée de Müller, qui se trouve au cœur de Rivage à l’abandon Médée-Matériau Paysage
avec Argonautes et est quasiment la seule à prendre la parole dans le volet central de
« Médée-matériau », tente alors de se libérer de l’emprise de Jason. Elle s’efforce en effet
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
45
d’affirmer son identité, sa voix, par le biais de cette parole monologuée, dans la
réitération du pronom personnel de la première personne : « Tout en moi est à toi
instrument tout entière […] / Moi ta chienne ta putain moi / Moi barreau sur l’échelle de
ta gloire » déclare-t-elle au début de sa longue tirade pour revendiquer à la fin « Je suis
Médée » (citant au passage Sénèque), même s’il s’agit d’une Médée morcelée, relevant
d’une humanité qu’elle veut « déchirer en deux »28. Le monologue de Médée suit le
mouvement de cette émancipation, qui s’effectue dans la violence et dans le sang, alors
qu’a été détruit le voile d’illusion l’empêchant jusque-là de réellement voir : « Aveugle à
cette vision sourde aux cris / J’étais jusqu’à ce que tu aies déchiré le filet / Tissé de mon et
de ton plaisir / Qui était notre demeure à présent mon exil29. » Le déchaînement des
crimes, la terreur que sème Médée, la barbare, dans la suite du monologue, est donc chez
Müller l’indice de la révolte d’une opprimée ou encore d’une « colonisée ». La part du
mythe, méprisée par la rationalité que figure Jason, fait retour, mais un retour terrifiant,
témoignant de la face cachée de la conquête de Jason, tout comme des monstres qu’est en
définitive toujours susceptible de produire l’histoire de la rationalité occidentale, depuis
son origine. Or le terme de « survivance », selon Aby Warburg, permet justement de
désigner l’impureté fondamentale d’une histoire, qui doit également prendre en compte,
au-delà de l’ordre symbolique, au-delà des significations, ses forces « obscures », ce que
Nietzsche, auquel se réfèrent Warburg tout comme Müller, avait nommé « pathos »,
« pulsion » (Trieb) ou encore « affect »30. Ce sont ces resurgissements et métamorphoses,
au cours de l’histoire, d’affects intensifiés, de « résidu symbolisé de réactions corporelles
primitives »31, que Warburg observe dans la migration de gestes d’une œuvre d’art à
l’autre. C’est la même symptomatologie psychique que Müller semble mettre en œuvre
dans son théâtre, quand il re-saisit le mythe de Médée sous une forme condensée,
exacerbée, mettant l’accent sur l’intensité des formes symboliques.
10 De la figure antique de Médée, Heiner Müller ne reprend donc pas tant, dans son texte
« Médée-matériau », une histoire à raconter qu’une énergie de révolte, s’inscrivant dans
le corps et ses gestes, ce que peut particulièrement mettre en lumière un spectacle tel que
celui de Medea de Pascal Dusapin et Sasha Waltz, par le biais de la musique et de la danse.
Si la Médée müllérienne est entre tous les fronts, si elle a trahi les siens et est à présent
trahie, elle se libère ce faisant de tous les liens, afin d’interrompre la continuité du même,
dans la douleur, tel un invraisemblable prix à payer pour son soulèvement : elle franchit
alors toutes les limites, sondant également celles de la représentation. Et Médée de
clamer au sujet de sa rivale, en insistant sur la dimension de performance : « Sur son
corps à présent j’écris mon spectacle32 ». De fait, en-deçà ou au-delà de toute réécriture et
de toute sémiotisation, ce théâtre müllérien se veut avant tout une pratique, une
expérience proprement tragique, un symptôme, lequel serait à définir, selon Jacques
Lacan, comme « un symbole sur le sable de la chair »33. En renouant avec la Médée de
l’Antiquité, « Médée-matériau » reprend ainsi le fil du pathos éprouvé, sur le mode, donc,
de la « survivance ».
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
46
NOTES
1. Heiner MÜLLER, Rivage à l’abandon Matériau-Médée Paysage avec Argonautes, traduit de l’allemand
par Jean Jourdheuil et Heinz Schwarzinger, in Heiner MÜLLER, Germania Mort à Berlin, Paris,
Minuit, 1985, p. 9-22 et en particulier p. 10-17 pour « MÉDÉE-MATÉRIAU » (noté désormais MM).
Nous citerons la pièce de Müller à partir de cette traduction française. Pour l’édition allemande :
Heiner MÜLLER, VERKOMMENES UFER MEDEAMATERIAL LANDSCHAFT MIT ARGONAUTEN, in : Heiner
MÜLLER, Die Stücke 3, Werke 5, édité par Frank Hörnigk, Francfort/Main, Suhrkamp, 2002, p. 71-84,
en particulier p. 74-80 pour « MEDEAMATERIAL LANDSCHAFT MIT ARGONAUTEN » (noté
désormais MLA).
2. L’opéra de Pascal Dusapin, Medeamaterial, a été créé le 13 mars 1992 à Bruxelles, tandis que la
création de la chorégraphie de Sasha Waltz a eu lieu le 23 mai 2007 à Luxembourg.
3. Cf. Aby WARBURG, « Dürer und die italienische Antike » (1905), in : Aby WARBURG, Die Erneuerung
der heidnischen Antike. Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance,
Gesammelte Schriften I.2, édité par Horst Bredekamp (et alii), Berlin, Akademie Verlag, 1998,
p. 443-449.
4. Gabriele BRANDSTETTER, Tanz-Lektüren. Körperbilder und Raumfiguren der Avantgarde, Francfort/
Main, Fischer, 2000.
5. Jean-Marie Piemme avait ainsi qualifié Heiner Müller de « réécrivain ». Cf. Jean-Marie PIEMME,
« Müller donc, réécrivain », in : Didascalies, no 7, décembre 1983, p. 49-53.
6. Rappelons que la Médée d’Euripide date de 431 avant J.-C. et celle de Sénèque de 60-65 après J.-C.,
tandis que la Médée de Jahnn parut en 1926.
7. Si la censure n’existait pas officiellement en RDA, elle n’en prenait pas moins, en réalité,
différentes formes, dont notamment, pour la publication d’une œuvre, une soi-disant
« procédure d’autorisation de l’impression » [Druckgenehmigungsverfahren].
8. « Theater nach Brecht. Gespräch mit Heiner Müller » (1984), in : Heiner MÜLLER, Gespräche
1 1965-1987, Werke 10, édité par Frank Hörnigk, Francfort/Main, Suhrkamp, 2008, p. 298-317. Ici,
p. 304. Quand une édition française n’est pas indiquée, les traductions des citations allemandes
sont effectuées par nos soins.
9. Müller propose en effet la définition suivante du mythe : « L’irruption du temps dans le jeu
constitue le mythe. Le mythe est un agrégat, une machine, sur laquelle peuvent toujours être
branchées de nouvelles machines, d’autres machines. Il transporte l’énergie ». Cf. Heiner MÜLLER,
« Shakespeare eine Differenz » (1988), in : Heiner MÜLLER, Schriften, Werke 8, édité par Frank
Hörnigk, Francfort/Main, Suhrkamp, 2005, p. 334-337. Ici, p. 336. Au sujet des références
müllériennes à l’Antiquité, nous nous appuyons en particulier sur les travaux de Wolfgang
Emmerich : Wolfgang EMMERICH , « Griechische Antike », in : Hans-Thies LEHMANN , Patrick
PRIMAVESI (dir.), Heiner Müller Handbuch, Stuttgart, Metzler, 2003, p. 171-178.
10. Heiner MÜLLER, « Verkommenes Ufer », in : Heiner MÜLLER, Eine Autobiographie, Werke 9, édité
par Frank Hörnigk, Suhrkamp, Francfort/Main, 2005, p. 250-253. Ici, p. 251.
11. Nous citons la traduction de Pierre Rusch, telle qu’elle est reprise dans l’ouvrage de Georges
Didi-Huberman consacré à Aby Warburg. Cf. « Introduction à l’atlas Mnémosyne », traduit par
Pierre Rusch, in : Trafic, no 9, 1994, p. 39-49 et Georges DIDI-HUBERMAN , L’Image survivante. Histoire
de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Minuit, Paris, 2002, p. 240-241. Il s’agit d’un passage
extrait de l’introduction au projet Mnémosyne d’Aby Warburg, en 1929 : Aby WARBURG,
« Einleitung zum Mnemosyne-Atlas », in : Ilsebill Barta FLIEDL, Christoph GEISSMAR (éd.), Die
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
47
Beredsamkeit des Leibes. Zur Körpersprache in der Kunst, Salzbourg/Vienne, Residenz-Verlag, 1992,
p. 171-173.
12. Cf. Wolfgang EMMERICH , Kleine Literaturgeschichte der DDR, Berlin, Aufbau, 2009 (4 e édition),
p. 84 et suivantes.
13. Au sujet du débat sur la traduction des deux termes d’Aristote eleos et phobos, on pourra lire
l’article suivant : Wolfgang SCHADEWALDT , « Furcht und Mitleid. Zur Deutung des Aristotelischen
Tragödiensatzes », in : Matthias LUZERKE, Die aristotelische Katharsis, Hildesheim, Olms, 1991,
p. 246-288.
14. Heiner MÜLLER, « Ich muß mich verändern, statt mich zu interpretieren » (1981), in : Heiner
MÜLLER, Gespräche 1, Werke 10, édité par Frank Hörnigk, Suhrkamp, Francfort/Main, 2008,
p. 153-157. Ici, p. 154.
15. MM, p. 13 et 15 / MLA, p. 76 et 78.
16. MM, p. 16 / MLA, p. 79.
17. Ce geste d’anéantissement de sa descendance, de négation de sa propre création, est aussi
celui d’Ophélie dans Hamlet-machine, texte de Müller datant de 1977, dans lequel Ophélie déclare :
« Je change le lait de mes seins en poison mortel. Je reprends le monde auquel j’ai donné
naissance. J’étouffe entre les cuisses le monde auquel j’ai donné naissance. » Cf. Heiner MÜLLER,
Manuscrits de Hamlet-machine. Transcriptions-traductions, traduit par Jean Jourdheuil et Heinz
Schwarzinger, Paris, Minuit, 2003, p. 157.
18. MM, p. 11, 12 et 15 / MLA, p. 75, 76 et 78.
19. MM, p. 12, 15 et 16. / MLA, p. 76, 78 et 79.
20. MM, p. 17 / MLA, p. 80.
21. MM, p. 17 / MLA, p. 79.
22. MM, p. 11 / MLA, p. 75.
23. Cf. Wolfgang EMMERICH , « Griechische Antike », in : Hans-Thies LEHMANN , Patrick PRIMAVESI
(dir.), Heiner Müller Handbuch, op. cit. Ici, p. 173.
24. Voir l’article mentionné dans la note précédente. Au sujet de la révolte de Médée
müllérienne, nous renvoyons également (entre autres) aux travaux suivants : Nobert Otto EKE,
« Archäologie der Revolte : ‘Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten’« ,
in : Norbert Otto EKE, Heiner Müller – Apokalypse und Utopie, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1989,
pp. 190-225 ; Sue-Ellen CASE, « Medea », in : Hans-Thies LEHMANN , Patrick PRIMAVESI (dir.), Heiner
Müller Handbuch, op. cit., p. 256-260.
25. MM, p. 12 / MLA, p. 76.
26. MM, p. 12 / MLA, p. 75.
27. Ibid.
28. MM, p. 12, 17 et 16 / MLA, p. 75, 80 et 79.
29. MM, p. 12 / MLA, p. 76.
30. Cf. Georges DIDI-HUBERMAN, op. cit., p. 152.
31. Ibid., p. 235.
32. MM, p. 15 / MLA, p. 78.
33. C’est ainsi que Lacan définit le symptôme hystérique ; cf. Jacques LACAN , Écrits, Paris, Seuil,
1966, p. 280.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
48
Les chœurs dansants de Sasha
Waltz. Medea, d’après l’opéra
Medeamaterial de Pascal Dusapin
Cécile Schenck
Il suffit de partir du sentiment que quelque chose
est fini et que l’on est face à un vacuum, face à un
espace vide que l’on doit décrire ou dont on doit
faire quelque chose.
Heiner Müller, Profession arpenteur,
cité par Stéphane Lépine,
in Matériaux pour Médée de Heiner Müller mis en
scène par Brigitte Haentjens, 2004.
1 Peut-on jamais retrouver ce que l’on a une fois perdu ? Ce pourrait être la question
commune à Orpheus et Medea, ces deux grandes figures amoureuses de la mythologie
grecque qui ont inspiré respectivement aux chorégraphes allemandes Pina Bausch et
Sasha Waltz un opéra dansé : Orphée et Eurydice est créé à Wuppertal en 1975 sur la
musique de Gluck (un an après Iphigénie en Tauride sur une partition du même
compositeur), tandis que Medeamaterial de Heiner Müller est chorégraphié et mis en scène
pour la première fois sur la musique de Pascal Dusapin en 2007, au Grand Théâtre de
Luxembourg. À plus de trente ans de distance, ces deux œuvres du répertoire opératique
de la danse contemporaine présentent de remarquables similitudes : l’une et l’autre sont
le produit d’une rencontre féconde entre la tradition germanique du Tanztheater et celle
de la modern dance américaine, dont Pina Bausch puis Sasha Waltz ont fait l’apprentissage
à New York. Dans les deux cas, le résultat est un ballet assez « sage », qui, sans être
classique, n’en convoque pas moins – pour reprendre la terminologie d’Aby Warburg –
des formules de pathos éprouvées, héritées à la fois de Mary Wigman et de Martha Graham.
Cette dernière se distingue en particulier, après la Deuxième Guerre mondiale, par sa
relecture psychanalysante et féministe de plusieurs grands mythes de l’Antiquité,
notamment celui de Médée, qu’elle incarne elle-même dans Cave of the Heart en 1947.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
49
Mary Wigman, quant à elle, déchaîne dans ses Danses de la sorcière les forces inconscientes
et pulsionnelles de son moi profond, pour tenter d’exorciser le démon androgyne qui
sommeille sous le masque de la civilisation1. Dans la plus pure tradition moderne, les
danseuses et danseurs aux pieds nus de Bausch comme de Waltz déploient en outre tout
un vocabulaire gestuel et postural qui rappelle singulièrement celui de leurs deux grands
modèles féminins : bras et cous tendus, doigts écartés, paumes offertes en signe
d’imploration, d’imprécation ou de conjuration, poignets fléchis, dos cambrés et têtes
dramatiquement renversées s’accompagnent de tout un travail d’opposition, de
dissociation et de tension entre le haut et le bas du corps, ainsi qu’entre les directions
« arrière », « avant » et « côté ». Les nombreux arrêts sur image du mouvement confèrent
de surcroît à leurs attitudes une dimension éminemment photographique, voire
photogénique, qu’alimente peut-être la pléthore de clichés ressurgis du passé, où l’on
peut reconnaître en Wigman et Graham les figures contradictoires de la sorcière et de la
victime d’un pouvoir patriarcal étouffant, de la femme rebelle et de l’animal sauvage.
2 Fondée sur une référence commune au passé – en quoi se donne à lire, plus obscurément,
la survivance lointaine de mystérieuses empreintes (ou « engrammes », en termes
warburgiens) d’un temps mythique qui jamais ne passe et revient sans cesse sur ses
propres traces, déposées par couches successives dans la mémoire de l’humanité –, la
parenté stylistique entre la chorégraphie de Sasha Waltz et les premiers opéras dansés de
Pina Bausch est non seulement affaire de motifs et de formes (de très longs bras, des
mouvements amples et fluides, un fort ancrage dans le sol), mais aussi de couleurs : la
triade « noir, blanc, rouge » imaginée par Rolf Borzik pour Iphigénie, Orpheus et le Sacre du
printemps se retrouve dans la palette utilisée par Thomas Schenk dans Medeamaterial,
enrichie de toute une gamme de bleus méditerranéens et de bruns foncés, qui ne sont pas
sans rappeler, au passage, certaines toiles métaphysiques de Rothko.
3 Enfin, comme si la légende de Médée ne pouvait échapper à l’emprise destinale du déjà-là,
du déjà-écrit et du déjà-vu, le ballet de Sasha Waltz convoque et mêle les souvenirs de
deux grands Sacre du printemps — œuvre originaire entre toutes, puisque à la fois ancrée
dans un imaginaire fantasmé du rituel archaïque, et considérée comme l’une des sources
emblématiques de la danse moderne depuis sa création par Nijinski en 1913 : derrière le
Frühlingsopfer (1975) de Pina Bausch, on devine en effet celui de Maurice Béjart (1959)
dans la forme omniprésente du cercle qui se fait et se défait sans cesse en lignes
sinueuses. Au centre de celui-ci, un couple d’élus2 – peut-être Jason et Médée du temps de
leur ivresse amoureuse – rappelle, au début du spectacle, le couple adamique et maudit
tout à la fois, car voué à la séparation : séparation des amants, mais aussi séparation de la
voix et du corps et division d’une même voix en plusieurs autres voix désincarnées 3…
4 On se souvient qu’en 1969, Pasolini avait déjà opté pour une audacieuse dissociation de la
voix et du corps en distribuant Maria Callas dans le rôle-titre de son film Médée, mais sans
jamais la faire chanter. Ce souvenir est non seulement présent dans la partition de Pascal
Dusapin, mais aussi dans la discrète allusion des scénographes Thomas Schenk et Heike
Schuppelius aux lourds colliers ethniques de la barbare, qui répandront leur poison
mortel sur le corps de sa rivale.
5 Enfin, dans ce palimpseste qui ne cherche guère à dissimuler ses sources, il y a la grande
ombre portée de L’après-midi d’un Faune (1912) de Nijinski : moins toutefois dans la
célébration d’une nature panique que dans la citation formelle, à plusieurs reprises, de la
fresque antique. La première se situe entre le long prologue muet du chœur4 et l’entrée
en scène de Medea, comme précédée par ses talents de magicienne : en effet, après nous
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
50
avoir fait croire à l’immobilité de la pierre, la frise en demi-bosse qui s’anime sous nos
yeux parvient à nous donner l’illusion de la vie à travers l’évocation de scènes
domestiques et guerrières – ces dernières renvoyant aux danses pyrrhiques de l’Antiquité
grecque, dont on retrouvera bientôt les attitudes dans les premières danses du chœur.
Illusion parfaite, puisque rien ne laisse deviner, dans la pénombre du plateau, qu’il s’agit
en réalité d’une projection vidéo5, et que les corps fantomatiques des danseurs enduits de
glaise rejouent sous nos yeux le vieux mythe de la caverne au moyen de la technologie
moderne.
6 Ce double leurre annonce d’ores et déjà que la geste médéenne à suivre va s’écrire au
futur antérieur : Médée aura été cette femme vivante et souffrante, dont la destinée est
aujourd’hui gravée dans le marbre du tombeau. Pour éviter toutefois le piège
muséographique, Sasha Waltz retrace à l’envers le chemin qui mène de la tragédie en acte
à sa pétrification mémorielle. En partant de modèles antiques qu’elle a pu observer avec
ses danseurs au Pergamon Museum de Berlin, elle cherche à retrouver le principe moteur
en puissance dans les figures sculpturales des frises, des bas-reliefs et des sarcophages
grecs afin de composer ses propres chœurs dansants (ou Bewegungschöre, pour reprendre
la célèbre formule de Rudolf Laban). Multipliant les arrêts sur image, la chorégraphe
exploite tout un fonds historique d’attitudes posturales, en travaillant, comme Nijinski ou
les inventeurs de la chronophotographie avant elle, sur le passage au ralenti de l’une à
l’autre, sur les tensions entre immobilité et mouvement, mais aussi entre passé et
présent, entre temps physique et temps lyrique.
7 D’où les nombreuses analepses qui donnent à voir, à côté d’une Medea condamnée à n’être
plus qu’une voix errante, le souvenir muet de sa fuite de Colchide sur terre et sur mer en
compagnie de Jason, cet être autrefois sensuellement aimé, devenu aujourd’hui pure
absence, et dont on n’entend plus que la voix enregistrée. C’est désormais au chœur des
danseurs entourant la soprano Caroline Stein de donner corps à ces réminiscences d’un
passé terrifiant mais heureux, en démultipliant, par exemple, l’image du couple en exil,
toutes voiles dehors, comme le suggèrent les amples étoffes bleues, noires et blanches
flottant au vent dont sont revêtus trois interprètes6, tels de splendides figures de proue
fendant les eaux claires de la Méditerranée.
8 Cette dimension illustrative du ballet n’est pas une donnée systématique ni continue du
spectacle, mais l’on peut aisément reconnaître, en maints endroits de la chorégraphie,
d’autres allusions immédiatement déchiffrables au texte, qui aboutissent à la formation
plus ou moins durable de personnages : Jason, la fille de Créon, le frère de Médée, ses
enfants, leur nourrice, des domestiques, etc. Ces identités sont néanmoins fluctuantes et
multiples, individuelles et collectives, les rôles n’étant jamais assignés une fois pour
toutes : les danseurs représentent tantôt le peuple de Colchide humilié et meurtri 7, tantôt
la cour hostile du roi Créon à Corinthe, tantôt la horde menaçante des Érinyes, ces figures
extériorisées de la colère de Médée, qui sombre peu à peu dans la folie. Ils pourront, dès
lors, aussi bien lui opposer l’impuissante réprobation de l’opinion commune, comme c’est
ordinairement le rôle du chœur citoyen de la tragédie antique, qu’épouser le point de vue
de l’héroïne, dont ils réalisent sur scène les visions hallucinées. La légende de Médée, telle
que la réécrit Müller, apparaît donc moins comme l’histoire d’un conflit désespéré entre
l’héroïne et ses adversaires, d’ailleurs singulièrement absents de la scène, que comme
l’expérience intime de la démesure, au sens d’une incommensurabilité fondamentale
entre le réel et l’imaginaire, entre la vie obscure du corps et celle, plus ténébreuse encore,
d’une âme en proie à la démence.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
51
9 C’est là que, derrière la fonction dramatique, expressive, voire ornementale, de la
chorégraphie, s’en profile une autre, sans doute plus originale, consistant à creuser, dans
le champ du visible, une échappée vers le paysage mental de la protagoniste. Passé,
présent et futur se téléscopent dans la confusion fiévreuse du souvenir et l’implacable
fatalité des meurtres à venir, introduisant, de cette façon, du mouvement à l’intérieur
d’un temps à jamais arrêté. Avec un peu d’avance, cette fois, sur le texte, la danse donne
ainsi à voir la superbe agonie de Glauke (autre nom de Créüse), dont la robe nuptiale se
tache de sang à mesure qu’éclatent une à une les fragiles capsules de son collier. Outre
qu’elle crée un saisissant effet d’hypotypose8, cette façon d’anticiper sur le déroulement
de la fable arrache le chœur à son rôle traditionnel de commentateur de l’action pour en
faire la figure même du temps tragique. Un temps qui se remet à circuler entre les
invariants du mythe, un peu comme les danseurs eux-mêmes papillonnent autour de
Medea, aimantés par la flamme incandescente de son désir.
10 Entre la figure solitaire de la cantatrice9 et le chœur silencieux, la chorégraphie tisse des
liens contradictoires d’attrait et de répulsion, comme dans ces moments singuliers où
Medea et les membres du chœur entrent physiquement en contact : caresses furtives,
étreintes passionnées et luttes énergiques redonnent de temps à autre du corps à cette
femme, qui en est désormais si cruellement privée. C’est notamment le cas lorsque, vers
le milieu du spectacle, se répète une scène que l’on vient juste de voir exécutée par trois
groupes de danseurs : deux hommes empoignent solidement Caroline Stein par le tissu de
sa longue tunique, la renversent, comme inerte, à l’horizontale et lui font décrire un
cercle, qu’elle trace au sol à l’aide d’une craie blanche, en proférant les premières paroles
d’un long récitatif sans accompagnement musical : « Bist du mein Mann bin in noch deine
Frau. » (« Si tu es mon mari je suis encore ta femme10. ») Or ce dernier fait immédiatement
suite au passage, chanté dans les aigus les plus stridents, où Medea déclare à Jason que
« [s]a mort n’a pas d’autre corps que le [s]ien »11 : corps éminemment paradoxal, donc,
puisque fait d’altérité et d’absence, de désir frustré et de pulsion morbide.
11 Figurant tout à la fois le même et l’autre – ou plutôt le même dans l’autre, et inversement
–, le chœur devient alors la vivante image du corps hybride, impossible et tragique du
couple désuni, dont le souvenir ne survit plus que dans la mémoire déchirée d’une femme
sinon innocente (comme dans le roman Medea : Stimmen de Christa Wolf, que Sasha Waltz
cite parmi ses principales sources d’inspiration12), du moins violemment habitée par des
forces contraires : « mère et guérisseuse du côté blanc, tueuse vengeresse du côté noir » 13,
elle ne peut vouloir, agir et penser qu’avec, par et pour le corps. L’en priver, comme le fait
Jason en la répudiant, c’est assurément méconnaître les « pouvoirs bénéfiques »14 de la
femme et de la magicienne, qui laisse alors libre cours à sa rage destructrice, mais c’est,
plus encore, l’enfermer dans la sphère exclusive du logos, en la coupant de la source vitale
de son être. Pascal Dusapin l’a bien compris, qui s’emploie à désincarner musicalement la
figure de Médée15, alors que dans le texte de Müller, l’épouse abandonnée souffre dans sa
chair de sa trahison envers les siens, de l’infidélité de Jason, de sa jalousie envers Glauke,
et de la séparation imminente d’avec ses enfants, fruits douloureux de ses entrailles.
12 Entre le vocabulaire éminemment charnel et cru de Medeamaterial, où s’expriment, dans
toute leur violence originaire, les pulsions désirantes ou dévastatrices du personnage, et
les « voix sans « corps »16 de Medea, les chœurs dansants de Sasha Waltz semblent
chercher à recréer du lien. Un lien cependant bien improbable, car pris dans la
contradiction de devoir « montrer quelque chose afin de le dire »17, comme le voulait
Dusapin pour son opéra, et de faire en même temps de ce « quelque chose » l’expression
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
52
même de l’irreprésentable. D’où un conflit irrésolu, presque jusqu’à la fin du spectacle,
entre la plénitude épiphanique des corps dansants et la puissance anéantissante du chant,
en quoi s’abîment tour à tour le moi, le monde, et leur cortège d’illusions baroques 18.
13 Si la danse continue donc à raconter quelque chose, tandis que la voix désincarnée de
Médée, elle, tend vers l’abolition de tout récit, de toute image et de tout spectacle, c’est
sans doute pour mieux rendre le personnage à son terrible isolement, quand s’effondrent
un à un les derniers garde-fou de la pensée, et que ses pleurs en viennent à dire la faillite
même du langage. Les chœurs dansants, qui accompagneront Medea jusqu’au seuil du
blackout final avant de disparaître à leur tour, se font alors paysage, au sens où Müller
écrit à la fin de Rivage à l’abandon : « Je sentis Mon sang sortir de Mes veines / Et MON
corps devenir le paysage / De MA mort19 ». Paysage sans Argonautes, cette fois, qui se
débarrasse d’un même mouvement du mythe et de ses ruines.
14 Les ventilateurs vrombissants de la fin du spectacle sont là aussi pour nous aider à nous
représenter le souffle puissant du chaos qui achève de détruire tout ce qui rattachait
Medea au monde et au sens communs. Dans cet édifiant finale où les danseurs paraissent
incarner pour la dernière fois les démons intérieurs de l’héroïne, un vent de mort balaye
tout le plateau20. Terreur et folie se lisent alors dans les petits gestes intimes et comme
involontaires des mains que tous exécutent aux côtés de la chanteuse, avant l’ultime
naufrage dans le gouffre de l’oubli. Médée se retrouve alors seule sur le plateau venteux,
au milieu des cadavres de ses victimes, qu’elle ne reconnaît pas plus que Jason lui-même.
« Les cris de la Colchide […] se sont tus21 », le passé est mort, le chœur s’est envolé sans
laisser de traces : devenue étrangère à elle-même, aux siens, à sa propre histoire,
l’héroïne de Heiner Müller se détache d’un seul coup de sa légende comme, de l’arbre, un
fruit trop mûr. « Et plus rien22 », dit le texte, cependant que la scène vide et les dernières
paroles de Medea – « Nourrice, connais-tu cet homme23 » – reposent la question
inaugurale de cet article, celle de la perte définitive, mais transposée cette fois au mythe.
Mythe à la fois possédé et perdu, dont l’œuvre d’art totale qu’est l’opéra dansé doit
apprendre à faire le deuil, plus qu’à en ressusciter les images médusantes. C’est ce que fait
assurément Müller dans Medeamaterial ; c’est ce que fait aussi, mais de manière moins
radicale peut-être, Sasha Waltz, en travaillant contre – tout contre – une Antiquité
monumentale dont les figures archétypales seraient magiquement rendues, pour une
heure, à l’émouvante fragilité du temps qui passe.
NOTES
1. Dans les différentes versions de sa Danse de la sorcière (Hexentanz, 1914-1926), Mary Wigman se
décrit elle-même comme un « être enraciné dans la terre, aux instincts déchaînés, doté d’un
insatiable appétit de vivre, tout à la fois animal et femme. », in Die Sprache des Tanzes (Le Langage
de la danse), Dresde, Éditions Carl Reissner, 1966, p. 41. La traduction est assurée par mes soins.
Dans Medeamaterial, Heiner Müller fait dire à l’héroïne de manière comparable : « Que ne suis-je
restée l’animal que j’étais / Avant qu’un homme ne fît de moi sa femme / […] Moi / Ni femme ni
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
53
homme. », in Heiner MÜLLER, Matériau-Médée, in Germania Mort à Berlin et autres textes, trad. Jean
Jourdheuil et Heinz Schwarzinger, Paris, Éditions de Minuit, 1985, p. 16.
2. Rappelons que, chez Maurice Béjart, la figure de l’Élue est remplacée par celle du couple
primitif, qui s’unit en des retrouvailles orgiaques à la fin du ballet.
3. Dans Medea de Pascal Dusapin, le personnage de Médée est interprété par cinq voix féminines
différentes, dont quatre « invisibles » sur scène. Jason, quant à lui, n’apparaît plus que sous la
forme d’une voix enregistrée, comme Amme, la nourrice.
4. D’une durée d’environ 7’30, l’ouverture chorale du spectacle après la chute du lourd rideau
rouge est seulement accompagnée de la note tenue à l’orgue positif et d’un bruit sourd de
ventilateurs qui anticipe sur la tempête finale.
5. Cette frise a été conçue par Sasha Waltz elle-même, qui a filmé cinq groupes distincts de
danseurs « mett[ant] en mouvement les rêves [archétypaux] de l’Antiquité. », in Stephen GRAHAM ,
Medea, La Monnaie, 17 avril 2010, consultable en ligne sur le site : http://
www.musicalcriticism.com/opera/lamonnaie-medea-0410.shtml. La traduction est assurée par
mes soins.
6. Deux femmes et un homme sont successivement entourés par les autres danseurs qui agitent
leurs vêtements (une longue écharpe bleue, une jupe noire et de vastes manches couleur chair
pour la première, une robe noire pour la seconde – dont ses compagnons secouent également la
sombre chevelure –, une chemise bleu clair à grands pans et une jupe noire pour le dernier).
7. Cf. Heiner MÜLLER, op. cit., p. 16 : « Ainsi criait la Colchide quand vous étiez dans mes entrailles
/ Elle crie toujours Avez-vous des oreilles pour ce cri ».
8. De tels effets sont déjà présents dans le texte de Müller, comme dans ce passage où se
confondent récit descriptif et hallucination visionnaire : « Voici le fiancé dans la chambre
nuptiale / Le voici qui dépose aux pieds de sa jeune épouse / La robe de mariée de la barbare mon
cadeau de noces / Imbibé de ma sueur de soumission / La voici qui se campe la putain devant le
miroir / Voici l’or de la Colchide qui obstrue les pores de sa peau », in Heiner MÜLLER, op. cit.,
p. 15.
9. À ce propos, Pascal Dusapin écrit dans le programme du spectacle des 9 et 10 novembre 2012,
que « l’isolement de cette voix est le fondement même de son effroi », in « La femme qui pleure »,
in Medea. D’après l’opéra Medeamaterial de Pascal Dusapin (1992). Création chorégraphique de Sasha
Waltz (2007), Théâtre des Champs-Élysées, 2012, p. 16.
10. Heiner MÜLLER, op. cit., p. 13.
11. Id.
12. Sasha WALTZ, « Point de vue sur Medea », in Programme du spectacle, op. cit., p. 41.
N.B. : dans son roman Médée. Voix, publié en 1996, Christa Wolf, revisite entièrement l’antique
légende. L’héroïne n’y est plus dépeinte sous les traits d’une meurtrière forcenée (la mort de son
frère Apsyrtos et de ses enfants ayant été provoquée par d’autres à des fins politiques, tandis que
Glauke, devenue épileptique, se suicide en se précipitant dans un puits) –, mais d’une femme
lucide et forte. Replacé dans le contexte historique d’une Allemagne encore profondément
divisée par la Guerre froide, le mythe n’y résiste pas à une enquête minutieuse sur les zones
d’ombre du pouvoir.
13. Id.
14. Id.
15. Je reprends ici une idée de Leyli Daryoush, que je remercie.
16. Pascal DUSAPIN, « Notes de composition », in Programme du spectacle, op. cit., p. 43.
17. Pascal DUSAPIN, « Une femme qui pleure », art. cit., p. 14.
18. Il y a, chez la Médée de Heiner Müller, un peu de l’Alcandre de L’Illusion comique : comme le
thaumaturge de Corneille, la magicienne a en effet le pouvoir de susciter des illusions par la seule
puissance de son verbe, comme lorsqu’elle peint à ses enfants l’horrible tableau de sa vengeance :
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
54
« Regardez maintenant votre mère vous offrir un spectacle / Voulez-vous la voir brûler la jeune
mariée / […] / Sur son corps à présent j’écris mon spectacle / […] / Elle brûle Riez Je veux vous
voir rire / Mon spectacle est une comédie Riez », in Heiner MÜLLER, op. cit., p. 15-16.
19. Heiner MÜLLER, Paysage avec Argonautes, in Germania Mort à Berlin et autres textes, op. cit., p. 21.
20. Cf. ibid. : « De qui est-il question quand / Il est question de moi Qui est-ce Moi / […] Un
flottement / Entre le néant et personne à condition qu’il y ait du vent ».
21. Heiner MÜLLER, Médée-Matériau, op. cit., p. 17.
22. Id.
23. Id.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
55
« Je crois que Médée n’est rien
d’autre qu’une femme ». Entretien
avec Krzysztof Warlikowski
Propos recueillis par Leyli Daryoush & Romain Piana
Krzysztof Warlikowski, Leyli Daryoush et Romain Piana
1 En avril 2008, Peter de Caluwe, qui assure sa première saison à La Monnaie/De Munt,
présente la création de Médée de Luigi Cherubini. Le metteur en scène Krzysztof
Warlikowski et le chef d’orchestre Christophe Rousset, à la tête de son orchestre les
Talents Lyriques, font tous deux leurs débuts dans cette maison d’opéra.
2 Pour la création du personnage de Médée, Warlikowski s’inspire d’autres versions du
mythe, tant celles d’Euripide ou du contemporain flamand Tom Lanoye1, que de la Medea2
de Pier Paolo Pasolini et de l’adaptation filmique de Lars Von Trier d’après le scénario de
Carl Theodor Dreyer3. Mais il est aussi fasciné aussi par l’étrangéité de Médée. Il découvre,
aussi bien en France qu’en Belgique, la complexité du rapport à l’autre, notamment par
rapport à l’immigration maghrébine, si présente dans ces pays respectifs. Et le contraste
avec son pays d’origine, la Pologne, dont le passé communiste ne connaît pas ces vagues
de mouvements migratoires durant les années 60, rend le phénomène encore plus
frappant dans sa complexité. Warlikowski s’interroge alors sur les couples mixtes qui,
malgré l’évolution de la société, vivent encore en marge de la société, victimes de
préjugés sociaux et raciaux (il songe notamment au film de Fassbinder, Tous les autres
s’appellent Ali4). Médée est l’étrangère dans cet opéra. Elle est même la seule à venir
d’ailleurs. Il y a elle et les autres dont Jason et même ses enfants. Nul doute alors que cette
solitude extrême encourage si ce n’est qu’elle engage son acte de folie criminelle.
3 Warlikowski n’enferme pas pour autant le personnage dans une figure quelque peu
archaïque de l’autre. Médée est avant tout une femme, n’importe quelle femme
abandonnée par l’homme qu’elle aime, et qui refuse de se séparer de ses enfants. Mais
encore, au-delà de la sorcière, de la prêtresse, de la femme trompée, de l’étrangère,
Médée est l’incarnation de la femme émancipée sous sa forme la plus extrême, celle qui,
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
56
peut-être aujourd’hui, serait une rock star, comme la jeune Amy Winehouse, chanteuse
soul déjà endeuillée qui se brûla les ailes sentant la mort si proche.
Médée en Belgique
4 Médée était ma première production à La Monnaie/De Munt. La Belgique, Bruxelles
notamment, a joué un rôle important lors de sa création. J’étais alors sous l’influence de
L’Enfant5 des frères Dardenne, un film dans lequel un couple de jeunes adultes à peine
sortis de l’adolescence, devient parent. Soumis à des pressions financières, le père vend
l’enfant, mais il va regretter son acte d’autant que ce sera la fin de son union et son
emprisonnement.
5 Après Varsovie, et Paris avec la création de Parsifal6, Bruxelles a fait une très forte
impression sur moi. La Monnaie/De Munt se trouve dans le centre-ville, une zone
historique et touristique, d’où les Bruxellois sont partis. Il y a aussi beaucoup d’immigrés
et cet environnement m’était familier, d’autant qu’il me rappelait Liège où j’avais
collaboré avec le Théâtre de la Place7 : là-bas, il y a un quartier qui s’appelle Carré, où j’ai
eu l’impression d’une sorte d’enfer. Bref, pour la proposition artistique que je comptais
présenter au public bruxellois, je venais avec quelque chose de lourd et de chargé. Et ce
sentiment sinistre que j’ai pu saisir dans certains endroits en Belgique, sans compter cette
vision des frères Dardenne, ont chargé ma perception de l’œuvre. Mais je ne sais pas
vraiment si ces idées se sont développées sur le plateau.
L’actualisation de Médée
6 L’histoire de Médée est très banale, quotidienne, et elle arrive tous les jours,
probablement, dans chaque grande ville. La trame est simple : une femme étrangère, avec
deux enfants, est abandonnée par son mari, dans une société qui ne reconnaît pas l’ancien
mariage qu’ils ont contracté dans un rituel barbare et inconnu. L’histoire commence avec
le jour des noces de Jason qui, de retour à Corinthe, va épouser la fille du roi Créon.
7 Le contexte politique est très fort. Dans le film Medea de Pasolini 8, il y a une opposition
entre l’univers de la civilisation grecque – l’Occident incarné par Créon et Jason – et
Colchos, avec ses dieux barbares et Médée l’étrangère. Je me demandais ce que je pouvais
faire avec cette contradiction. Dans ma première version de Médée9 en 2008, on pouvait
entendre la complainte de Médée en langue arabe avec des surtitrages qui mettaient en
valeur la calligraphie de la langue. Dans la deuxième version, cette complainte existe
encore mais elle se fait plus discrète, sans les surtitrages.
8 Évidemment, au théâtre, on préfère voir une magicienne, parce qu’elle nous éloigne du
réel et qu’elle nous divertit. Mais la perspective d’un divertissement autour de quelque
chose d’exotique ne m’enchantait pas vraiment. Je voulais me rapprocher du personnage
de Médée, tout en m’éloignant de tout ce qu’on sait sur elle – Médée la sorcière, la
magicienne, et même le film de Pasolini.
9 L’idée était de relier le personnage de Médée à la réalité d’aujourd’hui. J’ai essayé de
préserver l’étrangéité de Médée mais je ne sais pas si l’on voit une étrangère sur le
plateau. Lui façonner un look « Amy Winehouse », c’était lui donner une apparence à
laquelle on pouvait s’identifier, tout en reconnaissant la liberté de cette chanteuse. Dès
ses premiers clips, Amy Winehouse était une femme en noir qui se rendait à un
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
57
enterrement. Le deuil était là, dès le début de sa carrière. On croyait avoir déjà tout vu du
monde du rock, mais cette femme en quête de liberté a réveillé quelque chose en nous, et
elle était très jeune. À la deuxième reprise de l’opéra en 2011, Amy Winehouse était déjà
morte. Là, en 2012, c’est la troisième reprise de Médée. Et quand Médée entre en scène,
avec son look si identifiable, on saisit immédiatement la tragédie, le fatum.
10 Les vrais personnages de cet opéra sont les deux enfants qui vont devenir victimes. Ces
petits moments de vie des enfants qui fument, livrés à eux-mêmes, et qui vont être élevés
par le père – dans cet opéra il est normal qu’ils restent avec lui puisqu’il appartient à
l’univers occidental –, et qui assistent au mariage de leur père avec une jeune fille peut-
être déjà enceinte, tout cela appartient à une vulgarité quotidienne presque
cinématographique. Des moments scéniques de ce genre donnent un peu d’épaisseur, ou
suggèrent ce qui se passe vraiment : ce sont des flashes de la vie quotidienne, qui nous
permettent de reconnaître un contexte que l’on comprend très bien, et qui est le nôtre.
L’héritage des Grecs
11 Je crois que Médée n’est rien d’autre qu’une femme. En disant cela, je ne banalise pas son
histoire. La passion amoureuse n’a pas de limites et j’imagine que la plupart d’entre nous
sommes passés par des phases où nous nous sommes perdus, où nous étions dans une
sorte de folie, prêts à commettre quelque chose d’horrible. Vous avez évoqué la question
de la pathologie psychologique, notamment le complexe de Médée. Je ne sais pas si je
peux nommer la folie de Médée, surtout dans la deuxième partie où elle s’exprime
totalement. Est-ce que c’est une pathologie ? De l’extérieur, quand on juge le personnage,
on dirait sans doute que oui, cette femme est folle à lier, mais que ce soit un destin, une
vengeance, une pathologie, ou je ne sais quoi d’autre, cet état est aussi le propre de la
condition humaine.
12 Ce que j’ai toujours ressenti, c’est que les rapports conflictuels entre l’homme et la
femme, si présent chez les Grecs, n’ont pas cessé d’exister, et dans (A)pollonia 10, je montre
l’impossibilité de ces relations. Il y a huit ans, en voyage à Stuttgart, j’ai vu un immense
bâtiment recouvert en noir, en plein centre-ville. Très excité, j’ai demandé ce que c’est,
un musée, une installation… Mais non, c’était juste le théâtre de Stuttgart qui, ce soir-là,
représentait Œdipe. J’ai tout de suite pressenti, en voyant ce théâtre en noir, que cette
ville était en deuil, parce que le soir même, elle allait jouer Œdipe, à savoir encore un
tabou, encore un chef d’une ville maudite, etc. Stuttgart, à ce moment-là, était en deuil
d’Œdipe et de la malédiction sur sa famille. C’était un jour comme un autre, et le théâtre
imposait le deuil à la ville. Donc, vous voyez, on revient très souvent aux questions que les
Grecs nous ont laissées ; c’est un héritage de nos ancêtres qui est toujours important, et
qui continue à nous parler.
Déranger le public
13 Avec Nadja Michael qui interprète le rôle de Médée, on a réalisé la nécessité d’un voyage
intérieur : pour que cette histoire devienne de l’ordre du possible – une mère qui tue ses
propres enfants – il fallait que Médée tombe dans une folie où l’horreur devenait possible.
Les Grecs nous révèlent les tabous du début de la civilisation : le matricide, le parricide,
l’infanticide, et toutes les peurs que cette jeune civilisation s’infligeait s’imposent encore
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
58
à nous. Pouvons-nous affirmer que n’avons plus peur de ces histoires aujourd’hui ? Par-
delà les conventions lyriques du début du XIXe siècle, mon point de départ dans cet opéra
était non pas sa dimension esthétique, mais son aspect dérangeant : il fallait que le temps
d’une soirée, au théâtre, dans Médée, quelque chose d’horrible se déroule sous les yeux des
spectateurs.
14 Il y a des musées où l’on se retrouve, des tribunaux où l’on s’affronte, des églises où l’on
chante, mais au théâtre il y a autre chose encore. On se rencontre devant le théâtre, dans
le hall, les couloirs, les toilettes même, et quand on passe deux ou trois heures ensemble,
dans le même espace, on commence à s’influencer les uns les autres, on constitue une
communauté, une polis, au sens citoyen du terme. Qu’il y ait des étrangers ou non, nous
sommes ensemble, avec nos repères culturels, religieux, et esthétiques.
15 Et cette communauté doit vivre l’épreuve du dérangement, il faut bien la déranger pour
qu’elle sorte des rails quotidiens dans lesquels elle a tendance à s’enfoncer dans la vie
courante, pour ne pas devenir malade voire fou. Ce que l’on vit alors est peut-être la
catharsis, un terme magnifique que l’on n’a jamais compris. Il y a toutes les définitions
possibles pour cette expérience mais intuitivement, on pourrait dire que quelque chose
que nous vivons avec nos voisins, nous purifie. Mais cela peut aussi ne pas arriver : l’autre
soir, à côté de moi, étaient assis deux êtres qui ne voulaient pas vivre quoi que ce soit.
La réécriture des récitatifs
16 Dans le livret, les récitatifs sont écrits en vers. D’un côté, il y avait ces alexandrins, à la
fois difficiles et bavards, qu’on ne comprenait pas très bien, et de l’autre, des chanteurs
souvent non francophones, et je les imaginais souffrir en essayant de bien prononcer les
vers dans le rythme, alors qu’ils n’avaient même pas cette formation théâtrale. C’était
vraiment impossible et inutile.
17 Ce qui est nécessaire, c’est de mieux suivre l’histoire et de saisir l’enjeu de la mise en
scène. J’imagine que parmi les centaines de propositions possibles de Médée, il y a des
metteurs en scène qui apprécient l’aspect presque racinien de ces vers écrits au XVIII e
siècle. Moi, j’ai préféré les adapter, et les réécrire dans un langage quotidien. Mais on ne
visait pas la trivialité dans cette adaptation. C’est en contraste avec la musique du XVIII e,
que les paroles issues du langage quotidien paraissent presque vulgaires. On a cherché à
raccourcir le texte original, à retrouver, peut-être, l’esprit des dialogues de Sarah Kane :
des dialogues très courts, concentrés, très forts. Or Kane était elle-même influencée par le
théâtre shakespearien et le théâtre grec.
18 Avec l’adaptation des alexandrins, je me suis retrouvé dans un stress incroyable parce
que, d’un coup, le langage quotidien ne paraissait plus acceptable sur le plateau : il y avait
presque quelque chose d’indécent dans le fait que les chanteurs abordent directement le
théâtre. C’est le moment fort du refus du théâtre à l’opéra – j’imagine la minorité qui se
trouvait un soir dans la salle du théâtre des Champs-Élysées, celle qui a hué pendant une
scène de récitatif –, alors que le théâtre est inclus dans cet opéra, qu’on le veuille ou non !
L’amplification des dialogues
19 Parfois, quand on assiste à des représentations d’opéra du XVIIe ou XVIII e siècle, je
constate une très forte contradiction entre les scènes chantées et les brefs moments
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
59
accordés au silence et à la parole. Ce passage musical d’un état à un autre provoque
toujours un choc, une sorte d’inconfort, et je cherchais à éviter ce dérangement dans ma
mise en scène. Je ne voulais pas arrêter ce voyage émotionnel que la musique crée, que la
parole reprend pour atterrir à nouveau dans un nouveau morceau musical ; je ne voulais
pas rompre le liant entre la musique et la parole. Alors, j’ai décidé d’amplifier la parole.
20 L’amplification de la parole me permet d’être plus proche des personnages, d’être dans
leur intimité, d’autant que dans ces scènes de récitatifs, ils sont presque à nu dans leurs
émotions. L’amplification préservait cette nudité ; c’était un support qui les aidait à ne
pas hausser la voix pour se faire entendre. Évidemment, il est très difficile d’utiliser des
micros à l’opéra : il faut une technique très sophistiquée pour que tout soit parfait, et je
ne prétends pas que l’on entendait tous les soirs chaque parole distinctement.
La collaboration avec le chef d’orchestre
21 Il ne faut pas penser la relation entre la musique et la scène en termes de conflits ; les
choses ne se passent pas du tout ainsi. Il y a une rencontre entre le metteur en scène et le
chef d’orchestre : soit on arrive à se comprendre et à expliquer ce qu’on cherche, et c’est
clair dès la première rencontre, soit on n’y arrive pas. Parfois, même sans échange verbal,
les intuitions musicales du chef peuvent complètement dépasser sa compréhension de la
mise en scène. Quand il y a désaccord, la responsabilité est partagée entre les metteurs en
scène et les chefs : on n’est pas ensemble, alors on s’enferme. Les metteurs en scène vont
moderniser à tout prix, imposer des costumes de ville, mettre tous les malheurs du
monde actuel dans leur mise en scène, qu’il s’agisse de la Traviata ou d’une autre œuvre,
et les chefs vont avoir une vision totalement hermétique de l’œuvre, comme Parsifal, avec
tel objet symbolique voulant signifier ci, et les chevaliers qui renvoient à ça, et le Cygne
qui veut dire autre chose encore, etc. Dans ce cas, il y a beaucoup de malentendus. Mais
ces cas-limites ne représentent pas la réalité des rapports entre metteurs en scène et
chefs.
Le couple Jason-Médée
22 Cet opéra ouvre tellement de possibilités d’interprétation intéressantes ! Médée demande
à Jason : « Est-ce que je ne te plais plus ? ». À mon sens, Jason ne peut pas lui répondre
négativement, parce que son choix est celui de la norme sociale : de retour en Occident, il
en a assez d’être perçu comme un étranger, il veut appartenir à la société corinthienne
sans avoir une femme qu’il traînerait derrière lui, une épouse trop forte, une étrangère,
qui serait un poids dans la carrière. Avec une interprète comme Nadja Michael, il
paraissait assez improbable que Jason, par ailleurs aussi séduisant que Médée, puisse lui
répondre : « Je ne t’aime plus parce que j’ai une nouvelle copine beaucoup plus
intéressante et beaucoup plus belle que toi ! ». Du coup, on ne pouvait qu’aller dans la
première direction, à savoir la quête d’une tranquillité et d’une reconnaissance sociale.
23 Mais il y a un passé mystérieux entre ces deux aventuriers, qui sont liés par les meurtres
tel que le mythe nous les rapporte. D’une certaine manière, Médée est trop monumentale
pour Jason ; il pourrait à la rigueur lui répondre : « je veux m’installer, mener calmement
ma vie, je n’ai pas besoin de quelqu’un qui me secoue toutes les cinq minutes pour me
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
60
dire combien je suis nul et que je ne suis plus celui que j’étais à l’époque où on a voyagé
ensemble ».
Dans la tête de Médée
24 Dans mon univers esthétique, au théâtre et à l’opéra – et c’est encore plus fort à l’opéra –
je n’exprime pas la réalité extérieure voire objective des choses. Je me rends compte de
plus en plus que ce que l’on voit dans mes mises en scène est plutôt d’ordre mental. Dans
cet opéra très particulier, tout est basé sur un personnage, Médée, et tout se passe dans sa
tête. D’une certaine façon, je suis là pour suivre sa folie intérieure et la musique m’aide à
entrer dans sa psyché.
25 Par exemple, dans une scène de confrontation entre Médée et Créon, j’ai démultiplié le
personnage de Créon, et tous ces hommes, à un moment donné, jettent leurs lunettes de
soleil par terre. Médée, plus tard va les ramasser et les ranger sur sa commode. Ces
lunettes, pour moi, sont un peu l’accessoire macho, comme la serviette de toilette et la
bouteille en plastique du type qui fait du jogging dans un Center Park et qui, sur son
chemin, va s’approcher de Médée pour arranger la situation, vite fait bien fait : « Toi tu
pars, les enfants restent, et moi je vais continuer à courir parce qu’il faut penser à ma
jeunesse aussi ». Les enfants sont présents et font partie de cette vision. C’est peut-être
quelque chose qui est dans la tête de Médée, cette multiplication des Créon, et ces
lunettes qu’il faut ranger, et c’est peut-être le regard qu’il faut cacher, qui est celui des
enfants. Ce qui est important, c’est l’état d’âme du personnage dans l’air qui suit, l’un des
plus beaux de cet opéra, et il fallait qu’elle ait vécu quelque chose de très violent (que ce
soit dans son esprit ou avec Créon), sans que l’on explicite réellement ce qui s’est passé.
Mariage et faux-semblants
26 Dircé, la nouvelle mariée, est consciente de la situation compliquée dans laquelle elle se
trouve mais elle n’arrive pas à tout arrêter. Dans un sens, on peut imaginer qu’elle est
amoureuse mais c’est aussi un personnage qui doute, et qui n’a pas complètement éliminé
la réalité de Médée. Parce que les hommes, et toute cette société, font semblant de ne rien
savoir sur le mariage précédent de Jason, sur la présence des enfants, pour assister tran
quillement à la cérémonie de noces entre Jason et Dircé. C’est d’ailleurs un aspect
vraiment insupportable dans cet opéra : il commence avec le mariage qui dure toute la
journée, et quand cela finit on en est toujours au mariage.
27 Mais les doutes de Dircé portent aussi sur son propre mariage : quand on regarde les
vieilles photos de mariage de nos parents, ce n’est pas toujours la joie qu’on peut y voir.
Quand j’ai abordé Médée, nous avons commencé une recherche de films privés. La plupart
du temps, le matériel recueilli montrait des mariages, des baptêmes, les grandes
manifestations religieuses de la vie. Mais le plus intéressant pour moi, c’était de montrer
cet univers occidental, avec le poids de la religion, même si c’est la nôtre. Médée
emmènera ses enfants devant les deux madones, la Madone et la Pietà. J’étais touché par
le fait qu’elle veuille éduquer les enfants dans la religion occidentale. Pendant la guerre,
les enfants juifs devaient apprendre Pater noster au moins pour se sauver, au cas où on
leur demanderait de réciter une prière. Et c’est la force de cette vision théâtrale : une
étrangère, peut-être une Arabe, qui veut que les enfants soient chrétiens, pour qu’ils
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
61
soient protégés en cas de problème. Bien sûr, pour moi c’est très politique : l’étrangère
qui élève ses enfants dans la religion de leur père alors que son mariage n’a pas été
consacré par l’Église, et qu’il n’est même pas reconnu du coup.
NOTES
1. Tom LANOYE, Mamma Medea, [2001], traduction Alain van Crugten, Arles, Actes-Sud, « Papiers »,
2011.
2. Pier Paolo PASOLINI, Medea, 1969.
3. Lars Von TRIER, Medea, 1988.
4. Rainer Werner FASSBINDER, Tous les autres s’appellent Ali, 1974.
5. Jean-Pierre et Luc DARDENNE, L’Enfant, 2005.
6. Parsifal de Richard Wagner, production de l’Opéra national de Paris, 2008. Mise en scène de
Krzysztof Warlikowski, direction musicale de Harmunt Haenchen.
7. Warlikowski y présente (A)pollonia (29-31 octobre 2009) et y crée Contes Africains d’après
Shakespeare (5 octobre 2011), notamment.
8. Medea de Pier Paolo Pasolini, 1969.
9. La dramaturgie ici est signée par le metteur en scène et son dramaturge opéra Miron
Hackenbeck. Lors de sa reprise de la production en 2011, la dramaturgie passera entre les mains
de Christian Longchamp, alors dramaturge maison de La Monnaie/De Munt. Dans cette reprise,
les dialogues parlés des récitatifs, (qui avaient été réécrits dans un langage contemporain) ont été
modifiés à nouveau. La troisième reprise de Médée en 2012, au Théâtre des Champs-Élysées, tient
compte des modifications datant de 2011.
10. (A)pollonia, texte-montage d’après Alceste d’Euripide, L’Orestie d’Eschyle, (A)pollonia de Hanna
Krall, Les Bienveillantes de Jonathan Littell, Elizabeth Costello de J. M. Coetzee. Mise en scène :
Krzsyztof Warlikowski, Nowy Teatr, Varsovie, 2009.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
62
Carnet photographique
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
63
Trois Médée au Théâtre des Champs-
Élysées. Krzysztof Warlikowski,
Pierre Audi & Sasha Waltz
Ruth Walz, Sebastian Bolesch et Vincent Pontet
La Médée de Charpentier mise en scène par Pierre
Audi
Charpentier, Médée, mise en scène Pierre Audi, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Ruth Walz.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
64
Charpentier, Médée, mise en scène Pierre Audi, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Ruth Walz.
Charpentier, Médée, mise en scène Pierre Audi, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Ruth Walz.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
65
La Medea de Dusapin chorégraphiée par Sasha Waltz
Dusapin, Medea, chorégraphie Sasha Waltz, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Sebastian Bolesch.
Dusapin, Medea, chorégraphie Sasha Waltz, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Sebastian Bolesch.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
66
Dusapin, Medea, chorégraphie Sasha Waltz, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Sebastian Bolesch.
La Médée de Cherubini mise en scène par Krzysztof
Warlikowski
Cherubini, Médée, mise en scène Krzysztof Warlikowski, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Vincent Pontet.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
67
Cherubini, Médée, mise en scène Krzysztof Warlikowski, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Vincent Pontet.
Cherubini, Médée, mise en scène Krzysztof Warlikowski, Théâtre des Champs-Élysées, 2012.
© Vincent Pontet.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
68
Carnet de la création
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
69
Carnet de la création
Inédit
Littérature francophone
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
70
Présentation. Carlotta de Gilles
Laubert
Julia Peslier et Pascal Lécroart
L’auteur
1 Né en 1950, Gilles Laubert se forme au métier d’acteur aux côtés de Jacques Vingler, à
Besançon, puis à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Genève et lors d’un stage à l’Odin
Theatret danois. Acteur, metteur en scène et directeur de troupe, il a écrit également une
vingtaine de pièces dont une large part est restée inédite. Sont parus, aux Solitaires
intempestifs, les textes dramatiques L’Abus (2002) et Aminata (2012), tandis que les
éditions Comp’Act de Chambéry avaient publié L’Heure du courage en 1996. Gilles Laubert
est décédé brutalement en 2012.
2 Le fonds documentaire Gilles Laubert est consultable en ligne sur le site Fanum : http://
fanum.univ-fcomte.fr/laubert/index.php
3 La valorisation de son œuvre et sa bibliothèque ont été confiées au pôle « Arts et
Littérature » de l’équipe de recherche ELLIADD (EA4661), sise à l’Université de Franche-
Comté, dans le cadre d’un projet animé par Pascal Lécroart.
La pièce
4 Carlotta, complétée par la mention manuscrite « Soliloque », prend place dans une
trilogie, Elles parlent aux animaux, dont chaque partie se fonde sur un même dispositif : en
un lieu du monde, une femme s’adresse à un animal en un puissant soliloque. Elles parlent
aux animaux, c’est Denise, ouvrière horlogère exemplaire qu’on licencie à Besançon, dans
des années proches des nôtres et qui finit par se venger. Pour se tenir compagnie, au
départ de son dire, elle « installe un poisson rouge dans une petite verrine. » C’est alors
que pour elle tout commence. Elle se lance. Elle parle, part du détail, du regard sur un
monde miniature, pour ensuite dire son monde : « C’est petit hein ? C’est idiot c’est bête
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
71
une petite verrine comme ça fermée avec juste un trou pour que tu respires ! Pour un
poisson comme toi ! Oh !… tu n’es pas bien grand mais sur le coup de l’achat, toute ma
poitrine déjà elle bondissait d’amour de contentement ! ». C’est encore cette costumière
de théâtre suisse qui, convertie au cœur de l’émeute, prend nom de Khadîdja, elle ou lui
qui aurait dû avoir Georges comme nom de naissance, et qui a reçu Georgette, par sa
mère, comme nom d’enfance. Face à elle et au costume qu’elle coud, dans une Genève
contemporaine, son « rouchonnet des Colonies du Soleil », un canari tout ce qu’il y a de
plus jaune, l’écoute. C’est enfin Carlotta, à Moscou, artiste du peuple qui doit se vendre
pour les Variétés et déchoir d’une certaine idée du théâtre, pour racoler et faire sa
confession publique, quand bien même tout en elle y répugne, sous la pression de
directeurs peu consciencieux, avides de faire sensation. Elle doit d’ailleurs porter le frac,
devenir Carlotto, exposer le secret de ses entrailles sur la scène et c’est de sa loge que
nous sommes témoins de son bouillonnement intérieur. Dans sa loge, Lioubov, « Amour »,
la petite mouette empaillée, l’assiste et assiste à son tourment, à son remords et à sa
révolte intérieure.
5 Les animaux ne parlent pas. Ils sont pourtant au centre de la représentation, par la
présence silencieuse, attentive. Ce sont elles, ces femmes qui défient les processus de
déchéance, de mise à l’écart, d’enfermement dans lesquels on veut les circonscrire, qui
leur parlent et disent le plus intime et le plus exposé de leur vie, depuis ces lieux des
marges et des coulisses où elles œuvrent et ruminent leurs vies. Car chacune semble avoir
plusieurs vies possibles, dans leur énonciation sans cesse recommencée.
6 Ces textes ont fait l’objet de différentes réécritures. Le Dit de Carlotta a connu une
première version en 2001, avant d’être repris quelques années plus tard. Une première
lecture en a été donnée par Dominique Favre-Bulle au Théâtre Monot de Beyrouth en
octobre 2007.
7 À travers le personnage de Carlotta, Gilles Laubert travaille, comme à son habitude, les
thématiques intimes et sexuelles d’un côté, sociales et politiques de l’autre. Ancienne
grande actrice de la scène soviétique, Carlotta doit affronter le changement complet de
situation professionnelle dû à la perestroïka et au triomphe du monde capitaliste face au
naufrage de l’URSS. Ruinée et réduite à apparaître dans des shows télévisés à
l’américaine, elle devra affronter publiquement un drame personnel terrible jusque-là
caché : celui d’être responsable de la mort de son propre fils Gricha qu’elle a rejeté et
dénoncé, n’acceptant pas son homosexualité.
8 Carlotta est composée de neuf tableaux, qui sont intitulés d’après une périodisation de la
représentation, sur une scène médiatique, à laquelle nous n’assisterons pas : 1. Juste
avant que cela commence – 2. Juste après son numéro – 3. Juste après que du temps a
passé – 4. Juste un peu plus tard – 5. Juste après quelques représentations et juste un peu
avant la prochaine… – 6. Elle revient de scène, elle est en frac – 7. Juste après les nouvelles
orientations et juste avant leur mise en œuvre (donc dans un entre deux) – 8. Juste avant
de rentrer en scène – 9. Juste après la représentation.
9 La pièce a été jouée par Dominique Favre-Bulle en février-mars 2009, au Théâtre Saint-
Gervais de Genève, pour dix-huit représentations, en compagnie de Denise, jouée par
Martine Paschoud, issue de la même trilogie. Khadîja sera écartée des représentations ;
retravaillé sous le titre Georges ou tout ce qui file entre ses doigts, ce soliloque sera créé deux
ans plus tard par Gilles Laubert lui-même en scène, à Genève, au théâtre de la Traverse. Il
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
72
existe une captation vidéo de ces spectacles produits par la Compagnie des Cris
(consultable à la demande).
10 Suivent la didascalie initiale de Carlotta et les scènes 4, 5 et 6, telles qu’elles ont été
retravaillées lors des répétitions. Nous remercions Mme Béatrice Cazorla, administratrice
de la Compagnie des Cris, de nous avoir communiqué le texte et M. Jacques Bochaton de
nous avoir autorisé à en reproduire ces extraits.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
73
Carlotta (soliloque), 2008
Pièce issue de la trilogie Elles parlent aux animaux. Extraits
Gilles Laubert
Didascalie générale
Moscou
Le théâtre représente la loge d’une comédienne.
En scène il y a une femme.
C’est Carlotta.
Parfois, les besoins du spectacle l’amènent à revêtir un frac.
C’est alors Carlotto.
En scène il y a une mouette empaillée
C’est Lioubov
À qui s’adresse Carlotta
1 […]
4 – Juste un peu plus tard
Revenant de chez le directeur elle est en robe de ville.
2 –. « …GLASNOST ! SOUVENIRS D’UNE STAR SOVIÉTIQUE ! » Ce sera le titre de mon prochain
spectacle ma Liouba ! Ce directeur je l’ai mal jugé. C’est un charmant garçon bien entouré
avec son américain et tout le staff comme ils disent. Tous ils ont dit qu’ils m’aideraient
mais j’ai peur ma Lioubotchka, il faudrait que j’improvise c’est la condition « You must act
without any lines learned before acting ». Tout ça c’est en anglais bien sûr bien sûr c’est the
young producteur of West Forty Six Street Theater District enfin Broadway je ne sais pas alors
j’ai dit oui. Bien sûr je ne vais pas refuser. Je suis heureuse !
3 La prestidigitation tout ça c’était bouche-trou ! Là mais là !, c’est reprendre mon métier
de comédienne ! « And what about the Carlotta Carlotto performance ? » qu’il m’a demandé
« Carlotta Carlotto » j’ai répondu « Qu’importe je suis artiste dramatique avec citation
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
74
dans l’encyclopédie ni vu ni connu je t’embrouille c’est le public qui décide ! » Gentil cet
américain. Avec le directeur ils ont beaucoup rit. « Nous en verrons de toutes les couleurs
avec vous surtout du rouge ! » Oh ma jolie mon emplumée ! GLASTNOST SOUVENIRS D’UNE
STAR SOVIÉTIQUE ! Un titre comme ça ce sera un spectacle pour les touristes je devrais
parler un peu d’allemand un peu d’italien un peu tout quoi ! Mais l’anglais aussi beaucoup
d’américain ça ne me fait pas peur non. Je suis follement heureuse heureuse. C’est l’impro
visation ça tu vois ma toute blanche ma Liouba et les spectateurs me donneront des billets
des dollars des euros des francs suisses ou ils vont les glisser dans mon décolleté. Ils
veulent aussi me filmer caméra sur l’épaule dans le vif du sujet reality-show pour les télés
de l’Ouest Channel Four and CNN. Enfin tout quoi. Ça me propulsera New York Hollywood.
C’est l’américain qui supervise bien sûr « Any lines learned before » et pas de répétitions !
Jamais je n’ai fait chose pareille mais il faut savoir inventer de nouvelles formes c’est
toujours ce qu’il disait lui mon Gricha avant de… Mais moi bien sûr je ne comprenais pas
ce qu’il disait « Des formes nouvelles quelles formes nouvelles ? » Je vivais dans un autre
monde celui du théâtre d’art et pas ces choses-là, et le… et le… Sexe ! Non ! Pas la
politique de la famille ! Pas remettre en cause les fondements de notre état socialiste. Des
formes nouvelles dans notre théâtre, non ! Tout était parfait dans ce temps-là.
4 Oh… tu te souviens comme tout était réglé ? Les répétitions autant qu’on en voulait…
Tous les costumes les perruques les bottiers et leurs amours de petites bottines… Tout sur
mesure avec les chapeaux les voilettes et les accessoires et toi tellement jolie petite
empaillée ventre plein de papiers pour gonfler ton joli ventre rebondi « Kouarr, kriièh,
kouêk »
L’écho reprend :
5 – « Kouarr, kriièh, kouêk ventre ventre »
Silence
6 Tu tenais ton rôle dans ce moment de ma gloire et là dans ce moment où tout a craqué,
que j’ai dû là – comme en exil là partir dans les théâtres de variétés – là avec ma robe des
héroïnes tchékhoviennes je t’ai emmenée ma mouette ma Liouba mes souvenirs toute ma
gloire passée. Oh le théâtre de l’Union et les acteurs toujours payés même s’ils ne jouaient
pas toujours… Du travail bien fait en prenant notre temps. Personne pour nous dire trop
cher on ne peut pas le budget et tout rien n’était trop beau. En ce temps-là nous
présentions le spectacle au personnel du théâtre qui donnait son avis critique alors
quelquefois même nous changions les décors, et mes robes mes costumes mon habilleuse
personnelle mon habilleuse. Puis c’était la représentation pour la commission des
orientations artistiques oh ma Lioubotchka ! Là nous avions peur d’eux mais nous avons
toujours passé sauf… oui. Une fois seulement… oui, avec ça… l’histoire de Gricha… oui
cette fois-là… l’histoire de Gricha… mais une fois. Une fois seulement.
Autrement, autrement toujours été contente heureuse « Bonnes orientations vous
épousez les progrès Carlotta Ivanov vous êtes l’artiste du Peuple de saine moralité »
prétendaient les commissaires de la propagande. Toujours grâce à moi l’artiste chérie de
la nomenklatura. Oh ! Je scintillais dans la représentation de la bourgeoise dépravée –
non ! Pas ça. Pas dépravée. Finissante, la bourgeoisie. Ensuite public salles toujours
pleines ovations roses et des œillets des œillets et le répertoire une semaine une pièce
une semaine l’autre. L’intégrale des Tchékhov ! Je jouais la Natacha des Trois Sœurs
l’Arkadina de La Mouette et Lioubov. Oui ma petite ! Lioubov de La Cerisaie et après
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
75
Transsibérien Leningrad enfin Saint-Pétersbourg comme on dit maintenant – maintenant
enfin c’est fini tout ça c’est le passé.
Aujourd’hui c’est aujourd’hui ce jeune directeur comme j’ai été sotte de penser que c’était
un propre à rien un… dépravé. Non ! Pas dépravé. Enfin je pensais un Jean-Foutre évaporé
eh bien non. Très correct. Ce directeur. Et il y a cet américain the producteur avec lui et
tout son staff comme ils disent nous irons loin « GLASNOST » ! Mon prochain spectacle «
SOUVENIRS D’UNE STAR… », en lettres lumineuses.
Mais moi ils peuvent bien dire « Any lines learned before » mais moi je me débrouillerai
pour dire les répliques des rôles dont j’étais la titulaire. On ne sait jamais. Il passera peut-
être un metteur en scène agent imprésario à qui il viendra l’idée de me faire reprendre
mes grands rôles… il passera cet attaché culturel français il doit revenir avec de ses amis.
Non ma belle emplumée ne me regarde pas comme ça ! Je ne suis pas trop vieille. C’est
dans le cœur « UN DERNIER REGARD SUR CES MURS SUR CETTE FENÊTRE ET EN ROUTE 1 »… Peut-être
que le spectacle pourra se donner à Paris en Occident aux States va-t-en savoir ma
Lioubov ? Allons Carlotta tu dois te calmer ! Il faut aller sur le plateau tout à l’heure ils
veulent juste tout de même faire des repérages pour les lumières à cause de la caméra sur
l’épaule. Tu comprends ça sera retransmis oh ma mignonne qui m’aurait dit un jour que
je devrais improviser en public ! Mais je m’en sortirai. La grande Carlotta Ivanovna à plus
d’un tour tour passe passe drapeaux rouge dans son sac. Ce n’est pas pour rien qu’elle est
citée dans l’encyclopédie. Allez ma petite chérie sois contente ta Carlotta se lance dans la
Glasnost ! Je suis une mouette ! « Kouar, Kriièh, Kouêk »
L’écho reprend
– Kouarr, Krièèh, kouèk ventre ventre
Ici c’est plein de fantômes… un spectre hante ce théâtre
Toujours en robe elle sort.
5 – Juste après quelques représentations et juste un
peu avant la prochaine…
Carlotta en déshabillé et peignoir se maquille.
7 –. Toujours je suis toujours restée en scène non ma jolie ? La scène je n’ai jamais pu pas la
quitter. À la scène j’ai tout donné tout donné mais là ma petite, non ! Je ne peux pas. Non
non je ne veux pas. Étaler toute ma vie… « The private life tell us your secrete private life…
toute cette story… votre chute… your son ! ». Non ! Pas mon fils je ne peux pas aller dire /
Je n’ai rien fait. Moi rien juste comédienne. Je vais mettre le frac je vais faire l’homme je
ne vais plus mettre la robe je ne veux pas faire la mère. Le frac. Oui je vais… je vais m’en
sortir ! Carlotta Ivanovna tu vas leur faire voir que ce n’est pas pour rien que tu es citée
dans l’encyclopédie…
Moitié maquillée elle se regarde dans le miroir.
8 Oh heureusement tu es là ma belle emplumée souvenir de mes splendeurs sinon à qui
parler ?… je n’ai personne je suis au-dessous de l’amour… au-dessous de l’amour ?… c’est
où ?
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
76
6 – Elle revient de scène, elle est en frac
9 –. A very big successfully show oh ma Lioubov dear ces mensonges !…. ça me fait rire. l’m a
liar…/Carlotta Carlotto personne ne vérifiera. J’ai inventé, brodé, dis n’importe quoi sur
l’affreux de ma vie soviétique quoi !… Donnée en spectacle ! Mais pas parlée pas parlé de
lui. Mon Gricha. Ça non je ne le ferai jamais. I’m an actress ! J’ai parlé de souffrance. De MA
souffrance. Le public en a pour son argent. II faut bien la gagner sa vie hein ma petite ? En
délire le public !… Tu sais ma foi je prends beaucoup de plaisir à ce jeu-là je joue je
raconte with any lines learned before et ça gagne. Ça gagne. Le show est en ligne sur Internet
with prepaid card « Vous verrez vous n’y perdrez rien», qu’il m’a dit le directeur et c’est
vrai des dollars des euros des francs suisses là dans mon pantalon l’échancrure de mon
plastron tout ça si ça continue comme ça je vais pouvoir me payer une habilleuse
« Habilleuse habilleuse » que je crierai en rentrant de scène comme au bon vieux temps
du Théâtre d’Art. Dommage que je ne puisse pas garder tous ces dollars ces francs suisses
ces euros « C’est la condition » qu’il m’a dit le directeur « Et après le spectacle vous passez
à mon bureau je vous donne de la monnaie des roubles pour vos petits achats personnels
que feriez-vous de dollars d’euros de francs suisses ?… c’est moi qui paie votre
appartement ». C’est une société américaine qui a acheté l’immeuble et ce théâtre c’est la
même chose. Tout appartient au young american et à lui le directeur il est associé. Oh ma
belle emplumée tu sais ce qu’ils m’ont dit « D’ici à quelques mois si votre numéro
continue de marcher on vous paie le voyage et l’Europe pour une campagne publicitaire
la tournée des supermarchés et des discothèques ». Alors tu vois ce jeune ambassadeur
secrétaire culturel francophone français il est revenu. Il faisait une de ces gueules ma
petite chérie !, je ne te dis pas ! « Mademoiselle ! Prostituer votre talent de cette façon ! »
« Pourquoi c’est vous qui payez l’appartement et ma note d’électricité ? » Tu sais je n’ai
pas ma langue dans ma poche : « Les échanges francophones la culture mon cher
monsieur votre Voltaire et la grande Catherine c’est fini ! Les dollars where are they ? ». Il a
tourné les talons. Ce doit être un communiste français. Tu sais qu’il en reste dans ce
pays ? Oh ma Lioubov qu’est-ce que notre jeune directeur et son young american ils ont pu
rire et moi, de les voir de si bonne humeur, alors moi j’ai profité tout de suite « Et le
théâtre de répertoire, Tchékhov ? » Il a encore ri ce monsieur le directeur avec son ami
américain « Non les héroïnes tchékhoviennes vous ne pouvez pas encore vous ne nous
avez pas tout dit il doit rester encore des zones d’ombre pas très propres dans votre
carrière de star soviétique. Le public est exigeant, il s’impatiente ; n’oubliez pas
maintenant nous sommes en direct sur plusieurs chaînes américaines ; ils attendent
quelque chose d’encore plus saillant saignant palpitant un peu graveleux. Du people,
quoi ! Allons, Carlotta Ivanovna il vous faut vous dépasser ». Oh ma Lioubotchka quand je
pense qu’à chaque fois que je quitte cette loge, que je rentre en scène, c’est pour être vue
par des millions de téléspectateurs !… Life is a dream !… mais il faut assurer. La scène c’est
la scène. Ils veulent que je me confesse, que je pleure en direct !… mais sur quoi pleurer
j’ai toujours été heureuse heureuse !… « La société idéale socialiste et la décomposition
morale des classes dépravées. La dépravation parlez-nous de ça ! C’est ça qui marche » !
La scène c’est la scène bien sûr qu’il faut s’y replonger. Il faudrait que je repense me
ressouvienne de toutes ces années des temps d’avant la chute de l’écroulement du mur –
toutes ces pierres-là, tout cet effondrement de ma mémoire et à Berlin la Weigel et
Bertolt tout ensevelis… – Carlotta tu dois sortir du placard. C’est le prix hein ma jolie ?…
toi tu t’en fous avec tes plumes. Bon, on n’a rien sans rien je ne suis qu’une comédienne.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
77
Je sens bien qu’il veut quelque chose de précis ce directeur « Il faut que ça plaise il faut
qu’ils en aient pour leur argent ils veulent voir quelqu’un qui a souffert, entendre l’intime
le scabreux ! En dessous de la ceinture c’est ça qu’ils veulent. » Et là ce directeur très
violent d’un coup là : « And your son ? your fucking faggot son ? » « NO NO HE ISN’T ». J’ai hurlé.
Et là, après, j’ai fait un long silence et puis « Je suis une mère moi je suis une mère », que
j’ai dit, « Mais moi comédienne moi, pas de problème je suis allé de l’avant ; autre
théâtre ». Oui, toujours de l’avant. À nouveau la scène. La variété. L’Intourist une vraie
folle vie. Heureuse avec les Occidentaux nous buvions le champ ! Je recevais ces messieurs
de la police renseignements services spéciaux. C’était le temps l’époque les affaires le
dégel et je devais bien il fallait que je reste à Moscou que je retrouve la scène mais tout
s’est effondré… Le mur, les pierres… Mais avant non. Jamais été malheureuse. Pourquoi je
dirais une chose pareille ?… Et ça tu vois toute cette scène à la télévision et moi en frac en
homme je n’en pouvais plus. Et eux je le sens veulent autre chose. La dépravation je ne
sais pas. Mais je ne sais pas moi je ne connais pas je n’ai jamais connu de dépravé. LE
DANSEUR. Le danseur LÀ JAMAIS JE N’AURAIS ADMIS QU’IL ENTRE DANS MA LOGE . Alors je vais
continuer. Je vais continuer dans les questions politiques m’inventer un petit passé de
quelque mois dans un goulag. Non. Pas ça. Je suis une mère et lui mon. « MON ENFANT CHÉ
RI, PARDON. PARDONNE À TA MÈRE COUPABLE. PARDONNE-MOI, JE SUIS MALHEUREUSE »2.
Lentement elle se regarde dans le miroir.
10 Non. Une mère ? Une femme…. Et lui alors qui ? ? ?
Temps de contemplation
11 Alors oui qu’est-ce que je disais ?… Ah oui oh je suis si heureuse ce succès me rendra folle.
Les deux-là les directeur et producteur ils veulent me voir pour les nouvelles orientations
du show. « Just coaching you for the next ! let’s party » Il faut vivre. Il faut vivre. En rentrant
j’achèterai caviar vodka. Tout est tellement plus facile avec de l’argent et du succès. Nous
nous étourdirons nous oublierons. Puisque je dis que je suis heureuse !… mais qu’est-ce
que je suis heureuse ! Oui… je ne vais pas pleurer non ?
Maintenant en peignoir, Carlotta sanglote
NOTES
1. Tchekhov, La Mouette.
2. Tchekhov, La Mouette.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
78
Carnet de la création
Traduction
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
79
Santa Cecilia [Santa Cécilia]. Note
introductive de l’auteur
Abilio Estévez
Traduction : Laure Gauzé
1 Nous étions sur une terrasse au bord du fleuve Canímar, à Matanzas1, une ville paisible
qui ne fait heureusement pas honneur à son nom.
2 C’était l’été à Cuba. Ou ce qui revient au même, cela pouvait être décembre ou n’importe
quel autre moment de l’année 1993. Un vieux slogan touristique s’est toujours chargé de
nous rappeler, avec la voix joyeuse et impossible (et ici cyniquement cruelle) des
locuteurs de slogans, que « Cuba est le pays de l’été éternel ». Ce qui, je n’en doute pas,
peut être très attractif pour les touristes.
3 Nous, les natifs (dans ce cas des gens de théâtre et quelques candides couples de jeunes
mariés), étions assis à une terrasse d’hôtel au bord du fleuve Canímar et souffrions de la
chaleur infernale de toujours, avec ses pourcentages très élevés de consistante humidité,
et déplorions encore et encore l’éternité de l’été. Je me souviens que le fleuve était
sombre et d’un débit très faible et qu’il poussait sur ses rives une végétation immobile,
d’un vert que l’excès de lumière transformait en une grande tache uniforme.
4 D’excellentes journées de théâtre se déroulaient alors à Matanzas, au sein d’un des plus
beaux théâtres de Cuba, le Sauto. Des troupes de tout le pays avaient à cette occasion le
privilège de se présenter dans ce fabuleux colisée néoclassique construit en 1863, à une
époque où l’on avait l’habitude d’appeler Matanzas, comme pour estomper la terrible
origine de son nom et avec cette amusante prétention provinciale non exempte de raison,
l’Athènes de Cuba.
5 J’étais là en tant que conseiller dramatique du groupe Teatro el Público dirigé par Carlos
Díaz. Nous étions venus avec la mise en scène de La Niñita querida, de Virgilio Piñera, qui a
tant fait parler d’elle et que j’aimerais qualifier, si cela ne constituait pas une étrange
redondance, de « spectaculaire ».
6 Teatro el Público alternait les représentations avec la compagnie Galiano 108. Cette dernière
compagnie avait déjà gagné sa place parmi les mythes théâtraux de La Havane. Elle était
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
80
seulement composée de son metteur en scène, José González, et de sa femme, Vivian
Acosta. Tous deux remarquables disciples du dramaturge et metteur en scène Tomás
González, disciples qui s’étaient engagés dans une brillante carrière personnelle.
7 On parlait de Vivian Acosta avec dévotion. Beaucoup la considéraient déjà à cette époque
comme l’une des meilleures actrices cubaines, ce qui n’était pas, comme j’ai pu le
constater par la suite, une exagération. Elle donnait deux représentations, deux
spectacles unipersonnels : La Virgen triste et Cuando Teodoro se muera. Cela m’avait toujours
semblé un incroyable risque de laisser cette dame seule dans cet énorme et somptueux
théâtre construit pour des représentations d’opéra et de ballet. Je ne savais pas encore
que pour sa personnalité scénique il n’y avait pas d’espaces trop grands. C’est donc sur la
terrasse de l’hôtel de Matanzas, au bord du fleuve Canímar, durant l’été sans fin de l’île et
par une chaleur d’enfer humide, que j’ai rencontré Vivian Acosta.
8 C’était (c’est) une mulâtresse qui semblait immunisée contre la chaleur ou contre toute
autre contingence météorologique. Grande, stylisée, avec un corps entraîné, rapide et aux
mouvements élégants, elle s’habillait en blanc (elle s’habillait presque toujours en blanc),
comme avec des gazes (bien que je soupçonne les « gazes » de n’être qu’un facile ressort
de mon imagination), et de très nombreux bracelets et chaînes en argent, dans un étrange
mélange d’orisha, de diva et de dame de la noblesse.
9 C’était (c’est) une belle femme, mais belle comme seuls les acteurs et les actrices sont
beaux, ce qui n’a rien à voir avec la beauté conventionnelle (si tant est que la beauté
conventionnelle existe) et qui ne consiste pas en une « certaine perfection », mais en la
possibilité de toutes les perfections. Bien sûr, ses mains et ses yeux avaient une étonnante
capacité de dialogue. Pourtant, ce qui m’a le plus impressionné chez elle, c’est cette sorte
d’acier qui semblait l’articuler dans quelque mystérieuse zone de sa volonté.
10 On voyait que cette femme avait fait de son jeu quelque chose qui dépassait les limites du
théâtre proprement dit et qui se rapprochait de la religion, c’est-à-dire du rite, et de la
philosophie, c’est-à-dire d’une façon de comprendre la vie. On pouvait tout de suite
percevoir son idée fixe, son entêtement (cette clé du talent), son endurcissement contre
toute adversité et sa ferme et humble superbe. Comme de la lignée des grandes, des
éternelles têtues, des imbattables. Comme de la lignée d’une Alicia Alonso, par exemple.
11 Vivian Acosta et José González se sont approchés de moi en cette soirée du fleuve Canímar
pour me demander d’écrire pour eux un texte sur La Havane. La requête m’a flatté au plus
haut point, comme quiconque peut le supposer. Par ailleurs, et cela était évidemment
bien plus important que la vanité, cette demande révélait chez nous une obsession
commune : l’amour pour La Havane.
12 Un amour comme tout amour, fait d’abondantes passions, de douleurs, de désaccords, de
haines, de nostalgies, d’insatisfactions et d’épiphanies. Dans la ville de Matanzas,
l’ancienne Athènes de Cuba, nous avons commencé à parler de La Havane sur le ton des
amants vieux et désespérés pour qui se plaindre est toujours une consolation.
13 La méthode que nous nous sommes imposée ce soir-là pour la rédaction de mon
monologue m’est également apparue comme très séduisante. Nous sommes arrivés à la
conclusion que je n’écrirais pas une histoire « imaginée » par moi seul dans la solitude de
ma chambre et de ma machine à écrire (j’utilisais encore une Olivetti fatiguée), mais le
texte qui serait conçu à mesure que nous travaillerions ensemble. Ce serait un texte créé à
partir des stimulations que nous nous provoquerions mutuellement, actrice, metteur en
scène et auteur.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
81
14 C’est ainsi que j’ai commencé à assister à La Havane aux répétitions de Vivian Acosta, sur
la scène de la petite salle de théâtre du Museo de la Ciudad, qui des siècles plus tôt avait été
le palais des comtes de Casa Bayona. C’est là que j’ai découvert sa passion pour Kazuo Ono
et pour la danse Butô. (Le jour où j’ai révélé à Vivian que j’avais assisté à une
représentation miraculeuse de Kazuo Ono dans un petit théâtre de Stuttgart – un de ces
instants magiques que le théâtre n’offre que rarement –, elle a failli pleurer d’émotion et
de révérence.) Je l’y provoquais avec des situations, des poèmes et des musiques, tandis
qu’elle me provoquait par ses attitudes, gestes, expressions et voix. Puis, lorsque je m’en
allais, s’établissait la relation entre l’actrice et son metteur en scène. C’est ainsi que Santa
Cecilia a été écrit. Le texte sortait pratiquement de ma vieille Olivetti pour prendre corps
dans cette actrice si puissante.
15 On connaît la suite : première à La Havane et représentations presque partout dans le
monde, de Buenos Aires à Barcelone. Et de nombreux prix pour l’actrice et le metteur en
scène.
16 Un autre metteur en scène, Alberto Sarraín, cubain résident aux États-Unis, a monté sa
propre adaptation pour la troupe qu’il dirigeait alors, La Má Teodora, avec une légendaire
actrice de La Havane de toujours, Daisy Fontao. Très différent dans ses objectifs et donc
en solutions scéniques, son projet était également très émouvant. Je n’oublierai jamais
l’atmosphère si intense que l’on obtenait dans la petite salle du Creation Art Center de
Miami (où donnait d’ailleurs des cours quotidiens l’une de nos grandes artistes, la
danseuse Rosario Suárez).
17 Il y a également eu d’autres mises en scène : à Berlin (Petra Kelling sous la direction
d’Eddy Socorro), et celle qu’a réalisée à Caracas l’extraordinaire Laura Serna. Je n’ai pas
eu l’opportunité de voir ces deux dernières mais les commentaires qui me sont parvenus
font de moi un homme reconnaissant et satisfait.
18 Et dans son étrange parcours, Santa Cecilia est arrivée jusqu’à Off-Broadway, en anglais
et… sous forme de comédie musicale ! Avec au piano Meme Solís que j’admirais tant dans
ma lointaine adolescence ! Comédie musicale représentée en ce moment-même à Miami
par une très célèbre chanteuse de pop cubain : Maggie Carlés.
19 Une vieille femme parle d’une ville mythique qui n’est plus. Une pauvre folle dit qu’elle
s’est noyée et que La Havane s’est dissoute comme du papier. Je ne sais à quel point elle a
raison. Mais il vaut peut-être mieux la laisser parler, respecter sa douleur grandiloquente
et ne pas trop la contredire.
Abilio Estévez, Flaçà, février 2004
NOTES
1. Matanzas signifie « massacres ».
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
82
Santa Cecilia [Santa Cécilia], 1993
Extrait
Abilio Estévez
Traduction : Audrey Aubou et Laure Gauzé
NOTE DE L’ÉDITEUR
Note des traductrices
L’idée de donner corps, pour la première fois en France, au premier monologue de
Ceremonias para actores desesperados, est née de la volonté de faire connaître le théâtre
d’Abilio Estévez, dramaturge cubain surtout connu en France pour ses romans, et
notamment sa trilogie romanesque composée de Tuyo es el reino (Ce royaume t’appartient,
Grasset/Bourgois, 1999), Los Palacios distantes (Palais lointains, Grasset, 2004) et El Navegante
dormido (Le Navigateur endormi, Grasset, 2010).
Dans le cadre d’une manifestation baptisée « Une journée avec Abilio Estévez » et
organisée au sein de l’École Normale Supérieure de Paris le 18 mai 2012 en présence de
l’auteur, le monologue de Cecilia, damnée du fond de la mer, condamnée à se remémorer
sans répit la splendeur et les misères passées, fait renaître une Havane éternelle.
Plusieurs hasards heureux et de multiples bonnes volontés se sont conjugués pour créer,
de l’avis de tous ceux qui ont pu assister à cette journée, un moment magique : aux
communications portant sur l’œuvre aux multiples facettes d’Abilio Estévez ont succédé
la représentation de Santa Cecilia, magistralement incarnée par l’actrice cubaine Linnett
Hernández Valdés, dans une mise en scène intense et originale d’Iván Jiménez, et un
concert de musique caribéenne porté par le duo de guitares de Valéry Scholastique et
Frédéric Limoge. La direction de l’École, François Géal, Maître de conférences à l’ENS,
Ariane Fasquelle des éditions Grasset, Alejandra Segrelles des éditions Tusquets et Iván
Salinas, sont quelques-unes des personnes clefs qui ont fourni une aide précieuse sans
laquelle l’organisatrice, Audrey Aubou, installée à New York, n’aurait pu mener à bien ce
projet, monté de toute pièce entre New York, Paris et Barcelone.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
83
Les traductrices ont été amenées à travailler ensemble pour la première fois dans le cadre
de ce projet, afin de réaliser le sous-titrage du monologue, joué en version originale. Aux
délais serrés et à l’éloignement géographique se sont ajoutées les difficultés inhérentes à
la langue riche et puissante d’Abilio Estévez ainsi qu’à la rythmique et à l’oralité propres à
ce monologue qui rendent palpable l’atmosphère si vivante de La Havane.
C’est avec grand plaisir qu’elles voient aujourd’hui ce texte diffusé à nouveau en France
en version bilingue.
Santa Cecilia, Linnett Hernández Valdés, dans Santa Cecilia de Abilio Estévez, mise en sène d’Iván
Jiménez, Audrey Aubou et Laure Gauzé.
© Ana Gloria Salva.
Version espagnole (Cuba)
1 (Transición.) La Habana era luz, flan de calabaza, pregoneros, olor a bacalao, piña y una
risa que no había modo de parar. ¡Reír! Aunque el sol te deshidrate, el mar se desborde y
el ciclón levante el techo de la casa. ¡Reir! (A un espectador :) ¿Usted sabe lo que es reír? (A
otro :) ¿Y usted? ¿Lo recuerda? Reír, ¿qué es? Alguno de ustedes, tenga el coraje de
decirme qué es reír. (Suspira.) Problema de los muertos: ¡olvidamos! (Transición.) Cerca de
mi casa hay siempre una mujer en un sillón. Negra, vieja. La saya es de retazos ; pañuelo
blanco en la cabeza. Fuma tabaco. (Como la Negra. Canta La Esperanza, de Pepe Sánchez.)
Quiero prevenirte : lo que hoy crees lleno de esplendor, está ya destruido. La piedra cae
sobre la piedra sin que te des cuenta. El polvo regresa al polvo. Esta ciudad tuya, de
columnas y encanto, estaá sepultada.Y hay muertes, epidemias de nostalgia, tristeza…Sí,
la gente ríe pero en el fondo llora. Muchos huyen. Y hay quien muere tratando de huir.
(Como la Niña.) ¿Oíste, mamá? ¿No hay modo, virgencita, de detener la catástrofe? Te
pondré flores, agua, frutas. Encenderé una vela. (Como la Anciana.) Ya no estaba allí. La luz
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
84
se apagó. En su lugar, un círculo de fuego. No crean que hice caso. Nunca me importaron
los vaticinios. Fui tan descreída y frívola como La Habana. Indiferente, descarada, cínica y
alegre como La Habana. (Se oye el aria «Celeste Aída» de Aída, en la voz de Enrico Caruso.)
¿Malos augurios? ¡Voy al teatro! Al Payret o al Nacional. Cortinas, alfombras inmensas
lámparas de lágrimas… En el escenario, aquel Radamés inolvidable. ¡La Habana de Caruso!
¡Cuántos jóvenes no darían mis cien años por haber oído cantar a Caruso! Caruso, estás
cantando para mí. Lo sé. Me miras. Detenido casi en el proscenio, tiendes las manos hacia
mí. ¡De estos oídos no se irá nunca tu voz ! A veces me despiertas de tu letargo y
permanezco encantada, escuchándote para siempre. Con un Radamés como tú, Caruso,
vale la pena entrar al templo y morir. (Pausa.) Estoy delirando. Los muertos –y sobre todo
los ahogados– padecemos de altas fiebres y delirios. El polvo se revuelve en el fondo del
mar y provoca chispas de engaño. ¡Y este calor! (Como la Niña.) ¡Vamos de excursión! A
casa de la tía Teresa. Salgamos en cuanto amanece. El viaje en tren desde la Estación de
Carlos III hasta Marianao es una delicia. ¿Pasaremos por Puentes Grandes? Tía Teresa,
¿por qué todos dicen que eres una mujer célebre? Nadie como tú para hacer buñuelos de
yuca. Me gusta esta casa grandísima de la Calzada Real. ¿Cómo logras que tu siesta sea la
más respetada de La Habana? ¡La siesta! No sé por qué en tu casa cobra un silencio
religioso. (Como Ia Anciana.) Cuando comienza a caer la tarde, nos sentamos en el portal,
vestidos de punta en blanco. Tomamos limonada con hielo. Hay quien prefiere jugo de
tamarindo. Abuelo fuma. Hace cuentos del exilio. Abuela mira viejos números de La
Habana Elegante. Yo me echo en la Hamaca. Como los cubanos no aprendimos a levitar,
inventamos la hamaca. Espácio en el aire, balanceo dulce y por supuesto inútil. El
pensamiento se suspende. La hamacas una experiencia mística. Miras las copas de los
árboles, los penachos de las palmas, escuchas el sinsonte… ¡Ay, el ocio! ¡Ocio! Única
palabra que los cubanos no tenemos que buscar en el diccionario. (Otro tono.) La muerte
provoca alucinaciones. ¡Y este calor! (Se oye un danzón. Al público :) ¿Oyen? Siempre lo oigo.
Y es mentira, no es música. Aquí no hay nadie, ni orquesta, nada. ¿Para qué necesitamos
música en el fondo del mar? No sé por qué. Ahí está. La música de cuando cumplí los
quince años. (Transformándose en Ia Muchacha de Quince Años. Baila al compás del danzón.
Cambia el sombrero por una coronita de brillantes.) ¡Tráeme el espejo! (Mirándose en él.) ¿Estoy
bien así? Debo estar bien. Es mi primer baile. Quiero que me admiren. ¿Llegaron los
muchachos? Entonces es hora de salir. Deséame suerte, Pilar. Quiero que todos se
enamoren de mí. (Entrando al salón de baile.) En efecto, Pilar, están a mis pies, rendidos. Los
tengo encantados. Disputan por sacarme a bailar. Puedo hacer lo que quiera. (Pausa breve.)
El único problema es que en la orquesta hay un mulato, flautista él. No tengo que
describirlo, ¿verdad? Se dice mulato y ya. Lo miro. Toca la flauta y me mira con recato y al
mismo tiempo con una desfachatez que me desnuda. En un momento me lanza un beso.
Mulato al fin, se da cuenta de que resulta irresistible. Con una criada me envía una
esquelita… Vive en una cuartería del Manglar. (Pausa breve. Como la Anciana.) Yo era una
muchacha seria. Bien educada : mi profesor fue amigo de mi padre, hombre cultísimo
llamado Don Ramón, al que le decían –no sé por qué– «mi tío el empleado».Yo era una
muchacha temerosa de Dios. Por eso acudí a la cita. (Transición. Como la Muchacha de Quince
Años.) Oye, mulato, podrías tener más mujeres que Yarini. Déjame tocarte el pecho que
parece de bronce. Acariciarte el pelo crespo, mirarte los ojos negrísimos, poner mis labios
en los tuyos gruesos. ¡Qué muslos, mulato, qué piernas poderosas! Abrázame. Hazme
desaparecer en tus brazos larguísimos, fuertes. Todo en ti es grande y fuerte. No eres un
hombre sino Dios. ¿Oyes? Se oye tu flauta. Tu boca no se detiene, recorre mi cuerpo y me
hago invisible como cuando la luz de La Habana inunda mi cuarto. Tu cuerpo huele como
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
85
el mercado del Polvorín. Tu aliento, fresco, es la brisa que sube por el Prado cuando
empieza a ponerse el sol. Tu voz, grave como las campanas del Espíritu Santo. Desnudo, tu
cuerpo sobre el mío, tu cuerpo de gigante entrando en mí, me doy cuenta, es cierto : La
Habana nos pertenece. Sigue, mulato, tú anulas el tiempo. El tiempo se detiene. (Pausa
breve. Como la Anciana.) La Habana era luz, flan de calabaza, pregoneros,olor a bacalao,
rodajas de piña, risas y un mulato irresistible que abría tu cuerpo en dos. (Suspira.) ¡Ay!,
cuando uno está muerto en el fondo del mar no debiera tener estos recuerdos. De pronto
el polvo se estremece. ¡Qué poder, mulato, que haces del polvo, polvo enamorado! (Otro
tono.) ¡Y este calor! Tengo ganas de dormir. Qué cansada estoy. Dormir. Para siempre. Un
sueño sin imágenes. (Al público:) Yo no sé ustedes, amigos muertos que me acompañan,
qué pensarán de los recuerdos que se hunden en el mar y se filtran por el mármol del
sepulcro. Mi ceniza sigue estremeciéndose en el osario. (Transición.) Vamos.
Acompáñenme, en los terrenos de la antigua estación de Villanueva están construyendo
el Capitolio. Dicen que será un edificio enorme, el más grande del mundo. Aquí siempre
las cosas han sido las más grandes del mundo. Vamos a ver La Fuente de la India, a la Bella
Habana, con su cara italiana y los delfines que lloran. Podemos llegar hasta mi casa de El
Cerro. vecina de la de Arango y Parreño, con tantas frutas colgando de los árboles. y el
aire perfumado. No se puede vivir con este perfume. ¿No lo sienten? De noche es
imposible dormir. La cama me expulsa, el mosquitero de tul no puede retenerme. El galán
de noche pone mi cuerpo a temblar. ¿Y qué si nos llegamos al Almendares? Aguas
cristalinas, y sobre él, «un vuelo de zunzunes encendidos»1. ¡Almendares,mi rio! ¿Qué se
hizo de ti? (Otro tono.) Uno no se baña dos veces en el mismo Almendares… ¡Y este calor!
(Suspira.) ¡El tiempo! ¿Quién me da una definición del tiempo? (A un espectador:) Usted,
señor, sería tan amable, ¿qué es el tiempo? Con sus palabras, no cite a Proust. No. Usted
tiene cara de ignorancia. (A otro :) Usted menos, el tiempo para usted es el reloj que lleva
en la muñeca. ¡Vamos, se le hace tarde! Ustedes van en un tranvía atestado, con cortinas
negras en las ventanillas. Nadie mira la ciudad. (Despectiva.) Ustedes son muertos raros.
Vivir, ir perdiendo cosas, como digo siempre. Hoy pierdes un vaso que se rompe, mañana
un viejo libro, pasado un amigo que se va… Así hasta que pasas el umbral. ¡Y este calor! ¡El
umbral! (Transición.) ¿No crees, mamá? Ahora que empujaste la puerta y te fuiste para
siempre, más blanca que nunca, mamá, sobre la cama, rígida, con el crucifijo que te puse
entre las manos, ese lugar común de la muerte. Tus ojos no están del todo cerrados, y por
debajo de los párpados, el brillo que te dejó aquella bandera con la que tú creías que
seríamos felices. Ojalá tu muerte sea de verdad, no como la nuestra. Pues mi madre muere
y no me da por llorar. Mientras la velan, voy a los Aires Libres del Prado. ¡Oigan, ya
empiezan a tocar las orquestas! (Se oye algarabía y confusión de muúsica popular. Santa Cecilia
se rejuvenece, baila.) ¿Qué iba a hacer yo velando un cadáver? En La Habana, más que en
ningún otro lugar, un cadáver es una cosa sucia e inoportuna. (Al público:) ¿Nunca fueron a
los Aires Libres del Prado? ¡Ustedes nacieron muertos! Luces, jarras de cerveza, orquestas,
mujeres con ajustados vestidos de lamé ; los hombres más bellos del mundo, con trajes de
dril, diciéndote piropos creacionistas. (Como hombre.) «Mujer, irías a ser muda que Dios te
dio esos ojos».2 (Como mujer.) Te hacen sentir de una belleza irresistible.Quiero que sepas,
aquellos hombres de La Habana no nacieron para otra cosa que para enamorar. Con ojos,
manos, bocas, con todos sus generosos atributos. Allá los franceses que inventaron
métodos para pensar. Allá los alemanes que inventaron eso que dice «Todo lo racional es
real y toclo lo real es racional». Los habaneros de mi época inventaron una fórmula mejor
y más duradera: «Todo lo real es gozable y todo lo gozable es real». ¡Las noches de La
Habana! Cuerpos que se atraen en los bancos de los parques, contra los árboles, en los
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
86
atrios de las iglesias. Fuimos más panteístas que Spinoza. Para cualquier habanero un
cuerpo vivo era una imagen divina. Te arrodillas ante un hombre que se abre la
portañuela y estás elevando un himno de acción de gracias. ¿Qué iba a hacer yo frente a
un cadáver aunque este fuera el de mi madre? (Otro tono.) ¡Me voy de casa! Sí, papá, me
voy porque detesto tu represión, tu tiranía. (Como él Padre.) Hija, aprende a dominar tu
cuerpo. Los principios, hija. Aprende a sufrir, a pasar hambre y sed : una idea vale más
que todos los placeres. (Como ella.) No, papá, yo tengo un cuerpo y al cuerpo no le
importan las ideas. ¡Vivir! ¿Oíste? Yo sólo quiero vivir. Aquí y ahora.No me interesa el
futuro que nadie conoce. Yo nada más tengo el presente y mi cuerpo. ¡Y quiero vivir! ¡Por
eso me voy! (Pausa. Se oye un danzonete. Se transforma en la Puta.) ¡No me llames Cecilia !
Ahora soy Santa Cecilia. Me dicen así por bella, por aristócrata y porque Manuel Corona se
enamoró de mí. ¡Muchachitas, prepárense, es casi hora de abrir ! A mis clientes no les
gusta esperar. ¡Santa Cecilia de la calle Galiano! ¿Oyeron? Nada de barrio de Colón ni Jesús
Maria. Miren los muebles de rejilla, los medios puntos de colores, estos paisajes de
Chartrand… Incienso, opio. La Cuba secreta. ¡El mejor gusto! Música de Aniceto Díaz,
creador del danzonete. A veces él mismo viene con la orquesta. ¡Y mucha respetabilidad!
Aquí no se acepta a cualquiera. Buenos clientes. Limpios, perfumados, entalcados como
niños… Como soy Santa Cecilia, no me entrego a cualquiera. Me doy el gusto de elegir. Las
manos, miro las manos. Después las bocas y los ojos. Lo demás me lo imagino. Venga
usted, señor. O ni siquiera eso, un gesto de la mano. Sidra, champán. Me baño en vino del
Rin. Una mesa de langostas enchiladas junto a la cama. Espejos en el techo, en las paredes,
de modo que no somos dos sino muchos. Los que hablan de Síbaris no conocen esta
Habana mía.
Version française (traduction d’Audrey Aubou et Laure
Gauzé)
2 (Transition.) La Havane était lumière, flan à la citrouille, vendeurs ambulants, odeur de
morue, ananas, et un rire impossible à arrêter. Rire ! Même si le soleil te déshydrate,
même si la mer déborde, même si le cyclone soulève le toit de la maison. Rire ! (À un
spectateur :) Vous savez ce que c’est, rire ? (À un autre :) Et vous ? Vous vous en souvenez ?
Rire, qu’est-ce que c’est ? Que l’un d’entre vous ait le courage de me dire ce que c’est que
de rire. (Elle soupire.) Voilà bien notre problème à nous autres morts : on oublie (Transition.
) Près de chez moi, il y a toujours une femme assise dans un fauteuil. Noire, vieille. Jupe
rapiécée ; foulard blanc autour de la tête. Elle fume du tabac. (Comme la Noire. Elle chante La
Esperanza de Pepe Sánchez.) Je tiens à te prévenir : ce que tu crois aujourd’hui plein de
splendeur est déjà détruit. La pierre croule sur la pierre sans que tu t’en aperçoives. La
poussière retourne à la poussière. Ta ville de colonnes et de splendeur est ensevelie. Et il y
a des morts, des épidémies de nostalgie, de la tristesse… Oui, les gens rient mais dans le
fond, ils pleurent. Beaucoup fuient. Et certains meurent en essayant de fuir. (Comme la
Petite Fille.) Tu entends, Maman ? Il n’y a pas un moyen, Sainte Vierge, d’arrêter la
catastrophe ? Je t’offrirai des fleurs, de l’eau, des fruits. J’allumerai un cierge. (Comme la
Vieille.) Elle n’était plus là. La lumière s’est éteinte. À sa place, un cercle de feu. N’allez pas
croire que je me sois inquiétée. Je n’ai jamais fait attention aux prophéties. J’ai été aussi
incrédule et frivole que La Havane. Indifférente, effrontée, cynique et joyeuse comme La
Havane. (On entend l’aria Céleste Aïda d’Aïda, chantée par Enrico Caruso). Mauvais présages ?
Je vais au théâtre ! Au Payret ou au National. Rideaux, tapis, immenses lustres à
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
87
pampilles… Sur scène, cet inoubliable Radamès. La Havane de Caruso ! Mes cent ans, bien
des jeunes les échangeraient contre la possibilité d’entendre chanter Caruso. Caruso, tu
chantes pour moi. Je le sais. Tu me regardes. Debout sur le devant de la scène, tu tends les
mains vers moi. De ces oreilles, jamais ta voix ne s’en ira ! Parfois, tu me réveilles de la
léthargie dans laquelle tu m’as plongée et je demeure enchantée, t’écoutant pour
toujours. Avec un Radamès comme toi, Caruso, cela vaut la peine d’entrer dans le temple
et de mourir. (Pause.) Je délire. Les morts – et surtout nous les noyés –, nous souffrons de
fortes fièvres et de délires. La poussière remue au fond de la mer et provoque des
étincelles d’illusion. Et cette chaleur ! (Comme la Petite Fille.) Partons en excursion ! Chez
tante Teresa. Allons-nous-en dès le lever du jour. Le voyage en train de la Gare Carlos III à
Marianao est un délice. On passera par Puentes Grandes ? Tante Teresa, pourquoi tout le
monde dit que tu es une femme célèbre ? Personne ne fait les beignets de manioc comme
toi. J’aime cette immense maison de la Calzada Real. Comment fais-tu pour que ta sieste
soit la plus respectée de La Havane ? La sieste ! Je ne sais pas pourquoi, dans ta maison,
elle prend des airs de silence religieux. (Comme la Vieille.) Quand le soir commence à
tomber, nous nous asseyons dans l’entrée, tirés à quatre épingles. Nous buvons de la
limonade avec des glaçons. Certains préfèrent du jus de tamarin. Grand-père fume. Il
raconte des histoires de l’exil. Grand-mère feuillette de vieux numéros de La Havane
Élégante. Moi, je m’installe dans le hamac. Comme nous, les Cubains, n’avons pas appris à
léviter, nous avons inventé le hamac. Espace dans l’air, balancement doux et bien sûr
inutile. La pensée se suspend. Le hamac est une expérience mystique. Tu regardes la cime
des arbres, les panaches des palmes, tu écoutes le moqueur… Ah, l’oisiveté ! Oisiveté ! Seul
mot que nous les Cubains n’avons pas à chercher dans le dictionnaire. (Autre ton.) La mort
provoque des hallucinations. Et cette chaleur ! (On entend un danzón. Au public :) Vous
entendez ? Je l’entends tout le temps. Et ce n’est pas vrai, ce n’est pas de la musique. Il n’y
a personne ici, pas d’orchestre, rien. Pourquoi aurions-nous besoin de musique au fond de
la mer ? Je ne vois pas pourquoi. La voilà. La musique de la fête pour mes quinze ans. (Se
transformant en la Jeune Fille de quinze ans. Elle danse au rythme du danzón. Elle troque son
chapeau pour un diadème en strass.) Apporte-moi le miroir ! (S’y regardant.) Je suis belle
comme ça ? C’est mon premier bal. Je veux qu’on m’admire. Les garçons sont arrivés ?
Alors, c’est l’heure de partir. Souhaite-moi bonne chance, Pilar. Je veux qu’ils tombent
tous amoureux de moi. (Entrant dans la salle de bal.) Oui, Pilar, ils sont à mes pieds, ils
rampent. Je les ai charmés. Ils se disputent pour m’inviter à danser. Je peux faire ce que je
veux. (Pause brève.) Le seul problème c’est que dans l’orchestre, il y a un mulâtre, un
flûtiste. Pas la peine de le décrire, n’est-ce pas ? On dit mulâtre et ça suffit. Je le regarde. Il
joue de la flûte et me regarde avec pudeur et en même temps avec un aplomb qui me
déshabille. À un moment donné, il m’envoie un baiser. En bon mulâtre qu’il est, il se rend
bien compte qu’il est irrésistible. Il me fait envoyer un billet par une servante… Il habite
dans une chambrette qu’il loue à Manglar. (Pause brève. Comme la Vieille.) J’étais une jeune
fille sérieuse. Bien éduquée : mon professeur avait été l’ami de mon père, un homme très
cultivé du nom de Don Ramón, qu’on surnommait – je ne sais pas pourquoi – « mon oncle
l’employé ». Jeune fille, je craignais Dieu. C’est pour cela que je suis allée au rendez-vous. (
Transition. Comme la Jeune Fille de Quinze Ans.) Eh, mulâtre, tu pourrais avoir plus de
femmes que Yarini. Laisse-moi toucher ton torse qui ressemble à du bronze. Caresser tes
cheveux crépus, regarder tes yeux si noirs, poser mes lèvres sur tes lèvres épaisses.
Quelles cuisses, mulâtre, quelles jambes puissantes ! Embrasse-moi. Fais-moi disparaître
dans tes bras si longs et forts. Tout en toi est grand et fort. Tu n’es pas un homme mais un
Dieu. Tu entends ? C’est ta flûte. Ta bouche ne s’arrête pas, elle parcourt mon corps et je
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
88
deviens invisible comme lorsque la lumière de La Havane inonde ma chambre. Ton corps
sent le marché du Polvorín. Ton haleine, fraîche, est la brise qui se lève sur le Prado
quand le soleil se couche. Ta voix, grave comme les cloches de l’Espíritu Santo. Ton corps
nu sur le mien, ton corps de géant pénétrant en moi, je me rends compte, oui : La Havane
nous appartient. Continue, mulâtre, tu abolis le temps. Le temps s’arrête. (Pause brève.
Comme la Vieille.) La Havane était lumière, flan à la citrouille, vendeurs ambulants, odeur
de morue, rondelles d’ananas, rires et un mulâtre irrésistible qui ouvrait ton corps en
deux. (Elle soupire.) Ah ! Quand on est morte au fond de la mer, on ne devrait pas avoir de
tels souvenirs. Tout à coup, la poussière frémit. Quel pouvoir, mulâtre, tu fais de la
poussière de la poussière amoureuse ! (Autre ton.) Et cette chaleur ! J’ai envie de dormir.
Comme je suis fatiguée. Dormir. Pour toujours. Un sommeil sans images. (Au public :) Je ne
sais ce que vous, amis morts qui m’accompagnez, vous pensez des souvenirs qui
s’enfoncent dans la mer et qui s’infiltrent dans le marbre du tombeau. Mes cendres
continuent de frémir dans l’ossuaire. (Transition.) Allez, accompagnez-moi sur les terrains
de l’ancienne gare de Villanueva où l’on construit le Capitole. On dit que ce sera un édifice
énorme, le plus grand du monde. Ici, les choses ont toujours été les plus grandes du
monde. Allons voir la fontaine de la India, la belle Habana, avec son visage italien et ses
dauphins qui pleurent. Nous pouvons aller jusqu’à ma maison du Cerro, voisine de celle
d’Arango y Parreño, avec ses arbres chargés de fruits et son air parfumé. On ne peut pas
vivre avec un tel parfum. Vous ne le sentez pas ? La nuit, impossible de dormir. Le lit me
repousse, la moustiquaire en tulle ne peut me retenir. Le jasmin de nuit fait trembler mon
corps. Et si on allait au bord de l’Almendares ? Eaux cristallines et, au-dessus, « un vol
d’oiseaux-mouches carmin ». Almendares, ma rivière ! Qu’es-tu devenu ? (Autre ton.) On
ne se baigne pas deux fois dans le même Almendares… Et cette chaleur ! (Elle soupire.) Le
temps ! Qui me donne une définition du temps ? (À un spectateur :) Vous, Monsieur, vous
seriez bien aimable de me dire ce qu’est le temps ? Avec vos propres mots, ne citez pas
Proust. Non. Vous avez une tête d’ignorant. (À un autre :) Vous moins, le temps, pour vous,
c’est la montre que vous portez au poignet. Vite, vous allez être en retard ! Et vous tous
êtes dans un tramway bondé, avec des rideaux noirs aux fenêtres. Personne ne regarde la
ville. (Méprisante.) Vous êtes des morts bizarres. Vivre, c’est perdre des choses une à une,
comme je dis toujours. Aujourd’hui tu perds un verre qui se casse, demain un vieux livre,
après-demain un ami qui s’en va… Et ça, jusqu’à ce que tu franchisses le seuil. Et cette
chaleur ! Le seuil ! (Transition.) Tu ne crois pas, Maman ? Maintenant que tu as poussé la
porte et que tu es partie pour toujours, plus blanche que jamais, Maman, sur le lit, rigide,
avec le crucifix que je t’ai mis entre les mains, ce lieu commun de la mort. Tes yeux ne
sont pas tout à fait fermés, et sous tes paupières, l’éclat que t’a laissé ce drapeau grâce
auquel tu pensais que nous serions heureux. Pourvu que ta mort soit réelle, pas comme la
nôtre. (Transition.) Donc ma mère meurt et je n’arrive même pas à pleurer. Pendant qu’on
la veille, je vais aux Aires Libres du Prado. Écoutez, les orchestres commencent à jouer ! (
On entend du vacarme et des sons mêlés de musique populaire. Santa Cecilia rajeunit, danse.)
Qu’est-ce que j’aurais bien pu faire à veiller un cadavre ! À La Havane, plus que nulle part
ailleurs, un cadavre est quelque chose de sale et d’inopportun. (Au public :) Vous n’êtes
jamais allés aux Aires Libres du Prado ? Vous êtes mort-nés ! Lumières, pichets de bière,
orchestres, femmes en robes moulantes de lamé ; les hommes les plus beaux du monde,
avec des costumes de coutil, te débitant des galanteries créationnistes. (Comme un homme.)
« Femme, étais-tu destinée au mutisme pour que Dieu t’ait donné ces yeux ? » (Comme une
femme.) Ils te donnent l’impression d’être une beauté irrésistible. Sache-le, ces hommes de
La Havane ne sont sur Terre que pour conquérir des cœurs. Avec leurs yeux, leurs mains,
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
89
leurs bouches, avec tous leurs généreux attributs. Les Français ont découvert des
méthodes pour penser. Les Allemands ont découvert que : « Tout ce qui est rationnel est
réel et tout ce qui est réel est rationnel ». Mais les Havanais de mon époque, eux, ont
découvert une formule plus exacte et plus durable : « Tout ce qui est réel donne du plaisir
et tout ce qui donne du plaisir est réel ». Les nuits de La Havane ! Des corps qui s’attirent
sur les bancs des parcs, contre les arbres, sous les portiques des églises. Nous avons été
plus panthéistes que Spinoza. Pour tout Havanais, un corps vivant était une image divine.
Tu t’agenouilles devant un homme qui ouvre sa braguette et tu élèves un hymne d’action
de grâce. Qu’avais-je à faire devant un cadavre, même si c’était celui de ma mère ? (Autre
ton.) Je quitte la maison ! Oui, Papa, je m’en vais parce que je déteste ta répression, ta
tyrannie. (Comme le Père.) Ma fille, apprends à dominer ton corps. Les principes, ma fille.
Apprends à souffrir, à endurer la faim et la soif : une idée vaut plus que tous les plaisirs. (
Comme elle.) Non, Papa, j’ai un corps et le corps n’a que faire des idées. Vivre ! Tu
entends ? Je veux seulement vivre. Ici et maintenant. Je me fiche du futur que personne
ne connaît. Je n’ai rien d’autre que le présent et mon corps. Et je veux vivre ! C’est pour
cela que je pars ! (Pause. On entend un danzonete. Elle devient la Pute.) Ne m’appelle pas
Cecilia ! Maintenant je suis Santa Cecilia. On m’appelle comme cela parce que je suis belle,
parce que je suis noble et parce que Manuel Corona est tombé amoureux de moi. Les filles,
préparez-vous, c’est bientôt l’heure d’ouvrir ! Mes clients n’aiment pas attendre. Santa
Cecilia de la rue Galiano ! Vous avez entendu ! On n’est pas au quartier Colón ni à Jesús
María. Voyez ces meubles en vannerie, ces broderies de couleur, ces paysages de
Chartrand… Encens, opium. La Cuba secrète. C’est du meilleur goût ! Musique d’Aniceto
Díaz, créateur du danzonete. Il vient parfois lui-même avec son orchestre. Et c’est une
maison très respectable. Ici, on n’accepte pas n’importe qui. De bons clients. Propres,
parfumés, talqués comme des enfants… Comme je suis Santa Cecilia, je ne me donne pas à
n’importe qui. Je m’accorde le privilège de choisir. Les mains, je regarde les mains.
Ensuite la bouche et les yeux. Le reste, je l’imagine. Venez par-là, Monsieur. Ou même pas,
juste un geste de la main. Cidre, champagne. Je me baigne dans du vin du Rhin. Une table
avec des langoustes épicées près du lit. Miroirs au plafond, sur les murs, de sorte que nous
ne sommes pas deux mais plusieurs. Ceux qui parlent de Sybaris ne connaissent pas ma
Havane à moi.
NOTES
1. Dulce Maria LOYNAZ, « Al Almendares». (Nota del Autor.)
2. Vicente HUIDOBRO, « Altazor». Canto II. (Nota del Autor.)
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
90
Carnet des spectacles et des
professionnels
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
91
Carnet des spectacles et des professionnels
Chroniques des spectacles
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
92
Vers l’antique. Verso Medea,
spectacle-concert d’après Euripide,
mise en scène d’Emma Dante
Zoé Schweitzer
1 Le hasard fait bien les choses : alors que se préparait ce numéro de Skén&graphie, il a été
possible de voir, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, Verso Medea mis en scène par
Emma Dante, qui fut créé au Théâtre olympique de Vicence en 20121.
2 La Médée d’Emma Dante frappe d’emblée par son originalité : point de paroles pour
commencer mais une polyphonie à deux voix masculines, en sicilien, qui crée une
temporalité toute particulière et permet au spectateur de rompre avec le monde
quotidien. Cinq hommes et une femme, tous vêtus d’une robe noire, sont assis. Ces
hommes travestis devisent assez familièrement, d’un ton qui rappelle le cinéma réaliste
italien, et égrènent quelques anecdotes : l’une raconte un accouchement puis l’autre un
rêve dans lequel Médée était toujours enceinte et n’accouchait jamais. Vision absurde ou
songe prophétique ? Du moins, la cohérence de cette image apparaît quelques instants
après lorsque le sixième acteur se lève, une femme enceinte, et que l’on comprend qu’il
s’agit de Médée. Elle se nimbe d’un mystère angoissant lorsqu’on apprend que la ville est
stérile et que Médée seule peut enfanter mais qu’elle se consume de douleurs parce que
Jason l’a abandonnée. Comme chez Euripide, le chœur des femmes ouvre la pièce, il est
plein d’appréhension et redoute ce dont est capable l’épouse blessée.
3 La question du rapport à l’Antiquité est récurrente lors de la représentation d’une œuvre
à sujet mythologique. Lorsque le succès scénique du sujet est réel, comme c’est le cas pour
l’histoire de Médée, on pourrait craindre que la question ne soit même fastidieuse ; or il
n’en est rien pour Verso Medea qui ne manque pas d’étonner précisément dans ce domaine
du rapport à l’antique. L’enjeu n’est pas seulement le rapport de la Médée moderne avec
son lointain modèle grec ; la question est à la fois plus large et plus complexe ; il s’agit
d’étudier les traces des sources antiques mais aussi la relation du spectacle moderne avec
la tragédie d’Euripide dont elle s’inspire explicitement. La question n’est donc pas
uniquement l’actualisation d’une figure mythologique et d’un sujet antique, mais la
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
93
compréhension de ce qui motive ce recours à la Médée d’Euripide ; inversement, on se
demandera ce que Verso Medea donne à appréhender de l’Antiquité, comment l’œuvre
théâtrale moderne renouvelle notre conception de l’œuvre ancienne, voire de l’antique.
4 La filiation avec Euripide est explicite dans le programme de salle et justifiée aussi bien
par la trame de la pièce qui suit celle de la Médée antique (déploration de Médée, échanges
avec les adversaires que sont Créon et Jason, accomplissement de la vengeance) que par la
reprise de certaines répliques de la tragédie, ainsi de la déploration de la condition de
l’épouse et de l’accouchement, comparée à celle du soldat. Pourtant, au cœur de ce
canevas grec, se trouve une invention qui retentit sur l’ensemble de l’œuvre : Médée,
l’unique femme de la cité, est enceinte. L’héroïne d’Emma Dante est donc toute puissante,
dotée d’une forme de pouvoir magique qui évoque à la fois les rites archaïques de
fécondation et les hantises modernes liées à la procréation. La temporalité de la pièce
coïncide avec celle de son personnage : l’accouchement permet l’accomplissement de la
vengeance qui est le meurtre de ce fils nouveau-né. De la fable antique, il reste l’abandon
de Jason et la vengeance de Médée, c’est-à-dire tout ce qui a partie liée avec l’intime,
tandis que les éléments monarchiques et merveilleux, comme le char ailé ou la scène de
magie, ont disparu.
Verso Medea, d’Emma Dante.
© DR.
5 Cette simplicité de l’intrigue, qui concourt à la brièveté du spectacle, a une traduction
scénographique, conforme à la ligne esthétique épurée du travail d’Emma Dante : point de
palais ou de créature spectaculaire, seulement six chaises, une bassine d’eau, quelques
tissus de couleurs vives et une ample robe blanche et poussiéreuse que Médée vêt
quelques instants avant de l’offrir empoisonnée à Glaukè. Or, le même mouvement de
retour à l’antique naît de son apparente édulcoration car de cette simplicité domestique,
de ce drame intime jaillit une atemporalité qui évoque précisément la tragédie grecque
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
94
telle que la conçoit le spectateur actuel, telle que la décrivait par exemple Antoine Vitez
dans sa préface d’Électre, et qui fonde sa notion de « théâtre des idées » :
Je découvrais le Théâtre des Idées. L’auteur ne dit point son avis, tout au contraire du
théâtre à thèse ; non, il fait parler les Idées comme des êtres humains, comme si elles
avaient un corps. Et justement elles ont un corps, ce sont deux femmes de chair et
d’os, qu’opposent de vieilles rancunes familiales, peut-être.
6 La beauté de cette tragédie est toute contenue là-dedans : tantôt le public verra et
entendra la bataille pure des convictions morales, et tantôt celle, impure, des caractères
adverses. Cela dicte au régisseur et aux acteurs leur devoir : il y a deux pièces à jouer en
une ; certes on peut choisir de ne donner que l’une, ou que l’autre ; une profération froide
et immobile rendra bien la première, tandis que la seconde s’accommodera d’un jeu
rapproché, naturel et chaud. On peut vouloir aussi jouer les deux à la fois, c’est ma
recherche aujourd’hui : croiser la chaîne à la trame, et que chaque parole, chaque geste
des acteurs puisse être pris et compris selon les deux catégories, comme une déclaration
publique, chargée de sens pour tout le monde, ou comme une action privée, singulière, ne
répondant qu’à la situation des personnages supposés2.
7 Ce mouvement de distance initiale avec l’antique puis de rapprochement consécutif
s’observe également dans le traitement de la musique. Verso Medea est une œuvre assez
économe de paroles, tandis que la musique et le chant y tiennent une place considérable,
expliquant ainsi la mystérieuse désignation de l’œuvre comme « spectacle-concert »
indiquée dans le programme. En confiant de larges plages d’intervention aux frères
Mancuso, chanteurs-compositeurs de musique traditionnelle sicilienne, Emma Dante
s’écarte de la conception répandue selon laquelle la tragédie est un théâtre du langage et
de l’argumentation, mais pour mieux renouer avec la réalité athénienne que décrit
Aristote car la musique est une partie essentielle de l’œuvre, qui accompagne l’action,
tantôt comme un commentaire, tantôt comme une évocation de ce qui demeure invisible
et inouï. Elle permet aussi de renouveler complètement le dénouement et d’éviter ainsi
l’écueil d’une fin éculée, fût-elle terrible, pour le spectateur. Ici, point de char ailé, mais,
tandis que l’obscurité gagne progressivement et enveloppe les acteurs en ligne, debout et
de dos, à l’arrière du plateau, c’est la musique qui est devenue spectaculaire : le violon
joue pour la première fois, les deux voix évoluent séparément, semblables aux
personnages irrémédiablement séparés, et la musique emplit le théâtre, comme une
allégorie de la puissance d’évocation de la fable mythique.
8 Actualisation, déplacement et invention permettent tout à la fois de surprendre le
spectateur et de renouer avec l’antique, dans ce qu’il peut avoir de brutal et de primitif.
On peut se demander si la fidélité à l’antique ne saurait être autrement que paradoxale,
naissant à la faveur d’une distance avec la tradition interprétative dominante qui a capté
une Antiquité nécessairement incomplète, et qu’il faut toujours écarter pour redécouvrir
un pan délaissé. Matériau mobile et fluctuant, l’antique – et l’histoire de Médée de
manière exemplaire – est continûment investi par les dramaturges qui l’interprètent
depuis leur présent et donnent ainsi à comprendre ce temps passé lui-même, accompli
mais non révolu.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
95
Verso Medea, d’Emma Dante.
© DR.
9 Verso Medea, la bien nommée, invite à regarder vers le personnage de Médée, qu’Emma
Dante modifie significativement, vers le mythe et l’époque antique, mais aussi vers la
tragédie et le théâtre tragique. En effet, notamment grâce à la musique et à une mise en
valeur paradoxale de l’antique qui n’en réduit pas l’altérité, cette œuvre invite à réfléchir
à ce que peut être une tragédie aujourd’hui. À rebours de nombreuses entreprises
contemporaines, le geste d’Emma Dante ne consiste pas à rendre familier l’univers
antique mais, au contraire, à défamiliariser le mythe, ce qui permet précisément de le
réinventer avec liberté et de s’écarter du genre du drame pour proposer une forme
tragique moderne, capable de saisir, de ravir le spectateur. Le mouvement de distance
initiale puis de proximité, analysé comme crucial pour le rapport à l’antique, caractérise
également la relation du spectateur à l’œuvre et c’est finalement vers soi que Verso Medea
invite à se tourner.
NOTES
1. Texte et mise en scène : Emma Dante. Musique et chants : Fratelli Mancuso. Lumières :
Marcello d’Agostino. Avec Elena Borgogni (Médée), Sandro Maria Campagna (Messagero -
Caterina), Davide Celona (Mimma), Salvatore D’Onofrio (Creonte - Giuseppina), Roberto Galbo
(Rosetta), Alessandro Ienzi (Giasone - Mariarca).
2. Antoine VITEZ, préface à Sophocle, Électre, Arles, Actes Sud, 1986, p. 5.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
96
L’écriture au scalpel : La Dictadura de
lo cool de Marco Layera
Margot Dacheux
1 Un gymnase avignonnais bondé, le dernier jour du festival d’Avignon. Nous sommes à
Aubanel dont l’accès nécessite de se perdre dans de petites rues étroites avant de gagner
l’entrée du lieu. Comme il est désormais coutume en Avignon, nos sacs sont fouillés avant
de passer les portes, on nous débarrasse de nos bouteilles d’eau de plus de 50 cl, de nos
anti-moustiques, de certains brumisateurs. Ce nouveau rituel résonne des événements
encore trop récents du 14 juillet.
2 Ces contrôles passés, nous voilà assis à observer la salle et sa respiration. Nous sommes
réunis pour assister à La Dictadura de lo cool de la compagnie La Re-Sentida 1, connue pour
son sens de la subversion. Comme le dit la plaquette,
Marco Layera, conscient d’en faire lui-même partie, interroge le potentiel et
l’intégrité de ce groupe social (les bobos) devenu classe qui souscrit en tout point au
capitalisme comme mode de vie et de communication, dans ses rapports au monde
et au marché, mais revendique un héritage culturel et des valeurs dites à contre-
courant.
3 Un rapide scan autour de moi me conforte dans l’idée que ce propos devrait largement
faire écho dans la salle.
4 Les fouilles qui conditionnent notre entrée ont pris pour habitude de retarder le début du
spectacle d’une quinzaine de minutes, ce qui offre l’opportunité d’observer avec attention
cette femme très âgée qui se déplace devant la scène, cherchant vraisemblablement un
siège. En la détaillant plus précisément, nous arrivons à la conclusion que ce que nous
avions pris pour une spectatrice était en réalité une comédienne attendant le début du
spectacle. Les lumières sont encore allumées et la voilà au micro. Elle nous salue, nous
informe qu’elle fait partie du gouvernement chilien et que, dans le cadre d’une enquête
en cours sur les publics, elle souhaite nous poser quelques questions : « Votre tenue
vestimentaire coûte-t-elle plus de 100 € ? », « Qui est d’origine maghrébine dans la
salle ? », « Qui a voté pour François Hollande ? ». Quelques questions auxquelles les
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
97
spectateurs répondent en levant le bras. Ça y est, le ton irrévérencieux de la soirée est
donné.
5 En décidant de s’attaquer aux bobos, Marco Layera ne peut faire l’économie de
l’autodérision et de l’ironie, caricaturant à l’excès les vautours politiques et leurs
démarches d’intimidation, offrant l’image d’un Ministère de la Culture animé par des
préoccupations élitistes. Le cadre de cette critique acerbe : un groupe d’individus
représentant l’élite culturelle chilienne célèbre, un premier mai, alors que des
mouvements protestataires envahissent les rues, la nomination de l’un d’entre eux au
poste de Ministre de la Culture. Seulement, le ministre nouvellement nommé se cloître
dans sa chambre et refuse de participer aux réjouissances et quand il la quitte enfin, c’est
pour proposer un tout nouveau programme dont l’acte premier est d’évincer du
ministère l’élite dont il fait partie.
6 Comparant le monde politique et l’entre-soi qui l’agite à une scène de théâtre, le metteur
en scène donne à voir les coulisses presque invisibles du spectacle, par l’objectif d’une
caméra dont les images prises en direct sont diffusées à jardin. Habillage, maquillage,
discussions sont exhibés aux yeux des spectateurs par l’entremise de cette vidéo qui joue
de la frontière entre réel et fiction, présentant les différents personnages à la manière
d’un générique. Ces individus se préparent à entrer sur la scène politique et sociale tout
comme on entre sur le plateau de théâtre, dans un rythme effréné qui essoufflera le
public jusqu’à la dernière seconde.
7 La dialectique du caché/dévoilé qui ouvre le spectacle se déploie tout au long de la pièce
par le biais d’une caméra à l’épaule qui suit les déambulations des comédiens dans une
scénographie labyrinthique pour le spectateur. Dégageant deux espaces distincts que sont
le proscenium et une structure cloisonnée en fond de scène, Marco Layera expose le
clivage du moi social et de l’intime. Quand un personnage quitte le champ visuel du
spectateur, la caméra prend le relais et, tel un paparazzo, le poursuit et agit en révélateur
de son malaise, son angoisse, son narcissisme ou encore son machiavélisme.
8 Dans cette pièce où les masques recouvrent les masques, le spectateur peine à s’identifier
à un propos. Le nouveau ministre de la Culture désire mettre à l’écart le microcosme
autocentré que compose sa « cour » mais son alternative, loin d’être convaincante,
s’engouffre dans la brèche populiste. Les prises de parole des uns des autres ne seront que
tentatives de manipulation, chacun désirant être propulsé au-devant de la scène, comme
ce personnage derrière lequel on croit reconnaître l’esquisse d’Angelica Liddell et qui,
dans une tentative désespérée mêlant geste performatif et séduction tentera vainement
de conserver sa place.
9 Des bains de champagne aux nez recouverts de cocaïne, les images de fête se succèdent.
Entassés dans un espace réduit, les comédiens, que l’on discerne à peine, jouent la fête
face à la caméra, au son d’une musique clubbling qui chahute nos tympans. On les voit
boire, entamer des préliminaires sexuels, danser, se droguer, le tout dans un plan
séquence très mouvementé et resserré, caméra à l’épaule, qui illustre à merveille la
frénésie qui s’empare du groupe et qui les mènera à leur propre perte. Gros plans sur des
visages, une bouche hystérique, des corps en transe, des membres amassés. L’écran est
saturé de peau et de remous, étourdissant le spectateur. N’épargnant pas le milieu
théâtral dont il fait partie, Marco Layera ne fait l’économie d’aucune critique, usant de
clichés et de stéréotypes pour donner à voir l’exubérance et la décadence d’un milieu
qu’on ne peut s’empêcher de considérer abscons.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
98
10 Si ces personnages en huis clos se plaisent à penser le monde pour autrui, ils vivent reclus
dans leurs propres problématiques et sont complètement imperméables aux
bruissements du monde qui s’agite devant leur porte.
11 Et quand enfin la porte s’ouvre, quand la caméra quitte la salle et s’engouffre dans la rue,
quand une alternative se dessine, quand le spectateur espère une respiration, c’est une
bourrasque de violence qui l’emporte. La comédienne essoufflée conclut le spectacle par
une description enjouée des soulèvements populaires rappelant les pires heures de la
Révolution ou encore des actes barbares bien plus récents. Le chaos qui se dessine semble
n’épargner personne, de l’homme d’église à l’ouvrier en passant par le banquier ou
l’artiste. Tous sont en sang, tous se déchirent. Marco Layera n’est pas dupe et si la prise de
position du metteur en scène peut sembler obscure c’est justement parce qu’il met en
scène la difficulté de proposer une alternative et de se décentrer. Pas de solution,
seulement des explosifs disposés çà et là qui laissent au spectateur un champ de ruines
sur lequel méditer.
12 Au final, sur ce plateau peuplé des vestiges d’une soirée de débauche, un seul personnage
demeure, qui ne viendra pas saluer les spectateurs, qui ne prendra pas part à la
révolution qui agite les rues, qu’on aura pourtant vu traverser la scène à plusieurs
reprises dans un costume d’ours en peluche, un balai à la main. La femme de ménage,
unique figure stable durant la représentation, moquée par les autres, sans droit de
réponse, reste debout et continue de s’activer au plateau quand tous les autres, absents et
à terre, sont rattrapés par la violence d’un monde qu’ils ont tenté en vain d’ignorer.
NOTES
1. Mise en scène : Marco Layera ; texte : La Re-Sentida ; scénographie : Pablo de la Fuente ;
musique : Alejandro Miranda. Avec Diego Acuña, Benjamín Cortés, Carolina de la Maza, Pedro
Muñoz, Carolina Palacios, Benjamín Westfall. Spectacle créé à Santiago du Chili en juin 2016 ;
Festival d’Avignon 2016, Gymnase Aubanel, 18-24 juillet 2016.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
99
Carnet des spectacles et des professionnels
Portraits de compagnies
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
100
« Le rire est le meilleur remède
contre la peur ». Constantin
Bogomolov, « enfant terrible » de la
scène russe
Christine Hamon-Sirejols
1 Le 16 avril 2015 paraissait dans le journal Le Monde un article relatant un événement
récent. Une immense banderole avait été placardée à Moscou, face au bâtiment du
ministère de la culture, pour interpeller les pouvoirs publics d’un agressif : « Avons-nous
besoin de cette culture ? » et dénoncer, photos à l’appui, quatre artistes : le galeriste
Marat Guelman et trois metteurs en scène – Kirill Serebrennikov pour s’être « moqué des
icônes » dans un récent Coq d’or, Timofeï Kouliabine pour son Tannhäuser jugé
blasphématoire et Constantin Bogomolov pour avoir « offensé les bonnes mœurs » dans
son Mari idéal. Cette manifestation revendiquée par un collectif dont les membres
demeurent anonymes serait de peu d’importance si ce groupe qui signe « Glavplakat »
n’avait pris l’habitude de dénoncer par ce biais tous les opposants au régime accusés de
former une « cinquième colonne » chargée par l’Occident de déstabiliser la sainte Russie.
Le fait que le portrait de Boris Nemtsov, l’opposant assassiné en février 2015, ait fait
l’objet d’un pareil traitement peu de temps avant sa mort pouvait susciter une légitime
inquiétude.
2 Constantin Bogomolov pour sa part ne semble pas s’en être beaucoup inquiété, habitué
qu’il est aux attaques qui pleuvent depuis quelques années sur ses spectacles dénoncés
par les réactionnaires de tous bords : partisans de Poutine, ultra-orthodoxes, défenseurs
de l’ordre moral, etc. Il est vrai que la culture est depuis quelques temps sous haute
surveillance en Russie et soumise à toutes sortes d’interdits qui peuvent faire sourire en
France mais qu’il peut s’avérer dangereux d’outrepasser. C’est ainsi qu’il est non
seulement défendu de faire l’« apologie » de l’homosexualité – ce dont les journaux
occidentaux se sont largement fait l’écho – mais aussi d’employer des jurons dans la
presse, au cinéma et sur scène, aussi bien que d’y parler le mat, l’argot venu des camps si
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
101
largement utilisé dans la littérature russe de la fin du XXe siècle. À l’instar du chef de
l’État, l’art se doit d’être « correct » en toutes circonstances, ce dont ne manque pas de se
moquer la blogosphère aussi bien que le monde artistique. Cependant, les seuils de
tolérance varient suivant le lieu et le moment et, si de nombreux spectacles bravent
l’interdit de la nudité dans des espaces de représentation un peu marginaux, la critique
de l’église ou l’évocation de l’homosexualité sont très mal tolérées dans des lieux plus
officiels. Il en va ainsi du Théâtre artistique de Moscou, monument de la culture russe
fondé par Stanislavski et dirigé actuellement par Oleg Tabakov, artiste du peuple de l’ URSS
, acteur émérite, découvreur de talents, mais aussi soutien de Poutine aux dernières
élections. Comment dans un tel contexte, un spectacle comme Un mari idéal a-t-il pu voir
le jour en février 2013 ? C’est sans doute l’un des paradoxes de la Russie qu’il ait été toléré
comme le furent autrefois les spectacles de Lioubimov à la Taganka. Mais cet état de
choses ne pouvait pas durer et Les Karamazov, production suivante de Bogomolov au
Théâtre artistique en novembre de la même année, ont dû subir des coupes avant d’être
autorisés par la direction, entraînant peu après le départ du metteur en scène. Cela n’a
pas empêché Un mari idéal, nominé à peu près dans toutes les catégories pour le célèbre
Masque d’or de 2014 (mais couronné seulement du prix de la critique), d’être invité au
festival de Gwangju en septembre 2015 à côté d’autres spectacles de Wilson, Régy,
Marthaler, Kentridge, etc., et aux Wiener Westwochen au printemps 2016. Espérons que
cette reconnaissance internationale serve de paratonnerre au metteur en scène pour
quelque temps…
Une reconnaissance artistique marquée par les
scandales
3 Le nom de Bogomolov, encore presque inconnu en France, ne défraye vraiment la
chronique en Russie que depuis quatre ou cinq ans. Il est considéré comme l’un des plus
grands de sa génération. Né en 1975, fils d’un critique de cinéma célèbre, Constantin
Bogomolov a tout d’abord fait des études de littérature et commencé une thèse avant
d’entrer au GITIS dans la classe de Gontcharov. Il en est sorti en 2003, a mis en scène
quelques spectacles à Moscou et en province, puis a été engagé dans le studio théâtre de
Tabakov, la « Tabakerka », véritable pépinière de talents où il a rencontré plusieurs des
acteurs qui l’accompagnent aujourd’hui parmi lesquels sa femme Daria Moroz. Nominé en
2010 au Masque d’or pour Le Fils ainé, il s’est vraiment fait remarquer l’année suivante avec
Wonderland 80 d’après Lewis Caroll et Serge Dovlatov. Mais le premier choc critique est
sans doute lié à sa mise en scène de Lear Comédie d’après Shakespeare au théâtre l’Abri des
comédiens, à Saint-Petersbourg en 2012. Dans ce spectacle qui connut un rapide succès en
Pologne au festival Shakespeare, puis au festival Da!da!da! de Varsovie en 2014, Lear/
Staline, rongé par le cancer, était interprété par une femme, l’étonnante Roza Khairullina,
visage émacié, cheveux blancs en brosse, voix cassée de fumeuse, gestes rares et
tranchants, qui depuis 2009 joue dans presque tous les spectacles de Bogomolov. Régane,
Goneril et Cordélia étaient jouées par des hommes. Lear et Edgar (présenté comme juif)
étaient internés dans un asile soviétique destiné aux opposants politiques, mais à la fin de
la pièce, Lear reprenait le pouvoir grâce à l’intervention de sa fille Cordélia, arrivée en
Russie à la tête d’un régiment de SS commandé par son mari. Bogomolov expliquait à
cette époque que stalinisme et nazisme étaient pour lui les deux fléaux qui avaient
également imprimé leur marque funeste sur l’Europe et généré le cynisme désespéré du
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
102
monde contemporain. Déjà dans ce spectacle, le metteur en scène avait truffé le texte de
Shakespeare de passages empruntés à Paul Celan, à Nietzsche, à Chalamov, à un poète juif
de Czernowitz, mais aussi de textes médicaux sur la psychiatrie punitive soviétique ou
« l’immortalité » des cellules cancéreuses, car Roza Khairullina ne jouait pas seulement
Lear et Staline, elle jouait aussi le cancer qui rongeait le roi et son pays, cancer dont
Cordélia et son époux nazi prétendaient le débarrasser. Ainsi renvoyés dos à dos, les
personnages multiples de cette sombre comédie se retrouvaient au finale, situé après la
guerre, pour un repas mêlant sans distinction vivants et morts, dans un monde dont Dieu
serait pour l’éternité absent.
4 Si la complexité de ce collage laissa nombre de spectateurs perplexes, la mise en scène de
L’Année où je n’étais pas né d’après une pièce de Victor Rozov suscita une franche
polémique. L’action s’y déroulait dans l’appartement d’un puissant membre du parti dont
les pièces étaient surveillées en permanence par des caméras figurant le regard de
l’enfant avorté observant sa famille trente-six ans plus tard. Dans ce dispositif de reality
show, les non-dits et les mensonges s’exhibaient sur les écrans en gros plans silencieux
montrant clairement la faillite du post-communisme symbolisée par le strip-tease final
d’une jeune pionnière sur fond de défilé patriotique le Jour de la Victoire.
Un mari idéal : une tumultueuse consécration
5 Après le scandale suscité par cette représentation métaphorique du cynisme de la Russie
nouvelle, la possibilité d’une collaboration avec le très officiel Théâtre artistique semblait
bien compromise. Cependant, Bogomolov reçut l’autorisation de monter Un mari idéal.
Sans doute voyait-on mal quel traitement iconoclaste il allait pouvoir faire subir à la pièce
d’Oscar Wilde. Dans un pays de grande tradition théâtrale, mais très peu réceptif à
l’esthétique du théâtre allemand contemporain (les spectacles de Castorf y ont été mal
accueillis), il était difficile d’imaginer pareil traitement de la pièce anglaise. Bogomolov
avait en effet choisi d’associer l’intrigue d’Un mari idéal avec celle du Portrait de Dorian
Gray, de les assaisonner d’extraits de Tchékhov et de Shakespeare, de références à
Tarantino, et de transposer le tout dans la Russie contemporaine. Le héros devient ainsi le
puissant ministre Robert Ternov, ex-mafieux marié à une oligarque et Dorian Gray, le
président de la Russie qui arbore la couronne des tsars et fait réaliser son portrait par un
peintre célèbre afin de conserver éternellement jeunesse et pouvoir. Quant au crime jadis
commis par le héros, un délit d’initié qui fait l’objet d’un chantage dans la pièce de Wilde,
il devient la relation homosexuelle qu’entretient en secret Robert Ternov avec Lord,
ancien gangster, devenu star de la pop music. Ce dernier, interprété par l’étonnant Igor
Mirkournabov, s’identifie facilement au chanteur Philipp Kirkorov dont l’acteur reprend
de nombreux « tubes ». De son côté Gertrude, la femme de Ternov, vêtue d’un jogging
blanc décoré des armoiries rouge sang de la Russie impériale et portant le même motif
tatoué sur le corps, évoque nettement Alina Kabaieva, championne olympique de
gymnastique devenue femme politique et présumée maîtresse de Vladimir Poutine.
Ajoutez à cela l’introduction de plusieurs personnages : le pope Artem, fidèle ami de
Ternov et de Dorian Gray qui les accompagne partout y compris pour skier (à Sotchi ?) et
qui prie à genoux devant une femme nue crucifiée, le « dernier intellectuel » qui voudrait
conseiller Dorian Gray mais qui se fait tuer par lui, deux jumeaux clones d’Andy Warhol et
les élégantes « Trois sœurs », bien arrivées à Moscou en provenance de Rostov, Minsk et
Toula, qui devisent dans le très chic « café Vogue » de leur désir irrésistible de travailler,
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
103
et vous aurez une idée du maelstrom provocateur dans lequel Bogomolov embarque son
public quatre heures trente durant. Tout y passe : le tandem Poutine-Medvedev traité
comme un couple homosexuel très uni (dont l’amour est même célébré au finale avec des
extraits de Roméo et Juliette), la mise en scène permanente du pouvoir et l’obsession prési
dentielle d’apparaître toujours plus jeune et plus sportif dans les médias, l’omniprésence
du clergé orthodoxe, le moralisme étroit infligé à la société, mais aussi tous les mythes
sur lesquels s’appuie la Russie nouvelle qui vont de la récupération de Tchékhov à
l’exaltation des Romanov en passant par le sport, objet d’un culte national permanent.
Dans une interview donnée en 2013 à la revue Snob, Bogomolov explique que le théâtre
doit rompre avec le modèle de « cathédrale de l’art » et revenir à ses origines
carnavalesques, jouer du grotesque et du travestissement afin de mieux parler du monde
contemporain. Un mari idéal est bien l’éclatante démonstration de ce programme
artistique. Un programme que le metteur en scène a poursuivi dans Les Karamazov, puis
dans Boris Godounov monté au Théâtre du Lenkom auquel il est associé depuis son départ
du Théâtre artistique.
L’art de « faire rendre gorge » aux classiques
6 L’adaptation du roman de Dostoïevski aurait pu paraître plus sage dans la mesure où
Bogomolov semblait renoncer au collage de textes allogènes, mais c’était pour mieux
recourir à d’autres effets choc reposant sur l’image et le son. Dans cette nouvelle
adaptation, le roman dont l’intrigue et des pans entiers de dialogues étaient conservés se
transformait en une peinture très noire de la Russie profonde, violente et obscurantiste,
soumise à l’emprise d’une religion dont l’hypocrisie éclatait sur l’écran géant à travers les
discours lénifiants du frère Zossim. En projetant des commentaires ironiques rédigés dans
le style des contes de fée, en modifiant les voix des acteurs, en truffant le spectacle de
célèbres romances populaires ou d’extraits de Nick Cave et de Queen en total décalage
avec l’action, en jouant d’images scéniques violentes évoquant Orange mécanique,
Bogomolov faisait du roman de Dostoïevski une sorte d’évangile noir comme le décor et
les costumes, une peinture sombre et amère de la Russie d’hier et d’aujourd’hui sur
laquelle triomphait au finale l’inquiétante figure du diable interprété par Igor
Mirkourbanov. Cette relecture de Dostoïevski n’était pas de nature à satisfaire le public
du plus officiel théâtre de Russie et Bogomolov fut prié d’apporter quelques modifications
au spectacle. Cela retarda la première, mais n’empêcha pas le scandale.
7 Dans Boris Godounov créé en 2014, Bogomolov s’attaquait à un autre monument de la
culture russe. La pièce de Pouchkine offrait bien sûr l’occasion de parler du pouvoir et de
son usurpation, cette fois dans un élégant décor high tech où les nouveaux maîtres du
Kremlin s’adonnaient à d’interminables beuveries, mais aussi la possibilité de poursuivre
un démontage des mythes de la culture nationale à travers la projection sur grand écran
d’images très « kitsch » de la campagne russe ou encore la reproduction de tableaux
célèbres des « Peintres ambulants ». Insérés dans le décor, des écrans plasmas montraient
quant à eux en gros plans les acteurs filmés en direct, mais aussi des images de publicité
ou d’actualités télévisées comme celles de la prise de pouvoir de Poutine en 2012 où l’on
pouvait voir le cortège circuler dans les rues désertes de Moscou au moment du
couronnement du faux tsarevitch Dimitri, interprété par Igor Mirkourbanov. Le parallèle
était d’autant plus saisissant que Bogomolov avait auparavant eu recours à un procédé
destiné à « taper rythmiquement » sur les nerfs des spectateurs1. Durant de longues
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
104
minutes, sur la scène vide et dans un silence total, le public voyait se succéder sur les
écrans plasma différents messages : « le peuple se rassemble sur la place », « ils attendent
patiemment », messages longuement projetés et dix fois répétés jusqu’à ce que les
spectateurs crient leur impatience. Mais quelle meilleure actualisation aurait-on pu
trouver de l’énigmatique formule finale de Pouchkine, au moment de la prise de pouvoir
de l’usurpateur : « le peuple se tait » ?
Consécration internationale et nouveaux projets
8 Si les spectacles de Bogomolov se distinguent aujourd’hui dans le paysage théâtral russe
par leur lucidité politique et leur audace, c’est aussi parce qu’ils témoignent d’une
inventivité formelle constante qui présente de nombreuses affinités avec le théâtre
d’Europe occidentale, notamment celui de Warlikowski, tout en s’inscrivant dans une
tradition satirique bien ancrée dans le théâtre populaire. Le collage/montage de textes de
toutes sortes, les références à la culture pop, les accents trash de certains passages, les
scénographies toujours confiées à Larissa Lomakina qui évoquent souvent celles de
Malgorzata Szczesniak2, l’usage fréquent de l’écran géant ou des écrans multiples
montrent bien que Bogomolov regarde beaucoup du côté de la Pologne et de l’Allemagne
où il a été plusieurs fois invité, mais il a su donner à ses spectacles un accent original en
mettant l’histoire contemporaine de la Russie au cœur de sa réflexion critique. Il a
également réussi à regrouper autour de lui des personnalités qui tranchent sur celles des
acteurs issus des écoles traditionnelles russes. À côté de sa femme Daria Moroz, actrice du
Théâtre artistique et pur produit d’une formation classique, il a rassemblé des acteurs
comme Roza Hairoullina, venue du Théâtre pour la jeunesse de Kazan, qui a développé un
art étonnant de la présence muette sur scène ou encore Igor Mirkourbanov, formé
comme chef d’orchestre au conservatoire de Novorossisk, entré ensuite au Gitis dans la
classe de Gontcharov, membre dès sa fondation en 1992 du théâtre Gesher de Tel Aviv où
il joua six ans durant en russe et en hébreu – un acteur capable de jouer d’une palette
vocale très riche et de déployer sur scène une énergie de rocker, aussi bien que de se tenir
longuement immobile, affalé en robe de bure dans un coin de la scène, attendant son
heure telle une araignée géante, dans le rôle du jeune moine usurpateur du trône
impérial.
9 Outre l’inventivité constante de la mise en scène, c’est en effet la direction d’acteurs qui
est le plus souvent remarquée dans les spectacles de Bogomolov. Le fait qu’il demande à
ses comédiens de ne pas incarner un personnage mais de jouer des situations, de créer
des ruptures de jeu, de construire un rythme est un peu déstabilisant pour des acteurs
formés à une approche psychologique des rôles au Gitis ou à l’école du Théâtre artistique ;
néanmoins cette approche commence à devenir familière à travers les productions
d’artistes comme Ostermeier, Nekrosius, Warlikowski, Perceval, invités ces dernières
années à montrer leurs spectacles à Moscou, ou à mettre en scène des acteurs russes dans
des reprises ou des créations originales.
10 Ainsi se constitue peu à peu une jeune garde théâtrale davantage tournée vers l’Europe
occidentale, alors que la génération précédente, celle des Fomenko ou des Dodine avait
plutôt servi de référence en Occident (en France du moins) au cours des décennies
antérieures. À l’heure où j’écris cet article, Constantin Bogomolov, après avoir présenté
plusieurs mises en scène à l’étranger semble vouloir se tourner vers le cinéma. En
septembre 2013, il a présenté au théâtre Maly de Vilnius un montage de textes d’Euripide
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
105
centré sur Iphigénie en Aulide et intitulé Mon Père Agamemnon, spectacle dans lequel il
dénonce la violence des pères et le sacrifice des enfants (et particulièrement des filles)
comme fondement de la civilisation judéo-chrétienne. En janvier 2014, il a monté Ice, une
adaptation du roman de Sorokine au théâtre national de Varsovie. Il a également mis en
scène Platonov au théâtre Stary de Cracovie en décembre 2015, faisant jouer les rôles
d’hommes par des femmes et inversement – toujours avec l’intention de dénoncer le sort
réservé aux femmes dans la société occidentale et, en avril 2016, Un mois à la campagne de
Tourguéniev au théâtre de Lipaja, en Lituanie. Parallèlement, il mettait en scène au
Lenkom Le Prince, une adaptation de L’Idiot de Dostoïevski dont il assurait le rôle principal
et jouait dans Machine Müller mis en scène par Kirill Serebrennikov. Ce retour au travail
d’acteur marquerait-t-il une nouvelle étape dans la parcours de Bogomolov ? Cela paraît
peu probable car il lui est déjà arrivé de reprendre des rôles dans plusieurs de ses
spectacles.
11 En revanche, son intérêt croissant pour la vidéo semble l’avoir mis sur la voie du cinéma.
Il annonce en effet pour 2017 la sortie de Nastia d’après une nouvelle de Sorokine et le
tournage d’un autre film tiré de sa mise en scène de L’Année où je n’étais pas né. Mais le
récit de Sorokine décrivant le festin anthropophage auquel se livrent les parents et les
proches d’une jeune fille, victime consentante d’un sacrifice rituel, suscite déjà des
réactions. Comme il y a peu dans (A)pollonia de Warlikowski, le motif du sacrifice revient
chez Bogomolov en métaphore du mal qui, sous couvert de religion, gangrène la société
occidentale. Une lecture des mythes fondateurs qui n’est pas du goût de tout le monde.
12 À la fin du mois d’août 2016 des activistes orthodoxes ont en effet demandé l’interdiction
du film. Difficile de dire aujourd’hui ce qu’il adviendra de Nastia. Du moins pouvons-nous
souhaiter que Bogomolov puisse un peu desserrer l’étau politique qui contraint ses
recherches et que le public français ait prochainement l’occasion de découvrir le travail
de cet artiste à bien des égards exceptionnel…
NOTES
1. Selon la formule d’Eisenstein dans son Montage des attractions de 1924.
2. Scénographe de Warlikowski.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
106
Carnet des spectacles et des professionnels
Vie de festivals
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
107
Entretien avec Guillaume Dujardin,
directeur du « Festival de caves »
Propos recueillis par David Ball
Guillaume Dujardin et David Ball
NOTE DE L’ÉDITEUR
Après cinq ans au Centre Dramatique National de Besançon sous la direction de Michel
Dubois, Guillaume Dujardin a fondé sa propre compagnie théâtrale, Mala Noche et, quatre
ans plus tard, a organisé son premier Festival de caves. Il a aujourd’hui une grande
variété d’activités au sein du monde théâtral franc-comtois. Nous allons ici nous
intéresser à sa direction du Festival de caves, initiative remarquable et originale, basée à
Besançon mais au rayonnement aujourd’hui national avec plus de quatre-vingts
communes en France et en Suisse et qui a fêté ses dix ans d’existence en 2016.
Comment le Festival de caves a-t-il commencé ?
C’était une commande du Musée de la Résistance, en 2005, pour célébrer – même si le
mot célébrer semble un peu étrange – les soixante ans de la libération des camps. Et
comme j’avais déjà travaillé sur le sujet au Centre Dramatique National de Besançon, le
Musée m’a proposé assez naturellement de travailler dessus. Nous avons inventé un
spectacle qui s’appelle Le Journal de Klemperer, un texte qui parle de la vie quotidienne
sous Hitler. Nous avons joué le spectacle pour la première fois dans la cave de la
Préfecture à Besançon, et toute la dramaturgie du spectacle – le rendez-vous en ville,
l’aspect secret, emmener les gens à pied sans qu’ils sachent où ils vont, une forme
d’écoute – tout cela a été un projet passionnant, et nous a donné l’envie d’inventer un
Festival de théâtre dans des caves. Le Festival de 2006 proposait quatre spectacles, je
crois, en quinze jours. Aujourd’hui il y a trente spectacles pour trois cents
représentations dans quatre-vingts villes.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
108
Quels sont les facteurs qui ont favorisé son succès aux niveaux local et national ?
Je ne sais pas ! Rien n’était prévu mais il y avait quand même la chance de travailler
avec de très bons comédiens. Il le faut d’ailleurs, parce que, avec les spectateurs si
proches, cela ne pardonne pas. Un autre enjeu également était le fait de proposer la
même chose à la campagne qu’à la ville. J’en ai ras-le-bol du mépris de la campagne. De
toute façon, il y a beaucoup de citadins qui vivent à la campagne. Proposer une petite
pièce de Molière à la campagne et quelque chose de contemporain en ville n’est plus
possible. Intervenait de plus le facteur personnel et intime parce que les gens nous ont
accueillis chez eux. La simplicité de la rencontre. Et puis la proximité. Dans des caves, il
est difficile d’être un consommateur de la culture. C’est un peu comme le plaisir de se
trouver tout seul dans un musée de province face-à-face avec un Mantegna ou avec un
Monet. On a le temps de regarder. Il n’y a pas de téléphones portables – le réseau ne
passant pas dans les caves –, il n’y a pas de groupes scolaires. Ça crée une écoute
différente et nous donne la possibilité de faire des choses plus difficiles, et aux gens, à
dix-neuf personnes, la possibilité d’écouter. Ils ne vont pas dans une cathédrale
culturelle. Ils viennent juste pour écouter un texte, voir des acteurs. C’est une autre
façon d’aller au théâtre.
Comment cet événement national est-il structuré et organisé aujourd’hui ?
La base du Festival, ce sont les comédiens, une dizaine, qui sont engagés pour la durée
des événements. Nous invitons des metteurs en scène à travailler avec nos comédiens et
ensemble nous créons un spectacle. Puis, partout en France, dans les villes, les villages
ou chez des particuliers, ce sont nos créations qui sont accueillies dans les caves.
Chaque cas est différent : à Orléans c’est un architecte, à Paris un particulier, à Amiens
et à Neuchâtel c’est un théâtre, à Bordeaux et à Aix-en-Provence c’est une compagnie, à
Montpellier c’est une comédienne. On a besoin de très peu de choses techniques. Tout
part de Besançon et rayonne à partir de là. Nous sommes accompagnés financièrement
bien sûr par beaucoup de partenaires (État, Région, Département, Ville, Grand
Besançon…). Les comédiens sont des salariés du Festival, et les metteurs invités sont
financés par leurs propres compagnies. Nous coproduisons le spectacle, qui
appartiendra, après le Festival, à la compagnie invitée.
Un spectacle typique du Festival de caves est un monologue tiré d’un livre, la prestation par
un seul acteur qui se rapproche davantage de la lecture ou de la conférence que de la pièce
de théâtre au sens strict. Est-ce néanmoins une expérience pleinement théâtrale ?
Je ne suis pas d’accord avec ce que tu dis. Cette année par exemple, il y a plus de
dialogues que de monologues. Il n’y a qu’un seul spectacle en forme de lecture et c’est
celui de Klemperer. Tous les autres sont des incarnations. Aujourd’hui les incarnations
l’emportent largement sur les narrations. En plus, cette année les pièces de théâtre sont
plus nombreuses que les spectacles tirés des romans. Mais ça dépend des années. Dans
une cave, trois acteurs, c’est le maximum !
Une spécificité du Festival est l’absence d’un processus systématique de sélection. Les
propositions des metteurs en scène sont acceptées telles quelles. Comment expliques-tu
une telle absence de contrôle ?
D’abord je constate que dans les théâtres où il y a de la sélection, il y a quand même de
mauvais spectacles. Qui a le droit de sélectionner ? Quel est ce métier de sélectionneur ?
Les structures de sélection ont si souvent tort : le prix Goncourt, le Salon des refusés.
J’ai tendance à croire que plus je laisse de la liberté aux metteurs en scène et aux
comédiens, plus ils peuvent faire travailler leur imaginaire. Dans les contraintes,
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
109
évidemment, que les lieux imposent. Ce qui permet d’avoir le Festival le plus foisonnant
possible. Mon goût à moi n’a aucun intérêt.
Dans ta vie à toi d’homme du théâtre tu as, je le sais, une grande variété de rôles : directeur
de la compagnie Mala Noche et du Festival de caves, metteur en scène, surtout aux Nuits de
Joux en été, enseignant universitaire, animateur de stages et j’en passe. Comment arrives-
tu à faire rimer toutes ces activités différentes ?
C’est effectivement un problème. Je suis très bien entouré. Autant que possible, je garde
mes matinées libres pour lire, réfléchir, chercher. Et ce qui est une vraie facilité pour
moi, c’est que je travaille vite. J’ai une capacité de concentration, un esprit qui va vite,
je suis fait comme ça !
Enfin, comment vois-tu l’avenir, du Festival d’abord et puis de ta propre carrière au théâtre ?
L’avenir du Festival, je ne le connais pas. Il faut veiller à rester comme nous sommes.
J’adore cette idée de travailler avec les mêmes personnes depuis dix ans. Ça me plaît
beaucoup, cette fidélité des comédiens. Laissons la vie décider pour nous. Gardons cet
esprit. J’aime beaucoup ce mot de Howard Barker : « Nous sommes payés pour
imaginer ». Le théâtre ne sert à rien si ce n’est à proposer de l’imagination ! C’est du
superflu et en même temps c’est essentiel. À titre personnel, j’ai très envie de mettre en
scène une des dernières pièces de Howard Barker qu’il vient de m’envoyer…
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
110
Les Rencontres internationales du
Théâtre universitaire de Franche-
Comté
David Ball et Axelle Baux
1 Cinq jours voués au Théâtre, incluant des représentations, des conférences, des ateliers et
des réflexions sur la mise en scène, sur l’improvisation, sur la danse, les Rencontres
Internationales du Théâtre Universitaire se sont déroulés à Besançon, à l’automne 2015,
en choisissant de mettre « L’Europe à l’honneur ». La manifestation s’est déployée sur
quatre lieux différents : au Théâtre de la Bouloie, à la Maison des Étudiants, au Petit
Kursaal et au Centre de Linguistique Appliquée, mais également sur la place publique
(place Granvelle). David Ball et Axelle Baux, membres du TU, se font l’écho pour nous des
spectacles présentés. Annuel, l’événement existe depuis 19901.
Éclats, TUFC, Besançon, mise en scène : Joseph
Melcore, le 28 septembre 2015
2 Éclats – le mot est ici bien choisi, tant les acteurs étudiants s’éclatent en mimant les forces
physiques qui font la lumière. Vision scientifique et allégorie artistique, la lumière est
traversée dans tous ses états. Grâce à ce savant collage qui reflète les différents aspects de
la lumière, les comédiens nous conduisent d’un seul souffle jusqu’au questionnement
final : l’utilisation que nous faisons de celle-ci. Le spectateur prend alors conscience de
l’importance de la lumière dans l’histoire de l’humanité jusqu’à aujourd’hui.
3 Comme toujours c’est un travail collectif que le TUFC nous présente, sans personnages,
sans intrigue linéaire, et presque sans décor, mais avec énergie, invention et engagement.
C’est un spectacle qui fait partie aussi des activités universitaires en célébration de
l’année internationale de la lumière. Ce n’est donc pas une pièce mais plutôt une
exploration, une réponse collective à la question : si je te dis « lumière », à quoi vas-tu
penser ? À l’électricité, aux lois de la physique, à la relativité mais aussi à la peinture, à
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
111
l’arc-en-ciel et puis, peut-être, à la lumière métaphorique du sourire, du bonheur, de la
vérité. Il y a tout de même quelques éléments d’histoire qui se mettent en place : l’histoire
de l’univers, du monde, des idées. Le rythme endiablé du spectacle est celui du contraste :
entre l’individu et le groupe, entre les dialogues et la musique, entre le scientifique et le
poétique. Et il y a bien sûr des effets variés de lumière, avec fenêtres et miroirs, qui
jettent, comme il se doit, la lumière du jeu et de ses jeunes visages vers le public, un
public qui a, de toute évidence, bien apprécié cette joyeuse présentation.
I am Lucien, l’université de Brno, République tchèque,
mise en scène : Kamila Kostricova, le 29 septembre
2015
4 Une entrée en jeu remarquable : la naissance du héros mimée par la mère perchée au
sommet d’un escabeau, ses jambes couvertes d’un immense drap, de derrière lequel
émerge l’acteur qui joue le fils. Nous comprenons ensuite que son enfance va être
turbulente : tour à tour victime et bourreau. Il connaît plus tard des histoires d’amour, et
commence à exercer de l’influence sur les jeunes qui l’entourent, une influence
symbolisée, avons-nous appris après le spectacle, par un maquillage badigeonné sur les
bouches. Le pouvoir et ses abus sont les points d’ancrage principaux de la pièce. Les
comédiens nous conduisent dans une atmosphère de plus en plus sombre. À chaque pas
fait par le personnage principal pour atteindre le pouvoir, il tombe dans la folie. La pièce
est donc l’histoire d’une montée sociale mais aussi d’une déchéance personnelle.
5 Il n’y a pas de décor : les neuf acteurs remplissent le plateau de leur seule présence, des
acteurs dont il faut saluer le courage et la compétence. Leur point de départ : la nouvelle
de Jean-Paul Sartre, « L’Enfance d’un chef », nouvelle qui raconte la lente formation d’un
futur patron, prénommé en effet Lucien, qui essaie d’assurer son autorité virile par un
antisémitisme brutal.
Au-dessus de cinq pots de fleurs cassés, l’université de
Saint-Pétersbourg, le 30 septembre 2015
6 Les deux acteurs du spectacle, dans l’espace intime d’une petite salle, entourés du public,
nous ont émus par la sincérité de leur engagement. Ils chantent, dansent, mais chacun
seul, et quand ils parlent, c’est en monologues, ce qui crée une forte impression de
solitude individuelle, chacun dans son monde, sa bulle, seul avec ses obsessions.
7 Et encore une fois, il n’y a pas de décor. Quelques accessoires : une chaise, un drap. Mais
c’est tout ce qu’il a fallu au couple russe pour nous emmener voyager à travers des plaines
slaves. Un savoureux mélange de chant et de poésie composé sur scène comme une
chorégraphie de langue. La barrière linguistique ne nous empêche pas de comprendre le
spectacle. La langue russe nous berce pendant une heure et demie avec des tons de voix
graves, angoissés ou parfois résignés.
8 Sous les yeux des spectateurs les comédiens s’exercent à des passations d’émotions entre
eux et avec le public. Et puis, dans un moment de dialogue d’un ton plus apaisé, les
acteurs, tenant chacun un bout du drap, parlent enfin face-à-face. C’est peut-être le point
fort de ce spectacle touchant et plein de surprises.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
112
Equilibrium, l’université de Vilnius, Lituanie, mise en
scène : Andrius Pulkauninkas, le 1er octobre 2015
9 Un spectacle de danse. Huit jeunes danseurs bien formés jouent avec seulement deux
accessoires, des cordes et une valise, les deux créant un effet de capture ou
d’enfermement. La danseuse émerge de la valise comme un escargot de sa coquille. La
musique qui les accompagne est répétitive, envoûtante, vaguement menaçante. Des
images filmées, souvent abstraites, sont projetées sur un écran au fond de la scène, qui
permet aussi les jeux d’ombres des danseurs situés derrière. Les costumes, gris foncé au
début, blancs vers la fin, portent devant et derrière des cercles d’une autre couleur. Des
cibles ? Non, le centre de l’ego de chacun, avons-nous appris plus tard. Les mouvements
des danseurs et leurs interactions semblent le plus souvent conflictuels, entre domination
et soumission. Quant au public, ce spectacle l’a, de toute évidence, subjugué.
D’absence, l’Académie de la Culture, Riga, Lettonie,
mise en scène : Jonathan Durandin, le 2 octobre 2015
10 Dans un décor de bric-à-brac, d’objets hétéroclites jonchant le sol, deux actrices jouent en
français plusieurs rôles de mère et de fille, parlant à l’occasion directement au public. Les
histoires, tirées des écrits de trois auteures françaises contemporaines, sont à la fois
compliquées et inquiétantes. Et nous prenons connaissance d’une d’elles de manière
originale : grâce à une feuille photocopiée et distribuée au public. C’est l’histoire tragique,
et vraie, d’une mère qui a tué son enfant pour lui épargner la souffrance de la vie.
L’absence du titre du spectacle est celle du père, de tous les pères, toujours présents,
cependant, tant ils restent les objets parfois de rejet, parfois de sollicitation. Il faut saluer
enfin la prestation des deux jeunes actrices, qui jouent admirablement dans une langue
étrangère.
11 La question des langues est, bien sûr, une spécificité de l’expérience des Rencontres
Internationales du Théâtre Universitaire. À cause de la barrière linguistique, nous avons
souvent à entendre des dialogues auxquels nous ne comprenons rien. Rien ? En faisant
attention à la tonalité, à l’expression vocale, nous avons souvent accès à une émotion, à
un état d’esprit, amplifiés et complétés par la mise en scène, les gestes et les accessoires.
Et puis, sur un tout autre plan, nous penserons peut-être à l’histoire de la tour de Babel,
pour refaire le deuil du paradis perdu d’une langue unique comprise de tous. Mais en
revenant plus vite à la réalité, nous serons émerveillés de nouveau par la variété
inépuisable des langues humaines. Et dans les discussions qui suivent les spectacles, il est
toujours possible d’obtenir des explications des aspects restés obscurs. Les questions,
normalement, ne manquent pas, les discussions continuant parfois plus longtemps que
les pièces.
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
113
NOTES
1. Pour une présentation exhaustive de ces rencontres, voir : Rencontres de 1990 à 2010, URL :
http://www.theatre-universitaire-fc.fr/les-ritu/archives-ritu ; Rencontres de 2011 à 2015, URL :
http://www.theatre-universitaire-fc.fr/les-ritu/presentation-ritu
Sken&graphie, 4 | Automne 2016
Vous aimerez peut-être aussi
- Analse Baudelaire - Les - Fleurs - Du - Mal - Les - Petites - VieillesDocument7 pagesAnalse Baudelaire - Les - Fleurs - Du - Mal - Les - Petites - Vieillesaglae lobbePas encore d'évaluation
- Une Poignée D ÉtoilesDocument8 pagesUne Poignée D ÉtoilesEzzeddine0% (1)
- DJ Okawari - Flower Dance Sheet MusicDocument4 pagesDJ Okawari - Flower Dance Sheet MusicItachiforever123100% (6)
- Noces de SangDocument20 pagesNoces de SangIsabelle PiconPas encore d'évaluation
- Galipette Initiation PDFDocument58 pagesGalipette Initiation PDFalrededoor73% (11)
- Derniere Danse Indila Comprehension Orale Regarder Une Video 65627Document2 pagesDerniere Danse Indila Comprehension Orale Regarder Une Video 65627Nico Nico100% (1)
- Dictionnaire du Théâtre: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire du Théâtre: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les Carnets Du Sous SolDocument15 pagesLes Carnets Du Sous SolJérémie Nzita-MambuPas encore d'évaluation
- THEATREDocument8 pagesTHEATREtahanPas encore d'évaluation
- ABSURDE ET DERISION DANS LE THEATRE EST-EUROPEEN Par Maguy AlbetDocument20 pagesABSURDE ET DERISION DANS LE THEATRE EST-EUROPEEN Par Maguy AlbetflorianmotPas encore d'évaluation
- Anna Gural-Migdal, Entre Naturalisme Et Frénétisme: La Représentation Du Féminin Dans "Le Calvaire"Document9 pagesAnna Gural-Migdal, Entre Naturalisme Et Frénétisme: La Représentation Du Féminin Dans "Le Calvaire"Anonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLe Spleen de Paris de Charles Baudelaire: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- NnanaDocument4 pagesNnanaKamilia GharibePas encore d'évaluation
- Claude Herzfeld, "Le Monde Imaginaire D'octave Mirbeau"Document96 pagesClaude Herzfeld, "Le Monde Imaginaire D'octave Mirbeau"Anonymous 5r2Qv8aonf100% (3)
- Jean-Pierre Vernant - Aux Racines de L'homme Tragique (PDF)Document7 pagesJean-Pierre Vernant - Aux Racines de L'homme Tragique (PDF)api-3837574Pas encore d'évaluation
- KD Picasso Le PointDocument4 pagesKD Picasso Le PointAnonymous DHta6iPas encore d'évaluation
- Rire A La RenaissanceDocument3 pagesRire A La RenaissanceVanessa TrustPas encore d'évaluation
- Édourad Schuré - Precurseurs Et RévoltésDocument249 pagesÉdourad Schuré - Precurseurs Et Révoltésdjibril KONEPas encore d'évaluation
- BR-La Mort en Ses Miroirs - Louis-Vincent ThomasDocument4 pagesBR-La Mort en Ses Miroirs - Louis-Vincent ThomascanPas encore d'évaluation
- 1886 Jean Moréas - Le SymbolismeDocument12 pages1886 Jean Moréas - Le SymbolismeGabriel Costa JalotoPas encore d'évaluation
- Histoire Comparée Des ArtsDocument7 pagesHistoire Comparée Des ArtsGiåm DonnetPas encore d'évaluation
- 04-Le Recentrage Pornographique.Document8 pages04-Le Recentrage Pornographique.Aurélien MarionPas encore d'évaluation
- Anna Gural-Migdal, L'Oxymore Du Primitif Dans "Le Jardin Des Supplices" - Entre Naturalisme Et ModernitéDocument12 pagesAnna Gural-Migdal, L'Oxymore Du Primitif Dans "Le Jardin Des Supplices" - Entre Naturalisme Et ModernitéAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Alain Badiou: La Tétralogie D'ahmedDocument62 pagesAlain Badiou: La Tétralogie D'ahmedHoussam el assimiPas encore d'évaluation
- Manque Fev 19 DPDocument21 pagesManque Fev 19 DPSafta BilelPas encore d'évaluation
- 5e Édition Du Festival Premiers ActesDocument22 pages5e Édition Du Festival Premiers ActesFrance3AlsacePas encore d'évaluation
- Arts et culture du Canada: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandArts et culture du Canada: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Dossier Artistique Tempête QUAI OUESTDocument7 pagesDossier Artistique Tempête QUAI OUESTmoussaouiPas encore d'évaluation
- BenhaimiDocument11 pagesBenhaimiChaima YalaouiPas encore d'évaluation
- Sujet Bac Francais 2016 Séries ES-SDocument7 pagesSujet Bac Francais 2016 Séries ES-SLeHuffPost01Pas encore d'évaluation
- Anne Cirella Urrutia - Brèche Absurdiste Dans Le Répertoire Du Théâtre de Jeunesse AméricainDocument17 pagesAnne Cirella Urrutia - Brèche Absurdiste Dans Le Répertoire Du Théâtre de Jeunesse AméricainthelitartcoPas encore d'évaluation
- Eloge Du TheatreDocument11 pagesEloge Du TheatreShant PrakashPas encore d'évaluation
- Dissertation FinaleDocument7 pagesDissertation FinaleChristian OrtizPas encore d'évaluation
- La Femme Et L Oiseau Aux 18e Et 19e Si Cles Dans La Litt Rature La Peinture Et La Musique PDFDocument232 pagesLa Femme Et L Oiseau Aux 18e Et 19e Si Cles Dans La Litt Rature La Peinture Et La Musique PDFMihaela GeorgescuPas encore d'évaluation
- Teatro Medieval Lo Trágico y Lo CómicoDocument10 pagesTeatro Medieval Lo Trágico y Lo CómiconigvePas encore d'évaluation
- Festival PoésieDocument12 pagesFestival PoésiesoniapalmaPas encore d'évaluation
- ARRABAL, Fernando - Fando Et Lis. Théâtre de La Croix Rousse (Lyon) - Bulletin 1 Octobre 1965)Document24 pagesARRABAL, Fernando - Fando Et Lis. Théâtre de La Croix Rousse (Lyon) - Bulletin 1 Octobre 1965)Gérard ReynePas encore d'évaluation
- Dospe Da La Visite La VieilleDocument13 pagesDospe Da La Visite La Vieillehugo05patroPas encore d'évaluation
- Préface de Cromwell ExtraitsDocument3 pagesPréface de Cromwell ExtraitsSachaPas encore d'évaluation
- 207825-Text de L'article-285834-1-10-20101215Document14 pages207825-Text de L'article-285834-1-10-20101215ibrahim mohamedPas encore d'évaluation
- Les Fleurs Du Mal: ÉTUDE TRANSVERSALEDocument4 pagesLes Fleurs Du Mal: ÉTUDE TRANSVERSALEmathilde gameiroPas encore d'évaluation
- Cours 4 - Theatre - Absurde2Document8 pagesCours 4 - Theatre - Absurde2Geo.Pas encore d'évaluation
- La Poétique Théâtrale Dans Le Cadavre EncercléDocument13 pagesLa Poétique Théâtrale Dans Le Cadavre Encerclénourelhoudabenahmed4Pas encore d'évaluation
- le malentendu-dernière versionDocument11 pagesle malentendu-dernière versionHamshigaa JekumarPas encore d'évaluation
- correction questions d'ensembleDocument2 pagescorrection questions d'ensemblemarianagmiranda04Pas encore d'évaluation
- Introduction Au Theatre Contemporain-3Document61 pagesIntroduction Au Theatre Contemporain-3ealainflPas encore d'évaluation
- Fantasmagie No. 2Document9 pagesFantasmagie No. 2marceemansPas encore d'évaluation
- Brochure Saison 23-24-1Document59 pagesBrochure Saison 23-24-1Éloi mertzPas encore d'évaluation
- Les Fleurs Du MalDocument4 pagesLes Fleurs Du MalAlbertaMozzarelliPas encore d'évaluation
- Romantique Poète Parlant Des FemmesDocument18 pagesRomantique Poète Parlant Des Femmesben sylvanus ezanni FAMIENPas encore d'évaluation
- Germinal de Zola - Partie V, chapitre 5: Commentaire de texteD'EverandGerminal de Zola - Partie V, chapitre 5: Commentaire de textePas encore d'évaluation
- Dissertation Juste La Fin Du MondeDocument4 pagesDissertation Juste La Fin Du MondechvakePas encore d'évaluation
- Dossier Trois SoeursDocument14 pagesDossier Trois SoeursCie Lever du Jour100% (2)
- Ouverture Catalogue FemininMasculinDocument2 pagesOuverture Catalogue FemininMasculinGonzalo PechPas encore d'évaluation
- Genre, Modernise Et Culture de Masse Dans La Nouvelle VagueDocument16 pagesGenre, Modernise Et Culture de Masse Dans La Nouvelle VagueAlice in FursPas encore d'évaluation
- Le Drame Émancipé - ImpersonnageDocument8 pagesLe Drame Émancipé - ImpersonnageAnge Aristide DjedjePas encore d'évaluation
- fiche MEROVINGIENSDocument6 pagesfiche MEROVINGIENStamereeuPas encore d'évaluation
- La France - Cours 1Document15 pagesLa France - Cours 1tamereeuPas encore d'évaluation
- Suite de La Leçon Histoire Colonisation 2023Document12 pagesSuite de La Leçon Histoire Colonisation 2023tamereeuPas encore d'évaluation
- Suite de La Leçon Histoire Colonisation 2023Document12 pagesSuite de La Leçon Histoire Colonisation 2023tamereeuPas encore d'évaluation
- ARTAUD PASSION AvignonDocument2 pagesARTAUD PASSION AvignontamereeuPas encore d'évaluation
- Stéphane Mallarmé - Sonnet en X (Poème Alchimique)Document1 pageStéphane Mallarmé - Sonnet en X (Poème Alchimique)Psyl0wPas encore d'évaluation
- ToxicDocument3 pagesToxicSteve JonesPas encore d'évaluation
- Mambo Medley - Score and PartsDocument30 pagesMambo Medley - Score and PartsÜmit ÇavuşPas encore d'évaluation
- P1 - Comptines, Chansons - Doc ÉlèvesDocument30 pagesP1 - Comptines, Chansons - Doc ÉlèvesLy LyPas encore d'évaluation
- Luigi Rubino Last Dance Piano by Andrey ShuvalovDocument1 pageLuigi Rubino Last Dance Piano by Andrey ShuvalovLenaGaraschchenkoPas encore d'évaluation
- Se Dice de Mí Milonga Cuarteto Cuerdas - Violin IIDocument1 pageSe Dice de Mí Milonga Cuarteto Cuerdas - Violin IIAlet Rojas HerreraPas encore d'évaluation
- 10 Tango Standards VOL IIDocument14 pages10 Tango Standards VOL IIMarianaPas encore d'évaluation
- PonctuationDocument4 pagesPonctuationnkila lhoucinePas encore d'évaluation
- Rojas Miguel - El Suspiro Del Negro para PianoDocument3 pagesRojas Miguel - El Suspiro Del Negro para PianompcgalacticaPas encore d'évaluation
- SAS 105 KGB Contre KGB Gerard de VilliersDocument240 pagesSAS 105 KGB Contre KGB Gerard de Villiersfab59300Pas encore d'évaluation
- Big Band - Mambo Jambo (Rocha)Document27 pagesBig Band - Mambo Jambo (Rocha)Elmer CastroPas encore d'évaluation
- ROUVIERE Mouvement Folk 4sur4Document54 pagesROUVIERE Mouvement Folk 4sur4Alexis BoriePas encore d'évaluation
- Pavane - Arbeau (FR.)Document1 pagePavane - Arbeau (FR.)Ivan SuchardaPas encore d'évaluation
- Kropotkine - Autour D-Une VieDocument259 pagesKropotkine - Autour D-Une VieLa Pêche Du quartierPas encore d'évaluation
- Le Mec de La Tombe D'a Cote - Katarina MazettiDocument119 pagesLe Mec de La Tombe D'a Cote - Katarina MazettiBabaPas encore d'évaluation
- 3 Coeur Mandarine, Les Filles Au ChocolatDocument125 pages3 Coeur Mandarine, Les Filles Au ChocolatCamillePas encore d'évaluation
- Marenco ExcelsiorDocument135 pagesMarenco ExcelsiorGODEFROIDPas encore d'évaluation
- Polovtsian Dances PDFDocument1 pagePolovtsian Dances PDFΡηνιώ ΒούζηPas encore d'évaluation
- Devoir 2AM CendrillonDocument1 pageDevoir 2AM CendrillonLolo LaloPas encore d'évaluation
- Danza Del Oso - Partitura CompletaDocument1 pageDanza Del Oso - Partitura CompletaWillian Silva100% (1)
- Programme Conditions 2023: Samedi 11 NovembreDocument1 pageProgramme Conditions 2023: Samedi 11 Novembreapi-331831859Pas encore d'évaluation
- Controle Tronc Commun Le Bourgeois GentilhommeDocument2 pagesControle Tronc Commun Le Bourgeois GentilhommeYassine Zagh100% (1)
- Test Evaluare Finala BaremDocument8 pagesTest Evaluare Finala BaremOtilia UngureanuPas encore d'évaluation
- Valse 2 ChostakovitchDocument3 pagesValse 2 Chostakovitchekerilar91Pas encore d'évaluation
- Cedric Monnier Melodies Dun Film Perdu Oeupc6Document51 pagesCedric Monnier Melodies Dun Film Perdu Oeupc6Bogdan CaluPas encore d'évaluation
- Mal Bicho - Trompeta en SibDocument2 pagesMal Bicho - Trompeta en SibJhon Edison Castiblanco CasasPas encore d'évaluation
- PORQUE TENGO GANAS - Adalberto Santiago - 1 Trombón PDFDocument2 pagesPORQUE TENGO GANAS - Adalberto Santiago - 1 Trombón PDFHector LegerPas encore d'évaluation
- Le Malade ImaginaireDocument5 pagesLe Malade Imaginaireqwz8tp54pwPas encore d'évaluation