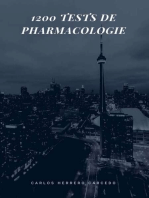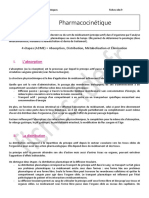Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
DCEM1 Pharmacologie Chapitre 4 Distribution Septembre 2005
Transféré par
Eminem_JanoCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
DCEM1 Pharmacologie Chapitre 4 Distribution Septembre 2005
Transféré par
Eminem_JanoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre 4 : DISTRIBUTION
Objectifs
- Savoir définir la distribution et expliquer les facteurs l’influençant
- Savoir définir et mesurer un volume de distribution
- Connaître les facteurs permettant d’évaluer le risque d’interactions médicamenteuses faisant
intervenir la liaison des médicaments aux protéines plasmatiques.
- Comprendre la signification d’un volume de distribution
Pour atteindre les objectifs, il est nécessaire de connaître, comprendre et maîtriser les mots clés
suivants : (mots clés soulignés dans le texte)
• "barrière"
• distribution
• fixation ou liaisons aux protéines plasmatiques
• médicament sous forme liée / médicament sous forme libre
• redistribution
• stockage tissulaire
• volume de distribution / volume apparent de distribution
Plan
Introduction
1. Notion de volume de distribution
2. Facteurs modifiant la distribution
2.1. Liaison aux protéines plasmatiques
2.2. Facteurs tissulaires
− le débit sanguin local
− la notion de " barrière "
− le phénomène de redistribution
− le stockage par des tissus
Faculté de Médecine de Strasbourg, Module de Pharmacologie Générale DCEM1 2005/2006 1
« Distribution » - C. Loichot et M. Grima - Mise à jour : septembre 2004
Introduction
La distribution correspond au processus de répartition du médicament dans l’ensemble des tissus et
organes.
Pour diffuser dans les différents tissus, le médicament doit passer les membranes plasmiques (voir
passages transmembranaires chapitre 2). La diffusion tissulaire dépend de la capacité du médicament à
franchir les membranes (voir chapitre 2) et d’autres facteurs qui seront analysés dans ce chapitre
Le paramètre choisi pour quantifier la distribution d’un médicament dans l’organisme est le volume de
distribution. Il existe de grandes variations, à la fois en intensité et en vitesse, dans la répartition des
différents médicaments dans l’organisme.
1. Notion de volume de distribution
Le volume de distribution (Vd) se définit comme le volume fictif (ou “ apparent ”) dans lequel se
distribue une quantité de médicament (M) pour être en équilibre avec la concentration plasmatique
(Cm).
M
Vd = -----
Cm
Le volume apparent de distribution se calcule comme le rapport de la quantité de médicament
administré et de la concentration plasmatique une fois l’équilibre atteint.
En pratique, la concentration plasmatique à l’équilibre est estimée comme étant la concentration
plasmatique théorique au temps 0. Cette concentration (C0) est calculée par extrapolation à l’origine de
la courbe de décroissance des concentrations plasmatiques mesurées après une injection i.v. d’une
quantité connue du médicament :
Quantité injectée
Vd = -----------------------
C0
NB : On calcule aussi Vd à partir de la clairance du médicament et de la constante d’élimination (Vd =
Clairance / Ke) (voir chapitre 7)
Faculté de Médecine de Strasbourg, Module de Pharmacologie Générale DCEM1 2005/2006 2
« Distribution » - C. Loichot et M. Grima - Mise à jour : septembre 2004
Exemple :
On administre 28 mg d’un médicament à un patient de 70 kg soit 0,4 mg/kg (ou 400 µg/kg) et on
mesure une C0 de 10 µg/l.
400
Vd = ------------- = 40 l/kg
10
Cet exemple illustre la notion de volume apparent de distribution : un volume de distribution supérieur
à 1 l/kg de poids corporel indique une capacité de stockage ou de forte liaison dans un compartiment
de l’organisme. L’ordre de grandeur du volume de distribution d’un médicament a une signification
pharmacologique comme l’illustre le tableau ci-dessous.
Vd Compartiment de distribution Exemples
(l/kg)
Poids moléculaire élevé :
0,05 Plasma
Héparine
Insuline
Forte fixation aux protéines plasmatiques :
Phénylbutazone
Warfarine
Aspirine
Théophylline
± 0,20 Eau extracellulaire
Aténolol
Pénicilline
Ethanol
± 0,55 Eau totale
Paracétamol
Indométacine
Morphine
> 2 et jusqu’à > 10 Stocké ou lié spécifiquement
Propranolol
dans certains tissus
Imipramine
2. Facteurs modifiant la distribution
2.1. La liaison aux protéines plasmatiques
Certaines protéines plasmatiques possèdent la propriété de fixer des substances endogènes mais
également les produits exogènes comme les médicaments. Il en résulte la formation d’un complexe
[protéine – médicament] menant à la distinction du médicament sous une forme libre et sous forme
liée.
La liaison médicament-protéine est réversible. Elle répond à la loi d’action de masse :
médicament libre + protéine plasmatique médicament lié à la protéine
Seule la forme libre du médicament est active pharmacologiquement. La forme liée est inactive
pharmacologiquement et ne peut diffuser pour atteindre son lieu d’action. Cette inactivité n’est que
temporaire car les formes liée et libre sont en équilibre réversible. Au fur et à mesure de la disparition
de la forme libre (par diffusion vers les tissus ou élimination), il y a passage de la forme liée vers la
forme libre.
Faculté de Médecine de Strasbourg, Module de Pharmacologie Générale DCEM1 2005/2006 3
« Distribution » - C. Loichot et M. Grima - Mise à jour : septembre 2004
Différentes protéines plasmatiques sont impliquées dans la fixation des médicaments :
− l’albumine
− l’α1 glycoprotéine acide
− les lipoprotéines
− la γ globuline
L’albumine et l’α1 glycoprotéine acide sont les deux principales protéines impliquées dans la fixation
des médicaments.
La fixation aux protéines plasmatiques dépend des caractéristiques acido-basiques des médicaments.
Médicament acide faible Médicament base faible
Protéines impliquées dans la Albumine α1 glycoprotéine acide ++
fixation albumine +
Affinité Forte Faible
Nombre de sites de fixation Peu de sites Beaucoup de sites
Possibilité d’interaction Possible Peu probable
médicamenteuse
Le phénomène de fixation ou liaison aux protéines plasmatiques est surtout le fait de médicaments
acides liposolubles qui se fixent à des sites spécifiques de l’albumine. Ces sites sont peu nombreux. Il
s’en suit une compétition entre les médicaments pour ces sites d’où possibilité d’interactions
médicamenteuses.
D’autres protéines plasmatiques, les alpha1-glycoprotéines fixent les médicaments basiques mais avec
moins de spécificité et un plus grand nombre de sites, ce qui diminue le risque d’interaction.
Les conséquences pratiques de cette liaison aux protéines plasmatiques peuvent être la prolongation de
la durée de vie du médicament dans l’organisme.
Exemples :
• Les sulfamides retards, liés à 98% aux protéines plasmatiques, ont une demi-vie de 70 heures ;
(définition de la demi-vie : voir chapitre 7)
• L’adiazine, un autre sulfamide antibiotique qui est peu fixé aux protéines, a une demi-vie de 4-5
heures ;
• Les diurétiques de l’anse, sont également fortement liés aux protéines plasmatiques (à 98%) mais
leur demi-vie plasmatique est de l’ordre de 30 min car ils ont une plus forte affinité pour le
mécanisme de transport des acides organiques du tubule proximal rénal et passent rapidement dans
les urines.
Une forte fixation aux protéines plasmatiques a pour conséquence de limiter la diffusion du
médicament en dehors du compartiment plasmatique comme l’illustre ci-dessous la comparaison entre
le pourcentage de liaison aux protéines plasmatiques et le pourcentage du médicament administré qui
reste dans le plasma :
% de liaison aux % du médicament
protéines plasmatiques restant dans le plasma
100 100
99 88
90 42
80 26
0 6,7
Des interactions médicamenteuses sont une autre conséquence de la fixation aux protéines
plasmatiques. L’interaction se produit si deux médicaments entrent en compétition pour le même site
de fixation sur l’albumine plasmatique. Le risque d’interaction dépend également du volume de
distribution. En effet le médicament libéré, “déplacé” lors de l’interaction retrouve à la fois la
Faculté de Médecine de Strasbourg, Module de Pharmacologie Générale DCEM1 2005/2006 4
« Distribution » - C. Loichot et M. Grima - Mise à jour : septembre 2004
possibilité de diffuser dans le reste de l’organisme et d’y exercer son effet pharmacologique. Ceci peut
avoir des conséquences importantes si le taux de fixation du médicament est très élevé.
Exemple : 99% d’un médicament A sont fixés aux protéines plasmatiques, l’activité thérapeutique est
obtenue avec 1% du produit libre et peu distribué hors du plasma (voir tableau ci-dessus). Si un
médicament B déplace A de 1% réduisant la fixation protéique à 98%, la fraction libre double. Bien
qu’une partie de cette fraction libre diffuse hors du plasma, les conséquences d’une telle augmentation
de la fraction libre peuvent être graves lorsque l’index thérapeutique d’un médicament est étroit.
Par contre, le déplacement de 1% de A n’a pas d’importance lorsque le pourcentage de fixation aux
protéines plasmatique est faible car les modifications de la fraction libre sont alors peu significatives.
En résumé, pour évaluer le risque d’interaction entre des médicaments, il faut connaître :
• le pourcentage de fixation : il ne pose réellement de problème que lorsqu’il est supérieur à 90 % ;
• le volume de distribution : plus il est faible, plus le risque augmente : il ne pose réellement de
problème que lorsqu’il est inférieur à 10 litres pour un sujet de 70 kg (soit 0,14 l/kg)
• le pKA (< 7) : l’acidité favorisant la fixation ;
• l’index thérapeutique : s’il est étroit, le risque d’interaction peut être important.
Les médicaments qui répondent à ces critères et sont susceptibles de présenter ce type d’interaction
avec des conséquences graves sont par exemple :
• les antivitamines K
• les sulfamides hypoglycémiants
2.2. Facteurs tissulaires
Le débit sanguin local
L’irrigation des tissus est un facteur limitant de la distribution tissulaire des médicaments.
Le schéma ci-dessous compare le pourcentage respectif des principaux organes par rapport au poids du
corps et le pourcentage du débit sanguin cardiaque qu’ils reçoivent. La distribution tissulaire des
médicaments est proportionnelle à l’importance de ces débits locaux.
• Les tissus les plus vascularisés sont le coeur, le rein, le foie, le poumon, les glandes endocrines.
Ces tissus reçoivent rapidement une grande quantité de médicaments mais ceux-ci sont également
rapidement éliminés en raison du débit sanguin élevé.
• La peau et les muscles sont moins vascularisés.
• Le tissu adipeux est peu vascularisé, tout comme les os, les phanères, les dents, les ligaments.
Par conséquent, ces tissus représentent un lieu de stockage avec la possibilité d’atteindre, dans ces
tissus, des concentrations toxiques si le médicament est utilisé au long cours.
Par opposition, le foie et le rein qui ont un débit sanguin local élevé sont surtout des lieux de transit
des médicaments.
Faculté de Médecine de Strasbourg, Module de Pharmacologie Générale DCEM1 2005/2006 5
« Distribution » - C. Loichot et M. Grima - Mise à jour : septembre 2004
La notion de “ barrière ” :
Certains organes disposent de structures propres qui limitent la diffusion des médicaments. On utilise
le terme de “ barrière ” tissulaire pour décrire ces structures (par exemple la barrière hémo-
encéphalique, la barrière foeto-placentaire).
N.B. : la “ barrière ” foeto-placentaire est traitée dans le chapitre 11 “ médicaments et grossesse ”.
La barrière hémo-encéphalique :
Au niveau de la barrière hémo-encéphalique, les capillaires sont constitués de cellules endothéliales
très serrées. De plus, les astrocytes (constituant la névroglie) sont particulièrement riches en lipides et
entourent les neurones et les vaisseaux sans laisser de place au liquide interstitiel. Cet ensemble joue
un rôle de barrière limitant la diffusion des médicaments. En pratique, la diffusion est d’autant plus
intense que la substance est de faible poids moléculaire, liposoluble et sous forme non ionisée.
Par ailleurs, à ce niveau, des phénomènes de transport actif ou de sécrétion contrôlent également le
passage des médicaments : ex. la P-glycoprotéine limite la diffusion des inhibiteurs de la protéase du
VIH et de certains anticancéreux ce qui pose problème dans ce dernier cas pour le traitement des
tumeurs cérébrales.
La notion de barrière trouve ainsi une application dans l’exemple suivant :
Dans la maladie de Parkinson les neurones souffrent d’une insuffisance de dopamine. Pour pallier
cette insuffisance, on administre de la L-dopa, liposoluble, qui passe la barrière hémo-encéphalique
(pour atteindre son lieu d’action) mais qui a aussi des effets périphériques indésirables résultant de sa
transformation en dopamine. Pour limiter sa transformation en dopamine au seul système nerveux
central, on associe à la L-dopa un inhibiteur de la dopa-décarboxylase qui, lui, ne passe pas la barrière
hémo-encéphalique.
Faculté de Médecine de Strasbourg, Module de Pharmacologie Générale DCEM1 2005/2006 6
« Distribution » - C. Loichot et M. Grima - Mise à jour : septembre 2004
DOPAMINE
dopa - décarboxylase
L - DOPA
BARRIERE HEMO - ENCEPHALIQUE
DOPAMINE
(effets indésirables) Inhibiteur de la
dopa-décarboxylase
PERIPHERIE
dopa - décarboxylase
L – DOPA (LEVODOPA)
+ inhibiteur de la dopa-décarboxylase
N.B. Il ne faut pas confondre la barrière hémo-encéphalique avec la barrière hémo-méningée
constituée par les méninges : elle limite la diffusion des médicaments mais de façon différente. Ainsi,
certains antibiotiques, qui habituellement ne peuvent pas passer la barrière hémo-méningée, passent,
en cas de méningite car la barrière hémo-méningée est plus perméable.
Le phénomène de redistribution
Un des facteurs essentiels qui règlent la répartition entre le plasma et les tissus est le gradient de
concentration. Pour certains médicaments liposolubles, la distribution tissulaire peut être si rapide et
intense dans certains organes à fort débit sanguin, que l’on assiste à une inversion du gradient de
concentration avec des concentrations plus élevées dans le tissu que dans le plasma. Il en résulte une
redistribution de ces médicaments vers le plasma. Ce phénomène est illustré par l’exemple suivant :
Faculté de Médecine de Strasbourg, Module de Pharmacologie Générale DCEM1 2005/2006 7
« Distribution » - C. Loichot et M. Grima - Mise à jour : septembre 2004
Le pentobarbital et le thiopental peuvent être utilisés comme anesthésiques généraux : le pentobarbital
est employé dans les anesthésies générales prolongées alors que le thiopental est utilisé dans les
anesthésies générales rapides et brèves. Leurs structures chimiques sont très proches :
Thiopental Pentobarbital
O O
CH2CH3 CH2CH3
HN HN
CHCH2CH2CH3 CHCH2CH2CH3
Structure
S N O CH3 O N O CH3
H H
pKa 7,6 8,1
Coefficient de 3,3 0,05
partition de la
forme non ionisée
Log P
Liaison aux protéines 75 % 5%
Plasmatiques
Le pentobarbital et le thiopental ont un pourcentage d’ionisation comparable et une demi-vie
plasmatique de même ordre de grandeur. Le seul paramètre qui les distingue est la liposolubilité. En
raison d’une très forte liposolubilité (log P = 3,3), le thiopental va diffuser très rapidement dans le
système nerveux central et induire une anesthésie rapide mais en créant un gradient de concentration
tel que cette situation va rapidement s’inverser et le thiopental va être éliminé du cerveau.
Le pentobarbital a une cinétique de distribution différente : sa concentration augmente
progressivement dans le système nerveux central mais sa liposolubilité n’est suffisante pour que le
gradient s’inverse rapidement.
Le stockage par des tissus
Certains tissus sont capables de fixer et de stocker de manière prolongée certaines substances :
Exemple des tétracyclines qui sont capables de fixer (chélater) du Ca2+ :
Les tétracyclines chélatent les ions Ca2+ des dents et des os. Ceci peut altérer la formation des dents
chez l’enfant car ces médicaments restent plusieurs semaines dans ces tissus.
Pour en savoir plus :
- Pharmacocinétique, Principes fondamentaux. JP Labaune. 2e édition, Masson, Paris 1988
- Fixation des médicaments sur les protéines plasmatiques. J.P. Tillement et coll. In : Pharmacologie
clinique - Bases de la thérapeutique. Ed. Giroud 2e édition, Expansion Scientifique Française,
Paris 1988
Faculté de Médecine de Strasbourg, Module de Pharmacologie Générale DCEM1 2005/2006 8
« Distribution » - C. Loichot et M. Grima - Mise à jour : septembre 2004
Vous aimerez peut-être aussi
- La chimiothérapie: Une brochure de la Fondation contre le CancerD'EverandLa chimiothérapie: Une brochure de la Fondation contre le CancerPas encore d'évaluation
- Pharmaco3an-Distribution Medicaments2018douadi GharbiDocument30 pagesPharmaco3an-Distribution Medicaments2018douadi GharbimhamedPas encore d'évaluation
- DCEM1 Pharmacologie Chapitre 5 Metabolisme Des MedicDocument10 pagesDCEM1 Pharmacologie Chapitre 5 Metabolisme Des MedicEminem_Jano100% (1)
- Ue6 - Fiche Cours 3 PD PK - GarraffoDocument11 pagesUe6 - Fiche Cours 3 PD PK - GarraffoLinaPas encore d'évaluation
- 1-Pathologie VasculaireDocument10 pages1-Pathologie VasculaireMontassar SakliPas encore d'évaluation
- Pancréatite Chronique 2019Document69 pagesPancréatite Chronique 2019Khallil OuahlimaPas encore d'évaluation
- Hemato4an Td-Interpretation Bilan Coagulation2020salhiDocument18 pagesHemato4an Td-Interpretation Bilan Coagulation2020salhianne marriePas encore d'évaluation
- DCEM1 Pharmacologie Chapitre 3 Resorption Absorption Septembre 2005Document11 pagesDCEM1 Pharmacologie Chapitre 3 Resorption Absorption Septembre 2005Eminem_JanoPas encore d'évaluation
- Accidents TransfusionnelsDocument10 pagesAccidents Transfusionnelsdtp mascaraPas encore d'évaluation
- Encephalopathie Hepatique PDFDocument5 pagesEncephalopathie Hepatique PDFJorge Tovar AvilaPas encore d'évaluation
- Rennes20090519012848yletulzoentrainement Semiologie Reanimation Urgence Dcem1Document10 pagesRennes20090519012848yletulzoentrainement Semiologie Reanimation Urgence Dcem1api-202942822Pas encore d'évaluation
- Supports ResidanatDocument2 pagesSupports ResidanatHadjer Guerfi Epse KabPas encore d'évaluation
- Cours 18 - NéphrologieDocument24 pagesCours 18 - Néphrologieأغا نيPas encore d'évaluation
- Les AisDocument20 pagesLes AisfarracygmailcomPas encore d'évaluation
- Pharmacodynamie Et Interactions MédicamenteusesDocument19 pagesPharmacodynamie Et Interactions MédicamenteusesChaima FatnassiPas encore d'évaluation
- Antimitotiques (Resume)Document4 pagesAntimitotiques (Resume)Mar OuaPas encore d'évaluation
- Les Anti-Inflammatoires Non StéroïdiensDocument27 pagesLes Anti-Inflammatoires Non StéroïdiensDïff RëntPas encore d'évaluation
- Item 291 - Traitement CancerDocument8 pagesItem 291 - Traitement CancerNarimènePas encore d'évaluation
- CIVDDocument27 pagesCIVDfifi fifiPas encore d'évaluation
- DCTCDocument34 pagesDCTCMadjidAvengersPas encore d'évaluation
- Sémiologie L2 Et L3Document20 pagesSémiologie L2 Et L3Anas IsmailPas encore d'évaluation
- Tumeurs Hémisphériques (Corrélation Anatomo Clinique DC Différentiel)Document25 pagesTumeurs Hémisphériques (Corrélation Anatomo Clinique DC Différentiel)yaalaPas encore d'évaluation
- Autoimmunite DFGSM3 2012-13Document63 pagesAutoimmunite DFGSM3 2012-13AbirPas encore d'évaluation
- ImmunitéDocument31 pagesImmunitélahlou Lh100% (1)
- CoursDocument19 pagesCoursJuszku MihályPas encore d'évaluation
- ENDOCDocument22 pagesENDOCFlamant Rose100% (1)
- Chapitre 1 Pharmacologie Gle - 3Document30 pagesChapitre 1 Pharmacologie Gle - 3M.B. IsmailPas encore d'évaluation
- PrepECN Item 323 - Oedèmes Des Membres InférieursDocument2 pagesPrepECN Item 323 - Oedèmes Des Membres InférieurseltouffuPas encore d'évaluation
- Endocrinologie Polycopie Semiologie Complet 2010 PDFDocument59 pagesEndocrinologie Polycopie Semiologie Complet 2010 PDFMourad BouigaPas encore d'évaluation
- Gynéco (TD Cours) en PocheDocument16 pagesGynéco (TD Cours) en PocheKadi NacimPas encore d'évaluation
- Antalgiques PDFDocument23 pagesAntalgiques PDFbelalia_aminePas encore d'évaluation
- LES SYNDROMES MYÉLOPROLIFERATIFS 2018 DR YAFOURDocument19 pagesLES SYNDROMES MYÉLOPROLIFERATIFS 2018 DR YAFOURcms sidi bel abbesPas encore d'évaluation
- Embolie Pulmonaire Cours DCEM3Document44 pagesEmbolie Pulmonaire Cours DCEM3Dany Ollo0% (1)
- Item 62 2017 Purpura FDocument30 pagesItem 62 2017 Purpura FAsma TurkiPas encore d'évaluation
- Physiopathologie Mai Final 2Document5 pagesPhysiopathologie Mai Final 2EbePas encore d'évaluation
- 01 HerpèsviridaeDocument25 pages01 HerpèsviridaeHikari KazuePas encore d'évaluation
- La Pharmacocinetique C Debraine PDFDocument72 pagesLa Pharmacocinetique C Debraine PDFMaria RPas encore d'évaluation
- Réaction InflammatoireDocument36 pagesRéaction InflammatoireScribd Reader100% (1)
- 21 Dermatoses Bulleuses - Cas CliniquesDocument208 pages21 Dermatoses Bulleuses - Cas CliniquesKada Ben youcefPas encore d'évaluation
- 1 - PharmacocinétiqueDocument4 pages1 - PharmacocinétiqueGillian BarnyPas encore d'évaluation
- Derma To LogieDocument84 pagesDerma To Logiem.aPas encore d'évaluation
- Fievre Typhoïde de L'enfantDocument46 pagesFievre Typhoïde de L'enfantIdiAmadou100% (1)
- Thrombose Veineuse Profonde - TraitementDocument9 pagesThrombose Veineuse Profonde - Traitementsabiou amadouPas encore d'évaluation
- PORPHYRINESDocument4 pagesPORPHYRINESFranck BitaPas encore d'évaluation
- Anatomie Oesophage PDFDocument12 pagesAnatomie Oesophage PDFAnis BergerPas encore d'évaluation
- Examens Complémentaires en HGE - Trésor de MédecineDocument5 pagesExamens Complémentaires en HGE - Trésor de MédecinedeadbysunriseePas encore d'évaluation
- Arbre Décisionnel APPAREIL LOCOMOTEURDocument13 pagesArbre Décisionnel APPAREIL LOCOMOTEURmarielle ayinadouPas encore d'évaluation
- 24 - HydrocéphalieDocument3 pages24 - HydrocéphalieFatiha YahiaouiPas encore d'évaluation
- Cytotoxiques (Anticancéreux)Document12 pagesCytotoxiques (Anticancéreux)Annab TakiPas encore d'évaluation
- Interpretation EPPDocument8 pagesInterpretation EPPFadwa DhimenePas encore d'évaluation
- Troubles de L'équilibre Acido-Basique PDFDocument24 pagesTroubles de L'équilibre Acido-Basique PDFsarah hPas encore d'évaluation
- Hémorragie Digestive Haute Liée À L'hypertension PortaleDocument20 pagesHémorragie Digestive Haute Liée À L'hypertension PortaleMoni RethPas encore d'évaluation
- Classification OMS 2008 Des LymphomesDocument5 pagesClassification OMS 2008 Des LymphomesabbasPas encore d'évaluation
- MyositesDocument5 pagesMyositesHakimoPas encore d'évaluation
- Maladie de WillebrandDocument6 pagesMaladie de WillebrandI.m. DanielPas encore d'évaluation
- Glomérulonéphrites Aiguës PostinfectieusesDocument10 pagesGlomérulonéphrites Aiguës PostinfectieusesGeorge CarpPas encore d'évaluation
- E1273s EufrDocument2 pagesE1273s EufrisaacPas encore d'évaluation
- Etude Sur Le Leadership en Afrique Resultats Du SondageDocument25 pagesEtude Sur Le Leadership en Afrique Resultats Du SondageFreekado Gratis100% (1)
- Module 3 Environnement 2019Document54 pagesModule 3 Environnement 2019Fedzer AnnéePas encore d'évaluation
- Brochure Commerciale Et Technique - Batifibre PDFDocument8 pagesBrochure Commerciale Et Technique - Batifibre PDFSerge Toniolo100% (1)
- Modes Opératoires Des Travaux de Gros OeuvreDocument68 pagesModes Opératoires Des Travaux de Gros OeuvreRabah Ahmed77% (13)
- 1es TP29Document6 pages1es TP29schelh1235Pas encore d'évaluation
- EXAMEN 2020 2021 Turbomacine SolutionDocument156 pagesEXAMEN 2020 2021 Turbomacine Solutionعلے فريجاتPas encore d'évaluation
- Processus M2 PDFDocument118 pagesProcessus M2 PDFMohamed RdaitPas encore d'évaluation
- Le Soudage en Phase SolideDocument14 pagesLe Soudage en Phase Solidesayr0sPas encore d'évaluation
- Moutarde Cultivee BiofumigationDocument4 pagesMoutarde Cultivee BiofumigationUziel CHIMIPas encore d'évaluation
- Comment Installer Votre AssainissementDocument10 pagesComment Installer Votre Assainissementjordan kembouPas encore d'évaluation
- Population Et Développement en Inde 1Document9 pagesPopulation Et Développement en Inde 1CamisPas encore d'évaluation
- WSIBClearance CertificateDocument1 pageWSIBClearance CertificateParteek LoungiaPas encore d'évaluation
- Support de Cours - Suret e de Fonctionnementet Maintenance - ELM - 2019 - 2020 - Chapitre 3 - Partie 3Document20 pagesSupport de Cours - Suret e de Fonctionnementet Maintenance - ELM - 2019 - 2020 - Chapitre 3 - Partie 3Sakhara SaadiPas encore d'évaluation
- Séance N°9 Je Découvre L'approvisionnement Du Rayon: 1 Rue Croce SpinelliDocument13 pagesSéance N°9 Je Découvre L'approvisionnement Du Rayon: 1 Rue Croce SpinelliHichem MbarkaPas encore d'évaluation
- Module Sécu Câblage 2014Document6 pagesModule Sécu Câblage 2014shaggyPas encore d'évaluation
- Chloride Chlorine Chromium FRDocument1 pageChloride Chlorine Chromium FRELYES CHOUCHENEPas encore d'évaluation
- Le Permis de LotirDocument2 pagesLe Permis de LotirAchour100% (1)
- Leçon 5-Installation BT 2Document9 pagesLeçon 5-Installation BT 2Dama DamaPas encore d'évaluation
- MemoireDocument83 pagesMemoireDjamel Eddine MekkiPas encore d'évaluation
- Article11 08Document4 pagesArticle11 08Silvia CalabresePas encore d'évaluation
- TD2020Document2 pagesTD2020Sana AnesPas encore d'évaluation
- Les Procedes de Traitement Et DepurationDocument150 pagesLes Procedes de Traitement Et DepurationM.Boutayeb EchraaPas encore d'évaluation
- Janv.-22 Févr.-22 Mars-22Document10 pagesJanv.-22 Févr.-22 Mars-22DAOUDPas encore d'évaluation
- Carte Mentale - Evaluation DiagnostiqueDocument1 pageCarte Mentale - Evaluation DiagnostiqueYoucef Noureddine1985Pas encore d'évaluation
- Alcool 1Document25 pagesAlcool 1Cecile SpykilinePas encore d'évaluation
- Epreuve Et Corrige Bac 2022 Francais Series Abcdeh Cote D'ivoireDocument28 pagesEpreuve Et Corrige Bac 2022 Francais Series Abcdeh Cote D'ivoiredfatym96100% (1)