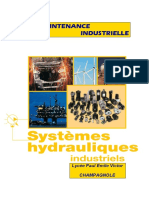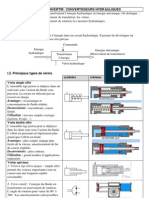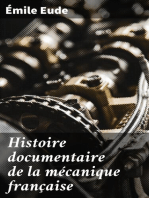Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Centrale Hydraulique
Transféré par
Permaflex Route Bekalta TeboulbaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Centrale Hydraulique
Transféré par
Permaflex Route Bekalta TeboulbaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
Centrale hydraulique
1. Introduction
- La centrale hydraulique (appelé aussi groupe hydraulique) est un générateur de débit et pas
de pression. La pression augmente lorsqu’il y a résistance à l’écoulement.
- Elle est constituée essentiellement d’un réservoir d’huile, d’un moteur et d’une pompe et
d’un système de filtration.
Réservoir : il permet le stockage de l’huile, protection contre des éléments qui peuvent le
polluer, et le refroidissement ;
Système de filtration : il est utilisé pour éliminer les impuretés et les particules solides du
fluide ;
Pompe : sa fonction consiste à :
- Générer un débit de liquide
- Mettre sous pression l’huile sous forme d’énergie hydraulique.
Huile
Réservoir d’huile
W. Hydraulique
Pompe
W. Mécanique
Moteur
- Une centrale hydraulique doit contenir aussi d’autres composants (filtre, limiteur de
pression, manomètre, …).
2. Eléments formant une centrale hydraulique
Figure 1 : Centrale hydraulique
Cette figure représente un schéma d’une centrale hydraulique.
Les éléments qui constituent la centrale sont :
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 1
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
1. Moteur électrique
2. Pompe
3. Filtre
4. Réservoir
5. Soupape de sécurité
6. conduite
2.1. Le réservoir
Voyant (niveau haut)
Voyant (niveau bas) Huile
Réservoir
Porte
de visite
Bouchon de vidange
Bac Pente Chambre Chambre
de retour d’aspiration
Le réservoir se compose d’une cuve en acier protégée. A l’intérieur, une cloison de
stabilisation sépare le réservoir en deux parties :
- Une chambre d’aspiration,
- Une chambre de retour.
Sur le dessus, le couvercle assure l’étanchéité du système et reçoit l’ensemble moteur-pompe.
Une porte de visite, assez grande, sert à nettoyer le fond du réservoir lors des interventions de
maintenance. La vidange de l’huile se fait par un orifice placé au point le plus bas du
réservoir. Le fond de celui-ci comporte une pente qui permet de le vider complètement.
Le remplissage se fait par un orifice placé sur le dessus. L’huile est filtrée et la fermeture est
assurée par des bouchons à voyant de niveau haut et un voyant de niveau bas. A l’intérieur du
réservoir, un tuyau d’aspiration avec crépine est placé le plus loin possible des retours d’huile.
Le retour d’huile se fait grâce à un tuyau immergé.
Le réservoir remplisse les fonctions suivantes :
- Stocker l'huile du circuit,
- assurer les variations de niveau du fluide hydraulique,
- permettre le refroidissement de l'huile,
- autoriser le montage de différents accessoires.
Défectuosités pouvant être constatées sur le réservoir après fonctionnement :
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 2
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
Constations Cause
Niveau d’huile : trop bas _Fuite externe : Prise d'air sur
canalisation d'aspiration
Défaut visuel Niveau d’huile : trop élevé _Le volume d'huile contenu dans les
actionneurs ou les tuyauteries peut
être supérieure au volume du
réservoir
Température d’huile _Insuffisance ou mauvais réglage du
circuit de refroidissement
_Viscosité de l'huile trop élevée
2.2. Les fluides hydrauliques
Les huiles utilisées dans les circuits hydrauliques sont classées en deux groupes :
- Les huiles minérales,
- Les huiles difficilement inflammables
La périodicité des vidanges est variable. Elle dépend du choix de l’huile et du taux de
fonctionnement du système. Les fabricants offrent une large gamme d’huiles et il est
préférable de prendre conseil auprès de spécialiste pour déterminer le choix de l’huile
répondant aux critères d’utilisation.
Classification des huiles hydrauliques :
2.3. Le filtre
Si on analyse les pannes se produisant sur les installations hydrauliques, on constate qu’un
grand nombre de celles-ci provienne du mauvais état du fluide hydraulique. L’huile sous
pression, circulant dans l’installation, véhicule toutes sortes d’impuretés se trouvant à
l’intérieur du circuit. Ces impuretés peuvent être abrasives ou non abrasives. Dans tous les
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 3
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
cas, il faut absolument les éliminer, car elles provoquent des pannes et une usure anormale
des composants amenant rapidement des fuites. C’est le rôle de la filtration.
La filtration de l’huile hydraulique peut se faire à l’aide :
- D’une crépine (grosses particules),
- De filtre (particules fines).
La filtration peut s’effectuer :
- Sur l’aspiration. Cette filtration doit protéger la pompe. Elle est assez grossière et ne peut
arrêter que les grosses particules. Elle se fait à l’aide de crépine (grille métallique très fine de
150 microns). En aucun cas cette filtration ne constitue une protection des composants des
systèmes hydrauliques.
- Sur la haute pression : le montage du filtre se fait sur la conduite de refoulement de la
pompe. Cette filtration est efficace :
1- Elle protège les composants hydrauliques.
2 - Arrête le débris provenant de l’usure de la pompe
3 - Agit en filtre de sécurité devant un composant sensible
- Sur le retour : Le montage du filtre se fait sur la conduite de retour. La totalité de l’huile est
filtrée. Il permet de :
1- Récupérer les débris provenant de l’usure des composants ou du circuit en général.
2- Maintenir le niveau de propreté du système dans le cas ou il existe des risques importants
de pollution ingérée.
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 4
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
Montage des différents types de filtres dans une installation hydraulique
Montage sur l’aspiration Montage sur le retour
P R R
P
Montage sur la haute pression
P R
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 5
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
2.4. Pompe hydraulique
2.4.1. Rôle
La pompe est destinée à transformer une énergie mécanique fournie par un moteur, en énergie
hydraulique. Son rôle se limite à aspirer l’huile de réservoir et de la refouler. La pompe
fournit un débit. Elle est donc un générateur de débit
2.4.2. Les caractéristiques générales d’une pompe
Une pompe se caractérise par :
- son débit
- sa cylindrée
- son rendement
- Son sens de rotation
- Sa vitesse de rotation
Débit :
C’est le volume d’huile que la pompe peut fournir pendant l’unité de temps pour une
vitesse de rotation établie.
Q : débit, en litres /minute (l/min)
Cylindrée :
Elle correspond au volume d’huile théorique débitée par tour en cm3 ou en litre. Donc le débit
Q correspond à la cylindrée par la vitesse de rotation.
Q = Cy l .N
Avec Q : débit, en litres /minute (l/min) ;
Cyl : Cylindrée, en litres (l/tr) ou en cm3/tr ;
N : vitesse de rotation, en tours /minute (tr/min).
Rendements :
La puissance hydraulique à la sortie d’une pompe, traitant le débit volumique Q est :
Phyd = ∆P.Q
avec Q : débit, en m3/s
P= Ps-Pe : La différence de pression entre l’entrée et la sortie de la pompe et Pe et Ps en Pascal
(Pa).
La puissance donnée à la pompe par le moteur dont l’axe tourne à la vitesse ω et transmet un
couple C, s’écrit :
Pa = C.ω
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 6
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
C : moment du couple appliqué à l’arbre d’entraînement de la pompe (N.m),
ω : La vitesse angulaire de l’arbre d’entraînement de la pompe (rad/s),
Pa : La puissance absorbée par la pompe (W).
Ces deux relations permettent d’exprimer le rendement global d’une pompe :
Phyd ∆P.Q
ηp = =
Pa C.ω
Pa=C.ω Phyd=∆P.Q
Pompe
Perte
Pour affiner notre connaissance d’une pompe volumétrique, on peut définir le rendement
volumétrique : rapport du débit réel au débit théorique,(qui permettra de connaître les fuites);
Q Q
ηvp = =
Q th Cyl.N
Q th : C’est le débit théorique, Qth = Cyl.N
N : C’est la vitesse de rotation (tr/min)
Le rendement mécanique ; rapport du couple théorique au couple réel (qui permettra de
connaître les pertes mécaniques : Frottement).
Le produit de ces deux rendements est évidemment le rendement global :
ηp = ηvp .ηmp
2.4.3. Classification des pompes
On classe les pompes en deux grandes familles :
- Les pompes non volumétriques ; dans les quelles la chambre d’admission et la chambre de
refoulement où le fluide est expulsé ne sont pas séparées l’une de l’autre par des pièces
mécaniques rigides.
- Les pompes hydrodynamiques (volumétriques), dans lesquelles la chambre d’admission est
séparée par des pièces mécaniques rigides de la chambre de refoulement, ce qui assure
l’étanchéité entre ces deux chambres.
Nous n’étudierons dans ce qui suit les pompes volumétriques qui sont utilisées en hydraulique
industrielle.
a- Pompe à engrenages
C’est la pompe standard, elle a une cylindrée fixe et fonctionne entre 10 et 170 bars. Il en
existe deux types, à dentures extérieures et à dentures intérieures.
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 7
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
Pompe à engrenages extérieur
- Fonctionnement : Elle est constituée de deux engrenages tournant à l’intérieur du corps de
pompe. Le principe consiste à aspirer le liquide dans l’espace compris entre deux dents
consécutives et à le faire passer vers la section de refoulement (La rotation d’un pignon
entraîne la rotation en sens inverse de l’autre, ainsi une chambre se trouve à l’aspiration,
l’autre au refoulement).
Elles peuvent fonctionner jusqu’à 170 bar. Elles ont un rendement d’environ 0,8.
Avantages Inconvénients
- Débit régulier. _ Nombreuses pièces d’usure
- Pas de clapets nécessaires. _ Pas de particules solides dans cette pompe, ni de produits
- Marche de la pompe abrasifs ; la présence de traces de solide ayant pour effet
réversible. d’accélérer l’usure mécanique des pignons et de diminuer
l’étanchéité entre le corps de pompe et les dents.
Pompe à engrenages intérieur
- Fonctionnement : Ces pompes existent aussi avec une roue à denture intérieure
(Couronne dentée) engrené à un pignon. Dans ce cas la pompe peut disposer d’une
pièce intermédiaire en forme de croissant pour séparer entre l’entrée et la sortie
permettant ainsi de diminuer les fuites internes et d’augmenter la pression de service.
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 8
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
Elles sont compactes et silencieuses, car leur débit est beaucoup plus régulier. Leur limite
d’utilisation est autour de 250 bars. Elles ont un rendement d’environ 0,9. Il en existe deux
types, avec ou sans croissant. Peu de pièces en mouvement. Faible encombrement.
Combinaison possible de plusieurs pompes. Aptitude à tourner vite : de 300 à 3000tr/min.
Bruit de fonctionnement très faible
Le croissant est lié à la forme des dents en développante de cercle ; sans croissant il y aurait
communication entre refoulement et aspiration.
b- Les pompes à palettes
Elle est aussi standard, fonctionne sur la même plage de pression que les pompes à
engrenages. Elles sont en revanche très silencieuses. Pour accepter les 200 bars elles doivent
être équilibrées, en effet le déséquilibre entre la pression d’aspiration d’un coté et la pression
de refoulement de l’autre coté crée des efforts sur les paliers, en revanche si on arrive à
doubler le refoulement et l’aspiration de façon symétrique les efforts s’équilibrent. Elles ont
un rendement d’environ 0,9. Débit régulier. Marche réversible de la pompe. Usure du corps
par frottement des palettes
On distingue deux types de pompes à palette
_ Pompes à palettes à cylindrée fixe
Pompes à palettes à cylindrée variable (autorégulatrice)
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 9
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
_ Cylindrée : 100 cm3/tour maxi
_ Pression de service : 160 bars maxi
_ Auto-aspirante
_ Pompe double ou triple
_ Régulation optimale du débit
_ Faible bruit de fonctionnement et de
_ Construction simple
_ Nécessite une filtration efficace
_ Rendement de 0,9 avec rotor équilibré
C- Les pompes à pistons
Ce sont des pompes volumétriques alternatives :
Tous les types de pompes à pistons reposent sur le même principe de fonctionnement
mouvement alternatif des pistons dans un alésage doté de deux orifices destinés à
l’aspiration et au refoulement. Selon la disposition des axes des pistons, plusieurs
configurations de pompes peuvent exister :
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 10
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
Le principe est celui de la pompe à vélo. Le piston se déplace dans le sens 1. Le volume (V)
augmente, il se produit une dépression ; le clapet (A) s’ouvre ; le clapet (B) se ferme ; c’est la
phase d’aspiration Le piston se déplace dans le sens (2). Le volume (V) diminue. Le fluide est
comprimé ; le clapet (A) se ferme ; le clapet (B) s’ouvre ; c’est la phase de refoulement.
Pour améliorer le débit on utilise plusieurs pistons ; on obtient un coefficient d’irrégularité en
mettant un nombre impair de pistons. On les utilise pour des pressions de 250 à 350 bars.
Elles sont relativement bruyantes. Elles ont un rendement d’environ 0,9.
Pompe à piston radiales
La force centrifuge applique les pistons contre la couronne extérieure fixe excentrée par
rapport au moyeu et à l’élément central fixe. En tournant, le moyeu imprime aux pistons un
mouvement de va et vient.
Pompe à pistons axiales : le mouvement de va et vient des pistons est obtenus par la rotation
d’un plateau à axe brisé. Dans chaque cylindre, des clapets communiquent, soit avec l’orifice
d’aspiration, soit avec l’orifice de refoulement. Il existe deux types à cylindré constante ou à
cylindré variable.
Suivant l’inclinaison a le débit est variable
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 11
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
2.5. Le limiteur de pression
Le limiteur de pression a pour fonction de limiter la pression dans système hydraulique à un
maximum préréglé, en dérivant la totalité ou une partie du débit de la pompe au réservoir,
lorsque la pression atteint la valeur de tarage (ou réglage) du limiteur. Il est monté en
dérivation de la pression.
Détermination du rôle du limiteur de pression
La figure suivante représente un circuit hydraulique, le montage est constitué :
- d'un groupe générateur;
- d'un limiteur de pression;
- d'un distributeur 4/2 ;
- d'un vérin double effet.
Si l'on actionne le distributeur, la tige du vérin sort.
Lorsque la tige est complètement sortie, le débit de la pompe se retrouve sans issue. La pompe
continuant à débiter, la pression monte très rapidement. Il en résulte obligatoirement la
rupture des canalisations et des composants. L'accident est inévitable. Le rôle du limiteur de
pression est de retourner au réservoir le débit, lorsque la pression préréglée est atteinte.
Description du fonctionnement
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 12
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
On distingue deux étapes dans fonctionnement du limiteur de pression. 1ere étape : au départ,
le clapet conique est en appui sur son siège grâce à une force F d'appui (préalablement
réglée). Cette force se règle avec un ressort de pression et une vis de réglage. 2eme étape: au
moment où la force F1 dépasse progressivement la force F préalablement réglée (le vérin est
en fin de course), le clapet recule de son siège, libérant et autorisant le retour du fluide, sans
pression au réservoir.
2.6. Le manomètre
Le manomètre, placé dans une installation hydraulique, permet de mesurer la pression du
fluide à l'intérieur de ce circuit.
Ses principaux éléments sont :
- un boîtier,
- un ressort tubulaire,
- un pignon à secteur denté,
- une aiguille,
- une zone de lecture graduée
Fonctionnement
Monté dans un système hydraulique, le manomètre est soumis à la pression régnant dans
l'installation. A l'intérieur du boîtier, un ressort tubulaire se déforme sous l'action de la
pression. Plus la pression augmente, plus la déformation n’est importante. Ce mouvement est
transmis à une aiguille qui se déplace devant un cadran gradué, par l'intermédiaire d'un
secteur denté et d'un pignon. On choisit en général un manomètre offrant une plage de lecture
de 50 % supérieure à la pression normale d'utilisation.
2.7. Tubes, boyaux et raccords :
Les conduites assurent le transport de l'énergie délivrée par la pompe hydraulique vers les
composantes de transformation et vers les actionneurs qui exécutent le travail.
Vous devez retenir que les deux facteurs physiques Qv, et p qui influencent la puissance agissent
sur le choix de tuyauterie.
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 13
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
La sélection des conduites hydrauliques s’effectue selon deux critères :
- Le débit qu’elles doivent porter.
- La pression qu’elles doivent supporter.
2.7.1. Tube en acier rigide :
Pour être de bonne qualité, le tuyau ou la conduite doit être fabriqué en acier étiré à froid pour
exempt de toute soudure ou joint. Souvent, on tolère le tuyau d'acier noir (utilisé généralement
pour l'eau) avec joint soudé. Or, l’utilisation d'un tel tuyau n'est faite que dans un seul but :
économiser. Ce choix s'avère dangereux puisque la soudure du joint peut briser à tout moment.
C'est pour cette raison que l'étude portera uniquement sur les tubes rigides sans soudure.
Les tubes se mesurent d'après leur diamètre extérieur et d'après l'épaisseur de leur paroi. Le
diamètre intérieur (diamètre extérieur moins deux fois l'épaisseur de la paroi) nous détermine le
diamètre d'écoulement. Cette donnée essentielle pour régler la vitesse d'écoulement et du débit.
Suivant la formule on a : le débit = la vitesse du fluide * la section.
De nos jours les abaques sont de plus en plus utilisés, il suffit de savoir la pression de service
utilisée.
2.7.2. Boyaux :
Les canalisations souples, plus souvent appelées boyaux, sont utilisées en hydraulique pour
raccorder des composantes relativement mobiles l’une par rapport à l’autre. On les utilise aussi
dans les endroits ou se produit une vibration.
On trouve plusieurs sortes de raccords pour boyaux flexibles. En fait, il existe des modèles pour
toutes les situations. Les raccords sont essentiellement formés de deux parties.
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 14
Hydraulique Industrielle ISSAT- Sousse
Bague de serrage
Protection extérieur
Gaine métallique Pression Support de
serrage
Protection intérieur raccord fileté
Il faut toujours s’en remettre au fabricant pour connaître les pressions d'utilisation, les
températures et les rayons de pliage des boyaux.
Les boyaux, tout en remplissant leur rôle de conducteur de fluide, peuvent aussi servir à absorber
les changements de pression puisqu'ils se gonflent légèrement.
On trouve plusieurs sortes de raccords pour boyaux flexibles. En fait, il existe des modèles pour
toutes les situations.
Lors de la sélection d'un tuyau souple (boyau), le mécanicien doit considérer les 4 facteurs
suivants :
La résistance à la pression.
Le diamètre intérieur versus la vitesse du liquide.
La compatibilité avec le fluide hydraulique et les produits environnants.
La résistance à la température maximale atteinte par le fluide.
Chapitre 4 : Centrale hydraulique 15
Vous aimerez peut-être aussi
- 23.1 Le Groupe Hydraulique Et Ses Constituants COURSDocument5 pages23.1 Le Groupe Hydraulique Et Ses Constituants COURSDan CheridanPas encore d'évaluation
- 04 La Centrale HydrauliqueDocument5 pages04 La Centrale HydrauliqueImane FirdawsPas encore d'évaluation
- Groupe Hydraulique 1Document4 pagesGroupe Hydraulique 1Jospin NtankeuPas encore d'évaluation
- Pompe VolumétriqueDocument23 pagesPompe VolumétriqueAmi RaPas encore d'évaluation
- 9 5 TD 3 Sujet PDFDocument3 pages9 5 TD 3 Sujet PDFMohamed MohamedPas encore d'évaluation
- 2 PneumatiqueDocument18 pages2 PneumatiqueMehdi AgoubPas encore d'évaluation
- Valve de PressionDocument33 pagesValve de PressionKatia MuslimaPas encore d'évaluation
- M11 - Analyse de Circuits Pneumatiques Initiation PDFDocument40 pagesM11 - Analyse de Circuits Pneumatiques Initiation PDFHassan Azmi100% (2)
- Hydraulique Industrielle - CoursDocument103 pagesHydraulique Industrielle - CoursEl Filali MhammedPas encore d'évaluation
- FLUIDSIMDocument7 pagesFLUIDSIMWassim BhaPas encore d'évaluation
- Technologie - Les Composants Pneumatiques (1 Ère Partie)Document31 pagesTechnologie - Les Composants Pneumatiques (1 Ère Partie)Nicola VitulliPas encore d'évaluation
- Schematisation HydrauliqueDocument5 pagesSchematisation HydrauliqueOmar ChPas encore d'évaluation
- Introduction Automatisme IndustrielDocument74 pagesIntroduction Automatisme IndustrielGuy Gildas Djem100% (1)
- Module 1 Chapitre 1 Schematisation Pneumatique A11Document32 pagesModule 1 Chapitre 1 Schematisation Pneumatique A11Brahim AmiatafaPas encore d'évaluation
- Cours HydrauliqueDocument99 pagesCours HydrauliqueSalma BelfallahPas encore d'évaluation
- M20 Circuits Hydrauliques GE MMOAMPADocument80 pagesM20 Circuits Hydrauliques GE MMOAMPAhavoc2012100% (1)
- Exercice 1 Grafcet-APIDocument3 pagesExercice 1 Grafcet-APIiman khadirPas encore d'évaluation
- EcolsabDocument70 pagesEcolsabValbien NkounkouPas encore d'évaluation
- APIDocument19 pagesAPIhalim otmanePas encore d'évaluation
- Cours Hydraulique L3 CM UsthbDocument10 pagesCours Hydraulique L3 CM UsthbHamza BellemouPas encore d'évaluation
- Convertir VérinsDocument3 pagesConvertir VérinsBALLOUK SoufianePas encore d'évaluation
- Fiche Résumé DistributeursDocument2 pagesFiche Résumé Distributeursyouri59490Pas encore d'évaluation
- Support de Cours de 'Systémes de Transmission Hydraulique'Document15 pagesSupport de Cours de 'Systémes de Transmission Hydraulique'OthmaniAliPas encore d'évaluation
- TP4 Pneumatique PDFDocument6 pagesTP4 Pneumatique PDFJoseph DamakoaPas encore d'évaluation
- ReducteurDocument106 pagesReducteursélem Az100% (1)
- Cours GRAFCETDocument22 pagesCours GRAFCETTomas Sanchez TronoPas encore d'évaluation
- Séminaire CompresseurDocument59 pagesSéminaire Compresseurballa bammounePas encore d'évaluation
- Vocabulaire Technique SPA3Document35 pagesVocabulaire Technique SPA3GOUAL SaraPas encore d'évaluation
- 02b - Les Fluides Hydraulique PDFDocument3 pages02b - Les Fluides Hydraulique PDFkaka kaladzePas encore d'évaluation
- 01 - Dossier Symboles HydrauliquesDocument11 pages01 - Dossier Symboles HydrauliquesLehleh Rida0% (1)
- Entretien Et Maintenance Des Engins Agricoles Introduction À La Pneumatique Et À L'hydraulique (Niveau de Base)Document64 pagesEntretien Et Maintenance Des Engins Agricoles Introduction À La Pneumatique Et À L'hydraulique (Niveau de Base)Khemili Sayf100% (1)
- Chap.4.Installations PneumatiquesDocument71 pagesChap.4.Installations PneumatiquesAbdelghani Cheniki100% (2)
- ADocument56 pagesAHoussam Haddouchane100% (2)
- Commande Electrovanne PDFDocument2 pagesCommande Electrovanne PDFRoy100% (1)
- Chap3controle de Debit Et de PressionDocument20 pagesChap3controle de Debit Et de Pressionamine bez100% (1)
- Machine ThermiqueDocument34 pagesMachine ThermiqueAzzeddine MokhtarPas encore d'évaluation
- HydrauliqueDocument24 pagesHydrauliqueOtman MchachtiPas encore d'évaluation
- Introduction Aux Systèmes Automatisés de ProductionDocument30 pagesIntroduction Aux Systèmes Automatisés de ProductionAmine Ait Elaasri100% (4)
- MONEMO Guideko JoeDocument72 pagesMONEMO Guideko JoeEssia NguiliPas encore d'évaluation
- Devoir Hydrolyque PneumatiqueDocument2 pagesDevoir Hydrolyque PneumatiquebaptichosendyPas encore d'évaluation
- TD Pompe Hydraulique EleveDocument4 pagesTD Pompe Hydraulique EleveHatem Laajili0% (1)
- 9 7 TD 3 CorrectionDocument6 pages9 7 TD 3 CorrectionToute EtudePas encore d'évaluation
- TP 4 Cablage Circuit Hydraulique PDFDocument17 pagesTP 4 Cablage Circuit Hydraulique PDFKhaoula Zefane0% (1)
- 2 Pompe À Pistons PDFDocument8 pages2 Pompe À Pistons PDFkarim khorsi100% (1)
- Chapitre 2 Organes PneumatiquesDocument6 pagesChapitre 2 Organes PneumatiquesDayang Dayang100% (1)
- Introduction À La Fabrication MécaniqueDocument14 pagesIntroduction À La Fabrication MécaniqueAnonymous 9qKdViDP4Pas encore d'évaluation
- Fusion 360 | étape par étape: Conception CAO, Simulation FEM & FAO pour les débutants.D'EverandFusion 360 | étape par étape: Conception CAO, Simulation FEM & FAO pour les débutants.Pas encore d'évaluation
- Fiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesD'EverandFiabilité, maintenance prédictive et vibration des machinesPas encore d'évaluation
- Simulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysD'EverandSimulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysPas encore d'évaluation
- Autodesk Inventor | étape par étape: Conception CAO et Simulation FEM avec Autodesk Inventor pour les DébutantsD'EverandAutodesk Inventor | étape par étape: Conception CAO et Simulation FEM avec Autodesk Inventor pour les DébutantsPas encore d'évaluation
- Cours D'hydrauliqueDocument33 pagesCours D'hydrauliqueSteph Akys80% (5)
- Hydraulique IndustrielleDocument35 pagesHydraulique IndustrielleHicham Boudrare100% (4)
- Le Groupe HydrauDocument9 pagesLe Groupe HydrauDriss SoulaimaniPas encore d'évaluation
- 2 Hydraulique IndustrielDocument58 pages2 Hydraulique IndustrielhatemPas encore d'évaluation
- 2 Hydraulique IndustrielDocument33 pages2 Hydraulique IndustrielEtienne BouronPas encore d'évaluation
- Hydraulique - La Centrale HydrauliqueDocument5 pagesHydraulique - La Centrale Hydrauliquejasim hamadPas encore d'évaluation
- Technologie Des Équipements HydrauliquesDocument34 pagesTechnologie Des Équipements HydrauliquesWalid BenaziPas encore d'évaluation
- Chap 3 M1 S2Document45 pagesChap 3 M1 S2Messaoud MisoPas encore d'évaluation
- Generalites Sur Les Circuits Dans Un Systeme HydrauliqueDocument15 pagesGeneralites Sur Les Circuits Dans Un Systeme HydrauliqueMahandrison Faste RobertPas encore d'évaluation
- Examen TP2 FAODocument2 pagesExamen TP2 FAOPermaflex Route Bekalta TeboulbaPas encore d'évaluation
- Tlija2012cours FAO - Leçon3 Et 4Document91 pagesTlija2012cours FAO - Leçon3 Et 4Permaflex Route Bekalta TeboulbaPas encore d'évaluation
- Examen TP FAO3Document2 pagesExamen TP FAO3Permaflex Route Bekalta TeboulbaPas encore d'évaluation
- Tlija CAO Leçon2 3 4 5Document81 pagesTlija CAO Leçon2 3 4 5Permaflex Route Bekalta TeboulbaPas encore d'évaluation
- Notions de Base en HydrauliqueDocument5 pagesNotions de Base en HydrauliquePermaflex Route Bekalta TeboulbaPas encore d'évaluation
- DistributeurDocument8 pagesDistributeurPermaflex Route Bekalta TeboulbaPas encore d'évaluation
- Remplacement Kit DistributionDocument5 pagesRemplacement Kit DistributionPermaflex Route Bekalta TeboulbaPas encore d'évaluation
- F-209-01 Distribution Des Moules Selon Machine D Injection)Document1 pageF-209-01 Distribution Des Moules Selon Machine D Injection)Permaflex Route Bekalta TeboulbaPas encore d'évaluation
- Chapitre 8 Prédimensionnement PDFDocument6 pagesChapitre 8 Prédimensionnement PDFWissem TaktakPas encore d'évaluation
- 9flexion ComposéDocument6 pages9flexion ComposéSouleymane Hermann BoroPas encore d'évaluation
- Cours GéothermieDocument81 pagesCours GéothermierutheneparisPas encore d'évaluation
- THPDocument96 pagesTHPTessi MakuyaPas encore d'évaluation
- Dab NKV65-2-2 10HPDocument3 pagesDab NKV65-2-2 10HPKhouja SamirPas encore d'évaluation
- Documentation Technique Can Aux Venturi Is Ma CompressedDocument9 pagesDocumentation Technique Can Aux Venturi Is Ma Compressedmili gamer roro game ROBLOX YESPas encore d'évaluation
- TP RDMDocument10 pagesTP RDMSoulaima100% (2)
- TP Echangeur ADocument19 pagesTP Echangeur AMohammedPas encore d'évaluation
- Corrige Exo Me CA Flu 1415Document19 pagesCorrige Exo Me CA Flu 1415Hafsa Alilat100% (8)
- Chap0 ONDES CHOC NORMAL OBLIQUE ECLT SUPERSONIQUEDocument19 pagesChap0 ONDES CHOC NORMAL OBLIQUE ECLT SUPERSONIQUEŒūb Æÿ KęVįnPas encore d'évaluation
- Solide de HOOKDocument80 pagesSolide de HOOKHanane BenGamra0% (1)
- Chaudieres Iut LokDocument76 pagesChaudieres Iut LokHermas SEYIKPE100% (1)
- Chapitre6 DM Double Vitrage PDFDocument2 pagesChapitre6 DM Double Vitrage PDFaboubakar GOMNAPas encore d'évaluation
- TD3 2019Document7 pagesTD3 2019Hassan ChehouaniPas encore d'évaluation
- Note de Calcul R 4Document40 pagesNote de Calcul R 4mef100% (2)
- Tp01ecoulement LamineairDocument15 pagesTp01ecoulement LamineairhousamPas encore d'évaluation
- Distribution Des Sollicitations HorizontalesDocument18 pagesDistribution Des Sollicitations Horizontalesmadjid tighiltPas encore d'évaluation
- Ffi1,, T1.: Y-Y Y-YDocument1 pageFfi1,, T1.: Y-Y Y-YFatih IlyezPas encore d'évaluation
- Présentation Mohamed BelbarakaDocument41 pagesPrésentation Mohamed BelbarakaMohamed BelbarakaPas encore d'évaluation
- 03 Meca0444-RdmDocument57 pages03 Meca0444-Rdmahmed kammounPas encore d'évaluation
- P243 Bton Arm BAEL AbdellatiDocument156 pagesP243 Bton Arm BAEL AbdellatiAbdelaliElFaiz100% (1)
- Cours ADS-convertiDocument36 pagesCours ADS-convertiHafsa MajentaPas encore d'évaluation
- Cours MefDocument58 pagesCours MefMohcenLaribi50% (2)
- Fiche Technique Vanne A Opercule Fonte Siege Inox Din 3202 f4 Brides Pn16Document7 pagesFiche Technique Vanne A Opercule Fonte Siege Inox Din 3202 f4 Brides Pn16YASSINE EZMAMTIPas encore d'évaluation
- CINTAC V 1-12 - 11 FrEnDocument52 pagesCINTAC V 1-12 - 11 FrEnBilelPas encore d'évaluation
- RDM: Méthode de CROSSDocument10 pagesRDM: Méthode de CROSSSimou El Mahmodi75% (4)
- Cours de Thermo ClassiqueDocument102 pagesCours de Thermo ClassiqueAmadou CISSEPas encore d'évaluation
- Série #2 Chimie 2Document1 pageSérie #2 Chimie 2Sara AkliPas encore d'évaluation
- Devoir LibreDocument3 pagesDevoir LibreFouad DimanePas encore d'évaluation
- eCLIMATIC - User Manual. FrançaisDocument202 pageseCLIMATIC - User Manual. FrançaisZakiFroidPas encore d'évaluation