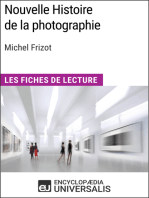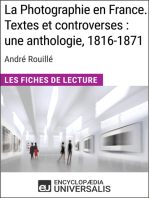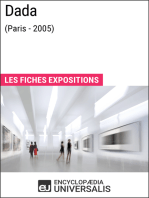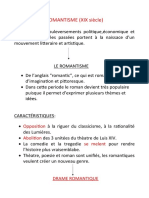Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Questionsdecommunication 5859
Transféré par
Mena AvvisatiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Questionsdecommunication 5859
Transféré par
Mena AvvisatiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Questions de communication
8 | 2005
Mondes arabophones et médias
Danièle MÉAUX, Jean-Bernard VRAY, dirs, Traces
photographiques, traces autobiographiques
Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, CIEREC,
Travaux 114, coll. Lire au présent, 2004, 296 p.
Emmanuel d’Autreppe
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/5859
DOI : 10.4000/questionsdecommunication.5859
ISSN : 2259-8901
Éditeur
Presses universitaires de Lorraine
Édition imprimée
Date de publication : 1 décembre 2005
Pagination : 489-493
ISBN : 978-2-86480-868-8
ISSN : 1633-5961
Référence électronique
Emmanuel d’Autreppe, « Danièle MÉAUX, Jean-Bernard VRAY, dirs, Traces photographiques, traces
autobiographiques », Questions de communication [En ligne], 8 | 2005, mis en ligne le 29 mai 2012,
consulté le 08 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/questionsdecommunication/5859 ;
DOI : https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.5859
Ce document a été généré automatiquement le 8 avril 2021.
Tous droits réservés
Danièle Méaux, Jean-Bernard Vray, dirs, Traces photographiques, traces autobi... 1
Danièle MÉAUX, Jean-Bernard VRAY,
dirs, Traces photographiques, traces
autobiographiques
Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, CIEREC,
Travaux 114, coll. Lire au présent, 2004, 296 p.
Emmanuel d’Autreppe
RÉFÉRENCE
Danièle MEAUX, Jean-Bernard VRAY, dirs, Traces photographiques, traces
autobiographiques, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, CIEREC,
Travaux 114, coll. Lire au présent, 2004, 296 p.
1 Photographie, trace, autobiographie : à première vue, ce livre paraît avoir vingt ans.
1983-1984, c’est l’époque où, dans la foulée et sur les traces du « ça-a-été » énoncé par
Roland Barthes dans La Chambre claire (Paris, Cahiers du cinéma/Gallimard/Éd. Le
Seuil, 1980), – qui vient d’ailleurs d’être réédité… à l’identique !, ses essais parus aux
Cahiers de la photographie réapparaissant sur les tables et les rayonnages, sous la jaquette
en trompe-l’œil d’un « nouvel » éditeur –, les sémioticiens et les théoriciens de la
photographie (Krauss, Schaeffer, Dubois, Vanlier) dépoussiéraient Charles S. Peirce et
s’accordaient à accorder, dans le signe photographique, le primat à la dimension
indicielle : indice, index, trace de lumière et empreinte du référent avant tout, le
référent fût-il le sujet lui-même. Pris dans le tourbillon et les accents définitifs de cette
révélation, l’on risquait de perdre de vue que la photographie était bien sûr également
peinture (de soi, de lumière, d’Histoire…), écriture ou musique, gorgée de silences à
l’aura funèbre, limpide ou mystérieuse, fascinante. C’était l’époque où ce sujet qui se
prenait pour sujet, s’écrivait, se peignait tout en cherchant l’en-soi de l’image, donnait
lieu à des prises de position et des manifestes ; dans la pratique de certains, ces
réflexions allaient guider de nouvelles esthétiques, jusqu’à une éthique ou un mode de
Questions de communication, 8 | 2005
Danièle Méaux, Jean-Bernard Vray, dirs, Traces photographiques, traces autobi... 2
vie déterminant, un habitus ou une seconde nature, voire des troubles obsessionnels
compulsifs : le néologisme « photobiographie » entrait dans les mœurs et pour ainsi
dire dans le langage courant, faisait école et drainait une flopée d’études et de
pratiques diverses dans le sillage du « Manifeste photobiographique » de Claude Nori et
Gilles Mora (L’Été dernier. Manifeste photobiographique, Paris, Éd. de l’Étoile, 1983 ; la
même année paraissait le numéro 13 des Cahiers de la photographie consacré à la
photobiographie).
2 C’était, glorieuse, l’époque également où ces études, ces pratiques, ces horizons divers
et nouveaux se voyaient brassés, mêlés dans de plantureux colloques ou de lourdes
publications, comme par exemple celles du GERMS (Pour la photographie, trois tomes,
Paris/Sammeron, 1982-1990) – initiatives fourre-tout, inégales, débordantes, avant-
gardistes à leur manière, pionnières et passionnées. C’était l’époque des emballements,
des débordements, d’une fièvre ontologique galopante et d’une (trop ?) rapide
consolidation théorique sur le socle du disparate, dont le boum du marché de l’art
photographique, les effets de mode ravageurs, les avancées technologiques
« insensées » et le grand barouf des esthétiques allaient rapidement brouiller les
postulats et dissiper les contours.
3 Ce n’est pas dire pour autant, loin de là, que ce temps est à enterrer et que ce livre
retarde de vingt ans : ses vingt ans, il les a, il les assume. Cette époque – il vient après –,
il en a conscience, il porte lui-même des traces, mesure des écarts. Des objets anciens
(travaux de C. Sherman, P.-A. Gette) y sont considérés sous un jour nouveau ; d’autres,
plus récents, s’y adjoignent, comme la peinture photo-cinématographique de Jeff Wall,
effleurée, ou les inévitables stratégies d’évitement, d’évidement ou de renforcement
identitaire de Sophie Calle, dont les 18 000 sites internet consacrés à l’artiste ne
suffisent apparemment pas à faire le tour, puisque deux contributions lui sont à
nouveau ici consacrées, celles de Jean Arrouye, « Des histoires vraies + dix de Sophie Calle.
Photographie et autobiographie » et de Jean-Paul Guichard, « Poker menteur : de la
photographie comme preuve de l’existence de Sophie Calle ». On pourra regretter
certaines absences, comme les sommes très différentes, mais tout aussi vertigineuses et
fascinantes, publiées récemment par un Michael Bradford (Drive by Shootings, Köln/
Hagen/Paris, Könemann, 2000), un Denis Proteor (Parts pour l’âme chaudron, Paris,
Marval, 2000) ou un Antoine d’Agata (Vortex, Hometown, Stigma…), qui semblent avoir
trop peu encore droit de cité dans ce réseau d’études et ce type de publication. On
mesure aussi, à l’aune et à l’ère du numérique, la capacité de renouvellement d’un
moyen expressif, viscéralement lié aux tentatives introspectives et aux aspirations
existentielles du créateur : l’utilisation de traces biographiques comme embrayeurs
d’écriture existait dès avant la photographie, s’y est arrimée avec voracité, lui survivra
peut-être et même probablement – s’il est vrai que la photographie, sous les aspects
classiques qui ont dominé pendant cent cinquante ans, est vouée à disparaître bel et
bien, ou à se diversifier sous des formes quasi méconnaissables. Cette question n’est
d’ailleurs pas non plus éludée : c’est ce que Régis Durand, cité par Danièle Méaux dans
son introduction (p. 8), appelle « le champ élargi » : « La perte de la place centrale
occupée par le médium “pur”. […] Le champ photographique est aujourd’hui en crise,
en pleine anomie, traversé de courants contradictoires qui tentent de récupérer une
partie du capital symbolique d’un médium en voie d’obsolescence technique… »
(Disparités. Essais sur l’expérience photographique 2, Paris, Éd. La Différence, 2002,
pp. 19-21). Et Gilles Mora lui-même revient, pour l’occasion et pour la seconde fois
Questions de communication, 8 | 2005
Danièle Méaux, Jean-Bernard Vray, dirs, Traces photographiques, traces autobi... 3
(après une première révision en 1999), de façon critique sur les traces de son célèbre
« Manifeste photobiographique » de 1983 ; ces trois textes (pp. 103-118), bien dans la
manière enlevée et pertinente de Gilles Mora, accessible à défaut d’être toujours
détaillée ou mesurée, continuent de receler, outre un intérêt historique évolutif
évident, quelques-unes des questions et des réflexions parmi les plus porteuses du
recueil.
4 Danièle Méaux et Jean-Bernard Vray dirigent cet ouvrage ; ils avaient déjà dirigé le
colloque de mai 2003 (CIEREC, université Jean Monnet/IUFM de l’Académie d’Amiens)
dont il est la trace. Mais dans le champ de la photographie, cette notion même de trace
– à l’utilité avérée et qui a prouvé aujourd’hui tant sa pertinence que ses limites, voire à
cet égard la façon, efficace mais lapidaire, dont André Rouillé lui règle son compte dans
le chapitre « Misère de l’ontologie » de son récent essai La Photographie (Paris,
Gallimard, Folio Essais, 2005) – mérite d’être reconsidérée, ce que font ici les
interventions de François Coblence et de François Soulages. Le premier entreprend de
revenir, « au risque de repasser par des sentiers battus, […] sur cette dimension
[indicielle], et sur ce que l’historien Carlo Ginzburg a nommé “paradigme indiciaire”,
pour réinterroger la notion de trace et sa constitution » (« L’invention et l’effacement
des traces », p. 25) – ce qui le mènera notamment à Marcel Proust. Le second,
proustien en cela lui aussi, invite au dépassement, constatant qu’« une trace ne vaut
rien telle quelle : il faut la travailler ; cela ne veut pas dire la faire revivre, ni faire
revivre le vivant dont elle est la trace, mais produire quelque chose à partir d’elle. La
trace est point d’inflexion, à la fois point d’arrivée et point de départ » (« La trace
ombilicale », p. 20). C’est, soit dit en passant, le leurre dans lequel tombera le Barthes
de La chambre claire, de ne pas les considérer à la fois mais séparément, prenant pour
point de départ à sa recherche telles images (le tout-venant d’une production
impossible à classer et à catégoriser) et pour point d’arrivée telle autre, singulière et
fétichisée (l’ultime trace de reconnaissance de sa mère au jardin d’hiver). Dès lors, on
voit toute la différence qui, pour saisir là l’énième occasion de paraphraser Jean-Luc
Godard, sépare l’obsession barthésienne de la recherche d’une « image juste », des
mises en scène du photographe et écrivain Jean-Loup Trassard : sur les traces de sa
mère disparue, celui-ci reconstitue les signes d’une présence quotidienne, familière, et
produit « juste des images » (d’une série pudique et émouvante d’ailleurs intitulée
« Juste absente » ; voire « Piège à temps », p. 48).
5 De cette réélaboration qui peut être aussi détournement, Jean Le Gac s’est fait l’un des
plus ardents et subtils praticiens, comme le montre l’étude de Jean-Pierre Mourey :
« Figures du théologien, du rédempteur, du prestidigitateur, et finalement du peintre.
Rapport spéculaire et dédoublement de l’auteur en ces figures. Depuis les années 70, à
travers une œuvre patiemment construite dans la diversité de ses moyens et dans
l’unité complexe de son projet, Jean Le Gac intègre sa personne, son nom dans les
tableaux, les photographies, les textes qu’il élabore » (« Fiction et mise en récit : Jean Le
Gac », pp. 53-54). Rappelant brièvement les principales phases de cette œuvre,
l’éclairant texte de Pierre Mourey se centre ensuite sur les rapports de la photographie
et de l’autobiographie dans ce jeu. Une façon plurivoque de brouiller les cartes, les
pistes, les traces, d’égarer les sens et l’essence qui n’est pas sans parenté avec l’œuvre
de Paul-Armand Gette, créateur en marge, artiste qui « en écartant l’univocité des
explications et des spécialisations du savoir, [a] fait de la lisière un espace privilégié
d’émancipation et de création » ; les sous-titres des paragraphes que lui consacre Lydie
Rekow dans son étude (« Paul-Armand Gette, photographe autobiographe ? » –
Questions de communication, 8 | 2005
Danièle Méaux, Jean-Bernard Vray, dirs, Traces photographiques, traces autobi... 4
« Écriture de l’œuvre/Résurgences, pérennités/Scènes de jeu/Feinte », p. 83 et sq.)
suffisent à dire la façon perspicace dont, de bordure en frontière, elle a suivi les
trajectoires multiples et subtiles de Paul-Armand Gette. Michel Séméniako, quant à lui,
revient brièvement sur l’expérience des « portraits négociés » qu’il mène depuis 1983,
« modeste contribution artistique à [des] questionnements sur l’identité et l’altérité »
(p. 97).
6 Passé le triptyque photobiographique de Gilles Mora qui fait ici quasi office de colonne
vertébrale, la partie « Photographies et vie intime » de l’ouvrage s’ouvre sur un
étonnant mélange de politique et d’intimité dans la passionnante lecture que Jean-
Pierre Montier livre de l’œuvre de Joseph Koudelka (« Traces de soi en régime
totalitaire », pp. 119-130, est d’ailleurs le seul texte à mentionner et à reprendre l’utile
et dynamique distinction que propose Serge Tisseron entre empreinte et trace, en note,
p. 125). Puis Louise Merzeau relate une expérience de « journal photographique sur le
web » (p. 131), Paul Léon tente de conjuguer à « un futur antérieur sans cesse déchiré »
(p. 137) le film de Jean Eustache Les Photos d’Alix (1981 – en redisant, en retraduisant
peut-être trop fidèlement l’inachèvement du film, et sans mentionner aucune autre
étude et notamment celles, récentes, qui ont déjà examiné comment l’essai d’Eustache,
centré sur la personne d’Alix Cléo-Roubaud, avait pu défaire la ressemblance
photographique : voir notamment Le Maître B., Lageira J., Wrona C., Breschand J., « La
récalcitrance au cinéma. Quatre lectures du film de Jean Eustache : Les photos d’Alix »,
in : Gagnebin M., Savinel Chr., dirs, L’image récalcitrante, Paris, Presses de la Sorbonne
Nouvelle, 2001), avant que Bernard Lafargue ne procède aux « Toilettes
photographiques de l’intime » (pp. 145-162, autour de Mapplethorpe, Goldin, Molinier
ou – encore ! – Calle) et que Jean-Claude Bélégou n’évoque, longuement, la manière
personnelle dont il n’a cessé de mêler la photographie à sa propre vie.
7 La dernière partie (« Photographie et écriture autobiographique ») recoupe assez large-
ment, signalons-le, le corpus constitué par Sylvie Jopeck dans une anthologie publiée
en même temps que ces actes, joli petit outil de travail (La Photographie et
l’(auto)biographie, Paris, La Bibliothèque Gallimard, 132, 2004), tout en l’abordant bien
sûr avec davantage de profondeur. Dans une juxtaposition sans autre structure
apparente que celle que laisse présager son titre (« L’image de soi dans le récit
d’enfance »), le texte d’Alain Schaffner finit par se cristalliser autour du morceau
probablement le plus intéressant, le plus retors et le moins classique : Georges Perec.
Stéphane Chaudier, feuilletant par fragments, par couches, par strates et à grand
renfort de citations le Roland Barthes qui, de 1975 à sa mort, s’est beaucoup préoccupé
des rapports du langage et de l’image, décèle chez le sémiologue l’ontologie précaire
dévolue à la photographie. Agnès Castiglione livre une lecture fouillée, complexe, des
Belles endormies de Gérard Macé, Agnès Fayet explore Le Labyrinthe du monde de
Yourcenar (regroupant Souvenirs pieux, Archives du nord et Quoi ? L’éternité), Christine
Jérusalem démonte avec précision et examine les « mécaniques optiques » au travail
chez François Bon, Philippe Antoine compare, croise et entremêle les récits de voyage
en Russie d’Olivier Rolin et de Jean-Loup Trassard – lequel Trassard fait une dernière
apparition, comme en lointain écho et pour clôturer l’ensemble de ces études, dans un
texte de Bernard Vray joliment intitulé « La dormance et la trace » (pp. 261-272).
8 Un ensemble riche, composite, vertigineux parfois, et souvent stimulant. Un parcours
clair dans un sujet inépuisable voire inextricable. Au fond, l’image photographique aura
peut-être été l’idéal consacré, presque la bouée de sauvetage des professionnels de
Questions de communication, 8 | 2005
Danièle Méaux, Jean-Bernard Vray, dirs, Traces photographiques, traces autobi... 5
l’image et du regard, à qui elle aura imposé des mises en ordre sans la possibilité
d’ignorer son désordre intrinsèque – nuisibles extrêmes dont les actes de ce colloque
ont su se préserver. Aucun auteur n’insiste ici sur le fait que cet équilibre précaire
construit sur le dos de la trace, matrice fondatrice, allait progressivement faire place à
la grande confusion des genres ; seuls espéraient y échapper ceux qui cherchaient, qui
voulaient voir là une image de soi, une réflexivité, un indice (même mince comme une
image et transitoire) d’existence propre. Car c’est Narcisse lui-même – et non pas
seulement le philosophe, comme le dit Yves Michaud –, que la photographie aura une
dernière fois réussi à « piéger aux charmes de l’image » (Michaud Y., « Formes du
regard. Philosophie et photographie », in : Frizot M., dir., Nouvelle histoire de la
photographie, Paris, Bordas/A. Biro, 1995, p. 738). Dans notre Occident éphémère où la
spectacularisation des reflets gagne en vitesse et en surnombre, seule la conscience –
pour combien de temps ? et quelles traces cela laisse-t-il ? – émerge encore un peu du
magma informe, opaque. Autant dire qu’il vaut mieux, comme y invitent les analyses et
les travaux photobiographiques les plus féconds et les plus porteurs de cet ouvrage,
jeter le regard devant soi pour s’y reconnaître et s’y projeter, plutôt que de tenter
d’identifier, dans l’impossible centre du tourbillon, une essence réflexive, le nombril de
la photographie – ou l’inverse –, la trace (é)perdue d’un passé qui hante un présent
esseulé. Sur les cendres encore tièdes des traces argentiques, s’annoncent d’ailleurs
bruyamment la pixellisation de nos existences, le passage de la constatation à la
constellation, la dissolution peut-être inéluctable du sujet.
9 Christian Boltanski (grand absent de cette photo de groupe) aura peut-être le plus
puissamment pressenti et le mieux expérimenté cette nécessité, depuis longtemps :
prendre la photographie à rebours de l’identité et de ses preuves supposées, et sans le
faire au détriment d’une peinture de l’Histoire, grande ou intime … De traces en traces,
le chemin vers soi est alors infini, et le grand récit photographique, à poursuivre, à
prolonger.
AUTEURS
EMMANUEL D’AUTREPPE
Université d’Anvers École supérieure des Arts Saint-Luc, Liège
emmanuel.dautreppe@ccrv.be
Questions de communication, 8 | 2005
Vous aimerez peut-être aussi
- FR Parole Eternelle Rouge3 Psaumes PDFDocument101 pagesFR Parole Eternelle Rouge3 Psaumes PDFEric MerlinPas encore d'évaluation
- Objectif Mémoire Au Lycée Et À Luniversité - Re - Trouvez Le Goût de Travailler Avec Plaisir Et Effica PDFDocument184 pagesObjectif Mémoire Au Lycée Et À Luniversité - Re - Trouvez Le Goût de Travailler Avec Plaisir Et Effica PDFAxel Ndjore100% (2)
- Nouvelle Histoire de la photographie de Michel Frizot: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandNouvelle Histoire de la photographie de Michel Frizot: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Roland Barthes, Le Metier D'ecrireDocument905 pagesRoland Barthes, Le Metier D'ecrirerodielpo80% (5)
- Les Cahiers Du Cinéma, Histoire D'une Revue, Tome 1 A L'assaut Du Cinéma, 1951-1959-Cahiers Du Cinéma (Antoine de Baecque, 1991) PDFDocument354 pagesLes Cahiers Du Cinéma, Histoire D'une Revue, Tome 1 A L'assaut Du Cinéma, 1951-1959-Cahiers Du Cinéma (Antoine de Baecque, 1991) PDFSdef AdertPas encore d'évaluation
- Le Regard Vide - Jean-Francois MatteiDocument22 pagesLe Regard Vide - Jean-Francois Matteistephie_elphie100% (1)
- Des Dispositifs Pulsionnels - Lyotard, Jean François - 1980 - Paris - C. Bourgois - 9782267002034 - Anna's ArchiveDocument328 pagesDes Dispositifs Pulsionnels - Lyotard, Jean François - 1980 - Paris - C. Bourgois - 9782267002034 - Anna's ArchivesolderanataliaPas encore d'évaluation
- Séance 6: Le Journal D'un Clone de GuduleDocument4 pagesSéance 6: Le Journal D'un Clone de GudulefranckPas encore d'évaluation
- La Photographie contemporaine de Michel Poivert: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLa Photographie contemporaine de Michel Poivert: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Jacques Ranciere Aisthesis Scenes Du Regime Esthetique de Lart 1 PDFDocument315 pagesJacques Ranciere Aisthesis Scenes Du Regime Esthetique de Lart 1 PDFKiara100% (3)
- Marcel Proust Aujourd'HuiDocument257 pagesMarcel Proust Aujourd'Huihattabsat100% (2)
- CHAPITRE 10 BOITE À MERVDocument1 pageCHAPITRE 10 BOITE À MERVFd Mt75% (4)
- Un Cerf en AutomneDocument21 pagesUn Cerf en AutomnemajoPas encore d'évaluation
- Mytho CritiqueDocument58 pagesMytho CritiqueAhlem OurabiPas encore d'évaluation
- Abensour - Adorno en FranceDocument14 pagesAbensour - Adorno en FranceEspaceContreCimentPas encore d'évaluation
- Didi-Huberman, G. - L Album de L Art À L Époque Du Musée ImaginaireDocument7 pagesDidi-Huberman, G. - L Album de L Art À L Époque Du Musée ImaginaireMaringuiPas encore d'évaluation
- Pierre Brunel MythocritiqueDocument252 pagesPierre Brunel MythocritiqueNour100% (5)
- Dictionnaire Des Philosophes Antiques (T. 3) - R. Goulet (Dir.)Document1 070 pagesDictionnaire Des Philosophes Antiques (T. 3) - R. Goulet (Dir.)Luciana100% (1)
- Lecture Suivie On A Vole Le Soleil Premiere PartieDocument5 pagesLecture Suivie On A Vole Le Soleil Premiere PartieDomi MartinPas encore d'évaluation
- Annie Le Brun Ethique de L Ecart AbsoluDocument87 pagesAnnie Le Brun Ethique de L Ecart AbsoluCarlosPas encore d'évaluation
- La Condition Humaine MalrauxDocument22 pagesLa Condition Humaine MalrauxHORUSPas encore d'évaluation
- Dosse Ricouer - d05431 - ChapitresDocument145 pagesDosse Ricouer - d05431 - ChapitresRuiMascarenhas100% (4)
- Lyotard - Questions Au CinemaDocument31 pagesLyotard - Questions Au CinemaZioraneskoPas encore d'évaluation
- EXTRËME Esthétique de La Limite DépasséeDocument22 pagesEXTRËME Esthétique de La Limite DépasséeTerra VedaPas encore d'évaluation
- Georges Didi-Huberman - "En Ordre Dispersé. Introduction"Document7 pagesGeorges Didi-Huberman - "En Ordre Dispersé. Introduction"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Effacer - Paradoxe D'un Geste Artistique de Maurice FréchuretDocument7 pagesEffacer - Paradoxe D'un Geste Artistique de Maurice FréchuretThomas FerreiraPas encore d'évaluation
- Etudesphotographiques 3592Document17 pagesEtudesphotographiques 3592TchourosPas encore d'évaluation
- La Photographie en France. Textes et controverses : une anthologie, 1816-1871 d'André Rouillé: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLa Photographie en France. Textes et controverses : une anthologie, 1816-1871 d'André Rouillé: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Rev 1895 1522 42 Francois Albera Marta Braun Andre Gaudreault Sous La Direction de Arret Sur Image Fragmentation Du Temps Stop Motion Fragmentation of TimeDocument5 pagesRev 1895 1522 42 Francois Albera Marta Braun Andre Gaudreault Sous La Direction de Arret Sur Image Fragmentation Du Temps Stop Motion Fragmentation of TimeZelloffPas encore d'évaluation
- Jacques Ranciere Le Destin Des Images PaDocument5 pagesJacques Ranciere Le Destin Des Images PaLuiza VasconcellosPas encore d'évaluation
- Environnement Et Catastrophe PDFDocument571 pagesEnvironnement Et Catastrophe PDFAnonymous saZrl4OBl4Pas encore d'évaluation
- Biblio CioranDocument53 pagesBiblio CioranGianluca SorcinelliPas encore d'évaluation
- Cinema Politique 3 Tables RondesDocument84 pagesCinema Politique 3 Tables RondesCaterinaPredaPas encore d'évaluation
- Siegfried KRACAUER, Théorie Du FilmDocument4 pagesSiegfried KRACAUER, Théorie Du FilmmayconbsPas encore d'évaluation
- Dubois Le FiguralDocument1 pageDubois Le FiguralSandro de OliveiraPas encore d'évaluation
- A-VOTRE-DISPOSITION-Guide Du Visiteur Thomas Ruff-FR-web PDFDocument28 pagesA-VOTRE-DISPOSITION-Guide Du Visiteur Thomas Ruff-FR-web PDFSimone BertiniPas encore d'évaluation
- Recit de Filition ViartDocument19 pagesRecit de Filition ViartAlonso Tapia AranedaPas encore d'évaluation
- Artigo Recit FilmiqueDocument3 pagesArtigo Recit FilmiqueGeraldo RodriguesPas encore d'évaluation
- 3-Bibliographieducours de LINDEPERGDocument4 pages3-Bibliographieducours de LINDEPERGJean CostaPas encore d'évaluation
- Dada (Paris - 2005): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandDada (Paris - 2005): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Quel Est Le Sujet de L Autoportrait MoiDocument4 pagesQuel Est Le Sujet de L Autoportrait MoiLiinda TounsyPas encore d'évaluation
- L'art du nu au XIXe siècle. Le photographe et son modèle (Paris - 1998): Les Fiches Exposition d'UniversalisD'EverandL'art du nu au XIXe siècle. Le photographe et son modèle (Paris - 1998): Les Fiches Exposition d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Photographie, Arme de Classe, Par François Albera (Les Blogs Du Diplo, 15 Janvier 2019)Document6 pagesPhotographie, Arme de Classe, Par François Albera (Les Blogs Du Diplo, 15 Janvier 2019)Paulo MarcelinoPas encore d'évaluation
- Archéologie Des Images Et Logique RétrospectiveDocument18 pagesArchéologie Des Images Et Logique Rétrospectivezalulé zanzibarPas encore d'évaluation
- Support SurfaceDocument50 pagesSupport SurfaceAngelica GonzalezPas encore d'évaluation
- Jameson Fredric - Le Postmodernisme, Ou, La Logique Culturelle Du Capitalisme TardifDocument602 pagesJameson Fredric - Le Postmodernisme, Ou, La Logique Culturelle Du Capitalisme TardifAMINEPas encore d'évaluation
- Cinéma Et PhilosophieDocument5 pagesCinéma Et PhilosophieDuezPas encore d'évaluation
- PhotoTheoria03 201511Document163 pagesPhotoTheoria03 201511NassimDaghighianPas encore d'évaluation
- Jean Baudrillard, 1929Document9 pagesJean Baudrillard, 1929Shorena KhaduriPas encore d'évaluation
- Théorie Du Portrait E.POMMIERDocument3 pagesThéorie Du Portrait E.POMMIERMadame BarbaraPas encore d'évaluation
- Hervé COUCHOT Le Regard Oublié Ou L'impensé Photographique de Claude Lévi-StraussDocument19 pagesHervé COUCHOT Le Regard Oublié Ou L'impensé Photographique de Claude Lévi-StraussHervé CouchotPas encore d'évaluation
- Actes Du Colloque Individualisme Et Autobiographie en Occident de 1979Document2 pagesActes Du Colloque Individualisme Et Autobiographie en Occident de 1979Lauana BuanaPas encore d'évaluation
- La Littérature à l'ère de la photographie de Philippe Ortel: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandLa Littérature à l'ère de la photographie de Philippe Ortel: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Época de Los Aparatas ExtractoDocument20 pagesLa Época de Los Aparatas ExtractoEspolión FilosóficoPas encore d'évaluation
- Corriges Hga3 Mai13Document22 pagesCorriges Hga3 Mai13Paul MagissonPas encore d'évaluation
- Ji-Yoon Han - "Résistance Des Lucioles Review of Survivance Des Lucioles de Georges Didi-Huberman"Document3 pagesJi-Yoon Han - "Résistance Des Lucioles Review of Survivance Des Lucioles de Georges Didi-Huberman"xuaoqunPas encore d'évaluation
- Lhomme 24033Document57 pagesLhomme 24033MohamedMoussafirPas encore d'évaluation
- Arts et architecture-dossier_peda_2021Document31 pagesArts et architecture-dossier_peda_2021mido.medessePas encore d'évaluation
- Editionsulm 1719Document367 pagesEditionsulm 1719Guillermo Alfonso de la TorrePas encore d'évaluation
- Antoine Compagnon Les Cinq Paradoxes de La Modernité - JerichoDocument175 pagesAntoine Compagnon Les Cinq Paradoxes de La Modernité - JerichoAMINEPas encore d'évaluation
- G1 Sem 1998-1999Document40 pagesG1 Sem 1998-1999fullymoonPas encore d'évaluation
- Effacer Paradoxe D Un Geste Artistique DDocument7 pagesEffacer Paradoxe D Un Geste Artistique DThomas FerreiraPas encore d'évaluation
- Stendhal, Deligny, Straub-Huillet Ce Qu'Il en Est Du Désir de CinémaDocument7 pagesStendhal, Deligny, Straub-Huillet Ce Qu'Il en Est Du Désir de CinémaBreno OliveiraPas encore d'évaluation
- Chronique Des Annees EgareesDocument504 pagesChronique Des Annees EgareesAlainzhu100% (1)
- ART DétourDocument6 pagesART Détourabbes18Pas encore d'évaluation
- La Nouvelle Vague: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandLa Nouvelle Vague: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- N° 2 C R I: EditorialDocument68 pagesN° 2 C R I: EditorialAdrian IancuPas encore d'évaluation
- Cours Mã©thodes Des Sciences Juridiques Et Sociales - Chapitre Prã©liminaire CH 1 CH 2 ch3 Et ch4Document50 pagesCours Mã©thodes Des Sciences Juridiques Et Sociales - Chapitre Prã©liminaire CH 1 CH 2 ch3 Et ch4Qo LestPas encore d'évaluation
- Sujet Reflexion BrevetDocument4 pagesSujet Reflexion BrevetHowPas encore d'évaluation
- Livre ÉpuiséDocument6 pagesLivre ÉpuiséArthur LecoqPas encore d'évaluation
- Jacques Le FatalisteDocument16 pagesJacques Le FatalistesamuelbeckettPas encore d'évaluation
- FurbolgDocument1 pageFurbolgj615p365Pas encore d'évaluation
- 6 006 Tombeza PDFDocument64 pages6 006 Tombeza PDFReda Bendimerad100% (1)
- Summary of First UnitDocument14 pagesSummary of First Unitsweetsarah17Pas encore d'évaluation
- Song of Roland WK 5 - Roland, Oliver and The HornDocument3 pagesSong of Roland WK 5 - Roland, Oliver and The HornKriKeePas encore d'évaluation
- Ens 20 0497Document83 pagesEns 20 0497philomenederassem1Pas encore d'évaluation
- "Rapport Sur La Construction Des Situations Et Sur Les Conditions de L'organisation Et de L'action de La Tendance Situationniste Internationale" PDFDocument14 pages"Rapport Sur La Construction Des Situations Et Sur Les Conditions de L'organisation Et de L'action de La Tendance Situationniste Internationale" PDFGrizzly Mexicain VikkingPas encore d'évaluation
- Cours 2 TBA 23-24Document23 pagesCours 2 TBA 23-24Quentin LandoltPas encore d'évaluation
- Des Marque-Pages en Papier MonstrueuxDocument10 pagesDes Marque-Pages en Papier MonstrueuxkeikoPas encore d'évaluation
- Le Drame Des PoisonsDocument350 pagesLe Drame Des PoisonsHISTÓRIA & CATOLICISMO100% (1)
- Sciences Et VieDocument25 pagesSciences Et Vienw9jcfjqnqPas encore d'évaluation
- LL7 Correspondances, Lecture Linéaire - OdtDocument3 pagesLL7 Correspondances, Lecture Linéaire - OdtYanis RienPas encore d'évaluation
- Pollen Le Magicien PistoleroDocument1 pagePollen Le Magicien PistolerojoPas encore d'évaluation
- La TendresseDocument2 pagesLa TendresseAntoine des CourtisPas encore d'évaluation
- Uday Uttar 14.03.24Document12 pagesUday Uttar 14.03.24indrasensingh6177Pas encore d'évaluation
- ROMANTISMEDocument10 pagesROMANTISMEchiara labbruzzoPas encore d'évaluation
- FR20 Te Wo 16 21Document19 pagesFR20 Te Wo 16 21Erza ScarlettPas encore d'évaluation
- Cours HIA S1. - 2020-2021Document17 pagesCours HIA S1. - 2020-2021Jihad El haririPas encore d'évaluation
- Guide Pour Étudiant PDFDocument31 pagesGuide Pour Étudiant PDFOsman AbdourahimPas encore d'évaluation