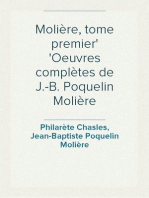Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
LE LATIN AU XVIIe SIÈCLE
Transféré par
Benedetta BartoliniCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
LE LATIN AU XVIIe SIÈCLE
Transféré par
Benedetta BartoliniDroits d'auteur :
Formats disponibles
LE LATIN AU XVII e SIÈCLE: LA FRANCE, RIVALE DE ROME
Author(s): MARIE-MADELEINE MARTIN
Source: Revue des Deux Mondes (1829-1971) , 15 AOUT 1966, (15 AOUT 1966), pp. 575-586
Published by: Revue des Deux Mondes
Stable URL: http://www.jstor.com/stable/44591808
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Revue des Deux Mondes
(1829-1971)
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LE LATIN AU XVIIe SIÈCLE
LA FRANCE, RIVALE DE ROME
Il y a eu, pendant longtemps, une manière simplifiée d'étudier
le XVIP siècle français : elle était strictement littéraire et ne
donnait qu'une explication limitée des faits.
On savait qu'au siècle de Louis XIV (terme inventé par Vol-
taire) une pléiade de grands écrivains avait donné à la langue fran-
çaise un éclat incomparable, et que pour cette raison les dits
écrivains étaient devenus classiques. Mais leur enseignement ayant
été caricaturé au XVIIIe ciècle, et les Romantiques, par la voix
de Victor Hugo, ayant sérieusement raillé ces maîtres à écrire, les
élèves en concluaient que leur œuvre intéressait seulement les dis-
cussions scolaires et les dipustes de cénacles, et restait sans grande
importance pour exprimer la destinée d'une nation. Je ne connais
pas actuellement de livre plus propre à élargir prodigieusement
le débat et à transposer le problème, que celui de l'historien
Gonzague de Reynold : Synthèse du XV IP siècle ; France classi-
que , Europe baroque .
Mais tout en proclamant, au début de ces lignes, ma dette
envers ce grand livre, j'ajoute aussitôt que mon projet n'est point
d'imiter son dessein. Reynold a replacé le XVIIe siècle français
dans l'histoire européenne de son temps et élargi l'étude littéraire
du siècle de Louis XIV, de toute son histoire politique et religieuse.
Je voudrais, pour ma part, tenter ici de montrer cette époque
entre le Moyen Age et le monde contemporain, en définissant son
drame à travers l'histoire du langage ; et voici pourquoi.
Au XIIIe siècle, à cause surtout de l'Université parisienne et de
sa place dans le monde chrétien, la grande œuvre intellectuelle
de l'époque (la construction de la Somme de saint Thomas, face
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
576 LE LATIN AU XVIIe
au monde hellénistique, aux Juifs et au
en France .
Au XVIIe siècle, et pour la dernière fois, la même réussite va
illuminer notre pays.
C'est dans la France du XVIIe siècle, et surtout pendant quel-
ques brèves années (car toutes les réussites parfaites sont, ici-bas,
vite menacées par le dépérissement et la ruine) que va s'accomplir
la vraie Renaissance française, celle qui était capable d'illuminer
le monde, comme le siècle de saint Louis et de saint Thomas
d'Aquin l'avait fait.
C'est dans la France de Louis XIV que l'on pourra croire, subi-
tement, voir ressusciter Rome : mais Rome, païenne et chrétienne
à la fois, avec son génie universel, son pouvoir de conquête res-
semblant à une séduction, à un attrait...
Et ce qu'il ne faut pas cesser de souligner, c'est que la victoire
du Grand Siècle intellectuel s'est faite tout de suite, par un redou-
blement de ferveur envers le latin . Je ne veux pas dire que les
classiques ont méprisé le grec plus que leurs pères du XVIe siècle,
mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont rejoint la grande tradition
du Moyen Age occidental, par delà les engouements hellénistiques
de la Renaissance : ils admettent la place primordiale du latin dans
notre tradition linguistique et ne veulent pas qu'on cultive le grec
sans le latin.
Les plus grands d'entre eux ont su aussi dominer les passions
nationalistes de la Pléiade : ils se font gloire d'écrire aussi bien en
latin qu'en français et, par ce moyen, deviennent les pluß grands
prosateurs que notre nation ait jamais produits dans son histoire.
Ainsi écrivent Richelieu, chef d'Etat, comme Bossuet, chef d'école
et docteur de l'Eglise ; comme Descartes, le nouveau maître de la
philosophie ; comme Corneille, poète et moraliste ; comme Madame
de Sévigné, épistolière au langage si charnu, si ferme ; comme
Pascal, polémiste aigu et exégète tragique. Jamais la langue de
Rome n'a connu une transposition aussi exacte dans un autre lan-
gage (avec son vocabulaire et sa syntaxe, avec son génie affleurant
de façon si proche qu'on croit lire du latin pur, lorsqu'on lit le
français de perfection de ces nouveaux Romains).
Qui écrit ces lignes? Est-ce Tite-Live ou Cicéron ? Non, c'est
Richelieu :
« Pour gouverner des Etats, conduire et maintenir des armées
en discipline, il faut une vertu mâle qui ne se trouve pas aux
hommes communs, sans laquelle, toutefois, ni les Etats ni les
armées ne peuvent être bien gouvernés, ni conservés en leur en-
tier... Il faut, en de telles occasions, pratiquer vertement ce que
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LE LATIN AU XVIIe 577
les préceptes de la politique font conna
et ce que les maximes de la théologie en
Qui écrit ces sentences, ces inscriptio
Sénèque, ou Salluste ? Non, c'est Corneille.
... Je suis maître de moi comme de l'univers
... Mais on doit ce respect au pouvoir absolu
De n'examiner rien quand un roi l'a voulu
...Va contre un insolent éprouver ton courage,
Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage,
Meurs ou tue.
Qui donc cisèle des fables comme Phèdre, des poèmes légers
comme Catulle ou Horace, qui retrouve si souvent les accents d
Géorgiques de Virgile ? C'est un Français : la Fontaine :
...J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique,
La ville et la campagne, enfin tout, il n'est rien
Qui ne me soit souverain bien,
Jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique.
...Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où,
Le héron au long bec emmanché d'un long cou.
Il côtoyait une rivière ;
L'onde était transparente ainsi qu'aux plus beaux jours.
Qui donc manie le fouet de Pétrone, édicté des règles de pro-
sodie comme Horace ? C'est un Français, Boileau :
...J'appelle un chat un chat, et Rolet un fripon.
...Cent fois, sur le métier, remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse et le repolissez,
Ajoutez quelquefois et souvent effacez ...
Qui ressuscite Virgile, avec encore plus de tendresse et de per-
fection ? Un Français : Jean Racine.
...Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous,
Seigneur, que tant de mérs me séparent de vous,
Que le jour recommence ąt que le jour finisse
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice,
Sans que, de tout le jour, je puisse voir Titus ?
Et qui parle le latin de César ou de Tacite, une langue vive, per-
çante, ou bien ramassée en formules abruptes ; qui donc argumente
LA REVUE N° 16 4
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
578 LE LATIN AU XVIIe
comme un scolastique railleur (Abelard
qui fouette comme Juvénal ? Un Françai
...La vérité est si délicate, que si peu q
dans l'erreur ; mais cette erreur est si
éloigner, on se trouve dans la vérité .
Mais surtout, qui a su se nourrir auss
siques que de celui des Pères (et il est
qui a hérité, à la fois, de la période de Cicerón et de la force
dialectique de Thomas d'Aquin ; qui donc aurait été digne, à lui
seul, de réussir l'accord de la Renaissance païenne et du renou-
veau catholique ? C'est Bossuet.
. Dieu seul est grand, mes frères !
C'est cette phrase qu'il redira sous des formes diverses dans
la chaire de Versailles, à son siècle de science déjà grisée d'elle-
même, comme à ces courtisans libertins annonçant les aristo-
crates de la Révolution. Dieu seul est grand !
Et Bossuet tente d'exprimer la grandeur de Dieu dans la lan-
gue des hommes, par l'intermédiaire du latin . C'est en lisant Bos-
suet que l'on peut comprendre la fierté des Français de son temps,
croyant avoir, à jamais, donné de Rome une réplique égale à elle-
même. La langue de Bossuet, c'est du latin vivant, c'est cette pos-
session et cet usage de la langue latine qu'avaient pratiquée tous
les docteurs du Moyen Age chrétien, empruntant à Rome une
forme, des règles, un cadre, mais y plaçant tout l'apport du dogme
nouveau, toutes les confidences d'une civilisation ouverte à l'ave-
nir. « Rome fut la patrie de son intelligence, et la Bible, celle dé
son cœur », dit magnifiquement Jean Calvet, commentant Bossuet.
Sainte-Beuve, auquel manquait, comme à tant d'hommes de
son siècle, le sens du sacré, a senti du moins, dans la phrase de
Bossuet, le long passé romain :
« C'est de cette connaissance approfondie du latin et de l'usage
excellent qu'il sut en faire, que découle, chez Bossuet, ce français
neuf, plein, substantiel, dan$ le sens de la racine ; et original non
seulement dans ses mots, mais encore dans l'ampleur des tours,
dans la forme des mouvements et des liaisons, dans le joint des
phrases, et comme dans le geste ».
Et Gonzague de Reynold avoue :
« Sa maîtrise de la langue a rangé Bossuet parmi les plus
grands classiques . J'en suis à me demander s'il n'est pas le plus
grand ».
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LE LATIN AU XVIIe 579
Cependant les deux révolutions lingu
été réalisées par les poètes ou les orate
cents ans que ceux-ci écrivaient en français. Les deux révolutions
importantes sont la rédaction des Traités diplomatiques en langue
française et la composition des traités philosophiques en français .
Pour le latin, ce sont deux immenses défaites ajoutées à celles
qu'il ne cesse de subir. François Ier lui avait retiré son privilège de
langue juridique, à l'intérieur de son royaume ; le XVIIe siècle lui
retire celui de langage diplomatique et de langage philosophique.
Et ces mutations se font, une fois de plus, au profit du français :
pour deux cents ans (jusqu'à la guerre de 1914-1918) les traités
concluant les guerres européennes seront rédigés en français. C'est
vraiment l'apogée du triomphe de notre langue : les diplomates
vantent sa précision, sa clarté, sa netteté et ce que Rivarol appel-
lera bientôt « cette probité attachée à son génie ». Le royaume
capétien atteint ici l'une de ses réussites capitales : par le moyen
de cette langue reconnue reine, la France apparaît alors comme
« la métropole de l'humanité ». Bientôt, l'Académie de Berlin
mettra au concours la recherche des causes de l'universalité de la
langue française. A la fin du règne de Louis XIV, le grand Leibniz,
philosophe germanique, vient à Paris et à Versailles, pour conseil-
ler à Louis XIV la conquête de l'Egypte et de la Mer Rouge
« comme première étape de la communion des peuples », afin que
puisse bientôt fleurir partout, grâce à la France, « l'empire de la
raison ».
Ils semble vraiment alors à tous , que les rois de France soient
les héritiers désignés des empereurs romains de jadis. C'est en
empereur romain que la municipalité de Paris représente
Louis XIV, au milieu de la Place des Victoires ; et sur les portes
des villes, des inscriptions latines, majestueuses comme les bulle-
tins victorieux de Jules César, apprennent aux peuples du monde,
que la France assume désormais l'héritage de la Ville.
Nul ne peut prévoir à ce moment que la monarchie capétienne
n'a pas cent ans à vivre ; nul ne peut prévoir que la campagne
d'Egypte, « préface à l'unité des peuples », et dont Louis XIV avait
sagement repoussé l'utopie, sera faite par Bonaparte ; et que
le prestige de la langue française ne servira bientôt qu'à répandre
les idées des Encyclopédistes et de la Révolution jusqu'aux limites
de l'univers.
Cependant, si nous avons considéré, le XVIIe siècle comme la
vrai Renaissance du royaume de France, ce n'est pas à cause de
ce triomphe du français ; c'est parce que l'équilibre se maintient
encore à ce moment entre le culte des langues anciennes ( les Hu-
manités) et l'idiome national. Il est d'ailleurs visible que la splen-
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
580 LE LATIN AU XVIIe
deur atteinte par celui-ci, vient de la p
mes cultivés avaient de celle-là.
C'est sous le règne de Louis XIII et de Richelieu, grand admi-
rateur de la latinité, qu'un juriste parisien, Belot, compose un petit
traité fervent sur le latin, dédié au chancelier Séguier. Ce traité
contient beaucoup de vérités essentielles, malgré la modestie de
l'auteur qui voit bien que la lutte entreprise contre le latin, au
profit des langues modernes depuis le XIVe siècle, au profit exclu
sif du grec depuis le XVIe, peut avoir de graves conséquences :
« L'apologie de la langue latine, dit-il, fait voir ... que la religion
peut augmenter ou perdre son zèle, les lois leur autorité et les
sciences, ce qu'elles ont acquis de gloire ». Notre auteur s'élève
contre tous ceux qui trouvent le latin « vieux », méprisent l'his-
toire romaine et disent que ce langage a péri en même temps qu
le peuple qui l'avait enfanté. « Les Romains, rappelle-t-il, commen-
cèrent les traductions du grec dès la naissance de la langue latine
et en un temps qu'elle était extrêmement rude ... Enfin, cette langu
dans son enfance, reçut facilement et par nécessité tous les termes
qui lui manquaient, sans examiner s'ils étaient grecs ou persans,
et s'enrichit de la sorte des langues de toutes les nations, comme
son Peuple fit, depuis, de leurs dépouilles et de leurs Etats ».
L'une des parties les plus intéressantes du mémoire de Belot est
celle où il montre les inconvénients d'abandonner le latin, en reli-
gion, dans les sciences et dans les lois.
En religion, dit-il, si l'on discute dans la langue du pays, le
résultat est toujours mauvais. Même quand on conteste l'erreur,
elle se propage ; les faibles l'emportent toujours sur les forts, les
ignorants sur les doctes.
Dans le domaine des sciences, il faut un langage accessible aux
seuls savants car « s'il est dangereux de posséder les sciences
parfaitement, il est encore plus dangereux de n'en avoir qu'une
légère teinture ».
Dans le domaine juridique : si les lois étaient demeurées en
latin, il y aurait moins de chicanes et de procès en France
(rappelons-nous telle satire de Boileau et Les Plaideurs de Racine).
En politique : les révolutions arrivent par la prétention qu'ont
les peuples de connaître les ressorts de la politique (songeons qu'il
écrit dix ans seulement avant la signature des traités de Westpha-
lie) : « Les secrets des savants, mal à propos découverts aux
peuples » arrivent à jeter le trouble. Il faut tenir les secrets
cachés ou ne les déclarer qu'à ceux qui en sont capables.
La philosophie, donnée abusivement aux peuples, fait « des
brouillons ou des sophistes ». La théologie, en langue du pays, fait
« des hérétiques ou des athées ». La morale, « des fausses vertus
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LE LATIN AU XVIIe 581
et des hypocrites » ; la médecine mult
homicides ».
★
Est-ce parce qjie beaucoup d'hommes pensaient encore comme
Belot, que le monde de la religion, des sciences, des lois, écrivit
au XVIIe siècle presque autant en latin qu'en français ? Est-ce
pour ce motif que l'on tenta aussi (et c'est le point le plus im-
portant du renouveau latin de cette époque) d'obéir au précepte
de l'humaniste Erasme, qui voulait qu'on reprît le latin, où il en
était au XIIIe siècle , c'est-à-dire au point où l'avait porté l'Eglise
chrétienne ? Des érudits comme Pithou, Cujas, Sirmond, entre-
prennent l'étude grammaticale du latin, avec beaucoup plus d'objec-
tivité et de science que ne l'avaient fait, au XVIe siècle, Casaubon
ou Scaliger. Ils proclament l'extrême utilité d'un glossaire pour le
latin médiéval et les dialectes romano-barbares. L'Anglais Spellman
avait publié en 1627 un glossaire latin-barbare, qui sera complété
en 1664. Mais c'est un Français, Charles Dufresne, seigneur du
Cange, qui va composer un recueil géant, donnant le sens de
140 000 mots retrouvés dans la production latine médiévale, et qui
fera le bilan de l'actualité contemporaine du latin. Du Cange
consacra sa vie à ce labeur considérable, si bien que la légende
veut qu'il n'interrompît jamais son travail un seul jour... même
pas celui de son mariage, où il abandonna les invités, la cérémonie
terminée, pour compulser ses fiches et dossiers. Par la grâce de
cette œuvre surhumaine, il semblait que fût effacée la conséquence
de l'engouement exclusif du XVIe siècle pour le latin classique ;
il semblait que la langue latine retrouvât sa vie, son usage fami-
lier, sa continuité et que fût mis à la portée de tous, l'instrument
de travail permettant son utilisation courante et perpétuelle.
A la mort de Du Cange, son livre fut terminé par deux Bénéc
dictins de Saint-Maur : Dom Tassin et Dom Tous tain : exemple
de cette admirable collaboration des laïcs et des clercs, au
XVIIe siècle. Ainsi parachevé, le Dictionnaire sera acheté dans
toute l'Europe savante (redisons-le, puisque des étourdis et des
ignorants croient encore que c'est la seule science germanique qui
a ressuscité, au XIXe siècle, la connaissance du Moyen Age).
Après les érudits laïcs, ce sont les Bénédictins de Saint-Maur
qui travaillent le plus au triomphe du latin vivant, de ce latin que
l'Eglise utilisait depuis quinze siècles pour ses travaux, possédait
comme son langage propre, faisait évoluer comme évolue tout ce
Xļui reste mêlé à la vie quotidienne, aux tâches professionnelles.
Le retour de l'Ordre bénédictin vers les Lettres est l'une des
gloires les plus considérables du XVIIe siècle français . Il eff
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
582 LE LATIN AU XVIIe
les moqueries dont les Humanistes a
moines ; il fait oublier les caricature
s'était réjoui le XIVe siècle des Fabliaux et qui avait nourri la
verve de Rabelais comme les sanglants commentaires d'Erasme
et de Calvin. Les moines redeviennent les propagateurs de la cul-
ture, leurs maisons réapparaissent comme ces conservatoires de
textes que connaissaient les plus grands siècles médiévaux.
Dom Mabillon, à Saint-Germain-des-Prés, fonde la science de la
diplomatique, avec son De re diplomatica. Et tandis que les Bol-,
landistes entreprennent aux Pays-Bas, la revision des Vies de
Saints qui sera la réponse définitive aux critiques protestantes, les
Bénédictins français composent deux ouvrages immenses : les
Acta sanctorum et la Gallia Christiana , dont les dizaines de
volumes ressuscitent les fastes de l'Eglise ancienne. Ils rééditent
aussi les Pères de l'Eglise en y joignant des Indices précieux...
★
Il semblait donc, à l'apogée du XVII6 siècle français qu'une
Renaissance mille fois plus équilibrée et parfaite que celle du
XVI6 siècle se fût accomplie. Plus de querelle entre le culte du
grec et celui du latin : on les réunit dans un même enseignement,
dirigé vers la splendeur civilisatrice des Humanités.
Plus de querelle non plus entre les Humanités et les langages
nationaux : en France, il est définitivement admis que ceux-ci sont
la préface nécessaire au bon usage de celles-là. Et la meilleure
preuve est que l'élite les pratique ensemble, avec perfection. On
lçs utilise simultanément et indifféremment (Bossuet annote ses
ouvrages tantôt en latin, tantôt en français. Descartes écrit ses
traités en latin ou en français ; beaucoup d'orateurs et de savants
font de même).
★
Une telle réussite, un tel apogée étaient d'abord dus à deux
facteurs : la volonté de la monarchie française et la renaissance de
l'Eglise de France. C'est un fait que le roi Henri IV, puis
Louis XIII et Richelieu, puis Louis XIV, mirent un soin extrême
à protéger les écrivains de leur temps, à les encourager par des
pensions et des récompenses, Henri IV fit de Malherbe un poète
de cour et voulait faire venir saint François de Sales à Paris ;
Richelieu fonde l'Académie française ; Louis XIV demande sans
cesse à Colbert de lui indiquer les écrivains de talent dans la gêne
(et le dictionnaire du seigneur du Cange doit au soutien du Roi
autant que lui doivent les comédies de Molière et le théâtre de
Racine, les écrits de Boileau, les sermons de Bossuet).
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LE LATIN AU XVIIe 583
La monarchie fait vivre beaucoup de gra
aide le talent et le génie à dominer les médiocres (ce qui ne se
fait jamais tout seul, du vivant des auteurs).
Or, la monarchie est frappée de mort.
A partir de 1715, malgré les plus brillantes des apparences, elle
va perdre à la fois son prestige intérieur et les éléments de sa
domination mondiale.
Bien plus : les écrivains vont lui déclarer la guerre, et ce sont
eux qui l'emporteront. La Révolution française triomphera grâce
aux écrivains, dont les Mécènes n'étaient plus le Roi, mais l'aris-
tocratie et la haute bourgeoisie, révolutionnaires d'idées.
L'apogée du XVIIe siècle français était dû aussi à la Renais-
sance de l'Eglise, et celle-ci sera non moins fugitive. A partir de la
fin du règne de Louis XIV, l'assaut du protestantisme reprend
avec une force accrue, par les Pays-Bas et l'Angleterre, réunis dans
la main du même monarque, Guillaume d'Orange. Le XVIIIe siècle
est l'histoire d'une décadence continue pour l'Eglise de France ;
et à cette époque, la France catholique tenait le sort de toute l'Eu-
rope chrétienne.
Autre événement considérable : l'incroyance fait des progrès
gigantesques. Au XVIIe siècle français, nous assistions, dans tous
les domaines du savoir, à une sorte de collaboration continue entre
les laïcs et le clergé : philosophes et savants, orateurs ou poètes
étaient indifféremment d'Eglise ou laïcs ; les mêmes convictions
les unissaient, de très haut, et donnaient à leurs travaux une unité
féconde.
Au XVIIIe, le monde laïc devient progressivement athée. La
société des salons parisiens, la çour du Roi, les cercles lettrés se
font gloire de leur scepticisme, voire d'une violente haine contre
l'Eglise (c'est en pensant à Elle que Voltaire termine toutes ses
lettres par la formule : « Ecrasons l'infâme »).
Or, comme l'a dit Paul Hazard en ime phrase décisive : « La
majorité des Français pensait comme Bossuet ; tout d'un coup, les
Français pensent comme Voltaire ».
Décadence du pouvoir monarchique, arrêt de la Renaissance
de l'Eglise.
Le clergé subit aussi à ce moment une crise qui retentira jus-
qu'à l'époque contemporaine : malgré l'effort tenté au XVIIe siècle ,
il perd de plus en plus sa qualité de corps savant . Les Jésuites
seuls auraient pu lui maintenir cette réputation, mais eux-mêmes,
très fins lettrés, n'avaient pas de solide culture philosophique (les
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
le latin au xvii€
rares exceptions du temps, d'ailleurs, manq
saire pour acquérir l'audience d'une société
lent, et le plus brillant, le plus léger). Au XVIII* siècle, nous
voyons basculer définitivement au profit des laïcs, cette sorte de
partage d'influence intellectuelle que, depuis le XIVe siècle, les
laïcs, et le clergé avaient tacitement admis. Plus jamais le clergé
ne regagnera sa place, ni ne rétablira l'équilibre... Voilà le grand
fait, expliquant toute l'histoire religieuse contemporaine ; voilà
un fait un peu plus important pour comprendre l'état actuel du
christianisme que les opinions dont on nous abreuve (1) : la crise
du christianisme de l'époque contemporaine s'amorce au temps que
nous décrivons. L'Eglise perd sa domination sur les esprits ;
l'Eglise perd son influence sur les classes dirigeantes ; elle ne
jouera plus aucun rôle bientôt sur les chefs d'Etat, sur les maîtres
de l'Université, sur le monde des Sciences. Que l'on mesure la
chute, depuis le XIIIe siècle, où des milliers de religieux et de
clercs, à travers toute l'Europe, conseillaient les rois et les empe-
reurs, négociaient la paix et limitaient les guerres, remplissaient
les chaires d'enseignement des Universités et des écoles, possé-
daient les hôpitaux, éduquaient toutes les classes de la société
(des artisans jusqu'aux princes, ce qui est plus important que de
se préoccuper d'une seule classe sociale).
*
Nous imaginons donc ce que va devenir le sort du latin, à tra-
vers ces bouleversements politiques et sociaux, gigantesques.
Dès le début du XVIIIe siècle sera détruite l'espérance de voir
le latin rester un langage usuel et vivant. Garder l'usage courant
du latin supposait la piété envers le latin d'Eglise, la pratique
du latin d'Eglise, puisque quinze siècles d'usage latin avaient passé
par Elle, reposé entre ses mains. Or, l'Eglise est en butte à la
haine générale, et de plus en plus. La société de Voltaire et de
Diderot se moque bien du latin d'Eglise, puisqu'elle ridiculise sans
cesse les textes sacrés eux-mêmes.
U y a davantage : en dépit des tentatives des Bénédictins et
Charles du Cange dont nous avons parlé, on revient de plus en
plus, au culte exclusif du langage classique, comme les hommes
XVIe siècle ; on refait, du latin une simple étude de grammairiens
et de dilettantes ; une science aristocratique et ésotérique. Ici, les
Jésuites et leur enseignement encourent une responsabilité im-
mense, car leur culte pour la Renaissance les a entraînés à adopter
entièrement ses opinions, dans le domaine des Lettres.
(1) Cf notre ouvrage Les Doctrines sociales en France et l'évolution de
la société française du XVIIIe siècle à nos jours.
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LE LATIN AU XVIIe f)85
Puristes du langage, comme l'étaient
influencés par les grammairiens et les érudits de Byzance, les
Jésuites se flattèrent de plus en plus d'enseigner dans leurs col-
lèges le seul latin de la Rome classique (et païenne). « Depuis
quarante ans , écrivait le Jésuite Hardouin à la fin du règne de
Louis XIV, je m'efforce de ne jamais faire usage d'un seul de ces
mots que M . du Cange a pris tant de mal à recueillir ».
Les collèges des Jésuites devinrent donc des écoles de beau
langage. On y jouait des pièces de théâtre, en latin et en grec ; on
y composait de magnifiques discours, dans la langue de Démos-
thène ou celle de Cicerón ; on y était encouragé à connaître et
commenter avec enthousiasme ces seuls auteurs païens que les
philosophes et savants du Moyen Age avaient toujours fréquentés
avec retenue et défiance, afín de leur emprunter leurs réussites
esthétiques, leurs connaissances logiques et dialectiques, mais non
leurs idées morales, ni certains aspects de leur philosophie.
Les Jésuites, eux, se flattent d'échapper à ces craintes et à ces
méfiances. Remplis d'un engouement pour leur temps, qui s'alliait
si bien à leur désir d'action rapide sur la société, ils étaient prison-
niers des modes et des erreurs d'une époque ; ils ignoraient et
méprisaient le Moyen Age, puisque leur Ordre, à eux, était mo-
derne. Ils se flattaient d'ailleurs de pouvoir mener parallèlement
l'enseignement de la religion et les progrès de la culture, mais en
les distinguant totalement, ils jetaient implicitement un discrédit
sur la religion. Ï1 y avait, d'un côté, un domaine pour les esprits
libres et forts ; il y avait, de l'autre, une piété de moins en moins
justifiable, de plus en plus réduite à des pratiques sans lien avec
le reste de la vie intellectuelle. On séparait insensiblement, et de
plus en plus, la raison et la foi : synthèse triomphale du Moyen
Age chrétien.
Il ne faut pas oublier que Voltaire a été l'élève des Jésuites
(ce qui montre qu'on pouvait être à cette époque brillant élève
des Jésuites et ennemi de la religion chrétienne).. Il ne faut pas
oublier non plus que tous les orateurs des Assemblées révolu-
tionnaires sortaient de collèges religieux : de Robespierre à Dan-
ton, de Saint-Just à Fouquier-Tinville. C'étaient dans ces collèges
que tous avaient appris à citer Caton et Brutus, à aimer l'antiquité
romaine du paganisme même dans son culte idolâtrique de l'Etat,
dans sa dureté cruelle pour les individus.
Nous voyons donc ici naître un état d'esprit qui progressera
tout au long du XIXe siècle : d'un côté la science et les lettres, la
culture de l'esprit, l'épanouissement de la personne humaine, tels
que l'Antiquité les avait compris et réalisés.
De l'autre, des convictions propres à satisfaire plus le sentiment
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
586 LE LATIN AU XVIIe
que la raison : le « Dieu sensible au cœur » de Pascal ; le Dieu
vague et attendri de Jean-Jacques Rousseau ; le Dieu des émotions
et du culte esthétique, de Châteaubriand ; un Dieu pour les seuls
mystiques, un Dieu pour la seule sentimentalité.
Les Jésuites qui, depuis le règne de Henri IV jusqu'au milieu
du règne de Louis XV, tinrent en mains tous les collèges français,
égarés par leur admiration exclusive pour la « Renaissance »,
contribuèrent à faire rejeter partout la connaissance du latin mé-
diéval. Ils prônèrent une étude de plus en plus soigneuse du latin
classique.
C'est ainsi que le latin disparut des écoles primaires où le
Moyen Age l'avait toujours enseigné aux enfants du peuple. Il était
impossible, dans les délais d'une éducation rapide, d'apprendre
le maniement parfait de la langue latine classique. Le latin d'Eglise
au contraire était très proche du français, par sa syntaxe et son
vocabulaire : un enfant pouvait acquérir sa connaissance, en même
temps que celle du français.
Le fossé qui n'avait jamais existé au Moyen Age dans l'ensei-
gnement des diverses classes sociales (on sait que tous les enfants
des premiers rois capétiens étudiaient, dans les écoles mo-
nastiques, aux côtés des enfants du peuple ; et que les fils des
seigneurs avaient toujours cotoyé les fils de serfs, dans les écoles
rurales) se creuse au XVIIIe siècle.
Les règles nouvelles seront bientôt codifiées par Napoléon,
lorsqu'il fondera l'Université laïque : le XIXe siècle, sera celui des
rivalités sociales et des fossés irréductibles entre les classes : la
forme de l'enseignement y contribuera beaucoup.
Ce qui va aussi sombrer, après l'apogée du XVIIe siècle, c'est le
goût d'une civilisation unifiée, prolongeant implicitement la chré-
tienté médiévale. Et ceci représente encore une défaite pour le
latin, langage universel.
Le siècle du cosmopolitisme est arrivé : les nations sont de
plus en plus orgueilleuses de leurs particularismes, de leur civilisa-
tion propre (et ici triomphe le despotisme des princes, dont l'ori-
gine est au XIVe siècle, avec le progrès de la raison d'Etat privée
des freins religieux).
La France des premiers Capétiens avait toujours uni la défense
de l'idée de patrie et le souci universel. La France de la Révolution
et de Bonaparte, la France de ces hommes nourris des idées de la
Renaissance païenne, ne connaîtra plus que l'idolâtrie nationaliste.
Le latin, langue de la chrétienté unie, et le français de
Louis XIV, langage de l'Europe civilisée, ont vécu tous deux.
MARIE-MADELEINE MARTIN
This content downloaded from
151.73.35.229 on Thu, 08 Sep 2022 15:42:35 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Vous aimerez peut-être aussi
- CERQUIGLINI - La Naissance Du Francais - Cerquiglini BernardDocument87 pagesCERQUIGLINI - La Naissance Du Francais - Cerquiglini BernardSamuel S. de OliveiraPas encore d'évaluation
- Initiation À L'éducation Chrétienne (1e Partie)Document28 pagesInitiation À L'éducation Chrétienne (1e Partie)Barnabas CLC100% (18)
- Jean Grenier de L$27intime Au SecretDocument12 pagesJean Grenier de L$27intime Au SecretGennaro BasilePas encore d'évaluation
- Les Lois Fondamentales de La Stupidite Humaine-MC CipollaDocument224 pagesLes Lois Fondamentales de La Stupidite Humaine-MC CipollaStéphane VinoloPas encore d'évaluation
- Mille+Ans+de+Langue+Francaise+2+ +Duval,+ReyDocument474 pagesMille+Ans+de+Langue+Francaise+2+ +Duval,+ReyCarlacpl100% (1)
- Langue OrphelineDocument24 pagesLangue OrphelineEmilia Barbara BaranPas encore d'évaluation
- V. Laurent, Revue Historique Du Sud-Est Europeen 1946 (Pp. 233-247)Document393 pagesV. Laurent, Revue Historique Du Sud-Est Europeen 1946 (Pp. 233-247)Florin CosteaPas encore d'évaluation
- Essai Sur Les Idees PolitiquesDocument17 pagesEssai Sur Les Idees PolitiquesÉric TonkaPas encore d'évaluation
- Franco Roumaine BiblioDocument384 pagesFranco Roumaine BiblioEugen-Tudor SclifosPas encore d'évaluation
- Classicisme: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandClassicisme: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Dante - L'Enfer, Illustré Par Gustave Doré (1868)Document516 pagesDante - L'Enfer, Illustré Par Gustave Doré (1868)Sylvain WsPas encore d'évaluation
- N6152360 PDF 1 - 1 PDFDocument556 pagesN6152360 PDF 1 - 1 PDFGeorgoulas IakovosPas encore d'évaluation
- J.B. Morin - Dictionnaire Étymologique Des Mots François Dérivés Du Grec (1809, L'Imprimerie Impériale) - Libgen - LiDocument998 pagesJ.B. Morin - Dictionnaire Étymologique Des Mots François Dérivés Du Grec (1809, L'Imprimerie Impériale) - Libgen - LiAndrewReyesPas encore d'évaluation
- Lexique comparé de la langue de Molière et des écrivains du XVIIe siècleD'EverandLexique comparé de la langue de Molière et des écrivains du XVIIe sièclePas encore d'évaluation
- L'art et les artistes modernes en France et en AngleterreD'EverandL'art et les artistes modernes en France et en AngleterrePas encore d'évaluation
- Cumont Lux PerpetuaDocument586 pagesCumont Lux PerpetuaMaria Isabel Gonzalez CaboPas encore d'évaluation
- Occultiste Aux XVIII Et XIX Siècles. Édit. A Faivre. LouvainDocument3 pagesOccultiste Aux XVIII Et XIX Siècles. Édit. A Faivre. LouvainUsalamaPas encore d'évaluation
- Les moralistes français au dix-huitième siècle: Histoire des idées morales et politiques en France au dix-huitième siècleD'EverandLes moralistes français au dix-huitième siècle: Histoire des idées morales et politiques en France au dix-huitième sièclePas encore d'évaluation
- La Societe Au Treizieme Siecle ExtraitDocument29 pagesLa Societe Au Treizieme Siecle Extraitt.grodniskiPas encore d'évaluation
- Histoire de La Littérature Française Par Denis NisardUnis A RDB Is HistoireDocument966 pagesHistoire de La Littérature Française Par Denis NisardUnis A RDB Is HistoireAndré Blitte100% (4)
- Histoire Romaine Republique M.michelet 3ed. t.1 P. 1843Document414 pagesHistoire Romaine Republique M.michelet 3ed. t.1 P. 1843old4x7382100% (1)
- Dictionnaire Chinois, Français Et Latin, Publié D'après L'ordre de Sa Majesté Napoléon Le Grand Par M. de Guignes,..Document1 183 pagesDictionnaire Chinois, Français Et Latin, Publié D'après L'ordre de Sa Majesté Napoléon Le Grand Par M. de Guignes,..NTMPas encore d'évaluation
- Traité de L'occident Adrien (... ) Mithouard Adrien bpt6k56846036Document285 pagesTraité de L'occident Adrien (... ) Mithouard Adrien bpt6k56846036Michel FritschPas encore d'évaluation
- Qu'est-Ce Que L'ancien Régime ?Document29 pagesQu'est-Ce Que L'ancien Régime ?Camila MuñozPas encore d'évaluation
- Le Violier Des Histoires Romaines (... ) Brunet Pierre-Gustave bpt6k278159Document482 pagesLe Violier Des Histoires Romaines (... ) Brunet Pierre-Gustave bpt6k278159Julian BorrekPas encore d'évaluation
- L Assemblee Constituante 000000709Document556 pagesL Assemblee Constituante 000000709Jorge Candido da SilvaPas encore d'évaluation
- Febvre 1929, Une Question Mal Posée Les Origins de La Réforme Française Et La Problème Général Des..Document74 pagesFebvre 1929, Une Question Mal Posée Les Origins de La Réforme Française Et La Problème Général Des..polgarfanPas encore d'évaluation
- Archives Parlementaire: Série 1 Tome 1 (1788-1789)Document801 pagesArchives Parlementaire: Série 1 Tome 1 (1788-1789)iveliosdu12Pas encore d'évaluation
- Dictionnaire de L'Ancienne Langue Française Et de Tous Ses Dialectes, Du Ixe Au Xve Siècle,... Par Frédéric Godefroy,..Document814 pagesDictionnaire de L'Ancienne Langue Française Et de Tous Ses Dialectes, Du Ixe Au Xve Siècle,... Par Frédéric Godefroy,..iraignePas encore d'évaluation
- Cours1 18eDocument37 pagesCours1 18eAdina OlaruPas encore d'évaluation
- Geffroy Auguste - Rome Et Les Barbares PDFDocument449 pagesGeffroy Auguste - Rome Et Les Barbares PDFKris Marko ArtPas encore d'évaluation
- Molière, tome premier Oeuvres complètes de J.-B. Poquelin MolièreD'EverandMolière, tome premier Oeuvres complètes de J.-B. Poquelin MolièrePas encore d'évaluation
- Cicéron - CicéronDocument352 pagesCicéron - CicéronAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Imaginaire de La NationDocument5 pagesImaginaire de La NationwebylomePas encore d'évaluation
- Histoire Des Gaulois T1Document488 pagesHistoire Des Gaulois T1uyu yablePas encore d'évaluation
- Principes de la Philosophie de l'Histoire traduits de la 'Scienza nuova'D'EverandPrincipes de la Philosophie de l'Histoire traduits de la 'Scienza nuova'Pas encore d'évaluation
- Le Moyen Age, Une Imposture - Jacques HeersDocument271 pagesLe Moyen Age, Une Imposture - Jacques HeersabbayedonezanPas encore d'évaluation
- Charpentier. Etudes Sur Les Peres de L'eglise. 1853. Volume 1.Document444 pagesCharpentier. Etudes Sur Les Peres de L'eglise. 1853. Volume 1.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- Le Treizième Siècle Artistique-CompactadoDocument441 pagesLe Treizième Siècle Artistique-CompactadoJorge Candido da SilvaPas encore d'évaluation
- L Iliade Et L OdysséeDocument671 pagesL Iliade Et L OdysséegarciaPas encore d'évaluation
- Renacimiento 7Document521 pagesRenacimiento 7Italo Nocetti SalazarPas encore d'évaluation
- Les Sources Orientales de La Divine ComedieDocument240 pagesLes Sources Orientales de La Divine Comedievarnamala100% (1)
- Poetique Chevalleresque Allemagne Au Moyen AgeDocument304 pagesPoetique Chevalleresque Allemagne Au Moyen AgeAdrian OrtizPas encore d'évaluation
- Istoria Literaturii Franceze - IluminismulDocument69 pagesIstoria Literaturii Franceze - IluminismulNicoleta Dragoman100% (1)
- 9782130468561 (1)Document24 pages9782130468561 (1)bendifmr94Pas encore d'évaluation
- Civilité Puerile ErasmeDocument188 pagesCivilité Puerile ErasmempelempemePas encore d'évaluation
- Etudes Critiques Sur L'histoire de La Littérature Française. 3Document342 pagesEtudes Critiques Sur L'histoire de La Littérature Française. 3Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Alfred Poizat Le Symbolisme de Baudelaire À ClaudelDocument210 pagesAlfred Poizat Le Symbolisme de Baudelaire À ClaudelAhmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- Brune Oppetit, Portalis Philosophe PDFDocument8 pagesBrune Oppetit, Portalis Philosophe PDFJofre SinghPas encore d'évaluation
- Histoire de France Henri Martin Tome 1Document532 pagesHistoire de France Henri Martin Tome 1Jean-Loup TellierPas encore d'évaluation
- Analyse Critique Et Littéraire Du (... ) Le Roux bpt6k6519656xDocument106 pagesAnalyse Critique Et Littéraire Du (... ) Le Roux bpt6k6519656xvilmaquintelaPas encore d'évaluation
- Rapport Grégoire - WikisourceDocument14 pagesRapport Grégoire - WikisourceIoana Radu VivirschiPas encore d'évaluation
- Louis Althusser 2003 - Montesquieu, La Politique Et L'histoireDocument120 pagesLouis Althusser 2003 - Montesquieu, La Politique Et L'histoireABOUABDILLAH AnasPas encore d'évaluation
- De La Manière D'écrire L'histoire JuxtaDocument190 pagesDe La Manière D'écrire L'histoire Juxtacaligulagermanicus100% (2)
- (NRF) Gaëtan Picon - L'Écrivain Et Son Ombre, Introduction À Une Ésthetique de La Litterature (1953, Gallimard) - Libgen - LiDocument329 pages(NRF) Gaëtan Picon - L'Écrivain Et Son Ombre, Introduction À Une Ésthetique de La Litterature (1953, Gallimard) - Libgen - LiBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Anne Lété, Claire Miquel - Vocabulaire Progressif Du Franã Ais - Niveau Intermã©diaire (1998, Cle)Document112 pagesAnne Lété, Claire Miquel - Vocabulaire Progressif Du Franã Ais - Niveau Intermã©diaire (1998, Cle)Benedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Lartpotiquedeb 01 DelaDocument414 pagesLartpotiquedeb 01 DelaBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Jauss, Théorie de La RéceptionDocument166 pagesJauss, Théorie de La Réceptiondomi5389% (9)
- Racine Orientation BibliographiqueDocument9 pagesRacine Orientation BibliographiqueBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Le Vers Théâtral Dans ChanteclerDocument22 pagesLe Vers Théâtral Dans ChanteclerBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Bibliographie Racine FrancaisDocument10 pagesBibliographie Racine FrancaisBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Intro Naissance de L Ecrivain de Alain VialaDocument6 pagesIntro Naissance de L Ecrivain de Alain VialaBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Plaisir Des Larmes Et Plaisir de La Représentation D'un Paradoxe À L'autreDocument22 pagesPlaisir Des Larmes Et Plaisir de La Représentation D'un Paradoxe À L'autreBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Intro Naissance de L Ecrivain de Alain VialaDocument6 pagesIntro Naissance de L Ecrivain de Alain VialaBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Esthétique de L'identitéDocument1 pageEsthétique de L'identitéBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Strategies Narratives Dans Les LivretsDocument12 pagesStrategies Narratives Dans Les LivretsBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Chroniques de Port-Royal. B. DorivalDocument14 pagesChroniques de Port-Royal. B. DorivalBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Article GoldmannDocument8 pagesArticle GoldmannBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Teatro PhobieDocument16 pagesTeatro PhobieBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Le Xvii Siecle Comme EnjeuDocument14 pagesLe Xvii Siecle Comme EnjeuBenedetta BartoliniPas encore d'évaluation
- Saint en CHRIST°Andrew MURRAY°200Document200 pagesSaint en CHRIST°Andrew MURRAY°200KABORE Felix100% (1)
- L'eglise Et La Franc Maconnerie Explicationd'Un MalentenduDocument8 pagesL'eglise Et La Franc Maconnerie Explicationd'Un MalentendumailfakoPas encore d'évaluation
- Neuvaine À Marie Qui Défait Les Noeuds D E Nos ViesDocument5 pagesNeuvaine À Marie Qui Défait Les Noeuds D E Nos ViesDominique EyadiPas encore d'évaluation
- Kabbale Symbolisme Et AstrologieDocument56 pagesKabbale Symbolisme Et Astrologiesephirotiq89% (9)
- Marilda Santana Message 8 Mai 2022Document5 pagesMarilda Santana Message 8 Mai 2022Peter BannisterPas encore d'évaluation
- La Grande Triade - René GuénonDocument21 pagesLa Grande Triade - René GuénonBelhamissi100% (1)
- Bible CodeCouleursDocument2 pagesBible CodeCouleursMission Baptiste FondamentalistePas encore d'évaluation
- 9782290097168Document30 pages9782290097168tatiana bimogaPas encore d'évaluation
- Retraite Careme 2016 S1Document4 pagesRetraite Careme 2016 S1Exauce DiakiesePas encore d'évaluation
- Combat SpirituelDocument2 pagesCombat SpirituelCapituloPas encore d'évaluation
- Lettre Pastorale À La Communauté Viatorienne - Juin 2015Document6 pagesLettre Pastorale À La Communauté Viatorienne - Juin 2015SersoSanViatorPas encore d'évaluation
- 62-0513E Laisser Échapper La PressionDocument16 pages62-0513E Laisser Échapper La PressionGRACEFUL BIHPas encore d'évaluation
- Tayeb Saddiki Et Samuel BeckettDocument5 pagesTayeb Saddiki Et Samuel BeckettAziz OualidPas encore d'évaluation
- Jacques Le Goff (Ed), Hérésies Et Sociétés Dans L'europe Pré-Industrielle 11e-18e Siècles (27-30 Mai 1962) (1968)Document488 pagesJacques Le Goff (Ed), Hérésies Et Sociétés Dans L'europe Pré-Industrielle 11e-18e Siècles (27-30 Mai 1962) (1968)BogdanPas encore d'évaluation
- PpsagessDocument22 pagesPpsagessUsalamaPas encore d'évaluation
- Saint Augustin - Discours Sur Les Psaumes - Ps 44 L'épithalame de L'égliseDocument26 pagesSaint Augustin - Discours Sur Les Psaumes - Ps 44 L'épithalame de L'égliseVan KarpoPas encore d'évaluation
- L'Etoile Flamboyante Par TschoudyDocument19 pagesL'Etoile Flamboyante Par TschoudyAdriana EvangeliztPas encore d'évaluation
- La Chute de Saül Ou La Faillite Dans Le MinistèreDocument48 pagesLa Chute de Saül Ou La Faillite Dans Le MinistèreDenis LamyPas encore d'évaluation
- L'amertume, Le Ressentiment Et Le Non-Pardon - Joyce MeyerDocument23 pagesL'amertume, Le Ressentiment Et Le Non-Pardon - Joyce MeyerL'adoratrice Ivona CbioPas encore d'évaluation
- Catechèse de ChenoutéDocument5 pagesCatechèse de ChenoutéAlbocicade100% (1)
- Saints AlgerieDocument393 pagesSaints AlgerieBaya MiloudiPas encore d'évaluation
- 1 5037711044357653040Document120 pages1 5037711044357653040Derkensly Lazarre100% (4)
- Philosophie MédiévaleDocument382 pagesPhilosophie Médiévalesantsetesh100% (1)
- Le DiscipleDocument295 pagesLe DiscipleFlorence AccohPas encore d'évaluation
- 2018 Dialogue 06Document12 pages2018 Dialogue 06Cristóbal Álvarez RodríguezPas encore d'évaluation
- Maxime KovalevskyDocument138 pagesMaxime KovalevskyMiminaMariaPas encore d'évaluation
- Milice de L'immaculée - Booklet - FRDocument44 pagesMilice de L'immaculée - Booklet - FRStephane GamachePas encore d'évaluation
- Kabaleb - Llop Tristan - Les Mystäres de L'oeuvre Divine PDFDocument217 pagesKabaleb - Llop Tristan - Les Mystäres de L'oeuvre Divine PDFJoffrey Piarulli100% (2)