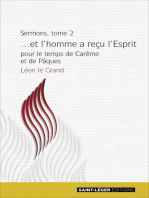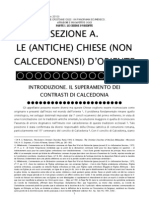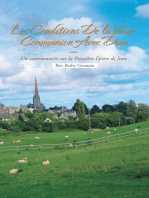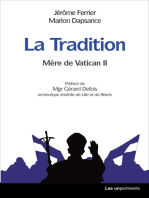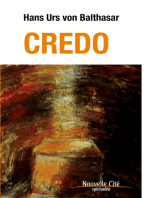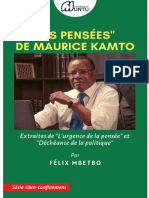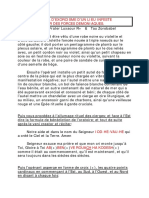Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Expiation, Repentance, Pardon Et Réconciliation Concepts Religieux Et Valeurs Des Sociétés Européennes Contemporaines Cairn
Transféré par
JOSHUATitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Expiation, Repentance, Pardon Et Réconciliation Concepts Religieux Et Valeurs Des Sociétés Européennes Contemporaines Cairn
Transféré par
JOSHUADroits d'auteur :
Formats disponibles
!
" # $
Vers Numéro 2016/1 (N° 15)
Expiation, repentance,
pardon et réconciliation :
concepts religieux et valeurs
des sociétés européennes
contemporaines
Frédéric Rognon
Dans Les Cahiers Sirice 2016/1
(N° 15), pages 15 à 23
! Précédent Suivant "
Article
E n dépit de la profonde sécularisation
qui marque les sociétés
européennes, et des divers régimes
de laïcité qui y régulent les relations entre
les États et les cultes, un impensé
religieux (d’autant plus efficient qu’il est
inconscient) travaille les représentations
et les conduites des peuples d’Europe,
notamment dans le champ des modalités
de sortie de conflit.
Il importe donc d’interroger les notions
d’« expiation », de « repentance », de
« pardon » et de « réconciliation », afin de
saisir ce qui se joue, fondamentalement,
dans les rapprochements entre peuples,
États et nations, qui se donnent en
apparence pour émancipés à l’endroit de
l’emprise religieuse. La meilleure façon
de montrer que les ressources spirituelles
sont toujours prégnantes à travers la
conceptualité séculière revient sans doute
à recouper la diversité des stratégies
nationales et la diversité des traditions
religieuses qui leur sont afférentes. C’est
pourquoi nous ferons droit à la pluralité
des acceptions de ces notions, selon les
diverses confessions et familles
religieuses.
Expiation
La notion d’« expiation », tout d’abord, il
faut le relever, n’est pas spécifiquement
judéo-chrétienne. On la repère déjà dans
les rites de la Grèce antique, avec le verbe
ιλάσκοµαι [ilaskomaï], qui signifie : « se
concilier quelqu’un », « se rendre
favorable à ses yeux », « apaiser sa
colère », et en particulier « apaiser la
colère des dieux ». L’expiation est donc à
comprendre en relation avec une offense
commise à l’encontre des dieux, et sur le
mode d’une opération rituelle visant à se
les rendre à nouveau propices malgré cet
affront. Elle s’inscrit sur un registre
cathartique et sacrificiel, puisque
l’expiation est une forme de purification
par la mise à mort d’une victime humaine
ou animale. C’est d’ailleurs le sens du
verbe latin expiare, qui a donné le français
« expier » : « purifier », « apaiser »,
« effacer par un sacrifice ». Le même
verbe est d’ailleurs aussi à l’origine des
mots « piété » et « pieux », qui désignent
l’attitude et le caractère de ceux qui
remplissent leur devoir envers les dieux.
C’est en ce sens, comme l’a montré René
[1]
Girard , que l’expiation n’exclut
nullement les logiques vindicatives, elle
ne fait que les canaliser vers une victime
émissaire afin d’apaiser les dieux, en
attendant la prochaine crise.
La notion d’expiation se retrouve dans le
judaïsme ancien, mais avec une première
inflexion sémantique après l’exil : les
sacrifices que l’on qualifie d’expiatoires
dans la Bible hébraïque ( חטאת: hattat et
אשם: asham) ne visent pas à apaiser la
colère de Dieu, mais à recréer les
conditions de sa présence au milieu de
son peuple après une transgression, et à
réintégrer ceux qui s’étaient trouvés
éloignés de lui. Comme le dit Alfred
Marx, exégète de l’Ancien Testament et
spécialiste du sacrifice,
« la visée première du culte sacrificiel
est la rencontre avec Dieu. C’est
uniquement pour permettre de
réaliser les conditions de cette
rencontre, qui est toujours un lieu de
bénédiction, que Dieu a mis ces deux
sacrifices à la disposition de son
[2]
peuple » .
C’est en particulier le cas du Yom
Kippour, littéralement « Jour du grand
pardon », consacré à la prière et au jeûne :
on y perçoit bien un reflet lointain de
l’ancien rituel du bouc émissaire, qui
consistait à sacrifier un bouc pour le
pardon des péchés du peuple ; mais le
sens qui s’est peu à peu imposé est celui
d’une rencontre du peuple avec son Dieu.
Paul Ricœur, dans un article de 1958
consacré aux sens de la peine, et
[3]
notamment de la peine carcérale ,
soutenait que l’expiation n’a en réalité
rien de judéo-chrétien, qu’il s’agit d’une
conception purement païenne : « La mort
du Christ, écrit-il, c’est la mort de
[4]
l’expiation » . Cette position quelque
peu abrupte doit certainement être
nuancée. Si le judaïsme, comme on vient
de le mentionner, peut être considéré
comme une réinterprétation de la notion
grecque d’expiation, le christianisme se
veut à l’évidence un dépassement de cette
compréhension des rapports de l’homme
avec Dieu. Mais le christianisme est
pluriel et le principe de l’expiation ne
disparaît pas des traditions qui
s’appuient sur une lecture sacrificielle de
la Passion du Christ. C’est ainsi que la
Contre-Réforme, au XVIe siècle, confirme
la dimension expiatrice de la vie
chrétienne pour achever les souffrances
du Crucifié ; cela se manifeste
notamment dans le sacrement de
l’eucharistie, la messe catholique étant
considérée comme un sacrifice. Ce
clivage entre Réforme et Contre-Réforme
se donne toujours à voir aujourd’hui, au
sein des sociétés européennes
sécularisées, par exemple dans la tension
entre pays catholiques du Sud et pays
protestants du Nord de l’Europe sur le
sens attribué à la peine carcérale :
expiation ou protection et purification de
la société d’une part, et réhabilitation ou
restauration de la personne d’autre part.
Faudrait-il donc voir, pour ce qui
concerne la gestion des sorties de conflit,
un impensé expiatoire dans les modalités
du Traité de Versailles ? Je ne serais pas
loin de le penser, surtout si l’on constate
que les rares figures à s’être élevées
contre les clauses outrancières de ce
Traité sont franc-maçonnes, comme Léon
[5]
Bourgeois , ou protestantes, comme
[6]
Charles Gide .
Repentance
À la différence de l’expiation, la
repentance est une notion
spécifiquement judéo-chrétienne. Elle est
récurrente dans la Bible hébraïque sous la
forme des racines ( נחםnaham), qui
signifie « avoir du regret » et ( שובshouv),
qui signifie « faire retour », « revenir en
arrière » ou « rentrer en soi-même ». La
( תשובהtechouvah) est littéralement un
« retour à Dieu » et elle est considérée
comme la condition préalable nécessaire
au pardon divin. La littérature rabbinique
distingue deux types de repentances,
celle qui est motivée par la crainte du
châtiment, et celle qui est inspirée par un
amour profond de Dieu ; la seconde
modalité est bien entendu valorisée au
détriment de la première. Signalons que
selon les récits bibliques, Dieu lui-même
se repent à plusieurs reprises,
notamment d’avoir créé l’homme, juste
avant le Déluge, et du mal qu’il avait
résolu d’infliger aux Ninivites dans le
livre du prophète Jonas.
La notion de repentance est très présente
dans le Nouveau Testament, mais avec
une acception légèrement différente. Elle
est exprimée par le vocable de µετάνοια
[métanoïa], qui signifie littéralement
« changement de compréhension » : il
s’agit donc d’un renversement du regard
porté sur les choses, et par voie de
conséquence d’une conversion de l’esprit
et de la conduite. C’est ce à quoi les
hommes sont invités dès la prédication
de Jean-Baptiste, afin de préparer leur
cœur à l’accueil du Messie et à l’entrée
dans le Royaume.
En français, le mot « repentance »
apparaît au XIe siècle, issu du latin
médiéval repoenitere, verbe lui-même
composé du préfixe « re- » à valeur
intensive et de la racine « poenitere », qui
signifie « être mécontent de soi », et
finalement « faire pénitence ». La
tradition chrétienne associe donc au
Moyen Âge la repentance et la pénitence
et en fait un rite sacramentel dans le tête-
à-tête au confessionnal entre le pénitent
et le prêtre. Ici encore, un clivage
conceptuel va s’instaurer à la Réforme du
XVIe siècle, mais avec une tension entre la
Réforme luthérienne et la Réforme
calvinienne : la première, en effet, va
maintenir le sacrement de pénitence
pendant quelques temps, tandis que
Calvin ne reconnaîtra que deux
sacrements, le baptême et la cène, et se
refusera à concevoir un pouvoir
sacerdotal autorisé à remettre les fautes
au pénitent. C’est sans doute dans cette
prégnance de l’esprit de pénitence en
territoire luthérien qu’il faut chercher les
ressorts de cette saisissante Déclaration de
culpabilité de Stuttgart (Das Stuttgarter
[7]
Schulderklärung) , par laquelle, dès
octobre 1945, l’Église protestante
d’Allemagne reconnut ses fautes, c’est-à-
dire son manque de courage et de fidélité
à l’évangile sous le troisième Reich. On
mesure la différence avec le Traité de
Versailles, imposé par le vainqueur au
vaincu. Mais l’Église catholique a aussi
évolué au cours du XXe siècle. Elle a eu
tendance, on le sait, depuis le Concile
Vatican 2, à multiplier les déclarations de
repentance pour les actes commis dans
un passé plus ou moins lointain
(l’esclavage, les persécutions antisémites,
etc.), et à transformer le sacrement de
pénitence individuelle en une
réconciliation collective.
Pardon
Si la repentance s’exprime par une
reconnaissance de faute ou d’offense, le
pardon en est la finalité et la
conséquence. Qu’il s’agisse de l’hébreu
biblique ou du grec du Nouveau
Testament, la notion de pardon s’exprime
très concrètement par une remise de
dettes : ( סליההselihah) en hébreu, άφεσις
[aphésis] en grec. Cette libération du
débiteur par la grâce de son créancier
peut être comprise dans une relation
entre l’homme et Dieu, mais aussi dans
une relation horizontale, marquée par
une situation d’endettement mutuel des
hommes entre eux. C’est pourquoi la
tradition juive insiste tout spécialement
sur le fait que l’homme ne doit pas se
contenter d’obtenir le pardon de Dieu,
mais qu’il lui faut également s’efforcer
d’obtenir celui de son prochain, en
exerçant le pardon à son égard.
Le christianisme s’inscrit dans la même
tradition d’interprétation et de
compréhension du pardon, mais il y
ajoute un élément décisif : la faute
fondamentale qui est la rupture de
l’homme avec Dieu (sens précis du mot
« péché » : αµαρτία [amartia] en grec) a
déjà été remise, plus exactement graciée
c’est-à-dire remise sans réciprocité, par
l’œuvre du Christ sur la Croix. Cette
remise imméritée de dette fondamentale
doit conduire les croyants à se remettre
les uns aux autres leurs dettes
secondaires : ainsi le pardon horizontal
trouve-t-il une légitimation
supplémentaire et aux implications
théologiques singulièrement acérées. À
partir de ce socle commun, les traditions
spirituelles divergent au sein du
christianisme. Pour la plupart des
traditions chrétiennes, et notamment
[8]
pour les courants confessants , cette
remise de dettes entre les hommes n’est
pas, à la différence du pardon divin,
inconditionnelle : elle repose sur la
repentance. Le pardon ne peut être bradé,
il doit être demandé pour être accordé.
D’autres traditions, plus libérales,
instaurent une telle relation d’analogie
entre le pardon divin et le pardon humain
qu’elles confèreront à ce dernier un
attribut d’inconditionnalité. Dans un cas
comme dans l’autre, la plupart des
théologiens chrétiens s’accordent à
penser que si le créancier refuse de
pardonner, le débiteur qui se repent peut
remettre sa repentance à Dieu qui lui
pardonnera ; inversement, si le débiteur
se refuse à la repentance, le créancier qui
veut pardonner peut remettre son désir à
Dieu et en être ainsi libéré. Les diverses
traditions chrétiennes sont unanimes à
considérer que le pardon n’est pas l’oubli :
pardonner, c’est remettre la dette sans
oublier l’offense, c’est faire mémoire
d’une offense délestée de sa dette. En ce
sens, le devoir de mémoire est
consubstantiel au pardon. En ce qui
concerne les sorties récentes de conflits
politiques ou interethniques, les
exemples des commissions « Vérité et
Réconciliation » en Afrique du Sud après
l’apartheid, et des juridictions Gacaca au
Rwanda après le génocide, indiquent
clairement que, dans des pays laïcs à forte
majorité chrétienne, et dans des sociétés
marquées par des traditions théologiques
différentes (anglicane et presbytérienne
en Afrique du Sud, catholique au
Rwanda), le pardon accordé après
repentance a conduit à de larges mesures
d’amnistie, si ce n’est de réconciliation.
Réconciliation
Enfin, notre quatrième et dernier concept
est celui de « réconciliation ». La
réconciliation est généralement comprise
comme une restauration de relations
après une rupture. Elle suppose donc
qu’un conflit ravageur s’est achevé, et que
la relation entre les protagonistes va
pouvoir se redéployer sur de nouvelles
bases. La Bible hébraïque n’emploie pas
de terme pour désigner la réconciliation :
on ne trouve que le vocable grec
καταλλαγή [catallaguè] dans le second livre
des Maccabées, c’est-à-dire parmi les
[9]
textes deutérocanoniques . Le
rétablissement de la relation entre Dieu
et son peuple après une rupture de
[10]
l’alliance s’exprime par une périphrase
ou sur un mode purement narratif, de
même entre deux frères comme Jacob et
[11]
Esaü . Et les réconciliations entre
peuples ennemis sont peu courantes,
Israël ayant conscience d’être un peuple
unique, seul élu de Dieu. Certes, Israël et
Juda, séparés par le schisme,
retrouveront leur unité au-delà de l’exil,
mais il s’agit de deux moitiés d’un même
[12]
peuple, qui se réunifie .
Dans le Nouveau Testament, la référence
à la réconciliation (καταλλαγή) est
beaucoup plus courante : il s’agit tout
d’abord de la réconciliation entre les
hommes et Dieu accomplie par l’œuvre
du Christ, comme le proclame la seconde
[13]
épître de Paul aux Corinthiens ; puis
de l’enseignement du Christ dans le
[14]
Sermon sur la montagne , qui fait de la
réconciliation avec son frère un
commandement, prioritaire même par
rapport aux devoirs cultuels : « Va d’abord
te réconcilier avec ton frère, puis viens
[15]
présenter ton offrande » . Enfin, la
réconciliation entre peuples trouve son
expression dans le motif de l’unité en
Christ des judéo-chrétiens et des pagano-
[16]
chrétiens , selon l’épître de Paul aux
[17]
Éphésiens . Dans les diverses traditions
[18]
chrétiennes , pardon et réconciliation
se conjuguent de la manière suivante : on
discerne une succession chronologique,
et surtout un conditionnement entre l’un
et l’autre ; le pardon précède la
réconciliation, et il est le critère d’une
réconciliation authentique. Il n’y a pas de
véritable réconciliation sans pardon,
alors qu’il peut y avoir des pardons sans
réconciliation, dans le cas d’une rupture
définitive de relation ou d’un décès qui
laisseraient place à une parole de pardon.
La réconciliation implique une nouvelle
relation : la parole ne suffit pas, pas
même l’engagement à ne plus
recommencer. Il faut un geste, une
conduite, une réparation matérielle ou
symbolique, et une véritable restauration
du lien. En d’autres termes, la
réconciliation est un pardon en actes, et
non seulement en paroles.
Si le pardon et la réconciliation sont
posés comme des commandements en
christianisme, les pratiques d’obéissance
à ces commandements peuvent être
vécues de diverses manières. Dans la
tradition catholique, l’obéissance aux
commandements est considérée comme
méritoire, c’est-à-dire comme un moyen
d’accéder au salut, dans le cadre d’une
compréhension rétributive de la destinée
humaine. Dans les traditions
protestantes, les bonnes œuvres
humaines telles que le pardon et la
réconciliation ne sont pas appréhendées
comme un chemin de salut, mais comme
une conséquence du salut offert par
grâce : ce n’est pas pour être sauvés que
les protestants vont pardonner et se
réconcilier, mais parce qu’ils ont la
conviction de l’être. C’est donc parce que
Dieu s’est réconcilié gratuitement avec
les hommes par l’œuvre du Christ que les
hommes doivent à présent se réconcilier
entre eux. En d’autres termes, la
réconciliation entre les hommes doit être
interprétée comme ce que le théologien
allemand Dietrich Bonhoeffer appellera
[19]
« le prix de la grâce » . Mais on repère
une inflexion différente entre les
traditions protestantes elles-mêmes :
dans la tradition luthérienne, l’amour
inconditionnel de Dieu et le
commandement d’amour adressé aux
hommes ont une dimension
« élenctique », c’est-à-dire qu’ils doivent
faire honte aux croyants, les confondre et
les humilier, pour les amener à
reconnaître leur incapacité à se
réconcilier entre eux en ne s’appuyant
que sur leurs propres forces ; dans la
tradition réformée, le commandement de
pardon et de réconciliation est compris
dans un sens didactique, comme une
manière de se conformer à la volonté de
Dieu, accessible aux chrétiens sanctifiés,
« nés de nouveau ». En d’autres termes,
Luther met l’accent sur la foi d’où découle
l’action de se réconcilier, tandis que
Calvin insiste sur l’action de se
réconcilier qui découle de la foi. Ces
différences d’accentuation peuvent
sembler anecdotiques ou scolastiques,
elles n’en informent pas moins les
pratiques de réconciliation entre
peuples : vécues comme méritoires dans
les sociétés latines de tradition
catholique, comme fruit de la
transcendance divine dans les sociétés
nordiques de tradition luthérienne, ou
comme manifestation de la
responsabilité humaine des élus de Dieu
dans les sociétés marquées par la
tradition réformée comme la Suisse ou
les Pays-Bas. D’où la dissymétrie
d’interprétation entre les protagonistes
dans la réconciliation franco-allemande,
ou dans la réconciliation germano-
polonaise : chacun des protagonistes
développant une lecture propre du
processus de réconciliation, tous ne lui
posent ou exposent pas exactement les
mêmes conditions, ni n’en attendent
rigoureusement les mêmes fruits.
Il faudrait encore intégrer dans l’analyse
les traditions orthodoxes (pour les pays
de l’Europe orientale), anglicanes (pour le
Royaume Uni), et bien entendu
musulmanes (pour la Bosnie, le Kosovo,
la Turquie, et les minorités issues de
l’immigration). Nous confirmerions alors
avec davantage d’assurance notre
hypothèse : la prise en compte des
héritages religieux des sociétés
européennes, et notamment de leurs
ressources théologiques et spirituelles,
ouvre ainsi à une intelligence plus fine de
leurs pratiques respectives de régulation
des sorties de crise. Bien entendu, des
influences non-religieuses sont aussi à
l’œuvre, qu’il conviendrait d’examiner :
héritage des Lumières, libre-pensée,
franc-maçonnerie, voire stoïcisme… Mais
même ces ressources philosophiques
n’échappent pas à l’impact du religieux,
ne serait-ce que du fait d’une posture
réactive. Car les différents paradigmes
dont nous avons fait état devraient
ensuite, une fois établis comme idéal-
types, être envisagés dans leurs
conjugaisons mutuelles et certainement à
l’aune d’une combinatoire foisonnante.
Notes
[1] René Girard, La violence et le sacré,
Paris, Grasset, 1972 ; Le bouc émissaire,
Paris, Grasset, 1982.
[2] Christian Grappe et Alfred Marx, Le
sacrifice. Vocation et subversion du
sacrifice dans les deux Testaments,
Genève, Labor et Fides, 1998, p. 40-41.
[3] Paul Ricœur, « Le droit de punir », Foi
et Vie, vol. CIV, nº 1, hiver 2005, p. 75-
96.
[4] Ibid., p. 94.
[5] Léon Bourgeois, Le traité de paix de
Versailles, Paris, Félix Alcan, 1919.
[6] Charles Gide, L’émancipation, Paris,
L’Harmattan (Les œuvres de Charles
Gide – volume III), 2001, p. 249-263.
[7] Henry Mottu (éd.), Confessions de foi
réformées contemporaines, Genève,
Labor et Fides, 2000, p. 80-89.
[8] En christianisme, on distingue les
courants « confessants » (ou
« piétistes », ou « évangéliques ») des
courants « libéraux » : les premiers
constituent un pôle plutôt
conservateur sur le plan doctrinal, en
s’attachant au caractère inspiré de
l’ensemble du corpus scripturaire et
au fondement normatif des
confessions de foi ; les seconds
constituent un pôle plus
progressiste, en s’autorisant un
regard critique sur les textes
bibliques, n’hésitant pas à recourir
aux outils des sciences humaines
pour les appréhender, et en
considérant le caractère historique,
et par conséquent relatif, de tous les
énoncés doctrinaux.
[9] Les textes deutérocanoniques (« du
deuxième canon ») sont une dizaine
d’écrits tardifs (des trois derniers
siècles avant notre ère) qui n’ont
jamais été intégrés par les Juifs dans
la Bible hébraïque. Ils nous sont
parvenus en grec par l’intermédiaire
de la version grecque de l’Ancien
Testament, dite version des
Septante. Les chrétiens les ont, dans
un premier temps, considérés
comme inspirés, et les ont donc
considérés comme faisant partie du
« canon » de l’Ancien Testament
(c’est-à-dire comme étant inspirés et
faisant autorité). Au XVIe siècle, le
protestantisme s’est aligné sur le
canon juif et a donc exclu ces textes,
qualifiés d’apocryphes, de son propre
canon. Seules les versions
catholiques (et aujourd’hui
œcuméniques) les ont retenus. Ces
textes sont les suivants : Judith,
Tobit, premier et second livres des
Maccabées, Sagesse, Siracide ou
Ecclésiastique, Baruch, Lettre de
Jérémie, suppléments grecs à Esther
et à Daniel.
[10] L’Ancien Testament met en scène
l’alliance conclue entre Dieu et le
peuple hébreu, et, à plusieurs
reprises, la rupture de cette alliance à
l’initiative des hommes, suivie de la
reprise de cette alliance à l’initiative
de Dieu.
[11] Le chapitre 33 du livre de la Genèse
relate la réconciliation entre deux
frères jumeaux, Jacob et Esaü, après
des actes de grande hostilité entre
eux, l’expression de désirs de
vengeance et de meurtre, et plus de
vingt ans de brouille.
[12] Au dixième siècle avant notre ère, le
peuple hébreu s’est divisé en deux
royaumes : Juda au sud et Israël au
nord. Après la chute du royaume du
nord et sa déportation en exil à
Ninive, en 721, puis la chute du
royaume du sud et sa déportation à
Babylone en 598, les deux moitiés du
peuple vont recouvrer leur liberté et
se réunifier.
[13] 2Co 5, 18-20 : « Tout vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par le
Christ, et qui nous a donné le
ministère de la réconciliation. Car
Dieu était dans le Christ,
réconciliant le monde avec lui-
même, sans tenir compte aux
% humains de leurs fautes, et mettant
en nous la parole de la réconciliation.
Nous sommes donc ambassadeurs
$ Suivre
pour #
le Christ ; c’est Dieu quiAjouter
encourage par notre entremise ; au
Vous aimerez peut-être aussi
- 2009-01-Sdt-Mgr Tissier-Le Mystere de La Redemption Selon Benoit XVI PDFDocument30 pages2009-01-Sdt-Mgr Tissier-Le Mystere de La Redemption Selon Benoit XVI PDFBARRO MOISEPas encore d'évaluation
- Le Fils Jésus, parfait médiateur: Une lecture de la lettre aux HébreuxD'EverandLe Fils Jésus, parfait médiateur: Une lecture de la lettre aux HébreuxPas encore d'évaluation
- Combat contre la fausse connaissance: La gloire de Dieu c'est l'homme vivantD'EverandCombat contre la fausse connaissance: La gloire de Dieu c'est l'homme vivantPas encore d'évaluation
- Salvifici DolorisDocument7 pagesSalvifici DolorisBrice DjoussePas encore d'évaluation
- Sermons - Tome 2: ... et l'homme a reçu l'Esprit pour le temps de Carême et de PâquesD'EverandSermons - Tome 2: ... et l'homme a reçu l'Esprit pour le temps de Carême et de PâquesPas encore d'évaluation
- ZUMSTEIN, Le Péché Dans La Prédication Du Jésus HistoriqueDocument15 pagesZUMSTEIN, Le Péché Dans La Prédication Du Jésus HistoriqueBruno de GABORYPas encore d'évaluation
- CC1ACAOR Chiese N.calcedonianeDocument99 pagesCC1ACAOR Chiese N.calcedonianebrunomorabito100% (1)
- Résumé - Rédemption Sacrificielle (Sabourin, 1961)Document7 pagesRésumé - Rédemption Sacrificielle (Sabourin, 1961)Emmanuel GilbertPas encore d'évaluation
- Marc 14 17 26Document3 pagesMarc 14 17 26paul NgwaimbiPas encore d'évaluation
- Travail FiniDocument8 pagesTravail FiniJacques ZANMENOUPas encore d'évaluation
- RÉDEMPTIONDocument25 pagesRÉDEMPTIONYves Timothée ManzanPas encore d'évaluation
- Eschatologie Nicodème Et TouréDocument6 pagesEschatologie Nicodème Et TouréebaPas encore d'évaluation
- Confe Rence-St SiffreinDocument8 pagesConfe Rence-St SiffreinHind BannaniPas encore d'évaluation
- 97-108 - Part 2Document8 pages97-108 - Part 2nanukPas encore d'évaluation
- Repentance Et Réconciliation - Perspective BibliqueDocument11 pagesRepentance Et Réconciliation - Perspective BibliqueJemps AdelsonPas encore d'évaluation
- Comprendre de manière nouvelle: Notes en marge de l'interview su pape émérite Benoît XVID'EverandComprendre de manière nouvelle: Notes en marge de l'interview su pape émérite Benoît XVIPas encore d'évaluation
- PFU ApologétiqueDocument11 pagesPFU ApologétiqueJemps AdelsonPas encore d'évaluation
- L'échec de Saint Paul: Comment les Pères Apostoliques défigurèrent le projet juif de Jésus.D'EverandL'échec de Saint Paul: Comment les Pères Apostoliques défigurèrent le projet juif de Jésus.Pas encore d'évaluation
- FR Martin - Le Baptême Dans L'esprit - Tradition Du Nouveau TestamentDocument36 pagesFR Martin - Le Baptême Dans L'esprit - Tradition Du Nouveau TestamentMihalache Cosmina100% (1)
- 5 EsDocument26 pages5 Escharbel ghafaryPas encore d'évaluation
- De La Jerusalem Celeste A BabyloneDocument12 pagesDe La Jerusalem Celeste A Babyloneaussedat.gaethanePas encore d'évaluation
- IndulgenceDocument3 pagesIndulgenceArcheducPas encore d'évaluation
- Chroniques Du Mondialisme by Pierre HillardDocument211 pagesChroniques Du Mondialisme by Pierre Hillardyo Jgn50% (2)
- FR5152-A Propos Dominus IesusDocument9 pagesFR5152-A Propos Dominus IesusMaria CrucisPas encore d'évaluation
- Alliance, Irenee PDFDocument7 pagesAlliance, Irenee PDFWillem KuypersPas encore d'évaluation
- Les Conditions De La Vraie Communion Avec Dieu: Un Commentaire Sur La Première Epitre De JeanD'EverandLes Conditions De La Vraie Communion Avec Dieu: Un Commentaire Sur La Première Epitre De JeanPas encore d'évaluation
- Purgatoire EmeryDocument18 pagesPurgatoire Emeryfrancis3ndourPas encore d'évaluation
- EnfertDocument3 pagesEnfertPère elie AssaadPas encore d'évaluation
- 8Document11 pages8Elie AssaadPas encore d'évaluation
- Prier 15 jours au souffle de la nouvelle évangélisation: Avec le directoire pour la catéchèseD'EverandPrier 15 jours au souffle de la nouvelle évangélisation: Avec le directoire pour la catéchèsePas encore d'évaluation
- 1990 Le Saint Sacrifice de La MesseDocument5 pages1990 Le Saint Sacrifice de La MesseJérôme DeuxièmePas encore d'évaluation
- La Justice de Dieu William M Greathouse & Linda M StargelDocument120 pagesLa Justice de Dieu William M Greathouse & Linda M Stargelkossi abaloPas encore d'évaluation
- Christologie - Cours - Théologie de La CroixDocument14 pagesChristologie - Cours - Théologie de La Croixjeimer moraPas encore d'évaluation
- SdT53 - Fatima, Le Catechisme Et La Nouvelle TheologieDocument14 pagesSdT53 - Fatima, Le Catechisme Et La Nouvelle TheologieSidneyPas encore d'évaluation
- Jacques Dupuis SJ, Le Dialogue Interreligieux À L'heure Du Pluralisme NRT 120-4 (1998) p.544-563Document20 pagesJacques Dupuis SJ, Le Dialogue Interreligieux À L'heure Du Pluralisme NRT 120-4 (1998) p.544-563aminickPas encore d'évaluation
- 22 Lagrave-RyssenDocument30 pages22 Lagrave-RyssenSérgio Renato Del RioPas encore d'évaluation
- FR Bcbook 10Document10 pagesFR Bcbook 10Étienne prince KayeyePas encore d'évaluation
- De la libération à la vie dans l'Esprit: Un chemin d’intégration progressifD'EverandDe la libération à la vie dans l'Esprit: Un chemin d’intégration progressifPas encore d'évaluation
- Les CatharesDocument18 pagesLes CatharesMouni Mohamed-SahnounPas encore d'évaluation
- Pretre Prophete RoiDocument4 pagesPretre Prophete RoiHomm DafrikPas encore d'évaluation
- Expose EschatologieDocument21 pagesExpose Eschatologieeba100% (1)
- DialogDocument8 pagesDialognjokou valeryPas encore d'évaluation
- Hors de Leglise Point de SalutDocument7 pagesHors de Leglise Point de SalutEmmanuel PolaPas encore d'évaluation
- Orthodoxie Et Modernité - Par Le Père Marc-Antoine Costa de BeauregardDocument24 pagesOrthodoxie Et Modernité - Par Le Père Marc-Antoine Costa de BeauregardChristophoros100% (1)
- IIA171 La Critique de La Religion FusionDocument18 pagesIIA171 La Critique de La Religion FusionFabio Prado de FreitasPas encore d'évaluation
- Les Sacrements de Leglise CatholiqueDocument6 pagesLes Sacrements de Leglise CatholiquekarisamPas encore d'évaluation
- Les dons et l'appel de dieu sont irrévocables: Romains chapitre 11, verset 29D'EverandLes dons et l'appel de dieu sont irrévocables: Romains chapitre 11, verset 29Pas encore d'évaluation
- L'esprit de La Liturgie - RatzingerDocument7 pagesL'esprit de La Liturgie - RatzingerClément AnouilPas encore d'évaluation
- Jessie Penn Lewis La Vie de ResurrectionDocument49 pagesJessie Penn Lewis La Vie de ResurrectionTIPIKMCPas encore d'évaluation
- Mysteres ChristiquesDocument9 pagesMysteres ChristiqueschristellechillyPas encore d'évaluation
- La Paque de JesusDocument6 pagesLa Paque de Jesusalfred cyrille tangPas encore d'évaluation
- 48 Lois Du PouvoirDocument7 pages48 Lois Du PouvoirPierre Richard Pepe Posy100% (2)
- Lhomme T RafiqueDocument224 pagesLhomme T Rafiquekkader_4Pas encore d'évaluation
- Jacqueline Kelen CitationsDocument11 pagesJacqueline Kelen CitationsMichel BarallonPas encore d'évaluation
- Angenot Marc La Parole PamphlétaireDocument7 pagesAngenot Marc La Parole PamphlétaireLaraPas encore d'évaluation
- Chene Et Ses MagieDocument81 pagesChene Et Ses MagieAnoventia OrxswixyPas encore d'évaluation
- Active MainsDocument33 pagesActive MainsPros Isso100% (1)
- Kimon Daniel - La Guerre AntijuiveDocument79 pagesKimon Daniel - La Guerre Antijuiveslimane gPas encore d'évaluation
- Le Festival Des Lucioles 1er SessionDocument3 pagesLe Festival Des Lucioles 1er SessionDo PerrPas encore d'évaluation
- Théorie de L'evolution, Gilles RagnaudDocument20 pagesThéorie de L'evolution, Gilles Ragnaudgosseyn0100% (2)
- Ud UWAcq 3 Cldda R50 L Iki K9 e OGpsDocument63 pagesUd UWAcq 3 Cldda R50 L Iki K9 e OGpsMao MawejaPas encore d'évaluation
- Progrès Du Golfe - Cathédrale de RimouskiDocument7 pagesProgrès Du Golfe - Cathédrale de RimouskiRadio-CanadaPas encore d'évaluation
- Remettez Vos Soucis À Dieu Et Aux Anges - INTELLIGENCE INFINIEDocument8 pagesRemettez Vos Soucis À Dieu Et Aux Anges - INTELLIGENCE INFINIEAlfredo MoundjiPas encore d'évaluation
- Messe 17e Ord C 2022Document2 pagesMesse 17e Ord C 2022PaolaPas encore d'évaluation
- Bentinho Massaro - Les "Émanants", ©messagers de La Nature PDFDocument6 pagesBentinho Massaro - Les "Émanants", ©messagers de La Nature PDFSKYHIGH444Pas encore d'évaluation
- Illuminati Illuminati Illuminati Longueuil SaturnDocument12 pagesIlluminati Illuminati Illuminati Longueuil SaturnAnonymous ZkB6d8100% (1)
- Dhondt Genese Dialectique HegelienneDocument14 pagesDhondt Genese Dialectique HegeliennejeanmariepaulPas encore d'évaluation
- Culture D'entreprise Et Implication Du PersonnelDocument20 pagesCulture D'entreprise Et Implication Du PersonnelAyoub Fouzai100% (3)
- Edith SteinDocument20 pagesEdith SteinJean-pierre Negre100% (1)
- Cours Nabhi 6pDocument6 pagesCours Nabhi 6pWOGNINPas encore d'évaluation
- Introduction À L'histoire Générale Des Littératures Orientales Texte EntierDocument114 pagesIntroduction À L'histoire Générale Des Littératures Orientales Texte EntierLéa LassoutPas encore d'évaluation
- Epoux - EpouseDocument1 pageEpoux - EpousePère elie AssaadPas encore d'évaluation
- Les Pensées de Maurice KamtoDocument54 pagesLes Pensées de Maurice KamtogwompoPas encore d'évaluation
- Chants Avent 2019 ADocument8 pagesChants Avent 2019 Aolivia chouadeuPas encore d'évaluation
- Rituel ExorcismeDocument10 pagesRituel ExorcismeTrakamusicgroup153 GroupPas encore d'évaluation
- Un Passage A SiloeDocument14 pagesUn Passage A Siloetrone3wmbPas encore d'évaluation
- Genies de La Kabbale PDFDocument149 pagesGenies de La Kabbale PDFNG Preneurs100% (2)
- MANTEGAZZA L'Amour Dans L'humanite 1886Document414 pagesMANTEGAZZA L'Amour Dans L'humanite 1886Studentul2000Pas encore d'évaluation
- Grimoire ChamanedejungleDocument20 pagesGrimoire ChamanedejungleantoinePas encore d'évaluation