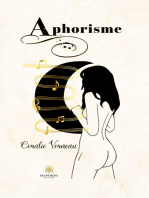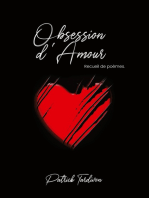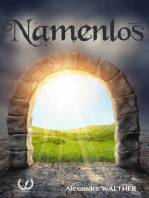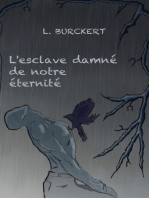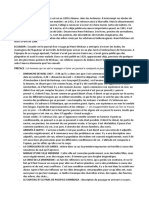Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Oeuvre Complète Sonnets
Transféré par
Fireball440 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
16 vues12 pagesTitre original
Oeuvre complète Sonnets
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
16 vues12 pagesOeuvre Complète Sonnets
Transféré par
Fireball44Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 12
Les sonnets de Louise Labé, œuvre intégrale
Sonnet I
Si jamais il y eut plus clairvoyant qu’Ulysse,
Il n’aurait jamais pu prévoir que ce visage,
Orné de tant de grâce et si digne d’hommage,
Devienne l’instrument de mon affreux supplice.
Cependant ces beaux yeux, Amour, ont su ouvrir
Dans mon coeur innocent une telle blessure
-Dans ce coeur où tu prends chaleur et nourriture-
Que tu es bien le seul à pouvoir m’en guérir.
Cruel destin ! Je suis victime d’un Scorpion,
Et je ne puis attendre un remède au poison
Que du même animal qui m’a empoisonnée !
Je t’en supplie, Amour, cesse de me tourmenter !
Mais n’éteins pas en moi mon plus précieux désir,
Sinon il me faudra fatalement mourir.
l
Sonnet II
Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés,
Ô chauds soupirs, ô larmes épandues,
Ô noires nuits vainement attendues,
Ô jours luisants vainement retournés !
Ô tristes plaints, ô désirs obstinés,
Ô temps perdu, ô peines dépendues,
Ô milles morts en mille rets tendues,
Ô pires maux contre moi destinés !
Ô ris, ô front, cheveux bras mains et doigts !
Ô luth plaintif, viole, archet et voix !
Tant de flambeaux pour ardre une femelle !
De toi me plains, que tant de feux portant,
En tant d’endroits d’iceux mon coeur tâtant,
N’en ai sur toi volé quelque étincelle.
l
l
Sonnet III
Ô longs désirs, ô espérances vaines,
Tristes soupirs et larmes coutumières
À engendrer de moi maintes rivières,
Dont mes deux yeux sont sources et fontaines !
Ô cruautés ô duretés inhumaines,
Piteux regards des célestes lumières,
Du coeur transi ô passions premières
Estimez-vous croître encore mes peines ?
Qu’encor Amour sur moi son arc essaie,
Que de nouveaux feux me jette et nouveaux dards,
Qu’il se dépite et pis qu’il pourra fasse :
Car je suis tant navrée en toute part
Que plus en moi une nouvelle plaie
Pour m’empirer, ne pourrait trouver place.
l
Sonnet IV
Depuis qu’Amour cruel empoisonna
Premièrement de son feu ma poitrine,
Toujours brûlai de sa fureur divine,
Qui un seul jour mon coeur n’abandonna.
Quelque travail, dont assez me donna,
Quelque menace et prochaine ruine,
Quelque penser de mort qui tout termine,
De rien mon coeur ardent ne s’étonna.
Tant plus qu’Amour nous vient fort assaillir,
Plus il nous fait nos forces recueillir,
Et toujours frais en ses combats fait être ;
l
Sonnet V
Claire Vénus, qui erres par les Cieux,
Entends ma voix qui en plaints chantera,
Tant que ta face au haut du Ciel luira,
Son long travail et souci ennuyeux.
Mon oeil veillant s’attendrira bien mieux,
Et plus de pleurs te voyant jettera.
Mieux mon lit mol de larmes baignera,
De ses travaux voyant témoins tes yeux.
Donc des humains sont les lassés esprits
De doux repos et de sommeil épris.
J’endure mal tant que le soleil luit ;
Et quand je suis quasi toute cassée,
Et que me suis mise en mon lit lassée,
Crier me faut mon mal toute la nuit.
L
Sonnet VI
Deux ou trois fois bienheureux le retour
De ce clair Astre, et plus heureux encore
Ce que son oeil de regarder honore.
Que celle-là recevrait un bon jour
Qu’elle pourrait se vanter d’un bon tour,
Qui baiserait le plus beau don de Flore,
Le mieux sentant que jamais vis Aurore,
Et y ferait sur ses lèvres séjour !
C’est à moi seule à qui ce bien est dû,
Pour tant de pleurs et tant de temps perdu ;
Mais, le voyant, tant lui ferai de fête,
Tant emploierai de mes yeux le pouvoir,
Pour dessus lui plus de crédit avoir,
Qu’en peu de temps ferai grande conquête.
lSonnet VII
On voit mourir toute chose animée,
Lors que du corps l’âme subtile part :
Je suis le corps, toi la meilleure part :
Où es-tu donc, ô âme bien aimée ?
Ne me laissez pas si longtemps pâmée :
Pour me sauver après viendrais trop tard.
Las ! Ne mets point ton corps en ce hasard :
Rends-lui sa part et moitié estimée.
Mais fais, Ami, que ne soit dangereuse
Cette rencontre et revue amoureuse,
L’accompagnant, non de sévérité,
Non de rigueur, mais de grâce amiable,
Qui doucement me rende ta beauté,
Jadis cruelle, à présent favorable.
Sonnet VIII
Je vis, je meurs: je me brûle et me noie,
J’ai chaud extrême en endurant froidure;
La vie m’est et trop molle et trop dure,
J’ai grands ennuis entremêlés de joie.
Tout en un coup je ris et je larmoie,
Et en plaisir maint grief tourment j’endure,
Mon bien s’en va, et à jamais il dure,
Tout en un coup je sèche et je verdoie.
Ainsi Amour inconstamment me mène
Et, quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me trouve hors de peine.
Puis, quand je crois ma joie être certaine,
Et être en haut de mon désiré heur,
Il me remet en mon premier malheur.
Sonnet IX
Tout aussitôt que je commence à prendre
Dans le mol lit le repos désiré,
Mon triste esprit, hors de moi retiré,
S’en va vers toi incontinent se rendre.
Lors m’est avis que dedans mon sein tendre
Je tiens le bien où j’ai tant aspiré,
Et pour lequel j’ai si haut soupiré
Que de sanglots ai souvent cuidé fendre.
Ô doux sommeil, ô nuit à moi heureuse !
Plaisant repos plein de tranquillité,
Continuez toutes les nuits mon songe ;
Et si jamais ma pauvre âme amoureuse
Ne doit avoir de bien en vérité,
Faites au moins qu’elle en ait en mensonge.
Sonnet X
Quand j’aperçois ton blond chef, couronné
D’un laurier vert, faire un luth si bien plaindre
Que tu pourrais à te suivre contraindre
Arbres et rocs ; quand je te vois orné,
Et, de vertus dix mille environné,
Au chef d’honneur plus haut que nul atteindre,
Et des plus hauts les louanges éteindre,
Lors dit mon coeur en soi passionné :
Tant de vertus qui te font être aimé,
Qui de chacun te font être estimé,
Ne te pourraient aussi bien faire aimer ?
Et, ajoutant à ta vertu louable
Ce nom encor de m’être pitoyable,
De mon amour doucement t’enflammer ?
Sonnet XI
Ô doux regards, ô yeux pleins de beauté
Petits jardins pleins de fleurs amoureuses
Où sont d’Amour les flèches dangereuses,
Tant à vous voir mon oeil s’est arrêté !
Ô coeur félon, ô rude cruauté,
Tant tu me tiens de façons rigoureuses,
Tant j’ai coulé de larmes langoureuses,
Sentant l’ardeur de mon coeur tourmenté !
Doncques, mes yeux, tant de plaisir avez,
Tant de bons tours par ces yeux recevez ;
Mais toi, mon coeur, plus les vois s’y complaire,
Plus tu languis, plus en as de souci.
Or devinez si je suis aise aussi,
Sentant mon oeil être à mon coeur contraire.
Sonnet XII
Oh, si j’étais en ce beau sein ravieDe celui-là pour lequel vais mourant :
Si avec lui vivre le demeurant
De mes courts jours ne m’empêchait envie :
Si m’accolant me disait : chère Amie,
Contentons-nous l’un l’autre ! s’assurant
Que jà tempête, Euripe, ni Courant
Ne nous pourra disjoindre en notre vie :
Si de mes bras le tenant accolé,
Comme du lierre est l’arbre encercelé,
La mort venait, de mon aise envieuse,
Lors que, soif, plus il me baiserait,
Et mon esprit sur ses lèvres fuirait,
Bien je mourrais, plus que vivante, heureuse.
Sonnet XIII
Luth, compagnon de ma calamité,
De mes soupirs témoin irréprochable,
De mes ennuis contrôleur véritable,
Tu as souvent avec moi lamenté ;
Et tant le pleur piteux t’a molesté
Que, commençant quelque son délectable,
Tu le rendais tout soudain lamentable,
Feignant le ton que plein avais chanté.
Et si tu veux efforcer au contraire,
Tu te détends et si me contrains taire :
Mais me voyant tendrement soupirer,
Donnant faveur à ma tant triste plainte,
En mes ennuis me plaire suis contrainte
Et d’un doux mal douce fin espérer.
Sonnet XIV
Tant que mes yeux pourront larmes épandre
A l’heur passé avec toi regretter :
Et qu’aux sanglots et soupirs résister
Pourra ma voix, et un peu faire entendre :
Tant que ma main pourra les cordes tendre
Du mignard Luth, pour tes grâces chanter :
Tant que l’esprit se voudra contenter
De ne vouloir rien fors que toi comprendre :
Je ne souhaite encore point mourir.
Mais quand mes yeux je sentirai tarir,
Ma voix cassée, et ma main impuissante,
Et mon esprit en ce mortel séjour
Ne pouvant plus montrer signe d’amante :
Prierai la mort noircir mon plus clair jour.
Sonnet XV
Pour le retour du Soleil honorer,
Le Zéphir l’air serein lui appareille,
Et du sommeil l’eau et la terre éveille,
Qui les gardait, l’une de murmurer
En doux coulant, l’autre de se parer
De mainte fleur de couleur nonpareille
Jà les oiseaux ès arbres font merveille,
Et aux passants font l’ennui modérer
Les nymphes jà en milles jeux s’ébattent
Au clair de lune, et dansant l’herbe abattent.
Veux-tu Zéphir, de ton heur me donner,
Et que par toi toute me renouvelle ?
Fais mon Soleil devers moi retourner,
Et tu verras s’il ne me rend plus belle.
Sonnet XVI
Après qu’un temps la grêle et le tonnerre
Ont le haut mont de Caucase battu,
Le beau jour vient, de lueur revêtu.
Quand Phébus a son cerne fait en terre,
Et l’Océan il regagne à grand’erre ;
Sa soeur se montre avec son chef pointu.
Quand quelque temps le Parthe a combattu,
Il prend la fuite et son arc il desserre.
Un temps t’ai vu et consolé plaintif,
Et défiant de mon feu peu hâtif ;
Mais maintenant que tu m’as embrassée
Et suis au point auquel tu me voulais,
Tu as ta flamme en quelque eau arrosée,
Et es plus froid qu’être je ne voulais.
Sonnet XVII
Je fuis la ville, et temples, et tous lieux
Esquels, prenant plaisir à t’ouïr plaindre,
Tu pus, et non sans force, me contraindre
De te donner ce qu’estimais le mieux.
Masques, tournois, jeux me sont ennuyeux,
Et rien sans toi de beau ne me puis peindre;
Tant que, tâchant à ce désir étreindre,
Et un nouvel objet faire à mes yeux,
Et des pensers amoureux me distraire,
Des bois épais suis le plus solitaire.
Mais j’aperçois, ayant erré maint tour,
Que si je veux de toi être délivre,
Il me convient hors de moi-même vivre;
Ou fais encor que loin sois en séjour.
Sonnet XVIII
Baise m’encor, rebaise-moi et baise :
Donne m’en un de tes plus savoureux,
Donne m’en un de tes plus amoureux :
Je t’en rendrai quatre plus chauds que braise.
Las, te plains-tu ? ça que ce mal j’apaise,
En t’en donnant dix autres doucereux.
Ainsi mêlant nos baisers tant heureux
Jouissons-nous l’un de l’autre à notre aise.
Lors double vie à chacun en suivra.
Chacun en soi et son ami vivra.
Permets m’Amour penser quelque folie :
Toujours suis mal, vivant discrètement,
Et ne me puis donner contentement,
Si hors de moi ne fais quelque saillie.
Sonnet XIX
Diane étant en l’épaisseur d’un bois,
Après avoir mainte bête assénée,
Prenait le frais, de Nymphe couronnée.
J’allais rêvant, comme fais mainte fois,
Sans y penser, quand j’ouïs une voix
Qui m’appela, disant : Nymphe étonnée,
Que ne t’es-tu vers diane tournée ?
Et, me voyant sans arc et sans carquois :
Qu’as-tu trouvé, Ô compagne en ta voie,
Qui de ton arc et flèches ait fait proie ?
– Je m’animai, réponds-je, à un passant,
Et lui jetai en vain toute mes flèches
Et l’arc après ; mais lui les ramassant
Et les tirant, me fit cent et cent brèches.
Sonnet XX
Prédit me fut que devait fermement
Un jour aimer celui dont la figure
Me fut décrite ; et sans autre peinture
Le reconnus quand vis premièrement.
Puis le voyant aimer fatalement
Pitié je pris de sa triste aventure,
Et tellement je forçais ma nature,
Qu’autant que lui aimai ardentement.
Qui n’eût pensé qu’en faveur devait croître
Ce que le ciel et destins firent naître ?
Mais quand je vois si nubileux apprêts,
Vents si cruels et tant horrible orage,
Je crois qu’étaient les infernaux arrêts
Que de si loin m’ourdissaient ce naufrage.
Sonnet XXI
Quelle grandeur rend l’homme vénérable ?
Quelle grosseur ? Quel poil ? Quelle couleur ?
Qui est des yeux le plus emmielleur ?
Qui fait plus tôt une plaie incurable ?
Quel chant est plus à l’homme convenable ?
Qui plus pénètre en chantant sa douleur ?
Qui un doux luth fait encore meilleur ?
Quel naturel est le plus amiable ?
Je ne voudrais le dire assurément,
Ayant Amour forcé mon jugement ;
Mais je sais bien, et de tant je m’assure,
Que tout le beau que l’on pourrait choisir,
Et que tout l’art qui aide la Nature,
Ne sauraient accroître mon désir.
Sonnet XXII
Luisant Soleil, que tu es bienheureux
De voir toujours t’Amie la face !
Et toi, sa soeur, qu’Endymion embrasse,
Tant te repais de miel amoureux !
Mars voit Vénus ; Mercure aventureux
De Ciel en Ciel, de lieu en lieu se glace ;
Et Jupiter remarque en mainte place
Ses premiers ans plus gais et chaleureux.
Voilà du Ciel la puissante harmonie,
Qui les esprits divins ensemble lie ;
Mais s’ils avaient ce qu’ils aiment lointain,
Leur harmonie et ordre irrévocable
Se tournerait en erreur variable,
Et comme moi travaillerait en vain.
Sonnet XXIII
Las! Que me sert que si parfaitement
Loua jadis ma tresse dorée,
Et de mes yeux la beauté comparée
A deux Soleils, dont Amour finement
Tira les traits causes de son tourment?
Où êtes-vous, pleurs de peu de durée ?
Et mort par qui devait être honorée
Ta ferme amour et itéré serment ?
Doncques c’était le but de ta malice
De m’asservir sous ombre de service ?
Pardonne-moi, Ami, à cette fois,
Étant outrée et de dépit et d’ire ;
Mais je m’assur’, quelque part que tu sois,
Qu’autant que moi tu souffres de martyre.
Sonnet XXIV
Ne reprenez, Dames, si j’ai aimé,Si j’ai senti mille torches ardentes,
Mille travaux, mille douleurs mordantes.
Si, en pleurant, j’ai mon temps consumé,
Las ! que mon nom n’en soit par vous blâmé.
Si j’ai failli, les peines sont présentes,
N’aigrissez point leurs pointes violentes :
Mais estimez qu’Amour, à point nommé,
Sans votre ardeur d’un Vulcain excuser,
Sans la beauté d’Adonis accuser,
Pourra, s’il veut, plus vous rendre amoureuses,
En ayant moins que moi d’occasion,
Et plus d’étrange et forte passion.
Et gardez-vous d’être plus malheureuses !
Vous aimerez peut-être aussi
- 01 Poesie LexiqueDocument2 pages01 Poesie LexiqueanaPas encore d'évaluation
- AnalyseDocument6 pagesAnalyseguigui farmeurPas encore d'évaluation
- Le Grand Livre Des SonnetsDocument1 204 pagesLe Grand Livre Des SonnetsLozac'h FranckPas encore d'évaluation
- Daid ZakiaDocument252 pagesDaid ZakiaIsmail TalbiPas encore d'évaluation
- INFERNO Aventures Kit-De-Decouverte WIP FR 2023-06-28Document68 pagesINFERNO Aventures Kit-De-Decouverte WIP FR 2023-06-28dungeonworld100% (2)
- Le RealismeDocument3 pagesLe RealismeSs KgPas encore d'évaluation
- Purcell O Solitude G MinorDocument4 pagesPurcell O Solitude G MinorMaria StPas encore d'évaluation
- LQ Sémiotique Du Conte Comme TexteDocument29 pagesLQ Sémiotique Du Conte Comme TexteNatalia Popusoi100% (1)
- 3 Partie Dissertation (Technique Et Exercices Corrigés)Document20 pages3 Partie Dissertation (Technique Et Exercices Corrigés)Ben Elyass100% (9)
- Oeuvres choisies: Amours de Cassandre, Bien qu'il te plaise, Une beauté, Avant le temps, Si mille oeillets, Discours des misères du temps, etc.D'EverandOeuvres choisies: Amours de Cassandre, Bien qu'il te plaise, Une beauté, Avant le temps, Si mille oeillets, Discours des misères du temps, etc.Pas encore d'évaluation
- Beautiful SaviorDocument3 pagesBeautiful SaviorIsrael de MelloPas encore d'évaluation
- Labe SijamaisilyeutDocument8 pagesLabe SijamaisilyeutFireball44Pas encore d'évaluation
- AnthologieDocument4 pagesAnthologieXenmer - LPas encore d'évaluation
- Le Second Livre Des Sonnets Pour Hc3a9lc3a8ne 1578Document51 pagesLe Second Livre Des Sonnets Pour Hc3a9lc3a8ne 1578Emmanuel FingilaPas encore d'évaluation
- Poeme L'amourDocument83 pagesPoeme L'amouryilmazturanalp007Pas encore d'évaluation
- Anna de Noailles - Les Vivants Et Les MortsDocument218 pagesAnna de Noailles - Les Vivants Et Les MortsephraimPas encore d'évaluation
- 124marceline Desbordes-Valmore - ÉlégiesDocument96 pages124marceline Desbordes-Valmore - ÉlégiesDaniel Felipe Arenas Ceballos100% (1)
- An Tho LogieDocument14 pagesAn Tho LogieAhmad LPBPas encore d'évaluation
- Amour 1321Document5 pagesAmour 1321gcuckhcchPas encore d'évaluation
- Gioco Della CiecaDocument7 pagesGioco Della CiecaCinqMarsPas encore d'évaluation
- Petrarque CanzoniereDocument2 pagesPetrarque CanzoniereFireball44Pas encore d'évaluation
- Corpus Beauté:souffranceDocument2 pagesCorpus Beauté:souffranceNana VérifPas encore d'évaluation
- La Poésie Du Moyen Âge Au XVIIIe Siècle - DossierDocument10 pagesLa Poésie Du Moyen Âge Au XVIIIe Siècle - DossierAkil MhannaPas encore d'évaluation
- Recueil PoèmesDocument6 pagesRecueil PoèmesSpartacraft GamingPas encore d'évaluation
- Christine de Pisan - Cent BalladesDocument101 pagesChristine de Pisan - Cent BalladeslittefrPas encore d'évaluation
- Franck Lozac'h Sonnets 78-84Document21 pagesFranck Lozac'h Sonnets 78-84Lozac'h Franck Olivier PierrePas encore d'évaluation
- Corpus Exam Poã©sieDocument4 pagesCorpus Exam Poã©sieNouha El megdaziPas encore d'évaluation
- GT Regards Sur La Passion AmoureuseDocument8 pagesGT Regards Sur La Passion AmoureuselyblancPas encore d'évaluation
- SEQUENCE Amour À Perdre La RaisonDocument4 pagesSEQUENCE Amour À Perdre La RaisonlyblancPas encore d'évaluation
- 123marceline Desbordes-Valmore - Bouquets Et PrièresDocument223 pages123marceline Desbordes-Valmore - Bouquets Et PrièresDaniel Felipe Arenas CeballosPas encore d'évaluation
- Corpus Poèmes AmourDocument5 pagesCorpus Poèmes AmourITPas encore d'évaluation
- PoésieDocument64 pagesPoésievstevealexanderPas encore d'évaluation
- Séquence Sonnet 16eDocument2 pagesSéquence Sonnet 16elyblancPas encore d'évaluation
- Valery Paul - El Cementerio Marino Jorge GuillenDocument8 pagesValery Paul - El Cementerio Marino Jorge Guillenhitchcock01Pas encore d'évaluation
- Rayons poétiques de lumière vers votre coeur-paradis de fleursD'EverandRayons poétiques de lumière vers votre coeur-paradis de fleursPas encore d'évaluation
- BaudelaireDocument4 pagesBaudelairekitten_pillowPas encore d'évaluation
- Verlaine Paul - Odes en Son HonneurDocument36 pagesVerlaine Paul - Odes en Son HonneurtuiPas encore d'évaluation
- Séance 4 Pétrarque Corrigé Des QuestionsDocument3 pagesSéance 4 Pétrarque Corrigé Des QuestionsFireball44Pas encore d'évaluation
- Laboureur Et Ses EnfantsDocument2 pagesLaboureur Et Ses EnfantsFireball44Pas encore d'évaluation
- Pot Terre FerDocument15 pagesPot Terre FerFireball44Pas encore d'évaluation
- Eaf17 LaDocument4 pagesEaf17 LaFireball44Pas encore d'évaluation
- LabejevisjemeursDocument4 pagesLabejevisjemeursFireball44Pas encore d'évaluation
- Le Chat La Belette Et Le Petit LapinDocument4 pagesLe Chat La Belette Et Le Petit LapinFireball44Pas encore d'évaluation
- Le Lion Et Le RatDocument1 pageLe Lion Et Le RatAna-Maria DimaPas encore d'évaluation
- Le Coche Et La MoucheDocument2 pagesLe Coche Et La MoucheFireball44Pas encore d'évaluation
- Le Loup Et Le ChienDocument4 pagesLe Loup Et Le ChienFireball44Pas encore d'évaluation
- Le Loup Et LagneauDocument2 pagesLe Loup Et LagneauFireball44Pas encore d'évaluation
- Grimm Contes Famille 08 - Le Loup Et Le RenardDocument4 pagesGrimm Contes Famille 08 - Le Loup Et Le RenardFireball44Pas encore d'évaluation
- La FontaineDocument1 pageLa FontaineSmilingyoPas encore d'évaluation
- La Grenouille Qui Veut Se Faire Aussi Grosse Que Le BoeufDocument1 pageLa Grenouille Qui Veut Se Faire Aussi Grosse Que Le BoeuftotocorpPas encore d'évaluation
- La Cigale Et La FourmiDocument1 pageLa Cigale Et La FourmirenaudrenardPas encore d'évaluation
- La FontaineDocument1 pageLa FontaineSmilingyoPas encore d'évaluation
- Débuter Le Commentaire - Rentabiliser Sa Lecture Et Construire Le BrouillonDocument2 pagesDébuter Le Commentaire - Rentabiliser Sa Lecture Et Construire Le BrouillonlyblancPas encore d'évaluation
- Mort Mourant LAFDocument9 pagesMort Mourant LAFHoucine OsltPas encore d'évaluation
- GARNIER, Pierre. Poésie Concrète Et SpatialeDocument14 pagesGARNIER, Pierre. Poésie Concrète Et SpatialeLorenaPas encore d'évaluation
- Catherine AGUILLON HTTPDocument3 pagesCatherine AGUILLON HTTPYann SittlerPas encore d'évaluation
- EcuadorDocument4 pagesEcuadorLETIZIA MELLACEPas encore d'évaluation
- Exercices Sur La Technique PoétiqueDocument2 pagesExercices Sur La Technique PoétiqueCatherine MAQUETPas encore d'évaluation
- Lecture Analytique Medee V 2Document6 pagesLecture Analytique Medee V 2andrianarisoaharenafitahinaahaPas encore d'évaluation
- 3 5e Rediger Un Poeme SimpleDocument4 pages3 5e Rediger Un Poeme Simpleyayasidibe0504Pas encore d'évaluation
- Carte Mentale FR LL 5-16 Part1Document1 pageCarte Mentale FR LL 5-16 Part1corvaisieralexisPas encore d'évaluation
- La Poésie LyriqueDocument13 pagesLa Poésie LyriqueGissel VivianaPas encore d'évaluation
- T3 - J'ai Tant Rêvé de ToiDocument5 pagesT3 - J'ai Tant Rêvé de ToiClémentine BRUGUEROLLEPas encore d'évaluation
- Le Parti Pris Des ChosesDocument1 pageLe Parti Pris Des ChosesBenoît rideauPas encore d'évaluation
- Zoom HebdoDocument9 pagesZoom HebdoAndy ONDo MAROGa andyPas encore d'évaluation
- Rimbaud RomanDocument3 pagesRimbaud RomanfraissePas encore d'évaluation
- Les Quatre Premiers Livres Des Odes de Pierre de Ronsard, VandomoisDocument169 pagesLes Quatre Premiers Livres Des Odes de Pierre de Ronsard, VandomoisabdelazizkooliPas encore d'évaluation
- Anthologie de La Poésie Russe Contemporaine 1989-2009 (Henry-Safier, Hélène (Ed.) Zeytounian-Beloüs Etc.)Document286 pagesAnthologie de La Poésie Russe Contemporaine 1989-2009 (Henry-Safier, Hélène (Ed.) Zeytounian-Beloüs Etc.)Thomas NenningerPas encore d'évaluation
- Emails+en+Anglais+ +8+Expressions+IncontournablesDocument5 pagesEmails+en+Anglais+ +8+Expressions+IncontournablesAbakachi DoungousPas encore d'évaluation
- Part Écrivains Partie 2Document4 pagesPart Écrivains Partie 2hownowproPas encore d'évaluation
- Ironic Leadsheet PDFDocument2 pagesIronic Leadsheet PDFCarlos PeraltaPas encore d'évaluation
- Résumé Sur Les Contemplation de Victor HugoDocument8 pagesRésumé Sur Les Contemplation de Victor HugoamritaPas encore d'évaluation
- Activités Les Figures de Style 4èDocument2 pagesActivités Les Figures de Style 4èEstelle ELIZABETH100% (1)