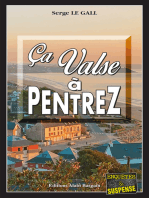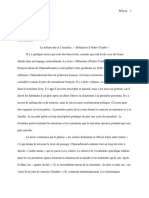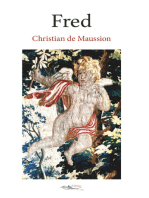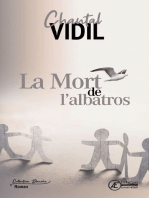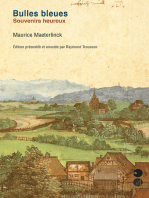Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
7 LP06 BoiteOutils - Texte+corrige
Transféré par
viator P.NTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
7 LP06 BoiteOutils - Texte+corrige
Transféré par
viator P.NDroits d'auteur :
Formats disponibles
Corrigé du sujet 2 du baccalauréat de spécialité HLP
Jeudi 12 mai 2022
Texte de Louis CALAFERTE, C’est la guerre (1939)
Ce récit s’ouvre sur l’annonce de la mobilisation générale en septembre 1939.
« Il est cinq heures d’un après-midi de septembre tiède et gris.
Le tocsin sonne.
On arrête de jouer.
Robe noire fermée jusqu’au cou, les bras levés, des mains blanches osseuses, le regard fixe, la vieille
femme crie sur la place du village que c’est la mobilisation générale.
Il n’y a pas un souffle d’air dans les feuilles du gros arbre.
Des oiseaux chantent.
Au garde-à-vous dans sa salopette de travail, les mains dans les poches, un homme
pleure.
Il est en sabots.
Il y a du bruit et du silence, mais le silence absorbe le bruit. C’est comme aux
enterrements.
Un long chat noir est étiré sur le rebord d’une fenêtre.
Deux femmes âgées s’étreignent, chacune la tête dans le cou de l’autre. Le chignon de la plus petite s’est
défait, ses cheveux grisonnants tombent en longues mèches ondulantes de chaque côté de ses épaules.
On dirait des anguilles vivantes. J’ai envie de faire pipi.
Quelque part, au loin, une génisse appelle d’un meuglement plaintif.
Des villageois restent adossés à la façade jaune sale d’une maison.
Assise sur une pierre, la petite fille bleue tient à deux mains son ballon sur ses
genoux. Ses chaussettes blanches sont en boules molles sur ses chevilles. Elle se mord
les lèvres.
Devant le muret de pierres sèches, une femme s’est agenouillée sur le sable de la
place. Elle a les mains jointes, le dos voûté, la tête baissée. C’est comme une statue
d’église, mais noire.
Ma culotte est trop courte, elle me tire entre les jambes, j’ai de grosses croûtes aux genoux, ça
sanguinole toujours un peu et ça brûle.
En blouses grises, l’épicier et sa femme se tiennent sur le pas de leur porte.
Un cerf-volant rouge clignote dans le ciel.
Des hommes arrivent. Ils se serrent la main. On les voit se parler, hocher la tête, la
secouer, hausser les épaules.
Les bras ballants, deux femmes ont déposé devant elles leurs seaux de fer pleins
d’eau.
Je n’ai pas goûté. J’ai faim.
Le petit rouquin se traîne à quatre pattes dans la poussière en faisant des bulles de
salive avec ses lèvres. Il reçoit un coup de pied, tombe en avant sur le ventre et éclate de rire. C’est sa
mère qui lui a donné le coup de pied. Elle le relève en le tirant brutalement par le bras. Elle époussette du
bout des doigts son tablier d’écolier noir. Elle lui donne une gifle. Il pleure.
- On ne tape pas les petits aujourd’hui, dit un vieux, c’est la guerre.
CNED TERMINALE HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 1
Je ne sais pas ce que c’est que la mobilisation générale, mais je suis bien content
que ce soit la guerre.
J’ai onze ans.
- Les salauds dit un homme.
J’aime les tartines épaisses avec dessus du beurre salé et un sucre.
Une grande femme surgit soudainement.
- Je le savais ! Je le savais !
Ses cheveux courts semblent grésiller autour de sa tête.
- Ce matin j’ai écrit une lettre à quelqu’un. Au lieu de mettre la bonne date j’ai mis
deux fois 1914 !
Je la regarde, étroite, nerveuse, les yeux écarquillés, cette voix criarde. Je ne comprends pas ce qu’elle
est en train de dire, mais je la trouve bête.
- Papa a fait 14 !
- Mon père aussi, dit un jeune paysan, le torse nu avec des poils blonds.
- Et nous voilà bons encore une fois dit l’homme à la moustache.
Il faut que j’aille chercher mon goûter à la maison. »
Louis CALAFERTE, C’est la guerre (1993)
CNED TERMINALE HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 2
CORRIGÉ
Première partie : Interprétation littéraire
« C’est la guerre » : ce texte vous en donne-t-il l’impression ?
« La guerre, on ne la fait pas : c’est elle qui nous fait » : l’affirmation de Sartre rappelle à quel point la
guerre est un état dans lequel on peut se trouver plongé très brutalement, sans y être préparé et sans
savoir ce qu’elle changera en nous. C’est en quelque sorte ce qui arrive au très jeune narrateur du texte
de Louis Calaferte, C’est la guerre, publié en 1993. L’extrait offre un point de vue original sur l’annonce
de la mobilisation générale en septembre 1939 dans un village qui pourrait être n’importe lequel, et on
assiste à la réaction des villageois qui pourraient être n’importe quels villageois. C’est à hauteur d’enfant
que le récit de cet épisode est mené avec une certaine innocence voire inconscience : « c’est la guerre »,
mais dans quelle mesure comprend-on que c’est le cas ici ? On verra que le texte ressemble à une série
d’arrêts sur images, comme au cinéma, qui montrent à quel point les personnages sont saisis face à une
promesse de violence imminente. On verra cela dit que le monde décrit, du fait du point de vue adopté, se
retrouve peuplé de détails enfantins qui ont tendance à tout placer sur le même plan, comme si la guerre
restait une idée vague. On mettra enfin en évidence qu’il revient au lecteur de décoder les sous-entendus
du texte : même si la guerre n’est qu’annoncée, la violence couve déjà.
Ce qui frappe en premier lieu dans l’extrait, c’est que l’annonce de la mobilisation provoque
paradoxalement l’immobilisation des villageois ; l’un des premiers verbes du texte est « arrêter » à la
ligne 3, « on arrête de jouer », ce qui pourrait sonner la fin du divertissement, de tout plaisir. La vieille
femme décrite la première a « le regard fixe » à la ligne 5. L’homme mentionné ensuite est « au garde-
à-vous » à la ligne 8. Ce sont toutes des notations d’immobilité. La nature elle-même répond à cette
sidération : « il n’y a pas un souffle d’air dans les feuilles du gros arbre » à la ligne 6, c’est comme si
le vent lui-même s’était arrêté à l’annonce de la guerre prochaine. L’univers est massivement statufié,
arrêté net. La structure du texte montre également que l’enfant saisit une série d’instantanés, comme
en photographie ; l’auteur a en effet décidé de revenir de très nombreuses fois à la ligne, trente-six fois
en cinquante-six lignes. Le narrateur passe d’une image à une autre, à l’aide du présent de description :
« un long chat noir est étiré » (ligne 13), « une génisse appelle » (ligne 18), « la petite fille […] se mord
les lèvres » (ligne 21) ou encore « un cerf-volant rouge clignote dans le ciel » (ligne 29). On voit bien que
l’enfant prête son attention successivement à des éléments de la nature, aux hommes et aux femmes,
aux autres enfants, aux objets, aux couleurs. La liste est hétéroclite, le narrateur est guidé par ses
perceptions du moment, et les fait partager au lecteur les unes après les autres. Ce n’est donc pas
encore la guerre dans le sens où elle n’est pas encore exprimée par une violence débridée.
Plus encore, cette série d’instantanés provoque un curieux effet de lissage : tout semble être replacé sur
le même plan. On dirait que l’enfant perçoit le monde autour de lui sans faire de distinction particulière,
sans que cela provoque en lui une réflexion sur les enjeux de la guerre qui va arriver. D’ailleurs, en tant
qu’enfant, il porte son attention sur des détails typiques de son univers de références, loin de tout champ
de bataille viril : le petit garçon précise que sa « culotte est trop courte » et lui « tire entre les jambes »
à la ligne 26, faisant ressentir au lecteur ce petit détail d’inconfort presque amusant, auquel s’ajoute
la brûlure causée par les « grosses croûtes aux genoux », grand classique de l’enfance turbulente. Ses
préoccupations sont essentiellement son « envie de faire pipi » (ligne 17) et son « goûter » évoqué à
plusieurs reprises aux lignes 34, 45 et 56. Les villageois ont beau sembler tristes et abattus, ils n’en
distraient pas pour autant l’enfant qui « aime les tartines épaisses avec dessus du beurre salé et un
sucre ». Les tournures syntaxiques ainsi que le vocabulaire montrent qu’ils sont le fruit d’un esprit
enfantin : la métaphore amusante « on dirait des anguilles vivantes » à la ligne 16 sort tout droit d’un
univers plein d’imagination, de la même manière que le groupe nominal « la petite fille bleue » à la ligne
20 fusionne une silhouette et la couleur du vêtement porté. Les tournures présentatives « ça » à la ligne
27 relèvent du registre familier. On constate que l’enfant ne saisit pas les enjeux de ce moment crucial
CNED TERMINALE HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 3
dans la vie du village par les négations entourant les verbes de savoir ou de compréhension : « je ne sais
pas » à la ligne 41 et « je ne comprends pas ce qu’elle est en train de dire » à la ligne 52. C’est bien que
le point de vue imposé au lecteur est celui d’un enfant incapable d’appréhender toute l’angoisse générée
par la situation. Les divers éléments énoncés n’ont pas de relief particulier, la scène pourrait passer pour
irréelle, on ne retient d’abord qu’une série de perceptions auxquelles on ne donne pas directement de
sens. L’enfant est même « bien content que ce soit la guerre » (ligne 41).
En réalité, la guerre est présente à travers une violence indirecte exercée sur les villageois, certainement
aussi parce qu’ils gardent en eux le souvenir de la guerre de 1914. C’est ce que montre le discours
direct de la fin de l’extrait, des lignes 44 à 55, qui se termine sur « Et nous voilà bons encore une fois ».
Cela manifeste bien d’un traumatisme collectif, l’histoire se répète. L’ambiance de cet « après-midi de
septembre tiède et gris » est au pathétique, voire au tragique : une vieille femme « crie » (ligne 5), « un
homme pleure » (ligne 9), des femmes âgées se consolent l’une l’autre à la ligne 14, une femme prie à
la ligne 24. Un enfant reçoit un « coup de pied » et une « gifle » par sa mère juste après la mention du
goûter par le jeune narrateur, la violence se transmet et contamine, et l’adverbe « brutalement » exprime
toute la tension dans les mouvements de la mère. Certes, le discours direct de la ligne 40 mentionne
explicitement la guerre : « c’est la guerre, dit un vieux ». Mais c’est peut-être l’ambiance générale du texte
qui plonge le lecteur dans une véritable tension : « Il y a du bruit et du silence, mais le silence absorbe
le bruit. C’est comme aux enterrements ». Par cette comparaison simpliste, le lecteur comprend la
dimension tragique de l’annonce qui vient d’être faite, des morts sont prophétisées, redoutées. Et c’est le
silence qui recouvre tout : il est bien difficile de parler de la guerre, ce qui explique peut-être le choix de
l’auteur de faire d’un enfant le témoin privilégié de la scène, sa parole est libre et dénuée d’analyse.
Dans le texte, on peut donc avoir l’impression que la guerre est encore loin, qu’elle n’est qu’annoncée
sans être réellement vécue ; ainsi le village reste le terrain de jeu d’un enfant inconscient des enjeux d’un
conflit mondial. Pourtant, l’atmosphère est pesante, tragiquement alourdie par le spectre de la guerre
précédente : les plus âgés savent à quoi s’attendre, la violence, l’absence, la privation, la mort. La guerre
se fait sur les champs de bataille, mais aussi dans la vie des êtres humains en modelant leur vision du
monde pour toujours : c’est ce qu’a pu montrer Céline dans son roman Voyage au bout de la nuit, dans
lequel le héros est devenu bien pessimiste sur le genre humain.
Deuxième partie : Essai philosophique
Qu’est-ce qu’être en guerre ?
Dans C’est la guerre, en 1993, Louis Calaferte emprunte le regard d’un enfant de onze ans pour décrire
l’annonce de la mobilisation générale de 1939 afin de montrer qu’être en guerre est une disposition
d’esprit, parfois malgré soi, avant d’être un conflit politique et militaire. Qu’est-ce qu’être en guerre ?
Dans quelle mesure cette expression, relevant d’une posture ou d’un état, met en jeu différentes sphères
du monde des humains, que l’humain soit considéré comme maillon d’une communauté ou comme
individualité ? La question exige de considérer les différentes définitions possibles de la guerre, selon
le point de vue que l’on veut bien adopter, selon le contexte et selon l’expérience que l’on a du conflit et
de la violence. Dans un premier temps, on peut considérer l’état de guerre comme un état relevant des
structures militaires et politiques. Dans un deuxième temps, on ne peut que s’interroger sur des cas où
l’état de guerre existe sans qu’il y ait affrontement réglé sur un champ de bataille. Finalement, on peut
se demander si l’état de guerre n’est pas aussi une disposition individuelle et collective à la lutte quelle
qu’elle soit.
Pour définir l’état de guerre, on peut s’en remettre aux tentatives de certains penseurs d’en évoquer le
sens de manière objective. La guerre, si l’on en croit la définition de la guerre dite « régulière », oppose
deux États, et l’enjeu est de conquérir des territoires ou une forme de puissance sur son adversaire. Dans
son traité De la guerre, Clausewitz, soldat et officier prussien du début du XIX siècle, a théorisé la guerre
CNED TERMINALE HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 4
comme « continuation de la politique par d’autres moyens ». On comprend par là que la guerre survient
quand toutes les solutions diplomatiques ont été épuisées, et l’autorité politique fait appel à l’autorité
militaire pour satisfaire ses objectifs de conquête ou de puissance. Être en guerre, c’est donc, pour un
état, en appeler à la violence pour contraindre un état adversaire à satisfaire sa volonté de conquête ou
de puissance. Cicéron lui-même définissait l’état de guerre comme une tentative d’« affirmation par la
force ». On voit que, théoriquement, ce ne sont pas les gens qui se font la guerre, mais les états. Dans ce
sens, la formule de Rousseau dans son Contrat social est éclairante : l’état de guerre serait une « relation
entre les choses, et non entre les personnes ». C’est pourquoi entrer en guerre pour deux états, c’est
faire appel systématiquement au droit et non à la morale. Ainsi, l’exemple des deux guerres mondiales
illustre en quelque sorte cette vision de l’état de guerre : toute la nation est mobilisée derrière une
décision politique. Pourtant, le texte de Calaferte, qui narre l’annonce de la mobilisation en 1939, montre
bien que les individus se retrouvent en guerre au nom de leur pays, au nom d’une alliance, et pourtant ils
ne se retrouveront pas tous, hommes, femmes et enfants, sur le champ de bataille. Alors être en guerre,
n’est-ce vraiment que prendre les armes pour vaincre un adversaire lors d’un affrontement en règles ?
Le problème pour définir l’état de guerre est que, depuis la Seconde Guerre Mondiale, le conflit ne
s’incarne plus uniquement sur le champ de bataille. D’abord, les projets d’Hitler ont pu montrer la
possibilité d’une guerre absolue au-delà d’une guerre régulière, avec la volonté par exemple d’exterminer
les populations juives. Avec la guerre dite « froide », les militaires ne s’affrontent plus sur le terrain ; le
monde se divise plutôt en pôles d’influence où la dissuasion nucléaire semble occuper le rôle d’arbitre
absurde, comme l’analyse d’ailleurs Hannah Arendt. De même, peut-on encore parler de « guerre »
quand des populations civiles s’affrontent au sein d’un même pays ? On peut penser à la guerre civile
au Rwanda en 1994 ; on parle de « génocide rwandais » dans la mesure où une ethnie a cherché à en
éradiquer une autre. La définition de Clausewitz est alors mise à l’épreuve : ce ne sont plus des nations
qui s’opposent mais des groupes ethniques sur un même territoire. La question semble encore plus
complexe avec la naissance du terrorisme dans les années 1980 ; par exemple, Al-Qaïda, l’État islamique
ou Boko-Haram cherchent à déstabiliser ce qu’ils considèrent politiquement comme des ennemis,
et non plus seulement des adversaires. Au passage, les deux mots n’ont pas tout à fait la même
connotation. Les attentats du Bataclan à Paris en novembre 2015 ont suscité des réactions chez les
hommes politiques français pouvant faire croire à un état de guerre. Si c’est le cas, « être en guerre »
signifie alors se déclarer hostile à un projet, mener une lutte contre un groupe idéologique recherchant
la déstabilisation d’un état. Dans les nouvelles formes de conflit, les simples civils sont d’autant plus
touchés. Dans le cas du terrorisme, de simples passants, promeneurs, voyageurs dans un transport en
commun peuvent perdre la vie dans une fusillade ou l’explosion d’une bombe parce qu’ils deviennent
des « ennemis » symboliques. On peut se demander si, depuis le 11 septembre 2001, on ne se sent pas
en état de guerre perpétuel. Les frontières entre les concepts sont-elles si claires ? Le conflit en Syrie
montre bien qu’une même guerre peut revêtir des allures multiples et complexes et presque concentrer
toutes les définitions qui précèdent.
Plus largement, « entrer en guerre » est une expression déjà entendue lorsque l’individu, appartenant ou
non à une communauté établie, cherche à lutter contre une forme d’oppression ou d’attaque quelconque.
Lors de la pandémie du Covid 19, Emmanuel Macron s’est adressé aux français en mars 2020 sur le point
d’être confinés en leur affirmant : « Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible ». L’expression
prend alors un tour plus métaphorique, plus imagé, et invite l’individu à se percevoir comme le maillon
indispensable d’une lutte contre une menace forte. Dans le cas du Covid 19, une menace pèse clairement
sur le système de santé français à cause d’une épidémie imprévue, et les individus sont invités à se
comporter de manière citoyenne pour « sauver » la collectivité en suivant les consignes sanitaires. Ils se
placent métaphoriquement en « ordre de bataille » … Par ailleurs, le mouvement « Me too » peut être
assimilé à une guerre contre l’oppression masculine dans les milieux où les hommes occupent encore
majoritairement les postes-clés, exerçant un pouvoir abusif sur les femmes. Dans la première moitié du
vingtième siècle, Simone Weil méditait déjà sur la violence « naturelle » des rapports sociaux, fondés sur
un jeu de domination dont il est difficile d’inverser les tendances. En ce sens, on n’a pas totalement quitté
l’esprit du texte de Calaferte, qui traite indirectement des souffrances intimes des individus lors d’une
guerre : qu’elle soit explicitement interétatique, larvée ou relative au système social, la guerre entraîne
des violences terribles sur les personnes, qu’elles y aient un rôle actif ou passif.
CNED TERMINALE HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 5
Pour conclure, « être en guerre » est bien une expression recouvrant diverses réalités : soit c’est un état
qui entre en conflit avec un autre état selon des règles bien précises, soit ce sont des pôles d’influence
qui tendent à opposer leurs idéologies de manière plus complexe, soit c’est l’individu qui s’engage dans
une lutte personnelle ou collective. Dans tous les cas, une violence s’exprime, empruntant une voie
militaire, politique ou sociale. Il semble qu’il soit de plus en plus question de lutte pour des valeurs ou
contre des systèmes fondés sur le crime, et alors la guerre peut prendre une dimension sociétale comme
dans le cas de la guerre contre les gangs, contre les narco-trafiquants ou contre la radicalisation. On
pourrait se demander si l’état, comme l’écrivait Hobbes au XVIIe siècle, joue encore son rôle à l’encontre
de la violence des hommes : est-il encore capable aujourd’hui de la rationnaliser ?
CNED TERMINALE HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 6
Vous aimerez peut-être aussi
- QCM en GestionDocument14 pagesQCM en Gestionsamira86% (7)
- Cours de Droit Fiscal General-1Document48 pagesCours de Droit Fiscal General-1BALLA KEITA100% (1)
- Synthèse Du Cours de Sociologie - IHECS Bac 1Document19 pagesSynthèse Du Cours de Sociologie - IHECS Bac 1Marine Piret100% (1)
- Alouette AnouilhDocument6 pagesAlouette Anouilhapi-308609915Pas encore d'évaluation
- 7AN08TE0223 Devoir2 1Document6 pages7AN08TE0223 Devoir2 1viator P.N0% (1)
- Littérature FLE Tout Niveau 2018 FusionnéDocument16 pagesLittérature FLE Tout Niveau 2018 FusionnéchandrikaomgPas encore d'évaluation
- Un Jeu Au Bord de La Mort Dans Voyage Au Bout de La NuitDocument30 pagesUn Jeu Au Bord de La Mort Dans Voyage Au Bout de La NuitVandeweerd alexisPas encore d'évaluation
- DM HLPDocument5 pagesDM HLPlou PagesPas encore d'évaluation
- Le Dernier Jour d'un condamné: Plaidoyer politique pour l'abolition de la peine de mortD'EverandLe Dernier Jour d'un condamné: Plaidoyer politique pour l'abolition de la peine de mortPas encore d'évaluation
- Benoît DuteurtreDocument13 pagesBenoît DuteurtreAgnes MonadePas encore d'évaluation
- Ne m'attends pas, mange pendant que c'est chaud: Recueil de nouvellesD'EverandNe m'attends pas, mange pendant que c'est chaud: Recueil de nouvellesPas encore d'évaluation
- Bibliographie Littérature ContemporaineDocument5 pagesBibliographie Littérature Contemporaineqmvk6bhp28Pas encore d'évaluation
- Malraux Devant L A Mort: Pierre BockelDocument7 pagesMalraux Devant L A Mort: Pierre BockelRenoir MarianePas encore d'évaluation
- Faits divers en Bretagne - Volume 4: Chroniques radiophoniques de France Bleu Breizh IzelD'EverandFaits divers en Bretagne - Volume 4: Chroniques radiophoniques de France Bleu Breizh IzelPas encore d'évaluation
- Atelier Lectures N° 73 Le Chagrin Lionel DUROYDocument2 pagesAtelier Lectures N° 73 Le Chagrin Lionel DUROYHind BannaniPas encore d'évaluation
- Comentario 2Document3 pagesComentario 2Anna Garcia FalasPas encore d'évaluation
- Le Bleu D'aprks Les Structures Anthropologiques de L'imaginaireDocument12 pagesLe Bleu D'aprks Les Structures Anthropologiques de L'imaginairemeryemPas encore d'évaluation
- AudioDocument2 pagesAudioboulayecamara95200Pas encore d'évaluation
- Anthologie de La Répartie 2019 FRDocument313 pagesAnthologie de La Répartie 2019 FRfanch333Pas encore d'évaluation
- Patrick ModianoDocument28 pagesPatrick Modianoمنه سالمPas encore d'évaluation
- Supplément Le Monde Des Livres 2013.04.19Document10 pagesSupplément Le Monde Des Livres 2013.04.19Oblomov 2.0Pas encore d'évaluation
- Litt Magh Expr FrancDocument20 pagesLitt Magh Expr FranckantikorsPas encore d'évaluation
- 5-Extrait - Incendies Parcours Crise Fam Et PersoDocument2 pages5-Extrait - Incendies Parcours Crise Fam Et PersooumsouleimPas encore d'évaluation
- Lepopee Vernon SubutexDocument14 pagesLepopee Vernon SubutexKok KokPas encore d'évaluation
- Cetait Impossible Et Pourtant - Pierre BellemaDocument349 pagesCetait Impossible Et Pourtant - Pierre Bellemasawssen24fPas encore d'évaluation
- L'homme Aux Sandales de Caoutchouc ReviewDocument4 pagesL'homme Aux Sandales de Caoutchouc ReviewDyhia BiaPas encore d'évaluation
- Entretiens avec le Professeur Y: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandEntretiens avec le Professeur Y: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Victor HUGO - Le Dernier Jour D'un CondamnéDocument98 pagesVictor HUGO - Le Dernier Jour D'un CondamnéJm ThugPas encore d'évaluation
- Dissertation Sur Juste La Fin Du MondeDocument3 pagesDissertation Sur Juste La Fin Du MondehiptoplopPas encore d'évaluation
- Prologue 2Document5 pagesPrologue 2aairouche11Pas encore d'évaluation
- Au cœur de la révolte: Une saga d'intrigue historiqueD'EverandAu cœur de la révolte: Une saga d'intrigue historiquePas encore d'évaluation
- Carnets: Albert CamusDocument32 pagesCarnets: Albert CamusLaura PedrozoPas encore d'évaluation
- Analyse Styl TextesDocument11 pagesAnalyse Styl TextesЕвгения КравченкоPas encore d'évaluation
- Maurice Attia - Alger La Noire Texte Imprimé Roman-Actes Sud Leméac, Attia Maurice (Imr. 2006)Document287 pagesMaurice Attia - Alger La Noire Texte Imprimé Roman-Actes Sud Leméac, Attia Maurice (Imr. 2006)Aaron PinedaPas encore d'évaluation
- 9782377317318Document35 pages9782377317318Salma TitiPas encore d'évaluation
- Ça valse à Pentrez: Les enquêtes du commissaire Landowski - Tome 36D'EverandÇa valse à Pentrez: Les enquêtes du commissaire Landowski - Tome 36Pas encore d'évaluation
- Explication de Texte ChateaubriandDocument4 pagesExplication de Texte Chateaubriandapi-406501758Pas encore d'évaluation
- 10 - Histoire de Ta Famille. Une ConclusionDocument8 pages10 - Histoire de Ta Famille. Une ConclusionNicolas Juan BoulainePas encore d'évaluation
- Le Rouge et le Noir, La scène du bal, de Stendhal: Commentaire de texteD'EverandLe Rouge et le Noir, La scène du bal, de Stendhal: Commentaire de texteÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Une Enfant de Poto Poto Lopes HenriDocument194 pagesUne Enfant de Poto Poto Lopes HenriMoon ONDONGOPas encore d'évaluation
- EXTRAIT A Louest Rien de NouveauDocument13 pagesEXTRAIT A Louest Rien de Nouveauismailelatbani66Pas encore d'évaluation
- L'assommoirDocument3 pagesL'assommoirDiane CastelPas encore d'évaluation
- Zero ConduiteDocument4 pagesZero ConduitemostabouPas encore d'évaluation
- Cesaire Cahier Dun Retour Au Pays Natal HNDP Nougaro 2021Document59 pagesCesaire Cahier Dun Retour Au Pays Natal HNDP Nougaro 2021eliazfrinPas encore d'évaluation
- Jean le Bleu de Jean Giono: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"D'EverandJean le Bleu de Jean Giono: "Les Fiches de Lecture d'Universalis"Pas encore d'évaluation
- Dissertation - Modernité PoétiqueDocument5 pagesDissertation - Modernité Poétiqueviator P.NPas encore d'évaluation
- 7ES01TEWB0822 Partie2Document12 pages7ES01TEWB0822 Partie2viator P.NPas encore d'évaluation
- FR Analyse PostambuleDocument3 pagesFR Analyse Postambuleviator P.NPas encore d'évaluation
- Methodologie Bac AmcDocument1 pageMethodologie Bac Amcviator P.NPas encore d'évaluation
- Maurice Kamto PourquoiDocument4 pagesMaurice Kamto PourquoicameroonwebnewsPas encore d'évaluation
- DIALOGUE SUR L'éveil (Intégralité)Document37 pagesDIALOGUE SUR L'éveil (Intégralité)BORIS60% (5)
- Carl Schmitt: Aux Confins de La Politique Ou L'âge de La NeutralitéDocument16 pagesCarl Schmitt: Aux Confins de La Politique Ou L'âge de La NeutralitéPhil TaylorPas encore d'évaluation
- Sciences PolitiquesDocument36 pagesSciences PolitiquesMOH N’da MariePas encore d'évaluation
- L Economie de La ConfianceDocument194 pagesL Economie de La ConfiancePatrick TchiraPas encore d'évaluation
- Chapitre I: La Politique Fiscale: Introduction GénéraleDocument24 pagesChapitre I: La Politique Fiscale: Introduction GénéraleBader-Eddine MoumouPas encore d'évaluation
- LA VIABILITE DES RADIOS DE PROXIMITE - MODULE 4 - Une Guide de Formation (Radio For Peacebuilding Africa, SFCG - 2010)Document17 pagesLA VIABILITE DES RADIOS DE PROXIMITE - MODULE 4 - Une Guide de Formation (Radio For Peacebuilding Africa, SFCG - 2010)HayZara MadagascarPas encore d'évaluation
- Roland 4720-15-00 2017 PDFDocument129 pagesRoland 4720-15-00 2017 PDFalicegomezmessagePas encore d'évaluation
- Cours Finances Publiques J. BousquetDocument35 pagesCours Finances Publiques J. BousquetNada NounettePas encore d'évaluation
- ALTHUSSER:Sur Le Contract SocialDocument38 pagesALTHUSSER:Sur Le Contract SocialPaola MolinattoPas encore d'évaluation
- 04 Dos 8 ToureDocument21 pages04 Dos 8 ToureprosperazanmanPas encore d'évaluation
- TD Finances PubliquesDocument37 pagesTD Finances PubliquesBALLA KEITAPas encore d'évaluation
- Fiche Philo La Liberte - Le CoursDocument4 pagesFiche Philo La Liberte - Le Coursalain kouassiPas encore d'évaluation
- De L'éducation D'un Homme Sauvageou Des Premiers Développemens Physiques Et Moraux Du Jeunesauvage de L'aveyron by Itard, JeanDocument33 pagesDe L'éducation D'un Homme Sauvageou Des Premiers Développemens Physiques Et Moraux Du Jeunesauvage de L'aveyron by Itard, JeanGutenberg.orgPas encore d'évaluation
- Esprit 5 - 7 - 193302 - Aron, Raymond - Lettre Ouverte D'un Jeune Français À L'allemagneDocument9 pagesEsprit 5 - 7 - 193302 - Aron, Raymond - Lettre Ouverte D'un Jeune Français À L'allemagneLePetitOlivierPas encore d'évaluation
- Dissertation Cohésion NationaleDocument5 pagesDissertation Cohésion NationalemariePas encore d'évaluation
- Démocratie en Santé: Les Illusions PerduesDocument28 pagesDémocratie en Santé: Les Illusions PerduesLe LanceurPas encore d'évaluation
- L'Esprit Familial Dans La Maison (... ) Delassus Henri Bpt6k5482237hDocument250 pagesL'Esprit Familial Dans La Maison (... ) Delassus Henri Bpt6k5482237hBruno ThérèsePas encore d'évaluation
- Boyance Com Dignitate Otium PDFDocument21 pagesBoyance Com Dignitate Otium PDFElviraDinuPas encore d'évaluation
- Le PSDH Et L'aménagement Du Territoire Du Grand-Sud D'haïtiDocument8 pagesLe PSDH Et L'aménagement Du Territoire Du Grand-Sud D'haïtiJean Francois TardieuPas encore d'évaluation
- Cours Finances Publiques 1er Semestre1Document49 pagesCours Finances Publiques 1er Semestre1Othmane SahbeddinePas encore d'évaluation
- L'Imputabilité Dans Le Droit de La Responsabilité InternationaleDocument452 pagesL'Imputabilité Dans Le Droit de La Responsabilité InternationaleHicham AoumouPas encore d'évaluation
- Cours Des Theories de L'economie Publique 01 Bis PDFDocument81 pagesCours Des Theories de L'economie Publique 01 Bis PDFdeborahmukeba07Pas encore d'évaluation