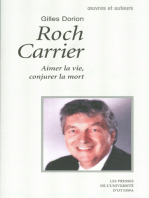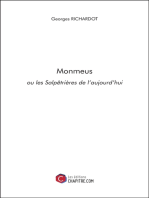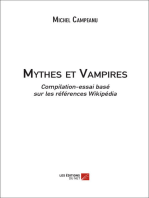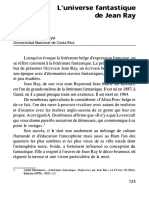Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Visage de La Scene Lautre Monde Dharo
Transféré par
lreisTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Visage de La Scene Lautre Monde Dharo
Transféré par
lreisDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le visage de la scène :
L’autre monde d’Harold Pinter et Emmanuel
Lévinas
de
Liza Kharoubi
Mars 2009
This text belongs to the theses series of sans papier, a collection of electronic pre-prints in
French and Francophone Studies at Cornell University.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009
© 2009 by Liza Kharoubi
Le visage de la scène :
L’autre monde d’Harold Pinter et Emmanuel Lévinas
de
Liza Kharoubi
Résumé
Dans le théâtre d’Harold Pinter, l’excentricité de l’espace littéraire – tout à la fois Alaska,
désert du Sahara, Méditerranée, île au Trésor ou tropicale, terrain de cricket, terrier, palaces
fantômes voire camps de concentration – contredit sans cesse le naturalisme de la scène. Les
paysages en filigranes que dessine le discours exilent le spectateur dans un « profond jadis »
innommable auquel il doit faire face. L’odyssée des spectres commence dès l’ouverture du
rideau et fait totalement disparaître le réalisme du décor ; la demeure qu’habitent tant bien que
mal les personnages échoue sur un rivage spectral et sauvage. Otage de cette hantise du
discours, le public assiste impuissant à la défiguration de l’humain. La violence d’un tel
théâtre se situe précisément dans cette oblitération esthétique du visage qui, pour Lévinas, est
l’expression même de l’injustice, et que nous nommons « poéthique ».
Sur l’auteur
Agrégée d’Études Anglophones en 2002, Liza Kharoubi a soutenu sa thèse de doctorat début
décembre 2007 à l’Université Paris-IV Sorbonne. Elle y a enseigné en tant qu’Attachée
Temporaire d’Enseignement et de Recherche pendant trois années à des étudiants de Licence
(Théâtre contemporain britannique et Philosophie). Elle a par la suite obtenu une bourse de
recherche BESSE à l’Université d’Oxford (Exeter College). Elle poursuit actuellement des
recherches postdoctorales à l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande.
Contact
Email : lizakharoubi@hotmail.com
Source
Thèse de Doctorat en Études Anglophones soutenue à l’Université Paris IV-Sorbonne le 7
décembre 2007.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009
Université Paris IV-Sorbonne
École Doctorale IV : Cultures, Littératures et Sociétés
THÈSE
pour obtenir le grade de
DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS IV
Discipline : Études Anglophones
présentée et soutenue publiquement par
Liza KHAROUBI
le 07 décembre 2007
Titre : Le visage de la scène
L’Autre monde d’Harold Pinter et Emmanuel Lévinas
Directrice de thèse : Mme Elisabeth Angel-Perez, Professeur à l’Université Paris-IV.
Jury : Mmes et MM. les professeurs Nicole Boireau, Ann Lecercle, Colin Davis, Ronald
Shusterman.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 1
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 2
Remerciements :
Je souhaiterais exprimer ma profonde gratitude à ma directrice de thèse, Elisabeth
Angel-Perez pour tout le soutien professionnel et personnel dont elle m’a témoigné
durant ces quatre années, pour ses encouragements et ses suggestions de lecture qui
ont considérablement enrichi ma recherche. Je souhaiterais la remercier également
pour mes trois années en tant qu’ATER à la Sorbonne et cette année passée à Oxford
grâce à son appui permanent. Mes plus sincères remerciements vont aussi à Jane
Hiddleston, Alexis Tadié, Jean-Luc Marion, Anne Sendra, Caroline Monge, Victoria
White, Cédric Mattei, Anossis Oliveira et bien sûr à ma famille, toujours présente.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 3
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 4
A ma famille,
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 5
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 6
Table
Introduction 9
Première partie : La demeure inhabitable 29
1. La scène, « espace nocturne » 39
1.1. Le terrier 44
1.1.1. Espace-minotaure 45
1.1.2. Inferno : l’Empire des Nains 51
1.2. Moonlight zone 67
1.2.1. Contre-jour : le bal des vampires 72
1.2.2. Spectralité et scepticisme : « Hantologie » ? 93
2. L’exil du décor 115
2.1. Exotisme : la scène comme une île 128
2.1.1 L’île au trésor : impostures et spoliation 132
2.1.2. Abstraction ou l’île déserte 152
2.2. Les maisons brûlées : profanations 171
2.2.1. Généalogie de la violence 179
2.2.2. Cendres 208
Deuxième partie : Le temps de l’Autre ou l’Ethique du spectacle 243
3. Scène et sens 247
3.1. La langue de l’oubli 254
3.1.1 Le grand théâtre de l’Oubli : A Kind of Alaska. 260
3.1.2. Les masques de la mémoire 282
3.2. La Passion du spectacle 318
3.2.1. Après la fin du monde : Célébration 335
3.2.2. Le dernier cri : langage et sorcellerie 359
4. Pour une poéthique : les enjeux de l’expression 383
4.1. Le visage du texte philosophique 387
4.1.1. Le discours comme désir 388
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 7
4.1.2. L’œil et la bouche : changements d’expression 395
4.2. Le concept d’ « exil » : l’écriture métèque 407
4.2.1. L’utopie de la demeure 409
4.2.2. Hybris de la parole : langage et tragédie 414
4.3. Philosophie du temps perdu : 425
4.3.1 La douleur du dialogue : le temps comme patience 426
4.3.2. Oblitération, défiguration : l’anarchie du visage 436
Conclusion 449
Bibliographie 457
Index 467
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 8
Introduction
Il m’a volé l’oreille gauche. Je lui ai arraché l’œil droit. Il m’a
escamoté quatorze dents. Je lui ai cousu les lèvres. Il m’a rôti
le derrière à point. Je lui ai retroussé le cœur. Il a mangé mon
foie. J’ai bu son sang. – Guerre.
Elias Canetti, Le territoire de l’homme 1.
La scène du théâtre d’Harold Pinter présente souvent l’intérieur meublé d’une maison au
premier abord tout à fait ordinaire - lits, tables, et chaises organisent un espace presque
étonnant de réalisme, tandis que les portes et les fenêtres suggèrent qu’il existe également un
monde extérieur. Tout indique le confort et chasse l’inquiétude claustrophobe d’un public
assis dans le noir. Pourtant, cette transparence du décor, sans fioriture esthétique ni anomalie
architecturale, donne une impression de vide. Il ne s’agit pas vraiment de minimalisme
délibéré, mais d’une froideur ambiante qui circule entre les meubles et accuse les distances
entre les quatre coins de la scène. Personne n’aimerait vivre dans une telle maison : ni celle de
The Room, ni celle de Landscape, ni celle d’Edward dans A Slight Ache ou celle d’Old Times
dont les pièces sont bizarrement symétriques. Malgré leur référence au réel, ces maisons
semblent s’éloigner et appartenir à d’autres espaces et d’autres temps que ceux du public. Plus
on les regarde de près, plus elles nous regardent de loin. Considéré dans son ensemble
d’ailleurs, le théâtre de Pinter ne dément pas ce malaise du décor puisque ces maisons, ou ces
« pièces », se répètent en série, comme dans une œuvre pop art, et leur reproduction les
déréalise au point de susciter une véritable hantise de la maison. Dans ce vide spectral qui
possède l’espace, les seuls objets qui paraissent avoir résisté au néant ont en général quatre
pieds : les tables, les chaises et les lits perdurent tandis que les personnages, qui n’en ont que
deux, sont parfois contraints de s’asseoir voire de disparaître. Le décor revient de loin - après
Beckett et la bombe atomique - et cependant on ne peut l’atteindre, se l’approprier, s’y
1
Canetti, Le Territoire de l’Homme : Réflexions 1942-1972. Paris : Albin Michel, 1978. p27.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 9
« voir ». Le décor pintérien ne permet aucune identification, aucun reflet, il accuse au
contraire son altérité et son altération. Comment regarder ce décor qui se dérobe à toute prise
et se refuse à être identifié ou reconnu ? Sans compter que l’ambiguïté du discours aggrave la
situation : on ne sait plus si les objets qu’on croyait avoir reconnus, table, chaises, lits,
fenêtres, murs, sont bien ce qu’ils sont. Les fenêtres donnent sur un dehors nocturne ou bien
une vision menaçante, les lits transformables mettent parfois le personnage dans une situation
inconfortable voire dangereuse, tandis que les chaises peuvent être musicales et que sur les
tables, on mange parfois son prochain. Concrètement, pour le spectateur, rien de tout cela ne
se passe - « nothing happens » ressassent les personnages : le glacis réaliste fait l’effet
hypnotique d’un loup sur le visage d’une femme ou d’une pomme verte, façon Magritte. Les
expressions volatiles du décor, qui s’évaporent comme la mémoire, ressemblent à celles d’un
mystérieux visage de sorcière. Seul un changement radical de perspective permet de
l’apercevoir, comme le fameux Visage de Mae West de Salvador Dalì : de près, on se trouve
dans un salon cossu, des cadres ornent le mur rouge-séduction au dessus de la cheminée, et un
sofa pulpeux nous accueille sur ses coussins moelleux. De loin, à travers une lunette
indiscrète et surélevée, le décor miniaturisé du salon rassemble les traits d’un visage célèbre
qui saute aux yeux : les cadres deviennent des yeux langoureux, la cheminée un « nez », et le
sofa rouge trahissait déjà l’ardeur des lèvres.
Dans la lunette obscène, le visage monstrueux du décor apparaît comme par magie ; le salon
confortable n’était qu’un leurre pour la perception, naïve et misérable, qui a toujours besoin
de verres correcteurs. Comme l’œuvre de Dalì, la scène de théâtre obéit à ce mécanisme
swiftien qui consiste à changer de perspective pour être enfin capable de « voir » toutes les
choses fantastiques que l’œil rate : lilliputiens, géants de Brobdingnag, l’île volante des
érudits de Laputa, et enfin les sages Houynhnhms. Physiquement, le décor de Pinter n’a rien
d’un visage, d’abord parce que le visage dont on parle ne se donne pas directement dans la
perception. La seule lunette qui permet de le comprendre, c’est le langage philosophique ou
théâtral : les didascalies et le discours des personnages. Une fois qu’on a chaussé ces verres
dépolis que sont les mots, on peut contempler un visage, terrible et grimaçant comme celui
que décrit Elias Canetti – les lèvres cousues et les yeux tuméfiés, presque aveugles. On enlève
vite nos lunettes. Il en va ainsi de la violence sur la scène de Pinter ; comparé à d’autres
théâtres, plus explicitement engagés dans un combat socio-politique ou plus délibérément « In
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 10
yer face » (mais là il s’agit du visage du public), le théâtre de Pinter a paru conformiste voire
« traditionnel ». Le jugement de valeur qui s’attache à ces termes, malgré leur part de vérité,
classe souvent sans suite et à tort, un théâtre hautement subversif. L’aspect conservateur de la
scène concerne l’esthétique, comme on parle d’un « conservateur » de musée par exemple –
en ce sens, le théâtre de Pinter est un théâtre d’ « après la fin du monde » qui collectionne
désespérément un espace en voie de disparition : une scène, un rideau, des meubles, une porte,
une fenêtre. L’espace que le théâtre contemporain remet en question, parce qu’il le doit, est
clairement celui de la demeure. L’obsession des intérieurs domestiques que l’on décèle au
contraire dans le théâtre de Pinter, interroge la demeure en lui donnant un visage, c’est-à-dire
en lui donnant la parole. Comme le fait remarquer Jean-Jacques Lecercle en étudiant le
rapport entre éthique et littérature : « Le mot grec ēthos, signifie la demeure, d’où la coutume,
d’où les mœurs, d’où le caractère, d’où la vie morale »1. La demeure et ses objets ordinaires
murmurent des paroles souffrantes derrière ses lèvres cousues, parfois même le discours,
comme celui de Bridget dans Moonlight, évoque le souvenir insupportable de maisons
brûlées. La souffrance va donc plus loin que celle des personnages puisqu’elle concerne un
concept – celui de « demeure » qu’Emmanuel Lévinas développe en tant que tel dans Totalité
et Infini 2 - qui rassemble tous les hommes dans un seul visage. Ce qui est en question, c’est le
sens même du séjour de l’homme, ou ce qu’il en reste, sur Terre. La démarche n’est donc pas
photographique ou documentaire, car les images de violence endorment les sens dans un
dernier réflexe de protection plus qu’ils ne les éveillent. La violence de la scène de Pinter
frappe après coup, comme l’écho détonnant d’un appel au secours qu’Elias Canetti résume
ainsi : « Il n’existe aucune action, aucune pensée, à part celle-ci : quand cessera-t-on
d’assassiner ? »3. Le visage de la scène parle au fond du silence, depuis les coulisses et les
recoins obscurs du décor à peine éclairé. Le visage que décrit Elias Canetti ressemble
d’ailleurs à celui de Gloucester dans King Lear, éborgné et injustement torturé, et que Lévinas
érige en paradigme éthique ; la phrase de Lear « I should even die with pity to see another
thus »4 sert de modèle à l’éthique lévinassienne qui envisage le sujet à partir de l’autre.
Lévinas érige cette citation en véritable slogan, elle apparaît notamment en épigraphe à
l’avant-propos de L’Humanisme de l’Autre Homme 5. Il s’agira donc, dans cette recherche, de
tenter une approche lévinassienne du visage de la scène dans le théâtre de Pinter et de
1
Jean-Jacques Lecercle & Ronald Shusterman, L’Emprise des signes : Débat sur l’expérience littéraire. Paris :
Seuil, 2002. p235.
2
Lévinas, Totalité et Infini. pp162-190.
3
Canetti, Le Territoire de l’Homme. p25.
4
Shakespeare, King Lear. IV : 7, 53-54. p917.
5
Lévinas, L’Humanisme de l’Autre Homme. p7.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 11
comprendre le sens éthique du drame qui part du public. En réalité, l’expression « visage de la
scène » constitue un paradoxe profane parce que la scène de théâtre est, selon Lévinas, le
domaine des apparences et de la magie, c’est-à-dire le domaine de l’Etre, de la façade, et non
de l’Autre ou visage. Arguer que le théâtre est le lieu d’un « face-à-face », relève de l’hérésie
– mais on peut peut-être appliquer au texte lévinassien ce que celui-ci applique au texte
biblique : « La profanation n’est pas la négation du mystère, mais l’une des relations possibles
avec lui »1. La référence même à Lévinas empêche de traiter l’écriture comme un dogme ou
une doxa. La présente étude ne prétend pas construire une nouvelle herméneutique doctrinaire
ou systématique mais explorer le relief du texte de théâtre à travers une lunette extérieure qui
permettrait des changements intéressants de perspective. L’image de la lunette grossissante de
Swift apparaît d’ailleurs explicitement dans le texte de Pinter, en particulier dans A Slight
Ache et Celebration, et constitue un élément essentiel de l’interprétation :
WAITER : When I was a boy my grandfather used to take me to the edge of the cliffs and
we’d look out to sea. He bought me a telescope. I don’t think they have telescopes any more. I
used to look through this telescope and sometimes I see a boat. The boat would grow bigger
through the telescopic lens. Sometimes I’d see people on the boat. A man, sometimes, and a
woman, or sometimes two men. The sea glistened.2
Il semblerait que Pinter lui-même voie ses personnages de loin quand il les crée - parfois un
homme et une femme, parfois deux hommes embarqués dans un drame. La lunette montre sa
propre écriture comme une Odyssée, comme un voyage en mer, et rappelle à distance la
recherche épique du sens chez Joyce et Proust. Lévinas, quant à lui, parle de l’ « Epos » de
l’écriture et de la métaphysique comme d’une odyssée3. L’éthique lévinassienne s’oppose en
effet à une vision « pédagogique » de la morale, voire à la morale tout court, qu’il dit
« naïve » - distinction capitale sur laquelle on reviendra. L’éthique devient l’épreuve
douloureuse du face-à-face avec autrui qui nous ordonne. La dimension épique redonne à ces
épreuves un sens insoutenable et « extraordinaire ». Ce que le serveur du restaurant dans
Celebration voit, ce sont avant tout des hommes et rien d’autre, hormis la surface de l’eau
chamarrée de lumière. L’objet du théâtre et de l’éthique est le même : non seulement on voit
des hommes mais on les approche. L’espace théâtral met le public et les personnages dans une
situation de proximité physique qui le distingue des autres œuvres littéraires. La lunette
grossit démesurément l’observation de l’homme au point qu’elle en devienne parfois une
1
Lévinas, Le Temps et l’Autre. p79.
2
Pinter, Celebration. p72.
3
Lévinas, Totalité et Infini. p75.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 12
espèce autre, étrangère – des ogres ou des nains1. Aussi paradoxale que l’expression « visage
de la scène » puisse paraître en rapport avec la philosophie de Lévinas, il semble qu’elle
désigne une rencontre qui a bel et bien lieu avec le public. Considérée séparément, nous
sommes cependant d’accord avec Lévinas pour dire que la scène est le lieu de la dévastation
anonyme où s’opposent des forces sorcières, autrement dit que la scène est la « guerre » et le
« mal ». Qu’il s’agisse d’une comédie n’y change d’ailleurs pas grand-chose ; pour Lévinas,
comme pour Pinter, le comique est aussi tragique. Dans « Writing for Myself », un discours
issu d’une conversation avec le critique de théâtre Richard Findlater, Pinter déclare : « The
old categories of comedy and tragedy and farce are irrelevant »2. Dans ses Écrits sur le
théâtre, Luigi Pirandello donne un point de vue plus précis sur cette question, qui est l’affaire
du public, son « état d’âme », et concerne tout le théâtre :
Cet état d’âme chaque fois que je me retrouve en face d’une représentation vraiment
humoristique, est la perplexité : je me sens comme tiraillé entre deux pôles ; j’aimerais bien
rire et je ris, mais mon rire est troublé, empêché par quelque chose qui se dégage de la
représentation elle-même.3
En ce sens, les pièces de Pinter sont vraiment « humoristiques » - mais cela ne prévient ni la
violence, ni la guerre ; l’humour, le rire sous cape, révèle justement la dague ou les
« canines », pour le dire avec Albert Cohen4, et l’urgence du « face-à-face ». L’humour
souligne souvent la tension explosive de la scène et l’imminence de la « guerre ». De façon
intéressante en ce qui nous concerne, Pirandello poursuit en attaquant toute vision « éthique »
de la représentation qui réduirait ce tiraillement à un malaise moral ou à un problème de
« valeurs », comme le fait son interlocuteur présumé Théodore Lipps dans son livre Le
Comique et l’humour. Le sentiment du contraire perturbe le discours comique amené à un
point de non retour par ce « je-ne-sais-quoi » de sérieux ; l’approche « morale » ou
« moralisante » de Lipps tend à effacer l’irruption du sérieux et sa cause, et à considérer
seulement l’effet psychologique ou quantitatif de ce qu’il appelle symptomatiquement, cette
« division » de l’âme. Pirandello interroge le moment où le comique s’éteint pour laisser place
à son contraire, le tragique :
1
Cf. The Dwarfs en ce qui concerne les nains - et pour les ogres, voir l’analyse de The Homecoming,
« Généalogie de la violence ».
2
Cf. Harold Pinter : Plays 2. Londres : Faber & Faber, pxi.
3
Pirandello, Ecrits sur le théâtre et la littérature. Paris : Denoël, 1968. p123.
4
Cf. Albert Cohen, Ô vous, frères humains. Paris : Gallimard, 1972. pp10-11.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 13
C’est-à-dire, entendons nous bien, que ce sentiment du contraire, Lipps n’en a vraiment jamais
l’idée. […] J’en cherche la raison. Pour la trouver, je n’éprouve aucunement le besoin de
réduire ce produit de l’imagination à un rapport éthique, de mettre en jeu la valeur éthique de
la personnalité humaine, et ainsi de suite. Ce sentiment de contraire, je le trouve, quel qu’il
soit, se dégageant de mille manières de la représentation elle-même, de toutes celles sans
exception que j’appelle humoristiques.1
L’humour qui suscite ce sentiment contradictoire, ne participe d’aucune mécanique
cathartique selon Pirandello ni d’aucun système de valeurs : l’humour est vivant, égoïste et
carnassier. Il a en vue le « bien être » qui éloigne la menace, la liberté. Mais, il dévoile par là
même et de mille façons, la menace du conflit. L’humour met en exergue la dimension de
« jeu » de l’agōn théâtral, ses masques et ses pièges ; selon Jean-Jacques Lecercle, le théâtre
d’Harold Pinter qui multiplie les jeux de guerres – Cowboys et Indiens, cricket, squash, ping-
pong - serait le parangon de la littérature agonistique :
Agōn, qui veut dire « combat », mais aussi « jeu » et « représentation théâtrale », dénote une
conception de l’interlocution fondée sur la lutte des participants, qui cherchent à imposer à
autrui leur image d’eux-mêmes, à lui imposer une place, voire à lui faire abandonner le champ
de bataille linguistique. La moindre pièce d’Harold Pinter donnera une idée de ce que peut être
l’agōn littéraire.2
La scène de Pinter s’occupe donc bien de ce que Lévinas appelle de façon récurrente, la
« guerre au sujet ». Il s’agit en effet d’exhiber l’égoïsme des personnages jusqu’à les anéantir,
comme Edward dans A Slight Ache ou Andy dans Moonlight. La « guerre » prend mille et une
formes sur cette scène qui finit par détruire sa propre création, à l’intérieur mais aussi en
dehors de l’interlocution entre les personnages. Le hors-scène désertique et nocturne, voire
tentateur, que l’on aperçoit par la fenêtre ou dans l’entrebâillement d’une porte, menace sans
cesse l’espace et ses personnages d’extinction. La scène paraît ainsi isolée en gros plan,
essentiellement séparée du dehors et du public. Le rôle de l’humour consiste également à
mesurer la distance qui nous sépare des personnages que le théâtre - comme la lunette - tente
d’approcher. En s’adressant au public, l’humour donne des repères pour évaluer la distance ou
le temps qui nous éloigne des personnages. L’hypothèse qu’on essaiera de démontrer dans
cette recherche consiste à défendre l’idée que la réalité figurée par la scène est éloignée non
dans l’espace, mais dans le temps ; la guerre qu’elle représente nous atteint toujours trop tard,
comme la brillance d’une étoile. La distance astronomique qui sépare le moi du public et
1
Pirandello, pp123-4.
2
Jean-Jacques Lecercle & Ronald Shusterman, p45.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 14
l’autre de la scène n’empêche pas cependant le regard que le théâtre symbolise, de
s’approcher des étoiles. Il nous a semblé que cette séparation ou ce « hiatus »
communicationnel pour reprendre le terme qu’utilise Ronald Shusterman1 et que l’on retrouve
de façon moins matérielle sans doute dans tout texte de littérature, est ce qui justement fait du
théâtre une rencontre. La « plaie béante »2 qui selon Pinter définit le théâtre de Shakespeare
ne serait pas autre chose – on pense à Lear en particulier qui met en scène le drame
communicationnel lui-même et la souffrance qu’il engendre. La perte de signification qui
caractérise le rapport entre le moi et le toi dans le langage, est une perte de « temps » ou
« patience ». Elle ne peut se quantifier, il ne s’agit pas d’entropie, elle est pure qualité, valeur,
ou encore sens. Ce trou noir qui sépare les égoïsmes montre que le langage ne se réduit pas à
un système de signaux, sans quoi non seulement la communication resterait un simple troc
mais encore on ne pourrait comprendre un auteur du passé ni traduire un auteur étranger. La
communication enferme le langage dans le besoin et sa satisfaction. C’est dans ce sens que
l’on comprend ce qu’écrit Ronald Shusterman à propos du « hiatus » entre auteur et
lecteur qui témoigne d’une « extension », ou d’une « expansion » du langage plutôt qu’il ne
constitue un obstacle linguistique :
Comprendre un auteur, cela ne veut pas dire partager la totalité de son intentionnalité et de ses
expériences vécues. Les déçus du langage désirent une union impossible, un échange qui serait
une identité. Ils accusent le langage de ne pas être de la télépathie. Il faudrait plutôt s’en
réjouir.3
Une telle vision de la scène, à des années-lumière de son public, proscrit toute approche
didactique qui ferait intervenir le public dans le jeu de la scène, et toute approche cathartique
basée sur l’identification avec les personnages. Elle ne permet pas non plus de considérer
l’éthique seulement comme un système de valeurs communes entre la scène et le public qui
appartiendraient au même monde, mais comme un face-à-face indiscret à travers une lunette,
presque un « viol ». Le Visage de Mae West de Dalì ressemble alors de plus en plus au tableau
de Magritte, Viol (1934) qui remplace les traits du visage de l’actrice par un corps de femme
nue ; le déplacement impossible des parties du corps féminins sur le visage suggère une
double nudité, celle du visage et celle du corps intime exposé au public. Dans la définition du
« face-à-face » qu’il élabore dans De l’existence à l’existant, Lévinas part de l’idée de nudité
de l’être comme retrait, comme un ailleurs ou un envers, exposé par surprise au regard de
1
Jean-Jacques Lecercle & Ronald Shusterman, p133.
2
Pinter, « Note sur Shakespeare » in Autre voix : Prose, poésie, politique. Paris : Buchet-Chastel, p16.
3
Jean-Jacques Lecercle & Ronald Shusterman, p133.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 15
l’autre : « comme si “le temps d’un sein nu entre deux chemises” il était surpris. C’est
pourquoi la relation avec la nudité est la véritable expérience – si ce terme n’était pas
impossible – de l’altérité d’autrui »1. Le théâtre de Pinter qui commence presque toujours in
medias res reproduit cette irruption du regard du public qui surprend le visage de la scène nu
comme un corps de femme. Dans cette perspective, le « tu ne tueras point » devient l’objet
d’une tentation obscène et définit la vulnérabilité du visage à partir de ce viol en puissance.
L’éthique de Lévinas naît de la violence et de la guerre plus que de bons sentiments. En effet,
il n’y a aucune communauté possible entre l’auteur, le narrateur et le lecteur, ni entre la scène
et le public. Le rapport doit être cherché ailleurs que dans un « partage » équitable du sens,
car selon Lévinas nous sommes toujours redevables à autrui, toujours en dette. Ce qui est ainsi
en question c’est la relation entre le moi et l’autre, la relation « sociale » dit Lévinas qui n’est
pas symétrique. Considérer l’altérité de la littérature et de la scène, c’est admettre que la
relation entre le moi et le toi, ne correspond pas à la relation entre un « moi » numéro un et un
« moi » numéro deux – autrement dit qu’il ne s’agit pas d’une relation d’identité. Tirer les
conséquences de l’altérité implique soit qu’on l’accepte dans l’ouverture et l’accueil de la
responsabilité pour autrui, soit qu’on le rejette et qu’on s’enferme dans l’injustice et la
communication. Le sens ne se partage pas car il n’est rien en dehors de la relation entre le moi
et l’autre, il est « pour-l’autre », ou encore « nudité », « exposition », « vulnérabilité » du
visage. On pourrait ainsi définir l’éthique comme l’approche de l’autre dans la justice, la
relation sociale désintéressée c’est-à-dire « malgré soi », dont on est le témoin ou le martyr –
Lévinas dirait l’ « otage ». La justice n’est donc pas seulement le partage des biens, ni la
justesse ou l’équité, mais le respect de la vie d’autrui, la résistance à la tentation de violence.
La « solidarité »2 et la « charité » ne suffisent pas à décrire l’absence de la guerre. Le sens
ultime de la littérature et du théâtre qui met en scène la guerre, c’est la paix. L’intérêt
principal du débat entre Jean-Jacques Lecercle et Ronald Shusterman est la centralité de ces
deux notions – agōn (combat) et eirēnē (paix) – autour desquelles la théorie littéraire
s’articule. Les enjeux de la perspective théâtrale et littéraire sont de taille ; le contact qu’elles
établissent malgré la distance n’a de sens qu’ « irénique » - la philosophie de Lévinas et le
théâtre de Pinter se rejoignent d’ailleurs dans la même dénonciation de la guerre. La relation
sociale doit s’envisager comme justice pour faire sens, mais il ne s’agit pas d’une
prescription, simplement d’une « optique » ; dans la préface de Totalité et Infini Lévinas
1
Lévinas, De l’existence à l’existant. p60.
2
Jean-Jacques Lecercle & Ronald Shusterman, p133.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 16
écrit : « L’éthique est une optique » 1 . La lunette swiftienne donne un sens éthique aux
relations de Gulliver avec les mondes inconnus qu’il explore dans les replis de la carte
géographique. Le face-à-face s’y raconte comme le voyage périlleux d’un Moi contraint, pour
sa survie, d’écouter et de comprendre l’autre ; il s’y éprouve aussi comme accueil et
hospitalité, et Swift montre bien que tout cela ne va pas de soi et combien on peut être seul
parmi les autres. Lévinas développe l’idée complexe du « face-à-face » à la fois à partir de la
nudité, de l’indiscrétion, et dans la perspective temporelle d’une intrigue et d’une odyssée qui
éprouvent l’égoïsme :
Le face à face est une relation où le Moi se libère de sa limitation à soi – qu’ainsi il découvre -,
de sa réclusion en soi, d’une existence dont les aventures ne sont qu’une odyssée, c’est-à-dire
le retour dans une île.2
Le « face-à-face » au théâtre éclaire tous les jeux de masques et tous les stratagèmes, la
perfidie et les trahisons, qui permettent de se dérober à la responsabilité que la relation à
autrui implique. Le théâtre de Pinter révèle la violence des conflits dans lesquels certains
personnages disparaissent sans laisser de traces : Nick dans One for the road, Riley dans The
Room, Gus dans The Dumb Waiter, Charley dans Mountain Language par exemple. A
l’origine de l’éthique, il y a la guerre que la « politique » ne réussit pas toujours à éviter : du
moins, convient Lévinas, « La politique s’oppose à la morale, comme la philosophie à la
naïveté »3. La politique a donc plus de rapport avec ce que Lévinas entend par « éthique » ou
« philosophie » qu’elle n’en a avec la morale. La guerre, explique Lévinas, rend la morale
dérisoire et il nous faut ainsi considérer l’éthique autrement que comme une série de règles.
L’éthique ne constitue aucun jeu de langage, comme le soutenait d’ailleurs Wittgenstein, car
elle n’est pas un jeu mais un « mystère » qui donne à la vie son poids :
On conviendra aisément qu’il importe au plus haut point de savoir si l’on n’est pas dupe de la
morale. La lucidité – ouverture de l’esprit sur le vrai – ne consiste-t-elle pas à entrevoir la
possibilité de la guerre ? L’état de guerre suspend la morale ; il dépouille les institutions et les
obligations éternelles de leur éternité et, dès lors, annule dans le provisoire, les inconditionnels
impératifs.
Pinter partage l’antimoralisme lévinassien, qui ne déconstruit pas totalement l’idée du Bien et
du Mal, mais qui ne les renvoie pas non plus aux actions des hommes. Le Bien et le Mal
1
Lévinas, Totalité et Infini. p8.
2
Lévinas, Altérité et Transcendance. p72.
3
Lévinas, Totalité et Infini. p5.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 17
n’appartiennent pas au même ordre : l’un est commandement d’autrui qui confère un sens à la
justice, l’autre est l’ordre du Même, du Moi ou encore de l’Etre totalitaire qui assujettit autrui.
Il n’existe pas de conflit entre le Bien et le Mal qui ne se rencontrent jamais, et donc pas de
moyen terme ni de concession possible sur la justice. Sur scène, les actions des personnages
manifestent l’injustice la plus cruelle et la plus égoïste qui soit. La scène, c’est le Mal. Et le
Mal, pour Pinter et Lévinas, c’est la guerre. L’éthique ne se joue pas sur scène mais dans la
relation exclusive avec le public. Contrairement aux apparences, la scène dévoile la « vérité »
en éclairant les masques - Pirandello parlait de « masques nus » - et « [brûle] les draperies de
l’illusion »1. La place de la vérité dans l’œuvre de Lévinas et celle de Pinter pose problème
car si elle n’est pas la source de tous les maux, elle y est intimement associée ; pour Lévinas,
la vérité montre la face cachée de l’Être, son chaos informe et grouillant. Les masques
tombent pour révéler l’ « existence sans monde », c’est-à-dire sans société, dans toute son
horreur. La vérité n’a rien d’un idéal de beauté, elle est obscène. Pinter lui préfère de loin la
trahison, l’équivocité voire la sorcellerie. La vérité n’a aucune place dans son théâtre sinon
comme silence destructeur ou comme « noir » non moins assassin. Autrement dit, la vérité
c’est la fin du théâtre et de la littérature car sa violence, proche de la cruauté d’Artaud, nous
apprend que « le ciel peut encore nous tomber sur la tête »2. En ce sens, la vérité intime le
souhait d’en finir, d’une révélation au sens le plus pessimiste du terme. Le théâtre ne peut tout
le temps montrer le vrai car il ne s’en remettrait pas, la vérité fait « mal ». Ainsi, le mal n’est
pas la méchanceté ni le mensonge, mais la destruction ou l’autodafé des croyances et des
livres. Elias Canetti s’insurge contre la toute puissance de la vérité, qui a parfois un arrière
goût commercial de délation, et prêche pour qu’elle soit administrée par doses
homéopathiques :
Je hais la disposition perpétuelle à la vérité, la vérité par habitude, la vérité par devoir. Que la
vérité soit un orage, et lorsqu’elle a purifié l’air, qu’elle se retire ! Elle doit frapper comme la
foudre, sans quoi elle est sans effet. Celui qui la connaît doit en avoir peur. Il ne faut pas
qu’elle devienne le chien de l’homme ; malheur à celui qui la siffle pour l’appeler ! Ne pas la
tenir en laisse ; ne pas lui mettre le mors en bouche. On n’a pas à la nourrir, on n’a pas à la
mesurer ; seulement à la laisser croître et grandir dans sa paix redoutable. Dieu lui-même a mis
trop de familiarité dans ses rapports à la vérité et c’est par là qu’il est mort étouffé.3
Lévinas substitue à la précellence de la vérité, celle de la nudité et de la vulnérabilité du
visage qui rend à la vérité sa valeur précieuse. La vérité doit rester limitée comme la
1
Lévinas, Totalité et Infini. p5.
2
Antonin Artaud, Le théâtre et son double. p123.
3
Canetti, Le Territoire de l’homme. p34 ;
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 18
connaissance, et Lévinas lui oppose la « sincérité » que l’on donne en partage sans limite. Une
œuvre littéraire peut être « sincère » sans nécessairement être vraie. Mais elle peut également
choisir le vrai pour détruire quand la sincérité ne suffit pas : peut-être est-ce là l’objectif du
théâtre « In Yer Face ». Le théâtre de Pinter au contraire est plus optimiste, car même si ce
qu’il tisse est une toile d’araignée dans laquelle se prend un fragile phalène noir, comme dans
Dialogue for Three, ou un fil d’Ariane fantôme qui guide les morts jusqu’aux vivants dans
Moonlight – il tisse et parle encore. Certes, la perspective éthique a métamorphosé les
hommes en animaux au gré du drame et des aléas du discours ; mais ils semblent toujours
reconnaissables, bien qu’étranges ou étrangers, et rien n’est encore complètement perdu. Le
théâtre de Pinter est une allégorie, c’est-à-dire étymologiquement un « parler autrement », qui
tient la vérité à une distance suffisante. La langue que parlent les personnages appartient
toujours d’abord à quelqu’un d’autre, auteur, public ou animal. L’hybridité de la parole, sa
monstruosité allégorique, incarne sur scène le « pour-l’autre » lévinassien qui définit le sujet à
partir d’autrui. D’ailleurs la langue lévinassienne elle-même tente douloureusement de se
tordre, de se luxer - Lévinas parle de « déhiscence » - pour exprimer cet « autrement
qu’être ». Le discours philosophique veut se rendre étranger à lui-même, allégorique, en
poussant l’hyperbole jusqu’au dernier degré d’éréthisme pour faire chavirer l’être et ses
concepts, déborder l’Un, le Tout et le Bonheur :
C’est au contraire dans l’hyperbole, dans le superlatif, dans l’excellence de signification
auxquels elles remontent – dans la transcendance qui s’y passe ou s’y dépasse et qui n’est pas
un mode d’être se montrant dans un thème – que les notions d’essence qu’elles articulent,
éclatent et se nouent en intrigue humaine. L’emphase de l’extériorité est excellence. Hauteur,
ciel. Le royaume du ciel est éthique. Cette hyperbole, cette ex-cellence, n’est que le « pour-
l’autre » dans son désintéressement. C’est cela que cherchait à dire l’étrange discours tenu ici
sur la signification dans l’un-pour-l’autre du sujet.1
La philosophie devient alors le lieu même du drame du langage ou plus exactement du
« Dit », comme le théâtre est celui de l’être, de l’Ego ou de la solitude. Les chemins escarpés
qu’emprunte Lévinas pour éloigner la philosophie d’elle-même, dans un élan (presque)
nietzschéen, se trouvent naturellement sur le terrain du théâtre. Le langage théâtral, d’emblée
hybride, « face-à-face » institutionnel, met en scène avant tout le drame du langage ; le visage
de la scène est « l’expression de l’exposition », le « dire », la relation désintéressée à l’autre.
Le plaisir du spectateur ne peut justifier entièrement la fascination ou plutôt l’ « emprise »2 du
1
Levinas, Autrement qu’être. p281.
2
Cf. Jean-Jacques Lecercle & Ronald Shusterman, p171 : « L’emprise des signes est plutôt éthique que
cognitive ».
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 19
théâtre, en particulier le théâtre tragique, ni d’ailleurs la catharsis. On essaiera donc de
témoigner de la « passion » du spectacle plutôt que du plaisir du spectateur ou d’une
purgation des esprits animaux. Le théâtre rend au contraire l’animal à la pensée ou la pensée à
l’animal, comme le défend Elias Canetti :
Dans cette optique, on peut facilement faire remonter un personnage de théâtre à un animal.
[…] L’auteur dramatique, tout comme Dieu, possède le pouvoir de donner le jour à des
animaux nouveaux, à des instruments nouveaux, à des créatures nouvelles, et de tirer de leur
assemblage une multitude d’accords. Son art, en cela, dépasse tous les autres. La gamme des
œuvres dramatiques est aussi inépuisable que celle des animaux possibles. Et la création,
comme si elle s’était épuisée en route, et qu’il appartînt à l’homme de la compléter, pénètre
littéralement dans le drame.1
À la guerre s’oppose donc la paix, c’est-à-dire non pas un immobilisme béat, mais une
création qui déborde d’animaux nouveaux, qui ne s’arrête jamais. La perspective baroque
d’un désir qui n’est plus seulement satisfaction ou jouissance mais effusion de sens,
débordement de mots créatures – Lilliput, Brobdingnag, chez Swift, « the straight flange
pump connectors, and back nuts, and the front nuts, and the bronzedraw off cock with
handweel », « the hemi unibal spherical rod end » chez Pinter2 - est une véritable ascèse qui
soulage de la violence, de la vérité et de sa douleur, par la passion. Le visage de la scène, à
vif, parvient à ne pas complètement se taire et à adresser ses murmures nocturnes au public –
le bruit de l’horloge fantôme dans The Homecoming ou encore l’écho d’un battement de cœur
dans Ashes to Ashes. La douleur, même monstrueuse, fait trembler la scène comme les feuilles
de Dodone. L’emprise des signes exprimerait cette indépendance du texte littéraire, difficile à
accepter, son altérité ou son intentionnalité propre : « Le texte n’est pas fixe ; le texte aussi est
labile, ses frontières sont mouvantes »3. Les changements d’expression du texte, ses poses, ses
grimaces et ses sourires, sont plus évidents au théâtre. L’altérité au théâtre se manifeste par
intermittences, entre les lignes du texte ; l’intrigue dramatique oscille du masque au visage, de
la vérité à la justice, de la guerre à la paix, du moi du public (ou de la scène) à l’autre de la
scène (ou du public). Pour rester dans le contexte des forêts de symboles, la parole théâtrale
s’approche au milieu du silence comme les cavaliers de Magritte dans Le Blanc-seing (1965)
– leur image projetée d’une source lointaine n’apparaît que sur le tronc des arbres tandis que
les feuillages effacent une partie de leur corps. Le déséquilibre de la représentation théâtrale,
celui du temps ou du drame, traduit l’asymétrie de la relation à l’autre qui ne souffre pas de
1
Canetti, p24.
2
Pinter, Trouble in the works. pp226-7.
3
Jean-Jacques Lecercle et Ronald Shusterman, L’Emprise des signes. p124.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 20
moyen terme pragmatique. La parole de théâtre n’est jamais intègre, mais toujours blessée,
habitée, infectée comme la plaie béante de Shakespeare ; elle ne relève pas de la « liberté »
mais au contraire, naît de la condition d’ « otage » du public qui écoute et regarde
passivement.
L’analyse cherchera ainsi à mettre en lumière certains enjeux de la perspective lévinassienne
sur le texte de Pinter, et en retour à souligner comment l’exploration du monde théâtral
permet d’appréhender concrètement quelques concepts lévinassiens tels que la « demeure »,
l’« horreur » de l’Être, l’ « exotisme » ou l’ « évasion », la « trace », l’ « oubli », et enfin la
« nudité », le « visage » et l’ « Autre ». Il nous a semblé important de suivre dans le texte de
Pinter l’intrigue du sujet que décrit Lévinas sans pour autant instrumentaliser ni le discours
philosophique ni le texte littéraire ; les deux « mondes » de Pinter et Lévinas communiquent
comme les vases surréalistes, à travers leur propre cadre imaginaire. Parfois ces cadres
allégoriques se superposent quand les métaphores portant le discours sont les mêmes -
l’odyssée par exemple, ou l’espace domestique – ou quand les écritures se réfèrent à des
atrocités historiques – Ashes to Ashes et Autrement qu’être font tous deux directement
référence à la Shoah. On ne peut ignorer que les deux auteurs se partagent la même époque,
les deux guerres mondiales et ses traumatismes, et la même culture – un tableau hybride
d’orient et d’occident. Néanmoins, le point de départ de l’analyse ne concerne ni la
chronologie, ni la géographie mais le fait qu’au-delà de leurs différences formelles, les deux
écritures offrent la même résistance à l’interprétation et le même souci de justice. Le langage
théâtral et philosophique sort du « jeu » pour devenir ce qui nous attache viscéralement à
autrui et au public, qui fait des « nœuds » ; en d’autres termes, le langage, cordon invisible
entre le Moi et l’Autre, nous tient responsables. Il préoccupe le théâtre d’Harold Pinter autant
que la métaphysique de Lévinas, même si celle-ci n’est pas présentée comme une philosophie
du langage. L’éthique qu’elle invoque concerne avant tout le langage car la naissance du sujet
est un événement linguistique, hyperbole et allégorie, avant d’être un véritable enfantement :
Le logique interrompu par les structures d’au-delà de l’être qui se montrent en lui ne confère
pas une structure dialectique aux propositions philosophiques. C’est le superlatif, plus que la
négation de la catégorie, qui interrompt le système, comme si l’ordre logique et l’être qu’il
arrive à épouser gardaient le superlatif qui les excède : dans la subjectivité la démesure du
non-lieu, dans la caresse et la sexualité – la « surenchère » de la tangence, comme si la
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 21
tangence admettait une gradation, jusqu’au contact par les entrailles, une peau allant sous
l’autre peau.1
Le discours commence par mimer l’abstraction logique puis se contracte, ou comme dit
Lévinas « contracte l’existence » et accueille la présence de l’autre. Le discours philosophique
ne relève alors plus de la dialectique ou du système, son sens, ou son drame, vient de la
relation à l’autre – de ses « épousailles » à la sexualité. L’avènement du subjectif à partir de
l’autre et donc de la relation sociale, brise les barreaux de la logique et libère ou inspire le
langage par la justice et l’amour. La métaphore s’invite dans le discours philosophique et
s’épanche, laissant derrière elle la carcasse logique. L’« étrange discours » de Lévinas semble
donc raconter l’histoire du langage devenu personnage.
L’intrigue du théâtre de Pinter part à l’inverse, du personnage pour exprimer la parole de la
justice, du visage de la scène. Le voyage du personnage se situe tout entier dans le discours –
qu’il soit décor, didascalie, dialogue ou silence ; le discours ne s’offre pas dès l’abord comme
une parole d’amour ou de justice, loin s’en faut, puisqu’il n’est pas rare que les personnages
s’invectivent voire s’insultent grossièrement. En réalité, c’est plutôt la violence verbale qui
caractérise le dialogue agonistique des pièces de Pinter. L’étude qui suit s’attache à décrire le
passage de cette parole violente, égoïste et autoritaire à une parole théâtrale, de l’accueil dans
l’intimité, et du don. Le théâtre de Pinter considère une parole en crise ou en guerre qui
semble n’avoir jamais connu ni l’harmonie ni la justice : « Une guerre se déroule toujours
exactement comme si l’humanité n’avait jamais conçu l’idée de justice »2 écrit Elias Canetti.
Les pièces placent le spectateur contemporain dans une position inconfortable de témoin et
d’accusé. Les éclairages en clair obscur manifestent le choc du contraste entre les
personnages, entre le féminin et le masculin, entre l’intérieur que la scène présente et le
dehors dangereusement destructeur. Le décor ne sait plus ce qu’il dit et les personnages
peinent à l’habiter. D’ailleurs, ils ne sont pas tout seuls : la demeure inhabitable qu’est la
scène se peuple de spectres et des créatures monstrueuses que le discours invente. Ces
revenants invisibles s’insinuent dans les recoins de la pièce, derrière les portes, ou bien sous
les rideaux, et s’interposent souvent dans les relations entre les personnages - en particulier les
couples. Le terrier nocturne dans lequel le public accompagne les acteurs se laisse infiltrer de
tous les côtés, comme dans la nouvelle de Kafka. L’espace domestique de la scène sort de ses
gonds ; les histoires du passé le traversent de part en part et remettent vivement en question
1
Cf. Note 1 in Autrement qu’être, p19.
2
Canetti, p19.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 22
l’apparente unité de lieu. Dans The Room, les murs du décor s’enfuient littéralement, et dans
A Slight Ache la maison d’Edward et Flora subit métaphoriquement une dangereuse attaque
pirate. Le décor s’exile dans des contrées imaginaires dominées par l’omniprésence
inquiétante du désert et des sables mouvants (« quicksand »), de l’île déserte de Landscape
aux syrtes tourbillonnants qui changent Rose en sable dans The Room. La disparition de la
maison dans le désert s’aggrave de tout le poids du passé et des guerres mondiales : The
Homecoming et Ashes to Ashes montrent des maisons profanées, voire brûlées ; l’espace
scénique passe complètement du côté des spectres et des monstres fantastiques de l’au-delà
dans Moonlight. Le scandale de la mort et son souvenir tabou fait éclater le décor puis
l’espace tout entier : la scène doit désormais s’appréhender à partir du temps. S’il exprime le
sens de l’œuvre en général, le passage de l’espace domestique au temps de l’Autre s’inscrit
plus explicitement dans ce qu’on a pu appeler les « pièces de la mémoire » : A Kind of Alaska
et Old Times par exemple. Il semblerait pourtant que ces pièces parlent moins de mémoire que
d’oubli, qui efface et transforme totalement le lieu du décor – chambre d’hôpital ou salon
bourgeois près du bord de mer. Les deux pièces explorent le seuil ou plutôt le « néant-
intervalle »1 pour le dire avec Lévinas qui sépare le décor du passé, elles explorent le non-
lieu, le « No Man’s Land » dans lequel Hirst commençait à sombrer dans la pièce éponyme.
Elles sondent le « passage » lui-même, c’est-à-dire la passivité, la patience que le temps perdu
signifie. Les deux pièces parlent une langue de l’oubli, de la blessure que l’on dissimule sous
les neiges trompeuses et complices de l’Alaska. Elles représentent une béance taboue que les
personnages tentent en vain d’ignorer ou d’esquiver. Enfin, le théâtre crève l’abcès dans les
pièces plus politiques comme Celebration, Party Time ou Mountain Language qui laissent
paraître sous les feux des projecteurs la parole-charogne du passé dans toute sa laideur. Ces
pièces révèlent la parole de théâtre comme une parole martyre, défigurée et brûlée vive qui
ressemble à ne plus s’y méprendre au visage souffrant d’Elias Canetti, sans oreille gauche,
sans œil droit, édenté et les lèvres cousues. Le cœur du spectacle arraché vivant dans un
dernier cri, est immolé aux sorcières : Dialogue for three et Monologue, entre autres,
témoignent du fait que les personnages ne sont pas étrangers à ces pratiques cannibales et
profanes.
Au terme de l’analyse des pièces de Pinter, il nous a paru intéressant de réunir, dans une sorte
de vue d’ensemble ou d’intrigue, les concepts principaux de Lévinas évoqués dans l’étude
1
Cf. « La ruine de la représentation » in Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. pp181-
183.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 23
littéraire afin d’en restituer la cohérence. La philosophie d’Emmanuel Lévinas y a été
interprétée du point de vue du langage et de ses enjeux éthiques – interprétation qui visait à
mettre en relief ce que Lévinas appelle la « passion foncière de l’être »1, c’est-à-dire le temps
comme patience et non comme rapport à une fin. Ainsi que l’a montré Beckett en effet, la
« fin » ne nous fait pas sortir du jeu, elle en fait partie. Lévinas écrit curieusement qu’il ne
faut pas considérer le temps à partir de la mort, mais la mort à partir du temps. Le temps du
drame ne s’oriente pas en fonction de sa fin – il n’y a d’ailleurs pas plus de fin que de
commencement dans le théâtre de Pinter – mais à partir de l’Autre. La souffrance d’autrui et a
fortiori le scandale de sa mort, révèlent dans la douleur du deuil et la responsabilité pour
autrui, la nature passive du temps subjectif. En dehors de cette relation à autrui, il est
impossible de déterminer le temps pour soi-même. Au théâtre, cette conception du temps qui
s’éloigne à la fois d’Heidegger et de Bergson, prend un sens fécond. Le temps du drame ne se
définirait pas seulement à partir de l’intrigue des personnages mais à partir de la relation au
public. Autrement dit, il n’existe pas vraiment de temps scénique mais un rythme - fait de
célébrations pour Pinter – qui ne signifie que par la douleur qu’il provoque chez le public, et
que l’on a nommé « passion du spectacle ». Le public, martyr du drame, donne à cette passion
une valeur éthique et donc irénique. La philosophie lévinassienne permet de mettre en valeur
l’« effet » complexe du théâtre, une néo-catharsis qui ne consisterait pas à purger les passions
mais à humilier les égoïsmes assis dans les fauteuils, à provoquer la honte de l’humain et de
son langage en témoignant de la souffrance du visage de la scène, c’est-à-dire à ouvrir le
public au temps de la patience. L’originalité d’Emmanuel Lévinas consiste à retrouver dans
son écriture des aspects de la littérature qui entraient en conflit avec la philosophie et de s’en
nourrir : la vérité par exemple subit un traitement sévère, indigne de l’ontologie. Son discours
est d’ailleurs un dialogue permanent entre littérature et philosophie – de Shakespeare à Racine
et Dostoïevski, en passant par Goethe, Gogol et Grossman – surtout quand il ne prend pas la
littérature pour objet de ses réflexions. En tant que critique littéraire, il semble en effet que
Lévinas ait eu des mots malheureux et trop peu nombreux qui ont contrarié les initiés. Dans
son article « Levinas and the Phenomenology of Reading »2, qui stipule dès le titre l’intérêt et
l’importance de la théorie lévinassienne pour la littérature, Colin Davis fait état de cette
mauvaise humeur :
1
Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. p182.
2
Colin Davis, « Levinas and the phenomenology of reading » in « Studia Phaenomenologica : Romanian Journal
for Phenomenology ». volVI. (2006), pp275-292.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 24
Levinas might have been surprised, and perhaps not hugely flattered, to find his work
discussed in the context of literary theory. His own comments on the subject were sparse; his
forays into literary criticism were rare and on the whole unimpressive; and his general
assessment of art and literature was to say the least disparaging. And yet, a vital strand in his
work consisted in reading and in writing about his experiences as a reader, initially in the
1930s as an exegete of Husserl and Heidegger, and later as a commentator on the Talmud from
the 1960s until his death. Moreover, the act of reading brings into play the most important
issue of his ethical philosophy, namely the possibility of transforming an encounter with
someone or something entirely other.1
À partir du problème de la lecture, Colin Davis montre combien ce qui est ici en question est
la possibilité même de parler de « rencontre » au sujet d’un texte ou encore de « visage de la
scène » en restant fidèle à Lévinas. En effet, cette entreprise est paradoxale et profane ; elle
mérite toutefois d’être tentée – c’est « un beau risque à courir », comme le dit Lévinas au sujet
de sa propre recherche. Ainsi, le corps du texte lévinassien n’a jamais été ressenti comme un
étau qui enfermerait le théâtre de Pinter dans un système préconçu. Les lectures des deux
textes se sont croisées : l’utopie de la demeure dans la philosophie de Lévinas éclairait le
décor en fuite de Pinter, tandis que l’agōn théâtral, ses trahisons et ses masques, ses pouvoirs
imaginaires, permettaient de comprendre la « guerre au sujet » et la sorcellerie de l’être. Si
Lévinas n’a pas fait de critique philosophique de la littérature, c’est donc peut être aussi parce
que la littérature ne se réduit pas en philosophie, qu’elle est son « autre », comme l’expliquent
Jean-Jacques Lecercle et Ronald Shusterman. À la fin de l’essai si controversé dans lequel il
traite de littérature, « La Réalité et son ombre », Lévinas esquisse néanmoins la possibilité
d’une critique philosophique de l’art :
Mais nous ne pouvons pas aborder ici la « logique » de l’exégèse philosophique de l’art. Cela
exigerait un élargissement de la perspective, à dessein limité, de cette étude. Il s’agirait, en
effet, de faire intervenir la perspective de la relation à autrui – sans laquelle l’être ne saurait
être dit dans sa réalité, c’est-à-dire dans son temps.2
La déclaration d’intentions n’aura pas de suite, mais la direction que Lévinas indique suffit ;
certes, impliquer la perspective de la relation à autrui dans l’herméneutique artistique n’est
pas révolutionnaire car elle a alimenté toute la critique de la réception. En revanche, sa
conception du temps comme patience nous semble poser de nouvelles questions quant au
rapport de l’art à la justice et à la responsabilité, sinon à la morale. Lévinas en veut sans doute
à l’art de ne pas avoir eu le pouvoir de découdre les lèvres du visage de l’Autre, de la même
manière que George Steiner déclarait la mort imminente de la culture parce que même la
1
Davis, p275.
2
Lévinas, « La réalité et son ombre » in Les Imprévus de l’Histoire. p148.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 25
musique classique avait été impuissante face à la barbarie – Steiner compare la culture à une
étoile prête à exploser :
Une étoile qui ayant atteint la masse critique – le point où s’équilibre à jamais les échanges
d’énergie entre la structure interne et la surface irradiante – s’effondre sur elle-même,
projetant, à l’instant où elle se détruit, cette flambée que nous associons avec les grandes
cultures dans leur phase terminale.1
La magie de l’art a ses limites insupportables, comme l’être ; mais le point de vue de Lévinas
n’est pas aussi radical, ni aussi pessimiste. Au contraire, l’art est un autre monde, ou plutôt
l’autre du monde, comme le public qui regarde la scène dans la lunette d’un télescope. Dans
« La Réalité et son ombre », Lévinas donne un point de vue sur l’art surprenant mais qui
précède justement tout jugement de valeur ; il explique que l’art n’est pas de ce monde, et sa
définition semble amplifier l’inquiétante étrangeté de Freud qu’il nomme « l’insaisissable
étrangeté de l’exotisme »2 et sur laquelle l’analyse littéraire insistera. L’autre monde de l’art
est un univers poursuit Lévinas « qui précède […] le monde de la création »3. Lévinas rejoint
ainsi la position d’Elias Canetti qui place l’artiste, et en particulier le dramaturge, en position
de créateur, hors du monde. De façon intéressante, c’est également en termes de théâtre que
Lévinas explique le rapport du sujet à l’art :
Le sujet est parmi les choses […], comme chose, comme faisant partie du spectacle, extérieur
à lui-même ; mais d’une extériorité qui n’est pas celle d’un corps, puisque la douleur de ce
moi-acteur, c’est moi-spectateur qui la ressens, sans que ce soit par compassion. Extériorité de
l’intime en vérité.4
Ce qui se montre dans l’art est donc une « passivité foncière », l’envers du monde, une
douleur à vif que ressent le spectateur - un « lointain intérieur », pour reprendre le mot
d’Henri Michaux. L’autre monde d’Harold Pinter et Emmanuel Lévinas n’inspire pas la
« compassion » puisqu’il n’y a aucune distance entre le moi-acteur et le moi-spectateur : c’est
ma douleur que l’on exprime dans d’autres corps. Il ne s’agit donc pas de compassion, mais
de passion ; Lévinas insiste sur l’ « emprise » de cette image dans la lunette : « L’image
marque une emprise sur nous, plutôt que notre initiative : une passivité foncière »5. La
séparation ou le hiatus qui éloigne le Moi du Toi, Lévinas l’appelle la « peau » et non le vide.
1
George Steiner, Dans le château de Barbe Bleue : notes pour une redéfinition de la culture. p34.
2
Lévinas, « La Réalité et son ombre » in Les Imprévus de l’Histoire, p125.
3
Lévinas, « La Réalité et son ombre », p135.
4
Lévinas, « La Réalité et son ombre », p129.
5
Lévinas, « La Réalité et son ombre », p128.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 26
La position que donne Lévinas sur l’art n’est pas une condamnation en termes de valeur, mais
une malédiction, celle d’être toujours exposé et de trahir la honte du spectateur. En ce sens,
l’art est abominable et sorcier. La magie enchanteresse que Lévinas lui attribue ne saurait être
réduite à des propos méprisants sur la pratique artistique. Lévinas célèbre d’ailleurs un art
d’ « oblitération », celui du sculpteur Sacha Sosno et celui de Paul Celan, qui témoigne de la
douleur et réfléchit sur l’œuvre la béance de la blessure. Lévinas met en valeur l’ « ouvert »
qui est la façon d’être de l’art, sa bestialité et non sa bêtise. Il rejoint Elias Canetti et
Agamben dans cette conception de l’ouvert 1 , une conception inhumaine, qui rompt les
frontières entre animalité et humanité sans qu’il s’agisse là de barbarie – purement rationnelle
au contraire. L’écriture de Pinter, comme celle de Swift, s’envisagera dans ce cadre « ouvert »
qu’est la scène - un autre monde peuplé de lilliputiens et de Léviathans, de vampires et de
nains, de Minotaures et d’ogres, d’araignées, de mantes religieuses, et de chats qui
s’esclaffent, de sirènes et de pélicans, de papillons noirs et de guêpes énormes. Dans le
premier chapitre de son essai sur l’homme et l’animal, Agamben fait allusion à une
illustration d’une Bible juive du XIIIe siècle qui représente le banquet messianique partagé
par les justes au dernier jour ; Agamben s’étonne : « Il est un détail surprenant que nous
n’avons pas encore mentionné : sous leurs couronnes, le miniaturiste n’a pas doté les justes
d’une figure humaine, mais manifestement d’une tête d’animal »2. La justice n’aurait pas
ultimement figure humaine. Selon l’explication que donne Agamben à partir des recherches
des historiens de l’art de l’école de Warburg :
Les images des justes avec des traits animaux renverraient au thème gnostico-astrologique de
la représentation des doyens théromorphes, selon la doctrine gnostique suivant laquelle le
corps des justes (ou mieux des spirituels), en remontant après la mort à travers les cieux, se
transforment en étoiles et s’identifient avec les puissances qui gouvernent chaque ciel.3
La lunette astronomique de Pinter, en particulier dans Ashes to Ashes, nous montre les
constellations animales que forment les justes dans le ciel. Le rôle de la mythologie, de
l’imagerie bestiale, de l’héraldique a une dimension oraculaire et profane qui exprime
néanmoins une conception mystique de la justice. Agamben fait un parallèle entre l’ouverture
de l’humain à l’animal et la « blessure ouverte » de George Bataille 4 qui ressemble
1
Giorgio Agamben, L’Ouvert : de l’homme et de l’animal. Paris : Rivages, 2006.
2
Agamben, p10.
3
Agamben, p11.
4
Agamben, p18.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 27
étrangement à la « plaie béante » de Pinter. Cette passion de la justice révèle qu’il est plus
urgent d’étudier ce qui différencie l’homme du non-homme, et l’animal de l’humain, « que de
prendre position sur les grandes questions sur les prétendues valeurs et droits humains »1.
Agamben écarte à la fois le moralisme et le droit positif, comme concepts ancillaires d’une
vision « ouverte » de la justice, et propose qu’on s’attache à être encore humains. Il me
semble qu’avec Agamben et Canetti, Pinter partage le souci d’un sens rescapé, c’est-à-dire
une passion profonde pour ce qui reste d’humain.
A l’image extrême d’une planète désertée – celle de Godot, Endgame et d’Happy Days –
Pinter substitue un autre monde peuplé de créatures hybrides et encore parlantes, même si le
sable des plages sans relief menace et infiltre les murs. Le visage de la scène que l’on tentera
d’approcher est celui qui se tisse dans la douleur de l’envers du décor, qui s’exprime dans
l’envers du langage, et s’expose dans la proximité, sans pour autant être obscène. Dans ce
théâtre, le regard du public se détourne du monde malgré lui, son langage et son corps sont
pris en otage par des créatures d’un autre monde, ils sont imaginés ou réinventés par les petits
hommes verts qu’évoque avec humour Wittgenstein dans De La certitude : « Ne serais-je pas
susceptible de croire qu’un jour, sans le savoir, par exemple en état d’inconscience, je me suis
trouvé transporté loin de la terre, et que même les autres le savent mais ne me le disent
pas ? »2. En effet, le théâtre ne se rapporte pas au langage et à la parole en tant qu’il est
construction, règle, jeu mais en tant qu’il est croyance ou inclination. Le théâtre met en scène
le doute, le scepticisme que Lévinas appelle le « revenant » et Wittgenstein le « Martien »3, et
repose sur la croyance sacrée, profane ou religieuse. Il pose la connaissance et l’apprentissage
en termes de croyance, et en même temps qu’il l’humilie, il rajeunit aussi considérablement
son public ; Wittgenstein écrit : « L’enfant apprend en croyant l’adulte. Le doute vient après
la croyance »4. L’hypothèse que l’on propose consiste à croire ou à imaginer que ce visage de
la scène est bien le nôtre, que cette douleur que parlent les personnages avec d’autres bouches
nous appartient et que cette étoile lointaine dans la lunette est le témoignage de la justice, ou
encore le temps.
1
Agamben, p34.
2
Wittgenstein, De la Certitude. Paris : Gallimard, p50. §102.
3
Wittgenstein, p106. §430.
4
Wittgenstein, p61. §160.
L. Kharoubi, Le visage de la scène, mars 2009 28
Vous aimerez peut-être aussi
- De l'écrit à l'écran: Les réécritures filmiques du roman africain francophoneD'EverandDe l'écrit à l'écran: Les réécritures filmiques du roman africain francophonePas encore d'évaluation
- Corrige Francais Brevet GeneralDocument4 pagesCorrige Francais Brevet GeneralGuler SunaPas encore d'évaluation
- Memoire Exil Et ThéâtreDocument154 pagesMemoire Exil Et ThéâtreLynda MebtouchePas encore d'évaluation
- Descriptif COSTE 1ES2 PDFDocument67 pagesDescriptif COSTE 1ES2 PDFMariana López EscobarPas encore d'évaluation
- Meadwell LAvale DesDocument311 pagesMeadwell LAvale DesvalencaorelienPas encore d'évaluation
- Le Schizo Et Les Langues, Point Final À Une Planète Infernale - ArtishocDocument30 pagesLe Schizo Et Les Langues, Point Final À Une Planète Infernale - ArtishocDulce DedinoPas encore d'évaluation
- Carteggio Giordani Leopardi2014 - FRANCO-arch PDFDocument337 pagesCarteggio Giordani Leopardi2014 - FRANCO-arch PDFMonica MoresiPas encore d'évaluation
- Planète N° 09Document166 pagesPlanète N° 09humbertorafaelg100% (1)
- 21147acDocument4 pages21147acsenghoraissatou04Pas encore d'évaluation
- Sansonnets aux sirènes s'arriment: Cent sonnets oscillent, règne sa rime...D'EverandSansonnets aux sirènes s'arriment: Cent sonnets oscillent, règne sa rime...Pas encore d'évaluation
- 08 Les HétérotopiesDocument16 pages08 Les HétérotopiesRafaelSilvaPas encore d'évaluation
- chacun_sa_façon_de_regarder_lanuitDocument10 pageschacun_sa_façon_de_regarder_lanuitxavierPas encore d'évaluation
- 1398631Document427 pages1398631Paulo Tomás Neves100% (1)
- (La Librairie Du XXIe Siècle.) Jakobson, Roman - Lévi-Strauss, Claude - Loyer, Emmanuelle - Maniglier, Patrice - Correspondance, 1942-1982 (2018, Éditions Du Seuil) PDFDocument452 pages(La Librairie Du XXIe Siècle.) Jakobson, Roman - Lévi-Strauss, Claude - Loyer, Emmanuelle - Maniglier, Patrice - Correspondance, 1942-1982 (2018, Éditions Du Seuil) PDFGabriel González Castro100% (1)
- DisplayDocument2 pagesDisplaySaint-paul WawehPas encore d'évaluation
- (Annelise Schulte Nordholt) Perec, Mondiano, Raczy (BookFi) PDFDocument337 pages(Annelise Schulte Nordholt) Perec, Mondiano, Raczy (BookFi) PDFBrandonPas encore d'évaluation
- LAvare SequenceDocument15 pagesLAvare SequenceStelle HZPas encore d'évaluation
- 2013 Dramaturgies de L'humour Dans Le ThéâtreDocument373 pages2013 Dramaturgies de L'humour Dans Le ThéâtreJulio LealPas encore d'évaluation
- Planète N° 21Document166 pagesPlanète N° 21humbertorafaelg100% (1)
- Pour Roland Barthes (Thomas, Chantal (Thomas, Chantal) ) (Z-Library)Document90 pagesPour Roland Barthes (Thomas, Chantal (Thomas, Chantal) ) (Z-Library)Nada MedhatPas encore d'évaluation
- De L'ironie Romantique Au Roman ContemporainDocument347 pagesDe L'ironie Romantique Au Roman ContemporainBernard SkiraPas encore d'évaluation
- Claude Simon La Question Du LieuDocument333 pagesClaude Simon La Question Du LieuCharlotte Wang100% (1)
- Shakespeare Et La Voix - Voice in Shakespeare's PlaysDocument635 pagesShakespeare Et La Voix - Voice in Shakespeare's PlaysEstelle Folest100% (1)
- Séquence 1 - L'Appel de L'aventure - 28.09.15Document9 pagesSéquence 1 - L'Appel de L'aventure - 28.09.15AvsVercorsPas encore d'évaluation
- Bonheur 2pdfDocument21 pagesBonheur 2pdfDenis5236Pas encore d'évaluation
- Denis Roche-Dans La Maison Du Sphinx. Essais Sur La Matière Littéraire-JerichoDocument171 pagesDenis Roche-Dans La Maison Du Sphinx. Essais Sur La Matière Littéraire-JerichorayanisPas encore d'évaluation
- Le Jeu de l'Oie Contemporain: Le Jeu de l'Accomplissement HumainD'EverandLe Jeu de l'Oie Contemporain: Le Jeu de l'Accomplissement HumainÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Digital Booklet - Il Fa 769 SoloDocument50 pagesDigital Booklet - Il Fa 769 SoloStanislav DimPas encore d'évaluation
- L'évanouissement Du Témoin 1Document64 pagesL'évanouissement Du Témoin 1DascopFivePas encore d'évaluation
- Jacques Dupin Collection Monographique Rodopi en Litt Rature Fran Aise Contemporaine 43 Collection Monographique Rodopi en Litterature FrancaiseDocument84 pagesJacques Dupin Collection Monographique Rodopi en Litt Rature Fran Aise Contemporaine 43 Collection Monographique Rodopi en Litterature Francaiseblzsmelinda5885Pas encore d'évaluation
- La Scène Et La Terre. Questions D'ethnoscénologieDocument99 pagesLa Scène Et La Terre. Questions D'ethnoscénologieXavier ChabouPas encore d'évaluation
- Les Carnets Du Sous SolDocument15 pagesLes Carnets Du Sous SolJérémie Nzita-MambuPas encore d'évaluation
- 16 FuseesDocument120 pages16 FuseesSliman EnnigrouPas encore d'évaluation
- Dialnet LuniverseFantastiqueDeJeanRay 5475970Document29 pagesDialnet LuniverseFantastiqueDeJeanRay 5475970LyaPas encore d'évaluation
- Nancy Huston. L Espèce Fabulatrice Actes SudDocument15 pagesNancy Huston. L Espèce Fabulatrice Actes SudblancaPas encore d'évaluation
- L'espèce Fabulatrice: Nancy HustonDocument15 pagesL'espèce Fabulatrice: Nancy HustonAmor DivinoPas encore d'évaluation
- Séquence 1 - L'Appel de L'aventure - 03.11.15Document13 pagesSéquence 1 - L'Appel de L'aventure - 03.11.15AvsVercors100% (3)
- Le Prologue: SynthèseDocument1 pageLe Prologue: SynthèseAnas AnasPas encore d'évaluation
- Sept-Oct en Seconde Séquence Le Sonnet 16e-17eDocument2 pagesSept-Oct en Seconde Séquence Le Sonnet 16e-17elyblanc100% (1)
- Poétique. Remarques. Poésie, Mémoire, Nombre, Temps, Rythme, Contrainte, Forme, Etc. (Jacques Roubaud (Roubaud, Jacques) ) (Z-Library) - 1Document482 pagesPoétique. Remarques. Poésie, Mémoire, Nombre, Temps, Rythme, Contrainte, Forme, Etc. (Jacques Roubaud (Roubaud, Jacques) ) (Z-Library) - 1César Palacios de DiegoPas encore d'évaluation
- Programmation 1ère 2022 V1Document3 pagesProgrammation 1ère 2022 V1stanic jeremyPas encore d'évaluation
- Brevet Liban 2017 Sujet Francais ReecritureDocument5 pagesBrevet Liban 2017 Sujet Francais ReecritureLETUDIANT67% (3)
- Pise 1951 (Fernandez Dominique) (Z-Library)Document277 pagesPise 1951 (Fernandez Dominique) (Z-Library)Yassine AhnachPas encore d'évaluation
- La JeunepremiredossierpdagogiqueDocument14 pagesLa JeunepremiredossierpdagogiqueBach AbouPas encore d'évaluation
- 2017 Sujet 1Document6 pages2017 Sujet 1sakura-chan1234Pas encore d'évaluation
- Appel de Cthulhu - Les Masques ParisDocument64 pagesAppel de Cthulhu - Les Masques ParisAlexandre BertolinoPas encore d'évaluation
- Secrets d'Egypte en bord de Sèvre: Roman policierD'EverandSecrets d'Egypte en bord de Sèvre: Roman policierPas encore d'évaluation
- CHAMOISEAU, Patrick - Frères MigrantsDocument85 pagesCHAMOISEAU, Patrick - Frères Migrantsdaraujo_15Pas encore d'évaluation
- La Demeure, La Souche: APPARENTEMENTS DE L'ARTISTE GEORGES DIDI-HUBERMANDocument178 pagesLa Demeure, La Souche: APPARENTEMENTS DE L'ARTISTE GEORGES DIDI-HUBERMANZhao Benqi ZhaoPas encore d'évaluation
- Les Sonnets de ShakespeareDocument3 pagesLes Sonnets de ShakespeareCoatalenPas encore d'évaluation
- Ami - Sequence QuestionnaireDocument12 pagesAmi - Sequence QuestionnaireIsmailRedaEchmaniPas encore d'évaluation
- 52590663-CS-00512hampate-ba - CopieDocument391 pages52590663-CS-00512hampate-ba - Copiesakhoib100% (1)
- Bled - Cours Sup Orthographe 4e 3eDocument281 pagesBled - Cours Sup Orthographe 4e 3eImad MohsinPas encore d'évaluation
- Images et mirages des migrations dans les littératures et les cinémas d'Afrique francophoneD'EverandImages et mirages des migrations dans les littératures et les cinémas d'Afrique francophonePas encore d'évaluation
- TC Qqla 26250Document340 pagesTC Qqla 26250Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Le Figaro Histoire - Ao 251 T-Septembre 2018 PDFDocument132 pagesLe Figaro Histoire - Ao 251 T-Septembre 2018 PDFSteve BacharidisPas encore d'évaluation
- Programme Classe de Quatri Mes 2022 2023Document5 pagesProgramme Classe de Quatri Mes 2022 2023mathieuPas encore d'évaluation
- Yram - La Méthode de ProjectionDocument5 pagesYram - La Méthode de ProjectionXiana Do Castelo100% (2)
- Sparte Et Les Sudistes - BARDECHE Maurice - A4Document117 pagesSparte Et Les Sudistes - BARDECHE Maurice - A4BibliothequeNatioPas encore d'évaluation
- Disertation CorrigerDocument10 pagesDisertation CorrigerMTPas encore d'évaluation
- Le RecelDocument26 pagesLe RecelmhdiPas encore d'évaluation
- Pénal 2e Année 1er SemestreDocument89 pagesPénal 2e Année 1er Semestreseb62117Pas encore d'évaluation
- (Jacques Derrida) Force de Loi - Le - Fondement Myst PDFDocument141 pages(Jacques Derrida) Force de Loi - Le - Fondement Myst PDFuc_victor100% (1)
- 7PH06TE0520 Partie3Document13 pages7PH06TE0520 Partie3Ousseynou MBAYEPas encore d'évaluation
- Code Pénal (France, 2018) PDFDocument384 pagesCode Pénal (France, 2018) PDFRadu-Cristian FotescuPas encore d'évaluation
- Analyse Du Dispositif Marocain Anti TerroristeDocument18 pagesAnalyse Du Dispositif Marocain Anti TerroristeAyoub Kebdani100% (1)
- Droit Penal S4Document43 pagesDroit Penal S4ioanad4235Pas encore d'évaluation
- Cahier Du PASCRENA N°5 CopieDocument258 pagesCahier Du PASCRENA N°5 CopiecourtinPas encore d'évaluation