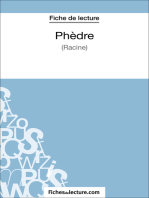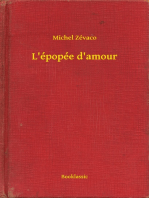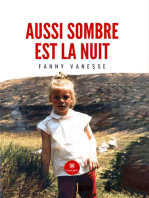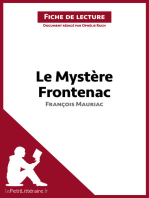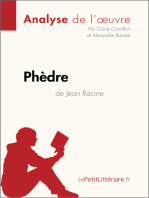Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Mini-Mémoire Wilhem ALLACHE
Mini-Mémoire Wilhem ALLACHE
Transféré par
Wil Million0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
16 vues10 pagesTitre original
Mini-mémoire Wilhem ALLACHE
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
16 vues10 pagesMini-Mémoire Wilhem ALLACHE
Mini-Mémoire Wilhem ALLACHE
Transféré par
Wil MillionDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 10
Eugénie et Franval : la liaison dangereuse
Le Mal au cœur de l’histoire tragique d’Eugénie de Franval
“Instruire l’homme et corriger ses mœurs, tel est le seul
motif que nous proposons dans cette anecdote”. Ainsi est
introduit la nouvelle tragique d’Eugénie de Franval du
marquis de Sade. Une visée moralisatrice et didactique, voici
ainsi le projet idéologique d’une œuvre manichéenne qui
tend moins à choquer un lectorat déjà aguerri par les
extravagances de Sade. Eugénie de Franval est le fruit du
Mal, celui dont un homme porte les traits et s’érige en figure
: M. de Franval, dont le bonheur et le plaisir ne peuvent être
assouvis que par le fruit de ses entrailles, Eugénie qui
devient malgré elle et inéluctablement la fille de son père,
une mauvaise créature soumise et dévouée à son père, au
grand dam de Mme de Franval, l’autre victime de la
tyrannie de son mari et qui, a contrario, se dresse en figure
d’opposition de par sa candeur et sa bonté. Eugénie de
Fraval est donc l’histoire d’une famille annihilée par le Mal,
entre le père démoniaque, la mère angélique et la fille
pervertie, victime du péché incestueux qui devient malgré
elle l’œuvre maléfique de son père. Entre inceste,
manipulation et meurtre, comment cette œuvre de Sade
questionne-t-elle les effets et les raisons d’un Mal intense et
destructeur, véritable moteur d’une histoire vouée au
malheur de ses protagonistes.
Franval : la figure du Mal qui pervertit et manipule Eugénie
Il semble intéressant, si ce n’est nécessaire, d’évoquer en
préambule l’onomastique du personnage central de cette œuvre.
En effet, le choix du nom d’Eugénie ne résulte en rien du hasard
ou d’une fulgurance esthétique. “Eugénie” est issu du grec
“Εὐγενία” qui signifie “bien-née”. Au premier abord, le choix de
Sade de proposer ce nom à son œuvre semble supposer le déroulé
d’une œuvre centrée sur la question du bien et du mal : comment
cette fille est-elle bien née ?, ou encore si cette fille est née
bonne, va-t-elle le demeurer ?
Eugénie est la fille d’une mère présentée comme le Bien incarné
et d’un père mauvais qui va, dès sa naissance, destiner sa fille
au vice et au Mal. Franval décide de la séparer dès son arrivée
au Monde de sa génitrice, qui ne le verra pour la première fois
qu’à ses sept printemps. Il est clair : Franval s’approprie sa fille
pour en faire son œuvre : il s’occupe personnellement de son
éducation, dénué de tout principe moral et religieux, où elle se
retrouve en marge de la société, simplement dans un château en
compagnie de quelques amies et de professeurs lui enseignant
les matières basiques, telles que la lecture ou encore le calcul.
Eugénie est destinée au mal de son père, et ce dès son enfance :
“M.de Franval qui, dès que cet enfant vit le jour, forma sans
doute sur elle les plus odieux desseins, la sépara tout de suite de
sa mère.” La peur du bien et des valeurs morales ont donc incité
Franval à se charger personnellement d’Eugénie afin de la
former, elle qui est dépeinte par le narrateur comme “le miracle
et l’horreur de la nature”. Mme de Franval représente un tel
danger pour lui qu’il la contraint à cette situation, allant jusqu’à
la menace suprême pour une mère : celle de ne plus voir sa fille.
Très vite, Franval façonne sa fille et devient l’objet de son désir.
“L’horrible dessein” semble inéluctable, Eugénie est vouée au
crime, celui que Freud considère comme le tabou suprême dans
Tabou et Totem : l’acte incestueux. Pour ce faire, Franval opère
un plan machiavélique, celui d’une sacralisation mutuelle. En
effet, s’il isole Eugénie du reste du monde, ce n’est pour
apparaître que comme la seule personne qui compte à ses yeux,
allant jusqu’à faire nourrir une haine viscérale d’Eugénie à
l’encontre de sa mère : “Le père […] avait trouvé le secret de
placer, dans l’âme de cette jeune personne, bien plus de haine et
de jalousie, que de la sorte de sentiments respectables et tendres
qui devaient y naître pour une telle mère (p.23)”. Eugénie
devient même une déesse à ses yeux : “j’aime ma fille, je l’aime
avec passion, elle est ma maîtresse, ma femme, ma sœur, ma
confidente, mon amie, mon unique dieu sur la terre (p.76)”,
rejetant avec véhémence la perspective d’un mariage avec le
jeune Colunce : Eugénie n’appartient qu’à lui.
Franval attend patiemment, quatorze ans précisément, avant de
réaliser son méfait, au terme d’une scène où il vénère sa fille :
“sois aujourd’hui la reine de mon cœur, et laisse-moi t’adorer à
genoux ! (p.27)”. Cette scène, où Eugénie telle une statue se
laisse peu à peu tomber dans le vice préparé par son père,
représente l’apogée des Crimes de l’amour, nom que Sade
donnera à son recueil dont est issue cette nouvelle, jusqu’à
accomplir le funeste destin auquel elle semblait vouée : “Ne vois-
tu donc pas […] que je suis aussi pressée que toi de connaître le
plaisir dont tu me parles ? Ah ! jouis, jouis ! mon tendre frère,
mon meilleur ami, fais de ton Eugénie ta victime (p.27)”. Franval
devient alors “impunément le destructeur d’une virginité dont la
nature et ses titres lui avaient confié la défense (l.28)”, selon les
termes d’un narrateur constamment heurté et offusqué face à la
noirceur de ce sombre personnage, usant tout au long du récit
d’adjectifs dépréciatifs à son égard, ce que l’on pourrait qualifier
d’épithètes sadiennes, à l’instar des épithètes homériques dans
L’Odyssée : “l’indigne” ; “l’homme horrible” ; “le scélérat” ; “le
misérable” : la stratégie narrative est primordiale car elle
permet de rendre compte constamment du mal que représente
Franval, qui a réalisé l’exploit, de rendre Eugénie, “la bien-née”
en une “infâme créature (p.46)”.
Néanmoins, il peut être conclu suite à l’étude de cette œuvre que
les actes de Franval témoignent d’une quête conjointe de plaisir
et surtout de bonheur. Rien de plus merveilleux qu’un père
heureux ! C’est ainsi que la nouvelle révèle un hédonisme et un
eudémonisme inhérents aux actes de Franval. Le plaisir charnel
vise selon à lui à permettre l’accès au bonheur, aussi bien à lui
qu’à sa fille, rappelant que le devoir d’un père est d’assurer cet
état à sa fille et qu’il est le fondement nécessaire de la vie :
“Foulons aux pieds ces préjugés atroces, toujours ennemis du
bonheur (p.44-45)”. Cet eudémonisme qui lui est cher se
retranscrit par l’amour unique qu’il éprouve pour sa fille : “il
était facile de voir qu’il n’avait jamais rien aimé comme Eugénie
(p.30)”.
En définitive, c’est par l’acte de l’inceste, qui, étymologiquement,
signifie “impur”, qu’il achève sa création : son “infâme créature”
et qu’il se l’approprie. La bien-née devient alors impur, ensevelie
par un mal qui doit également atteindre Mme de Franval : “il
faut que je lui fasse avoir des torts, pour réussir à couvrir les
miens, il faut donc que tu l’aies... (p.45)”. Le narrateur élabore
une maxime qui résume la perfidie de ces deux cœurs et leur
répulsion de tout principe moral : “c’est dans les leçons
mêmes de la sagesse qu’ils trouvent de l’encouragement
au mal (l.83)”.
Franval deviendra encore plus tyran par la suite, en enfermant
le bon Clervil, et deviendra même criminel, lorsqu’il capture
Valmont, son ami traître qui tenta de capturer Eugénie à
dessein de la marier. Franval ne représente pas uniquement le
Mal, il est le Mal incarné, ce que le narrateur nous apprend par
ailleurs dès l’ouverture du récit par le biais d’une énumération
significative : “de la méchanceté, de la noirceur, de l’égoïsme...
(p.13-14)”. C’est donc un être incestueux, libertin, pédophile,
tyran et meurtrier qui influence l’œuvre. Ses desseins vindicatifs
démontrent un désir, si ce n’est un plaisir de faire du mal,
notamment à sa femme : “Ce projet (d’offrir à Mme de Franval
un amant afin de lui faire avoir des torts) divertit Franval ; mais
bien plus méchant que sa fille, […] il répondit que cette
vengeance lui paraissait trop douce, et qu’il y avait d’autres
moyens de rendre une femme malheureuse (p.40)”. Franval veut
prendre du plaisir à faire souffrir, à rendre sa femme
malheureuse, jusqu’à en entreprendre la conception de fausses
lettres pour faire croire une relation avec Valmont : il est adepte
de sadisme, ce plaisir sournois et malsain qui s’érige ici en une
apogée du Mal, à l’encontre d’une femme de valeur, aux
antipodes de son mari.
Les spectres d’un Bien qui résiste aux assauts du Mal
Franval ?
L’histoire d’Eugénie de Franval est avant tout celle de la famille
Franval, une famille bipolaire, caractérisée par une ambivalence
entre la bonté d’une mère et la méchanceté du père. Le
narrateur ne tarit pas d’éloges concernant Mme de Franval :
“figure de vierge où se peignent à la fois la candeur et l’aménité
sous des traits délicats, aux beaux cheveux blonds flottant au
bas de sa ceinture, aux grands yeux bleus où respirent la
tendresse et la modestie” ; “respectable et malheureuse mère” ;
“âme tendre et sensible” : Mme de Franval a l’aspect moral et
physique d’un “ange céleste (p.116)” tant elle est vertueuse. Elle
se dresse en figure antithétique au tyran maléfique que
représente Franval : il s’agit d’un ange manipulé par un démon,
démon qui va mener à sa perte.
Très vite, Mme de Franval est présentée comme une femme
docile et soumise à son mari. Ce n’est qu’avec le plus grands des
désespoirs qu’elle voit sa fille lui être prise, avant de faire sa
connaissance sept ans plus tard, puis d’apprendre, impuissante,
qu’elle a été déviergée par son propre père. Eugénie, la
manipulée, développe un complexe d’Œdipe au contact de son
père. Une “implacable jalousie (p.40)” envers sa mère fait naitre
en elle une figure de rivale : “Eugénie n’imaginait pas qu’elle pût
avoir au monde une plus grande ennemie que sa mère”.
L’ennemie s’oppose derechef à “l’ami” Franval.
Eugénie, dans le désir de nuire à sa génitrice, propose dès lors
un stratagème : user de Valmont pour la séduire, et ainsi la
convertir au mal qui la consume depuis sa naissance. Une
volonté de faire du mal, en phase avec les valeurs qui lui ont été
inculquées : son père s’est chargé développer en elle une haine
viscérale envers sa mère.
Une figure endoctrinée aux antipodes de Clervil, le sage qu’elle
tentera même de séduire et qui est au soutien de Mme de
Franval et de mère, Mme de Farneille. C’est par ailleurs elle qui
laisse entendre une liaison incestueuse entre Eugénie et son
père, ce qui l’offusque et le choque, ne pouvant imaginer qu’un
tel crime ne puisse se produire. Néanmoins, lors d’une entrevue
avec Franval, Clervil expose à son interlocuteur mauvais
l’incompatibilité entre ses pratiques criminelles et le bonheur
auquel il aspire : “Il est impossible, monsieur, que le bonheur
puisse se trouver dans le crime (p.71)”. Clervil, dans cette œuvre,
est une figure de raison : l’eudémonisme tant convoité par
Franval ne peut être atteint avec un cœur si noirci, et finira par
être kidnappé puis retenu par Franval.
Ce même méchant, toutefois, estime que la bonté n’est qu’utopie
et, qu’il est fait comme tous les hommes : les hommes sont tous
mauvais : “Les femmes... fausses, jalouses, impérieuses,
coquettes ou dévotes... les maris, perfides, inconstants, cruels ou
despotes, voilà l’abrégé de tous les individus de la terre (p.33)”. Il
s’agit donc d’un Mal universel dont il est question pour Franval,
considérant la dévotion comme un péché. Or, les quatre
épithètes qu’il attribue aux maris ne semblent que le désigner.
La candeur et l’ingénuité de Mme de Franval, uniques remparts
à la cruauté tyrannique de son mari, vont finalement lui coûter
la vie.
Alors que son mari revient vers elle, après l’avoir accusée
d’enlever sa fille, et lui demande de fuir à la campagne avec eux,
Mme de Franval, aveuglée par l’amour qu’elle porte toujours à
son mari, accepte sans broncher, et ce malgré le malheur qu’il lui
a provoqué, au prix de velléités de suicide. L’on ressent alors
tout le pouvoir et la domination que Franval exerce sur elle :
“Mme de Franval, effrayée, n’ose plus rien répondre ; elle se
prépare : un désir de Franval n’est-il pas un ordre pour elle ?
(p.106)”, “peut-on haïr ce qu’on a bien aimé ? (p.103)”, elle qui va
même jusqu’à faire fi de la trahison et de l’insolence d’une fille
pervertie : “La voix de la nature est si impérieuse dans une âme
sensible, qu’une seule larme de ces objets sacrés suffit à nous
faire oublier dans eux vingt ans d’erreurs ou de travers (p.106)”.
Mme de Franval est incapable de quelque considération
vindicative, et encore moins de haïr. Ce que la miséricordieuse
ignore, c’est que Franval a imposé un dilemme à Eugénie, la
faisant promettre de la tuer.
L’issue du récit est l’apogée de la dimension tragique qui y
régnait : le cruel Franval, de retour de Suisse et attaqué par des
brigands, apprend de la bouche du bon Clervil que son dessein
avait abouti : la pervertie Eugénie a assassiné sa douce mère.
Néanmoins, ce matricide a fait éclore chez elle des remords
fatals. Aussitôt son acte produit, elle se rua sur elle pleine de
chagrin, réalisant l’ampleur de son crime : “son repentir, […]
s’exprimait déjà par les larmes et les sanglots les plus amers...
(p.127)”. Ce meurtre a, semble-t-il, fait émaner des sentiments
humains à Eugénie qui, bien que ne connaissant quasiment pas
sa mère et, “s’avouant coupable, invoquant la mort (p.128)”, finit
par mourir à son tour, “en même temps” qu’elle.
La mort de Mme de Franval s’accompagne de pensées à
l’encontre de son bourreau, symbole d’un Bien qui ne se sera
jamais éteint : “Vous le voyez, homme barbare, les dernières
pensées, les derniers vœux de celle que vous déchiriez étaient
encore pour votre bonheur (p.128)”. Le destin de cette
miséricordieuse prouve que le bien ne l’aura finalement pas
sauvé d’une vie et d’une mort cruelle.
La mort finale de Franval, agonisant, enterre cette histoire. Il
aura finalement été le protagoniste de la destruction de sa
famille, dont les motifs auront été dirigés par une quête de
bonheur et de plaisir cruels. La manipulation d’une fille destinée
au bien allant jusqu’à l’acte incestueux, le meurtre organisé
d’une femme fidèle et miséricordieuse ainsi que l’assassinat froid
de Valmont en font une figure du Mal incomparable dans les
œuvres de Sade. La voix du bien, celle de Clervil, demeure la
seule vivante à l’issue de ce drame, ce même Clervil qui
accompagne Franval dans son dernier souffle, et ce malgré la
retenue dont il a été victime. Le Bien n’était pas assez puissant
dans cet œuvre pour enrayer l’entreprise maléfique de Franval.
Pédophile, incestueux, meurtrier, barbare, libertin, despote :
Franval incarne à lui seul un Mal fatal à sa famille. La
manipulation de l’esprit, du cœur et du corps de l’insouciante
Eugénie fut l’accomplissement de l’hédonisme et de
l’eudémonisme auxquels il s’est attaché. Eugénie, fille d’une
mère bonne, fidèle, vertueuse et dévote, en paie le prix, mourant
dans la peine la plus abominable, en tant que coupable de
matricide. Cet esprit corrompu est l’œuvre du Mal de Franval,
fille totalement soumise et dévouée à son père, auquel elle vouait
un culte, et réciproquement.
La candeur et le cœur pur de Mme de Franval l’auront
finalement aveuglée : dans sa miséricorde et sa docilité, elle ne
trouvera que la mort des mains de son enfant, tout en ayant le
cœur à pardonner son cruel mari, signe que la bonté qui la
guidait l’accompagne jusque dans sa tombe.
Le Bien ne pouvait altérer la puissance du Mal de Franval dans
cette œuvre, un Mal bien trop puissant et sans limites. Cette
liaison incestueuse est plus dangereuse que ce qu’il pouvait
paraitre, car elle a finalement coûté le prix fort, la vie d’une
famille tiraillée entre deux pôles inconciliables.
Wilhem ALLACHE, M1
Vous aimerez peut-être aussi
- Manon Lescaut Première Rencontre Texte CommentaireDocument6 pagesManon Lescaut Première Rencontre Texte Commentaireteste66909Pas encore d'évaluation
- Initiation Aux ProbabilitésDocument468 pagesInitiation Aux ProbabilitésBrondon Pagou100% (5)
- Ethnographies Des Mondes À VenirDocument33 pagesEthnographies Des Mondes À VenirRousseyPas encore d'évaluation
- Trois Femmes PuissantesDocument5 pagesTrois Femmes PuissantesSara Lolli100% (2)
- Le Sabotage amoureux d'Amélie Nothomb (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandLe Sabotage amoureux d'Amélie Nothomb (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Phèdre de Racine (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandPhèdre de Racine (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Etude Des Personnages PhèdreDocument2 pagesEtude Des Personnages PhèdreSwirty100% (5)
- Le Grand Meaulnes - Alain Fournier (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLe Grand Meaulnes - Alain Fournier (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- L'École des femmes de Molière (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandL'École des femmes de Molière (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Evaluation Theatre 2 Molière LAVARE Corrigé1Document4 pagesEvaluation Theatre 2 Molière LAVARE Corrigé1987527615Pas encore d'évaluation
- Sri Aurobindo - La Synthèse Des Yoga Tome 2 PDFDocument279 pagesSri Aurobindo - La Synthèse Des Yoga Tome 2 PDFchbirdhouPas encore d'évaluation
- Rituel Du Rite de SwedenborgDocument46 pagesRituel Du Rite de SwedenborgHeritier Neal100% (1)
- TavaikDocument4 pagesTavaikibrahimaPas encore d'évaluation
- Alain Fournier-Adolescence Et SymbolismeDocument3 pagesAlain Fournier-Adolescence Et SymbolismeMacet JelenaPas encore d'évaluation
- Copie de Copie de DocumentDocument13 pagesCopie de Copie de Documentanfel.bk.97Pas encore d'évaluation
- PLAN390Document5 pagesPLAN390d8q6dcpzxpPas encore d'évaluation
- Effi Brist RésuméDocument13 pagesEffi Brist RésumévirginieperchetPas encore d'évaluation
- Anorexie, ProstitutionDocument15 pagesAnorexie, Prostitutiononsothmani12Pas encore d'évaluation
- Expose LITT FRANCAISE, FRANCOPHONE Par Hadassa Et ShriyaDocument15 pagesExpose LITT FRANCAISE, FRANCOPHONE Par Hadassa Et ShriyaHope NaiduPas encore d'évaluation
- Vipère au poing d'Hervé Bazin (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandVipère au poing d'Hervé Bazin (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- LL4 Lucrèce Borgia Texte Et CorrectionDocument4 pagesLL4 Lucrèce Borgia Texte Et Correctionpaulinegrevet23Pas encore d'évaluation
- Manon Lescaut Etude Linéaire N°1: Le Coup de FoudreDocument2 pagesManon Lescaut Etude Linéaire N°1: Le Coup de FoudreguilletmariejustinePas encore d'évaluation
- L'école Des Femmes, Molière - Fiche de LectureDocument6 pagesL'école Des Femmes, Molière - Fiche de Lecturekenzatazi2007Pas encore d'évaluation
- François le champi: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandFrançois le champi: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- L Invitee SimoneBeauvoirDocument14 pagesL Invitee SimoneBeauvoirAngélica NiñoPas encore d'évaluation
- Phèdre de RacineDocument26 pagesPhèdre de Racinekhalifa2007293267% (3)
- Arrêts 3-4 Mercure 2Document4 pagesArrêts 3-4 Mercure 2Mlk MrdssPas encore d'évaluation
- L'Ecole Des Femmes Scène D'expositionDocument4 pagesL'Ecole Des Femmes Scène D'expositionMarlene crazyPas encore d'évaluation
- Disseration Phèdre Jean RacineDocument2 pagesDisseration Phèdre Jean RacinejalanrigaudPas encore d'évaluation
- Exposer Temps Et EspäceDocument9 pagesExposer Temps Et EspäceFernando LuissPas encore d'évaluation
- SujetDocument5 pagesSujetDavid AkinlamiPas encore d'évaluation
- CommentaireDocument8 pagesCommentaireOumaima SahabPas encore d'évaluation
- Le Mystère Frontenac de François Mauriac (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandLe Mystère Frontenac de François Mauriac (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- IRONIK 5 Travaux PARCHLINIAKDocument5 pagesIRONIK 5 Travaux PARCHLINIAKsokolowskyPas encore d'évaluation
- (LA) 2 Racine, Phèdre I3 (Aveu)Document6 pages(LA) 2 Racine, Phèdre I3 (Aveu)koana bshsPas encore d'évaluation
- Molière, "L'Ecole Des Femmes", Analyse LittéraireDocument40 pagesMolière, "L'Ecole Des Femmes", Analyse Littéraireaida3lo4Pas encore d'évaluation
- L'Ecole des Femmes de Molière (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandL'Ecole des Femmes de Molière (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Analyse Des PersonnagesDocument2 pagesAnalyse Des Personnagesunkno777Pas encore d'évaluation
- L'école Des FemmesDocument7 pagesL'école Des Femmesmoussa CISSE100% (1)
- Une Version Du FémininDocument7 pagesUne Version Du FémininSarah Le PhilippePas encore d'évaluation
- Vipère Au PoingDocument3 pagesVipère Au PoingGatinePas encore d'évaluation
- Résumé Une Vie.Document11 pagesRésumé Une Vie.bramito100% (1)
- Arnolphe PDFDocument3 pagesArnolphe PDFsagalrob14Pas encore d'évaluation
- En Quoi La Cruauté EstDocument7 pagesEn Quoi La Cruauté EstLucie JBPas encore d'évaluation
- Dissertation Sur MolièreDocument4 pagesDissertation Sur MolièreClaudia JaimesPas encore d'évaluation
- Critiquelitteraire de S. de Beauvoir - L'inviteeDocument14 pagesCritiquelitteraire de S. de Beauvoir - L'inviteeHana Dautović-Jusufović100% (1)
- Phèdre SC 3 Acte 1Document9 pagesPhèdre SC 3 Acte 1meryemPas encore d'évaluation
- Le Corpus Des FemmeDocument10 pagesLe Corpus Des FemmeLea MariaPas encore d'évaluation
- L'Avare de Molière (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandL'Avare de Molière (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Récapitulatif EAF Blanc 1 FinaleDocument4 pagesRécapitulatif EAF Blanc 1 FinaleYashvi ShahPas encore d'évaluation
- Phèdre de Jean Racine (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandPhèdre de Jean Racine (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Limage de La Femme Dans Le Fils Du PauvrDocument15 pagesLimage de La Femme Dans Le Fils Du PauvrHope NaiduPas encore d'évaluation
- Phèdre Analyse 2Document3 pagesPhèdre Analyse 2adam.rahmatalah6Pas encore d'évaluation
- Dossier HugoDocument16 pagesDossier HugoHajare BekPas encore d'évaluation
- Emma BovaryDocument5 pagesEmma BovaryradanaxxPas encore d'évaluation
- Moliere L AvareDocument11 pagesMoliere L Avarealynyutza100% (2)
- Commentaire Sur Moderato Cantabile:: Romy Berthou Comte 1°esDocument4 pagesCommentaire Sur Moderato Cantabile:: Romy Berthou Comte 1°esOsama MohamedPas encore d'évaluation
- Le Courage de L'enonciationDocument4 pagesLe Courage de L'enonciationLaure NaveauPas encore d'évaluation
- La Legende de ManleDocument5 pagesLa Legende de ManleBarnabé Kwamé100% (3)
- Phèdre Racine Fiche de LectureDocument5 pagesPhèdre Racine Fiche de LectureKarim SaadPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument16 pages1 PBOthmane ADPas encore d'évaluation
- Zbook - Livres de Grammaire Filire Fra - 33954Document6 pagesZbook - Livres de Grammaire Filire Fra - 33954Isaek IsberabahPas encore d'évaluation
- Les PropositionsDocument5 pagesLes PropositionsOtmane El BardouniPas encore d'évaluation
- Connecteurs LogiquesDocument2 pagesConnecteurs Logiquesjohntrash.p1Pas encore d'évaluation
- Accord Du Verbe Avec Le Sujet Séance 7Document9 pagesAccord Du Verbe Avec Le Sujet Séance 7Bourama Dassé BouaréPas encore d'évaluation
- Réflexion Pour Une Théorie Critique Non EuropéanéocentréeDocument17 pagesRéflexion Pour Une Théorie Critique Non EuropéanéocentréeYann BgtPas encore d'évaluation
- Liberté ContractuelleDocument8 pagesLiberté ContractuelleMohammed SaoudiPas encore d'évaluation
- Les Poèmes de DominiqueDocument35 pagesLes Poèmes de Dominiquesendedominique7Pas encore d'évaluation
- Documento PDFDocument12 pagesDocumento PDFLisbeth De los SantosPas encore d'évaluation
- Les 13 Familles D'âmesDocument13 pagesLes 13 Familles D'âmesCréa YannickPas encore d'évaluation
- Faut Il Oublier Le Passé 1ere Partie RédigéeDocument1 pageFaut Il Oublier Le Passé 1ere Partie RédigéeFlamer15Pas encore d'évaluation
- Modes OcDocument1 pageModes OcVincent PPas encore d'évaluation
- Le But Ultime de L'EtpDocument26 pagesLe But Ultime de L'EtpMarcella PagnolPas encore d'évaluation
- TD Delelis Sociale S6Document4 pagesTD Delelis Sociale S6Léa RuckstuhlPas encore d'évaluation
- Les PronomsDocument5 pagesLes PronomsThe hackerPas encore d'évaluation
- ESPRIT SCIENTIFIQUE CaractéristiqueDocument2 pagesESPRIT SCIENTIFIQUE Caractéristiquegabin elougaPas encore d'évaluation
- Methode D'étude QualitativeDocument80 pagesMethode D'étude QualitativeBabila management100% (1)
- Présocratiques Et Pos Modernes: Les Effets de La Sophistique Barbara Cassin Michel NancyDocument11 pagesPrésocratiques Et Pos Modernes: Les Effets de La Sophistique Barbara Cassin Michel NancydanieulaPas encore d'évaluation
- GrilleniveauxtcfDocument4 pagesGrilleniveauxtcfSaid GuennounPas encore d'évaluation
- Entiers Naturels PDFDocument19 pagesEntiers Naturels PDFKhadim NdiayePas encore d'évaluation
- Raymond Boudon La Rationalité Ordinaire Colonne Vertébrale Des Sciences SocialesDocument23 pagesRaymond Boudon La Rationalité Ordinaire Colonne Vertébrale Des Sciences SocialesRadu TomaPas encore d'évaluation
- Georg Lukács Esthétique Septième Chapitre Problèmes de La Mimésis IIIDocument131 pagesGeorg Lukács Esthétique Septième Chapitre Problèmes de La Mimésis IIIJean-Pierre MorboisPas encore d'évaluation
- Bac 2022 Fiches de Révision, Cours, Quiz, Exercices, AnnalesDocument1 pageBac 2022 Fiches de Révision, Cours, Quiz, Exercices, AnnalesgirardPas encore d'évaluation
- 05-Cours Evn EleveDocument29 pages05-Cours Evn EleverabahPas encore d'évaluation
- Questionsdecommunication 9216Document22 pagesQuestionsdecommunication 9216Betschbel DorcéPas encore d'évaluation
- John Loke Et La SémiologieDocument21 pagesJohn Loke Et La Sémiologiekhalil RebbaliPas encore d'évaluation