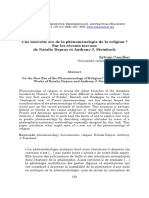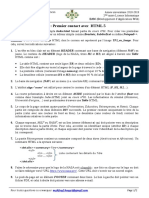Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Philosophiascientiae 1260
Transféré par
BARBETitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Philosophiascientiae 1260
Transféré par
BARBEDroits d'auteur :
Formats disponibles
Philosophia Scientiæ
Travaux d'histoire et de philosophie des sciences
21-2 | 2017
Raymond Ruyer
dialogues et confrontations
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/philosophiascientiae/1260
DOI : 10.4000/philosophiascientiae.1260
ISSN : 1775-4283
Éditeur
Éditions Kimé
Édition imprimée
Date de publication : 25 mai 2017
ISBN : 978-2-84174-795-5
ISSN : 1281-2463
Référence électronique
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017, « Raymond Ruyer » [En ligne], mis en ligne le 25 mai 2019, consulté le
31 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/philosophiascientiae/1260 ; DOI : https://doi.org/
10.4000/philosophiascientiae.1260
Ce document a été généré automatiquement le 31 mars 2021.
Tous droits réservés
1
SOMMAIRE
Raymond Ruyer
dialogues et confrontations
Introduction
Fabrice Colonna et Fabrice Louis
La finalité-harmonie
André Conrad
Comment Ruyer est-il entré dans la « grande voie naturelle de la philosophie » ?
Benjamin Berger
Comment Ruyer est devenu Ruyer. Entre épistémologie et psycho-biologie
Frédéric Fruteau de Laclos
Ruyer lecteur de Bachelard : réunifier l’image du monde
Fabrice Colonna
Enjeux métaphysiques de la morphogenèse : l’embryologie de Ruyer et la biologie du
développement
Bertrand Vaillant
Ruyer et Wittgenstein : la philosophie comme traduction ou bien comme grammaire
Fabrice Louis
L’intériorité n’est-elle qu’un mythe ?
Jean-Pierre Louis
Varia
Deux textes politiques de Jules Vuillemin
Baptiste Mélès, Julien Borgeon et Raphaël Derobe
Effets moraux de l’accélération de l’histoire
Jules Vuillemin
Sommes-nous libres ?
Jules Vuillemin
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
2
Raymond Ruyer
dialogues et confrontations
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
3
Introduction
Fabrice Colonna et Fabrice Louis
1 Le présent dossier consacré à Raymond Ruyer (1902-1987) s’inscrit dans le contexte
d’une redécouverte de ce penseur français admiré en son temps par plusieurs de ses
pairs, tels que Merleau-Ponty, Canguilhem ou Deleuze, et dans la dynamique de ce
qu’on peut désormais appeler les « études ruyériennes ». Plusieurs revues ont en effet
consacré ces dernières années des numéros au philosophe nancéien : Les Études
philosophiques (n°1/2007), la Revue philosophique de la France et de l’étranger (n°1/2013), et
Critique (n°804, mai 2014). Son maître-ouvrage, Néo-finalisme [Ruyer 1952] a été réédité,
inscrit au programme d’oral de l’agrégation de philosophie (2014), puis traduit en
anglais aux États-Unis [Ruyer 2016]1. Le dernier livre de Ruyer, qui était demeuré
inédit, a été publié à titre posthume : L’Embryogenèse du monde et le Dieu silencieux [Ruyer
2013]. Des travaux doctoraux, dont on trouvera des résultats dans les pages de ce
numéro, se font jour également.
2 Philosophia Scientiæ vient aujourd’hui proposer une nouvelle série d’analyses au sujet de
l’œuvre foisonnante d’un auteur qui défendait l’idée d’une « philosophie unie à la
science ». Toutefois, on se doit d’emblée de prévenir un malentendu. La philosophie
que Ruyer entend développer ne se laisse pas penser sur le modèle de l’épistémologie,
elle ne veut pas être une étude des procédures de la science, quoique certains de ses
moments ne soient pas dépourvus d’implications théoriques dans ce domaine. En
réalité, la philosophie telle que la conçoit Ruyer est d’une part une manière de rappeler
constamment à la science qu’elle ne doit pas prendre prétexte de ses résultats pour
basculer dans une forme d’idéologie réductionniste ou scientiste, et elle est d’autre part
une tentative de proposer une vision unifiée du monde qui intègre les résultats
nécessairement éclatés des savoirs positifs. Autrement dit, il s’agit pour Ruyer, comme
avant lui pour Bergson et Whitehead, de faire la métaphysique qui correspond à la
science de son temps. Sa pensée se laisse caractériser comme un monisme spiritualiste,
un panpsychisme dans la lignée de Leibniz, qui a pour ambition d’éviter le vague des
intuitions vitalistes, dont la tradition est riche, en les aiguisant au contact des données
scientifiques les mieux établies. On sait la précision avec laquelle Ruyer a discuté les
présupposés de l’embryologie et de la biologie moléculaire, de la théorie néo-
darwinienne de la sélection, de la cybernétique, de la physique quantique, des
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
4
neurosciences, montrant chaque fois la leçon que le philosophe devait retenir de ces
explorations inédites du réel et critiquant simultanément les interprétations hâtives
que les scientifiques, tentés de se porter au-delà de leurs résultats, en tiraient trop
souvent.
3 En ce sens, et selon un motif récurrent dans sa pensée, Ruyer procède à un
« retournement » de la science : ce qu’indiquent en creux les résultats de la science,
c’est un univers dont la consistance est psychique ou sémantique. La philosophie
montre ainsi l’envers du décor du monde étudié par la science, son « versant réel ».
Aussi Ruyer peut-il écrire :
Un panpsychisme tel que celui que nous soutenons est extrêmement proche d’un
matérialisme qui ne dogmatise pas sur l’essence de la matière. [Ruyer 1956, 345]
4 Naturellement une telle affirmation possède un caractère métaphysique ; mais le
matérialisme, de son côté, loin d’être un cadre de pensée inattaquable, apparaît au
contraire, du fait de ses contradictions essentielles, comme la moins soutenable des
métaphysiques. Comment en effet des phénomènes incontestables de finalité, déjà au
plan du symbolisme humain, naîtraient-ils d’un organisme lui-même non finalisé, et
celui-ci à son tour d’un univers matériel ressemblant à un immense jeu de billard ? La
science matérialiste rencontre systématiquement une limite dès qu’il s’agit de penser la
morphogenèse authentique, qui implique finalité et mémoire. Une formation véritable
engage une forme capable de conduire elle-même sa formation, de s’auto-former en se
guidant thématiquement, c’est-à-dire selon un principe de finalité, dont Ruyer
renouvelle la notion au-delà des simplifications héritées de la tradition. Les montages
mécaniques et les résultantes statistiques ne sont pas capables d’une telle auto-
formation. En retrouvant les lignes continues qui relient l’ensemble de ces formes
vraies, Ruyer restitue une vision unitaire du cosmos qui suit au plus près les
descriptions fournies par les différentes sciences.
5 C’est ainsi à une libre appropriation de la science que procède Ruyer. Cette lecture ne
peut certes se tirer de la science comme une déduction nécessaire, mais elle repose sur
une fine argumentation qui consiste à déceler constamment les affirmations
impossibles ou contradictoires des scientifiques qui dogmatisent sur l’essence du réel,
c’est-à-dire qui glissent d’un matérialisme simplement méthodologique, visant à
étudier des mécanismes naturels, à un matérialisme ontologique prétendant rendre
compte de tous les phénomènes de formation. Dans cette volonté argumentative très
caractéristique de sa pensée, les deux mouvements composés du refus anti-scientiste et
de l’unification des résultats scientifiques dans une métaphysique d’ensemble sont
étroitement solidaires. Le premier lève le barrage matérialiste et permet à la
métaphysique, dans un second temps, de compléter la science sans contester aucun de
ses résultats. Cette « philosophie-science », ainsi que Ruyer l’appelle, ne prétend pas
détenir une autre vérité que celle de la science, mais collaborer avec elle à
l’établissement d’une vérité nécessairement une. Une manière originale de faire de la
philosophie se dessine ainsi, dont Ruyer n’a cessé de rappeler par ailleurs qu’elle était
au fond la démarche traditionnelle de la pensée, singulièrement oubliée au vingtième
siècle. Il écrit ainsi :
Micromorphologie, embryologie, étude comparative des instincts ou des cultures,
psychanalyse individuelle et sociale, linguistique, sont aujourd’hui des exemples
typiques d’une science-philosophie de style nouveau, qui évite à la fois l’artifice
d’un mécanisme impensable, et d’une métaphysique qui ne sait prolonger la donnée
immédiate que dans des constructions mythologiques, où le Sujet, l’Objet, l’Ego
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
5
transcendantal, l’En-soi et le Pour-soi, l’Idée et ses avatars, jouent le rôle du Roi et
de la Princesse dans les contes de fées, et où tout se passe dans un « Il était une
fois... » non raccordable au temps et à l’espace de la cosmologie positive. [Ruyer
1957, 9]
6 Dans cette perspective, il a semblé éclairant de se pencher tout d’abord sur le concept
même de finalité, qui est au cœur de la pensée de Ruyer. André Conrad (qui fut l’élève
de Raymond Ruyer à Nancy) analyse ainsi la distinction essentielle que l’auteur de Néo-
finalisme opère entre la finalité-intention, qui renvoie à une conception dualiste
présupposant un agent distinct de son activité, et la finalité-harmonie, dans laquelle le
sujet est inséparable de son activité. La finalité se dit en plusieurs sens et la conscience
claire de ces différences est indispensable à une discussion fructueuse sur le finalisme.
Il en résulte notamment une élimination du préjugé selon lequel la finalité ne serait
concevable que dans le monde humain, comme finalité parlée, qui surgirait de façon
inexplicable sur fond d’un monde matériel et vivant régi par le seul mécanisme. La
solidité de la conception de Ruyer est éprouvée au gré d’une confrontation serrée avec
la pensée de Hume.
7 À partir de là, trois autres ordres de considération ont été développés.
8 Tout d’abord, une attention particulière a été portée à la genèse et à la maturation
progressive de la pensée de Ruyer, c’est-à-dire à la façon dont le philosophe, à partir de
ses premières conceptions « structurales » des années 1930, est parvenu à sa pensée
définitive. Car la pensée de Ruyer n’est pas sortie tout armée de son esprit, il a d’abord
tenté de ressaisir la totalité du réel en termes de structures, selon un relationnisme
généralisé qui a des parentés avec certaines conceptions émergentistes
contemporaines. Pourquoi a-t-il estimé ne pas pouvoir s’en tenir à une telle approche ?
Benjamin Berger montre dans son article comment le mécanisme du jeune Ruyer a été
le matériau qui lui a permis d’évoluer de manière méthodique et d’entrer dans ce qu’il
nommera plus tard la « grande voie naturelle de la philosophie », qui consiste à
« chercher, en l’homme, la trace du mode d’être commun à l’ensemble des
individualités psycho-biologiques ». L’auteur étudie alors avec précision la période des
articles de 1932 jusqu’à ceux de 1935. Cette période couvre en effet « “l’ontologie
transitoire”, forme de “panmécanisme” bâtard où Ruyer voit de la “subjectivité”
partout sans, pour dire les choses brutalement, lui rendre justice nulle part » (p. 32). Au
terme de cette transition, Ruyer adoptera définitivement une conception panpsychiste
du réel.
9 Frédéric Fruteau de Laclos montre à son tour comment « les thèses les plus fortes de
Néo-finalisme sont le résultat d’une évolution lente entamée dès la fin de sa thèse de
doctorat ». Ainsi, Ruyer n’aurait pas été conduit à la métaphysique si la théorie des
structures, inspirée notamment par la relativité einsteinienne, n’avait pas requis son
propre dépassement dans le mouvement même de son approfondissement. La nature de
la conscience exigeait en effet d’être précisée, et le résultat de cet effort fut d’aboutir à
une conception de la conscience-cerveau dont Frédéric Fruteau de Laclos dessine les
traits par une série de comparaisons avec la phénoménologie de Sartre. Mais entre 1938
et 1951, une seconde évolution majeure apparaît : la polarité entre le vital et le
psychique s’inverse. Ruyer accorde désormais une place centrale au vital, à partir
duquel il développe une vision du virtuel que l’auteur analyse en la mettant en regard
de celles de Bergson et de Burloud.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
6
10 Un autre axe d’étude a eu ensuite pour objet de revenir sur la façon dont Ruyer
interprète les résultats de la physique quantique et ceux de la biologie. À cette fin,
l’accent a été mis sur des comparaisons avec d’autres auteurs, issus respectivement de
l’épistémologie française (Bachelard) et de la biologie contemporaine. Fabrice Colonna
expose la façon dont Ruyer, à l’occasion de deux comptes rendus minutieux d’ouvrages
de Bachelard, défend une interprétation panpsychiste des résultats de la
microphysique contemporaine. Selon Ruyer, une telle lecture s’impose à partir des
formulations mêmes de Bachelard, dont il dissèque toutes les subtiles implications.
Cette approche a en outre le mérite de permettre une réunification des deux pans
séparés radicalement par le grand épistémologue français, à savoir celui du concept et
celui de l’image. Ruyer réconcilie en quelque sorte Bachelard avec lui-même, dans une
vision métaphysique unitaire du réel.
11 Ruyer ayant consacré une part importante de son œuvre à une analyse critique des
explications matérialistes et réductionnistes du vivant, il était important de poser la
question de sa pertinence eu égard aux nouvelles données issues de la biologie la plus
récente. Les idées de Ruyer sont-elles rendues caduques par la science actuelle du
vivant ? C’est à cette interrogation que le travail de Bertrand Vaillant vient apporter
une réponse nuancée. Trois problèmes sont examinés. Tout d’abord, celui de
l’explication des phénomènes biologiques par des facteurs uniquement génétiques ;
ensuite, celui de la coordination cellulaire qui a lieu dans la morphogenèse de
l’individu ; enfin, celui du type de causalité, seulement ascendante, ou également et
primordialement descendante, que l’on doit admettre en biologie. Or, les vues de Ruyer,
qu’il s’agisse de ses critiques du préformationnisme « génocentrique », de ses
remarques sur l’écart qui subsiste entre l’ambition affichée du réductionnisme et ses
résultats effectifs, ou encore de ses analyses sur la causalité en biologie, demeurent
d’une grande actualité et apparaissent comme en partie détachables de leurs postulats
métaphysiques les plus audacieux.
12 Un dernier angle d’approche au sein du présent ensemble a fait dialoguer Ruyer avec la
philosophie analytique et la philosophie de l’esprit, représentées ici respectivement par
Wittgenstein et Daniel Dennett.
13 Fabrice Louis compare la démarche philosophique de Ruyer à celle de Wittgenstein.
Quand le premier déclare faire œuvre de traduction pour rendre compte de l’ontologie
du monde, le second s’évertue à dissiper les mythes en philosophie grâce à une
grammaire de nos concepts. Dans les deux cas, il s’agit de résister à une tentation forte
en philosophie : s’en tenir strictement à la science pour ce qui est des conclusions à
tirer ou de la méthode à suivre. Mais Ruyer réfute l’idée selon laquelle le problème de
l’intériorité disparaîtrait en reconstituant de manière correcte le puzzle logique de
l’étude de l’esprit. Fabrice Louis tente de montrer que Ruyer réussit, d’un même geste, à
produire une grammaire rigoureuse ontologique (celle des formes) sans renier la
dimension métaphorique de son analyse. Cette dualité le conduit à accepter et non à
rejeter comme point de départ de son étude un mythe utile : celui de l’intériorité.
14 Le texte de Jean-Pierre Louis (qui fut lui aussi un élève de Ruyer) propose une lecture
ruyérienne de la critique du dualisme cartésien menée par Daniel Dennett et par
Wittgenstein. Il montre qu’on peut refuser l’existence d’un pur sujet cartésien sans
pour autant, comme le fait Dennett, réduire l’expérience phénoménale à l’état cérébral
connu par le neurologue, et sans davantage concéder à Wittgenstein que l’abîme entre
le cerveau et la pensée ne résulte que d’une erreur grammaticale. L’intériorité n’est pas
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
7
un mythe dont on puisse se débarrasser par une analyse du langage. La distinction
entre le langage des causes et le langage des raisons trouve alors son explication et sa
source dans la distinction faite par Ruyer entre le cerveau phénoménal et le cerveau
comme surface absolue. La conception moniste non matérialiste de Ruyer permet
d’abandonner le dualisme cartésien sans faire disparaître le problème de la conscience.
15 Toutes les études présentées ici ont voulu mettre le plus possible Ruyer en dialogue et
en confrontation avec d’autres figures de la pensée, qu’il s’agisse d’auteurs cités par
Ruyer lui-même, anciens ou contemporains, ou bien d’auteurs postérieurs à lui. Deux
conclusions s’imposent à la lumière de ces restitutions et de ces reconstructions. D’une
part, Ruyer n’est pas un philosophe isolé, une singularité étrange dans le champ
philosophique : la possibilité même de ces comparaisons et de ces débats montre
combien il parle une langue puissante et cohérente qui le rend à même de nourrir le
dialogue de la pensée qui est constitutif de la philosophie. D’autre part, on appréciera la
façon dont les discussions menées par Ruyer lui-même ou prolongées par ses
commentateurs ont le pouvoir de faire apparaître avec une grande clarté les
présupposés de ses interlocuteurs autant que les siens. Qu’on soit convaincu ou non en
dernière instance par les analyses de Ruyer, on en ressort toujours enrichi d’une
perception plus aiguë du problème examiné et des enjeux théoriques qu’il recouvre,
c’est-à-dire au fond mieux orienté dans sa propre pensée. C’est le bien que lègue tout
grand philosophe à ses lecteurs.
BIBLIOGRAPHIE
RUYER, Raymond [1952], Néo-finalisme, Métaphysiques, Paris : PUF, 2 éd., Préface de F. Colonna,
2012.
RUYER, Raymond [1956], Les postulats du sélectionnisme, Revue Philosophique de la France et de
l’étranger, 146, 318–353.
RUYER, Raymond [1957], La philosophie unie à la science, Encyclopédie française, XIX, 6–10.
RUYER, Raymond [2013], L’Embryogenèse du monde et le Dieu silencieux, Continents philosophiques,
Paris : Klincksieck, texte établi, présenté et annoté par F. Colonna.
RUYER, Raymond [2016], Neofinalism, Minneapolis; London: University of Minnesota Press, trad.
A. Edlebi.
NOTES
1. Une traduction en anglais de La Genèse des formes vivantes est annoncée pour l’automne 2017 :
The Genesis of Living Forms, trad. Nicholas B. de Weydenthal, Lanham, Rowman & Littlefield.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
8
AUTEURS
FABRICE COLONNA
Nanterre, Académie de Versailles (France)
FABRICE LOUIS
Département de Philosophie – Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie, Archives
Henri-Poincaré, Université de Lorraine, CNRS, Nancy (France)
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
9
La finalité-harmonie
André Conrad
1 Ruyer a distingué une « finalité-harmonie » d’une « finalité-intention » afin de refuser
une alternative, celle qui ne laisse comme seul choix pour expliquer l’origine de l’ordre
naturel que de se prononcer soit pour l’argument du dessein, soit pour la fécondité du
hasard. Il a parfois formulé cette alternative comme un choix entre un mythe et une
absurdité, auquel cas il faudrait préférer le mythe. L’absurdité consiste à croire le
hasard fécond alors qu’il ne vaut que capté par une conscience. Le mythe consiste à
séparer l’intention de l’activité, à en faire un précédent de l’activité organisatrice, en la
concevant comme idée conçue par un sujet, idée comprise elle-même comme moyen en
vue d’un but, ce qui n’est qu’une vue artificialiste de l’activité finaliste. Vue
mythologique qui est la finalité « parlée », c’est-à-dire la finalité qui s’explique à elle-
même, et substantialise par là les éléments de son analyse : le sujet, l’idée, le but,
l’organisation. Autrement dit, soit la matière s’ordonne d’elle-même, soit elle est mise
en ordre par un esprit dominant et praeter mundum (pour reprendre le terme de Leibniz
dans le De origine radicali) qui a une idée d’organisation. Émergence ou Dieu
anthropomorphe. Si Ruyer fait de Hume un interlocuteur si utile, c’est bien parce que
celui-ci a refusé d’une façon sceptique cette même alternative, par un argument décisif
concernant la finalité-intention : si la matière est mise en ordre par un esprit, il faudra
encore donner des causes à la mise en ordre des idées de cet esprit, et comme on est
conduit à répéter cette exigence indéfiniment, cette recherche est vaine. Il est donc
économe, puisque l’on finira tôt ou tard par s’arrêter à une mise en ordre sans raison, à
un pur « fiat ! », de décréter que la matière se met en ordre sans qu’un esprit
intervienne.
2 L’harmonie est une notion esthétique qui désigne la qualité des rapports des parties
d’un tout, particulièrement déclinée en musique avec la notion d’accord et en arts
plastiques avec celle de proportion. Atteindre une harmonie c’est réussir des rapports
tels que le tout soit expressif d’un thème, ou tels que rien ne manque ou qu’il n’y ait
rien de trop. L’usage analogique par Ruyer de cette notion insiste sur le « manque » à
combler, sur l’appel ou la pression d’une configuration donnée « vers » ce qui la
complètera, et il rapproche en cela l’harmonie esthétique des tableaux matriciels, ou
des jeux de mots-croisés. On pourrait parler donc d’une expressivité thématique, non
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
10
comme un état mais comme une activité par laquelle un sens prend forme. C’est en cela
que les êtres sont des activités harmoniques. Trois domaines scientifiques,
l’embryologie (son caractère épigénétique), la science du cerveau (son
équipotentialité), l’éthologie (le thématisme des instincts, le mimétisme), étayent cette
théorie qui ne paraît audacieuse que relativement aux schémas d’une science mécaniste
qui a formé, pour Ruyer, une parenthèse de trois siècles fermée par les découvertes de
la physique contemporaine. Pour éviter tout malentendu, il faut insister sur le
caractère d’activité, et éviter l’erreur de séparer le thème exprimé de son expression.
Ou bien, il faut garder le plus possible à ce dernier mot son sens actif : tels rapports
incarnent une idée, une couleur (dans le sens musical du mot), non parce que l’idée
précède, mais parce qu’elle conduit par un dynamisme particulier que l’activité
explicite, tel achèvement. Bergson a donné de cette activité de multiples exemples dans
sa conférence sur l’« effort intellectuel » (mémoration, imitation, interprétation,
apprentissage d’un geste de danse, etc.), en distinguant « schéma dynamique » (qui
conduit l’effort) et « image » (fruit de l’effort), de telle façon que le « schéma » est
irréductible à un « résumé », ou à un abstrait, mais garde toujours le statut d’un
potentiel. Enfin, Ruyer utilise le terme d’harmonie pour l’opposer à l’« intention ».
L’intention suppose une appropriation antécédente par un sujet de ce qu’il va et veut
faire, selon la conception ordinaire du « projet ». Or, Ruyer considère que le sujet est
inséparable de son activité harmonique, cette activité n’étant pas une activité du sujet
en tant qu’il a cette activité, mais en tant qu’il est l’activité qu’il a, ou en tant que pour
un sujet « avoir » est indissociable d’« être ». D’où la distinction d’une finalité-
harmonie et d’une finalité-intention. Le néo-finalisme ruyérien entend prouver (y
compris en l’étayant par l’observation empirique) la finalité-harmonie, et non la
finalité d’un sujet qui a une idée de ce qu’il va réaliser. Il ne nie pas, évidemment, cette
dernière finalité, mais en fait l’expression seconde d’une finalité primaire qui s’étend à
tout le monde naturel. Il réalise ainsi un « épiphénoménisme renversé » [Ruyer 1937, 2],
où l’activité consciente n’émerge pas d’actions matérielles, selon un physicalisme
(réducteur ou pas), mais où ce qui est considéré depuis la naissance de la science
classique comme physique est déjà le fait d’une subjectivité. La finalité-harmonie
marque-t-elle un réel progrès théorique ? Les mécanistes ne font-ils pas usage eux aussi
de notions aussi étranges que purement verbales telles que « auto-organisation ». Ou, si
l’on anticipe sur la discussion ruyérienne de Hume, peut-on dire de façon pronominale
que les choses s’organisent, ou s’ordonnent ? C’est bien ce que Ruyer va soutenir, lui
aussi, mais en un sens très original, car si les choses s’ordonnent d’elles-mêmes, c’est
qu’elles ne sont pas des « choses ». Pour éclairer cette nouvelle ontologie panpsychiste,
nous passerons par l’argument général selon lequel l’anti-finalisme est contradictoire
et par un résumé de la nature des êtres physiques comme activités harmoniques. Nous
étudierons ensuite l’illusion de la mise en scène de l’activité et la discussion de
l’argument humien.
1 Le paradoxe du physicien (non aristotélicien,
évidemment)
Personne ne croit sérieusement que l’homme conscient soit un robot. Et pourtant,
par une bizarre inconséquence, tout le monde admet les possibilités indéfinies de
l’automatisme pour expliquer la vie et pour expliquer l’homme. [Ruyer 1966, 7]
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
11
3 Quand le ténor se lamente en chantant qu’il est mort, personne ne le croit, puisqu’il
chante. Quand le physicien explique le fonctionnement de son cerveau par des
enchaînements d’effets physico-chimiques, quand l’embryologiste fait de son cerveau le
produit d’un code-script simplement constitué de molécules chimiques agencées dans
l’espace, on ne peut que constater la même « bizarre inconséquence ». Pourquoi une
« inconséquence » ? Pour cette raison que le physicien « explique » et parce
qu’« expliquer », c’est toujours soutenir une proposition comme vraie, et la « vérité »
d’une proposition est bien autre chose que le fait de son énonciation. Aussi les
explications du physicien, selon son intention même de vérité, ne peuvent être des
« produits » de son cerveau, ou, du moins de ce cerveau qu’il décrit scientifiquement
comme « enchaînements d’effets physico-chimiques ». La vérité est une valeur, elle
n’est pas un fait. Si faire c’est réussir, alors le cerveau matériel ne « fait » rien, il a des
« effets » ou « fonctionne ». Le paradoxe du physicien revient à ceci : les propositions
de la physique mécaniste sont incapables de rendre compte de leurs propres
énonciations, ou reviennent à dire qu’elles ne sont ni vraies ni fausses. « Je vous dis
cela, mais n’en croyez rien ». Quand un témoin affirme avoir vu, ce qui importe c’est
qu’il « témoigne ». Il n’utilisera la photographie qu’il a prise que pour confirmer son
témoignage, et là encore il soutiendra qu’il n’y a pas eu trucage.
4 Ce paradoxe fait partie des paradoxes révélateurs d’une erreur, à l’instar des paradoxes
de Zénon qui dénoncent des erreurs sur la conception de l’espace et du temps, plus
précisément les quatre erreurs possibles : la divisibilité indéfinie de l’un et de l’autre, la
formation de l’un et de l’autre à partir d’infinitésimaux. Comme la flèche « vole et ne
vole pas », le penseur mécaniste « pense et ne pense pas », ou « a et n’a pas une
intention de vérité ».
5 Comment se sortir de ce faux pas ? Le plus souvent par le verbalisme, ou pour
détourner le mot d’Henri Michaux (que ce dernier applique aux drogues), par un
« misérable miracle » : émergence ou complexification. Sinon, il reste une sorte de
bricolage confusément emprunté à la science : indéterminisme, solution de continuité
des enchaînements, hasards créateurs parce que sélectionnés sans sélecteur,
affirmation incantatoire d’un « sujet » humain irréductible, libre, et créateur de
valeurs. Ou encore, si l’on ne referme pas, comme le fait Ruyer, la « parenthèse »
kantienne, assigner à la connaissance le seul domaine de l’observable, et dénier à ce
domaine qu’il puisse conduire à une connaissance de ce qui est, ce qui revient à donner
au mot « expliquer » un sens sophistiqué que seuls les philosophes semblent
comprendre.
6 Whitehead a formulé autrement, et selon une ironie magistrale, le même paradoxe :
Les hommes de science animés par l’intention de prouver qu’ils sont dépourvus
d’intention constituent un sujet d’étude intéressant. [Whitehead 2007, 111] 1
7 Ce paradoxe est une invitation explicite à retourner la charge de la preuve. Alors que ce
que l’on appelle la « philosophie de l’esprit » semble se préoccuper de comprendre
comment l’esprit est possible dans une nature déterministe, exhaustivement expliquée
par des causalités de proche en proche, toutes réductibles à un actuel, observable en
droit, Whitehead demande un tout autre effort, inverse : comment comprendre la
nature puisque l’activité intentionnelle existe, et que son existence est ce qui est le
mieux attesté, le mieux connu [notior], puisque même l’effort intellectuel du savant
(matérialiste, par méthode au moins) en est une expression. Réaliste comme
Whitehead, Ruyer ne sépare pas les sciences de la nature des sciences de l’esprit, il
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
12
n’oppose pas deux régimes de connaissance baptisés « explication » et
« compréhension ». Nous ne sommes pas des « enfants trouvés métaphysiques » [Ruyer
1952, 19], nous cherchons à comprendre et à expliquer parce que nous avons un
cerveau. Dès lors, il ne s’agit pas de savoir comment une telle activité peut émerger du
cerveau connu selon un paradigme mécaniste de la neurologie, mais de savoir ce que
peut être ce cerveau pour qu’il ait une telle activité. C’est-à-dire, et c’est là une
différence seulement verbale avec Whitehead, mais chargée de prévenir un
malentendu, ce que peut être ce cerveau pour avoir (et être) une activité selon un sens,
ou selon une fin, ou selon une intention.
8 La solution ruyérienne est une physique radicalement opposée au mécanisme. Elle s’est
placée elle-même dans la tradition initiée par Leibniz, plutôt que dans la tradition
aristotélicienne, pour tenir réellement compte des progrès (provisoires) de la science
dite classique, selon la nécessité de toujours placer le progrès d’une élucidation dans le
dialogue fécond du développement du vrai. C’est pourquoi Ruyer accorde à Leibniz
d’avoir posé les vrais problèmes, comme il accorde aussi à Hume d’avoir su mettre en
question aussi bien la notion de causalité que celle de finalité. Leibniz et Hume sont
contemporains des premiers succès de la science mécaniste, tandis qu’Aristote affronte
une philosophie démocritéenne qui n’a pas la même portée2. Sans entrer dans la genèse
de la philosophie ruyérienne, il suffit de dire que la découverte de la notion de
« domaine absolu » forme la condition ontologique de cette nouvelle physique, comme
cela apparaît avec clarté dans Néo-finalisme où cette notion occupe les chapitres
centraux.
9 Avec les « domaines absolus » le paradoxe change de sens. Au lieu d’être une « erreur »,
une inconséquence, il est un « paradoxe vrai, c’est-à-dire une vérité paradoxale »
[Ruyer 1966, 7]3, clairement identifiée comme paradoxe de la conscience. Pourquoi la
vérité de la conscience nous apparaît-elle de façon inévitablement paradoxale ? Parce
qu’elle vient heurter en nous une conception intentionnelle de la conscience, qui n’est
pas fausse, mais qui est une description non de la conscience mais d’une conscience
particulière grevée d’une illusion originale, celle d’un sujet distinct de ce dont il a
conscience. Il y a, pour Ruyer, le même rapport entre la subjectivité proprement
humaine et la subjectivité en général qu’entre la finalité d’intention et la vraie nature
de la finalité qu’il nomme « finalité-harmonie ». Cette analogie se comprend comme
rapport du secondaire et du primaire. La subjectivité humaine (la conscience seconde,
le pour-soi) émerge bien d’une réalité primaire, elle comporte bien une différence de
nature, mais comment penser cette réalité primaire si la subjectivité humaine peut en
émerger ? Si cette réalité primaire est uniquement matérielle, rien de sensé ne peut en
émerger, pas plus qu’un effet douloureux n’inventera un analgésique. Les choses ne
produisent jamais des personnes. Mais si la réalité primaire est toujours déjà « action
unitaire » (ce qui est un nom possible du domaine absolu ou ce qui lui est « inhérent »)
alors « émerge un pôle actif, qui paraît s’opposer au domaine, passif, et subissant la
mise en ordre selon un sens » [Ruyer 1952, 144].
10 Nous examinerons le sens de la finalité-harmonie. Elle est aussi paradoxale qu’un
clavier qui trouverait les accords justement expressifs des thèmes, sans qu’il soit « mis
à la disposition d’un “sujet”, ou d’un “esprit” distinct qui en serait le pianiste » [Ruyer
1952, 141]. Un clavier-musicien. De ce point de vue « intention, projet, but » ne sont que
ce qui apparaît « dans l’univers du sens commun », dans la mesure même où intention,
projet, but, sont ceux d’un « homme qui nous parle de ce qu’il veut faire demain ». La
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
13
finalité d’intention est discours sur l’activité, finalité « parlée ». En ce sens, elle
participe de l’illusion du sujet de l’activité, ou fait de l’activité, l’activité d’un sujet.
Nous verrons que cette illusion est l’effet polymorphe d’une « mise en scène », un effet
mythologique. Mais cette mise en scène n’est pas qu’une illusion. Un autre concept
ruyérien lui accorde un autre rôle, celui d’une « distanciation » qui exprime, et c’est là
l’originalité de l’homme, un « détachement du potentiel mnémique » maximal [Ruyer
2013, 131-132] par quoi celui-ci passe de « la culture biologique, source de
l’embryogenèse, à une culture surspécifique, surbiologique, qui fait de l’individu une
personne, en participation virtuelle avec un Potentiel, avec une Puissance plus que
répétitive ou imitative, mais créatrice, bref, avec la Source même du monde, avec ce
qu’on appelle communément Dieu ». Ruyer liquide dans la phrase qui suit ce texte
audacieux l’appréhension rationaliste habituelle :
Le fait que l’homme y “croie” ou non n’a philosophiquement aucune importance
[...] tout homme est déiste ou plutôt théomorphiste dans sa pensée ou son
comportement. [Ruyer 2013, 132]
2 La mise en scène
11 Condition ontologique de la finalité, le « domaine absolu » prouve non une finalité-
intention, mais une finalité-harmonie. Car le domaine absolu désigne un existant pour
lequel exister consiste en une « action unitaire ». C’est-à-dire en une action
substantielle de s’assembler, d’unir sa multiplicité selon des accords qui sont autant de
formes, ou plutôt de formations, pour conserver le sens actif de ce dernier mot. Ces
formes, de l’atome à l’homme, actualisent des types, ou des thèmes, comme
l’improvisateur exprime des thèmes, selon une « partition intérieure 4 ». Tout être (vrai,
individué, distingué des « foules » ou des « apparences ») est un effort harmonique et
c’est en cela qu’il est aussi une subjectivité.
12 « Domaine absolu », la formulation est si peu parfaite que le philosophe lui a souvent
substitué d’autres formulations : « surface absolue », « surface-sujet », « survol sans
distance », « présence absolue », « self-enjoyment », « connaissance-texture », « étendue
vraie ». Il a même inventé un procédé typographique, en plaçant une virgule après un
nom d’objet, pour placer en apposition le terme « vue ». Comme si, pour désigner la
perception et non l’objet, un trait d’union ne suffisait pas : non pas « table-vue », mais
« table, vue » ! Cet artifice étrange a une fonction précise : montrer que le perçu n’est
pas un objet, en désamorçant le participe passé, en ôtant l’idée préconçue que ce qui est
une « vue » est vu par un sujet, est « pour » un sujet, est une « donnée », donnée à un
sujet, bref suppose un sujet qui le précède, qu’il soit substantiel ou transcendantal.
Selon l’exemple le plus simple, le champ visuel « “est,vu” sans avoir besoin d’“être vu”
au sens du verbe passif, [... il] est “présent”, dans son absolu, sans être “présenté”. C’est
l’objet qui est vu, ce n’est pas le champ visuel » [Ruyer 1966, 5]. Ruyer n’est jamais dupe
du caractère paradoxal de cette idée. Pour notre sens géométrique, une surface n’est
possible que dans un espace à trois dimensions, aussi Ruyer précise-t-il qu’il s’agit
d’une quasi-surface, dans la mesure où elle n’est pas relative à une dimension
perpendiculaire. D’où vient le paradoxe ? D’une illusion créée par une « mise en
scène ».
13 Cette mise en scène, Ruyer l’a relevée dès sa thèse de 1930, alors même qu’il n’a pas
encore découvert le concept général de subjectivité et qu’il identifie encore les réalités
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
14
physiques et les réalités mentales comme n’étant, les unes et les autres (le cercle de
craie et l’idée de cercle !), que des structures spatiales, ou des formes d’une « géométrie
naturelle ». Elle est fortement soulignée – après l’article décisif « Sur une illusion dans
les théories philosophiques de l’étendue » [Ruyer 1937] – en 1937, dans La Conscience et
le Corps :
C’est [...] notre habitude de la mise en scène de la perception qui nous fait croire
faussement à l’impossibilité, pour l’espace sensible, d’exister par lui-même sans un
Sujet pour rassembler ses points, pour être le centre de convergence de leur
multiplicité. [Ruyer 1937, 55]
14 Nous pensons que la vie mentale requiert un sujet distant de sa perception, nous
formons cette illusion du « sujet » comme étant devant ou au-dessus de « sa »
perception, nous confondons les idées avec des représentations, ou avec des tableaux,
en raison d’une nécessité physique, celle de la distance relative de nos yeux, de notre
corps en vue d’obtenir ou de modifier favorablement la perception. Ce jeu de mise à
distance plus ou moins favorable, ce ressenti de mise au point qui ajoute à la « vue » des
éléments sensitifs auxiliaires, nous le transportons dans ce que nous croyons être
l’intuition sensible elle-même du champ visuel, dans la perception une fois obtenue,
nous croyons faire l’expérience dans la conscience seconde d’un sujet-devant-sa-
perception.
15 Cette illusion revient à confondre le champ visuel (obtenu, non pas le monde devant
nous et hors de nous) avec un objet. Cette confusion fait du sujet un point de
perspective, alors que cela ne vaut que pour la ponctualité du corps. Le corps (la tête,
les yeux) se transforment en un fantôme, en un point de vue éthéré, le « je », au point
de croire que ce « je » hors de l’espace est même la condition d’apparition de l’espace,
sa condition d’unité. Ruyer renversera cet idéalisme en faisant de l’espace (réel, non
partes extra partes) la condition d’existence du « je ». La mise en scène requise pour
obtenir la perception est indûment répétée pour comprendre la perception obtenue,
alors que l’effort d’une attention retrouvée à la perception obtenue nous convaincra
que nous ne sommes pas « devant » notre perception mais seulement devant les objets
perçus. Ce sont ces objets qui sont donnés par la perception, et en aucun cas la
perception n’est une donnée, pas même immédiate, car elle n’est pas donnée du tout,
c’est-à-dire donnée à un sujet séparé qui lui préexisterait. Au contraire, c’est le sujet
qui est donné par la perception. Là où il y a perception, il y a un donné, comme il y a un
ici-maintenant, ou, mieux, une donation.
16 Mais l’argument de la mise en scène comme origine de l’illusion ne vaut pas que pour la
perception, Ruyer l’emploie explicitement dans de nombreuses occasions, pour le
travail, la finalité, l’attention et l’intention. Si le concept de travail n’a pas acquis le
statut qu’il mérite d’un concept métaphysique essentiel c’est à cause de la mise en scène
artificialiste, ou artisanale, ou industrielle, d’une mise en scène où le corps du travailleur
est distinct de ce sur quoi il travaille. L’existentialisme été « dupe de la mise en scène
grossière et quotidienne du travail économique et il a méconnu le caractère tout à fait
fondamental du travail axiologique » [Ruyer 1948, 197]. Ainsi, l’existentialisme a
manqué une « bonne phénoménologie du travail ».
17 On peut d’ailleurs considérer que la métaphysique ruyérienne du travail a plus d’une
parenté avec la phénoménologie de l’effort intellectuel bergsonienne. Car « chose
mentale », le travail, est toujours sur le chemin de l’actualisation d’une norme, « en
vue » d’une réussite. De même tout effort tend à traduire, ou développer un « schéma
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
15
dynamique » en « images ». Le « schéma dynamique » bergsonien est d’ailleurs une
excellente introduction à une notion cruciale de Ruyer, celle de Thème, si l’on
remarque que « la surface absolue » est activité organisatrice selon un thème.
18 De même pour la finalité : « la finalité-intention, la finalité “parlée”, est comme la mise
en scène de la perception [...] une technique secondaire qui ne doit pas être transposée
en nature primaire de la finalité » [Ruyer 1952, 141-142]. Les trois phénoménologies –
de la perception, du travail, de la finalité – doivent identiquement, pour être réussies,
déjouer la mise en scène ou en être assez conscientes pour ne pas opposer le sujet à un
domaine sur lequel il agirait. Il faut « ne pas être dupe de l’appareil mécanique ou social
de l’attention ou de l’intention qui donne un rôle actif au seul “je” actuel » [Ruyer 1970,
175]. Si je peux raconter un souvenir, c’est d’abord que je me souviens. Or en tant que je
me souviens, je suis saisi par un « je » inactuel (un « intemporel » selon [Ellenberger
1947]5), et je suis fasciné par lui, au point que cette activité mémorante est
existentiation d’un « je » autre. Mon « je actuel », celui qui mène le récit, l’interrompt,
considère les effets rhétoriques que le récit peut avoir sur ceux qui l’écoutent, est une
technique auxiliaire, celle du comédien, dont je me passe quand le souvenir
s’abandonne au rêve ou à la rêverie. Ce « je » actuel ne fait pas la remémoration, il en
sort comme un réveil, il est une « sortie de fascination ». Certes, toute conscience est,
en un sens, « réveil » ou « gouvernement » et Alain l’a fortement montré en soutenant
que ce qui n’est pas du tout exprimé n’est pas vécu. Mais la nécessité d’exprimer est
sous-tendue par une conscience primaire exactement comme la formation d’une image
est sous-tendue, guidée, chez Bergson, par un schéma dynamique. Quelle est l’intention
d’un peintre ? Si cette intention contrôle ses gestes comme un bleu d’architecte
contrôle les travaux d’un constructeur, si elle est détachable de l’œuvre en cours de
réalisation, cette œuvre est achevée avant d’être commencée. Le peintre peut formuler
une intention, un thème, par exemple l’opposition entre un centre lumineux et une
périphérie obscure, il peut même lier cette obscurité au thème particulier d’une
présence menaçante, il peut interpréter cette menace (la particulariser plus encore)
comme celle du sommeil de la raison, il peut encore trouver dans des figures
mythologiques des formes propices. Cela est encore « abstrait ». On reste là dans un
discours où l’intention s’analyse en sujet, d’une part (ce que « je » veux faire), et idéal
d’autre part (« ce que » je veux faire). Cette analyse est une observation de soi, et reste
dynamiquement impuissante. Pour qu’il y ait action réellement intentionnelle, il faut
que la subjectivité de l’artiste rejoigne la nature primaire de la finalité de toute action,
non pas la spontanéité pure d’un élan, ou une prétendue nécessité intérieure, mais un
domaine déjà agissant, une première démarche à la fois guidée par un sens et
cherchant à former ce sens qui le guide. En ce sens commencer c’est continuer, ou
comme le dit aussi Alain « délivrer ». En ce sens aussi, l’analogie entre l’épigenèse
embryologique et la naissance d’un tableau, telle qu’elle est montrée dans le film de
Clouzot sur Picasso est éclairante [Clouzot 1955]. Comme l’aire embryonnaire s’organise
thématiquement la toile s’organise, et subit parfois des réorganisations massives
surprenantes. L’artifice du cinéaste, qui fait croire que le tableau se fait sans peintre est
une correction de l’illusion de la mise en scène pour laquelle Picasso est « devant » le
tableau, car si Picasso est bien devant sa toile, il n’y a pas devant l’aire cérébrale du
peintre un fantôme de peintre qui dirige des pinceaux. Si l’intention est évidente, ce
n’est pas par la présence physique d’un peintre distinct de la toile, c’est par l’évidence
des progrès du tableau. Des progrès vers un sens de plus en plus précis, vers un
achèvement, autant sensible par la compréhension de plus en plus claire de ce qu’il
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
16
veut faire que par les détours et les repentirs. Sans compter avec un aspect essentiel de
l’intention qui est la valeur même de ce qui est atteint. L’intention est toute action
selon un sens, ou mieux toute action « sensifiante ». La signification est propre à la
parole, elle est commentaire, détachement interstitiel, discours. Et comprendre une
intention, y compris comprendre le discours qui signifie cette intention, c’est encore
interpréter. Nous ne voulons pas dire ainsi que, au sens ordinaire, on est voué à la
subjectivité, ou à des intuitions ineffables. Mais ce que nous avons compris de ce qu’un
philosophe voulait dire n’est pas le seul résumé cohérent de son idée centrale, ou une
formule (« c’est un panpsychisme, un semi-panthéisme, etc. »). Comme la finalité-
intention est une finalité parlée, la métaphysique elle-même tombe sous le coup de la
prudence qu’il faut garder avec la part fictive (relationnelle, dialoguale) de tout
discours. La meilleure élucidation d’une intention (pratique ou spéculative) c’est
l’action : l’œuvre elle-même. Ce qui est fait, compte tenu de toutes les dimensions de ce
qui est fait, de toutes ses résonances.
19 Ainsi, La Genèse des formes vivantes s’achève sur ces vers de D. H. Lawrence :
Even an artist knows that his work was never in his mind. He could never have
thought it before it happened. [...] Even the mind of God can only imagine Those
things that have become themselves. [Ruyer 1958, 262-263]
20 Si tout réel est invention, celle-ci est inanalysable, et la meilleure phénoménologie ne
peut, puisqu’elle parle, que décomposer, et à tort, « thème pur » et « forme pure »,
schéma et image, intemporel et actuel, alors que séparés ce ne sont que des « ombres »
[Ruyer 1958, 262-263].
3 Ruyer et Hume
21 Ruyer préfère, pour penser la finalité, Platon à Leibniz. Alors même que le Timée expose
ce qu’est la finalité-intention, Ruyer juge cet exposé plus proche du vrai que le pseudo
finalisme leibnizien. D’autre part, il ose assimiler Leibniz (De l’origine radicale des choses)
à Hume (Dialogues sur la religion naturelle), alors même que ce dernier critique la finalité
conçue comme compréhension de l’action de Dieu, selon le fameux argument du
dessein :
Il n’y a pas loin de la conception de Leibniz à celle de Hume. [Ruyer 1952, 143]
22 Platon, selon Ruyer, expose mythiquement la finalité, et Ruyer a toujours préféré un
mythe à une absurdité. Il restera fidèle aux « interminables réflexions, semi-
sentimentales » de son adolescence, en particulier à la méditation sur le vol de la graine
d’érable :
Je ne pouvais croire que des variations de pur hasard avaient façonné ce petit
hélicoptère, ou ce petit autogyre naturel que je tenais dans la paume de la main.
[Ruyer 1985, 217]6
23 Mais nier la créativité du hasard même « naturellement » sélectionné, n’est pas
soutenir l’argument du dessein et Ruyer n’a pas pour la finalité-intention une affection
seulement sentimentale comme le fut celle de Kant. Si « la conception platonicienne est
celle qui implique la meilleure phénoménologie de la finalité », bien supérieure à
Leibniz qui soutient cette finalité et à Hume qui la critique, c’est parce que ce n’est
jamais que de la « phénoménologie ». Cela reste surprenant, car on a parfois
l’impression que déjouer la mise en scène de la perception, de l’intention elle-même,
est, pour Ruyer, possible phénoménologiquement. Il accuse ainsi les existentialistes
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
17
d’avoir manqué une bonne phénoménologie du travail, en le limitant à une action sur
une chose. Il est vrai qu’il accuse les disciples de Husserl d’avoir gardé quelque chose de
ce qu’ils voulaient critiquer, par la formule « toute conscience est conscience de »,
formule qui laisse encore supposer que le sujet est distinct du champ de conscience,
qu’il est « devant » ce champ. Il y a ici une équivoque au sujet de ce que Ruyer entend
par « phénoménologie », car tantôt il en appelle à une meilleure phénoménologie, et
tantôt il détermine les limites de toute phénoménologie.
24 Le « mythe » platonicien opère un double dédoublement : d’une part, le Démiurge agit
sur un monde extérieur à lui, d’autre part il agit selon des Idées séparées de leurs
actualisations. Ruyer laisse ouverte la question de savoir jusqu’à quel point Platon est
sérieux. Il note une tension dans la théologie platonicienne qui fait hésiter le
commentateur sur la nature de Dieu : Démiurge ou Bien ? S’il s’agit du Démiurge, le
platonisme se conforme à une théologie classique, pour le dire sans les nuances qu’il
faudrait ici formuler, car le Dieu créateur « classique » n’est pas un façonneur d’une
matière préexistante, et la création conçue comme relation est loin d’avoir le simplisme
qu’on lui attribue. S’il s’agit du Bien, le platonisme se rapproche fortement du
ruyérisme, encore plus si l’on souligne que le monde des Idées n’est pas, relativement
au Bien, un absolu. Il semble que, pour Ruyer, Platon fait au mieux pour dire quelque
chose de la finalité, et qu’il réserve son opinion ultime. Au mieux, c’est-à-dire en
distinguant optimum et extremum. Car, si on veut éviter de dédoubler sujet actif et idéal-
modèle, on court le risque (que seule la notion de « domaine absolu » permet d’éviter)
de tomber dans une erreur manifeste, où tombent gestaltistes et Leibniz. En effet, les
gestaltistes font des formes des structurations spontanées d’un champ. Ils s’approchent
de la finalité-harmonie : un champ se dispose selon des formes. Mais il manque alors
l’essentiel : que ces formes soient réussies ! Or les « formes » de la Gestalt ne sont pas du
tout des formes ; ce ne sont que des équilibres atteints selon des lois de l’extremum. Le
dynamisme est bien immanent aux choses, mais il ne crée rien, et est incapable d’initier
une organisation. Il faut être bien naïf ou peu scrupuleux pour penser qu’un liquide
chauffé se disposant selon des forces latérales (des poussées a tergo) en hexagones
marque un début d’auto-organisation. Il a fallu à Schrödinger inventer pour
caractériser la vie, de façon purement verbale, le terme de « cristal apériodique ».
Leibniz tombe dans la même erreur, car Ruyer prend au sérieux (à tort ?) l’image de
L’Origine radicale des choses, celle du « poids conjugué d’existence virtuelle des
possibles ». Dès lors (mais pourquoi ne pas lui accorder comme à Platon le bénéfice du
doute ?) : le meilleur des mondes possibles ne peut obéir au principe finaliste du
meilleur ! Ce n’est qu’un dynamisme extrémal, ce n’est pas un finalisme du tout. On voit
que la « valeur » est la note essentielle du concept de finalité, ou de sa « constellation ».
Il faut pour échapper au mythe du dédoublement à la fois une immanence de l’ordre,
une auto-organisation, et une qualité de réussite selon des normes. Le seul dynamisme
conséquent est thématique et axiologique. Il faut donc à la fois un champ qui se connaît
dans sa multiplicité de détails sans point de vue extérieur à lui-même (une
« connaissance-texture » selon une ancienne formulation ruyérienne, distincte de la
« connaissance-correspondance ») et ouvert ou abouché à un monde de valeurs, ce que
Ruyer nommera une transversale métaphysique. Il faut à la fois un espace et un non-
espace, autant dire une étendue qui n’est vraiment étendue que parce qu’elle est la
limite (la « peau » observable pour une subjectivité différente) de ce qui n’est pas
spatial. Il faut, en bref, que tout ici réel soit aussi « ailleurs », selon une ubiquité que
seule une région trans-spatiale permet de comprendre.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
18
25 En somme, dans la création selon Leibniz, Dieu n’y est pour rien, « ne joue aucun rôle ».
Les possibles, en lui, trouvent un point d’équilibre maximal : le monde. Ils prétendent à
être et imposent leur plus grande combinaison. C’est aussi peu crédible que le propos
d’un romancier qui se dit assailli par des personnages qui s’imposeraient à lui ! C’est
bien ainsi que Hume se rapproche de Leibniz, dans sa lecture de l’argument du dessein.
Conformément à l’excellent principe (commun ici à Ruyer et à Hume) qu’il n’y a pas de
régression à l’infini, Hume demande qu’on lui dise quelle est la cause des idées de Dieu,
ou de cet ordre de ses idées, dont le théologien rationnel dit que cet ordre fut la cause
de l’ordre des choses. Il découvre alors la même justification : les idées s’organisent
d’elles-mêmes. Mais il en tire une conséquence opposée : si on se contente de dire cela
on ne voit pas pourquoi on ne se contenterait pas de dire comme un matérialiste (que
Hume n’est pas, puisqu’il est sceptique) que les choses s’organisent elles-mêmes sans
qu’une intelligence ait conçu un rapport des moyens et des fins qui expliquerait
l’organisation. On voit que l’auto-organisation montre ici un verbalisme qui anticipe
tant de discours pompeux sur la production de l’ordre à partir du désordre, tout en
reprenant une très ancienne vision démocritéenne. Si une échelle n’a pas de dernier
degré, ou si son dernier degré de l’explication de l’organisation est « l’auto-
organisation » autant en rester au sol des choses mêmes.
26 Hume, selon Ruyer, ne voit pas « une différence essentielle entre une collection d’objets
posés les uns à côté des autres dans l’espace physique [...] et un ensemble de formes ou
d’idées dans un domaine de survol absolu, entre des objets posés sur une table et la vue
de ces objets posés sur une table » [Ruyer 1952, 143-144]. Jamais des objets sur une table
ne se rangeront d’eux-mêmes ou selon une causalité mécanique. Mais, il suffit que je
regarde ces objets pour que « les objets-idées qui constituent la forme absolue de la
table-vue (ou « table, vue »), se mettent en ordre selon le sens de mon activité
esthétique, théorique, sociale, etc. Comprenons que ces objets-idées sont mon aire
cérébrale réelle, qui est regard sans avoir à être regardée, présence absolue. Nul n’est
besoin (« puéril » selon Ruyer) d’imaginer une sur-conscience, sur-percevante et sur-
voulante. Nul besoin, pour penser l’effort de ranger les objets, d’entrer dans les
méandres indéfinis de la « maîtrise de soi », d’une « strong evaluation » qui imposerait à
ma paresse de ranger. Ma réalité mentale est déjà agissante, déjà ordonnante, sinon il
n’y a pas de réalité mentale du tout. Et elle est agissante selon des ordres de valeur :
plaisir, curiosité, efficacité, importance d’un travail. Toute l’illusion humienne vient
d’une réduction de la conscience à une simple « awareness », à un spectacle pour un
sujet qui aurait à agir. Ou, comme le dit Ruyer, à un « simple éclairage ». Pradines a
bien noté cette confusion en insistant sur le caractère de « mise en faisceau » de la
conscience, et Bergson aussi en en faisant « une mémoire tenue en mains pour des
tâches d’avenir ». Ruyer insiste sur son aspect de système unitaire, qui non seulement
unit des détails de la perception (les livres, les feuilles, les stylos, le cendrier, etc.) mais
les unit aussi sous l’aspect des valeurs (pratiques, hygiéniques, esthétiques...) dans la
réalisation desquelles le sujet est toujours déjà engagé. La perception est, en quelque
sorte, « adverbialisée », la table-vue est vue « esthétiquement », « pragmatiquement »,
« hygiéniquement ». L’adverbe indique l’intention, et aussi le type d’accords qui
s’imposent comme pour un musicien s’impose la note harmoniquement justifiée. Un
champ de conscience est travail harmonique. Les choses ne s’organisent qu’en tant
qu’elles existent comme objets-idées dans ce champ. Si on attribue un rôle au hasard
dans la survenue de l’ordre, le même exemple illustrera que ce hasard ne sera créateur
d’ordre que s’il est « capté » dans ce champ de travail harmonique : un courant d’air
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
19
peut remettre des feuilles imprimées dans l’ordre, mais c’est à la condition que
l’homme qui voit ces feuilles apprécie ce « rangement », le voit comme « rangement »
et aille au plus vite fermer la fenêtre, avant que le même courant d’air défasse cette
« réussite », exactement comme le singe dactylographe peut rédiger l’œuvre complète
de Victor Hugo (et signer par le même hasard « Victor Hugo ») à condition qu’un
spectateur mette de côté toutes ses réussites partielles conformes :
Des fluctuations pures ne peuvent jamais par elles-mêmes créer d’organisation,
d’information. Il faut qu’elles soient, sinon toujours attendues et captées l’une après
l’autre par un être consistant extérieur aux fluctuations – comme dans la sélection
artificielle – du moins toujours maintenues selon une auto-consistance, qu’il faudra
essayer de définir. [Ruyer 1956, 326]
27 Le lecteur ruyérien reconnaîtra dans ce « maintien » l’activité structurante des
domaines absolus. Il n’importe pas qu’une machine remplace d’ailleurs ce spectateur,
car il faudra bien s’arrêter là aussi à celui qui a construit cette machine. L’efficacité
causale réelle (formatrice et non destructrice) est donc toujours le fait d’un champ
d’activité thématique et axiologique.
28 On voit que Ruyer est indifférent au pathos de la faiblesse de la volonté, ou aux
problèmes de la maîtrise de soi. Le rapprochement avec la théorie de l’effort de
W. James peut être éclairant. W. James dit que l’effort consiste à penser. Il ne s’agit pas
de se vaincre, mais de tourner sa pensée vers telle ou telle chose et l’action suit, sans
lutte où seraient également présents à la conscience deux désirs en conflit. Et changer
de pensée est une disposition qui est dans toute pensée, sous la condition cependant
bien restrictive d’une éducation formatrice de bonnes habitudes7. De même que je peux
regarder une photographie pour observer les traits d’un homme, je peux regarder cette
photographie pour examiner si l’appareil photographique a bien fonctionné. Dans les
deux cas, je suis extérieur à la photographie. Dans La Conscience et le Corps, Ruyer prend
cet exemple pour faire remarquer que je peux m’informer sur un objet par le moyen de
mon champ visuel, et je peux (« attention inspective » de Broad) examiner mon champ
visuel pour vérifier le bon état de ma vue. Dans ce cas je ne suis pas plus extérieur à
mon champ visuel, en explorant ses détails comme informations sur l’objet, qu’en
explorant des détails révélateurs d’un défaut de vision. Ce qui change, selon, Ruyer,
c’est « la direction de ma pensée abstraite, le schéma intellectuel ou la “configuration”
qui organise ma sensation » [Ruyer 1937, 56]. Ranger parce que le travail est devenu
plus difficile quand les livres s’empilent en désordre, ou ne pas ranger par paresse, ou
par une lubie esthétique qui apprécie un désordre relatif, c’est changer de sens de
l’activité, et non pas mettre du sens là où il n’y en a pas.
4 La distanciation
29 Redonnons la parole à Hume, cette fois dans un dialogue imaginaire. Ruyer a sans doute
raison de montrer la différence essentielle entre des objets (des inertes) et des objets-
vus. Les objets-vus ne sont pas vus, ils ne sont pas un domaine passif sur lequel un
éclairage se poserait. Ils sont liés dans un domaine qui est une action unitaire, qui est en
action. Et cette action est comme toute action vraie, selon un sens, et non pas action
d’un sujet mais action par laquelle un sujet est possible. Cela est étrange et touche le
paradoxe de Lequier (« faire et en faisant se faire »), car cela inverse le rapport
traditionnel de la substance et des attributs, ou crée le concept peu commun de
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
20
substances qui sont des actions. Il reste à comprendre par quelle cause l’effort est
possible s’il est changement de pensée.
30 Dans le champ visuel de l’oiseau paradisier, il y a, quand il se prépare à danser pour
attirer une femelle, une aire nettoyée dans la clairière d’une forêt. Si des enfants, par
jeu, pour déranger l’oiseau disposent des objets sur cette aire, l’oiseau les retire. Bref,
les animaux rangent aussi, de façon quasi obsessionnelle. Il n’y a pas seulement
probabilité, il y a certitude que, saisi par son activité de séduction, l’oiseau fasse le
ménage. D’où cette question : en est-il de même pour l’homme ? Ce piège d’illusion
qu’est la mise en scène de la perception, de l’attention, de l’intention, du travail, ne
joue-t-il pas aussi un rôle de mise à distance autant positif que négatif, qui fait qu’en se
détachant de sa perception, l’homme est, lui, libre de ranger ou de ne pas ranger, même
ce qu’il pense devoir être rangé ? Les animaux ne semblent pas pris par l’illusion du
sujet, mais n’est-ce pas pour cela aussi qu’ils sont si prévisibles que l’homme les piège
facilement ?
31 Des éléments de réponse se trouvent dans un chapitre essentiel de L’Animal, l’Homme, la
Fonction symbolique [Ruyer 1964], le chapitre XI sur la distance psychique,
caractéristique de l’homme. Cette distance conduit à une tout autre mise en scène,
cette fois théâtrale des situations humaines, mise en scène dans laquelle « le drame réel
vécu est transfiguré ». Cette mise en scène a pour condition une déprise des situations
qui ne serait pas possible sans ce que Ruyer persiste à appeler une illusion du sujet.
Mais c’est le texte que nous avons cité au début de cet article, extrait du dernier livre
de Ruyer [Ruyer 2013] qui permet d’approcher une solution de cette difficile question.
Saint Augustin justifie la création par cette « intention » : ut initium esset. Ce qui émerge
ce n’est pas l’ordre du désordre, le biologique du physique, le psychologique du
biologique, le spirituel du biologique, mais un rapport à la totalité (le Monde) d’un
rapport à des conditions particulières d’existence (des milieux). Il y a beaucoup
d’illusions dans le sentiment de liberté, dit Ruyer dans ce même passage. Mais ce
sentiment n’est pas totalement illusoire, et reste inséparable de la description de
l’intentionnalité. L’homme seul est détaché de son potentiel mnémique. Ce que les
existentialistes décrivent comme déréliction et qui est ici une disponibilité qui ouvre
l’individu et le fait accéder à la personnalité, conçue comme relation à la totalité et non
comme vaine appropriation de soi. L’aspect remarquable de cette thèse est le rôle
dévolu à la culture. Celle-ci est parfois comprise comme particularisante, et opposée au
caractère universel de ce qui est naturel, et par là conçue aussi comme limites
conventionnelles, voire arbitraires. Ici le rapport s’inverse : la nature est une première
culture, faite de possessions mnémiques, et la culture ouvre cette culture naturelle à
une véritable universalité.
5 Conclusion
32 Nous avons voulu montrer comment pour arrêter la régression indéfinie des causes il
fallait aboutir à une finalité-harmonie. Celle-ci est primaire par rapport à la finalité-
intention, parce que les êtres vrais, individués, sont des domaines absolus. Il n’y a
domaine, ou réalité domaniale que si une multiplicité est unie, en ce sens tout domaine
est cultivé, il est un effet de culture. Ou mieux, une activité culturelle, une activité
structurante. Un domaine est paradoxalement absolu parce qu’il se possède sans
possesseur distinct de lui. Le possesseur, le dominus du domaine est existencié par le
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
21
domaine, il en sort ou croit en sortir. Pour assentir à ce paradoxe il faut déjouer une
illusion fondamentale qui est suggérée par la mise en scène. Celle-ci est une technique
auxiliaire aussi vitale que trompeuse. Mais nous avons voulu au moins suggérer que
cette mise en scène est aussi ce qui permet, ou indique, une distanciation qui n’est pas un
exil ou une déréliction mais un détachement de toutes les activités culturelles
(typiques, spécifiques) qui font l’ordre de la nature. Ce détachement rend possible la
symbolisation par quoi la personne se forme en tant qu’elle n’est pas une crispation
individualisante, un accaparement, mais une relation créatrice avec la Source de toute
création8.
BIBLIOGRAPHIE
CLOUZOT, Henri-Georges [1955], Le Mystère Picasso, Paris : Arte.
ELLENBERGER, François [1947], Le Mystère de la mémoire, l’intemporel psychologique, Genève : Éditions
du Mont-Blanc.
RUYER, Raymond [1937], La Conscience et le Corps, Paris : Félix Alcan.
RUYER, Raymond [1948], Le domaine naturel du trans-spatial, Bulletin de la société française de
philosophie, 42, Séance du 31 janvier 1948(5), 133–165.
RUYER, Raymond [1952], Néo-finalisme, Métaphysiques, Paris : PUF, 2 éd., Préface de F. Colonna,
2012.
RUYER, Raymond [1956], Les postulats du sélectionnisme, Revue Philosophique de la France et de
l’étranger, 146, 318–353.
RUYER, Raymond [1958], La Genèse des formes vivantes, Bibliothèque de philosophie scientifique,
Paris : Flammarion.
RUYER, Raymond [1964], L’Animal, l’Homme, la Fonction symbolique, Paris : Gallimard.
RUYER, Raymond [1966], Paradoxes de la conscience et limites de l’automatisme, Paris : Albin Michel.
RUYER, Raymond [1970], « Le petit chat est-il mort ? », ou trois types d’idéalisme, Revue
philosophique de la France et de l’étranger, 160, 121–134.
RUYER, Raymond [1985], Souvenirs. 1 : Ma famille alsacienne et ma valleée vosgienne, Houdemont-
Heillecourt : Vent d’Est.
RUYER, Raymond [2013], L’Embryogenèse du monde et le Dieu silencieux, Continents philosophiques,
Paris : Klincksieck, texte établi présenté et annoté par F. Colonna.
SIRON, Jacques [2015], La Partition intérieure, Paris : Outre Mesure, 9 éd.
WHITEHEAD, Alfred North [2007], La Fonction de la raison et autres essais, Petite Bibliothèque, Payot,
première édition de la traduction : 1969. L’ouvrage groupe trois conférences prononcées par
Whitehead en 1927, 1929 et 1934.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
22
NOTES
1. La Fonction de la raison [Whitehead 2007], dont ce passage est extrait, est une conférence de
1929, et Ruyer traduit différemment, puisque dans Néo-finalisme il substitue le mot « fin» au mot
« intention» : « L’argument de Whitehead : “il est absurde de d’avoir pour fin de prouver qu’il n’y
a pas de finalité”, ne paraît pas aussi décisif que celui dont nous sommes partis : “Il est absurde
de prétendre, de signifier, que rien n’a de sens”, bien que les deux arguments soient
naturellement équivalents» [Ruyer 1952, 12-13].
2. Mais dont le sens est, selon Ruyer, plus subtil qu’une simpliste et pure fécondité du hasard (cf.
la note 1 du chapitre consacré à la critique de la sélection naturelle, dans Néo-finalisme [Ruyer
1952, 193]).
3. Ruyer qualifie « vrai» ou « faux» les paradoxes, selon qu’ils renseignent sur une erreur (Zénon,
Epiménide) ou sur une vérité (« surface absolue», « faire et en faisant se faire»).
4. L’expression est du saxophoniste Jean-Louis Chautemps et a donné le titre d’une somme sur
l’improvisation en jazz [Siron 2015].
5. La possession par un intemporel (larve, fascination) décrite avec minutie par Ellenberger, dans
le souvenir ou la rêverie, illustre aussi le « travail» bergsonien du schéma dynamique.
6. Ce n’est que 90 ans après cette méditation dans la cour du lycée d’Epinal qu’un savant
hollandais exposera comment la forme de la graine d’érable « convient» à une excellente
stratégie de dissémination, en mettant en évidence un courant d’air ascendant, un vortex
s’appuyant sur le bord de l’aile de la graine et ralentissant sa chute en la transformant en
parabole.
7. Ces bonnes habitudes consistent, en somme, à pouvoir s’échapper des habitudes par une
habitude de perfectionnement. La réponse ruyérienne à ce problème est, si l’on ose dire,
« expéditive» : « Dieu, ou la nature, donne à tous les êtres l’instinct ou le vif sentiment
d’obligation de se réaliser» [Ruyer 1970, 205].
8. On peut rapprocher cela des trois mondes de K. Popper, ouverts l’un à l’autre, en notant que le
monde « spirituel» est, pour Popper, « essentiellement» ouvert.
RÉSUMÉS
Ruyer démontre qu’une finalité-harmonie œuvre dans la formation des êtres physiques. Cette
finalité contredit le mécanisme, et se distingue de la finalité-intention qui est la finalité parlée.
Cette dernière est seconde et dépend d’une illusion d’un sujet de l’activité, posé devant celle-ci,
illusion inévitable pour la raison pragmatique d’une mise en scène de l’activité. Contre Hume,
Ruyer montre que les êtres s’organisent en effet, mais en tant qu’ils sont des subjectivités, des
« domaines absolus » constamment actifs, prenant forme selon des types, des essences ou des
thèmes, selon un dynamisme harmonique dont l’analogue est donné dans la formation d’une
improvisation musicale ou dans la création d’un tableau.
Ruyer demonstrates that a harmony-finality [finalité-harmonie] is at work in the formation of
physical beings. This finality contradicts mechanisms, and distinguishes itself from the
intention-finality [finalité-intention], which is only a way of speaking about finality. The latter is
secondary and depends on an illusion of a subject of activity, which is set in front of it. This
illusion is inevitable for the pragmatic reason that the activity is staged [mise en scène]. Against
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
23
Hume, Ruyer shows that beings are indeed organizing, but insofar as they are subjectivities—
constantly active “absolute domains” that take form according to types, essences or themes, in
accordance with a harmonious dynamism, analogous to the formation of a musical improvisation
or the creation of a painting.
AUTEUR
ANDRÉ CONRAD
Nancy (France)
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
24
Comment Ruyer est-il entré dans la
« grande voie naturelle de la
philosophie » ?
How Did Ruyer Find the “Great Natural Way of Philosophy”?
Benjamin Berger
1 Du « panmécanisme » au panpsychisme
1 En 1930, dans l’Esquisse d’une philosophie de la structure [Ruyer 1930], Ruyer élabore une
ontologie mécaniste aux visées hégémoniques1 : tout doit pouvoir être expliqué en
termes de structures mécaniques, y compris l’acte d’expliquer [Ruyer 1930, 211].
Connaître, c’est vivre un certain système de liaisons organiques, être celui qui
caractérise notre cerveau et son rapport à l’extériorité. Les liaisons mécaniques grâce
auxquelles fonctionne notre cerveau l’incluent dans le régime ontologique commun à
l’ensemble des formes comprises dans l’espace-temps. Nos idées sont à notre cerveau ce
que les feuilles sont aux arbres [Ruyer 1932-1933, 147]. Pareil rapprochement, s’il
évoque la dendrolâtrie de Ruyer [Vax & Wunenberger 1995, 331], illustre d’abord un
projet : abolir le partage ontologique de la matière et de l’esprit au profit du monisme
mécaniste. C’est dans cette perspective, située aux antipodes de l’idéalisme et de
l’humanisme, que Ruyer peut écrire de la science qu’elle est une « sorte de phénomène
de “duplication imparfaite du monde”, qu’un naturaliste stellaire comparerait peut-
être au mimétisme étrange de certains papillons2 » [Ruyer 1934-1935, 50]. La
connaissance n’est pas autre chose que la nature se redoublant dans un langage
symbolique, physico-mathématique.
2 Le Ruyer du « panmécanisme » des débuts ne nous est pas aussi familier que celui du
Néo-finalisme [Ruyer 1952]. Le finalisme, Dieu, les thèmes trans-spatiaux : autant de
concepts majeurs des œuvres de la maturité dont le caractère métaphysique tranche
avec le cadre théorique des textes de la première moitié des années 1930, où Ruyer
nous assure qu’il n’y a de réalités que physiques. Dans les œuvres phares, la distinction
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
25
du mécanisme et du matérialisme réductionniste – mise en avant dans l’Esquisse [Ruyer
1930, 42-43] – vole en éclats ; œuvres où Ruyer élabore pas à pas son panpsychisme. S’il
est arrivé à Ruyer de revendiquer explicitement l’héritage du panpsychisme leibnizien
[Ruyer 2013, 123-149], remarquons qu’il a également pris ses distances avec lui [Ruyer
1952, 88]. Aucune contradiction cependant : héritier du panpsychisme, Ruyer l’est
incontestablement dès lors qu’il identifie la conscience et la vie – conscience non
réflexive, « primaire », absorbée dans un « faire » et non dans un « voir » ou un
« connaître ». Tandis que s’il est un hérétique au sein du panpsychisme, c’est parce qu’il
condamne l’idée d’une différence de degré entre les consciences. La conscience
« primaire », organique, n’est pas plus diffuse, moins compétente, que notre conscience
perceptive et réflexive. L’amibe et l’embryon résolvent efficacement les problèmes
qu’ils affrontent. Ce point mis à part – le rejet d’une hiérarchie qualitative des
consciences – ce n’est pas trahir Ruyer que de le compter parmi les « panpsychistes ».
3 Le Ruyer « panpsychiste » n’est pas le négatif photographique du Ruyer
« panmécaniste ». Le rejet d’un pluralisme ontologique apparaît comme la ligne de
force commune de ces deux modèles a priori antagonistes.
Il y a de grands contrastes dans l’univers, mais pas de disparates, qui en feraient un
“multivers”. [Ruyer 2013, 121]
4 De même, Ruyer est toujours resté fidèle à son aversion pour la philosophie « idéaliste »
– dont il rejoue, inlassablement, le procès. À cet égard, les pages qu’il consacre à
critiquer certaines positions qu’a développées Merleau-Ponty sur la vie [Ruyer 1952,
235-238] et sur la cosmologie scientifique [Ruyer 1966, 111-112] font écho à celles de
l’Esquisse dans lesquelles il attaquait sévèrement l’idée brunschvicgienne de « réflexion
constitutive3 » [Ruyer 1930, 296-297]. Remarquons que si Quentin Meillassoux s’est fait
fort de mettre en exergue une certaine proximité du corrélationnisme et du
créationnisme [Meillassoux 2006, 36], Ruyer s’autorisait déjà, un demi-siècle plus tôt, à
rapprocher – certes allusivement – la perplexité affichée par Merleau-Ponty devant la
cosmologie laplacienne du discours créationniste [Ruyer 1966, 112]. Ruyer n’eut de
cesse de récuser les théories philosophiques défendant l’annexion de l’être du réel à la
conscience du sujet le visant. Le mode d’être de la réalité ne se constitue pas du fait que
je me l’approprie [Ruyer 1931, 85], [Ruyer 1934-1935, 36]. Cette certitude, qui
caractérise son « réalisme », ne fut jamais abandonnée par Ruyer.
5 Notre problème se formule ainsi : pourquoi Ruyer a-t-il abandonné son
« panmécanisme » pour adopter un panpsychisme ? Faut-il se contenter de la réponse
d’après laquelle Ruyer, échouant à penser la vie au moyen du « panmécanisme », se
serait finalement détourné de ce dernier4 ? Nous croyons plutôt que son
« panmécanisme » a initié Ruyer à un geste philosophique très spécifique – une
méthode – qui n’a pas compté pour rien dans l’élaboration de son panpsychisme –
encore que ce geste n’explique pas, à lui seul, l’édification dudit panpsychisme.
2 L’ontologie transitoire (1932-1935)
6 S’il n’est pas inexact de lire les Éléments de psycho-biologie [Ruyer 1946] comme l’ouvrage
inaugurant les œuvres de la maturité dans le corpus ruyérien, l’on trouve en fait dès la
fin des années 1930 une série d’articles où germe le panpsychisme des écrits futurs. On
pourrait classer les textes de 1930 à 1940 selon trois périodes : 1o) le « panmécanisme »
brut, limité à l’Esquisse et à l’article de 1931 « Le problème de la personnalité et la
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
26
physique moderne ». 2o) Ce que nous nommons « l’ontologie transitoire », forme de
« panmécanisme » bâtard où Ruyer voit de la « subjectivité » partout sans, pour dire les
choses brutalement, lui rendre justice nulle part. Cette période court des articles de
1932 jusqu’à ceux de 1935. 3o) L’élaboration du panpsychisme proprement dit. Tous les
articles à partir de 1938 témoignent ainsi d’un véritable saut théorique marqué par la
prise en compte de l’originalité de la vie et par la reconnaissance du caractère
secondaire et dérivé des lois de la mécanique classique.
7 Il est déjà possible de surprendre ce saut dans La Conscience et le Corps [Ruyer 1937] où
Ruyer s’avance clairement vers un modèle de la causalité organique prenant en défaut
les schèmes mécanistes ; néanmoins, il y reprend aussi de nombreux extraits de textes
des années 1932-1935, ce qui fait que la rupture à l’endroit de cette période n’y est, à
dire vrai, pas tout à fait consommée.
8 Les textes de cette période transitoire sont intriguants. Ruyer y conserve le
« panmécanisme » dont il est parti dans l’Esquisse en l’intégrant, étrangement, dans ce
que l’on peut nommer un « pansubjectivisme » [Vax 1953, 200]. « Pansubjectivisme »
que l’on ne peut pas confondre avec le panpsychisme de la maturité. À partir de
1932-1933, Ruyer développe une logique binaire – dont il ne se départira jamais –
suivant laquelle c’est de deux choses l’une : ou bien on est idéaliste et on annexe l’être
du réel à la conscience du sujet – ce qui revient à rabattre l’être sur la représentation –
ou bien on est réaliste et on reconnaît qu’en deçà de l’image perçue se dérobe l’être de
ce qui, précisément, apparaît.
9 Pour Ruyer, qui se dit sur ce point proche du sens commun [Ruyer 1934a], il y a
disjonction numérique de l’être et du phénomène [Ruyer 1935a, 76-78]. Le tour de force
de Ruyer consiste à raisonner de manière analogique : l’indépendance de l’être de
l’objet par rapport au sujet qui s’y rapporte ne peut se concevoir que sur le modèle de
ma propre indépendance, autrement dit comme subjectivité. En parcourant les textes de la
période 1932-1935 on trouve de nombreuses formules5 d’après lesquelles si l’être de la
forme que je perçois ne se réduit pas à son image, à son apparition pour moi, alors il
doit nécessairement être doué d’un pour soi, bref, exister sur le modèle de ma
subjectivité. Ainsi, Ruyer n’hésite pas à étendre à tout objet dont l’être est indifférent
au fait d’être perçu par un sujet6 la qualité de « subjectif ».
10 Dès lors, chez Ruyer, est « subjectif » en un sens ontologique ce qui ne dépend pas de
l’activité cognitive d’un sujet. Une idée que j’ai est subjective, ce que n’ignore pas le sens
commun. Dans le vocabulaire de Ruyer, un objet est « subjectif » non pas du tout au
sens où il serait une simple « représentation » du sujet, mais au sens où, précisément,
son mode d’être est autonome et indifférent à l’intérêt que nous pouvons lui porter.
C’est parce qu’elles possèdent leur subjectivité propre que les formes existent
indépendamment de la manière, pratique ou théorique, dont je peux les appréhender 7.
Ruyer écrit : « l’expression “existence objective” est un simple non-sens » [Ruyer 1933,
40] ; « logiquement, la notion d’un être qui n’est qu’objet, la notion de chose est
parfaitement absurde » [Ruyer 1934b, 573], « existence objective est une expression
contradictoire » [Ruyer 1932a, 568]. Et de conclure que « la subjectivité [...] n’est qu’un
autre nom pour dire : être » [Ruyer 1934b, 573]. Il ne s’agit pas du tout de dire que les
formes perçoivent, sentent ou se saisissent réflexivement, seulement de reconnaître
qu’elles s’appartiennent.
11 Or, la subjectivité dont il est question est tellement large et indéfinie qu’en la prêtant à
toutes les formes qui se découpent dans l’espace-temps, Ruyer ne modifie pas
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
27
foncièrement le « panmécanisme » de l’Esquisse. Lui-même en convient de façon très
explicite :
Nous croyons que l’on peut corriger le matérialisme, le « physicisme », le rendre
capable de comprendre la conscience, sans le bouleverser : par un changement de
clef radical, mais qui laisse subsister les grandes lignes, les cadres généraux de
l’explication physique des choses. [Ruyer 1933, 35]
Il nous reste à montrer qu’en transposant le matérialisme, en retournant l’univers
matérialiste, nous nous éloignons beaucoup moins qu’on ne pourrait le croire de sa
vision des choses. Le monde des objets auquel il croit n’est qu’une abstraction, mais
qui correspond point par point au monde des subjectivités réelles. [Ruyer 1933, 43]
12 Le « changement de clef » qu’évoque Ruyer – qui consiste à qualifier chaque forme de
« subjective » – est-il seulement verbal ? Il convient en tout cas de se demander s’il
possède vraiment quelque chose de « radical ». Ruyer peut bien décréter que toutes les
individualités de la nature sont « subjectives », cela ne change pas grand-chose du
moment qu’il persiste à dire qu’elles fonctionnent de manière mécanique. C’est parce qu’il
ne remet jamais en doute la vérité ontologique du mécanisme au plan de la causalité
que son « pansubjectivisme » sonne creux. Ce dernier ne rend pas justice à la
singularité des comportements organiques (croissance, reproduction, régulation,
invention), lesquels ne retiendront vraiment son attention qu’à partir de la seconde
moitié des années 1930.
13 Le rôle mineur que Ruyer concède à la métaphysique en 1935 [Ruyer 1935a], confirme la
faiblesse de cette extension du « subjectif ». En théorisant la « subjectivité » des formes
qu’étudie la science, Ruyer souligne en effet que sa métaphysique ne bouleverse pas
outre mesure les conclusions de celle-là. Conclusions qui portent sur la question
cruciale du mode de causalité des formes (développement, permanence, interaction) et
non sur une question d’étiquette abstraite (la forme est-elle douée d’un « pour soi » ?).
La métaphysique que Ruyer pratique à cette époque vient seulement « animer » et
colorer ce que le prisme physico-mathématique décrit selon lui fidèlement 8.
14 C’est peu dire que l’extension de la notion de subjectivité sur la période 1932-1935 n’est
pas du tout la même que celle de la notion de conscience « primaire » dans les textes de
la maturité. La première sert de caution au mécanisme, tandis que la seconde,
justement, est intéressante pour autant qu’elle en conteste la pertinence. Pour se
convaincre de la vacuité du « pansubjectivisme » de la période transitoire, il n’y a qu’à
faire la liste des objets auxquels Ruyer prête une subjectivité faute d’en avoir
suffisamment affiné le concept. On voit donc qu’un « caillou » [Ruyer 1933, 48], un
« cerveau mort » [Ruyer 1933, 47], un « bloc de marbre » [Ruyer 1933, 40], nos
« meubles » [Ruyer 1934b, 573] ou encore un « bâton » [Ruyer 1935b, 343] sont des
formes « subjectives », pour la seule raison qu’elles se découpent dans l’espace et
perdurent indépendamment du regard que l’on porte sur elles.
15 Le Ruyer de la maturité demeure convaincu que le réalisme doit être solidaire d’une
ontologie où le psychisme tient lieu d’étalon, mais il ne commet plus l’erreur de la
période transitoire. Celle-ci consistait à ne se donner aucun critère dynamique pour
étayer l’extension ontologique du « subjectif ». Entre 1932 et 1935, le critère dynamique
de la finalité (un agent cherche à se maintenir en vie, à actualiser tel thème vital ou
esthétique), fait encore défaut à la philosophie ruyérienne.
16 C’est seulement à partir de 1938 que Ruyer règle véritablement ses comptes avec le
fantôme du mécanisme qui hante le « pansubjectivisme » de la période 1932-1935. Seule
l’interprétation (spéculative) de données puisées dans les sciences lui permet d’en finir
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
28
avec la surestimation de la valeur ontologique de la conception mécaniste de la
causalité. Son intérêt pour la physique quantique [Ruyer 1938b, 117 sqq.] et pour les
prouesses dont est capable le vivant dénué de système nerveux central (l’amibe [Ruyer
1938c] ou l’embryon) l’incitent à reconsidérer l’extension, trop lâche, qu’il conférait au
concept de subjectivité au cours de la période transitoire. Ne mériteront, dorénavant,
d’être qualifiées de « subjectives » que les formes à même de s’auto-entretenir, de se
comporter de façon cohérente dans le temps, bref de conserver activement leur identité –
et non passivement ou par hasard.
17 Comparons deux extraits de textes, l’un de 1933 et l’autre de 1938, afin de mesurer le
chemin parcouru par Ruyer en l’espace de ces quelques années. La comparaison est
facilitée puisque Ruyer retravaille le même exemple, celui de la différence ontologique
entre cerveau mort et vivant (niée dans le premier extrait, reconnue dans le second) :
1. (1933)
Si donc, par exemple, nous coupions ce qui nous apparaît comme les fibres
d’association de l’area striata (ruban de Vicq d’Azir, etc.), nous supprimerions en fait
la subjectivité de cette zone du cerveau, en tant que champ des images visuelles
conscientes. Mais, en tant qu’objet matériel, le cerveau continuerait à posséder la
subjectivité ordinaire des autres objets. [Ruyer 1933, 77]
2. (1938)
La structure d’un ensemble d’observables se met, selon toute probabilité, très vite
en équilibre avec le mode d’action de la réalité qu’elle manifeste. Nous sommes
donc en droit de renverser la proposition et de conclure que toute différence de
structure est le symptôme d’une différence de manière d’être dans la réalité
inobservable correspondante. Appliquons ce critérium au cas d’un cerveau mort et
d’un cerveau vivant. Leur aspect structural est en gros identique. Mais leur
comportement révèle une différence. Le cerveau mort fonctionne selon le principe
d’analyse, c’est-à-dire comme il fonctionnerait si les molécules qui le composent
étaient simplement juxtaposées en amas. Aussi son aspect structural change vite. Le
cadavre est comme une empreinte de pas laissée sur le sable, qui n’est plus capable
de subsister par elle-même et qui n’a rien à opposer au nivellement du vent ou de
l’eau. Le cerveau vivant, au contraire, conserve sa structure. Nous devons donc
conclure qu’une différence réelle doit expliquer cette différence de comportement.
[Ruyer 1938b, 122]
18 C’est parce qu’aucun critère dynamique n’intervient dans l’ontologie transitoire qu’en
1933 le cerveau mort est encore « subjectif » ; a contrario, il appartient au domaine des
agrégats en 1938 parce que Ruyer s’est aperçu que la différence entre causalité
mécanique et dynamisme organique instaurait une véritable ligne de partage entre les
formes.
19 Ce n’est pas le lieu de faire ici une typologie des agrégats (l’outil ou la machine ne sont
pas le nuage ou le rocher), il nous suffit de préciser que la distinction, centrale dans les
œuvres de la maturité, des « formes vraies », authentiquement « subjectives », et des
agrégats, n’instaure toutefois aucun dualisme ontologique [Ruyer 1952, 101]. Les
agrégats étant eux-mêmes toujours composés de « formes vraies », « subjectives ». Le
cerveau mort n’est certes pas « subjectif » en lui-même, mais, comme agrégat, il reste
composé d’éléments (cellules, molécules, atomes) doués de « conscience primaire »,
c’est-à-dire à même de s’auto-organiser suivant des thèmes organiques. Notons bien
que ce n’est pas du tout ce que Ruyer défend dans le premier extrait. Car c’est bien
comme objet total dont le devenir, la dégradation, poursuit son processus, que le
cerveau y conserve la qualité de « subjectif ».
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
29
20 Il n’est pas inintéressant de relever que, s’il ne s’y est pas attardé, Ruyer a finalement
lui-même dénoncé la nullité d’un monisme subjectiviste qui ne prendrait pas ses
distances avec la causalité physique telle qu’elle fut élaborée à l’âge classique.
La vraie question n’est pas de savoir si l’on sera matérialiste ou panpsychiste, si l’on
admettra comme réalité ultime l’élément matériel ou la monade. Tant que l’on
croira que la causalité du type physique ordinaire est la seule que l’on puisse jamais
scientifiquement observer, on aura beau déclarer qu’il ne s’agit là que d’un aspect,
que la nature des réalités dont la science décrit les relations est spirituelle et non
matérielle, on aura fait une théorie philosophique vide parce que pratiquement
équivalente à celle qu’elle prétend remplacer. [...] Tout ce que fait le philosophe,
c’est de nous assurer que le contenu de ces coffrets est spirituel. [...] À quoi sert ce
« contenu » s’il ne change jamais rien à rien ? Si les coffrets restent clos, inutile de
se quereller pour une question d’étiquette. [Ruyer 1938b, 115-116]
21 Néanmoins, il est assez étonnant de voir qu’ici Ruyer ne fait pas référence à son propre
parcours intellectuel. Il cite plusieurs philosophes9 dans les deux textes de 1938 où il
prend ses distances avec le « pansubjectivisme » [Ruyer 1938a, 528], [Ruyer 1938b, 115],
mais, jamais, la critique qu’il leur adresse n’est formulée comme une auto-critique.
Pourtant, il suffit d’avoir lu les articles de la période 1932-1935 pour comprendre qu’il
parle de lui dans le passage ci-dessus. Il est incontestable qu’il effectua lui-même cette
« opération blanche » [Ruyer 1938b, 115] consistant à défendre un « pansubjectivisme »
en forme de caution métaphysique du mécanisme le plus orthodoxe.
22 À ce stade nous savons : a) que le « pansubjectivisme » de la période 1932-1935 est
beaucoup plus près du « panmécanisme » de l’Esquisse que de la philosophie organique
qui prend son essor à la fin des années 1930 ; b) que l’émergence d’un modèle
panpsychiste conséquent à la fin des années 1930 est liée à l’attention que Ruyer a
portée à certaines données scientifiques. Nous savons aussi : c) que le
« pansubjectivisme » s’est développé chez Ruyer via un raisonnement analogique pour
le moins osé, l’autonomie de l’être se concevant sur le modèle que me fournit ma
propre subjectivité.
23 Il nous faut maintenant exhumer la condition de possibilité de c), ce qui consistera à
montrer ce qui, du « panmécanisme » de départ, légitimait un tel raisonnement
analogique. Enfin, il faudra dire aussi que ce type de raisonnement n’a jamais été
abandonné par Ruyer qui, s’il n’en fit jamais un objet de réflexion, s’est toutefois
constamment appuyé sur lui. Si bien que si l’on s’attache aux seuls résultats de la
pensée ruyérienne, alors il faut admettre qu’il y a une rupture évidente entre le
« panmécanisme » de départ et le panpsychisme de la maturité, tandis que si l’on se
penche sur le mouvement de la pensée, c’est-à-dire sur la méthode employée, alors force
est de constater que le « panmécanisme » aura été le lit d’une décision méthodologique
centrale dans la période transitoire comme dans celle de la maturité.
24 En quoi le « panmécanisme » a-t-il pu favoriser le raisonnement analogique, le transfert
de la subjectivité à la totalité des formes découpées dans l’espace ? C’est la lecture d’un
texte essentiel du corpus ruyérien qui pourra nous le faire comprendre : « Sur une
illusion dans les théories philosophiques de l’étendue » [Ruyer 1932b], repris en grande
partie dans La Conscience et le Corps [Ruyer 1937], et dont le thème central (le champ de
conscience comme étendue « auto-survolée ») se retrouve ensuite dans toutes les
grandes œuvres de Ruyer. Il s’agit, au moyen d’une description introspective du champ
visuel, de montrer que percevoir, avoir une sensation extensive, c’est vivre comme
surface-sujet.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
30
25 Mais comment faut-il s’y prendre pour en remontrer à toute une tradition qui,
précisément, s’entend pour distinguer la conscience de l’étendue ? Ruyer nous invite,
tout d’abord, à suspendre la « mise en scène de la perception » dans la description de la
manière d’être de notre sensation visuelle [Ruyer 1932b, 523]. Pour percevoir
correctement un objet, il faut bien que je me tienne à une certaine distance par rapport
à lui, ni trop près ni trop loin. Seulement, ce qui vaut pour la perception d’un point de
vue pratique ne doit pas être projeté dans le mode d’être de la sensation. Je n’ai pas à
me mettre à distance de ma sensation visuelle pour en jouir. De sorte qu’il n’y a qu’un
« néant de distance » [Ruyer 1937, 59] entre elle et moi : je la suis constamment – y
compris d’ailleurs lorsque je ferme les yeux ainsi que le relève Ruyer, soulignant qu’une
« vision noire » n’est pas l’équivalent d’une « vision nulle » [Ruyer 2013, 59]. Le mode
d’être de ma conscience déjoue la logique de la géométrie la plus élémentaire. Il faut
bien avoir accès à la deuxième dimension pour percevoir la première, à la troisième
pour percevoir la deuxième ; pourtant je n’ai pas à être situé dans une dimension
supplémentaire pour jouir de ma propre sensation [Ruyer 1937, 58-59], [Ruyer 1952,
108-111]. La sensation m’est donnée sans délai ou, très exactement, elle n’a pas à m’être
« donnée » puisque « je » la suis immédiatement même si « je » ne m’y réduis pas. Le
« je » n’est pas détaché de sa sensation comme une abeille survolant un champ [Ruyer
1934-1935, 32], bien qu’il puisse, tout en l’éprouvant, essayer de l’analyser (comme un
œnologue qui goûte un vin). Ma sensation n’est pas là-bas, dans le monde, hors de mon
cerveau, elle est étendue et l’étendue qu’elle est est l’envers subjectif, vécu, d’une partie
de mon cortex cérébral. L’étendue de ma sensation n’a pas besoin d’être vue : elle est
vue [Ruyer 1966, 77], [Ruyer 2013, 46], c’est-à-dire qu’elle est ontologiquement
subjective et non objectivement saisie par « moi » – qui serait un sujet, littéralement,
« métaphysique ». Ruyer conclut que « “percevoir l’étendue”, c’est une façon d’être
étendu » [Ruyer 1932b, 527].
26 Ce qui est intéressant, c’est la conclusion que Ruyer tire de sa découverte d’après
laquelle il n’y a pas d’opposition entre conscience et étendue :
Si l’étendue sensible elle-même existe sans être posée comme l’objet d’un sujet, la
question ne se pose plus de refuser ce même mode d’existence à l’espace en dehors
de nos sensations. [Ruyer 1932b, 526], [voir aussi Ruyer 1933, 39]
27 Voir, c’est faire l’expérience de soi en tant que surface-sujet, étendue voyante. Mais
comment Ruyer passe-t-il de « ma subjectivité est étendue » à « toute étendue est
subjective » ? Qu’est-ce qui lui permet de faire, sans même prendre la peine de s’en
expliquer, de l’analyse de la subjectivité percevante un index du mode d’être de
n’importe quel morceau d’étendue ?
28 Nous croyons que la réponse (à cette question que Ruyer ne se pose pas) se situe dans le
nivellement ontologique qu’avait instillé chez lui sa souscription au « panmécanisme ».
Le monisme du premier Ruyer crée un plan de nivellement qui lui fait trouver tout à
fait logique de passer de l’étendue de la subjectivité à la subjectivité de l’étendue. Se
situant dans une sorte de plan d’immanence que rien ne transcende, pas même la
subjectivité du locuteur posant le plan, Ruyer suppose que ce qui vaut pour cette
dernière vaut pour l’ensemble des formes du plan. Il fallait que la valeur ontologique de
la différence anthropologique ait été confisquée par le « panmécanisme » pour que le
raisonnement analogique soit, secrètement, légitimé.
29 Si Ruyer peut transgresser l’interdit du criticisme suivant lequel on ne peut rien dire du
mode d’être de la chose dont on ne possède que la représentation, c’est qu’il pense
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
31
d’emblée en moniste : l’être de x ne peut être différent du mien et c’est pourquoi
l’introspection constitue une porte d’entrée privilégiée dans l’ontologie de la nature.
3 Ruyer dans « la grande voie naturelle de la
philosophie »
30 Dans un article de 1935, Ruyer revendique ainsi son appartenance à ce qu’il qualifie de
« grande voie naturelle de la philosophie », laquelle consiste à « tirer de l’intuition
psychologique ce qui peut servir de modèle et d’échantillon à une ontologie » [Ruyer
1935b, 346]. À parcourir l’ensemble du corpus, il semble que Ruyer soit toujours resté
fidèle à cette manière de procéder, et ce bien qu’il n’ait jamais pris la peine de réfléchir
à sa légitimité. Roger Chambon souligne très justement que Ruyer présuppose la
validité de cette voie plus qu’il n’en justifie l’usage [Chambon 1974, 358].
31 L’on peut supposer que l’embarras manifeste de Chambon à l’égard de la relève
ontologique du psychologique chez Ruyer eût été atténué si la référence à
Schopenhauer, pourtant frappante dans le titre de son ouvrage – Le Monde comme
perception et réalité [Chambon 1974] – n’avait pas été abstraite de son contenu. Il est vrai
que la proximité avec Schopenhauer n’est pas du tout revendiquée par Ruyer. Dans
l’article de 1935 où il se réclame de la « grande voie », il cite nommément Leibniz,
Maine de Biran, Bergson et Whitehead parmi ses représentants. Or, il est frappant de
voir que s’il tient également compte de Schopenhauer, il ne prend même pas la peine
de le nommer au cours du paragraphe qu’il consacre à sa philosophie [Ruyer 1935b,
347].
32 Dans L’Autre Métaphysique, Pierre Montebello circonscrit très clairement le double
mouvement qui caractérise l’esprit de cette tradition dont il exhume l’importance dans
ce livre :
Au plus profond, la tendance de cette philosophie a été la déshumanisation totale
de l’homme (ramener l’homme à l’être) aussi bien que l’humanisation totale de la
nature (proximité de toutes les formes naturelles avec l’homme). [Montebello 2003,
12]
33 Il n’est pas faux de dire que « l’autre métaphysique » correspond à ce que Ruyer nomme
la « grande voie », voie dont il semble, avec Jonas et le Merleau-Ponty du concept de
« chair », l’un des héritiers10.
34 Le problème de « l’accès » au réel, au mode d’être des individualités naturelles, ne
dépend donc pas seulement de la place que Ruyer ménage, peut-être laborieusement,
au concept d’intentionnalité [Barbaras 2008, 175-176]. Parce que, de la nature, nous en
sommes, l’être de ses différentes manifestations se laisse lire à même le livre de notre
propre existence. Qu’importe si la perception ne m’ouvre pas directement sur l’être,
mais seulement sur son image, puisque le mode d’être de la nature s’atteste de toute
manière en moi qui en fais partie au même titre que les différentes individualités qui
l’animent.
35 Ruyer est donc entré d’une manière originale dans la « grande voie naturelle de la
philosophie ». En effet, c’est un bagage mécaniste qui l’y a, paradoxalement, amené. La
lecture des dernières phrases que rédige Hans Jonas à la fin de la note qu’il consacre à
l’anthropomorphisme dans Le Phénomène de la vie [Jonas 2001] prend une saveur toute
particulière si l’on a en tête le trajet intellectuel de Ruyer :
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
32
Ainsi, dans une ontologie moniste, le procès de l’anthropomorphisme dans sa forme
extrême devient-il problématique et est-il réouvert en principe. Il semble alors
avoir pour résultat le choix suivant entre possibilités monistes : soit prendre la
présence de l’intériorité finale [purposive] dans une partie de l’ordre physique, c’est-
à-dire en l’homme, pour un témoignage valide quant à la nature de cette réalité
plus vaste qui la laisse émerger et accepter ce que cette présence révèle par elle-
même comme faisant partie de l’ensemble des données d’évidence ; soit étendre les
prérogatives de la matière mécanique jusqu’au cœur de la classe apparemment
hétérogène des phénomènes et évincer la téléologie même de la « nature de
l’homme » – c’est-à-dire rendre l’homme étranger à lui-même et refuser toute
authenticité à l’expérience de soi de la vie. [Jonas 2001, 49]
36 Le monisme qu’élabore Ruyer dans l’Esquisse eût pu rester ce qu’il avait commencé
d’être : une ontologie déshumanisée. Or, comme le voit très bien Jonas, tout monisme
s’expose (au moins théoriquement) à devoir réhabiliter un certain
anthropomorphisme. Créant un effet de nivellement ontologique, il autorise la relève
ontologique de la donnée psychologique. Celle-ci ne constituant plus une exception
ontologique, elle peut être investie de façon paradigmatique pour la constitution d’une
ontologie générale.
37 Toute version du « panmécanisme » est susceptible de se retourner contre elle-même
en faisant témoigner la partie pour le tout, l’homme pour la nature. Et si le
« panmécanisme » peut procéder ainsi, c’est que lui-même a suspendu toute différence
de nature entre le plan anthropologique et le plan de la nature. Entendons-nous bien
cependant : ce n’est évidemment pas parce que son « panmécanisme » l’a conduit à
attribuer à la donnée psychologique une portée ontologique que Ruyer s’est inscrit
d’emblée dans une tradition « panpsychiste ». Son cheminement fut plutôt lent et la
lecture des articles de la période transitoire l’illustre bien. Dans cette période, on voit
que le point de départ mécaniste est encore trop vif pour voler en éclats aussitôt qu’il
permet la relève ontologique de la donnée psychologique. Faut-il encore, en effet, que
la représentation que l’on a de cette dernière entame quelque chose du point de départ
mécaniste. La représentation que l’on a du « psychologique » ne joue évidemment pas
de manière automatique contre un modèle mécanique. Finalement, le
« panmécanisme » ruyérien ne s’est pas auto-converti en panpsychisme ; en revanche,
il s’est bien transformé en « pansubjectivisme », produisant celui-ci comme sa caution
métaphysique.
38 Nous concédons bien volontiers que Ruyer lui-même n’a pas dit grand chose de sa
propre méthode. Il ne parle d’ailleurs de la « grande voie naturelle de la philosophie »
qu’en 1935 ; bref, il faut avouer qu’il n’y a pas de méthodologie, de discours de la
méthode chez Ruyer. Ce n’est donc qu’en étant très attentif aux textes que l’on peut
surprendre chez lui l’esquisse d’une hiérarchisation des deux voies principales que
distinguait Roger Chambon dans l’élaboration de son monisme. 1o) La voie perceptive,
où l’observateur se penche sur les faits circonscrits par la science ; 2o) la voie
introspective, impliquant la relève de données psychologiques, au premier rang
desquelles figurent la sensation visuelle mais, aussi, la mémoire [par exemple Ruyer
1948, 139]. Une telle hiérarchie n’est ébauchée que timidement chez Ruyer, mais elle
sert l’hypothèse suivant laquelle la « grande voie » fut, sinon considérée comme plus
riche par lui, du moins comme plus fiable.
39 Dans un article de 1957 où il cherche à renouveler la monadologie leibnizienne en
l’étayant sur la physique quantique, Ruyer commente ainsi son usage de l’introspection
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
33
des structures de la mémoire, d’après lui isomorphes au jeu de l’un et du multiple dans
l’univers :
Il y a toujours le plus grand risque à extrapoler une expérience limitée. Mais il vaut
toujours mieux se servir, pour cette opération risquée, d’une expérience
psychologique que d’un phénomène physique à notre échelle. Un phénomène
physique est une expérience deux fois déformée, par le fait qu’il est observé, d’une
part, et, s’il s’agit d’un phénomène de la physique macroscopique, par le fait qu’il
est dissimulé par des phénomènes de foule. [Ruyer 1957b, 35-36]
40 La simple observation est une déformation. Voir, ce n’est pas se confondre avec ce que
l’on voit. Mais il existe deux raisons plus spécifiques qui conduisent à se méfier de la
perception : Ruyer suggère ci-dessus que l’observateur court toujours le risque de
passer à côté d’une activité sensée qui serait « dissimulé[e] par des phénomènes de
foule ». Par exemple, face à la mer déchaînée, mue par la mécanique des fluides, on n’a
guère le loisir de saisir la « conscience primaire » propre à chaque molécule d’eau,
tandis que chacune d’elle est pourtant agile dans son travail, consistant à réactualiser
une structure précise. Dans Néo-finalisme, Ruyer cite l’erreur inverse, qui consiste à
croire qu’un agrégat est vivant et nous conduit à prêter une individualité réelle à ce qui
ne fait qu’imiter la vie [Ruyer 1952, 98].
41 Signalons encore que dans un article intitulé « La philosophie unie à la science » rédigé
pour L’Encyclopédie française, c’est bien la voie introspective qui apparaît à Ruyer comme
« l’entrée la plus naturelle » [Ruyer 1957, 7b] dans la philosophie de la nature. Parce
que « l’étude de l’homme [...] ne fait que révéler en traits grossissants le statut de tous
les êtres de la Nature » [Ruyer 1957c, 649], il est légitime de regarder en soi pour en
sortir afin de bâtir une ontologie générale.
42 La découverte de la « grande voie naturelle de la philosophie » réside dans l’idée qu’il y
a en nous davantage que nous-mêmes : notre individualité nous isole physiquement
mais non pas ontologiquement du reste des créatures. Il faut être à la fois modeste, en
reconnaissant que notre mode d’être n’est pas différent de celui des autres
individualités psycho-biologiques, et ambitieux, en affirmant que s’il n’est pas
différent, il en est donc paradigmatique.
43 L’étude de la légitimité de cette « grande voie » pourrait être le point de départ de
l’examen d’un usage réfléchi de l’anthropomorphisme. Jonas est le celui qui a le plus
approfondi la question [Jonas 1992, 32-34], [Jonas 2001, 45-48] ; mais l’on trouve aussi
des développements intéressants chez Roger Caillois, qui oppose à raison
l’anthropomorphisme à l’anthropocentrisme [Caillois 1960, 19-20]. Ruyer n’est pas non
plus indifférent à la question, même s’il ne la traite que de façon allusive [Ruyer 1935b,
345], [Ruyer 1957d, 279]. Au dernier chapitre du Monde comme volonté et comme
représentation, Schopenhauer, père auto-proclamé de la « grande voie » [Schopenhauer
2009, 140], écrivait :
[...] on avait, depuis les temps les plus reculés, proclamé l’homme un microcosme.
J’ai renversé la proposition et montré dans le monde un macranthrope.
[Schopenhauer 2009, 1417]
44 L’anthropomorphisme peut être légitime, pourvu qu’il consiste, à rebours de
l’anthropomorphisme grossier, non pas à projeter sur la nature des caractéristiques
humaines, mais bien à reconnaître que certaines caractéristiques, dont on pouvait
penser qu’elles étaient typiquement humaines, sont en réalité neutres d’un point de vue
ontologique. Jonas le dit à sa façon :
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
34
Le constat anthropique relève également de la cosmologie. En tant que donnée
cosmique, il demande à être exploité dans une perspective cosmologique. [Jonas
1992, 221]
45 Mais la difficulté, Ruyer le disait clairement, c’est évidemment de savoir choisir ce qu’il
faut retenir dudit « constat anthropique » [Ruyer 1935b, 346] : qu’est-ce qui, en nous,
parle d’autre chose que de nous-mêmes ? Comment discriminer entre ce qui, en nous,
ne serait que humain et ce qui, de notre humanité, porterait le sceau d’un mode d’être
commun à l’ensemble des individualités psycho-biologiques ? Les différents tenants de
la « grande voie » ne sont pas d’accord à propos de ce qu’il y a de « cosmologique » en
l’homme, de plus grand que nous en nous.
46 De quoi pourrait-on s’autoriser pour légitimer plus avant une forme
d’anthropomorphisme réfléchi ? De l’évolutionnisme ? La science peut-elle être un
appui pour la « grande voie » ? Que penser de l’impressionnisme de certains de ses
représentants les plus illustres, qui y entrèrent avant la révolution darwinienne
(Ravaisson mettant en avant la « générosité » pour justifier le rôle de la projection
anthropomorphique dans l’élaboration d’une ontologie [Ravaisson 2008, 20-21] ;
Schopenhauer et son rejet de « l’égoïsme théorique » [Schopenhauer 2009, 146, 888]) ?
Dans le passage suivant, Ruyer se contente d’évoquer des « “convenances”
spéculatives » pour étayer son monisme :
Faire se heurter directement la nature d’une part comme chaos explosif de
particules, et d’autre part comme paysage harmonieux à la Titien ou à la Poussin,
où méditent de nobles personnages humains ; faire se heurter l’être, comme « En
soi » brut, et l’homme dans sa conscience et sa liberté ; ou encore, passer
directement de l’organisme, conçu comme pure mécanique, à l’esprit humain – c’est
choquer par trop le sentiment des « convenances » spéculatives. Les artistes et les
poètes ont raison de protester : la musique de Mozart ne peut apparaître dans un
monde dépourvu de toute musique intérieure. S’il n’y a pas de Méganthrope avant
l’homme, du moins doit-il y avoir, avant ou en dehors de l’homme, quelque chose
qui ressemble à l’homme, ou qui du moins appelle l’humain, n’est pas absolument
étranger à l’humain. [Ruyer 1964, 13], [Ruyer 1957d, 271]
47 Toutefois, il serait naïf de ne poser le problème que dans un sens et d’ignorer qu’en
retour les options que constituent le monisme et le dualisme structurent
souterrainement l’édification de tel ou tel modèle scientifique.
48 Quoi qu’il en soit du jeu d’étayage, au fond réciproque, de la métaphysique et de la
science, retenons que ce n’est qu’en analysant superficiellement le « panmécanisme »
de Ruyer que l’on peut dire qu’il fut seulement cette impasse dont l’aurait sauvé une
réflexion plus poussée sur la spécificité du vivant. Il nous a plutôt semblé que tout
s’était passé comme si, en niant la valeur ontologique de la différence anthropologique
dans son « panmécanisme », Ruyer avait, sans y songer, neutralisé l’alibi dualiste qui
fonde le rejet de l’anthropomorphisme méthodologique. Ainsi, en ouvrant un champ de
nivellement ontologique, son « panmécanisme » lui aura permis d’entrer dans la
« grande voie naturelle de la philosophie », d’en reproduire le geste tout en ne cessant
pas, pendant un certain temps, de œuvrer pour ledit mécanisme (jusqu’en 1935).
49 Ce sont bien des faits scientifiques, puisés notamment dans l’embryologie et dans la
physique quantique, qui, une fois interprétés de façon spéculative, permirent à Ruyer
de se désolidariser définitivement du « panmécanisme ». Mais c’est tout de même ce
dernier qui l’aura initié à la relève ontologique du psychologique, relève dont le lecteur
rencontrera nombre d’usages fructueux dans les œuvres de la maturité. Nous avons pu
évoquer ici le rôle important de l’analyse, en première personne, de la structure du
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
35
champ visuel ou de la mémoire ; mais, par exemple, c’est encore en recourant à l’auto-
analyse de la créativité humaine que Ruyer éclaire le thématisme trans-spatial à
l’oeuvre dans la morphogénèse organique [Ruyer 1958, 260-261].
BIBLIOGRAPHIE
BARBARAS, Renaud [2008], Introduction à une phénoménologie de la vie, Paris : Vrin.
BARBARAS, Renaud [2016], Le Désir et le Monde, Paris : Hermann.
CAILLOIS, Roger [1960], Méduse et Cie, Paris : Gallimard.
CHAMBON, Roger [1974], Le Monde comme perception et réalité, Paris : Vrin.
JONAS, Hans [1992], Évolution et liberté, Paris : Rivages Poche, cité d’après la traduction française
par S. Cornille et P. Ivernel.
JONAS, Hans [2001], Le Phénomène de la vie, Bruxelles : De Boeck, traduit par D. Lories, texte original
1966.
MEILLASSOUX, Quentin [2006], Après la finitude, L’ordre philosophique, Paris : Seuil.
[Montebello(2003)]MONTEBELLO, Pierre [2003], L’Autre Métaphysique, Paris : Desclée de Brouwer.
NIETZSCHE, Friedrich [1886], Par delà bien et mal, Paris : Hachette, cité d’après la traduction
française de A. Meyer et R. Guast, Paris, 2010.
RAVAISSON, Félix [2008], Testament philosophique, Paris : Allia, 1re publication en 1894.
RUYER, Raymond [1930], Esquisse d’une philosophie de la structure, Paris : Félix Alcan.
RUYER, Raymond [1931], Le problème de la personnalité et la physique moderne, Revue de synthèse,
octobre, 67–87.
RUYER, Raymond [1932-1933], La mort et l’existence absolue, Recherches philosophiques, II, 131–147.
RUYER, Raymond [1932a], Un « modèle mécanique » de la conscience, Journal de psychologie normale
et pathologique, 29, 550–575.
RUYER, Raymond [1932b], Sur une illusion dans les théories philosophiques de l’étendue, Revue de
Métaphysique et de Morale, 39(Suppl. 4), 521–527.
RUYER, Raymond [1933], Ce qui est vivant et ce qui est mort dans le matérialisme, Revue
philosophique de la France et de l’étranger, 116, 28–49.
RUYER, Raymond [1934-1935], Sur quelques arguments nouveaux contre le réalisme, Recherches
philosophiques, IV, 30–50.
RUYER, Raymond [1934a], Rôle du sens commun en philosophie, Revue philosophique de la France et
de l’étranger, 117, 248–258.
RUYER, Raymond [1934b], Les sensations sont-elles dans notre tête ?, Journal de psychologie normale
et pathologique, A31, 555–580.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
36
RUYER, Raymond [1935a], Une métaphysique présente-t-elle de l’intérêt ?, Revue philosophique de la
France et de l’étranger, 119, 79–92.
[RUYER, Raymond [1935b], Le versant réel du fonctionnement, Revue philosophique de la France et de
l’étranger, 119, 338–362.
RUYER, Raymond [1937], La Conscience et le Corps, Paris : Félix Alcan.
RUYER, Raymond [1938a], Micro-physique et micro-spiritualisme, Revue de Métaphysique et de
Morale, 45(Suppl. 4), 527–541.
RUYER, Raymond [1938b], Parallélisme et spiritualisme grossier, Revue philosophique de la France et
de l’étranger, 125, 110–127.
RUYER, Raymond [1938c], Le paradoxe de l’amibe et la psychologie, Journal de psychologie normale et
pathologique, A35, 472–492.
RUYER, Raymond [1946], Éléments de psycho-biologie, Paris : PUF.
RUYER, Raymond [1948], Le domaine naturel du trans-spatial, Bulletin de la Société française de
philosophie, 42, Séance du 31 janvier 1948(5), 133–165.
RUYER, Raymond [1952], Néo-finalisme, Métaphysiques, Paris : PUF, 2 éd., Préface de F. Colonna,
2012.
RUYER, Raymond [1957], La philosophie unie à la science, Encyclopédie française, XIX, 6–10.
RUYER, Raymond [1957b], Leibniz et « M. Tompkins au pays des merveilles », Revue philosophique de
la France et de l’étranger, 147, 27–40.
RUYER, Raymond [1957c], La philosophie de la vie, Critique, 122, 646–655.
RUYER, Raymond [1957d], Homonculus et Méganthrope, Revue de Métaphysique et de Morale, 62(3),
266–285.
RUYER, Raymond [1958], La Genèse des formes vivantes, Bibliothèque de philosophie scientifique,
Paris : Flammarion.
RUYER, Raymond [1963], La science et la philosophie considérées comme des traductions, Les
Études philosophiques, 18(1), 13–20, 10.2307/20844208.
RUYER, Raymond [1964], L’Animal, l’Homme, la Fonction symbolique, Paris : Gallimard.
RUYER, Raymond [1966], Paradoxes de la conscience et limites de l’automatisme, Paris : Albin Michel.
RUYER, Raymond [1967], La conscience et les théories des théories, Revue de Métaphysique et de
Morale, 72(4), 406–413.
[Ruyer(1970)]—— [1970], « Le petit chat est-il mort ? », ou trois types d’idéalisme, Revue
philosophique de la France et de l’étranger, 160, 121–134.
RUYER, Raymond [2013], L’Embryogenèse du monde et le Dieu silencieux, Continents philosophiques,
Paris : Klincksieck, texte établi, présenté et annoté par F. Colonna.
SCHOPENHAUER, Arthur [2009], Le Monde comme volonté et comme représentation, Paris : PUF, traduit
par A. Burdeau, texte original 1844.
VAX, Louis [1953], Introduction à la métaphysique de R. Ruyer, Revue de métaphysique et de morale,
58(1–2), 188–202.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
37
VAX, Louis & WUNENBERGER, Jean-Jacques (éds.) [1995], Raymond Ruyer, de la science à la théologie,
Paris : Kimé.
NOTES
1. Notons que Ruyer ne semble pas tout à fait dupe de l’exercice auquel il se livre alors, ainsi
qu’en témoigne la déclaration liminaire – plutôt hardie – qu’il adresse au lecteur dès la première
page de l’ouvrage : « La thèse que nous soutenons peut être considérée comme une hypothèse, et
ce travail, comme un essai, au sens propre. Il doit être permis, en effet, aux philosophes comme
aux physiciens, de faire des théories générales, de tenter des systématisations, dont le principal
mérite sera la cohérence. Sans chercher délibérément le paradoxe, en gardant même la confiance
de n’être pas dans l’erreur, on peut alors sacrifier à la cohérence, la vraisemblance. Nous
demandons donc que l’on ne fasse pas de notre dogmatisme un défaut. [...] Il n’y a jamais en
philosophie qu’un petit nombre de chemins dans lesquels on peut s’engager. N’est-il pas utile
d’aller jusqu’au bout, en choisissant l’un d’eux ? On devrait décréter que le premier devoir d’un
philosophe, dans l’exposé de sa thèse, c’est d’être un “lourdaud”, comme Aristote disait qu’était
Mélissos, ce disciple compromettant de Parménide» [Ruyer 1930, 1]. Cela fait penser à Nietzsche :
« Ne pas admettre plusieurs sortes de causalités tant que l’on n’a pas essayé jusqu’à l’extrême
limite (jusqu’à l’absurde si vous le permettez) de tout résoudre avec une seule, c’est une morale
de la méthode à laquelle on n’a pas le droit aujourd’hui de se soustraire» [Nietzsche 1886, 68-69].
2. Le problème n’est évidemment que déplacé et devient celui du statut de la science... du
naturaliste stellaire. Or, plusieurs textes montrent que Ruyer ne fut pas indifférent au problème.
À savoir qu’il faut être en mesure de pouvoir rendre compte des conditions de possibilité d’une
démarche intellectuelle dans les termes mêmes qu’autorise le modèle ontologique que celle-là
aura permis de dégager. Voir [Ruyer 1930, 211], [Ruyer 1963, 17], [Ruyer1967, 406-413].
3. L’Esquisse était l’une des deux thèses de Ruyer ; elle fut dirigée par... Léon Brunschvicg.
4. Dans un article, Louis Vax adopta la thèse de l’opposition radicale entre le premier Ruyer et
celui du Néo-finalisme : « Ruyer a débouché dans un finalisme et la philosophie de l’esprit après
avoir brûlé ce qu’il avait adoré» [Vax 1953, 188].
5. Que le Ruyer de la maturité ne renierait pas [par exemple Ruyer 1970, 125].
6. En guise de contre-exemple : un mirage, par exemple, n’est pas ontologiquement indépendant
du sujet qui, pour le coup, le constitue, certes souvent à partir d’éléments propres à
l’environnement sur fond duquel il se détache.
7. Mais, d’évidence, si mon intérêt pour l’objet me conduit à le détruire, son « autonomie
ontologique» n’est plus qu’une vaine formule.
8. « Ce monde de réalités absolues, en soi, que l’effort métaphysique définit, n’est pas un autre
monde que celui de la science [que Ruyer conçoit alors toujours comme dominée par les schèmes
mécanistes]. C’est le même exactement avec un simple changement de signe. Il présente les
mêmes détails, les mêmes corrélations, la même histoire. Il ne transcende pas l’univers de la
science, il est cet univers dans la force du mot : il est l’existence des objets connus.» Et Ruyer de
conclure ce passage en arguant que la métaphysique « est indispensable pourtant, et du point de
vue de la science même, pour calmer les arrière-pensées en face de la reconstruction scientifique,
et faire cesser l’impression d’irréalité que donne si fortement aujourd’hui cette reconstruction»
[Ruyer 1935a, 91].
9. Clifford, Parodi, Russell, Wundt, Fechner, Paulsen et Eddington.
10. Remarquons que, dans un récent ouvrage, Renaud Barbaras s’est explicitement réclamé d’une
telle voie [Barbaras 2016, 133-135].
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
38
RÉSUMÉS
Chez Ruyer, il y a une rupture flagrante entre le « panmécanisme » des débuts, élaboré dans
l’Esquisse d’une philosophie de la structure (1930), et le panpsychisme de la maturité. Nous verrons
que son inscription dans le premier lui donna l’occasion d’entrer dans ce qu’il repère comme
étant la « grande voie naturelle de la philosophie ». Celle-ci consiste à chercher, en l’homme, la
trace du mode d’être commun à l’ensemble des individualités psycho-biologiques.
L’appartenance de Ruyer à cette « grande voie » ne s’est jamais démentie, de sorte que l’on peut
dire du « panmécanisme » de départ, que Ruyer a rapidement abandonné, qu’il fut fécond au
moins d’un point de vue méthodologique.
There is an obvious gap between Ruyer’s early “pan-mechanism”, developed in the Esquisse d’une
philosophie de la structure (1930), and the panpsychism one finds in his mature work. We will see
that working within the field of the former gave Ruyer the occasion to find what he identified to
be the “great natural way of philosophy”. This consists of searching in humans the trace of the
mode of being common to all the psycho-biological individualities. Ruyer’s affiliation to this
“great way” has never failed, which means that one can say his early “pan-mechanism”, which
Ruyer quickly abandoned, was fruitful, at least from a methodological point of view.
AUTEUR
BENJAMIN BERGER
Institut Saint-Pierre, Brunoy (France)
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
39
Comment Ruyer est devenu Ruyer.
Entre épistémologie et psycho-
biologie
Frédéric Fruteau de Laclos
1 Raymond Ruyer rédigea trois ouvrages alors qu’il était prisonnier des Allemands
pendant la seconde guerre mondiale, Le Psychisme et la Vie1, un petit texte sur les
valeurs2, enfin un « traité de métaphysique » qui sera publié en 1952 sous le titre Néo-
finalisme [Ellenberger 1995, 329-332]. Ces trois textes sont liés. Le premier et le dernier,
en particulier, représentent deux branches issues d’un même tronc, à moins qu’il ne
faille dire que l’un enfonce les racines à partir duquel peut s’élancer la ramure de
l’autre : Néo-finalisme [Ruyer 1952] est la première systématisation spéculative de
l’analyse des relations du psychologique et du vital proposée par les Éléments de psycho-
biologie. Le livre expose la métaphysique de la philosophie scientifique soutenue par
Ruyer dès lors qu’il a mis au centre de son propos la question de la vie, opérant ainsi ce
qu’on pourrait appeler son « tournant biologique ».
2 On sait que le camp d’officiers français, l’Oflag XVII A, dans lequel Ruyer demeura cinq
ans comptait de nombreux biologistes, dont l’éminent Étienne Wolff, professeur au
Collège de France à partir de 1955, fondateur d’un laboratoire d’embryologie afférent
au Collège3. Cependant, on aurait tort d’inférer de la présence de Ruyer aux cours de la
Société de biologie du camp une influence de Wolff, dans la mesure où Ruyer s’était
tourné vers le vivant et le vital dès avant le conflit. Une conférence prononcée en 1938
annonçait, au mot près, le propos de la première synthèse d’après-guerre. Ruyer avait
en effet proposé à la Société française de philosophie une intervention titrée « Le
“psychologique” et le “vital” » [Ruyer 1938]. L’engagement dans le tournant biologique
est encore plus net dans les articles qui suivent cette conférence, notamment
« Causalité ascendante et causalité descendante dans les sciences biologiques », texte
donné en 1939 à la Revue philosophique de la France et de l’étranger [Ruyer 1939a,b]. En
1957 encore, Ruyer se référera à la distinction notionnelle entre les deux types de la
causalité, preuve de la continuité de ses recherches depuis l’entre-deux-guerres [Ruyer
1957, 35]. Précisons cependant que continuité ne signifie pas identité : la continuité de
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
40
la recherche implique au contraire, par l’approfondissement d’un unique problème
affronté dès 1930, une diversité de positions, la distinction de différentes stations
jusqu’à la « psycho-biologie » épistémologiquement développée en 1946 et
métaphysiquement détaillée en 1952. C’est le sens de cette évolution continuée que
nous aimerions appréhender ici.
1 Actualités de la conscience
1.1 Le sens des structures dans l’Esquisse de 1930
3 Ruyer est connu pour sa critique du mécanisme. Il entend par là la doctrine classique
du partes extra partes ou du « proche en proche », selon laquelle tout se compose
actuellement dans l’étendue par figure et mouvement. Mais cette conception classique
s’étend jusqu’à la théorie einsteinienne de la relativité : les lignes d’univers que définit
la relativité fonctionnent encore selon le principe du « proche en proche ». Si l’univers
a une « structure fibreuse », selon l’expression reprise par l’épistémologue Émile
Meyerson à Lord Balfour, homme politique britannique et penseur « théiste »
[Meyerson 1921, 136-137], alors il faut convenir que cette structure et les fibres qu’elle
implique sont incapables de rendre compte du travail des formes vivantes et même de
l’efficace des domaines d’action infra-atomiques. Les fibres sont définies par la
relativité comme des lignes de continuité et de subsistance, alors qu’on devrait y voir
des lignes d’activité et d’existence biologiques [Ruyer 1952, 178-179].
4 Or, le lecteur des œuvres de la maturité découvre avec étonnement que Ruyer avait
commencé par défendre un certain mécanisme dans sa thèse de 1930, Esquisse d’une
théorie de la structure [Ruyer 1930]. Il est bien vrai que le mécanisme en question
excédait ou dépassait déjà le mécanisme classique : la théorie de la relativité
représentait l’avènement d’un concept de « forme » absent des conceptions
scientifiques antérieures. Ruyer reviendra sur cette thèse ultérieurement, car il lui
apparaîtra, après son tournant vitaliste, que les formes identifiées par la relativité sont
insuffisantes, que pour trouver des formes vraies, il faut se tourner plutôt vers la
biologie que vers la physique : les formes de la relativité ne vont pas tellement plus loin
que les configurations de la mécanique classique et la théorie d’Einstein relève de la
même conception générale du « proche en proche » que le mécanisme et toutes les
théories physiques-physicalistes4.
5 Au premier abord, cependant, l’univers de la théorie de la relativité paraît à la fois
unitaire et dynamique, il réalise une unité formelle telle que le dynamisme semble
compris en lui. La théorie d’Einstein unifie en effet le champ de la physique par
l’identification de l’inertie et de la gravitation, de la masse inertielle et de la masse
gravitationnelle. Les objets ne tombent pas, ils suivent la pente de leur « ligne
d’univers », dans un univers à quatre dimensions d’espace et de temps. Par là même est
réalisée une union indéfaisable entre l’espace et le temps. L’univers ne se réduit pas à
trois dimensions d’espace, au cœur desquelles le temps ne compte pas. C’est au
contraire un continuum quadri-dimensionnel, dont les « éléments » ne sont pas des
points-instants, mais des points-événements. On n’ira pas croire que les hommes de
science ont procédé à une nouvelle « spatialisation du temps », selon l’interprétation
bergsonienne courante, dans la mesure où le temps n’est pas spatialisé sans que
l’espace ne soit temporalisé, ainsi que l’ont bien vu des interprètes aussi différents de la
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
41
relativité que Alfred North Whitehead [Whitehead 1922] et Meyerson [Meyerson
1926b]. En un sens, la réalisation de cette unité fait de la relativité le parachèvement de
la mécanique classique. C’est la raison pour laquelle Einstein dit s’être hissé sur les
épaules de géants tels que Galilée et Newton. Toutefois, l’unité est bien différente de
celle de la science classique, puisque les éléments du monde ne s’agencent plus
« mécaniquement », comme les pièces d’une machine, briques homogènes censées
rendre raison de toutes les modifications phénoménales, mais ils sont liés
dynamiquement : l’univers est zébré de lignes de points-événements.
6 L’unité dynamique découverte par Einstein équivaut à une « forme » et tout l’enjeu est,
en 1930, de réformer le sens du mécanisme conformément à l’enseignement de la
théorie de la relativité. Mais au moment de procéder à cette réforme, Ruyer croise sur
sa route les interprétations idéalistes de la théorie. Ces interprétations émanent de
penseurs comme Meyerson, épistémologue auquel Ruyer ne cessera de se référer par la
suite, et Léon Brunschvicg, qui fut son professeur à l’École normale supérieure. Pour
ces auteurs, s’il y a forme, c’est qu’il y a invention de formes, et l’inventeur des formes
n’est autre que l’esprit. Les formes sont des idées, mais en un sens kantien plutôt que
platonicien. La question qui se pose est celle de la possibilité de la coïncidence entre ces
formes et les choses mêmes. Ici, Brunschvicg et Meyerson divergent. Le premier convie
à un néo-kantisme qui dénonce la persistance de la chose en soi par-delà les
phénomènes : les phénomènes sont le seul « en-soi ». Ce faisant, Brunschvicg
outrepasse les limites fixées jadis par Kant aux prétentions dogmatiques de la raison : il
statue dans l’absolu au niveau des phénomènes [Lebrun 1970, 180-189]. Il y a là un vrai
problème, épineux et incontournable, pour Meyerson, qui se déclare réaliste : nous
aurons beau nous efforcer de poser la réalité de nos idées, la nature résiste, et
l’irrationnel est le nom de cette résistance de la réalité [Meyerson 1926a, 327-364].
7 Ruyer est d’avis que c’est là un faux problème. Le vice commun des deux maîtres est de
se placer d’abord dans l’esprit, et de s’interroger ensuite sur la façon de rejoindre le
réel. C’est prendre un mauvais départ. On s’expose à ne pas arriver là où on le devrait :
l’esprit n’a finalement affaire qu’à lui-même, estime Brunschvicg. Ou l’on est conduit à
douter de jamais atteindre les choses mêmes : la nature refuse de répondre à nos
questions, juge Meyerson5. Or pour Ruyer, la forme, c’est le réel même6. La conscience
n’est que la réplique intérieure ou mentale de la structure du réel. Regard sur le réel,
elle en reproduit structuralement la forme. Elle est une structure qui correspond
structurellement à la structure de la forme réelle. La conscience n’est pas d’abord
donnée, elle n’est pas davantage ce qui donne la structure du réel ; elle est au contraire
ce qui reçoit cette structure, ce qui est informé par elle, ce à quoi la forme structurée se
donne. Dès lors, Ruyer se sent tenu de préciser la nature ou la structure de la
conscience. Il ne peut pas ne pas faire de psychologie. S’il refuse d’aller de la
psychologie à la métaphysique, selon le mouvement opéré par Jules Lachelier puis
Brunschvicg, la métaphysique inaugurée par la relativité l’oblige à refluer vers la
conscience et à s’expliquer avec la psychologie sur les mécanismes de réduplication
structurelle interne de la structure formelle du réel.
1.2 La conscience des structures dans l’opuscule de 1937
8 Le chemin de cette explication mène Ruyer à la rédaction de La Conscience et le Corps
[Ruyer 1937]. Tout en explicitant le sens de la conscience comme « forme vraie »,
comme « domaine de survol » ou « domaine d’auto-survol », il est conduit à « marquer
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
42
les rapports du biologique au psychologique », à explorer le « rapport psycho-
organique » [Ruyer 1937, 127, 141]. Il découvre alors non seulement que toute
conscience est une structure, mais bien plus que toute structure est une conscience. Il
faut éviter à tout prix la conception, typiquement idéaliste, de la conscience comme
réflexion, comme si l’esprit, en se réfléchissant, prenait conscience de lui-même et du
monde ; bien plus, comme si le monde ne pouvait être que le corrélat d’un esprit
réflexif. Les formes ne sont pas les productions ou les projections d’un esprit qui,
d’abord, se saisirait lui-même. Elles sont immanentes aux choses, les choses mêmes
sont structurées selon des formes vraies et elles le savent.
9 On dira, pour employer un vocabulaire hégélien et existentialiste que Ruyer reprend
pour le retourner contre l’idéalisme et la phénoménologie, que les formes ou les
structures sont en soi et pour soi. Mais, contrairement à ce qui se passe chez Hegel,
l’en-soi n’a pas besoin de « passer » dans un pour-soi pour être pleinement ce qu’il est,
il n’est pas en attente de la réflexion du pour-soi pour être soi ou un véritable Soi. Les
formes sont ce qu’elles sont, à savoir des structures, tout en « se possédant » elles-
mêmes comme structures. Ruyer synthétisera cette thèse en une forte formule lancée
dans Néo-finalisme :
Tout réel se possède lui-même ; autrement, qui donc le possèderait ? [Ruyer 1952,
96]
10 Les formes agissent tout en sachant d’un savoir immanent qu’elles agissent, et tout en
sachant comment agir pour parvenir à leur fin. Il ne faut pas croire que la révélation
des structures du réel dépende de l’éclairage d’une conscience, soit que la conscience
informe le réel en projetant ses formes sur le réel (point de vue idéaliste de
Brunschvicg), soit que la conscience rencontre le réel et s’efforce de rendre raison de sa
forme (point de vue réaliste au sens de Meyerson). En vérité, chaque réalité est
structurée selon une forme vraie, et la conscience des conditions de l’activité vivante
fait partie intégrante de cette activité. Évidemment, il peut y avoir quelque chose de
troublant à accorder la conscience à tout l’univers. On pourrait concéder, par un
anthropomorphisme facile, que les singes aussi sont conscients, mais ce sont des
mammifères supérieurs et, en vérité, Ruyer, lorsqu’il parle des vivants, a en tête toute
l’échelle des êtres ou tous les genres d’êtres, animaux et végétaux, les organismes
complexes aussi bien qu’élémentaires, amibes, protozoaires, micro-virus, bactéries. Car
la conscience possède ces vivants-là aussi. Elle les possède plus qu’ils ne la possèdent,
dira Néo-finalisme, à travers d’éclairantes analyses du sens de l’être et de l’avoir [Ruyer
1952, 130, 168]. Cela choque déjà notre bon sens philosophique. Mais Ruyer ne s’arrête
pas en si bon chemin, puisqu’à ses yeux ce qui se passe au niveau infra-atomique relève
également de la conscience [Ruyer 1952, 123-130, 169-173].
11 Ruyer sait bien que l’identification de la conscience et de la réflexion est très forte. Il
propose donc que l’on distingue « conscience primaire » (ou « psychisme primaire ») et
« conscience secondaire » (ou « psychisme secondaire »). Seule la conscience
secondaire correspond à ce que nous appelons généralement « conscience », c’est-à-
dire à la réflexion. Elle ne concerne en réalité que les animaux supérieurs, dont les
structures et les organes, notamment les structures cérébrales, sont suffisamment
différenciés. Mais le type de cette conscience ne doit pas dissimuler ce qui se passe en
général dans le corps, à savoir que le corps est le lieu d’activités conscientes d’elles-
mêmes. Comme le mot, décidément, peut prêter à confusion, Ruyer préfèrerait parler
en d’autres termes. Il forge à cette occasion les expressions conceptuelles de « domaine
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
43
de survol », de « surfaces absolues » ou « vraies », enfin de « subjectivités d’ensemble »
et « inconscientes », bientôt baptisées « auto-subjectivités » [Ruyer 1937, 57-58, 66-69,
81, 98-99, 102-103, 130-139]. Ces expressions signifient que toute activité suppose chez
l’agent un savoir intime que quelque chose arrive, et même un savoir intime de ce qui
arrive. L’exemple le plus clair que Ruyer prend dès La Conscience et le Corps, et qui sera
repris dans le chapitre IX de Néo-finalisme justement titré « “Surfaces absolues” et
domaines absolus de survol », est celui de la sensation visuelle [Ruyer 1937, 52-69],
[Ruyer 1952, 107-122]. Si j’analyse ce qu’est un champ visuel, je dois admettre que mon
esprit est coextensif à ce qui entre dans ce champ. Il n’y a pas de quatrième dimension
spirituelle du champ, qui viendrait s’ajouter à ce qui entre dans ses trois dimensions
spatiales. Ce que je vois, ici et maintenant, ne dépend pas d’une conscience qui
surplomberait les objets perçus. Supposer la nécessité de ce pas de côté pour que la
sensation visuelle soit constituée est absurde. Le champ visuel est ce qu’il est, ma
conscience est coextensive à ce qui entre en lui, loin d’être une entité qui, du dehors,
serait sa condition de possibilité. La conscience de surplomb est bien plutôt une
production seconde, une entité qui peut éventuellement se constituer dans le
prolongement du champ de conscience immanent. En aucun cas ce champ et la
conscience qu’il implique ne sont relatifs à une telle conscience. Ils sont, en eux-mêmes
et pour eux-mêmes, tout ce qu’ils ont à être. Autrement dit, non relatifs à une
conscience réflexive, ils se survolent eux-mêmes absolument. Ils constituent un
« domaine » sans dépendre d’une conscience qui les dominerait.
1.3 Toute conscience n’est pas conscience de phénoménologue
12 Pour faire entendre la distinction entre « conscience primaire » et « conscience
secondaire », on peut se référer à la différence marquée par Sartre entre « conscience
irréfléchie » et « conscience réfléchie », « conscience non thétique » et « conscience
thétique ». Évidemment, le rapprochement ne saurait être fait qu’avec d’immenses
précautions, car Ruyer s’est toujours tenu à distance de la phénoménologie et de
l’existentialisme. Pour lui, l’opposition de l’en-soi et du pour-soi (nom que reçoit la
conscience à partir de L’Être et le Néant) est l’envers ou la contrepartie d’un
matérialisme scientifique mal digéré, hérité de la science classique [Ruyer 1952,
101-102, 104]. Sartre croit, conformément au mécanisme classique, que l’univers par-
delà la « réalité humaine » – expression par laquelle Henry Corbin, premier traducteur
français de Heidegger, pensait pouvoir rendre l’allemand « Dasein » – n’est que matière.
C’est de ce point de vue que Sartre est conduit à opposer la conscience à la matière, le
pour-soi à l’en-soi, en définissant conscience ou pour-soi comme étant ce qu’ils ne sont
pas et comme n’étant pas ce qu’ils sont. Or, la distinction qui parcourt l’œuvre entière
de Sartre, entre la nature matérielle, étendue et inerte, et la conscience, pure visée
intentionnelle constitutive de la réalité humaine, est farouchement rejetée par Ruyer.
13 Pour autant, dès lors que l’on a admis avec Ruyer que la conscience n’est pas
spécifiquement humaine mais qu’elle peut être considérée comme un trait du vivant et
même du microphysique, on est frappé de la ressemblance entre le sens ruyérien de la
conscience primaire et la description de la conscience comme intentionnalité proposée
par Sartre dans les textes qu’il a rédigés à Berlin en 1933-1934 [Sartre 1939, 29-32],
[Sartre 1936]. D’abord, Sartre et Ruyer refusent tous deux l’idée que la conscience soit
réflexion. Sartre, en dénonçant l’intimité gastrique d’un esprit qui serait pure
réflexion, s’en prend à la philosophie française, traditions spiritualiste et
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
44
épistémologique comprises, de Lachelier et Bergson à Brunschvicg, Lalande et
Meyerson. À tous ces penseurs, Sartre oppose le renouvellement de la notion de
conscience dû à la définition husserlienne d’intentionnalité, Husserl étant tenu par
Sartre pour un « réaliste » : la conscience n’est pas quelque chose (l’esprit) qui ferait
face à d’autres choses (naturelles), à charge pour la première de fonder les secondes par
réflexion ou de les retrouver par objectivation et approximation. Non, la conscience est
immanente à ce qui entre dans son champ de visée : avoir conscience de l’arbre, ce n’est
pas s’en faire une représentation, c’est au contraire être projeté dans la poussière du
monde, auprès de l’arbre même.
14 Pour Ruyer, on l’a vu, avoir conscience de la table, ce n’est pas se détacher de la
sensation pour se la représenter, c’est être immédiatement présent à son champ visuel,
ce n’est faire qu’un avec ce champ considéré comme un absolu. Aucune dimension
supplémentaire, aucun dedans gastrique ne sont prérequis, mais on a affaire à un
« survol absolu », à une auto-subjectivité qui ne fait qu’un avec le domaine de ses
activités, au refus du détour par une conscience transcendante dont devrait dépendre
la considération de ce qui se trame dans l’univers. Ruyer refuse en particulier de
présenter la conscience comme la réflexion d’un esprit situé en surplomb : la
compréhension de la conscience primaire ne se déduit pas de l’activité d’une
conscience réflexive. C’est au contraire la réflexion qui apparaît comme un champ de
conscience secondaire au regard de l’activité d’une conscience primaire fondamentale.
15 On peut bien dire que Sartre et Ruyer sont tous deux également hostiles à la réflexion,
et que leur conception de la conscience, considérée comme irréfléchie ou absolue,
équivaut à l’affirmation d’une certaine forme d’immanentisme. Toutefois, précisons
bien, car de deux points de vue au moins les thèses de Sartre, héritières de la
phénoménologie de Husserl, paraîtront inacceptables à Ruyer. D’abord, la
phénoménologie permet de se passer de toute référence à un support physiologique, de
tout rapport au système nerveux, de toute attention à l’activité cérébrale. Le jeune
Sartre, auteur en 1927 d’un Diplôme d’études supérieures consacré au rôle et à la
nature des images dans la vie psychologique, avait bien de la peine à concilier les
« synthèses de l’Esprit » (qui deviendront les « visées ou intentions de la conscience »)
et les « éléments physiologiques », mouvements cinesthésiques et affects qui sont les
ingrédients de toute synthèse. Converti à la phénoménologie, il parvient, au moyen de
la notion husserlienne d’intentionnalité, à se passer de ces « éléments ». Mouvements
et désirs deviennent de simples « analogons » pour les visées imageantes, que la
conscience emprunte présentement au corps pour constituer des intentions d’objets
absents. Ils n’ont plus le caractère constitutif d’éléments, mais apparaissent comme de
simples supports matériels qui font bénéficier la conscience de leur présence pour
suppléer l’absence actuelle des objets visés [Fruteau 2015, 151-158], [Fruteau 2016,
199-204].
16 Si l’on se tourne vers La Conscience et le Corps, ouvrage contemporain de la réception
sartrienne de la phénoménologie, on voit que Ruyer y assume totalement l’identité
entre la conscience et le cerveau et, plus généralement, entre l’âme et le corps : « l’âme
est la forme “en soi” du corps » [Ruyer 1937, 101]. Dira-t-on qu’il pratique
tranquillement la réduction du psychologique au physiologique, que Sartre voyait
comme la seule solution possible au problème des relations de l’âme et du corps, mais
qui l’embarrassait tant en 1927 qu’il la contournait à partir de 1933-1934 grâce à
Husserl ? Pas exactement, dans la mesure où Ruyer envisage, plus qu’une réduction du
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
45
psychologique au physiologique, une exhaustion du physiologique au psychologique.
Loin de redouter le matérialisme, Ruyer s’avance au-devant de l’interprétation des
phénomènes cérébraux en « panpsychiste ». L’immanence radicale de la conscience, sa
coextensivité au champ de la sensation, enfin sa définition comme domaine absolu de
survol, valent pour le cerveau : l’activité cérébrale se possède elle-même sur le mode du
survol absolu ; le cerveau est une surface absolue qui ne requiert aucune autre
dimension, de côté ou de surplomb, pour être consciente de ce qu’elle fait [Ruyer 1937,
63-64, 98-108, 137].
17 Le deuxième point, non moins frappant, qui instaure une rupture radicale avec les
conceptions de Sartre, tient à ce que cette conscience-cerveau, cette possession de soi
par le corps dans le moment même où il vise et appréhende des objets qui se
présentent, est définie par Ruyer comme « forme vraie ». Cette conception, qu’on
pourrait dire platonicienne, sera progressivement assumée par Ruyer. Elle le conduira à
une doctrine très originale des « essences » définitivement élaborée dans Néo-finalisme.
À cet égard, l’écart est net avec la définition sartrienne : la conscience, si elle est
quelque chose, est intention, c’est-à-dire aussi bien tension ou visée. C’est dans ce
mouvement même que Sartre puise les éléments de son existentialisme : l’existence
d’abord, ensuite les essences ou les formes, par exemple la forme du Moi, de l’Ego, et
encore concédées à titre de tristes et stérilisantes réifications [Sartre 1936]. Ruyer est
très manifestement d’un autre bord. Pour reprendre une formule qui sera employée par
Henri Berr, si l’on réfléchit à la « portée de la conscience », on est conduit à un
« essentialisme psychologique » [Berr 1951, 227-246]. L’expression a une portée anti-
existentialiste générale mais, indépendamment du sens précis que lui donne Berr, elle
s’applique particulièrement bien à la doctrine que Ruyer finit par défendre.
2 Virtualités de la vie
2.1 Les schémas du vital
18 Dans l’Esquisse de 1930, Ruyer mettait en place un nouveau mécanisme des formes ou
des structures grâce à la théorie de la relativité. Il l’opposait aux paradigmes
scientifiques antérieurs hérités du mécanisme, régis par le partes extra partes, la
causalité de proche en proche, l’inertie de parties extrinsèques, successives et
juxtaposées dans l’espace. À présent, l’opposition s’est muée en une distinction entre
deux « champs » ou deux « domaines », le psychologique d’un côté et le physique de
l’autre. Les formes sont le psychique en soi ; il y a des domaines « molaires » où l’action
du psychique sous-jacent n’apparaît pas immédiatement, mais dont l’existence même
découle directement de l’activité sous-jacente ; ces domaines sont dits « physiques ».
L’opposition a une portée non seulement épistémologique, mais également
ontologique, conduisant à la distinction de deux classes ou de deux genres d’êtres : les
individus réels correspondent aux « formes vraies » ; les foules sont en revanche l’objet
d’un traitement statistique. On retrouve la distinction des deux ordres au début des
Éléments de psycho-biologie [Ruyer 1946, 1-4].
19 C’est à cette occasion que Ruyer prend conscience du rôle joué par les phénomènes
vitaux. Il va progressivement leur accorder une importance considérable [Simondon
2015, 126-128]. On le voit à quelques schémas et à quelques ajustements de schémas
proposés dans les écrits de cette période. Entre la conférence « Le “psychologique” et le
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
46
“vital” » [Ruyer 1938] et la contribution aux discussions organisées par Berr, « Du vital
au psychique » [Ruyer 1951], la polarité s’inverse : en 1951, le vital est finalement
présenté comme premier, le psychique second. Cette inversion se double d’une
vectorisation : Ruyer va du vital au psychique, alors qu’il s’était contenté d’abord de
juxtaposer les « champs ». En vérité, au départ, le vital était à peine un « champ », il
représentait plutôt le point de jonction des deux champs existants, le coin d’insertion
du psychologique dans le physique, « une sorte de colonisation, de domination
imparfaite exercée par un champ “psychoïde” [...] sur des phénomènes d’ordre
physique » [Ruyer 1938, 162]. Cela signifie que le vital fait l’objet d’une promotion
conceptuelle exceptionnelle. De simplement médian qu’il était, il devient dominant. Il
est décrit comme un champ essentiel et déterminant, au sens même où il est lié aux
essences et oriente l’actualisation des déterminations psycho-physiologiques.
20 Ruyer hérite de la schématisation de Nicolaï Hartmann [Ruyer 1951, 13-32]. Philosophe
allemand évoluant à Marburg dans un contexte néo-kantien, Hartmann tente de
dépasser l’épistémologie et ses « catégories subjectives » pour tracer de « nouvelles
voies vers l’ontologie », selon le titre d’un de ses livres. Il en découle une série de
« catégories objectives » : physique/ vital/ psychique/ spirituel. On a ici affaire à une
théorie des couches juxtaposées, des plus simples et générales aux plus complexes et
particulières. Dans un premier temps, Ruyer procède à une « contraction » : le
psychique apparaît comme relevant d’une couche ou d’une strate elle-même vitale.
C’est le niveau proprement « psycho-biologique », la mise sous dépendance du
psychique à l’égard du vital. Mais dans un deuxième temps, le psychique-vital paraît
supposer le spirituel. Il ne suffit pas de dire que les associations psychologiques des
idées diffèrent des normes du raisonnement, car elles en dépendent : l’acte de
conscience spirituel précède et prépare l’état de conscience psychologique ; ce dernier
ne représente qu’un état « dégradé, enkysté, substantialisé » du spirituel et « la vie a
rapport direct avec les domaines de valeur qu’elle incarne » [Ruyer 1951, 31]. Le vital
appelle donc le spirituel, auquel il s’adosse et dont il se nourrit : les « nourritures
psychiques », comme Ruyer les appellera plus tard, ne sont nourrissantes que parce
qu’elles sont tournées vers le spirituel qu’elles individualisent en l’incarnant [Ruyer
1975, 10, 17]. Il ne reste plus à Ruyer qu’à expliciter le sens et la portée de la dimension
physique pour parvenir au seuil de Néo-finalisme. Il le fait en précisant que le sens et la
signification sont absents du physique comme tel. Le sens ne doit son existence qu’à
l’investissement de formes vraies, d’essences ou de normes, lorsque celles-ci
condescendent à s’incarner ou à s’actualiser : « on ne conçoit pas comment, d’un
univers purement physique, le sens, le significatif, peut surgir » [Ruyer 1951]. À vrai
dire, Ruyer va plus loin ici, et le tournant finaliste semble complet : « l’ordre physique
ne représente pas un ordre de réalité, mais plutôt un mode de légalité ». Seuls les
individus ont du sens, le reste, uniquement soumis au proche en proche, n’a de réalité
qu’à proportion des interactions entre les individus qui l’animent et le constituent. Ce
schéma est à peu de choses près celui de Néo-finalisme, il annonce en particulier la
« description de l’activité finaliste » proposée dans le deuxième chapitre du livre
[Ruyer 1952, 9-17].
2.2 Les visions du virtuel
21 Toutefois, dans un tel schéma n’est pas encore développée une caractéristique
essentielle du vitalisme ultimement assumée par Ruyer, à savoir sa dimension virtuelle.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
47
Dès la fin des années 1930, la virtualisation du vital est en marche, comme en
témoignent les textes écrits juste avant la mobilisation. Nous devons être bien
conscients du changement théorique qui s’opère chez Ruyer, des transformations
auxquelles il est contraint par sa propre évolution. La captivité n’a fait qu’accompagner
une mue amorcée avant la guerre, et même quasiment accomplie en 1939. Les leçons
d’embryologie reçues en Oflag ont achevé de convaincre Ruyer que le vital est central
et que cette centralité se manifeste depuis une position virtuelle : le vital témoigne de
l’efficace d’une réalité potentielle, idéelle sans être abstraite, réelle sans être actuelle.
22 Comment se fait-il que les relations du champ psychologique et du champ physique
appellent avec nécessité un approfondissement virtuel ? C’est que, dans le cas de
l’analyse des êtres vivants, les possibilités explicatives offertes par l’hypothèse
actualiste semblent insuffisantes. Cette hypothèse impliquerait en effet que les êtres
futurs soient « préformés » dans la cellule germinale. C’est à peu près la position que
soutenait – avec un humour qui le plaçait à distance du sérieux scientifique – l’écrivain
Samuel Butler, référence choyée par Ruyer7. Butler, dans La Vie et l’Habitude [Butler
1878], défend des thèses « mnémistes ». Il identifie mémoire et hérédité, et affirme que
l’hérédité est une mémoire géante, qui se transmet de génération en génération, mais
aussi bien que la mémoire est héréditaire, qu’il y a une mémoire organique qui
surplombe la mémoire psychologique individuelle. Opposé à Darwin, il est lamarckien :
il croit à la transmission des caractères acquis. Mnémiste anti-darwinien, il est
également actualiste : il est d’avis que la mémoire organique est inscrite dans les
cellules comme modification actuelle, c’est-à-dire qu’elle est ici et maintenant – un des
points-instants dans la structure complexe imposée par la théorie de la relativité, dirait
le Ruyer de l’Esquisse de 1930. Mais comment les structures de tous les êtres à venir
pourraient-elles être emboîtées par avance dans la moindre cellule germinale ? Il
faudrait aller à l’infini dans l’actuel. Ce n’est pas impossible, mais cela débouche
immédiatement sur des considérations métaphysiques qu’il faut être un Leibniz pour
accepter sans broncher [Jacob 1970, 73-74].
23 Or, du point de vue de Ruyer, une des branches récemment développée de la science du
vivant permet de se passer de l’hypothèse actualiste-préformiste, et même oblige à un
approfondissement par le virtuel : l’embryologie fait apercevoir que l’hérédité, dont le
mode de fonctionnement est mnésique ou mémoriel, n’en passe pas par des traces ou
« engrammes », qui seraient des préformations matérielles inscrites dans la structure
actuelle de l’organisme. L’être vivant croît par multiplication et différenciation
progressives, et non à partir d’éléments préformés dans l’œuf. L’embryologie révèle
que l’hérédité dépend d’une mémoire organique dont le mode d’être ou d’existence est
virtuel, et non actuel. Ce sont des puissances ou des potentialités, qui s’actualisent et
s’incarnent dans les structures vivantes à mesure que l’œuf se développe, car « l’œuf ne
peut contenir d’avance cette complexité à l’état de trace ou de plan d’architecture. Si
l’œuf le fait “par habitude”, cette habitude est un fonctionnement de traces, ou de
micro-structures quelconques » [Ruyer 1963, 7].
24 Cette conception du potentiel ou du virtuel a été anticipée par des penseurs dont Ruyer
se réclame. Un psychologue anglais émigré aux États-Unis, William MacDougall, l’a
soupçonnée. Il a beau écrire dans le contexte du béhaviorisme, approche anti-
internaliste du comportement due à John Broadus Watson, il est partisan d’un
dynamisme vitaliste. Son véritable maître se nomme James Ward, lointain héritier de
Franz Brentano, lui-même premier promoteur du concept d’intentionnalité. Attaché à
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
48
l’identification d’un substrat biologique des intentions, MacDougall situe dans l’activité
de l’organisme l’intentionnalité des conduites. Intentionnaliste contre le béhaviorisme,
mais biologisant contre la phénoménologie naissante : tel est l’alliage, contraire à nos
intuitions historiques, qu’offre à Ruyer l’œuvre de MacDougall.
25 Mais en France même, deux précédents ont vivement marqué Ruyer. L’œuvre d’Henri
Bergson propose ainsi un premier couplage du mémoriel et du virtuel 8.
Malheureusement, Bergson identifie le virtuel et l’élan vital tout en déclarant que ce
virtuel se déploie en marge du matériel, qu’il lui faut le contourner en permanence
comme un obstacle mis sur la voie de son développement et de sa différenciation
[Bergson 1908]. Or pour Ruyer, le virtuel est formes et non forces, éternité d’objets
essentiels et non devenir de données sans contour. Ruyer refuse de renoncer aux
formes-structures au profit d’un pur élan vital. La structure adulte n’est pas dans la
propre durée créatrice de l’œuf, car si un accident survient, la forme ne se développera
pas, tout en continuant d’exister. Dans le même temps, il ne faut pas craindre
d’affirmer que le virtuel est immanent au cerveau, qui l’exprime adéquatement : le
cerveau, comme l’embryon, est un domaine d’équipotentialité susceptible de s’incarner
ou de s’actualiser diversement, mais toujours en obéissant à un même thème dicté par
le potentiel [Ruyer 1952, 58, 88-89], [Fruteau 2016, 204-216]. Cette thèse était formulée
dès 1937 en des termes explicitement anti-bergsoniens [Ruyer 1937, 105-107]. C’est dire
que Ruyer est à la fois plus réticent à l’égard d’une pure énergie spirituelle et plus
engagé dans la matière que ne l’est Bergson : si le virtuel est formel, les formes ne font
qu’un avec la matière qui les actualise.
26 Sans doute est-ce d’un autre penseur français que Ruyer se sent le plus proche. Auteur
d’une remarquable psychologie des tendances, Albert Burloud est aussi critique à
l’égard de la phénoménologie que du bergsonisme. Pour lui, les intentions, loin de
relever d’une prise transcendantale, dépendent d’une analyse psycho-philosophique ;
ce sont des forces psychologiques, des tendances inconscientes fonctionnant
automatiquement, mais à comprendre comme des formes dynamiques s’inscrivant dans
des mouvements et des représentations. Toute activité est commandée et orientée par
des tendances affectives, les plus complexes équivalant à des thèmes formels, que
Burloud appelle des « abstraits réels », qui en passent par des schèmes variables pour
s’actualiser. Ainsi en est-il, chez l’homme, du besoin de connaître ou même du besoin
de manger [Burloud 1950, 32, 49-50]. Que le corporel soit dominé par le psychique,
l’actuel immédiatement animé par un potentiel thématique, voilà qui avait tout pour
plaire à Ruyer [Ruyer 1952, 261], [Ruyer 1963, 7].
2.3 La métaphysique néo-finaliste en creux
27 La mue virtualiste de Ruyer est presque totalement accomplie dans l’article qui suit la
conférence de 1938 à la Société française de philosophie « Causalité ascendante et
causalité descendante dans les sciences biologiques ». Tout l’arsenal des arguments
scientifiques et philosophiques est mobilisé pour que puisse se déployer la
métaphysique virtualiste de la vie de Néo-finalisme. Il apparaît que les formes ne sont
(finalement pas) la résultante des structures et de leurs effets de fonctionnement « de
proche en proche », quand bien même on entendrait celles-ci au sens de la théorie de la
relativité. Les formes, notamment, ne peuvent pas émerger d’un travail qui serait de
« consolidation », de coalescence ou de renforcement progressif des parties extensives.
Ruyer combat ici la thèse du philosophe belge Eugène Dupréel, pour laquelle il nourrit
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
49
par ailleurs le plus grand respect [Ruyer 1939a,b, 10-18, 28]. En vérité, c’est aussi bien
lui-même qu’il combat dans ces pages : Dupréel propose une solution actualiste au
problème de la distinction des champs, de l’apparition dans l’actualité d’un champ
psychologique différent par nature des champs physiques. Mais, explique Ruyer, il y a
lieu de distinguer deux types de causalité. Le jeu des structures engage un premier type
de causalité, que Ruyer nomme « descendante ». Un véritable platonisme du virtuel ou
du potentiel se fait jour : ce qui apparaît ou produit ses effets structurels d’en haut est
irréductible à l’actualité de ce qui se trame ici-bas [Ruyer 1939a, 56]. Par exemple, ce
n’est certes pas l’action des pierres qui explique la forme de la maison ; l’élévation
suppose au contraire une forme et une finalité extérieures, transcendantes. Il
n’empêche qu’une fois agencées, les pierres peuvent avoir une action sur la forme de la
maison, selon leur jeu ou leurs coactions de proche en proche. Ruyer voit dans cette
action en retour l’effet d’une causalité « ascendante ».
28 L’analogie avec la musique fournit le concept de « thème » promis chez Ruyer à une
vraie fortune spéculative : la suite des notes d’une mélodie obéit à la forme d’un thème
qui la domine ; les notes ne se soutiennent pas d’elles-mêmes, elles sont orientées et
constamment dirigées par le thème. Plus largement, référence est faite à un certain
vitalisme métaphysique du tournant du siècle, qui, « de Schopenhauer à Ravaisson et
Bergson », a développé le « thème biologique de la “volonté” », laquelle désigne assez
bien « le caractère potentiel de la forme » [Ruyer 1939a, 54]. Dès lors, tout est en place
pour les Éléments de psycho-biologie [Ruyer 1946]. Se précisent l’analyse de l’embryologie
et le rapprochement avec la mécanique quantique, comme le montrent les références
aux travaux sur les quanta de Louis De Broglie et Charles Dirac. S’y dégagent également
la parenté entre mémoire et hérédité, la compréhension de la mémoire comme réalité
organique. Ce qui, en revanche, a encore du mal à être affirmé, c’est l’existence d’un
domaine véritablement « trans-spatial », domaine de la finalité, des essences et des
valeurs, qui sera mis à l’honneur dans Néo-finalisme. N’est-ce pourtant pas un tel
domaine qui se dégage en creux dans ce qu’écrit alors Ruyer ?
29 Qu’est-ce en effet, demande Ruyer, qu’une existence incontestable, aux effets tangibles,
qui ne serait pas définie ? Ce serait une forme sans structure, et ce ne serait rien. Il
semble qu’il y ait impossibilité logique et ontologique à concéder l’existence à une
réalité qui ne se laisserait pas définir structurellement. C’est qu’aux yeux de Ruyer
alors – ou encore – toute forme semble devoir en passer par une ou des structures
actuelles : une forme est supposée être ou exister, et pouvoir être définie, actualiter.
L’hypothèse d’un arrière-monde platonicien se profile cependant, formulée par le biais
d’un « tout se passe comme si » timide, hasardeux [Ruyer 1939a, 57]. Un tel arrière-
monde non seulement serait lié au monde actuel, auquel il collaborerait, mais bien plus,
au cœur de cette liaison, aurait l’ascendant ontologique, en dominant causalement les
structures actuelles.
30 Nous n’avons pas affaire à un métaphysicien en mal de quintessence : Ruyer y insiste, la
postulation d’un arrière-monde s’impose au philosophe préoccupé de scientificité,
attentif à décrire la réalité, aussi bien les faits sociaux que les phénomènes vitaux. À
quoi l’arrière-monde ressemblerait-il s’il devait exister ? Comment peut se présenter
un monde qui n’est pas actuellement présent ? En quels termes définir l’indéfini ou
l’indéfinissable ? La formulation de ces questions ruine apparemment la possibilité
d’apporter des réponses sensées. C’est néanmoins à un tel exercice, véritablement
paradoxologique, que Ruyer choisit de se livrer. Il commence à lever le voile sur le sens
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
50
de la réalité auquel l’engage la reconnaissance de la surexistence – existence
indépendante, préexistante, survivante – d’un monde de formes potentielles, dans tous
les domaines ou dans tous les champs, organique, sociologique, psychologique. De fait,
lorsqu’il assumera cet « engagement », il sera conduit à une mise en ordre des formes, à
une description détaillée et raisonnée des niveaux du trans-spatial. Il y logera toutes les
formes, des formes-structures (organes, outils ou œuvres matérielles) aux formes-idées
(âmes individuelles, je et x individuels d’un côté ; thèmes mnémiques, idées, essences,
de l’autre), enfin à Dieu l’insaisissable, considéré soit comme agent, soit comme idéal.
C’est à établir schématiquement, diagrammatiquement, cette cohérence du monde des
formes, que Ruyer travaillera dans les dernières pages de Néo-finalisme [Ruyer 1952,
288].
31 Mais le problème est plus général, relevant de questions de logique et d’ontologie
mêlées, dont les accents sont franchement leibniziens. Quel rapport les premiers
possibles entretiennent-ils, entre eux d’une part, avec le réel d’autre part ? Les
possibles tendent-ils d’eux-mêmes à l’existence ? Ruyer ne voit pas pourquoi les
possibles, « s’ils avaient toute la place ailleurs », chercheraient à s’actualiser ici-bas,
compte tenu de « l’élagage sévère de notre monde aux réalisations limitées » [Ruyer
1939a, 57-58]. C’est à ce niveau d’abstraction qu’il faut reprendre l’interrogation à
partir du moment où l’on entend satisfaire aux exigences d’une explication du vivant,
du psychique ou du social. Ruyer ne sera pas toujours assuré de ses thèses et il usera de
mille précautions pour répondre aux demandes de précisions concernant la nature et le
mode d’action du trans-spatial [Ruyer 1948a, 58-162]. Mais il assumera dès lors la
position virtualiste du problème de l’existence des formes. Dès la fin du texte de 1939, il
se prépare à outrepasser les limites de la logique et du principe de non-contradiction,
en tant qu’ils s’exercent sur des réalités actuelles. Qu’est-ce qui fait, demande-t-il ainsi,
que le concept bergsonien d’évolution créatrice et celui, anglo-saxon, d’émergence sont
« déconcertants » et « à demi contradictoires » ? C’est qu’ils supposent des entités qui
sont là sans être là, des réalités qui agissent virtuellement sans être données
actuellement, autrement dit qui n’existent pas si l’on s’en tient à des positions
actualistes, qui existent d’une manière singulière si l’on accepte de concéder l’existence
au virtuel. Ruyer est alors tout près de reconnaître ce genre d’existence, la dissociation
entre structures actuelles et formes virtuelles étant presque consommée : il est admis
que les structures peuvent être considérées indépendamment des formes et que les
formes collaborent causalement avec les structures. « La naissance et la mort d’un être,
apparition et disparition absolues [dans l’actuel] », signalent le mode d’intervention
causal, et causalement descendant, des formes virtuelles, cette action équivalant à
l’actualisation ici-bas d’âmes, de je ou d’x individuels qui participent eux-mêmes d’une
nature trans-spatiale.
32 L’évolution propre de Ruyer l’a ainsi irrésistiblement amené à défendre une conception
originale du vital, qui s’exprimera scientifiquement dans Éléments de psycho-biologie et
s’explicitera spéculativement dans Néo-finalisme. En témoignent l’intense productivité
précédant le second conflit mondial, l’importance des difficultés qu’affronte alors le
développement philosophique de l’œuvre, la foule des hypothèses que le penseur
mobilise et met à l’épreuve, enfin l’esquisse en creux, par-delà les réticences initiales,
d’une solution virtualiste aux problèmes rencontrés. Rien ne portait Ruyer à la
métaphysique. Il n’y aurait pas été conduit si le dépassement psycho-biologique de
l’épistémologie des structures ne l’avait exigé et finalement imposé.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
51
BIBLIOGRAPHIE
BERGSON, Henri [1908], L’Évolution créatrice, Paris : PUF, 2008.
BERR, Henri [1951], La portée de la conscience. l’essentialisme psychologique, dans Valeur
philosophique de la psychologie, Paris : PUF, 227–246.
BURLOUD, Albert [1950], De la psychologie à la philosophie, Paris : Hachette.
BUTLER, Samuel [1878], La Vie et l’Habitude, Paris : Éditions de la Nouvelle Revue française, trad. fr.
V. Larbaud, 1922.
DELEUZE, Gilles [1967], La méthode de dramatisation, dans L’Île déserte et autres textes. Textes et
entretiens 1953-1974, édité par D. Lapoujade, Paris : Éditions de Minuit, 131–162, 2002.
DELEUZE, Gilles [1968], Différence et répétition, Paris : PUF.
ELLENBERGER, François [1995], Quelques souvenirs personnels sur Raymond Ruyer, dans Raymond
Ruyer, de la science à la théologie, édité par L. Vax & J.-J. Wunenberger, Paris : Éditions Kimé, 323–
333.
FRUTEAU DE LACLOS, Frédéric [2015], La métaphysique des forces et les formes du psychisme.
Deleuze, Sartre et les autres, Revue philosophique de la France et de l’étranger, 140(2), 149–168,
10.3917/rphi.152.0149.
FRUTEAU DE LACLOS, Frédéric [2016], Les fruits philosophiques perdus de la psychologie française,
dans L’angle mort des années 1950. Philosophie et sciences humaines en France, édité par G. Bianco &
F. Fruteau de Laclos, Paris : Pubications de la Sorbonne, 193–213.
JACOB, François [1970], La Logique du vivant. Une histoire de l’hérédité, Paris : Gallimard.
LEBRUN, Gérard [1970], Kant et la fin de la métaphysique : essai sur la « Critique de la faculté de juger »,
Paris : Librairie générale française, 2003.
MEYERSON, Émile [1921], De l’explication dans les sciences, Paris : Fayard, 1995.
MEYERSON, Émile [1926a], Identité et réalité, Paris : Vrin, 1951.
MEYERSON, Émile [1926b], La Déduction relativiste, Paris : Gabay, 1992.
RUYER, Raymond [1930], Esquisse d’une philosophie de la structure, Paris : Félix Alcan.
RUYER, Raymond [1937], La Conscience et le Corps, Paris : Félix Alcan.
RUYER, Raymond [1938], Le « psychologique » et le « vital », Bulletin de la Société française de
philosophie, 39, Séance du 26 novembre 1938(1), 159–195.
RUYER, Raymond [1939a], Causalité ascendante et causalité descendante dans les sciences
biologiques (I), Revue philosophique de la France et de l’étranger, 127(1–2 janvier–février 1939), 25–64.
RUYER, Raymond [1939b], Causalité ascendante et causalité descendante dans les sciences
biologiques (II), Revue Philosophique de la France et de l’étranger, 127(3–4 mars–avril 1939), 190–224.
RUYER, Raymond [1946], Éléments de psycho-biologie, Paris : PUF.
RUYER, Raymond [1948a], Le domaine naturel du trans-spatial, Bulletin de la Société française de
philosophie, 42, Séance du 31 janvier 1948(5), 133–165.
RUYER, Raymond [1948b], Le Monde des valeurs. Études systématiques, Paris : Aubier.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
52
RUYER, Raymond [1951], Du vital au psychique, dans Valeur philosophique de la psychologie, édité par
Centre International de Synthèse, Paris : PUF, 13–51.
RUYER, Raymond [1952], Néo-finalisme, Métaphysiques, Paris : PUF, 2 éd., Préface de F. Colonna,
2012.
RUYER, Raymond [1954], La Cybernétique et l’origine de l’information, Paris : Flammarion, 1968.
RUYER, Raymond [1957], Behaviorisme et dualisme, Bulletin de la Société française de philosophie, 51,
Séance du 26 janvier 1957(1), 1–45.
RUYER, Raymond [1963], Raymond Ruyer par lui-même, Études philosophiques, 80(1), 3–14, 10.3917/
leph.071.0003, texte original paru en 1963 dans Les Philosophes français d’aujourd’hui par eux-mêmes,
édité par G. Deledalle et D. Huisman, Paris : CDU, 262–276, 2007.
RUYER, Raymond [1975], Les Nourritures psychiques : la politique du bonheur, Paris : Calmann-Lévy.
SARTRE, Jean-Paul [1936], La Transcendance de l’Ego, Paris : Vrin, 1992.
SARTRE, Jean-Paul [1939], Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl :
l’intentionnalité, dans Critiques littéraires. Situations 1, Paris : Gallimard, 29–32, 1947.
SIMONDON, Gilbert [2015], Sur la psychologie : 1956 - 1967, Paris : PUF.
WHITEHEAD, Alfred North [1922], Le Principe de relativité et ses applications en physique, Louvain-la-
Neuve : Chromatika, 2012.
NOTES
1. Les Presses Universitaires de France imposeront le titre Éléments de psycho-biologie [Ruyer
1946].
2. Le Monde des valeurs paraîtra chez Aubier [Ruyer 1948b].
3. Ruyer lui-même le rappelle au début des Éléments de psycho-biologie [Ruyer 1946, Avant-propos
non paginé]. Ce Wolff ne doit pas être confondu avec un des interlocuteurs de Ruyer à la Société
française de philosophie, le philosophe Edgar Wolff.
4. Il y a lieu de préciser « physiques-physicalistes», car la mécanique quantique est un paradigme
de la physique, c’est même, si l’on se réfère à son nom, un paradigme « mécanique». Pourtant,
elle introduit selon Ruyer à la considération des formes vraies, n’étant par là ni physicaliste ni
mécaniste.
5. Ruyer semble faire en 1930 comme si Meyerson voyait dans la relativité l’avènement d’un
véritable « acosmisme» : la matière du réel serait purement et simplement niée par la forme
unitaire imposée par la rationalité einsteinienne [Ruyer 1930, 30-32, 223-232, 284-285]. Si c’était
le cas, Meyerson serait proche de Brunschvicg, épistémologue héritier du spiritualiste Lachelier
[Ruyer 1930, 286-300]. Ruyer n’ignore cependant rien de ce qui sépare Meyerson de Brunschvicg.
Il sait notamment que Meyerson a repéré dans l’irrationalité de la nature une résistance sur
laquelle achoppent les visées identifiantes de la raison. La complexité de la position
meyersonienne inspirera d’ailleurs à Ruyer la formulation d’un « dilemme de Meyerson» : « ou
comprendre un phénomène, en ramenant à une pure identité, par déduction à partir d’autres
phénomènes, les éléments de nouveauté qu’il semble contenir ; ou admettre la nouveauté comme
absolue, et renoncer à comprendre» [Ruyer 1954, 175].
6. En ce sens, Ruyer est de plain-pied avec les réalistes de langue anglaise, Samuel Alexander,
Charles Dunbar Broad, Roy Sellars, mais aussi Whitehead. Il faudrait également faire une place à
un des interlocuteurs d’Einstein, le physicien britannique Arthur Eddington. Ces penseurs étaient
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
53
connus en France au début du XXe siècle, discutés notamment à la Société française de
philosophie.
7. Dans ce cas-là, devons-nous estimer que Ruyer a été entraîné sur la voie virtualiste par la
considération du vivant, et non d’abord par la microphysique, qu’il a été amené à se pencher sur
la microphysique pour ne pas restreindre l’hypothèse au vivant mais l’étendre à la « matière
physique» ? À vrai dire, si l’on regarde la conférence de 1938 à la Société française de
philosophie, la microphysique était déjà tenue pour caractéristique du champ psychologique,
arrachée ce faisant au champ physique. Dès lors que le vivant obligeait à faire basculer le champ
psychologique dans le virtuel, il apparaissait que le microphysique, déjà placé dans la
dépendance du psychologique, devait à son tour basculer dans le virtuel. C’est à obtenir cette
confirmation que Ruyer travaille à partir de 1939 en interrogeant les textes de Louis de Broglie.
8. L’importance de ce couplage est décisive, car c’est le canal de la filiation avec les travaux de
Gilles Deleuze, qui insistera sur le commun attachement de Bergson et de Ruyer au virtuel
[Deleuze 1967, 141], [Deleuze 1968, 279].
RÉSUMÉS
La guerre et la captivité, en mettant Raymond Ruyer en relation avec des biologistes, ont donné à
ce philosophe parti du mécanisme et de la théorie de la relativité l’occasion d’accéder au
matériau scientifique dont il avait besoin pour élaborer sa « psycho-biologie ». Mais les thèses les
plus fortes de Néo-finalisme sont le résultat d’une évolution lente entamée dès la fin de sa thèse de
doctorat. Parti de positions nettement actualistes, Ruyer a commencé à soupçonner la nécessité
d’une profondeur virtuelle de la vie au milieu des années 1930, et il a atteint le point de bascule
dans l’épaisseur du sens et de la signification dans les ultimes publications précédant la seconde
guerre mondiale. Il lui est alors apparu qu’il devait admettre, par-delà la sécheresse de la
structuration causale du proche en proche, une doublure psycho-biologique susceptible d’animer
la moindre étendue de matière.
Raymond Ruyer was first interested in mechanism and relativity. War and captivity gave this
philosopher the occasion to meet biologists and to discover the rich material he needed to
develop his “psycho-biology”. Yet the main theses of Neo-finalism are the result of a long
evolution with its origins in Ruyer’s doctoral thesis. First a strong defender of actualist positions,
Ruyer began to consider the necessity of admitting a virtual depth for life in the middle of the
thirties, and he reached the thickness of meaning and signification in the articles he published
just before the Second World War. He then realized he had to admit, beyond the drought of the
causal structuration of the partes extra partes, a psycho-biological lining for the mere extent of
matter.
AUTEUR
FRÉDÉRIC FRUTEAU DE LACLOS
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France)
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
54
Ruyer lecteur de Bachelard :
réunifier l’image du monde
Ruyer Reading Bachelard: Re-Unifying the Image of the World
Fabrice Colonna
1 Rien n’a tant importé pour des philosophes comme Ruyer et Bachelard que le nouage
de la philosophie et de la science. Derrière ce constat d’évidence, qui dessine
immédiatement leur communauté d’esprit, il faut saisir aussi une indication sur leur
manière de concevoir le travail philosophique. Comment travaillent les philosophes ?
Des penseurs comme Bachelard et Ruyer ne donnent pas du tout à cette question la
même réponse que celle que fournirait un phénoménologue par exemple. Le labeur
philosophique consiste en effet, pour nos deux auteurs, à étudier les publications des
savants. Philosopher, c’est d’abord se mettre à l’école de la science, c’est donc
concrètement lire des traités et des articles scientifiques. Homme du livre, Bachelard
nous invite à prêter attention « à l’être du livre, au bibliomène » [Bachelard 1951, 6] : le
livre de science est en perpétuelle réécriture, il recueille un savoir collectif toujours
amélioré et il ne cesse, au gré de ses rééditions, de cristalliser les efforts de la cité
scientifique. C’est pourquoi « parfois il ne peut être lu sans une très longue
préparation » [Bachelard 1951, 8]. Et l’auteur du Rationalisme appliqué [Bachelard 1949]
d’évoquer la joie de lire, avec la discipline de l’écolier, les nouveaux manuels de
physique :
Ils sont là sur ma table ensoleillée. Septembre mûrit les fruits de mon jardin.
Bientôt octobre, le grand mois ! le mois où toutes les écoles sont jeunes, le mois où
tout recommence pour la pensée studieuse. Et voilà qu’avec un seul bon livre, avec
un livre difficile, je vis dans un octobre permanent ! [Bachelard 1949, 214]
2 Sur la table de Ruyer, les manuels d’embryologie remplacent ceux de physique, science
qu’il étudie plutôt dans les travaux de haute vulgarisation produits par les savants.
Mais la démarche est identique à celle de Bachelard. Il écrit ainsi :
On reconnaît le vrai philosophe à ce qu’il déteste lire les livres de philosophie pure
– ne concluez pas qu’il suffit de détester les livres de philosophie pour être un vrai
philosophe – à ce qu’il préfère se mettre au courant de telle science qu’il ignore, ou
s’initier aux procédés de tel art. [Ruyer 1946, 56]
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
55
3 Ruyer se définit comme un « philosophe d’esprit scientifique » qui souhaite persuader
les autres philosophes « de ne pas couvrir d’un prétexte de modestie
phénoménologique ou de purisme méthodologique l’envie tenace de philosopher rien
qu’en se prenant la tête à deux mains » [Ruyer 1960a, 36]. La vraie modestie est celle qui
consiste à ne pas prétendre tout tirer de son propre fonds et à se remettre
constamment à l’école des sciences.
4 Cependant, malgré cette incontestable proximité entre la démarche de Bachelard et
celle Ruyer, une divergence existe entre eux quant à la façon exacte dont la philosophie
doit prendre position devant la science. Le nouage évoqué peut se faire de plusieurs
manières, et celle de Ruyer n’est pas celle de Bachelard. Une fois les faits scientifiques
assimilés, l’interprétation qu’ils appellent ne relève pas des mêmes objectifs chez l’un
et l’autre penseur. On donnerait une première approximation de cet écart en disant que
Bachelard est épistémologue tandis que Ruyer est métaphysicien, ce qui est aussi sa
dissonance propre dans le paysage épistémologique français du vingtième siècle. La
science selon lui est le point de départ d’une métaphysique, elle sert à rendre précises
des conceptions vitalistes autrement frappées de confusion. Ruyer souhaite élaborer ce
qu’il appelle lui-même une « philosophie-science », qui intègre dans une vision globale
du monde les acquis de la physique, de la biologie et de la psychologie. Toutefois la
différence, qui n’est pas une opposition, entre métaphysique et épistémologie ne doit
pas être figée. Les considérations épistémologiques sont loin d’être absentes chez
Ruyer, et Bachelard n’a pas rejeté en bloc la métaphysique. Surtout, Bachelard n’a pas
fait seulement œuvre d’épistémologue : son exploration de l’imaginaire, qui s’épanouit
en une véritable ontologie, témoigne du fait qu’il savait que l’épistémologie ne suffisait
pas, que l’esprit humain, dans sa dualité, exigeait autre chose que la seule activité
rationaliste.
5 Or, pour Ruyer, il est justement regrettable que la philosophie de Bachelard reste ainsi
partagée en deux. Il doit être possible de faire se rejoindre les deux directions du
concept et de l’image, c’est-à-dire de réconcilier Bachelard avec lui-même. La richesse
de sens que nous offre la rêverie archétypale, ne peut-on la trouver aussi dans ce que la
science nous apprend du monde ? Ruyer en a la conviction. Pour lui le moyen terme est
précisément la métaphysique. Celle-ci se maintient dans le concept, mais sur un autre
plan que celui de la rationalité scientifique, et elle peut capter les pouvoirs d’évocation
de la poésie. Comme l’écrit Ruyer, « au lieu de discuter, dans l’absolu, sur la légitimité
et le sens d’une métaphysique au-delà de la science, il serait bon de définir une sorte de
métaphysique plus modeste, qui serait une sorte de cosmologie du connaissable au-delà
de l’observable » [Ruyer 1952b, 418]. Choisir entre une philosophie critique et une
métaphysique des sciences relève donc d’un enjeu très précis : jeter un pont entre la
raison et le mythe. La lecture que Ruyer fait de Bachelard consiste donc à adhérer sans
guère de réserves – il y en aura quelques-unes toutefois – aux résultats de ses
réflexions, tout en proposant, sur cette base même, une métaphysique que Bachelard
s’est toujours interdite et qui permet de ne pas scinder en deux la vie du philosophe, ni
l’image du monde.
6 Ce n’est pas dans ses grands ouvrages mais à l’occasion de deux comptes rendus parus
au début des années 1950 que Ruyer précise ses positions par rapport à Bachelard.
Toutefois ses travaux des années 1930 témoignaient déjà d’une lecture attentive de
celui-ci, cristallisée autour de la question de l’idéalisme et du réalisme. Les formules
bachelardiennes qui décrivent la science contemporaine comme une science d’effets,
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
56
débordant la science de faits traditionnelle – comme la phénoménotechnique déborde la
phénoménologie – possèdent, aux yeux de Ruyer, une « très grande valeur » [Ruyer
1934-1935, 42] pour décrire l’activité scientifique. Mais elles risquent aussi de conduire
à une forme d’idéalisme et d’anthropomorphisme, qu’il récuse au profit d’une
conception réaliste de la connaissance. Pour étayer celle-ci, Ruyer remarque que la
nature n’emploie pas des moyens différents de ceux de l’être humain dans ses créations
techniques. Le nom de certains phénomènes physiques, tels que ceux qu’on appelle
effet Zeeman ou effet Compton, n’est pas à prendre à la lettre au sens où il s’agirait
d’inventions ne dépendant que de l’expérimentateur, et « si l’astrophysique moderne
est devenue comme une annexe du laboratoire, en ce sens que les conditions de
température et de pression régnant à l’intérieur des étoiles réalisent de véritables
expériences qui peuvent confirmer des vues théoriques, cela prouve que la technique
de laboratoire est interchangeable avec des faits naturels » [Ruyer 1934-1935, 43]. Ruyer
est d’accord avec Bachelard pour souligner l’importance du dispositif technique
inhérent à la science contemporaine, mais il entend en tirer des conclusions inverses
des siennes, c’est-à-dire entièrement réalistes, dans le sens d’une naturalité
fondamentale de la connaissance humaine.
7 Dans une note, Ruyer, craignant d’entraîner son aîné sur un terrain qui n’est pas le
sien, et consacrant par là même la différence initiale de leur rapport à la science,
reconnaît que « le but de M. Bachelard est de donner une idée juste de la science, bien
plus que de discuter des doctrines philosophiques qu’il estime sans doute également
inadéquates » [Ruyer 1934-1935, 44, n. 2]. On pensera en effet au motif bachelardien de
la « polyphilosophie ». Une question se pose alors : cette discussion annonce-t-elle déjà
la lecture ultérieure que Ruyer fera de Bachelard ? Malgré le caractère délimité de la
question examinée, puisqu’il s’agit de théorie de la connaissance, ses implications sont
assurément importantes. En effet, la naturalisation de la connaissance chez le Ruyer
« structuraliste » des années 1930 engage la possibilité d’une vision moniste du monde,
que les vues finalistes ultérieures ne feront qu’élargir. À ce moment déjà, pour Ruyer,
les résultats de la science contemporaine appellent une prise de position
« cosmologique » sur la nature des êtres du monde et la place de l’homme dans
l’Univers.
8 Toutefois, on le sait, le système de Ruyer n’arrivera à sa pleine maturité que lorsqu’il
dépassera le point de vue qui assimile tous les êtres à des structures pour adopter une
vision panpsychiste du monde, qui voit dans les êtres capables d’auto-formation (atomes,
cellules, organismes, cerveaux) des domaines de conscience, c’est-à-dire des formes,
mais désormais capables de se diriger et de se surveiller elles-mêmes, par auto-survol
et auto-possession. C’est donc depuis ce point de vue, qui représente le centre de
gravité de la pensée de Ruyer, qu’il convient de ressaisir la question de son rapport à
Bachelard.
9 S’il ne fait que fort rarement référence à Bachelard dans ses ouvrages, Ruyer prend
néanmoins le soin de s’expliquer avec lui à l’occasion de deux substantiels comptes
rendus, en 1952 et en 1953, consacrés respectivement à L’Activité rationaliste de la
physique contemporaine [Bachelard 1951], [Ruyer 1952a] et au Matérialisme rationnel
[Bachelard 1953], [Ruyer 1953]. Pour comprendre le nerf de l’argument de Ruyer, il faut
repartir de l’une des distinctions fondamentales qui est à la base de sa conception du
monde, la différence entre les individualités vraies et les phénomènes de foule. Les
individualités authentiques sont capables de se former elles-mêmes, de s’auto-conduire
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
57
par « survol » de l’espace et du temps, tandis que les phénomènes de foule, pour
contraignants qu’ils soient, sont des résultantes statistiques, c’est-à-dire relèvent de
moyennes et d’effets globaux, selon la loi des grands nombres. L’objet de la physique
classique est précisément cet ordre de phénomènes. Les individualités vraies supposent
en outre un certain mode de causalité. Comme l’écrit Ruyer dans la première des deux
recensions, « la causalité, dans tous les ordres où il s’agit d’individualités réelles, par
contraste avec les équilibres purement statistiques, apparaît comme l’actualisation
d’une pré-structure, qui ne préexiste pas dans l’espace, mais qui se manifeste, quand
elle est déclenchée ou “appelée”, par un “état”, ou par un “effet” bien défini » [Ruyer
1952a, 90]. Ainsi, lorsqu’on pense à la façon dont un organisme se développe en
fonction des signaux véhiculés par certaines molécules, le développement n’est pas
contenu spatialement dans la molécule ni dans l’embryon, il se déroule comme
l’actualisation d’un type déjà existant à l’état virtuel et qui trouve là l’occasion et les
conditions de sa réalisation. Certes le « virtuel » d’un organisme, qui est sa mémoire
biologique, n’est pas identique aux virtualités à l’œuvre dans le monde atomique. Mais
pour Ruyer, l’opposition, dans ces deux cas, aux phénomènes de causalité aveugle des
amas et des foules, suffit à légitimer le rapprochement entre microphysique et
biologie1. Toute individualité vraie se fait, qu’il s’agisse d’un atome ou d’un organisme,
et dès lors ne relève pas du mode de causalité qu’impliquent les lois de la physique
classique.
10 Ce qui justifie, selon Ruyer, l’attribution de ce genre de causalité actualisante aux
phénomènes microphysiques, c’est, on l’a dit, la typicité des comportements que les
scientifiques observent dans ce domaine. Les interactions entre particules, de même
que les réactions chimiques au niveau moléculaire, sont réglées selon des « virtualités
de structure » [Ruyer 1952a, 90] qu’on ne retrouve pas dans les phénomènes de foule, si
définis qu’ils soient par ailleurs. C’est ainsi en termes de typicité que doivent
s’interpréter les « effets » tels que l’effet photo-électrique. On peut du reste voir une
continuité entre l’interprétation réaliste que Ruyer, contre Bachelard, donnait de ces
effets une vingtaine d’années plus tôt, et ce qu’il en dit ici, puisque dans les deux cas
l’accent est mis sur la préexistence de potentialités dans la nature qui sont actualisées
par déclenchement, ce qui prouve premièrement que l’homme n’en est pas le créateur
en un sens idéaliste malgré l’appareillage technique qu’il met en œuvre, et d’autre part
que le monde microphysique est structuré de telle sorte que la causalité classique, de
bord à bord, se révèle une notion inadéquate.
11 La distinction entre les deux formes de causalité, corrélative à la distinction entre les
deux types d’êtres, explique la mise au point opérée par Ruyer sur le statut des
probabilités. Si la physique quantique utilise les probabilités, cela n’est pas d’abord en
un sens simplement statistique, et Ruyer invite Bachelard à ne pas créer
involontairement de confusion dans l’esprit de son lecteur à ce sujet. Bachelard écrit en
effet :
Un point lumineux est dans l’espace-temps une multiplicité monstrueuse. En effet,
dès qu’un physicien réalise un “point lumineux” il produit dans un petit espace et
dans un petit temps une essentielle pluralité d’événements sans liens et sans
causalité minutieuse. [Bachelard 1951, 67]
12 Puis, passant ensuite à l’atome, il explique qu’« il est bien évident qu’aucune expérience
ne se fait sur l’atome unitaire, que toute expérience se fait sur l’atome quelconque d’un
ensemble d’atomes, que le concept-direct est l’atome-foule » [Bachelard 1951, 70]. Or
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
58
Ruyer entend rappeler que l’atome n’est pas statistique dans le même sens que le point
lumineux :
Il est certain que l’atome n’a pas de structure au sens ordinaire du mot, mais il a
potentiellement, dynamiquement, ce que l’on pourrait appeler une pré-structure,
puisque l’on peut calculer, au moyen du principe d’exclusion, sinon sa structure, du
moins le schéma par lequel on peut le représenter dans tel ou tel cas, et puisqu’on
peut finalement calculer la structure, au sens propre cette fois, de la molécule
formée à partir d’atomes. Rien de tel dans une émission lumineuse considérée en
gros. Elle n’a pas tendance à aller vers une structuration de plus en plus précise et
typique. [Ruyer 1952a, 89]
13 Si l’atome n’a pas de structure au sens classique, c’est-à-dire n’est pas pensable sur le
modèle d’un fonctionnement, il a, ou, plus exactement, il est une activité structurante,
et par là même n’est pas étranger à la structure2.
14 Derrière cette discussion technique sur le sens de l’emploi des probabilités et des
moyennes, lesquelles, « d’un côté, ne recouvrent rien d’autre qu’elles-mêmes, de l’autre
[...] signalent non pas l’existence, mais l’action de ce qu’il faut bien appeler des types »
[Ruyer 1952a, 90], se dessine un enjeu décisif : la possibilité de rapprocher les êtres
microphysiques et les êtres organiques. Autrement dit, la possibilité d’une unification
métaphysique du monde, sur la base de la distinction entre les individualités vraies et
les foules ou agrégats. Il s’agit de placer en continuité toutes les individualités sur des
lignes de complexification progressive, de l’atome à l’organisme.
15 La discussion se poursuit dans le même sens dans le second compte rendu que rédige
Ruyer, consacré cette fois au Matérialisme rationnel [Bachelard 1953]. La chimie
quantique, que traite Bachelard dans cet ouvrage, a renouvelé la compréhension des
molécules et des liaisons chimiques. Les « cartes de probabilité de liaisons », qui
indiquent les densités de présence des électrons dans la molécule, permettent en effet
de dépasser la vision purement statique des schémas structuraux, et font de la molécule
« un domaine où s’échangent des énergies, où l’énergie se structure » [Ruyer 1953, 417],
dit Ruyer en résumant le propos de Bachelard. Or de telles descriptions invitent selon
lui à rapprocher intimement les structurations actives des molécules et l’embryogenèse
des comportements et des instincts dans les organismes. Aux deux échelles,
moléculaire et organique, un dynamisme formateur est à l’œuvre impliquant
l’improvisation de liaisons et demeurant irréductible à des fonctionnements
mécaniques. L’analogie est suffisamment profonde et fondée pour appeler, selon Ruyer,
la conclusion suivante, tout à fait assumée dans sa portée métaphysique :
Si l’on rejette l’idée d’un pur fonctionnement – ce que fait explicitement Bachelard
– alors, par le fait même, on ne peut pas ne pas adopter quelque chose du vitalisme
ou de l’animisme. La science, en précisant en quoi la notion de fonctionnement est
insuffisante, se trouve préciser, par là même, la nature de la conscience ou de la vie,
que les théories anciennes évoquaient comme une force magique, et sans savoir ce
qu’elles nommaient ainsi. [Ruyer 1953, 420-421]
16 Les comportements décrits par la chimie quantique impliquent un champ de
conscience, non pas certes une conscience seconde réflexive au sens humain, mais ce
que Ruyer appelle habituellement un « domaine de survol », actualisant un thème ou
une essence transversaux à l’espace et au temps. Ruyer invoque explicitement un
« panpsychisme » [Ruyer 1953, 420]. Selon lui, Bachelard s’est approché d’une telle
conception lorsqu’il a parlé dans son livre de « l’aspect physiologique » de la molécule,
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
59
par opposition à son simple « aspect anatomique » [Bachelard 1953, 181]. Mais il n’en a
pas tiré les conséquences théoriques qui s’imposaient d’après Ruyer.
17 Cela tient sans doute à la façon différente dont les deux penseurs conçoivent le rôle et
le statut de la philosophie. Dès le début de son premier compte rendu, une
insatisfaction se fait jour chez Ruyer. Parlant de Bachelard, il écrit :
[...] il est inquiétant qu’il puisse se montrer aussi sévère pour Bergson, pourtant
bien au courant de la science de son époque, et même pour Meyerson, spécialiste de
philosophie scientifique, que pour Sartre. [Ruyer 1952a, 83]
18 Si bien des philosophes ont le tort de ne pas tenir compte du savoir scientifique –
indifférence sans doute exemplairement illustrée par l’existentialisme, qui prétend
parler de l’homme sans utiliser les ressources de la paléontologie, de l’embryologie, de
l’éthologie comparée, de l’anthropologie – il importe cependant de ne pas amalgamer
tous les penseurs et de faire un sort spécial à ceux qui ont su établir un dialogue avec
les sciences, même si celui-ci est à réécrire aujourd’hui. Lorsque Bachelard dit « les
philosophes », c’est toujours pour porter un jugement négatif à leur sujet. Or cette
absence de nuances ne convient pas à Ruyer. Il écrit ainsi, à propos du Matérialisme
rationnel :
On voit que, si le dernier ouvrage de G. Bachelard avait été écrit lui-même en forme
de dialogue entre un savant et un philosophe, le philosophe aurait dû s’appeler
Stultus ou tout au moins Simplicissimus. Au point que l’on a un peu envie de
défendre le pauvre Stultus. Bachelard oppose, à une science prise à ses moments de
plus haute subtilité, des philosophies parfois encore plus simplistes que nature.
[Ruyer 1953, 417]
19 S’agissant du vitalisme, que défend Ruyer, il convient de distinguer les vagues
invocations du « fond de vie » de la matière, déconsidérées à juste titre, et les
conceptions beaucoup plus précises qu’on peut se faire aujourd’hui du mode d’être des
individualités auto-formatrices. Comme le rappelle ailleurs Ruyer, le vitalisme est l’une
des inspirations majeures de la philosophie :
Le groupe de doctrines auxquelles peuvent s’appliquer, en les prenant au sens
vague, les termes de vitalisme, panpsychisme, philosophie de la vie, téléologie,
philosophie de l’organisme, etc., représente probablement la lignée doctrinale la
plus ancienne et le courant principal de la philosophie. [Ruyer 1959, 103]
20 Le geste théorique de Ruyer consiste à considérer que les avancées de la science
contemporaine, si bien décrites par Bachelard, loin de rendre obsolète ce courant de
pensée, invitent au contraire à le renouveler, en le dotant de la précision conceptuelle
qui lui a généralement manqué.
21 Aussi ne faut-il pas rejeter en bloc tous les philosophes ni mépriser ceux parmi les
« panpsychistes » ou « vitalistes » qui ont fait un effort pour intégrer une information
scientifique solide, quand ils n’ont pas contribué eux-mêmes aux progrès de la science.
Ruyer a cité déjà le nom de Bergson, et il faut y ajouter en particulier ceux de Leibniz et
de Whitehead. On ne dira certes pas que de tels métaphysiciens, qu’on peut qualifier de
« panpsychistes » ou de « vitalistes », quelle que soit par ailleurs la relative
inadéquation de tels vocables, furent indignes de la science de leur temps. En faisant
systématiquement du philosophe un naïf au regard des subtilités de la science
contemporaine, Bachelard occulte une figure possible du philosophe : celui qui, informé
des sciences, ne s’en tient pourtant pas à une stricte épistémologie, et leur donne un
prolongement métaphysique. Comme l’écrit Ruyer, « aucun philosophe authentique n’a
jamais fait une simple “philosophie scientifique”, ou une simple “philosophie de la
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
60
science” » [Ruyer 1963, 276]. On peut lire dans cette déclaration un désaveu de la
restriction que s’est imposée Bachelard, qui porte donc non sur ce qu’il a écrit, mais sur
ce qu’il s’est empêché d’écrire. Il est vrai que Bachelard avait affirmé, dans « Noumène
et microphysique », qu’il convenait de « fonder une métamicrophysique qui n’accepterait
pas sans preuve l’état analytique où se présentent les catégories de la métaphysique
traditionnelle » [Bachelard 1970, 19]. Et dans le Rationalisme appliqué, il parle
d’« atteindre à une métaphysique d’accompagnement pour la pensée scientifique »
[Bachelard 1949, 47]. Mais le statut exact de ces formules semble surtout renvoyer à un
anti-positivisme et exigerait une explicitation que Bachelard n’a pas donnée – lui qui
employait également les termes d’ontologie et de métaphysique dans sa réflexion sur
l’imaginaire.
22 Au total, donc, Bachelard ne se sera pas autorisé l’unification des lignées
d’individualités qui est selon Ruyer inévitable au regard des résultats de la physique
contemporaine. Mais il ne s’agit pas simplement de rétablir les droits d’une manière de
traiter philosophiquement les sciences qui aurait été injustement confondue avec la
posture naïve trop souvent répandue chez les philosophes. En effet, si Bachelard avait
cherché cette unification de l’image du monde sur la base des sciences, cela aurait eu
des conséquences également sur le statut attribué à l’imaginaire dans sa pensée. Non
seulement, par l’élaboration d’une métaphysique des individualités vraies, un pont
aurait été jeté entre la physique et la biologie contemporaines, qui « tendent nettement
à devenir psychobiologie et psychophysique » [Ruyer 1959, 121], mais en outre, grâce à
cette même métaphysique, l’activité imaginante n’aurait plus représenté une
occupation seconde et séparée. À la première unification de l’image du monde – celle de
toutes les formes vraies selon des lignées continues –, aurait fait suite, du moins à titre
d’ébauche, une seconde unification – celle du concept scientifique et de l’image
poétique. Car la métaphysique, si elle est rationnelle et conceptuelle, ne relève pas de la
rationalité de type scientifique. Elle recherche en réalité une interprétation du monde
qui, bien qu’inspirée et contrôlée par les sciences, dépasse la méthode scientifique en
s’ouvrant à la dimension du sens. Si elle n’est certes pas un travail de pure imagination
ni de poésie, elle est, du fait de son statut intermédiaire entre science et religion, ou
entre science et poésie, en continuité virtuelle avec l’imaginaire. Ruyer affirme ainsi
que pour le métaphysicien, « le monde est magique » [Ruyer 1946, 61].
23 Dans ces conditions, on voit se dessiner la perspective d’une réunification de l’œuvre de
Bachelard elle-même. Car Ruyer perçoit Bachelard comme un esprit dédoublé, et
n’échappant pas à « un certain malaise », ainsi qu’il le dit dans un important article
[Ruyer 1967, 80]. Il fait écho sur ce point à une étude de Clémence Ramnoux consacrée à
Bachelard, dans laquelle celle-ci écrivait notamment :
Oui, il a bien travaillé sur deux lignes, avec la conscience de sauter de l’une à
l’autre, et le malaise de laisser des lacunes dans le tissu de son œuvre. Plusieurs
textes prouveraient qu’il se savait vivre comme un être double, et selon deux modes
de la temporalité : savoir intime qu’il a projeté maladroitement, je crois, dans le
mythe jungien de l’animus et de l’anima. [Ramnoux 1965, 31]
24 Et elle ajoutait plus loin qu’il avait été « être d’imagination, être de raison, en
contradiction renouvelée avec soi-même, et portant dans une activité la nostalgie de
l’autre » [Ramnoux 1965, 39]. On sait que Bachelard ne souhaitait pas surmonter cette
contradiction. Il refusa explicitement de développer le thème classique de la « poésie
des mathématiques » et il reprocha vertement aux physiciens traitant de la physique
nucléaire de faire allusion à la transmutation et d’écrire que la physique nucléaire
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
61
réalisait « le vieux rêve des alchimistes » [Bachelard 1972, 67]. Ruyer, mêlant la
prudence et l’audace, entend précisément revenir sur ces questions, et trouver une
façon d’articuler la science et la poésie. Qu’attendre de la science ? Ruyer dit qu’il faut
« une science qui, tout en s’appliquant à ce monde et non à un au-delà religieux,
“révèle” le monde », autrement dit une science qui « soit une lecture du monde, au sens
le plus fort du mot « “lecture”, intéressante, “passionnante”... » [Ruyer 1967, 70]. La
science ne doit pas seulement permettre de constater le dynamisme et l’extrême
subtilité de la raison, elle doit aussi favoriser une intensification du sens du monde,
autrement dit une « lecture du monde ». Bien que Ruyer ne l’affirme pas explicitement,
il semble que le métaphysicien, tel qu’il le conçoit du moins, soit le mieux placé pour
proposer une telle lecture du monde. Mais la frontière est mouvante entre le poète
animé de profondes intuitions métaphysiques et le métaphysicien qui donne toute leur
expressivité à ses concepts, avec il est vrai le risque que parfois l’exercice soit mal
perçu, comme l’a montré l’épisode de la Gnose de Princeton. Et si Bachelard avait pu lire
La Gnose de Princeton, il y aurait sans doute trouvé une confirmation de la nécessité de
ne pas pratiquer le mélange des deux activités qu’il a toujours sévèrement distinguées.
25 Les autres ouvrages de Ruyer, assurément, sont moins ambigus. Il n’en reste pas moins
que l’écueil évident d’une telle entreprise est d’aboutir à des lectures inacceptables.
Quel critère distinguera les lectures légitimes et les lectures illégitimes ou délirantes ?
Qu’est-ce qui fait qu’il est inacceptable de voir Jupiter derrière un éclair qui déchire le
ciel, tandis qu’est recevable l’idée que les entités microphysiques et les organismes
possèdent un mode d’être analogue ? Reprenant la distinction entre les individualités
vraies et les phénomènes de foule, que Bachelard n’avait pas suffisamment prise en
compte, Ruyer indique que « les erreurs et risques d’erreurs de lecture, naissent
toujours de la même source qui est, non pas l’imagination gratuite d’un sens, mais
l’extension abusive, le débordement d’un domaine authentique de sens sur ce qui n’est
que collectivité sans unité, sans unité ni organisation domaniale, qu’une collectivité en
poussées bord à bord, en transmission de proche en proche, “sérielle”, ou en équilibre
par totalisation non survolante » [Ruyer 1967, 79]. Les éléments, comme l’eau ou la
terre, – ceux sur lesquels Bachelard médite dans son analyse de l’imaginaire – sont
précisément des êtres de type « foule » ou « collectif », et non des individualités auto-
formatrices. S’agira-t-il de mettre un petit dieu derrière la molécule sous prétexte de
son activité structurante ? Certes non, car ce serait là procéder par personnification
injustifiée. Mais il n’est pas déraisonnable de voir dans la molécule ou l’organisme un
champ unitaire, se possédant lui-même et improvisant ses liaisons, selon les termes
d’une néo-monadologie. Et il faut ajouter que bien des réalités du monde sont d’ordre
mixte, ouvrant ainsi la possibilité de lectures renouvelées. C’est donc dans la
métaphysique que peuvent converger, du moins de façon idéale, la ligne du concept et
la ligne de l’image. Pour Ruyer, il est permis d’entrevoir « certains raccords possibles
entre les rêveries riches d’intuition, et les découvertes scientifiques » [Ruyer 1967, 80].
26 Ruyer ne méconnaît absolument pas le caractère mythique des « intensifications » de
ce genre. Il en affirme cependant la nécessité et la valeur. La raison ne peut se passer
d’un mythe minimum, et c’est la tâche de la philosophie que de le formuler. Le besoin
de reconnaître des expressivités dans le monde et l’Univers n’est pas secondaire.
L’imagination est une « fonction vitale », au point qu’« il faudrait, comme Bachelard et
P. M. Schuhl s’efforcent de le faire, pouvoir transfigurer le mot » [Ruyer 1960b, 160,
n. 2]. L’imaginaire est pleinement valorisé chez Ruyer, mais il n’est plus en rupture
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
62
absolue, comme chez Bachelard, avec l’étude de la science. D’où à la fois une très
grande proximité des deux philosophes dans leur exploration de la rêverie poétisante,
et une divergence in fine sur la possible continuité de cette activité avec les
considérations scientifiques.
27 Il y aurait une étude minutieuse à faire sur ce qui rapproche Ruyer de Bachelard dans
son livre L’Art d’être toujours content – au titre inspiré par l’écrivain allemand Jean Paul.
La vie heureuse exige de retrouver un équivalent psychique de la sécurité et de
l’intimité de la formation embryonnaire. La rêverie éveillée en est le moyen, et Ruyer,
comme Bachelard avant lui, consacre de nombreuses pages à une poétique de l’espace
qui valorise la maison et le bonheur de l’intime [Ruyer 1978, chap. 12, « Intimité et
paradis psychique »]. Point de rapport à la science ici, il est vrai, et Ruyer semble
entièrement du côté « nocturne » de Bachelard, qui accueillerait sans doute bien plus
volontiers de telles méditations. On est descendu d’un étage, du métaphysique au
psychique. Ruyer invite effectivement à cultiver ce qu’il appelle l’irisation psychique :
Les êtres et les objets peuvent être « ourlés » de tous les sens possibles : ils sont
beaux, vivants, savoureux, poétiques, sacrés, comestibles, fortifiants, bienveillants,
consolants. [Ruyer 1978, 47]
28 Cependant si l’irisation est « sentimentale », elle peut aussi prendre un tour plus
spéculatif. Elle rejoint alors les motifs de la lecture du monde et du rapprochement des
êtres sur les lignes d’individualité. Car rendre ainsi magique le monde, par irisation,
« c’est en faire une apparition de l’éternel, ici, maintenant » [Ruyer 1978, 53]. Ce
dernier thème est ancien chez Ruyer, puisqu’il décrivait déjà ainsi le philosophe en
1941 :
Il marche dans un monde enchanté. En tout être, il sent affleurer ce qui lui donne sa
profondeur. N’importe quelle plante ou animal lui paraît, non pas un objet banalisé
par l’habitude, platement borné à son apparence, mais l’incarnation d’une idée et le
produit d’un effort continu qui le rattache sans coupure à la source de toute chose.
[Ruyer 1946, 61]
29 Le sens, alors, peut être trouvé également dans les êtres de la microphysique et dans les
organismes, et c’est ici que Ruyer se sépare de nouveau de Bachelard. Il est vrai que le
hiatus entre la situation de l’homme dans le monde et le niveau où s’observent de tels
phénomènes peut rendre difficile la perception de l’unité. Ruyer affirme de fait :
Le monde physique peut être considéré comme composé de myriades de micro-
organismes, car même les molécules et les atomes sont des micro-organismes. Mais,
comme tel, et dans la mesure où ces micro-organismes ne sont pas coordonnés en
organismes de plus grande taille, il est le règne des hasards, et des interférences
mécaniques, et il est donc dangereux pour ces grands organismes. [Ruyer 1978, 277]
30 L’être humain sent que le monde à son échelle, qui est celui des amas de matière, est
immense et hostile, et c’est alors que l’imaginaire se détourne de ce que nous
apprennent les sciences. Cependant ce sentiment normal n’a pas entièrement le dernier
mot chez Ruyer, qui fait prédominer le sentiment de notre parenté avec le cosmos :
nous sommes le bout de lignées d’individuation qui remontent de façon continue non
seulement aux premiers êtres vivants, mais aux origines de l’Univers lui-même et à ses
premiers domaines de survol [Ruyer 1964, chap. XXII, « L’homme et le cosmos »].
31 Bachelard se sera interdit de faire une « lecture » du monde tel qu’il se présente à
travers les avancées de la science, lecture qui eût non pas remplacé, mais complété son
travail épistémologique, et, réconciliant le philosophe avec lui-même, eût réunifié deux
fois l’image du monde. Aux yeux de Ruyer, les merveilleuses découvertes de la science
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
63
contemporaine ne sont pas seulement instructives pour la raison explicative, elles sont
aussi, si l’on sait en faire la métaphysique, parlantes pour la raison interprétative qui
est inséparable d’une « imagination animante » [Ruyer 1970, 400].
BIBLIOGRAPHIE
BACHELARD, Gaston [1949], Le Rationalisme appliqué, Quadrige, Paris : PUF, 1998.
BACHELARD, Gaston [1951], L’Activité rationaliste de la physique contemporaine, Paris : PUF.
BACHELARD, Gaston [1953], Le Matérialisme rationnel, Quadrige, Paris : PUF, 2000.
BACHELARD, Gaston [1970], Études, Paris : Vrin.
BACHELARD, Gaston [1972], L’Engagement rationaliste, Paris : PUF.
RAMNOUX, Clémence [1965], Avec Gaston Bachelard vers une phénoménologie de l’Imaginaire,
Revue de Métaphysique et de Morale, 70(1), 27–42.
RUYER, Raymond [1934-1935], Sur quelques arguments nouveaux contre le réalisme, Recherches
philosophiques, IV, 30–50.
RUYER, Raymond [1946], L’esprit philosophique, dans Orientation. Recueil de conférences faites au
Centre universitaire de l’Oflag XVII A, Paris : Éditions de Champagne, 55–61.
RUYER, Raymond [1952a], L’activité rationaliste de la physique contemporaine, Revue de
Métaphysique et de Morale, 57(1), 82–92.
RUYER, Raymond [1952b], Le problème de l’information et la cybernétique, Journal de psychologie
normale et pathologique, 45, 385–418.
RUYER, Raymond [1952c], Néo-finalisme, Métaphysiques, Paris : PUF, 2 éd., Préface de F. Colonna,
2012.
RUYER, Raymond [1953], Le matérialisme rationnel selon G. Bachelard, Revue de Métaphysique et de
Morale, 58(4), 413–422.
RUYER, Raymond [1959], La psychobiologie et la science, Dialectica, 13(2), 103–122.
RUYER, Raymond [1960a], Réponse à la note de M. J.-Claude Piguet, Dialectica, 14(1), 32–36.
RUYER, Raymond [1960b], La nutrition psychique et la vie politique, Revue de Métaphysique et de
Morale, 65(2), 129–162.
RUYER, Raymond [1963], Raymond Ruyer, dans Les Philosophes français d’aujourd’hui par eux-mêmes :
autobiographie de la philosophie française contemporaine, édité par G. Deledalle & D. Huisman, Paris :
Centre de Documentation Universitaire, 262–276.
RUYER, Raymond [1964], L’Animal, l’Homme, la Fonction symbolique, Paris : Gallimard.
RUYER, Raymond [1966], Paradoxes de la conscience et limites de l’automatisme, Paris : Albin Michel.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
64
RUYER, Raymond [1967], Lectures du monde abusives, et lectures légitimes, Cahiers internationaux
de symbolisme, 13, 69–83.
RUYER, Raymond [1970], Finalité, Encyclopædia Universalis, VII, 399–403, rééd. vol. IX, 2002.
RUYER, Raymond [1978], L’Art d’être toujours content, Paris : Fayard.
RUYER, Raymond [2013], L’Embryogenèse du monde et le Dieu silencieux, Continents philosophiques,
Paris : Klincksieck, texte établi, présenté et annoté par F. Colonna.
NOTES
1. Ruyer est revenu à maintes reprises sur la continuité entre entités microphysiques et
organismes, pièce essentielle de son système philosophique. On se reportera notamment à
[Ruyer1952c, chap. XV] et [Ruyer 2013, Deuxième partie].
2. Ruyer écrit ailleurs au sujet de l’atome : « Il ne peut se définir que par des actions, sa forme est
formation active, comportement temporalisé et dynamique. Il ne peut y avoir pour lui arrêt de
fonctionnement, puis remise en marche, pour la raison qu’un atome n’est pas une structure
fonctionnante, mais une action structurante» [Ruyer1966, 173].
RÉSUMÉS
Ruyer et Bachelard ont en commun de concevoir le travail de la philosophie comme
essentiellement lié à la science. Toutefois, alors que Bachelard s’en tient à des positions
épistémologiques, Ruyer entend tirer des conclusions métaphysiques des résultats de la physique
contemporaine. Il expose ses vues à l’occasion de deux comptes rendus qu’il fait des écrits de
Bachelard. Selon Ruyer, les activités structurantes originales qui caractérisent les atomes et les
molécules autorisent à les comparer aux êtres biologiques des étages supérieurs et à défendre
une vision panpsychiste du réel. L’imagination métaphysique peut alors proposer ce que Ruyer
appelle une « lecture du monde » qui en donne une vision unifiée et intensifiée. Les deux
directions opposées de l’œuvre de Bachelard, le concept et l’image, ont ainsi la possibilité d’être
réconciliées.
What Ruyer and Bachelard have in common is that they both see the work of philosophy as
essentially associated with science. However, while Bachelard does not go beyond
epistemological reflections, Ruyer seeks to draw metaphysical conclusions from the findings of
contemporary physics. He sets forth his views in two reports on Bachelard’s writings. According
to Ruyer, the original structuring activities which characterise atoms and molecules enable us to
compare them to the superior biological beings and argue for a panpsychist view of reality. The
metaphysical imagination is thus able to propose what Ruyer calls a “reading of the world” which
provides a unified and intensified vision of that world. The two opposing tendencies of
Bachelard’s work, the concept and the image, could thus be reconciled.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
65
AUTEUR
FABRICE COLONNA
Nanterre, Académie de Versailles (France)
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
66
Enjeux métaphysiques de la
morphogenèse : l’embryologie de
Ruyer et la biologie du
développement
The Metaphysical Challenge of Morphogenesis: Ruyer’s Embryology and Modern
Developmental Biology
Bertrand Vaillant
L’auteur tient à remercier MM. Renaud Barbaras, Fabrice Colonna et Raphaël Künstler pour leur
aide et leurs conseils.
1 Introduction
1 Le monisme de Ruyer poursuit une visée paradoxale : il cherche à la fois à retourner le
matérialisme en un panpsychisme, et à montrer que celui-ci rend mieux compte des
résultats de la science physique et biologique que le matérialisme lui-même – pourtant
adopté par l’immense majorité des scientifiques. Pour lui, ce n’est qu’au prix de
beaucoup d’aveuglement et de mauvaise foi que l’on peut donner des découvertes
scientifiques du XXe siècle une interprétation matérialiste stricte, c’est-à-dire
mécaniste. Comprendre le véritable sens de la mécanique quantique ou de
l’embryologie expérimentale nécessite selon lui d’accorder le primat ontologique à la
conscience, conçue comme individualité vraie, la matière et les phénomènes physiques
n’étant que des « phénomènes de foule » concernant les agrégats de ces individualités.
Ruyer traque donc avec acuité toutes les manifestations de cette mauvaise foi pour en
montrer le caractère à la fois dogmatique et inconsistant. Cette démarche a le mérite de
s’intéresser dans le détail aux faits complexes dévoilés par les sciences de son époque,
mais court par là même le risque d’être irrémédiablement datée, abandonnée à mesure
que la science progresse. Les interprétations vitalistes et finalistes de la vie se sont de
tout temps nourries des zones d’ombre de la biologie, avant d’être réfutées une fois
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
67
celles-ci comblées – et de renaître sous une autre forme à la faveur de nouvelles lacunes
théoriques. Qu’en est-il du panpsychisme de Ruyer ? N’est-il pas lui aussi
essentiellement dépendant des lacunes de la science de son époque ? C’est la question à
laquelle nous voudrions apporter quelques éléments de réponse, en nous intéressant
plus particulièrement à son analyse du développement embryonnaire ou
morphogenèse. Sa philosophie de la vie peut-elle s’accommoder des découvertes les
plus récentes de la biologie du développement, relais contemporain de l’ancienne
embryologie, et de l’apparition de l’evo-devo, la biologie évolutive du développement
qu’il appelait pourtant de ses vœux ?
2 Le but de notre étude sera de mettre en évidence certaines évolutions cruciales de la
biologie du développement des dernières décennies et d’examiner leur impact sur la
philosophie de la vie de Ruyer, afin de mieux cerner la place qui peut être la sienne
dans les tentatives très contemporaines, de la part de biologistes comme de
philosophes, pour produire une théorie générale du développement. Nous chercherons
d’abord à montrer que les évolutions récentes de la biologie du développement ont
donné raison à Ruyer dans sa critique du mécanisme et du préformationnisme
génétique. Nous examinerons ensuite la place que peut occuper la solution ruyérienne
dans le débat entourant encore, en biologie, la notion de champ morphogénétique, qui
évoque avec force le concept ruyérien de domaine absolu de survol. Ceci nous amènera
dans un troisième temps à comparer les conceptions ruyérienne et biologique des
causalités ascendante et descendante et de leur articulation au sein de la
morphogenèse. Cela nous permettra d’envisager en conclusion le statut de la tentative
métaphysique de Ruyer vis-à-vis de la science et l’intérêt pour la biologie
contemporaine elle-même d’un tel effort.
2 Contre le matérialisme mécaniste
La morphogenèse comme invention non causale
3 L’explication de la morphogenèse des êtres vivants, apparition d’un organisme
entièrement formé à partir d’un œuf apparemment indéterminé, a été la source de
querelles philosophiques et scientifiques innombrables. Ruyer en fait un point central
de sa philosophie, dans la mesure où pour lui la morphogenèse est l’un des lieux
privilégiés où se révèle, sous les yeux d’ailleurs incrédules des biologistes, l’impuissance
du matérialisme mécaniste. Une série de faits expérimentaux découverts au cours des
XIXe et XXe siècles lui semblent déterminants : ce sont les faits d’équipotentialité, et
notamment l’ensemble des phénomènes de régulation par lesquels les embryons se
« débrouillent » pour parvenir, malgré les manipulations, ablations ou greffes des
expérimentateurs, à réaliser souvent un organisme complet et fonctionnel. Non
seulement la cellule-œuf a le pouvoir de former un organisme complet, mais on a la
nette impression que l’embryon « s’efforce » activement de réaliser cet organisme : si
on provoque la division de l’œuf, on obtient des jumeaux ; si on greffe assez tôt une
ébauche de membre antérieur sur un emplacement de membre postérieur, le membre
se développe conformément à son nouvel emplacement, etc. Ainsi Ruyer écrit-il
clairement :
L’équipotentialité est l’aspect fonctionnel objectif que prend, pour un observateur,
un mode de réalité qui ne peut être qu’une conscience, c’est-à-dire, comme nous le
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
68
verrons bientôt, une forme absolue, ou un domaine absolu qui se survole lui-même.
[Ruyer 1952, 88]
4 Les capacités d’invention et d’adaptation de l’embryon, sa capacité à tendre vers la
réalisation du thème spécifique de son espèce et son développement simultané à des
échelles et dans des directions multiples sont pour lui inexplicables par le matérialisme
mécaniste. Celui-ci ne connaît que la causalité « de proche en proche », par choc et
poussée, et celle-ci paraît bien incapable de produire un tel développement depuis
l’abandon du préformationnisme classique à la fin du XIXe siècle. L’organisme adulte
n’est pas préformé en miniature dans l’œuf, le développement embryonnaire n’est pas
seulement croissance mais bien morphogenèse, apparition d’une forme nouvelle. Pour
Ruyer, l’épigenèse n’a de sens que si l’embryon, non pas a une conscience, mais est une
conscience, au sens de ce qu’il appelle la conscience primaire, c’est-à-dire une unité qui
se possède elle-même [Ruyer 2013, 37-38] : c’est parce que l’embryon est une telle
conscience qu’il peut se réaliser en suivant un thème trans-spatial, celui de son espèce,
qu’il est capable de se développer dans toutes les dimensions de l’espace et du temps,
de maintenir des équilibres et des proportions tout en changeant de taille et de volume,
de restaurer dans une certaine mesure le schéma global de l’organisme lorsqu’il est
abîmé, etc. Thématisme, dé-localisation, mémoire, signalisation et non causalité,
harmonisation et régulation, finalité : voilà ce que l’on découvre dans la morphogenèse
« si l’on écarte l’idéologie scientiste indûment ajoutée à la méthode expérimentale de la
science » [Ruyer 2013, 42 sq.]. Ces étonnantes capacités que Ruyer attribue à l’embryon
nous permettent de percevoir en négatif les caractères principaux du matérialisme
qu’il combat.
Un certain matérialisme
5 Le matérialisme que Ruyer rejette et prétend « retourner » en panpsychisme, c’est
avant tout le mécanisme classique, qui ne connaît que l’exercice de forces aveugles sur
des corps passifs. Le trait qui revient le plus souvent sous la plume de Ruyer est
l’incapacité qu’ont pour lui les matérialistes à admettre d’autres types de causalité que
celle qu’il appelle « de proche en proche » ou a tergo, c’est-à-dire une causalité par
contact, par choc et poussée, dont le point d’exercice est précisément localisable, qui
s’exerce de façon aveugle et sans réponse active de ce sur quoi elle s’exerce [Ruyer
2013, 133]. En biologie, une telle conception de la causalité correspond aux modèles qui
entendent réduire le fonctionnement des organismes mais aussi et surtout leur
formation (ce qui pour Ruyer est bien plus absurde) à des interactions physico-
chimiques. Au cours du XXe siècle et particulièrement dans les années 1940 à 1970
durant lesquelles Ruyer écrit l’essentiel de son œuvre, ces modèles se feront de plus en
plus géno-centriques. La métaphore du « programme génétique » prend une
importance considérable et ressuscite dans une version plus robuste l’ancien
préformationnisme1. On affirme volontiers que si l’œuf n’est pas un homoncule
préformé, il contient néanmoins toutes les informations nécessaires pour refaire un
individu complet, les plans de construction de l’organisme, qu’il suit aveuglément et
sans avoir jamais besoin de faire appel à une quelconque forme de conscience.
6 Ruyer s’opposera farouchement dans toute son œuvre à de tels modèles, affirmant
toujours que l’information génétique est insuffisante pour expliquer la formation d’un
organisme adulte et les régulations qui la permettent, et allant jusqu’à minimiser peut-
être excessivement le rôle aujourd’hui bien connu des gènes dans le développement
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
69
[Ruyer 2013, 85-89], [Ruyer 1958, 44-45], [Ruyer 1952, 211-223]. Il revendique
explicitement une défense de l’épigenèse :
Le développement est épigénétique : les formes apparaissent progressivement
jusqu’à la mosaïque finale qui est toujours seconde relativement à l’ébauche encore
indifférenciée. [Ruyer 2013, 43]
7 La thèse métaphysique du panpsychisme s’appuie sur un constat biologique, celui de
l’épigenèse, qui nécessite d’être expliquée par l’action de la conscience primaire.
L’examen de la philosophie de la vie de Ruyer suppose donc de s’intéresser ici à deux
problèmes : la valeur d’un tel « constat » épigénétique en biologie et celle d’une
interprétation panpsychiste de ce constat en philosophie. Le conflit entre le
néofinalisme de Ruyer et le géno-centrisme de la biologie du milieu du XXe siècle
apparaît donc comme l’un des derniers et peut-être des plus intéressants avatars du
débat entre épigenèse et préformation. Ce débat est de plus comme le point de contact
empirique et scientifique d’un conflit philosophique bien plus large entre
panpsychisme et mécanisme. Se posent alors deux questions : 1) Les évolutions récentes
de la biologie du développement laissent-elles encore place à un tel débat ? 2) Le cas
échéant, permettent-elles de donner davantage raison à Ruyer ou à ses adversaires ?
Préformation ou épigenèse, un débat dépassé ?
8 Lawrence & Levine mettent en garde les biologistes contre la tendance qui conduit
rapidement, dans les questions touchant à l’embryogenèse, de la science véritable aux
« marécages métaphysiques » dans lesquels s’embourbent biologistes et philosophes
[Lawrence & Levine 2006]. Ils citent ainsi quatre débats classiques : préformation contre
épigenèse, vitalisme contre mécanisme, cellules préprogrammées ou totipotentes,
embryon mosaïque ou à régulation. Pour eux, ces débats trouvent leur source dans
l’histoire des sciences du vivant et non dans la nature de leur objet : ils proviennent de
la division de l’étude du développement, au début du XXe siècle, entre des
embryologistes expérimentaux de la vieille école ignorant le rôle des gènes, et des
généticiens rigoureux – mais peut-être plus soucieux de statistiques que de la réalité
expérimentale. Depuis, affirment-ils :
Une révolution a eu lieu, provoquée par la génétique et la biologie moléculaire, et il
est temps d’enterrer certaines des vieilles disputes. [Lawrence Levine 2006, 236,
nous traduisons]
9 Et de montrer, exemples nombreux à l’appui, que la distinction entre embryon
mosaïque et embryon à régulation a perdu toute raison d’être. Les embryons dits
« mosaïques » sont ceux dont chaque territoire donné correspond à une partie
déterminée de l’organisme entier. L’ablation d’une partie de l’embryon dans les
premiers stades du développement produira un organisme incomplet, la partie
manquante étant toujours la même pour les mêmes cellules ôtées. L’embryon à
régulation est un embryon dont les territoires ne sont pas déterminés à donner telle ou
telle partie de l’organisme et qui est capable (dans une certaine mesure) de restaurer le
développement normal en cas d’interférences, comme l’ablation d’une partie de
l’embryon ou une greffe d’une partie d’un autre embryon.
10 Les embryons à régulation, longtemps considérés comme caractéristiques notamment
des vertébrés, correspondent aux descriptions d’embryons que fait régulièrement
Ruyer : ils paraissent s’efforcer de restaurer une norme comme s’ils savaient ce qu’ils
avaient à faire. Les embryons mosaïques apportent quant à eux de l’eau au moulin de
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
70
ses adversaires mécanistes et préformationnistes : ils sont entièrement déterminés et
ne font preuve d’aucune adaptation. Peut-on dire alors que chacun ne considère qu’une
partie du vivant ? Même pas, puisque comme le montrent Lawrence & Levine, ces deux
types d’embryon doivent être considérés comme des abstractions, dans la mesure où
tous les embryons sont à la fois mosaïques et capables de régulation, dans des
proportions variables. Qu’en conclure ? Premièrement, que le débat préformation
contre épigenèse, ou embryon mosaïque contre embryon à régulation, n’a plus de sens
sous cette forme stricte en biologie. Ensuite, que les positions du débat philosophique
opposant Ruyer et le matérialisme n’ont de pertinence que dans la mesure où la
position ruyérienne n’est pas un épigénétisme pur et s’accommode d’un
développement partiellement déterminé, et où le matérialisme n’est pas un simple
mécanisme incapable de penser les phénomènes de régulation. À ces conditions, le
débat mérite peut-être de ne pas être « enterré » comme le demandent Lawrence &
Levine. Nous tenterons d’esquisser plus bas quelques pistes montrant que la pensée
ruyérienne peut survivre à cette critique (voir infra, « L’enchevêtrement causal », 12),
et que le matérialisme auquel il a à répondre aujourd’hui a lui-même intégré ces
critiques et n’est plus le mécanisme qu’il décrit.
Des critiques justifiées
11 Si les thèses métaphysiques de Ruyer peuvent choquer bien des scientifiques, force est
de constater que la biologie contemporaine lui a plutôt donné raison quant à sa critique
de certaines attitudes dogmatiques courantes chez les biologistes du milieu du
XXe siècle (mécanisme, géno-centrisme, sélectionnisme et autres réductionnismes
excessifs), critiques qui sont aujourd’hui formulées par nombre de biologistes. Il est
peut-être utile de distinguer ici deux catégories d’énoncés chez Ruyer, quand bien
même ces catégories seraient parfois inextricablement mêlées dans son œuvre : A) les
énoncés descriptifs portant sur la science, et B) les énoncés proprement
philosophiques. La première catégorie concerne a) les énoncés décrivant un fait
scientifique et a’) les tentatives pour mettre au jour et critiquer une philosophie
implicite des communautés scientifiques qui fausse l’interprétation de ces faits. La
seconde concerne b) les thèses philosophiques qui donnent aux faits leur véritable sens
et b’) les critiques de thèses explicitement philosophiques. Seuls les énoncés de la
première catégorie peuvent être considérés comme directement confirmés ou infirmés
par des évolutions scientifiques, ceux de la seconde sortant du champ de la biologie et
de la science. Mais de telles évolutions peuvent les fragiliser très fortement en les
rendant inutiles ou redondants du point de vue de l’explication.
12 De fait, si la biologie du développement contemporaine reste très largement
matérialiste, elle est de moins en moins mécaniste au sens ruyérien. Le
préformationnisme géno-centrique est rendu toujours plus difficile à soutenir par les
découvertes de l’épigénétique moderne. En mettant en évidence des facteurs clefs du
développement qui ne sont pas hérités génétiquement, elle donne raison à la critique
ruyérienne du « tout génétique », fût-elle parfois excessive. Le rôle causal majeur des
gènes dans le développement ne peut plus être nié, mais les découvertes les plus
récentes ne permettent plus de penser que l’information contenue dans les gènes est
suffisante à la formation d’un organisme complet [Noble 2006], [Gilbert & Bard 2014],
[Minelli & Pradeu 2014]. On peut citer Gilbert & Bard :
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
71
Une théorie du développement ne peut être un sous-ensemble d’une théorie
génétique parce qu’une grande partie du développement n’est pas dirigée par le
génome. [Gilbert & Bard 2014, nous traduisons]
13 On peut donc faire crédit à Ruyer d’avoir à juste titre insisté sur cette catégorie de faits
qui, s’ils n’ont guère poussé les biologistes vers le panpsychisme, ont toutefois été
progressivement reconnus comme des faits cruciaux, que l’on ne pouvait plus ignorer,
et dont le matérialisme avait à rendre compte s’il voulait tenir tête à ses adversaires.
Ainsi émerge un matérialisme non géno-centrique qui, d’une façon ou d’une autre,
abandonne le mécanisme strict et admet une forme de complexité irréductible du
vivant. Un biologiste comme Stuart Newman, se revendiquant d’un matérialisme
pluraliste de type émergentiste, affirme on ne peut plus clairement :
La nature hybride des systèmes en développement, par la nature multi-échelle
[multiscale] de leur opération à toutes les phases de leur évolution, et par
l’empreinte, toujours croissante, de leur histoire, exclut la possibilité d’une théorie
unitaire ou d’un ensemble de lois du même type que celles qui s’appliquent à des
systèmes physiques à une seule échelle [monoscale] (par exemple la mécanique
classique ou quantique, ou la thermodynamique). [Newman 2014, 97, nous
traduisons]
14 Mais l’une des principales difficultés des modèles – géno-centriques ou non – de la
morphogenèse, est de rendre compte de l’extraordinaire coordination spatio-
temporelle du développement, à mesure que les cellules se différencient. C’est autour
de cette question que s’est développée la notion de « champ morphogénétique », qui
cristallise l’essentiel du débat entre le modèle géno-centrique et le modèle
épigénétique.
3 Un développement (trop) bien coordonné
L’information positionnelle
15 L’un des principaux défis que doit relever la biologie du développement est d’expliquer
comment le développement peut se produire selon des patterns spécifiques, qui
supposent que chaque cellule se comporte conformément à sa position dans l’embryon,
comme si elle « savait » où elle était. Ce « savoir » est ce que le biologiste Lewis Wolpert
a nommé « l’information positionnelle » [Wolpert 1969]. La question très ruyérienne de
la localisation spatiale de l’information (ou mémoire) nécessaire au développement et de
l’ubiquité apparente de l’embryon [Ruyer 2013, 44-48] se pose alors en biologie. Vecchi
et Hernandez, discutant Wolpert, formulent ainsi les questions qui se posent au
biologiste :
L’information additionnelle [i.e., non génétique] est-elle contenue dans le
cytoplasme, dans l’environnement interne de l’embryon qui se développe, ou dans
son environnement externe ? Est-elle d’abord localisée en un endroit ou dispersée ?
[Vecchi & Hernandez 2014, 81, nous traduisons]
16 Si le problème de la localisation de l’information se pose, la solution ruyérienne d’une
mémoire délocalisée, trans-spatiale, ne peut évidemment être envisagée comme valable
sur un plan strictement scientifique, la biologie devant rester réductionniste et
matérialiste au moins pour des raisons méthodologiques. Le biologiste cherchera
naturellement « où » se trouve cette information et par quels moyens physiques
localisés elle se transmet. Mais il est intéressant de constater que ces problèmes,
soulevés avec insistance par Ruyer, ont peu à peu été reconnus comme centraux pour
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
72
comprendre la morphogenèse. Wolpert se désolait d’ailleurs que l’étude de la formation
des patterns soit un domaine encore largement négligé de la biologie, et l’imputait à une
forme d’aveuglement de ses contemporains [Wolpert 1969]. Ce qui est plus intéressant
encore du point de vue des études ruyériennes, c’est de constater que, comme le
montrent avec une admirable clarté [Vecchi & Hernandez 2014], les débats autour du
concept d’information positionnelle (et les évolutions de Wolpert lui-même) ont fait
resurgir le conflit entre préformationnisme géno-centrique et épigenèse, et ont ramené
sur le devant de la scène scientifique un concept en apparence daté : celui de champ
morphogénétique.
Le champ morphogénétique
17 Comme le rappellent Vecchi & Hernandez, le concept de « champ morphogénétique » a
été forgé au début du XXe siècle : il apparaît en 1910 chez Boveri & Gurwitsch. Plus
qu’un modèle explicatif précis, il s’agit alors du cœur du programme de recherche
visant à explorer les phénomènes de coordination des comportements cellulaires
essentiels à la morphogenèse. Diverses interprétations ont été données de ce concept,
des plus matérialistes aux plus vitalistes. Notons simplement ici que même dans son
acception matérialiste, le concept de champ morphogénétique « contestait [challenged]
les explications mécanistes et préformationnistes dominantes des phénomènes de
morphogenèse » [Vecchi & Hernandez 2014, 79]. Cette contestation du mécanisme sera
ensuite résorbée par l’essor de la génétique, avant de refaire surface plus récemment
suite aux contestations croissantes du modèle géno-centrique.
18 Pour des raisons philosophiques, Ruyer a maintenu cette contestation malgré l’essor de
la génétique, refusant d’y voir la clef ultime du développement, et en cela il a eu raison.
Vecchi & Hernandez montrent bien comment l’évolution de Wolpert sur la question de
l’information positionnelle trace en creux la carte du problème : dans un premier
temps, l’idée d’une telle information redonne vie à l’idée de champ morphogénétique,
mais fait reposer l’ensemble de la théorie sur une capacité des cellules à « interpréter »
cette information, quel que soit son support physique, qui pose évidemment problème.
Ensuite, il déplace le poids causal entièrement sur les gènes, en postulant que chaque
cellule contient dans ses gènes, en plus d’un plan de formation, une carte complète de
toutes les cellules de l’organisme qui permet à chacune d’agir selon sa place, ce qui
revient à une forme de « préformationnisme informationnel » problématique, qui rend
inutile la notion de champ morphogénétique, mais ne fait que masquer la difficulté
[Wolpert & Lewis 1975]. Il renvoie au futur la tâche d’une modélisation [computing]
complète de l’embryon à partir des seuls gènes, tâche qui depuis s’est avérée
impossible.
19 Même dans ce cadre, on trouve chez Wolpert une reconnaissance des faits cruciaux
utilisés par Ruyer :
Au cours du développement une cellule reçoit des signaux simples, et y répond de
façon complexe. Le système des gènes contrôlant une cellule lui fournit une
mémoire, et dirige son comportement selon les circonstances passées et présentes.
[Wolpert & Lewis 1975, nous traduisons]
20 On reconnaît là, en dépit d’un cadre interprétatif géno-centrique, les faits chers à
Ruyer : stimuli-signaux et réponses complexes, mémoire et historicité, adaptation aux
circonstances. L’impossibilité toujours plus apparente de modéliser mathématiquement
l’embryon conduit à un renouveau de la notion de champ morphogénétique au moins
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
73
comme programme de recherche, ainsi que des questions métaphysiques qui y sont
liées. Ces questions, Ruyer a su les identifier et les poser très tôt avec acuité et son
panpsychisme entend y apporter une réponse philosophique, notamment à partir de la
notion de conscience primaire.
L’embryon comme conscience primaire
21 Les faits d’équipotentialité et les embryons à régulation, le déroulement spatial « multi-
échelles » des processus de développement, les paradoxes de la formation des patterns
et de la différenciation cellulaire à partir de divisions d’une même cellule originelle,
tout cela indique pour Ruyer l’origine non spatiale, non localisable de l’information qui
guide la morphogenèse. Mais là où les biologistes entendent « non localisable » au sens
de « diffus » ou « dispersé » dans l’espace, Ruyer entend « ubiquitaire » et
« délocalisé ». Le développement étudié par le biologiste n’est que « l’aspect objectif »
[Ruyer 1952, 88] du comportement d’une entité qui maintient activement son unité et
se forme elle-même : la conscience primaire. Cette conscience n’est pas la conscience
réfléchie ou même perceptive, c’est une conscience qui est pure formation de soi et non
ouverture sur le monde ou retour sur soi.
22 D’une part les faits biologiques cités indiquent que le développement est un effort vers
la réalisation d’un thème, puisque l’embryon s’efforce autant que possible de le réaliser
malgré les interférences. D’autre part le caractère prévisible et répétitif du
développement vient, non pas de ce que l’embryon fonctionnerait comme une machine
aveugle et condamnée à se répéter, mais de ce que l’embryon n’« hésite » pas, et que
l’information nécessaire n’est pas inventée de toutes pièces à chaque génération : le
thème qu’il réalise porte la mémoire de l’espèce. L’absence d’hésitation, d’innovation
inattendue ou de changement extravagant dans le développement n’indique pas son
caractère mécanique mais montre au contraire que l’embryon est comme l’acteur
expérimenté, absorbé tout entier dans son jeu :
Il sait son rôle par cœur, au point d’oublier qu’il joue son rôle et d’être en effet
inconscient de jouer un rôle difficile. [Ruyer 2013, 38]
23 Le « champ morphogénétique » devient chez Ruyer conscience primaire, et la
conscience primaire elle-même se comprend comme « forme absolue » ou « domaine
absolu de survol » [Ruyer 1952, 88], ce qui signifie que l’embryon constitue un domaine,
mais un domaine sans maître extérieur qui le dominerait et en ferait l’unité : il est lui-
même et maintient lui-même son unité. La conscience primaire n’est pas « au-dessus »
de l’embryon, ce qui serait encore une localisation spatiale, elle n’est pas non plus a-
spatiale, sans quoi elle ne pourrait guider un développement spatial : elle est la
possession de l’embryon par lui-même, le self-enjoyment d’un être qui n’est pas une
machine (unité purement artificielle au fonctionnement aveugle) mais une
individualité irréductible à la juxtaposition de ses parties.
24 S’il ne saurait être question d’affirmer que la résurgence du concept de champ
morphogénétique constitue une preuve ou une confirmation de la validité des concepts
ruyériens de conscience primaire et de domaine absolu de survol, il faut reconnaître
que ces problèmes sont loin d’être résolus, que l’interprétation qu’en donne Ruyer reste
compatible avec les faits et que les solutions réductionnistes qui auraient pu invalider
définitivement sa position n’ont pas obtenu les résultats escomptés. Il n’en reste pas
moins que des progrès considérables ont été faits ces dernières années dans la mise au
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
74
jour des processus physiques par lesquels se produit le développement dans ses
dimensions les plus problématiques, ce qui semble donner raison, sinon au mécanisme,
du moins à un matérialisme corrigé. Nous voudrions donc dans un dernier temps
esquisser une possible réponse ruyérienne à ces découvertes toujours plus nombreuses
et précises, qui battent en brèche l’image de l’œuf purement indéterminé et d’une
détermination sans aucune cause physique. Pour y répondre, il faut faire appel à la
notion, commune à Ruyer et à certains biologistes contemporains, de « causalité
descendante », et montrer comment elle s’articule à une causalité « ascendante ».
4 L’enchevêtrement causal
Un orchestre sans chef
Ce qui compte dans la genèse des formes – les « rubans mnémiques » restant
identiques dans toutes les cellules –, c’est l’activation ou l’inhibition, ou le
masquage, des parties utiles ou inutiles, à tel moment et à telle place. Ce qui
suggère fortement un x « joueur », se servant du clavier moléculaire des noyaux ou
du protoplasme, pour réaliser des formes macroscopiques ou surmoléculaires [...].
[Ruyer 2013, 87]
25 Dans ce passage de L’Embryogenèse du monde et le Dieu silencieux [Ruyer 2013], Ruyer
s’appuie comme souvent sur le paradoxe de la différenciation cellulaire pour contrer
une explication mécaniste géno-centrique. Puisque toutes les cellules ont le même
patrimoine génétique, les gènes ne peuvent seuls expliquer comment chaque cellule se
différencie selon sa place, et semble savoir quels tronçons de l’ADN contiennent
l’information qui la concerne. Il faut donc postuler un autre type de causalité que celui
qui va de l’information génétique à la structure de l’organisme. Or, on retrouve le
même type d’argument en biologie, notamment chez Denis Noble, pionnier de la
biologie des systèmes, qui utilise une métaphore très semblable à celle de Ruyer [Noble
2006] : celui-ci parlait d’un « joueur » utilisant le génome comme un « clavier », celui-là
compare le génome à un orgue, et se demande :
Qui joue de l’orgue aux trente mille tuyaux ? Y a-t-il un organiste ? Et qui peut bien
occuper cette fonction ? [Noble 2006, 42, nous traduisons]
26 Pour Noble comme pour Ruyer, il faut postuler une forme de causalité descendante, par
laquelle l’organisme en formation agit en retour sur la lecture du génome. En
biologiste, Noble ne voit dans cette « causalité descendante » qu’un réseau de
rétroactions, qui justifie un rejet radical du tout-génétique mais n’appelle aucune
« conscience primaire » ruyérienne. Notons cependant qu’en filant la métaphore, Noble
est étonnamment proche de Ruyer et de sa conception du « survol » :
L’organiste travaille selon une perspective bien différente de celle de chacun des
tuyaux de son orgue. Bien que physiquement, dans un orgue réel, les tuyaux soient
au-dessus du concertiste, métaphoriquement parlant celui-ci surplombe le clavier
et les pédales, voyant ainsi les formes et les motifs musicaux qu’il impose à
l’instrument. [Noble 2006, 42, nous traduisons]
27 Noble fait ici œuvre de pédagogie et ne prend pas au pied de la lettre sa métaphore,
probablement parce qu’il reste pris dans le caractère spatial, la « position de
surplomb » de cet organiste : c’est précisément ce que Ruyer entend dépasser en
attribuant la causalité descendante à une conscience « auto-survolée », qui se survole
sans surplomb. Une telle conscience n’est pas « au-dessus » d’un corps qu’elle unifierait
de l’extérieur. Elle est la forme vraie du corps, sa réalité subjective, car le corps n’est un
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
75
pur objet que pour l’observateur extérieur qu’est nécessairement le scientifique. Noble
renvoie lui-même à Coen :
Les organismes ne sont pas simplement élaborés selon un ensemble d’instructions.
Il n’y a pas de façon simple de séparer les instructions du processus qui les exécute,
ni de distinguer le plan de son exécution. [Coen 1999], cité par [Noble 2006, 41, nous
traduisons]
28 Ce qui apparaît à la biologie expérimentale comme un ensemble inextricable de
mécanismes se répondant les uns aux autres apparaît à Ruyer comme devant être le
fruit d’une « forme vraie », d’une unité fondamentale qui seule peut expliquer l’unité si
bien coordonnée du développement. Ce qu’il doit dès lors penser, c’est la façon dont
cette forme-conscience agit, la façon dont elle cause le développement : c’est l’objet de
ses réflexions sur la causalité descendante.
La causalité descendante
29 Comme le montre bien Noble, les explications de la biologie du développement ont
longtemps été dominées par la seule cause ascendante, celle qui va mécaniquement et
unilatéralement du gène à l’organisme. Il observe cependant le recours de plus en plus
nécessaire à une causalité descendante qui, à l’inverse, va de l’organisme au gène,
déclenche et dirige la lecture de l’ADN, conçu comme une vaste base de données qui ne
peut se lire et s’interpréter elle-même. En 1939, dans « Causalité ascendante et causalité
descendante dans les sciences biologiques » [Ruyer 1939a,b], Ruyer adoptait le même
vocabulaire. Son problème théorique est inverse de celui des biologistes
contemporains : pour lui, la causalité principale est descendante. La forme commande
la mise en place de la structure physique de l’organisme. Ce qu’il s’efforce de
comprendre dans ce double article, c’est plutôt comment sa philosophie peut admettre
une autre forme de causalité, ascendante cette fois. Il va alors affirmer que la structure
peut dans certains cas maintenir la forme, voire la modifier. La structure conservée de
la plante gelée lui permet de reprendre au printemps sa croissance, contrairement à la
plante brûlée dont la structure est déformée ou détruite. La causalité ascendante est un
fait, mais reste seconde par rapport à la causalité descendante. Derrière des similitudes
lexicales apparaît ici une divergence profonde entre le philosophe et le biologiste : la
causalité descendante de Ruyer n’est pas un simple réseau de rétroactions exercées par
l’organisme et l’environnement, ces rétroactions n’en étant que le versant ou
l’apparence objective. Elle est le comportement actif, inobservable sinon dans ses effets,
d’un être subjectif se formant lui-même. Là où le biologiste invoque un réseau de causes
physiques et observables, Ruyer en appelle à un mode d’unité inobservable qui ne peut
être appréhendé que par le philosophe, et qui donne son sens aux observations du
biologiste.
30 Citons une autre convergence intéressante entre Ruyer et Noble : l’image du disque.
Noble nomme le génome « le CD de la vie » [Noble 2006, 1], et prend l’exemple suivant :
lorsque j’écoute un disque d’un concerto de Schubert et que je me mets à pleurer, un
observateur extraterrestre extérieur pourrait en déduire que c’est la structure
physique des sillons du disque qui a mécaniquement produit mes larmes. Pourtant le
disque seul ne me fait pas pleurer : il ne produit cet effet que parce qu’il est déchiffré
par un lecteur, et que la musique ainsi produite éveille en moi le souvenir une émotion,
accompagnée par exemple du souvenir de la première fois que j’ai entendu ce concerto.
De même l’ADN seul ne peut rien, le gène ne « détermine » rien : il est là, et la cellule en
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
76
lit de temps à autre une séquence spécifique [Noble 2006, 6]. Ruyer emploie lui-même
l’image du disque en ce sens.
Étrange merveille, écrit-il, que par l’intermédiaire d’un peu d’encre et d’un disque
de cire, les émotions d’un musicien lointain ou depuis longtemps disparu puissent
agir sur notre vie émotive. [Ruyer 1939b, 194]
31 Et il ajoute immédiatement que cette merveille « n’est pas un mystère nouveau, si l’on
admet l’existence des deux espèces de causalité inverses », ascendante et descendante.
La forme musicale produit la structure du disque (causalité descendante), qui, quand il
est joué, la restitue (causalité ascendante).
32 Le rôle du génome est donc d’être lu et interprété comme un disque ou, mieux, comme
une partition, qui ne contient pas toute la musique mais seulement des indications
destinées à « l’évoquer » dans l’esprit du musicien, qui lui-même peut en proposer des
interprétations différentes. Le vocabulaire causal va ainsi être remplacé
progressivement chez Ruyer par celui de l’évocation, forgé sur le modèle de l’évocation
d’un souvenir complexe par un objet quelconque qui ne le contient pas. On le voit ainsi
dans L’Embryogenèse du monde :
Nous avons vu que, selon les faits d’embryogenèse et aussi selon les expériences de
la microphysique, le principe même de causalité, au sens classique, est faux. Il n’y a
pas de causalité déterministe, sauf dans les foules d’individualités. Dans toutes les
individualités prises en elles-mêmes, biologiques, microphysiques et chimiques, la
causalité est en fait la manifestation, induite par stimulus, d’un potentiel mnémique
ou typique. Elle est indiscernable de la finalité. [Ruyer 2013, 143]
33 Il y aurait lieu de consacrer à cette évolution ruyérienne une longue étude, que nous ne
saurions développer ici.
Le poids de la structure
34 La causalité descendante n’est pour le biologiste rien de métaphysique : elle est
rétroaction, régulation par réseaux et supports physico-chimiques, quoique la
modélisation de ces rétroactions soit encore dans beaucoup de cas un épineux
problème. Ruyer y voit néanmoins l’aspect fonctionnel extérieur de l’action de la forme
vraie, qui commande sa propre conception de la causalité descendante. Il refuse
toutefois d’affirmer que la forme ou la conscience commande seule la morphogenèse, et
il adjoint à la causalité descendante une causalité ascendante. Pour la penser, Ruyer
emprunte au philosophe belge Eugène Dupréel sa théorie de la « consolidation » et son
exemple du moulage. Avant la prise du ciment, les parties de l’objet ne tiennent
ensemble que par l’action extérieure du moule. Après la prise du ciment, l’objet a
acquis sa propre unité : ses parties « tiennent ensemble » sans soutien extérieur [Ruyer
1939a, 32-33].
35 Pour Ruyer, l’organisme obéit au même schéma, mais il n’a pas de moule extérieur :
c’est sa structure physique (celle qu’étudie la biologie) qui soutient son unité, et
constitue, pour reprendre le mot de Buffon, son « moule intérieur ». Mais cette
structure a d’abord dû être formée : elle est le résultat de l’action d’une « forme vraie »
qui constitue la véritable unité de l’organisme, qui n’est pas celle d’une machine, d’un
agrégat de parties fonctionnant ensemble mécaniquement, puisqu’il se forme, se régule
et se restaure lui-même. La forme se « repose » pour ainsi dire sur la structure qu’elle a
formée, et la morphogenèse n’est jamais une pure recréation de forme sans appui
structurel, puisqu’elle est reproduction : les gènes, l’ADN mitochondrial et toutes les
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
77
caractéristiques de l’œuf peuvent être comprises comme un aide-mémoire construit
par la forme au cours de l’évolution, qui lui permet de ne pas avoir à réinventer
entièrement ses organes à chaque morphogenèse. En biologie, Newman montre avec
beaucoup de précision que le stade « œuf » avec toutes ses caractéristiques physico-
chimiques est effectivement une innovation évolutive, que ce stade n’est pas
nécessaire, mais qu’il permet de stabiliser (Ruyer pourrait dire : de « consolider ») le
développement embryonnaire, en faisant en sorte qu’il se produise toujours dans les
mêmes conditions limites et initiales [boundary and initial conditions] [Newman 2014].
36 La démarche générale de Newman consiste à montrer que la morphogenèse fait appel à
une multitude de mécanismes physiques génériques (viscosité, excitabilité électrique,
rigidité, adhésivité...), qui se retrouvent chacun (mais pas ensemble) dans des réalités
non-organiques. Les innovations évolutives et notamment le stade de l’œuf ont permis
d’exécuter des ensembles coordonnés de ces processus (qu’il nomme DPM pour
developmental patterning module) de façon stable et régulière en mettant en place un
« programme » qui en guide la mise en place. On passe ainsi « de la période “bio-
générique” de l’histoire du développement à la période “programmatique” moderne »
[Newman 2014, 103]. L’explication biologique semble donc inverse de celle de Ruyer :
Newman va clairement de la structure physique à la forme, sa causalité est toute
ascendante – quoique des mécanismes de régulation descendants puissent ensuite se
mettre en place. Cela ne contredit pas directement Ruyer, mais fait en revanche
reposer une grande partie de son explication de la morphogenèse sur un autre aspect
de sa philosophie : la nécessité de postuler également des individualités vraies aux
niveaux cellulaire, moléculaire et quantique. Le problème est donc décalé à un autre
niveau de l’analyse ruyérienne, puisque la réponse à Newman supposerait de montrer
que les processus génériques dont il part exigent à leur tour une interprétation
métaphysique en termes de forme et de conscience primaire.
37 Ce type d’explication rompt avec l’opposition du spatial et du trans-spatial, qui
opposerait Ruyer et la biologie réductionniste, en faisant appel à la dimension
temporelle de l’évolution. Il semble que ce soit dans cette direction qu’il faille
maintenant chercher une explication qui, sans infirmer directement l’existence de la
forme ruyérienne, pourrait la rendre inutile et redondante. Si la biologie doit avoir
raison de l’interprétation ruyérienne du développement, c’est probablement en
substituant à sa « forme vraie » la temporalité de l’évolution. Si l’embryon « n’hésite
pas » et réalise un type selon une mémoire, n’est-ce pas parce que les processus de
développement sont eux-mêmes issus d’une longue histoire et d’une lente évolution ?
Ruyer distingue formation et fonctionnement des organismes : il va nous falloir dans
l’avenir considérer la « formation de la formation », c’est-à-dire l’histoire de l’évolution
du développement embryonnaire, afin de déterminer si elle peut jouer les rôles
d’invention, de consolidation et de mémoire attribués par Ruyer à la forme vraie.
Spécificité du vivant
38 Ruyer prépare d’ailleurs d’une certaine façon la voie à ce type d’explication de par sa
conception du vivant comme étant certes le produit d’une forme trans-spatiale, mais
d’une forme qui se repose autant que possible sur des structures consolidées, c’est-à-
dire sur la causalité mécanique. Dans le monde physique inorganique, on retrouve des
individualités vraies (atomes, molécules), et des foules ou agrégats (montagnes,
fleuves...), donc les deux types de causalité. Mais les deux ne sont pas enchevêtrées
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
78
comme dans un organisme. Les phénomènes physiques du niveau des agrégats (une
avalanche, une vague) y sont de purs effets statistiques, ils ne sont pas dominés, utilisés
ou produits par une individualité qui les survolerait. À l’échelle microphysique à
l’inverse, c’est la causalité ascendante ou le fonctionnement mécanique qui fait défaut :
dans un atome (et même dans les interactions atomiques) il n’y a pas trace de
mécanisme, c’est la conséquence paradoxale mais nécessaire de sa monadologie
corrigée. Seul le vivant, dans l’organisme d’abord et dans la vie sociale ensuite,
constitue une individualité domaniale dans laquelle la conscience laisse autant que
possible la place à la causalité déterministe, comme le sculpteur fait des moules pour se
reposer et faciliter son travail.
39 La spécificité de la causalité biologique n’est donc pas qu’il y ait un genre de cause
spécifique à la vie organique (un atome, une molécule sont eux aussi des consciences
primaires) mais est due à l’enchevêtrement dans un même être de processus
mécaniques et d’un effort unifié et finalisé, celui-ci dirigeant et canalisant ceux-là. Le
domaine du biologiste est donc celui des « unités précaires » : en tant qu’individus, les
organismes présentent des processus complexes irréductibles aux lois de la mécanique
classique et de la chimie, mais dans lesquels celles-ci jouent un rôle qu’il a à étudier.
C’est pour Ruyer la clef métaphysique de l’affirmation de Newman (cf. supra) : il est
impossible de réduire la morphogenèse à un ensemble de lois simples.
40 Cette causalité mécanique a pour Ruyer une portée faible : elle ne fait le plus souvent
qu’accélérer ou aider un processus qui aurait pu se faire sans elle. Elle est néanmoins
nécessaire à l’évolution du vivant vers plus de complexité et de perfectionnement
[Ruyer 1939b, 192], [Ruyer 1958, 68 sq.].
La causalité pure [i.e., mécanique] n’apparaît que dans les fluides, ou dans les
fabricats artificiels, où la complexité est contre-nature. Elle apparaît aussi dans la
vie des organismes supérieurs parce que l’unité du vivant domine précairement les
appareils construits et des amas de matériaux colonisés et canalisés. [Ruyer 2013,
134, nous soulignons]
41 Une amibe invente d’elle-même un pseudopode, un organe-outil très simple, parce
qu’elle est suffisamment simple pour être entièrement dominée par la conscience
primaire. Mais dans les organismes supérieurs, la complexité est trop grande pour un
tel contrôle, et la conscience doit se reposer sur des mécanismes déjà montés – elle peut
inventer « sur le moment » un pseudopode, mais pas un bras ou une aile. On voit ici
combien le poids causal porté par la conscience primaire correspond dans une large
mesure à celui que doit porter, pour le biologiste, cette invention aveugle qu’est
l’évolution.
5 Conclusion : dans les marécages métaphysiques
42 Dans cet article, nous avons examiné plusieurs faits biologiques liés à la morphogenèse
sur lesquels Ruyer appuie son travail de philosophe : le rôle des gènes, la coordination
et la notion de champ morphogénétique, la causalité ascendante et descendante. Nous
nous sommes demandé si les évolutions les plus récentes de la biologie du
développement permettaient de mieux comprendre ces faits, et si ces évolutions
pouvaient mettre en péril la philosophie de Ruyer en la privant de ses appuis
scientifiques. Nous avons cherché à montrer que ce n’était pas directement le cas, au
moins sur les points que nous avons examinés. La biologie contemporaine semble de
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
79
plus donner raison à ses critiques du dogme mécaniste et géno-centrique en biologie, et
se sert couramment de faits dont Ruyer peinait à faire valoir l’évidence : le gène comme
base de données nécessitant une interprétation, la coordination multi-échelle du
développement, la nécessité d’une forme de causalité descendante, la capacité des
cellules à répondre de façon disproportionnée aux stimuli, le renforcement mutuel des
mécanismes physico-chimiques et d’un type morphogénétique spécifique mis en place
au cours de l’évolution, etc. Il semble donc y avoir encore une place pour la philosophie
de Ruyer comme recherche d’une métaphysique qui donne leur sens à ces faits. La
principale menace que fait planer la biologie contemporaine sur sa conception du
développement est celle du rôle croissant joué par l’évolution dans notre
compréhension du développement tel qu’il se présente aujourd’hui : ne pourra-t-elle
pas, à terme, jouer de façon aveugle le rôle dévolu par Ruyer à une conscience active,
celui d’inventer et de former l’organisme et son processus de développement ?
43 D’une façon générale, les biologistes matérialistes ont intégré nombre des critiques que
Ruyer formulait à l’encontre du mécanisme. L’adversaire qu’il a à combattre
aujourd’hui est donc bien plus solide que la simple transposition en biologie du
mécanisme de la physique classique du XIXe siècle, dont il a fait son principal adversaire
et que les biologistes eux-mêmes ont rejeté. Il appartient également à la philosophie
d’expliciter, de délimiter et d’éprouver la cohérence de ce matérialisme nouveau, et sa
capacité à résoudre les problèmes posés par Ruyer. Le débat est donc non seulement
toujours ouvert, mais enrichi des transformations parfois radicales de la biologie des
dernières décennies. Ainsi, nous pouvons conclure, avec [Vecchi & Hernandez 2014], en
faveur d’une approche métaphysique du problème de la morphogenèse en général, et
de l’étude de la solution ruyérienne en particulier. La pertinence des critiques de Ruyer
montre l’intérêt d’une approche philosophique des faits biologiques : une telle
approche doit idéalement permettre de tirer des faits scientifiques la métaphysique qui
permet de les comprendre et de les unifier, ou, plus modestement, conduire au moins à
une réinterprétation constante du matérialisme constitutif de la science moderne,
pointer les zones d’ombre des explications biologiques (ce qui ne signifie pas s’y
engouffrer), et ultimement entretenir un pluralisme conceptuel fécond pour la science
elle-même.
44 Avec Lawrence & Levine nous pouvons reconnaître le caractère caricatural ou dépassé
des débats opposant préformationnisme et épigénétisme, ou mécanisme et vitalisme.
Mais on peut penser qu’au lieu de fuir ces « marécages métaphysiques », scientifiques
et philosophes ont tout à gagner à les explorer, et à en faire le lieu de débats explicites
et précis [Lawrence & Levine 2006]. Le monisme de Ruyer est une tentative
problématique mais audacieuse pour répondre à ces interrogations. Discuter cette
tentative et sa validité actuelle s’avère être a minima un point de départ fécond pour
aborder ces questions.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
80
BIBLIOGRAPHIE
COEN, Enrico [1999], The Art of Genes, Oxford : Oxford University Press, cité par [Noble2006].
GILBERT, Scott F. & BARD, Jonathan [2014], Formalizing theories of development: A fugue on the
orderliness of change, dans Towards A Theory of Development, édité par A. Minelli & T. Pradeu,
Oxford: Oxford University Press, doi: 129–143, 10.1093/acprof:oso/9780199671427.001.0001.
LAWRENCE, Peter A. & LEVINE, Michael [2006], Mosaic and regulative development : Two faces of one
coin, Current Biology, 16, R236–239, doi : 10.1016/j.cub.2006.03.016.
MINELLI, Alessandro & PRADEU, Thomas [2014], Theories of development in biology—Problems and
perspectives, dans Towards a Theory of Development, édité par A. Minelli & T. Pradeu, Oxford:
Oxford University Press, 1–14, doi: 10.1093/acprof:oso/9780199671427.003.0001.
NEWMAN, Stuart A. [2014], Physico-genetics of morphogenesis : The hybrid nature of
developmental mechanisms, dans Towards a Theory of Development, édité par A. Minelli &
T. Pradeu, Oxford : Oxford University Press, 95–113, doi : 10.1093/acprof :oso/
9780199671427.003.0006.
NOBLE, Denis [2006], The Music Of Life — Biology Beyond the Genome, Oxford : Oxford University Press,
cité d’après la traduction par C. Ojeda et V. Assadas La Musique de la vie – La biologie au-delà du
génome, Paris : Seuil, 2007.
RUYER, Raymond [1939a], Causalité ascendante et causalité descendante dans les sciences
biologiques (I), Revue philosophique de la France et de l’étranger, 127(1–2 janvier–février 1939), 25–64.
RUYER, Raymond [1939b], Causalité ascendante et causalité descendante dans les sciences
biologiques (II), Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, 127(3–4 mars–avril 1939), 190–224.
RUYER, Raymond [1952], Néo-finalisme, Métaphysiques, Paris : PUF, 2 éd., Préface de F. Colonna,
2012.
RUYER, Raymond [1958], La Genèse des formes vivantes, Bibliothèque de philosophie scientifique,
Paris : Flammarion.
RUYER, Raymond [2013], L’Embryogenèse du monde et le Dieu silencieux, Continents philosophiques,
Paris : Klincksieck, texte établi, présenté et annoté par F. Colonna.
VECCHI, Davide & HERNANDEZ, Isaac [2014], The epistemological resilience of the concept of
morphogenetical field, dans Towards a Theory of Development, édité par A. Minelli & T. Pradeu,
Oxford : Oxford University Press, 79–94, doi : 10.1093/acprof :oso/9780199671427.003.0005.
WOLPERT, Lewis [1969], Positional information and the spatial pattern of cellular differentiation,
Journal of Theoretical Biology, 25(1), 1–47, doi : 10.1016/S0022-5193(69)80016-0.
WOLPERT, L. & LEWIS, J. H. [1975], Towards a theory of development, dans Biology of Aging and
Development, édité par G. Jeanette Thorbecke, Boston, MA : Springer US, 21–34, doi :
10.1007/978-1-4684-2631-1_4.
NOTES
1. Voir par exemple [Vecchi & Hernandez 2014] qui parlent de « préformationnisme
informationnel».
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
81
RÉSUMÉS
La biologie occupe une place centrale dans la philosophie de Raymond Ruyer. Nous nous
intéressons dans cet article à certains faits biologiques, considérés par Ruyer comme ayant une
portée métaphysique essentielle. Nous nous demanderons si les récentes évolutions de la biologie
du développement ont pu invalider ses thèses concernant la morphogenèse, c’est-à-dire
l’apparition d’une nouvelle forme dans le développement embryonnaire, et particulièrement son
rejet des explications mécanistes. Nous étudierons trois ensembles de faits sur lesquels Ruyer
appuie sa philosophie du développement : le rejet du mécanisme et l’importance des facteurs
non-génétiques dans l’embryogenèse, la coordination spatiale du développement et notamment
de la différenciation cellulaire, et la nécessité de faire appel à une forme de causalité descendante
allant de l’organisme au génome. À travers cette étude, si nous ne pouvons prétendre statuer
définitivement sur la solution ruyérienne, nous avons toutefois cherché à mettre en évidence la
persistance d’importants débats philosophiques autour du problème de la morphogenèse et la
fécondité d’une étude de la philosophie de Ruyer pour les aborder.
Biology holds a special place in Raymond Ruyer’s philosophy. This paper focuses on several
biological facts considered by Ruyer as being of essential metaphysical interest. Its aim is to
inquire if recent discoveries in developmental biology may invalidate his most important
arguments concerning morphogenesis, i.e., the apparition of a new form in the development of
the embryo, and especially his rejection of mechanistic explanations. Three groups of facts are
examined: the role of genes in embryonic development and the necessity for non-genetic factors;
the multiscale coordination of development (leading to problems such as cell positional
information or the theory of a morphogenetical field); the requirement for a form of downward
causality, which goes from the organism towards the genome. This study is primarily intended to
emphasize the persistence of important philosophical questions concerning morphogenesis, and
the interest of Ruyer’s specific approach in understanding those questions.
AUTEUR
BERTRAND VAILLANT
Université Paris 1 (France)
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
82
Ruyer et Wittgenstein : la
philosophie comme traduction ou
bien comme grammaire
Ruyer and Wittgenstein: Philosophy as a Translation or even as a Grammar
Fabrice Louis
1 Ce texte a pour but de mettre en confrontation la conception ruyérienne de la
philosophie avec la conception wittgensteinienne. L’idée est de montrer qu’on ne peut
pas opposer leurs conceptions du mental sans tenir compte de cet arrière-plan.
L’opposition majeure consiste dans l’idée défendue par Ruyer selon laquelle on ne
saurait concevoir ce qu’est l’esprit sans définir un domaine, intérieur au sujet, qu’on
peut identifier avec sa subjectivité. Une telle idée est comprise comme un mythe, celui
de l’intériorité [Bouveresse 1987]. Deux thèmes permettent alors de comparer les
objectifs de Ruyer et ceux de philosophes wittgensteiniens : le thème des mythes en
philosophie et celui de la traduction. Ces objectifs trouvent leur sens dans une volonté
présente (mais bien différente) chez les deux philosophes de s’émanciper de la science.
2 Cette volonté conduit l’auteur des Recherches philosophiques à introduire une analyse
philosophique de type grammatical pour « clarifier un usage linguistique qui est celui
de notre langage – le langage existant » et « éliminer des mésintelligences
particulières » [Wittgenstein 2004, 124]. Là où Wittgenstein, déjouant les pièges du
langage, s’exerce à nous mettre en garde à propos des analogies trompeuses, Ruyer 1
s’inspire de paradoxes pour élaborer une conception de l’esprit [Ruyer 1966]. Certains
termes comme « créativité » donnent à l’auteur des Paradoxes de la conscience le moyen
de défendre l’idée d’une origine interne de la subjectivité. La subjectivité naîtrait au
cœur d’un processus de création interne au sujet. Quand le philosophe wittgensteinien,
en grammairien2, tente d’établir des catégories de langage pour faire disparaître les
problèmes philosophiques, Ruyer prend au sérieux les problèmes engendrés par nos
manières de parler du mental. Par exemple, la créativité de l’esprit pose le problème de
l’origine, de nos sources d’inspiration. Les problèmes de la source, de la cause, et du lieu
où résiderait la source, posés par le terme « créativité » sont-ils de faux problèmes
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
83
philosophiques, destinés à disparaître après nettoyage grammatical des manières de
penser du philosophe ? Ruyer est loin d’être aveuglé par le miroir aux alouettes du
langage. D’un terme comme « créativité » il écrit :
N’est-ce là qu’un mot dissimulant l’absence de solutions ? Il arrive au moment où la
raison doit bien s’arrêter pour faire place à la théologie et à la métaphysique.
[Ruyer 1954, 191]
3 Ruyer semble effectivement admettre deux sortes d’asymptotes à sa philosophie : une
asymptote scientifique à l’origine de la réflexion et une asymptote théologique lorsque
la raison quitte le champ de la métaphysique.
4 Mais à quel moment l’absence de solutions se fait-elle sentir ? Lorsque le philosophe
comprend qu’il ne peut plus faire œuvre de traduction de la réalité sans recourir à une
certaine forme de mythes. Est-ce là une défaite du philosophe ou une sorte de
mésintelligence dans l’usage du langage ? Ruyer réfute l’idée d’une sorte de
mésintelligence, comme nous allons le montrer en étudiant l’utilité d’un mythe, celui
du mythe de l’intériorité. Nous aboutirons à cette idée : pour traduire la réalité de notre
subjectivité en éliminant le mythe cartésien du sujet, Ruyer est conduit lui aussi à
construire une grammaire, celle des formes.
5 Dans ses Mémoires d’outre-tombe, Chateaubriand estimait que « les poètes sont des
oiseaux : tout bruit les fait chanter » [Chateaubriand 2005, 321]. L’opposition entre
Ruyer et Wittgenstein peut se résumer ainsi : pour Wittgenstein, le philosophe ne peut
faire œuvre de poésie sans se faire des bosses à l’entendement. Cette traumatologie
bien spécifique produit ce que Ryle appelle le « mythe du philosophe » [Ryle 2005, 81].
Pour Ruyer en revanche, le philosophe sera bien plus près de la vérité si son discours
traduit de manière expressive, comme le chant du poète, les bruits de la nature. En
effet,
[...] le symbolisme improvisé des métaphores ou des rites vivants se meut toujours
le long d’une dimension verticale idéale ; il cherche une adéquation, une réussite
esthétique qui n’est jamais parfaite, avec le sentiment de « quelque chose à
atteindre » qui n’est pas « une chose ». [Ruyer 1955, 88]
6 Cette quête est parfois aussi celle de l’artiste. On peut moquer la naïveté de celui qui est
persuadé que son travail vise « quelque chose » comme on vise une cible avec un arc, on
peut même croire que c’est un artifice psychologique, une sorte de montage social
parfois nécessaire pour maintenir sous tension l’activité créatrice. Mais en dépit du
caractère un peu fantasque de ce sentiment exacerbé, Ruyer soupçonne l’existence
d’une réalité qu’on ne saurait nier sans commettre une erreur bien plus grande que
celle de prendre au pied de la lettre les exigences de l’artiste en quête d’absolu. C’est de
cette quête un peu naïve que peut naître la grammaire des formes existant réellement 3.
1 Le problème des mythes en philosophie et la
philosophie comme traduction
7 Le rapport de la philosophie à la science est une caractéristique essentielle des travaux
de Wittgenstein et Ruyer : il s’agit de s’émanciper, soit de la manière de poser les
problèmes, soit des conclusions tirées de la démarche empirique des sciences 4.
8 Dans son article « La science et la philosophie considérées comme des traductions »
[Ruyer 1963], Ruyer tente de défendre l’idée d’une philosophie conçue comme une
traduction. Le philosophe entend opposer cette conception à celle d’une philosophie
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
84
conçue comme une activité fondée simplement sur le modèle scientifique tel qu’il est
conçu habituellement (une représentation du monde qui ne doit rien à une conception
métaphysique) ou comme une activité fondée sur le modèle grammatical de Ryle ou
Wittgenstein.
9 Ruyer [Ruyer 1963, 18] note que, dans le Tractatus, Wittgenstein s’interroge sur la
signification du mot « philosophie » et affirme qu’il « doit signifier quelque chose qui
est au-dessus ou au-dessous des sciences de la nature, mais pas à leur côté »
[Wittgenstein 1993, 4-111]. C’est dans une veine wittgensteinienne 5 que Ruyer répond
aux interrogations de l’auteur du Tractatus. Pour donner un sens au mot
« philosophie », il convient de comprendre l’activité du philosophe et de la comparer
avec celle du scientifique. Ruyer prend le parti de considérer que le travail du
philosophe consiste, comme celui du scientifique, à réaliser une traduction. En effet, la
nature nous donne à lire un texte à déchiffrer. Cette perspective a l’avantage de
remettre en cause l’intérêt d’une étude comparative qui serait fondée sur la
problématique de la recherche de la vérité. Une traduction n’est ni vraie, ni fausse, elle
est appropriée ou non, elle est valable ou pas. Elle est fidèle ou non à l’esprit de celui
qu’on traduit. Elle a un sens ou non. Elle prête à confusion ou non.
10 Ruyer admet l’étrangeté de cette perspective. Cette perspective peut surprendre car
« le texte » (le monde où nous vivons) qui doit être traduit par le philosophe (ou par le
scientifique) est apparemment sans auteur et de plus, les traducteurs « appartiennent »
au texte. Mais cette difficulté ne doit pas nous empêcher de saisir la portée de la
comparaison. Et cette comparaison nous permet de comprendre que le philosophe,
comme tout traducteur, peut être absorbé par l’un ou l’autre des deux axes de son
travail : la recherche de la littéralité ou bien la quête d’une équivalence. Dans les deux
cas, l’effort à consentir est d’abord celui qu’on fait en réalisant le travail d’un
grammairien. Par exemple, pour réaliser une traduction, aucune confusion ne doit être
faite entre un verbe et un substantif. De telles erreurs existent en science comme en
philosophie. L’unification de l’électricité et du magnétisme (en prenant en compte la
relativité du mouvement) est une correction de ce type. « Les lois physiques doivent
prendre la même forme, quel que soit le référentiel dans lequel est exprimée cette
loi » : c’est une sorte de règle de grammaire énoncée par la science et sur laquelle se
fonde Einstein pour formaliser la théorie de la relativité restreinte.
11 De même pour Wittgenstein, « “mental” n’est pas [...] une épithète métaphysique mais
logique » [Wittgenstein 2000, 83]. Par conséquent, les travaux sur les « verbes
psychologiques » doivent définir une catégorie de verbes pour laquelle des emplois
peuvent être sémantiquement inappropriés. Ces verbes sont ceux qui permettent
d’attribuer des attitudes, des actes, des états mentaux (voir, attendre, chercher,
souffrir), et ce sont également des verbes qui ont un fonctionnement spécial quand on
les emploie à la première personne de l’indicatif présent. La règle de grammaire qui les
caractérise est la suivante :
[...] il y a dans l’emploi de ces verbes, « asymétrie » du point de vue de la
« justification épistémologique » entre la première et la troisième personne de
l’indicatif présent (et seulement de l’indicatif présent). [Descombes & Lara 2013, 82]
12 Pour le dire rapidement, nous pouvons nous sentir contraints de justifier l’assertion « il
espère qu’il va faire beau » en indiquant que nous avons observé celui dont nous
parlons. En revanche, nous ne nous sentons pas contraints de nous observer avant
d’affirmer « j’espère qu’il va faire beau ».
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
85
13 Mais le travail du traducteur ne se réduit pas à celui du grammairien : de fait, il hésite
souvent entre la volonté d’être proche du texte dans une traduction quasi littérale et le
souci de trouver la signification qui respectera l’esprit dans lequel l’auteur a écrit ce
texte. Pour Ruyer, la différence essentielle entre science et philosophie réside dans
cette hésitation. Le scientifique n’a pas à hésiter car son travail l’incite à être le plus
littéral possible, alors que le philosophe est contraint sans cesse, pour être juste dans
son travail de traduction, à produire « des mythes expressifs » [Ruyer 1965, 14]. Ceci
entraîne le philosophe dans l’à-peu-près, dans une activité qui mélange de manière peu
satisfaisante théorie quasi-scientifique et mythologie expressive. Il est donc louable que
des philosophes comme Ryle ou Wittgenstein contribuent à dénoncer les « mythes
laïcisés » [Ruyer 1965] de la philosophie. Ainsi Ryle affirme-t-il :
[...] dans l’héritage de Descartes, il y a un mythe qui continue de déformer la
géographie globale du sujet. [Ryle 2005, 72]
14 Mais qu’est-ce qu’un mythe en philosophie, selon Ryle ? C’est une « présentation de
faits appartenant à une catégorie dans un idiome approprié à une autre catégorie »
[Ryle 2005, 73]. L’ambition de Ryle, et avec lui d’un certain nombre de philosophes
adeptes du tournant grammatical, c’est donc de dé-mythifier la philosophie 6.
Comment ? « Sans les nier », écrit Ryle, mais « en les réorganisant » [Ryle 2005, 73], ou
bien comprend Ruyer, « en les re-traduisant » [Ruyer 1965, 16].
15 Si on pense à la manière dont Einstein a éliminé le mythe de l’éther en physique, en
décrivant les phénomènes grâce au formalisme de la relativité restreinte, on réalise que
les philosophes wittgensteiniens sont proches de l’esprit avec lequel les scientifiques
conçoivent leurs pratiques. Certes, dans un cas, il s’agit de découvrir le formalisme
adéquat pour rendre compte des phénomènes physiques et, dans l’autre il s’agit de
déterminer la catégorie logique à laquelle appartient un concept, c’est-à-dire
l’ensemble des manières dont on peut le manipuler logiquement, mais dans les deux
cas, l’activité consiste à faire preuve d’une rigueur intellectuelle pour traquer les
déficiences de nos descriptions7. Or on peut craindre que l’adoption sans mesure de
cette vertu (la rigueur) produise un effet inverse de ce que recherche le philosophe :
rendre plus intelligible le monde. Comment pourrait-il en être ainsi ? Comment peut-
on se détourner d’une piste féconde en étant plus rigoureux que tous les autres
philosophes ? En détruisant justement les mythes.
2 De l’utilité du mythe en philosophie chez Ruyer
16 Impatient devant les mystères de l’univers ou de sa propre existence, l’homme ne se
contente pas des ressources que lui offre l’activité scientifique, il organise sa
compréhension du monde comme il organise ses interactions avec ses semblables. Cette
analogie est au cœur du mythe que l’homme se construit par impatience ou par refus
de la conception scientifique. Ruyer ne nie pas l’existence d’une telle attitude.
Pour comprendre ou avoir l’illusion de comprendre l’inhumain, le surhumain, la
source originelle comme l’océan terminal, le procédé spontané pour l’homme, c’est
de projeter sur l’inconnu son ombre, ou l’ombre des choses qui lui sont familières.
C’est le procédé le plus naturel, celui du mythe [...]. Pour comprendre sa propre vie
consciente [...], l’homme emploie le même procédé. Il se projette lui-même, [...] sur
la surface d’un ruisseau où il se mire, sur le miroir convexe de l’œil, qui lui fait voir
son double aminci ou rapetissé, sa propre miniature, son Homunculus [...]. Cet
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
86
Homunculus est dissimulé dans le corps pendant la vie [...]. À la mort, il quitte le
corps et s’envole. [Ruyer 1957, 266].
17 Mais pourquoi les explications mythologiques paraissent-elles souvent vaines ? Parce
que le mythe transporte le mystère et le plante un peu plus loin, répond Ruyer. Le
mythe donne une satisfaction esthétique qu’on prend pour une satisfaction théorique.
L’explication mythologique consiste à expliquer la conscience par la conscience d’un
petit homme intérieur. Le philosophe lorrain qui a eu ses premières intuitions sur la
nature du vivant en observant de longues heures la beauté des fleurs vosgiennes entend
défendre cette démarche consistant à expliquer par l’identique transposé. L’attitude
opposée qui consiste à expliquer le vivant par le « tout différent », comme tente de
faire le physicaliste, apparaît à Ruyer comme relevant tout aussi bien d’un mythe.
Certes la tâche du physicaliste est utile : il cherche à expliquer la nouveauté par
l’ancien en identifiant les lois de la physique qui font émerger les entités
macroscopiques de manière durable pour éliminer toute explication métaphysique du
vivant. Or, selon Ruyer, il existe une troisième voie qui a pour tâche d’établir des
transitions, des pentes douces entre le monde vu comme un ensemble d’atomes et le
monde vu de manière anthropomorphique. Cette perspective doit permettre de
repousser le moment où on s’en remet à la théologie ou à la science.
18 Cette perspective ne peut pas apparaître si on s’en tient au sens précis du mythe de
l’intériorité : il ne s’agit pas de croire que la valeur symbolique du billet de banque est
construite par la subjectivité du sujet qui pense à son argent. Certes en un sens, Ruyer
défend l’idée selon laquelle les significations sont bien dans nos têtes. Mais son propos
provocateur masque l’essentiel : Ruyer défend le mythe de l’intériorité, mais pas pour
affirmer que le contenu d’une croyance est localisable. Le mythe de l’intériorité, s’il
n’est pas pris au pied de la lettre, pose le problème de la source de la signification.
Si, avant ce que dit un homme, il n’y a rien, s’il ne veut rien dire, alors parler et
émettre des sons, agir ou gesticuler par nervosité pure, c’est la même chose.
L’invocation de la culture n’apporte pas vraiment de solution, elle transfère
simplement le problème à l’humanité toute entière, historique. [Ruyer 1965, 43]
19 Nos communications, nos activités semblent pouvoir être décrites selon un axe unique
(horizontal selon Ruyer), celui de l’accord entre les êtres vivants. Et nos activités
symboliques, entièrement dépendantes de conventions, nous incitent à ne percevoir
dans nos communications que l’expression des accords possibles, autrement dit « des
jeux de langage ». Or,
L’expression « jeux de langage » doit faire ici ressortir l’idée que parler un langage
fait partie d’une activité, ou d’une forme de vie. [Wittgenstein 2004, § 23]
20 S. Plaud comprend cette forme de vie comme « un ensemble culturel d’arrière-plan qui
constitue le lit de nos significations et dont le partage est une condition de possibilité
de la compréhension mutuelle » [Plaud 2009, 32]. Dès lors, le problème philosophique
de la signification de nos actes de langage se réduit à un problème anthropologique :
celui de l’accord entre les hommes, accord qui constitue comme une machine à tisser
de la signification. En revanche, ce que nous font comprendre les mythes, les
métaphores, les rites et l’attitude un peu ridicule du jeune créateur refusant toute
compromission avec un art trop conventionnel, c’est l’existence d’une réalité qu’on
décrit de manière maladroite et dualiste en la présentant verticale 8, c’est-à-dire sans
lien direct avec l’axe horizontal du symbolisme conventionnel. Retour à une forme de
dualisme cartésien s’exclameront sans doute les partisans de Ryle ! Nullement, comme
le montre l’œuvre de Ruyer. Prendre au pied de la lettre le mythe conduit à une erreur
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
87
condamnable philosophiquement. Mais qui pense à prendre réellement au pied de la
lettre les mythes ? En revanche, ne pas prendre au sérieux les mythes constituent une
autre forme d’erreur en philosophie, bien plus condamnable, aux yeux de Ruyer. Car les
mythes ont une utilité en philosophie.
3 Qu’en est-il du « mythe de l’intériorité » ?
21 Les philosophes grammairiens ont une tâche finalement bien moins facile que celle des
scientifiques. Ces derniers éliminent eux aussi parfois certains mythes mais ils ne
soutiennent pas qu’ils vont réussir à le faire sans nier les faits. Einstein nie l’existence
de l’éther et celle d’une horloge universelle. La tâche des grammairiens est autrement
plus difficile : ils affirment ne pas nier les faits mais « seulement » éliminer les emplois
de langage inappropriés en philosophie. Ainsi écrit Bouveresse dans la seconde préface
de son livre Le Mythe de l’intériorité :
Il est bien possible que [...] le livre ait suggéré qu’il était question de nier une chose
que tout le monde croit, alors que Wittgenstein nie simplement que la manière dont
nous nous exprimons à propos des choses mentales nous oblige à croire ce dont les
philosophes s’imaginent généralement que nous le croyons. [Bouveresse 1987, 13]
22 Effectivement, Wittgenstein ne nie pas l’existence d’un processus intérieur mais
conteste que l’image du processus intérieur puisse décrire correctement ce que signifie
un souvenir. Ces passages des Recherches philosophiques, l’attestent :
305. « Mais tu ne peux pourtant pas nier qu’il y a, par exemple, dans le souvenir, un
processus interne. » — Pourquoi cela donne-t-il l’impression que nous avons voulu
nier quelque chose ? Quand on dit : « Il y a effectivement ici un processus
interne » –, on veut poursuivre ainsi : « D’ailleurs, tu le vois bien. » Et c’est ce
processus interne que l’on vise par l’expression “se souvenir”. — Si nous donnons
l’impression d’avoir voulu nier quelque chose, c’est parce que nous nous opposons à
l’image du “processus interne”. Nous nions que l’image du processus intérieur nous
donne l’idée correcte de l’emploi de l’expression “se souvenir”. [...]
306. Pourquoi donc nierais-je qu’il y ait là un processus psychique ? ! Mais : « Le
processus psychique du souvenir de... vient de se produire en moi » ne signifie rien
d’autre que « Je viens de me souvenir de... » Nier le processus psychique signifierait
nier le souvenir, nier que quiconque ne se souvienne jamais de rien.
307. « N’es-tu donc pas un behaviouriste masqué ? Au fond, ne dis-tu pas que tout
est fiction, sauf le comportement humain ? » — Si je parle d’une fiction, c’est d’une
fiction grammaticale. [Wittgenstein 2004, § 305-307]
23 De quelle fiction est-il question ? De celle qui conduit le philosophe à croire qu’on peut
parler de l’esprit comme on parle d’une chose. Pourtant nous savons évoquer l’esprit
d’équipe en sports collectifs sans jamais nous demander si l’esprit d’équipe est
localisable, comme s’il s’agissait d’un objet meublant le monde. L’esprit d’équipe n’est
pas à l’intérieur de quelque chose d’autre. « Esprit d’équipe » est une expression qui
nous permet de comprendre un type d’activité humaine et non de faire référence à
quelque chose. On peut toutefois se demander si toutes les questions, en matière de
philosophie de l’esprit, succombent à cette critique. Est-ce encore une fiction
grammaticale qui nous conduit à la question philosophique de la cause du souvenir ?
Certainement, répondra un philosophe wittgensteinien : les questions de cause
concernant les événements physiques, les problèmes de causalité du souvenir sont
scientifiques et non métaphysiques. Par conséquent, la question de la cause du souvenir
semble constituer une erreur de catégorie de langage. Et ces erreurs de catégorie qui
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
88
conduisent à des mythes philosophiques doivent être éliminées. Comment ? En
souscrivant à la démarche décrite par Wittgenstein : « “mental” n’est pas pour moi une
épithète métaphysique mais logique » [Wittgenstein 2000, 83].
24 On peut toutefois se demander, comme le fait Ruyer, s’il n’est pas nécessaire de faire
appel à un « mythe minimum », pour conserver la possibilité de parler
philosophiquement des faits et notamment du fait qui consiste à se souvenir, avoir une
émotion, une sensation. Car c’est bien ce qui est en jeu dans l’approche logique du
mental : la possibilité de continuer à philosopher. Si réellement le problème des causes
du souvenir ou de la capacité à se souvenir est un pur problème scientifique, alors il
semble avéré que le scientifique est en mesure de décrire ce que doit être un être
humain pour qu’il puisse se souvenir. Mais cette conclusion ne paraît pas elle-même
reposer sur une simple analyse grammaticale.
25 En d’autres termes, doit-on se satisfaire d’une étude grammaticale qui aboutit à
répondre ainsi, comme Wittgenstein, à la question suivante ?
304. « Mais tu admettras tout de même qu’il y a une différence entre un
comportement de douleur accompagné de douleur et un comportement de douleur
sans douleur. » — L’admettre ? Pourrait-il y avoir différence plus grande ? — « Et
pourtant tu en reviens toujours à ce résultat : la sensation elle-même est un rien. »
— Certainement pas ! Elle n’est pas un quelque chose, mais elle n’est pas non plus
un rien ! Le résultat était seulement qu’un rien fait aussi bien l’affaire qu’un
quelque chose dont on ne peut rien dire. Nous n’avons fait que rejeter la grammaire
qui voulait ici s’imposer à nous. [Wittgenstein 2004, § 304]
26 Il est cependant difficile d’accepter une telle conclusion : qu’« un rien » sert tout aussi
bien qu’un « quelque chose » dont on ne peut rien dire. Ce que vise ici Wittgenstein, ce
sont les « emberlificotements » de l’esprit du philosophe qui tente d’exprimer des faits
dans un idiome qui ne convient pas. Le célèbre paragraphe 293 (portant sur le scarabée
dans la boîte) des Recherches philosophiques est sur ce point sans équivoque :
Si l’on construit la grammaire de l’expression de la sensation sur le modèle de
« l’objet et sa désignation », l’objet perd toute pertinence et n’est plus pris en
considération. [Wittgenstein 2004, § 293]
27 Or Wittgenstein parvient à nous faire comprendre son argument en utilisant une
analogie (celle du scarabée dans la boîte avec la douleur dans la tête) qui fonctionne
justement sur la base de la grammaire qu’il essaie de rejeter : celle de l’objet et de sa
désignation. Certes, on peut ne pas comprendre l’argument si on n’est pas philosophe.
En revanche même quelqu’un qui n’est pas philosophe comprend l’analogie. Comment
est-ce possible s’il est équivalent de parler de la douleur comme « d’un quelque chose »
dont on ne peut rien dire, aussi bien que d’un rien ? L’analogie fonctionne parce que le
sens commun saisit immédiatement à quoi fait référence le scarabée dans la boîte : à
quelque chose dont on ne peut parler autrement que comme le font tous ceux qui ont
une douleur, et à quelque chose qu’on se refuse à prendre pour un rien.
28 Il semble que le raisonnement de Wittgenstein conduise à une conclusion un peu
différente de celle que le philosophe décrit.
29 Ce que Wittgenstein réfute dans les paragraphes précédant celui du scarabée, c’est la
conception qui entend donner le statut de connaissance à un énoncé que porterait un
homme sur sa douleur. On ne peut pas croire qu’on a mal, on ne s’observe pas avoir mal
et on ne peut pas douter de sa douleur ou de celle des autres, en demandant par
exemple : « Es-tu certain d’avoir mal ? » ou bien « Ai-je vraiment mal ? Il faut que
j’observe un peu mieux ma douleur car je n’en suis pas certain. » De telles questions
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
89
sont appropriées pour un « quelque chose » qu’on cherche à connaître et ne le sont
clairement pas pour ce qui est de la sensation de douleur. Dans le paragraphe du
scarabée, Wittgenstein décrit ce qui incite le philosophe à continuer à parler de la
douleur comme si elle entrait dans la catégorie des choses sur lesquelles on peut porter
un jugement de connaissance : c’est le fait que le philosophe croit pouvoir parler de la
sensation sur le « modèle de l’objet et de sa désignation ». Ce modèle est construit sur la
grammaire d’un quelque chose qu’on pourrait décrire.
30 Le raisonnement qui utilise l’analogie avec le scarabée vise cette fin : rendre absurde
l’utilisation de cette grammaire et en finir avec le mythe de l’intériorité, du moins de
celui qui nous incite à parler de notre sensation comme si c’était quelque chose que
nous pourrions « voir de l’intérieur uniquement », et dont nous ne pourrions jamais
rendre compte fidèlement puisque cette chose serait notre chose et non celle des
autres.
31 Or, cette position est trop forte et il n’y a pas de nécessité de la tenir pour montrer la
fausseté de la conception qui fait de nos énoncés sur la douleur, des énoncés
épistémiques. Il suffit juste de montrer qu’on ne peut pas prendre les énoncés sur la
douleur pour des énoncés entrant dans la même catégorie que ceux qui sont formés
lorsqu’un sujet fait un énoncé au sujet de quelque chose9. Dans ce dernier cas, les
énoncés traduisent la relation qui existe entre le sujet et ce « quelque chose » qui est à
connaître. Ce que montre l’argument du scarabée (pour un philosophe partageant
l’analyse de Ruyer), c’est qu’aucun énoncé portant sur une relation entre le sujet et un
quelque chose ne peut traduire le fait que ce sujet a une douleur. Le mot « traduire » est
employé ici à dessein. Car il y a bien un fait que ne nie pas Wittgenstein : « un sujet a
une douleur ». Et Ruyer fait de la philosophie une activité qui consiste à faire une
traduction des faits.
32 Il est remarquable que Ruyer admette et argumente en faveur de l’idée selon laquelle
aucun énoncé portant sur une relation entre le sujet et sa douleur ne traduira 10 le fait
que le sujet a une douleur. L’argument est d’ailleurs le même que celui qui se dégage de
l’essai d’E. Anscombe sur l’usage du mot « je » en tant qu’expression référentielle, tel
qu’en rend compte V. Descombes [Descombes 2014, 252-294]. Nous reprenons ci-
dessous cet argument.
4 L’erreur épistémologique et la conception
ontologique de l’esprit à l’origine de l’erreur
33 Dans son article « Le marteau, le maillet et le clou », V. Descombes nous décrit ainsi
l’argument qui permet de détruire l’idée selon laquelle le mot « je » est tel que le
locuteur puisse s’en servir pour établir un rapport à soi qui soit celui d’un sujet à un
objet :
[...] faire référence à un objet quel qu’il soit est un acte transitif, lequel réclame en
dernière analyse un contact entre un objet à nommer et un sujet pour le nommer,
donc une forme de contiguïté entre eux, tandis qu’exprimer la conscience qu’on a
de soi-même réclame une coïncidence pure et simple du sujet conscient et de lui-
même, et c’est là ce qu’aucune contiguïté, aussi étroite soit-elle, ne peut réaliser.
D’où l’échec inévitable des théories égologiques qui ont cherché à concevoir la
conscience de soi comme le rapport d’un sujet à l’objet qu’il est pour lui-même.
[Descombes 2014, 294]
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
90
34 La leçon à retenir de cet argument, c’est que l’expression « j’ai mal ! » ne signifie pas :
« Je viens d’acquérir une connaissance sur moi-même. Cette connaissance, c’est : mon
moi-même a mal ! » Car nous ne sommes pas à distance de nous-même.
35 Il est fort probable, comme le signale V. Descombes [Descombes 1991], qu’une certaine
conception phénoménologique du sujet soit à l’origine d’une telle erreur
épistémologique. Car cette conception introduit l’idée que l’activité mentale du sujet le
dédouble, en faisant de lui à la fois un agent et l’objet de l’action. On peut sans doute
repérer le moteur du dédoublement dans la définition de la phénoménologie donnée
par Ricœur : l’attention, activité mentale qui fait de tout cogito une véritable action.
L’attention dans la perception est seulement l’illustration la plus frappante de
l’attention en général qui consiste à se tourner vers [...] ou à se détourner de. L’acte
de regarder doit être généralisé selon la double exigence d’une philosophie du sujet
et d’une réflexion sur la forme de succession. D’un côté en effet l’attention est
possible partout où règne le Cogito au sens large, conformément à l’énumération
cartésienne : « non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir est la
même chose ici que penser. » Elle est le mode actif selon lequel toutes les visées du
Cogito sont opérées, de telle façon que sentir même puisse être en quelque façon
une action [...]. C’est l’attention qui dévoile le « je » en ses actes [...]. [Ricoeur 1988,
148-149]
36 Or, selon Descombes, la phénoménologie ainsi définie « reprend le concept cartésien
“élargi” de la pensée, ou cogitatio » :
Car cette redéfinition de la pensée comme attention ou visée est justement
l’innovation cartésienne. Aux yeux de la philosophie passée par l’école de
Wittgenstein, cet élargissement de la cogitatio qui va couvrir jusqu’à la sensation est
une invention désastreuse. Le fait incontestable qu’il y ait un pensé partout où il y a
une pensée, un voulu partout où il y a une volonté, etc., ce fait ne permet pas de
donner à tout cela un statut homogène d’« acte » ou de « visée de la conscience »,
car : 1o) ce serait faire de la conscience un suppôt de l’acte de voir (or c’est moi qui
vois, ce n’est pas ma conscience) ; 2o) les verbes exprimant les opérations et les
états de l’esprit n’ont pas la même grammaire (les uns se construisent avec le
complément d’objet, d’autres avec la proposition complétive, d’autres avec
l’infinitif, certains admettant plusieurs constructions). [Descombes 1991, 3]
37 Il faut donc résister à la tentation de concevoir la connaissance de soi comme le résultat
d’un cheminement direct de soi à soi. Et l’argument qui nous permet de résister à la
tentation porte sur l’existence impossible d’une relation, relation parfaitement bien
décrite par Descombes : quand un sujet fait référence à un objet, c’est qu’il existe une
distance entre les deux, distance qui est réduite en quelque sorte dans le langage par la
transitivité de l’acte de faire référence, jusqu’à ce que sujet et objet se jouxtent. En
revanche, il en va autrement pour la conscience du sujet : ce dernier n’est pas à
distance de sa conscience (il ne la touche pas non plus), lorsqu’il exprime la conscience
qu’il a de lui-même. Il y a nécessité d’une coïncidence pure entre conscience et sujet.
38 Il faut convenir avec V. Descombes que la conception égologique présuppose « qu’un
penseur est à l’égard de sa pensée comme un observateur à l’égard d’un phénomène
observé » [Descombes 2014, 197] et que ce présupposé est une erreur. Mais on corrige
bien le présupposé (contrairement à ce que dit V. Descombes) « en soulignant qu’il ne
s’agit pas d’observer des états de conscience mais de les vivre » [Descombes 2014, 198].
Car alors le philosophe qui corrige ainsi le présupposé n’affirme pas que penser son
action c’est l’éprouver. Il soutient plutôt que nulle croyance n’est possible s’il ne se
produit pas dans la tête de l’agent quelque chose qui est de l’ordre d’une expérience. Le
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
91
rapport n’est pas logique mais ontologique. Que doit être l’homme pour que le langage
soit possible ? L’accord dans le langage, la véracité des croyances, leurs contenus ne
dépendent logiquement ni de processus causaux matériels, ni d’expériences de quelque
sorte que ce soit. Mais nous ne parlons pas ici de dépendance logique, nous tentons
d’identifier l’ameublement du monde pour comprendre comment peuvent exister de
telles croyances. Sans êtres humains d’une certaine sorte (nous n’en connaissons que
constitués de chair et de sang) nulle croyance. Les pierres n’ont pas de croyances. Mais
voilà à nouveau ce qui embarrasse le partisan du tournant grammatical opéré par
Wittgenstein : mélanger des concepts propres à rendre compte de l’ameublement du
monde (les objets) avec des concepts permettant de décrire nos états mentaux (nos
expériences sensorielles, notre subjectivité, nos croyances...). Cette confusion serait à
l’origine d’erreurs de catégorie comme celle qui consiste à localiser (à l’intérieur du
sujet) ce qui touche au mental, ou à concevoir le mental comme étendu dans l’espace, à
la manière des objets. Cette erreur de catégorie est emblématique de la confusion
grammaticale : la conception spatiale du mental est comparable à la croyance que le
père Noël peut se blesser réellement en passant dans la cheminée. Le mode d’existence
d’une fiction n’est pas celui des êtres vivants. De même, on ne doit pas rendre compte
du mode d’existence du mental comme de celui des choses existant dans le monde
physique. Pour un wittgensteinien, on peut rendre compte du mental de manière
anthropologique, en décrivant comment les hommes agissent.
39 Or, la question que se pose Ruyer est la suivante : peut-on se satisfaire d’une approche
grammaticale pour réfuter le physicalisme dans sa tentative d’identifier ce qui touche à
la pensée et ce qui touche à la nature ? Sa réponse est négative [Ruyer 1966]. : le
problème du philosophe qui se pose la question ontologique de la pensée ne sera pas
résolu comme on résout un puzzle logique. Le problème du contenu intentionnel de la
pensée est secondaire11 : pour un wittgensteinien, il est en rapport avec le problème de
l’accord entre les humains. Comment nous accordons-nous, comment nous
comprenons-nous ? Ces questions seront peut-être correctement traitées dans une
analyse anthropologique de la pensée qui se restreint à décrire la perspective dans
laquelle les hommes agissent et pensent. Mais ce problème de l’accord n’existerait pas
si nous n’avions pas la faculté d’être comme nous sommes, chaque fois que nous avons,
par exemple, « une vision ». Le problème initial est celui d’une cohérence, ou d’une
unité, celle qui caractérise l’être humain, en tant qu’être vivant. Et cette unité ne
dépend d’aucune perspective, ni d’aucun accord. Cette manière de rapprocher accord
dans le langage et régularité dans la vie biologique n’est d’ailleurs pas contradictoire
avec la perspective wittgensteinienne, comme le souligne C. Chauviré :
Même si ses intentions étaient pures – et purement grammaticales –, il n’est
pourtant pas illégitime de lire chez lui une conception naturaliste de la vie sociale
et de la forme de vie servant de cadrage aux remarques grammaticales 12. [Chauviré
2010, 97]
40 Ce que Ruyer réfute, en refusant la solution grammaticale de Ryle ou de Wittgenstein,
c’est l’idée selon laquelle une classification correcte des termes utilisés pour parler de
nos pensées suffit à éclaircir le problème de l’unité des affections physiques de mon
corps qui conditionnent l’existence de la pensée. Pour un wittgensteinien, le domaine de
nos réflexions portant sur l’action est soit celui de la physiologie si l’action est décrite
comme volontaire, soit celui de la grammaire philosophique si l’action est décrite
comme intentionnelle13. Du coup on ne voit pas ce qui est mental dans l’action
volontaire puisqu’« il appartient à une philosophie de la volonté de s’interroger sur
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
92
l’explication physiologique des mouvements volontaires, de façon à mieux comprendre
ce que nous devons entendre par la capacité à contrôler (jusqu’à un certain point) ses
propres mouvements » [Descombes 2003, 18]. Mais alors les seuls faits à questionner
pour le philosophe cherchant à comprendre ce que signifie la capacité à se contrôler
pour un agent seraient-ils de nature physiologique ? Il existe pourtant un fait commun
aux actions intentionnelles ou simplement volontaires, c’est qu’elles présupposent une
unité (qu’il s’agisse d’un accord dans la forme de vie, ou d’une cohérence vitale pour
l’organisme), c’est-à-dire l’existence de formes de liaisons « unifiantes ». Comprendre ou
expliquer la capacité d’un agent à se mouvoir volontairement pour agir
intentionnellement en faisant référence simplement à des explications physiologiques
est un choix ontologique qui ne résulte pas seulement d’une analyse grammaticale. Ce
choix résulte d’une ou plusieurs hypothèses sur la nature du monde dans lequel nous
vivons. On peut souligner l’importance d’une philosophie qui se passe d’hypothèses.
Mais Ruyer fait un tout autre choix. Sa conception du vivant se rapproche alors de
mythes qui font de certaines liaisons observées dans l’univers le symptôme de
l’expression du finalisme. Ruyer conçoit parfaitement ce qui est choquant dans ce
choix.
Si les mots « comportements » et « conscience » choquent, appliqués à des
déformations rythmiques d’un protoplasme d’amibe, [...] c’est qu’ils réveillent le
souvenir de vieux mythes que pourtant ils s’efforcent de détruire de la seule
manière efficace – en les remplaçant. [Ruyer 1957, 282]
5 Du mythe cartésien au mythe ruyérien : élaboration
d’une grammaire pour parler de l’existence de quelque
chose qui n’est pas un objet
41 Il y a bien un mythe à détruire, c’est celui de l’existence d’une interaction à distance
entre le sujet et sa douleur. Mais il existe une autre solution, adoptée par Ruyer pour
réfuter cette conception égologique de la conscience sans faire de l’intériorité un
mythe qui égare le philosophe, c’est de donner du sens à l’idée que le sujet est un
concept inutile sur un plan ontologique. Ruyer reconnaît que « cette négation du sujet
n’a rien, philosophiquement, de nouveau : elle a pour elle les vieilles traditions
empiriques » [Ruyer 1950, 56]. Mais ce sont les conséquences qui n’ont pas été
découvertes. Ces découvertes portent sur le mode d’existence de « l’étendue sensible ».
Car une fois le sujet écarté, il convient de donner du sens à ce qui apparaît comme une
conséquence paradoxale : l’étendue sensible « est extériorité et distinction réciproque
de parties, malgré l’absence de perspective ; elle est une sorte de surface absolue, ce qui
heurte en nous le sens géométrique, éduqué par le monde de la perception » [Ruyer
1950, 57]. Comment donner du sens à l’idée selon laquelle notre sensibilité serait
étendue ? C’est pourtant le propre des objets d’être étendus et non du mental. C’est
dans la manière de détruire le mythe de la conception égologique que se résout le
problème.
42 Pourquoi le concept de sujet est-il inutile ? C’est parce qu’il y a coïncidence pure entre
le sujet et sa conscience : le sujet n’est pas à distance de sa douleur, il n’a pas
d’expérience de la douleur comme on peut avoir quelque chose en sa possession, ou sur
soi. Il ne voit pas sa douleur comme on voit un bouton sur son nez dans un miroir. Le
sujet, en ayant une douleur, n’acquiert pas une information sur lui-même comme un
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
93
scientifique quand il observe quelque chose. La douleur n’est (n’existe) pas
« relativement » à autre chose, ni relativement au sujet qui crie « j’ai mal », ni à une
tierce personne qui l’observerait. La grammaire, bien utile pour faire comprendre qui a
mal (« il a mal », « j’ai mal ») nous induit en erreur sur un plan ontologique. Il serait
sans doute plus juste de dire « je suis mal » pour exprimer l’impossibilité de mettre une
distance entre le sujet qui souffre et sa souffrance. La conscience de soi n’est donc pas
la conséquence d’une réflexivité du sujet se tournant vers lui-même comme on se
tourne vers un objet.
43 Le problème que tente de résoudre Ruyer, c’est celui de l’élaboration d’une conception
ontologique de ce qui se révèle à chacun de nous à travers notre vécu : l’unité de notre
champ de conscience. Dès lors, la caractéristique propre du mental, quelle que soit la
manière dont il s’exprime (croyance, douleur) c’est ce qui caractérise toute forme : elle
a une unité. Il ne s’agit pas d’affirmer que la manière dont on peut rendre compte de ce
qu’est une croyance est identique à la manière dont on peut rendre compte d’une
sensation, mais que ce qui est en jeu, sur un plan ontologique, c’est l’existence d’une
forme qui s’actualise de différentes façons (en se comportant de manière sensée, en
ayant des sensations). Un ballon n’est pas une bulle de savon mais les deux choses ont
en commun d’être en forme de sphère. Si notre monde disposait d’une topologie
n’admettant pas l’existence de sphères, nous ne verrions ni bulle, ni ballon. C’est le
véritable problème de Ruyer : tenter de caractériser la topologie de notre monde. De
quelles formes est fait notre monde ? Qu’est-ce que nous enseigne, à ce propos, notre
existence d’être humain ? Nous sommes, comme les objets, étendus dans l’espace et
soumis à la loi du temps. Nous sommes donc des formes spatio-temporelles dont la
sensibilité révèle une caractéristique dont ne disposent pas les objets : nous disposons
d’une unité propre faisant de la forme spatio-temporelle un domaine étendu. Ce
domaine est étendu d’une manière qui ne répond pas aux lois géométriques régissant
les formes apparentes des objets. Nous sommes une « surface absolue ». Il s’agit donc
aussi de construire une grammaire philosophique, celle d’une forme sensible étendue
qui diffère d’un objet, pour rendre compte du caractère paradoxal14 du mental et non
pour dissoudre tous les problèmes le concernant.
6 Grammaire de « l’étendue sensible »
44 L’analyse wittgensteinienne, en faisant de l’erreur du phénoménologue la conséquence
d’une « fiction grammaticale » [Wittgenstein 2004, § 307], masque l’essentiel. Si je ne
peux décrire l’effet que cela me fait d’avoir une douleur, si je ne peux qu’exprimer ma
douleur, c’est selon Ruyer, parce que je ne suis pas à distance de ma douleur. Le
philosophe wittgensteinien s’émeut sans doute d’un tel amalgame : la distance est un
concept issu de la géométrie, concept dont on fait usage en mathématiques, en
physique et dans notre vie ordinaire pour savoir comment les choses sont distantes.
Quel sens doit-on donner à un tel terme pour formuler une proposition sur la douleur
et le sujet qui souffre ? Quelle expérience pourrions-nous partager pour donner du sens
à l’utilisation du concept de distance à propos de la douleur ou de notre perception ? Le
sens que Ruyer entend lui donner concerne le mode d’existence de notre subjectivité.
Notre champ de conscience est une forme d’un certain type, dont la caractéristique
essentielle est éprouvée dans le cadre de l’étendue sensible : cette forme est étendue,
douée d’intériorité [Ruyer 1950, 56]. Ruyer inverse l’ordre voulu par le propos
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
94
wittgensteinien qui cherche à relier le sens du discours philosophique à l’usage que
nous faisons habituellement de notre langage. La Conscience et le Corps [Ruyer 1950]
révèle une grammaire du mental qui modifie notre rapport habituel à la géométrie de
l’espace et entend résister à la « mise en scène de la perception » [Ruyer 1950, 55]. Cette
mise en scène nous porte à croire que nous sommes devant notre champ de conscience
comme devant un tableau. Or la différence est, selon Ruyer, flagrante et la preuve est
évidente : vous ne voyez pas le bord de votre champ de vision. Chacun de nous peut
faire cette expérience. Vous n’êtes pas donc pas à distance de votre champ de vision,
vous ne le voyez pas : vous êtes ce champ de vision. Votre vision, même hallucinatoire,
a donc toujours quelque chose de réel puisque vous êtes cette hallucination. Par
conséquent, toute connaissance, toute croyance présuppose un contenu qui permet aux
êtres humains de s’accorder (en adoptant une perspective semblable) mais cette
connaissance, cette croyance repose en premier lieu sur une expérience qui n’a, elle,
aucun contenu intentionnel et ne nécessite aucune perspective, aucun accord, aucune
action préalable.
45 On ne peut donc rendre compte de la douleur telle que nous la vivons dans aucune
perspective [Ruyer 1950, 56-57]. On ne peut que manifester l’expression de cette
douleur. Cette expression est l’expression d’un « survol absolu, sans distance » d’une
forme [Ruyer 1952, 110], c’est-à-dire l’expression d’une entité qui unifie ses composants
sans en être à distance. C’est cette unité dont ne peut rendre compte le langage et qui
fait de ma douleur une douleur, de ma vision une vision. Cette unité, cette douleur n’est
pas donnée aux autres, à ceux qui m’observent. Et ce fait ne peut pas être seulement
traduit par cette règle de grammaire selon laquelle moi seul qui ai cette douleur peux
affirmer (sans qu’on puisse en douter) « j’ai mal ». Il est également juste de dire que ma
douleur ne m’est pas non plus donnée à moi qui crie : « J’ai mal. » Mais il est peu
probable qu’il soit alors nécessaire de conclure que l’intériorité est un mythe pour
philosophe.
46 Revenons sur le paragraphe du scarabée dans la boîte. Ce paragraphe concerne la
grammaire du rapport entre le contenu et le contenant : « l’image du processus
intérieur ne nous dit rien sur le souvenir. » L’idée combattue par Wittgenstein est celle
qui consiste à penser qu’on décrira mieux ce qu’est un souvenir, une douleur, en
tentant d’identifier, à l’intérieur du sujet, une sorte de résidu caché, propre à chaque
sujet souffrant, que ne décrirait pas l’expression de la douleur. Or le langage n’étant pas
fait, dans le cas de la douleur, pour décrire (au sens de décrire un objet), mais
simplement pour l’exprimer, il ne saurait être question de chercher ce qui manque à ce
que nous disons lorsque nous parlons de notre douleur. Ce qui est utile dans cette
analyse wittgensteinienne, c’est l’idée selon laquelle nous ne pouvons pas faire mieux
que ce que nous faisons pour dire notre douleur, par exemple en la décrivant de telle
sorte que nous serions alors satisfaits de cette meilleure traduction. Si nous pouvions
réellement décrire notre douleur (par exemple à quelqu’un qui n’a jamais souffert), nous
pourrions tenter de faire mieux en changeant de perspective, à la manière dont on
décrit un objet : du dessus, du dessous, du dedans. De même, la conception égologique,
en imaginant un rapport de distance entre le sujet et sa conscience, commet cette
erreur. Nous exprimons notre douleur mais nous ne pouvons pas la décrire telle qu’elle
nous apparaît à nous et à nous seuls car pour cela, il serait nécessaire de pouvoir disposer
d’une perspective privée sur la douleur telle qu’elle est pour nous. La grammaire des sense
data semble donc ne jamais pouvoir être éclaircie, viciée d’une contradiction logique
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
95
interne « car l’idée, quand on a introduit cette expression, était de prendre modèle,
pour des expressions qui font référence à l’“apparence”, sur des expressions qui font
référence à la “réalité” » [Wittgenstein 1996, 129]. Cette critique faite aux partisans de
l’existence des sense data paraît être également valable pour la conception de Ruyer.
47 Le philosophe semble effectivement accréditer l’idée qu’on pourrait jouer sur deux
tableaux : se servir d’une expression utile pour décrire la réalité telle qu’elle m’apparaît
(je vois ce tableau peint en bleu) afin de décrire la réalité de ma subjectivité (mon
champ de vision a une unité lorsqu’il voit du bleu, il constitue donc une forme réelle). Il
y a bien une apparence : elle est créée au niveau du cerveau, organe de perception.
Cette apparence n’est pas l’objet physique tel qu’il est, c’est donc une sorte
d’hallucination. Les expressions liées à nos sensations sont propres à la grammaire des
apparences. Il y a bien des cas où les apparences sont trompeuses (cas du mirage). Mais
même dans les cas où les apparences ne sont pas trompeuses (ce tableau est bien peint
en bleu), je ne vois pas la réalité telle qu’elle est, la réalité du physicien, pourrait-on
dire. Et cependant, pour Ruyer, c’est une « hallucination vraie 15 », bien réelle : elle n’est
pas à nouveau une apparence pour moi [Ruyer 1950, 19]. Percevoir, c’est toujours avoir
une forme d’hallucination, mais la forme que prend cette hallucination n’est pas elle-
même une forme d’hallucination : c’est une forme qui existe et définit ici et maintenant
ma subjectivité en tant que forme. Ruyer est donc bien de ceux, décrits par
Wittgenstein qui « ont pensé avoir découvert de nouvelles entités, de nouveaux
éléments de la structure du monde, comme si dire “je crois qu’il y a des sense data” était
comparable à dire “je crois que la matière est composée d’électrons” » [Wittgenstein
1996, 129]. Pour Ruyer, l’expression « il existe des formes sensibles » a bien le même
sens que « il existe des électrons », car dans les deux cas, il existe une forme disposant
d’une unité intrinsèque qui est à la source des apparences.
48 Que nous ayons mal et que nous exprimions cette douleur en nous comprenant les uns
les autres, c’est le fait d’une intériorité et pas seulement d’une intériorité constituant le
champ d’étude du neurologue. C’est en tous cas, selon Ruyer, le mythe minimum auquel
on doit croire pour traduire philosophiquement l’existence de sujets exprimant leurs
douleurs. Cette intériorité existe du fait même des liaisons qui ordonnent la forme
subjective souffrant, car « la conscience n’est autre que l’ensemble même des liaisons »
[Ruyer 1950, 47].
7 Grammaire « des liaisons »
49 La grammaire philosophique que tente d’élaborer Ruyer pour rendre compte de
l’existence de choses qui ne sont pas des objets mais des subjectivités est fondée sur
cette question à la base de toute épistémologie : quel est le rapport entre la
connaissance et la chose à connaître ? L’épistémologie suppose toujours a minima qu’il y
a isomorphisme possible entre la connaissance (les relations faites par la raison) et les
relations réelles qui constituent la chose. Par exemple, on suppose un isomorphisme
entre le formalisme de la physique quantique et les liaisons réelles entre les états des
particules. Pour définir la subjectivité, Ruyer fait une hypothèse qui rompt avec ce
point de vue. La subjectivité, c’est le fait même des liaisons.
[L]es liaisons ne sont jamais à proprement parler connues. Elles ne sont donc jamais
comprises que de manière métaphorique et analogique. [Ruyer 1950, 33]
50 Cette hypothèse redéfinit notre conception des rapports entre intérieur et extérieur.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
96
51 La subjectivité est bien localisée (elle est étendue par le fait même de l’existence de
liaisons dont on peut observer les effets dans l’espace du monde physique) mais elle
n’est pas à l’intérieur d’un objet (elle n’est pas dans le corps). Le corps c’est ce qu’on
connaît de la subjectivité lorsqu’on adopte une perspective en 3e personne pour
observer la subjectivité :
[...] le corps résulte comme sous-produit, de la perception de l’être par un autre
être. L’être perçu est perçu par définition comme objet, au sens étymologique du
terme. [Ruyer 1952, 81]
52 Ce qu’on appelle « la perspective en 1re personne » ne peut être une perspective, car il
est impossible de se décrire à distance, de l’intérieur 16. Le domaine localisé de la
subjectivité est un domaine absolu, ce qui signifie qu’il n’est pas relatif à autre chose.
Les objets, eux, sont étendus les uns à côté des autres et de ce fait, nous pouvons avoir
une description de leur unité sous une certaine perspective, en étant à distance. Il en va
autrement pour le domaine de l’étendue sensible : la forme sensible se survole elle-
même, sans distance, sans créer de centre de perspective. Elle est bien douée
d’intériorité (elle ne se laisse pas traduire par un isomorphisme dans une perspective
en troisième personne) : les liaisons sont le fait de la subjectivité et ne se laissent pas
connaître telles qu’elles sont, d’où la nécessité de faire référence à des métaphores, des
analogies, des mythes.
8 Conclusion
Notre tâche est de ramener les mots de leur emploi métaphysique à leur emploi de
tous les jours. [Wittgenstein 2004, § 116]
53 La tâche est louable mais considérons un instant le langage du physicien tentant
d’expliquer la non-séparabilité quantique. Dira-t-on encore que c’est le sens du
quotidien qui doit s’appliquer pour comprendre comment le formalisme mathématique
aide le physicien dans sa recherche ? Ou admettra-t-on qu’il y a un résidu de sens que
ne décrivent pas les mots pris dans leur acception quotidienne 17 ?
54 Un métaphysicien comme Ruyer tente de construire une approche ontologique du
finalisme qui ne se limite pas au langage ordinaire. Sans le recours aux métaphores, aux
mythes, que peut le langage ordinaire pour exprimer ce qu’est un survol sans distance ?
« Mais où a-t-on besoin de recourir à un tel concept ? », demande Wittgenstein
[Wittgenstein 1998, I, § 109]. Nulle part. Ou bien peut-être dans le cadre de la poésie.
Car les idées-évènements de P. Valery [Lara 2005] soulignent aussi ce qui transparaît
dans le rêve : le sujet est possédé par ses pensées [Ruyer 1966, 210]. Doit-on conclure de
cette expression paradoxale qu’elle est le reflet des bosses que Ruyer s’est fait lui-même
à l’entendement ? Le philosophe nous met au contraire en garde contre nos habitudes
qui font du langage le seul moteur du sens :
[...] l’homme est tellement habitué au langage – c’est-à-dire au sens « signifié » –
qu’il doute aisément du sens de ce qui ne parle pas, de ce qui ne s’exprime pas, de ce
qui ne s’exprime pas par des paroles prononcées ou écrites. Il s’imagine que c’est lui
qui donne aux choses un sens en les nommant. [Ruyer 1952, 15]
55 Selon l’analyse de P. de Lara [Lara 2005, 75-76], Wittgenstein ne doutait sans doute pas
de l’existence de pensées non- ou pré-linguistiques mais il admettait aussi l’existence
d’une relation interne entre les deux formes de pensées : « une pensée doit pouvoir être
exprimée » [Lara 2005, 77]. Il y a un continuum entre la pensée non linguistique du chat
se préparant à chasser la souris et les pensées des chasseurs préparant un plan de
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
97
chasse. Ce qui lie les deux formes de pensées, ce sont les concepts qui sont définis par
les actions de l’agent. L’action de chasser permet de définir le concept de chasse
présent aussi bien dans la pensée non linguistique du chat que dans le plan des
chasseurs. Où s’arrête ce continuum ? Et pourquoi s’arrête-t-il ? Là où nous ne pouvons
plus décrire les évènements naturels comme des actions, c’est-à-dire là où nous ne
pouvons plus décrire les évènements comme orientés de manière finalisée. Mais la
question de cette rupture n’est plus de type linguistique : elle est ontologique. Cette
question ne peut être dissoute par une analyse grammaticale. Elle nécessite une analyse
philosophique du type d’êtres qui sont reliés par ce continuum allant des actions et
pensées pré-linguistiques à celles qui sont linguistiques. Dans tous les cas, ces actions
révèlent l’existence d’une entité disposant d’une unité, orientée vers une fin. Le mythe
minimum auquel il faut souscrire selon Ruyer, c’est celui qui nous conduit à croire en
une intériorisation de cette finalité comme propriété intrinsèque des êtres capables
d’actions et doués d’unité, comme toutes les formes composant le monde.
56 À quoi l’analyse philosophique de ce mythe est-elle utile ?
[Elle] représente [...] une avance vers la philosophie du « juste tempérament » vers
cette gamme bien tempérée [...], ou vers cet escalier à pente modérée destiné à
corriger la dénivellation abrupte de la mythologie et du scientisme [...]. [Ruyer
1957, 275].
57 Ruyer reconnaît bien volontiers que ce type d’analyse vient légitimer « une théologie
anthropomorphique et cependant non mythique [...] » [Ruyer 1957, 285].
BIBLIOGRAPHIE
BOUVERESSE, Jacques [1987], Le Mythe de l’intériorité, Paris : Éditions de Minuit.
CHATEAUBRIAND, François-René [2005], Mémoires d’outre-tombe, t. 3, Paris : Éditions Jean De Bonnot.
CHAUVIRÉ, Christiane [2010], Wittgenstein en héritage, Paris : Éditions Kimé.
DESCOMBES, Vincent [1991], Le pouvoir d’être soi. Paul Ricœur. Soi-même comme un autre, Critique,
47(529–530), 545–576, 2006, URL http://classiques.uqac.ca/contemporains/descombes_vincent/
pouvoir_etre_soi_ricoeur/pouvoir_etre_soi_ricoeur.html.
DESCOMBES, Vincent [1998], L’identification des idées, Revue Philosophique de Louvain, 96(1), 86–118.
DESCOMBES, Vincent [2003], Comment savoir ce que je fais ?, Philosophie, 76 (1, numéro spécial
Elizabeth Anscombe), 15–32, doi : 10.3917/philo.076.0015.
DESCOMBES, Vincent [2014], Le Parler de soi, Paris : Gallimard.
DESCOMBES, Vincent & LARA, Philippe de [2013], Exercices d’humanité : entretiens avec Philippe de Lara,
Paris : Les Petits Platons.
LARA, Philippe de [2005], L’Expérience du langage, Paris : Ellipses.
LAUGIER, Sandra [2009], Wittgenstein, les sens de l’usage, Paris : Vrin.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
98
PLAUD, Sabine [2009], Wittgenstein, Paris : Ellipses.
RICŒUR, Paul [1988], Philosophie de la volonté I, Paris : Aubier.
RUYER, Raymond [1950], La Conscience et le Corps, Paris : PUF.
RUYER, Raymond [1952], Néo-finalisme, Métaphysiques, Paris : PUF, 2 éd., Préface de F. Colonna,
2012.
RUYER, Raymond [1954], La Cybernétique et l’origine de l’information, Paris : Flammarion, 1968.
RUYER, Raymond [1955], L’expressivité, Revue de Métaphysique et de Morale, 60(1–1), 69–100.
RUYER, Raymond [1957], Homunculus et méganthrope, Revue de Métaphysique et de Morale, 62(3),
266–285, doi : 10.2307/40900136.
RUYER, Raymond [1963], La science et la philosophie considérées comme des traductions, Les
Études philosophiques, 18(1), 13–20, doi : 10.2307/20844208.
RUYER, Raymond [1965], Quasi-information, psychologisme et culturalisme, Revue de Métaphysique
et de Morale, 70(4), 385–418, doi : 10.2307/40900875.
RUYER, Raymond [1966], Paradoxes de la conscience et limites de l’automatisme, Paris : Albin Michel.
RYLE, Gilbert [2005], La Notion d’esprit, Paris : Payot & Rivages.
WITTGENSTEIN, Ludwig [1990], Remarques philosophiques, Paris : Gallimard, traduit par J. Fauve,
1re édition en français, 1975.
WITTGENSTEIN, Ludwig [1993], Tractatus logico-philosophicus, Paris : Gallimard, traduit par G.-
G. Granger.
WITTGENSTEIN, Ludwig [1996], Le Cahier bleu et le Cahier brun, Paris : Gallimard, traduit par
M. Goldberg et J. Sackur.
WITTGENSTEIN, Ludwig [1998], Remarques sur la philosophie de la Psychologie I, Mauvezin : TER, traduit
par G. Granel.
WITTGENSTEIN, Ludwig [2000], Derniers écrits sur la philosophie de la psychologie, 2. « L’intérieur et
l’extérieur », Mauvezin : TER, traduit par G. Granel.
WITTGENSTEIN, Ludwig [2004], Recherches philosophiques, Paris : Gallimard, 1re édition 1953.
NOTES
1. Comme dans son livre Paradoxes de la conscience et limites de l’automatisme [Ruyer 1966].
2. Wittgenstein décrit ainsi ce qui deviendra un « tournant grammatical» opéré dans la lignée du
philosophe autrichien et identifiant une manière nouvelle de considérer les problèmes
[Wittgenstein 2004, § 90]. « Nous avons l’impression que nous devrions percer à jour les
phénomènes : notre recherche n’est cependant pas dirigée sur les phénomènes, mais, pourrait-on
dire, sur les “possibilités” des phénomènes. Ce qui veut dire que nous nous remettons en
mémoire le type d’énoncés que nous formulons sur les phénomènes [...] Nos considérations sont
donc grammaticales. Et elles élucident notre problème en écartant les mécompréhensions
relatives à l’usage des mots et provoquées notamment par certaines analogies entre les formes
d’expressions qui ont cours dans différents domaines de notre langage.»
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
99
3. Par opposition aux formes qui ne sont que le résultat d’un agencement temporaire, statistique
et sans causes finales, les formes existant réellement maintiennent leur unité de manière
dynamique.
4. « Les philosophes voient constamment devant leurs yeux la méthode de la science, et sont
irrésistiblement tentés de poser et de résoudre des questions de la manière dont la science le fait.
Cette tendance est la source réelle de la métaphysique et elle conduit la philosophie à une
obscurité complète» [Wittgenstein 1996, 58].
5. Plutôt celle du second Wittgenstein.
6. De même, écrit S. Laugier, « Wittgenstein refuse les solutions (toujours présentes) de la
philosophie de l’esprit et les images qu’elle impose – celle de la signification ou d’un vouloir-dire
immatériel, la mythologie d’un sens caché [...]. La seule vie du langage, c’est l’usage, ou mieux les
usages, toujours différents et nouveaux selon les circonstances, de nos phrases» [Laugier 2009,
170].
7. Et pour Wittgenstein, « la philosophie est, de fait, “purement descriptive”» [Wittgenstein 1996,
58].
8. Ruyer considère que le physicalisme consiste à penser que pour expliquer quelque phénomène
que ce soit, qu’il s’agisse du monde de la microphysique ou du vivant, il suffit de faire intervenir
des réalités spatiotemporelles. Dans l’ensemble de son œuvre il s’efforce de dénoncer cette
position physicaliste pour montrer la nécessité de faire appel à une transversale métaphysique
[Ruyer 1952, 132], c’est-à-dire au domaine du trans-spatio-temporel, pour rendre compte de ce
qui se passe au niveau du spatiotemporel. Cette transversale métaphysique est constituée par les
sens, les finalités, les valeurs qui s’incarnent dans le spatiotemporel.
9. Comme le montre V. Descombes, cet engouement à concevoir l’esprit sur le même mode
d’existence que les choses (une localisation, une cause) est symptomatique du monisme
ontologique [Descombes 1998]. Le partisan du monisme ontologique ne fait qu’une liste pour
désigner ce qui existe, une sorte de liste notariale. En revanche, chez Wittgenstein, les
différences de catégories entre les différents types de réalités se présentent comme les
différences qu’on fait entre les « parties du discours». L’ontologie est donc construite grâce à une
analyse grammaticale.
10. Il est probable que ce terme de « traduire» ne convienne pas aux philosophes
wittgensteiniens car les seuls faits auxquels nous devrions faire référence ici, ce sont des faits
« appartenant au langage» [Wittgenstein 1990, § 45], ces faits « dont le sens d’une proposition
présuppose l’existence». Ce que nous faisons, lorsque nous nous accordons dans nos activités
quotidiennes, constitue un ensemble de faits appartenant au langage. Il y a une certaine
similitude dans nos gestes, dans nos actions, lorsque nous ressentons une douleur. Le langage
« au sujet de notre douleur» ne traduit pas notre douleur, il permet d’exprimer autrement ce que
nous faisons lorsque nous montrons, par nos actions, que nous avons mal. Comme l’affirme
Wittgenstein à propos du problème philosophique de la sensation : « le paradoxe ne disparaît que
lorsque nous rompons radicalement avec l’idée que le langage ne fonctionne que d’une manière,
et toujours pour le même but : traduire des pensées [...]» [Wittgenstein 2004, § 304].
11. Secondaire au sens où il y a des étages de la subjectivité et l’étage des activités intentionnelles
n’est pas le premier. Il est secondaire par rapport à celui des activités organiques. On pourra
consulter sur ce point Éléments de psycho-biologie.
12. Cette perspective est accréditée par la manière dont Wittgenstein [Wittgenstein 2004, § 415]
percevait lui-même son travail constitué de « remarques sur l’histoire naturelle de l’homme».
13. Comme le décrit V. Descombes [Descombes 2003].
14. Sur ce sujet, on lira avec profit le livre de Ruyer : Paradoxes de la conscience et limites de
l’automatisme [Ruyer 1966].
15. Ruyer, faisant la critique de la conception bergsonienne de la perception, montre que la
position réaliste est incompatible avec le processus physique et physiologique de la perception.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
100
Ce processus va de l’objet à l’organe des sens et donc chez l’homme au cerveau. La perception
n’est donc possible que parce que se produit dans notre cerveau une sorte d’image cérébrale de
l’objet. La conception réaliste qui affirme que dans la perception, l’objet lui-même nous est donné
« en chair et en os», est pour Ruyer totalement inintelligible.
16. Ruyer concéderait peut-être à Ricœur l’existence d’un « corps propre» qui est dégradé en
« corps-objet» par une description empirique. En revanche, il n’y a aucune possibilité de
description de ce « corps propre», car l’argument qui permet de rejeter le naturalisme vaut aussi
contre la conception phénoménologique qui tente de décrire « le corps-sujet» [Ricœur 1988, 15] :
aucune description n’est possible de mon corps propre car je ne suis rien d’autre que les liaisons
de ce corps.
17. On peut d’ailleurs se demander s’il existe une expérience (au sens où Wittgenstein l’entend)
qui permet de donner du sens à la terminologie du physicien lorsqu’il l’emploie pour s’exprimer
devant un public de non-physiciens pour expliquer la physique quantique telle qu’elle est comprise
par les physiciens. Et pourquoi accepterait-on du physicien ce qu’on refuse au philosophe?
RÉSUMÉS
Ce texte a pour but de mettre en confrontation la conception ruyérienne de la philosophie avec la
conception wittgensteinienne. L’opposition majeure consiste dans l’idée défendue par Ruyer
selon laquelle on ne saurait concevoir ce qu’est l’esprit sans définir un domaine, intérieur au
sujet, qu’on peut identifier avec sa subjectivité. Une telle idée est comprise par Ryle comme un
mythe, celui de l’intériorité. Il y a en revanche une volonté commune (mais bien différente) à
Ruyer et Wittgenstein de s’émanciper de la science. Deux thèmes permettent alors de comparer
les objectifs de Ruyer et ceux des philosophes wittgensteiniens : le thème des mythes en
philosophie et celui de la traduction.
This text aims to confront the Ruyerian concept of philosophy with the Wittgensteinian one. The
main opposition consists of the idea defended by Ruyer that one cannot conceive what a mind is
without defining a domain, interior to the subject, that one can identify with its subjectivity.
Such an idea is understood by Ryle as a myth, that of interiority. On the other hand, there is a
common (but quite different) will of the two philosophers to emancipate themselves from
science. Two themes then make it possible to compare the objectives of the philosophers Ruyer
and Wittgenstein: the theme of myths in philosophy and the theme of translation.
AUTEUR
FABRICE LOUIS
Département de Philosophie – Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie, Archives
Henri-Poincaré, Université de Lorraine, CNRS, Nancy (France)
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
101
L’intériorité n’est-elle qu’un
mythe ?
Jean-Pierre Louis
1 La critique du dualisme cartésien au XXe siècle a été conduite principalement à partir
de deux positions : d’une part le réductionnisme physicaliste identifiant un état de
conscience à un état cérébral connaissable à partir de ses propriétés physiques et
chimiques et, d’autre part, la critique wittgensteinienne voyant dans le dualisme
spiritualiste le résultat d’une erreur grammaticale conduisant au mythe de l’intériorité,
c’est-à-dire à la croyance que nous avons un accès privilégié à nos propres états
mentaux inaccessibles à une observation à la troisième personne, contrairement à nos
comportements qui sont publics.
2 Le rejet du dualisme cartésien n’offre-t-il pas d’autre alternative ? Nous faut-il choisir
entre un monisme matérialiste aux conséquences difficilement acceptables et une
critique grammaticale qui voit dans la question des relations entre le cerveau et la
conscience l’exemple type d’un problème voué à disparaître par une utilisation
correcte du langage ?
3 Si l’on considère que le monisme matérialiste, quelles que soient les formes qu’il revêt,
n’explique pas réellement les propriétés essentielles des états mentaux et qu’il aboutit
plutôt à la négation de ce qu’il prétend expliquer et si, d’autre part, une critique
grammaticale du langage philosophique ne nous semble pas faire disparaître le mystère
des relations entre le cerveau et la conscience, alors la philosophie de Ruyer nous offre
une troisième voie, celle d’un monisme non matérialiste permettant de rendre compte
de l’accès privilégié que nous avons à nos propres états mentaux sans pour autant nous
faire retomber dans un dualisme cartésien dont les faiblesses ont été à juste raison
dénoncées.
4 La critique de la position réductionniste de Dennett, telle qu’il la développe dans son
ouvrage La Conscience expliquée [Dennett 1993], me conduira à montrer pourquoi Ruyer,
qui avait pourtant développé une conception mécaniste de la conscience dans sa thèse
de doctorat, a été amené par une réflexion rigoureuse sur la notion de forme, à un
monisme non matérialiste identifiant état de conscience et état cérébral. Ce monisme
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
102
non matérialiste conduit-il à un retour au mythe de l’intériorité ? Ne relève-il pas, tout
autant que le matérialiste moniste, d’une erreur de catégorie qui fait du cerveau
l’organe de la pensée ? J’essaierai de montrer que le philosophe wittgensteinien partage
le même présupposé que le matérialiste moniste, ce qui le conduit à refuser de faire du
cerveau l’organe de la pensée.
1 Ruyer et la solution au problème de la conscience
selon Dennett
5 Le problème des qualia est au centre de l’ouvrage de Dennett et c’est certainement ce
problème qui justifierait le titre de cet ouvrage si Dennett avait réellement donné une
solution satisfaisante à cette question.
6 Rappelons pourquoi les qualia semblent devoir résister à toute explication
réductionniste. Il semble y avoir un fossé entre l’expérience subjective de la couleur, la
pure sensation de rouge, et ce que peut décrire un neurologue au moment où le sujet a
cette sensation de rouge. Wittgenstein parle à ce propos de l’infranchissable abîme
entre la conscience et les processus cérébraux. C’est cet abîme que conteste Dennett
mais sans faire de cet abîme une illusion prenant sa source dans une erreur
grammaticale. Ainsi les sensations de malaise à la vue des serpents peuvent être
identifiées à la somme totale des réactions inhérentes à mon système nerveux qui
résultent de ma confrontation avec un certain schéma de stimulation. Cette réduction
du quale à un ensemble de réactions cérébrales et comportementales permettrait selon
Dennett d’éviter le cercle vicieux dans lequel tombe le dualisme. En effet la thèse
dualiste semble condamnée à une explication semblable à celle qui fait appel à la vertu
dormitive de l’opium pour rendre compte des effets de l’opium. Pour rendre compte de
notre réaction face aux serpents, le dualiste devrait proposer l’explication suivante : les
serpents évoquent en nous un quale particulier d’envie de vomir et notre sentiment de
malaise est une réaction à ce quale. D’où le cercle vicieux dénoncé par Dennett :
pourquoi éprouvons-nous ce sentiment de malaise ? Parce que les serpents nous
dégoûtent. Pourquoi nous dégoûtent-ils ? Parce qu’ils provoquent en nous un
sentiment de malaise. Ce cercle vicieux peut être dénoncé dans la plupart des cas :
pourquoi aimons-nous telle personne ? Pour la beauté de ses yeux. Et pourquoi aimons-
nous ses yeux ? Parce qu’ils font naître en nous un sentiment d’amour.
7 La réduction des qualia aux réactions adaptatives de mon système nerveux a des
conséquences et le mérite de Dennett est d’en tirer toutes les conséquences même si,
pour rester cohérent, il lui faut refuser d’admettre ce qui nous paraît être une réalité
impossible à récuser. C’est cette conséquence que nous voulons mettre en lumière
parce qu’elle nous semble être le noyau de l’argumentation de Dennett, c’est-à-dire ce
qu’il nous faut accepter si nous admettons la thèse matérialiste de l’identité telle que la
définit Dennett. Si la sensation n’est pas un état de conscience distinct de l’état
cérébral, il semble alors que l’on puisse définir les propriétés de cet état de conscience
en termes neurologiques. Ma sensation de rouge, c’est ce que peut observer le
neurologue quand il observe les réactions cérébrales résultant du stimulus. C’est donc
la connaissance scientifique qui permet de connaître en quoi consiste cet état de
conscience identique à mon état cérébral. Il nous semble que la conséquence inévitable
de cette position, de ce primat accordé à la connaissance à la troisième personne, c’est
la négation du phénomène en tant que phénomène, de l’apparence en tant
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
103
qu’apparence et c’est d’ailleurs ce que reconnaît Dennett dans un passage clef de son
ouvrage La Conscience expliquée. Dennett imagine un dialogue avec un disciple de
Descartes refusant d’admettre que sa sensation se réduit à un ensemble de réactions
neurologiques observables par le neurologue. Prenons l’exemple d’une illusion
d’optique qui nous fait voir sur une page un anneau rosâtre là où il n’y a pas
physiquement d’anneau rosâtre. Dennett cherche à convaincre le cartésien que non
seulement il n’y a pas d’anneau rosâtre sur la page du livre mais qu’il n’y a pas non plus
d’anneau rosâtre dans le monde intérieur de la conscience. Il nous semble certes voir
un anneau rosâtre mais du fait qu’il nous semble voir un anneau rosâtre, Dennett refuse
de conclure à la réalité, à l’être de l’apparence de l’anneau rosâtre :
Tu sembles penser qu’il y a une différence entre le fait de penser (juger, décider,
croire du fond du cœur) que quelque chose te semble être rose et le fait quelque
chose te semble réellement être rose. Mais il n’y a pas de différence. Il n’existe pas
de phénomène tel que le sembler réel qui vienne s’ajouter au phénomène de juger
comme ceci ou comme cela que quelque chose est le cas. [Dennett 1993, 449]
8 Dennett reconnaît bien qu’il nous semble voir un anneau rosâtre et enregistre
fidèlement nos dires sans les mettre en doute (ce qu’il appelle faire de
l’hétérophénoménologie). L’erreur que dénonce Dennett consiste à penser que,
puisqu’il me semble voir un anneau rosâtre, alors il existe réellement une apparence
d’anneau rosâtre accessible uniquement au sujet cartésien. Dennett doit donc refuser
l’existence phénoménale de l’apparence de l’anneau rosâtre pour ne pas retomber dans
le dualisme cartésien. Comme il le dit :
Il n’y a pas de chose telle qu’un anneau rosâtre qui semble simplement exister.
[Dennett 1993, 449]
9 Ce qui reste vrai, c’est que j’ai pensé ou dit qu’il me semblait voir un anneau rosâtre.
Avoir la sensation d’un anneau rosâtre se réduit donc à penser ou dire qu’il me semble
voir un anneau rosâtre. Il n’y a pas à admettre en plus de ce jugement, de cet acte
linguistique, l’existence d’une apparence d’anneau rosâtre, apparence qui serait à
l’origine de mon jugement. Le stimulus sur la page du livre vous a seulement conduit à
dire que vous perceviez un anneau rosâtre. Dennett se voit donc obligé de refuser toute
existence à l’expérience subjective faite à la première personne. Il refuse l’existence de
ce qu’il prétendait pouvoir expliquer. Cette position est cohérente par rapport à ses
présupposés matérialistes mais elle a un prix que même un philosophe non dualiste
n’est peut-être pas prêt à payer. Son principal argument est que si l’on ne paye pas ce
prix, on retombe inéluctablement dans le dualisme.
10 C’est ce même souci de cohérence que l’on retrouve dans la manière dont Dennett
répond à une expérience imaginaire censée prouver l’impossibilité de réduire l’état de
conscience à l’aire cérébrale telle qu’elle est connue et enregistrée par le neurologue.
L’expérience imaginée par Jackson et reprise sous différentes formes, est celle d’un
neurologue enfermé dans une chambre noire dès sa naissance. Il a acquis la
connaissance de toutes les réactions qui se produisent dans le cerveau d’un homme
percevant les couleurs et il connaît donc la réaction cérébrale correspondant à la
perception d’une banane jaune. La question est de savoir si, n’ayant jamais eu
auparavant de sensations de couleur, il découvrira quelque chose de nouveau pour lui
lorsqu’on le mettra pour la première fois de sa vie devant une banane jaune. Tout
dualiste doit répondre que ce neurologue fait une expérience nouvelle puisqu’il refuse
d’identifier la sensation de jaune à un état cérébral. Dennett ne peut accepter cette
position parce que son monisme matérialiste l’oblige à considérer qu’une connaissance
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
104
objective à la troisième personne de l’état cérébral peut en principe être complète et ne
rien laisser en dehors d’elle. Il doit donc être possible au neurologue enfermé dans sa
chambre noire de savoir en quoi consiste l’expérience de la sensation de jaune à partir
de l’observation de l’état cérébral de celui qui fait cette expérience. Il semble en effet
que si l’on considère que la connaissance à la troisième personne n’équivaut pas à
l’expérience subjective, au fait d’éprouver la sensation de jaune, on soit
inéluctablement reconduit à une position dualiste. C’est tout l’intérêt de la philosophie
de Ruyer de montrer qu’il est possible de reconnaître une distinction fondamentale
entre la connaissance neurologique de l’état cérébral et l’expérience subjective de la
sensation de jaune. Refuser la primauté de la connaissance objective à la troisième
personne ne conduit pas inéluctablement à adopter une position dualiste. Comme le
montrera Ruyer dans La Conscience et le Corps [Ruyer 1937], la thèse de l’identité entre
l’état cérébral et l’état de conscience ne nécessite pas que l’on admette l’auto-suffisance
de la connaissance objective à la troisième personne.
11 Pourtant, Ruyer, dans sa thèse de doctorat avait développé des thèses et des arguments
proches de ceux de Dennett et que l’on pourrait rapprocher du courant fonctionnaliste.
Sans entrer dans le détail de cette thèse, nous voudrions mettre l’accent sur les deux
points que nous pouvons mettre directement en rapport avec l’argumentation de
Dennett pour comprendre ensuite ce qui a amené Ruyer à refuser la possibilité d’une
explication mécaniste de la conscience.
12 Dans son premier livre Esquisse d’une philosophie de la structure [Ruyer 1930], Ruyer
considérait que la sensation pouvait être définie comme une sorte de clef déclenchant
dans le cerveau une réaction, à la manière dont une clef ouvre une serrure. Considérons
un arbre et la perception qu’un homme a de cet arbre. Un arbre constitue une forme.
Cette forme objective existe par la liaison des éléments qui la constituent à la manière
dont la forme triangulaire n’existe que par la liaison des lignes. L’homme qui perçoit
cet arbre en a une image consciente au niveau de son cerveau. Cette image de l’arbre
peut être définie comme une forme cérébrale qui existe donc spatialement. Il ne s’agit
évidemment pas d’une image photo reproduisant l’arbre. Lorsqu’il emploie le terme
d’image cérébrale, Ruyer veut dire que les liaisons des différents éléments nerveux
constituent une forme. Ces liaisons sont de nature différente des liaisons qui
constituent la forme de l’arbre dans la forêt mais elles constituent elles aussi une forme
cérébrale résultant de l’action des ondes lumineuses sur la surface rétinienne. Les
qualités sensibles qui sont les éléments constitutifs des formes perçues, sont définies
elles-mêmes comme des formes, même s’il ne nous est pas possible de les décomposer
en leurs éléments sans les faire disparaître. L’image cérébrale de l’arbre est faite de
points qualités de couleur de même qu’une mélodie est constituée de sons élémentaires
que notre cerveau relie pour constituer cette forme temporelle qu’est la mélodie. Tout
est donc forme : l’arbre tel qu’il existe extérieurement à moi, de même que les
sensations de vert et de brun à partir desquelles le cerveau va constituer une image de
l’arbre. Mais la forme, quelle qu’elle soit, est un mécanisme et elle agit sur d’autres
formes, comme un mécanisme agit sur un mécanisme. Ainsi la forme arbre agit sur le
cerveau par l’intermédiaire des ondes lumineuses, et l’image cérébrale qui en résulte
agira sur d’autres formes cérébrales qui produiront une réaction organique. Ruyer,
pour expliquer ce mode d’action des formes les unes sur les autres se réfère donc à
l’action d’une clef sur la serrure. La clef permet d’ouvrir la serrure grâce à sa forme qui
est en harmonie avec celle de la serrure, d’où son efficacité. Le cerveau
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
105
[...] est un organe récepteur d’une forme, selon la nature de laquelle un mouvement
se déclenchera. Le mécanisme qui nous paraît le mieux répondre à cette définition
est celle d’une clef ouvrant une serrure. L’arbre de la biologie fonctionne selon sa
forme, se nourrit, croît, respire. L’image de l’arbre implique que toutes les parties
de l’arbre ont été unies entre elles par des liaisons d’un autre ordre fournies par des
conducteurs nerveux, de façon à pouvoir agir sur l’organisme par la forme même de
l’arbre comme une clef avec, comme serrure, le cerveau. [Ruyer 1930, 142]
13 Ruyer conclut de cette analyse du mode de fonctionnement du système nerveux, que
« si l’on pouvait construire un appareil physique reproduisant toutes les liaisons
physiques du système nerveux, cet appareil serait conscient » [Ruyer 1930, 169].
14 On retrouve chez Dennett cette référence au mode d’action d’une clef pour rendre
compte du fonctionnement cérébral. Voulant définir l’intentionnalité en termes
simples, il se réfère au rapport entre la clef et la serrure :
[...] une clef et une serrure manifestent la forme d’intentionnalité la plus grossière ;
il en va de même pour les récepteurs optiques qui se trouvent dans les cellules du
cerveau. C’est à partir de cet élément premier, le rapport grossier qui existe entre
une clef et une serrure, que la nature a construit donc des sous- systèmes plus
perfectionnés qui méritent davantage le titre de systèmes représentationnels.
[Dennett 1998, 56-57]
15 Ruyer, dans Esquisse d’une philosophie de la structure, se réfère à ce même modèle pour
expliquer l’adaptation de l’organisme à son milieu par un processus aveugle de type
darwinien et donc sans recourir à une explication de type finaliste :
L’harmonie d’une forme organique avec son milieu, fonctionnant comme un
barrage à propriétés définies, comme l’harmonie de la clef et de la serrure, est une
raison pour que cette forme organique existe. C’est ce qui explique que la finalité
paraisse dominer l’ordre du mécanisme. [Ruyer 1930, 149]
16 Il faut souligner qu’il y a un lien direct entre cette réduction des sensations et des états
de conscience à des mécanismes et le rejet de l’explication finaliste en biologie. Puisque
tout est forme et que toute forme agit causalement par ses propriétés propres à la
manière d’un mécanisme, la finalité intention ne peut être qu’une illusion.
17 Pourquoi Ruyer est-il passé de ce modèle mécaniste de la conscience et du vivant à une
conception qui s’efforcera de montrer que toute explication mécaniste de la conscience
équivaut à sa négation ? Il nous semble que c’est une réflexion sur les conditions
d’existence d’une forme qui a conduit Ruyer à abandonner son premier modèle
mécaniste. Tout est forme et toute action est celle d’une forme sur une autre forme et
le cerveau est lui aussi un ensemble de formes cérébrales. Une forme peut être définie
comme un certain type de liaisons entre les éléments qui constituent cette forme. Mais
quel est le mode d’existence de ces liaisons ? Puisqu’une forme est une unité d’une
diversité d’éléments, il faut rendre compte de cette unité si l’on veut rendre compte de
l’existence des formes. Expliquer par l’action d’une forme sur une autre forme sans
s’interroger sur le mode d’existence des formes, équivaudrait à ne rien avoir expliqué.
Le mécanisme ne rend pas compte des formes, c’est-à-dire de ce qui fait d’une forme
une forme. C’est ce que montrera Ruyer dans La Conscience et le Corps et c’est dans cet
ouvrage que Ruyer développe la notion qui permet de rendre compte de l’existence des
formes, c’est-à-dire de la conscience et, au-delà de la conscience, des formes
organiques. En effet, pour Ruyer, le problème de la conscience et le problème du vivant,
de la finalité organique, ne font qu’un. Reprenons l’exemple de la perception d’un
arbre. Pour que je puisse percevoir cet arbre, il faut qu’existe sous une forme ou sous
une autre, dans mon cerveau une forme cérébrale d’arbre. Mais pour qu’il y ait
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
106
perception, il faut que cette image cérébrale soit perçue sinon il n’y aurait pas plus de
perception qu’il n’y en aurait si personne n’était placé devant l’écran de télévision. D’où
la question que pose Ruyer : « Qui perçoit l’image cérébrale ? » Si on refuse de recourir
à l’œil de l’esprit cartésien et si on n’accepte pas de considérer que la caméra perçoit
réellement la scène qu’elle enregistre au sens où je perçois cette même scène, alors il
semble qu’il ne reste plus qu’une solution, même si cette solution implique un
bouleversement radical de la conception de la conscience et du corps et donc de leurs
« relations ». C’est cette solution que développera Ruyer dans toute son œuvre et qui se
trouve condensée dans la notion de survol absolu ou de surface absolue. Il nous faut
admettre que c’est la surface cérébrale qui se perçoit elle-même par ce que Ruyer
appelle un survol absolu, c’est-à-dire un survol sans distance. Il n’y a pas de sujet de la
perception, transcendant à cette surface cérébrale et distinct de cette surface
cérébrale. C’est cette surface cérébrale qui est sujet et objet de la perception par cette
propriété inhérente à tout champ de conscience de se survoler lui-même. Tout se passe
ici comme si un texte était capable de se lire lui-même, comme s’il n’y avait plus besoin
d’un lecteur placé devant le texte et distinct du texte pour que le texte soit lu. Si la
surface cérébrale n’était, comme la page du livre, qu’un pur objet, si les éléments de la
surface cérébrale étaient simplement juxtaposés les uns à côté des autres, partes extra
partes, comme le sont les lettres sur la page, il n’y aurait pas lecture. La page cérébrale
se lit elle-même. Comme l’écrit Ruyer :
Il est de la nature de toute forme de paraître se survoler elle-même. Chaque fois
qu’un ensemble vrai, une vraie forme, un vrai domaine de liaisons existe, un point
mythique de perspective est virtuellement créé. [Ruyer 1937, 64]
18 C’est cette propriété qui permet de rendre compte de l’existence des formes.
Puisqu’une forme n’existe que par la liaison de ses éléments, il est possible d’en rendre
compte par ce survol sans distance qui permet à la surface cérébrale de se voir elle-
même, de s’auto-posséder et d’être donc une forme cérébrale. Cette synthèse des
éléments n’est donc pas opérée de l’extérieur par un sujet métaphysique mais par la
surface cérébrale elle-même et en ce sens, la solution de Ruyer demande qu’on
abandonne le dualisme cartésien, l’opposition entre l’étendue et la pensée, sans pour
autant retomber dans un monisme matérialiste. En effet, les mécanismes ne possèdent
pas cette propriété d’auto-survol et il n’est donc pas possible de rendre compte de
l’unité d’une forme par des mécanismes. Dans notre champ de perception, tous les
éléments qui y figurent, tout en étant divers et distincts, appartiennent à un seul et
même champ de conscience et cette unité fondamentale par auto-survol doit donc être
attribuée aux éléments cérébraux qui constituent cet état cérébral. Cette propriété
appartient à tout champ de conscience et par conséquent la conscience ne saurait être
réduite à des mécanismes cérébraux.
19 Il nous faut donc faire une distinction essentielle entre l’état cérébral tel qu’il est donné
au neurologue comme pure substance étendue et ce même état cérébral tel qu’il est
donné à lui-même par auto-survol absolu. La connaissance objective de cet état, son
observation à la troisième personne, ne saurait donc être équivalente au fait d’être
dans cet état ou d’être cet état. B, qui perçoit l’état cérébral de A au moment où A a une
sensation de jaune, n’éprouve donc pas cette sensation. Évidemment dira Dennett,
puisque B n’est pas A. Mais ce qui fait problème pour le monisme matérialiste, c’est que
A éprouve quelque chose quand il est dans cet état cérébral. Ce dont il faut rendre
compte, c’est que cet état est ressenti. Lorsqu’une table peinte en vert est ensuite
peinte en bleu, on pourrait dire qu’elle change d’état et que cela lui fait quelque chose
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
107
puisqu’elle n’est plus dans le même état. Mais le fait de changer d’état n’implique pas
que la table a éprouvé quelque chose en changeant d’état. C’est l’observateur extérieur
qui a éprouvé quelque chose en voyant la table changer de couleur. Nous voulons dire
que cela ne fait rien à une table d’être une table parce qu’elle n’est pas dotée de ce
survol absolu et par conséquent, à supposer qu’une connaissance objective parfaite de
la table soit possible, cette connaissance ne laisserait aucun résidu. Rien de l’être de la
table ne lui échapperait. Par contre, la connaissance neurologique de l’état cérébral de
A, si complète soit-elle, laisse quelque chose d’essentiel en dehors d’elle, c’est-à-dire ce
que cela fait d’être dans cet état.
2 Ruyer face à la tentation d’un retour à
l’épiphénoménisme
20 C’est ce fossé entre la connaissance à la troisième personne et l’expérience subjective
dont n’arrivent pas à rendre compte des auteurs tels qu’Edelman, J. Proust ou
Jeannerod, alors même qu’ils reconnaissent, contrairement à Dennett, que la
connaissance objective n’est pas équivalente à l’expérience phénoménale. Ainsi, le
neurologue Edelman [Edelman 2004] considère que les qualia résultent de ce qu’il
appelle une « transformation phénoménale » de l’activité neurale. L’expérience
phénoménale est occasionnée par l’activité neurale et elle est une propriété de cette
activité. L’efficacité causale appartient aux voies neurales. Mais il reconnaît que « nulle
expérience scientifique de ces voies et de leur activité ne peut donner naissance à un
quale spécifique dans l’esprit du lecteur » [Edelman 2004, 97]. Mais pourquoi la
transformation phénoménale n’est-elle pas accessible à l’observation scientifique ?
Pourquoi cette propriété des états neuraux n’est-elle pas donnée au neurologue comme
le sont les autres propriétés ? Il ne devrait pas s’agir d’une question secondaire pour un
neurologue qui prétend expliquer la conscience à partir des propriétés physico-
chimiques du cerveau.
21 La même critique peut être adressée à J. Proust. Elle remarque que nous pouvons savoir
beaucoup de choses des expériences sensorielles ressenties par des animaux différents
de nous. Ainsi,
Nous pouvons apprendre à quoi il est sensible et quelle différence dans le stimulus
provoque une différence de sensation. En bref on peut construire un espace pour
toute modalité perceptive de cet organisme. [Proust 1997, 337]
22 Mais elle reconnaît « que nous ne pouvons rien savoir de la sensation brute qui forme
l’expérience de l’animal du fait de nos différences de constitution » [Proust 1997, 337].
Or la différence de constitution est observable. Pourquoi donc son effet, c’est-à-dire
l’expérience phénoménale, ne l’est-elle pas ?
23 M. Jeannerod affirme, dans La Nature de l’esprit [Jeannerod 2002], qu’un état mental
possède un côté public et un côté privé, ce côté privé concerne le sujet dans sa
particularité, dans son histoire individuelle. Il pourrait s’agir d’un type de douleur ou
de chagrin que n’aurait jamais connu l’observateur extérieur. Mais le problème
demeure : si l’aspect privé de l’état mental est bien identique à la surface cérébrale
observable, pourquoi cet aspect privé n’est-il pas aussi accessible que son aspect public
lui aussi identique à un mécanisme cérébral ? Pourquoi l’observateur a-t-il besoin de
reconstruire cet aspect privé alors qu’il n’a pas besoin d’une telle reconstruction pour
l’aspect public ? Pour un physicaliste, le type d’être des deux aspects est semblable :
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
108
dans les deux cas, il s’agit de phénomènes neuraux offerts à une observation à la
troisième personne. Dira-t-on enfin que l’expérience phénoménale est une propriété
émergente à partir des propriétés neurales comme les propriétés de la molécule d’eau
émergent à partir des propriétés des atomes d’hydrogène et d’oxygène ? Mais c’est
oublier que les propriétés nouvelles de l’eau sont données à une observation extérieure.
Pourquoi donc l’expérience phénoménale, le quale, n’est-il pas observable par le
neurologue comme le sont les propriétés de l’eau ?
24 Chalmers, contrairement aux auteurs que nous venons de citer, prend au sérieux
l’expérience phénoménale. Selon lui, l’expérience phénoménale n’est pas une propriété
physique ni fonctionnelle car elle ne survient pas logiquement sur le physique
puisqu’on peut concevoir sans contradiction un monde dans lequel existerait un zombi,
identique à nous physiquement, qui ne vivrait pas d’expérience phénoménale.
Cependant, la conscience, dans notre monde, surviendrait naturellement sur le monde
physique à partir d’une propriété physique, fonctionnelle. Ainsi, dans notre monde, un
robot doté de l’état fonctionnel adéquat, d’un programme informatique, aurait accès
comme nous aux expériences phénoménales et serait donc conscient. La conscience
serait donc l’effet de l’organisation fonctionnelle de notre cerveau sans être pourtant
une propriété physique fonctionnelle comme le soutient Dennett. Mais Chalmers, tout
en insistant sur la réalité et l’irréductibilité de l’expérience phénoménale, lui refuse
pourtant tout rôle explicatif puisque tous nos comportements, y compris nos jugements
sur nos états de conscience, peuvent être expliqués fonctionnellement :
[...] quoi que puisse être la métaphysique de la causalité, il paraît assez clair que l’on
peut donner une explication physique du comportement qui ne fasse pas appel à la
conscience et n’implique pas davantage son existence. [Chalmers 2010, 257]
25 Certes, Chalmers fait la distinction entre l’absence de rôle explicatif et l’absence de rôle
causal, mais si le monde physique est causalement clos, il paraît difficile d’envisager un
rôle causal de la conscience, de l’expérience phénoménale. Il s’agit donc d’un
épiphénoménisme et d’un dualisme des propriétés. Les propriétés phénoménales sont
alors des propriétés étranges : ce sont des propriétés non physiques mais naturelles,
dépendantes cependant de propriétés physiques, sans pouvoir, semble-t-il, exercer
d’action en retour sur ces propriétés puisque le monde physique est causalement clos.
Ces propriétés émergent de propriétés physiques sans pouvoir être expliquées à partir
des lois de la physique. La théorie de la conscience qu’il envisage pourra seulement
énoncer des lois psychophysiques gouvernant les relations entre les expériences
phénoménales et « des états informationnels », c’est-à-dire des états fonctionnels. Il
envisage donc un fonctionnalisme non réductionniste. Mais il nous faut alors admettre
avec Chalmers qu’une propriété non physique, non observable à la troisième personne,
puisse être dépendante d’une propriété physique. L’évolution aurait donc engendré une
propriété naturelle mais ne servant à rien, puisqu’un zombi non conscient pourrait agir
exactement comme moi et prononcer les mêmes jugements. Le paradoxe le plus
important de cette position est que Chalmers tout en prenant au sérieux la conscience
phénoménale, l’expérience subjective, lui refuse pourtant un rôle explicatif. Or, selon
mon expérience phénoménale, c’est ma sensation de soif qui est à l’origine de mon
geste vers le verre d’eau, et mes actes, selon le point de vue à la première personne,
sont finalisés, justifiés par des raisons d’agir. Or si la causalité n’est que physique, tout
ce contenu phénoménal ne serait qu’illusion. En quelque sorte, Chalmers reconnaît la
certitude du cogito, de la pensée consciente radicalement distincte du corps, mais paraît
envisager la possibilité qu’elle ne joue aucun rôle causal dans l’existence.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
109
26 Chalmers envisage pourtant une forme de monisme proche de celui développé par
Ruyer. Puisque le même état informationnel, c’est-à-dire le même programme
informatique, peut être réalisé physiquement et phénoménalement, c’est-à-dire
puisque l’information a un double aspect, un aspect physique et un aspect phénoménal,
alors
Nous pourrions dire que les aspects internes de ces états sont phénoménaux et que
leurs aspects externes sont physiques : l’expérience est l’information vue de
l’intérieur ; la physique est l’information vue de l’extérieur. [Chalmers 2010, 420]
27 La théorie du double aspect, contrairement à la thèse du dualisme des propriétés
développée par Chalmers, permet d’éviter les difficultés que nous avons relevées ci-
dessus.
28 Le monisme non matérialiste de Ruyer nous semble donc plus cohérent et plus en
accord avec notre expérience phénoménale puisque, dans ce cas, l’état phénoménal
identique à l’état cérébral, joue bien un rôle causal en tant qu’état phénoménal.
29 Il nous faut donc affirmer avec Ruyer que la connaissance objective de l’état cérébral
n’équivaut pas à l’expérience subjective vécue par celui qui est dans cet état cérébral
alors même que l’expérience subjective, c’est-à-dire l’état mental et l’état cérébral ne
font qu’un. Il n’est pas nécessaire d’être dualiste pour reconnaître l’irréductibilité des
qualia, de l’expérience phénoménale subjective, à la connaissance à la troisième
personne. Le cerveau objet du neurologue, la pure substance étendue, n’est que
l’apparence que prend une subjectivité quand elle est perçue de l’extérieur.
L’esprit n’est qu’un nom donné à la différence entre une surface objet et une
surface réelle. [Ruyer 1937, 99]
30 La surface réelle, c’est la surface cérébrale, la forme cérébrale telle qu’elle est donnée à
elle-même par survol absolu.
31 Ce que Ruyer découvre donc en 1936 à propos du champ de perception sera généralisé à
l’ensemble de l’organisme, non seulement à tous les organismes, donc à l’ensemble du
vivant mais aussi à l’ensemble des constituants ultimes de la matière, c’est-à-dire au
domaine de la physique quantique. Ce qui fait d’un organisme un être, c’est-à-dire ce
qui fait de lui l’unité d’une multiplicité, c’est cette propriété de survol absolu. Il y a
identité pour Ruyer entre conscience, vie et être. Il n’y a d’être que là où il y a un être.
Dans mon champ de perception, tous les éléments de ce champ constituent un champ
de perception. Toutes les cellules de mon corps forment un corps, tous les atomes d’une
cellule forment une cellule, tous les constituants d’un atome forment un atome et ceci
par survol absolu des constituants. Les êtres sont des formes et une forme ne peut être
une forme qu’en étant une.
32 Ruyer opposera donc non pas le corps et la conscience mais les êtres individualités et
les agrégats qui ne sont pas des êtres au sens strict. Un tas de sable, une montagne sont
des agrégats. Ils n’ont pas d’unité, contrairement à un organisme qui est un organisme.
Ce qui manque à la montagne pour être, c’est le une. La physique classique n’étudiait
que des agrégats, des foules. Lorsqu’elle a étudié les constituants ultimes irréductibles à
des agrégats, elle a dû abandonner définitivement le déterminisme de la physique
classique. Le déterminisme n’est que d’ordre statistique. Le vivant n’est donc pas plus
réductible à un ensemble de fonctionnements de type déterministe que les trajectoires
d’une particule ne peuvent être décrites par une loi déterministe. On voit donc que la
notion de survol absolu permet à Ruyer de rendre compte non seulement du champ de
conscience mais aussi de l’activité, irréductible à un déterminisme, liée à tout champ de
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
110
conscience, à tout domaine absolu. La conscience n’est donc pas pour Ruyer un
épiphénomène sans causalité efficiente. Elle est au contraire la véritable causalité, la
causalité de type déterministe n’étant qu’une résultante statistique. L’activité finalisée
n’est pas plus réductible à un fonctionnement que les qualia ne sont réductibles à un
ensemble de réactions adaptatives. L’expérience phénoménale doit là aussi être prise
au sérieux.
3 Ruyer face à la solution grammaticale de
Wittgenstein
33 Mais invoquer l’expérience phénoménale, ce que Chalmers appelle « la qualité
subjective de l’expérience » [Chalmers 2010, 22] et admettre la distinction entre
l’apparence de l’état cérébral observé par le neurologue et ce même état tel qu’il est
donné à lui-même, n’est-ce pas tomber dans le mythe du monde intérieur dénoncé par
Bouveresse ? Critiquer le physicalisme en affirmant que cela fait quelque chose d’être
une chauve-souris, n’est-ce pas accorder une primauté au point de vue à la première
personne et considérer donc que ce point de vue est inaccessible à l’observation
d’autrui ? De plus, faire du cerveau l’organe de la conscience ou plutôt d’une certaine
forme de conscience, n’est-ce pas commettre une erreur grammaticale et faire des
propriétés intentionnelles d’un état de conscience des propriétés intrinsèques du
cerveau ? Cela revient à croire que la valeur fiduciaire du billet de banque est une
propriété intrinsèque de ce billet de banque. Dans ce cas, Ruyer tomberait dans la
même erreur que les neurologues croyant pouvoir expliquer la pensée à partir du
fonctionnement cérébral. Comment répondre à ces objections ?
34 Il faut reconnaître avec Wittgenstein que le contenu intentionnel d’un état mental est une
propriété extrinsèque de cet état et donc qu’aucune description de cet état en termes
d’états neuraux ne saurait nous faire découvrir le contenu intentionnel de cet état. Être
marié est une propriété extrinsèque et aucune observation neurologique ne nous
permettra de connaître l’état civil d’un homme. Mieux vaut consulter son livret de
famille ou se rendre à la mairie. Mais faut-il en conclure que la croyance que je suis
marié est, elle aussi, une propriété purement extrinsèque et qu’elle ne peut donc pas
être un état cérébral ? Wittgenstein nous dira que cette croyance n’est pas plus un état
mental qu’elle n’est un état cérébral : ce n’est pas un état, c’est une capacité, celle de
répondre à une question concernant mon état civil.
35 Mais considérons alors le moment du mariage, c’est-à-dire le moment où je change de
statut et où j’acquiers la propriété extrinsèque d’être marié. Ne faut-il pas comparer ce
qui se passe au moment de cette cérémonie à ce qui se passe chez le neurologue qui a
pour la première fois la sensation de rouge ? Cette nouvelle expérience phénoménale
n’est-elle pas une propriété intrinsèque d’un état cérébral ? Cela fait quelque chose
d’avoir une sensation de rouge de même que cela fait quelque chose de se marier ou de
devenir père ou champion olympique. C’est le « cela fait quelque chose » qui nous
semble constituer une propriété intrinsèque d’un état de conscience. Comme le dit
Chalmers :
Le contenu d’une croyance phénoménale est constitué par la phénoménologie elle-
même. [Chalmers 2010, 295]
36 Mais évidemment, et sur ce point Wittgenstein a raison, cette expérience subjective
vécue à la première personne ne saurait être décrite en termes neurologiques et ne
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
111
pourrait être assimilée à un état cérébral si le cerveau était réductible à ce que nous en
dit le neurologue, c’est-à-dire au cerveau observé par le neurologue. Pour que cela fasse
quelque chose d’être dans cet état cérébral ou plutôt d’être cet état cérébral, il faut que
cet état possède cette propriété de survol absolu, qu’il soit une surface absolue. Par
conséquent, lorsque Wittgenstein refuse d’admettre qu’une pensée puisse être un état
cérébral, c’est qu’il partage le même présupposé que le neurologue ou que le
réductionniste, c’est-à-dire que le cerveau et, au-delà du cerveau, l’être vivant tout
entier, est cet objet ne possédant que les propriétés que lui attribuent les sciences de la
nature.
37 Mais reconnaître la réalité de l’expérience phénoménale, n’est-ce pas admettre, pour
reprendre la comparaison de Wittgenstein [Wittgenstein 2004], qu’il y a un scarabée
dans la boîte, et donc admettre l’existence d’un monde intérieur cartésien accessible
uniquement par une observation à la première personne ? Ce serait donc affirmer
l’existence d’un monde intérieur.
38 Le point essentiel de l’argumentation de Wittgenstein contre la thèse du monde
intérieur, consiste à montrer qu’il n’y a pas d’observation des états de conscience par
un sujet qui observerait ses états intérieurs comme il observe les objets du monde
physique. La conscience de soi ne consiste donc pas en une introspection d’états
inaccessibles à une observation à la troisième personne. Être en colère ou ressentir du
chagrin ne consiste certes pas à s’observer comme j’observe autrui. Lorsque X dit qu’il a
mal, cet énoncé n’est pas un simple énoncé d’observation d’un état de conscience. Il
s’agit bien plutôt d’une expression de ce qu’il ressent. Mais ceci ne permet pas de
remettre en cause l’existence de l’expérience phénoménale exprimée par cet énoncé ou
par un cri. On peut donc accorder à Wittgenstein que la conscience de soi ne consiste
pas en une observation d’états intérieurs par un sujet cartésien, analogue donc à une
observation à la troisième personne. C’est justement ce que veut dire Ruyer quand il
parle de survol absolu, de survol sans distance. L’observation à la troisième personne
suppose une distance réelle entre l’observateur et l’objet observé. Par contre, dans le
cas d’une sensation ou de n’importe quelle pensée consciente, il y a survol sans distance
parce que le champ cérébral est un domaine absolu. C’est ce survol absolu qui définit la
conscience et qui fait d’un être un être, et d’une forme une forme.
39 D’ailleurs, cette impossibilité d’observer mon propre état de conscience, mon
expérience phénoménale, comme j’observe le comportement d’autrui n’est pas propre
à mes états mentaux. Ce sont mes propres comportements que je ne peux observer
comme j’observe les comportements d’autrui. Quand je manifeste de la colère, j’en suis
conscient mais je ne suis pas en train d’observer mon comportement de colère.
Pourquoi ? Parce que la conscience de mon comportement suppose un survol sans
distance.
40 Le deuxième présupposé commun aux tenants de la critique du monde intérieur et aux
matérialistes réductionnistes, est qu’ils accordent un privilège à l’observation à la
troisième personne, comme si l’observation à la troisième personne allait de soi,
comme s’il n’y avait pas besoin d’en rendre compte et qu’elle ne constituait pas un
problème. Il nous semble au contraire que l’observation à la troisième personne
présuppose ce que Ruyer appelle le survol sans distance. Si on réduit l’observation à la
troisième personne à un processus analysable scientifiquement et assimilable à ce qui
se passe dans une caméra et, dans ce cas, l’expression « point de vue à la troisième
personne » n’a plus guère de sens. Et dans ce cas, tout phénomène au cours duquel un
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
112
rayon lumineux part d’un objet et rencontre un deuxième objet, pourrait à la rigueur
être considéré comme une observation à la troisième personne. Mais une observation à
la troisième personne est elle-même une expérience subjective à la première personne
dont le contenu est le comportement d’autrui. Il n’y a pas d’observation à la troisième
personne sans expérience phénoménale, subjective, à la première personne. Si l’on
refuse tout autant le réductionnisme que le recours à un sujet cartésien, il semble alors
que l’observation à la troisième personne présuppose, comme nous l’avons vu, ce que
Ruyer appelle un survol sans distance : lorsque j’observe le comportement d’autrui,
mon champ de conscience (ici mon champ de perception) doit être conçu comme un
domaine absolu doté de la propriété d’auto-survol sans distance. Ce n’est que parce que
j’ai bien, en ce sens, un accès privilégié à mon champ de perception, que j’ai accès au
comportement d’autrui. L’observation à la troisième personne ne doit donc pas être
considérée comme une donnée claire ni comme le moyen de sous-estimer le point de
vue à la première personne. Si je ne peux douter de ce que me présente ce survol absolu
de mes états de conscience, ce n’est pas pour une question de grammaire mais pour une
question d’ontologie.
41 On peut donc refuser l’existence d’un œil de l’esprit, d’un pur sujet cartésien, sans
réduire l’expérience phénoménale à l’état cérébral connu par le neurologue et sans
concéder à Wittgenstein que l’abîme entre le cerveau et la pensée ne résulte que d’une
erreur grammaticale, ni que l’intériorité ne soit qu’un mythe dont il faudrait nous
débarrasser par une analyse du langage. La distinction entre le langage des causes et le
langage des raisons trouve son explication et sa source dans la distinction faite par
Ruyer entre le cerveau objet du neurologue et le cerveau surface absolue, doté de cette
propriété de survol absolu qui est la marque de l’être individualité. L’intériorité ne
semble donc pas être un mythe et il semble donc bien y avoir un scarabée dans la boîte,
et d’ailleurs, s’il n’y en avait pas, comprendrions-nous ce à quoi fait référence
Wittgenstein quand il emploie cette comparaison ? Le scarabée dans la boîte, c’est
l’expérience phénoménale vécue nécessairement à la première personne, le « ce que
cela fait » d’avoir une sensation de rouge ; ou de douleur. Certes, comme le dit
Chalmers, « nous ne disposons d’aucun langage indépendant pour parler des qualités
phénoménales » [Chalmers 2010, 46]. Pourtant, « le problème de la conscience ne
saurait s’évanouir pour des raisons linguistiques » [Chalmers 2010, 47]. On doit même
reconnaître que l’expérience phénoménale ne peut non seulement pas être décrite en
tant que telle, mais qu’elle ne peut même pas être montrée. Or, comme Wittgenstein l’a
montré, il en va de même de l’existence du monde. Je ne peux ni décrire le fait de
l’existence du monde, ni montrer que le monde existe. L’énoncé « le monde existe » est
selon le Wittgenstein du Tractatus sinnlos, sans être unsinnig [Wittgenstein 1961].
Cependant, personne ne remet pourtant en question l’existence du monde (sauf le
professeur de philosophie pendant les quelques heures qu’il consacre à l’explication de
la première méditation cartésienne). Certes, la certitude de l’existence de l’expérience
phénoménologique, comme celle de l’existence du monde, ne relève pas d’un savoir
puisqu’il n’y a de savoir que là où le doute est possible. Toutefois cette certitude ne
nous semble pas être une question de grammaire, pas plus que l’asymétrie de l’emploi
des verbes psychologiques employés à la première personne. Il s’agit plutôt d’une
question d’ontologie : si je ne peux douter d’être en colère ou de souffrir, c’est
justement parce que mon état de conscience, comme tout état de conscience, m’est
donné par survol absolu et non par un sujet qui serait distinct de ce qu’il observe. Le
problème de la conscience nous semble donc être celui de l’irréductibilité de
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
113
l’expérience subjective à la première personne et la solution de ce problème nécessite
de remettre en cause tout autant les tentatives de le faire disparaître par une solution
grammaticale que par l’éliminativisme matérialiste sous ses différentes formes. Le
monisme non matérialiste de Ruyer permet d’abandonner le dualisme cartésien, qui
avait le mérite de prendre au sérieux le problème de la conscience, sans chercher à
faire disparaître le problème (en identifiant la conscience à ce qu’elle n’est pas ou en le
réduisant à une illusion grammaticale).
BIBLIOGRAPHIE
CHALMERS, David [2010], L’Esprit conscient, Paris : Les Éditions d’Ithaque, 1996.
DENNETT, Daniel [1993], La Conscience expliquée, Paris : Odile Jacob.
DENNETT, Daniel [1998], La Diversité des esprits, Paris : Hachette.
EDELMAN, Gerald M. [2004], Plus vaste que le ciel, Paris : Odile Jacob.
JEANNEROD, Marc [2002], La Nature de l’esprit, Paris : Odile Jacob.
PROUST, Joëlle [1997], Comment l’esprit vient aux bêtes, Paris : Gallimard.
RUYER, Raymond [1930], Esquisse d’une philosophie de la structure, Paris : Félix Alcan.
RUYER, Raymond [1937], La Conscience et le Corps, Paris : Félix Alcan.
RYLE, Gilbert [1949], La Notion d’esprit, Paris : Payot, 2005.
WITTGENSTEIN, Ludwig [1961], Tractatus, Paris : Gallimard.
WITTGENSTEIN, Ludwig [2004], Recherches philosophiques, Paris : Gallimard, 1re édition 1953.
RÉSUMÉS
La critique du dualisme cartésien, c’est-à-dire du mythe de l’intériorité, a été menée à partir de
deux positions philosophiques. La première cherche à réduire l’état mental à l’état neuronal
défini par ses propriétés neurologiques et l’autre, celle de Wittgenstein, tente de faire disparaître
le mystère des relations entre la pensée et le cerveau par une critique grammaticale du langage.
La notion de survol absolu, notion centrale de la philosophie de Ruyer, permet de développer une
conception non matérialiste de l’identité entre état cérébral et état mental. De plus, cette
conception montre que l’intériorité de l’état mental ne saurait être réduite à une erreur de
catégorie. Mais cette thèse de l’identité de la conscience et du corps nécessite de développer une
perspective radicalement nouvelle permettant de concevoir une conscience « étendue ».
The critique of Cartesian dualism, that is to say the myth of interiority, was carried out from two
philosophical positions. The first sought to reduce the mental state to the neuronal state defined
by its neurological properties, while the other, Wittgenstein’s, attempted to eliminate the
mystery of the relations between thought and brain. For this, there was a grammatical criticism
of language. The notion of absolute overflight, a central notion of Ruyer’s philosophy, makes it
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
114
possible to develop a non-materialistic concept of the identity between the cerebral and the
mental states. Moreover, this conception shows that the interiority of the mental state cannot be
reduced to a category-mistake [Ryle 1949]. This thesis of the identity of consciousness and the
body requires a radically new perspective to be developed to conceive an “extended”
consciousness.
AUTEUR
JEAN-PIERRE LOUIS
Nancy (France)
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
115
Varia
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
116
Deux textes politiques de Jules
Vuillemin
Two Political Texts by Jules Vuillemin
Baptiste Mélès, Julien Borgeon et Raphaël Derobe
1 Les deux textes que nous présentons ici, « Effets moraux de l’accélération de l’histoire»
et « Sommes-nous libres?», sont issus du fonds Jules-Vuillemin, conservé au
Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie – Archives Henri-Poincaré
(UMR 71171). Datant respectivement des années 1969-1970 et 1989-1990, ils montrent
du célèbre historien de la philosophie et philosophe des sciences un visage peu connu :
celui d’un observateur engagé de son époque.
1 « Effets moraux de l’accélération de l’histoire»
2 Le premier manuscrit, « Effets moraux de l’accélération de l’histoire» (cote 0.6), est
archivé dans la boîte 0 du fonds Jules-Vuillemin. Cette boîte, dont a déjà été extrait
en 2015 le texte « Un Français peut-il encore comprendre les philosophes d’outre-
Manche?» [Vuillemin 2015], [Mélès 2015], contient des documents antérieurs à un
classement numéroté datant environ de 1980.
3 La chemise 6 de la boîte 0 contient un seul manuscrit, dactylographié sur papier
carbone, de 16 pages numérotées. Ce texte propose de voir quatre caractéristiques du
rapport moderne entre l’homme et son milieu technique – la perte de l’autonomie, de
l’esprit critique, du jugement et des règles – comme la cause de mouvements sociaux et
politiques contre lesquels Vuillemin invoque l’impératif moral de liberté et
l’importance d’une réciprocité entre droits et devoirs.
4 Il s’agit manifestement d’une version définitive du texte. Pendant ses années
d’enseignement au Collège de France, Vuillemin avait coutume de rédiger d’abord une
ou plusieurs versions manuscrites, qu’il faisait ensuite taper à la machine par les
secrétaires du Collège de France avant d’en corriger manuellement les versions
successives. La version que nous possédons ne contient aucune correction sinon de
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
117
légères retouches, presque invisibles, à la pâte blanche et à la machine à écrire, signe
que le texte avait déjà traversé toutes les étapes préparatoires.
5 Nous disposons de peu d’indices pour dater le texte. Jules Vuillemin y cite un ouvrage
publié en 1965, évoque au détour d’une phrase la réforme de l’enseignement des
mathématiques initiée en France en 1967, condamne le mouvement de mai 1968 et fait
référence à l’alunissage d’Apollo 11 en juillet 1969. L’objet et le ton sont proches de
l’ouvrage Rebâtir l’Université, publié au lendemain de mai 1968 2. Les cibles également : la
société de l’information, mai 1968, le sociologisme, la pédagogie moderne. On peut
supposer que le texte date environ de la même période, soit fin 1969 ou 1970.
6 La destination de ce texte est incertaine. À notre connaissance, et d’après la
bibliographie établie par Catherine Fabre avec une rigueur que nous n’avons encore
jamais vu prendre en défaut, ce texte n’a jamais fait l’objet d’une publication. Il
pourrait donc s’agir soit d’un projet d’article abandonné soit d’un texte de conférence.
Nous inclinons pour la seconde hypothèse car le document est, dans la boîte 0, entouré
de textes de la même période expressément destinés à des conférences 3. D’après
l’annuaire du Collège de France, Vuillemin a prononcé en 1968-1969 des conférences
dans les universités de Rennes, Nice, Aix-en-Provence et Tunis, ainsi que devant
l’Association franc-comtoise de culture à Besançon. Étant donné le ton peu
universitaire du propos, cette dernière hypothèse nous paraît plausible : en l’absence
d’informations supplémentaires, nous en sommes réduits à des conjectures de cette
faiblesse.
2 « Sommes-nous libres?»
7 Le second texte, intitulé « Sommes-nous libres?», est conservé sous la cote 19.1. Jules
Vuillemin y critique le recours à l’expertise psychologique en matière judiciaire comme
un moyen de déresponsabilisation : à la suite de Kant, il renvoie la notion de
responsabilité, comme celle de liberté, au seul domaine de la morale.
8 La chemise 1 de la boîte 19 contient deux versions du texte : l’une, de 22 pages, est la
photocopie en noir et blanc d’une version dactylographiée et annotée au stylo, l’autre
est un manuscrit de 24 pages. Rien ne semble avoir précédé la version manuscrite, si
l’on en croit le nombre important de corrections et de ratures. Comme ces corrections
engendrent exactement le texte de la version dactylographiée, il ne semble manquer
aucune version intermédiaire. La version dactylographiée ne contient enfin que des
corrections rares et triviales ; il s’agit donc probablement d’une version définitive.
9 La version manuscrite a été rédigée au stylo noir (avec corrections en noir), puis au
stylo bleu (avec corrections en noir) lorsque le premier a montré des signes de fatigue,
enfin derechef au stylo noir (avec corrections en bleu). Les changements de stylo
permettent d’établir une chronologie relative des modifications du manuscrit.
10 Une main étrangère a noté sur la première page du texte dactylographié (avant
photocopie) une estimation de sa date : « après février 1989 / 1989-1990». Tous les
indices semblent confirmer cette hypothèse : non seulement la date des autres textes
de la boîte 194, mais aussi celle des brouillons divers au verso desquels a été rédigée la
version manuscrite. On y trouve en effet une feuille extraite d’une version
dactylographiée de l’article « Sur la dualité» [Vuillemin 1987], une autre extraite d’un
brouillon dactylographié non définitif d’un texte classé sous la cote 19.3 (« Les origines
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
118
et le développement du rationalisme grec») et des documents destinés au comité de
recrutement sur un poste de professeur ordinaire de philosophie à la faculté des lettres
de Genève. Ces derniers, précieux pour la datation de notre texte, comprennent les
titres et travaux des candidats ainsi que des courriers divers, dont le plus tardif est un
courrier du 8 février 1989. Une partie du texte est également écrite au dos d’une carte
de correspondance datée du 2 mai 1989. Le texte est donc postérieur à cette date.
11 Cette datation est d’ailleurs cohérente avec le contenu du texte : à l’occasion de la
question au premier abord purement métaphysique « Sommes-nous libres?», Vuillemin
fustige la réforme du Code pénal initiée par le président du Conseil constitutionnel,
Robert Badinter, en 1989. Cette réforme, promulguée en juillet 1992 et entrée en
vigueur le 1er mars 1994, a notamment transformé l’ancien article 64, « Il n’y a ni crime
ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a
été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister», par l’article 122.1, qui
introduit la notion de responsabilité :
N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des
faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes5.
3 Conclusion
12 Si Vuillemin traitait abondamment de politique à l’époque des Temps modernes 6, il
s’exposa moins volontiers dans les décennies suivantes [Vuillemin 1965, 100-103]. C’est
bien souvent par allusions qu’il dénonce mai 1968 [Vuillemin 1968, section III],
[Vuillemin 1982] et le « socialisme» – celui des pays communistes comme celui de
François Mitterrand –, dont il condamne l’idéologie7, la recherche du bonheur par
l’appropriation collective des moyens de production8, la barbarie des moyens9,
l’organisation de la santé publique10, l’illusion de justice [Vuillemin 1991, 162], et, dans
un texte non publié, la politique économique11.
13 Les deux textes que nous présentons aujourd’hui au public ne permettent pas
seulement d’éclaircir les positions politiques que laissent déjà deviner les allusions
disséminées dans l’œuvre publiée : ils montrent surtout que la politique n’est pas à ses
yeux simple affaire d’« opinion» et que l’engagement, loin d’y être une vertu, n’a de
valeur que soutenu par l’argumentation.
14 Perce alors, sous le visage méconnu de Vuillemin en observateur critique de la politique
de son temps, le visage autrement plus familier d’un philosophe soucieux de rigueur
argumentative et conscient de ses postulats.
BIBLIOGRAPHIE
GUIGNARD, Laurence [2016], La genèse de l’article 64 du code pénal, Criminocorpus, URL http ://
criminocorpus.revues.org/3215.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
119
MÉLÈS, Baptiste [2015], Un Français peut-il encore comprendre les philosophes d’outre-Manche ?
Présentation, Études philosophiques, 153(1), 9–15.
VUILLEMIN, Jules [1950a], Les classes sociales chez Schumpeter et dans la réalité, Économie
appliquée, 3(3–4), 571–614.
VUILLEMIN, Jules [1950b], Note sur Expérience de vérité ou Autobiographie de Gandhi, Les Temps
modernes, 56, 2259–2268.
VUILLEMIN, Jules [1950c], Nouvelles traductions de Marx. Recension de la Correspondance Fr. Engels–
K. Marx et divers, publié par F. A. Sorge, Les Temps modernes, 59, 548–563.
VUILLEMIN, Jules [1951], Un texte de Max Weber : La notion de classe. Introduction et traduction,
L’Information philosophique, 1(5), 186–189.
VUILLEMIN, Jules [1952a], La psychologie industrielle au niveau du Capital de Marx, Cours de l’année
universitaire 1951–1952 (Psychologie de la vie sociale), Université de Clermont-Ferrand, 1–14.
VUILLEMIN, Jules [1952b], Les syndicats ouvriers et les salaires, Économie appliquée, 5(2–3), 261–336.
VUILLEMIN, Jules [1952c], Signification pour la psychologie de la notion de valeur, Cours de l’année
universitaire 1951–1952 (Psychologie générale), Université de Clermont-Ferrand, 1–21.
VUILLEMIN, Jules [1954], Économie européenne ou économie mondiale. Recension de François
Perroux, L’Europe sans rivages, Paris, 1954, Les Temps modernes, 106, 398–441.
VUILLEMIN, Jules [1962], La Philosophie de l’algèbre. I. Recherches sur quelques concepts et méthodes de
l’Algèbre moderne, Épiméthée, Paris : Presses Universitaires de France.
VUILLEMIN, Jules [1965], Le Miroir de Venise, Paris : Julliard.
VUILLEMIN, Jules [1968], Rebâtir l’Université, Le Monde sans frontières, Paris : Fayard.
VUILLEMIN, Jules [1979], Ideologia, dans Enciclopedia, Turin : Einaudi, t. VI, 1144–1164.
VUILLEMIN, Jules [1980], Proposizione e giudizio, dans Enciclopedia, Turin : Einaudi, t. XI, 332–366.
VUILLEMIN, Jules [1981], Les lois de la raison pure et la supposition de leur détermination
complète, dans 200 Jahre Kritik der reinen Vernunft, édité par J. Kopper & W. Marx, Hildesheim :
Gerstenberg, 363–384.
VUILLEMIN, Jules [1982], Portrait d’un historien de la philosophie : Victor Goldschmidt, dans Victor
Goldschmidt (1914–1981). Journée d’hommage du 17 janvier 1982, Amiens : Université de Picardie.
VUILLEMIN, Jules [1984], Nécessité ou contingence. L’aporie de Diodore et les systèmes philosophiques, Le
Sens commun, Paris : Minuit.
VUILLEMIN, Jules [1987], Sur la dualité, Manuscrito, 10(2), 9–13, Campinas–São Paulo, Brésil.
VUILLEMIN, Jules [1991], Éléments de poétique, Essais d’art et de philosophie, Paris : Vrin.
VUILLEMIN, Jules [2015], Un Français peut-il encore comprendre les philosophes d’outre-Manche ?,
Études philosophiques, 153(1), 17–31.
VUILLEMIN-DIEM, Gudrun [2010], La création des Archives Jules-Vuillemin. Remerciements à
Gerhard Heinzmann, dans Construction. Festschrift for Gerhard Heinzmann, édité par P.-É. Bour,
M. Rebuschi & L. Rollet, Londres : College Publication, 683–687.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
120
NOTES
1. Nous remercions vivement les ayants droit, Gudrun Vuillemin-Diem, Françoise Létoublon et
Jean Vuillemin, respectivement épouse et enfants du philosophe, d’avoir accepté la publication
de ces textes. Gudrun Vuillemin-Diem a livré un récit détaillé de la création du fonds Jules-
Vuillemin [Vuillemin-Diem 2010]. Le site des Archives Jules-Vuillemin se trouve à l’adresse
http://poincare.univ-lorraine.fr/fr/archives-jules-vuillemin. À la demande des ayants droit, le
fonds d’archives est accessible à tout chercheur se rendant au Laboratoire d’Histoire des Sciences
et de Philosophie – Archives Henri-Poincaré (Nancy) en justifiant de son intérêt. Les deux textes
présentés ici ont été étudiés par Julien Borgeon et Raphaël Derobe dans le cadre d’un stage
d’initiation à la recherche encadré par Baptiste Mélès et destiné aux étudiants de licence 3 du
département de philosophie de l’Université de Lorraine. Ayant choisi un texte dans le catalogue
du fonds établi par Gudrun Vuillemin-Diem, les stagiaires en rédigent un commentaire
archivistique et philosophique : liste, ordre et dates des différentes versions, structure
argumentative, éclaircissement des références, mise en perspective dans l’œuvre de Vuillemin,
etc.
2. On comparera notamment le présent texte avec [Vuillemin 1968, 13, 55, 55-59].
3. On trouve ainsi la conférence anglaise de 1966-1967 « Un Français peut-il encore comprendre
les philosophes d’outre-Manche?» (cote 0.4), une conférence prononcée à Gand et Louvain
en 1967-1968 et intitulée « La signification du positivisme et ses limites» (cote 0.5), une
conférence sur Voltaire à l’université et la Société de philosophie de Genève en 1967-1968
(cote 0.7), une conférence de présentation personnelle à l’université de Bologne en octobre 1973
(cote 0.8) et une conférence à Cortona d’avril 1980 intitulée “Why should we increase the part of
history of science and history of philosophy in philosophical education?” (cote 0.9). Les textes
réunis sous les cotes 0.1 à 0.3 sont, quant à eux, antérieurs : une recension du livre de Max
Jammer Concepts of Force pour les Annales d’astrophysique en 1959 (manuscrit 0.1), une note sur le
manuscrit posthume d’Henri Dussort, L’École de Marbourg, que Vuillemin édite en 1963
(manuscrit 0.2) et un texte intitulé « L’ONU et l’esprit des lois» qui semble dater de 1952
(cote 0.3).
4. La boîte 19 contient en effet un texte intitulé « Jugement de goût et raison», dont le manuscrit
est écrit au verso de documents datés de mai-juin 1989 (cote 19.2), un autre intitulé « Objets de
l’histoire et vérité» prononcé à la maison Descartes à Amsterdam en février 1990 (cote 19.4), un
texte intitulé « Spéculation, analyse, critique» (cote 19.5), et un projet de recueil d’études intitulé
Rationalisme et mathématiques platoniciens (cote 19.3). Tous ces textes datent des années 1989-1990.
5. Voir [Guignard 2016]. Selon le témoignage de Joseph Vidal-Rosset aux auteurs de ces lignes
(mars 2017), Vuillemin désapprouvait également l’action de Robert Badinter comme garde des
Sceaux.
6. Voir notamment [Vuillemin 1950a,bc, Vuillemin 1951, Vuillemin 1952a,b,c, Vuillemin 1954].
Tous ces textes peuvent être consultés dans la bibliothèque de travail de Jules Vuillemin au
Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie – Archives Henri-Poincaré (Nancy).
7. [Vuillemin 1979, section III]. Voir la version française originale sous la cote 2.2 du fonds Jules-
Vuillemin.
8. [Vuillemin 1980, section I]. Voir la version française originale sous la cote 3.3 du fonds Jules-
Vuillemin, p. 8.
9. [Vuillemin 1981, 371] (réédité dans L’Intuitionnisme kantien en 1994) : par opposition à la loi
morale, « le socialisme […] ne spécifie pas les moyens, qui peuvent aller du conditionnement à la
torture». Déjà, dans La Philosophie de l’algèbre, Vuillemin critiquait Auguste Comte et sa postérité :
« Forcé d’assigner de l’extérieur ses limites à l’intelligence, il les emprunte au principe moral de
l’utilité publique, ouvrant ainsi la voie aux philosophies engagées et aux fanatismes» [Vuillemin
1962, 218, n; 1].
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
121
10. [Vuillemin, 347] : le malade choisit son médecin, « du moins quand l’organisation socialiste ne
lui retire pas ce souci».
11. Jules Vuillemin, « Une année d’économie socialiste (mai 81-mai 82) ; essai sur l’imputabilité
en histoire», cote 6a.1 du fonds Jules-Vuillemin. L’auteur y examine, statistiques à l’appui, « les
conséquences de la politique économique socialiste durant la première année de l’exercice du
pouvoir».
RÉSUMÉS
Dans les textes inédits « Effets moraux de l’accélération de l’histoire» (1969-1970) et « Sommes-
nous libres?» (1989-1990), Jules Vuillemin montre un visage peu connu : celui d’un observateur
engagé de son époque. Il y critique des mouvements sociaux et politiques contemporains –
mai 1968 et la réforme du Code pénal de 1989 – en s’appuyant sur des considérations
métaphysiques et morales. Plus que des tribunes politiques, ces textes montrent que la politique
n’est pas, pour Vuillemin, simple affaire d’« opinion» et que l’engagement n’a de valeur que
soutenu par l’argumentation.
In his unpublished texts “Moral effects of the acceleration of history” (1969-1970) and “Are we
free?” (1989-1990), Jules Vuillemin shows himself as an engaged observer of his time. He
criticizes some contemporary social and political actions—May 1968 and the 1989 reform of the
French penal code—on metaphysical and moral grounds. These texts show that engagement and
politics, for Jules Vuillemin, do not take place in opinion columns but in argumentation.
AUTEURS
BAPTISTE MÉLÈS
Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie, Archives Henri-Poincaré, Université de
Lorraine, CNRS, Nancy (France)
JULIEN BORGEON
Université de Lorraine, Nancy (France)
RAPHAËL DEROBE
Université de Lorraine, Nancy (France)
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
122
Effets moraux de l’accélération de
l’histoire
The Moral Effects of the Acceleration of History
Jules Vuillemin
1 [1] Les paléontologues constatent que, mesuré en genres, le taux d’évolution de nos
ancêtres1 et collatéraux directs a été exceptionnellement rapide. En 160 millions
d’années, on compte seulement huit genres d’ammonites. Il faut encore 60 millions
d’années pour huit genres de chevaux, mais il n’en faut plus que 12 millions pour
quatre genres d’hominoïdes et un seul, le dernier, pour trois genres d’hominidés 2i. Pour
expliquer une telle accélération, on suppose que la sélection a dû agir sur un nouveau
type d’environnement : l’environnement culturel. Naturellement, quand on fait le
tableau de l’histoire humaine, cette supposition, qui lui est empruntée, prend la
consistance d’un fait. Passez en revue, par exemple, depuis l’apparition du langage
parlé, les moyens de communication nouveaux : écriture sur pierre et manuscrits,
imprimerie, journaux, téléphone, télégraphie sans fil, radio, télévision, télévision en
couleur. Les inventions se pressent avec le temps. Surtout, l’accélération même de
l’histoire nous est comme rendue sensible, et ceci suppose, étant donné que nous ne
prenons probablement conscience que des variations dans le taux de changement, que
les choses vont assez vite, à présent, pour permettre à chaque individu au cours de sa
vie de comparer plusieurs impressions successives d’accélération, et de sentir, lorsqu’il
les rapporte à une unité de durée aussi courte qu’une décennie, un accroissement
vertigineux dans le nombre et l’importance des innovations qu’il accueille ou qu’il
subit.
2 Je me propose d’examiner ici quelques effets moraux de cette situation.
I
3 De cette situation, je ne retiendrai qu’un unique aspect. Non que je prétende diminuer
la part des bouleversements sociaux, politiques, nationaux et religieux des [2] deux
dernières guerres dans l’image que nous nous faisons du monde. Mais, emportés eux
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
123
aussi dans le tourbillon, nos malheurs perdent chaque jour de leur intérêt. Les
historiens futurs, il le faut bien, mentionneront3 charniers et massacres. D’autres
événements, en revanche, les arrêteront : le « V2 », ancêtre des vaisseaux de l’espace 4,
et le canon automatique anti-aérien, machine-modèle à mesurer l’information et à
prédire l’avenir. D’avance, imitons leur choix. Bien que collectifs, régimes, nations et
religions ont une tendance à la désuétude, qui les apparente à nos passions
individuelles. Parmi les causes du changement, bornons-nous aux plus stables, à celles
qui sont cumulatives et universelles. Bornons-nous, par conséquent, aux relations
techniques de l’homme à son milieu.
4 Quatre traits principaux paraissent caractériser ces relations aujourd’hui.
5 Il y a un million d’années, les Australopithèques inventaient de coupler l’organisme et
le milieu par le moyen d’instruments rudimentaires, de simples silex, dont nos
techniques proprement humaines représentent le développement lointain. L’esprit de
cette invention, que nous ne cessons d’exploiter et de perfectionner, consiste à
prolonger l’évolution naturelle. L’être vivant ne se conserverait pas un instant si de
nombreux mécanismes homéostatiques n’agissaient de concert pour assurer à son
milieu intérieur une stabilité relative par rapport aux variations du milieu extérieur.
L’homme se distingue sans doute des autres animaux5 en ce que les pressions de
sélection l’ont contraint d’interposer entre son organisme et l’univers un milieu
artificiel de plus en plus épais, en sorte qu’en toute rigueur, lorsqu’on parle du milieu
intérieur et des régimes homéostatiques de l’homme, ce n’est pas son corps seul, mais
le couplage de son corps et de la technique qu’il faut considérer. La langue 6, le
vêtement, la maison, le chauffage, le conditionnement ne sont pas sans retentir sur
l’équilibre et la sensibilité thermiques de l’individu.
6 Nous oublions trop aisément à quel degré d’intensité notre civilisation a porté ce
couplage. Lui seul permet de vaincre les fléaux ancestraux7 : la faim et les épidémies.
Mais s’il nous protège contre les accidents de la météorologie et des contagions, c’est en
nous asservissant aux prescriptions de la chimie et de l’hygiène. Et ceux-là même [3]
qui contestent en parole l’économie d’abondance et de bien-être reculeraient d’horreur
s’il leur fallait affronter la vie précaire à laquelle nous réduiraient leurs prédications
inconséquentes. Ce n’est pas tout. Car, au service de la production de masse, qui engage
l’homme dans un couplage technique irréversible, l’automatisme change la nature de
ce couplage. Il s’agit non plus seulement de substituer les énergies physiques à la force
brute de l’ouvrier, mais d’éliminer désormais toutes les tâches subalternes, qu’elles
soient d’ordre physique ou intellectuel, qu’elles relèvent de la répétition d’un acte ou
de la surveillance d’une opération. Un frigidaire, un four de cuisine, une machine à
laver illustrent le principe de ces nouvelles machines : à toute prestation fournie sous
forme d’énergie dépensée correspond une contre-réaction sous forme d’information
relatant l’effet de cette prestation – par exemple l’indication d’une variation de
température dans le milieu ambiant – et cette contre-réaction, à son tour, en
commandant l’alimentation énergétique, règle la nouvelle prestation. Ces machines,
qu’on tiendra pour des simulateurs grossiers, mais acceptables 8, des activités
organiques, et dont les formes les plus complexes, les calculatrices électroniques,
simulent même l’activité cérébrale, ont en propre d’être homéostatiques. À la limite,
une fois programmées et mises en marche, les usines automatiques fonctionnent toutes
seules et prennent en charge la dépense musculaire et nerveuse, que l’ouvrier doit
payer pour prix de son couplage avec les machines classiques. Bref, un automate
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
124
moderne fait fonction d’esclave en épargnant toutefois à son maître la crainte et la
mauvaise conscience. Tel est le premier trait caractéristique de la technique
contemporaine.
7 Il en entraîne un second, plus inquiétant. Le complexe de l’homme avec la production
de masse et l’automatisme ne se soutient en effet, comme la marche, que par une suite
de déséquilibres continuellement compensés. Les cybernéticiens diront que nous voici
aux prises avec un système à contre-réaction positive. En d’autres termes, le système
réagit aux états de stabilité et tend à s’emballer vers une position extrême et à s’y tenir.
La protection de la nature nous donne un exemple de cet état de choses. Nous nous
apercevons tout à coup – est-ce en toute bonne foi ? – que, dans le bilan de [4] notre
couplage technique, nous avions oublié de comptabiliser cette forme condensée de
désordre et d’entropie9 que l’homme produit lorsqu’il se rend « maître et possesseur de
la nature », la pollution. Compte tenu10 des pouvoirs privés et de notre propre inertie,
j’ignore ce que les pouvoirs publics peuvent faire et feront. Au mieux, ils élargiront la
définition de couplage technique et compteront parmi les termes de l’homéostasie non
seulement l’organisme, la production de masse et l’automatisme, mais aussi une
poubelle géante où entreraient, des poissons crevés aux cimetières d’auto et des bruits
des moteurs aux agressions publicitaires, tout ce qui à la ville et aux champs blesse les
sens et la raison. L’estimation, n’en doutons pas, sera de taille. Une chose ne fait pas de
doute : pour réaliser l’équilibre demandé, le système devra considérablement s’écarter
de l’équilibre actuel. Ainsi, l’abondance ne se maintient qu’en créant de nouveaux
besoins et l’homme ne se libère du monde extérieur qu’en s’asservissant à un monde
technique conquérant, sans limites assignables autres que celles de l’univers lui-même.
Déjà nous avons accepté, dans notre vie quotidienne, l’irrésistible modification de nos
goûts et de nos désirs. La technique est plus exigeante. Elle nous concurrence
désormais dans nos travaux et notre profession. La désuétude touche les hommes après
avoir touché les machines et les statisticiens déterminent, avec la marge de fantaisie
qui leur est coutumière, la probabilité pour un individu d’avoir à changer seulement
deux ou trois fois de métier dans un laps de temps déterminé. Comme le prophétisait,
dès 1958, le père de la Cybernétique, Norbert Wiener : la révolution technique « donne
à l’humanité un ensemble nouveau et au plus haut point efficace d’esclaves mécaniques
pour accomplir son travail. Un tel travail mécanique a la plupart des propriétés du
travail esclave, bien que, à la différence du travail esclave, il ne comporte pas les effets
directement démoralisants de la cruauté humaine. Toutefois, tout travail qui accepte
les conditions de compétition avec le travail esclave11 accepte les conditions du travail
esclave et est essentiellement travail esclaveii ». Le mal est clair et l’on n’indique pas
clairement les remèdes.
8 [5] La sensibilité des moyens de communication ajoute, en troisième lieu, aux risques
d’instabilité du système. Le courrier que Napoléon envoya à Paris après la prise de
Moscou n’allait pas sensiblement plus vite que celui par lequel César annonça à Rome la
capture de Vercingétorix. Dès 1896, en utilisant les ondes hertziennes pour
communiquer des informations, Marconi atteignait d’emblée la vitesse maxima avec
laquelle un message peut propager ses effets, celle de la lumière ; nos petits-enfants 12
communiqueront autrement que nous, non plus vite. Mais la qualité de l’information
importe autant que sa vitesse. Lire les bulletins du Moniteur, écouter les discours de
Hitler, voir en couleur les premiers hommes alunir, c’est passer d’une forme de
communication abstraite, symbolique, réfléchie et particulière à une forme concrète,
immédiate, périphérique et universelle, où toutes les difficultés du codage et du
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
125
décodage ont été transférées de l’homme à ses instruments. Faut-il alors s’étonner des
incertitudes dans les méthodes de communication entre générations et,
particulièrement, dans la façon d’enseigner ? D’une part, le son et l’image prétendent
supplanter l’écriture. De l’autre, une machine bien programmée vaut mieux qu’un
mauvais maître et bien des tâches qui, dans la transmission de la culture, sont
concurrencées par le travail esclave sont13, comme dit Wiener, essentiellement du
travail esclave.
9 Voici donc un milieu technique, en lui-même instable, et dont les procédés
d’information ne cessent de réverbérer et d’amplifier l’instabilité. Il serait assurément
exagéré de réduire le rôle des institutions juridiques, religieuses et morales à celui de
stabilisateurs des civilisations. Mais on conviendra aisément que l’une de leurs
destinations14 principales est de prévenir ou d’amortir et d’intégrer le choc des
innovations. On imagine alors qu’elles sont, aujourd’hui, soumises à rude épreuve.
Certes les marchands ont passé contrat et les ouvriers ont fait grève 15 avant que le
contrat et la grève soient reconnus en droit commercial et ouvrier. La lutte pour le
droit ne s’est jamais séparée de la justice même. Mais ces luttes prenaient naguère des
siècles ou du moins des décades. À présent, c’est avec une extrême rapidité que les
retards s’accusent et se comblent dans tous les domaines du droit. Les lois courent
après les [6] mœurs, qui courent après la technique. De ce fait, les idées qu’on se fait du
bien et du mal changent sous nos yeux. Ceux dont l’éducation remonte à l’époque bénie
de Raymond Poincaré n’auront pas oublié les préceptes d’épargne qui leur étaient
inculqués ; pour les États comme pour les ménagères, la règle d’or était de tenir un
équilibre constant et strict entre recettes et dépenses. Ailleurs cependant, où l’on
prenait mieux la mesure de la grande crise, on fustigeait la manie d’épargner comme
un vice responsable du chômage. Et, depuis, les sociologues nous ont accoutumés à
glorifier les largesses et le don, formes primitives de l’échange, sources non seulement
du prestige, mais de la solidarité.
10 Il est dangereux de rappeler aux hommes que les vertus elles-mêmes ont leurs travers.
Submergés par l’économie d’abondance, ils devraient s’interroger sur les contraintes et
les répressions que seules16 la disette et la rareté justifiaient. Maîtres d’automates
homéostatiques, ils devaient pousser le sacrilège jusqu’à s’enquérir du mécanisme
auquel obéit une règle. Un cybernéticien demande ainsiiii : « Chez l’homme et les
animaux supérieurs, quels facteurs vont corriger le signe des nombreuses contre-
réactions qui résultent de l’expérience individuelle ? Par exemple, qu’est-ce qui va
effectuer cette rectification chez l’enfant, qui peut être forcé d’apprendre à rechercher
la viande rouge, mais à éviter un fruit rouge, à rechercher une couverture rouge, mais à
éviter une braise rouge, les contre-réactions, pour fonctionner correctement, devant
être les unes positives, et les autres négatives ? » À cette question, l’auteur répondait en
invoquant un théorème « suivant lequel un système adéquat renfermant un grand
nombre de fonctions en gradins doit pouvoir changer automatiquement ses contre-
réactions jusqu’à ce qu’il ait trouvé une contre-réaction appropriée, le processus de
changement cessant au moment où se produit une contre-réaction affectée du signe
correct et à ce moment-là seulementiv ». À l’appui de la théorie, un homéostat était
présenté qui réalise un véritable simulateur d’adaptation, c’est-à-dire un automatisme
propre à produire ses règles de conduite.
11 [7] C’est non pas la science-fiction, mais un théorème démontré et une machine
construite qui tirent donc la conséquence de notre couplage technique et nous
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
126
fournissent le quatrième et dernier trait caractéristique de notre situation. De ces
règles, que nous voyons changer, nous pouvons imaginer l’origine, sans invoquer
aucune transcendance, puisqu’un automate fait l’affaire. Valéry le disait avec un peu
d’emphase : « Nous savons, nous autres civilisations, que nous sommes mortelles ».
Traduisons en langage de machines : « Nous savons, nous autres lois, que nous sommes
des adaptations ».
II
12 Voilà les faits : un couplage technique, rendu doublement exigeant par sa nature et par
la réverbération de son information, des règles tenues pour saintes et immuables et que
des automates simulent et démodent. Reprenons-les une à une pour examiner leurs
effets sur les mœurs.
13 Remarquons d’abord que les morales traditionnelles rappelaient l’homme à sa
condition d’animal démuni et prétendaient l’affranchir sans l’associer aux artifices.
Elles jouaient, pour ainsi dire, le rôle d’anti-couplages. « De quoi le sage a-t-il besoin
pour être heureux ? » – « De rien, répondent orgueilleusement les morales du bonheur,
puisque, même dans le taureau de Phalaris17, il ne dépend que de lui de n’être en quoi
que ce soit troublé et de pouvoir s’écrier : « Douleur, tu n’es qu’un mot ! » – Plus
humbles, les morales du devoir se contentent de libérer de toute hétéronomie cela seul
qui nous rend digne du bonheur, une intention pure. Dans les deux cas, ataraxie et
autonomie sont sous le seul commandement de la volonté, faculté mystérieuse qui nous
met en demeure soit d’agir sur les représentations propres à nous impressionner et à
émouvoir nos désirs, soit du moins de devoir purifier le principe de notre
détermination de tout intérêt extérieur. Cette unique faculté est divine 18, ou à défaut
sublime, puisqu’elle arrache l’homme aux sollicitations de sa sensibilité et l’élève au-
dessus de sa condition [8] animale.
14 D’un coup, le couplage technique fait s’écrouler ces rêves. Contre la douleur et contre
l’angoisse, un calmant ou ce qu’on appelle du nom si prometteur de « pilule 19 du
bonheur » agissent plus vite et plus sûrement qu’un précepte de morale. Mais alors, au
lieu de nous en tenir à l’idée fabuleuse de l’homme, empire dans l’empire de la nature,
acceptons-le pour ce qu’il est, constatons qu’il n’est rien sans son matelas d’artifices, et
laissons dépérir la morale puisque20 après tout voilà un bon million d’années que le sage
a cessé d’être nu.
15 Mais suivons les conséquences de cette idée : on n’agit jamais directement sur l’homme,
mais toujours et seulement par des voies indirectes, en modifiant son milieu, c’est-à-
dire en inventant un artifice de plus. Cette action indirecte ou conditionnement est le
principe qu’à l’aube de notre révolution technique découvrirent indépendamment
Pavlov et Watson. Nulle part l’analyse psychologique ne révèle une âme, siège de
méditation ou objet d’introspection, non plus qu’une réflexion ou une volonté qui
assignerait à l’agent sa responsabilité. Mais on peut résoudre le comportement humain
en une suite de réflexes conditionnels, réponses parfaitement automatiques à des
stimuli, parmi lesquels on comptera les mots, et auxquels nous ne prêtons de
significations que parce que le hasard les a une fois associés à l’objet d’un désir.
Lorsqu’ils croyaient décrire des caractères, mus par les ressorts qu’ils appelaient
ambition et amour, les romanciers cédaient donc à une séduisante illusion. Ainsi, Julien
Sorel décide brusquement d’assassiner Madame de Rênal. Il aurait fallu montrer au
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
127
lecteur l’objet, probablement caché à l’attention consciente du héros, que la seule vertu
d’anciennes rencontres avait chargé d’un pouvoir relevant apparemment d’une
décision passionnée. Les passions sont des mythes. Comme le savent les agents de
publicité et les sectateurs du nouveau roman, ce sont les signes qui nous gouvernent.
En un sens, le bruit n’est pas un simple déchet pour cette civilisation du réflexe, car il
fait obstacle à l’examen de conscience et au recueillement dont elle n’avait plus que
faire. Tel est l’homme selon les vœux du brave nouveau monde, celui de Harvard et
celui de Moscou. Il a troqué son arbitre contre [9] un peuple d’automates. Sa puissance
est liée au pacte qui le rend étranger à lui-même, voyageur délesté de son ombre, à
peine étonné de l’ingénieuse rêverie qui, derrière chaque apparence de décision,
assigne le jeu réglé des causes, des réflexes et des symboles. De ce seigneur, les
sociologues ont dit qu’il était « hétérodéterminé », juste le contraire d’un mot d’ordre
donné naguère par un grand homme, peut-être attardé parmi nous. Mais ce personnage
n’est pas si nouveau, dont l’unique maxime est de ne jamais penser par soi-même. On
l’appelait jadis un conformiste.
16 D’un homme qui a projeté hors de lui son centre de gravité, on attendra 21, en second
lieu, qu’il aille de déséquilibre en déséquilibre. À l’intérieur aussi, s’il est encore permis
d’employer ce mot, le couplage technique entraîne l’instabilité. Ici encore, le contraste
est complet avec les exigences des morales. Celles-ci définissaient le bonheur par la
tranquillité et Épicure, faisant le tri des plaisirs, ne retenait que ceux qui lui semblaient
en repos, les plaisirs en mouvement lui paraissant indiscernables de la douleur. Notre
conformité, au contraire, ne se satisfait que de nouveautés. Au bonheur immobile a
succédé un principe d’infinité, de renouvellement inexorable des besoins. C’est à des
signaux inouïs22, donc toujours plus improbables23, qu’est confié le soin d’entretenir
l’excitation suffisante au maintien de la vie et de rompre autant qu’il se peut la
monotonie des formes modernes et démocratiques du divertissement, l’affairement, le
souci et les loisirs programmés. Ainsi, il n’y a pas à s’étonner de l’état de
mécontentement, sourd ou violent, propre à nos sociétés gavées : c’est leur dynamisme
même qui veut que ce qui leur reste d’âme se consume en explosions de rage. Auprès de
Marthe, affairée au ménage, on se prend à regretter Marie, Marie l’inutile, comblée
d’éternité.
17 Car c’est notre conscience du temps qui s’est le plus profondément altérée. Des
techniques qui vieillissent très vite discréditent le passé. Dans les sociétés
traditionnelles, la lutte des âges favorisait l’expérience et les vieillards. À présent,
partout la jeunesse fait prime, et par jeunesse j’entends moins l’âge biologique que
l’absence de souvenirs ou leur régression. Ainsi sont jeunes les cités qui ne sont pas
faites pour durer, parce que chaque génération rase ce que la précédente avait édifié.
[10] Si la culture tient dans les monuments, les institutions et les pensées, qui assurent
quelque communication entre nos vies éphémères et leur survivent, on voit pourquoi
l’homme affairé est son ennemi. Préhistoire, archéologie, exotisme sont à la mode dans
notre société. Est-ce remède ou symptôme ? En tous cas, le mal 24 américain, le manque
d’ancêtres25, nous ronge déjà, et l’extension de notre intérêt dans le temps et l’espace
compense mal le peu d’épaisseur26, de passé vivant, de coutumes et de traditions qui
nous lient encore à nos pères et, par eux, à notre enfance.
18 L’affaiblissement de notre subordination au passé altère inévitablement notre
représentation de l’avenir. Il me paraissait naturel, à vingt ans, de nourrir de grands
desseins. J’avais cet âge, lorsque je fus présenté à l’un des personnages qui décidait
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
128
alors du goût dans les lettres françaises. Questionné sur mes projets, j’exposai sans rire
des plans de livres à la mesure de cartons pour le plafond d’une autre Sixtine. Je
m’aperçus qu’on s’étonnait, ou plus. « C’est que, m’expliqua-t-on, le public n’est plus
versé dans la composition, le temps lui fait défaut. S’il lit encore, ce sera d’un trait
quelque relation assez brève pour être lue de cette façon ». – Jugement perspicace à une
époque où les chefs d’État et les maires du Haut-Doubs arborent la devise :
Développement, Planification ! Quand les goûts et les besoins changent si vite, les
entreprises à long terme paraissent bien précaires. Suivez l’histoire d’une réforme. Un
incident, une grève, que sais-je, une insurrection en imposent l’idée au corps politique.
Le ministre prend des avis, presse les commissions, calme les impatients. Déjà on
l’accuse de tiédeur. Il décide. Le corps politique est, pour une fois, unanime, comme à la
nuit du 4 août. Et quand les ordres atteignent enfin ceux qui doivent les appliquer,
d’autres événements pressent qui appellent désormais d’autres réformes, d’autant que
les mêmes gens qui s’accordaient si bien sur les principes se sont, entre-temps,
désaccordés sur leur interprétation. Nos textes de lois ont la durée des créations des
couturiers, et il y a peu à parier qu’un artilleur invente une machine à prévoir les
évolutions d’une cible aussi capricieuse que l’homme.
19 [11] Le temps récompense donc bien mal ceux qui se jettent à corps perdu dans ses
affaires. Il arrive même qu’il leur fausse compagnie. Ainsi probablement de la requête
que je lisais, flambant rouge, il y a quelques semaines, au fronton d’une université du
Midi : « La Commune ! Ici, tout de suite ! » Les universités d’aujourd’hui servent, entre
autres choses, à exprimer au grand jour les désirs élémentaires du peuple. De tels
textes, si conformes à leur destination critique, méritent qu’on les commente comme
on ferait de classiques. D’abord le mot : « Commune ». J’ignore le sens exact que lui
attachait le contestataire. Ces pensées courtes et sacrées m’ont toujours laissé perplexe.
J’abandonne donc avant d’avoir combattu. Mais les mots « Ici, tout de suite ! », je crois
les reconnaître. Ce sont les cris de l’enfant magique, qui piétine à la moindre distance
entre son désir et sa main. Ce sont les protestations réprimées de l’enfant que nous
continuons d’être quand nous rêvons ou que la discipline de l’attention nous fait défaut
pour vivre autrement qu’en songe. Peut-être n’est-ce pas un hasard si le surréalisme est
si intimement lié à la civilisation des automates. Nous payons une puissance précaire
par une insatisfaction chronique, et, délogés par l’action même du temps long de
l’action, sans passé, sans avenir, nous nous réfugions dans l’enfantillage, prenant ou
feignant de prendre les vessies pour les lanternes et les rêves pour les réalités.
20 De leur côté, nos moyens d’information flattent ce goût des chimères, par les
confusions27 qu’ils entretiennent dans nos esprits. L’abondance des matières risque ici
de faire illusion, encore que leur disparate même gêne leur assimilation. Nous nous
trouvons pris dans un vertige de signes. Leur nombre cependant a moins d’effet que
leur façon de nous toucher. Quand nous lisons, la ponctuation, la division en
paragraphes et en chapitres nous invitent à faire des pauses et donc à réfléchir, je veux
dire à nous détacher du texte pour l’examiner et le juger. C’est pourquoi la lecture peut
former l’esprit critique. Nous y passons constamment du niveau superficiel des signes
physiquement perçus à la synthèse abstraite et profonde du sens, et cette synthèse
exige un effort intellectuel systématique d’articulation et d’organisation. Il ne dépend
pas de nous, en revanche, d’arrêter le spectacle télévisé. Les images tiennent notre
pensée captive et [12] pour ainsi dire envoûtée ; elles ont certes leur type à elles de
résonance, mais c’est une résonance toute concrète, circonscrite au seul plan de la
sensation, accueillante à tout ce qui, fait de bric et de broc, n’atteint qu’à l’unité
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
129
rhapsodique de la contiguïté. Bref, elles s’accordent admirablement avec les machines
qui nous font extérieurs à nous-mêmes, par le jeu conjugué28 de stimulations
superficielles irrésistibles et d’inhibition du doute. Le lecteur est naturellement
détaché, le téléspectateur spontanément crédule.
21 C’est le lieu, puisque j’ai loué tout à l’heure l’usage circonspect des machines à
enseigner, de dénoncer les mensonges de la pédagogie moderne. Méthodes « globales »
pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, abandon des exercices de géométrie
au profit des opérations mécaniques de l’algèbre élémentaire, introduction ridicule,
dans les premières classes, de la théorie des ensembles 29, dont l’intérêt n’apparaîtra que
les études secondaires terminées, substitution de la langue parlée à la langue écrite,
dénaturation audio-visuelle de l’activité mentale, cette haute science prétend faire
l’économie de l’abstraction et de l’effort et retarde absurdement l’âge où l’enfant sera
mis en demeure d’appliquer aux problèmes scolaires son intelligence et son jugement.
22 On conçoit à quelles brimades ces instructions soumettent un esprit bien fait. À force
de se voir trop peu demander, la jeune tête se lasse, se dégoûte et rejette avec cette
caricature de formation le portrait authentique que la caricature masque. Malraux note
que30 ce ne sont pas d’abord des idées nouvelles, mais des états : le sexe, l’oisiveté, la
drogue, la violence. Il est vrai que les idées auxquelles ces états s’opposent sont alors
réduites à ce qu’il en reste entre les mains des bateleurs.
23 Que toutes ces conditions réunies, l’homme extérieur à lui-même, le temps perdu, le
jugement mis hors de cause, produisent enfin un doute général sur la légitimité de la
morale, qui s’en étonnerait ? Assurément, ce n’est pas d’aujourd’hui que date le débat
sur la nature des règles et des lois, ni non plus qu’on passe insensiblement de la
justification à la critique et de la critique à l’utopie. Pourtant les affinités oniriques de
la contestation font attendre d’elles quelque trait nouveau et singulier. À bon droit, [13]
comme on va voir.
24 Quelque31 origine qu’ils aient assignée aux lois, Dieu, nature ou contrat, et quelque
révolutionnaires qu’aient été leurs ambitions, les hommes de naguère critiquaient
moins les lois que les exceptions déguisées en lois, les privilèges. Par privilège on
entendait un droit unilatéral que s’arrogent un individu ou un groupe sans fournir la
contre-prestation qui l’équilibre et le légitime. Si durs qu’aient été les droits
seigneuriaux, ils étaient ressentis comme justes et nécessaires, tant que l’insécurité des
temps contraignait32 le manant à demander protection. On les estima 33 injustes et
intolérables, dès que les conditions générales de sûreté furent rétablies. Les plus
anciennes obligations portent témoignage de l’échange tacite qui les fonde. Ainsi la
prohibition de l’inceste paraît résulter de l’accord entre deux clans, dont chacun
renonce aux femmes qu’il possède de par le fait de la parenté à condition de pouvoir
disposer des femmes de l’autre de par les lois de l’alliance. La solidarité a pour principe
la justice et la justice n’est que la relation du devoir et du droit. De cette relation nous
prenons conscience comme d’un devoir lorsque nous fournissons la contre-prestation
et comme d’un droit lorsque c’est d’autrui que nous exigeons la prestation
correspondante. Un droit sans devoir correspondant est un carré rond.
25 Dans l’ordre de la pensée, la contestation revendique la quadrature du cercle. On
comprend que les états qui l’accompagnent ressortissent plutôt au genre de la
stupéfaction.
26 Voici le raisonnement qu’on tient. La donnée primitive, le droit naturel est le pouvoir
de disposer de la nature. Il n’est borné que par nos forces. Le contrat social, cependant,
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
130
ajoute à ces bornes des limites propres. En effet, tout système social de production est
affronté à un type de rareté. C’est cette rareté qui contraint à limiter le pouvoir de
disposition des individus en deçà de leurs forces, et donc à réprimer le droit en
l’assujettissant34 à la contrepartie 35 du devoir et de la sanction. Supposez à présent la
rareté vaincue, comme est sur la voie de le faire notre société d’abondance. Alors la
contrepartie36 obligatoire et répressive du droit perd automatiquement [14] toute
légitimité. La maintient-on ? C’est qu’on fait violence aux choses. Que cette violence
vienne du capitalisme ou de la bureaucratie, peu importe. Il est temps que l’État, dont la
production de masse entraîne le dépérissement de principe, dépérisse aussi dans les
faits. Sa violence est inutile. Contre elle, la violence est donc nécessaire et juste.
27 Les applaudissements des foules vont à ces idées simples. Je ne les ai expurgées que de
leurs excroissances psychanalytiques, car ce qu’on dit des rapports entre Éros et
civilisation m’a paru relever des « états » plutôt que des pensées. Je ne me lamenterai
pas sur l’imposture des temps : quand décrire je ne dis pas une cellule vivante, mais un
atome physique défie, au sens strict, l’imagination, des réformateurs et des potaches,
qui pensent comme Bouvard et Pécuchet37, détiennent les clés du développement de
nos sociétés sans qu’on rie. Mais, je l’ai dit, les hâbleurs ont pour eux l’inquiétude et la
crédulité du siècle.
28 Disons donc que la rareté fut la raison d’être de quelques lois. Elle ne les explique pas
toutes. Elle ne les explique pas la plupart du temps jointe à l’utilité, elle définit la valeur
économique. En elle-même elle ne crée pas de règles, bien qu’elle fournisse un nombre
important d’occasions à leur création. Une règle ne naît que de l’autolimitation de
plusieurs volontés, et toute la question serait précisément de montrer que l’occasion
est cause et que l’échange des prestations et des contre-prestations 38 dans lequel se
résout l’obligation se trouve univoquement déterminé par la rareté.
29 Sur l’exemple de la politesse, montrons donc comment s’appliquerait notre
raisonnement chimérique. Sous leur forme la plus stricte, étiquette des cours et
convenances extrême-orientales39, les règles de la politesse paraissent répondre à la
menace que fait peser la densité démographique sur le for intérieur et tout simplement
sur l’art de vivre de chacun. C’est dans la foule qu’on se marche sur les pieds. Voilà
donc des règles dues à la rareté ! Tout le problème, on l’a dit, est dans le mot « dues ».
Mais laissons cela. Les amateurs de dialectique l’auront remarqué : l’explosion
démographique, c’est l’abondance des biens qui cause – en un sens cette fois clair du
mot – [15] la rareté de l’espace libre, et donc de nouvelles obligations, des tribunaux et
des polices pour imposer à chacun le devoir de ne pas gêner son voisin en
contrepartie40 du droit de ne pas être gêné par lui.
30 Il faut donc que la contestation tire son succès d’ailleurs que de sa valeur proprement
intellectuelle et que quelque préjugé commun avec la société qu’elle veut détruire
explique la présomption paradoxale qui prévient en sa faveur. Quel est ce préjugé ?
31 Revenons aux automates. Ils simulent la sensation, la réaction motrice, leur liaison
homéostatique, l’adaptation, c’est-à-dire l’apprentissage, l’habitude, la mémoire. Ils ne
simulent, en revanche, ni l’activité programmatrice centrale, à laquelle ils obéissent
aveuglément, ni la décision, dans la mesure où celle-ci tient compte de ce que tant les
données que le problème traités demeurent une abstraction, et recourt à une
appréciation globale pour se déterminer complètement. J’appelle raison, sous son
aspect à la fois théorique et pratique, la faculté de poser un problème, tout en
maintenant une distance entre le jugement final qu’on portera sur la situation et la
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
131
solution qu’on avait obtenue. Comparons à présent nos instincts aux automates.
L’image de l’homme, même réduit à sa qualité de maître des machines, ne serait-elle
pas complètement déformée, et rabaissée au seul travail esclave, si nous le réduisions 41
à une chaîne de réactions conditionnelles, sans faire jamais appel à l’autorité centrale
chargée d’équilibrer, de modérer et de spiritualiser les instincts ? Cette autorité, c’est
celle qui parle par les lois. Aussi les classiques définissaient la raison la faculté des lois,
non pas au sens des règles homéostatiques par lesquelles une machine s’adapte
spontanément à la réalisation optimisée de son programme, mais au sens des fins
dernières que tout programme suppose et qui sont du ressort de la liberté. Surestime
de l’homme extérieur à lui-même et mépris anarchique des lois ne font qu’un. La
contestation et l’établissement sont ici complices dans la même ignorance de la raison.
32 ***
33 [16] Je récapitule. L’accélération de l’histoire, examinée sous l’aspect technique qui la
caractérise aujourd’hui, paraît, à quatre titres principaux, être pour l’homme une cause
de démoralisation. Premièrement, le couplage le rend extérieur à lui-même et l’asservit
aux machines libératrices ; la responsabilité, l’autonomie morales en sont affectées
d’autant. En second lieu, l’emballement du progrès brise les contraintes auxquelles,
lorsqu’elle agit, se soumet notre conscience du temps et affaiblit notre sens du réel ; la
rechute dans le magique ne favorise pas les entreprises de la volonté. Troisièmement,
nos moyens d’information substituent l’image au concept et font obstacle à la réflexion
et au jugement que suppose toute conduite morale. Enfin, la rapidité des mutations et
l’allègement des contraintes du milieu naturel font croire à l’inutilité des lois. Or nulle
illusion n’est plus fatale à l’action que celle d’un pouvoir absolu sur les choses ou sur les
personnes et les anges sont la seule espèce ailée dont le vol n’ait pas à s’appuyer sur la
résistance de l’air.
34 J’ai parlé d’effets moraux et de causes techniques. Mais si les idées d’autonomie,
d’esprit critique, de jugement et de règles, que j’ai voulu défendre, peuvent l’être, c’est
à la condition précisément qu’on remplace le mot de cause par celui d’occasion et le
mot d’effet par celui de réponse. Ces corrections détruisent avec le fatalisme le
désespoir. Comme individus, il doit dépendre et donc il peut dépendre de nous seuls de
résister aux mythes et au conformisme en exerçant notre liberté. Comme membres du
grand animal politique, où nous avons affaire aux illusions des autres, notre pouvoir est
assurément plus borné. Mais où l’enthousiasme serait déplacé, il nous reste le cœur.
Deux proverbes le rappellent au moraliste et, à l’occasion, au praticien : « Le pire n’est
pas toujours sûr », « Il n’est pas nécessaire d’espérer42 pour entreprendre ».
NOTES
1. Nous supprimons ici une virgule.
2. Les notes indiquées par des chiffres romains sont de Vuillemin. Nous les renvoyons à la fin du
texte.
3. Nous proposons de corriger ainsi le mot « mentionnent ».
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
132
4. Nous ajoutons ici une virgule.
5. Nous supprimons ici une virgule.
6. Nous supprimons le mot « À » en début de phrase.
7. Nous corrigeons le mot « ancêstraux ».
8. Nous ajoutons une virgule.
9. Nous supprimons une virgule.
10. Nous corrigeons les mots « compte-tenu ».
11. Nous supprimons une virgule.
12. Nous ajoutons le trait d’union.
13. Nous déplaçons la virgule d’avant à après le mot « sont ».
14. Nous proposons de corriger ainsi le mot « destructions ».
15. Nous supprimons une virgule.
16. Nous corrigeons le mot « seule ».
17. Nous corrigeons le nom « Shalaris ».
18. Nous déplaçons la virgule d’après « à » avant le mot « ou ».
19. Nous corrigeons le mot « pillule ».
20. Nous corrigeons le mot « puisqu’« .
21. Nous ajoutons une virgule.
22. Nous corrigeons le mot « inouis ».
23. Nous ajoutons une virgule.
24. Nous proposons de corriger ainsi le mot « mas ».
25. Nous ajoutons une virgule.
26. Nous ajoutons une virgule.
27. Nous proposons de corriger ainsi le mot « confessions ».
28. Nous corrigeons le mot « conjugé ».
29. Nous ajoutons une virgule.
30. Nous supprimons une virgule.
31. Nous corrigeons le mot « Quelqu’« .
32. Nous corrigeons le mot « contraignaient ».
33. Nous proposons de corriger ainsi le mot « estime ».
34. Nous corrigeons le mot « assujetissant ».
35. Nous corrigeons le mot « contre-partie ». Nous supprimons une virgule.
36. Nous corrigeons le mot « contre-partie ».
37. Nous corrigeons le nom « Péruchet ».
38. Nous corrigeons le mot « contreprestation ».
39. Nous corrigeons les mots « extrêmes-orientales ».
40. Nous corrigeons le mot « contre-partie ».
41. Nous proposons de corriger ainsi le mot « réduisons ».
42. Nous corrigeons le mot « espèrer ».
NOTES DE FIN
i. J. N. Spuhler, « Somatic Paths to Culture», in The Evolution of Man’s Capacity for Culture, arranged
by J. N. Spuhler, Detroit, Wayne St. Un. Press, 1965, p. 10.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
133
ii. Cybernetics, p. 37.
iii. W. R. Ashby, « Les mécanismes cérébraux de l’activité intelligente», in Perspectives
cybernétiques en psycho-physiologie, trad. Cabaret, PUF, Paris, 1951, p. 6.
iv. Ibid., p. 6.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
134
Sommes-nous libres ?
Are We Free?
Jules Vuillemin
1 [1] Il n’est pas sûr que ceux qui croient à la liberté agissent autrement que ceux qui n’y
croient pas. L’incertitude est fâcheuse en un siècle où seules comptent les conséquences
empiriques. Mais on ne se débarrasse pas si aisément de la métaphysique. Car a-t-on le
droit de punir un criminel qui se croirait1 libre mais ne le serait pas ? La détermination
des actions humaines par l’éducation et la société est l’argument majeur de ceux,
aujourd’hui nombreux et puissants, qui s’opposent aux sanctions et aux peines.
2 Les contestataires du Droit pénal empruntent2 cet argument à la psychologie 3. Leurs
adversaires, partisans de la liberté4, répondent sur le même terrain. Je montrerai
qu’ainsi posée, la question est indécidable5 et que, si la liberté a quelque réalité, cette
réalité est inaccessible à la connaissance.
3 Il faudra changer de méthode. Nous ne pourrons postuler la liberté que si nous
découvrons un fait aussi spécifique qu’irrécusable, qui ne serait pas possible sans elle.
Ce fait est celui de l’obligation morale et juridique.
4 [2] Enfin si la liberté est la condition et non pas l’objet de l’expérience que l’homme a de
lui-même comme personne, ce statut singulier devra éclairer d’autres singularités de
notre condition : nous connaissons nos fautes, non nos mérites, la conscience de la
vraie liberté s’identifie6avec la vertu d’humilité, comme la7 dignité avec la
revendication de la responsabilité.
5 Le schème général de ces réflexions est kantien. Leur développement montrera où et
pourquoi l’on s’est écarté de Kant.
1 La liberté, inaccessible à la connaissance
6 On a avancé, contre la possibilité de la liberté, toute sorte d’arguments. Les uns, d’ordre
religieux, la combattent comme contraire à la prescience et à la prédestination divines.
D’autres, empruntés à la logique de l’action et rendus célèbres par l’argument
dominateur de Diodore Cronos, établissent l’incompatibilité entre 8 nécessité du passé,
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
135
genèse exclusive des possibles à partir des possibles, existence de possibles jamais
réalisés. On peut montrer cependant que ce qui prête leur force à ces arguments c’est
une thèse d’ordre physique, le déterminisme complet des [3] phénomènes. La science
du XIXe siècle et surtout la mécanique céleste accréditèrent cette thèse. Elle en fit un
dogme. Ceux qui tenaient à la liberté la reléguèrent en dehors des phénomènes
abandonnés à la nécessité la plus rigoureuse.
7 Quelques voix s’élevèrent, proclamant, par exemple avec Émile Boutroux, que les lois
de la nature sont contingentes. Mais on imagine aisément que les présomptions contre
la possibilité de la liberté ne s’affaiblirent qu’avec la révolution des idées en physique
même. On découvrit des relations d’indétermination dans les phénomènes collectifs
produits par les superpositions d’ondes. La mécanique quantique subordonna tous les
mouvements de l’échelle microscopique aux indéterminations de Heisenberg. Enfin,
dans le domaine macroscopique et au sein même de la mécanique céleste, la dynamique
des systèmes mit en valeur l’importance de la sensibilité aux conditions initiales et la
production du chaos à partir de la détermination.
8 Les sciences exactes nous ont libérés d’un dogme. Ne nous hâtons pas de conclure quoi
que ce soit de positif en faveur d’une liberté dont on sait seulement qu’elle n’est pas en
principe incompatible avec la nature des lois physiques9.
9 [4] Une circonstance particulière à la pensée se présente toutefois, qui a pu faire croire,
surtout aux partisans de la liberté, qu’elle permettrait de sortir d’embarras. Toute
pensée, en effet, se dédouble en réflexion. Allons donc demander à l’introspection son
témoignage direct. Que dit l’introspection ?
10 Si nous excluons les actes réflexes, les actions accomplies sous hypnose ou dans des
conditions réputées incompatibles avec l’expérience de la liberté, nos actions
volontaires se présentent à nous comme résultant d’une décision accompagnée de la
représentation de motifs. Cette formule, de laquelle la littérature classique française –
Corneille, Madame de Lafayette – a tiré quelques effets heureux, permet-elle de
répondre à la question posée ? Il semble que non pour peu qu’on analyse la notion de
motif, celle de leur représentation et celle de leur rapport à la décision.
11 On attribue à Buridan l’historiette de l’âne, placé à égale distance du seau 10 d’eau et de
la botte de foin, également assoiffé et affamé. Aucune décision n’est ici possible. De
deux choses l’une, en effet : ou bien il ira vers le seau 11 ou la botte, mais deux conditions
semblables auront alors des conséquences différentes en violation du principe de
raison suffisante, ou bien il mourra faute du surplus que la liberté est requise
d’apporter aux motifs. [5] Sans motifs la volonté est incompréhensible. Avec eux elle est
inutile. Tel est le dilemme devant lequel nous place le Commentaire à l’Éthique à
Nicomaque III, question 1 et suivantes.
12 La solution12 la plus absurde qu’on ait donnée au dilemme de Buridan l’a été 13 par André
Gide : la gratuité, c’est-à-dire l’absence même de motifs peut, selon lui, devenir un
motif d’agir. Cette vaine subtilité n’a qu’un mérite. Elle éclaire la nature des motifs qui,
à l’ordinaire, sont moins14 donnés à la liberté que choisis, sinon produits par elle.
Placées dans des circonstances semblables, deux personnes réagiront différemment
parce qu’elles éliront des motifs différents d’agir. Mais, s’il en est ainsi, comment
discerner, dans le motif lui-même, la part de la rencontre et la part de la volonté, ce qui
est donné et ce qui est produit ? Et comment, dans une multiplicité de motifs, assigner à
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
136
chacun son poids respectif ? Qui, l’action accomplie, peut dire, dans l’hypothèse
déterministe, quel motif il15 a véritablement choisi ?
13 Ces doutes se renforcent lorsqu’on considère non plus les motifs, mais leur
représentation par la conscience. Ils ont joué leur personnage sur le théâtre intérieur
de la délibération. Poursuivons la métaphore. Entrons dans les coulisses. Nos actions [6]
ne s’expliquent-elles pas par des mobiles qui ne franchissent pas le seuil de notre
conscience16, ou qui, si nous refusons d’hypostasier comme contradictoire le concept
d’inconscient17, mettent en scène ce que Sartre appelait la « mauvaise foi » ? Il est
difficile de contester dans la représentation des motifs l’existence de zones d’ombre et
bien naïf serait celui qui prendrait pour argent comptant je ne dis pas seulement les
motifs qu’on avance en public, mais ceux qu’on s’avoue à soi-même. Nous voici prêts à
voir en eux non plus les causes de nos actions, qui peuvent nous rester cachées notre
vie durant, mais la justification plus ou moins judicieuse en laquelle nous les
travestissons à des fins d’honorabilité.
14 Pour achever de nous désabuser, il reste à nous interroger sur le type d’efficacité ou de
force motrice que l’introspection nous fait apercevoir dans les motifs pour ébranler la
volonté. Hume l’a montré : quand une bille en choque une autre, nous voyons des
mouvements qui se succèdent, sans apercevoir la transition de la cause à l’effet. A
fortiori, quand nous invoquons un motif que nous imaginons puisqu’il ne nous est pas
donné de le voir, et que nous constatons que lui succède la représentation d’une action,
nous sommes totalement incapables de suivre [7] la prétendue transition de causalité
qui ferait du motif la cause motrice de l’action. Et ces successions imaginatives, dans le
sens interne, ne possèdent pas même la force de persuasion que nous reconnaissons
aux successions d’impressions dans le sens externe.
15 Nous ne pouvons espérer de réponse ni de la physique, ni de l’introspection. Il reste
une dernière voie. Il se pourrait, en effet, qu’en posant déterminisme et liberté comme
des hypothèses théoriques, et en examinant leurs conséquences respectives dans
l’expérience que nous avons des conduites humaines, un choix devînt possible ou même
nécessaire. Tel est le procédé général qu’on utilise dans les sciences. Prenons donc
exemple sur son modèle le plus célèbre, la gravitation newtonienne. Il faut formuler
une loi universelle, c’est-à-dire qui subsume tous les corps ou, en général, les systèmes
matériels, qu’ils relèvent de la mécanique céleste ou terrestre18.
16 On appelle maxime la subsomption de la diversité des motifs sous un unique principe.
Toute la question19 est donc de savoir s’il existe une maxime propre à subsumer les
motifs et les mobiles auxquels obéissent les actions de l’homme. L’amour de soi ou
égoïsme, déclare Kant, fournit une telle maxime. L’observation [8] ordinaire de la
société confirme Kant20 et 21 La Rochefoucauld avait exprimé avec vérité cette maxime,
lorsqu’il disait que « les vertus se perdent dans l’intérêt comme les fleuves dans la
mer ». Quant aux actions qui prétendent à une généalogie plus noble, dévouement et
équité civils22, abnégation religieuse, sacrifice militaire, on vient de voir comment la
ramener à la maxime commune, puisque, dans la décision, le poids réel du motif avancé
échappe à son agent23, que, par définition, nul ne pénètre les mobiles secrets qui n’ont
de cesse de lui faire prendre le change, qu’enfin, si les motifs ont quelque 24 efficace,
personne ne peut le savoir.
17 Cette maxime, principe universel des actions25, paraît décider en faveur du
déterminisme. En effet le mécanisme mental qu’utilise l’amour de soi mène les hommes
aussi rigoureusement que fait la gravitation pour les corps. En principe, ainsi conclut
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
137
Kant, si nous étions à même de pénétrer assez profondément dans l’ensemble des
phénomènes psychologiques qui constituent la vie intérieure d’un individu, nous
pourrions « prédire sa conduite future avec autant de certitude qu’une éclipse de lune
ou de soleili26 ».
18 Mais l’argument kantien est outré. Rousseau n’avait-il pas opposé à l’amour de soi
l’amour propre, qui fait que nous [9] nous comparons à autrui et préférons aux biens
dans lesquels l’amour de soi se satisferait les biens qu’autrui possède et auxquels la
seule comparaison donne leur prix. Allons plus loin. Il est possible que l’individu tienne
son bien – comme objet direct du désir ou comme objet contesté de l’envie – cela et
seulement cela que l’opinion reçue tient pour tel. Cette possibilité 27, qu’on ne saurait
écarter au siècle de la communication, suffit à vider de tout contenu la maxime de
l’amour de soi. Sous l’espèce du bonheur nous recherchons n’importe quoi. S’il était
possible à un homme ou à un parti de contrôler absolument les communications 28, on
pourrait imaginer cet homme ou ce parti instaurant l’unanimité, mettant l’amour du
prochain au principe de l’amour de soi et produisant, par mécanisme 29, le paradis sur
terre. On connaît les effets de ces utopies30. Mais elles renaissent de leur cendre31 bien
qu’à chaque fois le vieil homme l’emporte. C’est que, lorsque nous prétendons
connaître les phénomènes humains par le moyen d’une hypothèse théorique, la
maxime unique sous laquelle nous parvenons à subsumer les mobiles et en vertu de
laquelle chacun agit sous l’espèce du bien n’est universelle que parce que nous la
concevons formellement, non matériellement. Le déterminisme théorique 32 est plus
verbal que réel.
19 [10] Lorsque nous faisons nôtre la description que Kant donne de l’homme empirique 33,
nous portons sur nous-même un jugement non pas théorique, mais moral. On en verra
l’utilité pour borner nos34 vaines prétentions à l’angélisme. On ne saurait la faire passer
pour une véritable connaissance de soi35.
20 Nous aboutissons donc à un triple agnosticisme. La physique montre que la liberté n’est
pas impossible, l’introspection ne montre pas qu’elle soit réelle et le prétendu
déterminisme des phénomènes humains est incapable de fixer à l’amour de soi ses
limites36.
2 La liberté, fondement de la législation de justice37
21 Indécidable théoriquement par un acte de la connaissance, la question de la liberté se
trouve décidée et positivement par la pratique journalière du commerce juridique et
moral. Chacun d’entre nous porte des jugements de valeur, approbation, blâme,
admiration, mépris, qui perdraient toute signification si la conduite qui en est l’objet
n’était pas libre. Condamnations et peines prononcées par les tribunaux deviendraient
toutes injustes, si cette supposition se trouvait en défaut.
22 [11] Les arguments tirés de la pratique générale méritent toute notre attention. Encore
faut-il, pour être valables, que cette pratique n’exprime pas seulement l’accord de la
tribu sur des préjugés. On est en droit de demander si les punitions qu’infligent les
tribunaux sont justifiées. Et la législation qu’on invoque ne peut servir de preuve que si
l’on est assuré qu’elle n’est pas le pacte des puissants contre les faibles. Sinon la liberté
qu’on définirait par elle n’exprimerait qu’une violence déguisée 38.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
138
23 Pour qu’on puisse légitimement postuler la liberté au principe d’une législation morale
et politique, il faut donc qu’on retrouve en celle-ci la trace de celle-là. Or nulle
législation ne reflète plus immédiatement sa libre origine que celle que produit la
volonté en se donnant à elle-même sa loi. Lorsqu’en France les États Généraux de 1789
se transformèrent en Assemblée nationale constituante, à laquelle succéda la première
Assemblée législative, c’est cette idée qui prit39 forme politique : le peuple souverain
n’est sujet que de lui-même. Une législation ne sera donc marquée par la liberté que si
la volonté reconnaît qu’elle l’a créée ou du moins que, parce qu’elle aurait pu l’avoir
créée, elle l’accepte comme sienne. Mais l’autonomie [12] est identique avec la justice.
M’obliger librement signifie me contraindre au-delà de ce que la nature m’impose.
Aucune volonté n’acceptera de s’obliger de la sorte, si ce qui lui reste de pouvoir ne
reçoit pas, du fait de ce renoncement volontaire, une garantie qui le transforme en un
droit. Réciproquement, prétendre à un droit, c’est-à-dire invoquer la reconnaissance 40
d’autrui dans l’exercice de mon41 pouvoir, c’est attester les obligations42 qui limitent cet
exercice comme garantes de cette reconnaissance. Il suffit de réfléchir aux conditions
qui bannissent l’esclavage d’une législation acceptable au point de vue tant moral que
juridique pour apercevoir le lien entre cette réciprocité, l’autonomie de la volonté, la
liberté. Tout droit est la contrepartie d’un devoir et tout devoir est la contrepartie d’un
droitii
24 L’existence des crimes et des fautes atteste que la maxime de la volonté, quelle qu’elle
soit, qu’on ne tirerait pas de l’obéissance même à la législation de justice, peut entrer
en conflit avec cette obéissance. Nos actions se répartissent donc désormais en deux
classes : celles qui violent la loi et celles qui lui sont conformes. Les premières sont
répréhensibles, les secondes acceptables juridiquement. Quant aux motifs qu’on [13]
croit inspirer les actions, ils entrent incontestablement, pour les premiers, dans les
maximes que nous réputons immorales. En revanche la maxime d’une action
simplement conforme à la loi ne se voit pas automatiquement reconnaître une valeur
morale. Suivant la distinction proposée par Kant entre actions faites conformément au
devoir et actions faites par devoir, pour que nous estimions comme morale notre
maxime il faut que nous agissions non seulement en vue d’accomplir la législation de
justice, mais encore à l’exclusion de tout autre motif, cette seconde condition seule
assurant la pureté de notre intention43.
25 La situation créée par la liberté est nouvelle et spécifique. En premier lieu, tandis que le
pouvoir de l’homme comme être de nature s’identifie à tout ce qui échappe aux
contraintes physiques, son droit comme être moral et juridique ne s’identifie que
superficiellement avec ce qui échappe aux obligations correspondantes. Soit le droit de
légitime défense. Il serait plaisant de le fonder sur l’absence d’obligation de se laisser
tuer. Remontons donc au principe. Dans un État de droit, le citoyen est obligé de
remettre à la puissance publique le soin de sa protection. Cette obligation négative est
bien identique à la perte ou à l’abandon d’un droit, celui de se faire justice soi-même.
Mais [14] la raison d’être de l’obligation, ce qui en fait l’élément d’une législation de
justice, d’évidence, est ailleurs. Elle est dans le droit qui m’est ainsi garanti d’être
protégé par44 l’État. Ce droit cessant – ma vie se trouvant menacée hors de la présence
d’un agent de la force publique –, l’obligation cesse aussi : d’où naît la légitime défense.
La conscience juridique et morale est donc celle de l’identité du devoir et du droit qui
lui fait contrepartie.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
139
26 La conscience de l’identité du devoir et du droit n’est autre que la représentation de la
législation de justice. Mais puisque cette législation45 a sa source dans une volonté
législatrice ou du moins dans une volonté éclairée d’adhésion à la justice, nous
concevons la représentation de la législation comme un effet dont la liberté est la cause
ou raison d’être.
27 Pour le moment la postulation de la liberté reste suspendue à la supposition de la
possibilité46 d’une législation de justice. Si notre volonté est éclairée par l’idée d’une
telle législation, c’est qu’elle est libre. Et la liberté n’est, à son tour 47, rien d’autre que la
faculté de promouvoir la législation de justiceiii. Mais c’est une question controversée,
parmi les philosophes, de savoir comment cette faculté passe éventuellement à l’acte.
28 [15] Les uns – Socrate, Spinoza – soutiennent que l’idée claire et distincte du bien
produit par elle-même l’appétition. Les autres observent qu’on fait le mal les yeux
grand ouvertsiv, observation plus conforme à la faiblesse de l’entendement humain, à
moins de demander à l’intelligence du bien une force d’illumination qu’elle ne possède
pas dans l’expérience commune. On appelle arbitre ou libre arbitre 48 cette faculté
irrationnelle et brute49 de dire oui ou non 50 à la représentation du bien. Tous les
philosophes qui en acceptent l’existence la considèrent aussi comme le plus bas degré
de la liberté. On a vu qu’aucune donnée de la psychologie n’invite 51 à concevoir l’arbitre
ou pouvoir exécutif52 de la volonté – pas plus que la volonté législative elle-même –
comme accessibles à la connaissance. Si une législation de justice est possible, alors
seule une volonté libre peut en être la source. Si cette législation doit être réalisée,
alors seul un libre arbitre peut le faire.
29 Ni sous sa forme inférieure d’arbitre, ni sous sa forme supérieure de faculté législatrice,
la liberté n’est donc objet d’expérience. La maxime de l’action reste inconnaissable.
C’est à un autre que l’homme, s’il existe53, et son existence, si elle nous est accessible, ne
l’est qu’à travers la législation [16] de justice, de sonder les reins et les cœurs. En
particulier il nous est impossible, à supposer que nous ayons 54 agi par moralité pure, de
le savoir. Si cette ignorance paraît paradoxale, qu’on fasse l’hypothèse contraire. Il
faudrait alors qu’une action bonne fût accompagnée par la représentation que son
auteur en a le mérite : la moralité dégénérerait en son contraire, l’orgueil. En revanche,
du seul fait que notre action55, quoique56 éclairée 57, n’est pas conforme à la législation
de justice, ce qui arrive chaque fois que nous nous arrogeons un droit qui n’est pas la
contrepartie58 d’un devoir, nous savons que la maxime de notre action est immorale.
Notre connaissance des motifs qui ont prévalu n’a pas progressé pour autant. Mais la
comparaison de ce que nous avons fait avec ce que nous aurions dû faire produit en
nous des sentiments moraux spécifiques, tels que le remords, la mauvaise conscience, le
repentir, etc., par lesquels nous prenons conscience de notre responsabilité comme
agents libres. Par eux nous saisissons, bien qu’indirectement et au su d’un échec et
d’une négation, non pas que nous sommes, mais que nous devons être libres.
3 La liberté, concept purement pratique59
30 [17] Nos fautes l’attestent. La liberté est un devoir.
31 Si elle est un devoir, elle est la contrepartie60 d’un droit. Ce droit, c’est la responsabilité.
En amenuisant autant que faire se peut la responsabilité, les présents réformateurs du
droit pénal amenuisent d’autant la liberté. Le fondement du droit de punir, c’est le
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
140
devoir d’expier et c’est priver l’homme de sa dignité que de laisser une fausse pitié lui
ravir son statut d’agent moral.
32 Le juge doit certes s’enquérir scrupuleusement des faits qui font obstacle à la liberté et
à la responsabilité. L’établissement de ces faits, par exemple l’expertise mentale, n’est
pas une mince affaire. Il lui arrive de ne pas aboutir ; le jugement est alors prononcé au
bénéfice du doute. Mais, ces empêchements écartés, n’imaginons pas que nous allons
trouver sur le terrain des faits liberté et responsabilité. Nul ne peut connaître et
éprouver la mystérieuse force que, si nous devons être libres, nous devons prêter à la
représentation de la législation de justice pour qu’elle puisse se réaliser. La justice doit
être. [18] Qu’elle soit ! C’est tout ce que nous savons de notre liberté. Platon qui partait
du devoir définissait l’âme comme un automoteur. Aristote qui partait 61 de
l’observation des faits disait que l’âme n’agit pas par soi, mais tire son motif d’autre
chose. Que conclure de ce désaccord, sinon que liberté et responsabilité ne nous sont
pas données comme le sont plaisir et douleur, et même tendance altruiste ou pitié 62 ?
Leur promotion, par définition, rompt les chaînes de causalité naturelle.
33 On l’a vu, l’impossibilité qu’il y a de connaître l’automoteur et de constater notre
liberté nous préserve de l’orgueil. Dans la mesure où leur message coïncide avec celui
de la raison pratique, toutes les religions ont lié salut et humilité. En indo-européen,
une même racine est au principe des concepts homme, humilité, humus et les oppose au
divin63. L’humilité est la vertu qui dépouille toute vertu de son mérite pour le remettre
aux dieux. Aux Jeux Olympiques, les vainqueurs offraient au ciel leur couronne. Cette
vertu fondamentale et véritablement universelle est pourtant fragile, sa fragilité
fournissant la preuve de son importance, puisque sans elle les vertus dégénèrent en
leur contraire, comme le prouvent les mêmes religions qui en font l’éloge, lorsque,
préférant leur succès à leur fin, elles [19] enflamment 64 l’enthousiasme et le fanatisme
de leurs fidèles. L’hypothèse pratique de la législation de justice que nous ne pouvons
poser que comme un devoir semble alors à portée de main. L’automoteur devient
accessible par l’illumination. La liberté s’enivre.
34 L’ivresse de la raison pratique est probablement le pire état dont l’homme ait à souffrir,
car c’est au nom de la justice et de la raison qu’on établit son règne. Si une expérience
peut nous rendre pessimistes au sujet de la nature humaine, c’est celle-là. Prise
indépendamment de la législation de justice, cette nature fournit pêle-mêle les motifs
les plus divers à l’action. Mais il suffit que, confronté avec la représentation de la
législation de justice, l’agent moral se grise de l’illusion que cette représentation est
automotrice, que sa maxime est pure de tout motif autre que cette représentation, bref
qu’il est juste, pour se précipiter, lui et les autres, dans l’enfer et l’intolérance 65. C’est
alors et non quand nous les interrogeons préalablement à leur statut moral que nous
nous apercevons que notre nature, nos instincts sont pervertis, car c’est ce qui est
noble en nous qui est cause de la perversité. Il suffit, pour cette déchéance, que la
liberté interprète le [20] devoir-être comme un être. Et il y a lieu d’être vigilants parce
que la tentation de la liberté est imputable à la liberté même.
35 Il est donc de la plus haute importance de refuser à l’agent moral 66 une prétendue
spontanéité qui le porterait à la justice. C’est sous forme d’impératifs catégoriques que
nous affectent nos devoirs – et la juste revendication du droit, la lutte pour le droit v fait
partie de ces devoirs67. Les lois nous commandent68. Ce sont des ordres de la forme :
« Agis en sorte que la maxime de ton action soit la représentation de la législation de
justice ». Ce qu’il y a de contraignant dans la formule prévient assez contre la
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
141
déification de l’homme et impose à la conscience morale 69 le paradoxe de son
asymétrie. Nous connaissons nos démérites, nos mérites nous sont cachés. Cette
asymétrie est une disposition bienfaisante de la raison pratique. On a remarqué d’abord
que les croyances que l’agent moral entretient au sujet de la liberté et du déterminisme
sont en elles-mêmes dépourvues de valeur morale. Ce qui compte c’est l’action. C’est
l’action seule qui autorise la croyance en la liberté, comme devoir, croyance purement
morale et, de ce fait, étrangère aux présomptions, d’ailleurs illégitimes, que nous tirons
de l’observation des faits.
Conclusion
36 [21] La question « sommes-nous libres ? » est théoriquement indécidable 70. Nous ne
connaissons l’homme intérieur ni en autrui, ni en nous-même 71, et nous pouvons même
considérer cette ignorance comme le résultat d’une sage économie de nos facultés,
puisqu’elle nous avertit contre le vice d’orgueil.
37 Comme agents de la législation de justice nous devons être libres. La liberté est la
raison d’être de72 cette législation comme identité du devoir et du droit, et elle est,
comme arbitre, sa raison d’exister.
38 Ces raisons échappent à la connaissance. La liberté est un concept purement pratique 73.
Ne pouvant savoir que nous sommes libres, le devoir d’être libres nous enjoint de croire
que nous le sommes. Cette croyance, libre et purement morale, ne nous fournit aucun
éclaircissement théorique sur la nature de la liberté.
NOTES
1. Le mot « croirait » remplace « croit ».
2. Le mot « empruntent » remplace « invoquent ».
3. Les mots « à la psychologie » remplacent « de fait ».
4. Nous ajoutons cette seconde virgule.
5. Les mots « qu’ainsi posée, la question est indécidable » remplacent « que les faits ne
permettent pas d’en décider ».
6. Les mots « s’identifie » remplacent « ne fait qu’un ».
7. Le mot « la » remplace « toute notre ». À partir d’ici, le manuscrit passe au stylo bleu (avec
corrections en noir).
8. Le mot « la » est rayé.
9. Les phrases suivantes sont rayées : « Ne nous inquiétons pas, d’autre part, des prétendues
démonstrations du déterminisme de nos actions administrées par les prétendues sciences
humaines : sociologie, psychologie, pédagogie. Leur présomption est d’un autre siècle, aussi bien
en matière d’établissement des faits que de déduction des relations de causalité. »
10. Nous corrigeons le mot « sceau ».
11. Nous corrigeons le mot « sceau ».
12. Le mot « solution » remplace « réponse ».
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
142
13. Les mots « l’a été » remplacent « le fut ».
14. Les mots « sont moins » remplacent « ne sont pas ».
15. Le mot « il » remplace « elle ».
16. Un point d’interrogation est rayé.
17. Le mot « qui » est rayé et ajouté plus haut.
18. La phrase suivante est rayée : « En second lieu, les conséquences qui découlent de cette loi
doivent recouvrir l’universalité de l’ordre naturel : elles doivent expliquer les phénomènes
mécaniques aussi bien sur terre (chute des corps, balistique) que dans le ciel (mouvements
képlériens des planètes, trajectoires des comètes suivant des sections coniques éventuellement
plus générales ».
19. Les mots « toute la » remplacent « la première ».
20. Le nom « Kant » remplace les mots « ce jugement ».
21. Les mots « il est vrai » sont rayés.
22. Nous corrigeons le mot « civiles ».
23. Le mot « même » est rayé.
24. Nous corrigeons le mot « quelqu’« .
25. Nous ajoutons la seconde virgule. Le mot « humaines » est rayé et le verbe « décide » est
remplacé par « paraît décider ».
26. Les notes indiquées par des chiffres romains sont de Vuillemin. Nous les renvoyons à la fin du
texte.
27. Le mot « possibilité » remplace « réflexion ».
28. Le début de la phrase remplace « La seule qualité des communications, c’est peut-être qu’il
est impossible à un homme ou à un parti de les contrôler absolument. Sinon on imagine l’opinion,
rendue unanime et ».
29. Les mots « sans aucune réforme intérieure » sont rayés.
30. Le début de phrase remplace « Les utopies révolutionnaires se rassasient de cette fiction ». Le
début du paragraphe suivant est rayé : « La seconde chose qu’on demande à la maxime, c’est de
rendre possible un ordre moral et politique dont la cohérence soit comparable à l’ordre de la
nature matérielle. Supposons que le système des lois auquel aboutit une maxime choisie comme
principe universel ne soit qu’un chaos fait de contradictions ou d’exceptions, ».
31. Le début de la phrase remplace les mots « Qu’elles renaissent de leur cendre montre en tous
cas ».
32. Le mot « théorique » remplace « de la connaissance ».
33. Les mots « le jugement que » sont rayés.
34. Le mot « nos » remplace « les ».
35. Ce dernier paragraphe a été ajouté sur une feuille à part au stylo noir.
36. Ces derniers mots remplacent « déterminer les limites de l’amour de soi ».
37. Le titre a été ajouté à l’encre noire sous le numéro de section.
38. Ce paragraphe, ajouté sur une feuille à part au stylo noir, remplace le paragraphe suivant,
rayé : « “Votre généalogie, rétorque le révolutionnaire, est tout apparente. Les punitions
qu’infligent les tribunaux le prouvent. Car la législation dont vous parlez est le pacte des
puissants contre les faibles. Votre liberté n’est qu’une violence déguisée.” »
39. Le mot « prit » remplace « prend ».
40. Le mot « reconnaissance » remplace « garantie ».
41. Les mots « de mon » remplacent « d’un ».
42. Les mots « les obligations qui » remplacent « que les obligations que nous acceptons ».
43. À partir d’ici, le manuscrit passe du stylo bleu (avec corrections en noir) au stylo noir (avec
corrections en bleu).
44. Les mots « d’être protégé par » remplacent « de la protection de ».
45. Le mot « législation » remplace « représentation ».
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
143
46. Les mots « la possibilité » remplacent « l’existence ».
47. Nous ajoutons la seconde virgule.
48. Nous corrigeons les mots « libre-arbitre ».
49. Nous supprimons une virgule.
50. Nous supprimons une virgule.
51. Le mot « invite » remplace « oblige ».
52. Nous corrigeons le mot « éxécutif ».
53. Nous ajoutons la deuxième virgule.
54. Nous corrigeons le mot « ayions ».
55. Nous ajoutons une virgule.
56. Nous corrigeons le mot « quoiqu’« .
57. Nous ajoutons une virgule.
58. Nous corrigeons le mot « contre-partie ».
59. Le titre a été ajouté au stylo bleu sous le numéro de section.
60. Nous corrigeons le mot « contre-partie ».
61. Les mots « des faits » sont rayés.
62. Nous remplaçons le point par un point d’interrogation.
63. Les mots « L’humilité », puis « Être humble » sont rayés.
64. Ce début de phrase, écrit sur une paperolle au stylo bleu scotchée au manuscrit, remplace :
« Combien cette vertu fondamentale et véritablement universelle est fragile et fournit ainsi la
preuve de son humanité, les religions les fournissent en enflammant ».
65. La fin du paragraphe, écrite sur une paperolle au stylo bleu scotchée au manuscrit, remplace
les phrases suivantes, rayées : « Ce n’est pas notre nature, nos instincts qui sont pervertis. Il y a
lieu d’être vigilant parce que c’est ce qu’il y a de noble en nous qui cause la perversité. La liberté
interprète le devoir être comme un être. »
66. Les mots « agent moral » remplacent « homme sage ».
67. Ces derniers mots remplacent « ne sont qu’une forme du devoir ».
68. Le mot « commandent » remplace « parlent ».
69. Les mots « la conscience morale » remplacent « notre attention ».
70. Cette phrase remplace « À la question “sommes-nous libres ?”, une réponse théorique est
indécidable ».
71. Nous ajoutons la deuxième virgule.
72. Les mots « l’identité » sont rayés.
73. Cette dernière phrase est un ajout ultérieur au stylo bleu.
NOTES DE FIN
i. Kant, Critique de la raison pratique, Examen critique de l’analytique.
ii. C’est ici le lieu de marquer la différence principale entre cette définition de la législation de
justice et la doctrine kantienne. Cette dernière identifie l’action morale avec l’action dont la
maxime est d’obéir à la forme de la loi, la forme de la loi – ce que toutes les lois ont en commun –
étant l’universalité. Benjamin Constant avait objecté à Kant qu’il se trouve des circonstances dans
lesquelles nous avons le droit moral de mentir. Ainsi Madame de Staël, qui cachait chez elle
Mathieu de Montmorency [Nous ajoutons ces deux virgules.] , avait menti [ Le mot « menti» remplace
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
144
« déclaré».] à l’espion du tribunal révolutionnaire. De même, Kant refuse au peuple injustement
oppressé tout droit d’insurrection et de résistance. Or des situations d’exception naissent
inévitablement chaque fois [Les mots suivants sont rayés : « que l’agent moral est exposé à voir un
criminel utiliser».] qu’un criminel, dans l’attente légitime que l’agent moral agira en universalisant
la maxime de son action, exploite à des fins perverses cette attente. L’espion attend que Madame
de Staël, obéissant à la prohibition universelle du mensonge, livre Montmorency à la Terreur. Le
tyran attend que le citoyen obéissant à la prohibition universelle de la rébellion légitime ainsi ses
exactions. Ces exemples font voir que la loi doit prévoir des clauses de suspension. Ces clauses
sont contenues dans la réciprocité du devoir et du droit qu’on pose ici au principe de la
législation de justice [Cette note est écrite sur une feuille à part au stylo noir. La dernière phrase est un
ajout ultérieur au stylo bleu.].
iii. Cet argument correspond aux §§ 5 (Problème I) et 6 (Problème II) de la Critique de la Raison
pratique.
iv. Video meliora proboque,
deteriora sequor.
v. von Ihering.
Philosophia Scientiæ, 21-2 | 2017
Vous aimerez peut-être aussi
- MEMOIRE Axiologie RUYERDocument74 pagesMEMOIRE Axiologie RUYERJean-Paul Oury100% (1)
- Philosophie analytique: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandPhilosophie analytique: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Métaphysique AnalytiqueDocument44 pagesMétaphysique Analytiqueprecoce12100% (1)
- Raymond Ruyer, Dumoncel (Commentaire)Document32 pagesRaymond Ruyer, Dumoncel (Commentaire)Juan CamiloPas encore d'évaluation
- La Notion de Pulsion Chez Nietzsche Et FreudDocument35 pagesLa Notion de Pulsion Chez Nietzsche Et FreudAndré Ourednik100% (3)
- (Szilasi) Philo Allemande ActuelleDocument10 pages(Szilasi) Philo Allemande Actuellefoutre21Pas encore d'évaluation
- Gaston Fessard - Cinquante Ans de Philosophie FrançaiseDocument64 pagesGaston Fessard - Cinquante Ans de Philosophie FrançaisejdPas encore d'évaluation
- Cours de Philosophie - Les Origenes de La Psychologie Contemporaine - MercierDocument520 pagesCours de Philosophie - Les Origenes de La Psychologie Contemporaine - MercierGuilherme Coutinho100% (1)
- Introduction: Les Suites de La Phénoménologie: Denis FisetteDocument20 pagesIntroduction: Les Suites de La Phénoménologie: Denis FisetteFabio Prado de FreitasPas encore d'évaluation
- Code Uic: Conception Des Traverses Monoblocs en BétonDocument31 pagesCode Uic: Conception Des Traverses Monoblocs en BétonAli BdaPas encore d'évaluation
- Paul Gilbert SJ, Le Tournant Ontologique de La Phénoménologie Française NRT 124-4 (2002) p.597-617Document22 pagesPaul Gilbert SJ, Le Tournant Ontologique de La Phénoménologie Française NRT 124-4 (2002) p.597-617aminickPas encore d'évaluation
- Ziller, Carlos (1995) - L'Harmonie Du Monde Au XVIIe SiecleDocument321 pagesZiller, Carlos (1995) - L'Harmonie Du Monde Au XVIIe SiecleLucas Santos100% (1)
- Camilleri, Une Nouvelle Ère de La Phénoménologie de La ReligionDocument47 pagesCamilleri, Une Nouvelle Ère de La Phénoménologie de La ReligionludovicoPas encore d'évaluation
- Ricoeur PDFDocument74 pagesRicoeur PDFAndre FariasPas encore d'évaluation
- L'esthétique de Merleau-PontyDocument27 pagesL'esthétique de Merleau-PontyJuliana Ortegosa AggioPas encore d'évaluation
- RicoeurDocument74 pagesRicoeurBreak Focus100% (1)
- Logique Formelle Et Logique Transcendantale 2nbsped CompressDocument456 pagesLogique Formelle Et Logique Transcendantale 2nbsped CompressHAEGELI Lucas100% (1)
- Automates Programmables Industriels (A.P.I)Document26 pagesAutomates Programmables Industriels (A.P.I)Hayet BechedliPas encore d'évaluation
- Cerballiance Res 20210507 210507MO007801Document1 pageCerballiance Res 20210507 210507MO007801Neymar RolandoPas encore d'évaluation
- Ruyer-2Document13 pagesRuyer-2qboum23Pas encore d'évaluation
- Le Statut HerméneutiqueDocument19 pagesLe Statut HerméneutiqueMed yahya BensalahPas encore d'évaluation
- La Théologie Comme Science Et La Vocation de Savant D'après Max WeberDocument9 pagesLa Théologie Comme Science Et La Vocation de Savant D'après Max WeberEu, Nana LimaPas encore d'évaluation
- Élements Pour Une Épistémologie de La Méthode QualitativeDocument14 pagesÉlements Pour Une Épistémologie de La Méthode Qualitativemed_kerroumi76Pas encore d'évaluation
- Rorty 3 2Document17 pagesRorty 3 2qboum23Pas encore d'évaluation
- Epistémologie Ou Philosophie de La Nature?: Xavier VerleyDocument18 pagesEpistémologie Ou Philosophie de La Nature?: Xavier VerleyAdama NdiayePas encore d'évaluation
- Pierre HadotDocument7 pagesPierre HadotYvan NgueyemPas encore d'évaluation
- Cours Sur Merleau-PontyDocument73 pagesCours Sur Merleau-Pontyyf zhuPas encore d'évaluation
- Raymond Ruyer - 1995 - de La Science A La Technologie - Avec Inedit Dieu Et L Antidieu - KimeDocument55 pagesRaymond Ruyer - 1995 - de La Science A La Technologie - Avec Inedit Dieu Et L Antidieu - KimepuppetdarkPas encore d'évaluation
- Naissance de La Phénoménologie HALDocument57 pagesNaissance de La Phénoménologie HAL42005544Pas encore d'évaluation
- 41079692Document3 pages41079692Javier BenetPas encore d'évaluation
- Analyse Thématique Hier Aujourd'hui Demain PDFDocument44 pagesAnalyse Thématique Hier Aujourd'hui Demain PDFCours De SoutiensPas encore d'évaluation
- Ricoeur Inconscient Et Ses ImagesDocument6 pagesRicoeur Inconscient Et Ses ImagesAr RoPas encore d'évaluation
- Changeux-Ricoeur. Un Dialogue Exemplaire Et Déroutant - Müller 1998 RDocument6 pagesChangeux-Ricoeur. Un Dialogue Exemplaire Et Déroutant - Müller 1998 RtindermindPas encore d'évaluation
- Considerations Morales I.1Document11 pagesConsiderations Morales I.1Sébastian-Xavier Katz PinoPas encore d'évaluation
- Finitude Et Destinee Humaines Chez Maurice BlondelDocument106 pagesFinitude Et Destinee Humaines Chez Maurice BlondelRobert Francis Aquino100% (1)
- Sommaire 2122 La Periode ModerneDocument14 pagesSommaire 2122 La Periode Modernedjetou33% (3)
- Suite Du SupportDocument10 pagesSuite Du Supportsowphalia15Pas encore d'évaluation
- Hans-Jorg Rheinberger Introduction A La PhilosophiDocument5 pagesHans-Jorg Rheinberger Introduction A La Philosophielkabbadj mohammedPas encore d'évaluation
- 036791ar 1Document37 pages036791ar 1gynska23Pas encore d'évaluation
- L'idée de La Phénoménologie: Vers Une Sortie de L'attitude NaturelleDocument92 pagesL'idée de La Phénoménologie: Vers Une Sortie de L'attitude NaturelleBechah L.Pas encore d'évaluation
- Philosophie Des Sciences, Par Robert NadeauDocument74 pagesPhilosophie Des Sciences, Par Robert NadeauDavid FielPas encore d'évaluation
- DOSSIER Épistémologie de La Recherche Qualitative 4 NumérosDocument66 pagesDOSSIER Épistémologie de La Recherche Qualitative 4 NumérosIssa FofanaPas encore d'évaluation
- Interpretativisme PDFDocument14 pagesInterpretativisme PDFYoussPas encore d'évaluation
- Victor Delbos (1911), " Husserl. Sa Critique Du Psychologisme Et Sa Conception "Document14 pagesVictor Delbos (1911), " Husserl. Sa Critique Du Psychologisme Et Sa Conception "Thomas VongehrPas encore d'évaluation
- Louis LavelleDocument21 pagesLouis LavellecianPas encore d'évaluation
- Universite Du Que Bec: PhilosophieDocument116 pagesUniversite Du Que Bec: PhilosophieAlkım EkinciPas encore d'évaluation
- Raisons d'être. Le sens à l'épreuve de la science et de la religionD'EverandRaisons d'être. Le sens à l'épreuve de la science et de la religionPas encore d'évaluation
- TP Phenomenologie Des Religions - Copie (Récupération Automatique) (Récupération Automatique) - 124512Document15 pagesTP Phenomenologie Des Religions - Copie (Récupération Automatique) (Récupération Automatique) - 124512KUBIKA DaddhyPas encore d'évaluation
- Le Statut de La Philosophie Dans La Réflexion Philosophique Française Et Francophone de Nos JoursDocument18 pagesLe Statut de La Philosophie Dans La Réflexion Philosophique Française Et Francophone de Nos Joursbinetalom5Pas encore d'évaluation
- Untitled DocumentDocument17 pagesUntitled DocumentWissal ChawqiPas encore d'évaluation
- Extrait Extrait 0Document23 pagesExtrait Extrait 0Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Averroès Prof Boa19 20 CovidDocument9 pagesAverroès Prof Boa19 20 CovidEMERAUDE DJEPas encore d'évaluation
- ScolastiqueDocument16 pagesScolastiqueAnton CusaPas encore d'évaluation
- PHI 207 - Théories ÉpistémologiquesDocument17 pagesPHI 207 - Théories ÉpistémologiquesanselmeazidjePas encore d'évaluation
- DDucard 2015 de Deux Discours L'un Metodo HALDocument19 pagesDDucard 2015 de Deux Discours L'un Metodo HALmariametraore452Pas encore d'évaluation
- J. Farges - Lebenswelt - Husserl-Dilthey-EuckenDocument29 pagesJ. Farges - Lebenswelt - Husserl-Dilthey-EuckenFabio Prado de FreitasPas encore d'évaluation
- Louis Lavelle: La Philosophie, Chemin de Sagesse: Bernard M.-J. GrassetDocument21 pagesLouis Lavelle: La Philosophie, Chemin de Sagesse: Bernard M.-J. Grassetsorokognonjr222Pas encore d'évaluation
- Modifier Modifier Le Code: Les Lumières Et L'avènement de La Philosophie Moderne (XVII Et Xviii Siècles)Document8 pagesModifier Modifier Le Code: Les Lumières Et L'avènement de La Philosophie Moderne (XVII Et Xviii Siècles)Karl ZINSOUPas encore d'évaluation
- L'histoire de La Philosophie Et Son Temps: Henri DeclèveDocument18 pagesL'histoire de La Philosophie Et Son Temps: Henri DeclèveBambaPas encore d'évaluation
- ÉpistémologieDocument18 pagesÉpistémologieArthur HemonoPas encore d'évaluation
- Le Panpsychisme Leibnizien - BouveresseDocument15 pagesLe Panpsychisme Leibnizien - BouveresseAlabernardesPas encore d'évaluation
- Théorie, réalité, modèle: Epistémologie des théories et des modèles face au réalisme dans les sciencesD'EverandThéorie, réalité, modèle: Epistémologie des théories et des modèles face au réalisme dans les sciencesPas encore d'évaluation
- Centrale 2014 P MP SDocument7 pagesCentrale 2014 P MP SAbdelhamid Dehayni AL Abdali100% (1)
- Cps 359Document167 pagesCps 359Antonin JoeyKanePas encore d'évaluation
- Devoir de Synthèse N°1 1er Semestre - Sciences Physiques - Bac Sciences Exp (2018-2019) MR Foued Bahlous PDFDocument7 pagesDevoir de Synthèse N°1 1er Semestre - Sciences Physiques - Bac Sciences Exp (2018-2019) MR Foued Bahlous PDFMohamed SaidiPas encore d'évaluation
- SEG S4 IG Chap 1 PDFDocument38 pagesSEG S4 IG Chap 1 PDFSoufiane RiyadPas encore d'évaluation
- Négation Formes Et PlaceDocument1 pageNégation Formes Et PlaceIsabelle KantoussanPas encore d'évaluation
- TP Recap2 - Pointeurs Et FonctionsDocument7 pagesTP Recap2 - Pointeurs Et FonctionsMATH FOR EVERYONEPas encore d'évaluation
- MICRORESDocument3 pagesMICRORESKader BakourPas encore d'évaluation
- Exemple DDocument3 pagesExemple DAymen JokerPas encore d'évaluation
- Fondations Parasismiques - DpeaDocument12 pagesFondations Parasismiques - DpeaDonald AristorPas encore d'évaluation
- 4427 001-EbookDocument96 pages4427 001-EbookEmmanuel LAPEBIEPas encore d'évaluation
- Exercice FonteDocument5 pagesExercice FonteRabehi DhoPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Partie 2 Midnight SunDocument15 pagesChapitre 3 Partie 2 Midnight SunOrlane JoveniauxPas encore d'évaluation
- PHYSIOLOGIE Rein Nseka Modified FinalDocument46 pagesPHYSIOLOGIE Rein Nseka Modified FinalDominique Ilunga mbambiPas encore d'évaluation
- Daw - TP1Document2 pagesDaw - TP1hamamaPas encore d'évaluation
- Guide Pratique D'internet Pour Nouveaux InternautesDocument33 pagesGuide Pratique D'internet Pour Nouveaux InternautesMustapha FagrouchPas encore d'évaluation
- Moulage CalculDocument14 pagesMoulage CalculHajar ZarroukiPas encore d'évaluation
- Cifre PHD Ovhcloud Lispen EnsamDocument6 pagesCifre PHD Ovhcloud Lispen EnsamAlioune Badara DioufPas encore d'évaluation
- Présentation Neïla Mouihbi - Journées DoctoralesDocument12 pagesPrésentation Neïla Mouihbi - Journées Doctoralesneila mouihbiPas encore d'évaluation
- Proposition de Correction Du DEVOIR de TOPODocument3 pagesProposition de Correction Du DEVOIR de TOPOAssane NiangaoPas encore d'évaluation
- Master PDF Final - CompressedDocument59 pagesMaster PDF Final - Compressedberty sifaPas encore d'évaluation
- Les Pouvoirs Du NemesisDocument3 pagesLes Pouvoirs Du NemesisThomas ClaveauPas encore d'évaluation
- Outils QualitéDocument32 pagesOutils QualitéAbdessamad BenbahPas encore d'évaluation
- Ajustement MécaniqueDocument1 pageAjustement Mécaniquechacha_yousraPas encore d'évaluation
- Le Rotary Club de Rennes Reçoit Une Citation Du Président Du Rotary International Pour L'année 2010-2011Document3 pagesLe Rotary Club de Rennes Reçoit Une Citation Du Président Du Rotary International Pour L'année 2010-2011AnneArquePas encore d'évaluation
- APC ACTIVITE 2ndDocument2 pagesAPC ACTIVITE 2ndFrançois regis NikièmaPas encore d'évaluation
- Mécanique TD1Document2 pagesMécanique TD1MajdolinePas encore d'évaluation
- Mise en PratiqueDocument2 pagesMise en PratiquePierre Frantz PetitPas encore d'évaluation