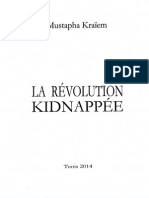Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CoqueryVidrovitch Rvoltesetrsistance 1983
CoqueryVidrovitch Rvoltesetrsistance 1983
Transféré par
Ota Benga BengaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
CoqueryVidrovitch Rvoltesetrsistance 1983
CoqueryVidrovitch Rvoltesetrsistance 1983
Transféré par
Ota Benga BengaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Révoltes et résistance en Afrique noire: Une tradition de résistance paysanne à la
colonisation
Author(s): Catherine Coquery-Vidrovitch
Source: Labour, Capital and Society / Travail, capital et société , April 1983 / avril 1983,
Vol. 16, No. 1 (April 1983 / avril 1983), pp. 34-63
Published by: Labour, Capital & Society
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/43157646
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Labour, Capital and
Society / Travail, capital et société
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
LABOUR Capital and Society 16:1 (April 1983), pp. 34-63
ABSTRACT
Revolt and Resistance in Black Africa: A Tradition
of Peasant Resistance to Colonization
Catherine Coquery-Vidrovitch
Unlike precolonical statist resistance movement, often
stemming from a strong conquering power, the movements of
primary resistance which broke out in the early days of coloniza-
tion - between 1895 and 1951 - were populist, rural and
spontaneous in nature: they were peasant revolts marking the
turning-point of a long process of evolution which cannot be
ignored if one is to understand present-day changes. These
revolts initiated the process of moulding the ideological environ-
ment in which African politics subsequently developed, in the
form of so-called "modern" resistance movements - unionist,
political, nationalist or national - including current liberation
struggles.
The problem is not only to take stock of these movements,
but to go beyond mere description to probe their significance.
What kinds of factors (the political system, a religious message,
the social organization, the nature of the colonical power, etc )
combined to produce at a given stage certain kinds of resistance
action? What, for example, were the circumstances most
favourable to open rebellion? What determined the "aptitude"
certain ¡peoples seemed to have for resistance, an aptitude in
some cases still apparent today? These are the answers we
sought through a study of the countries involved, both those with
Islamic traditions and those still adhering to animistic beliefs.
Over and above innumerable small-scale demonstrations,
some mass movements developed into virtual peasant wars
(Maji-Maji, Kongo-Warra, Mau-Mau, the Congo rebellions).
But all can be largely ascribed to religious fervor- messianism,
millenarianism, even witchcraft - stimuli which are the most
likely to achieve acceptance and adaptation. It is still absolutely
essential for us to understand this heritage if we are to grasp the
complexity of social movements which are now becoming
translated into urban action.
34
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
TRAVAIL Capital et Société 16:1 (avril 1983), pp. 34-63
Révoltes et résistance en Afrique noire:
Une tradition de résistance paysanne à la colonisation*
Catherine Coquery-Vidrovitch
Université de Paris VII
Aborder, dans une revue qui se consacre à l'analyse du mouve-
ment ouvrier, le problème des résistances paysannes à l'époque colo-
niale, peut apparaître déplacé. En fait, toute réflexion sur l'histoire des
revendications populaires se doit d'examiner la genèse du phénomène
au sein des masses rurales, qui constituaient, il y a à peine plus d'un
demi-siècle, la quasi-totalité des populations africaines, et en
représentent encore, la plupart du temps, entre 70% et 90%. C'est
pourquoi, à la différence (comme on va le voir) des résistances
étatiques pré-coloniales, les mouvements dits de "résistance primaire",
c'est-à-dire qui éclatèrent dans les premiers temps de la colonisation,
grosso modo entre 1895 et 1915, furent tous des mouvements ruraux,
spontanés et populaires: des révoltes paysannes qui se trouvent à la
charnière d'une évolution de longue durée dont il serait erroné de faire
abstraction pour comprendre les mutations de notre temps.
Car ces révoltes ont aussi commencé de façonner l'environnement
idéologique dans lequel la politique africaine s'est développée ulté-
rieurement, sous la forme des résistances dites "modernes" - syndi-
cales, politiques, nationalistes puis nationales, y compris sous la forme
immédiatement contemporaine des luttes de libération. Ce n'est donc
pas un hasard si les chercheurs s'interrogent aujourd'hui sur les
filiations à établir entre les premières et les secondes.
Contrairement au mythe colonial, ces résistances furent innom-
brables jusqu'à la première guerre mondiale au moins, car certaines
trouvèrent des prolongements jusqu'à nos jours. Il serait donc erroné de
se bloquer sur un premier constat: ces révoltes ont toutes échoué.
* Cet article reprend dans ses grandes lignes une conférence prononcée
en septembre 1981 au Centre d'études sur les régions en développement de
l'Université McGill.
35
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
L'analyse doit certes dégager le pourquoi de cet échec: nulle part elles
ne semblent avoir débouché sur autre chose qu'un repli passéiste, dont
le dernier avatar fut d'engendrer de véritables lames de fond religieu-
ses, à la fois messianiques et syncrétistes, plus favorables, en définitive,
à l'acceptation qu'à la contestation.
Le problème est à la fois d'inventorier l'ensemble de ces mouve-
ments, mais aussi de dépasser le niveau descriptif pour s'interroger sur
leur signification: quels sont les différents paramètres d'intervention
(système politique, message religieux, organisation sociale, mode
d'action coloniale, etc.) dont l'effet combiné a déterminé suivant les
époques telle ou telle modalité de résistance; quelles étaient, par
exemple, les conjonctures les plus favorables à la rébellion ouverte,
susceptibles à la fois de se maintenir ou de se transformer à travers le
temps, déterminant la plus ou moins grande "aptitude" apparente de tel
ou tel peuple à une résistance que l'on peut parfois suivre, à travers
l'histoire, des temps pré-coloniaux jusqu'à nos jours. Ce sont, en
examinant tour à tour les pays de tradition animiste et les terres
d'Islam, les conclusions, voire les modèles, que nous allons tenter de
dégager.
Les résistances pré-coloniales
Jusqu'à présent, les recherches ont davantage porté sur la période
antérieure, où de vastes résistances militaires se présentent comme les
dernières manifestations de l'Afrique indépendante. En fait, il s'est
souvent agi, dans cette période immédiatement pré-coloniale, de résis-
tances plus étatiques et politiques que nationales et populaires dans un
contexte social interne complexe, où s'entrecroisaient des réseaux
contradictoires d'intérêts et de pouvoirs en constante évolution.
On assista en effet, en cette période relativement brève des der-
nières décennies du 1 9ème siècle, à la cristallisation des oppositions en
réaction de rejet de l'intrusion étrangère. Qui s'en étonnerait? Le
phénomène est classique dans l'histoire. Mais il importe d'en interroger
la signification.
Au risque de choquer, disons tout de suite que cet épisode
apparemment le plus spectaculaire - celui des conquêtes, donc des
résistances militaires- ne nous paraît pas nécessairement le plus
significatif. Et ceci pour une raison simple: les guerres de résistance
pré-coloniales les mieux organisées furent celles où une formation
politique fortement structurée, possédant un chef énergique, au sens
politique développé, à la tête d'une armée régulièrement exercée et
assisté d'une aristocratie choisie affirmait un pouvoir réel sur un
territoire relativement étendu; il s'agissait en règle générale d'États
36
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
récents aux bases sociales et culturelles fluctuantes et mal assises, car
dominant des peuples soumis depuis parfois moins d'un siècle, voire
une ou deux générations au plus. Sauf peut-être sous la forme spécifi-
que de la Jihad , guerre sainte de l'Islam dont nous nous réservons
d'étudier la signification dans un second temps, ces guerres furent
secondairement le fait des peuples. Trois exemples, géographiquement
fort éloignés les uns des autres, permettent d'en témoigner: l'Empire de
Samori dans l'Ouest africain, les formations esclavagistes de l'Afrique
orientale et, antérieurement, l'expérience originale des Zulu en Afrique
australe.
En définitive, l'impact de ces soulèvements pré-coloniaux sur
l'évolution ultérieure de la résistance fut, dans l'ensemble, plus favo-
rable à l'assimilation qu'on ne pourrait le croire. C'est tardivement, à la
veille des indépendances, que les grands chefs d'antan (Shaka, Samori,
etc.) prirent figure de précurseurs et de symboles - ce qu'ils furent dans
une certaine mesure, à terme du moins, car, dans l'immédiat, l'effet fut
généralement inverse; l'effondrement des grands empires "étatiques"
fut sans lendemain; chacun des peuples soumis réagit à sa manière,
compte tenu de son histoire, de son contexte, de sa culture. Certains,
soulagés d'être délivrés d'une contrainte parfois insupportable, surtout
si elle s'accompagnait d'un renforcement du système esclavagiste (cas
des peuples Bantu asservis par les Emirats et Sultanats du Haut
Oubangui et de la cuvette tchadienne, ou des ethnies exploitées par
Samori) eurent plus ou moins, dans l'immédiat, tendance à se jeter dans
les bras du colonisateur considéré comme un allié momentané, de
courte durée, car la désillusion ne tarda pas à intervenir.
Ceci dit, il est juste de souligner qu'il exista aussi, en Afrique pré-
coloniale, de véritables petites ethnies-nations, construites sur un
sentiment d'identité "nationale", c'est-à-dire une langue, une culture et
une histoire communes - tels les royaumes Ashanti, d'Abomey,
Buganda, Bunyoro. Dans ce cas spécifique, la réponse à la volonté de
conquête coloniale fut une résistance politique qui prit une forme à la
fois nationale et populaire; le peuple tout entier suivit et aida la classe
dirigeante dans sa tentative pour expulser l'envahisseur occidental. Le
problème est que, traditionnellement soudée derrière son chef- garant
de sa permanence et gage de sa prospérité- la majorité de la popula-
tion continua de suivre ses directives, y compris dans la soumission: car
tôt ou tard, le pouvoir pré-colonial (cas des souverains locaux des
royaumes Ouolof, des familles royales d'Abomey, de l'Asantehene) fit
sa soumission. Il lui était en effet devenu évident que le seul moyen de
préserver quelques prérogatives était une docilité devenue garante en
outre d'avantages matériels (concessions de terre, facilités de circula-
tion). Une évidente alliance de classe souda la collaboration entre le
37
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
nouveau colonisateur, soucieux d'utiliser à son profit leur médiation
commode et efficace, et les anciennes autorités.
On peut aussi rappeler ici l'exemple Wahehe du Sud Tanganyika,
ou celui de la violente révolte des Shona et des Ndebele de Rhodésie en
1896-1897: face à l'expansion de la British South 4frica Company
qui, fin 1893. envahit l'ensemble du pays Matabele, les deux peuples
historiquement rivaux s'étaient unis contre les colons blancs de Cecil
Rhodes. Très vite, néanmoins, la politique de collaboration Ndebele
reprit le dessus; en acceptant des postes haut placés, ils furent les
premiers "pacifiés". Quant au massacre des Shona, il parvint par des
voies opposées au même résultat. La reconnaissance du pouvoir blanc
se révéla vitale; elle entraîna, dans les années qui suivirent, l'évidente
passivité du peuple Zimbabwe. D'où, paradoxalement, très vite après
la conquête, le succès d'une politique globale de collaboration dont un
des effets fut peut-être une acculturation plus précoce qu'ailleurs, ce
qui pourra, quelques décennies plus tard, devenir en revanche un des
gages de la précocité relative de l'éveil du nationalisme - cas du Ghana,
qui devint bientôt ( 1 9 1 1 ) le premier producteur mondial de cacao avant
d'être le premier pays indépendant de l'Afrique au sud du Sahara
(1957), ou du Dahomey (Bénin), considéré dès l'entre-deux-guerres
comme le "quartier latin" de l'Afrique d'expression française.
Enfin, d'autres groupes, traditionnellement réfractaires à toute
autorité supérieure surimposée, le restèrent: en Côte d'Ivoire le pays
Baoulé, au Bénin le Hollidje exigèrent une lente et douloureuse "pacifi-
cation". Autrement dit, une fois terminé l'épisode des résistances
d'État, les mouvements populaires reprirent force et droit.
Les résistances dites "primaires"
L'expression, qui n'est pas des plus heureuses mais fut vulgarisée à
partir d'une étude naguère remarquée,' ne fait pas, est-il besoin de le
préciser, allusion à un quelconque caractère "primitif, mais doit être
entendue par opposition aux mouvements "secondaires," dits "moder-
nes," de la deuxième génération qui en découlèrent d'ailleurs dans une
certaine mesure.
Elles furent populaires parce qu'il s'agissait d'une réponse directe
aux exigences immédiates et concrètes de la colonisation: impôt, recru-
tements forcés, cultures obligatoires.
Nous allons, dans un premier temps, tenter d'en dresser la
typologie à partir de leurs caractéristiques principales, avant de cher-
1 . Terence O. Ranger, "Connexions between Primary Resistance Movements
and Modern Mass Nationalism," Journal of African History 9:3 et 9:4
(1968). pp. 437-53 et 631-41.
38
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
cher à les expliquer et à les interpréter en fonction de leurs causes
plutôt que de leurs manifestations.
On peut, schématiquement, distinguer trois formes principales de
résistance: a) les soulèvements locaux; b) les mouvements "politiques"
régionaux; c) et les mouvements de masse.
a) Les soulèvements locaux
Au niveau d'un village, ou d'un groupe limité de villages, ce furent
les plus populaires et les plus ruraux, mais aussi les plus vulnérables,
car les moins préparés puisque fondés sur des structures lignagères
éparpillées, les plus offertes à la répression.
Ces réactions de rejet de la loi coloniale furent partout présentes,
parce que le colonisateur eut à affronter l'instinct de préservation de la
spécificité coutumière de chacun des groupes concernés. C'est proba-
blement la raison pour laquelle les cas les plus nets de résistance
paysanne eurent précisément lieu là où les sociétés étaient les plus
éloignées d'une organisation politique centralisée de type étatique-
c'est-à-dire, aussi, les plus vulnérables, les moins armées structurelle-
ment pour résister à la colonisation.
On se contentera ici de proposer quelques exemples caractéristi-
ques, tout en soulignant la nécessité de procéder dorénavant à l'inven-
taire exhaustif de ces manifestations qui permettent de saisir une des
expressions les plus authentiques du vécu des peuples.
L'Afrique équatoriale
"On oublie trop - notait un observateur en 1905 - que le Congo n'a
jamais été conquis, qu'il n'y a pas eu prise de possession effective des
vastes territoires de notre colonie."2 C'est donc bien à tort qu'on a
parlé, pour l'Afrique équatoriale française (AEF), de "colonisation
pacifique."3 Il est, à tout le moins, troublant de noter la coïncidence
entre les régions les plus instables et celles où les grands concession-
naires privés ou l'administration se livrèrent à des violences graves,
stigmatisées lorsqu'en 1905 éclata, sur la scène internationale, une
énergique campagne de presse orchestrée par le journaliste anglais E.
Morel et reprise par les socialistes français des Cahiers de la Quin-
zaine (Pierre Mille et Félicien Challeye).
C'est ainsi que le premier soulèvement d'envergure sur la route des
portages, entre Brazzaville et la côte, de 1897 à 1899, traduisit
l'exaspération des porteurs Loango épuisés; que l'année 1902, qui
2. Union Congolaise Française à Ministre des Colonies. 28 mars 1905.
Section Outre-Mer des Arch. Nat., Cone. 25 D (1).
3. H. Ziegle. Afrique Equatoriale Française (Paris: Berger-Levrault 1952).
39
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
coïncidait à la fois avec la période d'installation des concessions et
l'institution de l'impôt, fut marquée un peu partout par des désordres
graves (factoreries pillées, cas d'anthropophagie rituelle) exprimant
autant d'actes de vengeance. L'explosion la plus meurtrière fut celle
des Manja ravagés par le portage du haut Chari (1903-1904) reliant les
bassins du congo et du Tchad: ce qui frappe surtout dans ce pays,
d'ordinaire si morcelé, c'est l'ensemble du mouvement dont tous les
villages s'enfuirent dans la brousse pour animer la guerilla.
Les opérations de répression devinrent systématiques à partir de
1908, et la pacification définitive n'eut guère lieu avant 1913, avec
l'installation régulière de postes dans les zones hostiles. Sans qu'il soit
toujours aisé de discerner les causes parfois complexes de ces révoltes,
qui prirent dans certains cas privilégiés une ampleur considérable dans
une zone où le pouvoir était d'ordinaire si éparpillé, elles constituaient
incontestablement une réponse aux abus et un défi au bouleversement
des valeurs ancestrales.
Le Hollidjé4
Le pays des Holli, constitué de dix-sept villages disséminés dans
une forêt de dix kilomètres de large au nord-est de Porto-Novo au
Dahomey regroupant à peine dix mille habitants, offre un excellent
exemple d'un ilôt d'insoumission caractérisé par le refus permanent
d'une autorité supérieure. Il s'agissait, à l'origine, d'un groupe Yoruba
venu d'Oyo puis chassé d'Ifé dont les habitants, dotés d'une mentalité
de fugitifs repliés dans une zone écartée, avaient toujours refusé de re-
connaître l'autorité du roi d'Abomey. Leur groupe monolithique
reposait sur une solidarité assez "démocratique": les délégués des
villages constituaient une assemblée générale placée sous l'autorité
d'un "roi" élu à tour de rôle dans cinq familles, et dont l'avis ne
l'emportait pas toujours. Le groupe eut à mettre au point une tactique
adaptée à ses conditions naturelles, qui lui permit, depuis la création de
la colonie (1894) jusqu'au-delà de l'indépendance, de refuser tout
contact avec le pouvoir, exprimé par le refus de payer l'impôt.
L'insurrection éclata en janvier 1914, au moment où le dilemme
était devenu clair: soit se soumettre, soit passer à la révolte. Une guerre
de harcèlement fut entreprise contre les gardes-cercles. La répression
se poursuivit jusqu'en juin; avec l'aide de renforts venus de Dakar (des
camions et deux bataillons) les habitants furent désarmés, les impôts
4. Voir H. d'Almeida-Topor, "La révolte des Holli," Les résistances contre
l'Occident , Cahier Afrique noire, n° 1 (Paris: Laboratoire Connaissance du
Tiers-Monde, Université Paris VII, 1977), pp. 49-50. Voir également,
L. Garcia, "Les mouvements de résistance au Dahomey," Cahiers
d'Études Africaines 10:37 (1970), pp. 144-78.
40
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
doublés, les chefs arrêtés; on projetait de disperser les villages quand
intervint la guerre.
Dès l'année suivante, une seconde révolte éclata à la suite d'une
rapine (un tirailleur avait volé la poule d'une femme de chef; le frère
d'un autre chef avait été tué). L'administration entreprit d'affamer les
Holli en attendant la saison sèche. En fait, la fin de la rébellion ouverte,
au début des années 20, n'empêcha pas la population de demeurer
réfractaire: des troubles sérieux éclatèrent encore en 1956; même en
1963, une campagne de vaccination forcée fut le signal d'une nouvelle
révolte.
C'est que la résistance à la colonisation se situait dans la lignée de
la tradition: acquitter l'impôt, fournir des hommes à la corvée, bref se
plier aux exigences du pouvoir, c'était une preuve de dépendance. Voici
la raison principale d'un refus qui ne paraît pas lié à une misère parti-
culière: les Holli, qui échangeaient leur coton contre de la poudre et des
armes, avaient en fait les moyens de payer l'impôt.
On pourrait multiplier les exemples de ce type. Chaque étude
détaillée de terrain révèle qu'en fait, au début du 20ème siècle, la
pénétration ne faisait que commencer. Ainsi, dans les forêts de Basse
Casamance, à l'extrême sud du Sénégal, bien que l'on ait entrepris d'y
lever l'impôt dans les toutes premières années du siècle, il faudra
attendre plus de vingt ans avant de pouvoir circuler librement dans une
sécurité relative: chaque année, la perception donnait lieu à de longues
palabres et souvent à des coups de feu.5
Mais l'exemple le plus net et le plus fréquemment cité de la difficile
domination française est celui de la Côte d'Ivoire où, après une
première phase dite- quelque peu abusivement d'ailleurs - "de con-
quête pacifique" (1903-1907), fondée sur les pourparlers et la palabre,
le Gouverneur Angoulvant (1908-1918) inaugura un véritable plan de
conquête jalonné d'opérations militaires de grande envergure.
Ce qui frappe néanmoins, dans l'ensemble des exemples cités, c'est
le caractère localisé de ces résistances: celles-ci, reflet d'une structure
sociale fragmentée, ne furent guère l'expression d'un peuple en armes
(sinon de minuscules "mini-nations", à la façon des Holli): les foyers,
multiples mais sporadiques, réagissaient par à-coups contre l'agression
politique, économique et culturelle. Cela rend compte à la fois de leur
fréquence et de leur inévitable échec.
b) Les mouvements "politiques"
Très proches des précédents, mais liés à la présence d'une classe
dirigeante susceptible d'assumer la tête du mouvement, voire de l'utili-
5. Ch. Roche, Conquête et résistance des peuples de Casamance (Dakar:
Nouvelles Éditions Africaines, 1979).
41
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
ser à son profit- ce qui pose le problème de savoir ce qui, dans ces
soulèvements, relevait d'une origine ou d'une action populaire- on
peut citer une série de mouvements régionaux qui se déroulèrent de
façon analogue.
Un bon exemple en est constitué par les révoltes qui se succédèrent
chez les Zarma de l'ouest du Niger, entre 1899 et 1906, 6 où un malaise
aiguë tissa des liens réels à travers de vastes régions. L'objectif immé-
diat était certes de chasser les Blancs. Mais il s'agissait aussi de réduire
les chefs alliés au colonisateur - le chef de Say, dont la passivité
équivalait à un ralliement, ou celui de Dosso qui participa aux
opérations de répression.
En fait, dans cette zone bouleversée depuis le milieu du 19ème
siècle par les guerres contre les Peul, on décèle des ondes de courants
complexes sinon ambigus.
Les Européens exploitèrent naturellement les contradictions
existant entre nomades (Peul) et sédentaires (Zarma), autorités tradi-
tionnelles et aristocraties guerrières, pour susciter des ralliements et
diviser les clans: le choc colonial fut alors l'étincelle qui provoqua
l'explosion de tensions antérieures jusqu'alors contenues. Reste à
déterminer dans quelle mesure les mouvements n'émanaient pas, au
départ, des marabouts et des chefs plutôt que des masses populaires,
même si face aux exactions coloniales l'appui de celles-ci apparaît in-
déniable. Ni simplement religieuses, ni strictement politiques, ni
directement liées à la suppression de l'esclavage qui n'intervint qu'en
décembre 1905, ces révoltes n'en cherchaient pas moins à régler des
problèmes internes - réactions différentielles des différentes strates de
la couche dominante, contradictions entre captifs et hommes libres,
sédentaires et nomades, etc. - par le biais d'une nouvelle urgence, celle
du rejet de l'Occident. Mais l'intervention de la colonisation a provo-
qué de nouveaux clivages sociaux tout en aiguisant les anciens; dans ce
contexte, '"l'union sacrée" de tous les Africains ne pouvait être
qu'éphémère sinon impossible.
c) Les mouvements de masse
Dans certains cas, celle-ci est néanmoins intervenue, donnant lieu
à des insurrections massives capables d'embraser une vaste région: il
s'agit alors de grandes révoltes paysannes qui, exprimant le refus global
d'une situation devenue insupportable, furent susceptibles de provo-
quer, par-delà les divergences locales d'ordre ethnique ou politique,
6. Idrissa Kimba, "Guerre et sociétés: les reactions des populations de
l'ouest du Niger face à la colonisation, 1897-1920." thèse de 3ème cycle,
Université Paris VII, 1979.
42
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
l'union de peuples nombreux. Ainsi était réalisé, au moins momentané-
ment, le ralliement de tous derrière les chefs politiques, voire
messianiques, que se donnait le mouvement, soit parce qu'ils apparais-
saient effectivement comme l'émanation des forces rurales dont ils
exprimaient l'exaspération, soit parce que (plus récemment), ils saisis-
saient l'opportunité d'une conjonction provisoire entre une véritable
"jacquerie paysanne" et des desseins modernistes de réforme, voire de
révolution des structures sociales existantes.
Au travers de quelques exemples caractéristiques, on saisit au
cours du 20ème siècle la filiation de ces mouvements qui permettent de
comprendre comment des groupes jusqu'alors distincts, dispersés et
parfois rivaux prennent progressivement conscience, à la faveur d'une
lutte commune, d'un espace géo-politique élargi appelé à constituer la
base des nationalismes contemporains.
Quatre soulèvements majeurs présentent ainsi des traits similaires,
en dépit de leur éloignement dans le temps et dans l'espace: la révolte
Maji-Maji au Tanganyika (1905-1907), la guerre du Kongo-Warra en
Centrafrique (1927-1932), le soulèvement Mau-Mau du Kenya (1952-
1956) et les rébellions congolaises de 1964-1965.
La révolte Maji-Maji
Cette révolte se situe dans la période d'affermissement de la domi-
nation coloniale; elle traduisait le rejet global de cette situation
nouvelle - refus du travail forcé dans les plantations de coton et des
exactions des mercenaires allemands. Le soulèvement embrasa tout le
sud Tanganyika, surmontant de ce fait le morcellement tribal par le
recours à des techniques religieuses ou magiques: au moment où les
sociétés traditionnelles avaient de moins en moins prise sur le temporel,
l'intervention de leaders charismatiques offrait aux populations une
voie pour réintégrer leur histoire; les méthodes ancestrales de guerre
devenant insuffisantes (la révolte de Wahehe l'avait prouvé) le messia-
nisme permettait de leur insuffler une force nouvelle. La révolte Maji-
Maji est ainsi ponctuée de thèmes millénaristes: Kinjikitilé Ngwele, qui
avait le don d'immuniser les guerriers par une eau magique {Maji) qui
transformait aussi en eau les balles allemandes, était envoyé par Dieu
pour sauver le peuple de l'oppression coloniale, tandis que les ancêtres
morts étaient appelés à ressusciter à Ngalambe.
Ce soulèvement se solda par un énorme massacre: sans doute
120.000 morts, qui imprégna la mémoire collective du peuple
tanzanien: son échec même fut un des ferments ultérieurs du
nationalisme.7
7. Ranger, "Connexions".
43
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
La guerre du Kongo-Warra
Le décalage de quelque vingt ans avec la précédente s'explique en
partie par l'immobilisme tardif dans lequel fut maintenue l'Afrique
Équatoriale Française, que les expansionnistes eux-mêmes surnom-
maient "la Cendrillon de l'Empire."
Le foyer du soulèvement fut le peuple Baya, jusqu'alors dispersé en
rameaux diversifiés. Il embrasa le coeur de la fédération, en Oubangui-
Chari occidental surtout, mais aussi dans les zones limitrophes du
Moyen-Congo et du Cameroun. Le pays était meurtri depuis de longues
années par une exploitation particulièrement rude laissée en majeure
partie aux mains du secteur privé, sous la forme de vastes compagnies
concessionnaires qui se consacraient à l'exploitation du caoutchouc et
de l'ivoire, et connues précisément dans cette région par leurs excès.
Karnou, "l'âme de la révolte", fut le catalyseur non d'un mouve-
ment spontané, mais né d'une longue période d'humiliation et de souf-
france. Vers 1924, il entreprit de prêcher une doctrine anti-européenne
fondée sur la non-violence, par le refus du contact et la résistance
passive aux exigences coloniales. L'administration s'en avisa seule-
ment trois ans plus tard, au moment où les partisans de Karnou, de plus
en plus nombreux et convaincus de leur invulnérabilité par le Kongo-
Warra (baton de commandement du prophète) passèrent à la révolte
armée: plus de 350.000 habitants furent touchés, dont environ 60.000
guerriers, dans un élan de solidarité qui fit l'union des villages et des
clans dans une zone caractérisée jusqu'alors par son émiettement politi-
que. Bien que Karnou fût tué dès décembre 1928, l'insurrection se
propagea et se prolongea jusqu'en 1931 où la dernière phase de la ré-
pression, dite "guerre des grottes" fut particulièrement meurtrière. En
1935 encore, les derniers guerriers se cachaient encore dans leur
refuge, refusant d'en sortir par crainte de représailles.8
Par son ampleur, par sa durée, par le nombre des insurgés et des
engagements militaires, ce fut la plus grande insurrection paysanne
qu'ait connu l'Afrique Noire entre les deux guerres. L'administration
ne s'y trompa pas. Si, née dans une société qui n'avait pas encore
dépassé le stade tribal, l'action de Karnou s'appuyait nécessairement
sur les valeurs ancestrales, elle impliquait des revendications
politiques: le refus de collaborer avec l'occupant et surtout l'appel à
l'unité de toutes les ethnies situaient le mouvement à la charnière des
temps nouveaux. Seulement, la dureté de la répression écrasa le pays,
appauvri et déserté. Il ne devait jamais s'en remettre, comme le suggère
l'apathie apparente des paysans centrafricains face aux excès de leurs
8. R. Nzabakomada, "La révolte Kongo-Warra, 1928-1932," thèse de 3ème
cycle. Université de Paris VII, 1975.
44
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
dirigeants: on pourrait dès lors se demander pourquoi, alors que la
rébellion Maji-Maji a nourri les racines idéologiques de la résistance
tanzanienne, le mouvement baya semble, au contraire, avoir été occulté
autant par ses acteurs que par l'historiographie coloniale; il est vrai que
les régimes successifs aboutissant au désastreux Bokassa n'ont guère
permis au nationalisme baya de regermer sur ses ruines.
Les rébellions congolaises de 19649
On pourra s'étonner qu'on ait l'audace de qualifier de "mouve-
ments primaires de résistance" des événements qui survinrent en pleine
indépendance, bien après la deuxième guerre mondiale. C'est que nous
retenons ici non le contexte politique à certains égards révolutionnaire
de l'époque, mais les caractéristiques paysannes du soulèvement du
Kwilu: la réaction des masses rurales fut à la mesure de leur déception.
En 1960, l'indépendance n'avait pas seulement signifié pour elles
la fin d'un système d'oppression, mais aussi le transfert immédiat au
peuple congolais des avantages de la colonisation, sans exclure un
retour mal défini aux coutumes des ancêtres. Elles ne purent ni com-
prendre, ni accepter la détérioration de leurs conditions de vie et le
maintien d'une coercition administrative aggravée par la corruption.
Rurale et ethnique, l'insurrection fut littéralement portée de village en
village par l'espérance que suscitait chez des paysans misérables le mot
d'ordre lancé, au nom de Patrice Lumumba, d'une nouvelle indépen-
dance enfin garante de justice et de progrès social pour tous, contre le
régime corrompu de la classe dirigeante et la misère accrue par une
situation agricole et financière catastrophique.
Mais les bases idéologiques demeuraient confuses: aucune prise de
position claire (sur l'expropriation ou les nationalisations) ne précisait
le contenu de l'expérience socialiste adaptée aux conditions congo-
laises qui devait transformer les bases de la société. Face à ce flou
politique, l'extension sans cesse accrue de l'insurrection paysanne
livrée à elle-même la fit dégénérer vers des formes magico-religieuses
de plus en plus accentuées: Mulele devint un personnage légendaire,
insaisissable et doué d'ubiquïté. Ses partisans, les "Simba" (lions),
s'érigèrent en une caste fermée, à la suite d'un rituel d'initiation qui leur
assurait, grâce aux dawa (médicaments) distribués par les sorciers,
l'immunité contre les balles ennemies en dépit de leurs armes rudimen-
9. Sur la révolte Mau-Mau, se reporter à C. Coquery-Vidrovitch et H.
Moniot. L'Afrique noire de 1800 à nos jours (Paris: PUF. 1974). pp. 234-
35 et consulter R. Buijtenhuijs, Le mouvement Mau-Mau: une révolte
pavsanne et anti-coloniale en Afrique noire (Paris. La Have: Mouton
1971).
45
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
taires. Le terrorisme devint de plus en plus brutal (vagues d'exécutions
publiques à Stanleyville). Il est difficile de savoir jusqu'à quel point les
dirigeants contrôlèrent le mouvement, ou furent au contraire contraints
de le suivre, au gré des forces qu'ils avaient déclenchées; toujours est-il
que ses débordements entraînèrent son écrasement par le retour au
pouvoir de Tshombe et l'action de ses mercenaires.
Cette vaste insurrection à vocation- ou à prétention- révo-
lutionnaire traduisit en tous les cas la conjonction momentanée
entre un projet politique et une authentique révolte des masses rurales,
proche à beaucoup d'égards des jacqueries d'antan. Elle parut un
moment porteuse d'un immense espoir et d'un possible bouleverse-
ment des structures sociales. Mais, paradoxalement, le recours ambigu
aux pratiques traditionnelles pour briser les forces de la technique
moderne la fit déboucher sur une régression généralisée à coloration
xénophobe et raciale.10
Les techniques du sacré: du millénarisme au syncrétisme
a) Messianisme et millénarisme
La révolte primaire s'accompagne presque toujours, on l'a vu, de
traditions charismatiques: le "messie" ou prophète, doté de pouvoirs
magiques - qui lui permettent de prétendre triompher de la supériorité
technique européenne - apparaît comme l'interprète des volontés
divines, au nom desquelles il va prendre l'initiative de la résistance.
La tradition est ancienne. Elle exprime l'irréductibilité du conflit
entre les structures mentales, les données sociales et l'économie occi-
dentale. C'est l'ultime recours d'une société désarmée dont les outils
traditionnels ont échoué- d'où l'apparence souvent tragiquement
suicidaire de ce type d'affrontement. Le premier, et sans doute le plus
dramatique exemple, en fut, dès le milieu du 19ème siècle, le vaste
soulèvement Xhosa d'Afrique du Sud (1856-1857) qui exprimait le
désir désespéré de recouvrer leurs terres des populations Bantu de la
colonie du Cap progressivement refoulées par l'expansion conjuguée
des commerçants britanniques et des agriculteurs Boer descendants des
anciens colons hollandais.
Il exigea une purification radicale mêlant aux pratiques tradition-
nelles une vision apocalyptique héritée du christianisme, le tout prêché
par Mhlakaza assisté de sa nièce Nongquanse qui traduisait à son
peuple le message des ancêtres.
Alors commencèrent le massacre du bétail et la destruction des
récoltes qui affamèrent les Xhosa: durant l'année 1857, la population
10. R.I. Rotberg, The Rise of Nationalism in Central Africa (Cambridge, Ma.:
Harvard University Press, 1965).
46
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
tomba sans doute de 100.000 à 37.000 individus. L'exode entraîna les
survivants vers la colonie du Cap à la recherche d'un emploi salarié;
vers 1870, la majorité de la population travaillait désormais dans les
mines, les chantiers et les ports. Les profondes transformations écono-
miques et sociales qui s'ensuivirent accélérèrent l'acculturation et la
déstructuration du peuple Xhosa.
Cette forme de résistance par suicide collectif peut être opposée
aux réactions de type politique et militaire - comme celle, à peu près
dans le même temps, d'un Shaka. Pourquoi tel peuple opta-t-il pour la
première, et tel autre pour la seconde? L'explication devrait faire
ressortir à la fois le rôle des structures mentales, des valeurs et surtout
de l'histoire différentielle de chacun des groupes concernés. Il est vrai
aussi que la plupart des résistances primaires, même les plus violentes
sur le terrain, apparaissent comme ambivalentes. Les mouvements
d'origine paysanne sont toujours sous-tendus par un messianisme
prophétique qui sacralise et popularise des révoltes du désespoir; le
recours au surnaturel met à nu le conflit qui opposait l'idéologie de la
révolte aux réalités économiques et culturelles, dans un monde rural
que son organisation sociale même, caractérisée par sa dispersion,
rendait inapte à imposer les transformations fondamentales auxquelles
il aspirait.
Or l'échec entraîna l'écroulement des croyances ancestrales et des
valeurs socio-politiques traditionnelles, en même temps que la recon-
naissance de la vanité de la résistance: dès lors, il ne restait plus que le
repli sur "l'imaginaire".
Celui-ci peut revêtir deux formes, parfois mêlées: ou bien le réveil
de forces autochtones occultes de magie et surtout de sorcellerie; ou
bien la récupération du pouvoir de l'adversaire par l'adhésion à ses
techniques et à son idéologie religieuse (d'où la conversion massive aux
religions nouvelles qui apparaissaient comme le dernier refuge d'une
société désemparée, avec l'épanouissement de sectes et d'Églises plus
ou moins syncrétistes, surtout à partir de la première guerre mondiale).
Le mouvement affecta surtout les pays animistes davantage soumis aux
influences chrétiennes, mais toucha aussi, sous des formes spécifiques,
le monde musulman.
b) Sorcellerie et sociétés secrètes
Les forces naturelles des sociétés africaines se révélant ineffica-
ces, une réaction classique fut de recourir aux pulsions maléfiques
(opposées aux forces bénéfiques du culte et des rites animistes présidés
par le prêtre ou "féticheur"). La floraison de la sorcellerie révélait la
profondeur du malaise. Le phénomène était toujours analogue: les
47
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
maux abominables et sans remède apparent dont on se trouvait affligé
étaient attribués à des sorciers, qu'il fallait découvrir et éliminer.
Du même esprit relevait la recrudescence des sociétés secrètes
dont les actes de violence se référaient plus ou moins explicitement à la
sorcellerie, au nom d'un retour farouche aux anciennes coutumes, tels
les Hommes-léopards du Cameroun ou de Centrafrique (Mania et
Banda).11
Les syncrétismes de l'acceptation
Le courant syncrétiste permit en revanche de diluer l'agressivité de
résistance en véhiculant une idéologie de la résignation née de la prise
de conscience du caractère momentanément invincible de la puissance
coloniale.
Franz Fanon a déjà noté que le colonisé se sert de la religion pour
ne pas voir le colon et mieux supporter la colonisation12 (d'où, en
somme, la diffusion d'une sorte d'idéologie politique visant à expliquer,
donc à justifier ou, du moins, à rendre supportable, l'ordre social
colonial).
Cette vision populaire du vécu colonial est appréhendée de façon
éclairante par les mythes de justification qui semblent éclore un peu
partout en même temps et de la même façon.13 Ces récits, recueillis à
l'époque par les administrateurs et les missionnaires, mais en principe
débarrassés de leurs aspects les plus dénaturés mettant en relief la
Bible, le Christ, l'exotisme ou le rôle bienfaisant de la colonisation,
révèlent l'interpénétration religieuse qui permet, au travers de légendes
dont les acteurs sont à la fois des hommes et des divinités, de justifier
les hiérarchies et les pouvoirs en prônant la finalité de l'ordre établi.
Ainsi le schéma récurrent dans de nombreuses sociétés qui met en
scène l'origine des inégalités entre Noirs et Blancs ("l'épreuve de
Dieu" ou le "Bain miraculeux"). Le Blanc en sort toujours vainqueur
(généralement au prix d'une ruse ingénieuse) riche, heureux, et
détenteur du pouvoir. Le Noir est nu, misérable et dominé. Cette
disparité menace d'être durable, puisqu'elle tire ses origines du passé,
et surtout de la volonté divine (d'où l'acceptation provisoire néces-
saire, faite d'impuissance face à une rébellion jugée quasi-sacrilège).
11. A.M. Vergiat, Les rites secrets des primitifs de l'Oubangui (Paris: Payot,
1921: nouvelle édition refondue, 1951). pp. 149-50.
12. F. Fanon. Les damnés de la terre (Paris: Maspero. 1968). p. 41.
13. G. Balandier, "Les mythes politiques de la colonisation et de la décoloni-
sation en Afrique," Cahiers internationaux de Sociologie , n° 33 (1962);
et Jean Merlo, "Sources populaires de lideologie de l'independance en
Afrique noire: mythes africains de la colonisation." thèse de 3ème cycle,
E.P.H.E.. 1967.
48
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Mais l'état d'humiliation et de frustration est atténué par le fait qu'on se
soumet davantage à Dieu qu'aux Européens: au mieux voudra-t-on
participer en partie de leur puissance en annexant leur idéal et leurs
techniques du pouvoir: à savoir leur religion.
L'idéologie de la résignation peut aller de pair avec une idéologie
de la promotion sociale. C'est bien l'objet de la prédication d'un
prophète comme Harris qui, d'origine libérienne, parcourut entre 1913
et 1915 le littoral environnant de Côte d'Ivoire et du Ghana, en
entreprenant de convertir les peuples animistes côtiers à sa nouvelle
religion.
Le Harrisme, mouvement exclusivement religieux, n'eut jamais de
contenu anti-colonial; si l'administration française le réprima néan-
moins (Harris fut expulsé dès 1915), c'est par référence à la concur-
rence politique qui l'opposait traditionnellement au rival britannique.
Car le succès fut immédiat. Des villages entiers se convertirent - sans
doute entre 100.000 et 150.000 individus dès 1918, avec la floraison
d'une quantité de petits prophètes qui suppléèrent au départ du maître.
Pour ces peuples meurtris, la religion restait le seul moyen de défense;
mais l'unique signe de résistance fut, d'une façon assez généralement
significative, l'attirance pour la religion non du colonisateur direct,
mais de la puissance européenne concurrente. On optait pour le
protestantisme en pays de colonisation catholique (Harrisme, Kimban-
guisme), pour le catholicisme dans le cas contraire (Ibo du Nigéria ou
pays Ganda).14
L'essor du Kimbanguisme en Afrique belge fut similaire. Simon
Kimbangou, de souche paysanne, éduqué par les missionnaires, prit à
partir de 1921 conscience de la contradiction existant entre le message
divin et l'application qu'en faisait la colonisation. Mais ce mouvement
chrétien non syncrétiste de promotion par la religion minimisait le
conflit politique puisqu'il impliquait à la fois l'acceptation des valeurs
occidentales et la volonté de modernisme des Kongo par le progrès
économique et technique.15
d) Religion et résistance
En Afrique australe, le refuge religieux des Églises noires séparées
revêtit en revanche l'aspect d'une résistance militante. L'Église
Éthiopienne, fondée dès 1896 sur les compounds sud-africains dans la
14. Voir F.K. Ekechi, "Colonialism and Christianity in West Africa: The
Igbo Case, 1900-1915," Journal of African History 12:1 (1971) nn
103-16.
15. Voir M. Sinda, Les messianismes congolais (Paris: Payot, 1972) et
G. Balandier, Sociologie actuelle de l'Afrique noire (Paris: PUF 1963)
pp. 417-520.
49
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
tradition chrétienne biblique, excluait la filiation par l'Occident et
devint rapidement une arme de contestation idéologique contre
l'aliénation de la race noire. Plus révélateur encore fut l'itinéraire du
Watch Tower, vaste mouvement d'origine américaine (The Watch
Tower Bible and Tract Society) mais qui évolua de façon indé-
pendante, sous le nom de Kitawala en Rhodésie du nord et au
Congo, de Choonadi (la vérité) ou Mpakuta (ceux qui sont à part) au
Nyasaland durant l'entre-deux-guerres. Les prédicateurs, nombreux,
toujours hostiles aux gouvernements blancs, ne prêchaient pourtant pas
la sédition directe. Comme à l'accoutumé, leur message millénariste
annonçait la fin prochaine du monde, quand "les derniers [les Afri-
cains] deviendront les premiers".
La répression fut néanmoins vigoureuse: les prêches furent réputés
illégaux; début 1919, 138 membres influents du mouvement furent
arrêtés en Rhodésie du nord; le Congo belge déporta à son tour, entre
1 932 et 1 939, des centaines d'adeptes afin d'extirper le mouvement des
mines du Katanga. Après les émeutes du Copperbelt en 1935, où les
membres du Watch Tower étaient supposés avoir joué un rôle, l'intro-
duction et la vente de toute littérature Watch Tower fut interdite sur
l'ensemble des territoires jusqu'en 1946. Mais le mouvement continua
sa progression, au nom de l'alternative aux dures réalités de la loi
coloniale.16
La contestation religieuse fut alors, et peut-être surtout, dans des
pays souvent marqués par leur morcellement politique et par la disper-
sion de l'habitat, le seul ciment unitaire possible permettant à des
paysans, à l'organisation sociale dispersée et aux structures politiques
inexistantes, de faire corps, au nom d'une idéologie commune, en dépit
de toutes les forces centrifuges traversant un groupe qui n'avait jamais
été uni jusqu'alors, mais devenu désormais solidaire. Ainsi, au cours de
la deuxième guerre mondiale, vit-on pour la première fois prendre
forme la résistance commune de l'ensemble des Diola de Basse
Casamance, galvanisés par la prêtresse Alintsinoé qui anima la "guerre
du riz" menée contre les exigences de l'effort de guerre.
Incontestablement, ces Églises exprimaient une contestation non
seulement religieuse, mais sociale et globale. Elles constituaient, ce
faisant, un chaînon évident reliant les mouvements de résistance
"primaires" aux nationalismes modernes.
e) Les limites du millénarisme
Mais la tentation millénariste, par son ambiguïté, put aussi agir
16. Voir Rotberg. The Rise, pp. 136-42.
50
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
comme un frein. Tout en puisant sa force dans la tradition de résistance
des masses rurales, elle était susceptible, au nom de la référence au
passé, de dévier, voire de faire avorter des mouvements de contesta-
tion d'inspiration plus modernisante; ce fut le cas du Matswanisme du
Congo.
Au contraire des précédents, le mouvement démarra en effet sous
une forme politique. André Matswa, ancien tirailleur qui avait fait la
guerre du Rif, devenu au contact des milieux anti-coloniaux français
conscient des problèmes de l'exploitation en Afrique, fonda en 1926, à
Paris, l'Association amicale des originaires de l'A.E.F., groupe de
rencontre et d'entente dont le programme immédiat était de rassembler
en une seule communauté l'"élite" congolaise. Tandis que Matswa
adressait au Président Poincaré une lettre ouverte dénonçant le Code
de l'Indigénat, les abus des grandes sociétés de commerce et la misère
de la population noire, le prétexte d'intervention fut la collecte de fonds
organisée pour financer l'information et la propagande du groupe en
A.E.F., où il comptait quelque 13.000 militants. Matswa fut accusé
d'escroquerie, arrêté fin 1929 et transféré à Brazzaville où il fut
condamné, par le tribunal indigène, à trois ans de prison et dix années
d'interdiction de séjour.17 Malgré un mouvement spontané de grève
générale (abandon de travail, chantiers et commerces vidés, refus
d'approvisionner la ville) le mouvement, passé dans la clandestinité, ne
réussit guère à se réorganiser, en dépit d'un bref intermède de tolé-
rance au moment du Front Populaire (1935-1936).
C'est tardivement, après la mort de Matswa (1942), que ses
partisans s'évadèrent dans l'imaginaire. Les Lari- ethnie dont il était
issu - refusèrent d'admettre sa mort d'autant que, enterré clandestine-
ment le jour même du décès sans avoir été inhumé rituellement, il ne
pouvait, selon la tradition, être reconnu tel. Tout s'organise autour de
son retour, qui apparaît comme une déviation du culte des morts, acte
religieux par lequel se maintient le contact entre les vivants et André
Matswa, par un conditionnement affectif collectif; car la popularité du
mouvement fut extrême. Il regroupe quelque 30.000 fidèles dont le
premier Président du Congo, Fulbert Youlon, Lari lui-même, chercha à
utiliser le poids politique. Mais il ne s'agit plus, en fait, d'un courant
réformiste d'esprit syndicaliste: le mouvement, fondé à l'origine sur
l'idée nationale congolaise, a régressé sous la forme d'une secte reli-
gieuse à vocation ethnique, qui retrouve, avec plusieurs décennies de
décalage, les accents millénaristes du début du siècle qui l'ont vidé de
son contenu politique dynamique.
17. Sinda, Les messianismes congolais.
51
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Le rôle ambigu de l'Islam: idéologie populaire
ou idéologie du pouvoir?
Les pays musulmans (c'est-à-dire l'ensemble de la zone souda-
nienne qui s'étend de l'ouest sénégalais à la Corne orientale de l'Afri-
que, mais aussi la plus grande part de la côte orientale et un
pourcentage croissant des populations de la zone forestière guinéenne)
présentent face à l'Occident une idéologie structurée difficile à ébranler
car elle lie de façon intrinsèque les domaines religieux, politique et
culturel. L'Islam a donné une coloration spécifique aux réactions
contre la colonisation, issues de systèmes souvent plus institutionnel-
lement hiérarchisés, où pouvaient affleurer de façon plus nette les con-
tradictions existant entre les pulsions paysannes et les intérêts des
aristocraties dirigeantes.
a) L'Islam pré-colonial: un instrument d'État
L'ambiguïté remontait à l'époque pré-coloniale. Durant plusieurs
siècles, l'Islam était surtout apparu comme un appareil de pouvoir
réservé aux classes dominantes.
Certes, l'Islam devint aussi, au travers de la Jihad, une formule
mobilisatrice de rénovation de l'ordre social du moment répondant
assurément au défi que l'Occident diffusait (même si c'était encore de
façon indirecte et filtrée) depuis la côte.
Au long du 19ème siècle, il accusa son caractère interne de révolu-
tion politique. L'élite urbaine fit alliance avec les éleveurs Peul gagnés
à leur tour pour mettre à profit un terrain social explosif. Le recours
salvateur à l'Islam se propagea comme une traînée de poudre au travers
d'une bonne partie du paysanat animiste traditionnel, permettant
l'émergence de théocraties militaires à base populaire. Ainsi, à partir
de 1804, l'expansion d'Ousman dan Fodio regroupa les cités-États du
pays Haoussa et fut, au nom de la Foi, à l'origine de l'édification des
grands émirats du Nigéria septentrional. Ainsi s'épanouirent l'hégé-
monie du Macina dans la boucle du Niger (1817-1819), de Musa Molo
chez les Mandingues de Gambie.18 etc.
Un des meilleurs exemples de cette réponse à la fois politique,
religieuse et militaire au défi européen fut le projet d'El Hadj Omar.
Si elle ne fut pas l'expression d'une "resistance" militante, l'entre-
prise omarienne n'en constituait pas moins une réponse africaine
cohérente à une situation politique et social de crise. Mais la réponse
était aussi moins novatrice qu'il n'y paraissait: en cherchant à unifier
18. M.A. Klein. "Social and Economic Factors in the Muslim Revolution in
Senegambia." Journal of African History 13:3 (1972), pp. 419-41.
52
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
les communautés musulmanes purifiées dans un cadre multinational
mais unique, elle renouait, en définitive, avec une tradition politique
interne ancienne, puisqu'elle remontait au Moyen-Âge.
Comme par le passé, une fois l'État écroulé, rien n'en survécut sur
le plan politique; néanmoins, l'oeuvre d'Oumar Tall marqua la
conscience populaire. La Révolution musulmane qu'il avait contribué à
propager allait fournir dans les années à venir, dans une certaine
mesure, les bases de la volonté de résistance contre la colonisation,
même si les structures mêmes qu'il avait suscitées, fondées sur la
soumission à une aristocratie religieuse fortement charpentée, devaient
se prêter ultérieurement à une "récupération," voire une manipulation
par le pouvoir colonial.19
b) L'Islam résistant
Idéologie dominante des formations politiques soudanaises à la
veille de l'agression coloniale, l'Islam peut-il donc être regardé comme
un instrument potentiel durable de résistance?
À vrai dire, dans le cadre colonial, l'Islam commença plutôt par se
manifester comme un outil de pénétration par l'alliance des chefs avec
le nouveau pouvoir. L'administration britannique eut tôt fait, sur
l'exemple fameux du Nigéria du Nord, de s'assurer la collaboration
efficace des émirats par une politique respectueuse de leur pouvoir
local et de la culture islamique (notamment par l'absence des écoles
missionnaires). L'attitude du colonisateur français fut nettement plus
ambigüe, parce que l'impérialisme français se heurta de plein fouet aux
tentatives hégémoniques d'Ahmadou, de Samori ou de Rabah, et parce
que le modèle de référence était l'Afrique du Nord, où l'Islam s'était
imposé comme une force constituée qu'il fallait surveiller et encadrer.
En réalité, la puissance coloniale prêtait au monde musulman une
unité de pensée et de stratégie que celui-ci était loin de posséder.
Avec l'effondrement ou le ralliement des principaux États, l'Islam
ne devint ferment de résistance que s'il fut repris par les masses popu-
laires sous l'action de nouveaux leaders religieux soucieux de se
démarquer des anciens responsables compromis par leur défaite et leur
politique de collaboration: ce fut le rôle fréquent du "parti des
marabouts" qui, au tournant du siècle, organisa la résistance dans les
royaumes Ouolof ou bien, jusqu'à la première guerre mondiale au
moins, prit çà et là la tête de soulèvements locaux. C'était, en somme,
la version "islamique" des révoltes populaires, certes par certains
1 9. Sur El Hadj Omar, les mises au point les plus récentes sont les études de
S. M. Cissoko et B. Barry dans La revue sénégalaise d'histoire (Dakar) 1:1
(1980), pp. 39-69 et 70-81.
53
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
aspects profondément ancrés dans la tradition mahdiste musulmane,
mais aussi restés très proches d'un terroir imprégné de culture animiste,
où les paysans étaient prompts à saisir l'opportunité ainsi offerte de
secouer concrètement le joug colonial.
Ces mouvements de "jihad populaire" sont donc tout-à-fait
analogues aux rébellions qui essaimèrent à la même époque et pour les
mêmes raisons à travers l'Afrique noire toute entière; le mahdisme qui
en sous-tendait les formes multiples de résistance spontanée sur le
terrain relevait du même phénomène que celui du "messianisme"
récurrent de l'histoire du Christianisme aux époques de mission, et du
"millénarisme" des mouvements animistes ou syncrétistes africains
dans leur ensemble. Il s'agissait dans tous les cas d'une lutte sociale
désespérée, en partie livrée dans l'imaginaire, en rapport avec la fin du
monde et l'apparition d'un Justicier précédée et annoncée par de grands
malheurs dont la conquête européenne était le prototype; les oppres-
seurs seraient en définitive vaincus grâce au triomphe d'une foi puri-
ficatrice et populaire.
Sous ce nom, le mahdisme s'épanouit dès les prémisses de la con-
quête dans le Soudan nilotique, où il prit assez vite la forme d'un
mouvement politique récupéré par les couches dirigeantes. C'était,
certes, le résultat d'une puissante montée religieuse à la fois réformiste
et mystique, mais surtout l'expression d'un mouvement nationaliste
soudanais qui fut finalement écrasé en 1896-1898 par la conquête
anglo-égyptienne .
Mais la mahdisme fut aussi une des constantes (encore peu
étudiée) de la première phase coloniale, notamment dans toute
l'Afrique de l'ouest où il ne dépassa guère le niveau de mouvements
disséminés et fragmentaires, mais qui conservèrent de ce fait leur
caractère populaire spontané, marqué par certaines aspirations
sociales: l'affirmation de l'égalité de tous les Musulmans, le rejet de
l'aristocratie établie (notamment celle de l'oppression extérieure, mais
aussi parfois celle des pouvoirs coutumiers), le recours à la violence
répondant à l'appel des masses, enfin le rôle souvent joué par ce qu'on
pourrait appeler les "déclassés sociaux", aussi bien de l'ordre tradi-
tionnel que, de plus en plus, de l'ordre colonial.20
Les exemples en sont multiples. La plupart du temps, la résistance
présentait une combinaison complexe de courants religieux et
ethniques mêlés à des facteurs socio-économiques et politiques. Au
Niger, l'insurrection de l'Air (1916-1917) est à cet égard exemplaire.
20. A. Le Grip, "Le Mahdisme en Afrique noire," L'Afrique et l'Asie, n° 18
(1952), pp. 3-16; Th. Hodgkin, "Mahdisme, messianisme et marxisme
dans le contexte africain," Présence africaine, n° 74 ( 1 970), pp. 1 28-53; et
l'article "Mahdi" de l'Encyclopédie de l'Islam.
54
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Au nom de l'Islam, elle fit momentanément la jonction entre deux
courants au moins: d'un côté l'exaspération populaire exacerbée par la
grande sécheresse des années 1913-1914 (l'une des plus grandes
jamais connue au Sahel, qui fit plusieurs milliers de victimes dans le
Moyen Niger et décima le cheptel au moment précis où l'effort de
guerre incitait les Français à faire réquisitionner le mil et les chameaux
par des interprètes-intermédiaires imposés qui cristallisèrent la haine
des autochtones); de l'autre, le mécontentement du Sultan d'Agadès,
pourtant considéré comme soumis, mais agressé à la fois sur le plan
culturel et dans ses intérêts économiques puisque l'intrusion coloniale
désorganisait le trafic saharien et entravait la perception des droits
coutumiers dont il avait vécu jusqu'alors. Il serait donc tout-à-fait
insuffisant de ne voir dans la révolte qu'un mouvement d'inspiration
religieuse. Il y eut "front commun". Mais il était instable, voire
illusoire en raison de la diversité des intérêts en jeu: système social
Touareg, intérêts du Sultan - pas nécessairement anti-français - ou
rigorisme sénoussiste orienté vers l'est. Même si rezzous et contre-
ressous ne cessèrent de se succéder jusqu'en 1931 dans le nord-est
désertique dont les oasis furent ruinées, la répression immédiate fut
impitoyable: tous les marabouts d'Agadès furent décapités.21
Ce ne fut pas un hasard: d'un bout à l'autre du Sahel sévit chez les
autorités françaises, en ces années de guerre, une véritable psychose
anti-musulmane qui contribua sans doute, ultérieurement, à exagérer
dans l'historiographie le poids spécifique du facteur religieux.
c) Le repli religieux
Au tournant de la première guerre mondiale, la politique orchestrée
de répression anti-musulmane contribua assurément à convaincre les
croyants du caractère désespéré de l'action directe. L'évolution
chronologique fut en tous points comparable à celle des pays animistes
et l'on décèle les mêmes tendances qu'ailleurs à sublimer les contra-
dictions du vécu colonial par la quête salvatrice de nouvelles voies
religieuses. Ce fut le mode privilégié de la Taquiyya, ou prudence,
autorisant les sectes persécutées à négocier une sorte d'"exil inté-
rieur," qui apparaît à bien des égards comme la version musulmane
d'une idéologie de la résignation.
21. Voir F. Fuglestad, "Les révoltes des Touaregs du Niger," Cahiers d'Étu-
des Africaines 13:49 (1973), pp. 82-120; J.L. Dufour, "La révolte touarè-
gue," Relations Internationales, n° 3 ( 1 975). pp. 55-77; et A. Salifou.
Kaouassan: ou, la révolte Senoussiste, Etudes Nigériennes, n° 33
(Niamey: Centre nigérien de recherche en sciences humaines, 1973)
p. 197.
55
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
La différence majeure fut l'utilisation qu'en fit le colonisateur.
Contrairement à ce qui se passa en pays animiste où l'administration
eut toujours à rejeter et à réprimer les manifestations de la religiosité
africaine, la vocation traditionnellement politique de l'Islam le fit
souvent regarder par le pouvoir colonial comme un instrument com-
plémentaire de domination (ce qui n'empêcha pas non plus, dans
certains cas privilégiés, l'Islam de prendre l'allure d'un mouvement de
résistance, au moins sur le plan idéologique).
Le repli intellectuel favorisa surtout l'essor de réactions idéologi-
ques de type défensif, sous une forme transcendée, affective et
littéraire: certains poèmes du Fouta Djalon, lus à cette époque dans les
villages, témoignent de ces marques d'une culture, d'une littérature de
résistance islamique.22 Mais la forme la plus caractéristique fut
l'émergence de véritables structures d'accueil et de refuge - les
confréries.
Celles-ci, offrant un cadre substitutif sécrété sur les ruines des
anciennes chefferies, garantissaient à la fois un sentiment d'identité et
un espoir. La confrérie apparaissait bien, de ce fait, comme une
réponse à l'impérialisme, sous la forme d'un contre-pouvoir ambigu, le
chef maraboutique apparaissant à la fois comme un écran protecteur
pour les fidèles et comme un interlocuteur valable pour le colonisateur.
C'est pourquoi une double évolution était possible: le mouridisme
évolua vers la collaboration, le hamallisme vers la résistance.
Le fondateur de la secte Mouride, Amadou Bamba, n'en avait pas
moins commencé par être inquiété par les Français. Néanmoins, de
retour en 1912 à Djourbel (Sénégal) de l'exil mauritanien où l'avait,
après le Gabon, confiné la vindicte coloniale, son attitude pacifique
incita l'administration, face au succès grandissant de son message, à
changer de tactique en inaugurant un ère de coopération.
Si Amadou Bamba continua pour sa part, jusqu'à sa mort (en
1927), de se cantonner dans la méditation, son entourage et ses
disciples saisirent rapidement l'opportunité offerte par la bienveillance
coloniale d'utiliser à leur profit la force de travail que constituait la
masse des fidèles (bientôt 100.000) dans une zone ouverte à la culture
arachidière. L'aristocratie mouride institua un régime autoritaire de
type néo-féodal en attachant les paysans à la terre et en s'assurant, par
leur docilité, un pouvoir économique qui en fit les partenaires
privilégiés du pouvoir colonial et, plus généralement, du pouvoir d'État.
Encore aujourd'hui, les lois et règlements de l'État sénégalais ne sont
respectés sur leur territoire, que sous réserve de l'assentiment du
22. Voir transcrites par G. Vieillard, Bulletin du Comité d'Études Historiques
et Scientifiques de l'A.O.F.
56
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Cheik Abdoul Ahat M'Bakhé, héritier du prophète et khalife des
Mourides depuis 1968. 23
L'évolution fut loin d'être unique. Au sein de la confrérie
Tidjaniyya, les grands chefs traditionnels furent prompts à manifester,
de façon analogue, leur ralliement à la cause française qui leur
paraissait offrir le cadre favorable à leur expansion religieuse garante
de l'ordre social. Dans les années 30, les autorités coloniales favori-
sèrent donc la tournée en A.O.F. (Afrique ouest française) du grand
marabout Seydou Nourou Tall, petit-fils d'El Hadj Omar. En l'escor-
tant et en le recevant dans les principaux centres urbains, elles souli-
gnaient la présence de communautés musulmanes à la fois dynamiques
et soumises et encourageaient leur emprise unitaire; ainsi était utilisé le
pouvoir "immobilisateur" d'une idéologie requérant, au nom de
l'obédience religieuse, la docilité de l'ensemble des fidèles.24
C'est parce qu'il apparut comme l'adversaire de ce courant que
Hamallah ne cessa, pour sa part, d'être inquiété par l'administration
coloniale. Comme souvent, sa prédication démarra à la faveur de la
crise que vivaient les éleveurs de la région de Nioro (Soudan français,
aujourd'hui Mali) aux prises, vers 1913, à la sécheresse entraînant
disettes et épidémies. Le colonisateur n'en continuait pas moins
d'exiger la taxe de pacage ( Zakat ), contribution coranique dont la
perception par des Infidèles était ressentie comme un sacrilège, et à
imposer la carte de circulation afin de contrôler le déplacement des
nomades. Ce déséquilibre économique et social, présenté par les
marabouts comme le châtiment de Dieu, était éminemment favorable à
l'émergence d'un mouvement de type mahdiste.
La doctrine de Cheik Hamallah fut, à l'origine, strictement reli-
gieuse; il se référait à la Tidjaniyya, mais à la condition d'un retour à la
pureté originelle, notamment par le choix des formules de récitation des
prières (à "onze grains" au lieu de douze). Mais il serait dérisoire d'en
faire une simple affaire de nombre de grains: en fait, il s'agissait bien de
divergences révélatrices de la mise en contestation des dignitaires du
Tidjanisme omarien ralliés, pour la plupart, à la collaboration avec la
puissance coloniale. Ce furent d'ailleurs les cadres Tidjani tradition-
nels, menacés dans leurs privilèges, qui furent les premiers à réclamer
des mesures de répression: en 1925, l'administration expulsa Hamallah
pour dix ans en Mauritanie puis, à la suite de nouveaux troubles, en
Côte d'Ivoire.
23. Voir à ce propos, D. Cruise O'Brien, The Mourides of Senegal (Oxford-
Clarendon Press, 1971); et J. Copans, Les Marabouts de l'arachide
(Paris: Le Sycomore, 1980).
24. J.L. Triaud. "La question musulmane en Côte d'Ivoire."' Revue Française
d'Histoire d'Outre-Mer 51:225 (1974), pp. 542-71.
57
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
C'est là, autour des années trente, que le mouvement prit une allure
de contestation sociale qui ne récusait pas l'action violente. Le courant
fut animé par Yacouba Sylla qui intégra à sa prédication des revendi-
cations sociales égalitaires appelant à la suppression des castes et à
l'émancipation des captifs (mais à la claustration des femmes), et des
injonctions économiques somme toute analogues aux préoccupations
mourides: finalement déporté en Côte d'Ivoire, il y organisa, au sein de
la communauté de Gagnoa, un véritable petit empire économique et
commercial.
Quant à Hamallah, de retour au Mali, il fut accusé en 1940 d'être
responsable de violents antagonismes tribaux, déporté en Algérie puis
en France où il mourut en 1943. Bien que sa succession spirituelle ne
fut pas revendiquée, il fut à l'origine d'un mouvement qui diffusa dans
toute l'Afrique occidentale. Il était devenu, peut-être malgré lui, parce
qu'il répondait aux aspirations encore confuses des populations du
Sahel à la liberté, un symbole de ralliement des forces d'opposition
latentes à la présence coloniale. Il n'eut pas, à proprement parler, de
rôle politique, aucune instance hamalliste n'appela officiellement,
après la guerre, à un ralliement R.D.A., mais la solidarité de fait dans
la répression et l'action personnelle de Yacouba Sylla incita beaucoup
de ses adeptes à rejoindre le parti nationaliste naissant.25
C'est que l'ère de la Taquiyya et des confréries-refuges tirait à sa
fin. Au tournant de la deuxième guerre mondiale, l'Islam chercha, au
sein des mouvements politiques, syndicaux et nationalistes naissants, à
offrir une nouvelle réponse possible, susceptible de puiser ses modèles
de lutte aussi bien en Orient qu'en Occident: le "réformisme
musulman" d'Afrique noire se rattacha dès lors à un courant dont
l'essor dans le monde arabe remontait en fait au 19ème siècle. Cette
composante originale des mouvements de libération s'implanta et se
développa surtout dans le monde manding (Mali, Guinée, Côte
d'Ivoire). Peu étudiée jusqu'à présent, elle exprimait en particulier les
aspirations de la bourgeoisie dioula, soucieuse d'offrir des méthodes de
libération culturelle spécifiques, notamment par le développement d'un
système d'enseignement compétitif en arabe. Si cette forme de
résistance islamique avorta, pour l'essentiel, après 1950, elle connaît
depuis peu un renouveau différent mais vigoureux, encouragé à la fois
par la révolution religieuse iranienne (mouvement Jeune Mouride par
25. Voir ibid.; P. Alexandre, "Hamallism in French West Africa," dans
Protest and Power in Black Africa, eds. R.I. Rotberg et A.A. Mazrui (New
York: Oxford University Press, 1970), pp. 497-512; Alioune Traoré,
"Cheikh Hamahoullah (c. 1883-1 943?) ou la résistance pacifique dans
cherif mauritanien," dans Les Africains, ed. C.-H. Julien (Paris: Jeune
Afrique, 1978), vol. 9, pp. 81-108.
58
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
exemple) et la propagande active et généreuse de la Lybie de Khadafï
(don et construction de mosquées et d'universités arabes). La filiation
est donc ici évidente qui mena de la contestation religieuse à l'action
politique contemporaine.
En guise de conclusion: Paysans, révolte et révolution
De cet ensemble à la fois confus et foisonnant, que conclure?
D'abord, que si les aristocraties locales ont cherché, à travers les
temps, à préserver ce qu'elles pouvaient de leurs privilèges en
acceptant bon gré mal gré l'insertion dans les nouveaux cadres qui leur
étaient offerts, voire en apprenant à les manipuler à leur profit,
l'Afrique des profondeurs n'a jamais accepté la colonisation: tout au
plus l'a-t-elle subie, comme eile avait déjà subi avant elle nombre
d'autres dominations plus ou moins contraignantes, plus ou moins
despotiques. Une première césure apparaît donc, qui permet de diffé-
rencier des autres formes de résistance les mouvements paysans.
Ces mouvements, qui troublent le monde agricole "traditionnel",
furent dirigés d'abord contre les abus de l'oppression coloniale, qui
durcit avec l'apparition puis l'extension du capitalisme à la campagne:
fiscalité accrue, travail obligatoire, évictions, usurpations de terres et
appropriation privée de biens naguère communautaires produisirent,
accentués par les crises conjoncturelles, les agitations les plus amples
et les plus violentes. Ce furent des mouvements ambigus, à la fois
progressistes (parce qu'ils réclamaient la libération des hommes et du
travail) et conservateurs (par leur "passéisme"), le plus souvent
pimentés d'un millénarisme propre aux "émotions" des temps pré-
capitalistes, comme en témoigne, partout, l'histoire des mouvements
paysans, en Europe comme ailleurs.26 Ce refus du présent, sur un fond
de résistance sourde ou ouverte, devient épisodiquement massif et
violent, en fonction de conjonctures brutalement aggravées, coloré
(puisque l'étranger domine le pays) de xénophobie, voire d'un
nationalisme naissant intégrant le monde paysan à une identité qui
s'affirme peu à peu. Mais, en règle générale, ces rébellions sont peu
organisées; même si le chef est massivement suivi (cas des jihads), les
structures demeurent floues et les objectifs rarement définis, ne serait-
ce qu'à moyen terme.
Au total, ces mouvements paysans furent légion, d'autant qu'il ne
faudrait pas omettre toute une frange d'actes de refus, pacifiques
26. Commission internationale d'histoire des mouvements sociaux et des
structures sociales (1SMOS), Les Mouvements paysans dons le monde
contemporain (Naples: ISMOS, 1976), 3 vols. Voir compte rendu de
Y. Rinaudo. Le mouvement social, n° 113 (oct.-dec 1980). pp. 114-17.
59
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
comme la fuite ou l'émigration, ou violents comme le banditisme social
qui sévit dans de nombreuses régions d'Afrique (comme au Sahel ou au
Mozambique).27
C'est dire, face à ce foisonnement, l'intérêt d'une typologie. On
peut certes distinguer les formes passives (fuites individuelles et collec-
tives, émigration, banditisme) des formes actives de résistance (les
révoltes); on pourrait aussi distinguer, en fonction des motivations,
a) les troubles de subsistance, liés à l'alourdissement de la conjoncture
qui, en temps de crise, rend insupportables les pressions exercées sur la
paysannerie, b) la lutte pour la terre coutumière et la défense des droits
"traditionnels", c) les émotions fiscales, d) la résistance à l'enrôle-
ment, e) la brimade religieuse, ou ressentie comme telle.
Notons néanmoins que, sauf dans le cas particulier de l'Éthiopie, la
finalité de l'agitation paysanne ne s'est guère traduite par l'exigence
(pourtant si généralement exprimée ailleurs) de la réforme agraire -
signe d'une spécificité africaine, révélatrice d'une moindre conscience,
sinon aujourd'hui d'une moindre existence, de l'accaparement foncier.
Il va de soi que la complexité de bien des mouvements les rattache
à plusieurs de ces catégories. En fait, les mouvements paysans (mouve-
ments de contestation, mouvements de refus, mouvements de refuge)
prirent de l'ampleur et changèrent de tonalité en fonction d'une con-
jonction de facteurs dont l'analyse rend compte de la diversité des
formes repérables.
Le modèle d'organisation politique a certes joué: sauf dans le cas
relativement exceptionnel d'une structure politique "nationale", il
semble que ce soient les sociétés les plus segmentates qui aient été les
plus promptes à regimber, parce que les plus rebelles à l'État; ce sont
celles, aussi, où les mouvements furent les plus populaires (au sens
plein du terme) mettant au premier plan des forces jusqu'alors in-
soupçonnées (rôle des femmes, ou de leaders sortis du peuple que ne
prédisposait antérieurement ni leur fonction de chef ni leur niveau
d'érudition).
Moins inégalitaires, ces sociétés étaient aussi les plus dispersées;
leur organisation sociale même ne les mettait guère en mesure d'im-
poser les transformations que la révolte présentait comme nécessaires.
Les régulations internes habituelles se révélaient incapables de
résoudre les tensions accentuées provoquées par l'intrusion des
exigences et des réseaux coloniaux: d'où le recours inévitable au
surnaturel, à la pression religieuse et à la sorcellerie, qui apparaissait
dès lors comme la seule échappatoire possible.
27. Voir Allen Isaacman, "Social Banditry in Zimbabwe (Rhodesia) and Mo-
zambique, 1894-1907: An Expression of Early Peasant Protest." Journal
of Southern African Studies 4:1 (1977). pp. 1-30.
60
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Le contexte religieux du groupe jouait en effet son rôle. Parfois la
religion devint porteuse d'un message de contestation sociale, même si
le cas paraît relativement rare. À l'opposé, une idéologie de soumis-
sion la plus totale à la volonté divine put constituer, aux mains de
médiateurs fougueux, un ferment de révolte redoutable.
Le niveau de développement et d'intégration à l'économie moderne
intervint également dans un sens ou dans l'autre, soit (cas le plus
fréquent) que le groupe, n'ayant rien à perdre de ce qu'il ne connaissait
guère, rejetât tout en bloc, soit qu'il cherchât, dans un premier temps, à
ménager ses propres profits, ou qu'il se jugeât (plus tard) par trop
exploité par le système dominant.
Enfin intervint le style de la colonisation, plus ou moins brutale,
plus ou moins favorable à une politique de collaboration, et plus ou
moins habile à la mettre en œuvre. On voit la difficulté qu'il y aurait à
vouloir classer les peuples en fonction d'une hypothétique "aptitude à
la révolte"; le phénomène est d'autant plus complexe que, comme les
facteurs ci-dessus évoqués, il a pu varier pour le même groupe suivant
les époques et les facettes de son histoire.
Mais, de ces mouvements paysans, il demeure une constante, et ce
jusqu'à nos jours: la communauté rurale, le plus souvent "villageoise",
qui sur le plan local et régional appartient, par des liens complexes et
anciens, à un tissu social solidaire, est organisée "contre": autrefois
contre le chef, naguère contre le "commandant", aujourd'hui contre le
fonctionnaire. Quel qu'il soit, le pouvoir supérieur englobant (bref,
l'État) s'est toujours manifesté par ses impératifs, rarement ou jamais
par ses dons ou ses bienfaits immédiats, sinon dans le souvenir idéalisé
du "temps d'avant." Les résistances paysannes, pas plus qu'elles ne le
furent dans le passé, n'apparaissent aujourd'hui comme porteuses d'une
révolution politique, si l'on entend par là la substitution à l'État
existant, honni en tant que tel, d'un Etat nouveau, aussi juste soit-il
(non corrompu, socialiste, ou autre). Meurtris depuis un siècle au
moins, et plus probablement depuis les débuts de leur histoire par les
exigences sans cesse accrues des pouvoirs successifs, les paysans
africains souvent aux limites de la survie aspirent, aujourd'hui comme
hier, et peut-être plus qu'hier, non pas à changer le pouvoir, mais à le
rejeter, c'est-à-dire, et faute de mieux, le plus souvent à l'ignorer. C'est
tout le problème de la "prise de conscience" paysanne dont les
intellectuels révolutionnaires s'obstinent à déplorer l'absence: vouloir
changer l'État, ce serait changer de maître; à quoi bon? L'accélération
même de l'histoire en ce domaine pourrait tendre à leur donner raison.
Et le dialogue qui met face à face, dans nombre de prisons africaines,
l'intellectuel révolutionnaire et le paysan rebelle s'avère difficile, sinon
impossible. C'est bien la raison pour laquelle, en son temps, la concep-
61
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
tion populiste, rurale et décentralisée de l'insurrection en Guinée
Bissau avait soulevé tant d'espoirs: Amilcar Cabrai avait compris, et
mis en pratique, la nécessité de donner la priorité à la commune rurale,
centre de lutte mais aussi centre de décision et de formation.27 De
même, l'insurrection paysanne éthiopienne a, au moins un moment,
réussi sa réforme agraire parce qu'elle l'a faite par elle-même et pour
elle-même, submergeant pour un temps les initiatives du pouvoir
central.
Seulement, le contexte économique et politique, aussi bien africain
qu'international, est tel que les équipes au pouvoir, quelles que soient
leurs options idéologiques, n'ont pas le choix, ou du moins, estiment ne
pas l'avoir. Leur objectif, à court terme, est la constitution de / 'État-
nation: un État-nation unitaire, luttant contre les multiples forces
centrifuges internes - ethniques, c'est-à-dire linguistiques et culturel-
les - pour répondre aux agressions extérieures (dépendance économi-
que et menaces politiques et militaires). C'est le drame d'un pays
comme le Mozambique qui, face à ses 3,600 kilomètres de long sur une
largeur parfois inférieure à cent kilomètres, face surtout à la menace
sud-africaine et à la stratégie soviétique en Afrique, se voit contraint
d'imposer unitairement à ses masses rurales la langue nationale de
l'ancien colonisateur, le rejet des coutumes ancestrales et la générali-
sation autoritaire centralisée du système des villages communautaires.
Il serait naïf, dans ces conditions, de croire à l'"adhésion massive"
continue des masses rurales à l'État révolutionnaire, sauf si, en échange
(cas difficile et rare), les gains sociaux progressent suffisamment.
Ceci dit, les mouvements paysans ne sont plus, et de loin, les seuls
à exprimer le malaise et les aspirations des Africains. Tous les mouve-
ments dits "primaires", c'est-à-dire qui, en définitive, se référaient
prioritairement au fond culturel et politique autochtone, essentielle-
ment rural, pour tenter de remédier à la situation coloniale, évoluèrent
pendant la plus grande partie du 20ème siècle dans un contexte de
bouleversements politiques, sociaux et idéologiques qui les amenèrent
à cohabiter, et surtout à interférer, avec les mouvements dits "moder-
nes", syndicaux et nationaux qui se développèrent aussi dès les années
20, d'abord dans les concentrations ouvrières minières puis surtout
dans les villes. Or ouvriers et citadins encore mal stabilisés
continuaient d'appartenir au monde rural où le travail migrant
temporaire les ramenaient périodiquement. Aux indépendances, t
ces éléments imbriqués les uns aux autres constituèrent les bases de
partis politiques, dont les techniques "parlementaires" à l'occiden
se greffèrent sur un fond complexe où se mêlaient de façon chaotiq
28. Voir G. Chiliand, La lutte armée en Afrique (Paris: Maspero. 196
62
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
références religieuses, courants millénaristes et charismatiques et
techniques de l'imaginaire face à l'exigence immédiate de changements
née de la prise de conscience d'une intense exploitation économique
aboutissant à une profonde misère sociale. D'où, au niveau populaire,
une incroyable confusion mentale et sociale, qui faisait, et fait encore,
que l'on votait pour son chef, son marabout, voire son prophète, autant
que pour le leader politique qui se réclame du modèle démocratique
européen tout en jouant à fond sur l'ensemble des données dont il peut
disposer. On comprend dans ce contexte à quel point l'évolution
politique récente est redevable au passé à la fois pré-colonial et
colonial des sociétés africaines.
63
This content downloaded from
193.54.110.56 on Sat, 11 May 2024 09:48:47 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Vous aimerez peut-être aussi
- TP ProbabilitéDocument3 pagesTP ProbabilitéAbouZakariaPas encore d'évaluation
- "Rapport Sur La Construction Des Situations Et Sur Les Conditions de L'organisation Et de L'action de La Tendance Situationniste Internationale" PDFDocument14 pages"Rapport Sur La Construction Des Situations Et Sur Les Conditions de L'organisation Et de L'action de La Tendance Situationniste Internationale" PDFGrizzly Mexicain VikkingPas encore d'évaluation
- PFE TOUZANI & SAIDIimpriméDocument49 pagesPFE TOUZANI & SAIDIimprimérachidsaidi0100% (1)
- Rebelles Contre L'ordre Colonial - Expériences Et Trajectoires Historiques de Résistances Anticoloniales Didier MonciaudDocument5 pagesRebelles Contre L'ordre Colonial - Expériences Et Trajectoires Historiques de Résistances Anticoloniales Didier MonciaudYves MonteilPas encore d'évaluation
- Etude 238Document37 pagesEtude 238Tomasz CholewaPas encore d'évaluation
- Cultures Et Religions Du Monde Arabo-Musulman - Manon T.Document18 pagesCultures Et Religions Du Monde Arabo-Musulman - Manon T.Amanite xPas encore d'évaluation
- Extrait de La PublicationDocument19 pagesExtrait de La PublicationLouis Yannick EssombaPas encore d'évaluation
- Mbembe - Pouvoir Violence Et AccumulationDocument18 pagesMbembe - Pouvoir Violence Et AccumulationNahuel Winkowsky PiutrinskyPas encore d'évaluation
- Révolutions Africaines Congo, Sénégal, Madagascar, Années 1960 1970Document240 pagesRévolutions Africaines Congo, Sénégal, Madagascar, Années 1960 1970capitrijetPas encore d'évaluation
- Histoire Nationaliste Et Cohésion Nationale.Document21 pagesHistoire Nationaliste Et Cohésion Nationale.mehdiPas encore d'évaluation
- Guy Debord: RAPPORT SUR LA CONSTRUCTION DES SITUATIONS ET SUR LES CONDITIONS DE L'ORGANISATION ET DE L'ACTION DE LA TENDANCE SITUATIONNISTE INTERNATIONALEDocument14 pagesGuy Debord: RAPPORT SUR LA CONSTRUCTION DES SITUATIONS ET SUR LES CONDITIONS DE L'ORGANISATION ET DE L'ACTION DE LA TENDANCE SITUATIONNISTE INTERNATIONALEGilles KleinPas encore d'évaluation
- Géographie de L'insoumission Etudesafricaines-30077-1Document27 pagesGéographie de L'insoumission Etudesafricaines-30077-1Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- PostcolonialismeDocument25 pagesPostcolonialismeFlash FacebookPas encore d'évaluation
- Jacques BerqueDocument21 pagesJacques Berquekhouadi abdelwahidPas encore d'évaluation
- La Problématique de La Démocratie en Afrique Noire: La Baule, Et Puis AprèsDocument16 pagesLa Problématique de La Démocratie en Afrique Noire: La Baule, Et Puis AprèsBouta chrysPas encore d'évaluation
- La Rénovation de l'héritage démocratique: Entre fondation et refondationD'EverandLa Rénovation de l'héritage démocratique: Entre fondation et refondationAnne TrépanierPas encore d'évaluation
- Histoire Des Idées Politiques, 2ème Semestre.Document41 pagesHistoire Des Idées Politiques, 2ème Semestre.Marina LozovoiPas encore d'évaluation
- Cette AnalyseDocument2 pagesCette AnalyseItala ZoukaPas encore d'évaluation
- L'approche Culturelle de La GlobalisationDocument38 pagesL'approche Culturelle de La GlobalisationJesús Martín Barbero100% (2)
- Insurrection Du 30 Et 31 Octobre 2014 en GrosDocument37 pagesInsurrection Du 30 Et 31 Octobre 2014 en GrostedPas encore d'évaluation
- Chronologie Des Faits Et Mouvements Sociaux en Algerie 1830 1954 RepriseDocument77 pagesChronologie Des Faits Et Mouvements Sociaux en Algerie 1830 1954 RepriseAbrid IreglenPas encore d'évaluation
- Un Printemps Arabe - L'émulation Protestataire Et Ses LimitesDocument12 pagesUn Printemps Arabe - L'émulation Protestataire Et Ses LimitesDianaPas encore d'évaluation
- Daniel Bensaid, Eloge de La Politique ProfaneDocument19 pagesDaniel Bensaid, Eloge de La Politique ProfaneakansrlPas encore d'évaluation
- Balandier LESMYTHESPOLITIQUES 1962Document13 pagesBalandier LESMYTHESPOLITIQUES 1962Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- Histoire Du Politique en AfriqueDocument10 pagesHistoire Du Politique en AfriqueGÉNÉRAL TECHPas encore d'évaluation
- LEFORT, Claude. La Première Révolution Anti-TotalitaireDocument8 pagesLEFORT, Claude. La Première Révolution Anti-TotalitaireGabriel VecchiettiPas encore d'évaluation
- Lidentité Culturelle Et Les Défis de La MondialisationDocument6 pagesLidentité Culturelle Et Les Défis de La Mondialisationnassim lakhlifiPas encore d'évaluation
- CG 2013 CorrigeDocument2 pagesCG 2013 CorrigeOuaz YassouPas encore d'évaluation
- Négatif 24Document16 pagesNégatif 24Pat HibulairePas encore d'évaluation
- Chili 1970 1973 Allende Unite PopulaireDocument15 pagesChili 1970 1973 Allende Unite PopulaireThs ThsPas encore d'évaluation
- Ali Shariati Ou Un Autre IslamDocument8 pagesAli Shariati Ou Un Autre IslamBertyPas encore d'évaluation
- Sibertin-Blanc - Politique Et Etat Chez Deleuze Et GuattariDocument243 pagesSibertin-Blanc - Politique Et Etat Chez Deleuze Et GuattariFelipe Larrea100% (1)
- Le Vodou Face A La MondialisationDocument17 pagesLe Vodou Face A La MondialisationMichee DasmarPas encore d'évaluation
- Nuevomundo 38782 Moral y Disciplinamiento Interno en El PRT ErpDocument14 pagesNuevomundo 38782 Moral y Disciplinamiento Interno en El PRT ErpMariela PellerPas encore d'évaluation
- Inc en Dim Ill LightDocument324 pagesInc en Dim Ill Lightt_munzerPas encore d'évaluation
- Dozon, Jean Pierre - Le BeteDocument38 pagesDozon, Jean Pierre - Le BeteMiguel Valderrama ZevallosPas encore d'évaluation
- 2020 - Pop Culture Et Contre-Culture (3ème Partie)Document11 pages2020 - Pop Culture Et Contre-Culture (3ème Partie)Benoit Umno Palette SeibertPas encore d'évaluation
- 13 - Socio - 5 - Wieviorka - Sortir de La ViolenceDocument20 pages13 - Socio - 5 - Wieviorka - Sortir de La ViolencetiagohyraPas encore d'évaluation
- L'afrique Dans Le Monde: Une Histoire D'extraversionDocument24 pagesL'afrique Dans Le Monde: Une Histoire D'extraversionrockbenon87Pas encore d'évaluation
- Une Histoire Critique de La Guérilla Au Mexique. Genèse de La Gauche ArméeDocument18 pagesUne Histoire Critique de La Guérilla Au Mexique. Genèse de La Gauche ArméeluisscePas encore d'évaluation
- La résistance française contre l'occupation nazieD'EverandLa résistance française contre l'occupation naziePas encore d'évaluation
- CATUSSE L'Etat Au Péril Du Moyen-Orient 2016Document19 pagesCATUSSE L'Etat Au Péril Du Moyen-Orient 2016mhashem86Pas encore d'évaluation
- AUGE PT de Vue D-Ethnologue MondialisationDocument5 pagesAUGE PT de Vue D-Ethnologue MondialisationprofaudaPas encore d'évaluation
- Hammoudi 2 AAN-1998-37 - 02Document8 pagesHammoudi 2 AAN-1998-37 - 02nachazPas encore d'évaluation
- La Révolution Kidnappée - Mustapha KraiemDocument539 pagesLa Révolution Kidnappée - Mustapha KraiemNabil DakhliPas encore d'évaluation
- Existe-T'il Une Seule Humanité - Fiche de Cours - Éducation Morale Et Civique - SchoolMouvDocument6 pagesExiste-T'il Une Seule Humanité - Fiche de Cours - Éducation Morale Et Civique - SchoolMouvJean Marc OrsettigPas encore d'évaluation
- L'Afrique Dans Le Monde: Une Histoire D'extraversion: To Cite This VersionDocument25 pagesL'Afrique Dans Le Monde: Une Histoire D'extraversion: To Cite This VersionAGBEMADIPas encore d'évaluation
- Sur Les Ruses de La Raison ImpérialisteDocument11 pagesSur Les Ruses de La Raison ImpérialistefeinstPas encore d'évaluation
- Module Sciences Sociales Sec IvDocument156 pagesModule Sciences Sociales Sec IvJuan96% (27)
- Soulèvements et recompositions politiques dans le monde arabeD'EverandSoulèvements et recompositions politiques dans le monde arabePas encore d'évaluation
- Insurrections Zone D'expansion Et RemedesDocument40 pagesInsurrections Zone D'expansion Et Remedesmahdi tahiri alaouiPas encore d'évaluation
- Expose Emc 2Document19 pagesExpose Emc 2Zerka StarsPas encore d'évaluation
- Thème 8 D'histoire Mondiale - Mouvements Indépendantistes (1800 - 2000)Document56 pagesThème 8 D'histoire Mondiale - Mouvements Indépendantistes (1800 - 2000)adiouf7256Pas encore d'évaluation
- La Violence Dans Les Greves Ouvrieres enDocument11 pagesLa Violence Dans Les Greves Ouvrieres enAelessar NabodyPas encore d'évaluation
- La Violence Politique Et Son Deuil - 3. Exercer La ViolenceDocument53 pagesLa Violence Politique Et Son Deuil - 3. Exercer La ViolencegritandolealvientoPas encore d'évaluation
- La Tentation Insurrectionniste - Bibliothèque AnarchisteDocument47 pagesLa Tentation Insurrectionniste - Bibliothèque AnarchisteExumerPas encore d'évaluation
- Bayart Par Le Bas 8Document14 pagesBayart Par Le Bas 8Afro-Sahara Global Group ASGGPas encore d'évaluation
- ColonisationDocument39 pagesColonisationjix_alPas encore d'évaluation
- Noubissie Outre - 1631-0438 - 2007 - Num - 94 - 354 - 4262Document29 pagesNoubissie Outre - 1631-0438 - 2007 - Num - 94 - 354 - 4262Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- Owona Lanaissancedu 1973Document22 pagesOwona Lanaissancedu 1973Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- Ebolo LimplicationDesPuissances 1999Document44 pagesEbolo LimplicationDesPuissances 1999Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- Nken LouisPaulAujoulatFigure 2010 1Document28 pagesNken LouisPaulAujoulatFigure 2010 1Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- GonidecDocument31 pagesGonidecOta Benga BengaPas encore d'évaluation
- Onomo Fouellefack Diplomatie - Traditionnelle - Et - Rapprocheme Citation LMACDocument23 pagesOnomo Fouellefack Diplomatie - Traditionnelle - Et - Rapprocheme Citation LMACOta Benga BengaPas encore d'évaluation
- Eugeunéisme Dans Le Japon Moderne ContemporaiDocument374 pagesEugeunéisme Dans Le Japon Moderne ContemporaiOta Benga BengaPas encore d'évaluation
- Mandel-Lesrtrcisseursde Sexe Cameroun - 2008Document25 pagesMandel-Lesrtrcisseursde Sexe Cameroun - 2008Ota Benga BengaPas encore d'évaluation
- Beckers OutsiderDocument19 pagesBeckers OutsiderOta Benga BengaPas encore d'évaluation
- CirculateurDocument11 pagesCirculateursalPas encore d'évaluation
- CI 2021 Question ContemporaineDocument4 pagesCI 2021 Question ContemporaineN GPas encore d'évaluation
- Tutorat Et Autonomie de L Apprenant en Foad Par InternetDocument12 pagesTutorat Et Autonomie de L Apprenant en Foad Par InternetmonkaratPas encore d'évaluation
- Maroc-Projet de Cimenterie de Tekcim-Resume EIES-10 2017Document40 pagesMaroc-Projet de Cimenterie de Tekcim-Resume EIES-10 2017EMOPas encore d'évaluation
- L'analyse Genre Du Secteur de L'éducation. Rapport. Larbi Wafi. Consultant. Improving Training For Quality Advancement in National Education. Mai 2010 ...Document46 pagesL'analyse Genre Du Secteur de L'éducation. Rapport. Larbi Wafi. Consultant. Improving Training For Quality Advancement in National Education. Mai 2010 ...Abdelkrim MokhikaPas encore d'évaluation
- Cours de Sédimentologie ITA LP GPG-MIN 2020Document96 pagesCours de Sédimentologie ITA LP GPG-MIN 2020Emmanuel NguiletPas encore d'évaluation
- Ezine - Laser de Lune T025Document114 pagesEzine - Laser de Lune T025Frédéric Le GarsPas encore d'évaluation
- 12 Test La ComparaisonDocument1 page12 Test La ComparaisonNatali ScerbacovaPas encore d'évaluation
- Mon MémoireDocument124 pagesMon MémoireIkram rsPas encore d'évaluation
- Règlement Technique ET PRO 2024 - CD 28.06.2023Document8 pagesRèglement Technique ET PRO 2024 - CD 28.06.2023soyuz.brasseriePas encore d'évaluation
- French AssessmentDocument3 pagesFrench AssessmentguhPas encore d'évaluation
- Memento - APSSI - SBT52000238 - IndH - WEB - MEDIUM PDFDocument118 pagesMemento - APSSI - SBT52000238 - IndH - WEB - MEDIUM PDFbena omer100% (1)
- Algebre 6Document33 pagesAlgebre 6Let us DancePas encore d'évaluation
- Chapitre I-Généralités Sur Les Solutions 26-SEP2023Document12 pagesChapitre I-Généralités Sur Les Solutions 26-SEP2023fatmazahraboucettaPas encore d'évaluation
- Spagirie 37-48Document81 pagesSpagirie 37-48franck atlaniPas encore d'évaluation
- Les FARC Et Internet: Fabrique D'une Guérilla VirtuelleDocument150 pagesLes FARC Et Internet: Fabrique D'une Guérilla Virtuellenobr_Pas encore d'évaluation
- La Linguistique Dans Tous Les Sens by Françoise Sullet-Nylander, Hugues Engel, Gunnel Engwall PDFDocument241 pagesLa Linguistique Dans Tous Les Sens by Françoise Sullet-Nylander, Hugues Engel, Gunnel Engwall PDFMosbah Said100% (1)
- Etudes Theme 3 - SCDocument2 pagesEtudes Theme 3 - SCMohamed KABLYPas encore d'évaluation
- ISO 2006 - 14044 LCA GuidelinesDocument60 pagesISO 2006 - 14044 LCA Guidelinesmaximekouadio224Pas encore d'évaluation
- .Exercices p.4-7Document4 pages.Exercices p.4-7Dorota PoziemskaPas encore d'évaluation
- Séquence Passerelle. Mourad Maoui PDFDocument5 pagesSéquence Passerelle. Mourad Maoui PDFAhlem AichiPas encore d'évaluation
- ORL OtologieDocument8 pagesORL Otologieشيخ شيخPas encore d'évaluation
- Saint Saëns Cello Concerto - PartesDocument2 pagesSaint Saëns Cello Concerto - PartesDavid Ruiz LlanosPas encore d'évaluation
- Candle Lighting Prayer Card FrenchDocument2 pagesCandle Lighting Prayer Card FrenchJean Ernest JohannaPas encore d'évaluation
- Introduction Aux Circuits VlsiDocument15 pagesIntroduction Aux Circuits VlsiUlrich YednaPas encore d'évaluation
- Planilha Eventos RarosDocument132 pagesPlanilha Eventos RarosGustavo RibeiroPas encore d'évaluation
- Theorie Des PPDocument7 pagesTheorie Des PPdoctoratiPas encore d'évaluation
- 3 - Suspension Et Rupture Du Contrat de TravailDocument42 pages3 - Suspension Et Rupture Du Contrat de Travaillahrach.yasmine1Pas encore d'évaluation