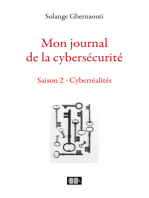Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Etudes Digitales 2018 2 N 6 Religiosite Technologique II Resumes
Etudes Digitales 2018 2 N 6 Religiosite Technologique II Resumes
Transféré par
Antonin MbaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Etudes Digitales 2018 2 N 6 Religiosite Technologique II Resumes
Etudes Digitales 2018 2 N 6 Religiosite Technologique II Resumes
Transféré par
Antonin MbaDroits d'auteur :
Formats disponibles
« Résumés », Études digitales, n° 6, 2018 – 2, Religiosité technologique, II,
p. 225-231
DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-09563-7.p.0225
La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de
communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.
© 2019. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.
RÉSUMÉS/ABSTRACTS
Franck Cormerais et Jacques Athanase Gilbert, « Introduction »
Franck Cormerais, professeur à l ’université Bordeaux Montaigne, laboratoire MICA
EA 4426 est responsable de l’axe prioritaire Humanités digitales. Il est docteur en
philosophie (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), en science de l’information et de la
communication (université Paris 13 Nord). Ses recherches portent sur l’anthropologie
des techniques et sur les pratiques herméneutiques des TIC.
Jacques Athanase Gilbert est professeur de littérature à l’université de Nantes. Il
s’intéresse aux questions de la représentation, de l’Antiquité à la modernité digitale.
Il explore les relations entre théorie et récit.
La question de la religiosité technologique implique la dimension fidu-
ciaire des sociétés hautement développées. La technologie procède moins d ’un
mouvement de sécularisation que de « désécularisation » : le fond religieux
et dogmatique imprègne les organisations et les imaginaires technologiques.
Mots-clés : Religiosité, technologie, transhumanisme, désécularisation,
culture, dogme.
Franck Cormerais et Jacques Athanase Gilbert, “Introduction”
The question of technological religiosity implies the fiduciary dimension of highly
developed societies. Technology is less a movement of secularization than of “de-secula-
rization”: the religious and dogmatic background permeates technological organizations
and imaginaries
Keywords: Religiosity, technology, transhumanism, de-secularization, culture, dogma.
Pierre Musso, « Le techno-imaginaire à l’ère des réseaux »
Pierre Musso, philosophe de formation, docteur d ’État en science politique, est
professeur des universités, c onseiller à l’Institut d’études avancées de Nantes. Il a
codirigé l ’édition critique des Œuvres complètes d’Henri Saint-Simon. Il est l’auteur d’une
trentaine d ’ouvrages, notamment La Religion industrielle et Le temps de l’État-Entreprise.
Berlusconi, Trump, Macron.
© 2019. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites.
226 Études digitales
Le « techno-imaginaire » du réseau demeure un intermonde entre technique
et l’organisme. Dans ses variations, il demeure structuré selon un triptyque
temps/ordre/corps dont la logique demeure invariante et fonctionne sur la
longue durée, c omme les mythes. Les techniques changent mais les repré-
sentations collectives se répètent. Ces techno-mythes sont nécessaires aussi
bien à l’invention qu’à la socialisation des techniques. Ils donnent sens aux
pratiques et à la puissance technologique.
Mots-clés : Techno-imaginaire, réseaux, techniques, mythes, religiosité
Pierre Musso, “The technoimaginary in the era of networks”
The “technoimaginary” of the network remains an interworld between technology
and the organism. In its variations, it remains structured according to a triptych of
time/order/body whose logic remains invariant and works over the long term, like
myths. The techniques change but the collective representations are repeated. These
technomyths are necessary for both the invention and the socialization of techniques.
They give meaning to practices and technological power.
Keywords: Technoimaginary, networks, techniques, myths, religiosity.
Katrin Becker, « La technologie blockchain et la promesse crypto-divine d ’en
finir avec les tiers »
Katrin Becker est chercheuse postdoctorale en droit et culture à l’université du
Luxembourg et actuellement fellow à l’Institut d ’études avancées de Nantes.
L’objectif clé de la technologie blockchain est de se débarrasser du tiers de
c onfiance. L ’article met en rapport cette technologie avec le système idéolo-
gico-institutionnel occidental, et problématise cette promesse de surmonter
le tiers selon une perspective c ulturelle et religieuse. L ’accent est mis sur la
réapparition paradoxale du décor irrationnel-mythologique dans l’entourage
de ce dispositif technologique qui prétend pourtant en avoir fini avec toute
forme d ’ambiguïté et d ’irrationalité.
Mots-clés : Blockchain, c onfiance, tiers, technologie, irrationnel.
Katrin Becker, “Blockchain technology and the cryptodivine promise to put an end
to third parties”
The key goal of blockchain technology is to get rid of the trusted third party. This
article links this technology with the Western ideological-institutional system and
problematizes this promise to overcome the third party from a cultural and religious
© 2019. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites.
RÉSUMÉS/ABSTRACTS 227
perspective. Emphasis is placed on the paradoxical reappearance of the irrational-
mythological setting in the environment of this technological mechanism, which claims
to have put an end to all forms of ambiguity and irrationality.
Keywords: Blockchain, trust, third party, technology, irrational.
Jean-François Lucas, « Pour une fabrique des imaginaires de la Smart City »
Jean-François Lucas, docteur en sociologie, explore et défriche les problématiques
et enjeux socio-techniques de la Smart City chez Chronos, cabinet d’études sociolo-
giques et de c onseil en innovation. Il est également chercheur associé au laboratoire
de sociologie urbaine (LaSUR) de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
en Suisse.
Les imaginaires de la Smart City sont pétris de nombreuses ambivalences,
notamment issues de l’imaginaire de l’innovation technique et des techno-
logies de l’information et de la communication. Pour saisir leur diversité,
il est possible de les analyser grâce à des textes (récits), à des images (films,
publicités, BD…), aux sensations du corps qui expérimente la ville calculée,
et à des algorithmes, car ils encapsulent des représentations du monde.
Mots-clés : Smart City, imaginaire, innovation technique, algorithmes,
ville calculée.
Jean-François Lucas, “For the manufacturing of imaginaries from the Smart City”
The imaginaries of the Smart City are full of ambivalences stemming, in particular,
from the imaginary of technical innovation and from information and c ommunications
technologies. To grasp their diversity, it is possible to analyze them thanks to texts
(narratives), images (films, advertisements, comic books…), the sensations of the body
that experiences the calculated city, and algorithms, because they encapsulate repre-
sentations of the world.
Keywords: Smart City, imaginary, technical innovation, algorithms, calculated city.
Annabelle Boutet-Diéye et Mathilde Sarré-Charrier, « La construction
d’un techno-imaginaire autour du tatouage c onnecté »
Annabelle Boutet-Diéye est maître de conférences à l’institut Mines-Télécom
Atlantique. Ses recherches portent sur les processus d’innovation ascendante en lien
avec l’appropriation des usages des TIC. Elle s’intéresse aux situations d’inclusion et
d’exclusion numériques, en lien avec des actions menées localement. Plus récemment,
elle s’est intéressée à ces phénomènes dans les pays africains.
© 2019. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites.
228 Études digitales
Mathilde Sarré-Charrier est chercheuse au sein de Sense, le laboratoire de sciences
sociales et humaines d ’Orange. Ses recherches portent sur la créativité, l ’innovation
ouverte et les enjeux sociétaux des technologies à long terme. Elle travaille également
sur l’articulation entre les méthodes de créativité et de prospective en lien avec le
Lirsa du Cnam.
Dans une société hyper-connectée, où le corps est devenu un faire-valoir
de l’individu, l’article porte sur la convergence, surprenante mais possible,
du monde du tatouage et des technologies numériques, pour réparer, gué-
rir ou prévenir les dérèglements du corps. Par une approche sociologique,
anthropologique, et prospective, il met en exergue la construction d’un
techno-imaginaire autour du tatouage c onnecté et d ’une créativité associée à
des dispositifs d’hybridation techno-corps.
Mots-clés : Tatouage connecté, technologies numérique, anthropologie,
techno-imaginaire, hybridation.
Annabelle Boutet-Diéye et Mathilde Sarré-Charrier, “The construction
of a technoimaginary around connected tattooing”
In a hyperconnected society where the body has become a foil for the individual,
this article focuses on the convergence, surprising but possible, between the world of
tattooing and digital technologies in order to repair, cure, or prevent malfunctions of the
body. Through a sociological, anthropological, and prospective approach, it highlights
the construction of a technoimaginary around connected tattooing and a creativity
associated with techno-body hybridization mechanisms.
Keywords: Connected tattooing, digital technologies, anthropology, technoimagi-
nary, hybridization.
Daphné Vignon, « Après la transcendance, de Solaris à Stalker. La religiosité
scientifique dans un monde sans dieu »
Daphné Vignon est chercheuse contractuelle à l’université de Nantes. Elle coa-
nime les projets « Potlatch / autour du récit » et réalise une grammaire narrative
autour des situations immersives. Elle prépare la publication de sa thèse « Les récits
du pouvoir » qui explore les matrices narratives de l’État et de la Nation (France de
l’âge classique et Allemagne du premier romantisme).
Cet article analyse le récit des échecs de la science et de la technique
mis en scène au sein de deux œuvres emblématiques de la science-fiction
soviétique des années soixante et soixante-dix : Stalker des frères Strougatski
et Solaris de Stanislas Lem. Ces deux textes, marqués par un refus radical de
© 2019. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites.
RÉSUMÉS/ABSTRACTS 229
la transcendance, permettent d ’interroger la pertinence du modèle dialectique,
sa positivité et son rapport sous-jacent à la problématique du salut.
Mots-clés : Science-fiction, Stalker, Solaris, frères Strougatski, stanislas
Lem, dialectique, salut.
Daphné Vignon, “After transcendence, from Solaris to Roadside Picnic. Scientific
religiosity in a godless world”
This article analyzes the story of the failures of science and technology staged in
two emblematic works of Soviet science-fiction from the sixties and seventies: Roadside
Picnic by the Strugatsky Brothers and Solaris by Stanisław Lem. These two texts,
marked by a radical rejection of transcendence, make it possible to question the rele-
vance of the dialectical model, its positivity, and its underlying relationship with the
question of salvation.
Keywords: Science fiction, Roadside Picnic, Solaris, Strugatsky Brothers, Stanisław
Lem, dialectic, salvation.
Jacques Athanase Gilbert, « La religiosité de Ted Chiang, là où Dieu n’est pas »
Un pattern explicitement religieux peut-il se trouver déplacer dans un
c ontexte narratif différent sans se trouver soumis à une profonde transformation.
L’article aborde plusieurs nouvelles de Ted Chiang en les interprétant à partir
des débats des premiers siècles du christianisme sur la double nature du Christ.
Mots-clés : Pattern, narration, Ted Chiang, science-fiction, salut.
Jacques Athanase Gilbert, “The religiosity of Ted Chiang, where God is absent”
Can an explicitly religious pattern be moved into a different narrative context
without being subjected to a profound transformation? This article tackles several of
Ted Chiang’s short stories by interpreting them on the basis of the debates from the
first centuries of Christianity on the dual nature of Christ.
Keywords: Pattern, narration, Ted Chiang, science fiction, salvation.
Camille Prunet, « Homo novus. La figure de l ’homme nouveau et la sacralisation
de l’œuvre d ’art technologique »
Camille Prunet, docteur en esthétique et sciences de l’art, enseigne à l’université
Toulouse – Jean-Jaurès. Elle est l’auteur d’un ouvrage intitulé Penser l’hybridation.
Art et biotechnologie. Ses recherches portent sur l’écologie des œuvres et sur le statut
épistémologique des images.
© 2019. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites.
230 Études digitales
L’article propose d’analyser ce que la présence de technologie fait à l’œuvre
d ’art. La dimension sacrée de l’œuvre d’art et la tentation à sacraliser l’objet
technique se trouvent incarnées dans la figure de l’homo novus qui devient un
paradigme de cette difficulté à penser la présence de l’objet technique dans
l’objet esthétique en dehors d ’un rapport au sacré.
Mots-clés : Technologie, œuvre d ’art, sacré, technique, objet esthétique.
Camille Prunet, “Homo novus. The figure of the new man and the sacralization
of the technological work of art”
This article aims to analyze what the presence of technology does to the work of art.
The sacred dimension of the work of art and the temptation to sanctify the technical
object are embodied in the figure of the homo novus, which becomes a paradigm for
this difficulty of considering the presence of the technical object in the aesthetic object
outside of a relation to the sacred.
Keywords: Technology, work of art, sacred, technique, aesthetic object.
Franck Cormerais et Amar Lakel, « Recherches digitales et production des
données, bouleversement des épreuves pour le chercheur en SIC »
Amar Lakel est MCF en SIC au Laboratoire MICA. Ses recherches actuelles
portent sur la mise en visibilité et l’analyse des corpus numériques sur le web. Ses
recherches se sont recentrées sur les enjeux méthodologiques de l’analyse des corpus
numériques. Il dirige le projet My Web Intelligence, noyau applicatif de constitution
de corpus numérique.
Après avoir interrogé la place de la technoscience dans la rénovation des
SIC et la nécessité d ’une politique de formation d ’un nouveau lettré digital,
il convient de souligner les « épreuves » que rencontre la recherche en SHS à
l’heure des humanités numériques. Notamment en termes d’accessibilité des
données de la recherche. Il faut interroger la place grandissante de l’outillage
algorithmique envisager la remise en cause de la figure de l’auteur par des
agencements pluridisciplinaires.
Mots-clés : Technoscience, lettré digital, formation, humanités numériques,
pluridisciplinarité.
Franck Cormerais et Amar Lakel, “Digital research and data production,
disruption of organizations for the ICS researcher”
After scrutinizing the role of technoscience in the renewal of information and
communication science and the need for a training policy for a new digital literate, it is
© 2019. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites.
RÉSUMÉS/ABSTRACTS 231
worth highlighting the “challenges” that social and human sciences research encounters
in the age of the digital humanities, especially in terms of accessibility of research data.
It is necessary to question the growing place of algorithmic tools in order to c onsider the
challenging of the figure of the author by multidisciplinary organizations.
Keywords: Technoscience, digital literate, training, digital humanities,
multidisciplinarity.
Pascal Robert, « Événement et document selon Robert Escarpit. Deux c oncepts
toujours pertinents pour questionner le numérique »
Pascal Robert est professeur des universités et directeur de la recherche à l’Enssib.
Ses domaines de recherche sont : histoire et géopolitiques des TIC, enjeux politiques
de l’informatisation de la société, anthropologie du document.
L’article se réfère à l ’œuvre fondatrice de Robert Escarpit. Ce dernier en effet
a joué un rôle décisif dans l’émergence des SIC. Il s’interroge sur l’actualité
de ses analyses pour notre environnement digital qu’il n’a pourtant pas connu
dans ses développements les plus contemporains.
Mots-clés : Robert Escarpit, environnement digital, sciences de l ’information
et de la c ommunication (SIC), théorie.
Pascal Robert, “Event and document according to Robert Escarpit. Two concepts
still relevant for questioning the digital”
This article refers to the founding work by Robert Escarpit, who played a decisive
role in the emergence of information and c ommunication science (ICS). It investigates the
timeliness of his analyses for our digital environment, whose most recent developments
he was not able to see.
Keywords: Robert Escarpit, digital environment, information and c ommunication
science (ICS), theory.
© 2019. Classiques Garnier. Reproduction et diffusion interdites.
Vous aimerez peut-être aussi
- ArmureDocument4 pagesArmureFrederic WustPas encore d'évaluation
- Ville PalimpsesteDocument64 pagesVille PalimpsesteEric MvogPas encore d'évaluation
- La Société Terminale 1. Communautés VirtuellesDocument366 pagesLa Société Terminale 1. Communautés VirtuellesSchmoll Patrick100% (1)
- POLITIQUE de L'INFORMATIQUE ET de L'INFORMATION Les Pionniers de La Nouvelle Frontière ÉlectroniqueDocument586 pagesPOLITIQUE de L'INFORMATIQUE ET de L'INFORMATION Les Pionniers de La Nouvelle Frontière ÉlectroniqueIntinionPas encore d'évaluation
- La CyberCulture - Exposé de TEEODocument11 pagesLa CyberCulture - Exposé de TEEOMpourouPas encore d'évaluation
- Usages Et Imaginaires Des TICDocument7 pagesUsages Et Imaginaires Des TICtonittPas encore d'évaluation
- Le TransumanismeDocument23 pagesLe TransumanismengariPas encore d'évaluation
- Nouvelles Technologies de L InformationDocument6 pagesNouvelles Technologies de L Informationaissa abPas encore d'évaluation
- La Société Terminale 2. Dispositifs Spec (Tac) UlairesDocument372 pagesLa Société Terminale 2. Dispositifs Spec (Tac) UlairesSchmoll Patrick100% (1)
- L'Imaginaire D'internet (Sciences Et Société) (French Edition)Document235 pagesL'Imaginaire D'internet (Sciences Et Société) (French Edition)Vinicius Noronha100% (1)
- 0021 Art. MANONGO BAKENGE Jean Marcel Corrige OkDocument16 pages0021 Art. MANONGO BAKENGE Jean Marcel Corrige Oknissrinbch32Pas encore d'évaluation
- Cahier Air2023Document38 pagesCahier Air2023fondationibdaaPas encore d'évaluation
- CFP - Imaginaires Et Développements Techniques À La Lumière Des MythesDocument4 pagesCFP - Imaginaires Et Développements Techniques À La Lumière Des Mythesvictor prestavoinePas encore d'évaluation
- Dominique Cardon - Culture Numérique-Presses Science Po (2019)Document295 pagesDominique Cardon - Culture Numérique-Presses Science Po (2019)Popescu Valentin100% (1)
- These Thomas Guignard PDFDocument400 pagesThese Thomas Guignard PDFCuriosiPas encore d'évaluation
- Aac Congres Sfsic Bordeaux 2023 3 1Document10 pagesAac Congres Sfsic Bordeaux 2023 3 1philippe hertPas encore d'évaluation
- Les Sciences de L'information Et La Communication Et La Technique: Une Filiation EmbarrassanteDocument10 pagesLes Sciences de L'information Et La Communication Et La Technique: Une Filiation EmbarrassanteJohnPas encore d'évaluation
- NTIC Et Ethique ChretienneDocument15 pagesNTIC Et Ethique ChretienneEmmanuel WanitouaPas encore d'évaluation
- Les Illusions Du Progrès Technique, Ses Conséquences Et Ses Alternatives !Document28 pagesLes Illusions Du Progrès Technique, Ses Conséquences Et Ses Alternatives !researchfr100% (4)
- 57ème Journée Mondiale de La Paix - Le Message Du Pape - Diocèse de LyonDocument18 pages57ème Journée Mondiale de La Paix - Le Message Du Pape - Diocèse de LyonTHOMAS OUBDAPas encore d'évaluation
- Art NumeriqueDocument21 pagesArt Numeriquenouchka LilomimiPas encore d'évaluation
- Vers Une Culture Informatique - L'impact Des Technologies de L'information Et de La Communication (Tic) Sur La Société Algérienne D'aujourd'huiDocument24 pagesVers Une Culture Informatique - L'impact Des Technologies de L'information Et de La Communication (Tic) Sur La Société Algérienne D'aujourd'huiidilmiPas encore d'évaluation
- Aujour'huiDocument10 pagesAujour'huiDEM AquilaPas encore d'évaluation
- Revuehn 3028Document7 pagesRevuehn 3028Ahmed AjebliPas encore d'évaluation
- Article FJutandDocument3 pagesArticle FJutandIliass MahrazPas encore d'évaluation
- Sciences Et TechniquesDocument4 pagesSciences Et TechniquesMariame TandiaPas encore d'évaluation
- Cours D Intelligence Artificielle L1 UNIKIN - UC 2009 2010 CORRIGEDocument187 pagesCours D Intelligence Artificielle L1 UNIKIN - UC 2009 2010 CORRIGELux Tl100% (7)
- Informaticiens Et EthiqueDocument9 pagesInformaticiens Et EthiqueKalinatsiPas encore d'évaluation
- Cnil Rapport Garder La Main WebDocument80 pagesCnil Rapport Garder La Main WebKevin Victoire100% (1)
- 11 - Usages Des Technologies de L'information Et de La Communication - Cairn - InfoDocument23 pages11 - Usages Des Technologies de L'information Et de La Communication - Cairn - InfoAndrada-Doriana Pocean100% (1)
- Monnin 2022-Ecologies - Du - SmartphoneDocument12 pagesMonnin 2022-Ecologies - Du - SmartphoneRayanePas encore d'évaluation
- Intro TechniqueDocument2 pagesIntro TechniqueLoïs MariottiniPas encore d'évaluation
- La Fracture Numérique GénérationnelleDocument8 pagesLa Fracture Numérique GénérationnellePablo Andrés CastellPas encore d'évaluation
- Le NumériqueDocument26 pagesLe NumériqueFatoumata GayePas encore d'évaluation
- Les TICE Représentent Les Technologies de L'information Et de La Communication Pour L'enseignementDocument3 pagesLes TICE Représentent Les Technologies de L'information Et de La Communication Pour L'enseignementDamis IsmaelPas encore d'évaluation
- Feuilletage 2661Document13 pagesFeuilletage 2661Afef RabaouiPas encore d'évaluation
- CHAPITRE Premier IDocument64 pagesCHAPITRE Premier IChristian MouandjoPas encore d'évaluation
- Les PRATIQUES TRANSFORMATRICES DES ESPACES SOCIONUMERIQUESD'EverandLes PRATIQUES TRANSFORMATRICES DES ESPACES SOCIONUMERIQUESPas encore d'évaluation
- VA OK EMI Fakenews Diakhate-et-Kouakou H2PTM21Document14 pagesVA OK EMI Fakenews Diakhate-et-Kouakou H2PTM21lenasarienPas encore d'évaluation
- Manifeste HumNum 2010Document7 pagesManifeste HumNum 2010fernanda.mugicaPas encore d'évaluation
- Blockchain Et Droit D'identitéDocument474 pagesBlockchain Et Droit D'identitézainabhami9Pas encore d'évaluation
- Tourisme 171Document11 pagesTourisme 171abbes18Pas encore d'évaluation
- Programme Prévisionnel - Journée D'étude "FinTech Et Ethique" - LEFMIDocument2 pagesProgramme Prévisionnel - Journée D'étude "FinTech Et Ethique" - LEFMIÉlijah ErraPas encore d'évaluation
- Informatique Et EthiqueDocument5 pagesInformatique Et EthiqueBahraouiPas encore d'évaluation
- Virus, parasites et ordinateurs: Le troisième hémisphère du cerveauD'EverandVirus, parasites et ordinateurs: Le troisième hémisphère du cerveauPas encore d'évaluation
- Ellul, Castoriadis Et IllitchDocument23 pagesEllul, Castoriadis Et Illitchlaurentbruggeman100% (2)
- AACcorps Ere Numerique Revue IN8!2!2018Document6 pagesAACcorps Ere Numerique Revue IN8!2!2018Amine AllaliPas encore d'évaluation
- Sur La Technique - Bernard Charbonneau & Jacques EllulDocument4 pagesSur La Technique - Bernard Charbonneau & Jacques EllulJean-François VarletPas encore d'évaluation
- OPECST Rapport Intelligence Artificielle Synthese 4pages-1Document4 pagesOPECST Rapport Intelligence Artificielle Synthese 4pages-1ayaycf0703Pas encore d'évaluation
- Mon journal de la cybersécurité - Saison 2: CyberréalitésD'EverandMon journal de la cybersécurité - Saison 2: CyberréalitésPas encore d'évaluation
- Vol27 1 2 38 43Document6 pagesVol27 1 2 38 43HachemBoughattasPas encore d'évaluation
- La TechnologieDocument7 pagesLa TechnologieRichard kouamé KouakouPas encore d'évaluation
- Programme Forum Pop'Sciences - A Quoi Revent Les Intelligences ArtificiellesDocument4 pagesProgramme Forum Pop'Sciences - A Quoi Revent Les Intelligences ArtificiellesPreclouxPas encore d'évaluation
- Critique de La Da Mata RialisationDocument16 pagesCritique de La Da Mata RialisationABDELKARIM BOUDDAFATEPas encore d'évaluation
- Société Postcroissance Et Technologies Numériques - Emmanuelle CaccamoDocument3 pagesSociété Postcroissance Et Technologies Numériques - Emmanuelle CaccamoJUCQUOISPas encore d'évaluation
- Dondero - PDF VF FinaleDocument240 pagesDondero - PDF VF Finaleuntilted1212Pas encore d'évaluation
- Des Machines Et Des Hommes - Enquête Prostitution MasculineDocument711 pagesDes Machines Et Des Hommes - Enquête Prostitution Masculinemesjeuxps31Pas encore d'évaluation
- DU CYBERESPACE À NEW YORK LA COMMUNAUTIQUE ET L'INTELLIGENCE COLLECTIVE. Moussa SarrDocument263 pagesDU CYBERESPACE À NEW YORK LA COMMUNAUTIQUE ET L'INTELLIGENCE COLLECTIVE. Moussa SarrCarol CaracolPas encore d'évaluation
- FR Yajna VediqueDocument20 pagesFR Yajna VediqueAntonin MbaPas encore d'évaluation
- La Progression de L'âme Dans La Foi: À Travers Les Homélies Sur Le Cantique Des Cantiques de Grégoire de NysseDocument140 pagesLa Progression de L'âme Dans La Foi: À Travers Les Homélies Sur Le Cantique Des Cantiques de Grégoire de NysseAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Phlou 0035-3841 1948 Num 46 10 4143 t1 0231 0000 2Document3 pagesPhlou 0035-3841 1948 Num 46 10 4143 t1 0231 0000 2Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Rscir 0035-2217 1991 Num 65 1 3163Document21 pagesRscir 0035-2217 1991 Num 65 1 3163Antonin MbaPas encore d'évaluation
- CH8 Un Progrès Spirituel InfiniDocument13 pagesCH8 Un Progrès Spirituel InfiniAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Tumu 048 0103Document14 pagesTumu 048 0103Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Anna 692 0471Document35 pagesAnna 692 0471Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Nigeriabokoharam656fweb 2Document44 pagesNigeriabokoharam656fweb 2Antonin MbaPas encore d'évaluation
- La Création de L'homme: Grégoire de Nysse (Saint, 0335?-0394?)Document5 pagesLa Création de L'homme: Grégoire de Nysse (Saint, 0335?-0394?)Antonin MbaPas encore d'évaluation
- CC01 Art 12 OcrDocument13 pagesCC01 Art 12 OcrAntonin MbaPas encore d'évaluation
- UntitledDocument46 pagesUntitledAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Équivocité Du Don Et Archi-Éthique. Interroger Avec Jacques DerridaDocument23 pagesÉquivocité Du Don Et Archi-Éthique. Interroger Avec Jacques DerridaAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Tumu 048 0117Document10 pagesTumu 048 0117Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Tumu 048 0141Document16 pagesTumu 048 0141Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Boko Haram Et Les Limites Du Tout-Repressif Au Nigeria - de Nouvelles PerspectivesDocument33 pagesBoko Haram Et Les Limites Du Tout-Repressif Au Nigeria - de Nouvelles PerspectivesAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Tumu 048 0087Document15 pagesTumu 048 0087Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Rhef 0300-9505 1998 Num 84 212 1307Document18 pagesRhef 0300-9505 1998 Num 84 212 1307Antonin MbaPas encore d'évaluation
- N 37 2023 Dossier Suspendre Le Temps ConDocument2 pagesN 37 2023 Dossier Suspendre Le Temps ConAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Tumu 048 0157Document13 pagesTumu 048 0157Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Tumu 048 0127Document15 pagesTumu 048 0127Antonin MbaPas encore d'évaluation
- 9782021153941Document22 pages9782021153941Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Le Probleme de L'EsclavageDocument14 pagesLe Probleme de L'EsclavageAntonin MbaPas encore d'évaluation
- L'abus Sexuel Des Religieuses: Prof. DR Karlijn DemasureDocument31 pagesL'abus Sexuel Des Religieuses: Prof. DR Karlijn DemasureAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Reaction Catholique Doctrine de La Decouverte Et TNDocument15 pagesReaction Catholique Doctrine de La Decouverte Et TNAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Opus Dei Archéologie de L'Office: Giorgio AgambeDocument22 pagesOpus Dei Archéologie de L'Office: Giorgio AgambeAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Le Feu Et Le Récit de Giorgio Agamben: Marc-Alexandre ReinhardtDocument4 pagesLe Feu Et Le Récit de Giorgio Agamben: Marc-Alexandre ReinhardtAntonin MbaPas encore d'évaluation
- Kuhlem La Folie de Limpossible Du PardonDocument10 pagesKuhlem La Folie de Limpossible Du PardonAntonin MbaPas encore d'évaluation
- 9782743657826Document18 pages9782743657826Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Lignes 017 0157Document16 pagesLignes 017 0157Antonin MbaPas encore d'évaluation
- 9782021358988Document22 pages9782021358988Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Procédures ECDIS - FRDocument72 pagesProcédures ECDIS - FRMKHELLASPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Des Sûretés Et Des Procédures CollectivesDocument78 pagesCours de Droit Des Sûretés Et Des Procédures CollectivesGeorges100% (1)
- Mémoire FinaleDocument79 pagesMémoire Finalebouslimane idirPas encore d'évaluation
- Catalogue Des Dégradations Dans Les TunnelsDocument14 pagesCatalogue Des Dégradations Dans Les TunnelsKahinaPas encore d'évaluation
- Tarifs 2021 Integration SensorielleDocument17 pagesTarifs 2021 Integration SensorielleAlix Brossard OlivePas encore d'évaluation
- Hem Guide de Letudiant 2021-2022 WebDocument178 pagesHem Guide de Letudiant 2021-2022 WebGianni BalestrieriPas encore d'évaluation
- Houag Mike: SoumeDocument1 pageHouag Mike: Soumemikesoume320Pas encore d'évaluation
- Fiche Des Activités Strctures Des Donnes2Document2 pagesFiche Des Activités Strctures Des Donnes2Zouheir MezziPas encore d'évaluation
- Le Journal de L'économieDocument12 pagesLe Journal de L'économiekjmanoPas encore d'évaluation
- Donoh Manual FrenchDocument22 pagesDonoh Manual Frenchwil100% (1)
- 210868 Manual de Instalaciвn y partes - V. InglВs PDFDocument4 pages210868 Manual de Instalaciвn y partes - V. InglВs PDFturbitolocoPas encore d'évaluation
- Examen de Math 2016Document16 pagesExamen de Math 2016John Lukusa AboubakarPas encore d'évaluation
- NoeuxDocument1 pageNoeuxMargaux PlatteauPas encore d'évaluation
- Fiches de Lecture 5Document14 pagesFiches de Lecture 5Romane Torregrossa100% (1)
- Images Des VibrationsDocument44 pagesImages Des VibrationsDavidPas encore d'évaluation
- Demande Carte FRDocument4 pagesDemande Carte FRPaul RegnierPas encore d'évaluation
- L'ambiguite, Fait de LangueDocument14 pagesL'ambiguite, Fait de LangueMichner AlfredPas encore d'évaluation
- Modèle de Kirkpatrick Comment Évaluer Une Action de FormationDocument2 pagesModèle de Kirkpatrick Comment Évaluer Une Action de FormationzaarirPas encore d'évaluation
- Brochure Alimentation Tip TopDocument28 pagesBrochure Alimentation Tip TopL.R ArchitectePas encore d'évaluation
- TFE Antoine-PIERI PDFDocument11 pagesTFE Antoine-PIERI PDFaze rezPas encore d'évaluation
- P0131MBF16Document68 pagesP0131MBF16KOUADIO Tigoli PrincePas encore d'évaluation
- 539 Les Defauts de PiquresDocument1 page539 Les Defauts de PiquresMoulay Ismail QobiPas encore d'évaluation
- GDP Chap 1 Lecon 4 Cours v4Document6 pagesGDP Chap 1 Lecon 4 Cours v4EsmaDergalPas encore d'évaluation
- 1 - CalorimetrieDocument3 pages1 - CalorimetrieDoha DahbiPas encore d'évaluation
- 2022 - Plaquette Tarifaire MutuelleDocument3 pages2022 - Plaquette Tarifaire MutuellecryoPas encore d'évaluation
- El Ve de Premiere Techno Comment Calculer Note Bac 2022 94496Document1 pageEl Ve de Premiere Techno Comment Calculer Note Bac 2022 94496Wisal TouilPas encore d'évaluation
- PianoDocument9 pagesPianoSeven Blech ArmyPas encore d'évaluation
- Projet1 PDFDocument101 pagesProjet1 PDFKaoutar malekPas encore d'évaluation
- TD 2 Econometrie FellajiDocument2 pagesTD 2 Econometrie FellajiAhmed JebariPas encore d'évaluation