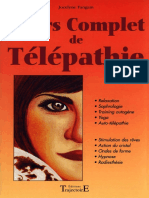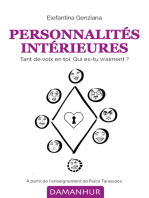Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1 Questions de Methode
1 Questions de Methode
Transféré par
nicojararam10 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues10 pagesla philosophie du son
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentla philosophie du son
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
4 vues10 pages1 Questions de Methode
1 Questions de Methode
Transféré par
nicojararam1la philosophie du son
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 10
Questions de méthode
Roberto Casati, Jérôme Dokic
To cite this version:
Roberto Casati, Jérôme Dokic. Questions de méthode. La philosophie du son, Jacqueline Chambon,
1994, 978-2877111096. �ijn_00000517�
HAL Id: ijn_00000517
https://hal.science/ijn_00000517
Submitted on 30 Jul 2004
HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents
entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de
teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires
abroad, or from public or private research centers. publics ou privés.
1.QUESTIONS DE MÉTHODE
1.1.L'intérêt de l'analyse descriptive
La plupart des descriptions des phénomènes sonores que
je suis capable de donner sont tributaires de ma familiarité
perceptive avec eux. Si quelqu'un me présente u n Do et un Si
l'un après l'autre, je peux remarquer une différence (ils
m'appcrrnissent comme différents), même si je suis incapable
d'expliquer, par exemple en utilisant une description qui fait
appel aux fréquences vibratoires, la base ph.ysique de la diffé-
rence. La description et l'analyse de ce qui m'apparaît, de ce
que j'ai l'impression de percevoir - indépendamment de ce
que j'apprends sur une base non perceptive, par exemple en
lisant u n livre de physique - relève de la partie phénoménolo-
gique d'une recherche philosophique. Une description des sons
ayant nécessairement recours a u concept de fréquence ne
serait pas phénoménologique; en revanche, une description
parlant d'une hauteur apparente des sons le serait. Quelles
raisons justifient la démarche phénoménologique en philoso-
phie de la perception auditive?
(1)Une phénoménologie détaillée de l'expérience peut être
une des conditions préliminaires d'une étude métaphysique,
ou d'une étude relative à la théorie de la connaissance. Si
quelqu'un envisage, par exemple, une réduction d'un certain
objet d'expérience à des entités logiquement plus simples, ou à
des entités qui seraient plus facilement accessibles à la
connaissance (comme dans le phénoménisme classique), il ne
saurait se passer d'une première description de l'objet fidèle
aux caractéristiques qui lui sont attribuées dans l'expérience.
Si vous pensez que les y peuvent être réduits à des @, il est
pour vous raisonnable d'avoir une idée aussi claire que pos-
sible de la façon dont les y se présentent dans l'expérience que
vous en avez; tout en laissant ouverte la possibilité que la
réduction aux @ vous oblige à corriger votre première impres-
sion. Bien entendu, l'exemple de la réduction n'a ici qu'une
valeur d'illustration; même si vous n'envisagez pas une réduc-
tion métaphysique des y , il vous est indispensable de faire un
premier appel aux caractéristiques apparentes des y que vous
avez (normalement) l'impression de saisir sur la base de vos
expériences. Souvent, ces caractéristiques sont utilisées tout
simplement pour fixer la référence des termes de la théorie, et
non pour donner la signification de ces termes, dans la mesure
où elles deviennent (peut-être, et non pas nécessairement)
inutiles au moment où les propriétés essentielles des y sont
visées (Kripke 1972,1982: 119-120, 142). Par exemple, la réfé-
rence du mot ~chaleurnest fixée à l'aide de certaines caracté-
ristiques phénoménologiques, mais la chaleur est métaphysi-
quement indépendante de ces caractéristiques.
(2) Une remarque similaire peut être faite à propos de cer-
taines explications qui relèvent de la psychologie. Si quelqu'un
croit qu'il n'existe pas de y , et que seuls les @ existent vérita-
blement dans le monde, et si par ailleurs il a l'impression de
percevoir des v, on doit bien sûr expliquer d'où provient cette
fausse impression. Par exemple, vous avez l'impression de
percevoir des objets verts, et vous apprenez que certains de ces
objets ne sont pas verts - par exemple, ils sont rouges. Vous
êtes amené à examiner ce qui ne fonctionne pas dans votre
système perceptif. La phénoménologie a une valeur heuris-
tique dans la psychologie de la perception : la psychologie
découvre souvent de nouveaux mécanismes perceptifs en étu-
diant le décalage entre la description (physique) du stimulus
et la description (phénoménologique) du contenu de la percep-
tion. Du coup, il est nécessaire, à ce stade, de disposer d'une
description phénoménologique assez détaillée de ce contenu.
(3) Enfin, l'examen phénoménologique de l'expérience
auditive présente un intérêt en soi; nous avons affaire ici a un
secteur vaste et complexe de l'expérience, insuffisamment
traité dans la philosophie (par contraste, on ne manquera pas
de relever l'ampleur des analyses consacrées à la couleur).
Nous entendons le terme «phénoménologien en un sens
large, ni technique ni doctrinal. Nous ne prétendons pas nous
réclamer des thèses officielles du mouvement phénoménolo-
gique historique, ni exprimer la position de tel ou tel auteur
qui en fait partie (même si de temps à autre, il nous arrivera
de citer certains de ces auteurs ou de faire référence à leurs
idées). Il s'agit pour nous simplement de fournir en premier
lieu une description de ce que nous entendons, une description
qui soit fidèle au contenu de la perception auditive.
1.2. La nature de l'analyse.
Pour se rendre compte de manière plus précise de ce qui
rend caractéristique la démarche phénoménologique, considé-
rons le cas suivant. Jean déplace son bras et frappe ainsi un
gong. Marie, qui se trouve dans la pièce voisine, fait l'observa-
tion suivante : ~J'entendsle son d'un gong». À quoi Jean lui
répond : «Le son du gong était l'effet d'un déplacement de mon
bras ».Marie en infère correctement : ~ J ' a donc
i entendu l'effet
d'un déplacement de ton bras». En revanche, ce que Marie
n'est pas en position d'affirmer en utilisant les informations
dont elle dispose, c'est qu'elle a entendu le son du gong comme
étant l'effet d'un déplacement du bras de Jean. Marie peut ne
pas entendre le son comme étant produit de cette façon; si elle
se limite à ce qu'elle entend, le son aurait pu se produire tout
seul, sans la coopération du déplacement du bras. La phéno-
ménologie de ce qu'elle a entendu n'inclut pas, dans ce cas, les
conditions de la production du son. Nous nous inspirons libre-
ment ici d'une distinction exploitée systématiquement par
Fred Dretske (1969) entre la perception simple (d'un objet ou
d'un événement) et la perception épistémique (en l'occurrence,
percevoir telle chose comme étant telle autre). En fait, l'utili-
sation de comptes rendus de perception simple (.(Marie
entend le son d'un gong,))n'est pas suffisante pour saisir ou
indiquer la complexité phénoménologique du contenu de la
perception. Par la suite, nous appliquerons les deux principes
élémentaires suivants : premièrement, l'analyse phénoméno-
logique tient compte seulement d u contenu de l'expérience;
deuxièmement, le contenu de I'expérience est dans la norme
exprimc; par des comptes rendus non simples (.(voir que...,),
<<entendre... comme.. .>, >.
1.3. Quelyues difficultés.
Il reste pourtant des difficultés, car bien entendu, ces deux
principes n'ont qu'une valeur indicative générale. Le filet jeté
s u r l'expérience par une clause complétive (ou une clause
introduite par <.comme>,) peut être trop large, au sens où il ne
capture pas toutes les distinctions phénoménologiques exis-
tantes. P a r exemple, la différence phénoménologique entre
voir en vision monoculaire que le chat est sur le paillasson et
voir le même état de choses en vision binoculaire peut ne pas
correspondre à une différence a u niveau des clauses utilisées
pour rapporter l'expérience : dans les deux cas, on voit que le
chat est sur le paillasson. Certes, l'expression de la différence
phénoménologique peut être confiée à un adverbe qui modifie
le verbe à l'extérieur de la clause ( p a r exemple, .<envision
monoculaire,>modifie le verbe de perception) : c'est précisé-
ment ce que nous avons fait en présentant l'exemple. Néan-
moins, le rôle de l'adverbe ne consiste pas à décrire la diffé-
rence phénoménologique e n question, mais à spécifier les
conditions dans lesquelles cette différence est décelable.
De plus, certains types de contenu, notamment les conte-
nus analogiques, posent normalement un problème de sous-
détermination par rapport aux concepts éventuellement
employés pour leur description (Dretske 1981, Peacocke 1986).
Si vous utilisez un vocabulaire relatif aux déterminations tem-
poreiles qui se limite seulement aux noms des heures, vous ne
pouvez pas, au moyen de ce vocabulaire, exprimer avec préci-
sion le contenu de votre perception lorsque vous voyez
l'aiguille des heures dans la position où elle devrait se trouver
à 15 h 15. Dans ce cas, peut-être pouvez-vous dire (<Jevois que
l'aiguille se trouve entre 15 heures et 16 heures,,, mais cela ne
constitue qu'une approximation de ce que vous voyez en fait.
> . ) L ' >
En outre, il est souvent difficile de sélectionner avec préci-
sion la description appropriée du contenu perceptif'. P a r
exemple, lorsque vous regarde$ ln photographie d'une tasse à , :
moitié pleine de café,.le contenu de ce que vous voyez par le
moyen de la photographie est que la tasse est h moiti6 pleine
de café. Mais le contenu puremcnt pictural de la photographie
est, en un sens, plus pauvre : celle-ci ne représente qu'une par-
tie du café (et, en fait, qu'une partie de sa surface). En réalité,
la photographie ne vous ment pas, car elle ne peut représenter
que le café visible sous l'angle à partir duquel la photographie
a été prise. Ainsi, il semble que le contenu perceptif cl6passe le
contenu puremcnt pictural, et qu'il transcende les limitations
imposées a u contenu pictural par le point de vue. Malgré ces
difficultés, nous continuerons à parler du contenu perceptif
comme de ce qui peut s'exprimer par un compte rendu de per-
ception non simple, en supposant que toute ambiguïté est
exclu?.
Tout en reconnaissant l'intérêt de l'analyse phénoménolo-
gique, nous voulons aussi en souligner les limites. Il est clair
que dans certains cas, la description phénoménologique est
incapable de trancher entre des hypothèses ou des théories en
lice. Par exemple, l'acceptation d'une théorie représentative de
la perception, d'après laquelle les objets directs de la percep-
tion sont des données sensorielles, au moyen desquelles la per-
ception nous offre un accès indirect aux objets externes, n'est
nullement menacée par le fait que nous avons l'impression de
percevoir directement les objets externes. La théorie représen-
tative n'est pas censée fournir une explication de ce que nous
avons l'impression de voir, mais de la structure de la percep-
tion (voir section 5.2).
D'autres précautions s'imposent à l'égard de la démarche
phénoménologique. En insistant exagérément sur l'analyse
descriptive, on court le risque de négliger la distinction entre
les aspects centraux ou essentiels du phénomène à décrire, et
ses aspects marginaux ou accidentels. Comme le phénomène à
décrire est souvent envisagé dans un contexte particulier, cer-
taines relations au contexte peuvent se révéler extrinsèques
a u phénomène en question, et non constitutives de celui-ci. Il
importe donc de souligner que la distinction entre les aspects
essentiels et accidentels d'un phénomène n'est pas forcément
accessible du point de vue de la phénoménologie descriptive.
Ce point reste valable quelle que soit l'interprétation exacte de
la distinction en question, qu'elle soit fondée dans la chose ou
seulement dans le concept.
Quelle méthode pouvons-nous adopter pour sélectionner
les aspects constitutifs d'un phénomène? Dans ce travail, nous
ferons largement appel aux expériences de pensée où l'applica-
tion d'un concept est testée dans un contexte inhabituel. (Les
phénoménologues classiques eux-mêmes étaient bien
conscients de la nécessité de quitter le plan purement descrip-
tif pour tracer la distinction entre les éléments constitutifs et
accidentels des phénomènes; voir par exemple l'insistance de
Husserl, 1913, $70, sur le rôle de l'imagination.) On peut dis-
tinguer deux types d'expériences de pensée selon le style
d'intervention sur le contexte. D'une part, le contexte d'appli-
cation d'un concept peut se voir systématiquement appauvri.
Par exemple, s'il est impossible de concevoir un son sans une
hauteur définie, il faut alors considérer la hauteur comme un
aspect essentiel du son. De même, s'il est impossible de conce-
voir une situation dans laquelle une expérience perceptive est
causalement indépendante de son objet, alors il faut accorder
un rôle essentiél à la causalité dans la perception. L'histoire de
la philosophie est riche en exemples d'expériences de pensée
où le contexte d'application d'un concept est intentionnelle-
ment appauvri. Berkeley soumettait à l'épreuve la notion
d'une expérience orientée dans le cas d'une intelligence angé-
lique, dépourvue de corps. Condillac examinait le concept de
modalité sensorielle en imaginant une statue qui, dans sa
condition initiale, est dépourvue de toute sensibilité, et se
demandait quelles caractéristiques lui manquaient pour
reproduire tel ou tel aspect de notre faculté perceptive. Les
expériences de pensée proposées par Nicod et Strawson, que
nous discutons dans le chapitre 10, relèvent également de ce
premier type.
D'autre part, le contexte d'application d'un concept peut se
trouver systématiquement enrichi. C'est le cas par exemple
des fameuses expériences de pensée impliquant Terre-Jumelle
(Putnam, 1975). On imagine une autre planète, Terre-Jumelle,
qui est une réplique presque fidèle de notre planète à quelques
traits pertinents près : par exemple, le liquide qui remplit ses
mers et qui coule de ses robinets ressemble superficiellement à
de l'eau mais possède une structure moléculaire inédite (sa
structure moléculaire n'est pas H20, mais disons XyZ). L'inté-
rêt de ces expériences de pensée consiste dans la possibilité de
tester nos intuitions relatives à l'application du concept d'eau
au liquide de Terre-Jumelle. Une des questions philosophiques
pertinentes est celle de savoir si l'application correcte de notre
concept d'eau à une substance donnée est sensible à la struc-
ture moléculaire de cette substance. Les expériences de pensée
impliquant une certaine inversion, spatiale ou qualitative,
auxquelles nous faisons appel dans les chapitres 2 , 7 et 9, relè-
vent de ce second type d'expérience. Une façon métaphorique
de résumer les différences entre les deux types d'expériences
de pensée serait de dire que l'usage des contextes appauvris
révèle les limites inférieures d'application d'un concept, alors
que l'usage des contextes enrichis indique les limites supé-
rieures d'application du concept.
1.5. Analyse conceptuelle et définition théorique.
Traditionnellement, l'analyse conceptuelle se propose de
dégager les éléments les plus importants de notre conceptuali-
sation ordinaire du monde. Le langage joue dans ce contexte
un rôle de fil conducteur; l'analyse tente de mettre en évidence
les critères d'application d'un terme utilisé au sein d'une com-
munauté linguistique, et pour ce faire, elle retrace les liens
constitutifk entre les diffërents concepts employés de manière
implicite ou explicite par le locuteur lorsqu'il utilise le terme.
En fait, l'expression .<analyse conceptuelle^^ a été utilisée pour
désigner des activités philosophiques assez différentes, telles
que la philosophie du langage ordinaire de Austin ( 1962)et la
metaphysique descriptive de Strawson ( 1985 1. On reproche
couramn~entà la philosophie du langage ordinaire de négliger
la distinction entre les traits essentiels et les traits accidentels
d'un concept (5laquelle nous avons fait allusion plus haut). En
effet, ce type de philosophie semble se limiter à collectionner
les idiosyncrasies de l'usage d'un terme au sein d'une commu-
nauté linguistique déterminée, sans explorer les intuitions des
locuteurs sur l'application du terme dans des situations moins
ordinaires, telles que celles qui sont envisagées dans les expé-
riences de pensée. La métaphysique descriptive, par contre,
aspire à une plus grande universalité, notamment par l'usage
de ces expériences.
Prise au sens général, l'analyse conceptuelle d'un terme
est une tentative pour rendre compte de la relation entre son
utilisation d'une part, et les croyances et intuitions des locu-
teurs qui l'emploient d'autre part (Neander, 1991: S 2). En ce
sens, l'analyse conceptuelle n'aboutit pas forcément à une
définition théorique, censée fburnir l'extension d'un terme en
isolant si possible les propriétés essentielles des membres de
cette extension. Lorsqu'un terme n'a pas d'extension, comme
dans le cas de .phlogistique,>, il n'est pas possible d'en donner
une définition théorique, mais cela ne nous empêche pas d'en
fournir une analyse conceptuelle si, par exemple, nous voulons
montrer à un locuteur persuadé de l'existence du phlogistique
les contradictions internes du concept. Une autre divergence
intéressante entre l'analyse conceptuelle et la définition théo-
rique concerne les limites d'application des concepts ordi-
naires. Certaines expériences de pensée peuvent révéler les
limites des intuitions des locuteurs relativement à l'applica-
tion d'un terme. Ces limites peuvent se révéler, soit parce que
les intuitions divergent d'un locuteur à l'autre, soit parce
qu'elles nous font complètement défaut. Dans une telle situa-
tion, une définition théorique peut résulter d'une stipulation
sur l'extension exacte du terme. Par exemple, ce genre de sti-
pulation permet au physicien d'envisager l'élargissement du
concept de son pour y inclure des vibrations mécaniques inau-
dibles, telles que les ultrasons.
Vous aimerez peut-être aussi
- (Textes Philosophiques) Etienne Gilson - L'Être Et l'Essence-Vrin (1962)Document375 pages(Textes Philosophiques) Etienne Gilson - L'Être Et l'Essence-Vrin (1962)Carlos SanchesPas encore d'évaluation
- BUTOR, M. Essais Sur Le RomanDocument10 pagesBUTOR, M. Essais Sur Le RomanNicole DiasPas encore d'évaluation
- 081205-La Logique Transcendantale de HusserlDocument11 pages081205-La Logique Transcendantale de HusserlL'As De PiquePas encore d'évaluation
- De Quoi L Experience Nous Instruit ElleDocument5 pagesDe Quoi L Experience Nous Instruit EllefrenchmermaidPas encore d'évaluation
- Design Branding PDFDocument195 pagesDesign Branding PDFAmina Alili100% (1)
- Chapitre 1Document39 pagesChapitre 1faredj rsPas encore d'évaluation
- Les Théories Simplifient Elles L'expérience - Éléments de CorrectionDocument10 pagesLes Théories Simplifient Elles L'expérience - Éléments de CorrectionNoël PécoutPas encore d'évaluation
- Annexe Le Mythe Individuel Du Nevrose 1952 1953Document33 pagesAnnexe Le Mythe Individuel Du Nevrose 1952 1953JUCQUOISPas encore d'évaluation
- Esquisse D'une Theorie Des Emotions - SartreDocument32 pagesEsquisse D'une Theorie Des Emotions - Sartrejonathan.hardyPas encore d'évaluation
- Philo Du SonDocument8 pagesPhilo Du SonNicole Brooks0% (1)
- 0 IntroductionDocument8 pages0 Introductionnicojararam1Pas encore d'évaluation
- Paris 1 - Épistémologie L2S3Document22 pagesParis 1 - Épistémologie L2S3Arthur HemonoPas encore d'évaluation
- Lenay Sebbah Constitution Spatiale IntellecticaDocument29 pagesLenay Sebbah Constitution Spatiale IntellecticaCharles LenayPas encore d'évaluation
- Le Mythe Individuel Du NevroseDocument33 pagesLe Mythe Individuel Du Nevrosemancol100% (2)
- Psychologie Et DualismeDocument11 pagesPsychologie Et DualismeBocar Diao100% (1)
- Le Mythe Individuel Du NevroseDocument34 pagesLe Mythe Individuel Du NevroseEzequiel MartinsPas encore d'évaluation
- DM Facu PhiloDocument3 pagesDM Facu Philodupinmargaux52Pas encore d'évaluation
- Expose: Groupe #13Document8 pagesExpose: Groupe #13Alexis YogoPas encore d'évaluation
- Logique g1Document35 pagesLogique g1Nzuzi50% (2)
- Lexique La Dissertation de PhilosophieDocument48 pagesLexique La Dissertation de PhilosophieÖmer Şentürk100% (1)
- 1py RaccahDocument18 pages1py RaccahMaroua Benk99rimaPas encore d'évaluation
- La Conscience en Tant Que Metaphore Spatiale Theorie de Julian Jaynes StewartDocument24 pagesLa Conscience en Tant Que Metaphore Spatiale Theorie de Julian Jaynes StewartboulegamaiPas encore d'évaluation
- Conscience, Espace Et RéalitéDocument31 pagesConscience, Espace Et RéalitéKeoprahPas encore d'évaluation
- Nas EpistémologieDocument7 pagesNas EpistémologieTala DioufPas encore d'évaluation
- Lacan Textes Et Conferences 2Document178 pagesLacan Textes Et Conferences 2JUCQUOISPas encore d'évaluation
- Introduction À L'épistémologieDocument20 pagesIntroduction À L'épistémologiekarima.mihoubiPas encore d'évaluation
- La Question Philosophique de La SCIENCE Bac Blanc 2023 EnvoiDocument13 pagesLa Question Philosophique de La SCIENCE Bac Blanc 2023 EnvoiSarah AmmarPas encore d'évaluation
- 9-Heisenberg CompressDocument2 pages9-Heisenberg CompressMoustapha MangassyPas encore d'évaluation
- Poly SV Epistémo 2019-20Document24 pagesPoly SV Epistémo 2019-20Romilord MagelaPas encore d'évaluation
- Sem 4 AFI PDFDocument435 pagesSem 4 AFI PDFdarkwarriofPas encore d'évaluation
- 1953-07-08 Conférence S.I.R.Document19 pages1953-07-08 Conférence S.I.R.lf 1898Pas encore d'évaluation
- Phlou 0776-555x 1930 Num 32 26 2574Document19 pagesPhlou 0776-555x 1930 Num 32 26 2574cuba esquivel amadeoPas encore d'évaluation
- TL Philosophie Suffit Il D Observer Pour Connaitre L Juin 2017Document5 pagesTL Philosophie Suffit Il D Observer Pour Connaitre L Juin 2017LinxegubPas encore d'évaluation
- Paul Watzlawick - ChangementDocument3 pagesPaul Watzlawick - ChangementLudovic LebelPas encore d'évaluation
- Juste Une Dimension de Plus - DR Jean Pierre JourdanDocument16 pagesJuste Une Dimension de Plus - DR Jean Pierre JourdanMichel Blanc100% (1)
- 1 La Deduction Et L'InductionDocument44 pages1 La Deduction Et L'InductionVíctor Manuel Hernández Márquez100% (1)
- Communication Hypnotique Symptomes Et emDocument12 pagesCommunication Hypnotique Symptomes Et emsookiPas encore d'évaluation
- Psychologie Du Travail Et Des Organisations 1Document75 pagesPsychologie Du Travail Et Des Organisations 1nawal.elkaamoussi.swinnenPas encore d'évaluation
- La Philosophie de La Nature (Partie 1) 000001365Document114 pagesLa Philosophie de La Nature (Partie 1) 000001365Jorge Candido da SilvaPas encore d'évaluation
- Chapitre 0Document8 pagesChapitre 0faredj rsPas encore d'évaluation
- PDF Theorie Du SyllogismeDocument70 pagesPDF Theorie Du SyllogismeJinOtaku100% (1)
- Cours Complet de Telepathie 271 Pages PDFDocument271 pagesCours Complet de Telepathie 271 Pages PDFLogan Hellstorm86% (7)
- Principes de Linguistique PsychologiqueDocument570 pagesPrincipes de Linguistique Psychologiquecoconut108100% (1)
- Jean Hyppolite - Genèse Et Structure de La Phénoménologie de L'esprit de Hegel - CHAPITRE 1Document11 pagesJean Hyppolite - Genèse Et Structure de La Phénoménologie de L'esprit de Hegel - CHAPITRE 1Calac100% (1)
- Conference SteinerDocument14 pagesConference SteinerAdeline GorsePas encore d'évaluation
- Binet 1903 L'Etude ExperimentaleDocument314 pagesBinet 1903 L'Etude ExperimentaleSARA GOMEZ CASTAÑEDAPas encore d'évaluation
- Paris 1 - Philosophie Générale Complémentaire L2S3Document64 pagesParis 1 - Philosophie Générale Complémentaire L2S3Arthur HemonoPas encore d'évaluation
- CM Épistémo 2021-22Document31 pagesCM Épistémo 2021-22Romilord MagelaPas encore d'évaluation
- Hyp PoliteDocument591 pagesHyp PolitePascal Le BotPas encore d'évaluation
- Ciocan 2011 ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE. TROIS PARADIGMES DE L'IMAGE CHEZ JEAN-LUC MARIONDocument14 pagesCiocan 2011 ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE. TROIS PARADIGMES DE L'IMAGE CHEZ JEAN-LUC MARIONPheno NewPas encore d'évaluation
- Dissertation Natygane de Jaegher VFDocument17 pagesDissertation Natygane de Jaegher VFNatygane De JaegherPas encore d'évaluation
- Bertrand Russell - Le Réalisme Analytique (1911)Document9 pagesBertrand Russell - Le Réalisme Analytique (1911)lepton100100% (1)
- Ce qui est en je: A la découverte des logiciels du vivantD'EverandCe qui est en je: A la découverte des logiciels du vivantPas encore d'évaluation
- Theosophie - Une introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée de l'homme (traduit)D'EverandTheosophie - Une introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée de l'homme (traduit)Pas encore d'évaluation
- Vos débuts en radiesthésie: Un guide pratique indispensable pour tous les débutants de cette disciplineD'EverandVos débuts en radiesthésie: Un guide pratique indispensable pour tous les débutants de cette disciplineÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- MANUEL DE LECTURE DES PENSÉES - Cours pratique en 12 leçons (traduit)D'EverandMANUEL DE LECTURE DES PENSÉES - Cours pratique en 12 leçons (traduit)Pas encore d'évaluation
- La pensée et le mouvant: Essais et Conférences (1903-1923)D'EverandLa pensée et le mouvant: Essais et Conférences (1903-1923)Pas encore d'évaluation
- Personnalités Intérieures: Tant de voix en toi. Qui es-tu vraiment ?D'EverandPersonnalités Intérieures: Tant de voix en toi. Qui es-tu vraiment ?Pas encore d'évaluation
- La télépathie, la science de la transmission de la pensée (traduit)D'EverandLa télépathie, la science de la transmission de la pensée (traduit)Pas encore d'évaluation
- Philosc09 Lichnerowicz 1965Document34 pagesPhilosc09 Lichnerowicz 1965hilladeclackPas encore d'évaluation
- Livre de ConjugaisonDocument54 pagesLivre de ConjugaisonLorelei877Pas encore d'évaluation
- Cours 1Document30 pagesCours 1Sidi Mohamed SalickPas encore d'évaluation
- Synthèse de Cours - 15Document7 pagesSynthèse de Cours - 15Venuti AnnalisaPas encore d'évaluation
- Félix Guattari - Machine Abstraite Et Champ Non DiscursifDocument13 pagesFélix Guattari - Machine Abstraite Et Champ Non DiscursifJoaquim VianaPas encore d'évaluation
- Utilisation Des Cartes Auto-Organisatrices de Kohonen Dans La Recherche Documentaire PDFDocument14 pagesUtilisation Des Cartes Auto-Organisatrices de Kohonen Dans La Recherche Documentaire PDFStephane MbiaPas encore d'évaluation
- Les ConjonctionsDocument4 pagesLes ConjonctionsKaram AlMashhadiPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument38 pagesExtraitFleur DivinePas encore d'évaluation
- Face Pile Methodes Actives FinalDocument2 pagesFace Pile Methodes Actives Finalanou1653Pas encore d'évaluation
- La République VI-VII ExtraitsDocument25 pagesLa République VI-VII ExtraitsGiorgi GiorgiPas encore d'évaluation
- Erreurs Et ObsstaclesDocument33 pagesErreurs Et ObsstaclesLoredana ManasiaPas encore d'évaluation
- Kholle IADocument3 pagesKholle IAnoebleyenheuftPas encore d'évaluation
- A2 PE Ex2 ExplicitationDocument1 pageA2 PE Ex2 ExplicitationCoralie GournayPas encore d'évaluation
- Expressions Verbo-NominalesDocument36 pagesExpressions Verbo-NominalesZivagoPas encore d'évaluation
- These FJDocument208 pagesThese FJPedro SaldiasPas encore d'évaluation
- Vingt Mille Mots Sous Les MersDocument42 pagesVingt Mille Mots Sous Les MersAttabPas encore d'évaluation