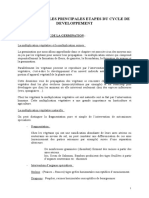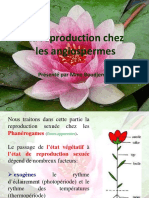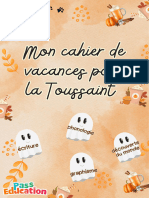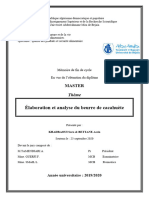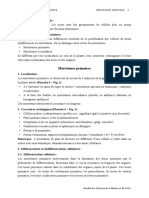Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
6 vuesLa Reproduction de La Plante, Entre Vie Fixée Et Mobilité - Chap3
La Reproduction de La Plante, Entre Vie Fixée Et Mobilité - Chap3
Transféré par
ninalequitte18Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous aimerez peut-être aussi
- 2nde S1 Les K3Document10 pages2nde S1 Les K3erangahhelenePas encore d'évaluation
- PPT-COURS - @ - TC FR - Reproduction Des AngiospermesDocument67 pagesPPT-COURS - @ - TC FR - Reproduction Des Angiospermesgalaxy centre zetana0% (1)
- Th3 CHAP3 Reproduction Angiospermes Arecopier2022Document2 pagesTh3 CHAP3 Reproduction Angiospermes Arecopier2022EliasPas encore d'évaluation
- ZhaoDocument4 pagesZhaotamiozzo.helioPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Plantes Spé NBDocument6 pagesChapitre 3 Plantes Spé NBImade AissouPas encore d'évaluation
- 213-Cours Vie Fixee Des PlantesDocument4 pages213-Cours Vie Fixee Des PlantesMosta GuezPas encore d'évaluation
- Chapitre 7 - Reproduction de La PlanteDocument7 pagesChapitre 7 - Reproduction de La PlanteYousra INDIAPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - La Reproduction Des AngiospermesDocument2 pagesChapitre 3 - La Reproduction Des AngiospermesjoanaPas encore d'évaluation
- SVT Plante Chap3Document3 pagesSVT Plante Chap3SaadaPas encore d'évaluation
- Reproduction Vegetale Et DeveloppementDocument6 pagesReproduction Vegetale Et DeveloppementDenia HelhalPas encore d'évaluation
- Cours SVTDocument2 pagesCours SVTlily.albert49Pas encore d'évaluation
- Réponses TD4 (TD-SVI-M9-Biologie Des Organismes Végétaux) Kamal AberkaniDocument12 pagesRéponses TD4 (TD-SVI-M9-Biologie Des Organismes Végétaux) Kamal Aberkanihanane boutajPas encore d'évaluation
- Cours Reproduction PlantesDocument9 pagesCours Reproduction PlantesniainamanuellaPas encore d'évaluation
- Plantes. Autogames AllogamesDocument5 pagesPlantes. Autogames AllogamesSamir BenmouffokPas encore d'évaluation
- Resumé SVTDocument2 pagesResumé SVTGuillermoPas encore d'évaluation
- Reproduction de La PlanteDocument2 pagesReproduction de La PlanteMGEKINGPas encore d'évaluation
- Reproduction Chez Les Végétaux10.05.2024Document19 pagesReproduction Chez Les Végétaux10.05.2024abdelkarimlamrani8Pas encore d'évaluation
- NotionsArguments Chap1et2plantesDocument5 pagesNotionsArguments Chap1et2plantesLéa DupriellePas encore d'évaluation
- Chapitre ViDocument35 pagesChapitre ViAbdenour AdjaoudPas encore d'évaluation
- Chapitre Vi PDFDocument35 pagesChapitre Vi PDFDJIL BENPas encore d'évaluation
- Capture D'écran . 2022-12-12 À 14.03.40Document6 pagesCapture D'écran . 2022-12-12 À 14.03.40Mérine RPas encore d'évaluation
- GrainesDocument41 pagesGrainesPaoloRoccaPas encore d'évaluation
- Pollinisation - WikipédiaDocument27 pagesPollinisation - WikipédiajoachimmvpPas encore d'évaluation
- Embranchement Des SpermaphytesDocument23 pagesEmbranchement Des SpermaphytessumaleePas encore d'évaluation
- La Reproduction SexuéeDocument2 pagesLa Reproduction SexuéeJannat NachirPas encore d'évaluation
- Cours 2Document37 pagesCours 2Tahiri AbdelilahPas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les Végétaux 2023Document5 pagesLa Reproduction Chez Les Végétaux 2023fmhada7Pas encore d'évaluation
- La Reproduction Sexuee Chez Les Angiospermes Activites 1Document20 pagesLa Reproduction Sexuee Chez Les Angiospermes Activites 1Rolf SagaPas encore d'évaluation
- Les AbeillesDocument27 pagesLes Abeilleschahrazad arifPas encore d'évaluation
- La Reproduction Sexuée Chez Les VégétauxDocument6 pagesLa Reproduction Sexuée Chez Les VégétauxMD Nassima100% (1)
- BotqniaueDocument5 pagesBotqniaueChoudder MeriamPas encore d'évaluation
- Végétaux 3Document1 pageVégétaux 3Matthias JudoPas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 5Document28 pagesLa Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 5salma zerhouniPas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les PlantesDocument8 pagesLa Reproduction Chez Les PlantesYaksok 1.1.0.2Pas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 2Document29 pagesLa Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 2salma zerhouniPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document5 pagesChapitre 3Finance France rapidePas encore d'évaluation
- Angl DemainDocument7 pagesAngl Demainhenry joelPas encore d'évaluation
- Cycles Biologiques Et Structures Reproductrices Chap06Document24 pagesCycles Biologiques Et Structures Reproductrices Chap06almnaouarPas encore d'évaluation
- CM Reproduction Des Thallophytes, Des Bryophytes Et Des PtéridophytesDocument66 pagesCM Reproduction Des Thallophytes, Des Bryophytes Et Des PtéridophytesBernard HamienPas encore d'évaluation
- Biologie Vegetale-2Document18 pagesBiologie Vegetale-2Carely AngelPas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les PlantesDocument7 pagesLa Reproduction Chez Les PlantesmohamedPas encore d'évaluation
- Réproduction Des Organismes Végétaux BCPSTDocument92 pagesRéproduction Des Organismes Végétaux BCPSTjosephsawadogo008Pas encore d'évaluation
- La Reproduction Sexuée Et Asexuée Chez Les Végétaux-Converti - Version2Document5 pagesLa Reproduction Sexuée Et Asexuée Chez Les Végétaux-Converti - Version2sbihiabdo9Pas encore d'évaluation
- En AgricultureDocument5 pagesEn AgricultureSakina AnouarPas encore d'évaluation
- Devoir MR RivalDocument5 pagesDevoir MR RivalDieuné JanvierPas encore d'évaluation
- Cours 8 - La Reproduction Chez Les AngiospermesDocument74 pagesCours 8 - La Reproduction Chez Les AngiospermesAmirou Baby MixicoPas encore d'évaluation
- Exposé - Reproduction Chez Les Plantes À Fleursf4Document3 pagesExposé - Reproduction Chez Les Plantes À Fleursf4Ibrahima Sory Sory DialloPas encore d'évaluation
- Resumé Reproduction AsexuéeDocument2 pagesResumé Reproduction AsexuéeAtahan KaracaPas encore d'évaluation
- Resume Cours 4Document2 pagesResume Cours 4sextansPas encore d'évaluation
- Reproduction Sexuee AsexueeDocument2 pagesReproduction Sexuee AsexueePaola MalsotPas encore d'évaluation
- La SemenceDocument12 pagesLa SemenceAmina Feriel KadriPas encore d'évaluation
- Zoubair Cours TC FR - 1p - Repro PlantesDocument21 pagesZoubair Cours TC FR - 1p - Repro Plantesgalaxy centre zetanaPas encore d'évaluation
- 2 - La Reproduction Des Végétaux-1 - 9Document6 pages2 - La Reproduction Des Végétaux-1 - 9a.KPas encore d'évaluation
- Cours Reproduction Chez Les Végétaux Univers DocumentsDocument9 pagesCours Reproduction Chez Les Végétaux Univers Documentselhadouni114Pas encore d'évaluation
- Exposé Sur Les Modalités de La Reproduction SexuelleDocument13 pagesExposé Sur Les Modalités de La Reproduction SexuelleLisa Lunime0% (1)
- 06 - Sex in PlantsDocument11 pages06 - Sex in PlantsKima MadPas encore d'évaluation
- 2 Prep U3l1 t2Document5 pages2 Prep U3l1 t2bibo biboPas encore d'évaluation
- À Imprimer ImportantDocument10 pagesÀ Imprimer ImportantDieudonné AdokoPas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 1Document7 pagesLa Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 1zakaria chakerPas encore d'évaluation
- Développement végétal: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandDéveloppement végétal: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Ebook Smart Energy Management Data Driven Methods For Energy Service Innovation 1St Edition Kaile Zhou Online PDF All ChapterDocument24 pagesEbook Smart Energy Management Data Driven Methods For Energy Service Innovation 1St Edition Kaile Zhou Online PDF All Chaptermartha.hernandez582100% (7)
- Capture D'écran . 2024-03-06 À 14.09.44Document2 pagesCapture D'écran . 2024-03-06 À 14.09.44elouardin6Pas encore d'évaluation
- Les Arbres de Madagascar Pour ReboisementDocument1 pageLes Arbres de Madagascar Pour ReboisementsolonanaharyleaPas encore d'évaluation
- Toussaint Cahier de Vacances Gratuit GS MaternelleDocument13 pagesToussaint Cahier de Vacances Gratuit GS Maternelleroums65Pas encore d'évaluation
- Rapport M 17Document108 pagesRapport M 17irrisys.kenitra26Pas encore d'évaluation
- GRP 4 Exo 2Document7 pagesGRP 4 Exo 2nealPas encore d'évaluation
- 2021 - Guide Reco EEEDocument122 pages2021 - Guide Reco EEEGabriel TinnèsPas encore d'évaluation
- Le Dispositif en Carrã© LatinDocument7 pagesLe Dispositif en Carrã© LatinYasmine ChercharPas encore d'évaluation
- Le Savoir-Faire Local Dans La Valorisation Alimentaire Des Fruits Du Safoutier (Dacryodes Edulis (G. Don) H.J. Lam) Au CamerounDocument5 pagesLe Savoir-Faire Local Dans La Valorisation Alimentaire Des Fruits Du Safoutier (Dacryodes Edulis (G. Don) H.J. Lam) Au CamerounJunias PakiPas encore d'évaluation
- Fiche Élève-6°-Une Flore ExtraordinaireDocument1 pageFiche Élève-6°-Une Flore ExtraordinairelauraPas encore d'évaluation
- Memento FleurDocument3 pagesMemento FleurVigourouxPas encore d'évaluation
- Alchornea Cordifolia - WikipédiaDocument11 pagesAlchornea Cordifolia - WikipédiaGilles Landry DIKEBIEPas encore d'évaluation
- Les Meilleurs Lieux de DragueDocument5 pagesLes Meilleurs Lieux de DraguebernardotapiePas encore d'évaluation
- Catalogue Plantes 2022Document57 pagesCatalogue Plantes 2022Sebastien GarciaPas encore d'évaluation
- Epreuve de Publication Assistee Par OrdinateurDocument6 pagesEpreuve de Publication Assistee Par Ordinateurinfocus rostoPas encore d'évaluation
- Les Tissus Végétaux 2020Document19 pagesLes Tissus Végétaux 2020Rahma Lionne100% (1)
- Elaboration Et Analyse Du Beurre de CacahuèteDocument32 pagesElaboration Et Analyse Du Beurre de CacahuètenawresnoussaPas encore d'évaluation
- GnisDocument179 pagesGnisIbrahim JolyPas encore d'évaluation
- 2 - MéristèmesDocument7 pages2 - MéristèmesHanna Lee MarinPas encore d'évaluation
- Cle Identification Famille de PlantesDocument17 pagesCle Identification Famille de PlantesNatiripsye Institut de FormationPas encore d'évaluation
- 9 Glossaire p409-425Document17 pages9 Glossaire p409-425Ammar BouzouerPas encore d'évaluation
- Les Bases Du BouturageDocument3 pagesLes Bases Du BouturagemedPas encore d'évaluation
- Présentation de Cours de Construction en Bois - Partie 1 - 2024Document89 pagesPrésentation de Cours de Construction en Bois - Partie 1 - 2024maxime CLOPas encore d'évaluation
- Cin - CJBG - HS17 - 2017 1Document203 pagesCin - CJBG - HS17 - 2017 1Gnaly KpazaiPas encore d'évaluation
- Les Insectes Pollinisateurs Indigènes Et L'agriculture Au CanadaDocument47 pagesLes Insectes Pollinisateurs Indigènes Et L'agriculture Au CanadazefaraPas encore d'évaluation
- BV1 Chap2 Du Thalle Au Cormus - DocDocument35 pagesBV1 Chap2 Du Thalle Au Cormus - DocPauline SoulierPas encore d'évaluation
- Bambouuu 1Document19 pagesBambouuu 1nicsdcPas encore d'évaluation
- Les InflorescencesDocument3 pagesLes Inflorescenceshadil saidiPas encore d'évaluation
- Bovet PH17Document103 pagesBovet PH17يوميات صيدلانية pharmacist diariesPas encore d'évaluation
- Activité N°1 Le Rapprochement Des GamètesDocument3 pagesActivité N°1 Le Rapprochement Des Gamètesisaacsouless0Pas encore d'évaluation
La Reproduction de La Plante, Entre Vie Fixée Et Mobilité - Chap3
La Reproduction de La Plante, Entre Vie Fixée Et Mobilité - Chap3
Transféré par
ninalequitte180 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
6 vues4 pagesTitre original
La Reproduction de La Plante, Entre Vie Fixée Et Mobilité- Chap3
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format odt, pdf ou txt
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
6 vues4 pagesLa Reproduction de La Plante, Entre Vie Fixée Et Mobilité - Chap3
La Reproduction de La Plante, Entre Vie Fixée Et Mobilité - Chap3
Transféré par
ninalequitte18Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme ODT, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Télécharger au format odt, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 4
Chapitre 3 – La reproduction de la plante,
entre vie fixée et mobilité
Les plantes à fleurs également appelées Angiospermes disposent de deux modes de
reproduction : la reproduction asexuée, s’effectuant sans l’intervention de gamètes et la
reproduction sexuée, reposant sur une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde. Dans
le cas de la reproduction sexuée, la rencontre entre les gamètes peut nécessiter des adaptations
chez les végétaux puisque ces derniers sont fixés, limitant donc les possibilités de contact et
de fusion entre gamètes de plantes différentes.
I. La reproduction asexuée
La reproduction asexuée est un processus naturel qui se réalise chez de nombreuses plantes et
qui permet la formation de nouveaux individus sans l’intervention de gamètes.
Même si la reproduction asexuée peut s’effectuer à partir de presque tous les organes (tiges,
feuilles, racines), elle s’effectue surtout à partir de tiges « spécialisées », comme les
tubercules (tiges souterraines de réserves ; exemple : pommes de terre), les stolons (tiges
aériennes; exemples : fraisiers, violettes, framboisiers) ou les bulbes (tiges souterraines de
réserve; exemple : iris, tulipes …). Ce mode de reproduction correspond donc à du clonage
puisque les nouveaux individus produits sont génétiquement identiques à l’individu parental.
La reproduction asexuée chez les végétaux est possible grâce à certaines propriétés des
végétaux :
– la totipotence cellulaire : elle correspond à la capacité des cellules végétales, même
spécialisées, à se dédifférencier et retrouver ainsi les propriétés des cellules méristématiques.
Ces cellules peuvent ainsi donner naissance à une diversité de cellules et donc à un nouvel
individu (remarque : chez les animaux, seules certaines cellules embryonnaires possèdent
cette propriété de totipotence cellulaire. Cette situation limite donc les possibilités de clonage
et de reproduction asexuée qui n’existe que chez de très rares espèces).
– la capacité de croissance infinie : si les conditions environnementales le permettent, les
méristèmes ont la capacité de produire indéfiniment de nouvelles cellules végétales qui elles-
mêmes peuvent croître et assurer ainsi la croissance permanente des organes végétaux.
La capacité des végétaux à réaliser la reproduction asexuée est exploitée par l’Homme qui
peut ainsi produire des plantes identiques entre elles en utilisant différentes techniques comme
le bouturage (technique de production de nouveaux individus à partir d’organes isolés de la
plante mère : feuilles, tiges, racines …) ou le marcottage (technique de production de
nouveaux individus essentiellement à partir de tiges « artificiellement » enterrées).
Bilan Reproduction Asexuée – Bordas, 2020
II. La reproduction sexuée des Angiospermes
A. La fleur des Angiospermes : un organe adapté à la fécondation
La fleur est l’organe spécialisé des plantes dans la reproduction sexuée. En général, une fleur
est constituée d’un ensemble de pièces florales dont les pièces centrales contiennent les
gamètes : c’est le pistil (généralement central) qui produit et contient les ovules (gamètes
femelles) et ce sont les étamines (généralement positionnées autour du pistil), qui produisent
les grains de pollen, contenant chacun un spermatozoïde (gamète mâle). La grande majorité
des fleurs d’Angiospermes contiennent ainsi un pistil et des étamines et sont donc
hermaphrodites.
Dans la majorité des fleurs, il existe deux autres pièces florales : les pétales (pièces souvent
très colorées) et les sépales (pièces de couleur verte) situées en périphérie de la fleur.
B. La fécondation et ses modalités
La fécondation consiste en la fusion d’un spermatozoïde apporté par un grain de pollen avec
un ovule; elle se déroule au sein du pistil. Comme de très nombreux grains de pollen peuvent
se déposer sur un même pistil, de très nombreux ovules peuvent être fécondés simultanément.
A l’issue de la fécondation, chaque ovule se transforme en une graine alors que la fleur se
transforme en un fruit.
Chez certaines espèces, la fécondation peut, voire doit, s’effectuer au sein d’une même fleur :
on parle alors d’auto-fécondation. Ce phénomène est par exemple obligatoire chez des
espèces dont certaines fleurs ne s’ouvrent pas (exemple : violette, blé) ou dont les étamines et
le pistil restent enfermés (exemple : pois). L’autofécondation produit des individus
génétiquement proches entre eux ce qui limite donc la diversité génétique de la descendance.
Remarque : on utilise aussi le terme d’auto-pollinisation pour indiquer que le pistil d’une
plante reçoit le pollen de la même fleur ou de la même plante.
Même si la majorité des Angiospermes possèdent des fleurs hermaphrodites, la pollinisation
et donc la fécondation ne se font pas toujours au sein d’une même plante. Ainsi, dans de
nombreuses espèces, la fécondation s’effectue entre des fleurs de plantes différentes. Ce
phénomène, appelé fécondation croisée, est même obligatoire pour certaines espèces
(exemple : sauge, orchidées, maïs, …). Cette obligation peut avoir différentes origines :
mécanismes d’incompatibilité génétique (empêchant le grain de pollen d’aboutir à une
fécondation de l’ovule), maturité décalée du pistil et des étamines (les gamètes d’une même
fleur ne sont pas produits simultanément). La mise en place de la fécondation croisée chez des
plantes possédant des fleurs hermaphrodites est considérée comme une adaptation contribuant
à la diversité génétique puisque ce mode de fécondation impose un brassage génétique au
cours de la fécondation entre deux individus génétiquement différents.
C. Les conditions de la fécondation croisée
Chez les plantes dont la fécondation se réalise entre individus différents et compte tenu de
l’immobilité des plantes, le pollen doit obligatoirement se déplacer d’une plante à une autre.
Ce transport peut être assuré par des éléments naturels comme le vent (= anémogamie ou
pollinisation par le vent) ou l’eau (= hydrogamie ou pollinisation par l’eau). Dans ces deux
situations, les grains de pollen possèdent des caractéristiques favorisant ce transport : grains
de pollen de petite taille et très nombreux pour une pollinisation par le vent (exemple :
graminées) ou grains de pollen résistants à l’eau pour la pollinisation par l’eau.
Chez la grande majorité des Angiospermes, la pollinisation est assurée par des animaux (=
zoogamie), et en particulier par les insectes (les autres animaux pollinisateurs étant les
oiseaux et les chauve-souris). La collaboration entre la plante et l’animal pollinisateur est une
forme d’interaction appelée mutualisme, c’est-à-dire une relation temporaire et non
obligatoire entre deux individus de deux espèces différentes, dans laquelle chaque partenaire
tire profit de cette relation. Cette interaction repose sur des adaptations des deux partenaires
favorisant leur interaction : ainsi, les fleurs peuvent présenter différentes caractéristiques,
comme des pétales colorés, la production de nectar (liquide sucré) ou de substances olfactives
(parfum), ces différents éléments exerçant un effet attractif sur l’animal pollinisateur. Les
animaux sont parfois dotés d’organes adaptés à la récolte et au transport du pollen (exemple :
abeille). Ces adaptations qui se sont développées parallèlement chez les deux partenaires
(plante et animal) caractérise le phénomène de coévolution. Il s’agit donc de l’évolution
simultanée de deux espèces interagissant entre elles. Cela aboutit parfois à une collaboration
totalement spécifique entre une plante et son insecte pollinisateur (ex : orchidées).
D. Le devenir et le transport des graines
A l’issue de la fécondation, la fleur se transforme donc en fruit qui contient 1 ou plusieurs
graines provenant de la fécondation d’un ou plusieurs ovules.
La graine produite est constituée d’une enveloppe résistante, de réserves, qui sont des
molécules organiques variées issues de la photosynthèse et accumulées dans la graine et d’un
embryon. Au cours de la germination, cet embryon utilise les réserves de la graine et se
développe en une nouvelle plante.
La dispersion (ou dissémination) des graines est un mécanisme favorisant la reproduction
des plantes. En effet, cette dispersion permet non seulement de coloniser de nouveaux
espaces, mais aussi de limiter la compétition entre les futures plantes, favorisant ainsi la
survie de ces nouveaux individus.
La diversité des fruits et des graines reflète en partie leur mode de dissémination et donc
leur agent de transport :
– transport par le vent : graines ou fruits légers et/ou munis de structures portantes facilitant
leur transport (exemples : « ailes » des fruits d’érables ; « plumeau » des fruits de pissenlit)
– transport par l’eau : graines ou fruits légers et flottants (exemple : noix du cocotier)
– transport par les animaux : graines ou fruits munis de structures s’accrochant dans le pelage
des animaux (exemple : fruits de la grande bardane) ; fruits contenant des sucres attirant les
animaux (exemples : pulpe sucrée du raisin, des mures, des cerises ..), ces derniers rejetant
aux alentours les graines dans leurs excréments. Ces interactions plantes-animaux
disséminateurs sont aussi des exemples de mutualisme.
– dispersion par le fuit lui-même : projection des graines lors de l’ouverture du fruit arrivé à
maturité (exemple : effet « catapulte » des fruits du genêt à balai).
Vous aimerez peut-être aussi
- 2nde S1 Les K3Document10 pages2nde S1 Les K3erangahhelenePas encore d'évaluation
- PPT-COURS - @ - TC FR - Reproduction Des AngiospermesDocument67 pagesPPT-COURS - @ - TC FR - Reproduction Des Angiospermesgalaxy centre zetana0% (1)
- Th3 CHAP3 Reproduction Angiospermes Arecopier2022Document2 pagesTh3 CHAP3 Reproduction Angiospermes Arecopier2022EliasPas encore d'évaluation
- ZhaoDocument4 pagesZhaotamiozzo.helioPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Plantes Spé NBDocument6 pagesChapitre 3 Plantes Spé NBImade AissouPas encore d'évaluation
- 213-Cours Vie Fixee Des PlantesDocument4 pages213-Cours Vie Fixee Des PlantesMosta GuezPas encore d'évaluation
- Chapitre 7 - Reproduction de La PlanteDocument7 pagesChapitre 7 - Reproduction de La PlanteYousra INDIAPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - La Reproduction Des AngiospermesDocument2 pagesChapitre 3 - La Reproduction Des AngiospermesjoanaPas encore d'évaluation
- SVT Plante Chap3Document3 pagesSVT Plante Chap3SaadaPas encore d'évaluation
- Reproduction Vegetale Et DeveloppementDocument6 pagesReproduction Vegetale Et DeveloppementDenia HelhalPas encore d'évaluation
- Cours SVTDocument2 pagesCours SVTlily.albert49Pas encore d'évaluation
- Réponses TD4 (TD-SVI-M9-Biologie Des Organismes Végétaux) Kamal AberkaniDocument12 pagesRéponses TD4 (TD-SVI-M9-Biologie Des Organismes Végétaux) Kamal Aberkanihanane boutajPas encore d'évaluation
- Cours Reproduction PlantesDocument9 pagesCours Reproduction PlantesniainamanuellaPas encore d'évaluation
- Plantes. Autogames AllogamesDocument5 pagesPlantes. Autogames AllogamesSamir BenmouffokPas encore d'évaluation
- Resumé SVTDocument2 pagesResumé SVTGuillermoPas encore d'évaluation
- Reproduction de La PlanteDocument2 pagesReproduction de La PlanteMGEKINGPas encore d'évaluation
- Reproduction Chez Les Végétaux10.05.2024Document19 pagesReproduction Chez Les Végétaux10.05.2024abdelkarimlamrani8Pas encore d'évaluation
- NotionsArguments Chap1et2plantesDocument5 pagesNotionsArguments Chap1et2plantesLéa DupriellePas encore d'évaluation
- Chapitre ViDocument35 pagesChapitre ViAbdenour AdjaoudPas encore d'évaluation
- Chapitre Vi PDFDocument35 pagesChapitre Vi PDFDJIL BENPas encore d'évaluation
- Capture D'écran . 2022-12-12 À 14.03.40Document6 pagesCapture D'écran . 2022-12-12 À 14.03.40Mérine RPas encore d'évaluation
- GrainesDocument41 pagesGrainesPaoloRoccaPas encore d'évaluation
- Pollinisation - WikipédiaDocument27 pagesPollinisation - WikipédiajoachimmvpPas encore d'évaluation
- Embranchement Des SpermaphytesDocument23 pagesEmbranchement Des SpermaphytessumaleePas encore d'évaluation
- La Reproduction SexuéeDocument2 pagesLa Reproduction SexuéeJannat NachirPas encore d'évaluation
- Cours 2Document37 pagesCours 2Tahiri AbdelilahPas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les Végétaux 2023Document5 pagesLa Reproduction Chez Les Végétaux 2023fmhada7Pas encore d'évaluation
- La Reproduction Sexuee Chez Les Angiospermes Activites 1Document20 pagesLa Reproduction Sexuee Chez Les Angiospermes Activites 1Rolf SagaPas encore d'évaluation
- Les AbeillesDocument27 pagesLes Abeilleschahrazad arifPas encore d'évaluation
- La Reproduction Sexuée Chez Les VégétauxDocument6 pagesLa Reproduction Sexuée Chez Les VégétauxMD Nassima100% (1)
- BotqniaueDocument5 pagesBotqniaueChoudder MeriamPas encore d'évaluation
- Végétaux 3Document1 pageVégétaux 3Matthias JudoPas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 5Document28 pagesLa Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 5salma zerhouniPas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les PlantesDocument8 pagesLa Reproduction Chez Les PlantesYaksok 1.1.0.2Pas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 2Document29 pagesLa Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 2salma zerhouniPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document5 pagesChapitre 3Finance France rapidePas encore d'évaluation
- Angl DemainDocument7 pagesAngl Demainhenry joelPas encore d'évaluation
- Cycles Biologiques Et Structures Reproductrices Chap06Document24 pagesCycles Biologiques Et Structures Reproductrices Chap06almnaouarPas encore d'évaluation
- CM Reproduction Des Thallophytes, Des Bryophytes Et Des PtéridophytesDocument66 pagesCM Reproduction Des Thallophytes, Des Bryophytes Et Des PtéridophytesBernard HamienPas encore d'évaluation
- Biologie Vegetale-2Document18 pagesBiologie Vegetale-2Carely AngelPas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les PlantesDocument7 pagesLa Reproduction Chez Les PlantesmohamedPas encore d'évaluation
- Réproduction Des Organismes Végétaux BCPSTDocument92 pagesRéproduction Des Organismes Végétaux BCPSTjosephsawadogo008Pas encore d'évaluation
- La Reproduction Sexuée Et Asexuée Chez Les Végétaux-Converti - Version2Document5 pagesLa Reproduction Sexuée Et Asexuée Chez Les Végétaux-Converti - Version2sbihiabdo9Pas encore d'évaluation
- En AgricultureDocument5 pagesEn AgricultureSakina AnouarPas encore d'évaluation
- Devoir MR RivalDocument5 pagesDevoir MR RivalDieuné JanvierPas encore d'évaluation
- Cours 8 - La Reproduction Chez Les AngiospermesDocument74 pagesCours 8 - La Reproduction Chez Les AngiospermesAmirou Baby MixicoPas encore d'évaluation
- Exposé - Reproduction Chez Les Plantes À Fleursf4Document3 pagesExposé - Reproduction Chez Les Plantes À Fleursf4Ibrahima Sory Sory DialloPas encore d'évaluation
- Resumé Reproduction AsexuéeDocument2 pagesResumé Reproduction AsexuéeAtahan KaracaPas encore d'évaluation
- Resume Cours 4Document2 pagesResume Cours 4sextansPas encore d'évaluation
- Reproduction Sexuee AsexueeDocument2 pagesReproduction Sexuee AsexueePaola MalsotPas encore d'évaluation
- La SemenceDocument12 pagesLa SemenceAmina Feriel KadriPas encore d'évaluation
- Zoubair Cours TC FR - 1p - Repro PlantesDocument21 pagesZoubair Cours TC FR - 1p - Repro Plantesgalaxy centre zetanaPas encore d'évaluation
- 2 - La Reproduction Des Végétaux-1 - 9Document6 pages2 - La Reproduction Des Végétaux-1 - 9a.KPas encore d'évaluation
- Cours Reproduction Chez Les Végétaux Univers DocumentsDocument9 pagesCours Reproduction Chez Les Végétaux Univers Documentselhadouni114Pas encore d'évaluation
- Exposé Sur Les Modalités de La Reproduction SexuelleDocument13 pagesExposé Sur Les Modalités de La Reproduction SexuelleLisa Lunime0% (1)
- 06 - Sex in PlantsDocument11 pages06 - Sex in PlantsKima MadPas encore d'évaluation
- 2 Prep U3l1 t2Document5 pages2 Prep U3l1 t2bibo biboPas encore d'évaluation
- À Imprimer ImportantDocument10 pagesÀ Imprimer ImportantDieudonné AdokoPas encore d'évaluation
- La Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 1Document7 pagesLa Reproduction Chez Les Plantes Cours PDF 1zakaria chakerPas encore d'évaluation
- Développement végétal: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandDéveloppement végétal: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Ebook Smart Energy Management Data Driven Methods For Energy Service Innovation 1St Edition Kaile Zhou Online PDF All ChapterDocument24 pagesEbook Smart Energy Management Data Driven Methods For Energy Service Innovation 1St Edition Kaile Zhou Online PDF All Chaptermartha.hernandez582100% (7)
- Capture D'écran . 2024-03-06 À 14.09.44Document2 pagesCapture D'écran . 2024-03-06 À 14.09.44elouardin6Pas encore d'évaluation
- Les Arbres de Madagascar Pour ReboisementDocument1 pageLes Arbres de Madagascar Pour ReboisementsolonanaharyleaPas encore d'évaluation
- Toussaint Cahier de Vacances Gratuit GS MaternelleDocument13 pagesToussaint Cahier de Vacances Gratuit GS Maternelleroums65Pas encore d'évaluation
- Rapport M 17Document108 pagesRapport M 17irrisys.kenitra26Pas encore d'évaluation
- GRP 4 Exo 2Document7 pagesGRP 4 Exo 2nealPas encore d'évaluation
- 2021 - Guide Reco EEEDocument122 pages2021 - Guide Reco EEEGabriel TinnèsPas encore d'évaluation
- Le Dispositif en Carrã© LatinDocument7 pagesLe Dispositif en Carrã© LatinYasmine ChercharPas encore d'évaluation
- Le Savoir-Faire Local Dans La Valorisation Alimentaire Des Fruits Du Safoutier (Dacryodes Edulis (G. Don) H.J. Lam) Au CamerounDocument5 pagesLe Savoir-Faire Local Dans La Valorisation Alimentaire Des Fruits Du Safoutier (Dacryodes Edulis (G. Don) H.J. Lam) Au CamerounJunias PakiPas encore d'évaluation
- Fiche Élève-6°-Une Flore ExtraordinaireDocument1 pageFiche Élève-6°-Une Flore ExtraordinairelauraPas encore d'évaluation
- Memento FleurDocument3 pagesMemento FleurVigourouxPas encore d'évaluation
- Alchornea Cordifolia - WikipédiaDocument11 pagesAlchornea Cordifolia - WikipédiaGilles Landry DIKEBIEPas encore d'évaluation
- Les Meilleurs Lieux de DragueDocument5 pagesLes Meilleurs Lieux de DraguebernardotapiePas encore d'évaluation
- Catalogue Plantes 2022Document57 pagesCatalogue Plantes 2022Sebastien GarciaPas encore d'évaluation
- Epreuve de Publication Assistee Par OrdinateurDocument6 pagesEpreuve de Publication Assistee Par Ordinateurinfocus rostoPas encore d'évaluation
- Les Tissus Végétaux 2020Document19 pagesLes Tissus Végétaux 2020Rahma Lionne100% (1)
- Elaboration Et Analyse Du Beurre de CacahuèteDocument32 pagesElaboration Et Analyse Du Beurre de CacahuètenawresnoussaPas encore d'évaluation
- GnisDocument179 pagesGnisIbrahim JolyPas encore d'évaluation
- 2 - MéristèmesDocument7 pages2 - MéristèmesHanna Lee MarinPas encore d'évaluation
- Cle Identification Famille de PlantesDocument17 pagesCle Identification Famille de PlantesNatiripsye Institut de FormationPas encore d'évaluation
- 9 Glossaire p409-425Document17 pages9 Glossaire p409-425Ammar BouzouerPas encore d'évaluation
- Les Bases Du BouturageDocument3 pagesLes Bases Du BouturagemedPas encore d'évaluation
- Présentation de Cours de Construction en Bois - Partie 1 - 2024Document89 pagesPrésentation de Cours de Construction en Bois - Partie 1 - 2024maxime CLOPas encore d'évaluation
- Cin - CJBG - HS17 - 2017 1Document203 pagesCin - CJBG - HS17 - 2017 1Gnaly KpazaiPas encore d'évaluation
- Les Insectes Pollinisateurs Indigènes Et L'agriculture Au CanadaDocument47 pagesLes Insectes Pollinisateurs Indigènes Et L'agriculture Au CanadazefaraPas encore d'évaluation
- BV1 Chap2 Du Thalle Au Cormus - DocDocument35 pagesBV1 Chap2 Du Thalle Au Cormus - DocPauline SoulierPas encore d'évaluation
- Bambouuu 1Document19 pagesBambouuu 1nicsdcPas encore d'évaluation
- Les InflorescencesDocument3 pagesLes Inflorescenceshadil saidiPas encore d'évaluation
- Bovet PH17Document103 pagesBovet PH17يوميات صيدلانية pharmacist diariesPas encore d'évaluation
- Activité N°1 Le Rapprochement Des GamètesDocument3 pagesActivité N°1 Le Rapprochement Des Gamètesisaacsouless0Pas encore d'évaluation