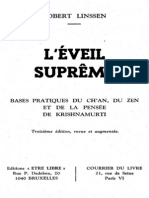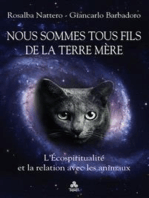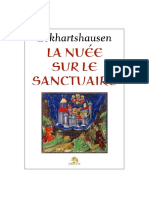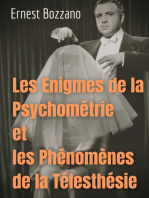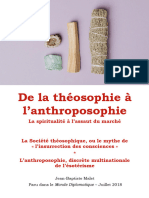Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rudolf Steiner - Connaissance, Logique, Pensée Pratique (PDF Images Avec Recherche) PDF
Rudolf Steiner - Connaissance, Logique, Pensée Pratique (PDF Images Avec Recherche) PDF
Transféré par
rastacourageTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rudolf Steiner - Connaissance, Logique, Pensée Pratique (PDF Images Avec Recherche) PDF
Rudolf Steiner - Connaissance, Logique, Pensée Pratique (PDF Images Avec Recherche) PDF
Transféré par
rastacourageDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rudolf Steiner CONNAISSANCE LOGIQUE PENSE PRATIQUE
Rudolf STEINER Steiner n'tait pas un philosophe abstrait, mais un raliste d'ducation scientifique... Je ne me souviens pas d'avoir jamais vu un homme aussi impressionnant. Lorsque je me fus habitu la singularit de son apparence, je compris combien il tait simple et humble... et pourquoi son visage m'avait tant impressionn. C'tait comme si ce visage n'tait pas assez grand pour contenir l'intensit de son expression spirituelle. R. Landau (dans: Dieu est mon aventure) Examiner sans prjugs l'oeuvre gigantesque de Steiner, c'est dcouvrir un des plus grands penseurs de tous les temps. Cet esprit prodigieux dominait les sciences modernes aussi bien que les connaissances classiques. Mystique, Steiner ne l'tait pas plus qu'Albert Einstein. Il tait avant tout un homme de science ayant le courage de pntrer les secrets de la vie. Russel W. Davensport (dans: The Dignity of Man(
RUDOLF STEINER
CONNAISSANCE LOGIQUE PENSE PRATIQUE
10 confrences faites dans diffrentes villes en 1903, 1908, 1909
Traduction Georges Ducommun
Editions Anthroposophiques Romandes 11, rue Verdaine, 1204 Genve/Suisse 1985
Traduction faite d'aprs notes et stnogrammes non revus par l'auteur. Titres des ditions originales: Confrences I III: Spirituelle Seelenlehre une Welt betrachtung (ex G.A. 52). Confrences IV VIII: Die Beantwortung von Welt- und Lebensfragen durch Anthroposophie (ex G.A. 108). Confrence IX: Wo und wie findet man den Geist (ex. GA 57). Confrence X: Beitrge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, N 78 de 1982/3.
TABLE DES MATIRES
CONNAISSANCE Premire confrence, Berlin, 27 novembre 1903 Les bases d'une thorie de la connaissance relative la thosophie (I) Deuxime confrence, Berlin, 4 dcembre 1903 Les bases d'une thorie de la connaissance relative la thosophie (II) Troisime confrence, Berlin, 17 dcembre 1903 Les bases d'une thorie de la connaissance relative la thosophie (III) LOGIQUE Quatrime confrence, Munich, 20 mars 1908 De la philosophie en gnral Cinquime confrence, Munich, 8 novembre 1908 Philosophie et logique formelle. Sixime confrence, Berlin, 20 octobre 1908 Logique formelle (Logique I) Septime confrence, Berlin, 28 octobre 1908 Jugements analytiques et jugements synthtiques (Logique II) Huitime confrence, Berlin, 13 novembre 1908 L'laboration des concepts et le systme des catgories chez Hegel. 58 68 91 103 114
7 23 40
1985. Tous droits rservs by Editions Anthroposophiques Romandes Traduction autorise par la Rudolf SteinerNachlassverwaltung Dornach/Suisse Imprim en Suisse Schiller SA, Bienne
ISBN 2-88189-003-2
PENSE PRATIQUE 128 Neuvime confrence, Berlin, II fvrier 1909 La culture pratique de la pense. Dixime confrence, Nuremberg, 13 fvrier 1909 144 La culture pratique de la pense. Notes 175 Ouvrages de Rudolf Steiner disponibles en langue franaise 180 5
AVIS AU LECTEUR
Au sujet de ces publications prives, Rudolf Steiner s'exprime de la manire suivante dans son autobiographie Mein Lebensgang (chapitres 35 et 36, mars 1925): Le contenu de ces publications tait destin la communication orale, non l'impression (...). Nulle part il n'est rien dit qui ne soit uniquement le rsultat de l'anthroposophie, qui est en train de s'difier. (...) Le lecteur de ces publications prives peut pleinement les considrer comme une expression de l'anthroposophie. C'est pourquoi on a pu sans scrupule droger l'usage tabli qui consistait rserver ces textes aux membres. Il faudra seulement s'accommoder du fait que dans ces stnogrammes, que je n'ai pas revus, il se trouve des erreurs. On ne reconnat la capacit de juger du contenu d'une telle publication prive qu' celui qui remplit les conditions pralables un tel jugement. Pour la plupart de ces publications figurent au moins parmi ces conditions la connaissance de l'enseignement anthroposophique sur l'homme et le cosmos et celle de l'histoire selon l'anthroposophie, telle qu'elle dcoule des communications provenant du monde de l'esprit.
CONNAISSANCE
I LES BASES D'UNE THORIE DE LA CONNAISSANCE RELATIVE LA THOSOPHIE (I) Berlin, 27 novembre 1903
A l'vocation du mot thosophie* nos contemporains se contentent de sourire, vous l'avez sans doute dj remarqu. Vous n'ignorez pas que ceux qui se considrent aujourd'hui comme les reprsentants de la mentalit scientifique ou invoquent leur culture philosophique estiment que la thosophie n'est rien d'autre qu'une agitation de dilettantes anims par une croyance fantaisiste. C'est avant tout du ct des savants que le thosophe passe pour un illumin adonn une vision singulire du monde, uniquement parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de se familiariser avec les vrais fondements de la connaissance. Quoi qu'il en soit, les milieux scientifiques considrent d'emble que le thosophe est dpourvu de toute culture philosophique ou que, s'il en possde ou en revendique une, il ne pourrait s'agir que d'un amateurisme superficiel. Les prsentes confrences ne sont pas consacres directement la thosophie, sujet dj trait en de nombreuses occasions. Il s'agit aujourd'hui d'engager une discussion avec la philosophie de l'Occident afin de voir comment se comporte le monde scientifique et quelle pourrait tre son attitude l'gard de la thosophie. Nous devons rfuter le prjug selon lequel tout 7
thosophe serait ncessairement un amateur sans aucune culture scientifique. Les philosophes de tous bords et les courants sont nombreux ne cessent d'affirmer que la mystique est une attitude obscure faite de sentimentalit et d'allgories, et que la thosophie n'ajoute rien qui puisse favoriser la culture d'une pense mthodique et rigoureuse. Si elle en tait capable, elle se rendrait compte dans quelle voie nbuleuse elle se trouve engage. Elle comprendrait que la mystique ne peut prendre racine que dans la tte de gens farfelus. Tel est ce prjug bien connu! Je ne dsire pas engager de polmique. Non parce que cela serait en contradiction avec la mentalit thosophique, mais parce que, me rfrant ma propre formation philosophique, je peux affirmer que loin d'tre un simple amateurisme la thosophie est fonde sur une conviction qui peut servir de base une discussion srieuse. Je puis bien comprendre que toute personne ayant assimil la philosophie occidentale et disposant de la gamme complte des arguments scientifiques puisse prouver quelques difficults considrer la thosophie autrement que ce qu'en disent les prjugs. Quiconque vient de la philosophie et des sciences aura beaucoup plus de mal se familiariser avec la thosophie que celui qui l'aborde avec bon sens, avec un sentiment naturel, naf, peut-tre mme religieux, et qui prouve le besoin d'y chercher la rponse certaines nigmes de l'existence. Car cette philosophie occidentale place tellement d'obstacles sur le chemin de ses disciples, leur propose tellement de jugements qui semblent contredire la thosophie, qu'il leur devient presque impossible de s'y intresser. Certes, c'est avec discrtion que la littrature thosophique engage les discussions philosophiques avec 8
les sciences contemporaines. C'est pourquoi j'ai dcid de faire quelques confrences ce sujet, afin d'expliquer les fondements d'une thorie de la connaissance relative la thosophie. Vous aurez ainsi l'occasion de vous familiariser avec les concepts et le contenu de la philosophie moderne. Et, si vous la considrez pour ce qu'elle a d'authentique et profond, vous verrez en fin de compte les fondements de la connaissance thosophique clore partir de la philosophie de l'Occident, mais il faudra vraiment patienter jusqu'au bout. Nous n'userons point d'une quelconque manipulation dialectique des concepts. Dans la mesure o le permettent ces quelques confrences, nous ferons appel toute la gamme des lments que le savoir de nos contemporains met notre disposition. Nous aurons recours tout ce qui permet, mme aux gens qui ne veulent rien en savoir, de comprendre que l'accession une conception du monde suprieur est affaire d'exprience. A une autre poque, ce que j'ai exposer n'aurait pas pu tre dit de la mme faon. Il est aujourd'hui ncessaire d'avoir consult Kant, Locke, Schopenhauer, mais aussi des auteurs plus rcents comme Eduard von Hartmann et son disciple Arthur Drews, ou le spcialiste de la thorie de la connaissance Volkelt, ou encore Otto Liebmann et le rationaliste rigoureux Eucken. Quiconque les a tudis, s'est familiaris avec les diverses nuances scientifiques et philosophiques de l'poque rvolue et actuelle, se rendra compte et c'est l ma conviction profonde qu'une comprhension vraie et sincre de cette volution de la philosophie ne nous loigne pas de la thosophie, mais au contraire nous y conduit invitablement. Toute personne ayant approfondi la philosophie doit ncessairement aboutir la thosophie. 9
Je n'aurais peut-tre pas besoin de faire cet expos si la pense contemporaine dans son ensemble n'tait place sous l'influence prpondrante d'un philosophe. On convient gnralement que par son lvation spirituelle Emmanuel Kant a dot la philosophie d'un fondement scientifique. On dit aussi que sa conqute sur le plan de la connaissance est inbranlable. Celui qui n'a pas tudi Kant, affirme-t-on, reste en marge de toute discussion philosophique. Vous pouvez parcourir les diffrents courants: Herbart, Fichte, Schelling, Hegel, passer de Schopenhauer Eduard von Hartmann, toutes ces dmarches demeurent inaccessibles sans la pense de Kant. L'largissement auquel aspire la philosophie du XIXe sicle se heurte, au milieu des annes soixante-dix, l'exhortation de Zeller, de Liebmann puis de Friedrich Albert Lange: Retour Kant ! Et les professionnels de la philosophie pensent que pour avoir droit de parole en ce domaine il faut obligatoirement se rfrer la pense de Kant. Kant a marqu de son sceau l'ensemble de la philosophie du XIXe sicle et du prsent. Mais il a suscit tout autre chose que ce qu'il prconisait. Il l'a d'ailleurs exprim en disant qu'il pensait avoir ralis un exploit gal celui de Copernic, qui avait invers la conception astronomique du monde en dlogeant la terre de sa position centrale pour lui substituer un autre corps que l'on avait auparavant imagin en circulation: le soleil. Pour Kant, l'tre humain et son pouvoir cognitif sera dsormais au centre de la vision physique de l'univers. Il inverse en quelque sorte la vision que l'on peut avoir du monde. La plupart des penseurs du XIXe sicle estiment que ce retournement s'impose. Pour comprendre cette philosophie, il faut 10
connatre les hypothses sur lesquelles elle est chafaude. Pour accder ce qui mane de la philosophie kantienne, il faut savoir sur quelles bases elle repose. Si nous saisissons comment Kant est arriv la conclusion que nous ne pouvons en fin de compte jamais connatre l' en soi des choses, puisque tout ce que nous connaissons n'est que manifestation, alors le dveloppement de la philosophie du XIXe sicle nous devient accessible. Du mme coup la clart se fait sur les objections que l'on peut mettre l'gard de la thosophie et sur l'attitude adopter son sujet. Vous savez sans doute que la thosophie est fonde sur une exprience suprasensible. Elle dit que ses connaissances dcoulent d'une exprience qui s'tend au-del de l'exprience sensorielle. Nous pouvons voir que cette connaissance-l est aussi valable que celle issue de nos sens, et que les descriptions faites par la thosophie au sujet du monde astral, etc. etc..., sont aussi relles que les objets sensibles perus par nos sens. La source de connaissance laquelle se rfre la thosophie est de nature suprasensible. Lisez, par exemple, Le plan astral de Leadbeater ', et vous verrez que sur le plan astral les choses sont aussi relles que les fiacres et les chevaux dans les rues de Londres. En disant cela, nous voulons souligner combien ce monde-l est une ralit pour quiconque le connat. Le philosophe moderne ne manquera pas d'objecter: Certes, mais tu te trompes quand tu penses qu'il s'agit effectivement d'une ralit. La philosophie du XIXe sicle n'a-t-elle pas prouv que ce que nous nommons notre exprience n'est vrai dire rien d'autre que notre reprsentation? Le firmament toil, lui aussi, n'est que notre reprsentation. Ce point est pour elle l'acquis le plus ferme qui soit. Le fait qu'il 11
s'agisse l de notre seule reprsentation et qu'hors d'elle il n'y ait pas de connaissance constitue pour Eduard von Hartmann2 la vrit la plus vidente. Penser d'une exprience qu'elle est relle revient souscrire au ralisme naf. En envisageant de la sorte le monde, est-il possible de dcider quelle valeur attribuer l'exprience? Voil le grand rsultat auquel est parvenu le kantianisme: le monde autour de nous ne saurait tre autre chose que notre reprsentation. Comment Kant en est-il arriv l? Sa philosophie s'inspire de ses prdcesseurs. Lorsque Kant tait encore jeune, toutes les coles philosophiques portaient la marque de la pense de Christian Wolff'. Cette philosophie faisait la distinction entre la connaissance exprimentale que nous acqurons grce aux impressions sensorielles, et la connaissance fonde sur la raison pure. Notre comprhension des choses de la vie courante nous vient exclusivement des expriences; mais il existe encore d'autres choses qui relvent de la connaissance suprieure, dcoulent de la raison pure, en l'occurence les mes humaines, la libert du vouloir, les questions relatives l'immortalit et l'entit divine. Les sciences que l'on appelle empiriques s'intressent aux domaines des sciences naturelles, de la physique, de l'histoire, etc... Comment l'astronome acquiert-il ses connaissances? En dirigeant son regard vers les toiles et en dduisant de l'observation les lois correspondantes. Dans ce cas, il est donc ncessaire d'ouvrir ses sens vers le monde extrieur. Personne n'oserait jamais prtendre que ces lois dcoulent de la raison pure. La connaissance ainsi acquise rsulte de ce que nous voyons. La vie pratique, l'exprience conduisent des connaissances empiriques. Peu importe 12
que nous les introduisions dans un systme scientifique ou non: il s'agit toujours de connaissances exprimentales. Personne n'est capable de dcrire un lion en se rfrant la seule raison. Par contre, Wolff suppose que ce que nous sommes, nous pouvons le tirer de la raison pure. Il affirme que notre psychologie procde de la raison, que l'me doit avoir un libre vouloir, qu'elle doit tre raisonnable, etc... C'est pourquoi Wolff appelle la science qui traite des aspects suprieurs de la psychologie une psychologie rationnelle. La question de savoir s'il existe pour l'univers un dbut et une fin ne peut tre rsolue qu'au moyen de la raison pure. Ce problme relve de la cosmologie rationnelle. Sur la base de l'exprience pratique, personne n'est en mesure de se prononcer sur l'opportunit de l'univers, car ce problme n'est pas du domaine de l'observation. Toutes ces questions relvent de la cosmologie rationnelle. Puis il existe une science concernant Dieu, concernant le projet divin. Cette science est galement base sur la raison: la thologie rationnelle ou mtaphysique. Kant volua une poque o la philosophie avait prcisment cette orientation. Dans ses premiers crits, vous le dcouvrirez adepte de la philosophie de Wolff. Vous le verrez convaincu qu'il existe une psychologie rationnelle, une thologie rationnelle, etc. etc... Il dveloppa une preuve dont il affirme qu'elle est la seule preuve possible de l'existence de Dieu. Puis il fit la connaissnce d'un courant de pense qui le bouleversa. Il s'initia la philosophie de David Hume 4 et put dire par la suite qu'elle l'avait sorti d'une somnolence dogmatique. Que nous propose cette philosophie? Hume dit: nous voyons le soleil se lever le matin et se coucher le soir. Cette constatation, nous la 13
faisons tous les jours. Nous savons aussi que tous les peuples observent le lever et le coucher du soleil et donc qu'ils font la mme exprience que nous. Alors nous prenons l'habitude de croire que cela devra se drouler ternellement de la mme manire. Voici un autre exemple. Nous voyons que les rayons du soleil tombent sur une pierre. Nous croyons que c'est la chaleur solaire qui rchauffe la pierre. Que se passe-t-il au juste? Nous percevons d'abord la chaleur du soleil et ensuite la pierre rchauffe. Que constatons-nous? Seulement que deux faits se succdent. Et lorsque nous faisons l'exprience que les rayons du soleil chauffent la pierre, nous avons dj form le jugement que la chaleur solaire est la cause de ce rchauffement de la pierre. Or Hume dit: Il n'existe rien pouvant nous rvler autre chose que la succession des faits. Nous prenons l'habitude de croire qu'il existe un lien de cause effet. Mais cette croyance n'est qu'une accoutumance, et tous les concepts de causalit invents par l'homme reposent sur une exprience semblable. L'homme voit une boule en heurter une autre et constate qu'il se produit un mouvement; il s'habitue alors dire que cela rpond une loi. A vrai dire, dans ce cas il ne saurait tre question d'une comprhension authentique du phnomne. Qu'est-ce qu'une connaissance tire de la raison pure? D'aprs Hume, ce ne serait rien d'autre qu'une synthse de diffrents faits. Nous avons tablir un rapport entre les faits qui se droulent dans le monde. Cela rpond aux habitudes intellectuelles de l'homme, son besoin de penser. Il nous est interdit d'aller audel de ce penser. Nous n'avons pas le droit de dire que les choses contiennent un lment les reliant entre elles selon des lois. Nous pouvons tout au plus affir14
mer que les choses et les vnements dfilent devant notre regard. Pour ce qui est du en soi des choses, par contre, il ne nous est pas permis d'voquer de tels liens. Comment pouvons-nous prtendre que les choses nous rvlent plus que ce que l'exprience nous permet de constater? Comment pouvons-nous dpasser la seule exprience et attribuer au plan exprimental une cohsion due l'intervention d'une entit divine, ds lors que nous ne sommes pas disposs invoquer autre chose que les penses habituelles? Cette conception eut pour effet d'arracher Kant sa somnolence dogmatique. Il se demanda: existe-t-il quelque chose qui aille au-del de l'exprience? Quelles connaissances l'exprience nous offre-t-elle? Nous donne-t-elle une connaissance sre? Bien entendu, Kant rpond immdiatement par la ngative cette question. Il dit: mme si vous avez vu cent mille fois le soleil se lever, vous n'avez pas le droit d'en conclure qu'il se lvera encore demain. Il pourrait en tre autrement. Etant donn que vos conclusions reposent uniquement sur l'exprience, il se pourrait qu' l'occasion celle-ci suscite en vous une conviction diffrente. L'exprience ne peut jamais fournir de connaissances irrmdiables et sres. Je sais par exprience que le soleil rchauffe la pierre. Mais je n'ai pas le droit d'affirmer qu'il doit obligatoirement la rchauffer. Tant que toutes nos connaissances prennent appui sur l'exprience, elles ne seront jamais affranchies d'une certaine inscurit. Il n'existe donc aucune connaissance empirique irrversible. Kant s'effora alors de scruter le fond de ce problme. Il chercha une issue. Durant la premire priode de son existence, il avait pris l'habitude de 15
croire la connaissance. Mais la pense de Hume l'avait convaincu qu'il n'existe aucune certitude. N'y aurait-il pas quelque part quelque chose qui permette d'affirmer l'existence d'une connaissance irrmdiable et certaine? Si, dit-il, il existe des jugements srs: les jugements mathmatiques. Ou alors, le jugement mathmatique serait-il semblable au jugement disant que le soleil se lve le matin et se couche le soir? Prenons le cas du jugement suivant: les trois angles d'un triangle totalisent cent quatre-vingts degrs. La preuve tablie pour un seul triangle est valable pour tous les triangles. La nature mme de la preuve dmontre que cette dernire s'applique tous les cas possibles. C'est l une caractristique de toutes les preuves mathmatiques. Personne ne peut douter que la somme des angles d'un triangle fasse cent quatre-vingts degrs. Cela serait mme valable pour les martiens ou les habitants de Jupiter s'ils possdaient des triangles. Autre exemple: jamais deux fois deux ne pourra donner autre chose que quatre. Cela est une vrit immuable et apporte la preuve qu'il existe des connaissances ayant une certitude absolue. Ds lors, le problme ne consiste pas s'interroger si de telles connaissances existent, mais de se demander comment il est possible d'laborer de tels jugements. Et maintenant, voyons la question fondamentale de Kant: Comment de tels jugements absolument certains sont-ils possibles? Comment parvient-on la connaissance mathmatique? Kant dit des jugements et connaissances puiss de l'exprience que ce sont des jugements et connaissances a posteriori. Par contre le jugement: la somme des angles d'un triangle fait cent quatre-vingts degrs, est un jugement qui prcde toute exprience, donc un jugement priori. 16
Je puis me reprsenter mentalement un triangle et en apporter la preuve pour, ensuite, lorsque j'en rencontre un, dire que ses trois angles doivent totaliser cent quatre-vingts degrs. Toute la connaissance suprieure dpend de la possibilit d'mettre des jugements fonds sur la raison pure. Comment de tels jugements priori sont-ils possibles? Nous avons vu qu'un jugement comme celui qui fixe cent quatrevingts degrs la somme des angles d'un triangle s'applique tous les triangles. L'exprience doit se conformer mon jugement. Lorsque je trace une ellipse et que j'observe l'espace cosmique, je dcouvre qu'une plante se dplace selon ce parcours elliptique. La plante obit au jugement que j'ai labor au niveau de la connaissance pure. Le jugement conscutif une dmarche strictement idelle est alors confront avec la ralit. Kant s'interroge: Ce jugement, l'ai-je puis de l'exprience? A n'en pas douter, un tel jugement idel n'quivaut aucune ralit exprimentale. L'ellipse, le triangle n'ont aucune ralit exprimentale, mais la ralit se soumet ce genre de jugements. Pour dtenir effectivement la ralit, je dois affronter l'exprience pratique. Mais lorsque je connais le genre de lois en vigueur, alors je dtiens une connaissance qui prcde toute exprience. La loi de l'ellipse ne se dduit pas de la ralit; je l'labore moimme au niveau de l'esprit. Dans les crits de Kant', on trouve la remarque suivante: Mme si toute notre connaissance commence avec l'exprience, elle ne dcoule nanmoins pas entirement de cette exprience. La connaissance acquise, c'est moi qui l'introduis dans l'exprience! L'esprit de l'homme est ainsi fait que l'ensemble de son exprience ne saurait dborder le cadre des lois qu'il connat. L'individu est 17
ncessairement amen dvelopper lui-mme ces lois. Ensuite, une fois qu'il sera confront l'exprience, celle-ci devra se conformer ces lois. Choisissons un exemple: Supposons que nous portions des lunettes bleutes. Autour de nous tout sera bleu. Les objets se prsenteront sous diffrentes nuances de bleu. Peu nous importe pour le moment la vraie ralit. Ds lors que les lois labores par mon esprit s'tendent sur l'ensemble du monde exprimental, celui-ci doit s'y conformer. Ce serait une erreur de prtendre que le jugement deux fois deux font quatre soit puis de l'exprience. C'est ma constitution spirituelle qui veut que deux fois deux fassent toujours quatre. Mon esprit est fait de telle sorte que les trois angles d'un triangle totalisent toujours cent quatre-vingts degrs. Voil comment Kant justifie les lois en les ramenant la nature mme de l'individu. Le soleil rchauffe la pierre. Chaque effet a une cause. Il s'agit, l encore, d'une loi de mon esprit. Et, lorsque le monde se prsente sous la forme d'un chaos, je lui oppose les lois labores par mon esprit. Je considre le monde comme un collier de perles. C'est moi qui fais du monde un mcanisme soumis la connaissance. Nous voyons maintenant comment Kant est parvenu trouver une mthode de connaissance aussi prcise. Tant que l'esprit humain est organis comme il l'est, toute la ralit, mme si elle se modifie au cours de la nuit, doit pouvoir se conformer cette organisation. Tant que les lois de mon esprit demeurent ce qu'elles sont, ces ralits ne sauraient changer en ce qui me concerne. Le monde tant ce qu'il est, nous ne le connaissons que dans la mesure o il est accessible aux lois de notre esprit. Vous voyez maintenant le sens qu'il convient 18
d'attribuer la remarque: Kant a invers toute la thorie de la connaissance. Prcdemment on supposait que l'homme apprenait tout de la nature. Maintenant, par contre, c'est l'esprit humain qui prescrit la nature les lois auxquelles elle doit obir. Pour Kant tout tourne autour du point central qu'est l'esprit humain, l'image de Copernic qui fit tourner la terre autour du soleil. Il existe encore un autre lment permettant de dmontrer que l'homme ne peut jamais dpasser l'exprience. Vous verrez que cela s'accorde parfaitement avec la pense kantienne, bien que l'on puisse croire une contradiction. Pour Kant, les concepts n'ont aucun contenu. Deux fois deux font quatre constitue un jugement vide tant que l'on ne sousentend pas des haricots ou des petits pois. Chaque effet a une cause est un jugement formel, tant qu'il ne se rfre pas un contenu exprimental prcis. Les jugements expriment mon anticipation qui peut ensuite tre applique au monde extrieur. La contemplation, prive de concepts, est aveugle les concepts, privs de contemplation, sont vides. 6 Nous pouvons toujours imaginer des millions d'ellipses, elles ne correspondront jamais une ralit tant que nous ne l'aurons pas dcouverte dans le trac qu'empruntent les plantes. Tout doit tre confirm par l'exprience. Certes, nous pouvons trouver des jugements a priori, mais ils ne sont utilisables que s'ils se recoupent avec l'exprience. Dieu, la libert, l'immortalit sont des donnes auxquelles nous pouvons toujours consacrer nos cogitations: aucune exprience ne nous permettra de les connatre. Il est donc totalement inutile de vouloir les comprendre par le raisonnement. Les concepts a 19
priori ne sont valables que dans les limites o s'tend notre exprience. Nous disposons d'une science de l'a priori, certes, mais elle nous dit seulement comment doit tre l'exprience, dans la mesure o elle est ralisable. Nous pouvons en quelque sorte emprisonner l'exprience dans un rseau, mais nous ne pouvons pas dfinir quelle doit tre la loi de cette exprience. Nous ignorons tout de la chose en soi, et comme Dieu, la libert et l'immortalit procdent de cette chose en soi, nous ne pouvons rien en savoir. Nous ne voyons jamais les choses comme elles sont, mais nous les voyons telles que notre organisation nous oblige les voir. En surmontant le ralisme naf, Kant a instaur l'idalisme critique. Ce qui obit la causalit n'est en aucun cas la chose en soi. Ce qui se soumet mon oeil ou mon oreille doit d'abord faire une impression sur ces organes, en l'occurence les perceptions et les sensations. Ces manifestations sont les effets des choses en soi dont j'ignore tout. Ces dernires produisent une quantit d'effets que j'insre dans un monde structur selon certaines lois. Je me construis un organisme fait de sensations. Mais ce qui demeure l'arrire-fond se soustrait mon entendement. Ce n'est autre chose que l'ensemble des lois que mon esprit a introduit dans les sensations. Je ne puis savoir ce qui se cache derrire la sensation. De ce fait, le monde qui m'entoure est strictement subjectif. Il n'est rien d'autre que ce que je construis moi-mme. L'volution de la psychologie au XIXe sicle semble entirement approuver Kant. Prenez les conclusions auxquelles est parvenu le clbre physiologue Johannes Mller'. Il a labor la loi des nergies sensorielles spcifiques. Elle dit que chaque organe a sa 20
propre manire de ragir. La lumire qui pntre dans l'oeil produit un effet lumineux. A la pression l'oeil ragit toujours par une sensation de lumire. Mller en dduit que le contenu de mes perceptions ne dpend pas des choses extrieures mais de mon oeil. A tout processus inconnu, l'oeil rpond en engendrant une qualit colore, par exemple le bleu. Or le bleu n'existe nulle part dans l'espace. Un processus agit sur nous et engendre le sentiment de bleu. Ce que nous croyons voir en face de nous n'est rien d'autre que l'effet de quelque processus inconnu sur les organes des sens. La psychologie du XIXe sicle dans son ensemble a apparemment entrin cette loi des nergies sensorielles spcifiques. Ceci semble tre une confirmation de la pense kantienne. Au sens plein du mot cette conception peut tre qualifie d'illusionisme. Personne ne sait ce qui agit au dehors et produit les sensations. C'est partir de notre vie intrieure que nous construisons notre monde exprimental selon les lois de notre esprit. Jamais rien d'autre ne peut nous toucher tant que notre organisation est ainsi faite. Voil comment se prsente la vision kantienne soutenue par la physiologie. C'est ce que nous appelons l'idalisme critique de Kant. Schopenhauer' ne dveloppe pas d'autre pense en disant que les gens croient tre entours du firmament toil et du soleil. Or, cela n'est que notre propre reprsentation. C'est nous qui crons nous-mmes ce monde. Et Eduard von Hartmann ajoute qu'il s'agit l de la vrit la plus invulnrable qui soit, et qu'aucune puissance ne saurait branler cette affirmation. Voil ce que dit la philosophie occidentale. Elle ne s'est jamais demand comment nat une exprience. Pour pouvoir s'en tenir au ralisme, il faut 21
savoir comment l'exprience est engendre. Une telle dmarche conduit alors l'idalisme critique. La vision de Kant est un idalisme transcendental, c'est-dire qu'il ignore tout de l'authentique ralit, ne sait rien de la chose en soi, mais ne connat que le monde des reprsentations. Il dit: avec mon monde des reprsentations je dois me rfrer quelque chose qui m'est inconnu. Et dire que cette vision des choses serait inbranlable! Cet idalisme transcendental est-il vraiment inbranlable? La chose en soi se soustrait-elle notre connaissance? S'il en tait ainsi, on ne pourrait plus parler d'une connaissance suprieure. Car si la chose en soi n'tait qu'illusion, nous n'aurions pas le droit de parler d'entits suprieures. L se situe d'ailleurs une objection souvent mise l'encontre de la thosophie. On nous reproche le fait de parler d'entits suprieures. Nous verrons lors de notre prochaine confrence comment approfondir ces problmes.
II LES BASES D'UNE THORIE DE LA CONNAISSANCE RELATIVE LA THOSOPHIE (II) Berlin, 4 dcembre 1903
La semaine dernire j'avais introduit notre srie de confrences en mentionnant que la philosophie contemporaine, plus particulirement l'allemande, propose une thorie de la connaissance qui suscite pas mal de difficults chez ses adeptes lorsque ceux-ci cherchent se familiariser avec la conception thosophique du monde. J'avais galement annonc que j'allais m'efforcer de dresser un tableau de cette thorie de la connaissance, de cette vision philosophique moderne, afin de montrer que toute personne engage dans cette voie prouvera quelques difficults se familiariser avec la thosophie. Dans l'ensemble, les thories de la connaissance issues du kantianisme sont excellentes et exactes. A partir de leur point de vue, on ne voit cependant pas comment l'individu peut accder la moindre connaissance des tres ayant une nature diffrente de la sienne, et, plus gnralement, accder la nature authentique des tres. L'tude du kantianisme nous a permis de voir que cette conception est amene tirer la conclusion suivante: tout ce qui forme notre entourage n'est que manifestation, n'est qu'une reprsentation de nous-mmes. Tout ce qui nous entoure n'a rien de rel, mais obit aux lois de notre esprit; ce 23
22
monde est domin par les lois que nous-mmes prescrivons notre entourage. J'avais rappel qu'une lunette bleute nous amne ncessairement voir l'ensemble du monde dans la nuance correspondante. D'aprs Kant, l'homme voit toujours le monde selon la tonalit que lui impose son organisme, quelle que soit au vrai la ralit extrieure. Il en rsulte que nous n'avons pas le droit de parler d'une chose en soi , mais seulement d'un monde des apparences teint subjectivement. Si tel est le cas, alors tout ce qui m'entoure la table, les chaises, etc. etc... n'est que reprsentation de mon esprit; car pour moi tous ces objets n'existent que dans la mesure o je les perois, dans la mesure o je donne ces perceptions une forme dcoulant de mes propres lois spirituelles et que je leur impose ces lois. Je suis incapable de dire s'il existe autre chose qui s'ajouterait ma perception de la table et des chaises. C'est au fond cette conclusion qu'aboutit la dmarche intellectuelle de Kant. Une telle conception est incompatible avec l'ide de vouloir pntrer jusqu'au coeur de la nature authentique des choses. La thosophie pense non seulement que nous pouvons connatre la nature physique des choses, mais galement que nous pouvons accder leur nature spirituelle; elle affirme d'une part que nous disposons d'une connaissance du monde corporel qui nous entoure, mais d'autre part aussi que nous pouvons faire l'exprience de ce qui est purement spirituel. Il existe un livre trs significatif et qui porte le sceau de la conception thosophique du monde. Ecrit peu de temps avant la naissance du kantianisme, cet ouvrage fut publi en 17669. J'en citerai un passage pour vous montrer comment son auteur dcrit ce que l'on nommera par la suite le kantia24
nisme. On peut affirmer que ce livre aurait pu tre rdig par un thosophe. On y lit que l'homme n'est pas seulement en rapport avec le monde corporel autour de lui, mais qu'en plus de cette appartenance au monde physique il fait aussi partie d'un monde spirituel, chose que l'on arrivera sans doute prouver scientifiquement; et par ailleurs que le genre de liens qu'il entretient avec ce monde-l peut tre tabli scientifiquement. Sous bien des aspects il s'agit l d'une excellente dmonstration quivalant pratiquement une preuve, ou tout au moins permettant de penser que celle-ci pourra tre apporte plus tard: Ni o ni quand, mais je sais que l'me humaine est en rapport avec d'autres mes, qu'elles agissent rciproquement les unes sur les autres, et qu'elles changent des impressions dont l'homme n'a aucune conscience tant que tout se droule normalement. Puis cet autre passage: Il s'agit souvent de sujets de la mme espce, incapables d'exprimer des ides venant d'un autre monde, et de ce fait toute pense relative l'esprit est telle qu'elle ne saurait accder la nature de l'esprit... etc... L'homme dou d'une capacit intellectuelle moyenne ne peut pas avoir conscience de l'esprit; mais, selon l'auteur, il faut tout de mme supposer la possibilit d'une vie en commun avec un monde spirituel. Il est certain que la thorie de la connaissance de Kant est incompatible avec une telle vision des choses. Or celui qui a expos les fondements d'une telle conception n'est autre qu'Emmanuel Kant lui-mme. Nous constatons donc qu'un revirement s'est opr dans sa pense. En effet, aprs avoir crit tout cela en 1766, il dveloppera, quatorze ans plus tard, une thorie de la connaissance qui rend impossible toute approche de la thosophie. 25
Notre philosophie moderne repose prcisment sur ce kantianisme. Elle se diversifie en plusieurs courants, ceux allant de Herbart, Schopenhauer, Otto Liebmann, Johannes Volkelt jusqu' Friedrich Albert Lange. Quelle que soit la nuance, nous avons chaque fois affaire une dmarche pistmologique portant la marque de Kant: la connaissance se limite aux manifestations; nous ne sommes confronts qu'avec nos perceptions subjectives et de ce fait ne pouvons jamais percer jusqu' la nature profonde, jusqu' la racine mme de la chose en soi. Maintenant je dsire vous prsenter tout ce qui s'est progressivement dvelopp au cours du XIXe sicle et que nous pouvons considrer comme la thorie de la connaissance kantienne modifie. J'aimerais montrer comment s'est dgage l'actuelle thorie de la connaissance, celle-l mme qui condescend, non sans un certain orgueil, toiser du regard quiconque croit que l'on peut accder la connaissance. J'aimerais montrer comment s'chafaude une thorie de la connaissance s'inspirant de la pense de Kant. Tous les acquis de la science constituent apparemment autant de preuves favorables la thorie kantienne. Celle-ci semble tre construite avec tellement de rigueur qu'il devient impossible de lui chapper. Aujourd'hui, nous allons tudier cette dmarche, et la prochaine fois nous verrons ce que nous pouvons en faire. La physique elle-mme semble nous dmontrer en toutes circonstances qu'il n'existe pas de ralit l o l'homme naf croit en dcouvrir. Voyons par exemple le son. Vous savez que le son qui frappe notre oreille provient d'une vibration de l'air au-dehors de cet organe. Il y a donc un processus extrieur: la vibration des particules de l'air. Cette vibration pntre 26
dans notre oreille, fait vibrer notre tympan et ce mouvement se prolonge jusque dans notre cerveau. C'est l que nous percevons ce que nous appelons le son. On dit que le monde serait muet. Pour accder l'exprience sonore, il faut que ce mouvement extrieur soit capt par notre oreille et que les vibrations en question soient transformes. Le reprsentant de la thorie de la connaissance peut alors aisment conclure: Le son n'est rien d'autre que ce qui existe en toi-mme et si tu limines cette exprience, il ne reste plus que de l'air en mouvement. Il n'en est pas autrement pour les couleurs et la lumire que nous rencontrons dans le monde extrieur. Le physicien attribue la couleur une vibration de l'ther qui remplit tout l'univers. Chaque fois que nous entendons un son, il n'y a en dehors de nous rien d'autre qu'un mouvement de l'air. Comme pour l'air mis en vibration par le son, il s'agit dans le cas de la lumire d'un mouvement ondulatoire de l'ther. Mais les ondulations de l'ther ne sont pas identiques celles de l'air, des mouvements ondulatoires de l'ther se situent perpendiculairement la direction emprunte par la progression des ondes. Ce fait a t clairement prouv par la physique exprimentale. Face l'impression colore du rouge, nous prouvons une certaine sensation. Nous devons alors nous demander: Que reste-t-il en l'absence d'un oeil sensitif? Les couleurs dans l'espace ne seraient en fin de compte que de l'ther en vibration. La qualit de couleur n'existe plus ds que l'oeil impressionnable est suppos absent. Le rouge que vous voyez rsulte de 392 454 billions d'ondulations la seconde; pour le violet il en faut de 751 757 billions. Cette vitesse prodigieuse dpasse notre entendement. La physique du XIXe si27
de a transpos toutes les impressions colores et lumineuses en ondulations thriques. Sans oeil, la palette des couleurs n'existerait pas. Tout serait d'une obscurit totale. On ne saurait alors parler de qualits colores dans l'espace. Helmholz1 va jusqu' affirmer que si nous portons en nous la sensation de couleur et de lumire, ou de son, cela ne ressemble en rien ce qui se droule en dehors de nous. Ce que nous ressentons ne serait mme pas une image de ce qui se droule autour de nous. La qualit colore du rouge, par exemple, que nous connaissons n'a aucune ressemblance avec les 420 billions d'ondulations la seconde. C'est pourquoi Helmholz conclut: Ce qui entre effectivement dans notre conscience n'est pas une image, mais tout au plus un simple signe. Les physiciens considrent toujours que l'espace et le temps existent tels que je les perois. Selon eux, ma sensation de couleur correspond un mouvement dans l'espace. Il en est de mme pour la notion de temps lorsque j'ai successivement la sensation du rouge, puis celle du violet. Dans les deux cas, il s'agit de processus subjectifs se droulant en moi. Ils viennent la suite l'un de l'autre. Dans le monde extrieur, les ondulations se succdent. Sur ce point, la physique ne va pas aussi loin que Kant. D'aprs ce dernier, nous sommes incapables de savoir si les choses en soi sont de nature spatiale, si elles existent dans l'espace ou se succdent dans le temps. La seule chose que nous pouvons savoir, c'est que nous sommes organiss de telle sorte que ce qui est de nature spatiale ou non-spatiale doit toujours emprunter la forme du spatial. Nous superposons cette forme tout ce que nous rencontrons. Pour la physique, par contre, le mouvement ondulatoire doit obligatoirement s'insrer dans l'espace et se drouler dans le 28
temps. En disant que l'ther compte 48 billions d'ondulations la seconde, nous nous rfrons implicitement aux notions d'espace et de temps. Pour la physique l'espace et le temps existent en dehors de nous. Mais tout le reste n'est que reprsentations, demeure purement subjectif. Vous pouvez lire dans les ouvrages de physique que, pour quiconque sait ce qui se passe dans le monde extrieur, il n'existe rien d'autre que l'air et l'ther en vibration. La physique semble donc avoir confirm que tout ce que nous dtenons n'existe qu'au niveau de notre conscience et que rien n'existe en dehors d'elle. Le second aspect dcoulant des sciences du XIXe sicle nous vient des arguments avancs par la physiologie. Le clbre physiologue Johannes Mller a invent la loi des nergies sensorielles spcifiques ". Selon cette loi chaque organe ragit par un sentiment dtermin. Lorsque vous frappez vous pouvez constater un effet lumineux. Le passage d'un courant lctrique produit le mme effet. A chaque sollicitation du dehors, l'oeil rpond conformment sa nature. Il a la facult inne de rpliquer en toutes circonstances par la production de lumire et de couleur. A l'incursion de la lumire et de l'ther, l'oeil ragit par des stimulations lumineuses et colores. La physiologie fournit encore d'autres lments capables de soutenir la thse subjectiviste. Supposons que nous ayons une sensation tactile. L'homme naf s'imagine qu'il peroit directement l'objet. Or, que peroit-il au juste? se demande le thoricien de la connaissance. La chose en face de moi n'est rien d'autre qu'un assemblage de minuscules particules: les molcules. Elles sont en mouvement. Chaque corps est pris dans un tel mouvement, mais les sens ne peuvent le 29
percevoir parce que les vibrations sont trop petites. A vrai dire je ne peux saisir que le mouvement, car le corps ne peut pas pntrer en moi. Que se passe-t-il lorsque nous posons notre main sur un corps? La main excute un mouvement. Celui-ci se prolonge jusqu'au nerf o il est transform en une sensation que nous prouvons, par exemple: chaud, froid, mou, dur. Mais le monde extrieur contient galement des mouvements, et lorsque mon sens tactile le heurte, l'organe le transforme en chaleur, froid, mollesse, duret. Nous ne pouvons mme pas percevoir ce qui se droule entre nous et un corps, car la surface de l'piderme est insensible. Lorsqu'elle ne recouvre pas un nerf, elle est incapable de ressentir la moindre sensation. L'piderme se trouve toujours entre la chose et le corps. L'excitation vient donc d'assez loin puisqu'elle doit traverser l'piderme. Seul ce qui se transmet au nerf est perceptible. Le corps extrieur demeure hors des limites o se droule le mouvement. Nous sommes spars de l'objet, et ce que nous ressentons effectivement est engendr en de de l'piderme. Tout ce qui peut accder notre conscience se droule dans la sphre du corps, en sorte que l'piderme constitue un barrage. D'aprs les thories physiologiques, nous devrions donc dire que nous n'intriorisons rien de ce qui se droule au-dehors, mais que les stimulations des processus nerveux qui se prolongent jusque dans notre cerveau proviennent de processus extrieurs; ceux-ci nous demeurent inconnus. Nous ne pouvons jamais dpasser la frontire que forme notre piderme. Nous sommes confins l'intrieur de l'espace limit par la peau et ne percevons rien d'autre que ce qui se droule en son intrieur. 30
Examinons le cas d'un autre organe des sens: l'oeil. Passons de l'aspect physique l'aspect physiologique. Nous voyons que les ondulations se propagent. Elles doivent d'abord pntrer dans le corps. L'oeil est constitu d'une peau, la corne. Derrire celle-ci nous trouvons la lentille, suivie du cristallin. La lumire doit donc passer par l. Puis elle atteint le fond de l'oeil recouvert de la rtine. Si nous supprimions cette dernire, l'oeil ne transformerait jamais en lumire l'impulsion reue. Pour fixer la forme d'un objet, les rayons doivent d'abord pntrer dans notre oeil o l'image sera projete sur la rtine. C'est la dernire phase conscutive l'excitation. Ce qui se situe devant la rtine est insensible, et nous ne saurions avoir de perception vritable du processus qui s'y droule. Seule l'image projete sur la rtine est perceptible. On pense que l se produisent des modifications chimiques du pourpre rtinien. L'effet d l'objet extrieur doit passer par la lentille et le cristallin, puis provoquer une modification de la rtine. Ainsi nat la sensation. Ensuite l'ceil projette de nouveau l'image vers l'extrieur; il s'entoure des excitations reues et les restitue au monde extrieur. Ce qui se droule dans notre oeil n'est pas imputable l'excitation, mais un processus chimique. Les physiologues ne cessent de produire de nouveaux lments l'appui de la thorie de la connaissance. Apparemment nous devons donner entirement raison Schopenhauer quand il dit: C'est nousmmes qui avons cr le firmament toil. Il est la transposition des excitations reues. Nous ne pouvons rien savoir de la chose en soi. Voyez-vous, cette thorie de la connaissance confine l'homme aux seules choses, disons aux seules 31
reprsentations labores par sa propre conscience. Il est enferm dans les limites de sa conscience. Certes, il peut toujours supposer que, dans le monde, existe quelque chose capable de provoquer en lui des impressions. Mais rien ne saurait pntrer en lui. Tout ce qu'il ressent, c'est lui-mme qui le produit. Nous ne pouvons mme pas savoir ce qui se passe la priphrie. Prenez le cas de l'excitation du pourpre rtinien. Elle doit tre dirige vers le nerf pour tre, peu importe ici de quelle manire, transpose en une sensation. Par consquent, le monde entier autour de nous ne serait rien d'autre que ce que nous avons labor au-dedans de nous-mmes. Telles sont les preuves physiologiques qui nous amnent dire que les choses se droulent ainsi. Mais certaines personnes se demandent aussi comment nous pouvons admettre l'existence d'autres hommes en dehors de nous, et que nous connaissons par les seules impressions qu'ils transmettent notre facult perceptive. Lorsque je suis face quelqu'un, il ne s'agit que d'ondulation produisant une excitation; ensuite j'ai une image de ma propre conscience. Qu'il puisse exister en dehors de cette image de ma conscience quelque chose qui ressemble l'homme relve de la pure supposition. La thorie moderne de la connaissance taye sa conception en prtendant que le contenu de l'exprience extrieure est de nature strictement subjectif. Elle dit: Ce qui est peru n'est rien d'autre que le contenu de ma propre conscience, qui correspond une modification de ma propre conscience. La chose en soi se situe en dehors du domaine de mon exprience. Le monde est pour moi une manifestation subjective consciemment ou inconsciemment difie au moyen de mes sensations. 32
Dans le cadre de mes expriences, je suis incapable de dire s'il existe encore d'autres mondes. Savoir s'il existe encore un autre monde est un problme qui dpasse la sphre de mon exprience; de mme, je suis incapable de savoir s'il existe encore d'autres humains dous de consciences diffrentes, puisque rien de la conscience d'autrui ne peut passer l'intrieur de ma propre conscience. Vos reprsentations ainsi que le contenu de votre conscience ne pntreront jamais dans la mienne. C'est du moins l'avis de ceux qui, de prs ou de loin, souscrivent la thorie de la connaissance kantienne. Kant a rsum sa thorie de la connaissance en donnant l'exemple suivant: Cent deniers possibles ne contiennent rien de moins que cent deniers rels, c'est-dire que je ne peux pas dcrter qu'un objet est rel du fait que j'ajoute quelque chose la reprsentation. La reprsentation ne fournit qu'une image. Pour qu'un objet existe, il doit venir ma rencontre, et je l'enlace alors des lois que j'ai moi-mme labores. Sous une forme quelque peu modifie Schopenhauer partage cette vision des choses. Trs jeune, Johann Gottlieb Fichte' se rallia galement cette ide. Il tudia fond le systme de Kant. Sans doute n'en existe-t-il gure de description plus belle que celle figurant dans l'ouvrage de Fichte La destination de l'homme, o il crivit: Le durable n'existe nulle part, ni en dehors de moi ni en moi; il n'existe qu'un changement ininterrompu. O que ce soit, je ne connais pas l'tre et je ne sais mme rien du mien propre. Il n'existe pas d'tre. Moi-mme, je ne sais rien et ne suis pas. Il n'existe que des images: ce sont les seules choses qui ont une existence, et elles ont conscience d'elles-mmes la manire d'images; 33
des images qui passent et s'vaporent sans qu'existe la moindre chose devant laquelle elles passent. Leurs liens rsultent d'images ne reproduisant toujours que des images. Ces images ne reprsentent rien, sont sans signification ni dessein. Je suis moi-mme une de ces images; je ne suis mme pas cela, je ne suis qu'une image confuse des images. Effectivement, tant que vous persistez penser que votre conception subjective ne traduit que les crations de votre propre conscience, vous aboutissez ncessairement la conviction que vous ne savez de vous-mme rien de plus que du monde extrieur. Si vous essayez de vous faire une reprsentation de votre propre Moi, vous n'en saurez jamais plus que ce que vous savez du monde extrieur. Si vous vous en tenez l'entire porte de cette pense, vous aurez vite fait de comprendre, que pour vous le monde extrieur, se dissout en une somme de chimres, et que mme le monde intrieur n'est rien d'autre qu'un engrenage de rves subjectifs. Vu de l'extrieur c'est--dire sous l'aspect de la corporit, vous pouvez vous reprsenter qu' l'gal du monde extrieur vous n'tes vousmme rien d'autre qu'un genre de chimre en germe, d'illusion. Ainsi le veut une interprtation correcte de cette vision des choses. J'observe ma main qui transforme le mouvement en une sensation tactile. Cette main n'est rien d'autre qu'une construction labore par ma conscience subjective; mon corps de mme, et tout ce qu'il y a en moi, n'est toujours qu'une construction due ma conscience subjective. Prenons le cas de mon cerveau. Si le microscope me permettait d'examiner comment une sensation nat dans mon cerveau, je n'obtiendrais toujours qu'un objet que je devrais transposer dans ma conscience en une image. 34
La reprsentation de mon Moi n'est rien d'autre qu'une reprsentation du mme ordre; elle est labore comme toutes les autres reprsentations. Des rves et des illusions passent et disparaissent, telle est la conception du monde due l'illusionnisme. Et c'est elle qui ncessairement dmontre l'ultime consquence o conduit le kantianisme. Kant a voulu vaincre l'ancienne philosophie dogmatique; il a voulu dpasser la pense de Wolff 13 et de son cole qu'il considrait comme la somme d'une vision chimrique du monde. Kant dvoila le ct illusoire des preuves relatives la libert du vouloir, l'immortalit de l'me et l'existence de Dieu. Mais quelles furent les preuves que lui-mme produisit? Il prouva que nous sommes incapables de connatre quoi que ce soit de la chose en soi, et que ce que nous dtenons est seulement le contenu de la conscience, alors que Dieu devrait pourtant tre quelque chose en soi. Selon Kant, il est impossible d'apporter la preuve que Dieu existe. Notre raison, notre intelligence s'appliquent seulement ce qui est accessible la perception. Ces facults servent uniquement dicter des lois pour ce qui relve de la perception. De ce fait, Dieu, l'me, la volont demeurent totalement en dehors de notre connaissance raisonnante. La raison a ses limites qu'elle ne saurait dpasser. Dans la prface la seconde dition de La Critique de la raison pure Kant dit entre autre: Je dus donc supprimer la connaissance pour faire place la croyance. Tel fut avant tout son dessein. Il voulut ramener la connaissance au domaine de la perception sensorielle et acqurir par une autre dmarche ce qui dpasse le domaine de la raison. A cet effet il proposa le chemin de la croyance morale. Il peut donc dire: 35
D'aucune faon les sciences n'accderont l'existenceobjective des choses. Mais il y a en chacun de nous quelque chose: l'impratif catgorique qui se manifeste en nous sous la forme d'une contrainte absolue. Kant l'identifie la voix divine. Cet impratif se situe au-dessus des choses et personnifie la ncessit morale inconditionnelle. C'est partir de ce point que Kant tente de reconqurir pour la croyance, ce qu'il avait cru devoir dtruire l'gard de la connaissance. L'impratif catgorique n'a rien voir avec ce qui dcoule d'influences sensorielles. Lorsqu'il surgit en nous, il doit donc exister quelque chose qui soit l'origine et des sens et de cet impratif catgorique, et qui apparat lorsque toutes les contraintes dcoulant de l'impratif catgorique sont remplies. Ce serait la batitude. Mais personne ne peut trouver le passage qui les relie tous deux. Comme nous ne pouvons pas le trouver, c'est une entit divine qui doit le raliser. Cela nous conduit un concept de Dieu qu'aucune dmarche sensorielle ne saurait nous offrir. Il s'agit de mettre en harmonie le monde sensoriel et le monde de la raison morale. Mme en faisant le maximum tout au long de notre existence, ce serait une erreur de croire qu'une seule incarnation soit suffisante. La vie humaine dpasse l'existence terrestre parce que l'impratif catgorique l'exige. De ce fait nous devons admettre l'existence d'un monde cosmique divin. Et comment pourrions-nous obir cet ordre cosmique, cet impratif catgorique, si nous ne possdions pas la libert? Kant a donc dtruit la connaissance afin d'ouvrir la voie la croyance qui conduit aux ralits suprieures de l'esprit. Nous devons croire! Il essaya de rintroduire par la raison pratique ce qu'il avait banni de la raison pure. Mme les courants philosophiques qui semblent 36
trs loigns de celui de Kant reposent en fait sur sa pense. C'est le cas pour Herbart'', par exemple, ce philosophe qui a si fortement influenc la pdagogie. A partir de la critique kantienne de la raison il devait laborer sa propre conception: Lorsque nous observons le monde nous nous heurtons sans cesse des contradictions. Voyons le cas de notre propre Moi. Aujourd'hui il contient certaines reprsentations, hier il en avait d'autres et demain il en aura encore d'autres. Ce Moi, qu'est-il au juste? Il se prsente nous, empli d'un ensemble de reprsentations. A un autre moment nous lui trouvons un autre contenu. Nous sommes confronts un devenir, un processus multiforme, bien que ce devrait tre une seule chose. Ce Moi est un et multiple. Toute chose est une contradiction. Herbart prtend donc que le monde ne nous offre que des contradictions. Nous devons surtout retenir que la contradiction ne saurait exprimer l'tre vrai. Herbart dduit de cette ide le but de sa philosophie. Il dit que nous devons liminer les contradictions et construire un monde qui en est affranchi. Le monde exprimental est irrel et contradictoire. Il pense que l'existence authentique consiste transformer le monde contradictoire en un monde qui ne l'est pas. Il croit qu'en voyant les contradictions nous trouvons la voie qui mne la chose en soi, et qu'en nous en librant, nous parvenons l'tre vrai, l'authentique ralit. Sur un point toutefois il est en accord avec Kant: le monde extrieur qui nous entoure n'est qu'illusion. Il est vrai que lui aussi s'est efforc, par une dmarche diffrente, de soutenir les valeurs dont l'tre humain a besoin. Et maintenant nous touchons en quelque sorte au noyau du problme. Nous devrions tout de mme 37
admettre que l'action morale n'a de sens que si elle est en mesure de se raliser concrtement dans le monde. A quoi servirait notre activit morale si nous vivions dans un monde fait d'illusions? Dans un tel monde, nous ne serions jamais convaincus que notre activit correspond une ralit. Toute volution morale et toute finalit morale demeureraient suspendues dans le vide. Sur ce point Fichte fut d'une consquence remarquable. Plus tard il changea d'avis et dfendit une thorie pure. Selon lui, la perception ne nous rvle du monde que les rves que nous rvons ". Mais quelque chose nous pousse vouloir le bien. Ceci nous permet spontanment de dvisager le vaste domaine du rve. Il croit que la concrtisation des rgles morales se ralise au sein du monde des rves. Ce qu'aucune raison n'enseigne doit tre ralis grce aux exigences formules par les lois morales. Et Herbart ajoute: Du fait que tout ce que nous percevons est contradictoire, nous ne parviendrons jamais fixer des normes notre activit morale. Il est donc indispensable de trouver des normes morales qui soient indpendantes de la raison et de l'intelligence. La perfection morale, la bienveillance, la libert intrieure, toutes ces qualits ne dpendent pas de la raison. Tout dans ce monde tant illusion, nous avons besoin de quelque chose qui nous dispense de rflchir. Ainsi se prsente la phase initiale de l'volution du XIXe sicle: la vrit est transforme en un univers de rve. L'idalisme teint de rve, qui se veut l'unique conclusion pouvant rsulter des cogitations relatives l'tre, c'est lui, cet idalisme, qui voulut rendre indpendante l'dification d'une conception morale du monde en l'affranchissant de la connaissance et du 38
savoir. II voulut limiter la connaissance pour faire de la place la croyance. C'est pourquoi la philosophie allemande rompit avec les trs anciennes traditions des courants philosophiques runis sous le nom de thosophie. Un reprsentant de la thosophie n'aurait jamais pu souscrire ce dualisme, cette sparation entre monde moral et univers de rve. Sa vision unitaire va de l'atome infrieur jusqu'au plus haut niveau de la ralit spirituelle. Ce que l'animal ralise partir de la joie ou de la peine n'est que graduellement diffrent de ce qui, au fate de la vie spirituelle, mane des mobiles les plus purs; de mme ce qui se droule partout ailleurs au niveau infrieur ne diffre que par degrs de ce qui se droule en haut. Cette voie moniste vers une connaissance globale et une vision d'ensemble du monde, Kant l'a abandonne en dissociant l'univers pour en faire un monde de connaissance mais illusoire et un autre monde d'une origine diffrente, le monde moral. De ce fait il a voil le regard de nombreux penseurs. Tous ceux qui ne trouvent pas accs la thosophie sont prcisment ceux qui subissent les effets de la philosophie de Kant. Vous verrez par la suite que la thosophie merge d'une authentique thorie de la connaissance. Il tait ncessaire de prsenter d'abord l'difice apparemment bien construit des sciences. La recherche semble avoir irrversiblement tabli que la vibration de l'ther provoque la sensation de vert ou de bleu, et que la vibration de l'air provoque celle du son. Nous verrons lors de notre prochaine confrence comment ce problme se prsente en ralit.
39
III LES BASES D'UNE THORIE DE LA CONNAISSANCE RELATIVE LA THOSOPHIE (III) Berlin, 17 dcembre 1903
Lors des prcdentes confrences, je me suis efforc de dresser une esquisse des ides fondamentales de la thorie contemporaine de la connaissance, telle qu'elle est enseigne dans nos universits et pratique par les philosophes et les savants se rfrant Schopenhauer, Kant et autres penseurs allemands clbres. Par la mme occasion j'ai essay d'indiquer comment toute l'volution scientifique du XIXe sicle, tant dans le domaine de la physique que dans celui de la physiologie ou de la psychologie, s'tait en quelque sorte rallie la thorie kantienne et ses prolongements dvelopps par Schopenhauer et Eduard von Hartmann. Nous avons donc montr que ce genre de thorie de la connaissance, que nous avons nomm illusionnisme, et qui nous renvoie entirement notre propre conscience pour ne considrer le monde que comme une reprsentation, semble tre la seule valable. Apparemment, cela est tellement vident que l'on passe aujourd'hui pour manquer de maturit si l'on doute de l'exactitude du postulat: le monde est ma reprsentation. Aprs vous avoir prsent presque tous les arguments ayant conduit cette thorie de la connaissance, cette vision illusoire, permettez-moi main40
tenant de parler de l'esprit. Je vous ai montr comment on est parvenu la conviction que le monde est notre reprsentation. Vous avez vu comment l'tude physiologique des phnomnes en vient dtruire tout ce qui nous entoure, que ce soit le domaine des sensations caloriques ou celui des sensations tactiles etc. etc... En fin de compte ces perceptions, ces reprsentations et ces concepts sont prsents comme tant engendrs par l'me humaine; ils semblent tre une auto-production de l'tre humain. La dmarche conduisant tayer sous tous ses angles cette conception est celle de Schopenhauer: Le monde est notre reprsentation. Il n'existe donc ni firmament mais seulement un oeil qui le peroit, ni sons mais seulement une oreille qui les entend. Vous auriez peut-tre pu penser que j'allais m'employer rfuter ces diffrentes positions pistmologiques. J'ai montr o elles mnent, mais je vous demande de ne pas considrer mes remarques comme une rfutation des diffrents points de vue choisis. Un thosophe ne cherche pas la polmique. Il ignore la pratique philosophique consistant trancher en faveur d'un point de vue unique. Ceux qui ont opt pour n systme philosophique ont tendance croire que le leur est le seul valable. C'est avec une mentalit de ce genre que Schopenhauer, Hartmann, Hegel et le kantianisme ont men leur combat. Le thosophe ne saurait se rallier une telle attitude, car il a sur ce point une vision diffrente. D'une manire plus gnrale galement, il ignore mme les controverses entre systmes religieux, parce qu'il a compris que tous reposent sur un noyau de vrit, et donc que la lutte entre bouddhistes, musulmans et chrtiens ne se justifie pas. De mme, le thosophe sait que tout systme 41
philosophique contient un germe de sagesse et que chacun reprsente en quelque sorte une tape de la qute intellectuelle du genre humain. L'important n'est pas de rfuter Kant ou Schopenhauer. Toute personne qui entreprend une dmarche sincre peut se tromper, certes, mais il est inadmissible que le premier venu se permette de la critiquer. Nous devons nous rendre compte que tous ces esprits, chacun sa manire, ont aspir la vrit. Il s'agit prcisment de dcouvrir le noyau de vrit que recle tout systme philosophique. Il ne peut non plus s'agir pour nous de dcider qui a raison et qui a tort. L'individu qui se cantonne sur son point de vue personnel d'o il compare entre eux les diffrents points de vue pour ensuite choisir celui qu'il peut admettre, cet individu fait preuve d'une attitude philosophique qui ne diffre gure de celle d'un philatliste. Un penseur arriv un niveau suprieur de la connaissance n'a toujours pas atteint le degr le plus lev de la sagesse. Nous sommes tous sur une voie volutive gradue. Mme le plus avanc ne peut rien dire d'absolu au sujet de la vrit, au sujet de l'esprit de l'univers. Et chaque fois que nous escaladons un nouvel chelon de la connaissance, nous ne dtenons toujours qu'un jugement relatif qui ne cessera de s'largir lorsque nous aurons atteint un niveau encore plus lev. Une fois que nous aurons assimil les bases fondamentales du systme thosophique, nous nous rendrons compte qu'il serait prsomptueux de vouloir parler d'un philosophe sans tre capable d'admettre hypothtiquement son point de vue et d'tre en mesure de dfendre la vrit de ses ides comme il le ferait lui-mme. Nous pouvons toujours nous tromper, mais nous n'avons pas le droit d'adopter une atti42
tude qui empcherait de comprendre le point de vue d'autrui. Je vais vous donner un exemple tir de l'histoire spirituelle allemande qui permet de saisir ce que je viens de caractriser. Les annes soixante virent l'aurore du Darwinisme, thorie qui fut immdiatement interprte de faon matrialiste. Ceux qui lui attriburent ce caractre excessif se considraient eux-mmes comme infaillibles. Les matrialistes de cette dcennie taient convaincus de l'irrversibilit de leurs conclusions. C'est alors que parut la Philosophie de l'inconscient d'Eduard von Hartmann". Je n'ai pas l'intention de dfendre cet ouvrage. Il comporte des aspects exagrs, certes, mais il faut nanmoins reconnatre que son point de vue est nettement suprieur ceux de Vogt '', Haeckel" et Bchner 19. Ce livre fut considr par les matrialistes comme une version rchauffe de la pense de Schopenhauer. Survint alors une nouvelle publication rfutant avec perspicacit la Philosophie de l'inconscient, mettant son contenu radicalement en pices. On pensait qu'une telle attaque ne pouvait venir que des milieux scientifiques. Haeckel lana cet appel: Que l'auteur se nomme et nous le reconnatrons comme un des ntres! Lors de la seconde dition l'auteur se nomma: c'tait Eduard von Hartmann en personne. Il avait apport la preuve qu'il tait tout fait capable d'pouser le point de vue scientifique. S'il avait ds le dpart sign son ouvrage, celui-ci n'aurait pas eu l'effet escompt. Vous voyez donc ici qu'un penseur situ un niveau suprieur est capable d'adopter un point de vue infrieur pour prsenter lui-mme tous les arguments que l'on peut avancer contre le point de vue suprieur. Personne n'a le droit, surtout pas au point de vue thosophique, 43
de critiquer un systme philosophique s'il n'est pas certain d'avoir compris de l'intrieur l'essence mme de ce systme. Il ne saurait tre question ici de rfuter la pense de Kant et de Schopenhauer. Nous devons surmonter cette maladie infantile qu'est la rfutation. Il s'agit de montrer comment ces systmes se dpassent euxmmes lorsque l'on poursuit l'impulsion qui les anime en profondeur. Essayons donc une nouvelle fois de nous placer dans l'hypothse de la thorie subjectiviste de la connaissance qui conduit au postulat: le monde est ma reprsentation. Cette thorie veut vaincre le ralisme naf qui attribue aux objets une vraie ralit, alors que les adeptes de la thorie de la connaissance ont dcouvert que tout ce qui nous entoure ne nous rvle que nos propres reprsentations. S'il fallait en rester ce type de thorie de la connaissance, il serait vain de chercher tablir la moindre base pour l'dification d'une conception thosophique du monde. En effet, nous savons parfaitement bien que ce que nous connaissons du monde ne se rduit pas de simples reprsentations. S'il ne s'agissait que de crations subjectives de notre Moi, nous ne pourrions jamais les dpasser. Nous serions incapables de nous prononcer sur le degr de vrit attribuer ce que nous connaissons. Dans le cadre d'une vision thosophique du monde, nous ne pourrions jamais attribuer aux choses la qualit d'essence, mais devrions les considrer comme de simples crations subjectives de notre Moi. Nous serions donc sans cesse ramens notre Moi. Nous ne pourrions jamais dire qu'une rvlation nous parvient d'un monde suprieur, peu importe ici lequel, si ce que nous pui44
sons dans les profondeurs de notre monde de la reprsentation n'tait que notre monde personnel; nous avons besoin que notre monde subjectif reoive galement des rvlations d'un monde vridique et rel. L se situe le point essentiel de la thosophie. Voil pourquoi la thosophie ne pourra jamais se satisfaire du postulat: le monde est ma reprsentation. Mme chez Schopenhauer nous pouvons voir qu'il transgresse les limites de son postulat: Le monde est ma reprsentation. " Ce philosophe avait mis encore cette autre affirmation appele complter la premire: Le monde est volont. En cela Schopenhauer fait exactement la mme dmarche que le thosophe. Il dit: Tout ce qui se trouve au firmament toil n'est rien que ma reprsentation, mais il existe une chose qui pour moi n'est pas seulement une simple reprsentation: ma propre existence. J'agis, je fais, je veux; dans le monde cela constitue une force dans laquelle je suis inclus et qui est en moi, en sorte que je sais par ma propre exprience ce qui est l'origine de ma reprsentation. Que tout ce qui m'entoure soit reprsentation, je veux bien, mais moi-mme je suis ma volont. C'est ainsi que Schopenhauer s'est efforc de trouver le point central qu'il n'a cependant jamais pu atteindre totalement. Car cette proposition s'annihile d'elle-mme. Il suffit de la penser jusqu' son terme pour dcouvrir qu'il s'agit exactement de ce que les mathmaticiens appellent une rduction 1' absurde . Pas la moindre pierre ne peut tre enleve de l'difice construit par Schopenhauer. Nous savons que nos sensations tactiles ou caloriques ne sont que des reprsentations de notre Moi. Soyons consquents! Comment pouvons-nous avoir connaissance de nous45
mmes? Nous ne voyons pas de couleurs vritables, nous savons seulement qu'il existe un oeil capable de voir des couleurs. Mais d'o savons-nous qu'un oeil voit, qu'il existe une main capable de sentir? Seulement par le fait que nous en avons la perception au mme titre que nous percevons n'importe quelle chose ou impression sensorielle lorsque nous cherchons connatre le monde extrieur. Notre soi-conscience dpend des mmes rgles et lois que celles dont dpend le monde extrieur. En consquence, ds lors que mon monde est ma reprsentation je dois moimme, avec tout ce qui fait partie de moi, tre ma reprsentation. Il s'en suit que toute la philosophie de Schopenhauer, tout ce qui est dit du monde subjectif et objectif, n'a que la valeur de reprsentation. Cette rflexion explique trs clairement la consquence ultime laquelle aboutit la pense de Schopenhauer. Il doit donc aussi admettre que tout ce qu'il a constat le concernant n'est que sa propre reprsentation. Nous voici en plein dans cette reductio ad absurdum du mathmaticien, l'instant o l'on se tient suspendu en l'air en se soulevant par ses propres cheveux. Nous sommes entirement suspendus dans le vide. Nous n'avons plus aucun appui. Nous avons dtruit le ralisme naf, certes, mais par la mme occasion nous avons montr que cela nous conduit au nihilisme. Puisque cette conclusion mne l'absurde, il nous faut chercher un autre point d'appui. Schopenhauer s'en est lui-mme charg. Il a dit: Si je veux atteindre la ralit, je n'ai pas le droit de m'en tenir la seule reprsentation; je dois avancer jusqu' la volont. Ainsi Schopenhauer devient-il raliste, mais d'une autre faon que Herbart'. Ce dernier prtend que la ralit se trouve l o il n'y a point de 46
contradictions. C'est dans ce but qu'il arrte sa vaste gamme de donnes relles. Schopenhauer en fait d'ailleurs tout autant. Le monde qui m'entoure est une illusion, c'est certain, absolument certain ! Mais comme la fume est signe de feux, l'illusion indique quelque chose qui est son origine. A l'exemple de Leibniz, Herbart aborde ce problme selon la conception monadologique, mais teint de kantianisme, alors que Leibniz" n'avait pas pu subir cette influence puisqu'il vcut avant Kant. Schopenhauer adopte le point de vue suivant : Je me sais un tre de volont. Cette volont d'exister me donne la certitude que je suis. Je suis volont, et dans le monde je me manifeste comme reprsentation. Etant donn que je suis volont et que je me manifeste, les autres choses le sont aussi et se manifestent l'extrieur. Tel le Moi qui est contenu en moi, la volont l'est galement, et dans les choses extrieures est contenue la volont de ces choses. Ainsi se prsente la voie propose par Schopenhauer pour accder la connaissance de soi, et par l il admet implicitement que pour connatre les choses il faut ncessairement tre l'intrieur d'elles. Certes, si le ralisme naf a raison de prtendre que les choses en dehors de nous n'ont absolument rien voir avec notre Moi, et que c'est uniquement grce nos reprsentations que nous avons connaissance de ces choses, si donc leur essence nous demeure extrieure, nous ne saurions chapper la thorie de Schopenhauer. En consquence, la seconde partie est bien difficile justifier: Le monde est ma volont. Vous allez tout de suite comprendre. Lorsque vous laborez une reprsentation, cela ressemble au phnomne du cachet et de son empreinte. La chose en 47
soi, ressemble au cachet, et la reprsentation l'empreinte. Rien du cachet n'entre dans la substance qui reoit l'empreinte. L'empreinte, la reprsentation est entirement subjective. En moi je n'ai rien de la chose en soi, de mme que l'empreinte ne contient jamais de substance du cachet. Telle est l'ide fondamentale qui anime la vision subjectiviste du monde. Mais Schopenhauer dit: je ne peux connatre une chose que si j'entre en elle. C'est ce qu'affirme aussi Julius Baumann 23 qui, soit dit en passant, fait timidement allusion la notion de rincarnation bien qu'il ne soit pas thosophe. Mais cette mentalit, Baumann l'a galement introduite dans ses cogitations pistmologiques. Mme si cette particularit de sa dmarche n'a gure dpass un stade lmentaire, on peut constater qu'il est tout de mme engag sur la bonne voie. Effectivement, il n'existe aucune possibilit de connatre une chose sans pntrer en elle. Or cela est irralisable tant que nous prtendons que la chose demeure en-dehors de nous et que nous ne recevons d'elle qu'un message; dans ce cas rien ne peut nous pntrer. Mais si nous pouvions entrer dans la chose, nous serions en mesure de connatre son essence. Pour tout spcialiste moderne de la thorie de la connaissance cela semble tre l'ide la plus absurde qui soit. Mais cela n'est qu'une impression imputable aux prmices de la thorie occidentale. Tel ne fut pas toujours le cas, notamment chez ceux dont l'esprit n'tait pas aurol par les principes de ce type de thorie de la connaissance. Une ventualit pourrait tre envisage, savoir que nous ne sommes peut-tre jamais rellement sortis des choses. Nous n'avons peut-tre jamais rig ce mur de sparation radicale, creus ce foss qui, selon 48
Kant, nous dissocie rigoureusement des choses. Ds lors, nous parvenons nous familiariser avec l'ide que nous pouvons tre dans les choses. Telle est d'ailleurs l'ide mre de la thosophie. Celle-ci pense que notre Moi ne nous appartient pas en propre et n'est pas enterr dans les limites troites de notre organisation; l'individu n'est que la manifestation du Soi divin de l'univers. Il n'est en quelque sorte qu'un reflet, une manation, une tincelle du Moi cosmique. Ce point de vue a d'ailleurs domin pendant de longs sicles les esprits, avant que ne surgisse la philosophie de Kant. Sur ce point les plus grands esprits n'ont jamais pens autrement. Kepler" nous a rvl la construction du systme plantaire et a dfendu l'ide que les plantes empruntent des parcours elliptiques autour du soleil. C'est une thse qui nous fait connatre la nature du cosmos. Pour nous permettre de voir de quels sentiments il tait anim, je vais vous citer ses propres paroles: La premire aurore m'est apparue voici quelques annes, j'ai dcouvert le jour voici quelques semaines, le soleil est venu moi voici quelques heures. J'ai crit un livre. J'apprcie ceux qui le lisent et le comprennent; les autres ne m'intressent pas... Une pense qui a mis du temps pour ressurgir dans la tte d'un homme. Ces paroles traduisent la certitude acquise que le contenu de notre esprit et ce que nous savons de l'univers est identique ce que cet univers a engendr. Ce n'est donc pas par hasard que les plantes suivent des courbes elliptiques puisque l'esprit crateur lui-mme a d les y placer. Nous ne serions donc plus seulement des spectacteurs capables d'laborer des ides au sujet de l'univers; au contraire, ce qui constitue le contenu de notre esprit est aussi ce qui au-dehors est agissant et crateur. Au sujet de ses penses fondamentales rela49
tives l'univers cosmique Kepler avait la conviction de n'tre que le thtre humain o s'est manifeste cette ide qui vit et agit dans l'univers, afin d'tre reconnue une nouvelle fois. Kepler n'aurait jamais eu l'ide de dire que ce qu'il avait dcouvert de l'univers, pouvait n'tre qu'une simple reprsentation, mais il aurait affirm: Ce que j'ai dcouvert m'apporte la connaissance de ce qui existe rellement dans l'espace. Si l'on avait suggr Kepler l'ide que tout ce monde extrieur n'avait rien d'objectif, n'tait que reprsentation, il aurait rpondu: Crois-tu vraiment que ce qui me permet de connatre un autre monde n'existe que dans la mesure o j'accepte ce message? Pour tre consquent, tout adepte d'une pistmologie subjectiviste devrait se dire lorsqu'il est au tlphone: ce monsieur de Hambourg qui m'appelle l'instant n'est que ma reprsentation; je ne le perois qu'en tant que ma reprsentation. Cette dmarche nous amne d'elle-mme nous poser la question: Comment est-ce possible d'admettre effectivement le principe selon lequel nous n'acceptons l'essence des choses que si nous russissons entrer dans cette essence, nous identifier cette essence? Telle serait la thorie de la connaissance de ceux qui cherchent tablir un point de vue plus clair et plus profond face la conception moderne. Hamerling" crivit un excellent ouvrage: L'atomistique de la volont. C'est un penseur profond,cultivant des ides srieuses. Ses crits sont conus dans l'esprit de Schopenhauer, mais il s'agit de penses qui s'efforcent d'accder l'essence mme des choses. Hamerling affirme qu'une chose est absolument certaine: aucun individu ne voudra nier sa propre existence, personne n'acceptera de dire que 50
son tre n'est qu'une illusion et que cet tre n'est plus ds qu'il cesse de penser. Mme Schiller avait une fois fait cette remarque: Il est vrai que Descartes affirme je pense, donc je suis; toutefois il m'est souvent arriv de ne pas penser, et nanmoins j'tais. Hamerling cherche retrouver une attitude semblable celle de Schopenhauer: je dois reconnatre tous les autres tres un sentiment d'exister. Il connat deux ples, le Moi et l'atome. Tout cela est un peu parcimonieux, mme l'ouvrage de Hamerling est pauvre. Pour chapper l'illusionnisme, il essaie de se l'expliquer de la faon suivante: Nous ne pouvons raliser que l'tre au sein duquel nous sommes nousmmes inclus. Hamerling s'efforce avec perspicacit d'approfondir ce problme. Fechner" tente de remplacer le sentiment d'exister par le sentiment tout court. Il dit que Herbart aurait commis l'erreur de vouloir atteindre la ralit authentique au moyen de la seule pense. Mais cela ne nous mne pas au Moi. Bien au contraire, le Moi se dgage du sentiment. Il aurait pu crire la manire de Schopenhauer: Le monde en tant que sentiment et reprsentation. Quant Hamerling, il aurait pu titrer: Le monde en tant qu'atome, volont et reprsentation. Pour expliquer l'tre, Frohschammer 27 attribue l'imagination la facult de cration universelle, comme Schopenhauer l'avait attribue la volont. Pour le premier, la nature entire ne serait que le produit de l'imagination. Tous ces penseurs s'efforcent d'chapper aux absurdits de Kant. Une dmarche intellectuelle trs dlicate s'impose maintenant. Pour tre la page il faut l'avoir effectue. Comment se fait-il que nous soyons en mesure d'mettre un postulat caractrisant ce qu'est notre connaissance?.Qu'est-ce qui nous permet de dire que 51
le monde est notre reprsentation, ou notre volont, ou notre imagination etc. etc...? Sans doute existe-t-il quelque chose qui nous donne la possibilit et la facult d'tablir un rapport entre le monde et nousmmes, notre facult de connaissance et notre facult de reprsentation. Voyons un instant le contraste qui existe entre le Moi et le reste du monde, c'est--dire: comment pouvons-nous acqurir une connaissance de notre Moi et du reste du monde? Prenons l'exemple de celui qui accuse un criminel et de son dfenseur. L'un juge partir d'un point de vue, l'autre dfend le point de vue oppos. Aucun ne peut tre suppos mettre un jugement totalement objectif. Seul le juge plac audessus d'eux peut donner un jugement non engag. Il y a les arguments des deux protagonistes, puis le juge qui les soupse objectivement. Aucun des deux ne pourra dcider valablement. De mme, le Moi seul ne peut pas apprcier objectivement ses rapports avec le monde. Chaque Moi est subjectif et ne saurait donc dcider valablement de la qualit de ses rapports avec le monde. Aucune thorie de la connaissance ne pourrait exister s'il n'y avait que le Moi d'un ct et le monde de l'autre. Ma pense doit s'lever un point de vue objectif pour surmonter l'antagonisme qui existe entre le Moi et le monde. Tant que je suis entirement engag dans mon penser, cela n'est pas possible, l'exemple de ce qui se passe pour les disciples de Kant et de Schopenhauer. Imaginons un instant Kant assis sa table de travail en train d'laborer des jugements. Une telle dmarche personnelle ne permet sans doute pas d'accder un jugement objectif. Pour y parvenir, pour que ma pense soit le juge suprme la fois de mon Moi et du monde, il faut qu'elle se dpasse et se place un niveau suprieur. 52
La moindre introspection nous montre que notrepenser est quelque chose qui va au-del de nousmmes. Il est faux de prtendre que l'affirmation deux fois deux font quatre, ainsi que toutes les vrits absolument certifies ne soient qu'illusions, simples manifestations valables seulement au niveau de notre conscience. Vu que leur validit est vidente, nous devons admettre que leur objectivit dpasse notre apprciation subjective. Le fait que deux fois deux font quatre n'a rien voir avec notre Moi. Rien dans le domaine de la sagesse n'est tributaire de notre Moi. Du fait que nous sommes capables de nous lever un penser objectif et cohrent, nous sommes en mesure d'mettre des jugements objectifs l'gard du monde. En fait, tous les penseurs prsupposent cette vidence, sinon ils ne pourraient jamais cogiter au sujet du monde. S'il n'existait que les deux rflexions suivantes: Je suis dans le monde et Le monde est en moi, on ne serait pas en mesure d'difier des thories comme celles de Kant ou de Schopenhauer. Nous devons admettre que nous sommes en droit d'mettre des jugements au sujet de la vrit. Car dans notre penser il y a quelque chose qui va au-del de notre Moi. Cela est d'ailleurs admis par tous les philosophes qui ne sont pas prisonniers du kantianisme mais partagent une vision monadologique du monde. Tous ceux qui rflchissent en ce sens aux ralits du monde les imaginent de nature spirituelle. Et si nous nous rfrons Giordano Bruno", Leibniz et tous ceux qui se sont efforcs de dcouvrir les particularits des choses relles, nous constatons qu'ils les ont conues selon le principe de la monade, c'est-dire ont vu la pense comme manant d'une source originelle qui n'est autre que l'esprit. Si donc l'esprit est ce qui fait l'essence mme des choses, alors, 53
face une telle conception, la thorie de la connaissance de Kant et de Schopenhauer se prsente comme un ralisme naf. Revenons notre exemple. Imaginons qu'aucune matire du cachet ne se transmette l'empreinte, mais que tout dpende des lettres, du nom grav dans le cachet, de l'esprit. Alors nous pouvons dire qu'aucune matire ne passera de l'un l'autre, mais que ce qui se transmet c'est le nom figurant sur le cachet. Celui-l passe du monde de l'esprit l'autre monde. Il passe de l'un l'autre malgr toutes les frontires que nous avons pu dresser. Dans ce cas on ne saurait nier que la thorie de Schopenhauer soit partiellement juste, mais nous passons par dessus ces frontires. Ne nous proccupons pas des considrations matrialistes. Acceptons qu'aucune particule du cachet ne se transmette l'empreinte, mais que seul l'esprit puisse passer de l'un l'autre, car sous sa forme authentique celui-ci pntre en nous puisque nous sommes vritablement issus de lui. Nous sommes une tincelle de cet esprit de l'univers; c'est pourquoi nous vivons en lui et le reconnaissons nouveau. Lorsque cet esprit de l'univers frappe notre oeil ou notre oreille, nous savons trs bien que cela n'est pas simplement une sensation subjective; nous voyons qui se trouve l'extrieur. Nous savons donc que l'esprit au-dehors cherche les mdiateurs dont nous avons dit qu'ils peuvent jouer le rle de transmission spirituelle. Une fois tabli que dans sa nature profonde le monde est esprit, nous pouvons intgralement embrasser le point de vue de Kant et de Schopenhauer. Tout cela est juste mais ne va pas assez loin. Il est ais de se familiariser avec les points de vue de ces deux penseurs. Mais ce qui compte c'est de les dpasser. En effet c'est l'es54
prit qui vit en toutes choses et c'est l'esprit qui frappe notre porte pour nous rvler sa nature profonde. Ainsi se confirme, au sens de la thosophie, ce que Baumann pose comme exigence l'gard de toute connaissance vraie, savoir que nous devons vivre l'intrieur des choses. Nous situant l'intrieur de l'esprit de l'univers nous ne sommes nous-mmes qu'une manation de celui-ci. La dmarche fondamentale de cette philosophie, je l'ai aujourd'hui transpose en images. Ma Philosophie de la Libert contient un expos philosophique cet gard mais aussi l'nonc des points de vue opposs. J'ai montr d'une part que Schopenhauer, Kant et les nokantiens partent de l'ide selon laquelle nous ne pouvons pas dpasser le niveau de la reprsentation, et d'autre part qu'ils ont moiti surmont le ralisme naf. Mais comme ils ont pour point de dpart la chose en soi et prtendent que l'on ne peut pas sortir de soi, ils demeurent malgr tout rivs au ralisme naf du fait que c'est au sein mme du domaine matriel qu'ils cherchent la vrit. Les spcialistes modernes de la thorie de la connaissance, mme s'ils sont persuads d'avoir vaincu le ralisme naf, reposent toujours partiellement sur ce ralisme naf parce qu'ils n'ont pas su viter de tout fonder sur le rgne matriel. Seule la thosophie peut nous conduire au seuil de la connaissance. Lorsque nous voulons trouver l'objet de la connaissance, elle nous induit dire que l'essence authentique de l'univers est esprit. Ds l'instant o nous atteignons ce seuil, la dmarche poursuivre sera d'ordre spirituel. L'univers dans sa totalit est fond sur l'esprit. Je tenais vous exposer cela. J'ai d me limiter esquisser quelques traits seulement. L'tre humain est 55
coup sr une empreinte de l'univers. Son essence n'est pas de nature physique. Nous pouvons tous moments reconnatre cette essence car elle est de nature spirituelle. L'esprit coule dans la matire, nous pntre, comme le nom grav dans le cachet se transmet l'empreinte. Je pense avoir montr que nous pouvons trs bien nous mettre la place de la philosophie classique mais que dans cette hypothse nous devons nous efforcer de la comprendre mieux que ne le font ses propres reprsentants. Alors chacun de nous trouvera le chemin conduisant la thosophie, mme s'il part d'un point de vue diffrent. Nous pouvons opter pour n'importe quel point de vue, pourvu que nous n'ayons pas d'oeillres car tous les courants philosophiques conduisent finalement la thosophie. Une tude approfondie de Schopenhauer constitue la meilleure faon de le surmonter. La plupart des gens ne le connaissent que trs peu. Or, l encore, il s'agit de pntrer dans la nature des choses, c'est-dire savoir adopter son point de vue. Il existe de lui douze volumes de textes" que j'ai comments et publis. J'ai donc eu l'occasion de me familiariser pendant de longues annes avec l'oeuvre de ce penseur. Je pense assez bien le connatre. Lorsque l'on saisit vraiment ses intentions, on aboutit au point de vue choisi par la thosophie, alors que toute demimesure dans le domaine de la connaissance nous empche d'accder la thosophie. Cette connaissance insuffisante de l'Occident nous loigne de la thosophie, conduit au subjectivisme, l'idalisme etc. etc... Pour l'Occident le chemin qui mne la thosophie passe par la recherche d'une connaissance complte et intgrale. 56
J'ai dj mentionn Julius Baumann. Il sait ce qu'est une vraie connaissance, mme s'il n'a pas encore atteint ce qui fait cette grandeur de la thosophie que je me suis efforc d'esquisser. La vraie connaissance ne contredit jamais la thosophie. Cette dernire cultive une vision du monde faite de paix et de tolrance. Toutes ces vrits que j'ai voques sont autant d'tapes conduisant la vrit centrale. Kant a partiellement entrepris cette ascension, Schopenhauer galement. Chacun selon ses possibilits. Tous deux sont sur cette voie. L'important est de savoir jusqu'o ils peuvent aller. La thosophie ne prtend pas avoir atteint la cime. Le juste chemin est prcisment celui qui s'inspire de la sentence grave sur le temple grec: Connais-toi toi mme! Nous sommes un avec l'esprit de l'univers. Comme nous connatrons notre propre essence, nous reconnatrons aussi celle de l'esprit de l'univers. S'lever de l'esprit humain l'esprit universel, voil ce que signifie la thosophie.
57
LOGIQUE
IV DE LA PHILOSOPHIE EN GNRAL Munich, 20 mars 1908
Le sujet que nous allons examiner aujourd'hui dborde le cadre de considrations strictement anthroposophiques. Il sera question de rflexions d'ordre purement philosophique qui n'ont qu'un lien indirect avec l'anthroposophie. Toutefois, il existe entre ces deux disciplines le rapport direct suivant. On prtend souvent que la science spirituelle anthroposophique est incompatible avec la pense scientifique, qu'elle n'est que pure dilettantisme ne mritant pas la moindre considration de la part de tout philosophe digne de ce nom. Nous nous proposons de montrer que le dilettantisme ne se situe pas du ct de l'anthroposophie, mais bien du ct de la philosophie. La philosophie actuelle est un instrument absolument inadquat pour s'lever au niveau de l'anthroposophie. Voyons d'abord ce qui en est de la philosophie. Observons son cheminement dans le temps et analysons ensuite son insuffisance fondamentale. Il s'agit de montrer que la philosophie est malade depuis que la dmarche de la pense s'est enchevtre dans une toile d'araigne, et de ce fait est devenue incapable d'largir son horizon au contact de la ralit. L'histoire de la philosophie commence avec Thals". C'est un fait incontestable. Rcemment, on a tent de la faire remonter au-del de cette poque et de placer ses dbuts antrieurement aux penseurs 58
grecs. On parle d'une philosophie hindoue, d'une philosophie gyptienne. Il n'est pas besoin d'insister sur le caractre arbitraire d'une telle apprciation, car c'est sans aucun doute avec Thals que dbute une poque importante. Si nous nous demandons ce qui intervint alors dans l'volution de l'humanit et qui n'existait pas auparavant, nous pouvons dire: la pense conceptuelle. C'est quelque chose de nouveau et trs diffrent de tout ce qui se pratiquait dans le pass. Prcdemment on ne faisait qu'exprimer ce que le voyant avait vu. Cette voyance dominait encore la pense de Platon". Le premier penseur conceptuel dont le systme n'est plus fond sur la voyance est Aristote". Il nous offre un systme purement intellectuel. Tout ce qui se situe avant lui n'tait qu'une prparation. Avec Aristote s'instaure la facult de se mouvoir et de penser en concepts purs. Ce n'est pas un hasard si ce philosophe est appel le pre de la logique. Chez un voyant, la logique se rvle en mme temps que la vision. Par contre, pour laborer des concepts, un art de la pense est indispensable. Certes, Aristote est le crateur d'un systme de la logique, mais sa rputation dpasse ce cadre. Grce lui les rvlations du christianisme seront transposes en formes intellectuelles selon la logique aristotlicienne. La pense aristotlicienne se propagea en Asie, en Arabie, en Espagne, ainsi qu'en Europe occidentale; dans les zones mridionales c'est le christianisme qui s'imprgna de ce courant de pense. Du VIIe au IXe sicle, la doctrine chrtienne aussi bien que le courant oppos au christianisme recoururent la pense aristotlicienne pour exprimer leurs ides. Il en fut ainsi jusqu'au XIIIe sicle. Nous verrons tout l'heure quel est le point fon59
damental du systme d'Aristote. Au milieu du Moyen Age, Thomas d'Aquin labore sa pense philosophique, le thomisme. Elle repose sur la rvlation chrtienne associe la logique aristotlicienne. Le formalisme strict de la pense ne sert pas enseigner le christianisme, mais dfendre la doctrine chrtienne contre l'arabisme et son disciple Averros" qui recourt d'ailleurs aussi cette forme de pense. La juste comprhension de la pense d'Aristote ne conduit pas soutenir l'enseignement arabe mais sert dfendre le christianisme. Dans le but d'infirmer les objections, on se met tudier srieusement les crits de Thomas d'Aquin. C'est d'ailleurs une poque o Aristote domine l'ensemble des sciences, y compris la mdecine. Il s'agit maintenant de caractriser l'influence d'Aristote sur la priode primitive de la scolastique. La pense d'alors tait trs diffrente de la ntre. Par rapport aujourd'hui, ce qui se faisait alors nous amne constater que dans le pass l'existence tait plutt terne. Les grandes dcouvertes datent de plus tard. Ce qui caractrise cette poque passe, c'est la stricte discipline de la pense. Aujourd'hui, les rigoureuses dfinitions d'alors prtent sourire. Mais une comparaison avec la faon arbitraire actuelle de comprendre les concepts permet de ressentir les bienfaits d'une mentalit fonde sur un systme cohrent de concepts. Il a fallu beaucoup de temps pour dfinir les concepts, mais une fois labors, ils constituent une base solide toute connaissance. Pour mieux orienter la suite de nos rflexions, il nous faut examiner de plus prs quelques concepts d'Aristote. Il fut un excellent interprte du christianisme et mme de l'anthroposophie. Il suffit de rf60
lchir certains concepts pour se rendre compte avec quelle prcision tait construit son systme de pense. Ce philosophe fit la distinction entre la connaissance tire de l'exprience sensorielle et celle tire de l'exprience intellectuelle. Les sens peroivent telle rose, tel homme ou telle pierre. Ensuite intervient l'intellect. Celui-ci porte d'une part sur la connaissance de la matire et d'autre part sur celle de la forme. Toute chose est faite de matire et de forme. Ces deux concepts nous ouvrent de vastes perspectives. Pour Aristote, chaque dtail capt par les sens est porteur de matire et de forme. Voyons, par exemple, le cas du loup. Il dvore des agneaux. Ds lors il est constitu de la mme matire que l'agneau. Nanmoins le loup ne devient jamais agneau. Ce qui les distingue, c'est la forme. Le loup a sa propre forme, et l'agneau la sienne. Aristote identifie cette situation par les notions d'espce, de loup et d'agneau. Il distingue rigoureusement entre espce et concept de l'espce. Face un troupeau d'agneaux, nous laborons le concept de l'espce. Ce que notre concept constate formellement concerne un fait objectif du monde extrieur, comme si nous nous reprsentions les images originelles des formes invisiblement tablies autour de nous dans le monde d'o manent les espces singulires, dans lesquelles est dverse une matire neutre. Tout ce qui existe alentour est fond sur cet lment qu'est l'espce. Pour Aristote, la matire reste quelque chose de neutre. Chez les scolastiques, chez Albert le Grand", nous trouvons ce qui est l'origine des tres extrieurs. La scolastique primitive distingue les universaux ante res, in res, et post res Albert le Grand dit ce sujet: Les universaux avant les choses sont les pen61
ses des entits divines. Cela concerne l'espce. Ces penses se sont coules dans les choses. Quand l'tre humain se place face aux choses, il labore les universaux aprs les choses, c'est--dire la forme conceptuelle. Dans toute cette description de la dmarche intellectuelle, il n'est question que de choses du monde sensible. Selon lui, il y a identit entre les sens en tant que tels et les sens physiques. Tout ce qui existe par ailleurs est concept. Le concept d'espce n'est pas identique l'espce. Cela s'explique par le fait que l'homme a perdu l'ancienne facult de clairvoyance, rendant ainsi possible la gense et le dveloppement de la philosophie. Un sage de l'antiquit n'aurait pas compris que l'on puisse faire ce genre de diffrences, car pour lui le don visionnaire permettait de percevoir l'espce. Il fallut que le don de vision ternisse pour que la vraie science puisse se dvelopper. L'homme dut tre abandonn lui-mme pour qu'apparaisse la ncessit de cultiver l'art de penser. C'est sous la pression de cet important principe qu'est ne la scolastique. Jadis, le monde spirituel tait encore accessible aux humains. Raison de plus pour que les scolastiques se rfrent Aristote qui avait parl de ce don visionnaire. D'aprs d'anciens rcits, les astres sont des dieux, mais la pense intellectuelle ne sait plus que faire d'une telle affirmation. Il n'y a cependant aucun motif d'en douter. La scolastique remplace la vision par la rvlation. La doctrine relve de l'inspiration du Verbe. Dans un premier temps, l'humanit doit s'habituer dvelopper le systme de la pense au contact des choses extrieures. Que deviendrait-elle, si elle voulait se laisser attirer par toutes sortes de choses suprasensibles? 62
Cela, nous nous l'interdisons. Nous voulons nous former aux choses perceptibles autour de nous. Ainsi parle Thomas d'Aquin. Lorsque des objets se dressent en face de nous, ils constituent des donnes pour nos sens. Nous sommes alors obligs d'laborer les concepts correspondants. Derrire les choses, il y a les puissances divines que nous n'osons pas approcher. Nous voulons nous former en progressant d'objet en objet. En nous en tenant strictement au monde sensible, nous accdons finalement aux concepts suprmes. La scolastique s'en tient donc deux aspects: d'une part la doctrine rvle, donne dans les Ecritures et que la pense ne saurait apprhender, elle a t reprise par les voyants; d'autre part ce qui est labor partir de la ralit sensible. Cela nous permet tout juste d'effleurer la Bible et la rvlation. Temporairement, la pense humaine est prive des mondes suprieurs. Il ne s'agit cependant pas d'un renoncement effectif la connaissance des mondes suprasensibles. Une fois que l'homme aura conquis le monde sensible, il pourra avoir un pressentiment des mondes suprasensibles. L'tre humain peut se rendre indpendant du corps physique et accder des rvlations directes. Mais il doit d'abord former son intellect. Lorsqu'il faonne des concepts se rapportant aux choses extrieures, ceux-ci demeurent tributaires de l'organisation humaine, non au point de vue de leur contenu mais en ce qui concerne leur forme. Chez les scolastiques, la thorie de la connaissance n'accepte jamais que puisse subsister un rsidu inconnu. Ce qu'il y a d'objectif entre dans la connaissance. Seule la manire d'laborer les concepts, c'est--dire la forme, dpend de la faon dont est organis l'esprit. Cette priode de la scolastique primitive fut celle 63
du ralisme. Elle croyait la ralit des contenus. Ensuite la scolastique vira au nominalisme. Les hommes avaient perdu tout lien avec l'objectivit du monde extrieur. Ils disaient: l'esprit labore des concepts, mais ceux-ci n'ont aucune ralit. Les concepts devinrent simplement des noms, de pures abstractions. Ce que communique le concept n'est pas rel. C'est pourquoi les nominalistes durent se dire: Devant notre regard s'tale la ralit sensible. Nous la rsumons la manire qui convient notre raison. Mais nos concepts ne correspond aucune ralit. L'authentique rvlation doit tre protge de l'intervention de la pense humaine; il y a donc lieu de renoncer toute comprhension. Le point culminant de cette philosophie est atteint avec l'affirmation de Luther" lorsqu'il dit que la raison est impuissante, est une folle totalement sourde et aveugle qui devrait s'interdire de s'immiscer dans la doctrine. Nous voici arrivs un point de sparation trs important. Luther condamne Aristote. C'est de l que dcoule la suggestion qui a engendr le kantianisme. Jusqu' la fin des annes soixante, Kant avait t un adepte de Wolff, comme d'ailleurs presque tous les philosophes de l'poque. D'aprs Wolff" la raison est capable de connatre les mondes suprasensibles. Il distingue entre une science rationnelle et une science empirique. Il est possible d'acqurir une certaine quantit de connaissance humaine. La connaissance a posteriori n'a qu'une valeur relative, par exemple le lever du soleil. Les connaissances accumules ne sont que le rsultat d'une accoutumance aux expriences vcues. La cosmologie rationnelle est le champ d'enseignement relatif l'univers et qui nat partir de l'observation, alors que la cosmologie empirique 64
dcoule de l'exprience. De ce fait, on peut faire une distinction entre la thologie rvle et la thologie rationnelle. Kant s'engage sur les traces de Wolff. Hume" le gne, car il dveloppe le scepticisme. Il prtend que l'on ne doit pas tablir de barrage entre les connaissances a priori et celles a posteriori. Tout notre acquis intellectuel est fait de connaissances dues l'accoutumance; il n'en existe pas de purement rationnel. Kant merge de sa somnolence dogmatique. Mais il ne peut pas souscrire entirement cette thse. Il dit que Hume a raison et que tout ce que nous savons rsulte de l'exprience. Seul le domaine des mathmatiques fait exception; ce que disent les mathmatiques a une valeur absolue. Il dfend donc deux thses. Premirement: il existe des jugements absolument certains. Deuximement: il prtend que toute connaissance doit tre tire de l'exprience. L'exprience se conforme nos jugements. C'est nous-mmes qui attribuons des lois au monde exprimental. C'est au moyen de son organisation intellectuelle que l'individu affronte les choses. Toute exprience se conforme notre connaissance. C'est ainsi que Kant peut rconcilier Hume et Wolff. Aujourd'hui, l'tre humain est prisonnier de cet enchevtrement de la philosophie. Fichte, Schelling et Hegel font exception. Il y a mme quelques savants qui s'engagent dans cette voie. Helmholtz dit": Le monde auquel je me trouve confront est le rsultat de ma propre organisation. Ce que je perois d'une chose n'est mme pas une image mais seulement un signe. L'oeil n'a que des perceptions en surface. Il est entirement prisonnier de sa propre subjectivit. La choses en soi demeure inconnue. Il tait invitable 65
que l'on aboutisse cette situation. Cach sous la surface, le spirituel chappe au nominalisme. La vie intrieure de l'homme s'est affaiblie. Ds lors le travail intrieur demeure purement formel. Si l'homme veut percer jour ce qu'il y a derrire la ralit, sa vie intrieure demeure sans rpondant. L'ensemble de la pense philosophique du XIXe sicle est incapable d'merger de cette situation. Hartmann", par exemple, ne parvient pas concevoir autre chose que la reprsentation. Une simple comparaison peut nous clairer. Un cachet est grav du nom de Dupont. Pas la moindre particule matrielle de cette pice de laiton ne peut se transmettre la cire cacheter. En consquence, rien d'objectif ne passe du cachet la cire. Le nom de Dupont doit donc se former partir de la cire. C'est la cire cacheter qui pense. Rien de l'objet ne se transmet au penseur. Nanmoins le nom Dupont figure sur la cire. C'est ainsi que nous liminons du monde objectif son contenu. Et pourtant, ce que nous liminons ainsi est bien le contenu authentique. Tant que l'on s'en tient l'aspect purement matriel, tout cela est juste: rien de la cire ne se transmet au cachet, ni du cachet la cire. Mais ds que l'on considre l'aspect spirituel, le principe suprieur capable d'englober la fois ce qui est objectif et ce qui est subjectif, l'esprit entre et sort sa guise, agit sur l'un et l'autre. Tout le contenu de ce qui est objectif, l'esprit le transmet ce qui est subjectif. Par nature, le Moi est la fois objectif et subjectif. Fichte l'a dmontr. L'ensemble de la thorie de la connaissance du XIXe sicle ressemble un chien qui court aprs sa queue. On en arrive se dire: j'ai tout cr; tout mane de ma vie intrieure; j'ai donc aussi le droit de tout tuer. Les concepts kantiens sont compliqus et sur66
chargs. Cependant, c'est bien lui qui a dot l'humanit d'une ide particulire. Kant a dit: j'ai dtruit la connaissance pour faire place la croyance. Il a fond une croyance pratique. Il a rduit la connaissance, l'a ramene jusqu' l'ignorance, parce que tout passe pour tre engendr par la subjectivit. Le kantianisme est l'ultime consquence du nominalisme. Aujourd'hui, cette thorie est prime. Pour acqurir des concepts justes, l'homme doit de nouveau former sa pense au contact de la ralit. Cela permettra de renouer avec la connaissance des vrits suprasensibles. La position scolastique tait tributaire de son poque: pendant un certain temps le spirituel devait tre soustrait la connaissance. Aujourd'hui, la doctrine rvle doit redevenir une doctrine vrifiable. La raison doit accompagner tous nos actes. Elle est une lumire appele se rpandre trs gnralement. Tout doit tre accessible l'investigation, la raison, la comprhension. La raison constitue la force de vision la plus infrieure, certes, mais c'est une force intelligente qui entend et qui voit. C'est ainsi que nous nous librons de ce filet enchevtr. La philosophie doit se laisser fconder par la logique, par la vraie pense.
67
V PHILOSOPHIE ET LOGIQUE FORMELLE Munich, 8 novembre 1908
Nous envisageons aujourd'hui un petit intermde dans notre srie de confrences. Ce n'est pas un thme anthroposophique que nous allons traiter, mais un sujet purement philosophique. De ce fait, cette soire risque d'tre quelque peu ennuyeuse, mais il est peuttre bon que les anthroposophes approfondissent de temps autre un sujet de ce genre. En effet, il semble tout fait indiqu de se consacrer une telle rflexion parce que nous entendons sans cesse rpter que les sciences, plus particulirement la philosophie, ne voient pas l'utilit de s'intresser l'anthroposophie. Celle-ci, dit-on, ne concerne que des dilettantes qui n'ont aucune envie de s'adonner une recherche srieuse et rigoureuse, ni d'emprunter les sentiers de la pense exacte et discipline. Les philosophes de mtier reprochent l'anthroposophie son dilettantisme, son amateurisme. Mercredi prochain, vous pourrez vous procurer le texte de ma confrence Philosophie et Anthroposophie faite Stuttgart. Cette confrence vous montrera sous un certain clairage comment la philosophie, condition d'voluer dans le sens d'un approfondissement, pourra trouver une ouverture en direction de l'anthroposophie. La dmonstration est faite que les philosophes si assidus pour qualifier l'anthroposophie de dilettantisme, ne possdent finalement aucun fondement philosophique srieux, et 68
que dans leur propre domaine ce sont prcisment eux qui font preuve du pire dilettantisme. Ds lors, on ne saurait tre surpris de constater qu'ils sont incapables de jeter un pont allant de leur prtendue rigueur scientifique vers cette anthroposophie tellement mprise. Il existe une certaine misre en philosophie. La vie spirituelle est marque par la fcondit et le rle trs important des sciences naturelles. Tous les domaines des sciences tmoignent de la russite et des progrs scientifiques. La science positive est parvenue construire des instruments permettant l'investigation prcise dans de nombreux domaines. Elle est capable de mesurer les lointains espaces et de dtecter les plus petites particules; elle dispose encore de diffrents autres moyens qui laissent prsager un avenir o le perfectionnement des mthodes de la recherche pourra tre considrablement dvelopp. Mais il faut aussi voir l'autre ralit, celle de l'absence totale de culture philosophique chez les savants. Cela a pour consquence que, grce aux instruments destins tudier la vie pratique, de nouvelles acquisitions considrables sont prvisibles, mais que ceux qui sont appels raliser ces conqutes sont dans l'impossibilit de tirer de ces rsultats pratiques les conclusions destines la vie de l'esprit. Cela s'explique par le fait que les savants dont la mission consiste prcisment faire avancer les sciences ont une formation philosophique insuffisante. La recherche fonde sur la mthode pragmatique des laboratoires, mme si elle dispose des instruments ncessaires, n'est pas tout. Encore faut-il, pour tirer de la recherche scientifique des conclusions valables et tre capable d'clairer les fondements de l'existence, avoir form et disciplin sa pense en consquence. 69
Il fut un temps o les hommes appels la rflexion philosophique disposrent d'une discipline de la pense particulirement affine. Par contre, la recherche scientifique tait alors nettement moins avance qu'aujourd'hui. De nos jours la situation est inverse. Nous disposons d'une recherche scientifique extraordinaire, mais elle est marque par son incapacit de penser et d'difier un systme philosophique cohrent. En fait, il ne s'agit pas tellement d'une incapacit de la part de ceux qui se consacrent la recherche scientifique, mais plus gnralement d'une attitude de mpris l'gard de la pense philosophique. Le botaniste, le physicien ou le chimiste, par exemple, ne voit pas l'utilit de consacrer son temps s'interroger sur les fondements les plus lmentaires de la technique intellectuelle. L'activit professionnelle dans les laboratoires se droule comme si la mthode progressait d'elle-mme grce une impulsion qui lui est inne. Les gens qui sont un peu familiariss avec ces problmes savent que la mthode travaille automatiquement et qu'il n'y a donc pas de quoi rvolutionner le monde entier quand quelqu'un fait une dcouverte fondamentale, puisque depuis longtemps la mthode, grce son dynamisme intrinsque, produit un effet anticipatif. Lorsqu'un chercheur empirique met le doigt sur un point significatif, le chimiste, par exemple, ou le physicien s'efforce alors d'tablir les rapports de cause effet au sujet de cette dcouverte. Du fait qu'il ne dispose d'aucune discipline intellectuelle, il aboutit des conclusions pour le moins tonnantes ds qu'il se met penser. Pour le profane cela est peine croyable, et pourtant... la pense du savant n'est pas forme; sa discipline intellectuelle ne dpasse gure celle du commun des mortels. Le savant 70
est l'origine de thses autoritaires qui font le tour du monde et que les gens non avertis acceptent avec crdulit, pensant qu'il s'agit de vrits confirmes, alors qu'elles ne sont que le rsultat de cette pense indiscipline. Parfois certaines conclusions dcoulent de dmarches vrai dire incroyables! Voyons de plus prs une conclusion de ce genre. Choisissons cet effet un cas d'une certaine valeur historique. Les gens disent: J'entends un son. Je vais sa recherche pour en connatre objectivement la cause extrieure. Pour une exprience prcise, c'est--dire en recourant des moyens permettant de constater physiquement les faits, je trouve que si ce son est mis par un objet, ce dernier subit en quelque sorte des secousses intrieures. Quand une cloche sonne, son mtal entre en vibration. On peut prouver scientifiquement que, tandis que la cloche sonne, l'air subit son tour une vibration qui se propage et vient heurter mon tympan. Cette observation conduit la conclusion qui semble plausible: En consquence de ces vibrations naissent les sons. Je sais qu'une corde est capable de vibrer. Pour en avoir la preuve matrielle il suffit de poser de petits cavaliers en papier sur la corde et de constater qu'ils se dtachent ds que j'excite la corde. De la mme faon on peut prouver que la corde transmet ses vibrations l'air qui, son tour, vient frapper mon oreille et provoquer le son. Ce que nous avons dit au sujet du son, fait partie de la ralit physique, et la description que nous en avons faite n'a rien de particulier. Tout cela est vrifiable. Il suffit d'assembler les faits et d'y ajouter la dmarche de la pense pour aboutir ces conclusions. Mais le problme se corse ds que l'on prolonge cette rflexion. Les gens disent: L'oreille sert percevoir 71
des sons et l'oeil percevoir la lumire et les couleurs. Ils ont l'impression que, parce que le son est pour ainsi dire l'effet de quelque chose d'extrieur, la couleur doit l'tre aussi. On pourrait trs bien se reprsenter cette chose extrieure, comme quelque chose qui ressemble des vibrations, comme l'air qui sert de support au son. De mme qu' chaque tonalit correspond une densit spcifique de vibrations, on pourrait se dire que chaque couleur s'explique galement par quelque chose qui se meut selon une certaine amplitude. Pourquoi n'existerait-il pas, sur le plan physique, quelque chose qui vibre et qui propage ces vibrations jusque dans mon oeil pour y provoquer une impression lumineuse, comme le fait l'air lorsqu'il frappe mon tympan? Bien entendu, dans le cas de la couleur, aucun instrument ne permet de percevoir ce qui vibre, alors que pour le son cela est possible, la vibration est perceptible. Pour la couleur, ce n'est pas le cas. Mais tout cela semble tellement vident qu'il ne vient l'ide de personne de douter de cette similitude applique la couleur. On pense gnralement que l'impression lumineuse a besoin d'un support ondulatoire comme l'impression sonore. Et comme il n'est pas possible, dans le cas de la couleur, d'observer cette vibration, on l'invente tout simplement. On dit: L'air est un lment dense qui, dans le cas du son, se met vibrer; les ondulations de la lumire sont dans l'ther qui remplit l'espace. Lorsque le soleil nous envoie de la lumire, cela veut dire que la matire solaire se met vibrer et que cette vibration se propage grce l'ther, frappe l'oeil et provoque l'impression lumineuse. On a vite fait d'oublier que cet ther est une invention hautement fantaisiste et relve de la pure 72
spculation. Voil comme les choses se sont effectivement droules! Nanmoins cette thorie est propage avec beaucoup d'assurance. On affirme que cet ther remplit l'espace et exerce un mouvement ondulatoire; on est tellement sr qu'il s'agit d'un fait scientifiquement tabli que tout le monde admet dornavant: La science a constat qu'il existe un ther dont les vibrations provoquent dans notre oeil des sensations lumineuses. Il existe mme une certaine littrature o l'on peut lire que tout repose sur ce genre de vibrations. On va jusqu' expliquer que ce mouvement ondulatoire de l'ther est l'origine de la pense humaine. On dit que la pense s'explique par l'effet que l'ther produit sur l'me. La pousse est due des vibrations dans le cerveau, de l'ther en vibration etc. etc... Ce produit de l'imagination, cette pure spculation est considre par beaucoup de gens comme l'authentique ralit du monde que l'on ne saurait mettre en doute. Et pourtant, tout cela repose sur l'erreur de raisonnement que nous avons voque. Ne confondons pas l'ther dont il est question ici avec le mme terme dont se sert l'anthroposophie. Quand nous utilisons le mot ther nous parlons de quelque chose de suprasensible, alors que la physique moderne parle de l'ther au sens de tout autre corps spatial et lui attribue les mmes qualits sensibles. Or, pour dire d'une chose qu'elle est une ralit tangible, il faut qu'elle ait une existence physique et qu'elle entre dans le champ de ce qui est contrlable et mesurable. Simplement imaginer un fait rel n'est pas permis. Ce qui compte ici, c'est de savoir que l'ther dont parle la science moderne n'est rien d'autre qu'une abstraction. La physique moderne repose donc sur des fondements hautement fantaisistes et sur l'invention arbi73
traire de ces mystrieuses ondulations thriques, ondulations d'atomes et de molcules. Or, cette thorie est indfendable car il n'est pas permis d'affirmer qu'une chose existe tant qu'elle n'a pas t rellement constate. Est-on en mesure de percevoir cette vibration thrique admise par les sciences? Du point de vue pistmologique la justification de cette thse dpend de la possibilit de vrifier ces vibrations thriques d'aprs les mmes moyens que ceux utiliss pour percevoir n'importe quelle autre chose situe dans l'espace. Or, le seul moyen permettant de constater l'existence d'une chose consiste en appeler la perception sensorielle. Cette chose qui vibre dans l'ther, serait-elle de la lumire ou de la couleur? Non, cela est impossible puisque c'est l'ther luimme qui doit engendrer la couleur et la lumire. Existe-t-il d'autres sens capables de la percevoir? Impossible, car il s'agit de quelque chose qui doit engendrer toutes les perceptions mais qui son tour ne peut en aucun cas tre peru au moyen du concept qui lui a t pralablement attribu. Cela ressemble d'assez prs un couteau qui n'a ni poigne ni lame, ou ce qui est dit d'un concept est en mme temps contredit. Ce que se permettent les savants est pour le moins surprenant, et cela nous autorise prononcer un jugement assez svre l'gard de leur discipline intellectuelle en disant qu'elle est laisse l'abandon. Ils oublient tout simplement de respecter les rgles les plus lmentaires de la dmarche philosophique. Aprs avoir lucubr de telles thories les gens se disent: Tout ce qui se manifeste, qu'est-ce d'autre qu'une chose reposant sur la matire vibrante, sur l'ther vibrant, sur le mouvement? En examinant tout ce qui existe dans le monde on trouverait que l o il y 74
a des couleurs, etc. etc... il ne s'agit toujours que de matire en vibration. Par exemple, quand un effet lumineux se propage, rien ne se dplace d'un endroit de l'espace l'autre, rien du soleil ne vient nous. Ces gens pensent qu'entre nous et le soleil il y a l'ther et que les molcules solaires dansent; par leur danse elles impriment un mouvement de danse aux particules thriques voisines en sorte que celles-ci leur tour se mettent danser. Leur mouvement se transmet aux prochaines, et ainsi de suite jusqu' notre oeil. Cet ultime effet de la danse, notre oeil le peroit sous forme de lumire ou de couleur. Donc, on dit que rien ne se dplace; ce qui danse reste l-haut et se contente d'inciter d'autres particules danser. Ce n'est que la danse qui se propage. La lumire ne contient rien qui nous vienne de l-haut. C'est un peu comme si nous tions en prsence d'une longue file de personnes o la premire frappe la seconde, la seconde la troisime, qui transmet ce mouvement la prochaine, et ainsi de suite. La premire personne ne se dplace pas, ni d'ailleurs les suivantes, mais c'est le geste qui se transmet. C'est de la sorte que l'on explique l'effet de propagation de la danse des atomes. Il existe une brochure rdige avec minutie' et qui traduit parfaitement la mentalit scientifique. On peut y lire que le principe de tout phnomne veut que rien ne puisse jamais occuper un autre endroit de l'espace que le sien; seul le mouvement se propage. Donc, lorsqu'un individu se dplace, une reprsentation errone nous fait croire qu'il transporte sa matrialit dans un autre endroit de l'espace. Il fait un pas en avant, se met en mouvement; ce mouvement se reproduit chaque pas suivant. Voil quoi aboutit une pense rigoureuse! Nous serions tents de conseiller un savant de ce 75
type de ne pas oublier, aprs avoir fait quelques pas dans l'espace, la ncessit de se reproduire. En effet, puisque rien de sa corporit ne s'est propag, il doit bien veiller ne pas oublier de se reproduire, sinon il risquerait de disparatre dans le nant. Cet exemple montre o peut conduire une certaine logique! Mais voil, ce genre de dmarche intellectuelle passe gnralement inaperu. Comment ragit le public? Il se dit: Voil le livre d'un auteur qui, la suite de longues tudes, nous expose des thories et les conclusions auxquelles il est arriv. Un point, c'est tout! Personne ne songe une autre explication. On s'aperoit donc que le soi-disant dilettantisme de l'anthroposophie n'est pas si terrible que cela! Sans doute ceux qui souscrivent la pense scientifique n'ont-ils d'autre choix que de considrer l'anthroposophie comme un dillettantisme. Mais ce qui compte, c'est de savoir que ces gens sont enchevtrs dans des ides de leur propre cru et qu'ils se sont accoutums ce genre de penses. Certes, on peut tre indulgent l'gard de celui dont le raisonnement l'oblige sans cesse se reproduire; il faut nanmoins souligner que sa thorie est une pitre rfrence pour oser qualifier l'anthroposophie de dilettantisme. Soit dit en passant: si l'anthroposophie atteint l'idal qu'elle s'est fix, elle ne tombera jamais dans l'erreur de ne pas essayer d'expliquer les effets par leurs causes et d'examiner si ceux-ci sont absurdes. Il est toujours possible de vrifier les effets engendrs par l'anthroposophie. Les conclusions en tirer sont applicables dans la vie, alors que celles de l'exemple voqu ne le sont pas puisque leur validit ne dpasse pas l'horizon triqu du savant. Ce que nous avons voqu est destin nous 76
rendre attentifs aux erreurs de la pense qui ne sautent pas aux yeux de ceux qui ne sont pas tellement fixs sur ces problmes. Le sentiment d'autorit qui domine aujourd'hui les rapports des savants avec le public est beaucoup trop rpandu. En ralit, cette autorit repose sur des fondements plutt fragiles, alors que l'on souhaiterait pouvoir lui faire confiance. Tout le monde n'a pas la possibilit d'tudier l'histoire des sciences pour y puiser les donnes l'clairant sur la porte des sciences pratiques et de la recherche philosophique. Le rle important accord Helmholtz pour son invention de l'ophtalmoscope, par exemple, est entirement justifi. Toutefois, en tudiant la gense de cette invention, c'est--dire en constatant ce qui existait dj auparavant et comment il a suffi de peu pour tre pouss dans cette direction, on voit que dans ce cas c'est la mthode elle-mme qui a conduit ce rsultat. A vrai dire, on peut trs bien tre un penseur modeste et nanmoins parvenir des dcouvertes sensationnelles lorsque l'on dispose des moyens et des mthodes ncessaires. Il ne s'agit pas ici de critiquer tout ce qui se fait dans ce domaine, mais ce que nous avons dit est tout de mme valable. J'aimerais maintenant vous indiquer, sous un certain angle, comment on en est arriv cette situation. Les motifs sont trs nombreux; il suffit d'en numrer l'un ou l'autre. Au cours de l'histoire de la philosophie, nous pouvons trouver que ce que nous appelons la technique intellectuelle a son origine en Grce. Aristote est le premier reprsentant classique de cette technique qui consiste formuler des ides. Rpondant aux besoins du monde cultiv il a labor un systme qui n'a pas tard tre discrdit: la logique formelle pure. De nos jours on discute ferme pour 77
savoir si la propdeutique philosophique ne doit pas tre bannie des lyces. On estime qu'elle est superflue, que son maintien en tant que discipline autonome ne se justifie pas, et qu'il suffirait de l'intgrer accessoirement dans l'enseignement linguistique. Voil jusqu'o peut conduire l'attitude hautaine adopte l'gard de la technique de la pense. Les fondements de la pense labors par Aristote sont, il est vrai, tellement premptoires qu'ils n'ont gure eu l'occasion d'voluer depuis. Cette technique n'a d'ailleurs pas besoin de progresser. Les ajouts intervenus entretemps tmoignent de l'ignorance qui svit l'gard de la logique. Pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, j'aimerais vous donner une ide de ce qu'est la logique formelle. La logique est la thorie du concept, du jugement et de la conclusion. Voyons d'abord quel est le rapport entre d'une part le concept et d'autre part le jugement et la conclusion. Sur le plan physique, c'est grce aux perceptions que l'homme accde la connaissance. D'abord il rencontre la sensation: ce pourrait tre une impression, par exemple une impression de couleur. Or les objets ne nous apparaissent pas sous la forme d'impressions isoles, mais toujours comme une combinaison d'impressions. Nous n'avons donc jamais affaire une seule sensation mais toujours une combinaison de sensations; c'est cela que nous appelons des perceptions. Lorsque vous vous trouvez devant un objet que vous percevez, vous avez la possibilit de dtourner vos organes de perception; il ne vous reste alors plus que l'image de l'objet. Si vous parvenez conserver cette image, vous n'aurez aucune peine pour la distinguer de l'objet luimme. Regardez ce marteau, vous pouvez le percevoir. Faites demi-tour, et vous n'aurez plus qu'une 78
image du marteau. C'est ce que l'on appelle une reprsentation. Il est trs important de savoir faire la distinction entre une perception et une reprsentation. Tout cela serait somme toute assez facile si l'insuffisance de la technique intellectuelle ne venait pas d'avance compliquer les choses. Admis par de nombreux courants philosophiques, l'axiome selon lequel nous ne disposons de rien d'autre que de nos reprsentations repose pourtant sur une erreur. Car on prtend que la chose en soi n'est pas perceptible. La plupart des gens pensent que derrire leurs perceptions se trouvent ces fameuses molcules en perptuel mouvement de danse. Ce qu'ils peroivent ne serait que l'impression produite sur leur me. Comme, par ailleurs, on nie l'existence de cette me, il est donc assez curieux d'entendre parler d'impressions qui se transmettent l'me, et d'apprendre par la mme occasion que cette me n'est, son tour, compose que d'atomes en train de danser. En analysant tout cela, on se souvient du brave baron de Mnchhausen suspendu en l'air en se tenant par ses propres cheveux. Aucune distinction n'est faite entre une perception et une reprsentation. Si on la ralisait, on ne serait plus tent de commettre une dmarche intellectuelle aussi irrflchie que celle qui consiste dire: Le monde est ma reprsentation,... sans parler de la tentative de comparer la perception la reprsentation et ensuite de considrer que la perception est une reprsentation. On pourrait demander quelqu'un de toucher un fer incandescent et de constater qu'il s'est brl. Ensuite il pourrait comparer la perception avec la reprsentation correspondante et nous dire si cette dernire brle autant que la perception. Il suffit de toujours procder selon un ordre 79
logique pour que les conclusions s'imposent d'ellesmmes. Nous avons donc d'une part la perception lorsque nous sommes face un objet, et d'autre part la reprsentation quand l'objet n'est plus prsent. Dans la sphre des reprsentations il faut encore faire la distinction entre la reprsentation entendue dans l'acception stricte de ce terme et le concept. Le concept du concept est ralisable dans le cas d'un concept mathmatique. Imaginez un instant que vous dessiniez un cercle. Ce n'est pas un cercle au sens mathmatique. Une fois que vous l'avez trac, vous pouvez le regarder et laborer la reprsentation du cercle, certes, mais pas son concept. Pour raliser le concept, il faut penser un point entour d'une multitude de points quidistants du seul point central. Cela donne le concept du cercle. Ce que vous avez dessin et qui est constitu de multiples petites montagnes de craie ne correspond absolument pas la construction intellectuelle que vous venez d'laborer. L'une comme l'autre, les diffrentes montagnettes de craie n'ont jamais la mme distance par rapport au point central. Lorsque nous parlons du concept et de la reprsentation, la diffrence suivante doit tre clairement respecte: la reprsentation est labore partir d'objets extrieurs, alors que le concept procde d'une construction intrieure faite au niveau de l'esprit. Toutefois, d'innombrables ouvrages de psychologie expliquent que le concept rsulte d'un processus d'abstraction partir des choses rencontres dans le monde extrieur. On croit qu'il n'existe autour de nous que des chevaux blancs, noirs, bruns, jaunes et que c'est de cela qu'il faut extraire le concept cheval. Voil comment la logique l'explique: On nglige ce qui est dissemblable, d'abord le blanc, le noir et les autres 80
couleurs, et ainsi de suite pour toutes les autres dissemblances. En fin de compte il reste quelque chose d'assez flou: c'est ce que l'on appelle le concept cheval. A force d'abstraire, dit-on, le concept se forme. Ceux qui se proposent cette dmonstration oublient que de nos jours la nature du concept ne peut tre comprise qu' partir de l'exemple du concept mathmatique. En effet, celui-ci montre ce que l'on construit d'abord au sein de la vie intrieure pour ensuite le redcouvrir au-dehors, dans le monde extrieur. Suivre la trace de plusieurs cercles vert, bleu, grand, petit etc. etc... et en liminer ensuite tout ce qu'ils n'ont pas en commun ne conduit pas au concept du cercle. Cette abstraction n'est pas un concept. Le concept est labor partir de la vie intrieure. Il est une construction intellectuelle. Actuellement, les gens ne sont tout simplement pas assez avancs pour tre capables de construire de cette faon le concept du cheval. Goethe s'tait efforc de raliser ce genre de construction intrieure galement pour les domaines suprieurs de la nature. Il a eu le mrite significatif de chercher s'lever de la reprsentation au concept. Ceux qui sont familiariss avec ce genre de problmes savent que le concept de cheval ne rsulte nullement de l'limination progressive des dissemblances pour ne conserver que le rsidu. Ce n'est pas ainsi que l'on forme un concept; il veut tre labor au niveau de la vie intrieure, comme le concept du cercle, bien que ce soit moins facile dans le cas du cheval. L intervient ce que j'ai voqu hier au sujet du loup qui, tout au long de son existence, se nourrit d'agneaux sans jamais devenir agneau. Lorsque l'on dtient le concept du loup, on a ce qu'Aristote appelle la forme du loup. Peu importe la matire dont il est constitu. 81
Mme s'il ne fait que dvorer des agneaux, il ne se transformera jamais en agneau. Si l'on ne tenait compte que de l'aspect matriel, il devrait, force d'en manger, effectivement se changer en agneau. Il ne le devient pas parce que la seule chose qui compte, c'est la faon d'organiser la matire, et cela est d la forme qui vit en lui. Et cette forme est un concept construit de toutes pices. L'assemblage de concepts ou de reprsentations engendre des jugements. En connectant les reprsentations cheval et noir on forme un jugement. Chaque fois que des concepts sont relis l'un l'autre, nous mettons un jugement. Mais il faut veiller ce que cet acte de former des jugements soit en accord avec la technique formelle applicable aux concepts. On peut l'apprendre. Elle nous enseigne comment relier entre eux des concepts valables, c'est--dire comment former des jugement. Cet enseignement constitue un des chapitres de la logique formelle. Nous verrons par la suite comment ce que j'ai dvelopp en fait partie. La logique formelle enseigne les lois selon lesquelles doit se drouler la dmarche intrieure de la pense; elle est, pourrait-on dire, l'histoire naturelle de la pense et nous permet de formuler des jugements valables, de tirer des conclusions valables. En examinant comment un jugement se fait, force est de constater que la recherche philosophique moderne s'est laisse prendre dans une souricire. Kant qui jouit d'une autorit considrable est l'initiateur de cette dmarche. Ds ses premiers ouvrages il prend le contre-pied de la notion aristotlicienne du jugement. Nous allons voir aujourd'hui comment naissent les erreurs de la pense. Au dbut de la Critique de Kant 43, il est question de jugements analytiques et de jugements synthtiques. Qu'en est-il des 82
premiers, des analytiques? Il s'agit d'associer des concepts en sorte que, dans le concept du sujet le concept du prdicat soit dj prsent et qu'il n'y ait plus qu' l'en dgager. Kant dit: Lorsque je pense le concept corps et que j'ajoute que le corps a un volume, nous sommes en prsence d'un jugement analytique. Car personne ne saurait penser le concept du corps sans y associer la notion de volume. Dans ce cas, nous ne faisons que librer le prdicat contenu dans le sujet. Tout jugement analytique s'obtient donc lorsque nous dgageons, du sujet, le concept du prdicat. Par contre, le jugement synthtique est un jugement o le concept du prdicat n'est pas encore impliqu dans le concept du sujet pour pouvoir en tre simplement dgag. Celui qui pense le concept du corps n'y ajoute pas ncessairement le concept de pesanteur. En consquence, lorsque le concept de pesanteur est ajout celui du corps, nous avons affaire un jugement synthtique. Il s'agit d'un jugement qui n'est pas seulement descriptif, mais qui enrichit la sphre de nos penses. Vous aurez vite fait de comprendre que cette diffrence entre jugements analytiques et jugements synthtiques ne repose sur aucune base logique. Pour que le concept du prdicat soit dj inclus dans le concept du sujet au moment o celui-ci est pens, cela est tout simplement fonction du niveau de nos connaissances. Quelqu'un qui se reprsente un corps, sans penser qu'il est pesant, apporte la preuve que le concept pesanteur applicable un corps lui est inconnu; par contre celui qui par la pense ou par d'autres moyens, a assimil le lien qui existe entre corps et pesant peut se contenter d'extraire de son concept corps l'autre concept qu'il y avait 83
pralablement introduit. La diffrence d'apprciation est donc purement subjective. Des probmes de cet ordre exigent une dmarche rigoureuse. Il s'agit de dtecter les sources d'erreur. Il me semble qu'au moment o l'on conoit que l'acte de dgager un concept d'un autre est de nature subjective, on n'en viendra jamais riger une frontire entre un jugement analytique et un jugement synthtique. On serait alors bien embarrass d'en fournir une dfinition. L'important n'est pas l! Quel est alors le point essentiel? Nous en parlerons tout l'heure. Cette question des deux types de jugements fut voque l'occasion d'un examen o un candidat devait accessoirement tre examin en logique. Dans sa spcialit il tait sr de son affaire, mais en logique il ignorait peu prs tout. Ce qui fut dit alors me semble trs significatif. Avant l'examen il demanda un de ses amis de lui donner quelques renseignements au sujet de cette discipline philosophique. Mais son ami qui prenait cela plus au srieux lui rpondit: Puisque tu ne sais rien, tu serais bien inspir de faire confiance ta bonne toile! Puis vint le jour de l'examen. Tout se passa trs bien dans les disciplines principales, car notre candidat dominait son sujet. Mais en logique il fut incapable de rpondre. Le professeur lui demanda ce qu'il savait du jugement synthtique. Trs embarras, le candidat resta muet. Monsieur le candidat, ne savez-vous vraiment pas ce que c'est? insista le professeur. La rponse fut Non! Excellente rponse, enchana l'examinateur, voyez-vous, cela fait longtemps que l'on cherche savoir de quoi il s'agit, mais on ne sait toujours pas ce qu'est un jugement synthtique. Vous n'auriez pas pu donner de meilleure rponse. Mais, Monsieur le candidat, pouvez-vous alors me dire ce qu'est un juge84
ment analytique? S'tant enhardi, le candidat rpondit avec assurance: Non! Bien, dit le professeur, je vois que vous avez bien assimil ce sujet. Cela fait tellement longtemps que l'on s'efforce de savoir ce qu'est un jugement analytique, sans y tre encore parvenu. Personne ne sait ce que c'est. Excellente rponse! . Ces faits se sont rellement drouls. Sans pouvoir souscrire tous les dtails, l'ensemble me parat trs symptomatique pour caractriser ce qui diffrencie ces deux jugements. En fait, il n'y a entre eux pas la moindre diffrence, tant donn que l'un passe progressivement l'autre. Il nous reste encore expliquer dans quelles conditions on peut dire qu'un jugement est valable et ce que signifie l'expression jugement valable. Il s'agit l d'un sujet trs important. Un jugement n'est d'abord rien d'autre que la connexion de reprsentations ou de concepts. La rose est rouge, est un jugement. Ce qui importe maintenant, c'est de voir si ce jugement juste est galement un jugement valable. Nous devons savoir qu'un jugement exact n'est pas ncessairement un jugement valable. Pour ce dernier, il ne suffit pas d'tablir un rapport entre le concept du sujet et le concept du prdicat. Revenons notre exemple: La rose est rouge constitue un jugement vrai. Qu'il soit galement valable n'est pas vident, car nous pouvons trs bien formuler d'autres jugements vrais qui sont loin d'tres valables. Selon la logique formelle il n'y aurait pas lieu de contester la vrit d'un jugement; il pourrait fort bien tre vrai sans pour autant tre valable. Quelqu'un pourrait, par exemple, laborer la reprsentation d'un tre qui soit moiti cheval, pour un quart baleine et pour le dernier quart chameau. Donnons un nom cet animal et appelons-le Taxou. 85
Personne ne contestera que cet animal soit laid. Le jugement: le Taxou est laid est donc vrai et peut tre prononc en accord avec toutes les rgles rgissant la vrit, car le Taxou (mi-cheval, quart de baleine, quart de chameau) est effectivement laid. Le jugement la rose est rouge tant vrai, celui-ci l'est galement. Mais voil, un jugement vrai n'est pas ncessairement un jugement valable. Que faut-il en plus pour qu'il soit valable? Le jugement vrai doit se prter la transformation. Un jugement vrai ne devient valable que si on peut affirmer: Cette rose rouge est, c'est--dire, quand le prdicat peut tre rinsr dans le sujet, quand le jugement vrai peut tre transform en un jugement existentiel. Dans ce cas le jugement est valable: Cette rose rouge est. Il n'existe pas de solution autre que celle de rinsrer le concept du prdicat dans le concept du sujet. Dans ce cas, ce jugement est valable. Le Taxou est laid ne peut devenir un jugement valable, puisque nous ne pouvons pas dire: Un Taxou laid est ou existe. Ce genre d'examen permet de voir si un jugement peut tre prononc; vous voyez maintenant comment on procde pour tablir la preuve. La vrification se fait en examinant s'il est possible de transformer le jugement. Nous avons donc dcouvert un aspect trs important qui mrite d'tre retenu: en logique, la seule connexion de concepts en vue d'aboutir un jugement vrai ne suffit pas pour servir de rgle au monde rel. Autre chose doit s'y ajouter. Pour qu'un concept, un jugement et mme une conclusion soit valable, un autre lment est ncessaire. Une conclusion rsulte de la connexion de jugements". La conclusion la plus simple peut tre formu86
le de la faon suivante: Tous les hommes sont mortels Socrate est un homme donc, Socrate est mortel. La majeure est: Tout homme est mortel, la mineure: Socrate est un homme, et le raisonnement dductif dit: Socrate est mortel. Ce raisonnement est form selon la premire figure o le sujet est reli au prdicat par le moyen terme. Ici, le moyen terme s'appelle homme, le prdicat mortel, et le sujet Socrate. Pour les relier, on utilise le mme moyen terme. On obtient alors la conclusion: Socrate est mortel. Ce raisonnement est construit selon des rgles trs strictes qu'il n'est pas permis de modifier. Ds que l'on intervertit quoi que ce soit, on aboutit un raisonnement impossible. Une telle modification ne conduit en aucun cas une conclusion valable. Cela ne fonctionne pas. Cette carence met en vidence le fait que la pense est tributaire de certaines rgles. Lorsque nous disons par exemple: Le portrait est une image de l'homme, la photographie est une image de l'homme, nous ne pouvons pas conclure: donc la photographie est un portrait. Lorsque les concepts sont disposs en un ordre qui ne respecte pas les rgles en vigueur, il est impossible d'aboutir une conclusion juste. Vous voyez donc qu'il existe une dmarche formelle des concepts et des jugements, et que la pense est rgie par des rgles trs prcises. Mais cette dmarche faite de concepts purs ne nous mne jamais la ralit. Dans le cas des jugements, nous avons vu qu'il faut d'abord transformer le jugement vrai en jugement valable. Dans le cas de la conclusion essayons de voir d'une autre faon qui la seule conclusion formelle ne conduit pas la ralit. En effet, une conclusion peut satisfaire toutes les rgles formelles et nanmoins ne pas tre valable, c'est--dire ne pas 87
s'appliquer la ralit. L'vidence de ce paralogisme apparat dans l'exemple suivant. Un Crtois dit: Tous les Crtois sont des menteurs. Admettons qu'il le dise. On peut alors procder en accord avec les figures de la logique et nanmoins aboutir une impossibilit. Si, aprs que le Crtois a dit cela, on lui applique la majeure, il doit avoir menti, et ce qu'il a dit ne peut pas tre vrai. Pourquoi cette impossibilit? Parce que nous appliquons la conclusion nous-mmes, parce que nous faisons concider l'objet avec les conclusions purement formelles. Or, ceci n'est pas permis. Lorsque la dmarche formelle de la pense s'applique nous-mmes, le pur formalisme de la pense se dtruit. Cela n'est pas admissible. L'exactitude de la pense est alatoire quand on applique soi-mme les penses que l'on a labores. Voici encore un exemple qui peut servir de dmonstration: Entre un professeur de droit et son lve fut convenu que ce dernier lui verserait une certaine somme au titre d'honoraires, une partie immdiatement et le solde lorsqu'il aurait gagn son premier procs. C'est ce qui avait t entendu. Par la suite l'lve ne voulut pas s'acquitter de sa dette. Son professeur lui dit alors: Quoi qu'il en soit, tu devras me payer mes honoraires. L'tudiant rpondit: En aucun cas je ne payerai. Pour parvenir ses fins il veut intenter son professeur un procs au sujet des honoraires. Son professeur lui explique alors que dans ce cas il serait coup sr oblig de payer: Ou les juges te condamnent payer, et tu devras t'excuter, ou ils dcident que tu ne dois pas payer, et dans ce cas tu devras payer puisque tu auras gagn ton procs. Le candidat rpond qu'il ne payera jamais: Si je gagne le procs, les juges me dispensent de payer, et si je le perds, j'aurai perdu mon premier procs et comme convenu je n'aurai 88
alors rien payer. Du fait que toute cette histoire concerne le sujet lui-mme, la construction formelle tout fait exacte, ne mne pas une solution valable. Dans ce genre d'affaires, la logique formelle est inefficace. La conclusion juste n'a rien voir avec la conclusion valable. C'est prcisment Kant qui commit l'erreur de ne pas faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est valable, et cela parce qu'il voulut tablir la preuve ontologique, prouver que Dieu existe. Il proposa peu de chose prs le raisonnement suivant: Lorsque nous nous reprsentons l'tre le plus parfait, il manquera toujours sa perfection une qualit: celle d'exister. Il n'est pas possible de se reprsenter l'tre le plus parfait sans lui attribuer une existence. Donc cet tre est. Kant dit: Cela est faux, car la qualit d'exister que l'on attribue une chose ne constitue pas une qualit supplmentaire. Il ajoute: Cent deniers possibles, des deniers simplement imagins, ne valent pas un sou de plus ou de moins que cent deniers rels. Et pourtant, les deux situations sont trs dissemblables cause prcisment de la notion d'existence! Il tire la conclusion: Donc, d'un concept pur, on ne saurait dduire l'existence. Car, pense-t-il, on peut possder autant de deniers imaginaires que l'on veut, ils n'auront jamais d'existence. De mme pour la preuve de Dieu: il n'est pas permis d'extraire de la pense, par un raisonnement dductif, le concept d'existence. C'est ce qu'oublient ceux qui appliquent indistinctement l'un ou l'autre les principes de la logique formelle. En effet, le denier ne se prte qu' la perception sensorielle, alors que Dieu est perceptible l'intrieur seulement; celui-ci n'a donc rien voir avec les 89
donnes perceptibles du monde extrieur. Si les hommes pouvaient convenir de rgler leurs comptes avec des deniers imaginaires, ils n'auraient pas besoin de distinguer entre deniers rels et deniers imaginaires. De mme, si en penses on pouvait attribuer une chose du monde sensible son existence, le jugement serait galement valable pour cette chose physique. Mais il ne faut jamais oublier qu'un jugement juste n'est pas ncessairement un jugement valable et que, pour l'tre d'autres conditions doivent encore tre remplies. Nous venons d'examiner quelques aspects de la philosophie. Cela n'a sans doute fait de mal personne, mais nous a permis de pressentir que l'autorit dont jouissent les savants n'est gure justifie et qu'il n'y a pas lieu de s'mouvoir si d'aucuns traitent l'anthroposophie de dilettantisme. En effet, ce que ces autorits sont en mesure de dire lorsque, partant de faits rels, elles veulent conclure une possible existence du monde spirituel est trs peu convaincant. J'ai voulu vous montrer aujourd'hui, d'abord quel point leur pense est vulnrable, et ensuite qu'il existe une authentique science de la pense. Malheureusement, j'ai d me limiter une simple esquisse. Nous pourrons reprendre ce sujet une prochaine occasion, mais vous devez vous attendre ce que ce genre d'tude ne soit pas tellement passionnant.
VI LOGIQUE FORMELLE (Logique I) Berlin, 20 octobre 1908
Nous parlerons aujourd'hui de quelques aspects lmentaires dans le cadre de ce qu'on appelle la logique formelle. Bien qu'il s'agisse de problmes relativement simples qui viennent s'intercaler dans nos considrations consacres aux mondes suprieurs, il n'est pas inutile de nous intresser ce chapitre de la philosophie. Cette confrence n'apportera rien qui puisse directement nous aider pntrer dans les mondes suprieurs. Des considrations d'ordre logique n'en sont pas capables, pas plus d'ailleurs que la logique formelle n'est en mesure d'enrichir nos expriences dans le domaine du sensible. Quelqu'un qui n'a encore jamais vu une baleine ne peut pas se faire donner la preuve qu'elle existe. Pour s'en convaincre, il doit lui-mme pouvoir l'observer. Mais la connaissance des disciplines limitrophes peut tre utile la thosophie, au mme titre, par exemple, que la logique rendit service aux scolastiques. La philosophie mdivale, dsigne non sans une pointe de ddain par le terme scolastique, ne voyait nullement dans la logique une discipline autonome, mais la considrait comme faisant partie des diffrentes branches de la philosophie. N'ignorant pas que la logique tait tout fait incapable d'enrichir l'exprience, les scolastiques la considrrent nanmoins comme un instrument utile pour dfendre leurs thses. Puisse-t-elle servir d'instrument galement pour notre cause! 91
90
On distingue entre la logique matrielle et la logique formelle. La logique ne saurait s'appliquer au domaine matriel, ce qui a un contenu. Par contre; elle s'intresse la forme de penser, l'ordonnance des penses, leur justesse. Il est certain que, dans le pass, la logique jouissait d'un meilleur renom que maintenant. Dans les lyces classiques de jadis, on cultivait la propdeutique philosophique, la logique et la psychologie. Cet enseignement avait pour but d'habituer les lves une pense ordonne et discipline. Aujourd'hui, on s'efforce d'liminer cet enseignement de base et de le rattacher l'tude linguistique. On estime qu'il est inutile de rserver la pense un secteur spcial, puisqu'il s'agit d'une facult inne l'homme et d'ailleurs suffisamment entretenue au sein des autres branches de l'enseignement. Cette situation justifie donc que nous nous interrogions maintenant au sujet du rle qui incombe la logique. Les fondements de la logique formelle remontent Aristote. Ce qu'il a fait en faveur de cette discipline n'a jamais t contest. Mme Kant affirme que depuis Aristote la logique formelle n'a gure progress. Des philosophes plus rcents ont tent de complter son enseignement. Ne cherchons pas savoir si, oui ou non, leurs ajouts taient ncessaires et justifis. Ce qui ,doit nous intresser maintenant, c'est de mesurer la porte de la logique. On reproche souvent aux anthroposophes leur manque de logique. Cela s'explique frquemment par le fait que l'auteur d'une telle critique ignore tout de la pense logique et des lois qui la rgissent. La logique est la thorie des connexions vraies et harmonieuses de nos concepts. Elle fournit les rgles selon lesquelles nous devons conduire nos penses pour que 92
notre vie intrieure soit un miroir juste, capable de vritablement reflter la ralit. Nous devons en premier lieu prciser ce qu'est un concept. Les gens ont gnralement des ides trs peu claires ce sujet. Cela est d la faon superficielle avec laquelle les rudits considrent la logique. Lorsque nous rencontrons un objet, nous avons d'abord faire des sensations. Nous remarquons une couleur, un got ou une odeur. Ce qui se droule ainsi entre l'individu et l'objet, nous devons, sous cette forme premire, le considrer comme une sensation. En affirmant: il fait chaud, ou froid, etc. etc..., nous exprimons une sensation. Or, dans la vie courante, cette sensation pure n'existe pas. Une rose rouge ne nous rvle pas seulement la couleur rouge. Tout change qui s'tablit entre nous et les objets nous communique chaque fois un groupe de sensations. La connexion des sensations rouge, odeur, volume, forme, c'est cela que nous nommons la rose. A vrai dire, nous n'avons jamais de sensations isoles, mais toujours des groupes de sensations. Pour dsigner un tel ensemble, la logique formelle utilise le terme de perception. La perception et la sensation sont donc deux choses trs diffrentes. La perception est ce que nous rencontrons en premier. Pour accder aux sensations il faut la dcomposer. Mais le contenu de l'me ne se limite pas ces seuls aspects. Imaginons que nous nous dtournions de la rose. Il nous reste dans l'me la couleur rouge, le parfum, le volume etc... Et c'est ce ple rsidu qui constitue notre reprsentation. Nous voici donc en possession d'une dfinition prcise de ce que sont la perception, la sensation et la reprsentation. Toute reprsentation contient dj 93
la notion de souvenir, bien que d'une faon souvent trs cache. La reprsentation est une image, un souvenir de la perception. Il nous reste encore prciser ce qu'est un concept. Nous obtenons une reprsentation quand nous nous soumettons aux impressions du monde extrieur. De cette exprience nous conservons en nous une image, c'est--dire une reprsentation. Au cours de leur existence, la plupart des gens ne dpassent gure le stade de la reprsentation et n'avancent pas jusqu'au concept. Qu'est-ce qu'un concept? La meilleure faon de rpondre cette question consiste tudier un exemple tir des mathmatiques. Prenons le cas du cercle. Supposons que nous nous embarquions en mer jusqu' ce que nous ne puissions plus rien voir d'autre que l'eau; l'horizon nous offre alors la perception d'un cercle. Si nous fermons les yeux, cette perception du cercle demeure en nous sous forme d'une image dont nous nous souvenons. Toutefois, en procdant de la sorte, nous n'accderons jamais au concept du cercle. Pour y parvenir nous devons construire en esprit une figure o tous les points sont quidistants d'un point central. Mais ce point doit rester une donne purement intellectuelle, nous devons le penser sans jamais nous aider d'un dessin. C'est ainsi qu'en esprit se construit une image. La craie nous permet d'illustrer au tableau noir cette image spirituelle. Tandis que nous contemplons cette image de notre construction purement intrieure, nous pouvons aprs coup faire cette constatation curieuse: Nous nous rendons compte que la perception de l'horizon dans le monde extrieur concide avec le concept que nous avons construit l'intrieur. Un tre qui pense rellement, dans l'acception stricte et logique de ce terme 94
de penser fait autre chose que simplement aligner des reprsentations. La reprsentation consiste se souvenir de la perception du monde extrieur, la replacer dans le prsent. Dans le cas de l'activit pensante, par contre, chaque pense doit tre labore en nous, doit tre construite selon le schma dcrit pour la construction du cercle. Cette construction intellectuelle peut ensuite tre confronte avec le monde extrieur afin de voir s'il y a concidence. La vraie pense n'a jamais t autre chose qu'une construction intrieure. C'est ainsi que procda Kepler pour laborer ses lois. D'abord il les construisit, ensuite il se les fit confirmer par la ralit extrieure. Un concept n'est donc rien d'autre qu'une construction dont l'origine et la gense procdent de l'activit pensante. Toute illustration extrieure n'est qu'un moyen auxiliaire, un support permettant de se reprsenter le concept. Ce dernier ne se manifeste d'abord que dans la pure vie intrieure. Dans le domaine de la pense conceptuelle notre culture intellectuelle n'a pas encore russi merger du stade mathmatique. Aux yeux de l'investigateur spirituel il est parfois grotesque de constater que les hommes ne parviennent pas dpasser le domaine de la reprsentation. Pour eux, le concept est gnralement conu comme une reprsentation, mais une reprsentation plus ple et moins substantielle. Ils imaginent que l'on peut passer de la perception d'un cheval, au concept correspondant en liminant tout ce qui est dissemblable pour ne conserver que les caractristiques communes. Or, cette dmarche aboutit seulement une reprsentation abstraite, mais jamais, dans le sens strict du terme, au concept du cheval. De mme, pour parvenir au concept du triangle il ne suffit pas de 95
prendre toutes les variantes de triangle et d'en liminer les dissemblances. Le seul moyen de trouver ce concept consiste laborer l'intrieur une figure faite de trois lignes qui se croisent. Dans le domaine des mathmatiques l'individu moderne est capable d'accder des concepts. On peut, par exemple, prouver par une construction intrieure que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrs. Mais ds que quelqu'un commence construire intrieurement des concepts relatifs d'autres sujets, bon nombre de philosophes manifestent leur rprobation. Goethe a cr de cette manire la plante originelle et l'animal originel. Il ne s'est pas content d'liminer le dissemblable pour ne retenir que le commun, comme dans notre exemple du cheval. Non, la plante originelle et l'animal originel sont effectivement de pures constructions intrieures, spirituelles. Rares sont ceux qui admettent cela. Pour raliser le concept du cheval il faut procder comme pour le triangle et recourir une construction intrieure. A l'vidence, les gens ignorent de quoi il s'agit quand il est question de la pense conceptuelle. Voyons le cas de concepts qui n'ont rien de mathmatique ni d'organique; ces derniers sont surtout le fait de l'inspiration gniale de Goethe. Le concept de vertu doit pouvoir natre d'une activit purement intrieure de l'me. Il doit tre construit en nous partir de certains concepts, par exemple, celui de la personnalit, ou de l'individualit, etc... Les philosophes qui ont trait de l'thique se sont de tous temps efforcs de produire un concept de la vertu qui ne soit pas tir du domaine du sensible. Bien entendu, cela ne va pas sans efforts, mais n'est pas moins possible que la construction de concepts mathmatiques. Rcem96
ment quelqu'un qui se faisait passer pour un philosophe a voulu rfuter cette notion d'une vie conceptuelle purement intrieure. Il a affirm que chaque fois que surgissait en lui la notion de vertu il devait penser une belle femme. Comme il tait incapable d'laborer des concepts, il contestait aux autres le droit d'en avoir. En fait, il ne s'tait tout simplement jamais donn la peine d'approfondir srieusement cette question. Etudiez l'Ethique de Herbart, et vous verrez que les concepts bienveillance et libert, par exemple, sont des notions morales qui ne rsultent nullement d'un processus liminatoire des dissemblances. Bien au contraire, il dit que la bienveillance est l'enlacement des impulsions volitives d'une personne par les impressions volitives d'une autre personne. Herbart fournit donc des dfinitions purement conceptuelles. En fait, l'thique peut parfaitement tre construite exclusivement au moyen de concepts purs, comme les mathmatiques, l'image d'ailleurs de ce que Goethe a tent de faire dans le domaine de l'organique. En se consacrant ce travail de constructions intrieures, on russit peu peu se forger des concepts. Il faut galement se souvenir que c'est au concept que nous devons la possibilit de surmonter l'aspect naf propre la vie des reprsentations. Essayons de suivre comment se droulent chez l'homme la dmarche purement reprsentative et la dmarche purement conceptuelle. Il n'est pas besoin de rappeler que la reprsentation d'un triangle concerne toujours tel ou tel triangle en particulier. Voyons maintenant comment s'opre la connexion entre d'une part les reprsentations, et d'autre part les concepts purs. Qu'est-ce qui rgle notre vie reprsentative? Lorsque nous 97
avons la reprsentaion d'une rose, il est possible que surgisse spontanment la reprsentation d'une personne qui nous a offert la rose. A cela peut ventuellement s'associer la reprsentation d'une robe bleue que portait cette personne, et ainsi de suite. On appelle cela une association de reprsentations. Mais ce n'est l qu'une des faons possibles de connecter entre elles les reprsentations. La forme la plus pure de ce processus apparait l o l'individu s'abandonne entirement la vie reprsentative. Mais il existe encore d'autres rgles permettant d'associer des reprsentations. Prenons l'exemple suivant: un jeune homme est install sous un arbre dans la fort. Quelqu'un passe et admire le bois. Bonjour charpentier, dit le jeune homme veill. Un autre personnage passe et examine l'corce. Bonjour tanneur, dit le jeune homme veill. Puis arrive encore quelqu'un qui admire la prestance de l'arbre. Je salue l'artiste-peintre, dit notre jeune homme. Dans le cas prsent, toutes les reprsentations font rfrence l'arbre, mais pour chacun de ces trois personnages surgissent des reprsentations diffrentes. Cela s'explique par le fait que tout individu assemble telles ou telles reprsentations en fonction de critres internes et ne se dtermine pas seulement d'aprs l'aspect extrieur des choses. Ici, l'homme laisse agir la force qui surgit au-dedans de lui-mme. On dit dans ce cas que ce sont les aperceptions qui agissent en lui. L'aperception et l'association sont les forces qui connectent les reprsentations dans le cadre de la vie exclusivement reprsentative. La vie des concepts se prsente tout autrement. O en arriverait-on si les concepts taient tributaires de la seule aperception du sujet et de l'association accidentelle? Ici, l'individu doit s'astreindre suivre des 98
rgles trs strictes qui demeurent indpendantes de l'association des reprsentations et de l'aperception du sujet. La seule relation extrieure des concepts nous donne la logique formelle. En l'absence de telles rgles extrieures applicables aux concepts, la logique formelle n'existe pas. Voyons maintenant comment s'associent deux concepts. Nous tablissons un rapport entre le concept du cheval et celui du galop lorsque nous disons: le cheval galope. Une telle relation s'appelle un jugement. Ce qui compte, c'est de raliser les connexions de telle sorte qu'elles ne conduisent qu' des jugements vrais. Le rapport se fait ici entre deux concepts, indpendamment de toute association et aperception. Lorsque deux concepts sont connects conformment leur contenu, nous obtenons un jugement. Une association n'est pas un jugement, sinon on pourrait associer, par exemple taureau et cheval. Il existe encore des rapports beaucoup plus complexes. En connectant un jugement un autre jugement, on obtient une conclusion. Il existe ce sujet un exemple clbre. Tout homme est mortel. Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel. Il s'agit l d'une conclusion o un troisime jugement rsulte des deux prcdents. Cet exemple conduit au schma gnral suivant. Si Socrate est le sujet, et mortel le prdicat, le jugement Socrate est mortel nous donne: S = P. Ce schma permet de construire d'innombrables jugements. Mais pour parvenir une conclusion un autre concept est encore indispensable, le moyen-terme M, dans notre exemple homme. Il en rsulte donc la formule suivante pour la conclusion: 99
M = P Tout homme est mortel S = M Socrate est un homme S = P Donc Socrate est mortel
Mais attention, ici aucune inversion n'est permise. Pour que la conclusion soit juste, la connexion des concepts doit obligatoirement se faire selon le schma indiqu. Nous pourrions, par exemple, aligner les jugements suivants: Le portrait ressemble l'homme. Le portrait est un chef-d'oeuvre. Mais nous n'avons pas le droit de conclure: donc le chefd'oeuvre ressemble l'homme: O serait dans ce cas l'erreur? Nous aboutirions au schma suivant:
M = P Le portrait ressemble l'homme M = S Le portrait est un chef-d'uvre mais S n'est pas gal P: Le chef-d'oeuvre ne ressemble pas l'homme.
Il existe donc des lois inhrentes la pense, en quelque sorte une arithmtique de la pense. Nous pouvons maintenant dresser le tableau idal de la pense vraie: tous les concepts doivent tre forms selon les lois de la logique formelle. Mais celle-ci a certaines limites. La vie intellectuelle de l'individu doit respecter ces contraintes. Cela permet d'approfondir le problme, par exemple, en dcouvrant ce qu'est un paralogisme. En accord avec les rgles de la logique, il serait exact de dire:
Tous les Crtois sont menteurs Celui-ci est un Crtois Donc il est un menteur, donc M=P S=M S=P
Ici, nous avons invers le schma gnral. Ce qui compte, prcisment, c'est la forme du schma, la faon dont sont tablis les rapports. Le premier type de raisonnement est juste, le second est faux. Quels que soient les rapports que nous tablissons par ailleurs entre les concepts que nous pensons, pour tre vraie la relation doit ici tre en accord avec la premire formule. Voyons maintenant comment dcouvrir les rgles qui rgissent ces rapports et permettent d'tablir un certain nombre de figures. Pour tre vraie, la pense doit se drouler en accord avec certaines figures trs prcises, sinon cette pense est fausse. Mais les choses ne sont pas toujours aussi faciles que dans le cas de l'exemple cit. Le simple fait qu'un auteur, si rudit soit-il, ne respecte pas ces figures permet de savoir que ses propos ne peuvent pas tre exacts. 100
De tous temps les logiciens se sont rendus compte que cette dmarche s'applique valablement tous les cas, sauf quand c'est un Crtois lui-mme qui le dit. Dans ce cas cela est coup sr faux puisqu'il dit la vrit. Il en est peu prs de mme pour tous les paralogismes, entre autre pour l'exemple clbre du crocodile: Une Egyptienne voit son enfant tomber dans le Nil et se faire happer par un crocodile. Donnant suite aux supplications de la mre, le crocodile promet de lui rendre son enfant si elle devine ce que va faire l'animal. La mre dit alors: Tu ne me rendras pas mon enfant. Le crocodile rpond: Que tu aies dit juste ou faux, dans les deux cas je n'ai pas te rendre ton enfant, car si tes propos sont vrais, conformment ce que tu viens de dire je ne te le rendrai pas. Et si tes propos sont faux, je n'ai pas te le restituer, comme cela a t convenu. La mre rpond alors: Que j'aie dit juste ou faux, tu es oblig de me rendre mon enfant. Car si j'ai dit vrai, tu dois me le rendre comme cela avait t convenu; et si mes propos sont 101
faux, le contraire doit tre vrai. Donc, tu vas me rendre mon enfant. Une situation semblable nous est donne avec la conclusion concernant un professeur et son lve. Le professeur a enseign le droit son tudiant. Il est convenu que la seconde moiti des honoraires ne sera chue que s'il gagne son premier procs. Aprs avoir termin ses tudes, le jeune juriste diffre quelque peu ses dbuts professionnels, mais aussi le rglement des honoraires. Finalement son professeur lui intente un procs et lui dit: Jeune homme, sachez que de toute manire vous serez oblig de me payer. Car si je gagne le procs, le rglement vous sera impos par dcision du tribunal, et si c'est vous qui gagnez le procs, vous aurez vous excuter conformment notre convention qui stipule que la somme est chue si vous gagnez votre premier procs. L'lve rpond: Sage matre! En aucun cas je n'aurai payer. Car si les juges se prononcent en ma faveur, je n'aurai rien rgler, conformment au jugement du tribunal, s'il se prononce en ma dfaveur, je n'aurai rien payer, comme le stipule notre convention. Il existe d'innombrables paralogismes qui, au point de vue formel, sont irrprochables. Cela s'explique par le fait que la logique s'applique tout, sauf soi-mme. Ds que le contenu concerne le sujet luimme la logique formelle est inapplicable. Cela est le reflet d'un autre problme: celui qui se pose lorsque nous passons des trois enveloppes humaines au Moi. L aussi, tout change. C'est pourquoi il est impossible de compter sur la logique pour faire des expriences; la logique permet seulement de mettre de l'ordre dans les expriences. 102
VII JUGEMENTS ANALYTIQUES ET JUGEMENTS SYNTHTIQUES (Logique II) Berlin, 28 octobre 1908 Le peu de temps dont nous disposons ne nous permet pas d'tudier fond le thme de la logique, comme nous le souhaiterions. Pour puiser ce sujet, il faudrait envisager toute une srie de confrences. Vous voudrez donc considrer l'expos de ce jour comme une simple esquisse. Je n'ai d'ailleurs pas l'intention de prsenter des dveloppements sytmatiques. J'aimerais simplement voquer quelques-unes des vrits lmentaires concernant la logique pour vous permettre de vous familiariser avec des notions susceptibles de vous rendre service. Nous avons dj labor la notion de concept, entendu ce qu'est un jugement et vu comment nat une conclusion. Nous avons voqu l'existence de certaines lois inhrentes la technique intellectuelle. Elles prcisent comment utiliser les jugements pour aboutir des conclusions justes. Nous avons prsent une figure de raisonnement dductif dans sa forme premire et choisi cet effet l'exemple suivant: Tout homme est mortel. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ce jugement comporte une majeure: Tout homme est mortel, et une mineure: Socrate est un homme! Il s'agit maintenant de conclure un nouveau jugement tout en respectant les lois propres ces deux jugements: Donc 103
Socrate est mortel. Cette dernire proposition s'appelle la conclusion. A l'origine nous disposons de deux propositions. Elles sont donnes. Nous savons ce qu'elles expriment. De ce qui est ainsi connu il s'agit maintenant d'liminer deux concepts. Le sujet de la majeure tait: Tout homme, le prdicat: mortel. Dans la mineure le sujet tait: Socrate, et le prdicat: homme. Dans la conclusion les deux concepts contenus dans chacune des deux propositions doivent tre limins, c'est--dire le concept homme. La conclusion est tributaire de l'endroit o le moyen terme homme est place dans la majeure et la mineure. Nous avions le schma: M = P; S = M; S = P. La possibilit de formuler de cette manire la conclusion dpend de la rpartition des concepts au sein de la majeure. Si cet ordre tait diffrent, nous n'aurions pas le droit de conclure comme nous l'avons fait dans l'exemple de la photographie voqu l'autre jour. Cela s'explique par le fait que dans les deux cas les concepts ne sont pas relis de la mme faon. Une fois M doit tre au dbut et l'autre fois la fin de la proposition; cette condition il est permis de tirer la conclusion nonce. La logique est donc un art formel d'laboration des concepts parce que la localisation de ceux-ci indique dj comment parvenir une conclusion. La faon dont les concepts doivent tre connects dpend d'une loi qui s'impose nous. Nous pouvons dire d'autre part que la logique formelle embrasse le systme des concepts, des jugements et des conclusions. Voyons maintenant quelques aspects relatifs aux jugements. A leur sujet on peut dicter certaines rgles. Pour que les lois concernant la conclusion 104
deviennent comprhensibles les propositions qui rgissent les concepts et les jugements doivent tre acquises. Examinons de plus prs les lois relatives aux jugements et aux concepts. Commenons par la loi des concepts. Le concept lion peut tre compar avec le concept mammifre. Nous sommes en mesure d'laborer chacun d'eux. En quoi diffrent-ils l'un de l'autre? Envisagez un instant tout ce qu'embrasse le concept mammifre. Aucun doute qu'il est bien plus vaste que le concept lion, lequel englobe un nombre beaucoup plus restreint de caractristiques. Il ne nous offre qu'un extrait limit de ce que contient le concept mammifre. Ce qui diffrencie les concepts, c'est prcisment le fait que certains ont une signification plus gnrale et que d'autres sont d'une porte plus limite. On dit alors: les concepts se distinguent par leur tendue. Mais il existe encore une autre distinction. Pour dterminer le concept lion, il faut tenir compte d'une multitude de donnes et de nombreux signes distinctifs. Tout ce qui est nonc pour parvenir ce concept se rsume dans ce qu'on a coutume d'appeler le contenu du concept. Le concept mammifre comprend beaucoup moins de particularits que le concept lion. En rassemblant sous un mme concept tous les animaux ayant une mme couleur de fourrure, nous aboutirions une impasse. Pour formuler le concept mammifre, vous devez choisir le plus petit nombre de signes distinctifs, donc opter pour un contenu faible, par exemple la seule particularit de mettre bas des petits et de les allaiter. Le concept mammifre possde donc un contenu restreint mais une porte trs vaste; l'inverse est vrai pour le concept lion. Il existe donc des concepts d'un contenu tendu et 105
d'autres d'un contenu restreint, ainsi que d'une porte vaste ou d'une porte limite. Plus l'tendue d'un concept est grande, plus son contenu est faible. Plus le contenu est grand, plus l'tendue est restreinte. C'est ainsi que les concepts se distinguent selon leur contenu et leur tendue. Examinons maintenant de faon analogue les jugements. Lorsque vous prononcez le jugement: Tout homme est mortel, vous dtenez un jugement qui diffre de cet autre jugement: Le crocodile n'est pas un mammifre. O se situe la diffrence? Dans un cas le jugement est affirmatif, les concepts sont assembls de telle sorte qu'ils puissent s'accorder. Dans le second cas, les concepts ne s'accordent pas ils s'excluent. Nous avons affaire un jugement ngatif. Nous pouvons donc discerner des jugements affirmatifs et des jugements ngatifs. Il existe encore d'autres types de distinction concernant les jugements. Tout homme est mortel, ce jugement indique autre chose que le jugement Quelques fleurs sont rouges. Dans le premier cas la qualification est valable pour la totalit du sujet, alors qu'il n'en est pas de mme dans le second cas. Ce dernier est un jugement particulier, par opposition au premier qui est un jugement gnral. On parle alors de jugements particuliers et de jugements universels. D'autres types de jugements sont encore envisageables. Un jugement peut parfaitement s'accorder au modle Tout homme est mortel, ou alors il peut tre formul de la faon suivante: Quand le soleil rayonne il fait jour. Dans le premier cas le concept du sujet et celui du prdicat sont ncessairement en accord, alors que cela n'est que conditionnel, n'est pas obligatoirement le cas dans le second. Il existe 106
donc des jugements absolus et des jugements hypothtiques ou conditionnels. On pourrait encore citer de nombreux autres traits caractristiques du jugement. Mais notre propos se rsume montrer qu'il n'est pas inutile d'en tre averti. L'importance de ces distinctions devient vidente ds que nous nous penchons sur la notion de conclusion. Dans le cas d'une conclusion faite selon la premire figure: Tout homme est mortel Socrate est un homme Donc Socrate est mortel, nous constatons que la majeure contient un jugement universel, la mineure un jugement singulier parce qu'elle ne s'applique qu' une seule personne, Socrate. Nous sommes en prsence d'une forme secondaire d'un jugement particulier. Cette disposition des jugements est permise. Elle conduit un jugement juste. Voyons quoi conduirait une autre disposition. Attribuons, par exemple, la majeure un caractre particulier: Quelques femmes portent des vtements rouges. Ceci est une femme. Dans ce cas je n'ai pas le droit de conclure: Donc cette femme porte un vtement rouge. Cela n'est pas permis, bien que la conclusion soit exacte. Car il est interdit de tirer cette conclusion ds lors que la majeure est faite d'un jugement particulier. Pour que cette conclusion puisse tre juste, la majeure devrait comporter un jugement universel. Ceci permet d'dicter certaines rgles bien prcises. Nous pouvons voquer encore d'autres proprits conduisant diffrencier les jugements. Nous avons dit qu'un jugement peut tre affirmatif ou ngatif. Prenons le second cas suivant: Le crocodile n'est pas un mammifre, Cet animal est un crocodile. Dans ce cas on peut conclure: Donc cet animal n'est pas un mammifre. La majeure peut donc tre soit affirmative, soit ngative. 107
Il existe donc une certaine technique de la pense qui est tout fait indpendante du contenu. En observant une certaine forme de l'acte de penser nous pensons correctement, et dans un autre cas notre pense est fausse. Nous devons donc nous conformer cette technique intellectuelle, ces lois de la pense. Kant nous a lgu sa clbre classification: les jugements analytiques et les jugements synthtiques". Il n'est pas rare d'tre confront avec une telle classification. Quelle est ici la distinction voulue par Kant? Dans un jugement analytique le sujet contient dj le prdicat. Dans un jugement synthtique le sujet ne contient pas ncessairement le prdicat. Un corps est tendu, est un jugement analytique parce que le concept corps implique dj le concept tendu. Etendu n'est qu'un signe caractristique du concept corps. Dans le cas d'un jugement synthtique le sujet ne contient pas encore le prdicat. Le corps est lourd, est selon Kant un jugement synthtique. En effet, il suppose que le concept lourd est associ celui de corps par des mobiles qui lui sont extrieurs puisqu'ils sont imputables la loi d'attraction. Dans le cas du jugement synthtique le rapport entre les concepts est moins strict. La distinction faite entre jugements analytiques et jugements synthtiques a souvent donn lieu des interprtations excessives. Il m'a toujours sembl que la meilleure lumire faite sur ce problme nous vient d'un incident survenu en cours d'examen dans une universit allemande. La veille de l'preuve, un tudiant qui allait tre examin vint trouver un de ses amis pour lui demander de l'initier rapidement aux concepts usuels en logique. Mais ce dernier, conscient de la strilit d'une telle entreprise lui conseilla vive108
ment de s'en remettre sa bonne toile pour affronter ses examinateurs. Le lendemain notre tudiant eut rpondre la question suivante: Pouvez-vous nous dire ce qu'est un jugement analytique? D'un ton rsign il rpondit : Non! Et au professeur d'enchaner: Voil une bonne rponse; pour ma part, je ne serais pas plus capable de le dire. Mais vous pouvez peut-tre m'expliquer ce qu'est un jugement synthtique? Devenu un peu plus tmraire, l'tudiant rpondit de nouveau: Non, je l'ignore! Il obtint en fin de compte une bonne note d'examen. En un certain sens cette anectdote me semble lumineuse. En effet, la diffrence entre ces deux catgories de jugements n'est pas nette; tout dpend du contenu que l'on attribue un concept. Si quelqu'un rattache obligatoirement le concept pesanteur celui de corps, il nonce effectivement un jugement analytique. Il s'agit maintenant de dcouvrir la vraie ralit qui provoque la combinaison de concepts conduisant formuler un jugement, c'est--dire la finalit inavoue de tout acte de juger. En effet, un jugement est d'abord une opration purement formelle. L'acte de juger est li quelque chose qu'une comparaison entre deux jugements peut rendre vident. Restons sur le plan physique et prenons par exemple le jugement suivant: Le lion est jaune. Ce jugement peut tre exact. Supposons le cas o quelqu'un puiserait dans son imagination pour construire le concept d'un animal mi-lion, quart de baleine et quart de chameau. Cette construction fantaisiste est parfaitement ralisable. Admettons que cette cration s'appelle Taxu. On pourrait maintenant former le jugement: Cet animal est beau. Au point de vue formel ce jugement 109
est aussi valable que le jugement Le lion est jaune Surgit alors la question: Comment distinguer un jugement valable d'un jugement nul? Nous voici arrivs au point o nous devons trouver le critre selon lequel l'nonc d'un jugement est permis. Le jugement: Le lion jaune peut tout instant tre modifi, et nous pouvons dire: Un lion jaune, ou Le lion jaune existe. Par contre, nous ne pouvons pas dire: Un Taxu beau existe. Notre critre veut que par une dmarche consquente un jugement formel puisse tre transform en un jugement existentiel. Le concept jaune est compatible avec celui de lion; cette association forme un concept qui constitue le sujet du jugement existentiel. Tel est le critre qui dtermine la validit de tout jugement. La justesse d'un jugement dpend uniquement de l'exactitude avec laquelle les concepts sont combins. Sa validit, par contre, est tributaire du jugement existentiel. En transformant un jugement formel en un jugement existentiel, nous insrons le prdicat au sujet. Nous enrichissons le sujet. Le but detout jugement et de toute conclusion consiste prcisment en ceci: former des concepts valables. Lorsque nous formulons le jugement: Un lion jaune existe, nous avons satisfait aux besoins d'exactitude et de validit. Nous voyons maintenant que la logique formelle offre la possibilit de nous enrichir de jugements valables, et que notre but doit tre d'laborer de tels concepts. Or, les concepts valables ne dpendent pas de la seule logique formelle. Le raisonnement existentiel prend source dans l'observation sensorielle. Le choix des concepts doit avoir une autre origine, car la logi110
que ne garantit que la justesse. Tout cela permet de se faire des ides utiles au sujet des lois rgissant l'univers. En rgle gnrale les gens ne savent pas vraiment en quoi consiste la logique. La logique aura souvent besoin d'tre stimule par d'autres concepts; mais apprendre saisir le concept du penser juste, indpendamment de son contenu, constitue un fait extrmement important. La validit et le formalisme du jugement sont deux choses diffrentes. Du fait que les gens n'ont aucune conscience de ce problme, ils laborent souvent des thories compliques considres comme immuables et qui pourtant s'crouleraient d'elles-mmes si les hommes se rendaient compte que la vrit formelle et la validit sont deux choses distinctes. Sans doute savez-vous qu'il existe en psychologie un courant moderne qui nie nergiquement la notion de libert humaine. Chaque acte de l'homme serait irrversiblement dtermin par un vnement antrieur. Il existe certaines mthodes pour en apporter la preuve. On tablit par exemple au moyen de la statistique discipline en flche notre poque le nombre des personnes qui se sont suicides en France en l'espace de cinq ans. Ce renseignement est facile obtenir, on n'a mme pas besoin de penser. Puis on examine les chiffres des cinq annes suivantes et ainsi de suite. On dcouvre une certaine variation entre les chiffres ainsi obtenus. On passe ensuite des comparaisons portant chaque fois sur vingt ans; il apparait alors que le nombre des suicids est pratiquement identique, pas exactement, bien entendu, puisque les conditions d'existence ne sont plus tout fait les mmes. Disons que ce chiffre augmente dans une certaine proportion. On trouve ainsi une loi des nombres, en sorte que l'on est 111
en mesure de prdire le chiffre des suicides venir. On dispose donc d'une loi qui permet de connatre d'avance le nombre des suicides pour la priode 1870 1890. Ceci conduit affirmer que la libert n'existe pas puisqu'il y aura invitablement un nombre donn de suicids, mais galement de meurtriers. Nous ne prtendons pas que la loi ne soit pas valable. Elle peut mme tre utile dans certaines occasions. Mais ds qu'il s'agit de scruter la vrit, elle peut susciter les pires malentendus. Songeons un instant aux assureurs qui ne sauraient se passer des calculs de probabilit. On obtient des formules prcises partir de l'observation exprimentale, par exemple: un certain nombre de chaque fois cent jeunes maris gs de vingt ans perdront au cours des trois dcennies venir leur partenaire. Des calculs de ce genre sont trs pratiques pour les assureurs et les lois qui en rsultent sont effectivement valables. En examinant ce sujet fond, il s'avre que les conclusions peuvent parfois tre comiques. Imaginons quelqu'un qui puisse consulter les donnes dont dispose une socit d'assurance. Il trouve alors la fiche d'une personne qui vit toujours alors qu'elle aurait absolument d tre morte. Or cette personne est en pleine sant et, de par sa nature profonde, ne manifeste pas la moindre intention de mourir. Nanmoins, la socit d'assurances aura gain de cause. Nous voyons donc que les lois ne permettent pas de pntrer la nature intime d'une chose. Dans un cas comme celui-ci, certains arrivent encore l'admettre. Mais lorsqu'il s'agit des lois naturelles tires de l'observation extrieure, cette acceptation est bien plus alatoire. On se contente d'un concept portant sur le droulement extrieur des donnes. Pour conc112
lure si quelqu'un est en bonne ou mauvaise sant, il faut se pencher sur sa nature intrieure. De mme, il ne suffit pas d'observer les manifestations lumineuses pour accder un concept sur la nature mme de la lumire. C'est l une vrit ne pas oublier, au risque de se fourvoyer et d'aboutir aux mmes rsultats que le professeur Exner47, recteur de l'Universit de Vienne. Les donnes extrieures ne sont pas dterminantes pour les lois internes. Nous ne prtendons pas que la logique soit un moyen pour apprendre penser, pas plus que la science de l'harmonie puisse former des musiciens. Mais la logique est ncessaire pour penser correctement, comme l'harmonie est indispensable tout bon musicien. Pour formuler des jugements formels justes, nous devons toujours rester sur le mme plan. Ainsi, par exemple, la conclusion: Tout homme est mortel. Je suis un homme. Donc je suis mortel n'est pas un paralogisme, bien que le rapport concerne apparemment le sujet. Par contre, la conclusion: Donc le Moi est mortel constituerait un paralogisme. Les lois de la logique ne sont valables que tant que nous demeurerons sur le mme plan. Le Moi appartient un plan suprieur, il n'est pas mortel. De ce fait notre seconde conclusion est fausse.
113
VIII L'LABORATION DES CONCEPTS ET LE SYSTME DES CATGORIES CHEZ HEGEL Berlin, 13 novembre 1908
La confrence de ce jour sera faite de telle sorte que certains commentaires qui complteront l'expos vous permettront de voir o se situe l'anthroposophie et la philosophie. Vous pourrez alors constater comment certains concepts et .cquis philosophiques peuvent avoir jouer un rle important au sein de la science spirituelle. Pralablement il faut voquer une notion qui nous aidera trouver le rapport juste de la philosophie avec la science spirituelle. Vous y avez t prpars par les confrences sur la logique faites lors de notre assemble gnrale". Ce fut l'occasion de dmontrer que l'acte de penser consiste connatre le monde au moyen d'une technique du concept. C'est ce que nous avons en quelque sorte caractris en nous efforant de dgager un concept relatif la logique formelle pure. On ne saurait parler de l'acte de penser que l o se droule un processus conceptuel, et nous avons fait une distinction stricte entre perception, reprsentation et concept. Certes, une telle analyse n'est pas facile, mais il faut se faire l'ide que la science spirituelle nous impose un travail rigoureux de la vie de l'me, afin d'tre capable de nous lever un niveau de connaissance fait de concepts prcis et structurs. 114
Nous avons vu que le concept est labor au sein de l'esprit et que cette construction est conforme la vrit. Toutes les considrations psychologiques selon lesquelles un concept ne serait que l'ombre de nos reprsentations due un processus d'abstraction, demeurent mi-chemin de la ralit. Ce n'est pas de cette faon que nait un concept. Il est le produit d'une laboration se droulant au sein mme de la vie intrieure. Pour nous faire une ide du rle que jouent les concepts et les rseaux de concepts, essayons de voir quel est le rapport de ce monde des concepts avec d'une part des perceptions sensorielles et d'autre part la ralit suprieure accessible au moyen de la perception suprasensible. L'ensemble de ce tissu de concepts dont dispose l'homme, allant du concept des nombres jusqu' ceux labors par Goethe", lesquels sont en Occident encore leurs premiers dbuts, nous pouvons nous les reprsenter comme un tableau marquant la frontire entre le monde suprasensible et le monde sensible. Le domaine des concepts constitue une ligne de dmarcation entre ces deux sphres. Si l'observateur du sensible se contentait de diriger son oeil ou les autres organes des sens sur le monde extrieur, il ne dtiendrait toujours que des reprsentations. C'est ce que nous avons dmontr avec l'exemple o la perception de l'horizon maritime ne nous transmet que la reprsentation d'un cercle. Par contre, lorsque nous laborons en esprit cette image de tous les points quidistants d'un point central, alors nous accdons au concept du cercle, non sa reprsentation. Outre les concepts mathmatiques, nous pourrions de la mme manire construire d'autres concepts et nous lever de la sorte jusqu' la connais115
sance de la morphologie goethenne, cet ensemble de concepts relevant d'une exprience intrieure au mme titre que l'laboration du concept cercle. Imaginons un instant l'ensemble du rseau des concepts que l'homme est capable de tisser. Grce ces concepts il nous est possible de contacter la ralit sensible et de constater que celle-ci concorde avec nos concepts. Le cercle que nous avons construit se recouvre avec le cercle que nous percevons lorsque nous sommes en haute mer. Telle est, face la ralit du monde, la situation de notre pense conceptuelle authentique. Un concept n'est jamais le produit de l'observation, bien que ce prjug soit largement rpandu. Au contraire, le concept rsulte prcisment d'une dmarche excluant la ralit extrieure. Telle est la situation de notre rseau des concepts face la ralit du monde accessible nos sens. Voyons maintenant comment se prsente l'ensemble des concepts face la ralit suprasensible. Quiconque pratique les mthodes de l'investigation clairvoyante et accde ainsi la ralit suprasensible peut constater, lorsqu'il confronte ses propres concepts avec cette ralit, qu'il y a concordance entre son rseau des concepts et le monde suprasensible. C'est un peu comme si, venant de l'autre ct, la ralit suprasensible projetait ses rayons sur ce tissu conceptuel, au mme titre que la ralit sensible le fait de ce ct-ci. Quelle est l'origine de cet ensemble de concepts? Pour l'instant, nous devons nous contenter de dcrire les faits, car la rponse dpend d'une dmarche logique que nous aurons peut-tre encore l'occasion d'entreprendre ensemble. Aujourd'hui, je me limiterai esquisser une image de ce systme conceptuel 116
pour montrer d'o vient cet ensemble de concepts labor au sein de la vie intrieure de l'individu. La meilleure faon de l'expliquer consiste voquer une projection d'ombre. Sans la main, la silhouette de la main n'apparatrait pas. La silhouette ressemble son image originelle, mais sa particularit consiste prcisment dans le fait qu'elle n'a aucune ralit, qu'elle n'est rien. En lieu et place de la lumire apparat la non-lumire, et cette absence de lumire engendre la silhouette. Les concepts naissent exactement de la mme faon: derrire notre me pensante il y a la ralit suprasensible. Et les concepts traduisent l'effacement de la ralit suprasensible. Au mme titre que les silhouettes ressemblent aux images originelles., les concepts ressemblent au monde suprasensible. C'est d'ailleurs pour cela que les concepts nous permettent de pressentir, de nous faire une ide de ce qu'est le monde suprasensible. L o la perception du suprasensible vient frapper le sensible, c'est l que naissent les silhouettes. Mais avec ces ombres que sont les concepts nous ne dtenons toujours pas la ralit suprasensible, pas plus que l'ombre projete par la main n'est cette main elle-mme. Bien que procdant de la ralit suprasensible, il est clair que les concepts ne constituent que la ligne de dmarcation entre les deux types de ralit. Une autre question surgit encore: Comment l'tre humain peut-il faire siens des concepts lorsque l'exprience du monde suprasensible lui fait dfaut? Si son exprience se limitait la ralit sensible, il devrait se contenter de reprsentations. Or, pour laborer des concepts, l'accs aux ralits suprasensibles n'est pas indispensable. Certes, le voyant peut plus aisment acqurir un rseau complet de concepts, tant donn 117
qu'il apprend connatre les forces qui engendrent les concepts. On trouvera dans mon livre Thosophie l'explication que donne ce sujet la science spirituelle. L'individu obtient des concepts en les laissant en quelque sorte se dverser sur lui. Mais alors, comment peut-on difier un rseau consistant de concepts? Ce n'est gure qu'en mathmatiques que l'on a dj atteint le niveau du concept pur. La plupart des gens pensent que les concepts rsultent d'un processus d'abstraction. A coup sr, ce n'est pas de cette faon qu'ils naissent. Il est vrai que, sur ce point, mme des penseurs avertis n'ont souvent pas d'ides bien claires. Lorsque je m'efforai, dans ma Philosophie de la Libert de dcrire quelle tait la force constructive inhrente aux concepts, j'eus l'occasion de faire une exprience tonnante". Dans ma controverse avec Spencer vous trouverez expos que la prtendue gense des concepts partir de l'exprience extrieure constitue une explication absolument insuffisante. Le concept ne saurait tre tir de l'observation. Ceci ressort dj du fait que l'tre humain, durant sa croissance, ne se forge que lentement et progressivement les concepts qui correspondent aux objets environnants. Les concepts sont ajouts l'observation. Herbert Spencer, un philosophe souvent lu aujourd'hui, dcrit de la faon suivante le processus spirituel que nous ralisons lors d'une observation. Par une journe de septembre, en nous promenant dans les champs, nous entendons un bruit quelques pas devant nous. Auprs du foss, d'o ce bruit semble venir, nous voyons l'herbe bouger. Il est fort probable que nous irons voir de plus prs ce qui a bien pu causer ce bruit et ce mouvement. A notre approche 118
une perdrix s'envole. Ds lors notre curiosit est satisfaite, car nous dtenons ce que l'on appelle l'explication du phnomne. Or, cette explication s'obtient comme suit: nous avons fait d'innombrables fois l'exprience que des perturbations venant troubler la position de corps de petites dimensions, provoquent le mouvement d'autres corps qui se trouvent mls eux; nous avons gnralis le rapport entre ces perturbations et ces mouvements. En consquence, nous trouvons que la perturbation en question est explique ds qu'elle se rvle tre un cas particulier de notre gnralisation. Examin de plus prs, le phnomne se passe tout autrement que ne le dcrit Spencer. Lorsque j'entends un bruit, je cherche tout d'abord le concept correspondant cette observation. C'est ce concept, et seulement lui, qui me dirige au-del du bruit observ. Celui qui ne rflchit pas, coute simplement le bruit et se trouve satisfait. Par contre, grce ma rflexion, je sais qu'un bruit doit tre conu comme effet de quelque chose. C'est donc seulement lorsque je relie ma perception du bruit le concept d'effet que je me sens incit dpasser la simple observation et chercher la cause. Le concept d'effet appelant celui de cause, je suis amen rechercher l'objet responsable, et je trouve la perdrix. Or, ces concepts de cause et d'effet, je ne puis jamais les tirer de la pure observation, ft-elle tendue un nombre infini de cas. L'observation appelle la pense, et c'est cette dernire seulement qui nous indique comment relier entre elles les expriences isoles. Demander une science strictement objective de puiser ses donnes dans la seule observation, c'est exiger d'elle qu'elle renonce toute pense. Car celle-ci, de par nature, dpasse les rsultats de l'observation. Si l'on s'alignait sur la dmons119
tration de Spencer, on en arriverait au point o les concepts exprimeraient les caractristiques communes extraites des situations particulires observes. Tant que je me comporte face ce bruit comme Spencer le dcrit, je suis incapable d'accder la connaissance. Il faut qu'intervienne encore un autre lment. Un clbre philosophe de notre poque" auquel j'avais ddicac un exemplaire de mon livre annota de la faon suivante le passage en question: C'est sans doute ce que fait aussi le lapin ! , et me retourna le livre. Mais nous n'allons pas nous attarder ici sur la philosophie du lapin. Notre me doit tre en mesure d'acqurir un rseau de concepts mme lorsqu'elle est incapable de l'obtenir directement par la perception. Les mthodes mme les plus scientifiques utilises pour laborer, grce l'exprience sensorielle, des reprsentations relatives au monde, toutes ces mthodes ne sauraient suffire pour permettre l'me humaine de construire un rseau de concepts vritables. Il doit toutefois exister une mthode qui soit indpendante de l'exprience extrieure et de l'exprience clairvoyante. En effet, l'me humaine doit, comme nous le prconisons, tre capable d'laborer des concepts avant de s'lever au niveau suprasensible. Nous avons donc nous mouvoir d'un concept l'autre tout en demeurant en-dea du rseau des concepts. Pour que cela puisse se raliser au sein de l'me il est ncessaire de prsupposer une mthode n'ayant rien voir ni avec l'observation extrieure ni avec l'exprience clairvoyante. Cette dmarche faite de concepts purs c'est ce que le philosophe Hegel" appelle la mthode dialectique. La vraie mthode dialectique consiste prcisment se mouvoir dans le seul domaine des concepts et d'tre capable de les 120
faire merger l'un de l'autre. Dans ce cas, l'individu vit dans une sphre o il peut ignorer le monde sensible ainsi que le monde suprasensible qui l'adombre. Nous avons indiqu ce que fait l'me lorsqu'elle progresse au sein du rseau des concepts. Elle tisse concept sur concept, comme le veut la mthode dialectique. Elle conduit l'homme d'un concept l'autre. Un point de dpart est ncessaire, certes, mais ensuite nous pouvons aligner les concepts pour en fin de compte disposer de la somme de tous les concepts. Cette somme serait l'difice fait de tous les concepts qui dans l'univers se sont adapts vers le bas au monde sensible et vers le haut au monde suprasensible. Tous ces concepts qui se meuvent grce leur dynamisme propre se sont adapts ces deux mondes, nous les appelons au sens le plus gnral du terme: des catgories. Ainsi peut-on dire que l'ensemble du rseau des concepts est constitu de catgories. On pourrait aussi choisir la formule suivante: tous les concepts sont des catgories, et toutes les catgories sont des concepts. La coutume veut, il est vrai, que le terme catgories soit rserv aux concepts gnraux, aux plus importants, aux plus significatifs. Cette notion de catgories nous vient d'Aristote. Au sens strict on peut interchanger les termes concept et catgorie. La somme de nos concepts avec le dynamisme et la puissance crative qui leur sont propres s'appelle la table des catgories. Et le livre de Hegel, sa Logique, se rfrant au mot Logos qui signifie aussi concept, constitue en ralit un systme des catgories. Hegel lui-mme avait dj dit: Quand on embrasse l'ensemble du rseau des concepts on y trouve les penses de l'entit divine d'avant la cration du monde. Comme nous trouvons les con121
cepts au sein mme du monde, il a fallu qu'ils y soient introduits ds l'origine. Lorsque nous dchiffrons les concepts nous dcouvrons les penses divines, le contenu catgorial du monde. Je n'ai pas le temps, aujourd'hui, de m'attarder sur l'histoire du systme des catgories; je dois me contenter d'indiquer comment en premier lieu Hegel, ce grand matre de la table des catgories, a dvelopp la srie des concepts. De nos jours il est peut-tre le philosophe le moins bien compris. On ne saurait donc s'tonner des propos qui circulent son sujet. On ne cesse de rpter, aujourd'hui encore, ce que l'on disait dj de son vivant, savoir qu'il se proposait de dvelopper l'ensemble de l'univers partir des concepts. D'aprs le philosophe Krug", par exemple, Hegel aurait voulu construire la rose partir de perceptions spirituelles, comme si elle pouvait, par un raisonnement dductif, tre engendre partir de concepts. Il lui fut rpondu que l'on ne voyait pas trs bien pourquoi sa plume ne serait pas, elle aussi, construite partir de concepts. Pour les anthroposophes il est extrmement important de se familiariser avec ces concepts purs. C'est en mme temps pour l'me un moyen ducatif trs puissant, mais aussi une occasion de surmonter une certaine indolence et ngligence de la vie intrieure. La dialectique de Hegel se charge de les liminer. Une fois que l'on s'est frott et form la table des catgories de Hegel, souvent cette impression de ngligence l'gard des concepts s'impose quand on lit des publications rcentes. Bien entendu, nous avons besoin d'un point de dpart; il faut commencer par un bout. Ce ne peut tre que le concept le plus simple, celui qui a le mini122
mum de contenu. Le concept au contenu le plus petit mais la porte la plus vaste, est celui de l'tre. Ce concept couvre toute l'tendue de notre univers. Rien n'est encore dit sur le genre d'tre lorsque nous voquons l'tre. Ce concept constitue la base du systme hglien. Mais comment le dpasser, comment aller au-del de ce concept? Pour sortir de notre immobilisme nous devons avoir la possibilit de permettre aux concepts d'merger l'un de l'autre. Ce point d'appui qui nous manque, nous le trouvons prcisment dans la mthode dialectique, lorsque nous comprenons que chaque concept contient en lui-mme quelque chose de plus que ce qu'il est en tant que concept, l'image de la racine contenant l'ensemble de la plante qui apparatra ultrieurement. Il en est de mme pour le concept. Lorsque nous portons notre regard physique sur la racine nous ne voyons prcisment pas tout ce qu'elle engendrera par la suite. Le concept tre contient galement quelque chose qui est capable d'engendrer un concept, celui de nontre, le contraire d'tre. Le nant est inclus dans l'tre, merge de l'tre lorsque notre regard intrieur contemple l'tre. Nous avons donc ici la possibilit de voir un concept natre de l'autre. Bien que ce soit difficile, il est trs important de se faire une reprsentation du concept nant. Bien des gens, mme des philosophes diront qu'il est impossible de se forger un concept du nant. Mais les anthroposophes doivent tre capables de le faire, c'est trs important. Nous allons au-devant d'une poque o bien des choses dpendront de la conception juste que l'on aura du nant. La science spirituelle souffre de ce que le concept nant ne puisse tre saisi l'tat pur. C'est pourquoi la thosophie est devenue une doctrine de l'manation. 123
Imaginez un instant que, plac face la ralit du monde extrieur, vous l'observiez d'un point de vue ne dpendant que de vous seul. Vous observerez, par exemple, deux personnages: l'un petit, l'autre grand. Vous laborez leur sujet un concept qui n'aurait jamais vu le jour si vous n'aviez pas rencontr ces deux personnages. Peu importe la pense qu'ils vous inspirent, mais ce qui est certain, c'est que sans cette rencontre il n'y aurait pas eu le concept en question. L'origine de ce concept ne s'explique ni par le fait qu'il y ait un petit et un grand personnage, ni par une cause quelconque surgissant des profondeurs de votre tre. Il est apparu grce la constellation spcifique de aux rapports des choses entre elles. Mais maintenant ce concept n du nant devient un facteur qui continue agir en vous. Le nant est donc effectivement un facteur rel au sein du devenir de l'univers tant que vous n'aurez pas saisi le nant dans cette signification relle. Si vous disposiez d'une notion claire au sujet du concept nant, vous comprendriez mieux aussi ce qu'est le nirvana. En reliant les deux concepts tre et nant nous arrivons un concept plus riche contenant implicitement les deux autres: le devenir. Devenir exprime un passage incessant du non-tre l'tre. Le concept devenir traduit le jeu des deux autres concepts tre et nant. A partir du concept devenir nous arrivons celui d'existence. C'est ce qu'il y a de plus proche au devenir: le raidissement du devenir conduit l'existence, un devenir qui s'est fig. Toute existence doit tre prcde d'un devenir. De quoi disposons-nous aprs avoir intrieurement labor et difi ces quatre concepts? Ce que nous dtenons est trs important. Dans le cas du 124
concept devenir nous ne pensons rien d'autre qu'au contenu admis pour ce concept. Nous devons exclure tout ce qui ne fait pas partie du concept, c'est--dire absolument tout sauf tre et non-tre qui en font partie. Ceci explique pourquoi un penseur disciplin et rigoureux n'est pas facile suivre. Lorsqu'on voque un concept, il ne faudrait jamais songer quoi que ce soit d'autre, comme dans le cas du concept triangle. La dialectique est une discipline magistrale de la pense. Nous disposons maintenant dj de quatre catgories successives: tre, non-tre, devenir, existence. Nous pouvons poursuivre notre dmarche et faire jaillir de l'existence toutes sortes de qualits. Nous verrions une existence riche clore de cette filire. Mais nous pouvons galement procder autrement. Etre se prte aussi un dveloppement en sens oppos, et cette autre dmarche est mme trs enrichissante. La pure pense d'tre est donne avant mme que la pure pense d'tre ne soit devenue ralit grce la dmarche intellectuelle. Ds l'instant o nous saisissons le concept tre, nous devons lui attribuer la qualit d'essence. L'essence, c'est l'tre retenant son activit, l'tre se concentrant sur lui-mme. Vous pourrez comprendre cela en rflchissant ce qu'il y a d'essentiel et de non-essentiel dans une chose. L'essence est l'tre oeuvrant l'intrieur, se consolidant en vue du travail. Nous parlons de l'essence de l'homme lorsque nous envisageons ses parties constitutives suprieures aussi bien qu'infrieures, et nous considrons le concept essence comme tant celui qui se juxtapose celui d'tre. A partir du concept essence nous obtenons le concept manifestation, donc quelque chose qui s'exprime au-dehors. La manifestation se prsente 125
donc comme tant le contraire de l'essence centre sur une qualit intrieure. Essence et manifestation se comportent entre elles comme tre et nant. Lorsque nous relions de nouveau essence et manifestation, nous obtenons la manifestation contenant en elle l'essence. Nous pouvons faire la distinction entre la manifestation extrieure et l'essence intrieure. Mais lorsque l'essence intrieure dborde et devient manifestation, en sorte que la manifestation elle-mme soit porteuse de l'essence, nous parlons de ralit. Celui qui a t form la dialectique ne considrera jamais le concept ralit autrement que comme une manifestation pntre d'essence. La ralit, c'est la fusion de ces deux concepts. Tout ce que l'on exprime au sujet de l'univers doit tre pntr par ces concepts qui reoivent leurs contenus par la structure interne, par la composition organique de l'ensemble du monde des concepts. Nous pouvons accentuer notre dmarche et nous lever vers des concepts encore plus riches. Nous pourrions dire: l'essence c'est l'tre, l'tre en tant que tel et conscient de l'tre, et par l capable de se manifester. Mais lorsque cet tre ne se contente pas de se manifester en tant que tel, mais tente de projeter ses filires vers son entourage et d'exprimer autre chose encore, alors nous arrivons la catgorie du concept. Nous sommes porteurs de notre essence qui oeuvre en nous. Mais lorsque nous permettons au concept de travailler en nous, c'est que nous possdons en nous quelque chose qui vise le dehors, qui inclut le monde extrieur. A partir de l'essence, de la manifestation et de la ralit nous pouvons nous lever au concept. Nous avons alors en nous le concept, et nous avons vu en logique formelle comment celui-ci agit au sein de la conc126
lusion. L, le concept demeure ce qu'il est, ne se dpasse pas. Ici, par contre, il peut sortir. Nous parlons alors d'un concept qui traduit la nature des choses. Nous atteignons l'authentique objectivit. Par opposition au concept agissant subjectivement, nous arrivons ici l'objectivit. Comme la manifestation se situe par rapport l'essence, l'objectivit le fait par rapport au concept. La seule faon de saisir correctement le concept objectivit consiste suivre la dmarche de notre dmonstration. Lorsque nous relions concept et objectivit, nous arrivons l'ide qui est en mme temps une manifestation objective incluant la subjectivit. A partir du concept fondamental originel tre les concepts jaillissent dans toutes les directions. C'est ainsi que nait ce monde cristallin et transparent des concepts. Nous en avons besoin pour connatre le monde sensible. Nous voyons alors comment les mondes sensible et suprasensible se recouvrent avec cette dialectique du concept. Et c'est cette concordance entre les concepts et la ralit qui constitue la vraie connaissance. tre I nant I devenir I existence Essence I manifestation I ralit Concept I objectivit I ide
127
PENSE PRATIQUE
IX LA CULTURE PRATIQUE DE LA PENSEE Berlin, 11 fvrier 1909
La science spirituelle anthroposophique que nous ne pouvons exposer que partiellement au cours de cette srie de confrences sera sans doute reue par un grand nombre de gens qui ne la connaissent pas ou ne dsirent pas la connatre, comme un domaine destin aux rveurs et aux visionnaires, des tres qui ne parviennent pas vraiment s'insrer dans la vie pratique. Quiconque chercherait s'informer rapidement, par la lecture d'une brochure par exemple ou en assistant une seule confrence, du contenu de la science spirituelle et du but qu'elle poursuit, sera rapidement amen se rallier ce genre de jugement. Ce sera surtout le cas pour le grand nombre de ceux qui sont peu dsireux d'accder aux mondes de l'esprit ou qui sont bourrs de prjugs l'gard d'une telle dmarche. Quand par surcroit s'y ajoute, consciemment ou inconsciemment, de la mauvaise volont, on a vite fait de prtendre que cette science spirituelle s'occupe, hlas, de choses qui ne sauraient concerner quelqu'un de pratique et auxquelles celui-ci n'a pas s'intresser. Or, la science de l'esprit se sent intimement lie aux domaines les plus pratiques de l'existence. L o elle est cultive avec srieux, elle attache la plus grande importance ce que le dveloppement de la pense pratique, cette qualit essentielle de la vie, soit 128
entrepris avec une attention particulire. La science spirituelle anthroposophique n'a rien voir avec une quelconque rverie lointaine incitant l'individu se dsintresser de la vie quotidienne. Au contraire, elle doit tre une impulsion capable, chaque instant, de nous seconder dans tout ce que nous pensons, ressentons et entreprenons. En second lieu elle constitue effectivement une prparation aux degrs qui permettent l'homme de pntrer dans les mondes suprieurs. L'importance de la science spirituelle, nous l'avons souvent rappel, ne concerne pas seulement l'tre dont l'oeil dj ouvert lui permet de contempler le monde spirituel, mais il suffit d'une raison saine pour saisir les rvlations des mondes de l'esprit. Nous avons maintes fois rpt que ces enseignements ont une valeur norme pour l'individu bien avant qu'il soit lui-mme capable de pntrer dans ces mondes. La science spirituelle prpare l'individu s'lever son tour dans les mondes suprieurs. Nous avons dj eu l'occasion de parler des diffrentes mthodes et pratiques permettant l'homme d'accder aux mondes spirituels, et nous aurons d'ailleurs encore l'occasion de nous entretenir de ce sujet. Quoi qu'il en soit, la condition suivante devra toujours tre strictment respecte: toute personne qui veut accder aux mondes de l'esprit en appliquant ce qui a t expos avec prcision au sujet des mthodes de la science spirituelle, ne devrait jamais s'engager sur la voie conduisant aux rgions suprieures de l'existence, sans avoir pralablement dvelopp une pense saine, une pense pratique. Celle-ci est le guide, le vrai Leitmotiv permettant de pntrer dans les mondes de l'esprit. Ceux qui en appellent aux mthodes de la science spirituelle peuvent y parvenir 129
condition de ne pas ddaigner les efforts rigoureux exigs par l'laboration d'une pense s'accordant avec la ralit et les lois qui la rgissent. Toutefois, lorsque l'on parle de la pense vraiment pratique, on se trouve vite en dsaccord avec la notion courante de pratique et pense pratique. Pour mettre cela en vidence il suffit de se rappeler un fait souvent relat ici. Que signifie au juste l'attitude pratique dont parlent aujourd'hui les gens plongs dans la vie pratique? Prenons le cas d'un jeune homme en apprentissage chez un matre. Il apprend connatre toutes les manipulations pratiques depuis des dizaines ou des centaines d'annes. Il sera d'autant mieux considr comme un homme pratique, qu'il aura renonc penser, pour, au contraire se conformer aux habitudes acquises. Il est courant d'admettre que tout ce qui diffre des habitudes acquises n'est pas pratique. Or le maintien des coutumes est affaire de force et de brutalit, et non de raisonnement. Celui qui se trouve plac dans une position cl insiste pour que tout le monde se conforme sa manire d'agir. S'il dtient le pouvoir, il limine tous ceux qui veulent s'y prendre autrement. On en arrive alors quelque chose qui ressemble l'exemple dj souvent mentionn ici. Il fut question d'ouvrir la voie un grand progrs: la construction d'un chemin de fer entre Frth et Nuremberg. On sollicita l'avis de membres de la facult de mdecine de Bavire, donc d'un collge de personnalits minemment pratiques. Leur conclusion consista dconseiller la construction d'une voie ferre car elle risquerait de ruiner le systme nerveux des gens. Pour le cas o le projet serait nanmoins maintenu, il faudrait prvoir des deux cts de hautes palissades afin d'viter aux passants de subir une commotion crbrale. Cela 130
se passa en 1835, c'est--dire dans un pass relativement rcent. On peut se demander si ces gens pratiques de l'poque seraient encore considrs comme tels aujourd'hui. Voici encore un autre exemple montrant bien d'o vient le progrs: des gens dits pratiques ou des autres. Quand vous allez la poste, sans doute apprciez-vous de ne plus avoir besoin, comme ce fut le cas jadis, d'avoir chaque fois consulter un registre pour dterminer la taxe en fonction de la distance du destinataire. Or le timbre-poste taxe unique n'existe que depuis les annes quarante du XIXe sicle. Il fut invent en Angleterre, mais pas par un spcialiste des postes! Bien au contraire, lorsque ce probme fut soumis au Parlement, le spcialiste devait contester les avantages proposs par Hill et rtorquer que l'on serait oblig d'agrandir l'office des postes. Il tait incapable d'imaginer que le btiment doive s'adapter au trafic et non le trafic au btiment. Et lorsque la premire voie ferre de Berlin Potsdam fut construite, un homme de mtier, celui qui depuis des annes faisait partir quotidiennement deux voitures postales pour Potsdam dclara: Si les gens veulent tout prix jeter leur argent par la fentre, ils n'ont qu' construire ce chemin de fer. Donc, ceux que l'on appelle les professionnels n'taient absolument pas les gens les plus pratiques quand il s'agissait de se prononcer sur les grands sujets de la vie. En parlant de la culture pratique de la pense on risque bien de se trouver en opposition avec les gens pratiques. Tout observateur impartial peut dcouvrir dans les divers domaines de l'existence des faits permettant de voir ce qui en est rellement de ce fameux comportement pratique. A partir d'un 131
exemple trs significatif j'ai eu l'occasion, jadis, de voir ce qui peut empcher d'accder une pense pratique. Cela se passa l'poque o j'tais tudiant. Un de mes camarades se prcipita vers moi pour me prvenir qu'il devait immdiatement aller voir son professeur (de mcanique) pour lui expliquer qu'il venait de faire une grande invention. Il revint bientt pour m'annoncer que ce spcialiste ne pouvait le recevoir que dans une heure. Il m'expliqua alors son invention. Il s'agissait d'une installation qui, une fois mise en marche par une trs faible quantit de vapeur, peut fournir un travail continu considrable. Lui-mme tait surpris par son intelligence et nanmoins tait sr de son affaire. Je lui conseillai de ramener son problme une rflexion simple et lui dis: Reprsentetoi un instant plac l'intrieur d'un wagon de chemin de fer en train d'appuyer de toutes tes forces contre la paroi du wagon pour le faire avancer. Je ralisai alors que pour dsigner une des principales entraves toute pense pratique on pourrait voquer celui qui pousse le wagon de l'intrieur. Autrement dit, on est en mesure d'embrasser du regard un domaine trs restreint et d'appliquer dans ce cadre ce que l'on a appris. Par nature on est amen en rester l et ne pas penser que tout ce tableau change considrablement ds que l'on sort du wagon. C'est un des principes qu'il faut avant tout respecter lors de la culture pratique de la pense. Selon une particularit lie une certaine nonchalance propre la pense, celle-ci a la tendance se replier sur ellemme et oublier ce qui est l'extrieur. Cela est vrai mme l o existe un lien troit avec l'objet contempl. Il y a quelque temps, je vous avais expliqu que la dmonstration suivante servait prouver la thorie 132
de Kant-Laplace: A l'origine il y avait une nbuleuse cosmique. Due une cause quelconque celle-ci entra en rotation. De ce fait, peu peu les diffrentes plantes se dtachrent du systme solaire et reurent le mouvement que nous leur connaissons aujourd'hui. Cela peut tre parfaitement dmontr au moyen d'une opration devenue classique. On verse dans un verre une goutte d'huile qui demeure en suspension la surface de l'eau. On dcoupe un morceau de carton qui sert d'quateur, et on le place sous la goutte d'huile. Puis on y fixe une aiguille qui est mise en rotation. Dans la zone quatoriale, de petites gouttes d'huile se dtachent et forment de minuscules plantes se mouvant autour de la grande goutte. Cette dmonstration est entache d'une lacune de la pense: l'oprateur a tout simplement oubli qu'il procde la manire de celui qui pousse le wagon de l'intrieur. Il s'est oubli lui-mme, ce qui en d'autres circonstances peut tre une bonne chose; il a oubli que c'est lui le producteur du mouvement rotatoire. Dans une exprience de ce genre il faut tenir compte de tous les lments entrant en jeu. Il faut avant tout croire et avoir confiance en la ralit des penses. Dans un verre qui n'en contient pas on ne puisera jamais de l'eau, pas plus que d'un monde qui n'en contient pas, on ne saurait tirer des penses. Supposer que toutes les penses se droulent exclusivement en nous-mmes est la chose la plus absurde qui soit. Personne ne devrait s'imaginer pouvoir extraire une quelconque pense d'un univers qui n'aurait pas t structur et form selon des penses. Notre me ne contient aucune pense qui n'ait pralablement exist dans l'univers. Mieux que tout homme moderne, Aristote avait dj dit: ce que l'homme 133
trouve en dernier dans sa pense existe en premier audehors dans l'univers. Lorsqu'on fait confiance la prsence des penses au sein des choses, on peut comprendre que l'on doit s'duquer penser le penser qui doit toujours tre prsent, c'est--dire ce penser concret qui se dtourne le moins possible des choses. Heimroth a si bien dit: la pense de Goethe est concrte et objective, et n'exprime rien d'autre que ce qui est contenu dans les choses et que prcisment elle ne cherche dans les choses rien d'autre que la pense idale et cratrice. Lorsque l'on accepte la ralit de la pense, on comprend comment on peut s'duquer au contact de la ralit afin d'acqurir une pense saine et pratique. Trois aspects sont considrer: D'abord l'homme doit dvelopper de l'intrt pour la ralit de son entourage, il doit veiller sa sensibilit pour les faits et les objets. S'intresser son entourage, telle est la formule magique pour celui qui veut discipliner sa pense. Le second aspect porte sur le plaisir et l'amour qui doivent accompagner notre agir. Le troisime concerne le contentement que doit engendrer toute contemplation. Ces trois exigences fondamentales une fois admises, il devient possible de comprendre les conditions dont dpend la culture pratique de la pense. Le penser lui-mme constitue souvent le plus grand ennemi de la pene. En effet, lorsque l'on croit que la pense est exclusivement notre affaire, et que les choses ne contiennent aucune pense, on se situe contre-courant de la ralit pratique de la pense. Imaginons le cas d'un individu s'tant forg quelques reprsentations trs restreintes, quelques ides schmatiques' de l'homme. S'il lui arrive d'en rencontrer 134
un qui possde peu prs les qualits entrant dans ce schma, il aura vite fait d'mettre un jugement et ne pensera pas que cet homme puisse encore lui rvler quoi que ce soit de particulier. Par contre, lorsque nous affrontons le monde avec l'tat d'esprit de pouvoir dceler de l'indit, et que nous n'avons pas le droit d'mettre sur les choses un jugement autre que celui qui dcoule de ce qu'elles-mmes expriment, nous ne tarderons pas constater le rsultat positif d'une telle attitude. Les choses expriment bien plus que ce que nous-mmes sommes capables de dire d'elles. Cette conviction constitue encore une de ces formules-miracles favorisant la culture pratique de la pense. Imaginons un instant un homme capable d'adopter les deux principes suivants. Il se trouve confront avec le fait que quelqu'un s'est rendu aujourd'hui tel ou tel endroit. Dans le but de discipliner sa pense, il est bon que le premier se pose la question suivante: dans quelle mesure l'acte de ce jour dcoule-t-il de causes passes, par exemple d'hier ou d'avant hier? Je remonte donc vers ce qui d'aprs mes rflexions, semble tre la cause. Une fois que j'ai opt pour un vnement que je puis ensuite vrifier, et o mes penses s'accordent avec la cause constate, je suis satisfait. Mais le plus souvent il n'en est rien. Dans ce cas on a la possibilit de comparer les ides errones avec le droulement exact des vnements. On remarquera alors peu peu, aprs une priode plus ou moins longue, que l'on ne commet plus d'erreurs; partir d'un fait, on devient capable d'laborer une pense qui s'accorde avec la ralit objective. Voici l'autre exercice: A partir d'un vnement donn, on peut essayer d'anticiper en penses les consquences qui en 135
dcouleront demain ou dans quelques heures. L encore, la prvision ne sera d'abord pas exacte, mais la pense aura vite fait de se familiariser avec les choses en sorte qu'il y ait concordance entre leur droulement et ce que l'on en pense. En plus de cela, si l'on s'nterdit d'laborer des penses abstraites, on sentira progressivement comment on s'unit troitement aux choses. Certaines personnes sont pousses par instinct vers ce genre de penses. Ce fut le cas de Goethe. Sa pense n'tait pas l'intrieur de sa tte mais dans les choses. Avocat de profession, il n'tait pas tellement vers en jurisprudence, mais son instinct sr le guidait dans le choix des mesures spcifiques prendre. Lorsqu'il tait charg d'une nouvelle affaire il ne passait pas tout son temps consulter et tudier les dossiers. Une fois que les actes constitus en sa qualit de ministre seront rendus publics, on pourra se rendre compte qu'il n'tait nullement tranger ce monde mais d'une nature minemment pratique. Il eut entre autre participer au recrutement des appels o il observa attentivement le droulement des oprations, tout en rdigeant par la mme occasion son Iphignie. Cette attitude mrite d'tre compare avec les prcautions de calme et de silence dont s'entoure le pote d'aujourd'hui. Et pourtant, Goethe fut un bien plus grand pote que tous ceux qui, de nos jours, craignent d'tre drangs. Son sens pratique de la pense lui permettait, par exemple, de dire, aprs avoir regard par la fentre: pas question de sortir aujourd'hui, car d'ici trois heures nous aurons de la pluie! Il avait fait des tudes sur les formes des nuages, mais sans aller jusqu' laborer une thorie, ce qui s'explique d'ailleurs par son attitude dsintresse. Celui qui ne pense 136
qu' soi n'ira pas bien loin. Et celui qui, aprs avoir vrifi un fait s'crie tout de suite Ah, je l'avais bien dit! fera peu de progrs. Ce qui compte avant tout, c'est de savoir maintenir face aux choses une attitude mditative, de penser en accord avec la nature intrieure des choses. En second lieu, tout ce que nous entreprenons doit s'accompagner de plaisir et d'amour. Ces qualits n'existent rellement que si nous renonons briguer un succs. Celui qui ne cherche qu' russir ne peut pas cultiver le calme ncessaire pour que le plaisir et l'amour puisse l'inspirer progressivement. Le meilleur moyen d'enrichir nos connaissances consiste s'occuper de quelque chose par pur plaisir. Tant que nous ne sommes pas capables de nous rjouir des checs autant que des succs, nous ne serons jamais en mesure de laisser les choses nous communiquer les penses qu'elles contiennent. , Troisimement, le penser doit tre une source de contentement. Or, c'est ce qui est actuellement le plus souvent combattu. On entend frquemment dire: Pourquoi nos enfants ont-ils besoin d'apprendre ceci ou cela? Ces notions ne leur seront d'aucune utilit dans la vie. On ne saurait noncer de principe plus irraliste que celui-l. L'tre humain a besoin de domaines o le seul fait de penser lui procure de la satisfaction, et o il n'a pas besoin d'attendre des rsultats en retour. Quelle que soit sa profession, si l'homme ne trouve pas le temps, ne serait-ce qu'un petit moment, pour entreprendre quelque chose d'ordre purement intellectuel capable de le satisfaire ce niveau, s'il ne trouve pas un tel domaine, il s'enfoncera toujours dans la routine. Par contre, quand il le trouve, il possde quelque chose qui agit 137
puissamment sur lui, pntrant mme l'organisation trs sensible de son organisme. Tout ce qui nous enchane au corps n'engendre jamais d'effets crateurs et formateurs. Bien au contraire, cela ne fait qu'user nos facults. Par contre, ce que nous entreprenons dans le seul but du contentement intellectuel est source de forces vitales; celles-ci pntrent jusque dans l'organisation la plus subtile de notre organisme et rhaussent le niveau de notre savoir. Chaque fois que nous agissons dans notre vie intrieure dans le but de stimuler notre contentement, nous crons quelque chose qui nous permet de progresser ici-bas. Lorsque nous contactons avec une telle disposition la vie pratique, nous constatons la justesse de notre attitude. Tant que l'on reste enchan la pratique courante de la vie, celle-ci nous cause toujours la mme impression et ne nous laisse pas libre de prendre des initiatives. Par contre, toute personne se consacrant perfectionner sa culture par ce genre de libre penser, en arrive se sentir pour ainsi dire comme si elle reprsentait deux tres face cette impression. Certes, ce type d'exercice qui ne fait pas directement partie des habitudes pratiques courantes entrane une perte de temps, mais indirectement il s'ensuit incontestablement un enrichissement de la vie pratique. Voil les trois principes fondamentaux destins la culture pratique de la pense. Lonard de Vinci avait scrut avec une perspicacit remarquable les liens intimes de l'existence et connaissait tout cela. Il avait expliqu de faon trs prcise comment procder pour stimuler le plaisir et l'amour du travail. Ces faits nous montrent que notre attitude de confiance l'gard de la construction de l'univers, mais aussi l'gard du penser, nous permet de nous familiariser 138
avec la pense pratique. Celui qui entreprend systmatiquement l'exercice suivant obtiendra d'excellents rsultats: Nous pensons quelque chose. Peu importe que ce soit du trs banal et quotidien ou du trs lev. Si nous avons besoin d'une rponse rapide ce n'est le plus souvent pas la pense pratique qui nous la donnera. Il s'agit de ne pas trop s'immiscer dans les penses. En effet, une des principales rgles veut que nous laissions les penses agir en nous et que nous prenions l'habitude d'tre simplement le thtre pour l'agir de notre penser. Nous sommes d'avis qu'une chose doit se faire d'une certaine manire. N'tant pas des dogmatiques, nous nous disons qu'elle pourrait aussi tre faite autrement, peut-tre mme d'une troisime, puis d'une quatrime, d'une dixime faon. Ce qui importe, c'est de se faire une image de tout cela, en procdant avec soin, comme si nous n'tions pas concern par la chose. Bien entendu, cela n'est possible que dans des cas o les choses s'y prtent. Nous connaissons les dix variantes, dont chacune sera ralise avec amour. Ensuite nous laisserons tout cela se poser. Nous ne devons absolument plus y penser mais laisser les penses agir. Nous devons nous dire: les penses sont des puissances qui agissent dans mon me mme lorsque je n'y assiste pas. J'attends jusqu'au lendemain ou surlendemain. J'essaie ventuellement de le faire une seconde, une troisime fois, et voil qu' chaque fois le problme trouve une rponse meilleure. J'agis alors partir de ma conviction que les penses sont des ralits qui continuent d'agir, en quelque sorte sans que je sois prsent. Celui qui entreprend pendant un certain temps de tels exercices verra sa pense gagner en vivacit, devenir plus alerte et prcise. Cela aura pour effet de 139
le souder aux aspects les plus courants de la vie quotidienne, ce qui est habile ou maladroit, banal ou sage. On ne se comportera jamais comme le font parfois des gens soi-disant trs pratiques. Observez-les, par exemple, quand ils sont en voyage, c'est--dire privs de leurs habitudes domestiques, et vous verrez qu'ils ont souvent un comportement trange. Ces exercices agiront jusque dans les mains, jusque dans la manire de saisir un objet. Vous laisserez moins souvent que d'autres chapper des assiettes ou des pots. Cultive quotidiennement et sous une forme qui ne soit pas abstraite, la pense pratique agit jusque dans les membres. La pense dpourvue de sens pratique est vidente surtout l o le penser s'applique aux sciences. J'ai dj mentionn l'exemple hypothtique relatif l'astronomie. Or, aujourd'hui encore, les sciences manquent souvent de sens pratique. Parfois on peut tre pouvant de voir comment certains sujets trs prcieux sont abords. On recourt au microscope pour observer les plantes, et on dcouvre de curieuses structures telles, par exemple, ce genre de facettes semblables aux yeux des insectes, parfois mme quelque chose qui s'apparente au cristallin. On trouve galement des vgtaux insectivores. Toutes ces observations sont importantes, certes, mais on confond ce qui rsulte de l'observation extrieure des plantes, avec la faon dont tout cela se reflte dans l'homme. On en arrive ne plus faire la distinction entre ce qui est me vgtale, me animale et me humaine. Cette confusion se propage dans de nombreux ouvrages de vulgarisation. Nous n'avons rien contre les rsultats extraordinaires diffuss par ces publications populaires. Toutefois, pour ceux qui savent penser, les con140
clusions proposes voquent le cas suivant: Je connais un genre d'tre merveilleusement organis. Il possde un organe capable d'attirer comme un aimant de petits animaux et de les dvorer. Cette ide se recoupe avec ce que l'on peut observer chez certaines plantes, mais l'tre en question n'est rien d'autre que la souricire. Tant que l'on s'en tient au mode de penser voqu on peut toujours parler d'une vie psychique de la souricire comme de celle de la plante. L encore, il faut viter de tomber dans le pige de celui qui pousse le wagon de l'intrieur. Un autre aspect extrmement important mrite encore d'tre voqu: Il faut faire confiance cet organe spirituel tellement intime qu'est l'organe de la pense. Chez la plupart des gens c'est la nature qui empche l'homme d'tre toujours partie prenante; il doit dormir. Alors l'organe de la pense agit en toute indpendance, et l'homme se trouve dans l'impossibilit de le dtruire sans cesse. Ceci dit, l'important est tout de mme de savoir si l'tre humain laisse simplement la nature agir sa manire ou s'il prend luimme en main son entranement. Au cours d'une journe on devrait s'imposer, ne serait-ce qu'un court instant, de ne penser rien. Laisser agir le flux et le reflux des penses jusqu'au moment o nous sommes dlivrs par le sommeil est bien plus facile que de ne penser rien. Dans le second cas l'organe de la pense accumule des forces. Un tre qui s'exerce rgulirement ne pas penser verra sa prsence d'esprit crotre, surtout s'il ne s'en remet pas seulement au sommeil pour fortifier son organe de la pense mais prend lui-mme l'initiative de le dvelopper. Il faut tre dlaiss par tous les esprits de la spiritualit pour croire que le penser s'arrte alors. On 141
peut se rfrer ici cette parole de Goethe sur la nature: Elle a pens et ne cesse de mditer. Mme lorsque l'homme ne participe pas activement son penser, quelque chose en lui, dont il n'a pas conscience, continue penser. Tandis qu'il est allong sans produire ses propres penses personnelles, c'est rellement une force suprieure en lui qui pense. L'homme laisse se mouvoir et agir en son tre intime la surconscience, ce qu'il y a de divin en lui. Cela n'apparait pas directement mais se manifeste indirectement par les effets qui en rsultent. Pour entreprendre ce genre d'exercice de la pense, une certaine force de volont est indispensable. Vous voyez donc comment on peut cultiver la pense. Nous n'avons pu donner aujourd'hui que quelques exemples seulement de l'auto-ducation de la pense, mais ceux-ci ont montr que l'on peut indiquer d'authentiques remdes pour la pense, remdes dont seule l'exprience concrte, l'existence pratique peut nous rvler les rsultats. Celui qui cultive de cette manire son penser verra qu'il peut d'une part s'lever vers les sphres suprieures de l'existence spirituelle, et d'autre part tre capable d'appliquer sa pense aux ralits les plus concrtes et pratiques de la vie quotidienne. Ce qui est acquis lors de la contemplation des faits spirituels doit tre appliqu la vie pratique. Tous les domaines, mais surtout celui de la pdagogie, pourraient en tirer avantage. Une conception trs diffrente l'gard de la vie pratique verrait le jour. Et celui qui veut accder aux mondes suprieurs y trouverait une base sre. Ce que nous voquons ici doit absolument tre ralis. Mme la science ordinaire tirerait grand profit en prenant appui sur la science de l'esprit. 142
Les pousseurs de wagon de la pense ignorent cette pense pratique; elle leur fait dfaut. Ils sont incapables de ramener un vnement une ide simple et gnrale. C'est pourtant ce que permet prcisment la science de l'esprit: elle nous ouvre le chemin conduisant une large vue d'ensemble de tant de dtails finement cisels que nous offre l'existence. L'homme se dtourne alors des spculations striles et s'engage sur la voie d'une existence rellement pratique. Lonard de Vinci peut nous servir de modle lorsqu'il disait: La thorie c'est le capitaine, la pratique ce sont les soldats. Celui qui s'engage dans la vie pratique sans disposer d'une pense discipline ressemble au marin embarqu sans boussole et qui n'a pas la possibilit de diriger son bateau. Goethe avait dj dit que si les sciences aboutissent des ides striles, c'est parce que leur penser manque de sens pratique. Certains penseurs expliquent le monde par une thorie des atomes, certains par une thorie du mouvement que d'autres s'empressent de nier. De leur ct les penseurs dous de sens pratique mettent l'accent sur la simplicit qu'engendre toute vision philosophique de niveau. A cet gard nous pouvons conclure en rappelant les lignes si justes de Goethe: Des vnements hostiles peuvent se produire Ne te dfais ni de ton calme ni de ton silence Et si tu es contest dans ton attitude Fais semblant de ne pas entendre.
143
X LA CULTURE PRATIQUE DE LA PENSE Nuremberg, 13 fvrier 1909
Toute information succinte et superficielle, puise dans telle ou telle brochure afin de savoir ce que veut la science de l'esprit, quelle est la finalit l'anthroposophie, risque de nous entraner vers une conclusion dj trs rpandue aujourd'hui, par suite prcisment de ce genre de dmarches raccourcies. Ce jugement se reflte dans la forme interrogative suivante: cette science spirituelle, que peut-elle bien avoir dire au sujet de la culture pratique de la pense? En effet, l'approche superficielle en question incite croire que la science de l'esprit plane dans les nuages, ignore les donnes concrtes terrestres et nous dtourne des ralits de la vie quotidienne. En consquence, elle serait particulirement peu qualifie pour traiter des exigences de la pense pratique lie aux conditions de la vie concrte. Une tude plus approfondie sur la nature mme de la science spirituelle conduit une apprciation trs diffrente. Elle permet de voir que l'anthroposophie est prcisment appele, et cela pour deux raisons, se prononcer au sujet du penser dans la mesure o celui-ci fait partie de la mission terrestre de l'homme. La premire raison est que l'anthroposophie ou science de l'esprit ne cherche nullement former des tres maladroits, distants voire hostiles l'gard de la vie pratique. Bien au contraire, elle est capable 144
d'intervenir tous les niveaux de la vie concrte et de rpondre tout moment n'importe quelle exigence de la vie pratique. La mission de la science spirituelle consiste nous pntrer jusque dans les moindres actes de notre vie pratique. Ce serait une erreur de penser qu'elle se contente de diffuser un enseignement relatif aux tches ultimes et aux nigmes de l'existence. Non, ce qu'elle veut, c'est nous rendre habiles et capables de rpondre aux sollicitations quotidiennes de la vie pratique. A cette premire raison vient s'ajouter la seconde qui concerne plus particulirement le but et la mission de la science de l'esprit ou anthroposophie. Ici mme, dans cette ville de Nuremberg, nous avons plusieurs reprises insist sur le fait que les enseignements de la science sprirituelle, tirs de l'observation clairvoyante, sont accessibles toute conscience humaine saine et libre de prjugs. Cela est vrai pour les problmes les plus levs de l'existence, les mystres de la vie ainsi que les nigmes de la nature humaine. Cela nous l'avons souvent dit. L'investigation des mondes suprieurs qui se propose d'y dcouvrir les lois et les secrets de l'existence est rserve celui qui a su dvelopper les facults et forces qui sommeillent en son me: l'oeil spirituel et l'oreille spirituelle. Les rsultats de l'investigation des mondes suprieurs, une fois transmis, peuvent tre assimils par tout tre humain dont la comprhension n'est pas entrave par des prjugs imputables notre culture moderne ou tout autre courant culturel. Le fait que l'anthroposophie puisse tre accessible de cette manire et non seulement utile mais galement indispensable tout individu, quelle que soit sa situation dans la vie pratique; voil au fond ce qui lui confre 145
sa vritable authenticit humaine. La science spirituelle est un bien destin tout tre. Elle s'adresse mme celui qui pourrait se dire: au cours de la prsente existence je n'atteindrai jamais le niveau de l'investigation spirituelle et ne russirai pas dvelopper mon organe de voyance permettant de contempler le monde de l'esprit. Or, cela n'est pas indispensable lorsque l'on cherche connatre la science de l'esprit. Sous certains aspects celle-ci constitue une prparation cette ouverture de l'oeil spirituel et plus gnralement des organes de perception et de connaissance sprirituelle. Il appartient la science de l'esprit de diriger l'homme vers le monde suprasensible. L'exaltation et l'enthousiasme dmesur ne sauraient tre des bases idales pour quiconque veut s'lever jusque dans les mondes de l'esprit et acqurir la conscience clairvoyante. Ce qui compte, c'est d'tre solidement ancr dans la ralit de la vie et d'y cheminer de pied ferme. Bien que cela puisse sembler grotesque, on serait tent de dire que plus l'investigation spirituelle est aborde en-dehors de toute rverie, imagination dmesure ou fantaisie dbride, mieux cela vaut. L'lve prfr de l'investigateur n'est pas celui qui cultive l'enthousiasme ou se distingue par sa fantaisie particulirement vive, mais celui qui a les deux pieds sur terre. L'investigateur prfre les hommes sobres; l'entrain et l'enthousiasme surgiront d'euxmmes ds que nous serons sollicits par les faits majeurs de l'existence. Ce seront alors les ralits extrieures qui susciteront en nous l'enthousiasme et l'lvation potique ncessaires. Cette attitude saine n'a rien voir avec celle relevant d'un enthousiasme d une surchauffe de la vie intrieure. Ceci explique pourquoi la pense pratique solidement ancre dans les fondements de l'existence cons146
titue une excellente, sinon la meilleure condition pour celui qui s'efforce d'atteindre la conscience clairvoyante. Plus l'individu est sobre et pratique, mieux cela vaut dans la perspective de s'lever vers les sphres de la contemplation clairvoyante. Tout cela peut nous montrer d'une part que la science de l'esprit est bien arme pour penser que ses acquis l'autorisent se prononcer au sujet de la pratique et de la culture de la pense, et d'autre part qu'elle est profondment intresse par la porte de la pense pratique. Bien videmment, le risque est grand, surtout notre poque, de se heurter ceux qui ont l'habitude de se faire passer pour les spcialistes de la vie pratique et qui, ds qu'ils entendent parler de science de l'esprit ont vite fait de la taxer de fantaisiste, et de prtendre qu'elle est en contradiction avec la vie pratique. Or, cette vie pratique, qu'est-elle aux yeux de ces prtentieux imbus de leur sens pratique et convaincus de leur droit de rfuter tout ce qui ne trouve pas place dans le schma de leur thorie du pratique? Quiconque sait observer la vie aura vite fait de s'apercevoir que ces gens ont t, ds leur plus jeune ge, dresss n'emprunter que des voies traces et ne jamais dvier d'une routine tablie une fois pour toutes. Si par malheur ils s'en cartaient, ils risqueraient d'tre bannis des sphres dans lesquelles ils souhaitaient tre admis. Se maintenir sur un chemin pitin de longue date, voil en quoi consiste leur concept de la vie pratique. Pour quiconque sait observer la vie, et le psychologue averti aura tt fait de s'en rendre compte, cette notion du pratique est faite de myopie, d'habitude, d'intolrance, le tout assaisonn d'une certaine dose de brutalit. Celle-ci est indis147
pensable pour pouvoir craser tout ce qui refuse de s'insrer dans ce dogmatisme de la vie pratique. Nul doute que, dans un tel contexte, des situations parfois assez bizarres puissent se prsenter. La meilleure faon de s'en rendre compte consiste reprendre des exemples dont certains ont dj t voqus ici-mme. Choisissons un cas qui illustre bien ce qu'est la vie pratique. Ce serait incontestablement peu pratique si chaque fois que nous voulons expdier une lettre nous devions nous rendre la poste, y consulter un norme registre pour dterminer la distance du lieu de destination et calculer par tranches de cinq centimes le port payer. Les quelques rares cas o cette procdure existe encore permettent de se rendre compte combien le principe de la taxe unique applicable toutes les distances est pratique. Le systme d'affranchissement que nous connaissons aujourd'hui n'a gure plus de quatre-vingts ans. Autour des annes quarante du sicle coul l'expdition d'une lettre exigeait de laborieuses dmarches au bureau de poste. Et dire que le timbre-poste taxe unique n'est nullement l'invention d'un spcialiste des postes, mais de l'anglais Hill qui n'appartenait pas cette branche professionnelle. C'est lui qui le premier attira l'attention sur les avantages du timbre-poste taxe unique. Il ne s'agit pas d'un conte, mais d'une ralit historique consigne dans les archives du Parlement anglais. L'homme de l'art, le professionnel avait contest les propositions chiffres de Hill et prtendu que le systme suggr ne ferait pas augmenter le trafic postal, contrairement ce que dit la proposition; et mme en admettant que ce soit le cas, il faudrait s'y opposer, sinon on devrait envisager la construction d'un bureau de poste trois fois plus grand que 148
l'actuel. Telle fut la prise de position des professionnels l'gard de cette invention rvolutionnaire du timbre-poste taxe unique, propose par un amateur. Nous pouvons aussi rappeler un autre fait que tout le monde ici connait. Lorsque l'on voulut construire le premier chemin de fer, on demanda un collge de mdecins, donc de spcialistes, une expertise afin de savoir s'il existait des contre-indications d'ordre hyginique ce projet. L'avis de ces hommes de mtier fut consign dans un rapport qui existe toujours et peut tre consult. Ils se prononcrent contre la construction d'un chemin de fer, car, selon l'avis de ces spcialistes, ce moyen de locomotion aurait un effet nocif sur le systme nerveux des gens. Pour le cas o l'on tenait quand mme raliser ce projet et que l'on trouverait une clientle pour ce type de transport, ils suggrrent d'installer de chaque ct de la voie ferre de hautes palissades pour viter que les passants ne subissent un traumatisme crbral. Un autre jugement de ce genre nous vient, l encore, d'un homme pratique, de Nagler, le matre de poste de Potsdam. Il dclara que, faisant circuler journellement deux diligences vides, il ne voyait pas comment le chemin de fer pourrait son tour trouver des clients. Les exemples cits sont tous tirs de la vie pratique. Il est certain qu'une pense authentiquement pratique a de quoi tre choque devant cette faon de concevoir la vie pratique. Mais ces gens-l, les penseurs pratiques de cette trempe, ont besoin de mieux approfondir la nature mme de la pense. Qu'il me soit permis de donner dans ce contexte un exemple concret o apparait clairement le prototype du penseur irraliste. Quand j'tais tudiant, j'ai connu le 149
cas d'un penseur irraliste, un exemple typique du genre que j'appellerai volontiers celui qui de l'intrieur pousse le wagon et constitue une catgorie au sein de laquelle pas mal de penseurs trouvent leur place. Je puis vous expliquer ce que sont dans le domaine de la pense ces gens qui de l'intrieur poussent le wagon. Quand j'tais tudiant, un de mes camarades vint me trouver pour m'annoncer avec un enthousiasme dbordant: je viens de faire une invention extraordinaire. Je dois tout de suite aller voir Radinger, le professeur de mcanique, pour lui expliquer ma dcouverte rvolutionnaire. Il ne se laissa pas retenir et se prcipita chez le spcialiste. Il en revint quelque peu abattu, car bien que sa dcouverte sensationnelle ne tolrt aucune attente, on lui avait demand de revenir une heure plus tard. Il en profita pour m'exposer son affaire. Ses explications taient perspicaces. Il me parla d'une construction mcanique d'un enchanement extraordinairement parfait, d'o il croyait pouvoir conclure qu'il y avait trouv la solution au problme suivant: grce un systme complexe de transmissions, sa machine peut dvelopper un maximum de force tout en consommant un minimum de vapeur. Je me fis expliquer son projet puis lui dis: Vois-tu, mon cher, pour ramener ton invention une ide simple, je dirais qu'elle est ralisable au mme titre que si tu te postais l'intrieur d'un wagon de chemin de fer pour le pousser. Autant russirais-tu faire avancer ton wagon, autant auraistu de chances que ta machine puisse fonctionner. Il se rendit assez vite compte du problme et ne retourna pas voir le professeur. Beaucoup de gens pensent comme cet tudiant, et 150
c'est pourquoi l'on peut les qualifier de pousseurs de wagon. Leur pense se meut dans un contexte limit, et ils demeurent aveugles pour ce qui dpasse leur horizon. Ils se cantonnent l'intrieur de certaines frontires o tout semble astucieux et valable. Mais ils ne se rendent pas compte qu'au-dehors du cadre choisi ce n'est pas le nant. Ils ne s'en aperoivent pas. C'est au fond comme s'ils se mouvaient le plus souvent dans un cercle trs restreint sans diriger leur regard au-dehors et sans savoir que pour pousser un wagon c'est l'extrieur qu'ils doivent chercher la rsistance. Tant qu'ils se contentent de manipulations au-dedans du wagon, dans leur domaine restreint, l'ide ne leur vient pas que le wagon ne se laissera en aucun cas pousser de l'intrieur. Ils pensent ne pas avoir besoin de savoir ce qui se passe au-dehors. Mais voil: la vie relle ne sait trop que faire de ces pousseurs. Ils ne s'inscrivent pas dans l'volution, pas plus que le wagon pouss de l'intrieur ne peut avancer. Nombreux sont ceux qui entrent dans cette catgorie de penseurs et sont de ce fait incapables de progresser. Il est primordial de dvelopper notre pense en sorte que nos intrts franchissent les limites du wagon. Les sciences ne sont pas affranchies de cette mentalit de pousseur de wagon. La spcialisation constitue un trait caractristique de la science moderne. Le regard du savant ne dpasse gure les limites de son domaine restreint. J'ai dj souvent eu l'occasion de le dire. Souvenez-vous de la thorie de Kant-Laplace. Beaucoup de gens la considrent encore aujourd'hui comme irrfutable, bien que parci, par-l, elle soit remise en question. Mais les autres thories ne valent gure mieux. Celle, par exemple, 151
qui admet une nbuleuse originelle, la met en rotation pour que s'en dgagent des anneaux et des plantes, est admirablement bien prsente dans les coles. On assiste alors une cration, en miniature, du systme de l'univers. On choisit une substance qui nage la surface de l'eau et on veille ce qu'elle forme de grandes gouttes. Puis on dcoupe un rond en carton que l'on ajuste dans le sens de l'quateur, non sans y avoir pralablement fix une pingle. Ensuite on imprime la goutte un mouvement rotatif. De petites gouttes se dtachent alors et suivent la rotation. On obtient ainsi un joli petit systme plantaire: au centre le soleil, et autour les plantes. On ne saurait mieux dmontrer la gense du systme solaire. Ce modle miniaturis en est la preuve vidente. Tout cela est bien gentil, sauf que cette dmonstration relve prcisment de la mentalit du pousseur du wagon. En effet, on a tout simplement oubli de signaler que ce mouvement de rotation est tributaire d'un individu extrieur et que sans son intervention ce systme plantaire ne prendrait pas naissance. Il n'est point besoin d'imaginer un gant install dans l'espace lointain d'o il imprimerait un mouvement rotatif cette nbuleuse originelle. On n'a toutefois pas le droit d'oublier les arrire-plans spirituels qui constituent la condition mme de cette manifestation mcanique. Tout cela dmontre combien il est ncessaire pour la vie courante et pour la vie des sciences que notre pense soit rellement ancre dans les fondements pratiques de la dmarche intellectuelle. La science spirituelle peut nous indiquer trois conditions remplir pour le cas o nous voudrions donner notre pense une tournure pratique. Bien que cela ne soit pas vident au dpart, ces trois aspects conduisent effec152
tivement la matrise de la pense. Et celui qui satisfait ces exigences ne tardera pas se rendre compte que sa pense devient plus claire, plus prcise et plus ample. Nous verrons tout de suite quels sont ces trois degrs qui conduisent au dveloppement de la pense pratique. Mais pralablement nous avons connatre la condition fondamentale sur laquelle repose l'tat d'esprit de tout individu dsireux de dvelopper l'attitude juste l'gard de la pense. Vous connaissez sans doute cette image: personne ne peut songer puiser de l'eau d'un verre qui n'en contient pas. Aujourd'hui, ceux qui cogitent sur la pense procdent cependant de cette faon; ils pensent pouvoir puiser des penses dans un monde qui n'en contient pas. Ce qui importe, c'est de reconnatre que nos penses, concepts et reprsentations qui surgissent au sein de notre me ne sont pas sans possder une essence, et que l'univers est construit selon les penses dont il est porteur et que nous dcouvrons en lui. Seul un monde engendr par les penses que nous trouvons en lui a le droit d'tre pens au moyen du penser. En examinant une montre, par exemple, il est ais de comprendre que les penses qu'elle contient proviennent de l'horloger. Par contre, quand on rflchit au sujet du monde, on est souvent tent de croire que celui-ci est ordonn selon des penses labores a posteriori par l'homme. Ne seraient donc valables que les penses engendres par l'me! On hsite croire que les choses ont t formes selon les penses que l'homme n'acquiert qu'aprs-coup. Aristote avait dj dit: Ce que l'homme dcouvre en dernier dans les choses y avait t dpos en premier. Si en fin de compte l'homme trouve des penses dans les choses, c'est 153
qu'elles y ont t pralablement introduites. Lorsque l'on envisage srieusement cette ide, on apprend avant tout faire confiance toute pense qui s'accorde avec la ralit. Quand je sais que ce n'est pas seulement l-dedans (dans la tte) que se droulent les penses, comme le prtendent les matrialistes, mais que tout ce qui vient ma rencontre rsulte de la pense, alors je m'efforce de contempler les penses au sein mme des choses et de tenir compte de la ralit des choses lorsque je suis amen penser. Heinroth, un psychologue de l'poque goethenne, avait dit Goethe qu'il possdait une pense concrte et objective, qu'il ne pensait que ce qui est contenu dans les choses ou capable d'y entrer. Il a pu dire cela parce que Goethe avait le don inn, dans son incarnation prsente, de vivre la concordance entre sa pense et les choses, de penser non pas en abstractions mais en quelque sorte avec et dans les choses. Goethe lui-mme avait estim que ce jugement tait parfaitement juste. Il possdait effectivement le don de penser en accord avec les choses, en sorte que sa pense n'tait pas spare des choses mais en liaison avec elles. Nous aurons peut-tre encore l'occasion de revenir sur ce point. Toute personne qui sa naissance ne possde pas ce genre de disposition, et a donc besoin d'acqurir progressivement cette facult de la pense pratique et concrte vivant au sein des choses, doit s'en tenir trois rgles. Premirement, en tant qu'tres aspirant devenir des penseurs pratiques nous devons cultiver une certaine attitude l'gard des objets et des ralits de notre entourage. Cette attitude peut tre caractrise comme suit: Autant que possible nous devons avoir de l'intrt pour les choses et les faits de l'exis154
tence. Etre intress par le monde extrieur, voil le premier remde miracle conduisant l'acquisition d'une pense pratique. Le second concerne tout ce que nous faisons, toutes nos activits. Elles doivent tre domines par la joie et l'amour. Le troisime concerne le fait de penser pour nous-mmes, de dpasser l'existence et de nous consacrer cultiver une vie intrieure faite de penses; cela doit avant tout nous causer une satisfaction intrieure. Tels sont les trois degrs, les remdes miracles toute pense pratique: l'intrt pour notre entourage, la joie et l'amour pour tout ce que nous entreprenons et la satisfaction intrieure l'gard de ce que l'on nomme la rflexion, c'est--dire la pense que nous cultivons dans le calme et l'abri de tout ce qui nous entoure. Ce sont l des exigences absolument indispensables. Oui, mais que veut dire: s'intresser aux choses? Cela ne signifie rien d'autre que de renoncer envisager les choses partir de nos schmas de penses ou concepts prconus, et de nous efforcer chaque instant de considrer les donnes comme s'il s'agissait d'individualits, lesquelles ont toujours quelque chose nous enseigner. Ce conseil apparemment insignifiant est pourtant extrmement important ds lors qu'il s'agit de la vie pratique. La plupart des gens abordent les hommes et les objets de leur entourage en se servant de leurs schmas conceptuels. Par exemple, ils observent un individu mais ne le voient pas vraiment en sa qualit d'individu; ils n'en retirent qu'une ide fugitive et superficielle. Ds que cette image s'accorde avec leurs schmas ils sont satisfaits. Une telle attitude ne conduit jamais la vraie pratique intellectuelle. Il s'agit l d'un domaine que les gens ont quelque peine comprendre. Aprs une rcente confrence consa155
cre au mme sujet, un auditeur est venu me voir pour me dire qu'il avait toujours la mme impression: chaque fois que je vois quelqu'un de corpulent avec une large nuque rouge, je sais que c'est un matrialiste. Son aspect extrieur me l'indique. Or, celui qui m'expliquait cela venait tout juste d'entendre tout ce que j'avais dit ce sujet, mais n'avait rien compris. Voil un cas typique d'une personne qui s'est forg le concept dogmatique: tout tre avec une large nuque rouge et manifestement une certaine corpulence est coup sr un matrialiste. Il aurait t prfrable pour l'auditeur de s'intresser la spcificit de cette individualit et de penser: elle a quelque chose m'apprendre, elle incarne une essence sprituelle et conceptuelle laquelle je dois tre attentif, car tout individu peut avoir quelque chose m'apprendre. Voil un premier point. Ensuite il ne s'agit pas seulement de dvelopper ce genre d'intrt pour l'individu en question mais de le faire galement pour le droulement des vnements. Dans cette perspective, des exercices spcifiques permettent d'obtenir d'excellents rsultats. Supposons un instant que vous soyez en face d'un vnement, d'un fait bien prcis: un homme fait ceci ou cela. Vous enregistrez fidlement ce qui se passe. Ensuite vous laborez l'ide suivante: partir de ce qui se droule aujourd'hui je vais essayer, sur la base des faits constats, d'imaginer ce qui a pu se passer hier et qui constitue la cause de ce qui se droule aujourd'hui. Je cherche laborer les concepts des vnements antrieurs, c'est--dire prolonger en retour les faits. Ensuite je m'efforce de dcouvrir ce qui s'est rellement pass. Je constate qu'au dbut je me suis tromp; mais peu peu je remarque que, par ce genre d'exercices o je cherche 156
les causes passes pour vrifier dans les faits si la pense tait bien conforme la ralit, je russis progressivement dvelopper une pense qui merge des faits eux-mmes, que ceux-ci me guident, et donc,que je suis capable d'mettre des hypothses valables. On peut aussi s'y prendre autrement, par exemple de la manire suivante: On examine un vnement tir du rgne de la nature ou de l'existence humaine qui se droule aujourd'hui. Ensuite on construit en penses la consquence qui dcoulera demain de cet vnement. On attend alors tranquillment pour voir ce qui arrive, puis on le compare avec ce que l'on avait imagin. L encore, on risque de se tromper au dbut. Mais les progrs ne se feront pas attendre, si l'on s'en tient fidlement aux faits rels et que l'on persvre en se disant: Si tu te concentres sur les faits et que tu laisses natre dans tes penses ce que la nature, elle aussi, doit engendrer, si tu t'en tiens l'vnement et exiges de toi-mme des penses se structurant en accord avec le droulement des faits, alors tu pourras progresser. Ces excercices destins dvelopper la pense pratique sont extrmement efficaces. Il convient toutefois de respecter une rgle. Tout exercice de cet ordre exige une attitude dsintresse, sinon il demeure sans effet. C'est un fait d'exprience. Ds l'instant o s'intercale l'gosme, il n'agit pas. Je m'explique: Je prconise par exemple que tel fait se produira. Constatant qu'il s'est rellement produit, je puis tre tent de me vanter: Ne l'avais-je pas annonc d'avance? Ce genre de joie goste est un obstacle pour la force que je cherche dvelopper et peut l'empcher d'tre vraiment agissante. Toute personne qui entreprend cet exercice peut en faire l'exprience. Au mme titre que l'analyse et la synthse chimique, ces choses-l doivent obir certaines lois. 157
Nous voyons donc comment l'homme peut en quelque sorte se glisser dans les choses et en penses s'identifier avec les faits. Alors, ce qu'il pense se droule en conformit avec la ralit. Ce que j'expose ici concerne les adultes. Cela nous conduirait trop loin, si nous voulions galement traiter le cas des enfants. J'aimerais seulement encore ajouter ceci: lorsqu'un tre veut dvelopper un penser authentique li au monde extrieur, en sorte que la pense corresponde aux vnements se droulant au-dehors, il doit veiller au cours de ces exercices ne pas aligner les vnements l'un la suite de l'autre, mais dvelopper une sensibilit pour l'importance de chacun d'eux. Cela fait partie de la culture pratique de la pense, mais peu de gens en ont conscience. Tout observateur sait que les gens ne font gure de diffrence quand quelque chose est dit par telle ou telle autre personne. Les deux peuvent exprimer la mme chose. Toutefois, selon la signification que revt pour nous l'une des deux, ses propos ont une porte trs diffrente de ceux de l'autre. Nous devons tout prix apprendre dvelopper une sensiblit pour l'importance respective des choses. Ce don, Goethe le possdait ds sa naissance. Il l'avait dvelopp au cours de ses prcdentes incarnations. Pour tout tre averti, il est vident qu'il possdait prcisment ce don que tant d'autres, qui se veulent des tres pratiques, ne possdent pas. Juriste de formation, Goethe a exerc cette profession. Ceux qui ont tudi cet aspect de sa vie savent que son bagage juridique n'tait pas trs tendu, certes, mais que son attitude professionnelle tait l'oppos de ce quoi nous sommes aujourd'hui habitus. De nos jours, en cas de procs, tout est entre les mains de l'avocat. 158
On va le consulter. Sa rponse ne dcoule pas d'une vraie activit de la pense. Il n'est pas concern par l'affaire. Il se contente de consulter des dossiers et d'examiner des documents. On ne saurait tre plus loign de la vie pratique. Pour beaucoup de gens les spcialistes que l'on doit consulter sont vrai dire bien loin de la ralit pratique. Goethe tait un homme pratique. Il n'tait pas trs vers en jurisprudence, mais il savait aborder avec beaucoup de sens pratique les cas qui lui furent soumis. Ce serait une erreur de se reprsenter Goethe comme un homme loign des ralits pratiques. Quand les dossiers qu'il a constitus en sa qualit de Ministre Weimar seront publis, on aura l'occasion de constater combien il tait familiaris avec les ralits de la vie pratique. On peut encore mentionner son sujet le fait suivant. On sait qu'ayant t charg de l'organisation pratique du recensement des appels, il accompagna le Duc Apolda. Cette opration une fois termine, il se mit rdiger son Iphignie laquelle il avait dj travaill pendant son sjour Apolda. On peut se demander combien de nos crivains ne se sentiraient pas drangs, alors qu'ils se consacrent rdiger leurs penses potiques, d'avoir en mme temps s'occuper du recrutement des soldats. Je ne pense pas que ce travail de recrutement ait influenc sa cration artistique et que de ce fait son Iphignie soit de qualit infrieure certaines productions potiques de l'poque. Si Goethe a pu faire cela, c'est qu'il avait des penses adaptes la ralit des faits, des penses agissant au sein des choses, et ne s'abandonnait jamais la spculation, l'abstraction. On peut s'en rendre compte l o Goethe avait l'occasion d'exposer le rapport entre sa dmarche 159
intellectuelle et le droulement des phnomnes extrieurs. Il avait tudi la mtorologie. Les spcialistes modernes observent de trs haut le dilettantisme de sa conception de la mtorologie. Mais Goethe parvint une attitude image mobile conforme la ralit des phnomnes. Elle lui permit de pressentir, partir d'une vision globale des choses, comment un vnement donn allait voluer pendant les jours suivants. Souvent Goethe s'approcha de la fentre et, au vu d'une partie du ciel annona: dans trois heures nous aurons la pluie. Ses pronostics taient bien plus srs que certains dont nous disposons aujourd'hui. Goethe savait vivre avec ses penses dans les choses. C'est surtout en s'intressant son entourage que l'on peut aussi acqurir ce degr de la mattrise de la pense pratique. Une deuxime attitude importante concerne la joie et l'amour pour ce que nous faisons. En d'autres termes, ce que nous entreprenons nous devons essayer de le faire avec joie et amour, quel que soit le rsultat. Nous aurons alors autant de plaisir faire un travail qui donne de bons rsultats qu'un autre susceptible d'chouer. Ceci est effectivement une condition ncessaire toute pense pratique. J'ai connu un jeune homme qui a cultiv sa pense pratique en faisant l'effort de relier lui-mme ses livres scolaires. Il avait beaucoup de plaisir se perfectionner dans toutes les oprations qu'exige le travail de reliure. Ce genre d'activit constitue un entranement de la pense pratique nettement suprieur toute rumination intellectuelle. On se trouve plac devant la ncessit de vrifier la rsistance de chaque fil utilis et d'tre sans cesse attentif aux mouvements des doigts; tout cela se rvle tre une excellente prparation la pense 160
pratique. On peut mme dire que plus on entreprend des tentatives infructueuses, mieux cela profite la pense pratique. Mme d'minentes personnalits dans le domaine de la thorie et de la pratique, comme Lonard de Vinci, soulignent cela et ne se lassent pas de caractriser les moindres dtails. Vinci explique, par exemple, comment pour copier un document on doit d'abord le reproduire sur un calque. Ensuite on peut vrifier la copie en lui superposant le calque et ainsi se rendre compte des inexactitudes. Puis on fait une nouvelle copie en soignant plus particulirement les parties qui n'taient pas prcises. Vinci avait jug cette mthode assez importante pour lui consacrer une page entire dans ses oeuvres. Dans tous les domaines de l'existence ce conseil permet de faonner la pense et de la rendre pratique. Le troisime aspect concerne la satisfaction intrieure que l'on peut prouver l'gard de la pense pure. C'est une factult que tout individu devrait possder, quel que soit son engagement dans la vie. Mme s'il n'y consacre que trs peu de temps, il sera toujours rcompens, y compris du point de vue matriel. Indpendamment de notre situation dans la vie nous devrions tre en mesure de rflchir, non ce qui a trait nos proccupations directes, mais des domaines que nous ne connaissons pas. C'est eux que nous devrions consacrer de temps autre quelques moments de rflexion. De tels instants de rflexion o nos penses ne sont pas destines pouser le monde extrieur doivent nous apporter une satisfaction intrieure. En se destinant uniquement solutionner des questions lies au ct pratique de l'existence, l'individu ne saurait voluer. Par contre, la satisfaction intrieure dcoulant de la pure activit
161
de la pense peut tre un facteur de progrs. Lorsque l'bniste ne pense qu' la fabrication de tables et de chaises, il ne progresse pas dans son humanit. Pour y parvenir il faut se consacrer une pense qui correspond aux besoins intrieurs. Cela faonne les organes de la pense. Alors l'homme peut progresser, avec les rpercussions indirectes sur ses qualits pratiques. Personne ne contestera que l'on se situe diffremment dans l'existence, suivant que l'on est tel tre ou tel autre tre. Ce n'est de loin pas la mme chose quand c'est un chien qui contemple la Madone Sixtine ou quand c'est un homme. L'attitude adopte par ce dernier est d'un tout autre ordre. Tant que l'individu demeure prisonnier d'un seul et mme domaine, il ne peut pas se dpasser. Par contre, quand il se consacre la pense et en tire des satisfactions, il devient capable d'voluer. La rflexion suscitant la satisfaction intrieure permet l'homme d'agir dans la vie pratique autrement que quand il renonce cette rflexion. C'est elle prcisment qui lui permet d'chapper aux contraintes du domaine restreint. Avec une pense engendrant ce sentiment de satisfaction intrieure, il pourra dpasser le point de vue troit de ceux qui poussent le wagon de l'intrieur. L se situe la source des critiques injustifies sans cesse renouveles l'gard de nos coles. On prtend que notre enseignement n'est pas adapt la vie pratique. Or, la matire enseigne qui ne conduit pas directement l'application pratique est d'une trs grande importance, condition qu'elle soit enseigne correctement. Ces choses non-pratiques sont prcisment celles qui transforment l'individu, alors que ce qui se dverse dans l'existence pratique est bien moins capable d'influencer l'tre humain. Ce qui ne se dverse 162
pas dans l'existence a la facult de faonner les organes subtils de l'tre humain et de le faire progresser. Il devient plus autonome, la maturation de la pense dveloppe des forces qui se rpercutent jusque dans les membres. La culture d'une pense non dirige vers la vie pratique, mais susceptible d'veiller un sentiment de satisfaction intrieure, a un effet vident: jusque dans ses membres l'individu devient plus souple, plus adroit. Rien ne saurait remplacer un tel entranement de la pense. Quiconque a de l'exprience dans ce domaine peut facilement distinguer ceux qui pratiquent ces exercices de ceux qui ne le font pas. Par exemple, lorsqu'on voyage on peut trs bien reconnatre les gens pratiques. Ceux qui excellent dans leur atelier par leur habilit pratique s'avrent par ailleurs souvent maladroits. Il est surprenant de constater que dans une situation autre que celle laquelle ils sont habitus ils sont incapables d'excuter le moindre geste de leurs doigts. Cela est la consquence directe de ce que ces gens pratiques n'ont pas l'habitude de cultiver des penses intrieures et d'en tirer un sentiment de satisfaction. Bien sr, il ne s'agit pas de ne faire que l'un et de ngliger l'autre. Un tre qui vit exclusivement dans la rflexion se coupe du monde et s'gare dans des spculations. Par contre, l o s'tablit un quilibre entre les deux tendances, quand l'individu sait observer les choses et rflchir, il connait une existence en quelque sorte vivifie et amplifie par l'adresse. En toutes circonstances il se montre habile. Cela va jusque dans sa faon de saisir la cuillre soupe; il la tiendra autrement qu'une personne qui nglige le calme de la rflexion. Tout cela se rpercute jusque dans les moindres dtails de la vie, car les 163
penses sont des ralits. Par les voies les plus diverses elles se transmettent au rgne matriel. Voil ce qui importe. C'est de cette manire que nous entranons notre pense pour la rendre pratique. Nous regardons par la fentre du wagon dans lequel nous avons pris place, et nous voyons les lois qui s'imposent nous du fait que notre wagon est en rapport avec le monde. Nous ne nous contentons pas de le pousser de l'intrieur. Cette thorie du pousser de l'intrieur est trs rpandue. Surtout notre poque o tout est intimement et intensivement marqu par la mentalit scientifique, celui qui s'est familiaris avec la vraie discipline de la pense pratique peut constater combien notre vie dpend d'une pense mal adapte la ralit pratique. Si les gens avaient la moindre ide de ce qu'est la pense pratique, ils se rendraient compte, au vu de l'inadaptation de la pense la vie pratique, que certaines choses doivent obligatoirement tre extraordinaires, mais les conclusions tires de ces faits sont souvent effarantes cause prcisment de l'inadaptation du penseur la vie pratique. Par quel moyen cherche-t-on aujourd'hui prouver que l'me n'existe pas et que tout ce qu'accomplit l'homme repose sur des lois purement mcaniques? A ce titre, voyons ce qu'crit un psychologue clbre. Ds la premire page de son tude on se heurte une conclusion tonnante. Un minimum de comprhension pour ce que sont le concept et la pense pratique suffit pour ramener cette conclusion sa juste valeur. Dans le passage en question on lit ceci: dans les temps anciens on disait qu'il existe une me autonome. Mais aujourd'hui l'tre humain se trouve inclus dans le tissu de la conservation des nergies. On a d'abord vrifi, dit-on, sur des animaux que toute nourriture est simplement modi164
fie et que ce qu'ils accomplissent n'est que de la nourriture transforme. La force qui se manifeste chez les animaux n'est que de la nourriture transforme. Ds lors que tout ce que l'on introduit ressort transform, comment pourrait-on conclure l'existence d'une me autonome? Non content de faire cette dmonstration sur l'animal, on s'est efforc de montrer sur l'homme que les valeurs nutritives introduites sont restitues sous une forme modifie. Pourquoi aurait-on alors encore besoin d'une me? Des tudiants se sont prts ce jeu. On a fait de savants calculs pour prouver que l'tre humain ne peut pas avoir d'me, et que tout ce qu'il entreprend et pense n'est rien d'autre qu'une modification des aliments absorbs. Les observations faites ce sujet sont d'une prcision remarquable, les mthodes sont astucieuses et les instruments spectaculaires. Mais les conclusions sont les plus horribles que l'on puisse imaginer. Pour s'en rendre compte il suffit de ramener cette dmarche intellectuelle ses composantes les plus lmentaires. Cette dmarche est construite exactement selon le schma suivant. Nous nous postons prs d'une banque. Nous savons qu'on y dpose de l'argent. Nous comptons cet argent et nous enregistrons les dtails. Ensuite nous surveillons ce qui sort de la banque. Nous arrivons alors ce rsultat merveilleux: l'argent sorti correspond exactement l'argent dpos. Ceci nous amne conclure que cette banque n'a pas besoin d'un employ puisqu'on y dpose autant d'argent qu'on en retire. Le jugement prcdent est aussi exact que celui-ci ! La quantit de travail et de pense chez un homme quivaut la quantit de nourriture absorbe. Mais cela touche aussi des domaines encore bien 165
plus subtils. Nous disposons aujourd'hui d'une recherche scientifique merveilleuse, capable de connatre les organes les plus minuscules de l'tre. Les mthodes d'investigation sont remarquables et permettent de dtecter chez certaines plantes des fonctions imitant les organes psychiques de l'homme. On connait des organes facettes assurant une fonction visuelle. On va jusqu' photographier des images qui se forment dans lceil de la plante. Il s'en dgage la conclusion suivante: vu que cette constatation est possible, la plante doit possder une me semblable celle de l'animal ou de l'homme. Il ne s'agit pas de railler ici les prouesses de la mthode scientifique, mais seulement de mettre en lumire la conclusion laquelle elle aboutit. On connait certaines plantes aux organes capables d'attirer les insectes et de les dvorer. Elles dveloppent un genre de gloutonnerie, une activit sensorielle: elles attirent les insectes et les dvorent en quelque sorte. Les conclusions tires de ces observations contribuent effacer la diffrence qui existe entre la plante, l'animal et l'tre humain, alors qu'au contraire, cette diffrence devrait tre mise en vidence. Quiconque s'est familiaris avec la pense pratique pourrait dire: je connais un tre tonnant qui, grce certains processus internes, possde la facult d'attirer comme un aimant de petits tres, non seulement de les attirer l'intrieur mais aussi de les tuer. Il s'agit de la souricire. Or, la forme de pense applique ici la souricire est faite sur le mme modle que celle applique l'investigation de la plante pour conclure l'existence d'une vie animique chez les vgtaux. Tout cela montre que le recours aux moyens indiqus peut tre d'importance pour structurer la pense 166
en vue de la rendre pratique. Ce n'est pas seulement la circonspection de la pense mais aussi sa clart qui peut tre renforce grce aux exercices suivants qui s'cartent des dmarches intellectuelles courantes. La plupart des gens ne savent comment faire assez vite pour donner leur avis sur n'importe quel problme. Une fois qu'ils ont arrt leur jugement ils sont satisfaits. Ils ne pensent mme pas que l'on puisse voir les choses autrement. Quiconque met un avis diffrent passe pour tre fou. Or, ce n'est certainement pas de cette faon que l'on apprendra penser. Pour bien faire, il faudrait, aprs s'tre forg un jugement, tre capable d'envisager d'autres manires de juger les choses; il faudrait savoir couter les autres avis et les comparer avec bienveillance au ntre. On verrait que cela est parfaitement possible. On peut aussi caractriser ce genre de dmarche en disant: pour tre en mesure de connatre la vrit il faut tre capable de remettre en question ses propres opinions. Pour rpondre une question ou rsoudre un problme il est trs utile, dans un premier temps, de se reprsenter les diffrentes solutions possibles, et ensuite de laisser reposer le tout et de se convaincre qu'il faut prendre de la distance. Il s'agit ici de faire confiance une chose qui, sur le plan pratique, s'avre d'une extrme importance. Il s'agit de savoir que l'on possde en soi quelque chose que l'on pourrait appeler en quelque sorte un tre humain suprieur qui pense encore mieux que nous le faisons lorsque nous sommes activement engags dans l'acte de penser. Nous n'avons pas besoin d'tre goste au point de vouloir toujours participer ce qui se droule dans notre me et de croire que rien ne puisse galer notre savoir. Quiconque croit la validit relle de la dmarche de la 167
pense et lui fait confiance se dira alors : Grce aux forces qui leur sont propres, mes penses progresseront d'autant plus objectivement que je m'abstiendrai d'intervenir, que je prendrai de la distance pour me consacrer autre chose. Le lendemain ou le surlendemain, face ce mme problme, je pourrai constater que cette attitude de rserve de non participation m'a rendu plus intelligent. Dans ce cas, diffrentes variantes de pense agissent en nous et nous dirigent vers un jugement nettement plus juste. Cette manire de procder est d'une importance considrable. Et si l'on pense que notre manque de dsintressement a une nouvelle fois empch la formation d'un jugement juste, il est pdagogiquement trs important de patienter encore une fois. On constatera alors assez rapidement que la pense devient plus prcise et plus prompte la riposte. En cultivant de la sorte la pense, on parvient plus facilement tablir une synthse rapide des choses. Voil comment on peut esquisser les mesures destines faonner progressivement la pense. Un autre conseil capital pouvant favoriser la culture de la pense pratique mrite d'tre retenu: Tant que tu es intress par une chose, tu dois la contempler, l'observer et ne pas te prononcer. Tu ne parleras que quand tu ne seras plus concern directement par elle, lorsque tu auras pris la distance ncessaire. Tant que l'on est encore trop engag par l'intrt que l'on porte une chose, il faut se contenter de l'observer et de se taire. Une fois que nous aurons surmont nos sentiments de plaisir et de dplaisir, et que notre intrt ne sera plus directement engag, alors seulement sera venu le moment de parler. Celui qui est capable de s'en tenir ce conseil peut faire de grands progrs. Il s'agit de ne 168
pas mettre de jugements tant que l'on est encore impliqu dans l'affaire. Il faut savoir s'intresser tout, mais sans juger immdiatement. Il est prfrable de ne juger que sur la base du souvenir que l'on a des vnements. Ces indications sont importantes dans l'optique de la culture de la pense pratique. Un autre aspect galement trs important consiste ne pas interfrer dans le processus du penser en y introduisant notre pense telle qu'elle s'est forme. Pour celui qui s'efforce de cultiver la pense pratique il est essentiel d'essayer, certains moments de la journe, de ne pas penser. Car la meilleure faon de cultiver la pense, c'est de ne pas l'abimer en y introduisant notre activit intellectuelle. Lorsque nous sommes capables de renoncer toutes nos penses, de ne pas former les penses que nous serions en mesure de former, et donc de ne pas penser, alors la force intime, inhrente l'me et toujours prsente, agit et nous fait progresser. Cet exercice est trs difficile raliser. L'nergie qu'il exige est norme. Mais le fait de ne pas penser et de refrner toutes ces penses qui surgissent et s'estompent au sein de notre vie intrieure est d'une porte considrable. Ce qui pense en nous est prsent mme quand nous-mmes ne pensons pas. La meilleure faon de cultiver cette qualit consiste se dsengager, s'effacer pendant un moment afin que notre personnalit, notre individualit ne fasse pas obstacle. Le fait de se reprsenter diffrentes possibilits et de laisser les penses agir d'elles-mmes exige un grand effort. Mais l'autre exercice n'est pas moins important, celui de laisser agir la force de la pense sans y participer nous-mmes et, ne serait-ce que par moments, laisser se dvelopper en nous, en dehors de toute intervention de notre part, l'essence 169
mme de la pense. A la longue, il est certain que nous dcouvrirons les bienfaits d'une telle attitude. Ce que Fichte dit au sujet d'une affaire trs diffrente est vrai. Il parle de la destination du savant et sait d'avance qu'il doit proposer des idaux de haut niveau, et que les hommes ne les suivront pas parce qu'ils considrent que ceux-ci ne sont pas pratiques. Fichte crit ceci : Il est certain, et nous le savons aussi bien sinon mieux qu'eux-mles: les idaux ne peuvent pas tre raliss au cours de l'existence. Nous affirmons seulement qu'ils doivent servir d'talon pour juger la ralit et pour la modifier si par bonheur il se trouvait des gens ayant le courage de le faire. Pour le cas o cela ne serait pas convaincant, les hommes n'y perdent presque rien, compte-tenu de ce qu'ils sont; quant l'humanit dans son ensemble, elle n'en sera pas affecte. Ce qui apparait clairement, c'est qu'il ne faut pas compter sur eux dans le projet d'ennoblissement du genre humain. Celui-ci poursuivra sans doute sa route, quant ces gens-l, faisons confiance la bienveillante nature pour s'occuper d'eux et leur offrir au bon moment la pluie et le beau temps, une nourriture convenable et une bonne digestion, mais aussi quelques penses intelligentes. Voil ce que Fichte dit de ceux qui prtendent que les idaux ne sont pas pratiques. A sa faon une heureuse providence agit en faveur de la pense humaine. Pour beaucoup de choses que l'individu dtruit dans le domaine de sa pense une compensation lui vient du sommeil. S'il tait toujours veill et entravait sans cesse par son activit intellectuelle sa force de pense, il se trouverait dans une situation insupportable. Le fait de dormir offre l'homme la possibilit de sans cesse faire un nouveau pas en direction de la force interne du penser. Mais la pense est bien plus intensment 170
stimule quand l'individu dcide de ne pas penser tout en tant veill. Les moments o l'on renonce penser s'avrent tre la meilleure faon d'duquer sa pense. Nous n'avons pu mentionner que quelques dtails d'un vaste champ dont il faudrait parler longuement et qu'une vingtaine de confrences ne sauraient puiser. Ces quelques indications permettent d'envisager, partir des lois de la science de l'esprit, comment la pense peut tre cultive pour s'accorder avec la vie pratique. C'est effectivement par ce genre d'exercices que l'on faonne la pense pour la rendre prcise, claire et prsente. Seul un effort soutenu dans ce sens permet de progresser. On souhaiterait pouvoir dire: si cette structuration interne de la pense tait entreprise assez tt, tout ce qui de la sorte est cisel intrieurement, dans une perspective ducative, pntrerait l'organisme humain et le rendrait plus habile. Ce que nous avons voqu aujourd'hui constitue une dmarche intellectuelle concrte qui rend l'homme habile. Bien que cela puisse sembler curieux, sachez bien que c'est actuellement grce la nature que l'homme peut redresser ce qu'il a laiss tomber. En soumettant la pense un entranement tel que je l'ai esquiss, l'homme deviendrait capable de dvelopper une habilet lui permettant de se servir de ses orteils pour ramasser ce qu'il a fait tomber. Si nous sommes tellement maladroits, c'est parce que notre pense n'est pas assez discipline et que la culture de la pense n'est pas une proccupation centrale de l'homme. Ce principe s'applique tout ce que nous avons mentionn aujourd'hui: il s'agit d'orienter tout vers le point central de l'individu d'o les forces peuvent rayonner vers les membres, jusqu' rendre l'individu capable de manipuler correctement sa cuillre soupe. 171
Si, grce la science de l'esprit, un entranement juste pntre la pense, l'homme verra systmatiquement en Goethe un modle. Il atteindra une pense qui plonge dans les choses relles, et est de ce fait une pense pratique. Par le fait prcisment de faonner ainsi la pense, on russit trouver en toutes circonstances les penses les plus simples, c'est--dire ce qui peut aisment tre englob du regard. Toutes les choses doivent tre ramenes leur structure intellectuelle lmentaire. Cela n'est possible que si l'on perfectionne la pense comme nous venons de l'expliquer, sinon elle se permet toutes les liberts imaginables. Prises individuellement les penses peuvent tre justes, mais prises dans un contexte d'ensemble elles sont inutilisables. En de nombreuses occasions les savants prsentent des preuves parfaites, alors qu'il suffit d'une pense claire pour dceler du premier coup d'oeil les erreurs. Il existe des gens qui prtendent par exemple: la substance n'existe pas, tout n'est que mouvement! Une brochure rcente mentionne effectivement qu'en se dplaant l'homme ne transporte nullement d'un endroit l'autre de la soi-disant substance, mais qu'il ne s'agit que de mouvements, d'une succession de mouvements. Cette ide s'inspire du modle suivant: L-haut il y a le soleil; les particules solaires sont en mouvement, dansent; cette danse n'implique pas le moindre transfert de particules solaires vers nous; l'environnement thrique se met aussi danser et c'est cette danse qui se prolonge jusqu' nous. Seul le mouvement se transmet, et c'est lui qui est ressenti sous forme de lumire. Dans cet ouvrage sagace, la danse de l'ther est transpose sur l'homme. En fait, celui-ci n'est, dans sa totalit, que de la danse. 172
Lorsque je change d'endroit je produis un nouveau mouvement, etc, etc... On aimerait conseiller l'auteur de cet article de ne jamais oublier, lorsqu'il se dplace, de produire chaque fois un nouveau mouvement, sinon il risquerait de disparatre dans le nant. Voil donc un exemple de cette thorie qui explique aujourd'hui tout par le mouvement. Goethe, au contraire, avait conu que tout devait tre ramen l'inertie et au calme. Ce que je vous ai expos est la consquence d'une pense non adapte la ralit pratique et incapable de passer du complexe au simple. Avec son esprit pratique Goethe s'est trouv confront tout cela, et pour pouvoir se retrouver parmi toutes ces dviations intellectuelles il lui a fallu s'en tenir ses expriences fondes sur sa pense pratique. C'est ce que je dsirais vous dire en guise de conclusion. Cela permet de dgager le point de vue juste concernant la mentalit dvelopper. Voyant que des gens privs de sens pratique s'opposrent sa faon pratique de voir et de penser les choses, Goethe nona le principe suivant dont devrait s'inspirer tout individu qui cherche parfaire sa pense pratique: Des vnements hostiles peuvent se produire. Ne te dfais ni de ton calme ni de ton silence Et si tu es contest dans ton attitude Fais semblant de ne pas entendre!
173
NOTES
Il s'agit de confrences publiques faites en 1903 dans une salle de l'Architektenhaus Berlin. Elles rsultent de la transcription combine de notes manuscrites et stnographiques de l'poque. Les prsents textes n'ont pas t revus par R. Steiner. Ils peuvent comporter certaines lacunes et erreurs dues au dchiffrage et la transcription des documents de base.
* ... Thosophie... jusqu'a la fin de l'anne 1912, Rudolf Steiner a collabor avec la section allemande de la Socit Thosophique. Il l'a fait, malgr la tendance de plus en plus orientaliste de cette socit, car il voyait au dpart de ce mouvement une impulsion rosicrucienne et il prenait le mot thosophie lui-mme dans son contexte occidental qui ramne des philosophies telles que celles de Jacob Boehme ou des rosicruciens du XVIIe sicle. Pendant toute cette priode, il n'a cess d'ailleurs de dispenser un enseignement dans le sens de l'sotrisme chrtien. En 1912, l'affaire Krishnamurti en fut une dmonstration, R. Steiner estima que les choses allaient dfinitivement trop loin, et qu'il tait dfinitivement compromis de voir le terme Thosophie retrouver son contenu chrtien et occidental. L'anthroposophie naquit alors, laissant la thosophie suivre son cours dans un courant oriental tranger son essence mme. Rudolf Steiner d'explique de tout cela dans le cycle Histoire et conditions de vie du mouvement anthroposophique (Dornach, 10 au 17 juin 1923) Connaissance 1. Charles Webster Leadbeater (1847-1934); Le plan astral, sa scnerie, ses habitants et ses phnomnes. 2. Edouard von Hartmann (1842-1906); Fondements critiques du ralisme transcendental, 1875. 3. Christian Wolff (1625-1754); Philosophia rationalis sive logica 1728, Philosophia prima sive ontologia 1729. 4. David Hume (1711-1776); Treatise on human nature, 1739 et Enquiry concerning human understanding, 1748.
175
5. Kant (1724-1804); Critique de la raison pure, introduction. 6. Kant: voir note 5. 7. Johannes Peter Mller (1801-1858). Fondateur de l'orientation physico-chimique de la nouvelle physiologie. 8. Schopenhauer (1788-1860): Le monde comme volont et comme reprsentation, 1819. 9. Il s'agit de l'crit de Kant Rves d'un visionnaire expliqus par des rves de la mtaphysique, 1766. 10. Hermann von Helmholtz (1821-1894); Manuel de l'optique physiologique, 1896 (2e d.). 11. Voir note 7. 12. Johann Gottlieb Fichte (1762-1814); La destination de l'homme, 1800. 13. Voir note 3. 14. Johann Friedrich Herbart (1776-1841); Introduction la philosophie 1815, Psychologie comme science 1824/5, Mtaphysique gnrale 1829. 15. Voir note 12. 16. Edouard von Hartmann. Son premier livre tait intitul: La philosophie de l'inconscient. Rsultats spculatifs selon la mthode inductive des sciences., 1869 et suscita une grande motion. La premire dition, anonyme, de l'tude L'inconscient du point de vue de la physiologie et de la doctrine du transformisme parut en 1872, la seconde sous le nom de l'auteur, complte par une introduction gnrale et des additifs, en 1877. 17. Karl Vogt (1817-1895), homme de science, un des principaux reprsentants du matrialisme. 18. Ernst Haeckel (1834-1919). Dans sa prface L'histoire de la cration naturelle, 4e d. 1873, Haekel nota: pour l'essentiel cette tude dit tout ce que j'aurais moi-mme pu dire de la Philosophie de l'inconscient, dans mon Histoire de la cration. 19. Ludwig Bchner (1824-1899), philosophe matrialiste. 20. Voir note 8. 21. Voir note 14. 22. Leibnitz (1646-1716). 23. Julius Baumann (1837-1916), professeur de philosophie l'universit de G6ttingen. Immortalit et migration des mes, 1909.
24. Johannes Kepler (1571-1630), Harmonices mundi 1619. 25. Robert Hamerling (1830-1889), L'atomistique du vouloir, 1891. 26. Gustav Theodor Fechner (1801-1887), homme de science et philosophe. 27. Jakob Frohschammer (1821-1893), philosophe et thologien catholique libral, L'imagination comme principe fondamental du processus universel, 1877. 28. Giordano Bruno (1548-1600). 29. Douze volumes...: Schopenhauer, oeuvres compltes en 12 volumes, par R. Steiner aux Editions Cotta, Stuttgart 1894. Logique Les confrences sur la logique, faites en 1908, sont en partie fragmentaires. Mais ensemble elles offrent une vue claire de la faon dont Rudolf Steiner a trait la question. Autour de 1908/9 se fit sentir la ncessit de prciser la frontire entre l'sotrisme occidental et la thosophie d'obdience orientale. La discipline de la dmarche intellectuelle tait appele y contribuer. - Selon les indications de l'auteur il y a lieu de remplacer dans les passages concerns les termes thosophie, thosophique par science de l'occulte, anthroposophie science de l'esprit etc... 30. Thals de Milet (vers 625-545 av. J.-C), mathmaticien et philosophe grec. 31. Platon (427-347 av. J.-C). 32. Aristote (384-322 av. J.-C). 33. Thomas d'Aquin (1225-1274) (La philosophie de Thomas d'Aquin, trois confrences de Rudolf Steiner, 1920, aux Editions Triades, Paris). 34. Averroes (1126-1198), philosophe arabe. 35. Albert le Grand (1193-1280). 36. Martin Luther (1483-1546). 37. Christion Wolff, voir note 3. 38. David Hum, voir note 4. 39. Hermann von Helmholtz: Les ralits dans la perception, clbre discours du 3 aot 1878 Berlin. Voir note 10.
176
177
40. Edouard von Hartmann: La philosophie de l'inconscient, 1869. 41. Philosophie et Anthroposophie, confrence de Rudolf Steiner faite Stuttgart le 17 aot 1908. (Publication prvue aux Editions Anthroposophiques Romandes, Genve). 42. Brochure crite avec minutie...: jusqu' ce jour elle n'a pas pu tre identifie. 43. Kant: voir note 5. 44. Formellement, le raisonnement, ou syllogisme, est constitu de trois propositions, deux extrmes et un moyen terme qui permet d'tablir le rapport des extrmes dans la conclusion. Je ne puis affirmer sans arbitraire que Socrate est mortel que si un troisime terme convient Socrate comme un mortel, homme par exemple. Ce moyen terme est donc la fois le lien et la raison de la relation. 45. Paralogisme du crocodile, chez Lucian Vitarum auctio. 46. Voir note 5. 47. Franz Exner (1849-1926), physicien. Confrence l'universit de Vienne, en aot 1908 Les lois dans les sciences naturelles et dans les sciences humaines. 48. Les deux confrences prcdentes, des 20 et 28 octobre 1908. 49. Goethe: Etudes sur la morphologie. 50. Philosophie de la Libert (Editions Anthroposophiques Romandes, Genve), chapitre IV, p. 58. Herbert Spencer (1820-1903): Fondements de la philosophie. 51. Edouard von Hartmann. 52. Hegel (1770-1831): Science et logique, 1812-16. Il crit dans la prface: la logique doit tre considre comme tant le systme de la raison pure, le rgne de la pense pure. Ce rgne est la vrit immdiate et nue, la vrit en soi. On peut donc dire que ce contenu est la manifestation de Dieu, tel qu'il est dans son tre ternel avant la cration de la nature et de l'esprit temporel. 53. Wilhelm Trangott Krug (1770-1842). La culture pratique de la pense. En 1908/9 Rudolf Steiner fit quatre confrences sur la culture pratique de la pense, chaque fois dans une autre ville:
le 27 novembre 1908 Klagenfurt, le 18 janvier 1909 Karlsruhe, le 11 fvrier 1909 Berlin, le 13 fvrier 1909 Nuremberg. Les deux premires confrences taient destines aux membres de la Section allemande de la Socit Thosophique, les deux suivantes taient publiques. Il n'existe pas de manuscrit de la confrence de Klagenfurt. Celle de Karlsruhe a t publie aux Editions Anthroposophiques Romandes, ensemble avec d'autres textes dans Etudes psychologiques: Culture pratique de la pense, Nervosit, Tempraments. Il est intressant de savoir que le texte en question ne correspond pas en tous points au document stnographique, surtout dans les derniers passages. Il s'agit probablement de modifications apportes par Rudolf Steiner au moment o il fit publier ce texte, en 1921, sous forme d'un opuscule. Le prsent ouvrage contient les deux confrences publiques des 11 et 13 fvrier 1909, donc celles de Berlin et Nuremberg. Elles reprennent en partie les mmes exemples que la confrence dj publie, du 18 janvier. Les exercices proposs, par contre, prsentent d'autres nuances. Dans la confrence de Nuremberg ils ressortent avec plus de prcision que dans les autres. L'indication la plus surprenante est sans doute celle de renoncer parfois s'immiscer dans le processus de penser (Karlsruhe), ou de renoncer par moments penser (Nuremberg), tout cela dans le but de cultiver la pense pratique.
178
179
Ouvrages de Rudolf Steiner disponibles en langue franaise
Editions Anthroposophiques Romandes Autobiographie Vol. I et II Vrit et Science Philosophie de la Libert Connaissance, Logique, Pense pratique Nietzsche, un homme en lutte contre son temps Chronique de l'Akasha Les degrs de la connaissance suprieure Goethe et sa conception du monde Thorie de la connaissance de Goethe Des nigmes de l'me Les guides spirituels de l'homme et de l'humanit Anthroposophie: L'homme et sa recherche spirituelle La vie de l'me entre la mort et une nouvelle naissance Histoire occulte Rincarnation et Karma. La vie aprs la mort Le Karma, considrations sotriques I, II, III, IV, V. Un chemin vers la connaissance de soi. Le seuil du monde spirituel Dveloppement occulte de l'homme Le calendrier de l'me Mtamorphoses de la vie de l'me Culture pratique de la pense. Nervosit et le Moi. Tempraments Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie Rapports entre gnrations, les forces spirituelles qui les rgissent Fondements de l'organisme social Economie sociale Impulsions du pass et d'avenir dans la vie sociale Education, un problme social. Education des Educateurs Pdagogie et connaissance de l'homme Enseignement et ducation selon l'Anthroposophie Pdagogie curative Psychopathologie et mdecine pastorale Physiologie occulte Mdecine et science spirituelle Thrapeutique et science spirituelle L'Art de gurir approfondi par la mditation Sant et maladie
181
Agriculture: fondements de la mthode biodynamique Entits spirituelles dans les corps clestes et dans les rgnes de la nature Les forces cosmiques et la constitution de l'homme. Le mystre de Nol Macrocosme et microcosme L'apparition du Christ dans le monde thrique Aspects spirituels de l'Europe du Nord et de la Russie: Kalevala - Songe d'Olaf Asteson - L'me russe Lucifer et Ahriman Centres initiatiques Mystres: Moyen Age, Rose-Croix, Initiation moderne Mystres du Seuil Thosophie du Rose-Croix Christian Rose-Croix et sa mission Noces chymiques de Christian Rose-Croix Mission cosmique de l'art Nature des couleurs Premier Goethanum, tmoin de nouvelles impulsions artistiques L'esprit de Goethe, sa manifestation dans Faust et le Conte du Serpent vert Goethe: Le serpent vert, Les Mystres Bindel: les nombres et leurs fondements spirituels Biesantz/Klingborg: Le Goethanum: l'impulsion de Rudolf Steiner en architecture Raab: Btir pour la pdagogie Rudolf Steiner Klockenbring: Perceval Mcke/Rudolph: Souvenirs: R. Steiner et l'Universit populaire de Berlin 1899-1904 Floride: Les Rencontres humaines et le Karma Editions Triades La Science de l'occulte L'Initiation Thosophie Manifestations du Karma Le monde des sens et le monde de l'esprit Pense humaine, pense cosmique Philosophie, Cosmologie et Religion L'apparition des sciences naturelles L'impulsion du Christ et la conscience du Moi Mystre du Golgotha Les Evangiles (5 volumes) Cours sur la nature humaine, etc.
Rpertoire des oeuvres crites de Rudolf Steiner disponibles en langue franaise (1985)
1. Introduction aux oeuvres scientifiques de Goethe. (1883-1897) partiellement publies dans Goethe: Trait des Couleurs et Goethe: La Mtamorphose des Plantes. (T) 2. Une Thorie de la connaissance chez Goethe (1886). (EAR) 3. Goethe, pre d'une esthtique nouvelle (1889). (T) 4. Vrit et Science (1892). (EAR) 5. Philosophie de la Libert (1894). (EAR) 6. Nietzsche, un homme en lutte contre son temps (1895). (EAR) 7. Goethe et sa conception du monde (1897). (EAR) 8. Mystique et Esprit moderne (1902). (puis) 9. Le Christianisme et les mystres antiques (1902). (EAR) 10. Thosophie (1904). (T) 11. Comment acqurir des connaissances sur les mondes suprieurs ou l'Initiation (1904). (T) 12. Chronique de l'Akasha (1904). (EAR) 13. Les degrs de la connaissance suprieures (1905). (EAR) 14. L'Education de l'enfant la lumire de la science spirituelle (1907). (T) 15. Science de l'Occulte (1910). (T) 16. Quatre Drames-Mystres (1910-1913). Ed. bilingue. (T) 17. Les Guides spirituels de l'Homme et de l'Humanit (1911). (EAR) 18. Le Calendrier de l'Ame (1912). Edition bilingue. (EAR) 19. Un chemin vers la connaissance de soi (1912). (EAR) 20. Le seuil du monde spirituel (1913). (EAR) 21. Douze Harmonies zodiacales (1915). Edition bilingue, (T) 22. Des nigmes de l'me (1917). (EAR) 23. Noces chymiques de Christian Rose-Croix (1917). (EAR) 24. 13 Articles sur la Tripartition sociale (1915-1921) dans le volume: Fondements de l'Organisme social. (EAR) 25. L'Esprit de Goethe (1918). (EAR) 26. Fondements de l'organisme social (1919). (EAR) 27. Autobiographie (1923-1925). (EAR) 28. Directives anthroposophiques (1924-1925). (T) 29. Donnes de base pour un largissement de l'art de gurir selon les connaissances de la science spirituelle. En collaboration avec le Dr lia Wegman (1925). (T)
(EAR): Editions Anthroposophiques Romandes, Genve (T): Editions du Centre Triades, Paris
182
183
Comme les mathmatiques ou les sciences de la nature, l'investigation spirituelle est base sur la prcision. Et j'ajouterai: l o la recherche scientifique trouve ses bornes, c'est l que la recherche spirituelle commence son travail, et avec la mme rigueur. Cette tude stricte, elle l'applique tout d'abord l'tre humain lui-mme, qui doit devenir investigateur spirituel et modle ainsi en lui l'organe qui doit atteindre jusqu'aux faits du suprasensible. Le terme de prcision dont je fais ici usage propos de l'investigation spirituelle, se rapporte en fait la prparation minutieuse de l'organisme interne, spirituel. C'est lui dont le chercheur doit avoir une vue prcise, contrlable. Lorsqu'il l'a atteinte, il peut faire pntrer son regard dans le monde des faits suprasensibles. Cette exigence pralable d'une prparation rigoureuse la perception suprasensible nous autorise lui donner le nom de clairvoyance exacte. La recherche spirituelle que nous faisons ici a ceci de caractristique qu'elle repose sur une clairvoyance exacte, mthodique. C'est l son caractre distinctif. Rudolf Steiner
!SCIENCE PF I.'ESPRIT8 cc o_
U)
w
o
Le compositeur travaille d'aprs des bases tablies par la science musicale. Celle-ci fournit un ensemble de notions indispensables l'art de composer. Mais dans la composition, les lois de cette science sont mises au service de la vie, de la ralit effective. C'est exactement dans le mme sens que la philosophie est un art. Tous les philosophes vritables furent des artistes du concept. Les ides humaines leur taient des matriaux et les mthodes scientifiques la technique artistique. C'est ainsi que la pense abstraite acquiert une vie concrte et individuelle. Les ides deviennnent des forces de vie. On ne se borne pas savoir certaines choses. Le savoir est transform en organisme rel et autonome; notre conscience vritable, active, s'est leve au-dessus de la simple rception passive des vrits. R. Steiner
w cn DEL'ESPRIT
La Philosophie de la Libert
ifL
Vous aimerez peut-être aussi
- Guide Mots PouvoirDocument160 pagesGuide Mots Pouvoirrastacourage84% (43)
- Derrière Le Voile Des Évènements RQLPDFDocument338 pagesDerrière Le Voile Des Évènements RQLPDFrosaire fogang100% (3)
- Rudolf Steiner - Le Monde Des Sens Et Le Monde de L'esprit - GA 134 PDFDocument135 pagesRudolf Steiner - Le Monde Des Sens Et Le Monde de L'esprit - GA 134 PDFrastacourage100% (2)
- Tantra - YoganiDocument86 pagesTantra - Yoganirastacourage100% (4)
- Au Cœur de La Conscience TotaleDocument205 pagesAu Cœur de La Conscience TotaleDamien BougreauPas encore d'évaluation
- Les - Guides - Sprirtuels - de - L'Homme - Et - de - L'Humanité - Rudolf SteinerDocument36 pagesLes - Guides - Sprirtuels - de - L'Homme - Et - de - L'Humanité - Rudolf Steineregg_rolls636100% (3)
- Pouvoirs Psychiques Et Réalisation Spirituelle - M. CoquetDocument558 pagesPouvoirs Psychiques Et Réalisation Spirituelle - M. Coquetrastacourage100% (5)
- Pouvoirs Psychiques Et Réalisation Spirituelle - M. CoquetDocument558 pagesPouvoirs Psychiques Et Réalisation Spirituelle - M. Coquetrastacourage100% (5)
- Le Chemin de La ConnaissanceDocument88 pagesLe Chemin de La Connaissanceradwulf63100% (2)
- GA 009 - THÉOSOPHIE - RUDOLF STEINER - Frz./francaiseDocument243 pagesGA 009 - THÉOSOPHIE - RUDOLF STEINER - Frz./francaisePetitJerome100% (1)
- Astrologie Karmique PDFDocument2 pagesAstrologie Karmique PDFrastacourage67% (3)
- Le Livre Des EspritsDocument407 pagesLe Livre Des EspritsrastacouragePas encore d'évaluation
- Steiner Rudolf - Le Devenir Humain Ame Et Esprit de L'univers PDFDocument250 pagesSteiner Rudolf - Le Devenir Humain Ame Et Esprit de L'univers PDFEmma Sezouhlon100% (3)
- Steiner Rudolf - Le Sens de L'amour Dans Le MondeDocument104 pagesSteiner Rudolf - Le Sens de L'amour Dans Le Mondeselom max100% (2)
- Steiner Rudolf - Le Sens de L'amour Dans Le MondeDocument104 pagesSteiner Rudolf - Le Sens de L'amour Dans Le Mondeselom max100% (2)
- Tarot, Lumiere Gnostique D'egyp - Pascal TreffainguyDocument249 pagesTarot, Lumiere Gnostique D'egyp - Pascal Treffainguymardirossian100% (2)
- Steiner Rudolf - Chronique de L Akasha PDFDocument252 pagesSteiner Rudolf - Chronique de L Akasha PDFmysterious100% (4)
- 901 3 Systeme Gurdjieff 1Document6 pages901 3 Systeme Gurdjieff 1ahmed louihraniPas encore d'évaluation
- Conscience LumiereDocument14 pagesConscience LumiereDaniel Robin100% (1)
- Rudolf Steiner - Le Moi Son Origine Spirituelle, Son Évolution, Son Environnement - GA 107 PDFDocument369 pagesRudolf Steiner - Le Moi Son Origine Spirituelle, Son Évolution, Son Environnement - GA 107 PDFrastacourage100% (3)
- Rudolf Steiner - Le Moi Son Origine Spirituelle, Son Évolution, Son Environnement - GA 107 PDFDocument369 pagesRudolf Steiner - Le Moi Son Origine Spirituelle, Son Évolution, Son Environnement - GA 107 PDFrastacourage100% (3)
- Moncomble Yann - Du Viol Des Foules À La SYNARCHIE Ou Le Complot PermanentDocument186 pagesMoncomble Yann - Du Viol Des Foules À La SYNARCHIE Ou Le Complot PermanentNunusse100% (2)
- Steiner Rudolf - La Quatrième Dimension Mathématique Et Réalité PDFDocument326 pagesSteiner Rudolf - La Quatrième Dimension Mathématique Et Réalité PDFjean-loïc100% (2)
- Steiner Rudolf - de Jésus Au ChristDocument118 pagesSteiner Rudolf - de Jésus Au Christsatho prod100% (1)
- Memoire de M1 Giordano Bruno LUnivers LeDocument75 pagesMemoire de M1 Giordano Bruno LUnivers LeAli BenzPas encore d'évaluation
- 1 - Nosso Lar - Chico XavierDocument170 pages1 - Nosso Lar - Chico XavierAndrea D'Amico0% (1)
- Manuel de L'eveil - Un Jour Sans Fin Comme Guide Spirituel (French Edition)Document124 pagesManuel de L'eveil - Un Jour Sans Fin Comme Guide Spirituel (French Edition)Denis VeilleuxPas encore d'évaluation
- Livre Des Révélations (T1)Document285 pagesLivre Des Révélations (T1)rastacouragePas encore d'évaluation
- A E Tome 2 Part2 PDFDocument150 pagesA E Tome 2 Part2 PDFjonhrobertsPas encore d'évaluation
- D'étranges coïncidences dans votre vie. Petits événements curieux. Pressentiments. Télépathie. Ça vous arrive aussi?D'EverandD'étranges coïncidences dans votre vie. Petits événements curieux. Pressentiments. Télépathie. Ça vous arrive aussi?Pas encore d'évaluation
- Daniel Robin - La Mort Et Au-DelaDocument227 pagesDaniel Robin - La Mort Et Au-Delamomoandco100% (1)
- Métaphysique AnalytiqueDocument44 pagesMétaphysique Analytiqueprecoce12100% (1)
- Evangile Jean SteinerDocument144 pagesEvangile Jean Steinerhanel56100% (3)
- Rudolf Steiner - Naissance Et Devenir de La Science Moderne - GA 326 (PDF Images Avec Recherche) PDFDocument208 pagesRudolf Steiner - Naissance Et Devenir de La Science Moderne - GA 326 (PDF Images Avec Recherche) PDFrastacourage100% (4)
- Rudolf Steiner - Naissance Et Devenir de La Science Moderne - GA 326 (PDF Images Avec Recherche) PDFDocument208 pagesRudolf Steiner - Naissance Et Devenir de La Science Moderne - GA 326 (PDF Images Avec Recherche) PDFrastacourage100% (4)
- Steiner - Le Combat IntDocument35 pagesSteiner - Le Combat Intjean-louis lavailPas encore d'évaluation
- Formation EspritDocument285 pagesFormation Espritpelopas3100% (1)
- Org OnesDocument37 pagesOrg Onesrastacourage100% (1)
- Barbarin Georges - Les Destins Occultes de L HumaniteDocument118 pagesBarbarin Georges - Les Destins Occultes de L Humaniteredvelvetmask2343100% (2)
- À l’aube du retournement: Propos sur les racines de la vie et les temps actuelsD'EverandÀ l’aube du retournement: Propos sur les racines de la vie et les temps actuelsPas encore d'évaluation
- Rudolf Steiner - Un Chemin Vers La Connaissance de Soi - Huit MéditationsDocument96 pagesRudolf Steiner - Un Chemin Vers La Connaissance de Soi - Huit Méditationsphnet4G100% (2)
- Les Origines de L'alchimieDocument551 pagesLes Origines de L'alchimiesantsetesh100% (1)
- Rudolf Steiner - Etudes PsychologiquesDocument137 pagesRudolf Steiner - Etudes Psychologiquesgatepol100% (1)
- (LIV) Confiseries Et FriandisesDocument17 pages(LIV) Confiseries Et Friandisesrastacourage100% (1)
- L'autre monde ou Le cadran stellaire: Édition NumériqueD'EverandL'autre monde ou Le cadran stellaire: Édition NumériquePas encore d'évaluation
- Steiner Rudolf - La Chute Des Esprits Des TénèbresDocument296 pagesSteiner Rudolf - La Chute Des Esprits Des Ténèbreswxcvbnnbvcxw100% (5)
- Steiner Rudolf - La Chute Des Esprits Des TénèbresDocument296 pagesSteiner Rudolf - La Chute Des Esprits Des Ténèbreswxcvbnnbvcxw100% (5)
- L'Histoire Et Le Pouvoir de (... ) Ingalese Richard Bpt6k5487274bDocument430 pagesL'Histoire Et Le Pouvoir de (... ) Ingalese Richard Bpt6k5487274bsantsetesh100% (1)
- Sri Aurobindo - La Vie DivineDocument992 pagesSri Aurobindo - La Vie Divineahikar1Pas encore d'évaluation
- Robert Linssen - L'éveil SuprêmeDocument157 pagesRobert Linssen - L'éveil SuprêmeJohn JONES100% (2)
- Nous sommes tous fils de la Terre Mère: L’Écospiritualité et la relation avec les animauxD'EverandNous sommes tous fils de la Terre Mère: L’Écospiritualité et la relation avec les animauxPas encore d'évaluation
- Centre Vedantique Science Et Spiritualite 2013Document8 pagesCentre Vedantique Science Et Spiritualite 2013luqmanPas encore d'évaluation
- Krishnamurti Les Annees de L Eveil Par Mary LutyensDocument344 pagesKrishnamurti Les Annees de L Eveil Par Mary Lutyensatrahasis153Pas encore d'évaluation
- Murs de Pierres Sèches - ASPO PDFDocument2 pagesMurs de Pierres Sèches - ASPO PDFrastacourage100% (1)
- Le Temps Et Les Lignes de Temps - DanielDocument15 pagesLe Temps Et Les Lignes de Temps - DanielWorldly Knowledge100% (1)
- Rudolf Steiner - Chaleur Et Matière - GA 321 PDFDocument342 pagesRudolf Steiner - Chaleur Et Matière - GA 321 PDFbrunolorenzo111100% (3)
- Dico Des Symboles Et DivinitésDocument10 pagesDico Des Symboles Et DivinitésNicolae Cuncea0% (1)
- Nexus 66 - Guérisons, Apparitions, Synchronicités - de L'autre Côté Du Miracle (Janv 2010)Document10 pagesNexus 66 - Guérisons, Apparitions, Synchronicités - de L'autre Côté Du Miracle (Janv 2010)ustensil100% (1)
- EBOOK Rudolf Steiner - Fondements Spirituels de La Methode Bio-DynamiqueDocument151 pagesEBOOK Rudolf Steiner - Fondements Spirituels de La Methode Bio-DynamiquebaclePas encore d'évaluation
- Le But Du Chemin SpirituelDocument6 pagesLe But Du Chemin Spiritueltanyel67Pas encore d'évaluation
- Steiner Rudolf - L'homme SuprasensibleDocument151 pagesSteiner Rudolf - L'homme SuprasensibleRodrigo HMPas encore d'évaluation
- Rousseau, Citoyen Du FuturDocument183 pagesRousseau, Citoyen Du Futurdagois100% (1)
- Robert Linssen La Voie Spirituelle 1998 PDFDocument10 pagesRobert Linssen La Voie Spirituelle 1998 PDFrastacouragePas encore d'évaluation
- Ecrits ScientifiquesDocument401 pagesEcrits Scientifiquesreddzscribd100% (1)
- Les Chariots de FeuDocument94 pagesLes Chariots de FeuKhalil RadouanePas encore d'évaluation
- Zoroastre de Perse - Clavis ArtisDocument68 pagesZoroastre de Perse - Clavis ArtisAlmuric59100% (1)
- La Nuée Sur Le Sanctuaire PDFDocument67 pagesLa Nuée Sur Le Sanctuaire PDFSamuel Lopez100% (1)
- O.M. Aïvanhov - Préambule - Juin 2016Document33 pagesO.M. Aïvanhov - Préambule - Juin 2016Les TransformationsPas encore d'évaluation
- Un Surviveur: KrishnamurtiDocument4 pagesUn Surviveur: KrishnamurtiJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Triptyque Graal PDFDocument7 pagesTriptyque Graal PDFslovanPas encore d'évaluation
- Argent ColloidalDocument1 pageArgent ColloidalrastacouragePas encore d'évaluation
- AnthroposophieDocument15 pagesAnthroposophiesavecodocjPas encore d'évaluation
- Oeuvre Graphique de Rudolf SteinerDocument7 pagesOeuvre Graphique de Rudolf Steinerredvelvetmask2343Pas encore d'évaluation
- Oeuvre Graphique de Rudolf SteinerDocument7 pagesOeuvre Graphique de Rudolf Steinerredvelvetmask2343Pas encore d'évaluation
- Cours de Métaphysique DogmatiqueDocument44 pagesCours de Métaphysique DogmatiquesantseteshPas encore d'évaluation
- La Postérité Des Noces Chymiques Dans La Littérature Théosophique Et AnthroposophiqueDocument18 pagesLa Postérité Des Noces Chymiques Dans La Littérature Théosophique Et AnthroposophiqueClaudePas encore d'évaluation
- La ConscienceDocument2 pagesLa ConscienceSarah BarbelPas encore d'évaluation
- René Fouéré - Krishnamurti Ou La Révolution Du Réel 1969Document137 pagesRené Fouéré - Krishnamurti Ou La Révolution Du Réel 1969helabz100% (2)
- 02-Corps Temple PDFDocument20 pages02-Corps Temple PDFrastacouragePas encore d'évaluation
- La Nature, Entre Métaphysique Et ExistenceDocument21 pagesLa Nature, Entre Métaphysique Et ExistencemrotPas encore d'évaluation
- Les enseignements de Dune: Enjeux actuels dans l'oeuvre phare de Frank HerbertD'EverandLes enseignements de Dune: Enjeux actuels dans l'oeuvre phare de Frank HerbertPas encore d'évaluation
- De L'amour Chez SpinozaDocument13 pagesDe L'amour Chez SpinozasantseteshPas encore d'évaluation
- MetafisicaDocument126 pagesMetafisicaluxfidesPas encore d'évaluation
- La Science Face Aux Extra TerrestresDocument150 pagesLa Science Face Aux Extra TerrestresBrunehaut100% (2)
- Science de L'absoluDocument239 pagesScience de L'absolunepherPas encore d'évaluation
- Les Quatres Évangiles de J.-B. Roustaing. Réponse A Ses Critiques Et A Ses Adversaires.Document173 pagesLes Quatres Évangiles de J.-B. Roustaing. Réponse A Ses Critiques Et A Ses Adversaires.Augusto AraujoPas encore d'évaluation
- Les Enigmes de la Psychométrie et les Phénomènes de la TélesthésieD'EverandLes Enigmes de la Psychométrie et les Phénomènes de la TélesthésiePas encore d'évaluation
- La Visite de l'Etre en nous-même: Une enquête du Professeur Docteur Zoro Astrien Jr Spécialiste en Kézako-Psycho appliquéeD'EverandLa Visite de l'Etre en nous-même: Une enquête du Professeur Docteur Zoro Astrien Jr Spécialiste en Kézako-Psycho appliquéePas encore d'évaluation
- 30 Recettes de Bricks PDFDocument62 pages30 Recettes de Bricks PDFNoNaSiPas encore d'évaluation
- Pierre Manoury - L'arbre Aux Milles Racines Vol 1 PDFDocument103 pagesPierre Manoury - L'arbre Aux Milles Racines Vol 1 PDFrastacouragePas encore d'évaluation
- Pierre Manoury - L'arbre Aux Milles Racines Vol 2 PDFDocument71 pagesPierre Manoury - L'arbre Aux Milles Racines Vol 2 PDFrastacouragePas encore d'évaluation
- Traité de L'antimoine PDFDocument339 pagesTraité de L'antimoine PDFrastacouragePas encore d'évaluation
- DDBS915Document6 pagesDDBS915Remus BabeuPas encore d'évaluation
- Corbin 1973 Rudolf Steiner PDFDocument4 pagesCorbin 1973 Rudolf Steiner PDFBruno MorinPas encore d'évaluation
- Elvezia PainiDocument14 pagesElvezia PainiseitePas encore d'évaluation
- Bramly Serge - Rudolf SteinerDocument190 pagesBramly Serge - Rudolf SteinerLADAGENPas encore d'évaluation
- Des Ateliers Montessori A L'ecoleDocument127 pagesDes Ateliers Montessori A L'ecoleDrelinPas encore d'évaluation
- GeigerDocument169 pagesGeigerPierre MoinePas encore d'évaluation
- Aux Origines de La SicileDocument9 pagesAux Origines de La SicileRemus Babeu100% (1)
- Steiner Rudolf - Macrocosme Et MicrocosmeDocument338 pagesSteiner Rudolf - Macrocosme Et MicrocosmedouldyPas encore d'évaluation
- Steiner Rudolf - Les Exigences Sociales Fondamentales de Notre TempsDocument278 pagesSteiner Rudolf - Les Exigences Sociales Fondamentales de Notre TempsBen ForetPas encore d'évaluation
- L'éducation de L'enfant - Rudolf SteinerDocument43 pagesL'éducation de L'enfant - Rudolf Steinerglodinho1⃣0⃣ NgamunaPas encore d'évaluation
- De La Theosophie A LanthroposophieDocument21 pagesDe La Theosophie A Lanthroposophiemadar11532Pas encore d'évaluation
- Aurélie Choné, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Hermann Hesse: Passeurs Entre Orient Et Occident. Intégration Et Transformation Des Savoirs Sur L'orient Dans L'espace Germanophone (1890-1940), 2009Document2 pagesAurélie Choné, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Hermann Hesse: Passeurs Entre Orient Et Occident. Intégration Et Transformation Des Savoirs Sur L'orient Dans L'espace Germanophone (1890-1940), 2009Joop-le-philosophe100% (1)