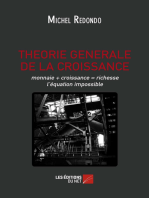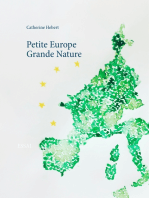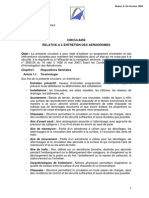Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Marshall - Principes Eco Pol I-II-III
Marshall - Principes Eco Pol I-II-III
Transféré par
Salamano123Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Marshall - Principes Eco Pol I-II-III
Marshall - Principes Eco Pol I-II-III
Transféré par
Salamano123Droits d'auteur :
Formats disponibles
Alfred Marshall (1890)
Principes dconomie
politique
Livres I, II et III
Traduit en franais par F. Sauvaire-Jourdan,
Professeur dconomie politique et de science financire
la facult de droit de lUniversit de Bordeaux
1906
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay, bnvole,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca
Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay,
bnvole, professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi partir
de :
Alfred Marshall (1890)
Principes dconomie politique.
Livres I, II et III.
Une dition lectronique ralise partir du livre d'Alfred Marshall, (18421924), professeur d'conomie politique l'Universit de Cambridge, Principes
d'conomie politique. (1890) Tome I : Livres I, II et III. (1890) (544 pp.) (pp. i
282). Texte de la 4e dition anglaise traduit de l'Anglais par F. Savaire-Jourdan
(professeur d'conomie politique et de science financire la Facult de droit de
l'Universit de Bordeaux). Reproduction de la premire dition franaise publie
Paris en 1906 chez V. Giard et Brire. Paris: Gordon & Breach, 1971. Collection :
Rimpressions G + B, Sciences humaines et philosophie.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft
Word 2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 13 avril 2003 Chicoutimi, Qubec.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
Table des matires
Prface de la premire dition, juillet 1890.
Extrait de l prface de l quatrime dition, 1898.
Note du traducteur
Livre I : Aperu prliminaire.
Chapitre I : Introduction
1. L'conomique est la fois une tude de la richesse et une branche de l'tude de l'homme.
L'histoire du monde a t dirige par les forces religieuses et les forces conomiques. - 2. L a
question de savoir si la pauvret est une chose ncessaire donne l'conomique un trs haut intrt. -
3. La science, pour la plus grande part, est ne depuis peu. - 4. La caractristique fondamentale de la
vie moderne nest pas la comptition, mais la libert de l'industrie et du travail. - 5. tude
prliminaire de la valeur. Conseils sur l'ordre suivre pour la lecture de l'ouvrage
Chapitre II : Les progrs de la libert de l'industrie et du travail
1. L'action des causes physiques est prdominante dans les civilisations primitives, et celles-ci ont
ncessairement eu leur sige dans les climats chauds. Dans une civilisation primitive le progrs est
lent; mais il y a progrs. - 2. La proprit collective augmente la force de la coutume et fait obstacle
aux changements. - 3. Les Grecs mirent l'nergie septentrionale en contact avec la civilisation
orientale. Modernes bien des points de vue, ils regardaient l'industrie comme devant tre laisse aux
esclaves; leur loignement pour tout travail continu fut une des principales causes de leur dcadence. 4. La ressemblance apparente qui existe entre les conditions conomiques du monde romain et du
monde moderne est purement superficielle : on ne trouve pas dans le monde romain les problmes
sociaux-conomiques modernes ; mais la philosophie stocienne et le cosmopolitisme des juristes
romains postrieurs exera une influence indirecte considrable sur la pense et sur l'action
conomiques. - 5. Les Germains furent lents s'instruire au contact de ceux dont ils firent la
conqute. Le savoir trouva asile chez les Arabes. - 6. 7. Le self-government par le peuple ne pouvait
exister que dans les villes libres ; elles furent les prcurseurs de la civilisation moderne au point de vue
industriel. - 8. Influence de la chevalerie et de lglise. Formation de grandes armes servant ruiner
les villes libres. Mais les esprances de progrs ressuscitent grce l'invention de l'imprimerie, la
Rforme et la dcouverte du Nouveau Monde. - 9. Le bnfice des dcouvertes maritimes
appartient en premier lieu la pninsule hispanique, Mais bientt il passa la Hollande, la France, et
lAngleterre
Chapitre III : Les progrs de la libert de l'industrie et du travail (suite)
1. Les Anglais montrrent de bonne heure des signes de l'aptitude qu'ils possdent pour l'action
organise. Le commerce a t chez eux la consquence de leur activit dans la production et dans la
navigation. L'organisation capitaliste de l'agriculture ouvrit la voie celle de l'industrie. - 2, 3.
Influence de la Rforme. - 4. Origine de la grande entreprise. Chez les Anglais la libre initiative avait
une tendance naturelle vers la division du travail, qui se trouva favorise par l'apparition au del des
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
mers de consommateurs ayant besoin, par grandes quantits, de marchandises simples. Tout d'abord les
entrepreneurs se contentrent d'organiser l'offre sans diriger le travail industriel : mais ensuite ils
grouprent dans des usines leur appartenant de grandes masses de travailleurs. - 5. Depuis lors, le
travail des ouvriers des manufactures se trouva lou en gros. La nouvelle organisation augmenta la
production, mais elle fut accompagne de grands maux, dont plusieurs cependant taient dus d'autres
causes. - 6. La guerre, les impts, et la disette, abaissrent les salaires rels. Mais le nouveau systme
a permis l'Angleterre de triompher des armes franaises. - 7. Progrs, durant le XIXe sicle. Le
tlgraphe et la presse permettent maintenant aux peuples de dcider eux-mmes des remdes qui
conviennent leurs maux ; et nous allons peu peu vers des formes de collectivisme, qui seront
suprieures aux formes anciennes parce qu'elles reposent sur le renforcement de l'individualit se
soumettant une discipline volontaire. - 8. Influence des Amricains, des Australiens, des
Allemands, sur les Anglais.
Chapitre IV : Le dveloppement de la science conomique
1. La science conomique moderne doit indirectement beaucoup la pense ancienne, mais
directement fort peu. L'tude de l'conomique fut stimule par la dcouverte des mines et des routes
commerciales du Nouveau Monde. Les entraves anciennes qui enserraient le commerce furent quelque
peu relches par les Mercantilistes. - 2. Les Physiocrates insistrent sur cette ide que la politique
restrictive est un rgime artificiel et que la libert est le rgime naturel, ainsi que sur cette autre ide
que le bien-tre de la masse du peuple doit tre le principal but de l'homme d'tat. - 3. Adam Smith
dveloppa la doctrine du libre change, et trouva dans la thorie de la valeur un centre commun qui
donne de l'unit la science conomique. - 4. L'tude des faits fut entreprise par Young, Eden,
Malthus, Tooke et d'autres. - 5. Plusieurs des conomistes anglais du dbut du sicle taient ports
vers les gnralisations rapides et les raisonnements dductifs, mais il taient trs au courant de la vie
des affaires et n'oublirent pas d'tudier la condition des classes ouvrires. - 6, 7. Ils ne tinrent
pourtant pas assez compte de ce fait que le caractre de l'homme dpend des circonstances. Influence
des aspirations socialistes et des tudes biologiques ce point de vue. John Stuart Mill.
Caractristiques des travaux modernes. - 8. conomistes des autres pays.
Chapitre V : L'objet de l'conomie politique
1. 2. Une science sociale unifie est dsirable, mais irralisable. Valeur des ides de Comte,
faiblesse de ses ngations. - 3, 4. L'conomie politique s'occupe principalement, mais non exclusivement, des mobiles susceptibles d'tre mesurs en monnaie, et elle cherche gnralement dgager de
larges rsultats qui ne soient que peu affects par les particularits individuelles. - 5. L'habitude ellemme repose en grande partie sur un choix rflchi. - 6, 7. Les mobiles conomiques ne sont pas
exclusivement gostes. Le dsir de gagner de l'argent n'exclut pas d'autres influences ; il peut luimme tre inspir par des mobiles nobles. Les procds conomiques de mesure des actions pourront
peu peu s'appliquer beaucoup d'actes de pure philanthropie. - 8. Les mobiles de l'action collective
ont pour l'conomiste une importance dj grande et sans cesse croissante. - 9. Les conomistes
envisagent la vie humaine surtout un certain point de vue, mais c'est la vie d'un homme rel, et non
celle d'un tre imaginaire
Chapitre VI : Mthodes d'tude. Nature de la loi conomique
1. En conomie politique, presque chaque pas, on a besoin la fois de l'induction et de la
dduction ; l'cole historique et l'cole analytique se servent toutes deux de ces deux mthodes, mais
des degrs divers : aucune ne peut se passer de l'aide de l'autre. - 2, 3, 4. La tche de l'analyse et de
la dduction en conomie politique est souvent mal comprise ; elle ne consiste pas forger de longes
chanes de raisonnement dductif. L'interprtation des faits du temps pass ou du temps prsent exige
souvent de subtiles analyses ; et il en est toujours ainsi lorsqu'on recourt elle pour se guider dans la
vie pratique. Stratgie et tactique. - 5. Le simple bon sens, avec ses seules ressources, peut souvent
pousser l'analyse assez loin : mais il lui est rarement possible de dcouvrir les causes profondes, et
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
notamment les causes des causes. Rle du mcanisme scientifique. - 6. Les lois sociales n'noncent
que des tendances. Lois conomiques. Le mot normal . Les lois conomiques ne sont pas analogues
la loi de la gravitation, mais aux lois secondaires des sciences naturelles, relatives l'action de forces
htrognes. Toutes les thories scientifiques, et par consquent les thories conomiques elles aussi,
supposent certaines conditions, et sont dans ce sens hypothtiques. - 7. Science pure et science
applique. L'conomie politique est une science plutt qu'un art
Chapitre VII : Rsum et conclusion
1. R s u m . - 2. Les tudes scientifiques ne doivent pas tre diriges en s'inspirant des buts
pratiques auxquels elles concourent, mais de la nature des sujets dont elles traitent. - 3. Principales
circonstances qui stimulent l'intrt des conomistes anglais notre poque, bien qu'elles ne rentrent
pas dans le domaine de leur science. 4. Principales questions de la science conomique.
Livre II : De quelques notions fondamentales.
Chapitre I : Introduction
1. L'conomie politique envisage la richesse en tant que moyen de satisfaire les besoins de l'homme,
et en tant que rsultat de ses efforts. - 2. Difficult de classer des choses dont les caractres et les
usages changent. - 3. L'conomie politique doit suivre la pratique de la vie de chaque jour. - 4. Il
est ncessaire que les ides soient trs clairement fixes, mais il n'est pas ncessaire que le sens des
mots soit rigide.
Chapitre II : La richesse
1. Sens technique du mot biens . Biens matriels. Biens personnels. Biens externes et biens
internes. Biens transmissibles et biens non-transmissibles. Biens gratuits. Biens changeables. - 2. La
richesse d'une personne se compose de ses biens externes susceptibles d'tre mesurs en monnaie. -
3. Mais parfois il est bon d'employer le mot richesse d'une faon large, en y comprenant toute la
richesse personnelle. - 4. Part de l'individu dans la richesse collective. - 5. Richesse nationale.
Richesse cosmopolite. Base juridique des droits sur la richesse
Chapitre III : Production. Consommation. Travail. Objets de ncessit
1. L'homme ne peut produire et ne peut consommer que des utilits, et non pas de la matire mme. 2. Le mot productif est expos tre mai compris, il faut d'ordinaire viter de l'employer ou
l'expliquer. - 3. Choses ncessaires pour soutenir l'existence et choses ncessaires pour maintenir
l'activit. - 4. Il y a une perte pour la socit lorsque la consommation d'un homme est infrieure ce
qui est ncessaire pour maintenir son activit. Objets de ncessit conventionnelle.
Chapitre IV : Capital. Revenu
1, 2. Le mot capital a plusieurs sens diffrents. La productivit et l'accumulation du capital
rglent : l'une, la demande de capital, et l'autre l'offre de capital. La diffrence entre la notion de capital
et celle de richesse n'est qu'une diffrence de degr. - 3. Le revenu au sens large. Revenu en monnaie
et l'expression de capital d'entreprise . - 4. Les usages les plus importants de l'expression capital
social se rattachent au problme de la distribution ; il faut donc la dfinir de telle faon que lorsqu'on
a fait dans le revenu rel de la socit les parts du travail, du capital (en y comprenant l'organisation) et
de la terre, rien ne soit omis, et rien ne soit compt deux fois. - 5. Capital de consommation. Capital
auxiliaire. Capital circulant et capital fixe, capital spcialis, capital personnel. - 6. Nous parlons
plutt de capital lorsque nous envisageons les choses comme objets de production : nous parlons de
richesse lorsque nous les envisageons comme moyens de satisfaire les besoins. - 7. Revenu net.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
Avantages nets. Usage de la richesse. Intrt. Profits du capital. Salaire de direction. Rente. - 8.
Revenu social. - 9. Le revenu national est une meilleure mesure de la prosprit conomique gnrale
que la richesse nationale. - 10, 11, 12 et 13.- Note sur quelques dfinitions du mot capital .
Livre III : Des besoins et de leur satisfaction.
Chapitre I : Introduction
1. Lien de ce livre avec les trois suivants. - 2. Jusqu' une poque toute rcente on ne s'est pas assez
occup de la demande et de la consommation
Chapitre II : Les besoins dans leurs rapports avec l'activit de l'homme
1. Dsir de varit. - 2, 3. Dsir de se distinguer. - 4. Dsir de se distinguer pris en lui-mme.
Place de la thorie de la consommation dans l'conomie politique
Chapitre III : Les variation: de la demande
1. Loi de satit des besoins ou de l'utilit dcroissante. Utilit totale. Accroissement limite. Utilit
limite. - 2. Prix de demande. - 3. Il faut tenir compte des variations de l'utilit de la monnaie. 4.
Tableau de demande d'un individu. Sens de l'expression augmentation de la demande . - 5.
Demande d'un march. Loi de la demande. - 6. Demande de marchandises rivales
Chapitre IV : L'lasticit des besoins
1. Dfinition de l'lasticit de la demande. - 2, 3. Un prix, qui est bas pour un homme riche, peut
tre lev pour un homme pauvre. - 4. Causes gnrales qui affectent l'lasticit. - 5. Difficults
venant de l'lment de temps. - 6. Changements de mode. - 7. Difficults pour se procurer les
statistiques ncessaires. - 8, 9. - Note sur les statistiques de consommation. Livres des commerants.
Budgets de consommateurs
Chapitre V : Choix entre diffrents usages de la mme chose. Usages immdiats et usages diffrs
1, 2. Distribution des ressources d'un individu entre la satisfaction de diffrents besoins, de faon
que le mme prix mesure, la limite des diffrents achats, des utilits gales. - 3. Leur distribution
entre besoins prsents et besoins futurs. Escompte des satisfactions futures. - 4. Distinction entre
l'escompte des, plaisirs futurs, et l'escompte des vnements futurs agrables.
Chapitre VI : Valeur et utilit
1. Prix et utilit. Bnfice du consommateur. Conjoncture. - 2. Bnfice du consommateur par
rapport la demande d'un individu. - 3, 4, et par rapport la demande d'un march. Cette analyse
permet de formuler avec prcision des notions courantes. mais n'introduit dans la question aucune
subtilit nouvelle. Les diffrences individuelles de caractre peuvent tre ngliges lorsque nous
considrons un grand nombre de gens ; et si parmi eux se trouvent en gale proportion des riches et des
pauvres, le prix devient alors une bonne mesure de l'utilit, 5, pourvu qu'on tienne compte de la
richesse collective. - 6. Ide de Bernoulli. Aspects plus larges de l'utilit de la richesse
Livre IV : Les agents de la production - nature, travail, capital et organisation.
Chapitre I : Introduction
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
1. Les agents de la production sont : la nature, le travail et le capital. Dans le capital, il faut faire
rentrer l'organisation industrielle et commerciale, qui doit pourtant, certaine points de vue, tre
tudie part. d'autres points de vue le capital peut tre runi au travail, et les agents de la
production deviennent la nature et l'homme. - 2. Disutilit limite. Bien que le travail porte parfois en
lui-mme sa propre rcompense, pourtant, sous certaines conditions, nous pouvons regarder l'offre de
travail comme rgle par le prix qu'on peut obtenir pour lui. Prix d'offre.
Chapitre II : La fertilit du sol
1. L'ide que le sol est un don gratuit de la nature, tandis que le produit du sol est d au travail de
l'homme, n'est pas tout fait exacte ; mais elle a un fond de vrit. - 2. Conditions mcaniques et
conditions chimiques de fertilit. - 3. Pouvoir que l'homme possde d'altrer le caractre du soi. - 4.
Les qualits originelles du soi comptent pour plus, et les qualits artificielles pour moins, dans certains
cas que dans d'autres. Dans tous les cas le rendement supplmentaire obtenu en augmentant le capital
et le travail diminue, plus ou moins vite
Chapitre III : Fertilit du sol (suite). Tendance au rendement dcroissant
1. Le sol peut tre mal cultiv ; alors le rendement d une plus grande dpense de capital et de
travail augmente, jusqu' ce qu'un certain maximum soit atteint, aprs quoi il diminue de nouveau.
L'amlioration des procds de culture peut permettre d'employer avec, avantage plus de capital et plus
de travail. La loi s'applique la quantit des produits, et non leur valeur. - 2. Une dose de capital et
de travail. Dose limite, rendement limite, limite de culture. La dose limite n'est pas ncessairement la
dernire dans le temps. Surplus de production ; ses liens avec la rente. Ricardo a born son attention
aux conditions d'un Vieux pays. - 3. Toute apprciation de la fertilit du sol doit s'appliquer un lieu
et un temps particuliers. - 4. En rgle gnrale les sols plus pauvres augmentent de valeur par
rapport aux sois riches, mesure que la population augmente. - 5. Ricardo disait que les sols les plus
riches ont t cultivs les premiers ; c'est vrai dans le sens o il le disait. Mais il a t mal compris par
Carey qui runit des exemples de pionniers ayant nglig des sols qui ont ensuite pris une grande
valeur. - 6. Ricardo n'a pourtant pas estim assez haut les avantages indirects qu'une population
dense offre l'agriculture. - 7. Lois de rendement de la pche, des mines et des terrains btir. - 8.
Note sur l'origine de la loi et sur le sens de la phrase une dose de capital et de travail
Chapitre IV : Le progrs de la population
1, 2. Histoire de la thorie de la population. - 3. Malthus. - 4, 5. Causes qui dterminent le taux
de nuptialit et celui de natalit. - 6, 7. Histoire de la population en Angleterre. - 8. Note sur les
statistiques dmographiques internationales
Chapitre V : Sant et vigueur de la population
1, 2. Conditions gnrales dont dpendent la sant et la vigueur. - 3. Objets ncessaires
l'existence. - 4. Esprance, libert et changement. - 5. Influence des occupations. - 6. Influence de
la vie des villes. - 7, 8. La nature laisse elle-mme tend liminer les faibles. Mais une foule
d'interventions humaines, inspires par de bons sentiments, font obstacle au succs des forts, et
permettent aux faibles de vivre. Conclusion pratique.
Chapitre VI : ducation industrielle
1, 2. L'expression de travail qualifi n'a qu'une porte relative. Il arrive souvent qu'une tche
avec laquelle nous sommes familiariss ne nous paraisse pas difficile. L'habilet purement manuelle est
en train de perdre de l'importance par rapport l'intelligence gnrale et l'nergie de caractre.
Habilet gnrale et habilet spcialise. - 3-5. Instruction librale et instruction technique.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
Apprentissage. - 6. Instruction en matire d'art. - 7. Mill pensait que les classes travailleuses sont
divises en quatre catgories bien marques ; mais toutes les divisions accuses comme celles-ci
tendent disparatre
Chapitre VII : Le progrs de la richesse
1-3. Jusqu' il y a peu de temps on faisait peu d'usage des formes Coteuses de capital auxiliaire ;
mais leur emploi augmente rapidement, comme aussi le pouvoir d'accumulation du capital. - 4. La
scurit en tant que condition de l'pargne. - 5. Le dveloppement de l'conomie monnaie fait natre
de nouvelles occasions de dpenses extravagantes, mais il a permis des gens qui n'avaient pas le
moyen d'entrer dans les affaires, de tirer parti de leurs pargnes. - 6. La principale cause de l'pargne
se trouve dans les affections de famille. - 7. Sources de l'accumulation des capitaux. Accumulation
publique. Coopration. - 8. Choix entre plaisirs prsents et plaisirs diffrs. Toute accumulation
implique une certaine attente, un certain ajournement de satisfactions. L'intrt est la rmunration de
cette attente. - 9, 10. Plus la rmunration est leve, et plus, en rgle gnrale, le taux de l'pargne
sera grand. Mais il y a des exceptions. - 11. Note sur les statistiques relatives au progrs de la
richesse
Chapitre VIII : Organisation industrielle
1, 2. L'ide que l'organisation du travail augmente son rendement est ancienne, mais Adam Smith
lui a donn une porte nouvelle. conomistes et biologistes ont travaill ensemble examiner
l'influence que la lutte pour l'existence exerce sur l'organisation ; ses caractres les plus durs sont
adoucis par l'hrdit. - 3. Castes antiques et classes modernes. - 4, 5. Adam Smith se montra
prudent, mais beaucoup de ceux qui l'on suivi ont exagr les conomies que procure l'organisation
naturelle. Dveloppement des facults par l'usage, et leur hrdit par une ducation prcoce et peuttre aussi par d'autres moyens.
Chapitre IX : Organisation industrielle (suite). Division du travail. Influence du machinisme
1. La pratique permet de se perfectionner. - 2. Dans les catgories infrieures de travail, l'extrme
spcialisation augmente le rendement ; mais il n'en est pas ainsi dans les catgories suprieures. - 3.
Les consquences du machinisme sur la qualit de la vie humaine sont en partie bonnes et en partie
mauvaises. - 4. Les machines faites mcaniquement inaugurent l're nouvelle des parties
interchangeables. - 6. Exemple tir de l'imprimerie. - 6. Le machinisme diminue la fatigue des
muscles pour l'homme, et par l empche la monotonie du travail de crer la monotonie de la vie. - 7.
Comparaison entre la main-d'uvre spcialise et les machines spcialises. conomies externes et
conomies internes.
Chapitre X : Organisation industrielle (suite). Concentration d'industries spcialises dans certaines
localits
1. Industries localises : leurs formes primitives. - 2. Leurs diverses origines. - 3. Leurs
avantages ; habilet hrditaire; naissance d'industries subsidiaires; emploi d'instruments trs
spcialiss ; march local pour la main-d'uvre spcialise. - 4. Influence de l'amlioration des
moyens de communication sur la distribution gographique des industries. Exemples tirs de l'histoire
rcente de l'Angleterre
Chapitre XI : Organisation industrielle (suite). Production en grand
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
1. Les industries typiques pour ce sujet sont les industries manufacturires. conomie de matires
premires. - 2-4. Avantages d'une grande entreprise au point de vue de l'emploi et de l'amlioration
des machines spcialises ; au point de vue de l'achat et de la vente; au point de vue de la maind'uvre spcialise; et au point de vue de la division du travail de direction. Supriorit du petit
industriel pour la surveillance. Le progrs moderne des connaissances agit en grande partie en sa
faveur. - 5. Dans les branches o la production en grand ralise de grandes conomies, une entreprise
peut grandir rapidement, la condition de pouvoir vendre aisment ; mais souvent cette condition n'est
pas remplie. - 6. Grandes et petites entreprises commerciales. - 7. Entreprises de transport. Mines et
carrires.
Chapitre XII : Organisation industrielle (suite). Direction des entreprises
1. L'artisan d'autrefois traitait directement avec le consommateur ; et c'est encore ainsi qu'oprent en
rgle gnrale les professions librales. - 2. Mais dans la plupart des branches intervient une classe
spciale d'hommes appels entrepreneurs. - 3, 4. Les principaux risques de l'entreprise sont parfois
spars du travail de direction en dtail, dans l'industrie du btiment et dans quelques autres.
L'entrepreneur qui n'est pas employeur. - 5. Les qualits que doit avoir l'industriel idal. - 6. Le fils
d'un homme d'affaires dbute avec tant d'avantages, que l'on pourrait s'attendre voir les hommes
d'affaires former comme une classe part ; raison qui empchent ce rsultat de se produire. - 7.
Socits de personnes. - 8, 9. Socits anonymes. Entreprises des autorits publiques. - 10.
Association cooprative. Participation aux bnfices. - 11. Chances qu'a l'ouvrier de s'lever. Son
manque de capital est un obstacle moins considrable qu'il ne semble premire vue, car la masse de
capitaux prter augmente rapidement. Mais la complexit croissante des affaires est contre lui. - 42.
Un homme d'affaires capable russit vite augmenter le capital dont il dispose ; et celui qui est
incapable perd gnralement son capital d'autant plus vite que son affaire est plus importante. Ces deux
forces tendent faire parvenir le capital entre les mains de ceux qui sont mme de bien l'utiliser.
L'aptitude aux affaires accompagne du capital ncessaire a, dans un pays comme l'Angleterre, un prix
d'offre assez bien dfini.
Chapitre XIII : Conclusion. La tendance au rendement croissant et la tendance au rendement
dcroissant
1. Rsum des derniers chapitres de ce livre. - 2. Le cot de production doit tre envisag en se
rfrant une maison type, bnficiant d'une faon normale des conomies internes et externes qui
accompagnent un volume total de production donn. Lois du rendement constant et du rendement
croissant. - 3. Une augmentation de population est gnralement accompagne d'un accroissement
plus que proportionnel de la puissance collective de production.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
10
Alfred Marshall, Principes dconomie politique
Avertissement
Retour la table des matires
La traduction ici reproduite est celle de 1906-1909, publie aux ditions Giard et
Brire. Cependant, il nous a paru ncessaire de couper quelques rares passages qui
n'apportent, notre sens, rien l'intelligence d'un ouvrage dj trs touffu. Il s'agit
des chapitres II et III du Livre Premier et des Appendices du dernier. Les titres des
chapitres supprims ont t nanmoins maintenus dans la table des matires ainsi que
les notes en bas de page, renvoyant ces chapitres.
Premire dition : V. Giard et E. Brire, Paris 1906
Paris - Londres - New York, Gordon & Breach, Librairie de Droit et de
Jurisprudence et Gordon & Breach 1971
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
11
Alfred Marshall, Principes dconomie politique
Prface de la premire
dition, juillet 1890
Retour la table des matires
Les conditions conomiques changent constamment, et chaque gnration envisage les problmes de son temps d'une faon qui lui est propre. En Angleterre, ainsi
que sur le Continent et en Amrique, on poursuit l'heure actuelle les tudes
conomiques avec plus d'ardeur que jamais ; mais toute cette activit a simplement
montr, de la faon la plus claire, que la science conomique est, et doit tre, d'un
dveloppement lent et continu. En considrant l'uvre de la gnration actuelle on
pouvait croire, tout d'abord, qu'une partie de ce qu'elle a de meilleur se trouvait en
antagonisme avec l'uvre des anciens conomistes ; mais lorsqu'il se fut coul assez
de temps pour qu'elle ft mise sa vraie place, et pour que ses angles brusques aient
t mousse, on s'aperut qu'elle ne crait pas de vritable solution de continuit
dans le dveloppement de la science. Les nouvelles thories ont complt les anciennes, elles les ont tendues, dveloppes, et parfois corriges ; elles leur ont donn
souvent un autre aspect en insistant d'une faon diffrente sur les divers points ; mais
elles les ont trs rarement renverses.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
12
Le prsent ouvrage est une tentative faite pour prsenter dans une forme moderne
les vieilles thories, en s'aidant de l'uvre nouvelle qu'a produite notre poque, et en
se rfrant aux problmes nouveaux qui sy posent. Son but gnral est indiqu dans
le Livre I ; la fin de ce Livre est donn un bref aperu des principaux objets des
recherches conomiques, et des principaux rsultats pratiques auxquels ces recherches
aboutissent. Conformment aux traditions anglaises, il y est entendu que le rle de la
science est de runir, de grouper et d'analyser les faits conomiques et d'utiliser les
connaissances, tires ainsi de l'observation et de l'exprience, pour dterminer ce que
doivent tre les effets immdiats et les effets postrieurs des divers groupes de
causes ; il est entendu aussi que les lois conomiques expriment des tendances formules dans le mode indicatif, et non des prceptes thiques dans le mode impratif.
Les lois et les raisonnements conomiques constituent simplement une partie des
matriaux, que la conscience et le sens commun ont utiliser, pour rsoudre les
problmes pratiques, et pour tablir les rgles qui peuvent servir de guide dans la vie.
Mais les forces thiques sont au nombre de celles dont les conomistes ont tenir
compte. On a bien, il est vrai, fait des efforts pour construire une science abstraite en
considrant les actions d'un homme conomique , qui ne serait soumis aucune
influence thique, et qui rechercherait son avantage pcuniaire avec sagesse et
nergie, mais mcaniquement et gostement. Ces efforts n'ont pas russi ; ils n'ont
mme pas t pousss compltement, car jamais on n'a considr l'homme conomique comme parfaitement goste. Personne ne sait, mieux que l'homme conomique, endurer la peine et la privation, dans le but non goste de pourvoir aux besoins
de sa famille ; on a toujours tacitement admis que les motifs qui normalement le
guident, comprennent les affections de famille. S'il en est ainsi, pourquoi n'y
comprendrait-on pas aussi d'autres motifs altruistes, dont l'action est assez uniforme
dans une mme classe, une mme poque, et dans le mme lieu, pour qu'on puisse
les ramener une rgle gnrale? Il ne semble pas y avoir de bonne raison pour les
exclure. Aussi, dans le prsent ouvrage, nous considrons comme action normale
celle que l'on peut attendre, dans certaines conditions, des membres d'un groupe
industriel ; parmi les motifs dont J'action est rgulire, aucun n'a t exclu pour cette
raison qu'il serait altruiste. Si l'ouvrage a quelque caractre spcial, on peut peut-tre
dire qu'il se trouve dans l'importance qui y est donne cette application, ainsi qu'
d'autres, du principe de continuit.
Il n'y est pas seulement appliqu la qualit thique des motifs par lesquels un
homme peut tre guid dans le choix des fins qu'il poursuit, mais aussi la sagacit,
l'nergie et la hardiesse avec laquelle il les poursuit. C'est ainsi que nous insistons
sur le fait qu'il existe une gradation continue depuis les actes d'un homme d'affaires,
bass sur des calculs rflchis et d'une porte lointaine, et excuts avec vigueur et
habilet, jusqu' ceux des gens ordinaires qui n'ont ni le pouvoir, ni la volont, de
diriger leurs intrts la manire des hommes d'affaires. Avoir une disposition
normale l'pargne, une disposition normale supporter une certaine peine pour une
certaine rmunration pcuniaire, ou une aptitude normale chercher les marchs les
meilleurs pour acheter et pour vendre, ou chercher l'occupation la plus avantageuse
pour soi-mme ou pour un de ses enfants : - toutes ces phrases, et d'autres semblables,
ont besoin de se rfrer aux membres d'une classe particulire de gens, dans un lieu et
dans un temps donns. Mais, une fois cela entendu, la thorie de la valeur normale est
applicable aux actes de gens vivant en dehors des affaires, tout aussi bien, quoique
avec une moindre prcision de dtail, qu' ceux du marchand ou du banquier.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
13
De mme qu'il n'y a pas de ligne bien marque de division entre une conduite qui
est normale et celle qui doit tre provisoirement nglige comme anormale, de mme
il n'y en a pas non plus entre les valeurs normales d'une part, et, d'autre part, les
valeurs courantes , ou de march , ou occasionnelles P. Ces dernires sont les
valeurs sur lesquelles les accidents du moment exercent une influence prpondrante ;
alors que les valeurs normales sont celles qui seraient en dfinitive ralises, si les
conditions conomiques considres avaient le temps de produire leur complet effet
sans tre troubles. Mais il n'y a pas d'abme infranchissable entre elles ; il y a une
gradation continue des unes aux autres. Les valeurs que nous pouvons regarder
comme normales, si nous pensons aux changements qui se produisent d'heure en
heure dans une bourse des marchandises, sont seulement des valeurs courantes si l'on
considre toute une anne : et des valeurs qui sont normales lorsqu'on envisage le
cours d'une anne, ne sont que des valeurs courantes si l'on considre l'histoire d'un
sicle. Car l'lment de temps, qui est le centre des principales difficults de presque
tous les problmes conomiques, est lui-mme continu : la Nature ne connat pas de
division absolue entre longues priodes de temps et priodes courtes ; mais on passe
des unes aux autres par des degrs imperceptibles, et ce qui est une priode courte
pour un problme, se trouve tre une priode longue pour un autre.
C'est ainsi, par exemple, que la plus grande partie de la distinction, mais non pas,
cependant, toute la distinction, entre la rente et l'intrt du capital, repose sur la
longueur de la priode que nous avons en vue. Ce qui est lgitimement considr
comme un intrt pour un capital libre ou flottant , ou pour des capitaux
nouvellement placs, gagne tre trait comme une sorte de rente - une quasi-rente,
dirons-nous ci-dessous - pour des capitaux placs depuis longtemps. De mme il n'y a
pas de ligne nette de dmarcation entre des capitaux flottants et des capitaux qui ont
t immobiliss dans une branche particulire de production, ni entre capitaux nouvellement placs et capitaux placs depuis longtemps ; on passe d'un groupe l'autre
graduellement. De mme encore la rente du sol ne se prsente pas comme une chose
distincte par elle-mme, mais comme l'espce principale d'un genre tendu ; quoique
elle prsente, il est vrai, des particularits propres qui sont, en thorie, comme dans la
pratique, d'une importance vitale.
De mme, quoiqu'il y ait une ligne bien nette de sparation entre l'homme luimme et les instruments dont il se sert, et quoique l'offre et la demande de travail
humain, avec les efforts et les sacrifices que celui-ci exige, offrent des particularits
qui leur soient propres et que ne prsentent pas l'offre et la demande des biens
matriels : nanmoins, aprs tout, ces biens matriels sont eux-mmes gnralement
le rsultat du travail de l'homme; la thorie de la valeur du travail, et celle de la valeur
des choses faites par lui, ne peuvent pas tre spares : elles sont les parties d'un tout,
et, bien que les diffrences qui existent entre elles pour les dtails soient grandes,
elles se ramnent pour la plupart, lorsqu'on les examine, des diffrences de degr,
plutt que de nature. De mme que, en dpit des grandes diffrences de forme entre
les oiseaux et les quadrupdes, une ide fondamentale se retrouve travers toutes
leurs formes : de mme, la thorie gnrale de l'quilibre de la demande et de l'offre
est une ide fondamentale, qui se retrouve travers les diverses parties du problme
central de la Distribution et de l'change 1.
1
Dans l'ouvrage Economics of Industry publi par ma femme et par moi en 1879, nous avoue tent
de montrer la nature de cette unit fondamentale. Nous y donnions, avant la thorie de la
distribution, un bref aperu provisoire des relations de l'offre et de la demande ; puis le mme
procd de raisonnement gnral y tait appliqu successivement la rmunration du travail,
l'intrt du capital et au profit de l'entrepreneur. Mais l'ide gnrale de ce plan n'y avait pas t
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
14
Une autre application du principe de continuit est celle qui concerne l'emploi des
termes. On a toujours t tent de classer les biens conomiques en des groupes nettement dfinis, l'gard desquels un certain nombre de propositions brves et tranchantes puissent tre exprimes, afin de satisfaire la fois le besoin que les tudiants
ont d'une prcision logique, et la faveur que la masse montre aux dogmes qui ont l'air
d'tre profonds, tout en tant pourtant d'un maniement ais. Mais il semble qu'on ait
eu tort de cder cette tentation, et de tracer des lignes artificielles de dmarcation l
o la Nature n'en avait marqu aucune. Plus une thorie conomique est simple et
absolue, plus est grande la confusion qu'elle entrane lorsqu'on essaye de l'appliquer
la pratique, si les divisions auxquelles elle se rfre ne se trouvent pas dans la vie
relle. Il n'y a pas dans la ralit de division nette entre les choses qui sont et celles
qui ne sont pas des capitaux, ni entre les choses ncessaires la vie et celles qui ne le
sont pas, ni encore entre un travail productif et celui qui ne l'est pas.
La notion de continuit en ce qui concerne l'volution est commune toutes les
coles conomiques modernes, qu'elles subissent surtout l'influence de la biologie,
la suite d'Herbert Spencer, ou celle de l'histoire et de la philosophie, que l'on trouve
dans la Philosophie de l'Histoire de Hegel et dans les tudes thico-historiques parues
rcemment sur le continent et ailleurs. Ce sont les deux influences qui ont agi, plus
que toute autre, sur le fonds des ides exprimes dans cet ouvrage ; mais, quant leur
forme, ces ides ont t surtout influences par la conception mathmatique de l'ide
de continuit telle qu'elle se trouve dans l'ouvrage de Cournot, Principes mathmatiques de la thorie des richesses. Il a enseign qu'il est ncessaire de se mettre en face
de la difficult que nous avons considrer les divers lments d'un problme conomique comme n'tant pas dtermins l'un par l'autre dans une chane de causation, A
dterminant B, B dterminant C, et ainsi de suite, mais comme se dterminant tous
mutuellement les uns les autres. L'action de la nature est complexe ; on ne gagne
finalement rien prtendre qu'elle soit simple, et tenter de la dcrire dans une srie
de propositions lmentaires.
Sous l'influence de Cournot, et, un moindre degr, de de Thnen, j'ai t amen
attacher une grande importance ce fait que nos observations de la nature, dans le
monde moral, comme dans le monde physique, portent bien moins sur des quantits
totales (agregate quantities), que sur des variations de quantits (increments of
quantities), et que, en particulier, la demande d'une chose est une fonction continue,
dont la diffrentielle limite (increment marginal) 1, en supposant une position
d'quilibre stable, est gale la diffrentielle (increment) correspondante du cot de
production de cette chose. Il n'est pas facile d'arriver une ide claire et complte de
la continuit ce point de vue sans l'aide des mathmatiques, ou des diagrammes.
L'emploi de ces derniers n'exige pas de connaissances spciales, et ils expriment
indique assez clairement ; sur le conseil du professeur Nicholson, j'ai insist davantage sur elle
dans le prsent ouvrage.
L'expression de diffrentielle limite (increment marginal ) est en harmonie avec les
mthodes de pense de de Thnen et m'a t suggre par lui, quoiqu'il ne s'en serve pas en ralit.
Elle a t, depuis quelque temps, employe couramment par les conomistes autrichiens, sur
l'initiative du professeur Wieser, et elle a t adopte par M. Wicksteed. Lorsque l'ouvrage de
Jevons parut, j'adoptai son mot final : mais j'ai t peu peu convaincu que marginal est
meilleur.
Dans la premire dition, cette note impliquait tort que l'on trouve dans de Thnen la trace
de l'expression, aussi bien que de l'ide de increment marginal.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
15
souvent les conditions de la vie conomique plus exactement, comme aussi plus
aisment, que ne le font les sciences mathmatiques ; aussi ont-ils t employs comme moyens supplmentaires d'illustration dans les notes de cet ouvrage. Les
dmonstrations du texte ne reposent jamais sur eux, et ils peuvent tre ngligs ; mais
l'exprience semble montrer qu'ils permettent de saisir plusieurs principes importants
mieux qu'on ne peut le faire autrement.
La principale utilit des mathmatiques pures dans les questions conomiques
semble tre d'aider les gens noter rapidement, brivement et exactement, leurs
penses pour leur propre usage ; ainsi que de leur donner la certitude qu'ils ont assez,
et pas trop, de prmisses pour leurs conclusions (c'est--dire que leurs quations sont
en nombre ni plus, ni moins grand que leurs inconnues). Mais lorsqu'il faut employer
beaucoup de signes, cela devient trs pnible pour tout autre que pour l'auteur luimme. Le gnie de Cournot insuffle une nouvelle activit intellectuelle tout homme
qui entre en contact avec lui, et les mathmaticiens de sa force peuvent, en employant
leurs armes favorites, se diriger jusqu'au centre de quelques-uns des plus difficiles
problmes de la thorie conomique, dont les bords seuls ont t jusqu' prsent
effleurs ; pourtant on peut se demander si c'est pour un lecteur un bon emploi de son
temps que de lire d'interminables transcriptions de thories conomiques en calculs
mathmatiques qui n'ont pas t faits par lui. Quelques-unes des applications du
langage mathmatique, qui m'ont paru les plus utiles pour mon usage personnel, ont
t nanmoins ajoutes, titre d'exemples, dans un appendice 1.
J'ai exprimer ma reconnaissance pour l'aide que plusieurs Personnes m'ont
donne dans la prparation de ce volume pour l'impression. Ma femme m'a aid et
conseill tout instant pour le manuscrit et pour les preuves, et je dois beaucoup
ses indications, sa sollicitude et son jugement. M. 3. N. Keynes et M. L. L. Price
ont lu toutes les preuves, et ne me les ont jamais renvoyes sans les avoir beaucoup
1
Beaucoup des diagrammes de cet ouvrage ont dj t imprims, et je saisis cette occasion pour
donner leur histoire. M. Henry Cunningham, qui suivait mes cours en 1873, me voyant ennuy de
ne pouvoir dessiner une srie d'hyperboles rectangulaires, inventa pour cela un bel et original
instrument. Il fut prsent la Cambridge Philosophical Society en 1873, et, pour expliquer son
emploi, je lus une tude (rsume dans les comptes rendus, partie XV, pp. 318-199) dans laquelle
je dcrivais, peu prs comme je le fais ci-dessous, livre V, chap. V et VIII (chap. XI et XIII de la
quatrime dition), la thorie des diverses positions que prennent les valeurs d'quilibre et les
valeurs de monopole. Pendant les annes 1875-1877, je menai presque bonne fin le projet d'un
trait sur The Theory of Foreign Trade, with some allied problems relating to the doctrine of
Laissez-Faire (De la thorie du commerce tranger, et de quelques problmes voisins touchant la
doctrine du Laissez faire ). La premire partie de ce trait s'adressait tous les lecteurs, tandis
que la seconde avait un caractre technique ; presque tous les diagrammes qui sont maintenant au
livre V, ch. V, VII et VIII (ch. XI, XII, XIII de la quatrime dition) sy trouvaient, rattachs au
problme des effets de la protection douanire sur le maximum de satisfaction sociale ; il y en
avait d'autres, relatifs au commerce tranger, Mais, en 1877, je me mis travailler mon ouvrage
Economics of Industry ; ensuite je fus atteint d'une maladie qui a presque interrompu mes tudes
pendant plusieurs annes. Pendant ce temps, le manuscrit du premier trait, que j'avais eu en vue,
restait inemploy. C'est de lui que parle le professeur Sidgwick dans la prface de son livre
Political Economy. Avec mon consentement, il choisit quatre chapitres (ne se suivant pas) de la
seconde partie, et les imprima pour tre distribus sans tre mie dans le commerce. Ces quatre
chapitres contenaient la plus grande partie de la substance du livre V, ch. V et VII, mais non du ch.
VIII (ch. XI et XII, mais non ch. XIII de la quatrime dition) du prsent ouvrage, et en outre deux
chapitres traitant de l'quilibre du commerce tranger. Ils ont t envoys beaucoup
d'conomistes en Angleterre et sur le Continent : c'est d'eux que Jevons parle dans la prface la
seconde dition de sa Theory (p. XLV) ; plusieurs de leurs diagrammes sur le commerce tranger
ont t reproduits, avec d'aimables remerciements, par le professeur Pautaleoni dans ses Principii
di Economia Pura (rcemment traduits en anglais).
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
16
corriges ; M. Arthur Berry et M. A. W. Flux m'ont t d'un grand secours pour
l'appendice mathmatique; enfin mon pre, M. W. H. B. Hall et M. C. J. Clay m'ont
aid sur quelques points particuliers.
Juillet 1890.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
17
Alfred Marshall, Principes dconomie politique
Extrait de la prface
e
de la 4 dition,
septembre 1898
Retour la table des matires
Les changements apports cette dition sont de peu d'importance...
L'emploi frquent de la phrase quilibre de la demande et de l'offre , dans les
livres V et VI, a fait croire certains lecteurs que les problmes conomiques sont
traits dans cet ouvrage d'aprs la mthode de la mcanique. Il est vrai que leurs
analogies avec la mcanique sont bien plus simples que celles qu'ils offrent avec la
biologie, aussi rendent-elles plus de services aux premiers chelons de l'analyse
conomique. Mais l'introduction historique et les discussions que contient le livre 1er
sur l'objet et la mthode de notre science, ont eu principalement pour but d'insister sur
le caractre essentiellement organique des grands problmes dont nous cherchons
nous approcher. La mme ide se retrouve dans beaucoup de passages du livre IV, et
mme dans quelques-uns des livres V et VI ; quelques passages nouveaux ont t
ajouts cette dition pour insister davantage encore sur elle...
Bailliol Croft, Cambridge,
Septembre 1898.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
18
Alfred Marshall, Principes dconomie politique
Note du traducteur
Retour la table des matires
L'ouvrage que nous prsentons au public franais porte en anglais le titre de
Principles of Economics. M. Alfred Marshall n'en a encore publi que le premier
volume. Il a eu quatre ditions : 1890, 1891, 1895, 1898. La traduction franaise est
faite sur le texte de la quatrime dition, en tenant compte d'un grand nombre de
corrections manuscrites, qui ont t envoyes par l'auteur ; elle comprendra deux
tomes.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
Alfred Marshall
Principes d'conomie politique
Tome premier
Retour la table des matires
19
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
Alfred Marshall, Principes dconomie politique : tome I
Livre premier
Aperu prliminaire.
Retour la table des matires
20
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
21
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre I : aperu prliminaire
Chapitre premier
Introduction
Retour la table des matires
1. - L'conomie politique ou conomique est une tude de l'humanit dans les
affaires ordinaires de la vie ; elle examine la partie de la vie individuelle et sociale qui
a plus particulirement trait l'acquisition et l'usage des choses matrielles
ncessaires au bien-tre.
Elle est donc, d'un ct, une tude de la richesse ; de l'autre, et c'est le plus important, elle est une partie de l'tude de l'homme. Car le caractre de l'homme a t
moul par son travail de chaque jour et par les ressources matrielles qu'il en tire, plus
que par toute autre influence, si ce n'est celle des idals religieux; et les deux grands
facteurs de l'histoire du monde ont t le facteur religieux et le facteur conomique.
et l l'ardeur de l'esprit militaire ou de l'esprit artistique ont, pendant quelque
temps, prdomin : mais les influences religieuses et les influences conomiques
n'ont jamais, mme momentanment, cess de figurer au premier rang ; elles ont presque toujours t plus importantes que toutes les autres influences ensemble. Les
mobiles religieux sont plus intenses que les mobiles conomiques ; mais leur action
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
22
directe s'tend rarement sur une aussi grande partie de la vie. Le travail par lequel une
personne gagne son pain remplit en effet sa pense pendant les heures o son esprit a
le plus d'activit ; c'est alors que le caractre de chacun se forme d'aprs la faon dont
il utilise ses facults dans son travail, d'aprs les penses et les sentiments que ce
travail lui suggre, et d'aprs les relations qu'il a avec ceux qui y sont associs, par
lesquels il est employ ou qu'il emploie.
Trs souvent l'influence exerce sur le caractre d'une personne par le montant de
son revenu est peine moindre, si mme elle l'est, que l'influence exerce par la faon
dont elle le gagne. Il peut y avoir une mdiocre diffrence au point de vue de la
plnitude de vie (fulness of life) entre une famille dont le revenu annuel est de 1.000
et une famille o il est de 5.000 ; mais la diffrence est trs grande suivant que le
revenu est de 30 ou de 150 : car avec 150 une famille possde, et avec 30 elle
ne possde pas les conditions matrielles ncessaires une vie complte.
Il est vrai que dans la religion, dans les affections de famille et dans l'amiti, le
pauvre lui-mme peut trouver un but pour beaucoup de facults qui sont la source du
bonheur le plus lev. Mais les conditions de vie qui entourent l'extrme pauvret,
surtout dans les lieux o la population est dense, tendent affaiblir les facults les
plus hautes. Ceux qui ont t appels le rsidu de nos grandes villes sont peu
mme de connatre l'amiti ; ils ignorent les charmes et la paix de la vie de famille ;
ils connaissent trs peu son union mme ; et la religion bien souvent n'arrive pas les
atteindre. Sans doute leur fcheux tat physique, intellectuel et moral, est en partie d
d'autres causes qu' la pauvret ; mais celle-ci en est la cause principale.
Et ct de ce rsidu, il y a un nombre immense de gens, soit dans les villes, soit
la campagne, qui n'ont qu'une nourriture, des vtements et des logements insuffisants ; dont l'instruction est arrte de bonne heure pour qu'ils puissent se mettre
travailler et gagner quelque salaire; qui sont occups pendant de longues heures
peiner jusqu' l'puisement avec des corps imparfaitement nourris, et qui n'ont ainsi
aucune chance de pouvoir dvelopper en eux les plus hautes facults de l'esprit. Leur
existence n'est sans doute pas ncessairement malsaine ni malheureuse. Rconforts
par leur amour pour Dieu et pour les hommes, dous peut-tre mme d'une dlicatesse
naturelle de sentiments, ils peuvent mener une existence bien moins incomplte que
celle de beaucoup d'hommes qui jouissent de plus de bien-tre matriel. Cependant,
cause de tout cela, leur pauvret est pour eux un grand mal et presque sans compensation. Alors mme qu'ils sont bien portants, leur fatigue va souvent jusqu' la
souffrance, tandis que leurs plaisirs sont peu nombreux ; et lorsque la maladie
survient, les maux causs par la pauvret sont alors dcupls. Si un esprit port la
rsignation peut beaucoup pour leur faire accepter ces maux, il est d'autres maux pour
lesquels il ne saurait en tre ainsi. Excds de travail et insuffisamment instruits, las
et accabls de soucis, sans repos et sans loisir, ils n'ont aucune chance de tirer parti de
leurs facults.
Ainsi donc, quoique quelques-uns des maux qui accompagnent ordinairement la
pauvret ne soient pas ses consquences ncessaires; pourtant, dans un sens large, il
est vrai de dire que ;le malheur des pauvres est dans leur pauvret . tudier les
causes de la pauvret c'est donc tudier les causes de la dchance dont souffre une
grande partie de l'humanit.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
23
Retour la table des matires
2. - Aristote regardait l'esclavage comme tant voulu par la nature ; et les
esclaves pensaient probablement de mme dans l'antiquit. La dignit de l'homme fut
proclame par la religion chrtienne ; elle a t affirme avec, une force croissante
pendant les cent dernires annes, mais c'est seulement la suite du progrs de
l'ducation dans ces derniers temps que nous avons enfin commenc sentir l'entire
importance de cette ide. Nous nous mettons enfin srieusement rechercher s'il est
ncessaire qu'il existe des basses classes : c'est--dire s'il est ncessaire qu'un
grand nombre d'hommes soient condamns depuis leur naissance un travail pnible
dans le but de procurer d'autres les choses ncessaires une vie raffine et cultive,
pendant qu'eux-mmes sont empchs par leur pauvret et par leur labeur de prendre
leur part de ces raffinements et de cette culture.
L'espoir que la pauvret et l'ignorance puissent graduellement disparatre, trouve
certes un grand appui dans les constants progrs des classes ouvrires au cours du
sicle actuel. La machine vapeur a dcharg les ouvriers de beaucoup de travaux
puisants et dgradants ; les salaires ont hauss ; l'instruction s'est dveloppe et
devient plus gnrale ; les chemins de fer et l'imprimerie ont permis aux membres du
mme mtier, disperss sur les diffrents points du pays, de communiquer aisment
ensemble, de former et d'excuter des plans d'action tendus et portant loin ; en mme
temps, la demande croissante de travailleurs intelligents a si rapidement fait augmenter le nombre des ouvriers qualifis, que leur nombre dpasse maintenant celui des
ouvriers non-qualifis. Un grand nombre d'ouvriers qualifis ont cess d'appartenir
aux basses classes , dans le sens o cette expression tait employe tout d'abord ;
et quelques-uns d'entre eux mnent dj une vie plus raffine et plus noble que celle
de la plupart des gens, des hautes classes eux-mmes il y a cent ans.
Ce progrs a contribu plus que toute autre chose donner un intrt pratique la
question de savoir s'il est rellement impossible que tous les hommes puissent venir
au monde avec chance de mener une existence cultive, l'abri des souffrances de la
pauvret et de l'influence dprimante qu'exerce un travail mcanique excessif. Cette
question est au premier plan parmi les proccupations de plus en plus graves de notre
poque.
La science conomique ne peut pas y rpondre compltement ; car la rponse
dpend en partie des capacits morales et politiques de la nature humaine ; et, en ces
matires, l'conomiste n'a pas de lumires particulires ; il doit faire comme les
autres, et deviner du mieux qu'il peut. Mais la rponse dpend dans une grande
mesure de faits et d'inductions qui sont du domaine de l'conomique ; et c'est l ce qui
donne aux tudes conomiques leur principal et leur plus haut intrt.
Retour la table des matires
3. - On pourrait penser qu'une science, qui traite de questions si vitales pour le
bien-tre de l'humanit, a d attirer toute poque l'attention des meilleurs penseurs,
et qu'elle est maintenant bien pi-s de la maturit. Mais le fait est que le nombre des
conomistes scientifiques a toujours t petit relativement aux difficults de l'uvre
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
24
accomplir ; et la science conomique est encore presque son enfance. Une des
causes de ce fait est que l'on n'a pas toujours compris l'intrt que prsente l'conomique pour le bien-tre de l'homme au sens le plus noble. Une science qui a pour
objet la richesse, rpugne souvent premire vue beaucoup d'hommes d'tude ; car
ceux qui font le plus avancer la connaissance se soucient gnralement peu de la
possession de la richesse pour elle-mme.
Mais une cause plus importante de ce retard est que beaucoup des conditions de la
vie industrielle, et beaucoup des modes de production, de distribution et de consommation, dont la science conomique moderne s'occupe, ne sont eux-mmes que de
date rcente. Il est vrai que les changements essentiels ne sont pas, certains gards,
aussi grands que les changements survenus dans la forme extrieure ; et qu'une partie,
beaucoup plus grande qu'il ne semble au premier abord, des thories conomiques
modernes, peut s'appliquer aux conditions dans lesquelles vivent les populations
arrires. Mais cette unit essentielle qui se retrouve sous la grande varit des formes
n'est pas aise dcouvrir ; et les changements de forme ont eu cet effet que les
crivains, toute poque, ont moins profit qu'ils ne l'auraient fait sans cela de luvre de leurs prdcesseurs.
Les conditions conomiques de l'poque moderne, quoique plus complexes, sont
bien des gards mieux dfinies que celles des temps plus anciens. Les affaires
(business) sont plus nettement spares du reste ; les droits des individus, soit entre
eux, soit l'gard de la communaut, sont plus nettement prciss ; et, surtout, en se
dbarrassant de l'influence de la coutume, en dveloppant les libres initiatives, l'habitude de regarder constamment en avant et un inlassable esprit d'entreprise, notre
poque a mieux prcis et mieux mis en relief les causes qui rgissent la valeur
relative des diffrentes choses et des diffrentes espces de travail.
Retour la table des matires
4. - On dit souvent que les formes modernes de la vie conomique se distinguent
des formes anciennes en ce que la concurrence y joue un plus grand rle. Mais cette
ide West pas absolument exacte. Ce que signifie strictement la concurrence, c'est,
semble-t-il, la lutte de deux personnes renchrissant l'une sur l'autre pour la vente ou
l'achat d'un objet. Ce genre de lutte est sans doute la fois plus intense et plus rpandu qu'il ne l'tait ; mais il n'est qu'une consquence secondaire, et on peut presque dire
accidentelle, des caractres fondamentaux de la vie industrielle moderne.
Il n'y a pas de mot qui exprime ces caractres d'une faon exacte. Ce sont, comme
nous le verrons tout l'heure : une certaine indpendance et une certaine habitude de
choisir soi-mme sa propre voie, une certaine confiance en soi ; de la rflexion et
pourtant de la promptitude dans les dcisions et dans les jugements, l'habitude de se
proccuper de l'avenir et de se tracer sa vole d'aprs des buts lointains. Ces caractres
peuvent amener et souvent amnent les gens entrer en comptition les uns avec les
autres ; mais, d'un autre ct, ils peuvent tendre, et prcisment l'heure actuelle ils
tendent, dans le sens de la coopration et de la mise en commun d'une foule de
bonnes et de mauvaises fortunes. Ces tendances vers la proprit collective et l'action
collective sont tout fait diffrentes de celles des poques anciennes, parce qu'elles
ne sont pas le rsultat de la coutume, ni d'une inclination passive s'associer avec ses
voisins, mais d'un libre choix par lequel chaque individu a pris cette ligne de conduite
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
25
parce que, aprs mre rflexion, elle lui semble la plus propre lui faire atteindre ses
fins, fins gostes ou fins dsintresses.
Le mot comptition est en mauvaise odeur, et il implique un certain gosme
et une certaine indiffrence pour le bien-tre d'autrui. Il est vrai qu'il y a moins
d'gosme rflchi dans les formes anciennes d'industrie qu'il n'y en a dans les formes
modernes ; mais il y avait aussi moins de dsintressement voulu. C'est la rflexion,
et non pas l'gosme, qui est la caractristique de l'poque moderne.
Par exemple, si la coutume dans une socit primitive tend les limites de la
famille, et prescrit envers les voisins certaines obligations qui tombent en dsutude
dans une civilisation postrieure, elle prescrit aussi une attitude d'hostilit l'gard
des trangers. Dans la socit moderne les obligations qu'imposent les affections de
famille deviennent plus troites, mais elles sont concentres sur une sphre plus
petite ; et les voisins sont mis presque sur le mme pied que les trangers. Les uns et
les autres sont traits avec moins de justice et de loyaut que ne le sont les voisins
chez un peuple primitif, mais avec beaucoup plus de justice et de loyaut que les
trangers. Ainsi ce sont les liens du voisinage seuls qui se sont relchs ; les liens de
famille sont, bien des gards, plus forts qu'autrefois, les affections de famille
inspirent beaucoup plus de sacrifice et plus de dvouement ; et la sympathie pour
ceux qui nous sont trangers est la source de plus en plus importante d'une sorte de
dsintressement voulu qui n'a jamais exist avant l'poque moderne. L'Angleterre est
le pays par excellence de la concurrence, cependant aucun autre ne consacre une aussi
grande partie de son revenu des emplois charitables ; et il a dpens vingt millions
pour donner la libert aux esclaves des Indes occidentales.
A toute poque, des potes et des rformateurs sociaux ont essay, par des contes
enchanteurs sur les vertus des hros d'autrefois, d'enflammer le peuple de leur temps
pour une vie plus noble. Mais ni l'histoire, ni l'observation contemporaine des peuples
arrirs, lorsqu'on les tudie soigneusement, ne viennent l'appui de l'ide que l'homme soit aujourd'hui plus dur et plus mchant qu'autrefois, ou qu'il ait jamais t plus
dispos que maintenant sacrifier son propre bonheur pour la satisfaction des autres
dans des cas o la coutume et la loi l'ont laiss libre de choisir. Chez des peuples dont
les facults intellectuelles semblent ne s'tre dveloppes dans aucune autre direction
et o l'on ne trouve personne possdant la puissance cratrice de l'homme d'affaires
moderne, on voit beaucoup de gens montrer une sagacit perverse exploiter dans un
march leurs voisins eux-mmes. Il n'y a pas de commerants qui soient moins
scrupuleux tirer bnfice des besoins d'un malheureux que les marchands de bl et
les usuriers de l'Orient.
L'poque moderne a sans aucun doute fourni de nouvelles tentations d'tre malhonnte en affaires. Les progrs de la science ont fait dcouvrir de nouvelles faons
de donner aux choses une apparence autre que la ralit ; ils ont rendu possibles
beaucoup de formes nouvelles de falsification. Le producteur est maintenant beaucoup plus loign du dernier consommateur ; et ses mfaits ne reoivent pas le
chtiment svre et prompt qui tombe sur la tte d'une personne oblige de vivre et d
mourir dans le village o elle est ne, lorsqu'elle fait quelque vilain Lotir l'un de ses
voisins. Les occasions de friponnerie sont certainement plus nombreuses qu'elles ne
l'taient ; mais il n'y a pas de raison de penser que les gens profitent de ces occasions
proportionnellement plus qu'ils ne le faisaient autrefois.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
26
Au contraire, les mthodes commerciales modernes impliquent d'un ct des
habitudes de confiance entire et, de l'autre ct, une facult de rsister aux tentations
malhonntes, qui n'existent pas chez un peuple arrir. Des exemples de loyaut
simple et de confiance personnelle se rencontrent dans toutes les civilisations ; mais
ceux qui ont essay de lancer dans des pays arrirs des affaires de type moderne,
constatent qu'ils peuvent rarement compter sur la population indigne pour remplir les
postes de confiance. On y trouve mme plus facilement des hommes pour un travail
demandant une grande habilet et de grandes aptitudes intellectuelles que pour les
travaux exigeant de la moralit et de la fermet dans le caractre. La falsification et la
fraude commerciales dominaient au Moyen Age d'une faon tout fait surprenante, si
nous considrons la difficult qu'il y avait alors de tromper sans tre dcouvert.
Le mot comptition ne convient donc pas bien pour dsigner les caractristiques de la vie industrielle moderne. Nous avons besoin d'un mot qui n'implique
aucune particularit morale, bonne ou mauvaise, mais qui indique le fait incontest
que la vie commerciale et industrielle moderne est caractrise par des habitudes de
plus grande confiance en soi-mme, par plus de prvoyance, par une conduite plus
rflchie et plus libre. Il n'y a pas de mot qui convienne entirement; mais l'expression de Libert de lindustrie et du travail, ou, plus brivement, Libert conomique,
met sur la bonne voie et peut tre employe faute d'une meilleure. Naturellement,
cette rflexion et cette libert dans la conduite de la vie peuvent mener renoncer
partiellement la libert individuelle lorsque la coopration ou l'association semble
tre la meilleure voie pour atteindre le but dsir. La question de savoir dans quelle
mesure ces formes d'association volontairement acceptes peuvent dtruire la libert
dans laquelle elles ont leur source, et la question aussi de savoir dans quelle mesure
elles sont conformes l'intrt gnral, sont des questions qui retiendront beaucoup
notre attention vers la fin de ce trait.
Retour la table des matires
5. - Nous rencontrerons dans cet aperu prliminaire un autre mot dont le sens
est incertain. Le mot valeur, dit Adam Smith, a deux sens diffrents : parfois il
exprime l'utilit d'un objet et, d'autres fois, il exprime le pouvoir d'achat que la
possession de cet objet confre l'gard des autres biens . Mais l'exprience a montr qu'il n'est pas bon d'employer le mot dans le premier sens.
La valeur, c'est--dire la valeur d'change, d'une chose par rapport une autre
dans un lieu et dans un temps donns, est le montant de cette seconde chose que l'on
peut obtenir dans ce lieu et ce moment en change de la premire. Ainsi l'expression
de valeur est relative, et exprime la relation entre deux choses dans un lieu et un
moment particuliers. Les pays civiliss adoptent gnralement l'or, ou l'argent, ou
tous les deux la fois, comme monnaie. Au lieu d'exprimer les valeurs du plomb, de
l'tain, du bois, du bl et d'autres choses, par rapport les unes aux autres, nous les
exprimons d'abord par rapport la monnaie ; et nous donnons le nom de prix la
valeur de chaque chose ainsi exprime 1.
On trouvera esquisses dans les chapitres II et III quelques-unes des transformations les plus importantes qui se sont produites dans le dveloppement de la vie
1
Pour plus ample tude de ce sujet, voir livre II, ch. II, 6.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
27
conomique ; cette esquisse indique l'volution de l'industrie depuis les civilisations
primitives jusqu' notre poque; elle peut ainsi contribuer rendre plus vivantes les
analyses qui suivent. Ce n'est pas un rsum de l'histoire conomique. Pareillement, le
chapitre IV indique le chemin par lequel la pense conomique a pass, particulirement depuis un sicle et demi ; mais il ne touche qu'aux points qui ont quelque
importance pour l'intelligence des ides actuelles. Le but principal de ces trois
chapitres est d'insister sur cette ide que l'conomique est une science de la vie, et
qu'elle est voisine de la biologie plutt que de la mcanique. La mme ide se
retrouve aux chapitres V et VI ; j'y discute brivement le point de vue auquel l'conomique se place pour aborder son sujet; j'y expose son but, ses limites et ses relations
avec d'autres branches d'tude. Ces cinq chapitres sont ainsi une introduction au reste
de l'ouvrage. Mais il est difficile de bien comprendre toute la porte d'une introduction une science si l'on n'est pas dj un peu familiaris avec les matires dont cette
science traite. Les lecteurs qui ne sont pas au courant (mais non les autres) feront
donc bien de renvoyer plus tard la lecture des chapitres Il, III, IV du livre I, ainsi
que celle des chapitres V, 1 et 2, VI, 1-5, et de toutes les notes appartenant
ces chapitres.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
28
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre I : aperu prliminaire
Chapitre quatrime
Le dveloppement de la science
conomique
Retour la table des matires
1. - Nous avons vu que la libert conomique a ses racines dans le pass, mais
qu'elle est surtout le produit d'une poque trs rcente. Il nous faut maintenant retracer le dveloppement parallle qu'a suivi la science conomique. Les conditions
sociales actuelles sont sorties des institutions primitives des peuples aryens et des
peuples smitiques, avec l'aide de la pense grecque et du droit romain ; mais les
spculations conomiques modernes ont trs peu subi l'influence des thories de
l'antiquit.
Il est vrai que la science conomique moderne a son origine, comme les autres
sciences, l'poque o l'tude des crivains classiques commena renatre. Mais un
systme industriel qui tait bas sur l'esclavage, et une philosophie qui mprisait
l'industrie et le commerce, convenaient peu nos hardis bourgeois qui tiraient autant
de fiert de leurs mtiers et de leur commerce que de leur participation au gouvernement de l'tat.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
29
Ces hommes nergiques, mais sans culture, auraient pu tirer un grand profit du
caractre philosophique et de la largeur de vues des grands penseurs de l'antiquit.
Quoi qu'il en soit, ils se mirent chercher eux-mmes la solution des questions de
leur temps; et l'conomie politique moderne prit ainsi son origine, une certaine
rudesse, une certaine troitesse de vue, et une tendance considrer la richesse comme une fin, plutt que comme un moyen, dans la vie humaine. Sa proccupation
immdiate se porta gnralement sur les finances publiques, sur les effets et sur le
rendement des impts. Sur ce point les hommes d'tat des villes libres, tout comme
ceux des grands pays, virent les problmes conomiques devenir plus pressants et
plus difficiles, mesure que le commerce s'tendait et devenait plus dispendieux.
toute poque, mais spcialement dans la premire partie du Moyen Age,
hommes d'tat et marchands ont essay d'enrichir l'tat en rglementant le commerce. Un des principaux objets de leurs proccupations a t la quantit de mtaux
prcieux, qu'ils pensaient tre le meilleur signe, sinon la cause principale, de la
prosprit matrielle, pour un individu comme pour une nation. Mais les voyages de
Vasco de Gama et de Christophe Colomb firent passer les questions commerciales, du
rang secondaire qu'elles occupaient alors, au premier rang chez les nations de
l'Europe occidentale. Les thories relatives l'importance des mtaux prcieux et aux
meilleurs moyens de se les procurer en grande quantit, commencrent dominer la
politique: elles agirent sur la paix et sur la guerre, dterminrent des alliances qui ont
amen le triomphe de certaines nations et la chute de certaines autres et contriburent
fortement provoquer l'migration des peuples sur toute la surface du monde.
Les rglements relatifs au commerce des mtaux prcieux ne furent qu'une partie
d'un vaste ensemble de rglements, qui avaient pour but, avec des degrs divers de
minutie et de rigueur, de dterminer pour chaque individu ce qu'il devait produire et
comment il devait le produire, ce qu'il devait gagner et comment il devait dpenser
son gain. La tnacit naturelle des Germains donna la coutume une force particulire dans la premire partie du Moyen Age. Cette force passa du ct des Corporations, des autorits locales et des gouvernements nationaux, lorsqu'ils se mirent
lutter contre les tendances novatrices que, directement ou indirectement, faisait natre
le commerce avec le Nouveau Monde. En France, ce penchant des Germains subit
l'influence du got que les Latins possdent pour la systmatisation; le gouvernement
paternel y atteignit son apoge. La rglementation du commerce par Colbert a pass
en proverbe. Ce fut prcisment ce moment que la thorie conomique revtit sa
premire forme ; le systme dit mercantile devnt prminent et la rglementation fut
pousse avec une vigueur inconnue jusqu'alors.
Plus tard, une tendance se manifesta dans le sens de la libert, et ceux qui taient
hostiles ces ides nouvelles invoqurent alors l'autorit des mercantilistes des
gnrations prcdentes. Mais l'esprit de rglementation et de restriction qui se trouve
dans leur systme vient de leur poque ; beaucoup des changements qu'ils ont tch
d'introduire taient dans le sens de la libert du travail. Contre ceux, notamment, qui
voulaient prohiber absolument l'exportation des mtaux prcieux, ils soutinrent
qu'elle devait tre permise dans tous les cas o le commerce extrieur doit la longue
faire rentrer plus d'or et d'argent dans le pays qu'il n'en fait sortir.
En soulevant ainsi dans un cas particulier la question de savoir si l'tat n'aurait
pas avantage laisser le marchand diriger ses affaires comme il l'entend, ils ont
involontairement ouvert une voie nouvelle la pense. Celle-ci s'avana ds lors par
pas imperceptibles dans le sens de la libert conomique, aide sur sa route par les
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
30
circonstances, non moins que par la tournure et le caractre qu'avaient cette poque
les esprits dans l'Europe occidentale. Le mouvement alla en s'largissant jusqu' ce
que, dans la dernire moiti du XVIIIe sicle, le temps ft mr pour l'ide que le bientre de la socit a presque toujours souffrir lorsque l'tat cherche par des rglementations artificielles mettre obstacle la libert naturelle que tout homme
possde de diriger ses affaires personnelles comme il l'entend.
Retour la table des matires
2 - La premire tentative systmatique d'difier une science conomique sur une
large base fut faite en France, au milieu du XVIIIe sicle environ, par un groupe
d'hommes d'tat et de philosophes sous la direction de Quesnay, mdecin de Louis
XV et noble esprit 1. La pierre angulaire de leur politique tait l'obissance la
Nature 2.
Ils furent les premiers proclamer la doctrine de la libert du commerce comme
grand principe d'action, allant cet gard plus loin mme que certains crivains
anglais avancs, comme Sir Dudley North. Leur faon d'envisager les questions
politiques et sociales annonait par bien des cts l'poque venir. Ils tombrent
pourtant dans une confusion de pense qui se rencontrait mme chez les hommes de
science leur poque, mais qui, aprs une longue lutte, a t bannie des sciences
physiques. Ils confondirent le principe thique d'obissance la Nature qui s'exprime
dans le mode impratif et prescrit certaines rgles d'action, avec ces lois de causes
que la science dcouvre en interrogeant la Nature et qui sont exprimes dans le mode
indicatif. Pour cette raison et pour d'autres, leur oeuvre n'a que peu de valeur directe.
1
L'Essai sur la nature du commerce de CANTILLON, crit en 1755, et qui touche une foule de
questions, a, il est vrai, quelque droit d'tre qualifi de systmatique. Il est pntrant et certains
gards en avance sur son temps, quoique nous sachions maintenant qu'il a t prcd sur bien des
points importants par Nicolas Barbon qui crivit soixante ans plus tt. Kautz fut le premier
reconnatre l'importance de l'uvre de Cantillon ; et Jevons a dclar qu'il fut le vritable
fondateur de l'conomie politique. On trouvera une quitable apprciation de la place qu'il occupe
en conomie politique dans un article de HIGGS, Quarterly Journal of Economics, vol. I.
Dans les deux sicles prcdents les crivains traitant des questions conomiques avaient
continuellement fait appel la Nature. chacun des adversaires invoquant que son plan tait plus
na. turel que celui des autres ; et les philosophes du XVIIIe sicle, dont quelques-uns exercrent
une grande influence sur l'conomie politique, taient habitus chercher le critrium du vrai dans
la conformit avec la Nature. Locke en particulier a anticip sur l'uvre des conomiques franais
quant leur tendance gnrale faire appel la Nature et pour quelques dtails importants de leur
thorie. Mais Quesnay et les autres conomistes franais qui travaillrent avec lui, furent amens
rechercher les lois naturelles de la vie sociale par diverses causes autres que celles qui agissaient
en Angleterre.
Le luxe de la Cour en France, et les privilges des classes suprieures qui taient en train de
ruiner la France, faisaient voir les pires effets d'une civilisation artificielle, et amenrent les
hommes rflchis dsirer un retour un tat de choses plus naturel. Les juristes, dans lesquels
rsidait la meilleure force intellectuelle et morale du pays, taient pleins de la Loi de Nature qui
avait t dveloppe par les juristes stociens de l'Empire romain, et mesure que le sicle
s'avanait, l'admiration sentimentale pour la vie a naturelle des Indiens d'Amrique, que
Rousseau rpandit, commena exercer son influence sur les conomistes. lis ne tardrent pas
tre appels Physiocrates ou adhrents la rgle de Nature ; ce nom vint du titre du livre de
Dupont de Nemours, Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux
au genre humain, publi en 1768. On peut signaler que leur enthousiasme pour l'agriculture et pour
le caractre naturel et simple de la vie rurale leur venait en partie de leurs matres stociens.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
31
Mais leur influence indirecte sur la situation actuelle de l'conomie politique a t
trs grande. La clart et la forme logique de leurs arguments leur ont permis d'exercer
une grande influence sur la pense postrieure. De plus, le principal motif de leurs
tudes ne fut pas, comme pour la plupart de leurs prdcesseurs, le dsir d'augmenter
les richesses des marchands et de remplir les trsors des rois 1 : ce fut le dsir de
diminuer les souffrances et les dchances causes par une misre extrme. Ils
donnrent ainsi l'conomie politique son but moderne qui est de chercher par la
science contribuer lever le niveau de la vie humaine 2.
Retour la table des matires
3. - Le progrs qui vint ensuite, le plus grand que l'conomique ait jamais fait,
ne fut pas l'uvre d'une cole, mais d'un individu. Adam Smith n'a pas t, il est vrai,
le seul grand conomiste anglais de son poque. Peu de temps avant qu'il crivit,
d'importantes contributions avaient t apportes la thorie conomique par Hume
et par Steuart, et d'excellentes tudes sur les faits conomiques avaient t publies
par Anderson et par Young. Mais l'esprit d'Adam Smith avait assez d'ampleur polir
embrasser tout ce qu'il y avait de meilleur dans les crits de ses contemporains,
franais et anglais. Quoiqu'il ait sans aucun doute emprunt beaucoup aux autres,
pourtant, plus on le compare Ceux qui sont venus avant lui et ceux qui sont venus
aprs, plus la beaut de son gnie apparat grande, sa science tendue et son jugement
bien pondr.
Il sjourna longtemps en France et y entretint des rapports personnels avec les
Physiocrates. Il se livra une tude srieuse de la philosophie anglaise et franaise de
son temps ; et il acquit une connaissance pratique du monde par un grand voyage et
par des relations intimes avec des hommes d'affaires cossais. ces avantages il
ajoutait une puissance d'observation, de jugement et de raisonnement, qui n'a pas t
surpasse. Le rsultat est que partout o il diffre de ses prdcesseurs, il est plus prs
qu'eux de la vrit ; et il y a peu de vrit conomique connue l'heure actuelle dont
il n'ait eu quelque lueur. Comme il fut le premier crire un trait sur la richesse dans
tous ses principaux aspects sociaux, il a pour cette raison seule quelque droit d'tre
regard comme le fondateur de l'conomie politique moderne 3.
1
Le gnreux Vauban lui-mme (il crivait en 1717) eut s'excuser de l'intrt qu'il portait au bientre du peuple, en prtextant que l'enrichir tait le seul moyen d'enrichir le Roi : Pauvres
paysans, pauvre Royaume, pauvre Royaume, pauvre Roi .
Leur expression favorite, laissez faire, laissez aller, est d'ordinaire maintenant dtourne de son
sens. Laissez faire signifie que tout homme doit avoir la permission de produire ce qu'il lui plat et
comme il lui plat; que tous les mtiers doivent tre ouverts tout le monde ; que le gouvernement
ne devrait pas, comme les Colbertistes y tenaient, prescrire aux industriels comment ils doivent
fabriquer leurs draps. Laissez aller ou passer signifie que les personnes et les biens devraient
pouvoir circuler librement d'un lieu un autre, et notamment d'une rgion de la France l'autre,
sans tre soumis des droits, des taxes et des rglements vexatoires. On peut signaler que
laissez aller tait le signal employ au Moyen Age par les Marchaux de camp pour laisser le
champ libre aux combattants dans un tournoi.
Comparer le bref mais srieux expos fait par Wagner des raisons qu'il y a de reconnatre la
suprmatie d'Adam Smith, Grundlegung, 3e dition, pp. 6 et ss. ; voir aussi HASBACH,
Untersuchungen tiber Adam Smith (o l'on remarquera comme particulire aient intressantes des
indications touchant l'influence que les ides hollandaises ont eue sur les Anglais et sur les
Franais) ; et L. L. PRICE, Adam Smith and his Relations to Recent Economics, dans l'Economic
Journal, vol. III. CUNNINGHAM, History, 306, soutient nergiquement que son grand mrite
est d'avoir isol la notion de richesse nationale, alors que les crivains antrieurs l'avaient
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
32
Mais le champ qu'il a dcouvert tait trop vaste pour pouvoir tre entirement
parcouru par un seul homme ; beaucoup de vrits, qu' certains moments il apercevait, d'autres moments lui chappaient. On peut, par suite, citer son autorit en
faveur d'un grand nombre d'ides errones ; bien que, l'examen, on constate toujours
qu'il marche dans le sens de la vrit 1.
Il perfectionna la thorie Physiocratique de la libert du commerce avec une telle
sagesse pratique et une telle connaissance des vritables conditions des affaires, qu'il
lui a donn une grande force dans la vie relle ; et il est surtout connu chez nous et
l'tranger par la dmonstration qu'il a faite de cette ide que l'intervention de l'tat
dans l'industrie et le commerce est fcheuse. Tout en citant beaucoup de cas dans
lesquels l'intrt personnel peut amener l'individu agir d'une faon nuisible pour la
socit, il soutenait que mme lorsque l'tat, agit avec les meilleures intentions, il sert
presque toujours le public plus mal que ne le fait l'initiative individuelle, quelque
goste qu'il puisse lui arriver d'tre. Il a fait une si grande impression sur le monde
par son plaidoyer en faveur de cette ide, que c'est celle que la plupart des crivains
allemands visent surtout lorsqu'ils parlent de Smithianisme 2.
Mais, aprs tout, ce ne fut pas l son oeuvre principale. Elle a t de combiner et
de dvelopper les spculations de ses contemporains et de ses prdcesseurs franais
et anglais relatives la valeur. Son principal droit tre considr comme ayant fait
poque dans la science vient de ce qu'il fut le premier tudier soigneusement et
scientifiquement la manire dont la valeur mesure les mobiles humains, en mesurant
d'une part le dsir des acheteurs d'acqurir les richesses et d'autre part les efforts et les
sacrifices faits par les producteurs (c'est--dire le cot rel de production) 3.
considre en la subordonnant expressment l'ide de puissance nationale : mais chaque face
de cette opposition est indique en traits trop accuss. Cannan dans son Introduction aux Lectures
of Adam Smith montre l'importance de l'influence qu'Hutcheson a eue sur lui.
Par exemple, il ne s'tait pas dbarrass tout fait de la confusion qui prvalait son poque entre
les lois de la science conomique et le prcepte moral qu'il faut se conformer la nature.
Naturel signifie chez lui tantt ce que les forces existantes produisent rellement ou tendent
produire, tantt ce que, d'aprs sa propre nature humaine, il dsirerait qu'elles produisent. De
mme, parfois il pense que le rle de t'conomiste est d'exposer une science et d'autres fois que
son rle est d'exposer une partie de l'art du gouvernement. Mais quelque relch que son langage
soit souvent, nous constatons en regardant de prs que lui-mme se rend assez bien compte de ce
qu'il en est. Lorsqu'il est occup rechercher des lois de causes, c'est--dire des lois de nature au
sens moderne du mot, il emploie des procds scientifiques ; et lorsqu'il met des prceptes
pratiques, il se rend compte d'ordinaire qu'il ne fait qu'exprimer ses vues personnelles sur ce qui
doit tre, alors mme qu'il semble invoquer pour elles l'autorit de la nature.
Le sens de ce terme, tel qu'il est employ couramment en Allemagne, n'implique pas seulement
cette ide d'Adam Smith que le libre jeu des intrts individuels Pst plus avantageux pour le bien
public que l'intervention du gouvernement, mais, en outre, qu'il agit presque toujours dans la voie
la meilleure. Or les conomistes allemands savent bien qu'Adam Smith insiste constamment sur
l'opposition frquente qui existe entre les intrts des individus et le bien public : aussi l'usage
qu'on faisait autrefois du terme de Smithianisme est-il en train de tomber en discrdit. Voir par
exemple une longue liste de conflits de ce genre que Knies cite d'aprs la Richesse des nations,
Politische Oekonomie, ch. oit, 3. Voir aussi : FEILBOGEN, Smith und Turgot ; Zryss, Smith und
der Eigennutz.
Les relations qui existent entre la valeur et le cot de production ont t indiques par les
Physiocrates et par beaucoup d'crivains antrieurs, parmi lesquels on peut citer : Harris,
Cantillon, Locke, Barbon, Petty et mme Hobbes qui donnait entendre, bien que vaguement, que
l'abondance rsulte du travail et de l'abstinence appliqus par l'homme obtenir par son travail et
accumuler les dons de la nature sur terre et sur mer, proventus terrae et aquae, labor et
parsimonia.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
33
Il est possible qu'il n'ait pas vu toutes les consquences de son uvre ; coup sr,
elles ne furent aperues que par un petit nombre de ses successeurs. Mais les meilleures oeuvres conomiques qui parurent aprs la Richesse des Nations se distinguent de
celles qui ont paru avant, par une connaissance plus claire de cette balance et de cette
comparaison qui s'tablit, par l'intermdiaire de la monnaie, entre le dsir de possder
une chose, et l'ensemble des efforts et des privations qui contribuent directement ou
indirectement la produire. Quelque importants qu'aient t les progrs accomplis par
d'autres dans cette voie, ceux qui lui sont dus sont si grands que c'est lui qui a
vraiment dgag ce point de vue nouveau, et, par l, son uvre a fait poque. En cela,
lui-mme et les conomistes antrieurs ou postrieurs lui n'ont pas invent une ide
nouvelle ; ils ont simplement dfini et prcis des notions qui sont familires dans la
vie courante. En fait, l'homme ordinaire, dont l'esprit n'est pas habitu l'analyse, est
sujet considrer la monnaie comme tant une mesure des mobiles et du bonheur
plus prcise et plus exacte qu'elle ne l'est en ralit. Cela est d en partie ce qu'il ne
rflchit pas la manire dont cette opration de mesure s'effectue. Le langage des
conomistes semble tre technique et moins conforme la ralit que celui de la vie
courante. Mais, au vrai, il est plus conforme la ralit parce qu'il est plus minutieux
et qu'il tient mieux compte des diffrences et des difficults 1.
Retour la table des matires
4. - Aucun des contemporains et des successeurs immdiats d'Adam Smith n'eut
un esprit aussi tendu et aussi bien quilibr que le sien. Mais ils firent uvre
excellente, chacun d'eux se consacrant un genre particulier de problmes vers lequel
il tait attir par le penchant naturel de son gnie, ou par les vnements particuliers
de l'poque laquelle il crivait. Pendant le reste du XVIIIe sicle, les principaux
ouvrages conomiques furent historiques et descriptifs, et portrent sur la situation
des classes ouvrires, particulirement dans les rgions agricoles. Arthur Young
continua l'inimitable rcit de ses voyages ; Eden crivit une histoire des pauvres qui a
servi la fois de base et de modle tous les historiens de l'industrie qui sont venus
ensuite ; pendant que Malthus montrait, par une tude soigneuse de l'histoire, quelles
ont t les forces qui ont, en fait, agi sur le dveloppement de la population dans
diffrents pays diffrentes poques.
Mais au total, celui des successeurs d'Adam Smith qui a eu le plus d'influence fut
Bentham. Il a peu crit sur l'conomique elle-mme, mais il contribua beaucoup
donner le ton l'cole conomique anglaise qui s'est forme au dbut du XIXe sicle.
C'tait un logicien intransigeant et un adversaire de toutes les restrictions et de toutes
les rglementations qui ne s'appuyaient pas sur une raison claire ; il demanda sans se
1
Voir ci-dessous ch. V. Adam Smith a bien vu que si la science conomique est base sur une tude
des faits, les faits sont si complexes, qu'ils ne peuvent d'ordinaire rien apprendre directement ; il
faut les interprter en leur appliquant avec soin le raisonnement et l'analyse. Comme le disait
Hume, l'ouvrage de la Richesse des Nations est illustr d'une telle abondance de faits curieux,
qu'il doit retenir l'attention publique . Voici exactement comment procde Adam Smith : il est
rare qu'il cherche tirer ses arguments d'inductions dtailles ou de l'histoire ; les faits servant
ses dmonstrations sont principalement des faits que tout le monde connat, faits physiques,
mentaux ou moraux ; mais il illustre ses dmonstrations de faits curieux et instructifs ; il leur
donne ainsi la vie et la force, et il fait sentir ses lecteurs qu'elles traitent de problmes du monde
rel et non d'abstractions. Son ouvrage, quoiqu'il ne soit pas bien ordonn, est, ainsi un modle de
mthode.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
34
lasser que l'on justifit leur existence, et ses protestations trouvrent un appui dans les
circonstances de l'poque. L'Angleterre avait acquis sa situation unique par la rapidit
avec laquelle elle s'tait adapte aux tendances conomiques nouvelles ; leur attachement aux vieilles routines avait, au contraire, empch les nations de l'Europe centrale
de tirer parti de leurs grandes ressources naturelles. Les industriels et les commerants anglais taient, par suite, disposs penser que l'influence de la coutume et du
sentiment est nuisible dans les affaires, qu'elle avait du moins diminu en Angleterre,
qu'elle continuerait diminuer et bientt disparatrait. Les disciples de Bentham, de
leur ct, ne furent pas longs conclure qu'ils n'avaient pas besoin de s'occuper
beaucoup de la coutume. Ils se contentrent de s'occuper des tendances que manifeste
l'action humaine en supposant que chaque homme soit toujours proccup de trouver
le parti qui peut le mieux servir son intrt personnel, qu'il soit libre de le suivre et
prompt le faire 1.
Il y a donc quelque vrit dans les reproches frquemment adresss aux conomistes anglais du dbut de ce sicle : reproche d'avoir omis de rechercher avec un
soin suffisant si une plus grande place ne peut pas tre donne l'action collective,
par opposition l'action individuelle, dans les questions sociales et conomiques ;
reproche d'avoir exagr la force de la concurrence et la rapidit avec laquelle elle
agit. Il y a aussi une part de vrit, quoique trs faible, dans le reproche que leur
uvre est gte par une certaine duret de ligne et mme une certaine raideur de
caractre. Ces dfauts ont t dus en partie l'influence directe de Bentham, en partie
aussi l'esprit de l'poque dont il tait un interprte. Mais ils ont t dus aussi au fait
que les tudes conomiques passrent de nouveau entre les mains d'hommes qui
taient plus remarquables sur le terrain de l'action que sur celui de la pense philosophique.
Retour la table des matires
5. - Les hommes d'tat et les commerants se remirent en effet tudier les
questions de monnaie et de commerce tranger, avec plus de zle encore qu'ils ne
l'avaient fait, lorsque ces questions taient pour la premire fois apparues au dbut de
la grande transformation conomique, la fin du Moyen Age. On pourrait croire
premire vue que leur contact avec la vie relle, leur grande exprience, et leur vaste
connaissance des faits, eussent d leur permettre d'avoir une vue d'ensemble de la
nature humaine et donner leurs raisonnements une base trs large. Mais la formation
d'esprit que donne la vie pratique mne souvent les hommes d'affaires gnraliser
trop vite leurs expriences personnelles.
Tant qu'ils restrent sur leur domaine propre, leur oeuvre fut excellente. La thorie
de la monnaie est prcisment une partie de la science conomique o il n'y a que peu
1
Il exera aussi une autre influence sur les jeunes conomistes qui se trouvaient auprs de lui, par sa
passion pour l'ordre. C'tait il est vrai un ardent rformateur. C'tait un adversaire de toutes les
distinctions artificielles entre les diffrentes classes d'hommes ; il dclarait avec force que le
bonheur d'un homme tait aussi important que celui d'un autre, et que le but de toute action doit
tre d'augmenter la somme totale de bonheur ; il reconnaissait que cette somme totale, toutes choses restant gales, serait d'autant plus grande que la richesse serait rpartie d'une faon plus gale.
Nanmoins, la Rvolution franaise l'avait tel point rempli d'effroi, et il attribuait de si grands
inconvnients la plus lgre atteinte contre l'ordre, que, quelque audacieux qu'il ft comme
analyste, il ressentait lui-mme, et suscita chez ses lves, un respect presque superstitieux pour
les formes existantes de proprit prive.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
35
d'inconvnient ngliger les mobiles humains autres que le dsir de s'enrichir. La
brillante cole de raisonnement dductif dont Ricardo fut le chef s'est trouve ici sur
un terrain solide 1.
Les conomistes se consacrrent ensuite la thorie du commerce tranger et
firent disparatre beaucoup de lacunes qu'Adam Smith y avait laisses. Il n'y a pas
d'autre partie de l'conomie politique, si ce n'est la thorie de la monnaie, laquelle
s'applique aussi bien le raisonnement purement dductif. Il est vrai qu'une discussion
de la politique libre-changiste doit, pour tre complte, tenir compte de beaucoup de
considrations qui ne sont pas strictement conomiques ; mais la plupart d'entre elles,
quoique importantes pour des pays agricoles, et particulirement pour des pays neufs,
ont peu de porte dans le cas de l'Angleterre.
Pendant tout ce temps l'tude des faits conomiques ne fut pas nglige en
Angleterre. Les tudes statistiques des Petty, Arthur Young, Eden et autres, trouvrent d'excellents continuateurs en Tooke, Me. Culloch et Porter. S'il est peut-tre vrai
qu'une importance exagre soit attribue dans leurs ouvrages aux faits qui prsentent
un intrt direct pour les commerants et les capitalistes, on ne peut pas en dire autant
de l'admirable srie des enqutes parlementaires sur la condition des classes ouvrires, qui furent provoques par l'influence des conomistes. En fait, les compilations
officielles et prives de statistiques et les tudes d'histoire conomique qui parurent
en Angleterre la fin du XVIIIe sicle et au commencement du XIXe, peuvent bon
droit tre regardes comme l'origine des tudes systmatiques d'histoire et de
statistique en conomie politique.
Nanmoins l'uvre de ces conomistes fut entache d'une certaine troitesse de
vue : ils firent vraiment uvre historique, mais ils ne firent pas uvre comparative . Rame, Adam Smith, Arthur Young et d'autres ont t amens, par l'instinct
de leur propre gnie et par l'exemple de Montesquieu, comparer parfois entre eux
les faits sociaux de diffrentes poques et de diffrents pays, et tirer des enseignements de cette comparaison. Aucun d'eux n'est arriv lide de l'tude compare de
l'histoire faite d'aprs un plan systmatique. De sorte que les crivains de cette
poque, quelque excellentes et srieuses qu'aient t leurs recherches touchant les
faits rels de la, vie, travaillrent un peu au hasard. Ils ngligrent des groupes entiers
de faits que maintenant nous jugeons d'une importance vitale, et souvent ils ne surent
1
On le considre souvent comme un Anglais typique, mais ce n'est pas exact. Sa forte originalit
cratrice est la marque qui signale le gnie sous sa forme la plus leve chez toutes les nations.
Quant son aversion pour les inductions et son got pour les raisonnements abstraits, ils ne sont
pas dus son ducation anglaise, mais, comme Bagehot l'indique, son origine smitique. Presque
toutes les branches de la race smitique ont eu une aptitude particulire pour les abstractions, et
plusieurs d'entres elles ont t portes vers les calculs abstraits touchant le commerce de monnaie
et les dveloppements que ce commerce a pris de nos jours. Il n'y a aucun conomiste vraiment
anglais dont la mthode ressemble celle de Ricardo. Jamais il n'a t dpass pour la facult qu'il
possde de trouver, sans faillir, sa route au milieu des chemins embrouills, et d'arriver des
rsultats nouveaux et inattendus. Car il ne s'explique jamais ; il ne montre jamais quel est son but
en tudiant d'abord une hypothse, ensuite une autre ; ni que, en combinant convenablement les
rsultats de ses diffrentes hypothses, il soit possible de rsoudre un grand nombre de questions
pratiques. Ce qu'il crivait n'tait pas d'abord destin tre publi, mais claircir ses propres
doutes, et peut-tre ceux de quelques amis, sur des points prsentant une difficult particulire.
C'taient, comme lui-mme, des hommes d'affaires ayant une ample connaissance des faits : et
c'est l'une des raisons qui lui ont fait prfrer les grands principes, conformes l'exprience
gnrale, aux inductions particulires tires de groupes choisis de faits. Mais il ne connaissait
qu'un ct des choses : il comprenait le ngociant, il ne comprenait pas l'ouvrier. Voir la note la
fin du Livre V.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
36
pas faire bon usage de ceux qu'ils rassemblaient. Cette troitesse de vues se trouva
aggrave lorsque, sur ces faits rassembls par eux, ils se mirent tablir des raisonnements gnraux.
Retour la table des matires
6. - Dans le but de simplifier l'argumentation, Ricardo et ses lves firent
souvent comme s'ils considraient l'homme comme une quantit constante ; ils ne se
proccuprent jamais assez d'tudier ses aspects divers. Les gens qu'ils connaissaient
le plus intimement taient des hommes d'affaires de la Cit et ils se sont exprims
parfois avec assez peu de soin pour donner presqu' penser que les autres Anglais leur
ressemblent beaucoup.
Ils savaient bien que les habitants des autres pays prsentent des particularits
propres qui mritent d'tre tudies ; mais ils semblaient considrer ces diffrences
comme superficielles et destines disparatre, ds que les autres peuples arriveraient
connatre la bonne vole, que les Anglais taient prts leur enseigner. La mme
tournure d'esprit qui amena nos juristes imposer le droit civil anglais aux Hindous,
conduisit nos conomistes construire leurs thories en supposant tacitement que le
monde tait compos d'hommes semblables ceux de la Cit. Si elle eut peu d'inconvnient tant qu'ils traitrent de la monnaie et du commerce tranger, elle les gara
lorsqu'ils s'occuprent des relations entre les diffrentes classes. Elle les amena
traiter le travail comme une marchandise, sans chercher se placer au point de vue de
l'ouvrier, sans insister sur la part qu'il faut faire ses passions d'tre humain, ses
instincts et ses habitudes, ses sympathies et ses antipathies, ses haines de classe
et sa solidarit de classe, son ignorance et l'absence d'occasions pour lui d'agir
avec libert et nergie. Ils attriburent, par suite, aux forces de l'offre et de la demande bien plus de rigueur mcanique et de rgularit, qu'elles n'en ont en ralit ; et ils
mirent pour les profits et pour les salaires des lois qui n'taient pas mme exactes
pour l'Angleterre leur poque 1.
Mais leur faute la plus essentielle fut de ne pas voir combien les habitudes et les
formes de l'industrie sont sujettes changer. En particulier ils ne virent pas que pour
les classes pauvres, la pauvret mme est la principale cause de la faiblesse et de
l'impuissance qui les maintiennent dans leur pauvret : ils n'eurent, pas la foi que les
conomistes modernes possdent en la possibilit d'une grande amlioration dans la
condition des classes ouvrires.
La perfectibilit de l'homme fut, il est vrai, affirme par les socialistes. Mais leurs
ides reposaient sur des tudes historiques et scientifiques insuffisantes ; et elles
taient exprimes avec une extravagance qui souleva le mpris des conomistes
appartenant la classe industrielle et commerciale. Les socialistes n'avaient pas tudi
1
En ce qui concerne les salaires, il y avait mme quelques erreurs logiques dans les conclusions
qu'ils tiraient de leurs propres prmisses. Ces erreurs, si on remonte leur origine, ne sont que des
ngligences de langage. Mais une foule de gens s'en emparrent avec ardeur, qui se souciaient peu
de l'tude scientifique de l'conomie politique, et cherchaient simplement invoquer ses thories
dans le but de maintenir les classes ouvrires au rang qu'elles occupent. Aucune autre grande cole
de penseurs n'a peut-tre autant souffert de ces parasites (pour se servir d'un mot ordinairement
employ en Allemagne pour les dsigner) qui, faisant mtier de simplifier les thories conomiques, les noncent en ralit sans indiquer les conditions ncessaires pour qu'elles soient vraies.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
37
les thories qu'ils attaquaient ; et il ne fut pas difficile de montrer qu'ils n'avaient pas
compris la nature et l'efficacit de l'organisation conomique de la socit. Aussi, les
conomistes ne cherchrent-ils examiner avec soin aucune de leurs ides, ni aucune
de leurs spculations touchant la nature humaine 1.
Mais les socialistes taient des hommes qui avaient pressenti fortement et qui
connaissaient un peu ces ressorts cachs de l'action humaine dont les conomistes ne
tenaient pas compte. Perdues ait milieu de leurs rapsodies sauvages, se trouvaient de
sagaces observations et des suggestions prcieuses, dont les philosophes et les
conomistes pouvaient tirer un grand profit. Peu peu leur influence commena se
faire sentir. Comte leur doit beaucoup ; et la crise qui eut lieu dans la vie de Stuart
Mill. lui vint, comme il le dit dans son autobiographie, de la lecture des socialistes.
Retour la table des matires
7. - Lorsque nous comparerons les ides modernes touchant le problme vital de
la distribution des richesses avec celles qui prvalaient au dbut du sicle, nous
constaterons que, en plus et au-dessus de toutes les modifications de dtail et de tous
les progrs qui ont t raliss au point de vue de l'exactitude scientifique des
raisonnements, il y a un changement fondamental dans la manire d'envisager ce
problme. Tandis que les anciens conomistes raisonnaient comme si le caractre et
les aptitudes industrielles d'un homme taient des quantits fixes, les conomistes
modernes ont constamment prsent l'esprit le fait qu'ils sont le produit des
circonstances au milieu desquelles il a vcu. Ce changement de point de vue est d en
partie ce que les transformations de la nature humaine pendant les cinquante dernires annes ont t si rapides qu'elles ont forc l'attention ; il est d aussi l'influence
directe de certains crivains, socialistes et autres ; enfla, au contre-coup indirect d'un
changement semblable qui s'est fait dans certaines branches de la science naturelle.
Au dbut du XIXe sicle, le groupe des sciences mathmatiques et physiques tait
en voie de progrs. Ces sciences, quelque grandes que soient les diffrences qui
existent de l'une l'autre, ont ce point de commun que leur objet reste constant et
toujours le mme dans tous les pays et toutes les poques. Le progrs de la science
tait une ide familire l'esprit des hommes, mais l'ide que l'objet d'une science
puisse se transformer leur tait trangre. mesure que le sicle avana, le groupe
des sciences biologiques fit lentement des progrs ; les gens commencrent se faire
des ides plus nettes touchant la nature d'un dveloppement organique. Ils apprirent
que si l'objet d'une science passe par diffrents degrs de dveloppement, les lois qui
le rgissent l'un de ces degrs, le rgiront rarement sans modification aux autres ; les
lois d'une science doivent recevoir un dveloppement correspondant celui des
choses dont elle traite. L'influence de cette ide nouvelle s'tendit peu peu aux
sciences qui s'occupent de l'homme ; elle se manifeste dans les uvres de Gthe, de
Hegel, de Comte et d'autres.
Une exception doit tre faite pour Malthus, dont les tudes sur la population lui furent suggres
par l'essai de Godwin. Mais il n'appartient pas proprement parler l'cole de Ricardo et ce n'tait
Pas un homme d'affaires. Un demi-sicle plus tard Bastiat, qui fut un crivain lucide, mais non pas
un penseur profond, soutenait la thorie extravagante que l'organisation naturelle de la socit,
sous l'action de la concurrence, est la meilleure organisation non seulement qui puisse tre
pratiquement ralise, mais mme que l'on puisse thoriquement concevoir.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
38
Enfin arrivrent les grands progrs accomplis par les tudes biologiques : les
dcouvertes qui y furent faites fascinrent l'attention du monde, comme celles de la
physique l'avaient fait autrefois ; et il s'opra un changement marqu dans le caractre
des sciences morales et des sciences historiques. L'conomique a particip au mouvement gnral; elle commence donner sans cesse une plus grande attention la
mallabilit (pliability) de la nature humaine, et l'action que les formes actuelles de
production, de distribution et de consommation de la richesse exercent sur le
caractre de l'homme, comme l'action que celui-ci exerce sur elles. La premire
manifestation importante de cette tendance nouvelle apparut dans l'admirable ouvrage
de John Stuart Mill. Principles of Political Economy 1.
Les conomistes qui ont suivi les traces de Mill ont continu marcher dans la
voie ouverte par lui, en s'loignant de la position prise par les lves immdiats de
Ricardo. L'lment humain, s'opposant l'lment mcanique, prend une place de
plus en plus importante dans l'conomique. Pour ne pas citer d'crivains encore en
vie, ce caractre nouveau se manifeste dans les tudes historiques de Cliffe Leslie et
dans l'uvre trs varie de Bagehot, de Cairnes, de Toynbee et d'autres, mais surtout
dans celle de Jevons, qui s'est fait une place durable et importante dans l'histoire
conomique par la runion bien rare d'un grand nombre de qualits diverses de
premier ordre.
Une conception plus leve du devoir social se rpand partout. Au parlement,
dans la presse, et dans la chaire, l'esprit d'humanit parle plus nettement et plus
fortement. Mill et les conomistes qui ont suivi ses traces ont contribu ce
mouvement gnral, et leur tour ils ont t aids par lui. En partie pour cette raison,
en partie aussi par suite du dveloppement qu'a pris de nos jours la science historique,
ils ont tudi les faits d'une faon plus large et plus philosophique. Il est vrai que
l'uvre historique et statistique de quelques-uns des conomistes antrieurs a peine
t surpasse. Mais beaucoup de renseignements qu'ils ne pouvaient avoir sont maintenant accessibles tout le monde; des conomistes qui ne sont pas aussi familiariss
que Me Culloch avec la pratique des affaires, et qui n'ont pas sa vaste rudition
historique, sont mme de se former sur les liens qui existent entre la thorie
conomique et les faits rels de la vie des ides la fois plus larges et plus claires que
les siennes. En cela ils ont t aids par le progrs gnral qu'ont fait les mthodes de
toutes les sciences, y compris celle de l'histoire.
Ainsi, tous les points de vue, le raisonnement conomique est maintenant plus
exact qu'il ne l'tait jadis ; les prmisses d'o part une tude sont poses avec plus de
1
James Mill avait lev son fils dans toute la rigueur des doctrines de Bentham et de Ricardo et lui
avait donn le got de la clart et de la prcision. En 1830 John Mill crivit un essai sur la
mthode conomique o il proposait de donner une plus grande nettet aux abstractions de la
science. Il examinait l'ide admise tacitement par Ricardo que l'conomiste n'a besoin de tenir
compte d'aucun mobile d'action autre que le dsir de s'enrichir ; il soutenait que cette ide offre du
danger tant qu'on ne l'affirme pas nettement, mais qu'alors elle n'en a plus ; et il annonait presque
un trait qui serait dlibrment et ouvertement bas sur elle. Mais il ne tint pas sa promesse. Un
changement s'tait fait dans ses ides et dans ses sentiments, avant la publication de son grand
ouvrage conomique en 1848. Il lui donna le titre de Principes d'conomie politique, avec
quelques-unes de leurs applications la philosophie sociale (il est significatif qu'il n'ait pas dit :
d'autres branches de la philosophie sociale ; cf. Ingram, History, p. 154) et il n'y a pas essay de
distinguer nettement entre les raisonnements qui impliquent que le seul mobile de l'homme soit la
poursuite de la richesse et ceux qui ne l'impliquent pas. Ce changement d'attitude tait d aux
grandes transformations qui taient en train de s'accomplir dans le monde autour de lui, quoiqu'il
ne se rendit pas parfaitement compte de l'influence qu'elles avaient sur lui-mme.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
39
prcision et plus de rigueur qu'autrefois. Mais cette exactitude plus grande de la
pense dtruit en partie sa puissance d'action. On montre que beaucoup des applications qui furent faites des thories gnrales taient vicieuses, parce que l'on n'avait
pas pris soin de considrer toutes les conditions qu'elles supposaient, ni de voir si ces
conditions se trouvaient ralises dans les cas particuliers en discussion. La consquence fut que beaucoup de dogmes ont t rejets, qui semblaient simples,
uniquement parce qu'ils taient exprims d'une faon incomplte ; mais ces dogmes,
pour cette raison mme, taient comme une cuirasse dont les parties en litige (principalement les membres de la classe capitaliste) se servaient pour se protger dans la
lutte. Cette uvre de destruction peut sembler premire vue avoir diminu en
conomie politique la valeur des mthodes de raisonnement abstrait ; mais en ralit
elle a eu le rsultat oppos. Elle a dgag le terrain pour une construction nouvelle et
plus rigoureuse, qui est en train de s'difier peu peu et patiemment. Elle nous a
permis de nous former sur la vie des ides plus larges, de procder plus srement
quoique plus lentement, d'tre plus scientifiques tout en tant beaucoup moins
dogmatiques que ces excellents et grands penseurs qui supportrent le premier choc
dans la lutte contre les difficults des problmes conomiques. C'est eux qui, par
leurs uvres, ont ouvert la voie, que nous devons d'avoir nous-mmes une tche plus
aise.
On peut voir l, dans le dveloppement des mthodes scientifiques, comme le
passage d'une premire phase o les phnomnes de la nature sont artificiellement
simplifis dans le but de permettre de les dcrire en formules brves et simples, une
phase postrieure o ils sont tudis avec plus de soin, et prsents avec plus
d'exactitude, mme au prix d'une moindre prcision et d'une moindre clart apparente.
Par consquent, au cours de notre gnration, o chaque pas, cependant, elle est
soumise une critique hostile, la mthode de raisonnement abstrait, dans son application l'conomique, a fait des progrs plus rapides et a conquis une place plus solide
qu'au moment o elle tait au plus haut point de sa popularit et o son autorit tait
rarement mise en doute.
Nous n'avons jusqu'ici considr les progrs rcents de l'conomique qu'au point
de vue de l'Angleterre seulement; mais les progrs qui ont eu lieu en Angleterre n'ont
t qu'une des faces d'un mouvement plus tendu qui s'est manifest dans tout le
monde occidental.
Retour la table des matires
8. - Les conomistes anglais ont eu beaucoup de partisans et beaucoup d'adversaires dans les pays trangers. L'cole franaise n'a pas cess de se dvelopper depuis
ses grands penseurs du XVIIIe sicle, et elle sut viter un grand nombre d'erreurs et
de confusions, o tombrent frquemment les conomistes anglais de deuxime ordre,
notamment en ce qui concerne les salaires. Depuis l'poque de Say elle a fait uvre
importante et utile. En la personne de Cournot elle a eu un penseur au gnie constructif de premier ordre; tandis que Fourier, Saint-Simon, Proudhon et Louis Blanc
ont exprim beaucoup des meilleures et aussi beaucoup des plus folles ides du
socialisme.
Les progrs relatifs les plus grands accomplis pendant les dernires annes sont
peut-tre ceux qui ont t faits en Amrique. Il y a une gnration, l'cole Amricaine
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
40
d'conomistes ne comprenait que le groupe de protectionnistes qui marchaient la
suite de Carey. Mais de nouveaux groupes de penseurs vigoureux apparaissent maintenant ; certains signes semblent montrer que l'Amrique est en train de prendre dans
la pense conomique la premire place qu'elle occupe dj dans la pratique conomique.
La science conomique montre des signes d'une vigueur renaissante dans deux
pays o elle a autrefois prospr, la Hollande et l'Italie. Dans tous les pays les travaux
de vigoureuse analyse des conomistes autrichiens attirent tout particulirement
l'attention.
Mais, en somme, l'uvre la plus importante en conomie politique qui ait t
accomplie sur le Continent en ce sicle est celle de l'Allemagne. Tout en reconnaissant la matrise d'Adam Smith, les conomistes allemands ont t irrits plus que tous
les autres par ce qu'ils ont appel l'troitesse insulaire et la confiance en soi de l'cole
Ricardienne. En particulier, ils se sont levs contre cette supposition, tacitement
admise par les partisans du libre-change en Angleterre, qu'une proposition tablie
pour un pays manufacturier comme l'tait l'Angleterre, puisse tre applique sans
modification des pays agricoles. Le brillant esprit de List et son enthousiasme
national renversrent cette ide. Il montra que les Ricardiens ont tenu trop peu compte
des effets indirects du libre-change. Il n'y avait pas de grands inconvnients les
ngliger en ce qui concerne l'Angleterre, parce qu'ils y taient plutt avantageux, et
augmentaient ainsi la force des effets directs du libre-change. Mais List montra qu'en
Allemagne, et encore plus en Amrique, plusieurs de ces effets indirects avaient des
inconvnients ; il soutint que ces inconvnients l'emportaient sur les avantages directs
du libre-change. Beaucoup de ses arguments taient peu solides, mais il n'en tait
pas ainsi de tous. Comme les conomistes anglais refusaient ddaigneusement d'en
discuter aucun de prs, des hommes capables et anims de l'amour du bien publie,
impressionns par la force de ceux d'entre eux qui taient bons, consentirent, dans un
but d'agitation populaire, employer les autres, qui n'taient pas scientifiques, mais
qui faisaient un grand effet sur les classes ouvrires.
Les industriels amricains adoptrent List comme avocat; l'origine de sa rputation, comme aussi le dbut de la dfense systmatique des doctrines protectionnistes
en Amrique datent de la grande diffusion donne un trait populaire qu'il crivit
pour eux 1.
Les Allemands sont fonds dire que les Physiocrates et l'cole d'Adam Smith
mconnurent l'importance de la vie nationale ; qu'ils tendaient la sacrifier d'une part
un individualisme goste, et d'autre part un vague cosmopolitisme scientifique.
1
On a dj observ que List a mconnu l'effet que produisent les facilits actuelles de communication, de rendre le dveloppement des diverses nations synchronique. Son ardeur patriotique
faussait bien souvent son jugement scientifique; mais les Allemands ont accueilli avec empressement la dmonstration qu'il donne de ce fait que tout pays doit passer par les mmes priodes de
dveloppement que l'Angleterre, or, elle-mme a protg ses manufactures lorsqu'elle tait en train
de passer de la priode agricole la priode industrielle. Il avait une vraie passion pour la vrit ;
sa mthode tait conforme la mthode comparative qui est employe largement en Allemagne
par les savants de tout ordre, mais surtout par les historiens et par les juristes ; sa pense a eu,
directement et indirectement, une trs grande influence. Son ouvrage, Outlines of a New System of
Political Economy, parut Philadelphie en 1827, et son ouvrage, Das nationale System der
politischen Oekonomie, en 1840. C'est un point discut de savoir si Carey doit beaucoup List.
Quant aux relations gnrales entre leurs doctrines, voir Knies, Politische Oekonomie, 2e dition,
pp. 440 et 88.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
41
Ils allguent que List a rendu un grand service en stimulant le sentiment du patriotisme qui se prsente comme plus gnreux que l'individualisme, et plus vigoureux et
plus prcis que le cosmopolitisme. On peut estimer que les sympathies cosmopolites
des Physiocrates et des conomistes anglais n'ont pas t aussi fortes que les
Allemands le croient ; mais il est certain que l'histoire politique rcente de l'Allemagne a influenc ses conomistes dans le sens du nationalisme. Entoure d'armes
puissantes et agressives, l'Allemagne ne peut exister qu'avec l'aide d'un sentiment
national ardent ; aussi les conomistes allemands ont-ils insist nergiquement, peuttre trop, sur le fait que les sentiments altruistes ont une place plus restreinte dans les
relations conomiques entre pays que dans les relations entre individus.
Mais si les Allemands sont nationalistes par leurs sympathies, ils sont noblement
internationalistes par leurs tudes. Ils sont au premier rang pour l'tude compare de
l'conomique, comme pour celle de l'histoire gnrale. Ils ont tudi cte cte les
phnomnes sociaux et industriels des diffrents pays et ceux des diffrentes
poques ; ils les ont groups de faon les clairer et les interprter les uns par les
autres, et les ont tous tudis dans leurs relations avec l'histoire suggestive du droit 1.
L'uvre d'un petit nombre des membres de cette cole est dpare par une certaine
exagration, et mme par un mpris troit pour les raisonnements de l'cole
Ricardienne, dont ils n'ont pas su comprendre la tendance et le but. Il en est rsult
trop de critiques acerbes et fcheuses. Mais, trs peu d'exceptions prs, les chefs de
l'cole ont t exempts de cette troitesse de vues. Il serait difficile d'exagrer le
mrite de l'uvre qui a t accomplie par eux et par ceux qui, dans d'autres pays, les
ont suivis, pour dcrire et pour expliquer l'histoire des murs et des institutions
conomiques. Cette uvre est un des plus grands rsultats acquis de notre poque, et
un enrichissement important pour notre science. Elle a fait plus que tout autre chose
pour largir nos ides, pour accrotre la connaissance que nous avons de nous-mmes,
et pour nous aider comprendre le plan d'ensemble, quel qu'il soit, du gouvernement
du monde par Dieu.
Leur attention a surtout port sur la science considre au point de vue historique,
et sur son application aux conditions de la vie sociale et politique allemande, particulirement au rle conomique de la bureaucratie allemande. Sous la direction du
brillant gnie de Hermann, ils se sont aussi livrs des analyses soigneuses et
profondes qui ont beaucoup ajout nos connaissances, et ils ont beaucoup recul les
limites de la thorie conomique 2.
La pense allemande a galement fait avancer l'tude du socialisme et celle des
fonctions de l'tat. C'est des crivains allemands, dont quelques-uns taient
d'origine juive, que le monde doit la plupart des projets les plus srieux qui aient t
rcemment formuls pour utiliser les biens du monde dans l'intrt de tous, en ne
tenant que peu de compte des formes actuelles de la proprit. Il est vrai que,
1
Le mrite peut peut-tre en tre attribu en partie l'union qui existe en Allemagne, ainsi que dans
d'autres pays du continent, entre les tudes de droit et celles d'conomie politique pour l'entre
d'un grand nombre de carrires. On en a un exemple remarquable dans les contributions de
Wagner l'conomie politique.
En ces matires, les Anglais, les Allemands, les Autrichiens, et d'ailleurs tous les peuples,
s'attribuent plus de mrites que les autres ne sont disposs leur en reconnatre. Cela est d en
partie ce que chaque peuple a ses qualits intellectuelles propres et remarque leur absence chez
les crivains trangers ; tandis qu'il saisit mai les critiques que les autres adressent , ses propres
dfauts. Mais la raison principale en est que toute ide nouvelle se fait jour d'ordinaire peu peu,
et qu'elle s'labore souvent chez plus d'un peuple la fois, chacun d'eux est port se l'attribuer et
apprcier au-dessous de ses mrites l'originalit des autres.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
42
l'examiner de prs, leur uvre apparat comme tant moins originale et moins profonde qu'il ne semble au premier abord ; mais elle tire une grande force de son ingniosit dialectique, de sa forme brillante, et parfois de son rudition historique
tendue, quoique mal employe.
En outre des socialistes rvolutionnaires, on rencontre en Allemagne un grand
nombre de penseurs qui se plaisent insister sur l'autorit insuffisante que l'institution
de la proprit dans sa forme actuelle peut tirer de l'histoire ; qui demandent, pour des
motifs scientifiques et philosophiques, que l'on soumette un nouvel examen les
droits de la socit en face des droits de l'individu. Les institutions politiques et
militaires des Allemands ont, depuis quelques annes, augment leur penchant naturel
compter plus sur le Gouvernement et moins sur l'initiative individuelle que ne le
font les Anglais. Dans toutes les questions relatives aux rformes sociales, les Anglais
et les Allemands ont beaucoup apprendre les uns des autres.
Au milieu de l'rudition historique et de l'enthousiasme pour les rformes qui se
manifestent notre poque, il est craindre qu'une partie difficile mais importante de
la tche incombant la science conomique ne soit nglige. La popularit de l'conomie politique a eu pour effet, dans une certaine mesure, de faire ngliger le
raisonnement serr et rigoureux. L'importance croissante de ce que l'on a appel la
conception biologique de la science a pouss rejeter l'arrire-plan les ides de loi
et de mensuration conomiques, comme si de telles ides taient trop rigides pour tre
appliques l'organisme conomique, organisme vivant et toujours en voie de
changement. Mais la biologie elle-mme nous enseigne que les organismes vertbrs
sont ceux qui ont atteint le degr de dveloppement le plus lev. L'organisme conomique moderne est vertbr ; la science qui s'occupe de lui ne doit pas tre
invertbre. Elle devrait avoir cette dlicatesse et cette sensibilit de touche qui lui
sont ncessaires pour lui permettre de s'adapter troitement aux phnomnes rels du
monde ; mais il lui faut aussi, et ce n'est pas la moindre des conditions ncessaires,
une base solide d'analyses et de raisonnements.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
43
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre I : aperu prliminaire
Chapitre cinquime
Lobjet de lconomie politique
Retour la table des matires
1. - Certaines personnes soutiennent avec Comte que toute tude relative
l'homme vivant en socit doit, pour tre profitable, rentrer dans l'ensemble de la
science sociale. Elles allguent que tous les aspects de la vie sociale sont si troitement unis, qu'une tude isole de l'un d'entre eux doit rester vaine ; elles pressent les
conomistes de cesser de faire bande part et de se consacrer aux progrs d'ensemble
d'une science sociale unifie et gnrale. Mais l'ensemble les actions de l'homme
vivant en socit est trop tendu et trop divers pour pouvoir tre analys et expliqu
par un seul effort intellectuel. Comte lui-mme et Herbert Spencer ont mis au service
de cette tche une science qui n'a pas t surpasse et un grand gnie ; ils ont fait
poque dans la pense par leurs larges aperus et leurs ides suggestives ; mais il est
difficile d'affirmer qu'ils aient mme pu jeter les bases d'une science sociale unifie 2.
Les sciences physiques firent peu de progrs tant que le gnie brillant mais
impatient des Grecs persista chercher une base unique pour l'explication de tous les
phnomnes physiques; et leurs progrs rapides l'poque moderne sont dus ce que
1
2
Le lecteur trouvera dans KEYNES, Scope and Method of Political Economy, une tude plus
complte et plus dtaille de plusieurs des sujets traits dans ce chapitre et dans les suivants.
Dans son ouvrage Bau und Leben des socialen Krpers Schffle s'est propos un but moins
ambitieux et il s'en est approch de plus prs.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
44
l'on a sectionn de grands problmes en leurs parties composantes. Sans doute il
existe une certaine unit la base de toutes les forces de la nature ; mais tous les
progrs qui ont t faits pour la dcouvrir sont dus aux connaissances acquises par des
tudes spcialises, non moins qu'aux coups d'il jets l'occasion sur le champ de la
nature dans son ensemble. Une uvre semblable, de patience et de dtail, est
ncessaire pour rassembler les matriaux qui permettront aux poques futures de
comprendre, mieux que nous ne le pouvons faire, les forces qui gouvernent le dveloppement de l'organisme social.
Mais, d'un autre ct, il faut accorder Comte que, mme dans les sciences
physiques, c'est le devoir de ceux qui consacrent leur principal effort un champ
limit, de se tenir en troite et constante relation avec ceux qui travaillent dans les
domaines voisins. Des spcialistes qui ne regardent jamais au-del de leur propre
domaine sont ports ne pas voir les choses avec leurs vritables proportions ;
beaucoup des renseignements qu'ils rassemblent ont relativement peu d'utilit ; ils
s'attachent dans le dtail des questions anciennes qui ont perdu la plus grande partie
de leur signification et auxquelles se sont substitues de nouvelles questions nes de
points de vue nouveaux ; ils se privent de ces grandes clarts que le progrs de toute
science jette par comparaison et par analogie sur les sciences qui l'entourent. Comte a
donc rendu service en insistant sur l'ide que la solidarit des phnomnes sociaux
doit rendre l'uvre des spcialistes exclusifs encore plus vaine dans la science sociale
que dans la science physique. Mill, aprs l'avoir reconnu, ajoute: Une personne ne
sera vraisemblablement pas un bon conomiste si elle n'est pas autre chose. Comme
les phnomnes sociaux agissent et ragissent les uns sur les autres, ils ne peuvent pas
tre bien compris isolment; cela ne prouve en aucune faon que les phnomnes
matriels et industriels de la socit ne soient pas eux-mmes susceptibles de
gnralisations utiles, mais seulement que ces gnralisations doivent ncessairement
se rfrer une forme donne de civilisation et une poque donne du progrs
social 1 .
Retour la table des matires
2. - Voil une bonne rponse la prtention que Comte exprimait de dnier
toute utilit une science de l'conomie politique ; mais elle ne prouve pas que l'objet
assign l'conomique par Mill et par ses prdcesseurs ft prcisment le bon. En
largissant cet objet on le rend sans doute moins dtermin et moins prcis, et
l'inconvnient peut tre plus grand que l'avantage qui en rsulte ; mais il n'en est pas
ncessairement ainsi. Il faudrait trouver un principe gnral pour dterminer, dans
cette extension donne l'objet de l'conomique, le point o la perte croissante en
1
MILL, On Comte, p. 82. La controverse de Mill avec Comte mrite encore d'tre tudie. Les
arguments de Comte ont t rcemment exposs de nouveau avec beaucoup de force et
d'loquence par Ingram. Ils ne semblent pas avoir branl l'observation faite par Mill que Comte,
tout en ayant raison lorsqu'il affirmait, avait tort lorsqu'il niait. On peut tendre cette observation ;
il semble que dans la longue controverse qui a eu lieu en Angleterre, en Allemagne, et plus
rcemment en Amrique, sur la bonne mthode en conomie politique, chaque adversaire ait eu
raison lorsqu'il affirmait que telle mthode tait utile : c'tait gnralement celle qui tait le mieux
approprie la partie de l'conomie politique laquelle il s'intressait le plus. Mais chacun d'eux
s'est trouv avoir tort lorsqu'il se refusait reconnatre que les autres mthodes fassent utiles : elles
peuvent ne pas convenir aux travaux dont il s'occupe principalement ; mais elles peuvent, mieux
peut-tre que ses mthodes favorites, convenir des travaux autres et plus importants. Mais nous
reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
45
prcision scientifique commence dpasser l'avantage qui rsulte d'une plus grande
ralit et d'une plus grande comprhension philosophique.
Nous devons donc rechercher quelles sont les particularits avantageuses qui ont
permis l'conomie politique, tout en restant bien loin derrire les sciences physiques
plus avances qu'elle, de devancer pourtant toutes les autres branches de la science
sociale. Il semblerait raisonnable de conclure que toute extension de l'objet de la
science conomique sera bonne, lorsque, sans la dpouiller de ces particularits
avantageuses, elle lui permettra de rpondre plus exactement aux faits, et d'embrasser
des idals de vie plus levs ; mais toute extension au-del de cette limite serait plus
nuisible qu'utile.
Retour la table des matires
3. - L'avantage que l'conomie politique possde sur toutes les autres branches
de la science sociale semble tenir au fait qu'elle s'occupe surtout de dsirs, aspirations
et autres affections de la nature humaine, qui se manifestent au dehors, comme
mobiles d'action, dans des conditions telles que leur force ou leur quantit peuvent
tre mesures avec quelque exactitude, et qui, par suite, se prtent particulirement
tre tudis par des procds scientifiques. Une porte s'ouvre aux mthodes et aux
constatations de la science, ds que la force des mobiles qui font agir une personne
peut tre mesure par la somme de monnaie qu'elle consent donner pour s'accorder
une satisfaction dsire, ou encore par la somme qui est ncessaire pour l'amener
accepter une certaine peine 1.
Mais ici quelques explications sont indispensables. Nous ne pouvons pas mesurer
directement une affection de l'esprit; le plus que nous puissions faire est de la mesurer
indirectement par ses effets. Personne ne peut comparer et mesurer exactement les
uns avec les autres ses propres tats mentaux diffrentes poques : et personne ne
peut mesurer les tats mentaux d'un autre, si ce n'est indirectement et par conjecture,
l'aide de leurs effets.
S'il en est ainsi, ce n'est pas seulement parce que, parmi les affections, les unes
appartiennent aux parties basses de la nature humaine, d'autres ses parties nobles, et
qu'elles sont ainsi d'espces diffrentes. C'est que, en outre, il n'y a aucun moyen pour
comparer directement les uns aux autres des plaisirs et des peines purement
physiques : ils ne peuvent tre compars qu'indirectement par leurs effets ; cette comparaison mme est, dans une certaine mesure, conjecturale, moins qu'ils ne se
rapportent la mme personne et au mme moment. Nous ne pouvons pas comparer
directement le plaisir que deux personnes prennent fumer ; ni mme le plaisir que la
mme personne y prend diffrents moments ; mais lorsque nous rencontrons un
homme qui hsite employer quelques pences, acheter un cigare, ou s'offrir une
tasse de th, on prendre l'omnibus au lieu de rentrer chez lui pied: alors nous pouvons suivre l'usage ordinaire, et dire qu'il attend, de ces diverses faons de dpenser
1
J. S. MILL indique lui-mme la raison de la supriorit de l'conomie politique lorsqu'il dit
(Logic, livre VI, eh. IX, 3), que dans les phnomnes conomiques la loi psychologique qui
intervient principalement est cette loi familire que l'on prfre un gain plus grand un plus
petit ; et il soutient que la science trouve plus de prise aux phnomnes conomiques qu'aux
autres phnomnes sociaux parce qu'elle y a affaire des motifs qui peuvent tre aisment
compars les uns avec les autres.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
46
son argent, un plaisir gal. Un autre jour notre homme pourra n'avoir ni plus ni moins
de monnaie de reste ; mais son humeur sera diffrente et il se trouvera peut-tre que
diverses faons de dpenser ses quelques pences lui feront ce jour-l plus de plaisir
que ne lui en aurait fait, le jour prcdent, l'un quelconque des emplois qu'il pouvait
leur donner 1.
Si donc nous dsirons comparer entre elles des jouissances mme physiques, nous
ne devons pas le faire directement, mais indirectement, par les mobiles d'action
qu'elles fournissent. tant donn deux sortes de jouissances, si nous voyons des
hommes, placs dans des situations de fortune semblables, faire chacun une heure de
travail supplmentaire, ou des hommes du mme rang et avec les mmes moyens
d'existence payer chacun un shilling, pour se procurer l'une ou l'autre d'entre elles,
nous pouvons alors dire qu'elles sont, notre point de vue, quivalentes, parce que les
dsirs qu'elles provoquent sont des mobiles d'action de force gale pour des personnes
qui sont premire vue semblables et dans des situations semblables 2.
Puisque nous mesurons ainsi un tat mental comme les hommes le font dans la vie
ordinaire, c'est--dire par sa force motrice, ou par sa force en tant que mobile d'action,
peu importe que quelques-uns des mobiles dont nous avons tenir compte appartiennent aux cts levs, d'autres aux cts infrieurs, de la nature humaine.
Supposons, en effet, que l'homme, que nous avons vu tout l'heure hsiter entre
plusieurs petites jouissances, vienne penser, aprs quelque temps, un pauvre
infirme prs duquel il passera en rentrant chez lui, et qu'il consacre un moment
dcider s'il prfrera une jouissance physique pour lui-mme, ou s'il fera un acte
charitable et prendra plaisir faire la joie d'un autre. mesure qu'il penche dans un
sens, ou dans l'autre, il se produit dans la qualit de ses tats mentaux un changement
dont l'analyse appartient au psychologue. Mais l'conomiste tudie les tats mentaux
plutt dans leurs manifestations qu'en eux-mmes; s'il constate qu'ils fournissent
l'action des mobiles de force gale, il les traite comme gaux son point de vue. Sans
doute il n'en a pas par l fini avec eux : mme pour des tudes conomiques comprises d'une faon troite, il est important de savoir si les dsirs qui prvalent sont
susceptibles de former des caractres vigoureux et droits ; et lorsque ces tudes sont
comprises d'une faon large, lorsqu'on les applique aux problmes pratiques, l'conomiste, comme tout autre, doit se proccuper des fins dernires de l'homme, et tenir
compte des diffrences qui existent, au point de vue de la valeur relle, entre des
jouissances constituant des mobiles d'action de force gale, et ayant par suite des
mesures conomiques gales. L'tude de ces mesures n'est que le point de dpart de
l'conomie politique ; mais c'en est le point de dpart 3.
1
Pour plus de simplicit, cet exemple se rfre des choses qui ne se consomment que par le
premier usage. Mais la plupart des objets matriels sont des sources plus ou moins durables de
jouissance ; naturellement, le dsir qu'on a d'un objet de ce genre n'est pas d'ordinaire accompagn
d'une prvision consciente des plaisirs particuliers que l'on tirera de son usage ; parmi eux il faut
souvent donner une place importante au simple plaisir de la possession. Nous reviendrons sur ces
questions.
Les objections que certains philosophes adressent cette faon d'envisager, sous certaines conditions, deux plaisirs comme gaux, semblent ne pas s'appliquer l'usage que les conomistes font
de cette expression, mais d'autres.
Malheureusement, il est arriv que l'emploi courant des termes conomiques a parfois fait croire
que les conomistes sont partisans du systme philosophique de l'Hdonisme ou de l'Utilitarisme.
Considrant d'ordinaire comme tabli que les plus grands plaisirs sont ceux que l'on prouve
lorsqu'on s'efforce de faire son devoir, ils ont en effet parl des plaisirs et des peines
comme tant les mobiles de toute action. Ils se sont ainsi exposs aux critiques des philosophes
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
47
Retour la table des matires
4. - La mesure des mobiles l'aide de la monnaie subit plusieurs autres limitations que nous devons examiner. La premire vient de la ncessit de tenir compte
des variations dans le montant de plaisir, ou de satisfaction, que la mme somme de
monnaie reprsente pour des personnes diffrentes et se trouvant dans des situations
diffrentes.
Un shilling peut reprsenter une plus grande somme de plaisir (ou de satisfaction)
un moment qu' un autre, mme pour la mme personne ; soit parce qu'elle aura
plus de monnaie, soit parce que sa sensibilit aura vari 1. Des personnes dont les
antcdents sont les mmes, et qui sont extrieurement semblables les unes aux
autres, sont souvent affectes de faons trs diffrentes par des vnements sem-
qui considrent comme un principe essentiel l'ide que, chez une personne qui accomplit son
devoir, le dsir de l'accomplir ne se confond pas avec le dsir du plaisir qu'elle peut esprer retirer
de cet accomplissement, supposer que celui-ci puisse mme se prsenter son esprit. Peut-tre,
cependant, ne serait-il pas incorrect de dsigner ce dsir sous le nom de dsir de satisfaction du
moi ou de satisfaction du moi permanent .
Ainsi T. H. Green (Prolegomena to Ethics, pp. 165-166) dit : Le plaisir d'accomplir son devoir
ne peut pas tre la cause qui fait natre le dsir de l'accomplir, pas plus que le plaisir qu'on
prouve satisfaire sa faim ne peut tre la cause qui fait natre la faim... Lorsque l'ide dont on
poursuit la ralisation n'est pas de se procurer un plaisir, le fait que l'on compte trouver une
satisfaction personnelle dans l'effort mme ncessaire pour la raliser, ne fait pas que le plaisir soit
l'objet du dsir... L'homme qui envisage avec calme une vie de souffrance dans l'accomplissement
de ce qu'il considre comme tant sa mission, ne pourrait pas supporter d'agir autrement. Vivre
ainsi est son bonheur. S'il pouvait avoir la conviction qu'il a accompli son devoir, s'il pouvait tre
sr d'arriver cette conviction, - et justement plus son caractre est lev, moins il en sera sr - il
trouverait une satisfaction dans la conscience du devoir accompli et avec elle un certain plaisir.
Mais, en supposant ce plaisir obtenu, quelque grand qu'il soit, seules les exigences d'une thorie
peuvent suggrer l'ide qu'il ddommage des plaisirs sacrifis et des peines endures au cours de la
vie au bout de laquelle on l'obtient. Il est d'autres personnes auxquelles il semble vident que la
peine qu'elles s'infligent en refusant dlibrment de faire leur devoir et en vivant ainsi leur
guise, est moindre que la peine qu'elles endureraient en vivant autrement.
Il est vrai que cet emploi dans un sens large des expressions peine et plaisir a parfois servi
comme d'un pont pour passer de l'Hdonisme individualiste une foi morale complte, en sup.
primant la ncessit d'introduire une prmisse indpendante suprieure ; or, la ncessit d'une
pareille prmisse semble absolue, quoique l'on doive diverger peut-tre toujours d'opinion quant
sa forme. Les uns la trouvent dans l'Impratif catgorique ; tandis que d'autres la tirent de la
simple croyance cette ide que, quelle que soit l'origine de nos instincts moraux, les indications
qu'ils nous donnent s'appuient sur ce fait, prouv par l'exprience de l'espce humaine, que l'on ne
peut pas avoir de vrai bonheur sans le respect de soi-mme, et que le respect de soi mme ne peut
s'acqurir qu' la condition de s'efforcer de vivre de faon contribuer au progrs de l'humanit.
Ce n'est videmment pas le rle de l'conomie politique de prendre parti dans la controverse
morale. Puisqu'on accorde gnralement que tous les mobiles d'action, dans la mesure o ils sont
conscients, peuvent sans improprit tre dsigns brivement sous le nom de dsirs de
satisfaction , il peut tre avantageux d'employer ce mot au lieu du mot plaisir , lorsque
l'occasion se prsente d'indiquer le but auquel tendent tous les dsirs, qu'ils appartiennent aux
cts nobles, ou aux cts bas, de la nature humaine. L'antithse de satisfaction est dissatisfaction ;
mais il peut tre bon d'employer sa place le mot plus court et galement sans couleur de
detriment (dtriment).
On peut encore se reporter l'intressante discussion de Mackenzie sur The relations between
Ethics and Economics dans le International Journal of Ethics, vol. III, et dans son ouvrage :
Introduction to Social Philosophy ; mais sa manire de voir semble tre encore plus intransigeante
que celle de Green.
) Cf. EDGEWORTH, Mathematical Psychics.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
48
blables. Quand, par exemple, une bande d'coliers va la campagne un jour de
vacance, il est probable qu'il n'en est pas deux parmi eux qui y prennent un plaisir de
mme espce ou d'intensit gale. La mme opration chirurgicale cause diffrentes
personnes des souffrances diverses. De deux parents, dont l'affection pour leurs
enfants, autant que nous pouvons en juger, est gale, lun souffrira beaucoup plus que
l'autre de la perte d'un fils Certaines personnes, qui ne sont pas dordinaire trs
sensibles, ressentent cependant tout particulirement certaines espces de plaisir et de
peine. Des diffrences de nature et d'ducation font aussi que la facult gnrale de
ressentir le plaisir et la peine est beaucoup plus grande chez un homme que chez un
autre.
Il ne serait donc pas sans danger de dire que deux hommes ayant le mme revenu
en tirent des satisfactions semblables, on qu'ils souffriraient galement d'une mme
diminution de leurs revenus. Lorsqu'un impt de 1 est lev sur deux personnes
ayant un revenu annuel de 300 , chacune d'elles se privera du plaisir (ou de tout
autre satisfaction) ayant une valeur de 1 , dont elle peut le plus aisment se passer,
c'est--dire que chacune se privera de quelque chose qui, pour elle, est exactement
mesur par 1 ; pourtant l'intensit des satisfactions sacrifies peut ne pas tre tout
fait gale dans les deux cas.
Nanmoins, si nous prenons des moyennes suffisamment larges pour que les
particularits personnelles des individus se compensent les unes avec les autres, la
quantit de monnaie que des gens ayant des revenus gaux donnent pour se procurer
une satisfaction, ou viter un dommage, est une bonne mesure de cette satisfaction ou
de ce dommage. S'il y a mille personnes Sheffield, et mille Leeds, ayant chacune
un revenu de 100 environ, et si un impt de 1 vient les frapper toutes, nous
pouvons tre srs que la perte de plaisir ou le dommage causs par l'impt Sheffield
sont d'une importance peu prs gale ceux qu'il causera Leeds. et si tous les
revenus augmentaient d'une livre, cette augmentation procurerait dans les deux villes
une somme quivalente de plaisir et autre satisfaction. Cette probabilit devient plus
grande encore si, tous les individus considrs sont des hommes adultes faisant le
mme mtier, car il est alors prsumer qu'ils ont quelque ressemblance entre eux au
point de vue de la sensibilit et du caractre, des gots et de l'ducation. La probabilit ne se trouve pas beaucoup diminue, si nous prenons la famille comme point de
dpart, et si nous comparons la perte de plaisir qu'entrane une diminution de 1 de
revenu dans chacune des familles qui, dans les deux villes, possdent un revenu de
100 .
Nous devons ensuite tenir compte du fait que pour amener une personne payer
un prix donn pour une chose, il faut un stimulant plus fort, si elle est pauvre, que si
elle est riche. Un shilling reprsente moins de plaisir ou de satisfaction d'un genre
quelconque pour un homme riche que pour un pauvre. Un homme riche hsitant
dpenser un shilling pour un seul cigare, compare les uns aux autres des plaisirs plus
faibles que ceux qui sont envisags par un homme pauvre hsitant dpenser un
shilling pour acheter une provision de tabac qui lui durera un mois. L'employ 100
par an ira pied son bureau par une pluie trs forte, alors qu'une pluie lgre
suffira pour que l'employ 300 prenne un omnibus ; car les trois pences de
l'omnibus reprsentent un plaisir beaucoup plus grand pour le plus pauvre que pour le
plus riche. Si le premier dpense ses trois pences ils lui manqueront ensuite beaucoup
plus qu'au second. Le plaisir que, dans l'esprit du plus pauvre, reprsentent les trois
pences, est plus grand que celui qu'ils reprsentent dans l'esprit du plus riche.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
49
Mais cette cause d'erreur, elle aussi, se trouve attnue lorsque nous pouvons
considrer les actions et les mobiles d'un grand nombre de gens. Si nous savons, par
exemple, que la faillite d'une banque a enlev 200.000 des personnes de Leeds et
100.000 1 des personnes de Sheffield, nous pouvons trs bien supposer que le
dommage caus a t Leeds environ deux fois aussi grand qu' Sheffield ; moins,
il est vrai, que nous n'ayons quelque raison particulire de croire que les actionnaires
de la banque appartenaient une classe plus riche dans une des deux villes que dans
l'autre; ou moins que la diminution de travail produite par la faillite ne se soit pas
fait sentir la classe ouvrire en proportions gales dans les deux villes.
Parmi les vnements, dont s'occupe l'conomie politique, de beaucoup le plus
grand nombre affectent dans des proportions peu prs gales toutes les diffrentes
classes de la socit ; de sorte que si les quantits de monnaie qui mesurent le bonheur caus par deux vnements sont gales, il est raisonnable et conforme l'usage
ordinaire de considrer le montant du bonheur dans les deux cas comme quivalent.
Bien plus, si l'on considre deux groupes importants de personnes pris au hasard dans
deux parties quelconques du monde occidental, comme les sommes de monnaie
consacres aux dpenses les plus importantes ont des chances d'y tre en proportions
peu prs gales, il y a donc mme probabilit premire vue pour qu'une augmentation gale des ressources matrielles de ces deux groupes de population ait pour
rsultat d'y augmenter d'une faon gale la plnitude de vie et d'y contribuer
galement au vritable progrs de l'humanit.
Retour la table des matires
5. - Passons une autre question. Lorsque nous disons qu'un dsir est mesur
par l'action dont il est le mobile, on ne doit pas croire que nous admettions que toute
action soit rflchie et le rsultat d'un calcul. En cela, comme toujours, l'conomique
prend l'homme exactement comme il se prsente dans la vie ordinaire ; or, dans la vie
ordinaire, les gens ne psent pas l'avance les rsultats de chaque action, qu'elle soit
inspire par les instincts nobles, ou par les instincts bas, de leur nature 1.
Certaines personnes sont de temprament capricieux, et ne peuvent pas se rendre
compte elles-mmes des mobiles de leurs actions; mais lorsqu'un homme est nergique et rflchi, ses impulsions mme sont le produit d'habitudes, qu'il a adoptes
aprs plus ou moins de rflexion. Qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas inspires
par ses instincts levs, qu'elles soient dues des ordres de sa conscience,
l'influence des relations sociales, ou aux exigences de ses besoins physiques, il les
soumet toutes un certain ordre de prsance relative sans y rflchir au moment
mme, mais parce que, dans une occasion prcdente il a, aprs rflexion, tabli cet
ordre de prsance. L'attrait particulier qu'exercent sur un homme certains genres
d'actions, alors mme qu'il n'est pas le rsultat d'un calcul fait au moment mme, est
1
Cela est particulirement vrai de ce groupe de satisfactions que l'on appelle parfois the pleasures
of the chase (les plaisirs de la lutte). Ils comprennent non seulement l'mulation intelligente dans
les jeux et dans les distractions, dans la chasse et dans les courses, mais les luttes plus srieuses de
la vie professionnelle et des affaires. Ils retiendront beaucoup notre attention lorsque nous
tudierons les causes qui dterminent les salaires et les profits, ainsi que les formes de
l'organisation industrielle.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
50
d des dcisions plus ou moins rflchies prises prcdemment dans des cas
semblables 1.
Or, la partie de la vie humaine dont l'conomie politique s'occupe particulirement est celle pour laquelle la conduite de l'homme est la plus rflchie, et o il lui
arrive le plus souvent de calculer les avantages et les inconvnients d'une action
particulire avant de l'excuter. De plus, c'est la partie de sa vie o, lorsqu'il obit
une habitude et une coutume, et agit pour le moment sans rflchir, il y a le plus de
chances pour que ces habitudes et ces coutumes elles-mmes soient nes d'un examen
minutieux et soigneux des avantages et des inconvnients que prsentent les
diffrents partis prendre 2.
Il est vrai que, lorsqu'une habitude on une coutume nes dans certaines conditions, influencent les actions d'hommes se trouvant dans des conditions diffrentes, il
n'y a plus de relation exacte entre l'effort accompli et le rsultat que cet effort donne.
Mais dans le monde moderne, en matires industrielles ou commerciales, de pareilles
habitudes disparaissent vite 3.
Ainsi donc la partie la plus systmatique de la vie des hommes est celle qu'ils
consacrent gagner leur subsistance. Le travail de tous ceux qui sont engags dans un
mtier quelconque est susceptible d'tre observ avec soin ; il peut faire l'objet de
conclusions gnrales, vrifiables par voie de comparaison avec les rsultats d'autres
observations ; et il est possible d'estimer numriquement la somme en monnaie, ou en
pouvoir gnral d'achat, qui est ncessaire pour y constituer un suffisant mobile
d'action.
De mme, la rpugnance diffrer une jouissance, et pargner ainsi en vue de
l'avenir, se mesure par l'intrt touch pour la richesse accumule qui constitue un
mobile juste suffisant pour dcider quelqu'un pargner. Ce genre de mesure prsente
pourtant quelques difficults particulires dont l'tude doit tre ajourne.
Enfin, le dsir de possder une chose qui s'achte et se vend pour de la monnaie,
peut, pour la mme raison, se mesurer par le prix que les gens sont disposs payer
pour elle.
1
2
Dans le chapitre II nous avons fait allusion ces caractres que prsentent l'habitude et la
coutume; nous aurons y revenir avant la fin de l'ouvrage.
D'ordinaire on ne procde pas par un examen en forme des deux faces de la question ; mais des
hommes rentrant chez eux aprs le travail de la journe, ou se rencontrant dans des runions, se
seront dit les uns aux autres. 'a t un tort d'agir de cette faon, il aurait mieux valu agir ainsi ,
et ainsi de suite. Si un procd est prfr un autre, ce n'est pas toujours parce qu'il procure un
avantage personnel ou quelque avantage matriel ; on allguera souvent que si telle ou telle
manire de faire conomise un peu de peine ou un peu de monnaie, elle nuit autrui , et
qu' elle vous fait considrer comme un homme mprisable ou qu' elle fait qu'on se sent soimme un homme mprisable .
Dans les pays arrirs il y a encore beaucoup d'habitudes et de coutumes semblables celles qui
poussent un castor en cage se construire une digue. Elles sont trs suggestives pour l'historien ;
et le lgislateur doit en tenir compte.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
51
Retour la table des matires
6. - Mais ici, comme ailleurs, nous devons toujours avoir prsent l'esprit ce
fait que le dsir de gagner de l'argent ne procde pas ncessairement de mobiles d'un
ordre infrieur, mme lorsqu'on le dpense pour soi-mme. L'argent n'est qu'un
moyen pour arriver certaines fins ; si ces fins sont nobles, le dsir qu'on a de le
possder ne saurait tre bas. Le garon qui travaille beaucoup et pargne tant qu'il
peut, en vue de pouvoir ensuite payer sa place l'Universit, est avide d'argent; mais
cette avidit n'a rien de bas. La monnaie est le pouvoir gnral d'achat, c'est un moyen
pouvant servir toutes sortes de fins, nobles aussi bien que basses, spirituelles aussi
bien que matrielles 1.
Il est donc sans doute vrai que la monnaie ou pouvoir gnral d'achat ou
pouvoir sur la richesse matrielle , est le centre autour duquel la science conomique tourne ; mais s'il en est ainsi, ce n'est pas que la monnaie ou la richesse
matrielle soient regardes par elle comme tant le but principal de l'effort des
hommes, ni mme comme le principal sujet d'tude de l'conomiste, mais par ce que
dans le monde o nous vivons elle est le seul moyen permettant de mesurer les mobiles humains. Si les anciens conomistes avaient exprim cela clairement, ils auraient
vit beaucoup de lourdes mprises ; et les magnifiques enseignements de Carlyle et
de Ruskin touchant le but vritable des efforts de l'homme et le vritable usage de la
richesse, n'auraient pas t gts par des attaques amres contre l'conomie politique,
reposant sur l'ide errone que cette science n'envisage pas d'autre mobile que le dsir
goste de la richesse, ou mme qu'elle inculque un systme d'gosme sordide 2.
1
Voir un admirable essai de Cliffe Leslie sur The Love of Money. On entend, il est vrai, parler de
gens qui recherchent l'argent pour lui-mme sans se proccuper de ce qu'il leur permettra
d'acheter, surtout la fin d'une longue vie consacre aux affaires : mais dans ce cas, comme dans
d'autres, l'habitude de faire quelque chose survit aprs que le but a cess d'exister. La possession
de la richesse donne ces gens lin sentiment de domination sur leurs semblables et leur assure une
sorte de respect ml d'envie dans lequel ils trouvent une amre mais puissante satisfaction.
Le fait que la place prdominante occupe par la monnaie en conomie politique rsulte plutt de
ce qu'elle est une mesure des mobiles qu'un but aux efforts, apparat bien si nous rflchissons que
l'usage peu prs exclusif de la monnaie comme mesure des mobiles est, pour ainsi dire, un
accident et un accident qui peut-tre ne se rencontrerait pas dans des mondes autres que le ntre.
Lorsque nous voulons amener un homme faire quelque chose pour nous, nous lui offrons
d'ordinaire de l'argent. Il est vrai que nous pouvons faire appel sa gnrosit ou son sentiment
du devoir ; mais ce serait mettre enjeu des mobiles latents qui existent dj, plutt que faire natre
de nouveaux mobiles. Si nous voulons faire natre un nouveau mobile, nous considrerons
d'ordinaire quelle somme d'argent sera suffisante pour le dcider agir. Parfois, il est vrai, la
reconnaissance, l'estime ou l'honneur nous induisent agir et peuvent devenir un mobile nouveau :
surtout s'ils peuvent tre cristalliss en quelque signe extrieur particulier, comme par exemple
dans le droit de faire usage des lettres C. B., ou de porter une toile ou une jarretire. De telles
distinctions sont relativement rares et ne s'appliquent qu' un petit nombre d'actions; elles ne
pourraient pas servir mesurer les mobiles ordinaires qui gouvernent les hommes dans les actes de
la vie de chaque jour. Mais les services politiques sont plus souvent rcompenss de cette faon
que d'une autre : aussi avons-nous pris l'habitude de les mesurer non en argent, mais en honneurs.
Nous disons, par exemple, que la peine que A s'est donne pour son parti ou pour I'tat, selon le
cas, a t bien paye par le titre de chevalier ; tandis que ce titre tait une rcompense insuffisante
pour B, et qu'il a t fait baronnet.
Il est tout fait possible qu'il puisse exister des mondes o personne n'aurait jamais entendu
parler de proprit prive sur les choses matrielles, ni de richesse au sens o nous entendons
gnralement ce mot ; mais o les honneurs publics seraient mesurs d'aprs des tables gradues et
distribus en rcompense de toute action accomplie pour le bien d'autrui. Si ces honneurs
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
52
De mme, lorsque l'on dit que le mobile des actions d'un homme rside dans
l'argent qu'il compte gagner, cela ne veut pas dire que son esprit soit ferm toute
considration autre que celle du gain. Car mme les relations qui sont uniquement des
relations d'affaires supposent de l'honntet et de la bonne foi; et souvent elles
supposent sinon de la gnrosit, du moins l'absence de bassesse, et cette fiert que
tout honnte homme prouve se bien conduire. En outre, une grande partie du
travail par lequel les hommes gagnent leur vie, est en lui-mme agrable; et il y a du
vrai dans l'ide soutenue par les socialistes que l'on pourrait, par plaisir, en faire
encore davantage. Le travail professionnel lui-mme, qui semble premire vue sans
attrait, procure souvent un grand plaisir en offrant un but l'exercice des facults de
l'homme, et ses instincts d'mulation et d'autorit. Un cheval de course ou un athlte
tend chacun de ses nerfs pour dpasser ses concurrents, et prend plaisir cet effort :
de mme un industriel ou un ngociant est souvent stimul beaucoup plus par l'espoir
de vaincre ses rivaux que par le dsir d'ajouter quelque chose sa fortune 1.
pouvaient tre transmis de l'un l'autre sans l'intervention d'aucune autorit extrieure, ils
pourraient servir mesurer la force des mobiles tout aussi bien et tout aussi exactement que le fait
la monnaie chez nous. Dans un tel monde on pourrait faire un trait d'conomie politique
thorique qui serait trs semblable celui-ci, quoique il n'y soit fait que trs peu mention de
choses matrielles, et pas du tout mention de la monnaie.
Il peut sembler presque inutile d'insister sur ce point ; mais il n'en est rien. Dans l'esprit de
bien des gens, en effet, une confusion s'est faite entre cette faon de mesurer les mobiles qui
prdomine dans la science conomique et le fait de prter une attention exclusive la richesse
matrielle. Les seules conditions que doive remplir une chose, pour servir de mesure au point de
vue conomique, sont d'tre bien dfinie et transmissible. Le fait qu'elle revt une forme matrielle
est commode au point de vue pratique, mais n'est pas essentiel.
Les conomistes allemands ont rendu service en insistant aussi sur ce genre de considrations,
mais ils paraissent avoir commis l'erreur de croire qu'elles ont t ngliges par les anciens
conomistes anglais. C'est une habitude anglaise de s'en rapporter en bien des points au sens
commun du lecteur ; ici la rticence a t pousse trop loin, et a produit de frquentes mprises
chez nous aussi bien qu' l'tranger.
C'est ainsi qu'on a cit avec insistance la formule de Mill, que l'conomie politique envisage
l'homme en tant qu'occup uniquement acqurir et consommer la richesse (Essays, p. 138, et
encore Logic, livre VI, ch. IX, 3). On oublie qu'elle se rfre une tude abstraite des questions
conomiques, laquelle il compta un moment se livrer ; mais il n'excuta jamais ce projet,
prfrant crire sur l'conomie politique avec quelques-unes de ses applications la philosophie
sociale . On oublie qu'il est all jusqu' dire : Il n'y a peut-tre aucune action dans la vie d'un
homme o il n'ait t directement ou indirectement sous l'influence d'aucun autre mobile que le
simple dsir de richesse ; et oit oublie que dans sa manire d'envisager les questions
conomiques il tenait constamment compte de beaucoup de mobiles autres que le dsir de la
richesse (voir ci-dessus, ch. IV, 7). Ses discussions relatives aux mobiles conomiques sont
pourtant infrieures, et au point de vue du fond et au point de vue de la mthode, celles de ses
contemporains allemands, de Hermann notamment. On trouvera dans Knies, Politische
Oekonomie, III, 3, une dmonstration instructive de cette ide que les plaisirs non-achetables, nonmesurables, varient suivant les poques et tendent augmenter avec le progrs de la civilisation ;
les lecteurs qui lisent l'anglais peuvent se rfrer Syme, Outlines of an Industrial Science.
Mais il peut tre bon de citer ici les parties essentielles de l'analyse des mobiles conomiques
(Motive im wirthschaftlichen flandeln) qui se trouve dans la troisime dition du grand trait de
Wagner. Il les divise en mobiles gostes et mobiles altruistes. Les premiers sont au nombre de
quatre. Le premier, et le plus continu dans son action, est le dsir de se procurer soi-mme un
avantage conomique et la crainte d'tre dans le besoin. Ensuite vient la crainte d'un chtiment et
l'espoir d'une rcompense. Le troisime groupe comprend le sentiment de l'honneur et le dsir de
se faire valoir (Geltungsstreben), en y faisant rentrer le dsir de l'approbation morale d'autrui, la
crainte de la honte et du mpris. Le dernier des mobiles gostes est le dsir d'avoir une
occupation, le plaisir de l'activit, le plaisir procur par le travail lui-mme et par ses circonstances
accessoires, en y comprenant les plaisirs de la lutte (pleasures of the chase). Le mobile altruiste,
c'est la force de l'autorit intrieure qui commande de se comporter selon la morale, la force du
sentiment du devoir, la crainte du blme intrieur, c'est--dire des remords de la conscience. Dans
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
53
Retour la table des matires
7. - Les conomistes ont, d'ailleurs, toujours eu l'habitude de tenir soigneusement compte de tous les avantages qui attirent d'ordinaire les gens vers un mtier,
qu'ils se prsentent ou qu'ils ne se prsentent pas sous la forme de monnaie. Toutes
choses restant gales, les gens prfreront les mtiers dans lesquels on ne se tache pas
les mains, dans lesquels on jouit d'une bonne situation sociale, et ainsi de suite.
Puisque ces satisfactions affectent, non pas il est vrai tout homme de la mme faon,
mais la plupart des gens d'une faon presque semblable, leur force d'attraction peut
tre estime et mesure d'aprs les salaires en monnaie qui sont regards comme leur
quivalent.
En outre, le dsir de gagner l'approbation, et d'viter le blme de ceux au milieu
desquels on vit, est un stimulant l'action, qui opre souvent avec une sorte d'uniformit dans une classe donne de personnes, un moment et dans un lieu donns,
bien que les conditions de lieu et de temps aient une grande influence non seulement
sur l'intensit de ce dsir d'approbation, mais aussi sur le genre de personnes dont on
dsire tre approuv. Un mdecin, par exemple, ou un artisan, sera trs sensible
l'approbation ou au blme de ceux qui ont le mme mtier que lui et se souciera peu
de l'apprciation des autres personnes. Il y a un grand nombre de problmes conomiques, dont la discussion reste tout fait en dehors de la ralit, si l'on ne prend pas
la prcaution d'observer et d'apprcier avec soin la direction et la force des mobiles de
ce genre.
De mme qu'il peut y avoir une nuance d'gosme dans le dsir que ressent un
homme de se rendre utile ses compagnons de travail, de mme il peut y avoir une
pointe de vanit personnelle dans son dsir de voir sa famille prospre pendant sa vie
et aprs sa mort. Pourtant les affections de famille sont d'ordinaire une forme
d'altruisme si pure, que leur action aurait eu peut-tre peu de rgularit, sans l'uniformit qui existe dans les relations de famille elles mmes. En fait, leur action est
parfaitement rgulire ; et les conomistes en ont toujours pleinement tenu compte,
particulirement au point de vue de la distribution du revenu familial entre les
diffrents membres de la famille, au point de vue des dpenses faites pour prparer
les enfants leur future carrire, et au point de vue de l'accumulation de richesses
destines tre consommes aprs la mort de celui qui les a gagnes.
Ce n'est donc pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent
pas, que les conomistes ne tiennent pas compte de l'action exerce par des mobiles
analogues ceux-ci. Ils se dclarent heureux de constater que quelques-unes des
formes de l'action philanthropique soient susceptibles d'tre dcrites l'aide de
statistiques et de se ramener dans une certaine mesure des lois, si l'on prend des
sa forme pure ce mobile apparat comme l'Impratif catgorique , que l'on suit parce que l'on
sent dans son me l'ordre d'agir de telle ou telle manire et l'ordre de se conduire droitement...
Obir cet ordre procure d'ordinaire certains sentiments de plaisir (Lustgefhlen), et ne pas lui
obir fait natre des sentiments de peine. Alors il peut arriver, et souvent il arrive, que ces
sentiments agissent aussi fortement que l'Impratif catgorique, on mme plus fortement, pour
nous pousser, ou pour contribuer nous pousser faire une chose ou ne pas la faire. Dans la
mesure o il en est ainsi, ce mobile, lui aussi, renferme un lment goste, ou dit moins se
transforme en un lment goste.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
54
moyennes suffisamment larges. D'ailleurs, il n'y a peut-tre pas de mobile si capricieux et si irrgulier, que l'on ne puisse son sujet formuler quelque loi l'aide
d'observations tendues et patientes. Il serait peut-tre possible ds maintenant de dire
l'avance avec une rigueur suffisante quelles sommes une population de cent mille
Anglais, de richesse moyenne, souscrirait pour subventionner des hpitaux, des
glises et des missions; dans la mesure o cette prvision peut se faire, il devient
possible de se livrer une discussion conomique de l'offre et de la demande en ce
qui concerne les services des garde-malades des hpitaux, ceux des missionnaires, et
des autres ministres de la religion. Pourtant il restera probablement toujours vrai que
la plus grande partie des actions dues un sentiment de devoir et d'amour envers le
prochain ne peuvent pas tre classes, ramenes des lois et mesures. C'est pour
cette raison, et non pour la raison qu'elles ne sont pas bases sur l'intrt personnel,
que l'conomie politique ne peut pas difier sur elles ses constructions.
Retour la table des matires
8. - Les anciens conomistes anglais ont peut-tre trop confin leur attention aux
mobiles de l'action individuelle. Or, en fait, les conomistes, comme tous ceux qui
tudient la science sociale, ont s'occuper des individus surtout en tant que membres
de l'organisme social. De mme qu'une cathdrale est quelque chose de plus que les
pierres dont elle est faite, de mme qu'une personne est quelque chose de plus qu'une
srie de penses et de sentiments, de mme la vie de la socit est quelque chose de
plus que la somme des vies des individus. Il est vrai que l'action du tout est forme de
l'action de ses parties constituantes, et que, dans la plupart des problmes conomiques, le meilleur point de dpart se trouve dans les mobiles qui affectent l'individu,
considr non pas certes comme atome isol, mais comme membre de quelque mtier
particulier ou de quelque groupe industriel. Mais il vrai aussi, comme certains
crivains allemands l'ont bien montr, que l'conomique doit se proccuper grandement, et de plus en plus, des mobiles se rattachant l'appropriation collective des
biens et la poursuite collective de certains buts importants.
Les proccupations de plus en plus graves de notre poque, les progrs de l'intelligence dans la masse populaire, les progrs du tlgraphe, de la presse, et des autres
moyens de communication tendent largir toujours le champ de l'action collective
inspire par le bien public. Ces transformations, auxquelles il faut ajouter l'essor du
mouvement coopratif, et des autres formes de l'association volontaire, sont dues
l'influence de divers mobiles autres que celui du bnfice pcuniaire. Elles offrent
sans cesse l'conomiste de nouvelles occasions de mesurer des mobiles dont il avait
paru jusqu'alors impossible de ramener l'action une loi quelconque.
La diversit des mobiles, les difficults qu'il y a les mesurer, et la manire de
triompher de ces difficults, sont parmi les principaux sujets dont nous nous
occuperons dans le reste de ce trait. Presque tous les points touchs dans le prsent
chapitre devront tre discuts avec plus de dtails propos des principaux problmes
de l'conomie politique.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
55
Retour la table des matires
9. - Nous conclurons provisoirement de la faon suivante. Les conomistes
tudient les actions des individus, mais au point de vue de la vie sociale, plutt qu'
celui de la vie individuelle ; par suite, ils ne se proccupent que peu des particularits
personnelles de temprament et de caractre. Ils observent avec soin la conduite de
toute une classe de gens, parfois l'ensemble d'une nation, parfois seulement ceux qui
vivent dans une certaine rgion, plus souvent ceux qui sont occups un mtier
particulier dans un certain moment et un certain endroit. l'aide de la statistique, on
de tout autre faon, ils dterminent quelle somme de monnaie les membres du groupe
particulier qu'ils observent sont en moyenne juste disposs payer comme prix d'une
certaine chose dsire, ou quelle somme il faut leur offrir pour les amener supporter
un effort ou une abstinence pnible. Cette faon de mesurer les mobiles n'est certes
pas absolument exacte ; si elle l'tait, l'conomie politique occuperait le mme rang
que les sciences physiques les plus avances, et ne serait pas, comme elle l'est en
ralit, parmi les sciences les moins avances.
Pourtant cette manire de mesurer les mobiles est assez exacte pour permettre
des hommes expriments de prvoir assez bien l'tendue des rsultats que doivent
produire des changements intressant particulirement les mobiles d'une certaine
espce. Ainsi, par exemple, ils peuvent estimer trs exactement les sommes ncessaires pour susciter l'offre de travail, sous sa forme la plus grossire, comme sous sa
forme la plus leve, dont a besoin une nouvelle industrie que l'on propose d'tablir
dans un endroit quelconque. Lorsqu'ils visitent une fabrique d'un genre nouveau pour
eux, ils peuvent dire un ou deux shillings prs ce que tel ouvrier gagne dans la
semaine, rien qu'en observant quelle est la difficult de son travail, et quelle fatigue il
exige de ses facults physiques, mentales et morales. Ils peuvent prdire avec une
certitude suffisante quelle hausse de prix entranera une diminution donne de l'offre
d'une certaine chose, et dans quelle mesure cette hausse de prix ragira sur l'offre.
Partant de considrations simples de ce genre, les conomistes en viennent
analyser les causes qui gouvernent la rpartition locale des diffrents genres d'industries, les conditions auxquelles des gens vivant en des lieux loigns changent leurs
biens entre eux, et ainsi de suite. Ils peuvent expliquer et prdire l'influence que les
crises de crdit auront sur le commerce tranger, ou encore dans quelle mesure les
gens sur qui un impt est lev, pourront le faire supporter par ceux aux besoins
desquels ils pourvoient, et ainsi de suite.
En tout cela ils envisagent l'homme tel qu'il est : non pas un homme abstrait ou
conomique , mais un homme de chair et de sang, fortement influenc par des
mobiles gostes dans sa vie professionnelle, mais sans tre l'abri de la vanit et de
la ngligence, ni insensible au plaisir de bien faire son travail pour lui-mme, ou au
plaisir de se sacrifier pour le bien de sa famille, de ses voisins, ou de son pays, ni
incapable d'aimer pour elle-mme une vie vertueuse. Ils considrent l'homme tel qu'il
est ; mais s'intressant surtout cette partie de la vie humaine o l'action des mobiles
est assez rgulire pour pouvoir tre prdite, et o le calcul des forces motrices peut
tre vrifi d'aprs les rsultats, ils ont pu tablir leur uvre sur une base scientifique.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
56
En premier lieu, ils ont s'occuper de faits qui peuvent tre observs, et de
quantits qui peuvent tre mesures et enregistres ; de sorte que si des divergences
d'opinion surgissent leur sujet, on peut faire appel au tmoignage du public ou des
constatations bien tablies. La science possde ainsi pour son uvre une base solide.
En second lieu, les problmes qui sont qualifis de problmes conomiques, pour
cette raison qu'ils se rfrent particulirement aux actions accomplies par l'homme
sous l'influence de mobiles qui peuvent tre mesurs par un prix en monnaie, forment
un groupe trs homogne. Naturellement, ils ont un grand nombre de points communs ; cela rsulte avec vidence de leur nature mme. Mais, ce qui n'est pas aussi
vident a priori, et ce qui est vrai pourtant, c'est que les principaux d'entre eux ont une
certaine unit de forme fondamentale. Aussi, en les tudiant tous ensemble, on fait la
mme conomie qu'en faisant distribuer par un seul facteur toutes les lettres d'une
certaine rue, au lieu que chacun fasse prendre ses lettres par une personne diffrente.
Les mthodes d'analyse et de raisonnement qui sont ncessaires pour tel groupe
d'entre eux, se trouvent tre gnralement utilisables pour d'autres.
Ainsi, moins nous nous proccupons des discussions scolastiques sur la question
de savoir si tel sujet rentre dans l'objet de l'conomie politique, et mieux cela vaut. Si
le sujet est important, tudions-le, du mieux que nous le pouvons. Si c'est un sujet sur
lequel existent des divergences d'opinion, et que l'on manque des connaissances
exactes et bien tablies ncessaires pour les trancher ; si c'est un sujet sur lequel
l'appareil du raisonnement et de l'analyse conomiques ne peut pas avoir de prise,
laissons-le de ct dans nos tudes purement conomiques. Mais si nous agissons
ainsi, que ce soit simplement parce que toute tentative faite pour l'y comprendre
affaiblirait la certitude et l'exactitude de nos connaissances conomiques sans nous
procurer aucun avantage proportionn. Rappelons-nous aussi toujours que nous
pouvons nous faire sur ce sujet quelques ides l'aide de nos instincts moraux et de
notre sens commun, lorsque nous recourons eux comme arbitres suprmes pour
appliquer, dans le domaine des rsultats pratiques, les connaissances obtenues et
labores par la science conomique et par les autres sciences.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
57
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre I : aperu prliminaire
Chapitre sixime
Mthodes dtudes. Nature de la loi
conomique
Retour la table des matires
1. - La tche de l'conomique, comme de presque toute science, est de rassembler des faits, de les grouper, de les interprter et d'en tirer des conclusions.
Observation et description, dfinition et classification sont les travaux prparatoires.
Mais ce que nous dsirons obtenir par l, c'est la connaissance des liens qui existent
entre les phnomnes conomiques... Induction et dduction sont toutes deux ncessaires l'uvre scientifique, comme le pied gauche et le pied droit sont tous deux
ncessaires la marche 1. Les mthodes qu'exige cette double tche ne sont pas
particulires l'conomique ; elles sont communes toutes les sciences. Tous les
expdients pouvant servir dcouvrir les relations existant entre causes et effets, dont
on trouve la description dans les ouvrages traitant de la mthode dans les sciences,
doivent tre employs leur tour par l'conomiste. Aucune mthode de recherche ne
peut tre proprement appele la mthode de l'conomie politique; mais toute mthode
peut rendre des services, lorsqu'elle est employe bien sa place, soit seule, soit en la
1
Schmoller, article Volkswirtschaft dans le Handwrterbuch de Conrad. Le sujet de ce chapitre a
t trait d'une faon un peu diffrente par l'auteur de cet ouvrage dans un article intitul :
Distribution and Exchange, dans Economic Journal, mars 1898.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
58
combinant avec d'autres. De mme que le nombre des combinaisons dans le jeu
d'checs est si grand que, probablement jamais n'ont t joues deux parties absolument semblables; de mme, dans les luttes que les savants engagent avec la nature
pour lui arracher ses secrets, jamais n'a t employe deux fois une mthode tout
fait identique, d'une faon absolument semblable.
Dans certaines branches des recherches conomiques, et pour certains sujets, il est
plus urgent de constater de nouveaux faits, que de chercher fixer les relations
mutuelles de ceux que nous connaissons dj et les expliquer. Dans d'autres
branches, au contraire, il reste encore tant d'incertitude sur la question de savoir si les
causes qui se trouvent en vidence, et qui viennent d'elles-mmes et tout de suite
l'esprit, sont la fois les vraies causes, et les seules causes, d'un phnomne, que la
tche urgente est alors de scruter nos raisonnements touchant les faits que nous
connaissons dj, plutt que de chercher de nouveaux faits.
Pour cette raison, et pour d'autres, on a toujours eu, et on aura toujours besoin de
trouver cte cte des travailleurs ayant des aptitudes et des buts diffrents, les uns
s'attachant surtout la constatation des faits, les autres l'analyse scientifique, c'est-dire morcelant des faits complexes et tudiant les relations que leurs diffrentes
parties ont entre elles ainsi qu'avec d'autres faits connus. Il faut esprer que ces deux
coles subsisteront toujours cte cte, chacune accomplissant parfaitement son
uvre, et chacune tirant parti de l'uvre de l'autre. C'est le meilleur moyen d'arriver
pour le pass des gnralisations solides, et d'y trouver un guide sr pour l'avenir.
Examinons l'uvre de l'une et de l'autre de ces deux coles 1.
Retour la table des matires
2. - Tout d'abord remarquons qu'il n'y a pas place en conomie politique pour de
longues chanes de raisonnements ; c'est--dire pour les raisonnements dans lesquels
chaque chanon est maintenu, principalement ou compltement, par celui qui vient
avant, sans que l'on recourre ensuite l'observation et l'tude directe de la vie relle.
De pareilles chanes de raisonnements peuvent bien donner lieu d'intressantes
spculations de cabinet ; mais elles ne pourraient pas tre assez conformes la ralit
pour servir de guides l'action. Les conomistes classiques ne traitaient pas l'conomie politique comme une distraction acadmique, mais comme un moyen d'arriver
1
Les discussions de ces vingt dernires annes ont peu peu montr que ceux auxquels on doit les
uvres les meilleures et les plus originales dans le champ de la recherche conomique, sont
d'accord au fond quant l'emploi faire des diffrentes mthodes scientifiques selon les parties
diffrentes auxquelles on travaille : les divergences qui, en ralit, existent entre eux, sont surtout
dues leurs faons diffrentes d'insister sur les diverses mthodes.
Dans ces derniers temps la controverse de mthode la plus remarquable est celle qui a eu lieu
entre Charles Menger et Schmoller. Mais il est devenu manifeste que l'attitude de Schmoller dans
la controverse a t mal comprise. Il est l'heure actuelle le chef reconnu des tendances historiques dans l'conomie politique allemande ; or son manifeste, dans l'article dj cit, dsavoue
formellement les thories troites et agressives qui ont t mises en avant en Allemagne et ailleurs
par quelques-uns des plus jeunes adhrents de l'cole. On peut donc esprer que le temps est enfin
venu de cesser les controverses striles et de consacrer toutes les nergies des conomistes aux
formes varies du travail d'dification, chacune d'elles venant aider les autres. Voir aussi
ASHLEY, On the Study of Economic History, dans Journal of Economics de Harvard, vol. VII, et
le magistral aperu qui est donn par Wagner des domaines particuliers et de la mutuelle
interdpendance des mthodes historiques et analytiques (Grundlegung, livre I, ch. II).
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
59
certaines fins importantes d'intrt public ; aucun d'eux, pas mme Ricardo, ne s'est
plu difier de longues chanes de raisonnements dductifs sans se rfrer l'observation directe.
Il est vrai que les forces dont s'occupe l'conomie politique se prtent particulirement au raisonnement dductif par le fait que leur mode de combinaison, comme Mill
l'a observ, est plutt celui de la mcanique que celui de la chimie. Cela veut dire que
lorsque nous connaissons l'action qu'exercent sparment deux forces conomiques, par exemple l'influence qu'une augmentation du taux des salaires et une diminution de
la difficult du travail dans une branche d'industrie pourront exercer respectivement
sur l'offre de travail dans cette branche, - nous pouvons alors prdire assez exactement ce que sera leur action combine, sans attendre qu'une exprience spcifique
vienne nous l'apprendre 1.
Mais mme en mcanique les longues chanes de raisonnements dductifs ne sont
directement applicables qu'aux recherches de laboratoire. Par elles-mmes il est rare
qu'elles soient un guide suffisant pour se dbrouiller parmi les matriaux htrognes
sous la forme desquels se prsentent les forces dans le monde rel, ainsi qu'au milieu
des combinaisons complexes et incertaines auxquelles ces forces donnent lieu. Pour
cela, elles ont besoin qu'on les complte par l'exprience spcifique, et qu'on les
emploie en les conformant, et souvent en les subordonnant, une tude continuelle
des faits, et une recherche continuelle de nouvelles inductions 2.
Mais les forces dont l'conomie politique doit tenir compte sont plus nombreuses,
moins dfinies, moins bien connues, et d'un caractre plus vari que celles de la
mcanique ; en mme temps, la matire sur laquelle elles agissent est plus incertaine
et moins homogne. De plus, les cas dans lesquels les forces conomiques se
combinent entre elles avec l'arbitraire apparent de la chimie, plutt qu'avec la simple
rgularit de la mcanique pure, ne sont ni rares, ni sans importance, En outre, bien
que des combinaisons inattendues de forces aient moins de chance en conomie
politique qu'en chimie de produire des rsultats foudroyants, elles y sont pourtant bien
plus difficiles viter 3.
1
Mill exagrait l'importance de ce fait ; cela l'a amen mettre des prtentions excessives sur
l'emploi de la mthode dductive en conomie politique. Voyez le dernier de ses Essays, le livre
VI de sa Logic et notamment le neuvime chapitre, ainsi que les pp. 157-161 de son
Autobiography. Comme il arrive pour beaucoup d'autres auteurs qui ont crit sur la mthode, sa
conduite tait moins intransigeante crue ses dclarations. Mais voyez ci-dessus Chapitre IV 7.
Les longues chanes de raisonnements dductifs sont, il est vrai, directement utilisables en
astronomie o la nature a donn elle-mme un empire, en fait exclusif, un petit nombre de forces
bien dfinies. Les prdictions des astronomes touchant les mouvements du systme solaire ne sont
soumises qu' une seule hypothse, savoir que la nature n'y introduit pas quelque grand corps
extrieur dont elles n'auraient pas tenu compte.
Lorsque les calculs de la mcanique thorique sont appliqus quelque problme pratique o
les forces de la nature sont peu nombreuses et bien dfinies, les matriaux simples et homognes,
ils rpondent en gros la ralit, peu prs comme un paysage vu au travers d'une vitre en verre
de mauvaise qualit. L'ingnieur, par exemple, peut calculer avec assez de prcision l'angle auquel
un cuirass perdra sa stabilit en eau tranquille ; mais avant de prdire comment il se comportera
dans une tempte, il devra se servir des observations faites par des marins expriments ayant
observ ses mouvements dans une mer ordinaire.
Connaissant la faon dont se comporte un fil lastique sous des tensions de dix et de vingt livres,
nous ne pouvons pas savoir comment il se comportera sous une tension de trente ; car il peut alors
ne pas s'tirer davantage, mais se briser et se contracter. De mme deux forces conomiques,
agissant dans la mme direction, peuvent amener des changements dans les habitudes et dans les
conceptions des hommes, et arriver ainsi produire des rsultats qui seront diffrents de ceux que
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
60
Enfin, alors que la matire laquelle le chimiste a faire est toujours la mme,
l'conomie politique, comme la biologie, traite une matire dont la nature intime et la
constitution, aussi bien que la forme extrieure, sont en voie de transformation
constante 1.
Ainsi, lorsque nous envisageons l'histoire des relations purement conomiques,
comme celles que font natre le crdit et la banque, le trade-unionisme ou la coopration, nous constatons que certaines faons d'agir, qui ont gnralement russi
certaines poques et en certains lieux, ont uniformment chou d'autres. La
diffrence peut parfois s'expliquer simplement par les carts existant au point de vue
du niveau des lumires, ou au point de vue de la force morale de caractre, et des
habitudes de confiance mutuelle ; mais souvent l'explication est plus difficile. une
certaine poque, ou dans un certain lieu, la confiance rciproque et le got de se
sacrifier pour le bien commun peuvent tre trs dvelopps, mais seulement dans
certaines directions ; une autre poque ou dans un autre lieu, on constatera des
tendances analogues, mais dans une autre direction. Toutes ces diversits rduisent
l'emploi de la dduction en conomie politique 2.
chacune d'elles aurait donns isolment, peut-tre mme partiellement en opposition avec eux. Par
exemple, une lgre augmentation du revenu d'un homme entranera un lger accroissement de
presque toutes ses dpenses ; mais une augmentation importante peut modifier ses habitudes,
augmenter peut-tre le respect qu'il a de lui-mme, et faire qu'il cesse tout fait de se proccuper
de certaines choses. Lorsqu'une mode gagne une couche sociale infrieure, elle peut, la suite de
cela, disparatre dans les classes plus leves. De mme le fait que nous nous proccupons plus
srieusement des pauvres peut donner notre charit un caractre de plus grande prodigalit,
comme il peut aussi faire disparatre quelques-unes des formes qu'elle revtait.
Les prvisions du chimiste reposent toutes sur l'hypothse latente, que le spcimen sur lequel il
opre, est bien ce qu'il est suppos tre, ou du moins que les impurets qui s'y trouvent ont assez
peu d'importance pour pouvoir tre ngliges. Les prvisions de l'conomiste supposent de plus
l'hypothse que la nature humaine soit, en substance, la mme qu'au moment o ont t observs
les faits sur lesquels sont principalement bass ses raisonnements. Le chimiste lui-mme, lorsqu'il
s'occupe non plus de la matire inanime, mais des tres vivants, peut rarement s'carter avec
scurit bien loin du terrain solide de l'exprience spcifique. Il faut notamment qu'il s'en rapporte
elle pour savoir comment un nouveau remde affectera une personne bien portante, et ensuite
comment il affectera une personne souffrant d'une certaine maladie. Mme aprs avoir fait
quelques expriences gnrales, il peut rencontrer des rsultats inattendus dans l'action que ce
remde exerce sur des personnes de constitutions diffrentes, on dans de nouvelles combinaisons
avec d'autres remdes. Mais grce une interrogation patiente de la nature, et grce aux progrs de
l'analyse, le rgne de la loi gagne du terrain en thrapeutique comme en conomie politique ; une
sorte de prvision, indpendante de l'exprience spcifique, y devient possible touchant l'action
isole et l'action combine d'un nombre toujours plus grand d'agents.
Comparez, ci-dessus, ch. I, 4, et ch. IV, 7. Pour notre sujet actuel les particularits de race ont
plus d'importance que celles qui tiennent l'individu. Il est vrai que le caractre individuel se
modifie, en partie d'une faon qui semble arbitraire, et en partie d'aprs des rgles bien connues. Il
est vrai encore, par exemple, que l'ge moyen des ouvriers engags dans un conflit industriel est
un lment important pour prvoir la tournure que le conflit prendra. Mais comme, gnralement
parlant, jeunes et vieux, gens de temprament sanguin et gens de temprament dcourag, se
trouvent en proportions peu prs semblables dans un lieu et dans un autre, une poque et une
autre, les particularits individuelles et les modifications de caractres ne font pas, autant qu'il
semble premire vue, obstacle l'emploi gnral de la mthode dductive. Cf. ci-dessus, ch. V,
4. Pour des raisons semblables, les discussions philosophiques sur la libert de la volont
n'intressent pas l'conomiste en tant que tel : les raisonnements auxquels il se livre ne prsupposent pas que l'on adopte une solution particulire sur ces questions.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
61
Retour la table des matires
3. - Le rle de l'analyse et de la dduction en conomie politique n'est donc pas
de forger un petit nombre de longues chanes de raisonnements, mais de forger
solidement un grand nombre de courtes chanes et de simples anneaux de jonction. Ce
n'est pourtant pas l un rle infrieur. Si l'conomiste raisonne rapidement et d'un
cur lger, il est expos faire tout moment des rapprochements vicieux. Il a
besoin d'employer avec soin l'analyse et la dduction, parce que c'est seulement avec
leur aide qu'il peut faire un bon choix parmi les faits, les grouper comme il faut, et les
faire servir de suggestions pour la pense et de guides pour la pratique ; parce que,
encore, s'il est certain que toute dduction doive reposer sur une base d'inductions, il
est sr aussi que tout emploi de l'induction entrane et implique celui de l'analyse et
de la dduction ; ou, pour exprimer la mme chose d'une autre faon, l'explication du
pass et la prdiction de l'avenir ne sont pas des oprations diffrentes, mais la mme
opration faite en sens contraires, l'une de l'effet la cause, l'autre de la cause
l'effet 1.
Nous ne pouvons expliquer compltement un vnement qu' la condition de
dcouvrir d'abord tous les vnements qui peuvent l'avoir affect, et la faon dont
chacun d'eux l'a fait. Dans la mesure o l'analyse que nous faisons de l'un quelconque
de ces faits, ou de l'une quelconque de ces relations, est imparfaite, notre explication
est expose se trouver inexacte ; sur les consquences latentes qu'elle contient,
s'difie dj une induction qui, bien que probablement plausible, est fausse. Au
contraire, lorsque notre connaissance des faits et notre analyse sont compltes, nous
pouvons, par la simple inversion de notre opration d'esprit, dduire et prdire l'avenir
avec presque autant de certitude que nous avons, l'aide des mmes lments de
connaissance, expliqu le pass. C'est seulement par la suite qu'une grande diffrence
apparat entre la certitude de la prdiction et la certitude de l'explication : en effet, une
erreur commise au dbut en matire de prdiction, grossit et s'intensifie par la suite ;
tandis que dans l'interprtation du pass, une erreur n'a pas autant de chance d'aller en
grandissant, l'observation on les documents historiques lui faisant obstacle chaque
pas 2.
1
Schmoller, dans l'article sur la Volkswirtschaft dj cit, dit trs bien que pour obtenir une
connaissance des causes individuelles nous avons besoin de l'induction ; elle conduit d'ailleurs
finalement l'inversion du syllogisme employ dans la dduction... L'induction et la dduction
reposent sur les mmes tendances, les mmes croyances et les mmes besoins de notre raison .
La science des mares prsente beaucoup d'troites analogies avec l'conomie politique. Dans
l'une et l'autre science on trouve une srie de grandes forces exerant une influence visible sur
presque tous les phnomnes et une influence prdominante sur quelques-uns : dans la science des
mares, ce sont les attractions de la lune et du soleil, dans l'conomie politique, c'est le dsir de se
procurer des satisfactions avec le moindre effort. Dans les deux cas une tude purement dductive
de l'action exerce par les forces principales, soit elles seules, soit par leur combinaison avec des
forces d'une action moins universelle, donnerait des rsultats qui pourraient avoir un intrt
scientifique, mais qui ne seraient d'aucun emploi pour guider dans la pratique. Cependant, dans les
deux cas, des dductions de ce genre sont utiles pour donner de la vie aux faits observs, pour les
grouper les uns avec les autres, et pour aider ainsi lever les lois secondaires de la science.
Il est vrai, par exemple, que, mme l'heure actuelle, ni la connaissance des courants
maritimes, ni celle de l'action du vent sur l'eau, ne permettraient un homme de dire exactement
quelles diffrences il y aura entre les mares dans les ports de Guernesey et dans ceux de Jersey, ni
d'indiquer les limites exactes des points de la cte anglaise o il y a quatre mares chaque jour, ni
quelle force devrait avoir une tempte dans la mer du Nord pour faire que dans les docks de
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
62
Il faut ainsi toujours se rappeler que si l'observation ou l'histoire peuvent nous dire
que tel fait s'est produit en mme temps qu'un autre, ou aprs lui, elles ne sauraient
nous dire si le premier tait la cause du second. Seule, l'aide de la raison oprant sur
les faits, peut le faire. Lorsqu'on dit que tel vnement historique nous apprend ceci
oit cela, c'est qu'on ne tient jamais formellement compte de toutes les conditions qui
l'ont accompagn : quelques-unes sont tacitement, sinon mme inconsciemment,
supposes avoir t sans action. Cette supposition peut tre lgitime dans un cas particulier, mais ne pas l'tre dans un autre. Une observation plus tendue, un examen plus
soigneux, peuvent montrer que les causes auxquelles l'vnement est attribu
n'auraient pas pu le produire, si elles n'avaient pas t aides; peut-tre mme qu'elles
ont entrav l'vnement et qu'il s'est produit en dpit d'elles, sous l'action d'autres
causes qui avaient chapp l'observation.
Cette difficult est mise en relief par les controverses sur les vnements contemporains de notre pays. Ds que la conclusion, quelle qu'elle soit, qu'on en tire,
rencontre de l'opposition, elle subit une sorte d'preuve ; des explications contraires
sont proposes ; de nouveaux faits sont mis en lumire; les faits dj connus sont
vrifis, disposs diffremment, et, dans certains cas, on constate qu'ils mnent une
conclusion oppose celle en faveur de laquelle ils ont d'abord t invoqus.
La difficult que rencontre l'analyse, et en mme temps le besoin qu'on en a, se
trouvent la fois accrus par le fait que deux vnements conomiques ne sont jamais
exactement semblables tous les gards, videmment, il peut y avoir une troite
ressemblance entre deux incidents simples : les conditions auxquelles sont faits les
baux de deux fermes peuvent tre rgles par des causes peu prs identiques; deux
questions de salaires renvoyes aux Conseils d'arbitrage peuvent soulever au fond la
mme question. Mais il n'y a pas de fait se rptant exactement, mme sur une petite
chelle. Quelque analogues que soient deux cas, nous devons toujours examiner si la
diffrence qui existe entre eux peut tre nglige comme n'ayant pas d'importance
pratique : cela peut ne pas tre trs facile, alors mme que les deux cas se rapportent
au mme temps et au mme lieu.
Lorsque nous nous occupons de faits passs, nous devons alors tenir compte des
changements qu'a subis le caractre d'ensemble de la vie conomique. Quelque troite
que soit la ressemblance qu'un problme de nos jours prsente, dans ses incidents
extrieurs, avec un autre rapport dans l'histoire, il y a des chances pour qu'un
examen plus approfondi fasse dcouvrir une diffrence fondamentale entre leurs
caractres rels. Tant que cet examen n'a pas eu lieu, on ne peut tirer aucun argument
solide d'un cas l'autre.
Londres l'eau baisse de deux pieds pendant la moiti du temps que dure une mare montante.
Pourtant l'tude des principes gnraux sert bien choisir les faits qu'il convient d'observer, et
les rattacher les uns aux autres par des lois secondaires, qui aident tout la fois expliquer des
faits connus, et prdire les rsultats des causes connues. Ce sont les mmes procds, la fois
inductifs et dductifs, et employs presque de la mme manire, qui servent, dans l'histoire des
mares, expliquer un fait connu et prvoir un fait inconnu (Cf. Mill, Logic, livre VI, ch. VI).
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
63
Retour la table des matires
4. - Cela nous amne examiner les relations de l'conomie politique avec les
faits des poques loignes.
L'tude de l'histoire conomique peut se proposer diffrents buts, et, par suite,
recourir des mthodes diverses. Considre comme une branche de l'histoire, elle
peut avoir pour but de nous aider comprendre ce qu'a t, dans ses traits essentiels,
la charpente de la socit aux diffrentes priodes, la constitution des diverses classes
sociales, et leurs relations les unes avec les autres ; elle peut se demander quelle a
t la base matrielle de la vie sociale; comment ont t produits les objets utiles et
agrables l'existence; l'aide de quelle organisation on a pu se procurer du travail et
le diriger; comment les marchandises ainsi produites ont t distribues ; quelles
institutions a donn naissance cette uvre de direction et de distribution ; ainsi de
suite 1.
Quels que soient l'intrt et l'importance de cette uvre, il n'est pas besoin, pour
l'accomplir, d'un trs grand travail d'analyse ; presque tout le travail ncessaire peut
tre fait par tout homme d'un esprit actif et curieux. Satur de connaissances touchant
le milieu religieux et moral, intellectuel et esthtique, politique et social, l'historien
conomiste peut tendre les limites de nos connaissances, et peut suggrer des ides
nouvelles et importantes, alors mme qu'il s'est content d'observer les affinits et les
relations causales superficielles.
Mais, en dpit de lui-mme, son oeuvre sortira certainement de ces limites; elle
trahira quelque effort fait pour comprendre le sens intime de l'histoire conomique,
pour dcouvrir les causes secrtes du progrs ou de la dcadence des coutumes, et de
bien d'autres phnomnes que nous ne saurions nous contenter longtemps de considrer comme des faits derniers et insolubles fournis par la nature : il ne pourra
vraisemblablement pas non plus s'abstenir tout fait de suggrer des conclusions
tirer du pass, pour servir de guide dans le prsent. D'ailleurs, l'esprit humain rpugne
laisser une lacune dans les ides qu'il se fait sur les relations causales entre les
vnements qu'on lui prsente d'une faon vivante. Rien qu'en mettant les choses dans
un certain ordre, et en suggrant consciemment ou inconsciemment le post hoc ergo
propter hoc, l'historien accepte la responsabilit de servir de guide 2.
1
2
ASHLEY, On the Study of Economic History.
Exemple : l'introduction dans le nord de la Grande-Bretagne de baux longs termes, avec
fermages fixs en monnaie, a t suivie de grands progrs dans l'agriculture, et dans la condition
gnrale de la population ; mais, avant de conclure que ce fut l la seule cause, ou mme la
principale cause, de ces progrs, nous devons examiner quels sont les autres changements qui se
sont produits au mme moment, et dans quelle mesure ces progrs peuvent tre attribus chacun
d'eux. Nous devons, par exemple, tenir compte des effets qu'ont eus le changement des prix des
produits agricoles, et l'tablissement de la paix civile dans les provinces frontires. Il faut pour
cela de l'attention et l'emploi de la mthode scientifique. Tant que ce travail ne sera pas fait,
aucune conclusion digne de confiance ne peut tre exprime touchant les rsultats gnraux du
systme des baux longs termes. Mme lorsqu'il sera fait, nous ne pourrons pas invoquer cette
exprience comme argument en faveur d'un systme de baux longs termes l'heure actuelle, en
Irlande par exemple, sans tenir compte des diffrences que prsentent le march local et le march
mondial des divers produits agricoles, des changements qui ont chance de se faire dans la
production et dans la consommation de l'or et de l'argent, ainsi de suite. L'histoire des modes de
tenure offre un grand intrt d'rudition ; mais, moins d'tre soigneusement analyse et interprte avec l'aide de la thorie conomique, elle ne jette pas de lumire laquelle on puisse se fier
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
64
Et si c'est l son principal but, s'il met surtout son intrt tcher de dcouvrir les
ressorts cachs de l'ordre conomique du monde, et demander au pass des lumires
servant guider dans le prsent: alors il doit s'armer de tout ce qui peut l'aider
dcouvrir les diffrences relles qui se dissimulent sous une similitude de nom ou
sous une apparence extrieure, ainsi que les ressemblances relles qui sont masques
par des diffrences superficielles.
On peut emprunter ici une analogie l'histoire des guerres navales. Les dtails
d'une bataille livre avec des moyens de combat qui ne sont plus employs, peuvent
avoir un grand intrt pour le savant qui tudie l'histoire gnrale de cette poque ;
mais ils ne peuvent fournir que peu d'enseignements utiles au chef d'une flotte de nos
jours, qui doit se servir d'un matriel de guerre tout fait diffrent. Aussi, comme le
capitaine Mahan l'a admirablement montr, le commandant d'une flotte, donnera, de
nos jours, plus d'attention la stratgie qu' la tactique des temps passs 1.
C'est seulement depuis peu de temps, et en grande partie grce l'influence bienfaisante de l'cole historique, que l'on a mis en lumire, en conomie politique, la
distinction qui correspond celle que l'on fait dans l'art militaire entre la stratgie et
la tactique. Analogues la tactique sont les formes extrieures et les accidents de
l'organisation conomique, qui tiennent aux particularits de temps et de lien, aux
murs et la situation des diffrentes classes, l'influence de certains individus, ou
aux ncessits et aux instruments trs changeants de la production. la stratgie, au
sur la question de savoir quel est le mode de tenure adopter l'heure actuelle dans un pays
donn. Certains auteurs soutiennent que la proprit prive du sol doit tre une institution contre
nature et transitoire puisque dans les socits primitives les terres restent en communaut. D'autres
prtendent avec une gale confiance qu'elle est une condition ncessaire pour de nouveaux
progrs, puisqu'elle a tendu son domaine mesure que la civilisation progressait. Mais pour tirer
de l'histoire le vritable enseignement qu'elle nous donne sur ce sujet, A faudrait analyser les effets
de la proprit collective du sol dans le pass, de manire dcouvrir dans quelle mesure chacun
d'eux a encore chance d'agir de la mme faon, dans quelle mesure au contraire il peut tre
influenc par les transformations qu'a subies l'humanit au point de vue des habitudes, des connaissances, de la richesse et de l'organisation sociale.
Plus intressante, et plus instructive encore, est l'histoire des ghildes et autres corporations ou
ententes industrielles et commerciales, affirmant qu'elles ont us en somme de leurs privilges
l'avantage du public. Mais pour porter sur la question un jugement complet, et plus encore pour en
tirer des principes directeurs applicables notre temps, il faut non seulement les connaissances
tendues et les instincts subtils de l'historien exerc, mais aussi une foule d'analyses et de raisonnements difficiles touchant les monopoles, le commerce extrieur, l'incidence de l'impt, etc.
Il ne se proccupera pas tant des incidents des combats, que des faits servant illustrer les
principes directeurs d'action qui lui permettront d'avoir toutes ses forces en main, tout en laissant
chacune des parties dont elles se composent une initiative suffisante; de maintenir ses communications avec des points loigns et cependant de rester mme d'effectuer une concentration
rapide et de choisir un point d'attaque o il puisse mettre en ligne une force suprieure. Un homme
trs au courant de l'histoire gnrale d'une poque, peut faire un tableau vivant des mouvements
tactiques d'une bataille, qui sera fidle dans ses traits gnraux, et dont les inexactitudes, s'il y en
a, seront sans inconvnients : personne, en effet, ne cherchera copier des mouvements tactiques
excuts avec des instruments aujourd'hui disparus. Mais pour comprendre la stratgie d'une
campagne, pour apercevoir les vraies raisons qui ont inspir un grand gnral des temps passs et
les distinguer des raisons apparentes, un homme doit tre lui-mme stratgiste. Et s'il prend la
responsabilit de suggrer, mme discrtement, les leons que les stratgistes d'aujourd'hui peuvent tirer de l'histoire qu'il expose, alors il est oblig auparavant d'analyser fond les conditions
des guerres navales de nos jours, aussi bien que celles de l'poque dont il s'occupe ; et il doit pour
cela ne pas ngliger l'aide que peuvent lui fournir les ouvrages de tous ceux qui, dans les diffrents
pays, tudient les difficiles problmes de la stratgie. Ce qui est vrai de l'histoire maritime, l'est
aussi de l'histoire conomique.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
65
contraire, correspond cette partie plus fondamentale de l'organisation conomique qui
dpend des besoins et des activits, des prfrences et des aversions, que l'on retrouve
partout dans l'homme : elles ne sont certes pas toujours les mmes dans leur forme, ni
mme toujours semblables quant au fond ; mais partout elles ont assez de permanence
et d'universalit pour qu'il soit possible, dans une certaine mesure, de les prsenter en
des formules gnrales, grce auxquelles les expriences d'une poque peuvent
clairer les difficults d'une autre.
Cette distinction est voisine de la distinction entre l'emploi des analogies mcaniques et celui des analogies biologiques en conomie politique. Elle n'a pas t
suffisamment aperue des conomistes du commencement du XIXe sicle. Son
absence est frappante dans l'uvre de Ricardo. Aussi, lorsque, sans faire attention aux
principes impliqus dans sa mthode de travail, on s'attache uniquement aux conclusions particulires auxquelles il arrive, et qu'on les convertit en dogmes, pour les
appliquer brutalement des conditions de temps et de lieu autres que celles o il
vivait, alors il n'est pas douteux qu'elles ne puissent faire du mal. Les penses sont
comme des ciseaux bien affils, avec lesquels il est trs facile de se couper in doigt, si
l'oit a des mains maladroites.
Mais les conomistes modernes, en analysant ses formules trop arrtes, en
extrayant l'essence qu'elles contiennent, et en y faisant des adjonctions, en repoussant
les dogmes, mais en dveloppant les principes d'analyse et de raisonnement, ont
trouv la pluralit dans l'unit et l'unit dans la pluralit. Ils enseignent, par exemple,
que le principe de son analyse de la rente est inapplicable la plupart des cas o se
prsente aujourd'hui ce que l'on dsigne ordinairement du nom de rente, comme aussi,
et bien plus forte raison, ce qui est gnralement, mais incorrectement, dsign
sous ce nom par les historiens du Moyen Age. Mais cependant, bien loin de restreindre l'application du principe, ils l'ont au contraire tendu. En effet, les conomistes
enseignent aussi qu'il est applicable, sous des rserves appropries, dans toutes les
poques, une foule de choses qui ne semblent pas du tout, premire vue, rentrer
dans la notion de rente 1.
Naturellement, un homme qui tudie la stratgie ne peut pas ignorer la tactique. Sans doute une vie
humaine toute entire ne pourrait suffire tudier les dtails tactiques de toutes les batailles que
l'homme a livres contre les difficults conomiques ; nanmoins, l'tude des grands problmes de
la stratgie conomique ne saurait avoir beaucoup de valeur, si elle n'est unie une connaissance
intime de la tactique, aussi bien que de la stratgie, employe par l'homme dans sa lutte contre les
difficults une poque et dans un pays donns. De plus, tout conomiste devrait faire, par des
observations personnelles, une tude minutieuse de quelque srie particulire de dtails, non pas
ncessairement en vue d'une publication, mais pour sa propre instruction ; cela l'aiderait beaucoup
interprter et peser les renseignements, imprims ou manuscrits, qu'il possde sur le prsent ou
sur le pass. Il est vrai que tout homme rflchi et observateur acquiert sans cesse, par la
conversation et par la littrature courante, la connaissance des faits conomiques de son temps, et
notamment de sa rgion ; il accumule ainsi insensiblement une masse de faits parfois plus
complte et plus exacte certains gards que s'il puisait dans les documents existants sur certaines
catgories de faits pour des lieux et des temps loigns. Indpendamment de cela tout conomiste
srieux consacre l'tude directe et formelle des faits, surtout de ceux de son poque, beaucoup
plus de temps qu' la pure analyse et la thorie , alors mme qu'il serait de ceux qui mettent le
plus haut l'importance des ides relativement aux faits, alors mme qu'il penserait que notre tche
la plus urgente l'heure actuelle, ou celle qui nous aidera le mieux faire progresser la tactique
aussi bien que la stratgie dans la lutte de l'homme contre les difficults, n'est pas tant de runir de
nouveaux faits, que de mieux tudier les faits dj connus.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
66
Retour la table des matires
5. - Il est vrai que, pour une grande partie de cette tche, on a moins besoin de
mthodes scientifiques compliques, que d'une sagacit naturelle, d'un sentiment trs
sr de la proportion et d'une large exprience de la vie. Cependant, pour une grande
partie aussi, elle ne peut tre aisment excute qu'avec le secours de ces mthodes,
Quelques dons naturels suffisent pour qu'un homme sache trouver rapidement, et
combiner avec exactitude, des considrations applicables aux faits qui l'entourent;
mais ce sont alors surtout les faits qui lui sont familiers, qui retiendront son attention ;
il s'en tiendra d'ordinaire la surface des choses et ne sortira pas des limites de son
exprience personnelle.
Or il arrive, en conomique, que ce ne sont pas les effets des causes les plus
connues, ni les causes des effets les plus manifestes, qui ont d'ordinaire le plus
d'importance. Ce que l'on ne voit pas mrite souvent beaucoup plus d'tre tudi
que ce que l'on voit . C'est notamment ce qui arrive lorsque nous n'tudions pas
une question d'un intrt purement local ou passager, mais cherchons tablir les
bases d'une politique longue porte conforme au bien public; ou bien lorsque, pour
toute autre raison, nous nous occupons moins des causes immdiates, que des causes
des causes, causae causantes. L'exprience montre, en effet, comme on pouvait le
prvoir, que le bon sens et l'instinct sont insuffisants pour cette tche ; que l'habitude
des affaires elle-mme n'amne pas un homme chercher au-del de ces causes des
causes, que lui fournit son exprience immdiate, et qu'il ne sait pas toujours bien
diriger ses recherches, mme lorsqu'il s'y applique. Pour s'aider dans cette uvre, tout
homme doit recourir aux puissantes mthodes de pense et de connaissance, qui ont
t peu peu cres par les gnrations passes. Le rle que jouent les procds
systmatiques de raisonnement scientifique dans l'acquisition de la connaissance
ressemble certainement celui que jouent les machines dans la production des biens.
Lorsque la mme opration doit tre effectue toujours et toujours de la mme
faon, il devient d'ordinaire avantageux de crer une machine pour l'excuter. Mais si
elle comprend tant de dtails divers qu'il n'y ait pas avantage faire usage de machines, on continuera l'excuter la main. De mme, en matire de connaissance,
lorsque, dans un certain ordre de recherches, ou de raisonnements, le mme genre de
travail doit se faire toujours et toujours de la mme faon alors il devient avantageux
de le ramener un type, d'tablir des procds de raisonnement, et de formuler des
propositions gnrales, qui serviront comme de machines pour laborer les faits, et
comme d'taux pour les tenir solidement dans une position o ils puissent tre
travaills. Quoique les causes conomiques se trouvent entremles avec les autres de
tant de faons, que le raisonnement scientifique exact puisse rarement nous mener
bien loin, cependant il serait fou de nous priver de l'aide qu'il peut nous donner :
comme il serait fou aussi, en sens inverse, de croire que la science elle seule puisse
tout faire, et qu'il n'y ait rien demander au flair des hommes de la pratique, ni au
sens commun instruit par l'exprience. Un architecte dnu d'exprience pratique, et
d'instincts esthtiques, ne fera que de pauvres constructions, quelles que soient ses
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
67
connaissances en mcanique ; mais, sans aucune connaissance mcanique, il fera des
constructions peu solides ou trs coteuses 1.
Les facults intellectuelles, tout comme l'habilet de main, disparaissent avec
ceux qui les possdent ; mais les progrs que chaque gnration fait faire aux machines Industrielles, ou aux procds de recherche scientifique, se transmettent la
gnration suivante. Il peut ne pas y avoir, l'heure actuelle, de sculpteurs plus
habiles que ceux qui travaillaient au Parthnon, ni de penseur mieux dou par la
nature qu'Aristote ; mais les instruments de la pense s'ajoutent les uns aux autres,
comme le font ceux de la production matrielle 2.
Retour la table des matires
6. - Cela nous amne examiner la nature des lois conomiques. Certains ont dit
que le terme est impropre, parce qu'il n'y a pas en conomique de propositions
dfinies et universelles comparables aux lois de la gravitation et de la conservation de
l'nergie en physique ; mais l'objection ne parat pas dcisive. S'il n'y a pas de lois
conomiques de ce genre, il y en a beaucoup qui peuvent marcher de pair avec les lois
secondaires de ces sciences naturelles, analogues l'conomique, en ce qu'elles ont,
comme elle, s'occuper de l'action complexe d'une foule de causes htrognes et
incertaines. Les lois de la biologie, par exemple, ou, pour emprunter un exemple
une science purement physique, les lois des mares, comme celles de l'conomique,
sont soumises de grandes variations quant la prcision, la certitude et les limites
de leurs applications 3. Une loi scientifique n'est ainsi pas autre chose qu'une proposition gnrale, l'expos de tendances plus ou moins certaines, plus ou moins dfinies.
1
Un lve de Brindley, n'ayant pas reu d'instruction acadmique, peut faire un meilleur ingnieur
qu'un homme moins bien dou que lui par la nature, quelque excellente qu'ait t son instruction.
Une bonne garde malade qui sait lire dans l'esprit de ses malades, grce sa force de sympathie,
peut, sur certains points, donner de meilleurs conseils qu'un mdecin trs savant. Ce n'est
cependant pas une raison pour que l'ingnieur nglige l'tude de la mcanique analytique, ni le
mdecin celle de la physiologie.
Des ides : ides en matire d'art et de science, ou ides incorpores dans des instruments qui
servent la vie pratique : voil le plus rel des legs que chaque gnration reoit des gnrations prcdentes. La richesse matrielle du monde serait rapidement reconstitue si elle venait
tre dtruite, la condition que les ides, l'aide desquelles elle est produite, survivent. Si, au
contraire, c'tait les ides, mais non pas la richesse matrielle, qui disparaissaient, alors celle-ci ne
tarderait pas diminuer, et le monde retomberait dans la misre. De mme, si la connaissance que
nous avons des faits venait se perdre, nous en aurions vite retrouv la plus grande partie, la
condition que les ides constructives fassent sauves ; si, au contraire, les ides prissaient, le
monde reviendrait aux sicles de barbarie. Poursuivre la recherche des ides est donc une uvre
non moins relle , au plus haut sens du mot, que runir des faits, bien que ce dernier genre de
travail soit, dans certains cas, appel en Allemagne Realstudium, c'est--dire une tude qui
convient particulirement aux ReaIschulen. Dans le vaste domaine de l'conomique, l'tude qui
mrite le mieux le nom de relle , au plus haut sens du mot, c'est celle o l'accumulation des
faits, ainsi que l'analyse et la construction des ides qui les unissent, sont combines dans les
proportions qui sont les plus propres augmenter nos connaissances et hter le progrs des ides
dans le champ particulier choisi.
Dans un certain sens toutes les lois physiques, en y comprenant mme celle de la gravitation, ne
sont que des cadres servant prsenter sous une forme convenable certaines analogies et certaines
tendances constates. Elles tirent leur prestige, en partie, du nombre et de la force des faits
auxquels elles s'appliquent ; en partie, aussi, du nombre et de la force des chanes de
raisonnements inductifs et dductifs qui les retient d'autres lois.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
68
On trouve dans toute science un grand nombre d'exposs de ce genre ; mais on n'a pas
l'habitude de leur donner tous un caractre formel et de les dsigner sous le nom de
lois 1.
Ainsi une loi de science sociale, ou loi sociale, est l'expos de tendances sociales ;
c'est--dire qu'elle indique qu'on peut, dans certaines conditions, s'attendre voir les
membres d'un groupe social agir d'une certaine faon.
Les lois conomiques, ou exposs de tendances conomiques, sont, parmi les lois
sociales, celles qui s'appliquent aux catgories d'actes pour lesquels la force des
mobiles en jeu peut se mesurer par un prix en monnaie.
Il n'y a donc pas de ligne de dmarcation nette et arrte entre les lois sociales
qu'il faut, et celles qu'il ne faut pas, regarder comme des lois conomiques ; il y a une
gradation continue, depuis les lois sociales touchant presque exclusivement des
mobiles qui peuvent se mesurer en prix, jusqu'aux lois sociales dans lesquelles ces
mobiles ne tiennent que peu de place, et qui diffrent par suite des lois conomiques,
en prcision et en exactitude, autant que celles-ci leur tour diffrent des lois des
sciences physiques plus exactes 2.
L'adjectif lgal correspond au substantif loi . Mais il n'est employ que
pour les lois au sens d'ordonnances du gouvernement, et non pas pour les lois au
sens d'noncs de rapport existant entre cause et effet. L'adjectif employ dans ce
sens est tir du mot norme , qui est peu prs l'quivalent du mot loi , et qu'il y
aurait peut-tre avantage lui substituer dans les discussions scientifiques. Reprenant
notre dfinition de la loi conomique, nous pouvons dire que la faon dont on peut
prvoir qu'agiront les membres d'un groupe industriel dans certaines conditions, peut
tre appele la faon normale d'agir des membres de ce groupe dans ces conditions 3.
1
Le choix est dirig bien moins par des considrations purement scientifiques, que par des
convenances pratiques. Lorsqu'on a besoin d'exprimer une ide gnrale assez souvent pour que la
peine de la citer tout au long soit plus grande que celle d'alourdir la discussion d'une formule de
plus, et d'un nom technique de plus, alors on lui donne un nom spcial : autrement, non.
Le nom de loi conomique est galement donn, pour raison de commodit, certaines lois
des sciences physiques dont l'conomique fait usage. La plus connue d'entre elles est la loi du
rendement dcroissant (Livre IV, ch. III), qui, du moins sous sa forme la plus simple, est
proprement un expos de faits physiques, et appartient la science agricole.
On remarquera que ce sens du mot normal est plus large que le sens couramment adopt. C'est
ainsi que l'on dit souvent que les seuls rsultats normaux sont ceux qui sont dus l'action sans
entrave de la libre concurrence ; or on a souvent besoin d'employer le mot dans des cas o la
concurrence absolument libre n'existe pas, et o il est mme difficile de supposer qu'elle puisse
exister. Mme l o la libre concurrence exerce le plus d'action, les conditions normales de chaque
fait et de chaque tendance comprennent des lments vitaux qui ne rentrent nullement dans la
concurrence, et n'ont mme rien voir avec elle. Ainsi, par exemple, la faon normale de conclure
une foule de transactions au dtail et en gros, la bourse des valeurs et celle du coton, repose sur
la conviction que des contrats verbaux, faits sans tmoins, seront honorablement excuts ; dans
les pays o cette conviction ne peut pas exister, certaines parties de la thorie occidentale de la
valeur normale cessent d'tre applicables. De mme, les prix des valeurs de bourse sont affects
normalement par les sentiments de patriotisme, non seulement des acheteurs ordinaires, mais
des agents de change eux-mmes, et ainsi de suite.
Le sens que nous proposons ici pour ce mot est plus conforme son tymologie, comme aussi
au langage courant de la vie de chaque jour. On peut objecter qu'il n'a pas un contour assez net et
assez rigide ; mais on constatera que les difficults rsultant de cet inconvnient ne sont pas trs
grandes, et que l'emploi propos par nous aide mettre les thories de l'conomique en rapports
troits avec la vie relle.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
69
Une action normale n'est pas une action droite au point de vue moral; c'est trs
souvent une action que nous devrions, de tous nos efforts, tcher d'empcher. Par
exemple, la condition normale de beaucoup des habitants les plus misrables d'une
grande ville est d'tre dpourvus d'esprit d'initiative, et de ne pas vouloir profiter des
occasions qui peuvent s'offrir eux de mener ailleurs une vie plus saine et moins
sordide ; ils n'ont pas la force physique, intellectuelle, ni morale, ncessaire pour
s'arracher leur milieu de misre. L'existence d'une offre considrable de maind'uvre pour la fabrication des botes d'allumettes un salaire infime est un fait
normal, tout comme la torsion des membres est un effet normal de l'absorption de la
strychnine. C'est un rsultat des tendances dont nous avons tudier les lois, mais un
rsultat dplorable 1.
[Dans les prcdentes ditions, l'expression elliptique action d'une loi , en
faveur de laquelle on peut invoquer de nombreuses autorits, tait employe pour
dsigner l'action des causes dont les rsultats, ou les tendances, sont exprims par
cette loi . Peut-tre est-il prfrable de se servir simplement pour cela du mot a
tendance . Quelques auteurs ont propos de se servir du mot tendance la place
du mot toi . Mais une loi est l'nonc d'une tendance. Un des principaux emplois
du mot normal se rencontre dans les cas o l'on oppose les prix normaux, les
salaires normaux , etc. aux prix de march , aux salaires de march , etc. Cet
emploi est tout fait conforme notre dfinition gnrale : nous tudierons, dans le
livre V, chap. V, le sens de la clause sous certaines conditions qu'il est ncessaire
d'y ajouter.]
On dit parfois que les lois de l'conomique sont hypothtiques . Naturellement,
comme toutes les autres sciences, elle s'efforce d'tudier les effets que produiront
certaines causes, non pas d'une manire absolue, mais sous la condition que toutes
choses restent gales , et que les causes en question soient mme de produire leurs
effets sans obstacle. Presque toute thorie scientifique, expose en forme et avec soin,
contient cette rserve que toutes choses restent gales : l'action des causes en question
est tudie isolment ; certains effets leur sont attribus, mais seulement dans
l'hypothse qu'aucune autre cause n'intervienne 2.
Ces rserves ne sont pas continuellement rptes, mais le bon sens du lecteur y
supple. En conomie politique, il est ncessaire de les rpter plus souvent
qu'ailleurs, parce que les thories conomiques risquent, plus que celles d'aucune
Ce fait rvle une particularit de l'conomie politique qui lui est commune avec un petit nombre
d'autres sciences, dont l'objet peut tre modifi par l'effort de l'homme. La morale ou des raisons
pratiques peuvent nous commander de tenter cette modification, et par l de porter atteinte des
lois naturelles. C'est ce que nous faisons, par exemple, lorsque nous remplaons par des ouvriers
capables des ouvriers ne pouvant pas faire d'autre travail que celui de la fabrication des bottes
d'allumettes ; ou encore lorsque nous modifions les races de btail, pour obtenir des btes qui
engraissent vite et donnent beaucoup de viande avec de petites charpentes. La prophtie de Jonas
sur la chute de Ninive sauva cette ville (Voir VENN, Empirical Logic, ch. XXV.) Les lois des
fluctuations du march montaire et celles des variations des prix se sont trouves sensiblement
modifies par la possibilit, plus grande aujourd'hui, de prvoir les vnements.
Il est vrai, que par suite des changements que subissent les faits conomiques, il y a souvent un
inconvnient particulier vouloir laisser aux causes le temps de produire leurs effets : pendant ce
temps, les faits sur lesquels elles agissent, et peut-tre les causes elles-mmes, auront chang, et
les tendances que l'on tudie n'auront pas eu le temps de se manifester pleinement. Nous reviendrons sur cette difficult plus Lard. Voir notamment, livre V, ch. XI.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
70
autre science, d'tre cites par des personnes qui n'ont pas d'instruction scientifique, et
qui les tiennent peut-tre de seconde main sans connatre leur contexte 1.
Il est cependant exact qu'une loi conomique ne peut tre applicable qu'en supposant ralises un certain nombre de circonstances, qui peuvent se prsenter ensemble
dans un lieu et un moment particuliers, mais qui disparaissent rapidement. Lorsqu'elles ont disparu, la loi perd toute porte pratique ; car les causes particulires dont
elle s'occupe ne se trouvent plus agir ensemble sans tre troubles par l'action d'autres
causes. Bien que l'analyse conomique et le raisonnement abstrait soient d'une
application tendue, nous ne saurions trop insister sur ce fait que chaque temps et
chaque pays ont leurs problmes particuliers, et que toute modification des conditions
sociales a des chances d'entraner une modification des thories conomiques.
Retour la table des matires
7. - Mais, en ces matires, tout dpend de la mesure dans laquelle nous envisageons l'conomique comme une science applique. L'opposition entre les sciences
pures et les sciences appliques n'est pas absolue ; elle est seulement une question de
degr. Par exemple, la mcanique est une science applique par rapport la
gomtrie ; mais une science pure par rapport l'art de l'ingnieur : alors que l'art de
l'ingnieur lui-mme est souvent qualifi de science pure par des hommes qui
consacrent leur vie la science applique du dveloppement des chemins de fer.
Cependant, dans un certain sens, l'conomique, prise dans son ensemble, constitue
une science applique, car elle a toujours affaire plus ou moins avec les conditions
incertaines et irrgulires de la vie relle 2.
Une des raisons pour lesquelles la conversation ordinaire peut se contenter d'une forme simple,
mieux qu'un trait scientifique, c'est que dans la conversation nous pouvons sans danger passer
sous silence les clauses restrictives. Si l'interlocuteur n'y supple pas de lui-mme, nous dcouvrons bien vite la mprise et nous la corrigeons. Adam Smith, et beaucoup des anciens conomistes, obtenaient une simplicit apparente, en suivant les usages de la conversation, et en
omettant les clauses restrictives. Mais cette habitude leur a valu d'tre constamment mal compris,
et de faire natre des controverses oiseuses qui nous ont caus beaucoup de perte de temps et
d'ennuis ; ils ont pay trop cher cette aisance apparente, si prcieuse qu'elle soit.
Certaines parties de l'conomique sont d'une science relativement pure, parce qu'elles traitent
surtout de grandes propositions gnrales. En effet, pour qu'une proposition soit susceptible d'une
large application, elle doit ncessairement ne contenir que peu de dtails ; elle ne peut pas
s'adapter aux cas particuliers, et si elle prtend servir prdire les vnements, il faut qu'elle soit
accompagne d'une clause restrictive trs prcise o le sens le plus large soit donn la phrase
toutes choses restant gales. En style de logique on dirait qu'une proposition ne peut gagner en
tendue qu'en perdant en force.
Dans d'autres parties, elle est une science relativement applique ; ce sont celles qui traitent
plus en dtail de questions limites, qui tiennent compte des lments de temps et de lieu, et qui
envisagent les conditions conomiques dans leurs relations troites avec les autres conditions de la
vie. C'est ainsi qu'il n'y a qu'un pas de la science applique des oprations de banque dans le sens
le plus gnral aux larges rgles et aux principes de l'art gnral de la banque : la distance qui
spare un problme particulier de la science applique des oprations de banque, de la rgle
pratique ou du principe d'art qui y correspond, peut tre encore plus faible.
Les conomistes du continent, et surtout les Allemands, aiment classer les diffrentes parties
de l'conomique. Mais leurs classifications diffrent, et elles ont peut-tre trop peu de valeur
constructive pour la place et pour le temps qu'on leur consacre.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
71
Un conomiste possde naturellement, comme tout le monde, la libert d'exprimer
son opinion sur les mesures politiques prendre, et de dire quelle est celle qui lui
parait la meilleure dans des circonstances donnes ; si les difficults du problme sont
surtout conomiques, son opinion aura une certaine autorit. Mais, en somme, bien
que sur ce point les avis diffrent, il semble alors prfrable que chaque conomiste
parle en son nom personnel, plutt que de prtendre parler au nom de la science
conomique.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
72
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre I : aperu prliminaire
Chapitre sept
Rsum et conclusion
Retour la table des matires
1. - Nous avons vu que les principaux caractres des problmes conomiques
modernes, et les principales raisons d'tudier l'conomie politique, sont de date tout
fait rcente. Jusqu' ces derniers temps, les conditions sociales et conomiques de la
vie et du travail ne changeaient que lentement : elles taient rgies par des institutions
qui avaient l'autorit de la coutume et de la prescription, et que la plupart des gens
acceptaient telles qu'ils les trouvaient. L mme o ne rgnaient ni l'esclavage, ni un
systme rigide de caste, les classes dominantes se proccupaient peu du bien-tre
matriel de la grande masse des travailleurs ; ceux-ci, de leur ct, n'avaient ni les
habitudes d'esprit, ni les occasions de penser et d'agir ncessaires pour arriver
comprendre les problmes de leur propre existence. Une grande partie des caractres
de l'conomie moderne existaient dj, il est vrai, dans les villes du Moyen-Age, o
un esprit d'intelligence et d'initiative se combina pour la premire fois avec des
habitudes d'activit tenace ; mais ces villes ne purent pas suivre en paix leur voie, et
le monde dut attendre pour voir se lever l're de l'conomie nouvelle, qu'une nation
tout entire ft apte supporter l'preuve de la libert conomique.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
73
L'Angleterre avait t peu peu tout spcialement prpare ce rle ; mais vers la
fin du XVIIIe sicle, les transformations, jusqu'alors lentes et graduelles, devinrent
tout coup rapides et brusques. Des inventions mcaniques, la concentration des
industries, et un systme de production manufacturire en grand pour (les marchs
loigns, vinrent briser les vieilles traditions industrielles en laissant chacun libre de
faire ses affaires lui-mme du mieux qu'il pourrait. En mme temps elles provoqurent un rapide accroissement de la population pour lequel rien n'avait t prvu, en
dehors de la place dans les fabriques et les ateliers. Ainsi la libre concurrence, ou
plutt la libert de l'industrie et du travail, se trouva dchane et prte prendre,
comme un norme monstre indisciplin, sa course en avant. Dans l'usage de leur
puissance nouvelle, les abus que commirent des entrepreneurs capables, mais sans
culture, causrent des maux de tous cts: les mres furent enleves leurs devoirs
maternels ; les enfants devinrent la proie du surmenage et de la maladie; en bien des
endroits la race dgnra. Pendant ce temps, la lgislation sur l'assistance, avec son
indiffrence inspire pourtant par de bonnes intentions, contribua, plus encore que la
discipline manufacturire avec son indiffrence froce, affaiblir l'nergie morale et
physique des Anglais : en tuant chez eux les qualits qui les auraient rendus aptes
profiter du nouvel ordre de choses, elle augmenta les inconvnients, et diminua les
avantages, dus au triomphe de la libert du travail.
L'poque o la libert du travail se montra sous cette forme affreusement dure, fut
prcisment celle o les conomistes se montrrent le plus prodigues d'loges envers
elle. Ce fait est d en partie ce qu'ils voyaient clairement, tandis que les hommes de
notre gnration l'ont au contraire oubli, la cruaut du joug de la coutume et de
l'ordre rigide dont la libert du travail venait prendre la place ; il est d encore ce
qu'il y a une tendance gnrale en Angleterre croire que la libert en toute matire,
en matire politique et en matire sociale, n'est jamais paye trop cher, si ce n'est au
prix de la scurit nationale; mais il est d aussi ce que la force productrice que le
pays puisait dans la libert du travail, tait pour lui, affaibli comme il l'tait par une
srie de mauvaises rcoltes, le seul moyen de rsister victorieusement Napolon.
Les conomistes envisageaient donc la libert du travail, non pas certes comme un
bien sans mlange, mais comme l'tat naturel des choses, et ils regardaient ses maux
comme tant d'importance secondaire.
Acceptant les ides gnrales qui devaient surtout leur naissance aux commerants du Moyen Age, et qu'avaient reprises les philosophes franais et anglais de la
fin du XVIIIe sicle, Ricardo, et ceux qui l'ont suivi, fondrent sur l'action de la
libert du travail (ou, comme ils disaient, de la libre concurrence) une thorie
contenant un grand nombre de vrits qui garderont une grande importance aussi
longtemps que le monde existera. Leur uvre fut merveilleusement complte pour le
champ limit qu'elle embrassait ; seulement, plusieurs de ses meilleures parties
s'appliquent aux problmes de la rente et de la valeur du bl, problmes de la solution
desquels le sort de l'Angleterre semblait alors dpendre, mais qui, sous la forme
particulire que Ricardo leur a donne, ont trs peu de porte directe pour l'tat de
choses actuel. Une bonne partie du reste de leur uvre est entache d'troitesse
d'ides, et se trouve presque vicie par le fait qu'ils ont envisag trop exclusivement la
situation particulire de l'Angleterre leur poque; cette troitesse a amen une
raction.
De sorte qu' l'heure actuelle, o une plus longue exprience et de plus grands
loisirs, ainsi que des ressources matrielles plus considrables, nous ont permis de
soumettre la libert du travail un certain contrle, de diminuer ses consquences
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
74
fcheuses, et d'augmenter ses effets heureux, on voit grandir contre elle chez beaucoup d'conomistes une sorte de rancune. Certains conomistes allemands en particulier semblent exagrer ses maux, lui attribuant une ignorance et des souffrances qui
sont plutt les rsultats de la tyrannie et de l'oppression des temps passs, ou ceux de
la mauvaise comprhension et du mauvais usage de la libert conomique.
gale distance de ces deux extrmes, se trouve la grande masse des conomistes, travaillant dans des voies parallles en beaucoup de pays, apportant leurs
tudes un dsir impartial d'arriver la vrit, et la volont de se soumettre au long et
pnible labeur par lequel seul des rsultats scientifiques de quelque valeur peuvent
tre obtenus. Des diversits d'esprit, de caractre, d'ducation et de circonstances, les
amnent travailler de faons diffrentes, et donner leur principale attention des
parties diffrentes du problme conomique. Tous s'efforcent plus ou moins de runir
et de grouper des faits et des statistiques relatifs au pass et au prsent ; tous aussi,
plus ou moins, s'occupent d'tablir des analyses et des raisonnements sur la base des
faits que l'on connat dj : mais, pour les uns, c'est la premire de ces tches, pour les
autres la seconde, qui leur parat la plus attrayante et la plus absorbante. Cette
division du travail n'implique cependant pas une opposition, mais une harmonie de
but. Le travail de tous ajoute aux connaissances qui nous permettent de comprendre
l'influence exerce sur la qualit et sur les caractres de la vie humaine par la manire
dont l'homme se procure sa subsistance et parla nature de cette subsistance.
L'conomiste doit tre avide de faits ; mais les faits par eux-mmes n'apprennent
rien. L'histoire nous fait connatre des squences et des concidences ; la raison seule
peut les interprter et en tirer des leons. Le travail faire est si vari qu'une partie
peut en tre confie au simple sens commun instruit par l'exprience, juge suprme
pour tout problme pratique. La science conomique n'est que l'effort du sens commun aid par les procds organiss de l'analyse et du raisonnement abstrait; grce
eux, on arrive plus facilement runir, disposer les faits particuliers, et en tirer les
consquences. Quoique son champ soit toujours limit, quoique sans l'aide du sens
commun son oeuvre soit vaine, cependant pour les problmes difficiles elle permet au
sens commun d'aller plus loin qu'il ne le pourrait sans elle. Les formules exprimant
les tendances que, sous certaines conditions, prsentent les actions des hommes, sont
des lois conomiques. Ces lois ne sont hypothtiques que dans le sens o le sont les
lois des sciences physiques : car celles-ci aussi contiennent, ou impliquent, certaines
conditions. Mais il est plus difficile d'exposer clairement ces conditions en conomique qu'en physique, et il y a plus de danger ne pas y russir. Les lois de l'action
humaine ne sont, il est vrai, ni aussi simples, ni aussi bien dfinies, ni aussi
clairement constatables, que la loi de la gravitation ; mais beaucoup d'entre elles
peuvent marcher de pair avec les lois des sciences naturelles qui s'occupent de
matires complexes. La raison d'tre de l'conomique, en tant que science distincte,
est qu'elle traite surtout de la partie des actions de l'homme qui sont le mieux
soumises l'influence de mobiles mesurables, et qui, par suite, demandent plus que
toutes les autres des raisonnements et des analyses systmatiques.
L'tude de la thorie doit aller cte cte avec celle des faits, et pour traiter les
problmes les plus modernes, ce sont les faits modernes qui rendent le plus de
service. Les documents conomiques des temps loigns sont, certains gards,
insuffisants et peu dignes de foi ; et les conditions conomiques des temps anciens
sont compltement diffrentes de celles de l'poque moderne, avec la libert du
travail, l'instruction gnrale, la vraie dmocratie, la vapeur, la presse bon march et
le tlgraphe.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
75
Retour la table des matires
2. - L'conomique a donc comme objet : premirement de faire avancer la
connaissance pour elle-mme, et secondement de jeter de la lumire sur les vnements de la vie pratique. Bien que nous soyons obligs, avant d'entreprendre une
tude, de considrer quelle est son utilit, ce n'est pas directement d'aprs cette utilit
que nous devons diriger notre travail. En agissant ainsi nous serions tents de nous
arrter tout instant dans nos recherches, ds qu'elles cessent d'avoir une porte
immdiate pour le but particulier que nous avons en vue ce moment : la poursuite
directe de fins pratiques nous amne grouper ensemble des fragments de toutes
sortes de connaissances, qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, sauf pour les buts
immdiats du moment, et qui jettent peu de lumire les uns sur les autres. Notre
nergie intellectuelle se dpense aller de l'un l'autre ; rien n'est examin fond et
aucun progrs rel ne se fait.
Le meilleur procd, pour faire avancer la science, est donc celui qui groupe
ensemble tous les faits et tous les raisonnements offrant une analogie par leur nature :
de sorte que l'tude de chaque fait puisse clairer les faits voisins. En travaillant ainsi
pendant longtemps une srie de questions, nous arrivons nous approcher peu peu
de ces units fondamentales que l'on appelle lois naturelles : nous dcrivons leur
action d'abord isolment, ensuite en combinaison avec d'autres actions ; le progrs se
fait ainsi lentement, mais srement. Les consquences pratiques des tudes conomiques doivent sans doute tre toujours prsentes l'esprit de l'conomiste, mais sa
tche spciale est d'tudier et d'interprter les faits et de dcouvrir quels sont les effets
des diffrentes causes dans leur action isole et combine.
Retour la table des matires
3. - On peut illustrer ces ides en numrant quelques-unes des principales
questions que l'conomiste tudie. Il recherche :
Quelles sont les causes qui, particulirement dans le monde moderne, affectent la
consommation et la production, la distribution et l'change des richesses ; l'organisation du commerce et de l'industrie ; le march montaire ; la vente en gros et en
dtail ; le commerce tranger; les relations entre employeurs et employs : comment
tous ces phnomnes agissent et ragissent les uns sur les autres; comment leurs
rsultats derniers diffrent de leurs rsultats immdiats.
Sous quelles rserves le prix d'une chose est-il une mesure de sa dsidrabiIit ?
Quelle augmentation de bien-tre doit, premire vue, rsulter d'un accroissement
donn de richesse dans une classe de la socit ? Dans quelle mesure la productivit
industrielle d'une classe est-elle affaiblie par l'insuffisance de son revenu? Dans
quelle mesure un accroissement de revenu pour une classe peut-il, une fois qu'il est
acquis, l'aider accrotre sa productivit et son aptitude s'enrichir ?
Quelles sont, en fait, ou quelles ont t, les consquences de la libert conomique
telle poque, dans tel lieu, dans tel rang de la socit, ou dans telle branche de
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
76
production ? Quelles sont les autres influences qui y ont le plus de puissance ?
Comment toutes ces influences se combinent-elles ? En particulier, dans quelle
mesure la libert conomique tend-elle d'elle-mme faire natre des ententes et des
monopoles, et quels sont leurs effets ? Comment les diverses classes de la socit
peuvent-elles tre affectes la longue par son action ; quels seront ses effets provisoires jusqu' ce qu'elle ait produit ses effets derniers, et, en tenant compte du temps
auxquels les uns et les autres s'tendent, quelle est l'importance relative de ces deux
catgories d'effets ? Quelle sera l'incidence d'un systme d'impts ? Quelles charges
imposera-t-il la communaut, et quels revenus donnera-t-il l'tat ?
Retour la table des matires
4. - Telles sont les principales questions dont la science conomique a
directement s'occuper, et en vue desquelles surtout elle doit s'efforcer de rassembler
des faits, de les analyser et de baser sur eux des raisonnements. Les vnements de la
vie pratique qui, tout en se trouvant pour la plus grande partie en dehors de la sphre
de la science conomique, sont cependant, mais au second plan, un objet important
d'tude pour l'conomiste, diffrent d'un lieu un autre, et d'une poque une autre,
plus encore que les faits et les conditions conomiques qui forment l'objet propre de
ses tudes. Les problmes suivants semblent tre particulirement urgents l'heure
actuelle dans notre pays :
Comment devons-nous faire pour arriver augmenter les avantages et diminuer
les inconvnients de la libert conomique, dans ses rsultats derniers, ainsi que dans
le cours de ses progrs immdiats ? Si les rsultats derniers sont heureux, mais les
effets immdiats fcheux, et si ceux qui souffrent des inconvnients de la libert ne
doivent jamais bnficier de ses avantages, dans quelle mesure est-il bon qu'ils
souffrent pour le profit des autres ?
En supposant admis qu'une rpartition plus gale des richesses soit dsirer, dans
quelle mesure se trouveraient justifies par l des modifications dans les institutions
de la proprit, ou des limitations de la libert du travail, quand bien mme elles
risqueraient de diminuer le total des richesses ? En d'autres ternies, dans quelle
mesure faut-il tendre une augmentation du revenu des classes pauvres et une
rduction de leur travail, mme s'il en rsulte quelque diminution de la richesse matrielle du pays ? Dans quelle mesure pourrait-on y arriver sans commettre d'injustice,
et sans affaiblir l'nergie des hommes qui sont les promoteurs du progrs ? Comment
les charges de l'impt doivent-elles tre rparties entre les diffrentes classes de la
socit ?
Devons-nous nous contenter des formes existantes de la division du travail ? Estce une ncessit que de grandes masses de gens soient exclusivement occupes un
travail qui ne prsente aucun caractre ennoblissant ? Est-il possible de dvelopper
peu peu dans la grande masse des travailleurs de nouvelles aptitudes pour les
travaux les plus relevs, ainsi que l'aptitude entreprendre cooprativement la
direction des entreprises dans lesquelles ils sont eux-mmes employs ?
Quelles sont les relations qui doivent exister entre l'action individuelle et l'action
collective une phase de la civilisation comme celle o nous nous trouvons ? Dans
quelle mesure l'association volontaire sous ses formes diverses, anciennes et nou-
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
77
velles, petit-elle servir d'instrument l'action collective pour les oeuvres o celle-ci
offre des avantages particuliers ? De quelles entreprises la socit doit-elle se charger
elle-mme, par l'intermdiaire du gouvernement, imprial ou local ? Avons-nous, par
exemple, pouss aussi loin que nous le devrions le systme de la proprit collective,
et l'usage des parcs publics, des oeuvres d'art, des moyens d'instruction et d'amusement, ainsi que celui de ces objets matriels ncessaires la vie civilise, et dont la
production exige une action concerte, comme le gaz, l'eau, les chemins de fer ?
Lorsque le gouvernement n'intervient pas lui-mme directement, dans quelle mesure doit-il laisser les individus et les associations diriger leurs affaires comme ils
l'entendent ? Dans quelle mesure doit-il rglementer les chemins de fer et autres
entreprises qui possdent une sorte de monopole, ainsi que la jouissance du sol et
celle des autres choses dont la quantit ne peut pas tre augmente par l'homme ? Estil ncessaire de maintenir dans toute leur force tous les droits actuels de proprit ; ou
bien les ncessits premires auxquelles ils taient destins faire face n'ont-elles
pas, dans une certaine mesure, disparu ?
Les procds qui prvalent pour l'usage des richesses sont-ils justifiables ? Quel
rle peut jouer la pression morale de l'opinion publique pour contraindre et diriger
l'action individuelle, dans les relations conomiques o la rigidit et la brutalit de
l'intervention du gouvernement risqueraient de faire plus de mal que de bien ?
quels points de vue les devoirs qu'ont entre elles les nations en matire conomique
diffrent-ils de ceux qu'ont entre eux les membres d'une mme nation ?
L'conomique est ainsi envisage comme l'tude des aspects et des conditions
conomiques de la vie politique, sociale et prive de l'homme, mais plus particulirement de sa vie sociale. Le but de cette tude est d'arriver la connaissance pour ellemme, et de servir de guide dans la conduite pratique de la vie, spcialement de la vie
sociale. Le besoin d'un tel guide n'a jamais t aussi pressant qu' l'heure actuelle; les
gnrations futures pourront avoir plus de loisir que nous pour des recherches qui
claireraient des points obscurs de la spculation abstraite, ou de l'histoire des temps
passs, mais qui ne nous seraient d'aucune aide immdiate pour nos difficults
prsentes.
Bien qu'elle soit ainsi largement inspire par des vues pratiques, l'conomique
vite autant que possible de discuter les exigences de l'organisation des partis et la
tactique suivre dans la politique intrieure ou trangre : toutes choses dont un
homme d'tat est oblig de tenir compte lorsque, parmi les mesures qu'il peut proposer, il dcide quelles sont celles qui le mneront le plus prs du but qu'il dsire
atteindre pour son pays. Elle l'aide, il est vrai, dterminer non seulement ce que ce
but doit tre, mais aussi quels sont les meilleurs procds qu'une large politique peut
y employer. Mais elle nglige une foule de circonstances politiques que le praticien
ne peut pas ignorer : c'est donc une science, la fois pure et applique, plutt qu'une
science et un art. Et il vaut mieux, pour la dsigner, se servir de l'expression large de
conomique, plutt que de celle plus troite de conomie politique.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
Alfred Marshall, Principes dconomie politique : tome I
Livre deuxime
De quelques notions
fondamentales
Retour la table des matires
78
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
79
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre II : De quelques notions fondamentales
Chapitre un
Introduction
Retour la table des matires
1. - Nous avons vu que l'conomique est, d'un ct, une science de la richesse,
et, de l'autre, cette partie de la science des actions de l'homme vivant en socit, ou
science sociale, qui s'occupe des efforts de l'homme pour satisfaire ses besoins, en
tant. que ces efforts et ces besoins sont susceptibles d'tre mesurs l'aide des
richesses ou de leur quivalent gnral, la monnaie. Nous nous occuperons pendant la
plus grande partie de ce volume de ces besoins et de ces efforts, et des causes par
lesquelles les prix qui mesurent les besoins sont mis en quilibre avec ceux qui
mesurent les efforts. Dans ce but nous aurons tudier dans le Livre III la richesse
dans ses relations avec les divers besoins qu'elle doit satisfaire, et dans le Livre IV la
richesse dans ses relations avec les divers efforts l'aide desquels elle est produite.
Mais, dans le prsent Livre, nous avons rechercher, parmi toutes les choses qui
sont le rsultat des efforts de l'homme et qui sont susceptibles de satisfaire ses
besoins, quelles sont celles qui doivent tre considres comme des richesses, et
voir en quels groupes, ou en quelles classes, elles peuvent tre ranges. Il y a toute
une srie de termes se rapportant la richesse elle-mme et au capital ; l'tude de
chacun d'eux claire le sens des autres ; de plus, cette tude est une continuation
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
80
directe, et certains gards un complment, des recherches sur le but et sur la
mthode de l'conomie politique auxquelles nous venons de nous livrer. Par suite, au
lieu de commencer, comme il paratrait naturel de le faire, par une analyse des
besoins et de la richesse, il semble prfrable de s'occuper tout de suite de ce groupe
de termes.
En agissant ainsi nous aurons naturellement nous faire quelque ide de la varit
des besoins et des efforts ; mais il nous suffira de nous en tenir ce qui est vident et
connu de tous. La vritable difficult de notre tche est ailleurs ; elle rside dans la
ncessit o se trouve l'conomie politique, seule parmi les sciences, d'arriver, l'aide
d'un petit nombre de termes d'un usage courant, exprimer un grand nombre de
distinctions subtiles.
Retour la table des matires
2. - Comme le dit Mill 1 : Le but d'une classification scientifique est le mieux
rempli lorsque les groupes entre lesquels les objets sont rpartis donnent lieu des
propositions gnrales la fois plus nombreuses et plus importantes que celles qu'on
tirerait d'autres groupes forms des mmes objets . Mais nous nous heurtons aussitt
cette difficult que les propositions les plus importantes une priode du dveloppement conomique peuvent tre parmi les moins importantes une autre, si
mme elles n'ont pas perdu toute application.
En cette matire, les conomistes ont beaucoup apprendre des rcentes expriences de la biologie, et la profonde discussion que Darwin a faite de la question 2 jette
une vive lumire sur les difficults qui se prsentent nous. Il montre que les
caractres qui dterminent les habitudes de vie, et la place gnrale de chaque tre
dans l'conomie de la nature, ne sont pas,en rgle gnrale, ceux qui jettent le plus de
lumire sur son origine, mais ceux qui en jettent le moins. Les proprits qu'un
leveur ou un jardinier signale comme minemment propres permettre un animal
ou une plante de prosprer dans son milieu, se sont probablement, et pour cette
raison mme, dveloppes une poque relativement rcente. De mme, pour une
institution conomique, celles de ses particularits qui contribuent le plus la rendre
propre l'uvre qu'elle a prsentement accomplir, sont vraisemblablement, pour
cette raison mme, de date rcente 3.
Mais, d'un autre ct, nous devons avoir constamment prsente l'esprit l'histoire
des termes dont nous nous servons. Cette histoire, en effet, est importante par ellemme. En outre elle claire l'histoire du dveloppement conomique de la socit.
1
2
3
Logic, Liv. IV, ch. VII, 2.
Origin of Species, ch. XIV.
On en trouve beaucoup d'exemples dans les relations entre employeurs et employs, entre
intermdiaires et producteurs, entre banquiers et leurs deux classes de clients, ceux auxquels ils
empruntent et ceux auxquels ils prtent. La substitution du mot intrt au mot usure
correspond un changement gnral dans le caractre des prts, qui a modifi entirement
l'analyse et la classification que nous faisons des divers lments en lesquels le cot de production
d'une marchandise peut se rsoudre. De mme, le sens gnral de la division en travail qualifi
(skilled) et non qualifi (unskilled) est en train de se modifier peu peu; le sens du mot rente
est en train de s'largir dans certaines directions et de se rtrcir dans d'autres, et ainsi de suite.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
81
Enfin, mme si, en tudiant J'conomique, notre seul but est d'acqurir des connaissances pouvant nous servir atteindre des rsultats pratiques immdiats, nous
sommes cependant tenus d'employer les mots en nous conformant autant que possible
aux traditions du pass : par l nous pouvons mieux saisir les suggestions indirectes et
les avertissements subtils et cachs (lue les expriences de nos anctres offrent notre
instruction.
Retour la table des matires
3. - Notre tche est difficile. Dans les sciences physiques, partout o l'on voit
qu'un groupe de choses possdent un certain nombre de proprits communes et que
l'on aura souvent les considrer ensemble, on en forme une classe part, avec un
nom spcial, et, toutes les fois qu'une notion nouvelle apparat, un nouveau terme
technique est invent pour la reprsenter. Mais l'conomie politique ne peut pas se
permettre de suivre cet exemple. Ses raisonnements doivent tre exprims en un
langage qui soit intelligible au grand public; elle doit donc tcher de se conformer aux
expressions familires de la vie de tous les jours, et, autant que possible, elle doit les
employer d'aprs l'usage courant.
Dans l'usage courant, presque tous les mots ont plusieurs sens, et l'on doit les
interprter d'aprs le contexte. Comme Bagehot l'a montr, dans la science conomique, les crivains mme les plus formalistes sont obligs de faire ainsi ; car
autrement ils n'auraient pas assez de mots leur disposition. Malheureusement, ils
n'avertissent pas toujours qu'ils prennent cette libert ; parfois peut-tre ils s'en
aperoivent peine eux-mmes, Les dfinitions tranchantes et rigides par lesquelles
ils commencent leurs exposs de la science, induisent le lecteur en une fausse
scurit. N'tant pas averti qu'il doit souvent chercher dans le contexte une indication
interprtative, le lecteur attribue ce qu'il lit un sens diffrent de celui qui tait dans
la pense de l'auteur ; peut-tre le calomnie-t-il et l'accuse-t-il d'une sottise dont celuici n'est pas coupable. Des mprises de ce genre ont souvent t une source de controverses qui ont dtourn les efforts qu'on aurait pu consacrer luvre constructive, et
qui ont retard les progrs de la science 1.
1
Il nous faut crire avec plus de soin que nous ne le faisons dans la vie ordinaire, o le contexte
est une sorte de clause interprtative sous entendue. Seulement, comme en conomie politique
nous avons parler de choses plus difficiles que dans la conversation ordinaire, nous devons faire
plus attention, prodiguer les avertissements pour tout changement, et parfois exprimer la clause
interprtative pour telle page ou telle discussion, de peur qu'il n'y ait erreur. Je reconnais que
c'est une tche difficile et dlicate ; tout, ce que j'ai dire en faveur de ce procd c'est que, en
pratique, il est plus sr que le procd contraire des dfinitions rigides. Quiconque essaye
d'exprimer des ides diverses touchant des choses complexes avec un vocabulaire insuffisant de
mots au sens arrt, s'apercevra que son style devient embarrass sans tre exact, qu'il est oblig
d'employer de longues priphrases pour des ides courantes, et que, malgr tout, il ne s'en tire pas
bien, car la plupart du temps il en revient employer ses mots dans les sens qui conviennent le
mieux l'ide du moment, c'est--dire tantt dans un sens, tantt dans un autre, et presque toujours
dans un sens diffrent du sens ferme et rigide qu'il avait voulu leur donner. Dans les discussions de
ce genre, nous devrions apprendre varier nos dfinitions quand nous en avons besoin, de mme
que nous disons : supposons que X, Y, Z reprsentent tantt ceci, tantt cela. Quoiqu'ils ne le
dclarent pas toujours, c'est l le procd employ par les auteurs les plus clairs et les plus
positifs. (BAGEHOT, Postulates of English Political Economy, pp. 78-79). Cairnes, (Logical
Method of Political Economy, Lect. VI) combat aussi l'ide que le caractre sur lequel repose une
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
82
De plus, la plupart des principales distinctions qu'expriment les termes conomiques reposent sur des diffrences de degr et non de nature. premire vue elles
semblent tre des diffrences de nature, et avoir des lignes de dmarcation nettes
pouvant tre clairement indiques ; mais un examen plus attentif montre qu'il n'y a
pas de vritable solution de continuit. C'est un fait remarquable que le progrs de
l'conomique n'a presque pas fait dcouvrir de nouvelles diffrences de nature, tandis
qu'il a sans cesse ramen de simples diffrences de degr des diffrences qui taient
en apparence des diffrences de nature. Nous rencontrerons un grand nombre d'exemples du mal que l'on peut faire lorsqu'on essaye de tracer des lignes de dmarcation
larges, arrtes et rigides, et de formuler des propositions prcises touchant des
diffrences entre choses que la nature n'a pas spares ainsi.
Retour la table des matires
4. - Nous devons donc analyser soigneusement les vritables caractristiques
des diffrentes choses dont nous avons nous occuper. Nous constaterons alors
gnralement que, pour chaque terme, existe un sens mritant, plus que tout autre,
d'tre appel son sens principal, pour la raison qu'il exprime une ide qui, pour le but
poursuivi par la science moderne, est plus importante que toute autre ide conforme
l'usage courant du mot. Ce sens peut tre adopt comme tant celui donner au mot
partout o le contraire n'est pas spcifi, et ne rsulte pas du contexte 1. Lorsqu'on a
besoin d'employer le mot dans un autre sens, plus large ou plus troit, ce changement
doit tre indiqu ; une clause interprtative expresse doit tre ajoute, s'il y a le
moindre danger de mprise 2.
dfinition doive tre tel qu'il n'admette pas de degrs ; il prtend que comporter des degrs est
le propre de tous les faits naturels .
Il subsistera toujours, mme entre les penseurs les plus rigoureux, des divergences d'opinion quant
la faon de comprendre certaines dfinitions. Ces discussions doivent d'ordinaire se trancher en
apprciant les avantages pratiques des diffrentes solutions ; mais les jugements qu'on se forme
ce sujet ne peuvent pas toujours s'tablir ni se rfuter au moyen du raisonnement scientifique, et il
reste forcment une certaine place pour la discussion. Mais il lie peut pas en tre ainsi pour le fond
mme d'une analyse : si deux personnes diffrent son sujet, elles ne peuvent pas avoir raison
toutes les deux, et l'on peut penser que le progrs de la science arrivera peu peu tablir cette
analyse sur une base inbranlable.
Lorsqu'on a besoin de restreindre le sens d'un mot (c'est--dire, dans la langue de la logique, de
diminuer sa force extensive pour augmenter sa force intensive), un adjectif qualificatif suffira
gnralement, mais un changement en sens contraire ne peut pas d'ordinaire se faire aussi simplement. Les discussions relatives aux dfinitions ont souvent la forme suivante : A et B sont des
proprits communes un grand nombre de choses ; plusieurs d'entre elles possdent en outre la
proprit C, d'autres la proprit D, et quelques-unes la fois C et D. On peut alors soutenir qu'il
sera prfrable de donner pour un terme une dfinition qui lui fasse embrasser soit toutes les
choses qui ont les proprits A et B ; soit seulement celles qui ont les proprits A, B, C ; soit
seulement celles qui ont les proprits A, B, D ; soit seulement celles qui ont les proprits A, 8,
C, D. Le parti prendre entre ces diverses solutions doit dpendre de considrations d'utilit
pratique, et c'est un point qui a bien moins d'importance qu'une tude attentive des proprits A, B,
C, D, et de leurs relations mutuelles. Malheureusement, dans l'conomie politique anglaise cette
tude a tenu beaucoup moins de place que les controverses touchant les dfinitions ; celles-ci ont,
il est vrai, parfois men indirectement la dcouverte de la vrit, mais toujours par des chemins
dtourns et avec un grand gaspillage de temps et de travail.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
83
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre II : De quelques notions fondamentales
Chapitre deux
La richesse
Retour la table des matires
1. - Toute richesse consiste en choses qui satisfont des besoins, directement ou
indirectement. Toute richesse consiste en choses dsirables, ou choses qui satisfont
les besoins de l'homme ; mais toute chose dsirable n'est pas une richesse. L'affection
des amis, par exemple, est un lment important du bonheur, mais elle n'est pas
compte au nombre des richesses, sauf par une licence potique. Commenons donc
par classer les choses dsirables, et recherchons quelles sont celles qui doivent tre
considres comme des richesses.
Le langage courant ne nous fournissant pas de terme pour dsigner les choses
dsirables, ou choses qui satisfont les besoins de l'homme, nous pouvons employer
dans ce sens le mot Biens (Goods).
Les biens, ou choses dsirables, sont soit matriels, soit personnels ou immatriels. Les biens matriels comprennent les choses matrielles utiles, ainsi que tout
droit de dtenir ou d'utiliser une chose matrielle, ou d'en tirer profit, ou de se la faire
livrer dans un temps futur. Ils comprennent donc les dons physiques de la nature, le
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
84
sol et Peau, l'air et le climat ; les produits de l'agriculture, des mines, de la pche, de
l'industrie manufacturire; les constructions, les machines et les instruments; les
hypothques et autres obligations ; les participations aux socits prives et aux
emprunts des personnes publiques, toutes les espces de monopoles, les brevets, les
droits de reproduction ; de mme les droits de passage et autres droits d'usage. Enfin,
les facilits pour voyager, pour jouir de beaux paysages, de muses, etc. doivent,
parler strictement, tre ranges, dans cette catgorie.
Les biens personnels d'un homme se divisent en deux classes. Dans la premire
figurent les bnfices qu'il tire d'autres personnes, comme les redevances en travail et
les services personnels de toute sorte, les droits de proprit sur des esclaves, l'organisation de ses affaires et ses relations d'affaires en gnral. La seconde classe
comprend ses qualits et facults personnelles pour l'action et pour le plaisir.
Les biens de la premire classe seront dsigns sous le noms (le biens externes;
ceux de la seconde sous le nom de biens internes 1.
En outre, les biens peuvent tre transmissibles ou non-transmissibles. Parmi les
derniers il faut ranger les qualits et facults d'un homme pour l'action et le plaisir
(c'est--dire ses biens internes) ; celles de ses relations d'affaires qui reposent sur la
confiance personnelle qu'on a en lui, et qui ne peuvent pas tre transmises avec le
reste de sa clientle; les avantages qu'un homme retire du climat, du soleil, de l'air;
ses privilges en tant que citoyen, et les droits et les facilits qu'il possde de jouir de
proprits publiques 2. Les biens gratuits sont ceux qui ne sont pas appropris et sont
fournis par la Nature sans exiger l'effort de l'homme.
1
Car, comme le dit Hermann au dbut de sa magistrale analyse de la richesse, certains biens sont
internes, d'autres externes pour l'individu. Un bien interne est celui qu'il trouve en lui-mme
octroy par la nature, ou qu'il cre en lui-mme par sa libre initiative, comme la force musculaire,
la sant, les connaissances intellectuelles. Toute chose que le monde extrieur offre pour la satisfaction de ses besoins est pour lui un bien externe .
La classification ci-dessus peut s'exprimer de la faon suivante :
matriels
transmissibles.
non transmissibles.
personnels
transmissibles.
non transmissibles.
personnels
non transmissibles.
externes
Les biens sont
internes
Ou de la faon suivante, en adoptant une autre disposition qui est plus avantageuse certains gards :
transmissibles.
non transmissibles.
matriels-externes
Les biens sont
externes
transmissibles.
non transmissibles.
internes
non transmissibles.
personnels
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
85
Les biens changeables sont tous les biens transmissibles qui sont limits en
quantit et qui ne sont pas gratuits. Cette distinction n'a pourtant pas une trs grande
importance pratique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de biens transmissibles qui soient
fournis gratuitement par la nature, et qui n'aient pas de valeur d'change.
Retour la table des matires
2. - Nous pouvons maintenant passer la question de savoir quelles sont, parmi
les biens appartenant un homme, les catgories qu'il faut considrer comme formant
sa richesse. C'est une question sur laquelle il existe quelques divergences d'opinion,
mais le poids des arguments comme aussi celui des autorits semble clairement faire
pencher la balance en faveur de la rponse suivante :
Lorsqu'on parle de la richesse d'un homme simplement, et sans qu'il y ait aucune
clause interprtative dans le contexte, on doit admettre qu'elle comprend deux catgories de biens.
La premire catgorie est forme des biens matriels sur lesquels cet homme a (en
vertu de la loi ou de la coutume) des droits de proprit, et qui sont, par suite,
transmissibles et changeables. Ils comprennent, on se le rappelle, non seulement les
choses telles que le sol, les maisons, les meubles, les machines, et les autres choses
matrielles qui peuvent tre en sa proprit prive, mais aussi toutes participations
aux emprunts des personnes publiques, les obligations, les hypothques, et les autres
droits lui permettant d'exiger d'autres personnes qu'elles lui paient des sommes
d'argent, ou qu'elles lui livrent des marchandises. D'un autre ct, les dettes qu'il a
envers d'autres personnes peuvent tre regardes comme une richesse ngative, et l'on
doit d'abord les soustraire de l'ensemble de ce qu'il possde pour avoir sa vritable
richesse nette.
Les services, et les autres biens dont l'existence cesse au moment mme o elle
commence, ne sont naturellement pas une partie de cette richesse 1.
La seconde catgorie est forme des biens immatriels qui lui appartiennent, qui
sont externes par rapport lui, et lui servent directement comme moyens d'acqurir
des biens matriels. Ainsi elle ne comprend pas ses qualits et facults personnelles,
Le sol, dans son tat primitif, tait un don gratuit de la nature ; mais dans les rgions occupes
ce n'est pas un bien gratuit pour l'individu. Le bois est encore gratuit dans certaines forts du
Brsil. Les poissons qui sont dans la mer sont d'ordinaire gratuits ; mais certaines rgions de pche
sont gardes avec jalousie pour l'usage exclusif des membres d'une nation particulire, et peuvent
tre ranges parmi les biens appartenant ce pays. Les bancs d'hutres qui ont t crs
artificiellement ne sont gratuits en aucun sens ; ceux qui se sont dvelopps spontanment sont
gratuits dans tous les sens, s'ils ne sont pas appropris ; s'ils sont proprit prive, ils sont encore
des biens gratuits au point de vue de la nation, mais puisque la nation a abandonn des
particuliers ses droits sur eux, ils ne sont pas gratuits au point de vue individuel ; la mme chose
est vraie du droit quont des particuliers de pcher dans les rivires. Mais le bl qu'on a fait
pousser sur un sol libre, et le poisson qui a t pris dans des rgions o la pche est libre, ne sont
pas des biens gratuits, car il a fallu du travail pour les obtenir.
Pour une action d'une socit commerciale, la partie de sa valeur qui est due la rputation
personnelle et aux relations de ceux qui conduisent l'affaire doit, vrai dire, tre range dans la
catgorie suivante parmi les biens personnels externes. Mais ce point n'a pas beaucoup
d'importance pratique.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
86
mme celles qui le mettent mme de gagner sa vie, parce qu'elles sont internes ; elle
ne comprend pas non plus ses relations personnelles d'amiti, en tant qu'elles n'ont
pas d'influence directe sur ses affaires. Mais elle comprend ses relations d'affaires et
ses relations professionnelles, l'organisation de ses affaires, et l o ces choses
existent - ses droits sur ses esclaves, ou ses, droits des redevances en travail, etc.
Cet emploi du mot richesse est conforme l'usage de la vie ordinaire ; en mme
temps, il comprend les biens, et ceux-l seulement, qui rentrent nettement dans le
cadre de, la science conomique, telle qu'elle a t dfinie au Livre I, et qui peuvent,
par, suite, tre appels biens conomiques. Il comprend en effet toutes les choses,
extrieures un homme, qui: 1 lui appartiennent et n'appartiennent pas galement
ses voisins, et, par suite, sont directement siennes ; et qui, 2 sont directement susceptibles de mesure en monnaie - mesure qui exprime d'une part les efforts et les
sacrifices au prix desquels. ces choses ont t cres, et, de l'autre, les besoins qu'elles
satisfont 1.
Retour la table des matires
3. - On peut d'ailleurs adopter certains points de vue une notion plus tendue
de la richesse ; mais alors il faut avoir recours une clause explicative pour viter des
confusions. Ainsi, par exemple, l'habilet d'un menuisier est, tout aussi bien que les
outils de sa bote outils, un moyen qui lui permet de satisfaire les besoins matriels
des autres, et par suite, indirectement, les siens propres ; il peut tre avantageux
d'avoir un mot qui, dsignant la richesse dans un sens plus large, l'y embrasse.
Marchant dans la voie indique par Adam Smith 2 et suivie par la plupart des conomistes du continent, nous pouvons dfinir la richesse personnelle de faon y
comprendre toutes les nergies, facults et habitudes, qui contribuent directement
augmenter la capacit industrielle des gens; les y comprendre ct de ces relations
d'affaires et de ces associations de toute sorte que nous avons dj comptes comme
tant une partie de la richesse dans le sens troit du mot. Les facults industrielles ont
un autre droit tre regardes comme conomiques par le fait que leur valeur est
d'ordinaire susceptible d'tre en quelque sorte mesure indirectement 3.
La question de savoir s'il vaut la peine de les considrer comme des richesses est
une simple question de convenance, quoiqu'on l'ait souvent discute comme si c'tait
une question de principe.
1
2
3
Cela ne veut pas dire que le propritaire de biens transmissibles, s'il les transmet, puisse toujours
en retirer toute la valeur en monnaie qu'ils ont pour lui. Un habit bien ajust, par. exemple, peut
valoir le prix qu'en demande un tailleur lgant un client, parce que celui-ci en a besoin et ne
peut pas l'avoir moins ; mais s'il le vendait, il n'en retirerait pas la moiti Un financier heureux
qui a dpens 50.000 francs pour avoir une maison et un jardin selon ses gots, a raison un point
de vue s'il les fait figurer leur prix cotant dans l'inventaire de ses biens ; mais s'il venait
tomber, ils ne constitueraient pas pour ses cranciers un gage de cette valeur.
De mme, un certain point de vue, nous pouvons compter la clientle du mdecin ou de
l'avocat, du commerant on de l'industriel, comme quivalant au revenu que celui-ci perdrait s'il en
tait priv ; nous devons pourtant reconnatre que sa valeur d'change, c'est--dire la valeur qu'il
pourrait retirer en la vendant, est bien moindre.
Cf. Wealth of Nations, liv. II, ch. II.
Les corps des hommes sont sans aucun doute le plus prcieux trsor d'un pays , disait Davenant
au XVIe sicle, et des phrases de ce genre ont t courantes partout o la marche des vnements
politiques a amen les hommes se proccuper de l'accroissement de la population.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
87
Ce serait certainement s'exposer des confusions que d'employer le mot richesse tout seul lorsque nous voulons viser les aptitudes industrielles d'une personne. Le
mot richesse tout seul devrait toujours signifier les richesses externes seulement.
Mais il y a peu d'inconvnient, et il semble qu'il puisse y avoir quelque avantage,
employer parfois l'expression de richesses matrielles et personnelles .
Retour la table des matires
4. - Mais il nous faut encore tenir compte des biens matriels qu'un homme
possde en commun avec ses voisins, et que, par suite, ce serait une peine inutile de
mentionner lorsque l'on compare sa richesse avec la leur. Ils peuvent pourtant avoir
de l'importance certains points de vue, et particulirement lorsque l'on veut comparer les conditions conomiques dans des endroits diffrents ou des poques
diffrentes.
Ces biens consistent dans les bnfices qu'un homme retire du fait de vivre dans
un certain lieu, une certaine poque, et d'tre membre d'une certaine nation ou d'une
certaine collectivit ; ils comprennent la scurit civile et militaire, le droit et la
possibilit de jouir des proprits et des institutions publiques de toute sorte, telles
que rues, clairage au gaz, etc., et le droit la justice ou l'instruction gratuite.
L'habitant d'une ville et l'habitant de la campagne ont gratuitement, chacun de son
ct, un grand nombre d'avantages que l'autre ne peut pas obtenir du tout, ou ne peut
obtenir qu'au prix d'une grande dpense. Toutes choses restant gales, une personne a
plus de richesse vritable qu'une autre au sens le plus large du mot, si l'endroit o elle
vit possde un meilleur climat, de meilleures rues, une meilleure eau, un systme
d'gouts plus salubre, de meilleurs journaux, de meilleurs livres, et de meilleures
occasions de distraction et d'instruction. Le logement, la nourriture et les vtements
qui seraient insuffisants dans un climat froid, peuvent tre largement suffisants dans
un climat chaud : d'un autre ct, la chaleur qui diminue les besoins physiques des
hommes et fait qu'ils sont riches mme avec une faible abondance de richesses
matrielles, affaiblit en eux cette nergie qui procure la richesse.
Beaucoup de ces choses sont des biens collectifs, c'est--dire des biens qui ne sont
pas de proprit prive. Cela nous amne envisager la richesse au point de vue
social, en l'opposant au point de vue individuel.
Retour la table des matires
5. - Considrons donc ces lments de la richesse d'une nation qui sont d'ordinaire ngligs lorsque l'on estime la richesse des individus qui la composent. Les
formes les plus videntes que revte cette sorte de richesse sont: les biens matriels de
proprit publique, tels que les routes et les canaux, les difices et les parcs publics,
les installations pour le gaz et pour l'eau ; quoique, malheureusement, beaucoup de
ces biens soient dus non pas aux pargnes publiques, mais des emprunts publics, et
il faut donc mettre en regard la lourde richesse ngative que constitue une grosse
dette.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
88
Mais la Tamise a plus ajout la richesse de l'Angleterre que tous ses canaux, et
peut-tre mme que tous ses chemins de fer. Or, bien que la Tamise soit un don gratuit de la nature, sauf dans la mesure o l'on a amlior la navigation, tandis qu'un
canal est l'uvre de l'homme, nous devons, bien des gards, regarder la Tamise
comme faisant partie de la richesse de l'Angleterre.
Les conomistes allemands insistent souvent sur les lments non-matriels de la
richesse nationale, et il est bon de le faire pour certains problmes relatifs la
richesse nationale, mais lion pas pour tous. Les dcouvertes scientifiques d'ailleurs,
o qu'elles soient faites, deviennent bientt la proprit du monde civilis tout entier,
et peuvent tre considres comme une richesse cosmopolite, plutt que comme une
richesse proprement nationale. La mme chose est vraie des inventions mcaniques et
de beaucoup d'autres progrs raliss dans fart de la production ; cela est vrai aussi de
la musique. Mais les uvres littraires, qui perdent leur cachet dans une traduction,
peuvent tre regardes dans un certain sens comme une richesse pour les nations dans
la langue desquelles elles ont t crites. L'organisation d'un tat libre et bien
administr doit tre regarde certains gards comme un lment important de la
richesse nationale 1.
Mais la richesse d'une nation comprend les biens individuels, tout comme les
biens collectifs de ses membres. Lorsque nous estimons la somme totale de leurs
richesses individuelles, nous pouvons simplifier la tche en omettant toutes les dettes
et autres obligations qui peuvent exister entre membres d'une mme nation. Par
exemple, en ce qui concerne la partie de la dette nationale anglaise et les obligations
1
La valeur d'une entreprise peut tre due, dans une certaine mesure, au fait qu'elle possde un
monopole, soit un monopole complet, assur peut-tre par un brevet, soit un monopole partiel
rsultant de ce que ses marchandises sont mieux connues que d'autres qui sont en ralit aussi
bonnes. Dans la mesure o il en est ainsi, celte entreprise n'ajoute rien la richesse vritable de la
nation. Si le monopole venait disparatre, la diminution de la richesse nationale due la
disparition de sa valeur serait d'ordinaire plus que compense par l'augmentation de valeur des
affaires rivales, d'une part, et, d'autre part, grce l'accroissement de pouvoir d'achat dont, par
suite de la baisse de prix, va bnficier le stock montaire reprsentant la richesse des autres
membres de la nation. (On doit pourtant ajouter que, dans certains cas exceptionnels, le prix d'une
marchandise peut tre plus bas lorsque sa production est monopolise ; mais les cas de ce genre
sont trs rares et peuvent tre ngligs pour le moment.)
Les relations d'affaire et les rputations commerciales n'augmentent la richesse nationale que
dans la mesure o elles mettent les acheteurs en relations avec ceux des producteurs qui sont
mme de satisfaire le plus compltement leurs besoins rels pour un prix donn ; ou, en d'autres
termes, dans la mesure o elles permettent aux efforts de la collectivit de mieux satisfaire les
besoins de la collectivit. Nanmoins, si nous ne voulons pas estimer la richesse nationale
directement, mais indirectement, en tant qu'ensemble de la richesse individuelle, nous devons tenir
compte de toutes les entreprises pour leur valeur entire, mme lorsque celle-ci vient en partie d'un
monopole qui ne soit pas utilis l'avantage du public. En effet le tort qu'elles font aux
producteurs rivaux a t dduit lorsqu'on a compt la valeur des entreprises de ces rivaux, et le tort
que subissent les consommateurs, par suite de l'lvation de prix du produit qu'ils achtent, a t
dduit, en ce qui concerne la marchandise considre, lorsqu'on a calcul le pouvoir d'achat que
possdent leurs revenus.
Un exemple est fourni par l'organisation du crdit. Le crdit augmente la puissance de
production et ajoute ainsi la richesse nationale. Pour tel commerant donn, le pouvoir d'obtenir
crdit est un lment important de son actif. Si, pourtant, quelque vnement vient lui faire
cesser ses affaires, la perte qu'prouve, la richesse nationale est quelque peu infrieure la valeur
totale du crdit dont il disposait ; car une certaine partie au moins des affaires qu'il aurait faites,
seront faites par d'autres, avec l'aide d'une partie au moins du capital qu'il aurait emprunt.
On rencontre des difficults semblables dans la question de savoir dans quelle mesure il faut
tenir compte de la monnaie pour le calcul de la richesse nationale ; mais pour les traiter fond il
nous faudrait anticiper beaucoup sur la thorie de la monnaie.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
89
de chemins de fer anglais qui appartiennent des nationaux, nous pouvons nous
contenter de comprendre les chemins de fer eux-mmes dans la richesse nationale,
laissant de ct les obligations de chemins de fer et la dette publique. Mais nous
avons, de plus, faire une dduction pour les valeurs mises par le gouvernement
anglais ou par des particuliers anglais, et qui sont entre les mains d'trangers, ainsi
qu'une addition pour les valeurs trangres dtenues par des Anglais.
La richesse au point de vue cosmopolite diffre de la richesse nationale, autant
que celle-ci diffre de la richesse individuelle. Lorsqu'on veut la calculer, les dettes
des membres d'une nation envers les membres d'une autre peuvent tre omises dans
les deux colonnes des comptes. En outre, de mme que les fleuves sont des lments
importants de, richesse nationale, la mer est, pour le monde, l'un des biens qui ont le
plus de valeur. La notion de la richesse au point de vue cosmopolite n'est d'ailleurs
pas autre chose que celle de la richesse nationale tendue au monde entier.
Les droits des individus et des nations sur la richesse sont fonds sur le droit civil
et sur le droit international, ou en tout cas sur des coutumes ayant force de loi. Une
tude complte des conditions conomiques d'un temps et d'un lieu quelconques
exigerait donc la connaissance du droit et de la coutume. Mais ses limites sont dj,
sans cela, assez vastes ; les fondements historiques et juridiques des thories relatives
la proprit des biens sont des sujets tendus qu'il vaut mieux discuter dans des
ouvrages distincts 1.
Retour la table des matires
6. - La valeur en change d'un bien conomique est mesure par son prix, c'est-dire par la somme de monnaie pour laquelle il s'change.
Une somme donne de monnaie achtera tantt plus, tantt moins de telle ou telle
chose; mais si chaque changement de ce genre se trouve compens peu prs par un
autre, on dit que le pouvoir gnral d'achat de la monnaie est rest constant. Cette
phrase cache quelques difficults que nous tudierons plus tard ; mais, en attendant,
nous pouvons la prendre dans son sens populaire, lequel est suffisamment clair.
Pendant tout le cours de ce volume nous ne tiendrons pas compte des changements
que peut subir le pouvoir gnral d'achat de la monnaie. Le prix d'une chose sera donc
considr comme reprsentant sa valeur d'change par rapport aux autres choses en
gnral, ou, en d'autres termes, comme reprsentant son pouvoir gnral d'achat 2.
On peut encore citer ici, tout particulirement, l'ouvrage de WAGNER, Volkswirthschaftslehre,
qui jette beaucoup de lumire sur les liens existant entre le concept conomique de la richesse et le
concept juridique des droits de proprit prive.
Le prix de chaque chose monte et baisse d'une poque une autre, et d'un lieu un autre, et tout
changement de ce genre modifie le pouvoir d'achat de la monnaie l'gard de cette chose. Tant
que le pouvoir de l'homme sur la nature reste stationnaire nous pouvons, en regard d'une hausse de
prix, mettre une baisse ; nous pouvons dire que le pouvoir d'achat de la monnaie est constant, si les
hausses de prix ont t peu prs gales aux baisses et ont affect des marchandises d'une
importance peu prs gale. En cela nous ne faisons que suivre la pratique ordinaire des hommes
d'affaires qui commencent invariablement par considrer un changement survenu un moment
donn, et supposent que pendant un certain temps toutes choses restent gales . Comme
Cournot le montre (Principes Mathmatiques de la Thorie des Richesses, ch. II), la supposition
qu'il existe un talon ayant un pouvoir d'achat uniforme, et par lequel se mesure la valeur, nous
rend le mme genre de services que rend aux astronomes la supposition d'un soleil moyen qui
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
90
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre II : De quelques notions fondamentales
Chapitre trois
Production. - Consommation. - Travail. Objets de ncessit
Retour la table des matires
1. - L'homme ne peut pas crer de choses matrielles. Dans le monde intellectuel et moral, il est vrai, il peut produire de nouvelles ides ; mais lorsqu'on dit qu'il
produit des choses matrielles, il ne produit rellement que des utilits. En d'autres
termes, ses efforts et ses sacrifices ont pour rsultat de changer la forme ou la
disposition de la matire, pour mieux l'adapter la satisfaction de ses besoins. Tout ce
que l'homme peut faire dans le monde physique, c'est: ou bien de modifier la matire
pour la rendre plus utile, comme lorsqu'il fait une table avec un morceau de bois; ou
bien de la placer dans des conditions o elle puisse, sous l'action de la nature, devenir
plus utile, comme lorsqu'il met des graines en terre pour que les forces de la nature les
fassent germer 1.
passe au mridien des intervalles uniformes, de sorte que le mouvement de l'horloge puisse le
suivre ; tandis que le soleil vritable passe au mridien tantt avant et tantt aprs midi.
Mais lorsque, la suite d'inventions, le pouvoir de l'homme sur la nature s'est beaucoup accru,
alors la vritable valeur de la monnaie se mesure mieux certains gards en travail qu'en
marchandises. Nous ngligerons cette difficult dans le volume actuel, mais elle nous occupera
beaucoup dans le volume suivant.
BONAR (Philosophy and Political Economy, p. 249). cite ces paroles de BACON, Novum
Organum, IV ; Ad opera nil aliud potest homo quam ut corpora naturalia admoveat et amoveat,
reliqua natura intus agit.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
91
On dit parfois que les commerants ne produisent pas que l'bniste produit des
meubles, mais que le marchand de meubles se contente de vendre ce qui est dj
produit. Cette distinction ne repose sur aucune base scientifique. Tous deux produisent des utilits, et aucun d'eux ne peut faire davantage: le marchand de meubles
dplace et dispose nouveau la matire, de faon lui faire rendre plus de services
qu'elle n'en rendait auparavant, et le menuisier ne fait pas autre chose. Le marin et
l'employ de chemin de fer, qui transportent le charbon loin de la mine, le produisent
tout aussi bien que le mineur qui le transporte au fond de la mine. Le marchand de
poisson fait passer le poisson des endroits o il a peu d'utilit ceux o il en a une
plus grande, et le pcheur ne fait pas davantage. Il est vrai que souvent le nombre des
commerants est plus grand qu'il n'est ncessaire, il y alors du gaspillage; mais il en
est de mme lorsque deux hommes mnent une charrue qui pourrait tre mene par un
seul. Dans les deux cas, tous ceux qui sont l'uvre produisent, bien que cela puisse
n'tre que fort peu. Certains auteurs amricains, et quelques autres aussi, ont rdit
les attaques diriges au Moyen Age contre les commerants pour ce motif qu'ils ne
produisent pas. Mais ils n'ont pas dirig leurs attaques comme ils auraient d. Ils
auraient d s'en prendre l'organisation imparfaite du commerce, particulirement du
commerce de dtail 1.
La consommation peut tre regarde comme une production ngative. De mme
que l'homme ne peut produire que des utilits, il ne peut pas non plus consommer
autre chose. Il peut produire des services et autres produits immatriels, et il petit les
consommer. Mais de mme que la production de produits matriels n'est en ralit
pas autre chose qu'une modification de la matire qui lui donne de nouvelles utilits,
de mme la consommation n'est pas autre chose qu'une modification de la matire qui
diminue ou dtruit son utilit. Souvent, il est vrai, lorsqu'on dit que l'homme consomme des objets, il ne fait pas autre chose que les dtenir pour son usage; mais,
comme le dit Senior, leur destruction s'opre graduellement sous l'action de ces
nombreux agents que nous dsignons en bloc sous le nom de temps 2. De mme que
le producteur de bl est celui qui met la graine dans un endroit o la nature la fera
germer, de mme celui qui consomme a des tableaux, des rideaux et mme une
maison, ou un yacht, contribue fort peu les user lui-mme, mais il s'en sert pendant
que le temps les dtruit.
Une autre distinction laquelle une certaine importance a t attribue, mais qui
est vague, et n'a peut-tre pas beaucoup d'utilit pratique, est celle qu'on fait entre les
biens de consommateurs (appels aussi biens de consommation, ou encore biens de la
premire classe) comme les aliments, les vtements, etc., qui satisfont des besoins
directement, et les biens de producteurs (appels aussi biens de production, ou biens
instrumentaux, ou biens intermdiaires), tels que charrues, mtiers, coton brut, qui
satisfont des besoins indirectement, en servant la production des biens de la
premire classe 3.
1
2
3
La production, au sens troit, change la forme et la nature des produits. Le commerce et le
transport changent leurs relations externes.
Political Economy, p. 54. Senior voulait substituer le verbe user au verbe consommer .
Ainsi la farine destine faire un gteau est considre par certains auteurs comme un bien de
consommation lorsqu'elle se trouve dj dans la maison du consommateur ; tandis que non
seulement la farine, mais le gteau lui-mme, sont considrs comme des biens de production
lorsqu'ils sont entre les mains du confiseur. Charles MENGER (Wolkswirthschaftslehre, ch I, 2)
dit que le pain appartient la premire classe, la farine la seconde, le moulin la troisime et
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
92
Retour la table des matires
2. - Tout travail est destin produire quelque rsultat. S'il est vrai que certaines
fatigues sont quelquefois acceptes pour elles-mmes, comme dans le jeu, elles ne
sont pas considres comme travail. Nous pouvons dfinir le travail: une fatigue de
l'esprit ou du corps accepte partiellement on compltement en vue d'un avantage
autre que le plaisir qu'on en tire directement 1. Si nous pouvions faire table rase, le
mieux serait de considrer tout travail comme productif, sauf celui qui n'a pas atteint
le but qu'il se proposait et n'a ainsi produit aucune utilit. Mais au cours des
nombreux changements que le sens du mot productif a subis, il a toujours t
employ pour dsigner particulirement la richesse accumule, en laissant un peu de
ct, et parfois mme en excluant, les satisfactions immdiates et transitoires 2. Une
tradition presque ininterrompue nous oblige ainsi considrer que, par son sens
principal, ce mot s'applique un approvisionnement en vue des besoins de l'avenir,
plutt qu'en vue des besoins du moment prsent. Il est vrai que toutes les jouissances
saines, qu'elles soient on non des jouissances de luxe, sont des fins lgitimes l'action
publique ou prive. Il est vrai aussi que les jouissances de luxe sont un stimulant
l'effort et aident au progrs bien des gards. Mais, degr gal d'activit et d'nergie
productrices, un pays trouve gnralement intrt subordonner le got des jouissances de luxe passagres l'acquisition de ces ressources plus solides et plus
durables qui aident la production dans sa tche venir, et qui contribuent de diverses
manires rendre la vie plus large. Quoiqu'il en soit, cette ide gnrale a t dans
l'air, toutes les phases de la thorie conomique ; elle a t exprime par diffrents
ainsi de suite. On voit que si un train transporte la fois des gens voyageant pour leur plaisir, des
botes de biscuits, des machines servant des moulins, et des machines servant fabriquer les
prcdentes, ce train est alors en mme temps un bien de premire, deuxime, troisime et
quatrime classe.
C'est la dfinition de Jevons (Theory of Political Economy, ch. V), sauf qu'il n'y comprend que les
fatigues qui causent une certaine peine. Mais il signale lui-mme combien l'oisivet est souvent
pnible. Biens des gens travaillent plus qu'ils ne le feraient s'ils ne considraient que le plaisir
direct qu'ils en retirent ; mais dans l'tat de sant, le plaisir l'emporte sur la peine dans une grande
partie mme du travail qui est effectu contre salaire. videmment la dfinition est lastique : un
journalier de la campagne travaillant le soir dans son jardin pense surtout au fruit de son travail ;
un ouvrier d'usine rentrant chez lui, aprs une journe de travail sdentaire, trouve un rel plaisir
travailler dans son jardin, mais il se proccupe pourtant du fruit de son travail ; tandis qu'un
homme riche s'adonnant au mme travail peut tre fier de le bien faire, mais il se souciera
probablement assez peu du profit pcuniaire qu'il en tire.
Ainsi les mercantilistes qui regardaient les mtaux prcieux, en partie parce qu'ils sont imprissables, comme la richesse par excellence, considraient comme improductif, ou strile , tout
travail qui n'avait pas pour but de produire des biens pour tre exports en change d'or et d'argent.
Les Physiocrates considraient comme strile tout travail qui consomme une valeur gale celle
qu'il produit, et pour eux le travailleur agricole est le seul travailleur productif, parce que son
travail seul, pensaient-ils, laisse derrire lui un revenu net de richesse accumule. Adam Smith
adoucit la rigueur de la dfinition physiocratique ; mais il pensait encore que le travail agricole est
plus productif que tout autre. Ses successeurs ont rejet cette distinction ; mais ils ont gnralement accept, quoique avec beaucoup de divergences de dtails, l'ide qu'un travail productif est
celui qui tend augmenter la richesse accumule, ide qui est implique plutt qu'affirme dans le
clbre chapitre de la Richesse des Nations qui porte le titre De l'accumulation du capital, ou du
travail productif et du travail improductif . (Cf. TRAVERS Twiss, Progress of Political
Economy, Sect. VI, et les discussions sur le mot productif dans les Essays de J. S. MILL, et dans
ses Principes d'conomie politique).
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
93
auteurs en des distinctions arrtes et rigoureuses par lesquelles certaines professions
sont dsignes comme productives, et d'autres comme improductives.
C'est ainsi que, par exemple, beaucoup d'auteurs, mme d'une poque rcente, ont,
avec Adam Smith, class, les domestiques parmi les travailleurs improductifs. Il est
certain que dans beaucoup de grandes maisons il y a un nombre excessif de domestiques, dont l'activit pourrait, avec profit, pour la socit, tre employe autre
chose ; mais il en est de mme de la plupart de ceux qui gagnent leur vie en fabriquant le wisky, et pourtant aucun conomiste n'a propos de les qualifier d'improductifs. Il n'y a pas de diffrence de caractre entre le boulanger qui fournit le pain
une famille, et la cuisinire qui fait cuire des pommes de terre. Si ce boulanger est en
mme temps confiseur, ou si c'est un boulanger faisant du pain de fantaisie, il est
probable qu'il dpense, comme la cuisinire, une grande partie de son temps un
travail qui est improductif, au sens vulgaire du mot, en ce qu'il pourvoit des
jouissances momentanes et non ncessaires.
Partout o nous employons le mot Productif tout seul, on doit le prendre au sens
de productif de moyens de production et de sources durables de jouissance. Mais
c'est un mot ambigu, et il vaudrait mieux ne pas l'employer lorsqu'on a besoin d'tre
prcis 1.
Si nous avons besoin de l'employer dans un sens diffrent, nous le dirons : par
exemple, nous pourrons dire d'un travail qu'il est productif d'objets de ncessit, etc.
L'expression de consommation productive, lorsqu'elle est employe dans un sens
technique, dsigne d'ordinaire l'emploi de la richesse en vue de produire une richesse
future ; strictement, elle ne devrait pas comprendre la totalit des objets consomms
par les ouvriers productifs, mais seulement la partie de ces objets qui est ncessaire
pour entretenir leur activit. Peut-tre l'expression peut-elle tre utile dans les
recherches relatives l'accumulation de la richesse matrielle ; mais elle est susceptible d'induire en erreur. En effet la consommation est le but de la production, et toute
consommation saine procure des avantages parmi lesquels plusieurs des plus remarquables ne se rfrent pas directement la production des richesses matrielles 2.
1
Parmi les moyens de production sont compris les objets ncessaires au travail, mais non les objets
de luxe phmres : l'homme qui fabrique des glaces est donc class parmi les travailleurs
improductifs, qu'il travaille dans une ptisserie, ou comme domestique dans une maison particulire la campagne ; mais un maon employ construire un thtre est class parmi les
travailleurs productifs. Sans doute, la distinction entre les sources permanentes et les sources phmres de jouissance est vague et sans consistance; mais cette difficult se trouve dans la nature des
choses et ne peut pas tre compltement supprime par un expdient de langage. Nous pouvons
dire que le nombre des hommes grands par rapport aux hommes petits a augment, sans dcider
s'il faut classer parmi les grands tous ceux qui ont plus de cinq pieds neuf pouces, ou seulement
ceux qui ont plus de cinq pieds dix pouces. Et nous pouvons parler d'une augmentation du travail
productif au dtriment du travail improductif sans fixer une ligne de dmarcation rigide, et par
suite arbitraire, entre eux. Si ou a, pour une raison particulire, besoin d'une division artificielle de
ce genre, on ne doit y recourir explicitement que pour cette occasion. Mais, en fait, de telles
occasions ne se prsentent que rarement, ou mme jamais.
Toutes les classifications dans lesquelles le mot Productif est employ sont trs subtiles et ont un
certain air d'irralit. Si on avait les introduire maintenant dans la science, elles n'en vaudraient
pas la peine ; mais elles ont une longue histoire, et il vaut probablement mieux rduire peu peu
leur emploi que de les supprimer subitement.
Les tentatives faites pour tracer des lignes rigoureuses de dmarcation, l o il n'y pas de
solution relle de continuit dans la nature, ont souvent fait plus de mal, mais n'ont peut-tre
jamais men des rsultats plus bizarres que les dfinitions rigides qui ont t parfois donnes de
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
94
Retour la table des matires
3. - Cela nous amne examiner l'expression de objets de ncessit. On divise
d'ordinaire les richesses en objets de ncessit, objets d'agrment et objets de luxe. La
premire catgorie comprend toutes les choses pourvoyant des besoins qui doivent
absolument tre satisfaits, tandis que les dernires comprennent des choses
pourvoyant des besoins d'un caractre moins urgent. Mais, ici encore, on trouve une
fcheuse ambigut. Lorsque nous disons qu'un besoin doit tre satisfait, quelles sont
les consquences que nous avons en vue au cas o il ne le serait pas ? Est-ce qu'elles
comprennent la mort ? Ou bien s'tendent-elles seulement la perte de toute force et
de toute vigueur? En d'autres termes, les objets de ncessit sont-ils ceux qui sont
ncessaires pour vivre, ou ceux qui sont ncessaires pour entretenir l'activit ? On
emploie souvent l'expression d'objets de ncessit, comme celle de productif, d'une
faon elliptique, laissant an lecteur le soin de comprendre quelles sont les choses
qu'elle vise ; comme ce ne sont pas toujours les mmes, il arrive souvent que le
lecteur ne soit pas d'accord avec l'auteur et se mprenne sur ce qu'il veut dire. Dans ce
cas, comme dans le prcdent, on peut viter la cause principale de confusion en
indiquant expressment, dans chaque passage douteux, ce que le lecteur doit entendre.
Dans son emploi ancien l'expression objets de ncessit ne comprenait que ce qui
suffit pour permettre aux ouvriers, pris ensemble, de vivre, eux et leur famille. Adam
Smith, et les plus aviss de ses successeurs, remarqurent bien que le niveau du
confort varie suivant les temps et les lieux; ils aperurent que les diffrences de climat
et les diffrences de coutumes rendent parfois ncessaires des choses qui, dans
d'autres conditions, sont superflues. Mais les ides d'Adam Smith taient grandement
influences par celles des Physiocrates; or leurs raisonnements taient bass sur la
condition du peuple franais au XVIIIe sicle, pour la grande masse duquel les
objets de ncessit ne comprenaient rien au del de ce qu'il faut strictement pour
vivre. des poques plus heureuses pourtant, une analyse plus soigneuse mit en
vidence la distinction entre les choses qui sont ncessaires pour maintenir l'activit
(efficiency), et celles qui sont ncessaires pour soutenir l'existence. On montra qu'il
existe pour chaque genre de profession, une poque et dans un lieu donns, un
certain revenu, plus ou moins nettement fix, qui est ncessaire pour faire simplement
vivre ses membres ; tandis qu'il en est un autre, plus considrable, qui est ncessaire
pour les maintenir en pleine activit 1.
ce mot productif. Quelques-unes, par exemple, amnent conclure qu'un chanteur de thtre n'est
pas productif, mais que l'imprimeur qui imprime les billets d'entre l'est ; que l'ouvreuse qui montre aux gens leurs places est improductive, moins qu'elle ne vende des programmes, et alors elle
est productive. Senior signale qu'on ne dit pas qu'un cuisinier fait un rti mais qu'il l'habille (not
to make but to dress) ; mais on dit qu'il fait un pudding... On dit d'un tailleur qu'il fait un habit,
mais on ne dit pas du teinturier qu'il fait du drap teint. La transformation que le teinturier fait subir
au drap est peut-tre plus grande que celle que lui fait subir le tailleur, mais le drap en passant
entre les mains du tailleur change de nom, en passant par celles du teinturier il n'en change pas : le
teinturier n'a pas produit un nom nouveau, ni par suite une chose nouvelle . Political Economy,
pp. 51, 52.
C'est ainsi que dans le sud de l'Angleterre la population a augment pendant le sicle actuel dans
une proportion assez grande, en tenant compte de l'migration. Mais le rendement du travail, qui
autrefois y tait aussi lev que dans le Nord, a baiss relativement au Nord ; de sorte que le
travail salaires bas du Sud revient souvent plus cher que le travail mieux pay du Nord. Nous ne
pouvons donc pas dire si, dans le Sud, les ouvriers ont ou n'ont pas toujours eu ce qui leur tait
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
95
Il pourrait arriver que les salaires gagns par telle catgorie d'ouvriers fussent
suffisants maintenir leur activit un niveau plus lev, s'ils taient dpenss avec
une sagesse, parfaite. Mais toute apprciation portant sur les objets de ncessit doit
tre relative un temps et un lieu donns, et, moins qu'il n'y ait en sens contraire
une clause interprtative expresse, on doit supposer que les salaires sont dpenss
prcisment avec la moyenne de sagesse de prvoyance et de dsintressement, qui
prvaut en fait dans la catgorie d'ouvriers dont il s'agit. En l'entendant ainsi, nous
pouvons dire que le revenu de telle catgorie d'ouvriers est au-dessous du niveau
ncessaire, lorsque toute augmentation de ce revenu amnerait avec le temps une
augmentation plus que proportionnelle de leur activit. La consommation peut tre
diminue par un changement d'habitudes, niais toute diminution au del du ncessaire
est dommageable 1.
Retour la table des matires
4. - Nous tudierons avec quelque dtail quels sont les objets ncessaires pour
maintenir l'activit des diffrentes catgories d'ouvriers, lorsque le moment sera venu
de rechercher les causes. qui dterminent l'offre de travail ; mais il sera bon, pour
prciser un peu nos ides, d'examiner ds maintenant quels objets sont ncessaires en
Angleterre l'poque actuelle pour maintenir l'activit d'un ouvrier agricole ordinaire
ou d'un ouvrier de ville non-qualifi (unskilled), en y comprenant leurs dpenses et
celles de leur famille. On peut dire qu'ils comprennent une maison bien saine avec
plusieurs pices, un vtement chaud, avec quelques vtements de dessous de rechange, de l'eau pure, du pain en abondance, une certaine quantit de viande et de lait, un
peu de th, etc., une certaine instruction et quelques distractions ; il faut enfin que la
femme ait suffisamment de libert pour remplir convenablement ses devoirs de mre
et de mnagre. Si quelque part les ouvriers non-qualifis (unskilled) sont privs
d'une de ces choses, ils en souffrent dans leur activit, comme un cheval qui n'est pas
convenablement soign, ou comme une machine vapeur laquelle ou ne donne pas
assez de charbon. Jusqu' cette limite, toute consommation est une consommation
ncessaire, moins de savoir dans lequel de ces deux sens le mot est employ. Ils ont eu le strict
ncessaire pour vivre et pour augmenter en nombre, mais, manifestement, ils n'ont pas eu tout ce
qui leur tait ncessaire pour maintenir leur activit. On doit pourtant se rappeler que dans le Sud
les ouvriers les plus vigoureux ont constamment migr vers le Nord, et que dans le Nord l'nergie
des ouvriers s'est trouve accrue par la libert conomique plus grande dont ils ont joui, par les
facilits plus grandes qu'ils ont eues ainsi de s'lever une situation plus haute. Voir MACKAY,
Charity Organization Journal, fvrier 1891.
Si nous considrions un individu possdant des aptitudes exceptionnelles, nous aurions tenir
compte du fait qu'il n'y a vraisemblablement pas, comme pour un membre ordinaire d'une
profession industrielle quelconque, une relation troite entre la valeur relle de son travail pour la
communaut et le revenu qu'il en tire. Nous devrions alors dire que tout ce qu'il consomme est
strictement productif et ncessaire, puisque s'il en supprime une partie il diminue son activit
efficiente d'une quantit qui a, pour lui ou pour le reste du monde, plus de valeur relle que
l'pargne qu'il fait en rduisant sa consommation. Si un Newton, ou un Watt, avait pu ajouter une
centime partie son activit en doublant ses dpenses personnelles, l'accroissement de sa
consommation aurait t en vrit productive. Comme nous le verrons plus tard, un pareil cas est
analogue celui o des dpenses additionnelles de culture sont faites sur un sol riche qui donne
une rente leve : il peut en rsulter un bnfice, quoique le rendement procur par elles soit
moindre que celui donn par les dpenses prcdentes.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
96
strictement productive : toute diminution, bien loin d'tre avantageuse, est au contraire dommageable.
Une certaine consommation d'alcool et de tabac, et une certaine lgance de
vtements sont, en beaucoup d'endroits, si habituelles que l'on peut les appeler des
objets de ncessit conventionnelle , puisque, pour se les procurer, l'homme et la
femme ordinaires sacrifient, quelques-unes des choses ncessaires l'entretien de leur
activit. Les salaires restent donc infrieurs au minimum pratiquement indispensable
pour maintenir l'activit des travailleurs, s'ils ne leur permettent pas de se procurer
non seulement les objets de consommation strictement ncessaires, mais aussi une
certaine quantit de ces objets de ncessit conventionnelle 1.
La consommation, par les ouvriers, d'objets de ncessit conventionnelle est
d'ordinaire range parmi les consommations productives ; mais, strictement parler,
elle ne doit pas l'tre, et dans les passages douteux une clause interprtative spciale
devrait tre ajoute pour dire si elle y est ou si elle n'y est pas comprise.
Il faut pourtant remarquer que beaucoup de choses, comptes avec raison comme
objets de luxe superflus, sont pourtant susceptibles, dans une certaine mesure, de
passer au rang d'objets de ncessit ; dans cette mesure leur consommation est productive lorsqu'elles sont consommes par des producteurs 2.
1
2
Comparez la distinction entre les choses physiquement et les choses politiquement ncessaires
dans James STEUART, Inquiry, A. D. 1767, II, XXI.
Ainsi un plat de petits pois en mars, cotant peut-tre dix shillings, est un objet de luxe superflu ;
pourtant c'est une nourriture saine, et qui fait peut-tre autant de profit que trois pence de choux,
ou mme nu petit peu plus que cela, puisque la varit est sans aucun doute ncessaire la sant.
Le plat de petits pois peut donc figurer pour la valeur de quatre pence parmi les choses ncessaires
et pour celle de neuf shillings et huit pence parmi les choses superflues ; sa consommation peut
tre regarde comme strictement productive pour un quarantime de sa valeur. Dans certains cas
exceptionnels, comme, par exemple, lorsque les petits pois sont donns un malade, les dix
shillings peuvent bien tre employs et reproduire leur propre valeur.
Pour prciser les ides il peut tre bon de tenter d'apprcier, alors mme que ce serait en gros
et un peu au hasard, ce que comprend le strict ncessaire. Avec les prix actuels, le strict ncessaire
pour une famille agricole moyenne est peut-tre reprsent par une somme de quinze dix-huit
shillings par semaine, le ncessaire conventionnel par environ cinq shillings de plus. Pour l'ouvrier
non-qualifi (unskilled) vivant en ville il faut ajouter quelques shillings au strict ncessaire. Pour
la famille de l'ouvrier qualifi (skilled) vivant en ville nous pouvons prendre vingt-cinq ou trente
shillings pour le strict ncessaire et dix shillings pour le ncessaire conventionnel. Pour un homme
dont le cerveau doit supporter une grande fatigue continue, le strict ncessaire est peut-tre de
deux cents ou deux cent cinquante livres par an s'il est clibataire, et plus du double s'il a une
famille coteuse lever. Le ncessaire conventionnel dpend pour lui de la nature de sa
profession.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
97
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre II : De quelques notions fondamentales
Chapitre quatre
Capital. - Revenu
Retour la table des matires
1. - On a l'habitude de diviser l'ensemble des biens qui constituent la richesse en
biens qui sont des capitaux, et en biens qui ne sont pas des capitaux. Mais on a besoin
de recourir cette distinction dans des cas forts diffrents ; aussi, le terme de capital
a-t-il bien des sens divers, soit dans la langue des affaires, soit dans les ouvrages des
conomistes. En fait, il n'y a pas de partie de l'conomie politique o la tentation soit
aussi forte d'imaginer une srie de termes techniques entirement nouveaux, dont
chacun aurait un sens prcis et fixe, et qui, eux tous, rpondraient toutes les
significations diverses donnes au mot unique de Capital dans la langue des affaires.
Mais, par l, on supprimerait le contact entre la science et la vie relle ; les sens que
nous donnons au mot capital doivent tre bass sur l'usage qui en est fait dans les
affaires ; ils doivent seulement tre mieux dtermins et plus prcis, et, lorsqu'il y a
danger de se tromper, il faut ajouter quelques mots pour guider le lecteur.
Presque tous les sens du mot Capital comprennent deux ides fondamentales,
celle de productivit (productiveness), et celle de mise en rserve en vue de
l'avenir (prospectiveness), ou subordination des dsirs prsents des jouissances
futures. Ces deux ides ont d'ailleurs beaucoup de points communs, car, comme nous
l'avons vu dans le chapitre prcdent, on a gnralement considr que le travail est
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
98
employ productivement lorsqu'il pourvoit aux besoins futurs, plutt qu'aux besoins
prsents.
La principale demande de capital vient de sa productivit, des services qu'il rend,
par exemple en permettant de filer et de tisser la laine plus aisment qu'avec la main
toute seule, ou bien en amenant l'eau l o elle manque, au lieu de l'apporter
grand'peine avec des seaux, bien qu'il y ait d'autres usages du capital qui ne peuvent
pas tre rangs sous ce chef, comme par exemple lorsqu'on le prte un prodigue.
D'un autre ct, l'offre de capital est gouverne par le fait que, pour qu'il se forme, il
faut que les hommes pratiquent la rserve en vue de l'avenir : il faut qu'ils attendent et qu'ils pargnent (wait and save), qu'ils sacrifient le prsent l'avenir.
Retour la table des matires
2. - Mais ces deux caractres de productivit et de rserve en vue de l'avenir
appartiennent, dans une certaine mesure, toutes les formes de richesse accumule.
Ils se prsentent, par exemple, pour les ustensiles de cuisine et pour les vtements ;
pourtant, lorsque ces choses sont utilises parleurs propritaires pour leur propre
usage, ils ne sont considrs comme des capitaux que par ceux qui ne font aucune
distinction entre la richesse et le capital.
Adam Smith dit que le capital d'une personne est cette partie de ses biens (part
of his stock), dont elle compte tirer un revenu ; et, de fait, tous les usages qu'on a
fait du mot Capital se rattachent plus ou moins troitement un des emplois du mot
revenu. Ceci nous suggre une solution de la difficult : les sens des deux mots ont
vari ensemble en tendue ; mais, dans presque tous les sens, le capital a t
considr comme cette partie des biens d'un homme dont il compte tirer un revenu.
Dans la vie ordinaire, le capital est communment envisag au point de vue individuel, et les conomistes sont lis troitement par les usages des affaires dans
l'emploi qu'ils font de l'expression capital individuel; mais ils ont leurs coudes plus
libres lorsqu'ils traitent du capital social, c'est--dire du capital envisag au point de
vue de la nation ou d'un groupe social quelconque. Le point de vue individuel et le
point de vue social ont t jusqu'ici envisags par nous ensemble, mais dsormais
nous devons distinguer entre eux. Nous commencerons par le point de vue individuel.
Retour la table des matires
3. - Dans une socit primitive on ne distingue pas entre le capital et les autres
formes de richesse ; chaque famille se suffit peu prs elle-mme et produit ellemme la plus grande partie de sa nourriture, ses vtements et mme ses meubles.
Seule une trs petite partie du revenu de la famille se prsente sous la forme de
monnaie. Lorsque les gens pensent leur revenu, ils y comprennent les profits qu'ils
tirent de leurs ustensiles de cuisine, tout comme ceux qu'ils tirent de leur charrue; ils
ne font pas de distinction entre leur capital et le reste de leurs biens accumuls, qui
comprennent aussi bien les ustensiles de cuisine que les charrues 1.
1
Ces faits et d'autres semblables ont amen quelques personnes penser non seulement que
certaines parties de la thorie moderne de la distribution et de l'change sont inapplicables aux
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
99
Mais, avec le dveloppement de l'conomie monnaie, on a eu une forte tendance
restreindre la notion de revenu aux revenus en monnaie (en y comprenant les
paiements en nature, comme la jouissance gratuite d'une maison, et la gratuit du
chauffage, du gaz, de Peau, qui figurent dans le traitement d'un employ au lieu et
place de paiements en argent).
D'accord avec ce sens du mot revenu, le langage des affaires regarde ordinairement le capital d'un homme comme comprenant la partie de ses biens qu'il consacre
se procurer un revenu en monnaie, ou, pour parler d'une faon plus gnrale,
acqurir (Erwerbung), au moyen d'une entreprise quelconque. Il peut tre avantageux
parfois de donner ces biens utiliss dans des entreprises commerciales ou industrielles le nom de capital d'entreprise (trade capital) ; on peut y comprendre les
biens externes qu'une personne emploie dans ses entreprises, soit pour les vendre
contre de l'argent, soit pour les employer produire des choses qui se vendent ensuite
pour de l'argent. On peut citer parmi les lments importants du capital ainsi compris
des choses comme l'usine et le matriel d'un industriel, c'est--dire ses machines, ses
matires premires, les aliments, les vtements et les logements qu'il fournit ses
employs, et la clientle de sa maison.
Aux choses qui sont en sa possession, il faut ajouter celles sur lesquelles il a un
droit et dont il tire revenu : prts qu'il a faits sur hypothque ou autrement, et tout le
capital dont il petit disposer grce aux formes complexes du march montaire
moderne. D'un autre ct, ses dettes doivent tre dduites de son capital.
Cette dfinition du capital au point de vue individuel, ou au point de vue des
affaires, est si bien tablie dans l'usage ordinaire que nous devons l'accepter sans
hsitation 1.
Retour la table des matires
4. - Lorsque nous passons au point de vue social, nous sommes alors libres
d'insister plus exclusivement sur des considrations purement conomiques. Mais
l'exprience montre qu'il est trs difficile de faire bon usage de cette libert.
La principale diffrence est relative au sol et aux autres dons gratuits de la nature.
L'habitude, et des raisons de commodit, portent comprendre dans le capital
individuel les droits sur le sol. Mais lorsqu'on envisage le capital au point de vue
social, il vaut mieux distinguer entre les ressources de la nation qui ont t cres par
socits primitives - ce qui est vrai - ; mais encore qu'aucune partie importante de cette thorie ne
leur serait applicable, ce qui n'est pas vrai. C'est un frappant exemple des dangers qu'il y a nous
laisser asservir par des mots, nous soustrayant ainsi au dur labeur qui est ncessaire pour
apercevoir l'unit de fond sous la varit de forme.
Ses avantages et ses inconvnients seront discuts 9. Lorsque nous tudierons les complications
du march montaire moderne, nous aurons examiner sous quelles rserves les pices de monnaie, les billets de banque, les dpts en banque, les comptes de crdit en banque, etc., peuvent
tre considrs comme faisant partie du capital, premirement des individus, et deuximement de
la socit.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
100
les hommes et celles qui ne l'ont pas t, sparant ainsi le capital, qui est le rsultat du
travail et de l'pargne, d'avec les choses que la nature a donnes gratuitement 1.
Quelques simplifications de compte se prsentent aussi d'elles-mmes. Par exemple, les dettes hypothcaires et les autres dettes entre personnes de la mme nation (ou
entre personnes de tout autre groupe social) peuvent tre ngliges ; dans le compte
du capital national elles figureraient la fois au crdit et au dbit, et s'annuleraient les
unes les autres 2.
Jusque-l les conomistes sont d'accord ; mais ici les opinions divergent, et il n'y a
aucune entente quant la dfinition exacte du capital au point de vue social. Ce qui
suit indique de quelle faon le mot sera employ dans cet ouvrage.
L'emploi de beaucoup le plus important qui est fait du mot capital, pris dans un
sens gnral, c'est--dire au point de vue social, se prsente dans l'tude de la question
de savoir comment les trois agents de la production, la terre, (c'est--dire les agents
naturels), le travail et le capital, contribuent produire le revenu national (ou le dividende national, comme il sera appel plus tard), et comment ce revenu est distribu
entre les trois agents. De l, l'utilit qu'il y a maintenir une troite corrlation entre,
les sens des mots Capital et Revenu au point de vue social, comme nous l'avons fait
au point de vue individuel. Mais, naturellement, il faut pour cela considrer le revenu
plus largement, et ne pas y comprendre seulement celui qui prend la forme de monnaie. Toute richesse est destine donner quelque chose qui, en thorie pure, peut
tre appel un revenu , un bnfice, ou un gain d'une forme ou d'une autre, et il
tait raisonnable de la part de Jevons et des autres, qui s'adressaient des lecteurs
mathmaticiens, de prtendre que les biens qui se trouvent entre les mains des
consommateurs sont des capitaux donnant un revenu. La langue des affaires, tout en
refusant de donner un sens aussi large au mot Revenu, y comprend d'ordinaire un
certain nombre de formes de revenu autres que les revenus en monnaie.
On peut donner comme exemple de cet emploi la pratique des commissaires de
l'income tax, lesquels font figurer clans leurs comptes toute chose ordinairement
susceptible de recevoir un emploi industriel ou commercial (everything wich is
commonly treated in a business fashion); mme si, comme c'est le cas d'une maison
habite par son propritaire, elle donne directement son revenu sous forme de confort.
Ils agissent ainsi non pas en vertu d'un principe thorique ; mais, d'une part, cause
de l'importance pratique des maisons d'habitation, et, d'autre part, parce que le revenu
qui en provient peut tre aisment spar et estim.
Dans cet ouvrage nous entendrons par capital au sens gnral, c'est--dire capital
envisag au point de vue social, l'ensemble des richesses, autres que les dons gratuits
de la nature, qui donnent un revenu gnralement compte comme tel dans le langage
courant : en y comprenant les choses du mme genre qui sont proprits publiques,
comme les usines appartenant au gouvernement.
1
2
Cette distinction n'est, il est vrai, pas toujours aise faire. Voir liv. IV, chap. II ; liv. V, chap. VI ;
liv. VI, chap. X, XI.
Rodbertus a insist sur la distinction entre les droits individuels sur le capital envisags au sens
historico-juridique (Kapital im historich-rechtlichen Sinne, Kapital-vermgen, Kapital-besitzt, et
le capital au point de vue social pur. Cette distinction a t dveloppe par Knies, Wagner, et par
d'autres.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
101
Ainsi l'expression de capital embrasse toutes les choses employes industriellement et commercialement (held for trade purposes), que ce soit des machines,
des matires premires ou des marchandises finies, les thtres et les htels; les
btiments de fermes et les maisons d'habitation : mais il ne comprend pas les meubles
et les vtements appartenant ceux qui s'en servent. Car les premires de ces choses
sont, et les autres ne sont pas, regardes comme donnant un revenu au sens large du
mot, ainsi qu'on le voit par la pratique des commissaires de l'income tax.
Cet usage du mot est en harmonie avec l'habitude qu'ont d'ordinaire les conomistes d'envisager, pour commencer, les problmes sociaux dans leurs grandes lignes
et de rserver les dtails pour plus tard. Il est conforme aussi l'habitude qu'ils ont
d'ordinaire de comprendre, sous le mot de Travail, les activits, qui sont regardes
comme tant une source de revenu au sens large du mot, et celles-l seulement. En
fait, beaucoup d'conomistes glissent insensiblement vers ce sens tout fait correspondant du mot capital lorsqu'ils discutent le problme de la distribution, et l'on peut
constater que presque toutes les propositions qui sont d'ordinaire exprimes quant aux
relations existant entre le bien-tre national ou social et le capital national ou social,
sont vraies en prenant le capital dans ce sens.
Retour la table des matires
5. - On a quelquefois divis le capital en capital de consommation, et capital
auxiliaire, ou instrumental. Nous sommes obligs de noter cette distinction, par ce
que beaucoup d'conomistes minents insistent sur elle, mais elle vise tracer une
ligne nette de dmarcation qui n'existe pas dans la nature. Elle ne rend en ralit
aucun service. On peut s'en former, d'aprs les dfinitions approximatives qui suivent,
une ide gnrale.
Le capital de consommation comprend les biens qui satisfont des besoins directement, c'est--dire des biens qui servent directement l'entretien des travailleurs,
comme aliments, vtements, logements, etc.
Le capital auxiliaire, ou instrumental, est ainsi nomm parce qu'il comprend tous
les biens qui aident le travail dans la production. Dans cette catgorie rentrent les
outils, machines, chemins de fer, docks, bateaux, etc., et les matires premires de
toutes sortes.
Mais il est vident que les vtements d'un homme l'aident dans son travail, et, en
lui tenant chaud, sont pour lui des auxiliaires dans son travail ; le toit de sa maison, en
l'abritant, lui rend un service direct, tout comme le toit de son usine 1.
Ensuite nous pouvons, avec Mill, distinguer le capital circulant qui remplit par
un seul usage tout son rle dans la production o il est employ , du capital fixe
qui se prsente sous une forme durable et dont le mouvement s'tend une priode
de dure correspondante 2.
1
2
Voir ci-dessus liv. II, chap. III, 1.
La distinction faite par Adam Smith entre les capitaux fixes et circulants reposait sur le point de
savoir si les biens donnent un profit sans changer de propritaires , ou en en changeant. Ricardo
la fit reposer sur le point de savoir si les biens sont d'une consommation lente ou demandent
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
102
Parfois, en outre, il nous faut distinguer parmi les capitaux certaines espces de
capitaux qui sont spcialiss en ce que, une fois consacrs un emploi, ils ne peuvent
pas tre aisment dtourns vers un autre.
Nous avons dj dit que l'expression de richesses personnelles, lorsque nous
l'emploierons, comprendra : premirement les nergies, facults et habitudes qui
contribuent directement augmenter la capacit industrielle des gens; en second lieu
leurs relations et associations d'affaires de tous genres. Si on comprend ces biens
parmi les richesses, il faut aussi les comprendre parmi les capitaux. Richesses
personnelles et capitaux personnels sont donc des termes que l'on peut remplacer l'un
par l'autre, et le mieux semble tre de suivre ici la mme marche que pour l'expression de richesse, et pour les mmes raisons : c'est--dire qu'il est bon d'admettre que
le mot capital, lorsqu'il est employ seul, ne comprend que des biens externes ; mais,
l'occasion, on peut pourtant se permettre de l'employer dans un sens large, et, en
l'indiquant expressment, y comprendre les capitaux personnels.
Retour la table des matires
6. - Plus tard 1 nous indiquerons les tentatives faites pour distinguer le capital
social de la richesse sociale par des dfinitions formelles et prcises, ainsi que les
raisons pour lesquelles elles n'ont pas russi. Le fait est que la nature n'a pas tabli de
ligne nette de division entre eux, et l'on doit faire comme elle. La notion de capital
social se retrouve dans un grand nombre de domaines de la pense conomique;
quelle que soit la dfinition qu'un auteur adopte au dbut, il s'aperoit ensuite que les
divers lments qu'il y comprend entrent de faons diffrentes dans les problmes
successifs dont il a s'occuper. Si donc sa dfinition du capital avait des prtentions
la prcision, il est oblig de la complter en expliquant quelle est, pour chaque point
en question, la porte de chacun des lments du capital, et cette explication est au
fond trs semblable celle des autres auteurs. Il y a donc en dfinitive une
convergence gnrale, et le lecteur est amen une conclusion trs analogue, quelle
que soit la route qu'on lui ait fait suivre : bien qu'il lui faille, il est vrai, quelque peine
pour apercevoir l'unit du fond sous les diffrences de forme et de mots. Les
divergences du dbut finissent donc par tre moins dangereuses qu'il ne semblait.
En dpit de ces diffrences de mots, il y a donc une uniformit de fond dans les
dfinitions du capital que donnent les conomistes de diffrentes gnrations et de
diffrents pays. Il est vrai que quelques-uns ont insist davantage sur le caractre de
tre reproduits frquemment ; mais il remarque avec raison que ce n'est pas une division
essentielle, et que la ligne de dmarcation n'en peut pas tre trace exactement . La modification
apporte par Mill est gnralement accepte par les conomistes modernes.
La notion de capital fixe se rapproche et pourtant diffre de la notion mdivale du capital comme
caput ou principal d'un prt. (Voir ASHLEY, History, livre II. ch. VI ; mais voir aussi le compte
rendu de HEWINS dans Economic Review, vol. III, pp. 396 et ss.). Le caput est une quantit fixe
de capital pur , suivant L'expression de J. B. Clark ; les biens peuvent circuler grce lui,
comme l'eau circule grce un rservoir maintenu un niveau constant.
Ci-dessous, 11-13. La dmonstration prsente dans cette section est dveloppe plus compltement dans Economic Journal, vol. VIII, pp. 55-59; on y trouvera aussi indique la suite des ides
qui nous ont amen la conclusion expose ici.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
103
productivit du capital, d'autres sur son caractre de rserve en vue de l'avenir
(prospectiveness), et que ni l'une ni l'autre de ces deux expressions n'est parfaitement
prcise, ni n'indique une ligne de dmarcation nette. Ces imperfections sont fatales
dans toute classification prcise, mais elles n'ont qu'une importance secondaire. Les
choses auxquelles s'appliquent les actions de l'homme ne peuvent jamais tre classes
avec prcision d'aprs un principe scientifique. On peut bien dresser avec elles des
listes prcises s'il faut les grouper en certaines catgories devant guider le commissaire de police, ou l'employ de la douane qui peroit les droits d'importation ; mais
ces listes sont ouvertement artificielles. C'est l'esprit et non la lettre de la tradition
conomique que nous devons surtout nous appliquer sauvegarder. Or s'il n'y a pas
de tradition claire et constante quant la dfinition formelle du capital, une tradition
claire nous indique au contraire que nous devons employer le mot Richesse de
prfrence au mot Capital, lorsque nous visons les relations existant entre l'ensemble
des choses utiles et le bien-tre gnral, les mthodes de consommation et les plaisirs
de la possession ; tandis que nous devons employer le mot Capital lorsque nous avons
en vue les caractres de productivit et de mise en rserve en vue de l'avenir qui se
rencontrent dans tous les fruits de l'effort humain lorsqu'ils sont accumuls, mais qui
sont plus frappants chez quelques-uns que chez d'autres. Nous devons employer le
mot de Capital, lorsque nous considrons les choses comme agents de production, et
nous devons employer le mot de Richesse, lorsque nous les considrons comme
rsultats de la production, comme objets de consommation, et comme procurant les
plaisirs de la possession.
Retour la table des matires
7. - Toute personne qui est la tte d'une entreprise doit faire certaines dpenses, pour les matires premires, le salaire des ouvriers, etc. Dans ce cas, son revenu
vritable ou revenu net se trouve en dduisant de son revenu brut les dpenses de sa
production 1.
Tout ce pour quoi une personne reoit, directement ou indirectement, un paiement
en monnaie, contribue augmenter son revenu nominal ; mais les services qu'elle se
rend elle-mme ne sont pas considrs comme s'ajoutant son revenu nominal. Or,
s'il vaut mieux d'ordinaire les ngliger lorsqu'ils sont d'un genre courant, il faudrait en
tenir compte, lorsqu'ils sont de ceux que l'on se procure d'ordinaire prix d'argent.
Ainsi, une femme qui fait ses vtements, ou un homme qui bche lui-mme son
jardin, ou qui rpare sa maison, se procure un revenu, tout comme le ferait le tailleur,
le jardinier ou le charpentier qu'il faudrait payer pour faire ce travail.
Comme conclusion, nous proposerons une expression dont nous aurons faire un
grand usage par la suite. Le besoin s'en fait sentir par la raison que toute occupation
prsente d'autres inconvnients que la fatigue du travail qu'elle occasionne, et offre
aussi d'autres avantages que la somme de monnaie qu'elle procure. La vritable
rmunration que procure une occupation s'obtient donc en dduisant la valeur,
apprcie en monnaie, de tous ses inconvnients, de celle de tous ses avantages ; et
nous pouvons dsigner cette vritable rmunration sous le nom de avantages nets de
cette occupation.
1
Voir un rapport de la British Association sur l'Income Tax, en 1878.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
104
Une autre expression commode est celle de usage (usance) de la richesse. Elle
dsigne l'ensemble des bnfices de toute espce qu'une personne tire de la proprit
des richesses, qu'elle les emploie comme capital ou non. Ainsi elle comprend les
bnfices que quelqu'un tire de l'usage de son propre piano, comme ceux qu'un
marchand de pianos tire de la location des pianos.
Le cas o le revenu se mesure le plus aisment, c'est celui o il prend la forme
d'un paiement effectu par un emprunteur pour l'usage, pendant un an par exemple,
d'une chose prte ; il s'exprime alors par le rapport entre la somme paye et le
montant du prix, et on l'appelle intrt. Mais ce mot est aussi employ dans un sens
plus large pour exprimer l'quivalent en monnaie de tout revenu que l'on tire du
capital.
Lorsqu'un homme dirige une entreprise, son profil pour l'anne est form par
l'excdent des recettes sur les dpenses pendant l'anne ; la diffrence entre la valeur
de ses stocks et de son matriel la fin et au commencement de l'anne, figurant soit
dans ses recettes, soit dans ses dpenses, suivant qu'elle a subi une augmentation ou
une diminution. Ce qui reste de son profit, dduction faite de l'intrt de son capital
au taux courant (en tenant compte de l'assurance, lorsque c'est ncessaire) peut tre
appel son bnfice dentreprise ou de direction.
Le revenu tir de la proprit du sol et des autres dons gratuits de la nature
s'appelle rente. Le mot est d'ordinaire entendu largement; on y comprend le revenu
tir des maisons, et des autres choses dont l'offre est limite et ne peut pas augmenter
rapidement. L'conomiste doit l'tendre encore davantage.
Retour la table des matires
8. - Le revenu social d'un groupe peut se calculer en additionnant les revenus
des particuliers appartenant ce groupe, que ce soit une nation, ou un groupe plus
large ou plus petit. Toute chose produite dans le cours d'une anne, tout service rendu,
toute utilit nouvelle cre, fait partie du revenu national.
Nous devons avoir soin de ne pas compter la mme chose deux fois. Si nous
avons compt un tapis pour toute sa valeur, nous avons dj compt les valeurs du fil
et du travail qui ont t employs le faire, et il ne faut pas les compter de nouveau.
Mais si le tapis est nettoy par des domestiques ou par le dgraisseur, la valeur du
travail dpens le nettoyer doit tre compte sparment, car autrement les rsultats
de ce travail seraient totalement omis dans l'inventaire des marchandises et des utilits
rcemment produites qui constituent le revenu rel du pays.
Supposez qu'un propritaire foncier, avec un revenu annuel de 10.000 , prenne
un secrtaire particulier 500 de traitement, lequel prend lui-mme un domestique
aux gages de 50 . Si les revenus de ces trois personnes sont compts comme
lments du revenu net du pays, il peut sembler que certaines parties soient comptes
deux fois, et d'autres trois fois. Mais il n'en est pas ainsi. Le propritaire transmet
son secrtaire, en retour de ses services, une partie du pouvoir d'achat tir des produits
du sol; le secrtaire son tour en transmet une partie son domestique en change de
son travail. Les produits de la ferme dont la valeur arrive sous forme de rente entre les
mains du propritaire, les services que le propritaire reoit de son secrtaire, et ceux
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
105
que le secrtaire reoit de son domestique sont des parties indpendantes du revenu
net rel du pays. Par suite, les sommes de 10.000, 500 et 50 , qui sont leurs mesures
en monnaie, doivent tre toutes comptes lorsque nous calculons le revenu du pays 1.
Retour la table des matires
9. - Le revenu en monnaie, ou accroissement, d la richesse, fournit, pour
apprcier la prosprit d'une nation, une mesure qui, quelque peu sre qu'elle soit, est
pourtant prfrable, certains gards, celle qui est fournie par la valeur en monnaie
de son stock de richesses.
En effet le revenu consiste principalement en marchandises se prsentant sous une
forme qui permet d'en jouir directement; tandis que la plus grande partie de la
richesse nationale se compose de moyens de production, qui ne sont d'utilit pour la
nation qu'autant qu'ils servent produire des marchandises pouvant tre consommes.
En outre, quoi que ce soit l un point de moindre importance, des marchandises consommables, tant plus portatives, ont des prix plus uniformes dans le monde entier
que les choses servant les produire : les prix d'un acre de bonne terre dans le
Manitoba et dans le Kent diffrent plus que les prix d'un bushel de bl dans les deux
pays.
Mais si c'est le revenu d'un pays que nous envisageons principalement, nous
devons pourtant tenir compte de la dprciation des sources dont il vient. Il faut faire
subir une dduction plus forte au revenu d'une maison si elle est en bois, que si elle
est en pierres ; une maison en pierres compte pour davantage dans la richesse relle
d'un pays qu'une maison en bois donnant un logement aussi bon. De mme, une mine
peut donner, pendant un temps, un gros revenu, mais s'puiser en peu d'annes ; dans
ce cas elle doit tre considre comme quivalant un champ, ou une pcherie d'un
revenu annuel beaucoup plus petit, mais perptuel 2.
Mais si le propritaire foncier fait une pension de 500 son fils, cette somme ne doit pas tre
compte comme revenu indpendant, parce qu'aucun service n'en est la contre-partie. Elle ne serait
pas frappe par l'Income Tax.
Tous les calculs pour apprcier la richesse d'une nation, qui sont bass sur une simple estimation
en monnaie, sont ncessairement trompeurs, surtout pour les raisons qui ont t indiques dans le
chapitre sur la richesse et dans le prsent chapitre. Mais comme on s'en sert frquemment, il peut
tre bon d'indiquer que mme si nous acceptons, dans un but particulier, de regarder la richesse
d'une nation comme reprsente par son revenu en monnaie, la question de savoir quelle est, de
deux nations, la plus riche, sera encore douteuse. La richesse d'une nation doit-elle tre mesure
par le revenu en monnaie total de ses habitants ou par leur revenu moyen ? Avec le premier
procd, l'Inde est plus riche que la Hollande ; avec le second, la Hollande est bien plus riche que
l'Inde. Le revenu moyen est le mode de mesure le plus important aux yeux de celui qui tudie la
science sociale; mais le diplomate s'intresse souvent davantage au revenu effectif total, c'est-dire l'ensemble du revenu, dduction faite du cot des choses ncessaires la vie.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
106
Note sur quelques dfinitions du capital
Retour la table des matires
10. - Nous avons dj observ que les conomistes n'ont pas le choix en ce qui
concerne l'emploi du mot capital au sens ordinaire des affaires, c'est--dire pour le
capital d'entreprise (trade-capital) et qu'ils sont obligs de suivre l'usage bien tabli.
Cet emploi a pourtant des inconvnients considrables et manifestes. Par exemple, il
nous oblige considrer comme capital les yachts appartenant un constructeur de
yachts, mais non pas sa voiture. Si donc celui-ci avait lou une voiture l'anne, et
qu'ensuite, au lieu de continuer ainsi, il ait vendu un constructeur de voitures un
yacht que celui-ci lui louait, et lui ait achet une voiture pour son usage personnel, le
rsultat serait que le capital du pays dans son ensemble se trouverait diminu d'un
yacht et d'une voiture. Cela, bien que rien n'ait t dtruit, et bien que les mmes
objets, produits de l'pargne, subsistent, procurant les mmes avantages qu'auparavant
aux individus en question et la socit,et probablement mme des avantages plus
grands.
D'autre part, nous ne pouvons pas nous dbarrasser de l'ide que le capital se distingue des autres formes de richesse par le pouvoir plus grand qu'il possde de fournir
de l'emploi au travail.
Or, en fait, lorsque des yachts et des voitures sont entre les mains de gens qui
vendent ces objets et sont alors compts comme capitaux, ils fournissent moins
d'emploi au travail qu'au cas o ils sont entre les mains de particuliers, bien qu'ils ne
soient pas alors compts comme capitaux. La demande de travail ne serait pas
augmente, mais diminue, si l'on remplaait les cuisines particulires, o rien n'est
pourtant compt comme capital, par des boutiques de cuisiniers et de rtisseurs de
profession, o tous les ustensiles sont des capitaux. Avec un employeur de profession,
les ouvriers peuvent peut-tre avoir plus de libert personnelle ; mais ils ont, peu
prs certainement, moins de confort matriel, et, en proportion du travail qu'ils font,
des salaires plus bas que sous le rgime plus lche d'un employeur priv 1.
Mais ces inconvnients n'ont gnralement pas t remarqus, et diverses causes
ont agi pour mettre en vogue cet emploi du mot. L'une de ces causes est que les
relations entre les employeurs non professionnels et les personnes qu'ils emploient
figurent rarement dans les mouvements stratgiques et tactiques des conflits entre
employeurs et employs, ou, comme on dit communment, entre le capital et le
travail. Karl Marx et ses disciples ont insist sur ce point; cest sur lui qu'ils ont
ouvertement fait reposer la dfinition du capital; ils affirment que cela seul est capital
qui est un moyen de production appartenant une personne ou un groupe de
personnes, et qui est employ produire des choses pour une autre, gnralement
l'aide du travail salari d'une troisime : de telle sorte, que la premire peut piller et
exploiter les autres.
Voir ci-dessous liv. VI, chap. II, 10.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
107
En second lieu, cet emploi du mot capital est utile pour le march montaire
comme pour le march du travail. Le capital qui sert aux entreprises industrielles et
commerciales, ou capital d'entreprise (trade-capital), est frquemment emprunt.
Personne n'hsite emprunter pour augmenter le capital d'entreprise dont il dispose,
lorsqu'il aperoit un bon emploi en faire ; pour cela il peut, dans le cours ordinaire
des affaires, le donner en gage plus facilement et plus rgulirement qu'il ne le ferait
de ses meubles ou de sa voiture particulire.
Enfin, tout homme tient avec soin le compte de son capital d'entreprise ; il tient
compte des dprciations que celui-ci subit et en maintient ainsi le stock intact. Sans
doute, il peut se faire qu'un homme qui louait une voiture l'anne, en achte une
avec le produit de la vente de valeurs de chemins de fer qui rapportent beaucoup
moins qu'il ne payait pour la location de sa voiture; s'il laisse le revenu annuel que lui
procure la diffrence, s'accumuler jusqu' ce que la voiture soit use, il aura plus qu'il
n'en faut pour s'en acheter une nouvelle, et ainsi cette faon d'agir aura augment
l'ensemble de son capital. Mais il peut se faire qu'il n'agisse pas ainsi. Au contraire,
tant que la voiture appartient un marchand de voitures, il s'arrange pour en retrouver
le prix dans le cours ordinaire de ses affaires.
Retour la table des matires
11. - Passons, maintenant, aux dfinitions du capital en gnral, ou du capital au
point de vue social. Voyons, en premier lieu, celles qui sont bases principalement sur
la notion de rserve en vue de l'avenir (prospectiveness), et qui ont envisag le capital
comme une accumulation de choses mises en rserve, rsultant d'efforts et de
sacrifices consacrs procurer des jouissances pour l'avenir plutt que pour le
prsent. La notion elle-mme est prcise, mais elle ne conduit pas une classification
prcise ; il en est d'elle comme de la notion de longueur, qui est prcise, mais ne nous
permet pas de distinguer les murs longs des murs courts, sauf par une rgle arbitraire.
Le sauvage montre une certaine prvoyance lorsqu'il runit des branches d'arbres afin
de s'abriter pendant une nuit; il en montre davantage lorsqu'il fait une tente avec des
perches et des peaux de btes, et davantage encore, lorsqu'il construit une cabane de
bois ; l'homme civilis, enfin, montre une prvoyance bien plus grande lorsqu'il
remplace ces huttes de bois par de solides maisons en briques et en pierres 1. On
pourrait tracer une ligne de dmarcation pour distinguer les choses dont la production
indique une grande proccupation de l'avenir, mais elle serait artificielle et instable.
Ceux qui ont cherch le faire se sont trouvs sur une pente glissante, et ils n'ont pu
s'arrter qu'aprs avoir fait entrer dans la notion de capital toute richesse accumule.
Ce rsultat logique a t accept par beaucoup d'conomistes franais. Suivant la
voie trace par les Physiocrates, ils ont employ le mot capital dans un sens trs
semblable celui dans lequel Adam Smith et ses successeurs immdiats prirent le
mot Stock, y comprenant toutes les richesses accumules (valeurs accumules), c'est-dire l'excdent de la production sur la consommation. Ils ont montr, depuis
quelque temps, une tendance accuse employer le mot dans le sens plus troit que
lui donnent les Anglais, mais il se manifeste en mme temps un mouvement srieux
de la part de quelques-uns des penseurs les plus profonds en Allemagne et en Angle1
Voir ci-dessous liv. III, chap. V et liv. IV, chap. VII.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
108
terre dans le sens de la vieille dfinition plus large donne par les Franais. Cette
tendance se remarque particulirement chez des auteurs qui, l'exemple des
Physiocrates, ont pench vers les mthodes mathmatiques, comme Hermann, Jevons,
Walras, Pareto et Fisher 1.
Retour la table des matires
12. - C'est en partie dans le but d'viter cette difficult, que la plupart des
tentatives faites pour dfinir le capital un point de vue strictement conomique, tant
en Angleterre que dans d'autres pays, ont envisag son caractre de productivit, et
ont considr le capital social comme un moyen d'acquisition (Erwerbskapital) ou
comme un stock de choses ncessaires la production (Productions-mittel, Vorrath).
Mais cette notion gnrale a t traite de diffrentes faons 2.
1
Les Physiocrates ont t en partie amens s'engager dans cette direction par l'avantage qu'il y a
exprimer dans une formule mathmatique tranchante les lments du travail pass qui ont t
consacrs pourvoir des besoins futurs, chacun d'eux tant multipli par l'intrt compos pour
le temps pendant lequel les fruits du travail sont rests en suspens. Cette formule est trs
attrayante, mais elle ne rpond pas exactement aux conditions de la vie relle. Par exemple, elle ne
tient pas compte des dprciations que subissent les divers produits du travail pass, suivant que
les usages pour lesquels ils ont t crs ont subsist ou ont disparu. Et lorsqu'on y introduit des
corrections de ce genre, la formule perd son grand mrite de simplicit et de prcision.
Hermann dit (Staatswirthschaftliche Untersuchungen, chap. III et V) que le capital comprend
les biens qui sont une source permanente de jouissances prsentant une valeur d'change .
Walras (lments d'conomie politique, 4e dit,, p. 177) dfinit le capital toute espce de
richesse sociale qui ne se consomme point ou qui ne se consomme qu' la longue, toute utilit
limite en quantit, qui survit au premier usage qu'on en fait, en un mot, qui peut servir plus d'une
fois : une maison, un meuble . La conception de Jevons est bien expose par Gide (conomie
politique, liv. II, ch. III) Stanley Jevons va mme plus loin et dclare que les approvisionnements
constituent le seul capital, que c'est l du moins sa forme essentielle et primordiale dont toutes les
autres formes ne sont que des drives. Il part en effet de ce point de dpart que la vritable
fonction du capital c'est de faire vivre le travailleur en attendant le moment o le travail pourra
donner des rsultats, et il est clair que cette dfinition du rle du capital implique ncessairement
qu'il se prsente sous la forme de subsistances, d'avances. Les instruments, machines, chemins de
fer, etc., ne seraient que des formes drives de celle-ci, car eux-mmes ont eu besoin d'un certain
temps, et souvent mme d'un long temps pour tre produits, et en consquence ont exig leur
tour certaines avances sous forme d'approvisionnements. C'est donc toujours cette forme
originaire qu'il faudrait en revenir.
Fisher est d'accord avec Cannan pour considrer le capital comme le stock existant des
richesses, et comme s'opposant au revenu qui est un afflux de richesses. Il est sans doute essentiel
de distinguer entre la richesse mesure par l'ensemble des biens et la richesse mesure par le
revenu qu'ils donnent (voir 9 du prsent chapitre); mais l'usage et des raisons de commodit
semblent exiger que le mot Richesse soit employ pour dsigner un ensemble de richesses ; par
suite, si l'on veut tirer parti du mot Capital, il semblerait ncessaire de lui donner un autre sens.
Les articles de Fisher et de Cannan sur ce sujet dans Economic Journal, vol. VII et VIII, sont
pourtant trs suggestifs.
Knies dfinit le capital le stock existant des biens qui est destin tre employ la
satisfaction de la demande dans l'avenir . Et Nicholson dit : La voie indique par Adam Smith
et suivie par Knies mne cette conclusion : le capital est la richesse mise de ct pour la
satisfaction, directe ou indirecte, de besoins futurs . Mais toute cette phrase, et particulirement
les mots mise de ct , semblent manquer de prcision et tourner les difficults plutt qu'en
triompher.
Voici quelques-unes des principales dfinitions du capital donnes par les successeurs d'Adam
Smith en Angleterre : - Ricardo dit: Le capital est la partie des richesses d'un pays qui est
employe dans la production et comprend les aliments, les vtements, les outils, les matires premires, les machines, etc., ncessaires pour que le travail produise ses effets (to give effect to
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
109
D'aprs les vieilles traditions anglaises, le capital se compose des choses qui
aident ou entretiennent (aid or support) le travail dans la production ; eu, comme on
l'a dit plus rcemment, il comprend les choses sans lesquelles la production ne
pourrait pas s'accomplir avec la mme efficacit et qui ne sont pas des dons gratuits
de la nature. C'est ce point de vue que l'on a fait la distinction dj indique entre le
capital de consommation et le capital auxiliaire.
Cette conception a t suggre par la pratique du march du travail, et elle n'a
jamais t trs consquente avec elle-mme. On en est arriv comprendre dans le
capital tout ce que les employeurs payent, directement ou indirectement, pour le
travail de leurs employs - capital salaire, ou capital rmunratoire, comme on
l'appelle ; - mais on n'y comprend aucune des choses dont ils ont besoin pour leur
propre entretien, ou pour celui des architectes, ingnieurs et autres spcialistes. Pour
tre consquent il faudrait y comprendre tout ce qui est ncessaire l'activit de
toutes les catgories de travailleurs, et en exclure tous les objets de luxe, qu'ils soient
consomms par les ouvriers manuels ou par les autres travailleurs; mais si cette
conception du capital avait t pousse jusqu' cette conclusion logique, elle aurait
tenu moins de place dans les discussions touchant les relations entre employeurs et
employs 1.
Retour la table des matires
13. - Dans d'autres pays pourtant, et notamment en Allemagne et en Autriche, il
y a eu une certaine tendance restreindre le capital (au point de vue social) au capital
auxiliaire ou instrumental. On allgue que, dans le but de rendre plus net le contraste
entre la production et la consommation, rien de ce qui est directement consomm ne
devrait tre regard comme moyen de production. Mais on ne voit pas pourquoi une
chose ne pourrait pas tre envisage un double point de vue 2.
1
2
labour) . Malthus dit : Le capital est, dans l'ensemble des biens (stock) d'un pays, la partie qui
est rserve ou employe en vue d'un profit faire dans la production et la distribution des
richesses . Senior dit : Le capital est une richesse rsultant des efforts humains et employe la
production et la distribution des richesses . John Stuart Mill dit : Ce que le capital fait dans la
production, c'est de fournir l'abri, la protection, les instruments et les matriaux que le travail
exige, et de nourrir et d'entretenir de toute faon les ouvriers pendant le procs de production.
Toutes les choses destines cet usage sont des capitaux . Nous aurons revenir sur cette
conception du capital, propos de la thorie dite du fonds des salaires.
Comme Held l'a remarqu, les problmes pratiques qui taient au premier rang au dbut du
XIXe sicle devaient suggrer une pareille conception du capital. Les gens se proccupaient de
montrer que le bien-tre des classes ouvrires dpend de l'approvisionnement pralable en moyens
de faire vivre et d'employer les ouvriers ; ils insistaient sur les dangers qu'il y a vouloir leur
trouver artificiellement des emplois l'aide des extravagances du systme protecteur et de
l'ancienne Loi des pauvres (assistance publique). L'ide de Held a t dveloppe avec une grande
pntration dans le livre suggestif et intressant de Cannan, Production and Distribution ;
quelques-unes des exagrations des premiers conomistes semblent pourtant susceptibles d'explications autres et plus raisonnables que celles qu'il leur assigne.
Voir un argument dans ce sens et une excellente discussion des difficults du sujet dans
WAGNER, Grundlegung, 3e d., pp. 315-316.
Le lien existant entre la productivit du capital et la demande de capital, ainsi qu'entre la mise en
rserve du capital en vue de l'avenir et l'offre de capital, est pendant longtemps rest latent dans
J'esprit des hommes, quoique il ait t dissimul sous d'autres considrations dont beaucoup, nous
le reconnaissons maintenant, taient bases sur des erreurs. Certains auteurs ont insist davantage
sur le ct demande et d'autres sur le ct offre ; mais entre eux la diffrence n'tait pas beaucoup
plus qu'une diffrence de nuance. Ceux qui ont insist sur la productivit du capital n'ont pas
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
110
On allgue, en outre, que les choses qui servent l'homme, non pas directement,
mais en l'aidant se procurer d'autres choses pour son usage, forment une catgorie
homogne, parce que leur valeur est drive de la valeur des choses qu'elles servent
produire. Il serait bon d'avoir un nom pour ces choses ; mais il est douteux que le nom
de capital leur convienne; il est douteux aussi que le groupe soit aussi homogne qu'il
semble premire vue.
Ainsi donc, nous pouvons dfinir les biens instrumentaux de faon y comprendre les tramways, et autres choses qui tirent leur valeur des services personnels
qu'elles rendent; ou bien nous pouvons, l'exemple de ce l'on faisait autrefois pour
l'expression de travail productif, ne considrer comme biens instrumentaux que les
choses qui s'incorporent directement dans un produit matriel. La premire dfinition
donne ce mot un sens assez voisin de celui qui a t discut dans la section
prcdente, et, comme lui, il a l'inconvnient d'tre vague. La seconde est un peu plus
prcise, mais elle parat faire une distinction artificielle l o la nature n'en fait
aucune, et convenir aussi peu aux tudes scientifiques que les anciennes dfinitions
que l'on donnait de l'expression de travail productif.
[Fin du livre II]
ignor pour cela la rpugnance de l'homme pargner et sacrifier le prsent l'avenir. D'un autre
ct, ceux dont la pense s'est arrte surtout sur la nature et l'tendue du sacrifice qu'exige cet
ajournement des jouissances, ont considr comme vidents les faits qui montrent qu'en accumulant les moyens de production, l'homme acquiert une puissance bien plus grande pour la satisfaction de ses besoins. En somme, il y a lieu de croire que les exposs faits par le Professeur BhmBawerk des thories sur le capital et l'intrt, thories naves de la productivit , thories de
l'usage , etc. n'auraient pas t accepts par les auteurs eux-mmes comme des tableaux exacts et
complets de leurs diverses opinions. Il ne semble pas non plus avoir russi trouver une dfinition
qui soit claire et logique avec elle-mme. Il dit que le capital social est l'ensemble des produits
destins servir une nouvelle production, ou, plus brivement, l'ensemble des produits
intermdiaires . Il exclut formellement (Liv. I, ch. VI) les maisons d'habitation et les autres
espces de btiments qui servent directement un but de jouissance, d'ducation ou de civilisation . Pour tre logique, il doit exclure les htels, les tramways, les bateaux de passagers, les
trains, etc. et peut-tre mme les installations pour fournir la lumire lectrique aux habitations
particulires. Mais ce serait enlever la notion de capital tout intrt pratique. Les raisons qui en
font exclure les thtres publics et y comprendre les tramways, mneraient tout aussi bien y
comprendre les mtiers tisser employs la maison, et en exclure ceux qui servent fabriquer
de la dentelle.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
Alfred Marshall, Principes dconomie politique : tome I
Livre troisime
Des besoins
et de leur satisfaction
Retour la table des matires
111
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
112
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre III : Des besoins et de leur satisfaction
Chapitre un
Introduction
Retour la table des matires
1. - Les anciennes dfinitions de l'conomique la dfinissaient comme tant la
science qui s'occupe de la production, de la distribution, de l'change et de la consommation des richesses. L'exprience a ensuite montr que les problmes de la
distribution et de l'change sont si troitement unis, qu'il est douteux qu'il y ait
avantage essayer de les sparer. Il y a pourtant un bon nombre d'ides gnrales
relatives aux relations de l'offre et de la demande qu'il faut connatre, car elles sont
la base des problmes pratiques de la valeur, et, comme une sorte d'pine dorsale,
elles servent donner de l'unit et de la force l'ensemble de la thorie conomique.
Leur porte et leur gnralit mme les distingue des problmes plus concrets de la
distribution et de l'change auxquels elles sont subordonnes. Elles sont, par suite,
runies dans le livre V sur La thorie gnrale de la demande et de l'offre , qui
prpare la voie l'tude du sujet du livre VI La distribution et l'change, ou la
valeur .
Mais, auparavant, viennent : dans le prsent livre (III) une tude des besoins et de
leur satisfaction, c'est--dire de la demande et de la consommation; puis, dans le livre
IV, une tude des agents de la production, c'est--dire des agents l'aide desquels les
besoins sont satisfaits, en y comprenant l'homme lui-mme, le principal agent et le
seul but de la production. Le livre IV correspond dans l'ensemble cette tude de la
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
113
production qui a occup une si grande place dans presque tous les ouvrages anglais
sur l'conomie politique gnrale pendant les deux dernires gnrations ; bien que
ses liens avec les problmes de la demande et de l'offre n'y fussent pas indiqus d'une
faon suffisamment claire.
Retour la table des matires
2. - Jusqu' ces derniers temps, le sujet de la demande ou de la consommation a
t quelque peu nglig. Quelque importante que soit la question de savoir comment
nous devons employer nos ressources pour en tirer le meilleur parti, elle ne se prte
pas, en ce qui concerne les particuliers, aux mthodes de l'conomie politique. Le bon
sens et l'exprience de la vie servent bien plus, en cette matire, que les analyses
conomiques les plus subtiles, et, jusqu' ces derniers temps, les conomistes ont dit
peu de chose sur ce point parce qu'ils n'avaient rellement rien dire qui ne fut connu
de toute personne sense. Mais, depuis quelque temps, diverses causes ont agi pour
donner ce sujet une plus grande importance dans les discussions conomiques.
La premire de ces causes est la conviction croissante qu'un certain mal est rsult
de l'habitude qu'avait Ricardo d'insister, d'une faon disproportionne, sur le cot de
production, lorsqu'il analysait les causes qui dterminent la valeur d'change. Bien
que lui-mme, en effet, et les principaux conomistes qui l'ont suivi, sussent bien que
les conditions de la demande jouent un rle aussi important que celles de l'offre dans
la dtermination de la valeur, ils n'en ont cependant pas exprim la porte avec une
clart suffisante, et ils n'ont t compris que par les lecteurs trs attentifs.
En second lieu, le progrs des procds exacts de raisonnement en conomie
politique a amen les gens se proccuper davantage de poser nettement les prmisses sur lesquelles Ils raisonnent. Ce souci croissant est d en partie l'emploi, par
certains auteurs, du langage mathmatique et des procds mathmatiques de raisonnement. Il est peut-tre douteux que l'on ait tir grand profit de l'usage des formules
mathmatiques compliques ; mais l'emploi des procds mathmatiques de raisonnement a rendu de grands services ; il a, en effet, amen les gens se refuser
examiner un problme tant qu'ils ne savent pas, d'une faon certaine, en quoi le
problme consiste, et se proccuper, ,avant d'aller plus loin, de savoir quelles conditions sont supposes exister, et quelles ne le sont pas.
Par l on a t ensuite oblig d'analyser plus soigneusement toutes les ides
directrices de l'conomie politique et particulirement de la demande, car la simple
tentative faite pour exposer clairement comment se mesure la demande d'une chose,
ouvre de nouveaux aperus sur les principaux problmes de l'conomique. Bien que
la thorie de la demande soit encore en enfance, nous pouvons dj constater qu'il est
possible de runir et de grouper des statistiques de la consommation, et d'clairer de
cette faon certaines questions difficiles qui ont une grande importance pour le bientre public.
Enfin, l'esprit du temps nous pousse examiner plus attentivement la question de
savoir si l'augmentation de nos richesses ne pourrait pas servir, plus qu'elle ne le fait,
accrotre le bien-tre gnral ; par l nous sommes amens rechercher dans quelle
mesure la valeur d'change de l'une de ces richesses, qu'elle soit utilise individuel-
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
114
lement oui collectivement, reprsente exactement ce que cette richesse ajoute au
bonheur et au bien-tre.
Nous commencerons ce livre par une brve tude des divers besoins de l'homme,
considrs dans leur lien avec ses efforts et son activit. La nature progressive de
l'homme forme un tout. Ce n'est que temporairement et provisoirement que nous
pouvons isoler, pour l'tudier, le ct conomique de sa vie ; mais nous devons avoir
soin en tout cas d'envisager dans son ensemble tout ce ct conomique. Il est
particulirement ncessaire d'insister sur ce point en ce moment, parce que la raction
contre l'oubli relatif dans lequel Ricardo, et ceux qui l'ont suivi, ont laiss l'tude des
besoins, semble vouloir se porter l'extrme oppos. Il importe encore d'affirmer la
grande vrit sur laquelle ils insistaient d'une faon trop exclusive : savoir que,
tandis que la vie des animaux infrieurs se rgle d'aprs leurs besoins, c'est dans
l'volution des formes de l'effort et de l'activit que nous devons chercher les
caractristiques de l'histoire de l'humanit.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
115
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre III : Des besoins et de leur satisfaction
Chapitre deux
Les besoins dans leurs rapports avec
l'activit de l'homme
Retour la table des matires
1. - Les besoins et les dsirs de l'homme sont innombrables et de sortes trs
diverses ; mais ils sont d'ordinaire limits et susceptibles d'tre satisfaits. L'homme
non civilis n'en a, il est vrai, gure plus que l'animal priv de raison ; mais chacun de
ses pas dans la voie du progrs augmente leur varit, en mme temps que la varit
des procds qu'il emploie pour les satisfaire. Il dsire les choses qu'il a l'habitude de
consommer, non seulement en plus grande quantit, mais de meilleure qualit ; il
dsire une plus grande varit, et des choses satisfaisant de nouveaux besoins qui se
dveloppent en lui.
Ainsi donc, bien que l'animal, et, comme lui, l'homme sauvage, prfrent certains
morceaux de choix, ni l'un ni l'autre ne recherche beaucoup la varit pour elle-mme.
mesure, pourtant, que l'homme s'lve en civilisation, mesure que son esprit se
dveloppe, et que ses passions animales commencent s'associer une certaine
activit mentale, ses besoins deviennent rapidement plus raffins et plus varis ; dans
les moindres dtails de la -vie, il commence dsirer le changement pour lui-mme,
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
116
longtemps avant qu'il se soit sciemment dbarrass du joug de la coutume. Le premier
grand pas dans cette direction se fait lorsque l'homme apprend faire le feu : peu
peu il s'habitue une grande varit de boissons et d'aliments cuits de faons
diffrentes ; avant peu la monotonie lui devient pnible, et c'est pour lui une grande
privation lorsque il est, par hasard, oblig de vivre pendant quelque temps exclusivement d'une ou de deux espces d'aliments.
mesure que la richesse d'un homme s'accrot, sa nourriture et sa boisson deviennent plus varies et plus chres ; mais son apptit est limit par la nature, et lorsque
ses .dpenses en nourriture deviennent extravagantes, il est plutt port se donner le
plaisir de lhospitalit et de l'ostentation qu' trop sacrifier pour ses propres sens.
Ceci nous amne remarquer avec Senior que quelque fort que soit le besoin de
varit, il est faible compar au besoin de se faire remarquer - sentiment qui, si nous
considrons son universalit et sa constance, si nous considrons qu'il affecte tous les
hommes et dans tous les temps, qu'il nous accompagne depuis le berceau jusqu' la
tombe, peut tre dclar la plus puissante des passions humaines . Cette grande
demi-vrit se trouve trs bien illustre par la comparaison que l'on peut faire entre le
besoin de recherche et de varit dans la nourriture, et le besoin de recherche et de
varit dans le vtement.
Retour la table des matires
2. - Ce besoin de vtement, qui est le rsultat de causes naturelles, varie d'aprs
le climat et la saison, et un peu d'aprs la nature des occupations de chacun. Mais, en
matire de vtements, la convention a plus d'importance que la nature. Ainsi, dans les
temps anciens, la loi et la coutume ont souvent prescrit aux membres de Chaque caste
ou de chaque profession la coupe de leurs vtements et la somme qu'ils devaient
coter, mais non dpasser ; une partie de ces rglementations subsistent encore
aujourd'hui dans leur fonds essentiel, tout en se transformant rapidement. En cosse,
par exemple, du temps d'Adam Smith, beaucoup de personnes pouvaient sortir sans
souliers et sans bas, qui ne le peuvent plus maintenant ; beaucoup de personnes
peuvent encore le faire en cosse, qui ne le pourraient pas en Angleterre. De mme
en Angleterre, l'heure actuelle, un ouvrier son aise doit se montrer le dimanche en
vtement noir et, dans certains endroits, en chapeau de soie ; or cela l'eut expos
tre ridicule il y a seulement peu de temps. Dans tous les rangs infrieurs de la socit
on voit augmenter constamment, au point de vue de la varit et du prix, tout ce que
la coutume exige comme minimum et ce qu'elle tolre comme maximum; le dsir de
se distinguer par le vtement est en train de se rpandre dans les rangs infrieurs de la
socit anglaise.
Mais dans les rangs suprieurs, si l'habillement des femmes est encore vari et
coteux, celui des hommes est simple et peu cher, en comparaison de ce qu'il tait en
Europe il n'y a pas longtemps et de ce qu'il est en Orient. Les hommes qui sont le plus
distingus par eux-mmes ont, en effet, une aversion naturelle attirer l'attention par
leurs vtements, et ils ont donn la mode 1.
1
Une femme peut, dans ses vtements, faire montre de sa richesse ; mais, si elle s'en tient l, elle
manque son but. Elle doit montrer, en mme temps que sa richesse, une certaine distinction de
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
117
Retour la table des matires
3. - L'habitation satisfait le besoin de s'abriter contre le mauvais temps ; mais ce
besoin joue un trs petit rle dans la demande effective de maisons. Si une cabane,
petite mais bien construite, donne un excellent abri, son atmosphre touffante, sa
malpropret force, l'absence de confortable et de tranquillit sont de grands inconvnients, non pas tant par la gne physique qu'ils causent, que parce qu'ils empchent
le dveloppement des facults, et entravent les plus hautes activits de l'homme. Avec
le dveloppement de ces facults la demande d'habitations plus spacieuses devient
plus pressante 1.
Aussi un logement relativement spacieux et bien amnag rentre, mme dans les
rangs infrieurs de la socit, dans la catgorie des choses ncessaires l'activit
(necessary for efficiency) 2, et c'est le moyen le plus commode et le plus manifeste de
prtendre la distinction sociale. Mme dans les rangs de la socit o chacun
possde un logement qui lui suffit largement, lui-mme et aux membres de sa
famille, pour l'exercice de leurs plus hautes activits, on dsire s'agrandir encore, et
d'une faon presque illimite, en vue de pouvoir exercer quelques-unes des plus
hautes activits sociales.
Retour la table des matires
4. - C'est encore le dsir d'exercer et de dvelopper nos facults, rpandu dans
tous les rangs de la socit, qui nous conduit non seulement nous livrer la science,
la littrature et l'art pour eux-mmes, mais recourir de plus en plus au travail de
ceux qui s'y livrent par profession. Les moments de loisir sont de moins en moins
employs ne rien faire, et l'on a de plus en plus le got des distractions, telles que
les sports et les voyages, qui dveloppent les facults, plutt que celui de s'abandonner des satisfactions des sens 3.
2
3
got. Si ses vtements doivent plus au couturier qu' elle-mme, pourtant on a coutume de
supposer que, tant moins occupe que l'homme par les affaires du dehors, elle peut consacrer plus
de temps penser sa toilette. Et mme, avec les modes modernes, tre bien habilles (et non
pas tre habilles d'une faon coteuse) est un but plus modeste que peuvent raisonnablement se
proposer celles qui dsirent se faire remarquer pour leur got et leur habilet ; il en serait encore
bien plus ainsi, si le fcheux empire des caprices de la mode venait disparatre. Savoir combiner
des toilettes belles par elles-mmes, varies et bien appropries leur usage, est en effet un objet
digne d'efforts ; il appartient la mme classe que le talent de peindre, tout en n'y occupant pas le
mme rang.
Il est vrai que beaucoup d'ouvriers l'esprit actif prfrent des logis troits dans une ville, un
cottage spacieux la campagne ; mais c'est parce qu'ils ont un got prononc pour des genres
d'activit auxquels la vie la campagne offre peu d'emploi.
Voir livre II, ch. III, 3.
Comme point de moindre importance on peut signaler que les boissons qui stimulent l'activit
intellectuelle remplacent en grande partie celles qui ne font que satisfaire les sens. La consommation du th augmente trs vite, tandis que celle de l'alcool est stationnaire, et il y a, dans tous les
rangs de la socit, une diminution de la demande pour les sortes d'alcool les plus grossires et les
plus abrutissantes.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
118
Le dsir d'arriver la perfection pour elle-mme a une porte presque aussi
grande que le dsir plus bas de se distinguer et de se faire remarquer. De mme que le
dsir de se distinguer va depuis l'ambition de ceux qui peuvent esprer que leurs
noms seront rpts par les hommes dans des pays lointains et dans des temps
reculs, jusqu' l'espoir qu'a la fille de village que le nouveau ruban qu'elle met pour
Pques ne restera pas inaperu de ses voisins ; de mme, le dsir de perfection va
depuis un Newton ou un Stradivarius jusqu'au pcheur qui, lorsqu'il n'est pas press,
prend plaisir, mme si personne ne le regarde, bien conduire sa barque, constater
qu'elle est bien construite et qu'elle obit bien sa direction. Des dsirs de ce genre
exercent une grande influence sur l'offre des plus hautes facults et des plus grandes
inventions, et ils ne sont pas sans importance au point de vue de la demande. Dans les
professions exigeant une trs grande habilet, et dans les mtiers mcaniques les plus
difficiles, une grande partie de la demande de travail vient, en effet, du plaisir que les
gens ont exercer leurs propres facults et les exercer l'aide d'instruments trs
dlicatement ajusts et trs obissants.
Ainsi donc, en prenant les choses en gros, ce sont les besoins de l'homme qui,
dans les premires priodes de son dveloppement, donnent l'essor son activit;
mais, par la suite, chaque progrs est d de nouvelles activits qui suscitent de
nouveaux besoins, bien loin d'tre d de nouveaux besoins provoquant des activits
nouvelles.
Nous le voyons clairement si nous cessons de considrer des conditions de vie
saines o de nouvelles activits se dveloppent constamment, et si nous observons le
ngre des Indes Occidentales qui fait usage de la libert et de la richesse, non pas
pour se procurer les moyens de satisfaire de nouveaux besoins, mais pour croupir
dans une paresse qui n'est pas un repos; ou encore si nous considrons cette partie, de
moins en moins nombreuse, des ouvriers anglais qui n'ont aucune ambition, aucune
fiert et aucun plaisir dvelopper leurs facults et leurs activits, et qui dpensent
boire tout ce qui, dans leurs salaires, dpasse le strict ncessaire d'une vie misrable.
Il n'est donc pas vrai que la thorie de la consommation soit la base scientifique
de l'conomique 1. Beaucoup de ce qui prsente le plus d'intrt dans la science des
besoins, est tir de la science des efforts et des activits. Elles se compltent l'une
l'autre ; aucune n'est parfaite sans l'autre. Mais si l'une des deux peut, mieux que
l'autre, prtendre expliquer l'histoire de l'homme, au point de vue conomique comme
aux autres, c'est la science des activits et non pas celle des besoins. Me Culloch
indiquait leurs vritables relations lorsque, discutant la nature progressive de
l'homme 2, il disait : La satisfaction d'un besoin ou d'un dsir n'est qu'un pas vers
quelque but nouveau. toute poque de progrs le destin de l'homme est d'imaginer
1
Cette opinion est exprime par Banfield, et Jevons l'a adopte comme tant le point central de ses
ides. Il est fcheux qu'ici, comme ailleurs, le got qu'a Jevons d'exprimer ses ides avec force l'ait
men une conclusion qui, non seulement est inexacte, niais fait croire tort que les anciens
conomistes se seraient tromps sur ce point plus qu'ils ne l'ont rellement fait. Banfield dit : La
premire proposition de la thorie de la consommation est que la satisfaction d'un besoin plac
assez bas dans l'chelle des besoins en fait natre un autre d'un caractre plus lev . Si cette ide
tait vraie, l'opinion que nous rapportons ci-dessus et qui est base sur elle, serait vraie aussi.
Mais, comme le montre Jevons (Theory, 2e dit., p. 59) elle n'est pas exacte. Il lui substitue cette
autre formule que la satisfaction d'un besoin infrieur permet un besoin plus lev de se
manifester. Cela est vrai et c'est d'ailleurs une phrase qui exprime deux propositions identiques ;
niais elle n'autorise pas donner la suprmatie la thorie de la consommation.
Political Economy, ch. II.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
119
et d'inventer, de s'engager dans de nouvelles entreprises, et, lorsque celles-ci sont
termines, de se lancer dans d'autres avec une nergie nouvelle .
Il rsulte de l qu' ce point de notre ouvrage, toute tude de la demande doit se
rduire une analyse lmentaire presque purement formelle. L'tude plus complte
de la consommation doit suivre et non pas prcder la partie principale de l'analyse
conomique; de plus, bien qu'elle ait son point de dpart dans le domaine propre
l'conomique, elle ne peut pas y trouver ses conclusions, mais doit les aller chercher
bien au del de ce domaine 1.
La classification des besoins n'est pas un travail dnu d'intrt ; mais elle n'est pas ncessaire
pour le but que nous nous proposons. Le fonds commun des ouvrages les plus rcents cet gard
se trouve dans HERMANN, Staatswirthschaftliche Untersuchungen, ch. II, o les besoins sont
classs en besoins absolus et relatifs, levs et infrieurs, urgents et susceptibles d'tre ajourns,
positifs et ngatifs, directs et indirects, gnraux et particuliers, continus et intermittents,
permanents et temporaires, ordinaires et extraordinaires, prsents et futurs, individuels et
collectifs, privs et publics .
On trouvera une analyse des besoins et des dsirs dans la plupart des ouvrages conomiques
crits en France et dans les autres pays du Continent mme par la prcdente gnration. Mais les
limites rigides que les auteurs anglais ont assignes leur science ont exclu les discussions de ce
genre. C'est un fait caractristique que Bentham n'y fait aucune allusion dans son Manual of
Political Economy, quoique l'analyse profonde qu'il en donne dans les Principles of Morals and
Legislation et dans la Table of the Springs of Human Action, ait exerc une grande influence.
Hermann a tudi Bentham ; d'un autre ct, Banfield, dont les cours ont peut-tre t les premiers
cours faits dans une Universit anglaise qui aient subi l'influence directe de la pense conomique
allemande, doit beaucoup Hermann. En Angleterre, la route a t prpare l'excellent ouvrage
de Jevons sur la thorie des besoins, par Bentham lui-mme, par Senior, dont les brves remarques
sur ce sujet sont pleines d'ides suggestives, par Banfield. et par l'Australien Hearn. Le livre de
HEARN, Plutology or Theory of the Efforts to satisfy Human Wants, est la fois simple et
profond ; il offre un admirable exemple de la faon dont l'analyse minutieuse doit tre employe
pour devenir une discipline de premier ordre l'gard des jeunes gens, et pour leur donner une
connaissance intelligente des conditions conomiques de la vie, sans leur imposer aucune solution
particulire des problmes plus difficiles sur lesquels ils ne sont pas encore mme de se former
une opinion indpendante. peu prs au mme moment o paraissait le livre de Jevons (Theory of
Political Economy), Charles Menger inaugurait les tudes subtiles et intressantes faites par l'cole
autrichienne sur les besoins et les utilits.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
120
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre III : Des besoins et de leur satisfaction
Chapitre trois
Les variations de la demande
Retour la table des matires
1. - Les expressions Utilit et Besoin sont, d'ordinaire, employes comme
corrlatives. L'utilit d'une chose pour une personne s'apprcie par la mesure dans
laquelle cette chose satisfait ses besoins ce moment-l. Les besoins sont apprcis
ici quantitativement, c'est--dire d'aprs leur volume et leur intensit, et non
qualitativement, d'aprs quelque idal de morale ou de sagesse. D'aprs un idal de ce
genre les aliments solides peuvent tre plus utiles qu'une quantit d'alcool d'un prix
gal, et des vtements chauds plus utiles qu'un habit de soire neuf. Mais si un
homme prfre l'alcool ou l'habit noir, c'est que l'un de ces objets satisfait un besoin
qui, pour lui, est plus grand ; il a donc pour lui une plus grande utilit. Sans doute cet
emploi du mot utilit peut induire en erreur ceux qui n'y sont pas accoutums; mais
cela arrive rarement en pratique, et il a en sa faveur de grandes autorits. Les mots par
lesquels on a propos de le remplacer, tels que Ophlimit (Pareto), Agrabilit,
Dsidrabilit, etc., ne sont pas sans inconvnients ; le mieux semble tre pour le
moment de conserver le mot Utilit, en dpit de ses dfauts.
Nous avons vu que, en rgle gnrale, chaque besoin est limit, et qu' mesure
qu'augmente la quantit d'une chose qu'un homme possde, le dsir qu'il prouve d'en
obtenir davantage diminue d'intensit ; jusqu'au moment o, sa place, apparat le
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
121
dsir d'une autre chose, laquelle peut-tre il ne pensait mme pas, tant que ses
besoins plus urgents n'taient pas satisfaits. Il y a une varit infinie de besoins, mais
chacun d'eux pris isolment est limit. Cette tendance bien connue et fondamentale de
la nature humaine peut s'exprimer de la faon suivante par la loi de satit des besoins
ou de l'utilit dcroissante :
L'utilit totale d'une chose pour quelqu'un (c'est--dire la somme des plaisirs ou
des autres avantages qu'il en retire) augmente avec toute augmentation de la quantit
qu'il en possde, mais non pas aussi vite que cette quantit. Si cette quantit augmente
un taux uniforme, les avantages (the benefit) qu'il en tire augmentent un taux
dcroissant .
En d'autres termes, le bnfice supplmentaire, qu'une personne tire d'une augmentation donne du stock d'une chose qu'elle possde, diminue chaque augmentation de ce stock.
La quantit de cette chose qu'elle consent tout juste acheter, petit tre appele
son achat-limite (marginal purchase), parce qu'elle est alors juste la limite du doute
sur le point de savoir s'il vaut la peine de faire la dpense ncessaire pour l'acqurir.
L'utilit de son achat-limite peut s'appeler l'utilit-limite de la chose pour elle ; ou
bien si, au lieu de l'acheter, notre personne fait la chose elle-mme, son utilit-limite
est l'utilit de la partie qu'elle pense tout juste valoir la peine de faire. La loi qui vient
d'tre expose peut donc se formuler ainsi :
L'utilit-limite d'une chose pour une personne diminue avec toute augmentation
de la quantit qu'elle en possde dj 1.
Cette loi implique pourtant une condition qu'il faut mettre en lumire. C'est que
nous supposons que le caractre et les gots de la personne elle-mme n'aient pas eu
le temps de changer. Il ne faut donc pas voir d'exception la loi dans le fait que plus
un homme entend de bonne musique, plus son got pour elle devient fort ; ni dans le
fait que l'avarice et l'ambition sont souvent insatiables; ni dans le fait que la vertu de
propret et le vice d'ivrognerie se dveloppent mesure qu'on les satisfait. En pareils
cas, nos observations s'tendent une certaine priode de temps, et la personne n'est
pas la mme au dbut qu' la fin. Si nous prenons un homme tel qu'il est, en
supposant que son caractre n'ait pas eu le temps de changer : pour lui, alors, l'utilitlimite d'une chose diminue constamment avec toute augmentation de la quantit dont
il dispose 2.
1
Voir note I l'appendice mathmatique la fin du volume. Cette loi a, au point de vue de
l'importance, la priorit, sur la loi du rendement dcroissant du sol, qui a pourtant la priorit au
point de vue historique, puisque c'est elle qui la premire fut soumise une analyse rigoureuse
d'un caractre semi-mathmatique. Si, par anticipation, nous lui empruntons quelques-unes de ses
expressions, nous pouvons dire que le rendement de jouissances (pleasure) qu'une personne tire de
chaque dose supplmentaire d'une marchandise, diminue, jusqu' ce qu'enfin une limite soit
atteinte partir de laquelle il ne vaut plus la peine d'en acqurir davantage.
L'expression utilit-limite (Grenz-nutzen) a t pour la premire fois employe dans ce sens
par le professeur autrichien Wieser. Elle correspond l'expression de Jevons, utilit finale.
On peut signaler ici, bien que le fait n'ait que peu d'importance pratique, qu'une petite quantit
d'une marchandise peut tre insuffisante pour satisfaire un besoin particulier, et alors la satisfaction augmente d'une faon plus que proportionnelle lorsque le consommateur vient en possder
assez pour atteindre le but dsir. Ainsi, par exemple, quelqu'un tirerait proportionnellement moins
de plaisir de dix rouleaux de papier tapisser que de douze, si, avec douze, il peut couvrir
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
122
Retour la table des matires
2. - Exprimons maintenant par rapport aux prix cette loi de l'utilit dcroissante.
Prenons pour exemple une marchandise, comme le th, pour laquelle la demande est
continue et qui peut tre achete en petites quantits. Supposons, par exemple, que
l'on puisse avoir du th, d'une certaine qualit, 2 shillings la livre. Une personne
peut tre dispose donner 10 shillings pour une seule livre une fois par an, plutt
que de se passer de th tout fait. Mais, au prix o il est, elle achte peut-tre 10
livres par an ; c'est--dire que la diffrence entre le plaisir qu'elle se procure en
achetant 9 livres, et celui qu'elle se procure en achetant 10 livres, est juste suffisante
pour la faire consentir payer 2 shillings ; le fait qu'elle n'achte pas une onzime
livre montre que, son avis, elle ne mrite pas une nouvelle dpense de 2 shillings.
Le prix de 2 shillings la livre est donc la mesure de l'utilit du th pour elle, la
limite, ou au terme, ou la fin, de ses achats ; c'est la mesure de l'utilit-limite du th
pour elle. Si le prix qu'elle est juste dispose payer pour avoir au moins un pound de
th s'appelle son prix de demande (demand price), le prix de 2 shillings est donc son
prix de demande limite (marginal demand price). Notre loi peut alors se formuler
ainsi :
Plus est grande la quantit d'une chose qu'une personne possde, plus sera
faible, toutes choses restant gales ( savoir le pouvoir d'achat de la monnaie, et la
quantit de monnaie dont elle dispose), le prix qu'elle consentira payer pour en avoir
davantage : ou, en d'autres termes, plus diminue son prix de demande-limite pour
cette chose .
Sa demande devient efficace seulement lorsque le prix qu'elle est dispose offrir
atteint celui auquel les autres sont disposs vendre.
Cette dernire formule nous rappelle que nous n'avons, jusqu' prsent, pas tenu
compte des changements qui peuvent survenir dans l'utilit - limite de la monnaie, ou
pouvoir gnral d'achat. un mme moment, les ressources matrielles d'une personne restant les mmes, l'utilit-limite de la monnaie est pour elle une quantit fixe,
de sorte que les prix qu'elle est dispose payer pour deux marchandises sont l'un
l'autre dans le mme rapport que l'utilit de ces deux marchandises.
entirement les murs de sa chambre, et ne le peut pas avec dix. Ou encore un concert trs court, ou
des vacances trs courtes, peuvent ne pas atteindre leur but qui est de reposer et de distraire ; un
concert ou des vacances de dure double peuvent avoir une utilit totale plus que double. Ce cas
correspond au fait suivant, que nous aurons tudier propos de la tendance au rendement
dcroissant : lorsque le capital et le travail dj employs sur un terrain sont en quantit insuffisante pour produire tous leurs effets, une dpense supplmentaire faite sur ce terrain, alors mme
que les procds de culture n'auraient pas chang, donnerait un rendement plus que proportionnel.
Dans le fait qu'une amlioration des procds de culture peut entraver l'action de cette tendance,
nous constaterons une analogie avec la condition qui vient d'tre indique au texte comme tant
implique par la loi de l'utilit dcroissante.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
123
Retour la table des matires
3. - Pour qu'une personne se dcide acheter une chose, il faut que cette chose
ait une plus grande utilit s'il s'agit d'une personne pauvre que d'une personne riche.
Nous avons vu que l'employ 100 par an ira pied son bureau par une pluie qui
dcidera l'employ gagnant 300 prendre un omnibus 1. L'utilit ou la satisfaction
que reprsentent 3 pence est plus grande pour l'employ pauvre que pour le riche ;
pourtant, si l'employ riche prend l'omnibus cent fois dans l'anne, et le pauvre vingt
fois, l'utilit du centime et dernier trajet en omnibus que le riche consent se payer
est mesure pour lui par 3 pence ; et c'est aussi par 3 pence que se mesure, pour
l'employ pauvre, l'utilit du vingtime et dernier trajet en omnibus qu'il se paye.
Pour chacun d'eux, l'utilit-limite se mesure par 3 pence ; mais cette utilit-limite est
plus grande pour l'employ pauvre que pour le riche.
En d'autres termes, plus un homme devient riche, moins est grande l'utilit-limite
de la monnaie pour lui ; toute augmentation de ses ressources augmente le prix qu'il
est dispos payer pour une satisfaction donne. De mme, toute diminution de ses
ressources augmente l'utilit-limite de la monnaie pour lui, et diminue le prix qu'il est
dispos payer pour se procurer une satisfaction 2.
Retour la table des matires
4. - Pour avoir une connaissance complte de sa demande d'une chose, il
faudrait nous renseigner sur le point de savoir quelle quantit il serait dispos en
acheter chacun des prix auxquels cette chose peut tre offerte ; l'tat de sa demande
de th, par exemple, peut s'exprimer par un tableau des prix qu'il est dispos payer,
c'est--dire par ses divers prix de demande pour diverses quantits. Ce tableau peut
s'appeler son tableau de demande (demand schedule).
Ainsi, par exemple, nous pouvons trouver qu'il achterait :
6 livres
7 livres
8 livres
9 livres
10 livres
11 livres
12 livres
13 livres
50 pence la livre
40 pence la livre
33 pence la livre
28 pence la livre
21 pence la livre
21 pence la livre
19 pence la livre
18 pence la livre
Si des prix correspondants taient indiqus pour toutes les quantits intermdiaires, nous aurions un tableau complet de sa demande [Voir la note ci-dessous :].
1
2
Voir livre I, chap. V, 4.
Voir note II l'appendice.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
124
Un tableau de demande de ce genre peut tre reprsent, selon un procd qui devient
d'un usage familier, par une courbe qui serait appele la courbe de demande. Tirons
deux lignes Ox et Oy, l'une horizontale, l'autre verticale. Supposons qu'un pouce pris
sur Ox reprsente 10 livres de th, et qu'un pouce pris sur Oy reprsente 40 pence.
Diximes
de pouce
1
Prenons Om = 6
2
Prenons Om = 7
3
Prenons Om = 8
4
Prenons Om = 9
5
Prenons Om = 10
6
Prenons Om = 11
7
Prenons Om = 12
8
Prenons Om = 13
Quarantimes
de pouce
1 1
et tirons m p = 50
2 2
et tirons m p = 40
3 3
et tirons m p =33
4 4
et tirons m p = 28
5 5
et tirons m p = 24
6 6
et tirons m p = 21
7 7
et tirons m p = 19
8 8
et tirons m p = 17
m1 se trouvant sur Ox et m1p1 tant tire verticalement de m1, et ainsi de suite Alors
p1, p2,... p8 sont des points situs sur la courbe de demande du th ; ou, comme nous
pouvons dire, des points de demande. Si nous pouvions tablir de la mme manire
des points de demande pour chaque quantit possible de th, nous aurions la courbe
continue DD' telle qu'elle est trace sur la figure. Cette faon de prsenter le tableau
et la courbe de demande n'est que provisoire ; nous renvoyons au chapitre V certaines
difficults qui s'y rattachent.
Nous ne pouvons pas exprimer la demande d'une personne pour une chose en
parlant simplement de la quantit qu'elle est dispose acheter , ou de l'intensit
de son dsir d'acheter une certaine quantit , sans indiquer les prix auxquels elle
achterait telle quantit ou telle autre. Nous ne pouvons la formuler exactement qu'en
dressant les listes des prix auxquels elle est dispose acheter chaque quantit 1.
1
Ainsi Mill dit que nous devons entendre par le mot demande la quantit demande, et nous
rappeler que ce n'est pas une quantit fixe, mais qu'elle varie en gnral suivant la valeur
(Principles, livre III, ch. II, 4). Cette formule est scientifique au fond.; mais elle n'est pas claire
et elle a t trs mal comprise. Cairnes prfre dire que la demande est le dsir de marchandises
et de services qu'on cherche raliser en offrant l'objet possdant le pouvoir gnral d'achat, et
l'offre est le dsir de pouvoir gnral d'achat qu'on cherche raliser en offrant des marchandises
ou des services . Il prfre cette formule afin de pouvoir parler de rapport ou d'galit entre l'offre
et la demande. Mais les dsirs de deux personnes diffrentes ne peuvent pas tre compars
directement ; leurs mesures peuvent l'tre, mais eux-mmes ne le peuvent pas. En fait, Cairnes est
lui-mme amen dire que l'offre est limite par la quantit de marchandises offertes en vente,
et la demande par la quantit de pouvoir d'achat offert pour leur acquisition . Mais les vendeurs
n'ont pas une quantit fixe de marchandises qu'ils offrent en vente sans condition n'importe quel
prix; les acheteurs n'ont pas une quantit fixe de pouvoir d'achat qu'ils soient prts dpenser en
achats de marchandises quelque lev que soit le prix qu'ils ont payer pour elles. Il faut tenir
compte dans l'un et l'autre cas de la relation entre la quantit et le prix, pour complter l'expos de
Cairnes, et, lorsqu'on le fait, ou revient la voie suivie par Mill. Cairnes dit, il est vrai : La
demande, telle qu'elle est dfinie par Mill, n'est pas mesure, comme dans ma dfinition, par la
quantit de pouvoir d'achat offerte pour satisfaire le dsir de marchandises, mais par la quantit de
marchandises pour lesquelles ce pouvoir d'achat est offert . Il est vrai qu'il y a une grande
diffrence entre les deux phrases j'achterai une douzaine d'ufs et j'achterai un shilling
d'ufs ; mais il n'y a pas de diffrence substantielle entre la phrase j'achterai douze oeufs s'ils
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
125
Lorsque nous disons que la demande d'une personne pour une chose augmente,
nous voulons dire qu'elle en achtera plus qu'auparavant au mme prix, et qu'elle en
achtera autant qu'auparavant un prix plus lev. Une augmentation de sa demande
d'une marchandise signifie d'ordinaire une augmentation de la liste entire des prix
auxquels elle est dispose acheter chaque quantit, et non pas seulement qu'elle soit
dispose en acheter davantage aux prix courants 1.
Retour la table des matires
5. - Jusqu' prsent nous n'avons envisag que la demande d'un seul individu.
Dans le cas particulier d'une marchandise comme le th, la demande d'une seule
personne reprsente trs bien la demande totale de tout un march : en effet la
demande de th est continue, et, comme il peut tre achet en petites quantits, toute
variation de son prix a des chances de se faire sentir sur la quantit qu'un individu en
achte. Mais, mme parmi les choses qui sont d'un usage continu, il y en a beaucoup
pour lesquelles la demande d'un seul individu ne peut pas varier continuellement
tout lger changement de prix, et ne peut varier que par grands sauts. Par exemple,
une lgre baisse dans le prix des chapeaux ou des montres n'affectera pas les achats
de tout le monde ; mais elle amnera quelques personnes, qui hsitaient s'acheter un
chapeau neuf ou une nouvelle montre, le faire.
Il y a beaucoup de choses pour lesquelles le besoin qu'en a un individu donn est
intermittent, capricieux et irrgulier. Il ne peut pas y avoir de liste des prix de
demande individuelle pour les gteaux de noce, ou pour les services d'un chirurgien
clbre. Mais l'conomiste s'occupe peu des incidents particuliers de la vie des
individus. Il tudie plutt les actions que, sous certaines conditions, on peut attendre
des membres d'un groupe industriel , dans la mesure o les motifs de ces actions
sont mesurables par un prix en monnaie ; dans ces rsultats gnraux, la varit et
l'intermittence de l'action individuelle se perdent dans l'ensemble relativement
rgulier des actions du grand nombre.
Sur de grands marchs - l o riches et pauvres, vieux et jeunes, hommes et femmes, personnes de tous les genres de gots, de tempraments et d'occupations, sont
mls ensemble - les particularits des besoins individuels se compensent les unes les
autres pour aboutir des variations relativement rgulires de la demande totale.
Toute baisse, quelque petite qu'elle soit, dans le prix d'une marchandise d'un usage
gnral, aura pour effet, toutes choses restant gales, d'augmenter sa vente ; de mme
qu'un mauvais automne augmente la mortalit d'une grande ville, quoique beaucoup
de gens puissent ne pas en souffrir. Si donc nous avions les renseignements nces-
sont un penny pice, mais je n'en achterai que six s'ils sont un penny et demi et la phrase
j'achterai des oeufs pour un shilling s'ils sont un penny chaque, mais s'ils cotent un penny et
demi chaque je n'en achterai que pour neuf pence . Si la formule de Cairnes, lorsqu'on la
complte, devient au fond la mme que celle de Mill, sa forme est encore plus susceptible
d'induire en erreur. (Voir un article de l'auteur de cet ouvrage Mill's Theory of Value, Fornightly.
Review, avril 1876.)
Nous aurons parfois avantage la dsigner sous le nom de augmentation de son tableau de
demande (demand schedule). Gomtriquement, on la reprsente en haussant la courbe de
demande, ou, ce qui revient au mme, en la faisant mouvoir vers la droite, avec peut-tre quelque
modification de forme.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
126
saires, nous pourrions dresser une liste des prix auxquels chaque quantit d'une
marchandise pourrait trouver acheteurs en un lieu donn, dans le courant d'une anne,
par exemple.
La demande totale, en un lieu donn, d'une marchandise quelconque, de th, par
exemple, est la somme des demandes de tous les individus qui s'y trouvent. Quelquesuns seront plus riches et d'autres plus pauvres que le consommateur individuel dont
nous venons d'tudier la demande ci-dessus ; le got pour le th sera chez quelquesuns plus grand et chez d'autres moindre que chez lui. Supposons qu'il y ait sur la place
un million d'acheteurs de th, et que la consommation moyenne soit gale la sienne
pour chaque prix. Alors la demande de cette place est reprsente par la mme liste de
prix qu'auparavant, si nous crivons un million de livres de th au lieu d'une
livre [Voir la note ci-dessous dans lencadr :].
La demande est reprsente par la mme courbe que
prcdemment, mais un pouce de Ox reprsente maintenant
dix millions de livres au lieu de 10 livres. On peut dfinir la
courbe de demande pour un march de la faon suivante : la
courbe de demande pour une marchandise sur un march
pendant une unit de temps donne est le lieu des points de
demande de cette marchandise. C'est--dire que c'est une
courbe telle que si, d'un point quelconque P pris sur elle, ou
tire une ligne droite PM perpendiculaire Ox, PM reprsente
le prix auquel des acheteurs se prsenteront pour acheter une
quantit de la marchandise reprsente par OM.
Il y a donc une loi gnrale de la demande : plus est grande la quantit vendre,
plus petit doit tre le prix auquel elle est offerte pour pouvoir trouver acheteurs ; ou,
en d'autres termes, la quantit demande augmente avec une baisse de prix, et
diminue avec une hausse de prix. Il n'y a pas de relation uniforme entre la baisse de
prix et l'augmentation de la demande ; une baisse de un dixime peut augmenter les
ventes de un vingtime, ou de un quart, ou les doubler; mais, mesure que les nombres de la colonne de gauche dans le tableau de demande (demand schedule)
augmentent, ceux de la colonne de droite iront toujours en diminuant 1.
Le prix sera la mesure de l'utilit-limite de la marchandise pour chaque acheteur
individuellement. Nous ne pouvons pas dire que le prix mesure l'utilit-limite en
gnral, parce que les besoins et les circonstances sont diffrents suivant les gens.
1
C'est--dire que si un point se meut le long de la courbe depuis Oy il se rapprochera constamment
de Ox. Par consquent, si on tire une ligne droite PT qui touche la courbe P et rencontre Ox en T,
l'angle PTx est un angle obtus. Il est commode d'exprimer ce fait d'une faon abrge ; on peut le
faire en disant que PT a une inclinaison ngative. Ainsi la seule loi universelle que suive la courbe
de demande c'est qu'elle a une inclinaison ngative sur tout le cours de sa longueur.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
127
Retour la table des matires
6. - Les prix de demande de notre liste sont ceux auxquels les diverses quantits
d'une chose peuvent tre vendues sur un march, pendant un temps donn, et dans des
conditions donnes. Si les conditions varient un point de vue quelconque, les prix
devront probablement subir un changement ; or il arrive constamment que le dsir
d'une chose se trouve matriellement modifi par un changement de mode, ou par
l'abaissement de prix d'une marchandise rivale, ou par l'invention d'une nouvelle
marchandise. Par exemple, la liste des prix de demande du th est dresse en supposant le prix du caf connu ; mais un dficit dans la rcolte du caf ferait hausser les
prix du th. La demande de gaz est Susceptible de diminuer par suite d'une
amlioration de l'clairage lectrique. C'est ainsi encore qu'une baisse de prix d'une
espce particulire de th peut faire qu'elle soit remplace par une varit infrieure
mais meilleur march 1.
On peut mme concevoir, quoique cela ne soit pas probable, qu'une baisse simultane et proportionnelle dans le prix de toutes les varits de th puisse avoir pour effet de diminuer la demande
d'une qualit particulire. Il en sera ainsi si les gens qui consommaient cette qualit, et que
l'abaissement du prix du th amne la remplacer par une qualit suprieure, sont plus nombreux
que ceux qui sont amens la prendre la place d'une qualit infrieure. La question de savoir en
quelles catgories il faut grouper les diffrentes marchandises, doit se trancher d'aprs chaque cas
particulier. certains gards, il peut tre bon de regarder les ths de Chine et les ths de l'Inde, ou
mme les ths de Souchong et les ths de Pekoe, comme des marchandises diffrentes, et d'avoir
pour chacun d'eux une liste de demande distincte. d'autres gards, au contraire, il peut tre bon
de grouper ensemble des marchandises aussi distinctes que la viande de buf et la viande de
mouton, ou mme que le th et le caf, et d'avoir une liste unique pour reprsenter la demande des
deux marchandises runies; mais en pareil cas, naturellement, on doit convenir du nombre d'onces
de th que l'on prend comme quivalent d'une livre de caf.
En outre, une marchandise peut tre simultanment demande pour diffrents usages (par
exemple il peut y avoir une a demande compose de cuir, pour faire des souliers et pour faire des
valises). La demande d'une chose peut encore dpendre de l'offre d'une autre chose sans laquelle
elle ne rendrait pas beaucoup de service (ainsi il y a une demande solidaire de coton brut et
d'ouvriers filateurs de coton). De plus, la demande d'une marchandise de la part d'acheteurs qui ne
l'achtent que pour la revendre ensuite, bien qu'elle soit dtermine par la demande des consommateurs dfinitifs, prsente quelques particularits qui lui sont propres. Mais la discussion de tous
ces points sera mieux place plus tard.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
128
Nous allons maintenant examiner le caractre gnral de la demande pour
quelques marchandises importantes prtes tre consommes immdiatement. Nous
continuerons ainsi l'tude faite dans le chapitre prcdent sur la varit et la satiabilit
des besoins, mais nous la traiterons un point de vue diffrent, celui des statistiques
de prix 1.
Un grand changement s'est opr dans les formes de la pense conomique au cours de la
gnration actuelle, par suite de l'adoption gnrale du langage semi-mathmatique pour exprimer
la relation qui existe entre de petites variations de quantit (small increments) d'une marchandise
et de petites variations du prix total pay pour elle, par suite aussi de l'habitude prise de considrer
ces petites variations de prix comme la mesure de variations de plaisir correspondantes. Le
premier pas dans cette voie, et de beaucoup le plus important, fat fait par Cournot (Recherches sur
les Principes Mathmatiques de la thorie des Richesses, 1838) ; le suivant par Dupuis (De la
mesure d'utilit des travaux publics, dans les Annales des Ponts et Chausses, 4844), et par
Gossen (Entwickelunq der Gesetze des menschlichen Verkehrs, 1854). Mais leurs travaux taient
tombs dans l'oubli, et une partie de ce qu'ils avaient fait fut refait nouveau et publi presque
simultanment par Jevons et par Charles Menger en 1871, ainsi que par Walras un peu plus tard.
Jevons, presque aussitt, attira l'attention publique par sa lucidit brillante et son style sduisant. Il
employa ingnieusement le nom nouveau de utilit finale, pour permettre aux gens qui ignoraient
les mathmatiques de se faire une ide claire des relations gnrales qui existent entre les
variations (small increments) de deux choses qui changent graduellement en liaison l'une avec
l'autre. Ses dfauts mme contriburent son succs. Dans la conviction sincre o il tait que
Ricardo et ceux qui l'ont suivi s'taient tromps, dans leur expos des causes qui dterminent la
valeur, en omettant d'insister sur la loi de satit des besoins, il amena beaucoup de gens penser
qu'il corrigeait de graves erreurs, alors qu'il ne faisait en ralit qu'ajouter des explications
complmentaires trs importantes. Il a fait uvre excellente en insistant sur un fait qui n'est pas
l'un des moins importants, et que ses prdcesseurs, mme Cournot, pensaient tre trop vident
pour qu'il fut ncessaire de le mentionner, savoir que la diminution de la demande d'une chose
sur un march indique une diminution dans l'intensit du dsir que les consommateurs individuels
ont de cette chose, parce que leurs besoins commencent tre satisfaits. Mais il a conduit
beaucoup de ses lecteurs confondre les domaines de l'Hdonique et de l'conomique, en
exagrant les applications de ses phrases favorites et en disant sans prciser (Theory, 2e dit., p.
105) que le prix d'une chose mesure son utilit finale non seulement pour un individu, ce qui peut
tre vrai, mais encore pour ci un groupe commerant (trading body), ce qui ne peut pas l'tre.
Ces questions seront examines avec plus de dveloppement plus tard la fin du Livre V, dans
une note sur la thorie de Ricardo touchant les relations du cot de production avec-la valeur.
Une excellente bibliographie de l'conomie politique mathmatique est donne par Fisher en
appendice la traduction anglaise par Bacon du livre de Cournot ; le lecteur peut s'y reporter pour
avoir un aperu plus dtaill des premiers ouvrages mathmatiques sur I'conomie politique,
comme aussi des ouvrages de Edgeworth, Pareto, Wicksteed, Auspitz, Lieben, et d'autres. Le livre
de Pantaleoni, Pure Economics, rend pour la premire fois accessibles tous les dmonstrations
profondment originales et vigoureuses, quoique parfois abstraites, de Gossen.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
129
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre III : Des besoins et de leur satisfaction
Chapitre quatre
Llasticit des besoins
Retour la table des matires
1. - Nous avons vu que la seule loi gnrale touchant le dsir qu'une personne a
d'une marchandise, c'est que ce dsir diminue, toutes choses restant gales, avec toute
augmentation de la quantit de cette marchandise dont elle dispose. Mais cette
diminution peut tre lente ou rapide. Si elle est lente, le prix que cette personne
consent donner de la marchandise ne baisse pas beaucoup, alors mme que la
quantit dont elle dispose augmente considrablement, et une baisse, mme lgre, de
prix lui fait augmenter d'une faon relativement importante ses achats. Si, au
contraire, cette diminution est rapide, une lgre baisse de prix ne provoque qu'une
augmentation trs faible de ses achats. Dans le premier cas, sa disposition acheter
augmente beaucoup sous l'action d'une tentation mme faible : l'lasticit de ses
besoins, dirons-nous, est grande. Dans le dernier cas, la tentation due la baisse du
prix amne peine une lgre augmentation de son dsir d'acheter : l'lasticit de sa
demande est faible. Si une baisse du prix du th de 16 pence 15 pence la livre par
exemple fait augmenter beaucoup ses achats, alors, l'inverse, une augmentation de
prix de 15 16 pence les ferait beaucoup diminuer. C'est--dire que si la demande est
lastique en cas de baisse de prix, elle l'est galement dans le cas inverse d'une
hausse.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
130
Ce qui est vrai pour la demande d'une personne, l'est aussi pour celle de tout un
march. L'lasticit de la demande sur un march est dite grande ou faible suivant que
la quantit demande augmente beaucoup ou augmente peu pour une baisse de prix
donne, et diminue beaucoup ou diminue peu pour une hausse de prix donne [Voir la
note ci-dessous dans lencadr].
Pour parler plus exactement, nous pouvons dire que
l'lasticit de la demande est de 1 lorsqu'une baisse de prix de
1 pour 100 produit un accroissement de 1 pour 100 de la
quantit demande ; qu'elle est de 2 ou de 1/2, lorsqu'une
baisse de prix de 1 pour 100 provoque une augmentation de 2
ou de 1/2 pour 100 de la demande, et ainsi de suite.
L'lasticit de la demande peut tre indique sur la courbe de
demande par le procd suivant. Tirons une ligne qui touche
la courbe un point P et qui rencontre Ox en T et Oy en t,
alors la mesure de l'lasticit au point P est donne par le
rapport de PT Pt.
Si PT est gal deux fois Pt, une baisse de prix de 1 pour 100 amnera une
augmentation de 2 pour 100 de la quantit demande ; l'lasticit de la demande serait
de 2. Si PT est gal 1/3 de Pt, une baisse de prix de 1 pour 100 amnera une
augmentation de demande de 1/3 pour 100 ; l'lasticit de la demande serait de 1/3, et
ainsi de suite. Une autre faon d'arriver au mme rsultat est la suivante : l'lasticit
au point P est mesure par le rapport de PT Pt, c'est--dire par celui de MT MO
(PM tant perpendiculaire OM) ; par suite, l'lasticit de la demande est gale 1
quand l'angle TPM est gal l'angle OPM ; elle augmente mesure que l'angle TPM
augmente par rapport l'angle OPM, et vice versa. Voir la note III l'appendice.
Retour la table des matires
2. - Le prix qui, pour un homme pauvre, est assez lev pour tre presque
prohibitif, peut tre peine sensible pour le riche ; le pauvre, par exemple, ne boit
jamais de vin, tandis que l'homme trs riche eu boit autant qu'il en a fantaisie, sans
mme songer son prix. Pour avoir une notion claire de la loi de l'lasticit de la
demande, il faut donc envisager chaque classe de la socit part. Sans doute il y a
bien des degrs de richesse parmi les riches, et de pauvret parmi les pauvres ; mais
pour le moment nous ngligerons ces subdivisions.
Lorsque le prix d'une chose est trs lev relativement une classe de gens, ceuxci n'en achtent que peu, et, dans certains cas, l'usage et l'habitude peuvent les
dtourner d'en faire librement usage, mme aprs que son prix a sensiblement baiss.
Il peut se faire que, mme alors, elle continue n'tre employe que dans un petit
nombre d'occasions particulires, ou en cas de maladie grave, etc. Mais les cas de ce
genre, bien qu'ils ne soient pas rares, ne forment pas la rgle gnrale, et, quoiqu'il en
soit, aussitt qu'une chose est entre dans l'usage courant, toute baisse de prix considrable provoque une grande augmentation de la demande. L'lasticit de la demande
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
131
est grande pour les prix levs; grande encore, ou en tout cas considrable, pour les
prix moyens ; mais elle diminue mesure que le prix tombe, et peu peu elle
disparat si la baisse est telle que la satit se trouve atteinte.
Cette rgle semble s'appliquer presque toutes les marchandises, ainsi qu' la
demande de toutes les classes de la socit ; avec cette rserve seulement que le
niveau auquel les prix levs finissent, et o les Prix bas commencent, n'est pas le
mme pour les diffrentes classes ; de mme pour le niveau auquel finissent les prix
bas et o commencent les prix trs bas. Il y a pourtant bien des particularits de
dtail; elles tiennent principalement au fait que, pour certaines marchandises, la
satit vient vite, tandis qu'il en est d'autres (surtout les choses employes dans un but
d'ostentation) que les hommes dsirent d'une faon presque illimite. Pour ces
dernires, l'lasticit de la demande reste considrable, quelque bas qu'en puisse
tomber le prix, tandis que pour les autres la demande perd presque toute son lasticit
ds que le prix est tomb un peu bas [Voir la note ci-dessous dans lencadr :].
Prenons comme exemple la demande de petits pois dans une ville o tous les
lgumes sont apports et vendus sur un seul march. Au dbut de la saison on en
apporte peut-tre 100 livres par jour que l'on vend 1 shilling la livre; plus tard 50Q
livres vendues 6 pence ; puis 1.000 vendues 4 pence, 5.000 vendues 2 pence, et
10.000 vendues 1 1/2 penny.
La demande est reprsente sur la
figure 4, un pouce de Ox reprsentant 5.000
livres et un pouce de Oy reprsentant 10
pence. Alors une courbe passant par les
points p1 , p2 ... p5 , dtermins comme la
figure l'indique, sera la courbe de demande
totale. Mais cette demande totale est forme
des demandes des classes riches, des classes
moyennes et des classes pauvres. Les quantits que chacune de ces classes demande,
peuvent tre reprsentes par les tableaux
suivants :
Prix par livre
en pence
12
6
4
2
1 1/2
Nombre de livres achetes
Classes riches
Classes moyennes
Classes pauvres
Total
100
300
500
800
1.000
0
200
400
2.500
4.000
0
0
100
1.700
5.000
100
500
1.000
5.000
10.000
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
132
Ces tableaux sont prsents sous la forme de courbes dans les figures 5, 6 et 7 qui
montrent les demandes des- classes riches, moyennes et pauvres, reprsentes d'aprs
la mme chelle que dans la figure 4. Ainsi, par exemple, les lignes AH, BK et CL
reprsentent chacune un prix de 2 pence, et ont chacune 0 pouce, 2 de longueur ; OH
= O pouce, 16, reprsentant 800 livres ; OK = O pouce, 5 reprsentant 2.500 livres et
OL O pouce, 34 reprsentant 1.700 livres, tandis que OH + OK + OL 1 pouce, c'est-dire = Om4 dans la figure 4. Cela peut servir d'exemple pour montrer comment
diverses courbes de demande partielles, dessines d'aprs la mme chelle, peuvent
tre superposes horizontalement pour donner la courbe de demande totale
reprsentant l'ensemble de ces demandes partielles.
Retour la table des matires
3. - Il y a certaines marchandises dont les prix courants en Angteterre sont trs
bas, mme l'gard des classes pauvres. Il en est ainsi, par exemple, du sel, d'un
grand nombre d'ingrdients et de condiments, des mdicaments bon march. Il est
douteux qu'une baisse de prix puisse faire augmenter beaucoup la consommation de
ces marchandises.
Pour la viande, le lait, le beurre, la laine, le tabac, les fruits imports, les soins
mdicaux ordinaires, toute variation de leurs prix courants entrane de grands changements dans la consommation des classes ouvrires et de la partie infrieure des
classes moyennes; mais, quelque bon march que ces objets puissent devenir, le riche
n'en augmenterait pas beaucoup pour cela sa consommation personnelle. En d'autres
termes, la demande directe de ces marchandises est trs lastique dans les classes
ouvrires et dans les couches infrieures des classes moyennes, mais elle ne l'est pas
pour les riches. Mais la classe ouvrire est trs nombreuse, et la consommation qu'elle
fait des choses qui sont bien sa porte dpasse de beaucoup celle des riches ; aussi,
la demande des choses de cette espce est-elle dans l'ensemble trs lastique. Il y a
peu de temps, le sucre appartenait aussi ce groupe de marchandises ; mais son prix a
tellement baiss en Angleterre qu'il est maintenant trs faible mme l'gard des
classes ouvrires, et la demande n'en est par suite plus lastique 1.
1
Nous devons cependant rappeler que le tableau de demande (demand schedule) d'une marchandise
quelconque dpend dans une grande mesure du fait que les prix des marchandises rivales restent
fixes ou au contraire varient avec son prix elle. Si nous sparons la demande de viande de buf
et celle de viande de mouton, et si nous supposons que le prix du mouton reste fixe tandis que
celui du buf varie, alors la demande de buf devient extrmement lastique. En effet, toute
baisse lgre dans le prix du buf amne beaucoup de gens en acheter au lieu de mouton, et fait
augmenter considrablement sa consommation : l'inverse, une hausse de prix mme lgre
amne beaucoup de gens manger du mouton en se passant presque compltement de buf. Mais
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
133
Les prix des fruits d'espalier, des meilleures qualits de poisson, et autres objets
de luxe d'un cot modr, permettent la consommation qu'en font les classes
moyennes d'augmenter beaucoup en cas de baisse de prix ; en d'autres termes, la
demande des classes moyennes pour ces objets est trs lastique. Au contraire, la
demande des riches et des ouvriers l'est beaucoup moins : pour les premiers, parce
qu'ils en sont dj presque rassasis ; pour les derniers, parce que le prix reste encore
trop lev pour eux.
Pour les choses comme vins rares, fruits hors de saison, soins des mdecins
clbres, et conseils des grands avocats, les prix courants sont si levs que la
demande vient presque toute des riches ; mais cette demande a toujours une lasticit
considrable. En ce qui concerne les objets d'alimentation les plus coteux, la
demande vient en ralit du dsir de se distinguer et de briller; aussi est-elle presque
insatiable 1.
Retour la table des matires
4. - Le cas des choses de ncessit est un cas exceptionnel. Que le prix du bl
soit trs lev, ou qu'il soit trs bas, la demande a trs peu d'lasticit. Il en est ainsi,
du moins, si nous admettons que le bl, mme lorsqu'il est rare, soit encore pour
l'homme la nourriture la moins chre; et que, mme lorsqu'il est en abondance, on
n'en fasse pas d'autre usage. Nous savons qu'une baisse du prix du pain de 6 4 pence
le quarter n'augmente peu prs pas la consommation. En ce qui concerne l'autre bout
de l'chelle il est plus difficile de parler avec certitude, parce que nous n'avons rien eu
en Angleterre qui ressemble une disette depuis la suppression des lois sur les
crales. Mais, d'aprs l'exprience de temps moins heureux, nous pouvons dire que
des dficits de 1, 2, 3, 4 ou 5 diximes dans l'offre, amneraient une hausse de prix de
3, 8, 16, 28 ou 45 diximes [Voir la note ci-dessous dans lencadr :].
C'est l la clbre estimation tablie par Gregory King. Sa porte
pour la loi de la demande est admirablement tudie par Lord
Lauderdale (Inquiry, pp. 51-53). Elle est reprsente dans la figure
8 par la courbe DD', le point A correspondant au prix ordinaire. Si
nous tenons compte du fait que lorsque le prix du bl est trs bas, il
peut tre employ, comme on le fit par exemple en 1834, pour
nourrir le btail, les moutons, ,es pores, pour la brasserie et la distillation, la partie infrieure de la courbe prendrait une forme assez
semblable celle de la ligne pointille sur la figure.
en considrant ensemble les diverses espces de viande frache, en supposant que leurs prix restent
peu prs dans les mmes rapports les uns l'gard des autres, et qu'ils ne diffrent pas beaucoup
de ceux qui prvalent l'heure actuelle en Angleterre, on doit dire que leur tableau de demande
(demand schedule) n'offre qu'une lasticit modre. Des remarques semblables s'appliquent au
sucre de betterave et de canne. Comparez la note 1 de la section 6 du chapitre III du livre III.
Voir ci-dessus ch. II, 1. En avril 1894, par exemple, six oeufs de pluviers, les premiers de la
saison, se vendirent Londres 10 shillings 6 pence chaque. Le jour suivant, il y en avait davantage, et le prix tomba 5 shillings ; le jour suivant 3 shillings, et une semaine aprs le prix tait
de 4 pence.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
134
Et si nous supposons que, lorsque le prix est trs lev, des substituts meilleur march puissent
remplacer le bl, la partie suprieure de la courbe prendrait la forme indique par la partie suprieure
de la ligne pointille.
Des variations de prix beaucoup plus grandes que Celles-l n'ont d'ailleurs pas t
rares. Ainsi, en 1335, le bl se vendit Londres 10 shillings le bushel, et l'anne
suivante il se vendit 10 pence.
Il petit mme y avoir des variations plus fortes que celles-l dans le prix d'une
chose qui n'est pas une chose de ncessit, si elle est prissable, et si la demande n'en
est pas lastique : c'est ainsi que le poisson petit tre trs cher un jour, et deux ou trois
jours aprs tre vendu comme engrais.
L'eau est l'une de ces choses peu nombreuses dont nous pouvons observer la
consommation tous les prix, depuis le plus lev, jusqu' la complte gratuit. des
prix modrs la demande en est trs lastique ; mais les divers besoins qu'elle peut
satisfaire sont susceptibles de l'tre compltement: aussi, mesure que son prix
descend vers zro, la demande perd toute lasticit. On peut en dire peut prs autant
du sel. En Angleterre son prix est si bas, que la demande de sel en tant qu'objet
d'alimentation n'a pas du tout d'lasticit ; mais dans l'Inde le prix en est relativement
haut, et la demande a une certaine lasticit.
Le prix des logements, au contraire, n'est jamais tomb trs bas, sauf lorsqu'une
localit s'est trouve abandonne par ses habitants. Partout o les conditions de la
socit sont saines, et o la prosprit gnrale ne rencontre pas d'obstacle, il semble
que la demande de logements soit toujours lastique, par suite tout la fois des
avantages rels et de la considration sociale que l'on tire de son logement. En ce qui
concerne les vtements pour lesquels n'intervient aucune ide de luxe, la satit est
vite atteinte : lorsque leur prix est bas, la demande n'en a presque pas d'lasticit.
Pour les choses d'une qualit plus releve, la demande dpend beaucoup du got
de chacun: il y a des gens qui se soucient peu que leur vit) ait un fin bouquet, pourvu
qu'ils puissent en boire abondamment; d'autres recherchent la bonne qualit, mais
sont vite rassasis. Dans les rgions ouvrires, les morceaux intrieurs et les bons
morceaux sont vendus peu prs au mme prix : mais dans le nord de l'Angleterre,
grce certains ouvriers bien pays, le got de la bonne viande s'est dvelopp, et on
la paye presque aussi chre qu' Londres dans le West End o le prix se trouve lev
artificiellement par la ncessit d'envoyer les morceaux infrieurs au loin pour les
vendre. L'habitude aussi fait natre des rpulsions acquises, tout comme des gots
acquis. Des illustrations qui augmentent pour beaucoup de lecteurs l'attrait d'un livre,
carteront au contraire des lecteurs habitus des uvres plus artistiques. Une
personne d'un got musical affin vitera dans une grande ville les mauvais concerts ;
elle les suivrait peut-tre avec plaisir si elle vivait dans une petite ville o il soit
impossible d'entendre de bons concerts, parce qu'il n'y a pas assez de personnes
disposes payer le prix lev ncessaire en couvrir la dpense. Pour la musique de
premier ordre la demande n'est lastique que dans les grandes villes; pour la musique
de second ordre la demande est lastique la fois dans les grandes et dans les petites
villes.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
135
D'une faon gnrale, les choses dont la demande a le plus d'lasticit sont celles
qui sont susceptibles d'tre employes de beaucoup de faons diffrentes. L'eau, par
exemple, est utilise d'abord comme boisson, puis pour la cuisine, puis pour la
lessive, et ainsi de suite. Lorsque, sans qu'il y ait disette extrme, l'eau se vend au
seau, il peut se faire que le prix en soit assez bas pour permettre, mme aux gens des
classes pauvres, d'en boire autant qu'ils en ont envie, mais que pour la cuisine ils
emploient parfois la mme eau deux. fois ou plus, et qu'ils s'en servent rarement pour
laver. Les gens ds classes moyennes n'emploieront peut-tre pas deux fois la mme
eau pour la cuisine ; mais pour laver ils feront servir beaucoup plus longtemps le
mme seau d'eau que s'ils en avaient une quantit illimite leur disposition. Lorsque
l'eau est fournie par des conduites, et se paye au mtre cube un prix trs bas, bien
des gens en emploient, mme pour laver, autant qu'ils ont envie de le faire.
Lorsqu'elle ne se paye pas au mtre, mais par abonnement, pour un prix annuel fixe,
et qu'on peut l'avoir partout o l'on en a besoin, l'emploi en est pouss pour chaque
usage jusqu' complte satit 1.
D'une faon gnrale aussi, les choses dont la demande a au contraire trs peu
d'lasticit sont : premirement les objets de ncessit absolue (s'opposant aux objets
de ncessit conventionnelle dont le rle est de maintenir l'aptitude productrice);
secondement certains de ces objets de luxe que les riches consomment sans y consacrer beaucoup de leur revenu.
Retour la table des matires
5. - Jusqu' prsent nous n'avons pas tenu compte des difficults qu'il y a
dresser des listes exactes de prix de demande et les interprter correctement. La
premire que nous ayons envisager vient de l'lment de temps, source de plusieurs
des plus grosses difficults en conomique.
Une liste de prix de demande reprsente les changements de prix d'une marchandise dus aux variations des quantits offertes en vente, toutes choses restant gales ;
mais, en fait, les choses restent rarement gales pendant la priode de temps
ncessaire pour runir des statistiques compltes et dignes de foi. Toujours des causes
perturbatrices se prsentent, dont les effets sont confondus avec ceux de la cause
particulire que nous dsirons tudier, sans pouvoir en tre aisment spars. Cette
difficult se trouve aggrave parle fait que, en conomique, une cause produit
Ainsi donc la demande totale d'une chose comme l'eau, de la part d'une personne, est l'ensemble
(ou le compos, voir liv. V, chap. VI, 3) de sa demande pour chaque usage de cette chose ; tout
comme la demande d'une marchandise susceptible d'un seul usage de la part d'un groupe de
personnes de fortunes diffrentes est le total des demandes de chaque membre du groupe. Autre
chose : la demande de petits pois de la part d'une personne riche est considrable mme lorsqu'ils
sont trs chers, mais lorsque leur prix baisse elle perd toute lasticit un prix qui est encore lev
pour le consommateur pauvre; de mme la demande d'une personne en eau boire est
considrable, mme lorsque l'eau est trs chre, mais elle perd toute lasticit mme un prix qui
est encore relativement lev quant sa demande en eau pour nettoyer sa maison. Le total des
demandes de petits pois de la part d'un certain nombre de personnes de classes diffrentes garde
bien plus longtemps son lasticit que la demande d'une seule personne ; de mme la demande en
eau de la part d'une personne pour ses diffrents usages garde son lasticit beaucoup plus
longtemps que sa demande en eau pour un seul de ses usages. Voir un article de J.-B. CLARK, A
Universal Law of Economic Variation, dans Harvard Journal of Economics, vol. VIII.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
136
rarement ses pleins effets en une fois, mais qu'ils durent souvent aprs qu'elle a cess
d'exister.
C'est ainsi, par exemple, que le pouvoir d'achat de la monnaie est en continuel tat
de changement ; il nous faut donc corriger les rsultats que nous avons obtenus en
raisonnant comme si la monnaie gardait une valeur uniforme. On peut cependant
triompher assez bien de cette difficult, puisque nous pouvons constater avec une
exactitude suffisante les changements importants qui se produisent dans le pouvoir
d'achat de la monnaie.
Ensuite viennent les changements que subissent la prosprit gnrale et le
pouvoir d'achat dont dispose la socit dans son ensemble. L'influence de ces
changements est grande, mais moins peut-tre qu'on ne le suppose gnralement. En
effet, lorsque la prosprit se ralentit, les prix baissent, et cela augmente les ressources de ceux qui jouissent de revenus fixes, au dtriment de ceux qui tirent leurs
revenus des profits du commerce ou de l'industrie. Les mouvements de prosprit
dcroissante sont apprcis par l'opinion courante presque entirement d'aprs les
pertes manifestes de cette dernire classe de gens; mais les statistiques touchant
l'ensemble de la consommation de marchandises comme le th, le sucre, le beurre, la
laine, etc., prouvent que, dans l'ensemble, la puissance d'achat des gens ne diminue
pas beaucoup pendant ces priodes-l. Il n'en est pas moins vrai qu'elle diminue, et
pour tenir compte de cette diminution il faut la prciser, en comparant les prix et la
consommation d'un nombre de choses aussi grand que possible.
Ensuite viennent les changements dus au dveloppement graduel de la population
et de la richesse. Pour ceux-l, il est ais d'apporter les corrections numriques ncessaires, lorsque les faits sont connus [Voir la note ci-dessous dans lencadr :].
Lorsqu'un tableau statistique indique le dveloppement graduel de la
consommation d'une marchandise pendant toute une longue srie d'annes,
nous pouvons avoir besoin de comparer entre eux les pourcentages dont elle
augmente chaque anne. Cela peut se faire assez aisment avec un peu de
pratique. Mais lorsque les chiffres sont exprims sous la forme d'un
diagramme statistique, on ne peut le faire qu'aprs avoir nouveau transform
le diagramme en chiffres, et c'est une des causes de la dfaveur dans laquelle
beaucoup de statisticiens tiennent la mthode graphique.
Or, par la connaissance d'une simple rgle, la balance peut tre retourne en faveur de la mthode
graphique, au moins pour ce qui concerne ce point. La rgle est la suivante : Supposons que le chiffre
indiquant la consommation d'une marchandise (ou l'importance d'un commerce, ou le rendement d'un
impt, etc.) soit reprsent par des lignes horizontales, parallles Ox (fig. 9), pendant que les annes
correspondantes sont, selon le procd ordinaire, marques gale distance le long de Oy. Pour
mesurer le taux d'augmentation un point P, placez une rgle touchant la courbe en P. Supposons
qu'elle rencontre Oy en t, et que N soit le point qui se trouve sur Oy la mme hauteur verticale que P :
alors le nombre d'annes comprises sur Oy dans l'intervalle Nt est l'inverse de la fraction qui indique le
taux annuel d'accroissement. C'est--dire que si NT comprend vingt annes, la quantit augmente au
taux de 1/20, c'est--dire de cinq pour cent par an ; si Nt comprend vingt-cinq annes, l'augmentation
annuelle est de 1/25 ou de quatre pour cent, et ainsi de suite. Voir une tude de l'auteur de cet ouvrage
dans le numro du Jubil du Journal of the London Statistical Society, juin 1885 ; voir aussi note IV
l'appendice.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
137
Retour la table des matires
6. - Il faut encore tenir compte des changements de mode, de got et
d'habitude 1, de la dcouverte de nouvelles faons d'employer une marchandise, de
l'invention, du perfectionnement, ou de la diminution de prix d'autres objets qui
peuvent tre employs aux mmes usages qu'elle. Dans tous ces cas une grosse
difficult est de tenir compte du temps qui s'coule entre la cause conomique et son
effet. Car il faut du temps pour que la hausse de prix d'une marchandise produise son
plein effet sur la consommation. Il faut du temps pour que les consommateurs se
familiarisent avec les substituts qui peuvent tre employs sa place, et peut-tre
pour permettre aux producteurs de shabituer produire ces substituts en quantits
Suffisantes. Il peut falloir du temps encore pour que l'on prenne l'habitude de se
familiariser avec les nouvelles marchandises, et pour que l'on trouve des procds
permettant de les employer avec conomie.
Par exemple, lorsque le bois et le charbon de bois devinrent chers en Angleterre,
l'habitude de se servir de houille ne se dveloppa que lentement, les loyers ne furent
adapts que lentement son usage, et le commerce ne s'en organisa pas vite, mme
dans les endroits o elle pouvait tre aisment apporte par eau : l'invention des
procds permettant de l'employer comme substitut du charbon de bois dans
l'industrie alla encore plus lentement et elle est mme peine termine aujourd'hui.
De mme, lorsque, il y a quelques annes, le prix de la houille devint trs lev, cela
stimula beaucoup l'invention de procds pour l'conomiser, en particulier dans la
production du fer et dans celle de la vapeur; mais peu de ces inventions avaient eu le
temps de produire leurs rsultats pratiques lorsque la priode de chert prit fin. De
mme, lorsqu'une nouvelle ligne de tramway ou un nouveau chemin de fer suburbain
sont ouverts, ceux-l mme qui habitent ct de la ligne ne prennent pas tout de
suite l'habitude de s'en servir autant qu'ils le pourraient, et un grand laps de temps
s'coule avant qu'un certain nombre de ceux dont les bureaux ou les ateliers sont prs
d'un bout de la ligne changent de logement pour aller habiter. l'autre bout. De
mme, lorsque le ptrole commena devenir abondant, peu de gens se mirent
aussitt s'en servir couramment; peu peu le ptrole et les lampes ptrole
devinrent familiers toutes les classes de la socit : ce serait donc reconnatre trop
d'influence la baisse de prix qui s'est produite depuis lors, si on lui attribuait
entirement l'augmentation de la consommation.
Une autre difficult du mme genre, c'est qu'il y a beaucoup d'achats qui peuvent
tre ajourns pendant un certain temps, mais non pendant longtemps. Il en est souvent
ainsi pour les vtements, et autres choses qui s'usent peu peu, et que l'on peut faire
servir plus longtemps que d'habitude lorsque les prix sont levs. Par exemple, au
dbut de la cotton famine, on constata que la consommation de coton en Angleterre
tait trs faible. Cela tait partiellement d ce que les commerants au dtail
rduisirent leur stock, mais surtout ce que les gens firent servir leurs objets de coton
aussi longtemps que possible sans en acheter d'autres. En 1864, cependant, beaucoup
se trouvrent hors d'tat d'attendre plus longtemps, et la quantit de coton qui entra
dans la consommation du pays cette anne-l fut bien plus grande, quoique le prix ft
1
Sur l'influence de la mode, voir des exemples dans les articles de miss Foley (Economic Journal,
vol. III) et de Miss Heather Bigg (Nineteenth Century, vol. XXIII).
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
138
beaucoup plus lev que dans aucune des annes prcdentes. Pour les marchandises
de ce genre, une disette soudaine n'a donc pas pour effet d'lever immdiatement le
prix jusqu'au niveau qui correspond vritablement la diminution de l'offre. De
mme aux tats-Unis, aprs la grande dpression commerciale de 1873, on a signal
que l'industrie des chaussures Se ranima avant l'industrie du vtement ; la raison en
est qu'il y a en rserve une grande quantit de vieux habits et de vieux chapeaux que
l'on jette comme uss aux poques de prosprit, mais il n'en est pas ainsi au mme
degr pour les chaussures.
Retour la table des matires
7. - Ces difficults tiennent au fond mme : mais il y en a d'autres qui tiennent
simplement aux dfauts plus ou moins invitables de nos sources statistiques.
Nous dsirons obtenir, si possible, une liste des prix auxquels diffrentes quantits
d'une marchandise peuvent trouver acheteurs pendant un temps donn sur un march.
Un march parfait est une rgion, grande ou petite, o il y a un certain nombre
d'acheteurs et un certain nombre de vendeurs, tous si bien sur leurs gardes et si bien
au courant des affaires des uns des autres, que le prix soit toujours en pratique le
mme pour toute la rgion. Mais outre que les gens qui achtent pour leur propre consommation et non pour revendre, ne sont pas toujours l'afft de tous les
changements qui peuvent se produire sur le march, de plus, dans beaucoup de
transactions il n'y a pas moyen de constater exactement quels sont les prix pays. En
outre, il est rare que les limites gographiques d'un march soient traces d'une faon
nette, sauf lorsqu'elles sont marques par la mer ou par des lignes douanires, et
aucun pays n'a de statistiques exactes des marchandises produites chez lui pour la
consommation intrieure.
De plus, mme lorsqu'on peut dresser des statistiques, elles offrent gnralement
quelque ambigut. Elles indiquent d'ordinaire les marchandises comme entres dans
la consommation ds qu'elles passent entre les mains des marchands au dtail; par
suite, il n'est pas facile de distinguer entre une augmentation du stock des marchands
et une augmentation de la consommation. Or les deux choses sont gouvernes par des
causes diffrentes. Une augmentation de prix tend arrter la consommation ; mais si
l'on prvoit que l'augmentation doive continuer, il arrivera probablement, comme
nous l'avons dj signal, que les marchands au dtail augmenteront leurs stocks 1
En outre, il est difficile d'affirmer que les marchandises en question soient toujours de la mme qualit. Aprs un t sec le bl peut tre peu abondant, mais il est
d'une qualit exceptionnelle, et les prix pour l'anne qui suit la rcolte paraissent tre
plus levs qu'ils ne le sont en ralit. Il est possible de tenir compte de ce fait,
1
Lorsqu'on examine les effets des impts, on a l'habitude de comparer entre elles les quantits
entres dans la consommation avant et aprs l'tablissement de l'impt. Mais cela n'est pas exact.
Les marchands au dtail, prvoyant l'impt, augmentent beaucoup leurs stocks avant son tablissement, et pendant quelque temps ensuite ils n'ont que trs peu acheter. Et vice versa lorsqu'un
impt est abaiss. De plus, les droits levs ont pour effet de fausser les rsultats. Par exemple,
lorsque le ministre Rockingham, en 1766, abaissa le droit de douane sur les mlasses de 6 pence
1 penny le gallon, l'importation nominale des mlasses Boston augmenta cinquante fois. Cela fut
principalement d au fait que, avec le droit de 1 penny, il tait meilleur march de payer le droit
que de faire la contrebande.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
139
maintenant que le bl sec de Californie sert d'talon. Mais il est presque impossible de
tenir compte des diffrences de qualit pour un grand nombre de marchandises
manufactures. Cette difficult se prsente mme dans le cas d'une marchandise
comme le th : la substitution, dans ces dernires annes, du th indien au th chinois
qui est plus faible, fait que l'augmentation relle de la consommation est plus grande
qu'il ne parat d'aprs les statistiques.
Note sur les statistiques
de consommation
Retour la table des matires
8. - Beaucoup de gouvernements publient des statistiques gnrales de consommation touchant certaines espces de marchandises. Mais, en partie pour les raisons
qui viennent dtre indiques, elles nous sont de trs peu d'utilit, soit pour nous aider
tracer les relations qui existent entre les variations de prix et les quantits achetes,
soit aussi pour nous aider apercevoir comment se rpartissent entre les diverses
classes de la socit les diffrentes sortes de consommations.
En ce qui concerne le premier de ces objets, c'est--dire la dcouverte des lois
relatives aux variations de la consommation qu'entranent les variations de prix, il
semble que l'on pourrait tirer un grand parti de l'ide indique par Jevons (Theory, pp.
11, 12) au sujet des livres des marchands au dtail. Un boutiquier, ou le directeur d'un
magasin coopratif, dans les quartiers ouvriers d'une ville industrielle, a souvent le
moyen de connatre avec une exactitude suffisante la situation financire de la plupart
de ses clients. Il peut savoir combien de fabriques travaillent, et pendant combien
d'heures par Semaine, et il peut tre au courant de toutes les modifications importantes que subissent les salaires : en fait c'est son mtier de savoir tout cela. Et
d'ordinaire ses clients ont vite fait de s'apercevoir des changements survenus dans le
prix des choses qu'ils consomment couramment. Il se trouvera donc souvent en
prsence de cas o la consommation d'une marchandise augmentera par suite d'une
baisse de son prix, la cause produisant ses effets rapidement, et les produisant sans
l'intervention d'autres causes perturbatrices. Alors mme que des causes perturbatrices interviendraient, il sera souvent mme de tenir compte de leur influence. Par
exemple, il saura que, l'approche de l'hiver, le prix du beurre et celui des lgumes
haussent ; mais le froid fait que l'on aime manger plus de beurre et moins de lgume :
par suite, si les prix de ces deux marchandises, lgumes et beurre, haussent au
moment de l'hiver, il s'attendra voir la consommation des lgumes baisser beaucoup
plus qu'elle ne l'aurait fait sous la seule action de la hausse du prix, et au contraire la
consommation du beurre baisser beaucoup moins. Si cependant, dans deux hivers
conscutifs, le nombre de ses clients a t peu prs le mme, et s'ils ont touch peu
prs les mmes salaires ; si, d'autre part, le prix du beurre a t sensiblement plus
lev dans une anne que dans l'autre, alors la comparaison de ses livres pendant les
deux hivers fournira des indications trs exactes touchant l'influence qu'exercent les
changements de prix sur la consommation. Les commerants au dtail qui fournissent
d'autres classes de la socit doivent parfois tre mme de constater des faits
semblables touchant la consommation de leurs clients.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
140
Si l'on arrivait dresser un nombre suffisant de tableaux de demande pour diffrentes classes de la socit, ils fourniraient le moyen d'estimer indirectement les
variations de la demande totale qu'entranent de grandes variations de prix, et par l le
moyen d'obtenir un rsultat qu'il est impossible d'atteindre par une autre voie. En
effet, en rgle gnrale, le prix d'une marchandise ne varie qu'entre des limites
troites ; les statistiques ne nous fournissent donc aucun moyen direct de deviner ce
qu'en deviendrait la consommation si son prix devenait cinq fois plus lev ou
tombait Un cinquime de son prix actuel. Mais nous savons que sa consommation
serait restreinte presque entire ment aux riches si son prix tait trs haut, et que si
son prix tombait trs bas, la plus grosse partie de ses acheteurs se trouveraient dans
les classes ouvrires. Si donc le prix actuel est trs lev relativement aux classes
moyennes ou aux classes ouvrires, nous pouvons, d'aprs les lois qui rgissent leur
demande au prix actuel, estimer ce que serait la demande des riches si le prix s'levait
au point de devenir trs lev mme pour eux. D'un autre ct, si le prix actuel est
modr relativement aux ressources des riches, nous pouvons infrer de leur demande
ce que serait la demande des classes ouvrires si le prix tombait assez pour devenir
modr mme pour eux. C'est seulement en runissant ainsi des lois de demande
fragmentaires, que nous pouvons esprer arriver par approximation une loi exacte
pour des prix offrant entre eux de grands carts. (C'est--dire que la courbe de
demande gnrale d'une marchandise ne peut pas tre trace avec certitude. sauf dans
le voisinage immdiat du prix courant, jusqu'au moment o nous pourrons arriver la
tracer en runissant les courbes fragmentaires de demande des diffrentes classes de
la socit. Comparer le second paragraphe de ce chapitre).
Lorsque l'on aura fait quelque progrs pour ramener des lois prcises la
demande des marchandises qui sont destines la consommation immdiate, alors,
mais alors seulement, il y aura lieu d'essayer de faire de mme pour les demandes
secondaires qui en dpendent : notamment la demande du travail des ouvriers et de
tous ceux qui participent la production de marchandises en vue de la vente ; ou
encore la demande de machines, usines, voies ferres, matires premires et autres
instruments de production. Quant aux mdecins, aux domestiques et tous ceux qui
ont directement faire au consommateur, la demande de ce genre de travail a le
mme caractre que la demande des marchandises de consommation immdiate, et
ses lois peuvent tre recherches de la mme manire.
Retour la table des matires
9. - Il est trs important, mais aussi trs difficile, de constater quelles sont les
proportions suivant lesquelles les diffrentes classes de la socit distribuent leurs
dpenses entre les choses de ncessit, les choses de confort et les choses de luxe;
entre les choses qui procurent seulement des plaisirs actuels, et celles qui procurent
des rserves de force physique et morale ; enfin entre les choses qui satisfont les
besoins infrieurs, et celles qui stimulent et dveloppent des besoins plus levs.
Diverses tentatives ont t faites dans ce sens sur le Continent dans les cinquante
dernires annes, et, depuis quelque temps, le sujet a t tudi avec un soin de plus
en plus grand, non seulement sur le Continent, mais aussi en Amrique et en
Angleterre.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
141
Nous nous contenterons de citer ici le tableau dress par le grand statisticien Dr
Engel pour la consommation des classes ouvrires intrieures et moyennes dans la
Saxe en 1857 ; il a servi de guide et de terme de comparaison pour les enqutes
suivantes.
Dpenses
1. nourriture
2. vtement
3. logement
4 clairage et chauffage
5. ducation
6. protection lgale
7. soins de sant
8. confort et distractions
Totaux
Proportions des dpenses faites dans la famille
D'un ouvrier ayant
un revenu annuel
de 45 60 .
D'un ouvrier ayant
un revenu annuel
de 90 120 .
D'une personne
de la classe moyenne
ayant un revenu
de 150 200 .
62 pour cent
16 pour cent
12 pour cent
5 pour cent
2 pour cent
1 pour cent
1 pour cent
1 pour cent
100 pour cent
55 pour cent
18 pour cent
12 pour cent
5 pour cent
3,5 pour cent
2 pour cent
2 pour cent
2,5 pour cent
100 pour cent
50 pour cent
18 pour cent
12 pour cent
5 pour cent
5,5 pour cent
3 pour cent
3 pour cent
3,5 pour cent
100 pour cent
On a souvent runi et compar des budgets d'ouvriers. Mais les ouvriers qui
prennent la peine de tenir volontairement leurs comptes ne sont pas des hommes
ordinaires, bien moins encore ceux qui les tiennent avec soin. Lorsqu'il faut complter
les comptes l'aide de la mmoire, la mmoire est porte se laisser influencer par la
faon dont l'argent aurait d tre dpens, surtout si ces comptes sont destins tre
lus par d'autres. Ce sont l des faits dont souffrent ces genres de recherches. Dans ce
domaine o se touchent l'conomie domestique et l'conomie publique, de grands
services pourraient tre rendus par ceux qui ont peu de got pour les spculations plus
gnrales et plus abstraites 1.
1
Des budgets d'ouvriers ont t runis par Eden la fin du XVIIIe sicle, et l'on trouve beaucoup
d'informations de toute espce sur les dpenses des classes ouvrires dans les rapports des
Enqutes sur l'assistance, sur les fabriques, etc. (Commissions on Poor-relif, Factories, etc.). Voir
aussi : un article sur les salaires et les prix dans le Companion du British Almanack de 1834 ;
Workmen's Budgets in Manchester dans le Statistical Journal, 1841-1842 ; TUCKETT, Labouring
Population, 1846 ; SARGANT, Economy of the Working Classes, 1857; rapports des consuls de
Sa Majest On the Condition of the Working Classes in Foreign Countries, 1872 ; l'enqute du
Board of Trade en 1887 ; M. HIGGS, Workmen's Budgets, Statistical Journal, 1893 ; rapports de
la Sous-commission de l'agriculture dans l'Euqute sur le travail (Labour Commission) de 1893,
1894; quelques articles dans les volumes V et VI du Bulletin de l'Institut international de
statistique, dans le vol. V on trouve un aperu tendu des rsultats des grands ouvrages de Le
PLAY, Les ouvriers europens ; le livre du Dr GRUBER, Die Haushaltung der arbeitenden
Klassen, contient le rsum d'un grand nombre d'enqutes faites sur le continent. On a fait
beaucoup dans la mme voie aux tats-Unis ; voir YOUNG, Labour in Europe and America ; les
rapports des divers Bureaux du travail amricains, et surtout les rapports des enqutes du travail de
1886 et 1891 ; l'introduction du Professeur FALKNER au Report on Wholesale Prices, prsent
au Snat en 1893.
La mthode de Le Play est l'tude intensive de tous les dtails de la vie domestique d'un petit
nombre de familles choisies avec soin. Pour bien l'employer, il faut une rare union de jugement
pour choisir les cas, de perspicacit et de sympathie pour les interprter. Lorsqu'elle est bien
employe, c'est la meilleure de toutes les mthodes ; mais, en des mains ordinaires, elle peut
amener des conclusions gnrales plus incertaines encore que celles obtenues par la mthode
extensive qui consiste runir plus rapidement des observations trs nombreuses, les ramener
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
142
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre III : Des besoins et de leur satisfaction
Chapitre cinq
Croix entre diffrents usages de la mme
chose. Usages immdiats et usages
diffrs
Retour la table des matires
1. - Dans l'conomie primitive, la mnagre, lorsqu'elle a constat que la tonte
de l'anne lui a donn un nombre limit d'cheveaux de fil, considre l'ensemble des
besoins de la maison en vtements, et s'efforce de rpartir le fil entre eux de faon
contribuer le plus possible au bien-tre de la famille. Elle pensera qu'elle s'est
trompe si, aprs coup, elle a lieu de regretter de n'avoir pas fait, par exemple, plus de
chaussettes et moins de gilets. Cela voudrait dire qu'elle a mal calcul les points o il
autant que possible une forme statistique, et prendre de larges moyennes o l'on peut penser
que les inexactitudes et les particularits se dtruisent les unes les autres dans une certaine mesure.
Des renseignements relatifs ce sujet ont t runis par Harrison, Petty, Cantillon (dont le
supplment aujourd'hui perdu semble avoir contenu des budgets d'ouvriers), Arthur Young,
Malthus et d'autres. Les jeunes sciences de l'anthropologie et de la dmographie s'occupent
aujourd'hui de ces recherches, et il y a beaucoup glaner dans la Descriptive Sociology des
diverses nations qui est rdige sous la direction de Herbert Spencer ; quoique trop ambitieuse,
elle peut rendre service l'conomiste qui s'en sert avec prudence. Voir aussi LAVOLLE,
Classes ouvrires en Europe ; BARBERET, Le travail en France ; SYMONDS, Arts and Artisans
at Rome and Abroad ; MAYHEW, London Labour ; Charles BOOTH, Life and Labour in London
et Condition of the Aged Poor.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
143
convenait de cesser de faire des chaussettes et des gilets ; qu'elle est alle trop loin
pour les gilets, et pas assez loin pour les chaussettes, et que, aux points o elle s'est
arrte, l'utilit de la laine employe en chaussettes tait plus grande que celle de la
laine employe en gilets. Mais si, au contraire, elle a su s'arrter temps, alors elle a
fait juste ce qu'il fallait de chaussettes et de gilets pour qu'elle retire la mme somme
d'avantages du dernier cheveau de laine qu'elle a employ faire des chaussettes et
du dernier qu'elle a employ faire des gilets. Ceci illustre un principe gnral que
l'on peut exprimer ainsi :
Lorsque quelqu'un possde une chose qui peut tre employe diffrents usages,
il la rpartit entre eux de faon qu'elle ait la mme utilit-limite dans tous; car, si elle
avait plus d'utilit-limite dans l'un que dans l'autre, il gagnerait en dtourner une
certaine quantit du second usage pour l'appliquer au premier 1.
L'conomie primitive, dans laquelle il n'y a que peu d'changes, prsente un grand
inconvnient, c'est qu'une personne peut avoir une si grande quantit d'une chose, de
laine par exemple, qu'aprs l'avoir employe tous les usages possibles, son utilitlimite dans chacun d'eux soit faible : et, en mme temps, elle peut avoir si peu d'une
autre chose, de bois par exemple, qu'il ait pour elle une trs grande utilit-limite.
Cependant, certains de ses voisins peuvent avoir un grand besoin de laine, et avoir
plus de bois qu'ils ne peuvent en employer. Si chacun cde ce qui a pour lui peu
d'utilit, et se procure ce qui en a beaucoup, tout le monde gagne l'change. Mais
faire cette opration par le troc serait ennuyeux et difficile.
La difficult du troc n'est, il est vrai, pas aussi grande lorsqu'il n'y a qu'un petit
nombre de marchandises simples, susceptible chacune d'tre adapte diffrents
usages par le travail domestique ; la femme en tissant et les filles en ]filant font
concorder les utilits-limites de la laine dans ses diffrents usages, pendant que le
mari et les fils font de mme pour le bois.
Retour la table des matires
2. - Mais lorsque les marchandises sont devenues trs nombreuses et trs
spcialises, l'emploi d'une monnaie, c'est--dire d'une chose ayant un pouvoir gnral d'achat, devient un besoin urgent. Seule, en effet, la monnaie peut tre employe
aisment en un nombre illimit d'achats divers. Dans une conomie monnaie, la
bonne gestion consiste fixer de telle manire les points o l'on s'arrte dans chaque
sorte de dpenses, que l'utilit-limite d'un shilling de marchandises dans chacune
d'elles soit la mme. Chacun obtient ce rsultat en cherchant constamment s'il n'y a
pas une chose pour laquelle il dpense trop, et s'il ne gagnerait pas restreindre un
peu ce genre de dpense pour en augmenter un autre.
Ainsi, par exemple, l'employ qui se demande s'il ira la ville en voiture ou
pied, et qui aime prendre quelques douceurs son lunch, compare l'une l'autre les
1
Notre exemple appartient, il est vrai, la production domestique plutt qu' la consommation
domestique. Mais cela tait presque invitable, car il y a trs peu de choses, parmi celles qui sont
prtes tre consommes immdiatement, qui soient susceptibles d'tre employes plusieurs
usages. La thorie de la rpartition des ressources entre diffrents usages a des applications moins
importantes et moins intressantes dans la science de la demande que dans celle de l'offre. Voir
par exemple liv. V, chap. III, 3.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
144
utilits de deux faons diffrentes de dpenser son argent. Et lorsqu'une matresse de
maison exprimente insiste auprs d'un jeune mnage sur l'importance de tenir des
comptes rgulirement, un des principaux motifs de ses conseils c'est qu'ils peuvent
viter ainsi de se laisser entraner des dpenses excessives en meubles ou en autres
choses ; en effet, quoiqu'il soit rellement ncessaire d'en avoir une certaine quantit,
si on en achte avec excs, leur utilit-limite n'est pas en proportion de leur cot. Et
lorsque, la fin de l'anne, les jeunes poux jettent les yeux sur leur budget, et qu'ils
trouvent qu'il est ncessaire de rduire leurs dpenses sur certains points, ils
comparent les utilits-limites des diffrentes dpenses, rapprochant la perte d'utilit
qui rsulterait d'une diminution de dpense sur un point, de celle qui rsulterait d'une
diminution sur un autre : ils s'efforcent de raliser des conomies de telle faon que la
somme d'utilit dont ils se privent soit aussi faible que possible, et que la somme
d'utilit qui leur reste soit aussi grande que possible 1.
Retour la table des matires
3. - Les diffrents usages que l'on peut faire d'une chose ne sont pas tous des
usages actuels : certains peuvent tre des usages actuels, d'autres des usages futurs.
Une personne prudente s'efforcera de distribuer ses ressources entre tous les diffrents
emplois qu'elle en peut faire, prsents et futurs, de faon qu'elles aient dans chacun la
mme utilit-limite. Mais en estimant l'utilit-limite actuelle d'une source de
jouissance loigne, il faut tenir compte de deux choses : en premier lieu, il faut tenir
compte de son incertitude (c'est une proprit objective que toutes les personnes bien
renseignes estiment de la mme manire) ; en second lieu il faut tenir compte de la
diffrence de valeur qui existe entre un plaisir actuel et un plaisir loign (c'est l une
proprit subjective que des personnes diffrentes apprcient de faons diffrentes,
suivant leurs caractres individuels et les circonstances du moment).
Si les hommes regardaient les avantages futurs comme aussi dsirables que des
avantages semblables mais immdiats, ils s'efforceraient probablement de rpartir
leurs plaisirs et leurs autres satisfactions d'une faon uniforme sur tout le cours de leur
vie. Ils seraient donc d'ordinaire disposs renoncer un plaisir actuel pour un plaisir
futur quivalent, pourvu qu'ils aient la certitude de l'obtenir. Mais, en fait, la nature
humaine est constitue de telle sorte que, en estimant la valeur actuelle d'un
plaisir futur, la plupart des gens font gnralement subir une seconde dduction sa
valeur future, sous la forme de ce que l'on peut appeler un escompte, qui va en
augmentant avec le laps de temps pendant lequel le plaisir est diffr. Telle personne
apprciera un plaisir loign presque la mme valeur que celui-ci aurait pour elle s'il
tait immdiat; telle autre, ait contraire, qui possde un moindre degr le pouvoir de
se reprsenter l'avenir, moins de patience et moins d'empire sur soi-mme, se souciera
1
Les budgets de familles ouvrires dont il a t parl au eh. IV, 9, peuvent rendre d'importants
services pour aider les gens distribuer leurs ressources sagement entre les diffrents emplois, de
sorte que l'utilit-limite soit la mme dans chacun. Mais, pour les problmes vitaux de l'conomie
domestique, il est aussi important de savoir bien agir que de savoir bien dpenser. La mnagre
anglaise et la mnagre amricaine savent moins bien que la mnagre franaise tirer parti de
ressources modestes, et ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas acheter, mais parce qu'elles ne
savent pas, comme elle, faire de bons plats avec des morceaux bon march, avec des lgumes, etc.
On dit souvent que l'conomie domestique appartient la science de la consommation ; mais cela
n'est qu' moiti vrai. Les plus grosses fautes dans l'conomie domestique, du moins dans la partie
des classes ouvrires anglo-saxonnes o rgne la sobrit, sont des fautes de production, plutt que
des fautes de consommation.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
145
relativement peu d'un plaisir qui n'est pas la porte de sa main. Et la mme personne
varie d'humeur ; tantt elle est impatiente et avide de jouissances immdiates ; tantt,
au contraire, elle songe l'avenir, et se trouve dispose ajourner toutes les
jouissances qui peuvent l'tre aisment. Parfois elle est d'humeur ne rien dsirer ;
tantt elle est comme les enfants qui enlvent les prunes de leur pudding pour les
manger toutes la fois, tantt comme ceux qui les mettent de ct pour les manger en
dernier. Et, dans tous les cas, lorsque nous calculons le taux auquel une jouissance
future est escompte, nous devons avec soin tenir compte des plaisirs de l'attente.
Les taux auxquels des personnes diffrentes escomptent l'avenir, n'affectent pas
seulement leur tendance pargner, au sens qu'on donne d'ordinaire ce mot, mais
affectent aussi leur tendance acheter des choses qui soient des sources de plaisir
durables, plutt que des choses donnant une jouissance plus grande mais passagre :
acheter un nouveau vtement, plutt que d'aller au caf ; acheter des meubles simples mais solides, plutt que des meubles voyants mais qui seront bientt briss.
C'est surtout pour ces objets que le plaisir de la possession se fait sentir. Bien des
gens tirent du simple sentiment de la proprit plus de satisfaction que ne leur en
donnent les jouissances ordinaires au sens troit du mot : par exemple, les joies que
donne la possession de la terre amnent souvent les gens payer pour elle un prix si
lev qu'ils ne tirent qu'un trs faible intrt de ce placement. La proprit procure par
elle-mme des satisfactions ; elle en procure d'autres par la considration qui s'attache
elle. C'est tantt l'un, tantt l'autre de ces deux lments qui domine, et personne
peut-tre ne se connat assez bien soi-mme, ou ne connat assez bien les autres pour
pouvoir tracer une ligne de dmarcation certaine entre eux deux.
Retour la table des matires
4. - Comme nous l'avons dj dit, il nous est impossible de comparer
quantitativement deux plaisirs, mme si c'est la mme personne qui en jouit, ds lors
que c'est des poques diffrentes. Lorsqu'une personne ajourne un vnement qui
doit lui procurer un plaisir, ce n'est pas le plaisir lui-mme qu'elle ajourne ; mais elle
renonce un plaisir actuel, et l'change contre un autre, ou contre l'attente d'un autre,
pour une date venir : et il nous est, impossible de dire, moins de connatre toutes
les circonstances de l'espce, si elle compte que le plaisir futur sera plus grand que le
plaisir actuel auquel elle renonce. Par suite, mme si nous savons quel taux elle
escompte les vnements agrables futurs, nous ne connaissons pourtant pas pour cela
le taux auquel elle escompte les plaisirs futurs 1.
1
Lorsqu'on classe certains plaisirs comme plus pressants que d'autres, on oublie souvent que
l'ajournement d'un vnement agrable peut modifier les circonstances dans lesquelles il se
produit, et modifier, par suite, le caractre du plaisir lui-mme, Par exemple, on peut dire qu'un
jeune homme escompte un taux trs lev le plaisir des voyages dans les Alpes qu'il espre
pouvoir accomplir lorsqu'il aura fait fortune. Il aimerait beaucoup mieux les accomplir maintenant,
parce qu'ils lui procureraient beaucoup, plus de plaisir.
De mme il peut arriver que l'ajournement d'un vnement agrable aboutisse distribuer un
bien d'une faon ingale au point de vue du temps, et que, prcisment, ce bien-l subisse
fortement l'effet de la loi de diminution de l'utilit-limite. Par exemple, on dit parfois que le plaisir
de manger est particulirement pressant, et il est certain que si un homme se prive de dner
pendant six jours, pour manger sept dners le septime, il y perd, beaucoup : en effet, en ajournant
six dners, on ne petit pas dire qu'il ajourne le plaisir qu'il aurait eu manger six dners sparment, il y substitue au contraire le plaisir de manger pendant un jour d'une faon excessive. De
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
146
Nous pouvons cependant arriver mesurer artificiellement le taux auquel elle
escompte les plaisirs futurs en faisant une double supposition : la premire qu'elle
pense tre peu prs aussi riche la date future que maintenant ; la seconde que son
aptitude jouir des choses que la monnaie permet d'acheter restera dans son ensemble
inchange, bien qu'elle ait pu augmenter certains gards et diminuer d'autres. Dans
ces conditions, si elle est dispose, mais tout juste dispose, conomiser une livre
(25 francs) sur ses dpenses actuelles dans la certitude d'avoir ( sa disposition ou la
disposition des siens) une guine (26 fr. 25) dans un an, nous pouvons parfaitement
affirmer qu'elle escompte les plaisirs futurs dont la certitude est complte (c'est--dire
qui ne sont soumis qu'aux risques de la mortalit humaine) au taux de cinq pour cent
par an. En supposant ralises nos deux conditions, le taux auquel elle escompte les
plaisirs futurs (certains) sera alors gal au taux de l'intrt de l'argent sur le march 1.
Jusque-l nous avons considr chaque plaisir sparment. Mais un grand nombre
des objets que les gens achtent sont des objets durables, c'est--dire qu'ils ne sont pas
consomms en une seule fois. Un bien durable, comme titi piano, est la source
probable d'un grand nombre de plaisirs plus ou moins loigns ; sa valeur pour un
mme, lorsque quelqu'un met de ct des ufs pour l'hiver, il n'a pas la pense qu'ils seront alors
meilleurs que maintenant, il pense qu'ils seront rares et que leur utilit sera plus grande. Tout cela
montre qu'il est important de distinguer nettement entre le fait d'escompter un plaisir futur, et le
fait d'escompter le plaisir qu'on retirera de la jouissance future d'une certaine quantit d'une
marchandise. Dans le dernier cas, nous devons tenir compte des diffrences entre les utilitslimites qu'aura la marchandise aux deux poques : tandis que, dans le premier cas, il en a t tenu
compte une fois pour toutes en estimant la somme de plaisir, et il ne faut pas en tenir compte de
nouveau.
Il est important de rappeler que, en dehors des conditions que nous avons supposes, il n'y a aucun
lien direct entre le taux de l'intrt dans le prt d'argent, et le taux auquel on escompte les plaisirs
futurs. Un homme peut supporter si impatiemment tout dlai que la promesse d'un plaisir dans dix
ans d'ici ne le fasse pas renoncer un plaisir qui est la porte de sa main, et qu'il regarde comme
quatre fois moins grand. Pourtant s'il redoute que dans dix ans il soit si court d'argent (et que
l'argent ait alors pour lui une si grande utilit-limite) qu'une demie-couronne (5 Shillings) puisse
alors lui donner plus de plaisir, ou lui pargner plus de peine, qu'une livre maintenant, cet homme
conomisera quelque chose pour l'avenir, dt-il mme garder cet argent improductif, pour la mme
raison qu'il mettrait des oeufs de ct pour l'hiver. Mais nous nous garons ici dans des questions
qui se rattachent plutt l'tude de l'offre qu' celle de la demande. Nous aurons les envisager de
nouveau diffrents points de vue lorsque nous tudierons l'accumulation de la richesse, et, plus
tard encore, lorsque nous tudierons les causes qui dterminent le taux de l'intrt.
Nous pouvons pourtant examiner ici comment on peut mesurer numriquement la valeur
prsente d'un plaisir futur en supposant que nous connaissions : 1 son montant, 2 la date
laquelle il se ralisera, s'il se ralise, 3 les chances de sa ralisation, et 4 le taux auquel la
personne considre escompte les plaisirs futurs.
Si la probabilit qu'il se ralisera est de trois pour un, de sotte qu'il y ait trois chances sur
quatre en sa faveur, la valeur du plaisir attendu est les trois quarts de ce qu'elle serait s'il tait
certain : si cette probabilit est seulement de sept cinq, de sorte que sept chances sur douze
seulement soient en sa faveur, la valeur du plaisir attendu n'est que les sept douzimes de ce
qu'elle serait s'il tait certain, et ainsi de suite. C'est l sa valeur arithmtique : mais il faut en outre
tenir compte du fait que pour quelqu'un la valeur vritable d'une satisfaction incertaine est
d'ordinaire moindre que sa valeur arithmtique (voir la note de la p. 279). Si le plaisir attendu est
la fois incertain et loign, nous avons faire subir une double dduction sa valeur complte.
Supposons, par exemple, qu'une personne soit dispose donner 10 sh. pour un plaisir actuel et
certain, niais que ce plaisir ne se ralise que dans un an, et que les chances de sa ralisation soient
de trois un ; supposons aussi qu'elle escompte l'avenir au taux de vingt pour cent par an. Alors la
3 88
x 10 sh., c'est--dire de 6 sh. Comparer le
valeur pour elle du plaisir attendu est de
x
4 100
chapitre d'introduction dans Jevons, Theory of Political Economy.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
147
acheteur est l'ensemble de ces services, ou ce que valent pour lui tous ces plaisirs, en
tenant compte de leur incertitude et de leur loignement 1.
Naturellement cette estimation se fait d'une faon grossire. En essayant de lui donner une
prcision numrique (voir la note V l'appendice), nous devons rappeler ce qui a t dit dans ce
paragraphe, et dans le prcdent, sur l'impossibilit de comparer exactement entre eux des plaisirs,
ou autres satisfactions, qui ne se ralisent pas au mme moment, ainsi que sur la condition
d'uniformit que nous avons admise en supposant que l'escompte des plaisirs futurs obit la loi
exponentielle.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
148
Principes dconomie politique : tome 1 :
livre III : Des besoins et de leur satisfaction
Chapitre six
Valeur et utilit
Retour la table des matires
1. - Nous pouvons maintenant examiner la question de savoir dans quelle
mesure le prix pay pour un objet reprsente le bnfice que procure sa possession.
C'est un vaste sujet, sur lequel la science conomique n'a que peu dire, mais ce peu
offre quelque importance.
Nous avons dj vu que le prix qu'une personne paie pour un objet ne peut jamais
excder, et atteint rarement, celui qu'elle serait dispose payer plutt que de se
passer de l'objet : de sorte que la satisfaction qu'elle retire de son achat excde
d'ordinaire celle laquelle elle renonce en abandonnant la somme paye comme prix;
l'achat lui procure donc un excdent de satisfaction. Cet excdent de satisfaction est
mesur conomiquement par la diffrence entre le prix qu'elle consentirait payer
plutt que de se passer de l'objet, et le prix qu'elle paye rellement. Il a quelques
analogies avec la rente ; mais il vaut peut-tre mieux l'appeler simplement le bnfice du consommateur (consumer's surplus).
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
149
Il est vident que le bnfice du consommateur est plus grand pour certaines
marchandises que pour d'autres. Il y a une foule d'objets dont les prix sont trs audessous de ceux que beaucoup de gens consentiraient payer plutt que de s'en
passer, et pour lesquels le bnfice du consommateur est alors trs grand. De bons
exemples sont les allumettes, le sel, un journal d'un sou, un timbre-poste. Ce bnfice
qu'un homme retire du fait d'acheter un prix bas des objets qu'il consentirait payer
fort cher plutt que de s'en passer, peut tre appel le bnfice qu'il retire des
circonstances, ou de son milieu : ou, pour employer un mot qui tait d'un usage
courant il y a quelques gnrations, de sa conjoncture . Notre but dans ce chapitre
est de nous servir de la notion du bnfice du consommateur pour nous aider
apprcier en gros quelques-uns des bnfices qu'une personne retire de son milieu, ou
de sa conjoncture 1.
Retour la table des matires
2. - Pour prciser nos ides, considrons du th achet pour la consommation
d'un mnage. Prenons l'exemple d'un homme qui, si le prix du th tait de 20 sh. la
livre, n'en achterait qu'une livre par an, qui en achterait deux livres si le prix tait de
14 sh., trois livres si le prix tait de 10 sh., quatre livres avec un prix de 6 sh., cinq
livres avec un prix de 4, six livres si le prix tait de 3 sh., et qui en achte sept livres
au prix de 2 sh., qu'atteint le th en ce moment. Nous avons rechercher quel est le
bnfice qu'il retire de cette possibilit d'acheter du th 12 sh. la livre.
Le fait qu'il achte juste une livre lorsque le prix est 90 sh., prouve que la satisfaction totale que lui procure cette livre est aussi grande que celle qu'il se procurerait
en dpensant 20 sh. acheter autre chose. Lorsque le prix tombe 14 sh., il pourrait,
s'il le voulait, continuer n'acheter qu'une livre. Il aurait ainsi pour 14 sh. ce qui, pour
lui, en vaut au moins 20 ; il se procurerait donc un surplus de satisfaction de 6 sh., ou,
en d'autres termes, son bnfice de consommateur serait de 6 sh. Mais, en fait, il
prfre acheter une seconde livre, montrant ainsi qu'il la regarde comme valant au
moins 14 sh. pour lui. Il obtient ainsi pour 28 sh. deux livres de th qui valent au
moins pour lui 20 + 14, c'est--dire 34. Son bnfice n'est en tous cas pas diminu par
son achat, mais reste 6 sh. L'utilit totale des deux livres est au moins de 34 sh., son
bnfice de consommateur est au moins de 6 sh. 2.
1
Ce mot est familier aux conomistes allemands, et il manque beaucoup dans la langue conomique
anglaise. En effet, les mots circonstances (opportunity) et milieu (environment), les seuls que l'on
puisse employer sa place, induisent parfois en erreur. Par conjoncture, dit Wagner
(Grundlegung, 3e d., p. 387), nous entendons l'ensemble des conditions techniques, conomiques, sociales et lgales qui, dans un tat de vie nationale (Volkswirtschaft) fond sur la division
du travail et la proprit prive - notamment la proprit prive du sol et des autres moyens matriels de production - dterminent la demande et l'offre des biens, et par suite leur valeur d'change : cette dtermination tant en rgle gnrale, ou du moins le plus souvent, indpendante de la
volont du propritaire, de son activit, et de sa ngligence.
La premire livre vaut probablement pour lui plus de 20 sh. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle
ne vaut pas moins. Il est probable qu'il retire, mme de celle-l, un petit bnfice. De mme, la
seconde livre vaut probablement pour lui plus de 14 sh. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle vaut
pour lui au moins 14 sh. et moins de 20. Son bnfice ce moment-l est donc au moins de 4 sh.,
mais il est probablement plus grand. Une marge indcise de ce genre existe toujours, les
mathmaticiens le savent bien, lorsque nous observons les effets produits par des changements
considrables comme l'est un changement de prix de 20 , 14 sh. la livre. Cette marge incertaine
aurait disparu si nous avions commenc un prix trs lev pour descendre peu peu par des
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
150
Lorsque le prix tombe 10 sh., il peut, s'il le prfre, continuer n'acheter que
deux livres. Il obtiendrait alors pour 120 sh. ce qui en vaut pour lui au moins 34, son
bnfice serait de 14 sh. Mais en fait il prfre acheter une troisime livre, et, comme
il le fait de son propre gr, nous pouvons tre sr qu'en agissant ainsi il ne diminue
pas son bnfice. Il se procure ainsi pour 30 sh., trois livres de th, dont la premire
vaut pour lui au moins 20 sh., la seconde au moins 14 et la troisime au moins 10.
L'utilit totale de toutes les trois tant de 44 sh. au moins, son bnfice de consommateur est au moins de 14 sh., et ainsi de suite.
Lorsqu'enfin le prix est tomb 2 sh., il achte sept livres qui valent
respectivement pour lui au moins 20, 14, 10, 6. 4, 3 et 2 sh., soit en tout 59 sh. Cette
somme mesure leur utilit totale pour lui, et son bnfice de consommateur est au
moins gal la diffrence entre cette somme et les 14 sh. qu'il paye rellement pour
elles, c'est--dire 45 sh. En d'autres termes, il doit ces 45 sh. de bnfice supplmentaire sa conjoncture, l'adaptation du milieu ses besoins en ce qui concerne le
th. Si cette adaptation cessait, et s'il tait impossible de se procurer du th, aucun
prix, il prouverait un prjudice au moins gal celui qu'il pourrait prouver s'il
dpensait 45 sh. de plus acheter des choses dont la valeur pour lui soit prcisment
gale ce qu'il paye pour elles 1.
changements de prix infinitsimaux d'un penny la livre, en observant quelles variations minimes
chaque changement produit sur la consommation.
Nous avons dit au texte que c'est de lui-mme que notre consommateur achte la seconde
livre. Le sens de cette condition apparat si nous considrons que le prix de 14 sh. pourrait lui tre
offert la condition qu'il prenne deux livres ; il aurait alors choisir entre acheter une livre pour
20 sh. et acheter deux livres 28 sh. : le fait qu'il achte deux livres ne prouverait donc pas que la
seconde livre vaille ses yeux plus de 8 sh. Mais, au contraire, avec les choses telles que nous
avons suppos qu'elles se passent, il prend la seconde livre pour 14 sh, sans qu'il lui soit impos
aucune condition; cela prouve qu'elle vaut pour lui au moins 14 sh. (Supposons que les brioches
cotent un penny pice, mais que l'on en donne sept pour six pence ; si quelqu'un se dcide en
acheter sept, cela prouve qu'il est dispos donner son sixime penny pour avoir la sixime et la
septime brioches ; mais nous ne pouvons pas dire combien il serait dispos donner plutt que
de se passer de la septime brioche seulement.)
On objecte parfois que, mesure que le consommateur augmente ses achats, l'urgence de ses
besoins diminue, et l'utilit de ses achats ultrieurs baisse ; nous devrions donc continuellement
refaire, en l'abaissant un niveau plus bas, les premires parties de notre tableau de prix de
demande mesure que nous arrivons des prix plus bas (c'est--dire tracer nouveau et plus bas
notre courbe de demande mesure qu'elle s'loigne vers la droite). Mais c'est l se tromper sur la
faon dont le tableau de ces prix est tabli. L'objection serait fonde si le prix de demande plac en
regard de chaque nombre de livres de th en reprsentait l'utilit moyenne. Il est exact, en effet,
que si le consommateur payait juste 20 sh. pour une livre, et juste 14 sh. pour une seconde, il
payerait juste 34 sh. pour les deux livres, c'est--dire 17 sh. pour chacune en moyenne. Si donc
notre liste se rfrait aux prix moyens que le consommateur consent payer, et portait 17 sh. en
regard de la seconde livre, alors il n'est pas douteux qu'il nous faudrait refaire la liste avant d'aller
plus loin: en effet lorsque le consommateur achte une troisime livre, l'utilit moyenne de
chacune des trois livres devient infrieure 17 sh.: elle serait en fait de 14 sh. 8 pence si, comme
nous le supposons dans notre exemple, le consommateur payait 10 sh. pour la troisime livre.
Mais cette difficult disparat, entirement avec la manire de dresser la liste des prix de demande
que nous avons adopte : en regard de la seconde livre nous avons inscrit non pas la somme de 11
sh. qui reprsente la valeur moyenne de chacune des deux livres, mais la somme de 14 sh. qui
reprsente l'utilit additionnelle qu'une seconde livre prsente pour le consommateur. Elle ne se
modifie pas lorsqu'il achte une troisime livre dont l'utilit additionnelle est mesure par 10 sh.
En d'autres termes : nous avons dj, en dressant le tableau, tenu compte du fait que chaque nouvel
achat rejaillit sur l'utilit de l'achat que notre consommateur a prcdemment dcid de faire, et il
ne faut pas en tenir compte une seconde fois.
Le Prof. Nicholson (Principles of Political Economy, vol. I, et Economic Journal, vol. IV), s'tant
mpris sur la nature du bnfice du consommateur, lui a adress diverses objections auxquelles le
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
151
Retour la table des matires
3. - De mme, si nous ngligeons pour le moment le fait que la mme somme de
monnaie reprsente des sommes de plaisir diffrentes pour des personnes diffrentes,
nous pouvons mesurer le bnfice supplmentaire que la vente du th procure, par
exemple sur le march de Londres, en calculant la diffrence entre le total des prix
inscrits sur un tableau complet de prix de demande pour le th, et les prix auxquels il
se vend [Voir la note ci-dessous dans lencadr :].
Considrons donc la courbe DD' reprsentant la demande
de tir sur un grand march. Supposons que OH reprsente la
quantit qu'on y vend annuellement au prix HA, une anne
tant l'unit de temps que nous adoptons. Prenons un point M
sur OH et tirons une ligne verticale MP rencontrant la courbe
en P et coupant en R une ligne horizontale tire de A. Nous
supposerons que les diffrentes livres de tir sont comptes
dans l'ordre de l'intensit du dsir des diffrents acheteurs ;
l'intensit du dsir de l'acheteur de chaque livre tant
mesure par le prix qu'il est tout juste dispos payer pour
elle.
La figure nous montre que OM peut tre vendu au prix PM, mais que, un prix
plus lev, il ne pourra pas tre vendu tout fait autant de livres. C'est donc qu'il se
trouve une personne qui achte au prix PM plus de th qu' un prix plus lev, et nous
devons regarder la OMime livre comme vendue cette personne. Supposons, par
exemple, que PM reprsente 4 sh. et OM un million de livres. L'acheteur dont il est
parl au texte est tout juste dispos acheter sa cinquime livre de th au prix de 4
sh., et l'on peut dire que la OMime ou la millionime livre est. achete par lui. Si
AH, et par suite RM, reprsentent 2 sh., le bnfice du consommateur procur par la
OMime livre est gal la diffrence entre PM, ou 4 sh., que l'acheteur de cette livre
aurait t dispos payer pour lui et RM, c'est--dire les 2 sh. qu'il paye rellement.
Supposons que l'on trace un trs mince paralllogramme vertical dont la hauteur soit
PM et dont la base soit la distance le long de Ox qui mesure une unit ou une livre de
th. Alors nous verrons que la satisfaction totale tire de la OMime livre de th est
reprsente (ou mesure, dans l'hypothse faite au dernier paragraphe du texte) par la
grosse ligne droite MP ; que le prix pay pour cette livre est reprsent par la grosse
ligne droite MR, et le bnfice du consommateur retir de cette livre, par la grosse
ligne droite RP.
professeur Edgeworth a rpondu dans la mme revue. Nicholson dit : quoi sert de dire que
l'utilit d'un revenu de 100 livres par an vaut par exemple 1.000 livres par an . Il n'y aurait aucun
avantage cela. Mais il peut tre utile, lorsqu'on compare la vie dans l'Afrique Centrale avec la vie
en Angleterre, de dire que, bien que tout ce que l'on peut acheter avec de la monnaie soit en
moyenne aussi bon march ici que l, pourtant il y a tant de choses que l'on ne peut pas du tout
acheter en Afrique, qu'une personne avec 1.000 livres par an, n'y vit pas aussi bien qu'une autre
avec trois ou quatre cents livres en Angleterre. Si un homme paye 1 penny de page sur un pont,
pour viter de prendre une voiture qui lui coterait 1 sh., nous ne disons pas que son penny vaut un
shilling, mais que son penny, en y ajoutant le service que lui rend le pont (le rle que celui-ci joue
dans sa conjoncture), vaut un shilling ce jour-l. Si le pont disparaissait un jour o il en a besoin,
ce serait comme s'il perdait onze pence.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
152
Supposons maintenant que de minces paralllogrammes, ou d'paisses lignes
droites de ce genre, soient tracs de toutes les positions de M entre O et H, pour
chaque livre de th. Les lignes droites paisses ainsi tires, comme c'est le cas pour
MP, depuis Oz jusqu' la courbe de demande reprsenteront chacune toute la
satisfaction retire d'une livre de th, et toutes ensemble elles occuperont et rempliront entirement toute la surface DOHA. Nous pouvons donc dire que la surface
DOHA reprsente le total de satisfaction tire de la consommation du th. De mme,
chacune des lignes droites tires, comme MR, de Oz jusqu' AC, reprsentent le prix
qui est rellement pay pour une livre de th. Ces lignes droites toutes ensemble
couvrent la surface COHA ; cette surface reprsente donc le prix total pay pour le
th. Enfin, chacune des lignes droites tires, comme RP, de AC jusqu' la courbe de
demande reprsente le bnfice du consommateur pour chaque livre correspondante
de th Ces ligues droites toutes ensemble couvrent la surface DCA ; cette surface
reprsente donc le bnfice total du consommateur que procure le th lorsque son prix
est AH. Mais il faut rpter que, si l'on ne se place pas dans l'hypothse indique au
texte, cette faon gomtrique de mesurer ne fait que runir ensemble des mesures de
bnfices qui ce sont pas apprcis d'aprs une chelle identique. Si l'on ne se place
pas dans cette hypothse, la surface ne reprsente qu'un ensemble de satisfactions de
chacune desquelles le montant n'est pas exactement mesur. C'est seulement dans
cette hypothse que la surface mesure le volume de la satisfaction nette totale
procure par le th ses divers acheteurs.
Cette analyse, avec ses noms nouveaux et son mcanisme compliqu, semble
premire vue laborieuse et irrelle. Mais, l'examiner de prs, on trouvera qu'elle
n'introduit pas de difficults nouvelles, ni de suppositions nouvelles ; elle met
seulement en lumire des difficults et des suppositions qui sont latentes dans le
langage courant des affaires. Car ici, comme en d'autres cas, la simplicit apparente
des phrases courantes dguise une complexit relle, et c'est le devoir de la science de
mettre nu cette complexit latente, de la regarder en face et d'en triompher autant
que possible : nous pourrons ainsi plus tard vaincre des difficults que l'on ne saurait
embrasser solidement avec la pense et le langage vagues de la vie courante.
On dit couramment dans la vie ordinaire que la valeur relle des objets pour un
homme n'est pas mesure par le prix qu'il les paye : que le sel a beaucoup plus de
valeur pour lui que le th, bien qu'il dpense davantage en th qu'en sel, et que cela se
verrait bien s'il tait entirement priv de sel. Nous ne faisons que donner cette ide
une forme technique prcise lorsque nous disons que nous ne pouvons pas nous en
fier l'utilit-limite d'une marchandise pour exprimer son utilit totale, que si
quelqu'un dpense six pence pour acheter un quart de livre de th, au lieu d'acheter du
sel, cela ne veut pas dire qu'il prfre le th, et qu'il n'achterait pas de th s'il ne
savait pas qu'il peut aisment se procurer tout le sel dont il a besoin. Si l'on cherchait
donner plus de prcision ces faons de parler vagues, la marche ordinaire serait
d'apprcier d'abord le prix que le consommateur paierait pour une petite quantit de
th, plutt que de s'en passer ; d'apprcier ensuite ce qu'il paierait pour une quantit
plus grande si le th devenait plus abondant, et ainsi de suite : on additionnerait alors
le tout. On ferait de mme pour le sel et l'on comparerait les deux rsultats. Ce serait
prcisment le procd que nous avons employ dans notre analyse ; mais il resterait
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
153
vague, et si l'on cherchait le rendre plus prcis et plus exact, on dpenserait inutilement beaucoup de peine faute d'employer les termes et l'appareil appropris 1.
La valeur relle d'une chose peut encore tre recherche non plus l'gard d'une
seule personne, mais l'gard d'un groupe d'hommes en gnral. Alors il faudrait
naturellement supposer que c pour commencer , et jusqu' ce qu'il en soit dcid
autrement , une satisfaction de la valeur d'un shilling pour un Anglais quivaut une
satisfaction d'un shilling aussi pour un autre Anglais. Mais qui ne voit que cela n'est
admissible qu' la condition de supposer d'abord que les consommateurs de th et les
consommateurs de sel appartiennent aux mmes classes et comprennent des gens de
toutes sortes de tempraments 2.
Cela nous amne envisager ce fait qu'un plaisir de la valeur d'une livre sterling
est, pour un homme pauvre, quelque chose de beaucoup plus grand qu'un plaisir de la
valeur d'une livre pour un riche. Si, au lieu de comparer le th et le sel qui sont tous
Jeux employs couramment par toutes les classes, nous comparions l'Lin ou l'autre
avec le champagne, ou avec les ananas, la correction qu'il faudrait apporter de ce chef
serait alors plus importante, elle transformerait entirement le caractre de notre
calcul. Dans les prcdentes gnrations, beaucoup d'hommes d'tat, et mme
quelques conomistes, ngligeaient de tenir un compte suffisant des considrations de
ce genre, notamment dans l'tablissement des systmes d'impts. Leurs propos, ainsi
que leurs actes, semblaient dnoter un dfaut de sympathie pour les souffrances des
pauvres gens : le plus souvent ils taient dus simplement un dfaut de rflexion.
Pourtant, au total, parmi les vnements dont s'occupe l'conomique, le plus grand
nombre, de beaucoup, affectent dans des proportions peu prs gales les diffrentes
classes de la socit ; aussi, ds lors qu'il y a galit entre les sommes de monnaie qui
mesurent le plaisir caus par deux vnements, il n'y a pas d'ordinaire de bien grande
diffrence entre le plaisir prouv dans les deux cas. C'est pour cela que le calcul
exact du bnfice du consommateur (consumer's surplus) sur un march, outre qu'il
L'esquisse de cette ide se trouve dans le passage suivant de Harris (On Coins, 1757) qu'Adam
Smith s'est born suivre ; c'est Ricardo qui a pouss l'analyse plus loin (voir ci-dessous la note
la fin du livre V). Harris dit (p. 5) : La valeur des choses est en gnral fixe, non pas d'aprs les
services qu'elles rendent en ralit pour fournir aux hommes ce qui leur est ncessaire, mais plutt
suivant la quantit de terre, de travail et d'habilet, qui est ncessaire pour les produire. C'est peu
prs selon cette proportion que les choses s'changent les unes contre les autres ; et c'est
principalement d'aprs cette chelle que les valeurs intrinsques de la plupart des choses sont
apprcies. L'eau est d'un grand usage et pourtant elle n'a d'ordinaire que peu ou mme pas du tout
de valeur ; c'est que, dans la plupart des cas, elle existe spontanment en si grande abondance
qu'elle chappe la sphre de la proprit prive ; tout le monde peut en avoir en quantit
suffisante, sans autre dpense que celle de la porter ou de l'amener lorsque cela est ncessaire. Au
contraire, les diamants sont trs rares, et ils ont pour cette raison une grande valeur quoiqu'ils ne
soient que de peu d'usage .
On peut concevoir qu'il y ait des personnes d'une haute sensibilit qui souffrent tout particulirement du manque de th ou de sel ; ou des personnes d'une sensibilit gnrale trs grande qui
souffrent de la perte d'une certaine partie de leurs revenus, plus que d'autres personnes places
dans une situation de fortune semblable. Mais nous admettrons que de pareilles diffrences entre
individus peuvent tre ngliges, puisque nous examinons des moyennes prises sur un grand
nombre de gens. Nanmoins, il peut tre ncessaire de rechercher s'il n'y a pas quelque raison
particulire de croire que ceux, par exemple, qui font la plus grande provision de th appartiennent
une catgorie de gens particulirement sensibles. S'il en tait ainsi, il faudrait alors en tenir
compte, avant d'appliquer aux problmes thiques ou politiques les rsultats de l'analyse
conomique.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
154
offre dj beaucoup d'intrt thorique, peut avoir aussi une grande importance
pratique.
Il faut signaler cependant que les prix de demande, d'aprs lesquels nous estimons
pour chaque marchandise son utilit totale et le bnfice du consommateur, supposent
que toutes choses restent gales, mesure que le prix monte. Lorsque, pour deux
marchandises qui servent au mme usage, leurs utilits totales sont calcules de cette
faon, nous ne pouvons donc pas dire que l'utilit totale des deux marchandises
ensemble soit gale la somme des utilits totales de chaque marchandise
sparment 1.
Retour la table des matires
4. - Le fond de notre argumentation subsisterait tout entier, si nous tenions
compte du fait que plus une personne dpense pour une chose, moins est grand son
pouvoir d'en acheter davantage, et plus est grande la valeur de la monnaie pour elle
(en langage technique : chaque nouvelle dpense augmente pour elle la valeur-limite
de la monnaie). Mais si le fond de l'argumentation n'en tait pas altr, sa forme
deviendrait plus embarrasse sans aucun avantage correspondant ; il y a en effet trs
peu de problmes pratiques o les corrections apporter de ce chef aient quelque
importance 2.
1
Dans les ditions prcdentes, certaines phrases ambigus semblent avoir suggr l'opinion contraire quelques lecteurs. Mais additionner les utilits totales de toutes les marchandises, de
manire obtenir l'utilit totale de la richesse dans son ensemble, est une tche qui exige l'emploi
des formules mathmatiques. L'auteur a essay de le faire il y a quelques annes, et il s'est convaincu que, mme si cette tche est thoriquement ralisable, le rsultat serait embarrass de tant
d'hypothses qu'il resterait sans utilit pratique.
Nous avons dj attir l'attention (pp. 231, 239) sur le fait que, certains gards, des choses
comme le th et le caf peuvent tre runies et considres comme une marchandise unique : et il
est vident que si le prix du th devenait inabordable, les gens augmenteraient leur consommation
de caf, et vice versa. Le prjudice qu'prouveraient les gens tre privs la fois de th et de caf
serait plus grand que la somme des prjudices qui leur seraient causs par la privation soit de l'une
seulement, soit de l'autre, de ces deux marchandises: c'est donc bien que l'utilit totale du th et du
caf est plus grande que la somme obtenue en additionnant l'utilit totale du th calcule en
supposant que les gens puissent recourir au caf, et celle du caf calcule en faisant la mme
supposition l'gard du th. On peut thoriquement triompher de cette difficult en groupant les
deux marchandises rivales sur un mme tableau de demande (demand schedule) commun
toutes deux. D'un autre ct, si nous avions dj calcul l'utilit totale du combustible en tenant
compte du fait que sans combustible nous ne pourrions pas avoir l'eau chaude ncessaire pour tirer
des feuilles de th la boisson qu'elles nous donnent, ce serait compter deux fois la mme chose que
d'ajouter cela l'utilit totale des feuilles de th calcule de la faon que nous venons de dire. De
mme l'utilit totale du bl pour l'humanit comprend celle des charrues, et on ne peut pas les
additionner toutes deux, bien que l'on puisse les envisager sparment, envisageant l'utilit totale
des charrues pour certaines questions, et celle du bl pour d'autres. Nous examinerons plus loin
d'autres aspects de ces difficults (livre V, ch. VI).
Patten a insist sur la dernire de ces difficults dans des crits suggestifs et pleins de talent.
Mais dans la tentative qu'il a faite d'exprimer l'utilit d'ensemble de toutes les formes de richesses,
bien des difficults semblent lui avoir chapp.
En langage mathmatique on dirait que les lments ngligs appartiennent au second ordre des
petites quantits. Que, suivant la mthode scientifique courante, il soit lgitime de les ngliger,
c'est l un point qui ne semblerait pas pouvoir tre mis en doute, si Nicholson ne l'avait contest.
Edgeworth lui a rpondu brivement dans Economic Journal, mars 1894 ; Barone a donn une
rponse plus tendue (Giornale degli Economisti, sept. 1894), que Sanger a signale dans
Economic Journal, mars 1895.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
155
Il y a pourtant quelques exceptions. Par exemple, comme Sir R. Giffen l'a signal,
une lvation dans le prix du pain draine tel point les ressources des familles
ouvrires pauvres, et lve tellement l'utilit-limite de la monnaie pour elles, qu'elles
sont obliges de rduire leur consommation en viande et en farineux les plus coteux:
et, le pain tant encore la nourriture la moins chre qu'elles puissent consommer, bien
loin d'on consommer moins, elles en consomment davantage. Mais des cas de ce
genre sont rares ; lorsqu'ils se rencontrent, chacun d'eux doit tre trait part.
Nous avons dj remarqu que nous ne pouvons pas du tout deviner avec exactitude quelle quantit les gens achteraient d'une marchandise des prix trs diffrents
de ceux qu'ils ont l'habitude de payer : ou, en d'autres termes, quels seraient les prix
de demande de cette marchandise pour des quantits trs diffrentes de celles qui sont
vendues d'ordinaire. Notre tableau de prix de demande est donc trs conjectural, sauf
dans le voisinage du prix ordinaire, et quand nous apprcions quel est le montant total
de l'utilit d'une chose, nos apprciations les meilleures sont sujettes de grandes
erreurs. Mais cette difficult n'a pas d'importance pratique. En effet, les principales
applications de la thorie du bnfice du consommateur (consumers's surplus) se
rapportent aux changements qu'il subit lorsque le prix de la marchandise en question
varie dans le voisinage du prix habituel : elles n'exigent donc que des renseignements
que nous nous procurons aisment. Ces remarques s'appliquent avec une force
particulire aux choses de ncessit 1.
Comme il est indiqu la note VI de l'Appendice, si on le dsirait on pourrait tenir compte des
changements subis par l'utilit-limite de la monnaie. Nous serions mme obligs de le faire si nous
essayions d'additionner ensemble les utilits totales de toutes les marchandises ; mais c'est l une
tche irralisable.
La notion du bnfice du consommateur peut, ds maintenant, nous rendre quelques services, et
lorsque nos connaissances statistiques seront plus avances, elle nous servira beaucoup pour
dterminer, par exemple, le dommage que causerait au public ut) impt additionnel de 6 pence par
livre sur le th, ou une augmentation de dix pour cent de son prix de transport. L'importance de la
thorie ne se trouve que peu diminue par le fait qu'elle ne saurait nous servir beaucoup pour
apprcier le dommage caus par une taxe de 30 shillings par livre de th, ou par une augmentation
de dix fois des tarifs de chemins de fer.
Revenant notre dernier diagramme, nous pouvons exprimer cette ide en disant que si A est
le point de la courbe qui correspond la quantit qu'on a l'habitude de vendre sur le march, on
peut obtenir des renseignements qui permettent de tracer la courbe avec une exactitude suffisante
une certaine distance de chaque ct de A. Elle pourra bien rarement tre trace avec une
exactitude mme approximative jusqu'en D ; mais cela n'a pratiquement pas d'importance, parce
que, dans les principales applications pratiques de la thorie de la valeur, nous aurions rarement
nous servir de la courbe de demande tout entire, mme si nous la connaissions. Nous avons
justement besoin de ce que nous pouvons obtenir, c'est--dire d'une connaissance assez exacte de
la courbe au voisinage de A. Nous avons rarement besoin de connatre toute la surface DCA ; il
nous suffit, pour la plupart de nos travaux, de savoir quels sont les changements qu'elle prouve
lorsque A se dplace lgrement d'un ct et de l'autre le long de la courbe. Nanmoins, il sera
commode de supposer provisoirement, comme nous avons en pure thorie le droit de le faire, que
la courbe soit compltement trace.
Il se prsente pourtant une difficult particulire lorsqu'on veut estimer la somme d'utilit des
marchandises ncessaires l'existence. Si on l'essaye, le mieux est peut-tre de partir de la quantit
qui est ncessaire, et de n'estimer l'utilit totale que pour la, partie qui excde cette quantit. Mais
nous devons nous souvenir que le dsir d'une chose dpend beaucoup de la difficult qu'il y a la
remplacer par des substituts (Voir note VI l'appendice).
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
156
Retour la table des matires
5. - Il reste une autre srie de considrations qui sont susceptibles d'tre
ngliges lorsqu'on apprcie les rapports entre le bien-tre et la richesse matrielle.
Non seulement il arrive souvent que le bonheur d'une personne dpende davantage de
sa sant physique, mentale et morale, que des conditions extrieures dans lesquelles
elle vit ; mais, mme parmi ces conditions, beaucoup, qui sont pour son bonheur rel
d'une grande importance, risquent d'tre omises dans un inventaire de sa richesse. Les
unes sont des dons gratuits de la nature, et celles-l pourraient, il est vrai, tre
ngliges sans grand inconvnient si elles taient toujours les mmes pour tout le
monde; mais, en fait, elles varient beaucoup d'un lieu un autre. Beaucoup sont des
lments de richesse collective qui sont souvent omis dans le compte de la richesse
individuelle; mais ils sont importants lorsque nous comparons entre elles diffrentes
parties du monde civilis moderne, et bien plus encore lorsque nous comparons notre
poque avec des poques antrieures.
Les entreprises collectives qui ont pour but d'assurer le bien-tre de tous, comme
par exemple celles qui sont destines l'clairage et l'arrosage des rues, nous retiendront beaucoup vers la fin de nos tudes. Les associations coopratives pour l'achat
d'objets de consommation personnelle ont fait plus de progrs en Angleterre que
partout ailleurs ; mais celles formes par les fermiers ou par d'autres, pour l'achat des
objets ncessaires leur industrie, sont jusqu' prsent restes en retard en Angleterre.
L'une et l'autre forme sont quelquefois dsignes sous le nom d'associations de consommateurs ; mais ce sont en ralit des associations destines conomiser l'effort
dans certaines branches d'entreprises industrielles ou commerciales, et elles
appartiennent la thorie de la Production plutt qu' celle de la Consommation.
Retour la table des matires
6. - Lorsque nous parlons des liens qui existent entre le bien-tre et la richesse
matrielle, nous visons l'afflux rpt, le courant de bien-tre d l'afflux de
richesses se prsentant sous la forme de revenu (incoming wealth), avec facult de
s'en servir et de les consommer. Les richesses que possde une personne lui procurent, par l'usage qu'elle en fait, et par d'autres manires aussi, une somme de
satisfactions parmi lesquelles il faut compter naturellement le plaisir de la possession : mais il y a peu de lien direct entre le montant de ces richesses et la somme de
satisfactions dont jouit son possesseur. C'est pour cela que, dans ce chapitre et dans le
prcdent, nous avons parl des revenus grands, moyens et petits. des classes riches,
moyennes et pauvres, et non pas des biens qu'elles possdent 1.
Suivant une ide mise par Daniel Bernoulli, nous pouvons admettre que la
satisfaction qu'une personne tire de son revenu commence lorsqu'il est suffisant pour
subvenir strictement sa vie, qu'elle augmente ensuite en proportions gales pour
Voir note VII l'appendice.
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
157
toute quantit dont il saccrot, et que les choses se passent de faon inverse en cas de
diminution du revenu 1.
Mais, aprs quelque temps, les richesses nouvelles perdent souvent une grande
partie de leurs charmes. Cela est d en partie l'habitude ; elle fait que les hommes
cessent de prendre plaisir aux objets de luxe et de confort auxquels ils sont habitus,
bien qu'ils souffrent grandement s'ils viennent les perdre. Cela est d en partie aussi
au fait que, mesure que la richesse d'un homme augmente, survient aussi pour lui la
lassitude de l'ge, ou pour le moins une croissante fatigue des nerfs, peut-tre mme
se prennent des habitudes de vie qui affaiblissent la vitalit physique et qui diminuent
la facult de jouir.
Dans tout pays civilis on rencontre des adeptes de la thorie bouddhiste pensant
qu'une existence sereine et tranquille est le plus haut idal de vie, qu'il convient
l'homme sage d'extirper de son me autant de besoins et de dsirs qu'il lui est
possible, que la richesse vritable n'est pas dans l'abondance des biens, mais dans
l'absence des besoins. l'autre extrme sont ceux qui soutiennent que le dveloppement de nouveaux besoins et de nouveaux dsirs est toujours avantageux, parce
qu'il pousse les hommes augmenter leurs efforts. Comme le dit Herbert Spencer, ils
semblent tomber dans l'erreur de croire qu'il faut vivre pour travailler, au lieu de
travailler pour vivre 2.
C'est--dire que si 30 reprsentent la somme strictement ncessaire pour vivre, la satisfaction
qu'une personne tire de son revenu commence ce point, et qu' partir de 40 toute livre
supplmentaire ajoute un dixime aux dix livres qui reprsentent l'aptitude de ce revenu procurer
des satisfactions (its happiness-yielding power). Mais si le revenu tait de 100 , c'est--dire 70
au-dessus du minimum ncessaire pour vivre, il faudrait une augmentation de 7 pour procurer
une satisfaction gale celle que procure 1 avec le revenu de 40 . Avec un revenu de 10.030
il faudrait une augmentation de 1.000 pour produire le mme effet (cf. note VIII J'appendice).
Naturellement, ces estimations sont faites au hasard et sont incapables de s'adapter aux circonstances variables de la vie individuelle. Comme nous le verrons plus tard, les systmes d'impt qui
prvalent l'heure actuelle sont bass sur l'ide de Bernoulli. Les systmes antrieurs demandaient
aux pauvres beaucoup plus qu'il ne convenait d'aprs cette conception. Au contraire, les systmes
d'impt progressif que l'on voit apparatre en plusieurs pays sont, dans une certaine mesure, bass
sur l'ide qu'une augmentation de un pour cent pour un trs gros revenu ajoute moins au bien-tre
de son propritaire qu'une augmentation de un pour cent pour de petits revenus, mme aprs avoir
fait la correction propose par Bernoulli pour le minimum ncessaire la vie.
On peut signaler en passant que deux principes pratiques importants rsultent de cette loi
gnrale suivant laquelle l'utilit que prsente pour quelqu'un une augmentation de revenu d'une
livre diminue avec le nombre de livres qu'il possde dj. Le premier est que le jeu aboutit
toujours une perte conomique, mme lorsqu'il se fait avec des chances parfaitement gales. Par
exemple, un homme possdant 600 fait un pari de 100 chances gales; il est maintenant dans
l'attente d'un plaisir gal la moiti du plaisir que lui procurerait la possession de 700 et la
moiti du plaisir que lui procurerait celle de 500 ; or, cela est infrieur l'attente sre du plaisir
que lui procure 600 , puisque, par hypothse, la diffrence entre le plaisir tir de 600 et le plaisir
tir de 500 est plus grande que la diffrence entre le plaisir tir de 700 et le plaisir tir de 600. (Cf.
note IX l'appendice, et Jevons, loc. cit., ch. IV). Le second principe, qui est la rciproque directe
du prcdent, est qu'une assurance thoriquement correcte contre les risques quivaut toujours
un bnfice conomique. Mais, naturellement, chaque tablissement d'assurance, aprs avoir
calcul quelle est la prime thoriquement suffisante, doit y ajouter ce qu'il faut pour payer les
intrts de son capital, et pour couvrir ses dpenses d'administration, parmi lesquelles il faut
souvent compter de trs fortes sommes pour la publicit et pour les pertes rsultant des fraudes. La
question de savoir s'il est bon de payer la prime que les tablissements d'assurance rclament, est
une question qui doit tre tranche dans chaque cas selon ses conditions particulires.
Voir sa leon sur L'vangile du repos (The Gospel of Relaxation).
Alfred Marshall, Principes dconomie politique (1890), trad. fr., 1906 : livres I, II et III
158
La vrit semble tre que, tant donne la nature humaine telle qu'elle est,
l'homme dgnre rapidement s'il n'a pas quelque tche un peu dure remplir, quelques difficults surmonter : un peu d'effort pnible est ncessaire sa sant
physique et morale. Pour vivre pleinement il faut dvelopper et mettre en jeu autant
de facults que possible, et des facults aussi hautes que possible. C'est un plaisir
intense de poursuivre ardemment un but, que ce soit le succs dans les affaires, le
progrs de l'art et de la science, ou l'amlioration du sort de ses semblables. Pour les
uvres constructives les plus hautes, dans tous les genres, les priodes de surmenage
doivent souvent alterner avec des priodes de lassitude et de stagnation ; mais pour
les gens ordinaires, pour ceux qui n'ont pas de grandes ambitions, c'est un revenu
modr, gagn par un travail modr et continu, qui offre les meilleures conditions
pour le dveloppement de ces habitudes de corps, d'esprit et d'me lui donnent seules
le vrai bonheur.
Dans tous les rangs de la socit il arrive parfois que des individus fassent un
mauvais usage de leur richesse. Nous pouvons dire, d'une faon gnrale, que toute
augmentation de la richesse des classes ouvrires a pour effet de rendre la vie
humaine plus pleine et plus noble, parce qu'elle est, pour la plus grande partie,
employe satisfaire des besoins rels; cependant, mme chez les ouvriers anglais, et
encore plus peut-tre dans les pays neufs, certains symptmes font craindre que ne se
dveloppe chez les ouvriers ce dsir malsain de la richesse dans un but d'ostentation,
qui a t le principal flau des classes riches dans tous les pays civiliss. Les lois
contre le luxe ont toujours t sans effet ; mais ce serait un grand avantage si le
sentiment moral de la collectivit pouvait amener les gens viter tout ce qui est
talage de richesse individuelle. Due magnificence sagement ordonne peut, il est
vrai, procurer des plaisirs vritables et nobles ; mais pour cela elle doit tre pure de
toute vanit personnelle d'un ct, et de toute envie de l'autre, comme lorsqu'elle se
manifeste en difices publics, parcs publics, collections publiques de tableaux, jeux et
amusements publics. Tant que la richesse est employe fournir chaque famille les
choses ncessaires l'existence et la culture, ou multiplier les formes leves de
jouissances collectives, alors la poursuite de la richesse est un but noble. Les plaisirs
que la richesse procure iront probablement en augmentant, mesure que se
dvelopperont ces formes d'activit suprieures, au progrs desquelles elle sert.
Lorsque le ncessaire est assur, chacun devrait chercher augmenter la beaut
des objets qu'il possde, plutt que leur nombre ou leur richesse. Un progrs dans le
caractre artistique des meubles ou des vtements exerce les facults de ceux qui les
fabriquent, et est une source de plaisirs croissants pour ceux qui s'en servent. Mais si,
au lieu de rechercher plus de beaut, nous dpensons nos ressources croissantes
rendre nos objets de mnage plus nombreux et plus embarrassants, nous n'y gagnons
aucun avantage vritable, aucun plaisir durable. Le monde irait beaucoup mieux si
chacun achetait moins de choses et des choses plus simples, et se proccupait de les
choisir pour leur beaut relle, cherchant sans doute avoir de la bonne marchandise,
mais prfrant acheter peu d'objets bien faits et faits par des ouvriers bien pays,
plutt que beaucoup d'objets mal faits par des ouvriers mal pays.
Mais nous sortons ici des limites du livre actuel. La question de l'influence
qu'exerce sur le bien-tre gnral la faon dont chaque individu dpense son revenu
est l'une des plus importantes parmi les applications de la science conomique l'art
de vivre qui trouveront place la fin de ce trait.
Fin du Livre III.
Vous aimerez peut-être aussi
- AFD Economie Africaine 2021Document128 pagesAFD Economie Africaine 2021Souleymane sawadogoPas encore d'évaluation
- Dictionnaire de Science Économique by Beitone (Alain Beitone)Document1 381 pagesDictionnaire de Science Économique by Beitone (Alain Beitone)Tasnim Jan100% (2)
- La Macroéconomie Enfin Comprise - La Macroéconomie Expliquée À Travers L'histoire Et L'actualité Économique (Etc.)Document313 pagesLa Macroéconomie Enfin Comprise - La Macroéconomie Expliquée À Travers L'histoire Et L'actualité Économique (Etc.)Adams KouribaPas encore d'évaluation
- La Monnaie Et Ses PiegesDocument271 pagesLa Monnaie Et Ses PiegesTouriaBenKhouya100% (1)
- Histoire Des Faits Economiques l1Document191 pagesHistoire Des Faits Economiques l1ahminePas encore d'évaluation
- (Emmanuel Buisson-Fenet) La Microeconomie en Prati PDFDocument355 pages(Emmanuel Buisson-Fenet) La Microeconomie en Prati PDFSABRI100% (2)
- Lalphabet Expliqué Aux Enfants (Marc-Alain Ouaknin)Document101 pagesLalphabet Expliqué Aux Enfants (Marc-Alain Ouaknin)Romain Teixeira100% (1)
- Hist Geo C3Document21 pagesHist Geo C3Jean-Philippe Solanet-Moulin100% (8)
- EconomieDocument46 pagesEconomiePositionPas encore d'évaluation
- Introduction À L'analyse ÉconomiqueDocument187 pagesIntroduction À L'analyse ÉconomiqueWalid Jouini100% (2)
- Cours de Théorie Des CyclesDocument45 pagesCours de Théorie Des Cycleshmdniltfi100% (1)
- Les Finances Publiques - Moysan ÉmilieDocument283 pagesLes Finances Publiques - Moysan ÉmilieWessam AzmyPas encore d'évaluation
- Ouvrages de Reference 2021 ENADocument39 pagesOuvrages de Reference 2021 ENAludovicPas encore d'évaluation
- Penser Relations InternationalesDocument435 pagesPenser Relations InternationalesCarlos FreirePas encore d'évaluation
- Économie Des Politiques Publiques by Antoine BOZIO, Julien GRENETDocument129 pagesÉconomie Des Politiques Publiques by Antoine BOZIO, Julien GRENETamson petit-frerePas encore d'évaluation
- Économie - Politique - Internationale ChavagneuxDocument130 pagesÉconomie - Politique - Internationale ChavagneuxGuillaume LamontagnePas encore d'évaluation
- CalligraphieDocument17 pagesCalligraphiechocolatekid67% (3)
- L'incertitude Dans Les Theories Economiques Nathalie Moureau, Dorothee Rivaud-Danset - La Découverte (2007) PDFDocument126 pagesL'incertitude Dans Les Theories Economiques Nathalie Moureau, Dorothee Rivaud-Danset - La Découverte (2007) PDFMarwaneEl-lamraniPas encore d'évaluation
- Politique ÉconomiqueDocument98 pagesPolitique ÉconomiqueChristian FofiePas encore d'évaluation
- Politique économique de la France (1900-2010)D'EverandPolitique économique de la France (1900-2010)Pas encore d'évaluation
- Encyclopédie Berbère Volume 14Document162 pagesEncyclopédie Berbère Volume 14idlisen86% (7)
- Économie - 1001 Citations Utiles Pour Léconomie - PagenumberDocument304 pagesÉconomie - 1001 Citations Utiles Pour Léconomie - PagenumberPatrick TchiraPas encore d'évaluation
- L'economie Monetaire Pas A PasDocument227 pagesL'economie Monetaire Pas A PasDiDou Hechiche100% (1)
- Decroissance Vs Developpement Durable Capitalisme Mondialisation Altermondialisme Ecologie Nature PDFDocument472 pagesDecroissance Vs Developpement Durable Capitalisme Mondialisation Altermondialisme Ecologie Nature PDFAmelNesrinePas encore d'évaluation
- Cours D'economieDocument147 pagesCours D'economieabdelll100% (1)
- Introduction À La Politique Économique Jacques GénéreuxDocument234 pagesIntroduction À La Politique Économique Jacques Généreuxeaigle2Pas encore d'évaluation
- Diagnostic Et Audit de La MaintenanceDocument20 pagesDiagnostic Et Audit de La MaintenanceAbdennacer Htt100% (4)
- Précis D'histoire Des Doctrines Économie SDocument276 pagesPrécis D'histoire Des Doctrines Économie SMavoungouPas encore d'évaluation
- Les Lois Fondamentales de La Stupidite Humaine-MC CipollaDocument224 pagesLes Lois Fondamentales de La Stupidite Humaine-MC CipollaStéphane VinoloPas encore d'évaluation
- Economie Du Developpement PDFDocument332 pagesEconomie Du Developpement PDFYassni YoussefPas encore d'évaluation
- Géopolitique (Helena)Document55 pagesGéopolitique (Helena)slimsimoPas encore d'évaluation
- Sociologie de La PolitiqueDocument132 pagesSociologie de La Politiquedestin-jean-5141Pas encore d'évaluation
- (Que Sais-Je - ) Jean-Michel Berthelot-La Construction de La Sociologie-Presses Universitaires de France (2010)Document107 pages(Que Sais-Je - ) Jean-Michel Berthelot-La Construction de La Sociologie-Presses Universitaires de France (2010)Denisa Elena FocaruPas encore d'évaluation
- BRICS : L'Émergence d'un Nouvel Ordre Mondial: Une Analyse Approfondie des Cinq Puissances Émergentes - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud - et Leur Impact sur l'Avenir MondialD'EverandBRICS : L'Émergence d'un Nouvel Ordre Mondial: Une Analyse Approfondie des Cinq Puissances Émergentes - Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud - et Leur Impact sur l'Avenir MondialPas encore d'évaluation
- Resumen - Économie Du DéveloppementDocument23 pagesResumen - Économie Du DéveloppementAnaBarahona100% (2)
- Cours de Macro-ÉconomieDocument525 pagesCours de Macro-ÉconomieanasabdelPas encore d'évaluation
- Economie Monetaire Internationale 2843710278 Content PDFDocument258 pagesEconomie Monetaire Internationale 2843710278 Content PDFmeone99Pas encore d'évaluation
- F004026 PDFDocument362 pagesF004026 PDFJohnson Jong100% (1)
- Marcel Gauchet Textes Choisis1Document10 pagesMarcel Gauchet Textes Choisis1Anderson MansuetoPas encore d'évaluation
- La Guerre Économique - Note D'analyse Géopolitique N°20Document3 pagesLa Guerre Économique - Note D'analyse Géopolitique N°20Grenoble Ecole de Management100% (2)
- Madagascar Coupdetat 2009Document350 pagesMadagascar Coupdetat 2009Andria Manjaka100% (1)
- Manuel D'aerodrome OndaDocument13 pagesManuel D'aerodrome OndaAbdennacer Htt100% (1)
- Les Vraies Lois de L'économieDocument4 pagesLes Vraies Lois de L'économieECE1DUMAS100% (1)
- Georg Lukacs Réalisme Critique Dans La Littérature RusseDocument442 pagesGeorg Lukacs Réalisme Critique Dans La Littérature RusseJean-Pierre Morbois100% (2)
- La Construction Européenne Et La DémocratieDocument10 pagesLa Construction Européenne Et La DémocratiedebadoloPas encore d'évaluation
- Antoine Compagnon - 1966Document24 pagesAntoine Compagnon - 1966Anonymous HyP72JvPas encore d'évaluation
- Politiques PubliquesDocument5 pagesPolitiques PubliquesCouille_de_Loup100% (2)
- Lewis Mumford La Cite A Travers L HistoireDocument0 pageLewis Mumford La Cite A Travers L HistoireParaboa Clara0% (1)
- Cours Analyse EcoDocument99 pagesCours Analyse EcoKouakou Jean eliezerPas encore d'évaluation
- La Demarche de L'auditDocument16 pagesLa Demarche de L'auditAbdennacer HttPas encore d'évaluation
- Grands Courants de La Pensée ÉconomiqueDocument75 pagesGrands Courants de La Pensée ÉconomiqueMohamedPas encore d'évaluation
- Pages Chronologie Observations OvniDocument926 pagesPages Chronologie Observations OvniBenzemas100% (3)
- Theorie - Evolution Économique Schumpeter IntroDocument148 pagesTheorie - Evolution Économique Schumpeter IntroNicolas DujardinPas encore d'évaluation
- Croissance HorizontaleDocument276 pagesCroissance HorizontaleFaridPas encore d'évaluation
- La mondialisation: Une proposition que l’on ne peut pas refuserD'EverandLa mondialisation: Une proposition que l’on ne peut pas refuserPas encore d'évaluation
- Institutions économiques internationales: Elément de droit international économiquesD'EverandInstitutions économiques internationales: Elément de droit international économiquesPas encore d'évaluation
- Biblio Eco Gestion 2015Document16 pagesBiblio Eco Gestion 2015romuald ouabo100% (1)
- JM Keynes: Théorie Générale de L'emploi, de L'intérêt Et de La MonnaieDocument3 pagesJM Keynes: Théorie Générale de L'emploi, de L'intérêt Et de La Monnaiebeebac2009100% (1)
- Classiques Et NeoclassiquesDocument3 pagesClassiques Et NeoclassiquesArgane ZohayrPas encore d'évaluation
- Finance PubliqueDocument172 pagesFinance Publiquedohni benedictePas encore d'évaluation
- Histoire Du MaliDocument3 pagesHistoire Du Maliballa pierre koivoguiPas encore d'évaluation
- Analyse-Eco Du DVPTDocument51 pagesAnalyse-Eco Du DVPTChristine El MurrPas encore d'évaluation
- Guide de La Libre Circulation Des Personnes Et Des Biens en Afrique de L'ouest - LCDocument16 pagesGuide de La Libre Circulation Des Personnes Et Des Biens en Afrique de L'ouest - LCAkimBiPas encore d'évaluation
- Extrait Travaux Diriges de MicroeconomieDocument14 pagesExtrait Travaux Diriges de MicroeconomieOuthami Bennaceur100% (1)
- Economie de La Connaissance - Sami - ELMINAOUIDocument10 pagesEconomie de La Connaissance - Sami - ELMINAOUIAUDACIEPas encore d'évaluation
- Introduction Ģ L'analyse Économique (Chap.1)Document18 pagesIntroduction Ģ L'analyse Économique (Chap.1)Julia KrikunovaPas encore d'évaluation
- La MondialisationDocument8 pagesLa Mondialisationchaimae el kasmiPas encore d'évaluation
- Présentation 5 Le Dumping FiscalDocument23 pagesPrésentation 5 Le Dumping FiscalahmedPas encore d'évaluation
- Le Modèle Monade De Développement: Le Développement Des Communautés En AfriqueD'EverandLe Modèle Monade De Développement: Le Développement Des Communautés En AfriquePas encore d'évaluation
- Entretien Des AerodromesDocument6 pagesEntretien Des AerodromesAbdennacer HttPas encore d'évaluation
- PUREN Essai Eclectisme PDFDocument230 pagesPUREN Essai Eclectisme PDFHo TenPas encore d'évaluation
- 251 Comptabilité AnalytiqueDocument1 page251 Comptabilité AnalytiqueAbdennacer HttPas encore d'évaluation
- NF C15100Document1 pageNF C15100Abdennacer Htt0% (1)
- Schaeffer Haguenau IDocument319 pagesSchaeffer Haguenau Ib6121432100% (1)
- Fr. Colin Bahariya. Pratiques Funeraires PDFDocument415 pagesFr. Colin Bahariya. Pratiques Funeraires PDFamany tahaPas encore d'évaluation
- P. Huvelin - Histoire Du Droit Commercial - Conception Générale Et État Actuel Des ÉtudesDocument132 pagesP. Huvelin - Histoire Du Droit Commercial - Conception Générale Et État Actuel Des ÉtudesArnOmkarPas encore d'évaluation
- Farel Réformateur PDFDocument51 pagesFarel Réformateur PDFgoforitandgetit007Pas encore d'évaluation
- DR Raphaëlle Taccone, Le Livre de Cratès Un Traité Alchimique Arabe Du Moyen AgeDocument19 pagesDR Raphaëlle Taccone, Le Livre de Cratès Un Traité Alchimique Arabe Du Moyen AgeAnnalesPas encore d'évaluation
- Histoire Des Sciences de Saint Augustin A Galilee Tome1 PDFDocument170 pagesHistoire Des Sciences de Saint Augustin A Galilee Tome1 PDFLorenzo CirrincionePas encore d'évaluation
- La EidéticaDocument22 pagesLa EidéticaduvanPas encore d'évaluation
- Alger 1830-1930 Ou Une Certaine Idée de La Construction de La France - Jean-Jacques JordiDocument8 pagesAlger 1830-1930 Ou Une Certaine Idée de La Construction de La France - Jean-Jacques JordiRBGHPas encore d'évaluation
- Etudesphotographiques 518Document143 pagesEtudesphotographiques 518BenjaminPas encore d'évaluation
- Grec - Le Minotaure Final Final FinalDocument15 pagesGrec - Le Minotaure Final Final Finaldinhchauanh01Pas encore d'évaluation
- 2012 Les Rois de Kinda Dans Arabia Greec PDFDocument72 pages2012 Les Rois de Kinda Dans Arabia Greec PDFmazarbulPas encore d'évaluation
- Nathanthistoire 1 Er 2016 CorrigesmanuelslyceeDocument308 pagesNathanthistoire 1 Er 2016 CorrigesmanuelslyceeMegumin100% (1)
- Providentia Deorum MartinDocument495 pagesProvidentia Deorum MartinKelli GomezPas encore d'évaluation
- Les Logiques Et La Portée Des Modèles Économiques Vers Un Éclairage Du Modèle Du MarocDocument8 pagesLes Logiques Et La Portée Des Modèles Économiques Vers Un Éclairage Du Modèle Du MarocAbdallah ChakorPas encore d'évaluation
- Nab TiDocument105 pagesNab TinajhabibPas encore d'évaluation
- Latour - Ciudad Invisible PDFDocument5 pagesLatour - Ciudad Invisible PDFArbre DesjardinsPas encore d'évaluation
- Géothecnique Et Monuments Hitoriques PDFDocument303 pagesGéothecnique Et Monuments Hitoriques PDFJalal KePas encore d'évaluation
- Maurice Daumas L'histoire Des Techniques Son Objet, Ses Limites, Ses MéthodesDocument29 pagesMaurice Daumas L'histoire Des Techniques Son Objet, Ses Limites, Ses Méthodesze_n6574Pas encore d'évaluation