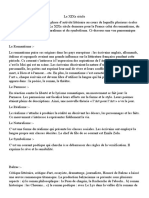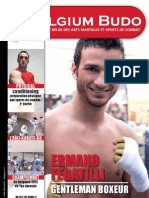Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Elements Pour L Analyse Du Roman
Elements Pour L Analyse Du Roman
Transféré par
Ana-Maria PricopTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Elements Pour L Analyse Du Roman
Elements Pour L Analyse Du Roman
Transféré par
Ana-Maria PricopDroits d'auteur :
Formats disponibles
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
lments pour lanalyse du roman
Sources :
Reuter, Yves, Introduction lanalyse du roman, Dunod, 1996
Jouve, Vincent, La potique du roman, SEDES, 1997
Grard Genette, Figures III, Seuil, 1972
Ce document vous prsente quelques notions centrales pour lanalyse du texte littraire.
Lisez-le et essayez surtout de comprendre, sans vous proccuper ce stade de mmoriser tous
les termes techniques qui y figurent.
Texte
Le texte, du latin textus (tissu), est un ensemble de mots corrls entre eux afin de constituer
une unit logique-conceptuelle. Un texte se diffrencie par rapport un ensemble de mots
juxtaposs au hasard grce la prsence dune finalit communicative. Un texte peut tre bref
(Giuseppe Ungaretti, pote italien du XXe sicle a crit un pome intitul Mattina, qui se
compose de deux vers: Millumino /dimmenso. Le roman Le Pre Goriot est un texte long).
Les textes se diffrencient non seulement par leur longueur, mais aussi par les diffrents buts
quils se donnent. Voici une typologie de base des textes:
- texte descriptif: il contient la description dun objet, dun lieu, dun personne. La
description peut tre objective, lorsquelle est conduite de manire dtache et se donne le but
principal de reproduire lobjet tel quil est ou tel quil apparat (descriptions de btiments, de
lieux, de monuments telles quon les trouve dans les guides touristiques). Elle peut tre
subjective, lorsque la participation motive de lauteur dtermine le choix des mots utiliss
pour dcrire (par ex la description dune personne aime, dans un roman damour).
- texte informatif: a le but dinformer travers une explication. Ex: chroniques
journalistiques ou historiques, relations de voyage ou dexpriences scientifiques;
biographies; manuels scolaires; entres des encyclopdies; guides touristiques.
- texte normatif : a le but de guider le comportement du destinataire du message travers des
obligations, des interdictions, des conseils. Ex: les instructions pour le fonctionnement dun
appareil lectromnager; les rgles des jeux; les rgles respecter dans diffrentes situations
sociales (cole, piscine, bibliothque...); les instructions pour remplir des formulaires; les
instructions pour lemploi dun mdicament; les instructions de lenseignant en vue dun
exercice.
- texte argumentatif : le destinateur dun texte argumentatif a pour but de persuader le
destinataire, en dmontrant ce quil affirme laide de preuves convaincantes.
- texte narratif: a le but de raconter une histoire, cest--dire une srie dvnements lis
entre eux et centrs sur un ou plusieurs personnages. Le texte narratif est appel littraire sil
raconte une histoire qui est le fruit dune invention, mais qui est prsente et accepte par le
lecteur comme si elle stait vritablement produite. Dans une telle histoire, il ny a pas que
les vnements qui soient importants, mais aussi la forme travers laquelle ils sont raconts.
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
Cette union dun contenu et dune forme est source de plaisir pour celui qui lit ou qui coute.
La narration est donc un acte communicatif ayant pour objet la reprsentation dvnements
rels ou imaginaires qui se droulent le long dun axe temporel travers un ensemble de
situations lies entre elles par des rapports de cause et effet. Le but profond dun texte
littraire est de proposer un discours gnral sur lexistence.
Dans la suite de ce document, nous sous intresserons au texte littraire.
Paratexte
Par le mot paratexte on entend tout ce qui entoure le texte sans tre le texte proprement dit
(par ex. le titre, la prface, la table des matires, la postface).
Le paratexte est le lieu o se noue le contrat de lecture entre auteur et lecteur. Le contrat de
lecture indique au lecteur un horizon dattente, cest--dire un champ de possibles qui se
dessinent pour le lecteur avant quil ait commenc sa lecture.
Le titre
Il y a plusieurs types de titres : On distingue :
- le titre thmatique : voque le thme de louvrage, ce dont on parle. Il peut tre
littral (Les Liaisons dangereuses, par de Laclos, qui renvoie au sujet central),
mtonymique (Le Pre Goriot, par Balzac, qui renvoie un personnage secondaire de
lhistoire), mtaphorique (Voyage au Bout de la Nuit, par Cline, qui dcrit le contenu
du texte de faon symbolique), antiphrastique (La Joie de Vivre, par Zola, qui prsente
ironiquement le contenu du roman, o le protagoniste est obsd par la mort).
- le titre rhmatique : dsigne la forme (par ex. Le Roman comique, qui dsigne un
trait formel : lappartenance un genre)
La prface
La prface est normalement crite par lauteur au moment de la premire parution du livre
(prface auctoriale originale). Elle a deux fonctions principales :
- Lincitation la lecture : Pourquoi lire?
la prface insiste sur limportance de la question traite et sur lutilit
(documentaire, intellectuelle, morale, religieuse, politique ou sociale) quil y a
lire louvrage ;
la prface souligne (selon les gots supposs du public auquel le texte
sadresse) loriginalit de luvre, son respect de la tradition ou sa vridicit.
- La programmation de la lecture : Comment lire?
la prface donne toute sorte dinformation qui peut orienter la rception du
roman, guider le lecteur dans sa relation au texte (informations sur
llaboration de luvre, commentaire du titre, dclarations dintention etc.)
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
La prface peut aussi tre ultrieure (crite par exemple pour rpondre aux critiques),
allographe (crite par un tiers), fictionnelle (elle peut par exemple attribuer le texte un
auteur fictif).
Incipit
Lincipit (= les premires lignes dun texte) remplit trois fonctions :
- 1. nouer le contrat de lecture. Lincipit indique la position de lecture adopter pour le
lecteur, en donnant souvent des indications gnriques ( quel genre appartient le texte).
Exemples :
Jinn et Phyllis passaient des vacances merveilleuses, dans lespace, le plus loin
possible des astres habits annonce un roman de type fantastique (La Plante des
Singes, Pierre Boulle)
Dans les premiers jours de lan VIII, au commencement du vendmiaire .,
annonce un roman historique, sur la Rvolution franaise (Les Chouans, Balzac)
Lincipit du roman raliste se caractrise, en gnral, par la rfrence une date et des lieux
prcis, pour que le lecteur reconnaisse dans le texte ce qui existe hors du texte. Lauteur veut
faire oublier le caractre fictif du roman, donner lillusion que lhistoire raconte se confond
avec le monde rel. Il utilise souvent le procd du dbut in media res (expression latine qui
signifie au milieu des choses , cest--dire que le rcit commence au cur de laction), trs
efficace pour authentifier la fiction.
Exemple : lincipit des Noces Barbares, par Yann Quefflec :
Le bain refroidissait. Nicole mergea
- 2. informer : lincipit rpond aux trois questions : qui ? o ? quand ?
Le dbut du roman renseigne le lecteur sur : les personnages principaux, le lieu, lpoque de
laction.
- 3. intresser : lincipit suscite la curiosit du lecteur (en crant une atmosphre, en
annonant une thmatique)
nonc et nonciation
Tout fait linguistique peut sanalyser soit comme nonc, soit comme nonciation.
Lnonc est le produit fini et clos objet dtude de la narratologie
Lnonciation est lacte de communication qui a gnr lnonc (qui? quel
temps ? quel lieu ? quelle intention ?) objet dtude de la sociologie,
lhistoire, la psychanalyse.
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
Auteur et lecteur ; narrateur et narrataire
Une distinction de base pour ltude de la littrature est celle entre le texte et le hors-texte, ou
entre le linguistique et lextra-linguistique. Il faut donc faire la diffrence entre :
dun ct lauteur (qui a exist ou existe, en chair et en os) et le lecteur
(lindividu qui tient le livre entre ses mains) qui existent dans le monde rel ;
de lautre, le narrateur et le narrataire, cest--dire les personnes fictives qui
semblent communiquer dans le texte et qui existent, elles, dans le monde textuel.
Le narrateur est cr par lauteur, cest la voix qui raconte lhistoire lintrieur
du livre. Il nexiste quen mots dans le texte. Le narrataire est celui auquel le
narrateur sadresse dans lunivers du rcit. Il na quune existence textuelle, il
est construit par le roman.
Narrateur et narrataire peuvent tre explicites ou implicites, ils sont en tout cas
consubstantiels au texte. (Reuter, p. 37)
Auteur
Narrateur
Lecteur
Narrataire
Fiction et rfrent
Il ne faudra pas non plus confondre fiction et rfrent:
Fiction : le monde tel quil est reprsent par et dans le texte, limage du monde
construite par le texte, qui nexiste que dans et par ses mots.
Rfrent : notre monde empirique, le rel qui existe hors du texte et auquel le
texte rfre.
Le mot chien naboie pas (Roland Barthes)
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
Histoire/narration/rcit
Ces trois termes sont utiliss par le thoricien Grard Genette pour distinguer trois niveaux
danalyse du texte littraire. Parfois on utilise dautres termes pour signifier les mmes
choses ; ils sont donns entre parenthses.
Lhistoire (fiction, fable) : cest lunivers cr, lintrigue et les actions, les
personnages, lespace, le temps. On peut dire que cest le contenu, le cur du
roman . Cest lobjet dtude de la smiotique.
La narration : cest les choix techniques selon lesquels la fiction est mise en
scne, raconte. Lorsquon sintresse au niveau de la narration, on se pose des
questions comme : Par qui lhistoire est-elle raconte ? Quel est le point de vue
adopt ? Quel est lordre dans lequel les vnements sont narrs ? Selon quel
mode ? On peut dire que cest le contenant, le corps du roman . Cest lobjet
dtude de la narratologie.
La narratologie est donc la discipline qui tudie le rcit en tant que tel, dans ses
formes, indpendamment de son contenu et de son insertion dans la socit.
Le rcit (la mise en texte) : la ralisation concrte de la fiction et de la narration,
travers le choix de mots, la construction des phrases, le choix des figures de
style, le registre de langue utilis.
Cest lobjet dtude de la linguistique et de la stylistique.
Dans ce qui suit, vous trouverez des exemples de comment on peut analyser des lments du
texte littraire situs deux de ces trois niveaux : celui de lhistoire (exemple du personnage)
et celui de la narration (exemples du narrateur, du mode, du temps et de lespace).
Niveau de lhistoire : le personnage
Au niveau de lhistoire, on peut sintresser, par exemple, au personnage. Le personnage peut
tre tudi par exemple partir de son faire et de son tre.
1- Le personnage et son faire
Le thoricien Greimas a class les personnages sur la base de leur fonctionnalit, de leur faire.
Ils sont regroups dans des catgories communes et vus comme des forces agissantes (appels
les actants), ncessaires toute intrigue. Dans le modle de Greimas pour qui le rcit est
une qute il y a six classes dactants, qui occupent chacun sa place dans un schma
relationnel :
- le Sujet et lObjet, sur laxe du vouloir (le sujet cherche lobjet)
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
- lAdjuvant et lOpposant, sur laxe du pouvoir (le premier aide, le deuxime
soppose au Sujet dans la ralisation de son dsir)
- le Destinateur et le Destinataire, sur laxe du savoir (ils font agir le Sujet en le
chargeant de la qute et en sanctionnant le rsultat de celle-ci).
Il est important de comprendre que, selon Greimas, lactant est un rle, une place occupe
dans le schma relationnel. Cette place peut tre occupe par un personnage, mais aussi par
des entits collectives (la famille, le milieu social) ou des valeurs, des ides (largent, la
vrit). Inversement, un mme personnage peut tenir plusieurs rles.
2. Le personnage et son tre
Le thoricien Hamon a analys le personnage non pas travers ce quil fait, mais comme un
tre de papier, dot dun nom (lun des instruments les plus efficaces de leffet de rel) et dun
portrait, qui comprend des traits physiques et moraux. Le portrait du personnage peut
concerner le corps (parfois trs codifi, comme dans les contes de fes), lhabit (qui renseigne,
avant tout, sur lorigine sociale et culturelle du personnage), la psychologie (qui donne
lillusion dune vie intrieure. Le portrait psychologique cre souvent un lien affectif entre le
personnage et le lecteur) et la biographie (en faisant rfrence au pass, elle permet de
renforcer le vraisemblable psychologique du personnage).
A ct de ltre et du faire du personnage, certains thoriciens ont tudi ce quils appellent
leffet-personnage, cest- dire limage que le lecteur a dun personnage, les sentiments quil
lui inspire et qui sont trs largement dtermins par la faon dont il est prsent, valu et mis
en scne par le narrateur. Ils tudient donc comment le texte programme et dirige la relation
qui stablit entre lecteur et personnage.
Niveau de la narration
Au niveau de la narration, on peut sintresser plusieurs aspects :
1. Le statut du narrateur.
2. Les modes de la reprsentation narrative
3. Le temps
4. Lespace
1. Le statut du narrateur
tudier le statut du narrateur signifie se poser la question de savoir qui raconte lhistoire.
Cette question est traite par Grard Genette, selon qui deux donnes doivent tre prises en
compte: la relation lhistoire et le niveau narratif.
6
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
a) La relation lhistoire : le narrateur est-il prsent ou non comme personnage dans lunivers
du roman ?
- le narrateur prsent comme personnage dans lhistoire quil raconte est appel
homodigtique (Watson dans les aventures de Sherlock Holmes, Marcel dans
la Recherche du temps perdu). Si le narrateur est le personnage principal de
lhistoire, on lappelle autodigtique.
- le narrateur absent de lhistoire quil raconte est appel htrodigtique (le
narrateur dans Pre Goriot)
b) Le niveau narratif : le narrateur est-il lui-mme lobjet dun rcit fait par un autre
narrateur?
- le narrateur qui raconte en rcit premier une histoire et nest lui-mme lobjet daucun
rcit est appel extradigtique (cest un cas trs frquent).
- le narrateur qui est lui-mme objet dun rcit est appel intradigtique
(Schhrazade dans Les Mille et Une Nuits, est narratrice intradigtique, puisquelle est
elle-mme objet dun premier rcit, mais narre un rcit second. Le narrateur premier qui
raconte lhistoire de Schhrazade est par contre extradigtique)
Sur la base de ces critres, on distingue quatre situations possibles :
-
Le narrateur extradigtique-htrodigtique : raconte en rcit premier une histoire
do il est absent (le narrateur de Germinal raconte les aventures dtienne dans le
monde de la mine).
Le narrateur extradigtique-homodigtique : raconte en rcit premier une histoire o
il est prsent (le personnage de Gil Blas voquant son pass dans le roman de Lesage).
Le narrateur intradigtique-htrodigtique : raconte en rcit second une histoire
do il est absent (Schhrazade dans les Mille et Une Nuits).
Le narrateur intradigtique-homodigtique : raconte en rcit second une histoire o
il est prsent (le personnage de Dominique, hros de Fromentin, racontant sa vie un
ami anonyme).
2. Les modes de la reprsentation narrative
Sintresser aux modes de la reprsentation narrative signifie tudier la distance et la
focalisation.
La distance renvoie au degr dimplication du narrateur dans lhistoire quil raconte :
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
- le narrateur peut effacer les signes de sa prsence, avec le rsultat que lhistoire semble
se raconter delle-mme, sans la mdiation dun narrateur. La vision sera objective (on
parle de mode mimtique. Dans la tradition anglo-saxonne on appelle ce mode showing).
- le narrateur peut parler en son nom, sans dissimuler les signes de sa prsence. La vision
sera subjective (on parle de mode digtique. Dans la tradition anglo-saxonne on appelle
ce mode telling).
La focalisation concerne le problme de la slection de linformation narrative. Quel est le
point de vue partir duquel lhistoire est raconte ? Qui peroit ? On distingue trois types de
focalisation:
- focalisation zro : (ou absence de focalisation). Aucune restriction de champ, la
vision du narrateur est illimite (on parle de narrateur omniscient), elle nest pas lie
celle dun personnage particulier.
- focalisation interne : le narrateur adapte son rcit au point de vue dun personnage et
ne sait que ce que sait ce personnage.
- focalisation externe : lhistoire raconte de faon neutre. Le narrateur ne saisit que
laspect extrieur des choses. La narration donne limpression que les vnements se
droulent sous lil dune camra, sans tre filtrs par une conscience.
Exemples :
Paul tait angoiss. Il ne savait pas que Marie ltait autant.
Narrateur omniscient : il pntre lintriorit de chaque personnage, il ny a aucune
restriction de champ (focalisation zro).
Paul tait angoiss. Et Marie, que ressentait-elle ? Il ne parvenait pas le dceler
Restriction de linformation, limite au savoir de Paul (focalisation interne)
Lhomme marchait le long de la plage. Ses mains tremblaient lgrement. Une femme
laccompagnait
Le savoir dlivr par le narrateur se limite laspect extrieur des choses (focalisation
externe)
3. Le temps
Genette propose quon distingue deux sortes de temps :
-
Le temps de lhistoire. Un rcit peut voquer une journe, toute une vie ou plusieurs
gnrations. Cest le temps fictif de lhistoire.
Le temps du rcit, cest--dire le temps mis raconter. Ce temps se mesure en lignes,
pages, volumes
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
On peut sintresser aux aspects suivants :
le moment de la narration
la vitesse
la frquence
lordre
Le moment de la narration : quand est raconte lhistoire par rapport au moment o elle est
cense stre droule ?
-
la narration ultrieure : la plus frquente. Le narrateur raconte ce qui sest pass
auparavant.
la narration antrieure : plus rare. Le narrateur anticipe la suite des vnements
(souvent sous forme de rve ou de prophtie), raconte ce qui est cens se passer dans
le futur de lhistoire.
narration simultane : donne limpression quelle scrit au moment mme de laction.
Emploi du prsent.
la narration intercale : typique du journal intime, mixte de narration ultrieure et de
narration simultane. Le rcit au pass sinterrompt de temps en temps pour un
commentaire au prsent.
La vitesse de la narration concerne le rapport entre le temps de lhistoire (la dure fictive
des vnements, en annes, mois, jours, heures) et le temps du rcit (la dure de la
narration, ou plus exactement de la mise en texte, en nombre de pages ou de lignes). La
vitesse concerne donc le rythme du roman, ses acclrations et ses ralentissements. On
distingue quatre relations possibles entre ces deux niveaux temporels:
-
la scne : le temps du rcit est gal au temps de lhistoire (exemple canonique : les
dialogues). La scne visualise, donne limpression que cela se passe sous nos yeux.
Typique du mode mimtique (cf p. 8).
le sommaire : une longue dure dhistoire est condense et rsume en quelques mots
ou quelques pages. Cela produit un effet dacclration
la pause : dsigne les passages o le rcit se poursuit alors quil ne se passe rien sur le
plan de lhistoire. La pause provoque un effet de ralentissement (typique des
descriptions)
lellipse correspond une acclration maximale. Une dure dhistoire (parfois des
annes) est passe sous silence. Dans Lducation sentimentale, le chapitre 2 se
conclut sur la sparation entre Frdric et son ami Deslauriers, et le ch. 3 commence
ainsi,: Deux mois plus tard, Frdric, dbarqu au matin rue Hron, songea
immdiatement faire sa grande visite : les deux mois dont il est question font
lobjet dune ellipse
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
La frquence dsigne le nombre de fois quun vnement fictionnel est racont par
rapport au nombre de fois quil est cens stre produit. On distingue trois relations
possibles :
-
le mode singulatif : le narrateur raconte une fois ce qui sest pass une fois (ou n fois
ce qui sest pass n fois). Typique du rcit daction.
le mode rptitif : consiste raconter plusieurs fois ce qui sest pass une fois.
Typique du roman pistolaire du XVIIIe (pour montrer les diffrences
psychologiques), ou de nombreux romans contemporains (pour relativiser la vrit des
choses).
le mode itratif : consiste raconter une fois ce qui sest pass plusieurs fois. voque
lhabitude et la monotonie. Le mode itratif en est exprim en gnral limparfait.
Lordre : concerne le rapport entre la succession logique des vnements de lhistoire et
lordre dans lequel ils sont raconts.
-
ordre chronologique : les vnements sont narrs dans la succession o ils se sont
produits.
anachronies : lordre dans lequel les vnements sont narrs ne correspond pas
lordre dans lequel ils se sont produits. Deux cas possibles :
anachronie par anticipation (prolepse): consiste narrer lavance un
vnement ultrieur.
anachronie par rtrospection (analepse ou flash back ): consiste
raconter, aprs coup, un vnement antrieur.
4. Lespace
Sintresser lespace dun point de vue narratologique revient sintresser la description
qui le prend en charge (alors que, du point de vue de lhistoire, lespace par exemple la mer,
la ville ou le dsert est tudi comme un contenu avec des valeurs symboliques).
La description peut tre tudie partir de quelques aspects:
- Linsertion : comment sinscrit la description dans lensemble qui constitue le rcit ?
- Le fonctionnement : comment sorganise-t-elle ?
- Les fonctions : quoi sert-elle dans le roman ?
- Linsertion de la description
Toute description est une expansion partir dun thme donn (objet, personnage, lieu) qui
peut tre dsign par un titre. Le thme-titre est ce dont parle la description. Le thme-titre
peut tre prsent de diffrentes manires :
10
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
par ancrage : le thme-titre figure au dbut du passage, ce qui facilite la
comprhension immdiate.
Ex. : Je portai les yeux sur M. Dupont : il tait grand, jeune, etc
par affectation : le thme-titre figure la fin du passage, ce qui suscite le mystre,
la surprise.
Ex. : Je vis venir vers moi un homme grand, jeune, etc Ctait M.
Dupont
Dans les romans ralistes et naturalistes, linsertion de la description exige une motivation. La
description y est souvent mise sur le compte dun personnage et apparat dans des conditions
naturelles (attente du personnage, qui justifie la pause descriptive ; curiosit, qui justifie
son regard, etc.).
- Le fonctionnement et lorganisation de la description
La description fonctionne partir de deux oprations fondamentales :
- laspectualisation : consiste indiquer laspect de ce qui est dcrit en mentionnant les
proprits (la taille, la forme, la couleur, etc) ou les parties, les composants.
- la mise en relation : consiste prciser le lien de lobjet dcrit avec dautres objets :
la situation : indique la place de lobjet dans lespace et dans le temps
lassimilation : indique (par des comparaisons, des mtaphores ou des
reformulations) le rapport de lobjet avec dautres objets
La description sorganise selon des plans :
- plan spatial : les indications spatiales structurent lespace reprsent (haut/bas,
droite/gauche, est/ouest, devant/derrire, etc)
- plan temporel : les indications temporelles (dabord, puis, enfin) dynamisent et
temporalisent la description.
La description est souvent anime par la prsence de verbes de mouvement appliqus des
ralits inertes (staler, sallonger, slever)
- Les fonctions de la description
- dans le roman raliste et naturaliste, la description produit lillusion de la ralit, prsente
lespace-temps, les personnages et les objets comme rels, comme vrais.
- la description diffuse un savoir sur le monde. Cela peut entraner des difficults de lecture
(vocabulaire spcialis, technique)
- la description remplit des rles dans le dveloppement de lhistoire. Elle peut fixer un savoir
sur les lieux et les personnages, donner des indications datmosphre, dramatiser le rcit en
11
Carla Cariboni Killander, SOL, FRAA01
VT 2013
ralentissant laction un moment crucial, disposer des indices pour la suite de lintrigue. Elle
peut donc avoir des fonctions narratives.
- la description signale une prise de position de lcrivain dans lordre esthtique. Elle
sinscrit dans tel ou tel courant littraire. Par exemple, la description romantique se distingue
par la dominance de la mtaphore ; la description raliste par abondance de termes
techniques ; la description du Nouveau Roman se veut objective, elle prend laspect dun
compte rendu.
Ces fonctions ne sont pas exclusives les unes des autres : une mme description peut remplir
plusieurs fonctions simultanment.
12
Vous aimerez peut-être aussi
- Prière Pour Les Couples en DifficultésDocument7 pagesPrière Pour Les Couples en DifficultésEric Merlin100% (1)
- Comment Étudier Un RomanDocument2 pagesComment Étudier Un Romanboukhemis manelPas encore d'évaluation
- La Vie Intellectuelle en France - Des Lendemains de La Révolution À 1914Document660 pagesLa Vie Intellectuelle en France - Des Lendemains de La Révolution À 1914ju2015100% (1)
- 11 - Litterature QuebecoiseDocument47 pages11 - Litterature QuebecoiseWinterTimePas encore d'évaluation
- Les Classes GrammaticalesDocument4 pagesLes Classes GrammaticalesAna-Maria PricopPas encore d'évaluation
- Père GoriotDocument11 pagesPère GoriotABDOUPas encore d'évaluation
- Roman Picaresque Espagnol À La Lumière de La PoétiqueDocument43 pagesRoman Picaresque Espagnol À La Lumière de La PoétiqueDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- A la recherche du temps perdu: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandA la recherche du temps perdu: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Commentaire Composé Sur GerminalDocument2 pagesCommentaire Composé Sur GerminalFaten Rezaigui50% (2)
- Introduction À La Séquence Sur Manon LescautDocument6 pagesIntroduction À La Séquence Sur Manon Lescautel BOUKARAI RaniaPas encore d'évaluation
- Dossier AndromaqueDocument26 pagesDossier AndromaqueetazevedoPas encore d'évaluation
- Roland Barthes Comment Vivre Ensemble Cours Et Seminaires Au College de France 19761977 PDFDocument222 pagesRoland Barthes Comment Vivre Ensemble Cours Et Seminaires Au College de France 19761977 PDFpuppetdark100% (1)
- Le Savant de la langue française au second cycleD'EverandLe Savant de la langue française au second cyclePas encore d'évaluation
- Le Roman Policier - CorrigéDocument18 pagesLe Roman Policier - Corrigézack379Pas encore d'évaluation
- Le Romancier Et Son Personnage - DossierDocument10 pagesLe Romancier Et Son Personnage - DossierpattybellaPas encore d'évaluation
- Fra 170 Littérature Française Le XIXe SiècleDocument4 pagesFra 170 Littérature Française Le XIXe SiècleJoseph VargasPas encore d'évaluation
- Pop Accompaniment PopstinatosDocument11 pagesPop Accompaniment PopstinatosHoàng ThanhPas encore d'évaluation
- Le Père GoriotDocument3 pagesLe Père GoriotkheusssPas encore d'évaluation
- Maupassabt Bel AmiDocument2 pagesMaupassabt Bel AmirhubheniPas encore d'évaluation
- Dossier Huis ClosDocument17 pagesDossier Huis ClosIlyess100% (1)
- Convocation ARA GD Chapitre 02 12 2011Document4 pagesConvocation ARA GD Chapitre 02 12 2011Roberto AmatoPas encore d'évaluation
- Analyse de Texte Partie RomanDocument4 pagesAnalyse de Texte Partie RomanRaphaël GeorgesPas encore d'évaluation
- Le Passé Simple ProfessionnelleDocument14 pagesLe Passé Simple ProfessionnelleTarik Chouaibis100% (1)
- Une SorciereDocument17 pagesUne Sorcieresarah wahib 28Pas encore d'évaluation
- Choisis Vie PDFDocument242 pagesChoisis Vie PDFAna-Maria Pricop100% (1)
- Resume Les Miserables Victor Hugo 1236694288Document5 pagesResume Les Miserables Victor Hugo 1236694288Fouzia BadiPas encore d'évaluation
- Invention Rediger Une Suite de TexteDocument1 pageInvention Rediger Une Suite de TexteFouzia BadiPas encore d'évaluation
- Le Théâtre de L'absurde, Résumé.Document7 pagesLe Théâtre de L'absurde, Résumé.Duilio BoscoPas encore d'évaluation
- Définir Un TexteDocument2 pagesDéfinir Un TexteRi Rithecat100% (1)
- ALBERT CAMUS L'etrangerDocument3 pagesALBERT CAMUS L'etrangerElena MardarePas encore d'évaluation
- Le Contre-Courant Réaliste - Roman Burlesque, Roman PhilosophiqueDocument2 pagesLe Contre-Courant Réaliste - Roman Burlesque, Roman PhilosophiqueMarija KržanPas encore d'évaluation
- Theatre N 15Document2 pagesTheatre N 15Fernan Fortich RestrepoPas encore d'évaluation
- Kit Pour Le CommentaireDocument3 pagesKit Pour Le CommentaireFouzia Badi100% (1)
- 07 Les Registres Litteraires PDFDocument5 pages07 Les Registres Litteraires PDFYoussef AsliPas encore d'évaluation
- Pere Goriot - ExpliqueDocument477 pagesPere Goriot - ExpliqueAna-Maria Pricop100% (2)
- Le Genre ÉpistolaireDocument3 pagesLe Genre ÉpistolaireAliceHopePas encore d'évaluation
- BalzacDocument3 pagesBalzacLessica3Pas encore d'évaluation
- IsomDocument26 pagesIsomNj Nj100% (1)
- Dom Juan Acte 1 Scene 1 Tabac Plan DetailleDocument2 pagesDom Juan Acte 1 Scene 1 Tabac Plan Detailleayouzyouftn100% (1)
- Mona Lisa Leonardo Da Vinci PDFDocument1 pageMona Lisa Leonardo Da Vinci PDFalexrojas_55Pas encore d'évaluation
- Descriptif NaturalismeDocument27 pagesDescriptif NaturalismeBüşra BakarPas encore d'évaluation
- Sur Le Style de ChateaubriandDocument11 pagesSur Le Style de ChateaubriandRomain PtrPas encore d'évaluation
- Analyse Du Roman-ConvertiDocument55 pagesAnalyse Du Roman-ConvertiLailaPas encore d'évaluation
- ClasicismDocument11 pagesClasicismAncuta MaximPas encore d'évaluation
- Caractéristiques Du ROMAN PDFDocument8 pagesCaractéristiques Du ROMAN PDFAissatou WaibaiPas encore d'évaluation
- Le Naturalisme 1Document2 pagesLe Naturalisme 1Sharon GreecePas encore d'évaluation
- Voix Passive PDFDocument5 pagesVoix Passive PDFClamailsPas encore d'évaluation
- Sequence Petit Pays Version PDFDocument8 pagesSequence Petit Pays Version PDFEmmanuelle PetitPas encore d'évaluation
- Fiche de CoursDocument4 pagesFiche de CoursAura Airinei100% (1)
- Annexes LEtrangerDocument32 pagesAnnexes LEtrangerbeebac2009Pas encore d'évaluation
- Analyse Type de FocalisationDocument4 pagesAnalyse Type de Focalisationcarmen_calin8822Pas encore d'évaluation
- Analyse Du CH 3Document3 pagesAnalyse Du CH 3ADRAOUI MOULAY ABDELHAKPas encore d'évaluation
- L Histoire Du TheatreDocument3 pagesL Histoire Du TheatreJipa IoanaPas encore d'évaluation
- La Structure Du ConteDocument1 pageLa Structure Du ConteDuver FotosPas encore d'évaluation
- Analyse de Tirade PhèdreDocument4 pagesAnalyse de Tirade PhèdreMedoJoutiPas encore d'évaluation
- Pour Un Oui Ou Pour Un NonDocument14 pagesPour Un Oui Ou Pour Un NonMhmd KhaskiehPas encore d'évaluation
- Le Thème Éducatif Chez RabelaisDocument12 pagesLe Thème Éducatif Chez RabelaisMoraruElenaPas encore d'évaluation
- LFIAL 1550 - Théorie de La LittératureDocument58 pagesLFIAL 1550 - Théorie de La LittératureLaloPas encore d'évaluation
- Littérature Francaise de 19Document9 pagesLittérature Francaise de 19Amadou Empereur KeitaPas encore d'évaluation
- Catégories Du Récit L'intertextualitéDocument4 pagesCatégories Du Récit L'intertextualitéÎmÀd ÀvëïrøPas encore d'évaluation
- Commentaire ThéorieDocument9 pagesCommentaire ThéoriePreparador Oposición Maestros y Profesores de FrancésPas encore d'évaluation
- Le RéalismeDocument7 pagesLe Réalismepapa yoroPas encore d'évaluation
- Biographie de Guy de MaupassantDocument2 pagesBiographie de Guy de Maupassantالضحك حتى تصبح مضحكPas encore d'évaluation
- Quelques Pistes de Correction Du Sujet S-ESDocument3 pagesQuelques Pistes de Correction Du Sujet S-ESLydia P.BlancPas encore d'évaluation
- Fiches AnalyseDocument7 pagesFiches AnalyseMaria Angeles Rol CortijoPas encore d'évaluation
- L'etranger, IncipitDocument3 pagesL'etranger, IncipitSarah MortagyPas encore d'évaluation
- Cours Théâtre Romantique S4 Section1Document6 pagesCours Théâtre Romantique S4 Section1Choukri OthmanePas encore d'évaluation
- Lecture Analytique Victor Hugo Réponse À Un Acte D'accusationDocument3 pagesLecture Analytique Victor Hugo Réponse À Un Acte D'accusation83squadPas encore d'évaluation
- Dom Juan, L'éloge de L'hypocrisieDocument3 pagesDom Juan, L'éloge de L'hypocrisierhea bachaalaniPas encore d'évaluation
- L'Amant : Etude de L'autobiographie Dans L'œuvre de Marguerite DurasDocument44 pagesL'Amant : Etude de L'autobiographie Dans L'œuvre de Marguerite DurasMASTER MARIUS SHUKURUPas encore d'évaluation
- Pouvoir Plaire Et InstruireDocument2 pagesPouvoir Plaire Et InstruireRACHID CHELHIPas encore d'évaluation
- Support Cours La Competence de CommunicationDocument4 pagesSupport Cours La Competence de CommunicationAna-Maria PricopPas encore d'évaluation
- Le Noel en France 2Document3 pagesLe Noel en France 2Mariana Luminita RafailaPas encore d'évaluation
- Le Journal PDF de Mars de L'association Verdon - InfoDocument36 pagesLe Journal PDF de Mars de L'association Verdon - InfoverdoninfoPas encore d'évaluation
- De Música Ligera - PartesDocument25 pagesDe Música Ligera - Partesjorge gabriel delgadoPas encore d'évaluation
- Annexe 1 - Mise en Forme Avec CSSDocument2 pagesAnnexe 1 - Mise en Forme Avec CSSmistermohPas encore d'évaluation
- Les Livres Du Rallye Lecture PDFDocument15 pagesLes Livres Du Rallye Lecture PDFGrama MariusPas encore d'évaluation
- Quadrum MagazineDocument24 pagesQuadrum MagazinefrancisscribidPas encore d'évaluation
- GlossaireDocument2 pagesGlossaireRosa Espinar HerreroPas encore d'évaluation
- 14114042narrateurs FocalisationsDocument1 page14114042narrateurs FocalisationsMohamed SimPas encore d'évaluation
- Introduction A La Litterature BelgeDocument77 pagesIntroduction A La Litterature BelgeCopăcel Alexandra100% (1)
- De Nul à Jsuis Pas Pire Sur FacebookDocument21 pagesDe Nul à Jsuis Pas Pire Sur FacebookZakaria EncgPas encore d'évaluation
- L'enfant NoirDocument4 pagesL'enfant NoirMoubarek100% (1)
- Cathedrale NotreDocument2 pagesCathedrale NotreПро100 СидPas encore d'évaluation
- 2 AndalusDocument5 pages2 Andalusarchi archPas encore d'évaluation
- PHCH 1347425Document24 pagesPHCH 1347425Eric LefrançaisPas encore d'évaluation
- RebusDocument2 pagesRebusMartin RoxanaPas encore d'évaluation
- Vincent VAN GOGH L'église d'Auvers-sur-OiseDocument2 pagesVincent VAN GOGH L'église d'Auvers-sur-OiseHamid TalaiPas encore d'évaluation
- Rousseauonline 0078 PDFDocument201 pagesRousseauonline 0078 PDFElivelton César SanitáPas encore d'évaluation
- Belgiumbudo 201202 5 KtywpuxDocument64 pagesBelgiumbudo 201202 5 KtywpuxKikou ZeusPas encore d'évaluation
- Viollet - Marion. Thèse Oeuvre Et Public PDFDocument422 pagesViollet - Marion. Thèse Oeuvre Et Public PDFLuis BisbePas encore d'évaluation
- Application de La Propagation Rectiligne de La LumièreDocument4 pagesApplication de La Propagation Rectiligne de La LumièreFã Ţý50% (2)
- A1plus - Interrogation MODULE 2 FrancaisDocument3 pagesA1plus - Interrogation MODULE 2 FrancaismaiariasrPas encore d'évaluation