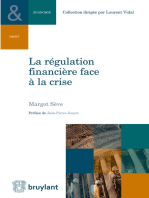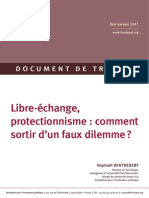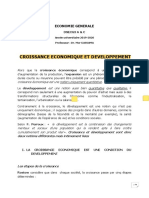Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Intrudoction Economie
Intrudoction Economie
Transféré par
massaridadesTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Intrudoction Economie
Intrudoction Economie
Transféré par
massaridadesDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
Contribution pour le rapport UNESCO Construire des socits du savoir
Introduction lconomie de la connaissance
Bruno Amable (Universit Paris 10 et Cepremap) Philippe Askenazy (Centre National de la Recherche Scientifique et Cepremap)
Le savoir est le pouvoir , Francis Bacon Meditationes Sacrae (1597)
Rsum :
Lattention rcente porte lconomie de la connaissance est lie limportance croissante des activits de recherche et dducation dans lconomie mondiale. Cette augmentation de lintensit en connaissances concerne aussi les technologies associes de linformation et de la communication (TIC). Lconomie de la connaissance se dfinit alors comme un stade du capitalisme o se gnraliserait un modle productif particulier organis autour des complmentarits organisationnelles et technologiques entre les TIC, le capital humain des agents susceptibles dutiliser ces technologies et une organisation ractive de la firme qui permettrait la pleine utilisation du potentiel de productivit des deux premiers lments. Les rseaux tendraient se substituer aux catgories plus classiques dorganisation des marchs. Mais, plutt quune rvolution, lconomie de la connaissance recouvre des mcanismes du dveloppement conomique tudis depuis les auteurs classiques. De plus, lconomie de la connaissance nest certainement pas l eldorado promis, elle bute sur le problme de lasymtrie dinformation, qui ne peut pas tre intgralement rsolu par les TIC. Par ailleurs, seul un optimisme technologique sans borne mnerait la conclusion que la diffusion des TIC peut mener les pays du sud rattraper les pays du nord. La diffusion de ces techniques se comprend en complmentarit avec des changements organisationnels et surtout laugmentation des comptences des individus. Un seul de ces lments transplant dans un contexte diffrent ne peut suffire enclencher une dynamique vertueuse. Ceci devrait mettre en garde contre laspect normatif associ lconomie de la connaissance : rforme des institutions et modes dorganisation accompagnant un nouvel age du capitalisme cens tre caractris par lintensification de la concurrence, la prcarit et lexigence de flexibilit. Une partie de ces lments relve du mythe. Une autre oriente les socits vers un modle unique de capitalisme sous couvert dun dterminisme technologique ou dun impratif de modernit. Il en est probablement de lconomie de la connaissance comme des prcdents ages du capitalisme, elle saccommodera de la diversit.
La place du savoir, des sciences et des technologies dans la dynamique de croissance actuelle donne lieu une intense rflexion au sein du champ conomique. En particulier, de nombreux auteurs soulignent que lon serait entr dans une nouvelle phase du dveloppement capitaliste base sur la connaissance1 succdant une phase daccumulation de capital physique ; cette vision impose des scnarios prospectifs particuliers auxquels sont associes des prescriptions politiques. Lobjectif de cette contribution est de proposer une prsentation critique non exhaustive de ces analyses. Les deux premires parties dcrivent les principaux lments de lconomie de la connaissance, de llment de base que constitue le secteur producteur de savoir et de technologie lirrigation de la connaissance dans lensemble des activits de production et dans lorganisation des marchs. La dernire partie, qui prcde nos propres recommandations, sattache recenser les limites de cette vision notamment sa nonoriginalit historique, la pertinence des scnarios futurs, son inadquation lensemble des pays ou son dtournement idologique . I. Lconomie de la production de savoir et de technologie Lattention rcente porte lconomie de la connaissance ou plutt lconomie fonde sur la connaissance, voire la socit fonde sur la connaissance part du constat que certaines activits immatrielles lies la recherche et lducation tendent prendre une importance croissante dans lconomie mondiale. Cette importance se manifeste dabord de faon quantitative (OCDE, 1996) ; les parts relatives de ces activits dans le PIB ont tendance crotre. Le phnomne est relativement bien document pour les pays dvelopps, o la part des dpenses de recherche et dveloppement (R&D) dans le PIB sest accrue depuis le dbut des annes 1950, comme le dmontre le cas des EtatsUnis repris dans la Figure 1 ; la tendance la hausse est continue pour les dpenses hors financement fdral dans les domaines spatial et militaire.
La nouvelle conomie ne fut quune version de ce concept, centre sur lexprience amricaine des annes 90 et le dveloppement des technologies de linformation et de la communication.
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50% 1950
1960
1970
1980
1990
2000
Figure 1. Ratio des dpenses de R&D au PIB aux Etats-Unis (1953-2000) en %. Lecture : En pointill, dpenses totales ; en continu, hors dpenses fdrales en militaire et spatial. Source des donnes : National Science Foundation.
Plus gnralement, cest la part des investissements intangibles (R&D, ducation, sant) qui sest accrue par rapport aux investissements tangibles (capital physique, ressources matrielles). Les chiffres de Kendrick (1994) montrent que le stock dinvestissement en capital intangible avaient dj dpass le stock de capital tangible au dbut des annes 1990 aux Etats-Unis (Tableau 1). Pour dautres auteurs (Abramovitz et David, 1996), ce phnomne se serait produit ds le dbut des annes 1970, consquence du biais du progrs technique en faveur du capital intangible depuis au moins les annes 1920. Les quelques statistiques disponibles pour les pays du Sud confirment la porte globale du phnomne, traduisant une volution manifeste de lconomie mondiale vers une intensit croissante de la production en connaissances . Le mme constat sapplique aux connaissances incorpores dans les individus. Les niveaux de scolarisation des populations ont augment sur lensemble de la plante, quelques exceptions prs, et les niveaux dtudes atteints par ces populations sont eux aussi en progression constante (Tableau 2). On assiste donc deux volutions parallles et complmentaires affectant les connaissances non incorpores et les connaissances personnelles.
Tableau 1 : Stock de capital rel brut aux Etats-Unis (en milliards de dollars de 1987) 1929 Capital 6075 tangible Capital 3521 intangible Education et 2647 formation R&D 37 Source : Kendrick (1994) 1948 8120 5940 4879 169 1973 17490 17349 13564 1249 1990 28525 32819 25359 2327
Ces modifications dans les inputs de la production se sont accompagnes de modification dans la structure de loutput. Le changement structurel en cours dans les conomies dveloppes depuis le dbut des annes 1970 sest traduit vers une rorientation des structures productives vers des activits reposant plus sur la cration, lutilisation et la diffusion de nouvelles connaissances. Cest ainsi que les activits dites intensives en technologie comme llectronique, linformatique, les tlcommunications ou les biotechnologies ont connu une croissance beaucoup plus rapide que la moyenne des autres secteurs au cours des annes 1980-1990 (OCDE, 2000). Laugmentation de lintensit en connaissances se traduit aussi par une diffusion croissante des technologies associes la transmission de linformation et la communication (les TIC) : matriel informatique, software, internet, tlcommunications etc. Ces activits sont considres comme le support dune phase ascendante dun cycle long. Les branches produisant les TIC prennent une importance croissante dans les structures productives des conomies, aussi bien au nord quau sud comme lillustre le dveloppement du software en Inde, voir Amable et al. (2003) ; linvestissement des entreprises inclus une part croissante de TIC de telle sorte que la production devient de plus en plus intensive en technologies de linformation ; le changement technique et les progrs de productivit sont particulirement rapide dans les secteurs des TIC, ce qui fait que ces technologies, se diffusant rapidement, constituent un moteur de croissance pour lensemble de lconomie. Par ailleurs, les autres secteurs en pointe dans ce nouveau cycle long, comme les biotechnologies, ont aussi une relation troite avec la recherche, la science et lavancement des connaissances. Mais limportance de la connaissance ne se limite pas aux secteurs high-tech (Smith, 2002), et les modes dorganisation, mthodes de productions et les outputs de secteurs apparemment low tech ont aussi t transforms, avec un rle accru pour les bases de connaissance .
Tableau 2 : Nombre moyen dannes de scolarisation de la population ge de plus de 25 ans.
1950
1955 0,90
1960 0,97 1,60
1965 0,65 1,37
1970 0,82 1,24
1975 1,08 1,91
1980 1,55 1,92
1985 2,14 1,93
1990 3,01 1,97
1995 3,91 2,05
2000 4,72 2,23
Algrie Sngal Afrique du Sud Argentine Brsil Core Japon Australie Finlande France Italie Royaume Uni Etats-Unis Pologne
4,07 7,68 4,36
4,08 4,99 2,83 3,30 3,23 6,87 9,43 5,37 5,78 4,56
3,76 5,21 2,78 4,43 7,22 9,30 5,78 5,86 4,77
4,47 5,88 2,92 4,76 6,88 10,09 6,50 5,86 5,22
4,41 5,85 2,78 5,77 7,36 9,81 7,23 6,08 5,28
4,82 6,62 2,98 6,81 8,23 10,02 8,33 6,77 5,32
5,22 6,74 3,22 8,03 8,51 10,06 7,95 7,31 5,76
5,14 7,77 3,76 9,25 9,22 10,12 9,48 7,56 6,16
8,07 8,12 4,17 10,09 9,44 10,31 9,82 7,94 6,60
7,87 8,49 4,56 10,46 9,72 10,57 10,14 8,37 7,00
7,32 7,94
7,67 8,66 6,74
7,17 9,25 6,97
7,66 9,79 7,56
8,01 10,01 8,02
8,17 11,91 8,65
8,44 11,71 8,80
8,74 12,00 9,60
9,03 12,18 9,73
9,35 12,25 9,90
Source : Barro, Robert J. et Jong-Wha Lee, International Data on Educational Attainment,Avril 2000, http://www.cid.harvard.edu/ciddata/ciddata.html
II Vers l'conomie de la connaissance Capital intangible Lconomie de la connaissance tente de dpasser la proccupation majeure des conomistes pour les biens matriels et de porter lattention sur des lments intangibles qui ont voir avec la production de savoir, de science, de comptences techniques et aussi de capital humain . Ces divers lments se distinguent par de nombreux aspects des biens conomiques matriels traditionnels en terme dappropriation et de rivalit dans leur utilisation comme dans leur transmission. Alors que les biens matriels sont en gnral caractriss par la rivalit , au sens o lutilisation dun bien par un agent empche un autre agent dutiliser ce mme bien, la connaissance a une nature de bien
public, non rival ; une mme connaissance peut tre utilise par plusieurs agents sans diminuer lutilit quelle procure chacun. La connaissance a alors pour caractristique que sa production est principalement une affaire de cot fixe, avec un cot marginal de diffusion faible, et ce dautant plus que les progrs accomplis sur les TIC tendent rendre les cots de stockage de la connaissance codifie de plus en plus faibles. Un des aspects les plus importants de lconomie de la connaissance est prcisment, grce aux progrs accomplis sur les TIC mais aussi grce aux progrs de la connaissance, un accroissement considrables des possibilits de codification de linformation (Foray, 2000 ; David et Foray, 2002), qui rendent son stockage et sa manipulation beaucoup plus faciles. Mais la connaissance peut aussi sincarner dans des pratiques plus ou moins codifiables : savoirfaire, mode dorganisation, etc. Lconomie de la connaissance recouvre donc des aspects divers : apprentissage, acquisition de comptences, de capacits cognitives. Un aspect important de lconomie de la connaissance est que ces diverses dimensions sont complmentaires : il est ncessaire que les agents disposent de comptences particulires pour pouvoir bnficier des avances de la connaissance, pour pouvoir utiliser linformation qui est stocke et circule de faon de plus en plus efficace ; les possibilits de stockage et circulation de linformation dpendent des progrs de la codification ; les connaissances se diffusent alors dautant plus rapidement que les progrs dans le TIC sont rapides et que les individus sont duqus et comptents. Ceci repose sur les efforts en R&D et en ducation et formation. Comme la connaissance se produit principalement partir dautres connaissances, il y a dans cette dynamique un fort aspect de cercle vertueux ou vicieux. En effet, lconomie fonde sur la connaissance implique un dpassement de la sparation entre les organisations qui dcouvrent les connaissances, les universits ou les centres de recherche spcialiss, et celles qui les appliquent, les organisations publiques et surtout les firmes (Soete, 2002). La priode contemporaine est caractrise la fois par une plus grande importance stratgique de la connaissance, comme source de comptitivit pour les firmes, et par de plus grandes possibilits de combiner les connaissances pour produire de nouveaux savoirs. Les firmes ont alors un besoin accru davoir accs aux nouvelles connaissances et dtre capables de les mettre profit pour leurs propres objectifs. Cela demande quelles investissent elles-mmes dans la connaissance dans un double but : largir leur propre base de connaissance pour augmenter leur comptitivit (effet direct), et accrotre leurs capacits aller chercher dans les connaissances produites en dehors delles les savoirs potentiellement utiles (effet indirect). On retrouve alors une autre caractristique importante de lconomie de la connaissance : il est au moins aussi important dapprendre apprendre que dapprendre. Ces tendances exercent des effets sur la protection des connaissances, la proprit intellectuelle. Comme la connaissance devient un enjeu de la concurrence, les questions de proprit intellectuelle et de protection de linnovation passent au premier plan des proccupations des firmes et des Etats. Ce phnomne se manifeste notamment par lextension des possibilits de breveter, au-del des seuls artefacts : le squenage des gnes est brevetable aux Etats-Unis depuis 1995 ; les inventions biotechnologiques, des organismes vivants, sont brevetables en Europe depuis 1998 ; lextension de la brevetabilit vers le software se fait progressivement, par le biais de la jurisprudence ; les mthodes commerciales mises en uvre par ordinateur sont reconnues comme brevetables aux Etats-Unis Lconomie de la connaissance reposant sur linnovation, elle a besoin du dynamisme industriel procur par les nouvelles firmes forte intensit en connaissances,
recherche ou science. Ces nouvelles firmes possdent des caractristiques qui rendent leur financement difficile assurer par les intermdiaires financiers traditionnels : marchs nouveaux ou peu dvelopps, incertitude sur les techniques, difficult exercer un contrle clair du dveloppement de la firme par consquent, le dveloppement des startups ncessite une disponibilit en capital-risque. Linnovation industrielle exigerait alors certaines innovations organisationnelles et institutionnelles complmentaires. De nouveaux modles productifs Lconomie de la connaissance se dfinit alors comme lanalyse dun stade particulier du capitalisme caractris par la gnralisation lensemble de lconomie dun modle productif spcifique organis autour des complmentarits organisationnelles et technologiques identifies par les thoriciens2 (par ex. Milgrom et Roberts, 1995 ; Lindbeck et Snower, 1996). Elles impliquent des lments tels que : les TIC et les possibilits tendues de codification, stockage et transmission de linformation quelles permettent ; le capital humain des agents susceptibles dutiliser ces technologies ; une organisation ractive de la firme qui permettrait la pleine utilisation du potentiel de productivit contenu dans les deux premiers lments. La complmentarit entre TIC du moins linformatique- et capital humain est taye par de nombreux travaux empiriques (par ex. Entorf, Gollac et Kramarz., 1999). Lusage des TIC ncessiterait un capital ducatif ou cognitif important, notamment des capacits dadaptation, de gestions de plusieurs tches. En retour, la productivit des plus qualifis serait suprieure. Cette complmentarit expliquerait la hausse des ingalits entre groupes et au sein des groupes de travailleurs dans la plupart des pays du Nord comme du Sud dans les dernires dcennies (Caroli, 2001). Cette face de lconomie de la connaissance ne signifie pas la disparition des tches physiques ou pnibles ; les travailleurs, de louvrier au cadre, doivent la fois supporter des contraintes industrielles ou marchandes et exercer une activit de collecte, de contrle et de gestion de linformation (par ex. Askenazy, 2002). Lorganisation globale du travail semble galement jouer un rle essentiel dans cette conomie de la connaissance. La ractivit demande au travailleur se retrouve au niveau de lentreprise toute entire. Les entreprises, notamment dans les pays du Nord, dveloppent depuis 20 ans des pratiques innovantes de travail dites de haute-performance, ou encore flexibles, qui doivent se substituer progressivement au modle tayloriste. Ces changements organisationnels sinspirent de nombreux concepts thoriques connexes dvelopps depuis une trentaine dannes qui ont mis en vidence le rle des mthodes dorganisation du travail (Ichniowski et al., 1996). Entre autres, on peut citer : - la lean production ou production au plus juste directement issue du toyotisme (limination des stocks, juste--temps, circulation horizontale de linformation, suggestions des salaris pour amliorer les performances et la qualit).
En fait, les arguments thoriques abondent. Une baisse du cot de traitement de l'information sur de nouveaux projets, peut encourager une dlgation de l'autorit formelle (le droit de dcider) par les dirigeants aux plus bas niveaux hirarchiques. Les progrs des technologies de contrle de l'effort permettent de superviser plus d'agents, ce qui rduit la taille des hirarchies intermdiaires. Les TIC augmentent les bnfices deffectuer plusieurs tches complmentaires ncessitant ainsi labandon de la division des tches fordiste pour lmergence de mtiers versatiles etc
- le re-engineering ou reconfiguration recherche la rduction des cots et lexternalisation. Il concerne plus particulirement lencadrement, les nouvelles technologies de communication permettant lmergence de nouveaux services, et la coordination et le contrle du travail travers des rseaux locaux et non les cadres intermdiaires. - la qualit totale approfondit certains points de la production au plus juste : satisfaction complte du client et chasse au muda (terme japonais dsignant le gaspillage). Dans les faits, mme au sein dune industrie coexistent des dispositifs productifs diffrents notamment du fait de particularismes locaux (nature de la main duvre, institutions) ou historiques. Malgr lhtrognit des changements organisationnels, on observerait de manire rcurrente certaines pratiques clefs et complmentaires de travail : le travail en quipe autonome, la rotation de poste, les dmarches de qualit totale ou le Juste--Temps. Les dmarches de qualit totale regroupent un ensemble de procdures mises en uvre pour atteindre un objectif de qualit. Les procdures peuvent tre formalises pour obtenir une certification ISO ou bien trs volutives pour une amlioration continue du processus de production. De fait, la qualit totale tend englober lensemble des pratiques innovantes de travail. La diffusion des pratiques innovantes a t rapide et se poursuit. Pour les seules normes de qualit de type ISO, la croissance dans les 5 dernires annes du nombre dentreprises certifies et de pays impliqus a t quasiexponentielle travers le monde (tableau 3). Tableau 3 : nombre dentreprises certifies ISO 9000 dans le monde Pays Jan. Sept. Juin Mars Dec.
1993 Afrique et Asie de lOuest % du total mondial Egypte Inde Nombre de pays Amrique du Sud et Centrale % du total mondial Brsil 1993 1994 1995 1995
Dec.
1996
Dec.
1997
Dec.
1998
Dec.
1999
Dec.
2000
951 3,42 0 8 7
1272 2,73 0 73 8
1855 2,64 9 328 16
2619 2,75 16 585 24
3378 2,65 45 1023 27
6162 3,79 166 1665 37
8668 3,88 344 2865 40
12150 4,47 385 3344 48
17307 5,04 649 5200 49
20185 4,94 468 5682 52
27 0,1 19
140 0,3 113
475 0,68 384
733 0,77 548
1220 0,96 923 15 10374
1713 1,05 1198 19 16980
2989 1,34 2068 23 25144
5221 1,92 3712 28 33550
8972 2,61 6257 29 45166
10805 2,64 6719 30 48296
Nombre de pays 3 6 9 12 Amrique du Nord 1201 2613 4915 7389 % du total mondial 4,32 5,61 6,99 7,77 Mexique 16 24 85 145 Europe 23092 37779 55400 71918
8,15 10,44 11,25 12,34 13,14 11,82 215 412 711 978 1556 1843 92611 109961 143674 166255 190248 220127
% du total mondial Hongrie Nombre de pays Asie de l'Est % du total mondial Chine
83,02 81,12 78,73 75,61 3 23 58 125 24 683 2,46 10 30 1583 3,4 35 34 3091 4,39 150 34 5979 6,29 285
72,72 309 36 9240 7,26 507
67,58 423 38 18407 11,31 3406
64,31 1341 42 29878 13,42 5698
61,13 1660 42 37920 13,99 8245
55,36 3282 47 56648 16,48 15109
53,87 4672 50 81919 20,05 25657
Nombre de pays 9 11 11 12 13 14 16 18 20 21 Total mondial 27 816 46 571 70 364 95 117 127349 162 701 223 299 271 847 343 643 408 631 Nombre de pays 48 60 75 88 96 113 126 141 150 158
Source : ISO survey 2002.
Des travaux conomtriques ont mis en vidence que les entreprises conjuguant ces pratiques avec lusage des TIC bnficiaient de performances suprieures aux entreprises qui se contentent dinvestir dans ces technologies (Arnal et al., 2001, pour une revue ; Black et Lynch, 2001). Seules les industries rorganises pourraient extraire des gains de productivit des TIC notamment en exploitant linformation sur les volutions de leurs marchs alors que les TIC seraient inutiles dans les industries avec une organisation fige. La complmentarit serait mme macroconomique (Askenazy et al. 2003) : les TIC accroissent lchange dinformation et lefficacit du processus dinnovation ; lacclration conscutive de linnovation pousse lensemble des entreprises sengager dans une production ractive pour accder ce march processus crateur/destructeur rapide ; la complmentarit nest donc pas technique mais rsulte de la concurrence globale. Le capital organisationnel immatriel et le capital humain seraient donc devenus clefs pour les entreprises. Des rseaux au commerce lectronique En particulier, cette conomie de la connaissance permet un mode d'organisation msoconomique, celui des rseaux. Ceux-ci tendent se substituer aux catgories plus classiques d'organisation des marchs : l'change anonyme au moyen du prix et la hirarchie. L'utilisation des TIC et plus gnralement de l'information permet de dpasser le premier de ces lments par lexploitation des connaissances concernant les clients et fournisseurs rels ou potentiels. Ces mmes techniques permettraient aussi aux firmes de se dbarrasser des contraintes imposes par l'organisation hirarchique. Lconomie fonde sur la connaissance implique donc des changements majeurs dans les modes dorganisation des firmes. En raison de la difficult croissante matriser lensemble des connaissances qui pourraient directement ou indirectement affecter la productivit des firmes, ces dernires cherchent se spcialiser en fonction des connaissances et comptences quelles dominent, et partir desquelles elles peuvent maintenir leur position concurrentielle. Cette logique de la division du travail, qui pousse la firme se concentrer sur un cur de mtier , peut conduire des restructurations significatives et ventuellement mener un concept tel que celui de lentreprise sans
10
usine , si la comptence principale de la firme ne rside pas tant dans la fabrication que dans lorganisation et la supervision. Dans ce contexte, la firme doit faire appel des connaissances externes, quelle ne contrle pas directement, et les articuler avec sa propre base de connaissance. La firme industrielle typique qui dveloppe en interne les innovations issues de ses propres laboratoires (le modle dit linaire de linnovation), cderait la place la firme en rseau, qui aurait recours au march (achats de brevets, cession de licences, contrats de R&D) aussi bien qu la coopration avec des partenaires publics (universits, centres de recherche) ou privs (fournisseurs, clients ou mme concurrents). Les avantages de ce mode dorganisation en termes de flexibilit seraient susceptibles dtre contrebalanc par des inconvnients en termes de capacit dapprentissage, de circulation de linformation et de diffusion de la connaissance. Cest pourquoi cette mise en rseau est l encore complmentaire avec un dveloppement de la codification et de la facilit de circulation de linformation, c'est--dire principalement avec les progrs raliss dans les TIC. Ces technologies facilitent non seulement les transferts de connaissances lintrieur de la firme, mais aussi en dehors, rendant possible le fonctionnement effectif des rseaux articuls autour de la connaissance, mais aussi les divers marchs de la connaissance, c'est--dire de biens intangibles. Lorganisation en rseau lie lconomie de la connaissance a des consquences sur les relations entre fournisseurs et donneurs dordre. Les TIC en particulier modifient la gestion de la chane dapprovisionnement. L'change de donnes par l'internet amliore l'exactitude et la vitesse de transmission des informations. Linternet peut tre employ pour assurer des transactions ordinaires comme le traitement dun ordre dachat ou le service aprs-vente. Le traitement en ligne de ces oprations rduit non seulement les cots, mais augmente la fiabilit des oprations (Danzon et Furukawa 2001). Le mme mcanisme s'applique d'autres oprations : achats, dpenses, planification La diffusion des TIC et du commerce en ligne doit ainsi conduire une rorganisation significative du secteur de l'intermdiation. Rduire les dpenses dinformation mnerait la disparition de certains intermdiaires traditionnels la faveur non seulement de transactions de producteur/consommateur directes3 (Business to Consumers, B2C), mais aussi des transactions de producteur/producteur (Business to Business, B2B) et mme C2C4 (c'est--dire de Consommateur Consommateur). La baisse du cot de recherche des informations reprsente un danger pour les intermdiaires traditionnels . Cairncross (2001) compare leffet des achats par internet au succs des catalogues de vente par correspondance la fin du XIXme sicle, qui mit en faillite de nombreux magasins de dtail. Les possibilits du commerce lectronique tant trs grandes, la part de march potentielle du commerce de dtail par internet est probablement bien suprieure celle conquise par la vente par correspondance. Le commerce lectronique favorise aussi lapparition de nouveaux intermdiaires spcialiss dans la vente par internet comme Amazon. Au total la dsintermdiation peut apporter un gain montaire significatif pour le consommateur (par ex. Larribeau et Pnard, 2002) Limportance du commerce entre firmes, B2B, peut se juger par lampleur des conomies quil procurerait : 29 39 % pour le secteur des composants lectroniques, 22
3 4
Cest par exemple le cas dans le secteur de lassurance vie. Ainsi, les intermdiaires sur le march immobilier tendent seffacer pour laisser place des transactions directes entre vendeur et acheteur, inities via Internet (Amable et al., 2003) ; les rentes dintermdiations sont alors partags entre les particuliers.
11
% dans l'usinage de mtaux, 12 19 % dans les biotechnologies5. Comme dans le commerce lectronique de dtail, quelques socits de commerce B2B agissent en intermdiaires dans des transactions entre des socits, reconfigurant le modle de transactions entre un entrepreneur et ses fournisseurs. Le B2B permet une centralisation des achats et la fin de la dispersion des ordres dapprovisionnement. Une consquence directe est que de nombreuses socits s'attendent diminuer le nombre de leurs fournisseurs pour se concentrer sur ceux qui offrent les prix les plus bas. Les connexions lectroniques bases sur Internet permettent aussi aux acheteurs de machines-outils ou d'autres intermdiaires de faire concevoir des produits leur spcification exacte ; ils conomisent galement sur le dlai de livraison et la gestion des stocks. Dj des places de march lectroniques regroupant de grands donneurs dordre sont en activit comme dans lautomobile. Les changes lectroniques sont particulirement dvelopps pour les marchs de biens non manufacturs dans lesquels les pays du Sud sont fortement impliqus (voir les exemples des commerces des fleurs et du caf dans Amable et al., 2003). Ce mode dchange tend se gnraliser. Le risque dune double fracture numrique (digital divide) Les avantages que procurent les TIC ne deviendront effectifs que si lensemble des firmes et des mnages peut avoir accs internet. Le risque est celui dun mode particulier dexclusion si un clivage devait sinstaurer entre les agents ayant accs au monde numrique et les autres, surtout que les firmes peuvent renforcer la slectivit des clients finaux, notamment pour les relations de long terme dans la banque ou lassurance. Force est de constater quen ltat actuel, tous les mnages nont pas accs aux technologies numriques et linternet. Une raison est notamment que linternet est domin par la langue anglaise : en juillet 2000, les serveurs scuriss en anglais reprsentaient 90% du total des serveurs scuriss alors que les langues europennes continentales ntaient utilises que par 5% de ces serveurs. La matrise de langlais constituerait toujours un obstacle la diffusion des TIC. La figure 2 montre une corrlation positive claire entre la pntration dinternet (dfinie comme le pourcentage de foyers connects en 2000) et un indicateur dapprentissage des langues trangres au lyce pour la Belgique, le Danemark, lAllemagne, la Grce, lEspagne, la France, lItalie, les Pays-Bas, lAutriche, le Portugal, la Finlande, la Sude, et le Japon.
Estimations de Goldman Sachs reprises par Cairncross [2001]
12
% des foyers connects 60,00 internet en 2000 50,00
40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Internet versus langues apprises Estimation linaire
Nombre moyen de langues trangres apprises dans le secondaire
Figure 2. Diffusion de linternet (pourcentage des foyers connects) et matrise des langues trangres (nombre moyen de langues trangres apprises dans le secondaire). Source : Commission Europenne (2003). Par ailleurs, des facteurs tels que lducation et le revenu sont de puissants dterminants de la diffusion dinternet, mme aux Etats-Unis. En aot 2000, daprs le Current Population Survey, alors que 75% des titulaires dun diplme universitaire avaient accs internet, seuls 10% des non titulaires en bnficiaient. Les travailleurs diplms occupent gnralement des postes o ils sont forms aux technologies informatiques et o ils disposent dune connexion au travail. Internet est ainsi par nature une technologie qui produit une fracture selon la profession des individus. Le foss numrique travers le niveau dducation reflte aussi partiellement un foss induit par le niveau de revenu. En moyenne, les foyers du plus haut dcile sont cinq fois plus connects que les foyers avec revenu dans le plus bas dcile (OCDE, 2001). Le cot d'un ordinateur individuel multimdia reste un investissement rdhibitoire pour de nombreux foyers mme dans des pays dvelopps. Par exemple, en France, un ordinateur de base cote au moins 1000 euros alors que le salaire mensuel mdian est approximativement de 1200 euros. Un dterminisme technologique trs partiel Si l'conomie de la connaissance est un nouvel ge du capitalisme, quels en sont les dterminants ? Une explication rpandue insiste sur la dynamique propre des technologies, dont le dveloppement au moins partiellement autonome imposerait des modes particuliers d'organisation des marchs et des entreprises. Il est galement avanc que ces technologies en fait initie ds les annes 1960 nauraient connu leur essor que lors de la dcennie 1980 aux Etats-Unis, une fois le stock de capital humain suffisamment large et htrogne pour assurer une quantit suffisante dutilisateurs (professionnels ou privs) et donc un march rentable ces technologies : se pose alors la question de lappropriation des TIC pour les autres pays, sur laquelle nous reviendrons. De fait, une explication plus satisfaisante nous orienterait plutt vers la dynamique conjointe des techniques et des marchs ; louverture de nouveaux marchs ou encore la
13
drglementation ont galement influ sur lmergence de technologies qui ne suivent pas un cours dterministe. En ce qui concerne les pays les plus avancs, l'insistance sur l'conomie de la connaissance est clairement relie aux proccupations issues de la concurrence que les pays du sud peuvent reprsenter dans les segments de production les moins intensifs en connaissances (R&D, qualifications, etc.). C'est probablement une proccupation qui animait le sommet europen de Lisbonne, avec son impratif pour l'Europe de devenir en 2010 l'conomie fonde sur la connaissance la plus avance au monde (European Commission, 2003). L'insistance sur la connaissance en gnral, la R&D, l'ducation et les comptences en particulier, est un moyen pour les conomies du nord de redfinir leurs avantages comptitifs : production haut de gamme , concurrence par le temps et la gestion de l'information. Lconomie de la connaissance serait ainsi une tape supplmentaire et institutionnalise des stratgies dinnovations dfensives qui auraient pouss les entreprises dans les annes 1980 et 1990 recourir linformatique et la substitution qualifis/non qualifis (Wood, 1994). III Les limites Le concept dconomie de la connaissance semble donc recouvrir une part importante de la ralit conomique prsente. Nanmoins, il prsente des limites claires portant la fois sur sa nouveaut, la pertinence des scnarios futurs, son adquation lensemble des pays ou son dtournement idologique . Une fausse rupture ? Lconomie de la connaissance est communment prsente linstar de son double, la nouvelle conomie comme une nouvelle rvolution industrielle et lavnement dune re nouvelle qui non seulement annoncerait des transformations majeures dans les structures productives, les structures de consommations, les modes dorganisation et les institutions de lconomie mondiale, mais ncessiterait aussi de refonder la science conomique pour lui permettre danalyser ce nouvel age du capitalisme. Ce genre daffirmation donne toujours loccasion de faire un retour en arrire pour vrifier sil y a vraiment tant de nouveauts sous le soleil. En fait, limportance du changement technique et des avances de la connaissance sont reconnues en conomie depuis au moins Marx et Marshall. Ainsi dans les Fondements de la critique de lconomie politique [Grundisse] publi en 1859, Karl Marx affirmait : Le dveloppement du capital fixe indique quel degr le niveau gnral des connaissances, Knowledge6, est devenu force productive immdiate et quel degr, par consquent, les conditions du procs vital dune socit [sont] soumises au contrle de lintelligence gnrale 7. Trente ans plus tard on trouve chez Marshall : Le capital consiste en grande partie de capital et dorganisation [] La connaissance est notre plus puissant moteur de production [] Lorganisation aide la connaissance [...] La distinction entre proprit prive et publique dans la connaissance est dune importance la fois grande et grandissante : par bien des aspects dune plus grande importance quentre la proprit publique et prive des biens matriels [] (Marshall, Principes dEconomie, 1890, chapitre 1). Certains qualifient
6 7
En anglais dans le texte. K. Marx, Editions Anthropos Paris 1968, p. 223 tome 2.
14
ces propos de visionnaires de la phase actuelle du capitalisme, mais ces auteurs parlaient bien de leur propre prsent du 19ime sicle. Plus rcemment, lanalyse conomique a t irrigue par les ides de Arrow (1962) ; il a soulign limportance de la connaissance en tant que fondement de la fonction de production ainsi que de lapprentissage, qui est lorigine de laccumulation de connaissance. On pourrait multiplier les rfrences (Schumpeter dans les annes 30, Hicks dans les annes 70) pour montrer que la rflexion conomique ne considre pas que lconomie est fonde sur la connaissance que depuis les annes 1990. La rfrence Arrow permet aussi de souligner le lien troit entre connaissance et investissement en capital physique, cest--dire entre capital intangible et capital tangible. Les avances de lconomie fonde sur la connaissances ne peuvent devenir effectives que si les quipements en TIC sont suffisamment diffuss ; les progrs de la codification de linformation restent sans intrt si les supports physiques de stockage, transport et traitement de cette information sont absents. De fait, pour pouvoir affirmer que la connaissance remplace le capital (tangible), il faudrait pouvoir clairement sparer les deux. Or laccumulation de capital est lie laccumulation de connaissances ; la fonction de linvestissement est prcisment limplmentation de nouvelles connaissances dans les processus productifs. Les chiffres ne montrent pas une nette sparation entre linvestissement en R&D et linvestissement en capital. Des limites techniques Les technologies de linformation connaissent de spectaculaires progrs. Les microprocesseurs continuent de voir leurs capacits doubler tous les 18 mois suivant la loi de Moore. Mais ce progrs technologique est justement concentr la priphrie de la connaissance (mmoires, micro-processeurs) ; les TIC facilitent la production de connaissance mais cette dernire ne connat pas une croissance nette de ses performances. Ainsi, lactivit de R&D grosse consommatrice de TIC, a priori fortement bnficiaire des effets rseaux, ne semble pas avoir connu durant la dernire dcennie des gains defficacit substantiels ; il apparat mme travers des indicateurs comme le nombre de brevets ou de publications scientifiques que les rendements y soient toujours dcroissants. En outre, leffondrement des cots marginaux induit la gnration de masses croissantes de donnes non pertinentes qui exigent un traitement qui puise les capacits d'analyse. Plus fondamentalement, si les TIC diminuent le cot de transmission et de traitement de l'information, elles contribuent trs peu la diminution des asymtries d'information sur lesquelles butent les firmes. Les achats de pices dtaches ou biens intermdiaires ont des consquences significatives pour l'efficacit du processus productif et la chane de valeur de la socit cliente ; les questions relatives la qualit des pices achetes, les spcifications de conception et la fiabilit gnrale de la firme vendeuse sont cruciales. Or, les dmarches de qualit rendent prcisment critique la qualit des fournisseurs pour de nombreuses entreprises mme en dehors des secteurs o la scurit est en jeu comme par exemple laronautique. Les certifications ne permettent que partiellement de rsoudre labsence dinformation directe dans les relations B2B (Business to Business ) des places de march lctroniques. Les achats impliquent gnralement des rapports long terme et non le type d'change impersonnel que le commerce lectronique est suppos faciliter. Hormis sur des biens trs homognes et identifis comme les fournitures, ces difficults limitent le dveloppement du commerce
15
lectronique entre entreprises et loriente dans une direction trs loigne de sa reprsentation nave comme un march sans friction. On retrouve galement des asymtries dans le commerce B2C (Business to Consumer). Lasymtrie joue l dans les deux sens. Suivant Latzer et Schmitz [2001], on peut affirmer que l'utilit drive de l'achat de marchandises travers le-commerce dpend de la qualit d'un bien composite i.e. le produit achet lui-mme mais aussi de services complmentaires tels la protection des informations personnelles, la transparence de linformation, la prcision et lefficacit du service de distribution, lefficacit et la scurit de la procdure de paiement, etc Les socits de vente de dtail en ligne doivent faire face galement nombreux cots annexes comme les droits de douane linternational ou les fraudes de paiement. Enfin, l'efficacit du service fourni par leintermdiaire B2C est dpendante de la logistique (distribution, stocks) que l'intermdiaire lui-mme ne peut contrler que partiellement. Les services complmentaires offerts par les acteurs du commerce lectronique sont htrognes. Acheter sous de telles circonstances implique un certain degr d'incertitude, mme si la qualit du bien en lui-mme est parfaitement connu (camscopes dune marque internationale, vins de grands crus classs). Les sites comparatifs ne permettent que de partiellement capturer et analyser cette htrognit. Acheter en ligne reste donc un pari (du moins lors de la premire transaction) sur la qualit des services complmentaires lachat. Ce type de mcanique a tendance renforcer les socits bien tablies sur le march on-ligne ou off-ligne. Une exprience positive avec un l'intermdiaire sera une motivation pour rester avec cet intermdiaire. Par consquent, en sus de l'ampleur de la gamme de marchandises disponibles, un autre critre essentiel du choix du consommateur serait la rputation du vendeur en ligne. Sauf auprs de quelques acteurs majeurs comme Amazon, le consommateur na souvent que peu de rfrences sur loffreur via le rseau. Inversement un prteur ou un assureur, par exemple, souhaite les informations les plus compltes et fiables possibles sur ses clients. Lasymtrie et lincompltude ne peuvent tre rsolues que par la conservation dun contact personnel F2F (face to face) que ce soit pour les relations entre entreprises ou les relations entre entreprise et client particulier. Une conomie non ncessairement porteuse de dveloppement pour le Sud. Malgr cet ensemble de limites techniques , lconomie de la connaissance sous la forme de la diffusion des technologies de linformation est souvent prsente comme une clef possible de dveloppement rapide pour les PVD. Ces pays pourraient sauter des tapes technologiques obsoltes pour rejoindre la frontire technologique. La rduction de la fracture numrique Nord-Sud est ainsi en tte des agendas internationaux ; lONU a par exemple lanc en 2002 une ICT Task Force. On retrouve l un dbat classique de lconomie du dveloppement, celui des technologies appropries et de leur diffusion (voir par exemple Nelson et Phelps, 1966). Nanmoins, les technologies de linformation se distinguent des technologies classiques sur lesquelles stait porte jusqualors la rflexion. Leurs proprits particulires tendent insister sur leur ncessaire adoption ou au contraire sy montrer trs rserv. Dune part, les TIC interviennent non seulement dans la production de biens mais aussi dans celle de connaissances et en particulier dducation ; les investissements en TIC peuvent ainsi permettre daccrotre le capital humain. Ils sont en outre essentiels pour assurer lintgration du pays aux marchs internationaux qui sorganisent autour des market places.
16
Dautre part, les TIC prsentent une forte obsolescence. Comme nous lavons soulign, la diffusion de ces techniques se comprend en complmentarit avec des modifications dans les modes dorganisation et laugmentation des comptences des individus, en parallle aux transformations des structures de production. Par consquent, un seul de ces lments les TIC- transplant dans un contexte diffrent (institutions et dotations) ne peut a priori suffire enclencher une dynamique vertueuse, surtout si lon admet que les TIC sont des technologies appropries une conomie dj sur la frontire technologique comme les Etats-Unis. Outre lusage, ladoption et la maintenance, notamment logicielle, les TIC sont intensives en travailleurs qualifis. Leur implmentation dans un PVD risque donc de tarir les ressources financires et en capital humain utiles ladoption ou la maintenance des autres formes de capital voire lducation. A titre dexemple, Boucekkine, Martinez et Saglam (2003) ont modlis la trajectoire de croissance optimale pour un PVD qui dispose de ressources rares en capital humain et dun secteur dadoption des innovations extrieures ; la technologie extrieure est incorpore au capital, autre caractristique de la plupart des TIC notamment de linformatique. Ce modle thorique montre que leffet dobsolescence8 induit la sousoptimalit dune adoption immdiate des NTIC en terme de richesse inter-temporelle ; une part trop grande du capital humain serait dirige vers leur adoption au lieu du secteur producteur de biens finals. Ladoption doit alors tre retarde, lagenda exact dpendant des politiques commerciales et dducation du pays. Au niveau empirique, il apparat en outre que les externalits sont suprieures dans les secteurs qui utilisent les technologies simples (voir Grether sur le cas du Mexique). Enfin, on peut noter que les progrs dans les TIC entranent une obsolescence rapide des diagnostics. Ainsi, la fin des annes 1990, on montrait en exemple la Chine qui dveloppait de manire exponentielle un rseau de tlphonie mobile, dlaissant ltape de la tlphonie fixe devenue inutile. Lirruption au dbut de la dcennie de la technologie ADSL montre dsormais tout lintrt des vielles lignes fixes pour assurer un accs facile et faible cot linternet haut dbit. Au total, il nous semble que seul un optimisme technologique bat permet actuellement de recommander uniformment la ncessiter de rentrer massivement dans lconomie de la connaissance pour les PVD. Par ailleurs, loin dune disparition des distances, lconomie de la connaissance devrait les renforcer (Venables, 2001). Les nouvelles formes de concurrence par la qualit et le temps commande une proximit des firmes aux marchs (Amable et al., 2003). La ractivit des volutions chaotiques de la demande et le juste--temps interdisent un loignement trop grand des fournisseurs. Le cas des meubles exotiques dont les ventes ont rcemment explos en Europe de louest, est loquent. Initialement en provenance dAsie du Sud-Est, ces meubles demandaient un long transport maritime qui provoquait des dgts sur une proportion importante de ces meubles. Recherchant qualit et temps dexpdition courts, les donneurs dordre europens se fournissent dsormais majoritairement auprs de producteurs dEurope de lEst, notamment Roumains, qui ralisent des copies exotiques . Hormis pour les biens immatriels, lintgration dun pays lconomie de la connaissance doit donc sapprcier au regard de sa situation gographique. Ainsi, on ne peut prtendre une unique voie de dveloppement qui passerait ncessairement par lconomie de la connaissance.
Cet effet joue galement dans les pays dvelopps (Greenwood, Hercowitz, Krusell, 1997).
17
Le mythe de luniformit Comme lconomie de la connaissance est prsente comme une nouvelle re pour lconomie mondiale, les conomistes universitaires et les organisations internationales ont frquemment tendance poser le dbat en termes dadaptation des tendances auxquelles nul ne peut chapper. Aprs avoir identifi des formes particulires dans les volutions relles ou supposes, on les agrge en un modle des transformations lies lconomie de la connaissance qui peut rapidement devenir un modle suivre. Sans prtendre tre exhaustif on peut mentionner plusieurs de ces volutions invitables qui seraient constitutives du nouveau modle de dveloppement fond sur la connaissance : comme les marchs sur internet sorientent vers des marchs sans friction, la politique optimale consiste ne pas les rglementer ; les nouveaux modes de production et daccumulation des connaissances tant fonds sur une diversit des sources, sur une organisation en rseaux et sur une firme fonctionnant par projets, la flexibilit et ladaptabilit deviennent indispensables, ce qui demande de diminuer les sources de rigidit : droit du travail, protection de lemploi, protection sociale ; le dynamisme technologique reposant sur les start-ups et le capital-risque, les intermdiaires financiers traditionnels (banques) sont appels disparatre Ces mythes reposent en partie sur des volutions relles constates et en partie sur des extrapolations partir de cas nationaux fortement spcifiques, la plupart du temps le cas des Etats-Unis. Les expriences passes comme prsentes conduisent relativiser les prdictions dune convergence inluctable vers un modle productif unique. La situation des pays scandinaves, en pointe dans lconomie de la connaissance comme en tmoignent tous les indicateurs de diffusion des TIC ou de qualification de la main-duvre, indique que ladaptation lconomie de la connaissance ne demande pas dadopter les formes organisationnelles et institutionnelles des Etats-Unis. Sil est vrai que lconomie de la connaissance implique des tendances communes toute lconomie mondiale, les adaptations aux volutions peuvent a priori tre diverses, comme cela a t le cas pour les prcdentes rvolutions industrielles.
18
Recommendations 1. Lconomie de la connaissance ne doit pas tre considre comme une rupture. Elle sinscrit dans la continuit dun dveloppement conomique bas sur linnovation. 2. Elle ne se limite pas aux seules technologies de linformation mais inclut des investissements en capital humain et en innovations organisationnelles qui sont complmentaires et ncessaires ces technologies 3. En particulier, elle ncessite de poursuivre leffort dducation gnrale et technique. 4. Elle gnre de nouvelles formes de concurrence fondes sur la qualit et le temps qui entretiennent en retour le besoin dinnovations. Elles tendent tablir la production proximit des marchs. 5. Thoriquement, lmergence de lconomie de la connaissance nexige pas un unique modle productif et institutionnel. 6. Pour les pays du Sud, lobsolescence des vagues technologiques commande de ne pas concentrer lensemble de leffort national sur les technologies de linformation avances. Les structures de bases et nouveau lducation doivent tre dveloppes.
19
Rfrences Abramovitz, M. et David P.A. Technological Change and the Rise of Intangible Investments: the US Economys Growth-path in the Twentieth Century, in D. Foray et B. A. Lundvall, (eds.), Employment and Growth in the Knowledge-based Economy, OECD, Paris: OECD, 1996, 389 p. Amable, B., Askenazy P., Cohen D., Goldstein A. et OConnor D. Internet and the three digital divides: the elusive quest of a frictionless economy, partie II in T. Boeri ed. ICT Revolution, Oxford University Press: Oxford, 2003, paratre. Arnal, E. Ok W. et Torres R. Knowledge, work organisation and economic growth, Labour Market and Social Policy paper N 50, 2001, DEELSA-OECD. http://www.olis.oecd.org/OLIS/2001DOC.NSF Askenazy, P. La Croissance Moderne. Organisations innovantes de travail, Economica : Paris, 2002, 288 p. Askenazy, P., Thesmar D. et Thoenig M. Time-based competition and innovation, Economic Journal (London), 2003, paratre. Black, S. et Lynch, L. How to Compete: the Impact of Workplace Practices and Information Technology on Productivity, The Review of Economics and Statistics (Boston), 83 (3), 2001, p. 434-45. Boucekkine, R., Martinez B., et Saglam H.C. The development problem under embodiment, Journal of Development Economics, 2003, paratre. Brown, C., Campell A.B.A. The impact of technological change on work and wages, Industrial Relations (Berkeley), vol. 41 (1), 2002, pp. 1-33. Brynjolfsson, E. et Hitt L.M. Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance, Journal of Economic Perspectives (Nashville, TN), 14(2): 2000, p. 23-48. Caroli, E. Organizational Change, New Technologies and the Skill Bias: What do we Know? in P. Petit et L. Soete eds: Technology and the Future of European Employment, Edward Elgar: London, 2001, 576 p. Curry, J., Contreras O. et Kenney M. The Internet and E-commerce Development in Mexico, BRIE Working Paper (Berkeley), No. 144, 2001. Danzon, P. et Furukawa M.,e-Health: Effects of the Internet on Competition and Productivity in Health Care. in The Economic Payoff from the Internet Revolution, The Brookings Task Force on the Internet. Brookings Institution Press, 2001, 280 p.
20
Desai, A.V. The Peril and The Promise: Broader implications of the Indian Presence in Information Technologies, Stanford University, Center for Research on Economic Development and Policy Reform, Working Paper, No. 70, 2000. Entorf, H., Gollac M. et Kramarz F. New Technologies, Wages, and Worker Selection, Journal of Labor Economics (Chicago), 17(3), 1999, p. 464-491. European Commission, Third European Report on Science and Technology Indicators. Towards a Knowledge-based Economy. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities ? 2003, 451 p. Foray, D. Lconomie de la connaissance. Paris, La Dcouverte, 2000, 124p. Greenwood, J., Hercowitz Z. et Krusell P. Long_run implication of investment-specific technological change, American Economic Review (Nashville), vol. 87, 1997, p. 342-362. Grether, J. M. Determinants of technological diffusion in Mexican manufacturing: a plant level analysis, World Development, vol. 27, 1999, p. 1287-1298. Ichniowski, C. Kochan T.A., Levine David I., Olson C. et Strauss G., What Works at Work: Overview and Assessment, Industrial Relations (Berkeley), 35 (3), 1996, p. 299333. Kendrick, J.W. Total Capital and Economic Growth. Atlantic Economic Journal (Saint Louis, MO), vol. 22 n1, 1994, p. 1-18. Larribeau, S. et Pnard T. Le commerce lectronique en France : un essai de mesure sur le march des CD, Economie et Statistique (Paris), N 355-356, 2002, pp. 27-46. Lindbeck, A. et Snower D. Reorganization of Firms and Labor Market Inequality, American Economic Review (Nashville, TN), 86(2), 1996, p. 315-321. Mueller, R.A. E. Emergent E-Commerce in Agriculture, University of California, Davis, AIC Issues Brief, No. 14, 2000. Nelson, R., Phelps E., Investment in humans, technology diffusion and economic growth, American Economic (Nashville) Review, vol. 56,1966, pp. 69-75. OCDE, The Knowledge-Based Economy. Paris: OECD, 1996, 46 p. OECD, A New Economy? The changing role of innovation and information technology in growth. Paris: OECD, 2000, 92 p. OECD, Understanding the Digital Divide. Paris: OECD, 2001, 32 p. Osterman, P. Work Reorganization in an era of Restructuring: Trends in Diffusion and Effects on Employee Welfare, Industrial and Labor Relations Review (Ithaca), 53(2), 2000, p.179-195.
21
Ramachandran, V. et Goebel J. Linkages between the Information Technology Sector and Traditional Sectors in Tamil Nadu, Working paper Center for International Development, Harvard University, 2002. Smith, K. What is the Knowledge Economy? Knowledge Intensity and Distributed Knowledge Bases. The United Nations University, INTECH Discussion Paper Series 2002-6. Soete, L. The challenges and the potential of the knowledge-based economy in a globalised world. In by Bengt-Ake Lundvall (Editor), Maria Joao Rodrigues (Editor), Maria Jooao Rodrigues (Ed.) The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion. Cheltenham: Northampton 2002, p. 28-53, 337 p. Venables, A. J. Geography and International Inequalities: the impact of new technologies, World Bank Annual Conference on Development Economics, Washington, D.C., May. Wood, North-South Trade, Employment and Inequality: Changing Fortunes in a SkillDriven World (Ids Development Studies Series), 1994, 664 pages; Clarendon Press: Oxford. World Bank (2002), World Development Indicators, World Bank: Washington 2001, 424 p.
Vous aimerez peut-être aussi
- Business Plan HotelDocument65 pagesBusiness Plan Hotelousmane100% (4)
- Stratégie AdidasDocument13 pagesStratégie Adidaselifcelia68% (22)
- Häagen DazsDocument14 pagesHäagen DazsCyrilPas encore d'évaluation
- Rapport - de - Stage - 3ème CorrectionDocument37 pagesRapport - de - Stage - 3ème CorrectionDjibe T. CosmoPas encore d'évaluation
- Fiche de Poste Assistant Marketing Et CommunicationDocument2 pagesFiche de Poste Assistant Marketing Et CommunicationFatim DiawaraPas encore d'évaluation
- Dans Quelle Mesure Le Protectionnisme EstDocument4 pagesDans Quelle Mesure Le Protectionnisme EstAndyPas encore d'évaluation
- Clusters Mondi AuxDocument181 pagesClusters Mondi Auxmiggymoy100% (1)
- Régulation bancaire et financière européenne et internationale: 5e éditionD'EverandRégulation bancaire et financière européenne et internationale: 5e éditionÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- 04 Planificationproduction PDFDocument53 pages04 Planificationproduction PDFSimo BerradaPas encore d'évaluation
- Orloge StratégiqueDocument24 pagesOrloge StratégiqueNihad_Nasr_701Pas encore d'évaluation
- (Repères Économie 302) Dominique Foray - L'Économie de La Connaissance-La Découverte (2009)Document128 pages(Repères Économie 302) Dominique Foray - L'Économie de La Connaissance-La Découverte (2009)Aristide Kuitche100% (2)
- La Théorie de La Croissance EndogèneDocument5 pagesLa Théorie de La Croissance EndogèneNouhaila ZaghriPas encore d'évaluation
- Qu'Est-ce Que L'economie NumeriqueDocument19 pagesQu'Est-ce Que L'economie NumeriqueL'étudiant ÉconomistePas encore d'évaluation
- Internationalisation des PME: Comment réussir à l'étranger ?D'EverandInternationalisation des PME: Comment réussir à l'étranger ?Pas encore d'évaluation
- Delocalisation Impact PDFDocument145 pagesDelocalisation Impact PDFVoodoo ChildPas encore d'évaluation
- Les Crises EconomiquesDocument12 pagesLes Crises EconomiquesLoucif AsPas encore d'évaluation
- Prospective Maroc 2030 - Éléments Pour Le Renforcement de L'insertion Du Maroc Dans L'économie de La Connaissance.Document145 pagesProspective Maroc 2030 - Éléments Pour Le Renforcement de L'insertion Du Maroc Dans L'économie de La Connaissance.frlancedesignPas encore d'évaluation
- Nationalite Des Entreprises Multinationales Et MondialisationDocument164 pagesNationalite Des Entreprises Multinationales Et MondialisationMihai Popa100% (1)
- Les Déterminants de L'investissementDocument184 pagesLes Déterminants de L'investissementOusseynou LagnanePas encore d'évaluation
- Investissement Et CroissanceDocument2 pagesInvestissement Et CroissanceNinasimone NinaPas encore d'évaluation
- Concepts Fondamentaux DeveloppementDocument47 pagesConcepts Fondamentaux DeveloppementHarouna CoulibalyPas encore d'évaluation
- Les Crises EconomiqueDocument2 pagesLes Crises EconomiqueLoucif AsPas encore d'évaluation
- Investissement Public Et CroissanceDocument130 pagesInvestissement Public Et CroissanceMohamed IbnAliPas encore d'évaluation
- L'économie de L'immatérielDocument184 pagesL'économie de L'immatérielremolino100% (9)
- La Croissance ÉconomiqueDocument14 pagesLa Croissance ÉconomiqueHicham AtroniPas encore d'évaluation
- L Économie Informelle - Lomami Shomba 4Document3 pagesL Économie Informelle - Lomami Shomba 4bilkolPas encore d'évaluation
- Economie InternationaleDocument12 pagesEconomie InternationaleValérian DlhsPas encore d'évaluation
- L'impact de La Pandémie Sur L'economie MarocaineDocument2 pagesL'impact de La Pandémie Sur L'economie MarocaineALAE BELRHAZIPas encore d'évaluation
- Quel demain pour quel Maroc ?: Réflexions sur le développementD'EverandQuel demain pour quel Maroc ?: Réflexions sur le développementPas encore d'évaluation
- Les IDE Dans Le Monde Benchmarking PDFDocument74 pagesLes IDE Dans Le Monde Benchmarking PDFJilani Bejaoui100% (2)
- Actes Attr TerritoiresDocument124 pagesActes Attr TerritoiresSiham NaymPas encore d'évaluation
- CroissanceDocument12 pagesCroissancejad 404Pas encore d'évaluation
- Relation Economique IntarnationalDocument27 pagesRelation Economique IntarnationalWarda WardaPas encore d'évaluation
- These NoureddineDocument340 pagesThese NoureddineSalma RehîouîPas encore d'évaluation
- La CriseDocument24 pagesLa CriseM-SamiOuardirhiPas encore d'évaluation
- WP Libre Echange ProtectionnismeDocument33 pagesWP Libre Echange ProtectionnismeIssam Hafid100% (1)
- La Croissance Économique - DSECG3 PDFDocument8 pagesLa Croissance Économique - DSECG3 PDFSamba Sakho100% (1)
- III-Le Libre-Échange Et Le ProtectionnismeDocument11 pagesIII-Le Libre-Échange Et Le ProtectionnismetalhartitPas encore d'évaluation
- Déterminants Du Comportement D'innovation Des Entreprises en TunisieDocument292 pagesDéterminants Du Comportement D'innovation Des Entreprises en TunisieAnas TouahriPas encore d'évaluation
- Les Enjeux Du Développement Durable PDFDocument16 pagesLes Enjeux Du Développement Durable PDFMohammed JabranePas encore d'évaluation
- Fiche 212 - Avantages Et Inconvénients Des Échanges Inter NationauxDocument16 pagesFiche 212 - Avantages Et Inconvénients Des Échanges Inter NationauxMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Relations Nord SudDocument0 pageRelations Nord Sudxarper930% (1)
- Politique Économique Chapitre-1Document60 pagesPolitique Économique Chapitre-1clémence_forestPas encore d'évaluation
- Economie InformelDocument32 pagesEconomie InformelSaid RudaniPas encore d'évaluation
- Les Investissements Directs G 1 Et 2Document14 pagesLes Investissements Directs G 1 Et 2Initiald RazdPas encore d'évaluation
- Economie de L'incertainDocument34 pagesEconomie de L'incertaindeezy100% (1)
- Is LMDocument18 pagesIs LMGangster marocianPas encore d'évaluation
- Economie InternationaleDocument12 pagesEconomie Internationaleilham gharbabyPas encore d'évaluation
- Croissance Economique1Document10 pagesCroissance Economique1Oumaima AnnabaPas encore d'évaluation
- L'economie Mondiale, 2019, Cepii PDFDocument100 pagesL'economie Mondiale, 2019, Cepii PDFabderrrassoulPas encore d'évaluation
- La Croissance InclusiveDocument9 pagesLa Croissance InclusiveGuillaumeKouassiPas encore d'évaluation
- Jean-Marc Siroen - La Regionalisation de L'economie Mondiale PDFDocument129 pagesJean-Marc Siroen - La Regionalisation de L'economie Mondiale PDFseydinaPas encore d'évaluation
- These Sossi AlaouiDocument289 pagesThese Sossi AlaouiAnonymous DYNsIegfPas encore d'évaluation
- Consortia A L'exportation Et Strategie D'internationalisation Des Pme/pmi: Cas Du Secteur de La ChaussureDocument116 pagesConsortia A L'exportation Et Strategie D'internationalisation Des Pme/pmi: Cas Du Secteur de La ChaussureAZROUL100% (9)
- Economie InternationaleDocument70 pagesEconomie InternationaleFarid HadiPas encore d'évaluation
- Gestion de RisqueDocument3 pagesGestion de RisqueB.IPas encore d'évaluation
- Libre Echange Et Protectionnisme WWW - Etudiant MarocDocument9 pagesLibre Echange Et Protectionnisme WWW - Etudiant MarocetudmarocPas encore d'évaluation
- Commerce International Et Balance Des PaiementsDocument45 pagesCommerce International Et Balance Des PaiementsHafssa BENDRISS100% (1)
- Les Crises Financières:origines, Interconnexions Et RéactionsDocument11 pagesLes Crises Financières:origines, Interconnexions Et RéactionsAissata Mohamar Youssoufou MaigaPas encore d'évaluation
- Determinants de L'epargne Et de L'investissement Au MarocDocument14 pagesDeterminants de L'epargne Et de L'investissement Au Marocimane100% (1)
- 768-Article Text-2742-2-10-20211026Document18 pages768-Article Text-2742-2-10-20211026akhrif abdoPas encore d'évaluation
- Crises ÉconomiquesDocument43 pagesCrises Économiqueshamza1996Pas encore d'évaluation
- De la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieuxD'EverandDe la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieuxPas encore d'évaluation
- Les Capitalistes du XXIème siècle: La montée en puissance des nouveaux gestionnaires financiers. Un résumé généralement compréhensibleD'EverandLes Capitalistes du XXIème siècle: La montée en puissance des nouveaux gestionnaires financiers. Un résumé généralement compréhensiblePas encore d'évaluation
- L' innovation et l’économie sociale au cœur du modèle québécois: Entretiens avec Benoît LévesqueD'EverandL' innovation et l’économie sociale au cœur du modèle québécois: Entretiens avec Benoît LévesqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- La NégociationDocument147 pagesLa NégociationAkira CM100% (5)
- L'Analyse de La Structure Financière Des Comptes ConsolidésDocument7 pagesL'Analyse de La Structure Financière Des Comptes ConsolidésHanane AitPas encore d'évaluation
- Bondachat Carrefour 19 EURDocument1 pageBondachat Carrefour 19 EURyohan.praucaPas encore d'évaluation
- Livre Blanc Les 10 Secrets CDocument34 pagesLivre Blanc Les 10 Secrets ChakimPas encore d'évaluation
- Examen MF 2018Document10 pagesExamen MF 2018tabet100% (1)
- Lexique LEANDocument23 pagesLexique LEANZW FniPas encore d'évaluation
- Département FinancierDocument2 pagesDépartement Financierimanetamim1234Pas encore d'évaluation
- Le Marketing Social Au Service de La Sécurité RoutièreDocument17 pagesLe Marketing Social Au Service de La Sécurité RoutièreMahassinMidiPas encore d'évaluation
- Mémoire CompletDocument94 pagesMémoire CompletKoko KoceilaPas encore d'évaluation
- LTV FRDocument21 pagesLTV FRd.popa6665Pas encore d'évaluation
- CBB - Guide Création - Check-List Des Actions - Août 2016Document6 pagesCBB - Guide Création - Check-List Des Actions - Août 2016MarylènePas encore d'évaluation
- Business Plan RestaurantDocument12 pagesBusiness Plan RestaurantHala Halhouli100% (1)
- 1.1.8. Exercices Strat - CroissDocument3 pages1.1.8. Exercices Strat - CroissPizzolantePas encore d'évaluation
- Introductio 1Document12 pagesIntroductio 1Razine KettouPas encore d'évaluation
- Grilles Analyse PassationDocument14 pagesGrilles Analyse PassationAnonymous RuB6o4Pas encore d'évaluation
- Analyse Porter CAS IAMDocument4 pagesAnalyse Porter CAS IAMmarocPas encore d'évaluation
- Sujets-EO 2Document12 pagesSujets-EO 2ABPas encore d'évaluation
- L Effet Du Tourisme Et L Hotellerie Sur L Economie MarocaineDocument39 pagesL Effet Du Tourisme Et L Hotellerie Sur L Economie MarocaineNouaman Fanidi67% (3)
- Définitions MarketingDocument3 pagesDéfinitions MarketingCamille CelerierPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Effectué ÀDocument15 pagesRapport de Stage Effectué ÀRacha SehiLiPas encore d'évaluation
- 1507 711 Salma Boumzguid CV Mvb2bDocument1 page1507 711 Salma Boumzguid CV Mvb2bbenslimane moulay hfidPas encore d'évaluation
- User Manual BPro FR 2Document76 pagesUser Manual BPro FR 2Yacine GraragePas encore d'évaluation
- Con CoursDocument7 pagesCon CoursDony KravitzPas encore d'évaluation