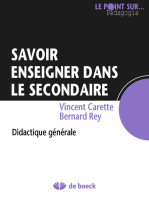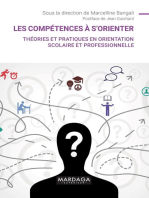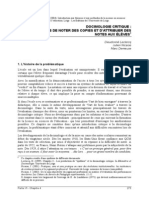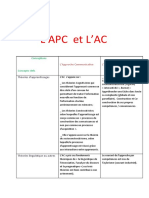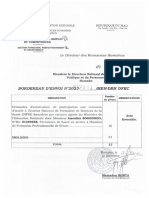Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Pedagogie de L Integration
La Pedagogie de L Integration
Transféré par
oxxwoodTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Pedagogie de L Integration
La Pedagogie de L Integration
Transféré par
oxxwoodDroits d'auteur :
Formats disponibles
La pdagogie de
lintgration en bref
Xavier ROEGIERS
Rabat, Mars 2006
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 2
Table des matires
1 Lapproche par les comptences de base .................................................................. 3
1.1 Lapproche par les comptences de base en quelques lignes ....................................3
1.2 Les objectifs de lapproche par les comptences de base ..........................................3
1.3 Les principales notions relatives lapproche par les comptences de base...........4
1.4 La conception des apprentissages dans lapproche par les comptences.................9
1.5 Comment planifier les apprentissages en termes de comptences de base ?.........11
1.6 Limpact de lapproche par les comptences de base ..............................................12
1.7 Pour en dcoudre avec certaines ides vhicules autour de lapproche par les
comptences...........................................................................................................................14
2 Un cadre de rfrence en matire dvaluation des acquis des lves................... 17
2.1 Une dfinition de lvaluation ....................................................................................17
2.2 Deux types dinformations recueillir......................................................................17
2.3 Les qualits des informations recueillies : pertinence, validit, fiabilit ...............18
2.4 Information, critre, indicateur : des clarifications conceptuelles.........................19
2.5 Le recours aux critres................................................................................................22
3 Llaboration des outils de recueil des informations ............................................. 31
3.1 Llaboration dune preuve dvaluation................................................................31
4 La correction des copies dlves ............................................................................ 36
4.1 Les principes de la correction des copies ..................................................................36
4.2 Des exemples de grilles de correction........................................................................38
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 3
1 Lapproche par les comptences de
base
1.1 Lapproche par les comptences de base en
quelques lignes
Lapproche par les comptences de base repose essentiellement sur les travaux de De
Ketele la fin des annes 80, bass sur la notion dobjectif terminal dintgration.
Dveloppe sous le terme pdagogie de lintgration (Roegiers, 2000), lapproche a
t oprationalise par le BIEF progressivement dans plusieurs pays dEurope et
dAfrique depuis les annes 90, essentiellement au niveau de lenseignement primaire et
moyen (lcole de base), ainsi que de lenseignement technique et professionnel.
Base sur le principe de lintgration des acquis, notamment travers lexploitation
rgulire de situations dintgration et lapprentissage rsoudre des tches complexes,
la pdagogie de lintgration tente de combattre le manque defficacit des systmes
ducatifs (voir ci-dessous les rsultats de lexprimentation).
1.2 Les objectifs de lapproche par les comptences de
base
On peut dire que cette approche poursuit essentiellement trois objectifs principaux
(Roegiers, 2000).
(1) Il sagit tout dabord de mettre laccent sur ce que llve doit matriser la fin de
chaque anne scolaire, et en fin de scolarit obligatoire, plutt que sur ce que
lenseignant(e) doit enseigner. Le rle de celui(celle)-ci est dorganiser les
apprentissages de la meilleure manire possible pour amener ses lves au niveau
attendu.
(2) Il sagit galement de donner du sens aux apprentissages, de montrer llve
quoi sert tout ce quil apprend lcole. Pour cela, il est ncessaire de dpasser des
listes de contenus-matires retenir par cur, des savoir-faire vides de sens, qui trop
souvent ennuient llve, et ne lui donnent pas lenvie dapprendre. Au contraire,
lapproche par les comptences lui apprend situer continuellement les apprentissages
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 4
par rapport des situations qui ont du sens pour lui, et utiliser ses acquis dans ces
situations.
(3) Il sagit enfin de certifier les acquis de llve en termes de rsolution de
situations concrtes, et non plus en termes dune somme de savoirs et de savoir-faire
que llve sempresse souvent doublier, et dont il ne sait pas comment les utiliser dans
la vie active. En cela, lapproche par les comptence de base est une rponse aux
problmes danalphabtisme fonctionnel.
1.3 Les principales notions relatives lapproche par
les comptences de base
1.3.1.1 Quest-ce quune comptence ?
On dit de quelquun quil est comptent lorsque non seulement il possde certains
acquis (connaissances, savoir-faire, procdures, attitudes, etc.), mais surtout lorsquil
peut mobiliser ces acquis de faon concrte pour rsoudre une situation-problme
donne.
EXEMPLES DE COMPETENCES
(1) Tenir une conversation tlphonique qui ne fait pas appel un vocabulaire spcialis, et dans sa
langue maternelle
(2) Rdiger une facture simple (5 10 articles)
(3) partir dune situation vcue mettant en vidence diffrents problmes de pollution de leau, de
lair et de pollution par le bruit, proposer des solutions appropries aux diffrents problmes identifis au
pralable.
Dune faon plus prcise, une comptence est la possibilit, pour un individu, de
mobiliser un ensemble intgr de ressources en vue de rsoudre une situation-
problme qui appartient une famille de situations (Roegiers, 2000).
Parler des comptences suppose que lon voque tout la fois :
- les ressources, cest--dire les savoirs, savoir-faire et savoir-tre que llve va devoir
mobiliser ;
- les situations dans lesquelles llve devra mobiliser ces ressources.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 5
1.3.1.2 Les ressources
Les ressources sont essentiellement les savoirs, savoir-faire et savoir-tre ncessaires
la matrise de la comptence.
Dans lexemple (1) ci-dessus, les ressources suivantes sont mobilises :
- savoirs : la connaissance dun vocabulaire de base pour une conversation
tlphonique, les formules de politesse ;
- savoir-faire : la formulation dune question, la formulation dune rponse une
question pose, le fait de se prsenter, lutilisation du futur, de limparfait... ;
- savoir-tre : le fait dadopter une attitude cordiale, de sintresser son interlocuteur...
Ces ressources relvent de ce que llve apprend lcole. Elles font lobjet
dapprentissages organiss cet effet, que ce soit de faon traditionnelle, ou travers
des situations-problmes didactiques, o llve est mis au centre des apprentissages.
Dautres ressources entrent toutefois en ligne de compte, comme les savoirs
dexprience ou encore les procdures automatises.
Outre les ressources internes llve, ou, de faon plus gnrale, celui qui dveloppe
la comptence, il y a les ressources externes, ncessaires pour exercer la comptence.
Parmi celles-ci, il y a les ressources matrielles : il est difficile de montrer quon est
comptent pour jouer un match en double au tennis, si on ne dispose pas dune
raquette !
1.3.1.3 La notion de situation cible
Une situation cible est une situation qui est le reflet dune comptence installer
chez llve. Elle peut tre considre comme une occasion dexercer la comptence, ou
comme une occasion dvaluer la comptence. Dans lapproche par les comptences de
base, quand on parle de situations, on parle de situations cibles , de situations de
rinvestissement, de situations dintgration (tous ces termes sont des synonymes), pour
bien la distinguer des situations didactiques qui, elles, ont pour fonction de dvelopper
de nouveaux apprentissages de concepts, de savoir-faire, etc
1
. Certains auteurs utilisent
le terme de tche complexe pour dsigner une situation cible . Cest galement un
terme intressant, mais il ne rgle pas la distinction entre une tche qui est une occasion
dacqurir de nouveaux savoirs ou savoir-faire au sein dun groupe classe (situation-
problme didactique) et une tche qui est vise au terme dun ensemble
1
Pour plus de prcisions sur la diffrence entre situation cible et situation didactique , voir
Roegiers (2003).
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 6
dapprentissages ponctuels parce que reprsentative dune comptence acqurir
(situation cible ).
Ces situations cibles sont des situations-problmes complexes, et pas un simple
exercice. Tout comme un joueur de football ne peut pas se contenter dexercer sa
comptence en tirant des penalties, ou en sexerant dribbler, et ne peut vritablement
exercer sa comptence quen jouant un match de football, un lve ne peut dvelopper
la comptence (1) ci-dessus quen tant confront une conversation tlphonique,
dans toute sa complexit. Encore faut-il bien ajuster le niveau : lui proposer de se
contenter dune rplique dans une conversation naurait pas le niveau de complexit
requis. En revanche, lui demander de faire face une conversation spcialise ou dans
une langue trangre serait le piger, parce quil naurait pas acquis les lments qui lui
permettraient de faire face. Tout comme le match de football est une situation pour la
comptence jouer au football , une conversation tlphonique est une situation
cible relative la comptence (1), condition quelle rponde certaines
caractristiques, par exemple le fait que linterlocuteur ne soit pas visible pendant la
communication tlphonique, ou le fait quil y ait un effet de surprise.
De mme, dans lexemple de la comptence (3), une situation cible consiste
prsenter llve un contexte de pollution ( travers un dessin, une photo).
1.3.1.4 La notion de famille de situations
A chaque comptence est associe une famille de situations-problmes. Cest un
ensemble de situations cibles dont chacune est une occasion dexercer la
comptence : une occasion dun niveau de complexit suffisant (en conditions relles),
mais dun niveau qui ne dpasse pas ce qui est attendu. Toutes ces situations sont dites
quivalentes, cest--dire interchangeables en termes de niveau de difficult et de
complexit.
Pour la comptence jouer au football , la famille de situations se dgage
naturellement : cest lensemble des matchs que le joueur pourrait jouer
2
. Sil est
comptent dans un match, il le reste dans un autre. Sauf accident, il suffirait un
entraneur de voir le joueur luvre dans deux ou trois matches pour apprcier sil est
comptent. Il en va de mme des comptences lcole, qui peuvent tre values
travers deux ou trois situations cibles , voire mme une seule, condition que ces
2
Encore quil nest pas la mme chose de jouer un match lentranement, ou devant un public, dans
lequel intervient le stress. Ce sont des comptences diffrentes. On pourrait prciser si la comptence
est jouer un match de football lentranement , ou jouer un match de football devant un
public .
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 7
situations soit reprsentative de la comptence
3
. Ceci ne veut pas dire que llve est
directement valu sur sa comptence : il a dabord loccasion de sentraner. Il en va de
mme dun futur conducteur de voiture : quand il a appris le code de la route, et quil a
acquis les ressources ncessaires pour conduire (embrayer, dbrayer, dmarrer en cte,
etc.), on ne lvalue pas tout de suite. Il faut dabord quil sexerce plusieurs reprises
conduire en situation relle.
Reprenons les exemples proposs ci-dessus.
La famille de situations-problmes de la comptence (1) est lensemble des
conversations tlphoniques diffrentes auxquelles llve devrait pouvoir faire face
(lune avec une tante qui linvite passer des vacances, lautre avec un ami qui lui
demande de ses nouvelles, etc.), condition quelles restent dans les limites fixes : se
drouler dans sa langue maternelle, et ne pas faire appel un vocabulaire spcialis.
La famille de situations-problmes de la comptence (2) est lensemble des factures
que llve devrait pouvoir rdiger, dans des contextes diffrents (une facture qui
mentionne des achats alimentaires, une autre relative des pices de voiture, etc.),
condition que ces factures restent dans les limites fixes : une facture simple, avec 5
10 articles.
Dans lexemple (3), la famille de situations-problmes est lensemble des situations
diffrentes que lon peut soumettre llve, et qui combinent de faon diffrente, dans
des contextes diffrents, des problmes de pollution de leau, de lair, et de pollution par
le bruit.
Llve ne sera dclar comptent que lorsquil pourra faire face nimporte quelle
situation qui appartient la famille de situations, la situation tant nouvelle, indite. La
reproduction pure et simple est donc exclue. Pour le concepteur de programmes et de
manuels, cela implique que, dans chaque famille de situations-problmes, il faut
chercher construire plusieurs situations quivalentes. Par exemple, si on mentionne
dans la comptence (2) quil sagit de factures de 5 10 articles, cest pour situer le
niveau de complexit de la situation. Il en va de mme dans la comptence (1) dans
laquelle on prcise qui ne fait pas appel un vocabulaire spcialis , et dans sa
langue maternelle . Ces prcisions, ou caractristiques des situations de la comptence
sont des paramtres de la famille de situations.
3
Et que lon ait plusieurs occasions distinctes de vrifier chaque critre, comme nous le verrons plus loin
(voir page 23).
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 8
O se trouvent ces situations ? Elles sont construire par les enseignants. Cependant,
certaines peuvent se trouver titre dexemples dans des livrets-programmes, dans des
documents daccompagnement des curriculums, dans des banques de donnes
nationales ou rgionales, dans des cahiers de situations pour les lves ou encore dans
des manuels scolaires.
Sur le plan pdagogique, une fois que les apprentissages ponctuels qui prparent une
comptence ont t dvelopps, cest--dire une fois que les ressources ncessaires
lexercice de la comptence sont installes, on prsente llve plusieurs de ces
situations complexes pour exercer sa comptence (apprentissage de lintgration) ou
pour valuer sa comptence (valuation).
Chacune des situations dune famille de situations peut donc tre exploite
indiffremment dans lapprentissage (pour apprendre llve intgrer ses acquis) ou
dans lvaluation (pour valuer ses acquis)
4
.
1.3.1.5 Quest-ce quun OTI (Objectif terminal dintgration) ?
Un OTI (Objectif terminal dintgration) est une macrocomptence qui recouvre
lensemble des comptences, et donc lensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-tre
dun cycle (en gnral 2 ans). Il traduit le profil attendu de llve au terme dun cycle,
dans une discipline donne, ou dans un champ disciplinaire donn.
Il ne faut pas confondre un OTI avec un objectif gnral, qui, comme son nom
lindique, dsignait dans la P.P.O. des intentions gnrales.
Les objectifs gnraux de la pdagogie par objectifs, par dfinition abstraits et facilement
confondus avec de vagues buts ou des finalits, nont jamais eu de consistance (Vial, p. 150).
Au contraire de lobjectif gnral, un OTI possde un caractre trs prcis, puisque,
comme une comptence de base, il se dfinit travers une famille de situations-
problmes bien dlimites. Ces situations-problmes sont relativement complexes
puisquelles recouvrent lessentiel des acquis dun cycle dans une discipline donne, ou
dans un champ disciplinaire donn.
On recourt galement parfois la notion dOII (Objectif Intermdiaire dIntgration),
qui recouvre lensemble des comptences atteindre au terme dune anne.
4
Pour plus de prcisions sur la construction et la gestion des situations, voir Roegiers (2003).
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 9
1.4 La conception des apprentissages dans lapproche
par les comptences
Dans une approche par les comptences, il y a essentiellement deux moments dans les
apprentissages.
1. Les apprentissages ponctuels des ressources : savoirs, savoir-faire et savoir-tre.
2. Les activits dintgration et dvaluation formative.
1.4.1.1 Apprentissages de savoirs, savoir-faire et savoir-tre
Dans une approche par les comptences, les savoirs, savoir-faire et savoir-tre
continuent faire lobjet dapprentissages ponctuels, selon les mthodes pdagogiques
en vigueur
5
, ceci trois nuances prs :
- on met une priorit dvelopper les savoirs, savoir-faire et savoir-tre qui se
rapportent une comptence ; les autres sont considrs comme des savoirs et des
savoir-faire de perfectionnement, et ne sont abords que si lensemble des comptences
est matris par tous les lves ;
- on essaie, dans la mesure du possible, de rendre ces apprentissages significatifs en
montrant aux lves quoi ils servent, et on amne les lves combiner
progressivement ces ressources (savoirs, savoir-faire et savoir-tre) entre elles ;
- on ne dveloppe ces ressources que pendant une partie du temps scolaire, par exemple
pendant trois semaines sur quatre, afin de laisser du temps pour lintgration des acquis
proprement dite.
1.4.1.2 Les activits dintgration
Dans cette optique, une partie du temps dapprentissage est rserve ce que lon
appelle activits dintgration, cest--dire quelle est consacre apprendre llve
mobiliser ses ressources dans des situations complexes. Ces activits peuvent prendre
place tout moment dans lanne : cest rgulirement que lon soumet llve des
situations complexes, dans lesquelles il peut mobiliser ses acquis.
Une alternative cette faon de faire consiste bloquer une semaine entire pour
lintgration, par exemple une semaine par mois, ou une semaine toutes les 6 semaines.
Concrtement, cette priode consiste prsenter llve une ou deux situations qui
5
Ce qui ne veut pas dire que les mthodes pdagogiques ne sont pas appeles, elles aussi, voluer. Au
contraire, introduire des apprentissages travers des situations-problmes didactiques est un excellent
entranement pour llve, quand il sera invit mobiliser ses acquis dans des situations cibles .
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 10
font partie de la famille de situations, de manire lui apprendre intgrer ses acquis.
En effet, il est rare quun lve puisse automatiquement intgrer ses acquis. Il faut le lui
apprendre.
Cette intgration peut se faire de faon progressive, ou en une fois, lors dun module
plus important, appel module dintgration. Supposons quune comptence ncessite
de dvelopper 8 objectifs de leon, ou squences (savoirs, savoir-faire, savoir-tre).
Lintgration peut se raliser des deux manires suivantes.
- de faon progressive :
Objectif
1
Objectif
2
Objectif
3
Objectif
7
Objectif
8
Objectif
4
Objectif
5
Objectif
6
Intgration partielle
Module
d'intgration
- en fin dapprentissage :
Objectif
1
Objectif
2
Objectif
3
Objectif
7
Objectif
8
Objectif
4
Objectif
5
Objectif
6
Module d'intgration
La premire faon procde par intgration progressive. Elle est plus riche, mais elle
nest pas toujours possible.
Les modules dintgration sont suivis par des modules dvaluation formative. Pour
mener lvaluation formative, on prsente galement aux lves une situation qui
appartient la famille de situations de la comptence.
Lvaluation formative comprend des moments de remdiation o sont travailles les
lacunes des lves.
En fin danne, on trouve lvaluation certificative. Les preuves dvaluation
certificative font elles aussi fait lobjet de situations complexes. Lapproche par les
comptences na ds lors pas de sens si lon ne fait pas voluer les preuves de
module
d'intgration
module d'valuation
formative et de remdiation
valuation
certificative
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 11
lvaluation certificative dans le sens de lapproche par les comptences, en les
construisant sur la base de situations complexes.
1.5 Comment planifier les apprentissages en termes de
comptences de base ?
Une planification annuelle des apprentissages consiste essentiellement partir de la fin
de lanne, et revenir progressivement en arrire. Voici un exemple de planification
type .
(1) Rserver la priode consacre lvaluation finale (valuation certificative).
(2) Dlimiter une priode en dbut danne pour vrifier lOTI de lanne prcdente, et
pour remdier aux principales lacunes (valuation dorientation).
(3) Rserver une priode pour les valuations formatives intermdiaires, et pour les
remdiations.
(4) Rserver une priode (une deux semaines) en fin danne pour dvelopper des
situations qui refltent lOTI de lanne.
(5) De mme, rserver une semaine toutes les 5 ou 6 semaines pour les modules
dintgration. Cest surtout pendant ces modules que se dveloppent les comptences.
Ces semaines seront rserves la rsolution de situations qui refltent chacune de ces
comptences. Cest pendant les mmes semaines que sont menes les valuations
formatives (3).
(6) Rpartir lensemble des apprentissages ponctuels de ressources (savoirs, savoir-
faire, savoir-tre) dans les priodes qui restent.
On peut reprsenter cette dmarche par le schma suivant.
(1) valuation certificative
(3)
(2) (6) (6) (6) (4)
(5)
(6) (6)
(3)
(5)
(3)
(5)
(3)
(5)
(1)
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 12
(2) valuation diagnostique dorientation de dbut danne
(3) valuations formatives intermdiaires
(4) module dintgration de fin danne
(5) modules dintgration intermdiaires
(6) apprentissages ponctuels
Mme sil peut arriver quune comptence se dveloppe pendant quelques semaines
seulement, les comptences se dveloppent en gnral tout au long de lanne. Chaque
priode reprsente un palier pour chaque comptence. Pour chaque comptence,
lanne est ainsi dcoupe en 5 paliers.
1.6 Limpact de lapproche par les comptences de
base
Les principaux rsultats de recherche que lon peut avancer lheure actuelle sont les
suivants.
En Tunisie, un gain de 3 6 points selon les disciplines a t observ, dans lpreuve
de fin de sixime anne primaire, dans les performances des lves qui ont suivi
lapproche par les comptences de base, par rapport aux autres lves
6
. Si les donnes
releves ne permettent pas didentifier la catgorie dlves (forts, moyens faibles)
laquelle lapproche par les comptences de base profite le plus, elles montrent en
revanche de faon claire que ce type dpreuve en termes de tche complexe discrimine
beaucoup mieux les lves forts des lves faibles, et permet notamment de travailler
trs tt avec les lves risque , cest--dire ceux dont il faut peu de chose pour
quils russissent ou pour quils chouent (voir page 28).
6
C.N.I.P.R.E. (Tunis)
(3)
(5)
(3)
(2) (6) (6) (6) (4)
(5)
(6) (6) (1)
Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4 Palier 5
(3)
(5)
(3)
(5)
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 13
Au Gabon, une tude mene sur 7500 lves
7
a montr entre autres choses que
lapproche par les comptences en 1
e
anne primaire (CP1) fait russir 12% dlves
supplmentaires par rapport lapproche sommative. Le gain se situe parmi les primo-
arrivants qui nont pas fait de pr-primaire dune part, et chez les redoublants dautre
part, cest--dire surtout dans les deux catgories les plus fragilises, plus que chez les
lves qui ont suivi un pr-primaire. Les donnes ne permettent cependant pas de
chiffrer les gains relatifs dans chacune de ces deux catgories.
A Djibouti, une tude a t mene en mai 2003, sur deux groupes de 200 dlves de
fin de 2
e
anne primaire de niveaux comparables : un groupe exprimental, constitu
dlves qui ont suivi lapproche par les comptences de base pendant 2 ans, et un
groupe tmoin, de la filire traditionnelle. Des preuves en termes de tches complexes
leur ont t prsentes en franais oral, en franais crit et en mathmatiques (Aden &
Roegiers, 2003).
Sur le plan de lefficacit, les rsultats montrent que lapproche par les comptences
conduit un gain qui se situe autour de 3 points sur 20 en faveur des lves des classes
exprimentales, ceci pour chacune des trois preuves, ce qui permet deux fois plus
dlves environ de disposer des acquis de base pour passer dans lanne suivante.
Sur le plan de lquit, les rsultats montrent que, si on divise les lves en quatre
catgories, savoir les forts, les moyens, les faibles, les trs faibles, lapproche par les
comptences profite chacune des quatre catgories, mais surtout la catgorie des
lves faibles, ensuite celle des lves trs faibles, puis celle des lves moyens et
enfin celle des lves forts.
Il y a donc des gains la fois en termes defficacit interne et dquit
8
. Ces gains sont
essentiellement imputables lintroduction dun module dintgration dune semaine
toutes les 6 semaines, au sein duquel les lves ont loccasion de rsoudre des situations
complexes (situations cibles ) qui mobilisent les ressources acquises pendant les 5
semaines prcdentes.
On observe donc, ct de rsultats relatifs lefficacit interne du systme (davantage
dlves russissent en possdant les acquis de base), des rsultats intressants du point
de vue de lquit puisque, si lapproche par les comptences profite tous les lves,
elle profite surtout aux plus faibles.
Ces rsultats sont confirms par dautres tudes qui montrent en quoi les lves plus faibles ou
de milieux dfavoriss sont loin de russir moins bien les preuves comptences que des
7
IPN Libreville, dcembre 2003, dans le cadre du projet Fed Education
8
Pour la texte complet de ltude, on peut consulter le site du BIEF (www.bief.be).
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 14
preuves ressources , bien au contraire (Allal, Rouiller, Saada-Robert, Wegmuller (1999) ;
Rey, Carette, Defrance, Kahn (2002, 2003) ; Letor, Vandenberghe & Jadoulle (2004,
paratre)).
Lexplication de ce phnomne qui peut paratre curieux a priori semble tre la suivante : dans
le systme traditionnel, les carts entre lves forts et lves faibles sont notamment dus au fait
que les plus forts sont capables dintgrer spontanment : ils nont pas besoin dun
apprentissage spcifique pour rinvestir leurs acquis. Dvelopper des situations dintgration
profite certes aux plus forts dans la mesure o elles constituent des occasions dentranement,
mais encore davantage aux plus faibles dans la mesure o elles constituent pour eux un
vritable apprentissage. Cest un apprentissage quils ont rarement loccasion de faire tant une
ide est fortement ancre dans la tte des enseignants : celle selon laquelle la seule aide pour les
plus faibles est de simplifier les apprentissages. Cest certes vrai certains moments, mais ils
ont autant besoin de revenir ensuite des moments dapprentissage de la complexit, parce que
cest elle seule qui leur permet de mettre en uvre leurs acquis de faon oprationnelle.
1.7 Pour en dcoudre avec certaines ides vhicules
autour de lapproche par les comptences
Examinons certaines critiques mises propos de lapproche par les comptences.
Comme on peut le constater, ces critiques sont parfois opposes les unes aux autres.
Lapproche par les comptences provoque un nivellement des curriculums par le bas.
Il est vrai que, quand un systme ducatif choisit de mettre laccent sur des comptences
dvelopper, cest parfois au dtriment de certains autres acquis. Cest parfois le cas de
lapprentissage de la littrature dans les petites classes. Cest aussi le cas de certains
lments de culture gnrale.
Pour trancher, il faut revenir la question des valeurs que lon veut vhiculer lcole.
Quand, lcole, on dit quil est important que les lves sachent qui est Karl Marx, et
ce quil a fait, de quels lves parle-t-on ? Quest-ce que les lves en font ? Quest-ce
quon fait passer la trappe en prenant du temps pour parler de Karl Marx ? Voil les
questions quil faut se poser avant de dcrter Les lves ne savent plus qui est Karl
Marx . Quand on connat le cot dun systme ducatif dans un pays pauvre, peut-on
se payer le luxe de passer des heures pour apprendre des choses dont seule une petite
fraction dlves va pouvoir faire quelque chose, alors que dans le mme temps ils ne
disposent pas des acquis de base, ou ils en disposent de faon non oprationnelle ? On
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 15
en revient aux choix de valeurs. Le tout est une question de priorits. Bien sr, il nest
pas inutile de parler de Karl Marx, et tous les lves devraient idalement connatre ses
uvres. Mais quelle place faut-il lui laisser ? A quel moment de la scolarit faut-il en
parler ? A quels lves faut-il en parler ? Quel statut lui donner en termes dvaluation
des acquis ?
Cest pour cette raison que certaines recommandations de dcideurs ou dexperts vont
dans le sens de naborder certaines matires qu titre de perfectionnement, ou encore
partir de certains niveaux dtudes (par exemple au collge), quand lensemble des
lves ont acquis les comptences de base qui leur permettent de faire face aux
situations de la vie quotidienne.
Lapproche par les comptences provoque un nivellement du niveau des lves par le
bas.
Nous avons vu ci-dessus que les rsultats dexprience dmentent cette ide, dans la
mesure o lapproche par les comptences de base bnficie lensemble des lves, y
compris la catgorie des lves forts.
Lapproche par les comptences est litiste. Elle ne sadresse quaux lves forts.
Cette ide est galement dmentie par les rsultats de recherche qui semblent montrer
que lapproche par les comptences de base augmente lquit dun systme, en
profitant davantage aux lves faibles quaux lves forts.
Lapproche par les comptences est utilitariste.
Cette critique est fonde en partie, dans la mesure o les situations qui sont prsentes
ont partiellement pour fonction daider les lves sinsrer dans la vie quotidienne.
Cet aspect est toutefois nuancer pour deux raisons.
1. Si ce sont des situations proches de la vie quotidienne qui sont proposes aux lves,
ce nest pas seulement parce quelles les prparent la vie. Cest aussi parce que ces
situations sont riches, et que, sur le plan pdagogique, leur exploitation constitue un
enrichissement, quelles sont intressantes.
2. Il faut galement rappeler que des rsultats de recherche montrent que, si on veut
dvelopper des capacits gnrales trs long terme (des comptences transversales), la
meilleure faon est damener les lves rsoudre de faon rpte des situations
pointues. Dveloppement de capacits long terme et de comptences de base
utilisables directement sont des objectifs diffrents, mais qui, curieusement, empruntent
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 16
le mme chemin en termes dapprentissages : celui de la rsolution par chaque lve de
situations-problmes complexes.
Si on devait rsumer, on pourrait dire quil parat aujourdhui incontournable de
travailler avec les lves sur des situations complexes, pour des raisons defficacit des
apprentissages, qui se doublent de raisons dquit. Tant qu faire, autant que ces
situations soient des situations proches de la vie quotidienne, pour motiver llve, pour
le prparer faire face des situations de la vie de tous les jours, plutt que des
situations construites, artificielles, qui auraient moins cet effet fonctionnel. Il vaut donc
mieux parler dutilit sociale (Roegiers, 2000) que dutilitarisme dans la mesure o le
travail sur des situations proches de situations relles est davantage une occasion saisir
quun but en soi.
Lapproche par les comptences enlve aux lves tout sens critique
Cette critique nest pas fonde, du moins formule comme telle. Sil ne faut pas penser
que comptences rime avec utilitarisme , il ne faut pas non plus penser que les
comptences empchent de dvelopper lesprit critique des lves. Tout dpend de la
faon dont on dfinit les comptences. Par exemple, au Burkina Faso, les comptences
en histoire de la fin de lcole primaire sont exprimes en termes de regard critique
poser sur des vnements actuels et passs.
Lapproche par les comptences est un cadre de travail qui amne llve rsoudre des
problmes. Cest un cadre large, qui permet une vaste catgorie de situations-
problmes dtre traits. La rduction quen font certains nest pas imputable
lapproche elle-mme.
Lapproche par les comptences met davantage laccent sur lvaluation que sur les
apprentissages.
Cette critique est fonde en partie galement. Lapproche par les comptences de base
ne fait toutefois certainement pas limpasse sur les apprentissages, mais il est vrai que
lvaluation constitue une porte dentre privilgie pour lvolution des pratiques de
classe. Lide est de commencer par transformer lide que les acteurs (enseignants,
lves, parents) se font de lvaluation, dans la direction du travail sur des situations
complexes, pour entraner ensuite le reste des apprentissages ponctuels voluer
progressivement dans le sillage des activits dintgration et dvaluation.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 17
2 Un cadre de rfrence en matire
dvaluation des acquis des lves
2.1 Une dfinition de lvaluation
Au sens tymologique du terme, valuer vient de ex-valuere , cest--dire extraire
la valeur de , faire ressortir la valeur de . Nous reviendrons plus tard sur cette
dfinition qui voque un changement dattitude par rapport lvaluation, dans laquelle
on valorise ce que llve produit de positif.
Parmi lensemble des dfinitions qui ont t donnes de lvaluation, celle de De Ketele
(1989) reste encore aujourdhui parmi les plus oprationnelles et les plus compltes.
valuer signifie
9
.
recueillir un ensemble dinformations suffisamment pertinentes, valides et
fiables
et examiner le degr dadquation entre cet ensemble dinformations et un
ensemble de critres adquats aux objectifs fixs au dpart ou ajusts en cours de
route,
en vue de prendre une dcision.
2.2 Deux types dinformations recueillir
On distingue en gnral deux types principaux dinformations (De Ketele & Roegiers,
1996) :
les faits : ce sont toutes les informations que lon peut objectiver dune faon ou
dune autre : un nombre de personnes qui, le niveau de matrise attest de tel savoir-
faire, de telle comptence, la proportion denseignants qui, etc. ;
9
De Ketele, J.-M., (1989), L'valuation de la productivit des institutions d'ducation, Cahiers de la
Fondation Universitaire : Universit et socit, le rendement de l'enseignement universitaire.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 18
les reprsentations : ce sont les avis, les perceptions, les images de personnes
concernes par lvaluation.
Les faits
Les faits sont des informations objectivables, et auxquelles on peut se fier, du moins
lorsquelles sont recueillies dans les conditions de pertinence, de validit et de fiabilit
suffisante (voir ci-dessous). En revanche, elles sont souvent pauvres et peu porteuses de
sens, parce que peu dtailles et peu nuances. Cest pour cette raison quil convient de
les combiner avec des reprsentations, qui donnent une information plus riche, plus
significative, plus comprhensive. Par exemple, on dira Joseph na pas pu excuter la
performance attendue en ducation physique (fait). Je pense quil a t impressionn
(ou il dit quil a t impressionn) par laccident dont il a t tmoin ce matin
(reprsentation). La combinaison de ces deux types dinformations donnent un tableau
plus nuanc de la situation de Joseph.
Les reprsentations
Les reprsentations sont des informations importantes, mais il convient de les traiter
avec prudence. Ce nest pas parce quune personne donne un avis quil faut fonder des
conclusions sur ce seul avis : il faut le confronter dautres avis. Par exemple, llve
qui dcrte Jai acquis la comptence de traduire en anglais un article de journal de
20 lignes exprime une reprsentation, quil convient de confronter dautres sources
dinformation, du moins si on veut valider la comptence chez llve en question.
2.3 Les qualits des informations recueillies :
pertinence, validit, fiabilit
Le tableau suivant reprend les trois qualits dun recueil dinformations.
La question poser Ce qui est en jeu
Pertinence des
informations
Est-ce que les informations que je
choisis de recueillir sont les bonnes
informations ?
Le choix du type
dinformations
recueillir
Validit des
informations
Est-ce que mon dispositif de recueil
dinformations garantit que les
informations que je recueille sont celles
Le dispositif de recueil
dinformations, les
instruments de recueil, et
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 19
que je dclare vouloir recueillir ? plus largement la
stratgie
Fiabilit des
informations
Est-ce que les conditions du recueil
dinformations sont telles que les mmes
informations seraient recueillies un
autre endroit, par une autre personne,
un autre moment ?
Les conditions dans
lesquelles se droule le
recueil dinformations
2.4 Information, critre, indicateur : des clarifications
conceptuelles
2.4.1 La notion dinformation
Comme dans toute valuation, la notion dinformation est centrale dans lvaluation des
acquis des lves, puisque lvaluation consiste recueillir de linformation. Mais de
quelle information parle-t-on ?
On peut identifier quatre types principaux dinformations recueillir, que lon peut
dailleurs dcider de combiner ou non. Ces quatre types correspondent aux quatre
mthodes de recueil dinformations (De Ketele & Roegiers, 1993, 3
e
dition 1996) :
questionnaire, interview, observation, tude documentaire.
- Des performances ralises par les lves, propos de comptences, dobjectifs
spcifiques, de savoirs, de savoir-faire, de savoir-tre acqurir. Ces informations
peuvent tre soit une performance excuter, un projet monter, une tche
raliser (disciplines artistiques ou manuelles, dans lesquelles la composante
gestuelle est prdominante), soit des informations orales (preuves orales), soit
encore et cest le cas le plus frquent des informations crites, recueillies
travers des preuves organises cette fin (disciplines ou champs disciplinaires dans
lesquel(le)s la composante cognitive est dominante). Selon les niveaux et les
disciplines, ces dernires informations sont soit des rponses, lorsquon pose des
questions llve, soit des productions, lorsque lon donne llve une consigne
de travail (Roegiers, 2003).
- Des reprsentations des acteurs concerns par les acquis scolaires propos de ces
acquis : llve lui-mme, ses camarades de classe, ses parents, ses enseignants, les
personnes qui le ctoient (ducateurs, psychologues, orthophonistes). Ces
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 20
reprsentations sont la plupart du temps recueillies travers des entretiens
informels. Entrent dans cette catgorie les reprsentations qua llve de ses
propres acquis et de la faon dont il les acquiert (mtacognition), lexplicitation
quil fait dun processus cognitif, le regard quil porte sur un travail (grille
dautovaluation), dans le sens du modle de lvaluation formatrice.
- Des faits observs en classe, ou en dehors de la classe, propos des acquis dun
lve : une raction propos de telle tche accomplir, de tel savoir mobiliser, de
tel savoir-faire, de tel savoir-tre. Ces ractions peuvent tre de diffrents types :
une question pose, un (ds)intrt particulier, attention/distraction, rapidit/lenteur,
un manque de comprhension, une demande de clarification, un (ds)investissement
particulier, etc.
- Des informations releves sur les documents utiliss par llve en classe ou en
dehors de celle-ci, cest--dire sur des documents authentiques : son journal de
classe, ses cahiers, ses manuels scolaires (cahiers dexercices), un portfolio, etc. Ces
informations peuvent tre de tous types : ratures, productions scolaires, dessins,
commentaires spontans, cours inachevs, etc.
Selon les valuations mener, une seule catgorie dinformations peut tre mobilise,
ou plusieurs, voire toutes.
Dans la mesure o lvaluation vise donner du sens (surtout dans le cas de
lvaluation dorientation, de lvaluation de rgulation, de lvaluation formative), on
peut galement recueillir des informations de contexte, comme les caractristiques
socioculturelles des lves, afin de mettre du relief et des nuances dans les conclusions
de lvaluation.
Selon les critres dvaluation que lon se donne, ces informations seront pertinentes, ou
non.
2.4.2 La notion de critre
Le critre est considr comme une qualit que doit respecter le produit dune tche
complexe. Il est pris dans le sens dun critre de correction dune production. Cela
signifie quun critre sera une qualit que lon attend de la production dun lve : une
production prcise, une production cohrente, une production originale, etc.
Un critre est donc un point de vue selon lequel on se place pour apprcier une
production. Cest un peu comme une paire de lunettes que lon mettrait pour examiner
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 21
une production : si on veut valuer une production travers plusieurs critres, on
change chaque fois de paire de lunettes. Les diffrentes paires de lunettes sont choisies
de manire ce que le regard soit le plus complet possible. Si un lve excute une
performance sportive collective, on peut par exemple examiner cette performance
sportive selon plusieurs points de vue : lesprit dquipe, la dextrit, llgance, le
respect des rgles, etc. Ce sont autant de paires de lunettes que lon met.
2.4.3 La notion dindicateur
Parmi les informations que lon relve dans le cadre dune valuation, il y a les
informations relatives la correction des copies dlves. Ce sont des informations
relatives une des catgories abordes la page 19 : la catgorie des performances
ralises par les lves.
Si les critres donnent le sens gnral dans lequel la correction doit seffectuer, ils ne
sont la plupart du temps pas assez prcis pour permettre une correction efficace.
En effet, un critre possde un caractre gnral, et abstrait. On ne peut apprcier un
critre que de faon globale, sauf si on se donne un moyen de lapprocher de faon plus
prcise : cest le rle des indicateurs.
Les indicateurs sont de l'ordre de l'observable en situation, et ont une valence positive
ou ngative. Ils prcisent un critre, ils permettent doprationaliser un critre.
EXEMPLES
Le critre prsentation correcte dune copie peut soprationaliser travers quelques
indicateurs : : prsence de titres identifiables, absence de ratures, absence de taches
Le critre correction syntaxique dune production peut tre oprationalis par les indicateurs
suivants : prsence dun verbe dans une phrase, agencement correct des mots dans la phrase,
utilisation correcte des substituts
Selon les cas, un indicateur prcise :
- la prsence ou labsence de (indicateur qualitatif) ;
- le nombre de , la quantit de, la proportion de (indicateurs quantitatifs
absolus) ;
- le taux daugmentation ou de diminution de (indicateurs quantitatifs relatifs).
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 22
2.5 Le recours aux critres
2.5.1 A partir de quand un critre est-il matris ?
La matrise dun critre, entre la photo souvenir et le mythe de llve parfait
La question de la matrise dun critre est un point important, et dlicat. Doit-on exiger
quun critre soit vrifi une seule fois pour que sa matrise par llve soit acte ? On
tomberait alors dans le travers de guetter la moindre occasion de voir llve matriser le
critre, que lon immortaliserait comme une photo souvenir, sans oser vrifier si la
performance est due un tat de grce passager, au hasard des circonstances, un effet
dosmose, ou au contraire si elle sinstalle dans le temps.
A linverse, pour quun critre soit dclar atteint, llve doit-il en manifester la
matrise chaque occasion ? On tomberait alors dans le mythe de llve parfait, qui
veut quun lve soit dclar comptent lorsquil ne commet plus aucune erreur. Or,
comptence nest pas perfection. Mme le plus comptent commet des erreurs , dit-
on. Quel est le grand joueur de football qui na jamais rat un penalty ? Quel est le
grand cuisinier qui na jamais rat un plat ? Lcole aurait-elle ce point perdu la tte
quelle ne permettrait pas un lve en apprentissage ce qui est permis au plus grand
spcialiste ?
Dautres questions se posent galement. Un critre vrifi dans une comptence reste-t-
il acquis dans une autre comptence ? Un critre vrifi en situation provoque (un
examen par exemple) mais non en situation naturelle est-il considr comme acquis ?
Que faire par exemple de ces lves qui ne remettent une copie sans faute dorthographe
que lorsquil sagit dune situation dexamen ? Que se passe-t-il lorsque le nombre de
critres devient important (Gerard & Muguerza, 2000) ?
Une formalisation souvent utile
Il est des cas o point nest besoin de formaliser : la connaissance qua lenseignant de
ses lves suffit, grce lexprience et/ou lexpertise acquise. Mais dans la plupart des
cas, il est utile de formaliser les choses. La rgle des 2/3, propose par De Ketele
(1996), et valide empiriquement, donne des rponses intressantes cette question.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 23
La rgle des 2/3
10
La rgle des 2/3 consiste construire lpreuve dvaluation de faon telle que llve ait trois
occasions indpendantes de montrer sa matrise de chaque critre.
Ces trois occasions peuvent prendre des formes diverses. Ce peut tre :
- trois questions pour vrifier le critre adquation par rapport la consigne , ou pertinence
de la production
- trois phrases dont on souhaite vrifier le critre correction syntaxique
- trois occasions deffectuer une technique de calcul, pour le critre utilisation correcte des outils
mathmatiques en situation
- etc.
On considre quil y a matrise dun critre par llve lorsque celui-ci montre sa matrise du
critre lors de 2 occasions sur 3 au moins : 2 phrases sur 3 correctes sur le plan syntaxique, 2
rponses en adquation avec la consigne, etc. Ce seuil de matrise porte le nom de matrise minimale
du critre. La matrise maximale correspond pour sa part la russite lensemble des occasions de
montrer sa matrise dun critre.
On nexige donc pas la perfection de la part de llve : une erreur ne signifie pas la non-matrise
et lchec. Ce nest qu partir o lerreur se rpte que lon parle de non-matrise.
Les trois occasions doivent tre de relles occasions, cest--dire quil faut garantir que lon puisse
apprcier positivement le critre 2 si llve sest tromp dans le critre 1. Si par exemple le critre 1
est le critre choix du bon outil mathmatique, et le critre 2 est le critre utilisation correcte des
outils mathmatiques en situation, il faut pouvoir se prononcer sur lutilisation correcte des outils
mathmatiques par llve (critre 2), mme sil sest tromp doutil (critre 1). Sinon, on a un critre
qui est absorbant (dans ce cas, le critre 1).
Ces trois occasions doivent tre galement indpendantes, cest--dire que la russite de loccasion
2 ne doit pas dpendre de la russite de loccasion 1.
Selon les cas, il y aura une production relativement courte de la part de llve, cette production
tant analyse selon plusieurs regards, correspondant chacun un critre. En gnral, cest le cas des
disciplines orientes vers une production originale (un repas, une uvre artistique, une production
littraire, une ralisation manuelle,...). Cest galement le cas de la production dun crit (en langue),
que lon regarde selon la cohrence smantique, la correction syntaxique, etc.
Dans dautres cas, il y aura une question pour chacun des critres, ou plutt trois questions (items)
pour chacun des critres, chaque item ne servant qu se prononcer sur un critre.
Remarque : on na pas toujours loccasion de vrifier un critre trois fois exactement. Le minimum
est de trois fois. Lorsquil sagit de plus de trois fois, on peut prendre des proportions proches de 2/3
comme point de repre pour la matrise minimale :
3 sur 4 3 sur 5 4 sur 6 5 sur 7 etc.
10
Pour plus de prcisions, voir Roegiers (2000).
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 24
2.5.2 Les principaux critres (liste propose titre indicatif)
Les principaux critres en langue (primaire / collge)
Critres gnralement prsents
Adquation de la production au support (pertinence)
Correction de la langue (correction syntaxique)
Autres critres pouvant apparatre
Respect de la consigne
Volume
Cohrence smantique
Correction orthographique
Originalit
Correction de la prononciation
Les principaux critres en mathmatiques
Critres gnralement prsents
Interprtation correcte de la situation problme
Utilisation correcte des outils mathmatiques en situation
Cohrence de la rponse
Autres critres pouvant apparatre
Prcision
Caractre personnel de la production
Attention ! Eviter le critre correction de la rponse
Dans les sciences sciences humaines
Critres gnralement prsents
Pertinence de la production
Utilisation correcte des outils de la discipline
Qualit / cohrence de la production
Autres critres pouvant apparatre
Qualit de la langue
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 25
2.5.3 Critres minimaux et de perfectionnement
Dans le cadre de lvaluation dune tche complexe, il est intressant de distinguer deux
catgories de critres : les critres minimaux et les critres de perfectionnement (De
Ketele, 1996). Les critres minimaux sont ceux qui dterminent la russite, cest--dire
la matrise de la comptence. Les critres de perfectionnement sont des critres non
strictement indispensables, qui situent les productions des lves entre une production
tout juste satisfaisante et une production excellente. Les critres de prsentation,
doriginalit, de prcision sont en gnral des critres de perfectionnement.
Comment dterminer si un critre est un critre minimal ou un critre de
perfectionnement ? Si llve trbuche sur un critre, mais russit tous les autres,
estime-t-on que la comptence est acquise malgr tout ? Si oui, alors ce critre est un
critre de perfectionnement. Si on estime que la comptence nest pas acquise, cest un
critre minimal. Dans ce cas, il faut orienter leffort de llve en direction de ce critre
pour quil puisse matriser la comptence.
La rflexion sur les critres minimaux et les critres de perfectionnement pose donc la
question de savoir quelle est la limite de la matrise dune comptence.
Il faut viter davoir trop de critres parce que cela allonge le temps de correction de
lenseignant. Il faut aussi viter davoir trop de critres minimaux, parce quon risque
dtre trop svre. Pour dterminer si un critre est minimal, il faut se poser la question :
un lve qui choue ce critre, peut-il nanmoins tre dclar comptent ? . Par
exemple, un lve qui effectue une production excellente en histoire, mais qui fait
plusieurs fautes dorthographe, mrite certes de ne pas avoir le maximum, mais mrite-
t-il dchouer dans la comptence ?
Quels poids accorder aux critres de perfectionnement ?
Dans une optique de matrise des comptences, il est normal que le poids accord aux
critres de perfectionnement soit limit. En effet, un enjeu majeur est dviter les checs
abusifs. Pour cela, il faut garantir que les checs soient dus la non-matrise des critres
minimaux ceux qui traduisent vritablement la comptence , et non celle des
critres de perfectionnement. De mme, si on veut viter les russites abusives, il sagit
dviter quun lve puisse russir grce sa matrise des critres de perfectionnement.
La rgle des 3/4 , introduite par De Ketele (1996) propose ce sujet un garde-fou
intressant
11
.
11
De mme que la rgle des 2/3, la rgle des 3/4 doit tre considre comme un point de repre parmi
dautres, propos dans un souci doprationalit, et non comme une norme respecter.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 26
La rgle des 3/4
La rgle des 3/4 veut que le poids attribu aux critres de perfectionnement dans une preuve
dvaluation ne dpasse pas 1/4, ce qui permet aux critres minimaux davoir un poids qui soit au
moins de 3/4.
Si un poids suprieur tait attribu aux critres de perfectionnement, on naurait pas la garantie
quun lve qui ne matrise que les critres minimaux arrive au seuil de russite.
Supposons en effet que 1/3 du poids soit mis sur des critres de perfectionnement, et 2/3 sur des
critres minimaux. Un lve qui russit 2/3 des occasions relatives aux critres minimaux (la matrise
minimale) devrait avoir russi, selon la rgle des 2/3 (voir page 23). Or, mathmatiquement parlant, il
nobtient que 2/3 x 2/3 des points, soit 4 points sur 9, cest--dire moins que la moiti des points.
Bien sr, on nest pas oblig de compter en points , mais lexprience montre que rares sont les
systmes ducatifs qui peuvent se dbarrasser entirement dune note chiffre. Nous reviendrons plus
tard sur cette question.
La rgle des 3/4 complte donc la rgle des 2/3 en ce sens que, si un lve satisfait 2 fois sur 3 aux
critres minimaux, qui eux-mmes reprsentent 3/4 des points, il est certain dobtenir 2/3 x 3/4 des
points, cest--dire 50% des points. La russite est donc certifie avec la matrise minimale des critres
minimaux.
En rsum, on peut dire quon peut faire reposer lvaluation certificative sur deux rgles nonces
ci-dessus : la rgle des 2/3 et la rgle des 3/4.
1. Les preuves dvaluation doivent comporter au minimum 3/4 de critres minimaux (cest--
dire maximum 1/4 de critres de perfectionnement).
2. La matrise minimale des critres minimaux est une matrise des 2/3 des occasions de vrifier
ces critres minimaux.
Le choix de 2/3 et de 3/4 nest pas un hasard. En effet, lorsquon combine ces deux rgles, on
saperoit quun lve qui russit 2/3 des occasions de montrer sa matrise des critres minimaux (3/4
du poids total) est un lve qui obtient 50% des points
12
.
12
Ce seuil de 50% doit tre pris ce faon nuance. Il ne fait que reflter que les pratiques courantes en
vigueur, mais il ne faut pas entendre que des dcisions de matrise doivent ncessairement tre valides
sur la base de 50% de russite. Certains enseignants travaillent par exemple des chelles dapprciation
dans une logique de la pdagogie de matrise, en dterminant des seuils de matrise 80%.
3/4 du poids sur les critres minimaux
une russite de 2/3 des occasions de montrer
sa matrise des critres minimaux
2/3 de 3/4 = 50% pour la russite minimale des critres minimaux
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 27
De mme que la rgle des 2/3, la rgle des 3/4 est valable aussi bien quand on value des contenus
que quand on value des comptences ou encore lobjectif terminal dintgration. Ces rgles ne
constituent quune proposition doprationalisation du recours aux critres. Dautres formes
dutilisation des critres, plus lgres, ou au contraire plus dtailles, peuvent tre imagines en
fonction du contexte spcifique dans lequel on se trouve.
Comment choisir les critres, et comment dterminer si un critre est minimal ou de
perfectionnement ?
On peut procder par deux dmarches, qui ne sont pas ncessairement contradictoires.
On peut tout dabord procder par consensus, partir de lavis de plusieurs experts. Par
exemple, on rassemble un ensemble dinspecteurs, de conseillers pdagogiques,
denseignants, qui se prononcent sur les critres minimaux ou de perfectionnement.
On peut aussi sy prendre de faon empirique, partir de lanalyse de copies dlves.
On met dun ct les lves que lon estime tre les lves qui ont russi, cest--dire
qui ont matris la comptence, et dun autre ct ceux dont on estime quils ne la
matrisent pas. Les critres minimaux sont ceux qui sont respects par les lves qui ont
russi, sans ltre par ceux qui ont chou.
2.5.4 Lindpendance des critres entre eux
Une des qualits principales des critres est dtre indpendants les uns des autres. Par
exemple, la pertinence de la production permettra de dterminer si llve a rpondu
ce qui tait demand, tandis que la cohrence de la production dterminera si ce quil
crit se tient, mme sil ne rpond pas ce qui est demand.
Cette indpendance est importante pour viter de pnaliser deux fois un lve qui
commet une erreur. Par exemple, un lve qui sest tromp dans un calcul ne devrait
tre pnalis que pour le critre utilisation correcte des outils mathmatiques , et non
pour les autres critres (interprtation correcte du problme, prcision,).
Pour cette raison, il est bon dviter, dans les disciplines scientifiques, le critre
Rponse correcte , car cest un critre qui englobe tous les autres critres : un lve
qui fait une seule erreur est de toutes les faons sanctionn ce critre, de mme quil le
sera probablement dans un des autres critres. Ce critre est un critre absorbant . La
seule utilisation que lon pourrait en faire serait dexaminer tout dabord si la rponse de
llve est correcte. Dans laffirmative, on attribue la note maximale llve
13
, dans la
13
Du moins sur les critres lis lexactitude de la rponse (pas sur un critre propret par exemple)
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 28
ngative, on regarde lensemble des critres, ce qui fait gagner lenseignant du temps
dans la correction. Nous reviendrons sur cette pratique plus loin.
2.5.5 Le nombre optimal de critres
Nous avons vu ci-dessus que le recours aux critres prsente trois avantages majeurs
dans lvaluation.
1. Des notes plus justes
Tout dabord, il permet de rendre les notes plus justes que dans lapproche
traditionnelle, dans la mesure o le recours aux critres limite les checs abusifs, et les
russites abusives. Autrement dit, il permet de faire russir une plus grande proportion
dlves qui ont les acquis pour russir, et de faire chouer une plus grande proportion
de ceux qui doivent chouer, parce quils ne possdent pas les acquis qui leur
permettent de passer dune classe lautre.
2. La valorisation des points positifs
Ensuite, le recours aux critres permet en gnral de valoriser les lments positifs dans
les productions des lves, et par l dlever les notes. Nous verrons quune recherche
voque ci-dessous confirme cette tendance.
3. Une meilleure identification des lves risque
Enfin, le pouvoir discriminatoire du recours aux critres est suprieur, cest--dire que
le recours aux critres permet de distinguer beaucoup mieux les lves risque, cest--
dire les lves qui il faut peu de chose pour basculer au-dessus ou en dessous du seuil
de russite, comme en tmoigne une recherche rcente mene en Tunisie
14
, ou encore
les recherches menes par Jadoulle & Bouhon (2001). En effet, il permet de
diagnostiquer de faon plus efficace les difficults rencontres par les lves, et
lidentification dun critre dficient donne des pistes pour la remdiation. Dans
lapproche traditionnelle, de par le jeu de lchantillonnage de savoirs et dobjectifs
spcifiques qui sont valus, le fait quun lve chouait quelques savoirs ou quelques
objectifs spcifiques ne donnait pas la garantie que, si on remdie aux faiblesses, llve
possde les acquis ncessaires pour passer dun niveau un autre.
14
Recherche mene dans le cadre du C.N.I.P.R.E., cite dans Roegiers (2000)
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 29
Si le recours aux critres nest plus contest dans le monde des sciences de lducation,
son utilisation est parfois galvaude. En particulier, on aurait spontanment tendance
multiplier le nombre de critres pour apprcier de faon la plus fine possible une
production donne. La pratique montre le contraire : un petit nombre de critres
permet souvent darriver une note plus juste.
Quatre raisons essentielles justifient le fait de limiter le nombre de critres.
1. Leffort de correction
La premire raison est lie leffort de correction. Plus un systme prne la
multiplication du nombre de critres, et plus il court le risque que ces critres ne soient
pas utiliss du tout par les enseignants, pour une raison de temps de correction.
2. La prise en compte des critres pendant les apprentissages
La deuxime raison tient au potentiel des enseignants et des lves prendre en compte
de faon spontane les critres dans les apprentissages. Tout comme ils peuvent assez
facilement avoir en tte deux ou trois comptences dvelopper chez les lves, les
enseignants peuvent assez facilement sapproprier un petit nombre de critres, et les
mobiliser de faon spontane, non seulement au moment de la correction, mais au cours
des apprentissages. Si leur nombre augmente, ces critres perdent de facto leur statut de
point de repre.
Il en va de mme des lves qui peuvent tre attentifs deux ou trois critres lorsquils
effectuent une production, mais qui, lorsquils ont un grand nombre de critres
prendre en compte, peuvent plus difficilement cibler leur effort.
3. Le risque de dpendance des critres entre eux
La troisime raison, plus technique, est lie au risque de dpendance. Plus le nombre de
critres est lev, plus on a des chances de trouver des critres qui ne sont pas
indpendants lun de lautre : en augmentant le nombre de critres, on multiplie les
chances quune erreur de llve soit sanctionne deux, voire trois fois.
4. Les effets lis au comportement du correcteur
Pour bien cerner ces effets lis au comportement du correcteur, prsentons les rsultats
de la recherche suivante, visant dterminer leffet du nombre de critres sur la qualit
de la correction. Dans cette recherche, les trois premiers facteurs (leffort de correction,
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 30
la prise en compte des critres pendant les apprentissages et lindpendance des critres)
sont neutraliss, et seule entre en ligne de compte la faon dont le correcteur opre.
Les considrations mises ci-dessus ne portaient que sur les critres. Pour rduire
encore lcart type relatif la note des diffrents correcteurs, on peut encore jouer sur
les indicateurs et sur la grille de correction (voir plus loin), dont il est utile quelle
soit dtaille.
En rsum, il vaut mieux un petit nombre de critres et des grilles de correction
prcises, assez dtailles sur la base dindicateurs, quun grand nombre de critres,
surtout lorsquon ne dispose pas de grille de correction.
2.5.6 Faut-il communiquer les critres aux lves ?
Les pdagogues ont dj rpondu depuis longtemps la question de savoir sil faut
communiquer les critres aux lves. La rponse est positive, bien entendu, sans
aucune restriction.
Cette pratique a en effet plusieurs consquences positives.
Tout dabord, les rsultats de recherche (Bonniol, 1985 ; Jadoulle & Bouhon, 2001) ont
montr quun lve qui connat les critres dvaluation effectue des meilleures
performances lexamen, parce quil sait comment orienter son effort dans la
prparation de lexamen.
Ensuite, il sagit l dun levier gigantesque pour lautonomie de llve, dans la mesure
o non seulement on lui donne la liste des critres de correction, mais on lui propose
galement des grilles dautovaluation labores sur la base de ces critres, voire mme
on lui fait construire ce type de grille par lui-mme. Ces outils sont des supports
privilgis pour lautovaluation, qui elle-mme dclenche des dmarches
mtacognitives chez llve. Les travaux sur lautovaluation et la mtacognition (Nol,
1991, 2001 ; Grangeat, 1998 ; Allal, 2001) mettent en vidence lapport de ces types de
pratiques dans la rgulation des apprentissages.
Ces rflexions vont dans le mme sens que les prcdentes, qui portent sur les critres
comme axes des apprentissages. Il est beaucoup plus efficace daccorder une place de
choix aux activits visant apprendre llve matriser les critres que de baser les
apprentissages sur la seule matrise des contenus. Mais il sagit l dun changement
culturel, qui touche lhabitus, aux comportements intrioriss de lenseignant, et ce
type de changement met toujours un certain temps sinstaller en profondeur.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 31
3 Llaboration des outils de recueil des
informations
3.1 Llaboration dune preuve dvaluation
3.1.1 Les qualits dune preuve dvaluation travers une situation complexe
Rappelons que nous entendons ici par preuve dvaluation une ou plusieurs
situations dintgration, des situations complexes, travers lesquelles llve dmontre
sa comptence. Dans la pdagogie de lintgration
15
, les preuves consistent
essentiellement en des situations appartenant la famille de situations de la comptence
ou de lOTI
16
que lon veut valuer.
Voici les qualits requises pour llaboration dune situation dintgration, cest--dire
pour llaboration dune situation cible (Roegiers, 2003).
1. Une situation dintgration
Susciter lintgration des savoirs et savoir-faire, non leur juxtaposition
2. Une situation nouvelle
Garantir le caractre de nouveaut de la situation
Eviter la restitution dguise
Travailler sur des documents indits
3. Une situation dbouchant sur une production
Prfrer une consigne une question, ou un ensemble de questions
4. Une situation dont llve est acteur
Rendre la situation grable par chaque lve compte tenu du contexte local
Sadresser personnellement llve
5. Une situation en adquation avec les objectifs pdagogiques
Se situer au sein dune situation de communication
Proposer une consigne en adquation avec la comptence vise
Eviter la drive littraire
6. Une situation dun niveau adapt
15
Roegiers, 2000
16
Pour rappel, lOTI est lObjectif Terminal dIntgration, la macro-comptence de fin de cycle dans
une discipline donne
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 32
Donner la situation le niveau de difficult voulu (savoirs, savoir-faire mobiliser)
Ajuster les donnes, et la faon de les fournir llve
Ajuster le niveau par les contraintes
7. Une situation qui vhicule des valeurs positives
Vhiculer des valeurs positives
8. Une situation significative pour llve
Donner la situation un but oprationnel
Choisir un contexte qui parle llve
Illustrer
Introduire des donnes qui soient, sinon relles, du moins vraisemblables
Travailler sur des documents authentiques
9. Une situation dont la prsentation est accessible
Rendre lisible la prsentation de la situation
Proposer une consigne claire
Eviter des supports trop verbeux
10. Une situation valorisante pour llve
Rendre les consignes / questions indpendantes
Ces qualits sont valables pour toutes les situations cibles , quelles soient utilises
des fins dapprentissage de lintgration ou des fins dvaluation.
Seule va changer la faon dont on prsente la situation.
Exemple de situation (Djibouti, Roegiers, 2003)
AVIS DE CANDIDATURE
Un grand htcl dc la placc chcrchc
pour une activit tcmpnrairc (juillct ct ant)
Unc pcrsnnnc chargcc dc la rcccptinn dc la clicntclc
ayant unc matrisc dcs langucs natinnalcs (afar, snmali, arabc)
parlant ct ccrivant cnrrcctcmcnt lc franais (nivcau 3
c
)
ayant dcs facilitcs dc cnmmunicatinn
dispnniblc lc wcck-cnd a tcmps plcin
Adrcsscr unc lcttrc dc mntivatinn
a la bntc pnstalc n 426 - DJIBOUTI
Tu es inferesse(e) por cef ovis de condidofure pubIie dons Ie journoI Lu Nution.
Pedige une Ieffre d'une poge environ pour exposer Ies roisons qui f'omnenf presenfer fo
condidofure.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 33
N.B. Ce type de situation est particulirement recherch dans la pdagogie de
lintgration, parce quelle repose sur un support actif : pour produire, llve est
oblig de manifester sa comprhension du texte qui sert de support. On combine donc la
production crite et la comprhension la lecture, qui sont les caractristiques dune
situation de communication lcrit.
3.1.2 Les tapes de llaboration de lpreuve dvaluation
On peut rsumer par les tapes suivantes la dmarche suivre pour construire une
situation des fins dvaluation :
- choisir la comptence (les comptences) ou lOTI valuer ;
- choisir ou construire une ou deux situations de la famille de situations, mais en
sassurant que llve nait pas encore rencontr ces situations quon lui demande de
rsoudre, sinon ce serait de la reproduction !
- veiller ce que chaque critre puisse tre vrifi plusieurs reprises, de faon
indpendante (au moins trois fois, si on veut respecter la rgle des 2/3) ;
- rdiger soigneusement les supports et les consignes pour que la tche excuter
apparaisse clairement llve ;
- prciser les indicateurs que lenseignant relvera lorsquil passera la correction de la
copie ;
- rdiger la grille de correction.
Voici quelques prcisions pour guider certains choix poser. Ces questions refltent
celles que lon pose habituellement lorsquil sagit dlaborer des preuves dvaluation
sur la base de situations complexes.
3.1.3 Quelques questions pour guider les choix
Choisir une ou deux ou trois situations ?
Limportant, cest que chaque critre puisse tre valu plusieurs reprises, de faon
indpendante. Trois occasions apparaissent comme un point de repre intressant (voir
page 23). Dans certains cas, une situation unique suffira pour que chaque critre puisse
tre valu trois reprises diffrentes. Dans dautres cas, il faudra recourir deux, voire
trois situations pour permettre dvaluer chaque critre trois reprises au moins.
Ces trois reprises sont surtout importantes pour les critres minimaux (voir page 25).
On peut admettre plus de souplesse pour les critres de perfectionnement.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 34
Travailler sur une consigne unique, ou la dtailler en plusieurs consignes, ou en
plusieurs questions ?
Les avantages du travail sur une consigne unique rsident essentiellement dans le fait
que lon est certain davoir la complexit requise. On ne rduit pas cette complexit.
Linconvnient majeur est quune consigne unique peut provoquer du tout ou rien , et
handicaper les lves qui pourraient excuter une partie de la tche seulement.
Les avantages dun ensemble de questions est de rpondre cet inconvnient, en
multipliant les chances pour llve de pouvoir effectuer des productions indpendantes,
cest--dire qui ne soient pas lies des rponses ou des productions antrieures. Un
autre avantage est de pouvoir orienter ces questions dune manire telle que chaque
question soit davantage oriente vers un critre particulier, ce qui facilite la correction.
Comme nous lavons vu ci-dessus, linconvnient dun ensemble de questions ou de
consignes est un risque important de rduction de la complexit.
Il nexiste pas de rgle gnrale. Chaque cas doit faire lobjet dun examen attentif, en
fonction de la discipline et en fonction du niveau.
Comment choisir les critres ?
Il ne faut pas oublier que les critres sont lis la comptence, et non chaque situation
tmoin de cette comptence. La question qui doit guider le choix des critres est la
suivante : quelles qualits la production de llve face une tche complexe doit-elle
possder ?
Selon que lon attend une production originale dans le cadre dune situation ouverte, ou
une rponse une situation ferme, les types de critres choisir sont diffrents (voir
page Erreur ! Signet non dfini. et suivantes).
Est-il bon de garder les mmes types de consignes que les situations travailles
antrieurement ?
Dans les petites classes, introduire une nouvelle consigne est une chose complique, et
on peut reprendre la mme consigne. Limportant est que le contexte de la situation,
ainsi que la production attendue, soient entirement nouveaux.
Est-il intressant de travailler sur des documents connus, sur des supports connus ?
La rponse gnrale est non. La raison est que, si lon cherche laborer une situation
nouvelle, le fait de travailler partir dun support connu va inciter llve de la
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 35
reproduction, mme si cette reproduction nest pas tout fait pertinente, elle va induire
chez lui le fait quil peut reproduire. Et la reproduction lcole a la vie dure !
3.1.4 Une check list pour llaboration dune preuve dvaluation
La liste suivante reprend quelques questions essentielles relatives aux principales tapes
de llaboration dune preuve dvaluation.
1. Centration sur la comptence
Ne se trompe-t-on pas de comptence valuer ?
Nvalue-t-elle pas une comptence dun autre niveau ?
Lpreuve value-t-elle bien la comptence quelle est cense valuer ?
2. Situation-problme
Evalue-t-on bien une comptence et non des lments spars ?
Est-ce bien une tche oriente dans une situation prcise et non une suite de petites
questions sans lien ? Llve voit-il pourquoi il rsout ce quon lui demande de rsoudre ?
La situation-problme est-elle nouvelle ?
3. Appartenance une famille de situations
La situation-problme appartient-elle bien la famille de situations de la comptence ?
Le niveau de difficult est-il comparable celui dune autre preuve qui value la
mme comptence ?
4. Caractre significatif
Le travail demand a-t-il un caractre significatif pour llve ?
Le sens du travail demand est-il vident pour llve ?
5. Rptition des observations
Chaque critre de russite est-il bien vrifi au moins 3 fois (russite : rgle des 2/3) ?
Les occasions de vrifier chaque critre sont-elles bien indpendantes les unes des autres ?
6. Centration sur les critres essentiels
Lpreuve respecte-t-elle bien la rgle des 3/4 ? Le poids des critres de
perfectionnement nest-il pas trop important ?
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 36
4 La correction des copies dlves
4.1 Les principes de la correction des copies
4.1.1 Des indicateurs pour oprationnaliser les critres
A la page 21, nous avons abord la notion dindicateur, comme signe observable pour
oprationnaliser un critre. Un indicateur est une information prcise que lon recueille,
pour se prononcer sur la matrise dun critre par les lves.
On peut distinguer deux types dindicateurs.
Un indicateur peut tre qualitatif, quand il prcise une facette du critre, comme dans
les deux exemples ci-dessus. Il reflte alors soit la prsence / l'absence dun lment,
soit un degr d'une qualit donne.
Utilis dans une optique descriptive, un indicateur qualitatif aide reprer les sources
derreur, et y remdier.
Il peut galement tre quantitatif, quand il fournit des prcisions sur des seuils de
russite du critre. Il s'exprime alors par un nombre, un pourcentage, une grandeur.
Exemples :
- deux tiers des additions sont correctement effectues
- deux transformations de grandeurs sur trois sont correctes
- 80% des mots doivent tre correctement orthographis
- quatre caractristiques sur cinq doivent tre prsentes
-
Cette utilisation de lindicateur est plus simple, mais elle est moins descriptive, et ds
lors moins formative, cest--dire quelle aide moins la remdiation.
4.1.2 Ce quest une grille de correction
On peut dfinir une grille de correction comme un outil dapprciation dun critre
travers des indicateurs prcis. En termes stratgiques, elle rpond un souci de
standardisation de la correction.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 37
En termes pdagogiques, elle constitue un outil daide la correction des productions
des lves, utilis essentiellement dans deux buts :
garantir un maximum dobjectivit dans la correction, permettre un accord
intercorrecteurs le plus lev possible, grce aux indicateurs ; en effet, un correcteur est
souvent influenc par une erreur, en rapport avec un critre, qui contamine tout le reste
de la correction ; lexemple le plus frappant est donn par ces corrections en
mathmatiques pour lesquelles on attribue zro doffice llve si la premire partie de
la rponse est errone ;
procurer un appui aux enseignants dbutants, ou ceux qui veulent (doivent)
changer leurs pratiques dvaluation (outil de formation). Il ne sagit pas de
dresponsabiliser lenseignant par rapport la correction quil mne, mais de lui fournir
des outils pour lamener changer son regard sur la production de llve.
Une grille de correction peut tre envisag qualitativement ou quantitativement.
Envisage dans une optique qualitative, elle fournit au correcteur une liste
dindicateurs qualitatifs.
Exemple pour le critre prsentation matrielle
Indicateurs du critre prsentation matrielle
Lisibilit de lcriture (lisible ou non)
Absence de taches (prsence ou absence)
Orthographe (prsence ou absence de fautes dorthographe)
Envisage dans une optique quantitative, elle tablit le lien entre la production et la
note en fixant des seuils.
Exemple pour le critre Les informations utiles sont-elles extraites des documents ?
Toutes les informations sont extraites (3 pts)
2/3 des informations sont extraites (2 pts)
Au moins une information est extraite (1 pt)
Aucune information nest extraite (0 pt)
Les deux optiques, qualitative et quantitative, peuvent tre combines, comme dans
lexemple suivant :
Indicateurs du critre prsentation matrielle
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 38
Lisibilit de lcriture
Absence de taches
Orthographe
Respect des 3 indicateurs (3 pts)
Respect de 2 indicateurs (2 pts)
Respect dun seul indicateur (1 pt)
Respect daucun indicateur (0 pt)
Pour des raisons defficacit de la correction, on a toutefois intrt construire des
grilles de correction cibles, cest--dire qui se rapportent chaque situation-problme,
surtout lorsque la situation-problme na pas t labore par lenseignant lui-mme.
4.2 Des exemples de grilles de correction
4.2.1 Un exemple de grille de correction en mathmatiques
Comptence de base vise : rsoudre une situation problme qui met en uvre les 4
oprations sur les nombres de 0 1000.
Situation
Omar est pre dune famille de 5 enfants. Pour la fte du mouton, il achte un mouton
470 DH et paie 30 DH pour le transport, aller-retour. Il nourrit le mouton pendant une
semaine raison de 50 cts par jour.
1) Combien le pre a-t-il dpens pour acheter le mouton ?
2) Quel est le prix du transport aller ?
3) Calcule la dpense pour la nourriture.
Critres
C1 : interprtation de la situation-problme : lopration est correctement pose
C2 : utilisation correcte des outils mathmatiques en situation : les calculs sont exacts
C3 : cohrence de la rponse : lordre de grandeur est respect (par exemple entre la
moiti et le double de la bonne rponse, lunit de mesure figure ct du nombre)
C4 : prsentation de la copie
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 39
Grille de correction
C1 Interprtation
correcte de la
situation-problme
C2 utilisation correcte
des outils mathmatiques
en situation
C3 cohrence de la
rponse
C4 prsen-
tation de
la copie
Q1 Llve pose
lopration
470 + 30 =
/1pt
Llve rsout
correctement une
opration avec les
nombres de lnonc
/ 1 pt
La rponse se situe
entre 470 et 600
Llve indique
lunit de mesure : DH
/ 1 pt
Q2 Llve pose
lopration 30 : 2
=
/ 1 pt
Llve rsout
correctement une
opration avec les
nombres de lnonc
/ 1 pt
La rponse se situe
entre 10 et 20
Llve indique
lunit de mesure : DH
/ 1 pt
Q3 Llve pose
lopration
50 x 7 =
/ 1 pt
Llve rsout
correctement une
opration avec les
nombres de lnonc
/ 1 pt
La rponse se situe
entre 200 et 500
Llve indique
lunit de mesure : DH
/ 1 pt
Absence
de taches
Ecriture
lisible
/ 3 pts / 3 pts / 3 pts / 1 pt
4.2.2 Un exemple de grille de correction en langue : situation PALU
17
Palier de la comptence (CE1)
Dans une situation de communication, et partir dun texte crit de 5 phrases environ
adapt lge de lenfant, produire un paragraphe cohrent de 3 phrases au prsent de
lindicatif ou de limpratif pour dcrire une scne ou pour donner des conseils.
Situation
17
Dakar, aot 2004
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 40
Ton ami te demande ce quil faut faire pour lutter contre le palu. Tu as lu une bande
dessine qui porte sur la lutte contre le paludisme.
Consigne Lis attentivement cette bande dessine, et donne 3 conseils ton ami pour se
protger du paludisme.
N.B. Alternative dun niveau suprieur (pour un CE2 par exemple) : Lis attentivement
cette bande dessine, et cris ton ami une petite lettre dans laquelle tu lui donnes 3
conseils pour se protger du paludisme. Parle-lui aussi des dangers du paludisme.
Exemple de grille de correction et barme de notation de la situation PALU
Critre 1. Pertinence par rapport la situation
Toutes les phrases sont des conseils qui se rapportent au palu et la B.D. 3 pts
Il y a au moins deux conseils qui se rapportent au palu et la B.D. 2 pts
Il y a au moins un conseil, ou une phrase qui se rapporte au palu et la B.D. 1 pt
Il ny a ni conseil, ni rien qui se rapporte au palu. 0 pt
Si on ne se
profge pos, on
risque doffroper
Ie poIu
Les mousfiquoires
impregnees donnenf
oussi des bons
resuIfofs
On peuf ufiIiser oussi Ies insecficides, mois beoucoup
sonf mouvois pour Io sonfe ef pour Ienvironnemenf.
MoubIie pos
deIiminer Ies
fIoques deou
II y o frop de
mousfiques dons
Ie viIIoge
Luttons tous contre Ie puIu |
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 41
Par exemple Flaques limine est accept pour ce critre, mais pas Regarder
moustique
Critre 2. Correction de la langue
Toutes les phrases produites sont agences correctement* 6 pts
Au moins deux tiers des phrases produites sont agences correctement* 4 pts
Une phrase au moins est agence correctement* 2 pt
Aucune phrase nest agence correctement 0 pt
(*) En dehors de lorthographe. Agences correctement signifie essentiellement S, V,
C dans le bon ordre, et la prsence correcte des dterminants . On ne tient pas compte
de lorthographe.
Critre 3. Originalit (critre de perfectionnement)
Prsence dun verbe ou dun substantif pertinent qui ne se trouve pas sur le
support
1 pt
Tous les verbes et les substantifs utiliss se trouvent sur le support. 0 pt
4.2.3 Une grille de correction est-elle toujours ncessaire ?
Une grille de correction est surtout utile pour la correction dune copie. Lorsquil sagit
dvaluer une production orale ou une performance raliser (comme en ducation
physique), il sagit souvent de prendre linformation au vol . Par exemple, lorsque,
en dbut dapprentissage, lenseignant value une production orale, il va apprcier au
vol la production de llve selon les diffrents critres : pertinence de la production,
cohrence smantique, correction syntaxique, prononciation, etc. Il sagit de disposer
dune petite grille oprationnelle de deux ou trois indicateurs par critre, titre de point
de repre.
Cela veut-il dire quon a toujours besoin dune grille dvaluation, quand la production
est crite ? La rponse est non. Une grille de correction nest ncessaire que quand il
existe un doute sur le lien entre une production de llve et le critre que lon veut
apprcier.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 42
Bibliographie
ALLAL, L. (2001). La mtacognition en perspective, in FIGARI, G., ACHOUCHE, M.
(2001). Lactivit valuative rinterroge. Regards scolaires et socioprofessionnels,
Bruxelles : De Boeck Universit, p. 142-145.
ALLAL, L. , ROUILLER, Y., SAADA-ROBERT, M., WEGMULLER, E. (1999). Gestion des
connaissances orthographiques en situation de production textuelle, Revue Franaise de
Pdagogie, n126, janvier-fvrier-mars 1999, p. 53-69
BELAIR, L. (1999). Lvaluation dans lcole. Nouvelles pratiques. Paris : ESF.
BONNIOL, J.-J. (1985). Influence de lexplicitation des critres utiliss sur le
fonctionnement des mcanismes de lvaluation dune production scolaire. In Bulletin
de Psychologie, XXXV, 353, p. 173-186.
DE KETELE, J.-M. (2001). Place de la notion comptence dans lvaluation des
apprentissages, in FIGARI, G., ACHOUCHE, M. (2001). Lactivit valuative rinterroge.
Regards scolaires et socioprofessionnels, Bruxelles : De Boeck Universit, p. 39-43.
DE KETELE, J.M. (1996). Lvaluation des acquis scolaires : quoi ? pourquoi ? pour
quoi ?, Revue Tunisienne des Sciences de lducation, 23, p. 17-36.
DE KETELE, J.-M. (1989), L'valuation de la productivit des institutions d'ducation,
Cahiers de la Fondation Universitaire : Universit et socit, le rendement de
l'enseignement universitaire.
DE KETELE, J.-M. (1986). Lvaluation du savoir-tre. In DE KETELE, J.-M. (Ed)
Lvaluation : approche descriptive ou prescriptive ?. Bruxelles : De Boeck Universit.
DE KETELE, J.-M., DUFAYS, J.-L. (2003). Vers de nouveaux modes dvaluation des
comptences. In Colls, L., Dufays, J.-L., Maeder, C. Enseigner le franais, lespagnol
et litalien. Les langues romanes lheure des comptences. Bruxelles : De Boeck
Duculot.
DE KETELE, J.-M., ROEGIERS, X. (1993, 3
e
dition 1996). Mthodologie du recueil
d'informations, Bruxelles : De Boeck Universit.
GERARD, F.-M. (2000). Savoir, oui mais encore ! In Forum pdagogies, mai 2000, pp.
29-35.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 43
GERARD, F.-M. (2002). Lindispensable subjectivit de lvaluation, Antipodes, n156,
pp. 26-34.
GERARD, F.M., BRAIBANT, J.M. (2004). Activits de structuration et activits
fonctionnelles, mme combat ? Le cas de lapprentissage de la comptence en lecture
lcole primaire, In Franais 2000, paratre.
GERARD, F.-M., MUGUERZA, S. (2000). Quel quilibre entre une apprciation globale de
la comptence et le recours aux critres ? In : BOSMAN, C, GERARD, F.-M., ROEGIERS,
X. (2000). Quel avenir pour les comptences ? Bruxelles : De Boeck Universit, p. 135-
140.
GERARD, F.-M. & ROEGIERS, X. (2003). Des manuels scolaires pour apprendre.
Bruxelles : De Boeck Universit.
GRANGEAT, M. (1998). Rgulation mtacognitive, transfert de connaissances et
autonomisation. Educations, n15, p. 37-40.
JADOULLE, J.-L. & BOUHON, M. (2001). Dvelopper des comptences en classe
dhistoire. Louvain-la-Neuve : Unit de didactique de lHistoire lUniversit
catholique de Louvain.
NOL, B. (1991). La mtacognition. Bruxelles : De Boeck.
NOL, B. (2001). Lautovaluation comme composante de la mtacognition : essai
doprationalisation, in FIGARI, G., ACHOUCHE, M. (2001). Lactivit valuative
rinterroge. Regards scolaires et socioprofessionnels, Bruxelles : De Boeck
Universit, p. 109-117.
ROEGIERS, X. (1997, 2
e
dition 2003). Analyser une action dducation ou de
formation. Bruxelles : De Boeck Universit.
ROEGIERS, X. (2000, 2
e
dition 2001). Une pdagogie de lintgration. Bruxelles : De
Boeck Universit.
ROEGIERS, X. (2003). Des situations pour intgrer les acquis. Bruxelles : De Boeck
Universit.
VIAL, M. (2001). Se former pour valuer. Se donner une problmatique et laborer des
concepts, Bruxelles : De Boeck Universit.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 44
Glossaire
Barme de notation
Dans une valuation travers des situations complexes, un barme de notation est un
tableau qui prcise les seuils de matrise requis pour chaque critre de correction.
En gnral, un barme de notation dfinit quatre niveaux de matrise de chaque critre : la matrise
maximale, la matrise minimale, la matrise partielle et labsence de matrise du critre.
Capacit
Une capacit, cest le pouvoir, laptitude faire quelque chose. Cest une activit que
lon exerce. Identifier, comparer, mmoriser, analyser, synthtiser, classer, srier,
abstraire, observer,... sont des capacits.
Une capacit se dveloppe tout au long de la vie. Elle est transversale, dans la mesure o on peut la
mobiliser dans toutes les disciplines. De par son caractre gnral, elle est trs difficilement valuable.
Champ disciplinaire
Un champ disciplinaire est un ensemble de disciplines proches, le terme discipline
tant entendu dans un sens large englobant les nouvelles disciplines : lducation la
sant, lenvironnement, lducation la citoyennet, lducation en matire de
population, etc.
Par exemple, la physique, la chimie, la biologie et les sciences de lenvironnement peuvent tre regroupes
dans un champ disciplinaire unique. De mme, lhistoire, la gographie, lducation la citoyennet et
lducation en matire de population peuvent tre regroupes dans un champ disciplinaire.
Comptence
Une comptence est la possibilit, pour un lve, de mobiliser un ensemble de savoirs,
de savoir-faire et de savoir-tre pour rsoudre des situations.
L'lve exerce une comptence en rsolvant des situations. Pour vrifier si l'lve a acquis la comptence,
l'enseignant lui soumet une situation nouvelle qui est le tmoin de la comptence.
Comptence de base
Une comptence de base est une comptence dfinie en termes de profil minimum
acqurir par llve pour quil puisse suivre avec succs les apprentissages de lanne
suivante.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 45
Pour constituer un point de repre efficace, le nombre de comptences doit se situer autour de 2 ou 3 par
discipline et par anne.
Complexe (situation)
Une situation complexe est une situation qui, pour tre rsolue, fait appel plusieurs
lments (ressources) qui ont dj t abords par llve, mais de faon spare, dans
un autre ordre, dans un autre contexte. Une situation complexe n'est pas une simple
application d'une notion, d'une rgle, d'une formule.
La complexit est principalement lie au contexte, la quantit de ressources mobiliser, tandis que le
caractre compliqu est plutt li la nouveaut des contenus qui interviennent dans la situation.
Complique (situation)
Une situation complique est une situation qui mobilise des acquis dun niveau
cognitif, affectif ou gestuel lev pour llve, parce que peu connus par lui,
insuffisamment matriss par lui, ou qui lui sont peu familiers.
La notion de situation complique est relative chaque lve, en fonction de ses acquis.
Consigne
La consigne est lensemble des instructions de travail qui sont donnes lapprenant de
faon explicite.
Dans la rsolution de tches complexes, le fait de recourir une consigne, plutt qu des questions, est
souvent un gage de non-rduction de la complexit.
Contexte
Le contexte est lenvironnement dans lequel se droule une situation.
Le contexte est une composante part entire dune situation, surtout dans la mesure o on veut rendre
cette dernire significative et proche dune situation relle.
Critre
Un critre est une qualit que lon considre pour porter une apprciation.
Un critre dvaluation est un point de vue selon lequel on se place pour valuer.
Un critre de dcision est un critre que lon adopte pour prendre la dcision. Il est appel critre de
faon abusive, puisquil nest en fait quun indicateur quantitatif dun critre dvaluation.
Un critre de correction est une qualit attendue dune production de llve.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 46
Donne
Une donne est une information susceptible dintervenir dans la rsolution dune situation.
Une donne peut tre pertinente (utile la rsolution), parasite (inutile pour la rsolution), ou lacunaire (
trouver, ou complter).
Epreuve en termes dintgration
Une preuve en termes dintgration est une preuve dvaluation qui consiste prsenter
llve une ou plusieurs situations complexes rsoudre, plutt quune srie de questions.
La note obtenue par llve rsulte de la mise en uvre de critres dvaluation.
Epreuve sommative
Une preuve sommative est une preuve dvaluation qui consiste prsenter llve
une srie de questions (items) indpendantes les unes des autres.
La note obtenue par llve est la somme des notes obtenues chaque item.
Equivalentes (situations)
Des situations quivalentes sont des situations de mme niveau de difficult, cest--
dire des situations interchangeables.
Des situations quivalentes appartiennent la mme famille de situations.
Evaluation certificative
Une valuation certificative est une valuation dbouchant sur une dcision
d'acceptation ou de refus dans une classe suprieure, ou sur une dcision de classement.
Dans une optique dintgration des acquis, une valuation certificative se droule sur la base de la rsolution
de situations complexes, plutt que sur la base d'une somme d'items isols (preuve sommative).
Evaluation formative
Une valuation formative est une valuation qui a pour but de dtecter les difficults
de l'lve afin de lui venir en aide.
Au contraire de l'valuation certificative, qui a une fonction administrative, l'valuation formative a une
fonction pdagogique.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 47
Famille de situations
Une famille de situations est un ensemble des situations de niveau de difficult
quivalent qui traduisent une mme comptence.
Chaque comptence est dfinie par une famille de situations. Pour exercer la comptence de l'lve ou
pour valuer s'il a acquis cette comptence, lenseignant lui soumet une situation nouvelle, mais qui
appartient la famille de situations.
Ferme (situation)
Une situation ferme est une situation-problme qui possde une solution unique,
dtermine au dpart.
Llve dispose de lensemble des donnes ncessaires pour y arriver, et il doit aboutir cette solution
quelle que soit la dmarche choisie : la mme rponse est attendue de lensemble des lves.
Fonction oprationnelle (dune situation)
La fonction oprationnelle dune situation, cest le pourquoi de cette situation, le
besoin auquel elle est cense rpondre dans la ralit.
Cette fonction oprationnelle dune situation est souvent lie son utilit sociale.
Fonction pdagogique (dune situation)
La fonction pdagogique dune situation, cest son utilit sur le plan des
apprentissages.
Les trois fonctions pdagogiques principales sont (1) une fonction didactique pour de nouveaux appren-
tissages (2) une fonction dintgration des acquis (3) une fonction dvaluation, formative ou certificative.
Grille de correction
Une grille de correction est un tableau double entre qui reprend la fois, critre par
critre, les indicateurs de ces critres pour chaque question ou partie de situation, et le
nombre de points qui leur est attribu.
Il existe une grille de correction pour chaque situation.
Habillage
Lhabillage dune situation est la forme sous laquelle la situation est prsente llve.
Lhabillage constitue un cran lapproche de la situation qui, selon les cas, lui facilite le travail ou au
contraire complique celui-ci.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 48
Indicateur
Un indicateur est un signe observable qui permet doprationnaliser un critre.
Un indicateur peut tre qualitatif (une qualit possder) ou quantitatif (un seuil atteindre)
Information
Dans le cadre dune valuation, une information est un lment que lon recueille, que
ce soit un fait objectif ou une reprsentation.
Lorsquil sagit dvaluer les performances dun lve, on peut recueillir des informations de diffrentes
faons : travers un test dvaluation, travers lobservation, travers un entretien, travers ltude de
documents relatifs llve, comme un portfolio.
Intgration
Le terme intgration dsigne la mobilisation conjointe de plusieurs savoirs et savoir-
faire pour rsoudre une situation complexe.
La pdagogie de l'intgration vise faire acqurir llve des comptences de rsolution de situations
complexes qui mobilisent des ressources acquises antrieurement.
Interdisciplinaire (situation)
Une situation interdisciplinaire est une situation qui fait appel plusieurs disciplines,
mais dont la contribution nest pas identifie au dpart.
Cest souvent une situation qui comprend une consigne ou une question unique, dont les lments de
rponse sont rechercher dans plusieurs disciplines.
Item
Un item est un lment dun outil dvaluation : une question (question ferme,
question ouverte, question choix multiples), un exercice rsoudre, etc.
Dans une preuve sommative, on attribue chaque item un score (une note).
Module d'intgration
Un module d'intgration est un module au cours duquel l'lve a l'occasion d'exercer
une comptence, c'est--dire d'utiliser dans des situations plusieurs savoirs, savoir-faire
et savoir-tre qu'il a acquis.
La dure indicative dun module d'intgration est dune semaine. Il nest pas pertinent quand lenseignant
a la proccupation constante damener les lves intgrer leurs acquis.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 49
Naturelle (situation)
On appelle situation naturelle une situation quoffre la vie quotidienne et
professionnelle, dans toute sa diversit, une situation qui rpond un besoin rel.
On oppose une situation naturelle une situation construite des fins pdagogiques.
OTI (objectif terminal d'intgration)
Un OTI est une macrocomptence qui reprend les principaux acquis d'une anne ou d'un
cycle.
L'OTI intgre l'ensemble des comptences du cycle. Il se dfinit galement travers une famille de situations.
Ouverte (situation)
Une situation ouverte est une situation-problme qui dbouche sur plusieurs
productions possibles, ou sur plusieurs solutions.
On loppose une situation ferme.
Palier
Un palier dune comptence est un niveau intermdiaire de latteinte de cette comptence.
Un palier peut se dfinir sur la base de contenus, de plus en plus compliqus, sur lesquels on exerce des
mmes activits, ou sur la base dactivits de plus en plus compliques que llve est appel exercer
sur des mmes contenus.
Paramtre (dune famille de situations)
Les paramtres dune famille de situations sont les caractristiques que doivent
respecter toutes les situations qui se rapportent une comptence.
Ce sont eux qui permettent de garantir que lensemble des situations dune mme famille sont
quivalentes, du moins a priori.
Parasite (donne, information)
Une donne parasite est une donne prsente dans lnonc dune situation, mais qui
nintervient pas dans la rsolution minimale de cette situation.
Cest une donne que llve ne devra pas utiliser, mais quon introduit dans lnonc pour lobliger
distinguer ce qui est utile la rsolution de ce qui ne lest pas.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 50
Portfolio
Un portfolio est un dossier labor par lapprenant, qui contient essentiellement un ensemble
de productions personnelles tmoins de sa progression ou de ses comptences.
Un portfolio peut tre exploit comme aide lapprentissage, ou comme source dinformations dans le
cadre de la validation de acquis.
Problme
Un problme est une question rsoudre, un obstacle, un cart surmonter entre une
situation attendue et une situation actuelle.
Dans le cadre scolaire, le problme est souvent vu comme un support brut, qui consiste en un contexte,
une tche et des informations.
Ressource
Le terme ressource dsigne lensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-tre, savoirs
dexprience, , que lapprenant mobilise pour rsoudre une situation.
Les ressources dpendent de la situation pose, mais sont aussi relatives au processus cognitif de llve :
celles quun lve va mobiliser pour rsoudre une situation problme ne sont pas ncessairement les
mmes que celles que mobiliserait un autre lve, et elles ne sont pas mobilises dans le mme ordre.
Savoir
Le terme savoir est utilis comme synonyme de "contenu", "connaissance". Les savoirs
constituent une des catgories de ressources que lapprenant mobilise pour rsoudre une
situation.
Un savoir s'exprime par un substantif.
Savoir-tre
Un savoir-tre est une attitude de l'lve, qui est passe dans l'habituel, et, de faon
plus gnrale, tout savoir-faire pass dans lhabituel. Les savoir-tre constituent une des
catgories de ressources que lapprenant mobilise pour rsoudre une situation.
On reconnat qu'un savoir-tre est acquis par l'lve au fait que ce dernier le met en uvre spontanment,
sans que l'enseignant ne doive le lui dire.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 51
Savoir-faire
Un savoir-faire est lexercice d'une activit sur un savoir, sur un contenu ; poser un
geste prcis, utiliser une technique de calcul, appliquer une rgle... Les savoir-faire
constituent une des catgories de ressources que lapprenant mobilise pour rsoudre une
situation.
Un savoir-faire s'exprime l'aide d'un verbe l'infinitif. Dans une optique dintgration des acquis, on
apprend l'lve matriser des savoir-faire, d'abord sparment, et puis on l'invite exercer les savoir-
faire acquis dans des situations plus complexes.
Significative (situation)
Une situation significative pour un lve est une situation avec laquelle il entretient
une relation affective positive, une situation qui lui donne l'envie de se mettre en
mouvement.
Elle peut tre une situation proche dune situation naturelle, ou encore un dfi qui intresse l'lve et qui
le motive.
Situation
Dans cet ouvrage, le terme situation dsigne le support finalis dune situation-
problme que lenseignant prpare de manire le prsenter ses lves dans le cadre
des apprentissages, en vue de leur faire rsoudre.
Une situation a le niveau de complexit d'une situation de vie. Elle doit tre significative pour l'lve.
C'est une occasion d'exercer une comptence, ou d'valuer celle-ci.
Situation cible
Une situation cible est une situation-problme qui reprsente limage de ce qui est
attendu comme performance de la part de llve au terme dun ensemble
dapprentissages de savoirs et de savoir-faire. Les termes situation dintgration , ou
situation de rinvestissement sont des synonymes.
Une situation cible peut tre utilise des fins dintgration des acquis de llve, ou des fins
dvaluation.
Situation-problme
Une situation-problme dsigne un ensemble contextualis dinformations articuler,
par une personne ou un groupe de personnes, en vue dune tche dtermine, dont
lissue nest pas vidente a priori.
La pdagogie de lintgration en bref X. ROEGIERS Rabat, mars 2006 52
On distingue les situations-problmes didactiques, des fins dapprentissage de nouveaux savoirs, savoir-
faire ou savoir-tre, et les situations cibles , pour intgrer et valuer des acquis.
Situation-problme didactique
Une situation-problme didactique est une situation-problme que lenseignant
organise pour lensemble dun groupe-classe, en fonction de nouveaux apprentissages :
nouveau(x) savoir(s), nouveau(x) savoir-faire, etc.
Une situation-problme didactique vise favoriser de nouveaux apprentissages (notions, procdures...), en
vue dune meilleure appropriation de ceux-ci par les lves. Elle se distingue en cela de la situation
cible .
Support
Le support dune situation reprsente lensemble des lments matriels qui sont
prsents llve : un contexte, des informations (des donnes), une fonction, une
consigne.
On distingue le support brut (le contexte, les informations, la fonction, du support finalis, qui est le
support brut prpar des fins pdagogiques, en fonction de ce que lenseignant veut en faire dans une
suite dapprentissages : une exploitation collective, une exploitation par petits groupes, une exploitation
individuelle, une valuation, etc.
Tche
La tche est limage de ce que lon attend de llve quand il rsout une situation.
La tche est un processus mettre en uvre, mais surtout un produit obtenir : la rponse la situation-
problme, une production personnelle, lexcution dune tche courante, une proposition daction, etc.
Tche complexe
Le terme de tche complexe est souvent pris dans le sens de situation complexe .
Tout comme la situation, une tche complexe mobilise des ressources diverses pour sa rsolution.
Vous aimerez peut-être aussi
- Savoir enseigner dans le secondaire: Didactique généraleD'EverandSavoir enseigner dans le secondaire: Didactique généralePas encore d'évaluation
- L'accompagnement du développement personnel et professionnel en éducationD'EverandL'accompagnement du développement personnel et professionnel en éducationPas encore d'évaluation
- Pédagogie DifférenciéeDocument117 pagesPédagogie DifférenciéeEttlili Rayen100% (1)
- L'évaluation en Didactique Du Francais Résurgence D'une ProblématiqueDocument256 pagesL'évaluation en Didactique Du Francais Résurgence D'une ProblématiqueNouhaila RochdiPas encore d'évaluation
- Différence Entre Formation en Ligne Et Formation À DistanceDocument2 pagesDifférence Entre Formation en Ligne Et Formation À DistancejjjojhhoPas encore d'évaluation
- Didactique de L'écritureDocument18 pagesDidactique de L'écritureAndréa OliveiraPas encore d'évaluation
- Analyse-Des-pratiques Enseignantes TratDocument255 pagesAnalyse-Des-pratiques Enseignantes Trathmayda riadPas encore d'évaluation
- Hubert Vincent-De Linnovation en Pédagogie-Jericho-1Document285 pagesHubert Vincent-De Linnovation en Pédagogie-Jericho-1KACHAI MohammedPas encore d'évaluation
- Sciences de L Education Et Philosophie de L EducationDocument30 pagesSciences de L Education Et Philosophie de L EducationPFE100% (2)
- L'enseignement de L'orthographe en FLEDocument175 pagesL'enseignement de L'orthographe en FLEALBAPas encore d'évaluation
- Enjeux de la place des savoirs dans les pratiques éducatives en contexte scolaire: Compréhension de l’acte d’enseignement et défis pour la formation professionnelle des enseignantsD'EverandEnjeux de la place des savoirs dans les pratiques éducatives en contexte scolaire: Compréhension de l’acte d’enseignement et défis pour la formation professionnelle des enseignantsPas encore d'évaluation
- Gestes Professionnels de L'enseignantDocument21 pagesGestes Professionnels de L'enseignantNadia GuendoulPas encore d'évaluation
- Les compétences à s'orienter: Théories et pratiques en orientation scolaire et professionnelleD'EverandLes compétences à s'orienter: Théories et pratiques en orientation scolaire et professionnellePas encore d'évaluation
- Modèles PédagogiquesDocument26 pagesModèles PédagogiquesALI Zidelkhir33% (3)
- Évaluation des apprentissages en formation à distance: Enjeux, modalités et opportunités de formation en enseignement supérieurD'EverandÉvaluation des apprentissages en formation à distance: Enjeux, modalités et opportunités de formation en enseignement supérieurPas encore d'évaluation
- Enjeux et défis de la formation à l'enseignement professionnelD'EverandEnjeux et défis de la formation à l'enseignement professionnelPas encore d'évaluation
- Les Repères PhilosophiquesDocument16 pagesLes Repères PhilosophiquesamoroshenryPas encore d'évaluation
- J'ai mal à mon stage: Problèmes et enjeux de la formation pratique en enseignementD'EverandJ'ai mal à mon stage: Problèmes et enjeux de la formation pratique en enseignementPas encore d'évaluation
- L' L'EVALUATION DES COMPETENCES : UNE PLURALITE DE DEFIS: De la description à des pistes d’innovationD'EverandL' L'EVALUATION DES COMPETENCES : UNE PLURALITE DE DEFIS: De la description à des pistes d’innovationPas encore d'évaluation
- Approche Par Compétence 2Document5 pagesApproche Par Compétence 2Anonymous nHhspqzGC100% (1)
- L' ETHIQUE PROFESSIONNELLE EN ENSEIGNEMENT, 2E EDITION ACTUALISEE: Fondements et pratiquesD'EverandL' ETHIQUE PROFESSIONNELLE EN ENSEIGNEMENT, 2E EDITION ACTUALISEE: Fondements et pratiquesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Aperçu Systemeducatif MarocainDocument96 pagesAperçu Systemeducatif MarocainNafie El100% (1)
- Memoire 1Document38 pagesMemoire 1Kiro MouhPas encore d'évaluation
- Perrenoud Compétences Et SocioconstructivismeDocument35 pagesPerrenoud Compétences Et Socioconstructivismekwtwz544Pas encore d'évaluation
- Focus Enseignement Apprentissage Precoce Des Langues PDFDocument16 pagesFocus Enseignement Apprentissage Precoce Des Langues PDFLaura RuizPas encore d'évaluation
- La Classe InverséeDocument3 pagesLa Classe InverséeHana MadaniPas encore d'évaluation
- Analyse Didactique Clinique de Pratiques EnseignantesDocument376 pagesAnalyse Didactique Clinique de Pratiques EnseignantesMamane BoubakarPas encore d'évaluation
- Coup de Pouce Pedagogique 5 Evaluer Les Apprentissages Des EtudiantsDocument6 pagesCoup de Pouce Pedagogique 5 Evaluer Les Apprentissages Des Etudiantsali100% (1)
- L'approche Par CompétenceDocument17 pagesL'approche Par Compétencehmissi_a2007Pas encore d'évaluation
- Quelle Formation? Pour Quels Enseignants? Vers Un Auto-Apprentissage Différencié Et Accompagné Des Métiers de L'enseignementDocument150 pagesQuelle Formation? Pour Quels Enseignants? Vers Un Auto-Apprentissage Différencié Et Accompagné Des Métiers de L'enseignementluc villepontouxPas encore d'évaluation
- Competences TransversalesDocument15 pagesCompetences TransversalesBård BrendenPas encore d'évaluation
- Module Gestion ClasseDocument54 pagesModule Gestion ClasseSalem Ahmed100% (1)
- Article Approcheparcompetences DeKeteleDocument18 pagesArticle Approcheparcompetences DeKeteleSarah Amri100% (1)
- Comment Motiver L'apprenant Par Rolland ViauDocument4 pagesComment Motiver L'apprenant Par Rolland Viaujommad100% (1)
- Cours Didactique 1Document19 pagesCours Didactique 1mariaaitkechPas encore d'évaluation
- Evaluation PDFDocument139 pagesEvaluation PDFAmine AzairPas encore d'évaluation
- Pédagogie de L'intégrationDocument10 pagesPédagogie de L'intégrationalfath1Pas encore d'évaluation
- Guide Pedagogie D Integration Final Au MarocDocument57 pagesGuide Pedagogie D Integration Final Au Marocاركيك88% (16)
- Types D'évaluationsDocument5 pagesTypes D'évaluationsBAMALJoseph FirminPas encore d'évaluation
- La Pratique de l'APCDocument20 pagesLa Pratique de l'APCNouara Nouar100% (1)
- Theories ApprentissageDocument3 pagesTheories ApprentissagesaidaggounPas encore d'évaluation
- Approche Par Competences de KeteleDocument35 pagesApproche Par Competences de Keteleاركيك75% (4)
- Cours EVALUATION DES APPRENTISSAGES (Autosaved) .Document56 pagesCours EVALUATION DES APPRENTISSAGES (Autosaved) .hilairedavidson12Pas encore d'évaluation
- Les Stages D Observation en Milieu Scolaire - Quelles Opportunites Pour Le Developpement Des Etudiants PE1Document12 pagesLes Stages D Observation en Milieu Scolaire - Quelles Opportunites Pour Le Developpement Des Etudiants PE1safahatPas encore d'évaluation
- Guide de La RemediationDocument81 pagesGuide de La Remediationyassine100% (1)
- PortfolioDocument38 pagesPortfolioSiwar KsPas encore d'évaluation
- L'pprentissage ExperientielDocument18 pagesL'pprentissage Experientielwebsearch.ss100% (1)
- Le Socioconstructivisme - Définition, Principes Et MéthodesDocument12 pagesLe Socioconstructivisme - Définition, Principes Et MéthodesMoumouni SAWADOGO100% (1)
- Pédagogie Générale VF Août 2012Document37 pagesPédagogie Générale VF Août 2012SteffenPas encore d'évaluation
- L'histoire de L'évaluation Des Apprentissages Dans Plusieurs PaysDocument181 pagesL'histoire de L'évaluation Des Apprentissages Dans Plusieurs PaysJamal BoPas encore d'évaluation
- La Pédagogie de ProjetDocument2 pagesLa Pédagogie de Projetgeniemaroc100% (3)
- SP2Document12 pagesSP2Lakbir FATIANEPas encore d'évaluation
- Approche CompetencesDocument214 pagesApproche Competencesاركيك100% (11)
- Le Multi-Agenda Des Gestes ProfessionnelsDocument13 pagesLe Multi-Agenda Des Gestes ProfessionnelsDirecteur des Ecoles DELPONT VincentPas encore d'évaluation
- DocimologieDocument20 pagesDocimologieabdelyamakasiPas encore d'évaluation
- Réflexsion DidactiqueDocument16 pagesRéflexsion DidactiqueorihemePas encore d'évaluation
- PédagogieDocument6 pagesPédagogieWALD NASSPas encore d'évaluation
- Tic e LearningDocument4 pagesTic e LearningMiro MiroPas encore d'évaluation
- Didactique GeneraleDocument59 pagesDidactique GeneraleTatiana BotnaruPas encore d'évaluation
- La Docimologie PDFDocument18 pagesLa Docimologie PDFEmacon30100% (1)
- Pfe 1Document18 pagesPfe 1saidPas encore d'évaluation
- L'APC Et L'ACDocument7 pagesL'APC Et L'ACSAMOPas encore d'évaluation
- Enseigner avec passion: À PARTIR DES CONDITIONS PROPICES À L’APPRENTISSAGE ET À L’ENSEIGNEMENTD'EverandEnseigner avec passion: À PARTIR DES CONDITIONS PROPICES À L’APPRENTISSAGE ET À L’ENSEIGNEMENTÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Effet de LapprentissageDocument25 pagesEffet de LapprentissageScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- HHG4MDocument56 pagesHHG4MHossam HamidPas encore d'évaluation
- Applications and Interpretation Higher May 2021 Paper 3 TZ1 MSDocument13 pagesApplications and Interpretation Higher May 2021 Paper 3 TZ1 MSsachinPas encore d'évaluation
- TICDocument2 pagesTICroger copernic AmonchiPas encore d'évaluation
- Bordereaux Envoi Liste Autorisations Participation Concours 10-12-07 2023Document32 pagesBordereaux Envoi Liste Autorisations Participation Concours 10-12-07 2023Moussa DehPas encore d'évaluation
- 13 Compétences ProfDocument28 pages13 Compétences ProfjocedagePas encore d'évaluation
- Les Cogni'classes, Le Cerveau Et Les Apprentissages, NATHAN 2018Document13 pagesLes Cogni'classes, Le Cerveau Et Les Apprentissages, NATHAN 2018Savoir VivrePas encore d'évaluation
- Stage Enseignants Fle 2019 PDFDocument2 pagesStage Enseignants Fle 2019 PDFGhecham JosefPas encore d'évaluation
- TIGps EB2 MATHS P-DDocument2 pagesTIGps EB2 MATHS P-DZe Yann KevinePas encore d'évaluation
- Saad Eddine Jafri - Chief Editor - L'Opinion _ LinkedInDocument17 pagesSaad Eddine Jafri - Chief Editor - L'Opinion _ LinkedInghissassi.ahmedPas encore d'évaluation
- Referentiel Enseignant Specialise 2021 VEIDocument1 pageReferentiel Enseignant Specialise 2021 VEITony TotiPas encore d'évaluation
- Homenaje A Lewis Carroll de LacanDocument6 pagesHomenaje A Lewis Carroll de LacanJorge TarelaPas encore d'évaluation