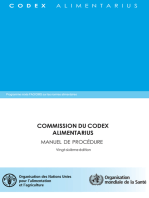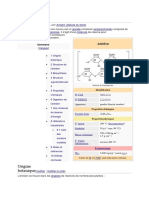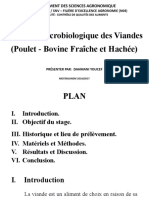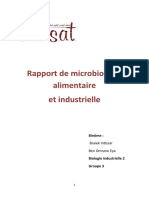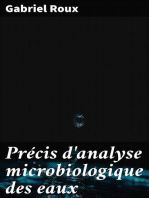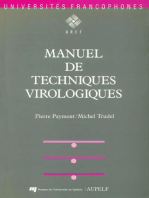Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Haccp 2
Haccp 2
Transféré par
houda_2008Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Haccp 2
Haccp 2
Transféré par
houda_2008Droits d'auteur :
Formats disponibles
Page 1 sur 1
Fiche technique
Prsentation de la dmarche HACCP
Dfinitions et origines de LHACCP
Conformment aux indications du codex alimentarius et la directive CEE 93/43, la mthode HACCP est un systme qui dfinit, value et matrise les dangers qui menacent la salubrit des aliments. Sa mise en place permet dune part de satisfaire aux exigences qualit du client et du consommateur et dautre part, de rpondre la directive europenne 93/43 CEE et larrt du 28 mai 1997 modifi par celui du 30 juillet 1999. Depuis de nombreuses annes des mthodes, tels que Hazard and Operability Point ou HAZOP, se basant sur lide "mieux vaut prvenir que gurir", sont utilises dans lindustrie chimique, nuclaire et aronautique. Cest sur les principes de ces techniques que le systme HACCP a t fond. Tout commence en 1971, la firme PILLSBURY se charge de fabriquer des aliments pour des astronautes. Afin dassurer la scurit alimentaire de ses produits, elle sentoure alors dun maximum de prcautions : cest la naissance du systme HACCP. Quelques annes plus tard, le professeur JOUVE introduit et dveloppe la mthode en France. La CEE suivant les recommandations du codex alimentarius, et de lOMS, introduit lutilisation de lHACCP dans la directive hygine des denres alimentaire (93/43) du 14 juin 1993.
Les Bonnes Pratiques dhygines
Cet arbre symbolise un lment important de structuration pour les entreprises alimentaires. Il a besoin pour s'panouir de nombreuses racines solides et profondes. Tout d'abord, la terre, dans laquelle il est plant, doit tre un terreau favorable sa croissance. Il doit y rgner une "culture Hygine" symbolise par les Bonnes Pratiques d'Hygine. Plus les Bonnes Pratiques d'Hygine sont prises en compte et plus la solidit de l'assise est effective. Plus les bases sont solides, plus les fondamentaux de l'hygine sont acquis, plus la mthode HACCP est aise mettre en uvre et oprationnelle. La mthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), ou Analyse des dangers et la matrise des points critiques, est un outil mthodologique de la matrise de la scurit sanitaire des aliments. Il doit reposer sur des bases ou des fondamentaux de l'hygine. Les racines de HACCP reposent sur un terrain qui a pralablement t travaill et faonn par les diffrents personnels de l'entreprise pour construire et dvelopper les outils et les mthodes de travail leur permettant de planter et de faire vivre l'arbre de la scurit sanitaire des aliments.
C.C.I. Arras/Service Dveloppement des Entreprises/Sophie Perret du Cray/avril 2008
Page 2 sur 2
Prsentation Prsentation des tapes de mise en uvre de lHACCP
Prparation de ltude
Cette phase permet danalyser le processus de fabrication et lensemble des composantes qui lentourent (matires premires, milieu)
Etape 1 : Constitution de lquipe HACCP
Engagement de la direction Nomination dun coordinateur HACCP Constitution de lquipe HACCP. Formation du personnel.
Etape 2 : Description du produit
Description des matires entrant dans la fabrication du produit fini : les ingrdients, les matires premires, leau, les emballages, le gaz Cahier des charges pour les produits exigences spcifiques. Descriptions du produit fini : fiche produit avec description des caractristiques attendues du produit fini.
Etape3 : Description de lutilisation prvue du produit
Identification du consommateur et de la population risque Utilisation du produit par le consommateur Dure dutilisation Temprature de conservation Conditions spcifiques du transport.
Etape 4 : Construction dun schma diagramme de fabrication.
Il reprend les principales tapes du processus de fabrication (de la rception des matires premires jusqu lexpdition du produit fini) Le diagramme doit tre accompagn dun schma illustrant les mouvements de matires, ingrdients, emballages. Ce schma doit aider reprer toutes les zones de contamination croise potentielle dans ltablissement (les vestiaires, les toilettes, les caftrias).
Etape 5 : Vrification/confirmation sur place du diagramme de fabrication.
Etude HACCP
Cette phase se base sur les 7 principes HACCP. Elle dtermine les points critiques matriser (CCP)
Etape 6 : Enumration des dangers (principe 1)
Lanalyse des dangers est ltape permettant dnumrer tous les dangers auxquels on peut raisonnablement sattendre chacune des tapes du diagramme de fabrication : rception, production, transformation, stockage, distribution et consommation finale. a. numration des dangers potentiels Il sagit dans un premier temps de lister lensemble des dangers qui peuvent apparatre au cours des phases de vie du produit (cf. diagramme de fabrication) Les groupes de dangers considrer sont les suivants : Chimiques sont les produits chimiques risquant dentrer en contact avec le produit (rsidus de nettoyage, antibiotiques, allergnes, OGM) Physiques sont lensemble des corps trangers susceptibles de contaminer le produit (os, mtal, bois, carton, verre, plastique) Micro biologiques et biologiques sont dune part les types dtres vivants pouvant tre lorigine de contaminations et dautre part les micro organismes et les toxines pouvant contaminer et/ou se dvelopper dans les matires premires et/ou le produit fini (germes pathognes, germes indicateurs dhygines, possibilit de survie de toxines produites par des micro organismes)
C.C.I. Arras/Service Dveloppement des Entreprises/Sophie Perret du Cray/avril 2008
Page 3 sur 3
Pour chaque danger, on dfinit une origine. Les dangers peuvent tre classs selon 5 origines : personnel, quipement, environnement, matires premires, processus. Pour trouver cette origine on peut utiliser la mthode des 5 M (Matires premires, Milieu, Main duvre, Mthode) Se reporter au tableau didentification et dvaluation des dangers outil tlchargeable
b. analyse des risques Le risque est une fonction de la probabilit dun effet nfaste sur la sant et de la gravit de cet effet rsultant dun ou de plusieurs dangers dans un aliment. Une valuation qualitative (consquence, gravit) et ventuellement quantitative (probabilit dapparition, frquence) des dangers doit tre effectue pour valuer le degr du risque. A partir de ces donnes, une hirarchisation des dangers peut tre ralise. Se reporter au tableau didentification et dvaluation des dangers outil tlchargeable
c. tablissement des mesures de matrise Les mesures de matrise sont des actions, activits, matriels ou facteurs ncessaires pour liminer les dangers ou rduire leur probabilit dapparition un niveau acceptable. Les mesures sont dfinies partir : Des causes identifies et de leur valuation. Des moyens et ressources de lentreprise (matriel, technique, humains) Les mesures de matrise doivent tre formalises sous forme de procdures ou dinstructions.
Etape 7 : Dtermination des CCP laide de larbre de dcision (principe 2)
Un CCP ou point critique est un point, procdure ou tape ou la perte de matrise entrane un risque inacceptable. Il faut retenir que globalement un CCP est une opration pour laquelle, en cas de perte de matrise, aucune opration ne viendra compenser la dviation qui sest produite et qui entranera un risque inacceptable. Lutilisation de larbre de dcisions propos par le codex alimentarius est un outil pour la dtermination des CCP parmi lensemble des dangers lists ltape prcdente.
Etape 8 : Etablissement des limites critiques (principe 3)
Les limites critiques fixent les frontires de lacceptabilit. Elles peuvent tre des valeurs chiffres, des paramtres sensoriels ou des ralisations.
Etape 9 : Etablissement des procdures de surveillance (principe 4)
Cette tape doit permettre de mesurer ou dobserver les seuils critiques correspondant un CCP. Les mesures sont des actions de surveillance enregistres afin dapporter la preuve de la matrise du CCP. Les procdures appliques doivent tre en mesure de dtecter toute perte de matrise.
C.C.I. Arras/Service Dveloppement des Entreprises/Sophie Perret du Cray/avril 2008
Page 4 sur 4
Pour chaque action de surveillance, au travers dune procdure, doivent tre prciss si ncessaire : La mthode utilise pour la surveillance ; Le mode opratoire ; Les responsabilits dexcution et dinterprtation des rsultats ; La frquence de lobservation ; Le plan dchantillonnage ; Les modalits denregistrement des rsultats. Il existe 2 types de surveillance : La surveillance en continu qui permet de conserver lenregistrement de la surveillance et dagir en temps rel, notamment lors du dclenchement dactions correctives. La surveillance discontinue qui demande des rponses accessibles rapidement du type oui ou non (check list) une frquence dfinie.
Etape 10 : Etablissement des mesures correctives (principe 5)
Des mesures correctives doivent tre prvues pour chaque CCP afin de pouvoir rectifier les carts. Ces mesures doivent garantir que le CCP a t matris et prvoir le sort qui sera rserv au produit en cause : destruction, dclassement, retouche, identification et traabilit.
Etape 11 : Etablissement des procdures de vrification (principe 6)
Cette tape consiste vrifier lefficacit du systme mais galement son application effective. On peut avoir recours des mthodes, des procdures et des tests de vrification et daudit, notamment au prlvement et lanalyse dchantillons alatoires, pour dterminer si le systme fonctionne correctement.
Etape 12 : Etablissement du systme documentaire (principe 7)
Le systme documentaire doit comporter deux types de document : Le manuel HACCP qui comprend lensemble des documents dfinis lors de lnumration des diffrentes tapes : diagramme de fabrication, liste de dangers, dfinitions des responsabilits Les enregistrements.
C.C.I. Arras/Service Dveloppement des Entreprises/Sophie Perret du Cray/avril 2008
Vous aimerez peut-être aussi
- HACCP Sardina 1234Document26 pagesHACCP Sardina 1234Khaoula SoufianiPas encore d'évaluation
- Spe140 6644132Document543 pagesSpe140 6644132Martín100% (1)
- Chapitre 01 PDFDocument6 pagesChapitre 01 PDFNadjmo Ben Messaoud100% (1)
- Français GCL CCIDocument4 pagesFrançais GCL CCIbfmtv100% (1)
- Exercices de Géotechnique EUROCODE 7 Murs Parois Et Stabilité de Pente PDFDocument128 pagesExercices de Géotechnique EUROCODE 7 Murs Parois Et Stabilité de Pente PDFKyser Sose75% (4)
- Commission du Codex Alimentarius: Manuel de Procédure Vingt-sixième editionD'EverandCommission du Codex Alimentarius: Manuel de Procédure Vingt-sixième editionÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Outil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Introduction et glossaireD'EverandOutil d'évaluation des systèmes de contrôle des aliments: Introduction et glossairePas encore d'évaluation
- LP-IA Exposé HACCP Huile D'olive À Système ContinuDocument40 pagesLP-IA Exposé HACCP Huile D'olive À Système Continustyle musicPas encore d'évaluation
- HACCP SardinaDocument25 pagesHACCP SardinaKhaoula SoufianiPas encore d'évaluation
- Travaux Diriges SMSDA QSE 2 UD 2019Document3 pagesTravaux Diriges SMSDA QSE 2 UD 2019valeriePas encore d'évaluation
- La Traçabilité: ThèmeDocument12 pagesLa Traçabilité: ThèmeBudz CastilloPas encore d'évaluation
- LEGHLIMI 2013 ArchivageDocument159 pagesLEGHLIMI 2013 ArchivageLina Safa0% (1)
- Milieux de CultureDocument87 pagesMilieux de Cultureperlamorena100% (1)
- Contribution A L'installation - Ouafae KHAMROUNI - 4120Document39 pagesContribution A L'installation - Ouafae KHAMROUNI - 4120Amirou Baby MixicoPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage-Candia Apres EntretienDocument81 pagesRapport de Stage-Candia Apres EntretienAiicHa Azzamouk100% (2)
- Mémoire PFE Mohamed ATTOUCHEDocument52 pagesMémoire PFE Mohamed ATTOUCHEÃmbitious Gïrl50% (2)
- Mémoire FromageDocument56 pagesMémoire Fromageamina imene100% (1)
- Fiche Degustation CaféDocument1 pageFiche Degustation CaféreniePas encore d'évaluation
- Examen 2 Génie Industriel 2 en Génie de Technologie AlimentaireDocument2 pagesExamen 2 Génie Industriel 2 en Génie de Technologie AlimentaireJoël Mètogbé ZinsaloPas encore d'évaluation
- Mémoire: ThèmeDocument69 pagesMémoire: ThèmeSoumia AbboudPas encore d'évaluation
- 4.1.2-Suivi Des Paramètres PH, Extrait Sec, Viscosité, Température Du Leben Beldi À La Société Chergui - MarocDocument32 pages4.1.2-Suivi Des Paramètres PH, Extrait Sec, Viscosité, Température Du Leben Beldi À La Société Chergui - MarocTayeb BouazizPas encore d'évaluation
- Présentation de Laboratoire de La MicrobiologieDocument3 pagesPrésentation de Laboratoire de La MicrobiologieBOUMECHHOUR FatimaPas encore d'évaluation
- Affs4 1Document17 pagesAffs4 1Lek YassirPas encore d'évaluation
- Teneur en Eau Dans Les Fruits Secs PDFDocument39 pagesTeneur en Eau Dans Les Fruits Secs PDFkokoPas encore d'évaluation
- ViandeDocument15 pagesViandemeyes26100% (2)
- Application de La Méthode HACCPDocument29 pagesApplication de La Méthode HACCPYassirPas encore d'évaluation
- Mazeghrane Djouher & Gaya LyndaDocument129 pagesMazeghrane Djouher & Gaya LyndaTayeb BouazizPas encore d'évaluation
- Brahimi Massinissa & Kahil Salim Abdeslam PDFDocument74 pagesBrahimi Massinissa & Kahil Salim Abdeslam PDFBilal DjouhriPas encore d'évaluation
- Techniques Controle Microbiologiques 1Document59 pagesTechniques Controle Microbiologiques 1RãjDā AiissàPas encore d'évaluation
- Power PointDocument18 pagesPower Pointinscripemma100% (1)
- 16.conclusion GénéraleDocument2 pages16.conclusion GénéraleTaha OukasePas encore d'évaluation
- Technologie Agro-Alimentaire Et Controle de Qualité OfficielleDocument62 pagesTechnologie Agro-Alimentaire Et Controle de Qualité OfficielleRayane BkrPas encore d'évaluation
- These Sur Le PMSDocument371 pagesThese Sur Le PMSManong Sheguey100% (1)
- Manuel Haccp Lait en PoudreDocument44 pagesManuel Haccp Lait en PoudreLamzaouak Fatima ZahraPas encore d'évaluation
- AmidonDocument9 pagesAmidonchristophePas encore d'évaluation
- LaitDocument11 pagesLaitEssassi AmmarPas encore d'évaluation
- Pfe KamalDocument57 pagesPfe Kamalahmed fahem100% (3)
- Har 5591Document45 pagesHar 5591Asafo BoualouchPas encore d'évaluation
- Microbiologie Methode OfficielDocument28 pagesMicrobiologie Methode OfficielcosmixvjPas encore d'évaluation
- TD Hygiène Alimentaire M1Document5 pagesTD Hygiène Alimentaire M1safirPas encore d'évaluation
- QUALITéDocument33 pagesQUALITéSara NailiPas encore d'évaluation
- 2 Cours HACCP PDFDocument14 pages2 Cours HACCP PDFahlemPas encore d'évaluation
- YAOURTCAM (Réparé)Document66 pagesYAOURTCAM (Réparé)Patrick LessiPas encore d'évaluation
- Adoui 2Document98 pagesAdoui 2Kita BelaPas encore d'évaluation
- Lait VegetauxDocument6 pagesLait VegetauxAbd El AdimPas encore d'évaluation
- Stage en Industrie PharmaceutiqueDocument4 pagesStage en Industrie PharmaceutiqueInes SahraouiPas encore d'évaluation
- Cours TD Destruction Thermique Microorganismes L2SADocument13 pagesCours TD Destruction Thermique Microorganismes L2SAMoha Mfam100% (1)
- Mise en Place Du Système HACCP Pour Le Lait Pasteurisé - BELLAH NaimaDocument34 pagesMise en Place Du Système HACCP Pour Le Lait Pasteurisé - BELLAH NaimaHaméd HamèdPas encore d'évaluation
- Evaluation Des Paramètres Physico-Chimiques Du Yaourt Ferme Activia ...Document90 pagesEvaluation Des Paramètres Physico-Chimiques Du Yaourt Ferme Activia ...hassan mouslikPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument18 pagesRapport de StageyoucefPas encore d'évaluation
- Qualite Microbiologique Et Physicochimique de Fromages Frais (Jben) Preleves A Rabat Et SaleDocument13 pagesQualite Microbiologique Et Physicochimique de Fromages Frais (Jben) Preleves A Rabat Et SaleChet AHmedPas encore d'évaluation
- Les TP Du LaitDocument63 pagesLes TP Du LaitZineb BelalaPas encore d'évaluation
- Cours Analyse Microbio s5 21-22Document46 pagesCours Analyse Microbio s5 21-22Narcisse OuedraogoPas encore d'évaluation
- CorrectionDocument6 pagesCorrectionNoureddine OUNINISSEPas encore d'évaluation
- Ikn5339 PDFDocument90 pagesIkn5339 PDFFousseyni TRAOREPas encore d'évaluation
- Fiche Synthese ABVTDocument4 pagesFiche Synthese ABVTAbdennour BaroudaPas encore d'évaluation
- Chap1. Rap. B.al - IndDocument27 pagesChap1. Rap. B.al - Indsouad sadiPas encore d'évaluation
- Rapport de Microbiologie AlimentaireDocument22 pagesRapport de Microbiologie AlimentaireAmeni Ben AmorPas encore d'évaluation
- Règlementation Sur La Filière Viande, Contamination DesDocument25 pagesRèglementation Sur La Filière Viande, Contamination DesSara NailiPas encore d'évaluation
- Contrôle Qualité Du Lait Et Ses Dérivés de La Laiterie MilalaitDocument85 pagesContrôle Qualité Du Lait Et Ses Dérivés de La Laiterie MilalaitAmina mimiPas encore d'évaluation
- Micropilot M FMR230/231/240/244/245: Information TechniqueDocument68 pagesMicropilot M FMR230/231/240/244/245: Information TechniqueBlakePas encore d'évaluation
- Silo - Tips - Livre Prof fr6 Chap04Document16 pagesSilo - Tips - Livre Prof fr6 Chap04taffach57Pas encore d'évaluation
- Notion Sur Le Champ Tournant Edition 2023-2024Document38 pagesNotion Sur Le Champ Tournant Edition 2023-2024reda hassiniPas encore d'évaluation
- Son-Odeur-Apres-La-PluieDocument176 pagesSon-Odeur-Apres-La-PluieNhi HoangPas encore d'évaluation
- Pierrot Sur Scene Anthologie de Pieces Et Pantomimes Francaises Du Xixe Siecle Bibliographie PDFDocument11 pagesPierrot Sur Scene Anthologie de Pieces Et Pantomimes Francaises Du Xixe Siecle Bibliographie PDFkardozo1988Pas encore d'évaluation
- Dimensionnement Des Structures Mtalliques NDC EGLISEDocument12 pagesDimensionnement Des Structures Mtalliques NDC EGLISEJoseph G B AMONPas encore d'évaluation
- LEFECDocument7 pagesLEFECAbdo GuezriPas encore d'évaluation
- Traduction - Recherche Google PDFDocument1 pageTraduction - Recherche Google PDFHsm HuujPas encore d'évaluation
- Côte D'Ivoire - École Numérique: EPS TerminaleDocument8 pagesCôte D'Ivoire - École Numérique: EPS TerminaleOlga KouaméPas encore d'évaluation
- Chap.07 Etude de La Contre-RéactionDocument30 pagesChap.07 Etude de La Contre-RéactionmariemPas encore d'évaluation
- Expose Sur Le Marche Des CapitauxDocument6 pagesExpose Sur Le Marche Des CapitauxSeria50% (2)
- Horloge StrategiqueDocument5 pagesHorloge StrategiquesarbiPas encore d'évaluation
- PK IntroductionDocument40 pagesPK IntroductionOMAR EL HAMDAOUIPas encore d'évaluation
- CV - 2022-12-10 - Adnane - El KasmiDocument1 pageCV - 2022-12-10 - Adnane - El KasmiLayana LouPas encore d'évaluation
- June Week 2Document15 pagesJune Week 2Tatah FabiolaPas encore d'évaluation
- AnnéeDocument6 pagesAnnéeSAMIPas encore d'évaluation
- Etude Dimpacte Environnementale de Centrale SolaireDocument155 pagesEtude Dimpacte Environnementale de Centrale SolaireM'BRA FRANÇOIS ASSOMANPas encore d'évaluation
- Exam Mip2 TMCEM 9jan2020Document5 pagesExam Mip2 TMCEM 9jan2020TECHNOLOGIES MODERNES DU CAMEROUNPas encore d'évaluation
- Claude Lévi-Strauss - Race Et HistoireDocument87 pagesClaude Lévi-Strauss - Race Et HistoireAbdeltifPas encore d'évaluation
- TD Eg Iset ZGDocument16 pagesTD Eg Iset ZGabdelgoui rymPas encore d'évaluation
- Les Noyaux PDFDocument4 pagesLes Noyaux PDFMohamed LaliouiPas encore d'évaluation
- INTERBUSDocument23 pagesINTERBUSjoseph tohmePas encore d'évaluation
- Chap2a BDRODocument175 pagesChap2a BDROAsMa Thabet0% (1)
- Séance D'encadrement GRATUITE Concours MEFDocument8 pagesSéance D'encadrement GRATUITE Concours MEFRed ReddingtonPas encore d'évaluation
- Livre AudaceReusite BR PDFDocument75 pagesLivre AudaceReusite BR PDFSaid MohamedPas encore d'évaluation
- Épreuve Mise en Ligne Par: Site de T Éléchargement Gratuit Des Épreuves Au CamerounDocument2 pagesÉpreuve Mise en Ligne Par: Site de T Éléchargement Gratuit Des Épreuves Au CamerounNgos JeanPas encore d'évaluation
- Valvulas Check Tipo Bola y Resorte CepexDocument4 pagesValvulas Check Tipo Bola y Resorte CepexOliveira LugoPas encore d'évaluation