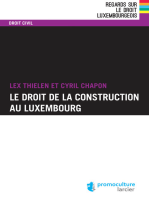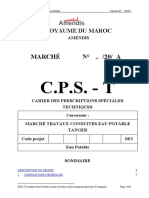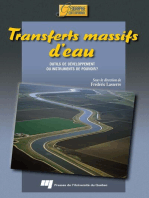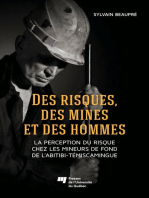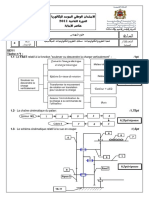Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
4.1.2 FAT1 Conception Des Reservoirs Deau Potable PDF
4.1.2 FAT1 Conception Des Reservoirs Deau Potable PDF
Transféré par
Oussama El'Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
4.1.2 FAT1 Conception Des Reservoirs Deau Potable PDF
4.1.2 FAT1 Conception Des Reservoirs Deau Potable PDF
Transféré par
Oussama El'Droits d'auteur :
Formats disponibles
FASCICULE TECHNIQUE
Conception des rservoirs deau potable
Code 4.1.2. FAT1
Date de rdaction : jeudi 4 Octobre 2012
Version : mercredi 21 novembre 2012
Version finale
4.1.2. FAT1
Note aux lecteurs
Les prescriptions techniques gnrales sappliquent aux oprations raliser en Hati et relevant du
champ de comptence de la Direction Nationale de lEau Potable et de lAssainissement (DINEPA).
Elles constituent un rfrentiel, certaines porte rglementaire, nationale, technique et sectorielle,
dautres ayant un rle dinformation et de support complmentaire.
Les documents porte rglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :
- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions
communes une sous thmatique technique ;
- Les Directives Techniques prescrivant les rgles minimales imposes pour la conception
et la ralisation ainsi que la gestion douvrages spcifiques.
Tout propritaire et/ou ralisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont
indiques. Toute drogation devra faire lobjet dune autorisation au pralable et par crit de la
DINEPA.
Les documents ayant un rle dinformation et de support complmentaire, sont :
- Les fiches techniques et Guides techniques prsentant ou dcrivant des ouvrages ou des
actions dans les diffrentes thmatiques ;
- Les modles de rglements dexploitation ou de gestion ;
- Les modles de cahiers des clauses techniques particulires, utilisables comme cadres type pour les matres douvrages et concepteurs ;
- Divers types de modles de documents tels que procs verbaux des phases de projet,
modles de contrat ou de rglement, contrle de bonne excution des ouvrages, etc.
Ces documents ayant un rle dinformation et de support complmentaire sont compatibles avec la
rglementation impose et peuvent prciser la comprhension des techniques ou fournir des aides
aux acteurs.
Le prsent rfrentiel technique a t labor en 2012 et 2013 sous lgide de la DINEPA, par lOffice International de lEau
(OIEau), grce un financement de lUNICEF.
Dpt lgal 13-11-505 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-64-6.
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle dun document doit tre accompagne des rfrences de la source par la
mention suivante : par exemple extrait du rfrentiel technique national EPA, Rpublique dHati : Fascicule
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013)
2 / 23
4.1.2. FAT1
Sommaire
1
2
3
Introduction....................................................................................................................................... 5
Fonctions........................................................................................................................................... 6
Critres de dcision et configurations du systme ............................................................................ 7
3.1
Rservoir sur tour : chteau deau............................................................................................. 8
3.2
Rservoir enterr ou semi enterr ............................................................................................. 9
4
Dimensionnement des rservoirs ...................................................................................................... 9
4.1
Alimentation du rservoir continue 24h/24 h ........................................................................... 9
4.2
Alimentation du rservoir uniquement en priode nocturne................................................... 10
4.3
Calcul du temps de sjour ....................................................................................................... 10
4.4
Protection incendie.................................................................................................................. 10
4.4.1
Cas dune rserve incendie simple ( proscrire) ............................................................. 10
4.4.2
Cas dune rserve incendie avec siphon ......................................................................... 10
4.5
Maintien de la qualit de leau dans les rservoirs ................................................................. 12
5
Prescriptions pour la conception ..................................................................................................... 14
5.1
tanchit................................................................................................................................ 15
5.2
Conception de louvrage ......................................................................................................... 15
5.2.1
tats limites..................................................................................................................... 15
5.2.2
Actions ............................................................................................................................ 15
5.3
Dispositions supplmentaires.................................................................................................. 16
5.3.1
Analyse des sollicitations................................................................................................ 16
5.3.2
Analyse des sollicitations Construction ..................................................................... 17
5.3.3
Analyse des sollicitations Chteaux d'eau ................................................................. 17
5.4
Protection contre les instruisons, accs................................................................................... 17
6
Contrles, preuves et mise en service ........................................................................................... 17
6.1
Considrations gnrales......................................................................................................... 17
6.1.1
Gnralits ...................................................................................................................... 17
6.1.2
Hygine ........................................................................................................................... 17
6.1.3
Scurit des accs du rservoir ....................................................................................... 17
6.1.4
Scurit du personnel ...................................................................................................... 18
6.2
preuve d'tanchit ............................................................................................................... 18
6.2.1
Principes.......................................................................................................................... 18
6.2.2
Parois et radiers............................................................................................................... 18
6.2.3
Toiture............................................................................................................................. 19
6.3
Nettoyage et dsinfection........................................................................................................ 19
6.3.1
Nettoyage ........................................................................................................................ 19
6.3.2
Dsinfection .................................................................................................................... 20
6.3.3
Conformit de la qualit de l'eau .................................................................................... 20
6.4
Mise en service........................................................................................................................ 20
6.4.1
Qualit de l'eau................................................................................................................ 20
6.4.2
Bon fonctionnement des appareils .................................................................................. 21
7
Exploitation..................................................................................................................................... 21
8
Conclusion ...................................................................................................................................... 21
9
Sources ............................................................................................................................................ 21
10
Lexique........................................................................................................................................ 22
ANNEXE : PLAN GUIDE DUN RESERVOIR ................................................................................... 23
3 / 23
4.1.2. FAT1
Liste des figures
Figure 1 : Schma de configuration hydraulique............................................................................... 8
Figure 2 : Fonctionnement dune rserve incendie avec syphon ................................................. 11
Figure 3 : Coupe schmatique dun rservoir de rseau............................................................... 13
Figure 4: Amnagement schmatique dun rservoir de rseau.................................................. 14
4 / 23
4.1.2. FAT1
1 Introduction
La conception et la gestion dun rservoir aujourdhui doit prendre en compte ces comportements des
consommateurs et la stratgie de la DINEPA.
La conception dun rservoir deau potable doit nanmoins tenir compte des lments suivants :
Durant une priode, leau distribue tait plutt considre comme une eau seulement
domestique par la population. Aujourdhui, leau distribue dans le rseau public est mise
en service pour tout usage, hors irrigation (boisson, et autres usages domestiques) et doit
donc tre traite ;
le comptage de leau doit toujours pouvoir tre effectu en sortie de rservoir ;
la facturation au forfait souvent applique, ainsi que la gratuit ponctuellement mise en
uvre lors de diverses situations (rponse une urgence, programme humanitaire de
court terme, enjeu de politique locale) sont appels disparaitre et remplacs par le
paiement au volume ;
Le mode de distribution auprs des usagers doit tre pris en compte pour la conception du
rservoir. Par exemple, les installations domiciliaires aprs branchement ne sont pas
toujours quipes de robinets fonctionnels ou de compteurs, mme si le comptage est
clairement un objectif prioritaire pour la DINEPA. Lorsque leau est disponible, elle remplit
autant de rcipients que possible, puis coule gueule be. Limpact sur le rseau est que,
lorsque le rseau est mis en eau, le stockage (rservoir) se vide rapidement. Ceci
engendre un systme de distribution usuel qui consiste fermer le rservoir pour quil
puisse se remplir puis distribuer le volume du rservoir pour une zone prcise, un quartier.
Chaque quartier reoit alors leau une heure et une date connue de la population.
Etat donn le dveloppement des usages, on peut retenir les chiffres suivants :
Besoins des usagers : (100 l/jour/pers pour la zone mtropolitaine de Port Au Prince, 70 l/jour/pers
pour les villes secondaires, et 20 l/jour/pers pour les zones rurales (source : Etude sur
lapprovisionnement en eau potable en Hati, 2005)
Le taux de couverture varie selon les villes et les estimations de 33,4 % en zone mtropolitaine 10
30 % dans les villes secondaires (source : IHSI, 2002).
Le rapport tude de faisabilit des travaux durgence pour une remise niveau de la production et de
la desserte en eau dans la Rgion - Mtropolitaine de Port-au-Prince (CAMEP) - Rapport Prliminaire
de diagnostic et didentification des Travaux durgence ; paru en avril 2010 prcise que La
population de 2009 des 39 secteurs desservis par les quatre agences de la CAMEP est 2 370 000
personnes, couvrant une superficie denviron 10 000 ha. La demande en eau moyenne pour le
territoire de la CAMEP atteint plus de 140 000 m3/j en utilisant une consommation moyenne de 60
l/j/pers. Les donnes actuelles ne permettent pas dvaluer quelle proportion des 600 000 personnes
lextrieur des secteurs de la CAMEP sapprovisionnerait aux fontaines publiques de la CAMEP. Il
sagit principalement de dveloppements anarchiques flanc de montagnes et prs de la mer. La
plupart salimenteraient en eau mme les sources (adductions, trop-pleins, etc.), aux cours deau et
des vendeurs deau. Inversement, plusieurs familles sur le territoire de la CAMEP sapprovisionnent
aussi par camion de vendeurs deau et achtent de leau potable embouteille.
5 / 23
4.1.2. FAT1
Tableau 1 Eau utilise par les mnages pour boire (source : EMMUS-V Hati 2012)
2 Fonctions
La conception et le dimensionnement du rservoir doit tenir compte des dbits disponibles de la
ressources, de lalimentation continue (24h), dun volume de rserve de 24h en cas de rupture
dalimentation du rservoir, de la mise en scurit du rservoir par lamont (dispositif de fermeture en
cas de pollution) et ventuellement la rserve incendie
La capacit dun rservoir de rseau deau potable et la dure de stockage de leau dans ce rservoir
dpendent des fonctions que le rservoir doit remplir et de son rgime dexploitation dans le systme
de distribution de leau.
Les fonctions pouvant tre assures par un rservoir sont les suivantes:
La rgulation de dbit
Le rservoir est un ouvrage rgulateur de dbit qui permet d'adapter la production la consommation.
6 / 23
4.1.2. FAT1
Les ouvrages de production sont gnralement dimensionns pour fournir le volume correspondant
la consommation journalire totale de pointe, avec un temps journalier de fonctionnement compris
entre 16 et 20 heures.
Or, la consommation journalire prsente des fluctuations importantes : il est donc judicieux, du point
de vue technique et conomique, de faire jouer aux rservoirs un rle d'appoint pour la satisfaction
des besoins horaires de pointe.
La prsence des rservoirs permet donc de limiter le dimensionnement des quipements de
pompage.
La rgulation de la pression
Le rservoir est un ouvrage rgulateur de pression puisque son niveau conditionne, aux pertes de
charges prs, la cote pizomtrique et donc la pression dans le rseau.
La scurit d'approvisionnement
Le rservoir permet de maintenir la distribution dans l'ventualit d'un accident sur les quipements
d'alimentation du rseau : pollution de l'eau brute alimentant la station de traitement, pannes
dorigines diverses de la station de pompage, rupture d'une canalisation d'adduction
Les rserves de scurit sont dtermines sur la base de lvaluation du risque et de la dure
probable de dysfonctionnement.
La simplification de l'exploitation
Le rservoir facilite les oprations d'exploitation en permettant les arrts pour entretien ou sparation
de certains quipements : ouvrage de production, station de pompage, canalisation d'adduction
Lutte incendie
Le rservoir permet de mettre disposition de leau pour la lutte contre lincendie en accord avec les
prescriptions locales.
Il convient daugmenter les rserves de scurit si le systme de distribution sert la lutte contre
lincendie. De telles rserves peuvent ne pas tre ncessaires sil y a dj une grande capacit de
stockage. Souvent, on peut effectuer des arrangements temporaires pour couvrir la demande
durgence pour la lutte contre lincendie.
3 Critres de dcision et configurations du systme
Les critres de choix pour la configuration la plus adapte sont :
La scurit de lalimentation et la qualit de leau ;
Le cot global de la construction, de lexploitation et de la maintenance ;
Lintgration dans le systme de distribution deau ;
Lamnagement du territoire ;
La durabilit de louvrage prenant en compte les comportements des riverains (vandalisme) et
les alas (risque sismique, mtorologique).
Les critres dfinis ci-dessus peuvent tre respects pour des rservoirs de rseau au sol, des
chteaux deau ou pour des rservoirs de rseau de bas service coupls avec des stations de
pompage.
Les rservoirs de rseau peuvent tre conus comme des ouvrages enterrs, partiellement enterrs
ou au sol.
7 / 23
4.1.2. FAT1
1
5
3
12345-
Niveau deau
Rservoir de rseau au sol
Rservoir de rseau avec station de pompage
Zone de distribution
Chteau deau
Figure 1 : Schma de configuration hydraulique
3.1 Rservoir sur tour : chteau deau
Il repose sur un principe de distribution gravitaire de l'eau, la diffrence de hauteur ncessaire
entre l'eau stocke et les postes de distribution tant obtenue par lvation du rservoir sur une tour,
sur piliers ou sur une construction existante.
L'difice se situe aprs la production, en tte ou en relais sur les rseaux d'adduction et de
distribution. Le volume du rservoir correspond au maximum des besoins de la consommation
journalire et de la scurit incendie (120 m3). Il comporte parfois deux cuves spares, ce qui permet
leur entretien sans interruption de service.
8 / 23
4.1.2. FAT1
Le remplissage du rservoir s'effectue gnralement par l'intermdiaire d'une station de
pompage partir du lieu de production ou d'une bche de reprise.
La plupart des chteaux d'eau sont raliss en bton arm ou prcontraint. Certains sont
raliss en acier soud ou assembl. Les plus anciens sont en maonnerie traditionnelle.
Avantages :
Cration d'un point haut en terrain plat.
Inconvnients :
Stockage limit
Cot de construction lev,
Entretien (peinture),
Forte vulnrabilit au risque sismique,
Variation de temprature journalire et saisonnire peut poser des problmes de salubrit :
leau stocke atteignant des tempratures leves, accentuant le dveloppement des
bactries.
3.2 Rservoir enterr ou semi enterr
Ce systme repose galement sur un principe de mise en pression gravitaire de l'eau stocke. La
diffrence de hauteur est obtenue par l'exploitation d'un dnivel naturel du terrain. Le rservoir est
donc difi mme le sol.
L'alimentation peut tre gravitaire ou se faire laide dune station de pompage.
Avantages :
Stockage moins limit que le chteau deau,
Cot de la construction plus faible que pour un rservoir sur tour,
Intgration plus facile dans le paysage,
Maintien de la temprature de l'eau constante.
Vulnrabilit plus faible au vandalisme
Inconvnients :
L'assujettissement d'un tel systme la topographie du site peut conduire des surcots au
niveau de la mise en place et de lexploitation des les rseaux de distribution.
4 Dimensionnement des rservoirs
4.1 Alimentation du rservoir continue 24h/24 h
Il s'agit de dterminer le volume ncessaire pour assurer le fonctionnement de rgulation entre :
la demande (consommation du jour de pointe),
la production.
Ce volume est calcul partir de l'volution au cours de la journe entre :
la courbe de consommation du jour de pointe,
9 / 23
4.1.2. FAT1
la courbe de production.
Il dpend donc de la variation journalire de la demande.
Un ordre de grandeur :
Gnralement, le volume utile calcul est compris entre un tiers et la moiti de la consommation
journalire projet sur un horizon de 20 ans. Dans le cas de limpossibilit dtudier la courbe relle de
variation journalire, cet ordre de grandeur peut tre pris en compte pour les petites et moyennes
installations en zone rsidentielle sans consommateurs particuliers (industriels, centres commerciaux,
htels)
4.2 Alimentation du rservoir uniquement en priode nocturne
On appliquera les ordres de grandeur ci-dessous pour le dimensionnement des rservoirs en cas
d'une adduction de nuit 10h/24h :
Une journe de consommation de pointe en milieu rural,
Une demi-journe de consommation de pointe en milieu urbain.
Ces volumes permettent d'assurer une scurit d'approvisionnement sans pour autant exagrer le
temps de stagnation de l'eau dans la cuve.
4.3 Calcul du temps de sjour
Le surdimensionnement des rservoirs peut conduire un temps de sjour excessif de l'eau dans la
cuve entranant des risques d'altration de la qualit de l'eau et dinefficacit des dsinfections.
On ne dpassera pas (sauf exception) un temps de sjour de lordre de 24 h.
4.4 Protection incendie
4.4.1 Cas dune rserve incendie simple ( proscrire)
Certains rservoirs sont quips de telle manire qu'une partie de leur capacit constitue une rserve
incendie. Le volume pris en compte est gnralement de 120 m3. Il est noter que ce volume est fix
par les autorits locales selon le contexte de chaque ville et village.
Ce systme est simple, mais il prsente l'inconvnient majeur de comporter une tranche d'eau morte.
Ce principe est viter pour privilgier le systme suivant.
4.4.2 Cas dune rserve incendie avec siphon
Le dispositif le plus courant est constitu dun siphon qui se dsamorce quand le niveau de la rserve
est atteint. L'ouverture d'une vanne permet d'utiliser le volume de la rserve constamment renouvel.
10 / 23
4.1.2. FAT1
Figure 2 : Fonctionnement dune rserve incendie avec syphon
Le schma ci-dessus illustre le fonctionnement dune rserve incendie avec syphon. Lors du
fonctionnement normal en distribution le marnage va du niveau haut du rservoir son niveau bas
de distribution, limit la hauteur du siphon. En cas dincendie, on ouvre la vanne sur la conduite
dincendie pour utiliser ce volume supplmentaire. Lintrt principal de ce dispositif est dutiliser tout
le volume du rservoir pour la circulation de leau, mme en fonctionnement normal . La stagnation
deau est rduite (meilleure protection contre les bactries).
11 / 23
4.1.2. FAT1
4.5 Maintien de la qualit de leau dans les rservoirs
Prvention des dgradations de la qualit de l'eau :
Afin de prserver la qualit de l'eau dans les rservoirs, un certain nombre de prcautions sont
prendre en compte :
Assurer l'tanchit de l'ouvrage : terrasse, radier, murs, capots et accs divers.
Protger les entres d'air de toute intrusion par des dispositifs d'aration qui comporteront une
grille fine en acier inoxydable ou matire plastique.
Limiter l'clairage naturel de l'intrieur du rservoir (favorise la croissance des algues).
Assurer un renouvellement permanent de l'eau.
Nettoyer annuellement le rservoir.
On se basera sur la structure type des rservoirs des figures suivantes.
Dans tous les cas, les lments constitutifs dun rservoir de rseau incluront au projet :
au moins deux cuves (voir figure 3).
pour chaque cuve d'eau : une conduite d'entre, une conduite de sortie, un trop-plein, des
conduites de vidange et des vannes ncessaires,
des dbitmtres et des limnimtres,
prciser les dispositifs anti intrusion / insectes
une aration fonctionnelle quipe dun dispositif anti pluie et anti intrusion deau de
ruissellement,
dispositif dentre pour lentretien (chelle),
des canalisations de by-pass pour raccorder les tuyauteries d'entre et de sortie.
Le type des vannes ainsi que leur disposition dpendent de la configuration du systme de distribution
d'eau.
12 / 23
4.1.2. FAT1
3
8
5
7
6
8
10
11
12
14
13
Figure 3 : Coupe schmatique dun rservoir de rseau
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ventilation
Niveau deau maximal
Niveau deau maximal oprationnel
Capacit
Profondeur deau maximal
Radier en pente
trop-plein
13 / 23
8. Entre
9. Sortie
10. Vanne de by-pass
11. Fosse
12. Vidange/trop plein
13. Drainage sous radier
14. Drainage primtrique
4.1.2. FAT1
7
1
4
3
5
6
6
5
10
4
3
2
1.
2.
3.
4.
5.
Cuve 1
Cuve 2
Entre
Sortie
Trop-plein
6. Vidange
7. Vanne de by-pass
8. Unit de traitement
9. Vidange/trop plein
10. Vers la zone de distribution
Source : Norme Europenne EN1508
Figure 4: Amnagement schmatique dun rservoir de rseau
5 Prescriptions pour la conception
Les ouvrages en bton seront conus conformment des normes du LNBTP et la Directive
Technique ralisation douvrages de gnie civil maonn (4.1.1 DIT1) prcisant la mthode de calcul
des lments suivants :
calcul des structures
actions sur les structures
calcul des structures en bton
calcul des structures en acier
calcul des structures mixtes acier bton
calcul gotechnique
calcul des structures pour leur rsistance aux sismes
Pour assurer une durabilit satisfaisante des constructions, cest aux matres douvrage et leurs
matres duvre de dfinir ds le stade de conception, outre la dure dutilisation de projet, les
classes dexposition traduisant les attaques et risques de corrosion que subiront chaque partie
douvrage au cours de la dure dutilisation de louvrage.
14 / 23
4.1.2. FAT1
On se rfrera aux Directives Techniques Ralisation douvrages de gnie civil maonns (4.1.1
DIT1)et Conception et ralisation d'ouvrages hydrauliques en bton (4.1.1 DIT2)
5.1 tanchit
Les rservoirs doivent tre conus pour tre tanches. Ceci peut tre ralis partir de diverses
dispositions, utilises seules ou en combinaison ; savoir :
ouvrages dont l'tanchit est assure par la structure seule, construite gnralement en
bton arm ou prcontraint. Dans ce cas, il est possible d'amliorer l'tanchit du bton par
l'emploi d'adjuvants ou l'application de traitements d'impermabilisation de surface ;
ouvrages dont l'tanchit est assure par la structure complte par un revtement
d'impermabilisation ;
ouvrages dont l'tanchit est assure par un revtement ou un cuvelage d'tanchit,
adhrent ou indpendant de la structure rsistante assurant le support.
Pour des ouvrages construits l'aide d'lments prfabriqus, l'tanchit peut tre obtenue en
utilisant les techniques ci-dessus.
Une attention particulire doit tre porte aux joints de construction et de dilatation, aux traverses de
radiers et de parois et aux autres lments soumis la pression d'eau. Lutilisation de joints
d'tanchit et de joints de construction waterstops est impose.
5.2 Conception de louvrage
5.2.1 tats limites
Ltude de conception devra comprendre les lments de calcul aux tats limites suivants :
la perte d'quilibre de la structure ou de l'un de ses lments, considrs comme un corps
rigide ;
la ruine conscutive une dformation excessive, la rupture, ou la perte de stabilit de la
structure ou de l'un de ses lments, y compris ses appuis et ses fondations.
les dformations ou flches qui nuisent l'aspect de l'ouvrage ou son utilisation effective (y
compris le mauvais fonctionnement d'appareils ou d'quipements) ou provoquant des
dommages aux finitions ou aux lments non structuraux (compatibilit de la rsistance et des
dformations avec les revtements dtanchit) ;
la fissuration
la rsistance aux vibrations affectant le confort des personnes, causant des dommages au
rservoir de rseau ou ses composants, ou limitant son efficacit fonctionnelle ;
5.2.2 Actions
La conception de louvrage doit prendre en compte les effets dactions permanentes, variables et
accidentelles.
Le rservoir et ses cuves doivent tre conus pour les tats vide ou plein. Le concepteur fournira les
calculs aux tats limites et les rsultantes de contraintes dans les deux cas.
15 / 23
4.1.2. FAT1
Les tudes gotechniques et structurelles comprendront les justifications de la prise en compte des
actions suivantes :
a. Actions permanentes
Les actions permanentes sont :
le poids propre de l'ouvrage ;
le poids des quipements et installations d'exploitation (pompes et tuyauterie par exemple) ;
le poids de toutes les adjonctions ventuelles,
la prcontrainte ;
le poids et les pousses des terres ;
le poids et la pression de l'eau de nappe phratique ses valeurs prsumes les plus basses ;
les dplacements imposs ;
le retrait ;
le fluage qui est le phnomne physique provoquant la dformation irrversible dun matriau
soumis une contrainte constante
b. Actions variables
Les actions variables sont :
le poids et la pression de l'eau contenue dans le rservoir ;
les charges de vent ;
les charges dues l'exploitation du rservoir ;
les charges dues l'entretien des installations,
le poids et la pression de l'eau de nappe phratique ses valeurs prsumes les plus hautes ;
les surcharges transitoires proximit de l'ouvrage ;
les charges au moment de la construction ;
les variations de temprature tant intrieure qu'extrieure du rservoir tenant compte des
extrmes climatiques et des variations de la temprature de l'eau stocke dues aux saisons et
l'exploitation ;
le gradient thermique entre parties de la construction exposes des conditions climatiques
diffrentes.
c. Actions accidentelles
Elles comprennent la sismicit, et d'autres actions accidentelles telles que linondation (submersion,
rosion et dgts lis au transport solide, particulirement intense en Hati), vandalisme volontaire ou
involontaire (chocs par vhicule et par avion), dformation du sol (glissement de terrain notamment,
qui sont frquent en Hati, une zone la fois cyclonique et karstique) etc. Les lments techniques
prendre en compte doivent tre dfinis par le prescripteur.
NB : une carte de lalea sismique est disponible auprs du Bureau des Mines et de lEnergie
(www.bme.gouv.ht).
Une valuation des alas par zone est disponible sur :
http://www.understandrisk.org/ur/files/MultipleHazardsAssessmentSergioMoraA.RoumagnacJ.AsteE.C
alaisJ.HaaseJ.SaborioM.MarcelloJ.Milce.pdf
On trouvera une valuation des menaces naturelles pour les communes de Jacmel, Petit Gove et
Grand Gove sur http://www.crid.or.cr
5.3 Dispositions supplmentaires
5.3.1 Analyse des sollicitations
Les sollicitations doivent tre calcules partir des combinaisons de charges applicables par les
mthodes appropries de conception de structures.
16 / 23
4.1.2. FAT1
5.3.2 Analyse des sollicitations Construction
Lorsque les mthodes d'excution font intervenir des phases de construction au cours desquelles les
conditions de stabilit et de rsistance peuvent tre diffrentes de celles de l'ouvrage termin, les
vrifications correspondantes doivent tre effectues par rapport aux tats limites appropris.
5.3.3 Analyse des sollicitations Chteaux d'eau
Pour les chteaux d'eau, les effets de la dformation de la structure du support doivent tre pris en
compte. Dans le cas de rservoirs sur tours leves et lances, et pour le calcul des efforts
dynamiques dus au vent ou aux sismes, l'inertie massique de translation et de rotation en tte est
examiner. Les effets du mouvement de l'eau stocke sur la structure sont galement examiner s'ils
sont significatifs.
5.4 Protection contre les instruisons, accs
La trappe daccs dans le rservoir doit tre verrouille par un dispositif clef et rsistant aux
conditions mto (inox, lubrification rgulire). La trappe daccs sera protge conte la corrosion due
la prsence de chlore. Elle sera minima revtue dune peinture anti corrosion. De prfrence
laluminium peut tre un bon matriau pour une trappe daccs au rservoir car il rsistante trs bien
la corrosion.
6 Contrles, preuves et mise en service
6.1 Considrations gnrales
6.1.1 Gnralits
Les tapes suivre pour la mise en service d'un nouveau rservoir de rseau passent par la
ralisation des actions suivantes :
contrle des mouvements ;
preuves d'tanchit ;
nettoyage et dsinfection ;
mise en service.
6.1.2 Hygine
L'ensemble du personnel concern par des travaux doit respecter la rglementation sanitaire, en
particulier en ce qui concerne les maladies hydriques. On imposera lors de lexcution des travaux
une dmarche qualit ou des procdures valides sur lhygine des chantiers.
6.1.3 Scurit des accs du rservoir
La conception du rservoir inclut obligatoirement une protection de la zone du rservoir : protection
contre le vandalisme et les pollutions (dtritus, lavage de linge). Les personnes ne peuvent pas
habiter au pied du rservoir. Cette zone doit ainsi interdire tous les accs au rservoir aux personnes
non autorises.
17 / 23
4.1.2. FAT1
La clture sera surtout dpendante de la zone dimplantation du rservoir pour des raisons
dacceptation. Cette clture a vocation limiter risques de vandalisme / pollution lie lactivit, mais
ne dois pas tre confondue avec le primtre de protection des sources. On se rfrera la Directive
Technique protection des captages et des forages (1.2.1 DIT2)
Un point deau public peut tre propos proximit immdiate du rservoir pour acceptation par le
quartier. Ce kiosque ne doit pas tre coll au bti du rservoir, il est recommand de pratiquer une
tarification attractive.
6.1.4 Scurit du personnel
Avant le dbut des travaux, un contrle doit tre effectu pour vrifier que les quipements de scurit
adapts sont disponibles et que tout le personnel porte les vtements de protection corrects.
La possibilit d'un systme d'autorisation de travail appropri et de procdures de travail en toute
scurit doit tre envisage.
Un moyen sr d'accs et de sortie doit tre prvu.
6.2 preuve d'tanchit
6.2.1 Principes
Avant la mise en service d'un rservoir de rseau, des preuves doivent tre ralises pour vrifier
l'tanchit de chaque cuve conformment aux prescriptions de 4.1.
Les modalits de l'preuve des parois et radiers et la baisse du niveau de l'eau permise doivent tre
spcifies par le prescripteur. La toiture du rservoir de rseau doit tre tanche l'eau.
Le prescripteur peut spcifier l'preuve de la toiture par un arrosage continu ou une mise sous eau.
Dans tous les cas, l'preuve doit tre juge satisfaisante si aucune fuite n'apparat la sous-face
(cot plafond de la dalle) de la toiture. On se rfrera aux Directives Techniques Ralisation
douvrages de gnie civil maonns (4.1.1 DIT1) et Conception et ralisation d'ouvrages hydrauliques
en bton (4.1.1 DIT2)
Toute humidit mise en vidence au niveau de joints ou ailleurs dans l'ouvrage doit tre examine
pour dterminer s'il y a un risque de fuite long terme. Si l'preuve n'est pas satisfaisante, des
travaux doivent tre effectus avant de renouveler l'preuve.
6.2.2 Parois et radiers
La procdure d'preuve doit comprendre au moins les oprations suivantes :
a. Prparation
Aprs l'achvement de la construction :
s'assurer que les dispositifs d'vacuation d'eau adquate sont disponibles ;
nettoyer soigneusement toutes les surfaces internes ;
isoler et scuriser toute la tuyauterie d'arrive et de sortie ;
remplir la cuve d'eau lentement jusqu'au niveau du trop-plein, ce qui peut rendre ncessaire
des dispositions temporaires de remplissage ; pour les rservoirs de rseau, il convient
d'utiliser de l'eau potable ;
18 / 23
4.1.2. FAT1
laisser un dlai d'absorption, le cas chant, pour permettre aux surfaces mouilles d'atteindre
la saturation et rtablir si ncessaire le niveau d'eau la fin de cette priode.
b. Procdure d'preuve
Mesurer le niveau d'eau au dbut de l'preuve par rapport un repre fix et l'enregistrer ;
observer et si ncessaire mesurer le dbit d'eau des drains sous le radier ;
-surveiller le niveau d'eau par intervalles pendant le temps de l'preuve ;
surveiller l'tat des surfaces extrieures, y compris des parois de sparation entre cuves,
pour dtecter les signes de fuites ;
mesurer la fin de l'preuve le niveau d'eau final ;
calculer la perte d'eau ;
prendre en compte lvaporation sur un contenant tmoin
tablir le rapport d'preuve.
On se basera sur la prconisation suivante :
Les pertes de leau ne doivent pas dpasser, pour des rservoirs avec revtement
dimpermabilisation ou dtanchit, 250 cm3 par mtre carr et par jour sous la pression maximale
prvue, lvaporation en laboratoire tant considre comme la moiti de lvaporation in situ.
6.2.3
Toiture
La procdure d'preuve doit comprendre au moins les oprations suivantes :
a. Prparation
vrifier que la cuve est vide d'eau ;
dans le cas d'une toiture en terrasse, prendre des mesures temporaires pour obturer toutes les
vacuations de l'eau de toiture ;
lorsque ncessaire, prendre toutes les dispositions temporaires pour mettre la toiture en eau
sous la hauteur d'eau spcifie par le concepteur.
b. Procdure d'preuve
mettre la toiture en eau ou l'arroser comme spcifi par le prescripteur ;
effectuer l'arrosage ventuellement spcifi sur toute la surface de la toiture de faon continue
avec de l'eau ;
surveiller la sous-face de la toiture pour dtecter des fuites ;
tablir le rapport d'preuve.
6.3 Nettoyage et dsinfection
Avant la mise en service, le rservoir vide doit dans tous les cas tre nettoy et tre dsinfect, sauf
prescription contraire.
6.3.1 Nettoyage
Avant la mise en service, le rservoir vide doit tre nettoy. Pendant le nettoyage principal, toutes les
surfaces intrieures du rservoir doivent tre abondamment rinces gnralement l'eau potable
sous pression adquate pour les rservoirs de rseau. Toutes les tuyauteries doivent tre rinces.
19 / 23
4.1.2. FAT1
L'emploi de produits chimiques de nettoyage doit tre rduit au minimum. Mais, s'ils sont utiliss, le
prescripteur doit spcifier l'emploi de produits adquats.
6.3.2 Dsinfection
a. Choix du dsinfectant
Le choix des dsinfectants doit tenir compte du temps de contact ncessaire et des proprits de
l'eau, comme par exemple le pH et, dans le cas d'utilisation d'hypochlorite de calcium, la duret de
l'eau traiter. D'autres facteurs comme la dure de vie, la facilit d'utilisation et la probabilit
d'accidents pour le personnel ou l'environnement sont galement prendre en compte.
Le choix du protocole de dsinfection pour un nouvel ouvrage sera soumis au matre douvrage.
b. Procdure de dsinfection
Toutes les surfaces internes du rservoir ainsi que les tuyauteries associes doivent tre nettoyes
(gnralement par aspersion) avec un produit dsinfectant et ensuite rinces avec de l'eau potable.
Le prescripteur ou l'exploitant doit spcifier la concentration du produit de la solution dsinfectante
ainsi que le temps de contact minimal et maximal. Le produit dsinfectant doit tre vacu de la cuve
et limin avec prudence, en utilisant un produit neutralisant lorsque ncessaire afin d'viter des effets
indsirables pour le personnel ou l'environnement.
Aucun dommage aux surfaces du rservoir ne doit tre caus par la mthode de dsinfection.
Ensuite, le rservoir doit tre rempli jusqu'au niveau spcifi avec une eau potable dont la teneur
rsiduelle en produit dsinfectant est infrieure ou gale la valeur normalement rencontre dans
l'eau potable alimentant le rservoir.
6.3.3 Conformit de la qualit de l'eau
Aprs le remplissage ou un dlai spcifi par le prescripteur, et suprieur cinq jours, des
prlvements doivent tre faits aux fins d'analyse bactriologique.
La conformit microbiologique est obtenue si les rsultats des prlvements sont conformes aux
exigences nationales.
Si un chantillon se rvle non conforme, le prescripteur ou l'exploitant doit spcifier des actions pour
y remdier afin que la conformit microbiologique soit obtenue.
Les prlvements doivent galement tre conformes aux exigences nationales sous tous les autres
aspects de la qualit de l'eau.
6.4 Mise en service
Le rservoir ne doit pas tre mis en service tant que les conditions prsentes dans les paragraphes
suivants ne sont pas remplies :
6.4.1 Qualit de l'eau
Juste avant la mise en service du rservoir, il doit tre confirm que la qualit de l'eau dans le
rservoir comme dans les tuyauteries et composants associs respecte les prescriptions de 5.3.3.
20 / 23
4.1.2. FAT1
6.4.2 Bon fonctionnement des appareils
Le fonctionnement correct de tous les appareils et de tout l'quipement du rservoir doit tre vrifi et
les instructions pour l'exploitation doivent tre notes dans un manuel de l'exploitation.
7 Exploitation
Afin dassurer une distribution rgulire et pour viter des effets indsirables pour lenvironnement et
la sant publique, les rservoirs doivent tre systmatiquement :
surveills : La surveillance de rseau doit porter sur lanalyse de prlvements deau selon
toutes les prescriptions dhygine et de sant en vigueur.
inspects : Linspection doit comprendre au moins le contrle priodique pour confirmer le bon
fonctionnement du rservoir, aussi bien que des mises hors service priodiques et
programmes pour contrler ltat intrieur des cuves, des composants et des quipements.
On se basera sur une inspection priodique de deux fois par an (dbut et fin de saison cyclonique).
Par ailleurs, un manuel dexploitation doit tre fourni avec chaque rservoir de rseau qui doit
comporter toutes les instructions et procdures suivre.
Exemple de prescriptions obligatoires dans un manuel dexploitation :
plans gnraux du site et des structures et charges maximales applicables celles-ci ;
mesures particulires prendre en cas durgence et/ou dincendies importants dans la zone de
distribution ;
procdures pour la mise hors service du rservoir
instructions pour le nettoyage et la dsinfection avant la mise en service
instructions pour la maintenance de tous les autres composants du rservoir, y compris les
quipements lectriques et hydraulique et les dispositifs de tltransmission
rapports des contrles, oprations dentretien et incidents inhabituels
8 Conclusion
Le dimensionnement dun rservoir reste une affaire de bureaux dtudes spcialiss. Nous avons
mis dans ce Fascicule des obligations techniques que ces professionnels doivent respecter. En
revanche il ne sagit en aucun cas dun document livrant une procdure applicable par tout le monde y
compris des non-spcialistes pour raliser des calculs de dimensionnement dun rservoir. Ce calcul
doit tre fait par un bureau dtude spcialis qui doit se baser notamment sur ce fascicule pour
respecter les prescriptions de la DINEPA. Ce fascicule doit tre aussi utilis par le matre douvrage et
le maitre duvres pour vrifier que les prescriptions de la DINEPA sont bien respectes lors de la
conception des rservoirs deau potable.
9 Sources
Le prsent fascicule technique a t labor en partie partir des documents suivants :
Etude sur lapprovisionnement en eau potable en Hati, 2005.
La norme Europenne EN 1508 : Prescriptions pour les systmes et les composants pour le
stockage deau.
IHSI, 2002
21 / 23
4.1.2. FAT1
10 Lexique
Btiment de contrle : Local ferm du rservoir utilis pour abriter les principales vannes, pompes,
quipements de contrle et de surveillance et qui peut constituer le moyen daccs aux cuves.
Cuve : Partie ferme dun rservoir munie de dispositifs dentre, sortie, trop-plein et vidange spars
et qui peut tre exploite de faon indpendante dautres cuves du mme rservoir.
Etanchit : Qualit caractristique dun ouvrage contenant de leau ou un liquide sopposer au
passage de ce fluide, dans les limites de dbits de fuite qui ont t dfinies pour son exploitation.
Fluage : le phnomne physique provoquant la dformation irrversible dun matriau soumis une
contrainte constante
Revtement dimpermabilisation :
Ecran intrieur adhrent son support pouvant assurer ltanchit, mais ne rsistant pas une
fissuration (donne, quantifie) apprciable du support.
Ce revtement est constitu denduits au mortier de ciment hydrofugs ou denduits pelliculaires
base de rsines
Revtement dtanchit
Revtement plastique, lastoplastique ou lastique appliqu lintrieur de la structure. Ce
revtement nest pas ncessairement adhrent la structure et cest la pression de leau qui
lapplique sur celle-ci. Le revtement doit pouvoir sadapter aux lgres dformations ou fissurations
des ouvrages.
Rservoir de rseau :
Rservoir deau potable couvert, ventuellement compartiment assurant la stabilit de la fourniture et
de la pression, amortissant les fluctuations des besoins et comprenant un btiment de contrle, des
quipements dexploitation et des dispositifs daccs.
22 / 23
4.1.2. FAT1
ANNEXE : PLAN GUIDE DUN RESERVOIR
23 / 23
Vous aimerez peut-être aussi
- L' Ingénieur et le développement durableD'EverandL' Ingénieur et le développement durableÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Mecanique SolDocument118 pagesMecanique SolRamy Meh100% (1)
- 52 Manuel Moteur FocsDocument106 pages52 Manuel Moteur Focsna100% (1)
- 4.2.3 FAT1 Conception Des Reseaux D Adduction Et Reseaux de DistributionDocument37 pages4.2.3 FAT1 Conception Des Reseaux D Adduction Et Reseaux de DistributionAhmed Boussoffara100% (3)
- Projet Irrigation WiemDocument36 pagesProjet Irrigation WiemWiem Zouaoui100% (1)
- COURS Ouvrages - RDocument39 pagesCOURS Ouvrages - RabdoumedyadahPas encore d'évaluation
- Planinng VRD ExcelDocument1 pagePlaninng VRD ExcelAhmed BelmajdoubPas encore d'évaluation
- NC - Chambre de Vannes RS117Document28 pagesNC - Chambre de Vannes RS117hamouda100% (1)
- Guide D'aide À L'achat Relatif Aux Émulseurs PDFDocument53 pagesGuide D'aide À L'achat Relatif Aux Émulseurs PDFHamzaOssPas encore d'évaluation
- Modélisme Ferroviaire À L'échelle HO. Atelier de Confection de Décor Végétal. Par Ph. Vépierre. 2013Document13 pagesModélisme Ferroviaire À L'échelle HO. Atelier de Confection de Décor Végétal. Par Ph. Vépierre. 2013Philippe VepierrePas encore d'évaluation
- Cahier Prescriptions Tech Reseaux AEP SAGeDocument36 pagesCahier Prescriptions Tech Reseaux AEP SAGeFabienne TohouriPas encore d'évaluation
- Etude de Bache D'eau (Detaillé)Document23 pagesEtude de Bache D'eau (Detaillé)nabil mebarkiPas encore d'évaluation
- 5001 D Tuyaux Et Raccords en Fonte Ductile NBN en 545 Et Leurs AssemblagesDocument7 pages5001 D Tuyaux Et Raccords en Fonte Ductile NBN en 545 Et Leurs AssemblagesJàMàl MejorPas encore d'évaluation
- Massif de ButeeDocument4 pagesMassif de Buteen_zeinounPas encore d'évaluation
- CPS Assainissement Tranche 1 Guigou 22-08-2023Document89 pagesCPS Assainissement Tranche 1 Guigou 22-08-2023HADRIPas encore d'évaluation
- Note de Calcul Des Évents D'un Bac de StockageDocument6 pagesNote de Calcul Des Évents D'un Bac de Stockagetanda notsawo100% (1)
- Bache A Eaux 400m3 Rv01Document16 pagesBache A Eaux 400m3 Rv01Ahmed MokhtariPas encore d'évaluation
- B4-Station de Pompage - PL TypeDocument1 pageB4-Station de Pompage - PL TypeKhalid Abou iyad100% (1)
- Principes Generaux Du Dimensionnement Des Ouvrages Eurocodes en 1990 Et en 1991Document45 pagesPrincipes Generaux Du Dimensionnement Des Ouvrages Eurocodes en 1990 Et en 1991gusyl44Pas encore d'évaluation
- Eurocode FD ENV 1993-4-3Document32 pagesEurocode FD ENV 1993-4-3HAMDAOUI Mohamed Amine100% (1)
- Tamba GoudiryDocument21 pagesTamba GoudiryAliAnisPas encore d'évaluation
- L3 GC Cours 3 V.R.DDocument2 pagesL3 GC Cours 3 V.R.DGladys Mackenzie100% (1)
- 1 - Introduction Generale-1Document96 pages1 - Introduction Generale-1Soumana AbdouPas encore d'évaluation
- Chapitre 4.dimensionnement Du Réseau ProjetéDocument11 pagesChapitre 4.dimensionnement Du Réseau Projetéjust ANDROIDPas encore d'évaluation
- NASSER Djibo Souley Abdoul PDFDocument94 pagesNASSER Djibo Souley Abdoul PDFOmar100% (1)
- Note de Calcul Plomberie Immeuble R+6Document28 pagesNote de Calcul Plomberie Immeuble R+6camraPas encore d'évaluation
- Etude Comparative Entre Le Bael 91 ModifDocument125 pagesEtude Comparative Entre Le Bael 91 ModifKouadio Jean Luc YobouéPas encore d'évaluation
- Fasc 8 Feuille ExcelDocument2 pagesFasc 8 Feuille ExcelMalik AtikPas encore d'évaluation
- VRD Les Reseaux Assainissement Formules Methodes 1 PDFDocument14 pagesVRD Les Reseaux Assainissement Formules Methodes 1 PDFSara KheiriPas encore d'évaluation
- Analyse Et Conception Des Chaussees PDFDocument89 pagesAnalyse Et Conception Des Chaussees PDFMira RedaPas encore d'évaluation
- ANBT AONI Etude Faisabilite Barrage Trois Rivieres W.mascaraDocument74 pagesANBT AONI Etude Faisabilite Barrage Trois Rivieres W.mascaraHocinePas encore d'évaluation
- Intro GIREDocument20 pagesIntro GIREEunockPas encore d'évaluation
- CCTG Assainissement Liquide ONEE Branche Eau Tome2Document32 pagesCCTG Assainissement Liquide ONEE Branche Eau Tome2ingPas encore d'évaluation
- Dynamique Presentation Intro Plus 2ed PDFDocument38 pagesDynamique Presentation Intro Plus 2ed PDFZa KiPas encore d'évaluation
- PEND FR 00 Pendules Direct Et InverseDocument5 pagesPEND FR 00 Pendules Direct Et InverseKaddarPas encore d'évaluation
- CCTP Barrage SaidaDocument301 pagesCCTP Barrage SaidaKhlif NadaPas encore d'évaluation
- CCTG AEP - Tome 2 - Comptage ONEE - Branche Eau (Version 1 - Octobre 2012)Document32 pagesCCTG AEP - Tome 2 - Comptage ONEE - Branche Eau (Version 1 - Octobre 2012)hel137Pas encore d'évaluation
- Pathologie Des Barrages en Service Et Orientations Pour La RechercheDocument21 pagesPathologie Des Barrages en Service Et Orientations Pour La RechercheLouis Serge GuellaPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - Les Chateaux D'eau - 2020Document7 pagesChapitre 3 - Les Chateaux D'eau - 2020Háífà MathlouthiPas encore d'évaluation
- Calcul Des Débits Et DimensionnementDocument3 pagesCalcul Des Débits Et DimensionnementZiaad AmekloulPas encore d'évaluation
- CPS-T-1 Réalisation Du Réservoir - Lot GCDocument92 pagesCPS-T-1 Réalisation Du Réservoir - Lot GCamine derdPas encore d'évaluation
- CPS-T Conduites Eau PotableDocument100 pagesCPS-T Conduites Eau Potableamine derdPas encore d'évaluation
- Cps CepDocument123 pagesCps CepLagdaa Mohammed100% (1)
- NDC AssainissementDocument3 pagesNDC AssainissementlimmoudPas encore d'évaluation
- Tuyaux Perfores Pour DrainsDocument5 pagesTuyaux Perfores Pour DrainsbourichPas encore d'évaluation
- Code de Bonne Pratique Pour La Pose Des Égouts Et CollecteursDocument108 pagesCode de Bonne Pratique Pour La Pose Des Égouts Et CollecteursMadelbrot AzarPas encore d'évaluation
- Note de Calcul Des AtalusDocument16 pagesNote de Calcul Des AtalusSelma OfficePas encore d'évaluation
- Formulaire Des Poutres PDFDocument8 pagesFormulaire Des Poutres PDFMakrem AouaniPas encore d'évaluation
- Rapport Statistique2017 SONEDE PDFDocument230 pagesRapport Statistique2017 SONEDE PDFissam hamdiPas encore d'évaluation
- DT7016Document76 pagesDT7016hythryPas encore d'évaluation
- ENSP - GCU4projet COFFRAGE 2020Document1 pageENSP - GCU4projet COFFRAGE 2020Junior BagaPas encore d'évaluation
- Etude Au Vent Selon NV65Document38 pagesEtude Au Vent Selon NV65anas oumousPas encore d'évaluation
- HEC-HMS Users Manual 3.4Document25 pagesHEC-HMS Users Manual 3.4SaidDiasPas encore d'évaluation
- MODELISATIONDocument5 pagesMODELISATIONBilal IzemPas encore d'évaluation
- Comparaison Entre La Méthode Dynamique Et StatiqueDocument4 pagesComparaison Entre La Méthode Dynamique Et StatiqueFatima Zahra LamsiahPas encore d'évaluation
- Chapitre 3.nature Des Canalisations (Sous Pression Et ADocument28 pagesChapitre 3.nature Des Canalisations (Sous Pression Et AJe suis Je suisPas encore d'évaluation
- CPS ZebzateHIERDocument31 pagesCPS ZebzateHIERnajibPas encore d'évaluation
- Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018.doc Poteau PoutreDocument3 pagesAutodesk Robot Structural Analysis Professional 2018.doc Poteau PoutrejutolePas encore d'évaluation
- Bouche D'egout A GrilleDocument4 pagesBouche D'egout A GrilleSaid MrfPas encore d'évaluation
- Les Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?D'EverandLes Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?Pas encore d'évaluation
- Des risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscamingueD'EverandDes risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscaminguePas encore d'évaluation
- 4423 Sujet E4 Derailleur 2014 (Documentation)Document45 pages4423 Sujet E4 Derailleur 2014 (Documentation)bouchaibelmarhraoui70Pas encore d'évaluation
- Chap. 11 Circuit RLC en Régime Sinusoïdal ForcéDocument11 pagesChap. 11 Circuit RLC en Régime Sinusoïdal ForcéDieu Est Fidèle100% (1)
- ThyristorDocument3 pagesThyristorIlias MajidiPas encore d'évaluation
- Conception Hardware Systeme Monitoring Transformateur Distribution PDFDocument47 pagesConception Hardware Systeme Monitoring Transformateur Distribution PDFsancho100% (1)
- ABB - Traversées de Transformateur Type GOHDocument22 pagesABB - Traversées de Transformateur Type GOHVlad Rene RoscaPas encore d'évaluation
- Pompe A BoueDocument88 pagesPompe A Bouebouzid benouadfelPas encore d'évaluation
- TD Physique TC 2023 2024 - CopieDocument8 pagesTD Physique TC 2023 2024 - CopieDavid VHOUMBYPas encore d'évaluation
- Mach Pain Cor 10siosp01c PDFDocument9 pagesMach Pain Cor 10siosp01c PDFTriki BilelPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage NaDocument19 pagesRapport de Stage NaNoor Ammar100% (1)
- Cours CVC Final PPT ProtDocument163 pagesCours CVC Final PPT ProtOumayma MelkiPas encore d'évaluation
- Culasse Fissurée Symptome PDFDocument16 pagesCulasse Fissurée Symptome PDFMayeul GeraldoPas encore d'évaluation
- Programme Du Colloque de Saint NazaireDocument2 pagesProgramme Du Colloque de Saint NazairepomahadePas encore d'évaluation
- Éléments Techniques Sur L'exposition Professionnelle Aux Carburants Et Solvants PétroliersDocument24 pagesÉléments Techniques Sur L'exposition Professionnelle Aux Carburants Et Solvants PétroliersSômè ÔnëPas encore d'évaluation
- Rostom Ghardaia 2020Document108 pagesRostom Ghardaia 2020KOMCIPas encore d'évaluation
- CCTP AmoDocument7 pagesCCTP AmoKhalid KhalidiPas encore d'évaluation
- Manual Pequeño Del Modem Con ChipDocument4 pagesManual Pequeño Del Modem Con ChipSilverio Espinoza RoquePas encore d'évaluation
- Module 14.005 Principes de PropulsionDocument102 pagesModule 14.005 Principes de PropulsionyacinelordePas encore d'évaluation
- 2KGWIN CIV6 Gathering Storm PC Online Manual V4 FREDocument32 pages2KGWIN CIV6 Gathering Storm PC Online Manual V4 FREjulien.henry5521Pas encore d'évaluation
- BAC 2011 SI Normale STM CorrigéDocument8 pagesBAC 2011 SI Normale STM CorrigéIbra Moulay0% (1)
- CoursDocument181 pagesCoursTunisie JournalPas encore d'évaluation
- Elock Mayouck LucDocument70 pagesElock Mayouck LucAbouZakariaPas encore d'évaluation
- Programme de Formation 2021 Du CETIME Version Juin 2021 - TXT-édition TBsTN.28.05.2021-PDF-X (6356ko)Document16 pagesProgramme de Formation 2021 Du CETIME Version Juin 2021 - TXT-édition TBsTN.28.05.2021-PDF-X (6356ko)Taoufik TBsPas encore d'évaluation
- Bruleur PDFDocument64 pagesBruleur PDFzinebPas encore d'évaluation
- Usine D Outillage Bost Garnache IndustriesDocument68 pagesUsine D Outillage Bost Garnache IndustriesChristophe BrissonnetPas encore d'évaluation
- Brûleurs Fioul WL5-PB-H Purflam BE2019-03Document76 pagesBrûleurs Fioul WL5-PB-H Purflam BE2019-03Christophe MassinPas encore d'évaluation
- Transformateurs de Service Auxiliaire TsaDocument2 pagesTransformateurs de Service Auxiliaire Tsafd_haslerPas encore d'évaluation
- Manuel Kididog BleuDocument12 pagesManuel Kididog BleubovobovoPas encore d'évaluation