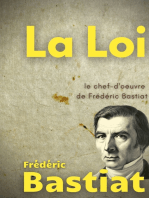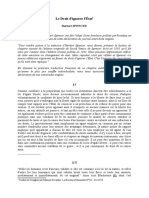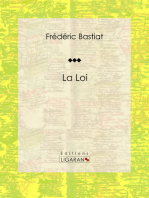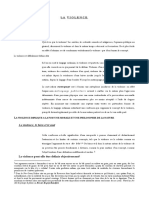Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Nietzsche - Genealogie de La Morale II 11
Nietzsche - Genealogie de La Morale II 11
Transféré par
IlhanTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Nietzsche - Genealogie de La Morale II 11
Nietzsche - Genealogie de La Morale II 11
Transféré par
IlhanDroits d'auteur :
Formats disponibles
« Quant à l’affirmation particulière de Dühring, qu’il faut chercher l’origine de la
justice dans le sentiment réactif, on doit, par amour de la vérité, lui opposer la thèse
inverse : le sentiment réactif est la toute dernière conquête de l’esprit de justice ! […] Du
point de vue historique le droit apparaît précisément dans le monde comme la lutte contre
5 les sentiments réactifs, la guerre menée contre eux par les puissances actives et agressives
qui utilisent une part de leur force à contenir le débordement du pathos réactif et à le
contraindre à composer. Partout où l’on rend la justice, où règne la justice, on voit une
puissance, supérieure relativement à d’autres qui lui sont subordonnées (groupes ou
individus), et qui s’efforce d’arrêter parmi elles les déchaînements absurdes du ressentiment.
10 Elle le fait soit en arrachant l’objet du ressentiment des mains de la vengeance, soit en se
chargeant elle-même de mener la lutte contre les ennemis de la paix et de l’ordre, soit en
inventant des compromis qu’elle propose et le cas échéant impose, soit encore en donnant
force de loi, pour chaque préjudice, à un équivalent auquel est désormais et une fois pour
toutes renvoyé le ressentiment. Mais c’est en instituant la loi, notification impérative de ce
15 qui, à ses yeux, est permis et juste ou interdit et injuste, que la puissance suprême intervient
décisivement contre la prédominance des sentiments réactifs – et elle l’a toujours fait dès
qu’elle était assez forte pour le faire. Après l’établissement de la loi, elle considère toute
infraction et tout acte arbitraire, individuel ou collectif, comme crime contre la loi, comme
rébellion contre elle-même, et détourne ainsi l’attention de ses sujets du dommage immédiat
20 causé par ces crimes pour obtenir à la longue l’inverse de ce que veut toute vengeance, qui
se place au seul point de vue de l’homme lésé et ne voit que son intérêt : désormais l’œil
s’exerce à apprécier le méfait de façon plus impersonnelle et même l’œil de l’homme lésé
(encore que ce soit en tout dernier lieu […]). En conséquence il n’y a de « justice » et
d’« injustice » qu’à partir de l’institution de la loi (et non, comme le veut Dühring, à partir
25 de l’accomplissement de l’acte de violation). Parler de justice et d’injustice en soi n’a pas de
sens, en soi l’infraction, la violation, l’exploitation, la destruction ne peuvent évidemment
pas être « injustes », puisque la vie procède essentiellement, c’est-à-dire dans ses fonctions
élémentaires, par infraction, violation, exploitation, destruction, et qu’elle ne peut être
pensée sans cela. »
30
Nietzsche, La Généalogie de la morale (1887), II, 11
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours Philo Justice Et DroitDocument15 pagesCours Philo Justice Et DroitMamadou Moustapha Sarr50% (2)
- Cour Droit Penal GeneralDocument49 pagesCour Droit Penal GeneralHãrkùt Mùhâkût Mūkìt100% (1)
- Du Contrat SocialDocument9 pagesDu Contrat SocialFALL DIOR GARMIPas encore d'évaluation
- La VengeanceDocument11 pagesLa VengeanceWendy NiuPas encore d'évaluation
- Justice Les InstitutionsDocument17 pagesJustice Les Institutionsthymy magouilleslandPas encore d'évaluation
- La Violence Peut-Elle Etre Juste?Document4 pagesLa Violence Peut-Elle Etre Juste?Anthony Amprimo100% (2)
- La Loi - Suivi de Notice sur la vie et les écrits de F. BastiatD'EverandLa Loi - Suivi de Notice sur la vie et les écrits de F. BastiatPas encore d'évaluation
- Résumé Du Contrat Social de Rousseau Et MENON SOCRATE PLATON-2Document8 pagesRésumé Du Contrat Social de Rousseau Et MENON SOCRATE PLATON-2Magatte DiopPas encore d'évaluation
- Cours La Justice PhilosophieDocument7 pagesCours La Justice PhilosophieCloé JeanPas encore d'évaluation
- Fiche Rousseau Contrat SocialDocument10 pagesFiche Rousseau Contrat SocialbhardhamuPas encore d'évaluation
- Fondements Du Droit Et de La RépubliqueDocument4 pagesFondements Du Droit Et de La RépubliqueGuy BonvalletPas encore d'évaluation
- Fiche (Livre) - Principes de La Philosophie Du Droit de HegelDocument3 pagesFiche (Livre) - Principes de La Philosophie Du Droit de HegelAudrey L.Pas encore d'évaluation
- 128pouvoirs p43-47 Responsabilite PenaleDocument6 pages128pouvoirs p43-47 Responsabilite PenaleNDF93 OfficialPas encore d'évaluation
- La Loi: Suivi d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur (format pour une lecture confortable)D'EverandLa Loi: Suivi d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur (format pour une lecture confortable)Pas encore d'évaluation
- La Justice 6Document14 pagesLa Justice 6Neila BerkanePas encore d'évaluation
- Devoir PhiloDocument2 pagesDevoir PhilorayanPas encore d'évaluation
- Cours Sur La Justice 1Document6 pagesCours Sur La Justice 1bqfkth7pbqPas encore d'évaluation
- La Justice Et Le DroitDocument4 pagesLa Justice Et Le DroitlefebvrePas encore d'évaluation
- La JusticeDocument2 pagesLa JusticeAbdoul RazzakPas encore d'évaluation
- Fiche Notion Justice STMGDocument4 pagesFiche Notion Justice STMGtgkkkw9x2mPas encore d'évaluation
- Llhum521 Lavergne Corpus de TextesDocument8 pagesLlhum521 Lavergne Corpus de Textesvictorsidyane27Pas encore d'évaluation
- Ignorer LetatDocument7 pagesIgnorer LetatLu LarPas encore d'évaluation
- Pourquoi PunirDocument9 pagesPourquoi PuniroumoutallawaPas encore d'évaluation
- Quelle Justice Sur Les Réseaux Sociaux Cairn - InfoDocument11 pagesQuelle Justice Sur Les Réseaux Sociaux Cairn - InfoElvye Naoline NSE NSIHPas encore d'évaluation
- La Justice Et Le DroitDocument25 pagesLa Justice Et Le DroitAude DiXñïnePas encore d'évaluation
- PeutDocument2 pagesPeutGaSpArDPas encore d'évaluation
- Dissertation PhiloDocument3 pagesDissertation Philoprincesseleia33Pas encore d'évaluation
- Un Etat Violent Peut Il Etre JusteDocument4 pagesUn Etat Violent Peut Il Etre JustedylanPas encore d'évaluation
- Chapitre 7Document8 pagesChapitre 7ebenammar53Pas encore d'évaluation
- TermS 04 Fiche Droit Morale Et La Liberte Cours 2012Document12 pagesTermS 04 Fiche Droit Morale Et La Liberte Cours 2012Issoufou TallPas encore d'évaluation
- Justice Pour NousDocument15 pagesJustice Pour NousKyôka SeilahPas encore d'évaluation
- 1651 - Leviathan - Thomas HobbesDocument3 pages1651 - Leviathan - Thomas Hobbesjuliette1.masselotPas encore d'évaluation
- La Justice Cours de PhiloDocument10 pagesLa Justice Cours de PhiloBadr FenjiroPas encore d'évaluation
- La JusticeDocument3 pagesLa JusticeLouise SolelhacPas encore d'évaluation
- TD HPE Dossier 5Document31 pagesTD HPE Dossier 5Violette ViguierPas encore d'évaluation
- Hobbes + WeberDocument4 pagesHobbes + WeberElia WizmanPas encore d'évaluation
- Justice Publique Et Justice Privée: Daniel CDocument13 pagesJustice Publique Et Justice Privée: Daniel CLoic Guillaume Kingue DibonguePas encore d'évaluation
- Seance 4 HobbesDocument1 pageSeance 4 Hobbesnoemiecab1999Pas encore d'évaluation
- Devoir Explication de Texte PhiloDocument6 pagesDevoir Explication de Texte Philotom renPas encore d'évaluation
- Thoreau PDFDocument7 pagesThoreau PDFdiomandéPas encore d'évaluation
- Suis Je Libre Quand Je Fais Mon DevoirDocument5 pagesSuis Je Libre Quand Je Fais Mon DevoirMehdi LamriniPas encore d'évaluation
- Doit-On Toujours Obéir À La Loi Colloque Répartition Par Groupe TSTMG2 4Document4 pagesDoit-On Toujours Obéir À La Loi Colloque Répartition Par Groupe TSTMG2 4mmans2068Pas encore d'évaluation
- Exposé Sur La Démocratie Chez RousseauDocument9 pagesExposé Sur La Démocratie Chez RousseauEl hadji Bachir KanePas encore d'évaluation
- Expose Le Sentiment D'injustice Autorise T-Il Le Recourt A La ViolenceDocument8 pagesExpose Le Sentiment D'injustice Autorise T-Il Le Recourt A La Violencezambleadolphe56Pas encore d'évaluation
- 12 Hommes en Colere Par Guillaume LursonDocument4 pages12 Hommes en Colere Par Guillaume LursonkoaloPas encore d'évaluation
- Violence - Bien Et Mal (2) - CopieDocument17 pagesViolence - Bien Et Mal (2) - CopieAyoub OukadPas encore d'évaluation
- CoursPhIlo A1-A2Document29 pagesCoursPhIlo A1-A2Lylian MabickaPas encore d'évaluation
- Institutions JuridictionnellesDocument44 pagesInstitutions Juridictionnellesladelinquance ndongPas encore d'évaluation
- La Peine de MortDocument12 pagesLa Peine de MortChristopher ShepherdPas encore d'évaluation
- Document Sans Titre 6Document4 pagesDocument Sans Titre 6zelloowpvpPas encore d'évaluation
- Fiche JusticeDocument3 pagesFiche Justicearnaud.bedouinPas encore d'évaluation
- Resume de Blanchot, Maurice, Lautréamont Et Sade (1949)Document2 pagesResume de Blanchot, Maurice, Lautréamont Et Sade (1949)francondesotoPas encore d'évaluation
- Texte de Kant Sur Le Droit de PunirDocument1 pageTexte de Kant Sur Le Droit de Punirafeissa.hichamorange.frPas encore d'évaluation
- Sequence Olympe de GougesDocument13 pagesSequence Olympe de GougesMax FournierPas encore d'évaluation
- Theorie de La JusticeDocument7 pagesTheorie de La JusticeBijitDasroxxPas encore d'évaluation
- Legitimite A MentirDocument4 pagesLegitimite A Mentirkoffikonaneric299Pas encore d'évaluation
- Dissertation Avec Textes - Le Bonheur Est-Il Une Affaire PrivéeDocument2 pagesDissertation Avec Textes - Le Bonheur Est-Il Une Affaire Privéemanel rhPas encore d'évaluation
- Descartes Et Spinoza - La GénérositéDocument4 pagesDescartes Et Spinoza - La GénérositéAndriy HnativPas encore d'évaluation
- Leçon 2 Complément 1 Définitions de La LeçonDocument5 pagesLeçon 2 Complément 1 Définitions de La LeçonMathieu LACPas encore d'évaluation
- Civ10-Responsabilite en General 2009-2Document70 pagesCiv10-Responsabilite en General 2009-2kemmach toufikPas encore d'évaluation
- 03 Société D'acquets Précautions RédactionnellesDocument21 pages03 Société D'acquets Précautions RédactionnellesIcare100% (2)
- Kant e Derrida CosmoplitismoDocument14 pagesKant e Derrida CosmoplitismoMaíra MatthesPas encore d'évaluation
- Questionnaire - Contentieux AdministratifDocument14 pagesQuestionnaire - Contentieux AdministratifwyzychuigunsPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Acte Et Faits ProfDocument7 pagesChapitre 4 Acte Et Faits Profouadich hichamPas encore d'évaluation
- Syllabus Procédure Pénale. 2017-2018. PDFDocument447 pagesSyllabus Procédure Pénale. 2017-2018. PDFdeodatPas encore d'évaluation
- Jurislogement - Occupants Sans Droits Ni TitreDocument11 pagesJurislogement - Occupants Sans Droits Ni Titremicrosoftloterie63Pas encore d'évaluation
- Le Vampire de Dusseldorf (1932)Document38 pagesLe Vampire de Dusseldorf (1932)bouzounaPas encore d'évaluation
- 96 - Discours Louis Favoreu Droit de La ConstitutionDocument10 pages96 - Discours Louis Favoreu Droit de La Constitutiondiallo brehima noumoussaPas encore d'évaluation