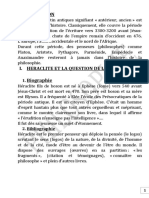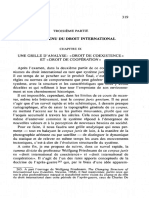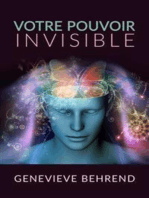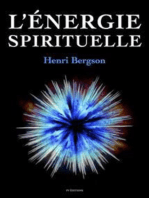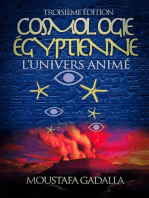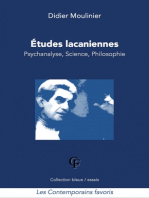Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Philosophie de Kant
Transféré par
Maxime Porco0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
321 vues122 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
321 vues122 pagesLa Philosophie de Kant
Transféré par
Maxime PorcoDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 122
La Philosophie de Kant
Biographie et œuvres précritiques
I. Introduction
Parmi les auteurs allemands que l'on vient de citer, plusieurs sont contemporains de Kant.
Quelques-uns l'ont connu ou ont correspondu avec lui. Kant les a lus. Tantôt il a rejeté leurs
conclusions, tantôt il a intégré certaines d'entre elles dans ses propres écrits.
Il a voulu, en effet, dresser un bilan complet de la connaissance humaine de son temps. Ce
bilan est d'abord destiné à l'enseignement. Kant a été un professeur merveilleux qui a suscité
maintes vocations. Mais il veut surtout fournir des directions à tous ceux qui exercent leur
esprit, artistes, techniciens, théologiens, politiques et leur éviter les illusions, les erreurs qui
pourraient les paralyser ou rendre leur action malfaisante. En ce sens le kantisme est une
encyclopédie, non seulement parce que le philosophe enseignant est tenu par des
programmes ambitieux, mais parce qu'il veut, pour lui-même, régler l'usage des facultés de
l'esprit. Il faut réellement apprécier, juger, mettre à sa place chacune de nos facultés. Tâche
irréalisable, si le philosophe ne connaît pas à la fois le mécanisme de l'esprit et l'ensemble
des principales sciences. La tâche que s'est proposée Kant ne diffère pas, dans son essence,
de celle qu'avaient assumée les grands penseurs de l'Antiquité, du Moyen Âge et après eux
Bacon, Descartes, Leibniz, Newton, Wolff. Cette tâche concerne toutes les formes d'activité
de la pensée humaine.
Fils d'un temps marqué par de grands bouleversements politiques, religieux et sociaux, Kant
met au centre de ses préoccupations le problème de l'action. Il veut assurer, dans les
meilleures conditions, la prise de l'intelligence sur les hommes et sur les choses. Au cours
d'une enquête qui dure pendant plus de cinquante ans, son but, sa méthode n'ont guère
changé. Toutefois, l'ensemble de ses idées s'est modifié peu à peu, à mesure qu'il découvrait
de nouveaux aspects du réel appréhendés par l'esprit. Mais le germe de ses dernières
spéculations est déjà indiqué dans ses travaux de jeunesse et Kant est resté fidèle à lui-
même, au cours d'une évolution ininterrompue. Hautement conscient de son originalité, il a
toujours exprimé franchement sa pensée, sans dissimuler ce qu'il devait à ses contemporains
et à ses devanciers, même quand il s'est séparé d'eux. Une recherche extrême de la rigueur
logique a souvent compliqué sa doctrine à l'excès et affaibli dans une certaine mesure la
portée de ses conclusions. Mais il n'est pas un penseur actuel qui ne lui doive, même s'il
interprète imparfaitement la doctrine de ce maître difficile.
II. Biographie de Kant (1724-1804)
1. La jeunesse (1724-1755)
Emmanuel Kant est né le 22 avril 1724 à Königsberg en Prusse orientale, sur les tristes
bords de la Pregel, tout près du Frisches-Haff. La ville (aujourd'hui Kaliningrad) était petite
et ses rues mal pavées, bordées de vieilles maisons pittoresques, descendaient en étoile
irrégulière autour de l'ancienne église. Kant y a passé presque toute sa vie ; il y est mort en
1804, à un peu moins de quatre-vingt ans.
Le père du philosophe, Johann Georg Kant – Kand ou Cand – (1683-1746), tenait à
Königsberg une petite boutique de sellier-bourrelier, fréquentée surtout par les officiers de la
garnison prussienne ou russe. Il était, disait-on, d'origine écossaise, et Kant lui-même s'est
fait dans sa vieillesse l'écho de cette tradition. En tout cas, la famille était depuis longtemps
établie en Prusse. Elle était luthérienne évangélique et non pas anglicane ou calviniste,
comme la plupart de celles qui avaient émigré récemment des Îles britanniques. Le grand-
père de Kant était déjà sellier à Königsberg et citoyen prussien, et l'on a retrouvé à Memel
(aujourd'hui Klaipeda) les actes de baptême de ses enfants. Georg Kant avait épousé une
Allemande authentique, Anna Regina Reuter, née en 1697. Elle semble avoir été plus fine et
plus cultivée que son mari, et elle a exercé une grande influence sur ses enfants. Six d'entre
eux – des filles – sont morts en bas âge. Deux autres filles ont survécu, et la plus jeune est
morte après le philosophe. Kant a eu un frère cadet, Johann Heinrich (1736-1800), qui est
devenu pasteur à Alt-Rehden en Courlande. Regina Kant est mort en 1737, peu après la
naissance de ce deuxième fils.
Les Kant appartenaient à la plus sévère des sectes luthériennes, la secte piétiste. La mère du
philosophe avait été l'auditrice fervente du pasteur piétiste Albert Schultz (1692-1763), qui
venait de Halle, centre de diffusion du piétisme. Détachés de tout culte extérieur, avec un
rituel réduit au minimum, les piétistes, entre toutes les embûches de Satan, redoutaient la
sensiblerie (Schärmerei) et la superstition (Aberglaube). Le niveau intellectuel de la famille
paraît avoir dépassé celui des artisans.
Albert Schultz, membre du Consistoire, puis professeur de théologie à l'Université, était en
même temps directeur du Collegium Fridericianum, établissement d'enseignement
secondaire créé par Frédéric II pour la formation des futurs serviteurs de la Couronne.
Spécialiste des oraisons funèbres pour les notables de Königsberg, Schultz, lié avec les
parents de Kant et très influent, fit admettre au Collège Royal, à l'automne 1732, le jeune
Emmanuel, âgé de moins de huit ans. Kant y est resté huit années avant d'être immatriculé,
en septembre 1740, à l'Université de Königsberg. Il a été un écolier parfait, vif, docile,
studieux, méthodique. Il a appris à fond le latin sous un maître excellent, Heydenreich. Puis
il a étudié à l'Université les mathématiques, la physique et la théologie. Ses parents et ses
maîtres ne voulaient pas en faire un pasteur, mais lui permettre de quitter l'artisanat et de
choisir une carrière libérale, comme l'enseignement ou la bureaucratie.
L'Université, vieille de moins de deux siècles, était misérablement installée derrière la
cathédrale, au bord de la Pregel. Elle ressemblait à une « école de village ». Elle comptait
sept chaires, dont les titulaires étaient tous chargés de plusieurs enseignements. Le
professeur de mathématiques, de physique et de philosophie, Martin Knutzen (1713-1751),
paraît avoir eu quelque influence sur Kant. Kant lui doit non seulement son initiation à la
pensée de Wolff, mais encore sa connaissance des mathématiques et de la science
newtonienne. Il est d'ailleurs d'accord avec Schultz pour concilier le rationalisme wolffien
avec le piétisme, malgré les difficultés que Wolff avait eu à souffrir des piétistes à Halle vers
1723. Knutzen s'est intéressé à son élève, lui a ouvert sa bibliothèque personnelle, assez
riche. Nous ne savons presque rien de la vie d'étudiant de Kant sinon qu'il s'est lié avec un
de ses condisciples, Marcus Herz, qui devait rester son ami le plus intime. Il a été un
travailleur zélé, d'esprit universellement curieux, grand lecteur de livres de toutes sortes,
tenant journal de ses études et de ses réflexions. Kant a quitté l'Université à la fin de 1746,
quelques mois après la mort de son père. Il avait présenté à la fin du semestre d'été un
travail de doctorat sur la Véritable loi de la conservation des forces vives.
Sans être dans le dénuement, les Kant vivaient pauvrement. Kant, comme beaucoup de ses
collègues, a dû pour gagner sa vie se faire précepteur en attendant un poste de Dozent à
l'Université. Nous connaissons trois de ces préceptorats, les deux premiers, dans de petits
domaines de la campagne prussienne, à Jüdschen près de Gumbinnen, chez un pasteur, puis
chez un grand propriétaire du voisinage de Mohrungen, von Hülsen. Là, Kant s'est initié aux
bonnes manières et Mme von Hülsen, qui dessinait bien, a fait le portrait du jeune
précepteur de ses enfants. En dernier lieu, Kant a trouvé une place chez le comte
Kayserling, qui partageait son temps entre sa terre de Rautenburg et sa maison de
Königsberg. Kant a pu rencontrer chez les Kayserling l'élite de la « société » de Prusse
orientale. Il a préparé chez eux les thèses d'habilitation qu'il a soutenues à Königsberg les 17
avril et 27 septembre 1755. La cérémonie d'habilitation a eu lieu au début du semestre
d'hiver 1755-1756.
2. L'enseignement à Königsberg (1755-1794)
Kant a enseigné pendant quarante ans à l'Université de Königsberg. Il n'a interrompu ses
leçons qu'à soixante-treize ans, en 1797, quand ses forces l'ont décidément trahi. Il a
professé ainsi 277 cours semestriels : logique (54 cours, 1755-1796), métaphysique (49
cours, 1751-1796), géographie physique (46 cours, 1756-1796), physique (46 cours, 1756-
1796), morale (28 cours, les derniers en 1788-1789), anthropologie (24 cours, 1772-1796),
mathématiques (16 cours, 1755-1763), encyclopédie philosophique (16 cours, 1767-1787).
En tout, une moyenne de sept cours par an, soit 26 à 28 heures par semaine.
Conformément à l'usage, il ne choisit lui-même ni la matière, ni l'ordre de ses leçons.
L'autorité prussienne et, de 1756 à 1763, l'autorité russe occupante, imposent les manuels et
désignent les professeurs chargés de les commenter. Enseigner (vorlesen), c'est, en effet,
paraphraser le manuel en usage. De 1766 à 1772, pendant six ans, Kant a cumulé avec son
enseignement la charge de sous-bibliothécaire au château royal, aux appointements annuels
de 62 thalers. Les cours de Kant ont connu un succès rapide et durable. Certains d'entre eux
étaient « privés », faits devant un auditoire payant. L'enseignement de la géographie
physique, alors tout nouveau, a eu un public assez nombreux.
La voix de Kant, un peu grêle et d'un timbre assez aigu, est très nette ; l'élocution, facile,
imagée, entraînante. Kant parle d'abondance, avec beaucoup de vie et de clarté. Chaque
phrase du manuel lui suggère un monde de pensées brillantes ou profondes, exprimées avec
une grande spontanéité et souvent avec une pointe d'humour. Herder, qui a été l'auditeur de
Kant en 1762-1764, a écrit : J'ai eu le bonheur de connaître un philosophe. Il a été mon
professeur. Dans ses jeunes années, il avait l'entrain joyeux de son âge, qu'il a gardé je
crois jusque dans sa vieillesse la plus avancée. Herder décrit un Kant d'esprit vraiment
supérieur et universel. Peut-être le portrait est-il un peu idéalisé, pour faire pièce aux
disciples pédants d'un maître si plein de fantaisie. Mais le jugement de Herder est confirmé
par d'autres témoignages et par la lecture des lettres et des carnets de Kant.
3. Démêlés sur le tard avec la censure prussienne (1794-1804)
La carrière universitaire de Kant a été troublée, vers sa fin, par des incidents qui ont
profondément ému le philosophe. Pendant le règne de Frédéric II et les premières années du
règne de Frédéric-Guillaume II, Kant a profité de la bienveillance du ministre des Cultes
d'alors, von Seydlitz, puis de la neutralité craintive de Wöllner, un ancien prédicateur
devenu homme d’État. Sous la pression du roi, Wöllner affirme en 1788 (édit du 9 juillet) sa
volonté d'extirper la libre pensée de Prusse. Or, quatre ans plus tard, le développent de sa
doctrine amenait Kant à traiter du problème religieux qui l'avait toujours occupé. À partir
d'avril 1792, une revue de Berlin, le Mois berlinois (Berliner Monatschrift), éditée par
Biester, a publié trois articles de Kant sur la religion. Leur réunion devait, l'année suivante,
former la Religion dans les limites de la seule raison (Religion in den Grenzen der blossen
Vernunft). Le premier des articles de Kant a obtenu le visa du censeur de Königsberg. Mais
la censure de Berlin interdit le second article : Sur le combat du bon et du mauvais principe.
Cependant, fort du visa de la Faculté de Théologie de Königsberg, Kant n'en publie pas
moins son article, et, pour Pâques 1793, le recueil des trois articles est imprimé. Il sera
d'ailleurs réédité l'année suivante.
Le 12 octobre 1794, Kant se voit notifier un ordre menaçant du Cabinet prussien : Notre
plus haute Personne [le Roi], a appris avec grand déplaisir que, depuis assez longtemps,
vous employez mal votre Philosophie, pour défigurer et discréditer diverses doctrines
essentielles et fondamentales de la Sainte Écriture et du Christianisme... Kant est donc
invité, à l'avenir, à utiliser ses talents dans une intention conforme à celle du Souverain. Il
est avisé que toute récidive l'exposerait à des mesures désagréables (unangenehmen
Verführungen). On sait aujourd'hui que le Roi de Prusse en personne avait alerté Wöllner. La
réponse de Kant est curieuse. La première partie, la plus longue, proclame avec force le
droit du philosophe à penser librement, même en matière de religion. Mais Kant conclut en
déclarant qu'il s'abstiendra complètement à l'avenir, de tout enseignement ou écrit public
touchant la religion naturelle ou révélée. Il a tenu parole et il a commenté lui-même sa
position dans la préface du Conflit des Facultés en 1798. On a beaucoup discuté à ce sujet.
Certains ont douté du courage civique de Kant. Il a lui-même expliqué son attitude dans une
note trouvée dans ses papiers, lors de sa mort : Rétractation, démenti donné à des
convictions intimes est bassesse. Mais le silence, dans un cas comme celui d'aujourd'hui, est
le devoir d'un sujet. Si tout ce que l'on affirme doit être vrai, ce n'est pas, pour autant, un
devoir que de publier toute la vérité. C'était exactement la position prise par Leibniz, en
1693, dans la préface au Codex juris Gentium diplomaticus. L'indignation que certains,
surtout en France, ont affichée à la lecture de ces lignes de Kant, vient de ce que le sens
même de la morale kantienne leur a échappé.
Kant s'est affaibli graduellement après 1789, comme il le déclare lui-même. Pourtant, il a
peu modifié son régime de vie. Après sa retraite à partir de 1796, ses facultés semblent
s'éteindre peu à peu et il glisse doucement dans la mort le 12 février 1804.
4. Personnalité de Kant
Depuis 1840 environ, on n'a jamais cessé de célébrer Kant comme un génie et cet éloge est
mérité. Ce génie est même beaucoup plus riche et plus varié qu'il ne paraît à la lecture de ses
œuvres les plus classiques. Dans ces grands ouvrages, Kant a voulu éclaircir toutes les
difficultés, user d'un vocabulaire précis et invariable, se faire l'Aristote des temps nouveaux.
Ainsi le kantisme a pris l'aspect d'une scolastique plus hérissée que celle des docteurs de
l'époque médiévale.
Cependant, une partie des œuvres de Kant, antérieures à 1770, ou antécritiques, la
correspondance, les recueils de notes, maintes pages des grandes œuvres, donnent
l'impression d'une vie intérieure intense, d'un sentiment très vif des choses concrètes, et
même parfois d'un réel talent poétique. Le respect de Kant pour une certaine forme n'est pas
seulement une concession au goût contemporain, ou aux exigences de la pédagogie ; il
traduit un perpétuel scrupule de conscience, une austérité volontaire et, sans doute, une
défense contre l'excès de facilité.
Par tempérament Kant est un libéral, toujours tenté de faire confiance à l'humanité. Il sera
favorable aux Américains pendant la guerre de l'Indépendance, aux Français pendant les
premiers mois de la Révolution. La tradition veut qu'à la nouvelle de la Révolution, Kant ait
modifié l'itinéraire invariable de sa promenade quotidienne. Il a souvent dépeint avec
éloquence les dangers de la servitude. On a parfois interprété faussement l'aveu qui lui
échappe dans une lettre du 8 avril 1761 à Moïse Mendelssohn : J'estime vraies avec la
conviction la plus ferme, beaucoup de choses que je n'aurai jamais le courage de dire. Mais
jamais je ne dirai une chose que je ne pense pas. Kant s'effraye lui-même de la force
explosive de ses pensées, de leur opposition avec l'état de fait. Mais l'ordre, à ses yeux, reste
mille fois préférable à la révolution violente. Aussi toute pensée vraie n'est-elle pas bonne à
exprimer sans précaution. La vraie liberté sera surtout intérieure, comme l'a pensé Luther.
Kant n'est nullement le vieux célibataire égoïste et timoré que l'on a parfois dépeint. Il a
choisi un régime de vie proportionné à la faiblesse de son tempérament physique. Il a tout
sacrifié à la recherche personnelle et aux exigences de la réflexion. Il ne paraît jamais avoir
sérieusement éprouvé le besoin de fonder un foyer au risque de mettre en péril sa liberté
intérieure. Mais il a eu un petit cercle d'amis, le plus souvent de condition modeste : un
directeur de banque, quelques commerçants ou professeurs ; Johann Schulze, Kraus, Hippel,
Hamann paraissent avoir été parmi les plus chers, après Marcus Herz, son correspondant et
parfois son confident. Kant aime les petites réunions très simples, autour d'une tasse de café,
les concerts de quelques amateurs, les jeux d'esprit, les distractions innocentes qui le
reposent de son labeur continu. Mais la lecture est son jeu préféré. Il lit tout ce qui lui
parvient : ouvrages de science, d'histoire, romans, poèmes ; il aime à feuilleter les classiques
latins dont il sait par cœur et se répète de longs fragments.
5. Aspects de l’œuvre kantienne
Ce n'est sans doute pas uniquement le hasard de la distribution des matières dans
l'Encyclopédie pédagogique qui a déterminé l'ordre des premiers travaux notables du jeune
Kant. Avant tout, il s'est informé de son mieux, par un choix de lectures très considérables,
de tout ce qui peut être utile à un homme chargé d'un enseignement encyclopédique. Sa
réflexion s'étend ainsi, de bonne heure, aux formes les plus diverses et les plus actuelles du
savoir ou de ses succédanés à la mode. Mécanique et notion de force, astronomie
newtonienne avec ses conséquences pour la mécanique générale, géographie physique,
logique, théologie naturelle, transferts de méthode d'une science à une autre, esthétique,
fondements de la croyance religieuse et de la morale, méthode de la métaphysique, structure
de l'espace, valeur des vaticinations des inspirés, autant de problèmes qui ont, à la fois ou
successivement, occupé une pensée soucieuse de donner à ses inductions une solide base
positive. Bref, Kant consacre une quinzaine d'années de travail intense et continu, à jeter des
coups de sonde dans les domaines les plus différents du savoir. Tous travaux destinés à
circonscrire le terrain qu'il se propose de conquérir, celui d'une métaphysique, non pas
arbitraire et fantaisiste, mais modelée à la fois sur les faits connus, et sur les besoins de notre
perfectionnement matériel, intellectuel, social et moral. Cet état d'esprit n'est pas très
éloigné, à ce qu'il semble, de celui de beaucoup des contemporains français de Kant.
Les œuvres de Kant s'étendent sur plus d'un demi-siècle (1747-1800), au cours duquel la
pensée du philosophe a évolué. On les partage souvent en deux groupes : avant la
dissertation inaugurale de 1770 et après cette œuvre, où Kant paraît avoir, pour la première
fois, exposé l'orientation définitive de sa pensée. Mais les choses sont loin d'être aussi
simples. Le développement de la pensée de Kant paraît caractérisé par une remarquable
continuité et il s'est poursuivi, sans interruption, jusqu'aux approches de la mort. On ne peut
guère, en dépit de certaines affirmations du philosophe, notamment à propos de l'influence
qu'aurait exercé sur lui David Hume, y discerner de coupures radicales.
III. Les travaux de Kant jusqu'à la première Critique
1. La période précritique (1747-1770)
A) Œuvres de jeunesse : recherches de physique et d'astronomie (1747-1755)
a) Pensées sur la véritable évaluation des forces vives (Gedanken von der wahren
Schätzung der Lebendigen Kräfte). Dans le semestre d'été 1746, le jeune Kant remettait au
doyen Adam Gregorovius, un mémoire en vue du doctorat : ce mémoire a été imprimé en
1747, partie aux frais de l'auteur, partie grâce à la générosité d'un parent de Kant, le
cordonnier Richter.
Kant ignore les remarques faites en 1743 par d'Alembert dans son Traité de Dynamique ;
mais il arrive presque au même résultat par ses propres réflexions. Ce jeune homme de
vingt-trois ans commence par une déclaration d'indépendance absolue : je suivrai la voie
que je me suis tracée et rien ne pourra m'empêcher de continuer à la suivre. La querelle
entre cartésiens et disciples de Leibniz sur l'évaluation des forces vives est simple dispute de
mots ; les deux doctrines concordent pour l'essentiel. Irréfutable quand il s'agit de la réalité
mathématique, le principe de Descartes (soutenu par Euler) doit être remplacé par celui de
Leibniz dès que l'on touche à la réalité sensible. La mathématique seule n'admet de force
dans le corps qu'autant que cette force est causée en lui du dehors. La formule de Descartes,
évaluant la force par le produit de la masse et de la vitesse, est alors seule valable. Dans ce
cas, en effet, le corps n'applique pas la force qui réside en lui mais la laisse inactive, et sa
vitesse est infiniment petite. Au contraire, s'il s'agit du corps sensible réel, la force se définit
par la grandeur des obstacles que peut vaincre le corps, quand il se meut. La force entretient
le mouvement commencé, grâce à une propriété que Kant nomme intension. Ce qui se
conserve, c'est le produit de la masse par l'intension. Mais il faut distinguer deux cas : 1°
L'intension ne peut pas être renouvelée du dehors et ne varie pas, quelle que soit la vitesse.
Elle ne peut alors entretenir le mouvement que pendant un temps très court. La loi de
Descartes est ici valable ; 2° L'intension peut être renouvelée du dedans, ou vivifiée, la
vivification étant proportionnelle à l'intension. C'est le cas examiné par Leibniz : la force est
alors égale au produit de la masse par le carré de la vitesse. Ce cas n'est possible que s'il
existe des mouvements libres de vitesse définie, ce que les mathématiques seules ne
permettent pas d'affirmer. On retrouve ainsi des idées de Leibniz, mais débarrassées de tout
appareil métaphysique.
Le travail de Kant témoigne de beaucoup de lectures. Il cite Christian Wolff, Hermann,
Jacques Bernoulli, Dortous de Mairan, Wren, Huygens, Jurin, Papin, Catelan, S'Gravesande
et d'autres auteurs moins connus. Il cite aussi Newton, mais probablement d'après le livre de
la marquise du Châtelet, qui paraît alors une de ses sources principales.
b) Sur la rotation de la Terre. – Les deux travaux suivants de Kant portent sur l'astronomie.
L'Académie de Berlin avait mis au concours, le 1er juin 1752, la question suivante : Le
mouvement de la Terre a-t-il été de tout temps de la même vitesse ou non ? Par quels
moyens s'en assurer ? Au cas où il y aurait quelque inégalité, quelle en est la cause ? La
réponse de Kant porte le titre : Recherches sur la question de savoir si la Terre, dans sa
rotation autour de son axe, par laquelle elle détermine la distinction du jour et de la nuit, a
subi quelques changements depuis les premiers temps de son origine et comment on peut
s'en assurer ? Cette réponse a paru les 8 et 9 juin 1754 dans les Wöchentliche
Königsbergische Frag- und Auszugs-Nachrichten (questions, nouvelles et extraits
hebdomadaires de Königsberg). Kant vient d'étudier l’œuvre de Newton. Le mouvement de
la Terre peut être tenu pour libre, et la matière raréfiée qui remplit l'espace supposé vide
peut être considérée comme négligeable. Or, le mouvement des marées exerce évidemment
une action opposée à celle de la rotation de la Terre autour de son axe. Kant cherche à
évaluer le retard qui en résulte et il conclut que l'effet des marées devrait, en deux millions
d'années, arrêter la rotation terrestre. Il annonce une cosmogonie, essai pour déduire des lois
générales de la mécanique de Newton, l'origine du monde, la formation des corps célestes et
la cause de leurs mouvements. Ce sera le sujet de l'ouvrage suivant.
c) Histoire générale de la Nature et Théorie du Ciel (Allgemeine Naturgeschichte und
Theorie des Himmels), éditée en mars 1755 sans nom d'auteur (le nom de Kant figure dans
le catalogue de la foire de Leipzig, pour 1756). L'ouvrage a été fort peu connu ; J.-F.
Lambert, qui a publié en 1762, dans ses Cosmologische Briefe, une théorie analogue, a
ignoré l'écrit de Kant, de même que Laplace (L'Exposition du système du Monde date de
1796). Le mémoire de Kant est cité pour la première fois en France par Arago dans
l'Annuaire du Bureau des Longitudes de 1842. Kant voulait publier une seconde édition de
son mémoire, mais il n'en a jamais trouvé le temps. Un professeur de Königsberg,
Gensichen, en a donné en 1791 un extrait assez fidèle, avec l'autorisation de Kant.
L'occasion du livre de Kant a été fournie par un ouvrage utilisé par Buffon, publié à Londres
en 1750 par Thomas Wrigth, de Durham : An original Theory and new Hypothesis of the
Universe. Kant n'a connu ce livre que par une brève notice publiée en 1751 dans une revue
allemande. La préface, fort curieuse, de l'exposé de Kant souligne les dangers apparents de
toute cosmologie rationnelle, du point de vue religieux. La religion exige la finalité ; la
mécanique l'exclut. Kant prétend concilier mécanisme et finalité. En effet, contrairement à
l'hypothèse des atomistes, l'ordre ne peut jamais naître du hasard ; c'est même la meilleure
preuve de l'existence de Dieu : Il y a un Dieu parce que, dans le Chaos lui-même, la nature
ne peut pas procéder autrement que par ordre et suivant des règles. Kant le montre en
considérant, tour à tour, la distribution des étoiles fixes, la théorie des planètes, enfin la
pluralité des mondes habités et le futur destin de l'homme. On partira de l'exposé de
Newton. Les six planètes (on ne connaît pas encore Neptune, Uranus et Pluton) sont
soumises, comme leurs satellites, à l'action des forces centrifuge et centripète. Le monde des
astres errants obéit donc à des lois. Il y a même un ordre, malgré les apparences, dans le
monde des étoiles fixes et Wright l'a relevé ; la matière stellaire est plus dense dans la Voie
Lactée que dans le reste du ciel. Il existe donc dans l'Univers une liaison générale (eine
allgemeine Verbindung) qui doit s'étendre à l'infini autour du soleil et de toutes les autres
étoiles. On peut croire qu'à la fin toute la matière sidérale se réunira en un unique amas (in
einen Klumpen). Tous les astres sans exception sont animés d'une rotation autour d'un
centre. Les causes qui ont tendu à mettre dans un même plan toutes les trajectoires
planétaires ont agit pour l'ensemble du système solaire et pour l'univers entier, réplique
démesurément agrandie du système solaire. Mais, dira-t-on, le soleil et les autres étoiles ne
se meuvent pas. Selon toute vraisemblance cette absence de mouvement n'est qu'apparente :
Bradley (1693-1762) a observé des mouvements très petits des étoiles fixes ; l'immobilité
apparente des étoiles est due, sans doute, à leur prodigieuse distance. Il y a partout des
systèmes analogues à la Voie Lactée, et partout doit régner un ordre absolu.
D'autre part, le système solaire comporte un sens de rotation unique et tous les mouvements
doivent donc avoir une seule et même cause. Tous ont lieu dans un espace pratiquement
vide, et Newton en a conclu qu'il ne peut pas y avoir de liaisons matérielles entre les astres.
Mais il y a là une contradiction. Pour éviter cette contradiction entre la liaison des
mouvements et l'absence de mécanisme de liaison, Kant propose une hypothèse qui pourra
peut-être un jour se démontrer : j'admets que toutes les matières dont sont faites les sphères
appartiennent à notre système solaire, planètes et comètes ont, au début de toutes choses,
alors qu'elles étaient résolues en leurs éléments, rempli tout l'espace occupé par l'Univers,
et dans lequel ces corps figurés circulent encore aujourd'hui. N'est-ce pas là l'état le plus
simple qui puisse faire suite au néant ? La nature qui a suivi immédiatement la création
était aussi grossière, aussi informe que possible... Mais il y avait en elle une impulsion à
prendre une organisation plus parfaite, par l'effet d'un développement naturel (Durch eine
natürliche Entwickelung). Avec Buffon, Kant admet donc dans toute son étendue, le
principe d'une évolution spontanée de la matière, en vertu d'un pouvoir intime
d'organisation. En effet, les éléments se sont distingués ; les plus denses, prenant moins de
place que les plus légers, sont plus dispersés ou espacés. Il n'y a donc pas d'homogénéité
dans l'espace plein. D'autre part, il existe dans les éléments une tendance à se mouvoir, et le
repos ne peut durer qu'un temps infime. D'où ce principe (pris à Buffon) : la matière tend
immédiatement à prendre forme (Die Materie ist sofort in Bestrebung sich zu bilden). La
matière lourde se précipite vers le centre où l'attraction est la plus forte. Ce mouvement
général se combine avec les mouvements propres des particules, et il laisse chaque parcelle
de la matière au point exact où les deux forces s'équilibrent parfaitement. Les distances au
centre sont d'autant plus grandes que les densités sont plus faibles. Ce dispositif a lui-même
évolué, parce que la distribution du chaos initial n'était pas exactement uniforme. Par
exemple, des particules légères, primitivement proches du Soleil, ont pu en rester plus
voisines que des particules plus denses. Mais dans l'ensemble, les matières les plus denses
sont les plus voisines du Soleil. Le corps central comprend ainsi des éléments denses et des
éléments légers. Cette masse pourra être plus grande que celle de tous les satellites réunis.
La densité totale de l'ensemble des planètes doit être à peu près égale à celle du Soleil ;
Buffon l'admet, et cela démontre l'hypothèse de Kant.
Il y a, dans l'espace immense, des univers sans nombre. Pourtant la condensation a dû
commencer à se propager à partir d'un point unique. Il lui a fallu, pour s'étendre, peut-être
des milliers de siècles. Elle disparaîtra sans doute car il y a en elle de l'imperfection et du
fini. Mais elle contient probablement un principe de renouveau. Ne cherchons pas, dans cet
ensemble infini, des fins particulières, qui expliqueraient par exemple l'inclinaison diverse
des axes planétaires. Mais si le détail nous échappe, la finalité est évidente dans le Tout.
Un tel ordre dans le système mérite l'admiration. Quel émerveillement nous procure la
contemplation de l'Univers céleste ! Cet univers est infini, car l'infini peut seul traduire la
grandeur de Dieu. Dès ce moment Kant aborde les problèmes métaphysiques.
B) Vers la Métaphysique (1755-1770)
a) Principes premiers de la connaissance métaphysique (Principiorum primorum
Cognitionis metaphysicae nova Dilucidatio) 1755. Cette thèse d'habilitation part des
théories de Leibniz et de Wolff, mais les modifie notablement, pour leur donner une portée
plus générale. Kant substitue au principe de contradiction, employé par ces deux penseurs,
le principe plus large d'identité. De même, le principe de raison suffisante est transformé en
un principe de raison déterminante, qui serait à la fois plis compréhensif et plus précis.
D'après ce nouveau principe, il y aurait dans l'Univers une quantité d'être constante, qui ne
peut ni augmenter, ni diminuer. D'où résulte évidemment la liaison réciproque des
substances pendant le changement. Ce principe permet la compensation des pertes à une
place donnée de l'ensemble, par des gains équivalents, en d'autres régions. Par là, sont
rendues objectives (ou réelles pour l'esprit) les représentations qui résultent de cette liaison.
Liaison évidemment fondée dans l'esprit divin, seul capable de penser à la fois toutes les
substances et leurs connexions. Ainsi peuvent être exclues les causes occasionnelles de
Malebranche, et l'harmonie préétablie de Leibniz et de Wolff. À vrai dire, la doctrine de
Kant est simple transposition de celle de Wolff. Un contemporain de Kant, Christian August
Crusius (1712-1775) a critiqué vivement cette hypothèse, laquelle ruinerait, selon lui, toute
spontanéité et toute liberté. Kant réplique aussitôt : la seule spontanéité concevable est la
spontanéité tout intérieure d'un être vivant. Elle se nomme liberté, quand le vivant qui la
possède est pourvu de raison. Ici apparaît déjà une des idées maîtresses des trois Critiques.
b) Monadologie physique. – En 1756 Kant, candidat à une chaire de professeur
extraordinaire, présente un travail sur L'emploi dans la philosophie naturelle de la
métaphysique unie à la géométrie, dont le premier échantillon contient une Monadologie
physique. En effet, tout Dozent qui veut devenir professeur extraordinaire doit présenter
trois dissertations. Martin Knutzen est mort le 23 mars 1756 ; Kant se propose pour le
remplacer. La soutenance a lieu le 10 avril. Une opposition apparente sépare, dit Kant, les
mathématiques et la physique. Les premières traitent de quantités continues, divisibles à
l'infini... La physique traite de corps, formés de parties séparées et discontinues. Les deux
types de science diffèrent autant que le cheval du griffon. Cette opposition est évidente chez
Wolff. D'après ce dernier, les Monades, ou substances simples, sont des corps. Mais
l'espace, lieu des corps, est indéfiniment divisible et ne peut, par suite, être formé d'unités
simples. Kant a essayé de résoudre le problème grâce à l'attraction newtonienne combinée
avec le Leibnizianisme. Les Monades remplissent l'espace. Chacune d'elles s'entoure d'une
sphère d'activité et tend à occuper tout l'espace. Une force auxiliaire, celle de l'attraction,
limite l'expansion des Monades. Kant restera toujours fidèle à cette hypothèse.
c) Opuscules sur la Géographie physique, sur l'Optimisme et sur le Syllogisme (1756-
1762). – Kant donnera beaucoup de temps à la préparation de ses cours de Géographie
physique dont le programme est publié le 13 avril 1757. Kant traite de toutes les parties de
la géographie physique (océans, continents, sources, rivières, fleuves, atmosphère, vents,
saisons, histoire de la terre, navigation, faune, flore, minéraux).
Une seule diversion pendant cinq ou six années : la réponse à un certain Wegmann, auteur
d'une brochure contre l'optimisme. Dans son Essai de quelques considérations sur
l'optimisme (octobre 1759) Kant, sans nommer Wegmann, s'en prend à Voltaire et soutient la
proposition : le Tour est le meilleur possible ; rien n'est bon qu'en vue de la perfection du
Tout.
Le programme des leçons de Kant pour le semestre d'hiver 1762-1763 s'accompagne d'une
dissertation sur La fausse subtilité des quatre figures du syllogisme, écrite en quelques
heures, suivant Hamann. La thèse qui pourrait invoquer un texte des Analytiques d'Aristote
est simple et claire : la première figure permet seule des raisonnements mêlés (vermischte).
Un raisonnement pur n'utilise que trois propositions. Or, l'âme ne peut exécuter qu'une seule
opération intellectuelle, juger, unir un prédicat à un sujet. Le raisonnement n'est qu'un cas
du jugement. Kant le soutiendra toujours : le moyen terme permet une extension du
jugement.
d) L'unique principe possible d'une démonstration de l'existence de Dieu. – Kant a publié en
1763 (et réimprimé en 1770, 1794, 1798, 1799) sous ce titre un travail dans lequel, après de
longues réflexions, il ne se croit pas en état d'apporter un principe simple, mais plutôt un
assemblage de matériaux péniblement réunis. En effet, l'existence n'est pas un prédicat, une
détermination d'une chose quelconque. L'expérience permet seule de constater une
existence, car l'existence est un concept empirique (Erfahrungsbegriff). Baumgarten et
Wolff nous disent : l'existence apporte un supplément d'être à la simple possibilité, car la
contradiction exclut à la fois existence et possibilité. Mais que peut être une possibilité pure,
nue, sans aucune existence ? En fait, la réalité précède la possibilité. Par suite, il existe un
Être nécessaire, dont le contraire (l'inexistence de Dieu) est impossible. Si cet être n'existait
pas, il n'y aurait même pas de possibilité. L'argument ontologique remonte du possible à
l'être, mais traite (à tort) l'existence comme un prédicat. L'argument physico-théologique et
l'argument cosmologique font intervenir la causalité. Le second est peut-être valable, mais il
faudrait remanier la forme que Wolff lui a donnée. Sur ce point la pensée de Kant ne variera
plus guère.
e) L'Essai pour introduire dans la sagesse humaine le concept des grandeurs négatives a été
imprimé en 1763 et annoncé à la foire de Pâques 1764. Selon Kant, il est avantageux de
transférer à une science des procédés employés dans une autre (Leibniz l'avait déjà observé
et d'Alembert après lui).
Les mathématiques et la mécanique font usage de grandeurs négatives qui ont une réalité
propre. Ne peut-on utiliser cette notion dans la psychologie et dans la morale ? Par exemple,
la douleur n'est pas seulement l'absence de plaisir.
f) Les Considérations sur les sentiments du Beau et du Sublime, remises par Kant à son
doyen en octobre 1763, ont paru en 1764. On y trouve beaucoup de fines remarques,
reprises dans la Critique du Jugement et demeurées classiques. Plusieurs sont empruntées à
Baumgarten. La beauté sublime excite un sentiment de crainte et d'amour. La nuit est
sublime, le jour est beau ; le sublime touche, le beau chatouille. Le sublime est toujours
grand ; le beau peut être petit. On qualifie le sublime d'effrayant, de noble, d'éclatant. Dans
l'ordre moral, la vertu seule est sublime. Sublime aussi, le sentiment de la force et de la
noblesse de la nature humaine. La vertu de la femme est belle vertu ; la vertu du sexe mâle
doit être une noble vertu. Dans l'action morale sublime, rien de dû, de contraint. Les
caractères nationaux se reflètent dans les conceptions morales : Italiens et Français
s'attachent au beau ; Allemands, Anglais, Espagnols, au sublime. Kant a lu les esthéticiens
français de son temps.
g) Démonstration mathématique et démonstration physique. – En 1762, Sulzer avait
proposé à l'Académie de Berlin de mettre au concours le sujet suivant : Si les vérités
métaphysiques en général, et spécialement les principes de la théologie naturelle et de la
morale, sont susceptibles de recevoir les mêmes démonstrations évidentes que les vérités
géométriques ? Un prix de 50 ducats devait récompenser la réponse couronnée. Kant a
rédigé hâtivement un mémoire. Mendelssohn a obtenu le prix le 2 juin 1763. Mais de grands
éloges ont été décernés au mémoire de Kant (Recherches sur l'évidence des Principes de la
Théologie naturelle et de la morale), imprimé aux frais de l'Académie à la suite de celui de
Mendelssohn. Kant a utilisé le mémoire dans le programme de ses cours (1765-1766).
Selon Kant, la science mathématique part de définitions synthétiques ou constructives (le
cône est construit par rotation d'un triangle rectangle autour d'un des côtés de l'angle droit).
Une construction géométrique met en jeu les propriétés de l'espace. Ces propriétés sont
données ; on ne peut pas les expliquer logiquement. Mais, peu de propositions
mathématiques sont indémontrables ; car l'objet de la mathématique est simple et uni. Au
contraire, la métaphysique part de définitions complexes, obtenues par analyse ; son objet
est compliqué, embrouillé. Des notions comme : représentation (Vorstellung), beau, noble,
etc., sont obscurs. On ne peut employer la méthode constructive des mathématiques ; en
effet, la métaphysique n'est pas autre chose qu'une philosophie concernant les premiers
fondements de nos connaissances (d'Alembert l'avait affirmé). Ici point de faits donnés dans
l'expérience, et notamment dans une expérience intérieure. Cependant, nous ne pouvons
opérer qu'à partir de faits. La vraie méthode de la métaphysique est donc identique à celle
que Newton a introduite dans les sciences de la Nature : partir d'expériences certaines et
chercher les règles suivant lesquelles se produisent les phénomènes. Il y faut une expérience
interne, certaine. Et l'entendement humain, force de la nature est, comme toutes les autres
forces de la nature, assujetti à certaines règles (an gewissen Regeln gebunden). Certaines
évidences intérieures indiscutables sont connues en matière de théologie. Mais, en matière
de psychologie et de morale, les faits sont encore mal observés et aucune évidence n'a pu
être dégagée. Cependant, on doit pouvoir arriver à des principes moraux d'un caractère
formel ; par exemple : « Fais ce que tu peux faire de plus parfait » est le premier principe
formel de toute obligation à agir. Il y a dans cet essai improvisé le germe des trois Critiques.
h) Rêves d'un voyant expliqués par les Rêves de la Métaphysique. – Pendant l'hiver 1765-
1766 Kant a traité de Logique, de Morale et de Géographie physique. En matière logique il
suivait le manuel copieux et précis de Baumgarten. Il a proposé de réaliser ce qu'il nomme
une critique de l'entendement, de l'érudition, de la raison, du goût.
Mais au milieu de ces recherches, Kant entretenait une correspondance avec Charlotte
Knobloch. Cette amie fidèle manifestait beaucoup d'intérêt pour le visionnaire Swedenborg
(Schwendenborch, 1688-1772) dont les Révélations sur le Monde des esprits avaient eu en
Allemagne de nombreux lecteurs. Pour Mlle Knobloch, Kant a rédigé rapidement et publié à
Riga sans nom d'auteur, en 1766, les Rêves d'un voyant (un voyeur d'esprits : eines
Geistersehers). Kanter, l'éditeur, a eu grand-peine à imprimer le manuscrit très peu lisible.
Kant a voulu écrire en style poétique et fleuri. Le royaume des ombres (Schattenreich) est le
paradis des gens à imagination (der Phantasten). Qu'est-ce qu'un esprit ? Il y a sûrement
des réponses ; On n'aime pas, dans les Académies, à entendre les mots : je ne sais pas. Un
esprit est-il un être raisonnable ? Peut-il exister un esprit dans l'espace, sans matière ou avec
une matière très ténue ? On ne sait pas. On ne peut rien dire de raisonnable à ce sujet, ou
l'on s'expose à la réponse qu'un cocher fit un jour à Tycho Brahé : Vous vous y connaissez
sans doute pour le ciel, mais sur terre vous êtres un imbécile... Nous sommes ici dans le
domaine non seulement de l'opinion, mais du rêve ; le rêve peut être le règne du sentiment et
même parfois celui de la raison. Or, M. Schwendenberg (sic) de Stockholm est en rapport
très intime, dit-il, depuis plus de vingt ans, avec des esprits, ou âmes séparées ; il en reçoit
des nouvelles de l'autre monde et il leur fait part, en échange, des nouvelles de celui-ci. On
raconte de lui mille histoire, qui témoignent surtout de la sottise et de l'extrême crédulité des
hommes. Kant analyse les Arcana Coelestia de Swedenborg, travail ingrat qu'il accepte par
amour de la métaphysique. En tant que science de ce qu'on ne peut pas savoir, la
métaphysique est vaine. Mais en un autre sens, c'est une science des limites de la raison
humaine (von den Grenzen der menschlichen Vernunft) qui nous donnerait, si elle était
réalisée, la solution d'un problème capital, déterminer ce qui est possible. Or, la raison
constate des faits ; elle en trouve les causes. Mais elle ne peut prévoir a priori ni les faits, ni
leurs causes. Concluons donc, avec Candide, laissez-nous prendre soin de notre bonheur,
aller et travailler dans notre jardin. L'essai s'achève par un aveu de scepticisme, dans le
style de Hume.
i) Du premier principe de la distinction des régions dans l'espace. – Le dernier travail de la
période antécritique a paru en 1768, dans une revue de Königsberg. On y trouve une théorie
de l'espace, qui provient en grande partie de Newton et fort différente de celle que
présentera la dissertation de 1770. Mais Kant y note diverses observations profondes qu'il
retiendra dans sa philosophie définitive. Il réfute d'abord la théorie de Leibniz qui déduit
l'espace des relations entre les corps qui l'occupent. Les propriétés de l'espace devraient, en
ce cas, se déduire de celles de ces corps. Or, il n'en est rien. L'espace a trois dimensions,
définies par trois plans perpendiculaires. Mais un objet dans l'espace ne se détermine pas
seulement par sa position et par sa figure. Deux figures géométriques identiques peuvent ne
pas être superposables ; par exemple, deux spires d'hélice égales, les deux mains, deux
triangles sphériques égaux. Et la main gauche est semblable et égale à la main droite mais
ne peut pas lui être superposée. Les propriétés propres de l'espace ne sont donc pas d'ordre
rationnel. L'espace est rempli d'objets incongruents et il existe, par suite, un espace absolu.
Kant ne croit pas encore, on le voit, à l'idéalité de l'espace.
j) Résultats de la période précritique. – Dans ces écrits de sa jeunesse ou de sa maturité
commençante, Kant a dégagé une dizaine de thèmes qui seront repris et orchestrés dans les
œuvres critiques.
1. Il n'existe pas de liberté d'indifférence ; 2. Chaque unité physique s'entoure d'une sphère
d'activité ; 3. Le bien l'emporte dans l'univers ; 4. Toutes les opérations mentales se
ramènent à des jugements ; 5. L'existence n'est pas un prédicat logique mais une notion
empirique ; 6. L'être n'exclut pas une élément négatif ; 7. La vertu et le devoir ont une
importance capitale : 8. La métaphysique concerne nos moyens de connaître et elle tend à
devenir une critique de nos facultés ; 9. C'est la science des limites de l'esprit humain ; 10.
L'espace a des propriétés distinctes de celles des objets qui le remplissent ; 11. Dans toutes
les réalités de la nature il se manifeste des lois ou des règles applicables, les unes aux
œuvres de la nature, les autres à celles de la liberté.
2. La Dissertation de 1770
La première version presque achevée d'une partie du Kantisme figure dans la dissertation de
Mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, connue sous le nom de Dissertation
de 1770. Le professeur de mathématiques à l'Université de Königsberg, Langhausen, étant
mort le 15 mars 1770, un ordre du Cabinet royal prussien désigna Kant pour le remplacer.
Le philosophe s'attendait à cette nomination. Il composa, entre avril et août, la dissertation
d'usage, dite pro loco, et il la soutint le 21 août avec comme opposant son ami Marcus Herz.
Il voulait d'abord y ajouter un complément de quelques pages. Au lieu de le faire, il se
décida, en juin 1771, à rédiger en allemand une petite Étude sur les limites de la sensibilité
et de la raison.
Le problème. – Qu'est-ce que le monde, l'univers ? Cette question métaphysique doit être
traitée par les méthodes essentiellement démonstratives de la métaphysique ; méthodes dites
apodictiques (du mot grec άποδειξις démonstration). Un « Monde » comprend une matière
dont il est fait (des substances), et une forme (union ou coordination des substances) qui en
assure l'unité.
Rien de plus obscur que l'idée d'unité de l'univers. L'unité ne peut pas être faite de la somme
des états successifs du monde, parce que l'on ne peut jamais considérer à la fois tous ces
états. Unité et succession sont deux idées incompatibles. La succession concerne le temps
qui est une chose sensible, connue par une vision (intuitus). L'unité est notion intellectuelle,
perçue par l'entendement. Il faut donc distinguer ce qui est sensible (sensualitas) et ce qui
est intelligible (intelligibilitas ou rationalitas). Grossièrement, les sens nous représentent les
choses, non comme elles sont (ut sunt), mais comme elles nous apparaissent (uti apparent),
c'est-à-dire le Phénomène (Phaenomenon) ; l'intellect, au contraire, est la faculté de
concevoir ce que le sens ne peuvent pas représenter (Noumenon).
Qu'est donc concevoir ? Le terme a deux sens, car l'intelligence a deux usages. L'usage
logique se traduit par des relations, ou par un ordre donné aux notions en vue de leur
emploi ; ainsi la géométrie opère sur les données des sens qu'elle met en ordre. Avant cette
coordination, nous avions de simples apparences ; après la coordination, nous avons
l'expérience (experientia) qui nous offre des phénomènes ordonnés. Un usage réel de
l'intelligence nous présenterait des objets connus directement par l'intellect, sans recours aux
phénomènes.
Or, les notions sensibles ne sont pas nécessairement confuses, ainsi que le croit Leibniz.
Elles peuvent être pures, comme le montre la géométrie. D'autre part, s'il y a des notions
intellectuelles pures, comme celle du perfectum noumenon, de la perfection intelligible (qui
se rapporte à Dieu ou à la morale), il y a aussi, notamment dans la métaphysique, des
notions intellectuelles confuses.
Une connaissance sensible exige l'intervention des sens : sens externes dans la physique ;
sens interne dans la psychologie empirique. Il n'y a pas, dans l'ordre intellectuel, de
connaissance sensible ou par vision. Toute vision sensible de choses intellectuelles a un
caractère confus ou symbolique.
Or, nous avons trois sortes d'intuitions sensibles : temps, espace, nombre. Toutes trois se
rapportent à la quantité (non à la qualité). Elles jouent un grand rôle dans la mécanique, la
géométrie et l'arithmétique, les trois sciences sur lesquelles repose notre connaissance du
monde sensible. Seules, ces trois notions permettent d'unir les phénomènes par un lien
universel (nexus universalis). D'où la définition : L'intuition pure humaine n'est pas un
concept universel ou logique, mais concept singulier, sous lequel sont pensés tous les objets
sensibles quels qu'ils soient. (L'expression conceptus... singularis est curieuse.) Hegel la
retiendra.
Kant va donc analyser les notions de temps et d'espace (il laisse de côté le nombre) et il va
démontrer à ce sujet cinq propositions : 1. Ce ne sont pas des notions abstraites (ou concept
au sens ordinaire du terme) ; 2. Ce ne sont pas des objets extérieurs ; 3. Ce sont des
intuitions ; 4. Ce sont des intuitions pures ; 5. Ce sont des intuitions pures a priori.
Dans la Critique de la Raison pure, Kant distinguera une exposition métaphysique et une
exposition transcendantale (on indiquera plus loin le sens de ces termes). La dissertation de
1770 ne fait pas encore cette distinction. Elle commence par le temps ; l'ordre sera renversé
dans la Critique.
Le temps. – On croit souvent que le temps est une idée abstraite, formée à partir des
sensations. Kant le nie et il défend sa thèse par quatre arguments : 1. L'idée de temps de
vient pas des sensations. Au contraire, les sensations supposent le temps (supponitur a
sensibus) et le temps global précède l'idée de succession ; des termes comme avant, après,
en même temps, impliquent le temps global ; 2. L'idée de temps est concrète (singularis) et
non pas générale ; elle est unique ; tous les temps particuliers sont fragments d'un seul
temps ; 3. Par suite, l'idée de temps est une intuition pure, antérieure aux sensations. Elle ne
se forme pas par l'addition d'éléments simples ou d'instants préexistants, et elle est continue
comme le changement (mutationes omnes sunt continuae) ; 4. Le temps n'est donc pas un
objet réel, distinct de nous. Il n'est ni substance, ni accident, ni relation d'objets réels. Les
théories de Leibniz et de Newton impliquent un cercle vicieux.
On dira que le temps est une condition subjective, nécessaire, fondée dans la nature
humaine : subjectiva conditio per naturam mentis humanae necesseria. On peut le nommer
un être imaginaire (imaginarium), ou un principe formel du monde sensible.
L'espace. – La démonstration relative à l'espace est symétrique, avec un certain flottement
qui révèle une arrière-pensée. L'idée d'espace n'est pas extraite de nos sensations, car il n'est
pas de phénomènes externes sans un espace pour les recevoir. L'espace est singularis, objet
d'une notion globale, comme le temps. Il comprend en lui tout ce qui est externe. C'est donc
aussi une intuition pure, une forma fondamentalis. Cette forme n'est pas logique ou
rationnelle, comme le montrent des figures identiques, mais non superposables, telles deux
triangles sphériques ou les deux mains. L'espace n'est pas un objet extérieur, un réceptacle,
car il cesserait alors d'avoir un caractère universel. Fondant toute réalité, il n'est pas
imaginaire comme le temps, mais c'est un fondamentum reale.
Temps et espace sont donc des intuitions sensibles, pures et a priori, ce qui paraît paradoxal.
Kant le souligne dans un texte fameux : L'un et l'autre concept est, sans nul doute, acquis.
Toutefois, il n'est pas extrait du sens des objets, mais de l'action même de l'esprit,
coordonnant nos sensations selon des lois constantes... en effet, les sensations excitent
l'action de l'esprit. Elles n'ont pas d'influence sur l'intuition (non influunt intuitum). Donc,
pas d'intuition directe d'un espace ou d'un temps vides. Espace et temps sont fonctions de
l'esprit, recevant les données sensibles. Ce sont des intuitions sensibles et non
intellectuelles. Elles sont donc, dans l'esprit même, en partie impénétrables à l'intelligence
logique, une forme d'activité réfractaire à la logique ordinaire. Ce sera une des idées
maîtresses du romantisme.
Appliquons ces notions au problème de l'Univers, que nous avons posé. Supposons le
Monde constitué de substances qui forment un Tout. Or, un tout constitué de substances
nécessaires est inconcevable, car il n'y aurait alors qu'une substance unique. L'Univers est
donc formé d'éléments contingents, donc contingent aussi dans son ensemble. Mais il ne
serait pas un, sans une harmonie qui nous force à proclamer l'existence de Dieu.
D'un autre côté, monde sensible et monde intelligible, perçus par deux facultés différentes,
sont entièrement hétérogènes et l'on ne peut étendre à l'un les propriétés de l'autre. Nous
n'avons qu'une intuition sensible qui implique des objets, et aucune intuition intellectuelle
du monde suprasensible n'est possible à notre esprit. Quand nous cultivons la géométrie,
nous définissons a priori les propriétés de notre intuition sensible pure et nous créons ainsi
la plus certaine et la plus rigoureuse de toutes les sciences humaines. Un monde intelligible
ne peut nous être rendu accessible par aucune expérience. La métaphysique ne porte donc
pas sur des objets extérieurs au monde de l'expérience. Elle se borne à explorer les
propriétés de l'esprit humain par lequel passent, pour y recevoir leur forme, toutes nos
expériences.
Dans sa forme scolaire, la Dissertation de 1770 contient, comme on va le voir, l'essentiel de
toute la philosophie critique. Mais la théorie de l'espace et du temps va être uniformisée et
simplifiée. Dans la Dissertation, Kant garde à l'espace une réalité qu'il ne définit pas. Il
présente le temps comme imaginaire. Dans la Critique de la Raison pure, la théorie de
l'Imagination transcendantale permettra de mieux définir la symétrie qui existe entre les
deux formes d'espace et de temps.
Le Problème critique et l'Esthétique transcendantale
I. Le Problème critique
I. Naissance de la Critique de la Raison pure
Dès le début de 1764, Hamann signale à Herder un travail commencé par Kant et qui sera
bientôt terminé, l'Essai d'une nouvelle métaphysique. Kant en agit aussi parlé à Lambert qui,
au début de 1765, lui a offert sa collaboration en vue d'exposer la méthode propre à la
métaphysique (Die eigentliche Methode der Metaphysik). De 1765 à 1769, Kant ne faut que
peu de progrès. Mais dans son exemplaire de la Metaphysica de Baumgarten, il écrit : L'an
1769 m'a donné une grande lumière (grosses Licht). C'est le moment où Kant prépare sa
dissertation inaugurale. Il écrit à Lambert, en septembre 1770 : Depuis environ un an je suis
parvenu, je m'en flatte, à une conception telle que je ne crains pas d'avoir jamais à la
modifier, mais qu'il me faudra étendre (erweitern). Treize ans plus tard, il écrira à
Mendelssohn : La critique de la Raison pure est le résultat d'un travail qui a duré au moins
douze ans ; et à Garve qu'il a fait deux découvertes : La distinction de la sensibilité et de
l'entendement, et que l'entendement ne peut rien construire en matière métaphysique.
La Dissertation de 1770 pose déjà clairement le problème critique à propos du temps et de
l'espace. Treize ans plus tard, dans la préface des Prolégomènes (1783), Kant écrit : La
lecture de David Hume est justement ce qui, il y a bien des années, a interrompu ma
somnolence (ou ma rêvasserie) (Schlummer) dogmatique et donné une tout autre direction à
mes recherches dans le champ de la raison spéculative. À quel moment s'est donc
manifestée l'influence de David Hume ? La traduction allemande des Essays de Hume a
paru en 1756, quatorze ans avant la Dissertation de 1770. Kant a pu la lire dès sa
publication. En tout cas, il mentionne Hume en 1766, dans son mémoire sur Swedenborg,
sans toutefois se référer aux Essays ; mais Kant ne traite pas, en 1770, de la causalité. Le
problème kantien, contrairement à ce que l'on dit souvent, n'est pas exactement celui que
Hume a posé. Selon Hume, la notion de cause et d'effet est fondée sur la succession
constante, dans l'expérience, de deux événements différents. Quand le premier réapparaît,
nous attendons le second, par l'effet de l'habitude. Cela ne préjuge nullement d'une liaison
interne entre les deux événements, liaison dont nous ne pouvons avoir aucune impression.
Mais nous devons pratiquement nous fier à l'impression de réflexion qui nous fait attendre
l'effet dont nous avons observé la cause. C'est le seul moyen d'organiser notre vie. La théorie
de Kant, nous le verrons, est très différente : les jugements synthétiques a priori et non
analytiques des mathématiques nous montrent la solution, et la causalité mécanique aura
pour lui une valeur absolue dans le monde phénoménal.
Les lettres à Lambert, des années 1770 et 1771, donnent une idée du plan initial de Kant. Il a
en vue une philosophie complète, comprenant esthétique ou doctrine de la connaissance
sensible, métaphysique proprement dite, et morale. Pendant l'hiver 1770-1771, j'ai
parcouru tous les matériaux touchant le rapport des principes fondamentaux et des lois
établies pour le monde sensible avec la notion générale de ce qui constitue la nature de la
doctrine du Goût (Geschmackslehre), de l'esthétique, de la métaphysique et de la morale.
J'ai tout examiné, tout pesé, tout mis d'accord. Mais bientôt une pièce se détache de cet
ensemble. Le 4 juin 1771, Kant écrit : Je viens de terminer le plan d'un écrit sur les limites
de la sensibilité et de la raison, et je suis occupé à élaborer, d'une manière un peu plus
développée, un ouvrage sous ce titre. On y trouvera une esthétique, une métaphysique, une
morale... Kant a déjà distingué l'élément sensible et l'élément intellectuel dans la morale. De
même, j'avais depuis longtemps esquissé, à ma satisfaction, les principes du sentiment du
goût et de la faculté de juger, ainsi que leurs effets, l'agréable, le beau et le bon...
L'ouvrage sur les Limites de la sensibilité et de la raison comprendra deux parties : Partie
théorique avec deux sections : la Phénoménologie de l'esthétique en général (le terme
phénoménologie figurera chez la plupart des successeurs de Kant) et la Métaphysique,
considérée seulement dans son essence et sa méthode ; Partie pratique, deux sections
également : Principes généraux du sentiment du goût et des désirs des sens ; Premiers
fondements de la Morale.
Fort occupé par son enseignement et par de très vastes lectures, Kant est constamment
retardé dans l'exécution de son plan. De plus, une question qu'il ne peut pas encore résoudre
à sa convenance l'obsède. Il écrit à Lambert le 6 juin 1771 : Je me demandais à moi-même :
sur quel principe repose la relation avec l'objet de ce que nous appelons en nous
représentations (Vorstellungen) ? Question essentielle que Kant s'accuse d'avoir, comme
tous les autres, omis de poser jusqu'ici. Comment des notions a priori peuvent-elles
s'appliquer à des choses ? Ce problème a reçu deux solutions contraires : l'esprit crée son
objet, c'est la solution idéaliste (intellectus archetypus) ; l'objet crée l'esprit, c'est la solution
matérialiste (intellectus ectypus).
Dans la Dissertation, Kant paraît encore admettre parfois la possibilité d'une connaissance
intellectuelle d'un monde intelligible, et la distinction réelle de deux univers. Mais dans une
lettre du 21 février 1772 à Marcus Herz, il se demande déjà comment des concepts purs de
l'entendement peuvent nous faire connaître un monde sensible distinct de nous. Dans
l'expérience ou la connaissance sensible, nous estimons qu'un objet extérieur détermine
l'expérience, qu'il en est la cause et cela paraît une idée claire. Comment cela est-il
possible ? On conçoit que Dieu, créateur du monde, en ait la connaissance parfaite. Mais
comment l'entendement peut-il, entièrement a priori, se former à lui-même des concepts des
choses, avec lesquels ces choses doivent nécessairement s'accorder ? L'esprit peut donc
connaître une réalité qu'il n'a pas produite et avec laquelle il ne peut pas s'identifier ? Dira-t-
on avec Platon, Malebranche, Leibniz, Crusius, que Dieu réalise lui-même à chaque instant
l'harmonie entre l'esprit humain et le monde extérieur ? C'est là un artifice, un subterfuge, un
pis-aller ! Le problème critique portera précisément sur un point : On cherchera dans les
produits de l'activité mentale, ce que l'esprit y a déposé de lui-même.
Ce sont là les thèmes de deux œuvres, confondues en une seule. Kant est près d'achever la
première partie, qui sera finie dans trois mois. Ce sera la Critique de la Raison pure qui
indiquera sources, méthodes et limites de la métaphysique. La seconde partie : Les
Principes de la Moralité suivra bientôt.
Mais la besogne est de plus en plus difficile et n'est pas terminée en octobre 1773. A la fin
de l'année, Kant espère en finir à Pâques prochaines : Ce sera ma philosophie
transcendantale, où l'on recherche les sources de tous les concepts de la raison, entièrement
pure. Ensuite, je me donnerai à la métaphysique ; métaphysique de la nature et
métaphysique des mœurs. C'est la deuxième (métaphysique des mœurs) que je publierai
d'abord et je m'en réjouis à l'avance. La Critique du Jugement n'est plus mentionnée.
Pendant trois ans, on n'entendra plus parler de rien. Le 24 novembre 1776, Kant écrit à
Marcus Herz qu'on lui reproche de tous côtés son inaction. Pourtant, son travail n'a jamais
été plus actif et plus systématique. Il est en possession des divisions principales de la
Critique de la Raison pure : Critique, Discipline, Canon, Architectonique. La rédaction
retient Kant une partie de l'été 1777. Il s'agit d'arrêter définitivement le vocabulaire. Enfin le
15 décembre 1778 il expédie à Herz le texte de l'Analytique. En juillet 1779, la fin du livre
est annoncée pour Noël. En août 1780, Kant promet toute l’œuvre pour le 29 septembre.
Cependant, le manuscrit, plusieurs fois réclamé, ne sera aux mains de l'éditeur Hartknoch
qu'au début de l'hiver 1780-1781 ; il sera imprimé en avril 1781.
La préparation avait été très longue. Mais la rédaction finale a été faite à la hâte, ce qui ne
va pas sans quelques négligences de style, quelque précipitation et aussi des obscurités
(Kant à Biester, 8 juin 1781). Kant a cinquante-sept ans ; il sent décliner ses forces et veut
aboutir au plus vite. Mais si la forme est ingrate, Kant a mis tous ses soins à bien établir ses
divisions et il tient à son plan. Envoyant la Critique de la Raison pure à Marcus Herz, il lui
écrit : Ce livre contient les conséquences de toutes les recherches variées qui se rattachent
aux notions sur lesquelles nous avions discuté, sous la rubrique du Mundus sensibilis et
intelligibilis. (C'est la Dissertation de 1770.)
Cette Dissertation contenait déjà le programme de toute la philosophie de Kant. De 1773 à
1781, la Critique de la Raison pure se forme et bientôt se précisent les thèmes de la Critique
de la Raison pratique et de la Critique du jugement.
2. La notion de Critique philosophique
La critique peut être entendue en un sens négatif ou en un sens positif. Le sens négatif est
celui de David Hume et des sceptiques. Le sens positif est celui du verbe grec κρινειν juger.
Un juge impartial se prononce sur les prétentions de nos diverses facultés. L'homme ne peut
pas ne pas se poser certaines questions relatives à l'âme, à la nature, à Dieu. Les philosophes
ont donné à ces questions des réponses contradictoires, et cette contradiction a paru justifier
la position des sceptiques, selon lesquels toute métaphysique est impossible. Or, dès 1781,
Kant croit posséder une métaphysique valable. Ne peut-on rendre à la Reine des Sciences, la
couronne que les sceptiques lui ont enlevée ?
Qu'est-ce, en effet, qu'une métaphysique ? Une science qui, dépassant l'expérience, n'est pas
empirique, mais pure et a priori. La notion même d'une connaissance métaphysique
suppose qu'elle ne peut pas être empirique, dira Kant au premier paragraphe des
Prolégomènes. Mais, la critique ne se confond pas avec la métaphysique. Celle-ci ne peut
être qu'un inventaire du contenu de la raison pure. Un tel inventaire entraîne une étude
historique, certes très intéressante, mais entièrement distincte de la Critique.
La Critique doit déterminer le pouvoir de la raison pure considéré en lui-même. Si nous
n'avions que des connaissances empiriques, il n'y aurait pas de métaphysique. Mais nous
possédons de toute évidence une science pure, non empirique – bien connue – la
mathématique. La mathématique est possible et elle nous apporte des vérités indubitables.
Pourquoi, dès lors, la métaphysique serait-elle impossible ? C'est l'existence de la
mathématique qui a donné aux philosophes l'idée qu'une métaphysique est possible. Kant,
on le voit, pose le problème tout autrement que David Hume. Quel est le rapport entre
l'élément venu des choses et l'élément venu de l'esprit ? Entre la forme (esprit) et la matière
(les choses) ? La nature, les choses, exercent, selon Kant, une excitation, une sollicitation
(Reiz) sur l'esprit. Cette excitation est, par nature, hétérogène à l'esprit qu'elle affect
(affiziert) du dehors (comme il est dit dans la première édition de la Critique) ; l'esprit
possède ainsi une réceptivité (Rezeptivität) propre.
Sous quelle forme précise se manifeste donc l'activité mentale ? L'esprit est, avant tout, la
faculté de juger. Toutes nos opérations mentales se ramènent à des jugements (Urtheile) et le
raisonnement, assemblage de jugements, n'est pas une action distincte. Toute science, la
métaphysique comme les autres, est un système de jugements. Or, tous les jugements se
ramènent à deux types : ils sont analytiques, quand le prédicat est contenu dans le sujet ;
synthétiques, si le prédicat B est entièrement hors du sujet A (liegt ganz ausser dem Begriffe
A). Dans le jugement analytique, le prédicat ne fait qu'expliciter le sujet, auquel il est
identique (Erlaüterungsurtheil), comme lorsque je dis : tout corps est étendu. Un jugement
synthétique rapproche au contraire deux notions hétérogènes, par exemple : tout corps est
pesant. On ne peut pas concevoir un corps inétendu, mais un corps sans pesanteur est
concevable. Seule une expérience peut me faire constater la pesanteur. Un jugement
analytique n'étend pas ma connaissance ; il développe ce qui était contenu (bien que parfois
inaperçu) dans le sujet. Au contraire, le jugement synthétique accroît ma connaissance. Cela
est évident pour les jugements empiriques (Erfahrungsurtheile).
Peut-il exister des jugements synthétiques a priori ? Puis-je étendre mes connaissances sans
recourir à l'expérience ? Exemple : je dis : tout ce qui survient a une cause ; ce qui survient
maintenant a donc une cause. Quel est l'X sur lequel l'entendement s'appuie quand, en
dehors de la notion de A, il croit trouver un prédicat, étranger à cet A et qui pourtant lui est
uni ? Il y a là un mystère (Geheimniss). Pour que la métaphysique soit possible, il faut
qu'existent des jugements à la fois synthétiques et a priori, puisque les objets métaphysiques
ne tombent pas sous l'expérience des sens.
Hume, dira Kant dans la préface des Prolégomènes, a démontré de façon irréfutable qu'il
est tout à fait impossible à la raison de penser a priori et par ses propres notions, une
liaison de ce genre. Or, cette liaison enferme la nécessité.
Dès le début, le problème critique se présente donc sous une forme précise. On peut ainsi
concentrer tout l'effort sur un seul point. Par quelle méthode l'aborder ? Chose curieuse,
cette question a donné lieu à des interprétations très différentes du Kantisme.
Un commentateur déjà ancien, Jakob Friedrich Fries (1773-1863), a pensé à une analyse
empirique. D'après lui Kant, sans l'avouer, serait parti de l'expérience interne, comme les
Anglais qu'il réfute. Mais Kant a expressément rejeté le procédé empirique de Locke et de
Hume. Une telle méthode, dit-il, ne peut pas mener à la science nécessaire et démonstrative
que nous cherchons. Pouvant toujours être démentie par une expérience nouvelle,
l'expérience ne peut nous fournir rien de nécessaire. D'autre part, nous savons que
l'expérience pourrait contenir des données a priori, mais il n'est nullement certain que nous
les trouverons. La méthode serait alors non empirique, mais indirecte ou analytico-
hypothétique. La conscience ne peut pas atteindre directement l'activité de l'esprit ; elle
opère seulement sur les produits de cette activité : science, morale, art, technique, religion.
L'analyse critique ressemble donc à celle du chimiste, ou au procédé employé par Newton
dans son Optique. Cette interprétation, celle d'Aloys Riehl, a été adoptée par Émile
Boutroux.
C'est bien ainsi, en effet, que le philosophe a souvent représenté sa méthode. Mais toutes les
sciences n'opèrent pas exactement de la même manière, et la part des données empiriques y
est plus ou moins grande. Par exemple, en 1785, dans les Principes métaphysiques d'une
Science de la Nature, Kant utilisera des notions que ne sont pas directement empiriques :
masse, force, mouvement, vitesse, égalité d'action et de réaction, priorité du mouvement
circulaire..., c'est-à-dire des notions empiriques plus ou moins profondément élaborées. En
ce cas, le philosophe doit rassembler des expériences, en isoler des définitions, tenter de
justifier ces définitions, ce qui suppose des tâtonnements.
Enfin, plusieurs continuateurs de Kant, Fichte, Schopenhauer, parfois Hegel, et d'autres
interpréteront la méthode dans un sens constructif, impliquant un progrès de l'esprit, livré à
lui-même. Elle ressemblerait à celle de Descartes dans les Méditations. Supposant le
problème résolu, la raison avancerait, sans recours à l'expérience, par une suite de synthèses
a priori ou de constructions.
En réalité, la méthode de Kant n'est nullement uniforme. Si l'on dépouille méthodiquement
ses notes, sa correspondance, on constate que deux opérations alternent dans toutes ses
démarches. En premier lieu une observation intérieure parfois très subtile ; en second lieu
une sorte d'induction, à partir de divisions et de classifications logiques ou de définitions
établies à partir de l'expérience. Souvent aussi, Kant raisonne sur de simples définitions de
mots et il fait, en somme, flèche de tout bois.
3. Le plan de l’œuvre critique en général
Kant s'est proposé de rivaliser avec Aristote, dont il avait une connaissance approfondie et
qu'il admirait beaucoup. Or la doctrine d'Aristote s'était développée selon un plan invariable,
celui d'un enseignement encyclopédique. Aristote avait créé pour son œuvre, en utilisant les
recherches de ses devanciers, non seulement des cadres, mais un vocabulaire constant,
auquel il était demeuré remarquablement fidèle. La pensée de Kant, beaucoup plus que celle
d'Aristote, a varié en plus de trente ans. Kant a voulu composer une encyclopédie ; dans
cette entreprise, il a rencontré des problèmes auxquels il n'avait pas toujours pensé au
début ; il a utilisé des faits qu'il ignorait primitivement. Il faut passer en revue les
productions de nos facultés mentales pour découvrir, en chacune, ce qu'elle peut renfermer
d'éléments a priori provenant de notre esprit. La classification des facultés et celle des
sciences existantes vont donc se commander réciproquement. La classification kantienne
des facultés humaines vient d'Aristote : connaissance vulgaire, science (Mathématiques,
Physique, Histoire naturelle) ; technique (à cette rubrique se rapportent les arts) ; Droit,
Politique, Morale, Religion. Chacune de ces activités met en jeu les mêmes pouvoirs
intellectuelles. Kant distingue d'ordinaire six facultés principales, qui se ramènent à trois,
chacune d'elles renfermant une partie supérieure et une partie subordonné. Ces trois facultés
sont Entendement (Verstand), Sensibilité (Sinnlichkeit), Pouvoir de désirer
(Begehrungsvermögen). Chacune se divise en deux : l'entendement comprend une partie
supérieure : l'intelligence intuitive ou la Raison (Vernunft), au sens propre du terme, définie
d'une manière très particulière chez Kant, et l'intelligence discursive (Verstand) qui se
confond avec le pouvoir de juger (Urteilskraft). Ces deux facultés sont pures (rein). La
sensibilité comporte deux divisions : une partie intuitive ou sensibilité pure, reine
(Sinnlichkeit), dont Kant se flatte d'avoir, le premier, établi l'existence ; une sensibilité
empirique (sensations et perceptions internes et externes) ; et des formes pathologiques,
dans la mesure où les sensations sont accompagnées d'émotions ou de passions diverses.
Enfin la faculté de désirer comprend, elle aussi, une partie inférieure, l'instinct, l'impulsion,
le désir (Instinkt, Trieb, Begierde) irrationnels, et une partie supérieure. Cette dernière sera
identifiée à la raison pure, devenue volonté ou principe d'action et caractérisée par la liberté,
la Raison pure pratique.
Ces divisions tranchées et les définitions qui les justifient sont rendues nécessaires par le
caractère systématique propre, selon Kant, à toute science authentique. Mais le philosophe
sait que des compartiments aussi bien délimités n'existent jamais en fait. Ce que nous avons
toujours sous les yeux dans le monde réel, c'est l'homme complet, en lequel les oppositions
s'effacent parce que l'on passe par transitions insensibles d'un aspect à l'autre de son
activité ; c'est une unité réelle et fondamentale. L'unité est, en effet, le caractère essentiel de
la nature humain. Cette nature ne peut être comprise que si l'on a en vue, à la fois, toutes ces
facultés dans leur jeu simultané. C'est ce qui sera admis dans les trois Critiques, dans la
Religion dans les limites de la seule raison, et encore dans le Conflit des Facultés de 1798.
Kant n'ignore pas non plus le rôle des impressions venues du corps, des états de santé ou de
maladie, et aussi de l'exercice et de l'éducation. Mais ces considérations n'appartiennent pas
à la Critique proprement dite. Elles relèvent de l'Anthropologie, à laquelle Kant a
longuement réfléchi par la suite.
Ainsi, le plan initial devra s'élargir à mesure que le développement de l'enquête montrera
des domaines mitoyens entre deux ou plusieurs facultés. Ces flottements ont dérouté les
premiers lecteurs de Kant, habitués aux exposés des empiristes britanniques, aux
classifications de Wolff, et aux simplifications des Encyclopédistes français.
La Critique de la Raison pure concerne à peu près exclusivement les facultés de
l'Intelligence (parfois dans leurs applications techniques et pratiques), donc de l'Intelligence
théorique. Les produits de l'activité mentale qui font l'objet de la première Critique se
rapportent à la science sous ses deux formes principales : sciences mathématiques et
sciences de la nature.
Mais comment ne pas y adjoindre la métaphysique, ou les tentatives pour connaître
directement le monde intelligible, tentatives étroitement mêlées aux entreprises des sciences
mathématiques et physiques ? En effet, c'est de ce côté qu'apparaissent les difficultés les
plus graves soulevées par l'exercice normal de nos facultés. Tous les métaphysiciens et de
nombreux savants sont venus se heurter à ces difficultés, sans parvenir à les vaincre. Quelle
est la cause de ces échecs répétés ? Ce sera une des questions principales traitées dans la
Critique de la Raison pure. Pour couper court aux controverses, il fallait naturellement
définir la limite au-delà de laquelle nos facultés perdent leur pouvoir. Dans quels domaines
pouvons-nous obtenir des résultats certains et indubitables ? Dans quels domaines toute
conclusion précise nous est-elle interdite ? Quand enfin pouvons-nous énoncer des
hypothèses raisonnables ? Kant sait déjà en 1781 que les domaines moral, technique,
artistique, religieux, font partie de ce dernier groupe.
La Critique de la Raison pure (théorique) sera divisée en quatre parties de longueur
inégale : 1. Enquête sur la présence d'éléments a priori ou purs dans la sensibilité elle-même
(esthétique transcendantale). 2. Analyse des fonctions de l'entendement pur, des jugements
et raisonnements intellectuels. Cette analyse isolera ce qui appartient à l'entendement ou à la
raison, ce qui ne peut venir ni de la sensibilité empirique, ni de la sensibilité pure. L'analyse
nous découvrira des notions ou concepts propres de l'entendement et des principes dont
l'entendement fait usage pour donner ses représentations. C'est l'objet de l'Analytique
transcendantale. Il ne suffit pas d'ailleurs de dénombrer ou d'expliquer concepts et
principes ; il faut montrer comment les uns et les autres peuvent déterminer et utiliser les
données fournies par la sensibilité pure et la sensibilité empirique, distinguées dans
l'esthétique transcendantale. Ce sera l'objet de l'exposition et de la déduction
transcendantales, les parties les plus difficiles de la première Critique.
La troisième partie relèvera les difficultés propres à une Métaphysique relative au monde de
l'expérience et au monde intelligible. Cette troisième partie, la Dialectique transcendantale,
indiquera les points sur lesquels une contradiction paraît inévitable : existence et nature de
l'âme humaine, spiritualité et immortalité de l'âme, existence et structure de l'univers où
l'action humaine s'exerce. Le monde est-il fini ou infini ? éternel ou créé ? les faits s'y
enchaînent-ils d'une manière nécessaire, ou des actes libres peuvent-ils s'y introduire ?
Enfin, existe-t-il ou non un Dieu distinct du monde et peut-on, dans une certaine mesure,
connaître la nature de ce Dieu ?
Cette analyse des sciences et de la métaphysique permettra de mieux définir les procédés
valables pour la recherche philosophique : ce sera l'objet de la quatrième partie ou
Méthodologie transcendantale.
Au terme de ces recherches, nous pourrons répondre à la première question essentielle : Que
pouvons-nous savoir ? Le résultat ne sera pas uniquement négatif. Nous n'aurons pas
seulement délimité les régions interdites à nos facultés. Nous serons rassurés sur la
légitimité d'une partie de notre science ; celle qui ne dépasse pas les bornes fixées par la
nature. De plus, nous saurons que certaines hypothèses concernant le « monde intelligible »
ne sont pas exclues, mais que la Métaphysique doit se contenter de croyances raisonnables
et ne peut en général prétendre à la certitude logique. Nous saurons que la raison ne peut
étendre son usage qu'en devenant pratique ou technique, et le terrain sera déblayé pour la
morale, l'art, la technique, la religion. Il appartiendra à d'autres Critiques de donner une
réponse aux deux autres questions vitales : Que devons-nous faire ? Que pouvons-nous
espérer ?
4. Le vocabulaire critique
Kant est, avec Aristote, saint Thomas, Leibniz, Hegel, un des plus grands fabricants de
définitions que l'on connaissance. Son vocabulaire paraît bizarre, mais il est moins neuf
qu'on ne le dit. Le vrai créateur du vocabulaire philosophique allemand est Christian Wolff,
car les écrits philosophiques allemands de Leibniz sont longtemps restés peu connus. Kant a
utilisé Wolff, mais il a inventé des expressions nouvelles.
Voici quelques-uns des termes techniques essentiels du Kantisme :
A) Erscheinung-Phaenomenon. C'est la matière brute des impressions sensibles (roher Stoff
sinnlicher Empfindungen) ce qui apparaît (apparentia). Mis en ordre par l'esprit, les
phénomènes deviennent représentations (Vorestellungen) groupées dans l'expérience
(Erfahrung), le premier produit de l'entendement, faculté de l'esprit travaillant sur le
phénomène brut. Kant comprend, dans l'expérience, les connaissances (Erkenntnisse) qui
nous donnent des représentations d'objets et ces objets eux-mêmes (Gegenstände).
B) Ding an sich (chose en soi). Au phénomène s'oppose la Chose en soi, telle qu'elle est en
elle-même, telle qu'elle est avant l'intervention de notre esprit, si elle pouvait nous être
présente. Cette chose sera appelée Noumenon (noumène, objet de l'intellection, partie d'un
ordre intelligible, si l'esprit humain avait accès à un tel ordre). Mais le terme « Noumène » a
initialement un sens péjoratif.
C) Transcendent (transcendant), conformément à l'usage commun, tout ce qui dépasse le
domaine des phénomènes ou de l'expérience.
Transcendentale (transcendant), toute condition de possibilité de connaissance qui s'occupe
non des objets, mais des notions a priori d'objets en général, c'est-à-dire de ce qui existe
dans l'esprit avant tout expérience et nous permettrait d'atteindre des objets, en unissant ce
qui vient de l'esprit et ce qui vient des choses.
D) Les facultés de l'esprit sont : la Sensibilité (Sinnlichkeit) ; l'Entendement (Verstand) ou
intelligence en général et plus spécialement l'entendement discursif et facultés des concepts,
διανοια ; la Raison (Vernunft, Ratio, Νοΰς), partie supérieure du Verstand ou facultés des
Principes ; la faculté de juger (Urtheilskraft), qui désigne une catégorie spéciale de
jugements mixtes, différents de ceux que formule l'entendement ; la faculté de désirer
(Begehrungsvermögen). Cette faculté devient Volonté (Wille), quand elle est pénétrée de
raison, sinon, elle se confond avec la sensibilité pathologique (plaisir, douleur, émotions,
passions variées, ensemble des sentiments et désirs). Il y a, nous le verrons, une Volonté
pure (reiner Wille), d'où tout élément empirique et pathologique est exclu ; cette faculté se
confond avec la Raison pure appliquée à l'action, avec la Raison pure devenue pratique. Au
sens propre du terme, l'entendement est ainsi la faculté de former des notions ou des
concepts (Begriffe), tandis que la Raison opère par principes (Grundsätze). Il y a de
l'universel dans tous les concepts et plus encore dans tous les principes. Nous rencontrerons,
chemin faisant, d'autres termes techniques, pris à la philosophie classique, ou fabriqués par
Kant, suivant les besoins de ses démonstrations.
Le dédoublement, ou le détriplement des notions classiques, rend difficile l'application
invariable de toutes les classifications prévues, de même qu'il rend malaisée la distinction de
ce qui appartient à chaque faculté, de ce qui appartient à l'esprit et de ce qui dépend du
corps. Kant rencontre, en effet, sous une forme différente, l'obstacle qui avait amené
Descartes à distinguer entre l'âme et le corps, la région intermédiaire, variable et mal
définie, de l'Union de l'âme et du corps.
En somme, Kant restera toujours hanté par l'opposition du Mundus Sensibilis et du Mundus
intelligibilis ; on le verra par l'examen de la morale, de l'esthétique, de la politique
kantiennes. L'action, considérée sous sa forme la plus haute, la Création par liberté,
permettra le passage progressif, du monde sensible, siège de la nécessité, du mécanisme des
causes et de leurs effets dans le temps, au monde intemporel des esprits, de la contingence et
de la liberté.
II. La sensibilité pure et l'esthétique transcendantale
1. La sensibilité et ses formes « a priori » dans la Critique
Ce problème a été étudié dans la Dissertation de 1770, et, sur ce point, la Critique de la
Raison pure enregistre, sans changements notables, les résultats obtenus dans la
Dissertation. Deux nouveautés seulement : l'ordre est renversé et Kant traite d'abord de
l'espace. Il distingue aussi, ce qu'il ne faisait pas encore, une exposition métaphysique et une
exposition transcendantale. La première traite des caractères généraux des deux notions
d'espace et de temps. La seconde montre que ces deux notions contiennent des éléments a
priori, présents partout où apparaissent espace et temps. D'où l'existence d'une sensibilité
pure, ce qui est, selon beaucoup d'interprètes, une des découvertes fondamentales de Kant.
Les deux mots sensibilité et pure paraissent au premier abord inconciliables ; l'objet d'une
telle sensibilité ne lui est pas extérieur ; il réside en elle-même et pourtant il sera tenu, dans
un certain sens, pour extérieur à l'esprit. Cela revient à dire qu'il y a dans l'esprit une partie
inconnue ou qui est extérieure à la conscience.
Kant pose en principe que toute connaissance d'objets (Gegenstände) a lieu en bloc par
vision ou par intuition (Anschauung). Cette intuition n'est possible que si l'esprit (Gemüth)
est affecté dans une certaine mesure par l'objet ou la chose. La sensibilité nous livres des
intuitions qui, élaborées par l'esprit, deviennent des concepts (Begriffe, de begreifen, saisir,
concevoir). Aucun objet ne peut nous être donné, là où il n'y a pas d'intuitions sensibles.
Kant appelle impression (Empfindung) l'action de la chose sur la faculté de représentation
empirique. Le phénomène (Erscheinung) est l'objet de cette intuition empirique. Kant
appelle Matière dans le phénomène, ce qui vient de l'impression, du divers (Mannigfaltige)
des phénomènes ; et il nomme forme ce qui ordonne les phénomènes selon des relations
variées. Sont pures, les représentations de l'esprit, dans lesquelles ne figure aucun élément
venu de l'impression. L'intuition pure est ainsi la première des formes qui ordonnent les
représentations. L'Esthétique transcendantale traite des ingrédients d'une sensibilité pure a
priori. Il faut isoler cette sensibilité de tout le reste des fonctions mentales, par exemple
l'entendement, puis, dans la sensibilité elle-même, séparer ce qui ne vient pas de
l'impression ; le résidu sera la forme ou la sensibilité pure.
Cette analyse implique deux démarches : exposition métaphysique et exposition
transcendantale. La première isole l'intuition pure que l'expérience seule ne saurait fournir.
La seconde établit que cette intuition pure nous fournit des connaissances a priori certaines,
ou scientifiques. Ces deux expositions se mêlaient encore en 1770.
Kant pose en ces termes les deux problèmes qu'il va résoudre : 1° Isoler de la sensibilité
tout ce que l'entendement pense en elle, par ses concepts, de telle façon qu'il ne subsiste
plus en elle que l'intuition empirique ; 2° Séparer de l'intuition empirique, tout ce qui
appartient à l'impression (Empfindung), de telle façon qu'il ne reste plus que l'intuition pure
et la simple forme des phénomènes, c'est-à-dire l'unique chose qu'une sensibilité a priori
puisse donner. Ainsi : 1° On sépare dans l'impression tout ce qui est d'origine intellectuelle ;
2° Dans le résidu sensible qui demeure après cette opération, on distingue ce qui est dû à
une action des choses et ce qui provient de la sensibilité réduite à l'élément pur et a priori.
Ces propositions sont énoncées, mais non démontrées. L'essai tenté montrera seul, par le
fait, qu'elles sont légitimes. Une vérification complète implique toute la Critique.
Les définitions de Kant sont paradoxales aux yeux d'un philosophe habitué à la
métaphysique traditionnelle. La tradition ne connaît que l'intuition intellectuelle. L'intuition
intellectuelle, d'après les classiques, ne porte que sur des objets extérieurs à l'esprit humain
(Dieu et les Idées), ou à la fois présents à l'esprit et réels en dehors de lui (comme l'admet
par exemple Descartes). Kant, conscient de son paradoxe, l'indiquera, dans les
Prolégomènes, par une curieuse formule : Comment l'intuition d'un objet peut-elle précéder
cet objet ?
Kant pose comme évidente cette proposition : il ne peut exister que deux éléments a priori
d'une sensibilité pure ; l'espace, « forme » du sens externe ; le temps, « forme » du sens
interne. Le sens externe nous représente, dans l'espace, des objets extérieurs (grandeurs,
figures, relations). Le sens interne ne nous offre pas, comme le sens externe, une sorte de
vision globale de la vie intérieure ou de l'âme. Mais tous les objets du sens interne (idées,
sensations, sentiments, volitions, désirs, etc.) sont perçus dans le temps et ordonnés en lui.
Les objets externes, dans la mesure où nous nous les représentons à la conscience, doivent
donc passer par le sens interne, si bien que le sens interne a la priorité. Ce sont là des faits
évidents et indémontrables logiquement, par quelque procédé que l'on imagine. D'autres
notions auxquelles on pourrait recourir, par exemple celle du mouvement, font intervenir des
éléments fournis par l'expérience sensible et qui par suite ne sont pas purs.
L'exposition métaphysique va établir directement que les notions d'espace et de temps sont
a priori et non empiriques. L'exposition transcendantale montrera qu'elles sont fécondes,
génératrices de jugements synthétiques a priori. Elle pourra être très brève.
Exposition métaphysique du concept d'espace. – Elle emploie trois arguments : 1. La notion
ne peut pas venir de l'expérience : en effet, une impression (Empfindung) ne peut pas être
rapportée à des objets extérieurs, si la notion globale d'espace ne nous est pas préalablement
présente. La vision du tout précède, pour l'espace, celle des parties ; 2. La notion d'espace
est une représentation a priori. En effet, on peut bien concevoir un espace vide d'objets.
Mais on ne saurait concevoir un objet qui n'occuperait aucun espace. L'espace est donc
condition de la possibilité des phénomènes ; 3. L'espace n'est pas un concept général,
abstrait, de relations. Les espaces particuliers sont tous fragments d'un espace unique. Mais
ils ne sont pas des parties constituantes simplement additionnées ; ils sont données en lui.
Tout objet particulier suppose une limitation de l'espace global. Donc, l'espace est connu par
une intuition globale. De même, les propriétés du triangle ne se déduisent pas des propriétés
de l'angle ou de la ligne ; elle supposent une vision ou intuition d'ensemble du triangle, dans
l'espace, distincte de celles de l'angle ou de la ligne.
Exposition transcendantale du concept d'espace. – Nous connaissons donc les propriétés de
l'espace par des jugements synthétiques a priori, et la géométrie est faite d'une série de tels
jugements. Elle démontre ses proportions par superpositions et constructions dans l'espace,
et nullement par une simple analyse de notions abstraites. Or les propositions géométriques
ont une certitude démonstrative, apodictique, née des constructions. Nous sommes captifs
de leur vérité, dès que nous l'avons clairement appréhendée. Un raisonnement n'y suffit pas :
il faut aussi la vision, l'intuition des figures.
Exposition métaphysique du concept de temps. – La notion de temps n'est pas tirée de
l'expérience, mais précède et rend possible l'expérience. Sans l'intuition préalable d'un
temps global, nous ne pouvons percevoir ni succession, ni simultanéité. D'autre part, on peut
bien concevoir un temps sans événements, un temps vide. Mais on ne peut percevoir aucun
phénomène en dehors du temps, condition de la possibilité des phénomènes, ni aucun temps
séparé de tout phénomène.
Exposition transcendantale du concept de temps. – Elle est courte. Le temps n'a qu'une seule
dimension ; il se développe suivant une ligne dont l'instant présent est l'extrémité. On ne
peut d'ailleurs se représenter des événements simultanés sans faire appel à la notion
d'espace, et sans la combiner avec celle du temps. D'autre part, le temps est la condition du
changement et du mouvement. Ceux-ci sont inconcevables sans le temps, puisque deux états
contraires ou différents d'un même objet au même instant se détruiraient l'un l'autre.
De cette double exposition, il résulte que l'espace et le temps ne sont pas des choses données
hors de nous, et que ce ne sont pas non plus des concepts abstraits. À ce résultat négatif
s'ajoute un résultat positif : temps et espace sont des intuitions sensibles pures a priori. Ces
caractères ne peuvent appartenir à aucun objet physique ou intellectuel. Par exemple,
l'espace n'est pas, comme l'affirmait Newton, une chose en soi. Ce n'est pas, comme
l'affirme Leibniz, un effet des choses en soi mises en relations. Ce ne peut être une illusion,
analogue aux qualités secondes de la matière. On ne peut cependant attribuer l'espace qu'à
des objets sensibles. Il en est de même du temps qui n'est ni chose en soi, ni effet de
relations entre des choses en soi. Il est lié au changement, mais le changement, à la
différence du temps, est un objet. Le temps n'est pas une illusion, une qualité seconde, non
plus qu'une idée ou un concept abstrait.
Il existe une différence entre temps et espace. Le temps est plus général que l'espace. Il vaut
à la fois pour les phénomènes externes et pour les faits de conscience. C'est la forme
générale de tous les phénomènes internes et externes, au lieu que l'espace ne s'applique pas
au sens interne.
Quelle est donc la nature de l'espace et du temps, ou celle du monde des phénomènes, tel
qu'il apparaît dans ces deux formes ? Deux formules résument cette nature : réalité
empirique, idéalité transcendantale. Tous les objets donnés dans l'espace et dans le temps
sont réels pour l'expérience ; et l'espace, le temps, sont aussi réels en ce sens. Nous sommes
forcés de nous comporter comme si l'espace et le temps étaient réels, n'étaient pas une
illusion ou une apparence (Schein).
Cependant, temps et espace ont un caractère idéal, dans la mesure où ils nous apportent des
connaissances pures, a priori. Kant dira, dans la seconde édition de la Critique de la Raison
pure, que l'affirmation de la réalité transcendantale de l'espace et du temps peut conduire à
nier l'existence du monde sensible – à la doctrine de Berkeley. En effet, la géométrie nous
amène à reconnaître à l'espace et au temps des propriétés invérifiables par l'expérience, ou
même directement contraires à l'expérience ; homogénéité, divisibilité à l'infini, etc. Un
espace et un temps objectivement réels seraient des monstruosités (Undinge, des choses
impensables).
Espace et temps ne sont concevables sans contradictions que rapportés à une réalité
intérieure, mais d'ordre non intellectuel. Par exemple, une propriété telle que la dissymétrie
de deux figures planes ou solides identiques, relève de la sensibilité seule. Aucune raison ne
m'apprendra pourquoi le gant de ma main droite, identique par la grandeur et la forme à
celui de ma main gauche, ne lui est pas superposable. Il y a donc une sensibilité pure, que
l'entendement ne peut concevoir et dont toutes les déterminations ne sont pas logiques. On
ne peut construire logiquement l'espace et le temps, car la sensibilité, même pure, n'est
jamais réductible à l'entendement. Essayer la réduction, c'est simplement supprimer les
objets. Kant se flatte d'être parvenu sur ces points à une certitude parfaite et mathématique :
La méthode suivie est aussi certaine et aussi indubitable qu'on peut l'exiger d'une doctrine
qui doit servir d'Organon (ou d'instrument de recherche).
2. L'espace et le temps dans les « Prolégomènes »
Deux ans après la première Critique, Kant a repris le sujet dans les Prolégomènes en
simplifiant l'exposition de 1781. La philosophie, dit-il, utilise des concepts (Begriffe) ; la
mathématique use d'intuitions (Anschauungen). Elle construit les figures dans l'espace et les
nombres dans le temps. Comment pouvons-nous avoir l'intuition d'un objet à construire,
avant que cet objet soit donné ? Comment l'intuition d'un objet peut-elle précéder cet objet ?
Elle ne peut pas le représenter à l'avance, car alors elle serait empirique, avant l'expérience.
Il faut donc une intuition intérieure. N'est-ce pas absurde, puisqu'une faculté ne peut guère
se voir elle-même ? En fait, l'intuition de l'espace et du temps ne fonctionne que lorsque des
objets sont donnés dans l'espace et dans le temps. Elle ne peut donc être que formelle et non
intellectuelle. En effet, l'entendement humain ne possède pas de facultés intuitives ; il ne
peut que réfléchir (Schaut nichts an, reflectiert nur).
3. Obscurités de la théorie de Kant
Claire et séduisante quand on l'expose incomplètement, la théorie de Kant est en réalité
complexe et ambiguë, comme l'a bien montré Hans Cornelius dans son Commentaire de la
Critique. Qu'il suffise d'indiquer les difficultés les plus graves.
A) Temps et espace mis à part, que reste-t-il pour les choses en soi ? Kant répond : le
« divers » de l'intuition, le désordre, le chaos complet (das mannichfaltige der Anschauung,
ein Gewühl). Cependant, ce « divers » n'est pas le simple néant. En effet, sans les choses,
sans les perceptions qu'elles nous procurent, l'espace, le temps, vides, ne seraient rien. Nous
ne pouvons pas nous représenter un espace et un temps vides. Pas de perception sans une
excitation (Reiz) venue des objets. Mais le résidu qui demeure quand l'espace et le temps
sont enlevés n'a plus aucun ordre. Kant admet donc a priori, que la réalité extérieure n'a
aucun ordre propre, aucune liaison interne. De même l'analyse de l'entendement établira que
ni l'unité, ni la causalité, ni l'action réciproque des objets ne résident dans les objets eux-
mêmes, mais seulement dans l'esprit. D'autre part, la succession touche à la fois les
événements internes du sujet pensant et les événements extérieurs. Mais la simultanéité
n'existe que dans l'espace. Elle est absente des faits de conscience. Elle ne pourra y être mise
que par un usage illégitime de la notion d'espace. Cette obscurité fournira le point de départ
de la théorie de Bergson.
B) Kant admet cependant une réalité du monde sensible. Mais, le mot de réalité a plusieurs
sens dans le langage kantien. La réalité sensible est première. C'est celle du phénomène, de
l'Erscheinung, la réalité empirique. Elle comporte un élément inaccessible venue des choses.
Au contraire, le monde intelligible, s'il est réel, a un caractère fort différent. Sa réalité ne
peut jamais être connue par intuition, elle est idéale. Or l'idéalisme kantien ne concerne pas
les objets, mais l'espace et le temps. Pourtant l'espace et le temps ne sont pas « idéaux », au
même sens que les Idées platoniciennes. Ils sont tels en tant que déterminations venues de
notre esprit. La notion de réel est donc très malaisée à définir dans le Kantisme et nous en
verrons bientôt les conséquences.
C) Quel élément l'espace et le temps ajoutent-ils donc aux objets de l'intuition sensible ?
Kant répond : un ordre. Quel ordre ? Uniquement une disposition simultanée ou successive,
une possibilité de construire. Temps et espace ne fournissent par eux-mêmes ni volume, ni
figure, ni distinction des instants, etc. Pour définir ces caractères, il faudra l'intervention de
l'entendement et de la raison discursive. C'est ce que le philosophe explique dans un passage
de la première Critique. Notre connaissance naît de deux sources essentielles de l'esprit. La
première consiste à recevoir des représentations (faculté de recevoir, réceptivité des
impressions). La seconde est le pouvoir de reconnaître un objet par l'entremise de ces
représentations (la spontanéité des concepts). L'ordre des objets dans l'espace et le temps
implique donc une intervention de l'entendement, ajoutée à la sensibilité pure a priori.
D) Kant ne prouve aucune de ses affirmations. Il se contente de les énoncer en termes
tranchants. S'agit-il, par exemple, de la différence entre intuition et pensée discursive ? Il
dira : Toute pensée doit, directement ou par détour, grâce à certains indices, se rapporter en
nous à la sensibilité parce qu'un objet ne peut pas être donné d'une autre façon. Ailleurs,
pour montrer que temps et espace ne sont pas des concepts, il se réfère à Newton et
mentionne l'homogénéité, les figures dissymétriques, la symétrie, toutes propriétés qui,
selon lui, n'auraient rien d'intelligible. Mais cela ne suffit pas à démontrer la thèse. Un
espace et un temps vides seraient des monstres (Undinge). Mais ne pourrait-on concevoir un
espace et un temps pleins, qui ne seraient ni homogènes ni symétriques ?
Ne pourrait-on dire aussi que les idées d'homogénéité et d'isotropie sont le résultat d'un
travail d'abstraction ? Bref la théorie de Kant est ingénieuse et séduisante. Elle n'est pas
aussi solide que le croyait son auteur. C'est pourtant, de toutes les parties théoriques de
l’œuvre kantienne, celle qui a excité l'admiration la plus vive et qui, avec certaines parties
de la morale kantienne, garde le plus d'attrait pour beaucoup d'esprits.
La Logique transcendantale : Analytique des concepts et des principes
Nous savons par l'Esthétique transcendantale que la sensibilité renferme des éléments purs
et a priori. Il reste à explorer de la même manière les facultés intellectuelles. La logique
transcendantale est, de toutes les parties de la première Critique, celle qui a demandé à Kant
les plus grands efforts. Elle donne au lecteur l'impression d'un système artificiel, et
beaucoup d'interprètes ont insisté sur le caractère arbitraire des divisions adoptées par Kant.
En fait, l'artifice apparaît plus dans la forme que dans le fond et Kant a multiplié les
observations pénétrantes.
I. Objet de la Logique transcendantale
Que reste-t-il dans l'esprit quand on a mis à part les formes de la sensibilité pure ? Des
impressions sensibles d'une part, de l'autre des concepts (Begriffe) ou des moyens de penser
d'une manière discursive, de juger et de raisonner, puisqu'il n'existe pas d'intuition
intellectuelle. Sans la sensibilité il ne serait pas donné d'objet. Sans l'entendement
(Verstand), aucun objet ne pourrait être pensé (gedacht). L'opération de l'entendement, au
sens large, c'est la pensée (Denken), le pouvoir de concevoir, de saisir, de comprendre
(begreifen), non celui d'avoir des intuitions. Mais intuition sensible et concept sont toujours
unis : Des pensées sans contenu sont vides (leer), des intuitions sans concept sont aveugles
(blind). L'entendement est dans l'impossibilité d'avoir aucune intuition. Les sens sont dans
l'impossibilité de penser quoi que ce soit. Ces deux facultés ne peuvent échanger leurs
fonctions (die Funktionen vertauschen) ni permuter l'une avec l'autre.
La logique a pour objet l'étude des concepts. Mais la logique transcendantale diffère de la
logique classique. Cette dernière se divise en une logique générale, valable pour toutes les
activités de l'entendement, et en autant de logiques spéciales qu'il existe de sciences
particulières. Ainsi l'ont conçue les logiciens de Port-Royal.
Kant distingue une logique pure et une logique appliquée. La première a pour objet l'étude
de l'entendement pur, et elle est à la fois générale et pure. L'entendement pur qu'elle étudie
est avant tout une faculté active, qui accomplit des actions (Handlungen). Il faut, pour
concevoir cette faculté, partir de la notion de vérité. On dit souvent : la Vérité implique deux
sortes de conditions. Les premières concernent l'accord de la pensée avec les objets, les
secondes l'accord de la pensée avec elle-même. Mais la première catégorie de conditions
nous échappe. L'objet lui-même (die Sache), l'intuition sensible, le divers, est inconnaissable
en tant que tel. Reste l'accord de la pensée avec elle-même, objet, dans le schéma classique,
de la logique formelle. Or, la logique formelle est insuffisante pour deux raisons. Les
logiciens se persuadent qu'ils ont dégagé des règles qui leur permettraient d'étendre leurs
connaissances a priori, sans faire appel à l'expérience. Mais cela est impossible. D'autre
part, ils se contentent du principe de contradiction qui ne suffit pas. Il existe d'autres lois,
dues à la structure même de notre pouvoir de penser, car la pensée est la condition de
l'expérience. Le système de la logique classique est donc inutile. Ce qu'il faut, c'est un
instrument, un organon, fixant les lois d'un usage efficace de l'esprit : ce sera l'objet de la
Logique transcendantale.
Une telle logique ne définit pas de règles ; elle cherche les conditions a priori qui rendent
possibles les règles elles-mêmes. Son objet est de dénombrer exactement les éléments a
priori de l'entendement, de montrer jusqu'à quel point ces éléments peuvent fournir des
connaissances a priori. La logique transcendantale détermine les conditions mentales faute
desquelles aucun objet ne peut être pensé. Ces conditions sont des concepts ou des principes
(Grundsätze) liés à ces concepts et qui règlent leurs opérations. L'entendement forme une
unité active et vivante dont concepts et principes déterminent les fonctions principales et les
opérations ou directions.
II. Concepts de l'Entendement pur ou Catégories
1. La dissection de la faculté de juger
De tels concepts doivent être purs, dépourvus de tout élément sensible, primitifs ou
élémentaires, donc distingués avec soin de ce qu'on en peut déduire. La liste sera complète.
Ils doivent, puisque l'entendement est un, former un ensemble, un système. Bref, il faut
procéder à un « démembrement » du pouvoir même de l'entendement (eine Zergliederung
des Verstandesvermögen selbst).
Comment procéder à cette dissection de l'entendement ? Il faut distinguer d'abord le procédé
de recherche et la méthode de l'exposition. L'ordre systématique vrai ne se découvrira qu'à
la fin de l'analyse. Nous trouverons ces concepts un à un, en désordre. Puis, nous les
mettrons en ordre, sans les déduire, mais en cherchant un principe qui permettra de les
classer.
Ce principe est manifeste. Tout les concepts traduisent, on l'a vu, une seule activité générale
de l'entendement ou de la faculté de juger (Urtheilskraft). La spontanéité, l'activité de
l'entendement ne se manifestent que par des jugements. Juger, c'est appliquer une notion à
un objet. Par exemple je dis : tous les corps sont divisibles. J'acquiers ainsi une
connaissance d'un objet, le corps. Cette connaissance n'est pas immédiate, mais médiate,
grâce à une notion qui, dans cet exemple, est fournie par l'intuition de l'espace. Tout
jugement, en ce sens, opère une unification et les divers types de jugements expriment des
formes variées d'unification.
Le plus simple est donc de partir de la classification ordinaire des jugements qui remonte à
Aristote. Les jugements ont une qualité : ils sont affirmatifs ou négatifs ; ils ont une
quantité : ils sont universels ou particuliers. Ils expriment une relation : ils sont
catégoriques ou hypothétiques. Ils expriment une modalité : ils sont assertoriques ou
problématiques.
Kant, on le voit par ses notes, a tourné et retourné en tous sens ces définitions, et finalement,
il a trouvé douze types de jugements, répartis en quatre groupe de trois : quantité, qualité,
relation, modalité.
quantité: jugements universel, particuliers (besondere), singuliers (einzelne) ;
qualité : jugements affirmatifs, négatifs, indéterminés ou indéfinis (unendliche) ;
relation : jugements catégoriques, hypothétiques, disjonctifs ;
modalité : jugements problématiques, assertoriques, apodictiques.
Kant énonce, à propos de cette classification, diverses remarques grâce auxquelles nous
pouvons mieux en saisir le sens : 1. Selon les logiciens, les jugements singuliers sont une
variété des jugements universels, car l'attribut y est affirmé de tout le sujet. Or, cela est faux
en réalité, puisque le singulier n'est qu'un fragment de l'universel. 2. Les jugements indéfinis
dans l'ordre de la qualité placent un individu dans un groupe dont l'extension n'est pas
définie. Si je dis l'âme est immortelle (unsterblich), le jugement est de forme négative, mais
l'extension du groupe non mortel, dans lequel je range l'âme, n'est pas indiquée, peut-être
parce que je l'ignore. 3. Les deux derniers groupes concernent non seulement des jugements
isolés, mais des séries de jugements, liés entre eux par des raisonnement (le raisonnement
étant formé de jugements). Par exemple, dans le groupe relation, deux notions peuvent être
simplement liées comme un attribut et un sujet, et je n'ai alors qu'un seul jugement. Mais si
je fais intervenir une condition, je constate la liaison de propositions, sans savoir si elles
sont vraies ; je dis, par exemple : s'il existe une justice absolue, le méchant sera
nécessairement puni. De même, il existe des cas d'alternatives à plusieurs termes : par
exemple, le monde peut être régi, par la simple nécessité, ou par le hasard, ou par une cause
extérieure, par une Providence.
Kant est fort embarrassé par la modalité : il est malaisé de la distinguer de la relation, et elle
paraît caractérisée surtout par l'état d'esprit de celui qui formule un jugement. Ce jugement
est problématique si celui qui le profère n'a pas de certitude. Il est assertorique, si l'auteur
du jugement se croit sûr de ce qu'il avance, apodictique, quand cet auteur possède une
certitude absolue et peut démontrer sa proposition. Toute la classification semble arbitraire
et dictée par des raisons de symétrie. On se demande si Kant saisit réellement des directions
de pensée, ou s'il se borne à analyser les formes du langage, à la façon de Condillac.
2. La table de Catégories
Quel parti Kant a-t-il tiré de sa table des jugements ? Un jugement, nous l'avons vu, est une
action de l'esprit (eine Handlung), par laquelle l'esprit applique à la multiplicité la forme
d'unité qui réside en lui. Une telle action se nomme une Synthèse. J'entends par synthèse,
dans le sens le plus général, l'action de rapprocher plusieurs représentations et de saisir
leur diversité dans une connaissance unique. Cette multiplicité peut être empirique, fournie
par les données de la sensibilité. Mais elle peut aussi être fournie par les intuitions pures de
l'espace et du temps, qui joueront, par rapport à la fonction unificatrice de l'entendement, le
rôle d'une multiplicité relative. Bref, la synthèse peut être empirique, ou elle peut être pure.
De toute façon, la connaissance qui résulte de la synthèse n'est pas distincte d'emblée, elle
peut être brute, grossière (roh), ou déformée (verworren). Un travail d'analyse sera
nécessaire pour ordonner les éléments bruts dont elle se compose. Une première synthèse
inconsciente de l'imagination sera suivie d'une synthèse consciente, coupée d'analyses. C'est
cette synthèse du second degré qui va donner naissance aux concepts. Il y aura autant de
concepts que la table des jugements a permis de distinguer de types principaux de
Jugements. Kant appelle ces concepts des Catégories ou Prédicaments et il en donne un
table, calquée sur celle des Jugements.
Jugements Catégories
Quantité :
universels ....................................................... unité
particuliers ..................................................... pluralité
singuliers ....................................................... totalité
Qualité :
affirmatifs ...................................................... réalité
négatifs .......................................................... négation
indéfinis ......................................................... limitation
Relation :
catégoriques ................................................... inhérence, subsistance
hypothétiques ................................................. causalité, dépendance
disjonctifs ....................................................... communauté ou action réciproque
Modalité :
problématiques ............................................... possibilité ou impossibilité
assertoriques ................................................... existence, non existence
apodictiques .................................................... nécessité, hasard (Zufälligkeit)
Kant fait diverses remarques sur sa table, mais il omet d'abord certains caractères essentiels,
sur lesquels il devra revenir.
Le terme Catégorie n'est pas neuf. Il a été employé par Aristote et par beaucoup d'autres. On
a voulu dresser des tables de Prédicaments ou de Post-Prédicaments qui correspondent en
partie aux Catégories. La table d'Aristote est incomplète. On y remarque aussi des termes
comme situs et tempus qui ne relèvent pas de l'entendement mais de la sensibilité. La liste
d'Aristote mentionne également des termes qui ne sont pas à proprement parler des
Catégories. C'est que l'inventaire de toutes les directions principales de la pensée est très
difficile. Kant estime que sa liste indique réellement les rubriques essentielles. Mais chacune
de ces rubriques pourrait donner lieu à des subdivisions que relèverait une Philosophie
transcendantale complète. Kant s'est contenté des indications indispensables à une
méthodologie transcendantale.
3. Remarques sommaires de Kant sur les Catégories
A) Les douze catégories se divisent naturellement en deux groupes de six. Le premier
(quantité et qualité) concerne seulement les caractères d'objets de l'expérience, donc
actuellement donnés. Le second (relation et modalité) concerne des objets dont l'existence
peut ne pas être donnée, mais résultera, dans l'avenir, d'une activité humaine. On peut
nommer les premières mathématiques, les secondes dynamiques.
B) On peut s'étonner de la division tripartite dans chaque catégorie. Mais le troisième terme
semble naître du rapprochement des deux autres, par exemple la totalité résulte de l'unité
jointe à la pluralité.
C) Une question paraît avoir embarrassé Kant et lui avoir fait vaguement soupçonner que sa
classification pourrait bien être artificielle. Dans la catégorie de la relation, la Communauté
ou action réciproque répond aux jugements disjonctifs, comme l'inhérence à la substance
répond aux jugements catégoriques et la causalité aux jugements hypothétiques. Aucune
difficulté pour ces dernières correspondances. Mais quelle analogie y a-t-il entre un
jugement disjonctif : A ou B existe, – et une action réciproque ? Kant s'en tire par une sorte
de calembour. Dans un jugement disjonctif, on envisage un tout constitué d'objets qui ne
forment pas une hiérarchie, ne sont pas subordonnés les uns aux autres, mais sont à la fois
indépendants et coordonnées, ce qui permet une alternative...
Enfin, Kant déclare que les termes : unité, vérité, bonté qui figurent dans des tables
anciennes de catégories se ramènent aux notions d'unité et de pluralité.
D) A la différence des catégories d'Aristote, les catégories de Kant ne sont pas des
Catégories de l'être. Elles n'indiquent pas des coupures dans la réalité elle-même. Ce sont
les directions les plus générales dans l'activité de l'entendement et elles ne se comprennent
qu'en action. Kant ne peut admettre, dans les choses mêmes, aucune division ou distribution
nécessaire et qui s'imposerait à l'esprit du dehors.
Le caractère arbitraire de la classification de Kant a été signalé par une foule de
commentateurs, depuis Hegel et Schopenhauer jusqu'à Kuno Fischer, Renouvier, Riehl,
Boutroux, Hamelin, Lachièze-Rey. Par exemple, Schopenhauer parle du « Lit de Procuste »
des Catégories. D'autres ont proposé des simplifications ou des corrections à la table, sans
en contester le principe. On a discuté la méthode même, qui consiste à partir d'une
classification arbitraire des diverses formes de jugement. Comment découvrir les fonctions
originelles de l'entendement, d'après les résultats de l'analyse entreprise par Aristote ? En
réalité, Kant s'inspire souvent de Condillac qu'il ne cite pas.
III. La Déduction transcendantale
1. La notion de Déduction transcendantale
Kant a voulu montrer, dans l'exposition métaphysique et dans l'exposition transcendantale
de l'Esthétique transcendantale, que l'Espace et le Temps sont des formes a priori de la
sensibilité pure, des intuitions. Il a voulu établir que ces formes ne prennent un sens que
remplies par une matière, les impressions de la sensibilité empirique.
Il lui reste à accomplir la même tâche pour les Catégories, formes a priori de l'entendement
pur. Mais l'entreprise paraît ici plus difficile. Les catégories s'appliquent à la fois à la
sensibilité pure et à la sensibilité empirique. Kant aura la plus grande peine à exprimer
clairement sa pensée. Il s'y appliquera avec tant d'insistance, un désir si vif d'être
absolument exact et précis, qu'il laissera le lecteur perplexe. Enfin, peu satisfait de son texte
de 1781, il a remanié, d'une manière complète, dans l'édition de 1787, la rédaction de la
Déduction transcendantale des Catégories.
Il faut d'abord circonscrire exactement le problème. L'entendement est la faculté une et
active de juger. Cette faculté s'exerce dans les directions définies par les Catégories. Mais
elle garde, malgré ces divisions, toute son unité essentielle. Il faut donc indiquer et, si
possible, saisir ce principe d'unité. Mais il faut aussi tenter de suivre les Catégories, dans
leur application, pour montrer que l'Empfindung, l'impression du donné, de la sensibilité
brute, s'y insère infailliblement. Un seul moyen : donner des preuves tirées de la possibilité
de connaissances a priori, fournies par l'entendement pur. La preuve sera symétrique de
celle que nous avons rencontrée dans l'exposition transcendantale des concepts de l'espace et
du temps. Puis on montrera que le jugement formé ici par l'entendement est synthétique,
qu'il autorise par suite un progrès de la connaissance et qu'il est légitime. La question de
droit et la question de fait ne sont pas séparées dans la déduction transcendantale. L'analyse
de la table des Catégories peut tenir lieu de déduction métaphysique.
Il n'y a pas lieu d'attacher de l'importance au terme de déduction qui remplace le mot
d'exposition. En effet, dans la première édition de la Critique (p. 70, 12), Kant parle d'une
déduction transcendantale de l'Espace et du Temps. Les deux termes sont donc pratiquement
synonymes.
Il faut expliquer la façon dont des concepts a priori peuvent se rapporter à des objets.
Comment les conditions subjectives de la pensée peuvent-elles avoir une valeur objective ?
C'est-à-dire être la condition de la possibilité de toutes connaissances d'objets ? Ce texte
figure dans les deux éditions. Il formule le problème sur lequel s'exerceront tous les
successeurs de Kant. Le problème a reçu deux solutions opposées : la première, celle de
l'Empirisme, consiste à remonter des sensations aux concepts, ou à tirer la pensée des
choses, par une déduction physiologique. C'est celle de presque tous les philosophes du
XVIIIe siècle. Mais cette déduction ne peut, dans aucun cas, nous apporter des concepts
purs. Dans la seconde édition (p. 115) une addition observe que Locke a échoué, et que
Hume l'a reconnu. La seconde solution affirme qu'il n'existe pas d'objets extérieurs ou que la
Nature en tant qu'elle a des lois est entièrement produite par l'esprit. Kant, en 1781 et en
1787, rejette cette solution avec autant d'énergie que la première et il estime que la
déduction transcendantale suffit à la réfuter. Il aura quelques doutes plus tard, comme le
montrent les divers fragments de l’œuvre posthume publiés dans l'édition de Berlin.
Kant examine successivement : l'activité propre du Moi et l'unité du « je pense » ; le
mécanisme de la déduction transcendantale.
2. L'activité propre du Moi et l'unité du « je pense »
A) L'activité propre de la pensée
Que faut-il entendre quand j'affirme « je pense » ? C'est le problème du Cogito. La théorie
de l'aperception transcendantale, pièce maîtresse de la première Critique, en donne une
solution qui paraît assez obscure au premier abord. L'entendement comporte une réceptivité
ou faculté de connaître un objet (Vermögen einen Gegenstand zu erkennen) de l'intuition
sensible, et une spontanéité des concepts, faculté de concevoir, de penser un objet de
l'intuition sensible, ou de le « mettre », de le « placer », ou « poster » sous des concepts
(unter Begriffe zu bringen). Il existe ainsi en moi un élément passif et un élément actif. Dans
le jugement, l'entendement – quand je dis, par exemple : tous les corps sont divisibles –
représente les corps par la notion de divisibilité. Une représentation plus large se substitue à
la notion immédiate de corps, permettant de rapprocher des connaissances diverses. Le
jugement met donc de l'Unité dans nos représentations, il procède à une synthèse, c'est-à-
dire effectue l'action d'ajouter plusieurs représentations les unes aux autres (hinzuthun). Il y
a en réalité synthèse dans toutes les opérations de l'esprit (sensation, perception,
imagination, jugement, raisonnement). Il faut, pour une telle synthèse du multiple dans
l'unité, que le multiple soit préalablement parcouru (durchgegangen), reçu (aufgenommen),
lié enfin (verbunden), pour en faire une connaissance. Ce progrès dans la synthèse a été noté
déjà par Descartes, puis, plus en détail, par Leibniz et par Wolff. Dans la Critique de la
Raison pure, surtout dans la première édition, Kant considère deux formes principales de
synthèse : la synthèse inconsciente de l'imagination et la synthèse pure. La première est un
simple effet de l'imagination, une fonction aveugle (blind) mais indispensable de l'âme, sans
laquelle nous n'aurions aucune connaissance, mais dont nous avons rarement conscience.
La seconde est la synthèse pure considérée d'une manière générale et elle donne le concept
pur de l'entendement. Mais en réalité, la première synthèse elle-même est une conséquence
de l'unité qui domine l'entendement. Cette unité ne peut venir ni des sens, ni de
l'imagination, ni d'une intuition, même pure. Elle ne peut résulter que d'une action de
l'esprit. L'unité n'est pas dans les objets ; elle ne peut pas non plus en être extraite par la
perception.
B) L'Unité du « je pense »
D'où vient cette Unité ? Nous pourrions croire qu'elle vient des catégories de l'entendement,
de la catégorie d'unité dans la quantité. Mais cela est faux. Cette unité qui, a priori, précède
tous les concepts de liaison, donc toutes les catégories, n'est pas la Catégorie de l'Unité. Par
suite, il nous faut la chercher plus haut encore, dans ce qui contient en soi-même le
fondement de l'Unité de concepts différents dans le jugement... Bien plus cette unité n'est
pas quantitative, mais qualitative. Elle vient du je pense. Je pense évidemment toutes mes
représentations, qui, sans ce « je pense », n'entreraient pas dans mon esprit ; c'est là le fait le
plus général de toute la vie mentale, valable également pour ce qui est pur et pour ce qui est
empirique. Quels sont donc les caractères du « je pense » ? L'analyse qui est centrale dans le
Kantisme, a été le point de départ de toutes les philosophies allemandes postérieures.
a) Ce n'est pas une donnée de la conscience empirique. – En elles-mêmes, les données de
l'expérience sont dispersées (zerstreut) et sans relation avec l'identité du sujet. Il ne suffit
pas, pour que je pense, que chaque représentation soit accompagnée de conscience : il faut
que j'ajoute une représentation à l'autre (hinzusetze) et que je sois conscient de leur synthèse.
b) Ce n'est pas une synthèse de l'imagination, formée simplement grâce à l'intuition pure de
l'espace et du temps. Le principe de l'unité doit être antérieur à l'intuition, qui ne suffit pas à
unifier toutes les intuitions en un bloc unique. En effet, Kant suppose que l'intuition sensible
n'a pas d'unité par elle-même, ce qui ne s'accorde pas tout à fait d'ailleurs avec divers textes
de l'Esthétique transcendantale. Mais Kant considère ici, dans la déduction, non pas l'unité
globale de l'intuition pure, mais l'unité d'une portion découpée dans cette intuition globale.
c) L'unité n'est pas analytique et ne se réalise pas automatiquement par une simple
juxtaposition d'éléments dispersés dans la conscience, ou par addition. Il faut toujours une
fonction unifiante préalable.
d) La synthèse est donc objective. – En effet, une simple association par contiguïté donnerait
une synthèse subjective, individuelle, variable et contingente, un phénomène. L'unité
transcendantale de l'Aperception est celle par laquelle tout multiple donné dans une
intuition est unifié en un concept d'objet. L'unité empirique dérivera de cette unité
transcendantale, mais ne se confondra pas avec elle.
e) Cette unité transcendantale sera appelée aperception pure (non empirique)
transcendantale (donnant lieu à des connaissances a priori), originelle (ursprünglich),
universelle (se trouvant dans tout esprit) ; ce sera la première connaissance pure de
l'entendement.
Ce sera aussi sa première action (Handlung), son premier acte de spontanéité. Mais elle est
indéterminée et ne nous fournit aucune connaissance. Quelle est sa nature ? Kant se sert à
plusieurs reprises, pour la caractériser, du terme Selbstbewusstsein (conscience de soi) qui
pourrait faire allusion à une expérience intérieure. Mais Kant distingue soigneusement et
même il oppose conscience empirique (donc expérience intérieure) et conscience
transcendantale. Cette dernière est l'identité de l'aperception elle-même qui précède a priori
toute pensée déterminée... Le Moi, le Je pense, est distinct de Moi qui a l'intuition de lui-
même. Ce premier Moi, le Moi transcendantal, est indéterminé, ne me procure aucune
connaissance. La synthèse transcendantale me donne simplement conscience que je suis
(dass ich bin) ; elle ne s'accompagne d'aucune intuition. Mon entendement n'a aucun
caractère intuitif ; il me donne simplement conscience d'une forme, d'une fonction, d'une
action. Par suite, il ne procède pas par vision globale, comme la sensibilité pure, mais par
une suite discontinue d'actes de synthèse, échelonnés dans le temps. Nous supposons
seulement, derrière de tels actes, une faculté unifiante, un pouvoir d'unir à priori, une unité
transcendantale, dont la nature nous demeure inconnue. Bref le Moi se subdivise en un Moi
transcendantal et un Moi empirique.
N'imaginons pas cependant qu'il y ait deux entendements superposés. Le Moi empirique est
foncièrement identique au Moi transcendantal. Un seul et même entendement, grâce aux
mêmes actions pour lesquelles il avait mis au jour (par l'entremise de l'unité synthétique) la
forme logique du jugement, apporte aussi par l'entremise de l'unité synthétique du multiple
dans l'intuition, un contenu transcendantal dans les représentations. Donc, à la racine :
Unité active, synthèse, spontanéité, action. Cette unité apparaît dans l'étude logique du
jugement. Mais elle est antérieure à cette étude et je la saisis vaguement avant tout jugement
dans une sorte de conscience profonde de ma vie mentale. Kant cherche, non sans embarras
visible, à définir cette activité. Si pur que le « je pense » soit de tout élément empirique
(c'est-à-dire de toute impression des sens), il sert cependant à distinguer deux sortes
d'objets, selon la nature de notre faculté de représenter : Moi, en tant que pensant, je suis
aussi un objet du sens interne et je m'appelle âme. Ce qui est objet du sens externe se
nomme corps. Et, dans les Réflexions : toute expérience interne est un jugement, dans
lequel le prédicat est empirique et où le sujet est Je. Indépendamment de cette expérience, il
ne reste, pour la psychologie rationnelle, que le Je. Car ce Je est le support de tous les
jugements d'expérience.
Certains commentateurs considèrent ces textes comme très obscurs. Ils s'expliquent
cependant si l'on songe au fond de la doctrine. Le Moi, selon Kant est, par essence, activité,
force, principe de vie, être. Toutefois, si la conscience lui apprend son activité, elle ne lui en
indique aucunement la nature et le mécanisme. Descartes, constatant le rôle capital de
l'action dans le jugement, a voulu en conclure la nature de l'âme, substance pensante, dont
nous aurions ainsi l'intuition immédiate, dans son opération, l'acte de la pensée. Kant, dans
la Dialectique transcendantale, reprochera à Descartes d'avoir voulu passer de la conscience
pure, considérée dans son acte primitif, le Cogito, le Je pense, à la conscience empirique.
Selon lui : je n'ai conscience de Moi, ni comme je suis réellement, ni comme je m'apparais à
moi-même, mais j'ai seulement conscience que je suis. Le Cogito m'avertit que j'existe, que
j'agis ; il ne m'apprend nullement ce que je suis. Il manifeste simplement l'acte de
déterminer (bestimmen), ou ma présence comme être (Dasein). Dans la conscience de moi-
même, au sein de la simple pensée je suis l'être même (das Wesen selbst), mais je ne pense
aucune détermination précise de ma pensée (par suite, je ne puis pas, comme le croit
Descartes, connaître mon âme et la distinguer du corps). Là se trouve le germe des
philosophies de Fichte, Schelling, Hegel.
3. Le Mécanisme de la Déduction transcendantale
La description de ce mécanisme est différente dans les deux éditions de la Critique. Mais il
n'y a pas de variation de la pensée de l'une à l'autre, comme on l'a souvent affirmé depuis
Schopenhauer.
A) Texte de la première édition
D'après ce qui précède, les éléments a priori contenus dans notre perception des choses
(intuitions pures du temps et de l'espace, « je pense », catégories), rapprochés du divers de
l'intuition sensible (das mannigfaltige der Anschaung) donnent naissance à l'expérience
(Erfahrung), c'est-à-dire à un tout formé de représentations liées entre elles après
comparaison (ein Ganzes verglichener und verknüpfer Vorestellungen). Comment cette
unification peut-elle se produire ? On peut distinguer trois opérations superposées, celles : 1.
de l'intuition ; 2. d'une faculté nommée par Kant imagination transcendantale ; 3. de
l'aperception. Ces trois opérations : l'appréhension dans l'intuition, la reproduction dans
l'imagination transcendantale, la recognition (reconnaissance) dans le concept, sont
indispensables et inséparables.
L'appréhension ou perception d'un objet dans l'intuition de l'espace et du temps comporte
d'abord une synthèse instantanée (in einem Augenblicke enthalten) a priori, qui détache un
bloc – par exemple tel homme – dans l'espace et le temps. Une seule synthèse instantanée ne
suffit pas ; il faut la soudure de plusieurs appréhensions. L'imagination proprement dite,
prisonnière de l'impression immédiate, ne permet pas d'effectuer la soudure. Si les qualités
d'un morceau de cinabre (couleur et poids) variaient sans répit, jamais l'imagination
proprement dite ou empirique, ne pourrait qualifier le cinabre. Il faut, derrière l'imagination
empirique, une imagination transcendantale, capable, à la fois, de conserver et de
reproduire les images antérieurement perçues et d'en tirer une image collective : la première
fonction est reproduction ou mémoire, la seconde est production ou création.
Mais la soudure, la combinaison des images successives en une image d'objet (ici, un
morceau de cinabre) implique un pouvoir interne d'unification contenu dans l'âme, une
aperception transcendantale, une fonction unifiante de l'esprit. Cette fonction ne nous
apprend pas ce qu'est l'objet, et ce n'est pas de l'objet que l'unité peut venir, car l'objet reste
un x, dont nous ignorons la substance. Elle vient de la façon dont nous le pensons, de l'unité
de notre fonction mentale, d'une conscience pure, primitive, immuable.
Cette fonction fait, de toutes nos perceptions, des perceptions d'objets. Elle les unifie toutes,
dans une seule et même expérience. Elle fait que le Moi, restant identique dans toutes nos
perceptions, accompagne toutes nos représentations.
Impossible d'expliquer ces faits par l'association des idées, parce que chacune de nos
représentations instantanées est isolée et n'a aucune propriété qui puisse la rapprocher
d'autres représentations. Des faits isolés ne peuvent avoir que des liaisons dues au hasard ou
contingentes (c'est ce que Hume avait reconnu). La seule affinité concevable est
transcendantale, vient d'un pouvoir a priori qui réside dans l'esprit. Une conscience pure,
condition a priori de tout ordre dans les phénomènes, se superpose forcément à la
conscience empirique, et traduit d'une manière a priori l'unité permanente de notre moi.
Kant paraît, dans la première édition, admettre l'existence hors de nous, de choses en soi
(Ding an sich) inconnues, d'un x, d'un objet transcendantal qui joue, par rapport à nos
intuitions sensibles, un rôle analogue à celui que remplit le Moi transcendantal à l'égard du
Moi empirique. Il n'y a pas d'idéalisme dans la première édition, contrairement aux
interprétations de Schopenhauer et de Kuno Fischer. Kant est guidé par une constatation fort
analogue au Cogito cartésien. Pour Descartes, le Cogito conduit à l'affirmation de mon
existence comme être constitué par la faculté de penser et par l'unité intérieure. Pour Kant,
le Cogito mène à affirmer l'existence en moi d'une faculté unifiante manifestée par la
discontinuité d'actes de pensée séparés ; l'essence, la nature de la pensée me demeure
impénétrable. Le Cogito kantien est lié à une analyse d'opérations logiques essentiellement
discontinues. Descartes affirme, en invoquant une garantie divine, l'existence réelle de
l'espace et du corps et il explique l'imagination par les propriétés de ce corps, ou par l'union
de l'âme et du corps. Pour Kant, l'imagination transcendantale est liée à la fonction du Je
pense. La force unifiante n'est pas substance ; elle n'apparaît que dans ses actes : elle se
traduit par la régularité de lois, par une nécessité que, seules, la science des phénomènes et,
plus tard, la règle a priori de l'action pratique, pourront étendre et préciser. Mais sans
l'expérience externe et interne, je ne pourrais avoir ni la conscience du moi, ni celle d'un
objet.
B) Texte de la seconde édition
Kant s'applique, dans la seconde édition, à montrer qu'il ne veut pas d'idéalisme empirique
et tient le monde sensible pour réel et, d'autre part, il cherche à réduire le rôle de
l'observation psychologique. Cela pour répondre aux observations de ses correspondants et
de ses critiques. Mais on trouve, dans la deuxième rédaction, les mêmes démarches que dans
la première, exposées plus brièvement. On peut distinguer deux moments dans la
démonstration :
a) Premier moment. – Nous constatons l'unité des représentations : 1° dans les objets ; 2°
dans l'ensemble des phénomènes qui s'ordonnent et nous apportent une vision du monde
considéré comme un Tout. L'unité, la synthèse, ne peuvent venir ni de l'intuition sensible
brute, ni de l'intuition pure de l'espace et du temps. L'unité doit précéder les parties et ne
peut pas venir de leur assemblage. Elle ne peut pas non plus être fournie par l'unité de la
Catégorie de quantité. Elle implique, en effet, une liaison, c'est-à-dire un jugement. Or juger,
c'est penser. Toutes nos représentations sont accompagnées du Je pense, qui les précède et
manifeste une aperception pure primitive ou une spontanéité. Cette aperception pure est
l'unité transcendantale de la conscience du Moi, de l'identité permanente de la perception.
C'est cette unité qui transforme en objet le donné de l'intuition sensible.
Kant veut l'établir par une analyse nouvelle du jugement. En effet, la définition des logiciens
qui parlent d'une liaison de deux concepts ne l'a jamais satisfait. Elle ne vaut que pour les
jugements catégoriques. La copule « est », transforme l'unité subjective du jugement en une
unité objective, valable d'une manière universelle. Or, les fonctions logiques du jugement,
les catégories, ne viennent pas de la représentation elle-même ; elles sont ajoutées par la
pensée, dont le caractère principal est l'unité.
b) Deuxième moment. – Examinons d'abord l'objet. L'objet est objet d'expérience
(Erfahrung). Or l'expérience suppose : intuition pure, intuition sensible et, de plus, une
unité que l'intuition ne saurait fournir. Supprimez les deux intuitions, il ne reste que l'unité
d'une fonction de synthèse mentale et de simples formes de pensée (Gedankenformen). La
synthèse est double : 1. Synthèse figurative (figürlich) de l'imagination ou de la faculté de se
représenter un objet, même s'il n'est pas actuellement donné dans l'intuition. L'imagination
est reproductive (mémoire) ou productive et ne se confond pas avec l'association des idées.
2. Synthèse de l'entendement par les Catégories. En somme, Kant résume ce qu'il avait
exposé en détail dans la première édition. Mais il développe avec précision les
conséquences de sa théorie.
En ce qui nous touche, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes tels que nous sommes. Ni
l'expérience, ni l'aperception transcendantale ne me révèlent ce que je suis. Une seule chose
m'est connue : j'existe et j'agis. Malebranche l'avait déjà dit.
En ce qui touche les objets extérieurs, j'ignore pareillement ce qu'ils sont. Il faut toujours,
pour les connaître, une intuition sensible et un acte de la pensée. Toujours il faut, pour
percevoir, une action : Nous ne pouvons pas nous représenter une ligne sans la tracer, un
cercle sans le décrire, les trois dimensions de l'espace sans trois lignes perpendiculaires, le
temps sans une ligne droite. Aucune connaissance a priori ne nous est possible, sinon celle
d'objets d'une expérience possible.
Toutefois, cela ne veut pas dire que nous devons nous en tenir à l'empirisme. Nous pouvons
dépasser l'expérience, énoncer des lois valables pour l'avenir. Mais nous ne pouvons jamais
penser ultimement sans faire appel à une expérience. Seule, l'expérience permet d'utiliser les
concepts ; toute la difficulté porte sur un point : est-il possible d'isoler ce qui, dans l'esprit,
n'est pas apport du monde extérieur ? Kant en est d'emblée fermement persuadé. S'il en était
autrement, l'homme, cessant d'être lui-même, serait définitivement condamné à
l'impuissance. Or Kant a, dès le début, considéré la philosophie comme la doctrine de
l'action.
Si Kant n'a jamais nié, dans la première Critique, l'existence du monde extérieur, il est
amené par la logique même de sa pensée, à réduire de plus en plus l'importance du monde
extérieur pour accroître le domaine ouvert à l'action. Kant se propose de saisir les fonctions
de l'esprit, à l'état naissant, dans leurs produits fixés. Il part d'une hypothèse qu'il ne
démontre pas : tout ce qui est ordre, régularité dans les apparences, y est introduit par
l'activité de l'esprit. Par elle-même, la chose en soi est incohérence et confusion. Ou, si elle a
un ordre propre, cet ordre nous est inaccessible, ce qui revient au même.
En somme, Kant se tient, ou il veut se tenir, en équilibre dans une position moyenne, sans
verser dans l'immatérialisme de Berkeley, ni dans le dogmatisme cartésien, ni dans le
scepticisme. Mais il offre à ses successeurs une double tentation qu'ils n'ont pas évitée et à
laquelle il semble avoir lui-même succombé dans ses dernières années. Réduire au
minimum l'élément fourni par l'expérience et faire surgir le monde extérieur tout entier de
l'activité de l'esprit et de la volonté de l'être pensant. Donc, découvrir en l'âme humaine
mille ressources qu'elle ignore et que la sagacité du philosophe saura, par une sorte
d'analyse chimique, en faire surgir. Fichte, Schelling, Hegel et d'autres s'engageront dans
cette voie, au risque de rééditer, sous une forme modernisée, l'expérience manquée des
sophistes antiques.
IV. Objet de l'Analytique des Principes
Aux yeux de Kant, l'Analytique des Principes est une pièce essentielle de la Critique. Elle
énonce, en effet, les principes de la science et de la métaphysique, tels que la structure de
notre esprit les impose à tous les genres de connaissance. Elle enseigne à appliquer à des
phénomènes les concepts de l'entendement qui contiennent la condition requise pour
formuler des règles a priori. Les principes ne tiennent pas aux choses en soi ; ils ne peuvent
être découverts qu'au cours de l'emploi des formes de l'intuition et des catégories. Kant
pourrait tenter de déduire les principes, a priori ; i préfère les chercher dans une analyse de
la science et de la philosophie, telles que ces deux disciplines sont données en fait. Mais il
s'est engagé à reconstruire les résultats de cette analyse dans le cadre des catégories. D'où
une foule de complications.
L'Analytique des Principes comporte, après une introduction : 1. L'exposé du Schématisme
des concepts de l'entendement pur qui se recouvre en partie avec la Déduction
transcendantale ; 2. La classification et l'exposé des principes, groupés selon la table des
Catégories. Enfin, deux suppléments ; la Réfutation de l'idéalisme et l'Amphibolie des
concepts de réflexion – en réalité une double préface à la Dialectique transcendantale.
Aucune partie de la Critique ne nous découvre mieux le contenu et le sens de la philosophie
personnelle de Kant. L'entendement, faculté discursive, est maintenant dédoublé en Faculté
des concepts et Faculté de juger ou de lier des concepts. Mais la logique ordinaire, théorie
purement formelle des concepts, ne suffit pas. L'Analytique des Principes nous offre une
étude a priori du contenu même des jugements, la faculté de juger étant définie, faculté de
subsumer sous des règles, c'est-à-dire de discerner si, à un cas donné, une règle générale
s'applique ou non. La logique formelle ordinaire ne suffit pas, puisqu'elle doit ignorer le
contenu des jugements.
V. Le schématisme des concepts de l'entendement pur
Kant raisonne ainsi : quand je dis « cette assiette est ronde », je fais entrer l'assiette que je
vois, dans les objets ronds, je la subsume sous le concept général : rond. Cela serait
impossible sans une analogie entre l'objet subsumé (ici l'assiette) sous un concept, et ce
concept lui-même. Kant oublie que l'analogie éclate au moment même de la perception et il
affirme qu'il n'y a rien de commun entre un concept abstrait et un objet sensible. S'il en est
ainsi, il faut un terme intermédiaire entre le concept et l'objet, un schème (de σχημα) ou une
figure. D'où la théorie du Schématisme des concepts de l'entendement pur.
Un schème n'est pas une image concrète, qui serait obscure au même degré que l'objet. Ce
n'est pas une image générique (par exemple du triangle, du nombre cinq ou du chien,
comme l'affirmera Galton). Kant nie l'existence de telles images génériques. Pour me
représenter en image le nombre 5, j'use d'une image concrète : 5 points. Comment une telle
image est-elle possible ? Elle ne peut l'être que s'il y a en nous une faculté d'imaginer a
priori, une imagination pure a priori, liée aux notions d'espace et de temps et aux
catégories ; elle fait passer, dans la sensibilité pure, une détermination d'origine
intellectuelle, selon certaines directions qui correspondent aux catégories. Cela donne une
image symbolique, grâce à laquelle les catégories pourront s'appliquer aux données
sensibles. Le schème de concepts sensibles, par exemple de figures dans l'espace, est un
produit et, en même temps, un monogramme (un dessin unique) de l'imagination pure a
priori, par lequel et selon lequel des images deviennent possibles, une sorte de composteur
que l'imagination pure applique sur les perceptions. Mais, prenons-y garde, ce monogramme
n'est pas lui-même une figure dans l'espace. Il vaut pour tous nos concepts, même ceux qui
dérivent du sens interne et ne concernent pas l'espace. Le monogramme opère dans le temps,
mais il a un caractère notable de généralité abstraite.
On aura les schèmes suivants : Quantité = nombre (ou succession de formes dans le temps) ;
Réalité = existence dans le temps, ou temps occupé ; Négation = non être dans le temps ou
temps vide ; Substance = permanence dans le temps ; Causalité = succession dans le
temps ; Action réciproque = Simultanéité ; Possibilité = représentation de l'être dans un
temps indéterminé ; Nécessité = présence de la chose en tout temps. Bref les schèmes sont
des déterminations a priori du temps, par règles, selon l'ordre des Catégories : Série dans le
temps (Zeitreihe), Contenu du temps (Zeitinhalt), Ordre dans le temps (Zeitordnung),
Contenu global du temps tout entier (Zeitinbegriff).
Le schème est, en somme, un phénomène, ou plutôt un concept sensible d'objet, concordant
avec la catégorie, ce que l'objet lui-même ne pouvait faire. Il ne nous renseigne pas sur la
chose en soi : supprimez la permanence dans le temps, la substance n'est plus rien. Le
schème offre à la pensée le minimum de matière idéale. C'est sur de tels symboles que la
science va opérer. Mais ils doivent garder quelque analogie avec l'expérience, comme une
théorie mathématique doit s'accorder avec les faits physiques.
VI.Le dénombrement des Principes
Les Principes de l'Analytique transcendantale s'appliquent à des jugements synthétiques. Par
suite, les principes de la logique formelle (identité et contradiction) n'est font pas partie.
Les Principes formels valent des seuls jugements analytiques. À vrai dire, il n'est pas
toujours facile de distinguer jugements analytiques et jugements synthétiques. Si je dis :
impossible qu'une chose soit et ne soit pas à la fois, ou bien : un homme ignorant n'est pas
instruit en même temps, je parais énoncer deux jugements analytiques. Cependant, ils sont
synthétiques, en raison de la condition de temps qui intervient. Une chose peut exister en un
temps et non dans le temps qui suit ; un ignorant peut s'instruire. Il faut, pour un jugement
synthétique, unir deux notions, dont l'une n'est pas contenue dans l'autre. Cela est
impossible, comme la déduction transcendantale vient de le montrer, sans l'aperception
transcendantale et son unité. Et l'aperception transcendantale ne joue que dans le temps et
l'espace.
La liste des Principes est ordonnée suivant l'ordre des Catégories. Catégories
mathématiques : Axiomes de l'Intuition, Anticipations de la Perception. Catégories
dynamiques (relation et modalité) : Analogies de l'expérience, Postulats de la Pensée
empirique.
1. Axiomes de l'Intuition
Ils se ramènent à un seul : Tous les phénomènes sont, en ce qui touche leur intuition, des
grandeurs extensives. En effet, les phénomènes sont perçus par actes successifs
d'appréhension et la représentation des parties précède celle de l'ensemble. Pour me
représenter une ligne, même très petite, il me faut la tracer par la pensée. De même, le
passage d'un instant à un autre ne peut être figuré que par synthèse successive dans l'espace.
(Ce sera le principe de la théorie du temps développée par Bergson). C'est pour cette raison
que la science cherche toujours les parties des objets, que la mathématique procède par
synthèses successives de l'imagination. Ainsi se trouve justifié le caractère mathématique
croissant de la science moderne.
2. Anticipations de la Perception
Dans tous les phénomènes, le réel, objet de nos impressions, a une grandeur intensive ou un
degré. – Que faut)il entendre par grandeur intensive ou degré ? L'idée vient de l'application
à nos impressions de la catégorie de qualité. À la différence des axiomes de l'intuition,
l'anticipation se rapport, non à l'intuition pure, mais à l'intuition empirique, à la perception,
aux impressions (Empfindungen) que j'éprouve, aux sensations. On passe, de la sorte, du
sujet pur, dont temps et espace sont les seules intuitions, au sujet empirique, dont les
impressions sont d'intensités variées. Mais le changement graduel (stufenartige
Veränderung) qui se produit en lui, n'est possible que grâce à l'espace et au temps. Pourquoi
parler d'anticipation ? S'agit-il d'une modification analogue à la prolepse stoïcienne ? Kant a
probablement en vue, dans un exposé assez embrouillé, le passage d'une intuition
initialement pure, à une intuition plus ou moins chargée d'apports sensibles. Tous les degrés,
du zéro à l'infini, pourront être considérés. À la fin, des impressions telles que la couleur et
les saveurs seront uniquement sensibles. C'est ce qui arrive si, voyant une couleur rouge
d'une certaine intensité, nous imaginons, sans la voir, la couleur rouge, plus intense ou plus
faible qui lui fera suite, et nous la reconstruisons en nous. Axiomes et Anticipations ne
concernent que la possibilité et résultent, grâce à une construction dans l'espace et dans le
temps, de l'application de la Catégorie à l'intuition plus ou moins saturée d'apports sensibles.
3. Analogies de l'expérience
L'expérience n'est possible que grâce à la représentation d'une liaison nécessaire des
perceptions par des concepts a priori. – Ce principe, d'une valeur absolue, est le seul moyen
de déterminer l'existence des phénomènes dans le temps, ou de connaître la Nature. La
Nature est, en effet, liaison des phénomènes, suivant des lois, ou des règles nécessaires.
Cette liaison peut se faire de trois façons selon les trois aspects du Temps : permanence
(Beharrlichkeit), succession (Folge), simultanéité (Zugleichsein). Ainsi sont déterminés les
événement qui surviennent.
A) Première analogique
Permanence de la substance. À travers tous les phénomènes qui changent, la substance
demeure, et sa quantité dans la nature, n'est ni augmentée ni diminuée. – En effet, le temps
a deux propriétés différentes, simultanéité et succession. Or, un temps ne peut pas être
déterminé, si rien ne demeure. C'est une simple constatation de bon sens, qui a conduit les
philosophes à distinguer la substance et ses accidents. Il ne peut y avoir de changement que
par opposition avec un sujet permanent. Mais, dans le fait, l'expérience ne nous révèle
jamais de permanence complète. La démonstration de Kant (elle est prise de Hume) est
assez vague : il semble penser tantôt à ce que nous appelons permanence de la matière,
tantôt à la permanence du sujet d'inhérence particulier à chaque groupe de changements.
B) Deuxième analogie
Loi de causalité. Tous les changements ont lieu suivant la loi de la succession de la cause et
de l'effet. – Les phénomènes se succèdent ; l'état d'une chose est contraire, à un moment, à
ce qu'il était au moment antécédent. La loi de la causalité permettra de les relier les uns aux
autres, sans préjuger de ce qui a lieu au-dedans des choses elles-mêmes. Les choses en soi,
répète Kant, sont tout à fait en dehors de la sphère de notre connaissance. Or, les
phénomènes, dans le temps, se succèdent dans un ordre invariable ; j'ignore entièrement s'il
existe un ordre réel des choses en soi, et quel il peut être. La liaison de cause à effet est
rendue possible, dans le temps, par l'action de notre entendement. L'ordre du temps n'est pas
réversible. Quand je regarde une maison, je puis de mes yeux en parcourir la façade dans
toutes les directions. Mais, pour la construire, il m'a fallu procéder de bas en haut. Les cas
où la causalité paraît indépendante de la succession (cause et effet simultanés, par exemple
quand ma chambre s'échauffe dès que le poêle est allumé), ne font que confirmer la règle.
Cette analogie mène aux notions d'action, de force, de substance. Elle nous confirme la
continuité du changement. Elle ne fait pas double emploi avec la catégorie de causalité, dont
elle est une conséquence.
C) Troisième analogie
Toutes les substances, en tant qu'elles peuvent être pensées simultanément dans l'espace,
sont en action réciproque continue. – C'est le principe de la simultanéité selon la loi de
l'action réciproque ou de la communauté (Gemeinschaft). Nous concevons qu'il y a des faits
simultanés. Mais la perception ne se fait que par suite d'appréhensions successives. Il faut,
pour que la simultanéité soit perçue, que nos yeux puissent parcourir une même route dans
les deux sens. La simultanéité n'est donc jamais perceptible que grâce à l'action réciproque.
Or, l'action réciproque est impossible si les substances sont isolées les unes des autres. Il
faut supposer, sous l'espace, une communauté dynamique de réalités véritables. Sans cette
communauté, aucune simultanéité dans l'espace ne serait concevable. Kant était, dès la
période antécritique, parvenu à une solution analogue, renouvelée de Leibniz et de Wolff.
Ce sera une des pièces essentielles du romantisme et de l'idéalisme modernes, comme jadis
ce le fut du stoïcisme et du néoplatonisme.
4. Postulats de la Pensée empirique
Cette sorte de principes relève de la Catégorie de la Modalité. Cette Catégorie, on l'a vu, ne
s'applique pas aux objets, mais au pouvoir de les connaître, aux conditions dans lesquelles
une science est possible. Ces principes nous apportent des définitions des trois termes :
possible, réel, nécessaire. Kant caractérise ces termes en des formules traditionnelles en
apparence. Ce qui s'accorde avec les conditions formelles de l'expérience (intuition et
concept) est possible. Mais la présence de l'intuition pure parmi les conditions exclut de la
possibilité tout ce qui ne fait pas partie d'un monde sensible. – Ce qui s'accorde avec les
conditions réelles de l'expérience (actuelle) est réel. Par suite, il n'existe pas d'autre réalité
que perçue par les sens. – Enfin, ce dont la liaison avec le réel est définie selon les
conditions générales de l'expérience est nécessaire. Il en résulte que le simple concept d'une
chose ne peut nous fournir aucune indication sur l'existence de cette chose. D'où la
condamnation de l'argument ontologique. En somme, notre représentation du monde
implique les affirmations suivantes : Tous les phénomènes sont des grandeurs extensives. La
substance est permanente. Tous les phénomènes sont enchaînés par la loi causale. Toutes les
substances sont en action réciproque. Les choses sont possibles, réelles ou nécessaires. En
dehors de ces principes, il n'y a qu'absurdité et si on les oublie il est impossible de penser.
(Kant transforme en lois absolues les solutions générales que la philosophie traditionnelle a
données aux problèmes.) Les Principes apparaissent comme un résumé, réduit à l'essentiel,
débarrassé de toutes les superfluités dues à l'abus de la symétrie. Ils ne diffèrent pas
beaucoup des principes énoncés par Leibniz et Christian Wolff. Le monde y apparaît comme
un, et cette unité se rattache à celle de l'aperception transcendantale. Les notions premières
que le philosophe vient d'énoncer lui semblent a priori ; elles résument les directions
nécessaires de notre pensée. Mais Kant les a extraites, en fait, d'une analyse des procédés de
la recherche scientifique. Elles vont lui servir précisément à réfuter les philosophies, grâces
auxquelles il a pu établir ces principes.
VII. L'Introduction à la Dialectique
La suite de l'Analytique des Principes est, en fait, un chapitre détaché de la Dialectique. Ce
chapitre a été fortement abrégé de la première à la seconde édition. La première édition
renferme deux développements : l'un sur la distinction des Phénomènes et des Noumènes,
l'autre sur l'Amphibolie des concepts de réflexions. La seconde édition raccourcit le premier
exposé et y ajoute trois pages sous le titre : Réfutation de l'idéalisme.
1. L'Activité critique est résumée par l'introduction : Nous n'avons pas seulement parcouru
le pays de l'entendement pur et considéré avec soin chacune de ses parties. Nous l'avons
arpenté et nous avons défini la place que chaque chose y occupe. Mais ce pays est une île,
et la nature même l'a enfermé entre des limites immuables. C'est le pays de la Vérité (oh
quel nom charmant !). Il est entouré d'un Océan vaste et orageux, le siège de l'apparence...
Tout en trompant constamment le voyageur enthousiaste qui s'y agite, ce nouveau pays
l'engage dans des aventures dont il ne pourra plus jamais s'arracher et que cependant il ne
pourra jamais conduire à bonne fin. On pense en lisant ces mots aux vers de Parménide.
Nous savons que les produits de l'entendement ne sont utilisables que dans l'expérience.
Toute pensée se rapporte à un objet, à une intuition donnée. Si l'intuition manque, il n'y a
pas non plus de pensée ; l'objet est purement chimérique ou transcendantal. Les Catégories,
simples formes de la Pensée et rien de plus (Gedankenformen), n'ont pas d'usage
transcendant et ne nous apprennent rien sur les choses en soi. Nous ne connaissons aucun
objet d'une intuition non sensible.
2. Distinction des Phénomènes et des Noumènes. – Kant appelle Noumenon, une chose en
tant qu'elle n'est pas l'objet de notre intuition sensible. Que peut être une telle chose ? 1° Ce
peut être une chose en soi (an sich). Mais nous ne pouvons rien en savoir, sinon que sa
notion n'est pas contradictoire, mais reste problématique, en tant que notion limite
(Grenzbegriff) ; 2° Ce peut être un Noumène. En ce sens, nous voulons opposer un monde
réel ou idéal au monde sensible, et nous nous flattons de raisonner sur un tel monde. C'est
ce qu'ont fait, entre autres, Leibniz et Newton. Le monde sensible, celui des phénomènes,
des apparences, est doublé d'un monde intelligible parfaitement ordonné. Mais ce
raisonnement est vain. La pensée est impossible sans l'union de la sensibilité et de
l'entendement. Il y a ici concordance complète entre les deux éditions.
3. Amphibolie (ou amphibologie) des concepts de réflexion. – Sous ce titre bizarre, Kant
insère une critique sommaire de la philosophie de Leibniz qui, après beaucoup d'autres, a
voulu appliquer au monde intelligible des procédés valables seulement pour l'étude du
monde sensible. Réfléchir, c'est prendre conscience du rapport qui unit nos représentations à
nos moyens de connaître ou à nos facultés. Or, nous rencontrons, dans la philosophie, une
foule de notions à double sens, ou amphibologiques ; tels sont : homogénéité, diversité,
accord et conflit (Einstimmung und Widerstreit), interne et externe, matière et forme... Par
exemple, je parle d'interne et d'externe comme de deux choses opposées. Une chose
« interne » ne peut pas comporter de relations, toute relation se produisant dans l'espace et
dans le temps. Rien de plus confus que l'idée de diversité. Locke ramène l'entendement à la
sensibilité ; Leibniz opère la réduction inverse. Or, faculté sensible et entendement sont
irréductibles l'un à l'autre. Leibniz invoque les principes de contradiction et des
indiscernables. Mais le principe de contradiction n'est pas applicable à la nature, puisque des
termes contradictoires peuvent se succéder dans le temps. Le principe des indiscernables
veut ignorer qu'il n'y a pas de rapport entre la nature des objets et leur place dans l'espace.
4. Réfutation de l'Idéalisme. – Ce texte, ajouté dans la seconde édition, est fort important
pour l'interprétation générale du Kantisme. Il est annoncé dans la Préface de la seconde
édition, où l'idéalisme psychologique est qualifié de scandale pour la philosophie et pour la
raison humaine en général. L'idéalisme est la théorie qui explique la réalité des objets dans
l'espace, en dehors de nous, tantôt comme simplement douteuse et indémontrable, tantôt
comme fausse et impossible. La première est l'idéalisme problématique de Descartes ; la
seconde l'idéalisme dogmatique de Berkeley.
Selon Kant, l'expérience interne n'est possible qu'avec le secours de l'expérience externe : la
simple conscience de mon existence propre démontre l'existence des objets dans l'espace en
dehors de moi. Sans objets extérieurs, je n'aurais pas conscience de moi. D'autre part,
l'expérience externe est immédiate au même degré que l'expérience interne (ce sera le point
de départ des méditations de Hegel). On invoque souvent les rêves contre la réalité du
monde extérieur. Mais comment rêverais-je, s'il n'y avait pas en moi, sous forme d'images
simplement reproduites dans le rêve, des souvenirs d'expériences antérieures ? L'expérience
interne seule ne peut même pas nous donner l'idée de la possibilité. À plus forte raison, ne
peut-elle pas nous fournir le réel avec tous ses caractères.
L'expérience interne selon Kant renferme effectivement un élément intérieur. Mais cet
élément est extrêmement difficile à isoler. C'est le Moi transcendantal, le Je pense, avec les
Catégories et les formes pures de l'intuition. Or les impressions fournies par les choses
externes sont difficiles à séparer de ces éléments vraiment intérieurs. Où est alors le réel ?
Dans le Moi pur insaisissable, ou dans la matière, sans laquelle il ne deviendrait pas lui-
même ? La Réfutation de l'idéalisme contient ainsi le germe de l'idéalisme futur. Mais Kant
affirme que le réel implique l'élément interne et l'élément externe réunis.
La Dialectique transcendantale et les Fondements de la Métaphysique de la Nature
I. La Dialectique transcendantale et la Méthodologie de la Raison pure
1. L'illusion transcendantale et les Idées de la Raison
L'analytique transcendantale a établi que les catégories ne sont pas applicables au-delà des
limites de l'expérience. Pourtant les métaphysiciens s'acharnent à tenter une telle
application. D'où vient cette obstination ? D'une illusion (Schein) inévitable, que Kant
nomme transcendantale. Cette illusion diffère de toutes les autres, par exemple des illusions
d'optique. Une illusion ordinaire peut comporter un jugement et un raisonnement corrects,
mais le résultat est vicié par l'imagination. Ici, au contraire, l'imagination elle-même nous
force, en quelque sorte, à dépasser l'expérience, à faire des catégories un usage non
empirique. L'illusion vient de ce que nous voulons appliquer les catégories là où une matière
fait défaut, chercher des principes non pas immanents mais transcendants. Pourquoi
l'illusion reste-t-elle naturelle et inévitable, même quand elle a été démasquée ?
Notre entendement, on l'a vu, contient des maximes ou principes qui doivent en régler
l'emploi. Les uns sont propres à un entendement donné, donc subjectifs. D'autres ont une
valeur universelle, sont donc objectifs, principes de la nature. Or, nous confondons
facilement principes objectifs et principes subjectifs. La Dialectique transcendantale est la
partie de la logique transcendantale qui nous découvre la cause de cette illusion et nous
apprend à ne pas en être dupes, pas plus que nous ne croyons la terre plate parce que nous
ne percevons pas immédiatement sa courbure.
D'abord, que signifie exactement le terme Raison (Vernunft) ? Proprement la partie la plus
haute de l'esprit humain, ou la faculté des Principes (distincte, on l'a vu, de l'entendement,
faculté des concepts ou du raisonnement discursif). Comment distinguer clairement la
Raison de l'entendement ? Kant va isoler, par degrés ou par approximations successives, les
deux aspects de la Raison. Ce sont la Raison logique, pour laquelle les logiciens ont fixé des
règles formelles, et la Raison pure transcendantale ; celle-ci partage avec l'entendement le
pouvoir d'énoncer des concepts. Mais c'est, en même temps, une faculté des Principes par
laquelle je reconnais le particulier dans le général, en utilisant les concepts. À l'aide de
Principes, qui ne peuvent pas, nous l'avons vu, venir de l'expérience, la Raison unifie (par
exemple grâce au principe de causalité) le particulier sous le général. Dans son usage
logique, la Raison se distingue à peine de l'entendement. Soit un syllogisme : l'entendement
énonce une majeure ; la faculté de juger énonce la subsomption d'un cas particulier dans la
mineure. Enfin, la Raison formule la conclusion a priori. Mais la Raison n'aurait-elle pas un
autre usage et ne pourrait-elle, sans objet sensible, sans intuition, valoir pour des objets,
situés hors de l'expérience ou transcendants ? En quoi consiste exactement la différence
entre Entendement et Raison ? Selon Kant, les deux facultés utilisent des concepts de nature
différente. Les concepts de l'entendement s'appliquent directement à l'intuition. Au contraire,
ceux de la Raison sont réflexifs ; ils résultent d'une réflexion ou conclusion (geschlossene
Begriffe). Notre langage manque de termes appropriés à ces concepts réflexifs. Kant usera
pour les désigner du mot platonicien Idée, ce qui entraînera force confusions. Nos Idées les
plus visibles sont pratiques, s'appliquent à l'action (par exemple Vertu et Liberté). De tels
concepts dépassent l'expérience : l'objet d'une Ide simplement transcendante est une chose
dont on n'a pas de concept, bien que cette idée ait été produite dans la Raison d'une
manière absolument nécessaire et selon des lois primitives. Sans relations avec un objet, de
telles notions ne peuvent pas être déduites. On les conclut d'une analyse du sujet pensant,
par analogie avec la Table des Catégories. Finalement, après quelques considérations
ténébreuses, Kant conclut : Autant l'entendement se représente de formes de liaison par
l'entremise des Catégories, autant il y aura de concepts purs de la Raison. Kant distingue
alors trois formes de liaison : 1. Liaison des représentations avec le sujet ; 2. Liaison des
représentations avec des phénomènes, ou unité absolue de la série des conditions du
phénomène ; 3. Liaison des représentations avec des objets de pensée en général ou l'unité
absolue de la condition de tous les objets de pensée en général...
Ces énoncés abstraits désignent, en réalité, les trois parties de la Métaphysique
traditionnelle : l'Âme, le Monde, Dieu, objets de la Psychologie, de la Cosmologie, de la
Théologie rationnelles. Chacune de ces « Sciences » comporte un ensemble de notions et de
jugements synthétiques a priori.
Comment connaissons-nous donc l'existence de ces Idées, auxquelles nous sommes amenés
toutes les fois que nous raisonnons à partir de prémisses empiriques ? Connaissant quelque
chose a priori, nous en concluons une autre chose, dont nous ne possédons aucun concept,
mais à laquelle nous attribuons une réalité objective, en vertu de l'illusion transcendantale.
Nos raisonnements n'ont ainsi que l'apparence d'être rationnels. Ce sont en réalité des
sophismes nés, non de la malice de l'homme, mais de la nature de la Raison elle-même. Il y
en a trois classes, conformément à la classification ci-dessus : 1. Le Paralogisme : on passe
du concept transcendantal au sujet pur (ou qui ne renferme rien qui soit venu de l'intuition
sensible). On en profite pour proclamer l'unité « absolue » du sujet lui-même, dont je n'ai
aucun concept ; 2. L'Antinomie : on considère la totalité des conditions d'un phénomène
donné. Cette considération peut se faire de deux points de vue différents ; si l'on considère
un des deux aspects de la série, l'autre paraît contradictoire ; 3. L'Idéal : on conclut de l'unité
synthétique de toutes les conditions d'une chose pensée, à l'existence d'un Être de tous les
Êtres.
Ces trois doctrines résument le contenu de toutes les métaphysiques. Depuis Platon, la
Métaphysique oppose au monde perçu par les sens, un Monde idéal qui n'est jamais observé
d'ici-bas. L'Idée, le monde idéal, ne jouent aucun rôle dans la Science, où l'expérience est
notre seul guide.
Mais ce modèle a un rôle capital dans l'ordre de l'action pratique. Dans le monde de la
Science, l'expérience est donnée ; elle s'impose à moi ; je la subis. Dans l'ordre pratique
(Morale et Théologie), l'expérience est mon œuvre, je la produis par mon action. Le modèle
ne m'est pas extérieur, je ne le contemple jamais hors de moi, dans les faits. Par exemple, la
Vertu parfaite n'est jamais réalisée ici-bas. La Dialectique transcendantale va donc poser les
pierres d'attente, sur lesquelles le philosophe bâtira sa morale, sa politique, son esthétique,
sa technique, etc.
2. Critique de la Psychologie rationnelle
L'exposé des Paralogismes relatifs à l'âme figure, sous des formes très différentes, dans les
deux éditions de la Critique. Il a été très abrégé dans la seconde édition, passant de 37 pages
à 19. De plus, la marche même de la pensée n'est pas identique dans les deux versions.
A) Texte de la première édition
Un paralogisme logique est un raisonnement inconsciemment faux dans la forme (l'auteur
n'a pas eu l'intention de tromper, comme dans un sophisme). Un paralogisme est
transcendantal quand il transporte au contenu, à la matière du raisonnement, des données
valables seulement de sa forme.
Nous avons trouvé en nous-mêmes une notion tout à fait générale, inutilisable comme
catégorie, le je pense, véhicule de tous les concepts en général. Grâce à elle, nous
distinguons le Moi et le Non-Moi ; et tout ce qui est en moi m'est présenté comme
appartenant à la conscience. De là, on conclut : en tant que je pense, je suis un objet du sens
interne et je me nomme âme. C'est exactement le sens du « Je pense, donc je suis une
substance pensante », du Cogito de Descartes. Le sujet logique du Je pense, devient sujet
réel. On tire de cette proposition force conséquences : l'âme est une substance, simple,
identique à elle-même dans le temps, en rapport avec des objets possibles dans l'espace. Elle
est immatérielle, spirituelle, incorruptible, personnelle, unie au corps, principe de vie et
d'animalité, immortelle, etc. A la base de toutes ces affirmations, se trouve la confusion
entre le sujet transcendantal ou logique et le Moi de la conscience empirique.
a) Le premier paralogisme. L'âme est substance. – La catégorie de la substance, prise en
elle-même, séparée de toute intuition sensible, n'a aucune valeur objective. Elle exprime
seulement une fonction de la pensée et ne prend sens que par son contenu. Mais, quand on
affirme que l'âme est substance, on entend par là que je ne puis ni naître, ni mourir, ce qui
échappe à toute expérience possible...
b) Le second paralogisme. L'âme est un être simple. – C'est le plus important de tous,
« l'Achille » de tous les Paralogismes. On affirme l'unité de la substance pensante, distincte
de tous ses accidents. Or, il y a bien en moi l'unité du Je pense, l'unité formelle de
l'Aperception transcendantale. Mais je ne puis avoir aucune représentation spatial de cet être
personnel, ni, en fait, aucune connaissance interne du sujet pensant. Kant vise spécialement
ici le Phédon de Platon et plus encore celui de Mendelssohn (1767).
c) Le troisième paralogisme. – Ce qui a conscience de son unité numérique en des temps
différents est une personne. Mais je ne perçois jamais cette unité numérique ou réelle ; le Je
pense ne me fait connaître qu'une unité formelle et rien de concret.
d) Le quatrième paralogisme. – Descartes fournit ici la majeure : je ne connais directement
aucun être extérieur : il faut raisonner pour montrer que des phénomènes existent hors de
moi. Descartes a raison sur ce point. Mais, de cette majeure on peut tirer deux conclusions,
l'une est aventurée et fausse : les objets existent hors de moi, dans l'espace et dans le temps,
réceptacles réels. On peut la nommer un réalisme transcendantal. L'autre conclusion est
légitime et justifie un idéalisme transcendantal : L'espace et le temps ne sont que les formes
sensibles de notre intuition, non des déterminations données pour soi.. Un partisan de cet
idéalisme transcendantal peut être appelé réaliste : pour lui, les phénomènes ordonnés dans
l'expérience sont réels ; il est même dualiste, car pour lui la matière en tant que phénomène
est chose réelle, distincte de l'esprit.
Bref, la connaissance externe, celle de la Nature, nous apporte un grand nombre de vérités
synthétiques a priori, par l'entremise de l'espace et du temps. Au contraire, aucune
connaissance a priori ne peut être tirée de la notion d'un être pensant. Dans l'expérience
externe, quelque chose demeure dans l'espace. Dans ce que nous appelons âme, tout est
dans un flux continuel et rien ne demeure, sinon le moi transcendantal, qui n'est qu'un cadre
vide.
L'idéalisme transcendantal permet cependant d'écarter le matérialisme, car si le moi
transcendantal disparaît, il ne reste plus rien ni en nous, ni hors de nous. Kant ne se lassera
pas de répéter que les questions classiques : Union de l'âme et du corps : état de l'âme avant
la naissance, immortalité, surgissent simplement, parce que nous « réalisons » de simples
concepts vides de tout contenu.
B) Texte de la deuxième édition
Elle abrège les raisonnements embrouillés de la première édition. Le Je pense, dit Kant, est
un cadre vide, tant qu'aucune intuition ne vient le remplir. L'analyse intérieure ne me donne
aucune information sur moi-même, comme objet de la nature. Kant ajoute une réfutation de
la preuve de l'immoralité de l'âme, donnée par Mendelssohn dans le Phédon (1767). L'âme,
disait Mendelssohn, ne saurait périr, parce qu'elle est indivisible. Il se trompe, confondant
une grandeur extensive, faite de parties, et une grandeur intensive qui peut comporter une
infinité de degrés. Pourquoi l'âme ne pourrait-elle pas disparaître tout d'un coup, ou par
épuisement insensible, sans se diviser (durch Verschwinden) ? Au fond de tous ces
paralogismes, il y a un malentendu ou un faux sens (Missverstand) ; la confusion du sujet
transcendantal avec un sujet réel.
Ainsi tombe une prétendue science : la Psychologie rationnelle. On peut regretter qu'elle
soit fausse, car les vues spiritualistes ont un avantage pratique évident. On se consolera, en
observant que les raisonnements subtils des Métaphysiciens ont peut d'action sur le plus
grand nombre des hommes. Une preuve beaucoup plus forte nous viendra de la loi morale.
Kant, en 1787, achève la rédaction de la Critique de la Raison pratique et il dispose de la
clef qui lui ouvrira, dans une certaine mesure, l'accès d'un monde intelligible. Aussi conclut-
il l'étude des Paralogismes, en soulignant que l'avantage se trouve, dès maintenant, du côté
du Pneumatisme, c'est-à-dire du spiritualisme.
3. L'antinomie de la Raison pure et la Critique de la Cosmologie rationnelle
A) Principe de l'Antinomie
L'antinomie est présentée de façon identique dans les deux éditions de la Critique. Kant va
exposer et opposer deux thèses différentes, par une méthode qu'il n'a pas jugée nécessaire à
propos de la psychologie rationnelle. C'est que, dans la critique de la psychologie, Kant
conteste les procédés des métaphysiciens plus que leurs conclusions. D'ailleurs, il sait déjà,
surtout quand il prépare la deuxième édition, que la loi morale va lui permettre de justifier le
Pneumatisme. Au contraire, les solutions des deux premières Antinomies au moins, restent
discutables. D'ailleurs, ces solutions n'ont pas le même intérêt pratique que celles de la
critique de la psychologie rationnelle.
La Cosmologie rationnelle est caractérisée par la recherche de la totalité absolue des
conditions de l'expérience. Cette recherche nous met en présence de conceptions de
l'Univers (Weltbegriffe) fort différentes les unes des autres. Kant médite sur le sujet au
moins depuis 1755 et ses notes portent témoignage de maints tâtonnements. Il n'a pas cessé
de dresser des listes de problèmes cosmologiques. L'Opus postumum en contient plusieurs.
Voici les principaux thèmes qu'il a le plus souvent indiqués : le Monde est fini – ou infini ; il
a eu un commencement – ou il est éternel ; la matière est formée d'unités indivisibles – ou
elle est divisible à l'infini ; le monde est soumis à un mécanisme absolu – ou il fait place une
place au hasard, à la contingence, à la liberté ; il est dominé par la finalité – il ne comporte
aucune finalité ; ses formes sont invariables – elles sont changeantes ; un Dieu l'a créé et a
procédé à son arrangement – ou il n'existe pas de Dieu, etc. Kant ne se lasse pas de
dénombrer des Weltbegriffe utilisés par les philosophes du passé ou par ses contemporains.
Il faut, pour simplifier, ramener ces listes à l'essentiel, en procédant à une sorte de déduction
des concepts d'Univers.
Or la Raison agit ici d'après un principe : Si le conditionné est donné, la somme entière des
conditions ou l'inconditionné doit être également donné. Condition suppose série, et une
série peut être parcourue en deux sens qui correspondent logiquement à induction et
déduction. Dans le premier cas, on remonte des conditions au principe et la série est
régressive, parcourue par l'induction. Dans le second cas, on descend du principe aux
conditions et la série progressive est parcourue par déduction. Kant veut procéder par
induction, car seul le conditionné, l'Univers actuel, nous est donné. Mais deux restrictions
sont nécessaires : 1. Les phénomènes conditionnés nous sont donnés dans l'espace et dans le
temps. Dans l'espace, ces phénomènes sont simultanés ou coordonnés, et une régression est
impossible. Mais les phénomènes dans l'espace ne peuvent être appréhendés que par une
synthèse successive. La série sera donc régressive pour l'espace comme pour le temps qui
sont inséparables ; 2. La régression doit être examinée dans le cadre des catégories. Pas de
régression possible en ce qui touche la substance ; pas de synthèse régressive dans la
catégorie de la modalité. La synthèse régressive n'est en somme réalisable que dans la
catégorie de la causalité.
Or, dans cette catégorie seule, nous pouvons déjà nous former quatre images différentes de
l'Univers :
1° Idée de la totalité donnée de phénomènes considérés comme donnés, totalité finie ou
infinie dans le temps et l'espace et qui est celle d'un Monde (Welt).
2° Idée d'une totalité phénoménale connue par l'expérience, dont on peut considérer la
division en parties.
3° Idée de la naissance absolue d'un phénomène, sans lien avec d'autres.
4° Idée de la dépendance complète d'un phénomène.
Les deux premières images sont mathématiques et concernent l'ordre de la quantité. Les
deux dernières sont considérées du point de vue dynamique, et elles représentent le Monde
comme une seule Nature.
Si artificiel que soit l'appel à la table des catégories, Kant n'en classe pas moins avec
profondeur les questions cosmologiques.
1. Le monde est-il limité ou illimité dans l'espace ?
2. A-t-il un commencement et une fin, dans le temps ?
3. Est-il formé d'unités indivisibles ou est-il divisible à l'infini ?
4. Est-il soumis partout à des lois nécessaires ou comporte-t-il une causalité par liberté ? ou
des premiers commencements ?
5. Forme-t-il un ensemble dont toutes les parties sont liées ou comporte-t-il des régions
diverses ?
Kant a séparé, pour en faire l'objet d'un chapitre spécial, les problèmes de la Théologie
rationnelle.
Sur chacun de ces points, on peut affirmer une thèse ; par exemple le monde est fini dans
l'espace ; il a commencé dans le temps ; il y a des substances simple. Il y a des naissances
absolues ou des actes libres ; il y a un Être nécessaire. Ces thèses expriment l'exigence de la
Raison pure, qui veut toujours un tout déterminé et achevé, qui cherche toujours l'unité.
Mais on peut aussi défendre, avec de bons arguments, les antithèses contraires, qui
traduisent les exigences de l'entendement, organe de la discursion. Il existe de la sorte une
Antithétique ou Dialectique inévitable, qui éternise sans résultat les discussions des
métaphysiciens. Particularité curieuse, celui qui est opposant à la thèse ou à l'antithèse
paraît toujours avoir raison quand il parle, et c'est un fait qu'il faudra expliquer. (La
remarque vient de d'Alembert.)
B) Tableau des Antinomies
a) Les Antinomies mathématiques. – Thèses : Le monde a commencé dans le temps – il est
fini dans l'espace – il y a des substances simples.
Antithèses : Le monde n'a pas commencé dans le temps – il est infini dans l'espace – il n'y a
pas de substances simples.
La première antinomie comporte en réalité deux thèses et deux antithèses différentes, ce qui
devrait, en bonne logique, fournir trois antinomies mathématiques. On doit tenir compte,
dans chacune des deux antinomies mathématiques des deux formes de l'intuition, temps et
espace.
Première Antinomie. Thèse : Temps. – Le monde a eu un commencement dans le temps. On
peut l'établir par deux démonstrations : 1° Si le monde n'a pas de commencement, la série de
ses états passés est infinie. Mais une série infinie actuelle, pouvant être parcourue en entier,
ne peut pas être pensée ; 2° L'exploration d'une série infinie actuelle ne pourrait être
effectuée que dans un temps infini, elle est donc irréalisable par un entendement fini. On
peut ajouter une raison auxiliaire : si une série infini était donnée, on pourrait toujours y
ajouter une unité. Ce sont là des arguments classiques depuis les Eléates.
Espace. – Le monde est borné dans l'espace. Un monde illimité, formé d'une infinité
d'objets, ne peut être construit que par addition, donc par appréhensions successives qui
demanderaient un temps infini.
Antithèse : Temps. – Le monde n'a pas eu de commencement dans le temps. S'il avait
commencé, il aurait dû exister, avant son apparition, un temps vide. Mais il n'y a, dans un
temps vide, aucune condition suffisante de l'apparition d'un être quelconque.
Espace. – Le monde n'est pas borné dans l'espace. S'il l'était, il serait entouré d'un vide
illimité. Or, un espace vide illimité que rien ne borne est inconcevable, parce que le néant ou
le vide ne peut avoir aucune relation avec un être concret. L'échappatoire indiquée par
Leibniz : l'espace résulterait de relations entre unités spirituelles non spatiales, n'est pas
valable. Un être non spatial ou idéal, ne peut pas produire d'espace, de phénomènes
(observons en passant que le Kantisme arrivera finalement à une solution de ce genre).
Deuxième Antinomie. Thèse : Toute substance composée en ce monde est composée de
parties simples et il n'existe absolument rien, dans le monde, que le simple, ou ce qui est
composé de parties simples. – C'est la thèse des atomistes. Faisons abstraction par la pensée
du fait de la composition. S'il n'y a pas d'éléments simples, il n'existe rien du tout. Il faut ici
une nature simple, homogène à celle du composé. Kant a en vue l'atomisme et non la
Monadologie de Leibniz, parce que les Monades ne sont pas des parties constituantes des
corps.
Antithèse : Aucune chose constituée, dans l'Univers, n'est constituée de parties simples, et il
n'existe rien d'absolument simple dans l'Univers. – En effet tout composé est forcément une
réalité dans l'espace. Par suite, il y a autant de parties dans le composé que dans l'espace, ou
toute partie du composé est, en même temps, une partie de l'espace. Or toute partie de
l'espace, si petite qu'on la suppose, implique coordination et tout espace peut être divisé à
l'infini. Il n'y a donc pas de parties simples ; rien absolument n'est simple dans la nature.
Cette antithèse générale porte aussi contre la doctrine de Leibniz et des monadistes. Ceux-ci
(Leibniz) tiennent les raisonnements mathématiques pour logiques et non pour fondés sur la
nature de l'espace, non pour intuitifs. Ils croient qu'on peut faire abstraction de la nature de
l'espace, ce qui est impossible. La validité de la thèse est donc suspecte a priori.
b) Les Antinomies dynamiques. – Elles sont relatives à la causalité et à l'existence de Dieu,
considérées du point de vue de la philosophie naturelle et non de la théologie.
Troisième Antinomie. Thèse : La causalité selon les lois de la nature n'est pas la seule de
laquelle on puisse déduire l'ensemble des phénomènes de l'Univers. Il est encore nécessaire
d'admettre, pour les expliquer, une causalité par liberté. – En effet, s'il existe seulement une
causalité naturelle, chaque phénomène suppose un phénomène antérieur, auquel il fait suite,
selon une règle. Ce phénomène en implique un autre, et il n'y a jamais de premier
commencement. La série sera toujours inachevée. Il faut donc supposer une causalité, en
vertu de laquelle quelque chose arrive, sans cause antérieure, une spontanéité absolue des
choses, une causalité qui commence de soi, bref une causalité par liberté. Nous rencontrons
ici, pour la première fois, le concept transcendantal de liberté.
Or, le mot liberté a deux sens différents. Au sens psychologique, il a un contenu en grande
partie empirique. Mais, au sens transcendantal, la liberté est spontanéité absolue de l'action.
Cette spontanéité a deux aspects : 1. Le sujet commence de lui-même une série d'actions,
qui n'est pas comprise même implicitement dans ce qui précède ou ne dépend pas d'une
série antérieure (ce sera le point de départ de Renouvier). 2. L'action libre ainsi entendue est
imputable à celui qui l'exerce et, par là, nous passons à la Morale et à l'idée de
responsabilité.
Antithèse : Il n'y a pas de liberté... tout, dans la nature, survient uniquement selon les lois
de la nature. – S'il existe une liberté, il y a des actions indépendantes d'actions antérieures,
donc indépendantes des lois de la nature. La contrainte disparaît mais aussi la règle ou la loi.
Si bien que Nature et liberté transcendantale se distinguent comme légalité et absence de loi.
Supprimer la série des causes revient à supprimer l'ordre de la nature, donc tout principe
d'explication. Il n'y a plus de nature. Mais ne pourrait-on pas imaginer la liberté, hors du
monde ? L'entreprise semble bizarre : elle obligerait à distinguer deux vies ne nous, deux
aspects de la nature, et à passer d'un terme à l'autre. Kant sait déjà, quand il écrit, que son
dessein le force à tenter de résoudre ce problème paradoxal.
La quatrième Antinomie. – Nous posons ici la question de l'existence divine, sur le plan
cosmologique, sans nous occuper de théologie.
Thèse : A l'Univers appartient quelque chose qui, soit comme sa partie, soit comme sa
cause, est un Être absolument nécessaire. – La démonstration de cette thèse est purement
cosmologique. L'Univers est constitué sous la forme d'une série de changements dans le
temps. Chacun d'eux implique une condition. On s'élève de changement à changement, de
condition à condition, jusqu'à un Être absolument nécessaire, soustrait à toute condition.
Nous ne sortons donc pas de l'univers non plus que du temps, et l'argument est strictement
cosmologique. L'Être nécessaire est un terme de la série et il fait une partie du monde. Nous
n'avons pas besoin de passer dans un monde intelligible, d'une μετάβασις είς άλλο γένος.
Antithèse : Il n'existe nulle part un Être absolument nécessaire, soit dans le monde, soit en
dehors de lui, et qui en serait la cause. – La démonstration se fait par l'absurde. Supposons
la thèse vraie ; il existe un Être sans cause, la série elle-même n'a pas de commencement.
Ou cet Être est dans le monde, ou il est en dehors du monde. Dans le premier cas, la
régression s'interrompt, ce qui est absurde. Dans le second cas, cet Être ne peut pas agir
dans le monde n'ayant rien de commun avec lui. Dans cette antinomie, comme on le voit, le
même argument sert à prouver thèse et antithèse. Seul, nous dit-on, un Être nécessaire serait
condition de tous les phénomènes donnés, dans la série. Mais il n'y a pas d'Être nécessaire,
sinon la série disparaît. La thèse va de contingence à la nécessité. Inversement, l'antithèse
nous interdit de passer du contingent au nécessaire. Les astronomes raisonnent ainsi à
propos de la lune. La lune nous présente toujours la même face. Deux hypothèses rendent
également compte du fait : la lune tourne – ou elle ne tourne pas autour de son axe.
Les antinomies dynamiques appellent diverses remarques : La liste de Kant n'est pas
complète. D'autres hypothèses sont possibles. Les démonstrations manquent de clarté et
pourraient être simplifiées. Elles ont toutes le même principe ; opposition entre entendement
et raison. L'entendement parle par les antithèses ; il exige de continuer sans fin son œuvre
d'appréhension. La raison affirme la nécessité de s'arrêter et elle exige une synthèse totale. Il
y a conflit entre deux facultés. Les arguments employés par Kant ne sont pas neufs. Aristote,
les sceptiques grecs, Leibniz les ont employés.
c) Solution des Antinomies. – Considérons maintenant d'ensemble la solution des
Antinomies. Le jeu dialectique n'a aucune raison de cesser. Il semble que l'on soit acculé à la
solution sceptique : ne pas conclure. Kant n'a pas de parti pris contre la solution sceptique.
Toutefois, il faut essayer de l'éviter. Nous avons le choix entre le dogmatisme des thèses, et
l'empirisme des antithèses. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux
doctrines ?
Le dogmatisme a évidemment l'avantage pratique ; il est la pierre angulaire de la morale et
de la religion. L'antithèse nous ôte ces appuis, ou du moins elle paraît nous les ôter. D'autre
part, même théoriquement, les thèses sont plus satisfaisantes. Elles nous apportent une
solution achevée, de caractère architectonique. Enfin, elles s'accordent avec le bon sens
populaire.
L'empirisme, qui semble ruiner la morale en la privant de tout soutien métaphysique, a de
grands avantages en théorie ; il rend facile l'exercice de la spéculation, favorise la science
qui est fort utile. Mais il n'est pas populaire.
Que fera la philosophie transcendantale ? Elle ne peut pas capituler, se contenter de
lamentations. La solution dogmatique est intenable ; la solution empirique est décevante.
Une solution critique est nécessaire et il faut, pour la découvrir, abandonner les sentiers
battus. La philosophie critique explique l'antinomie par la structure des facultés humaines.
Ni le dogmatisme, ni l'empirisme ne tiennent. Un monde infini (celui de l'entendement et de
l'empirisme) est trop grand pour nos concepts. Un monde fini (celui du dogmatisme et de la
raison) est trop petit. Reste l'unique solution satisfaisante : l'idéalisme transcendantal ou
formel. Seuls sont réels les objets de l'expérience externe, dans l'espace, ceux de
l'expérience interne, dans le temps. Mais ces objets ne sont jamais connaissables, tels qu'ils
sont en eux-mêmes ou en soi (an sich selbst). Ils ne sont donnés que dans l'expérience et ils
n'existent aucunement en dehors d'elle. De même, les habitants de la lune (s'il y en a) ne
seront réels pour moi que lorsque je pourrai les voir. Rien ne nous est réellement donné que
des perceptions et un progrès empirique d'une perception à d'autres perceptions possibles.
Quand nous rencontrons un conditionné, une régression dans la série des conditions de ce
conditionné nous est également proposée. Ce conditionné n'est donc pas chose en soi car,
dans ce cas, ses conditions nous seraient données en même temps que lui. En somme, dans
l'argument proposé, la majeure est prise dans un sens transcendantal, la mineure dans un
sens empirique et la synthèse empirique des deux propositions est impraticable.
Antinomies mathématiques. – Je dis : le monde n'est pas infini dans l'espace ; il est infini
dans l'espace. Si la première proposition est vraie, la seconde est fausse et réciproquement.
Mais si le monde n'est pas une chose en soi, les deux propositions pourront être également
vraies. Elles ne sont contradictoires que si le monde est tenu pour une chose en soi. La
même opposition, considérée dans l'ordre des phénomènes, est simplement dialectique.
Antinomies dynamiques. – On distingue ici une causalité naturelle (nach der Natur) et une
causalité par Liberté (aus Freiheit). La causalité naturelle représente chaque phénomène
comme uni, dans le temps, à un phénomène antécédent, lui-même uni, par la même relation,
à un troisième. Au contraire, j'entends par liberté, au sens cosmologique, le pouvoir de
commencer de soi-même (von selbst) un état, sans cause antécédente. C'est là une idée
transcendantale, dont l'objet ne peut être donné dans aucune expérience. Le terme Liberté a
aussi un sens moral, dérivé du sens transcendantal : la liberté, au sens pratique, est
l'indépendance du vouloir par rapport à la contrainte ou nécessitation qui provient de
l'impulsion sensible. Le vouloir, par suite le libre arbitre (Willkür), est appelé sensible ou
pathologique, quand il est affecté par la sensibilité ; et même animal quand il est nécessité
par elle, ou le sera. Si la causalité naturelle existait seule, il n'y aurait qu'un vouloir animal.
Le conflit nature-liberté se formule donc en une proposition disjonctive, ou en deux
propositions qui s'excluent. Or, dit Kant, les deux propositions sont vraies toutes deux, mais
en un sens différent... Si les phénomènes sont les choses elles-mêmes, telles qu'elles sont, on
ne peut pas sauver la liberté... La condition de chaque chose n'est jamais contenue que
dans la série des phénomènes... Dans le cas contraire, les phénomènes doivent avoir eux-
mêmes comme des fondements (Gründe) qui ne sont pas des phénomènes.
Nous arrivons ainsi à une cause intelligible qui a des effets-phénomènes. Cette cause est
hors de la série des phénomènes, hors du temps. Le monde a deux aspects ; ici la cause est
libre ; là elle est déterminée selon des lois. Mais ce sont deux aspects d'une seule et même
vérité. Un même objet, l'homme, est caractère empirique, suite de phénomènes liés entre
eux selon les lois naturelles ; il est aussi caractère intelligible, cause libre, qui se manifeste
par des phénomènes dans le temps. Ce sont deux réalités identiques. La causalité joue dans
le monde intelligible, hors de la série des conditions empiriques ; là, pas de changements ou
d'événements. Rien n'arrive dans le caractère intelligible. Au contraire, dans la série des
causes phénoménales, il y a régression à l'infini, pas de premier commencement, aucune
action primitive (ursprünglich) ou qui ne dépendrait de rien, donc une suite d'événements.
La causalité qui s'exerce dans le monde intelligible (ou nouménal) n'intervient jamais pour
infléchir la série nécessaire par des actes libres. Le changement ne concerne que la manière
de penser dans l'entendement pur (betrifft blos das Denken, im reinem Verstande). Par son
aperception pure (durch blosse Apperception) et dans ses actes et déterminations intérieures
qu'il ne peut nullement tenir pour des impressions des sens, l'homme se reconnaît comme
libre et raisonnable.
Il y a donc une causalité propre de la Raison humaine. Cela, dit Kant, résulte clairement des
impératifs que nous énonçons dans toutes les choses pratiques, comme règles à l'usage des
forces que nous exerçons. Dans tout ce qui est pure théorie, les choses sont ce qu'elles sont
et nous ne pouvons les changer ; par exemple nous ne pouvons pas modifier par notre
volonté les propriétés du cercle. Au contraire, la Raison peut recevoir des commandements
pratiques (distingués en allemand par l'emploi du verbe sollen, au lieu de müssen réservé à
l'action nécessaire). Notre caractère empirique est soumis aux lois du mécanisme ; notre
caractère intelligible à la loi du devoir, au sollen de la Raison pure pratique. Un homme a
commis un mensonge fâcheux. Cette faute peut s'expliquer uniquement par un ensemble de
conditions extérieures ; par exemple la liberté du coupable a pu ne pas être entière. Pourtant,
son action est l'objet d'un blâme, comme s'il avait pu éviter de l'accomplir. Nous n'avons pas
démontré la liberté. Nous en avons montré la possibilité. La loi morale fera le reste.
La quatrième antinomie comporte une solution particulière. Là aussi, nous nous trouvons
devant deux propositions antagonistes ; et là aussi une échappatoire (ein Ausweg) peut être
trouvée. Les deux propositions opposées peuvent être vraies toutes les deux – en des sens
différents. Toutes les choses du monde sensible sont déterminées, conditionnées. Mais nous
n'y trouvons rien d'absolument nécessaire. Cependant, un terme d'une nécessité absolue
mettrait fin à la régression indéfinie qui nous déroute. Or, l'existence d'un être nécessaire en
dehors du monde sensible n'est pas impossible, et cela suffit.
Bref, les idées cosmologiques sont légitimes, tant que nous cherchons simplement les
conditions des faits. Elles deviennent transcendantales, dès que nous nous flattons de
pénétrer dans un monde intelligible. Un ordre intelligible déterminé entièrement par
entendement et raison peut être réservé comme un idéal, non comme une réalité. Ainsi vont
se développer parallèlement deux images du monde, déjà séparées dans la Dissertation de
1770 : le monde de l'expérience et le monde intelligible, domaine de la liberté. L'action
humaine aura pour objet de les unifier progressivement en un seul.
4. Critique de la Théologie rationnelle
A) L'Idéal transcendantal
Le propre des Idées, on l'a vu, c'est que nous ne pouvons pas les traduire en images
concrètes, parce que l'intuition sensible correspondante fait défaut. L'idée est encore plus
éloignée du sensible que la catégorie. Si l'on nomme idéal un objet déterminé par une idée,
cet objet ne peu pas être concret. Par exemple, l'idée d'un entendement divin, d'une âme
humaine parfaite, etc., ne se traduisent jamais en images sensibles. Toutefois, l'idéal peut
être conçu comme un modèle esthétique et aussi comme un modèle pratique.
Une des plus notables, parmi les idées de la raison pure, est celle d'un Être souverainement
réel, auquel conviennent par suite tous les attributs possibles (Ens realissimum). Un tel Être
est conçu comme parfaitement déterminé, car la Raison renferme l'exigence de la
détermination complète. Un tel Être doit être simple ; on dit de lui qu'il est tout-parfait,
éternel, qu'il se suffit.
Cette idée, qui est donnée, prête à confusion. Un Être réel ne peut être donné que dans une
expérience. Or, l'expérience totale qui nous serait ici nécessaire, nous est interdite. Nous
n'atteindrons jamais l'unité collective, globale, d'une perfection achevée. Nous ne concevons
qu'une unité distributive, donc partielle, qui ne suffit pas. Il faut d'abord prouver l'existence
de Dieu.
B) Les preuves de l'existence de Dieu
D'une manière générale, on raisonne ainsi pour y parvenir : Si quelque chose existe d'une
existence conditionnée, il doit aussi exister un Être nécessaire qui échappe, par nature, aux
conditions. Un tel Être doit contenir tout le réel, dit-on parfois. Mais cela est faux. Pourquoi
ne s'arrêterait-on pas à un terme déterminé d'une série de conditions ? Aussi l'argument a-t-il
pris trois formes différentes : 1. Partant de l'ensemble des faits existants, on veut remonter
au principe de la série des causes. On peut appeler cet argument physico-théologique, car il
remonte de la nature à Dieu ; 2. On part du seul fait de l'existence du monde et l'on remonte
à sa condition : c'est l'argument proprement cosmologique ; 3. Enfin, on prétend conclure,
entièrement a priori, à l'existence d'un être nécessaire. C'est l'argument ontologique, lequel
commande en réalité les deux autres et qu'il faut bien comprendre pour commencer.
a) Argument ontologique. – Un être nécessaire est un être dont l'inexistence est impossible.
La nécessité de son existence est analogue à celle des propriétés du triangle, pour qui a
exactement défini cette figure. On part donc de jugements que l'on déclare nécessaires et
l'on en conclut à une nécessité identique, pour les choses mêmes. Si j'enlève le prédicat
existant, la définition de l'être nécessaire est contradictoire, dit-on, en sorte que l'argument
semble se fonder sur l'inhérence du prédicat au sujet. Mais il y a ici une méprise évidente.
Si je dis : une chose existe, le jugement que je formule n'est pas analytique, mais
synthétique. L'existence ne peut jamais être contenue dans une chose comme un prédicat.
L'être, dit Kant, n'est pas un prédicat, c'est-à-dire le concept d'une chose quelconque qui
peut s'ajouter à une autre. C'est la simple position (Stellung) d'une chose. Si je dis Dieu
existe, je n'ajoute aucun attribut à la notion de Dieu. Cent thalers réels ne contiennent pas la
moindre détermination de plus que cent thalers possibles. L'existence n'étant pas un attribut
logique, ne peut pas être contenue dans un concept. Sur ce point, au moins, Descartes et
Leibniz se sont manifestement trompés. Kant l'avait déjà proclamé en 1763, après Hume,
dans son travail de jeunesse sur les preuves de l'existence de Dieu.
b) Argument cosmologique. – Il affirme une liaison absolument nécessaire entre l'existence
et la réalité logique la plus haute. C'est l'argument a contingentia mundi de Leibniz. Si
quelque chose existe, il doit exister aussi un Être nécessaire. Or j'existe, donc... La mineure
est ici un fait d'expérience, mon existence donnée. Mais on en conclut une chose qui ne peut
pas être un fait d'expérience. On poursuit ; le seul être nécessaire est l'Être souverainement
réel. Par suite, l'expérience n'a fourni que le point de départ, et l'argument cosmologique
sous-entend, en fait, l'argument ontologique, car l'Être nécessaire n'est d'abord qu'un être
simplement conceptuel (aus blossen Begriffen). L'être nécessaire est, en même temps, le
plus réel. L'argument cache donc un nid de sophismes dialectiques. Il applique, hors de
l'expérience, un principe de valeur exclusivement empirique, le principe de causalité ; il
implique la fausse espérance que l'on pourra parcourir la série tout entière des causes. Il
confond réalité empirique et réalité transcendantale. On peut admettre l'existence de Dieu à
titre d'hypothèse. On ne peut pas l'établir par ces deux arguments transcendantaux, sans
valeur empirique. Nécessité, possibilité ne sont pas des concepts positifs ou constitutifs,
mais seulement des notions régulatives, heuristiques (utilisables à titre de suggestions, en
vue de la découverte), où se traduit une exigence de notre raison.
c) Argument physico-théologique. – Les deux précédents arguments sont ou veulent être a
priori. Mais ne peut-il exister une expérience suffisant à nous imposer l'existence d'un Être
suprême ? Une telle espérance semble bien vaine a priori. Quelle expérience pourrait être
égalée à une Idée, à un idéal ? Le propre de l'idéal n'est-il pas que jamais une expérience ne
peut coïncider avec lui ? D'autre part, comment un terme, extérieur à la série des
expériences, pourrait-il expliquer cette série ?
Pourtant, l'argument a souvent pris une forme qui le rend très séduisant ; il fait état de la
symétrie, de la beauté, de la finalité, de l'ordre, constatés dans l'univers. Il affirme qu'une
perfection supérieure à tout le possible est nécessaire pour en rendre compte. C'est, dit Kant,
le plus ancien, le plus clair, le mieux adapté à la raison commune des hommes, de tous les
arguments concevables. Il vivifie l'étude de la nature, en nous montrant partout l'ordre et la
finalité. Kant semble l'approuver mais lui refuse toute valeur démonstrative. D'ailleurs, cet
argument se ramène, lui aussi, à l'argument ontologique. Il implique même en réalité les
deux arguments précédents. Nous imaginons une analogie entre la nature et les œuvres de
notre activité ; nous comparons l'univers à une maison, à un navire, à une montre... Enfin, si,
par impossible, l'argument était légitime, il ne viserait que la forme et non la substance
matérielle des choses.
C) Portée de la Critique théologique
Toute la théologie rationnelle est ainsi privée d'assiette. Cosmothéologie, ontothéologie,
théologie morale, sont pareillement atteintes. D'ailleurs, les deux premières peuvent nous
mener à une simple force aveugle (Déisme). Le troisième (Théisme) nous mène à un Dieu,
entendement et liberté. Mais tous les essais de la Théologie rationnelle sont vains, parce
qu'ils dépassent l'expérience. La raison pratique aura seule le droit de défendre et de
démontrer l'existence de Dieu. Nous montrerons des lois morales, qu'elles ne supposent pas
seulement l'existence d'un Être suprême, mais qu'elles le postulent à bon droit, parce
qu'elles sont en un autre sens (que les lois naturelles) absolument nécessaires.
Bref, toutes les fois que nous dépassons le champ de l'expérience, nos raisonnements sont
fautifs, parce que les lois logiques de l'entendement ne peuvent pas être transformées en lois
de l'être. Une critique complète établit qu'aucune Raison, dans son usage spéculatif, ne peut
jamais avec ces éléments (intuitions sensibles, concepts, idées) dépasser le champ de
l'expérience possible. C'était la conclusion que la plupart des philosophes français au XVIIIe
siècle avaient admise. Plus tard, Kant, définissant le domaine propre d'une Religion
raisonnable, partira de ces affirmations. Toutefois, si négative qu'elle soit en apparence, la
Critique de la Religion naturelle met déjà en relief toute l'importance vitale du problème
religieux et la haute valeur de quelques arguments théologiques, comme principes
régulateurs, sinon constitutifs de l'emploi de nos facultés.
II. Méthodologie transcendantale et discipline de la Raison pure
On nomme méthodologie la détermination des conditions formelles d'un système complet de
la Raison pure. On en exclut ainsi tout ce qui constitue la matière propre à chacune des
différentes sciences. Une méthodologie comprend une Discipline, un Canon, une
Architectonique et une Histoire de la Raison pure. Ces chapitres ont été lus attentivement
par la plupart des Allemands postérieurs à Kant, notamment par Hegel.
1. Discipline de la Raison pure
Elle concerne les règles applicables à la rédaction d'une Encyclopédie philosophique, telle
que les programmes universitaires obligeaient Kant à l'enseigner. Il ne s'agit pas de cultiver
la Raison pure en amateur, mais d'en régler l'emploi dans l'enseignement et la discussion
polémique, d'en déterminer l'usage dogmatique et l'usage polémique.
L'usage dogmatique de la Raison, dans la philosophie, sera compris par comparaison avec
l'usage qu'en fait la mathématique. Celle-ci opère par construction de concepts. Aucune
construction n'est possible sans intuition, sans considération du général dans le particulier.
On découvre les propriétés du triangle dans un triangle concret que l'on a construit. Le
mathématicien ne trouve pas les propriétés des figures, par considérations abstraites, mais
en regardant les figures, dans les intuitions sensibles (de l'espace et du temps) et dans la
matière. Toutefois, en ce qui touche la matière, nos concepts de synthèse restent
indéterminés. Aussi le mathématicien, disposant d'intuitions pures, peut-il énoncer des
définitions, des axiomes, des démonstrations, toutes démarches qui semblent interdites au
philosophe. Il est presque impossible de fournir des définitions en matière de philosophie et
de Science de la Nature, car les choses concrètes échappent à la définition. Qui pourrait
définir l'or autrement que par une énumération résumée des principales propriétés de ce
métal, simple essai, toujours sujet à l'erreur ?
Si la mathématique use d'axiomes ou de principes synthétiques a priori immédiats et
certains, la philosophie ne peut jamais procéder que par opérations discursives.
L'expérience du philosophe montre ce qui est, non ce qui doit être, au lieu que le
mathématicien démontre a priori d'après des intuitions pures.
Il n'existe donc pas de philosophie dogmatique, susceptible dénoncer des dogmata,
symétrique des mathemata. Impossible de réaliser ce que Descartes et Spinoza n'ont pas
réussi (Schelling et Hegel seront d'un avis différent).
La Raison pure a un emploi polémique quand elle défend ses affirmations contre les
négations sceptiques ou les réfutations dogmatiques. C'est ce que viennent de réaliser les
théories des Paralogismes et des Antinomies. Impossible de démontrer logiquement
l'existence ou l'inexistence de Dieu, le pessimisme ou l'optimisme. C'est toujours, dans de
pareils exercices, celui qui a le plus de talent littéraire qui l'emporte, dans la petite guerre
entre philosophes. Pourtant, nous ne sommes pas réduits au scepticisme, ou à la neutralité.
La solution sceptique, par exemple celle de Hume, n'en est pas une. Hypothèses vagues,
rêveries, suppositions transcendantales ne vont pas sans dangers. La philosophie, pas plus
que la géométrie, ne peut se contenter de vraisemblances. Il lui faut des démonstrations.
Mais elle doit user d'une prudence extrême, examiner très soigneusement les principes. Le
principe de causalité n'a aucune valeur hors des limites de l'expérience. D'autre part, les
propositions transcendantales de la métaphysique ne comportent pas de matière, puisqu'elles
sont a priori. Toute démonstration est ici forcément ostensive (directe) et non apagogique
(détournée).
2. Canon de la Raison pure
Kant nomme Canon l'ensemble des principes a priori utilisables dans l'usage d'une certaine
faculté de connaître. L'analytique transcendantale contient un tel Canon pour l'entendement
pur. Or la Raison cherche à résoudre trois questions : liberté du vouloir, immortalité de
l'âme, existence de Dieu. Ces questions n'ont guère d'intérêt spéculatif et leur examen
théorique est fastidieux, ce qui peut paraître un paradoxe. Mais elles sont un intérêt non
scientifique et pratique très considérable. On appelle pratique, tout ce qui est possible par
liberté. Que devons-nous faire, si la volonté est libre, s'il y a une vie future, si Dieu existe ?
(Was zu thun sei) ? La volonté libre se distingue de la volonté animale, déterminée par des
impressions uniquement sensibles ou pathologiques ; elle dépend en effet de motifs que la
Raison est seule capable de déterminer.
Or l'expérience permet de démontrer l'existence de la liberté pratique (kann durch
Erfahrung bewiesen werden). Nous avons le pouvoir réel de nous déterminer en vue de
choses invisibles ou éloignées, d'un idéal, de maîtriser les impressions qui agissent sur la
faculté sensible de désirer.
Cette liberté réelle repose sur la Raison. La Raison donne des Impératifs, des Lois (ou
commandements), des lois objectives de la Liberté qui définissent ce qui doit arriver, même
si cela n'arrive jamais. On pourrait à ce sujet se poser maintes questions. Par exemple : La
raison est-elle, elle-même, déterminée quand elle énonce un impératif ? ou bien : la Liberté
ne pourrait-elle être appelée elle-même une Nature, quand on la compare à un ordre
supérieur ? Mais de telles questions sont pratiquement oiseuses. La liberté pratique est
reconnue par l'expérience, comme une cause naturelle. Au contraire, la liberté
transcendantale exige l'indépendance de la Raison, même à l'égard de toutes les causes
déterminantes de l'univers sensible. Il y a là une contradiction au moins apparente et qui
doit être levée.
De là trois questions inévitables : une question théorique : Que puis-je savoir ? Une
question purement pratique : Que dois-je faire ? Une question à la fois théorique et
pratique : Que puis-je espérer ? Nous aspirons au bonheur ; l'aspiration selon laquelle le
bonheur doit récompenser la vertu est morale. Elle exige un monde parfaitement conforme à
la morale, ou un monde moral. Si ce monde existe, je pourrai me dire : Fais ce par quoi tu
te rends digne d'être heureux. Il doit exister un Monde intelligible où tombent tous les
obstacles mis ici-bas à l'ordre moral, un système, une unité des Fins.
Nous voici amenés à distinguer trois degrés du savoir : Opiner (Meinen), Savoir (Wissen),
Croire (Glauben). Une vérité théoriquement incomplète, mais pratiquement nécessaire est
l'objet d'une croyance. J'indique alors un but à l'action ; cela fait, je dois en définir les
moyens d'une manière hypothétiquement nécessaire, tout en obéissant à la loi morale. C'est
tout le plan de la Critique de la Raison pratique. Le but ainsi défini coïncide avec celui
d'une technique ne général.
3. L'Architectonique de la Raison pure
A l'exemple de Wolff, Kant, on l'a vu, accorde une grande importance à la disposition de son
œuvre. Une philosophie n'est pas une rhapsodie. Il faut la présenter avec art. Elle traduit une
idée qu'elle doit réaliser ; toutes ses parties doivent se subordonner à un dessein principal.
Elle comporte une préface ou propédeutique : la Critique. Puis viennent une Métaphysique
de la Nature et une Métaphysique des Mœurs. Enfin, on trouvera une Ontologie, une
Physiologie, une Cosmologie, une Théologie rationnelles. Il faudrait aussi une partie
historique. Kant l'omettra provisoirement et la place de l'histoire restera vide. Mais il faudra
définir, par les exemples du passé, l'objet, l'origine, la méthode de l'Histoire. Par exemple les
sensualistes et les intellectualistes (Épicure et Plotin) ont défini différemment l'objet de
l'histoire. Des empiristes (Aristote) et des noologistes (Platon) en ont compris l'origine de
façon diverse. Quand à la méthode, on distinguera des naturalistes guidés par le sens
commun (Démocrite) et des savants tantôt dogmatiques (Wolff), tantôt sceptiques (Hume).
Kant espère, grâce à la méthode critique, éviter dans ce domaine les erreurs de ses
devanciers.
III. Sens de la Critique de la Raison pure
On a voulu suivre pas à pas cette analyse touffue des possibilités de l'esprit humain, qui est
en même temps le programme d'une Encyclopédie méthodique. L'effort de Kant mérite
l'attention et l'admiration. Depuis 1787, des millions de disciples ont tenté de comprendre et
d'étendre les démarches déjà réalisées par Kant. Il en est résulté un grand désarroi et, moins
d'un siècle après la mort de Kant, un penseur allemand, Friedrich Paulsen, s'écriait :
Revenons à Kant ! Mais pouvait-on, au début du XXe siècle, accepter encore ce que maints
Allemands contemporains de Kant ont déjà tenu pour une nouvelle scolastique ?
Pour découvrir, pour ordonner les facultés originales de l'esprit, Kant a recours à une
analyse indirecte des produits fixés de l'activité humaine (sciences, arts, techniques,
institutions, religions), comme un chimiste détermine les acides ou les bases par l'analyse
des sels. Mais Kant ne s'occupe guère de l'étude de ces produits. Il observe avant tout le
langage particulier, employé par chaque science, et de l'examen des termes, il conclut à la
nature des représentations mises en jeu. Le Kantisme n'est qu'accessoirement une analyse
des produits de l'activité mentale. C'est surtout une analyse du vocabulaire des sciences et
des règles grammaticales. L'élément formel qu'elle atteint, n'est formel qu'au sens du
grammairien.
Par cette analyse, Kant est amené à créer des termes nouveaux, et aussi à prendre dans un
sens neuf beaucoup de termes anciens. Kant garde les facultés classiques, et il crée des
facultés nouvelles et des opérations probablement imaginaire de ces facultés. À quoi
répondent en réalité des expressions telles qu'intuition pure, moi transcendantal,
aperception, etc. ? Ce foisonnement de facultés est déjà visible chez Leibniz et chez Wolff ;
il s'aggravera chez les Idéologues et chez les Écossais comme chez les « phrénologistes ».
Kant obéit à une tendance commune à tous ses contemporains. Mais il y a deux sens bien
différents du terme Faculté : il peut désigner un ensemble d'opérations mentales connexes,
ou bien le territoire cérébral affecté à tel groupe d'opérations. Il est a priori évident que
l'analyse du langage ne nous fournit aucune indication sur une séparation et sur un conflit
des facultés mentales réelles. Pourtant l'existence de ce vocabulaire, probablement tout à fait
artificiel, explique la longue survivance du kantisme, comme la présence de mots clés,
disposés par ordre, explique en partie la longue fortune de l'Aristotélisme et du Thomisme.
De même, la savante Architectonique des trois Critiques et de chaque Critique en particulier,
a un caractère artificiel. Les fonctions mentales sont probablement beaucoup moins
spécialisées ou tout autrement spécialisées que la Kantisme ne l'admet, et Kant lui-même en
a eu le sentiment quand il s'est proposé de montrer l'unité essentielle de la vie intérieure.
Le terme Critique doit être pris dans toute sa force. Kant entend réellement juger, à la
manière d'un magistrat impartial, l'attitude mentale des hommes et les différentes doctrines
philosophiques. Il se flatte de les traduire devant le tribunal de la Raison pure. Il se propose
plus encore de juger ce que nous pouvons attendre de l'esprit. Et il indique aussitôt la
division qui va dominer ses recherches : Que pouvons-nous savoir ? (Sous formes de lois
universelles.) Que devons-nous croire ? (Il sous-entend ainsi l'intervention d'une Raison
devenue pratique, se transformant en volonté pure, et fondant une croyance rationnelle.)
Que pouvons-nous espérer ? (Il annonce ainsi l'optimisme relatif par lequel s'achève sa
réflexion morale.) Ainsi procède-t-il à une enquête sur toute la vie humaine. Au terme de
cette enquête, il pourra vraiment – selon le programme fixé par les règlements universitaires
– passer en revue toutes les formes de l'activité humaine, en indiquant le degré de certitude
et la confiance que chacune d'elles peut mériter.
IV. Les Fondements métaphysiques de la Science de la Nature
1. Le Projet de Métaphysique de la Nature et l'Opuscule de 1786
Au moment où il allait préparer le texte de la seconde édition de la Critique de la Raison
pure et où il élaborait sa morale et sa métaphysique des mœurs, Kant songeait aussi à
donner une métaphysique complète de la Nature. Sans avoir pu réaliser complètement ce
projet, dont traitent encore maints passages de l'Opus postumum, Kant a pourtant écrit un
petit traité publié à Riga en 1786 et réédité deux fois de son vivant : Les Premiers Principes
métaphysiques de la Science et de la Nature (Metaphysische Aufgangsgründe der Natur-
Wissenschaft). En portant la lumière critique sur des problèmes de mécanique et de
physique, Kant revenait à des préoccupations qui avaient dominé son esprit près de quarante
ans plus tôt.
Cependant, comme l'a remarqué Ueberweg, Kant devait un peu dépasser, sur ces questions,
les cadres précis de la Critique de la Raison pure, énoncés avec tant de force en 1781, et
bientôt en 1787, tout en conservant la même nomenclature. Il formule, sur la structure de
l'univers, diverses propositions où déjà se manifeste la tendance à un idéalisme radical,
visible plus tard dans une bonne partie de l'Opus postumum. En effet, aux termes de la
Critique de la Raison pure, les seuls éléments a priori impliqués dans notre activité
théorique et pratique sont fournis par les « formes » de l'espace et du temps, les catégories
de l'entendement, les spécifications nées du jeu simultané de l'intuition pure et des
catégories, et décrites dans l'Analytique des principes. Tout le reste viendrait de la
sollicitation, en elle-même insaisissable, de la chose en soi. Or, dans les Fondements
métaphysiques, Kant recourt à des propriétés théoriquement inaccessibles de la chose en soi,
et il paraît souvent transformer en données pures et a priori des éléments visiblement
empiriques. Kant entreprend de pousser aussi loin que possible le domaine de l'entendement
et de l'intuition pure.
La construction de ce petit ouvrage a été longuement méditée, bien qu'elle ne soit pas
exempte parfois de fausse symétrie. Il comprend quatre parties d'inégale importance. La
Préface, après avoir délimité le sens du mot Nature, montre quel est le domaine propre de la
science de la nature ; c'est celui d'une théorie rationnelle a priori de type mathématique,
procédant par construction des concepts ; en ce sens la chimie, dans la mesure où elle n'est
pas une chimie physique intelligible, demeure un art systématique ou une théorie
expérimentale ; a fortiori, la psychologie empirique se trouve encore plus éloignée de la
science naturelle.
Pour fonder une métaphysique de la science naturelle, Kant va utiliser les tables de
Catégories et de Principes énoncés dans l'Analytique de la Critique de la Raison pure : « Le
schéma nécessaire pour un système métaphysique intégral est le tableau des Catégories, car
il n'existe pas d'autres concepts purs de l'entendement qui puissent s'appliquer à la nature
des choses. » Dans ces quatre classes doivent entrer toutes les déterminations du concept
universel de matière, tout ce qu'on en peut penser a priori.
Or, la détermination fondamentale d'un objet des sens externes devait être le mouvement,
car celui-ci seul peut affecter les sens. C'est au mouvement que l'entendement ramène tous
les autres prédicats de la matière ; en conséquence, la science de la nature sera en totalité
une théorie du mouvement. Tel est l'aspect fondamental de la conception kantienne, en
accord avec la physique mobiliste et dynamique de son temps : la Phoronomie étudiera le
mouvement comme une quantité ; la Dynamique l'étudiera comme appartenant à la qualité
de la matière soumise à une force motrice ; la Mécanique considérera la matière pourvue de
cette qualité en relations réciproques, en vertu de son mouvement ; la Phénoménologie
déterminera le mouvement et le repos par rapport aux modalités de représentations. Ces
quatre aspects correspondent également aux quatre domaines des Principes. La première
partie correspond à peu près à ce qu'on appelle aujourd'hui la cinématique, alors que la
seconde et la troisième correspondent à la dynamique ; la troisième énonce les principes
généraux, tandis que la quatrième indique les lois des processus. La notion de matière se
trouve ainsi définie à quatre niveaux différents.
2. La Phoronomie
Cette partie traite du mouvement en tant qu'il est soumis à des conditions spatio-
temporelles, conformément aux résultats de l'Esthétique transcendantale. Elle correspond
aux axiomes de l'intuition et à la Catégorie de quantité. Il est fait ici abstraction de la force ;
la Phoronomie n'attribue en effet à la matière que la seule mobilité : la matière est ce qui
peut se mouvoir dans l'espace. Le mouvement d'une chose est une modification de ses
conditions externes par rapport à un espace donné et le repose est la présence permanente en
un même lieu. Considéré en grandeur, le mouvement est déterminé par sa vitesse et sa
direction ; le mouvement le plus simple est le mouvement rectiligne uniforme, où
l'accélération est constamment nulle et la vitesse constante. La Phoronomie n'étudie pas le
mouvement curviligne parce que le mouvement y est changé continûment dans sa direction,
et il faut faire appel à une cause de ce changement qui ne peut être le simple espace. Si l'on
considère plusieurs portions de matière animée de mouvement, leur composition peut se
faire suivant les trois aspects de la quantité : ou bien deux mouvements s'ajoutent dans la
même ligne et la même direction ; ou deux mouvements s'ajoutent dans la même ligne et en
directions opposées : ou bien enfin deux mouvements se composent à partir de directions
formant un angle. Kant indique les schémas des compositions des mobiles et en particulier
le parallélogramme de composition des vitesses, qui sont des grandeurs intensives.
Mais plus important que le théorème de composition de vitesse est le principe de relativité.
En effet, la Phoronomie fait abstraction du sujet du mouvement. À la suite de d'Alembert,
Kant l'énonce fort clairement : l'espace mobile s'appelle l'espace matériel ou relatif, et
l'espace dans lequel doit se penser tout mouvement se nomme l'espace pur absolument
immobile. Or, la Phoronomie étudie le mouvement purement apparent où la référence peut
être soit dans le corps, soit dans l'espace : tout mouvement comme objet d'une expérience
possible peut à volonté être considéré comme mouvement du corps dans un espace en
repose ou comme repose d'un corps dans un espace au contraire doué d'un mouvement de
même vitesse dans la direction opposée. Si, dans un espace donné, le mouvement rectiligne
de la matière dans une direction n'est pas distinct d'un mouvement en sens inverse de
l'espace, c'est que nous n'avons aucun moyen empirique de séparer ces deux mouvements,
aucun terme immobile absolue ne nous est donné. Dans l'espace céleste, par exemple, tout
corps en mouvement suppose idéalement un mouvement opposé de cet espace lui-même ;
affranchie de la relation, cette pure possibilité du mouvement inverse devient impensable ;
le mouvement de la matière sera dit réel, alors que celui de l'espace sera dit apparent.
3. La Dynamique
La Phoronomie est insuffisante lorsqu'elle définie la matière comme une mobilisation dans
l'espace ; il y manque la possibilité de mobilisation, objet de la dynamique, qui est l'étude du
rapport des forces. En effet, considérée du point de vue de la quantité, la matière a la
propriété de remplir l'espace. Or la possibilité pour un mobile d'occuper un lieu manifeste la
force. Mais si la phoronomie appelle la dynamique, la dynamique présuppose la
phoronomie, de même que l'analytique suppose une hiérarchie des principes ; les théorèmes
dynamiques supposent déjà les axiomes de l'intuition, comme la phoronomie supposait les
références à la géométrie. La dynamique ajoute, à la définition de la matière par la
phoronomie, la propriété de résister à la pénétration.
L'analyse du mouvement comme qualité permet de distinguer deux forces motrices
antagonistes : l'attraction (Anziehung), par laquelle une portion de matière attire les corps
voisins, et la répulsion (Abstossungskraft), par laquelle une portion de matière repousse les
corps voisins.
Mais la force de répulsion suppose l'impénétrabilité matérielle au moins relative. Quand à
l'attraction, Kant admet, à la suite de Newton, qu'elle agit immédiatement à distance d'une
façon inverse au carré de la distance. Ces deux systèmes de forces posent le problème de
l'infini : force d'attraction et force de répulsion peuvent avoir théoriquement toutes les
valeurs possibles entre l'infiniment petit et l'infiniment grand ; en particulier Kant admet la
divisibilité infinie de la matière ; chaque partie devenant à son tour matière ; de même
l'attraction a une possibilité d'extension infinie.
À l'exemple de Newton, Kant montre la supériorité, sur la physique mécanique de la
substance, de la physique du champ, qui combine la masse et la quantité de mouvement
avec l'action à distance.
La Remarque générale sur la Dynamique permet à Kant d'analyser certaines propriétés
concernant la matière définie selon la dynamique. Tout d'abord le volume et la densité d'un
corps : un corps est une matière comprise dans des limites déterminées – il s'agit d'une
grandeur extensive ; le degré de plénitude d'un volume déterminé se nomme densité : c'est
une grandeur intensive. Ensuite, la cohésion, qui est l'attraction conçue comme n'étant active
qu'au contact ; cette notion lui permet d'étudier la fluidité, la rigidité et les frottements ;
enfin, l'élasticité et l'action chimique par compénétration et dissolution des corps, agissant
au repose par opposition à l'action mécanique résultant du mouvement ; en fait, ces
combinaisons chimiques doivent être compénétration absolue des corps.
Dans son ensemble, la dynamique apparaît entièrement dominée par les découvertes de la
physique newtonienne du XVIIIe siècle, issue de la notion de force de gravitation. Mais elle
est aussi description de mécanique appliquée.
4. La Mécanique
La Mécanique définit les principes généraux de la science physique sous l'aspect de la
relation. En posant que la matière est définie par l'élément mobile disposant de force
motrice, Kant pose, par là même, les deux notions de quantité de matière et de quantité de
mouvement, en ramenant la première à la seconde.
La Mécanique étudiera donc les principes des relations effectives d'un corps mû avec les
autres corps dans l'espace de son mouvement. En se fondant sur les analogies de
l'expérience, Kant peut ainsi énoncer les trois grandes lois de la mécanique. La première loi
correspond à la permanence de la substance : c'est le principe de conservation de la quantité
de matière – dans toutes les modifications de la nature corporelle, la quantité de matière
reste constante dans l'ensemble. La seconde loi correspond à la causalité : c'est le principe
d'inertie – tout changement dans la matière a une cause externe et toute particule de matière
ne peut être mue que par une impulsion extérieure ; chaque corps persévère dans son état de
repos ou de mouvement en conservant même direction et même vitesse.
La troisième loi correspond à l'action réciproque, c'est le principe d'égalité de l'action et de
la réaction dans la communication du mouvement.
Dans la Remarque générale sur la Mécanique, Kant montre que plusieurs processus de la
mécanique, et notamment ce rapport de l'accélération à la vitesse, impliquent un passage
graduel continu. Kant formule ainsi le principe de continuité : les grandeurs intensives des
modifications de vitesse et de direction ont la propriété de continuité fluente, c'est-à-dire de
passer par une série infinie d'états intermédiaires. Le principe de continuité de la causalité
assure la possibilité de perception du changement ; le mouvement réel se manifeste par une
accélération.
5. La Phénoménologie
Elle définit la matière comme le mobile pouvant être objet de l'expérience. Elle applique au
mouvement la catégorie de modalité et les postulats de la pensée empirique en rapport avec
la notion de relativité déjà définie dans la phoronomie : le mouvement dans l'espace est
conçu comme possible selon la phoronomie, comme réel selon la dynamique, et comme
nécessaire selon la mécanique.
La Remarque générale sur la Phénoménologie reprend le principe de relativité, mais en
l'appliquant particulièrement au mouvement circulaire dans l'espace céleste (rotation de la
terre relativement au ciel étoilé).
Enfin Kant montre que le rapport entre la quantité de matière constante dans le monde et la
notion d'espace vide permet sans doute le mouvement libre des corps. Et la question de cette
possibilité de l'espace nous fait pénétrer dans le mystère de la nature.
6. Portée de l'opuscule
Une grande nouveauté de la philosophie de Kant est la distinction radicale de la matière et
de l'étendue ; le mouvement n'est plus un mode de l'étendue, mais une existence réelle non
géométrique. Le trait essentiel de cet ouvrage de Kant est le sentiment remarquablement fort
de la relativité des lois qui s'y exprime, et c'est sur cette notion qu'il achève son ouvrage. Le
désir de se rapprocher autant que possible des données concrètes, conduit à étendre le
domaine des fonctions mentales, au point de résorber en partie ce qui provient de la chose
en soi, caractérisée comme inconnaissable dans la Critique de la Raison pure. La méditation
sur le mécanisme conduit à juxtaposer à la relativité proprement kantienne, due à la
structure de l'esprit humain, une seconde relativité plus essentielle, manifestée par les
difficultés à saisir un mouvement absolu, à étendre le domaine du relatif jusqu'à la chose en
soi elle-même. Il se trouve que, par cet aspect, le Kantisme a frayé la voie aux théories
modernes de la relativité, telles que la science du XXe siècle devait les formuler peu à peu.
Descartes, Newton et d'Alembert avaient déblayé la route. Mais Kant a sans doute
contribué, dans une certaine mesure, à la naissance de la plus récente philosophie de la
nature, et Einstein a peut-être lu Kant.
La Morale et la Pédagogie de Kant
I. Genèse de la Morale kantienne
Les préoccupations morales de Kant sont signalées pour la première fois dans une lettre de
Hamann à Lindner, en 1764. Mais les réflexions de Kant sur la morale sont antérieures et
elles sont indiquées par des passages de ses plus anciens travaux. Le 31 décembre 1765,
Kant écrit à Lambert qu'il vient seulement, après beaucoup d'essais, de découvrir une
méthode assurée pour les recherches morales. Mais il n'entend pas en faire connaître
immédiatement les résultats. Il publiera d'abord quelques essais d'application de ses
procédés, avant d'éditer des Principes métaphysiques de la Philosophie naturelle et de la
Sagesse pratique (der praktischen Weltweisheit). C'est probablement le livre annoncé la
même année, par l'éditeur Kanter de Königsberg, sous le titre : Critique du goût moral (des
moralischen Geschmacks). Le 16 février 1767, Hamann signale que Kant travaille à une
Métaphysique de la morale et il ajoute : on y recherchera ce que l'homme est réellement,
plutôt que ce qu'il doit être. Le 9 mai suivant, Kant écrit à Herder qu'il espère en finir cette
année. Devenu professeur ordinaire de physique et de métaphysique le 31 mars 1770, Kant
écrit à Lambert, le 2 septembre : Je me suis proposé de mettre en ordre et d'achever cet
hiver mes recherches sur la sagesse morale pure (où l'on ne doit pas rencontrer de
principes empiriques) et en même temps la Métaphysique des mœurs. Cependant, les deux
années suivantes, il n'avait encore fait, nous l'avons vu, que réunir des matériaux et
esquisser un plan. Les limites de la sensibilité et de la Raison (c'est le titre) comprendront
une partie théorique et une partie pratique, chacune en deux sections. 1. Partie théorique :
Phénoménologie en général ; Nature et méthodes de la Métaphysique. 2. Partie pratique :
Principes généraux du sentiment du goût et des désirs sensibles ; premiers fondements de la
moralité.
Mais Kant est alors pris tout entier par la mise au point de la Critique de la Raison pure, qui
est loin d'être achevée à la fin de 1773. Quand j'aurai terminé ce travail, je passerai à la
Métaphysique ; elle n'a que deux parties : Métaphysique de la nature et Métaphysique des
mœurs. Je publierai la deuxième en premier lieu, et je m'en réjouis d'avance.
Ainsi, Métaphysique et Morale lui semblent inséparables ; les faits moraux sont symétriques
des faits de la nature et posent des problèmes de même ordre. D'autre part, Kant énonce,
tout à fait dans le style des philosophes français du XVIIIe siècle, la question morale :
Comment fonder (gründen) les principes de la morale ? Les théories et les concepts de
l'entendement n'y suffisent pas. Il faut ici une force motrice en rapport avec les premiers
mobiles du vouloir. Kant n'en a pas fini le 28 avril 1775, et nous n'en avons plus de
nouvelles jusqu'à la publication de la Critique de la Raison pure (automne 1781).
Cependant, Kant a dû en parler à l'éditeur Hartknoch de Halle, qui a publié la première
Critique et lui demander d'éditer sa future Métaphysique des Mœurs et de la Nature. Il
travaille à ce livre en même temps qu'aux Prolégomènes (publiés le 16 août 1783). Le jour
de la publication des Prolégomènes, Kant écrit à Mendelssohn : Cet hiver, je mettrai sur
pied la première partie de ma Morale, sinon en entier, du moins pour l'essentiel. En 1784, il
rédigeait un préambule (Prodromus) à la Métaphysique des Mœurs annoncée pour la Saint-
Michel. Les retards de l'imprimeur ajourneront la publication jusqu'au 7 avril 1785.
En même temps, Kant travaille activement à rédiger un exposé scientifique de sa morale,
destiné à compléter la version relativement populaire qu'il vient de terminer. Le 26
décembre 1787, il indique à Reinhold l'harmonie générale de sa doctrine. L'esprit a trois
facultés principales : faculté de connaître, faculté de ressentir le plaisir et la douleur, faculté
de désirer. La Critique de la Raison pure a décrit la première ; la Critique des principes a
priori de la Raison pratique traite des désirs. Kant cherche encore un titre à la seconde
Critique (la Critique du jugement ne prendra forme qu'un peu plus tard). La philosophie
comporte ainsi trois parties : philosophie théorique ; Téléologie ou doctrine des fins ;
philosophie pratique. La seconde édition de la Critique de la Raison pure paraît en 1787. La
Critique de la Raison pratique (troisième partie prévue) est prête dès le 25 juin suivant et
paraîtra à Riga en 1788. Mais la réflexion morale se prolongera dans la Critique de la
faculté de juger (1790), la Religion dans les limites de la seule raison (1793) et
l'Anthropologie (1798) qui allait clore, après une méditation de plus de trente ans, le cycle
des recherches pratiques de Kant.
II. Les Fondements de la Métaphysique des Mœurs (1785)
1. Place de la Morale dans le système de Kant
La morale doit être tirée d'une analyse approfondie des faits moraux, de la réalité morale.
Elle a donc un préambule empirique inévitable, comme la Critique de la Raison pure part de
l'examen de la science existante. Cette analyse préalable nous mène à dégager des faits ou
principes purs, non empiriques, donc a priori, dont il faut découvrir la liaison. Le résultat
sera un système de notions pures a priori qui constituent la morale proprement dite et sans
lesquelles une réalité morale serait inconcevable. En effet, au début des Fondements de la
Métaphysique des Mœurs (1785) Kant, laissant de côté la logique ou philosophie formelle,
découvre dans la Philosophie matérielle, doctrine des objets et de leurs lois, une partie
physique (Philosophie de la Nature) et une partie éthique (Morale). Chacune de ces deux
parties a ses lois ; lois de la nature pour la première, lois de la liberté pour la seconde.
Chacune comporte une partie empirique : la Nature physique, objet de l'expérience sensible,
pour la première, la Volonté humaine considérée dans la Nature et objet de la Physique des
Mœurs ou de l'Anthropologie pratique, pour la seconde. Chaque Physique se double d'une
Métaphysique : Métaphysique de la Nature pour la première, Métaphysique des Mœurs ou
Morale pure, au sens propre du terme, pour la seconde.
2. Analyse des notions morales communes : de la bonne volonté à l'impératif
catégorique
La connaissance morale commune est visiblement tirée de l'expérience et Kant entre
immédiatement in medias res.
Premier fait, relevé par l'observation courante : Rien n'est bon moralement sans réserve,
sinon une bonne volonté. L'intelligence, le jugement, le courage, la résolution, la
persévérance, parmi les qualités intellectuelles ; la santé, la fortune, le contentement, la
richesse, l'honorabilité, parmi les biens extérieurs, peuvent contribuer à la moralité. Ils ne la
constituent pas. Si la bonne volonté manque, l'usage des qualités extérieures et
intellectuelles est toujours mauvais (l'analyse est classique : Kant pouvait la trouver chez
Cicéron et Sénèque). – Or la bonne volonté n'est pas bonne en raison du but qu'elle vise ou
qu'elle atteint. Elle est bonne par elle-même, comme un pur joyau ; elle reste bonne même en
cas d'échec. Sa valeur est absolue. La destination (Bestimmung) vraie de l'homme est donc
de mettre au jour une volonté bonne en soi. Fait troublant car, après tout, la Nature aurait pu
nous donner un instinct infaillible du bien, de notre bien.
La notion de bonne volonté est étroitement unie à celle de Devoir (Pflicht, Sollen), plus
étroite à certains égards. Nous devons éviter non seulement les actions contraires au devoir,
mais celles qui, apparemment conformes au devoir, ne sont pas faites par devoir. Obéir à
l'instinct de conservation n'est pas accomplir une action moralement bonne ; elle peut être
mauvaise si l'instinct nous empêche de secourir autrui, même au péril de notre vie, comme
le devoir l'ordonne. C'est par devoir que l'on résiste à la tentation du suicide quand on
éprouve de très vives douleurs, à la tentation de haïr un ennemi pour obéir à l’Évangile qui
prescrit de l'aimer. Cet amour, commandé par le devoir, est pratique et non pathologique
(passionnel) comme l'amour, effet du désir. Un devoir est défini par le caractère d'une
maxime ou règle individuelle et non par la nature de l'action prescrite. Il ne dépend pas d'un
penchant, d'un instinct, mais seulement du respect (Achtung) pour la Loi.
La maxime est subjective, si elle est et reste individuelle. Elle deviendrait objective,
semblable à une loi naturelle, si tous les êtres doués de Raison y subordonnaient toujours
entièrement leurs penchants, leur faculté de désirer (Begehrungs-vermögen). Devenue
objective, donc universelle, la maxime est la Loi morale ; elle est alors équivalente à une loi
de la nature.
Une action est ainsi morale, si elle est légale (commandée par la loi). Je dois vouloir que
mon action soit exactement conforme à la loi, sans tenir compte d'aucune autre
considération. Si je fais une promesse, je dois la tenir, du moment que ma parole est
engagée, sans me demander si j'y ai mon avantage. Donc, rien de plus pour me déterminer
que la représentation de la loi elle-même. Pour savoir si une action est morale, il suffit de se
poser la question : Peux-tu vouloir que ta maxime (subjective) devienne une loi universelle
(objective) valable pour tout être doué de raison ? Évidemment, l'application de la loi est
malaisée en raison des résistances de l'instinct. Mais nous ne sommes plus ici dans le
domaine des notions empiriques (Erfahrungsbegriffe).
Il y a très peu d'exemples d'actions accomplies uniquement par devoir, peut-être pas un seul.
Souvent une action qui semble faite par devoir a été dictée par l'égoïsme ou la vanité (d'où
l'empirisme moral). Il ne suffit pas d'ailleurs de se référer à des exemples tirés des vies de
saints. La valeur de tels exemples vient tout entière de leur comparaison avec la perfection
idéale, réalisée en Dieu seul. Aucune science, même occulte, ne peut apporter de lumières à
la Métaphysique des mœurs, pas même l'Anthropologie ou la Théologie. Toute
considération empirique diminue la valeur du raisonnement. Nous dirons donc : Tout être
raisonnable a le pouvoir d'agir d'après la représentation de lois ou par des lois, s'il dispose
d'une volonté. En effet, la raison peut seule concevoir des lois. Une volonté conforme à la
loi est en réalité identique à la raison devenue principe d'action, à la raison pratique. C'est
le pouvoir de choisir ce que la raison, indépendamment de nos penchants, reconnaît comme
pratiquement nécessaire, c'est-à-dire bon.
Pour une volonté qui n'est pas entièrement purifiée (devenue conforme à la raison), l'empire
de la loi morale apparaît comme une contrainte pénible. La loi prend l'aspect d'un
commandement (Gebot), d'un commandement de la raison dont l'énoncé se nomme un
Impératif. Le verbe allemand sollen (être obligé moralement par un devoir), opposé au verbe
müssen (être contraint matériellement par nécessité), caractérise la formule d'un impératif.
Une volonté imparfaite a seule besoin d'un impératif. La volonté pure ou parfaite obéirait
spontanément à la loi devenue objective, en vertu de sa propre structure ; elle ne serait
déterminée que par la notion du bien, ignorerait totalement la tentation et la contrainte
(Nïthigung). Il n'y a d'impératifs ni pour Dieu, ni pour les saints. Kant utilise une distinction
qui remonte au moins à Démocrite. Celui-ci distinguait deux univers, l'un de l'expérience
sensible, l'autre, domaine du ciel supérieur, où tout est spontanéité.
Mais il faut considérer plusieurs types d'impératifs. Sont hypothétiques, problématiques ou
conditionnels, ceux qui subordonnent l'action prescrit à une fin donnée : Si tu veux telle fin,
tu dois faire telle chose. Sont catégoriques, assertoriques (affirmatifs) ou apodictiques
(démonstratifs) ceux qui ordonnent une action, sans indiquer aucune condition ou fin. On
peut encore distinguer des impératifs techniques ou de l'adresse (der Geschicklichkeit), des
impératifs pragmatiques ou de la prudence (der Klugheit). Mais, pour les impératifs moraux
(Gebote, Gesetze) l'obéissance est requise, à l'exclusion de toute autre considération.
Un impératif catégorique, soustrait à toute condition, à toute fin extérieure, ne considère
évidemment que la forme de l'action, à l'exclusion de tout contenu. Mais que peut-on
nommer forme dans une action ? Uniquement la disposition, l'intention (Gesinnung) de son
auteur. Aucune expérience ne peut justifier un tel impératif qu'il faut connaître a priori. C'est
une loi synthétique, pratique, de valeur universelle, comme les lois de la nature. Une telle
loi se distingue d'une maxime individuelle. La maxime (subjective) de mon action doit, par
ma volonté, pouvoir être transformée en une loi universelle de la nature. D'où l'énoncé
célèbre : Agis de telle manière, d'après une maxime telle, que tu puisses, en même temps,
vouloir qu'elle devienne une loi universelle.
Les exemples donnés par Kant n'illustrent pas très exactement cette définition et ils ont prêté
à confusion. Un individu veut se suicider. Qu'il se demande d'abord ceci : Que serait une
société où chacun, de sa propre autorité, pourrait mettre fin à sa vie ? Un emprunteur peut-il
accepter de l'argent quand il sait qu'il ne pourra pas le rembourser ? Un homme a des talents
mais ne les développe pas, par paresse. Faut-il le donner en exemple ? Kant semble
invoquer l'intérêt social et c'est, en fait, la conséquence, inavouée d'ailleurs, que l'on tirera
de ses enseignements. Kant ne songe portant, en 1785, qu'à l'universalité logique de la règle.
Si tous obéissaient à l'impératif, les maximes seraient concordantes. Il naîtrait spontanément
un ordre moral universel, aussi régulier que celui de la Nature, tel qu'il résulte de
l'application automatique des catégories. La loi morale s'appliquerait avec la même rigueur
que les lois physiques comme, d'après les Anciens, la spontanéité du mouvement des Astres
traduit l'ordre le plus admirablement régulier. Mais nous n'avons encore rien démontré à la
rigueur. Ce sera l'objet de la vraie métaphysique.
3. Passage à la liberté et à l'autonomie
Les remarques précédentes supposent une volonté pourvue du pouvoir de se déterminer
elle-même en conformité avec certaines lois. Pour y parvenir, la volonté se donne un but
(Zweck) valable pour tout être raisonnable, donc choisi par la Raison, donc objectif. Si le
désir individuel (Begehren) choisissait, nous aurions un mobile (Triebfeder : ressort
impulsif), non un motif ou un moteur (Bewegungsgrund), fixé par la Raison. Excluant tout
ce qui est subjectif, ne gardant que l'attitude de la volonté, la construction est purement
formelle, opposée à une construction matérielle dont le désir aurait fixé le but. Selon
l'impératif catégorique, le but est en soi (an sich), c'est : la nature humaine devenue
raisonnable ; ce n'est jamais un moyen pour autre chose ; seul un but en soi peut valoir pour
tous les êtres raisonnables, être universel, concerner tous les hommes. D'où une autre
formule : Agis de telle façon qu'en même temps, tu traites l'Humanité, dans ta propre
personne, comme dans la personne de tout autre, comme un but et jamais comme un moyen.
L'homme n'est jamais un instrument pour autrui.
De là encore, une nouvelle conséquence : Un homme libre est celui dont la volonté légifère
universellement. Sa volonté est subordonnée à la loi, de telle manière qu'elle se donne à
elle-même cette loi, et c'est même la raison pour laquelle elle doit, la première, être
considérée comme soumise à cette loi.
Ainsi, la notion de liberté s'introduit au cœur de la morale. L'homme fixe lui-même la loi du
devoir qui l'oblige et le lie à tous les êtres raisonnables. Agissant sous le principe de
l'autonomie, la volonté ou Raison devenue pratique se donne librement ses propres lois, sans
aucune hétéronomie. L'individu moral se juge lui-même et il juge autrui, d'après lui-même.
Il n'y a donc pas autonomie sans liaison de tous les êtres raisonnables en un système
unique, où ils sont liés par des lois communes. La première de ces lois est évidemment de se
traiter eux-mêmes et de traiter leurs semblables comme des fins et jamais comme des
moyens. Un tel système se nomme un Règne des Fins (Reich der Zwecke). Chacun étant à la
fois législateur et sujet, l'accord universel est possible.
Quelle est la nature de cet accord ? Kant s'inspire ici des raisonnements du Contrat social de
Rousseau, comme le prouvent les termes qu'il emploie. L'accord moral n'est pas un Contrat
commercial. Pas d'accord commercial sans un prix qui permet d'échanger deux objets tenus
pour équivalents. Mais un prix concerne des désirs ou des besoins communs. Il y a des prix
commerciaux à l'aide desquels on évalue des marchandises (travail, adresse ont un prix
commercial) et il y a des prix affectifs (esprit, honneur, imagination ont un prix que ne se
monnaye pas). Au contraire, un accord moral se fonde sur une valeur, une dignité, une
noblesse absolues (Wert, Würde), qui seules peuvent être un but en soi (telles la fidélité aux
engagements, la bienveillance voulue), donc supérieures à toute valeur.
La forme de la loi peut seule devenir universelle, donner à la loi morale le caractère d'une loi
de la nature. D'où une nouvelle formule : Agis par des maximes qui se puissent aussi
prendre elles-mêmes pour objet, comme des lois universelles de la nature (raisonnable).
Ainsi concevons-nous un monde intelligible, un Règne des Fins, né de la volonté législatrice
de toutes les personnes morales qui en sont membres. On classera les actions par rapport à
lui : Permise (erlaubt), l'action qui s'accorde avec les lois de l'autonomie du vouloir ;
défendue (verboten, unerlaubt) celle qui est contraire à ces lois. Une volonté droite, dont les
lois s'accordent entièrement avec l'autonomie, n'a pas besoin d'impératif. Est liée, obligée
(verbunden) par l'impératif moral, une volonté imparfaite qui n'est pas en accord complet
avec l'autonomie. L'autonomie de la volonté est donc le principe suprême de la Morale et,
par elle, la volonté est à elle-même sa loi ; elle se ramène à une forme du vouloir.
Toutes les erreurs morales viennent de la croyance en une hétéronomie. Sont souillées
d'hétéronomie, non seulement les morales utilitaires et « eudémoniques », mais tous les
systèmes mixtes où l'on mêle principes empiriques et principes rationnels (par exemple
l'idée indéterminée de perfection).
La liberté. – Nous avons dégagé une proposition pratique, synthétique a priori. Mais il faut
la justifier. Cela ne se peut sans une Critique de la Raison pratique. Toutefois, les
Fondements esquissent la théorie de la liberté, pièce maîtresse de la Critique.
La volonté, on l'a vu, est une sorte de causalité propre aux êtres vivants doués de raison.
Tous les êtres privés de raison sont soumis à la causalité naturelle, à des causes extérieures ;
ils obéissent à des lois qu'ils n'ont pas faites. Une volonté raisonnable doit, elle aussi, avoir
des lois, car il n'est pas de causes sans lois : la volonté libre doit donc avoir des lois
immuables d'une nature spéciale, car l'autonomie est la propriété du vouloir d'être à lui-
même sa loi. Donc la liberté consiste à être soumis à des lois. C'est, dit Kant, la seule
conception possible de la liberté, dont on peut se faire deux idées : 1. indétermination
complète, caprice, désordre, imprévisibilité ; 2. ordre réalisé, sans contrainte, par une
volonté raisonnable. Seule la deuxième conception est synthétique et positive.
La Critique de la Raison pure a démontré la possibilité, non l'existence de la liberté. Nous
savons maintenant que la liberté est propriété nécessaire du vouloir de tout être raisonnable.
Nous ne pouvons agir que sous l'idée de la liberté. Or, dans ce cas, valent pour nous, toutes
les lois qui sont inséparablement unies à la liberté.
Kant n'ignore pas le paradoxe apparent de cette affirmation. Liberté et soumission à la loi
sont deux notions en apparence contraires. Comment peut-on en faire maintenant des
notions interchangeables (Wechselbegriffe) ?
La Critique de la Raison pure a distingué des phénomènes soumis aux lois de la nature et,
derrière ces phénomènes, des choses en soi où pourraient se déployer des causes libres. De
même, en nous, sous les phénomènes internes ou externes que nous percevons, il y a un Moi
pourvu d'une activité propre, la Raison. C'est dans cette partie intelligible de mon être que
joue la causalité par liberté. Et l'expérience la plus banale confirme cette vue de l'esprit.
Tous les hommes en fait se savent libres, se sentent libres. Le pire vaurien connaît ses
désires subalternes, parfois il les déteste et voudrait lutter contre eux, s'il en avait la force.
Cela ne suffit pas à démontrer la liberté, qui reste douteuse, tandis que l'expérience atteste
chaque jour les lois de la Nature. Cependant, l'idée de liberté, c'est l'unique tremplin d'où
nous puissions nous lancer dans l'action, et toute réflexion un peu fine est tenue de lui faire
une place. Mais la liberté doit nous introduire dans un monde intelligible, dont nous ne
trouvons pas l'entrée. Il faudra, pour la découvrir, un long et difficile effort.
En somme, Kant a disséqué et décrit avec minutie une suite d'expériences banales et il a
voulu remonter jusqu'aux faits primitifs qui commandent ces expériences. Aucun de ces
faits ne nous donne connaissance d'un monde supérieur. Mais nous savons qu'il n'y a pas de
morale sans liberté et sans autonomie. La Critique de la Raison pure pratique va reprendre
et développer, avec le maximum d'abstraction, les principes que l'on vient de dégager et elle
en présentera les conséquences nécessaires.
III. La Critique de la Raison pratique (1788)
Nous savons qu'il y a, dans l'âme humaine, une partie instinctive et irrationnelle, siège du
désir, et une partie rationnelle, siège de la volonté pure. La Raison se donne à elle-même un
commandement inconditionnel qui lui prescrit de réaliser un ordre valable pour tous les
êtres raisonnables. Enfin, la raison peut devenir pratique, se libérer de l'élément instinctif,
devenir principe actif, seul moteur, et librement moteur. La Critique de la Raison pure
pratique va justifier, confirmer ces résultats et en tirer les conséquences.
1. Caractères propres de la recherche critique en morale
La Critique de la Raison pratique s'ordonnera nécessairement dans le cadre de la Critique
de la Raison pure. Selon Kant, la disposition n'est pas factice, et d'ailleurs la symétrie ne
saurait être complète. Le cadre complet serait : une esthétique (critique de la sensibilité) ;
une logique (analytique des concepts et analytique des principes) ; une dialectique où sont
exposées et levées dans la mesure possible les contradictions métaphysiques ; une
méthodologie enfin. Mais ici pas d'intuition pure ; la sensibilité est surtout affective et
motrice (plaisir et douleur, appétits, tendances, désirs, passions). D'autre part, puisqu'il s'agit
d'une action libre réglée, les principes doivent intervenir avant les concepts. L'ordre de la
première Critique sera donc, en partie, renversé.
De plus, le sujet principal est spécialement difficile : définir la portée du vouloir humain et
de la causalité qui lui est attribuée, traiter de la volonté comme cause d'actions. Le domaine
est scabreux, on s'y égare aisément ; une extrême sévérité logique sera de rigueur. Être
conséquent est, ici, le plus grand devoir du philosophe et Kant ajoute que ce devoir est
rarement pratiqué. Nous devons construire une Métaphysique ou une science rigoureuse de
la Morale (la science de la Morale, dira Renouvier). Il faudra partir de principes ou de
définitions ; leurs conséquences seront présentées sous forme de théorèmes, disposés à leur
place logique et démontrés avec le plus grand soin.
Définitions. – Quelques définitions rappelleront d'abord les résultats acquis dans les
Fondements de la Métaphysique des Mœurs ; ce sont celles des mots : principe pratique,
maxime, loi pratique, impératif, désir, forme de l'action.
Principe pratique se dit d'un principe qui préside à l'usage de la liberté. C'est une
détermination universelle du vouloir, qui se traduit, dans le détail, par des règles
subordonnées. Un principe se nomme une maxime, quand le sujet moral ne le tient valable
que pour lui-même, pour sa propre volonté. Il prend le nom de Loi pratique quand il est juge
valable pour tout être raisonnable, donc objectivement, d'une manière universelle. Comme la
Raison est l'unique faculté de l'universel, il faut que, dans une loi pratique, elle détermine
entièrement la volonté. Une loi pratique se distingue d'une loi naturelle ou physique. En
physique, principes et lois ne peuvent pas être séparés ; un principe physique est une loi,
puisqu'il se réalise de lui-même, par le seul jeu de notre entendement, sans intervention de
notre volonté. Dans le cas de l'action morale, la raison, identique à la volonté, trouve devant
elle les appétits, les instincts, les désirs inconstants du sujet. Il lui faut lutter pour appliquer
sa loi et la rendre universelle. Une loi pratique se présente ainsi sous forme d'impératif,
exprimé par le verbe sollen (devoir) ; ce terme désigne une action prescrite, mais que le
sujet auquel on l'ordonne peut exécuter ou ne pas exécuter. L'impératif moral ne comporte
aucune condition : il est catégorique. Un impératif hypothétique, soumis à condition, peut
être un précepte, une recommandation (Vorschrift) ; il n'est jamais une loi. En effet, il
comporte une matière, un objet de désir ou de plaisir éventuel, intéressant l'amour de soi et
le bonheur, donc un élément subalterne et sensible. La loi pratique ne peut ainsi concerner
que la forme de l'action, ce qui reste dans la loi quand on a ôté toute matière, c'est-à-dire
tout objet du vouloir, bref un commandement vide. Ce fait capital est confusément perçu par
la conscience commune. L'escroc, qui nie le dépôt qu'il a reçu, sait très bien que sa pratique
ne peut pas être recommandée à tous, comme une loi.
L'objet essentiel de la Critique est ici de répondre aux deux questions que posent
implicitement ces définitions tirées de l'usage commun. 1. Existe-t-il une espèce de volonté
susceptible de se déterminer uniquement d'après un impératif catégorique ? 2. Quelle est la
nature, la manière d'être, la constitution (Beschaffenheit) d'une telle volonté ?
2. Impératif et Liberté
Une volonté soumise à une telle loi doit être libre, soustraite à l'enchaînement des
phénomènes, dû à la causalité. Or cela n'est possible que si la volonté est déterminée
uniquement par la forme de la loi, à l'exclusion de tout contenu. Liberté, loi inconditionnelle
et formel, ces deux termes se commandent réciproquement. On peut le démontrer.
L'expérience ne nous offre jamais que des phénomènes, donc le contraire de la liberté. La
liberté ne peut pas être constatée directement. Mais la loi morale, présente à la conscience
morale, nous met devant le fait de la liberté (Faktum) : le fait de la Raison pure, qui se
manifeste par ce fait comme une puissance législative (Sic volo, Sic jubeo). Devenant
pratique par elle-même, la Raison pure nous apprend par là notre liberté. En effet, elle se
donne sa loi ; elle est autonome : la loi morale n'exprime rien de plus que l'autonomie de la
Raison pratique, c'est-à-dire la liberté. L'idéal, le modèle (Urbild) en ce sens, ce serait une
volonté soustraite à l'action du désir, se portant naturellement vers le bien, sans aucune
obligation. Ce modèle est réalisé en Dieu et chez les saints ; les êtres finis devraient s'en
rapprocher indéfiniment. Cette conception exclut tous les principes matériels, subjectifs,
extérieurs ou intérieurs, dont Kant donne une liste détaillée. Principes subjectifs : Éducation
(Montaigne), Constitution civile (Mandeville), Sentiment physique (Épicure), Sentiment
moral (Hurcheson) ; Principes intérieurs : Perfection (les Stoïciens, Christian Wolff) ;
Principes extérieurs ou objets : Volonté divine (Théologiens, Crusius). Ainsi nous sommes
devant un fait, lié à la conscience de la liberté du vouloir et même identique (einerlei) à
cette liberté, ne faisant qu'un avec elle.
Ce fait nous intègre dans un monde intelligible ou pur, inexplicable par toutes les données
du monde sensible. Ne croyons pas cependant qu'il s'agisse d'une sorte de Révélation, d'une
intuition de la liberté par elle-même. Voyons-y plutôt le jeu de certaines lois dynamiques et
causales, qui peuvent également déterminer une causalité dans le monde sensible. Il s'agit
d'une loi de l'action, la loi morale. Elle nous impose de croire aux conditions de la
possibilité et de l'efficacité de l'action, mais ne nous apport pas un savoir analogue à une
science. En effet, il ne suffit pas de plonger un instant dans le monde intelligible ; il faut en
redescendre dans le monde sensible et donner à ce dernier (pour ce qui touche les rapports
avec des êtres raisonnables) la forme même d'une nature suprasensible, rendre, autant que
possible, ce monde sensible semblable au monde idéal.
Cette exigence nous place devant un problème nouveau, le plus grave de tous. La liberté
doit façonner le monde de l'expérience. Pourtant, elle ne peut pas en briser le mécanisme qui
soumet tous les êtres raisonnables eux-mêmes à des lois nécessaires, celles de la Nature.
D'où la question centrale d'une Critique de la Raison pratique : Comment la causalité de
l'être raisonnable peut-elle agir immédiatement, sans l'intermédiaire d'une intuition, jusque
dans le monde sensible ?
Problème beaucoup plus difficile que celui de la déduction transcendantale des catégories de
l'entendement pur, puisque la loi morale n'est vraiment appliquée dans aucun cas de
l'expérience sensible, et puisque toute expérience du monde intelligible nous est refusée.
L'idée de volonté pure affranchie du désir, de l'instinct, donc libre, est inaccessible à
l'expérience. C'est celle d'une cause intelligible (Causa Noumenon), d'un effet possible de
l'action libre. Mais on est victime d'une confusion quand on énonce le problème sous cette
forme. Le cas est tout à fait différent de celui d'une loi empirique. Nous ne nous demandons
pas, en fait, si l'action est possible ou impossible. Nous nous demandons : Avons-nous le
devoir de faire cette action ? Est-elle possible moralement ? Ce n'est pas l'objet, mais la loi
intérieure du vouloir (l'impératif catégorique) qui détermine l'action.
Nous rencontrons ici les notions ambiguës de Bien et de Mal. Il faut, en effet, distinguer
bien et mal moral (en allemand Gut und Böse) et bien et mal physique (Wohl und Uebel). Le
mal physique peut être un instrument du bien moral. Kant cite les exemples classiques du
chirurgien qui fait souffrir son malade pour le sauver et de l'éducateur qui corrige son élève,
pour le bien de celui-ci.
Quand la volonté est immédiatement déterminée par la loi morale, donc bonne, l'action est
absolument bonne par son intention. Si l'appel de la faculté de désirer précède celui de la loi
morale (nous voulons, par exemple, éviter la douleur, obtenir le plaisir), la volonté est
déviée, elle n'est pas pure. La notion de bien et de mal ne doit pas être déterminée avant la
loi morale..., mais seulement après elle et par elle... car le critérium du plaisir ne peut rien
fournir d'universellement valable.
Une seule catégorie est utilisable dans l'ordre moral, celle de la causalité et tous les
concepts purs que nous trouvons ici sont des variantes de la causalité, dont nous cherchons
des formes rationnelles dans le monde sensible. Leur rôle est d'unifier la multiplicité des
désirs... dans l'unité de la Raison pratique, ou d'une volonté pure a priori.
Bien que la symétrie des deux Critiques soit imparfaite, Kant s'applique de son mieux à
dresser une Table des Catégories de la liberté. Table de douze catégories, d'autant plus
artificielle que le philosophe vient d'avouer que la causalité seule est en jeu dans la Morale.
Trois catégories de la Quantité : subjective (par le vouloir d'une seule individu), objective
(selon des principes universels), a priori (selon les principes de la liberté) ; dans la Qualité,
les trois catégories sont : action (préceptes), abstention (interdictions), exception. La
Relation nous donne : Personnalité, état (de la personne), action (d'une personne sur une
autre). Enfin, dans la Modalité, on trouve : Permis et interdit, devoir et opposé au devoir,
devoir complet ou incomplet. Renouvier est sans doute le seul interprète, avec Hegel, à avoir
pris ces distinctions au sérieux.
On ne peut évidemment, faut d'intuition sensible, retrouver ici l'équivalent du Schématisme
dans la Critique de la Raison pure. Mais Kant y supplée par ce qu'il nomme la Typique,
destinée à autoriser un jugement moral concret. À vrai dire, c'est simple analogie, car
aucune image sensible ne peut être donnée d'un Bien idéal. Mais pour juger d'une actions
que je me prépare à accomplir, je dois me poser cette questions : Si cette action devait se
produire selon la loi d'une Nature dont tu serais toi-même une partie, tu pourrais la
considérer comme (moralement) possible par ton propre pouvoir. Autrement dit, une
analogie physique nous aidera à discernes la matière morale ou immorale d'une action
projetée.
La Théorie du respect. – Toute action humaine a besoin d'un moteur en rapport avec la
faculté de désirer, donc avec les sentiments de plaisir et de douleur. Or Kant découvre, avec
la loi morale, un sentiment d'une nature toute spéciale : la loi morale détermine directement
(sans intermédiaire) le vouloir de l'homme moral. Si un sentiment du type ordinaire
intervient, l'action peut être extérieurement conforme à la loi, donc légale, mais elle n'est
pas morale. Cependant Kant est persuadé, comme tous ses contemporains, qu'une faculté
analogue à un sentiment peut seule mettre l'âme en mouvement, en obtenir plus qu'une
soumission abstraite. Mais un moteur moral doit évidemment être pur. Or aucun de nos
sentiments habituels, l'égoïsme, l'amour de soi, la complaisance pour soi-même
(Selbstsucht, Selbstliebe, Philautia, Wohgefallen an sich selbst, Eigendünkel, Arrogantia)
n'a le caractère de pureté requis.
Ainsi existe, selon Kant, un sentiment purement intellectuel, a priori, nécessaire, le respect
(Achtung) pour la loi, et pour moi-même qui suis le porteur de la loi. Le respect me réveille,
me revigore, me relève, après m'avoir abaissé devant la loi. À la différence de l'admiration, à
laquelle il ressemble, il ne comporte pas de plaisir, et même le plus souvent, allant contre
nos penchants, il ne nous est pas agréable. Il est entièrement désintéressé, soumis
uniquement à la loi morale et au devoir. La bonne conscience consiste à avoir agis
conformément au devoir, par devoir, c'est-à-dire par respect pour la loi.
Morale, Religion, Personnalité. – Dans un être parfait la loi morale réalisée est Sainteté
(Heiligkeit), donc se réalise sans effort. Au contraire, en tant qu'êtres imparfaits, nous
sommes soumis par la loi morale à une discipline continue. Nous ne possédons pas la vertu.
Nous sommes tenus à nous efforcer (streben) de la conquérir.
Fait remarquable, Kant n'a pas voulu un seul instant, dans sa morale, parler d'amour ou de
charité. Sans doute, nous lisons dans l’Évangile : Aime Dieu au-dessus de toutes choses et
ton prochain comme toi-même. Mais de quel amour s'agit-il ? Ce n'est pas assurément
l'amour des sens, l'amour passionnel ou pathologique, inconcevable ici, puisque Dieu ne
peut être objet des sens. Au surplus, aucun amour ne se commande, pas même l'amour
humain. Kant ne veut d'ailleurs, à aucun prix, de cette mysticité morale qui infecte nombre
de têtes et de cette sensiblerie (Schwärmerei) qui, hélas, a passé des romanciers aux
philosophes. Ces effusions outrepassent les bornes prescrites à notre nature par la raison.
C'est à propos de cette question que le philosophe lance l'apostrophe célèbre : Devoir, ô toi,
nom grand et sublime, toi qui ne renfermes rien d'aimable, rien qui comporte flatterie, toi
au contraire qui exiges la soumission, et cependant ne profères, pour mouvoir la volonté,
nulle menace propre à susciter dans le cœur une naturelle répulsion, toit qui formules
simplement une loi... qui, par elle-même, contre notre volonté, conquiert le respect... Le
respect du devoir nous explique beaucoup de formules de la morale : La loi morale est
intangible et sainte. Si l'homme individuel n'est pas saint, l'humanité doit lui être sacrée
dans sa propre personne. Seul il est fin en soi, sujet de la loi morale, autonome ; seul il est
Personne. (Kant se souvient des Stoïciens.) Ici la Raison ne se propose plus, comme la
Raison théorique, de connaître des objets. Elle veut produire, donner la réalité à des objets,
par une action volontaire, conforme à la détermination rationnelle, selon des principes a
priori. L'ordre logique est : Majeure : un principe moral ; Mineure : détermination d'un bien
et d'un mal ; Conclusion : détermination subjective du vouloir.
Qu'est-ce donc qu'une personne ? Personnalité équivaut à Liberté, à indépendance par
rapport à tout le mécanisme naturel. La Personne vit dans le monde sensible, mais elle est
subordonnée aux lois que lui donne sa propre Raison et, par là, elle appartient en même
temps au monde intelligible.
La liberté nous explique ce fait. C'est une causalité qui, par son origine, n'opère pas dans le
temps. Habitants du monde phénoménal, notre action y dépend de conditions qui sont dans
le passé et, au moment où j'agis je ne suis jamais libre. Car la loi de la liberté est
inapplicable dans le temps, domaine de la nécessité.
Si la Morale nous l'impose, elle nous fait faire un pas dynamique et décisif en nous plaçant
dans un monde intelligible, hors du temps.
3. Dialectique de la Raison pratique
Tout usage pratique ou théorique de la Raison comporte une Dialectique. On l'a vu,
l'entendement opérant dans le temps nous amène de condition à condition, sans jamais
atteindre un premier ou un dernier terme de la série. D'autre part, la plus haute partie de
l'Entendement, la Raison, exige la totalité absolue des conditions d'un terme conditionné,
totalité que les phénomènes ne nous présenterons jamais. Il faut cherche la cause de cette
opposition : recherche difficile mais bienfaisante, dans la Critique de la Raison pure. La
difficulté est beaucoup plus grande dans la Critique de la Raison pratique. Ici, les
conditions sont l'ensemble des penchants et des besoins de notre nature. L'inconditionné
c'est la totalité inconditionnée de tout l'objet de la Raison pratique, ou le Souverain Bien.
Or, la loi morale, pure de tout contenu matériel, ne peut pas nous fournir un objet ; et par
suite le Souverain Bien n'est pas identique à la loi elle-même. Qu'est-il donc ? Il a deux
aspects contradictoires. En un sens, il est le Bien le plus élevé (oberste). En un autre sens, il
est le Bien achevé ou parfait (vollendete), au-delà duquel on ne peut pas remonter : il n'est
subordonné à rien ; il est le Tout qui n'est pas une partie d'un Tout plus grand. De plus, la
Raison conçoit la Béatitude (Glückseligkeit) comme un ingrédient nécessaire du Souverain
Bien.
Par suite, ni la vertu, ni la Béatitude ne peuvent être identifiées au Souverain Bien. La vertu
ne contient pas par elle-même la Béatitude. Le Souverain Bien ne produit pas de lui-même
la vertu. D'où les deux attitudes opposées de l’Épicurien et du Stoïciens. Selon le Stoïcien la
Vertu produit seule la Béatitude. Selon l’Épicurien, la Béatitude produit seule la Vertu. Mais
Béatitude et Vertu, notions hétérogènes, ne peuvent être identifiées, car il n'y a entre elles
aucun lien analytique. Il faut donc une synthèse. La loi morale ne peut pas agir directement
sur les faits. Elle n'agit que sur notre volonté en lui imposant une attitude invariable.
Impossible de démontrer que cette attitude nous assure la Béatitude ici-bas. Nous sommes
ainsi amenés à penser que certaines conditions irréalisables dans la vie terrestre seront
réalisées dans un prolongement futur de cette vie. La Béatitude exigerait une parfaite
concordance de notre volonté et de la loi morale, c'est-à-dire une Volonté sainte, semblable à
la Volonté divine elle-même. Or la Sainteté, exigée par la loi morale, parfaite concordance
du vouloir et de la loi, n'est accordée à aucun être sensible au cours de son existence
temporelle. Cependant, un progrès indéfini vers la Sainteté, nécessaire pour obtenir une
concordance parfaite, doit être l'objet essentiel de notre vouloir. Ce progrès suppose la durée
indéfinie de notre personne ou l'immortalité de l'âme. Liée à la morale, l'immortalité est
donc un Postulat analogue au postulat d'Euclide. Kant appelle ainsi une proposition
indémontrable par la Raison théorique, mais démontrable pratiquement, dans la mesure où
elle est liée à une loi pratique a priori de valeur inconditionnelle.
L'immortalité doit nous amener par degrés à une Béatitude appropriée. Mais le Souverain
Bien serait inaccessible s'il n'existait pas un Dieu. En effet, le monde doit être tel que tout
advienne à l'être moral selon le vœu de sa volonté pure ; il faut que la Nature s'accorde avec
la fin de l'homme, définie elle-même par sa volonté, dans sa libre décision. Nous devons
donc postuler une cause de la Nature, distincte de la Nature et garantissant l'accord final de
la Nature et de la moralité.
Le Souverain Bien n'est réalisable, en ce monde ou ailleurs, que si l'on admet une cause de
la Nature dont la causalité soit conforme à l'intention morale, ou une Intelligence suprême
parfaitement raisonnable. Cette conclusion, de nécessité morale, n'est pas objective comme
celle de la loi morale. Mon devoir ne peut pas me forcer à admettre l'existence d'un objet.
Nous n'aurons donc jamais une certitude intellectuelle de l'existence d'un Être suprême.
Nous sommes seulement amenés à formuler une hypothèse et à lui accorder une croyance
(Glauben). Cette croyance est pure, conforme à la Raison théorique et à la Raison pratique.
Passage au Christianisme. – Cette croyance est impliquée dans la Religion chrétienne,
considérée non dans son détail historique, mais dans son essence (Wesen). Cette manière
d'aborder le problème religieux sera imitée par Schleiermacher et tous les théologiens
protestants modernes. Le Christianisme nous apporte l'idée du Règne de Dieu qui satisfait
seule à l'exigence la plus stricte de la Raison pratique, et dont les doctrines antiques ne nous
offraient aucun équivalent. La conception chrétienne du divin s'accorde seule avec la loi
morale, sainte, inconditionnée, qui exige la sainteté des mœurs. L'homme le plus vertueux
ne peut, par ses propres forces, échapper à l'impureté, à la contamination de sa volonté par
des mobiles inférieurs, à la tentation. Le Christianisme le réconforte en lui offrant l'image
d'un monde dans lequel des êtres raisonnables se donnent, de toute leur âme, à la loi
morale, ou d'un Règne de Dieu. La Morale mène donc à la Religion, but final de la Raison
pure pratique. Dans la Religion chrétienne, nos devoirs apparaissent comme des
commandements divins, lois de toute volonté libre.
La Morale ne nous apprend pas à être heureux et elle n'est pas science du bonheur, étant
désintéressée. C'est par surcroît qu'elle nous rend dignes de la Béatitude car le but divin
n'est pas la Béatitude, mais le Souverain Bien. Ainsi, n'étant un « moyen » pour personne,
pas même pour Dieu, l'homme reste fin en soi, et ne peut être saint que comme sujet de la
loi morale.
De là, trois Postulats de la Raison pure pratique : immortalité, liberté (au sens positif) ou
causalité d'un être qui fait partie d'un monde intelligible, existence de Dieu. Donc, durée
suffisante pour observer complètement la loi morale, indépendance à l'égard du monde
sensible, ou liberté dans un monde intelligible, enfin croyance en un Dieu, Bien Suprême
indépendant, tels sont les trois Postulats.
N'y voyons pas des dogmes, mais des Présuppositions (Voraussetzungen) essentiellement
pratiques. Elles n'augmentent pas notre savoir, mais donnent une réalité objective à des
idées de la Raison spéculative. Il n'y a pas ici de véritable immanence, mais seulement
passage du transcendant à l'immanent dans un dessein pratique (in praktischer Absicht).
Nous n'avons aucune notion théorique de l'essence de notre âme, du Monde intelligible, ou
de l'Être Suprême, de la Liberté, de la nécessité, selon ce que ces réalités sont en elles-
mêmes. Il ne s'agit pas de connaissances, mais de pensées (Gedanken) qui dépassent
l'expérience ; sont transcendantes, mais non contradictoires ou impossibles.
Ne croyons pas cependant que l'admission de ces postulats n'ait fait faire aucun progrès à
notre pensée théorique. Nous sommes réellement contraints de convenir qu'il existe de tels
objets transcendants, bien que nous ne puissions pas en préciser la nature. Ainsi, de
transcendants ils deviennent immanents ou constitutifs, c'est-à-dire incorporés à notre
système intellectuel.
La raison pure pourra utiliser ces objets d'une manière négative, pour mieux assurer son
usage pratique ou pour le purifier, sans toutefois l'étendre. Bien qu'aucune intuition sensible
ne corresponde à de tels objets, nous sommes autorisés, dans une certaine mesure, à y
appliquer les catégories de l'entendement. Nous ne pouvons, sans doute, leur donner aucune
interprétation psychologique, mais il nous est possible de leur appliquer des prédicats, dans
une intention pratique, pour les mieux entendre. La notion du divin restera indéterminée
dans l'ordre spéculatif. Nous pourrons dire cependant que Dieu est tout connaissant et doit
pénétrer au plus intime de nos intentions, pour tous les cas possibles, passés, présents ou à
venir. Nous le dirons tout-puissant, omniprésent, éternel, parce qu'il peut donner à toutes ses
intentions les suites appropriées.
Kant constate qu'il a introduit dans la morale diverses notions insolites, et surtout celle d'une
Croyance pure pratique de la Raison. Or, une croyance ne peut pas donner lieu à un
impératif. Vouloir commander une croyance est proprement monstrueux. Mais alors,
pourquoi la Nature nous a-t-elle traités en marâtre, nous refusant, de toutes les
connaissances, les plus nécessaires ? La réponse de Kant est curieuse : la limitation même
de notre savoir témoigne de la sagesse divine. Imaginons l'état d'un homme qui aurait sans
cesse sous les yeux Dieu et l’Éternité dans leur Majesté terrible. Il obéirait sans doute à la
loi, mais dans le tremblement ; il perdrait par là même tout ressort intérieur. Plus d'intention,
plus de travail de la Raison contre les penchants, plus de devoir, puisque plus d'espérance ;
surtout, fin de toute valeur morale, de toute dignité humaine. Renan s'inspirera, dans ses
Dialogues, de réflexions sans doute prises à la Critique de la Raison pratique.
4. Méthodologie de la Raison pratique
Pour ouvrir l'âme aux lois de la Raison pure pratique, agir sur les maximes, assurer
l'efficacité de la raison, une Méthodologie, encore inconnue, serait nécessaire. On se
contentera d'en indiquer le principe : la représentation pur et simple du devoir, si
constamment négligée par les philosophes. Mais pas de raisonnements, toujours fastidieux à
bref délai. Pour commencer, l'examen de cas particuliers (valeur morale de telle action,
caractère de telle personne). On utilisera le goût inné des hommes pour la casuistique
morale. On étudiera les réactions de l'honnête homme en présence d'une situation de fait, on
montrera l'importance d'une vertu vraiment pure. La permanence des principes, les effets
passagers des sentiments seront mis en lumière. Bref, l'individu sera habitué à apprécier, à
juger les actions, du point de vue moral. On mêlera l'observation intérieure et l'examen du
comportement d'autrui, en cherchant toujours le rapport entre l'action et l'intention (Kant
s'inspire de Rousseau).
Il faudrait, dans cette méthodologie (ou pédagogie), user de maints artifices, multiplier les
exemples, en soulignant chaque fois la beauté propre de l'acte moral. On sera d'ailleurs
forcé, en raison de la diversité des cas, de s'en tenir aux traits les plus généraux.
Et voici la conclusion célèbre : Deux choses remplissent l'âme d'une admiration et d'un
respect toujours nouveaux et croissants... le ciel étoilé au-dessus de moi, et la loi morale en
moi... je les vois devant moi et je les unis immédiatement à la conscience de mon existence.
D'un côté, ma place dans le monde sensible, dans l'immensité des espaces célestes et du
temps, et mon orgueil est abattu... Mais, de l'autre côté, mon moi invisible, ma personnalité,
unie à l'univers, d'une liaison purement contingente, mais universelle... Cette seconde image
me donne le sentiment de mon intelligence et de ma valeur propres ; elle met en moi
l'appétit, l'espérance du progrès moral, le respect de moi-même ; elle m'ouvre le Règne de
Dieu...
IV. Remarques sur la Morale kantienne
On ne connaît la Morale kantienne, surtout en France, que par le schéma simplifié que la
pédagogie officielle en a longtemps retenu, d'abord en vue de restaurer le patriotisme après
la défaite de 1870, ensuite pour constituer une morale laïque, détachée de toute religion. On
a retenu l'impératif catégorique, la raison opposée, non comme chez Kant, à l'instinct, mais à
la foi ; on a gardé la rigueur du devoir, la liberté intérieure, le désintéressement. Cette
morale qui s'achève, on le verra, par une religion nouvelle, dans le système de Kant, a été
utilisée avec des dispositions contraires à celles de son créateur. De là sans doute des erreurs
graves dans l'interprétation. En premier lieu, Kant affirme en effet qu'il entend procéder a
priori à partir de définitions, par analyse d'un jeu de concepts. Aussi sa théorie morale est-
elle d'une abstraction extrême, ce qui rend malaisée la lecture de la Critique. Mais elle a été
précédée par une analyse très poussée des données prises à l'observation intérieure, au
comportement d'autrui, à la lecture des moralistes, poètes ou théoriciens du passé. La
Méthodologie de la seconde Critique, l'Anthropologie, les cahiers de notes de Kant, nous
montrent un observateur clairvoyant, malicieux, sans illusions sur les ruses du vice et les
occasions de pécher. Les notes sur la Pédagogie nous montrent, chez lui, un sens très vif de
la diversité des caractères et des ressources cachées de la nature humaine.
Kant a pris, pour la Critique de la Raison pratique, le plan même qu'il avait suivi dans la
Critique de la Raison pure. Quoi de surprenant, puisque les mêmes pouvoirs de l'esprit
interviennent dans la recherche scientifique, l'art, l'action pratique ; puisque la première
Critique part de l'affirmation de l'unité foncière des esprits ? Partout un élément universel,
formé par les dispositions générales de l'esprit communes à tous les esprits, et un élément
changeant, dû aux impressions extérieures ou intérieures d'origine corporelle, ou venu des
parties inférieures de l'âme. L'élément universel s'applique à une matière ; à des éléments
irrationnels, qui sont ici : les passions, les sentiments, les appétits, les désirs. Ces éléments,
où la tendance à l'action et le plaisir – ou la douleur – se mêlent, doivent être ordonnés en
vue de l'action. Une telle mise en ordre est impossible dans une faculté de décision, ou de
choix, sans la liberté. Et la liberté n'aurait pas de sens si elle ne se donnait à elle-même sa
loi. Tel est le thème simple de la seconde Critique.
Mais une loi de la liberté ne peut être autre chose qu'une exigence de l'Universel ; l'ordre
que l'Entendement réalise dans la Science, avec l'aide de la Raison, et qu'il réalise
automatiquement (car ici la règle s'applique d'elle-même) est, dans l'action, l’œuvre de
l'individu humain. L'ordre réalisé est non pas l'ordre d'une Nature soumise au déterminisme,
mais – Kant ne le dit que rarement – le but de toute son entreprise sera celui d'une société
humaine universelle, régie par des lois juridiques et morales. Seule une société organisée –
ce sera sous la forme d'un État et d'une Église – pourra donner un contenu valable à
l'Universel en voie de réalisation. Ce contenu n'est pas réalisé actuellement, et il ne le sera
peut-être jamais. L'Humanité pleinement ordonnée sous l'empire de la Loi morale, ne serait
pas très différente du Dieu immanent, dont parle la Critique de la Raison pratique.
On a voulu expliquer toute la morale de Kant par sa foi protestante et piétiste. Nous verrons
plus loin que la Religion de Kant est assez différente du Piétisme et que la rigueur logique
du Kantisme n'implique pas la raideur prussienne. Ce qui donne l'illusion d'une grande
rigidité, c'est le caractère absolu attribué au libre commandement de la raison. Mais
prenons-y garde, Kant souligne que l'impulsion initiale ne peut venir que d'un sentiment
dynamique : le respect de la loi, le scrupule à tenir l'engagement que l'on a pris vis-à-vis de
sa propre raison. Cet engagement, c'est celui de toute vocation, et il est la condition de toute
action sérieuse. Ce fait, consacré par l'expérience séculaire, n'est pas en lui-même religieux
et c'est pourquoi des hommes sans religion seront kantiens, ou croiront l'être.
Toutefois, la morale de Kant va plus loin que l'honneur de l'honnête homme. Elle se
prolonge par un rudiment de religion. Si cette rallonge métaphysique manquait, nous
n'aurions qu'une variante raffinée de ce qui est, chez les philosophes français contemporains
de Kant et chez les révolutionnaires de 1793, le culte de l'Humanité, celui qu'Auguste
Comte voudra restaurer. Mais la religion kantienne des postulats retrouve une partie du
Déisme de la tradition britannique. Le Dieu moral, garantie de l'ordre universel, sera un
Dieu puissant, juste, bon, auquel un culte, réduit d'ailleurs à un minimum de cérémonies,
pourra être rendu. Ce sera le Dieu des hommes « éclairés » de son temps. Ceux-ci ont
vraiment ôté à la religion tout ce par quoi elle peut parler à la sensibilité. En effet, le respect
kantien ne se confond pas avec l'Amour, sentiment qui, aux yeux de Kant, est trop proche du
papisme, trop proche de la sensiblerie, pour être accepté par la Raison. Mais aux opérations
de la Raison proprement dite, mère de nos certitudes théoriques ou pratiques, viennent
s'ajouter celles des jugements esthétiques ou téléologiques. L'activité technique, artistique
ou politique, fait appel à la fois au raisonnement et à la sensibilité sous ses formes diverses,
si bien qu'en fin de compte la stricte loi morale ne suffit pas à dominer toutes les nécessités
de l'action. Ainsi va s'introduire dans la philosophie de Kant un élément de souplesse dont
elle semblait dépourvue. Les notions filent les unes dans les autres, en un glissement
continuel. Cela est fatal, puisque l'expérience seule a fourni les données de l'armature a
priori du système. Kant réunit deux dispositions différentes : un goût très vif du concret et
une confiance probablement excessive dans les facultés logiques de la raison. Cela ne
facilite pas la compréhension de sa pensée, mais cela fait qu'elle est beaucoup moins
absolue et inhumaine qu'on le croit généralement.
V. La Pédagogie de Kant
A quatre reprises (1776, 1777, 1786, 1787), Kant a dû enseigner la pédagogie. Ses leçons
sont assez sommaires car il ne disposait que d'un petit nombre d'heures. Kant devait suivre
un manuel de pédagogie, le Lehrbuch für Erziehengskunst du conseiller Bock. Le plan à
peine développé de ces cours a été publié par Rink en 1803.
L'homme, observe d'abord Kant, est la seule de toutes les créatures vivants qu'il faille
éduquer. L'homme passe par trois états successifs : il est tour à tour nourrisson (Säugling),
élève (Zögling), disciple (Lehrling). De là trois parties de l'éducation : garde ou surveillance
(Wartung) exercée sur l'alimentation et l'entretien physique – discipline et dressage (Zucht)
– instruction ou formation (Unterweisung, Bildung). Les animaux n'ont pas besoin d'être
éduqués, l'instinct leur indique précocement la façon dont ils doivent se comporter ; les
jeunes hirondelles, par exemple, encore aveugles, poussent instinctivement leurs déjections
en dehors du nid. Kant a cependant observé une exception à ce principe : ayant donné des
œufs de moineau à couver à des canaris, il a entendu les jeunes moineaux, fraîchement
éclos, chanter à l'imitation des canaris.
Mais contrairement à la tradition l'homme, dit Kant, n'a pas d'instinct et doit lui-même
établir les plans de son comportement. Il lui faut donc un dressage, une discipline
mécanique (Zucht) qui assure le passage de l'animalité à l'humanité, par une véritable
transformation de la nature animale. Chaque génération éduque la génération suivante, la
fait sortir de son état originel de grossièreté. La discipline maintient les résultats obtenus et
prévient le retour à l'animalité. Sauvagerie et brutalité sont absence de règle et de loi. La
discipline est la fin de la sauvagerie ; c'est le sentiment, imprimé dans l'être tout entier, de la
soumission à une loi. Ce dressage a donc un caractère négatif. À l'école, par exemple, les
enfants sont d'abord contraints à rester immobiles et attentifs. Ils n'ont encore que la liberté
animale, une fausse liberté, qui se traduit par des actes incohérents et brutaux. Cette liberté
ne connaît aucune loi. Mais ils apprennent à connaître la loi par l'entreprise de leurs aînés.
Kant écarte entièrement la méthode de Rousseau pour revenir à la tradition. L'homme n'est
pas autre chose que ce que l'éducation fait de lui. L'éducation ou information
(Unterweisung) qui s'ajoute au dressage a un caractère positif. Éduquer, c'est élever pour
réaliser une forme qui ne se rencontre pas encore dans l'expérience, pour réaliser une idée.
C'est, en même temps, développer les dons naturels de l'homme (Naturanlagen), d'une
manière harmonieuse (proportionierlich), car l'enfant, à peine sorti de l'inconscience, ne
peut accomplir seul ce développement. Problème infiniment délicat qui exige un art (Kunst)
difficile.
Cet art n'a rien de mécanique : il suppose avant tout des jugements. Pour former une nature
d'homme selon sa destination (Bestimmung) particulière, il faut un esprit judicieux.
L'éducation est d'abord l’œuvre des parents ; mais avant de proposer des règles à leurs
enfants, ils doivent servir d'exemple. L'éducation n'est aucunement du ressort des princes,
car il est rare qu'un prince ait été lui-même bien élevé ; le prince ne peut avoir que deux
rôles : facilité la tâche des parents ; organiser les écoles et les confier à des éducateurs d'une
expérience éprouvée. À ces maîtres il appartient de définir la discipline et la culture (donc
l'instruction et les bonnes manières) que l'école devra réaliser.
Un principe (qui vient de Locke et de Rousseau) présidera à toute l'éducation : laisser dès le
début le plus de liberté possible aux enfants. On leur montrera donc que la contrainte à
laquelle ils sont soumis n'a d'autre but que de leur permettre, au plus tôt, l'usage de leur
propre liberté. Deux limites seulement : lorsque l'enfant pourrait se nuire à lui-même et
lorsque l'exercice de sa liberté priverait d'autres enfants de la possibilité d'atteindre leurs
propres fins. Si l'éducation physique de l'homme ressemble à celle des animaux, l'éducation
pratique ou morale prépare l'homme à l'usage de la liberté et développe en lui le sentiment
de la personnalité. De là deux intentions parallèles : en premier lieu une pédagogie
scolastique ou didactique à caractère mécanique ; en second lieu, une pédagogie de la
finesse pratique ou de la prudence (Klugheit).
Pour les détails pratiques de l'éducation, Kant suit pas à pas Jean-Jacques Rousseau dont –
on l'a vu – il a rejeté le principe. Allaitement maternel, habillement commode et léger ;
mesures d'un caractère surtout négatif : il ne faut pas bercer les enfants, ni les tenir attachés
quand on leur apprend à marcher, ni leur mettre de corsets. Point de mollesse, des lits durs.
Point de caresses alternant avec les réprimandes ; les châtiments corporels peuvent être
utiles, mais il n'en faut pas abuser. L'effet de l'habitude est grand mais on ne peut pas,
contrairement au proverbe, s'habituer à tout.
Cette première éducation achevée, vient la culture ou l'emploi fait par l'enfant de ses
facultés intellectuelles et corporelles. Dans la culture physique, il faut donner aux enfants
l'occasion d'exercer leurs propres aptitudes corporelles. Depuis la Philanthropium de
Basedow à Dessau, beaucoup d'essais ont été faits en ce sens. Kant recommande les jeux
éducatifs les plus habituels, une telle culture physique est avantageuse, à la fois pour l'enfant
et pour la société. Elle permet de combattre, chez l'enfant, un caractère insociable et une
certaine tendance à la flatterie.
La culture de l'âme vient ensuite ; elle est préparée par la culture physique, mais la culture
intellectuelle et morale reste l'essentiel ; avec une culture physique assez étendue, on peut
rester moralement un vaurien. Dans la culture intellectuelle, chaque faculté doit être cultivée
en elle-même par des moyens appropriés : mémoire, imagination, attention. L'affectivité –
douleur, plaisir ou sentiment – requiert des soins particuliers. La patience et la persévérance
seront développées en même temps que la volonté ; mais sans satisfaire immédiatement aux
désirs de l'adolescent, il ne faut pas non plus leur imposer une longue attente inutile.
Cependant, la culture du jugement demeure fondamentale, car c'est aussi celle de la raison ;
elle résulte non seulement de l’œuvre du maître mais aussi de l'effort personnel de
l'adolescent ; elle doit être libre.
La culture morale ne doit pas être hâtive ; ne cherchons pas à rendre les enfants précoces,
chaque chose a son temps ; ni précédents, ni exemples, ni menaces ne peuvent agir
directement ; il faut apprendre à faire le bien en vue du bien lui-même ; il faut des maximes
qui résument une culture morale essentielle. Avant tout être sincère, se garder de la comédie
et de l'emphase.
Une méthode appropriée doit être employée. S'agit-il de combattre la tendance au
mensonge ? Ne punissons pas l'enfant qui ment mais témoignons-lui du mépris ; quand il a
une fois menti, montrons-lui que personne ne le croira plus. Voulons-nous cultiver
l'obéissance ? N'usons pas de la contrainte, mais essayons d'habituer peu à peu l'enfant à se
soumettre librement à un commandement raisonnable ; l'obéissance a beaucoup de nuances
et Kant les analyse finement.
Nous avons des devoirs envers nous-mêmes : le premier est de maintenir en soi la dignité
humaine ; la malpropreté, le mensonge, sont des attentats contre cette dignité. Modérer ses
désirs, se priver au besoin, rester bienveillant sans tomber dans la sentimentalité naïve, tels
sont les buts à atteindre. On ne peut pas non plus laisser l'enfant dans une complète
ignorance ne matière sexuelle. Il faut aborder la question sans détours, clairement et avec
précision, et cela dès l'âge de treize ans. On éclairera l'enfant sur les dangers du vice
solitaire et l'on mariera les jeunes gens dès l'âge viril.
L'enfant doit parallèlement apprendre ses devoirs envers autrui. On surveillera certains
défauts, et d'abord l'envie ; on mettra sous les yeux de l'enfant le catéchisme des Droits de
l'Homme. L'éducation morale s'achève en exercices pratiques, qui enseignent comment il
faut se comporter dans la vue. Cela implique adresse (Geschichlichkeit), prudence
(Weltklugheit) ou expérience du monde, et surtout moralité. Kant fait très large la part du
savoir-faire dans le monde. Il consiste à se rendre impénétrable, en perçant à jour les
intentions d'autrui, tout en évitant l'hypocrisie et la fausseté. Mais la moralité reste
primordiale. N'attirons jamais l'attention de l'enfant sur les inégalités sociales. L'expérience
l'instruira toujours assez tôt. Évitons toute comparaison avec autrui ; n'excitons jamais la
vanité. Que notre élève garde toujours une humeur aimable et enjouée, qu'il ne craigne pas
la mort et puisse au besoin la regarder sans faiblir.
L'enseignement religieux, qui est essentiel, ne sera pas théologique ; il ne se perdra pas en
explications sur l'incompréhensible. Une religion trop « théologienne » n'est pas morale ; il
faut toujours partir de la loi morale, que l'enfant doit entendre parler en lui-même, et l'on se
contentera de très simples notions sur la divinité.
Esthétique, Finalité et Religion
I. La Critique du Jugement (1790)
La Critique du Jugement apporte à la Critique de la Raison pure et à la Critique de la
Raison pratique des prolongements et des compléments qui aident à en mieux comprendre
la portée. L'esthétique de Kant, qui remplit une grande partie de la Critique du Jugement, a
d'ailleurs moins d'originalité que la conception des fins qui l'achève.
1. Objet d'une critique de la faculté de juger
A) L'édification de la Critique du Jugement
La préoccupation de la finalité est ancienne chez Kant (elle est antérieure à 1755) et
subsistera pendant trente-cinq ans. L'Histoire générale de la Nature et Théorie du Ciel
(1755) renferme déjà cette phrase : Il est plus aisé de comprendre tout le mécanisme des
mouvements célestes que la naissance d'une herbe ou d'une chenille. Dix ans plus tard
(1765-1766) Kant fait un cours sur la Critique du Beau et sur l'Esthétique. En 1771, il veut
écrire un ouvrage sur les Limites de la Sensibilité et de la Raison. En 1780, Kant cherche le
sens exact à donner au terme Esthétique. Il faut, selon lui, prendre le sens étymologique et
l'appliquer à tout ce qui concerne l'usage des données sensibles. En 1786, achevant la
seconde édition de la Critique de la Raison pure, Kant se demande si quelque élément a
priori ne jouerait pas un rôle dans nos jugements sur la beauté. Le catalogue de la Foire des
Livres pour 1789 annonce même, sous le nom de Kant, des Fondements de la Critique du
Goût (Grundlegung zur Kritik des Geschmacks).
Dès 1785, Kant avait écrit à Reinhold (le 26 décembre) que l'esthétique et l'étude de la
finalité sont intimement unies et que, dans l'une et l'autre, on doit rencontrer des éléments a
priori. Il esquisse ainsi le programme général d'une étude couplée sur l'Esthétique et la
Téléologie (doctrine des fins) : 1. Place des ces études et définition de la faculté de juger
(Urtheilskraft) ; 2. Divisions d'une Critique de la faculté de juger ; 3. Jugement esthétique
et analytique du Beau ; 4. Analytique du Sublime ; 5. Dialectique du Beau ; 6. Réflexions
sur l'Art ; 7. Étude du Jugement téléologique ; 8. Méthodologie de la faculté de juger.
Kant utilisera, comme dans toute l’œuvre critique, la classification suivante des facultés
humaines : Sensibilité pure (espace et temps), sensibilité empirique ; entendement ou faculté
des concepts et des jugements déterminants, raison ou faculté des principes ; sensibilité
pathologique ou plaisir et peine ; imagination transcendantale ou faculté des schèmes ;
faculté de désirer et, d'autre part, faculté d'agir déterminée par la Raison, ou Volonté pure ;
Raison pure pratique caractérisée par la Liberté. Les modes variés de la connaissance et de
l'action sont le résultat du jeu combiné de ces facultés ou de certaines d'entre elles.
Or, la préface de la Critique du Jugement (1790) s'attache aux domaines intermédiaires entre
ceux qu'ont définis séparément la Critique de la Raison pure et la Critique de la Raison
pratique. En effet, la Raison pure ou le pouvoir d'avoir des connaissances a priori par
principes, néglige le plaisir et la peine et ne traite pas en détail des rapports de l'Imagination
et de la Raison ; en tant que philosophie théorique, elle traite des concepts de la Nature
(Naturbegriffe) qui définissent le mécanisme. De son côté, la philosophie pratique concerne
les concepts de liberté (Freiheitsbegriffe) et de spontanéité créatrice qui mettent en jeu la
faculté de désirer et constituent les objets de la Raison pratique légiférant librement dans
l'ordre suprasensible.
Mais entre ces deux domaines distincts, se trouve-t-il, comme il semble, un abîme
insondable (eine unübersehbare Kluft) ? Non pas, puisqu'un intermédiaire (Mittelglied) est
possible entre eux : la faculté de juger.
Ainsi apparaît une tripartition des fonctions mentales et des intérêts de la Raison : 1.
Pouvoir de connaître (Erkenntnissvermögen) ou entendement (Verstand), dont la Raison
pure est la partie la plus haute ; 2. Pouvoir de désirer (Begehrungsvermögen), dont la raison
pure pratique, après avoir dominé le désir, sera la partie supérieure ; 3. Sentiment de plaisir
et de peine (Gefühl der Lust und der Unlust), pour lequel s'appliqueront certaines formes de
jugement.
B) Le Jugement réfléchissant
Connaître, vouloir, apprécier, ces trois fonctions s'exercent par l'entremise de jugements
(Urtheile). Mais la diversité des fonctions entraîne l'existence de types de jugements très
variés. Dans le langage courant, on parle d'entendement sain (gesunder Verstand), de bon
sens, de bon jugement. Ce sont des formules vagues. Le philosophe dit que la faculté de
juger en général est la faculté de penser le particulier comme compris dans l'Universel.
Mais il faut distinguer deux cas très différents : 1. Le jugement déterminant (bestimmend) –
dans ce cas, je dispose au préalable d'une règle générale sous laquelle je subsume le cas
particulier ; c'est ce que je fais si je dis : Socrate est un homme. La Critique de la Raison
pure a étudié le jugement déterminant, mais elle a laissé de côté le jugement réfléchissant ;
2. Le jugement réfléchissant (reflectirend) – je remonte alors du particulier au général, mais
sans posséder à l'avance une règle générale ; un tel jugement est une appréciation : ceci est
beau, ceci est laid, ceci sert à telle chose, à telle fonction.
Un jugement réfléchissant fait intervenir la finalité. Je dis : ceci sert à telle chose, à tel but,
comporte une finalité (Zweckmässigkeit). Leibniz et Wolff ont exploité ces remarques ; du
principe de finalité, ils ont tiré une foule de principes subordonnés : Principe d'économie : la
Nature agit toujours par les voies les plus simple ; Principe de continuité : la Nature ne fait
pas de sauts dans la série des changements ou dans le passage d'une forme à une autre. On
parle alors d'un certain ordre de la Nature. Cette notion d'ordre ne vient pas de l'expérience,
qui nous montre souvent le désordre en action. Elle ne résulte pas non plus de l'application
pure et simple des catégories à l'expérience. La notion de Finalité de la Nature est un
concept a priori spécial qui tire uniquement son origine de la faculté réflexive de juger.
Cette faculté opère dans des conditions très particulières ; la recherche des fins suppose en
nous un sentiment, un pathos, apparenté au plaisir et à la peine. Ce qui nous interdit
l'explication purement intellectuelle ou logique de Leibniz, qui ramène la sensibilité
« pathologique » à des perceptions confuses. Nous ne sommes pas ici devant un fragment
de savoir (Erkenntnisstück). Cependant le plaisir qui résulte du jeu de la Finalité et de
l'Ordre a une certaine universalité comparable aux produits de l'entendement, puisqu'il
concerne tous les hommes : je suis certain que tous les autres hommes ressentent un plaisir
analogue au mien (dass ein Jeder andere es eben so finden müsse). Ici, Kant paraît ignorer
les controverses esthétiques déjà fréquentes de son temps. Il érige une sorte d'universalité
particulière, distincte de celle des lois de la science et due à une faculté intermédiaire entre
Entendement et Raison active ou pratique. Aucun rapport ne semblait concevable entre
l'Entendement qui énonce des lois théoriques nécessaires en vue d'une connaissance de la
Nature dans une expérience possible et la Raison pratique qui légifère a priori sur la liberté,
sans s'occuper des conditions de la réalisation et qui n'apporte qu'une détermination
(Bestimmung) ; or la faculté de juger fournit une détermination intellectuelle qui veut
considérer la Nature comme soumise à l'ordre de la Raison.
La faculté de juger a deux aspects : 1. Le jugement esthétique : contemplant la Nature, je
ressens un plaisir esthétique (sensible) ou bien je cherche à imiter la Nature par une activité
humain qui suppose la liberté : c'est le domaine de la Beauté et de l'Art ; 2. Le jugement
téléologique (ou de finalité). Contemplant la Nature, je cherche à y découvrir le Règne des
Fins et à contribuer à ce règne par mon action, accomplie en vue d'une Fin, et qui doit être
féconde. L'Art, l'Industrie, la Technique, dont il faut dégager les éléments a priori, sont
presque aussi essentiels que la Science et la Morale.
2. Le Jugement esthétique
Kant distingue, selon la formule critique, une analytique et une dialectique du jugement
esthétique. Mais il existe deux types de jugements esthétiques, portant l'un sur le Beau,
l'autre sur le Sublime.
A) Analytique du Beau
Elle a pour objet la recherche des éléments a priori, impliqués par les jugements
esthétiques. Kant utilise Leibniz, Wolff, Baumgarten, Crusius, Shaftesbury. Mais il
entremêle sa discussion d'une foule de remarques psychologiques originales et fines. Un
jugement de goût (Geschmacksurtheil) ne consiste pas, comme un jugement de
l'entendement, à classer un fait dans une catégorie : il n'accroît pas mon savoir et n'est pas
nécessairement identique à celui de mon voisin dans ses caractères particuliers. Aux quatre
catégories kantiennes correspondent quatre moments dans l'analyse du jugement de goût.
Le Jugement de goût considéré sous l'aspect de la qualité. – Il concerne les dispositions, les
sentiments, le plaisir du sujet qui juge ; il est subjectif en ce sens. Le plaisir y joue un rôle
essentiel. Mais quel plaisir ? Ce n'est pas un de ces agréments des sens, pour lesquels
l'allemand dispose d'un vocabulaire si riche : gracieux, charmant, délicieux, ravissant
(anmuthig, lieblich, ergötzend, erfrölich) et dont chaque terme énonce une nuance dans le
désir. Ne présentent également aucun intérêt des impressions comme celle-ci : devant un
beau palais, je peux dire que je n'aime pas les choses faites uniquement pour les badauds et
que je préfère les rôtisseries en plein vent, comme le Sachem Iroquois en visite à Paris. Le
plaisir esthétique n'est pas non plus celui que provoque le Bien. Sans doute, le Bien procure
un agrément durable ; mais l'agréable n'est pas toujours bon. L'agréable ne devient bon que
sous l'influence d'un concept de la Raison. Un plat épicé peut être agréable, il n'est pas bon,
parce qu'il est malsain. L'agréable et le bien sont en rapport avec le désir ; le Beau, au
contraire, concerne la contemplation à l'état pur. L'agréable procure du plaisir (Vergnügt) ; le
beau plaît simplement par lui-même, le bon a une valeur objective. On peut ainsi définir le
goût comme la faculté de juger par un agrément ou un désagrément, sans intervention
d'aucun intérêt.
Le Jugement de goût considéré sous l'aspect de la quantité. – Une chose belle ne l'est pas
pour moi seul, à la différence du vin des Canaries ou de la couleur mauve, pour lesquels je
puis avoir un goût particulier. Mais cette universalité du jugement esthétique ne se
représente pas par un concept, comme la loi morale, car le Beau se confondrait alors avec le
Bon. D'autre part, tout jugement esthétique est singulier. Je ne devrais donc pas dire, si je
parlais à la rigueur : « les roses sont belles mais : cette rose est belle ». Le Beau est ce qui
plaît universellement sans concept.
Le Jugement de goût considéré sous l'aspect de la relation. – Cette analyse, menée par Kant
avec une grande subtilité, a exercé une influence profonde sur Hegel. Un artiste projette de
faire une statue ; le concept du modèle à représenter précède en lui l'existence de la statue.
La volonté peut alors se définir : faculté de désirer selon un concept préconçu, et de produire
un objet conforme à ce concept. Nous faisons très facilement le même raisonnement pour
les œuvres de la Nature ; je puis donc, observant une réalité naturelle, l'expliquer par une
Fin, dire qu'elle a été produite en vue de tel effet. Nous ne pouvons, en effet, concevoir
aucune explication de sa possibilité, si nous ne la déduisons d'une volonté. Mais cette
volonté ne peut pas être consciente, car nous retomberions alors dans le cas des actions
produites par la volonté humaine. D'autre part, l'élément de plaisir contenu dans le Beau
n'implique aucun intérêt pratique, et ne peut pas se déduire d'un concept. Le plaisir est ici
primitif, lié à la détermination initiale de la volonté ; une excitation extérieure (Reiz,
Rührung) est donc inutile ; elle n'appartient pas à la Beauté (gehört gar nicht zur
Schönheit) : la beauté du vert d'un pré, celle d'une note de la gamme, ne viennent pas de
l'action de ces objets sur les sens, mais de leur simplicité ou de leur pureté. Ici, ni perfection,
ni idéal, ni finalité interne. La Beauté, dit-on (Kant fait allusion à Leibniz sans le nommer)
vient de la liaison des parties. Cette liaison apparaîtrait distinctement à l'entendement et
aussi, d'une manière confuse, à la sensibilité. La Beauté serait alors la perfection ou l'unité
logiques confusément entrevues. Mais le raisonnement de Leibniz et de Wolff est faux ; je
n'ai aucune notion objective du but ou de la perfection, mais seulement une représentation
subjective de l'orientation de mes représentations personnelles.
On peut distinguer une beauté libre et une beauté dépendante. La beauté libre se définit par
l'absence de finalité, de liaison avec un but : voici de belles fleurs ; à quoi servent-elles ?
Seul, le botaniste pourrait répondre et sa réponse ne concernerait en rien la beauté. Pourquoi
l'oiseau de paradis, le colibri, certains crustacés sont-ils beaux ? Quelle peut être leur
finalité ? Quelle est la finalité d'arabesques capricieuses, de certains motifs décoratifs
naturels, d'une musique pure que ne soutient aucun texte, comme celle de l'oiseau ? (c'était
le thème des théoriciens du style rococo). Il existe donc une beauté dépourvue de tous
ingrédients intellectuels. La beauté dépendante, au contraire, est liée à la finalité : les
éléments intellectuels sont présents quand j'admire une église, un palais ; ces édifices ont
toujours été construits en vue d'une fin et le concept s'ajoute ici au jugement esthétique.
Mais l'universel esthétique, s'il est réel, n'est pas extérieur à nous ; il résulte simplement d'un
accord des jugements individuels, il est purement humain et l'expérience en fournit seule les
données. Au contraire, l'idée rationnelle relative à la fin de l'homme, à sa destination, est une
idée morale de la Raison qui n'a pas ici sa place. Dans le domaine de la Beauté, on peut tout
au plus invoquer une sorte d'image confuse et vague de l'Humanité qui flotterait au-dessus
des individus et qui provient de l'imagination reproductrice. C'est une image de ce genre
qu'ont fixée les Canons esthétiques, par exemple celui de Polyclète. Mais Kant n'a pas réussi
à clarifier complètement ce problème. Cependant ce troisième moment du Jugement
esthétique conduit à définir la beauté comme la forme de la finalité d'un objet, sans que soit
perçue cette fin.
Le Jugement de goût sous l'aspect de la modalité. – On croit d'ordinaire que la beauté
procure un agrément nécessaire. Curieuse nécessité ! Elle n'est ni théorique ni pratique ; elle
ne porte pas sur des notions, mais sur des sentiments ; elle ne vient ni de l'entendement, ni
du vouloir, mais d'un jugement individuel, subjectif, libre. Il y a pourtant dans ce jugement
une tendance à l'universalité, une loi implicite ; il semble de lui-même se conformer à une
loi (gesetz-mässig von selbst). Mise en présence de la symétrie rigide et des figures
géométriques régulières, l'imagination à elle seule ne peut donc nous procurer aucun
agrément ; la symétrie ne concerne pas le sentiment mais la connaissance ; aussi est-elle
ennuyeuse. De même la répétition d'une perception plaine de liberté finit par lasser. Ce
quatrième moment nous permet donc de définir le beau : ce qui est reconnu sans concept
comme l'objet d'une satisfaction nécessaire.
B) L'Analytique du Sublime est étudiée avec soin
La définition grecque du Sublime s'accorde partiellement avec celle du Beau. Là encore, ni
concept, ni impression sensible directe. Mais ayant un objet illimité le Sublime, à la
différence du beau, concerne surtout la quantité. Il met en jeu, non des formes naturelles,
mais des Idées de la Raison, avec un mouvement de l'intelligence et de la faculté de désirer.
Kant distingue un Sublime mathématique et un Sublime dynamique.
Dans le Sublime mathématique apparaît ce qui est grand absolument (schlechthin) et en
comparaison tout le reste est petit. Le pouvoir qui s'y exprime dépasse l'échelle sensible ; ce
pouvoir donné est infini, suprasensible, absolu. L'imagination n'opère pas avec
l'entendement, mais avec la Raison et ses Idées. Le plaisir que nous procure ce Sublime est
donc mêlé de respect et d'une sorte de satisfaction due à notre impuissance même.
Dans le Sublime dynamique, la Nature apparaît encore comme Force (Macht). Elle inspire
l'impression de la crainte jointe à celle de l'infini. Des rochers hardis, surplombants,
menaçants, des nuées d'orage qui s'amoncellent dans le Ciel, se rassemblent avec éclairs et
tonnerre, des volcans dans toute leur puissance destructive, des cyclones et les dévastations
qu'ils laissent sur leur passage, l'océan illimité que gonfle la tempête, la chute élevée d'un
grand fleuve, tout cela réduit à une petitesse infime notre résistance comparée à ces
forces... Il nous faut alors découvrir en nous-mêmes une capacité de résister d'une tout
autre sorte qui nous donne le courage de nous mesurer avec l'apparente toute-puissance de
la Nature... Le Sublime réside alors en nous-mêmes, non dans la Nature, mais dans notre
esprit. Il naît du contraste entre notre force d'âme – qui en impose même aux plus sauvages
– et les forces illimitées de la Nature.
Aucun objet n'est sublime en lui-même et rares sont les esprits humains sensibles au
Sublime. Cette sensibilité n'est pas l'enthousiasme. Seul est sublime un sentiment qui
renforce notre conscience de pouvoir vaincre des obstacles. Le Sublime appartient donc au
genre actif, vigilant ou vif (der wackeren Art). La mollesse n'est jamais sublime.
C) Déduction des Jugements esthétiques
Une déduction du Sublime est difficile, car la matière manque et nos jugements de goût
n'ont pas une valeur objective, mais nous pouvons pourtant opérer une déduction des
jugements de goût. Si tout jugement esthétique est subjectif, nous sommes fondés cependant
à constater, chez tous les hommes, les conditions de la faculté de juger que nous observons
en nous. Quand je dis « cette fleur est belle », je puis croire, sans pouvoir le démontrer, que
tout homme jugera comme moi (observons en passant que je ne puis pas en dire autant d'un
parfum qui me paraît agréable). Il y a donc un sens commun du goût, qui n'est pas d'ordre
intellectuel. Il y entre un élément collectif. Il n'y aurait pas d'esthétique pour Robinson dans
son île.
D) Nature de l'Art et classification des arts
Qu'est-ce donc que l'Art ? Il est production libre, à la différence des productions de la
science et de la technique. Il donne l'illusion d'une réalité naturelle, ce qui exclut tout
artifice visible. Si l'artiste a un but, ce but ne doit pas apparaître. L'Art est œuvre du Génie,
c'est-à-dire d'une disposition innée de l'esprit ; le talent artistique est naturel ; aucune recette
ne peut le faire naître. Il ne peut pas être enseigné ; les idées d'un maître ne font surgir des
idées analogues dans l'esprit de son élève que si ce dernier a le don.
Kant classe les arts en trois groupes : Les arts de la Parole (redende) ; l'éloquence nous
présente comme une œuvre de l'imagination une création de l'entendement ; et la poésie
effectue la transposition inverse. – Les arts plastiques (bildende) ; la sculpture crée des
objets copiés sur des objets réels ; l'architecture produit des objets qui n'ont pas d'équivalent
dans la Nature. – Les arts du jeu des impressions (des Spiels der Empfindungen) ; musique
et peinture. L'ordre hiérarchique est poésie, musique, peinture (Hegel adoptera la gradation
inverse). Kant prévoit un art unique, où tous les arts seront réunis en un seul. C'est ce que
Richard Wagner essaiera de réaliser après avoir repris et modifié cette théorie. En passant,
Kant donne une explication du rire, suscité par le contraste provenant d'une attente déçue.
E) La Dialectique du Jugement esthétique
Elle se réduit à une antinomie du goût. Thèse : le jugement de goût ne se fonde pas sur des
concepts : à chacun son goût (sinon on pourrait décider par des preuves). Antithèse : le
jugement de goût se fonde sur des concepts (sinon on ne pourrait pas prétendre l'imposer).
La résolution est simple : le terme concept est pris dans des sens différents dans les deux
cas ; dans le premier cas, il s'agit d'un concept ordinaire de l'entendement ; dans le second
cas, il s'agit d'un concept rationnel transcendantal du suprasensible. La thèse revient à
appliquer normalement les lois du mécanisme matériel ; l'antithèse veut que certains
produits de la nature matérielle ne soient pas jugés selon les lois du mécanisme, mais selon
le suprasensible, et elle est évidemment indémontrable. En conséquence, la thèse ne se
fonde pas sur des concepts déterminés, et l'antithèse se fonde sur un concept indéterminé. Il
peut y avoir ainsi unanimité sans concept déterminant.
Kant peut alors conclure sa critique du jugement esthétique : « L'idéalisme de la finalité
dans le jugement porté sur le beau de la nature et de l'art, est la seule hypothèse grâce à
laquelle la critique puisse expliquer la possibilité d'un jugement de goût qui prétend à une
valeur universelle a priori (sans fonder cependant sur des concepts la finalité représentée
dans l'objet) » (§ 58).
3. Le Jugement téléologique
La seconde partie de la Critique du Jugement traite du Jugement téléologique ou jugement
de finalité. Le jugement esthétique n'épuise pas, en effet, les possibilités du jugement
réfléchissant. Il n'en constitue qu'une espèce ; la finalité peut aussi se présenter sous une
forme objective grâce au concept.
A) Analytique du Jugement téléologique
Soucieux d'ordonner en un système cohérent mes connaissances relatives au monde
extérieur, j'imagine une Nature universelle et j'affirme que cette Nature se dirige vers une
fin. C'est pourquoi on peut parler de finalité lorsqu'il y a insuffisance de lois naturelles à
l'égard de la réalité. Mais Nature et Finalité n'ont pas un lien nécessaire ; la finalité objective
sert plutôt à démontrer la contingence de la Nature et de sa forme ; tous les oiseaux ne sont
pas du même modèle et on pourrait concevoir une structure différente traduite par des effets
identiques ; la Nature a résolu par des moyens très divers, donc contingents, les mêmes
problèmes.
Mais dans cette finalité objective (opposée à la finalité esthétique subjective), Kant
distingue la finalité objective formelle, domaine des mathématiques – qui fournissent, par
exemple, une solution unique à plusieurs problèmes (cas du cercle) – et la finalité objective
matérielle, domaine de la biologie et de la géographie, qui est l'objet spécifique de la
philosophie kantienne de la finalité. Cependant Kant distingue encore, dans la finalité
matérielle, une finalité relative interne et une finalité externe : la finalité interne est l'effet
direct de l'arrangement des choses, telle la structure d'une plante ; la finalité externe est un
matériel utilisable – soit par l'homme, et cette finalité s'appelle alors utilité (le fleuve est par
exemple un moyen de transport) – soit par d'autres êtres naturels, et cette finalité s'appelle
alors convenance (l'eau est, par exemple, un élément de la plante). Dans ce domaine de la
finalité matérielle, il s'agit de juger un rapport de cause à effet ; ce rapport implique non
seulement une action causale, mais la présence de l'idée de l'effet dans la causalité de sa
cause. La liaison causale n'est pas conçue par l'entendement en termes de causes efficientes,
mais en termes de causes finales par un concept rationnel des fins : la maison construite est
la cause des sommes perçues comme loyer, mais inversement l'idée de ce revenu possible a
été la cause de la construction. La chose est cause et effet d'elle-même en un double sens : la
chose ne doit pas être d'abord cause puis effet dans un processus irréversible, mais dans une
causalité réciproque ascendante et descendante.
Il faut pourtant opposer radicalement des êtres naturels réglés par la finalité interne et les
œuvres de l'homme réglées par la finalité externe : les choses en tant que fin naturelle sont
des êtres organisés (un produit organisé de la nature est un produit où tout est fin et moyen
réciproquement). L'être vivant se caractérise par la possibilité de croissance et de
reproduction ; les êtres par artifice, produits de la fabrication humaine, ont une cause
extérieure : la montre est l’œuvre de l'horloger ; elle ne reproduit pas d'autres montres ; pas
plus qu'elle ne se produit en s'entretenant elle-même ; un de ses rouages n'est pas la cause
efficiente qui engendre les autres.
Mais par analogie au projet de l'horloger, ni dirait-on pas aussi que l'arbre se nourrit et
engendre selon un projet ? De tels exemples de finalité interne et externe et de convenances
entre les êtres amènent à penser qu'il y a un but (scopus) dans la nature, et à suspendre
l'ordre naturel à un ordre suprasensible ; la nature entière semble suivre cette maxime : tout
dans le monde est bon à quelque chose. Seule une subordination de ce genre peut nous
montrer que la nature est ordonnée. Ce principe n'intéresse pas le jugement déterminant
mais le jugement réfléchissant, il n'est pas constitutif, mais régulateur. Aussi est-il
impossible de mêler physique et théologie, de faire intervenir à tout moment la Providence
pour essayer de rendre compte de la subordination des moyens aux fins dans la Nature.
Sinon, démontrant l'ordre de la nature par l'existence de Dieu, et l'existence de Dieu par
l'ordre de la nature, nous tomberions dans le paralogisme appelé Diallèle. Autrement dit la
physique, comme science mécanique de la nature doit faire complètement abstraction de
considérations finalistes, si elle veut maintenir son caractère propre ; sinon elle nous jetterait
en pleine métaphysique. L'usage de la téléologie ne vaudra que pour ménager une transition
vers la Théologie. Ce sera l'objet de la Dialectique du Jugement téléologique.
B) Dialectique du Jugement téléologique
C'est une pièce capitale de la Critique. Kant lui a consacré une vingtaine de paragraphes
denses, parfois obscurs, où l'esprit de toute sa doctrine apparaît peut-être mieux que partout
ailleurs.
Le jugement téléologique met en jeu la faculté de déterminer ou de « subsumer » sous des
règles, et à ce titre il ne comporte pas de notions d'objets, donc pas de création d'objets. Par
suite, il n'entraîne pas, en ce sens, l'antagonisme entre entendement et raison, pensée
discursive et pensée intuitive, antagonisme qui avait engendré les antinomies de la raison
pure théorique. Mais il met en action la faculté de réfléchir. Or, dans ce dernier cas, la règle
propre à déterminer n'est pas encore donnée, et elle ne se dégagera que pendant l'exécution.
La pensée devra donc se guider d'après ses propres maximes particulières, encore
dépourvues du caractère de lois. Nous rencontrons ici deux maximes opposées. La première
est celle du mécanisme : toute production de choses matérielles et de leur forme doit être
jugée comme possible, selon des lois purement mécaniques. Cette proposition, analogue aux
antithèses des antinomies de la Critique de la Raison pure, forme ici la thèse. L'antithèse
sera : Quelques productions de la nature matérielle ne peuvent pas être jugées comme
possibles selon des lois purement mécaniques.
Ce conflit n'est pas au fond bien grave. La thèse affirme seulement que je dois (ich soll)
juger, et non pas que le principe est nécessaire ou fatal, comme l'antithèse des antinomies de
la Raison pure. D'autre part, la seconde maxime (l'antithèse) dit seulement qu'il doit exister
quelques exceptions au mécanisme.
La thèse ne peut pas se démontrer. Nous ne pourrions le faire qu'en analysant tout le
mécanisme infini du monde matériel. L'antithèse non plus, car le fondement interne des lois
empiriques infiniment variées, étant suprasensible, nous échappe. Nous ne pouvons savoir,
en conséquence, si elles suffisent à produire l'organique tout autant que l'inorganique, ni si
comme fondement du premier, il faut poser un entendement architectonique exorbitant de la
nature matérielle ou de son substrat intelligible. Cette antithèse est donc seulement valable
comme jugement réfléchissant. Comment les différents systèmes de philosophie nous
présentent-ils thèse et antithèse ? Les uns nient la finalité et adoptent la thèse : selon
l'Idéalisme, la finalité objective de la Nature n'implique pas de pensée ou d'intention ; pour
Démocrite et Épicure, comme pour Spinoza, la finalité de la Nature n'est qu'apparence ; tout
naît du hasard, la Nature est aveugle. Les autres affirment une certaine finalité et admettent
l'antithèse du Réalisme, qui peut être de deux sortes : s'il est physique, il suppose dans la
Nature une intelligence diffuse et une vie mystérieuse ; s'il est hyper-physique, comme le
théisme, il fait appel à un principe extérieur suprême dont on déduit tout chose : Kant va
renvoyer dos à dos ces idéalismes et réalismes de la finalité. Ces dogmatismes opposés
commentent la même erreur ; ils confondent jugements réflexifs et jugements déterminants.
En effet, le dogmatisme entreprend d'expliquer par un jugement constitutif ou déterminant
ce qui relève seulement, en fait, d'un jugement réflexif.
Nous ne voyons jamais d'une manière distincte les fins de la Nature, si elle en a. Il nous
faut, pour les induire, un raisonnement fondé sur le caractère de notre activité propre,
toujours orientée vers une fin. Mais la fin de notre activité est toujours contingente, puisque
nous ignorons si ce but sera atteint. Donc le jugement que nous formulons à ce sujet n'est
pas déterminant, mais réflexif ou fondé sur des considérations sans rigueur. Si notre
entendement était intuitif, il n'existerait que du réel et non du possible. Mais un entendement
dépourvu de faculté intuitive ne connaît la réalité que par l'expérience des sens. De la sorte,
la notion de nécessité reste toujours problématique, en ce qui touche l'avenir. Notre raison
ne considère l'avenir sous l'angle de la nécessité, que quand la loi morale l'oblige à affirmer
l'existence d'une causalité libre, quand notre raison devient pratique. Ainsi s'impose à nous
la nécessité morale du devoir (sollen) suivie d'une exécution exigée par la loi morale (thun).
L'écart qui existe entre devoir et exécution (sollen et thun) est, en quelque sorte, comblé par
la notion de finalité. L'entendement ne peut normalement énoncer que des jugements
constitutifs portant sur des faits ; et l'idée de finalité ne peut pas jouer pour de tels
jugements. Ainsi l'entendement est forcé d'aller de l'universel au particulier qui est contenu
dans l'universel. Cela se fait par analyse, au lieu que la finalité permettrait d'aller du général
au particulier par synthèse. De là, deux visions complémentaires des choses. L'ensemble des
choses peut nous apparaître d'abord comme un système de pièces ajustées dans un
mécanisme. Si nous connaissons le mécanisme, nous pouvons à l'occasion reproduire des
objets de la nature, en concevoir une production mécanique (mechanische Erzeugung). Mais
l'ensemble des mêmes choses peut nous apparaître comme organisé en vue d'une fin.
Or, ces deux aspects des choses ne peuvent être sacrifiés ni l'un ni l'autre. On ne peut pas
négliger le point de vue du mécanisme : ce serrait supprimer la science. On ne peut pas
davantage oublier la finalité : ce serait s'interdire la possibilité de l'anticipation ou de la
découverte. Mais il faut user du principe de finalité avec beaucoup de précautions et de
mesures. La contradiction apparente des deux aspects ne peut être levée que par le recours à
un principe suprasensible, seul capable de les unir. Mécanisme et téléologie sont donc
suspendus à une puissance unique, supérieure à la Nature et dont, par suite, nous ne pouvons
nous donner aucune représentation. Le principe qui autorise la soudure entre mécanisme et
finalité guide un jugement réflexif et subjectif, résumé dans l'adage vulgaire : Qui veut la
fin, veut les moyens.
C) Méthodologie du Jugement téléologique
Ainsi sommes-nous amenés à une Méthodologie spéciale de la faculté du juger ; cette
méthodologie n'est pas dogmatique, ne forme pas un corps de doctrine ; elle est purement
critique, distincte à la fois de la théorie de la Nature et de la Théologie.
Il y a en nous une exigence, en elle-même illimitée, de dépasser l'explication mécanique.
Mais cette exigence est étroitement circonscrite par les bornes de notre entendement. On
poussera évidemment aussi loin que possible l'explication du mécanisme par la finalité, en
lui donnant toute la précision concevable. C'est ce qui advient par exemple quand nous
voulons décrire la succession réelle des formes vivantes. D'où les hypothèses de
l'occasionnalisme, de l'harmonie préétablie et toutes leurs variantes, celles de l'emboîtement
des germes, de l'évolution, de l'épigenèse, etc. on peut d'abord imaginer une téléologie
externe ; en ce cas, un objet de la nature sert à un autre comme moyen à sa fin (ici, un être
organisé). Pourquoi telle chose naturelle existe-t-elle ? Deux réponses : On invoque le
mécanisme de la nature ; ou l'on cherche une intention à son existence. Cette seconde
réponse prévaut en ce qui touche les être vivants organisés. Mais ni l'une, ni l'autre réponse
ne nous apporte une certitude. Pourquoi y a-t-il des végétaux ? Pour nourrir les animaux
herbivores : mais pourquoi ces animaux sont-ils là ? Pour nourrir les animaux carnassiers...
On peut avancer ainsi à l'infini : on arrive toujours finalement à la conclusion : tout est
organisé à l'usage de l'homme. Ou bien on dit avec Linné : chaque espèce est là pour limiter
le domaine des autres. Toutes considérations que les faits ne permettent jamais de justifier ;
simples procédés réflexifs, que l'on invoque pour présenter l'homme comme le but et le Roi
de la Nature. La Nature tout entière serait organisée en vue du bonheur de l'homme ; ou de
la culture capable d'assurer son bonheur. Spéculation arbitraire ; la culture ne saurait être
une fin valable ; aucune culture ne peut nous procurer le bonheur ici-bas. Aucun artifice (ou
Geschichlichkeit), toujours générateur de conflits et de guerres, ne peut davantage nous
procurer le bonheur. La seule finalité est ici la finalité intérieure de l'homme en tant que
soumis à la loi morale.
D) Passage à la Théologie
Nous voici aux confins de la théologie physique ou de la théologie morale qui nous obligent
l'une et l'autre à dépasser l'ordre naturel.
La Physicothéologie ne peut ni atteindre la fin suprême ni même nous mettre sur sa voie.
Elle nous remplit sans doute d'admiration pour l'Univers ; mais comment, partie de faits
d'expérience, pourrait-elle nous mener à l'Être suprême ? Son unique rôle est de fournir une
préface souvent mal comprise, à la théologie morale.
La Théologie morale peut nous être de plus de secours. Sans la présence de l'homme, la
création reste un désert, une jungle (eine blosse Wüste). L'homme ne peut évidemment
fournir un but à la création qu'en qualité d'être moral, Dieu n'a de sens que comme Chef du
Règne des Fins. La théologie morale peut seule déterminer Dieu comme tout-connaissant,
tout-puissant, parfaitement bon, et donner une valeur à la théologie physique. Le Dieu
bienfaisant n'est concevable que grâce à la loi morale et une doctrine fondée sur la crainte ne
peut enfanter que des démons. Si la théologie physique nous oblige à admettre une cause
intelligente à l'Univers, la théologie morale nous touche directement, comme êtres de cet
univers, unis à d'autres êtres analogues. L'existence de Dieu, la valeur de la loi morale sont
donc deux termes inséparables.
En matière théologique, ni les preuves dites rationnelles, ni les analogies, ni les hypothèses
ou les opinions vraisemblables ne sont recevables. Notre esprit ne peut avoir que trois
attitudes : l'Opinion (Meinen, Opinabile), le Savoir – soumission aux faits – (Thatsachen,
Scibile, Wissen), enfin la Croyance appliquée à ses objets propres (Glaubensachen, mere
Credibile). Or, les faits de l'ordre religieux ne sont, au premier abord, que des opinions
dérivées du mouvoir d'opiner (Meinen). Mais c'est une conclusion fausse ; si la science, en
effet, concerne des faits vérifiés par l'expérience, si l'opinion concerne une connaissance
empirique possible, mais actuellement invérifiable (par exemple l'opinion des physiciens qui
affirment l'existence de l'éther), la croyance concerne l'usage de la Raison pure pratique
conforme au devoir affirmé a priori ; et grâce à cet impératif moral, le maximum de bien
réalisable ici-bas par l'emploi de la liberté. Cette croyance suppose une confiance
(Vertrauen) inébranlable dans la possibilité de réaliser une intention morale. Nous avons le
devoir de réaliser cette intention, mais la possibilité de la réaliser en actes est par elle-même
invérifiable. Une différence très grande apparaît donc entre opinion et croyance rationnelle :
l'opinion s'accommode du scepticisme ou de l'artifice ; la croyance exige une sincérité
totale, le don de soi-même, le risque joyeusement couru, un abandon qui est l'équivalent
pratique de la certitude théorique des sciences les plus exactes.
On ne peut donc connaître le suprasensible. La théologie ne nous apportera pas de
démonstrations du même type que celles de la physique ou de la géométrie. Une théologie
morale, fondée sur la notion du devoir, est possible, mais une morale théologique est
inconcevable ; la raison peut seule donner des lois morales, et la morale précède
logiquement la théologie.
En résumé, il n'y a pas d'explication finaliste de la Nature. Si la finalité intervient dans la
biologie, c'est que, pour ordonner les faits de la vie, il nous faut recourir à une croyance
rationnelle, mais indémontrable. Cette croyance n'est pas négligeable cependant ; elle n'est
pas une simple opinion, elle nous est imposée par la loi de la liberté, celle du devoir. Elle
nous mène de la morale à la religion. De là, une double version des sciences de la vie, l'une
mécanique, l'autre finaliste. Ces deux versions sont également indispensables.
II. La Religion dans les limites de la simple Raison
Kant s'est préoccupé du problème religieux dès sa jeunesse et en particulier des preuves de
l'existence de Dieu. Le Théisme et le Déisme des Britanniques l'ont intéressé et il a lu les
œuvres de Hume avec passion. Enfin la dernière partie vraiment achevée de son œuvres est
la Religion dans les limites de la simple Raison (1793 et 1794).
1. Sources et publications
Après le Piétisme, cet ouvrage représente une étape importante pour éliminer du
Christianisme tout élément sentimental, pour en expulser tout ce qui peut émouvoir les sens
et l'imagination, et même le moindre soupçon de charité.
Kant a été séduit par le Théisme anglais, par Voltaire et l'Encyclopédie, et surtout par la
Profession de foi du vicaire savoyard, ainsi que par l’Émile, le Contrat social et en général
toute l’œuvre de Rousseau. Il a lu Mably et Morelly et il a sûrement subi l'influence du
courant d'idées représenté à la fin de l'Ancien Régime par l'abbé Raynal et qui devait aboutir
aux divers cultes révolutionnaires. D'ailleurs ce n'est nullement ce effort pour rationaliser la
religion et pour en faire une discipline abstraite, qui a tourné contre Kant l'hostilité du bras
séculier. Ce qui a indisposé le roi Frédéric-Guillaume III, c'est la suppression implicite de la
hiérarchie, la constitution d'un clergé laïque et indépendant du pouvoir politique, la
possibilité d'une dissidence, la menace d'un schisme suspendue sur une Église privée
d'organisation temporelle. Aussi Kant se sent-il condamné à une stricte prudence, car il est
surveillé. Il n'ignore pas, en 1791, que le Collège des Censeurs, créé par Frédéric-Guillaume
III et son ministre Wöllner, a l’œil sur lui. Les trois censeurs Hermes, Woltersdorf et Hilmer,
lui sont hostiles. Cependant il a rédigé des articles sur la Religion et va les publier dans la
Revue mensuelle de Berlin, éditée à Berlin par Biester, mais imprimée à Iéna (Berliner
Monatschrift). Le premier article (mars 1792) est remis à la censure de Berlin. Hilmer lit,
accorde le visa, parce que le travail n'est lisible que par des savants. Le deuxième article
passe sous les yeux d'Hermes, qui refuse le visa et renvoie le manuscrit à Kant. Pour tourner
la censure berlinoise, Kant s'adresse alors à la Faculté de Théologie de Königsberg, puis à
Iéna, qui accordent également l'imprimatur.
L'ensemble forme quatre dissertations : La Présence du mauvais principe à côté du bon, ou
le mal radical de la nature humain ; La lutte du bon principe avec le mauvais, pour la
domination de la nature humain ; La victoire du bon principe sur le mauvais et
l'établissement de Dieu sur la terre ; Du culte et de la superstition sous le règne du bon
principe, ou de la religion et du cléricalisme (Pfaffenthum). En fait, le thème de ces leçons
est de plus en plus actuel au moment où la Révolution française se heurte violemment à la
religion de l'Ancien Régime.
2. Le domaine kantien de la religion
Cet ouvrage souligne l'opposition entre le Kantisme et les religions existantes. La tradition
assimile les vérités religieuses aux vérités scientifiques, mais elle range les vérités
religieuses dans un ordre supérieur ; or pour Kant, l'existence de Dieu ne peut être
démontrée scientifiquement ; toutes les preuves classiques sont inopérantes ; la
Physicothéologie est illusoire.
Selon la Critique de la Raison pratique, l'impératif catégorique suppose seulement
l'efficacité de l'action humaine et l'union future du bonheur et de la vertu, union impossible
sans la présence d'un Dieu juste et bon. De même la Critique du Jugement montre qu'une
interprétation finaliste de la nature, qui est utile, suppose un gouvernement moral du monde,
et le Règne des Fins ; mais ce règne n'est pas un fait et ne peut être constaté par aucune
expérience. En effet, après la résolution du vouloir qui décide l'obéissance à la loi morale, il
est nécessaire de se donner un but et de se fixer les moyens de l'atteindre ; de la morale
résulte un but (aus der Moral geht doch ein Zweck hervor), car nous ne pouvons rester
indifférents aux résultats de nos actions. Ainsi naît en nous l'idée d'une condition absolue de
toutes les fins que nous pouvons avoir dans le monde, ou d'un Bien suprême dans le monde.
Cette idée naît vraiment de la morale, et elle ne la fonde pas (ist doch nicht die Grundlage
derselben), elle la continue : inutile d'invoquer Dieu pour témoigner devant un tribunal. Par
conséquent, la Morale se suffit à elle-même et n'a pas besoin d'être fondée par la religion. La
Finalité n'a pas besoin non plus d'être fondée, car son principe réside dans la structure même
de la faculté de juger. Loin de dépendre de la religion, morale et finalité s'achèvent en
Religion. La Religion n'est pas un système de vérités révélées portant sur ce qui dépasse
l'expérience ; elle traduit simplement la tendance de la Raison pratique à affirmer un ordre
moral futur en prolongeant vers l'avenir un résultat obtenu par l'impératif moral ; enfin, la
Religion est personnelle.
Mais toute chose, même la plus sublime, se rapetisse entre des mains humaines. Les
théologiens sont venus et ils ont imaginé un précepte pratique : « Obéis à l'autorité » ; ils
ont mis la morale en rapport avec ce précepte, et fait de la Religion une annexe de la
politique. Ils ont bâti une théologie biblique, justifié les abus du pouvoir, installé la censure,
inventé mille « folies », dans la confusion des genres. Ils ont, ajoutera Kant dans la seconde
édition, subordonné la théologie rationnelle à la théologie biblique et prétendu prouver par
la raison des faits historiques. Or la Révélation peut bien envelopper une religion
rationnelle, mais la religion rationnelle ne peut jamais contenir une Révélation.
3. Le problème du mal et la religion morale
A) La présence du mal en l'homme
L'homme pèche, c'est un fait. Quelle en est la cause puisque le péché a été constaté de tout
temps ? Sur ce problème, on pourrait faire deux hypothèses : ou bien le mal accroît son
empire, ou bien le monde s'améliore et il y a un progrès moral – mais ces deux hypothèses
sont invérifiables.
Il faut donc tenter d'analyser la nature humaine. On le peut de deux façons :
– Une première analyse montre que la nature comporte trois éléments : animalité, humanité,
personnalité. L'animalité est le règne du mécanisme ; elle produit amour-propre,
conservation de soi, reproduction, sociabilité ; elle s'accompagne du désir (plaisir, brutalité,
bestialité). L'humanité est le règne de la culture, phénomène social (égalité, concurrence,
envie, ingratitude, plaisir pris au mal du prochain). La personnalité, enfin, se manifeste par
le respect pour la loi morale.
– La deuxième analyse peut ainsi se résumer : il y a en l'homme une propension au mal
(Hang), une fragilité (Gebrechlichkeit) visible même chez les Apôtres, une impureté
(mélange de données morales et immorales), enfin une méchanceté (corruption, perversité,
mauvaises maximes). Cependant de telles analyses – Hegel s'en souviendra – ne sont guère
instructives et il faut expliquer les faits mêmes qu'elles révèlent. Une constatation évidente
les domine : Personne n'est responsable de sa sensibilité innée et ce n'est donc pas en elle
que le péché a son gîte.
D'autre part, il y a dans l'homme une maxime morale et pourtant il commet le péché. Y
aurait-il donc en lui de bonnes et de mauvaises maximes ? Serait-il tantôt bon, tantôt
mauvais ? Cette hypothèse obligerait à mettre en nous un principe d'indifférence, contraire à
toute moralité. Comment, partiellement mauvais, l'homme ne mettrait-il pas un élément de
malice jusque dans sa maxime ? Cela ne se peut, car selon Kant la propension au péché ne
peut pas venir d'une mauvaise maxime. Le péché ne peut donc se loger dans la raison
pratique, qui ne peut être ni mêlée ni corrompue, ni affranchie de la loi morale. Un homme à
la fois immoral et raisonnable serait un diable. Il est donc impossible de trouver l'origine du
péché dans la sensibilité ou dans la raison pratique.
Kant peut alors faire trois remarques : L'homme est ou bon ou mauvais, il n'y a pas de
milieu. On ne peut être bon ou mauvais partiellement, sinon l'impératif perd aussitôt son
caractère absolu et inconditionné. Le choix entre bien et mal est par suite un acte indivisible,
définitif, valable pour la vie entière, donc intemporel. Ce n'est pas, dit Kant, un acte dans le
temps (ein Zeitaktus). L'intention ne peut être qu'unique et elle vaut, d'une manière
générale, pour tout l'usage de la liberté. Résultat d'un acte libre, ce choix n'est nullement
fatal. Mais en le faisant l'homme se donne un caractère (empreinte ineffaçable). Selon qu'il
se donne, par une libre décision du vouloir, une maxime bonne ou une maxime mauvaise, il
devient une personne bonne ou mauvaise. C'est improprement qu'on appelle ce caractère
inné. Ce n'est pas une manière d'être congénitale, c'est l'effet d'un choix libre, d'un acte
intelligible, dans l'absolu.
Cependant ce choix primitif est en principe toujours mauvais. L'homme est pécheur,
mauvais par nature. Que l'option initiale soit mauvaise, cela saute aux yeux si l'on observe
les peuples sauvages ; chez les civilisés, le mensonge et l'hypocrisie masquent et aggravent
la perversité native. Il y a donc chez tout homme une propension (Hang) naturelle au mal,
une méchanceté (Bösartigkeit) foncière, un mal radical qui corrompt le fondement de ses
maximes.
Mais pour comprendre ce mal radical ou péché, ne confondons pas origine dans le temps
(Zeitursprung) et origine rationnelle (Vernunftursprung). L'histoire biblique de la chute
d'Adam est fausse en elle-même, c'est plutôt une simple image du péché. Si le péché
héréditaire existait chez l'enfant naissant, il n'y aurait plus de liberté possible. Il faut donc
que l'homme débute par l'état d'innocence (unschuld). Il entend bientôt un commandement
moral (Gebot) et il désobéit par un acte intemporel.
B) La possibilité d'une conversion au bien
L'homme déchu par le péché doit alors se faire et devenir ce qu'il doit être, par un nouvel
acte libre, par une conversion ou une rupture radicale avec le passé ; il doit renverser sa
décision initiale. Mais comment une conversion est-elle possible, et comment un mauvais
arbre peut-il porter de bons fruits ? Cela dépasse tout ce que nous pouvons concevoir (des
übersteigt alle unsere Begriffe). Chute et rédemption nous sont incompréhensibles.
Cependant quelques observations utiles sont possibles.
La conversion n'est concevable que si, même au milieu des pires égarements, la loi morale
subsiste en nous dans toute sa pureté. Car si nous avions perdue, dans le péché, l'impulsion
vers le bien, nous ne pourrions jamais la retrouver. Que nous ordonne la loi morale ?
Devenir bon et rien d'autre ; il est donc possible de devenir bon. La loi prescrit une
révolution dans la façon de penser (eine Revolution in der Denkungsart) et en même temps
une résolution unique et qui ne variera plus (eine Einzige und unwandelbare
Entschliessung) ; bref, je deviens un nouvel homme, par un acte souverain et définitif de la
liberté (comme Rousseau l'avait voulu). Une pratique religieuse quotidienne s'ensuivra sans
doute ; mais cette amélioration de notre comportement visible n'est pas première. Ce qui est
primitif, c'est la transformation de la façon de penser, l'établissement d'un caractère. La
volonté se relève d'elle-même, avant tout, par une vraie régénération morale. Par
conséquent, à la question : pourquoi Dieu permet-il la faute, Kant a fait la réponse
classique : Dieu m'a donné la liberté, sans laquelle je serais moins parfait, mais qui ne va
pas sans le risque d'erreur. La liberté ne détruit pas le mauvais principe, mais elle me donne
la possibilité de le vaincre. Mon option absolue peut seule couper court à la perversité
native. Pas de miracle superstitieux ici ; c'est dégrader la Religion que d'invoquer sans cesse
le miracle. Le juge ne se demande pas, au tribunal, si le diable a tenté le coupable.
C) Une conception morale de la religion
Ainsi s'opposent deux types différents de religion : le culte extérieur, et la religion du bon
comportement dans la vie (des guten Lebenwandels). Selon la première, l'homme ne peut
rien faire lui-même pour son salut : seule la grâce divine peut le sauver ; selon la seconde (la
religion chrétienne), il doit faire lui-même tout ce qu'il peut afin de devenir meilleur, avec
l'espoir qu'un secours extérieur ou une grâce viendra finir ce qu'il ne peut achever lui-même.
Inutile de poser le problème redoutable du mécanisme de la grâce. Il suffit de savoir où est
le devoir, d'avoir confiance, de garder la foi. On aboutit donc à une religion morale. Avoir la
foi se ramène à l'espérance que nous trouverons le secours divin dans notre effort pour
vivre moralement, que la conversion est possible et sera suivie d'effets pratiques. Voilà tout
l'élément positif du Christianisme. La vie morale est un combat quotidien qui veut vigilance
et courage (Mut, Tapferkeit). Il faut exciter le courage en soi-même pour le faire naître.
L'ennemi à combattre, c'est la méchanceté (Bosheit), le mauvais esprit, le Malin. Notre idéal
sera de réaliser en nous-même la perfection morale de l'homme, la perfection faite chair,
sans aucun des vices humains, la Sainteté.
Nous en avons un symbole dans l'abaissement volontaire (Erniedrigung) du Fils de Dieu.
Nous nous rendons agréables à Dieu en copiant le modèle divin que nous a offert son Fils,
descendu sur la terre ; un homme, mais avec une intention divine (Göttlich gesinnt). Soyez
saints comme votre Père céleste est saint, voilà la loi, car c'est l'idéal du Fils de Dieu. Mais
l'infinie distance qui sépare de nous le modèle divin ne peut pas être parcourue en temps
donné. Il faut seulement, pour le moment, réaliser un renouvellement global, total ; il faut
dépasser le vieil homme, revêtir un homme nouveau, parce que le sujet de la faute meurt
(abstirbt) en nous. Kant, on le voit, transpose le langage de Rousseau et aussi celui de
Pascal.
4. Religion et société
A) L'instauration d'un état moral
L'homme doit sortir de l'état de nature pour devenir membre d'une république morale. L'état
de nature juridique qui est la condition du groupe en état de guerre permanente comme
l'état de nature morale qui est la condition de l'homme en état d'indépendance absolue
représentent la lutte du mauvais principe contre le bon. Or ces états de liberté extérieure
anarchique, où chacun, groupe ou individu, se donne à lui-même sa loi, ont été remplacés,
comme le montrent les juristes, par un état juridico-civil où une autorité publique puissante
édicte les lois des relations entre les hommes ; mais cet état légal fait triompher le droit par
des lois externes, qui sont toutes de contrainte ; la liberté de chacun n'a alors pour bornes
que les conditions où elle est compatible, selon une loi générale, avec la liberté de tous ;
cette société juridique s'occupe donc uniquement de la légalité des actes et non de la
moralité interne des gens. Là encore, la coexistence du mauvais principe avec le bon se fait
au détriment du bon, car si la faute est personnelle, le péché naît aussi de la vie sociale qui
excite en l'homme les passions ; l'envie, l'ambition, l'avarice, la haine ravagent les bonnes
dispositions dès que l'homme vit au milieu des hommes.
Il faut donc, comme le voulait Rousseau, réformer la société pour faire triompher le bon
principe ; fonder une société gouvernée par les lois de la vertu et n'ayant d'autres fins
qu'elle ; cet état éthico-civil sera une République morale, un Royaume de la Vertu. À la
différence de l'ordre juridique, l'ordre moral n'est pas celui de la contrainte mais de la
liberté ; les hommes y sont unis spontanément par les simples lois de la vertu. La morale y
est à la fois personnelle et publique : les devoirs moraux sont en même temps des
commandements législateurs. Devenu libre par la conversion de soi-même et la coopération
de ses semblables, l'homme s'affranchira du mal et pourra vivre selon la Justice et le Bien.
B) L’Église véritable
Si cette république à fonder devait être seulement juridique, les hommes seraient leur propre
législateur. Mais cette République morale, qui concerne la valeur interne des actes, échappe
aux lois humaines publiques ; son chef n'a pas à imposer une obligation légale.
Le législateur suprême de cette république, qui juge les devoirs moraux et sonde les
intentions les plus cachées, c'est Dieu. Une République morale est un peuple de Dieu, les
lois morales sont des commandements divins ; Dieu est le chef moral du monde, l'autorité
invisible du père de famille commun.
Par conséquent, le concept d'un peuple de Dieu, d'un ordre moral des libertés, ne peut être
fondé sur des lois statutaires : ce serait un état théocratique, un gouvernement des prêtres, où
le juridique serait le moral ; le législateur divin resterait purement externe. Ce type
d'institution, qui est historique, doit être rejeté.
L'idée du peuple de Dieu ne peut recevoir son accomplissement que sous la forme d'une
Église véritable. Par essence l’Église est idéale, invisible : c'est la société qui comprend tous
les justes sous le gouvernement divin immédiat et moral et qui sert de modèle à celles que
les hommes doivent fonder. l’Église visible sera la réunion en un tout des hommes qui
veulent réaliser cet idéal ; aussi près soit-elle de la perfection, elle n'échappe pas aux défauts
humains et ne réalise pas entièrement la communauté invisible : l'idée sublime d'un être
moral commun ne peut jamais être pleinement réalisée, elle se rétrécit en une institution qui
ne peut en représenter, dans sa pureté, que la forme.
Quels seront les caractères de la véritable Église ? Kant se réfère une fois de plus à son
tableau des catégories : 1. Elle doit être une (non divisée en sectes), et universelle ; 2. elle
sera pure, c'est-à-dire uniquement fondée sur des mobiles moraux ; elle exclura les deux
folies de la Superstition et du Fanatisme : elle se gardera également de l'exaltation confuse
(Schwärmerei) ; 3. elle sera libre dans chacun de ses membres et dans son ensemble, donc
sans hiérarchie, et formant une sorte de république indépendante du pouvoir politique ; 4.
comme le Piétisme enfin, elle sera immuable, sans variations, sinon celles qui seront
imposées dans ses organes administratifs par la situation de l'époque. Elle ne prendra donc
aucune des constitutions politiques telles que monarchie, aristocratie, démocratie.
Cependant, la structure de l’Église est liée à des conditions historiques. Notre faiblesse nous
interdit, en effet, de donner à l’Église une organisation purement rationnelle. Règles et
statuts seraient inutiles si l'homme pouvait vivre seul. Mais, membre d'un État, il est
prisonnier d'un passé complexe. Il lui faut non seulement une tradition, mais des
formulaires, des textes. Ils ont varié et le Christianisme lui-même a utilisé des formules
diverses ; pourtant toutes manifestent une seule et même religion : elles ont été
bienfaisantes, car elles seules lui ont donné un corps, en rendant concrets et sensibles les
préceptes spirituels. Mais la seule Religion vraie, authentique, demeure celle de la Raison ;
l'érudition biblique, l'exégèse (Schriftgelehrsamkeit), études proprement doctrinales,
peuvent seulement aider à faire prévaloir la Religion véritable. Cette religion vraie, toujours
irréelle dans les conditions historiques, reste un idéal auquel nous devons tendre. Elle sera
réalisée quand tous les fidèles, sans avoir besoin de statuts, vivront de la vie morale. Les
formes matérielles sont des étapes provisoires dans la marche vers l'idéal.
C) Le sens du message chrétien : la foi et les œuvres
Chargé de péchés, conscient de son abjection, l'homme a le sentiment d'un mal radical dont
il est impuissant à se libérer. La Révélation, les textes, lui apprennent qu'une réparation
(Genugthuung) a eu lieu. Un Dieu a pris sur lui les péchés du monde. La foi, d'origine
céleste, entre alors dans l'âme du Chrétien et elle lui semble suffire au salut. Mais suffit-elle
vraiment ? Sans doute, il faut accepter, du fond du cœur, la foi dans la justification ou
satisfaction par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais il y a aussi en nous le commandement
moral. Il faut consacrer notre force morale d'intention à imiter la conduite parfaite de Dieu,
et croire que son amour pour l'homme corrigera dans le sens de nos intentions
l'imperfection de nos actes, si grande qu'elle soit...
On rencontre souvent deux attitudes opposées sur le problème du rapport de la foi et des
œuvres : croire d'abord, agir ensuite parce que l'on croit, ou bien agir d'abord et croire
ensuite parce que l'on agit. Le premier principe est celui des prêtres ; le second celui des
moralistes. Mais les deux règles sont simplement complémentaires ; l'avenir amènera leur
identification et fera tomber tous les obstacles à leur unité.
Kant paraît ainsi renoncer partiellement au principe luthérien – qu'il semblait d'abord
adopter – du salut par la foi et non par les œuvres. En réalité, il transpose les idées des
révolutionnaires français et leur culte de l'Humanité future.
D) L'Histoire religieuse
L'Histoire confirme, selon Kant, ces conclusions.
Le Judaïsme est une religion étroitement statutaire et théocratique, avec gouvernement du
clergé. C'est moins une religion qu'une société politique dont les préceptes et les sanctions,
uniquement terrestres, attestent le caractère humain et strictement national. Religion d'Israël,
le Judaïsme ne peut pas prétendre à l'universalité.
Le Christianisme primitif est d'abord libération à l'égard du Judaïsme. Extérieurement, cette
religion prêchée par un homme divin semble attestée par des miracles. Mais Dieu incarné,
miracles, textes, preuves historiques ne jouent dans le Christianisme qu'un rôle accessoire.
L'essentiel, dans le Christianisme, ce sont les préceptes moraux, ce que nous devons faire.
Le temps des Révélations n'est plus et une nouvelle Révélation est improbable. Tenons-nous
en donc aux vérités du Christianisme. Il prolonge l'histoire en nous annonçant l'avènement
du règne de Dieu. L’Évangile ne nous promet pas la béatitude ici-bas, mais l’Église nous
prédit le règne futur de Dieu en nous-mêmes, dans tous les hommes, donc sur la Terre. Elle
nous enseigne l'existence d'un Maître moral du monde. Elle ne définit pas ce Maître en lui-
même : elle nous dit ce qu'il est pour nous. Elle le nomme Créateur, Législateur, Saint,
Justicier, Providence.
Mais ne prenons pas ces mots en un sens anthropomorphique ; ne disons pas de Dieu
Législateur qu'il est gracieux, indulgent, bon, bienveillant ni qu'il est un despote ; de même,
il n'y a pas de mystères au sens clérical du terme. Croyons seulement qu'une vocation
(Berufung) nous appelle à faire partie d'un ordre moral futur. Croyons que, malgré nos
péchés, nous serons justifiés : Dieu qui nous a appelés sur terre doit nous donner les moyens
de nous sauver. Croyons à l'élection (Erwählung) par Dieu, de ceux qui appliquent la loi
morale.
5. Religion et superstition
On peut distinguer une religion naturelle et une religion enseignée qui peuvent d'ailleurs
coïncider en tout ou en partie.
La religion naturelle est uniquement morale et pratique. Seule l'intention morale nous rend
ici agréables à Dieu. Tout péché en intention ou en paroles équivaut à une faute en action.
Tout péché à l'égard du prochain exige une réparation faite au prochain. Liberté,
immortalité, peines et récompenses futures sont les seuls articles positifs, avec l'existence de
Dieu. l’Église universelle ainsi entendue se passe de prêtres.
Mais la religion enseignée est l’œuvre de savants. Elle oppose à la foi rationnelle, la
croyance révélée (Offenbarungsglauben) avec une Église historique, des faits historiques.
Sans être essentielle à la religion, la Révélation peut lui donner un supplément de force.
Mais dès que la Révélation prévaut sur la Raison, nous entrons dans le domaine de la
Superstition (Aberglauben).
La superstition prospère dès que l'on cherche à établir (stiften) ici-bas le règne de Dieu. Ce
règne implique, dit-on, une organisation administrative, des serviteurs (Diener), un service
(Dienst). Sous ce nom, on désigne bien souvent un culte faussée, corrompu (Kultus spurius,
Afterdienst) qui éloigne, en réalité, la venue du règne de Dieu. Le culte faussée change, en
quelque sorte, l'importance des termes. On dira, par exemple : Il y a eu un peuple élu, le
Peuple juif ; le Christ devait naître Juif et le Christianisme est solidaire de ses origines
juives ; c'est donc une religion statutaire du type juif. Il y a, dans cette interprétation une
folie (Wahn) aussi absurde que l'anthropomorphisme.
Ainsi s'installe le cléricalisme, la domination des prêtres (Pfaffentum), le règne des
ordonnances et des textes, qui étouffe la vie morale. Or Religion et Morale ont le même
principe : l'usage de la conscience morale. Avant d'agir, je dois savoir que mon action est
droite. Ce n'est pas la conscience, mais un jugement de l'entendement qui me renseignera
sur ce point. Quand le jugement ne peut être énoncé avec sécurité, le premier devoir d'un
homme religieux est de s'abstenir, car il court le risque d'être injuste. Le risque d'injustice est
grave, en matière religieuse : rien n'autorise un inquisiteur consciencieux et honnête appelé
à juger un hérétique, à le condamner à mort, à frapper un Chrétien, pour avoir omis
d'observer quelque précepte extérieur ou n'avoir pas cru à quelque événement historique ; de
même, le respect du dimanche (lié à des faits historiques) ne peut pas être un article de foi.
À tout ce que l'homme peut faire par le jeu de sa propre, la grâce ajoute un secours
surnaturel. Les lois de cette faveur nous sont inconnues, aucune expérience ne peut nous
renseigner sur un principe transcendant. L'idée de la grâce, considérée avec soin, est donc
terriblement audacieuse (Gewagt). On ne peut pas la réfuter, justement parce qu'elle est
transcendante. On peut dire seulement : il pourrait y avoir un secours surnaturel. Nous ne
pouvons aller plus loin, le seul service divin légitime est celui du cœur.
Mais Kant tient pour fétichisme – et met dans le même sac – tous les procédés recommandés
pour forcer la grâce, tel l'usage de la prière et du baptême dans ce but, les pèlerinages, les
formules de prières récitées d'après un livre ou inscrites sur des drapeaux comme au Tibet :
autant d'idolâtries semblables à celles des sauvages fétichistes.
Kant n'ose cependant pas condamner tout à fait ces pratiques. Elles ont, en effet, une valeur
symbolique et l'intention peut les purifier : la prière figure l'intention morale, le baptême
symbolise la rédemption des chrétiens dans la communauté des fidèles, l’Église figure cette
communauté et son caractère universel, la Communion veut en assurer le maintien.
6. Conclusion
Le Kantisme religieux est un édifice puissant à certains égards, mais qui revient en fait à
remplacer la religion par un ensemble d'abstractions. Il ne laisse subsister qu'un sentiment,
dans toute la gamme de ceux que les religions avaient utilisés : le respect pour un ordre
universel ; il ampute les religions de tout ce qui leur donnait substance et poésie. La théorie
coupe la religion de toutes ses racines ; elle supprime l'union profonde avec la nature et avec
la vie propre au Catholicisme et que Luther, et même parfois Calvin, avaient laissée
subsister.
Une religion ramenée aux simples exigences de la science, serait la science elle-même, si la
science pouvait nous renseigner sur autre chose que des faits observables ; mais si le
sentiment doit y trouver sa place, la religion rationnelle ne sera qu'une parodie de la religion
historique.
Kant transpose en réalité à la fois le Piétisme et la philosophie du XVIIIe siècle ; sa religion
évoque finalement celle de Robespierre et celle de Larevellière-Lepeaux. Plus tard Comte
énoncera sous une forme plus schématique, qui les ridiculise quelque peu, des idées
analogues venues peut-être indirectement du Kantisme.
L'évolution religieuse de Kant ne s'est pas arrêtée là : l'Opus postumum reprend le même
problème sous toutes ses faces et l'on voit, jusqu'à la veille de sa mort, Kant hésiter entre le
Dieu transcendant et personnel de la tradition et la religion naturelle déjà esquissée chez
Rousseau, et que les révolutionnaires français avaient tenté de réaliser.
Philosophie de l'Histoire, du Droit et de la Politique
I. Histoire et Finalité
Le cours de Kant sur l'Encyclopédie critique (1767-1787) impliquait naturellement une
philosophie de l'Histoire. Mais lorsque Kant a commencé, vers 1775, à méditer
particulièrement sur le développement de l'humanité dans le temps, il n'obéissait pas
seulement à la logique intérieure de sa pensée. Il rejoignait un grand mouvement d'idées,
issu des conceptions stoïciennes rajeunies par saint Augustin et Lactance, reprises par
Bossuet et adaptées au cadré chrétien par ces trois penseurs. Avec beaucoup d'autres par la
suite, Vico (1666-1740) et deux contemporains plus jeunes de Kant, Herder (1741-1803) et
Volney (1757-1820), ont renouvelé ce thème de pensée traditionnel. D'ailleurs dans la
Critique de la Raison pure elle-même (Théorie transcendantale de la Méthode), Kant avait
déjà annoncé une Histoire de la Raison.
Kant aborde le problème d'une philosophie de l'Histoire d'une façon encore tout extérieure
et très technique, dans trois opuscules concernant les races humaines.
1. L'Anthropologie physique et la Finalité
A) Sa première étude Sur les différentes races humaines (1775 et 1777) cherche à classer les
divers types humains en quatre races et à déterminer les causes qui sont à l'origine de ces
différences. Kant conteste la conception scolastique de la classification et de la division,
mais garde les termes usuels de classement, qu'il prend soin de bien définir. Il s'appuie sur
les descriptions des voyageurs et de nombreux exemples, qu'il cite ici, reparaîtront dans des
ouvrages postérieurs et notamment dans la seconde partie de la Critique du Jugement sur la
finalité. Les causes de l'origine des races que Kant propose sont évidemment très
conjecturales, mais sa conception de la finalité dans la philosophie de la nature se trouve
déjà esquissée. À Maupertuis qui veut faire une sélection de la race humaine pour obtenir
une lignée intelligente, habile et vertueuse, Kant oppose la prévoyance de la nature, car le
mélange du bien et du mal constitue la source d'énergie des forces créatrices de l'humanité
qui tendent à la perfection ; d'ailleurs la nature finit toujours par produire une lignée durable,
sa sollicitude a doté ses créations de dispositions internes cachées et adaptables aux
circonstances. La prédétermination, en puissance, de la force génératrice, conditionne donc
l'adaptation. Kant termine en soulignant une distinction qui conduit tout son exposé et qu'il
reprendra par la suite : il oppose, en effet, la Description de la nature, qui a pour objet l'état
de la nature à notre époque et qui n'indique pas la raison d'être des dérivations à partir de
la souche originelle (parce que cette description est une classification extérieure) – et
l'Histoire de la nature, science séparée, susceptible de progresser peu à peu du stade des
opinions à celui des connaissances (parce qu'elle recherche les causes et les filiations). Kant
adopte une philosophie de l'Histoire de la Nature, parce qu'il adopte le point de vue
génétique en histoire naturelle.
B) Sa Définition du concept de race humaine (1785) reprend la même question en précisant
les caractères héréditaires essentiels qui permettent de distinguer infailliblement une race.
Pour définir ses quatre races, Kant retient essentiellement la couleur de la peau. Par là il est
amené à traiter la question du métissage. Il pose d'abord les rapports de la théorie et de
l'expérience : il est très important, avant d'interroger l'expérience à son sujet, d'avoir au
préalable défini le concept que l'on veut éclaircir par des observations, car l'expérience ne
peut nous procurer ce dont nous avons besoin que si nous savons par avance ce que nous
devons y chercher. En opposant genre nominal et genre réel, Kant veut, comme
précédemment, passer d'une classification externe à une genèse des races ; cette genèse
déterminerait la véritable succession des hommes et surtout la nature de la souche humaine
primitive. Mais la science en est encore aux conjectures. D'après ses théories
physiologiques, seule l'originalité de la race noire prouve clairement la finalité de la nature
humaine. Or, la part de finalité dans une organisation est le fondement universel d'où nous
concluons à l'existence des moyens placés dès l'origine dans la nature d'une créature, en
vue de la réalisation de ce dessein. Kant légitime ainsi une sorte de va-et-vient entre théorie
et expérience.
C) Un troisième opuscule, Sur l'emploi des principes téléologiques dans la philosophie
(1788) répond aux objections que le naturaliste Forster avait portées contre l'argumentation
précédente. Au passage, Kant rappelle les prescriptions de la Critique de la Connaissance
selon la Critique de la Raison pure et précise la place de la Finalité dans les sciences
naturelles, ce qui annonce la Critique du Jugement.
Kant montre la nécessité d'un principe de recherche pour guider l'observation et constituer
non une simple description (physiographie), mais une histoire de la nature (physiogonie).
Par le seul tâtonnement empirique et sans un principe directeur qui oriente la recherche,
aucune finalité n'aurait jamais été découverte. Si une physiographie apparaît dans tout l'éclat
d'un grand système, une physiogonie se contente d'être d'abord une esquisse constituante,
même si l'origine humaine reste hors de l'atteinte de la Raison. Cette distinction repose sur
l'essence des choses, de même que les concepts de race ou de variété.
Après avoir défini par rapport aux cadres traditionnels ces deux concepts, Kant rejette la
distinction de deux souches à l'origine – celle des Noirs et celle de tous les autres hommes.
Il admet en effet un développement de dispositions primitives innées, existantes en vue
d'une fin à l'intérieur de la souche primitive. La raison conjugue en effet facilement la
grande diversité dans les générations et leur succession, avec une unité de la source
primitive. Les races qui en sont issues résultent de la répartition non pas sporadique – c'est-
à-dire dispersée également sur toute la terre soumise à un même type de climat, mais
cycladique – c'est-à-dire en groupes cohérents et par régions habitables. Contre Forster, qui
pense que le climat, du Pôle à l’Équateur, a différencié les hommes en Blancs (blonds et
bruns) et en Noirs, Kant soutient que le climat a seulement permis le développement de
caractères indistincts à l'origine : le développement de caractères potentiels s'est fait en
fonction de l'habitat et l'habitat n'a pas été recherché en fonction des dispositions humaines
particulières. Ainsi la cause de la différence qui fonde la classification repose dans les races
mêmes et non simplement dans le climat. Kant bâtit son argumentation sur la grande fixité
des types malgré les migrations (exemple des Tziganes). La nature ne crée pas non plus en
toute liberté des variétés, dont le nombre est sans doute limité : elle se borne à développer,
selon des fins, la diversité déjà inscrite dans les germes primitifs de la souche humaine.
Cette diversité des caractères suscités par les croisements est donc une fin de la nature.
Dans cet opuscule, Kant insiste très longuement sur la méthode d'explication, sur les
principes téléologiques et les limites de la métaphysique, car Forster tend à écrire pour les
hypermétaphysiciens. Or, dans une science de la nature, tout doit être expliqué
naturellement ; on en fixe, par là, les limites. Le concept d'être organisé implique un être
matériel, possible seulement par des rapports réciproques de tous ses éléments en fins et
moyens dans un système de causes finales ; c'est un droit et un besoin de partir d'un principe
téléologique là où les sources théoriques données avec l'expérience nous abandonnent ; cette
légitimation exclut les fantaisies de la raison ; mais les fins sont soit des fins de la nature,
soit des fins de la liberté, ce qui conduit à une double téléologie. La téléologie de la nature
permet de connaître a priori qu'il y a une liaison nécessaire entre causes et effets ; l'usage du
principe téléologique de la nature est donc toujours empiriquement conditionné. Ainsi la
vraie métaphysique connaît-elle les limites de la Raison humaine : elle ne peut et ne doit
absolument pas concevoir a priori des formes fondamentales ; elle ne peut que réduire au
plus petit nombre celles que lui enseigne l'expérience. Il en irait de même pour les fins de la
liberté, si les objets du vouloir devaient être préalablement donnés à cette liberté par la
nature, sous forme de besoins et d'inclinations, comme principe de détermination ; mais les
fins de la liberté sont déterminés a priori par les principes de la raison pure pratique. Ainsi
la vocation métaphysique de la raison pure théorico-spéculative est-elle une théologie pure.
2. L'Anthropologie génétique et la Finalité
Deux autres opuscules moins techniques concernent également une philosophie de
l'Histoire, mais orientée surtout vers les origines de l'humanité.
A) A l'occasion de la publication du livre de Herder – ancien auditeur de Kant – Idées pour
une philosophie de l'Histoire de l'Humanité, Kant rédige, en janvier et novembre 1785, un
Compte rendu pour chacune des deux parties ; analyse bienveillante mais accompagnée de
quelques réserves.
Pour Herder, la philosophie de l'Histoire n'est pas une détermination rigoureusement logique
de concepts, ni une justification de principes, mais un large regard perspectif jeté sur
l'Histoire, une sagacité habile à déceler les analogies. Il commence par situer la place de
l'homme dans l'univers et sur la terre habitable ; il évoque les révolutions terrestres qui ont
précédé l'apparition de l'homme. Il compare les organismes végétaux et animaux : la
poussée vitale et la force organique, la croissance et l'instinct les caractérisent. Mais plus
une nature est organisée, plus sa structure est une synthèse des échelons inférieurs ; aussi
l'homme est-il un compendium de l'Univers, par son organisation la plus fine.
Cependant un caractère fondamental distingue l'Homme du reste des vivants : la station
verticale, qui n'est pas fonction de son accession à la raison, mais sa conséquence naturelle :
dès qu'on domine le sol et les herbes, la prédominance ne revient plus à l'odorat, mais à la
vue. De la station droite résulte l'apparition du langage, de la liberté et de la pudeur.
L'Homme a acquis et conquis sa position et par là la vérité, la justice, la bienséance. En
montrant que la pensée est d'une autre nature que ce qu'apportent les sens, d'une nature
spirituelle, et que l'esprit se développe par la culture des idées, Herder veut suggérer que
l'organisation humaine prend naissance dans un monde de forces spirituelles. L'Homme est
le moyen terme entre deux mondes, celui de l'organique et celui du spirituel. Pas à pas la
nature rejette la gangue et commence à dresser l'édifice du spirituel ; notre humanité n'est
encore qu'un bouton d'où sortira une fleur... Cette conception sera largement reprise au
XIXe siècle, par exemple chez Reynaud, Leroux, Hugo.
Kant critique cette perspective d'une montée des formes organiques, ce règne invisible des
forces animant la matière, et agissant sur les organes pour les différencier ; surtout la station
verticale comme cause de l'aptitude rationnelle – enfin le développement de l'homme après
la mort, par analogie avec les métamorphoses des insectes. Tout cela est étranger à la théorie
naturelle de l'observation, dépasse la raison humaine et explique ce que l'on ne comprend
pas par ce que l'on comprend moins encore : rechercher dans le champ fertile de la poésie,
c'est faire de la métaphysique très dogmatique. Si la mystérieuse obscurité de la nature est
responsable pour une part de l'incertitude de l'Histoire naturelle, nulle analogie ne peut
pourtant combler le vide entre accidentel et nécessaire. L'usage rationnel de l'expérience
connaît des limites ; elle peut nous enseigner la constitution des choses, mais ne peut jamais
nous en dire la nécessité, c'est-à-dire l'impossibilité d'une autre constitution.
La première partie de l'ouvrage n'était qu'une étude préparatoire à l'Anthropologie qui suivit.
La deuxième partie contient en effet beaucoup de descriptions de populations. Mais l'espèce
humaine, malgré ses diverses formes, constitue une unité ; dans une anthropologie, la
méthode consiste soit à admettre des différences naturelles, soit à juger tout en fonction du
principe « tout comme chez nous », c'est-à-dire accuser les différences, ou souligner les
ressemblances. Les climats et les terres sont des causes indirectes de diversité : Herder
admet que la force génétique est un principe vital capable de modifier l'homme, de
l'intérieur, selon les conditions extérieures ; il rejette un système évolutionniste, résultat
d'influences purement mécaniques.
Herder traite aussi de l'origine de la civilisation et de la formation de l'homme conçu comme
créature raisonnable et morale ; les sens, l'imagination, l'entendement, la conception du
bonheur relèvent en grande partie de l'éducation et de l'imitation ; les institutions, le
langage, l'habitat, les gouvernements et les religions découlent de la tradition, ce qui
explique la lenteur des transformations. L'homme est formé au milieu où il vit. C'est
pourquoi, à toutes les époques, les hommes conçoivent un bonheur adapté aux conceptions
et aux conditions de leur groupe social.
Le dessein véritable de la Providence ne semble pas être l'image de félicité que l'homme se
crée à lui-même, mais plutôt l'activité et la culture dans leurs progrès incessants et dont le
point culminant est une constitution politique parfaite. L'espèce seule peut l'atteindre
pleinement dans son développement infini ; aucun membre pris isolément n'atteint sa
destination absolue.
Cette lignée se rapproche continuellement du tracé de sa destination, qui court à ses côtés
en asymptote. Cette idée d'accomplissement total est une idée pure mais utiles, c'est le
dessin de la nature auquel nous devons donner nos efforts.
En s'intéressant à l'ouvrage de Herder, qui rejoignait ses propres conceptions de la
philosophie de l'Histoire, Kant montrait que, malgré les audaces, il présentait l’œuvre d'un
esprit qui devait avoir une influence considérable sur son époque par sa synthèse de toute la
philosophie du progrès du XVIIIe siècle.
B) Dans ses Conjectures sur les débuts de l'Histoire humaine (1786), Kant s'inspire des
Discours sur les sciences et les arts, et Sur l'origine de l'Inégalité, de Rousseau. Pour
combler les lacunes historiques sur les origines de l'Humanité, Kant pense établir des
conjectures qui se fondent sur l'expérience actuelle de l'Histoire, la finalité de la nature et les
dispositions fondamentales de l'Homme. Cet exercice concédé à l'imagination accompagnée
de la raison diffère de l'Histoire documentaire accréditée, mais n'est pas un roman tiré de la
fantaisie, puisque le chemin où s'engage la philosophie en suivant des concepts, s'accorde
avec celui que l'Histoire indique. Kant garde un fil conducteur de la raison à l'expérience, et
se réfère sans cesse à la Genèse, dont il fait une reconstruction philosophique à la lumière de
la raison. Il la conçoit comme l'histoire du passage de la tutelle de la nature à l'état de
liberté.
Kant suppose à l'origine un couple humain à son développement complet ; il est dans une
sorte de jardin fertile et tempéré, à l'abri des animaux de proie. L'homme sait se tenir debout
et marcher, il sait aussi parler, et donc penser ; il a des aptitudes techniques et intellectuelles
mais il est encore gouverné par l'instinct, c'est-à-dire – pour Kant – par la voix de Dieu ;
c'est un pouvoir d'apprécier immédiatement l'utilité et la nocivité. L'instinct de nutrition vise
à la conservation individuelle et l'instinct de reproduction à la conservation de l'espèce.
Au cours d'une première période apparaît le développement de la raison. Elle va pouvoir,
avec l'appui de l'imagination et de la mémoire, déceler les ressemblances entre impressions
antérieures et sensations données, créer artificiellement des désirs et des projets. Ainsi vont
naître la sensualité et le besoin. Le moment décisif est la découverte du pouvoir de la raison,
qui peut contester la voix de la nature et franchir les bornes de l'instinct. Mais ce
dépassement entraîne l'angoisse, l'inquiétude du savoir et de la liberté. La première
tentative d'un libre choix de sa conduite alimentaire ouvrit les yeux de l'homme. La seconde
tentative porta sur l'instinct sexuel : au lieu d'une impulsion passagère animale, l'homme vit
que son inclination était plus forte et plus durable en retirant son objet aux sens et en le
confiant à l'imagination ; puis s'ajouta le refus, qui conduisit l'homme du désir à l'amour, de
la sensation agréable au goût du beau et à la décence, source de la sociabilité. Le troisième
pas fut l'attente réfléchie de l'avenir – signe distinctif de la supériorité de l'homme. Certes, la
pensée de l'avenir est souci, incertitude, vision de la mort, mais aussi postérité heureuse et
consolation de la famille. Le quatrième progrès de la raison fut de comprendre l'homme
comme fin de la nature. Ce privilège de droit sur les autres animaux tenus pour moyens,
devait entraîner aussi le traitement de tous les hommes selon la raison et la fin, c'est-à-dire
l'égalité des êtres raisonnables. La raison technique se distingua de la raison morale.
Affranchi de la nature, l'homme se trouva chassé d'un paradis d'insouciance et d'innocence,
mais quitta une conduite animale instinctive pour une humanité consciente. La raison
poussait l'homme, désormais, vers les difficultés et le perfectionnement de ses aptitudes.
La période suivante est celle où l'homme passe de l'époque du confort et de la paix à celle
du travail et de la discorde ; la contradiction surgit entre l'état de nature et l'état de
civilisation. L'espèce humaine se propage sur la terre ; après la cueillette et la chasse,
l'homme s'adonne à l'élevage et à l'agriculture. Les groupements entraînent les échanges et
les guerres ; les batailles ont lieu surtout entre les nomades qui ont Dieu pour maître et les
sédentaires régis par des magistrats. Dans les communautés apparaissent les constitutions
civiles et la culture. La sociabilité développe la sécurité et la justice publique : la punition
n'appartient plus aux particuliers mais à l'autorité légale. Cependant l'apparition de
l'inégalité souligne les dangers des villes et de la propriété : la servitude, la misère des
pasteurs, les vices moraux et sociaux. La guerre surtout, et ses préparatifs coûteux, nuit à la
civilisation ; elle est pourtant indispensable au perfectionnement de l'homme pour éviter la
corruption et l'incurie. Cette période, très longue, n'est, elle aussi, qu'une étape.
La contradiction et la guerre ne sont en effet que le prélude nécessaire à l'union des hommes
dans le cadre de la société civile, car si la sociabilité est la fin essentielle de la destinée
humaine, une constitution civile parfaite doit être le couronnement et la réconciliation de la
nature et de la liberté : l'art sera redevenu nature.
Avant l'éveil de la raison, les interdits étaient absents, l'innocence était ignorance. Mais les
premiers pas donnèrent bientôt un sens au mal et au vice, par la culture et le raffinement de
la raison. Ainsi l'Histoire de la Nature commence par le Bien car elle est l’œuvre de Dieu ;
l'Histoire de la Liberté commence par le Mal, car elle est l’œuvre de l'Homme ; à la
suffisance d'état, succèdent une foule de maux et les peines d'usage. Tel est le sens de la
chute pour l'individu, qui est responsable de ses fautes et de ses maux par un mauvais usage
de la raison. L'homme n'est pas fondé à rejeter sur un péché originel héréditaire une
inclination à pécher, car une action accomplie par une volonté radicale n'entraîne aucune
hérédité. Mais en tant que membre du tout de l'espèce, l'homme a raison d'admirer
l'ordonnance des fins : pour la nature, cette chute fut un gain. Par conséquent on ne doit pas
dire que le cours de l'Histoire va du Bien au Mal ; mais, lentement, du pis vers le meilleur.
L'homme ne doit pas être mécontent, ni de la Providence, ni de la brièveté de la vie, ni de la
perte d'un âge d'or, car il n'aurait pas alors conscience de la finalité de la nature et il n'y
contribuerait pas.
Enfin, dans trois autres opuscules, Kant s'occupe plus spécialement de la Philosophie de
l'Histoire et des progrès de l'Humanité vers sa fin, c'est-à-dire vers une constitution
politique, la plus parfaite, que Kant place, à l'exemple de Rousseau, au centre de ses
préoccupations.
3. Philosophie de l'Histoire et Finalité
A) L'essai de Kant sur l'Idée d'une Histoire universelle au point de vue cosmopolitique
(1784), est sans doute celui qui résume le mieux la conception kantienne de la Philosophie
de l'Histoire et annonce sur bien des points celle de Hegel.
La philosophie doit chercher si l'on ne peut pas découvrir, dans le cours absurde des choses
humaines, un dessein de la Nature. Or le cours des actions humaines n'est pas moins
déterminé que tout événement naturel ; malgré l'obscurité où peuvent être plongées leurs
causes et malgré l'énorme influence de la volonté libre des hommes. Kant a découvert que la
conduite humaine suit des lois statistiques constantes et que les fins de la nature se dessinent
sous les fluctuations variées des actions individuelles : ce qui, dans les sujets individuels,
nous frappe par sa forme irrégulière et l’absence de tout dessein personnel raisonnable,
pourra être cependant connu dans l'ensemble de l'espèce sous l'aspect d'un développement
continu.
Kant admet la finalité des dispositions naturelles des êtres. Pourtant ce n'est pas dans
l'individu que l'usage naturel de la raison reçoit son développement complet, mais dans
l'espèce. De même toute perfection dans l'histoire humaine demeure relative avant sa fin.
Par principe d'économie, la nature a voulu laisser à l'homme le soin d'inventer ses moyens
pour triompher des difficultés ; elle a obligé l'homme à s'élever, par ses propres efforts, vers
la perfection. La nature semble avoir préféré chez l'homme l'estime raisonnable de soi au
bien-être.
Le moyen dont la nature se sert pour mener à bien ses fins est l'antagonisme des hommes au
sein de la société ; en effet, deux inclinations opposées résident en l'homme : une tendance à
s'attirer ou s'associer et une tendance à se détacher ou à se repousser. Dans la concorde,
l'homme n'aurait pas l'occasion de sortir de son inertie satisfaite, et toutes les excellentes
dispositions naturelles de l'humanité resteraient étouffées dans un éternel sommeil.
L'homme veut la concorde et la nature lui impose la discorde : l'envie, la vanité, l'appétit
aiguisent ses forces et l'enserrent. Cependant les diverses inclinations s'équilibrent dans
l'ensemble de cette communauté et l'ordre social le plus discipliné peut être le fruit de
l'insociabilité. De la même façon, les nouvelles relations ou la régularisation des relations
entre États sont souvent la conséquence des guerres. En présence des ébranlements
économiques causés par les hostilités, les neutres s'offrent nécessairement à maintenir les
échanges commerciaux ; ainsi subsiste le sentiment d'une activité économique globale de
l'humanité.
En dépit des discordes apparentes, le cours de l'Histoire suit donc un plan régulateur. Si la
réalisation de la constitution civile universelle la plus parfaite est la destination de l'espèce
humaine, elle nécessite une justice publique, tant intérieure qu'extérieure ; chacun en effet,
individu ou État, tend dans son désir égoïste d'expansion à abuser de la liberté s'il ne
reconnaît pas l'universalité et la nécessité de la loi. Par conséquent, l'organisation
absolument équitable de cette société, implique d'une part la présence de la plus grande
liberté alliée à la plus grande garantie des limites de cette liberté ; d'autre part,
l'établissement de conventions et de législations régulières entre États et finalement une
Société des Nations (Foedus Amphyctionum).
La constitution d'un État cosmopolitique universel n'est pas une rêverie de visionnaire. La
philanthropie, la bienfaisance et la liberté qui se sont répandues à l'époque des Lumières
ébauchent déjà l'organisation future. Et si l'on admet une téléologie de l'Histoire, il faut en
favoriser l'avènement ; le cours de l'Histoire sera alors adapté à des buts raisonnables.
Chaque État devra faire naître chez les citoyens, une volonté du Bien décidée à promouvoir
et accepter cette Constitution. Le problème pratique lui-même tient à la définition exacte des
concepts de cette nouvelle législation, qui demandera une grande expérience historique et
juridique.
B) L'opuscule de Kant « Qu'est-ce que les Lumières ? » est un article critique sur l'état
politique du XVIIIe siècle et le despotisme éclairé de Frédéric II ; Kant y définit le sens et la
portée de l'Aufklärung. Il précise également la conception kantienne de la revendication
libérale à l'égard des autorités.
Qu'est-ce que les Lumières ? – Le fait pour l'homme de sortir de la minorité dont il est lui-
même responsable, une prise de conscience, un besoin de penser par soi-même et pour soi-
même, besoin étouffé par la lâcheté et la paresse. Kant entend par minorité l'incapacité de se
servir de son entendement sans la direction des tuteurs : un livre vous tient lieu de pensée,
un médecin de régime, un confesseur de conscience ; les formules fixes sont les instruments
mécaniques d'un usage mineur de la raison. Ainsi la minorité est devenue pour l'homme une
nature. La plupart des hommes tiennent pour dangereux le pas vers la majorité ; les tuteurs
les renforcent dans cette opinion.
Or, une limitation de la liberté et de la raison est contraire aux Lumières, lorsqu'il s'agit de
leur usage public. Il faut en effet distinguer entre usage public et usage civil de la liberté.
L'usage public de notre raison est celui qu'en fait un savant devant un public éclairé ; cet
usage doit être toujours libre et lui seul peut propager les Lumières. L'usage civil (que Kant
appelle aussi privé) est l'usage de la raison que l'on fait dans une fonction civile déterminée
qui vous est confiée ; cet usage y est très limité car, dans un poste civil, il ne s'agit pas de
raisonner mais d'obéir. L'officier n'a pas à discuter l'ordre, le citoyen à refuser l'impôt, le
prêtre à contester les doctrines de l’Église ; mais en s'adressant à l'opinion publique, tous
peuvent faire des remarques sur les erreurs de l'organisme auquel ils appartiennent. Ce
problème de la minorité intéresse au plus haut point le pouvoir politique et la doctrine
religieuse. Si la vocation de tout homme et la condition d'un public éclairé est de penser par
soi-même, un homme ne peut renoncer à l'acquisition d'un savoir nécessaire et encore moins
mettre en tutelle une collectivité ; ce serait compromettre l'avenir, violer le droit de
l'humanité, commettre un crime contre la destination de la nature humaine.
Ce siècle est-il un siècle éclairé ? Non pas, mais un siècle en marche vers les lumières. Il
s'en faut encore que l'ensemble des hommes sachent utiliser avec maîtrise et profit leur
entendement. Mais l'homme a des indices qui lui donnent la certitude de sortir de sa
minorité. L'essentiel est de reconnaître, du point de vue politique, l'usage public de la
raison, permettant d'exposer une conception meilleure de la législation. Cette disposition de
la pensée libre agit sur le gouvernement, qui apprend à traiter l'homme avec dignité – et sur
le peuple, qui apprend à agir par une discipline librement consentie. Mais prenons garde
que toute réforme n'est jamais radicale, qu'elle amène de nouveaux préjugés et reste
provisoire.
C) Le genre humain est-il en progrès constant ? – Dans un ouvrage bien plus tardif, le
Conflit des Facultés (1798), Kant a recueilli trois dissertations, écrites à des époques et avec
des intentions différentes ; la seconde section : Conflit de la Faculté de Philosophie avec la
Faculté de Droit pose la question du progrès humain.
Si l'on veut caractériser l'avenir sous l'angle de cette question, trois positions sont possibles :
admettre une régression (que Kant appelle conception terroriste), ou une stagnation
(conception abdéritaine), qui équivaut soit au repos, soit à une oscillation constante, ou
enfin une progression (conception eudémoniste). Or une prédiction a priori de l'avenir ne
semble possible que pour qui annonce et organise à la fois les événements ; Kant prend pour
exemple les politiciens. On ne peut déterminer a priori l'avenir suivant l'une de ces
conceptions, puisque l'homme agit par volonté ; son devoir peut être connu a priori, mais
seule la Providence sait ce qu'il fera. Kant remarque cependant que si l'on découvre une
cause générale donnée dans l'Histoire, on peut prédire les événements, probables ou
possibles. Il faut donc chercher dans l'Histoire un événement montrant que l'homme, en tant
qu'être libre, est la cause certaine de son progrès. Ce signe historique donnera également son
sens au passé et orientera tout l'Histoire humaine vers sa destination.
Kant aperçoit ce signe dans la Révolution française : il remarque dans les spectateurs
étrangers à ce mouvement une manière de penser qui manifeste un caractère universel,
désintéressé et moral. Malgré toutes les misères et les atrocités qu'elle a provoquées, la
Révolution a trouvé dans les autres pays une sympathie d'aspirations qui frise
l'enthousiasme et qui ne peut avoir d'autre cause qu'une disposition morale du genre
humain. Kant, peu suspect de complaisance pour l'émotion et les sentiments moraux,
reconnaît ici que le véritable enthousiasme ne se rapporte qu'à l'idéal moral, ou concept pur
du droit du peuple ; il est participation passionnée au Bien, cause du zèle et de la grandeur
de certains révolutionnaires.
Cette cause moral revêt un double aspect : la Révolution a révélé d'abord le droit d'un
peuple à se donner librement une constitution politique ; ensuite, le droit de choisir une
constitution républicaine, opposée à toute guerre offensive assurant, au moins négativement,
le progrès humain (pour Kant, en effet, la guerre est une cristallisation du Mal, le plus grand
obstacle à la moralité puisqu'elle résulte d'un simple rapport des forces aux mains des
souverains). Cette forme républicaine de constitution peut d'ailleurs être soit directe, soit
sous la conduite d'un monarque : les monarques ont le devoir de traiter le peuple suivant des
principes conformes aux lois de la liberté. La manifestation morale et juridique de la
Révolution est une évolution vers une constitution de droit naturel, où la nature et la liberté
se trouveront réunies. Ceux qui obéissent à la loi doivent aussi légiférer lorsqu'ils sont
réunis en corps. Cet organisme né selon de purs concepts est un idéal platonicien (Res
publica noumenon), la norme éternelle de toute constitution politique universelle. Une
société cosmopolitique conforme à cet idéal, suivant les lois de la liberté, de la moralité et
de la légalité, en sera la représentation (Res publica phenomenon).
Cet événement révolutionnaire est trop important et trop moral pour n'avoir pas
nécessairement un retentissement futur. Peu à peu ce type de constitution prendra
solidement corps, par suite d'expériences répétées. Kant peut alors prédire que le genre
humain tout entier s'ouvrira à cette perspective, qu'il a été en progrès constant et continuera
de l'être. Traiter l'homme comme un instrument sera désormais considéré comme le
renversement du but final de l'humanité.
Kant préconise divers moyens pour hâter le progrès de l'homme vers cette fin : rendre la
guerre de plus en plus humaine et faire effort pour l'abolir ; réformer et rendre perfectibles
l’État et la constitution, pour qu'ils évoluent dans le sens du progrès moral ; former la
jeunesse par la culture intellectuelle et morale, pour éduquer de bons citoyens (Kant réclame
des maîtres) ; enfin éclairer le peuple, lui enseigner publiquement ses devoirs et ses droits
vis-à-vis de l’État et, à cet effet, assurer la liberté de publication : les commentateurs du
droit naturel ne seront pas les professeurs de droit officiels, mais les philosophes connus
sous le nom de propagateurs des lumières, qui prient respectueusement l’État de prendre en
considération cette orientation nouvelle du droit. Tel est le sens de cette dissertation en
faveur de l'enseignement libéral ; on sait que Kant avait eu naguère des démêlés avec la
censure.
D'une façon générale, tous ces opuscules montrent les préoccupations finalistes de Kant
avant la publication de la Critique du Jugement, et plus particulièrement la finalité de
l'histoire humaine, dont la destination politique unira la moralité et la légalité, la nature et la
liberté.
II. Morale et Politique
Kant a plus de sympathie pour les idées de Herder que pour celles de deux autres de ses
contemporains, Schulz et Hufeland.
Le sceptique Johannes Schulz avait publié en 1783 l'Essai d'introduction à une doctrine des
mœurs pour tous les hommes sans distinction de religion. Dans son Compte rendu (1783),
Kant montre que selon Schulz, un fatalisme universel gouverne l'Histoire. Schulz n'admet
pas de différences de genre, mais seulement de degré : il n'y a pour lui ni vérité ni fausseté
absolues, ni liberté ni détermination fatales, ni même de différence essentielle entre vice et
vertu. En supprimant la notion fondamentale d'obligation, il détruit l'idée même de moralité.
Or Kant souligne la distinction radicale entre lois de la nature et lois de la moralité.
Kant retrouve des tendances voisines dans l'Essai sur le fondement du Droit naturel (1786)
de Hufeland. Le Compte rendu de Kant souligne que pour l'auteur, l'idée d'obligation
(Verbindlichkeit) est superflue dans le droit naturel. Car ici la question est de savoir à
quelles conditions on pourrait exercer une contrainte sans aller contre les fondements
universels du droit. On s'interdit alors d'établir une morale et un droit.
Plus tard, Kant a été amené au problème central de la théorie et de la pratique, qu'il a
examiné dans un opuscule de 1793 : A propos du lieu commun : c'est peut-être vrai en
théorie, mais ne vaut rien en pratique. Kant refuse d'opposer la pratique à la théorie, car il
existe un intermédiaire nécessaire entre elles : la faculté du juger. Connaissant la règle, le
praticien juge si la question posée tombe sous cette règle. Mais souvent, pour juger, il lui
faut compléter la règle et parfois aussi elle lui paraît inutile. La valeur de cet adage est
différente pour l'homme privé, pour l'homme public et pour le citoyen du monde ou
l'homme cosmopolite (Weltbürger, Weltman). C'est pourquoi l'opuscule comprend trois
parties : Rapport de la théorie à la pratique en Morale (à propos de Garve) ; en Politique
(contre Hobbes) ; en Droit international (contre Mendelssohn).
Le premier thème est abordé par Kant à l'occasion des Essais de Garve sur divers sujets de
morale et de littérature, publiés à partir de 1792. le lien entre théorie et pratique est d'autant
plus lâche que la part de liberté de l'individu va s'amenuisant sous la pression sociale. Kant
pense que la philosophie morale n'ignore pas le désir du bonheur qui réside dans l'âme
humaine ; mais elle en fait abstraction pour se concentrer sur l'idée du devoir. Le devoir ne
se justifie pas par son but ; il mène à un but qui sera justifié par le devoir ; le motif unique
de nos actes sera la loi, idée plus nette et plus simple que tout ce que l'on peut romancer sur
le bonheur.
Contre Hobbes, Kant soutient que dans la société chaque individu est libre en tant
qu'homme ; personne ne peut le forcer d'être heureux d'une certaine façon. En ce sens, le
Paternalisme (vaterlische Regierung) – l'illusion du prince, père de ses sujets et responsable
de leur bonheur – supprime les droits personnels de l'individu et devient le plus grand des
despotismes. Sujets sous la même loi, tous les citoyens sont égaux. Ils sont indépendants du
fait même de leur égalité, et tous tenus pour citoyen (Bürger). Pourtant l'égalité civile ne se
confond pas avec l'égalité mathématique ; chacun doit atteindre l'échelon que ses talents lui
offrent. Tout citoyen est « colégislateur » (Mitgesetzgeber) en droit, mais ne peut participer à
la rédaction et au vote que s'il en est capable. Une catégorie de citoyens bourgeois devra
seule participer à la direction, de laquelle les femmes et les enfants seront naturellement
exclus. Kant critique ainsi Filmer, et s'éloigne de Rousseau, dont il semblait s'inspirer. Si
l'on utilise, pour définir la naissance de l'ordre social, l'idée d'un Contrat primitif, on ne doit
pas oublier que c'est seulement une idée de la Raison, dont l'utilité est pratique, nullement
théorique. Elle équivaut à cette formule : le législateur est obligé moralement de s'acquitter
de sa tâche, comme si cette tâche traduisait la volonté du peuple tout entier. Le contrat est
donc inexistant ou symbolique. Il a cependant des conséquences capitales. Le peuple doit
obéir, quand le législateur a édicté la loi, même si cette loi va contre sa volonté intime.
Pourtant, tout en demeurant soumis, le citoyen doit garder un esprit de liberté (Geist der
Freiheit). Quand l'autorité se fait policière, tracassière, tyrannique, on voit naître une
opposition masquée et des sociétés secrètes ; ces oppositions sont inutiles quand l'autorité
garantit suffisamment la liberté de l'individu.
Considéré d'un point de vue cosmopolitique et philanthropique, le droit des gens est pour le
moment simple théorie, déclare Mendelssohn, qui n'espère aucun progrès pour l'avenir.
Dieu, selon lui, ne s'occupe pas de nous. Chaque progrès est suivi d'une déchéance. Kant
estime au contraire qu'il doit en fait exister un progrès global, parfois interrompu
(unterbrochen), mais qui n'est jamais supprimé entièrement (abgebrochen).
III. Droit et Politique
1. La Métaphysique des mœurs (1797)
C'est un des ouvrages de Kant qui fait la synthèse la plus claire de ses conceptions
juridiques et morales ; il comprend en effet deux parties, une doctrine du Droit
(Rechtslehre) et une doctrine de la Vertu (Tugendlehre) : Principes métaphysiques de la
Doctrine du Droit et Principes métaphysiques de la Doctrine de la Vertu. L'Anthropologie
du point de vue pragmatique (1798) y ajoute divers compléments importants.
Dans sa Doctrine du Droit, Kant utilise largement les travaux des juristes anciens ou
contemporains et on pourrait comparer ses définitions avec celles d'Althusius, de Leibniz,
Puffendorf, Wolff, Rousseau, Baumgarten.
A) Généralités
A sa coutume, Kant rappelle d'abord les résultats auxquels il est parvenu dans la Critique de
la Raison pratique ; le principal est la distinction de lois de la nature, appliquées
automatiquement par l'entendement, et de lois de la liberté, appliquées par des actes
volontaires. Ces lois de la liberté sont de deux sortes : juridiques ou éthiques.
Les lois juridiques concernent seulement la conformité à la loi de nos actions extérieures ;
l'ordre juridique concerne donc des devoirs et des motifs d'agir extérieurs. Au contraire la loi
éthique ou morale exige, outre la conformité à la loi, que cette loi soit seule, par elle-même
et sans intervention extérieure, le motif déterminant de la volonté ; l'ordre moral concerne
les devoirs et les intentions tout intérieurs. On appelle légale une action conforme à la loi
juridique, et morale une action conforme à la loi éthique.
Mais il existe un terrain commun aux deux ordres de lois. Par suite, beaucoup de définitions
sont à la fois juridiques et morales ; par exemple : obligation (Verbindlichkeit), permis
(erlaubt), défendu (verboten), devoir, acte, personne, juste, injuste, etc. Est appelé Personne
un sujet auquel des actions peuvent être imputées (zurechnen), mises à son compte. Mais la
personne morale est soumise seulement aux lois qu'elle se donne à elle-même, à la
différence de la personne juridique, soumise aux lois fixées par le Droit.
La Doctrine du Droit (Rechtslehre) traite de l'ensemble des lois qui peuvent faire partie
d'une législation externe. Elle est doctrine du Droit positif, quand la législation n'est pas
seulement idéale, mais réelle. Le Droit est alors l'ensemble des conditions auxquelles la
volonté d'un individu peut être unie avec celle d'un autre, sous une loi générale de la liberté.
La définition ou la loi générale du Droit est donc : Agis extérieurement de telle façon que le
libre usage de ton vouloir puisse subsister, en même temps que la liberté de chacun, sous
une loi générale.
Une telle loi m'impose une obligation ; mais elle n'exige pas, et même elle n'attend pas de
moi, que je procède moi-même à la limitation, ainsi imposée, de mon vouloir. Par suite, une
contrainte extérieure est indispensable pour faire disparaître l'obstacle mis par une liberté
particulière à l'exercice d'autres libertés. Au Droit même est liée l'autorisation de
contraindre celui qui commet une violation du Droit.
Le droit étroit ou strict fait appel uniquement à des principes externes, et nullement à la loi
morale ou intérieure. L'autorisation d'employer la contrainte n'est valable que dans le droit
strict ; sans droit strict, pas de contrainte valable. Ainsi peut-on réfuter le prétendu réalisme
politique avec sa formule : nécessité n'a pas de loi (Not kennt kein Gebot, necessitas non
habet legen), car aucune nécessité physique ne peut rendre conforme à la loi ce qui est
injuste en soi.
Kant va examiner, selon le plan ordinaire des juristes, le droit privé et le droit public. Le
droit privé comprend le droit de propriété et d'acquisition, le droit personnel, matrimonial,
paternel et domestique. Le droit public comprend le droit de l’État, le droit des gens (guerre
et paix) et le droit cosmopolitique (idée rationnelle d'une société de paix entre tous les
peuples). Mais les seules parties originales de sa théorie concernent le droit public : État
national, pouvoirs publics, droit international.
Le droit public est l'ensemble des lois qui ont besoin d'être publiées pour produire un état de
droit (öffentliches Recht). On le définit donc : un système de lois, formulées pour un peuple
(une foule d'hommes), ou pour plusieurs peuples qui, exerçant les uns sur les autres une
influence réciproque, ont besoin d'un état de Droit, sous une volonté qui les unifier, ou sous
une constitution, en vue de participer à ce qui est de droit.
B) Le Droit de l’État (ou de la Cité)
a) Définitions. – Au-dedans d'un seul peuple, un tel état de droit se nomme civil
(bürgerlich), quand il concerne un individu, un citoyen, dans ses rapports avec ses pareils.
On nomme État (der Staat, Civitas) l'ensemble des citoyens, par rapport à un particulier ; un
État est une réunion d'hommes sous des règles juridiques. Dans ses relations avec les
citoyens, l’État lui-même se nomme République (gemeines Wesen) ; dans ses rapports avec
d'autres États analogues, il s'appelle une Puissance (Macht, Potentia). Ces définitions
viennent de Rousseau.
b) Constitution d'un État. – Tout peuple se constitue en État par un contrat primitif : tous
abandonnent au peuple entier leur liberté, même intérieure, mais pour la reprendre aussitôt
en tant que membre du Peuple, considéré maintenant comme un État. L'individu ne fait donc
pas le sacrifice réel de sa liberté. Ce que chacun cède au corps social, c'est une liberté de
forme sauvage (wild) ou sans lois. Mais il reçoit, en échange, une liberté légale (gesetzlich),
dans un État juridique librement constitué par les volontés concordantes de tous les
citoyens. Ce contrat transfère à l’État des pouvoirs illimités ; l’État devient irrépréhensible
pour tout ce qui concerne le tien et le mien extérieurs. Le pouvoir exécutif suprême de l’État
est irrésistible, sans appel à celui d'un juge supérieur (Kant utilise les mots du Droit
prussien).
c) Séparation des Pouvoirs. – Tout État comporte en lui-même trois pouvoirs (Gewalten),
une trinité politique (Trias politica) : pouvoir souverain (Herrschersgewalt, Suprematus,
Souveraineté) résidant en la personne du Législateur ; pouvoir exécutif (vollziehende
Gewalt), dans la personne du Gouvernant ou Régent (Regierer) ; pouvoir judiciaire ou
juridique (rechtsprechende Gewalt) en la personne du Juge.
La Souveraineté et le Législatif. – Le pouvoir législatif ou souverain ne peut appartenir qu'à
la volonté unie du Peuple entier. C'est de cette volonté que tout tire son origine. Ce pouvoir
ne peut donc pas commettre d'injustice, car si l'on peut commettre une injustice à l'égard
d'autrui, on ne peut pas être injuste à l'égard de soi-même (volenti non fit injuria). Seule la
volonté générale unanime peut être législatrice. Kant, qui s'inspire de Rousseau et adopte la
théorie du Contrat social, ne parle plus du Législateur, homme providentiel qui dirige, ou
plutôt rend consciente d'elle-même, la volonté générale.
L'Exécutif. – On nomme Régent de l’État, Roi, Prince (status Rector, Rex, Princeps), la
personne physique ou morale à laquelle appartient la puissance exécutive. Ce personnage
ne se confond pas avec le Législateur (ou le Peuple) parce qu'il est lui-même soumis à la loi
à laquelle le Législateur et Souverain peut le forcer à obéir. Le peuple souverain peut
destituer le Régent, réformer son administration. Toutefois, il ne peut pas le punir... car ce
serait un acte de la puissance exécutive (Kant pense évidemment au cas de Louis XVI).
Le Judiciaire. – Ni le chef de l’État, ni le Régent ne peuvent juger eux-mêmes ; il doivent
seulement nommer des juges et des magistrats, qui rendront la justice au nom de l’État.
Cependant l'Exécutif a le droit exceptionnel de faire grâce.
d) Rapports du Régent et des sujets. – Ainsi est consacré le principe dominant de toute
République, celui de la Séparation des Pouvoirs. Dès que ce principe n'est plus respecté, la
démagogie, prélude à la dictature, a déjà commencé. Kant n'admet donc pas le prétendu
droit de Révolution cher à Rousseau. Le peuple souverain n'a pas à discuter les origines de
la Souveraineté, car le peuple, ce souverain, devient sujet dès que le Régent est établi. Il n'a
donc pas à ergoter (vernünfteln) sur les sources du pouvoir, comme le rappelle le vieil adage
allemand : alle Obrigkeit von Gott, qui proclame l'origine divine de tout commandement. Le
premier devoir du peuple souverain est le devoir d'obéissance.
Par suite, à l'égard du sujet, l'exécutif n'a que des droits et pas de devoirs. Si le Régent,
organe du peuple souverain, agit contre les lois (par exemple, au sujet des impôts, de la
répartition des charges, du service miliaire), le peuple sujet peut évidemment se plaindre,
exprimer des doléances, mais il ne peut pas résister. Car l’État n'est concevable que dans la
soumission de tous à la volonté générale, une fois exprimée. Kant adopte ici la thèse
luthérienne.
Ni sédition (Aufstand), ni rébellion (Aufruhr) ne sont tolérables. Tout attentat contre la
personne du Régent, même en supposant qu'il a mal usé de son pouvoir, s'est comporté non
en monarque, mais en tyran, est un fait de haute trahison (Hochverrath) : Un traître de cette
sorte, qui cherche à anéantir la patrie, ne peut être frappé d'une peine moindre que la mort.
De même, toute réforme constitutionnelle, même quand elle paraît indispensable, ne peut
être entreprise que par le Régent, non par le peuple. De là diverses conséquences curieuses.
Une Révolution qui réussit, crée un nouvel état juridique et l'illégalité de son origine
n'affranchit pas les sujets de se soumettre au nouvel état de choses, en bons citoyens.
D'autre part, le monarque détrôné, s'il survit, ne peut être ni puni, ni même inquiété pour ses
actes antérieurs à la révolution. Le Souverain ou Régent est propriétaire éminent de toutes
les terres du pays. Son peuple lui appartient également, non sans doute à titre de propriété,
mais parce que le Régent est chef suprême, en vertu d'un droit attaché à sa personne.
e) Les Rapports de l’Église et de l’État. – Kant énumère en détail les droits souverains et
insiste longuement sur la question religieuse. Considérée comme disposition intérieure des
âmes individuelles, la Religion ne tombe pas en principe sous les prises de l'autorité
politique. Cependant l’Église doit être soigneusement distinguée de la Religion intérieure.
C'est une organisation, un étanlissement (Anstalt) destiné à fournir au Peuple le culte public
de Dieu. Mais l'organisation ecclésiastique pourrait facilement entre en conflit avec les
droits du gouvernement. l’État doit donc disposer, à l'égard de l’Église, de droits
particuliers. S'il ne peut pas l'organiser lui-même selon ses vues propres, ni prescrire au
Peuple certaines croyances ou un certain rituel, il a le pouvoir de surveiller les prédicateurs,
de neutraliser leur influence, quand elle devient nuisible à l'ordre public ou à la paix.
f) Unité nationale et Patrie. – La police de l’État doit veiller sur l'unité nationale ; il lui
appartient d'interdire toute propagande, génératrice de divisions.
On appelle Patrie (Vaterland) un territoire occupé par des concitoyens. Son caractère
essentiel est l'unité. Trois limitations seulement au droit de la Nation : le sujet a le droit
d'émigrer, en emportant ses biens mobiliers ; le souverain a le droit de faciliter
l'immigration, l'établissement sur le territoire national d'étrangers ou de colons, même si les
citoyens regardent cet établissement d'un mauvais œil ; il a toujours le droit de bannir ou
d'exiler ses ennemis intérieurs. Kant justifie ainsi les pratiques traditionnelles de la couronne
prussienne.
C) Le Droit international (ou cosmopolitique)
Kant nie l'existence d'un droit international, car l'humanité demeure encore partiellement
sous l'empire du droit naturel, qui est un état de guerre permanent. Considérés dans leurs
relations extérieures, les États vivent encore aujourd'hui en hostilité plus ou moins larvée,
sinon dans un état de guerre caractérisé ; ils ne sont pas plus que les peuples sauvages dans
un état de droit. Il serait évidemment souhaitable de faire naître une Union des peuples
(Völkerbund) afin de protéger tel groupe plus faible contre les attaques de peuples étrangers.
Mais dans l'état de nature, même partiel, la guerre est le seul moyen pour un peuple de faire
valoir ses droits, quand ils semblent menacés. Il y a d'ailleurs, entre la paix et la guerre
déclarée, des situations intermédiaires : menaces, préparatifs et armements entrepris à
l'avance pour prévenir l'ennemi, conquêtes préventives, droit de guerre préventive (Recht
des Zuvorkommens). Pour le moment, un seul palliatif à l'absence d'un droit de la guerre est
concevable : le refus d'utiliser certaines formes de lutte particulièrement atroces, propres à
entretenir des haines durables. C'est l'unique moyen de garder quelque espoir en un statut
raisonnable des rapports futurs entre peuples.
Kant n'est pas toujours dans ses écrits, le rêveur bienveillant que l'on a représenté. S'il
déplore les excès de la violence et de la ruse, il fait, à la conception réaliste de la politique
étrangère, des concessions qui peuvent aller loin. Clausewitz pourra invoquer les principes
kantiens pour libérer provisoirement les chefs militaires de toute contrainte morale. La
doctrine de Kant est parfois pénétrée du pessimisme piétiste et il voudrait limiter le règne du
Mal avant d'en attaquer les causes profondes.
2. Le projet de paix perpétuelle (1795)
Cependant une société plus parfaite, une société pacifiée est probablement possible. Le
projet de paix perpétuelle, avec ses conclusions nuancées d'une ironie amère, se rattache aux
méditations de Kant sur la doctrine du droit.
Les victoires des armées françaises viennent de cause en Allemagne une véritable panique.
Les jeunes philosophes, Fichte et Hegel entre autres, ont reçu un choc dont leur doctrine
porte la trace. Kant a trouvé, dans les événements, le moyen de mieux distinguer l'utopie et
le réel. Il l'a fait dans des termes que la plupart des interprètes, notamment des interprètes
français, semblent avoir méconnus. Nous sommes, en réalité, devant un pastiche ironique
des projets de paix perpétuelle qui se sont multipliés depuis l'abbé de Saint-Pierre et que l'on
retrouve chez Volney ou Sébastien Mercier, comme chez l'abbé Raynal.
Le traité de paix perpétuelle comprend, selon Kant, trois articles définitifs précédés de six
articles préliminaires, qui expriment, aux yeux de l'auteur, des vérités moralement
évidentes : 1. le traité ne doit renfermer aucune matière à guerre future ; 2. jamais des États
indépendants ne pourront faire l'objet de ventes, trocs ou cessions ; 3. plus d'armée
permanentes ; 4. les rapports des États ne seront plus subordonnés à des intérêts
commerciaux extérieurs ; 5. aucun État ne doit se mêler violemment de la constitution ou
des affaires intérieures d'un autre État ; 6. dans la guerre même, on n'emploiera jamais
certaines formes atroces d'hostilités (trahison, espionnage, assassinat). Ces articles
impliquent, chez les gouvernants, une disposition, une intention, venues de la loi morale.
L'oubli des préliminaires rendrait impossible l'application des trois articles définitifs et de
leurs compléments.
Premier article. – La Constitution de tous les États contractants sera républicaine. –
Constitution républicaine signifie : liberté, législation uniforme, égalité. Mais la
République est le contraire de la Démocratie et Kant n'a pas oublié la leçon de Rousseau. Il
n'y a pas, en effet, de République, sans la séparation complète des pouvoirs exécutif et
législatif. Dans la Démocratie, le peuple est à la fois législateur et gouvernant. La
Démocratie, au sens propre du terme, est nécessairement un despotisme (Kant pense au
pouvoir de la Convention ou de la Commune de Paris). On ne peut pas séparer exécutif et
législatif, si l'on ne revient pas aux vues de Frédéric II qui a dit : Je suis le premier serviteur
de la Nation. En ce sens, toute forme de gouvernement qui n'est pas représentative est
proprement monstrueuse (Unform) parce que le législateur y est aussi exécutant en une
seule et même personne. Le Peuple ne peut pas exercer le gouvernement ; il lui faut un
représentant. Mais le seul représentant du Peuple est le Souverain, dans l'espèce le roi de
Prusse. On a joué sur les mots quand on a fait de Kant un champion du régime
parlementaire.
Second article. – Le projet sera fondé sur une fédération d’États libres. – Un traité de paix
perpétuelle implique une fédération d’États libres (Volksbund), unis par un traité de paix
(Friedensbund) ou plutôt une alliance perpétuelle de paix générale, alors qu'un traité de paix
ordinaire (Friedensvertrag) met simplement fin à des opérations militaires. Une convention
de ce genre n'est pas une simple organisation philanthropique : elle fonde un droit et fait
naître une citoyenneté mondiale. Ou trouve quelque chose d'analogie chez Sébastien
Mercier, auteur de « L'An 2440 ».
Troisième article. – Le droit de citoyenneté mondiale est réduit aux conditions d'un devoir
universel d'hospitalité. – Le droit de citoyenneté mondiale n'implique nullement la fin des
nations actuelles. Il suppose seulement la liberté de circulation des personnes et des biens
sur tous les territoires qui font partie du traité, et le droit pour chaque ressortissant étranger
d'être considéré honnêtement et amicalement, comme hôte (Gast), sans recevoir pour autant
les droits politiques intérieurs, réservés aux seuls citoyens nationaux.
Les garanties d'un tel Bund viennent en fait de la Nature elle-même. C'est le plus souvent la
nécessité qui a réparti les peuples sur la terre, les a fait refluer vers les régions fertiles, mais
parfois les a aussi amenés, sous la pression d'envahisseurs, à occuper des terres arides. La
même nécessité les a obligés à entrer en relations les uns avec les autres et ces relations
nécessaires seront purifiées par la nouvelle alliance.
C'est là un cas particulier du conflit général de la Morale et de la Politique. Les deux
attitudes, commandées, l'une par la Morale, l'autre par la Politique, sont opposées. La
Politique exige la prudence du serpent, la Morale réclame la franchise de la colombe. Or la
Morale seule peut fonder l'union entre les peuples. La Morale condamne les préceptes trop
fameux du Machiavélisme : Fac et excusa (fais et justifie), Si fecisti, nega (si tu l'as fait, nie-
le), Divide ut imperes (divise pour régner). Elle veut, dans les relations politiques, la même
loyauté que dans les relations privées. La Paix entre États ne peut subsister que si un état de
droit public s'est préalablement établi, car le droit privé ne suffit pas à régler les rapports
entre nations ; la paix internationale a pour condition la réforme morale des nations elles-
mêmes et d'abord de leur dirigeants de fait. Elle ne peut se réaliser que dans une Union
d’États. Tout autre procédé est casuistique, sophistique, à base de finasserie (Klügelhei).
Mais la paix perpétuelle, qui ne s'établit pas par des artifices de procédure, exige aussi le
renouvellement moral des individus.
L'avenir a malheureusement justifié le raisonnement de Kant et l'insaisissable ironie qui
caractérise son projet.
« Opus Postumum », Remarques sur le Kantisme et sa diffusion
I. Les fragments de l’œuvre posthume
L'Opus postumum de Kant (publié en partie par le pasteur Krause à Stuttgart en 1884, et
réédité plus complètement – deux volumes – dans la publication de l'Académie de Berlin)
nous présente un tableau des hésitations de Kant vieilli. Les textes s'échelonnent sur
plusieurs années. Un fragment, daté par une référence à l'Anzeiger de Göttingen de 1792,
fixe approximativement la date de l'ensemble. Kant n'y mentionne qu'un physicien à
tendances mystiques, Lichtenberg, dont il a dû feuilleter quelque mémoire, qui avait circulé
avant la publication de ses œuvres, commencée en 1800. Peut-être ce nom a-t-il été ajouté
après le début de la publication. Kant prépare à cette époque le passage des Principes
métaphysiques de la science de la Nature à la Physique, des théories générales aux
applications, ou, pour parler son langage, la transition de la forme à la matière, que cette
forme doit encadrer. Pour répondre à diverses questions, Kant est amené à préciser le sens
de « philosophie transcendantale » et de certains termes usuels dans les trois Critiques, dont
l'emploi variable avait dérouté beaucoup de lecteurs. Kant ne nomme aucun de ses
contradicteurs, bien qu'on puisse reconnaître des souvenirs de Jacobi, Reinhold, Herder,
Fichte et peut-être Schelling.
Kant se tient pour l'inventeur de la philosophie transcendantale et s'efforce de la définir
avec précision. Ce n'est pas un système d'affirmations dogmatiques, un corps de
philosophèmes (c'est le terme dont les jeunes Schelling et Hegel se servent depuis 1796 pour
désigner les propositions des philosophes). L'objet de cette discipline est de dégager les
principes métaphysiques de toutes les autres sciences métaphysiques et notamment des deux
plus importantes, métaphysique de la Nature et métaphysique des mœurs. On appelle
métaphysique, une science portant sur la forme de la connaissance, dans la mesure où cette
forme autorise, entre certaines limites, une connaissance rationnelle ou a priori, sans aucun
recours à l'expérience. Une telle science comporte un enchaînement rigoureux de principes.
La Métaphysique, avec ses principes, est une œuvre du sujet, car elle implique la distinction
du sujet et de l'objet. Le sujet est le Moi lui-même, avec les déterminations propres à sa
structure, qui sont de deux sortes : les lois de l'entendement pur ou Catégories, et les lois de
la volonté ou de l'action pratique ; et je sais par analogie que les autres hommes sont de
même structure et constitués comme moi. L'entendement pur se divise en fonctions
parfaitement différenciées, mais intimement unies et formant, dans le Moi, une complète
unité. Mais le sujet ne peut être séparé de la matière sensible, ou de l'objet, sans lesquels les
formes mentales resteraient formes vides. Cet objet est donc, en quelque mesure, étranger
(fremd) au sujet, rebelle aux cadres. Il est en lui-même inassimilable par l'esprit et nous
sommes tentés de croire que nous ne le connaissons ni a priori, ni par l'expérience. Il
s'ensuit qu'il n'y a d'intelligible dans l'objet que ce que le sujet y introduit lui-même.
Kant a déjà constaté, avant 1781, que l'esprit a le pouvoir de penser des idées qui, à la
différence des concepts, ne s'appliquent pas actuellement à des objets sensibles ; ces idées,
établies d'après les concepts, ne sont pas réelles comme les concepts. Toutefois la réalité ne
pourrait-elle, dans l'avenir, se modeler sur elles ? Car l'esprit énonce, se donne à lui-même
des principes logiques et moraux ; ceux-ci déterminent l'usage qu'il fera de ses facultés pour
agir, pour créer, en dehors de lui et en lui-même, quelque chose qui sera son œuvre. Dans
l'ordre moral, cette exigence de l'esprit se traduit pas l'impératif catégorique. Comme les
catégories, l'impératif est formel, et ne concerne que la forme de l'action ; c'est le cadre
abstrait de la loi morale, l'exigence de l'universel. La matière de l'action n'est plus le donné
connaissable de nos sensations ; elle est constituée par nos sentiments de plaisir et de peine,
affectant nos sens internes et externes, par nos impulsions spontanées, nos désirs et les élans
de notre volonté. Cette masse confuse fait obstacle au déploiement de notre liberté. Mais
dans quelles conditions cette liberté agit-elle ? Par un fait, un ordre intérieur que je me
donne librement : obéis à la loi qui est universelle et à laquelle tu as le pouvoir de désobéir ;
obéis sans contrainte, car toute soumission à une contrainte te priverait de la liberté qui te
fait égal à Dieu. Ainsi, la décision initiale, l'option à une heure critique, fixe ton destin, peut-
être pour toujours. Les lois de l'activité sont donc différentes de celles de la pensée, puisque
le sujet se les donne à lui-même librement.
La lumière de la conscience de soi éclaire de plus en plus la ténèbre de l'inconscient. C'est
dans cette illumination progressive de l'être intérieur par la conscience que réside tout le
progrès, scientifique et moral. À la base de l'un et de l'autre, la même exigence, celle d'un
ordre universel mais toujours précaire, parce que l'esprit doit lutter en lui-même contre les
deux tentations parallèles de l'erreur et du péché. Le réel ne serait-il pas tout entier caché
dans notre inconscient, d'où la conscience le fera surgir pièce à pièce ?
La philosophie transcendantale isole donc les éléments a priori de la conscience ; elle isole
de même la représentation d'un but idéal, ou d'une Idée. Kant écrira dans ses notes : la
philosophie transcendantale est le système de l'idéalisme pur. Elle nous met en présence
d'Idées. Les idées ne sont pas, comme les idées platoniciennes, des êtres réels extérieurs à
l'esprit, mais des lois de la pensée que le sujet se prescrit à lui-même. La pensée crée ses
idées, et les crée en se créant elle-même. Autrement dit, la pensée énonçant une Idée opère
sur elle-même, en elle-même. On ne peut philosopher sur aucun objet, en tant que donné,
mais seulement en tant que chose de pensée (Gedankending) provenant du sujet même. Une
tendance visible dans beaucoup de fragments nous montre Kant résorbant peu à peu, tout
comme ses disciples infidèles, la part de l'extérieur ou de l'objet.
La distinction même de l'extérieur et de l'intérieur, du Moi et du non-Moi provient de ma
structure mentale. Kant reste entièrement fidèle à la théorie de l'intuition sensible. L'espace
et le temps n'ont pas d'existence hors de l'esprit ; ils ont des caractères qu'on ne peut pas
traduire par des concepts de l'entendement. Ils sont donc en moi comme étrangers à
l'entendement, à la conscience claire : ils expriment les propriétés fondamentales du Moi, et
pourtant le Moi ne les comprend pas. Or c'est dans l'intuition sensible, dans la sensibilité
pure, que résident la distinction de l'extérieur et de l'intérieur, la dispersion de l'extérieur
dans l'espace, et l'échelonnement des événements dans le temps. Tous les événements
intérieurs accessibles à la conscience, représentations (Vorstellungen), sensations, désirs,
volitions, s'y développent également. Cependant, derrière ces événements intérieurs se
trouve le fait du Je pense, l'acte même de l'entendement, qui est à l'origine du concevoir
(Begreifen) ; et plus encore l'acte volontaire, la résolution, l'option initiale, le respect qui,
dans un moment indivisible, me transportent pour ainsi dire dans un autre univers. Ces deux
mondes sont identiques, se superposent exactement, et pourtant ils n'ont rien en commun.
D'un côté, le caractère empirique de la conscience psychologique, de l'autre le caractère
intelligible de la conscience morale. Le premier n'est que le reflet du second qui seul fait de
moi une personne.
De plus en plus, il semble à Kant que l'Homme, seule créature raisonnable, a la place
principale dans l'organisation de la Planète ; Kant n'exclut ni la science positive, ni la
technique, ni l'art, de cette construction d'une humanité meilleure, qu'il se refuse à décrire
par crainte de tomber dans la rêverie (Schwärmerei). Kant rencontre ici une notion dont il a
trouvé l'analogie chez les révolutionnaires français et qui a fait l'incomparable force et
l'unité du peuple français, fragment de l'unité de la société humaine. Un monde terrestre
entier, unifié de la sorte, porteur d'une intention et d'une volonté unique, ce sera le Divin
incarné ici-bas, le Dieu terrestre, le ciel sur la terre, la perfection toujours visée. La loi
morale se réalisera alors avec la même spontanéité vivante que les lois physiques de la
gravitation et de l'affinité des corps élémentaires.
Depuis que la morale l'a réintroduit dans le domaine religieux, le problème du Divin et de la
Révélation se pose à Kant sous une forme nouvelle, à laquelle il a rêvé pendant des années ;
et c'est la leçon que Herder et Schleiermacher ont retenue de son enseignement. Ce
problème a reçu, dans l'Histoire, diverses solutions, toutes imparfaites, bien que de
nombreux théologiens aient entrevu l'essentiel. Le Catholicisme a fondé une Église
universelle ; mais l'extérieur, le rituel, le temporel, ont masqué l'élan des âmes et l'ont
étouffé. Le formalisme, la simonie, l'appétit de puissance ont tout corrompu. Des
dissidences comme le Grand Schisme, le Luthéranisme, ont ramené l’Église à des
communautés nationales, qui ont divisé les hommes au lieu de les unir. De petits groupes de
fidèles d'une confession particulière ont réalise, dans un cercle étroit, de vraies
communautés. Mais le grand idéal de l'Humanité unie, de l'Esprit divin rapprochant les
hommes, n'a jamais été réalisé. Pourtant l'idéal accessible du monde futur, c'est l’Église
terrestre, la communauté, dans le monde entier, de toutes les volontés soumises à la loi
morale, expression de la Personne humaine.
Cet idéal oblige à renoncer au Dieu transcendant, au monde céleste, inaccessible et
chimérique. Kant reproche à Spinoza d'avoir confondu le mécanisme du monde physique et
l'unité intérieure du monde moral, mais parle avec indulgence du Panthéisme et de
l'immanence divine. Kant veut amener la loi morale au rang des lois de la science, tout en
évitant le mécanisme et la nécessité : il remplace par la spontanéité vivante la nécessité
écrasante des lois de la mécanique, en installant, en quelque sorte, l'esprit au cœur du
mécanisme. C'est, semble-t-il, le sens d'une étrange formule de l'Opus postumum : l'esprit
de l'homme est le Dieu de Spinoza, et l'idéalisme transcendantale est le réalisme dans sa
signification absolue. L'Humanité unie sera une Personne, un Être (divin) donc un être
détenteur du droit contre lequel ne prévaudra le droit d'aucun autre... Dieu possède des
droits et n'est pas limité par des devoirs. Ce jour-là, le monde sera Dieu en tant que la
totalité d'êtres raisonnables ; il y a un être doué de raison morale pratique ; il y a un
impératif commun du droit, et par suite, aussi, un Dieu.
II. Remarques sur la pensée kantienne et l'« Opus postumum »
Au cours de sa longue carrière, Kant ne s'est fermé à aucune réalité humaine, mais il est
resté prisonnier de schémas scolaires auxquels il a volontairement soumis sa pensée. Le
Kantisme représente l'effort méthodique et conscient d'un homme d'une intelligence aiguë et
scrupuleuse pour justifier les sentiments dominants de son temps et pour les adapter à la foi
austère du Piétisme.
La substance du Kantisme n'est pas, en effet, très différente de la philosophie du XVIIIe
siècle français ou de la philosophie allemande des Lumières. Croyance au progrès technique
et scientifique, à la rigueur des lois de la nature, à une humanité future de plus en plus unie,
et formant un seul peuple. Identification graduelle d'un Dieu transcendant, auquel Kant
voudrait demeurer fidèle, et d'un Dieu vivant, immanent dans la Nature et dans l'Humanité,
celui de Buffon, de Diderot, de Spinoza et d'Hemsterhuis. Mais à cette vision des choses –
celle des « philosophes » – Kant ajoute la foi profonde du Christianisme piétiste, la
croyance en une décision libre du vouloir qui unit ou sépare à jamais l'individu et Dieu en
un choix intemporel, qui place l'individu parmi les élus ou parmi les réprouvés. Ces deux
conceptions apparaissent finalement au philosophe comme superposables. Kant pourra donc
assimiler les deux opérations différentes de l'entendement et de la raison pratique qui, l'une
et l'autre, sont toujours conquête de la lumière sur l'ombre, du bon principe sur le mauvais,
de la forme sur la matière.
Pour caractériser l'attitude de l'esprit découvrant ce dédale, Kant a imaginé le terme
transcendantal. Est transcendantal un type de pensée qui parvient à isoler forme et matière,
à séparer les conditions a priori d'une connaissance ou d'une activité, celles qui résident
dans l'être même qui connaît et agit. Ce n'est pas une pensée empirique, puisqu'elle remonte
en deçà des apports de l'expérience ; ni une pensée métaphysique, puisqu'elle ne nous mène
pas à un autre monde, distinct de la Nature connue par l'expérience des sens. C'est une
pensée liée, comme toutes les autres, aux ressources propres de la nature humaine. Elle nous
renseigne, partiellement sans doute, mais exactement, sur la portée réelle de nos pouvoirs de
connaître et de nos facultés. Elle ne désavoue aucune des acquisitions solides, demeurées
valables, du travail ancien de la pensée. Kant pourra donc garder beaucoup de formules
traditionnelles (la classification des facultés humaines par exemple) et de termes logiques
qui remontent à Aristote. Il distinguera seulement dans chaque faculté une partie pure et a
priori : sensibilité pure, imagination transcendantale, sentiment pur de respect, volonté pure
ou raison pratique.
Mais il constatera que ces facultés vraiment distinctes ont un principe commun profond,
l'unité du Moi, qui les rapproche en un tout réellement indivisible. Ce principe d'unité
commandera l'attitude initiale du Moi, en face de ce qui semble s'opposer à lui, comme une
chose étrangère soit en lui-même, soit hors de lui, le non-Moi. Le Moi apparaîtra d'abord
comme une activité indivisible manifestée par une suite d'actes particuliers échelonnés dans
le temps. Pourtant tous ces actes (Tathandlungen), toutes ces décisions ne formeront l'unité
que dans la mesure où ils seront tous commandés par une attitude fondamentale unique et
invariablement maintenue ; une telle décision est un fait qui commande toute l'évolution de
la conduite de son auteur.
L'analyse critique de la pensée et de l'action isolera, dans l'expérience interne comme dans
l'expérience externe, ce qui appartient à l'esprit et ce qui lui est étranger. Elle distinguera les
divers produits conscients de l'activité mentale : actes de pensée, activités pratiques sous
toutes leurs formes, art, technique... Elle cherchera dans la conscience ce qui provient du
non-Moi et constatera alors l'existence d'un élément étranger au Moi, mystérieux, défendu :
l'inconscient, qu'elle voudra éclairer davantage (Kant a pressenti l'analyse de l'inconscient).
Elle apercevra enfin la décision initiale qui commande tout notre comportement temporel ;
cette décision fondamentale a un caractère purement formel : mettre de l'ordre dans la
pensée, dans la conduite individuelle, dans la condition collective ; c'est cette décision qui
va rapprocher l'ordre nécessaire des règles de l'Entendement pur et l'ordre prescrit par la
décision libre de la volonté. Au terme du progrès, l'ordre humain aura identifié la nécessité
de la science et l'obligation de la morale.
Cette attitude exige que l'ordre individuel soit valable universellement, pour l'humanité
entière ; que tous les hommes puissent former, dans un avenir indéterminé, une seule
Humanité, unie par la communauté de la Raison. L'action actuelle n'y suffit pas ; il faut la
supposer, par la pensée, prolongée indéfiniment dans un futur inconnu. Ainsi naît un Idéal
où Nature, Humanité, Religion, seront réconciliées, où l'homme retrouvera l'unité rompue
par le péché d'Adam.
Ce modèle entrevu d'abord confusément, sera défini peu à peu avec une précision
croissante, à mesure que la pensée s'enrichira et que l'action deviendra plus sûre. De là
résulte l'ambiguïté de l'Idéalisme kantien. L'Idéal, dans le Kantisme à ses débuts, c'est
l'irréel, l'humain opposé à l'objet, distinct de lui : par exemple l'ordre spatial ou temporel. Il
parlera de l'idéalité transcendantale de l'espace et du temps. Puis, c'est le corps des Idées de
la Raison, réelles dans l'esprit, mais non perceptibles dans l'expérience sensible, donc un
univers idéal ou futur, plus parfait que le monde existant. À cet idéal, s'oppose le monde de
l'expérience, seul réel, et Kant tient fermement au réalisme empirique et à la valeur
objective de la science ; sur ce dernier point, sa pensée ne variera pas. Mais de plus en plus
le monde idéal, celui des Idées, se plaquera sur le monde réel jusqu'à le transfigurer
entièrement.
Comme tous ses contemporains, Kant est obsédé par l'existence humaine dans sa réalité
concrète, et par le sentiment de l'unité. Ce qui l'intéresse, ce n'est plus la solution de
problèmes scientifiques, insolubles en eux-mêmes, en raison de la limitation de nos
facultés ; mais c'est d'abord de rendre habitable le monde réel, le seul monde accessible, de
former l'Humanité à le mieux utiliser pour ses fins propres. Notre domaine est terrestre et
non céleste. C'est ici-bas que nous devons assurer notre destin et celui de nos enfants.
L'Humanité, en fin de compte, est l'unique objet de nos espérances et de nos soins. Loin de
s'isoler de ses contemporains, Kant partage leurs ambitions et leurs espoirs. C'est ainsi que
l'entendront tous ceux qui sont partis de lui, depuis Herder jusqu'aux Romantiques, à Fichte,
Schelling, Hegel et leurs continuateurs.
Il se distingue d'eux par le sentiment profond de la liberté individuelle, par sa crainte
instinctive des empiétements de l’État, de l'autorité, du mécanisme pratique, sur l'asile
inviolable où se fonde l'être dans sa spontanéité créatrice. Sans doute il n'a pu, faute
d'énergie physique suffisante, lutter efficacement contre l’État prussien, qu'il a cependant
servi. Mais son respect ne va pas aux lois imposées du dehors, il s'adresse seulement à la loi
intérieure qui subordonne l'individu au grand dessein de la communauté humaine. C'est là,
probablement, sa grandeur la plus indiscutable.
La notion du divin a subi, au cours de cette analyse, une transformation profonde. Kant, qui
a d'abord rejeté le Spinozisme, s'en rapproche de plus en plus. Il est tenté, à mesure qu'il
approfondit sa réflexion, de bannir le Dieu transcendant et inaccessible de la théologie
classique, de l'identifier à l'Humanité, comme le faisaient déjà avant lui les philosophes
révolutionnaires français. L'Opus postumum nous montre ses hésitations, son trouble, devant
cette solution qui le ramène à un panthéisme plus ou moins masqué. Mais ses efforts,
presque désespérés à la fin, pour maintenir le Déisme traditionnel, pour garder le cadre
chrétien et piétiste, n'aboutissent pas à une position claire.
III. Premières discussions du Kantisme en Allemagne
1. Circonstances et publications
L’œuvre de Kant fut immédiatement commentée en Allemagne. Par exemple, dès le 19
janvier 1782, Christian Garve, l'introducteur de la philosophie morale des Anglais, publie
une importante recension dans le Moniteur de Göttingen. Mais c'est trois ou quatre ans plus
tard que paraissent livres et articles en grand nombre. Dans la préface de ses Heures
matinales, Mendelssohn attaque Kant et déclare qu'il pulvérise tout (1785). L'année
suivante, Ludwig Heinrich Jakob (1759-1827) lui répond en défendant Kant dans son
Examen des Heures matinales de Mendelssohn. Au même moment, Gottlieb August Tittel
(1739-1816) écrit Sur la réforme morale de Kant et Adam Weishaupt (1747-1830) exprime
en 1788 ses Doutes sur les concepts kantiens du temps et de l'espace. Les universités
allemandes sont partagées entre les écoles et chacune voit en Kant la résurrection de ce
qu'elle refuse : la philosophie populaire en fait un sceptique, d'autres un supranaturaliste, un
leibnizien, un sensualiste, un éclectique ou un berkeleyen. On s'accorde à trouver que la
Critique est un livre difficile qui soulève beaucoup de problèmes : est-ce vraiment une
métaphysique ? Défend-elle ou ruine-t-elle la religion ? Qu'est-elle dans son fond ? Malgré
tout ce bruit, lorsqu'en 1791 l'Académie de Berlin mit au concours ce sujet : Quels progrès
la métaphysique e-t-elle faits en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolff ? un
wolffien, Johann Christian Schwab (1743-1821), qui remporta le prix, déclarait qu'elle n'en
avait fait aucun. Cependant Jacobi, dans son appendice à son livre David Hume : sir la
croyance ou Idéalisme et Réalisme (1787), avait déjà reconnu l'importance de la philosophie
nouvelle. Mais pour cet esprit religieux tout rationalisme tend vers l'athéisme et il reproche
à Kant d'avoir voulu fonder la religion. Il dénonce, d'autre part, un idéalisme que n'élimine
pas la doctrine de la chose en soi, car celle-ci ne s'accorde pas avec le reste : empiriquement,
les objets ne sont rien hors de nous et, sur le plan transcendantal, nous ne pouvons savoir
s'ils sont causes ni comment ils pourraient agir. Jacobi mettait ainsi l'accent sur le point le
plus délicat du Kantisme.
Il commence pourtant à y avoir des kantiens : un pasteur de Königsberg, Johannes Schultz
(1739-1805), publie en 1784 des Éclaircissements sur la Critique de la Raison pure, et en
1785 le Journal général des Lettres d'Iéna s'ouvre à la nouvelle philosophie ; en 1786, un
Abrégé de la Critique de la Raison pure avec un lexique pour faciliter l'usage de la
philosophie kantienne est publié par Karl Christian Schmid (1761-1812).
Parmi les kantiens de la première heure, celui dont l’œuvre déclenche les polémiques les
plus vives et les plus fécondes est Karl Leonhardt Reinhold (1758-1823). Né à Vienne en
1758, il entre d'abord au noviciat des Barnabites. Collaborateur de Wieland et de sa revue le
Mercure allemand, il expose et défend les idées dans un exposé populaire, les Lettres sur la
philosophie kantienne, parues d'abord ans le Mercure (1786-1788). Appelé à la chaire de
philosophie d'Iéna, il en fait le lieu de diffusion du kantisme, approfondit sa connaissance de
la Critique et compose divers ouvrages pour la prolonger, entre autres son Essai d'une
théorie nouvelle de la faculté humaine de représentation (1789) et Sur le fondement du
savoir philosophique et c'est en kantien dissident qu'il achève sa carrière à Kiel, où il meurt
en 1823. Cet esprit changeant est sensible aux influences : lié d'abord avec Fichte, il se
retourne contre lui après s'être rapproché de Bardili, dont le réalisme rationnel s'oppose à
l'idéalisme transcendantal. Son œuvre suscita les réflexions et les réactions tant des
antikantiens que des kantiens comme Karl Heinrich Heydenreich (1764-1801), préoccupé
surtout du problème religieux.
Mais la critique la plus pénétrante fut celle de Salomon Maïmon (1753-1800). D'une famille
juive de Lithanie, c'est un autodidacte formé simplement aux commentaires du Talmud. Il
apprend l'allemand seul et abandonne sa famille pour parcourir l'Allemagne dans une très
grande pauvreté. Il découvre successivement les sciences et la philosophie à laquelle il
applique les méthodes de commentaire et de discussion de sa jeunesse. La lecture de Kant
lui inspire son Essai sur la Philosophie transcendantale (1790), et celle de Reinhold des
Incursions dans le domaine de la philosophie (1793).
Gottlob Ernst Schulze (1761-1833), d'abord professeur à Helmstedt, devait être plus tard à
Göttingen le maître de Schopenhauer. Il publie son livre le plus célèbre en 1792,
anonymement, sous le titre : Aenesidème ou les fondements de la philosophie élémentaire
exposée à Iéna par M. le Pr Reinhold avec une défense du scepticisme contre les
prétentions de la Critique de la Raison pure, dialogue par lettres, où le sceptique
Aenesidème représente les idées de l'auteur.
Devant tant d'attaques, Kant trouva un défenseur en la personne de son élève Sigismond
Beck (1761-1840), professeur à Rostock. Celui-ci publie un commentaire, qu'il prétend
autorisé, des œuvres du maître, l'Abrégé explicatif des écrits critiques de M. le Pr Kant, sur
ses propres conseils (1793-1796), dont le troisième volume s'intitule Le seul point de vue
possible d'où l'on doive juger la Philosophie critique.
Ainsi s'achèvent les premiers remous soulevés par Kant. De nouveaux maîtres vont surgir,
qui ont fait leur apprentissage dans cette bataille et vont infléchir le kantisme vers leur
propre système, Gichte et Schelling. C'est pourtant contre Fichte aussi bien que contre Kant
que Christoph Gottfried Bardili (1761-1808) écrit, en 1800, ses Éléments de Logique
première, qui font de lui un précurseur de Hegel. Ces quinze années de polémiques et de
réflexion critique vont implanter solidement en Allemagne la pensée kantienne et seront
pour les temps qui suivront d'une extrême fécondité, même si cette abondante production
reste dans son ensemble de peu d'originalité.
2. Le premier glissement du Kantisme : Reinhold et le Système de la représentation
L’œuvre de Reinhold est au centre des discussions les plus importantes. Comme tant
d'autres en ce temps, il est troublé par les restrictions que font subir aux mystères religieux
les constructions rationalistes de l'Aufklärung et les assauts du scepticisme. Ce qu'il
découvre d'abord dans la Critique, c'est une reprise, sur le plan de la raison, de ce que le
Christianisme avait autrefois tenté sur le plan du cœur : l'union, cette fois définitive, de la
religion avec la morale, et désormais ses doutes sont dissipés. Il sera le hérault de ce nouvel
évangile. Mais pourquoi la philosophie de Kant a-t-elle été mal comprise ? D'abord parce
qu'on a essayé de l'enfermer dans l'opposition traditionnelle entre les idées innées et
l'empirisme, que sa théorie de l'expérience cherchait précisément à dépasser. D'autre part,
son obscurité vient de ce qu'il a eu recours à beaucoup de notions contestées qu'il n'a pas
éclaircies. Enfin il a séparé l'usage pratique et l'usage théorique de la raison. Cela montre
bien que, de son aveu, il a établi une propédeutique de la métaphysique, mais comme il n'a
pas abordé le problème du fondement, il n'a pas fait cette science elle-même. Il est d'ailleurs
naturel qu'une pensée découvre les conséquences avant de dégager les principes. Kant a bien
montré que l'expérience n'est possible que par le lien de l'entendement à la matière sensible,
mais la loi suprême de l'expérience n'est pas le principe premier de toute philosophie. Enfin,
il n'a pas montré comment l'entendement est lié à la sensibilité ; comme il n'a pas dégagé les
éléments de la connaissance, il n'a fait ni la science de notre pouvoir de représentation, ni
celle de nos diverses facultés.
Reinhold va donc entreprendre d'achever l’œuvre de Kant en se posant la question :
Comment la Critique de la Raison pure est-elle possible comme système ? Pour cela, il
convient d'établir une philosophie élémentaire ou science des éléments simples, qui sera le
fondement de toutes les autres parties de la philosophie. Cette science doit partir d'un
principe unique, puisque le système général des connaissances est un. Ce principe, antérieur
à tout raisonnement, ne peut être qu'un fait. Mais puisque sa valeur est universelle, ce ne
sera pas un fait d'expérience, intérieure ou extérieure. Il reste que ce soit le fait même de la
conscience ou la représentation : la représentation dans la conscience est distincte du sujet
et de l'objet et en rapport avec eux. La représentation est donc le genre dont la connaissance
est une espèce. Remontant ainsi à l'unité de la conscience, Reinhold entend en tirer à la fois
la théorie et la pratique, en déduire nos diverses facultés et surmonter ainsi tout germe de
dualisme au sein de la philosophie critique.
À partir des trois termes, sujet, objet et représentation, il entreprend une série d'analyses qui
aboutissent à une série de définitions : de la matière et de la forme (dans l'une la
représentation se réfère à l'objet, dans l'autre au sujet), de la spontanéité de la conscience,
faculté de lier le divers, de sa passivité ou affection. Lorsque la matière vient
immédiatement de l'objet, la représentation se rapport immédiatement à l'objet, elle est
sensible et s'appelle intuition, sous les formes fondamentales de l'espace et du temps. La
connaissance utilise une représentation au second degré, née de l'intuition, qui donne une
unité au divers représenté. Cette synthèse est le concept, dont l'entendement est la faculté.
Entendement, sensibilité et leur rapport sont donc déduits du seul pouvoir de représentation.
Quant à la raison, elle a pour matière les concepts dans leur diversité logique et les ramène à
l'unité absolue des Idées. Il y a trois Idées : le Sujet absolu, la Causalité absolue, la
Communauté absolue. Appliquée au sujet, la Causalité absolue le détermine comme libre,
absolument libre lorsque la faculté de désirer, déduite elle aussi de la représentation, est
déterminée par la raison, ce qui fonde la pratique.
Le Kantisme ainsi unifié et ordonné, que devient la distinction de la chose en soi et du
phénomène ? Il y a phénomène lorsque la représentation est rapportée à l'objet, chose en soi
si on les distingue. Celle-ci n'est donc qu'un concept, inconnaissable. Mais elle reste la
condition nécessaire pour que la connaissance ait une matière et, sans elle, la représentation
serait vide. Il faut donc en admettre l'existence. Sur ce point, Reinhold maintient ou même
aggrave la difficulté du Kantisme. De la chose en soi, qui n'est pas représentable et qui n'est
qu'un simple concept, il faut une cause ; or comment un concept peut-il être cause ? Quant
au fameux principe de la conscience, il entraîne, lui aussi, un argument ontologique : parce
que la matière est pensée comme donnée, elle est. Dans ces conditions, en quoi la
philosophie critique se distingue-t-elle de l'empirisme de Hume ? Elle prétend prouver la
nécessité par une raison existant comme chose en soi. Si l'existence de celle-ci est
contestable, comme nous venons de le voir, la Critique est dans son fond sceptique. Elle
prétend aussi se distinguer de Berkeley en disant que le phénomène n'est pas une simple
représentation, mais s'appuie sur une chose en soi. La mise hors de cause de celle-ci montre
que le phénomène est pure représentation, ce qui ramène à Berkeley.
Cette tentative de ramener le Kantisme à un système unifié, même si elle échoue finalement
devant le dualisme du phénomène et de la chose en soi, est d'une grande importance, car elle
contribuera à entraîner Fichte vers une Doctrine de la science et fixera l'ambition des
philosophes postkantiens. Certes, ses successeurs reprocheront à Reinhold bien des choses,
et tout d'abord le caractère purement formel de sa tentative. Procédant par déduction
conceptuelle, il ne donne pas à sa théorie de fondement réel, ce que la doctrine kantienne
des jugements avait pourtant essayé. D'autre part, il n'est pas évident que l'on puisse
ramener la conscience entière à la représentation et par conséquent le principe de
représentation n'est peut-être pas principe premier. La représentation, en effet, suppose un
objet ; et il faut supposer une conscience antérieure, comme le fera remarquer Maïmon.
Enfin, la doctrine de la chose en soi est contradictoire : comment un inconnaissable peut-il
d'une manière quelconque nous affecter, puisqu'il n'est qu'un simple concept ? Les
représentations naissent d'une faculté du sujet qui est une chose en soi – dont un
inconnaissable – dont on ne voit pas comment elle peut produire quoi que ce soit. D'ailleurs
affecter et être affecté sont des actions qui présupposent la causalité, sans que Reinhold ait
répondu aux critiques de Hume. Finalement, la Philosophie élémentaire ne conduirait-elle
pas au scepticisme ?
3. Le scepticisme critique de Maïmon et la conscience du donné
Ce sont ces reproches, entre autres, que reprend Maïmon. S'il considère, avec Reinhold, que
Kant a fourni le vrai point de départ de la philosophie et n'en a pas fait une science, il va
beaucoup plus loin dans la discussion de la Critique. Le problème posé par Kant est celui
des jugements synthétiques et a priori. Car il constate leur emploi sans justifier leur
possibilité. Or, les jugements synthétiques supposent une intuition. En mathématiques déjà,
il y a bien des intuition a priori ; mais celles de l'espace et du temps ne sont pas produites
par la règle de l'entendement et le fondement de leur nécessité nous échappe ; les
mathématiques elles-mêmes doivent se contenter d'une simple vraisemblance. Le fondement
de ces synthèses, non nécessaires mais non arbitraires. Maïmon l'appelle le principe de
déterminabilité. Dans la synthèse de l'imagination, les objets peuvent être pensés à part, par
exemple le cercle et le noir. La synthèse de l'entendement, c'est le rapport. Celle qu'exigent
les mathématiques n'est pas le rapport réciproque dont le caractère est formel, mais le
rapport unilatéral ; il n'y a pas de détermination sans déterminable, mais non
réciproquement. Tel est le principe. Il signifie par exemple que la droite suppose la ligne,
mais non l'inverse, l'une étant le sujet dont l'autre est le prédicat.
Si les mathématiques sont certaines, mais non nécessaires, le problème est plus difficile
encore pour les jugements qui portent sur l'expérience, parce que celle-ci reste douteuse :
nous n'avons pas la possibilité de construire a priori, comme en mathématiques. Pour que la
connaissance soit possible, nous dit-on, il faut distinguer le phénomène de la chose en soi.
Sans la chose en soi, la sensibilité n'est pas justifiée. Mais en même temps, on fait reposer la
théorie de la connaissance sur la conscience. Nous nous trouvons donc en face de deux
doctrines différentes. Il faudrait, pour rétablir l'unité de la science, éliminer la chose en soi
et faire reposer toute la doctrine sur la conscience.
Ici, le jugement synthétique a priori suppose une donnée et on justifie celle-ci par la chose
en soi. Ce qui caractérise la chose en soi, c'est qu'elle est totalement extérieure à la
conscience. Or, l'objet que nous connaissons ne saurait être extérieur, et cela résulte de la
Critique elle-même. La matière de la connaissance est le perçu dont le temps et l'espace (qui
fondent la notion d'extériorité) ne sont que les formes. Les représentations des objets sont
donc des images projetées par le Sujet transcendantal, le Moi pur, dans ce miroir qu'est le
Moi empirique ; et si elle semble venir de quelque chose qui soit hors de la conscience, c'est
pure illusion. Car hors de la conscience il n'y a rien, et toute saisie d'objet est conscience.
Reste à expliquer cette illusion. Extérieur signifie simplement que nous n'avons aucune
conscience d'être actifs dans la représentation. Les choses paraissent donc s'imposer. Mais il
serait absurde de croire qu'elles sont en soi, car cette notion est aussi impensable que la
racine carrée d'un nombre négatif. Et, d'autre part, comment appliquer la catégorie de
causalité à ce qui échappe à l'expérience ? La chose en soi serait de toute manière inutile. La
connaissance ne saurait donc s'expliquer ni par elle, ni par l'activité de la conscience que le
moi empirique ignore. La donnée est simplement l'impénétrable.
Pour établir le statu de cet impénétrable, Maïmon recourt à une théorie ingénieuse,
d'inspiration leibnizienne. Il étend l'entendement à l'infini et introduit l'infiniment petit. Si,
en effet, nous avons de la donnée une connaissance imparfaite, il faut considérer celle-ci
comme plus ou moins claire, comme allant d'une conscience déterminée jusqu'au néant
absolu de la conscience et cela par une série de degrés décroissant à l'infini. Le pur donné
est la limite de cette série infinie ; on ne peut dire qu'il est étranger à la conscience. Les
représentations sensibles sont comme les différentielles de la conscience déterminée, des
actes de conscience infiniment petits, que nous appellerons Noumènes ou Idées de la raison.
Le donné doit être considéré non pas comme un zéro, mais comme un irrationnel analogue à
la racine carrée de 2. Mais la faculté de penser reste passive et n'entre en jeu que lorsque
l'imagination rassemble plusieurs éléments sensibles de même espèce pour en élaborer une
intuition unique. On pourrait dire qu'un entendement infini propose l'objet à un entendement
fini qui le traite alors selon ses règles. Il en résulte que la distinction de la sensibilité et de
l'entendement n'est plus que relative à notre finitude : la sensibilité est un entendement
incomplet. Mais il en résulte aussi qu'aucune connaissance de ce type n'est jamais parfaite,
ni, par conséquent, entièrement nécessaire.
Si pour Maïmon le dogmatisme métaphysique est irrecevable parce qu'il pose des choses en
soi et fait un emploi illégitime du principe de causalité, si l'empirisme ramène la faculté de
connaître à une sorte d'instinct animal, la philosophie critique représente un progrès, mais
elle repose finalement sur un cercle : de la possibilité de l'expérience, elle tire les conditions
de la connaissance, d'où elle déduit que l'expérience est possible. Elle présuppose la réalité
objective sans se demander si l'objet réel est possible. C'est donc un dogmatisme empirique
et un scepticisme rationnel. La philosophie de Maïmon cherche à montrer que les objets de
pensée sont a priori ; mais alors la généralité et la nécessité ne s'appliquent plus à la
connaissance empirique. Elle est donc un dogmatisme rationnel et un scepticisme
empirique.
4. Schulze : la critique par le scepticisme radical
Maïmon compare son scepticisme au serpent, qui doit toujours piquer au talon le philosophe
critique qui cherche à l'écraser. Avec Aenesidème-Schulze, c'est finalement le scepticisme
qui l'emporte, car ni Kant ni Reinhold n'ont réussi à venir à bout des attaques de Hume.
Comme Maïmon, ils pensent que la doctrine kantienne des facultés met en jeu la
présupposition d'un principe de causalité que Hume a contesté. D'autre part, Kant affirme
que la connaissance implique des jugements synthétiques a priori, où la raison pure lie des
représentations possibles. Kant raisonne ainsi : Parce que la connaissance exige des
jugements synthétiques a priori, de tels jugements existent. Parce que la généralité et la
nécessité sont des attributs de la faculté de connaître, elles existent. Parce qu'il n'y a pas
d'autre fondement que la raison pure à cette connaissance, il y a une raison pure. Donc,
chaque fois que Kant affirme : telle chose doit être pensée d'une certaine manière, la réalité
s'y conforme. C'est proprement une argumentation ontologique, celle du dogmatisme, que la
Critique réfute explicitement. Kant se réfute donc lui-même et reste désarmé devant Hume.
Enfin, si cet argument ontologique avait de la valeur, les choses en soi pourraient être
connues, ce que Kant refuse.
Aussi Kant n'a pas montré qu'il est impossible de penser la nécessité à partir de la sensation,
ni même les jugements nécessaires et généraux à partir de la chose en soi. Car si on ne sait
rien d'elle, pourquoi ne serait-elle pas cause ? Et qui dit qu'un jour on ne la connaîtra pas ?
Pourquoi les catégories ne lui seraient-elles pas applicables ? Ne parle-t-on pas d'ailleurs de
leur réalité et de leur causalité, alors que ce sont là des catégories de l'entendement ? Si la
chose en soi est connaissable, la Critique s'effondre ; si elle est inconnaissable, elle ne peut
jouer aucun rôle.
5. Le second glissement du Kantisme : l'activité du sujet intellectuel selon Beck
Ainsi, de manière différente, les successeurs de Kant se trouvent embarrassés par les mêmes
problèmes : le rôle de la chose en soi et la difficulté d'expliquer la donnée sensible. Ni le
formalisme de Reinhold, qui maintient la chose ne soi, ni le dogmatisme sceptique de
Maïmon et son retour à Leibniz, ni le scepticisme de Schulze n'apportent des solutions
satisfaisantes. C'est alors que Beck se demande si l'on a vraiment compris la position de
Kant. Toutes ces attaques, toutes ces accusations de sophisme restent-elles sur le plan où
Kant a voulu se placer ? En d'autres termes, quel point de vue faut-il adopter pour
comprendre la Critique ? Tout le mal ne viendrait-il pas de ce que, en se situant à un point
de vue encore dogmatique, on tombe tout naturellement sous les coups d'Aenesidème ? On
commence par poser la réalité de la chose en soi. On dit ensuite : il y a un rapport entre elle
et la représentation. S'il y a un tel rapport, je dois pouvoir me la représenter. Or, c'est
impossible. Donc la chose en soi ne peut être une cause, ni la représentation un signe. Donc
la Critique est incompréhensible. De même Kant distingue des jugements analytiques et
synthétiques qui supposent un objet et une représentation. Tant qu'on déclare ainsi que
l'objet est extérieur à la représentation, leur rapport est incompréhensible et la distinction
des deux sortes de jugements s'efface. On raisonnerait de même sur le caractère
incompréhensible des distinctions entre la connaissance empirique et la connaissance pure,
entre l'intuition et le concept.
D'où viennent tant de confusions dans ces interprétations ? De ce que l'on n'a pas pris la
peine de se placer au vrai point de vue de Kant. Il faut d'ailleurs avouer que celui-ci n'a pas
rendu la tâche facile ; pour se faire comprendre, il a usé d'un langage réaliste qui a induit
finalement ses lecteurs en erreur. Son vrai point de vue est tout autre : il est transcendantal et
finalement idéaliste. Pour bien comprendre, il faut d'abord poser que l'objet est
représentation. Pour parler plus précisément, il est le produit de l'acte originel de
représenter. Comprendre la philosophie exige cette activité. Le premier principe est une
exigence, un postulat : il faut se représenter un objet originellement, comme le géomètre
exige qu'on se représente au préalable l'espace pour connaître ses dimensions. La
philosophie transcendantale est simplement l'art de se connaître soi-même, et son centre est
l'unité synthétique de la conscience. C'est dans la conscience et par la synthèse que l'acte
originel de représenter est possible, donc l'objet, puisque rien ne peut être lié avant cette
synthèse. Alors seulement, la conscience reconnaît la représentation, découvre que sous le
concept il y a un objet. Les catégories sont les modes, qu'il faut déduire de cet acte de
représenter. Dans la représentation, l'intuition ne se distingue du concept que comme
l'immédiat du médiat. On comprend maintenant que le phénomène n'est rien d'autre que
l'objet perçu et la chose en soi l'objet pensé clairement et distinctement. Il est tiré de la
réalité phénoménale, mais en tant qu'objet il n'est rien, il ne peut être donné. Reinhold s'était
approché de ce point de vue transcendantal, lorsqu'il établissait son système de la
représentation. Mais chemin faisant, il est revenu, lui aussi, au point de vue dogmatique,
lorsque par exemple il réintroduit le dualisme de l'activité et de la passivité, qui aboutit à
séparer la représentation de la cause de notre représentation, la chose en soi.
La tentative de Beck consiste donc à exprimer la philosophie critique en termes d'activité :
l'espace et le temps ne sont pas des intuitions données, mais l'acte même de l'intuition ; les
catégories ne sont pas des concepts, mais des fonctions. Il tente de ramener toute la
connaissance à l'acte originel de représenter. Cela suffi-il à résoudre les problèmes posés ?
Certes, la chose en soi perd son caractère mystérieux, mais la matière de l'acte de
représenter continue d'être inexpliquée.
6. Bardili et la transition vers la logique spéculative
C'est ce problème du fondement réel qui conduit Bardili vers l'ontologie. La pensée pure se
pense dans sa logique formelle, A = A, qui est l'unité indifférenciée. Comment passer à la
multiplicité et l'appliquer à la matière ? Il y faut un objet. Et Bardili montre comment l'unité
se fait unifiante en posant elle-même sa limite pour se déterminer. Il professe un réalisme
logique et rationnel aussi bien opposé d'ailleurs à la doctrine de Kant qu'à celle de Fichte.
À vrai dire, une partie de l'intérêt de ces divers auteurs est l'influence que leurs recherches et
leurs controverses ont pu avoir. L'interprétation du Kantisme est difficile et fait surgir
nombre de difficultés, qui déplacent peu à peu les problèmes. De nouveaux maîtres, Fichte,
Schelling, ont médité l'effort de Reinhold pour bâtir une métaphysique, ainsi que la critique
impitoyable de Maïmon et de Schulze. Ils en ont tenu compte dans l'édification de leur
propre système.
IV. La diffusion du Kantisme
1. Prolongements néo-kantiens en Allemagne
C'est en critiquant le Kantisme que les grands philosophes de l'époque romantique
constituent leurs systèmes. Pendant la première moitié du XIXe siècle, Fichte et Schelling
éclipsent Kant en Allemagne et le système hégélien règne seul en 1830. Schopenhauer
cependant, malgré ses attaques, reprend et commente l’œuvre de Kant. Mais c'est Liebmann
(1840-1912) qui, par son ouvrage Kant und die Epigonen (1865), proclame la nécessité d'un
retour à Kant et favorise l'éclosion du Néo-Kantisme. Ce mouvement est tout entier dominé
par l'idée de relativisme, mais il se diversifie en de multiples tendances. Réalisme, a priori
et méfiance à l'égard de toute idée métaphysique, caractérisent la pensée de Helmholtz
(1821-1894), de Lange (1828-1875) et de Riehl (1844-1924), qui se sont surtout inspirés de
la Critique de la Raison pure.
Le Néo-Kantisme de l’École de Marbourg renouvelle la théorie kantienne de la
connaissance, en élargissant considérablement son domaine de type mathématique. Cohen
(1842-1924), pense également que le passage de la pensée à l'Être est possible, dans la
mesure où il est construction. Cassirer (1874-1945) est l'héritier de cet intellectualisme
mathématique. Le Néo-Kantisme de l’École de Bade ne s'attache pas au problème de la
connaissance mais à celui des valeurs. Windelband (1848-1915) pose les valeurs comme
absolues, sans d'ailleurs indiquer les critères de cette détermination. De même Rickert
(1863-1936) n'étudie pas la déduction des catégories de la connaissance, mais celles des
catégories axiologiques indépendantes de toute réalité.
Au contraire, le relativisme sera défendue par Volkelt (1848-1930) et Simmel (1858-1918),
sans tomber pourtant dans le subjectivisme pur. Un mouvement d'étude historique et critique
apparaît lorsque Vaihinger (1852-1933) fonde à Halle, en 1904, une Société de Philosophie
kantienne, dont les publications (Kantstudien) montrent la continuité et l'importance du
Néo-Kantisme.
2. En France
Dans une première période, le Kantisme est connu de façon encore fragmentaire et surtout
par des œuvres secondaires présentées sans la moindre référence à l'évolution de Kant. Par
la suite, apparaît un mouvement néo-kantien qui installe le Kantisme dans la philosophie
française ; on ne connaît plus alors de Kant que les trois Critiques.
La philosophie nouvelle ne sera exactement connue que dans les dernières années du XIXe
siècle. Mais dès la fin du XVIIIe siècle, en 1796, Keil publie une Notice sommaire sur
Kant ; le Magasin encyclopédique présente ensuite quelques traductions, par Lezay-
Marnesia, Peyerimoff et Griesinger, de divers passages de la Critique de la Raison pure. En
1799, Joseph Mounier y donne des Lettres sur la philosophie de Kant. Un émigré, Charles
de Villers, fait connaître dans le Spectateur du Nord – devenu ensuite le Conservateur du
Nord – (1798-1801), ce qu'on tient alors pour l'essentiel du Kantisme ; son ouvrage La
philosophie de Kant ou Principes fondamentaux de la philosophie transcendantale (Metz,
1801), provoque à l'Institut de France un débat sur la Kantisme : Destutt de Tracy fait une
communication ; De Gerando, auteur de la Génération des connaissances humaines (Berlin,
1802) ; De Gersdorff, le vulgarisateur Sébastien Mercier prennent également part à la
discussion. Les écrits de François de Neufchâteau, les exposés de Le Fèvre, Prévost,
Daunou et Portalis donnent de brefs aperçus du Kantisme.
Ainsi la philosophie de Kant a été introduite très partiellement au début du XIXe siècle et
surtout sous l'influence de littérateurs admirant l'Allemagne et d'émigrés de l'entourage de
Mme de Staël. Les premiers commentateurs connaissent mieux la Dissertation de 1770, le
Projet de Paix perpétuelle ou l'Idée d'une Histoire universelle au point de vue
cosmopolitique, que la Critique de la Raison pure, dont les analyses sont encore succinctes.
On ne trouve ni l'esprit de l'ensemble du système critique, ni la compréhension de
l'originalité et de la nouveauté du Kantisme, qui se trouve rattaché au rationalisme leibnizien
ou au sensualisme empirique. C'est donc sur des données assez vagues que les Idéologues et
Maine de Biran discutent de la valeur des théories kantiennes. Plus tard, Cousin n'a encore
qu'une connaissance insuffisante du Kantisme, et Comte avait déjà élaboré les grandes
lignes de son système lorsqu'il lut, par hasard, quelques opuscules de Kant. Pourtant
l'ouvrage de Schön : La Philosophie transcendantale ou système de Kant (Paris, 1831),
contient déjà un bon exposé des trois Critiques.
Il faudra cependant attendre le Néo-Criticisme pour que le Kantisme paraisse assimilé par la
pensée française. Le relativisme de Cournot (1801-1877) trouvait déjà son origine dans la
pensée kantienne. Mais Renouvier (1815-1903) fut vraiment l'initiateur de ce mouvement et
consacra de nombreux travaux au Kantisme. Par la suite, Lachelier (1832-1918) et Boutroux
(1845-1921) introduisirent le Kantisme dans l'Université. Hamelin (1856-1907) s'efforça
même de concilier Kant et Hegel. On en vint alors à une admiration exclusive des trois
Critiques, qui rejeta dans l'ombre tout le reste du Kantisme, considéré comme moins
conforme au criticisme. Pour réagir contre cet excès, et juger plus équitablement le
Kantisme, Delbos (1862-1916) l'étudia davantage en historien de la philosophie.
Il est remarquable que le Kantisme se vulgarise surtout après 1871. On attribue la défaite au
déclin de la science française, à l'utilitarisme grandissant, à l'immoralité. Aussi le Kantisme
devient-il, vers 1880, le symbole d'une pensée morale et politique profonde, aux yeux de
ceux qui sont animés d'une foi républicaine. La philosophie de Kant doit fournir, à une
pensée que se veut affranchie de la « superstition », les moyens de répandre dans la jeunesse
une moralité sévère, le civisme, le désintéressement, le patriotisme, toutes ces disciplines
apportant un substitut républicain à l'ancienne formation religieuse, en somme l'armature
d'une religion laïque.
Le résultat le plus important de la discipline kantienne a été de contribuer à former en
France de bons historiens de la philosophie. Elle a coupé court aux fades synthèses de
l’Éclectisme et on la trouve même à l'origine de la sociologie de Durkheim. Elle aurait pu
être salutaire dans la morale et la vie politique, si la passion des partis ne l'avait viciée dans
son principe.
3. En Italie
Il y a eu, comme en France, deux étapes de l'influence du Kantisme. Elles ont été séparées
par l'influence hégélienne. On ne connut d'abord que quelques textes de Kant, assez mal
interprétés parfois. Testa, de Plaisance (1784-1860), après avoir combattu Kant en
s'inspirant tour à tour du Sensualisme de Condillac, de l'Idéologie de Tracy et de
l’Éclectisme de Cousin, finit par enseigner la doctrine kantienne. La portée de cette
première influence fut assez limitée. En réaction contre la philosophie déterministe et
évolutionniste, un renouveau kantien, dont la diffusion fut beaucoup plus large, apparut.
Cantoni, de Pavie (1840-1906), prit directement contact à Berlin avec la philosophie
allemande et enseigna les principes du Kantisme, tant théorique que pratique : Études sur
Kant (1879-1884). Dans le même sillage, se placent Barzellotti (1844-1917) qui fit
connaître le Néo-Kantisme allemand dans son étude : La Nuova Scuola del Kant (1878), et
Juvalta, fondateur de la Rivista Filosofica.
4. Dans les pays anglo-saxons
L'influence de Kant y a été pareillement profonde. Elle apparaît notamment dans l’œuvre
considérable de l’Écossais Hamilton (1788-1856) qui mêle à la doctrine de Reid et des
Empiristes maints souvenirs de la Critique kantienne, visibles surtout dans ses Leçons de
Logique et de Métaphysique, professées à Édimbourg et publiées par Mansel (Londres,
1859-1860). Pour Hamilton comme pour Kant, la logique est une science des conditions
formelles de la pensée qui fait abstraction du contenu des cadres fournis par l'esprit. Il
identifie la Conscience kantienne au common sense des Écossais. Il part de la distinction du
Moi (la conscience) et du non-Moi (qui réside en elle) pour nous interdire toute affirmation
relative à l'Absolu ou à l'Être, par suite toute connaissance relative à Dieu et au destin. La
philosophie de Hamilton, comme celle de Mansel, son principal disciple, s'intitule
philosophie de la conscience.
L'influence de Kant – et celle de Hegel – est également visible chez Whewell (1794-1866),
particulièrement dans son Histoire des Sciences inductives (1837), suivie d'une Philosophie
des Sciences inductives fondée sur leur histoire (1840). Kant est également à l'origine de la
doctrine idéaliste de Green (1836-1882). Caird (1835-1908) a vulgarisé en Angleterre le
Kantisme dans sa Philosophie critique de Kant (1889) après avoir vulgarisé l’œuvre de
Hegel (1883). Au contraire, Stuart Mill (1806-1873) restera un empiriste convaincu, fort
ennemi de Kant.
Malgré des critiques et des interprétations diverses, le Kantisme restera, jusque vers 1914,
un des éléments dominants de la pensée occidentale. Lorsqu'en 1900, la philosophie
allemande paraît évoluer dangereusement sous l'influence du romantisme, un célèbre
professeur de Berlin, F. Paulsen poussera ce cri d'alarme « Zurück zu Kant » (retour à
Kant) !
Vous aimerez peut-être aussi
- Philosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moraleD'EverandPhilosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moralePas encore d'évaluation
- Emmanuel KantDocument8 pagesEmmanuel KantSere100% (1)
- Explication de Texte KantDocument3 pagesExplication de Texte KantMithil KrishnanPas encore d'évaluation
- Le Criticisme de KantDocument1 pageLe Criticisme de KantGeorgesEdouard100% (1)
- Tous Les Courants PhilosophiquesDocument2 pagesTous Les Courants PhilosophiqueslatmgoPas encore d'évaluation
- Texte TowaDocument1 pageTexte TowaMacoura sowPas encore d'évaluation
- Le Travail Philo PDFDocument1 pageLe Travail Philo PDFdjivaPas encore d'évaluation
- Expose PhilosophieDocument3 pagesExpose PhilosophieEtienne MeanPas encore d'évaluation
- La Periode Antiques Les PresocratiquesDocument2 pagesLa Periode Antiques Les PresocratiquesAssero EricPas encore d'évaluation
- Synthese Philosophie MODERNE Et CONTEMPORAINEDocument26 pagesSynthese Philosophie MODERNE Et CONTEMPORAINEeris_lashtamPas encore d'évaluation
- Philo 1ere - Lec 8 - La Periode ModerneDocument6 pagesPhilo 1ere - Lec 8 - La Periode ModerneAdopo100% (1)
- PhilosophieDocument7 pagesPhilosophieSerePas encore d'évaluation
- Exposé Sur Les Enjeux, Finalités Et Perpectives PhliosophiquesDocument5 pagesExposé Sur Les Enjeux, Finalités Et Perpectives PhliosophiquesEl hadji Bachir KanePas encore d'évaluation
- John LockDocument2 pagesJohn Lockestella rasolofoniainaPas encore d'évaluation
- Perspective 3 Liberte IllusionDocument6 pagesPerspective 3 Liberte Illusionaight JinWOOPas encore d'évaluation
- These Alexandra BerbainDocument384 pagesThese Alexandra BerbainMaroua Benk99rimaPas encore d'évaluation
- Expose de Philosophie Medievale - DMDocument10 pagesExpose de Philosophie Medievale - DMDaniel MoukouriPas encore d'évaluation
- Cours de Philosophie (Institut Bamanya)Document20 pagesCours de Philosophie (Institut Bamanya)Raphaël Chiegain100% (1)
- PHILOSOPHIEDocument5 pagesPHILOSOPHIEkarim traore100% (1)
- Exposé Sur L'anthropologie PhilosophiqueDocument3 pagesExposé Sur L'anthropologie PhilosophiqueEl hadji Bachir Kane100% (2)
- Revision Generale PhilosophieDocument26 pagesRevision Generale PhilosophieGuina GueyePas encore d'évaluation
- Philo ReligionDocument8 pagesPhilo Religionbuilding infoPas encore d'évaluation
- Exposé Philo MédiévaleDocument10 pagesExposé Philo Médiévalekoffiyann4Pas encore d'évaluation
- Exposé de PhilosophieDocument8 pagesExposé de PhilosophieniampaPas encore d'évaluation
- Le CriticismeDocument14 pagesLe Criticismedelanautakou38Pas encore d'évaluation
- Cogitatio PhilosophusDocument59 pagesCogitatio PhilosophusIsmael OuedraogoPas encore d'évaluation
- Guide de PhilosophieDocument86 pagesGuide de Philosophienguettaolivier1100% (1)
- Faut-Il Douter Pour Savoir-Exemple-DissertationDocument4 pagesFaut-Il Douter Pour Savoir-Exemple-DissertationSonia Da-ConceiçãoPas encore d'évaluation
- Tle - Philo - L5 - Dieu Et La RéligionDocument7 pagesTle - Philo - L5 - Dieu Et La RéligionKey ManPas encore d'évaluation
- Aristote Et La VéritéDocument8 pagesAristote Et La VéritéKOUASSI100% (2)
- Mémoire de MasterDocument13 pagesMémoire de MasterMoussa Sow100% (2)
- Philo Tle - L7 - La Valeur de La PhilosophieDocument11 pagesPhilo Tle - L7 - La Valeur de La Philosophienyambidjesone4Pas encore d'évaluation
- Raison Foi PhilooooooDocument2 pagesRaison Foi PhilooooooAliou DialloPas encore d'évaluation
- Philosophie Sujet Corrige Ü2-1Document7 pagesPhilosophie Sujet Corrige Ü2-1yusufbakhit100% (1)
- Résumé de L'apologie de Socrate (MR Fofana)Document5 pagesRésumé de L'apologie de Socrate (MR Fofana)Yaya FofanaPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Sur Discours de La MethodeDocument6 pagesFiche de Lecture Sur Discours de La MethodeJunior KouaoPas encore d'évaluation
- TILLIETTE, Études Mystiques Du P. Joseph Maréchal PDFDocument14 pagesTILLIETTE, Études Mystiques Du P. Joseph Maréchal PDFVincent ColonnaPas encore d'évaluation
- Toute Croyance Est-Elle Contraire À La RaisonDocument4 pagesToute Croyance Est-Elle Contraire À La RaisonjuliettePas encore d'évaluation
- Dieu Est Ne en Afrique NoireDocument7 pagesDieu Est Ne en Afrique NoireNfoundi FefePas encore d'évaluation
- EXPOSE Influence Des TIC Sur La JeunesseDocument7 pagesEXPOSE Influence Des TIC Sur La Jeunesselolekoko54100% (1)
- Cour de Philosophie LivraitDocument38 pagesCour de Philosophie LivraitRaphaël ChiegainPas encore d'évaluation
- Introduction Et Conclusion Sur La Philisophie ModerneDocument2 pagesIntroduction Et Conclusion Sur La Philisophie ModerneYann Ewile KonanPas encore d'évaluation
- La Mésopotamie Patou Nolf FalbierskiDocument33 pagesLa Mésopotamie Patou Nolf Falbierskinicotheflash62223Pas encore d'évaluation
- Apport de Socrate Dans La Construction Du SavoirDocument8 pagesApport de Socrate Dans La Construction Du SavoirKOUASSIPas encore d'évaluation
- Philosophie KantDocument5 pagesPhilosophie KantFabioDeMartin100% (1)
- 8 PHILOscienceDocument2 pages8 PHILOscienceDiary BaPas encore d'évaluation
- Cours L1 Philo Afric Abad Kout-1Document25 pagesCours L1 Philo Afric Abad Kout-1john AkaPas encore d'évaluation
- De Musset - La Nuit D'octobre PDFDocument6 pagesDe Musset - La Nuit D'octobre PDFAnonymous KG8CNJYW0MPas encore d'évaluation
- Gaston Bachelard - L'Épistémologie Non-CartésienneDocument14 pagesGaston Bachelard - L'Épistémologie Non-CartésienneAlexyu RasqualPas encore d'évaluation
- Discours de La PhilosophieDocument163 pagesDiscours de La Philosophieazrak samawiPas encore d'évaluation
- EXPOSE DE PHILOSOPHIE Utilite de La PhilosophieDocument5 pagesEXPOSE DE PHILOSOPHIE Utilite de La Philosophiekarim traore100% (2)
- Cours Sur La PhilosophieDocument3 pagesCours Sur La PhilosophieMamadou Moustapha Sarr100% (1)
- Expose BachelardDocument7 pagesExpose Bachelardmonnet100% (1)
- Phylo Bac SujetDocument39 pagesPhylo Bac SujetSoul weshPas encore d'évaluation
- Philo AntiqueDocument4 pagesPhilo AntiqueAlain TerrieurePas encore d'évaluation
- MON FASCICULE PHILO TL2 2Document31 pagesMON FASCICULE PHILO TL2 2Ablaye DiaPas encore d'évaluation
- Philos Tle - CoursDocument70 pagesPhilos Tle - CoursMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- Cours de Philosophie Sur Les PassionsDocument25 pagesCours de Philosophie Sur Les PassionsNanaPas encore d'évaluation
- Série de Textes Sur Nature Et CultureDocument6 pagesSérie de Textes Sur Nature Et CultureCHEIKH سهليPas encore d'évaluation
- On SavaitDocument1 pageOn SavaitEverton Lula da SilvaPas encore d'évaluation
- Maitre Philippe Et MédecineDocument9 pagesMaitre Philippe Et MédecineYeshoua HoldingPas encore d'évaluation
- Gestion-des-RH Modifié PDFDocument29 pagesGestion-des-RH Modifié PDFSamuel RchstPas encore d'évaluation
- Les 77 Degrés de La FoiDocument3 pagesLes 77 Degrés de La FoiJon JayPas encore d'évaluation
- CrepusculeDocument291 pagesCrepusculeAntoine GalletPas encore d'évaluation
- Sangupamba MwiluDocument225 pagesSangupamba MwiluSerge MWAMBAPas encore d'évaluation
- Les Agents Intelligents PDFDocument29 pagesLes Agents Intelligents PDFDon Pascal100% (1)
- These Belkadi-2 2Document107 pagesThese Belkadi-2 2Nabil MesbahiPas encore d'évaluation
- Raymond RDocument104 pagesRaymond RMartinPas encore d'évaluation
- Vol Des OiseauxDocument10 pagesVol Des OiseauxMatthieu BecquartPas encore d'évaluation
- Méthodologie DissertationDocument3 pagesMéthodologie Dissertationskctz9gzsqPas encore d'évaluation
- Eco ConceptionDocument8 pagesEco ConceptionoussougoudjPas encore d'évaluation
- 06 Le Contenu Du Droit InternationalDocument140 pages06 Le Contenu Du Droit InternationalPedro Gomes AndradePas encore d'évaluation
- Behold The Wounds in Jesus HandsDocument5 pagesBehold The Wounds in Jesus HandsAnamaria SzarkowiczPas encore d'évaluation
- Cours Audit BancaireDocument87 pagesCours Audit BancaireSoumayah Arban100% (4)
- Droits Et Devoirs Des ElevesDocument2 pagesDroits Et Devoirs Des ElevesTatiana PogorPas encore d'évaluation
- Troude, Alexis - Les Relations Franco-SerbesDocument19 pagesTroude, Alexis - Les Relations Franco-SerbesskeniranaPas encore d'évaluation
- Canevas MéthodologiquesDocument32 pagesCanevas MéthodologiquesEl Marjani MokhtarPas encore d'évaluation
- Cours Modelisation AM Chap1 ProfDocument4 pagesCours Modelisation AM Chap1 ProfBouba RabebPas encore d'évaluation
- Cours Administration Réseau FinalDocument70 pagesCours Administration Réseau FinalAmir MirouPas encore d'évaluation
- TesvvstDocument3 pagesTesvvstHajar HSNPas encore d'évaluation
- Cours de Sociologie PolitiqueDocument2 pagesCours de Sociologie PolitiqueRamatoulaye SANEPas encore d'évaluation
- Glandes Salivaires FRDocument112 pagesGlandes Salivaires FRMadi LazarPas encore d'évaluation
- BGR Chirac Sans SDocument4 pagesBGR Chirac Sans SfistonvinyyPas encore d'évaluation
- Test de Grammaire DELF B1Document10 pagesTest de Grammaire DELF B1Anastasia BakunovichPas encore d'évaluation
- Roupe de Repetition Le Genie Se Developpe Tel: Tel: 671346005 Classe: Terminale D Matiere: Mathematique Sujet Type N°1Document2 pagesRoupe de Repetition Le Genie Se Developpe Tel: Tel: 671346005 Classe: Terminale D Matiere: Mathematique Sujet Type N°1Chaabane BOUALIPas encore d'évaluation
- A27 Complement Roles Infirmieres Chef 2017Document58 pagesA27 Complement Roles Infirmieres Chef 2017Youssef El BoukhariPas encore d'évaluation
- Obligation de Reserve Et Liberte SyndicaleDocument4 pagesObligation de Reserve Et Liberte SyndicaleZou DialloPas encore d'évaluation
- (Essais) Haroun - La Septième Wilaya - La Guerre Du FLN en France (1954-1962) - Seuil (1986)Document533 pages(Essais) Haroun - La Septième Wilaya - La Guerre Du FLN en France (1954-1962) - Seuil (1986)Omar DeckardPas encore d'évaluation
- La Sexualite de L'homme Romain AntiqueDocument12 pagesLa Sexualite de L'homme Romain Antiquelefino77Pas encore d'évaluation
- L'Ombre à l'Univers: La structure des particules élémentaires XIIfD'EverandL'Ombre à l'Univers: La structure des particules élémentaires XIIfPas encore d'évaluation
- Les enseignements secrets de la Gnose: Guide pratique d'initiation gnostiqueD'EverandLes enseignements secrets de la Gnose: Guide pratique d'initiation gnostiqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- L'Art d'avoir toujours raison (L'édition intégrale): La dialectique éristique - L'art de la controverse qui repose sur la distinction entre la vérité objective d'une proposition et l'apparence de véritéD'EverandL'Art d'avoir toujours raison (L'édition intégrale): La dialectique éristique - L'art de la controverse qui repose sur la distinction entre la vérité objective d'une proposition et l'apparence de véritéÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (177)
- Cesser de souffrir à cause de quelque chose qui n’existe pas !: De l'illusion de l'Ego à la Paix dans le monde : la Révolution commence à l'intérieur de nous-mêmeD'EverandCesser de souffrir à cause de quelque chose qui n’existe pas !: De l'illusion de l'Ego à la Paix dans le monde : la Révolution commence à l'intérieur de nous-mêmeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Bioénergie et Sciences Occultes: Pour un corps sain et un esprit sain dans un lieu sainD'EverandBioénergie et Sciences Occultes: Pour un corps sain et un esprit sain dans un lieu sainÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Essai sur le libre arbitre: Premium EbookD'EverandEssai sur le libre arbitre: Premium EbookÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Le Langage Métaphysique Des Hiéroglyphes ÉgyptiensD'EverandLe Langage Métaphysique Des Hiéroglyphes ÉgyptiensÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Paroles De Mon Âme: Un Dialogue Avec L'Âme Pour Mieux Vivre Sa VieD'EverandParoles De Mon Âme: Un Dialogue Avec L'Âme Pour Mieux Vivre Sa VieÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3)
- L'univers est intelligent. L'âme existe. Mystères quantiques, multivers, intrication, synchronicité. Au-delà de la matérialité, pour une vision spirituelle du cosmos.D'EverandL'univers est intelligent. L'âme existe. Mystères quantiques, multivers, intrication, synchronicité. Au-delà de la matérialité, pour une vision spirituelle du cosmos.Pas encore d'évaluation
- La Mort: Approche anthropologique et eschatologiqueD'EverandLa Mort: Approche anthropologique et eschatologiqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Voyager à Travers les Mondes Parallèles pour Atteindre vos RêvesD'EverandVoyager à Travers les Mondes Parallèles pour Atteindre vos RêvesÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (11)
- Métaphysique de l'amour (L'édition intégrale): Psychologie des désirsD'EverandMétaphysique de l'amour (L'édition intégrale): Psychologie des désirsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Cosmologie Égyptienne, L’Univers Animé, Troisième ÉditionD'EverandCosmologie Égyptienne, L’Univers Animé, Troisième ÉditionPas encore d'évaluation
- La Conscience Et L'Univers Existent Sans Commencement Ni FinD'EverandLa Conscience Et L'Univers Existent Sans Commencement Ni FinPas encore d'évaluation
- KANT: Oeuvres Majeures: Critique de la raison pratique + Doctrine de la vertu + Doctrine du droit + La Métaphysique des mœurs + Qu'est-ce que les Lumières ? + Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant + Analyse de sa philosophie…D'EverandKANT: Oeuvres Majeures: Critique de la raison pratique + Doctrine de la vertu + Doctrine du droit + La Métaphysique des mœurs + Qu'est-ce que les Lumières ? + Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant + Analyse de sa philosophie…Pas encore d'évaluation