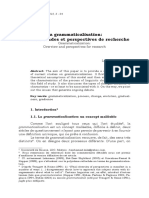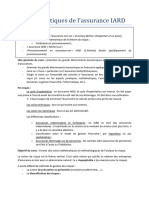Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
FDL Article p71
FDL Article p71
Transféré par
Livaï TrevorTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
FDL Article p71
FDL Article p71
Transféré par
Livaï TrevorDroits d'auteur :
Formats disponibles
Grammaire historique du chinois :
développements récents
Alain Peyraube*
INTRODUCTION
Les études de grammaire diachronique ont été incontestablement en Occident
la parente pauvre de la recherche linguistique au cours du siècle dernier. Dans les
années 1970, toutefois, à la suite des travaux de Greenberg (1963) sur les
universaux de langues, de nombreux travaux sur la typologie, mais aussi sur la
diachronie, tant il est vrai que les deux domaines sont vite apparus liés, ont vu le
jour. Depuis une quinzaine d’années, à l’instar de la linguistique typologique,
dont un des programmes essentiels est la recherche d’universaux dans les
langues, la grammaire historique a considérablement élargi sa perspective en se
voulant en partie tributaire de la linguistique cognitive dans son ensemble1. Elle
s’est ainsi attachée, au-delà de l’étude des changements que présentent toutes les
langues sans exception, à cerner les lois de fonctionnement de l'esprit humain.
L'idée est la suivante : derrière les changements grammaticaux particuliers, il y a
des principes organisateurs plus abstraits de la faculté dont ils procèdent, i.e. des
lois du fonctionnement de la faculté de langage. L’hypothèse essentielle est alors
qu'il y a des processus cognitifs à l'origine du changement grammatical.
Aussi, de même que les typologues recherchent en priorité des universaux
implicationnels, les diachroniciens sont-ils à la recherche de régularités, dans des
langues très diverses, qui attesteraient que le changement grammatical n'est pas le
fruit du hasard, mais obéit à des contraintes cognitives, voire biologiques, qui
nous aideraient à organiser nos perceptions et nos idées dans des voies similaires.
Comment s’établit concrètement ce lien entre linguistique cognitive et grammaire
historique ?
Dans leur introduction à la linguistique cognitive, Ungerer et Schmid (1996)
mentionnent dans leur dernier chapitre intitulé «Other issues in cognitive
linguistics» quelques questions qui ne ressortissent pas à proprement parler à la
linguistique cognitive, mais qui ont développé, sous l’influence de cette dernière,
des lignes de recherche originales et prometteuses. Ils citent ainsi les études sur
* CNRS et EHESS, Centre de recherches linguistiques sur l’Asie Orientale, Paris.
Courriel : peyraube@ehess.fr
1 Sur les liens étroits qui existent entre linguistique typologique et linguistique cognitive,
cf. Croft (1999).
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
72 Alain Peyraube
l’iconicité, sur la grammaticalisation, sur le changement lexical et sur
l’apprentissage et l’enseignement des langues étrangères.
Depuis cinq ans, en fait, les relations entre linguistique cognitive et grammaire
historique ne se limitent plus à quelques avancées théoriques et méthodologiques
concernant la seule notion de grammaticalisation. A l’inverse, les études
diachroniques ont aussi, de leur côté, contribué à ouvrir de nouvelles
perspectives au sein de la linguistique cognitive.
Ces tendances, on les retrouve naturellement en Chine, si ce n’est que le
mouvement a été inverse pour ce qui est des relations entre grammaire historique
et grammaire typologique. Ce sont les recherches en grammaire historique,
dominantes dans le monde académique chinois dès la fin des années 1970, qui
ont entraîné un développement des études en syntaxe typologique, en renouvelant
les approches théoriques et méthodologiques du domaine traditionnel qui était la
dialectologie, limitée au demeurant à la phonétique et à la phonologie.
Un état des lieux relativement détaillé sur les recherches menées en syntaxe
historique du chinois de la fin des années 1970 à 1994 a été dressé dans Peyraube
(1996) où l’origine et le développement de plusieurs structures fondamentales de
la langue chinoise (ordre des mots et changement d’ordre des mots, marqueurs
d’objet direct différentiels, formes passives, constructions datives, locatives,
aspectuelles, prépositions et conjonctions, classificateurs, pronoms personnels et
démonstratifs, etc.) ont été abondamment discutés. On se contentera donc ici de
prolonger ce panorama pour les vingt dernières années (1995-2015), au cours
desquelles les études en grammaire historique se sont considérablement
développées et approfondies.
De nouvelles hypothèses sur l’histoire des structures mentionnées ci-dessus ont
été formulées, d’autres constructions ont été étudiées (auxiliaires modaux, verbes
directionnels, adverbes, particules finales, etc.). Des ouvrages importants ont
aussi été publiés, sous la forme de monographies générales (Jiang S. 2005, Jiang
S. & Cao G. 2005, Wu F. 2005, Cao G. & Yu H. 2006, Jiang L. 2008), ou sur
des problèmes spécifiques (Cao G. 1995 sur les particules aspectuelles,
structurales et modales, Sun 1996 sur le changement d’ordre des constituants, ou
sur des textes ou des périodes bien définis de l’époque médiévale (Wu F. 1997,
2003, Zhang M. 2003).
Les chercheurs chinois ont aussi tenu, au cours des deux dernières décennies, à
inscrire délibérément leurs études dans le contexte international, et cela a été
nouveau. Les analyses des mécanismes du changement grammatical en chinois
ont pris deux directions : (i) discussion des processus de syntaxe diachronique
tels qu’ils étaient identifiés en linguistique générale, avec application
systématique à la langue chinoise ; (ii) mise au jour d’opérations récurrentes et de
voies de grammaticalisation propres au chinois.
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
Grammaire historique du chinois 73
1. MODELE DU CHANGEMENT GRAMMATICAL
Les spécialistes chinois du changement grammatical admettent volontiers que
les deux mécanismes internes essentiels du changement sont ceux qu’avaient
identifiés Meillet dès 1912, i.e. l’analogie et la grammaticalisation. Ils cherchent
aussi à apporter des réponses aux deux questions suivantes : (i) qu’est-ce qui
motive, en premier lieu, une grammaticalisation ? (ii) quels sont les résultats
qu’elle engendre ? Un troisième mécanisme, mais externe, intervient aussi dans le
changement : l’emprunt externe, dû au contact prolongé avec des langues
typologiquement différentes.
Le processus de grammaticalisation a été considérablement privilégié et
discuté au cours des dernières années. Rien d’étonnant à cela quand on sait que
ce concept de grammaticalisation, dans la définition même de Meillet
«(«attribution du caractère grammatical à un mot jadis autonomie») était
familier aux chercheurs chinois depuis bien longtemps. Dès la dynastie des Yuan
(1279-1368), en effet, le lettré Zhou Boqi 周伯琦 affirmait :
‘今之虚字皆古之实字 jīn zhī xū zì jiē gŭ zhī shí zì’ (tous les ‘mots vides’ [i.e.
éléments grammaticaux] d’aujourd’hui sont d’anciens ‘mots pleins’ [i.e. items
lexicaux]).
Les questions qui ont été débattues ont alors été celles qui étaient l’objet de
réflexions approfondies au sein de la communauté internationale, à savoir : (a)
est-ce que le processus de grammaticalisation a une quelconque valeur théorique,
surtout après la parution de Newmeyer (1998, chapitre ‘Deconstructing
grammaticalization’, qui revendiquait que «there is no such thing as
grammaticalization, at least in so far as it might be regarded as a distinct
grammatical phenomenon requiring a distinct set of principles for explanation» ;
(b) existe t-il un principe d’unidirectionnalité qui gouverne le mécanisme de
grammaticalisation, et ce principe a-t-il une quelconque importance théorique ?
(c) qu’en est-il des cas connus de dégrammaticalisation qui contredisent le
principe d’unidirectionnalité ? (d) la notion d’‘exaptation’ empruntée au domaine
de la biologie (cf. Lass 1990) est-elle d’une quelconque utilité pour rendre
compte du changement grammatical en chinois ? (e) l’extension métaphorique,
l’inférence pragmatique (ou métonymisation) et la subjectivité / inter-subjectivité
sont-elles les motivations essentielles du changement syntaxique et, en
conséquence, des mécanismes centraux du changement sémantico-pragmatique.
On trouvera un état détaillé de ces discussions dans Chappell & Peyraube
(2011) et Peyraube (2005, 2015). Contentons-nous ici de résumer brièvement les
principaux acquis qui résultent de ces nouvelles recherches.
1.1. Analogie
Le processus d’analogie (lèituī 类推), souvent cité dans les travaux des
linguistes chinois, n’a pas été pour autant l’objet de recherches approfondies au
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
74 Alain Peyraube
cours des dernières années. Un certain nombre d’entre eux ont d’ailleurs
considéré qu’il s’agissait plus d’un facteur motivant que d’un mécanisme pur et
simple. La définition qu’ils en donnent est souvent reprise de celle de McMahon
(1994 : 71) : «generalization of a morpheme or relation which already exists in
the language into new situations or forms». Plus récemment, cependant, les
nouvelles recherches de Kiparsky (2012), qui distingue une «examplar-based
analogy» et une «non-examplar-based analogy» ont retenu l’attention des
diachroniciens chinois pour rendre compte des nombreux cas de fusion en bas-
archaïque (chinois classique par excellence, 5ème - 2ème siècles avant notre ère),
ou des cas de séparation quelques siècles plus tard, sous la dynastie des Han (1er
siècle avant notre ère).
Exemples de fusion en bas-archaïque : zhī 之 ‘pronom personnel de la
troisième personne’ + yú 于 ‘à’ > zhū 诸 ; bù 不 ‘négation’ + zhī 之 ‘pronom
personnel de la troisième personne’ > fú 弗 ; yú 于 ‘à, de’ + zhī 之 ‘pronom
personnel de la troisième personne’ > yān 焉 ; etc. Exemples de séparation en
pré-médiéval, sous les Han : zhū 诸 > zhī 之+ yú于; fú 弗 > bù 不 + zhī 之; yān
焉 > yú 于 + zhī 之.
1.2. Réanalyse et grammaticalisation
La réanalyse (on parle aussi volontiers de nos jours de ‘néoanalyse’) est un
concept plus récent que celui de grammaticalisation. Il est toutefois très utilisé,
avec la définition qu’en donnait Langacker dès 1977 : «Change in the structure
of an expression or class of expressions that does not involve any immediate or
intrinsic modification of its surface manifestation». Les deux notions de
grammaticalisation et de réanalyse ont été et sont toujours souvent confondues
par beaucoup de linguistes chinois, en raison même du fait que la plupart des cas
de réanalyse dans la langue chinoise sont des cas de grammaticalisation. On ne
sait donc pas très bien s’ils considèrent que la réanalyse est un sous-produit de la
grammaticalisation ou bien l’inverse. Le fait est que peu d’entre eux sont enclins
à admettre, à l’instar de Harris & Campbell (1995: 61), que la réanalyse, et non
pas la grammaticalisation, est l’un des deux mécanismes internes du changement
grammatical, le second étant l’analogie.
Depuis une dizaine d’années, toutefois, le processus de réanalyse est davantage
étudié, avec la définition suivante de Hagège (1993: 62), reprise en chinois par
Peyraube (2005), qui seule permet de rendre compte de phénomènes comme le
changement d’ordre des mots, qui ne sont pas des cas de grammaticalisation :
«An operation by which language builders cease to analyze a given structure as
they did previously, and introduce a new distribution of, and new relations
between, the syntactic units that constitute this structure».
En ce qui concerne la grammaticalisation à proprement parler, des centaines
d’articles lui ont été consacrés depuis le début des années 2000. La définition de
Meillet (1912) a été bien sûr complétée pour s’étendre aux constructions et pour
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
Grammaire historique du chinois 75
autoriser des grammaticalisations à partir de formes déjà grammaticalisées (ce
qu’on a aussi appelé la ‘grammaticalisation secondaire’). Voir la définition de
Hopper & Traugott (2003: 231): «Grammaticalization is a robust tendency for
lexical items and constructions to be used in certain linguistic contexts to serve
grammatical functions, and once grammaticalized, to be used to further develop
new grammatical functions».
Beaucoup de linguistes chinois ont aussi préféré adopter la définition
beaucoup plus large de Greenberg (1991: 303) pour qui «grammaticalization is
not only a shift from lexical to grammatical. It is ‘(a) process of development of
grammatical elements from all sources», qui revient de fait à confondre
grammaticalisation et changement grammatical, quel qu’il soit.
Pour le reste, la linguistique chinoise a repris les tendances dégagées en
linguistique générale, en les illustrant avec des exemples chinois révélateurs. Ont
été ainsi confirmés : (i) la tendance à ne grammaticaliser que des items lexicaux
suffisamment généraux, autrement dit des hyperonymes comme les verbes ‘dire’,
‘donner’ ou ‘aller’ (et non pas ‘murmurer’, ‘octroyer’ ou ‘déambuler’) ; (ii)
l’existence de degrés de grammaticalisation, par exemple l’évolution graduelle
suivante qui mène du verbe à la conjonction : gòng 共 [+ Verbe] ‘partager’ > [+
Adverbe] ‘ensemble’ > [+ Préposition] ‘avec’ > [+ Conjonction] ‘et’ ; le fait que
la grammaticalisation obéit souvent à un processus cyclique, déjà identifié par
Gabelentz (1891 : 251). Mais le ‘principe’ associé à la grammaticalisation, qui a
été le plus discuté au cours de ces dernières années, est certainement le ‘principe
d’unidirectionnalité’ (voir la section 1.4 ci-dessous).
1.3. Exaptation
Le terme ‘exaptation’, largement utilisé aujourd’hui dans les études de
morpho-syntaxe historique a été employé en biologie évolutionnaire par Gould
(1983, cité par Lass 1990: 80) : «We wish to restrict the term adaptation only to
those structures that evolved for their current utility; those useful structures that
arose for other reasons, or for no conventional reasons at all, and were
fortuitously available for other changes, we call exaptations». Pour Lass, en
linguistique, «Exaptation … is the opportunistic co-optation of a feature whose
origin is unrelated or only marginally related to its later use … In other words
(loosely) a conceptual novelty or invention». Autrement dit, le phénomène
d’exaption consiste à ré-utiliser une forme grammaticale qui a disparu ou qui est
devenue très marginale en lui donnant une nouvelle fonction qui n’est reliée en
aucune sorte à la fonction qu’elle véhiculait auparavant (cf. Traugott 2004).
Peu de cas d’exaptation ont été relevés jusqu’à présent dans l’histoire des
formes grammaticales du chinois, sans doute parce que les linguistes chinois ont
accordé peu d’attention à ce phénomène, qui a été pourtant abondamment
discuté, notamment par Wu F. (2005). On peut néanmoins citer la nouvelle
utilisation de la particule modale du chinois archaïque (5ème- 2ème siècles avant
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
76 Alain Peyraube
notre ère) yě 也 comme un adverbe signifiant ‘aussi’, sept ou huit siècles plus
tard, en chinois médiéval. Un autre cas, identifié par Cao Guangshun
(communication personnelle), pourrait être l’emploi nouveau de nà 那, qui était
une préposition locative (avec le sens de ‘à’) dans les textes bouddhiques des
2ème-5ème siècles de notre ère, comme un pronom démonstratif lointain (sens de
‘cela’) dès la dynastie des Tang (7ème - 10ème siècles).
1.4. Uni-directionnalité et lexicalisation / dégrammaticalisation
Le ‘principe d’unidirectionnalité’, en revanche, supposé être une des
caractéristiques essentielles de la grammaticalisation, a été tout de suite accepté
par les linguistes chinois2. Il est vrai qu’il confirme ce que pensent les lettrés
chinois depuis longtemps, à savoir que les dérivations vont dans le sens des items
lexicaux (ou ‘mots pleins’, shící 实词 en chinois) vers des éléments
grammaticaux (ou ‘mots vides’ xūcí 虚词), et jamais dans une direction opposée.
Ils soulignent toutefois qu’il est sans doute inutile de faire appel à ce ‘principe
d’unidirectionnalité’ dans la mesure où il s’agit d’une caractéristique définitoire
de la grammaticalisation (la grammaticalisation est unidirectionnelle par
définition). Cf. Wu F. 2003, 2005.
Il existe aussi en chinois quelques cas de ‘dégrammaticalisation’ (évolution
d’un élément grammatical vers un item lexical, ou d’un ‘mot vide’ vers un ‘mot
plein’), mais la plupart des linguistes chinois les traitent comme des cas de
‘lexicalisation’. Il est vrai qu’ils sont beaucoup moins nombreux que les
exemples connus dans les langues indo-européennes3. On peut citer cependant :
Adverbe tóng 同 ‘ensemble’ > Nom tóng 同 (dans sān tóng 三同 ‘les trois
ensembles’, par exemple); pronom démonstratif shì 是 ‘ceci’ > verbe shì 是
‘être’ ; etc.
Cela dit, comme pour la grammaticalisation où on a noté plus haut que certains
linguistes chinois préféraient adopter la définition large de Greenberg (1991 :
303) pour qui la grammaticalisation est synonyme de changement grammatical, la
lexicalisation est conçue par certains comme une ‘intégration de mots dans le
lexique’ par quel que procédé que ce soit, y compris, en chinois, les opérations
classiques de composition, dérivation, réduplication. D’autres, plus nombreux,
considèrent que la lexicalisation doit être limitée à un processus historique dont
la direction est inverse de celle du mécanisme de grammaticalisation, à savoir le
changement opère à partir d’un élément grammatical qui évolue vers un item
lexical.
2Cf. Haspelmath (1999) qui soutient que la ‘grammaticalization is irreversible’.
3 Un exemple typique de ‘dégrammaticalisation’ en français est l’évolution des
prépositions ‘pour’ ou ‘contre’ vers des noms, comme dans «le pour et le contre».
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
Grammaire historique du chinois 77
1.5. Emprunt externe ou changement grammatical inféré par contact entre
langues
Les recherches les plus prometteuses et les plus récentes concernant la
grammaire historique du chinois ont incontestablement concerné le troisième
mécanisme du changement grammatical, le mécanisme externe (et non plus
interne) inféré par le contact entre langues qui conduit à l’emprunt externe, défini
ainsi : «It is an attempted reproduction in one language of patterns previously
found in another» (Haugen 1950, cité in McMahon, 1994: 200).
Ce mécanisme, en effet, n’a pas été l’objet de recherches approfondies pendant
plusieurs décennies, les linguistes chinois ayant privilégié les processus internes.
Ce n’est qu’au cours des dernières dix années que les travaux de Thomason &
Kaufman (1988), de Thomason (2001), de Heine & Kuteva (2002, 2005) ont
conduit une équipe de l’Académie des sciences sociales de Chine à considérer
l’emprunt externe comme une motivation essentielle, voire primordiale du
changement grammatical.
Les différents principes et contraintes qui ont été identifiés, notamment par
Moravcsik 1978, ont été vite considérés comme inopérants4, et les chercheurs
chinois ont concentré leurs recherches sur les langues sinitiques parlées dans le
nord-ouest de la Chine, en contact avec les langues altaïques, et sur les langues
du sud-est, en contact avec les langues tai-kadai et/ou austro-asiatiques, en
adoptant les cadres théoriques et méthodologiques de Thomason d’une part, de
Heine et Kuteva d’autre part. Ils parlent ainsi de ‘transferts’ et non plus
d’emprunts de structures grammaticales d’une langue modèle (model language)
vers une langue cible (replica language).
S’agissant de grammaire historique, les efforts ont naturellement porté sur les
périodes où les transferts ont été les plus nombreux, et notamment lorsque une
bonne partie de la Chine était sous l’emprise et l’administration de dynasties
extérieures, les dynasties Liao (khitane, 907-1125), Jin (djourchète, 1115-1234),
Yuan (mongole, 1206-1368), et Qing (mandchoue, 1644 à 1911). Cf. Cao G. &
Chen D. (2009), Cao G. (2012), Djamouri (2015), Yu H. (2011, 2013), Yang Y.
(2015), Zu S. (2009).
Ces recherches ont déjà contribué à une meilleure compréhension des
caractéristiques typologiques qui différencient les langues sinitiques et à une
identification plus précise des aires linguistiques (voir plus loin le texte de
Chappell, en introduction de la troisième partie de ce numéro).
4 Par exemple le principe qui veut qu’une langue emprunte des structures auprès d’une
langue qui est plus prestigieuse. Il y a, en effet, de nombreux exemples d’emprunts en
chinois qui ont été faits auprès de langues altaïques qui étaient loin d’avoir le prestige de
la langue chinoise. L’opposition entre zánmen 咱们 'nous, pluriel inclusif' vs wǒmen 我们
'nous, pluriel exclusif’, qui est apparue dans la langue chinoise au 12ème siècle a été
emprunté à la langue djourchète, ancêtre direct du mandchou.
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
78 Alain Peyraube
2. CONTRIBUTIONS DANS CE VOLUME
Les trois articles sélectionnés dans cette deuxième partie consacrée à la
diachronie rendent compte des développements récents de la recherche dans ce
domaine, esquissés ci-dessus. Aussi, deux d’entre eux sont-ils consacrés à ce
qu’il est convenu d’appeler maintenant la linguistique de contact, mais
appréhendée dans la diachronie. Seul, le premier d’entre eux (celui de Djamouri)
renvoie à des discussions anciennes, mais toujours d’actualité et qui ont encore
fait l’objet, au cours des deux dernières années, de débats très intenses : l’ordre
des mots et le changement d’ordre des mots en chinois.
2.1. R. Djamouri
L’auteur montre dans cette contribution que l’ordre basique des mots de la
langue chinoise est et a toujours été un ordre SVO, et cela dès les plus anciens
documents découverts à ce jour, à savoir les inscriptions sur os et carapaces de
tortue de l’époque Shang (13ème - 11ème siècles avant notre ère). Il n’y a donc
aucune raison de penser que cet ordre ait pu être SOV en proto-chinois, sous le
seul prétexte que les langues tibéto-birmanes (qui forment l’autre branche du
sino-tibétain) manifestent, à quelques exceptions près, un ordre régulier SOV, et
qu’on pourrait ainsi recontruire un ordre SOV en sino-tibétain.
L’auteur s’intéresse plus particulièrement à cette structure particulière du
chinois ancien qui est la position préverbale du pronom objet dans des phrases
négatives, phénomène qui est observable sur plusieurs siècles, des plus anciennes
inscriptions des Shang (13ème siècle avant notre ère) jusqu’aux textes de la fin de
la dynastie des Han (2ème siècle de notre ère). Il montre bien que cette position
préverbale ne peut pas être analysée comme un reliquat d’un ordre plus ancien.
Cet emploi préverbal de l’objet direct dans les phrases négatives répond en
effet à une contrainte syntaxique précise et stricte qui a eu cours dès l’époque des
Shang, où seul l’usage de la négation bù est alors attesté. Ce marqueur de
négation ayant aussi une fonction de copule verbale, il permet d’extraire le
pronom objet et de former ainsi une phrase clivée. On a alors affaire à une
structure bù PRON.OBJ, qui correspond de fait à un ordre VO et non pas à un
ordre OV.
Djamouri remarque enfin que dans les documents ultérieurs de l’époque
archaïque qui représentent le chinois classique par excellence (5ème - 2ème siècles
avant notre ère), il y a finalement presque autant de phrases négatives où le
pronom objet apparaît en position préverbale que de phrases négatives où il
apparaît en position postverbale.
2.2. Cao Guangshun & Yu Hsiao-jung
Dans leur étude systématique des emprunts du chinois auprès de langues
n’appartenant pas au groupe des langues sinitiques, Cao G. et Yu H. ont identifié
deux périodes de l’histoire chinoise au cours desquelles ces emprunts ont été
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
Grammaire historique du chinois 79
significatifs : (i) la période médiévale (3ème - 7ème siècles) où les nombreuses
traductions de soutras bouddhiques en sanscrit (ou, plus vraisemblablement en
différents prakrits) ont exercé une influence non négligeable sur le
développement de la langue chinoise vernaculaire et (ii) l’époque où la Chine
était soumise à l’Empire mongol (dynastie mongole Yuan, 1271-1368).
Ils ont ainsi identifié des caractéristiques atypiques, notamment l’utilisation de
la particule yǐ 已 comme marqueur aspectuel pour l’accompli, celle de qǔ
取comme marqueur d’objet préverbal pour former des phrases ‘disposales’, ou
encore l’emploi de gù 故 comme marqueur de cause à la fin des phrases, autant
de phénomènes qui sont courants dans les textes bouddhiques médiévaux, et qui
ont fortement influencé la langue chinoise standard de l’époque. L’origine de la
fameuse construction ‘disposale’ (avec un marqueur d’objet préverbal) du
chinois pourrait être ainsi retracée à partir de qǔ 取.
En ce qui concerne la deuxième vague d’emprunts, sous la dynastie des Yuan,
ils ont analysé les marqueurs d’objet post-positionnels comme gēndǐ 根底, shàng
上 ou háng 行 qui ont été empruntés du mongol. Ils ont aussi longuement analysé
les phrases qui révèlent un ordre OV, issu assurément des contacts avec les
langues altaïques.
2.3. Chen Dandan
Chen D. s’est aussi intéressée à cet ordre des mots OV dans la langue
vernaculaire des Yuan, qui est souvent différent de l’ordre des mots standard du
chinois (VO). Elle retrace aussi les caractéristiques principales de cette langue
appelée par Ohta Tatsuo (1957) Hàn’ér yányǔ 汉儿言语, dont on sait aujourd’hui
qu’elle était devenue la langue commune du nord de la Chine, et notamment de
Dadu (ancien nom de Pékin), et qui était très fortement influencée par le mongol.
Elle analyse également dans les textes juridiques des Yuan l’utilisation des
postpositions locatives shàng 上 et shàngtou 上头 pour indiquer la causalité, les
postpositions gēndǐ, shàng et háng comme marqueurs d’objet et formule des
hypothèses sur l’apparition de telles structures singulières, qui seraient le résultat
d’interférences initiées par les locuteurs mongols de l’époque lorsqu’ils
s’exprimaient en chinois. Pour ce faire, elle a mené une étude détaillée des
dialogues dans le Yuáncháo mìshǐ 元朝秘史 ‘Histoire secrète des Mongols’ (13ème
siècle).
BIBLIOGRAPHIE
Cao Guangshun, 1995, Jindai hanyu zhuci [Particules du chinois médiéval et
moderne], Beijing, Yuwen chubanshe.
Cao Guangshun, 2012, Xibei fangyan teshu yufa xianxiang yu Hanyu shi zhong
yuyan jiechu yinfa de yufa gaibian – yige fanchou weili [Traits syntaxiques
spéciaux dans les dialectes du nord-ouest et changement syntaxique au cours
de l’histoire de la langue chinoise – problème des cas], Lishi yuyanxue yanjiu
5, p. 85-94.
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
80 Alain Peyraube
Cao Guangshun & Chen Dandan, 2009, Yuan baihua teshu yuyan xianxiang zai
yanjiu [Etude de traits syntaxiques spéciaux dans la langue vernaculaire des
Yuan], Lishi yuyanxue yanjiu 2, p. 108-123.
Cao Guangshun & Yu Hsiao-jung, 2006, Zhonggu hanyu yufa shi yanjiu
[Recherches en grammaire diachronique du chinois médiéval], Chengdu,
Bashu shushe.
Chappell H. & Peyraube A., 2011, Grammaticalization in Sinitic Languages, in
H. Narrog & B. Heine (eds.), The Oxford Handbook of Grammaticalization,
Oxford, Oxford University Press, p. 786-796.
Croft W., 1999, Some Contributions of Typology to Cognitive Linguistics and
Vice-versa, in T. Janssen & G. Redeker (eds.), Cognitive Linguistics :
Foundations, Scope and Methodology, Berlin, Mouton de Gruyter, p. 61-94.
Djamouri R., 2015, Object positioning in Tangwang, in Cao Guangshun, R.
Djamouri & A. Peyraube (éds.), Languages in contact in Northwestern
China, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, p. 251-276.
Dong Xiufang, 2012, Lexicalization in the history of the Chinese language, in J.
Z. Xing (ed.), Newest trends in the study of grammaticalization and
lexicalization in Chinese, Berlin, de Gruyter Mouton, p. 235-274.
Gabelentz G. von der, 1891, Die Sprachwissenschaft: ihre Aufgaben, Methoden
und bisherigen Ergebnisse, Leipzig, Weigel.
Gould S. J., 1983, Hen’s Teeth and Horse’s Toe. Further Reflections in Natural
History, New York, Norton.
Greenberg J. H., 1963, Some Universals of Grammar with Particular Reference
to the Order of Meaningful Elements, in J. H. Greenberg (ed.), Universals of
Language, Cambridge (Mass.), MIT Press, p. 58-90.
Greenberg J. H., 1991, The last stages of grammatical elements: contractive and
expansive desemanticization, in E. C. Traugott & B. Heine (eds.),
Approaches to grammaticalization, Amsterdam, John Benjamins, p. 301-314.
Hagège C., 1993, The Language Builder, Amsterdam, John Benjamins.
Harris A. & Campbell L., 1995, Historical syntax in cross-linguistic perspective.
Cambridge, Cambridge University Press.
Haspelmath M., 1999, Why is grammaticalization irreversible?, Linguistics 37,
p. 1043-1068.
Haugen E., 1950, The Analysis of Linguistic Borrowing, Language 57, p.183-
191.
Heine B. & Kuteva T., 2002, Word Lexicon of Grammaticalization, Cambridge,
Cambridge University Press.
Heine B. & Kuteva T., 2005, Language Contact and Grammatical Change,
Cambridge, Cambridge University Press.
Hopper P. & Traugott E. C., 2003, Grammaticalization, Cambridge, Cambridge
University Press.
Jiang Lansheng, 2008, Jindai hanyu yanjiu xin lun [Nouvelles recherches sur le
chinois medieval et moderne], Beijing, Shangwu yinshuguan.
Jiang Shaoyu, 2005, Jindai hanyu yanjiu gaiyao [Sur les recherches en chinois
médiéval et chinois moderne], Beijing, Beijing daxue chubanshe.
Jiang Shaoyu & Cao Guangshun, 2005, Jindai hanyu yufa shi [Grammaire
historique du chinois médiéval et moderne], Beijing, Shangwu yinshuguan.
Kiparsky P., 2012, Grammaticalization as Optimization, in D. Jonas, J. Whitman
& A. Garrett (eds.), Grammatical Change: Origins, Nature, Outcomes,
Oxford, Oxford University Press.
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
Grammaire historique du chinois 81
Langacker R., 1977, Syntactic Renalysis, in C. N. Li (ed.), Mechanisms of
syntactic change, Austin, University of Texas Press, p. 57-139.
Lass R., 1990, How to do things with junk: exaptation in language evolution,
Journal of Linguistics 26, p. 79-102.
McMahon A., 1994, Understanding Language Change, Cambridge, Cambridge
University Press.
Meillet A., 1912, L’évolution des structures grammaticales, in A. Meillet,
Linguistique historique et linguistique générale, Paris, Champion, 1948, p.
130-148.
Moravcsik E., 1978, Language contact, in Greenberg J., Ferguson C. &
Moravcsik E. (eds.), Universals of Human Language, Stanford, Stanford
University Press. 93-123.
Newmeyer F., 1998, Language form and function, Cambridge (Mass.), MIT
Press.
Ohta Tatsuo, 1958, Chungokugo Rekishi Bunpo [Grammaire historique du
chinois], Tokyo, Konan Shoin.
Peyraube A., 1996, Recent Issues in Chinese Historical Syntax, in J. C.-T. Huang
& A. Y-H. Li (eds.), New Horizons in Chinese Linguistics, Dordrecht,
Kluwer Academic Publishers, p.161-214.
Peyraube A., 2005, Leitui, yufahua, qu yufahua yu gongneng gengxin [Analogie,
grammaticalisation, degrammaticalisation et exaptation], Communication au
3ème Colloque international sur la grammaticalisation, Luoyang (Chine), 27-
28 octobre.
Peyraube A., 2015, Syntactic and Semantic Change in Chinese, Newcastle and
Northumbria Working Papers in Linguistics 21-1, p. 112-119.
Sun, C., 1996, Word Order Change and Grammaticalization in the History of
Chinese, Stanford, Stanford University Press.
Thomason S., 2001, Language contact, Edinburgh, Edinburgh University Press.
Thomason S., & Kaufman T., 1988, Language Contact, Creolization and
Genetic Linguistics, Berkeley and Los Angeles, University of California
Press.
Traugott E. C., 2004, Exaptation and grammaticalization, in Minoji Akimoto
(ed.), Linguistic studies based on corpora, Tokyo, Hituzi Syobo Publisihing
Co., p. 133-156.
Ungerer F. & Schmid H. J., 1996, An introduction to Cognitive Linguistics,
London & New York, Longman.
Wu Fuxiang, 1997, ‘Dunhuang bianwen’ yufa yanjiu [Recherches sur la
grammaire des ‘Textes transformationnels de Dunhuang’], Yuelu shushe.
Wu Fuxiang, 2003a, ‘Zhuzi yulei jilüe’ yufa yanjiu [Recherches sur la
grammaire des ‘Propos de Zhu Xi’], Kaifeng, Henan daxue chubanshe.
Wu Fuxiang, 2003, Guanyu yufahua de danxiangxing wenti (Sur le problème de
l’unidirectionnalité dans la grammaticalisation), Dangdai yuyanxue 4. Repris
in Wu Fuxiang, Yufahua yu hanyu lishi yufa yanjiu [Grammaticalisation et
recherches en syntaxe diachronique du chinois], Hefei, Anhui jiaoyu
chubanshe, p. 24-49.
Wu Fuxiang, 2005, Hanyu yufahua yanjiu [Recherches sur la
grammaticalisation en chinois], Beijing, Shangwu yinshuguan.
Yang Yonglong, 2015, Song-Jin shiqi Hanyu yu Nüzhen yu de jiechu shuolüe
[Sur le contact de langues entre le chinois et le djourchète sous les dynasties
des Song et des Jin], in Cao Guangshun, R. Djamouri & A. Peyraube (éds.),
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
82 Alain Peyraube
Languages in contact in Northwestern China, Paris, Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, p. 75-96.
Yu Hsiao-jung, 2011, Shiyong duibi fenxi Lao Qida zhong de teshu yuyan
xianxiang [Analyse contrastive et phénomènes syntaxiques spéciaux dans le
Lao Qida], Lishi yuyanxue yanjiu 4, p. 1-17.
Yu Hsiao-jung, 2013, Contact and change in the history of Chinese language, in
Cao Guangshun, H. Chappell, R. Djamouri & T. Wiebusch (eds.), Breaking
down the barriers: Interdisciplinary studies in Chinese linguistics and
beyond, Taipei, Academia Sinica, p. 485-501.
Zhang Meilan, 2003, ‘Zu tang ji’ yufa yanjiu [Recherches sur la grammaire du
‘Recueil de la salle des patriarches’], Beijing, Shangwu yinshuguan.
Zu Shengli, 2009, Yuandai de Han’er yanyu [Sur la langue Han’er à l’époque
des Yuan], Lishi yuyanxue yanjiu 2, p. 124-135.
Downloaded from Brill.com01/09/2023 12:30:20PM
via free access
Vous aimerez peut-être aussi
- 34 - Problemes de Linguistique Generale t1 t2 BenvenisteDocument636 pages34 - Problemes de Linguistique Generale t1 t2 BenvenisteAnca Silviana96% (54)
- Problèmes de Linguistíque GénéraleDocument372 pagesProblèmes de Linguistíque GénéraleBreno Gomes100% (3)
- Cours de linguistique générale (Edition Illustrée - 1916)D'EverandCours de linguistique générale (Edition Illustrée - 1916)Pas encore d'évaluation
- Philosophies du langage: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandPhilosophies du langage: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- L'apprentissage implicite du langage: Étude des liens entre facteurs psycholinguistiques et langageD'EverandL'apprentissage implicite du langage: Étude des liens entre facteurs psycholinguistiques et langagePas encore d'évaluation
- Notions de Linguistique Générale (FR)Document19 pagesNotions de Linguistique Générale (FR)kamal100% (3)
- Dans tous les sens du termeD'EverandDans tous les sens du termeJean QuirionÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Le Loup Dans La Bergerie - Droi - Jean-Claude Michea PDFDocument125 pagesLe Loup Dans La Bergerie - Droi - Jean-Claude Michea PDFabderrrassoul100% (2)
- Structuralisme: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandStructuralisme: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Analyse DiscursiveDocument5 pagesAnalyse DiscursivehyoussemPas encore d'évaluation
- Corpus en Analyse de DiscoursDocument32 pagesCorpus en Analyse de Discoursdanipari100% (2)
- CHEVALIER JC, La Langue. Linguistique Et HistoireDocument26 pagesCHEVALIER JC, La Langue. Linguistique Et HistoireEDisPALPas encore d'évaluation
- LinguistiqueDocument25 pagesLinguistiqueallegPas encore d'évaluation
- Aprecu Des Theories Et Des Methodes de TraductionDocument22 pagesAprecu Des Theories Et Des Methodes de TraductionDenitsa Dimova100% (1)
- Le prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesD'EverandLe prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesPas encore d'évaluation
- Eléments D'analyse Du Discours (Georges-Elia Sarfati)Document145 pagesEléments D'analyse Du Discours (Georges-Elia Sarfati)Bounama Mbengue100% (1)
- Linguistique Analyse Du Discours Et InterdisciplinariteDocument15 pagesLinguistique Analyse Du Discours Et InterdisciplinariteLe CroaePas encore d'évaluation
- Cours de Linguistique-ExempleDocument5 pagesCours de Linguistique-ExemplehattabsatPas encore d'évaluation
- De La Methode en Traduction Et en TraducDocument228 pagesDe La Methode en Traduction Et en TraducAdm DF100% (2)
- Courants Et Approches en TraductologieDocument31 pagesCourants Et Approches en TraductologienikasolaPas encore d'évaluation
- Réel Symbolique ImaginaireDocument51 pagesRéel Symbolique Imaginaireminushka33Pas encore d'évaluation
- GC SM QHSE MC-1-Démarche CompétenceDocument27 pagesGC SM QHSE MC-1-Démarche CompétenceHajjej YasserPas encore d'évaluation
- Linguistique PDFDocument6 pagesLinguistique PDFRachid KhalifaPas encore d'évaluation
- Fiche TD1 MDS1Document3 pagesFiche TD1 MDS1RABIE BENTAIEBPas encore d'évaluation
- Communicationorganisation 2427Document10 pagesCommunicationorganisation 2427Fatiha ZounidPas encore d'évaluation
- Le mythe de l'innéité du langage: Essai de linguistiqueD'EverandLe mythe de l'innéité du langage: Essai de linguistiquePas encore d'évaluation
- Fuchs - La Paraphrase (LF 1982)Document13 pagesFuchs - La Paraphrase (LF 1982)rverano1983Pas encore d'évaluation
- Thème 25 CEDE - Concept Et Articulation Du DiscoursDocument24 pagesThème 25 CEDE - Concept Et Articulation Du DiscoursMarga VicentePas encore d'évaluation
- Arbres de Decision 3Document22 pagesArbres de Decision 3byeboy007Pas encore d'évaluation
- Chapitre 01 Architecture Des Réseaux ÉlectriquesDocument9 pagesChapitre 01 Architecture Des Réseaux Électriquesabed elkader Laamri100% (2)
- Stranger Things Opening ThemeDocument2 pagesStranger Things Opening ThemeWerbert Brito VianaPas encore d'évaluation
- Fiche Pédagogique de PELDocument2 pagesFiche Pédagogique de PELOns LassouedPas encore d'évaluation
- Beacco y Darot - Analyse - de - Discours - Et - Textes - de - Specialité PDFDocument50 pagesBeacco y Darot - Analyse - de - Discours - Et - Textes - de - Specialité PDFvic_kymeras_entusojos4442Pas encore d'évaluation
- La GrammaticalisationDocument20 pagesLa GrammaticalisationIdir MazighPas encore d'évaluation
- Les Tendances de La Neologie Terminologique en Français ContemporainDocument10 pagesLes Tendances de La Neologie Terminologique en Français ContemporainMaroua Benk99rimaPas encore d'évaluation
- CIEL2000-2003la Metaphore Dudisc Gen Aux Disc SpecialisesDocument212 pagesCIEL2000-2003la Metaphore Dudisc Gen Aux Disc Specialisesraluca_gt100% (1)
- Article15Agnes Pernet LiuDocument8 pagesArticle15Agnes Pernet LiuSadiq ASMAPas encore d'évaluation
- Linguistic Contributions To The Development of Translation Studies in ChinaDocument10 pagesLinguistic Contributions To The Development of Translation Studies in ChinaGlittering FlowerPas encore d'évaluation
- AHLAM (Resume Méthodes D'appentissages) 2Document36 pagesAHLAM (Resume Méthodes D'appentissages) 2Youssra ChPas encore d'évaluation
- Haroche, Henry, Pêcheux, "La Coupure Saussurienne"Document15 pagesHaroche, Henry, Pêcheux, "La Coupure Saussurienne"yankel98Pas encore d'évaluation
- Cours 1 La Tradition GrammaticaleDocument25 pagesCours 1 La Tradition GrammaticaleBekkaoui HichamPas encore d'évaluation
- Linx 1037Document4 pagesLinx 1037TasedlistPas encore d'évaluation
- Approches Et Modèles de La Traduction XXèmeDocument86 pagesApproches Et Modèles de La Traduction XXèmeGibran Damrosch BanhakeiaPas encore d'évaluation
- Lectura - Guilbaut (2005) Introduction À La Linguistique 1Document4 pagesLectura - Guilbaut (2005) Introduction À La Linguistique 1Yisell OsorioPas encore d'évaluation
- De L'émergence Disciplinaire À La Didactisation Des SavoirsDocument17 pagesDe L'émergence Disciplinaire À La Didactisation Des SavoirsangelabaalbakiPas encore d'évaluation
- La Linguistique de Corpus Et La Partition Des Structuralismes - Gabriel Bergounioux - Université D'orléansDocument14 pagesLa Linguistique de Corpus Et La Partition Des Structuralismes - Gabriel Bergounioux - Université D'orléansrxsimardPas encore d'évaluation
- 1354 Fige LexDocument17 pages1354 Fige LexElyazid SenhadjiPas encore d'évaluation
- De La Pragmatique A La Competence Pragmatique A LaDocument22 pagesDe La Pragmatique A La Competence Pragmatique A LaNelly SoroPas encore d'évaluation
- Variation Ledegen LegliseDocument17 pagesVariation Ledegen LegliseMaría Del Refugio FabysPas encore d'évaluation
- T03 Concepto y Enseñanza de La GramáticaDocument7 pagesT03 Concepto y Enseñanza de La GramáticaElisabethPas encore d'évaluation
- 04 Fortis Grinevald Kopecka VittrantDocument10 pages04 Fortis Grinevald Kopecka VittrantPaco Melero RomeroPas encore d'évaluation
- Au Sujet Des Fondements de La Theorie Linguistique de Louis HjelmslevDocument25 pagesAu Sujet Des Fondements de La Theorie Linguistique de Louis Hjelmslevlarsen.marPas encore d'évaluation
- 6approches de La TraductionDocument25 pages6approches de La TraductionMounirPas encore d'évaluation
- Lidil 3001Document132 pagesLidil 3001Hind Karou'ati OuannesPas encore d'évaluation
- Grammaire GénérativeDocument3 pagesGrammaire GénérativeLeon KakolePas encore d'évaluation
- Thème 25Document24 pagesThème 25lukasPas encore d'évaluation
- Définition Et Objet Détude de La Lexicologie - Première Partie - 2021Document5 pagesDéfinition Et Objet Détude de La Lexicologie - Première Partie - 2021loli doliPas encore d'évaluation
- 06 Cosaceanu La-LinguistiqueDocument17 pages06 Cosaceanu La-LinguistiqueBkr MoslimPas encore d'évaluation
- (Lingvisticae Investigationes. Supplementa 8) Pierre Attal, Claude Muller - de La Syntaxe À La Pragmatique - Actes Du Colloque de Rennes, Université de Haute-Bretagne-John Benjamins (1984)Document393 pages(Lingvisticae Investigationes. Supplementa 8) Pierre Attal, Claude Muller - de La Syntaxe À La Pragmatique - Actes Du Colloque de Rennes, Université de Haute-Bretagne-John Benjamins (1984)Rabha MohammedPas encore d'évaluation
- Grammaire Generative 27 PDFDocument15 pagesGrammaire Generative 27 PDFLucia Capatina100% (1)
- Figement, Néologie Et Renouvellement Du Lexique: Fixation, Neology Et Lexical RenewalDocument13 pagesFigement, Néologie Et Renouvellement Du Lexique: Fixation, Neology Et Lexical RenewalNero HomersPas encore d'évaluation
- Brahim ErrafiqDocument13 pagesBrahim ErrafiqhermesPas encore d'évaluation
- Les Theories Grammaticales Ou Linguistiques 1Document11 pagesLes Theories Grammaticales Ou Linguistiques 1hodaPas encore d'évaluation
- (2013) DEBONO, Pragmatique, Théorie Des Actes de Langages Et Didactique PDFDocument14 pages(2013) DEBONO, Pragmatique, Théorie Des Actes de Langages Et Didactique PDFMarinușa ConstantinPas encore d'évaluation
- Apprentissage de Litalien Langue ÉtrangereDocument28 pagesApprentissage de Litalien Langue ÉtrangereYosr GhannouchiPas encore d'évaluation
- Gambier Retour Sur La Notion Du Discours en TraductionDocument12 pagesGambier Retour Sur La Notion Du Discours en Traductionlydia damachePas encore d'évaluation
- Breve Histoire Des Idees Linguistiques PDFDocument16 pagesBreve Histoire Des Idees Linguistiques PDFJean-Philippe BABUPas encore d'évaluation
- Une réforme radicale de l'orthographe française ?: Pourquoi oui ? Comment ? Pourquoi non ?D'EverandUne réforme radicale de l'orthographe française ?: Pourquoi oui ? Comment ? Pourquoi non ?Pas encore d'évaluation
- Cha 2.Document12 pagesCha 2.Khalid LahouarPas encore d'évaluation
- Mwanzo Droit Civil Pers 2018-1Document307 pagesMwanzo Droit Civil Pers 2018-1Matthieu MatiyaboPas encore d'évaluation
- Liste 53851Document5 pagesListe 53851Antonin HubertPas encore d'évaluation
- Interrogation Écrite N°1 G2 - 1314Document3 pagesInterrogation Écrite N°1 G2 - 1314mohammed8nizarPas encore d'évaluation
- Détartrant Pour Cafetière ÉlectriqueDocument3 pagesDétartrant Pour Cafetière ÉlectriqueDaniela DinicaPas encore d'évaluation
- TP 02. ConductimétrieDocument4 pagesTP 02. Conductimétriefafoulol100% (1)
- Chapitre 1 Compactage Du SolDocument3 pagesChapitre 1 Compactage Du Solno pain no gainPas encore d'évaluation
- Flyer Courant Solar SystemDocument1 pageFlyer Courant Solar SystemGeralsen TsobengPas encore d'évaluation
- MP1M1Document8 pagesMP1M1mpmPas encore d'évaluation
- Département de Biologie Appliquée PV de La Commission D'Étude Des Demandes D'Acces Aux MastersDocument5 pagesDépartement de Biologie Appliquée PV de La Commission D'Étude Des Demandes D'Acces Aux MastersdionnedoPas encore d'évaluation
- Reçu de Billet Électronique / Electronic Ticket Receipt: Passager / Passenger Reference Du Dossier / Booking RefDocument3 pagesReçu de Billet Électronique / Electronic Ticket Receipt: Passager / Passenger Reference Du Dossier / Booking RefLy PendaPas encore d'évaluation
- RAPPORT MANAG StrategiqueDocument13 pagesRAPPORT MANAG StrategiqueMouad TouilPas encore d'évaluation
- 0.programme 2023-2024Document2 pages0.programme 2023-2024brahimnourelhouda776Pas encore d'évaluation
- Math. de L'assurance IARD PaulineDocument42 pagesMath. de L'assurance IARD PaulineMoïse SankaraPas encore d'évaluation
- Eau de Mer - WikipédiaDocument9 pagesEau de Mer - WikipédiaJulio AndrinirinaPas encore d'évaluation
- Chap 2 Des Ressources Majeures Sous PressionDocument3 pagesChap 2 Des Ressources Majeures Sous Pressionyounsss21Pas encore d'évaluation
- Date Night With BrittneyDocument6 pagesDate Night With BrittneyCodrin-Constantin RipanuPas encore d'évaluation
- S - Rie 8 - Mouvement (WWW - Pc1.ma)Document10 pagesS - Rie 8 - Mouvement (WWW - Pc1.ma)mohamed bignanePas encore d'évaluation
- PFE-Soukaina EL YAMANIDocument130 pagesPFE-Soukaina EL YAMANIkhammal anasPas encore d'évaluation
- Eléctrisation (MR Boussada Atef)Document2 pagesEléctrisation (MR Boussada Atef)AmineJaoued100% (1)
- PolyTD EDP PDFDocument15 pagesPolyTD EDP PDFChiheb MamriPas encore d'évaluation
- Cours D'algèbre 1 PDFDocument60 pagesCours D'algèbre 1 PDFNabik100% (1)