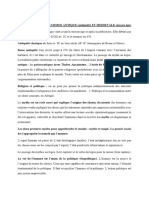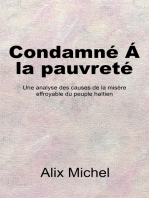Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ilide - Info Cours de Philosophie Et Logique Uak Juillet 2022 PR
Ilide - Info Cours de Philosophie Et Logique Uak Juillet 2022 PR
Transféré par
matiaboemmaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ilide - Info Cours de Philosophie Et Logique Uak Juillet 2022 PR
Ilide - Info Cours de Philosophie Et Logique Uak Juillet 2022 PR
Transféré par
matiaboemmaDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSIATIRE
AMERICAN UNIVERSITY OF KINSHASA
NOTES DE COURS DE PHILOSOPHIE ET DE LOGIQUE
(A l’usage des Etudiants de L1 CJ,SPA et RI)
TITULAIRE: Laurent MPUTU LOPEKA
Chef de Travaux
Année académique 2022-2023
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
2
1. Introduction
S’initier à la Philosophie et à la Logique n’est pas œuvre de tout repos.
Celui qui cherche la vertu et/ou la cohérence devra faire preuve de
courage, de persévérance et de discernement. Cela se passe, disons-le,
dans la connaissance en l’homme lui-même, i.e. le ’’connais toi-même ’’.
Une vie sans examen, nous dit Platon, ne vaut pas la peine d’être vécue.
En effet, la philosophie est un examen critique des questions
fondamentales concernant l’être. La logique indique les principes
élémentaires du bon raisonnement et sert donc de support
épistémologique aux connaissances dont elle facilite la comprehension et
l’assimilation.
Si le discours philosophique s’appréhende comme discours de la raison
pour l’être humain dans sa quête de vérité, celui de la logique se
présente comme discours de la raison sur elle-même. Autant l’essence de
la philosophie est la recherche de la vérité, la logique, partenaire dans
cette entreprise, en est l’instrument de la raison dans sa quête de vérité.
Si tel est le cas, est-il vraiment nécessaire d’apprendre pour atteindre
cette vérité de l’homme ou dans l’homme? Comment développer cette
connaissance? Comment penser? Qu’est-ce que penser, et pourquoi
penser? Ne pourrait-on vivre en toute quiétude pour soi-même sans être
préoccupé par ces questions qui semblent ne mener nulle part?
Le problème est réel, sans doute. La dynamique pédagogique installée
au cœur du questionnement exige que le sujet soit approché à partir de
son expériençe propre. La philosophie nait de l’étonnement. Et cet
étonnement est provocation, bouleversement, comme mode de pensée.
Ainsi, faudrait-il des balises; instance de police ou d’encadrement.
Clairement dit, la philosophie questionne; i.e. mise en question
perpétuelle. Elle vise à aiguiser le sens critique. Et, pour rendre l’esprit
rigoureux, et fonder son jugement sur un raisonnement adéquat et
coherent, telle sera l’oeuvre des leçons de logique.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
3
Pareil cours tente d’offrir une vision d’apprentissage conformémént aux
concepts philosophique et pédagogique, avec l’arrière fond de la
recherché de la vérité et non de la possession.
Pour ce faire, nous allons, dans la première partie, parler de Philosophie,
et nous pencher sur la logique dans la deuxième partie.
PREMIERE PARTIE: LA PHILOSOPHIE
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
4
Philosophie, voilà le scoop qui traverse temps et espace; culture et
période ; auteur et doctrine. Assurément parce que la pensée
philosophique provient du devenir réflexif de la raison incorporée dans
la connaissance, dans la parole et dans l’action1.
Tout homme réfléchit2. Mais certaines réflexions ne sont pas
nécessairement philosophiques. Comme d’autres types de pensée, la
réflexion philosophique part de l’existence quotidienne de l’homme, i.e.
de la réalité telle que vécue par l’homme. Celui-ci expérimente, à
certaines occasions de sa vie, des ‘‘situation-limites’’ le mettant en
condition de se poser la question du pourquoi fondamental, c-à-d. de
‘‘philosopher’.
Dès lors l’on peut se demander, comment un enseignement peut-il être
philosophique? Ou encore, comment la philosophie peut-elle être
enseignée? Autant dire comment apprendre à douter? Apprendre,
puisqu’il s’agit d’un cours. Douter, puisque, c’est la démarche de la
philosophie. Comment passer du doute sur le cours à un cours sur le
doute? Mais, qu’est-ce que la philosophie? Comment s’est-elle
manifestée, et en tant que discours, quel rapport entretient-il avec
d’autres discours sur la réalité? L’Afrique est-elle dépourvue de cet acte
de philosopher?
CHAPITRE I: ELEMENTS DE L’INTENTION PHILOSOPHIQUE
Dans ce chapitre, il sera question de tenter définir la philosophie, de
s’appuyer sur l’intention philosophique, de situer l’origine de la
philosophie et de marquer l’indépendance philosophique.
1.1. QU’EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE?
Question intéressante. La philosophie peut se comprendre soit au sens
technique ou soit au sens étymologique.
a. Au sens étymologique
Le terme « philosophie » a été inventé, d’après la tradition, par
Pythagore, mathématicien philosophe grec du VIe avant J.C. Du grec
1
Cfr J. HABERMAS, TAC I, p. 17.
2
Ré-fléchit, i.e. se retourne sur l’acte même du sujet pensant.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
5
philia (amour) et sophia (sagesse), étymologiquement, philosophie
signifie donc ‘‘amour de la sagesse’’.
Toutefois, le mot ‘‘sagesse’’ signifiait primitivement l’habilité manuelle
dans un art quelconque et spécialement dans les beaux-arts (musique,
poésie). Ainsi donc la sophia greque est à la fois:
Un art de vivre: i.e. une morale recommandant une conduite
raisonnable, une conduite empreinte de mesure (ni excès, ni défaut) et
sérénité devant les épreuves. En tant que tel, elle s’érige en sagesse
pratique; dirige le vouloir et oriente la conduite, la praxis. Sans doute,
c’est donc une action, une manière de se comporter qui se caractérise par
une maîtrise révélant à la fois d’une transcendance, d’un engagement et
un détachement. Du coup, on voit pourquoi ‘‘le sage’’ montre sa
supériorité par rapport aux autres choses, aux opinions des autres et aux
instincts. Il ne se trouve pas perdu par rapport à toutes ces données qui
constituent en fait le monde.
Et un savoir: le savoir essentiel, le savoir par excellence, la science
des premiers principes et des causes premières.
Ainsi, en tant qu’amour de la sagesse, la philosophie est tout à la fois, un
savoir et un salut ; ou plutôt un savoir qui conduit au salut. Car c’est du
savoir que l’homme se dirige personnellement et poursuit par la son
salut (l’ignorant se conduit mal parce qui ignore le bien).
Le philosophe est d’avantage un ami de la sagesse, un ami de la vérité, à
l’exemple de Socrate, plutôt que sage3. La philosophie est d’avantage une
recherche qu’une possession. Un philosophe, c’est alors un pèlerin de la
vérité que le propriétaire d’une certitude. La philosophie excelle donc à
développer en nous l’esprit critique et l’esprit de tolérance4.
La philosophie est une façon d’être qu’un avoir. La sagesse, ici, se veut
être une attitude critique qui, dans l’ordre du savoir, nous met à distance
de préjugés, dans l’ordre de l’action, nous met à distance des passions et
des impulsions de la conscience collective5.
3
En déhors de la dérivation du sage que représentaient les sophistes ceux qui excellent dans un art, maître
d’éloquence avant de prendre le sens péjoratif, maître de rhétorique qui manie, à Athènes, avec habilité, les
arguments capiteux.
4
VERGEZ A et HUISMAN D, Nouvel abrégé de philosophie, Paris, Fernand Nathan, 1978, p.9.
5
Ibid.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
6
Soit dit en passant, la sagesse a été l’objet de cogitation de Descartes.
Pour lui, le mot philosophie signifie étude de la sagesse (…). Et par
sagesse, on n’entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais
aussi une parfaite connaissance de toute chose que l’homme peut savoir,
tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et
l’invention de tous les arts ; et afin que cette connaissance soit elle, il est
nécessaire qu’elle soit déduite des premières causes.
Il n’y a véritablement que Dieu seul qui soit parfaitement sage, c.à-d qui
ait l’entière connaissance de la vérité de toute chose. Mais, on peut dire
des hommes qu’ils ont plus au moins de sagesse à raison de ce qu’ils ont
plus au moins de connaissances de vérité plus importantes6.
b. Au sens technique
S’il est facile de définir étymologiquement le mot philosophie, il est par
contre difficile si pas impossible de le définir, de manière exhaustive
dans son sens technique. Il parait comme un fait : il y a cours de
philosophie, des facultés ou filières d’études, des hommes dits
philosophes,…
Dès lors, il devrait y avoir un horizon commun, un ensemble de
caractéristiques permettant de distinguer le ‘‘savoir philosophique‘’ de
tout autre savoir.
Mais existe-t-il un savoir philosophique unique? Un savoir entendu
comme ‘’un ensemble de connaissances méthodiques acquises et
ordonnées’’? La réponse est évidemment négative. Car la philosophie se
caractérise précisément par une multiplicité de savoirs, de systèmes
philosophiques parfois complémentaires, mais souvent opposées.
Dans cette multiplicité/diversité de savoirs philosophiques, certains ont
cru impossible de proposer une définition suffisamment large et précise
pour l’appliquer à tous les courants philosophiques, d’une part et pour
distinguer le savoir de tout autre savoir d’autre part.
Pour contourner cette difficulté, allons vers ce que J. Vialatoux a
judicieusement appelé ‘‘intension philosophique’’.
1.2. INTENTION PHILOSOPHIQUE
6
Cf. R. Descartes, Préfaces aux principes de philosophe, p.10
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
7
Cette intention est le dessein qui animait et sous tendait la constitution et
l’élaboration du savoir de ceux dont l’histoire appelle ’’philosophes’’.
Pertinemment, il est question de connaitre le but poursuivi, l’objet
d’investigation et la méthode mise en œuvre dans leur recherche.
2. But de la philosophie
En tant qu’être conscient, tout homme est habité par une double
exigence de lumière et de vérité, laquelle le pousse à questionner aussi bien
le monde que lui-même afin de connaitre le pourquoi et le comment des
choses et des événements. Il veut comprendre (prendre-avec), i.e. unifie
la raison, l’incompréhensible, le multiple.
Mais plus que les autres hommes, le philosophe ou plutôt l’homme à
l’esprit philosophique vise un ‘’savoir radical et intégral’’. Bref, le but de
la philosophie est la recherche d’un savoir radical et intégral pour la
signification de l’existence humaine. Il faut bien comprendre que la
philosophie n’est pas une théorie mais une activité, qui se compose
essentiellement d’éclaircissements, au tour du Bonheur.
Il y a lieu de regrouper ces questions que les hommes se posent au tour
de trois pôles:
i. Sa vie et son développement dans le monde où il vit
Par la technique, l’homme manipule les objets de ce monde pour le
rendre utiles. Par la science, il veut connaitre son entourage, pour mieux
pouvoir utiliser les choses. Ce premier point concerne la recherche
scientifique et son application, la technique.
ii.Le sens de son comportement :
Que dois-je faire pour faire le bien qui soit tel universellement, quelle est
l’orientation que je dois donner à ma vie? Comment dois-je me
comporter envers les autres?
Il ne s’agit pas de découvrir ce qui est, mais ce qui doit être: Comment,
moi, je dois être, comment la société des hommes devrait-elle être?
iii. L’homme dans son ensemble, le monde et l’Absolu
Ce 3 groupe est lié au précédent, car pour pouvoir répondre à la
e
question comment dois-je me comporter, comment une société devrait-
elle être, il faut que l’on sache ce qu’est l’homme, d’où il vient et quelle
est sa destinée, quelle est sa destinée, quelle est sa raison d’être ? D’où
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
8
vient le monde dans lequel l’homme vit? Et finalement: n’y a-t-il rien
d’autre que l’homme et le monde? Comment l’homme et le monde sont-
ils possibles?
On aura remarqué que les trois séries des questions se situent à des
niveaux différents. On va de plus en plus loin, on creuse de plus en plus
profondément, on veut atteindre les dernières réponses aux dernières
questions.
3. La matière de la philosophie : totalité du réel
Elle réfléchit sur toutes les opérations de l’esprit et du vouloir grâce
auxquelles le monde se déploie devant le sujet. Le philosophe s’intéresse
à tout ce qui se présente devant son regard: les choses, les hommes, les
événements, tout ce qui d’une manière ou d’une autre peut être perçu,
imaginé, conçu, jugé et effectué. Ici, se note donc le caractère englobant de
la philosophie.
Cela étant, au VIe av. J.C, la philosophie se présentait comme un savoir
encyclopédique. Thalès de Milet, Pythagore, Empédocle et Démocrite
furent des 1ers savants comme plus tard Platon et Aristote. Au moyen
Age européen, la philosophie est représentée comme la source d’où
émanent sept fleuves des arts libéraux (entendez toutes les sciences: que
sont la grammaire, la géométrie, la dialectique, la musique, la rhétorique,
l’arithmétique, l’astronomie.
Au XVIIe s ap.J.C, Descartes compare la philosophie à un arbre dont les
racines sont la métaphysique, le tronc, la physique au sens large de
science de la nature, les branche étant la mécanique, la médecine et la
morale.
Malgré cette attitude thuréfaire selon la quelle, à l’origine, la philosophie
était une sorte de connaissance universelle englobant toutes les sciences,
mais c’est depuis longtemps que celles-ci ont commencé à se séparer de
la philosophie. Dès l’antiquité, les sciences ont commencé à conquérir
leur autonomie par rapport à la philosophie. Ainsi:
Les mathématiques avec Pythagore ;
La géométrie Euclide (300 av.JC) ;
La mécanique avec Archimède (250 av.J.C) ;
La physique avec Galilée (Xve S.ap.J.C) ;
La chimie avec Lavoisier (XVIIeS) ;
Les sciences humaines (sociologie, psychologie aux XIX e et XXe S)
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
9
La communication avec Mc Luhan.
Malgré cette émancipation, il ne reste pas moins vrai que la philosophie
aspire à être un savoir total. Trois thèmes représentant précisément la
totalité du réel: l’homme, le monde et l’absolu.
4. La méthode propre de la philosophie : méthode réflexive
Une méthode est voie de recherche (méta-ordos). De quelle manière,
selon quelle voie l’intention philosophique conduira-t-elle sa recherche?
De tout temps, on a considéré que la poursuite de ce but ne peut
s’effectuer que par la réflexion, et que pour ce motif, elle est l’apanage de
la raison. Le terme ‘’raison’’ n’étant qu’un autre nom pour désigner le
sommet de la pensée, cet effort suprême de l’esprit en quête de la vérité.
Le choix de la rationalité est un choix grec, celui d’Athènes, en grec,
raison se dit ‘’logos’’ qui signifie aussi ‘’discours cohérent’’. Langage et
raison sont aussi noués dès l’origine7. Si l’homme a une raison, mais elle
qu’elle soit sa parole, elle manifeste son désir d’être entendu et d’être
connu par cet autre avec qui il cohabite.
Dans la cité grecque, les discours se croisent et s’opposent. La forme de
la démocratie, en faisant renoncer à la violence comme forme
d’imposition de preuve et lui substituant un champ de langage où les
conflits se règlent, ouvre la voie à la l’argumentation et à la recherche du
discours capable de convaincre n’importe qui, indépendamment de sa
situation et de ses particularités de son être.
Dans le domaine de la pensée, le mot réflexion est pris en sens différent:
a. Au sens général
Réfléchir, c’est mettre en suspens un jugement pratique ou spéculatif,
s’efforcer de juger en connaissance de cause. En ce sens, toute discipline
rationnelle et tout activité pratique humaine doit être réfléchie. Et c’est
précisément ce caractère réfléchi qui les faits humains ou leur vaut de
‘’discipline’’.
b. Au sens philosophique
7
A lire avec intérêt MPUTU LOPEKA Laurent, De la discussion à l’intercompréhension chez
Habermas.UNIKIN, FLSH, Mémoire de licence, 2009-2010. inédit.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
10
La réflexion est la voie de retour par cette quelle la pensée revient des
objets pensés et voulus au sujet pensant et vouant, de l’extérieur, de
l’espace à l’esprit, de l’univers à moi et à l’absolu8.
Autrement dit, la réflexion dans le sens philosophique est la pensée qui,
tout en pensant, pense l’acte de penser en train de penser son objet de
pensée. C’est la pensée qui se pense elle-même. Par cette réflexion, par ce
tour, la pensée revient sur ses expériences pour en dégager le sens et
l’origine, pour en expliquer la signification que ces expériences
impliquent. Ainsi, par exemple, la pensée africaine s’efforcera
d’expliquer sa solidarité vécue entre les membres, d’expliciter les valeurs
qui orientent le comportement de l’africain, son éthique, sa conception
de l’Absolu, etc.
Cela étant, on pourra dire le philosophe réfléchit sur le vécus (ce dont il
a l’expérience) pour formuler de manière claire, cohérente. Philosopher,
dira kant, c’est avoir le courage de penser par soi-même: sapere Aude.
Le décor étant planté, définissons en fin la philosophie. La première
tentative serait de dire que la philosophie consiste à tenir un discours
guidé par la raison, à se poser des questions, à penser à partir de
problèmes. Elle est un effort systématique et critique pour comprendre,
de manière radicale, l’expérience intégrale de l’homme. Elle s’effectue en
dialogue par la réflexion sur le vécu. Le travail philosophique est
comparable à un symposium auquel prennent part les philosophes de
tous les temps. La vérité, en tant que dévoilement progressif du réel,
advient dans un dialogue où la tradition et l’apport personnel se
fécondent naturellement. C’est aussi une réflexion, résultant du choix
libre de l’homme pour le discours cohérent portant sur l’expérience
humaine totale dans le but de donner un sens à l’existence humaine.
Explicitons quelque peu cette définition.
La philosophie résulte d’un acte de liberté d’un individu qui a
décidé de refuser la violence pour la raison, pour un discours
cohérent ;
Ce discours se présente sous la forme de réflexion, i.e. D’une
pensée qui retourne vers le sujet entrain de penser ;
8
C’est comme le rebondissement de la balle contre le mur, le retour du rayon lumineux frappant un miroir.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
11
L’expérience humaine, totale constitue le vaste champ de réflexion
de la philosophie ;
Cette pensée a pour but de donner un sens à l’existence humaine;
elle reste d’essence rationaliste. Subalternation rien ne peut plus
nous empêcher de définir la philosophie comme examen critique
des questions fondamentales concernant l’être humain.
Un examen : examiner, c’est mettre à l’épreuve une opinion afin
d’évaluer ce qu’elle contient de vérité. L’examen vise à porter un
jugement décisif sur cette opinion. C’est un exercice de réflexion
méthodique sur ce que nous croyons être vrai ou être bien…
Critique : désigne avant tout une attitude de l’esprit. Celui-ci fait
appel au
doute comme instrument d’évaluation. Etre critique indique la capacité
en même temps d’un moment privilégié dans l’exercice de la réflexion.
Des questions:
Questionner, c’est chercher à savoir. La philosophie est recherche,
ouverture sur l’indéterminé, cet espace de l’indécidable aux origines de
la liberté fondamentale de l’etre humain. Philosopher, c’est apprendre à
questionner, c’est apprendre à devenir libre.
Fondamentales : ce qui est au fondement, à la racine de l’etre
humain, et ce qu’il définit en tant que tel. La philosophie est une
réflexion radicale. Sa rcherche porte sur ce qui constitue l’etre
humain en tant que subjectivité libre et pensante et qui lui permet
alors de se développer.
La définition de la philosophie est précédée par son origine. Qu’en est-il
alors de l’origine de la philosophie?
1.3. ORIGINE DE LA PHILOSOPHIE
L’histoire de la philosophie a commencé sous forme d’un effort de
pensée méthodique et ce, sous la forme d’une pensée mythique
beaucoup plutôt un commencement. C’est autre chose qu’une origine.
Celle-ci, c’est la source d’où jaillit constamment l’impulsion à
philosopher. C’est par elle seulement qu’une philosophie contemporaine
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
12
devient quelque chose d’essentiel, par elle que l’on comprendra la
philosophie du passé.
Cet élément originel est multiple. L’étonnement engendre l’examen
critique et la connaissance ; le doute au sujet de ce qu’on croit connaitre
engendre l’examen critique et la claire certitude ; le bouleversement de
l’homme est le sentiment qu’il a d’être perdu l’amène à s’interroger sur
lui-même.
Ainsi, s’étonner, c’est tendre à la connaissance. En m’étonnant 9, je prends
conscience de mon ignorance. Je cherche à savoir, mais seulement pour
savoir, et non pour contenter quelque exigence ordinaire.
A dire vrai, philosopher, c’est s’éveiller en échappant aux liens de la
nécessite vitale. Cet éveil s’accomplit lorsque nous jetons un regard
désintéressé sur les choses, le ciel et le monde, lorsque nous nous
demandons ‘’ qu’est-ce que tout cela? D’où vient-il tout cela? Et l’on
n’attend pas que les réponses à ces questions aient une quelconque
utilité, mais qu’elles soient en elles-mêmes satisfaisantes.
Une fois mon étonnement et mon émerveillement apaisés par la
connaissance du réel, voici que surgit le doute.
Le doute devenu méthodique entraine un examen de toute connaissance
(et la Recherche d’une certitude). D’où, il découle que sans doute radical,
il n’est pas de philosophie véritable. Mais, ce qui est décisif, c’est de
savoir comment et où le doute, lui-même permet de conquérir le
fondement d’une certitude.
Subtilement dit, philosopher c’est se saisir du doute, le pousser jusqu’au
bout:
Soit pour se livrer à la volupté de nier
Soit pour chercher une certitude qui échappe et résiste à tout
examen critique loyal.
Le bouleversement permet à l’homme de s’interroger sur lui-même
(d’amener à sa pensée tout ce qui dépend de lui). Autrement dit,
9
A. Schopenanhauer dira : avoir l’esprit philosophique, c’est être capable de s’étonner des événements habituels
et des choses de tous les jours, de se poser cmme sujet d’étude ce qu’il ya de plys général et de plus ordinaire.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
13
c’est prendre conscience de soi et faire l’expérience de sa propre
faiblesse et de son impuissance.
Désormais philosopher, c’est prendre conscience de nos
situations-limites:
Nous ne pouvons les dépasser
Nous ne pouvons les transformer. Lorsque nous le voyons
clairement…Nous devenons nous-mêmes.
1.4. Rôle de la philosophie:
Le rôle de la philosophie est de nous aider à nous défaire des prétentions
que nous nourrisons autour des prénotions communes, et de nous
procurer une règle qui puisse nous permettre d’appliquer correctement
nos prénotions10.
Dans l’histoire de l’humanité, la philosphie joue le role d’étudier les
facteurs dans leur nature et leur action réciproque. Elle s’active à
rechercher les sources du fait historique, non pas seulement du point de
vue critique, e.i. sous le rapport de leur force probante, mais au point de
vue de leur valeur ontologique et causale.
Aujourd’hui, la philosphie constitue le cadre dans lequel l’homme peut
comprendre le monde et agir sur sa propre vie. Elle fournit les outils par
lesquels, l’homme peut découvrir la vérité et utiliser son esprit pour
améliorer sa vie. Elle sert d’outil qui permet aux plus jeunes surtout
d’appréhender le monde qui les entoure avec davantage de recul,
d’esprit critique et de curiosité.
Son impact n’est plus à démontrer, tant est vrai qu’en tant qu’amour,
étude de la sagesse et mère de toutes les sciences. Au niveau moral, c’est
la philosophie qui cimenta nos valeurs éthiques en transformant
l’homme, d’un animal stupide et borne en un être intelligent et
perfectible.
L’idéal philosophique, le but poursuivi par le philosophe c’est de
dépasser l’opinion, la conviction individuelle et élaborer un savoir
radical, universellement valable et critiquement fondé concernant
10
Felix Nestor AHOYO, Histoire de la philosophie grecque. Une étude systématique de thalès à politin,
ibandan, Hope publication,2016, p. 155
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
14
l’homme, le monde l’absolu11. Il y a là dans la philosophie une ferme
volonté de dire la vérité, tout du moins de s’en approcher.
* Relation entre les sources
Il peut s’agir de concevoir les relations entre ces sources concomitantes
(étonnement, doute et bouleversement) de la philosophie.
En effet le bouleversement traverse le doute et l’étonnement mais en
dernier ressort, permet à l’homme de se définir un but. Ainsi donc, si
l’étonnement est aux origines du questionnement philosophique, le
doute est-ce qui remet en question les réponses jusqu’ici soustraites à la
pensée critique, et le bouleversement provoqué par la conscience d’être
perdu, est ce qui permet à la démarche de se définir un but et d’aboutir
dans cet apaisement qui est un moment privilégié de réalisation de soi.
Vivre l’achèvement d’un instant privilégié dans une vérité pareillement
conquise trouvé la paix dans la recherche d’une vérité en fin aperçue tel
sont les deux axes majeurs qui guident la démarche philosophique dans
les principes originels et dans l’actualisation de ceux-ci. La définition de
la philosophie complète l’expérience de son origine multiple. Elle
transforme l’étonnement en question, le doute en examen méthodique, et
le bouleversement maintient la critique systématique des réponses
inadéquates.
Le terme ultime de cette démarche, c’est la conquête de science,
l’affirmation de sa propre vérité, de sa liberté toujours ouverte, toujours
maintenue. C’est là le propre de l’indépendance philosophique, axe
central autour duquel origine et définition de la philosophie se renvoient
l’un à l’autre et se complément.
1.5. INDEPENDANCE DE LA PHILOSOPHIE
L’indépendance de la philosophie se dessine en combinant les éléments
de la définition et de l’origine de la philosophie.
L’origine de la philosophie, rappelons-le, c’est étonnement qui ouvre la
voie à la question. Celle-ci provoque à son tour le doute qui engendre la
réflexion critique. Autant dire que celle-ci est en même temps
11
Trois thèmes représentant précisément la totalité du réel
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
15
l’expression du bouleversement et la mise en question fondamentale de
ce que nous croyons avoir acquis jusqu’ici à titre de connaissance. Mais,
ce bouleversement provoque aussi la recherche d’un certain
dépassement de soi afin de trouver un profond apaisement.
Cependant, cette paix intérieure, qui est achèvement de soi, ne peut être
acquise que dans le cadre d’une indépendance-philosophique se mettant
à l’abri de l’opinion, du jugement sommaire, partisan et craintif.
C’est en d’autres termes, se refuser de sombrer dans les dogmes du
totalitarisme ou de se perdre dans l’anonymat de l’opinion commune.
S’interdire du fanatisme, du militantisme et frivole.
Vu de la sorte, il est tentant de dire que la philosophie est à la fois
expression de liberté, mais aussi apprentissage de la liberté. Philosopher,
c’est exprimer sa liberté, mais aussi apprentissage de la liberté, et en
même temps apprendre à devenir libre. Philosopher, c’est retrouver le
chemin de son for intérieur; c’est lutter en toutes circonstances pour son
indépendance intérieure.
Autant dire que philosopher indépendamment, c’est prendre la décision
de faire jaillir à nouveau en soi la source vive, de retrouver le chemin de
son for intérieur, de s’aider soi-même par une action intime, dans toute
la mesure de ses forces.
Point n’est besoin de dire que cette approche évoque un thème délicat de
la philosophie: liberté. L’homme est-il libre? Et qu’est ce que la liberté?
Il y a lieu de distinguer plusieurs sens de liberté:
Liberté : possibilité de choix pour des raisons personnellement
intériorisées, le libre-arbitre, la liberté philosophique ;
Liberté: un sens des conditions économiques et sociales. Par ex.
Les Libertés ou le droits de l’homme; c’est la liberté sociopolitique. Soit
dit en passant, c’est au tour de la liberté philosophique, liberté de choix,
que se déroulent les discutions extrêmement importantes pour la morale.
L’homme est libre de choisir tel objet ou tel autre? Est-il capable de se
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
16
déterminer de savoir ce qu’il fait et pourquoi le fait-il, de prendre
position?
Trois tendances se dessinent:
1. Déterminisme :
Les matérialismes insistent sur le déterminisme (nécessité) au quel
l’homme est soumis et exposé.
Le destin ou factum des anciens
Des facteurs génétique, héréditaires : tel père tel fils
Facteurs physiques : la psychanalyse montre l’importance du
subconscient
Des facteurs sociologiques: l’influence de la société sur la
manière de penser de s’habiller (snobisme).
2. Le spiritualisme
Les spiritualistes insistent sur la possibilité dont dispose l’homme de
prendre sa vie en main. Il a la capacité d’agir en connaissance de cause.
Ici, la liberté est évoquée dans la capacité de prendre distance par
rapport à tout ce qui l’entoure. Parce que L’homme est esprit, il est aussi
libre. Les deux se tiennent. Par exemple certaines tendances de
l’existentialisme.
3. Des tentatives de synthèse
Ces tentatives soulignent le caractère situé, incarné et donc limite de la
liberté. La liberté est enracinée dans la corporéité, elle subira l’influence.
La liberté devrait aussi tenir compte de déterminisme de la nature
extérieure. La liberté de l’homme n’est pas totale, elle est une tâche à
réaliser aussi bien sur le plan individuel que collectif (toutes révolutions
visent la libération). L’homme est un paradoxe de situation et de tâche,
de fait et projet, il est un donné plein de possibilités.
Conclusion:
De ce qui précède, il faut retenir que la philosophie est ce chemin ouvert
à la liberté de l’être humain et qui maintient outre cette liberté. Elle en est
garante. A ce titre, il est hors de question de la mettre de côté. Apprendre
à philosopher, c’est apprendre à devenir libre; c’est apprendre à penser par soi-
même.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
17
L’enseignement de la philosophie a pour visée le développement d’une
façon de penser et non un système de pensées. Il a été noté qu’en
philosophie, la vérité tant recherchée est de l’ordre du questionnement et
du cheminement et non de l’acquisition des reponses toutes faites; ce qui
est prouvé, c’est advantage un chemin, une route.
De ce point de vue, le philosophe est un artiste de l’écriture
argumentative et un un specialiste des questions fondamentales qui
nécessitent de tourmenter l’esprit humain.
C’est ne pas exagéré de dire que l’indépendance philosophique est
l’aboutissement de toutes les démarches pédagogiques inscrites au cœur
de la philosophie.
Celle-ci peut être comprise en rapport avec d’autre discours sur la
réalité. Voilà le champ d’œuvre du chapitre suivant.
CHAPITRE II: LA PHILOSOPHIE ET LES AUTRES DISCOURS SUR
LA REALITE
Introduction
Le discours est un produit du langage et de la culture. Il se présente
comme un ensemble de signes suivants à exprimer une réalité à
communiquer (à soi ou à l’autre), à lui donner sens. Il est pour l’homme
une manière de penser le monde et de l’organiser.
Tout discours se présente comme système de signification qui met en
place des réseaux de signes, de symboles, de concept etc.
Que ce soit le discours banal de la quotidienneté, le discours mythique
du sacré, le discours philosophique de la recherche de la vérité, le
discours scientifique du mesurable ou le discours artistique de la
création esthétique, tous ces discours sont des modes de pensée de l’être
humain. Ils expriment et créent la relation de l’homme à l’univers.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
18
Mais comment situer le discours philosophique en rapport avec d’autre
discours sur la réalité? Pour ce faire, nous retenons, arbitrairement, d’une
part le mythe, la science et l’art , et d’autre part le journalism et les
Relations internationales.
a. Le discours mythique
Le discours mythique est récit imaginaire et scientifique qui met en
scène des êtres représentant des énergies, des aspects de la condition
humaine; représentation idéalisée. L’homme mythique évolue dans un
univers chaotique. Pour lui, la vie est menacée par: les éléments de la
nature qu’il ne contrôle pas et par ses semblable, ses rivaux.
Autrement dit, pour l’homme mythique, il y a une relation au monde
doublement piégée, c.-à-d. qu’il y a l’univers hostile qui le menace et
l’écrase, et les autres qui le guettent et en veulent à sa vie. Voilà
pourquoi, il se réfugie dans de lieux sacrés et qu’il y trouve réponse au
non envahissant de la banalité quotidienne dans la quelle il évolue.
De la sorte, ce discours correspond alors au besoin profond de l’homme
de donner sens à l’existence, insatisfait de la demeure naturelle qu’il à
fait naître. En effet, les dieux permettent aux hommes de comprendre qui
les entoure.
Mais ’’l’explication mythique‘’ n’arrive toujours pas à satisfaire la
volonté de plus en plus grande des hommes de s’approprier les mystères
de l’univers. Cette insuffisance du mythe engendre un autre discours.
b. Le discours philosophique
Le philosophe livre ainsi la question du sens et se pose en juge des
réponses donnée. Du coup, il refuse le piège des réponses toutes faites et
maintient le sens de son émerveillement dans la question qui au départ,
l’a mis en route vers la recherche de la vérité.
Discours critique par excellence, le discours philosophique introduit une
démarche de vérité et maintient la liberté de l’être humain comme espace
entre le sens déjà enfermé dans le mythe ou capturé par l’opinion, et sens
à retrouver à l’horizon de la question originelle, fondamentale.
c. Le discours scientifique
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
19
La science est l’ensemble de connaissances d’une valeur universelle
portant sur les fait et relations véritables selon des méthodes déterminées
(observations, expériences, hypothèses et déduction) ensemble cohérent
de connaissances relatives à certaines catégories de fait, d’objets ou de
phénomènes obéissant à de lois et/ou vérifiés par le méthodes
expérimentales.
Contrairement, à la manière dy myhe ou de la philosophie, le discours
scientfique transforme la vérité en langage mathématique utilisable pour
conquete de la nature. Il n’est de savoir que le mesurable. Le monde est
un système de chiffres, un ensemble mathématisable.
De plus, la science fournit des réponses garanties par l’expérience, qui
font consensus et rallient autour d’elles les hommes qui veulent
comprendre et bientôt controler la nature.
Toute fois, le discours scientifique doit etre pris dans ces limites propres.
Ces théories obéissent aux lois de la raison.
d. Le discours artistique
Il est de tout discours le discour le plus irréductible à la raison. Discours
à la limite de la subjectivité pure, il promeut la vérité dans sa beauté.Il
fait dériver la recherche du sens dans le sentiment. Le monde apparent
peut se preter à plusieurs formes données à l’etre humain de créer des
formes qui seraient plus compatibles avec ses aspirations et ses gouts.
e. Rapprochement des différents discours avec la philosophique
Maintenant, tentons d’abord de rapprocher ces discours face à la
philosophie et ensuite schématisons-les.
i. Mythe vs philosophie
Le mythe et la philosophie considèrent le monde comme étrange. Pour
la mythologie grecque, le chaos est aux origines du monde. Les deux
vont naitre et ordonner les phénomènes naturels. Pour résoudre le
problème de l’angoisse existentielle (qui empeche le sommeil et inquiète
l’esprit), le mythe fait appel aux forces de la nature qu’il projette dans un
au-delà de l’espace et du temps. Il les personnalise, les divinise et en fait
des êtres sacrés qui interviennent pour protéger ou punir. Le rituel soude
alors l’etre humain à ces forces tutélaires invoquées pour protéger
l’homme des mauvais sorts de l’existence quotidienne. L’homme
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
20
mythique se soumet ….. d sorte que le mythe devient inséparable de la
magie.
La philosophie va à l’encontre du mythe. Elle ne récite pas; elle
argumente. Elle ne croit pas elle doute. Elle met en jeu la vérité des dieux
et dresse contre eux la raison dans sa volonté de conquérir par elle-
même sa propre vérité. La paix recherchée est intérieure, expression de
lberté d’independance vis-à-vis du pouvoir.
Discours mythique Ce qui est commun Discours philosophique
Le monde est - Le monde Le monde est étonnant
Expérience du engoissant est étrange
monde - Il n’a pas de sens
en lui-même
Discours :conscience Il faut trouver un sens -il faut trouver un Il faut trouver un sens
du monde absolu sens pour l’homme relatif,
(transcendant) - faire appel à la Immanent à l’etre humain
penssé, au logos -faire rappel à la penssée
( langage) Logique, aux raisons
d’exister
Action : transformation -soumission - régulariser le -trouver la paix
du monde aux forces rapport -s’accomplir
naturelles Homme- univer -se réaliser dans le monde
- contrôle de -Rendre le
forces occultes monde habitable
de la nature pour
L’etre humain
ii. Science vs philosophie
La science est la philosophie se distingue fondamentalement de par leur
visée. Dans le cadre de la relation homme/univers, d’un côté l’accent
porte sur l’homme, c’est la philosophie. La première se prétend objetive,
fondée sur l’observable et le mesurable, l’autre est cogito subjectivité
pensante qui cherche le fondement, la cetitude absolue.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
21
Le mesurable scientifique débouche sur un savoir pratique qui met en
équation le monde et permet son appropriaton technique. La
contemplation, philosophique aboutit à un savoir critique qui remet en
question les réponses offertes par les idéologies dominantes pour le bien-
être de l’humanité.
Mais on aurait tort de croire et faire croire que la science n’est pas
contemplative ou que la philosophie est absente de la pratique. L’homme
de science se régale de vérités qu’il trouve dans ses éprouvettes. La
philosophie a déclenché nombre de bouleversements sociaux qui ont
profondément changé l’histoire de plusieurs sociétés et engendré de
nouvelles expressions culturelles. La philosophie de K. Marx a
profondément modifié l’histoire du monde dès la fin du XIXe s.
Discours scientifique Ce qui est Discours philosophique
commun
Expérience du
-Le monde est ensemble - Le monde est - Le monde est étonnant,
Monde
de formes, de figures étrange questionnement pour etre
géométriques ; - Le monde : une humain ;
-Le monde est donnée à connaitre - Le monde :un déjà là, lieu
mathématisable des sens pour l’homme
(Galilée)
Discours : - Comprendre, - Faire appel à l’expérience
Conscience du Faire appel Aux
expliquer le monde intérieure
Monde phénomènes observables, à
en trouvant des - Faire appel à la raison qui
l’expérience objective du
phénomènes du cherche l’origine
monde faire appel à la raison
monde fondamentale des
qui cherche des causes
- Faire appel à la phénomènes du monde
exactes certaines
rationalité à la pensé
logique
Action : - Trouver la paix intérieure ;
- Découvrir les lois qui Rendre l’homme
transformation l’achèvement de soi…
gouvernent l’univers maitre et possesseur
Du monde - Conquérir son
- Trouver la théorie des de la nature et de lui-
même. indépendance et affirmé sa
phénomènes naturels
liberté
permettant le contrôle
iii. Philosophie vs art
La dernière comparaison dans laquelle nous aventurons est celle qui
oppose la philosophie et l’art, comparaison quelque peut difficile étant
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
22
donnée que l’art ne rêvet pas toujours les mêmes habits langagiers que la
philosophie.
L’art n’émerge pas dans la latéralité d’un discours antérieure comme s’il
marquait les insuffisances de l’autre. Il est un discours qui se situe au cœur
de ce rapport dans la volonté de l’être humain de se faire une
représentation du monde plus conforme à son désir d’être le maitre du
monde et de donner forme lui-même aux choses.
L’émotion du système engendre celle esthétique et la quête de l’absolu. Il
n’ y a pas à confondre l’émotion qui vient du cœur avec celle qui habite
l’esprit épouvanté par le spectacle du chao qui s’offre aux yeux. Autant
dire que le cœur a ses raisons, mais l’esprit a aussi ses émotions12.
Discours artistique Ce qui est Discours philosophique
commun
Expérience du Le monde est beau ; -le monde est merveilleux -Le monde est étonnant
monde - Le monde -le monde est plein de Questionnement pour
est ensemble de formes être humain ;
formes -Le monde est à
à représenter, à connaitre dans ses
construire formes intelligibles
Discours : Faire appel à l’émotion -Donner sens à ces formes -Faire appel à
Conscience du monde intérieure, au sens l’expérience intérieure
esthétique phénomène -faire appel à l’intuition, à subjective du monde
la pensée imaginative
Faire appel à l’institution, -Faire appel à
à l’imagination créatrice l’imagination à la raison
pour créer le monde critique qui cherche
l’origine fondamentale
des phénomènes du
monde
Action : transformation - Recréer le monde dans -Rendre le monde est ses - Trouver la paix
du monde ses formes telles que représentations conformes intérieure ;
perçues par le sens aux aspirations de l’être l’achèvement de soi
esthétique de l’homme humain dans la contemplation
- créer un univers de du soleil de la vérité
formes imaginaires du bien
correspondant au désir de - Conquérir son
l’absolu et du sublime qui indépendance vis-à-vis
habitent l’être humain des contingences du
monde et affirmé sa
liberté
12
C e discours envahit celui des autres, i.e. que tout discours vise à plaire, ou à séduire.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
23
C’est à partir de ce noyau dur que l’on peut attester pourquoi et en quoi,
depuis la nuit des temps, le discours philosophique ne cesse de sortir du
giron mythique par son sens de l’émerveillement et de la recherche de
vérité. Bref, il fait de la raison son cheval de bataille. Aussi prétend-il
maintenir la liberté de l’être humain pour son émancipation retrouvée à
l’horizon de la question originelle, fondamentale. Puis que, la raison lui
est la thématique foncière. ‘’ S’il est quelque chose de commun aux
doctrines philosophiques, nous avertit Habermas, c’est l’intention de
penser l’être ou l’unité du monde en passant par une explication des
expériences que fait la raison en ayant affaire à elle-même’’ 13. C’est dans
ce sens que la philosophie s’établira comme un discours critique par
excellence.
Cependant, depuis quelques temps, ce noble discours n’a plus le même
aura. Il se passe comme s’il y a péremption de quelques théories et
postulats, et du coup, certains maitres-penseurs tombent en discrédits.
La philosophie semble désuète, au point qu’un certain Marx aura
l’audace de la suspendre dans le vide. Pour lui, la théorie ou la
connaissance spéculative perdrait de sens si elle n’avait une finalité
pratique. Une telle position semble avoir une portée philosophique
indéniable. Elle tient allusion, peut-on dire, à la finalité de la philosophie
qui ne fait qu’interpréter le monde. Est-il besoin de rappeler sa 11 e thèse
sur Feuerbach : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde des
toutes manières, il s’agit de le transformer ». Se servant de cette thèse,
comme nous relate Okolo Benoit14, L. Ankunde a introduit et clarifié sa
fameuse philosophie fonctionnelle. Celle-ci, en convolant les critiques
portées contre la philosophie spéculative, abstraite et contemplative, la
dépasse en lui révélant sa finalité essentielle, la transformation du
monde.
f. Philosophie et jounalisme
13
TAC I, p. 17.
14
B. OKOLO Okonda, Pour une philosophie de la culture et du développement. Recherches d’herméneutiques
et de praxis africaines, Kinshasa, PUF, 1986, p.76-77.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
24
Le journalisme15 qui consiste à recueillir, à verifier et éventuellment à
commenter des faits pour les porter à l’attention du public interesse le
philosophe. La question de la philosophie, dit M. Foucoult, c’est la
questin du présent qui est en nous-même. La philosophie qui se consacre
à l’ontologie du présent permet de voir plus clair, de se reréper au sein
d’un monde complexe, avec de communication déformée qui engendre
des malentendus et des conflits lavrés et/ou ouverts. Le fait étant sacré,
le commentaire est libre exige esprit critique, connaissance, prudence,
justice, reconnaissance mutuelle, bon sens...
Ce n’est pas sans intérêts que certains auteurs avisés16 présentaient leurs
idées sur différentes tribunes, que ce soit à l'université, le journal, la
radio ou la télévision, endroits propices à la mise à l'épreuve ou à la
falsification des théories philosophiques.
2.7. Philosophie et Relations et Internationales
RI, domaine insaisissable, marquee par des conflits interétatiques, des
luttes de pouvoirs et des alliances politiques incertaines, les
problématiques internationales n’ont été l’object que d’une attention
subalterne par la philosophie, en quête d’une vérité qui a souvent eu du
mal à s’accomoder des comportements nocifs, des compromossions et
des intrigues de la chose publique. La question inconturnable de la
guerre suscite des réfléxions philosophiques méconnues, mais fécondes.
L’actualité en vaut son pésant d’or.
En Relations internationales17, les approches réaliste, libérale et
constructive sont des paradigms, i. e. des modeless dominants. Cette
formation apporte une vision interculturellle à même de bien
communiquer, d’être en connexion globale.
Du coup, la culture ou même la politique se voient ainsi attribuer une
position de force sur la détermination de la philosophie. De sorte que ‘’
15
Dans son métier, le journaliste receuille des informations, puis écrit des articles ou publie des
reportages (écrits, audio, photo ou video). Il consulte les dépêche des agencies de presse et la
documentation de son entreprise, il interroge des specialistes u des témoins.
16
En rappelant Heidegger, Jaspers, Gehn, Bloch et Adorno
17
Nées officiellement en 1919, lorsque le mécène gallois David Davies finança la création de la première chaire
de politique internationale à l’University College of Wales à Aberystwyth
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
25
(...) l'avenir de la pensée philosophique est affaire de pratique
politique ... ‘’18. Il peut s’agir, en principe, difficile de ressortir avec
précision ce qui est à la base d'une raison philosophique ou d'une raison
politique. Il y a là un : ‘’ (...) rapport de causalité morale existant entre le
contenu d'une doctrine philosophique et les fonctions de légitimation
qu'elle endosse à l'égard du comportement de ceux qui s'en
réclament...’’19.
A dire vrai, la philosophie se doit d’avoir des égards envers d’autres
sphères d'activités qui ont émergé et fournissent tout de même des
réponses aux questions de la place de l'être humain dans l'univers : la
psychologie, la sociologie, la chimie, la physique, l’environnement, etc.
chacune avec une rationalité propre. Vraisemblablement parce qu’
‘’Aujourd’hui, avoue Habermas, la philosophie ne peut plus se rapporter
dans le sens d’un savoir totalisant à l’ensemble du monde, de la nature,
de l’histoire, de la société’’20. Cette dévaluation a suscité, bien
heureusement, la nécessité d’intercomplémentarité entre l’éventail
discours scientifiques. Les différentes théories entretiennent un rapport
mutuel de complémentarité et de présupposition réciproque.
Cela étant, la philosophie qui n’a plus le monopole de tout maitriser,
essaiera de rendre evident la place que doit occupier la rationalité et la vie
juste dans la vie quotidienne, caractérisée par de transformations parfois
dramatiques sur le plan culturel, politique, économique et scientifique.
C’est de cette manière que le discours philosophique sera à mesure de
répondre aux questions foncières de notre situation dans le monde
Toutefois, rien n’est si simple. Mais comment répondre, maintenant, à la
question : "A quoi bon la philosophie, maintenant ? En effet, hier,
aujourd’hui et certainement demain, la science de Socrate, d’Aristote,
d’Okolo, de Mbolokala…, la philosophie donc, se voudra toujours
actuelle. Elle existera aussi longtemps qu’il y aura exigence de
conceptualisation. Dans l'élaboration d'une théorie de la société, des
nouveaux concepts valent leur pesant d’or: volonté, rationalité,
consensus, cohésion, etc. Son actualité nous semble être affaire de
18
Ibid., p. 48.
19
MC, p. 26.
20
TAC I, p. 17.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
26
critique. ‘’Cela confère donc, à nouveau, à la philosophie un rôle qui,
face à la culture dans son ensemble, est d’une importance actuelle, à
l’échelle de l’histoire universelle’’21.
En fin, après avoir tenté de montrer en quoi consiste la philosophie, son
origine, son rapport avec d’autre discours, nous allons à présent infléchir
cette pensée, comment elle se manifeste en Afrique.
CHAPITRE III: PROPOS SUR LA PHILOSOPHIE AFRICAINE
Ce propos peut trahir un parti pris. Cette inflexion consiste à
démontrer que la philosophie n’est pas l’apanage de l’occident. Autant
l’oriental a produit la philosophie, autant l’africain l’a produite.
Pour ce faire, nous situerons l’origine lointaine,
3.1. ORIGINE LOINTAINE
3.1.1. Antoine Guillaume AMO (1703-1753)
Le personnage d’A.-G. Amo est révélation de l’existence des hommes
africain qui ont accompli l’acte de philosopher à un moment déterminé
de l’histoire. Ce ghanéen est parti de son pays à l’âge de quatre ans.
En 1727, il présente en Allemagne à l’université de Halle sa thèse (de
promotion) de doctorat sur ‘’ les droits des africains en Europe’’ dans
laquelle il fait un plaidoyer pour égalité entre blanc et noirs.
En 1734, il soutient sa seconde thèse (d’habilitation) et est
nommé professeur à l’univesité de wittenberg. Quatre ans plus tard, soit
en 1738, il publia son ‘’Traité sur l’art de philosopher avec sobriété et
avec précision’’.
De ce qui précède, cette pérsonnalité nous interesse parce que
dans l’Allemagne de l’Aufklarung déjà, il a existé un homme, un africain
qui pensé comme Africain sur les condition de noir en Europe.
3.1.2. Thèse sur l’image négative du noir
Si déjà à l’époque d’Amo, il existe des théories qui justifiaient le
racisme, ces théories on continué à se fonder sur des thèses pseudo-
21
MC, p. 37.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
27
scientifiques qui présentaient une image négative du noir et justifiaient
ainsi colonialisme etb éxploitation de l’Afrique.
a. Le Nègre n’a pas d’ame : il n’est qu’un singe
La thèse souténue par C. Carrel en 1900 pour lui, le nègre est une
brute créée avec le langage articulé et des mains pour servir son maitre,
l’homme blanc. C’est pourquoi, estimait-il, « sous peine d’athéisme, il
faut admettre que les nègres ne sont que des singes. Les prendre pour les
hommes, essayer de les éduquer, de les élever, de les christianiser, est
entreprise criminelle ».
b. Le nègre est naturellement incapable de progresser.
Le Dr Charbonnier, pour soutenir cette thèse, a fait appel à deux lois de
Wirchow:
- Loi de l’angle sphénoidal22
- Loi de la soudure des sutures crâniennes23.
c. Le nègre est un être sans logique et insensible aux contradictions
les plus étranges
d. Le nègre est un être sans logique et insensible aux contradictions
le plus étranges.
A ce sujet, Dieterton dira: “Nous Européens, gens de réflexion et
de raison, nous éprouvons un besoin irrésistible de tout comprendre,
d’être logiques, de tout réduire en systèmes. D’écarter toute
contradiction dans nos idées et dans nos croyances. Le nègre se contente
des idées vagues et ne se laisse pas incommoder par les contradictions
flagrantes qui s’y trouvent. Il ne précise pas, il ne raisonne pas, il n’a pas
22
2313
Cette loi explique que chez le blanc, à partir de la naissance jusqu'à l’âge de la puberté, la branche antérieure
(du sphénoïde qui forme la base du crâne), comme si elle se mouvait sur un pivot au point de jonction avec la
branche postérieure, s’abaisse. L’édifice crânien s’est augmenté d’un étage où viennent se loger les
circonvolutions. Chez le noir par contre, cet abaissement n’a pas lieu et donc pas d’augmentation crânienne d’un
étage : « la nature lui a refusé l’appartement réservé à la raison ».
Les sutures permettent de réunir les vertèbres crâniennes, se soudent différemment selon qu’il s’agit d’un blanc
ou d’un noir. Chez le 1er, les sutures occipitales se soudent de très bonnes heures pour empêcher tout
développement des instincts brutaux. Par contre, les sutures fondamentales ou antérieures sont laissées intactes
de manière à donner à la raison toute latitude d’agrandir son compartiment jusqu'à un âge avancé. Chez le nègre,
la soudure frontale est soudée dès la 1 re jeunesse pour empêcher tout développement au compartiment
raisonnable tandis que la suture est très longtemps ouverte permettant ainsi l’agrandissement indéfini de
l’appartement réservé aux instincts brutaux (A lire, Les européens au contact des africains, Bruxelles, 1905 ;
MPUTU LOPEKA Laurent, L’identité Africaine face à l’axiome hégélien. Essai sur l’ identitaire , 2019).
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
28
de logique; il n’y regarde pas si près. Du reste, ces nègres n’ont pas des
théories. Ils n’ont pas même de conviction, ils n’ont pas que des
habitudes, des traditions”.
Qu’une chose soit absurde ou qu’elle soit ridicule, qu’est-ce cela
leur fait? Ils la font, non par conviction, mais instinctivement,
aveuglement, sans réflexion, sans raisonnement parce que c’est comme
l’on fait quand est mo-soute. Voilà la thèse soutenu par wirchow et
l’école naturelle allemande
Le nègre est doté d’une incapacité congénitale de penser, de
réfléchir et d’entendre le langage de la raison. Il entend le langage
du cœur ;
Le nègre est naturellement poussé au mal et à la violence. Il n’a
pas de morale et le nègre n’a pas de religion.
3.1.3. Thèse sur l’image de positive du noir
Face aux thèses qui niaient l’humanité du noir, d’autres auteurs avaient,
bien avant P. Tempels, découvert l’autre face de noir. Par leurs écrits, ils
ont voulu non seulement réhabiliter le noir et sa culture, mais aussi
permettre une action ‘’ civilisatrice’’ plus efficace. Pour eux, l’homme
noir avait une philosophie, une philosophie collective ou populaire.
Voici quelques thèses:
a. Le nègre est comme le blanc
C’est notamment l’expérience fait Van OverbergC d’un voyage aux
Etats-Unis et au canada en 1905 où il fait la découverte de Booker Taliane
Washington, l’esclave affranchi; respecté par le blanc du Sud. Grâce à la
culture reçue du général Astrong, B.T Whanshington a réalisé son rêve
en construisant, pour et par des nègres àTuskege, une grande école qui a
permis d’élever le niveau de noirs.
b. Le nègre n'est pas un sauvage
Cf. Van Der Kerken qui dira: “l'étude que nous avons faite
précédemment démontre que les bantous ne sont pas des "sauvages", c.-
à-d. des groupes d'individus sans institutions familiales et sociales, mais
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
29
au contraire qu'ils possèdent une organisation familiale, sociale et
politique bien déterminée”.
c. Le nègre a une civilisation
Cf. Der Kerken, Les populations africaines du Congo-belge et du Ruanda-
Urundi, Encyclopédie du Congo-Belge, T.I, Bruxelles, 1954, p. 130-131.
Soit dit en passant, c'est dans la mouvance de ces 'dernières thèses qui
ont évolué simultanément avec les thèses sur l'image négative du noir
que se situe le R.P. Placide Tempels.
3.2. LA PHILOSOPHIE AFRICAINE TRADITIONNELLE
En 1954, Placide Tempels publie: « Philosophie bantoue ». Dès sa
publication à Elisabethville (actuel Lubumbashi), ce livre provoque des
réactions en sens divers. Pour les uns, ce livre venait confirmer
l'humanité de l'homme noir. Pour d'autres, la multiplicité de la
philosophie qui y est présentée révélait que les bantu étaient différents
des autres hommes.
Tentons de résumer en 5 points ce spécial livre de 7 chapitres:
1. L’affirmation de l'existence de la philosophie bantu. A ce sujet,
partant de l’universalité et de la permanence du comportement des
bantu face à la mort et à la maladie, Tempels affirme l'’existence
d'un ensemble d'idées, un système logique. Donc les bantu ont une
philosophie;
2. Cette philosophie bantu est différente de la philosophie
occidentale. Les occidents ont une conception statique de l'être
(l’être est), les bantu ont une conception dynamique de l'être (l'être
est force de la vie) ;
3. La notion fondamentale de cette philosophie est la notion de
FORCE, force de la vie, vie est force;
4. il faut distinguer une hiérarchie des forces: Dieu, les fondateurs des
clans, les premiers hommes, les ancêtres, les esprits, les hommes
vivants, les forces animales, végétales et minérales et
5. Il y a une interdépendance des forces, une interaction.
Ajoutons à cela la pertinente contribution de Kagame Alexis. Ce clerc
rwandais a continué, pour l'essentiel, sur la même voie que le père belge.
Des idées contenues dans son livre intitulé: « La philosophie bantu
rwandaise de l'être », l'’on peut en retenir les suivantes:
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
30
a. L'abandon d'une philosophie issue d'un examen général de la
culture (cas de Tempels) pour celle issue de l'analyse de la langue
(Kinyarwanda).
b. La limitation de ses recherches à des zones culturelles (Rwanda-
bantu). Le refus de réduire la philosophie bantu à une catégorie.
c. La non-exécution mutuelle de l'aspect dynamique et statique de la
philosophie.
.3.3. QU'EST-CE DONC LA PHILOSOPHIE AFRICAINE?
La question peut s'articuler de la manière suivante:
a. Qu'est-ce que la philosophie et quelles en sont les exigences?
b. Les visions africaines de l'homme, du monde et de l'absolu,
peuvent-elles prétendre au statut épistémologique, i.e au genre de
recherche et de connaissance caractéristique de la philosophie?
c. Quels sont en Afrique d'hier et d'aujourd'hui, les principaux
thèmes que l'on puisse qualifier exclusivement africains?
d. Comment apprécier les recherches philosophiques
contemporaines?
Nous conviendrons de donner à l’expression «philosophie
africaine» l'usage restrictif de négro-africaine subsaharienne. C'est ce
dernier surtout qui fait problème et non, par exemple, la philosophie
arabo-africaine.
Par "Philosophie africaine traditionnelle" entendons l'ensemble
des énoncés explicites de tradition orale (sentences, maximes, apophtegmes,
proverbes, dictions, mythes, épopées) des négro-africains au sujet de ce qu'il en
est, enfin de compte pour eux, de l'homme, du monde et de l'absolu.
Par "philosophie africaine contemporaine" entendons les
ébauches faites par les philosophes africains et africanistes, soucieux de
méthode scientifique, envue soit de ’’restituer" une pensée africaine
traditionnelle cohérente et ouverte à des prolongements, soit par les
impératifs délibération et de développement, soit encore de critiquer de
façon constructive les recherches africaines en cours.
Il va de soi que le jugement apporter sur la philosophie africaine
sera nuancé suivant qu'il s'agit de la philosophie traditionnelle, de la
philosophie restituant, de philosophie constituante ou de philosophie
critique. Plus radicalement encore, ce jugement est, lui-même, fonction de
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
31
l'idée qu'on se fait des exigences auxquelles doit satisfaire une pensée
pour être appelée philosophie. A Présent parlons maintenant de la vision
que les négro-africains se font de l'homme.
3.4. L'homme selon la philosophie negro africaine
1. la place de l'homme dans la hiérarchie des êtres (ntu)
Certaines langues négro africaines, spécialement des peuples
appelés bantu, utilisent le radical "NTU " pour désigner tout ce qui est.
Le " ntu" est la réalité fondamentale sous-jacente à tout ce qui est 24”
Ainsi, Dieu, comme l'animal, le végétal ou le minéral sont ces " ntu". Le
ntu est un radical ou une racine invariable. En tant que tel il est précède
des préfixes qui permettent d'opérer des distinctions et, par-là,
d'attribuer dans le langage diverses significations aux différents ntu.
Bien que constitué de deux classes (mu-ntu/bantu d'un côté, ci-
ntu/bintu de l'autre), le ntu n'est pas une entité concrètement identique
dans tous les état. Bien au contraire, il existe une hiérarchie des ntu en
fonction du degré de participation à la vie dont la source se trouve être
Dieu à travers les ancêtres. Cette hiérarchie des ntu se présente de la
manière ci après25 :
a) Dieu: il est la source et le créateur de toutes choses. C'est de lui que
provient le renforcement de la vie humaine; car il est celui qui « est
la grande force », qui est “plus fort que tout autre”26 Il est la source
de la vie. Il est " la force suprême, complète, parfaitement en soiet
pour soi (...) :il a sa cause existent elle en soi »27
b) Les ancêtres (bakishi, bantoko, bankoko, bankaa): ils possèdent,
après Dieu, une capacité extraordinaire de renforcement de la vie
qu'ils ont transmise aux vivants sur terre. En tant que tels, ils sont
les garants et les intendants de la vie telle qu'elle est vécue au sein
du clan.
c) Les hommes (les vivants sur terre): parmi ceux-ci, on distingue les
ainés des clans, les plus âgés et les autres. Chaque homme en
fonction de sa position dans le clan, est avec la vie, qui elle, est un
don de Dieu par l'intermédiaire des ancêtres claniques
24
TSHIMALENGA, la vision ntu de l’homme
25
P.TEMPELS, Philosophe bantu. Introduction et révision de la traduction, de A.Rubbens sur le ‘’texe original’’
par A.S.SMET, Kinshasa, FTC, 1979, p45
26
Ib, p.22
27
Ib,p. 74
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
32
d) Les animaux : non seulement, en tant que ntu, les animaux ont la
vie,mais aussi peuvent renforcer la vie, notamment celle des
hommes.
e) Les végétaux : eux aussi ont la vie qui peut être partagée aux
autres ntu
f) Les minéraux : occupent le rang inférieur, dans la hiérarchie des
ntu. Malgré leur position, ils servent dans le renforcement de la vie,
notamment des animaux, des végétaux et des hommes.
Il convient de noter que ces divers ntu ne sont pas indépendants les
uns des autres. Bien au contraire, il existe une interdépendance, une
interaction entre ces différents étant dans la mesure où, en dehors de
Dieu qui n'attend pas d'être renforcé par des êtres (supérieurs ou
inférieurs) comme ils peuvent renforcer la force des autres28.
Mais parmi tous les ntu créés, l'homme occupe la place dominante.
Car sa vie et sa plénitude d'être ressemblent à celles de Dieu. P. Tempels
n'avait-il perçu que:" Les Bantu voient dans l'homme, la force vivante,
l'être qui possède la vie vraie, pleine et suprême. L'Homme est la force
suprême, la plus puissante parmi les autres êtres visibles créés: les
animaux, les plantes et les minéraux. Ces forces inférieures ne possèdent
pas la vraie vie, pleine, supérieure et plus vigoureuse de Muntu. Elles
n'existent, par la prédestination divine, que pour l'assistance de la force
de vie visible la plus haute: l’homme »29.
2. Les caractéristiques de l'homme
Le centre de toute l'humanité, y compris celle des défunts, l'homme
comporte des traits qui permettent de le définir tantôt en tant que
personne, tantôt en tant qu'individu.
a. l'homme comme personne
Alors que dans la conception occidentale, l'homme défini par 2
principes essentiels, à savoir: son âme et son corps; les bantu ne
définissant pas l'homme par tel ou tel trait à l'exclusion des autres. Pour
eux, l'homme est à la fois un être matériel et un être spirituel: l'homme
est multidimensionnel.
28
Ib, p. 40-43
29
Ib, p.73
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
33
Néanmoins, lorsqu'on réfère aux expressions verbales des bantu,on
pourrait distinguer en l'homme :
• D'abord le principe vital qui est double:
Il y a d'une part le principe vital supérieur qui est immortel appelé
le Muntumuine en ciluba, l'homme lui-même, qui est immortel parce
qu'il subsiste après la mort du corps visible. C'est ce que les occidentaux
appellent " l'âme".
Il y a d'autre part deux principes vitaux inférieurs qui sont
matériels et périssables. Leur rôle est de vivifier le corps. S'agit-il de
l'ombre et du souffle qui périssent avec le corps?
Le corps visible: il joue le rôle d'habitat pour le principe vital
supérieur. C'est l'homme visible ou l'homme apparent.
Toutefois les bantu ne considèrent pas le corps comme identique
au muntumuine (l'homme véritable). Celui-ci s'incarne, et n'est visible
que par le corps, car il continue de vivre même après la mort du corps
visible. Mais le corps n'est pas le muntumuine, l'homme lui même
véritable30
b. L'homme comme individu déterminé
Entant qu'individu, l'homme est inconnu, impénétrable par les
autres. C'est pourquoi, les bantu recourent à deux critères principaux
pour approcher l'homme concret. Il s'agit du nom et de l'apparence
sensible.
• Le nom
Le nom, pour les Bantu, n'est pas une simple étiquette collée à
l'individu, il traduit et définit la nature de l'individu, c'est-à-dire la
réalité de l'individu.Il est, au dire de Mbolokala, un programme et une
direction.
En effet, au-delà de ce qu'il est extérieurement pour les autres, le nom
fait entrer un individu dans la lignée de ces ancêtres. En fait, on peut
distinguer trois sortes de noms31:
Ib, p.36-38
30
31
Ib, p.81-82.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
34
- Le nom intérieur, ou le nom de la vie, ou encore le nom d'être qui
spécifie un individu. Ce nom ne se perd jamais, et ne se change
pas.
- Le nom de circonstance ou le nom donné à l'occasion d'un
événement qui provoque l'accroissement spécial de la force de vie;
investiture d'un chef ou l'initiation d'un nouveau sorcier.
- Le nom extérieur: c’est le nom que l'individu lui-même se choisit.
Ce nom peut être changé, modifié selon les milieux.
L'apparence sensible
Dans tout homme, il y a, rappelons-nous, l'homme véritable
comme principe vital supérieur à la fois indéterminé, immortel et
impérissable, et 1'homme apparent, qui se manifeste par le corps vivifié
par deux principes viraux inférieurs, à savoir le souffle l'ombre.
Le corps visible constitue cette apparence sensible à travers lequel
apparait l'homme comme individu déterminé. Ainsi, à travers son
regard, son geste, sa parole un muntu peut agir sur un autre et lui
transmettre une bénédiction, une malédiction ou une maladie
En fait, c'est la force de vie que porte un homme ou un être et non
pas son regard ou sa parole qui lui permet d'influencer la force de vie
d'un autre ou de provoquer sur lui des dommages quelconques.
3. Les valeurs fondamentales de l'homme Négro africain
a. La vie forte, intense, pleine
De tous les biens que les bantu souhaitent obtenir, le bien par
excellence, c'est la vie32. Celle-ci a sa source en Dieu. Alors que les
ancêtres claniques sont les garants de la vie que portent tous les
membres du clan, les parents n'en sont que les transmetteurs immédiats.
Si les Bantu sont conscients du fait que la vie qu'ils portent leur est
transmise par leurs parents, leur plus grand souhait est que cette vie soit
non seulement sauvegardée, mais aussi intensifiée, renforcée, revigorée
en cas de maladie ou que autre faiblesse 33. Ce processus se produit grâce
au lien vital qui unit les êtres(ntu) tout en fondant une hiérarchisation
des êtres suivant le degré de participation de chaque être à la vie de
Dieu, passe par les ancêtres; il se produit surtout grâce à l'interaction des
32
TSHIMALENGA, la vision ntu de l’homme P. 163 Lire également, P. TEMPELS, Notre rencontre, p.38 ou
dans Philosophie bantu.
33
Ib. p.21
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
35
forces. Chaque force, supérieure ou même inférieure, peut faire renforcer
ou faire diminuer la force d'une autre.
Cela se comprend lorsque l'on se rappelle que les différentes
forces ne sont pas autonomes les unes des autres. Bien au contraire, elles
exercent une influence, bénéfique ou maléfique, les unes sur les autres.
Compte tenu de l'importance capitale que les Bantu accordent à
la vie, toutes les atteintes à la vie d'autrui sont considérées comme fautes
lourdes. C'est le cas du meurtre et toute autre atteinte à l'intégrité
physique d'autrui.
b. La fécondité totale et intense
De même que les Bantu sont conscients que la vie qu'ils portent
en eux e:st un don de Dieu leur transmis par les parents, de même ils
comprennent qu'ils ont le devoir de transmettre cette vie à d'autres.
C'est pourquoi, les bantu tiennent .à la fécondité, une fécondité
nombreuse qui ne s'arrête pas à la fécondité physique, mais aussi sociale
et spirituelle. Au-delà de la famille ou clan, la fécondité dont il est
question concerne des personnes avec lesquelles on a tissé des liens
d'affinité (par le mariage) ou des pactes de sang ou d'amitié.
Finalement en tant qu'adulte, mâle ou femelle, tout homme est
supposé être un père (la paternité) ou une mère (la maternité) d'une
multitude d'enfants.
C'est ici le lieu de marquer l'importance et le sens du mariage.
Celui-ci est une institution sociale ayant pour but de permettre. à un
homme ou à une femme de manifester sa fécondité, et tout d'abord sur le
plan physique.
Dès lors, on comprend l'attitude que manifestent les Bantu
vis-à-vis des hommes des couples stériles. Le mariage ayant comme
premier but de procréer, un couple stérile ou infécond doit être dissout;
"soit donner lieu à d'autres procédé qui ont pour objectif de permettre
l'avènement des enfants dans le couple. Ces procédés sont notamment la
polygamie, l'adoption et la prise en charge des enfants d'un ami ou d'une
personne avec laquelle on a tissé des liens très spéciaux. C'est le cas
d'une personne qui vous aurait sauvé la vie34.
En rapport avec la stérilité, la tradition Négro-africaine,
notamment mongo prévoit des cérémonies spéciales lors de la mort
d'une personne stérile. Celle d’étant morte sans laisser d'enfants est
invitée, à cause de sa "double mort", à s'en aller définitivement et à ne
34
Ib, p. 24-25
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
36
pas revenir dans le monde des vivants pour la simple raison qu'elle
n'y a pas laissé de descendances.
c. L'union vitale (solidarité)
Chez les Bantu, tout homme est toujours et déjà un être avec,
un homme clanique, vivant en union vitale, dans la solidarité et
fraternité avec tous les membres de sa famille ou de son clan. il est,
comme le note Tempels, dans " une relation intérieure de vie avec Dieu,
avec son ascendance, avec ses frères du clan, avec sa famille et avec ses
descendants35.
En effet, le Muntu n'apparait jamais comme individu isolé et
indépendant; il est constitué toujours un chaînon dans la chaine des
forces de vie; en tant que tel, il se situe entre la lignée et la lignée des
puinés. Tout individu est ainsi nécessairement clanique36.
Aussi le muntu peut-il s'éprouver comme un être de relation
non dans le mode de l'avoir mais dans celui de l'être avec. Le muntu
n'est pas, il n'existe pas, mais il est là parmi d'au', lls étant, parmi d'autres
hommes. Aussi est-il poussé à être altruiste. C'est en termes non d je,
mais de nous, de biso, que le muntu s'éprouve37
Le ntu n'entretient pas la solidarité au niveau clanique, mais
aussi avec des inconnus. Car, ceux-ci avec qui il -a, n'a aucun lien, ni
amical, ni clanique, ni politique ne sont pas à proprement parler des
étrangers. Tout inconnu, tout " bobutu, bopaya" est déjà un homme
d’autrui,” un homme de Dieu qui est ressortissant d'un clan et, par
conséquent, il est mon hôte38. D'où toute personne considérée comme
inconnue de la famille est sacrée et inviolable.
4. La vie et la mort pour les Négro-africains
Pour les Négro-africains, la mort intervient lorsque le corps,
l'homme apparent avec les principes vitaux inférieurs (le souffle et
l'ombre) n'alimentent plus le muntumuine, l'homme véritable, le
principe vital supérieur. Alors celui-ci quitte définitivement le corps.
Contrairement à la vie qui est excellence, la mort n'est pas
facilement acceptée. Elle est considérée comme une faille dans l'œuvre
créée par "Wangi bolongo". Si elle est tolérée, acceptée pour les "bikota",
‘’les bingambi’’, les vieillards, elle est considérée comme absurde et
scandaleuse pour les enfants, les jeunes et les adultes encore dans la
35
Ib,82
36
TSHIMALENGA p. 166
37
Ib, p.168
38
Ib, 168
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
37
force de l'âge. Parfois, les Ekonda disent, impuissamment avec
regret:"bapolo la Nzambe"39.
La mort ne vient pas de Dieu, mais des ancêtres, d'un sorcier,
d'un haineux, ou en général, des personnes maléfiques. Ainsi, si le
vieillard meurt de sa vieillesse, le jeune meurt à la suite d'une
intervention maléfique d'un agent extérieur}! Dont la force vitale se
relève supérieur à celle du défunt. Il n'y a donc pas, en dehors des cas de
vieillards des morts naturelles.
Quoiqu'il en soit du caractère redoutable de l'épreuve de la
mort, celle-ci est un départ pour l'inconnu, un événement qui provoque
un préjudice pour le défunt et sa famille, bien que le défunt soit
considéré comme protecteur des vivants sur terre.
Néanmoins, le mort ne meurt pas, à proprement parler, il ne
disparait pas totalement. Il est rentré dans le village des ancêtres où il
continue une nouvelle vie. La mort n’est donc pas la fin de l’homme. Elle
n’est qu’un départ pour une autre vie, différente de vie sur terre.
5. La place de Dieu dans l’univers mental du Négro-africain
Le négro-africains considèrent que la vie vient de Dieu qui en est
la source. Aussi, entretiennent-ils de relations avec lui et le prie pour
sauvegarder leur force de vie.
Dans ce lien, les ancêtres claniques jouent le rôle d’intermédiaires
D’autant plus qu’il considérés comme des familiers de Dieu. Loin d’être
distant des hommes, Dieu est à la fois créateur et générateur primordial.
Il est également transcendant et immanent, près des hommes, même si
ceux-ci recourent d’avantages aux ancêtres claniques.
Conclusion
39
Expression ekonda qui peut être traduite par “l’on une lutte pas contre Dieu”ou “l’on ne s’oppose pas (à la
volonté) de Dieu”
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
38
L’enseignement de la philosophie a pour visée le développement
d’une façon de penser et non un système de pensées. Il a été note qu’en
philosophie, la vérité tant recherché est de l’ordre du questionnement et
du cheminement et non de l’acquisition des reponses toutes faites; ce qui
est prouvé, c’est advantage un chemin, une route.
Depuis ses débuts la philosophie s’entreprend de désenvelopper le
monde dans son entier, la multiplicité des phénomènes dans leur unité.
Le philosophe se fait passer pour un artiste de l’écriture argumentative et
un specialist des questions fondamentales qui nécessitent de tourmenter
l’esprit humain.
En fin, si l’effort philosophique a été d’esquisser quelques aspects
de l’homme et dans la réception nègro africain, celui de la logique ce
concentrera sur le discours de la raison sur elle-même.
DEUXIEME PARTIE : LA LOGIQUE
2.1. PRELIMINAIRES
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
39
La raison est puissance infinie. Elle se réalise dans l’actualité. Elle
mérite de ce fait une attention toute particulière pour sa conduite
correcte. Cela permettra à réfléchir de manière consistante, à juger avec
pertinence, à décider de façon judicieuse et à éviter l’égarement.
Dès lors, la logique s’érige en discours qui examine les œuvres de la
raison afin que celle-ci soit guidée sur le chemin de savoir. C’est dire
qu’elle s’occupe justement du fonctionnement optimal de cette faculté, la
plus importante, impartie à l’être humain: de raisonner, de raisonner
correctement, le pouvoir et la capacité de juger validement.
Immanquablement, l’étude de la logique vise l’éveil, l’encadrement
et l’entrainement du pouvoir et de la capacité de l’homme de bien
raisonner. Elle se pointe de ce fait comme un instrument pour aiguiser le
sens critique. Aussi sert-elle de support épistémologique aux
connaissances dont elle facilite la compréhension et l’assimilation. Elle
tient au vrai40.
2.2. DEFINITION DE LA LOGIQUE
La logique vient, du grec « logikè », tiré de « logos », veut dire science
du raisonnement en lui-même, abstraction faite de sa matière et de tout
processus psychologique. En gros, deux sens apparaissent lorsque l’on
traite de la logique. Il y a le sens ordinaire41 et le sens scientifique42.
Retenons que la logique est l’étude des conditions de la pensée
valable, i.e. de la pensée qui atteint la vérité. Mieux, c’est l’étude de la
cohérence et de la validité des raisonnements. Elle est, selon J. Dopp, science
qui détermine qu’elles sont les formes correctes (ou valides) de
raisonnement. Mieux, elle est une science ayant pour objet de
déterminer, parmi toutes les opérations discursives de l’esprit, lesquelles
conduisent à la vérité et lesquelles conduisent à l’erreur43.
40
Autant le terme ‘’beau’’ renvoie à l’esthétique et le terme ‘’bon’’ à l’éthique, le terme ‘’vrai’’ renvoie à la logique. Certes
toutes les sciences ont la vérité pour but, mais, la logique s’en occupe d’une toute autre manière. Autrement dit, découvrir des
vérités est la tâche de toutes les sciences, mais à la logique, il appartient de connaître les lois de l’être vrai.
41
Dans ce cas, la logique signifie le bon sens (la chose du monde la mieux partagée selon Descartes). C’est une manière
propre à un individu ou une collectivité de penser, de se comporter et même de gérer ses affaires. C’est la logique naturelle.
C’est-à-dire, c’est l’aptitude innée d’arriver à la vérité sans connaissance préalable des lois (académiques) de la pensée que
nous allons étudier dans ce cours. On le voit, pragmatiquement, elle est illogique ou alogique ou encore antilogique si et
seulement si, elle ne conduit pas à la vérité des faits, i.e. à la réussite des projets.
42
Contrairement au sens ordinaire, la logique, ici, se conçoit comme la science qui, techniquement, détermine les formes
correctes du raisonnement. C’est la logique au sens « rigoureux » du terme. Elle est constituée de deux branches : la logique
mineure (ou formelle) et la logique majeure (matérielle).
43
A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris/Quadrige, PUF, 1993.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
40
Cela étant, elle est à la fois science et art. Science, elle a pour objet le
langage qu’elle examine afin de découvrir les lois qui le gouvernent. En
étudiant le langage, la logique examine son fonctionnement. Elle
détermine la nature des propositions qui sont à la base du jugement. Elle
classe ces propositions suivant qu’elles se fondent sur une réalité
objective (jugement de fait) ou sur une perception subjective (jugement
de préférence). Ici, le logicien, comme tout autre scientifique, observe,
analyse et propose une théorie explicative de l’objet analysé.
Mais la logique est aussi un art. Art de raisonner, elle produit le bon
raisonnement. Ici le logicien intervient pour construire l’œuvre et
fabriquer l’agencement entre les propositions, permettant ainsi à la
raison d’accéder à la connaissance de la vérité.
Comprise comme science normative, elle édicte des règles pour bien
conduire le raisonnement. Elle ne se limite pas à décrire, comme le ferait
une science descriptive, mais elle établit des lois que l’esprit doit suivre
pour rester cohérent et harmonieux. Car il (esprit) doit respecter sa
propre forme pour atteindre la cohérence et la vérité pour ne pas être
contradictoire avec lui-même ni avec la réalité.
En somme, la logique peut se concevoir comme science qui nous
aide à bien raisonner dans tous les domaines de la vie (sociale,
académique, professionnelle,…) en vue d’en découvrir la vérité et être
précis et cohérent. De la sorte qu’elle assure l’encadrement et la police de la
raison.
Cette logique s’appelle indifféremment logique ancienne, classique,
mineure, ou formelle. C’est la partie de la logique qui étudie l’activité de
la raison humaine du point de vue formel (rectitude, cohérence). Il s’agit
de la science de l’accord de la pensée avec elle-même, indépendante du contenu
matériel des propositions.
Or toute pensée se réduit, en dernière analyse, à des relations
établies entre des représentations elles-mêmes exprimées sous forme de
Concept, de Jugement et de Raisonnement.
CHAPITRE I : LE CONCEPT
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
41
L’étude de concept est abordée dans le tout premier traité d’Aristote,
intitulé : Les Catégories. Ce point porte notamment sur la définition,
l’expression, les propriétés, la classification, la hiérarchie et la division
des concepts.
1.1. DEFINITION
Du latin conceptus, participe passé du verbe concipere, ‘’former en
son sein, contenir’’, le concept est la représentation abstraite et générale
d’une chose ou d’un fait.
En tant que représentation abstraite, le concept est une idée générale.
C’est un acte mental par lequel l’esprit perçoit l’objet (ou le référant)
dans son essence sans rien affirmer ni nier. C’est donc une représentation
intellectuelle de l’objet.
Le concept est l’essence d’une chose dans la pensée ; il se forme par
mécanisme psychologique. C’est des expériences sensibles accumulées
que se forme un concept.
Ex: - musicien, arbre, ventilateur….
Toutefois, le concept se différencie de l’image par le fait qu’il est une
représentation mentale (ou abstraite) et générale de l’objet, alors que
l’image est une représentation concrète (sensible) et particulière de
l’objet, i.e. représentation déterminée d’objet sensible.
Ex: Ce Chef de Travaux Laurent, tel directeur consciencieux, le graffiti qui est
l’entrée de x, ce geste d’amour … sont des images.
Ainsi défini, pour que le concept se forme dans notre esprit, les
exigences ci-après doivent être satisfaites :
a) Le sujet : c’est l’homme qui conçoit une idée.
b) L’objet : c’est ce à quoi la pensée se réfère, c’est la chose à laquelle on
pense. Cette chose peut être matérielle (le téléphone, la
marchandise…) ou immatérielle (l’amour, la paix…). L’objet sert
donc de suppôt à la pensée.
c) La conception : la transmutation de l’objet en pensée ; l’acte de penser
l’objet. Le concept, résultat de la conception, peut être mental ou
objectif. Il est mental pour autant qu’il existe dans l’intelligence
seulement, sans référence directe à l’objet ou au suppôt. Il est objectif
s’il se réfère directement à l’objet.
Par ailleurs, il faille noter que le terme peut être univoque,
équivoque ou analogique.
Le terme (concept) est univoque, lorsqu’il s’applique à deux
ou plusieurs sujets dans un sens totalement identique. Ex. : homme se dit
aussi bien du garçon que de la fille ; il signifie dans ce cas être humain.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
42
Le terme est équivoque, lorsqu’il s’applique à deux ou
plusieurs sujets aux sens totalement différents.
Ex. : ‘’sol’’ signifie terre et note musicale.
Le terme est analogique lorsqu’il s’applique à deux ou
plusieurs sujets aux sens qui ne sont ni totalement identiques ni
totalement différents ; on remarque une certaine similitude. Ex. : pied
peut s’appliquer à l’homme, à la montagne, à l’arbre, à la table, mais tout
en ne signifiant pas exactement la même chose.
1.2. L’EXPRESSION ET VALEUR LOGIQUE
Le concept s’exprime de deux manières : soit comme mot soit
comme terme. Le mot est l’expression verbale d’un concept, tandis que le
terme en est l’expression graphique ou écrite.
Par ailleurs, le concept est soit vrai (1), soit faux (0).
1.3.LES PROPRIETES DU CONCEPT
Le concept a deux propriétés: la compréhension et l’extension.
a. Compréhension d’un concept :
C’est l’ensemble des caractères intelligibles ou des propriétés
nécessaires à saisir de ce concept. C’est la connotation. Ainsi du concept
Denis Mukwenge, on entend : être, vivant, sensible, raisonnable, intellectuel,
africain, congolais, médecin, gynécologue, prix Nobel de la paix en 2018…
b. Extension du concept
Elle se comprend comme l’ensemble des objets réels ou idées,
concrets ou abstraits auxquels s’applique un concept ou dont ce dernier
est l’attribut. C’est la dénotation.
Ainsi, l’extension du concept «homme» s’étend aux six milliards
d’hommes qu’il y a sur la terre.
1.4. CLASSIFICATION DES CONCEPTS
On catégorise les concepts selon leurs compréhensions et leurs
extensions.
1.4.1. SELON LA COMPREHENSION
On distigue :
le concept simple: est celui qui a une seule note essentielle, c'est-à-
dire la compréhension s’analyse en un seul élément: être, possible,
vide, espace, (les couleurs et les sentiments. en tant que réalité, sont
des concepts simples : on perçoit les couleurs, on éprouve des
sentiments ; mais on ne les décrit ni les définit).
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
43
le concept composé (complexe): est celui qui a plusieurs notes
essentielles, c'est-à-dire sa compréhension s’analyse en une pluralité
d’éléments. Ex: - enfant.
1.4.2. SELON L’EXTENSION
On distingue:
-Concept particulier: Sa compréhension s’applique à une partie
indéterminée de son extension. Il est souvent accompagné de
quantificateur particulier comme: certain, certains, quelque, quelques,
un, des, la majorité des, peu de, la plus part des, beaucoup de, bien
des, deux, des, etc.
Ex: Quelques assureurs, la majorité des journalistes, deux vérificateurs.
Concept singulier : est celui dont l’extension ne comprend qu’un
suppôt, un concept qui connoterait l’exclusivité et serait défini
comme ne pouvant être réalisé que par un et un seul individu ou un
seul objet. Il est exprimé par de nom propre ou par de nom commun
spécifique à un individu.
Ex: Chance Lopeka, la Slovénie, une, etc.
concept universel(ou général): est celui dont la compréhension
s’applique à tous les éléments de l’extension. Il est souvent accompagné de
quantificateur universel tel que: tout, aucun, nul, le, les, etc. Il s’exprime
également par des termes, nom commun (homme, désir), adjectif (mortel,
inquiet) et verbe.
Ex: Tous les étudiants, aucun douanier, les formateurs.
Concept collectif : désigne un nombre indéterminé d’objets ou
d’individus pris en bloc.
Ex: une bande, une foule, un paquet, bataillon…
Concept distributif : il s’agit d’un concept dont la compréhension
s’applique a plusieurs objets ou individus et à chacun.
Ex: Les députés sont tous congolais (ici, congolais s’applique et à tous les
membres de la chambre basse et à chaque député).
Concept transcendantal : dont la compréhension peut s’appliquer à
n’importe quoi.
Ex: Le concept ‘’être’’ s’applique à n’importe quelle réalité.
Soit dit en passant, au cours de l’histoire de la philosophie, les
concepts ont été classés en :
a) Prédicaments : c’est ce qu’un prédicat dit du sujet.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
44
b) Prédicables : c’est la manière dont le prédicat détermine le sujet.
Ex. : Dieu est bon
Les prédicaments donnent un classement d’être en dix catégories,
selon la logique d’Aristote. Celui-ci a, en effet, nommé ces catégories les
« dix genres suprêmes » d’être. Ce sont :
La substance : Prodige est un être humain.
La quantité : Prodige a deux pieds.
La qualité : Prodige est jolie.
La relation : Prodige est la fille du CT Laurent
L’action : Prodige a jeté son jouet.
La passion : Prodige apprécie les dessins animés.
Le lieu : Prodige est à l’école.
Le temps : Prodige dort à 20h00’.
La situation (attitude): Prodige va à l’école toute joyeuse
L’avoir (possession, revêtement): Prodige a un chapeau sur la tête.
En évoquant l’idée l’essence des choses, on fait appel à la notion de
définition avec son corrélat, la division.
1.5. LA DEFINITION ET LA DIVISION.
1. La définition :
C’est l’analyse du concept du point de vue de sa compréhension,
elle est une opération grâce à laquelle on dit ce qu’est un objet
essentiellement. Autrement dit, une définition est une proposition dans
laquelle on dit ce qu’est une chose. On distingue la définition
étymologique et définition réelle.
-La définition étymologique est celle qui donne l’origine généralement
étrangère, d’un mot.
Ex. : budget est issu de l’a. fr. ‘’ bougette’’, petite bourse.
-La définition réelle est celle qui tente de dire ce qu’est réellement l’objet.
Elle comprend : le premier élément constitué du terme que l’on veut
définir et le deuxième élément fait appel à des concepts connus pour
indiquer deux choses.
1er ce que cet objet a en commun avec d’autres objets du même type que
lui (le genre).
2e ce qui le différencie de ces autres objets (la différence spécifique).
Ex. : Qu’est-ce que l’homme ? L’homme est un animal raisonnable.
REGLES D’UNE BONNE DEFINITION
1° Une bonne définition doit être positive et dire ce qu’est la chose et
seulement la chose ;
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
45
2° Elle doit être claire et simple. Elle ne doit pas être plus compliquée
que ce qu’il faut définir ;
3° On ne doit pas reprendre dans la définition le mot à définir ;
4° Elle doit être précise.
Bref, une bonne définition44 doit être claire, réciproque, ou
convertible, elle ne doit pas être négative, elle ne doit pas contenir le mot
à définir ; elle doit convenir au terme défini et rien qu’à celui-là.
2. La division
C’est l’analyse du concept du point de vue de son extension : elle
partage l’extension d’un genre en plusieurs classes de moindre extension
et indique à combien d’objets ou d’être différents s’applique une idée.
Une bonne division doit être cohérente, progressive, irréductible,
complète et exacte.
a. La hiérarchie logique des concepts
La hiérarchie logique est la conséquence du principe selon lequel
l’extension d’un concept est inversement proportionnelle à sa
compréhension : quand l’extension croit, la compréhension décroit, et
vice versa. En effet, il s’établit entre des termes formant une hiérarchie
un ordre de subordination qui va du genre à espèce. Conséquemment, le
concept qui a la plus grande extension (genre) est en même temps celui
qui a la plus faible compréhension ; le concept qui occupe la position
inférieure a la plus petite extension mais en même temps une plus
grande compréhension.
La hiérarchie logique témoigne de la capacité intellectuelle de
l’esprit humain à établir des liens de génération (tel concept provient de
tel autre, ainsi de suite) ou des corrélations entre différents concepts.
Ex. Animal-vertébré-mammifère-homme-africain-congolais-intellectuel-
Professeur, Médecin, Génycologue, Prix Nobel de la paix, Dénis Mukwenge.
Du coup, on établit un certain jugement.
CHAPITRE II : LE JUGEMENT
2.1. DEFINITION
44
Voici quelques exemples de mauvaises définitions :
-Qui est-ce qu’un étudiant ? R/ Ce n’est pas un kuluna.
-Une voiture est une mécanisation métallisée et plastifiée d’un système à moteur dont la fonction est la transportation.
-Qu’est-ce que penser ? R/Penser, c’est produire des pensées.
-L’homme est un animal, la beauté, c’est la perfection formelle provoquant l’adhésion du sentiment esthétique.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
46
Le jugement est un acte mental par lequel on affirme ou on nie un
rapport entre deux concepts ou, dans le cadre d’un jugement composé,
un rapport entre deux jugements.
Autrement dit, c’est l’établissement d’un rapport de convenance ou
de disconvenance entre deux termes.
Ex. : La formation à l’Institut Motema Mpiko est excellente: je juge le
rendement, et conclus après certains constats ou certaines considérations qu’elle
donne des indications d’excellence en contribuant efficacement au budget de
l’Etatconvenance
Le lien diplômatique RDC-Rwanda n’est plus au beau fixe : j’inspecte et
constate l’impraticabilé.disconvenance
Ce qui faut souligner c’est que le rapport de convenance ou de
disconvenance est rendu par le verbe (la copule), selon qu’il est affirmatif ou
négatif.
Il y a le jugement simple et le jugement composé. Si pour le
premier c’est la combinaison des concepts, le second consiste à combiner
les jugements.
Le père est heureux (Jugement Simple.) ;
S’il étudie, il réussit (Jugement Complexe.)
2.2. EXPRESSION ET VALEUR LOGIQUE
Le jugement s’exprime par la proposition, qui est en l’expression
orale ou écrite. Elle consiste en l’organisation logique des concepts
qu’elle implique. Elle est le lieu privilégié d’expression des jugements
dans la mesure où exprime des affirmations ou des négations.
Par ailleurs, le jugement est soit vrai, soit faux. Il est vrai lorsqu’il
désigne une proposition vraie par rapport au réel, faux quand il autorise
un nombre indéfini de proposition.
2.3. LA COMPOSITION DU JUGEMENT
Le jugement se compose :
D’un sujet (être dont on affirme ou nie quelque chose).
D’un prédicat ou attribut (la chose que l’on affirme ou nie du sujet).
D’une copule (qui marque le rapport entre le sujet et le prédicat. Le
plus souvent le verbe «est»).
2.4. CLASSIFICATION DES JUGEMENTS OU DES PROPOSITIONS
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
47
2.4.1. SELON LE RAPPORT ENTRE DEUX CONCEPTS (OU RAPPORT
EXPRIME PAR LE JUGEMENT)
1. Jugement attributif (ou d’inhérence, prédicatif) : il sert à affirmer ou à
nier un attribut d’un sujet.
Ex: -Aucun détourneur de dénier public n’est vertueux.
2. Jugement de relation : ici, il n’y a ni sujet, ni attribut, mais deux termes
qui jouent un rôle semblable.
a. Jugement symétrique
On dit qu’un jugement de relation est symétrique lorsque les deux
concepts ont la même valeur ou mesure. On peut inter-changer les
termes sans modifier la relation.
Ex: Prodige est la sœur d’Emiliana Emiliana est la sœur de Prodige.
b. Jugement asymétrique
Lorsque les deux concepts n’ont pas la même valeur, a.v. si l’inter-
changement des termes, dans une proposition affecte leur relation. Ex: -
Mme Rose est la maman de Christina.
c. Jugement transitif : lorsqu’il y a un concept intermédiaire qui, étant
vérifié entre les deux premiers, et les deux derniers, il se vérifie aussi
entre le premier et le dernier sans modification de la relation.
Ex: Emmanuelle est la collègue de Mariah,
Mariah est la collègue de Véronique,
Emmanuelle est la collègue de Véronique.
Si la relation vérifiée entre les deux premiers et entre les deux
derniers ne se vérifie pas entre le premier et le dernier élément, l’on dira
qu’elle est intransitive.
Ex: Abraham est le père d’Isaac et Isaac est le père de Jacob
Abraham ≠ père de Jacob.
3. Jugement existentiel : il est celui ou le verbe « être ne joue pas que le
rôle de copule, mais peut aussi exprimer soit l’existence d’un objet soit
celle d’un être.
Ex: «Dieu est» ; «je pense donc je suis».
2.4.2. SELON LA QUANTITE
On y distingue deux sortes :
a. Proposition Universelle, dont le prédicat (attribut) est affirmé ou nié
de toute l’extension du sujet.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
48
Ex: - Toute femme est prudente ; - Le chat n’est pas ruminant.
b. Proposition particulière, dont le prédicat est affirmé ou nié d’une
partie seulement de l’extension du sujet (qui est un concept particulier).
Ex: - Certains douaniers sont intègres. - Qlqs policiers ne sont pas sérieux.
2.4.3. SELON LA QUALITE
Il y a deux sortes :
a. La proposition affirmative, dont le prédicat est affirmé du sujet.
Ex: -Les apprenants sont curieux.
b. La proposition négative, dont le prédicat est nié du sujet.
Ex: - Les apprenants ne sont pas curieux.
Il est à noter que la quantité du prédicat ou de l’attribut dépend de
la qualité de la proposition. Clairement dit, dans toute proposition
affirmative, le prédicat est pris particulièrement et dans celle négative, le
prédicat est universellement pris.
2.4.4. LA MISE ENSEMBLE DE LA QUANTITE ET DE LA QUALITE
8
L’on utilise savamment des voyelles mnémotechniques A, E, I, O
pour désigner quatre types de propositions.
a. La proposition Universelle Affirmative, symbolisée par la lettre A
majuscule. Ex: Tout homme est mortel.
b. La proposition Universelle Négative, symbolisée par la lettre E
majuscule.
Ex: Aucun homme n’est parfait.
c. La proposition Particulière Affirmative, symbolisée par la lettre I
majuscule.
Ex: - Quelques étudiants sont appliqués.
d. La proposition Particulière Négative, symbolisée par O majuscule.
Ex: - Quelques parents ne sont pas responsables.
Ainsi, parvenons-nous alors au carré logique45 qui est, disons-le, la
figure facilitant la rétention des diverses propositions énoncées ci-haut :
A Contraires E
Subalternes
Subalternes
Contradictoires
I Subcontraires O
45
Imaginé par Apulée (vers 125-vers 170) au IIe siècle.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
49
2.4.5. SELON LA COMPREHENSION
Il y a deux sortes :
a. Jugement analytique: c’est lorsque l’attribut fait nécessairement partie
de la compréhension du sujet. L’analyse de la compréhension permet de
découvrir l’attribut qui n’ajoute rien à la définition du sujet.
Ex: Le triangle a trois angles.
b. Jugement synthétique : quand l’attribut introduit un caractère nouveau
que la définition ne comporte pas. Il est fondé sur l’expérience.
Ex:- Les congolais sont endurants ; - Quelques chevaux sont vifs.
2.4.5. SELON LA MODALITE
On a :
a. Jugement problématique : énonce une vérité peu sûre ou
hypothétique ; une possibilité des faits. Ex: - La RDC se ressaisira demain.
b. Jugement apodictique (nécessaire) : il est celui qui est affirmé à titre de
vérité de droit ; énonce une vérité de fait, une vérité inductible.
Ex: - L’homme doit mourir.
- Le président doit signer l’ordonnance pour être effectivement nommé
premier ministre.
c. Jugement assertorique(contigente) : énonce une réalité des faits,
contingente mais qui n’est pas nécessaire.
Ex: - Son bureau est endommagé ; - Il est vrai que…
2.4.6. SELON LA RELATION
a. Jugement catégorique :est un jugement simple établissant un rapport
entre deux concepts sans formuler d'hypothèses, de disjonction, ni de
conjonction. Ex. : l’homme est un bipède.
b. Jugement composé : exprime le rapport entre plusieurs faits, i.e.
affirme ou nie un rapport entre d’autres jugements. Il est identifié dans le
jugement hypothétique, disjonctif et conjonctif.
1. jugement hypothétique (conditionnel) :
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
50
Jugement dans lequel, le premier jugement est précédé de « si »… et
la vérité du second jugement de «alors». Il affirme un rapport de
principe à conséquence. La première, antécédent, exprime une
hypothèse ; la seconde, conséquent, indique la conséquence résultant de
l’hypothèse.
Ex: - Si Helena étudie bien, elle réussira
- Si la RDC veut être respectée, elle doit se choisir des dirigeants intègres,
sérieux, compétents et dignes.
2. Jugement conjonctif, dont les faits sont liés par la conjonction « et »,
symbolisé par
Ex: - Laurent est enseignant et administratif ; -Nancy danse et rit.
3. Jugement disjonctif :il est constitué d’au moins deux proposions,
réunies entre elles par le mot «ou» et forment chacune une
alternative. On en distingue deux :
a. disjonctif exclusif (strict, non inclusif) : Jugement composé de deux
jugements simples unis entre eux par une disjonction «ou» fort traduit
par «aut».
Ex: - Tout nombre entier est pair ou impair.
- Il fait jour ou il fait nuit.
b. Disjonctif inclusif (non exclusif) : jugement composé de deux jugements
simples unis entre eux par un «ou» faible, compris comme «Vel».
Ex: 1. Joyce est malade ou (et) fâchée.
- Il danse ou (et) il rit.
On le voit, l’homme ne se limite pas uniquement à affirmer, à nier
ou à signaler des faits, mais aussi, il démontre. Voilà le champ d’œuvre
du point suivant.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
51
CHAPITRE III. LE RAISONNEMENT
3.1. DEFINITION
Le raisonnement est un acte mental qui permet de passer d’un ou
des jugements, appelés antécédents (ou prémisses) à un autre appelé
conséquent ou conclusion.
Ex: Tous les hommes sont mortels
Or Socrate est un homme
Donc Socrate est mortel
3.2. EXPRESSION ET VALEUR LOGIQUE
Le raisonnement s’exprime par l’argument, qui est de ce fait sa forme
concrète.
Par ailleurs, il (raisonnement) est soit valide, soit non valide. Il est
dit valide lorsque la conclusion découle logiquement de la prémisse ou
des prémisses logiquement constituées. Dans le cas contraire, il est
déclaré non valide.
3.3. LES PRINCIPES LOGIQUES OU PRINCIPES DE RAISONNEMENT
Ce sont des propositions évidentes et indémontrables d’absolue
universalité, non déduites d’autres propositions ni de l’expérience mais
qui sont de présupposés ou des hypothèses nécessaires dans toute
opération de la raison comme norme absolue.
Il y en a quatre :
1. Le principe d’identité : une chose est toujours identique à elle-même.
Toute chose est égale à elle-même. « Ce qui est, est ; ce qui n’est pas, n’est
pas ».
2. Le principe du tiers-exclu : une chose est vraie, ou alors elle est fausse. Il
n’y a pas de tierce possibilité.
3. Le principe de non-contradiction(ou de contradiction) : une chose ne peut
pas être à la fois la même et autre chose. Une chose ne peut pas être et
n’être pas à la fois, dans le même temps et sous le même le rapport.
4. Le principe de causalité : toute chose a sa cause. Toute cause a son effet.
3.4. SORTES DE RAISONNEMENT
On compte plusieurs types de raisonnements, dont voici quelques-
uns à titre exemplatif.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
52
1. LE RAISONNEMENT INDUCTIF OU L’INDUCTION
C’est un raisonnement qui consiste à généraliser une proposition ou
une relation vérifiée analogue dans certains cas particuliers pour tous les
cas analogues. Autrement, l’induction est un raisonnement, un discours où,
en nous appuyant sur un certain nombre de faits observés auxquels nous
attribuons une cause commune, nous en arrivons à une conclusion. Il permet
de passer de la connaissance de faits à celle des lois régissant ces faits. Il
est souvent utilisé en science expérimentale.
On en distingue trois sortes :
a. L’induction formelle ou aristotélicienne :
Elle consiste à dénombrer tous les individus définis par la
possession d’une propriété. Autrement dit, elle consiste en une
énumération complète des sujets ayant la même propriété, ce qui permet
de conclure que l’ensemble de ces sujets possède la propriété.
Ex: Les végétaux, les animaux et les hommes respirent
Or les végétaux, les animaux et les hommes sont tous des êtres vivants connus,
Donc tous les êtres vivants connus respirent.
b. L’induction complète(ou par récurrence) :
Elle consiste à étendre à tous les cas semblables, les propriétés
arithmétiques ou algébriques vérifiées pour un seul cas. Il s’agit,
finalement, d’une généralisation complète.
Ex: Si la première copie est bonne.
Alors toutes les autres de la série sont également bonnes.
c. L’induction amplifiante (ou baconienne, en réf. à F. Bacon)
Elle consiste à étendre à l’espèce tout entière l’observation faite sur
un ou plusieurs individus de cette espèce. Elle est l’induction au sens
ordinaire du mot. On passe de quelques cas à l’affirmation d’une loi
généralisée.
Ex: Le fer, le cuivre, le zinc…, sont des métaux,
Le fer, le cuivre, le zinc… sont de bons conducteurs d’électricité,
Donc tous les métaux sont des bons conducteurs d’électricité.
2. Le raisonnement par analogie est celui qui conclut à l’identité de deux
ou plusieurs réalités différentes sur base de quelques similitudes.
Ex: J’ai lu un livre d’un auteur et je l’ai apprécié ;sa prochaine publication, par analogie, je
serai motivé de la lire.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
53
N.B : Ce mode de raisonnement, si précieux soit-il, pour imaginer des
hypothèses, n’est pas sûr, car il peut faire aboutir à l’erreur si nous
n’atteignons que des ressemblances superficielles.
3. Le raisonnement par l’absurde : est un procédé qui établit la vérité
d’une proposition en montrant que sa contradictoire aboutit à des
conséquences absurdes, des conséquences fausses ou incompatibles avec
l’hypothèse.
Ex: La RDC est un pays fertile. Car : supposons qu’elle n’était pas fertile (proposition
contradictoire). Alors elle serait dans l’impossibilité de nourrir une population très dense.
Or elle nourrit une population très dense. Donc…
4. Le raisonnement déductif ou la déduction (inférence)
La déduction est une opération mentale qui conclut du général au
particulier, ou de la loi au fait. C’est une synthèse des jugements
permettant d’établir un rapport de nécessité logique. Elle consiste à
partir d’un ou des jugements posés appelés antécédents ou prémisses à
une conclusion qui est une vérité nécessaire. La déduction est
absolument rigoureuse ; sa conclusion est nécessaire et unique
On en distingue deux sortes: la déduction immédiate et la déduction
médiate (ou syllogisme). On appelle aussi «inférence», l’acte par lequel
l’intelligence infère, i.e. déduit une vérité à partir d’une autre.
A. La déduction immédiate
Elle est un raisonnement qui aboutit directement à la conclusion et sans
emploi d’une deuxième présence. Clairement dit, l’inférence immédiate
ou immédiate est un raisonnement qui se fait sans détours, i.e. en partant
d’une seule donnée (prémisse) et en menant à une seule transformée
(conclusion).
Cette synthèse s’effectue grâce à un ensemble d’opérations logiques dont
il convient de maîtriser le mécanisme théorique. Voici quelques-unes :
1. La négation :
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
54
C’est une opération qui consiste à modifier la forme de la qualité
d’une proposition. Ainsi, du point de vue de vérité, si la proposition
donnée est affirmative, la transformée sera négative, et vice versa.
Ex: La DGRAD est performante, donc la DGRAD n’est pas performante.
2. L’opposition : Deux propositions sont dites opposées quand elles
(se) diffèrent tout en ayant le même sujet et le même prédicat. On
distingue les contradictoires (A-O et E-I), les subalterne s (A-I et E-
O), les contraires (A-E) et les subcontraires (I-O).
a. La contrariété : C’est une opération logique qui oppose deux
propositions universelles, de qualités différentes. Du point de vue de la
valeur de vérité, deux propositions contraires peuvent être fausses à la
fois, mais jamais vraies à la fois. Logiquement dit, de la vérité de l’une on
conclut à la fausseté de l’autre.
Ex: - Tout étudiant est mature (A) V
Aucun étudiant n’est mature (E) F
- Tout exemple est bon à suivre (A) F
Nul exemple n’est bon à suivre (E) F
b. La subcontrariété : C’est une opération qui oppose deux propositions
particulières du seul point de vue de qualité. Les subcontraires peuvent
être vraies à la fois ; si l’une est fausse, l’autre doit être nécessairement
vraie. De la fausseté de l’une, on conclut à la vérité de l’autre.
Ex: - Quelques régies financières de la RDC sont compétitives (I) V
Donc quelques régies financières de la RDC ne sont pas compétitives (O) V
- Certains parents ne sont pas responsables (O) F
Donc certains parents sont responsables (I) V
c. La contradiction : C’est une opération qui oppose deux propositions
de qualité et de quantité différentes.
Deux propositions contradictoires ne peuvent être ni vraies, ni fausses à
la fois. Par conséquent, de la vérité de l’une on conclut à la fausseté de
l’autre et, de la fausseté de l’une, on conclut à la vérité de l’autre.
Ex:- S’il est vrai que quelques régies sont performantes (I),
Il est nécessairement faux qu’aucune régie ne soit performante
- Aucun parent n’est responsable (E) V
Donc certains parents sont responsables (I) F
- Quelques apprenants ne sont pas des fonctionnaires (O) V
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
55
Donc tout apprenant est fonctionnaire (A) F
d. La subalternance : C’est lorsque les propositions ne diffèrent que du
seul point de vue de la quantité. On le voit, c’est une opération qui
oppose les deux propositions universelles (A et E) aux deux particulières
(I et O).
Quand l’universelle est vraie, la particulière l’est aussi. Car ce qui est
vrai du tout l’est à fortiori de la partie.
Ex: Tout homme est mortel (A)
Quelques hommes sont mortels (I) V
Quand la particulière est fausse, l’universelle l’est aussi : ce qui est
faux des quelques-uns l’est également de l’ensemble. Car ceux
quelques-uns en font parties.
Ex: S’il est faux que quelques apprenants sont des ministres (I)
Il est également faux que tous les apprenants sont des ministres (A)
Tandis que quand l’universelle est fausse ou si la particulière est
vraie, on ne peut rien conclure. Car ce qui est vrai de quelques-uns
peut ne pas l’être de l’ensemble ; ce qui est faux du tout peut être vrai
de la partie.
Ex: - Aucun élève n’est sage (E) F
Quelques élèves ne sont pas sages (O) ?, c'est-à-dire V/F
- Certains apprenants ne s’appliquent pas (O) V
Nul apprenant ne s’applique (E) ?, c'est-à-dire V/F
3. L’inversion
C’est une opération logique qui consiste à remplacer les termes
d’une proposition par leurs opposés
N.B : L’opposé de chaque « être », c’est le « non-être ».
Ex:- Homme= non- homme ; Jeune = non-jeune
- Ainsi, tout homme est mortel =Donc, tout non-homme est non-mortel
Aucun sage n’est ange, donc aucun non-sage n’est non-ange.
4. La conversion
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
56
C’est une opération logique qui consiste à permuter (intervertir) les
termes d’une proposition, en sorte que celui qui était sujet devient
prédicat et vice versa sans modifier la qualité. Simplement dit, c’est
l’opération par laquelle on permute le sujet et l’attribut pour examiner ce qu’on
peut dire de la réciproque.
Il y a trois sortes :
a. Conversion simple ou parfaite
Elle est la permutation simple du sujet au prédicat, et vice versa. La
qualité de la 1re proposition n’est pas modifiée. Elle ne s’effectue que sur
E, I et A dans les définitions.
Ex:- Aucun homme n’est mortel (E), Donc aucun mortel n’est homme (E)
- Tout nombre pair est divisible par deux (A), déf.
Tout nombre divisible par deux est un nombre pair (A).
b. Conversion imparfaite (ou par accident)
Elle est appelée par accident parce que tout en gardant la même
qualité, cependant la transformée change de quantité. Elle s’applique sur
A qui devient I et, E devient O.
Ex: - Tout ophtalmologue est médecin (A)
Quelques médecins sont des ophtalmologues (I)
- Nul homme n’est irréprochable (E)
Quelques (êtres) irréprochables ne sont pas des hommes (o).
c. Conversion par contraposition : est effectuée en permutant et en niant
les termes d’une proposition. Autrement dit, elle consiste à remplacer le
sujet et le prédicat par leurs contradictoires respectifs, puis à opérer une
conversion parfaite. Elle se vérifie pour A et O.
Ex: - Tout homme est mortel
Donc tout non-mortel est non-homme
- Quelques cadres ne sont pas des directeurs
Donc quelques non-directeurs ne sont pas non-cadres.
5. L’obversion
C’est une opération logique qui consiste à transformer les
propositions générales à d’autres propositions générales de qualité
différente, dont le prédicat de la transformée devient l’opposé du
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
57
prédicat donné. C’est dire qu’on change la qualité de la proposition et
que l’on nie l’attribut.
Ex: - Votre chemise est blanche (A)
Votre chemise n’est pas non-blanche (E)
- Quelques digressions sont utiles (I)
Quelques digressions ne sont pas inutiles (O)
6. La concrétisation
C’est une opération qui consiste à transformer une proposition
universelle affirmative A ou négative E en une concrète correspondante.
Elle conserve nécessairement la valeur vraie, mais pas nécessairement la
valeur fausse. De la Vérité d’un jugement universel, on conclura toujours
à la vérité d’un jugement concret, qui gardera la même qualité et le
même prédicat.
Ex. s’il est faux que tout enfant va à l’école, alors il est vrai que Christian va à l’école.
B. DEDUCTION MEDIATE
Elle est communément appelée «Syllogisme». C’est un discours dans
lequel certaines choses étant posées, quelque chose d’autre que ces données en
résultent nécessairement par le seul fait de ces données.
On enregistre: le syllogisme classique et le non classique.
B.I. Le syllogisme classique ou catégorique
B.I.1. Définition
Appelé aussi syllogisme simple, il est un procédé de raisonnement
déductif par lequel, à partir de deux propositions données (prémisses),
une nouvelle proposition conclusive est nécessairement tirée.
Au fait, il comprend trois propositions prédicatives, à savoir : deux
prémisses et une conclusion.
B.I.2. Structure de syllogisme : le syllogisme dispose des éléments
matériels qui sont les termes et les propositions.
a. Termes
Le syllogisme comprend trois termes :
Terme majeur ou grand terme : ayant la plus grande extension, il est
prédicat dans la conclusion.
Terme mineur ou petit terme :il a la plus petite extension, il sert de
sujet dans la conclusion.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
58
Moyen terme ou moyen : avec une extension intermédiaire entre le
majeur et le mineur, il établit la comparaison entre les deux extrêmes.
Soit dit en passant, ce dernier terme joue un rôle considérable dans la
théorie du syllogisme dans la mesure où il est porteur d’essence.
b. Propositions
Voici les trois propositions que comprend un syllogisme régulier :
{
Antécédent : −la majeure : contenant≤grand terme
−la mineure :renfermant ≤ petit terme
Conséquent :−laconclusion : déduite de deux
B.I.1. Les règles du syllogisme classique
Elles sont huit et se répartissent de la manière suivante : quatre se
rapportent aux termes et quatre autres concernent les propositions.
a. Règles concernant les termes
Règle n ° 1:≤syllogisme classique doit comporter trois termes,
et trois seulement ,univoques ;
Règle n ° 2:≤moyen terme ne doit pasfigurer dans la conclusion ;
Règle n ° 3 :≤moye nterme doit être pris au moins une foisuniversellement ;
Règle n ° 4 : Aucun terme ne doit avoir plus d ’ extension dans
la conclusion que dans les prémisses;
b. Règles concernant les propositions
Règle n ° 5 : Deux prémisses affirmatives donnent une conclusion affirmative ;
Règle n ° 6 : De deux prémisses négati ves , on ne peut rien conclure
Règle n ° 7 : De deux premisses particulières , on ne peut rien conclure
Règle n ° 8 :
La conclusion suit toujours≤ca ractère de la prémisse
la plusfaible .
B.I.4. LES FIGURES DU SYLLOGISME CLASSIQUE
En raison de la disposition du moyen terme dans les prémisses, le
syllogisme se divise en quatre figures.
1. Figure Sub-Prae (SP)
Ici, le moyen terme est sujet dans la première prémisse, et prédicat dans
la seconde ;
|
Ex : Toutes les régies financières sont compétitives
¿ la D . G. D . A est une régie financière
2. Figure Prae-Prae (PP)
Le moyen terme est prédicat dans les deux prémisses.
Ex :Toutes les régies financières sont compétitives
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
59
Or l’Onatra n’est pas compétitive
3. Figure Sub-Sub(SS)
Ici, le moyen terme est sujet dans les deux prémisses.
Ex: Toutes les régies financières sont compétitives
Toutes les régies financières sont accréditées par l’Etat.
4. Figure Prae-Sub (PS)
Ici, le moyen terme est prédicat dans la 1re prémisse et sujet dans la 2e.
Ex :¿
B.2. LE SYLLOGISME NON-CLASSIQUE
Appelé aussi syllogisme non-classique, c’est un syllo-gisme dont la
majeure est une proposition composée selon lequel la mineure affirme
ou nie une des parties de la majeure.
On en distingue:
1. Le syllogisme hypothétique ou conditionnel
Il est un syllogisme dont la majeure est une proposition
conditionnelle. Il y a deux modes:
a. Le modus ponendo ponens : en affirmant (en posant) la condition, on
pose (on affirme) la conditionnée (la conclusion). C’est dire que la
mineure affirme la conditionnante et la conclusion affirme la
conditionnée.
Ex : Si tu réussis en logique, tu es un bon étudiant
Or tu as réussis en logique
Donc tu es un bon étudiant.
b. Le modus tollendo tollens : en niant la conditionnée, on nie la conclusion
et la conclusion, i-e. la mineure nie la conclusion et la conclusion nie la
conditionnante.
Ex :Si le D.G. signe l’ordre de mission, le contrôleur ira à Mbandaka.
Or le contrôleur n’est pas allé à Mbandaka
Donc le D.G. n’a pas signé l’ordre de Mission.
2. Le syllogisme conjonctif
C’est un syllogisme dont la majeure est une proposition conjonctive.
Il n’a qu’un seul mode (MPT) et sa majeure est toujours fausse. (Modus
ponendo tollens)
Ex : - Il est faux d’être à la fois C.B et C.D
Or il est C.B
Donc il n’est C.D.
- Il n’est pas vrai que ce nombre soit à la fois pair et impair
Or ce nombre est pair
Donc ce nombre n’est pas impair.
3. Syllogisme disjonctif
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
60
C’est un syllogisme dont la majeure est une proposition disjonctive,
posant une alternative. Il y a deux :
a.Le modus ponendo tollens (valable seulement dans le disjonctif exclusif).
Ex : Il travaille ou il ne travaille pas
Or il travaille
Donc il est faux qu’il ne travaille pas.
b. Le modus tollendo ponens (inclusif et exclusif)
Ex1 : Ou bien il pleure ou bien il danse
Or il ne pleure pas
Donc il danse.
Ex2 : Il est C.B. ou il est C.D
Or il n’est pas C.D.
Donc il est C.B.
QUELQUES VARIANTES RHETORIQUES DU SYLLOGISME
4. L’épichérème
C’est un syllogisme dont chacune des prémisses est accompagnée d’une
justification.
Ex : Il est permis de tuer un incivique et méchant agresseur pour se défendre : la raison, la
loi, la coutume assurent le droit de légitime défense
Or tel ‘’Kuluna’’ est un incivique et méchant agresseur : ses antécédents, ses préparatifs, ses
mobiles, les circonstances…
Donc …
5. L’enthymème :
C’est un syllogisme incomplètement exprimé dans lequel une des
propositions est sous entendue.
Ex. :1. Vous êtes congolais
(or les congolais sont africains)
Donc vous êtes africain
1. Vous avez triché
Donc vous ne méritez plus confiance
(la majeure est sous entendue)
6. Le dilemme
C’est un syllogisme hypothético-disjonctif. Il est consti-tué sous sa
forme courante d’une proposition disjonctive exclusive puis de deux
propositions hypothétiques qui énoncent que, quelle que soit la
possibilité envisagée, la conséquence est toujours la même, ce qui
exprime la conclusion.
Ex: Ou ce chef est apte à accomplir cette mission, ou il est inapte
S’il en est apte, sa nonchalance est inexcusable
S’il en est inapte, il est inexcusable qu’il ait accepté cette mission
Donc, dans tout le cas, ce chef est inexcusable.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
61
N.B : pour qu’un dilemme soit valide, il faut que :
1. la disjonction soit exclusive ; 2. les deux implications soient
valables et ; 3. la conclusion soit unique.
7. Le polysyllogisme
C’est un syllogisme composé de plusieurs syllogismes dont la
conclusion de l’un sert de mineure à l’autre ainsi de suite.
Ex : Tout animal est mortel
Or tout homme est animal
Donc tout homme est mortel
Or tout apprenant est homme
Donc tout apprenant est mortel
Or tous des Tronc commun sont des apprenants
Donc tous de Tronc commun sont mortels
Or Sylvie est du Tronc commun
Donc Sylvie est mortelle.
N.B: A titre indicatif, disons qu’il y a le polysyllogisme progressif et
régressif.
8. Le Sorite
C’est un polysyllogisme abrégé où l’on sous-entend la conclusion de
chaque syllogisme, sauf celle du dernier.
Ex : Tout mammifère est vertébré
L’herbivore est mammifère
Le ruminant est herbivore
Donc tout ruminant est vertébré.
9. Les sophismes
Les sophismes sont des raisonnements invalides. Un sophisme est
une erreur de raisonnement, un manque aux règles de logique et un abus
dans l’usage des procédés argumentatif. C’est une stratégie
argumentative ayant pour but de convaincre mais ses moyens vont
d’une perversion dans l’usage des moyens argumentatifs. Ce problème
qui se pose est à la fois logique et éthique.
Ex : Tout chien aboie. Or chien est une constellation. Donc toute constellation aboie.
Quelques sophismes courants :
1. Le subjectivisme consiste à faire reposer la validité d’une
conclusion sur le fait que celui qui la soutient affirme qu’elle est
vraie. Ex. : Au référendum, les congolais ne devraient pas voter
pour le Oui, car je pense que ce serait une erreur.
2. Sophisme du privilège (appel au privilège) consiste à
utiliser comme argument principal, pour justifier le fait que quelque
chose doit nous attribué, notre compétence ou notre prestige.
Ex. : Ce poste devrait me revenir de droit, étant donné mon ancienneté et mon expérience.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
62
3. Sophisme du préjugé (Appel au préjugé) consiste à utiliser
une idée préconçue, c'est-à-dire une opinion sans fondement rationnel,
pour justifier une proposition.
Ex. : Je suis contre l’immigration parce que les étrangers nous volent nos jobs.
4. Sophisme de la majorité (Appel à la majorité) consiste à
utiliser, pour justifier une conclusion, le fait que tout le monde ou la
majorité des gens pensent ou agissent ainsi.
Ex. : Tout le monde le fait, fais-le donc !
5. La faute reportée, le sophisme de la double faute consiste à
légitimer un comportement sous prétexte qu’il y a encore plus coupable
que lui.
Ex. : Je veux fumer en paix. La fumée qui se dégage de nos voitures et de nos usines
est encore plus nocive pour nos poumons que celle de ma cigarette.
6. Sophisme du procès d’intention consiste à attaquer une
personne en affirmant que son intention véritable est cachée et que
l’argumentation qui nous est fournie n’est qu’un écran de fumée.
Ex. : la Fondation Ford fournit des bourses d’études à des étudiants du tiers-monde.
Au fond, les membres fondateurs voulaient, par le biais de ces bourses, recruter des agents de
la CIA parmi les intellectuels de ce pays.
7. Attaque ad hominem (ad personnam) : elle porte sur la
personne de son adversaire. On discrédite son argumention en le
discréditant li-même. On comprend la colère de celui ou celle su qui on
jette ainsi le discrédit.
8. Sophisme par ambigüité : contient 4 termes.
Ex :Un douanier malhonnête est un immoral
Or un immoral est un virus
Donc ce douanier est dangereux.
9. Sophisme par amphibologie : se base sur une proposition à double
sens.
Ex1 : Ce qui ne meurt pas est immortel. Donc, l’âme humaine est immortelle.
2. Il quitte sa femme le jour de son anniversaire.
B.3. LES ERREURS DE RAISONNEMENT
1. Les abus des « a priori »
Ex. Le soleil n’a pas des tâches car (a priori). Les astres sont constitués d’un feu incorruptible
2 Les abus d’autorité
Ex. : Les fantômes existent sûrement parce que mon père me l’a dit.
3 La fausse observation des faits
Ex. : c’est le soleil qui tourne autour de la terre, car je le vois se lever chaque matin et se
coucher chaque soir.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
63
4. Opposition ou sophisme de la fausse distinction, cette erreur de
raisonnement consiste à séparer artificiellement des termes qui ne le sont
pas en réalité.
Ex. : Lors des élections de 2023, les luba voteront pour le candita X et tous les autres pour
le candidat Y.
4 Les vices de logique
Ce sont des para-logicismes ou des sophismes selon qu’ils sont commis
sans ou avec l’intention de tromper les interlocuteurs. Ce sont :
a) Les pétitions de principe : lorsqu’on donne pour preuve ce qui
devrait être prouvé. Faute logique par lequel on considère comme
admis ce que doit être démontré.
Ex. : l’opium fait dormir parce qu’il a une vertu dormitive.
b) Le cercle vicieux : c’est une sorte de pétition de principe dans
laquelle on veut prouver deux choses l’une par l’autre. Raisonnement
faux où l’on donne pour preuve la supposition d’où l’on est parti ;
situation dans laquelle on est enfermé. La conclusion revient sur les
propres prémisses.
Ex. L’expérience montre que plus on montre de mauvise humeur, plus on rencontre des
personnes qui font de même.
c). Le faux dilemme (exclusion du tiers, fausse dichotomie ou
énumération incomplète) : raisonnement fallacieux qui consiste à
présenter deux solutions à un problème donné comme si elles étaient les
deux seules possibles, alors qu’en réalité, il n’en existe d’autres.
EX : Ceux qui ne seront pas avec nous seront contre nous (G.W. Bush).
CONCLUSION
Nous voulions à travers ce cours, montrer ce qu’est la philosophie, ce
dont elle s’occupe, ce qu’elle poursuit et elle opère, et s’outiller grâce à la
logique afin de rendre l’esprit rigoureux et fonder le jugement sur un
raisonnement adéquat, coherent et valide.
La philosophie s’est révélée être essentiellement questionnement à
travers lequel l’homme accepte librement de s’y adonner et cherche à se
donner un sens plénier à son être-au-monde. Elle n’est pas speculation
oiseuseuse, sans emprise sur le vécu; bien au contraire, elle se voudrait
transformatrice de la vie. Apprendre à philosopher, c’est apprendre à
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
64
devenir libre; c’est apprendre à penser par soi-même, et non par
procuration. Dans ce sens, la philosophie, dont l’épicentre est l’homme,
voudrait amener celui-ci, maître non seulement de la nature, mais aussi
de ses actes et y assumer pleinement; à maximiser ses chances pour une
vie épanouie.
Face à la culture des antivaleurs (mensonge, irresponsabilité, trichrie,
immoralité, ivrognerie, cupidité, médisance…), la philosophie voudrait
jouer son role d’éveilleuse des consciences encore endormies afin que les
homes comprennent qu’en fin de compte, c’est en reference aux valeurs
qui donnent sens à la vie (justice, amour des hommes, liberté, loyauté,
solidarité, tolerance…) que leurs pensées auront à trouver des
justifications raisonnables.
A cet égard, la philosophie africaine, aujourd’hui, prône un ensemble des
valeurs qui participant à l’humanisation de l’homme. Il s’agit notamment
de la vie forte, de la fécondité et de l’union vitale. Cependant, ce travail
de forgeron est fastidieux et vise le long terme. Il est plus facile de
démissionner et de suivre l’opinion commune plutôt que de s’astreindre
à la tâche de réflexion critique.
On l’aura éprouvé, le cours était constitué en deux blocs. Le premier a
été une réflexion sur ce qu’est la philosophie, son intention, sa situation
en rapport avec d’autres sciences, notamment le mythe, la science et l’art,
et une inflexion sur l’Afrique. Le deuxième et le dernier bloc s’est
appesanti sur l’acqisition de la pensée logique, essentiellement de la
logique formelle. Il a donc porté respectivement sur le concept, le
jugement et le raisonnement.
Il n’en reste pas moins vrai que ce cours reste bel et bien, non seulement
une pure théorie, mais aussi une pratique. Le future cadre, future
enseignant n’a-t-il pas l’obligation de s’interroger sur la capacité de saisir
l’objet, et sur la rigueur des operations mentales qu’il déploie (ou
déploiera) dans son environnemnt, dans sa profession en vue d’une
application rigoureusement rationnelle des lois et des règles pour le bien
de tous.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
65
BIBLIOGRAPHIE
1.AHOYO F-N, Histoire de la philosohie grecque. Une étude crique
systématique de Thalès à Plotin, Ibandan, Hope publication, 2016.
2. ARNAULD, A et NICOLE P, La logique ou l’art de penser, Paris,
Flammarion, 1972.
3. DESCARTES R, Discours de la méthode, Paris, Vrain, 1992.
4. DIVERN E, Introduction aux logiques, Kinshasa, Ed.Loyola, 1990.
5. GOBLOT, Traité de logique, Paris, A.Colin, 1981
6. JASPERS K, Introduction à la philosophie, Paris, Paris, Plon, s.d.
7. LALANDE A, Vocabulaire technique et critique de la philosophie,
Paris/Quadrige, PUF, 1993.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
66
8. MAYOLA Mavunza C., Logique et argumentation. Rhétoricité de la palabre
africaine et de l’analyse sociale, Kinshasa, Science et Dircursivité, 2003.
9. MUTUNDA Mwembo, Elements de logique, Kinshasa, Médiapaul, 2006.
10. TEMPELS P, Philosophie bantu. Introduction et révéision de la trad. De
A.Rubbens sur ‘’texte original’’ par SMET A.S, Kinshasa, FTC, 1979.
11. VIALATOUX J., L’intention philosophique, Paris, PUF, 1973.
12. VERGEZ A et HUISMAN D, Nouvel abrégé de philosophie, Paris,
Fernand Nathan, 1978.
13. MPUTU Lopeka Laurent, L’Illocution comme acte essential du langage.
Une lecture de ‘’ Quand dire, c’est faire”, dans “Maisha, Revue congolaise
des arts”, N° 10 , octobre 2015, p.238-254.
14. MPUTU Lopeka Laurent; L’identité africaine face à l’axiome hégélien.
Essai sur l’affirmation identitaire, dans “Les Annales de l’ISAM”, N° 20, p.
56-75.
15. TSHIAMALENGA Ntumba, La vision ntu de l’homme, in AJ
SMET(éd.), Philosophie afriacaine, textee choisis, T1, PUZ, 1975.
Laurent MPUTU LOPEKA M., originaire du Territoire de Bikoro dans la
Province de l’Equateur, est marié et père de deux enfants.
Chef de Travaux et doctorant, Laurent est sous l’encadrement
scientifique du Pr. Emérite Okolo Okonda Benoit à la Faculté des Lettres
et Sciences Humaines de l’Université de Kinshasa.
Chercheur et collaborateur au centre de recherche « Séminaire
d’Herméneutique et Histoire des idées » (UNIKIN, FLSH) sous la
présidence du Pr.Okolo, son maître et promoteur de thèse, Laurent a son
actif quatre publications scientifiques.
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
67
Secrétaire Général administratif honoraire de l’ISP/Kiri (Mai-
Ndombe), le CT Laurent enseigne egalement à l’UNITSHU, à l’UFA et à
l’ENF. Il a également presté à l’USAKIN (2012-14; 2018-2020).
Domaines de recherches: Philosophie du Langage, Communication,
Herméneutique, Pragmatique, Management et Logique.
Outre le domaine de recherche, Laurent est cadre dans l’administration
publique, Chef de Bureau au Ministère de Budget; Direction des
Ressources Humaines du SENAPI et Secrétaire Général de l’ONG
E.S.E/Asbl (Education, Santé et Environnement).
Enfin, ce chercheur a suivi plusieurs formations, ateliers et séminaires en
Management, Gestion des Ressources Humaines, Elaboration et Gestion
de projets, Droits de l’Homme, Informatique, Gestion des conflits,
Comptabilité, Finances publiques, Développement...
Philosophie et Logique UAK, L1 CJ,RI et SPA(2022-2023) C.T Laurent M.Lopeka
Vous aimerez peut-être aussi
- DidactiqueDocument23 pagesDidactiqueAbdelowahed67% (3)
- Fascicule PhiloDocument76 pagesFascicule PhiloOumarou Djibo Zoulkiffi100% (2)
- Philosophie TerminaleDocument112 pagesPhilosophie Terminalebeebac2009100% (4)
- Philosophie Terminale BrochuDocument33 pagesPhilosophie Terminale BrochuSalomon Salomon100% (2)
- La matière et l'esprit (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLa matière et l'esprit (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Resume Philo CompletDocument105 pagesResume Philo CompletKarim524Pas encore d'évaluation
- Philo TA4Document90 pagesPhilo TA4Richard GotorayePas encore d'évaluation
- La Philosophie en Terminales GénéralesDocument8 pagesLa Philosophie en Terminales GénéralesMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- Cours PhilosophieDocument104 pagesCours PhilosophiePanaite Mirela IonelaPas encore d'évaluation
- 8 PHILOscienceDocument2 pages8 PHILOscienceDiary BaPas encore d'évaluation
- Sujets Bac Philo - Dissertations (1996-2021)Document141 pagesSujets Bac Philo - Dissertations (1996-2021)Fabrice DèvePas encore d'évaluation
- Cours Nature PhilosophieDocument8 pagesCours Nature PhilosophieCloé JeanPas encore d'évaluation
- L'apprentissage des sciences et des technologies par l'expérimentation – Module 4: Le magnétismeD'EverandL'apprentissage des sciences et des technologies par l'expérimentation – Module 4: Le magnétismePas encore d'évaluation
- Mc3a9thodologie Du Commentaire de Texte Bac PhiloDocument3 pagesMc3a9thodologie Du Commentaire de Texte Bac PhiloJorkaef MbiniPas encore d'évaluation
- Document Terminale PhiloDocument40 pagesDocument Terminale PhiloDavid Sibone100% (1)
- Philo Et Science PDFDocument2 pagesPhilo Et Science PDFndiaye100% (1)
- Bac - Sujets de Philosophie Term L, ES, SDocument185 pagesBac - Sujets de Philosophie Term L, ES, SAnonymous NE7Bwby7Pas encore d'évaluation
- Des Sujets de Philosophie CorrigesDocument34 pagesDes Sujets de Philosophie CorrigesSamry dyijPas encore d'évaluation
- BonheurDocument14 pagesBonheurSerena MontanaPas encore d'évaluation
- Phil Dev1 CorrigeDocument9 pagesPhil Dev1 CorrigeEmeline KeithPas encore d'évaluation
- Revision Generale PhilosophieDocument26 pagesRevision Generale PhilosophieGuina GueyePas encore d'évaluation
- Éléments de Cours PhilosophieDocument39 pagesÉléments de Cours PhilosophieAbba100% (2)
- Dissertation Philosophie PDFDocument4 pagesDissertation Philosophie PDFEdel Mac0% (1)
- Corrige Philosophie Bac 2010Document6 pagesCorrige Philosophie Bac 2010Papa SarrPas encore d'évaluation
- Des Sujets de Philosophie Et CorrectionsDocument33 pagesDes Sujets de Philosophie Et CorrectionsDaniel MoukouriPas encore d'évaluation
- Cours de Philosophie Politique-1Document12 pagesCours de Philosophie Politique-1Diallo africaPas encore d'évaluation
- 50 Sujets Corrigés de PhilosophiqueDocument122 pages50 Sujets Corrigés de Philosophique062570252daniellaparker100% (1)
- Krishnamurti en Questions - Qu'est-Ce Que La MéditationDocument8 pagesKrishnamurti en Questions - Qu'est-Ce Que La MéditationRodolphe DametPas encore d'évaluation
- Histoire Cours de PhilosophieDocument8 pagesHistoire Cours de PhilosophieMamadou Moustapha Sarr100% (1)
- Histoire de La PhilosophieDocument18 pagesHistoire de La PhilosophieArthur HemonoPas encore d'évaluation
- COURS DE PHILOSOPHIE A MendiriDocument29 pagesCOURS DE PHILOSOPHIE A MendiriMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- La Conscience - Cours TerminaleDocument16 pagesLa Conscience - Cours TerminaleMilkyWayPas encore d'évaluation
- Introduction À La Psychologie Sociale DiapoDocument66 pagesIntroduction À La Psychologie Sociale DiapoGeorgiana Dicu100% (4)
- 0fascicule de Cours PhiloDocument92 pages0fascicule de Cours PhiloAssane Mboup100% (1)
- TES L S PhilosophieDocument16 pagesTES L S PhilosophieTaoufik Sayahi100% (1)
- Modules Formation Contractuels - PhilosophieDocument252 pagesModules Formation Contractuels - Philosophiebloko DIT Elddar'1er100% (1)
- Philo BlancsDocument4 pagesPhilo BlancsSouaïbou BabaPas encore d'évaluation
- Sujets Et Corrigés Bac 2022 - L'épreuve de Philosophie - Studyrama 2Document14 pagesSujets Et Corrigés Bac 2022 - L'épreuve de Philosophie - Studyrama 2Carlito Riccy100% (1)
- PhilosophieDocument88 pagesPhilosophieFofa FofaPas encore d'évaluation
- Philo PDFDocument8 pagesPhilo PDFmeone99Pas encore d'évaluation
- Textes de Sall Domaine 1Document27 pagesTextes de Sall Domaine 1diarraPas encore d'évaluation
- Repartition Terminale DDocument50 pagesRepartition Terminale DCelestin MarolahyPas encore d'évaluation
- Le Secret 2 de Philo Bac Groupe La CertitudeDocument83 pagesLe Secret 2 de Philo Bac Groupe La Certitudedupontvania822Pas encore d'évaluation
- À Plhilo APCDocument20 pagesÀ Plhilo APCnganjie100% (2)
- Annale Philosophie 1Document159 pagesAnnale Philosophie 1Tyler RolissonPas encore d'évaluation
- Fascicule Philosophie TleDocument71 pagesFascicule Philosophie Tlejb863259Pas encore d'évaluation
- Cle Ts Philo t1 Chapitre1 - 2017Document17 pagesCle Ts Philo t1 Chapitre1 - 2017Léo DelabyPas encore d'évaluation
- Cours Philo Le LangageDocument9 pagesCours Philo Le LangageMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- ContinueDocument2 pagesContinueghabdollahimohamedPas encore d'évaluation
- Français TerminalDocument59 pagesFrançais TerminalBriden KoubetchyPas encore d'évaluation
- Sujet NDocument66 pagesSujet NISSA THIAMPas encore d'évaluation
- Philo Methode Remise À Niveau BACDocument7 pagesPhilo Methode Remise À Niveau BACTony BlvckPas encore d'évaluation
- PHILOSOPHIE de L'histoireDocument47 pagesPHILOSOPHIE de L'histoireSARAHPas encore d'évaluation
- Les Dialogues de PlatonDocument2 pagesLes Dialogues de PlatonMoustapha SarrPas encore d'évaluation
- Cours de Philosophie (Institut Bamanya)Document20 pagesCours de Philosophie (Institut Bamanya)Raphaël Chiegain100% (1)
- Tle-Philosophie-La Conscience Et L'inconscient - CoursDocument4 pagesTle-Philosophie-La Conscience Et L'inconscient - CoursTia Amaneddine100% (1)
- Bac S 2010 Philosophie Sujet 3 CorrigéDocument2 pagesBac S 2010 Philosophie Sujet 3 CorrigéalainconuPas encore d'évaluation
- Cours Histoire TleDocument72 pagesCours Histoire TleSolo Beton100% (1)
- Philosophie Sujet Corrige Ü2-1Document7 pagesPhilosophie Sujet Corrige Ü2-1yusufbakhit100% (1)
- Livret Philo MAI 2023 VF REF 231026 160243Document130 pagesLivret Philo MAI 2023 VF REF 231026 160243Fox SNPas encore d'évaluation
- Condamne´ Á La Pauvreté: Une Analyse Des Causes De La Misère Effroyable Du Peuple HaïtienD'EverandCondamne´ Á La Pauvreté: Une Analyse Des Causes De La Misère Effroyable Du Peuple HaïtienPas encore d'évaluation
- Page de Garde SeuleDocument75 pagesPage de Garde SeuleAnonymous CZVjyUzPas encore d'évaluation
- DUBET, L'Ecole Des ChancesDocument3 pagesDUBET, L'Ecole Des ChancesEmphirisPas encore d'évaluation
- Le Sens Du Signifiant. Texte IntégralDocument201 pagesLe Sens Du Signifiant. Texte Intégraltheo_31Pas encore d'évaluation
- Analyse Sémiologique Du Graffiti 04160097 PDFDocument69 pagesAnalyse Sémiologique Du Graffiti 04160097 PDFJulio LealPas encore d'évaluation
- Léthique Et La Déontologie Universitaires PDFDocument17 pagesLéthique Et La Déontologie Universitaires PDFMarie MimiiPas encore d'évaluation
- Journees Scientifiques Internationales Actes 1iulie PDFDocument435 pagesJournees Scientifiques Internationales Actes 1iulie PDFAndreea RebeccaPas encore d'évaluation
- Travail Sur Le Langage Et La Pensée - OdtDocument6 pagesTravail Sur Le Langage Et La Pensée - OdtJean-Pierre MarcosPas encore d'évaluation
- Litterature Entre Deux GuerresDocument3 pagesLitterature Entre Deux GuerresBüşra BakarPas encore d'évaluation
- IFS Food v8 Audit Checklist Guideline CCSDocument217 pagesIFS Food v8 Audit Checklist Guideline CCSMEDPas encore d'évaluation
- Merged ChapitreDocument45 pagesMerged Chapitrecprofessionnel07Pas encore d'évaluation
- French CV 1Document1 pageFrench CV 1Med Amine HattakiPas encore d'évaluation
- Philosophie - Terminale: La ConscienceDocument2 pagesPhilosophie - Terminale: La ConscienceAbdelhak LamiPas encore d'évaluation
- Vincent BounoureDocument7 pagesVincent BounourejuliomcPas encore d'évaluation
- Intelligence PDFDocument17 pagesIntelligence PDFEunockPas encore d'évaluation
- Frantz Le Penseur (Culture Générale) PDFDocument5 pagesFrantz Le Penseur (Culture Générale) PDFfabiboyhaiti4496Pas encore d'évaluation
- Expose Sous L'orageDocument7 pagesExpose Sous L'oragejeanndiaye754Pas encore d'évaluation
- Éducation Morale Et Civique: Séquence 1: Élaborer Des Règles Et Des Sanctions Pour Mieux Vivre EnsembleDocument3 pagesÉducation Morale Et Civique: Séquence 1: Élaborer Des Règles Et Des Sanctions Pour Mieux Vivre Ensembleapi-395453022Pas encore d'évaluation
- Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou Faculté Du Génie de La Construction Département D'architectureDocument96 pagesUniversité Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou Faculté Du Génie de La Construction Département D'architectureAber DraaPas encore d'évaluation
- Exposer CasteDocument4 pagesExposer CasteBaye mondial100% (6)