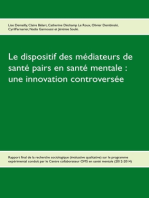Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rsi 082 0004
Rsi 082 0004
Transféré par
Hamidouu DliDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- 3008 Du 04 2009 1,6L HDI 112cv Et 2LHDI 150cvDocument318 pages3008 Du 04 2009 1,6L HDI 112cv Et 2LHDI 150cvDany Defossez-anceaux100% (5)
- Rsi 122 0077Document6 pagesRsi 122 0077osteopat.gonthierPas encore d'évaluation
- Analyse Psychodynamique Du Travail InfirmierDocument12 pagesAnalyse Psychodynamique Du Travail Infirmiercamilledanion98Pas encore d'évaluation
- Rsi 080 0087Document18 pagesRsi 080 0087MBOWAMBA LOBOMBOPas encore d'évaluation
- Rsi 089 0033Document11 pagesRsi 089 0033BENSLIMANEOTHMANEPas encore d'évaluation
- Rsi 125 0020Document13 pagesRsi 125 0020amboukhechemPas encore d'évaluation
- Autoestima Análisis de ConceptosDocument10 pagesAutoestima Análisis de Conceptosadrianafrcv26Pas encore d'évaluation
- Rsi 089 0033Document11 pagesRsi 089 0033Fiona DaphPas encore d'évaluation
- Science Et Science Infirmière Quels Liens, Quels Enjeux EtDocument11 pagesScience Et Science Infirmière Quels Liens, Quels Enjeux EtKate GUINLEYPas encore d'évaluation
- Rsi 111 0013Document10 pagesRsi 111 0013Issam BelPas encore d'évaluation
- Analyse Dimensionnelle Du Concept de Biosécurité Face Aux Risques BiologiquesDocument16 pagesAnalyse Dimensionnelle Du Concept de Biosécurité Face Aux Risques BiologiquesAbdoulaye SarambounouPas encore d'évaluation
- Rsi 116 0040Document18 pagesRsi 116 0040Maria MimiPas encore d'évaluation
- Rsi 140 0077Document21 pagesRsi 140 0077GermainPas encore d'évaluation
- Rsi 118 0007Document11 pagesRsi 118 0007saraasseffar3Pas encore d'évaluation
- Evaluation en Formation InfirmiereDocument33 pagesEvaluation en Formation InfirmiereASMAA AZHOUNEPas encore d'évaluation
- Rsi 106 0082Document5 pagesRsi 106 0082victorinevddPas encore d'évaluation
- Rsi 084 0041Document12 pagesRsi 084 0041LAS SourouPas encore d'évaluation
- Rsi 127 0091Document14 pagesRsi 127 0091cammganeshPas encore d'évaluation
- Tanner Raisonnement CliniqueDocument34 pagesTanner Raisonnement Cliniqueأصيلة أصيلةPas encore d'évaluation
- 4 Indicateurs Dactivites Soisn InfirmiersDocument16 pages4 Indicateurs Dactivites Soisn InfirmiersMAROUANI El HoussainPas encore d'évaluation
- ObservationDocument15 pagesObservationnablaoui.jawadPas encore d'évaluation
- Rsi 125 0046Document16 pagesRsi 125 0046khalida el ghazyPas encore d'évaluation
- TF 081 0037Document6 pagesTF 081 0037moulinPas encore d'évaluation
- Surveillance Prénatale Et Éducation Pour La Santé Rsi - 110 - 0060Document6 pagesSurveillance Prénatale Et Éducation Pour La Santé Rsi - 110 - 0060Kate GUINLEYPas encore d'évaluation
- Rsi 082 0031Document13 pagesRsi 082 0031musicalcholicPas encore d'évaluation
- Cara - 2016 - Modèle Humaniste Des Soins InfirmiersDocument13 pagesCara - 2016 - Modèle Humaniste Des Soins InfirmierstoniksPas encore d'évaluation
- Différentes Traditions Philosophiques Pour LeDocument12 pagesDifférentes Traditions Philosophiques Pour LeSaidi SoundosPas encore d'évaluation
- Rsi 136 0054Document13 pagesRsi 136 0054DALI FFXPas encore d'évaluation
- L'observation Clinique AttentiveDocument15 pagesL'observation Clinique AttentivebchPas encore d'évaluation
- Inka 042 0043Document11 pagesInka 042 0043Houda SalasPas encore d'évaluation
- HTA Approche de Leur VécuDocument5 pagesHTA Approche de Leur VécuLAS SourouPas encore d'évaluation
- Article de Recherche Scientifique Sur L'hypnose Et Soins Pre-Post OpDocument9 pagesArticle de Recherche Scientifique Sur L'hypnose Et Soins Pre-Post OpVincent-Sully MariePas encore d'évaluation
- CartesDixit Comme Support Aux Représentation Métaphoriques Un Média D'intervention Systémique Sous MandatDocument25 pagesCartesDixit Comme Support Aux Représentation Métaphoriques Un Média D'intervention Systémique Sous Mandatannesophie.varese.proPas encore d'évaluation
- Humanitude Dans Les SoinsDocument15 pagesHumanitude Dans Les SoinsDINO ECOPas encore d'évaluation
- Rsi 091 0012Document13 pagesRsi 091 0012Christian Abel MendyPas encore d'évaluation
- Rsi 110 0098Document16 pagesRsi 110 0098Jihane HtPas encore d'évaluation
- Rsi 135 0007Document8 pagesRsi 135 0007Ab SantePas encore d'évaluation
- Rsi 097 0063Document12 pagesRsi 097 0063Sephora KhllPas encore d'évaluation
- Différence Soin Idde Et Soin MédicalDocument33 pagesDifférence Soin Idde Et Soin Médicalosteopat.gonthierPas encore d'évaluation
- Rsi 102 0035Document8 pagesRsi 102 0035Yakhlef IkramPas encore d'évaluation
- Le Transfert Des Connaissances en Soins de Plaies Chez Les Infirmières Une Revue Intégrative Des ÉcritsDocument18 pagesLe Transfert Des Connaissances en Soins de Plaies Chez Les Infirmières Une Revue Intégrative Des ÉcritsSaidi SoundosPas encore d'évaluation
- Les Savoirs Infirmiers Liés Au Care Exprimés DansDocument12 pagesLes Savoirs Infirmiers Liés Au Care Exprimés DansSaidi SoundosPas encore d'évaluation
- Psys 131 0043Document12 pagesPsys 131 0043Damien BaudryPas encore d'évaluation
- Médiateurs Et ModérateursDocument23 pagesMédiateurs Et ModérateursakkselPas encore d'évaluation
- Houssaye Le Triangle PedagogiqueDocument11 pagesHoussaye Le Triangle Pedagogiquedahmanimaroua88Pas encore d'évaluation
- Rsi 126 0065Document7 pagesRsi 126 0065Ab SantePas encore d'évaluation
- Rsi 106 0047Document13 pagesRsi 106 0047To PlaysPas encore d'évaluation
- Clinique Des Soins BiblioDocument6 pagesClinique Des Soins BiblioYounès KhalilPas encore d'évaluation
- Rsi 098 0019Document10 pagesRsi 098 0019Jacqueline Mariame Mamadouno100% (1)
- 3 Developpment de Competences Et Raisonnement CliniqueDocument13 pages3 Developpment de Competences Et Raisonnement CliniqueMAROUANI El HoussainPas encore d'évaluation
- RPPG 063 0065Document15 pagesRPPG 063 0065Syryne BelghithPas encore d'évaluation
- Rsi 116 0070Document12 pagesRsi 116 0070Koku Elom DzamessiPas encore d'évaluation
- Lectura en FrancesDocument17 pagesLectura en FrancesSara Juliana Rosero MedinaPas encore d'évaluation
- Rsi 097 0004Document20 pagesRsi 097 0004KONE MoussaPas encore d'évaluation
- Distinguer Savoir Et ConnaissancesDocument4 pagesDistinguer Savoir Et ConnaissancesSaidi SoundosPas encore d'évaluation
- Texte - Tanda Etal 2020 - Analyse Dimensionnelle Du Construit Formation Par La Recherche .Document13 pagesTexte - Tanda Etal 2020 - Analyse Dimensionnelle Du Construit Formation Par La Recherche .ns5819Pas encore d'évaluation
- 1Document7 pages1achrafkchaw96888939Pas encore d'évaluation
- DDOC T 2017 0034 HAYO Vol1Document381 pagesDDOC T 2017 0034 HAYO Vol1Rabie MachloukhPas encore d'évaluation
- Mav 054 0215Document23 pagesMav 054 0215KERARMICHAIMAEPas encore d'évaluation
- Infirmière-Une Profession Problématique - Anne-Cécile BroutelleDocument4 pagesInfirmière-Une Profession Problématique - Anne-Cécile BroutelleDINO ECOPas encore d'évaluation
- Le dispositif des médiateurs de santé pairs en santé mentale : une innovation controversée: Rapport final de la recherche Evaluative qualitative sur le programme expérimental 2012-2014D'EverandLe dispositif des médiateurs de santé pairs en santé mentale : une innovation controversée: Rapport final de la recherche Evaluative qualitative sur le programme expérimental 2012-2014Pas encore d'évaluation
- Epees LegendairesDocument9 pagesEpees LegendaireshhhhhhPas encore d'évaluation
- Les Nappes de Charriage 2024Document6 pagesLes Nappes de Charriage 2024lashabdorsafPas encore d'évaluation
- Ssp095 - FR Eobd DieselDocument24 pagesSsp095 - FR Eobd DieselAzimPas encore d'évaluation
- MCC18 v16 PDFDocument48 pagesMCC18 v16 PDFSmart ClassePas encore d'évaluation
- CM Comm Evenementielle M2Document20 pagesCM Comm Evenementielle M2Tougma WilfriedPas encore d'évaluation
- Technicien EnvironnementDocument1 pageTechnicien EnvironnementRodolphe AtsainPas encore d'évaluation
- Reseaux Sociaux Comprendre Et Maitriser Ces Nouveaux Outils de Communication 6e Edition - SommaireDocument17 pagesReseaux Sociaux Comprendre Et Maitriser Ces Nouveaux Outils de Communication 6e Edition - SommaireMa Ra LiPas encore d'évaluation
- Psaume de La Créa PDFDocument2 pagesPsaume de La Créa PDFDosferdy Dosferdy100% (1)
- BalzacDocument30 pagesBalzacJipa IoanaPas encore d'évaluation
- Le Réglage Des SoupapesDocument5 pagesLe Réglage Des SoupapesJim Lieb100% (1)
- CV MATTICHE Nouha INGENIEUR CIVIL Acctualisã© 2Document2 pagesCV MATTICHE Nouha INGENIEUR CIVIL Acctualisã© 2tp546dqvj8Pas encore d'évaluation
- LIVRE I, Chant 5 - Le Yoga Du Roi - Le Yoga de La Liberté Et de La Grandeur de L'esprit - Savitri en FrançaisDocument23 pagesLIVRE I, Chant 5 - Le Yoga Du Roi - Le Yoga de La Liberté Et de La Grandeur de L'esprit - Savitri en FrançaisRoland KagboPas encore d'évaluation
- Stabilite - Contreventement Des Batiments - A.skowRONDocument24 pagesStabilite - Contreventement Des Batiments - A.skowRONMariam Moumni100% (1)
- TP SQLDocument13 pagesTP SQLyassinedoPas encore d'évaluation
- Cours Langage C - 16v17Document10 pagesCours Langage C - 16v17redstealth100% (1)
- Dossier de Presse Pme Aout 2021Document21 pagesDossier de Presse Pme Aout 2021laryskal95Pas encore d'évaluation
- L'Architecture Biophilique Pour Le Bien-Être Des PatientsDocument95 pagesL'Architecture Biophilique Pour Le Bien-Être Des PatientsHiba BouballoutaPas encore d'évaluation
- Quotidien D'Oran - 04-09-2013 PDFDocument24 pagesQuotidien D'Oran - 04-09-2013 PDFnidronyPas encore d'évaluation
- Bif N°95 Intégration de L'activité Domiciliation Des Entreprises Dans Le Code de CommerceDocument2 pagesBif N°95 Intégration de L'activité Domiciliation Des Entreprises Dans Le Code de CommerceAchraf ouissadenePas encore d'évaluation
- SPECIAL ENGRAIS FOLIAIRE LIQUIDE DDocument4 pagesSPECIAL ENGRAIS FOLIAIRE LIQUIDE DbinodjayPas encore d'évaluation
- Religion Et SantéDocument15 pagesReligion Et SantéJodel PierrePas encore d'évaluation
- Meeùs - Théorie Modale - IntroductionDocument6 pagesMeeùs - Théorie Modale - IntroductionDale CooperPas encore d'évaluation
- Lecon N 3 Les Espaces de Faible Densite Et Leurs Atouts 1Document27 pagesLecon N 3 Les Espaces de Faible Densite Et Leurs Atouts 1natacha joseph-mathurinPas encore d'évaluation
- Toaz - Info Liants Hydrocarbones PRDocument7 pagesToaz - Info Liants Hydrocarbones PRmohamedaziz.karaborniPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage PFEDocument15 pagesRapport de Stage PFEhamidbourhim822Pas encore d'évaluation
- Décret N° 2.17.451Document21 pagesDécret N° 2.17.451RIM EL MESSAOUDIPas encore d'évaluation
- Université Taheri Muhammad BécharDocument13 pagesUniversité Taheri Muhammad Bécharثقافة عامةPas encore d'évaluation
- Mettre en Concurrence Ses Fournisseurs-PartenairesDocument42 pagesMettre en Concurrence Ses Fournisseurs-PartenairesRihab SadikiPas encore d'évaluation
- Rodriguez - Latelier Et Lexposition - TexteDocument16 pagesRodriguez - Latelier Et Lexposition - Texteleduc.gabriellaPas encore d'évaluation
Rsi 082 0004
Rsi 082 0004
Transféré par
Hamidouu DliTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rsi 082 0004
Rsi 082 0004
Transféré par
Hamidouu DliDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le concept de résilience et ses applications cliniques
Marie Anaut
Dans Recherche en soins infirmiers 2005/3 (N° 82), pages 4 à 11
Éditions Association de Recherche en Soins Infirmiers
ISSN 0297-2964
DOI 10.3917/rsi.082.0004
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
Article disponible en ligne à l’adresse
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2005-3-page-4.htm
Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s’abonner...
Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.
Distribution électronique Cairn.info pour Association de Recherche en Soins Infirmiers.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le
cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est
précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
L E CONCEPT DE RÉSILIENCE
ET SES APPLICATIONS CLINIQUES
Marie ANAUT,
Professeur de Psychologie,
Psychologue clinicienne,
Université Lumière-Lyon2
INTRODUCTION : QU’EST- ÉMERGENCE DU CONCEPT ET
CE QUE LA RÉSILIENCE ? INFLUENCES THÉORIQUES
Dans le champ de la clinique et des soins, les Commençons par
apports de la résilience et des facteurs de pro- quelques définitions
tection peuvent être analysés à partir de leurs
convergences, de leurs complémentarités mais En physique des matériaux (métallurgie), la rési-
aussi de leurs différences face aux modèles lience concerne l’évaluation de la résistance des
devenus classiques de la prise en compte des matériaux à des chocs élevés et leur capacité
facteurs de risque et de la vulnérabilité des per- d’absorber l’énergie cinétique sans se rompre.
sonnes. En informatique, la résilience est la capacité d’un
système à continuer à fonctionner en dépit
Dans le vaste secteur sanitaire et social, loin de d’anomalies liées aux défauts de ses éléments
se substituer à la prise en considération des fac- constitutifs. En Sciences Humaines (psychologie,
teurs de risque des sujets, la résilience enrichit sociologie…), la résilience peut être considérée
la clinique en proposant de nouvelles perspec- comme un processus dynamique impliquant
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
tives dans la compréhension de la souffrance et l’adaptation positive dans le cadre d’une adver-
la prise en charge des patients. On peut dire sité significative.
que ce concept participe à la constitution d’un
modèle théorico-clinique original dont les appli- Du point de vue psychologique, la résilience se
cations sont nombreuses et variées dans la cli- révèle face à des stress importants et/ou cumu-
nique contemporaine. lés, face à des traumatismes ou des contextes à
valeur traumatique.
La résilience peut être interrogée à la lumière de Concept transdisciplinaire, la résilience s’est
ses contours théoriques qui se précisent petit développée sous l’impulsion d’approches pluri-
à petit autant que dans ses applications sur les disciplinaires. Ainsi le concept de résilience s’ap-
terrains de pratiques. Nous proposons d’aller à puie sur des assises relevant de disciplines
la rencontre du concept de résilience en le variées comme : la psychologie, la sociologie,
situant dans la perspective évolutive de son l’éthologie, la médecine…
émergence dans le domaine scientifique et cli-
nique. Pour cela, nous allons aborder les prin- Le concept de résilience est en travail dans la
cipales assises théoriques de la résilience, en communauté scientifique depuis quelques
retraçant les grandes lignes de son évolution au décennies. Ainsi, dans les pays anglo-saxons des
cours des dernières décennies. travaux sur la résilience ont cours depuis une
trentaine d’années et ont donné lieu à des publi-
La résilience est sans doute encore en cours de cations scientifiques reconnues depuis plus de
développement et les applications cliniques qui 25 ans. Avec notamment des auteurs comme :
en découlent dans les pratiques de soins sont Emmy Werner, Michael Rutter, Robert
encore à construire, à valider et à délimiter. Haggerty, Lonnie Sherrod, Norman Garmezy…
Cependant, le modèle issu de la résilience
représente un espoir important qui change le En revanche, la résilience a pris son essor en
regard porté aux patients et à l’accompagne- France et dans les pays francophones surtout
ment de leur souffrance (Anaut, 2004). depuis les années 1990. De nombreux auteurs
4 RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 82 - SEPTEMBRE 2005
LE CONCEPT DE RÉSILIENCE
ET SES APPLICATIONS CLINIQUES
et praticiens (souvent psychiatres ou pédopsychiatres) APPROCHES ÉLARGIES OU RES-
ont contribué à faire connaître ce concept et à déve- TRICTIVES DE LA RÉSILIENCE
lopper ses contours théoriques autant que le champ de
ses applications pratiques. Parmi ces auteurs, nous pou-
vons citer : Boris Cyrulnik, Michel Manciaux, Stanislas La résilience peut être abordée dans le cadre d’ap-
Tomkiewicz ; ou encore Michel Lemay ou Stéphane proches qui s’appuient parfois sur une définition très
Vanistendael… A l’heure actuelle de nombreux auteurs, large de son acception, alors que d’autres dessinent des
chercheurs et praticiens contribuent à mettre en travail contours plus nets, voire restreints. Voyons à partir de
ce concept et à interroger ses apports et ses limites quelques définitions comment peut être abordée la rési-
(Anaut, 2003). lience dans la littérature, en partant des approches les
plus ouvertes mais parfois vagues, jusqu’à des défini-
Les influences les plus notoires tions plus restreintes et plus précises.
Parmi les principales influences théoriques qui ont Dans la littérature, la résilience peut être référée à :
contribué à construire le socle théorique de la rési- - Un développement normal dans des conditions difficiles.
lience, on trouve : - Un processus par lequel un individu interagit avec son
- John Bowlby et la théorie de l’attachement (années environnement pour produire une évolution donnée.
1960-70). - Une capacité de réussir une insertion dans la société
- Les nombreux travaux sur le stress et le coping (pro- en dépit de l’adversité qui comporte le risque grave
cessus d’ajustement). d’une issue négative.
- L’analyse des facteurs de risque et des différences - Une adaptation exceptionnelle malgré l’exposition à des
interindividuelles face aux stress et aux traumatismes stresseurs significatifs.
(Anthony et al.).
- L’analyse des processus de protection individuels et Ces différentes définitions (on pourrait en citer bien
socioenvironnementaux. d’autres encore) permettent de souligner combien il
- Les études du développement tout au long de la est parfois difficile de délimiter la résilience et de s’en-
vie… tendre sur ce que résilience veut dire. Une définition
trop large tend à vider le concept de résilience de son
Différents secteurs relevant des prises en charges sani- intérêt en lui enlevant sa pertinence. Ainsi, par exemple,
taires et sociales ont contribué au développement des la résilience définie comme « un développement nor-
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
théories sur la résilience. Actuellement, le champ de la mal dans des conditions difficiles » simplifie à outrance
psychologie de la santé (accidents, traumatismes, mala- le concept de résilience et revient à rendre la résilience
dies létales…) est devenu un domaine de recherche et synonyme d’une banale adaptation au cours de la vie,
d’applications des théories de la résilience parmi les quelles que soient les circonstances. Nous pouvons
plus féconds. Par ailleurs, les observations cliniques des remarquer également que l’on aborde la résilience par-
praticiens dans leur quotidien des prises en charge des fois comme un phénomène, une forme de développement,
patients, ainsi que des recherches exploratoires sur des une capacité ou encore comme un processus… Cela
populations dites à risque, ont permis de démontrer la revient à envisager la résilience selon des perspectives
réalité clinique du phénomène de résilience. Parmi les d’approche très différentes. Ainsi, dans la communauté
observations cliniques marquantes, la recherche scientifique, autant que dans les domaines d’applications
conduite par Emmy Werner et coll. (1982) occupe une sur les terrains cliniques, on peut parler de résilience à
place prépondérante. Cette étude longitudinale (sur partir de considérations très distinctes, parfois diver-
plus de 30 ans), portant sur le suivi d’une cohorte d’en- gentes. D’où la nécessité de préciser les définitions aux-
fants et de familles considérée comme à risque, a mis quelles on se réfère.
en évidence des processus de résilience chez de nom-
breux enfants élevés dans des contextes fortement En fait, chaque discipline semble avoir développé sa
carencés. propre définition de la résilience. De plus, au sein d’une
discipline donnée, on peut rencontrer des différences
Différents concepts et notions peuvent être associés à entre sous-disciplines extrêmement importantes et des
la résilience, soit en participant à la compréhension de références à des champs théoriques parfois divergents.
la résilience, soit en permettant de la différencier. Parmi Cette complexité des approches est particulièrement
les concepts associés, nous pouvons citer les notions évidente dans le domaine de la psychologie. Ainsi, on
de : compétences sociales, cognitives, comportemen- peut relever des écarts importants entre les approches
tales… ; stress et coping (ajustements aux situations de la résilience relevant, par exemple, du champ sous-
aversives) ; facteurs de risque/facteurs de protection ; disciplinaire de la psychosociologie et celles qui font
vulnérabilité ; estime de soi ; attachement ; trauma- référence aux théories de la métapsychologie freu-
tismes ; mécanismes de défense… dienne (psychanalyse).
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 82 - SEPTEMBRE 2005 5
Nous pouvons également relever des définitions capacité de résistance à l’adversité. D’autres en évo-
transversales qui évoquent également la variété du quant chez certains enfants (ou sujets) une suppo-
champ de la résilience, dans la mesure ou la rési- sée invulnérabilité, telle que décrite par Anthony et
lience peut concerner non seulement un individu, al. (théorie ensuite abandonnée).
mais aussi un groupe familial, ou encore une com-
munauté sociale. La résilience pouvait ainsi apparaître comme acquise
une fois pour toutes par certains individus, alors
Dans cette perspective, rappelons la définition pro- qu’actuellement les chercheurs s’accordent pour la
posée par Manciaux, Vanistendael, Lecomte et considérer comme un processus dynamique et évo-
Cyrulnik (2001) : « Capacité d’une personne ou lutif et qui n’est pas forcément pérenne ni persistant
d’un groupe à se développer bien, à continuer à se pro- à toutes les épreuves de la vie. A l’heure actuelle, les
jeter dans l’avenir en dépit d’« événements déstabili- théories sur la résilience insistent davantage sur la
sants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes flexibilité dans les modalités d’ajustement, la sou-
sévères ». plesse adaptative et défensive, voire la créativité dans
les processus de protection.
Le processus de résilience est un phénomène com-
VULNÉRABILITÉ VERSUS RÉSI- plexe qui implique l’interaction de facteurs psy-
LIENCE choaffectifs, relationnels et sociaux avec les caracté-
ristiques internes du sujets (processus défensifs,
personnalité…).
Résilience et style d’attachement
Vulnérabilité et métaphore
Au cours des premières approches de la résilience, des trois poupées (Anthony)
l’une des questions qui a émergé est celle des rap-
ports entre le développement de la personnalité et Pour décrire les différences interindividuelles face
l’influence des styles d’attachement comme éven- aux stress et aux traumatismes, Anthony (1982) a
tuels déterminants de la résilience. Dans cette pers- proposé la métaphore des trois poupées : l’une est
pective ont été mises en travail des questions en verre, l’autre en plastique et la troisième en
comme : Peut-on relever des traits de personnalité acier.
spécifiques chez les sujets développant un proces-
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
sus résilient ? Elles reçoivent un coup de marteau d’égale intensité,
ce qui donnera des résultats, on s’en doute, bien dif-
L’analyse du développement de la résilience chez férents en fonction de leur structure. Ainsi, la pre-
les sujets s’est ainsi intéressée à l’importance des mière poupée est brisée totalement, la deuxième
premières expériences d’attachement, avec notam- garde à jamais les traces du coup reçu (traumatisme)
ment le style d’attachement « sécure » comme per- et la dernière résiste et ne présente pratiquement
mettant à l’enfant de développer la résilience. Par aucune trace. Cette dernière apparaît donc comme
la suite, le déterminisme des premiers styles d’at- à l’image de l’enfant invulnérable, capable de résister
tachement a été revisité à la lumière des travaux à tout sans séquelles. Cependant, cette métaphore
sur le développement et la plasticité des styles d’at- n’illustre pas la résilience mais une supposée invul-
tachement au cours de la vie (Pierrehumbert 2003, nérabilité liée à une insensibilité peu humaine (ou
Anaut, 2005). pathologique) bien éloignée de la réalité des per-
sonnes résilientes.
Résilience et différences
interindividuelles Nous pouvons saisir facilement les limites de cette
analyse. Ainsi, cette métaphore se centre sur les
Les différences interindividuelles sont parfois expli- effets du choc (ou du traumatisme) comme étant
quées en termes de résistances plus ou moins essentiellement liés aux capacités du sujet à faire
grandes des individus, en référence à la variation de face à l’agression. Elle souligne l’importance de la
la vulnérabilité interne des personnes. Cela a été le constitution du sujet et de son degré de vulnéra-
cas des premières interprétations proposées par bilité intrinsèque face aux situations aversives.
Emmy Werner pour tenter de comprendre les Enfin, elle ne tient pas compte des paramètres de
enfants résilients. l’environnement qui peuvent contribuer soit à
amplifier le choc, soit à l’atténuer. Autrement dit,
Plus généralement, les premières approches ont elle néglige l’articulation entre les facteurs de
interrogé la résilience chez les individus en l’expli- risque et les facteurs de protection d’origine
quant uniquement ou essentiellement comme la internes et externes.
6 RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 82 - SEPTEMBRE 2005
LE CONCEPT DE RÉSILIENCE
ET SES APPLICATIONS CLINIQUES
Résilience et métaphore Facteurs de résilience individuelle
de la poupée (Manciaux)
A partir de l’étude des individus réputés résilients,
Pour illustrer la résilience, nous lui préférons la on peut retenir un certain nombre de caractéris-
métaphore (inspirée d’Anthony) proposée par tiques qui contribuent à faciliter la résilience comme,
Michel Manciaux (1999) qui dit en substance. Si on par exemple :
laisse tomber une poupée, elle se brisera plus ou • Habilités de résolution de problèmes
moins facilement, en fonction de divers para- • Autonomie
mètres : la force du jet (négligence ou agression…) ; • Capacités de distanciation face à un environnement
la nature du sol (ex. béton, sable, moquette…) et le perturbé
matériau dont elle est fabriquée : verre, porcelaine, • Compétences sociales
chiffon… • Empathie
• Altruisme
La complexité des interactions qui participent au • Sociabilité, popularité
processus de résilience est ici davantage illustrée par • Perception d’une relation positive avec un adulte
la métaphore de Manciaux. En effet, la résilience est
un processus multifactoriel impliquant des facteurs Facteurs de résilience familiale
protecteurs versus des facteurs de risques qui, dans
un contexte donné, produisent une interaction sin- Parmi les caractéristiques de la structure familiale :
gulière. Ainsi, chez une personne, le degré de vul- • Âge des parents
nérabilité est à considérer dans sa complémentarité • Nombre d’enfants (<5)
avec ce qui relève de la résilience et non comme • Espace entre les naissances
opposable. • Espace physique suffisant
• Spiritualité, idéologie
Résilience comme processus • Discipline éducative
multifactoriel
Parmi les caractéristiques de la dynamique fami-
La résilience est un processus multifactoriel issu de liale :
l’interaction entre l’individu et son environnement, • Qualité de la communication
comprenant des variables internes au sujet (struc- • Interactions chaleureuses et positives
ture psychique, personnalité, mécanismes défen- • Support et affection
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
sifs…) et des variables externes (caractéristiques de
l’environnement socioaffectif). Il en résulte des Facteurs de résilience sociale
formes de résiliences spécifiques résultant d’un pro- et/ou communautaire
cessus dynamique et évolutif qui est propre à chaque
sujet. Parmi les niveaux de résilience sociale, on peut citer :
• Les pairs
L’interaction entre les facteurs de risque et les • Communauté sociale : école, quartier…
facteurs de protection pourra conduire vers la • La communauté religieuse ou idéologique
résilience ou vers la vulnérabilité. On peut souli- • La société et la culture
gner l’effet filtre des facteurs de protection
internes et externes face aux événements aver- Parmi les formes de résilience sociale, on peut retenir :
sifs. Autrement dit, les facteurs de protection • Solidarités
agissent comme des « mécanismes médiateurs » de • Attentes élevées
la résilience. • Implication active
• Valeurs d’entraide et de tolérance sociales
• Diversité des supports et des ressources
sociales
FACTEURS DE RÉSILIENCE ET
PROCESSUS DE PROTECTION
APPROCHE PSYCHODYNAMI-
La résilience peut concerner les individus, les QUE DE LA RÉSILIENCE
familles, les communautés ou sociétés. Un certain
nombre de caractéristiques associées au processus
de résilience, ont été identifiées et constituent des Dans les approches psychodynamiques de la résilience,
« facteurs » de résilience individuelle, familiale ou notamment dans un référentiel psychanalytique, la rési-
communautaire selon les approches. lience est considérée comme un processus dynamique.
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 82 - SEPTEMBRE 2005 7
Cette approche est essentiellement centrée sur le perte d’un être cher). Mais de même une accumula-
sujet et l’analyse de son fonctionnement intrapsychique. tion d’événements aversifs, ou de carences graves
Dans les approches psychodynamiques, à l’heure répétées peuvent revêtir un caractère traumatique
actuelle, on peut noter que peu d’intérêt est accordé (par exemple : négligences familiales, abus sexuel,
à l’influence de l’environnement (relationnel ou maltraitance…).
contextuel) dans le développement du processus rési-
lient. On peut souligner la variabilité du retentissement
affectif du traumatisme chez chaque sujet particulier.
En psychologie clinique, l’approche de la résilience Ainsi, l’intensité émotionnelle d’un contexte trau-
est volontairement restrictive. La résilience est consi- matique dépend de la perception du sujet et de ses
dérée comme un processus dynamique qui implique capacités défensives. C’est donc bien la « subjecti-
le ressaisissement de soi après un traumatisme et la vité » et non les aspects objectifs qui peuvent rendre
construction ou le développement normal en dépit compte du caractère traumatique d’une situation
des risques de désorganisation psychique. La rési- donnée. En fait, les aspects traumatiques sont en
lience peut donc se définir comme incluant : a) le quelque sorte filtrés par les modalités défensives des
ressaisissement de soi après un traumatisme ; b) la sujets qui articulent les ressources internes des sujets
(re) construction ou le développement normal en et les ressources de leur environnement relationnel et
dépit des risques ; et c) un rebond psychologique socio-affectif.
avec une force mobilisable dans d’autres circons-
tances. Résilience et mécanismes
de défense
On peut appréhender le processus de résilience de
manière psychodynamique suivant deux axes princi- Pour aborder les mécanismes de défense nous nous
paux. D’une part du point de vue du traumatisme et appuierons sur la définition donnée par Alain
de la réponse du sujet, d’autre part du point de vue Braconnier (1998) : « La notion de mécanisme de
des mécanismes de défense mobilisés par le sujet défense englobe tous les moyens utilisés par le moi pour
réputé résilient. maîtriser, contrôler, canaliser les dangers internes et
externes ».
Résilience et traumatisme
Ce qui caractérise les mécanismes de défense est
Dans la perspective psychodynamique, on consi- avant tout leur rôle homéostatique. Son but est de
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
dère qu’il n’y a résilience que dans la rencontre protéger le sujet, l’empêchant d’être immobilisé par
avec le traumatisme. Ainsi, le processus de rési- l’anxiété et la dépression. Cependant, ils peuvent être
lience suppose la survenue d’un traumatisme plus ou moins adaptés, notamment en fonction du
(unique ou multifactoriel) et la réponse du sujet contexte de leur utilisation et de la rigidité de leur
qui relèvera de son aptitude à surmonter le trau- expression. Leur adaptabilité déprendra, par
matisme. La résilience résultera de l’expérience exemple : de l’âge du sujet ou de son contexte de
traumatogène qui met en jeu les dimensions sui- vie.
vantes :
- un risque vital (physique ou psychique) Selon Vaillant (1993/2000) l’utilisation des méca-
- un éprouvé d’agonie psychique… nismes de défense altère pour une large part de
- les modalités de réponse du sujet pour se défendre. manière involontaire la perception des deux réali-
tés internes et externes. Le résultat de cette distor-
En psychanalyse, on distingue trauma et traumatisme. sion mentale de la réalité est de diminuer l’anxiété
Précisons brièvement que le trauma indique l’expo- et la dépression, réduisant ainsi les manifestations
sition à des événements aversifs (violence externe de la souffrance et des « dommages physiques et
et effraction physique). Alors que le traumatisme réfère psychiques. On peut distinguer des défenses
à l’effet psychique résultant de la rencontre avec le « matures » (p. ex., sublimation, humour, altruisme,
trauma, lorsque l’énergie mobilisée pour s’adapter anticipation) et des défenses « immatures » (p. ex.,
au trauma dépasse les capacités d’élaboration du projection, passage à l’acte, comportement passif-
sujet. On dit qu’il y a effraction psychique. Le terme agressif). Les secondes sont surtout utilisées par les
de « traumatogène » pourra donc s’appliquer à un individus jeunes, alors que les premières sont asso-
contexte ou à des circonstances potentiellement ciées à un bon état de santé mentale chez les sujets
traumatiques. plus âgés. Ainsi, au cours du développement, les
personnes ont tendance à abandonner les défenses
Un traumatisme peut être dû à un événement immatures au profit des défenses plus matures (mais
unique, massif, qui bouleverse les capacités défen- il peut y avoir coexistence des deux registres chez
sives du sujet (par exemple : catastrophe, accident, un même sujet).
8 RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 82 - SEPTEMBRE 2005
LE CONCEPT DE RÉSILIENCE
ET SES APPLICATIONS CLINIQUES
ANALYSE DU FONCTIONNE- cliniques du modèle de la résilience peuvent
consister à repérer dans l’entourage du sujet des
MENT PSYCHIQUE DE LA RÉ- relations d’aide et de soutien, des compétences
SILIENCE familiales et/ou sociales qui peuvent soulager le
sujet.
L’analyse du fonctionnement psychique de la rési-
lience se décompose en deux phases : L’objectif est de mettre en place des accompagne-
ments pour transformer les formes souffrantes de
1) Confrontation au trauma et résistance à la désor- résilience en processus résilients véritablement salu-
ganisation psychique. togènes. On peut cependant se demander si les
La première phase est caractérisée par le recours formes de résilience ancrées dans la souffrance relè-
à des mécanismes défensifs «d’urgence», pour se vent du processus de résilience ou bien s’il s’agit de
protéger de l’effraction psychique. Par exemple : pseudo-résiliences ?
déni, projection, imaginaire, répression des affects,
passage à l’acte, comportement passif/agressif…).
2) Intégration du choc et réparation RÉSILIENCE ET PRATIQUES CLI-
La deuxième phase suppose l’abandon de cer- NIQUES
taines défenses d’urgence (ex, : déni, projection)
pour privilégier des ressources défensives plus
matures, plus souples et plus adaptées à long On peut souligner l’intérêt de ce modèle sur les ter-
terme. Par exemple : créativité, humour, intellec- rains de pratiques cliniques divers : psychologiques,
tualisation, altruisme, sublimation. éducatifs, de soins (psychique et somatique)… Dans
les pratiques de soin, le modèle de la résilience com-
Par ailleurs, le fonctionnement psychique de la rési- plète l’approche classique de la vulnérabilité, des fac-
lience passe par le processus de mentalisation, qui teurs de risque et de la psychopathologie. En effet,
fait appel aux représentations psychiques et à la la résilience élargit les perspectives des pratiques cli-
symbolisation des affects. La mentalisation per- niques en complétant la prise en compte des « carac-
mettant de mettre en pensée les excitations téristiques pathogènes » par celle des « caractéris-
internes. Autrement dit, il s’agit de conférer un sens tiques salutogènes »…
à la blessure. Cette phase d’élaboration, qui passe
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
par la mise en sens du vécu traumatique et le Résilience comme un potentiel
processus d’historicisation, peut donner lieu chez tous les individus ?
(éventuellement bien des années plus tard) aux
récits de vie (Anaut, 2002) ou se traduire par la La plupart des chercheurs et des praticiens s’ac-
créativité. cordent pour considérer que la résilience est un
potentiel présent chez tout un chacun. Dans cette
D’autre part, on ne peut pas dire véritablement perspective, Michel Lemay (1999) la décrit
qu’il existe des défenses résilientes, au sens de comme : « un formidable réservoir de santé dont dis-
défenses spécifiques des sujets dits résilients, car poserait chaque individu ». La résilience peut se
tout le registre défensif dont disposent les indivi- développer différemment suivant les individus,
dus en général peut être mis à contribution dans le leurs caractéristiques singulières, en fonction des
processus de résilience. Cependant, on peut repé- étapes du développement psychologique, du cycle
rer des mécanismes défensifs qui semblent favori- de vie et des circonstances socio-environnemen-
ser le processus résilient et/ou sont souvent pré- tales.
sents dans les observations, tels que : le recours à
l’imaginaire ; l’humour ; le clivage ; le déni : l’intel- La résilience n’est donc pas considérée comme
lectualisation l’apanage de certains individus et absente chez
d’autres, mais comme un potentiel présent chez
Résilience et souffrance ? tous les sujets. Cette hypothèse de ressources rési-
lientes latentes permet d’envisager des accompa-
Des questions demeurent à travailler notamment gnements basés sur le modèle de la résilience. Ainsi,
concernant les souffrances qui peuvent être liées à les mécanismes de la résilience peuvent soit être
certaines formes de résilience. Dans cette pers- activés spontanément par les individus lors de cir-
pective, l’analyse des mécanismes de défense d’un constances particulières (traumatismes…) ; ou bien
sujet peut permettre de repérer des processus être stimulés par des procédures d’aide ou d’ac-
défensifs rigides et/ou coûteux en énergie (p. ex. compagnement (éducatif, thérapeutique, soi-
persistance de défenses d’urgence). Les applications gnant…).
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 82 - SEPTEMBRE 2005 9
Quels accompagnements Plus généralement, dans bien des cas, une même
de la résilience ? variable peut soit contribuer au risque soit parti-
ciper à la protection, en fonction du degré (inten-
Les programmes d’accompagnement de la résilience sité) ; en fonction du contexte (adaptée ou inadap-
peuvent tenter de stimuler ou développer des modes tée à la situation…), en fonction de l’interaction
de protection en s’appuyant sur des caractéristiques avec d’autres variables. Aussi, on peut penser qu’il
individuelles déjà existantes ou à développer chez un conviendrait, comme le préconise Michael Rutter
sujet. Comme par exemple : l’efficience intellec- (1990), de considérer les « processus » ou « méca-
tuelle ; l’autonomie et l’efficacité dans ses rapports nismes » de risque ou de vulnérabilité. Il faudrait
à l’environnement ; le sentiment de sa propre valeur ; donc analyser les processus de protection plutôt
les capacités d’adaptation relationnelles et d’empa- que de prendre en compte isolément des « fac-
thie ; l’anticipation et la planification ; le sens de l’hu- teurs de risque » et des « facteurs de protection ».
mour.
Parmi les processus, on peut distinguer différents
Les objectifs des prises en charge peuvent notam- types de protection. Par exemple, ceux qui rédui-
ment tenter de travailler sur des paramètres tels sent l’impact du risque (agissent sur le risque lui-
que : l’estime de soi, la confiance, l’optimisme, le sen- même ou réduisent son influence) ; ceux qui rédui-
timent d’espoir, la sociabilité. Ou encore, l’autono- sent la probabilité des effets négatifs en chaîne
mie et l’indépendance, l’endurance, la capacité à com- dérivant de l’exposition au risque ; ceux qui sti-
battre les stress. Il peut s’agir d’accompagner mulent l’estime de soi et la conscience de l’effica-
l’émergence des attitudes positives pour faire face à cité à travers des expériences de relations valori-
des problèmes, les résoudre, prévoir leurs consé- santes et sécurisantes (soutien social, amical,
quences… familial). Il s’agit notamment des expériences de
réussites ou de succès de différentes natures… Et
Du point de vue psychothérapique, le travail peut se enfin, les processus de protection qui ouvrent vers
centrer sur l’élaboration de la culpabilité et de la l’avenir en augmentant les opportunités d’actions
honte, notamment p. ex., pour les victimes de vio- et de projets.
lences, d’agressions, d’accidents traumatiques, de
catastrophes… La résilience n’est pas acquise une fois pour toutes,
mais en constant développement. Ainsi, un sujet
Limites et variabilité des formes réputé résilient peut rencontrer des ruptures ou
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
de résilience failles de résilience lors d’une accumulation de stress
ou de traumatismes. Par ailleurs, le processus de rési-
Les formes de la résilience peuvent être diverses, lience souvent évoqué chez les enfants ou à partir
parfois non académiques, par exemple : certaines de l’enfance semble pouvoir apparaître à différentes
formes de délinquance chez les enfants des rues. étapes de la vie. Ainsi, on observe l’émergence du
L’insertion sociale présentée souvent comme un processus résilient à tout âge (y compris dans la
critère de résilience ne prévaut pas ici. Les formes vieillesse).
de résilience marginales font problème pour
les personnes concernées comme pour celles qui
tentent de leur venir en aide (intervenants socio-
éducatifs…) POUR CONCLURE :
«LA MÉTAPHORE DES CASSEURS
Les relations familiales peuvent avoir un rôle pro- DE CAILLOUX»
tecteur. Ainsi, en est-il du rôle de pare-excitation
parental qui contribue à protéger l’enfant face aux
excitations externes, et en quelque sorte filtre les Rappelons pour terminer la fable des « casseurs de
stress et les traumatismes. A contrario, les pathologies cailloux », citée par Boris Cyrulnik (2004). En voici
des liens familiaux peuvent constituer des contextes le récit : En se rendant à Chartres, un voyageur voit
traumatogènes pour l’enfant, p. ex. maltraitances sur le bord de la route un homme qui casse des
physiques et abus ; maltraitances psychologiques cailloux à grands coups de maillet. Son visage
(négligence ou rejet parental) ; ou encore l’exposition exprime le malheur et ses gestes la rage.
de l’enfant à des situations non gérables pour lui.
C’est le cas des enfants dits parentalisés ou adultifiés, Le voyageur demande : « Monsieur que faites-
p. ex. certains enfants ayant des parents malades vous ? »
mentaux ou des parents fortement défaillants du
point de vue social… Ainsi, la famille peut protéger – « Vous voyez bien, lui répond l’homme, je n’ai
ou devenir traumatogène. trouvé que ce métier stupide et douloureux ».
10 RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 82 - SEPTEMBRE 2005
LE CONCEPT DE RÉSILIENCE
ET SES APPLICATIONS CLINIQUES
Un peu plus loin, le voyageur aperçoit un autre Anaut, M. (2002). Résilience, transmission et
homme qui lui aussi casse des cailloux, mais son élaboration du trauma dans l’écriture des
visage est calme et ses gestes harmonieux. enfances blessées. Revue Perspectives Psy. Paris.
Volume 41, n° 5, 380-388.
– « Que faites-vous Monsieur ? », lui demande le
voyageur. Anthony, EJ., Chiland, C. et Koupernick,
– «Et bien je gagne ma vie grâce à ce métier fatigant, C. (1982). L’enfant vulnérable. Paris : PUF.
mais qui a l’avantage d’être en plein air», lui répond-il.
Bourguignon, O. (2000). Facteurs psychologiques
Plus loin un troisième casseur de cailloux irradie de contribuant à la capacité d’affronter des trau-
bonheur. Il sourit en abattant la masse et regarde matismes chez l’enfant. Devenir. 12,2 ; 77-92.
avec plaisir les éclats de pierre. « Que faites-vous ? »
lui demande le voyageur. Braconnier, A. (1998). Psychologie dynamique
– « Moi, répond cet homme, je bâtis une cathé- et psychanalyse. Paris : Masson.
drale ! ».
Cyrulnik, B. (2004). Parler d’amour au bord du
Je rajouterai à cette illustration que : ce qui est gouffre. Paris : Odile Jacob.
important pour le développement de la résilience
c’est, non seulement le regard que les personnes Cyrulnik, B. (2001). Les vilains petits canards.
portent sur elles-mêmes face à l’adversité, leur per- Paris : Odile Jacob.
ception de la situation, leur projection dans l’avenir
etc., mais également le regard que l’on porte sur les Cyrulnik, B. (1999). Un merveilleux malheur.
sujets blessés. Ainsi, les considère-t-on seulement Paris : Odile Jacob.
comme des casseurs de cailloux ? Ou bien comme
de possibles bâtisseurs de cathédrales ? DeTychey, C. (2001). La résilience au regard de
la psychanalyse. Manciaux et al. La résilience :
résister et se construire. Genève : Cahiers
Médicaux Sociaux, 145-157.
Haggerty, R., Sherrod, L, Garmezy, N, Rutter, M.
(1997). Stress, Risk and Resilience in Children and
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
© Association de Recherche en Soins Infirmiers | Téléchargé le 21/03/2024 sur www.cairn.info (IP: 41.143.196.247)
Adolescents. NY, Cambridge University Press.
Lemay, M. (1999). Réflexions sur la résilience.
In M-P. Poilpot et al. Souffrir mais se construire.
Ramonville Saint-Agne : Fondation pour
l’Enfance, Erès.
Manciaux, M. et al. (2001). La résilience : résis-
ter et se construire. Genève : Cahiers Médicaux
Sociaux.
BIBLIOGRAPHIE
Pierrehumbert, B. (2001). Le premier lien, théo-
rie de l’attachement. Paris : Odile Jacob.
Anaut, M. (2005). Soigner la famille, Paris : Rutter, M. (1990). Psychosocial resilience and
Armand Colin. protective mechanisms. In J. Rolf & A. Master,
Risk and Protective Factors, in the Development
Anaut, M. (2004). La résilience en situations de of Psychopatholy. New York : Cambridge
soins : approche théorico-clinique. Revue University Press.
Recherche en soins infirmiers. N°77.
Vaillant G.E. (1993-2000). The Wisdom of the
Anaut, M. (2003). La résilience, surmonter les Ego. USA Cambridge, Harward University Press
traumatismes, Paris : Nathan Université. (4ème édition, 2000).
Anaut, M. (2002). Trauma, Vulnérabilité et Werner E., Smith, R. (1982). Vulnerable but
Résilience en Protection de l’Enfance. Revue Invincible : a longitudinal study of resilient chil-
Connexions, Erès, Volume 77, 101-118. dren and youth. NY : Mac Graw Hill.
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS N° 82 - SEPTEMBRE 2005 11
Vous aimerez peut-être aussi
- 3008 Du 04 2009 1,6L HDI 112cv Et 2LHDI 150cvDocument318 pages3008 Du 04 2009 1,6L HDI 112cv Et 2LHDI 150cvDany Defossez-anceaux100% (5)
- Rsi 122 0077Document6 pagesRsi 122 0077osteopat.gonthierPas encore d'évaluation
- Analyse Psychodynamique Du Travail InfirmierDocument12 pagesAnalyse Psychodynamique Du Travail Infirmiercamilledanion98Pas encore d'évaluation
- Rsi 080 0087Document18 pagesRsi 080 0087MBOWAMBA LOBOMBOPas encore d'évaluation
- Rsi 089 0033Document11 pagesRsi 089 0033BENSLIMANEOTHMANEPas encore d'évaluation
- Rsi 125 0020Document13 pagesRsi 125 0020amboukhechemPas encore d'évaluation
- Autoestima Análisis de ConceptosDocument10 pagesAutoestima Análisis de Conceptosadrianafrcv26Pas encore d'évaluation
- Rsi 089 0033Document11 pagesRsi 089 0033Fiona DaphPas encore d'évaluation
- Science Et Science Infirmière Quels Liens, Quels Enjeux EtDocument11 pagesScience Et Science Infirmière Quels Liens, Quels Enjeux EtKate GUINLEYPas encore d'évaluation
- Rsi 111 0013Document10 pagesRsi 111 0013Issam BelPas encore d'évaluation
- Analyse Dimensionnelle Du Concept de Biosécurité Face Aux Risques BiologiquesDocument16 pagesAnalyse Dimensionnelle Du Concept de Biosécurité Face Aux Risques BiologiquesAbdoulaye SarambounouPas encore d'évaluation
- Rsi 116 0040Document18 pagesRsi 116 0040Maria MimiPas encore d'évaluation
- Rsi 140 0077Document21 pagesRsi 140 0077GermainPas encore d'évaluation
- Rsi 118 0007Document11 pagesRsi 118 0007saraasseffar3Pas encore d'évaluation
- Evaluation en Formation InfirmiereDocument33 pagesEvaluation en Formation InfirmiereASMAA AZHOUNEPas encore d'évaluation
- Rsi 106 0082Document5 pagesRsi 106 0082victorinevddPas encore d'évaluation
- Rsi 084 0041Document12 pagesRsi 084 0041LAS SourouPas encore d'évaluation
- Rsi 127 0091Document14 pagesRsi 127 0091cammganeshPas encore d'évaluation
- Tanner Raisonnement CliniqueDocument34 pagesTanner Raisonnement Cliniqueأصيلة أصيلةPas encore d'évaluation
- 4 Indicateurs Dactivites Soisn InfirmiersDocument16 pages4 Indicateurs Dactivites Soisn InfirmiersMAROUANI El HoussainPas encore d'évaluation
- ObservationDocument15 pagesObservationnablaoui.jawadPas encore d'évaluation
- Rsi 125 0046Document16 pagesRsi 125 0046khalida el ghazyPas encore d'évaluation
- TF 081 0037Document6 pagesTF 081 0037moulinPas encore d'évaluation
- Surveillance Prénatale Et Éducation Pour La Santé Rsi - 110 - 0060Document6 pagesSurveillance Prénatale Et Éducation Pour La Santé Rsi - 110 - 0060Kate GUINLEYPas encore d'évaluation
- Rsi 082 0031Document13 pagesRsi 082 0031musicalcholicPas encore d'évaluation
- Cara - 2016 - Modèle Humaniste Des Soins InfirmiersDocument13 pagesCara - 2016 - Modèle Humaniste Des Soins InfirmierstoniksPas encore d'évaluation
- Différentes Traditions Philosophiques Pour LeDocument12 pagesDifférentes Traditions Philosophiques Pour LeSaidi SoundosPas encore d'évaluation
- Rsi 136 0054Document13 pagesRsi 136 0054DALI FFXPas encore d'évaluation
- L'observation Clinique AttentiveDocument15 pagesL'observation Clinique AttentivebchPas encore d'évaluation
- Inka 042 0043Document11 pagesInka 042 0043Houda SalasPas encore d'évaluation
- HTA Approche de Leur VécuDocument5 pagesHTA Approche de Leur VécuLAS SourouPas encore d'évaluation
- Article de Recherche Scientifique Sur L'hypnose Et Soins Pre-Post OpDocument9 pagesArticle de Recherche Scientifique Sur L'hypnose Et Soins Pre-Post OpVincent-Sully MariePas encore d'évaluation
- CartesDixit Comme Support Aux Représentation Métaphoriques Un Média D'intervention Systémique Sous MandatDocument25 pagesCartesDixit Comme Support Aux Représentation Métaphoriques Un Média D'intervention Systémique Sous Mandatannesophie.varese.proPas encore d'évaluation
- Humanitude Dans Les SoinsDocument15 pagesHumanitude Dans Les SoinsDINO ECOPas encore d'évaluation
- Rsi 091 0012Document13 pagesRsi 091 0012Christian Abel MendyPas encore d'évaluation
- Rsi 110 0098Document16 pagesRsi 110 0098Jihane HtPas encore d'évaluation
- Rsi 135 0007Document8 pagesRsi 135 0007Ab SantePas encore d'évaluation
- Rsi 097 0063Document12 pagesRsi 097 0063Sephora KhllPas encore d'évaluation
- Différence Soin Idde Et Soin MédicalDocument33 pagesDifférence Soin Idde Et Soin Médicalosteopat.gonthierPas encore d'évaluation
- Rsi 102 0035Document8 pagesRsi 102 0035Yakhlef IkramPas encore d'évaluation
- Le Transfert Des Connaissances en Soins de Plaies Chez Les Infirmières Une Revue Intégrative Des ÉcritsDocument18 pagesLe Transfert Des Connaissances en Soins de Plaies Chez Les Infirmières Une Revue Intégrative Des ÉcritsSaidi SoundosPas encore d'évaluation
- Les Savoirs Infirmiers Liés Au Care Exprimés DansDocument12 pagesLes Savoirs Infirmiers Liés Au Care Exprimés DansSaidi SoundosPas encore d'évaluation
- Psys 131 0043Document12 pagesPsys 131 0043Damien BaudryPas encore d'évaluation
- Médiateurs Et ModérateursDocument23 pagesMédiateurs Et ModérateursakkselPas encore d'évaluation
- Houssaye Le Triangle PedagogiqueDocument11 pagesHoussaye Le Triangle Pedagogiquedahmanimaroua88Pas encore d'évaluation
- Rsi 126 0065Document7 pagesRsi 126 0065Ab SantePas encore d'évaluation
- Rsi 106 0047Document13 pagesRsi 106 0047To PlaysPas encore d'évaluation
- Clinique Des Soins BiblioDocument6 pagesClinique Des Soins BiblioYounès KhalilPas encore d'évaluation
- Rsi 098 0019Document10 pagesRsi 098 0019Jacqueline Mariame Mamadouno100% (1)
- 3 Developpment de Competences Et Raisonnement CliniqueDocument13 pages3 Developpment de Competences Et Raisonnement CliniqueMAROUANI El HoussainPas encore d'évaluation
- RPPG 063 0065Document15 pagesRPPG 063 0065Syryne BelghithPas encore d'évaluation
- Rsi 116 0070Document12 pagesRsi 116 0070Koku Elom DzamessiPas encore d'évaluation
- Lectura en FrancesDocument17 pagesLectura en FrancesSara Juliana Rosero MedinaPas encore d'évaluation
- Rsi 097 0004Document20 pagesRsi 097 0004KONE MoussaPas encore d'évaluation
- Distinguer Savoir Et ConnaissancesDocument4 pagesDistinguer Savoir Et ConnaissancesSaidi SoundosPas encore d'évaluation
- Texte - Tanda Etal 2020 - Analyse Dimensionnelle Du Construit Formation Par La Recherche .Document13 pagesTexte - Tanda Etal 2020 - Analyse Dimensionnelle Du Construit Formation Par La Recherche .ns5819Pas encore d'évaluation
- 1Document7 pages1achrafkchaw96888939Pas encore d'évaluation
- DDOC T 2017 0034 HAYO Vol1Document381 pagesDDOC T 2017 0034 HAYO Vol1Rabie MachloukhPas encore d'évaluation
- Mav 054 0215Document23 pagesMav 054 0215KERARMICHAIMAEPas encore d'évaluation
- Infirmière-Une Profession Problématique - Anne-Cécile BroutelleDocument4 pagesInfirmière-Une Profession Problématique - Anne-Cécile BroutelleDINO ECOPas encore d'évaluation
- Le dispositif des médiateurs de santé pairs en santé mentale : une innovation controversée: Rapport final de la recherche Evaluative qualitative sur le programme expérimental 2012-2014D'EverandLe dispositif des médiateurs de santé pairs en santé mentale : une innovation controversée: Rapport final de la recherche Evaluative qualitative sur le programme expérimental 2012-2014Pas encore d'évaluation
- Epees LegendairesDocument9 pagesEpees LegendaireshhhhhhPas encore d'évaluation
- Les Nappes de Charriage 2024Document6 pagesLes Nappes de Charriage 2024lashabdorsafPas encore d'évaluation
- Ssp095 - FR Eobd DieselDocument24 pagesSsp095 - FR Eobd DieselAzimPas encore d'évaluation
- MCC18 v16 PDFDocument48 pagesMCC18 v16 PDFSmart ClassePas encore d'évaluation
- CM Comm Evenementielle M2Document20 pagesCM Comm Evenementielle M2Tougma WilfriedPas encore d'évaluation
- Technicien EnvironnementDocument1 pageTechnicien EnvironnementRodolphe AtsainPas encore d'évaluation
- Reseaux Sociaux Comprendre Et Maitriser Ces Nouveaux Outils de Communication 6e Edition - SommaireDocument17 pagesReseaux Sociaux Comprendre Et Maitriser Ces Nouveaux Outils de Communication 6e Edition - SommaireMa Ra LiPas encore d'évaluation
- Psaume de La Créa PDFDocument2 pagesPsaume de La Créa PDFDosferdy Dosferdy100% (1)
- BalzacDocument30 pagesBalzacJipa IoanaPas encore d'évaluation
- Le Réglage Des SoupapesDocument5 pagesLe Réglage Des SoupapesJim Lieb100% (1)
- CV MATTICHE Nouha INGENIEUR CIVIL Acctualisã© 2Document2 pagesCV MATTICHE Nouha INGENIEUR CIVIL Acctualisã© 2tp546dqvj8Pas encore d'évaluation
- LIVRE I, Chant 5 - Le Yoga Du Roi - Le Yoga de La Liberté Et de La Grandeur de L'esprit - Savitri en FrançaisDocument23 pagesLIVRE I, Chant 5 - Le Yoga Du Roi - Le Yoga de La Liberté Et de La Grandeur de L'esprit - Savitri en FrançaisRoland KagboPas encore d'évaluation
- Stabilite - Contreventement Des Batiments - A.skowRONDocument24 pagesStabilite - Contreventement Des Batiments - A.skowRONMariam Moumni100% (1)
- TP SQLDocument13 pagesTP SQLyassinedoPas encore d'évaluation
- Cours Langage C - 16v17Document10 pagesCours Langage C - 16v17redstealth100% (1)
- Dossier de Presse Pme Aout 2021Document21 pagesDossier de Presse Pme Aout 2021laryskal95Pas encore d'évaluation
- L'Architecture Biophilique Pour Le Bien-Être Des PatientsDocument95 pagesL'Architecture Biophilique Pour Le Bien-Être Des PatientsHiba BouballoutaPas encore d'évaluation
- Quotidien D'Oran - 04-09-2013 PDFDocument24 pagesQuotidien D'Oran - 04-09-2013 PDFnidronyPas encore d'évaluation
- Bif N°95 Intégration de L'activité Domiciliation Des Entreprises Dans Le Code de CommerceDocument2 pagesBif N°95 Intégration de L'activité Domiciliation Des Entreprises Dans Le Code de CommerceAchraf ouissadenePas encore d'évaluation
- SPECIAL ENGRAIS FOLIAIRE LIQUIDE DDocument4 pagesSPECIAL ENGRAIS FOLIAIRE LIQUIDE DbinodjayPas encore d'évaluation
- Religion Et SantéDocument15 pagesReligion Et SantéJodel PierrePas encore d'évaluation
- Meeùs - Théorie Modale - IntroductionDocument6 pagesMeeùs - Théorie Modale - IntroductionDale CooperPas encore d'évaluation
- Lecon N 3 Les Espaces de Faible Densite Et Leurs Atouts 1Document27 pagesLecon N 3 Les Espaces de Faible Densite Et Leurs Atouts 1natacha joseph-mathurinPas encore d'évaluation
- Toaz - Info Liants Hydrocarbones PRDocument7 pagesToaz - Info Liants Hydrocarbones PRmohamedaziz.karaborniPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage PFEDocument15 pagesRapport de Stage PFEhamidbourhim822Pas encore d'évaluation
- Décret N° 2.17.451Document21 pagesDécret N° 2.17.451RIM EL MESSAOUDIPas encore d'évaluation
- Université Taheri Muhammad BécharDocument13 pagesUniversité Taheri Muhammad Bécharثقافة عامةPas encore d'évaluation
- Mettre en Concurrence Ses Fournisseurs-PartenairesDocument42 pagesMettre en Concurrence Ses Fournisseurs-PartenairesRihab SadikiPas encore d'évaluation
- Rodriguez - Latelier Et Lexposition - TexteDocument16 pagesRodriguez - Latelier Et Lexposition - Texteleduc.gabriellaPas encore d'évaluation