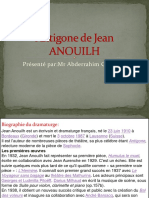Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Antigone Le Garde
Antigone Le Garde
Transféré par
maryamnawdaliTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Antigone Le Garde
Antigone Le Garde
Transféré par
maryamnawdaliDroits d'auteur :
Formats disponibles
I.
L'impossible dialogue entre les deux personnages
1.Un faux dialogue
Le dialogue entre le garde et Antigone semble impossible.
- Antigone est à l'initiative du dialogue. On remarque en effet de nombreuses phrases interrogatives
qui appellent donc une réponse. Pourtant, à plusieurs reprises le garde répond par des tournures
négatives « je ne sais pas », « je ne peux pas vous dire » ou par une absence de réponse comme
l'indiquent certaines didascalies (ex : « silence ») qui stoppent ainsi la conversation.
- De plus, à chaque fois le garde répond à ce que dit Antigone en ramenant à lui la conversation.
Prédominance ainsi de la première personne du singulier sous différentes formes « je », « m' »,
« moi ». On remarque d'ailleurs que le « moi » est mis en valeur par sa place soit en début de phrase,
soit isolé en incise : « Moi, je n'ai jamais été blessé (…) », « Je risquerais gros, moi, à ce petit jeu-là »,
« Si on me fouille, moi, c'est le conseil de guerre ».
- Par ailleurs, on peut remarquer que le dialogue peine à progresser puisqu'il fonctionne sur un
système de répétitions entre les deux personnages (exemple : « Deux bêtes… - Quoi, deux
bêtes ? », « C'est de l'or ? – Oui, c'est de l'or », « C'est une drôle de lettre. – Oui, c'est une drôle de
lettre »).
Transition : Cette indifférence perceptible dans la manière de répondre du garde contribue à en faire
un personnage odieux.
2. Un garde odieux
Plusieurs éléments contribuent à rendre le garde particulièrement odieux à l'égard d'Antigone.
- Face à une jeune femme qui s'apprête à mourir, il insiste ainsi particulièrement sur les détails
sordides de la mort. On remarque en effet un champ lexical correspondant : « souiller la ville »,
« votre sang », « vous murer dans un trou », etc.
- De plus, c'est un personnage qui va aider Antigone non par bienveillance, mais par cupidité. En
effet, lorsque celle-ci lui demande de rédiger une lettre, il refuse dans un premier temps, arguments à
l'appui. Pourtant, quand Antigone refait la même proposition en échange d'une bague en or, le garde
réussit à s'arranger avec ses principes ; il y a un contraste entre l'affirmation vive par l'exclamative
« Ah ! ça non ! Pas d'histoires ! » et la concession « ce que je peux, si vous voulez ».
- Enfin, Antigone se confie au garde. On assiste à un moment crucial où pour la première fois
Antigone se remet en question et avoue sa peur et ses remords. On attendrait du garde qu'il
compatisse, ce n'est pourtant pas le cas. Exemple : « Toute seule… » dont les points de suspension
marque le désarroi d'Antigone est suivi par « Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville. En plein
soleil. » c'est-à-dire des détails logistiques au lieu de paroles de réconfort.
Transition : Face à une héroïne au sommet de la tragédie qu'elle vit, le garde est odieux. La rencontre
des deux fait ici ressortir tout le grotesque de cette scène.
3. Le grotesque de la scène
Petit rappel : « grotesque » à la Renaissance désigne un style d'ornement. Aujourd'hui ce terme
qualifie ce qui semble ridicule, bizarre, risible, mêlé parfois d'un certain effroi.
- La scène est grotesque dans le rapport qui existe entre les deux personnages. En effet, on a une
héroïne prête à mourir, et un garde qui semble totalement indifférent à cela.
- Mais cela s'accentue lorsque le garde écrit la lettre. En effet, il y a une opposition entre le contenu
à la fois fort et intime de la lettre et la posture du garde rédigeant cette lettre. Certains éléments
permettent de l'associer à un enfant à l'école, notamment par le biais des didascalies « il suce sa
mine », « vexé, fait mine de rendre la bague », « répète de sa grosse voix en écrivant », « qui peine
sous la dictée » et par le jeu de mise en scène qui consiste à faire répéter le garde avec un temps de
retard par rapport à Antigone (« Eh dites, vous allez trop vite ! ») et qui place dans la bouche de ce
garde bourru la confession terrible d'Antigone « Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas plus
m'aimer… », « Créon avait raison, c'est terrible… », etc.
- Par ailleurs, on peut noter les réactions à la fois étonnantes et décalées du garde « On ne sait jamais
pourquoi on meurt », « c'est une drôle de lettre ». L'adjectif « drôle » est utilisé à deux reprises, pour
qualifier la corvée et la lettre et que normalement il signifie « qui est comique, amusant »…
- Tout cela désacralise cette lettre.
Transition : La mise en scène suggère un décalage important entre Antigone et le garde, celui-ci
n'étant pas à l'écoute de sa prisonnière. Cela renforce d'autant plus les derniers instants d'Antigone.
II. Les derniers instants d'Antigone
1. L'expression du doute et des regrets
- Ce passage semble être à la fois une sorte de bilan et une prise de conscience pour Antigone. Elle
contredit ainsi ce qu'elle a dit jusque-là « Créon avait raison ». Répétition du « c'est terrible »
accentuée par la répétition du garde.
- Le verbe « savoir » associé à la négation « ne… plus » marque la perte des certitudes
d'Antigone « Je ne sais plus ». Le « plus » marque le fait qu'un jour elle a eu l'impression de savoir
mais que c'est désormais une chose révolue. A l'inverse « Je le comprends seulement maintenant »
souligne une nouvelle façon de penser en opposition à ses certitudes passées.
- Importance du « pardon » avant de mourir. Antigone demande à travers la lettre à être pardonnée
pour ses erreurs. Ce mot est mis en valeur puisqu'elle demande de tout rayer pour ne garder que lui
« Mets seulement : « Pardon » ».
- On note aussi la projection dans un monde sans elle avec l'utilisation du conditionnel « Sans la petite
Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles » qui met en relief la conséquence de ses actes sur les
autres. Evocation également de ce qui ne sera jamais « Oh ! Hémon, notre petit garçon. ».
Transition : La scène ressemble ainsi à une sorte de bilan d'Antigone sur sa vie, bilan marqué par la
solitude de l'héroïne au moment où elle se rend compte de tout cela.
2. La solitude
- Antigone est dans ce passage un personnage profondément seule. Cette solitude est
paradoxalement accentuée par la présence du garde. En effet, le fait qu'il y ait une autre présence que
celle de l'héroïne devrait être un réconfort. Pourtant, à cause de tout ce qu'on a dit précédemment de ce
garde, cela ne fait que renforcer la solitude d'Antigone.
- Par ailleurs, insistance sur cette solitude par l'anaphore de l'expression « toute seule ».
La comparaison avec les deux bêtes souligne davantage encore cette solitude. En effet, « l'une contre
l'autre » s'oppose dans la même réplique à « Je suis toute seule ». D'autant plus qu'à ce moment-là,
Antigone évoque son besoin d'une personne à ses côtés et que le garde répond par le besoin de
« quelque chose ».
- Importance de la didascalie « Elle est toute petite au milieu de la grande pièce nue/ Elle s'entoure de
ses bras ». Opposition entre les adjectifs « grande » et « petite » qui isole un peu plus Antigone et
l'utilisation pronominale du verbe « entourer » avec le possessif « ses » : normalement on prend dans
ses bras une autre personne que soi ; ici Antigone, dans sa solitude, devient elle-même son propre
réconfort.
- Enfin dans la remarque finale, il y a une opposition entre « sans la petite Antigone » et le pronom
« tous » qui montre qu'elle est exclue de cette famille.
Transition : Cette solitude accentue le tragique d'Antigone et sa mort imminente.
3. Le tragique et la mort
- Mort omniprésente ; on peut citer le champ lexical et caractère tragique de cela avec la répétition de
l'adjectif « tragique ».
- Envolée lyrique avec l'anaphore du « ô » et les synonymes : « Ô tombeau ! Ô lit nuptial ! ô ma
demeure souterraine ! » Importance ici de la métaphore « lit nuptial » qui souligne que Antigone
épouse la mort.
- Antigone apparaît non pas comme un personnage qui va mourir dans un futur proche, mais
comme une personne déjà emportée par la mort. Ainsi sa voix n'est plus qu'un « murmure », la
chaleur des « deux bêtes » s'oppose au froid qui la qualifie (« On dirait qu'elle a un peu froid », « Elle
a un petit frisson »), elle a « les yeux fermés » et enfin elle utilise le verbe mourir au présent « Je
meurs » ce qui lui donne une valeur d'énonciation (l'action a lieu au moment où on la dit).
- Tonalité également pathétique car le décalage entre les deux personnages est propice à déclencher la
pitié du spectateur et renforce le caractère tragique d'Antigone.
Conclusion
Cette scène de la tragédie Antigone, de Jean Anouilh est particulièrement marquée par l'absence
véritable de dialogue alors même que nous sommes dans une pièce de théâtre, lieu de la parole.
L'attitude du garde face à Antigone est insoutenable mais accentue aussi le caractère tragique de
l'héroïne en l'isolant une fois de plus. Antigone est un personnage solitaire par excellence. Même
entourée, elle a toujours été seule. Seule face à sa famille, seule face à la loi, seule face à
l'incompréhension, et ici seule face à la peur et à la mort.
Cette scène n'existe pas dans la version de Sophocle, elle a été ajoutée par Anouilh. Cela annonce le
théâtre de l'Absurde d'après-guerre. Pourquoi mourir quand on ne croit pas aux justifications que l'on
se donne ?
Vous aimerez peut-être aussi
- Antigone de Jean Anouilh (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandAntigone de Jean Anouilh (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Antigone Et Le Garde Lecture Analytique2Document7 pagesAntigone Et Le Garde Lecture Analytique2Ahmed Said100% (1)
- La Parure RéponsesDocument2 pagesLa Parure RéponsesZoéPas encore d'évaluation
- Fiche Pédagogique Prologue AntigoneDocument4 pagesFiche Pédagogique Prologue Antigoneanas mhidraPas encore d'évaluation
- Merlin AlchimiDocument14 pagesMerlin AlchimiAhlem Lahidheb0% (1)
- Antigone de Jean AnouilhDocument10 pagesAntigone de Jean AnouilhElisa AeticPas encore d'évaluation
- Antigone LectureDocument16 pagesAntigone LectureSmove Oner75% (4)
- Cours 1 Le RomantismeDocument6 pagesCours 1 Le RomantismeRofaida MhbPas encore d'évaluation
- Le Present Des Verbes Etre Avoir Aller Venir Et Fa Exercice Grammatical Feuille Dexercices Fiche Peda - 62405Document1 pageLe Present Des Verbes Etre Avoir Aller Venir Et Fa Exercice Grammatical Feuille Dexercices Fiche Peda - 62405許樂然Pas encore d'évaluation
- Antigone Ismène HémonDocument2 pagesAntigone Ismène HémonYassine100% (2)
- Antigone de Jean AnouilhDocument10 pagesAntigone de Jean AnouilhYounessBenayad100% (1)
- Antigone-Le Garde. AnalyseDocument2 pagesAntigone-Le Garde. Analysekhadija0% (1)
- L'autobiographie en 3eDocument12 pagesL'autobiographie en 3eStephane FouenardPas encore d'évaluation
- Fiches Pedagogiques p1s1 2am - Nouveau Prog. Sihem Zaher PDFDocument23 pagesFiches Pedagogiques p1s1 2am - Nouveau Prog. Sihem Zaher PDFnafissa benlahcen100% (1)
- Themes Antigone 2Document2 pagesThemes Antigone 2Ghizlane MouhoubPas encore d'évaluation
- TD 2 DémarchesDocument3 pagesTD 2 DémarchesmouatezPas encore d'évaluation
- La Couronne Du DestinDocument15 pagesLa Couronne Du DestinIsidore ScottPas encore d'évaluation
- Soliloque D'antoineDocument4 pagesSoliloque D'antoineAssile100% (1)
- Lettre Amicale CoursDocument5 pagesLettre Amicale Courstigga100% (1)
- SYNTH-Parole-Dire-Ne Pas Dire-Comment dire-JusteLaFinDuMondeDocument5 pagesSYNTH-Parole-Dire-Ne Pas Dire-Comment dire-JusteLaFinDuMondenatalia100% (1)
- Antigone Le Garde 2Document4 pagesAntigone Le Garde 2maryamnawdaliPas encore d'évaluation
- Antigone Le GardeDocument3 pagesAntigone Le GardeBouzarmine Mohammed El HabibPas encore d'évaluation
- Antigone NourriceDocument1 pageAntigone NourricemaryamnawdaliPas encore d'évaluation
- Antigone Le DénouementDocument1 pageAntigone Le DénouementOuazzani KhalidPas encore d'évaluation
- AntigoneDocument6 pagesAntigoneSheldon Carrie0% (1)
- La Nourrice AntigoneDocument3 pagesLa Nourrice AntigoneKOCTEAU BPas encore d'évaluation
- La Fin Dantigone CorrectionDocument2 pagesLa Fin Dantigone Correctionazizhajar68Pas encore d'évaluation
- C-3C Antigone-Partie 6-Antigone Et Le Garde-2ème Partie-8-9-10-11-12-13Document3 pagesC-3C Antigone-Partie 6-Antigone Et Le Garde-2ème Partie-8-9-10-11-12-13spatio shortPas encore d'évaluation
- Antigone Hémon 2024Document25 pagesAntigone Hémon 2024aguouramayaPas encore d'évaluation
- Séquence 2Document2 pagesSéquence 2ayato55.ka7Pas encore d'évaluation
- Prologue AntigoneDocument3 pagesPrologue AntigoneGil CohPas encore d'évaluation
- Resume Antigone N°3Document5 pagesResume Antigone N°3Al AyubPas encore d'évaluation
- Le RireDocument12 pagesLe Riresaadkarous43Pas encore d'évaluation
- Comparer Antigone Pour Sophocle Et Antigone Pour Anouilh .... - Mot À MotDocument4 pagesComparer Antigone Pour Sophocle Et Antigone Pour Anouilh .... - Mot À MotElattar AbdeljalilPas encore d'évaluation
- Sujet 6Document8 pagesSujet 6Vincent CarnetPas encore d'évaluation
- Genre LittéraireDocument2 pagesGenre LittérairemohaPas encore d'évaluation
- Commentaire Kolt S BB2Document7 pagesCommentaire Kolt S BB2noahdebugnyPas encore d'évaluation
- L.A Tirade Du Messager Antigone D'anouilh - Espace LettresDocument4 pagesL.A Tirade Du Messager Antigone D'anouilh - Espace Lettresplenviede37Pas encore d'évaluation
- Texte 5 LinéaireDocument2 pagesTexte 5 LinéaireDeyan HussonPas encore d'évaluation
- Analyse AntigoneDocument24 pagesAnalyse AntigonemaryamnawdaliPas encore d'évaluation
- Scène 13 14 15..... 21Document13 pagesScène 13 14 15..... 21ahmed elkobbiPas encore d'évaluation
- FC Analyse Lagarce Juste 200221v2Document10 pagesFC Analyse Lagarce Juste 200221v2ouiza.sabrina01Pas encore d'évaluation
- Antigone PrologueDocument7 pagesAntigone PrologueBouzarmine Mohammed El Habib100% (1)
- Antigone Explication de La Scène 5 À 10Document2 pagesAntigone Explication de La Scène 5 À 10Amal EssehliPas encore d'évaluation
- Le Registre TragiqueDocument1 pageLe Registre Tragiquekfpw8jpgbgPas encore d'évaluation
- ArticleDocument10 pagesArticleAziz BouchannaPas encore d'évaluation
- AntigoneDocument8 pagesAntigoneAziz BouchannaPas encore d'évaluation
- AntigoneDocument3 pagesAntigoneAli AliPas encore d'évaluation
- Adam HardajDocument1 pageAdam Hardajmaroc05220marocPas encore d'évaluation
- Juste La Fin Du Monde - Deuxième Partie - Scène 3 - Le Duel FratricideDocument7 pagesJuste La Fin Du Monde - Deuxième Partie - Scène 3 - Le Duel FratricideMattin. NblPas encore d'évaluation
- Quelques CitationsDocument5 pagesQuelques CitationsnewmanlazalPas encore d'évaluation
- Moliere LL 14Document6 pagesMoliere LL 14G BPas encore d'évaluation
- Resume AntigoneDocument6 pagesResume AntigoneMohamed Ilyas BOUKHLIKPas encore d'évaluation
- Compréhension 1 Avec Le Corrigé Antigone Et Le GardeDocument2 pagesCompréhension 1 Avec Le Corrigé Antigone Et Le GardeKhalidBHL100% (1)
- LL11 Analyse Prof Et ÉlèveDocument8 pagesLL11 Analyse Prof Et Élève5p2wrvcsbbPas encore d'évaluation
- AntigoneDocument2 pagesAntigoneahmed taffachPas encore d'évaluation
- Cours Classe AntoineDocument2 pagesCours Classe AntoinelyblancPas encore d'évaluation
- 9782743657826Document18 pages9782743657826Antonin MbaPas encore d'évaluation
- 3C Français Mardi 2 Juin Antigone Séance 3Document3 pages3C Français Mardi 2 Juin Antigone Séance 3Hassane EL BahhagPas encore d'évaluation
- Dissert Sans Action Pas de Trag DieDocument4 pagesDissert Sans Action Pas de Trag DiepalomabaronPas encore d'évaluation
- Commentaire RhinocerosDocument5 pagesCommentaire RhinocerosJulia BerjoanPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire LAGARCE - AntoineDocument5 pagesLecture Linéaire LAGARCE - Antoinelyblanc100% (1)
- 4 - Antigone-Le GardeDocument39 pages4 - Antigone-Le GardeaguouramayaPas encore d'évaluation
- Le Messager 1Document6 pagesLe Messager 1maryamnawdaliPas encore d'évaluation
- À LireDocument8 pagesÀ LireHAKIM SAADIPas encore d'évaluation
- AntigoneDocument2 pagesAntigoneTracy ThinePas encore d'évaluation
- AntigoneDocument19 pagesAntigoneSimp for ErosPas encore d'évaluation
- La Boite a Merveilles محولDocument31 pagesLa Boite a Merveilles محولProfesseur EL MehdiPas encore d'évaluation
- Analyse Logique de La Phrase - Les Propositions PDFDocument5 pagesAnalyse Logique de La Phrase - Les Propositions PDFmhdi100% (1)
- Révision 19è SDocument3 pagesRévision 19è SThierno ThiawPas encore d'évaluation
- Les Registres Pathétique Et Polémique DJCDocument3 pagesLes Registres Pathétique Et Polémique DJCOum Abdou RayanPas encore d'évaluation
- Analyse Et Depouillement de La Revue Policière Espagnole Gimlet / Anne GodineauDocument70 pagesAnalyse Et Depouillement de La Revue Policière Espagnole Gimlet / Anne GodineauBiblioteca la BòbilaPas encore d'évaluation
- Frances Elem 1 Tarea 1 (Wehnelt Almánzar 16-9228)Document4 pagesFrances Elem 1 Tarea 1 (Wehnelt Almánzar 16-9228)jose limaPas encore d'évaluation
- Accords Dans Le Groupe Nominal - Accords Dans Le Groupe VerbalDocument4 pagesAccords Dans Le Groupe Nominal - Accords Dans Le Groupe Verbalc6244725Pas encore d'évaluation
- Dissert Sans Action Pas de Trag DieDocument4 pagesDissert Sans Action Pas de Trag DiepalomabaronPas encore d'évaluation
- Les Amants MagnifiquesDocument71 pagesLes Amants MagnifiquesDanilo FigueiredoPas encore d'évaluation
- Cours FrancaisDocument7 pagesCours FrancaisclementinelclPas encore d'évaluation
- 2019 12 DP 450 Sherlock HolmesDocument25 pages2019 12 DP 450 Sherlock HolmesAlexia RousselPas encore d'évaluation
- Adjectifs Traits de Caractere Feuille DexercicesDocument3 pagesAdjectifs Traits de Caractere Feuille DexercicesHana KabbaniPas encore d'évaluation
- Présentation Des Livres (AP)Document7 pagesPrésentation Des Livres (AP)Juju LPas encore d'évaluation
- Candide Ou Loptimisme ResumeDocument2 pagesCandide Ou Loptimisme Resumenano edinPas encore d'évaluation
- 9Document2 pages9celeste deltourPas encore d'évaluation
- DocuDocument21 pagesDocuMayrogan27Pas encore d'évaluation
- ParisDocument6 pagesParisFouad BenbechinaPas encore d'évaluation
- Voix Et Oralite Dans LecritDocument27 pagesVoix Et Oralite Dans LecritEdinson Tarazona ArgüelloPas encore d'évaluation
- LL Colchiques 6Document3 pagesLL Colchiques 6Captur AsosPas encore d'évaluation
- Evet MariageDocument3 pagesEvet MariageabdelazizfellagPas encore d'évaluation
- Travail Livre FrancaisDocument5 pagesTravail Livre FrancaisvardarelimayaPas encore d'évaluation
- Contrôle Continu 1: Exprime La Négation Avec Deux Manières Différentes Dans La Phrase Suivante: (4pts)Document2 pagesContrôle Continu 1: Exprime La Négation Avec Deux Manières Différentes Dans La Phrase Suivante: (4pts)FatiPas encore d'évaluation