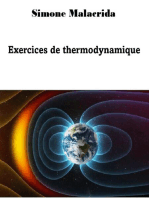Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CNC Chimie Tsi 2016
CNC Chimie Tsi 2016
Transféré par
Wafae Barara0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues5 pagesTitre original
Cnc Chimie Tsi 2016
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
2 vues5 pagesCNC Chimie Tsi 2016
CNC Chimie Tsi 2016
Transféré par
Wafae BararaDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 5
Concours National Commun – Session 2016 – Filière TSI
• On veillera à une présentation et une rédaction claires et soignées des copies.
Il convient en particulier de rappeler avec précision les références des
questions abordées.
• Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur
d’énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant
clairement les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre.
• Toutes les réponses devront être très soigneusement justifiées.
• Si un résultat donné par l'énoncé est non démontré, il peut néanmoins être
admis pour les questions suivantes. Ainsi, les diverses parties du problème
sont relativement indépendantes entre elles.
Métallurgie thermique du zinc
Dans la nature, le zinc se trouve essentiellement sous forme de sulfure,
ZnS , appelé blende : celle-ci est associée à des métaux et une gangue constituée
par de la calcite CaCO3 et de la dolomie MgCO 3 . Dans ce minerai, le zinc est
associé aussi à d’autres métaux ( Pb , Fe ,..) sous forme de sulfure et sous forme
d’oxyde. L’abondance de l’élément zinc dans l’écorce terrestre est de 80 g par
tonne d’écorce. Les minerais exploités renferme jusqu'à 20 % de zinc.
Pour récupérer le métal zinc, la blende subit des transformations physico-
chimiques. Celle-ci est transformée en calcine (constituée principalement de ZnO )
au moyen d’une opération appelée grillage. La calcine est ensuite traitée par
hydrométallurgie ou pyrométallurgie pour obtenir le métal zinc quasiment pur.
La principale utilisation du zinc est l’élaboration de l’acier zingué
(galvanisation). Il intervient aussi comme constituant essentiel des laitons et en
petite quantité dans les bronzes et dans des alliages.
Ce problème propose d’étudier de manière simplifiée quelques étapes de la
pyrométallurgie du zinc. Il est composé de parties totalement indépendantes, à
l’intérieur desquelles de nombreuses questions peuvent être traitées
indépendamment les unes des autres.
Données :
• Rayons ioniques : r− = r ( S 2− ) = 184 pm et r+ = r ( Zn 2+ ) = 74 pm .
• Masse molaire atomique du soufre : M (S) = 32,1g.mol −1 .
• Masse molaire atomique du zinc : M (Zn) = 65, 4g.mol −1 .
• Masse volumique du zinc : ρ (Zn) = 7140kg.L−1 .
• Pression de référence : P 0 = 1 bar = 1,0.105 Pa .
• Concentration de référence : C 0 = 1 mol . L−1 .
• Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J .K −1.mol −1 .
• Constante d'Avogadro : N A = 6, 02.1023 mol −1 .
Epreuve de Chimie 1/5
Concours National Commun – Session 2016 – Filière TSI
• Constante de Faraday : 1F = 96500 C .mol −1.
RT
• Constante de Nernst à 25 °C : ln(10) = 0,06 V .
F
• T (K ) = t (°C ) + 273 .
• Les gaz seront considérés parfaits et les solutions aqueuses diluées.
• Le constituant A en solution aqueuse est noté A (aq ) , A en phase solide est
noté A ( s ) , A en phase gazeuse est noté A ( g ) et A en phase liquide est noté A ( l )
.
• Potentiels standard à 25 °C :
Couple O2( g ) / H 2O( l ) H aq+ / H 2( g ) Zn 2+
aq / Zn(s) Fe 2+
aq / Fe(s)
Potentiel standard E 1° = 1, 23 V E 2° = 0, 00 V E 3° = −0,76 V E40 = −0, 44V
• Température de fusion du zinc : Tf (Zn) = 693K ;
• Température de vaporisation du zinc : Tv (Zn) = 1180K .
1. L’élément zinc et ses ions
1.1. La configuration électronique de l'atome de zinc dans son état
fondamental est [Ar]4s 2 3d 10 , où Ar est l’élément argon. Déterminer le
numéro atomique du zinc et donner la position (période et colonne) de cet
atome dans la classification périodique des éléments. Justifier la formation
l’ion Zn 2+ .
1.2. Peut-on considérer le zinc comme un élément de transition ? Expliquer.
1.3. Déterminer les nombres d'oxydation du zinc présent dans les molécules et
2-
les ions suivants : Zn , Zn 2+ , Zn(OH) 4 , Zn(OH)2 et ZnS .
2. Structure cristalline de la blende
La blende ZnS , principal minerai de zinc, est la variété allotropique qui
cristallise dans le système cubique. Sa structure peut être décrite par un réseau
cubique à faces centrées constitué par les anions S2- de rayon r− = r (S2- ) et les
cations Zn 2+ de rayon r+ = r (Zn 2+ ) . Les cations occupent, alternativement, la moitié
des sites tétraédriques du réseau.
2.1. Dessiner la maille conventionnelle et donner la coordinence des ions S2- et
Zn 2+ .
2.2. Dans le modèle de cristal parfait de type ionique, les ions constitutifs du
cristal ionique sont assimilés à des sphères dures et les ions de signes
contraires sont en contact. Exprimer la condition de tangence entre les ions
S2- et Zn 2+ en fonction du paramètre a de la maille, r− et r+ et déduire la
valeur numérique de a .
Epreuve de Chimie 2/5
Concours National Commun – Session 2016 – Filière TSI
2.3. Exprimer la masse volumique ρ (ZnS) de la blende. Sa valeur est
ρ ( ZnS) = 4084 kg .m −3 . En déduire la valeur numérique du paramètre a de la
maille. Conclure.
3. Métallurgie du zinc
La métallurgie thermique du zinc permet l’élaboration du métal à partir du
minerai en faisant appel à des transformations s’opérant habituellement dans les
hauts fourneaux. On étudie dans cette partie deux étapes principales de la
métallurgie du zinc; le grillage et la réduction.
3.1. Grillage de la blende
Après l'opération dite de flottation qui consiste à enrichir le minerai naturel
renfermant environ 20 % de zinc en éliminant une partie de la gangue, on obtient
un minerai contenant de 60 à 90 % de ZnS (concentré de ZnS ).
Le principe du grillage consiste à transformer le sulfure de zinc solide ZnS (s )
en oxyde de zinc solide ZnO ( s ) . Le grillage est effectué en chauffant fortement le
sulfure de zinc en présence du dioxygène de l’air.
On étudie ici les conditions thermodynamiques de cette transformation.
L'équation bilan de la réaction de grillage est :
3
ZnS ( s ) + O2( g ) ←
!!→ ZnO( s ) + SO2( g ) (1)
!
!
2
Les grandeurs thermodynamiques de cette réaction à 25 °C sont :
Δ r H (298K ) = −442kJ.mol −1 , Δ r S10 (298K ) = −73, 23J.mol −1.K −1 et Δ r C p1
0
1
0
= −6J.mol −1.K −1 .
3.1.1.La réaction est-elle favorisée à haute ou basse température ? Pourquoi est-
on obligé de travailler à au moins 700 °C ?
3.1.2.Calculer la constante d'équilibre K10 à 700 °C . Commenter.
3.1.3.En fait, le grillage de la blende a lieu à haute température ( T > 1298 K ). En
supposant les capacités calorifiques des produits réagissant et formés
indépendantes de la température, calculer l’enthalpie standard de la
réaction à 1298 K .
3.1.4.Pourquoi la réaction est favorisée par une pression élevée ? Pourquoi n'est-
il pas indispensable de travailler à pression élevée ?
3.1.5.Le dioxyde de soufre SO2 est un gaz toxique. Expliquer comment peut-on
l’exploiter afin d’éviter de le rejeter dans l’atmosphère.
3.2. Réduction du zinc
Le diagramme d'Ellingham du couple ZnO / Zn pour 300 K < T < 2000 K est
représenté dans le document en annexe. On y a superposé celui des couples
CO2( g ) / C ( s ) , CO2( g ) / CO( g ) et CO( g ) / C ( s ) .
Epreuve de Chimie 3/5
Concours National Commun – Session 2016 – Filière TSI
3.2.1.À partir de quelle température la réduction de ZnO par le monoxyde de
carbone est-elle possible dans les conditions standard ? Écrire l’équation
bilan de la réaction (2) de réduction du ZnO dans ces conditions. On
indiquera l’état physique des espèces en présence. Calculer la variance du
système. Conclure.
3.2.2.La réduction de ZnO par le monoxyde de carbone est réalisée
industriellement dans un haut-fourneau à 1300 K , sous une pression totale
de 1bar . À cette température, l’enthalpie libre standard de la réaction
correspondante est : Δ r G20 (1300K ) = 29, 2kJ.mol −1 . Calculer à cette température
PCO
le rapport minimal des pressions partielles nécessaire pour déplacer la
PCO2
réaction de production du zinc dans le sens direct si on désire une pression
de vapeur de zinc PZn = 0, 5bar .
3.2.3.Le monoxyde de carbone nécessaire à la réduction de ZnO est produit à
l’aide de la réaction (3) , dite de Boudouard : C(s) + CO2(g) → 2CO(g) . Cette
réaction a lieu dans les conditions de température et de pressions établies
dans la question précédente. Son enthalpie libre standard est :
Δ r G30 (1300K ) = −57, 0kJ.mol −1 . Vérifier que cette réaction permet de fixer le
PCO
rapport à une valeur supérieure à celle désirée dans la question
PCO2
précédente.
4. Utilisation du zinc : protection par anode sacrificielle
La corrosion est un fléau industriel. On estime en effet que 20% de la
production mondiale d’acier sont perdus chaque année sous forme de rouille.
L’oxydation du fer de cet alliage par le dioxygène est accentuée en milieu humide
et salé.
Ainsi, au contact de l’eau de mer, les coques de nombreux bateaux fabriquées
en acier sont-ils attaquées par le dioxygène dissous à l’interface air-eau salée. Les
deux couples oxydant/réducteur qui interviennent sont alors : Fe(aq)
2+
/ Fe(s) et
O2(g) / H 2O(l ) .
4.1. Le flacon d’acide sulfurique comporte le pictogramme ci-
contre. Quelle est la signification de ce dernier ? Quelles
précautions doit-on prendre pour manipuler ce produit ?
4.2. Écrire les deux demi-équations d’oxydoréduction dans le
sens où elles se produisent, en supposant que le milieu est
acide. Écrire l’équation bilan de la réaction de corrosion.
Pour protéger l'acier de la coque de la corrosion, on fixe le zinc en différents
endroits de celle-ci ou sur le gouvernail.
4.3. Dessiner le schéma de la pile qui se forme. On indiquera la polarité des
électrodes et le déplacement des espèces chargées.
Epreuve de Chimie 4/5
Concours National Commun – Session 2016 – Filière TSI
4.4. L’oxydation de l’anode sacrificielle s’accompagne d’un courant de protection
au niveau de la surface S de la coque immergée dans l’eau de mer. Sa
densité de courant volumique moyenne est : j = 0,1A.m −2 . Calculer la masse
totale d’anode sacrificielle en zinc qu’on doit répartir sur la coque pour la
protéger pendant une année. On donne S = 40m 2 . Commenter si l’anode
sacrificielle sur une coque de bateau doit être remplacée quand elle a perdu
50 % de sa masse.
4.5. Expliquer pourquoi l’anode utilisée est qualifiée de « sacrificielle ».
4.6. Citer en le justifiant, un autre métal autre que le zinc susceptible de
protéger la coque en acier d’un bateau.
4.7. Citer une autre méthode de protection du fer.
Δ r G°(T ) en kJ.mol −1
Annexe : diagramme d’Ellingham du zinc et du carbone
Epreuve de Chimie 5/5
Vous aimerez peut-être aussi
- Diag Ellingham ExercicesDocument2 pagesDiag Ellingham ExercicesIsmailBelguith33% (3)
- Traitement Des Effluents Miniers. IntroDocument43 pagesTraitement Des Effluents Miniers. IntroCisséPas encore d'évaluation
- Cours Corrosion - IC2 PDFDocument45 pagesCours Corrosion - IC2 PDFBadra Ali SanogoPas encore d'évaluation
- PyrometallurgieDocument6 pagesPyrometallurgieMag ManPas encore d'évaluation
- Ellingham ExercicesDocument6 pagesEllingham ExercicesBerenger MabéléPas encore d'évaluation
- ZincgageDocument6 pagesZincgageAmourat Papaha100% (1)
- Serie Electrolyse Transformations ForcéesDocument6 pagesSerie Electrolyse Transformations ForcéesDaghsni Said100% (4)
- TD - Electrochimie - IUT Bobo Mai 2022Document5 pagesTD - Electrochimie - IUT Bobo Mai 2022Abdoul Kader OUATTARAPas encore d'évaluation
- Grosjean 1 Acier 2017 Web PDFDocument84 pagesGrosjean 1 Acier 2017 Web PDFJàMàl Mejor100% (2)
- Elaboration Industrielle Du Zinc: Les Différentes Parties de Cet Exercice Sont Indépendantes. DonnéesDocument2 pagesElaboration Industrielle Du Zinc: Les Différentes Parties de Cet Exercice Sont Indépendantes. Donnéesrufin rufin rufinPas encore d'évaluation
- TD No4 Chimie 14-15Document3 pagesTD No4 Chimie 14-15Mc KobaPas encore d'évaluation
- ChimieDocument5 pagesChimieEssamiPas encore d'évaluation
- Exposé Corrosion 1 GPDocument12 pagesExposé Corrosion 1 GPMelissaPas encore d'évaluation
- CNC Chimie MP 2017 EpreuveDocument6 pagesCNC Chimie MP 2017 Epreuveninari.miraPas encore d'évaluation
- Formation Et Reduction Des OxydesDocument37 pagesFormation Et Reduction Des Oxydeswissal1111 blmPas encore d'évaluation
- E3a 2007 PDFDocument4 pagesE3a 2007 PDFJean Donald BonyPas encore d'évaluation
- TD Applications Corrosion2020Document4 pagesTD Applications Corrosion2020Fatima BenPas encore d'évaluation
- Oxydoréduction PDFDocument5 pagesOxydoréduction PDFGaniyou AdenidjiPas encore d'évaluation
- 2021 NR CRCDocument4 pages2021 NR CRCdouchnaima09Pas encore d'évaluation
- Corrigier TD DescriptiveDocument32 pagesCorrigier TD DescriptiveMohamed mePas encore d'évaluation
- Recueil BODA ELECTRO. PG 2016Document12 pagesRecueil BODA ELECTRO. PG 2016mycorpbPas encore d'évaluation
- TD L2 PC VF - 2018-2019 - Copie - CopieDocument11 pagesTD L2 PC VF - 2018-2019 - Copie - Copiestephane boniPas encore d'évaluation
- DS6chim CC BLC +corrDocument9 pagesDS6chim CC BLC +corrPeres eloi Makendi jioguePas encore d'évaluation
- MP ChimieDocument8 pagesMP ChimieSoukaina HachimiPas encore d'évaluation
- DS02 2Document9 pagesDS02 2issraPas encore d'évaluation
- CH IV 2021 FORMATION ET REDUCTION DES OXYDES 2020-ConvertiDocument89 pagesCH IV 2021 FORMATION ET REDUCTION DES OXYDES 2020-ConvertiCHEIKH ABDOUL AZIZ H'MEIDYPas encore d'évaluation
- EllinghamDocument7 pagesEllinghamCedric NiamkéPas encore d'évaluation
- SoufreDocument20 pagesSoufreBanoumou SaadPas encore d'évaluation
- Activités 2 Transformations ForcéesDocument2 pagesActivités 2 Transformations ForcéesMed KassiouiPas encore d'évaluation
- ElectrochimieDocument10 pagesElectrochimieKorona jonathan COULIBALYPas encore d'évaluation
- Oxydoréduction PBDocument12 pagesOxydoréduction PBRajaa BousmaraPas encore d'évaluation
- TD Séries 1 À 4 Lst-Tacq Octobre 2021Document8 pagesTD Séries 1 À 4 Lst-Tacq Octobre 2021imad sahliPas encore d'évaluation
- TD EadDocument19 pagesTD Eadoussama khadroufPas encore d'évaluation
- TD N 2 CHIMIE 1ère CDTIDocument2 pagesTD N 2 CHIMIE 1ère CDTIANDRE ELOCKPas encore d'évaluation
- Qui MicaDocument8 pagesQui Micatamylemor2002Pas encore d'évaluation
- E Chtsi2023Document4 pagesE Chtsi2023younes lachgarPas encore d'évaluation
- 2016 NRDocument4 pages2016 NRdouchnaima09Pas encore d'évaluation
- 2016 Rat CRTDocument3 pages2016 Rat CRTdouchnaima09Pas encore d'évaluation
- TD30Document2 pagesTD30Anis SouissiPas encore d'évaluation
- DM Nc2b02 de La ThermochimieDocument1 pageDM Nc2b02 de La ThermochimieLoïc MBELE KASTHANEPas encore d'évaluation
- 8199 E4 U41 Ab Bts TM 2013 Partie 1 SujetDocument6 pages8199 E4 U41 Ab Bts TM 2013 Partie 1 SujetChokri AtefPas encore d'évaluation
- Transformations Forcees Electrolyse Exercices Non Corriges 2 1Document3 pagesTransformations Forcees Electrolyse Exercices Non Corriges 2 1lazarePas encore d'évaluation
- Exercice 1Document8 pagesExercice 1Mouhieddine KhailiPas encore d'évaluation
- E Chpsi2023Document5 pagesE Chpsi2023Moad BarbariPas encore d'évaluation
- CH18 ExercicesDocument2 pagesCH18 ExercicesHAMADA1972100% (1)
- TD S6Document14 pagesTD S6AbPas encore d'évaluation
- Thermochimie 1Document2 pagesThermochimie 1Imane GhanouPas encore d'évaluation
- Diagramme D'ellinghamDocument2 pagesDiagramme D'ellinghammaino100% (2)
- Serie Electrolyse Bacinfo 2015Document2 pagesSerie Electrolyse Bacinfo 2015Daghsni SaidPas encore d'évaluation
- 6 Exc2001Document5 pages6 Exc2001Yassine RakchoPas encore d'évaluation
- 2017 Rat CRCDocument3 pages2017 Rat CRCdouchnaima09Pas encore d'évaluation
- Electrolyse SerieDocument3 pagesElectrolyse SerieMeryem ChakriPas encore d'évaluation
- Serie 16 ElectrolyseDocument3 pagesSerie 16 Electrolysee.maskarPas encore d'évaluation
- Corrigier TD DescriptiveDocument33 pagesCorrigier TD DescriptiveMohamed mePas encore d'évaluation
- LETITANEDocument15 pagesLETITANEayoub dahbi100% (1)
- Classification Quantitative Dosage 1S1 AT RenfDocument5 pagesClassification Quantitative Dosage 1S1 AT RenfAmath ThionganePas encore d'évaluation
- TD-Série #4Document2 pagesTD-Série #4Snaptube 2022Pas encore d'évaluation
- Eval 3 F52020 2021 +Document2 pagesEval 3 F52020 2021 +brice mouadjePas encore d'évaluation
- TD Redox Qualitative 2019 LSLL WahabdiopDocument2 pagesTD Redox Qualitative 2019 LSLL WahabdiopAriel100% (1)
- الفرض المنزلي رقم1 الدورة 2 الأولى علوم رياضيةDocument2 pagesالفرض المنزلي رقم1 الدورة 2 الأولى علوم رياضيةfool.infp2021Pas encore d'évaluation
- Tableau Periodique-Noir Et BlancDocument1 pageTableau Periodique-Noir Et BlancJosé Carlos GB100% (1)
- Exercices Chapitre 8Document2 pagesExercices Chapitre 8Tchoupi CyrilPas encore d'évaluation
- TP 2Document6 pagesTP 2Adel LaimechePas encore d'évaluation
- Que Signifie EN 1090 Pour La Construction Metallique Partie 2 (Metallerie 2010)Document3 pagesQue Signifie EN 1090 Pour La Construction Metallique Partie 2 (Metallerie 2010)bvbarcPas encore d'évaluation
- Defauts de Soudure - FissuresDocument27 pagesDefauts de Soudure - FissuresFethi BELOUISPas encore d'évaluation
- Zamet 2018 Fren Zu PDFDocument73 pagesZamet 2018 Fren Zu PDFFrancois HumbertPas encore d'évaluation
- Acide Base PDFDocument2 pagesAcide Base PDFabdelkrim salemPas encore d'évaluation
- 2010 Polynesie Exo3 Sujet Accumulateurs 4ptsDocument4 pages2010 Polynesie Exo3 Sujet Accumulateurs 4ptsriha3003Pas encore d'évaluation
- GA753Document4 pagesGA753KEVIN BOGNINGPas encore d'évaluation
- 2-1-Controle 2 S1Document3 pages2-1-Controle 2 S1lahcen essPas encore d'évaluation
- Rapport Record01-0119 1ADocument77 pagesRapport Record01-0119 1ANourhen OmriPas encore d'évaluation
- Total 788500$Document2 pagesTotal 788500$David MagaraPas encore d'évaluation
- ChimieDocument18 pagesChimieAchraf MoutaharPas encore d'évaluation
- TD Radioactivite Et Reaction Nucleaire CCRDocument5 pagesTD Radioactivite Et Reaction Nucleaire CCROumar TraorePas encore d'évaluation
- 1 - Les-Alliages-dorDocument3 pages1 - Les-Alliages-dorHaniDjekrifPas encore d'évaluation
- Université Ferhat Abbas Sétif TP - 01 - Chimie MineraleDocument11 pagesUniversité Ferhat Abbas Sétif TP - 01 - Chimie Mineralemeriem.bouaouda7102Pas encore d'évaluation
- AcierDocument16 pagesAcierrobsonPas encore d'évaluation
- Correction de l' Activité 2 Apparition Du Dioxygène AtmosphériqueDocument1 pageCorrection de l' Activité 2 Apparition Du Dioxygène AtmosphériquejaunePas encore d'évaluation
- La Combustion de La Matière OrganiqueDocument8 pagesLa Combustion de La Matière OrganiqueMounir AzimPas encore d'évaluation
- L'Opération de DécapageDocument1 pageL'Opération de Décapagepedro66Pas encore d'évaluation
- Dosage D'oxydo Reduction Complement Du CoursDocument16 pagesDosage D'oxydo Reduction Complement Du CoursAnonymous 83IGhG100% (1)
- 1.1 Identification: 2-Propriétés PhysiquesDocument3 pages1.1 Identification: 2-Propriétés Physiquesatlagh ayoubPas encore d'évaluation
- Smaw 5Document26 pagesSmaw 5GOUAREF SAMIRPas encore d'évaluation
- Exercices de Révision - Examen 1Document3 pagesExercices de Révision - Examen 1gmx4x78dxtPas encore d'évaluation
- Galvanisation A Chaud Pour La Protection Contre La CorrosionDocument11 pagesGalvanisation A Chaud Pour La Protection Contre La CorrosionYassine DhajiPas encore d'évaluation
- Chap1 PDFDocument68 pagesChap1 PDFLucas DupuisPas encore d'évaluation
- Chapitre 12Document27 pagesChapitre 12nadyPas encore d'évaluation
- GRILLE TARIFAIRE 3it - Me Cano E2022-3 1Document2 pagesGRILLE TARIFAIRE 3it - Me Cano E2022-3 1BoutaharPas encore d'évaluation