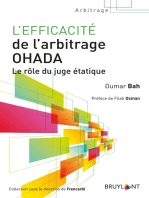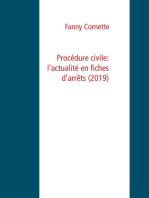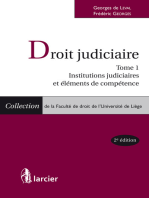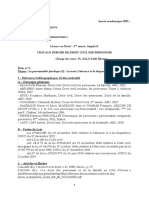Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Systeme Juridique Ivoirien
Systeme Juridique Ivoirien
Transféré par
GaRçon CharmeurTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Systeme Juridique Ivoirien
Systeme Juridique Ivoirien
Transféré par
GaRçon CharmeurDroits d'auteur :
Formats disponibles
NATIONS UNIES
Opration des Nations Unies en Cte dIvoire
ONUCI
UNITED NATIONS
United Nations Operation in Cte dIvoire
TUDE DVALUATION DU SYSTME JUDICIAIRE IVOIRIEN
LORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTME JUDICIAIRE EN CTE DIVOIRE
PAR LUNIT DE LTAT DE DROIT (RULE OF LAW), ONUCI
JUIN 2007
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
SOMMAIRE
PRSENTATION DE LUNIT DE LTAT DE DROIT DE LONUCI ......................... 3 RSUM XCUTIF............................................................................... 5 INTRODUCTION................................................................................... 8 I. LORGANISATION DE LAPPAREIL JUDICIAIRE.....................................11 1. Les textes et les institutions ......................................................11 1.1. Les textes .....................................................................11 1.2. Les institutions ...............................................................13 2. La prsentation de lorganigramme du Ministre de la justice et lorganisation judiciaire proprement dite ......................................14 2.1. La prsentation de lorganigramme du Ministre de la Justice....14 2.2. Lorganisation judiciaire proprement dite .............................15 II. LE FONCTIONNEMENT DE LAPPAREIL JUDICIAIRE ............................22 1. Les questions dordre gnral ....................................................22 1.1. Les infrastructures ..........................................................22 1.2. Les difficults lies au budget allou aux juridictions ..............26 1.3. Les difficults lies linsuffisance dquipements et de moyens matriels ............................................................28 1.4. Les ressources humaines et la formation...............................31 1.5. La corruption .................................................................35 1.6. La question de lindpendance de la magistrature...................41 1.7. Laccs la justice ..........................................................45 2. Quelques questions spcifiques ..................................................51 2.1. Les difficults daccs la jurisprudence ..............................51 2.2. Les renvois intempestifs et multiples des dossiers fixs ............52 2.3. Le retard dans la dlivrance des dcisions de justice ...............53 III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ..............................................55
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Prsentation de lUnit de ltat de Droit de lONUCI (Rule of Law Unit)
LUnit de lEtat de Droit assure, en collaboration avec dautres composantes de lONUCI, le suivi des rformes lgislatives adoptes par lAssemble Nationale et / ou le Prsident de la Rpublique et mises en uvre par le Gouvernement de Cte dIvoire. Elle mne des recherches et donne des avis juridiques au sein de la mission concernant linterprtation des rsolutions du Conseil de Scurit, les Accords de paix, la Constitution et la lgislation ivoirienne. Les membres de lunit ont galement particip la formation juridique de 600 auxiliaires de police Bouak en 2005. LUnit Rule of Law est charge didentifier et danalyser lensemble des difficults (cadre lgal et institutionnel, ressources humaines, moyens matriels, fonctionnement, etc.) que rencontrent les acteurs des systmes judiciaire et pnitentiaire ivoiriens ainsi que de conseiller le Gouvernement leur propos. Le rapport dvaluation de la section des affaires judiciaires qui suit sinscrit dans cette perspective de mme que le suivi des dtentions prventives ( la suite du projet de Prisonniers sans Frontires) qui a dmarr fin fvrier 2007. Cette section assure galement le monitoring daudiences ordinaires ainsi que dun certain nombre de procs qui prsentent un intrt dans le cadre de la lutte contre limpunit. Cest ainsi que ses membres ont assist toutes les audiences des grands procs devant le tribunal militaire et tabli des rapports qui ont t prsents et discuts avec les autorits judiciaires directement concernes. La section des affaires pnitentiaires a pour rle de fournir un appui technique et un support de formation la direction de ladministration pnitentiaire et de lducation surveille au Ministre de la Justice. Cette unit visite rgulirement lensemble des tablissements pnitentiaires du Sud et du Nord du pays et a rdig un rapport qui a t adress au Ministre de la Justice. Cette section, travers des projets impact rapide, a contribu la scurisation de la Maison dArrt et de Correction dAbidjan (MACA) et au dveloppement dactivits de rinsertion pour les dtenus. Elle travaille actuellement sur un projet de rhabilitation de ferme pnale Dimbokro. LUnit de lEtat de Droit a aussi pour mandat dencourager et de conseiller le Gouvernement quant au redploiement des effectifs judiciaires et du personnel pnitentiaire ainsi quau rtablissement du systme judiciaire sur toute ltendue du territoire et spcialement dans les zones sous contrle des Forces Nouvelles. LUnit est prsente Bouak et tudie le processus par lequel les Forces Nouvelles, en labsence de tout systme judiciaire, rglent la question des infractions commises dans leur zone, selon un systme qui leur est propre. Dans lattente du redploiement effectif de ladministration judiciaire, elle contribue dgager des solutions juridiques concrtes, notamment en ce qui concerne le traitement par les forces impartiales des cas de personnes interpelles en flagrance dans lex zone de confiance pour avoir commis des
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
infractions (lutte contre limpunit). Elle a galement travaill avec le Ministre de la Justice sur le projet de constitution de groupes mobiles pour la tenue daudiences foraines permettant la dlivrance de jugements suppltifs dactes de naissance ainsi que de certificats de nationalit. Elle appuie actuellement la Division Electorale dans ce domaine. En matire de partenariats, lunit de lEtat de Droit travaille en troite collaboration avec les autorits judiciaires et pnitentiaires et avec le Ministre de la Justice. Elle est en relation avec des ONG nationales et internationales et les institutions internationales prsentes en Cte dIvoire. Elle collabore au quotidien avec les autres composantes de lONUCI intervenant dans les domaines concerns.
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Rsum excutif
La Rsolution 1528 du Conseil de Scurit de lONU qui cre lONUCI (Oprations des Nations unies en Cte dIvoire) lui donne mandat, daider le gouvernement de rconciliation nationale, en concertation avec la CEDEAO et dautres organisations internationales, rtablir lautorit du systme judicaire et lEtat de droit partout en Cte dIvoire . Ainsi, lUnit de lEtat de Droit de lONUCI, avec laccord et lappui du Ministre de la Justice et des Droits de lHomme, a pu rencontrer les diffrents acteurs de la justice, les magistrats, les greffiers, les auxiliaires de justice et les services de ladministration centrale du ministre, ainsi que les syndicats et les ONG. Ltude est constitue de diffrents constats que nous avons pu faire sur le terrain partir des rsultats des entretiens mens avec les acteurs mmes du systme judiciaire en zone gouvernementale et porte sur deux grandes parties qui touchent son organisation et son fonctionnement. Le rapport veut aussi suggrer aux bailleurs de fonds et organisations non gouvernementales des pistes dintervention dans le domaine de la justice. I / Lorganisation de lappareil judiciaire Dans la premire partie, la question de lorganisation de lappareil judiciaire ivoirien a t aborde du point de vue des textes et des institutions. En effet, la constitution du 1er aot 2000, la loi de 1978 portant statut de la magistrature et la loi de 1961 portant organisation judiciaire sont les textes majeurs qui rgissent lappareil judiciaire ivoirien. La constitution de 2000 a rig lautorit judiciaire en pouvoir et garantit galement le principe de la sparation des pouvoirs et lindpendance de la justice. Du point de vue institutionnel, le Conseil Suprieur de la Magistrature apparat comme un organe central dans le systme judiciaire ivoirien, dans la mesure o il examine toutes les questions relatives lindpendance de la magistrature et celles qui concernent essentiellement la nomination et la promotion des magistrats. Toujours dans cette premire partie, outre lorganigramme du Ministre de la Justice et des Droits de lHomme qui a t prsente, laccent a t mis sur lorganisation judiciaire proprement dite. Cette organisation est matrialise par les juridictions de droit commun que sont la Cour Suprme qui est appele disparatre au profit des nouvelles juridictions suprmes que la constitution a cres (le Conseil dEtat, la Cour de Cassation et la Cour de Comptes), les trois cours dappel (Abidjan, Bouak et Daloa), les tribunaux de premire instance et leurs sections dtaches. Paralllement ces juridictions, il existe une juridiction spciale, le Tribunal Militaire qui fera lobjet dun rapport spar.
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
II / Le fonctionnement de lappareil judiciaire Dans cette seconde partie, le rapport sest intress au fonctionnement de lappareil judiciaire en touchant aux questions dordre gnral qui vont des problmes dinfrastructures, aux difficults lies linsuffisance dquipements et de moyens matriels, linsuffisance du budget allou aux juridictions, en passant par la question de la scurit des juridictions. A ce niveau, le rapport insiste sur le manque de bureaux dans les juridictions, la vtust des machines crire et linsuffisance des outils informatiques, des moyens de communication et de locomotion, ainsi que la pnurie de matriels, de fournitures de bureau et de documentation juridique, et surtout sur la ncessit de relever le budget de fonctionnement des juridictions. Le budget allou la justice reprsente moins de 2% du budget gnral annuel de lEtat de Cte dIvoire, ce qui est totalement insuffisant pour couvrir les besoins de base et fournir aux justiciables un service de qualit et une justice indpendante. Un appareil judiciaire dot de tous les moyens performants de travail, sil ne sappuie pas sur un personnel bien form est vou linefficacit. Ainsi, le rapport a tent de comprendre les difficults lies la formation tant initiale que continue des principaux acteurs de la justice que sont les magistrats et les greffiers. Les autorits ivoiriennes ont compris la ncessit damliorer la formation des cadres et agents de la justice avec la cration dun institut de formation du personnel de la justice. Tous nos interlocuteurs ont admis la ralit et lampleur du phnomne de la corruption en milieu judiciaire. Cette corruption prend plusieurs formes. Nous avons trait cette question avec le souci dinciter les autorits ivoiriennes prendre une srie de mesures concrtes qui vont de lamlioration du traitement de plusieurs acteurs de la justice, au dcouragement de ce phnomne par des mesures de contrle et de coercition appropries la cration dune commission charge de la lutte contre la corruption. Dans le cadre de cette valuation de lappareil judiciaire, notre unit a pu apprhender galement la question de lindpendance de la magistrature en relation avec la nomination et de la promotion des magistrats. Les magistrats sont soumis exclusivement lautorit de la loi dans lexercice de leurs fonctions et ceux du sige sont inamovibles. Mais ces principes se heurtent la ralit, eu gard aux fortes pressions dordres sociologique (les relations familiales et amicales), administratif (les suprieurs hirarchiques) et politique (limmixtion du politique). Le fait quen Cte dIvoire les magistrats passent aisment de la magistrature assise au parquet et inversement peut aussi contribuer entacher leur indpendance. La justice est appele tre rendue, non pas au seul profit des citoyens aiss et duqus, mais au bnfice de tous. En Cte dIvoire, la proportion de la population qui a vritablement accs la justice est trs faible, en raison de lignorance des procdures suivre, de son loignement gographique des 6
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
tribunaux et encore et surtout de son manque de moyens financiers. Lassistance judiciaire, prvue par la loi, nest pratiquement jamais utilise par les justiciables et est mconnue de la plupart des gens. Pour ceux qui choisissent dy recourir, la lourdeur et la complexit de la procdure est dissuasive. Le recours aux avocats est rare cause du cot lev des honoraires et frais et leur concentration Abidjan. Labsence davocats aux cts des parties ne permet pas de garantir les droits de la dfense, ni dassurer un meilleur suivi des dossiers en ce qui concerne la clrit de leur traitement et lexercice des voies de recours, sans oublier la contribution juridique des avocats aux dbats. Pour rapprocher davantage la justice des justiciables, il est ncessaire douvrir de nouvelles juridictions, et surtout mettre sur pied celles qui ont dj t cres par voie de dcret, tels que les Cours dappel de Man, de Korhogo et dAbengourou, les tribunaux dAbobo, de Port-Bouet et de Guiglo. Certaines questions spcifiques se rapportant aux diffrents services de la justice ont t mises en avant dans le cadre de ce rapport. Nous avons approfondi les problmes de labsence daccs la jurisprudence pour les magistrats, les renvois intempestifs et multiples des dossiers au cours des audiences, ainsi que le retard dans la dlivrance des dcisions de justice.
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
LORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTME JUDICIAIRE IVOIRIEN
INTRODUCTION A la faveur de la crise politico-militaire que connat la Cte dIvoire depuis le 19 septembre 2002, les accords de paix inter-ivoiriens de Linas-Marcoussis signs le 24 janvier 2003 ont assign au gouvernement de rconciliation nationale, entre autres missions, celle du renforcement de lindpendance de la justice notamment, comme le prcise lannexe, en matire de contentieux lectoral . Le Conseil de Scurit de lONU a adopt le 27 fvrier 2004 la rsolution 1528 portant cration de lOpration des Nations Unies en Cte dIvoire (ONUCI). Cette rsolution, dans son paragraphe 6-q), assigne lONUCI le mandat daider le Gouvernement de rconciliation nationale, en concertation, avec la CEDEAO et dautres organisations internationales, rtablir lautorit du systme judiciaire et lEtat de droit partout en Cte dIvoire 1. Avec laccord et lappui du Ministre de la Justice, lUnit de ltat de Droit de lONUCI (Rule of Law Unit) sest assigne pour mission deffectuer une tude dvaluation du systme judiciaire ivoirien, en vue daider son amlioration, et consolider ainsi lEtat de droit. Lenjeu dune telle mission dans un pays en guerre, et surtout dans une perspective post-crise, est de contribuer faire prendre conscience quun pouvoir judiciaire fort, stable et indpendant est ncessaire la sortie de la crise mais aussi la stabilit conomique. Il est essentiel de permettre tous les citoyens un libre et gal accs la justice et viter ainsi larbitraire ou le recours la vengeance prive comme unique rponse la dfense ou la protection de leurs droits. Dans le cadre de lvaluation du systme judiciaire ivoirien, lUnit de lEtat de droit de lONUCI a dploy plusieurs quipes sur le terrain afin de mieux apprhender le fonctionnement et les difficults rencontres dans lexercice de la justice, travers les visites de toutes les juridictions situes en zone gouvernementale, lexception du tribunal de premire instance de Gagnoa qui na pu tre visit pour des raisons de scurit. Sur les 37 juridictions dinstance ivoiriennes2 (3 cours dappel, 9 tribunaux de premire instance et 25 sections dtaches), les quipes dployes ont pu se rendre auprs de 24 dentre elles, savoir 2 cours dappels sur 3 (Abidjan et Daloa), 5 tribunaux de premire instance sur 9 (Abidjan, Yopougon, Daloa, Bouafl et Abengourou) et 17 sections dtaches sur 25 (Bassam, Agboville, Aboisso, Adzop, Tiassal, Dabou, Dimbokro, Bongouanou, MBahiakro, Toumodi, Sassandra, Soubr, Tabou, Divo, Lakota, Oum et Bondoukou ; celle de Sinfra nest pas encore entirement fonctionnelle en zone gouvernementale)3. Les
La rsolution 1731 du 10 janvier 2007 reprend la mme formule mais en adjoignant lUnion Africaine la CEDEAO. 2 Il sagit des juridictions qui ont t cres par dcret et qui ont dj fonctionn par le pass. 3 Il faut souligner que dans la seule perspective de la tenue des audiences foraines, les dcrets prsidentiels n2006/308 du 5 octobre 2006 et n2006-405 du 07 dcembre 2006 ont cr titre
1
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
autres juridictions, dont les siges sont situs dans la zone sous le contrle des Forces Nouvelles, ne sont pas oprationnelles du fait de labsence dautorits judiciaires dans cette zone4. Cette tude ne stend pas la manire dont les crimes et dlits sont traits dans la zone sous le contrle des Forces nouvelles ni aux modes de rsolution de conflits qui y ont cours. Outre lobservation daudiences ordinaires dans certaines juridictions, ces visites ont t loccasion de longs entretiens avec lensemble des autorits judiciaires, plus prcisment les prsidents des juridictions concernes et certains juges des enfants (magistrats du sige), les juges dinstruction ou des membres des chambres daccusation, les procureurs gnraux, les procureurs de la Rpublique ou leurs substituts (magistrats du parquet) ainsi que les greffiers en chef. Des rencontres ont galement eu lieu avec les membres du tribunal militaire dAbidjan, le seul qui est oprationnel en Cte dIvoire. Par ailleurs, lunit a eu des entretiens avec les reprsentants des diffrents syndicats de la magistrature (Union Nationale des Magistrats de Cte dIvoire UNAMACI-, lAssociation Syndicale de la Magistrature -ASM- et le Syndicat des Magistrats de Cte dIvoire -SYMACI-), le Btonnier de lOrdre des Avocats de Cte dIvoire, les responsables de l Association des Jeunes Avocats du Barreau de Cte dIvoire, des reprsentants de la Chambre des Huissiers de Justice, ceux des ONG internationales Avocats Sans Frontires (ASF), Prisonniers sans frontires (PrSF), Transparency Justice et le Bureau International Catholique de lEnfance (BICE). LUnit a aussi eu des changes fructueux avec les ONG, Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH), Ligue Ivoirienne des Droits de lHomme (LIDHO), lAssociation des Femmes Juristes de Cte dIvoire (AFJCI), le Mouvement pour lEducation, la Sant et le Dveloppement (MESAD) et le centre Amigo-Doum. Les membres de lUnit ont tenu sentretenir, avec lautorisation du Garde des Sceaux, avec la plupart des directions centrales du Ministre de la Justice, savoir la Direction des services judiciaires, la Direction des affaires civiles et pnales, la Direction des tudes, de la lgislation et de la documentation, la Direction des affaires pnitentiaires ainsi que la Direction de la protection judiciaire de lenfance et de la jeunesse et la Direction des affaires financires et du patrimoine. Ils ont en outre rencontr lInspecteur Gnral et les membres de lInspection Gnrale des Services Judiciaires et Pnitentiaires ainsi que les directeurs du centre dObservation des Mineurs dAbidjan et du centre de rducation de Dabou.
temporaire 160 nouveaux tribunaux de premire instance et ont temporairement rig 35 sections de tribunaux dj cres en tribunaux de premire instance. Il existait dj auparavant 14 tribunaux de premire instance, du moins thoriquement, ce qui fait un total gnral de 207 TPI. Les 160 nouveaux tribunaux ne sont pas appels perdurer au-del des audiences foraines et les sections riges en TPI uniquement pour ce contentieux particulier sont appeles redevenir des sections la fin de lopration des audiences foraines. Nous ne nous attarderons donc pas dans cette tude sur les 160 nouveaux TPI crs en octobre et dcembre 2006 qui ne sont pas appels siger en matires ordinaires (civiles, pnales et commerciales). 4 Il sagit de la cour dappel de Bouak, des 3 tribunaux de premire instance de Bouak, Man, Korhogo et des 7 sections dtaches de Bouna, Boundiali, Danan, Katiola, Odienn, Sgula et Touba.
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
La trame de cette tude est constitue des diffrents constats que les membres de lUnit Etat de Droit ont pu faire sur le terrain, essentiellement partir des rsultats des entretiens mens avec les acteurs mmes du systme judiciaire en zone gouvernementale. Etant donn lampleur du travail, nous avons prfr rpartir les rsultats de notre tude en plusieurs rapports thmatiques. Ce premier rapport dune teneur plus gnrale se penche sur lorganisation et le fonctionnement du systme judiciaire ivoirien tandis que les prochains rapports soccuperont de thmes plus spcifiques tels que lenfance dlinquante, que nous prsentons en mme temps que le prsent rapport, le procs pnal, le tribunal militaire et laccs des femmes la justice. Ce premier rapport nest pas exhaustif mais se veut le reflet des proccupations et des suggestions exprimes par les acteurs de terrain et a pour objectif dinciter la rflexion du lecteur quant lamlioration de lorganisation et du fonctionnement de lappareil judiciaire. LUnit sest soucie de suggrer aux bailleurs de fonds et organisations non gouvernementales des pistes dintervention dans le domaine de la justice.
10
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
I.
LORGANISATION DE LAPPAREIL JUDICIAIRE
Lorganisation du systme judiciaire ivoirien suppose que lon sintresse aux institutions et aux textes qui rgissent la matire (1.), lorganigramme du Ministre de la Justice et lorganisation et aux comptences judiciaires proprement dites (2.). 1. 1.1. Les textes et les institutions Les textes
1.1.1. La constitution La loi n 2000-515 du 1er aot 2000 portant constitution de la Rpublique de Cte dIvoire consacre, dans son prambule, lattachement de la Cte dIvoire au respect et la protection des liberts fondamentales tant individuelles que collectives, ainsi quau principe de la sparation des pouvoirs excutif, lgislatif et judiciaire. Elle a ainsi rvolutionn le paysage institutionnel ivoirien, en rigeant lautorit judiciaire en pouvoir, ce dernier faisant lobjet du titre VIII intitul DU POUVOIR JUDICIAIRE . Loin dtre une dmarche cosmtique, le souci du constituant ivoirien tait de doter la Cte dIvoire dune justice indpendante du pouvoir excutif et du pouvoir lgislatif (article 101 de la Constitution). La constitution ivoirienne de 2000 sest cependant abstenue de clarifier les relations entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs, alors que les rapports entre le pouvoir excutif et le pouvoir lgislatif sont clairement dfinis. Cette situation mriterait dtre corrige pour permettre une meilleure mise en uvre du principe de la sparation des pouvoirs constitus. 1.1.2. La loi portant statut de la magistrature En attendant quun nouveau texte de loi soit adopt sur le statut de la magistrature afin de larrimer lobjectif dindpendance reconnu par la constitution et damliorer lindpendance et les conditions de travail des magistrats de Cte dIvoire, ceux-ci continuent, quant leurs droits et leurs obligations, tre rgis par la loi n 78-662 du 4 aot 1978 portant statut de la magistrature, telle que modifie par les lois n 94 437 du 16 aot 1994 et n 94 498 du 6 septembre 1994. Larticle 1er de ce statut dispose que le corps judiciaire comprend : les magistrats de la Cour suprme, les magistrats du sige et du parquet des cours dappel, des tribunaux de premire instance ainsi que les magistrats en service lAdministration centrale du ministre de la Justice. Il comprend en outre les auditeurs de justice. Le texte de loi qui rgit actuellement le statut de la magistrature laisse une grande marge de manuvre au pouvoir excutif (Ministre de la justice et Prsident de la Rpublique) dans la nomination et la promotion des magistrats, ce qui est en totale contradiction avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. Dans llaboration du nouveau projet de loi portant statut 11
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
de la magistrature que la chancellerie a bien voulu mettre notre disposition, lon a pu relever le souci daffranchir, dans une large mesure, le corps judiciaire des pesanteurs de toutes sortes, pour permettre lmergence dune justice indpendante et efficace. En effet, ce projet de loi, qui tient compte des rformes constitutionnelles relatives la justice, est prcis sur les questions de dontologie du magistrat. Il est prvu que chaque magistrat ait dsormais une ide claire et prcise de ses obligations tant dans lexercice de ses fonctions quen dehors de celles-ci, cest--dire quil sache exactement ce quil doit faire et ce qui lui est interdit de faire. Une telle clarification aurait lavantage de donner un contour rel tout manquement susceptible de donner lieu des poursuites disciplinaires. Il sagit donc doffrir des garanties supplmentaires pour lindpendance de la justice, dautant plus que ce projet de texte ne limite pas lapprciation des questions de discipline des formules gnriques telles que manquement aux convenances de son tat, lhonneur, la dlicatesse ou la dignit . Sous rserve des dbats que pourraient susciter les dispositions de ce projet de loi, il nous apparat globalement que son adoption irait dans un sens constructif, en confortant le rle des magistrats dans la socit, leur importance et leur indpendance mais en les rendant aussi davantage responsables de leurs actes. 1.1.3. La loi portant organisation judiciaire Lappareil judiciaire ivoirien est organis par la loi n 61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire, modifie et complte par les lois n64-227 du 14 juin 1964, n97-399 du 11 juillet 1997, n 98-744 du 23 dcembre 1998 et n 99-435 du 6 juillet 1999.5 Ce texte est satisfaisant dans une certaine mesure, surtout depuis la modification intervenue en 1999 qui consacre enfin la sparation des fonctions de poursuite, dinstruction et de jugement dans les sections dtaches de tribunaux. Auparavant, en effet, un seul magistrat cumulait ces diffrentes fonctions, ce qui tait contraire aux principes les plus lmentaires de justice et tait de nature favoriser la toute puissance et larbitraire des juges de section. Malheureusement, la mise en uvre, compter de la rentre judiciaire 2004, de cette rforme tant attendue est intervenue dans une certaine prcipitation. Les magistrats (substituts du procureur et juges dinstruction) ont t dploys dans ces sections leurs nouvelles fonctions avant que les moyens matriels ne soient disponibles et avant que lon procde aux amnagements et ajustements ncessaires. A lheure actuelle, il est ncessaire que son application soit amliore par des moyens appropris tant sur le plan des infrastructures, que celui des moyens humains et matriels et du budget de fonctionnement : les parquets ne disposent pour le moment ni despaces clairement spars des tribunaux, ni de bureaux suffisants pour remplir leurs missions, ni de personnels (greffiers et secrtaires) qui leur seraient spcialement attachs ni de budget propre. Le Ministre de la justice travaille cependant rsoudre ces difficults transitoires mais bien relles.
Pour le dtail de lorganisation judiciaire actuelle, voir les dveloppements qui y sont consacrs cidessous, 1.2.2, lorganisation judiciaire proprement dite .
5
12
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Par ailleurs, cette loi devra subir des modifications afin de la rendre conforme la Constitution adopte en 2000. Celle-ci a cr des juridictions suprmes qui nexistent actuellement quen thorie. Il sagit de la Cour de Cassation, du Conseil dEtat et de la Cour des Comptes qui sont destins remplacer les diffrentes chambres de la Cour Suprme actuelle. Ces trois nouvelles juridictions restent mettre en place, organiser et faire fonctionner. Cette proccupation est dailleurs prise en compte dans lavant-projet de loi portant organisation judiciaire. Il faut encourager ladoption rapide de cet avant-projet de loi qui envisage la cration de deux ordres juridictionnels distincts, lun se rapportant aux affaires civiles, commerciales et pnales, et lautre la matire administrative. Ainsi, le projet prvoit, pour le premier ordre, la Cour de Cassation, les Cours dAppel et les Tribunaux de Premire Instance, et pour le second ordre, le Conseil dtat, les Cours Administratives dAppel, les Tribunaux Administratifs, la Cour des Comptes et les Chambres Rgionales des Comptes. La cration de ces nouvelles juridictions ncessiterait, si le projet aboutit, des efforts supplmentaires au niveau du recrutement du personnel (magistrats, greffiers et autres agents), des infrastructures et des quipements. Il sagit par ailleurs de rapprocher davantage la justice des justiciables et consolider ainsi ltat de Droit. Enfin, la rpartition actuelle des comptences entre les juridictions pose galement de nombreuses questions au regard des difficults daccs la justice, dorganisation des cours dassises et au regard du manque deffectivit des voies de recours, surtout en matire pnale. 1.2. Les institutions
Le Conseil Suprieur de la Magistrature, auquel les articles 104 107 de la Constitution sont consacrs, joue un rle central dans le systme judiciaire ivoirien. Il examine toutes les questions relatives lindpendance de la magistrature et qui concernent essentiellement la nomination et la promotion des magistrats du sige. Il fait ainsi des propositions pour la nomination des magistrats des juridictions suprmes, des Premiers Prsidents des Cours dAppel et des Prsidents des Tribunaux de Premire Instance, et donne un avis conforme la nomination des autres magistrats du sige. Il statue comme conseil de discipline des magistrats du sige et du parquet. Il faut prciser que pour remplir ce rle, tel que prvu par les dispositions constitutionnelles, une loi organique devrait tre adopte en vertu de larticle 107 de la Constitution, afin de dterminer les conditions dapplication des dispositions relatives au Conseil suprieur de la Magistrature. En attendant cette loi organique, le Conseil Suprieur de la Magistrature continue dexercer ses fonctions et attributions conformment aux lois et rglements en vigueur (article 130 de la Constitution, cest--dire quil ne dispose pour le moment que dun rle davis relatif la nomination et la promotion des magistrats et quil ne statue pas encore comme conseil de discipline des magistrats du parquet).
13
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Selon les propos de lInspecteur Gnral, avec ladoption de ladite loi organique, le Conseil Suprieur de la Magistrature aura sa disposition un outil de gestion pour la nomination et la promotion des magistrats: lInspection Gnrale des Services Judiciaires et Pnitentiaires (IGSP). Le projet de loi organique relatif au Conseil suprieur de la Magistrature que notre unit a parcouru tient compte des rformes constitutionnelles qui crent les juridictions suprmes et modifient la composition de cet organe. Ainsi, au nombre des personnalits qui le composent, lon devrait compter le Prsident de la Cour de Cassation, Vice- Prsident de droit, au lieu du Prsident de la Cour Suprme, le Prsident du Conseil dEtat (et non le prsident de la Chambre Administrative), le Prsident de la Cour des Comptes (et non le Prsident de la Chambre des Comptes). Ce projet donne par ailleurs plus de prcisions sur les attributions du Conseil Suprieur de la Magistrature quant la procdure de nomination et de promotion des magistrats du sige. Sur ce point, il est dailleurs dplorer que cette reforme nait pas modifi de manire plus radicale la composition de ce Conseil. De nombreux acteurs rencontrs sur le terrain ont soulev par ailleurs quun Conseil Suprieur de la Magistrature, garant de lindpendance des magistrats, ne devrait en aucun cas tre compos de membres du pouvoir excutif ou nomms par ce dernier mais uniquement de magistrats rellement indpendants. Ces derniers devraient tre choisis par leurs collgues. Il importe de noter ici les efforts consentis par le Ministre de la justice dans llaboration de textes tendant assurer un meilleur fonctionnement de lappareil judiciaire ivoirien. Aussi, conviendrait-il que le gouvernement mette tout en uvre pour que ces textes soient adopts le plus tt possible.
2.
La prsentation de lorganigramme du Ministre de la justice et lorganisation judiciaire proprement dite
La rencontre que lUnit de ltat de droit a eue avec le Directeur des tudes, de la lgislation et de la documentation du ministre de la Justice a permis de souligner lintrt que le Ministre de la Justice et ses collaborateurs portent la redynamisation du systme judiciaire ivoirien. Cela a conduit ses services favoriser ladoption dun dcret pris sous le n 2006- 70 du 26 avril 2006 portant organisation du Ministre de la Justice et des Droits de lHomme et prparer plusieurs autres projets de textes sur lorganisation judiciaire qui tiennent compte des rformes constitutionnelles sur la justice (voir plus haut les brefs commentaires relatifs aux projets de lois portant statut de la magistrature, organisation judiciaire et concernant le Conseil Suprieur de la Magistrature) . 2.1. La prsentation de lorganigramme du Ministre de la Justice.
Initialement limit la justice, le ministre tait devenu, entre dcembre 2005 et septembre 2006, celui de la Justice et des Droits de lHomme, depuis la mise en place du gouvernement dirig par le Premier Ministre Charles KONAN BANNY. Ainsi, un dcret avait t pris sous le n 2006-70 du 26 avril
14
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
2006 portant organisation du ministre de la Justice et des Droits de lHomme. Larticle 1er de ce dcret dispose que pour lexercice de ses attributions, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de lHomme dispose, outre le cabinet, de services rattachs au cabinet, de deux directions gnrales, de directions centrales et de services extrieurs quil est charg dorganiser par arrt. Les services rattachs au cabinet du Garde des Sceaux sont lInspection gnrale des services judiciaires et pnitentiaires, la Direction des affaires financires et du patrimoine, la Direction des ressources humaines et des professions judiciaires, la Direction de la formation, le Service de la communication et des relations publiques, le Service central des archives judiciaires et le Service autonome des statistiques et de linformatique. Lavnement en septembre 2006 dun ministre charg spcifiquement des Droits de lHomme, faisait prvoir de nouvelles modifications lorganigramme interne du ministre mais le nouveau gouvernement mis en place en avril 2007 a recr nouveau un ministre de la Justice et des Droits de lHomme. Le dcret n 2006-70 du 26 avril 2006 devrait donc rester en vigueur. 2.2. Lorganisation judiciaire proprement dite
Les lois organiques, qui doivent fixer, en vertu de larticle 102 de la Constitution, la composition, lorganisation et le fonctionnement des juridictions suprmes que sont la Cour de Cassation, le Conseil dEtat et la Cour des Comptes nont pas encore t adoptes. En attendant, lorganisation judiciaire ivoirienne, du point de vue juridictionnel, est rgie par la loi n 99435 du 06 juillet 1999 modifiant la loi n61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire. 2.2.1. Les juridictions de droit commun Parmi les juridictions de droit commun, lon peut relever la Cour Suprme, les Cours dAppel (juridictions de second degr), les Tribunaux de Premire Instance et leurs Sections Dtaches (juridictions de premier degr). 2.2.1.1. La Cour Suprme La constitution du 1er aot 2000 a prvu trois juridictions suprmes dont les lois organiques fixant la composition, lorganisation et le fonctionnement nont pas encore t adoptes. Il sagit de la Cour de Cassation, le Conseil dEtat et la Cour des Comptes. Dans lintervalle, la Cour Suprme est la seule juridiction suprme. Elle comprend la chambre judiciaire, la chambre administrative et la chambre des comptes.
15
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
La chambre judiciaire connat des pourvois en cassation forms contre les dcisions juridictionnelles rendues en dernier ressort sauf celles dans lesquelles est partie une personne morale de droit public etc. La chambre administrative connat des pourvois en cassation dirigs contre les dcisions rendues en dernier ressort dans les procdures o une personne morale de droit public est partie et en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excs de pouvoir forms contre les dcisions manant des autorits administratives. Enfin, la chambre des comptes est charge du contrle des finances publiques. A ce titre, elle vrifie la rgularit des recettes et des dpenses publiques, juge les comptes des comptables publics et sanctionne la gestion de fait et les fautes de gestion ; Elle assure galement un contrle budgtaire et de gestion. La Cour de Cassation chapeaute la fois les juridictions ordinaires (les cours dappels, les TPI et les sections dtaches de tribunal) et le tribunal militaire, juridiction spciale. A ce titre, il ne sagit pas seulement dune juridiction de droit commun. 2.2.1.2. Les Cours dAppel Les Cours dAppel, juridictions de second degr, sont des juridictions de droit commun de lordre judiciaire statuant sur les appels interjets contre les dcisions rendues par les tribunaux de premire instance ou leurs sections dtaches. Il existe 3 cours dappel en Cte dIvoire. La Cour dAppel dAbidjan connat des appels des dcisions des TPI dAbidjan-Plateau, de Yopougon, dAbengourou et de leurs sections dtaches ; la Cour dAppel de Bouak est comptente pour tous les appels des dcisions des TPI de Bouak et de Korhogo et de leurs sections dtaches ; enfin, la Cour dAppel de Daloa statue sur tous les appels des dcisions des TPI de Daloa, Bouafl, Gagnoa, Man et de leurs sections dtaches. La Cour dAppel de Bouak ne fonctionne plus depuis septembre 2002, ce qui pose non seulement problme pour la partie du territoire ivoirien occupe par les Forces nouvelles au Nord du pays mais aussi en ce qui concerne les sessions dassises6 et les appels introduits par les justiciables de quatre sections dtaches qui continuent fonctionner en zone gouvernementale : Mbahiakro, Dimbokro, Bongouanou et Toumodi. Les moyens devraient en priorit se concentrer sur la rouverture urgente de la cour dappel de Bouak. Nous apprenons que le Ministre de la Justice et des Droits de lHomme dploie actuellement des efforts en ce sens. terme, les Cours dAppel en fonction devraient tre plus nombreuses. Les Cours dAppel de Man, dAbengourou et de Korhogo ont dj t cres par dcret mais nont jamais fonctionn comme telles. Ce sont actuellement
Pour toutes les affaires criminelles, le juge dinstruction doit obligatoirement envoyer les dossiers quil a clturs la chambre daccusation prs la cour dappel, juridiction dinstruction dappel, avant sa fixation devant la cour dassises. La cour dassises, qui se tient au sige des tribunaux de premire instance, est elle-mme prside par un magistrat de la cour dappel comptente.
6
16
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
toujours des tribunaux de premire instance. Le Ministre de la justice a pour projet de les ouvrir dans les annes qui viennent, dans le souci de rapprocher la justice des citoyens. Il nous apparat quil faudrait galement renforcer lefficacit de la Cour dAppel dAbidjan, qui draine lessentiel des affaires du pays, par lamlioration des infrastructures, de lquipement et par le recrutement de personnel, voire ouvrir une seconde Cour dAppel Abidjan. 2.2.1.3. Les tribunaux de premire instance Les tribunaux de premire instance et leurs sections dtaches connaissent en premier ressort de toutes les affaires pour lesquelles comptence nest pas attribue spcialement une autre juridiction7. Dans les faits, il existe 9 tribunaux de premire instance sur les 12 crs par dcret : Abidjan, Yopougon, Abengourou, Daloa, Bouafl, Gagnoa, Bouak, Korhogo, et Man (ces trois derniers ntant pas oprationnels depuis septembre 2002). Au niveau de lorganisation interne des tribunaux de premire instance, lon relve diffrentes chambres (civile, commerciale, correctionnelle et une chambre correctionnelle pour mineurs). En matire pnale, le tribunal est territorialement comptent en fonction du lieu o linfraction a t commise ou du lieu de larrestation. Chaque tribunal de premire instance a des sections dtaches : TPI Abidjan : sections dtaches dAgboville, dAdzop, dAboisso et de Grand Bassam ; TPI Yopougon : section dtache de Dabou ; TPI Abengourou : sections dtaches de Tiassal, de Bondoukou et de Bouna ; TPI Bouak : sections dtaches de Katiola, de MBahiakro, de Dimbokro, de Bongouanou et de Toumodi ; TPI Korhogo : sections dtaches de Boundiali et dOdinn ; TPI Daloa : sections dtaches de Sassandra, de Soubr et de Sguela ; TPI Gagnoa : sections dtaches de Divo, dOum et de Lakota ; TPI Bouafl : section dtache de Sinfra ; TPI Man : sections dtaches de Touba et de Danan. 2.2.1.4. Les sections dtaches des tribunaux de premire instance Ces juridictions, constituent lune des spcificits du systme judiciaire ivoirien. Jusquaux nominations de lanne judiciaire 2004-2005, elles taient tenues, pour la plupart, par un seul, parfois deux magistrats, qui cumulaient les fonctions de poursuite, dinstruction et de jugement. Une telle situation, qui sexpliquait par le manque de ressources humaines et qui ne saccommodait gure du souci defficacit de la justice et des principes de droits de lHomme, a t corrige par les rformes de 1999. Ainsi, ont t nomms au sein de ces sections dtaches de tribunaux, des magistrats dans
7
Art. 35 al,6 de la loi portant organisation judiciaire.
17
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
les fonctions distinctes de poursuite, dinstruction et de jugement. Depuis la fin de lanne 2004, chaque section dtache de tribunal est dsormais dirige par un prsident de section mais compte galement un juge dinstruction (et quelques fois un troisime juge du sige) ainsi quun substitut - rsident qui dpend du procureur de la Rpublique prs le tribunal de premire instance auquel la section de tribunal est rattache. Le Directeur de la lgislation du Ministre de la justice nous a assur quavec les nouvelles rformes, le microcosme judiciaire va connatre une volution laquelle les services du ministre se prparent, de sorte quil y aura dsormais deux ordres juridictionnels : lun judiciaire avec les tribunaux de premire instance, cours dappel et cour de cassation, et lautre administratif avec les tribunaux administratifs, les cours dappel administratives et le Conseil dtat. Les sections dtaches, dont les comptences sont identiques celles des tribunaux de premire instance dont elles dpendent administrativement, sont ds lors appeles disparatre moyen terme. Cela aura pour consquence que, sauf les exceptions prvues explicitement par la loi, toutes les audiences seront collgiales dans le futur : l o un juge unique pouvait prsider les audiences et rendre seul des jugements dans les sections dtaches, un collge de trois magistrats serait dsormais ncessaire. Cela ne semble pas encore acquis tant donn que cela ncessiterait la nomination dun nombre bien plus grand de magistrats et aurait un cot lev. Par contre, la collgialit donnerait a priori davantage de garanties qualitatives aux justiciables. 2.2.1.5. Rflexions relatives une ventuelle rforme de lorganisation judiciaire Les ides et suggestions qui sont prsentes ici sinspirent tant des rflexions que certains acteurs de la justice ivoirienne ont formules lors des entretiens que de systmes prvalant dans dautres pays. Elles nont pour but que de susciter la rflexion sur le systme actuel qui montre rgulirement ses limites, partir de deux exemples concrets de dysfonctionnement. Nous partons du constat que larrir judiciaire des cours dassises, indpendamment mme de la crise actuelle qui amplifie le phnomne, est trs important. Il ne suffira pas dorganiser deux sessions par an dans chaque tribunal de premire instance pour le rsorber. Le temps qui scoule entre la fin de linstruction (elle-mme bien trop longue) et la fixation devant les cours dassises est souvent extrmement long, en bonne partie parce que lorganisation de ces sessions est trop coteuse. Comment rsoudre ce problme ? La question fondamentale est de savoir si linstitution des cours dassises, lesquelles jugent depuis plusieurs annes les personnes souponnes de crimes dans des dlais non raisonnables et dont les procdures sont lourdes, coteuses et inefficaces8, se justifie encore dans la
18
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Cte dIvoire daujourdhui et mme plus gnralement en Afrique. Cette question mrite rflexion tant elle est centrale pour le bon fonctionnement de la justice pnale. Quelle que soit la qualit des magistrats, il va sans dire que dans un pays o lessentiel des preuves recueillies consiste en des tmoignages, il est particulirement difficile de juger des criminels, 5 ou 10 ans aprs les faits, selon une procdure accusatoire : les tmoins et les parties civiles se dsintressent des procs aprs tant de temps, ne peuvent plus tre retrouvs ou ne se souviennent plus des faits avec prcision. Dans ces conditions, la justice rendue ne peut qutre approximative et les risques derreurs judiciaires sont normes. Or, il sagit de crimes dont les auteurs encourent les peines les plus svres. Par ailleurs, il faut souligner que les parties des procs en assises, parce que les arrts rendus ne sont pas motivs, sont prives de recours devant la cour dappel. Quant aux affaires correctionnelles, il est choquant de constater quen violation des standards internationaux en matire pnale, les condamns de premire instance, par manque de moyens de transport et par manque de volont sans doute, sont jugs en appel par les cours dappel sur pices, sans quils soient prsents. Face de tels exemples de dysfonctionnement, plusieurs solutions peuvent tre envisages au niveau de lorganisation judiciaire pour que les criminels soient jugs dans un dlai raisonnable et que tous les appelants en matire pnale soient jugs en leur prsence. Il sagirait : soit daugmenter immdiatement et de manire considrable les moyens dont disposent la justice pour a) tenir les sessions des cours dassises deux quatre fois par an dans chacun des tribunaux de premire instance ou mme les riger en juridictions permanentes (solution coteuse et peu raliste court ou moyen terme) et b) pour permettre, par leur transport dans les dlais, chacun des dtenus condamns en matire correctionnelle ayant exerc son droit dappel, de comparatre en personne devant lune des cours dappel (dont le nombre serait rapidement port de 3 6 cours dappel) ; soit de faire preuve de pragmatisme en tenant compte de linsuffisance des moyens actuellement disponibles pour le systme judiciaire et : rduire fortement le champ de comptences des cours dassises (limitation par exemple aux seuls crimes de sang) en largissant la comptence des tribunaux de premire instance pour les autres infractions qualifies crimes; dans ce cas, il resterait encore rendre effective et conforme aux normes internationales la voie de recours ordinaire quest lappel ; supprimer les cours dassises et imaginer une organisation judiciaire diffrente mais dj prouve ailleurs : les sections de tribunaux actuels pourraient devenir des tribunaux de premire instance (ou rester des sections si lon tient prserver leur nom) qui seraient comptents pour toutes les affaires correctionnelles et pour les affaires civiles et commerciales dont lobjet du litige ne dpasse pas un certain
19
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
plafond ; des tribunaux de grande instance (TGI, qui seraient les TPI actuels) seraient comptents pour tous les appels des jugements rendus en premire instance et jugeraient en premier ressort de toutes les affaires criminelles et de toutes les affaires civiles et commerciales dont lobjet du litige dpasse le plafond susmentionn; les cours dappels verraient leur comptence limite lappel des jugements rendus au premier degr par les tribunaux de grande instance, soit au pnal soit au civil. Dans certaines localits, il faudrait sassurer de lexistence et du fonctionnement simultan dun TPI et dun TGI. Cette dernire possibilit permettrait sans doute : de mieux rpartir le contentieux entre les juridictions alors quactuellement les comptences des TPI et des sections sont identiques et alors que certaines sections sont dpourvues de dossiers (comme Mbahiakro), dautres tant submerges (Sassandra, Dimbokro, etc.) ; de permettre de juger des affaires criminelles dans des dlais bien plus raisonnables que devant les cours dassises; de garantir tous les condamns au premier degr, y compris en matire criminelle, lexercice de lappel, voie de recours ordinaire ; de permettre en mme temps aux appelants correctionnels dtre jugs en appel proximit des faits commis, ce qui permettrait de les acheminer plus facilement vers les juridictions dappel (TPI actuels).
Dans tous les cas de figure, il faudrait de toute faon rsoudre la question du transport, vers les cours dappel, des personnes criminelles condamnes en premier ressort par les TGI. 2.2.2. Une juridiction spciale : le tribunal militaire dAbidjan Il nexiste quun seul tribunal militaire en Cte dIvoire pour le moment mais il serait important den crer dautres. Il sagit dune juridiction spciale pour les militaires dont le magistrat du parquet et les 4 jurs sont militaires. Seul le prsident est un magistrat civil, dtach de la cour dappel dAbidjan. Elle fonctionne largement comme une cour dassises (procdure accusatoire et non pas inquisitoire). En temps de paix, elle est comptente, lorsque les prvenus sont tous militaires, pour connatre : 1 des infractions militaires prvues par le code pnal non connexes une ou plusieurs infractions relevant de la comptence dautres juridictions ; 2 des infractions contre la sret de lEtat ; 3 de toute infraction commise : - soit dans le service ou loccasion du service (inapplicable aux infractions autres que militaires, commises par les militaires de la gendarmerie dans lexercice de leurs attributions de police judiciaire civile ou de police administrative) ; - soit en maintien de lordre ; 20
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
soit lintrieur dun tablissement militaire.
Lorsquun seul civil est souponn dune infraction commise avec un groupe de militaires, sa prsence rend le tribunal de droit commun exclusivement comptent. En temps de guerre par contre, cette rgle sinverse et le tribunal militaire est comptent pour juger des civils, mme en labsence de tout militaire. Le tribunal militaire statue en premier et dernier ressort : pas dappel possible, comme pour les arrts de cour dassises. Cette tude ne porte pas sur le tribunal militaire. Lanalyse du code de procdure militaire et du fonctionnement du tribunal militaire, notamment au travers de lobservation de procs et partir des rencontres avec les principaux acteurs de cette juridiction spciale, fera lobjet dun rapport spcifique ultrieur.
21
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
II.
LE FONCTIONNEMENT DE LAPPAREIL JUDICIAIRE
Dans les diffrentes juridictions visites, dnormes difficults de fonctionnement ont t observes. Certaines sont dordre gnral et touchent tous les services, quil sagisse du parquet, du sige ou du greffe (1.), alors que dautres difficults sont spcifiques au sige (2.). 1. Les questions dordre gnral 1.1. Les infrastructures
Les diffrentes visites des juridictions ont rvl des dficits importants au niveau des infrastructures. En effet, les locaux abritant les juridictions sont, pour la plupart, en mauvais tat, inadapts et dpasss. Certains palais de justice ont t construits dans les annes 60 et 709 et nont pas t rnovs pour rpondre aux exigences tenant au surcrot deffectifs du personnel judiciaire, laccroissement du nombre de justiciables et du volume des affaires. Idalement, si les moyens existaient, la plupart des btiments des juridictions ivoiriennes devraient tout simplement tre reconstruits. Pour tre plus ralistes, il faudrait prvoir des investissements lourds pour rnover, agrandir et quiper la plupart des palais de justice existants. En plus de labsence de salles dattente pour les justiciables et autres auxiliaires de justice10, les juridictions dappel et de premire instance sont confrontes un manque de bureaux (1.1.1). Elles ne disposent pas souvent de salles daudience en bon tat (1.1.2) et ces juridictions ne sont pas scurises (1.1.3). 1.1.1. Le manque de bureaux Le manque de bureaux pour le personnel judiciaire se fait sentir dans toutes les juridictions du pays. A titre dexemple, le palais de justice dAbidjan (Plateau), qui abrite la cour dappel et le tribunal de premire instance (TPI), est confront un manque criant de locaux. De nombreux magistrats sont contraints de travailler domicile, faute de bureaux11. Les autres partagent souvent un bureau trois ou quatre, sans parler des greffiers qui manquent totalement despace. Les btiments du tribunal de premire instance de Yopougon, bien que construit rcemment, sont dj trop exigus pour le personnel. Dans ce cas, cest la planification des btiments et lutilisation optimale des fonds disponibles qui semblent en cause.
Dautres datent mmes des annes 40 (comme la section de Sassandra), une poque o le contentieux tait rduit et se limitait aux affaires impliquant des membres de ladministration coloniale ! Aujourdhui, la population a au moins quintupl et les gens ont de plus en plus souvent recours la justice, ce qui rend ces btiments dun autre ge totalement obsoltes. 10 Ainsi au tribunal de premire instance dAbidjan, les avocats arpentent les couloirs du tribunal en attendant que leur affaire soit voque pour les audiences de rfrs qui se tiennent au cabinet du juge. 11 Autant dire que ces magistrats ne travaillent pas dans des conditions qui leur permettent dtre productifs. Emporter ses dossiers la maison pose galement le problme de leur confidentialit et est de nature exposer le magistrat davantage dinscurit chez lui.
22
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Concernant le Tribunal de premire instance dAbidjan-Plateau qui concentre lessentiel des dossiers du pays, louverture effective des tribunaux de premire instance de Port-Bout et dAbobo-Gare (dj crs par dcrets) pourrait tre une rponse partielle au dficit de bureaux et au dsengorgement de cette juridiction. Nous pensons quil serait judicieux de dlocaliser le Tribunal de premire instance dAbidjan-Plateau dans des btiments plus spacieux et mieux conus, de manire concder la cour dappel lentiret du palais de justice actuel. Une solution plus radicale encore serait de construire un plus grand palais de justice qui pourrait accueillir la fois la cour dappel dAbidjan et le tribunal de premire instance dAbidjan (Plateau). De tels bouleversements ncessiteraient cependant des fonds trs importants dont le Ministre de la Justice nest actuellement pas dot. La rforme de lorganisation judiciaire concernant les sections dtaches de tribunaux, avec la cration dun service du parquet, na pas t accompagne des ncessaires travaux damnagement des infrastructures. Idalement, pour des raisons pratiques et de transparence, le tribunal et le parquet devraient tre logs dans deux btiments distincts, ce qui permettrait ainsi la population de diffrencier les fonctions. Trs souvent, de petites salles darchives ou de scells ont t, la hte, dbarrasses de leur contenu, entirement ou partiellement, et quipes de meubles de fortune pour accueillir les substituts rsidents ou les juges dinstruction. A Tiassal par exemple, le bureau attenant celui du prsident de section a t scind, par une cloison en contreplaqu, en deux bureaux distincts occups par le substitut rsident et le juge des enfants et des tutelles. Ces petits bureaux ne sont pas insonoriss, de sorte que la confidentialit des entretiens que lun ou lautre magistrat conduits nest pas assure. Le cas du tribunal de Sassandra est plus symptomatique encore de la totale inadquation des locaux. Except le prsident, qui occupe un bureau spar, un juge du sige, le juge dinstruction et les deux substituts rsidents partagent un seul bureau. Cette cohabitation pose de graves questions tant du point de vue de lefficacit du travail des magistrats, qui peuvent difficilement se concentrer sur leurs dossiers, que du point de vue de la confidentialit et de la rgularit des procdures. Les fonctions exerces par chacun deux sont lgalement distinctes. En consquence, il nest pas normal quun magistrat susceptible de rendre un jugement entende les auditions et interrogatoires mens lors du dferrement par le parquet ou par le juge dinstruction au stade de linformation judiciaire.12 Cette situation extrme rend compte des difficiles conditions de travail dans les juridictions ivoiriennes. Il faut noter toutefois qu Agboville, grce aux fonds gnrs par les frais de certains actes dlivrs par les autorits judiciaires et laide des autorits locales administratives, la salle de dlibration a t transforme en un
Signalons toutefois que, lors de notre passage Sassandra, une petite annexe, finance par les fonds du tribunal gnrs par la dlivrance des actes administratifs, tait en construction pour remdier cette situation. Elle est destine accueillir les deux substituts rsidents et leur secrtariat : 2 petits bureaux spars en plus de la pice daccueil.
12
23
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
bureau et un secrtariat. Ce bureau prsente le minimum de confort permettant au substitut rsident de travailler dans des conditions acceptables. Certains btiments larchitecture inadapte ntaient pas conus, lorigine, pour abriter des palais de justice. Par exemple, les btiments des sections dOum et de Lakota, aux dires des autorits judiciaires locales, taient affectes respectivement au stockage des produits agricoles et un dispensaire. De plus, les locaux du tribunal dOum seraient la proprit dun oprateur conomique de la place qui aurait menac, une certaine poque, de reprendre son local pour cause de non-paiement de loyers par lEtat. Le fait pour des juridictions dtre loges dans des difices appartenant des personnes prives est incompatible avec lexercice de la justice en toute indpendance. Il suffit dimaginer ltat desprit dun justiciable en conflit avec le bailleur du local abritant une juridiction. Ce justiciable pourrait lgitimement craindre un procs inquitable lavantage de son adversaire. Les infrastructures sont galement trs vite dpasses puisque les plans de construction nont pas pris en compte le moyen, voire le long terme. Lexpression la plus loquente de ces difficults est celle de la Cour Suprme qui, bien qutant la juridiction la plus importante et la plus prestigieuse du pays, voit ses services disperss dans la ville dAbidjan et ne dispose pas de vritable prestige ni de visibilit pour le public. Or, toute la symbolique attache au respect de la sparation et de lquilibre des pouvoirs excutif, lgislatif et judiciaire devrait se traduire par lexistence ddifices publics ostensibles abritant les diffrents pouvoirs. Cest le cas de la Prsidence de la Rpublique (Excutif) et de lAssemble nationale (Lgislatif) mais pas de la Cour Suprme. Cet tat de fait est symptomatique du manque de considration dont jouit la justice en Cte dIvoire : un pouvoir qui les moyens font largement dfaut pour contrebalancer la puissance de lExcutif. Le transfert de la capitale Yamoussoukro, qui a pris en compte la ralisation ddifices devant abriter la Prsidence de la Rpublique et lAssemble nationale, devrait pouvoir apporter une correction cette situation, afin de marquer physiquement la sparation des pouvoirs constitus. Une telle dmarche, couple avec une augmentation substantielle du budget consacr la justice, dmontrerait lattachement de lEtat ivoirien au pouvoir judiciaire et sa volont de rompre lactuel dsquilibre entre les diffrents pouvoirs. En effet, dans un contexte dmocratique, la justice ne saurait tre traite comme une question priphrique. 1.1.2 Les salles daudience A Abidjan, le problme de linsuffisance de salles daudience se pose avec acuit. Ainsi, les deux salles daudience sont utilises par les 21 chambres du Tribunal de Premire Instance dAbidjan, quasiment sans arrt, ce qui les obligent expdier rapidement les affaires qui sont fixes devant elles, au dtriment de la qualit de la justice rendue. En dehors dAbidjan, les autres juridictions parviennent en gnral tenir leurs audiences dans la salle unique qui leur est affecte.
24
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Le cas de la section de tribunal de Grand Bassam est singulier et proccupant puisquelle ne dispose daucune salle daudience. Dans cette juridiction, les audiences se tiennent dans la salle de runion de la sous-prfecture situe en face du palais de justice. Cette salle demprunt, qui ne prsente aucune commodit pour tenir des audiences juridictionnelles, ne constitue quune solution provisoire laquelle il serait urgent de remdier. Le constat gnral est que les salles daudience ne traduisent pas, dans leur configuration, toute la solennit qui doit caractriser lexpression de la justice. A lexception des salles daudience du palais de justice dAbidjan Plateau et, un degr moindre, de Yopougon, il sagit de salles larchitecture trs ordinaire. Les audiences se tiennent dans des conditions difficiles, les salles tant, dans la plupart des cas, en mauvais tat, voire insalubres, insuffisamment entretenues et mal ares (poussire, peinture dfrachie, meubles endommags, absence de brasseurs dair et a fortiori de systme de conditionnement dair). Elles sont en rgle gnrale dpourvues de tout matriel de sonorisation alors que les bruits causs par la circulation routire ou par la population riveraine peuvent tre assourdissants et rendre les dbats inaudibles. Il nous est ainsi arriv dassister des audiences au premier rang de lassistance et tre incapable dentendre les propos des parties. Le caractre public des audiences ncessiterait pourtant que chacun des membres de lassistance soit en mesure de suivre lintgralit des dbats. Mentionnons toutefois que la section de tribunal dAgboville a une salle daudience trs bien tenue, quipe dune dizaine de brasseurs dair et de matriel de sonorisation de qualit. Le prsident du tribunal a prcis que ces quipements ont t mis la disposition du tribunal grce aux bonnes relations quil entretient avec les autorits administratives locales telles que le Maire et le Prsident du Conseil gnral. Il est recommand que les chefs de juridictions, en tant quadministrateurs du service public de la justice, fassent les dmarches ncessaires auprs des autorits locales pour obtenir des aides matrielles permettant damliorer le fonctionnement de la justice au bnfice de leurs administrs, du moment que cela naffecte pas leur indpendance. Il nen irait pas de mme de partenaires privs dont laide est ncessairement intresse. Les salles daudience ne disposent pas de local rserv aux tmoins o ils pourraient se retirer durant les procs. En consquence, les tmoins sont bien souvent prsents dans la salle daudience et suivent les dbats, sans que le prsident de chambre puisse facilement y remdier. Cette situation peut nuire gravement au bon droulement du procs et la manifestation de la vrit puisque les tmoins peuvent tre influencs par les dclarations des diffrentes parties ou par celles des autres tmoins. 1.1.3. La question de la scurit des juridictions La scurit des btiments abritant les juridictions fait partie intgrante des mesures ncessaires garantir la scurit juridique travers la bonne conservation des dossiers et des quipements, lutter contre la corruption et lintimidation du personnel judiciaire et contribuer lindpendance des 25
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
magistrats dans lexercice de leurs fonctions. Les mesures de scurisation des btiments devraient comprendre un dispositif de contrle de laccs aux juridictions qui permettrait doprer la distinction entre le personnel et les justiciables. Dans toutes les juridictions visites, lon a pu remarquer lextrme facilit avec laquelle les justiciables ont accs non seulement lenceinte des juridictions, mais aussi aux bureaux des magistrats du sige. Les parcelles de certains tribunaux, comme cest le cas Divo et Grand Bassam, ne sont pas cltures. Concernant le tribunal dAbidjan, qui est le phare des juridictions de premire instance du pays, la permabilit son entre a favoris lmergence de courtiers de justice des temps modernes communment appeles margouillats . Ces derniers, selon les propos de certains de nos interlocuteurs, nhsitent pas intercepter les usagers du service public de la justice et prtendre trouver une solution tous leurs problmes moyennant rmunration. Ainsi, selon les besoins exprims, ils orientent le justiciable vers un magistrat ou un greffier ou tout autre membre du personnel. Le service rendu sapparente dans certains cas une escroquerie ou participe au phnomne malheureusement rpandu de corruption. Cette question de la scurit des locaux sest pose avec acuit en 2003 la suite de lagression physique de certains magistrats par des individus qui manifestaient leur opposition linstallation du prsident du tribunal. Larrt de travail observ par les diffrents syndicats de magistrats a conduit le Prsident de la Rpublique prendre un dcret classant les locaux abritant les juridictions au rang ddifices de lEtat devant faire lobjet de protection par les Forces de dfense et de scurit (FDS). Mais aux dires du directeur des services judiciaires du Ministre de la justice, ce dcret est difficile mettre en uvre en raison de la question des primes dues aux lments des FDS, notamment concernant le palais de justice dAbidjan. Le Ministre de lintrieur estimerait que ces primes seraient dues par le Ministre de la justice qui dit ne pas disposer de fonds cet effet. Il aurait t convenu quun arrt conjoint soit pris par les Ministres de lintrieur, de la justice et de lconomie et des finances pour rgler cette question de primes. Concernant les juridictions de province, le problme ne peut se rsumer une question de primes, puisque les lments des Forces de dfense et de scurit (brigades de gendarmerie et commissariats de police) disent tre en nombre insuffisant pour assurer la scurisation des juridictions en plus de leurs missions ordinaires. 1.2 Les difficults lies au budget allou aux juridictions
Le ministre de la justice est thoriquement un ministre de souverainet. Le Directeur des Affaires financires et du Patrimoine (DAFP) dudit ministre sest dsol du fait que le budget consacr la justice reprsente moins de 2% du budget gnral annuel de lEtat de Cte dIvoire. Par ailleurs, il note que ce budget est presque toujours dgressif. Comme cest rgulirement le cas, le budget pour lanne judiciaire 2005 2006 a t mis en place en juillet 2006 au lieu de janvier 2006. Il slve 9 milliards de francs CFA, au titre du crdit de fonctionnement, et 900 millions pour le crdit dinvestissement. 26
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Le crdit de fonctionnement de 9 milliards de francs CFA prend en compte les salaires et les frais dabonnement en eau et lectricit, de sorte que la dotation qui fait vritablement fonctionner les juridictions et les maisons darrt est de 2,5 milliards de francs CFA. Si la part du crdit de fonctionnement rserve aux salaires et aux frais dabonnement en eau et lectricit relve de la responsabilit directe du ministre de lconomie et des finances, celle de 2,5 milliards est directement gre par les services du DAFP du ministre de la justice. Quant au crdit dinvestissement de 900 millions pour lanne judiciaire 20052006, il sert quiper les diffrents services du ministre de la justice et est rparti entre les juridictions et les maisons darrt et de correction. La gestion des crdits de fonctionnement des diffrents services des juridictions est dconcentre : chaque chef de service en est ladministrateur tandis que les prfets en sont les ordonnateurs. A ce niveau galement lindpendance de la justice et le principe de la sparation des pouvoirs, notamment entre lExcutif et le Judiciaire, se trouvent gravement affects par le fait que le prfet soit lordonnateur du budget des juridictions (et des tablissements pnitentiaires) de son ressort. Les diffrents chefs de services rencontrs ont dnonc la lourdeur de la procdure dengagement des crdits. Ils se font dlivrer les fournitures et matriels de bureau, mais les services du Trsor ntant pas diligents pour le rglement des factures, les fournisseurs rechignent honorer de nouvelles commandes. Cette situation cause dnormes dsagrments qui compliquent le fonctionnement des juridictions. Certains chefs de services ont fait remarquer que pour pallier cette inertie, il leur arrive dutiliser les fonds propres des juridictions pour couvrir les dpenses de fonctionnement. Le DAFP nous a fait connatre titre dexemples les montants des crdits allous la cour dappel dAbidjan et la section dtache de tribunal de Dimbokro pour lanne 2005-2006. Concernant la cour dappel dAbidjan, le crdit du sige slve 16 millions Fcfa et celui du parquet 15 millions Fcfa. Quant la section de tribunal de Dimbokro, le sige est dot de 7 millions Fcfa et le parquet de 6 millions Fcfa. Les diffrents chefs de services (sige et parquet) ont souhait que les crdits de fonctionnement soient revus la hausse et mis leur disposition dans les dlais qui conviennent, pour un meilleur fonctionnement des juridictions. Il serait souhaitable de distinguer le budget du Ministre de la justice, manation du pouvoir excutif, de celui des juridictions, manation du pouvoir judiciaire, afin de donner plus de consistance la sparation des pouvoirs. En effet les juridictions ne devraient pas dpendre, dans leur fonctionnement, du Ministre de la justice, et souffrir par consquent des lourdeurs administratives pour les dcaissements du budget. Larticle 101 de la Constitution dispose clairement que le pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir excutif et du pouvoir lgislatif. Si la Prsidence de la Rpublique et les diffrents ministres, ainsi que le parlement ont un budget propre, cela 27
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
devrait galement tre le cas des juridictions, au risque de compromettre, dans une certaine mesure, lindpendance du pouvoir judiciaire. De manire plus gnrale, la proportion du budget consacr par lEtat la justice est totalement insuffisante couvrir les besoins de base de celle-ci et fournir aux justiciables un service de qualit et une justice indpendante. Selon plusieurs interlocuteurs, notamment du Barreau, tant les Gardes des Sceaux successifs que les syndicats de magistrats et dautres acteurs judiciaires ne se seraient pas suffisamment battus pour obtenir un budget plus consquent. Or selon eux, la justice gnre des rentres de fonds importantes qui sont ensuite englouties ailleurs alors quils pourraient peut-tre tre rinvestis ou rinjects dans le systme judiciaire. 1.3. Les difficults lies linsuffisance dquipements et de moyens matriels
1.3.1. La vtust des machines crire et linsuffisance de lquipement informatique Le manque dquipements et de moyens matriels est criant. Ltat des quipements existants est insatisfaisant. Toutes les juridictions en souffrent puisquelles ne disposent pas doutils de travail performants. 1.3.1.1 La vtust des machines crire
Les secrtaires dactylographes se plaignent de la vtust de leurs machines crire mcaniques qui tombent constamment en panne, affectant considrablement lefficacit de leur travail. Plusieurs secrtaires en viennent partager une seule machine crire. Par ailleurs, les magistrats imputent bien souvent la lenteur avec laquelle leurs jugements, rdigs la main, sont mis la disposition des justiciables, au fait que les jugements dactylographis doivent tre corrigs et intgralement repris plusieurs fois avant dtre signs. La perte de temps est considrable et se rpercute sur lefficacit des services que le systme judiciaire est cens rendre. 1.3.1.2. Linsuffisance de lquipement informatique
A lre des autoroutes de linformation, lon a constat que la plupart des juridictions ne sont pas dotes doutils informatiques performants. Les rares ordinateurs mis la disposition des juridictions les plus chanceuses sont tombs en dsutude, soit par faute dentretien, soit parce que leurs utilisateurs nont pas la formation requise pour les utiliser bon escient. Prcisons toutefois que lONG Prisonniers Sans Frontires (PrSF), avec lappui financier de la Commission Europenne, a ralis un projet dinformatisation des juridictions dinstruction et des maisons darrt afin de mieux suivre les cas de dtention prventive et, plus largement, la situation carcrale des pensionnaires des maisons darrt. Ainsi, ladite structure a dot chaque cabinet dinstruction dordinateur, mme si lon constate quelques frictions, dans certaines juridictions, quant laffectation de cet outil. Ces efforts
28
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
restent toutefois insuffisants pour le moment, les parquets et les magistrats du sige devant galement tre dots doutils informatiques. Rcemment les greffiers et les magistrats de la Cour dAppel et du Tribunal dAbidjan ont t quips en outils informatiques (ordinateurs et imprimantes). Selon le Ministre de la justice, un tel projet devrait stendre ensuite toutes les juridictions. La guerre, qui a caus la destruction de la plupart des archives judiciaires dans le nord du pays, a rvl tout lintrt de linformatisation des greffes et dun systme fiable de sauvegarde des archives sur CD-Rom ou sur des cls USB. Les acteurs de la justice, quil sagisse des magistrats, des greffiers et des secrtaires dactylographes doivent tre initis aux techniques dutilisation de loutil informatique et bnficier de recyclages rguliers ensuite. Il appartient principalement lEtat et accessoirement aux bailleurs de fonds, dquiper les juridictions et parquets ivoiriens doutils informatiques afin de rendre plus performant lappareil judiciaire. Ce faisant, il importe aussi de mettre en place un systme de sauvegarde des donnes qui soit efficace. En effet, la poussire, le mauvais usage, les virus informatiques, la foudre et les variations de tension lectrique sont de nature endommager irrmdiablement les appareils. Cest ainsi que paralllement la sauvegarde des donnes informatiques, il serait judicieux de conserver une mthode de classement manuelle confie des professionnels de la conservation. Il faut souligner que, par contraste avec la majorit dentre elles, certaines juridictions, lasses dattendre la modernisation de leurs quipements, se sont quipes de postes informatiques (ordinateurs, onduleurs et imprimantes), grce la majoration des cots de certains actes de nature administrative, notamment les certificats de nationalit, les extraits de casiers judiciaires, les registres de commerce et/ou en vendant les formulaires de requte desdits actes. Si cette situation a lavantage de satisfaire les besoins des usagers du service public de la justice en acclrant le traitement de leurs dossiers et la dlivrance de ces actes, elle est critiquable dun point de vue juridique et conomique, en ce quil sagit, selon le Ministre de la justice, de frais illgaux13 qui viennent sajouter aux frais de greffe dj la charge des justiciables. En ralit, un tel systme satisfait les personnes qui en bnficient parce quelles ont les moyens de payer ces frais mais il nest pas certain que la population rurale y ait accs dans son ensemble. 1.3.2 Linsuffisance des moyens de communication et de locomotion 1.3.2.1 Linsuffisance des moyens de communication
Les lignes tlphoniques actuelles dont disposent les juridictions ne suffisent pas couvrir leurs besoins. Il sagit pourtant doutils de travail essentiels, surtout pour les procureurs et les juges dinstruction qui doivent contrler en
13
Mentionnons cependant que le TPI de Bassam aurait pass un accord avec la direction des finances pour pouvoir garder un pourcentage des bnfices obtenus grce lmission des certificats de nationalit.
29
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
permanence, pour les premiers, ltat des gardes vue et lavancement des enqutes de police judiciaire, et pour les seconds, lexcution des commissions rogatoires par les officiers de police judiciaire. Dans certaines juridictions, notamment dans les sections dtaches de tribunaux, telles que Agboville et Aboisso, certains magistrats ont install des lignes tlphoniques prives pour les besoins du service public. Dans lintrt du service public, il nest pas souhaitable que les magistrats puissent utiliser leurs deniers personnels pour laccomplissement de la mission que lEtat leur a confie. Sil est vrai que lutilisation abusive du tlphone de service pour des besoins personnels a aggrav les charges de lEtat, la suppression ou la restriction de certaines lignes, solutions radicales, sont apparues comme nuisibles au bon fonctionnement de la justice. Lon pourrait suggrer dtablir un systme de quota de communications ne pas dpasser ou de faire supporter par lutilisateur du tlphone tous les frais de communication nayant aucun rapport avec le service public de la justice. Cette solution aurait le mrite de rpondre au souci de rduction des charges de lEtat tout en assurant un meilleur fonctionnement du service public de la justice. Dans les tribunaux de premire instance, seuls les chefs de service (prsident du tribunal, procureur de la Rpublique et greffier en chef) disposent dune ligne tlphonique directe. Ces lignes tlphoniques sont parfois restreintes au ressort territorial ou au sige de la juridiction. Le fax est quasiment un luxe qui, lorsquil existe, nest pas souvent fonctionnel. 1.3.2.2. Linsuffisance des moyens de locomotion
Les juridictions nont pas de vhicules de liaison, de sorte que les magistrats qui devraient se dplacer dans le cadre dune affaire pour pouvoir juger en toute connaissance de cause neffectuent presque jamais de descentes sur les lieux. Lorsquils le font, cest en utilisant leurs moyens de dplacement personnels ou en sollicitant le concours des parties au litige. Cette dernire solution augmente non seulement les frais de procdure des parties, mais pourrait heurter lindpendance des juges qui, au lieu de sappuyer sur les ressources de lEtat, recourent plutt aux justiciables. Or un justiciable qui paierait seul les frais de dplacement pourrait rompre lquilibre entre les parties et influencer les juges au moment de la dlibration. Si les vhicules de fonction des chefs de juridictions (Cours dAppel et tribunaux de premire instance) taient, pour la plupart, en trs mauvais tat, il convient de signaler, que lEtat leur a rcemment affect de nouveaux vhicules. Ces efforts devraient pouvoir stendre aux sections dtaches de tribunaux de premire instance. Il faut aussi insister sur le fait que les vhicules soient mis la disposition des autres magistrats pour les besoins de service. 1.3.3. La pnurie de matriels, de fournitures de bureau et de documentation juridique Les acteurs de terrain ont galement attir notre attention sur la pnurie de fournitures de bureau, tels que les imprims, les registres, les chemises, le papier et autres petits matriels. Cette situation serait due au fait que le 30
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
budget des juridictions reste insuffisant couvrir tous les frais de fonctionnement mais aussi au fait que les fournisseurs rechignent livrer des fournitures de bureau lorsquils nont pas t pays plusieurs mois aprs les livraisons prcdentes. Il nexiste quasiment pas de documentation juridique et encore moins de bibliothque dans les juridictions. Les magistrats soucieux de maintenir le niveau de leurs connaissances juridiques sont contraints de se procurer, leurs frais, la documentation qui les intresse. Ils nont pas de ligne de crdit qui leur permettrait de rpondre leurs besoins en codes et lois, revues juridiques, ouvrages de doctrine ou recueils de jurisprudence. Le rsultat de cette absence de documentation est que les magistrats, censs mieux que quiconque matriser le droit, ne sont dans certains cas plus en mesure de rendre des dcisions qui y soient conformes, faute dinformations suffisantes, parfois mme faute de codes jour. La qualit des dcisions de justice en ptit. Surtout dans les sections dtaches, ces magistrats se sentent isols des autres et cette situation favorise des carts importants dans lapplication du droit par les diffrentes juridictions du pays. LEtat pourrait accorder chaque magistrat une indemnit de documentation ou, mieux encore, une dotation en ouvrages juridiques. Encore une fois, comme dans dautres domaines, cela ncessiterait que le secteur de la justice soit mieux considr du point de vue des investissements et de son budget de fonctionnement. La situation est telle quil arrive souvent, aux dires des magistrats rencontrs, quau lieu de rechercher les sources des lments de droit invoqus par les avocats, supposer quils soient prsents, ils invitent ceux-ci les produire. Par ailleurs, les magistrats de province sont obligs de se rendre Abidjan pour se procurer la documentation spcialise, quasi-inexistante dans les librairies de leur ressort territorial. (Voir aussi infra la question de labsence daccs la jurisprudence). 1.4 Les ressources humaines et la formation
1.4.1. Les effectifs des services de la justice Selon la direction des services judiciaires du Ministre de la justice, le personnel judiciaire tait compos en 2006 de 494 magistrats (auxquels sajoutent les 105 magistrats en dtachement ou de la Cour Suprme, soit 599 au total) et de 624 greffiers. Pour une population approximative de 16 millions dhabitants, le ratio est dun magistrat pour 26 000 habitants. Il est ncessaire de produire un effort supplmentaire de recrutement sans en altrer toutefois la qualit. Celui-ci se limite, depuis les trois promotions annuelles de 50 magistrats de 1995 199714, 10 ou 15 magistrats au maximum par promotion. Ce besoin de recrutement se fait galement sentir pour les greffiers. Cette question renvoie la formation du personnel judiciaire qui continue de se faire dans le cadre inappropri de lEcole Nationale dAdministration, en attendant la mise
14
Ces 3 promotions de 50 magistrats ont t diversement apprcies par les professionnels du secteur rencontr lors de ltude. Beaucoup ont dplor la faible qualit et le manque de motivation de certains des laurats de ces promotions.
31
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
en uvre du dcret portant cration de lInstitut National de Formation Judiciaire. Soulignons aussi que le fonctionnement de la justice ivoirienne repose aussi sur un certain nombre de personnes volontaires payes directement (et trs mal payes) par les juridictions, en raison de labsence de moyens de lEtat. Il sagit des secrtaires - dactylographes, des interprtes et parfois du personnel de gardiennage ou dentretien. Ces personnes ne disposent daucun cadre lgal ou daucun statut pour lexercice de leurs fonctions, ce qui est particulirement inconfortable et inscurisant pour elles. Ainsi les secrtaires ne sont pas tenues au secret professionnel ni aucune dontologie. Leur utilisation est ds lors extrmement prilleuse, surtout en raison de leur grande vulnrabilit. La notion de rendement leur est galement trangre et aucune sanction disciplinaire ne peut leur tre impose, part mettre fin leur collaboration. En pratique, les chefs de juridiction passent souvent lponge car ils estiment avoir besoin delles. 1.4.2 La formation des magistrats et des greffiers 1.4.2.1. La formation des magistrats
La formation initiale des magistrats qui se droulait lorigine en France, a lieu au sein de lEcole Nationale dAdministration (ENA) depuis 1983. Cest lENA quest loge la section de la magistrature qui dpend du Ministre de la justice. Une fois de plus, cette situation, qui a t la source de difficults, heurte le principe de la sparation des pouvoirs excutif et judiciaire : lENA dpend du Ministre de la fonction publique, tandis que la section de la magistrature relve du Ministre de la justice. Cest dans le souci de mettre un terme cette situation atypique, qua t pris, le 3 fvrier 2005, un dcret portant cration dun Institut National de Formation Judiciaire (INFJ) qui comprendra 4 coles, savoir : LEcole de la magistrature ; LEcole des greffes ; LEcole de ladministration pnitentiaire et de lducation surveille ; LEcole de la formation continue.
Ce dcret ntant pas encore mis en uvre, la formation initiale actuelle des magistrats dure toujours 2 annes : une anne thorique au sein de lENA et une anne pratique au sein des juridictions. La directrice de la formation et des stages du ministre de la justice a fait remarquer que la formation des magistrats, en Cte dIvoire, a t longtemps soutenue par la coopration franaise jusqu la survenance du coup dEtat de 1999. La coopration franaise a ainsi appuy la formation initiale et de nombreux sminaires de formation continue des magistrats jusquen 1998 mais ne le fait plus depuis. Cela a fait dire plusieurs interlocuteurs rencontrs que les magistrats promus avant 1999 taient mieux forms que maintenant. Depuis 1999, le Ministre de la fonction publique a renforc son autorit sur la section de la magistrature lENA, surtout aprs que la coopration franaise a mis un 32
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
terme son intervention. Sil est vrai que le dcret du 3 fvrier 2005 a cr lINFJ en le dtachant de lENA, encore faut-il relever que son directeur est lui-mme nomm par le Ministre de la fonction publique et non par le Garde des Sceaux. Avec franchise, certains interlocuteurs de lUnit Etat de Droit de lONUCI ont voqu une certaine dcadence dans la formation et le niveau actuel des magistrats, qui serait lie l'intrusion de la politique et de la corruption dans le recrutement . Certains soutiennent que de nombreux nouveaux magistrats nont pas la vocation mais quils entrent maintenant dans la magistrature par dfaut. Beaucoup ont galement critiqu le recrutement massif de magistrats (50 par promotion pendant quelques annes), avec le soutien de la Banque Mondiale, au dtriment de la qualit. Notons que la dernire promotion de magistrats comptait 10 magistrats civils seulement, ce qui ne peut suffire compenser les dparts la retraite et louverture de nouvelles juridictions. La directrice de lcole de la magistrature, dont les locaux sont situs au sein de lENA, dplore elle aussi le fait que cette cole soit toujours place sous la tutelle du ministre de la fonction publique dont les objectifs diffrent de ceux du ministre de la justice. Quant au concours, il est ouvert chaque anne par un arrt du Ministre de la fonction publique, de lemploi et de la rforme administrative qui prcise les diffrents modules qui seront prsents aux futurs candidats. Lorganisation pratique du concours relve du secrtariat gnral de lENA (Ecole nationale dadministration) sans que la direction de lcole de magistrature ny soit implique. Le jury du concours, compos de hauts magistrats et denseignants luniversit, est prsid par un haut magistrat de la Cour suprme. Elle relve galement que lcole de magistrature na pas de budget propre et que les enseignants ne sont pas trs motivs enseigner lENA, ntant rmunrs qu concurrence de 7500 FCFA de lheure, alors quils peuvent toucher jusqu 25000 FCFA de lheure dans des universits prives. Quant au niveau de la formation qui est dispense aux stagiaires, la directrice reconnat quil est bas. Elle estime cependant quil ne sagit pas dun phnomne spcifique la magistrature mais qui est plus large. Le niveau des auditeurs de justice ne serait ainsi que le reflet de celui des tudiants en droit. Elle reconnat galement que la qualit de deux promotions de magistrats tait discutable. Sagissant dun concours, il arrive malheureusement que le jury soit contraint dadmettre les moins mauvais parmi les mdiocres. Les responsables de lEcole Nationale dAdministration, qui abrite lEcole de Magistrature, ont rfut largument de lintrusion de la politique et de la corruption dans le recrutement . En effet, ils soutiennent que si le concours est admistrativement organis par leurs soins, tous les aspects techniques relatifs aux sujets, la correction et aux dlibrations sont du ressort exclusif dun jury indpendant. Ils ont reconnu toutefois quil est arriv que certains de leurs collaborateurs, se prvalant dune influence suppose, aient reu des sommes dargent, en contrepartie dune admission au concours. Il sagit dactes isols qui nengagent pas la direction de lENA.
33
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
A lheure actuelle, le Ministre de la justice nest pas financirement en mesure dorganiser, pour les magistrats, des activits de formation continue. Les seuls sminaires ou ateliers qui ont lieu sont organiss soit par des oprateurs privs (Caisse Nationale de Prvoyance Sociale, Trsor, etc.) avec lautorisation du Ministre, soit par des ONG nationales ou internationales (Ex. PrSF sur la dtention prventive) avec lappui de bailleurs de fonds, soit par lONUCI (Division des droits de lHomme notamment). Dautres formations, payantes celles-l, sont organises lattention des magistrats et des avocats, Porto Novo au Bnin, lEcole Rgionale Suprieure de la Magistrature (ERSUMA), dans le cadre de la mise en uvre des rformes de lOrganisation pour lHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Par ailleurs, le budget destin la formation continue, quasiment inexistant, est trs souvent vers en fin danne judiciaire, priode qui ne se prte gure lorganisation dactivits de formation lattention des magistrats qui sont en vacances. Si lon souhaite que la justice ivoirienne gagne en efficacit, des moyens supplmentaires doivent tre consacrs la formation des acteurs judiciaires, notamment des magistrats, compte tenu de la dlicatesse de la mission de juger. Une bonne formation initiale, sous la tutelle du Ministre de la justice, ainsi que lassurance dune formation continue de qualit, contribueraient non seulement lamlioration des conditions de travail de ces acteurs, mais surtout lmergence dune justice de meilleure qualit. 1.4.2.2. La formation des greffiers
La formation des greffiers se fait galement au sein de lEcole Nationale dAdministration (ENA). Les greffiers sont unanimes sur le fait que ladite formation est inadapte, surtout quils ne bnficient pas dune formation spcifique en matire de dactylographie et dutilisation de loutil informatique. Ces lacunes les rendent moins oprationnels sur le terrain et affectent leur production et, par voie de consquence, lefficacit de la justice. Par ailleurs, la technologie volue et les exigences vis--vis de la justice augmentent. Il est donc imprieux dorganiser lattention des greffiers des sances de formation continue afin quelles ne soient pas lapanage des seuls magistrats, dont on a vu ci-dessus quils nen bnficient plus non plus. En plus des cours dinformatique, de droit, de tenue des registres, de tenue des dossiers et des techniques de classement et darchivage, il conviendrait aussi de mettre laccent, pour les cadres, sur la gestion du personnel, lorganisation des greffes et la gestion des fonds de greffe. Les greffiers tant rgis par le statut gnral de la fonction publique, ceux-ci souhaiteraient, au-del de lamlioration de la qualit de leur formation, ladoption dun statut particulier revalorisant leurs conditions de vie et de travail, et linstauration dune vritable hirarchisation de leur corps. Les greffiers en chef rclament de rels pouvoirs dadministration (notation et coercition) sur leurs collaborateurs dans lexercice de leurs fonctions. De plus, la fonction de greffier est dvalorise, de sorte que lon assiste une fuite de 34
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
comptence des greffiers vers les autres administrations (diplomatie, administration gnrale etc.). La fonction dadministrateur de greffe et parquet a t cre pour amliorer le profil de carrire des greffiers mais cela ne sest pas encore traduit en pratique par des changements importants. Sans revalorisation du statut de greffier, lon pourrait rapidement tre confront une pnurie de cadres pour occuper ces fonctions. Le corps des greffiers est compos, comme suit, des : 1.5 administrateurs des greffes et parquets qui ont le grade A4 diplme universitaire de matrise ; attachs des greffes et parquets qui sont du grade A3 avec le universitaire de la licence ; secrtaires des greffes et parquets qui sont du grade B3 diplme du Baccalaurat ; assistants des greffes et parquets qui sont du grade C3 avec le du Brevet dEtudes du Premier Cycle (BEPC). La corruption avec le diplme avec le diplme
Cette question est revenue de faon rcurrente dans les propos de tous nos interlocuteurs qui ont admis la ralit et lampleur du phnomne dans le milieu judiciaire. Il sagit de la gangrne de la justice. Elle est suffisamment rpandue pour que la population elle-mme en vienne croire, mme si ce nest heureusement pas toujours vrai, quil est impossible dobtenir une dcision favorable sans paiement. Les personnes contre qui des dcisions dfavorables sont prises souponnent trs souvent, tort ou raison, leurs adversaires davoir corrompu les magistrats ou davoir us de leur influence. Certains ne pensent pas quils pourraient simplement avoir tort au regard du droit. Cela dnote une absence de confiance de la population envers la justice. Or, il faut relever quil existe encore dans le systme judiciaire des magistrats intgres et impartiaux qui ne rendent leurs dcisions quen vertu du droit, comme la dontologie et la loi lexigent. Si certains acteurs de la justice estiment, raison dans une large mesure, que les mauvaises conditions de vie et de travail des magistrats constituent un terreau fertile pour la corruption, dautres, par contre, pensent que quelque soit le niveau de leur rmunration (traitement et indemnits), seule la moralit individuelle de magistrats motivs par leur noble fonction, permettrait de rsister aux multiples influences, interventions, menaces, incitations et pressions conomiques, sociales, familiales, ethniques et politiques qui sexercent sur eux15. Ces
Comme rfrence, citons larticle 2 des Principes fondamentaux relatifs lindpendance de la magistrature adopts par le 7me congrs des Nations Unies pour la prvention du crime et le traitement des dlinquants qui sest tenu Milan du 26 aot au 6 septembre 1985 et confirms par lAssemble Gnrale des Nations Unies dans ses rsolutions 40/32 du 29/11/1985 et 40/146 du 13/12/1985 : Les magistrats rglent les affaires dont ils sont saisis impartialement, daprs les faits et conformment la loi, sans restrictions et sans tre lobjet dinfluences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit . Le ministre de la justice souhaite voir adopter une telle formulation explicite dans la loi portant (nouveau) statut de la magistrature dont le projet a t finalis son niveau.
15
35
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
derniers, tort ou raison, dnoncent le fait que de plus en plus, les jeunes magistrats qui entrent en fonction ne seraient plus mus par lidal de justice mais plutt par lappt du gain. Comme nous lavons dj mentionn, ces mmes personnes vont mme jusqu prtendre que des nouveaux magistrats auraient pay pour lobtention de leurs diplmes ou bnficieraient dappuis de nature politique pour leur promotion. Enfin de nombreux observateurs estiment qu lheure actuelle, certains magistrats sont manifestement au service de partis, de causes ou didologies politiques. Dans le milieu judiciaire, la corruption peut prendre diffrentes formes, selon ce qui a t rapport par de nombreux acteurs judiciaires (magistrats, greffiers, avocats, membres dONG, etc.). La forme de corruption laquelle lon pense immdiatement est le versement de sommes dargent par les justiciables aux magistrats (procureurs et substituts, juges dinstruction et magistrats du sige). Ces sommes peuvent tre spontanment proposes par les justiciables ou tre sollicites par les magistrats, dans le but par exemple, dobtenir une dcision favorable, la rdaction ou la dlivrance rapide dune dcision ou une libration provisoire. La plupart du temps, les magistrats interrogs expliquent que le phnomne est trs rpandu mais quil ne les touche pas personnellement. A mots couverts, ils mentionnent tout de mme quil faut tre dune moralit audessus de la moyenne pour refuser des dessous-de-table importants dans des affaires dont les enjeux conomiques peuvent tre considrables (des dizaines de millions de FCFA), alors quils ont eux-mmes du mal couvrir leurs charges mensuelles et que le montant de leur future pension est trs bas. Les tentations sont importantes et multiples et il est dautant plus facile dy succomber que les risques encourus sont trs limits : les dnonciations de ce type de comportement sont rares ou mal tayes et les organes de contrle (hirarchie, Inspection gnrale des services judiciaires et Conseil suprieur de la magistrature) sont largement dfaillants. Lors dune entrevue avec notre unit, un magistrat a t jusqu avouer explicitement que si une partie un procs, en plus davoir manifestement le droit de son ct, lui proposait de largent, il naurait aucun complexe accepter la somme offerte. Dautres ont admis mots couverts accepter de largent. Des membres du Barreau ont galement mentionn que certains magistrats dconseilleraient carrment aux parties de se faire reprsenter ou assister par des avocats, dans la mesure o leurs honoraires et frais seraient plus onreux que de verser directement de largent au(x) magistrat(s) concern(s), seul(s) matre(s) de la dcision rendre. Dans ces conditions, les avocats sont souvent amens jouer un rle trs actif dans le systme de corruption judiciaire, soit en suggrant leurs propres clients daller sarranger avec le(s) magistrat(s) en charge du dossier, soit en servant dintermdiaires ( les porteurs denveloppes ). Lapplication du principe de la collgialit dans les tribunaux de premire instance et les cours dappel, ne constitue pas une garantie suffisante qui permettrait dempcher la corruption de sexercer, les
36
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
revenus engendrs pouvant tre rpartis entre les 3 magistrats qui sentendent pralablement cette fin. A ct des propositions de sommes dargent, la corruption des magistrats peut prendre des formes plus subtiles. Ainsi, un magistrat peut tre influenc dans ses dcisions par le lien familial, social, ethnique ou amical qui le lie lune des parties. Il sagit dans ce cas de services rendus cette partie pour prserver la paix familiale ou les relations sociales etc. Il peut aussi sagir de services croiss entre un magistrat (gnralement un chef de juridiction) et un oprateur conomique qui aurait rendu un service titre personnel ou qui aurait fait don, par exemple, dquipements au tribunal. En effet, il arrive que certains chefs de juridictions sollicitent des oprateurs conomiques pour quiper leurs juridictions en mobilier ou autres matriels de bureau. Cest le cas de certaines scieries qui ont parfois fourni du mobilier pour garnir les bureaux de magistrats. Ceci met mal lindpendance de la justice, surtout en cas de conflit en matire de droit du travail impliquant ces entreprises bienfaitrices. Ces dernires bnficient alors dune immunit de fait. Des magistrats assis ont aussi mentionn avoir parfois reu des pressions de magistrats hirarchiquement suprieurs pour les encourager trancher une affaire dans un sens ou un autre, en faveur de leur(s) protg(s)16. Par crainte de saliner la hirarchie, qui intervient notamment dans la notation et la promotion des magistrats, ils se plient linvitation exprime au mpris du droit et des droits des parties qui en sont victimes. Enfin, il a mme t fait cas de ce que des faveurs sexuelles seraient loccasion proposes ou sollicites en change dune dcision de justice favorable. En ralit, quon soit magistrat ou avocat, en accdant sa profession, on est directement confront la corruption et, trs vite, le seul choix possible revient soit participer ce systme, des degrs divers selon sa moralit, mme son corps dfendant, soit quitter le milieu judiciaire si lon se souhaite ne pas se compromettre. Plus encore que les magistrats, les secrtaires dactylographes et les greffiers sont exposs quotidiennement aux sollicitations des justiciables, dintermdiaires (les margouillats Abidjan) ou davocats qui souhaitent tous obtenir le plus rapidement possible des jugements, expditions ou autres actes judiciaires ou administratifs (certificats de nationalit, extraits de casier judiciaire, etc.). Bien souvent, ils utilisent leur position privilgie pour satisfaire les personnes qui les motivent le plus souvent en plaant leur dossier au-dessus de la pile , au mpris de lordre chronologique de traitement des dossiers. Pour lutter contre ce flau rpandu, des magistrats ont eu la brillante ide dutiliser des cahiers de transmission qui rvlent la
16
Cest le systme des interventions de suprieurs hirarchiques que les magistrats appellent ironiquement les constitutions par ces suprieurs au profit dune des parties pour des motifs peu avouables.
37
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
date, la trajectoire et la destination des dcisions quils ont rdiges et transmises au greffe pour tre dactylographies. Cela leur permet de refuser de signer des dcisions qui auraient t dactylographies avec une diligence suspecte au dtriment de celles qui ont t pralablement transmises. Cest en effet en exigeant des greffes le traitement strictement chronologique des dossiers que lon pourra empcher leurs agents de senrichir sur le dos des justiciables. Parmi dautres bonnes pratiques, il convient aussi dafficher clairement les montants des frais de greffe partout dans les locaux des juridictions et de sensibiliser activement la population la lutte contre la corruption active et passive. De leur ct, les greffiers rencontrs ont parfois fait mention du fait que les mmes magistrats qui prtendent lutter contre les lenteurs judiciaires et les pratiques inavouables des greffiers nhsitent pas leur demander de droger la chronologie de traitement des dossiers lorsquils sont financirement intresss par les justiciables ou quils veulent favoriser des parents ou des amis. Selon nos interlocuteurs dans les juridictions visites, les cas avrs de corruption des greffiers donnent rarement lieu de vritables sanctions par les greffiers en chef ou par les chefs de juridictions. Les poursuites judiciaires sont encore plus exceptionnelles. La plupart du temps, lorsque les justiciables osent se plaindre des sollicitations financires dont ils sont victimes pour un service que la justice devrait leur fournir sans frais, les fautifs font seulement lobjet davertissements ou de remontrances de leurs suprieurs. Or en labsence de menaces de sanctions claires et immdiates, les personnes corrompues nont gure le souci de modifier leurs habitudes lucratives, ou au mieux, essaieront-ils dtre plus discrets. Sagissant des secrtaires bnvoles, il est encore plus dlicat de les raisonner ou de les sanctionner. En effet, ils/elles officient temps plein au sein des tribunaux mais ne sont pay(e)s quune misre sur les fonds propres des tribunaux (en moyenne 20000 FCFA par mois). Dpourvus de tout statut, ces bnvoles ne prtent pas serment et ne sont tenus ni par la dontologie des greffiers ni par les rgles de la confidentialit. Sans les recettes provenant de leur corruption, ceux-ci refuseraient sans doute de travailler plus longtemps au sein de juridictions qui ont besoin deux parce quelles manquent de personnel. Dans le cadre de la lutte contre les mauvaises pratiques dont fait partie la corruption, lEtat devrait faire des efforts substantiels pour amliorer le traitement des magistrats et des greffiers afin de les mettre labri des besoins minimaux. Il convient galement de rsoudre la question du statut des bnvoles, quils soient secrtaires, gardiens ou interprtes. Enfin, tant que lEtat ne paiera plus les prestations des huissiers de justice, des mdecins et dautres experts, le risque avr est que ceux-ci soient tents dintervenir en faveur des parties qui supporteront leurs frais et leurs honoraires. L encore,
38
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
un effort substantiel doit tre fourni pour que la justice soit quitable pour tous tous les niveaux des procdures. Il faut donc crer les conditions dune justice qui rassure. Avec un salaire de 460.000 francs CFA17, toutes indemnits confondues, pour un magistrat dbutant, il est difficile de lui assurer des conditions de vie dignes de sa prestigieuse fonction. Le serment du magistrat lui impose dtre digne et loyal , mais il est moins ais de cumuler ces deux valeurs de dignit et de loyaut si lon prouve des difficults faire face des besoins lmentaires de la vie courante (dplacements vers le lieu de travail en taxi ou vhicule priv, frais de scolarit des enfants, eau et lectricit, loyer, soutien de la famille largie, etc.). Cest le lieu de saluer les efforts consentis par ltat de Cte dIvoire qui a amlior le traitement des magistrats de la Cour suprme. Cette dynamique devrait pouvoir toucher les magistrats des autres juridictions. Cependant les acteurs de la justice qui se laisseraient habiter par un esprit de prvarication devraient se rappeler le caractre sacerdotal de leur mission et avoir le supplment dme ncessaire pour rsister la tentation de la corruption. Si un engagement politique fort est ncessaire pour amliorer des conditions de vie et de travail des magistrats et des greffiers, il est tout aussi essentiel de prvoir et de mettre en uvre des mesures efficaces de dissuasion pour tout fonctionnaire de la justice qui entrerait en conflit avec la dontologie. Il faudrait donc encourager lide du Ministre de la justice de doter lInspection gnrale des services judiciaires et pnitentiaires de moyens efficients pour accomplir ses missions de contrle et de surveillance des juridictions. Il faut lui donner toute sa fonctionnalit afin quelle puisse sattaquer aux causes des dysfonctionnements de la justice, de la lenteur judiciaire ainsi que traquer tous ceux qui seraient convaincus de corruption, de toutes autres malversations ou dinconduite notoire. Pour redorer son blason, il convient de la mettre en avant, de lui donner les moyens daccomplir ses missions, de placer ses membres devant leurs responsabilits et de ny nommer que des personnes motives et ayant dmontr leur attachement la justice et leurs fonctions. Il faut lui permettre de mener ses missions dinspection de routine selon un calendrier fix lavance mais de mener aussi des missions de suivi inopines. La rencontre de notre unit avec lInspection gnrale des services judiciaires a rvl les difficults de ce service qui sont en bonne partie lies linsuffisance de moyens matriels. Ce service dispose dun effectif de dix personnes mais ne dispose que dun bureau pour lInspecteur gnral : les autres en sont dpourvus et sont pratiquement au chmage technique. Au
Evidemment, cela peut paratre beaucoup par rapport dautres fonctions ou au salaire de magistrats de certains pays de la sous rgion, comme le Burkina Faso. Par contre, par rapport au cot de la vie en Cte dIvoire, aux charges de famille largie et certains fonctionnaires de rang infrieur tels les agents du Trsor, ce salaire parat insuffisant. Ceci dit, cest ltat desprit des magistrats qui importe. Mme si lon multipliait leur salaire par deux, beaucoup dentre eux prouveraient du mal se dpartir des habitudes qui ont t malheureusement prises.
17
39
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
moment de notre visite, lIGSJ avait deux vhicules de tourisme en mauvais tat, alors quil leur faudrait des vhicules tout terrain 4x4 plus adapts aux routes et pistes de province. Cependant, le Ministre de la justice a promis de doter rapidement lIGSJ de nouveaux vhicules dont la livraison tait attendue la fin de lanne 2006. Soulignons que plusieurs magistrats dAbidjan nous ont fait savoir quils navaient jamais reu la visite daucun inspecteur des services judiciaires au tribunal de premire instance et la cour dappel dAbidjan. Cest dire quil ne sagit pas seulement dune question de moyens mais aussi de la volont de lIGSJ de prendre des initiatives et accomplir certaines missions ralisables avec les moyens rduits dont elle dispose actuellement. Selon de hauts magistrats, la question de sanctions appropries est essentielle. Au dbut des annes 80, le Conseil suprieur de la magistrature tait trs fort. Quatre magistrats avaient ainsi t radis en trois ans. Les membres du CSM navaient pas peur de rvoquer des magistrats en cas de corruption ou mme dindiscipline. Aprs cette priode, la politique aurait commenc simmiscer dans le systme : lon aurait alors utilis les cas de fautes disciplinaires / pnales commises comme moyens de chantage et dinstrumentalisation contre certains magistrats des fins politiques. Des magistrats vont jusqu dire quon a organis volontairement limpunit de certains magistrats pour mieux sen servir. Nous avons dj voqu la facilit daccs aux magistrats du sige lie la porosit des locaux abritant les juridictions qui ne prsentent pas, pour la plupart, des garanties de scurit minimales. Si les fonctions du parquet, de par leurs spcificits, autorisent que les magistrats qui les assument, puissent recevoir des justiciables, lon sexplique difficilement que les magistrats du sige, en dehors du Prsident qui est investi de fonctions administratives, prvoient de recevoir les justiciables certaines heures. Ceux-ci ne devraient pas avoir de contact physique du tout avec les magistrats du sige, de sorte limiter la tentation de la corruption. Nous suggrons aussi que le ministre de la justice rflchisse la mise en place dune commission charge de la lutte contre la corruption qui agirait tant dans le cadre de la prvention que du soutien la rpression. Sagissant de la rpression, mme si elle ne sen chargeait pas elle-mme, elle pourrait rassembler des lments de preuve et porter des faits de corruption la connaissance des organes comptents tels que lInspection gnrale des services judiciaires et le conseil suprieur de la magistrature en matires disciplinaire et dontologique ainsi que les parquets concerns pour dventuelles poursuites pnales. Ces organes pourraient ainsi ragir promptement, dans le respect cependant des droits de la dfense. Il faut videmment excs inverse, cest--dire une chasse aux sorcires. En rsum, parmi dautres lments prendre en considration, nous suggrons que des mesures soient prises dans les directions suivantes:
40
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
- la revalorisation du statut et des conditions de travail de tous les acteurs de justice et le paiement des prestations des auxiliaires de justice chargs de missions de service public ; - lapplication de mesures efficaces de restriction daccs des justiciables aux magistrats assis ; - le contrle renforc de la dure de traitement des dossiers (respect systmatique de lordre chronologique dans leur traitement sauf motif extraordinaire) et de la motivation en droit de certaines dcisions par la hirarchie et une IGSJP plus oprationnelle remise flot ; - le renforcement institutionnel de lindpendance du conseil suprieur de la magistrature vis--vis du pouvoir excutif ; - laffichage de tous les frais de greffe lgaux dans chaque juridiction; - une plus grande diffusion de la jurisprudence auprs des magistrats et de la population ; - un accs plus facile de la population lassistance judiciaire pour rendre les procdures plus quitables ; - lobligation terme de prendre toutes les dcisions de justice de manire collgiale (ce qui serait un progrs bien que la collgialit ne constitue pas une arme absolue contre la corruption des magistrats) ; - une campagne de sensibilisation de la population et des entreprises relative la corruption passive et active ; - le renforcement des capacits des organes de contrle du systme judiciaire en vue de sanctions rapides et systmatiques en cas de violations avres de la dontologie et des dispositions du code pnal par les acteurs judiciaires; - la constitution dune cellule anti-corruption crdible et dote de moyens importants au sein du Ministre de la justice. 1.6. La question de lindpendance de la magistrature
Dans lintrt suprieur de la justice et de la socit, la profession de magistrat requiert quil prserve son intgrit morale et dfende lindpendance de la magistrature. Nous nous attarderons ici sur trois points spcifiques : pour sexercer, cette indpendance ncessite notamment des systmes de nomination (1.6.1) et de promotion (1.6.2) objectifs et transparents ainsi que le respect des principes de la soumission exclusive des magistrats lautorit de la loi et de linamovibilit des magistrats du sige (1.6.3). 1.6.1. La nomination des magistrats Cette dlicate question est au cur de lactualit et des proccupations des diffrents magistrats rencontrs. Lon sait effectivement que depuis octobre 2004 le ministre de la justice et la Prsidence de la Rpublique se sont souvent opposs ce sujet par voie darrts ou de dcrets dont la lgalit a pu tre remise en cause. Les magistrats souhaiteraient dans leur ensemble que les procdures soient plus transparentes et moins marques par la
41
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
politique. En effet, toute mthode de slection des magistrats doit prvoir des garanties contre les nominations abusives18. Cette question a connu une volution notable avec la constitution du 1er aot 2000, en son article 106, qui fait du Conseil Suprieur de la Magistrature un organe incontournable de la nomination et de la discipline des magistrats. Certaines difficults lies lapplication de ces dispositions constitutionnelles subsistent cependant, puisque larticle 107 de la mme constitution dispose qu une loi organique dtermine les conditions dapplication des dispositions relatives au Conseil suprieur de la magistrature . Or cette loi organique nest pas encore adopte ce jour. En outre, la composition actuelle du conseil suprieur de la magistrature nest pas conforme celle qui est prvue par la constitution, en ceci que cette institution doit comprendre dsormais les prsidents des juridictions suprmes que seront la Cour de Cassation, le Conseil dEtat et la Cour des Comptes, la Cour Suprme actuelle tant condamne disparatre. Or, les lois organiques qui fixent la composition, lorganisation et le fonctionnement de ces juridictions, nont pas encore t adoptes. Dans lattente de ladoption de ces diffrents textes, le conseil suprieur de la magistrature parat devoir fonctionner et exercer ses attributions, en application des dispositions transitoires de larticle 130 de la constitution, conformment aux lois et rglements en vigueur prcdemment. Larticle 5 de la loi actuelle portant statut de la magistrature, laisse une grande marge de manuvre au pouvoir excutif (Ministre de la justice et Prsident de la Rpublique) dans la procdure de nomination des magistrats. Cette loi devrait tre revue pour reflter les changements constitutionnels et introduire des rformes salutaires. Lintrt des nouvelles dispositions constitutionnelles rside dans le fait que la comptence de lExcutif (Ministre de la justice et Prsident de la Rpublique) dans la nomination des magistrats nest plus aussi discrtionnaire quavant. En effet, le conseil suprieur de la magistrature aura dsormais le pouvoir de proposer la nomination des magistrats des juridictions suprmes, des premiers prsidents des cours dappel et des prsidents de tribunaux de premire instance, tandis quil donnera son avis conforme la nomination et la promotion des autres magistrats du sige , l o son simple avis tait sollicit jusqu prsent. Le dbat qui a entour la question de la nomination des magistrats ces dernires annes pourrait tre lucid par ladoption des lois organiques relatives aux juridictions suprmes et au conseil suprieur de la magistrature, et surtout par le vote dune nouvelle loi portant statut de la magistrature prenant notamment en compte la nouvelle donne constitutionnelle.
Article 10 des Principes fondamentaux relatifs lindpendance de la magistrature adopts par le 7me congrs des Nations Unies pour la prvention du crime et le traitement des dlinquants qui sest tenu Milan du 26 aot au 6 septembre 1985 et confirms par lAssemble Gnrale des Nations Unies dans ses rsolutions 40/32 du 29/11/1985 et 40/146 du 13/12/1985.
18
42
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
1.6.2. La promotion des magistrats sur base de lvaluation et de la notation La promotion des juges doit tre fonde sur des facteurs objectifs, notamment leur comptence, leur intgrit et leur exprience 19. Les magistrats ont dnonc le systme actuel dvaluation et de notation qui laisse une grande marge larbitraire et ne garantit pas suffisamment leur indpendance. En fin danne judiciaire, les chefs de juridiction procdent lvaluation de chaque magistrat plac sous leur responsabilit. Il sagit des premiers prsidents de cours dappel et des prsidents de tribunaux en ce qui concerne les magistrats du sige, et des procureurs gnraux et procureurs de la Rpublique concernant les magistrats du parquet. Le chef hirarchique value le magistrat selon une grille consigne sur le bulletin de notation. Il arrive souvent que les magistrats soient frustrs de voir le Premier Prsident de Cour dAppel ou le Procureur Gnral leur attribuer une note qui ne serait pas le reflet de lvaluation de leur chef direct, cest--dire le prsident du tribunal ou le procureur de la Rpublique. Les magistrats sexpliquent difficilement que ces derniers, qui connaissent mieux leurs collaborateurs pour les ctoyer au quotidien, ne donnent quun avis secondaire dans lapprciation de leurs performances. Il est en effet rare que les premiers prsidents de cours dappel ou les procureurs gnraux connaissent rellement la qualit du travail des magistrats quils ont valuer. Cette situation est dmotivante, de sorte que les magistrats, dans leur grande majorit, appellent une vritable rforme du systme de notation qui, dans sa formule actuelle, les fait dpendre du bon - vouloir de leurs suprieurs hirarchiques. Ces derniers donnent leur carrire une courbe qui ne reflte pas toujours leurs comptences et leurs performances. Par ailleurs, beaucoup se sont plaints du fait que des considrations politiques, rgionales ou ethniques entreraient en ligne de compte dans le systme de notation, ce qui rejaillirait par voie de consquence, sur les promotions. Certains magistrats ont prconis que soient rgulirement organiss des examens ou des concours internes pour tre valus sur des bases objectives. Les critres de cette valuation pourraient tre dfinis par lensemble de la corporation et consigns dans la loi rvise portant statut de la magistrature. Dautres magistrats sont moins enthousiastes lvocation dune telle formule car ils estiment quelle aurait dj t tente et aurait abouti un chec dans le pass. Mentionnons galement que le mode de fonctionnement de la commission charge de la promotion et de lavancement des magistrats a fait lobjet de critiques dun grand nombre de magistrats rencontrs.
Article 13 des Principes fondamentaux relatifs lindpendance de la magistrature adopts par le 7me congrs des Nations Unies pour la prvention du crime et le traitement des dlinquants qui sest tenu Milan du 26 aot au 6 septembre 1985 et confirms par lAssemble Gnrale des Nations Unies dans ses rsolutions 40/32 du 29/11/1985 et 40/146 du 13/12/1985.
19
43
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
1.6.3. La soumission exclusive des magistrats lautorit de la loi dans lexercice de leurs fonctions et le principe de linamovibilit des magistrats du sige Larticle 103 de la Constitution dispose que les magistrats ne sont soumis, dans lexercice de leurs fonctions, qu lautorit de la loi. Cette question de limpartialit20 rejoint largement celle de la corruption dveloppe plus haut. Pour rappel, cette disposition nest pas toujours respecte, eu gard de fortes pressions dordres sociologique, administratif, matriel et mme politique. Ainsi, le poids des relations familiales et amicales complique parfois lexpression de la justice, les parents et les amis tant toujours prompts intercder auprs du magistrat afin quune suite favorable soit donne leurs dossiers. Le juge qui devrait rendre des dcisions se trouve ainsi contraint de rendre des services des privilgis pour conserver ses bonnes relations sociales. Les pesanteurs dordre administratif se caractrisent par la pression qui peut provenir dun suprieur hirarchique auquel le juge aurait du mal rsister. Quant la corruption, lon note que les difficiles conditions de vie et de travail des magistrats les inclinent plus facilement cder la tentation des dessous de table , surtout lorsquils ont prendre une famille largie en charge. Enfin, compte tenu de lemprise du pouvoir politique sur la vie sociale, emprise qui sest accrue ces dernires annes, certains magistrats font difficilement abstraction de leurs convictions politiques dans laccomplissement de leur mission. Ils sestiment tre protgs et, ce titre, ne pensent plus dpendre daucune hirarchie en dehors de celle de leur affiliation politique. Personne ne leur a retir volontairement leur indpendance mais ils en font mauvais usage et salinent. Cette emprise a pu faire natre des suspicions dans la nomination et la promotion des magistrats ces derniers temps, y compris en relation avec les audiences foraines. Sil est vrai quil faut un environnement institutionnel et lgal propice lmergence dune justice indpendante, le magistrat doit lui-mme avoir le courage de faire face, avec lucidit, toutes les pressions, ingrences, influences et interfrences, quelles soient directes ou indirectes et de la part de quiconque. Cette intgrit fait ncessairement partie intgrante de la dontologie et de la profession du magistrat dont on attend un comportement exemplaire, au-dessus de tout soupon. Le principe de linamovibilit des magistrats du sige, qui participe de la consolidation de lindpendance de la justice, implique quaucun dentre eux ne peut recevoir de nouvelle affectation sans son consentement, mme en avancement. Au niveau des standards internationaux, larticle 12 des principes fondamentaux relatifs lindpendance de la magistrature confirms par lAssemble Gnrale des Nations Unies dans ses rsolutions 40/32 du 29/11/1985 et 40/146 du 13/12/1985 prvoit que les juges, quils soient nomms ou lus, sont inamovibles tant quils nont pas atteint lge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat . Selon nos interlocuteurs,
Pour rappel, citons larticle 7, 1. d) de la Charte Africaine des Droits de lHomme et des Peuples qui prcise, parmi dautres principes fondamentaux, que toute personne a le droit dtre juge par une juridiction impartiale.
20
44
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
ce principe nest pas non plus toujours respect. Ces dernires annes, des magistrats du sige reoivent parfois de nouvelles affectations sans leur consentement, dans lintrt du service. De plus, les mutations opres au titre de sanctions ne sont pas non plus une solution ; cela ne fait que reporter le problme et retarde mme le processus judiciaire puisquil arrive aux magistrats muts demporter des dossiers non termins avec eux. Par ailleurs, nous avons constat quen Cte dIvoire des magistrats passent trs aisment (et parfois plusieurs fois dans leur carrire) de la magistrature assise au parquet et inversement ou dune de ces deux fonctions au ministre de la justice. Cette situation est malsaine car le magistrat du sige daujourdhui, cens exercer ses fonctions en toute indpendance et impartialit, peut devenir demain membre du parquet, soumis la hirarchie du ministre public et du Garde des Sceaux, ou mme membre de la Chancellerie. Cette possibilit est de nature influencer gravement lindpendance et limpartialit du magistrat du sige durant sa carrire, qui reste sous la menace de changements daffectation, vritable pe de Damocls. La solution rside en la cration de deux carrires distinctes : celle des procureurs et celle des juges inamovibles. A tout le moins, il faudrait rendre impossible le retour au parquet ou la chancellerie des magistrats du sige. 1.7. Laccs la justice
Laccs la justice recouvre la possibilit gale pour chaque citoyen de saisir les parquets et les tribunaux afin dy voir ses droits et intrts dfendus. De cet accs quitable la justice, quels que soient sa nationalit, son ge, sa race, son ethnie, sa religion, son domicile, son niveau social ou son degr dducation, dpend en grande partie le respect et lexercice des droits de la personne les plus fondamentaux. La justice est appele tre rendue, non pas au seul profit des citoyens aiss ou duqus, mais au bnfice de tous. Cet accs la justice passe galement par la sensibilisation et linformation de la population. En Cte dIvoire comme dans de nombreux pays africains, la proportion de la population qui a pleinement accs la justice est trs faible, en raison de son ignorance des procdures suivre, de son loignement gographique des tribunaux ou encore et surtout de son manque de moyens financiers. Les modes de saisine de lappareil judiciaire et les frais payer varient notamment en fonction de lobjet du litige. En matire pnale, le justiciable peut saisir les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, mais il peut galement saisir directement, soit le procureur de la Rpublique dune plainte, soit le juge dinstruction dune plainte avec constitution de partie civile. Dans ce dernier cas, comme en ce qui concerne la saisine du tribunal correctionnel par citation directe, une consignation sera fixe par le juge dont le montant varie de 5 10% de lintrt du litige. En cas de citation directe, le justiciable aura supporter les frais dhuissier (25000 FCFA minimum).
45
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
En matire civile, le principe est le mme, en ce que des frais doivent tre pays au greffe. Le montant de ces frais slve 2,5 % de lintrt du litige pour les droits proportionnels et varie de 10 000 30 000 FCFA pour les droits fixes. Le justiciable aura galement sacquitter des frais dhuissier. Pour remdier ces obstacles matriels infranchissables pour lcrasante majorit des justiciables, la loi a prvu un systme dassistance judiciaire. Celui-ci obit malheureusement des rgles qui rendent difficiles son exercice. 1.7.1 Lassistance judiciaire Cette question est examine tant au niveau des textes que de leur application. 1.7.1.1. Les textes rgissant lassistance judiciaire
Ce sont les articles 27 31 du code de procdure civile qui organisent lassistance judiciaire. Larticle 27, le plus important dentre eux, dispose que : Lassistance judiciaire, hors le cas o elle est de droit, a pour but de permettre ceux qui nont pas de ressources suffisantes, dexercer leurs droits en justice, en qualit de demandeur ou de dfendeur, sans aucun frais. Lassistance judiciaire peut tre accorde en tout tat de cause toute personne physique, ainsi quaux associations prives ayant pour objet une uvre dassistance et jouissant de la personnalit civile. Elle est applicable : 1 A tous litiges ports devant toutes les juridictions ; 2 En dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires. Au regard de ce texte, lassistance judiciaire peut tre demande tant en matire civile, commerciale, administrative que pnale. Les articles 28 31 dfinissent son champ dapplication et les conditions de retrait du bnfice de lassistance judiciaire. Le dcret n 75-319 du 9 mai 1975 fixant les modalits dapplication de la loi n72-833 du 21 dcembre 1972 portant code de procdure civile, commerciale et administrative, en ce qui concerne lassistance judiciaire, dtermine le mode de fonctionnement du bureau national de lassistance judiciaire, les conditions dobtention du bnfice de lassistance judiciaire, les consquences pour son bnficiaire et les cas dans lesquels lassistance judiciaire peut tre retire.
46
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
1.7.1.2.
Lapplication des textes
Dans les juridictions visites, les juges relvent unanimement que les justiciables de leurs ressorts ne bnficient pratiquement jamais de lassistance judiciaire. Pourtant, les besoins sont rels en raison du grand nombre dindigents qui devraient tre dfendus en justice. Une assistance judiciaire performante rencontrerait le souci de respecter les droits de la dfense et les principes du contradictoire et de lgalit des armes. La possibilit dobtenir lassistance judiciaire est mconnue de la plupart des gens. Pour les justiciables qui choisissent tout de mme dy recourir, la lourdeur et la complexit de la procdure est bien souvent dissuasive. La proportion des personnes qui en bnficient in fine par rapport au nombre total de parties nest pas connue mais, si lon sen tient aux dclarations des acteurs du systme judiciaire lors de notre enqute, elle serait marginale ou quasi-inexistante. La tendance est encore plus marque en province qu Abidjan, tant donn que le bureau national dassistance judiciaire sige la Chancellerie. Seul bmol ce constat gnral : lassistance judiciaire (de droit) est utilise en matire pnale lors des sessions de cours dassises (articles 274 276 du code de procdure pnale) et devant le tribunal militaire, par le biais des commissions doffice davocats (pour lesquelles les avocats ont fini par obtenir des indemnits21 aprs des revendications de longue date). Malheureusement, ces commissions doffice davocats interviennent au stade bien trop tardif du procs lui-mme alors quune intervention efficace ncessiterait leur dsignation, soit ds larrestation ou le dferrement, soit en cours dinstruction du dossier. Selon le Btonnier de lOrdre des avocats, il est anormal que le dossier soit prpar par un juge dinstruction et le parquet et que lavocat, lui, nen prenne connaissance qu la dernire minute, laudience. Il lui est alors impossible de demander des contre-expertises en labsence de largent ncessaire ; la dfense ne peut ds lors travailler dans de bonnes conditions. Lavocat doit plaider le dossier tel quil lui a t remis sans quil ait pu avoir aucune influence sur son contenu au cours de la procdure. Quant aux commissions doffice prvues en faveur des mineurs, larticle 770 CPP tablit que le juge des enfants dsigne ou fait dsigner par le btonnier un dfenseur doffice dfaut de choix dun dfenseur par le mineur ou son reprsentant lgal . Cette disposition du code nest utilise que trs rarement, les avocats tant dmobiliss en raison de labsence de mcanisme de rmunration des avocats commis doffice. Les mineurs restent ds lors sans dfense en dpit des termes de la loi.
21
Se rendre aux audiences dassises en dehors dAbidjan peut savrer trs coteux (perte de temps et donc de clients, transport, logement, repas, etc.). Lindemnit prvue actuellement pour les avocats varie selon la distance mais peut aller de 100000 300000 FCFA par dossier plaid.
47
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
La procdure suivre pour obtenir lassistance judiciaire gagnerait tre connue de tous, car lorsque lassistance judiciaire est accorde, le bnficiaire na pas supporter les frais de justice (frais de greffe et dhuissier notamment). Il na pas non plus payer les honoraires et frais des avocats dsigns par le Btonnier lorsquil perd son procs. Ce nest pas le cas lorsquil lemporte. Dans ces conditions, les avocats acceptent plus facilement leur dsignation doffice dans les procdures civiles ou commerciales o il y aura une somme importante recouvrer. Cela leur permet en effet de percevoir des honoraires en cas de recouvrement mais ce mcanisme ne favorise absolument pas la dfense des indigents par les avocats en matire pnale, en dehors des assises. Il serait cependant trop simple de blmer outre mesure les avocats commis ou dsigns doffice, qui se dsintressent des dossiers pnaux ou des dossiers relatifs aux mineurs, en invoquant leur manque de professionnalisme et de dvouement. Sil est normal que le Barreau, travers ses membres, auxiliaires de la justice, participe un service public par lassistance dindigents, le systme existant ne favorise pas les vocations ou la motivation des avocats dfendre leurs intrts. Lon ne peut tre exigeant vis--vis davocats dcourags par le fait que le Trsor ne couvre mme pas une partie de leurs frais en dehors des assises. A fortiori, les affaires qui ncessitent des dplacements en province ne voient pas les avocats dsigns intervenir. Les failles du systme dassistance judiciaire ont des consquences dsastreuses, de laveu mme du Btonnier de lOrdre des avocats de Cte dIvoire, sur le fonctionnement, lquit, la qualit et la lenteur de la justice. Ainsi, les forces en prsence sont dsquilibres et des parties sont dsavantages au procs par leur ignorance des procdures et labsence de conseils aviss ; des dtenus provisoires sont oublis et ne peuvent faire valoir leurs droits tous seuls et les voies de recours ne sont pas exerces dans les dlais prescrits, surtout en matire pnale. Le Barreau de Cte dIvoire se voit bien jouer un rle central dans le cadre dune assistance judiciaire rnove et rclamer de lEtat une subvention cet effet sur le Fonds pour payer les avocats qui se chargeraient des dossiers des indigents. Certains magistrats ont propos la dcentralisation du bureau de lassistance judiciaire, log Abidjan, au sige de chaque cour dappel court terme, et de chaque tribunal de premire instance moyen terme, afin de rapprocher ce service des justiciables et lassouplissement de la procdure pour une meilleure accessibilit. Cela parat une excellente ide dont lapplication ncessitera cependant un suivi de qualit par le Ministre de la Justice. Par ailleurs, outre lignorance et le manque de moyens financiers, les pesanteurs culturelles et traditionnelles constituent galement un obstacle laccs la justice moderne dans certaines juridictions. En effet, Abengourou par exemple, la chefferie traditionnelle a une influence telle que la justice se retrouve en bout de chane : elle nest saisie que lorsquil ny a pas eu de solution un problme donn, au niveau de la chefferie 48
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
traditionnelle. Le Roi est vnr et la population accepte assez souvent sa dcision, si bien que les contentieux judiciaires sont peu nombreux. Dans un sens, ce nest pas plus mal, larbitrage du Roi supplant labsence de flexibilit et de rapidit du systme judiciaire. Cependant, une fois la justice saisie, le Roi ninterfre pas dans la prise de dcision. Il sagit de deux entits totalement indpendantes. Concernant lassistance concrtes suivantes: judiciaire nous suggrons les mesures
la rvision de la procdure dassistance judiciaire qui doit tre simplifie et bnficier un plus grand nombre de justiciables indigents; une campagne dinformation des justiciables en ce qui concerne la procdure suivre pour bnficier de lassistance judiciaire ; la dcentralisation progressive du bureau de lassistance auprs de chaque tribunal de premire instance et de chaque cour dappel ; la dsignation des avocats commis doffice un stade prcoce de la procdure, celle-ci devant tre systmatique en faveur des mineurs dtenus et dans les affaires criminelles, les dtenus bnficiant dune prsomption dindigence ; confier la responsabilit de lorganisation et du suivi quotidien du systme dassistance judiciaire au Barreau de Cte dIvoire comme cela se fait dans de nombreux pays, la gestion du budget dassistance judiciaire tant soit conserve par lEtat, soit confie galement au Barreau moyennant contrles et audits rguliers ; Le paiement des frais des avocats commis doffice devrait intervenir intervalles rguliers, mais uniquement pour les dossiers clturs et condition quils aient rempli leurs obligations (rapports de prestation, production de jugement ou daccord etc.) selon le Barreau22.
1.7.2. Le recours aux avocats Les justiciables nont que rarement recours aux avocats essentiellement pour deux motifs : le cot lev de leurs honoraires et frais et leur concentration quasi exclusive Abidjan, capitale conomique. En consquence, les justiciables ne sont gnralement pas assists davocats tant pour les procdures civiles que pour les procdures pnales. La situation est plus alarmante encore en matire pnale o les prvenus ne sont quexceptionnellement dfendus lors les audiences correctionnelles et devant le juge dinstruction pour les crimes de sang. Labsence davocats aux cts des parties ne permet pas de garantir les droits de la dfense ni dassurer un meilleur suivi des dossiers en ce qui concerne la clrit de leur traitement et
22
Pour ne pas dpasser le budget allou par lEtat, lenveloppe budgtaire dune anne prcise pourrait tre divise par le nombre de points obtenus, selon des barmes pr-tablis par le Barreau, par lensemble des avocats pour les procdures menes durant cette priode. Le rsultat obtenu est la valeur du point pour cette anne-l. Il ne reste plus qu le multiplier par le nombre de points obtenus individuellement par chaque avocat avant de le payer. Ce systme classique est notamment utilis en Belgique et donne de bons rsultats. Au niveau du suivi, un tel systme ncessite au moins un secrtariat performant, disposant de logiciels de gestion, et le dvouement davocats expriments pour pauler les avocats plus jeunes.
49
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
lexercice des voies de recours. La perte se situe galement au niveau de la contribution juridique des avocats aux dbats qui permet souvent de contribuer la formation continue des magistrats. Certains magistrats ont dplor cette situation qui les oblige dans certaines circonstances, dans lintrt du justiciable, jouer le rle de lavocat en lui donnant des conseils pour un meilleur aboutissement de son dossier. Cela va lencontre des rgles dimpartialit que le magistrat doit observer. Ainsi, il arrive que le juge dinstruction suggre des demandes de mise en libert provisoire ou dautres actes de procdure etc. Pour ne donner quun exemple frappant, aucun avocat ne sest rendu laudience de la section dtache de Tabou depuis plus dun an. Le lgislateur a anticip ce type de situation, en naccordant pas le monopole exclusif dassistance aux avocats mais en donnant la possibilit des personnes extrieures (membres de la famille ou reprsentants) de reprsenter les parties en justice, moyennant un mandat exprs. Il serait donc parfaitement possible que des ONG engagent des para - juristes ou, mieux, des juristes, avec laccord du Ministre de la justice, dans le cadre de lassistance judiciaire aux dtenus ou aux autres personnes indigentes, spcialement dans les zones les plus loignes dAbidjan. Le Barreau na effectivement pas, lheure actuelle, la capacit dassister tous les indigents en justice, surtout lorsque des dplacements doivent tre envisags. Le Barreau compte actuellement 490 avocats, stagiaires compris. Il ny a quun seul Barreau actuellement mme si la loi prvoit la possibilit den crer dautres auprs des siges de cours dappel. Le Btonnier a expliqu quavant septembre 2002, le nombre davocats installs Bouak tait suffisant pour crer un Barreau sur place mais quils ne lont jamais fait, pour des motifs relatifs la rentabilit financire. Lavenir passe cependant par la cration dautres barreaux que celui dAbidjan, dans le souci de se rapprocher des clients potentiels. Celui de Bouak pourrait dfinitivement voir le jour la fin de la guerre lorsque la capitale aura t transfre Yamoussoukro. 1.7.3. La ncessit douvrir de nouvelles juridictions Pour assurer lgal accs des citoyens au service public de la justice, il serait essentiel de se concentrer sur louverture et le fonctionnement de juridictions dj cres par dcret mais qui nont jamais t oprationnelles, telles que les Cours dAppel de Man, de Korhogo et dAbengourou ou les Tribunaux de Premire Instance dAbobo, de Port-Bout, de Guiglo notamment. Ainsi le TPI de Guiglo devrait tre ouvert en priorit, cette rgion, qui se situe dans le ressort territorial du TPI de Man, non oprationnel, tant dpourvue de toute justice depuis septembre 2002. Pour illustrer les difficults daccs la justice, relevons le cas dun justiciable qui rside Bondoukou et qui souhaite relever appel dune dcision de justice rendue par la section du tribunal. La cour dappel comptente est celle dAbidjan, pourtant distante de plus de 400 km. Son 50
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
dossier transitera dabord par le TPI dAbengourou avant dtre transmis la cour dappel. Connaissant les lenteurs de la justice et larrir judiciaire de cette cour, il ne lui suffirait pas de se rendre une seule fois Abidjan pour suivre le cheminement de son dossier jusqu sa fixation. Il est ncessaire de rapprocher durablement la justice des justiciables, et non dans le seul cadre temporaire des audiences foraines. Cela ncessite des investissements en infrastructures, quipement et en personnel. 2.
Quelques questions spcifiques
Parmi les difficults qui ont t releves lors de nos enqutes de terrain, nous avons choisi den approfondir trois relatives au sige. 2.1. Les difficults daccs la jurisprudence.
Une des grandes dficiences laquelle les magistrats sont confronts dans lexercice de leurs fonctions tient au fait quils nobtiennent pas les arrts des cours dappels ou de la cour suprme (cour de cassation) rendus lorsquune voie de recours a t exerce lencontre de leurs dcisions. Les juges de section, dj isols gographiquement, nont aucun cho de la valeur juridique des jugements quils rendent. Cette absence de communication entre les juridictions et, plus gnralement, les difficults daccs la jurisprudence, peut engendrer la rcurrence de leurs erreurs. Soulignons galement les avantages que les autres professionnels du droit et les justiciables pourraient tirer dune jurisprudence largement accessible. Avec un minimum de moyens, il serait possible de crer un bulletin de jurisprudence dans le ressort de chaque cour dappel qui serait mis gratuitement la disposition des juridictions concernes afin de leur permettre de rorienter leurs positions sur des questions de droit ou de procdure. Un recueil des arrts de la cour de cassation pourrait lui aussi tre publi et largement diffus auprs des magistrats et des autres professionnels du droit. Cette proccupation de labsence daccs aux dcisions des juridictions suprieures est partage par les diffrents chefs de tribunaux et de cours que nous avons rencontrs, notamment les Premiers Prsidents des cours dappel dAbidjan et de Daloa. Nous leur avons suggr un moyen moins coteux dy arriver dans un premier temps : faire simplement une copie supplmentaire de toutes les expditions des arrts rendus, les rassembler par juridiction de premier degr concerne et les expdier mensuellement celles-ci avec le reste du courrier qui leur est adress. Cest simple, bon march et efficace. Tous les magistrats rencontrs ont adhr cette ide qui permettrait dassurer une meilleure communication entre les juridictions de diffrents degrs (qui ne fonctionneraient ds lors plus en vase clos mais dans la
51
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
transparence), de contribuer la formation continue des magistrats des juridictions infrieures et de rduire le risque de persistance des erreurs judiciaires. Quelques magistrats ont sembl cependant mettre des doutes sur la qualit des arrts rendus par les cours dappel et des difficults adhrer leurs raisonnements juridiques. Une autre possibilit serait dtablir un cadre dchanges priodiques entre les magistrats et leur hirarchie afin de dresser le bilan du fonctionnement des juridictions et de lapplication des textes. De telles initiatives pourraient permettre terme de rduire lopacit qui parat entourer les motivations en droit des dcisions de justice et duniformiser davantage lapplication du droit. Le ministre de la Justice pourrait galement sen servir pour prendre linitiative de modifier certaines lois ou rdiger des circulaires ministrielles. 2.2. Les renvois intempestifs et multiples des dossiers fixs
Tant en matire civile que correctionnelle (audiences de citation directe), lon note dans la plupart des juridictions visites que les dossiers sont trs souvent renvoys quinze jours voire mme un ou deux mois. Ces renvois multiples et rptitifs participent la lenteur judiciaire ou lengorgement de certaines juridictions. Ils sont justifis : par le dfaut de comparution des parties ou des tmoins ; par le non-retour des citations des parties ou des rapports dexpertises ; par labsence dexcution des jugements avant - dire droit (par exemple les enqutes ordonnes en matire dtat civil), par le temps pris par les avocats ventuels pour changer leurs conclusions ou produire leurs pices ; par les retards accumuls par le parquet pour donner son avis en matire civile dans les affaires communicables ou pour accomplir dautres formalits procdurales.
Il faut mentionner que les huissiers de justice, que lEtat nhonore plus depuis plusieurs annes, marquent trs peu de diligence dans lexcution des mandements de citation et des significations, moins quune des parties ne les paie titre personnel23, ce qui une fois de plus rompt le ncessaire quilibre entre les parties et dmontre que la justice rendue lest souvent au bnfice des plus nantis. Si lon peut comprendre le manque de motivation des huissiers, lesquels doivent continuer vivre de leur travail, lon ne peut que dplorer le fait quils aient en quelque sorte dmissionn du rle que la loi leur assigne : celui dauxiliaires de justice au service du public. Lorsquils tiennent sacquitter de leur mission, il faut regretter que, par facilit, les huissiers qui ne souhaitent pas mener de longues recherches pour localiser une personne ou effectuer de longs dplacements pour la citer, en viennent
23
En matire pnale, voyez leurs obligations lgales dfinies aux articles 543 560 du CPP ainsi que les articles 101 et 319 du mme code de procdure pnale.
52
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
citer systmatiquement mairie ou parquet. Cette pratique aboutit ncessairement des jugements par dfaut, les parties ntant pas directement informes, et ne fait que reporter le problme plus tard, lorsquune tentative dexcution du jugement rendu aboutira une opposition ou un appel. Devant la gravit de la situation et pour contourner ces difficults, certains magistrats prconisent que les parties se prsentent laudience sur simple convocation du procureur de la Rpublique, comme cest le cas en matire de flagrants dlits. Signalons enfin quen matire pnale, les magistrats nhsitent plus sen tenir aux textes et juger les prvenus par dfaut aprs 2 renvois successifs pour les mmes motifs, quels quils soient. Certains continuent cependant, titre exceptionnel, renvoyer une affaire plus de deux fois sils lestiment ncessaire. Les jugements par dfaut permettent dans limmdiat de ne pas accumuler darrir judiciaire en matire pnale. Si lopposition est exerce, la charge de travail cumule est cependant plus importante. Mentionnons que les renvois intempestifs la cour dappel Abidjan sont principalement dus labsence du dossier ou du jugement crit prononc en premire instance. Sur 160 dossiers enrls, 70 ne contiennent pas les dcisions crites et les renvois sont ordonns indfiniment. Il arrive aussi que les dcisions se perdent parce que des magistrats emportent les dossiers avec eux lors de nouvelles affectations et ne les retournent plus ensuite. 2.3. Le retard dans la dlivrance des dcisions de justice
Les magistrats visits sont unanimes pour dire que les dcisions ne sont gnralement pas remises aux parties dans de courts dlais aprs leur prononc en audience publique, ce qui empche leur excution et lexercice des voies de recours dans de bonnes conditions. A part les difficults rcurrentes des secrtariats saisir les dcisions rapidement et sans faute, la cause de retard la plus proccupante est labsence de rdaction de certains jugements au moment o les magistrats les prononcent. Cette situation est particulirement grave et nest pas compatible avec une justice impartiale et de qualit. Le corps des jugements rendus en premier ressort nest parfois rdig que des semaines ou des mois aprs leur prononc, parfois uniquement parce quun appel a t interjet. Quoi de plus inquitant pour la scurit juridique quune justice qui ne parat reposer sur aucun fait ni sur aucun raisonnement juridique construit, sur aucune motivation, ceux-ci ne suivant la dcision que bien plus tard ? Comment peut-on imaginer en effet, au pnal, rendre une dcision de culpabilit et de condamnation 20 ans demprisonnement ou la perptuit sans quelle repose sur des arguments de droit et pas uniquement sur lintime conviction du juge ? Il va sans dire quune telle pratique de rdaction tardive des jugements en premire instance contribue au sentiment gnral de mfiance de la population vis--vis de la justice. La rdaction de factum devient dautant plus problmatique lorsquun magistrat est mut. Lobtention du jugement crit devient alors hypothtique puisquelle dpend de la bonne volont mise par le juge rdiger son jugement, pour autant quil 53
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
se souvienne encore de laffaire. Or, tant que le factum du jugement nest pas rdig, il est impossible de revtir le jugement de lautorit de la chose juge ou, en cas dappel, denrler laffaire. Alors que dans bien des systmes juridiques, la motivation en fait et en droit de la requte dappel constitue une condition de fond mise sa recevabilit, en Cte dIvoire, il est souvent impossible de motiver convenablement une requte dappel introduite dans les dlais lgaux contre un jugement sans motivation. A tout le moins faudrait-il forcer les juges concerns rendre et signer tous leurs jugements avant de rejoindre toute nouvelle affectation et tre moins complaisant vis-vis de telles pratiques. Une autre raison du retard dans la dlivrance des jugements est le commerce illicite qui sest instaur autour de la dlivrance des dcisions, civiles et commerciales notamment et auquel les greffiers et secrtaires se livrent (voir, la section consacre la corruption ci-dessus). L o ce systme fonctionne, les dcisions qui sont rdiges rapidement sont celles pour lesquelles les auteurs de la rdaction sont rtribus. Enfin, il faut citer pour rappel le privilge des relations ou connaissances et la parent au nom desquelles une dcision rcente sera rdige et dlivre avant une dcision plus ancienne. Ici encore, comme cela a dj t mentionn, deux principes doivent tre rigoureusement observs par les magistrats : 1 Ne prononcer de dcision que si elle est dj rdige ; 2 Donner instruction aux greffiers et secrtaires de saisir ou dactylographier les dcisions prononces dans un ordre strictement chronologique, sans drogation et sous peine de sanctions.
54
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
CONCLUSION Au terme de notre dmarche, guide par le souci de comprendre le systme judiciaire ivoirien, travers son organisation et son fonctionnement, nous pouvons retenir que la Cte dIvoire sest dote dun arsenal juridique et dinstitutions de qualit. Il convient dadmettre cependant que des efforts considrables restent faire non seulement sur le plan normatif, par ladoption de nouveaux textes, tels que ceux relatifs lOrganisation et au Fonctionnement des juridictions suprmes, au Statut de la Magistrature etc., mais aussi sur le plan des infrastructures et des quipements. Par ailleurs, avec lopportunit de laccord de OUAGADOUGOU, le pays est dans une phase de rconciliation et de reconstruction qui exige de mettre la justice au cur des proccupations tant des autorits gouvernementales que de tous les partenaires au dveloppement. En effet, il est de plus en plus question de garantir la scurit judicaire pour encourager les investissements en Cte dIvoire. Les autorits ivoiriennes devraient pouvoir rassurer les partenaires de la Cte dIvoire, ainsi que les populations qui vivent sur ce territoire, quant leur volont de crer les conditions dune justice qui rassure. La justice apparat comme une lucarne adquate qui permet dapprcier lattachement dun tat aux valeurs de la dmocratie. Le processus de rconciliation nationale, qui devrait aboutir la runification du pays, doit accorder une place de choix la justice. En effet, la justice est en amont et en aval du processus lectoral, puisquelle intervient dans le processus didentification avec les audiences foraines, dans les contestations relatives aux inscriptions sur les listes lectorales, sur la question de lligibilit des candidats et dans le contentieux lectoral de faon gnrale. A ct de la question cruciale des lections, la question non moins importante des litiges relatifs lexpropriation irrgulire des biens mobiliers et des biens immobiliers tels que les maisons dhabitation et les plantations, du fait de la guerre, pourraient avoir des retentissements judiciaires. Do la ncessit daccorder la justice un rle davant-garde, en garantissant son indpendance, afin quelle puisse jouer son rle de rgulation des rapports sociaux. RECOMMANDATIONS Nous esprons, travers ce rapport, que lUnit de ltat de Droit de lONUCI contribuera tant soit peu amliorer le systme judiciaire ainsi qu la consolidation de la dmocratie en Cte dIvoire, surtout dans cette priode sensible de rconciliation nationale. Aussi, avons-nous admis la ncessit de mettre en exergue les recommandations suivantes : 1. Les textes et les institutions :
Le Ministre de la Justice a consenti des efforts dans llaboration de textes tendant assurer un meilleur fonctionnement de lappareil judiciaire ivoirien. 55
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Il faudrait que le gouvernement mette tout en uvre pour que ces textes soient adopts le plus tt possible. Nous recommandons que la constitution puisse dfinir clairement les relations entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs afin de renforcer la sparation des pouvoirs constitus. Nous encourageons vivement ladoption dune nouvelle loi portant statut de la Magistrature qui tienne compte des reformes constitutionnelles afin de permettre lmergence dune justice vritablement indpendante et efficace dans laquelle la responsabilit du magistrat sera davantage affirme. Il serait souhaitable que les lois organiques se rapportant aux juridictions suprmes (Cour de Cassation, Conseil dtat et Cour des Comptes) prvues par la constitution soient rapidement adoptes afin quelles puissent tre fonctionnelles. Nous encourageons galement ladoption rapide de lavant-projet de loi portant Organisation Judiciaire qui prvoit la cration de deux ordres juridictionnels distincts: lun judiciaire (Cour de Cassation, Cours dAppel et Tribunaux de Premire Instance) et lautre administratif (Conseil dtat, Cours dAppel et Tribunaux Administratifs, ainsi que la Cour des Comptes et les Chambres Rgionales des Comptes). Une loi organique devra tre adopte, en vertu de larticle 107 de la constitution, leffet de dterminer les conditions dapplication des dispositions relatives au Conseil Suprieur de la Magistrature qui examine toutes les questions relatives lindpendance de la magistrature. Lorganisation judiciaire proprement dite : Nous encourageons vivement, dans le souci de rapprocher la justice des justiciables, louverture effective des Cours dAppel de Man, dAbengourou et de Korhogo, ainsi que les Tribunaux de Premire Instance de Port-Bout et dAbobo thoriquement crs. Il faudrait aussi amliorer la situation gnrale de la Cour dAppel dAbidjan. Concernant les cours dassises, le rapport envisage diffrentes solutions alternatives applicables afin que les criminels soient jugs dans des dlais raisonnables : dgager les moyens ncessaires pour tenir deux quatre sessions dassises par an par TPI ; rduire fortement le champ de comptences de ces cours dassises ; supprimer les cours dassises et imaginer une organisation judiciaire diffrente.
2.
56
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Relativement la situation des personnes dtenues et ayant relev appel de leurs dcisions de condamnation : Pour une protection des droits de la dfense, il serait souhaitable que des efforts soient faits en vue de rendre possible la comparution personnelle de ces prvenus devant la Cour dAppel. Le fonctionnement de lappareil judiciaire :
3.
Au titre des problmes matriels Prvoir des investissements consquents afin de rnover, agrandir et quiper la plupart des palais de justice existants et den assurer la scurit. Augmenter le budget consacr la justice et prvoir un budget pour les juridictions (Pouvoir judiciaire) distincts de celui du Ministre de la Justice (Pouvoir excutif) afin de donner plus de consistance la sparation des pouvoirs. Nous encourageons lEtat poursuivre linformatisation des greffes, des juridictions et parquets de lensemble du pays. En effet, les acteurs de la justice, quil sagisse des magistrats, des greffiers et des secrtaires dactylographes doivent tre initis aux techniques dutilisation de loutil informatique ;
Au titre des ressources humaines et la formation Compte tenu de la dlicatesse de la mission de juger et pour lmergence dune justice de meilleure qualit, nous recommandons que, sous la tutelle du Ministre de la Justice, des moyens supplmentaires soient consacrs la formation initiale des acteurs judiciaires, notamment des magistrats et les greffiers, suivie rgulirement dune formation continue de qualit ;
Au titre de la lutte contre la corruption Nous encourageons les mesures suivantes : le renforcement des capacits de linspection gnrale des services judiciaires et pnitentiaires afin quelle puisse sattaquer aux causes de dysfonctionnements de la justice, de la lenteur judiciaire et poursuivre toutes personnes convaincues de corruption, de toutes autres malversation et dinconduites notoires ; La mise en place dune commission charge de la lutte contre la corruption qui agisse tant dans le cadre de la prvention que du soutien la rpression de la corruption ; Le traitement chronologique des affaires et laffichage des frais de greffe pourraient tre en partie une solution au flau de la corruption.
57
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
la revalorisation du statut et des conditions de travail des magistrats et des greffiers et le paiement des prestations des auxiliaires de justice et des experts. lapplication de mesures efficaces de restriction daccs des justiciables aux magistrats assis ; le contrle renforc de la dure de traitement des dossiers (respect systmatique de lordre chronologique dans leur traitement) et de la motivation en droit de certaines dcisions et une Inspection gnrale plus oprationnelle ; le renforcement institutionnel de lindpendance du Conseil Suprieur de la Magistrature vis--vis du pouvoir excutif ; laffichage de tous les frais de greffe lgaux dans chaque juridiction; une plus grande diffusion de la jurisprudence auprs des magistrats et de la population ; un accs plus facile de la population lassistance judiciaire pour rendre les procdures plus quitables ; lobligation terme de prendre toutes les dcisions de justice de manire collgiale; une campagne de sensibilisation de la population et des entreprises relative la corruption passive et active ; la constitution dune cellule anti-corruption crdible et dote de moyens importants au sein du Ministre de la justice.
Au titre de laccs la justice Pour une meilleure assistance judiciaire des justiciables indigents, nous recommandons les mesures suivantes : la simplification de la procdure dassistance judiciaire et son ouverture un plus grand nombre de justiciables indigents ; une campagne dinformation sur le service dassistance judiciaire et son fonctionnement ; la dcentralisation progressive du fonds dassistance auprs de chaque tribunal de premire instance et de chaque cour dappel ; la dsignation des avocats commis doffice un stade prcoce de la procdure et le paiement rgulier de leurs frais ; confier la responsabilit de lorganisation et du suivi quotidien du systme dassistance judiciaire au Barreau de Cte dIvoire;
Pour pallier lincapacit du Barreau dassister tous les indigents en justice, surtout lorsque des dplacements doivent tre envisags, nous recommandons la possibilit pour des ONG dengager des para-juristes ou, mieux, des juristes, avec laccord du Ministre de la justice, dans le cadre de lassistance judiciaire aux dtenus ou aux autres personnes indigentes, spcialement dans les zones les plus loignes dAbidjan.
58
ONUCI, Unit Etat de Droit
Juin 2007
Au titre des questions spcifiques Pour permettre laccs des juridictions la jurisprudence, nous recommandons les mesures suivantes : la cration dun bulletin de jurisprudence dans le ressort de chaque cour dappel et sa diffusion auprs des magistrats et des autres professionnels du droit ; lenvoi de toutes les expditions des arrts des cours dAppel rendus aux juridictions de premier degr concernes ; L tablissement dun cadre dchanges priodiques entre les magistrats et leur hirarchie afin de dresser le bilan du fonctionnement des juridictions et de lapplication des textes.
Pour lutter contre le retard dans la dlivrance des dcisions de justice, nous recommandons aux magistrats deux principes qui doivent tre rigoureusement observs : ne prononcer de dcision que si elle est dj rdige ; donner instruction aux greffiers et secrtaires de ne saisir ou dactylographier que les dcisions prononces dans un ordre strictement chronologique, sans drogation et sous peine de sanctions.
59
Vous aimerez peut-être aussi
- Contrats - Spéciaux Eberand-1Document49 pagesContrats - Spéciaux Eberand-1J'aime Fortuna100% (1)
- SPARK-Welplan Fiche WebDocument2 pagesSPARK-Welplan Fiche WebVITRY JérômePas encore d'évaluation
- Fiche de Révision Procédure Pénale GénéralitéDocument3 pagesFiche de Révision Procédure Pénale GénéralitéAleksei KonavalovPas encore d'évaluation
- Fiche de TD Droit SocialDocument12 pagesFiche de TD Droit SocialMichel TiaPas encore d'évaluation
- L'efficacité de l'arbitrage OHADA: Le rôle du juge étatiqueD'EverandL'efficacité de l'arbitrage OHADA: Le rôle du juge étatiquePas encore d'évaluation
- Cours de Droit AdministratifDocument53 pagesCours de Droit Administratifdemop100% (31)
- Efficacité de l'exécution des décisions de justice dans le monde: Rapport sur l'exécution dans les pays membres de l'uihjD'EverandEfficacité de l'exécution des décisions de justice dans le monde: Rapport sur l'exécution dans les pays membres de l'uihjPas encore d'évaluation
- Procédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2019)D'EverandProcédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2019)Pas encore d'évaluation
- UML: Entrepot PDFDocument7 pagesUML: Entrepot PDFperico1962Pas encore d'évaluation
- Extrait Annale Droit Constitutionnel IvoirienDocument11 pagesExtrait Annale Droit Constitutionnel IvoirienLuli jonesPas encore d'évaluation
- Droit judiciaire: Tome 1 : Institutions judiciaires et éléments de compétenceD'EverandDroit judiciaire: Tome 1 : Institutions judiciaires et éléments de compétencePas encore d'évaluation
- Le rôle du juge national dans l'espace judiciaire européen, du marché intérieur à la coopération civileD'EverandLe rôle du juge national dans l'espace judiciaire européen, du marché intérieur à la coopération civilePas encore d'évaluation
- Cours Droit Administratif BléouDocument149 pagesCours Droit Administratif Bléouberessou michelPas encore d'évaluation
- Cours de Droit AdministratifDocument67 pagesCours de Droit AdministratifKoffi Maxime Diby100% (1)
- Fiche 4Document6 pagesFiche 4Gildas BossoPas encore d'évaluation
- Droit de L EnfantDocument5 pagesDroit de L Enfantkouassi pélagiePas encore d'évaluation
- Les Cour de DroitDocument56 pagesLes Cour de DroitSAMUEL ORO100% (1)
- Opaj 2021Document132 pagesOpaj 2021bedjeangePas encore d'évaluation
- 3 Exos Corrigés de Droit Const - CDocument16 pages3 Exos Corrigés de Droit Const - Cfranck amonPas encore d'évaluation
- Annales de Droit Civil L1 - 2021 C-1-Gfkyna-1Document223 pagesAnnales de Droit Civil L1 - 2021 C-1-Gfkyna-1Key Man100% (1)
- Marchés Public - J.L EsamboDocument284 pagesMarchés Public - J.L EsamboDominique KabambaPas encore d'évaluation
- Institution Judiciare SenegalaisDocument37 pagesInstitution Judiciare SenegalaisMaimouna DoumbouyaPas encore d'évaluation
- Commentaire D'article (Lamy) - 1 PDFDocument3 pagesCommentaire D'article (Lamy) - 1 PDFHarlette OndendePas encore d'évaluation
- Droit International PrivéDocument54 pagesDroit International PrivéRadu GeorgePas encore d'évaluation
- Droit Des Tic - CoursDocument26 pagesDroit Des Tic - CoursStyve PolaPas encore d'évaluation
- Droit Constitutionnel 2: Cours Du Professeur Martin BLEOU Professeur Titulaire Des UniversitésDocument58 pagesDroit Constitutionnel 2: Cours Du Professeur Martin BLEOU Professeur Titulaire Des UniversitésJules Emmanuel67% (3)
- Entraînement À La Recherche Juridique Pour Élaborer Des Textes NormatifsDocument31 pagesEntraînement À La Recherche Juridique Pour Élaborer Des Textes NormatifsStéphane Cottin100% (1)
- Le Contentieux Electoral en Afrique NoirDocument142 pagesLe Contentieux Electoral en Afrique NoirPatienPas encore d'évaluation
- Oj Annee Promotion 2023 2024Document125 pagesOj Annee Promotion 2023 2024stephanejeanpaulkonan100% (2)
- Cours de Droit Constitutionnel 2 20219 2020 IuaDocument53 pagesCours de Droit Constitutionnel 2 20219 2020 Iuaemmanuel assiPas encore d'évaluation
- Exercice Droit Administratif 1Document19 pagesExercice Droit Administratif 1Ali GoranePas encore d'évaluation
- Droit Des PersonnesDocument61 pagesDroit Des PersonnesEl JadouPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Des Successions Et Des LiberalitesDocument18 pagesCours de Droit Des Successions Et Des LiberalitesEunice AllouanPas encore d'évaluation
- Droit Senegalais 11Document318 pagesDroit Senegalais 11Cheikh DiemePas encore d'évaluation
- Droit International Public L3 M. ThouveninDocument43 pagesDroit International Public L3 M. Thouveninfidae_elismaili67% (3)
- Les Actes AdministratifsDocument56 pagesLes Actes Administratifspcleme0150% (2)
- Esquisses de Corrigés D'exercice de Droit CivilDocument38 pagesEsquisses de Corrigés D'exercice de Droit CivilMoussa Ndiaye100% (1)
- Cours Numérique Introduction Au Droit 2021Document69 pagesCours Numérique Introduction Au Droit 2021Ariel Ker100% (3)
- Droit Constitutionnel NumeriqueDocument89 pagesDroit Constitutionnel NumeriqueAnge Emmanuel KROU100% (1)
- Fiches TDDocument81 pagesFiches TDBahBélalYayaPas encore d'évaluation
- I - A - Ouvrages GénérauxDocument4 pagesI - A - Ouvrages GénérauxKey ManPas encore d'évaluation
- Les Voies D'exécutionDocument32 pagesLes Voies D'exécutionjechangemonquartierPas encore d'évaluation
- Introduction Au DroitDocument7 pagesIntroduction Au DroitmahrouguiPas encore d'évaluation
- Droit de Succession en Droit Positif IvoirienDocument48 pagesDroit de Succession en Droit Positif IvoirienAnge-Roland Obanda100% (5)
- Exemple D'une DissertationDocument2 pagesExemple D'une Dissertationpropetejeremie100% (1)
- Cours Organisation Judiciaire 2022Document128 pagesCours Organisation Judiciaire 2022stephanejeanpaulkonan100% (2)
- Les Cinq Étapes Pour Réussir Son Cas PratiqueDocument2 pagesLes Cinq Étapes Pour Réussir Son Cas PratiqueDouba DoumbouyaPas encore d'évaluation
- Droit International PublicDocument17 pagesDroit International PublicWALD NASSPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Civil 2021Document64 pagesCours de Droit Civil 2021Kingx EmmvnuelPas encore d'évaluation
- Ena Droit AdministratifDocument159 pagesEna Droit AdministratifKOUAKOU100% (2)
- 2eme Annee de Licence DroitDocument8 pages2eme Annee de Licence DroitDave Davis100% (2)
- GUIDE DE PREPA INFJ - Version AUDEDocument52 pagesGUIDE DE PREPA INFJ - Version AUDEMonica EssohPas encore d'évaluation
- Guide Methodologie 2019Document11 pagesGuide Methodologie 2019MANGOUA charlotte100% (2)
- CHAPITRE I L'organisation de L'administration 2023Document22 pagesCHAPITRE I L'organisation de L'administration 2023Juge PierreJeanPas encore d'évaluation
- Presentation Du Nouveau Droit OhadaDocument18 pagesPresentation Du Nouveau Droit OhadamokaPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Administratif Ena 23Document71 pagesCours de Droit Administratif Ena 23Christophe Nemlin100% (1)
- Sûretés et garanties au Grand-Duché de LuxembourgD'EverandSûretés et garanties au Grand-Duché de LuxembourgPas encore d'évaluation
- Définition de La PédophilieDocument4 pagesDéfinition de La Pédophiliesoukaina100% (1)
- Business PARIS DOCKS FinalDocument29 pagesBusiness PARIS DOCKS FinalSizaza BruciaPas encore d'évaluation
- YAKI Xaam KyxyDocument13 pagesYAKI Xaam KyxyKallHunter100% (2)
- Suaire de TurinDocument4 pagesSuaire de TurinLascarO.Lascar0% (1)
- 03-M-02 Doc Diversifier Les QuestionsDocument2 pages03-M-02 Doc Diversifier Les QuestionsMOZIKA BEKOPas encore d'évaluation
- Séminaire Marketing Stratégique 2016Document54 pagesSéminaire Marketing Stratégique 2016Mohammed KHAYAPas encore d'évaluation
- Pourquoi Craindre DieuDocument3 pagesPourquoi Craindre DieuMazanaPas encore d'évaluation
- Décret N° 861-PR-MFP 20-08-1981Document5 pagesDécret N° 861-PR-MFP 20-08-1981ivane BLAMPAINPas encore d'évaluation
- RapportRSE Version Electronique5 CompressedDocument57 pagesRapportRSE Version Electronique5 CompressedZeid killerPas encore d'évaluation
- Plaisirs D'egypte (Feneuille) PDFDocument8 pagesPlaisirs D'egypte (Feneuille) PDFTarek EzzatPas encore d'évaluation
- Presentation Ecrits ProfessionnelsDocument87 pagesPresentation Ecrits Professionnelshicham hicham0% (1)
- Loi N° 66-69 Du 4 Juillet 1966 Relative À L'exercice de La Médecine Et À L'ordre Des MédecinsDocument6 pagesLoi N° 66-69 Du 4 Juillet 1966 Relative À L'exercice de La Médecine Et À L'ordre Des MédecinsModou ThiamPas encore d'évaluation
- Quelles Mutations Du Travail Et de L'emploiDocument17 pagesQuelles Mutations Du Travail Et de L'emploiDimitri AlexanderPas encore d'évaluation
- L - École ClassiqueDocument4 pagesL - École ClassiqueNajia El Yanboiy100% (2)
- PDFDocument3 pagesPDFFares AmgPas encore d'évaluation
- 1 - Happy Ending สมบูรณ์ Score and parts PDFDocument21 pages1 - Happy Ending สมบูรณ์ Score and parts PDFEktana PonvisetPas encore d'évaluation
- Livre Hebdo Classement Juin 2018Document10 pagesLivre Hebdo Classement Juin 2018Nicolas BeaunePas encore d'évaluation
- RARE - Hymne D'amon Râ - Traduction ManuscriteDocument344 pagesRARE - Hymne D'amon Râ - Traduction ManuscriteAdriana EvangeliztPas encore d'évaluation
- CurriculumDocument1 pageCurriculumremegie niyongabirePas encore d'évaluation
- Filetage Taraudage WWW - Tunisie-EtudesDocument13 pagesFiletage Taraudage WWW - Tunisie-Etudesntayoub100% (1)
- 3e Examen FR 1 Ecoute ADocument1 page3e Examen FR 1 Ecoute AIsådora de CåstroPas encore d'évaluation
- Loi Production D'électricité À Partir d'ERDocument24 pagesLoi Production D'électricité À Partir d'ERDora FadPas encore d'évaluation
- Norme Comptable 41Document9 pagesNorme Comptable 41Amine BejaouiPas encore d'évaluation
- LF AD 2 LFMN en 2015-06-25Document14 pagesLF AD 2 LFMN en 2015-06-25peroprcPas encore d'évaluation
- "Les Sectes Protestantes Ou Histoire Alphabétique Des Divisions Survenues Dans La Réforme Depuis Luther Jusqu'à Nos Jours", Par Le Baron Gaston de FlotteDocument413 pages"Les Sectes Protestantes Ou Histoire Alphabétique Des Divisions Survenues Dans La Réforme Depuis Luther Jusqu'à Nos Jours", Par Le Baron Gaston de FlottevbeziauPas encore d'évaluation
- Tayeb Saddiki Et Samuel BeckettDocument5 pagesTayeb Saddiki Et Samuel BeckettAziz OualidPas encore d'évaluation