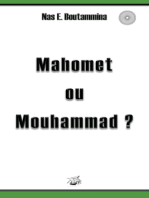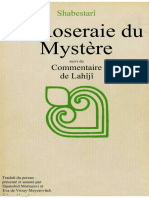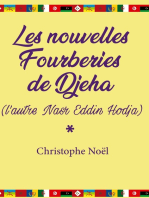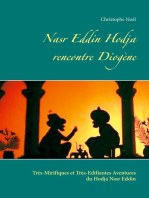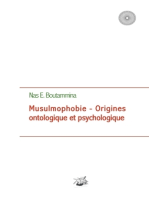Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Charles-André Gilis: Pour Une Présentation Traditionnelle D'ibn Arabî
Charles-André Gilis: Pour Une Présentation Traditionnelle D'ibn Arabî
Transféré par
Jalila JalilTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Charles-André Gilis: Pour Une Présentation Traditionnelle D'ibn Arabî
Charles-André Gilis: Pour Une Présentation Traditionnelle D'ibn Arabî
Transféré par
Jalila JalilDroits d'auteur :
Formats disponibles
Charles-Andr Gilis : Pour une prsentation traditionnelle dIbn Arab.
Ibn Arab est le plus grand des matres (ash-shaykh al-akbar) de lsotrisme islamique. Sa Voie initiatique propre est celle de la Connaissance mtaphysique, et son uvre englobe toutes les voies de ralisation possibles en islm. Sa mthode sappuie sur les donnes universelles de la rvlation muhammadienne envisage dans son intgralit. Son orthodoxie ne peut tre mise en doute car, en ralit, ce sont ses crits qui en dterminent les critres. Les attaques, les rserves dont il fait lobjet refltent invitablement une incomprhension de la tradition islamique. En Occident, luvre akbarienne a puissamment contribu la formation dune lite intellectuelle dont la fonction apparat chaque jour plus ncessaire face au dsordre gnral, labandon de tout principe et la confusion des mentalits sur la nature de la rvlation islamique. Lintrt que cette uvre suscite ne cesse de crotre et les publications inspires par ses enseignements se multiplient. Toutefois cette abondance nentrane pas toujours une meilleure intelligence de la doctrine, qui pourtant seule importe. Les critres qualitatifs inhrents lessence initiatique de lenseignement akbarien ne sont pas ceux qui prvalent dans lOccident moderne. Par cette expression, nous ne visons pas seulement les prsentateurs dIbn Arab qui sont ns dans les pays occidentaux, mais aussi les Orientaux, principalement les musulmans arabophones qui la lisent et ladaptent en suivant les modes et les prjugs de lducation universitaire. Les mthodes prnes par la science officielle sont incompatibles avec lenseignement initiatique et le dnaturent invitablement. La quantit mme des ouvrages produits engendre un malaise et un sentiment de lourdeur, car ils dispersent lattention l o sont requises avant tout la concentration et la possibilit dune assimilation qualitative. La prsentation de la doctrine akbarienne doit tre essentiellement traditionnelle , cest--dire dans un esprit conforme aux principes noncs par le Cheikh Abd al-Whid Yahy dont luvre entire, publie sous le nom de Ren Gunon (1), a t crite en vue de modifier ltat desprit des Occidentaux afin quils reconnaissent lexistence et lautorit de la tradition universelle reprsente aujourdhui par lislm. A ce point de vue aussi lenseignement de ce matre savre incontournable. Du reste, on remarque une relation constante entre la volont de rejeter toute rfrence luvre gunonienne et les prsentations profanes du Cheikh al-Akbar. Non seulement les doctrines exposes par Cheikh Abd alWhid permettent aux Occidentaux de raliser la porte universelle de la rvlation muhammadienne en fournissant une preuve dcisive (2)
lgard de ceux qui contestent les privilges de lislm et de sa loi sacre (shara), mais elles sont aussi un guide sr et une protection efficace contre les drives antitraditionnelles dont la mentalit occidentale est coutumire. Le plus extraordinaire est que ces principes ont t formuls par Ren Gunon sans aucune rfrence lislm ou luvre dIbn Arab puisquils ont t dfinis propos des doctrine hindoues. Limportance de celles-ci dans une perspective cyclique et eschatologique a t mise en lumire dans son tude sur Les mystres de la lettre Nn (3) dont le Cheikh Mustaf Abd al-Azz (Michel Vlsan) a dgag la signification du point de vue de luniversalit islamique. Ce qui frappe le plus, lorsquon relit les considrations dveloppes en 1921 dans LIntroduction gnrale ltude des doctrines hindoues, cest leur actualit et leur opportunit. Ren Gunon sexprime sur la question de lenseignement traditionnel dune faon gnrale, de sorte quil ny a pas un mot changer. Lesprit dans lequel luvre du Cheikh al-Akbar doit tre lue, comprise et prsente est indiqu avec une matrise sans pareille dans les textes rdigs par Ren Gunon propos de lhindouisme. En voici un premier extrait (4) : Lenseignement traditionnel se transmet dans des conditions qui sont strictement dtermines par sa nature ; pour produire son plein effet, il doit toujours sadapter aux possibilits intellectuelles de chacun de ceux auxquels il sadresse, et se graduer en proportion des rsultats dj obtenus, ce qui exige de la part de celui qui le reoit et qui veut aller plus loin, un constant effort dassimilation personnelle et effective. Ce sont des consquences immdiates de la faon dont la doctrine tout entire est envisage, et cest ce qui indique la ncessit de lenseignement oral et direct, quoi rien ne pourrait supplerLOriental est labri de cette illusion, trop commune en Occident, qui consiste croire que tout peut sapprendre dans les livres, et qui aboutit mettre la mmoire la place de lintelligence ; pour lui, les textes nont jamais que la valeur dun support et leur tude ne peut tre que la base dun dveloppement intellectuel, sans jamais ce confondre avec ce dveloppement mme : ceci rduit lrudition sa juste valeur, en la plaant au rang infrieur qui seul lui convient normalement, celui de moyen subordonn et accessoire de la connaissance vritable. La fin de ce texte condamne sans appel une des composantes les plus habituelles du manirisme universitaire, savoir la superstition de la bibliographie. Lquation est ici tout fait simple : aucun ouvrage publi dans une perspective traditionnelle na jamais comport de bibliographie ; tout ouvrage publi avec une bibliographie montre par l mme quil nest pas entirement traditionnel, quels que puissent tre par ailleurs ses mrites, car il contient une concession la mentalit profane incompatible avec la nature de lenseignement quil se propose de vhiculer, tout particulirement quand celui-ci est dordre initiatique.
(1) Il crivait ce sujet : Nous ne voyons pas du tout pourquoi nous serions obligs de vivre toujours dans la peau dun mme personnage, quil sappelle "Ren Gunon" ou autrement ; ou encore : Si on continue nous empoisonner avec la "personnalit de Ren Gunon" nous finirons bien quelque jour par la supprimer tout fait. Mais nos adversaires peuvent tre assurs quils ny gagneront rien, tout au contraire ; cf. Etudes sur la Franc-Maonnerie et le Compagnonnage, Tome 1, p.185 et 198. (2) Cor.6.149. (3) Cf. Symboles fondamentaux de la Science sacre, chap.XXIII. Sur le mme sujet, voir aussi Ren Gunon et lavnement du troisime Sceau, chap.III. (4) Cf.p.262-263 (dition de 1952). Rappelons quil ny a pas de ralisation mtaphysique ou spirituelle sans hirarchie, et que la notion de hirarchie implique ncessairement une rfrence celle dlite. Si lon considre quil sagit en loccurrence dune lite intellectuelle (comme lindique la prsence de ce terme plusieurs endroits du texte reproduit ci-dessus), il doit tre bien compris que lintellectualit vritable na rien de commun, ni avec lrudition, ni avec une spculation quelconque. Ce nest pas uniquement lUniversit quil convient de mettre en cause ici, mais aussi toutes les drives qui ont leur origine dans la dgnrescence des organisations initiatiques occidentales, principalement la FrancMaonnerie moderne. Les bibliographies sont censes tout inclure dans un domaine dont il importe prcisment de sauvegarder la nature propre en excluant ce qui est incompatible avec lui. Cest pourquoi chaque numro dune revue qui, au temps de Ren Gunon et de Michel Vlsan, a pu lgitimement revendiquer le titre d Etudes Traditionnelles portait sur sa couverture la mention : Publication exclusivement consacre aux doctrines mtaphysiques et sotriques dOrient et dOccident . L o prvaut le respect de la Tradition, les hirarchies intellectuelles, au sens vritable du terme, stablissent delles-mmes et sont spontanment admises et reconnues. En revanche, l o lgalitarisme domine et corrompt ce quil touche, il faut exercer une action que lon a pu appeler familirement de police traditionnelle afin, comme il est dit dans le texte cit, de rduire lrudition sa juste valeur, en la plaant au degr infrieur qui lui convient normalement . En matire initiatique, les rfrences vritables sont dun tout autre ordre, car elles impliquent un rattachement des principes mtaphysiques manifests en ce monde et un Compagnonnage visible et invisible. Seuls les degrs dune lvation trs exceptionnelle ne peuvent tre raliss que dans la solitude. Lessentiel nest pas la bibliographie, mais la manifestation dune autorit doctrinale supra-individuelle, seule mme de fonder la lgitimit dune doctrine et lorthodoxie de sa prsentation.
Cette autorit dtient les trsors immuables de la sagesse et de la science divines auxquels le Coran fait allusion en ces termes : Il nest aucune chose dont les Trsors soient auprs de Lui ; et Nous les rvlons seulement selon une mesure dfinie par la science (que Nous avons delles) (Cor.15.21). La mesure mentionne dans ce verset rgit les adaptations des principes immuables opres dans le monde de la manifestation contingente, o la cration est sans cesse renouvele de telle sorte quil convient de demander un accroissement de science . La rfrence doctrinale est puise, soit directement la Mine originelle de lEnvoy et des envoys (5) dans le cas des initis qui ont atteint le degr de la prophtie gnrale (an-nubuwwat al-mma), soit ce que ces derniers sont transmis grce aux maillons dune chane qui peut tre plus ou moins longue. (5) Cf. Le Livre des Chtons des Sagesses, p.479. Le ftichisme de la rfrence acadmique saccompagne dtranges illusions. Si la valeur dune traduction dpend sans conteste de lexactitude du texte, on se trompe en imaginant que les critres de la critique universitaire puissent tre suffisants pour tablir la version correcte. Dans le cas denseignements initiatiques au sens propre, les mthodes modernes sont en ralit impuissantes, car la mentalit dont elles procdent ne peut atteindre ce qui dpasse lordre individuel. Rappelons aussi quil convient daborder certaines sciences traditionnelles, comme celle du hadth, dans une perspective analogue car la chane de transmission historique (isnd) nest pas forcment dcisive. Selon le Cheikh al-Akbar, lautorit doctrinale appartient en ce domaine ceux qui, linstar des prophtes lgifrants , la tirent directement dAllh. Par l, ils dtiennent le privilge de confirmer lauthenticit des hadths dont la transmission est faible ou dinfirmer celle des hadths dont la transmission est forte (6). Sagissant des traits procdant des mystres divins, comme Le Livre des Chatons ou ceux qui se rapportent la Science des lettres, lide dune dition critique tablie daprs les mthodes universitaires est un leurre. Seule la connaissance intrieure intime des vrits caches permet de dterminer le texte vritable. Cest lautorit spirituelle qui rgit lexpression littraire, et non linverse. (6) Ibid. p.497-498. Voici un exemple de nature montrer ce que nous voulons dire. Dans le texte intitul Linvestiture du Cheikh al-Akbar au Centre Suprme, Michel Vlsan prsente un passage de la Prface des Futht al-Makkiyya quil traduit de la faon suivante : Alors le Sceau installa la Chaire dans cette solennelle tenue. Sur le fronton de la Chaire tait inscrit en Lumire Bleue : "Ceci est la Station Muhammadienne la Plus Pure, etc." (7) Des esprits bien intentionns, mais superficiels, ont jug une traduction errone en affirmant quil sagissait en loccurrence, non pas dune lumire bleue (azraq) , mais bien dune lumire brillante (azhar) .
Effectivement, cest ce dernier terme qui est indiqu dans ldition critique tablie par Othman Yahy (8) o la variante azraq nest mme pas signale. Pourtant cest bien celle-ci qui correspond la version correcte en vertu dun secret initiatique ignor aussi bien des copistes que des critiques. Dans le cas prsent, lattitude de M. Chodkiewicz, qui passe pour tre un champion de la rfrence universitaire, est trs significative. En effet, la page 163 de son Sceau des saints, il se rfre au mme passage des Futht en citant Michel Vlsan, mais sans reprendre la traduction de ce dernier. Pourtant, il mentionne son tour la lumire bleue sans donner la moindre explication ou justification de son choix. A moins dune inadvertance, on peut donc supposer quil avait lui-mme connaissance du secret auquel nous avons fait allusion de sorte quil ne pourrait qutre daccord avec nous sur linanit des ditions critiques en pareilles matires. (7) Cf. Etudes Traditionnelles, 1959, p.304. (8) Cf. vol I, p.45. Un autre point du texte de Ren Gunon mrite dtre soulign, savoir la ncessit de lenseignement oral et direct, quoi rien ne saurait suppler . Ceci sapplique lenseignement traditionnel dans son ensemble avec les diverses modalits quil comporte, notamment dans le domaine des arts sacrs ou lorsquil sagit de sciences exotriques comme le droit. Si la bndiction divine (baraka) stend tous les rites accomplis avec foi et avec une intention droite, elle concerne plus spcialement ceux qui sont rattachs au Prophte au moyen dun rite initiatique. Un tel rattachement implique habituellement lintgration une confrrie (tarqa) et la pratique de rites collectifs qui comportent un bnfice propre. Cependant, il ne faut pas oublier que chaque voie de ralisation est unique, car elle concide avec la Face divine de ltre. Cest la lumire de cette Face qui se dcouvre ventuellement grce lenseignement oral dun matre (cheikh murshid) adress tel disciple particulier, ce que ne peuvent faire, ni la lecture dun livre, ni la pratique dun rite collectif si efficace quil soit. Cet enseignement est une expression directe du Verbe divin, car cest de la Vrit que procde le Vrai en vue de faire natre le Vrai dans tel rceptacle choisi. Il nest pas possible de sexprimer sur ce sujet de manire plus dtaille, mais il convient peut-tre tout de mme, pour viter une mprise, de prciser quun tel enseignement oral consiste le plus souvent, non pas expliquer des points de vue de doctrine, mais tirer le disciple de son tat de sommeil et dinconscience en combattant son imagination, en lui tant ses illusions et surtout en lui inculquant le sens des convenances, cet adab dans lequel rside tout le bien . Plus essentiel encore que lenseignement oral et direct mentionn par Gunon est celui qui est transmis par le silence ou, sil sagit dun saint, par la pure prsence du matre qui manifeste de faon immdiate la Prsence divine, car cette
modalit de lenseignement initiatique rappelle incommunicable de la Connaissance vritable.
le
caractre
La supriorit de lenseignement oral est plus vidente encore lorsquil sagit de doctrines provenant de traditions antrieures lislm. Du fait de sa position cyclique finale et rcapitulative, il peut se faire que celui-ci hrite de certains enseignements rservs, conformment lindication coranique : En vrit, cest Nous qui hriterons de la Terre, et cest vers Nous quils reviendront (Cor.19.40) ; En vrit, cest Nous qui faisons vivre et mourir et cest Nous qui recevons lhritage (Cor.15.23) ; La Terre, Mes serviteurs purs (slihn) en hriteront (Cor.21.105). Ces apports trouvent ncessairement leur correspondance dans la rvlation islamique totale et contribuent montrer lampleur de la Science sacre contenue dans le Coran ; ils vivifient lintelligence de lislm et fructifient en son sein avec une profusion qui nest souvent plus possible dans leur tradition dorigine. En ce domaine surtout, rien ne saurait suppler lenseignement oral, en particulier dans les cas o la transmission traditionnelle rgulire saccommode mal dune quelconque fixation par crit (9). Il va de soi que la possibilit laquelle nous faisons allusion nimplique aucun mlange de formes traditionnelles et que lassimilation par lislm de tels apports ne peut se faire que dans le respect de rgles prcises, notamment lorsquil sagit de concordances symboliques : cest Allh, et Lui seul, qui propose les similitudes aux hommes, car Il possde la science de toute chose (Cor.74.25). SIl sinterdit de proposer des similitudes qui sappliqueraient Lui, cest parce quIl sait et vous ne savez pas (Cor.16.74). De telles transmissions, lorsquelles oprent dans un esprit traditionnel et saccompagnent dun respect des rgles de convenance, font ressortir immanquablement le caractre factice et drisoire des travaux universitaires qui traitent des mmes sujets (10). A propos des mthodes utilises par lorientalisme, dont lislamologie fait partie, Ren Gunon prcisait encore : Il y a l avant tout, une crainte instinctive de tout ce qui dpasse lrudition et risque de faire voir combien elle est mdiocre et purile au fond ; mais cette crainte se renforce de son accord avec lintrt, beaucoup plus conscient, qui sattache au maintien de ce monopole de fait quont tabli leur profit les reprsentants de la science officielle dans tous les ordres, et les orientalistes peut-tre plus compltement que les autres , et qui saccompagne de la volont bien arrte de ne pas tolrer ce qui pourrait tre dangereux pour les opinions admises et de chercher le discrditer par tous les moyens (11). Nous nous garderons bien dindiquer quels prsentateurs de lenseignement akbarien ces lignes seraient applicables aujourdhui et nous soulignerons plutt lessentiel, savoir que lUniversit a rejet Ren Gunon comme elle a rejet Michel Vlsan. Il ny a donc pas lieu de stonner si elle semploie galement donner une vision fausse et incomplte de lenseignement akbarien. Par l, elle apparat dsormais comme une institution partiale et partisane
utilise pour la dfense de lOccident afin dempcher le rayonnement de lOrient traditionnel dune faon gnrale et celui de lEsprit universel de lislm en particulier (12). (9) Nous songeons ici avant tout aux doctrines traditionnelles des peuples ngro-africains. (10) Pour tre complet, il faut signaler encore le cas extrme et exceptionnel des reprsentants autoriss de traditions sotriques qui poursuivent une carrire acadmique, mais se gardent bien dinsrer dans leurs publications les cls pouvant donner accs leur comprhension vritable. (11) Cf. LIntroduction gnrale ltude des doctrines hindoues, d. De 1952, p.271. (12) Lvolution rcente de la revue Connaissance des religions est, cet gard, particulirement inquitante. Nous terminerons ces citations sur lorientalisme officiel par un dernier extrait. Aprs avoir relev lhostilit dont la gnralit des orientalistes font preuve lgard de ceux qui ne se soumettent pas leur mthodes , Ren Gunon ajoutait : Malgr toutes les excuses que lon peut trouver (leur) attitude, il nen reste pas moins que les quelques rsultats valables auxquels leur travaux ont pu aboutir, ce point de vue spcial de lrudition qui est le leur, sont bien loin de compenser le tort quils peuvent faire lintellectualit gnrale, en obstruant toutes les autres voies qui pourraient mener beaucoup plus loin ceux qui seraient capables de les suivre (13) Ce texte ne correspond pas tout fait la situation actuelle : lpoque, les voies obstrues taient celles qui faisaient obstacle la diffusion des ides traditionnelles que Ren Gunon sefforait dintroduire en Occident en vue de modifier la mentalit gnrale ; de nos jours, il sagit plutt de combattre une approche spculative qui consiste rduire les doctrines rvles de lislm ces mmes ides en les dtachant de linspiration divine dont elles procdent, ce qui nous amne la question de la prsentation de la doctrine akbarienne. Celle-ci procde dune source principielle que lintellect ne peut contenir (14) et sappuie constamment, dans son expression formelle, sur les donnes de la rvlation. Linspiration du Sceau des saints est purement muhammadienne. Envisager son uvre du point de vue de l histoire des ides , cest la profaner et trahir son intention profonde. Seule une connaissance intime de son enseignement permet den communiquer le got ingalable qui fait paratre un peu fade les exposs dautres auteurs. Cette intimit est seule capable de rvler un aspect mal connu de ses crits, savoir quils renferment une guidance spirituelle et initiatique quivalente ce quest lenseignement oral et direct dun matre spirituel. Il y a l une modalit de la baraka muhammadienne qui ne peut
tre prserve quau moyen dune prsentation adquate, car elle ne saccomode pas de nimporte quel support. (13) Cf. ibid., p.268. (14) la diffrence du cur, qui, selon un hadith quds, contient Dieu . Cette prsence divine cache ne rside pas forcment dans les dveloppements doctrinaux ; elle est trangre la dcouverte de cls dont le rle demeure subsidiaire et prparatoire et qui peuvent conduire, quand leur usage nest pas matris, des drives dordre spculatif ou imaginaire. On la trouve plutt dans les anecdotes, des vnements ou des dtails personnels, des exemples, des remarques insolites qui sapparentent, par leur familiarit, un enseignement donn vive voix et qui ont pour effet de crer entre Ibn Arab et certains de ses lecteurs une intelligence et une harmonie comparables. L aussi, lessentiel est transmis parfois, non par ce qui est exprim,mais par ce qui est tu, comme dans lexemple suivant qui concerne la bonne opinion quil convient davoir du serviteur croyant, mme quand il commet des fautes : Pourquoi traiterait-on de pcheur un (serviteur croyant) qui est en train d'accomplir une oeuvre d'adoration ? La bonne opinion n'est-elle pas prfrable la mauvaise ? Ce que sera son avenir, nous n'en savons rien et, pour ce qui est pass, nous ignorons les consquences de ses actes et si Allah lui a pardonn ou non. Comme l'instant prsent est rgi par l'acte d'obissance que le serviteur accomplit et dont il est "revtu", il est prfrable d'avoir une bonne opinion de lui, car c'est l une manifestation indubitable de mansutude. Un ami dans la religion duquel j'ai la pleine confiance m'a rapport le cas d'un homme qui se faisait du tort luimme par ses excs (musrif 'al nafsihi). Cet ami me dit : "J'ai rencontr cet homme en un lieu o les gens taient assis et o l'on faisait circuler des boissons alcoolises (khamr). Il buvait avec les autres. Le vin tait venu manquer, on lui dit: "Va auprs d'un tel pour qu'il en rapporte d'autres". Il rpliqua : "Je n'en ferai rien ! De ma vie je n'ai jamais dcid d'accomplir un acte de dsobissance. Entre deux coupes, je fais retour Allah (l tawba) et je n'attends pas que l'on me prsente une autre. Lorsqu'elle arrive dans ma main, je demeure attentif: mon Seigneur m'accordera-t-il le succs de sorte que je la laisserai passer ou m'abandonnera-t-il de telle manire que je la boirai ?"" (15) Le Cheikh termine son rcit en disant : "Tel est, en effet, le souci des savants (vritables). Nanmoins, cet homme mourut en ayant dans le coeur un regret: celui de n'avoir pu me rencontrer. Un jour pourtant, je me trouvai prs de lui, mais il ne me connaissait pas; il posait des questions pour savoir o j'tais, tant tait vif son dsir de me voir !... Cela se passait Murcie en 595." Enfin, une prsentation traditionnelle dIbn Arab doit prendre en compte la manire dont celle-ci est perue dans les pays islamiques, o elle a
constamment fait lobjet dattaques et de suspicions engendres par lincomprhension (16). Mme au sein dorganisations initiatiques (turuq), elle est parfois rejete pour des questions de mthodes (17). Un souci de prudence excessive et mal claire conduit lui opposer une rfrence exclusive au Coran et la Sunna du Prophte , alors que ces deux sources traditionnelles inspirent et confirment lensemble des enseignements akbariens. Lon oublie que les donnes rvles peuvent donner lieu des interprtations diverses, et surtout une hirarchie de point de vue. Les savants officiels , ceux qui sen tiennent aux explications les plus ordinaires, ont quelque fois peine admettre quil puisse y en avoir de plus profondes et de plus compltes des degrs de comprhension auxquels ils nont pas accs. Lorsque lon examine les causes de cette hostilit rcurrente, lon saperoit quelles sont semblables celles que nous avons dmontres plus haut propos des prsentations acadmiques qui prvalent en Occident. Dans un cas comme dans lautre, tout le mal vient du fait quon ne dpasse pas le point de vue spculatif et individualiste en rduisant luniversalit des doctrines mtaphysiques et initiatiques des systmes particuliers qui donnent naissance des oppositions entre des ides considres comme contradictoires (18). Du ct islamique, ces oppositions prennent le plus souvent la forme de professions de foi (aqid) dogmatiques limitatives de la Vrit totale, au nom desquelles on prtend juger des enseignements qui ne peuvent tre conditionns par ces dfinitions. La doctrine universelle dIbn Arab inclut toutes les professions de foi lgitimes, allant parfois jusqu emprunter leur langage. Linadquation des crdos conditionns a t expose dans le Livre des Chatons propos du Verbe de Shuayb (19). Commentant le verset : En vrit, il y a en cela un rappel pour ceux dous de cur (Cor.50.37), le Cheikh dclare : (Dieu) na pas dit : pour ceux qui sont dous dintellect (spculatif), car lintellect conditionne il ne sagit nullement dun rappel pour ceux qui professent des crdos, qui se dclarent mcrants les uns les autres et qui se maudissent ; et plus loin : et ils nont pas de dfenseurs (Cor.3.22) : Dieu a ni que les vrits dogmatiques puissent tre dun secours quelconque pour ceux qui les envisagent sparment : ce qui est effectivement secouru, cest la Synthse (almajm) ; et ce qui secourt, cest galement la Synthse (al-majm) . Cette dernire indication renvoie la doctrine initiatique expose dans le prsent ouvrage, car le terme majm est de la mme racine que jumua qui dsigne le Jour du Vendredi. En effet, ce jour est celui de la synthse finale contenue dans la rvlation faite au Sceau des prophtes . Ce volume fait partie dune srie destine montrer comment lenseignement du plus grand des matres claire la signification des rites islamiques fondamentaux comme le jene ou encore la prire
accomplie sur l dfunt. Son nom de Muhiy-d-Dn indique quIbn Arab est, par excellence, le vivificateur de la religion , celui dont la science est utile selon la recommandation prophtique. Puissent ces ouvrages communiquer le got de cette doctrine et renforcer la foi de tous ceux qui laccueillent. (15) Cf. Futht, chap.72 ; tome 10, p.342 de ld. O.Yahy. (16) Ibn Arab y fait souvent allusion ; cf. par exemple, Le Livre du Mm, du Ww et du Nn, p.56-59. (17) Cf. Introduction lenseignement et au mystre de Ren Gunon, deuxime dition, p.18-19. (18) Michel Vlsan a fait cet gard lobservation suivante : Dailleurs, si lon voulait ne regarder que le sens littral, on pourrait trouver chez le Cheikh al-Akbar lui-mme des formulations tellement diffrentes de la mme doctrine, et cest mme le cas le plus frquent chez lui, quon pourrait les considrer comme tout fait contradictoires avec la position de la wahdat al-wujd. Mais les adversaires exotristes ou autres quil a eus, ou quil a encore et qui laccusent de panthisme , nont jamais lobjectivit de relever le fait, ni lastuce de le mettre en contradiction avec lui-mme ; ils seraient alors peut-tre obligs de faire un effort de comprhension, et ils risqueraient ainsi soit de douter du bien-fond de leur opinion, soit davouer ny rien comprendre ; cf. Etudes Traditionnelles, 1953, p.24. (19) Cf. p.318. (Charles-Andr Gilis - Pour une prsentation traditionnelle dIbn Arab postface de La prire du jour du vendredi ; p.133-137).
Vous aimerez peut-être aussi
- Azkar Frinsh Blac Red Final 2017Document117 pagesAzkar Frinsh Blac Red Final 2017Youssouf ALAOPas encore d'évaluation
- Le Manuel Du Pasteur FONCTION DU PASTEURDocument27 pagesLe Manuel Du Pasteur FONCTION DU PASTEURChristian Anybilo100% (1)
- Charles-André Gilis - L'ordre Universel de L'islâmDocument3 pagesCharles-André Gilis - L'ordre Universel de L'islâmbarouk444100% (1)
- Cle Spirituelle de L Astrologie Musulmane D Apres Mohyiddin Ibn ArabiDocument29 pagesCle Spirituelle de L Astrologie Musulmane D Apres Mohyiddin Ibn Arabihyperboree100% (2)
- Charles-André Gilis - L'ordre Universel de L'islâmDocument3 pagesCharles-André Gilis - L'ordre Universel de L'islâmbarouk444100% (1)
- Ontologie trinitaire: Penser et vivre à la lumière de la TrinitéD'EverandOntologie trinitaire: Penser et vivre à la lumière de la TrinitéPas encore d'évaluation
- Sciences religieuses traditionnelles en Islam: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandSciences religieuses traditionnelles en Islam: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le livre descendu: Essai d'exégèse coranique, Volume 2D'EverandLe livre descendu: Essai d'exégèse coranique, Volume 2Pas encore d'évaluation
- Charles-André Gilis - Le Statut Islamique de La FemmeDocument3 pagesCharles-André Gilis - Le Statut Islamique de La Femmebarouk444Pas encore d'évaluation
- Charles-André Gilis - L'Esprit Universel de L'islamDocument8 pagesCharles-André Gilis - L'Esprit Universel de L'islambarouk444Pas encore d'évaluation
- Station de L'équivalence Entre La Femme Et L'homme Dans Certaines Demeures Divines - Ibn ArabiDocument21 pagesStation de L'équivalence Entre La Femme Et L'homme Dans Certaines Demeures Divines - Ibn Arabibarouk444Pas encore d'évaluation
- Cheikh Martin Lings Abu Bakr Siraj Al-DinDocument4 pagesCheikh Martin Lings Abu Bakr Siraj Al-Dinlordbou66Pas encore d'évaluation
- Charles-André Gilis - La Papauté Contre L'islâmDocument81 pagesCharles-André Gilis - La Papauté Contre L'islâmroger111222100% (2)
- Charles-André Gilis - Le Pouvoir de La FemmeDocument3 pagesCharles-André Gilis - Le Pouvoir de La Femmebarouk444100% (1)
- Michel Vâlsan - Inde Et ArabieDocument5 pagesMichel Vâlsan - Inde Et ArabiePurushaPrakriti100% (1)
- Une Interprétation Cosmologique Des FUSÛS - Charles-André GilisDocument9 pagesUne Interprétation Cosmologique Des FUSÛS - Charles-André Giliskarina46Pas encore d'évaluation
- Ibn Arabi - Sur La Connaissance de La Station de L - Équivalence Entrela Femme Et L - Homme PDFDocument33 pagesIbn Arabi - Sur La Connaissance de La Station de L - Équivalence Entrela Femme Et L - Homme PDFAdrien BockPas encore d'évaluation
- These Rene GuenonDocument14 pagesThese Rene GuenonccshamiPas encore d'évaluation
- La Conversion À L'islam Par Guénon de Merlin Le DiscipleDocument7 pagesLa Conversion À L'islam Par Guénon de Merlin Le DiscipleMarco CodiciniPas encore d'évaluation
- Charles Andre Gilis Tawhid Et Ikhlas Chap 9Document5 pagesCharles Andre Gilis Tawhid Et Ikhlas Chap 9Mostafa MenierPas encore d'évaluation
- Etude Critique David BissonDocument51 pagesEtude Critique David BissonchristellechillyPas encore d'évaluation
- Compte-Rendu Paru Dans La Revue La Tourbe Des Philosophes, N° 24-25 (1983) - Jean Tourniac - Melkitsedeq Ou La Tradition PrimordialeDocument2 pagesCompte-Rendu Paru Dans La Revue La Tourbe Des Philosophes, N° 24-25 (1983) - Jean Tourniac - Melkitsedeq Ou La Tradition PrimordialeRoberto TurciPas encore d'évaluation
- (Etudes Traditionnelles - Islam - FR) - Geoffroy - Articles Soufime & IslamDocument178 pages(Etudes Traditionnelles - Islam - FR) - Geoffroy - Articles Soufime & IslamRoger Mayen100% (2)
- Shabestari - La Roseraie Du MystèreDocument226 pagesShabestari - La Roseraie Du MystèreismaelPas encore d'évaluation
- Le Grand Diwan - Ibn'ArabiDocument247 pagesLe Grand Diwan - Ibn'ArabiEcom Kal100% (1)
- Yawaqit 13 Étude 16Document30 pagesYawaqit 13 Étude 16Jonas LewisPas encore d'évaluation
- René Guénon Les Directions de L'espaceDocument7 pagesRené Guénon Les Directions de L'espacesyliusPas encore d'évaluation
- La Fin Des Temps Modernes - La Tariqah ShâdhiliyyahDocument1 pageLa Fin Des Temps Modernes - La Tariqah ShâdhiliyyahzamudioPas encore d'évaluation
- La GhaybatDocument282 pagesLa GhaybatYassine KonePas encore d'évaluation
- Le Développement de La Pensée D'henry Corbin Pendant Les Années Trente - Par Maria SosterDocument106 pagesLe Développement de La Pensée D'henry Corbin Pendant Les Années Trente - Par Maria Sosterdanielproulx2100% (2)
- Michel Vâlsan - Remarques Préliminaires Sur L'intellect Et La Conscience - ETDocument12 pagesMichel Vâlsan - Remarques Préliminaires Sur L'intellect Et La Conscience - ETkarina46Pas encore d'évaluation
- Michel Vâlsan, Sur Abu Yazid Al-BistamiDocument3 pagesMichel Vâlsan, Sur Abu Yazid Al-BistamiScienza SacraPas encore d'évaluation
- Frithjof Schuon Enseignements SpirituelsDocument233 pagesFrithjof Schuon Enseignements Spirituelsrosamystica111100% (2)
- Rene Guenon - Les Carnets Du YogaDocument7 pagesRene Guenon - Les Carnets Du YogaDuo Sing'Sing100% (1)
- Michel Vâlsan - Biblographie Par Ordre ChronologiqueDocument4 pagesMichel Vâlsan - Biblographie Par Ordre Chronologiquebarouk444100% (1)
- Lory, Pierre - Note Sur L'ouvrage Religion After Religion - Gershom Scholem, Mircea Eliade and Henry Corbin at Eranos, Par Steven M. WasserstromDocument11 pagesLory, Pierre - Note Sur L'ouvrage Religion After Religion - Gershom Scholem, Mircea Eliade and Henry Corbin at Eranos, Par Steven M. WasserstromhighrangePas encore d'évaluation
- Valsan - Remarques Occasionnelles Sur Jeanne D'arcDocument16 pagesValsan - Remarques Occasionnelles Sur Jeanne D'arcMahakala95Pas encore d'évaluation
- (Etudes Traditionnelles - Islam FR) - Charles-André Gilis - Articles Et Extraits de LivresDocument35 pages(Etudes Traditionnelles - Islam FR) - Charles-André Gilis - Articles Et Extraits de LivresRoger MayenPas encore d'évaluation
- Michel Vâlsan - La Science Propre À Jésus.Document6 pagesMichel Vâlsan - La Science Propre À Jésus.pemagesarPas encore d'évaluation
- Michel Vâlsan, Remarques Préliminaires Sur L'intellect Et La ConscienceDocument13 pagesMichel Vâlsan, Remarques Préliminaires Sur L'intellect Et La ConscienceScienza SacraPas encore d'évaluation
- Divin Féminin Et Spiritualité ChiiteDocument7 pagesDivin Féminin Et Spiritualité ChiiteIbrahima SakhoPas encore d'évaluation
- Jean Foucaud - Le Musulman Suédois, Cheykh Abdu-l-Hedi Al-Maghribi Uqayli - II. Le Précurseur. - Dinul QayyimDocument10 pagesJean Foucaud - Le Musulman Suédois, Cheykh Abdu-l-Hedi Al-Maghribi Uqayli - II. Le Précurseur. - Dinul QayyimRoberto TurciPas encore d'évaluation
- Michel Vâlsan - Un Texte Du Cheikh El-Akbar Sur La Réalisation DescendanteDocument20 pagesMichel Vâlsan - Un Texte Du Cheikh El-Akbar Sur La Réalisation DescendanteAldor RedouanePas encore d'évaluation
- Jean Moncelon - Les Cahiers D'orient Et D'occident No.28Document24 pagesJean Moncelon - Les Cahiers D'orient Et D'occident No.28danielproulx2Pas encore d'évaluation
- Michel Vâlsan - Textes Sur La Connaissance Suprême.Document11 pagesMichel Vâlsan - Textes Sur La Connaissance Suprême.pemagesarPas encore d'évaluation
- Le Mahdi Des ChiitesDocument11 pagesLe Mahdi Des ChiitesAbdallah ibn aliPas encore d'évaluation
- 6 - Ceux Qui Unıversalisent L'Islam Dans L'Histoire Et Dans Notre Epoque Mevlana, Yunus Emre Et M - Ikbal-Prof - DR - Halili CİNDocument10 pages6 - Ceux Qui Unıversalisent L'Islam Dans L'Histoire Et Dans Notre Epoque Mevlana, Yunus Emre Et M - Ikbal-Prof - DR - Halili CİNpll01Pas encore d'évaluation
- Les Perles Du Plongeur1Document76 pagesLes Perles Du Plongeur1DrawUrSoulPas encore d'évaluation
- L'Interprete Des Desirs - Ibn'ArabiDocument572 pagesL'Interprete Des Desirs - Ibn'ArabiEcom KalPas encore d'évaluation
- Gril, Le Commentaire Du Verset de La Lumière Par Ibn 'ArabiDocument10 pagesGril, Le Commentaire Du Verset de La Lumière Par Ibn 'ArabiYea YipPas encore d'évaluation
- Au Coeur de RGDocument579 pagesAu Coeur de RGDIegobPas encore d'évaluation
- Al Zeituni - QuatrainsDocument126 pagesAl Zeituni - Quatrains1001nuits67% (3)
- Biographie de L'imam ZarruqDocument11 pagesBiographie de L'imam Zarruqqutb111Pas encore d'évaluation
- Les nouvelles Fourberies de Djeha: (l'autre Nasr Eddin Hodja)D'EverandLes nouvelles Fourberies de Djeha: (l'autre Nasr Eddin Hodja)Pas encore d'évaluation
- Nasr Eddin Hodja rencontre Diogène: Très-Mirifiques et Très-Edifiantes Aventures du Hodja Nasr EddinD'EverandNasr Eddin Hodja rencontre Diogène: Très-Mirifiques et Très-Edifiantes Aventures du Hodja Nasr EddinPas encore d'évaluation
- Histoire des Musulmans d'Espagne, t. 3/4 jusqu'à la conquête de l'Andalouisie par les Almoravides (711-1100)D'EverandHistoire des Musulmans d'Espagne, t. 3/4 jusqu'à la conquête de l'Andalouisie par les Almoravides (711-1100)Pas encore d'évaluation
- Musulmophobie - Origines ontologique et psychologiqueD'EverandMusulmophobie - Origines ontologique et psychologiquePas encore d'évaluation
- L'islam dans tous ses états: de Mahomet aux dérives islamistesD'EverandL'islam dans tous ses états: de Mahomet aux dérives islamistesPas encore d'évaluation
- La Doctrine Des Trois SceauxDocument5 pagesLa Doctrine Des Trois Sceauxbarouk444100% (2)
- Voyage À Travers La Bibliothèque de René GuénonDocument2 pagesVoyage À Travers La Bibliothèque de René Guénonbarouk444100% (1)
- Station de L'équivalence Entre La Femme Et L'homme Dans Certaines Demeures Divines - Ibn ArabiDocument21 pagesStation de L'équivalence Entre La Femme Et L'homme Dans Certaines Demeures Divines - Ibn Arabibarouk444Pas encore d'évaluation
- Ibn 'Arabi (Maqdisi) - Shajarat Al-KawnDocument18 pagesIbn 'Arabi (Maqdisi) - Shajarat Al-KawnTur111Pas encore d'évaluation
- René Guénon - Nécessité de L'exoterisme TraditionnelDocument4 pagesRené Guénon - Nécessité de L'exoterisme Traditionnelbarouk444Pas encore d'évaluation
- الفتوحات المكيه 1Document1 121 pagesالفتوحات المكيه 1suhaibu100% (6)
- Michel Vâlsan - Biblographie Par Ordre ChronologiqueDocument4 pagesMichel Vâlsan - Biblographie Par Ordre Chronologiquebarouk444100% (1)
- Ibn 'Arabî - La Présence Du LutfDocument1 pageIbn 'Arabî - La Présence Du Lutfbarouk444100% (1)
- Charles Andre Gilis Tawhid Et JihadDocument5 pagesCharles Andre Gilis Tawhid Et JihadMostafa MenierPas encore d'évaluation
- RENE GUENON - Y-A-T-Il Encore Des Possibilités Initiatiques Dans Les Formes Traditionnelles OccidentalesDocument7 pagesRENE GUENON - Y-A-T-Il Encore Des Possibilités Initiatiques Dans Les Formes Traditionnelles Occidentalesbarouk444Pas encore d'évaluation
- Charles Andre Gilis Tawhid Et Ikhlas Chap 9Document5 pagesCharles Andre Gilis Tawhid Et Ikhlas Chap 9Mostafa MenierPas encore d'évaluation
- Michel Valsan L Investiture Du Cheikh Al Akbar Au Centre SupremeDocument15 pagesMichel Valsan L Investiture Du Cheikh Al Akbar Au Centre SupremeMostafa MenierPas encore d'évaluation
- Charles-André Gilis - Le Pouvoir de La FemmeDocument3 pagesCharles-André Gilis - Le Pouvoir de La Femmebarouk444100% (1)
- Michel Valsan L Islam Et La Fonction de Rene Guenon Article CompletDocument25 pagesMichel Valsan L Islam Et La Fonction de Rene Guenon Article CompletMostafa MenierPas encore d'évaluation
- Charles Andre Gilis L Integrite IslamiqueDocument30 pagesCharles Andre Gilis L Integrite IslamiqueBachir Niang100% (2)
- Michel Vâlsan - Remarques Préliminaires Sur L'intellect Et La Conscience - ETDocument12 pagesMichel Vâlsan - Remarques Préliminaires Sur L'intellect Et La Conscience - ETkarina46Pas encore d'évaluation
- Charles-André Gilis - L'Esprit Universel de L'islamDocument8 pagesCharles-André Gilis - L'Esprit Universel de L'islambarouk444Pas encore d'évaluation
- Charles-André Gilis - Le Statut Islamique de La FemmeDocument3 pagesCharles-André Gilis - Le Statut Islamique de La Femmebarouk444Pas encore d'évaluation
- Le Nouveau Vous Et Le Saint EspritDocument126 pagesLe Nouveau Vous Et Le Saint EspritDemassou Jérémie100% (8)
- Marie Heurtin 1904 PDFDocument71 pagesMarie Heurtin 1904 PDFAlbocicade100% (2)
- Calendrier Musulman corrigé-1Document50 pagesCalendrier Musulman corrigé-1nathanaellonkpame1Pas encore d'évaluation
- CS N°11 L'humiliteDocument13 pagesCS N°11 L'humiliteAlex Dnp03Pas encore d'évaluation
- De Admirandis Numerorum Platonicorum SecretisDocument3 pagesDe Admirandis Numerorum Platonicorum SecretisTiffany BrooksPas encore d'évaluation
- Les Principes de La Sunna Ousoul As-SunnaDocument4 pagesLes Principes de La Sunna Ousoul As-SunnaMathieu RichardPas encore d'évaluation
- Mode D Emploi Comment Parler Du Ramadan A Vos EnfantsDocument27 pagesMode D Emploi Comment Parler Du Ramadan A Vos EnfantsPancake760% (1)
- L'Atlantique Feministe. L'intersectionnalité en Débat.Document17 pagesL'Atlantique Feministe. L'intersectionnalité en Débat.Luis Fernando Gutiérrez DomínguezPas encore d'évaluation
- Une-Vie-Interieure-Epanouie - Andrew-MurrayDocument171 pagesUne-Vie-Interieure-Epanouie - Andrew-MurrayJordanPas encore d'évaluation
- Henry Michaux Et Les GouffresDocument8 pagesHenry Michaux Et Les GouffresFet BacPas encore d'évaluation
- Orgueil Égocentrisme Et NarcissismeDocument14 pagesOrgueil Égocentrisme Et NarcissismeConstance Descartes100% (1)
- 36407415595Document2 pages36407415595habonimanayvan49Pas encore d'évaluation
- Programme Mariage EgliseDocument16 pagesProgramme Mariage EglisemouperPas encore d'évaluation
- Faire Fonctionner Le Mariage - Faith Oyedepo-1Document71 pagesFaire Fonctionner Le Mariage - Faith Oyedepo-1Endjy Laguerre100% (3)
- 3e Lettre de BAYE Dans Djawâhirou RassâilDocument3 pages3e Lettre de BAYE Dans Djawâhirou Rassâilbolonice100% (1)
- Patience Dans Le Coran (La) Télécharger, Lire PDFDocument5 pagesPatience Dans Le Coran (La) Télécharger, Lire PDFOuzaouitPas encore d'évaluation
- Tableau Synoptique Des Grandes Religions Fiche PédagogiqueDocument2 pagesTableau Synoptique Des Grandes Religions Fiche PédagogiqueJohn TimothyPas encore d'évaluation
- Guide Omra DoganDocument20 pagesGuide Omra Doganfhpndjb67dPas encore d'évaluation
- Litanies de La Vierge MarieDocument1 pageLitanies de La Vierge MarieYves BlanchardPas encore d'évaluation
- Un Livre de Priere Publie en Langue Française Par La Metropole Orthodoxe Roumaine D'europe Occidentale Et MeridionaleDocument7 pagesUn Livre de Priere Publie en Langue Française Par La Metropole Orthodoxe Roumaine D'europe Occidentale Et MeridionaleAnonymous 52asQOUcyPas encore d'évaluation
- DajaalDocument7 pagesDajaalSameer AumPas encore d'évaluation
- تيسير مصطلح الحديثDocument911 pagesتيسير مصطلح الحديثnuckcheddyPas encore d'évaluation
- La Nature de DieuDocument42 pagesLa Nature de DieuSylvain HounyemePas encore d'évaluation
- L Approche Du PR Geneviere Gobillot PDFDocument4 pagesL Approche Du PR Geneviere Gobillot PDFSamir BenmouffokPas encore d'évaluation