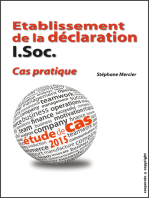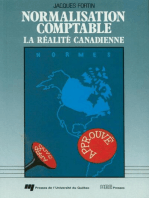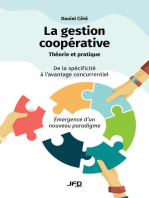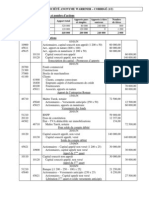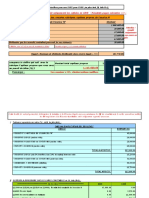Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cpta Bis
Cpta Bis
Transféré par
AbdelhamidOughanem0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
19 vues208 pagesTitre original
cpta_bis
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
19 vues208 pagesCpta Bis
Cpta Bis
Transféré par
AbdelhamidOughanemDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 208
1
Ecole Suprieure des Affaires
Rue du Collge, 8 5000 Namur
Initiation au systme dinformation comptable
Les socits
Notions de TVA et de Fiscalit
2011 2012
M. FIEVET
Y. MINE
2
Table des matires
Chapitre 1 : le bilan
1.1 lentreprise
1.2 les relations de lentreprise avec les tiers
1.3 cration de lentreprise
1.4 description du bilan
1.5 signification du bilan
Chapitre 2 : le rsultat de lentreprise
2.1 produits, charges, bnfices
2.2 description du compte de rsultats
Chapitre 3 : obligations comptables des entreprises
3.1 principes gnraux
3.2 livres et documents
3.2.1 les obligations des petites entreprises
3.2.2 les obligations des grandes entreprises
3.3 le livre journal
3.4 le livre des comptes ou grand livre
Chapitre 4 : la comptabilit simplifie
4.1 aperu succinct de la tva
4.2 les diffrents taux
4.3 comptabilisation des taxes
4.4 les facturiers
4.4.1 le facturier dentre, ou journal des achats
4.4.2 le facturier de sortie, ou journal des recettes
Chapitre 5 : notions gnrales de comptabilit en partie double
5.1 fonctionnement
5.1.1 obligations lgales
5.1.2 organisation pratique
5.1.3 rgles gnrales
5.2 technique des comptes
5.3 classement des comptes
5.4 plan comptable simplifi
Chapitre 6 : oprations courantes
6.1 les documents courants
6.1.1 la facture
6.1.2 la note de crdit
6.2 oprations dachat
6.2.1 enregistrement des notes de crdit
6.3 oprations de vente
6.4 oprations financires
6.4.1 les garanties
6.4.2 le crdit de caisse
6.4.3 le crdit descompte
6.4.4 les oprations temprament
6.4.5 le crdit hypothcaire
6.4.6 le leasing
3
Chapitre 7 : les relations de lentreprise
7.1 clients et fournisseurs
7.2 tva
7.3 emprunts et charges financires
7.4 les frais de personnel
7.5 relations avec les entreprises
Chapitre 8 : clture des comptes annuels
8.1 principes gnraux
8.2 amortissements
8.3 variations des stocks
8.3.1 mthode PMP
8.3.2 mthode FIFO
8.3.3 mthode LIFO
8.4 rgularisations
8.5 autres
8.6 tablissement des comptes annuels
Chapitre 9 : lecture critique des comptes annuels
9.1 lactif
9.2 le passif
9.3 comptes de rsultats
9.4 enseignements du bilan
9.5 les masses bilantaires
9.6 le fonds de roulement
9.7 le besoin en fonds de roulement
Chapitre 10 : les socits
10.1 la constitution des socits
10.2 le plan financier
10.2.1 dispositions lgales
10.2.2 contenu
10.3 les statuts de la socit
10.4 lattestation bancaire
10.5 les apports
10.6 immatriculation au Registre de Commerce
10.7 la dnomination de la socit
10.8 le sige de la socit
10.9 lobjet de la socit
10.10 le capital
10.11 la souscription du capital
10.12 la libration du capital
10.13 le fonctionnement de la socit
10.13.1 lassemble gnrale
10.13.2 la convocation lassemble gnrale
10.13.3 la tenue de lassemble gnrale
10.13.4 les pouvoirs de lassemble gnrale
10.13.5 les administrateurs et les grants
10.13.6 la nomination des administrateurs et des grants
10.13.7 les pouvoirs des administrateurs et des grants
10.13.8 les commissaires
4
Chapitre 11 : les diffrents types de socits
11.1 la SA Socit Anonyme
11.1.1 constitution de la SA
11.1.2 le fonctionnement de la SA
11.2 la SNC Socit en Nom Collectif
11.2.1 administration de la socit
11.2.2 dissolution de la socit
11.3 la Socit en Commandite Simple
11.3.1 administration de la socit
11.4 la Socit en Commandite par Actions
11.4.1 administration de la socit
11.5 la SPRL Socit Prive Responsabilit Limite
11.5.1 constitution de la SPRL
11.5.2 fonctionnement de la SPRL
11.6 la SC Socit Cooprative
11.6.1 constitution de la SC
11.6.2 fonctionnement de la SC
Chapitre 12 : le passage en socit
12.1 opportunit de passer en socit
12.2 pistes possibles pour exercer une activit
12.2.1 indpendant en personne physique
12.2.2 association de fait
12.2.3 passer en socit
12.3 considrations fiscales
12.4 inconvnients de passer en socit
12.5 avantages passer en socit
Chapitre 13 : comptabilit informatique
Chapitre 14 : la TVA
14.1 concept de lassujetti
14.2 petites entreprises
14.3 obligations de lassujetti
14.4 listing annuel tva
14.5 rgime forfaitaire
14.5.1 mcanisme
14.5.2 bases forfaitaires
14.5.3 conditions dadmission au forfait
14.5.4 secteurs ou la forfait peut tre pratiqu
14.6 Lacquisition intracommunautaire
Chapitre 15 : lments de fiscalit
15.1 structure du systme fiscal belge
15.2 lIPP Impt des Personnes Physiques
15.3 la dclaration
15.4 taxation par prcomptes
15.5 versements anticips
15.6 schma gnral dimposition
15.6.1 revenus immobiliers
15.6.2 revenus mobiliers
15.6.3 revenus professionnels
15.6.4 avantages en nature
15.6.5 les profits
15.7 revenus imposables distinctement
5
15.8 dpenses donnant droit une rduction dimpt
15.8.1 frais professionnels
15.8.2 personnes charge
15.8.3 limites maximales des dductions
15.9 dcumul des revenus
15.10 calcul de limpt
15.11 lISOC Impt des Socits
15.12 socits assujetties lISOC
15.13 base de calcul de limpt
15.14 montants dductibles
15.15 calcul de lISOC
15.16 limpt des personnes morales
15.17 base de limpt des personnes morales
Chapitre 16 : autres taxes
16.1 les accises
16.2 les cotaxes
16.3 droits denregistrement, dhypothque et de greffe
Chapitre 17 : les incoterms
Chapitre 18 : introduction la logistique
Chapitre 19 : le SEPA
6
CHAPITRE 1 : LE BILAN
1.1 L'entreprise.
Dfinition de lentreprise : Groupement de personnes hirarchis qui met en uvre des
ressources pour produire des richesses conformment des objectifs qui relvent de
diffrentes motivations (profit, recherche ).
Crer une entreprise exige des moyens
financiers et/ou
matriels,
apports en premier lieu par le crateur, cet apport personnel est appel capital.
Ce capital peut galement tre apport par des actionnaires extrieurs :
pouvoirs publics
investisseurs privs
socits
Ce capital peut consister :
en une somme d'argent que le crateur met la disposition de son affaire;
mais aussi, ventuellement, en immeuble (un local commercial), matriel, mobilier, stock
de marchandises qu'il possdait avant de lancer son affaire ;
c'est ce capital que l'entrepreneur entend faire fructifier; il dsire galement le rcuprer
lorsquil cessera ses activits, major dun bnfice.
7
Le chiffre daffaire gnr par lentreprise doit couvrir tous les cots de production ; cest le
seuil de rentabilit. A ce stade, les actionnaires ne reoivent aucun dividende.
1.2 Les relations de lentreprise avec les tiers.
Ce schma prsente le rle de la comptabilit gnrale et cerne les relations de lentreprise
avec les tiers et notamment les flux financiers existants.
La base de la comptabilit gnrale est constitue de documents tablis de faon
contradictoire et donc probablement corrects.
Dfinition de la comptabilit
La comptabilit est une technique denregistrement et de classement selon un plan adapt,
de faits conomiques, juridiques et financiers qui se produisent dans une entit conomique
et influencent, ou risquent dinfluencer la composition et/ou le niveau de son patrimoine. Elle
est organise dans le but de fournir des informations de gestion. Elle informe mais ne gre
pas.
1.3 Cration de lentreprise
Lors de la cration de l'entreprise, son propritaire apporte un capital qui se matrialise sous
la forme d'argent ou de biens; ce qui permet de dresser le bilan de dpart de l'entreprise.
8
Exemple : un boulanger cre sa propre affaire, sous le nom de Au bon pain et apporte
une somme d'argent de 20.000 , qu'il dpose sur un compte en banque ouvert au nom de
"Au bon pain"; ce qui donne le bilan initial suivant :
Le bilan est un tableau deux volets, dont la partie gauche est appele actif, et la partie
droite passif.
l'actif du bilan regroupe les avoirs et les crances,
le passif du bilan comporte le capital et toutes les dettes de l'entreprise.
Le passif montre donc les ressources et sources de financement de l'entreprise, tandis que
l'actif explique comment les ressources sont employes, quelles fins elles sont utilises.
Vu que les diverses utilisations des ressources sont forcment quivalentes celles-
ci, il en dcoule que l'actif et le passif seront toujours gaux.
ACTIF DU BILAN = PASSIF DU BILAN
1.4 Description du bilan
Le bilan est un document standardis et impos par la loi; pour les socits, le bilan doit
rpondre une prsentation impose, reprenant 10 rubriques l'actif et 10 rubriques au
passif. Voici les rubriques les plus courantes dans la comptabilit des PME.
Actif Passif
IX Disponible 20000 I Capital 20000
Total 20000 Total 20000
Actif Passif
avoirs capitaux
crances dettes
Total actif .= Total passif
Emploi des ressources .= Ressources
Actif Passif
III Immo corporelles I Capital
VI Stocks IV Rserves
VIII Crances un an au plus VIII Dettes plus d'un an
IX Disponible IX Dettes un an au plus
Total Total
9
Actif
les immobilisations corporelles (III) sont essentiellement constitues par
les terrains & btiments
les installations, machines & outillages
le matriel roulant
le mobilier
dtenus par l'entreprise (ou pris en leasing)
les stocks (VI) comprennent les matires premires, approvisionnements, marchandises et
produits finis
les crances un an au plus un an maximum - (VII) reprennent les montants dus
l'entreprise par ses clients, ainsi que par tout autre dbiteur (associ, fisc, ...), et qui doivent
tre payes avant la fin de l'exercice comptable
le disponible regroupe les sommes se trouvant en compte bancaire, en C.C.P. et en caisse
Passif
le capital (I) est l'apport personnel du propritaire de l'entreprise; dans les socits, il s'agit
des apports raliss par les diffrents associs
les rserves (IV) constituent dans les socits (sprl, sa, scrl) un prolongement du capital;
elles proviennent de la non-distribution aux associs d'une partie du bnfice; en particulier,
la rserve lgale, impose par la loi, se constitue par un prlvement de 5 % sur le bnfice
annuel, jusqu' atteindre 10 % du capital souscrit;
les dettes reprennent tout ce que l'entreprise doit ses banquiers, fournisseurs, au fisc, la
TVA, son personnel et sont classes en deux catgories :
celles qui viennent chance dans les 12 mois (dettes un an au plus (IX)),
celles qui viennent chance au-del de cette priode (dettes plus d'un an (VIII)).
1.5 Signification du bilan.
Reprenons l'exemple de l'entreprise Au bon pain
Le boulanger avait cr son affaire par un apport en banque de 20.000 Euros
Avec son argent, il s'quipe de matriel pour 8.000 Euros et de mobilier pour 3.500 Euros,
en payant ses fournisseurs au comptant; aprs ces oprations, son nouveau bilan se
prsentera comme suit :
Actif Passif
III Immo. Corporelles 11500 I Capital 20000
matriel 8000
mobilier 3500
IX Disponible 8500
Total 20000 Total 20000
10
le capital n'a pas chang (le boulanger n'a rien apport de plus, ni rien repris);
la structure de l'actif a t modifie : moins d'argent en banque, apparition du matriel et
du mobilier;
le total du bilan reste inchang, car il n'y a pas de ressources nouvelles.
Observez la disposition du bilan : les rubriques principales sont numrotes en chiffres
romains (toujours les mmes), et certaines rubriques sont dtailles (immobilisations
corporelles, par exemple); prenez l'habitude de toujours prsenter vos bilans selon ce
schma.
Le boulanger achte maintenant un stock de produits de base, pour un montant de 1.500
Euros; son fournisseur accepte qu'il paie dans 6 semaines; il a donc maintenant une dette
vis--vis de ce fournisseur et le bilan devient :
L'actif et le passif ont augment car les ressources ont augment sous la forme dune dette
envers un fournisseur.
Le total est le rsultat de laddition des valeurs comprises dans les grandes catgories
(chiffres romains). Les valeurs telles que celles de Matriel et Mobilier sont lexplication de la
ventilation des postes lintrieur du point III. Ces valeurs ne sont pas comptes 2 fois.
Le bilan d'une entreprise donne un instantan de sa situation patrimoniale un moment
dtermin. Lvolution des circonstances conomiques dans lesquelles lentreprise volue
fait donc que sa situation patrimoniale change en permanence au rythme des recettes et des
dpenses quelle rencontre.
Toutes les entreprises dressent leur bilan une fois par an, aprs inventaire, la fin de
l'exercice comptable qui dure normalement une anne. L'entrepreneur peut tirer des
situations bilantaires tous les trimestres ou tous les mois pour savoir o il en est.
Pour enregistrer les modifications des postes du bilan durant l'exercice comptable, il faut
tenir un systme de comptes qui sont des fiches reprsentant chacune une rubrique du bilan
et sur lesquelles on enregistre les modifications apportes cette rubrique en cours
d'exercice, cest--dire tous les mouvements internes, toutes les entres et toutes les sorties.
Actif Passif
III Immo. Corporelles 11500 I Capital 20000
matriel 8000
mobilier 3500 IX Dette un an au plus 1500
VI Stock 1500 fournisseur 1500
IX Disponible 8500
Total 21500 Total 21500
11
Vocabulaire de base
actif, passif; ressources, emplois; bilan, exercice comptable, inventaire.
crances: ce que l'on vous doit; vous tes le crancier, et la personne qui vous doit de
l'argent est votre dbiteur.
dettes: ce que vous devez vos cranciers; vous tes le dbiteur
patrimoine: votre patrimoine est compos de vos avoirs propres, de vos crances car cest
de largent qui vous est d et de vos dettes car ce sont des choses dont vous disposez et
que vous navez pas encore payes.
immobilisations corporelles, stocks, disponible, capital, rserves.
EXERCICES
1/ Classez ces diffrentes valeurs en actif ou en passif. Cochez la colonne adquate
Actif Passif
Caisse x
Capital x
Caution tlphone x
Chque payer x
Client qui doit encore payer x
CCP x
Dividendes payer x
Emprunt auprs dune banque x
Fournisseur que lon doit encore payer x
Garantie locative x
Marchandise en stock x
Mobilier de bureau x
Ordinateur x
Voiture x
2/ Etablissez le bilan partir des donnes suivantes :
Immeuble : 15.000 voiture : 850 fournisseurs que lon doit encore payer : 650
camionnette : 1.200 caisse : 120 ccp : 500 emprunt la banque : 7.000 capital :
10.020
3/ Mme exercice utilisez les numros de rubriques
- Immeuble : 30.000 - Clients 1.800
- Capital : 25.000 - Prt hypothcaire : 22.000
- Stock march. : 9.000 - Mobilier : 3.500
- Fournisseurs : 1.200 - Banque Fortis. : 750
- Banque Dexia : 3.150
Note : un prt hypothcaire est un prt long terme (10 25 ans) destin la construction
ou l'achat d'un immeuble.
12
4/ Cherchez la valeur du capital et tablissez le bilan
- Stock march. : 2.245 - Banque : 1.690
- Fournisseurs : 975 - Matriel : 6.190
- Mobilier : 1.960 - Impt payer : 1.110
5/ Bilan de dpart
Les oprations suivantes ont t effectues :
- achat de matriel pour 6.250 , paiement l'aide du disponible;
- achat d'un stock de marchandises pour 940 , le fournisseur fait crdit;
- remboursement de 625 du prt, l'aide du disponible.
Dressez le nouveau bilan.
6/ Cration de la socit InfoNamur. Faites les bilans successifs et observez ce qui change
dun tat lautre, ensuite, passez les critures et soldez les comptes.
1 janvier : apport en nature de A, immeuble de valeur 500.000
apport en espces de B : 300.000
apport en espces de C : 150.000
15 janvier : dpt de 400.000 sur le compte bancaire interne de lentreprise
1 fvrier : achat dun vhicule doccasion pour 20.000 au garage G. Paiement dans les
15 jours
10 fvrier : achat de mobilier H pour 5.000
15 fvrier : paiement de G par banque
1 avril : le fournisseur H accorde un dlai de paiement de 1 an
7/ Cration de la socit Garage ABC. Faites les bilans successifs et observez ce qui
change dun tat lautre.
1 juillet : apport en nature (mobilier) de X pour 12.000
apport en espces de Y pour 200.000
apport en espces de 100.000
2 juillet : achat dun immeuble de 51.000 Z
Actif Passif
IX Disponible 15625 I Capital 10000
VIII Dettes plus d'un an 5625
Total 15625 Total 15625
13
4 juillet : dpt de 290.000 sur le compte bancaire de la socit
5 juillet : paiement de Z par la banque
12 juillet : achat dun vhicule pour 42.000 chez W
15 juillet : W accorde un dlai de paiement de 5 mois
9/ Complter le tableau
dbite / crdite actif / passif
Si le compte de .. capital augmente, on le car c'est un compte de passif
Si le compte de .. caisse augmente, on le car c'est un compte de actif
Si le compte de .. immeubles augmente, on le car c'est un compte de actif
Si le compte de .. caisse diminue on le car c'est un compte de actif
Si le compte de .. banque augmente, on le car c'est un compte de actif
Si le compte de .. fournisseurs augmente, on le car c'est un compte de passif
Si le compte de .. dette financire augmente, on le car c'est un compte de passif
Si le compte de .. fournisseurs diminue on le car c'est un compte de passif
Si le compte de .. matriel roulant augmente, on le car c'est un compte de actif
Si le compte de .. mobilier augmente, on le car c'est un compte de actif
Si le compte de .. dette long terme augmente, on le car c'est un compte de passif
Si le compte de .. banque diminue on le car c'est un compte de actif
14
CHAPITRE 2 : LE RESULTAT DE L'ENTREPRISE.
2.1 Produits, charges, bnfice
A/ L'objectif normal de toute entreprise est de faire du profit qui permet l'entrepreneur de se
rmunrer pour son travail, et pour le capital qu'il a investi.
Pour raliser ce profit, l'entrepreneur va vendre des biens ou prester des services un prix
qui lui permet de couvrir ses propres achats et ses frais de toute nature. Ces diffrentes
oprations sont enregistres par le compte de rsultats, appel aussi compte dexploitation.
B/ On enregistre dans les produits tout montant provenant d'une opration ayant ou devant
engendrer une recette pour l'entreprise : vente de marchandises, prestation de services
(main-d'oeuvre), intrts encaisss sur des placements d'argent, ...
Attention ne pas confondre produits et recettes
1/ je vends des marchandises un client : j'enregistre un produit (et une crance) = flux
"physique";
2/ le client me paie : j'enregistre une recette (et j'annule la crance) = flux "financier"
C/ On enregistre dans les charges tout montant provenant d'une opration ayant ou devant
engendrer une dpense (ou une perte de recette, ou d'actif) pour l'entreprise : achat de
marchandises, de services, frais gnraux, salaires du personnel, taxes, frais financiers.
Attention ne pas confondre charges et dpenses
1/ j'achte des marchandises un fournisseur : j'enregistre une charge (et une dette) = flux
"physique"
2/ je paie mon fournisseur : j'enregistre une dpense (et j'annule la dette) = flux "financier"
2.2 Description du compte rsultat
BENEFICE = PRODUITS - CHARGES
On peut prsenter le compte de rsultats de la manire suivante :
I VENTES ET PRESTATIONS (chiffre d'affaires) +
II CHARGES D'EXPLOITATION (cot des ventes) -
achats & variations des stocks
frais gnraux (services et biens divers)
rmunrations et charges sociales
amortissements & rductions de valeurs
charges diverses
15
III RESULTAT D'EXPLOITATION
IV PRODUITS FINANCIERS +
V. CHARGES FINANCIERES -
IX. RESULTAT BRUT
X. impts sur le bnfice -
= RESULTAT NET
le chiffre d'affaires [CA] est constitu par le total des ventes et prestations de
l'entreprise (ne pas confondre chiffre d'affaires et bnfice);
les achats reprennent les matires premires, approvisionnements et marchandises;
les frais gnraux reprennent essentiellement
le loyer des btiments professionnels;
l'entretien courant des btiments;
l'lectricit, le chauffage, l'eau;
les frais de bureau;
les frais de dplacements (voiture, );
les frais de publicit;
les frais de rception (restaurant)
les honoraires des experts (comptables, avocat);
les commissions
les rmunrations et chartes sociales reprennent les salaires, primes et avantages
verss au personnel salari de l'entreprise, ainsi que les cotisations de scurit
sociale (ONSS, assurance-loi, ...) payes par l'employeur;
les amortissements consistent en la prise en charge de l'usure de l'immobilis
les charges diverses reprennent les taxes (taxes communales, par ex.), les amendes
les charges financires reprennent les intrts pays sur les emprunts, les frais
bancaires, les escomptes, ...
Le bnfice net de l'entreprise appartient son propritaire; celui-ci (ou ceux-ci, s'il s'agit
d'une socit) doit donc dcider de son affectation. Vu que lentreprise est redevable de ses
rsultats envers ses propritaires, laffectation du rsultat comportera la prsence dun
compte de dettes. Cette dette sera en augmentation si il y a bnfice et en diminution si il y
a perte.
16
L'entrepreneur peut s'attribuer le bnfice qui lui revient, (dette de l'entreprise envers son
propritaire); il peut aussi dcider d'affecter le bnfice en rserve (au moins la rserve
lgale, ensuite dautres rserves volontaires), ou en bnfice report (cf impts, prcaution
envers des frais venir).
Ainsi, quelle que soit l'affectation, le bnfice fera toujours partie du passif du bilan.
Si l'entreprise ralise une perte, l'entrepreneur peut prendre diverses dcisions :
combler cette perte l'aide de moyens personnels;
absorber la perte par diminution de son capital (!!! pas sous le plancher requis si socit);
reporter la perte dans le bilan, en attendant des jours meilleurs; dans ce cas, la perte
figure aussi au passif, sous la rubrique PERTE REPORTEE.
On peut reporter une perte lexercice comptable suivant via lcriture suivante :
140 perte reporte (cpte de dette en diminution) 100000
790 perte reporter (cpte de produit en augmentation) 100000
17
CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES
3.1 Principes gnraux.
La loi oblige les entreprises tenir une comptabilit, mais adapte leurs besoins. Il est
vident que les obligations comptables du commerant indpendant seront moins
exigeantes que celles de la P.M.E. ou de la grande entreprise.
Notre lgislation distingue diffrentes catgories d'entreprises :
Classification europenne
1) PME
Par PME au sens europen applicable partir du 1er janvier 2005, il faut entendre:
* la micro entreprise est une petite entreprise:
1) dont l'effectif d'emploi compte moins de 10 travailleurs;
2) et dont:
a) soit le chiffre d'affaires annuel n'excde pas 2.000.000 euros;
b) soit le total du bilan annuel n'excde pas 2.000.000 euros.
* la petite entreprise est l'entreprise:
1) dont l'effectif d'emploi compte au moins 10 travailleurs et moins de 50 travailleurs;
2) et dont:
a) soit le chiffre d'affaires annuel n'excde pas 10.000.000 euros;
b) soit le total du bilan annuel n'excde pas 10.000.000 euros.
* la moyenne entreprise est l'entreprise:
1) dont l'effectif d'emploi compte au moins 50 travailleurs et moins de 250 travailleurs;
2) et dont:
a) soit le chiffre d'affaires annuel n'excde pas 50.000.000 euros;
b) soit le total du bilan annuel n'excde pas 43.000.000 euros.
Types d'entreprises prendre en compte pour le calcul de l'effectif et des montants
financiers.
En ce qui concerne le calcul des seuils viss ci-dessus, on distingue 3 types d'entreprises en
fonction du type de relations qu'elles entretiennent avec d'autres entreprises en termes de
participation au capital et de droit de vote (le plus lev des 2 taux tant pris en compte); il
s'agit de:
- l'entreprise autonome, si elle:
* n'a pas de participation de 25% ou plus dans une autre entreprise;
* n'est pas dtenue directement 25% ou plus par une entreprise ou un organisme public,
ou conjointement par plusieurs entreprises lies ou organismes publics, part quelques
exceptions;
18
Remarque:
Une entreprise est considre comme autonome si le seuil de 25% est atteint ou dpass,
lorsqu'on est en prsence des catgories d'investisseurs suivants ( condition que ceux-ci ne
soient pas lis avec l'entreprise demanderesse):
- socits publiques de participation, socits de capital risque, personnes physiques ou
groupes de personnes physiques ayant une activit rgulire d'investissement en capital
risque ("business angels") qui investissent des fonds propres dans des entreprises non-
cotes en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits "business angels" dans une
mme entreprise n'excde pas 1.250.000 euros;
- universits ou centres de recherche but non lucratif;
- investisseurs institutionnels, y compris fonds de dveloppement rgional.
* n'tablit pas de comptes consolids et n'est pas reprise dans les comptes d'une entreprise
qui tablit des comptes consolids et n'est donc pas une entreprise lie.
- l'entreprise partenaire d'une autre entreprise, si:
* possde une participation comprise entre 25% et moins de 50% dans celle-ci;
* cette autre entreprise dtient une participation comprise entre 25% et moins de 50% dans
l'entreprise demanderesse;
* l'entreprise demanderesse n'tablit pas de comptes consolids reprenant cette autre
entreprise et n'est pas reprise par consolidation dans les comptes de celle-ci ou d'une
entreprise lie cette dernire.
- l'entreprise est lie, si elle:
* fait partie d'un groupe;
* est tenue d'tablir des comptes consolids ou est reprise par consolidation dans une autre
entreprise.
2) Grande entreprise
Par grande entreprise, il faut entendre celle qui ne rpond pas la dfinition de la PME au
sens europen, c'est--dire:
1 dont l'effectif d'emploi est gal ou suprieur 250 travailleurs;
2 ou dont:
a. le chiffre d'affaires annuel excde 50.000.000 euros;
b. et le total du bilan annuel excde 43.000.000 euros;
3 ou qui est dtenue hauteur de 25% ou plus du capital ou des droits de vote par une
entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises remplissant une des conditions
dfinies aux points 1 et 2.
19
Classification nationale
Sont des socits dotes de la personnalit juridique :
Grandes entreprises au regard du Code des socits :
Les entreprises dont la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occups excde 100
personnes ou les entreprises qui dpassent plus d'un des critres ci-aprs :
moyenne annuelle du nombre de travailleurs occups: 50 ;
chiffre d'affaires annuel (hors tva): 7 300 000 EUR ;
total du bilan: 3 650 000 EUR.
Le schma complet doit tre utilis par les grandes entreprises.
Trs petites entreprises au regard du Code des socits :
En vertu de larticle 5 de la loi, sont considres comme trs petites entreprises, les
entreprises rpondant cumulativement aux critres suivants :
il doit sagir de personnes physiques qui sont des commerants, de socits en nom
collectif ou en commandite simple ;
le chiffre daffaires, sans la T.V.A., du dernier exercice ne peut excder 500.000,00
EUR ou 620.000,00 EUR pour celles vendant des hydrocarbures gazeux ou liquides
destins la propulsion des vhicules automobiles circulant sur la voie
publique.(stations de distribution dessence).
Comme les autres entreprises, ces trs petites entreprises doivent tenir une
comptabilit approprie leur exploitation (article 2 de la loi). Cependant elles
disposent de la possibilit de tenir une comptabilit simplifie pour autant que
toutes les oprations soient inscrites sans retard, de manire fidle et complte, et
par ordre chronologique, dans au moins trois journaux :
le journal de trsorerie : un livre financier o sont inscrits les mouvements des
liquidits en espces et en compte; les prlvements autres que pour
lexploitation; les soldes journaliers en espces ;
le journal dachats : un livre des oprations dachat, dimportations et de
prestations reues o sont inscrits les montants dats et les modes de paiement
qui sy rapportent ;
le journal des ventes : lorsquune entreprise vend des marchandises, elle est
tenue dtablir une facture et de linscrire dans le livre des ventes. Lors du
paiement, il se produit une inscription dans le journal de vente et dans le journal
de trsorerie. Le livre des ventes contient galement les notes de crdit qui sont
des documents mis lorsque le commerant a tabli une facture errone,
effectu une livraison non justifie,.
Une fois par an au moins, ces entreprises sont galement tenues dtablir un inventaire de
tous les avoirs, crances, dettes et obligations, de mme que de toutes les ressources
affectes lexploitation. Concrtement, linventaire doit contenir les lments suivants :
20
le stock ;
toutes les dettes de lentreprise ;
les avoirs ;
les fonds propres ;
les disponibilits en caisse et en banque ;
les autres avoirs de lentreprise tels que les machines, les btiments,
Petites entreprises au regard du Code des socits :
Il sagit dentreprises dotes de la personnalit juridique et nayant pas au cours du dernier
exercice cltur, dpass plus dune des limites suivantes:
nombre de travailleurs occups, en moyenne annuelle 50 ;
chiffre daffaires annuel, sans la taxe sur la valeur ajoute, 7.300.000 EUR ;
total du bilan: 3.650.000 EUR sauf si le nombre de travailleurs occups en moyenne
annuelle dpasse 100.
Lorsque pour lexercice prcdant, une entreprise na pas dpass les critres
susmentionns, elle sera considre comme une petite entreprise pendant lexercice en
cours et cela, mme si, pour lexercice actuel, elle ne rpond plus aux critres imposs.
Lorsque lentreprise peut tre considre comme une petite entreprise, elle peut tablir et
publier ses comptes annuels selon le schma abrg et nest pas oblige dtablir un rapport
de gestion.
Les petites socits cotes ne peuvent plus choisir dtablir leurs comptes annuels et de les
publier selon un schma abrg ; - les petites socits cotes sont dornavant tenues
dtablir un rapport de gestion et de le dposer la BNB
Exemples : classez les entreprises suivantes :
1. artisan plombier, CA 4 70.997 entreprise
2. boulanger en SA, 2 ouvriers, CA 223.104 entreprise
3. pompiste, CA 570.155 entreprise
4. garagiste en SPRL, CA 7.400.000 , bilan 3.700.000 entreprise
3.2 Livres et documents
Les pices justificatives.
la tenue de la comptabilit s'effectue partir de pices justificatives; celles-ci sont, par
exemple :
une facture reue d'un fournisseur;
une facture tablie pour un client; un extrait de compte bancaire; un relev de caisse;
une feuille de paie tablie pour un ouvrier;
un dcompte d'impt;
un inventaire des stocks;
un tableau d'amortissement; ...
21
Ces pices justificatives sont transcrites dans des livres, par ordre chronologique, fidlement
et sans retard (c.--d. le plus vite possible), puis classes.
Une comptabilit est "normalement" constitue de journaux comptables, c'est dire que tout
document comptable doit tre affect dans un journal.
Les journaux comptables font partie des documents obligatoires. Chaque type de journal
correspond diffrentes natures de documents comptables.
1. Des journaux de ventes vous permettant d'enregistrer des factures clients
2. Des journaux d'achats vous permettant d'enregistrer des factures fournisseurs
3. Des journaux d'od pour les oprations diverses ne jouant pas sur les comptes de tiers
4. Des journaux financiers pour les oprations de rglements clients et/ou fournisseurs
5. Des journaux d'OD spciales permettant la gestion des critures automatiques de
clture ou de rouverture, de rapprochements automatiques entre factures et avoirs et
acomptes
3.2.1 Les obligations des petites entreprises
Une petite entreprise peut se contenter d'une comptabilit simplifie, et doit disposer des
livres et documents suivants :
un facturier d'entre, qui reprend les donnes des diffrentes factures des fournisseurs,
avec indication de la date, du libell, des montants achets, de la tva (dductible ou pas -
voir le fascicule de tva), et du paiement (date - montant mode)
un facturier de sortie, qui reprend les factures mises par l'entreprise, avec indication de
la date, du libell, des montants facturs (ventils par taux de tva), de la tva, des autres
taxes, et du paiement
un livre financier, reprenant les mouvements journaliers des comptes bancaires, du c.c.p.
et de la caisse, avec pour celle-ci indication du solde
un livre des inventaires, reprenant l'inventaire annuel, ainsi qu'une valuation des
rubriques du bilan; il doit tre complt par des tableaux d'amortissement pour les
investissements
en outre, les indpendants non soumis au forfait doivent tenir un journal des recettes,
reprenant les ventes au comptant (sans facture); cette formalit est exige par le code
tva.
Cette comptabilit, dcrite au chapitre suivant, est de moins en moins pratique par les
spcialistes. En effet, tant trs peu dtaille, elle ne peut tre un vritable outil de gestion
de l'entreprise. Nanmoins, elle constitue la base du systme pour la rdaction des
documents fiscaux, dclaration TVA en particulier.
3.2.2 Les obligations des grandes entreprises.
Une grande entreprise doit tenir une comptabilit dite complte, en partie double,
comprenant au moins, outre les facturiers, le journal des recettes et le livre des
inventaires
22
un livre-journal, qui reprend par ordre chronologique les enregistrements de toutes les
pices justificatives;
un grand-livre des comptes, qui reprend les mouvements de chacun des comptes
(rubriques) du bilan ou du rsultat
en outre, ces entreprises doivent prsenter leurs comptes en fin d'exercice, sous la forme
d'un document lgal comprenant
un compte de rsultat;
un bilan;
une annexe au bilan, qui en dtaille les rubriques.
De plus, les socits doivent dposer la centrale des bilans de la banque nationale de
commerce le compte de rsultat, le bilan et l'annexe; une mention de ce dpt est
publie au Moniteur Belge. Les grandes socits sont tenues de dposer le compte de
rsultats en version intgrale.
Forme des livres.
Diffrentes mesures sont prvues pour assurer l'inaltrabilit des critures dans les livres
lgaux. Ces mesures sont :
la cote, consistant numroter en continu toutes les pages d'un livre, avant utilisation
le visa, consistant inscrire sur la page de garde du livre certaines mentions : titre du
livre, n dans la srie, nombre de pages,
le paraphe, consistant parapher chaque page du livre.
Ces oprations sont normalement effectues par le Greffe du Tribunal de Commerce.
Ainsi,
tous les livres sont cots et identifis (ex. : sprl Durant, journal des achats, n 3);
le livre-journal, ou les 3 livres de la comptabilit simplifie sont viss; il en va de mme
pour le livre des inventaires;
lorsque ces livres sont tenus sur des feuilles mobiles, chacune d'elles doit tre cote,
puis notes du nom de l'entreprise et de la fonction du livre, et enfin paraphe; ces
feuilles sont enliasses aprs usage.
Aujourd'hui, la plupart des comptabilits sont informatises. Les logiciels informatiques
vendus sur le march permettent d'enregistrer les donnes comptables dans les facturiers,
les journaux et les comptes, puis d'effectuer la centralisation au centralisateur. La loi autorise
ces pratiques, condition de garantir l'inaltrabilit des donnes. La comptabilit sera donc
imprime sur des feuilles mobiles, qui seront soit traites comme expliqu ci-dessus, soit
colles dans des registres.
Les livres et les pices doivent tre conservs 10 ans.
23
3.3 Le livre journal
Document lgal dans lequel on enregistre toutes les oprations de lentreprise. Les
inscriptions se font dans lordre chronologique et au jour le jour (au moins une fois par mois).
Toute criture doit sappuyer sur une pice justificative .
Il est divis en 8 colonnes ; n opration, date, n compte dbit, n compte crdit, n
document, compte + libell, dbit et crdit.
3.4 Le livre des comptes ou grand livre
Document lgal dans lequel on enregistre toutes les oprations de lentreprise. Les
inscriptions se font ici selon leur nature.
Sortes de comptes : davoir
de dettes
de charge
de produits
spcifiques lentreprise (clients et fournisseurs)
24
CHAPITRE 4 : LA COMPTABILIT SIMPLIFIE
4.1 Aperu succinct de la tva
La tva est une taxe la consommation acquitte par paiements fractionns.
Elle frappe les livraisons de biens et les prestations de service faites par un assujetti dans le
cadre de ses activits professionnelles.
Elle est calcule opration par opration en fonction de la base imposable et du taux en
vigueur. Elle est porte en compte au client, sur la facture et sparment du prix. La base
imposable se calcule remise dduite.
Sont repris dans la base imposable :
Les frais de transport et les assurances
Les emballages perdus
Ne sont pas repris dans la base imposable :
Les frais demballage cautionns ou consigns
Les sommes pouvant tre dduites du prix titre descompte
Les rductions de prix la vente
Les intrts pour paiement tardif
La tva en elle-mme
4.2 Les diffrents taux
6% : biens de premire ncessit (alimentation, eau)
12 % : certains biens (abonnements tv payantes, margarine)
21% : tous les autres biens
Lassujetti bnficie du rgime des dductions ; c--d quil reoit des tva de ses clients et en
paie ses fournisseurs lors de ses achats.
Lassujetti verse ltat pour une priode donne un solde gal la diffrence entre le
montant total des taxes dues sur les ventes (tva reues) et montant total des tva qui ont
grev les dpenses professionnelles consacres lexercice de son activit (tva verses).
Lassujetti doit remplir et transmettre ladministration de la tva une dclaration priodique
(mois, trimestre ou anne).
Il paiera la diffrence entre la tva due et la tva dductible
Ladministration paiera la diffrence entre la tva dductible et la tva due
Le montant final doit correspondre avec le solde du compte courant admin tva.
4.3 Comptabilisation des taxes
La tva sera comptabilise sparment des biens et services quelle frappe.
Lors des achats, la tva sera dductible (rcuprable) et sera un avoir pour lentreprise.
Lors des ventes, elle sera due ltat et sera une dette.
25
Comptes utiliss :
Tva dues 451000 tva due sur ventes
451040 tva due sur note de crdit reue
tva dductibles 411100 tva dductible ou rcuprer
411130 tva dductible sur note de crdit envoye
en fin de priode, les comptes de regroupement sont :
si tva payer > tva dductible => dette pour lentreprise et choix dun compte de dettes vis--
vis de ladministration : 451200 compte courant admin tva
si tva payer < tva dductible => crance pour lentreprise et choix dun
compte davoir : 4111200 compte courant admin tva
Exemple
Facturation dune marchandise taxe 21%, critures chez le vendeur et chez lacheteur
Marchandise : M
Quantit : 10
P. unit. 10.000 E
cher le vendeur
400003 client 121.000
700003 vente marchandise M 100.000
451100 tva payer (due) 21.000
chez lacheteur
604001 achat marchandise M 100.000
411000 tva rcuprer 21.000
440001 fournisseur 121.000
Exercice 10
Facturation dune marchandise taxe 12%, critures chez le vendeur et chez lacheteur
Marchandise M
Quantit : 50
P.unit. : 5.000
Frais de transport : 1.000
cher le vendeur
400003 client 281.120
700003 vente marchandise M 251.000
451100 tva payer (due) 30.120
chez lacheteur
604001 achat marchandise M 251.000
411000 tva rcuprer 30.120
440001 fournisseur 281.120
26
4.4 les facturiers
Les facturiers sont des documents qui reprennent les donnes manant des factures reues
par l'entreprise pour ses diffrents achats (facturier d'entre), soit mises par l'entreprise lors
de ses ventes et prestations (facturier de sortie).
Ces documents sont importants, surtout en matire de TVA; correctement tenus, ils
permettent de remplir la dclaration de TVA avec rigueur et facilit.
Art 15 2 : "les inscriptions relatives la comptabilit s'appuient sur des pices justificatives,
dates et conserves, selon le cas, en original ou en copie. Les inscriptions dans les
registres sont faites sans retard, par ordre de dates, sans blanc ni lacune; en cas de
rectification, l'criture primitive doit rester lisible; les totaux de chaque page sont reports en
haut de la page suivante".
4.4.1 Facturier d'entre ou journal des achats.
Pour certaines professions fonctionnant au forfait tva , le facturier d'entre doit suivre un
modle prcis. Pour les autres, le facturier doit reprendre les indications suivantes
n de rfrence de la facture (attribue par l'assujetti);
date de la facture;
nom du fournisseur;
montant total de la facture;
montant net (hors tva, mais y compris tva non-dductible) de l'achat, avec ventilation :
marchandises, frais gnraux, investissements;
montant de la tva dductible;
montant des tva dues en rgime cocontractant (art. 20 )
montant des tva reportes pour importations ce;
montant des achats cocontractants et des importations ce;
indication de la date du paiement, du mode (caisse, c.c.p., barque, ...) et du montant;
ces indications peuvent toutefois tre portes directement sur les factures, ou sur les
fiches fournisseur.
4.4.2 Facturier de sortie ou journal des recettes.
Le facturier de sortie doit reprendre les indications suivantes
n de rfrence de la facture;
date de la facture;
nom du client;
montant total de la facture;
ventilation de la base taxable par taux de TVA, y compris pour les oprations
exonres;
TVA due l'tat;
pour le paiement, mme procd que ci-dessus.
Pour ce qui est des notes de crdit ventuelles, il est prfrable de tenir des feuilles
particulires, plutt que de les inscrire dans les facturiers. Toutefois, cette dernire pratique
est tolre, dans ce cas, l'criture se fait en rouge, ou est prcde de la mention CR.
27
CHAPITRE 5 : NOTIONS GENERALES DE COMPTABILITE EN PARTIE DOUBLE.
5.1 fonctionnement de la comptabilit double
5.1.1 Obligations lgales
En vertu des dispositions lgales, les entreprise soumises la comptabilit en partie double
doivent :
sur base de pices justificatives
* tenir un livre-journal
* tablir des comptes adapts un plan comptable minimum normalis
pcmn grand livre des comptes
tablir annuellement un inventaire complet selon des rgles d'valuation stipules par la
loi ;
dresser des comptes annuels internes (bilan, compte de rsultats et annexe)
conformment aux schmas dfinis par l'Arrt Royal;
pour les SA, SPRL, SCRL, (...), dposer les comptes annuels la Centrale des Bilans de
la Banque Nationale de Belgique (BNB).
L'application de ces dispositions implique, au niveau de la tenue des comptes, un double
travail, puisque chaque opration doit tre transcrite deux fois
une fois dans le livre-journal;
une fois dans les comptes (minimum 2 comptes).
Le travail est donc fastidieux, et les risques d'erreur dus au recopiage sont vidents.
5.1.2 Organisation pratique
Les comptables ont donc cherch des mthodes pratiques pour s'viter ce lourd travail. C'est
ainsi qu'a t dveloppe la technique des journaux auxiliaires. L'ide est la suivante : les
oprations dune entreprise peuvent tre classes en 4 groupes :
1. les achats;
2. les ventes;
3. les oprations financires;
4. les autres, dites oprations diverses (OD); ex. : amortissements, imputation des
salaires, ...
On va donc tenir non pas un, mais 4 journaux, appels ,journaux auxiliaires
1. le journal des achats (= facturier d'entre);
2. le journal des ventes (= facturier de sortie + ventes comptant);
3. le(s) journal(aux) financier(s) :journal de caisse, journal de banque, ...
4. le journal des OD.
Dans ce systme, chaque pice est enregistre dans le journal auxiliaire correspondant.
Priodiquement (mois, quinzaine, semaine, voire plus frquemment encore), les totaux de
ces journaux sont retranscrits dans le livre-journal (appel centralisateur) et dans les
comptes. Cette opration s'appelle la centralisation.
28
5.1.3 Rgles gnrales
L'arrt royal du 8 octobre 1976 (modifi) impose que la comptabilit soit tenue en
respectant un certain nombre de principes gnraux
continuit de l'entreprise (going concern) : ce principe fondamental signifie que
lentreprise ayant une dure de vie illimite, elle est un lment volutif long terme, les
rgles d'valuation seront donc mises en oeuvre dans une perspective de continuit des
activits de l'entreprise ;
permanence des mthodes comptables : toutes les oprations de mme nature
seront traites de manire identique, de manire aboutir des situations fiables et
comparables ;
interdiction de compensation: quelques exceptions prs, toute compensation entre
actif et passif ou entre charge et produit est INTERDITE ;
spcialit de l'exercice ( matching principle ) : les produits et les charges sont
enregistres au moment de leur acquisition ou de leur engagement ; en outre, les charges et
les produits doivent tre rattachs l'exercice o elles (ils) sont ns ; ainsi, les pertes
ventuelles ayant pris naissance au cours de l'exercice doivent tre prises en compte, mme
si elles sont connues aprs la date de clture ;
principe de prudence: c'est l'application du principe selon lequel le pessimisme est
plus sage que loptimisme; donc seuls les bnfices raliss la date de clture peuvent
tre acts ; par contre, il sera tenu compte des risques prvisibles et des pertes ventuelles
qui sont ns durant l'exercice ou des exercices antrieurs, mme si ces risques ne sont
connus qu'aprs la date de clture (mais avant la date laquelle on tablit les comptes
dfinitifs) ;
les dprciations (exemple : amortissements) seront toujours prises en compte, que
l'exercice soit bnficiaire ou dficitaire.
image fidle : les comptes annuels (bilan, rsultat) doivent donner une image fidle
du patrimoine et des rsultats de l'entreprise ; ils indiqueront, la date de clture de
l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits, des dettes, obligations, engagements
et moyens propres de l'entreprise, d'une part, et la nature et le montant de ses charges et
produits, d'autre part, le tout valu avec prudence, sincrit et bonne foi .
5. 2 technique des comptes
Nous avons vu, lors de l'approche lmentaire du bilan et du compte de rsultats, que toute
opration conomique modifie le patrimoine de l'entreprise (c'est--dire un ou plusieurs
postes bilantaires), et/ou induit des produits et des charges, lments du rsultat. Il serait
bien entendu fastidieux de dresser un nouveau bilan et/ou un nouveau rsultat aprs chaque
opration; c'est pourquoi l'volution des diffrentes rubriques du bilan et du compte de
rsultats sera suivie par l'enregistrement des oprations sur des fiches appeles comptes.
29
LES COMPTES
Linstrument permettant denregistrer les modifications dun poste du bilan est un compte.
Cet outil enregistre tous les mouvements de cet lment entre 2 bilans.
On y enregistre la situation initiale ainsi que toutes les augmentations et toutes les
diminutions subies par le compte durant la priode concerne. Chaque fois que 1 E entre
dans la socit, en sort ou change de compte, on ralise une criture qui concerne au moins
2 comptes, pour acter cet vnement.
Dans un compte, on travaille toujours par addition. On y trouve 2 colonnes, une pour les
augmentations et une pour les diminutions (on ajoute une diminution).
La colonne de gauche concerne les dbits et celle de droite les crdits.
Pour les comptes dactif (davoir) et de charge, on enregistre les augmentations au dbit et
les diminutions au crdit ; pour les comptes de passif (dettes) et de produits, on enregistre
les augmentations au crdit et les diminutions au dbit.
Un compte est un tableau reprsentant un poste du bilan ou du compte de rsultat, et
comportant deux colonnes, celle de gauche est appele dbit (D), et celle de droite crdit
(C). On peut galement y trouver la date de lopration, un numro dordre (interne), le
numro et le libell du compte.
Exemple de fiche
Dans la pratique, nous reprsenterons ces fiches de la manire suivante
D C
date n op. n cpte libell D C
Compte Dbit Crdit
Si augmentation
actif
.= .+ .-
avoirs
diminution
augmentation
passif
.= .- .+
dettes
diminution
30
Il existe 4 catgories de comptes :
1/ Actif et passif qui sont des comptes de bilan
Les comptes d'actif reprennent les rubriques figurant l'actif du bilan; ils sont
dbits des augmentations; D C
crdits des diminutions. + -
Les comptes de passif reprennent les rubriques figurant au passif du bilan; ils sont
crdits des augmentations; D C
dbits des diminutions. - +
2/ Charges et Produits qui sont des comptes de rsultats
Les comptes de charges sont
dbits des charges; D C
crdits des ventuelles diminutions de charges. + -
Les comptes de produits sont
crdits des produits; D C
dbits des ventuelles diminutions de produits. - +
Comptes de : Dbit des Crdit des
Actif augmentations diminutions
Passif diminutions augmentations
Charges charges diminutions de charges
Produits diminutions de produits produits
Exemple : un entrepreneur cre son entreprise, en apportant lui-mme 100.000 (= son
capital), reprsent par un dpt quivalent en compte bancaire. Son bilan de dpart
s'exprime donc comme suit
ACTIF PASSIF
-----------------------------------------------------------------------------------------
DISPONIBLE 100.000 CAPITAL 100.000
TOTAL 100.000 TOTAL 100.000
Les comptes correspondant ce bilan sont les suivants
D C D C
100000 100000
Banque Capital
31
et les inscriptions au livre journal sont
Le compte BANQUE COMPTE COURANT est dbit de 100.000 , et le compte CAPITAL
est crdit de la mme somme. Ceci est la rgle absolue en comptabilit :
Quand on dbite un compte, il faut en crditer un (ou plusieurs) autres pour un mme
montant total, de manire a ce que les dbits galent toujours les crdits.
Dans le journal, nous avons crit le compte dbit, puis , puis le compte crdit, ainsi
que les montants, suivis d'un libell explicatif.
Lentrepreneur s'quipe de matriel pour 8000 , et de mobilier pour 3500 (il reoit une
facture [1]) en payant le fournisseur l'aide d'un chque (il reoit un extrait de compte [2]);
les comptes se prsentent comme suit (en gras, les sommes primitives)
Inscriptions au livre journal
Commentaires
a) lors de la rception de la facture du fournisseur, on a pass l'criture (1) : dbit des
comptes MATRIEL et MOBILIER (comptes d'actif qui augmentent), et crdit du compte
date libell D C
banque 100000
capital 100000
* ouverture des comptes *
D C D C
100000 100000
11500 [2]
SD 88500 SC 100000
D C D C
8000 [1] 11500 [2] 11500 [1]
SD 8000
D C
[1] 3500
SD 3500
Mobilier
Banque Capital
Matriel Fournisseur
date Libell D C
matriel 8000
mobilier 3500
fournisseur 11500
.- facture n ., du fournisseur .. -
forunisseur 11500
banque 11500
.- extrait banque n. -
32
FOURNISSEUR, signalant la dette vis--vis de ce dernier (compte de passif [dette] qui
augmente);
b) lors de la rception de l'extrait de compte bancaire indiquant le paiement, on passe
l'criture (2) : crdit du compte BANQUE CC (compte d'actif qui diminue), et dbit du compte
FOURNISSEUR (suppression de la dette; compte de passif qui diminue);
Remarquez que les comptes ne sont mouvements que lorsque la pice justificative (facture,
extrait de compte) a t reue;
en fin d'exercice (anne), on calcule les soldes des comptes en faisant la diffrence:
entre D et C (comptes d'actif et charge); on obtient alors un SOLDE DEBITEUR (SD);
entre C et D (compte de passif et de produit); on obtient alors SOLDE CREDITEUR (SC);
Il est quelquefois difficile de bien distinguer dbit et crdit, et donc mouvementer
correctement les comptes. Quelques trucs peuvent tre utiles, dont celui-ci : l'entreprise
tant un lieu o entrent et d'o sortent des valeurs, on peut, pour construire la comptabilit,
utiliser la convention suivante
ENTRE DE VALEUR = DBIT
SORTIE DE VALEUR = CRDIT
Actif Passif
III Immo corporelles 11500 I Capital 100000
matriel 8000
mobilier 3500
IX Disponible 88500
Total 100000 Total 100000
33
5.3 le classement des comptes
La lgislation comptable prvoit que les entreprises doivent tenir leurs comptes selon
certaines rgles strictes, conformes au plan comptable minimum normalis (PCMN). Ce plan
dtaille les intituls des diffrents comptes utiliss, et les classe selon un systme de
numrotation trs prcis. Chaque compte est donc identifi par un nom et un numro.
Le PCMN distingue diffrentes classes de comptes
Comptes de patrimoine (bilan)
CLASSE 1 : fonds propres (capital, rserves, ...) et emprunts plus d'un an
CLASSE 2 : immobilisations (immeuble, matriel, mobilier, ...)
CLASSE 3 : Stocks
CLASSE 4 : crances un an au plus (clients, ...), et dettes un an au plus
(fournisseurs, TV A, fisc, personnel ...)
CL ASSE 5 : disponible (banque, caisse, ...)
Comptes de rsultats
CLASSE 6 : charges
CLASSE 7: produits
Comptes hors bilan
CLASSE 0 : comptes d'ordre et d'engagements
CLASSE 9 : comptabilit analytique
Le premier chiffre d'identification du compte indique la classe laquelle il appartient;
l'ensemble des deux premiers permet de localiser la rubrique dans le bilan ou le rsultat.
Les comptes des cinq premires classes constituent les comtes de patrimoine (bilan), ceux
des classes 6 & 7, les comptes de rsultats.
L'entreprise doit adapter le plan comptable ses besoins, par exemple en crant les sous-
comptes ncessaires.
34
5.4 PLAN COMPTABLE
http://www.becompta.be/
PLAN COMPTABLE MINIMUM NORMALISE
CLASSE 1. FONDS PROPRES, PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES ET DETTES A PLUS D'UN AN
10 CAPITAL
100 Capital souscrit ou capital personnel
1000 Capital non amorti
1001 Capital amorti
101 Capital non appel
109 Compte de l'exploitant
1090 Oprations courantes
1091 Impts personnels
1092 Rmunrations et autres avantages
11 PRIMES D'EMISSION
12 PLUS-VALUES DE REEVALUATION
120 Plus-values de rvaluation sur immobilisations incorporelles
1200 Plus-values de rvaluation
1201 Reprises de rductions de valeur
121 Plus-values de rvaluation sur immobilisations corporelles
1210 Plus-values de rvaluation
1211 Reprises de rductions de valeur
122 Plus-values de rvaluation sur immobilisations financires
1220 Plus-values de rvaluation
1221 Reprises de rductions de valeur
123 Plus-values de rvaluation sur stocks
124 Reprises de rductions de valeur sur placements de trsorerie
13 RESERVES
130 Rserve lgale
131 Rserves indisponibles
1310 Rserve pour actions propres
1311 Autres rserves indisponibles
132 Rserves immunises
133 Rserves disponibles
1330 Rserve pour rgularisation de dividendes
1331 Rserve pour renouvellement des immobilisations
1332 Rserve pour installations en faveur du personnel
1333 Rserves libres
14 BENEFICE REPORTE (ou PERTE REPORTEE)
15 SUBSIDES EN CAPITAL
150 Montants obtenus
151 Montants transfrs aux rsultats
16 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
160 Provisions pour pensions et obligations similaires
161 Provisions pour charges fiscales
162 Provisions pour grosses rparations et gros entretiens
163 169 Provisions pour autres risques et charges
164 Provisions pour srets personnelles ou relles constitues l'appui de dettes et
d'engagements de tiers
165 Provisions pour engagements relatifs l'acquisition ou la cession d'immobilisations
166 Provisions pour excution de commandes passes ou reues
167 Provisions pour positions et marchs terme en devises ou positions et marchs
terme en marchandises
35
168 Provisions pour garanties techniques attaches aux ventes et prestations dj
effectues par l'entreprise
169 Provisions pour autres risques et charges
1690 Pour litiges en cours
1691 Pour amendes, doubles droits, pnalits
1692 Pour propre assureur
1693 Pour risques inhrents aux oprations de crdits moyen ou long terme
1695 Provision pour charge de liquidation
1696 Provision pour dpart de personnel
1699 Pour risques divers
17 DETTES A PLUS D'UN AN
170 Emprunts subordonns
1700 Convertibles
1701 Non convertibles
171 Emprunts obligataires non subordonns
1710 Convertibles
1711 Non convertibles
172 Dettes de location-financement et assimils
1720 Dettes de location-financement de biens immobiliers
1721 Dettes de location-financement de biens mobiliers
1722 Dettes sur droits rels sur immeubles
173 Etablissements de crdit
1730 Dettes en compte
17300 Banque A
17301 Banque B
17302 Banque C
17303 Banque D
1731 Promesses
17310 Banque A
17311 Banque B
17312 Banque C
17313 Banque D
1732 Crdits d'acceptation
17320 Banque A
17321 Banque B
17322 Banque C
17323 Banque D
174 Autres emprunts
175 Dettes commerciales
1750 Fournisseurs : dettes en compte
17500 Entreprises apparentes
175000 Entreprises lies
175001 Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
17501 Fournisseurs ordinaires
175010 Fournisseurs belges
175011 Fournisseurs C.E.E.
175012 Fournisseurs importation
1751 Effets payer
17510 Entreprises apparentes
175100 Entreprises lies
175101 Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
17511 Fournisseurs ordinaires
175110 Fournisseurs belges
175111 Fournisseurs C.E.E.
175112 Fournisseurs importation
36
176 Acomptes reus sur commandes
178 Cautionnements reus en numraires
179 Dettes diverses
1790 Entreprises lies
1791 Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
1792 Administrateurs, grants, associs
1794 Rentes viagres capitalises
1798 Dettes envers les coparticipants des associations momentanes et en participation
1799 Autres dettes diverses
18 COMPTES DE LIAISON DES ETABLISSEMENTS ET
SUCCURSALES
CLASSE 2. FRAIS D'ETABLISSEMENT. ACTIFS
IMMOBILISES ET CREANCES A PLUS D'UN AN
20 FRAIS D'ETABLISSEMENT
200 Frais de constitution et d'augmentation de capital
2000 Frais de constitution et d'augmentation de capital
2009 Amortissements sur frais de constitution et d'augmentation de capital
201 Frais d'mission d'emprunts et primes de remboursement
2010 Agios sur emprunts et frais d'mission d'emprunts
2019 Amortissements sur agios sur emprunts et frais d'mission d'emprunts
202 Autres frais d'tablissement
2020 Autres frais d'tablissement
2029 Amortissements sur autres frais d'tablissement
203 Intrts intercalaires
2030 Intrts intercalaires
2039 Amortissements sur intrts intercalaires
204 Frais de restructuration
2040 Cot des frais de restructuration
2049 Amortissements sur frais de restructuration
21 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
210 Frais de recherche et de dveloppement
2100 Frais de recherche et de mise au point
2108 Plus-values actes sur frais de recherche et de mise au point
2109 Amortissements sur frais de recherche et de mise au point
211 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires
2110 Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques, etc...
2118 Plus-values actes sur concessions, brevets, etc...
2119 Amortissements sur concessions, brevets, etc...
212 Goodwill
2120 Cot d'acquisition
2128 Plus-values actes
2129 Amortissements sur goodwill
213 Acomptes verss
22 TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
220 Terrains
2200 Terrains
2201 Frais d'acquisition sur terrains
2208 Plus-values actes sur terrains
2209 Amortissements et rductions de valeur
22090 Amortissements sur frais d'acquisition
22091 Rductions de valeur sur terrains
221 Constructions
2210 Btiments industriels
2211 Btiments administratifs et commerciaux
2212 Autres btiments d'exploitation
37
2213 Voies de transport et ouvrages d'art
2215 Constructions sur sol d'autrui
2216 Frais d'acquisition sur constructions
2218 Plus-values actes
22180 Sur btiments industriels
22181 Sur btiments administratifs et commerciaux
22182 Sur autres btiments d'exploitation
22184 Sur voies de transport et ouvrages d'art
2219 Amortissements sur constructions
22190 Sur btiments industriels
22191 Sur btiments administratifs et commerciaux
22192 Sur autres btiments d'exploitation
22194 Sur voies de transport et ouvrages d'art
22195 Sur constructions sur sol d'autrui
22196 Sur frais d'acquisition sur constructions
222 Terrains btis
2220 Valeur d'acquisition
22200 Btiments industriels
22201 Btiments administratifs et commerciaux
22202 Autres btiments d'exploitation
22203 Voies de transport et ouvrages d'art
22204 Frais d'acquisition des terrains btir
2228 Plus-values actes
22280 Sur btiments industriels
22281 Sur btiments administratifs et commerciaux
22282 Sur autres btiments d'exploitation
22283 Sur voies de transport et ouvrages d'art
2229 Amortissements sur terrains btis
22290 Sur btiments industriels
22291 Sur btiments administratifs et commerciaux
22292 Sur autres btiments d'exploitation
22293 Sur voies de transport et ouvrages d'art
22294 Sur frais d'acquisition des terrains btis
223 Autres droits rels sur des immeubles
2230 Valeur d'acquisition
2238 Plus-values actes
2239 Amortissements
23 INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
230 Installations
2300 Installations btiments industriels
2301 Installations btiments administratifs et commerciaux
2302 Installations btiments d'exploitation
2303 Installations voies de transport et ouvrages d'art
2300 Installation d'eau
2301 Installation d'lectricit
2302 Installation de vapeur
2303 Installation de gaz
2304 Installation de chauffage
2305 Installation de conditionnement d'air
2306 Installation de chargement
231 Machines
2310 Division A
2311 Division B
2312 Division C
237 Outillage
38
2370 Division A
2371 Division B
2372 Division C
238 Plus-values actes
2380 Sur installations
2381 Sur machines
2382 Sur outillage
239 Amortissements
2390 Sur installations
2391 Sur machines
2392 Sur outillage
24 MOBILIER ET MATERIEL ROULANT
240 Mobilier
2400 Mobilier
24000 Mobilier des btiments industriels
24001 Mobilier des btiments administratifs et commerciaux
24002 Mobilier des autres btiments d'exploitation
24003 Mobilier oeuvres sociales
2401 Matriel de bureau et de service social
24010 Des btiments industriels
24011 Des btiments administratifs et commerciaux
24012 Des autres btiments d'exploitation
24013 Des oeuvres sociales
2408 Plus-values actes
24080 Plus-values actes sur mobilier
24081 Plus-values actes sur matriel de bureau et service social
2409 Amortissements
24090 Amortissements sur mobilier
24091 Amortissements sur matriel de bureau et service social
241 Matriel roulant
2410 Matriel automobile
24100 Voitures
24105 Camions
2411 Matriel ferroviaire
2412 Matriel fluvial
2413 Matriel naval
2414 Matriel arien
2418 Plus-values sur matriel roulant
24180 Plus-values sur matriel automobile
24181 Idem sur matriel ferroviaire
24182 Idem sur matriel fluvial
24183 Idem sur matriel naval
24184 Idem sur matriel arien
2419 Amortissements sur matriel roulant
24190 Amortissements sur matriel automobile
24191 Idem sur matriel ferroviaire
24192 Idem sur matriel fluvial
24193 Idem sur matriel naval
24194 Idem sur matriel arien
25 IMMOBILISATION DETENUES EN LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS
SIMILAIRES
250 Terrains et constructions
2500 Terrains
2501 Constructions
2508 Plus-values sur emphytose, leasing et droits similaires : terrains et constructions
39
2509 Amortissements et rductions de valeur sur terrains et constructions en leasing
251 Installations, machines et outillage
2510 Installations
2511 Machines
2512 Outillage
2518 Plus-values actes sur installations, machines et outillage pris en leasing
2519 Amortissements sur installations, machines et outillage pris en leasing
252 Mobilier et matriel roulant
2520 Mobilier
2521 Matriel roulant
2528 Plus-values actes sur mobilier et matriel roulant en leasing
2529 Amortissements sur mobilier et matriel roulant en leasing
26 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
260 Frais d'amnagements de locaux pris en location
261 Maison d'habitation
262 Rserve immobilire
263 Matriel d'emballage
264 Emballages rcuprables
268 Plus-values actes sur autres immobilisations corporelles
269 Amortissements sur autres immobilisations corporelles
2690 Amortissements sur frais d'amnagement des locaux pris en location
2691 Amortissements sur maison d'habitation
2692 Amortissements sur rserve immobilire
2693 Amortissements sur matriel d'emballage
2694 Amortissements sur emballages rcuprables
27 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS ET ACOMPTES
VERSES
270 Immobilisations en cours
2700 Constructions
2701 Installations, machines et outillage
2702 Mobilier et matriel roulant
2703 Autres immobilisations corporelles
271 Avances et acomptes verss sur immobilisations en cours
28 IMMOBILISATIONS FINANCIERES
280 Participations dans des entreprises lies
2800 Valeur d'acquisition (peut tre subdivis par participation)
2801 Montants non appels (idem)
2808 Plus-values actes (idem)
2809 Rductions de valeurs actes (idem)
281 Crances sur des entreprises lies
2810 Crances en compte
2811 Effets recevoir
2812 Titres revenu fixes
2817 Crances douteuses
2819 Rductions de valeurs actes
282 Participations dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
2820 Valeur d'acquisition (peut tre subdivis par participation)
2821 Montants non appels (idem)
2828 Plus-values actes (idem)
2829 Rductions de valeurs actes (idem)
283 Crances sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
2830 Crances en compte
2831 Effets recevoir
2832 Titres revenu fixe
2837 Crances douteuses
40
2839 Rductions de valeurs actes
284 Autres actions et parts
2840 Valeur d'acquisition
2841 Montants non appels
2848 Plus-values actes
2849 Rductions de valeur actes
285 Autres crances
2850 Crances en compte
2851 Effets recevoir
2852 Titres revenu fixe
2857 Crances douteuses
2859 Rductions de valeur actes
288 Cautionnements verss en numraires
2880 Tlphone, tlefax, tlex
2881 Gaz
2882 Eau
2883 Electricit
2887 Autres cautionnements verss en numraires
29 CREANCES A PLUS D'UN AN
290 Crances commerciales
2900 Clients
29000 Crances en compte sur entreprises lies
29001 Sur entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
29002 Sur clients Belgique
29003 Sur clients C.E.E.
29004 Sur clients exportation hors C.E.E.
29005 Crances sur les coparticipants (associations momentanes)
2901 Effets recevoir
29010 Sur entreprises lies
29011 Sur entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
29012 Sur clients Belgique
29013 Sur clients C.E.E.
29014 Sur clients exportation hors C.E.E.
2905 Retenues sur garanties
2906 Acomptes verss
2907 Crances douteuses ( ventiler comme clients 2900)
2909 Rductions de valeur actes ( ventiler comme clients 2900)
291 Autres crances
2910 Crances en compte
29100 Sur entreprises lies
29101 Sur entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
29102 Sur autres dbiteurs
291020 ....................
291021 ....................
2911 Effets recevoir
29110 Sur entreprises lies
29111 Sur entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
29112 Sur autres dbiteurs
2912 Crances rsultant de la cession d'immobilisations donnes en leasing
2917 Crances douteuses
2919 Rductions de valeur actes
CLASSE 3. STOCK ET COMMANDES EN COURS
D'EXECUTION
30 APPROVISIONNEMENTS - MATIERES PREMIERES
300 Valeur d'acquisition
41
309 Rductions de valeur actes
31 APPROVISIONNEMENTS ET FOURNITURES
310 Valeur d'acquisition
3100 Matires d'approvisionnement
3101 Energie, charbon, coke, Mazout, essence, propane
3102 Produits d'entretien
3103 Fournitures diverses et petit outillage
3104 Imprims et fournitures de bureau
3105 Fournitures de services sociaux
3106 Emballages commerciaux
31060 Emballages perdus
31061 Emballages rcuprables
319 Rductions de valeur actes
32 EN COURS DE FABRICATION
320 Valeur d'acquisition
3200 Produits semi-ouvrs
3201 Produits en cours de fabrication
3202 Travaux en cours
3205 Dchets
3206 Rebuts
3209 Travaux en association momentane
329 Rductions de valeur actes
33 PRODUITS FINIS
330 Valeur d'acquisition
3300 Produits finis
339 Rductions de valeur actes
34 MARCHANDISES
340 Valeur d'acquisition
3400 Groupe A
3401 Groupe B
3402 Groupe C
349 Rductions de valeur actes
35 IMMEUBLES DESTINES A LA VENTE
350 Valeur d'acquisition
3500 Immeuble A
3501 Immeuble B
3502 Immeuble C
351 Immeubles construits en vue de leur revente
3510 Immeuble A
3511 Immeuble B
3512 Immeuble C
359 Rductions de valeurs actes
36 ACOMPTES VERSES SUR ACHATS POUR STOCKS
360 Acomptes verss ( ventiler ventuellement par catgorie)
369 Rductions de valeur actes
37 COMMANDES EN COURS D'EXECUTION
370 Valeur d'acquisition
371 Bnfice pris en compte
379 Rductions de valeur actes
CLASSE 4. CREANCES ET DETTES A UN AN AU PLUS
40 CREANCES COMMERCIALES
400 Clients
4007 Rabais, remises, ristournes accorder et autres notes de crdit tablir
4008 Crances rsultant de livraisons de biens (associations momentanes)
401 Effets recevoir
42
4010 Effets recevoir
4013 Effets l'encaissement
4015 Effets l'escompte
402 Clients, crances courantes, entreprises apparentes, administrateurs et grants
4020 Entreprises lies
4021 Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
4022 Administrateurs et grants d'entreprise
403 Effets recevoir sur entreprises apparentes et administrateurs et grants
4030 Entreprises lies
4031 Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
4032 Administrateurs et grants de l'entreprise
404 Produits recevoir (factures tablir)
405 Clients : retenues sur garanties
406 Acomptes verss
407 Crances douteuses
408 Compensation clients
409 Rductions de valeur actes
41 AUTRES CREANCES
410 Capital appel, non vers
4100 Appels de fonds
4101 Actionnaires dfaillants
411 T.V.A. rcuprer
4110 T.V.A. due
4111 T.V.A. dductible
4112 Compte courant administration T.V.A.
4118 Taxe d'galisation due
412 Impts et versements fiscaux rcuprer
4120 4124 Impts belges sur le rsultat
4125 4127 Autres impts belges
4128 Impts trangers
414 Produits recevoir
416 Crances diverses
4160 Associs (compte d'apport en socit)
4161 Avances et prts au personnel
4162 Compte courant des associs en S.P.R.L.
4163 Compte courant des administrateurs et grants
4164 Crances sur socits apparentes
4166 Emballages et matriel rendre
4167 Etat et tablissements publics
41670 Subsides recevoir
41671 Autres crances
4168 Rabais, ristournes, remises obtenir et autres avoirs non encore reus
417 Crances douteuses
418 Cautionnements verss en numraires
419 Rductions de valeur actes
42 DETTES A PLUS D'UN AN ECHEANT DANS L'ANNEE
420 Emprunts subordonns
4200 Convertibles
4201 Non convertibles
421 Emprunts obligataires non subordonns
4210 Convertibles
4211 Non convertibles
422 Dettes de location-financement et assimiles
4220 Financement de biens immobiliers
4221 Financement de biens mobiliers
43
423 Etablissements de crdit
4230 Dettes en compte
4231 Promesses
4232 Crdits d'acceptation
424 Autres emprunts
425 Dettes commerciales
4250 Fournisseurs
4251 Effets payer
426 Cautionnements reus en numraires
429 Dettes diverses
4290 Entreprises lies
4291 Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
4292 Administrateurs, grants, associs
4299 Autres dettes
43 DETTES FINANCIERES
430 Etablissements de crdit. Emprunts en compte terme fixe
431 Etablissements de crdit. Promesses
432 Etablissements de crdit. Crdits d'acceptation
433 Etablissements de crdit. Dettes en compte courant
439 Autres emprunts
44 DETTES COMMERCIALES
440 Fournisseurs
4400 Entreprises apparentes
44000 Entreprises lies
44001 Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
4401 Fournisseurs ordinaires
44010 Fournisseurs belges
44011 Fournisseurs CEE
44012 Fournisseurs importation
4402 Dettes envers les coparticipants (associations momentanes)
4403 Fournisseurs - retenues de garanties
441 Effets payer
4410 Entreprises apparentes
44100 Entreprises lies
44101 Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
4411 Fournisseurs ordinaires
44110 Fournisseurs belges
44111 Fournisseurs CEE
44112 Fournisseurs importation
444 Factures recevoir
446 Acomptes reus
448 Compensations fournisseurs
45 DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
450 Dettes fiscales estimes
4501 4504 Impts sur le rsultat
4505 4507 Autres impts en Belgique
4508 Impts l'tranger
451 T.V.A. payer
4510 T.V.A. due
4511 T.V.A. dductible
4512 Compte courant administration T.V.A.
4518 Taxe d'galisation due
452 Impts et taxes payer
4520 4524 Autres impts sur le rsultat
4525 4527 Autres impts et taxes en Belgique
44
45250 Prcompte immobilier
45251 Impts communaux payer
45252 Impts provinciaux payer
45253 Autres impts et taxes payer
4528 Impts et taxes l'tranger
453 Prcomptes retenus
4530 Prcompte professionnel retenu sur rmunrations
4531 Prcompte professionnel retenu sur tantimes
4532 Prcompte mobilier retenu sur dividendes attribus
4533 Prcompte mobilier retenu sur intrts pays
4538 Autres prcomptes retenus
454 Office National de la Scurit Sociale
4540 Arrirs
4541 1er trimestre
4542 2me trimestre
4543 3me trimestre
4544 4me trimestre
455 Rmunrations
4550 Administrateurs, grants et commissaires (non rviseurs)
4551 Direction
4552 Employs
4553 Ouvriers
456 Pcules de vacances
4560 Direction
4561 Employs
4562 Ouvriers
459 Autres dettes sociales
4590 Provision pour gratifications de fin d'anne
4591 Dparts de personnel
4592 Oppositions sur rmunrations
4593 Assurances relatives au personnel
45930 Assurance loi
45931 Assurance salaire garanti
45932 Assurance groupe
45933 Assurances individuelles
4594 Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indpendants
4597 Dettes et provisions sociales diverses
46 ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES
47 DETTES DECOULANT DE L'AFFECTATION DES RESULTATS
470 Dividendes et tantimes d'exercices antrieurs
471 Dividendes de l'exercice
472 Tantimes de l'exercice
473 Autres allocataires
48 DETTES DIVERSES
480 Obligations et coupons chus
481 Actionnaires - capital rembourser
482 Participation du personnel payer
483 Acomptes reus d'autres tiers moins d'un an
486 Emballages et matriel consigns
488 Cautionnements reus en numraires
489 Autres dettes diverses
49 COMPTES DE REGULARISATION ET COMPTES D'ATTENTE
490 Charges reporter ( subdiviser par catgorie de charges)
491 Produits acquis
4910 Produits d'exploitation
45
49100 Ristournes, rabais obtenir
49101 Commissions obtenir
49102 Autres produits d'exploitation (redevances par exemple)
4911 Produits financiers
49110 Intrts courus et non chus sur prts et dbits
49111 Autres produits financiers
492 Charges imputer ( subdiviser par catgorie de charges)
493 Produits reporter
4930 Produits d'exploitation reporter
4931 Produits financiers reporter
499 Comptes d'attente
4990 Compte d'attente
4991 Compte de rpartition priodique des charges
4999 Transferts d'exercice
CLASSE 5. PLACEMENTS DE TRESORERIE ET DE VALEURS DISPONIBLES
50 ACTIONS PROPRES
51 ACTIONS ET PARTS
510 Valeur d'acquisition
511 Montants non appels
519 Rductions de valeur actes
52 TITRES A REVENUS FIXES
520 Valeur d'acquisition
529 Rductions de valeur actes
53 DEPOTS A TERME
530 De plus d'un an
531 De plus d'un mois et un an au plus
532 D'un mois au plus
539 Rductions de valeur actes
54 VALEURS ECHUES A L'ENCAISSEMENT
540 Chques encaisser
541 Coupons encaisser
55 ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
550 559 Comptes ouverts auprs des divers tablissements, subdiviser en :
...... 0 Comptes courants
...... 1 Chques mis
...... 9 Rductions de valeur actes
56 OFFICE DES CHEQUES POSTAUX
560 Compte courant
561 Chques mis
57 CAISSES
570 577 Caisses - espces ( 0 - centrale ; 7 - succursales et agences)
578 Caisses - timbres ( 0 - fiscaux ; 1 - postaux)
58 VIREMENTS INTERNES
CLASSE 6. - CHARGES
60 APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES
600 Achats de matires premires
601 Achats de fournitures
602 Achats de services, travaux et tudes
603 Sous-traitances gnrales
604 Achats de marchandises
605 Achats d'immeubles destins la revente
608 Remises, ristournes et rabais obtenus sur achats
609 Variations de stocks
6090 De matires premires
6091 De fournitures
46
6094 De marchandises
6095 D'immeubles destins la vente
61 SERVICES ET BIENS DIVERS
610 Loyers et charges locatives
6100 Loyers divers
6101 Charges locatives (assurances, frais de confort, ...)
611 Entretien et rparation (fournitures et prestations)
612 Fournitures faites l'entreprise
6120 Eau, gaz, lectricit, vapeur
61200 Eau
61201 Gaz
61202 Electricit
61203 Vapeur
6121 Tlphone, tlgrammes, tlex, tlfax, frais postaux
61210 Tlphone
61211 Tlgrammes
61212 Tlex et tlfax
61213 Frais postaux
6122 Livres, bibliothque
6123 Imprims et fournitures de bureau (si non comptabilis au 601)
613 Rtributions de tiers
6130 Redevances et royalties
61300 Redevances pour brevets, licences, marques, accessoires
61301 Autres redevances (procds de fabrication)
6131 Assurances non relatives au personnel
61310 Assurance incendie
61311 Assurance vol
61312 Assurance autos
61313 Assurance crdit
61314 Assurances frais gnraux
6132 Divers
61320 Commissions aux tiers
61321 Honoraires d'avocats, d'experts, etc ...
61322 Cotisations aux groupements professionnels
61323 Dons, libralits, ...
61324 Frais de contentieux
61325 Publications lgales
6133 Transports et dplacements
61330 Transports de personnel
61331 Voyages, dplacements, reprsentations
6134 Personnel intrimaire
614 Annonces, publicit, propagande et documentation
6140 Annonces et insertions
6141 Catalogues et imprims
6142 Echantillons
6143 Foires et expositions
6144 Primes
6145 Cadeaux la clientle
6146 Missions et rceptions
6147 Documentation
615 Sous-traitants
6150 Sous-traitants pour activits propres
6151 Sous-traitants d'associations momentanes (coparticipants)
6152 Quote-part bnficiaire des coparticipants
61700 Personnel intrimaire et personnes mises la disposition de l'entreprise
47
61800 Rmunrations, primes pour assurances extralgales, pensions de retraite et de
survie des administrateurs, grants et associs actifs qui ne sont pas attribues en vertu d'un
contrat de travail
62 REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS
620 Rmunrations et avantages sociaux directs
6200 Administrateurs ou grants
6201 Personnel de direction
6202 Employs
6203 Ouvriers
6204 Autres membres du personnel
621 Cotisations patronales d'assurances sociales
6210 Sur salaires
6211 Sur appointements et commissions
622 Primes patronales pour assurances extralgales
623 Autres frais de personnel
6230 Assurances du personnel
62300 Assurances loi, responsabilit civile, chemin du travail
62301 Assurance salaire garanti
62302 Assurances individuelles
6231 Charges sociales diverses
62310 Jours fris pays
62311 Salaire hebdomadaire garanti
62312 Allocations familiales complmentaires
6232 Charges sociales des administrateurs, grants et commissaires
62320 Allocations familiales complmentaires pour non salaris
62321 Lois sociales pour indpendants
62322 Divers
624 Pensions de retraite et de survie
6240 Administrateurs et grants
6241 Personnel
625 Provision pour pcule de vacances
6250 Dotations
6251 Utilisations et reprises
63 AMORTISSEMENTS, REDUCTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS POUR RISQUES
ET CHARGES
630 Dotations aux amortissements et aux rductions de valeur sur immobilisations
6300 Dotations aux amortissements sur frais d'tablissement
6301 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles
6302 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles
6308 Dotations aux rductions de valeur sur immobilisations incorporelles
6309 Dotations aux rductions de valeur sur immobilisations corporelles
631 Rductions de valeur sur stocks
6310 Dotations
6311 Reprises
632 Rductions de valeur sur commandes en cours d'excution
6320 Dotations
6321 Reprises
633 Rductions de valeur sur crances commerciales plus d'un an
6330 Dotations
6331 Reprises
634 Rductions de valeur sur crances commerciales un an au plus
6340 Dotations
6341 Reprises
635 Provisions pour pensions et obligations similaires
6350 Dotations
48
6351 Utilisations et reprises
636 Provisions pour grosses rparations et gros entretiens
6360 Dotations
6361 Utilisations et reprises
637 Provisions pour autres risques et charges
6370 Dotations
6371 Utilisations et reprises
64 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
640 Charges fiscales d'exploitation
6400 Taxes et impts directs
64000 Taxes sur autos et camions
6401 Taxes et impts indirects
64010 Timbres fiscaux pris en charge par la firme
64011 Droits d'enregistrement
64012 T.V.A. non dductible
6402 Impts provinciaux et communaux
64020 Taxe sur la force motrice
64021 Taxe sur le personnel occup
6403 Taxes diverses
641 Moins-values sur ralisations courantes d'immobilisations corporelles
642 Moins-values sur ralisations de crances commerciales
643 648 Charges d'exploitations diverses
649 Charges d'exploitation portes l'actif au titre de restructuration
65 CHARGES FINANCIERES
650 Charges des dettes
6500 Intrts, commissions et frais affrents aux dettes
6501 Amortissements des agios et frais d'mission d'emprunts
6502 Autres charges de dettes
6503 Intrts intercalaires ports l'actif
651 Rductions de valeur sur actifs circulants
6510 Dotations
6511 Reprises
652 Moins-values sur ralisation d'actifs circulants
653 Charges d'escompte de crances
654 Diffrences de change
655 Ecarts de conversion des devises
656 Frais de banques, de chques postaux
657 Commissions sur ouvertures de crdit, cautions, avals
658 Frais de vente des titres
66 CHARGES EXCEPTIONNELLES
660 Amortissements et rductions de valeur exceptionnels
6600 Sur frais d'tablissement
6601 Sur immobilisations incorporelles
6602 Sur immobilisations corporelles
661 Rductions de valeur sur immobilisations financires
662 Provisions pour risques et charges exceptionnels
663 Moins-values sur ralisation d'actifs immobiliss
6630 Sur immobilisations incorporelles
6631 Sur immobilisations corporelles
6632 Sur immobilisations dtenues en location-financement et droits similaires
6633 Sur immobilisations financires
6634 Sur immeubles acquis ou construits en vue de la revente
664 668 Autres charges exceptionnelles
664 Pnalits et amendes diverses
665 Diffrence de charge
49
669 Charges exceptionnelles transfres l'actif en frais de restructuration
67 IMPOTS SUR LE RESULTAT
670 Impts belges sur le rsultat de l'exercice
6700 Impts et prcomptes dus ou verss
6701 Excdent de versements d'impts et prcomptes port l'actif
6702 Charges fiscales estimes
671 Impts belges sur le rsultat d'exercices antrieurs
6710 Supplments d'impts dus ou verss
6711 Supplments d'impts estims
6712 Provisions fiscales constitues
672 Impts trangers sur le rsultat de l'exercice
673 Impts trangers sur le rsultat d'exercices antrieurs
68 TRANSFERTS AUX RESERVES IMMUNISEES
69 AFFECTATION DES RESULTATS
690 Perte reporte de l'exercice prcdent
691 Dotation la rserve lgale
692 Dotation aux autres rserves
693 Bnfice reporter
694 Rmunration du capital
695 Administrateurs ou grants
696 Autres allocataires
CLASSE 7. - PRODUITS
70 CHIFFRE D'AFFAIRES
700 707 Ventes et prestations de services
700 Ventes de marchandises
7000 Ventes en Belgique
7001 Ventes dans les pays membres de la C.E.E.
7002 Ventes l'exportation
701 Ventes de produits finis
7010 Ventes en Belgique
7011 Ventes dans les pays membres de la C.E.E.
7012 Ventes l'exportation
702 Ventes de dchets et rebuts
7020 Ventes en Belgique
7021 Ventes dans les pays membres de la C.E.E.
7022 Ventes l'exportation
703 Ventes d'emballages rcuprables
704 Facturations des travaux en cours (associations momentanes)
705 Prestations de services
7050 Prestations de services en Belgique
7051 Prestations de services dans les pays membres de la C.E.E.
7052 Prestations de services en vue de l'exportation
706 Pnalits et ddits obtenus par l'entreprise
708 Remises, ristournes et rabais accords
7080 Sur ventes de marchandises
7081 Sur ventes de produits finis
7082 Sur ventes de dchets et rebuts
7083 Sur prestations de services
7084 Mali sur travaux facturs aux associations momentanes
71 VARIATION DES STOCKS ET DES COMMANDES EN COURS D'EXECUTION
712 Des en cours de fabrication
713 Des produits finis
715 Des immeubles construits destins la vente
717 Des commandes en cours d'excution
7170 Commandes en cours - Cot de revient
50
71700 Cot des commandes en cours d'excution
71701 Cot des travaux en cours des associations momentanes
7171 Bnfices ports en compte sur commandes en cours
71710 Sur commandes en cours d'excution
71711 Sur travaux en cours des associations momentanes
72 PRODUCTION IMMOBILISEE
720 En frais d'tablissement
721 En immobilisations incorporelles
722 En immobilisations corporelles
723 En immobilisations en cours
74 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
740 Subsides d'exploitation et montants compensatoires
741 Plus-values sur ralisations courantes d'immobilisations corporelles
742 Plus-values sur ralisations de crances commerciales
743 749 Produits d'exploitation divers
743 Produits de services exploits dans l'intrt du personnel
744 Commissions et courtages
745 Redevances pour brevets et licences
746 Prestations de services (transports, tudes, etc...)
747 Revenus des immeubles affects aux activits non professionnelles
748 Locations diverses caractre professionnel
749 Produits divers
7490 Bonis sur reprises d'emballages consigns
7491 Bonis sur travaux en associations momentanes
75 PRODUITS FINANCIERS
750 Produits des immobilisations financires
7500 Revenus des actions
7501 Revenus des obligations
7502 Revenus des crances plus d'un an
751 Produits des actifs circulants
752 Plus-values sur ralisations d'actifs circulants
753 Subsides en capital et en intrts
754 Diffrences de change
755 Ecarts de conversion des devises
756 759 Produits financiers divers
756 Produits des autres crances
757 Escomptes obtenus
76 PRODUITS EXCEPTIONNELS
760 Reprises d'amortissements et de rductions de valeur
7600 Sur immobilisations incorporelles
7601 Sur immobilisations corporelles
761 Reprises de rductions de valeur sur immobilisations financires
762 Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnelles
763 Plus-values sur ralisation d'actifs immobiliss
7630 Sur immobilisations incorporelles
7631 Sur immobilisations corporelles
7632 Sur immobilisations financires
764 Autres produits exceptionnels
77 REGULARISATIONS D'IMPOTS ET REPRISES DE PROVISIONS FISCALES
771 Impts belges sur le rsultat
7710 Rgularisations d'impts dus ou verss
7711 Rgularisations d'impts estims
7712 Reprises de provisions fiscales
773 Impts trangers sur le rsultat
79 AFFECTATION AUX RESULTATS
51
790 Bnfice report de l'exercice prcdent
791 Prlvement sur le capital et les primes d'mission
792 Prlvement sur les rserves
793 Perte reporter
794 Intervention d'associs (ou du propritaire) dans la perte
CLASSE 0. DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
00 GARANTIES CONSTITUEES PAR DES TIERS POUR COMPTE DE L'ENTREPRISE
000 Cranciers, bnficiaires de garanties de tiers
001 Tiers constituants de garanties pour compte de l'entreprise
01 GARANTIES CONSTITUEES POUR COMPTE DE TIERS
010 Dbiteurs pour engagements sur effets
011 Cranciers d'engagements sur effets
0110 Effets cds par l'entreprise sous endos
0111 Autres engagements sur effets en circulation
012 Dbiteurs pour autres garanties personnelles
013 Cranciers d'autres garanties personnelles
02 GARANTIES REELLES CONSTITUEES SUR AVOIRS PROPRES
020 Cranciers de l'entreprise, bnficiaires de garanties relles
021 Garanties relles constitues pour compte propre
022 Cranciers de tiers, bnficiaires de garanties relles
023 Garanties relles constitues pour compte de tiers
03 GARANTIES RECUES
030 Dpts statutaires
031 Dposants statutaires
032 Garanties reues
033 Constituants de garanties
04 BIENS ET VALEURS DETENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX
RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE
040 Tiers, dtenteurs en leur nom mais aux risques et profits de l'entreprise de biens et de
valeurs
041 Biens et valeurs dtenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de
l'entreprise
05 ENGAGEMENTS D'ACQUISITION ET DE CESSION D'IMMOBILISATION
050 Engagements d'acquisition
051 Cranciers d'engagements d'acquisition
052 Dbiteurs pour engagements de cession
053 Engagements de cession
06 MARCHES A TERME
060 Marchandises achetes terme - recevoir
061 Cranciers pour marchandises achetes terme
062 Dbiteurs pour marchandises vendues terme - livrer
063 Marchandises vendues terme - livrer
064 Devises achetes terme - recevoir
065 Cranciers pour devises achetes terme
066 Dbiteurs pour devises vendues terme
067 Devises vendues terme - livrer
07 BIENS ET VALEURS DE TIERS DETENUS PAR L'ENTREPRISE
070 Droits d'usage long terme
0700 Sur terrains et constructions
0701 Sur installations, machines et outillage
0702 Sur mobilier et matriel roulant
071 Cranciers de loyers et redevances
072 Biens et valeurs de tiers reus en dpt, en consignation, ou faon
073 Commettants et dposants de biens et valeurs
074 Biens et valeurs dtenus pour compte ou aux risques et profits de tiers
52
075 Cranciers de biens et valeurs dtenus pour compte de tiers ou leurs risques et profits
09 DROITS ET ENGAGEMENTS DIVERS
Exercice 11 (ne met en jeu que des comptes de patrimoine)
Je cre une SPRL avec un capital de 50000 , et un emprunt de 8000 remboursable en 5
ans. Ces montants ont t dposs sur un compte en banque. Mes premires oprations
sont les suivantes :
achat de matriel pour 10000 ; le fournisseur est pay par virement bancaire;
achat d'une camionnette pour 8000 ; le fournisseur accepte un dlai de paiement d'un
mois;
retrait de 500 la banque pour crer une caisse.
Etablissez le bilan initial; ouvrez les comptes, et indiquez les mouvements; tirez les soldes et
dressez le bilan final,
53
CHAPITRE 6 : OPERATIONS COURANTES
Dans la comptabilit d'une entreprise, il y a des oprations qui reviennent tout le temps : ce
sont les achats, les ventes et les paiements; il faut y incorporer les problmes lis la TVA,
puisque celle-ci est prsente dans les achats et les ventes. Nous allons dcrire ici leur
enregistrement dans les comptes.
6.1 Les documents courants
6.1.1 la facture
Ce qui fait quun document est vraiment une facture tient la prsence dune srie de
mentions lgales.
Il est prudent dimprimer ses conditions gnrales de vente au dos de ses factures . Celles-ci
dcrivent notamment les dlais de paiement, la comptence des tribunaux en cas de litige,
La FACTURE constitue le document de base de nombre d'oprations commerciales.
Elle se compose de deux parties: l'EN-TETE et le CORPS.
L'EN-TETE comporte un certain nombre de mentions relatives l'entreprise
son nom ou sa raison sociale;
le mot facture
un n dordre interne
son adresse, n de tlphone, de fax, d'e-mail;
ses numros de RC, TVA, de compte(s) en banque;
le lieu et la date de rdaction de la facture;
l'identification complte du client (y compris son n TVA ventuel) ;
le n de la facture (dans l'ordre du facturier) ainsi que le terme facture
des indications ventuelles relatives au mode de transport, au paiement, ...
Expdition
non franco : frais d'envoi charge de l'acheteur;
franco domicile : envoi charge du vendeur;
franco gare de destination : envoi charge du vendeur jusqu' la gare la plus proche du
domicile de l'acheteur.
Paiement
au grand comptant : ds rception du bien;
au comptant : bref dlai (quelques jours);
x jours de date : x jours aprs la date de facturation;
x jours de vue : x jours aprs la rception de la facture;
x jours fin de mois : x jours aprs la fin du mois de facturation.
Le CORPS reprend les diffrents calculs effectus pour aboutir au total payer
quantit et nature des marchandises ou services;
indication du prix unitaire et du prix global par article;
prix total hors TVA, par taux;
rductions ventuelles ou majorations de prix;
escompte commercial ventuel (= rduction pour paiement anticip);
frais annexes : transport, assurances, emballages, ...
54
TVA, par taux et au total.
Rgles applicables pour dterminer la base imposable la TVA
ELEMENTS INCLUS DANS LA BASE IMPOSABLE A LA TVA
- le PRIX des marchandises, DIMINUE de toutes les rductions : rabais, remises,
ristournes, bon poids, .
- le COUT DU TRANSPORT, pour autant que le fournisseur le porte en compte au client
(application du taux le plus bas des marchandises transportes);
- les COUTS ANNEXES. assurances, emballages non repris (voyez ci-dessous).
ELEMENTS EXCLUS DE LA BASE IMPOSABLE
- l'escompte, mme si le client n'en bnficie pas (systme discutable et d'ailleurs
contest)
- les intrts pour paiement tardif;
- les cautions pour emballage, savoir la diffrence entre le prix factur et le prix auxquels
ils sont repris (voyez ci-dessous). En fait, il faut distinguer deux cas: emballages
consigns ou non, si le contrat de vente prvoit que les emballages seront rembourss,
leur montant ne doit pas tre soumis la TVA, mme si le client les conserve
ultrieurement;
Si le contrat prvoit un remboursement partiel, la. diffrence entre le prix factur et le prix de
reprise fait partie de la base; si le contrat ne prvoit rien, ou pas de reprise, le cot des
emballages est inclus dans la base.
Ayant la base imposable, il suffit d'y appliquer la REGLE DE CALCUL.
La rgle gnrale est la suivante :
ON MULTIPLIE LA BASE IMPOSABLE A LA TVA PAR LE TAUX
Il reste ensuite arrondir le montant obtenu, s'il comporte plus de deux dcimales:
6.1.2 la note de crdit
Cest un document trs semblable la facture, mais sur lequel la mention Note de crdit
remplace Facture . Tous les autres renseignements repris ci-dessus doivent sy trouver.
6.2 oprations d'achat
L'entreprise achte en gnral 3 catgories de biens et de services
ceux qui constituent des investissements (matriel, mobilier, ...)
ceux qu'elle va revendre comme tels ou aprs transformation (marchandises,
matires premires)
ceux qui constituent des frais gnraux
Les biens d'investissement sont enregistrs dans des comptes d'immobilis (classe 2), lors
de la rception de la facture.
55
reu la facture 10/01 du fournisseur H, achat de matriel pour 650 , TVA 21 % (136,50 ),
au total 786,50
reu la facture 25/01 du garage G, achat d'une voiture, 20000 , TVA 21 (4200 ), au total
24200
La TVA n'est dductible qu' 50 % (2100 ); la TVA non dductible s'ajoute au 20000 dans
le compte MAT.ROULANT
TOUTE OPERATION D'ACHAT AVEC FACTURE PASSE PAR LE COMPTE
FOURNISSEUR, QUE LE PAIEMENT SOIT COMPTANT OU PAS.
Les achats de marchandises sont enregistrs dans les comptes 60 (et non dans le stock au
bilan; celui-ci dcoule de l'inventaire et n'est mouvement que lors de celui-ci);
reu la facture du fournisseur D, achats de marchandises pour 1200 , TVA 21 % (252 ),
soit 1452 .
Les achats de biens et services divers s'enregistrent dans des comptes 61
reu la facture de lUNERG, consommation d'lectricit, 145 , plus TVA 21 % (30,45 ),
soit 175,45 .
DANS UNE OPERATION D'ACHAT, ON CREDITE LE FOURNISSEUR, ON DEBITE LA
TVA DEDUCTIBLE (normalement) ET UN COMPTE 2 OU 6
Lorsque l'on se trouve en prsence de fournisseurs importants, il y a lieu de tenir une fiche
de compte leur nom, tout en mouvementant le compte fournisseur. La fiche du fournisseur
D 6040 achats C D 411 tva dduct C D 4400 fournisseur C
1200 252 1452
D 2410 Mat roulant C D 411 tva dduct C D 4400 fournisseur C
22100 2100 24200
D 2300 Matriel C D 411 tva dduct C D 4400 fournisseur C
650,00 136,50 786,50
D 6120 lectricit C D 411 tva dduct C D 4400 fournisseur C
145,00 30,45 175,45
56
est appele compte particulier (compte de tiers), tandis que le compte fournisseur est le
compte centralisateur. .
Pour les fournisseurs qui ne sont pas importants, on tient alors un compte particulier
dnomm fournisseurs divers.
6.2.1 Enregistrement des notes de crdit
La note de crdit est en quelque sorte le contraire dune facture. La facture vous enjoint de
payer, la note de crdit vous dispense de le faire ou vous procure une remise partielle du
montant que vous avez ou que vous devez payer.
Une note de crdit reue d'un fournisseur peut notamment signifier
un retour de marchandises (non conformes, dtriores)
une remise, une ristourne, un rabais, ..., accord hors facture
critures
retour de marchandises : il faut corriger le compte dans lequel elles ont t imputes lors
de leur entre (6040) ; exemple : NC de 100 plus TVA 21 % (21 ), soit 121
ristournes, ... : on utilise le compte 6080 RRR obtenus ; exemple : idem
Dans le compte de rsultats, le solde (crditeur) du 6080 viendra en dduction de la rubrique
achats .
Enregistrement des notes de crdit
A/ retour de marchandises : NC 100 + tva 21% (21 ), soit un total de 121
B/ ristourne exemple : idem.
D 6040 achats C D 4515 tva due sur NC C D 4400 fournisseur C
100 21 121
D 6080 RRR obtenus C D 4515 tva due sur NC C D 4400 fournisseur C
100 21 121
D 4000 clients C D 4516 tva dd s/ nc C D 7000 chiffre affaire C
121 21 100
D 4000 clients C D 4516 tva dd s/ nc C D 7080 RRR accords C
121 21 100
57
6.3 oprations de vente
Les ventes d'une entreprise peuvent tre de deux types : soit elles font l'objet d'une facture
adresse au client, soit elles s'effectuent sans facture (on dit : au comptant). L'criture d'une
vente s'effectue comme suit :
ma facture n 3 au client A, vente de marchandises pour 456 , plus TVA 21% (95,76 ),
soit 551, 76
Les ventes au comptant passent par le livre des recettes, lequel est totalis avant d'tre
transcrit de la mme manire dans les comptes. Toutefois, il est plus que recommand de
passer par un compte CLIENTS, notamment pour des raisons de concordance des montants
de la dclaration TVA.
DANS UNE OPRATION DE VENTE, ON DBITE LE CLIENT, ET ON CRDITE TVA DUE
(normalement) ET UN COMPTE 7 (CH AFF).
Quand on se trouve en prsence de clients importants, il y a lieu de tenir une fiche de
compte leur nom, tout en mouvementant le compte CLIENTS.
La fiche du client est appele compte particulier (compte de tiers), tandis que le compte
gnral clients est le compte centralisateur. pour les clients qui ne sont pas importants et qui
paient comptant, on tient alors un compte particulier dnomm clients divers.
6.4 oprations financires
Les oprations financires concernent essentiellement les comptes banque & caisse.
Ces comptes sont :
dbits des augmentations (paiements reus);
crdits des diminutions (paiements effectus).
Exemples :
a) Extrait de compte bancaire n xx, reu paiement du client A : 551,76 .
b) Extrait de compte bancaire n xy, virement fournisseur, 212.47
D 4000 clients C D 451 tva due C D 7000 chiffre affaire C
551,76 95,76 456,00
D 5500 banque C D 4000 clients C
551,76 .(551,76) 551,76
D 5500 banque C D 4400 fournisseur C
212,47 212,47
.(212,47)
58
c) Pice de caisse n n, achat d'une carte de soutien une association 5 (sans facture)
Les comptes financiers ne sont mouvements que sur base de pices justificatives : extrait
de compte et pice de caisse. Il est interdit de mouvementer le compte banque sous prtexte
que l'on a tir un chque ou effectu un virement; il faut attendre l'extrait.
Les comptes financiers fonctionnent rgulirement entre eux : transfert de la caisse la
banque, d'un compte en banque vers un autre, ... Etant donn le dcalage dans la rception
des pices justificatives, il faut utiliser un compte transitoire, appel virements internes 5800.
Exemples :
transfert de caisse banque, 2500
(1) le 10/02 : pice de caisse constatant le retrait;
(2) le 14/02: extrait de compte constatant le dpt.
transfert de banque caisse, 500
(1) le 25/03 : pice de caisse constatant lentre d'argent ;
(2) le 01 /04 : extrait de compte constatant le retrait.
D 5700 caisse C
D 5800 virements int C
D 5500 banque C
500 (2)
500 (1) 500 (2)
500 (1)
D 5700 caisse C D 6170 frais reprsent C
5,00 5,00
D 5700 caisse C D 5800 virements int C D 5500 banque C
2500 (1) 2500 (1) 2500 (2) 2500 (2)
59
Exercice 12 : dressez le bilan de dpart, puis passez les critures. Toutes les valeurs sont
en .
Situation de dpart :
Immeuble : 300.000
Fournisseur A : 3000
Fournisseur D : 2000
Stock X : 10.000
Stock Y : 5.000
Client R : 6000
Banque : 90.000
Capital : ? ? ? ?
10/12 : on prend 2.000 pour les mettre en caisse
11/12 : on achte du matriel informatique au fournisseur B pour 1.000 tva 21%
13/12 : on reoit la facture de P pour lentretien des bureaux : 800 tva 6%
15/12 : on vend au client L, 300 units de X 11 lunit il y a 100 de frais de transport -
tva 21%
20/12 : on achte la firme V, 300 units de X 8,5 lunit (tva 21%) et des marchandises
Y (tva 6%) pour 5.500 (10 la pice), emballages perdus pour y, 20 transport pour
lensemble : 250
21/12 : on vend, au client D, 250 units de Y 12 il y a 1 emballage cautionn pour 150
tva 6%
21/12 : rception extrait bancaire actant le paiement du fournisseur B
22/12 : on adresse une note de crdit L pour lui accorder une ristourne de 50 sur les
marchandises X
22/12 : on reoit une note de crdit de V pour retour de 100 marchandises X et 50
marchandises Y
24/12 : extrait bancaire pour paiements de L et V
25/12 : on achte D, 400 units de Y 85 pice il y a un emballage consign de 200
tva 6%
26/12 : note de crdit de D pour retour demballages
6.4.1 Les garanties sur les oprations financires
Toute opration de crdit entrane un risque: celui de l'insolvabilit future du dbiteur. Le
banquier limite ce facteur risque par une analyse plus ou moins dtaille de la solvabilit de
l'entrepreneur; il va accrotre sa scurit en exigeant des garanties ou, en termes juridiques,
des SURETES.
Nous pouvons dfinir celle-ci comme un moyen par lequel le prteur conforte sa crance,
normalement avec l'accord du dbiteur ou d'un tiers. Toute sret suppose donc un contrat,
ou l'existence d'un texte lgal; elle est toujours l'accessoire d'une crance.
On distingue deux grandes catgories de srets:
les srets REELLES, qui portent sur les biens et sont de trois ordres : lhypothque, le
gage, le privilge
les srets PERSONNELLES qui portent sur l'engagement d'une personne, physique ou
morale, de rembourser le crdit en cas de dfaillance du dbiteur : c'est le
CAUTIONNEMENT ou l'AVAL.
60
A / L'hvpothque est un droit rel tabli sur un bien immobilier titre de garantie d'un
engagement. Elle confre son dtenteur le droit de faire vendre l'immeuble concern en
cas de dfaut de paiement du dbiteur.
L'hypothque est obligatoirement constitue par un acte notari; elle est transcrite dans le
Registre du Conservateur des Hypothques, qui est un agent du Ministre des Finances.
Une prise d'hypothque fait l'objet d'un impt, appel droit d'hypothque. La dure de
l'hypothque est de 30 ans.
L'hypothque est coteuse, mais constitue une bonne garantie. Le propritaire de l'immeuble
n'en est pas dpossd, mais ne peut le vendre sans accord des cranciers. L'opration qui
radie l'inscription s'appelle la main leve.
B/ Le gage sur fonds de commerce est une garantie classique dans le domaine des affaires.
Le fonds de commerce comprend les biens corporels (matriel, stocks, crances) et
incorporels (droit de bail, clientle, enseigne, ...).
Ce gage est consenti sans dpossession, le commerant continuant exploiter son affaire
normalement. L'acte de gage est enregistr et inscrit au Bureau des Hypothques; il est
valable 10 ans.
Le gage (ou nantissement) est un contrat par lequel le dbiteur remet son crancier ou
un tiers un bien meuble pour garantir sa dette. Par bien meuble, on entend notamment les
bijoux, les titres, les effets de commerce, les polices d'assurance, ... Le bien mis en gage
n'est restitu qu'aprs apurement de la dette. Si le dbiteur ne respecte pas son
engagement, le crancier aura le droit de faire vendre le bien gag par autorit de justice et
de se faire payer sur le prix de vente.
C/ Le privilge est un droit de prfrence que la loi accorde certains cranciers.
D/ Le CAUTIONNEMENT est un contrat par lequel une personne, appele LA CAUTION,
s'engage envers le crancier lui payer tout ou partie de ce que le dbiteur lui doit, au cas
o celui-ci ne respecterait pas ses engagements.
Ce contrat prvoit gnralement la solidarit avec le dbiteur. Ce principe est important car
la caution renonce au droit de discussion; le crancier ne doit pas prouver l'insolvabilit du
dbiteur avant de poursuivre la caution. Lorsqu'elles sont plusieurs, les cautions s'engagent
solidairement entre elles; cela signifie que le crancier peut exiger d'une des cautions le
montant total de la dette.
6.4.2 Le crdit de caisse
Le CRDIT DE CAISSE, appel aussi avance en compte courant, ou facilits de caisse, ou
encore crdit par dcouvert, est un CONTRAT par lequel la banque autorise son client
RENDRE SON COMPTE COURANT DBITEUR, dans des limites et pour une dure
dtermines.
Habituellement, ce crdit est consenti sous la forme d'avance en compte courant, avec la
stipulation que le compte du client peut prsenter un solde dbiteur d'un montant maximum,
correspondant la LIGNE DE CRDIT; il est normalement stipul que le solde du compte
doit redevenir positif dans un certain dlai, ou certains intervalles.
61
Le crdit de caisse est commode et souple; il est certainement le mieux adapt une
gestion efficace de la trsorerie, mais ...
Le cot du crdit de caisse est particulirement lev; il y a cela deux raisons: la premire
est que le banquier ne reoit, en contrepartie de ce crdit, aucun actif mobilisable; il ne peut
donc se refinancer; la seconde est que le banquier doit rester trs liquide vis--vis de ces
crdits, puisque le dbiteur peut tirer n'importe quand sur son compte.
En fait, un crdit de caisse oblige le banquier rester liquide, sans contrepartie lui
permettant de restaurer cette liquidit; il en fait donc payer le cot au client !
Sur le plan pratique, le dbiteur sera tenu de payer des intrts, calculs au jour le jour sur le
montant du dpassement, partir du taux de base auquel s'ajoute une marge variable, et
galement une commission de 0,25 % 0,5 % trimestriels sur le plafond autoris (au-del en
cas de dpassement), mme si le crdit n'est pas utilis. Les dpassements de plafonds
sont pnaliss par un sur-taux qui peut atteindre 6 %.
Cela fait du crdit de caisse le plus coteux de ceux qui sont mis disposition de
l'entreprise; pour cette raison, il ne devrait intervenir dans la gestion de la trsorerie que pour
raliser des ajustements ponctuels, et de faibles montants, ou, si l'on prfre, pour affiner
des ajustements raliss l'aide d'autres crdits.
6.4.3 Le crdit d'escompte
La lettre de change.
Lorsqu'un fournisseur de marchandises accorde un dlai de paiement son client, il peut
tirer une LETTRE DE CHANGE, encore appele TRAITE, par laquelle il oblige le dbiteur,
qui accepte, s'acquitter de sa dette une poque dtermine (souvent quelques mois).
Le mcanisme de la lettre de change est intressant pour le crancier-bnficiaire, et ce
deux points de vue au moins
d'une part, sur le plan financier, il peut dcider soit
1. d'attendre l'chance de la traite
2. de l'endosser, afin d'teindre une dette
3. de l'ESCOMPTER auprs d'un organisme financier, auquel cas il reoit son argent
anticipativement;
d'autre part, sur le plan juridique, il dispose d'une arme dissuasive en cas de refus soit
d'acceptation, soit de paiement du dbiteur : c'est le PROTET, dress par un huissier de
justice, et publi au journal des Protts, dsignant ainsi publiquement le mauvais dbiteur, le
privant de crdit.
Au niveau du crdit lui-mme, on distingue le CRDIT D'ESCOMPTE-CDANT (ou
ordinaire), et le CRDIT D'ESCOMPTE-FOURNISSEUR.
Dans le CRDIT D'ESCOMPTE-CDANT, le tireur de la lettre (le crancier = le fournisseur)
de change passe avec sa banque un contrat par lequel elle accepte l'escompte un montant
dtermin de traites et pour autant que le tir (le dbiteur, le client) soit sa convenance; le
tireur doit supporter les frais de ce crdit, appels AGIOS.
Dans le CRDIT D'ESCOMPTE-FOURNISSEUR, c'est le tir (le dbiteur) de la lettre de
change qui demande sa banque un crdit d'escompte en faveur du tireur (crancier); et
c'est donc le tir (le client) qui supporte les agios.
62
Le crdit d'escompte s'effectue toujours sauf bonne fin ; cela signifie que si, l'chance,
le tir ne paie pas la banque, celle-ci se retourne sur son client.
Cela provient du mcanisme de l'endossement : le dernier bnficiaire d'une traite peut, si le
tir ne remplit pas ses engagements, se retourner contre le tireur et les diffrents
endossataires de la traite, qui sont dbiteurs solidaires. De mme, l'aval est toujours caution
solidaire du tir.
Le crdit d'escompte commercial est scurisant pour le banquier, car:
il est accord sauf bonne fin ;
il permet un clatement des risques, puisqu'il n'y a pas un seul dbiteur (lentreprise), mais
plusieurs (les diffrents tirs).
Ce type de crdit prsente galement des avantages pour l'entreprise, essentiellement par le
fait qu'il se situe dans la ligne de la tradition commerciale du crdit-client ; en outre, il est
moins cher que le crdit de caisse, et s'obtient en gnral plus aisment.
Toutefois, il n'est pas sans inconvnients, car il manque de souplesse, l'entrepreneur n'tant
pas matre de la dure des effets ni de leur montant.
6.4.4 Les oprations temprament.
Les crdits temprament couvrent des oprations prives ou professionnelles, court et
moyen terme; ils sont caractriss par un paiement priodique constant, comprenant le
remboursement du capital et des intrts. Il existe deux grandes catgories d'oprations
temprament:
- le prt temprament;
- la vente temprament.
Le prt temprament est dfini comme tant tout contrat de crdit quelle que soit sa
qualification ou sa forme, aux termes duquel une somme d'argent ou un autre moyen de
paiement est mis la disposition d'un consommateur qui s'engage rembourser le prt par
versements priodiques (deux suffisent) .
La vente temprament est dfinie comme tant tout contrat de crdit quelle que soit sa
qualification ou sa forme, qui doit normalement comporter acquisition de biens meubles
corporels ou prestations de service et dont le prix s'acquitte par versements priodiques, en
trois paiements au moins, acompte non compris .
La dure maximum des financements privs est rgle par la loi, celle des financements
professionnels n'excde, en gnral, pas 5 ans.
6.4.5 Le crdit hypothcaire
Le crdit hypothcaire est un crdit long terme (10 30 ans) destin financer des
acquisitions immobilires, et qui est garanti par un bien immobilier. Les organismes
financiers prtent sur base de la valeur vnale du bien, c'est--dire sur la valeur en cas de
vente force estime par un expert.
Il existe diffrentes formules de prt hypothcaire, dont la plus courante reste celle o les
remboursements s'effectuent par annuits constantes; chaque annuit comprend les intrts
63
et le remboursement en capital (principal). Au fil des annes, la part des intrts diminue
tandis que celle du remboursement en capital augmente.
Le prt est garanti non seulement par une hypothque, mais galement par une assurance
solde restant d , qui interviendra en cas de dcs de l'emprunteur.
Il est galement possible de raliser ce type d'emprunt auprs d'une compagnie
d'assurance, sur base d'une police d'assurance-vie.
En principe, l'annuit est fixe une fois pour toutes au dpart; elle dpend du montant de
l'emprunt, du taux appliqu, et de la dure. A titre d'exemple, un emprunt de 25.000 en 20
ans 7 % donne une annuit d'environ 2.360 .
Mais certains organismes introduisent dans leur contrat une clause de rvision
(quinquennale, par exemple), s'autorisant par l revoir le taux (avec un plafond) au terme
d'une certaine priode. Il y a l un danger non ngligeable pour l'emprunteur.
Les contrats prvoient galement une clause de remploi : en cas de remboursement anticip
de la part de l'emprunteur, il lui est rclam une indemnit de ddit (ex.: 3 mois d'intrt)
pour rupture de contrat.
Les organismes financiers affichent en gnral un taux plancher ( partir de ...); le taux
rellement appliqu dpendra de facteurs tels que la qualit de l'emprunteur, le montant de
l'emprunt par rapport la valeur vnale de l'immeuble, le systme adopt (taux fixe taux
variable).
6.4.6 Le leasing
Le leasing, appel aussi location-financement, ou encore parfois crdit-bail, est un systme
de financement destin aux investissements professionnels.
Le mcanisme est le suivant: l'entreprise dsireuse d'investir, mais ne souhaitant ni
s'autofinancer, ni emprunter, va s'adresser une entreprise de financement spcialise;
celle-ci commande le bien, selon les spcifications de l'investisseur, et paie la facture.
L'investisseur va alors acquitter un loyer, qui est calcul de telle manire que le bien est
entirement rembours, intrts compris, sur sa dure de vie conomique.
Dans le contrat figure en gnral une clause d'option d'achat (max. 15 %); cette clause
permet au locataire de racheter le bien au terme du contrat, une valeur fixe ds le dpart
(par exemple 5 % du prix), appele valeur rsiduelle. Si le locataire ne lve pas cette option,
la socit de leasing reprend le bien, puisqu'il en reste jusque l, le lgitime propritaire.
Le leasing constitue un moyen pratique de financer des investissements, mais il est plus
onreux qu'un emprunt classique, ce qui prsente un certain dsavantage. Les avantages du
leasing peuvent tre rsums comme suit
la socit de leasing s'occupe en gnral de toutes les formalits d'achat, ce qui, pour
certains investissements, constitue un gain de temps apprciable;
la socit de leasing restant propritaire du bien, ce financement n'exige pratiquement
aucune garantie, contrairement au crdit classique;
sur le plan fiscal, les loyers sont considrs comme des charges dductibles, et la TVA est
rcuprable; cela permet d'amortir des biens dans des dlais plus courts que ceux qui sont
admis traditionnellement; le leasing sera donc intressant pour du matriel volution
technologique rapide;
64
enfin l'option d'achat permet d'acqurir des biens encore en bon tat une valeur
intressante et connue ds le dpart.
II existe de multiples formes de contrats de leasing; ainsi, on peut associer un leasing un
contrat d'entretien de type omnium , qui permet une gestion efficace du matriel acquis.
65
CHAPITRE 7 : LES RELATIONS DE L'ENTREPRISE.
Ce chapitre dcrit sommairement les relations de l'entreprise avec les tiers (clients,
fournisseur, banques, administrations, personnel), ainsi qu'avec son (ses) propritaire(s).
L'essentiel est de bien comprendre l'impact de ces oprations tant sur le patrimoine de
l'entreprise que sur son compte rsultat.
7.1 Clients et fournisseurs
Une bonne gestion ncessite la tenue de comptes particuliers clients, pour chaque client un
tant soit peu important.
En consquence :
Toute opration de vente tel client se traduira non seulement par un dbit du compte 400
clients (dnomm compte gnral clients ou encore compte centralisateur clients), mais
galement par un dbit du compte particulier de ce client.
Ex.: vente de marchandises au client DUBOIS, 250 E plus 21% TVA (52,50 E) = 302,50 E
Toute opration de paiement de la part d'un client se traduira par un crdit du compte 4000
CLIENTS et du compte particulier de ce client.
En ralit, il n'y a pas dbit ou crdit de deux comptes, car le compte particulier du client
n'est qu'un sous-compte du centralisateur (on parle galement de compte extra-comptable).
Dans les comptabilits informatises, on mouvemente toujours (et uniquement) le compte
particulier du client, et le centralisateur est automatiquement mouvement de ce montant.
Rgulirement, on tire une balance clients, qui indique ce que chaque client doit. Cette
balance peut galement montrer des situations anormales , comme par exemple un client
crditeur (un client qui on doit de l'argent).
On peut galement tirer, dans une comptabilit informatise, une balance ge clients, c'est-
-dire une balance qui indique les clients en retard de paiement par rapport aux chances
prvues. Cette balance permet d'effectuer les rappels ncessaires.
Le dveloppement vu ci-dessus s'applique galement la comptabilit fournisseur.
Lorsque l'entreprise facturait un client, le montant total de la facture tait inscrit au compte
"4000 CLIENT" (et au compte particulier du client, si celui-ci existe). Il y reste aussi
longtemps que le client n'a pas honor sa dette. Mais que se passe-t-il lorsque le client tarde
D 7000 chif aff C D 4511 tva due C D 4000 clients C
250 53 303
D 4001 client D C
303
66
payer, ou mieux, lorsque le vendeur se rend compte qu'il ne paiera pas (faillite, par
exemple). Ces faits doivent bien entendu tre constats dans la comptabilit, soit ds que
l'on est au courant, soit lors de l'inventaire annuel.
Partons d'un exemple, pour illustrer les diffrents cas possibles : nous avons factur un
client des marchandises pour un montant de 1.000 , plus TVA 21 % (210 ), soit au total
1.210
Cas 1 : le client se rvle totalement et dfinitivement incapable de payer : la perte est
constate par le compte 6420 MOINS-VALUE SUR RALISATION DE CRANCES
COMMERCIALES
La perte de la crance reprsente pour l'entreprise une CHARGE; remarquez que la TVA,
qui avait t verse l'tat lors de la facturation, va tre rcupre (compte 41).
Cas 2 : le client fait des difficults pour payer.
a) Cela signifie que malgr plusieurs rappels, le client ne paie toujours pas, promet, ..., sans
que l'on puisse dire s'il est ou non capable de payer. on dit que le client est DOUTEUX, ce
que l'on va constater par une criture comptable
Notez qu'aucune perte n'est encore enregistre. Elle ne pourra l'tre, comme dans le cas 1,
que lorsque lincapacit de payer est dfinitivement constate.
b) Lorsqu'il est constat qu'une partie de la crance ne pourra probablement pas tre
rcupre (cas d'une faillite, par exemple), il appartient au gestionnaire d'oprer un
ajustement de la crance par une rduction de valeur, c'est--dire acter en charge au
compte de rsultat la perte probable sur cette crance (ex. : 40%). Cela s'effectue par une
criture un compte de rduction d'actif dnomm 4090 RDUCTION DE VALEUR
ACTE SUR CLIENTS.
Remarquez que la crance d'origine (1210) figure toujours au compte 4070 ; par contre, on
inscrira au bilan la valeur nette de la crance, savoir (1210-484) = 726
c) Le cas de ce client finira par tre rgl, en bien ou en mal.
Supposons que ce client verse pour solde de tout compte 800 E. Il faut d'abord calculer le
solde TVA de cette opration
D 4000 clients C D 6420 m/v clients C D 4118 tva rec/rgul C
.(1210) 1210 1000 210
D 4000 clients C D 4070 clients douteux C
.(1210) 1210 1210
D 6340 dot rv s/ client C D 4090 r/v sur client C
484 484
67
part de la TVA comprise dans le paiement : 800*21/121 = 138,84
TVA rcuprer par rgularisation: 210 - 138,84 = 71,16
Donc
J'ai reu 800
La TVA me rembourse 71,16 TOTAL 871,16
Alors que la crance nette, suite la RV, vaut 726
J'ai donc rcupr 145,16 en plus que mon estimation, montant que je dois inscrire en
rsultat (crdit) dans le compte 6341 REPRISE DE RV SUR CREANCES COMMERCIALES
A UN AN AU PLUS. Je dois galement annuler dans ma comptabilit les comptes
correspondant ce client, soit les 4070 et 4090.
Supposons maintenant que le client ne verse que 400 ; calculons la rgularisation TVA :
Part de la TVA comprise dans le paiement : 400*21/121 = 69,42
TVA rcuprer par rgularisation : 210 - 69,42 = 140,58
Donc :
J'ai reu 400
La TVA va me rembourser 140,58 TOTAL 540,58
Alors que ma crance nette vaut 726
J'ai donc perdu 185,42 (en plus que la RV dj acte), montant que je dois acter en perte
dans le compte 6420 MOINS-VALUES SUR RALISATION DE CRANCES
COMMERCIALES
Autre compte utilis dans les relations avec les clients : 4010 effets recevoir. Au dbit de
ce compte, on inscrira la valeur des lettres de change acceptes par les clients. La plupart
des auteurs pratiquent de la manire suivante : enregistrement classique de la facture,
dans un premier temps ; enregistrement de la lettre de change, ensuite.
Exemple : facture un client, 1.000 plus TVA 21,% (210 c) (1) ; ce client accepte une
lettre de change (2).
Il existe un compte correspondant au passif : 4410 EFFETS A PAYER.
D 4070 clients douteux C D 4090 r/v sur client C D 4118 tva rec/rgul C
1210,00 1210,00 484,00 484,00 140,58
D 5500 banque C D 6420 m/v clients C
400,00 185,42
D 4000 clients C D 451 tva due C D 7000 chiffre affaire C
1210 (1) 1210 (2) 210 (1) 1000 (1)
D 4010 effet recevoir C
1210 (2)
D 4070 clients douteux C D 4090 r/v sur client C D 4118 tva rec/rgul C
1210,00 1210,00 484,00 484,00 71,16
D 5500 banque C D 6341 reprise rv s/ cl C
800,00 145,16
68
7.2 La TVA
La situation normale d'une entreprise est d'tre dbitrice vis--vis de la TVA, c'est--dire de
devoir de largent enfin de priode (mois ou trimestre).
451 TVA due
411 TVA rcuprer
Tous les comptes TVA dues et dductibles sont donc solds, leur total tant transfr au
compte 4510 TVA A PAYER. Le solde de celui-ci exprime le montant d par l'entrepreneur
la TVA. Il doit bien entendu correspondre exactement au rsultat final de la dclaration. Si ce
compte prsente un solde dbiteur, il sera son tour transfr au compte 4110 TVA A
RECUPERER.
Impts et versements anticips
Le bnfice des indpendants est soumis l'impt des personnes physiques (IPP), et celui
des socits l'impt des socits (ISOC). Compte tenu du systme fiscal en vigueur, les
revenus d'une anne ne sont dclars et taxs que l'anne suivante. Cette situation entrane
deux obligations :
l'entreprise doit, sur base de ses comptes annuels, calculer et PREVOIR l'impt qu'elle
devra ultrieurement verser;
elle doit effectuer, quatre fois sur l'anne (pour les 10 avril, 10 ,juillet, 10 octobre et 20
dcembre), des VERSEMENTS ANTICIPES d'impt, chacun gal 1/4 de l'impt
estim. En cas d'absence ou d'insuffisance de versement, une majoration est applique
l'impt final.
Exemple : une entreprise s'attend devoir payer, sur les revenus de l'anne en cours, un
impt de 16.000 ; conformment aux prescriptions lgales, elle effectue 4 versements
anticips de 4.000 chacun. Au terme de l'anne, une fois connu son revenu final, elle
s'aperoit que l'impt sera de 17.000 .
Les critures (1) (4) correspondent aux versements anticips.
En fin d'exercice, lentreprise estime donc son impt total 17.000 ; comme elle a dj
pay 16.000 , elle sait qu'elle recevra un supplment de 1.000 verser. Ces 1.000
constituent une dette, qui sera crite au compte 4500 dettes fiscales estimes , dont le
solde se retrouvera parmi les dettes un an au plus, au passif du bilan.
D 6700 impts & VA C D 5500 banque C D 4500 impt estim C
(1) 4.000 4.000 (1) 1.000(5)
(2) 4.000 4.000 (2)
(3) 4.000 4.000 (3)
(4) 4.000 4.000 (4)
(5) 1.000
SD 17.000
69
Lorsqu'elle recevra son avertissement extrait de rle, le comptable transfrera le montant du
4500 au 4520 impt a payer, en rgularisant par rapport au montant rel.
Tous les impts constituent une charge (classe 6), et viennent en dduction du bnfice brut
dans le compte de rsultat.
7.3 Emprunts & charges financires
Lors de sa cration, ou plus tard, pour faire face son dveloppement, l'entreprise a besoin
de fonds; une partie de ses fonds proviendra souvent d'emprunts, contracts auprs
d'organisme financiers.
Ces emprunts peuvent tre classs en deux catgories : long terme (ceux dont le
remboursement s'effectue en plus d'une anne), et court terme. Ces emprunts figurent au
passif du bilan, les premiers au poste VIII Dettes plus d'un an, les seconds au poste IX
Dettes un an au plus.
Lors d'un emprunt long terme, l'emprunteur reoit de la banque un tableau
d'amortissement du prt, qui est un tableau indiquant les diffrentes dates et montants de
remboursement et de paiement des intrts.
Exemple : emprunt de 10.000 , taux 10 %, remboursables en 5 ans, amortissement
constant.
Dans ce systme, chaque anne, l'emprunteur rembourse 1/5 du capital emprunt, et paie
les intrts, qui sont de 10 % du capital restant rembourser.
Ecritures
Un entrepreneur emprunte 10.000 auprs d'une banque, qui lui les verse sur un compte; il
faut donc enregistrer dune part le mouvement du compte bancaire (+ 10.000), et la dette de
l'entreprise; puisque l'entrepreneur doit rembourser 2.000 dans un an, et le reste plus tard,
il faudra sparer la dette court terme de celle long terme
Remarquez que les intrts ne sont jamais comptabiliss au dbut du prt.
A la fin de la premire anne, l'entrepreneur rembourse 2.000 et paie galement 1.000
d'intrts, soit au total 3.000 , le tout par virement de son compte bancaire.
Fin Remboursement Intrts Total payer
anne
1 2.000 1.000 3.000
2 2.000 800 2.800
3 2.000 600 2.600
4 2.000 400 2.400
5 2.000 200 2.200
10.000 3.000 13.000
D 5500 banque C D 1730 det fin LTerm C D 4230 det fin c term C
10000 8000 2000
D 5500 banque C D 4230 det fin c term C D 6500 intrts C
3000 2000 .(2000) 1000
70
Alors que le remboursement (2.000 ) est une diminution de la dette, les intrts constituent
une CHARGE (classe 6).
Toutes les charges financires (intrts, escomptes de traites, frais financiers pays aux
banques) s'enregistrent dans les comptes 65.
Toujours la fin de cette premire anne (et des suivantes aussi), il faut reclasser la dette;
en effet, des 8.000 que l'entrepreneur devait long terme, 2.000 sont payer en fin
d'anne, et deviennent donc court terme ( un an au plus). D'o une nouvelle criture
comptable:
D 4230 det fin c term C D 1730 det fin LTerm C
2000 2000 .(8000)
71
Synthse de ces oprations dans les comptes, sur l'anne:
(1) emprunt des 10.000 la banque, dont 2.000 rembourser en fin d'anne;
(2) fin d'anne: remboursement de 2.000 et paiement des intrts (1.000 e);.
(3) reclassement des dettes: constatons que 2.000 des 8.000 restants sont rembourser
dans un an.
Exercice 13
Vous empruntez une banque une somme de 18.000 , remboursable en 6 ans, intrt 9 %
l'an. Dressez le tableau de remboursement, passez l'criture lors de l'emprunt, puis celle du
premier paiement.
7.4 Les frais de personnel.
1. La gestion administrative du personnel est une matire d'une complexit extrme, en
constante volution. C'est la raison pour laquelle de trs nombreuses entreprises
confient cette gestion des organismes spcialiss appels secrtariats sociaux
2. Les documents dlivrs par ceux-ci permettent ensuite l'enregistrement comptable des
charges salariales et assimiles. L'exemple que nous donnons ici est par consquent
extrmement simplifi.
Lorsqu'un travailleur est engag, l'employeur indique au contrat d'emploi le salaire brut,
exprim soit mensuellement (employs), soit par heure (ouvriers). Ce salaire est en gnral
impos par une convention collective sectorielle et dpend de l'ge et du niveau de
qualification du travailleur.
Sur ce salaire brut, l'employeur va, au moment du calcul mensuel, prlever deux montants:
le premier, fix par la loi, et calcul en % du salaire brut, est destin l'ONSS (Office
National de Scurit Sociale); le taux actuel est de 13,07 % (sur 108 % du brut pour les
ouvriers) ;
le second est calcul sur le solde (= brut imposable), et est fonction des taux d'imposition
sur le revenu. Le Ministre des Finances fournit des tableaux de calcul (prcompte
professionnel).
Ces montants seront ensuite verss aux administrations respectives.
D 5500 banque C D 1730 det fin LTerm C
10000 (1) 3000 (2) 2000 (3) 8000 (1)
D 4230 det fin c term C D 6500 intrts C
2000 (2) 2000 (1) 1000 (2)
2000 (3)
72
salaire brut
- 13,07 % ONSS
___________________________
= brut imposable
- prcompte professionnel
___________________________
= net a payer
De son ct, l'employeur doit faire face plusieurs charges supplmentaires:
il doit galement verser une cotisation patronale onss, pour couvrir intgralement son
employ (pensions, allocations familiales, - maladies, accidents de travail, ... );
il doit prvoir (on dit provisionner ) les congs pays, et ventuellement, les 13e mois ou
prime de fin d'anne;
il doit souscrire une assurance-loi (couverture en terme de responsabilit civile);
il doit assumer ventuellement un certain nombre de frais, tels que: remboursement des
frais de transport, vtements professionnels, service de mdecine du travail, cantine,
salaire brut
+ onss patronale
+ provisions (congs pays, 13e mois)
+ assurance-loi
+ frais divers
___________________________________________
= salaire-cot
Salaires, charges sociales et autres cots relatifs au personnel s'enregistrent en charge dans
les comptes 62 et en dettes dans les comptes 45.
Exemple : un employ rmunr 1.500 brut/mois. Le taux d'ONSS patronale est de 35%,
celui de la provision pour pcule de vacances 1,8 %, et de l'assurance-loi est de 30 .
L'employ reoit une prime de fin d'anne de 1.200 brut. L'employeur rembourse 50 e/mois
de frais de transport.
Employ Patron
Brut 1500 Brut .+ 1500
. - ONSS
196,05 ONSS
.+
525
Provision pcule .+ 270
imposable 1303,95 Provision prime .+ 100
. - provision pcule
298,7 Assur-loi
.+
30
Frais .+ 50
Net 1005,25
Cot 2475
73
Le tableau ci-dessus, donne un aperu des cotisations patronales et personnelles dues pour
l'occupation de travailleurs manuels et intellectuels (taux en vigueur au 1er trimestre 2005).
La provision de 13 % pour pcule de vacances vaut pour les employs; pour les ouvriers,
elle est de 9,6 % des 108 % du salaire brut. En effet, la cotisation ONSS patronale est plus
leve parce qu'elle prvoit le P. V.
Structure des comptes
6202 rmunrations employs 4530 prcompte payer
6210 cotisations patronales 4540 GNSS payer
6220 assurance-loi 4550 Net payer
6230 provision P. V . 4558 primes payer
6231 provision prime 4560 P. V. payer
4590 assurance-loi payer
74
Lors du paiement effectif du travailleur, ainsi que des administrations concernes, les
comptes de la classe 4 sont solds, par le crdit d'un compte financier.
7.5 Relations avec les propritaires
Cas de l'entreprise individuelle.
Le patrimoine de l'indpendant en personne physique se confond avec celui de l'entreprise.
Le compte de l'exploitant (compte PCMN 109) enregistre les versements et les prlvements
du chef d'entreprise, faits titre permanent. Il s'agit pratiquement de modifications du capital
de l'entreprise. D'ailleurs, en fin d'exercice, le solde du compte 109 est transfr au compte
100 capital.
Quant aux avances momentanes du chef d'entreprise et ses retraits pour besoins
personnels, ils seront consigns dans un compte personnel de classe 4 (crances et dettes
un an au plus).
Cas de l'entreprise socitaire.
Dans l'entreprise socitaire (SA, SPRL, SCIIRL, ...), le patrimoine de la socit est distinct de
celui des associs. Il est frquent que la socit reoive des avances financires de la part
des associs ou qu'elle paie des frais pour leur compte.
Dans le premier cas, les avances des associs sont consignes au crdit d'un compte de
dettes (48 dettes diverses). Dans le second, les crances de la socit sur des associs sont
dbits au compte 416 associs .
Notons encore qu'en socit, les modifications du capital font l'objet de procdures lgales
prcises et complexes, et ce notamment parce qu'il s'agit d'un changement aux statuts,
c'est--dire au contrat entre les associs.
Charges Dettes
D 6202 rmunrations C D 4550 net payer C
1500 1005,25
50
D 4530 prco payer C
298,70
D 6210 ONSS patron C D 4540 ONSS payer C
525 196,05
525
D 6220 assurance-loi C D 4590 ass-loi payer C
30 30,00
D 6230 provision PV C D 4560 PV payer C
270 270,00
D 6231 prov prime C D 4558 prime payer C
100 100,00
D 6290 frais divers C
50
75
Exemples
un associ reoit une avance de 2000 e de la socit
un associ avance 5000 e la socit
D 5500 banque C D 4160 associ C
2000 2000
D 5500 banque C D 4890 av. d'assoc C
5000 5000
76
CHAPITRE 8 : CLOTURE DES COMPTES ANNUELS
(Travaux de fin d'exercice)
8.1 Principes gnraux
1) Arriv au terme de l'exercice comptable, il faut calculer le rsultat dgag par l'entreprise,
et tablir le bilan. Avant cela, un certain nombre d'oprations de vrification et de
rgularisation sont indispensables, afin de s'assurer que la comptabilit reflte bien la ralit
de la situation, et donc, que le bilan sera fiable.
La loi sur les comptes annuels des entreprises impose d'ailleurs un inventaire annuel. Faire
un inventaire, ce n'est pas seulement compter les marchandises en stock, mais c'est aussi
examiner l'ensemble des immobiliss, des crances et des dettes de l'entreprise afin de
s'assurer que les chiffres donns par la comptabilit correspondent bien la ralit
physique; si tel n'est pas le cas, il faut oprer les rectifications ncessaires.
2.a) La premire opration, purement arithmtique, consiste calculer pour chaque compte
du Grand-Livre les totaux des dbit et crdit, et en tirer le solde. On tablit aussi une
balance provisoire des comptes, tableau reprenant pour chaque compte le total du dbit, le
total du crdit et le solde, dbiteur ou crditeur.
On tablit galement une balance des comptes particuliers clients et une balance des
comptes particuliers fournisseurs.
b) Il est alors procd l'inventaire gnral, les principales oprations tant :
valuation des immobiliss (frais d'tablissement, immobilisations
incorporelles et corporelles); application des amortissements (en fonction des
tableaux) et d'ventuelles rductions de valeur et/ou de plus-values
inventaire des stocks, et rectification des comptes de stock en consquence
inventaire des crances (analyse de la balance CLIENTS), constatations
d'ventuelles pertes ou de crances douteuses, et rductions de valeur ; on
valuera galement les crances libelles en devises, et on appliquera les
moins-values ventuelles;
inventaire de caisse, et correction ventuelle;
rapprochement de la situation des comptes banque et des extraits de
comptes;
inventaire des dettes (et analyse de la balance fournisseurs); transfert des
dettes plus d'un an vers les dettes un an au plus de celles qui
choient dans l'anne; valuation des dettes libelles en devises et ajustement;
analyse des charges et rattachement des charges l'exercice comptable auquel
elles doivent rellement tre imputes; idem avec les produits ;
77
Amortissements.
Les immobilisations acquises par l'entreprise perdent de leur valeur au fil du temps; ceci est
comprhensible: le matriel, le mobilier, la voiture que vous achetez aujourd'hui n'aura plus
la mme valeur dans un an ou deux. Il faut donc constater cette perte de valeur dans la
comptabilit par un amortissement.
Cet amortissement s'effectue en principe sur une base annuelle, la condition tant que le
bien se trouve dans le patrimoine de l'entreprise au 31 dcembre.
Exemple : le 3 septembre N, achat d'une camionnette, 15.000 , (plus TVA 21%, soit 3.150
, mais qui est dductible), amortissement en 5 ans, soit 20 % par an.
Tableau
Amortissement Somme amortie Valeur rsiduelle
N 3.000 3.000 12.000
N + 1 3.000 6.000 9.000
N + 2 3.000 9.000 6.000
N + 3 3.000 12.000 3.000
N + 4 3.000 15.000 0
Ecritures lors de l'achat
D 2410 Mat roulant C D 411 tva dduct C D 4400 fournisseur C
15000 3150 18150
la fin de chaque anne, jusqu'en N + 4
Notez que les comptes d'amortissement (classe 2) ont le mme numro que le compte
d'immobilis, sauf qu'ils se terminent par le chiffre 9.
L'amortissement est une charge (classe 6), qui influence donc le rsultat final; remarquez
que l'amortissement est obligatoire, mme si l'entreprise fait des pertes.
Au bilan, on inscrira la diffrence entre le solde du compte 2410 et celui du 2419, soit
12.000e, valeur qui apparat d'ailleurs la premire ligne du tableau d'amortissement, dans
la colonne valeur rsiduelle.
Aprs N + 4, la valeur sera 0, mme si la camionnette est toujours utilise; les deux
comptes, 2410 et 2419, figureront toujours au Grand Livre l'un avec un SD de 15.000, l'autre
avec un SC de 15.000. Ce n'est que lorsque la camionnette sera vendue (ou limine du
patrimoine de l'entreprise) qu'ils disparatront.
NOTEZ
D 2419 amort/mat roul C D 6302 amortiss C
3000 3000
78
que si le bien concern doit tre mis hors d'usage avant la fin de la dure prvue
d'amortissement, il y aura lieu d'acter un amortissement exceptionnel via le compte 6602.
Exemple : fin N + 3 la camionnette est mise hors d'usage., alors qu'il reste 6000 amortir:
que les biens qui ne s'amortissent pas, comme les terrains, peuvent faire l'objet de
rductions de valeurs (compte 6309).
Exercice 14
Vous achetez du matriel professionnel pour un montant de 3000 , plus TVA 21% (630 ).
L'amortissement s'effectuera en 6 ans.
Passez les critures lors de l'achat, puis la fin de la 1 anne ;
Quelle somme figurera dans le bilan la fin de la 3 anne ?
8.3 Variations des stocks
1. Nous avons vu au cours des chapitres prcdents que tous les achats de marchandises
taient comptabiliss dans un compte de classe 6 (charge), et toutes les ventes dans un
compte de classe 7 (produit). En outre, il est tenu un compte de STOCK (classe 3), qui figure
au bilan, et qui montre la valeur d'inventaire des marchandises. Cet inventaire est en principe
ralis une fois l'an, et act au livre des inventaires. C'est cette opration que nous allons
maintenant nous intresser.
Le problme numro 1 est au-del de l'inventaire physique, de valoriser le stock.
L'A.R. du 8 octobre 1976 prvoit quatre mthodes possibles
le prix individuel (pice par pice), cette mthode n'est applicable que lorsque le stock est
limit et compos de bien trs diffrents;
le prix moyen pondr (PMP);
la mthode FIFO (First in, First out);
la mthode L IFO (Last in, First out).
Voyons ces trois dernires mthodes, par l'exemple.
Un exemple illustrera la pratique de ces trois dernires mthodes. Un commerant vend des
chemises bleues classiques. Voici le dtail de ses achats et ventes de dcembre. Son stock
de dpart tant suppos nul
1 /12 : achat : 100 chemises 18,75 /pice
1 au 10;12 : vente : 70 chemises
11 / 12 : achat: 120 chemises 19,25 /pice
16 au 20/ 12 : vente : 90 chemises
21 /12 achat : 60 chemises 20,25 /pice
21 au 31 vente : 50 chemises
Stock au 31/12 = 70 chemises
D 6602 amort except C D 2419 amort/mat roul C
6000 6000
79
8.3.1 Mthode PMP (1.379)
8.3.2 Mthode FIFO (1.407,50)
8.3.3 Mthode LIFO (1.342 50)
Dans le Grand Livre de l'entreprise, au compte 3400 STOCK , figure la valeur du dernier
inventaire (fin de l'anne dernire). Arriv en fin d'exercice comptable, on va procder au
nouvel inventaire, pour ajuster le compte de stock; trois cas peuvent se prsenter:
ou le stock n'a pas chang (rare), et aucune criture n'est passer;
ou le stock a augment;
ou le stock a diminu,
DATE ACHATS VENTES STOCK
nombre val totale val unitaire
1-dc 100 x 18,75 = 1.875 100 1.875 18,75
1 au 10 70 x 18,75 30 562,5 18,75
11-dc 120 x 19,25 = 2.310 150 2.872,50 19,15
11 au 20 90 x 19,15 60 1.149 19,15
21-dc 60 x 20,25 = 1.215 120 2.364 19,7
21 au 31 50 x 19,70 70 1.379 19,7
DATE ACHATS VENTES STOCK
nombre val totale val unitaire
1-dc 100 x 18,75 = 1.875 100 1.875 18,75
1 au 10 70 x 18,75 30 562,5 18,75
11-dc 120 x 19,25 = 2.310 30 562,5 18,75
. +120 2.310 19,25
11 au 20 30 x 18,75 60 1.155 19,25
+ 60 x 19,25
21-dc 60 x 20,25 = 1.215 60 1.155 19,25
. +60 1.215 20,25
21 au 31 50 x 19,25 10 192,5 19,25
. + 60 1.215 20.25
DATE ACHATS VENTES STOCK
nombre val totale val unitaire
1-dc 100 x 18,75 = 1.875 100 18,75 1.875
1 au 10 70 x 750 30 18,75 562,5
11-dc 120 x 19,25 = 2.310 30 18,75 562,5
120 19,25 2.310
11 au 20 80 x 19,25 30 18,75 562,5
30 19,25 577,5
21-dc 60 x 20,25 = 1.215 30 18,75 562,5
30 19,25 577,5
60 20,25 1.215
21 au 31 50 x 20,25 30 18,75 562,5
30 19,25 577,5
10 20,25 202,5
80
et il faut passer les critures correspondantes.
Soit une entreprise qui dbute un exercice avec un stock de 2.500 ; durant l'anne, elle a
achet des marchandises pour 22.500 , et a vendu pour 46.500 .
1er cas : l'inventaire de fin d'exercice montre un stock de 4.000 ; cela signifie qu'une partie
des marchandises achetes dans l'anne n'ont pas t vendues, alors qu'elles ont t
comptabilises en charge; il faut donc corriger les chiffres, faute de quoi le compte de
rsultat ne sera pas correct.
Ecritures [entre (), la situation initiale des comptes]
2 cas : l'inventaire de fin d'exercice montre un stock de 500 ; cela signifie que toutes les
marchandises achetes dans l'anne ont t vendues, mais qu'en outre, pour raliser le
chiffre daffaire de 46.500 , il a fallu puiser dans le stock; il faut donc corriger les chiffres,
faute de quoi le compte de rsultat ne sera pas correct :
D 3400 stocks C D 6094 var stock C
.(2500) 1500
1500
SD 4000 SC 1500
D 6040 achats C D 7000 chiffre affaire C
.(22500) .(46500)
SD 22500 SC 46500
81
Ecritures [entre (), la situation initiale des comptes]
Le solde du compte 6094 (solde dbiteur) viendra s'ajouter au compte d'achats
8.4 Rgularisations.
Nous avons vu que tant l'actif qu'au passif du bilan figurait un poste RGULARISATIONS.
Ces rgularisations dcoulent de l'application du principe d'annualit, qui veut que les
charges et les produits soient rattachs l'exercice o ils sont ns.
Le plan comptable a prvu quatre comptes de rgularisation:
- 490 charges reporter ACTIF
- 491 produits acquis ACTIF
- 492 charges imputer PASSIF
- 493 produits reporter PASSIF
Utilisation :
a) charges reporter :
a. Supposons que l'entreprise ait fait imprimer en dcembre N des prospectus publicitaires
pour 1.500 , distribuer durant le premier trimestre, N + 1. Lorsqu'elle a reu la facture
(1500 + 21% TVA(315)), elle a enregistr la charge; toutefois, cette charge ne doit pas
affecter l'anne N, mais l'anne N + 1 . Fin dcembre N, on va donc oprer une
rgularisation; les 1.500 figureront l'actif du bilan, poste X, et seront dbits en charges
ds l'ouverture des comptes en N + 1 .
lors de la rception de la facture
au 31 dcembre
D 3400 stocks C D 6094 var stock C
.(2500)
2000 2000
SD 500 SD 2000
D 6040 achats C D 7000 chiffre affaire C
.(22500) .(46500)
SD 22500 SC 46500
D 61** publicit C D 4512 tva dduct C D 4400 fournisseur C
1500 315 1815
D 61** publicit C D 490 ch reporter C
.(1500) 1500 1500
82
lors de la rouverture des comptes en( N + 1) :
b. Supposons que l'entreprise ait plac, le 1er dcembre N, 20.000 pour 3 mois, au taux de
6 %. Fin fvrier N + I elle touchera donc 300 d'intrts, qui se rpartissent pour 1/3 l'anne
N et 2/3 lanne N + 1. Pour respecter le principe d'annualit, elle doit, fin dcembre, acter
dans ses produits 100 e d'intrts (qu'elle n'a pas encore reu), puisque ceux-ci sont
affrents l'anne N.
au 31 dcembre N
lors du paiement des intrts, fin fvier N +1
solde N + 1 = 200
8.5 Quelques autres critures
L'examen de la balance clients peut faire apparatre, dans l'un ou l'autre compte particulier,
un solde crditeur (c'est--dire un client auquel on doit de l'argent). Exemple pour une
entreprise ou trois clients sont en compte.
Balance clients
N client Nom SD SC
400.001 Dubois 3202
400.002 SPRL ABC 1407
400.003 Van Laer 148
4609 148
Le compte centralisateur clients prsente alors un solde de (4609 - 148) = 4461. Prsenter
ce solde au bilan n'est pas correct, car on compense deux crances et une dette sur des
personnes diffrentes, ce qui n'est pas autoris. Il y a lieu de transfrer la dette vis--vis du
client Van Laer au passif du bilan, sous la rubrique Dettes un an au plus - Dettes
commerciales.
D 61** publicit C D 490 ch reporter C
1500 .(1500) 1500
D 491 produits acquis C D 7500 intrts C
100 100
D 491 produits acquis C D 7500 intrts C D 5500 banque C
.(100) 100 300 300
83
Le raisonnement est identique avec les fournisseurs : tout solde dbiteur doit tre transfr
l'actif sous la rubrique <.< Crances un an au plus - Crances commerciales .
Lorsqu'en fin d'exercice, un compte bancaire prsente un solde crditeur (c'est--dire
ngatif, il doit tre transfr au passif sous la rubrique Dettes un an au plus - Dettes
financires .
Cette situation est bien le reflet de la ralit : (entreprise est endette de 250 vis--vis de sa
banque. Ds la rouverture des comptes, au dbut de l'anne suivante, on passera l'criture
inverse, pour ramener les 250 au crdit du compte 5500.
D 4000 clients C D 440* cl crditeurs C
.(4609) 148 148
148
D 5500 banque C D 433 dette financ C
250 .(250) 250
84
8.6 tablissement des comptes annuels
Une fois ces travaux termins, il faut dterminer le rsultat de l'entreprise, en suivant le
schma lgal.
Il appartient l'entrepreneur d'estimer son impt (IPP ou ISOC) partir de son bnfice brut,
des dpenses non admises et d'ventuelles latences fiscales, et de le comparer aux
prcomptes et versements anticips imputables. La diffrence sera acte en dettes
(supplment estim payer) ou en crances (surplus recevoir). Ce qui se produit par une
criture
dettes estimes
Crances estimes
Le montant de l'impt soustrait du bnfice brut donne le bnfice net, dont il faut dcider de
l'affectation.
Ce bnfice peut tre utilis: pour combler des pertes antrieures;
pour rmunrer l'entrepreneur ou les associs;
pour augmenter le capital;
pour constituer une rserve lgale (obligatoire dans les
SPRL, SA, SCRL) : 5 ,% du bnfice net, jusqu'
concurrence de 10 % du K; :
pour constituer d'autres rserves.
La structure des comptes utiliser est
6920 Dot. la rserve lgale 1300 Rserve lgale
6921 Dot. aux autres rserves 1330 Rserve disponible
6930 Bnfice reporter 1400 Bnfice report
6940 Rmunration du capital 4710 Dividendes
6950 Administrateurs - grants 4720 Tantimes
Ainsi, l'affectation est une opration qui se traduit par un jeu d'critures comptables
reprsentant les affectations et prlvements. Supposons une entreprise qui a ralis un
bnfice net de 75.000 ; 3.750 doivent tre placs en rserve lgale ; 7.500 rmunrent
le capital, 31.000 vont chacun des deux grants et le solde 1.750 est reporter.
D 6701 excdent VA C D 4120 impt rcup C
x x
D 6700 impt C D 4500 dette fisc est C
x x
D 6920 dot rs lgale C D 1300 rserve lgale C
3750 3750
D 6930 bn reporter C D 1400 bn report C
1750 1750
D 6940 rmun capital C D 4710 dividendes C
7500 7500
D 6950 admin - grant C D 4720 tant grant A C
62000 31000
D 4721 tant grant B C
31000
85
Tantimes : part du bnfice net attribue aux administrateurs d'une socit aprs les
versements lgaux et statutaires aux rserves.
L'intgralit du bnfice affecter se retrouve ainsi au passif du bilan ( = dettes envers les
associs), alors que le compte de rsultats est sold.
Toutes les critures d'affectation tant termines, on dresse alors la balance dfinitive.
Il suffit alors de reprendre l'ensemble des comptes de bilan (classes 1 5) pour tablir le
bilan final et l'annexe.
Puisque, dans cette balance, au sous-total bilan TSD = TSC, l'actif sera bien gal au
passif . Rappelons qu' l'actif du bilan n'apparaissent que des valeurs nettes.
en immobilis : valeur des immobiliss - amortissements ;
en stocks : valeur de stocks - rductions de valeur ;
en crances : valeur des crances - rductions de valeur.
n intitul TD TC SD SC
l xxx
COMPTES DE BILAN
5xxx
BILAN TD = TC TSD = TSC
6xxx
& COMPTES DE RESULTAT
7xxx
RESULTAT TD = TC TSD = TSC
TOTAL GENERAL TGD = TGC TGSD TGSC
86
CHAPITRE 9 : LECTURE CRITIQUE DES COMPTES ANNUELS
Le bilan - description complte.
Avant d'analyser un bilan, il est impratif de savoir quoi correspondent ses diffrentes
rubriques.
9.1 Lactif
Poste I : les frais d'tablissement : il s'agit de frais qui ont t engags lors de la constitution
de l'entreprise, et qui ont t ports l'actif du bilan (on dit : activs ) plutt que d'tre
imputs en charge immdiatement. De cette faon, ils seront amortis au maximum sur 5 ans.
Ces frais se retrouvent essentiellement dans les socits et comprennent par exemple les
frais de notaire, d'enregistrement, d'tude de march, ...
Poste II : les immobilisations incorporelles : on retrouve essentiellement sous cette rubrique
l'acquisition d'un bien immatriel, tel un brevet, une licence ou un droit de franchise et le
goodwill *, en cas de reprise d'une entreprise existante.
* Goodwill ou survaleur ou cart d'acquisition : cest la fraction de la diffrence de premire
consolidation subsistant aprs la rvaluation des actifs de la filiale. Cet cart d'acquisition,
s'il est positif, apparatra comme une immobilisation incorporelle d'un type particulier qui
devra tre amortie, linairement, sur une dure qui s'tale dans la pratique entre 5 et 40 ans,
avec une concentration autour de 10 20 ans.
Poste III : les immobilisations corporelles, qui comprennent les terrains et les constructions,
les installations et les machines, le gros outillage, le mobilier, le matriel roulant; notez que la
valeur des immobilisations qui figure au bilan est nette, c'est--dire amortissements dj
dduits (idem pour les frais d'tablissement)
Poste IV : les immobilisations financires, il s'agit de la valeur des participations que
l'entreprise dtient dans une ou plusieurs autres, de mme que les crances sur ces mmes
entreprises. On en rencontre peu dans les P.M.E. Figure galement ici la valeur des cautions
verses par l'entreprise (par exemple, caution locative)
Poste V : les crances plus d'un an, qui reprsentent les montants payer par les
dbiteurs (clients, associs, ...), dont lchance excde 12 mois.
CES CINQ POSTES CONSTITUENT LES ACTIFS IMMOBILISES.
Poste VI : les stocks, matires premires, produits fins, marchandises, ... dont la valeur est
dtermine par l'inventaire.
Poste VII : les crances un an au plus, qui reprsentent les montants payer par les
dbiteurs, dont l'chance n'est pas suprieure 12 mois.
Poste VIII : les placements de trsoreries, sommes places en banque sur des comptes
intrt, ou dans d'autres formes de placements.
87
Poste IX : le disponible, argent possd par lentreprise sur ses comptes bancaires, en
caisse, ...
Poste X : les rgularisations d'actif
CES CINQ POSTES CONSTITUENT LES ACTIFS CIRCULANTS.
9.2 Le passif
Poste I : le capital, savoir l'apport personnel de l'entreprise ou des associs (socit).
Poste II: les primes d'mission. La prime dmission est la diffrence entre la valeur nominale
d'une obligation et son prix d'mission.
Par exemple, une prime dmission sera dduite dun prix de souscription pour tenir compte
de la non-attribution dintrts pour une certaine priode.
Poste III : les plus-values de rvaluation, qui correspondent des plus-values actes sur
les immobilisations corporelles.
Poste IV : les rserves, qui proviennent de bnfices laisss la disposition de l'entreprise.
Parmi elles, la rserve lgale, obligatoire dans les SA, SPRL, SCRL.
Poste V : le bnfice (ou perte) report, il s'agit de bnfices laisss la disposition de
l'entreprise, et non mis en rserve; une perte peut galement tre reporte (le montant est
affect du signe -).
Poste VI : les subsides en capital, obtenus des pouvoirs publics lors d'investissements.
Poste VII : les provisions pour risques et charges, prleves sur le bnfice pour courir des
risques ou des charges futures, nettement circonscrites, et certaines ou probables.
CES SEPT POSTES CONSTITUENT LES FONDS PROPRES.
Poste VIII : les dettes plus d'un an, sommes dues par l'entreprise ses cranciers
(banque, fournisseurs, ...), dont l'chance excde 12 mois.
CE POSTE VIII AJ OUTE AUX SEPT PRECEDENTS DONNE LES CAPITAUX
PERMANENTS.
Poste IX : les dettes un an au plus, sommes dues par l'entreprise ses cranciers
(banque, fournisseurs, fisc, TVA, ONSS, ...), dont l'chance n'excde pas 12 mois.
Poste X : les rgularisations de passif.
CES DEUX POSTES CONSTITUENT LES DETTES A COURT TERME.
88
9.3 Le compte de rsultat - description complte
Le compte de rsultat (appel aussi compte d'exploitation) est tabli en reprenant les
comptes des classes 7 et 6 de la comptabilit, savoir les produits et les charges.
Il permet, en dduisant les charges des produits de dterminer le rsultat (bnfice ou perte)
ralis par l'entreprise.
Pour rappel, on classe essentiellement en produits:
le chiffre d'affaires produits d'exploitation;
les intrts perus produits financiers;
certains produits spciaux produits exceptionnels (ex. : revente de matriel avec
plus-value).
et en charges:
les achats et les variations de stock
(matires premires, marchandises) charges
les frais gnraux;
les salaires et charges sociales d'exploitation
les amortissements, les provisions,
les rductions de valeurs;
les intrts pays charges
les charges financires
certaines pertes spciales charges exceptionnelles
(ex. : revente de matriel avec moins-value)
La tentation est grande de ne considrer que le rsultat final donn par ce compte
d'exploitation. Or, une analyse attentive de celle-ci peut amener d'intressantes rflexions
quant la manire dont s'est form ce rsultat.
C'est la raison pour laquelle le rsultat final constitue l'aboutissement d'un calcul en 3
tapes:
on calcule le rsultat d'exploitation, reflet des oprations quotidiennes de l'entreprise;
on corrige ce rsultat d'exploitation du rsultat financier (souvent ngatif, vu les charges
d'intrts dues l'endettement), pour arriver au rsultat courant;
ce dernier doit tre son tour corrig des phnomnes exceptionnels, pour obtenir enfin
le rsultat brut.
Ainsi peut-on analyser chacun des rsultats partiels.
89
COMPTES DE RSULTATS
I Ventes et prestations (Chiffre d'affaires) +
II Cots des ventes et prestations -
A. 1. Achats
2. Variations de stocks
B. Services et biens divers
C. Rmunrations et charges sociales
D. Amortissements, provisions et rductions de valeurs
E. Charges d'exploitation diverse
III RSULTAT D'EXPLOITATION =
IV Produits financiers +
V Charges financires -
VI. RSULTAT COURANT =
VII Produits exceptionnel +
VIII Charges exceptionnelles -
IX. RSULTAT BRUT =
X Impts sur le rsultat -
RESULTAT NET =
9.4 Que nous enseigne le bilan ?
Il est possible dextraire de nombreux renseignements du bilan, par une technique appele
analyse de bilan.
En principe, les comptes annuels fournissent une image fidle et reprsentative de
l'entreprise. Toutefois, les comptes doivent tre lus d'un il critiques, car certains piges
peuvent fausser lanalyse
les erreurs de calcul, frquentes, et difficiles redresser, dans la mesure o les comptes
annuels sont un tableau synthtique;
les fraudes:
destines amliorer fictivement l'image de l'entreprise : surestimation des stocks,
absence de rductions de valeur, amortissements insuffisants, ...
destines dprcier fictivement cette image : vente en noir , exagration des
amortissements, ..., essentiellement dans le but d'luder l'impt.
90
Ces fraudes sont difficiles dtecter, en particulier lorsque l'on connat mal l'entreprise. Quoi
qu'il en soit, les risques de dformation sont nombreux, par exemple.
rubrique clients : quelle est la solvabilit de ces clients ?
rubrique stocks : quelle est la valeur marchande relle des stocks ?
rubrique matriel roulant : quelle est la nature exacte de ce matriel ?
II faut bien garder l'esprit que les comptes annuels ne reprsentent que la partie merge
d'une ralit qui chappe souvent l'analyste, moins qu'il ne connaisse physiquement
lentreprise ; la prudence s'impose donc.
9.5 Les masses bilantaires
La structure du bilan telle qu'expose ci-dessus, ne doit rien au hasard; au contraire, nous
remarquons que:
les rubriques de lactif sont classes selon un ordre croissant de LIQUIDITE, c--d
laptitude tre transformes en argent liquide plus ou moins rapidement.
les rubriques du passif sont classes selon un ordre croissant D'EXIGIBILITE
91
Nous pouvons examiner ces notions dans un tableau bilantaire qui contient quatre masses
(les chiffres indiquent les postes reprendre pour le calcul de chaque masse).
Les actifs immobiliss sont des biens acquis pour fonctionner en tant dtenus de faon
permanente (immeubles, machines, vhicules).
Les actifs circulants sont des actifs grande liquidit :
Ralisables : doivent encore tre transforms (stocks, clients)
Disponible : comptes vue, comptes terme, caisse
Les capitaux permanents comprennent le capital, les rserves et le bnfice report.
Ce tableau montre quil faut un quilibre entre ces diffrentes masses; notamment,
l'entreprise doit gnrer suffisamment de liquidits pour faire face ses dettes court
termes.
Si la masse des dettes court terme venait dpasser celle des actifs circulants, lentreprise
ne serait plus en mesure dassurer ses paiements, mme si elle disposait dune masse
norme dactifs fixes. Ceux-ci ne peuvent en effet pas tre raliss rapidement et/ou leur
ralisation compromettrait la capacit de production de lentreprise.
9.6 Fonds de roulement
Un des quilibres fondamentaux est que les ressources permanentes (capitaux permanents)
doivent tre suprieures aux emplois immobiliss (actifs fixes). Pourquoi?
Je dispose pour crer mon entreprise de fonds propres pour 10.000 . Etant donn que mes
investissements ncessaires en matriel et mobilier s'lvent 16.000 , je vais emprunter
auprs de mon banquier. mais si je n'emprunte que les 6.000 qui me manquent, comment
vais-je acqurir un stock de marchandises de dpart, et comment vais-je pouvoir payer mes
premires charges (loyer, ...) avant que mon affaire commence tourner ?
92
La rponse est en soi simple: il faut que j'estime le stock ncessaire, et les liquidits
indispensables pour dmarrer mon entreprise, et emprunter plus de 6.000 . par exemple, si
j'estime 1.000 , le stock et 3.000 la liquidit, j'emprunterai 10.000 ma banque. ces
4.000 supplmentaires constituent le fonds de roulement.
2. Reprenons notre schma bilantaire
Les capitaux permanents (fonds propres plus ce que j'emprunte au banquier) sont suprieurs
aux actifs fixes, et couvrent aussi une partie des actifs circulants.
Autre manire de voir la situation : les actifs circulants comprennent
les stocks, dont la vente va procurer de l'argent;
les clients en compte, qui vont bientt payer;
le disponible, qui est de l'argent,
sont suprieurs aux dettes court terne, payer prochainement. En principe, je disposerai
donc d'assez d'argent liquide pour faire face mes dettes.
Le FONDS DE ROULEMENT NET (FRN) peut tre calcul de deux faons:
soit par le HAUT du bilan
frn = capitaux permanents - actifs fixes
soit par le BAS du bilan ->
frn = actifs circulants - dettes a court terme
93
Ce dernier mode de calcul est surtout intressant chez les indpendants, qui, faute d'un bilan
structur, ont souvent une mauvaise connaissance des termes de la 1re formule.
Exemple : supposons qu'aprs son dmarrage, le bilan de l'entreprise se prsente comme
suit :
Les masses bilantaires sont :
FRN = 3.000 (4.500 1.500)
l'entreprise doit bientt payer 1.500 e (DCT);
elle dispose dj de 1.000 e (disponible);
des clients vont galement bientt la payer et elle va couler au moins une partie de son
stock.
Elle sera donc l'aise pour faire face sa dette.
Que faire quand une entreprise n'a pas (assez) de FRN? Pour y rpondre, voyons les
lments essentiels qui influencent le FRN:
La valeur des capitaux permanents
apport nouveau en capital;
emprunts long terme ;
rinvestissement du bnfice : mise en rserve, report nouveau.
La valeur des immobilisations
acquisitions
cessions (= revente, dsinvestissement)
amortissements
Ainsi, lorsqu'une entreprise manque de FRN, il faut souvent passer par une restructuration
financire pour assurer sa survie; c'est--dire agir sur les capitaux permanents.
III immo corp 16000 I capital 10000
VI stocks 2000 VIII dettes plus d'un an 9000
VII crances 1500
IX disponible 1000 IX dettes un an au plus 1500
20500 20500
Actifs fixes 16000 Capitaux permanents 19000
Actifs circulants 4500
Dettes court terme 1500
94
Au contraire, un FRN trop important n'est pas ncessairement le signe d'une bonne sant
financire; en effet, cette situation peut indiquer
soit une mauvaise utilisation des capitaux permanents;
soit des actifs circulants trop importants, notamment en termes de stock (surstockage).
Il ne faut pas confondre FRN et liquidits; avoir un FRN n'est pas ncessairement synonyme
d'argent en caisse; le FRN reprsente de l'actif circulant;
Une extension des affaires ncessite un FRN plus important.
Le FRN est un premier instrument de mesure de la solidit financire de l'entreprise
Quel doit tre le montant du FRN, pour assurer l'quilibre financier de l'entreprise ?
Lorsque vous tablirez un business plan, vous devez veiller organiser le
financement de votre entreprise de faon dgager ds le dpart un FRN suffisant.
9.7 Le besoin en fonds de roulement (BFR)
Le besoin en fonds de roulement est li au financement du cycle d'exploitation. Ce cycle
comprend en fait deux types de mouvements :
PHYSIQUES achat de marchandises, ou de matires premires, stockage, fabrication,
vente, service aprs-vente, ...
FINANCIERS traduisant les consquences financires des mouvements physiques,
acomptes verss et reus, paiement des fournisseurs, des salaires, des taxes et impts,
encaissements des ventes, ...
On conoit bien qu'il existe rgulirement des dcalages entre les dcaissements et les
encaissements, dus l'existence des phases de stockage, aux mcanismes de crdit
(clients et fournisseurs), la priodicit de certaines obligations (loyer, salaires, ONSS, TVA,
impts, ...).
A certaines priodes, les encaissements ne suffiront pas financer les dcaissements,
d'autres, il n'y aura pas de problme.
Pour couvrir les dcalages entre les dcaissements et les encaissements, l'entreprise doit
disposer d'une trsorerie suffisante.
95
Nous remarquons que le BFR dpend essentiellement de trois lments :
le crdit fournisseur, qui agit positivement;
le crdit client;
le dlai de stockage, agissant tous deux ngativement.
Les entreprises l'ont d'ailleurs bien compris : alors qu'elles essaient d'obtenir les meilleures
conditions de leurs fournisseurs, elles tentent de rduire leurs stocks au minimum (voire
parfois 0 : just-in-time ) et les facilits de paiement qu'elles accordent leurs clients;
cette politique contribue en effet rduire le BFR au strict minimum.
Notion du just-in-time (ou flux tendu) : possder un stock de marchandises cote cher,
environ 25% (variable selon la nature du stock) de la valeur de ce stock chaque anne. Ce
cot norme est compos de diffrents postes :
Acquisition ou location, entretien, chauffage, assurances, des lieux de stockage
Assurance du stock en lui-mme
Salaires du personnel dentretien et de manutention
Pertes invitables dues lobsolescence et aux accidents de manipulation ou autres
La solution semble simple : ne plus dtenir que le stock strictement ncessaire au bon
fonctionnement de lentreprise et ne recevoir la livraison suivante que quand cest
indispensable, cest--dire juste temps just-in-time pour ne pas interrompre le
processus de fabrication. Ainsi, certaines entreprises sont livres chaque jour et possdent
seulement de quoi travailler le lendemain. Cette mthode permet de rduire les cots de
stockage pratiquement nant mais prsente deux inconvnients directs :
Le moindre retard de livraison interrompra lactivit de lentreprise
La multiplication des rotations de livraison augmente gnralement le prix dachat des
marchandises
En outre, cette mthode a augment considrablement la circulation des camions de
livraison, impliquant un surcrot de pollution, dembouteillages et daccidents.
L'approche JIT a t lance dans les annes 70 par le constructeur automobile Toyota.
L'limination du gaspillage et la capacit de raction sont les piliers du JIT. Quand cette ide
est applique la chane de production et au-del aux fournisseurs, on s'approche de la
production en continu, puisque la commande adresse au fournisseur est suivie d'une
rception immdiate. En fin de compte, les matires premires entrent dans la chane
logistique la suite de la demande du client. D'o le nom de systme remorque . L'ide
est de n'avoir rien de plus que le stock minimal et de fabriquer juste ce qu'il faut la
demande et pas avant.
Concrtement, cela peut se traduire par une livraison par heure de pices identiques en
petites sries. Les camionnettes de livraison apportant juste le ncessaire pour l'heure de
production venir et livrant directement la chane de montage. Pour illustrer la mthode de
fabrication synchronise, on peut prendre l'exemple d'un constructeur automobile japonais,
Nissan. A chaque fois qu'un vhicule entre en fabrication dans son site de production de
Washington, une tiquette code envoie un message un fabricant de tapis 3 kilomtres
de l, pour lui commander l'une de ses 120 garnitures intrieures pour automobiles. L, le
tapis demand est slectionn, dcoup et charg sur un camion en suivant la mme
squence que la voiture sur la chane. La livraison est ensuite effectue directement sur la
chane.
96
Exemple : Un entrepreneur ralise un chiffe d'affaires annuel de 121.680 e, pour des achats
de marchandises d'un montant de 49.500 e. Son stock est en moyenne de 20 jours. Il paie
ses fournisseurs 30 jours et ses clients le rglent 35 jours. Quel est son BFR ?
a) Il doit financer son stock (au prix d'achat)
49.500 x 20 j = 2.750 e
------------------
360J
Cela signifie que la valeur moyenne de son stock est de 2.750 e.
b) il doit financer son crdit clients (au prix de vente)
121.680 x 35 j = 11.830 e
--------------------
360 J
Cela signifie que son encours moyen client est de 11.830 e.
c) Il est financ par le crdit que lui accorde ses fournisseurs (au prix d'achat)
49.500 x 30 j = 4.125 e
-----------------
360 j
Cela signifie qu'il doit en moyenne ce montant ses fournisseurs,
Son BFR sera
Financement du stock 2.750 e
+ Financement des clients 11.830 e
- Financement par le fournisseur - 4.125 e
= 10.455 E
Exercice : faites le calcul s'il parvient rduire son stock 10 jours et le paiement de ses
clients 25 jours [R : 5.700 e].
Remarque importante: dans cet exemple, nous avons nglig, dans un souci de
simplification, le BFR engendr par les frais gnraux et les salaires.
Si l'entrepreneur dispose d'un FRN suffisant, il pourra couvrir son BFR; dans le cas contraire,
il devra faire appel au crdit.
Le BFR dpend essentiellement des secteurs dans lequel volue l'entreprise; ainsi, dans la
grande distribution, le BFR sera faible, car les stocks ont une rotation rapide, le crdit clients
est pratiquement inexistant et le crdit fournisseur est important. Par contre, plus le cycle
d'exploitation est long, plus le BFR sera important (financement du stockage et de la
fabrication). Une entreprise industrielle a donc souvent un BFR plus important qu'une
entreprise commerciale. Nous remarquons toutefois que:
97
le BFR peut varier d'une priode lautre (variations saisonnires, notamment);
le BFR varie avec le chiffre d'affaires, une augmentation de celui-ci entranant un
accroissement des stocks, et, en principe, des crances;
une augmentation du prix de revient (matires premires, salaires, ...) accrot le BFR.
La diffrence entre le FRN et le BFR se retrouve au niveau de la trsorerie.
TRESORERIE = FRN - BFR
Par consquent,
si FRN > BFR, la trsorerie sera positive;
si FRN < BFR, la trsorerie sera ngative, ce qui obligera l'entreprise recourir un
crdit appropri et prendre des mesures pour renforcer FRN et/ou diminuer BFR.
Pour atteindre un bon quilibre financier, il faut tenter de rapprocher le plus possible le FRN
du BFR; idalement le FRN devrait tre gal ou lgrement suprieur au BFR.
Pour cela l'entrepreneur peut agir sur l'un et/ou l'autre, de la manire suivante
action sur le FRN : (+)
- autofinancement (c'est--dire : mise d'une partie des bnfices disposition de
l'entreprise);
- accroissement des dettes plus d'un an (emprunt);
- augmentation du capital;
- dsinvestissement (cession d'immobiliss).
actions sur le BFR : (-)
- accroissement de la rotation des stocks;
- accroissement de la rotation clients (les faire payer plus vite);
- rduction de la rotation fournisseur (en obtenant de meilleures conditions de
paiement).
Le chef d'entreprise doit se donner un volant de trsorerie suffisant au dpart; celui-ci permet
d'assurer les premires chances jusqu' ce que les encaissements assurent la couverture
des dcaissements.
Le mode de financement du BFR aura en outre des rpercussions sur le prix de revient et la
rentabilit; s'il est assur par du crdit bancaire, il faudra en effet tenir compte des charges
d'intrts.
98
CHAPITRE 10 : LES SOCIETES
10.1 La constitution des socits
La constitution d'une socit passe ncessairement par un acte de constitution contenant
notamment l'ensemble de ses caractristiques.
Les fondateurs devront cependant procder certaines formalits et accomplir certaines
dmarches avant de signer cet acte.
tout d'abord tablir un projet de statuts reprenant les caractristiques de la socit
(forme, objet, capital, etc.).
tablir un plan financier* et le remettre au notaire avant la signature de l'acte de
constitution (il s'agit en fait d'un plan prvisionnel des besoins et des ressources de la
socit pour les deux premiers exercices sociaux).
remettre au notaire une attestation bancaire de nature tablir que les fonds destins
la libration du capital de la socit sont effectivement mis la disposition de celle-ci.
Le capital de la socit peut tre constitu par des apports en espces et/ou par des apports
en nature.
Ce n'est que lorsque ces formalits auront t remplies par les futurs associs que l'acte de
constitution de la socit pourra tre sign par les fondateurs et le notaire qui procde
ensuite l'enregistrement de l'acte (il le dpose en fait chez le receveur de l'enregistrement
qui procde lui-mme l'enregistrement de l'acte et peroit le droit d'enregistrement d
l'tat).
Lorsque l'acte revient de l'enregistrement, le notaire effectue le dpt au greffe du Tribunal
de Commerce comptent de lexpdition de l'acte ainsi que d'un extrait de l'acte reprenant
les mentions fixes par la loi et destin tre publi au Moniteur Belge.
Le notaire remettra enfin la socit les expditions de l'acte de constitution afin de
permettre au(x) reprsentant(s) de celle-ci de procder l'inscription de la socit la
banque Carrefour (http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/) et la T.V.A.
10.2 Le plan financier
10.2.1 Dispositions lgales
Le lgislateur (code des socits) exige que les fondateurs d'une Socit Anonyme (SA),
d'une Socit Prive Responsabilit Limite (SPRL) - y compris uni personnelle, ou d'une
Socit Cooprative Responsabilit Limite (SCRL) dposent chez le notaire, lors de la
constitution de la socit, un plan financier, "dans lequel ils justifient le montant du capital
social".
Ce texte lgal, malheureusement trs succinct, a t explicit par la jurisprudence. En
ralit, le plan financier constitue une prvision budgtaire tablie sur base du programme
d'action que les fondateurs se proposent de mettre en uvre.
99
Ce plan mentionne les moyens financiers prvus par les fondateurs en vue de garantir la
viabilit de la socit pendant les deux premires annes de son existence" (Tribunal de
Commerce de Bruxelles, 8 avril 1986, Revue Pratique des Socits, 1986, p. 166).
Le plan financier est donc, outre une justification du capital, un budget tabli sur deux ans,
dater de la constitution de la socit. Ses objectifs sont clairs : les fondateurs doivent
dmontrer qu'ils ont tudi les besoins de la socit constituer avec tout le srieux qui
s'impose.
Le nombre croissant de faillites est partiellement la consquence de la constitution htive
d'entreprise, en particulier socitaires. Les tiers-cranciers doivent tre protgs de
l'inconscience, voire du manque de scrupule de certains fondateurs.
Le plan financier est en principe rdig par les fondateurs de la socit; en pratique, vu la
complexit de cette matire, il est conseill de s'adresser un spcialiste, tel un expert
comptable, qui aidera les fondateurs dans leurs estimations budgtaires.
Le plan financier est remis au Notaire le jour de la constitution de la socit. Celui-ci vrifie
sa prsence (mais non son contenu ou son exactitude !) et le conserve dans le dossier de la
socit.
Outre son importance en matire de prvision financire, le plan engage dans certains cas la
responsabilit des fondateurs de la socit. Le code stipule en effet que les fondateurs sont
tenus solidairement "(...) des engagements de la socit dans une proportion fixe par le
juge, en cas de faillite prononce dans les trois ans de la constitution, si le capital social tait
lors de la constitution manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activit
projete pendant une priode de deux ans au moins".
Cet article est important, car il prcise le rle lgal du plan financier:
a) si la socit concerne fait faillite dans les trois ans de sa constitution, le Tribunal peut
demander au notaire de lui soumettre le plan;
b) s'il est prouv que le capital social (capital propre apport par les fondateurs) tait
insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activit projete (c'est la raison pour laquelle
un budget et une comptabilit sont ncessaire), le juge peut exiger des fondateurs qu'ils
paient une partie de faillite, voire mme le tout.
Exemple : Une socit (SPRL) avait t cre en 1980 avec un capital de 250.000 F (capital
minimum admis cette poque). Aprs examen du plan financier, le Tribunal a estim qu'un
capital de 2.000.000 F et t ncessaire. Il a condamn les fondateurs payer 1.750.000 F
(coin. Bruges, 12 mars 1981, RPS 1982, p. 43).
Les indpendants "personnes physiques" et les autres socits ne sont pas tenues
lgalement d'tablir un plan financier. Mais il parait vident que se lancer dans l'aventure
"entreprise" sans rflexion et sans plan relve de l'inconscience. Voil pourquoi toute
cration d'entreprises ncessite l'tablissement d'un business plan.
10.2.2 Contenu
L'IEC (Institut des Experts-Comptables) et l'IPC (Institut professionnel des Comptables) ont
labor des modles de plan financier. Celui de l'IPC est particulirement bien adapt une
petite entreprise. Le plan doit d'abord justifier le capital de l'entreprise.
100
Cela ncessite :
a) la description de l'activit projete (programme d'action des fondateurs);
b) l'estimation du volume d'activit raisonnablement raliste, permettant de prvoir le chiffre
d'affaires;
c) l'tablissement des prvisions de rentabilit de l'entreprise, ncessaires sa viabilit.
A partir de l s'labore la structure financire de l'entreprise, fonction de six lments
principaux:
Montant des quipements acqurir.
1. btiment, matriel, mobilier, matriel roulant;
2. rythme d'amortissement.
Constitution du stock.
1. composition du stock;
2. rotation moyenne des produits;
3. dlais et cadences de livraison.
Crdit clients (dpend du chiffre d'affaires).
Liquidits ncessaires au dpart.
Combien de ressource faut-il et comment les runir?
1. fonds propres que les associs apportent;
2. crdits long terme;
3. crdits court terme, dont fournisseurs.
10.3 Les statuts de la socit
Les statuts prcisent notamment les rgles qui rgissent le fonctionnement de la socit
ainsi que les rapports avec les tiers, les rapports entre associs eux-mmes, les pouvoirs de
ses reprsentants, etc.
La loi prvoit ainsi que les statuts doivent ainsi contenir les dispositions relatives :
La forme de la socit
La dnomination de la socit
La dure de la socit
Le sige social
L'objet social
Le capital de la socit
Les titres de la socit
La reprsentation de la socit
Les rgles de fonctionnement de la socit
La dissolution et la liquidation de la socit
101
Cette numration n'est pas exhaustive car le contenu des statuts peut varier selon la forme
de socit que les futurs associs ont dcid de constituer (la loi dtermine pour chaque
type de socit les mentions obligatoires que l'acte de constitution et les statuts devront
contenir et les rgles que la socit devra observer).
Les statuts peuvent tre modifis par l'assemble gnrale des associs des conditions de
prsence et de majorit fixes par la loi et, ventuellement, par les statuts, dans les limites
fixes par la loi.
Aprs une modification des statuts, la socit a l'obligation de procder une coordination
des statuts (ce qui revient dposer au greffe du Tribunal de commerce un document qui
reprendra l'ensemble des statuts tels qu'ils se prsentent aprs la modification).
10.4 L'attestation bancaire
Les fondateurs doivent fixer le montant du capital de la socit au moment de sa
constitution.
Ils doivent en outre librer ce capital (ou une partie de ce capital).
La loi impose d'ouvrir un compte spcial auprs d'une banque et d'y verser le montant du
capital qu'ils s'engagent librer.
L'institution financire devra par consquent remettre aux fondateurs une attestation
prcisant le montant du versement, le nom de la socit constituer ainsi que le nom des
fondateurs qui versent les fonds librer.
Cette attestation devra tre remise au notaire charg de recevoir l'acte de constitution.
Aprs l'accomplissement de toutes les formalits de constitution, le notaire remettra aux
fondateurs une autre attestation, par laquelle il certifiera que l'acte de constitution a t
sign, et dpos au tribunal de commerce.
Il y prcisera qui sont les reprsentants de la socit qui peuvent engager la socit.
10.5 Les apports
Les fondateurs ne sont pas tenus d'apporter de l'argent au moment de la constitution de la
socit : ils peuvent parfaitement apporter un bien dtermin (il s'agit alors d'un apport en
nature et non plus d'un apport en espces).
En principe, tout ce qui peut tre valu conomiquement peut tre apport une socit
(exemples : immeuble, matriel de bureau, crances, marques ou brevets, fonds de
commerce, etc.).
Les fondateurs doivent toutefois tablir un rapport dans lequel ils justifient l'intrt que peut
reprsenter ce bien pour la socit.
Ils engagent d'ailleurs leur responsabilit s'il s'avre que la valeur du bien apport est
manifestement exagre et si la stabilit de la socit est mise en pril.
102
Avant la constitution de la socit, les fondateurs doivent par consquent demander un
rviseur d'entreprises de dcrire en dtail chaque bien qui est apport en nature et d'tablir
un rapport sur le mode d'valuation du bien.
10.6 L'immatriculation la Banque Carrefour
La Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, attribue
chaque entreprise et chaque commerant un numro didentification unique. Elle contient
le numro de chaque entreprise ainsi que des donnes didentification de bases
correspondantes (nom, adresse, raison sociale,). Grce ce numro unique, les
entreprises ne devront plus effectuer plusieurs fois les mmes formalits auprs
dadministrations diffrentes. Lchange dinformation entre ces administrations se fera via la
Banque-carrefour.
Toute personne a le droit de le consulter gratuitement pour savoir par exemple si une autre
entreprise n'a pas dj la mme dnomination que celle que l'on souhaite adopter ou pour
savoir si la personne avec laquelle on souhaite collaborer n'a pas t dclare en faillite.
Toutes les socits qui souhaitent exercer une activit commerciale doivent demander une
immatriculation la Banque-carrefour. Elles doivent plus prcisment s'inscrire au greffe du
Tribunal de commerce du lieu o se trouve leur sige social.
Si la socit dispose de plusieurs siges d'exploitation, elle devra se faire immatriculer dans
tous les arrondissements o elle exercera ses activits commerciales.
Ce sont les reprsentants de la socit (grants ou administrateurs) qui doivent demander
l'immatriculation.
La demande d'immatriculation doit contenir la dnomination exacte de la socit, le sige
social, l'objet social et les activits commerciales qu'elle exercera, la date du dbut des
activits, le nom et les pouvoirs de ses reprsentants ainsi que le numro d'un compte
financier.
Si la socit modifie son objet et ses activits commerciales, elle devra galement modifier
son immatriculation la Banque-carrefour. Elle devra galement le faire si elle s'tend
gographiquement (cration de nouveaux siges d'exploitations ou d'agences dans d'autres
arrondissements).
La socit gardera son immatriculation pendant toute la dure de son existence, elle ne
pourra en demander la radiation quaprs la clture de sa liquidation.
Les frais de constitution dune socit
Un droit denregistrement de 0,5 % de la valeur des apports.
Une T.V.A. est prleve sur la valeur des actions que le fondateur reoit en change
de lapport de biens.
Un droit de timbre est peru par feuille ltablissement de lacte constitutif par le
notaire.
Linscription la Banque Carrefour par lintermdiaire des Greffes du tribunal de
commerce.
Le contrle et le rapport du rviseur pour les apports en nature doivent tre
indemniss en fonction de leur importance et de leur degr de difficult.
103
Le plan financier peut tre tabli par les fondateurs. Dans ce cas, seuls les frais de
dpt des pices auprs du notaire sont acquitter. Si ce plan est tabli en
collaboration avec un expert-comptable, celui-ci devra videmment aussi tre
indemnis.
Les honoraires du notaire sont calculs sur la base du capital souscrit.
Les frais de publication au Moniteur belge.
10.7 La dnomination de la socit
Une socit doit pouvoir tre identifie: elle porte donc un nom qui permet de l'individualiser.
Le choix du nom d'une S.P.R.L. ou d'une S.A. est libre: la socit peut reprendre le nom
d'associs, l'objet de son activit, ou tout autre nom.
Le nom de la socit sera prcd ou suivi de sa forme juridique, soit compltement (ex :
socit anonyme), soit en abrg (ex : SA).
Pour viter toute confusion, il faudra naturellement veiller lui donner un nom qui n'a pas
encore t choisi par une autre socit ou entreprise et viter galement de choisir une
dnomination qui ressemblerait trop celui d'une autre socit ou entreprise.
Si le nom a dj t choisi et si une confusion est possible, la socit ou l'entreprise qui
utilisait dj le nom pourraient en effet exiger une modification de la dnomination de la
nouvelle socit et celle-ci devra immdiatement modifier ses statuts afin de satisfaire
cette demande (le premier utilisateur du nom pourrait mme rclamer des dommages-
intrts la nouvelle socit ...).
Les fondateurs doivent donc se renseigner sur l'existence ventuelle d'une autre entreprise
qui porterait le mme nom.
10.8 Le sige de la socit
Le sige de la socit peut se dfinir comme le lieu de son principal tablissement.
En principe, le sige de la socit ne peut tre une simple boite aux lettres: il doit en effet
tre tabli l'endroit de sa direction administrative.
Une socit n'a qu'un seul sige social mais elle peut avoir plusieurs siges d'exploitation
et/ou plusieurs agences.
Le sige social peut naturellement faire l'objet d'un transfert qui devra tre publi au
Moniteur belge.
10.9 L'objet de la socit
L'objet d'une socit dsigne en fait l'activit que les associs souhaitent exercer ensemble.
La loi impose aux fondateurs de reprendre la dsignation prcise de l'objet social.
Il suffit en fait de dterminer quelle est l'activit commerciale ou industrielle ou l'activit civile
que la socit va exercer.
104
Les socits ne peuvent exercer une activit qui n'entre pas dans leur objet social mais elles
peuvent tendre ou modifier leur objet (ce qui suppose une modification de ses statuts).
10.10 Le capital
Le capital d'une socit reprsente l'ensemble des apports que les associs mettent la
disposition de cette socit.
Les sommes ou les valeurs que les associs s'engagent remettre la socit forment le
capital souscrit tandis que celles que les associs ont remises la socit reprsente le
capital libr.
Le capital reprsente donc ce que les fondateurs ont dcid de mettre en commun afin de
permettre la socit de fonctionner et de remplir les objectifs fixs lors de sa constitution.
Les fondateurs reoivent en contrepartie des parts ou actions de la socit dont le nombre
est calcul en fonction de ce qu'ils ont apport.
Il ne faut pas confondre le capital avec l'actif de la socit : le capital est d'ailleurs repris au
passif de la socit dans la comptabilit puisqu'il reprsente ce que les associs ont apport
et ce qu'ils pourront ds lors rcuprer lors de la liquidation de la socit.
Une socit ne peut fonctionner que si elle dispose d'un minimum de moyens.
La loi a par consquent fix un montant minimum pour le capital des socits.
Il est actuellement fix :
S.A. et S.C.A : un minimum de 61.500 intgralement souscrit et un capital libr de 1/4
avec un minimum de 61.500 EUR
S.P.R.L. : un minimum de 18.550 . Capital libr : 1/5 me avec un minimum de 6.200
(12.400 pour la SPRLU).
S.C.R.L. : un minimum de 18.550 . Capital libr :1/4 avec un minimum de 6.200 .
10.11 La souscription du capital
Lors de la constitution de la socit, les statuts prcisent quel est le montant du capital de
cette socit.
Ce montant doit tre fix en fonction des besoins de la socit et des minima imposs par la
loi pour chaque type de socit.
Chacun des fondateurs de la socit s'engagent apporter celle-ci le capital ainsi
mentionn dans les statuts : ils souscrivent ainsi au capital et ils obtiennent en contrepartie
de leur apport des actions ou des parts de la socit.
105
Le capital de la socit doit bien sr tre intgralement souscrit la constitution de la socit
: le montant du capital dtermin dans les statuts de la socit doit en effet correspondre la
somme des engagements des fondateurs.
10.12 La libration du capital
La libration du capital peut se dfinir comme l'excution des engagements pris par les
souscripteurs : il s'agit donc du paiement effectif des apports en espces ou de la remise
effective des apports en nature.
Lorsque les parts de la socit ont t souscrites en espces, elles sont libres par un
versement en espces.
Ces fonds doivent tre dposs sur un compte spcial ouvert auprs d'une institution
financire qui fournira cette occasion une attestation bancaire
Lorsque les parts de la socit ont t souscrites en nature, l'apport est mis la disposition
de la socit qui en devient la propritaire.
La libration du capital peut tre totale ou partielle mais les minima prvus par la loi doivent
tre respects..
En cas de libration partielle du capital, les souscripteurs doivent verser le solde au moment
fix par les statuts ou par l'assemble gnrale.
A dfaut, c'est le grant ou le conseil d'administration qui pourra fixer le moment de ce
versement.
10.13 Le fonctionnement
Une socit fonctionne par l'intermdiaire de ses organes :
1) l'assemble gnrale
2) les administrateurs et les grants
3) les commissaires
10.13.1 L'assemble gnrale
L'assemble gnrale regroupe l'ensemble des associs ou des actionnaires des socits.
Elle a les pouvoirs les plus tendus pour tous les actes qui intressent la socit.
La loi prcise que toutes les socits (mme les S.P.R.L.U. qui ne comprennent qu'un seul
associ) doivent tenir au moins une assemble gnrale par an : c'est l'assemble gnrale
ordinaire.
106
Lorsque l'intrt de la socit le commande, les grants ou les administrateurs de la socit
(ou les associs ou les actionnaires si les conditions prvues par la loi sont remplies)
peuvent convoquer l'assemble gnrale : c'est l'assemble gnrale extraordinaire.
10.13.2 La convocation l'assemble gnrale
Il faut naturellement avertir les associs ou les actionnaires de la tenue de l'assemble
gnrale et les inviter y participer pour faire valoir leur point de vue, ce qui suppose une
convocation par les reprsentants de la socit (le grant ou le conseil d'administration) ou
aux commissaires-rviseurs.
Ils peuvent la convoquer ds qu'ils l'estiment ncessaire mais ils doivent la convoquer si les
actionnaires reprsentant au moins 20 % du capital social leur demandent de le faire.
L'assemble gnrale doit tre convoque en respectant une procdure qui varie selon la
nature des titres :
Si tous les titres sont nominatifs, les convocations peuvent tre adresses au moins 8
jours avant la tenue de l'assemble, par lettre recommande la poste.
S'il existe des titres au porteur, il n'y a forcment pas moyen de contacter tous leurs
titulaires : il faudra alors les convoquer par voie de publication dans la presse (si
certaines actions sont nominatives, les convocations seront galement envoyes par
lettre ordinaire aux actionnaires concerns).
Les convocations l'assemble gnrale doivent contenir les mentions suivantes :
L'identification de la socit
La date et le lieu de l'assemble gnrale
La dtermination de l'ordre du jour
les autres renseignements ncessaires ou utiles
10.13.3 La tenue de l'assemble gnrale
L'assemble gnrale fonctionne de la manire suivante:
1) Une liste de prsence est tablie (ce qui permettra de vrifier si le nombre minimum
requis par la loi pour pouvoir se constituer valablement est atteint).
2) L'assemble lit un bureau comprenant gnralement un prsident, un secrtaire et deux
scrutateurs (il s'agit surtout de vrifier le respect de toutes les formalits et de rgler les
problmes susceptibles de surgir au cours de l'assemble).
107
3) Le prsident expose l'ordre du jour (il s'agit du relev des sujets qui seront abords lors
de l'assemble)
4) L'assemble vrifie si le nombre minimum de prsence est atteint et si elle est
valablement constitue
5) Elle dlibre sur les points figurant l'ordre du jour en respectant l'ordre tabli.
6) Elle passe au vote pour accepter ou refuser les propositions formules : les dlibrations
ne sont adoptes que si elles sont acceptes par une majorit dtermine
7) Tout ce qui a t dit ou dcid lors de l'assemble gnrale est consign dans un procs-
verbal
10.13.4 Les pouvoirs de l'assemble gnrale
De manire gnrale, l'assemble dispose des pouvoirs les plus tendus pour faire ou
ratifier les actes de la socit. Ainsi, certains actes doivent ncessairement tre soumis
l'assemble gnrale des associs ou des actionnaires :
l'approbation des comptes annuels
les modifications des statuts
les nominations, rvocations et remplacements des administrateurs et des grants
10.13.5 Les administrateurs et les grants
Il va de soi que l'on ne peut charger l'assemble gnrale de la ralisation de tous les actes
ncessaires l'exercice de l'activit de la socit.
Celle-ci doit en pratique agir par l'intermdiaire de reprsentants pour de nombreux actes
(signature de contrats, rapports avec les clients et les fournisseurs, reprsentation en justice
...).
Les socits sont ainsi administres par un ou plusieurs grants (ex : la S.P.R.L.) ou par un
ou plusieurs administrateurs (ex : la S.A.).
Lorsque la socit est gre par plusieurs administrateurs, ceux-ci se runissent au sein
d'un conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut dlguer une partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la
gestion journalire :
l'un de ses membres (l'administrateur-dlgu) ou
un tiers (le directeur gnral).
108
10.13.6 La nomination des grants et des administrateurs
C'est l'assemble gnrale qui nomme, remplace et rvoque les grants et les
administrateurs.
Le mandat peut tre gratuit ou rmunr.
10.13.7 Les pouvoirs des grants et des administrateurs
Les grants et les administrateurs sont censs accomplir tous les actes ncessaires ou utiles
la ralisation de l'objet social, l'exception de ceux qui sont rservs par la loi
l'assemble gnrale.
Ils ont galement pour mission de reprsenter la socit en justice.
10.13.8 Les commissaires
Le commissaire a pour mission de contrler la situation financire, les comptes annuels et la
rgularit des oprations constater dans les comptes selon les lois sur les socits
commerciales et les statuts.
Il est obligatoirement choisi parmi les membres de l'Institut des Rviseurs d'Entreprises.
Le commissaire est nomm par l'assemble gnrale pour une dure de 3 ans.
Dans les S.A., les S.C.A., les S.P.R.L. et les S.C., un commissaire doit ncessairement tre
dsign lorsque la socit dpasse l'un des seuils suivants :
chiffre d'affaires annuel de 7.300.000 E
bilan de 3.650.000 E
50 personnes occupes en moyenne
109
CHAPITRE 11 : LES DIFFERENTS TYPES DE SOCIETES
11.1 La socit anonyme
La S.A. est une forme de socit qui est principalement axe sur lapport de capital par les
associs. Cest pourquoi on lappelle aussi socit de capitaux .
Les actions dune S.A. sont gnralement au porteur et, partant, cessibles sans limitation,
sous rserve dune disposition statutaire expresse qui limiterait la cessibilit des actions.
La socit anonyme est celle que contractent plusieurs personnes qui s'engagent verser
une mise dtermine et qui ne sont tenues des dettes de la socit que dans la mesure de
leurs apports.
La responsabilit des associs est donc limite au montant de leur mise.
11.1.1 La constitution de la S.A
Les conditions de fond sont les suivantes :
1) un capital minimum de 61.500 E
2) la souscription intgrale du capital
3) la libration intgrale du capital minimum
4) la libration du quart de chaque action (ainsi les associs dune socit constitue au
capital de 300.000 doivent librer au minimum 75.000 )
5) un minimum de 2 actionnaires
6) les actions correspondant en tout ou en partie des apports en nature doivent tre
entirement libres dans un dlai de cinq ans dater de la constitution de la socit.
Les conditions de forme sont les suivantes :
1) un acte notari
2) le respect de la lgislation sur l'emploi des langues
3) l'acte constitutif doit contenir les mentions requises par la loi :
la forme et la dnomination de la socit
la dtermination de l'objet social
la dsignation du sige social
la dure de la socit
le montant du capital social et de la partie libre
110
le montant du capital autoris
les rgles d'administration et de contrle de la socit
le nombre, les conditions de cessibilit et les droits des actions reprsentatives du
capital
le nombre, les conditions de cessibilit et les droits des parts bnficiaires
la forme des actions
la spcification et la rmunration des apports en nature
l'identit des fondateurs
la cause et la consistance des avantages particuliers attribus aux fondateurs
les frais de constitution
le nom de l'organisme dpositaire des apports librer en numraire
les mutations titre onreux relatives aux immeubles apports
les charges grevant les biens apports
les conditions de ralisation des options apportes la socit
11.1.2 Le fonctionnement de la S.A.
A - L'assemble gnrale
L'assemble gnrale regroupe l'ensemble des associs ou des actionnaires des socits.
Elle a les pouvoirs les plus tendus pour tous les actes qui intressent la socit.
La loi prcise que la S.A. doit tenir au moins une assemble gnrale par an : c'est
l'assemble gnrale ordinaire.
Lorsque l'intrt de la socit le commande, les administrateurs de la socit (ou les
actionnaires si les conditions prvues par la loi sont remplies) peuvent convoquer
l'assemble gnrale : c'est l'assemble gnrale extraordinaire.
Il faut naturellement avertir les associs ou les actionnaires de la tenue de l'assemble
gnrale et les inviter y participer pour faire valoir leur point de vue, ce qui suppose une
convocation par le conseil d'administration.
Les administrateurs peuvent la convoquer ds qu'ils l'estiment ncessaire mais ils ont
l'obligation de le faire si les actionnaires reprsentant au moins 20 % du capital social leur
demandent de le faire.
L'assemble gnrale doit tre convoque en respectant une procdure qui varie selon la
nature des titres :
111
Si tous les titres sont nominatifs, les convocations peuvent tre adresses au moins 8
jours avant la tenue de l'assemble, par lettre recommande la poste.
S'il existe des titres au porteur, il n'y a forcment pas moyen de contacter tous leurs
titulaires : il faudra alors les convoquer par voie de publication dans la presse (si
certaines actions sont nominatives, les convocations seront galement envoyes par
lettre ordinaire aux actionnaires concerns).
Les convocations l'assemble gnrale doivent contenir les mentions suivantes :
L'identification de la socit
La date et le lieu de l'assemble gnrale
La dtermination de l'ordre du jour
les autres renseignements ncessaires ou utiles
L'assemble gnrale fonctionne de la manire suivante:
1) Une liste de prsence est tablie (ce qui permettra de vrifier si le nombre minimum
requis par la loi pour pouvoir se constituer valablement est atteint).
2) L'assemble lit un bureau comprenant gnralement un prsident, un secrtaire et deux
scrutateurs (il s'agit surtout de vrifier le respect de toutes les formalits et de rgler les
problmes susceptibles de surgir au cours de l'assemble).
3) Le prsident expose l'ordre du jour (il s'agit du relev des sujets qui seront abords lors
de l'assemble)
4) L'assemble vrifie si le nombre minimum de prsence est atteint et si elle est
valablement constitue
5) Elle dlibre sur les points figurant l'ordre du jour en respectant l'ordre tabli.
6) Elle passe au vote pour accepter ou refuser les propositions formules : les dlibrations
ne sont adoptes que si elles sont acceptes par une majorit dtermine
7) Tout ce qui a t dit ou dcid lors de l'assemble gnrale est consign dans un procs-
verbal
De manire gnrale, l'assemble dispose des pouvoirs les plus tendus pour faire ou
ratifier les actes de la socit.
Ainsi, certains actes doivent ncessairement tre soumis l'assemble gnrale des
associs ou des actionnaires :
l'approbation des comptes annuels
112
les modifications des statuts
les nominations, rvocations et remplacements des administrateurs et des grants ...
B - Le conseil d'administration
La socit anonyme est reprsente par un conseil d'administration nomm lors de la
constitution de la socit ou au cours d'une assemble gnrale. Il doit comprendre au
moins 3 membres (il n'y a pas de maximum).
Le nombre d'administrateurs peut toutefois tre exceptionnellement limit 2 lorsque la
socit ne comprend que 2 actionnaires.
Si le nombre d'administrateurs passe sous ce minimum, les autres administrateurs doivent
convoquer le plus tt possible une nouvelle assemble gnrale pour le remplacer.
En rgle gnrale, les administrateurs choisissent un prsident qui reoit le plus souvent les
missions suivantes :
prsider l'assemble gnrale des actionnaires
convoquer le conseil d'administration lorsque l'intrt de la socit l'exige
signer les procs-verbaux des dcisions du conseil
On lui reconnat traditionnellement une voix prpondrante en cas d'galit des voix au
cours d'une dlibration du conseil.
Le conseil d'administration doit runir la majorit des administrateurs pour pouvoir dlibrer
valablement. Il peut se runir priodiquement (aux dates prvues l'avance) ou sur
convocation.
Il doit en tous les cas de runir ds que l'un des administrateurs le souhaite.
Si un administrateur ne peut pas tre personnellement prsent au moment de la runion, il
peut se faire reprsenter par procuration (mais le mandataire doit lui aussi tre
administrateur de la socit).
Les dcisions du conseil d'administration sont prises la majorit des voix, sauf si les statuts
prvoient expressment une majorit plus large.
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs ncessaires pour grer et
reprsenter la socit : il peut en effet accomplir tous les actes de gestion l'exception de
ceux que la loi rserve l'assemble gnrale.
Il reprsente en outre la socit pour tous les actes et en justice.
Il est noter que le conseil d'administration de la S.A. peut parfaitement dlguer une partie
de ses pouvoirs un administrateur-dlgu (si le dlgu est lui-mme administrateur) ou
un directeur gnral (si le dlgu est un tiers).
113
Les administrateurs sont responsables l'gard de la socit de tous les actes qu'ils
accomplissent en excution du leur mandat et de toutes les fautes qu'ils peuvent commettre.
C'est toutefois la socit qui devra assumer toutes les consquences de ces fautes puisqu'ils
agissent comme organes de celle-ci.
Si l'assemble gnrale dsire sanctionner un administrateur, elle peut le rvoquer et, le cas
chant, procder son remplacement.
En cas de faillite de la socit, le curateur peut poursuivre personnellement les
administrateurs en cas de faute grave et caractrise.
C - Les commissaires
Le commissaire a pour mission de contrler la situation financire, les comptes annuels et la
rgularit des oprations, constater dans les comptes selon les lois sur les socits
commerciales et les statuts.
Il est obligatoirement choisi parmi les membres de l'Institut des Rviseurs d'Entreprises.
Le commissaire est nomm par l'assemble gnrale pour une dure de 3 ans.
Un commissaire doit ncessairement tre dsign lorsque la socit dpasse l'un des seuils
suivants :
chiffre d'affaires annuel de 7.300.000 E
bilan de 3.650.000 E
50 personnes occupes en moyenne
11.2 La socit en nom collectif
La socit en nom collectif est une vritable socit de personnes, que contractent des
associs responsables et solidaires et qui a pour objet social dexercer une activit civile ou
commerciale sous une dnomination sociale. Il sagit dune pure socit de personnes, ce
qui signifie :
que la socit est dissoute par la mort dun associ ;
que les associs ne peuvent vendre ou offrir leur part sans laccord des autres
associs ;
que toute dcision doit tre prise lunanimit
Les associs sont solidaires pour tous les engagements de la socit, encore quun seul des
associs ait sign, pourvu que ce soit sous la dnomination sociale. La faillite de la SNC
entrane la faillite des associs. Seuls les noms des associs peuvent figurer dans la raison
sociale.
Les associs peuvent choisir librement la dnomination sociale et peuvent engager des
poursuites au cas o une autre socit porterait le mme nom ou un nom prtant
confusion. Le sige social de la socit doit tre prcis dans lacte de constitution.
114
La constitution rgulire dune SNC sopre par la rdaction dun acte sous seing priv, qui
est enregistr. Tous les documents commerciaux manant de cette socit doivent
mentionner quil sagit dune SNC. Dans ce cas, la SNC est fiscalement soumise limpt
des socits. Dans lhypothse contraire -une SNC peut toujours exister sans
reconnaissance crite - il ny a pas en matire dimpts, dexistence dune socit et les
bnfices seront ds lors imposs au titre des personnes physiques.
Ce type de socit est particulirement intressant comme forme de coopration entre
professions librales qui, dontologiquement, ne peuvent jamais bnficier de la
responsabilit limite.
Avantages :
la constitution de la socit ne ncessite gnralement pas dacte notari ;
les actions ntant pas transmissibles unilatralement, le caractre ferm de la
socit est garanti au maximum ;
en raison de la responsabilit personnelle des associs, la loi se dsintresse de la
consistance du capital, pour lequel aucun minimum nest requis;
lapport des associs peut consister en du travail.
Inconvnients :
la responsabilit solidaire des associs ;
les documents commerciaux doivent faire mention quil sagit dune SNC ;
la faillite de la socit entrane la faillite des associs.
Exemple : agence de banque
11.2.1 L'administration de la socit
Si le grant est dsign dans les statuts de la socit, il ne peut tre rvoqu sauf stipulation
contraire ou cause lgitime.
S'il n'est pas dsign dans les statuts, il ne peut tre nomm, remplac et rvoqu qu'
l'unanimit (sauf si le pacte social prvoit la majorit).
S'il n'y a aucun grant, les associs sont censs s'tre donn rciproquement le pouvoir de
grer la socit.
Le grant dispose d'un pouvoir de gestion exclusive : les associs ne peuvent intervenir
dans le cadre de cette gestion.
11.2.2 La dissolution de la socit
La socit finit de plein droit :
l'expiration du terme prvu
par l'extinction de la chose ou la consommation de la ngociation
115
par l'interdiction, la dconfiture ou le dcs de l'un des associs
par la volont de l'un des associs si le contrat de socit a t conclu pour une dure
indtermine.
11.3 La socit en commandite simple
Nous n'examinerons ici que les particularits de cette forme de socit : les principes
gnraux du droit des socits lui sont applicables.
La socit en commandite simple comprend deux groupes d'associs :
1) les commandits (associs) : ils s'occupent de la gestion et sont indfiniment et
solidairement responsables de toutes les dettes de la socit. Le grant doit tre un
commandit.
2) les commanditaires (associs) : ils ne sont pas responsables au-del de leurs apports
(cet apport est appel la commandite ) et ne peuvent pas intervenir dans la gestion. S'ils
s'impliquent quand mme dans la gestion, leur responsabilit devient gale celle des
commandits.
La loi ne fixe pas de capital minima.
Les parts des commanditaires sont personnelles et incessibles (ce qui n'est pas le cas dans
les S.C.A.).
11.3.1 L'administration de la socit
Le grant ne peut en aucun cas tre un commanditaire.
Pour le reste, les rgles sont les mmes que pour la socit en nom collectif :
Si le grant est dsign dans les statuts de la socit, il ne peut tre rvoqu sauf stipulation
contraire ou cause lgitime.
S'il n'est pas dsign dans les statuts, il ne peut tre nomm, remplac et rvoqu qu'
l'unanimit (sauf si le pacte social prvoit la majorit).
S'il n'y a aucun grant, les associs sont censs s'tre donn rciproquement le pouvoir de
grer la socit.
Le grant dispose d'un pouvoir de gestion exclusive : les associs ne peuvent intervenir
dans le cadre de cette gestion.
Pour le reste, la S.C.S. est soumise aux principes gnraux du droit des socits.
11.4 La socit en commandite par actions
La SCA est celle que contractent un ou plusieurs associs responsables et solidaires, que
lon nomme commandits, avec un ou plusieurs associs qui nengagent quune mise
dtermine, que lon nomme commanditaires. Les commanditaires reoivent en change de
leurs apports des actions au porteur. Dans la pratique, les associs commandits sont
toujours dirigeants de la socit.
116
La socit en commandite simple comprend deux groupes d'associs :
1) les commandits : ils sont indfiniment et solidairement responsables de toutes les dettes
de la socit. Les dirigeants de la socit doivent faire partie de cette catgorie.
2) les commanditaires (bailleurs de fonds actionnaires) : ils ne sont pas responsables au-
del de leurs apports.
La SCA se compose dau moins deux actionnaires dont lun doit tre au moins
commandit et lautre commanditaire ;
Les grants doivent tre mentionns dans lacte constitutif ; ils sont toujours
responsables en tant que fondateurs de la socit ;
La responsabilit des commanditaires se limitent leurs apports ; celle des
commandits porte titre principal sur les dettes de la socit ;
Le dirigeant ou le grant peut tre une personne physique ;
Les grants sont toujours des associs lis titre principal ;
En cas de changement de statut, laccord des grants est toujours exig (droit de
veto);
Le dirigeant dune SCA dispose galement dun droit de veto lencontre de toutes
oprations relatives aux intrts de la socit par rapport aux tiers (cest--dire toutes
les oprations qui peuvent rduire le nantissement de la socit lgard des tiers,
par exemple la distribution des dividendes) ;
La SCA se termine par suite du dcs du grant, moins quil en soit mentionn
autrement dans les statuts. La plupart du temps un successeur est dsign
statutairement ;
La SCA peut mettre des actions au porteur ;
Les actions sont ngociables librement.
Au 1er janvier 2002, le capital minimum dune SCA a t fix 61.500 .
Les avantages de la SCA sont la responsabilit des commanditaires leur apport personnel
et les actions qui peuvent tre au porteur, donc cessibles. Cette forme de socit est
indique pour la succession.
Inconvnients :
responsabilit illimite des commandits pour toutes les dettes
rdaction dun acte notari
obligations comptables en matire de publication
comptabilit en partie double.
11.4.1 L'administration de la socit
La grance appartient aux associs dsigns dans les statuts de la socit.
117
Le nombre de grants n'est pas prcis par la loi.
Le(s) grant(s) exerce(nt) les pouvoirs qui lui sont reconnus par les statuts ou, en cas de
silence, par les dispositions relatives aux S.A.
L'assemble gnrale ne peut quant elle agir sans le concours et le consentement des
grants qui supportent toute la responsabilit de l'entreprise.
On applique donc aux actionnaires les rgles des S.A. (sous quelques rserves) tandis que
l'on se rapporte aux rgles de la S.N.C. pour les commandits.
Pour le reste, la S.C.A. est soumise aux principes gnraux du droit des socits.
11.5 La socit prive responsabilit limite
Nous n'examinerons ici que les particularits de cette forme de socit : les principes
gnraux du droit des socits lui sont applicables.
La socit prive responsabilit limite est constitue par une ou plusieurs personnes qui
n'engagent que leurs apports et o les droits sociaux ne sont transmissibles que sous
certaines conditions.
Sauf dispositions contraires des statuts, les socits prives responsabilit limite sont
constitues pour une dure illimite.
Si une dure est fixe, l'assemble gnrale peut dcider, dans les formes prescrites pour la
modification des statuts, la prorogation pour une dure limite ou illimite.
La dissolution de la socit dure limite ou illimite peut tre demande en justice pour
de justes motifs. En dehors de ce cas, la dissolution de la socit ne peut rsulter que d'une
dcision prise par l'assemble gnrale dans les formes prescrites pour la modification des
statuts.
En cas de dcs de l'associ unique et dfaut de tout successible, la succession sera
acquise l'Etat et la socit sera dissoute de plein droit.
11.5.1 La constitution de la S.P.R.L.
Les conditions de fond sont les suivantes :
1) un capital minimum de 18.550 intgralement souscrit
2) la souscription intgrale du capital
3) la libration d'un montant minimum de 6.200
4) la libration du cinquime de chaque action avec un minimum de 6.200 (12.400
pour la SPRLU).
5) les parts sociales ou parties de parts sociales correspondant des apports en nature
doivent tre entirement libres
6) au moins deux associs, sauf sil sagit dune SPRLU
118
7) Acte de constitution authentique
Responsabilits :
Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intresss, malgr toute stipulation
contraire :
1 de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la
diffrence ventuelle entre le capital minimum requis et le montant des souscriptions;
2 de la libration effective du capital et des parts, ainsi que de la partie du capital dont ils
sont rputs souscripteurs
4 de la rparation du prjudice qui est une suite immdiate soit de la nullit de la socit, ,
soit de la survaluation manifeste des apports en nature
5 des engagements de la socit dans une proportion fixe par le juge, en cas de faillite,
prononce dans les trois ans de la constitution si le capital social tait, lors de la constitution,
manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activit projete pendant une
priode de deux ans au moins.
Dans une sprl, les parts sont toujours nominatives et cessibles seulement dans certaines
limites.
La SPRLU est une SPRL qui prsente quelques caractristiques propres :
elle peut tre constitue par une personne physique unique;
la responsabilit limite ne vaut que pour la premire SPRLU fonde sauf sil hrite
dune autre SPRLU;
lorsque le grant qui est la fois associ unique a un intrt oppos celui de la
socit dans une opration, il doit tablir un rapport motiv qui sera dpos en mme
temps que les comptes annuels;
lassoci doit tenir un registre des dcisions prises en tant qu assemble
gnrale ;
en cas de dcs de lassoci, les hritiers, lgataires ou usufruitiers exercent les
droits affrents aux parts sociales recueillies.
Dans une S.P.R.L.U., le seul associ-fondateur a toutes les parts en proprit. En tant
quassoci unique, il dcide de faon entirement libre de la cession des parts.
11.5.2 Le fonctionnement de la S.P.R.L.
A - L'assemble gnrale
L'assemble gnrale regroupe l'ensemble des associs ou des actionnaires des socits.
Elle a les pouvoirs les plus tendus pour tous les actes qui intressent la socit.
119
La loi prcise que la S.P.R.L. doit tenir au moins 1 assemble gnrale par an : c'est
l'assemble gnrale ordinaire.
Lorsque l'intrt de la socit le commande, le grant de la socit (ou les actionnaires si les
conditions prvues par la loi sont remplies) peut convoquer l'assemble gnrale : c'est
l'assemble gnrale extraordinaire.
Il faut naturellement avertir les associs ou les actionnaires de la tenue de l'assemble
gnrale et les inviter y participer pour faire valoir leur point de vue, ce qui suppose une
convocation par le grant.
Le grant peut la convoquer ds qu'il l'estime ncessaire mais il a l'obligation de le faire si
les actionnaires reprsentant au moins 20 % du capital social lui demandent de le faire.
Les convocations peuvent tre adresses au moins 8 jours avant la tenue de l'assemble,
par lettre recommande la poste.
B - L'identification de la socit
La date et le lieu de l'assemble gnrale
La dtermination de l'ordre du jour
les autres renseignements ncessaires ou utiles
L'assemble gnrale fonctionne de la manire suivante:
1) Une liste de prsence est tablie (ce qui permettra de vrifier si le nombre minimum
requis par la loi pour pouvoir se constituer valablement est atteint).
2) L'assemble lit un bureau comprenant gnralement un prsident, un secrtaire et deux
scrutateurs (il s'agit surtout de vrifier le respect de toutes les formalits et de rgler les
problmes susceptibles de surgir au cours de l'assemble).
3) Le prsident expose l'ordre du jour (il s'agit du relev des sujets qui seront abords lors
de l'assemble)
4) L'assemble vrifie si le nombre minimum de prsence est atteint et si elle est
valablement constitue
5) Elle dlibre sur les points figurant l'ordre du jour en respectant l'ordre tabli.
6) Elle passe au vote pour accepter ou refuser les propositions formules : les dlibrations
ne sont adoptes que si elles sont acceptes par une majorit dtermine
7) Tout ce qui a t dit ou dcid lors de l'assemble gnrale est consign dans un procs-
verbal
De manire gnrale, l'assemble dispose des pouvoirs les plus tendus pour faire ou
ratifier les actes de la socit.
120
Ainsi, certains actes doivent ncessairement tre soumis l'assemble gnrale des
associs ou des actionnaires :
l'approbation des comptes annuels
les modifications des statuts
les nominations, rvocations et remplacements des administrateurs et des grants ...
C - La grance
La socit prive responsabilit limite est reprsente par un ou plusieurs grants
nomm(s) lors de la constitution de la socit ou l'occasion d'une assemble gnrale.
Chaque grant peut accomplir tous les actes ncessaires ou utiles la ralisation de l'objet
social l'exception de ceux que la loi rserve l'assemble gnrale. Il reprsente la socit
pour tous les actes et en justice
Les statuts peuvent limiter les pouvoirs de gestion des grants en rservant l'assemble
gnrale le pouvoir de prendre certaines dcisions.
Ces limitations ne sont pas opposables aux tiers mais le grant qui ne les respecte pas
engage sa responsabilit vis--vis de la socit.
D - Les commissaires
Le commissaire a pour mission de contrler la situation financire, les comptes annuels et la
rgularit des oprations constater dans les comptes selon les lois sur les socits
commerciales et les statuts.
Il est obligatoirement choisi parmi les membres de l'Institut des Rviseurs d'Entreprises et
est nomm par l'assemble gnrale pour une dure de 3 ans.
Un commissaire doit ncessairement tre dsign lorsque la socit dpasse l'un des seuils
suivants :
chiffre d'affaires annuel de 7.300.000 E
bilan de 3.650.000 E
50 personnes occupes en moyenne
11.6 La socit cooprative
Il existe deux types de socits coopratives :
responsabilit limite (S.C.R.L.)
responsabilit illimite (S.C.R.I.).
La socit cooprative se compose d'associs dont les apports sont variables et dont les
parts ne peuvent tre cdes un tiers.
121
Cette forme de socit prsente deux caractristiques essentielles :
1) la variabilit des associs et des apports : la cooprative est une socit "ouverte"
2) la cessibilit strictement limite des droits sociaux : les parts ne peuvent tre cdes
ou transmises qu'aux personnes nominalement dsignes dans les statuts ou faisant
partie de l'une des catgories que ceux-ci dterminent et qui remplissent les conditions
requises par la loi ou les statuts pour devenir associs.
Les statuts doivent prciser si la responsabilit des associs de la socit cooprative est
limite ou illimite.
Lorsque la socit cooprative a opt pour la responsabilit illimite, les associs rpondent
personnellement et solidairement des dettes sociales et elle porte le nom de socit
cooprative responsabilit illimite; lorsqu'elle a opt pour la responsabilit limite, les
associs ne sont passibles des dettes sociales que jusqu' concurrence de leurs apports et
elle porte le nom de socit cooprative responsabilit limite.
Les parts dune socit cooprative ne peuvent tre cdes des tiers que :
lorsque ces tiers sont nominativement dsigns dans les statuts
ou lorsquils entrent dans les catgories dtermines par les statuts
et lorsquils remplissent les conditions lgales ou statutaires requises pour tre
associs.
Lagrment de linstance comptente est requis pour pouvoir statuer valablement.
En cas de runion de toutes les actions en une main lintrieur dune socit cooprative,
celle-ci est dissoute de plein droit.
11.6.1 La constitution de la S.C.
Les conditions de fond sont les suivantes :
1) un capital minimum de 18.500 (plan financier)
2) la souscription intgrale du capital
3) la libration d'un montant minimum de 6.200 E
4) la libration du quart de chaque part
5) 3 associs minimum
L'acte constitutif peut tre sous seing priv (un acte notari n'est donc pas ncessaire), sauf
s'il s'agit d'une S.C.R.L. ou si l'un des associs apporte un immeuble.
122
11.6.2 Le fonctionnement de la S.C.
A - Les associs
Ce sont les statuts qui fixent les rgles relatives l'admission, la dmission et l'exclusion
des associs.
Les statuts dsignent galement l'organe habilit trancher ces questions : l'assemble
gnrale, le conseil d'administration ou un autre organe.
A dfaut de dispositions statutaires, la dcision appartient l'assemble gnrale, sans
recours possible.
L'admission est constate par l'apposition de la signature de l'associ sur le registre spcial
que doit tenir toute S.C. : c'est en effet par l'inscription sur ce registre que l'on devient
membre d'une cooprative.
Ce livre doit tre vis, cot et paraph. Il doit mentionner sur la premire page l'acte
constitutif de la socit.
La dmission est possible dans les 6 premiers mois de l'anne sociale (elle est constate par
une mention dans le registre des associs).
Cette dmission entrane la possibilit de procder un retrait de parts.
L'exclusion ne peut quant elle tre dcide que pour de justes motifs ou pour toute autre
cause indique dans les statuts.
Elle est normalement prononce par l'assemble gnrale, sauf si les statuts en disposent
autrement.
L'associ dont l'exclusion est demande doit tre invit faire connatre ses observations
par crit (mais il peut demander tre entendu).
Toute dcision d'exclusion doit tre motive et un procs-verbal de cette dcision doit tre
dress.
Une copie de ladite dcision doit par ailleurs tre adresse par recommand l'associ dans
les 15 jours.
Enfin, l'exclusion doit faire l'objet d'une mention dans le registre de la socit.
On devient membre de la cooprative par l'inscription dans le registre. La preuve des droits
de l'associ est constitue par un titre nominatif.
Les parts sont cessibles des associs dans les conditions prvues par les statuts.
Elles ne peuvent tre cdes ou transmises des tiers, si ce n'est ceux qui sont
nominalement dsigns dans les statuts ou ceux qui font partie de l'une des catgories
dfinies par ces statuts et qui remplissent les conditions lgales ou statutaires (l'agrment de
l'organe comptent pour statuer sur l'admission des associs est requis en pareil cas).
123
Les parts d'une S.C. responsabilit illimite et solidaire reprsentant les apports effectifs ne
consistant pas en numraire ne peuvent tre cdes que 10 jours aprs le dpt des
deuximes comptes annuels qui suivent sa cration.
B - L'assemble gnrale
La plus grande libert est laisse aux fondateurs en ce qui concerne l'organisation des
pouvoirs et le fonctionnement de l'assemble.
La loi prcise en effet que l'acte constitutif indique les droits des associs, le mode de
convocation, la majorit requise pour la validit des dlibrations et le mode de vote.
A dfaut de dispositions statutaires sur ces points, tous les associs peuvent voter, chaque
part donnant droit une voix.
Les convocations se font au moins 15 jours l'avance par lettre recommande signe par le
grant ou les administrateurs.
Pour le reste, ce sont les rgles de la S.A. qui sont applicables.
C - L'administration
C'est nouveau la plus grande latitude qui est laisse aux fondateurs sur ce point.
Il leur est en effet loisible de confier l'administration de la cooprative un grant ou un ou
plusieurs administrateurs.
En cas de silence sur la question dans les statuts, la socit est gre par un administrateur
dsign par l'assemble gnrale.
Les pouvoirs du grant ou des administrateurs sont normalement dtermins par les statuts.
Si ceux-ci sont muets, l'administrateur est investi de l'ensemble des pouvoirs de gestion : il
pourra donc accomplir tous les actes ncessaires ou utiles la ralisation de l'objet social.
Il va par ailleurs de soi que la socit est reprsente par le grant ou les administrateurs
pour tous ses actes et en justice.
D - Les commissaires
Le commissaire a pour mission de contrler la situation financire, les comptes annuels et la
rgularit des oprations constater dans les comptes selon les lois sur les socits
commerciales et les statuts.
Il est obligatoirement choisi parmi les membres de l'Institut des Rviseurs d'Entreprises.
Le commissaire est nomm par l'assemble gnrale pour une dure de 3 ans.
Un commissaire doit ncessairement tre dsign lorsque la socit dpasse l'un des seuils
suivants :
124
chiffre d'affaires annuel de 7.300.000 E
bilan de 3.650.000 E
50 personnes occupes en moyenne
Rsum des caractristiques des formes de socits les plus rpandues :
Annexe : Contenu de lacte constitutif
Pour une S.P.R.L.
la forme juridique et la dnomination;
la dsignation prcise de lobjet social;
la dsignation des associs;
la dure de la socit : dtermine ou indtermine;
le montant du capital souscrit ainsi que le montant de la partie libre de ce capital;
le nombre et la valeur nominale des parts ainsi que, le cas chant, les conditions
particulires qui limitent leur cession;
125
linstitution bancaire dpositaire des apports librer en numraire;
en ce qui concerne les apports en biens immeubles :
les mutations titre onreux pendant les cinq annes prcdentes;
les conditions auxquelles ces mutations ont t opres;
les charges hypothcaires ou les nantissements grevant les biens apports;
les conditions auxquelles est subordonne la ralisation des droits apports en option;
en ce qui concerne les apports en nature :
la spcification de chaque apport;
le nom de chaque apporteur;
le nom du rviseur et les conclusions de son rapport;
les autres conditions ventuelles auxquelles lapport est fait;
la dsignation des personnes autorises administrer et engager la socit;
le dbut et la fin de lexercice;
ventuellement le jour et lheure de lassemble annuelle appele statuer sur les comptes
annuels;
la cause et la consistance des avantages particuliers attribus chacun des fondateurs;
le montant total, au moins approximatif, des frais, dpenses et rmunrations ou charges qui
incombent la socit.
Pour une S.A.
la forme juridique et la dnomination;
la dsignation prcise de lobjet social;
la dsignation prcise du sige;
la dure de la socit lorsquelle nest pas illimite;
le montant du capital souscrit ainsi que le montant de la partie libre de ce capital;
le cas chant, le montant du capital autoris;
les rgles, dans la mesure o elles ne rsultent pas de la loi, qui dterminent le nombre et le
mode de dsignation des membres des organes chargs de la reprsentation lgard des
tiers, de ladministration et, le cas chant, de la gestion journalire, de la surveillance et du
contrle ainsi que la rpartition des comptences entre ces organes;
en ce qui concerne les actions reprsentatives du capital
le nombre et la valeur nominale;
ou le nombre seul pour les actions mises sans valeur nominale;
les conditions particulires ventuelles qui limitent leur cession;
126
sil existe plusieurs catgories dactions
les mmes indications pour chaque catgorie;
les droits attachs chaque catgorie;
en ce qui concerne les parts bnficiaires
le nombre de parts;
les droits attachs ces parts;
les conditions particulires qui limitent leur cession;
la forme nominative ou au porteur des actions, ou leur dmatrialisation; ainsi que toutes les
autres dispositions relatives leur conversion qui diffrent de celles que la loi fixe;
en ce qui concerne les apports autres quen numraire
la spcification de chaque apport;
le nom de chaque apporteur;
le nom du rviseur et les conclusions de son rapport;
le nombre et la valeur nominale des actions ou, dfaut de valeur nominale, le
nombre dactions mises en contrepartie de chaque apport;
les autres conditions ventuelles auxquelles lapport est fait;
la cause et la consistance des avantages particuliers attribus chaque fondateur;
le montant total des frais, dpenses et rmunrations ou charges qui incombent la socit;
lorganisme dpositaire des apports librer en numraire;
en ce qui concerne les apports en biens immeubles : les mutations titre onreux pendant les
cinq annes prcdentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont t faites;
les charges hypothcaires ou les nantissements grevant les biens apports;
les conditions auxquelles est subordonne la ralisation des droits apports en option.
Pour une S.C.R.L. et une S.C.R.I.
la forme juridique et la dnomination;
le sige et lobjet de la socit;
la dsignation prcise des associs;
la dsignation des apports et le montant de la part fixe du capital;
la spcification de chaque apport en nature;
en ce qui concerne les apports en nature :
le nom de chaque apporteur;
le nom du rviseur et les conclusions de son rapport;
le nombre et la valeur nominale des parts mises en contrepartie;
127
les autres conditions ventuelles auxquelles lapport est fait;
la dure de la socit;
les conditions dadmission, de dmission et dexclusion des associs et les conditions de
retrait des versements;
ladministration et le contrle :
la nomination et la rvocation des grants, administrateurs et commissaires;
ltendue de leur pouvoir;
la dure de leur mandat;
les droits des associs; le mode de convocation; la majorit requise pour la validit des
dcisions; le mode de scrutin;
le mode de rpartition des bnfices et des pertes;
le montant du capital souscrit ainsi que le montant de la partie libre de ce capital.
128
CHAPITRE 12 : LE PASSAGE EN SOCIETE
12.1 Quelle est l'opportunit de passer en socit ?
Souvent, le passage en socit est dcrit comme une solution fiscalement avantageuse qu'il
faudrait adopter sans rflchir.
Le passage en socit est pourtant une solution complexe. Les matires qui doivent entrer
en ligne de compte sont comme les pices d'un puzzle : chacune d'entre elles ont leur
importance et sont indispensables - citons notamment les droits comptable, commercial,
fiscal et social.
Dans la plupart des cas, il est vrai, le passage en socit des professions librales et des
dirigeants d'entreprise permet de dfiscaliser et dsocialiser leurs revenus professionnels,
tout en optimisant les diffrentes formes de rmunration possibles.
12.2 Trois pistes sont possibles pour entamer l'exercice d'une activit
en personne physique (indpendant)
par une association de fait
par le passage en socit
12.2.1 Indpendant
L'entreprise individuelle est la forme la plus simple pour commencer l'exercice d'une activit :
aucun capital minimum n'est ncessaire et les formalits accomplir sont rduites.
La personne physique qui exerce une activit en nom propre est soumise la scurit
sociale des travailleurs indpendants.
Le fonctionnement de l'entreprise individuelle est galement simple : l'entrepreneur dispose
des pleins pouvoirs pour diriger son entreprise, il n'a pas rendre compte de sa gestion, ni
mme publier ses comptes annuels. L'entrepreneur prend seul les dcisions, ce qui lui
permet de ragir rapidement. Il dispose de la totalit des bnfices. La comptabilit est
simplifie.
L'inconvnient majeur de l'exercice d'une activit en nom propre est l'existence d'une
responsabilit illimite sur ses biens propres, mobiliers et immobiliers, prsents et futurs pour
payer les dettes de l'entreprise.
12.2.2 Association de fait
Plusieurs indpendants autonomes (au minimum deux) tablissent une collaboration
commerciale pour exercer, d'une manire durable et ostensible, une activit en commun.
L'AF n'a pas d'identit propre et ne peut ni conclure d'engagements ni possder de biens
propres. En outre, les associs sont tenus solidairement sur leur patrimoine propre. Par
contre, les obligations juridiques, fiscales et comptables sont rduites nant.
L'association de fait suppose la runion de moyens pour atteindre un but dtermin ou pour
exercer une activit donne ; l'association ne dispose cependant pas de la personnalit
juridique et les rsultats sont rpartis entre les associs (transparence fiscale). La
responsabilit des associs est bien videmment illimite.
129
Exemples : socit interne, socit momentane
Dans le prolongement des associations de fait, les socits responsabilit illimite pour
tout ou partie des associs sont souvent cres pour des raisons successorales ou pour
faciliter la sortie d'une indivision immobilire (la sortie d'indivision ncessite simplement un
change de parts sociales)
12.2.3 Passage en socit
Plusieurs motivations expliquent la constitution d'une socit responsabilit limite
- la diffrence du taux de taxation des socits par rapport aux personnes physiques,
- la volont de collaborer dans un cadre lgal,
- la volont de modifier sa situation en matire de cotisations sociales,
- la limitation du risque financier;
- la prennit de l'entreprise.
12.3 Considrations fiscales
Trs souvent, la constitution d'une socit correspond la recherche d'un avantage fiscal.
L'avantage le plus apparent est celui qui rsulte de la diffrence de taux entre impt des
personnes physiques (I.P.P.), d'une part, et impt des socits (I. Soc.), d'autre part.
Taux de l'impt des personnes physiques
Pour l'exercice d'imposition 2011 (revenus 2010), les barmes d'imposition l'impt des
personnes physiques sont les suivants :
Les premiers 7.900 25 %
De 7.900 11.240 30%
De 11.240 18.730 40%
De 18.730 34.330 45%
A partir de 34.330 50%
Avant d'effectuer le calcul de l'impt, un montant non imposable est calcul. Ce montant doit
tre compt sur les tranches des revenus le plus bas. Il se monte pour l'exercice d'imposition
2011 (revenus 2010) 6.430 . Si le revenu imposable ne dpasse pas 23 900 euros, le
montant de base de la quotit du revenu exempte dimpt est major 6 690 euros.
130
En plus de l'impt des personnes physiques, vous devez payer une taxe communale
additionnelle. Celle-ci varie en fonction de la commune o vous habitez.
Le forfait en IPP exercice 2010, revenus 2009
1 pour les rmunrations des travailleurs :
a) 28,7 % de la premire tranche de 5.190 EUR
b) 10 % de la tranche de 5.190 EUR 10.310 EUR
c) 5 % de la tranche de 10.310 EUR 17.170 EUR
d) 3 % de la tranche excdant 17.170 EUR
2 pour les rmunrations des dirigeants d'entreprise : 5 %;
3 les rmunrations des conjoints aidants: 5 %;
Le forfait ne peut, en aucun cas, dpasser 3.590 EUR pour l'ensemble des revenus d'une
mme catgorie.
En ce qui concerne les rmunrations des travailleurs, le forfait est major, pour tenir compte
des frais exceptionnels qui rsultent de l'loignement du domicile par rapport au lieu de
travail, d'un montant dtermin suivant une chelle fixe par le Roi.
Majoration de la quotit du revenu exempte dimpt
1 enfant: 1.370 euros
2 enfants: 3.520 euros
3 enfants: 7.880 euros
4 enfants : 12.750 euros
Supplment de chaque enfant de moins de trois ans pour les contribuables qui ne
dclarent pas de frais de garde : 510 euros
Toute autre personne charge: 1.370 euros
Revenu professionnel imputable (coefficient matrimonial): 9.280 euros
Epargne pension: 870 euros
Primes dassurance-vie et amortissements de capital: 2.080 euros
Crdit logement, dduction hypothcaire pour habitation propre et unique :
Dduction de base: 2.080 euros
Dduction releve 10 premires annes : 690 euros
Majoration pour trois enfants charge ou plus : 70 euros
131
Le dcompte final dun salaire est le suivant :
brut X 0,1307 = ONSS mensuel
brut ONSS mensuel = imposable
imposable prcompte professionnel = net
Taux de limpt des socits
Disposition lgale : art. 215 CIR
A partir de lexercice dimposition 2004, le taux nominal de l'ISOC est fix 33 % (plus 3%
de cotisation spciale dite CCC, soit 33,99%).
Lorsque le revenu imposable n'excde pas 322.500,00 EUR, l'impt est toutefois fix comme
suit :
Taux rduits :
1 sur la tranche de 0 25.000 EUR : 24,25 % (plus 3% de cotisation spciale dite CCC, soit
24,98 %)
2 sur la tranche de 25.000 EUR 90.000 EUR : 31 % (plus 3% de cotisation spciale dite
CCC, soit 31,93 %)
3 sur la tranche de 90.000 EUR 322.500 EUR : 34,50 % (plus 3% de cotisation spciale
dite CCC, soit 35,54 %)
322.500 et plus : 33,99 %
Pour bnficier de ce tarif rduit, une socit doit satisfaire aux conditions suivantes :
Le bnfice distribu de la socit ne peut pas dpasser 13% du capital libr au
dbut de lexercice.
La socit doit avoir attribu au moins un de ses dirigeants une rmunration
de 36.000 minimum (exercice d'imposition 2011). Lorsque le revenu imposable est
infrieur 36.000 , la socit doit attribuer au moins un de ses dirigeants une
rmunration qui ne peut tre infrieure son revenu imposable.
La comparaison de ces deux barmes montre que l'on atteint rapidement un taux marginal
de taxation de 45% en personne physique, alors que lIPP est nettement moins lev. Mais il
faut tenir compte des quotits exemptes en IPP.
Volont de collaborer dans un cadre lgal
Plusieurs personnes dsirant travailler ensemble prfreront savoir quoi ils s'engagent
avant de commencer. Le Code des socits prvoit en ses dispositions diffrents lments
destins les garantir et les prserver; la constitution d'une socit s'inscrit donc dans une
perspective rassurante.
132
Considrations sociales
Les administrateurs ou grants des S.A., S.P.R.L. et S.C. sont assujettis au statut social des
indpendants :
titre principal lorsque ce mandat est exerc l'exclusion de tout autre activit
professionnelle,
titre complmentaire, en cas d'exercice concomitant d'une autre activit
professionnelle ouvrant un droit la pension lgale dans un autre rgime de scurit
sociale.
La limitation du risque financier
La cration d'une socit, dote de la personnalit juridique, responsabilit limite, peut
mettre le patrimoine personnel de l'indpendant l'abri de certains risques. En effet, la
responsabilit des associs d'une socit anonyme, d'une socit prive responsabilit
limite ou d'une socit cooprative est limite concurrence de leur apport. La perte
maximale qu'ils encourent correspond donc au capital qu'ils ont souscrit.
La prennit de l'entreprise
La transmission des parts socit facilite la cession de l'entreprise au bnfice des hritiers
ou d'un repreneur ventuel. Il est en effet plus facile de partager le capital d'une socit
qu'une entreprise en nom personnel.
Lisser sa rmunration
En cas d'exercice d'une activit en personne physique, une augmentation du bnfice
entranera un accroissement de l'impt sur les revenus avec, ensuite, un rajustement ( la
hausse) des cotisations sociales. Si, cette poque, les bnfices d'un indpendant ont
chut, il devra avoir mis de l'argent de ct pour pouvoir faire face ces charges.
Avec une socit soumise l'impt sur les socits, la rmunration personnelle d'un
dirigeant d'entreprise peut rester stable au fil des annes. Lorsque les rsultats de la socit
sont plus faibles, on retirera un mme salaire ; on distribuera par contre par exemple moins
de dividendes. Ceci peut tre ralis en prlevant des sommes sur les bnfices non
distribus des exercices prcdents.
Aspects salariaux
Les indpendants ne sont jamais soumis un quelconque rgime de modration salariale ;
les socits sont par contre concernes.
12.4 Inconvnients du passage en socit
Le principal inconvnient de l'existence d'une socit est qu'il exige une administration plus
complexe et, par l, plus coteuse tant pour les frais de constitution, de fonctionnement et de
liquidation de la socit.
Il faut relativiser
133
En personne physique
Les indpendants maris souscrivent souvent un contrat de mariage en sparation de biens.
En cas de problme, le patrimoine propre du conjoint ne peut en principe pas tre saisi. De
plus, les personnes qui exercent une activit commerciale sont plus exposes (lorsqu'un
client ne paie pas, il n'est pas toujours vident que l'indpendant paie ses propres
fournisseurs), dans la mesure o on les compare aux prestataires de services. Inversement,
les professions librales (qui ont pour objet une prestation de services caractre
intellectuel) devront payer essentiellement leurs dettes sociales et fiscales, d'une part, et les
sommes qui rsultent de litiges ventuels (la responsabilit professionnelle est cependant
souvent couverte par une assurance ad hoc, cf. p.ex. les experts-comptables, les
comptables agrs ou les mdecins).
En socit
Les fondateurs de la socit sont tenus d'tablir et de dposer un plan financier chez le
notaire instrumentant, ds la constitution de celle-ci. Si la socit fait faillite dans les trois
ans, et qu'il apparat que le capital tait manifestement insuffisant que pour permettre une
activit normale pendant deux ans au moins compter de la constitution, les fondateurs
peuvent tre condamns combler l'insuffisance d'actif.
12.5 Avantages du passage en socit
L'attrait fiscal de la cration d'une socit est une savante alchimie de diffrents paramtres.
1/ Economie d'impts et de cotisations sociales Les fiscalistes conseilleront la constitution
d'une socit ds qu'un indpendant ralise des bnfices importants. En effet, ces derniers
sont soumis dans un premier temps aux cotisations sociales et ensuite l'impt des
personnes physiques (I.P.P.).
Dans le pire des cas, ces prlvements atteindront 16,7% x 1,047 (cotisations sociales avec
frais de gestion) + 55% x 1,085 (I.P.P. + centimes additionnels) = 77% !
La constitution d'une socit permet de rpartir les bnfices ou profits entre :
la personne physique, devenue dirigeant d'entreprise ; seuls ces revenus sont sujets
des cotisations sociales d'indpendants ;
la socit, qui ne paie pas de lois sociales, et qui bnficie du taux rduit de l'impt des
socits
Exemple (BEF)
Bnfice indpendant = 1.500.000
Cotisations sociales (calcules 17%) : (255.000)
I.P.P. (clibataire, sans enfant) : (455.000)
Montant net: 790.000(1)
Ou:
Bnfice indpendant : 600.000
Cotisations sociales (calcules 17%) : (102.000)
I.P.P. (clibataire, sans enfant) : (100.000)
Montant net : 398.000 (2)
134
Et
Bnfice socit : 900.000
Cotisations sociales : 0
I. Soc. (361.530)
(taux plein, c. . d. cas le plus pessimiste)
Montant net: 538.470 (3)
Total (2) + (3) : 398.000 + 538.470 = 936.470 BEF, ce qui donne une conomie par rapport
au cas (1) d'un montant de 936.470 - 790.000 = 146.470 BEF
mme si celles-ci sont plafonnes 2.756.223 BEF (anne 2000)
135
Chapitre 13 : Popsy
Voir syllabus ddi.
136
CHAPITRE 14 : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
IMPOTS SUR LA CIRCULATION JURIDIQUE DES BIENS.
Ces impts relvent de l'administration de la taxe sur la valeur ajoute, de l'enregistrement et
des domaines et comprennent essentiellement la taxe sur la valeur ajoute, les taxes
assimiles au timbre, les droits d'enregistrement et les droits de timbre.
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
La T.V.A. est un impt sur les biens et services qui est support, en dfinitive, par le
consommateur final et qui est peru par tapes successives, savoir chaque transaction
dans le processus de production et de distribution. Etant donn qu' chaque stade du
processus de production et de distribution la taxe paye sur les inputs peut tre dduite,
seule la valeur ajoute est taxe ce stade. La T.V.A. est donc une taxe unique la
consommation, qui est acquitte au moyen de paiements fractionns.
La T.V.A. est un impt proportionnel sur le prix de vente hors T.V.A.. Les taux appliqus
peuvent toutefois varier suivant la nature du bien ou du service tax.
14.1 Concept de lassujetti
Les assujettis la T.V.A. constituent un maillon essentiel dans la perception de la T.V.A.. Ils
portent en compte une T.V.A. sur les ventes leurs clients et peuvent, d'autre part, dduire
de cette T.V.A. perue sur leurs ventes, la T.V.A. frappant leurs propres achats et
investissements. ils ne versent donc au Trsor que la diffrence (la taxe sur la valeur ajoute
par eux).
Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activit conomique, d'une
manire habituelle et indpendante, titre principal ou titre d'appoint, avec ou sans esprit
de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de service vises par le code de la
T.V.A., quel que soit le lieu o s'exerce l'activit conomique.
Assujetti occasionnel
Quiconque effectue une activit conomique bien dfinie peut tre considr comme
assujetti occasionnel. Il sagit entre autres :
de la vente de btiment neuf ;
de la vente de vhicule neuf.
Assujetti sans droit de dduction
Il sagit dassujettis qui en principe ne posent pas dactes pour lesquels ils ont droit une
dduction de T.V.A. sur leurs achats, acquisitions et importations. Il sagit entre autres :
de certaines professions librales : notaires, avocats inscrits au barreau belge et les
huissiers de justice;
des professions mdicales : mdecins, dentistes, kinsithrapeutes ;
137
des institutions mdicales.
Ces assujettis qui ne peuvent porter en compte de T.V.A. pour leurs oprations, sont
nanmoins tenus de :
de satisfaire la T.V.A. lorsquils acquirent des marchandises dautres Etats membres
tenir un livre o ils inscrivent les factures et les documents en rapport avec les activits
pour lesquelles ils sont redevables de la T.V.A. .
Ne sont pas tenus de sidentifier la TVA :
- lassujetti exempt qui neffectue que des oprations exemptes par lart 44 du Code de la
TVA ne lui ouvrant aucun droit dduction.
- lassujetti occasionnel vis au Code de la TVA art 8 et 8 bis pour la vente occasionnelle
de btiments neufs et de moyens de transports neufs.
Rgimes particuliers.
Tenant compte du fait que lapplication du rgime normal de la TVA pourrait entraner des
difficults pour les petites entreprises, certains rgimes particuliers sont prvus, en vue
dallger les obligations fiscales.
Ces rgimes sont cependant facultatifs; lassujetti peut toujours opter pour le rgime normal.
* Le rgime forfaitaire :
- applicable aux entreprises dont le chiffre daffaires annuel ne dpasse pas 750.000
(hors TVA), qui traitent principalement avec des particuliers et qui exercent leur activit dans
certains secteurs.
* Le rgime de la franchise :
- applicable aux petites entreprises qui ralisent un chiffre daffaires annuel qui nexcde
pas 5.580,00 . Ces petites entreprises sont dispenses de la plupart des obligations
fiscales qui incombent normalement aux assujettis la TVA.
Pour bnficier de ce rgime, il est obligatoire de se prsenter loffice de contrle de
la TVA dont on relve.
* Le rgime applicable aux exploitations agricoles :
- applicable aux exploitants agricoles dont lactivit est limite celle de producteur
agricole.
* Le rgime dimposition de la marge :
- applicable aux biens doccasion, aux objets dart, de collection ou dantiquit.
138
14.2 Petites entreprises
Rgime de la franchise pour les petites entreprises
Les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est infrieur 5 580 euros par an peuvent
bnficier d'un rgime de franchise de TVA. Les entreprises franchises ne peuvent pas
percevoir la TVA sur leurs factures, ni dduire la TVA sur leurs acquisitions et elles ne sont
pas soumises au dpt de dclarations priodiques.
Lexonration de T.V.A. nest pas dapplication sur :
la vente de btiments neufs et de vhicules neufs dans le cadre de leur activit
conomique ;
les oprations effectues par les agriculteurs soumis au rgime particulier pour certaines
entreprises agricoles ;
les oprations qui bnficient du rgime spcial des tabacs fabriqus ainsi que les
oprations relevant de la pche ;
les oprations effectues par des assujettis qui ne sont pas domicilis en Belgique.
Entreprises agricoles
Les entreprises agricoles ne sont pas soumises aux obligations en matire de facturation de
dclaration et de paiement de la taxe, l'exception des obligations rsultant de leurs
acquisitions intracommunautaires dpassant le seuil de 11 200 euros (hors TVA).
Le rgime particulier est dapplication aux agriculteurs qui exercent les activits suivantes :
agriculture gnrale, culture de lgumes, de fruits, de fleurs, de champignons, de
semences , de plants, de raisins ; levages ;
ppinires ;
forestires.
Oprations imposables
Livraison de biens
Par biens, il faut entendre les biens corporels, c'est--dire llectricit, le gaz, la chaleur et le
froid ainsi que les droits rels autres que le droit de proprit, donnant leur titulaire un
pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles.
Services
Un service est toute manipulation qui nimplique pas la livraison physique dun bien au sens
de larticle 18 du code de la T.V.A. Seulement quelques services mentionns explicitement
constituent un travail matriel ou intellectuel, dont :
le travail faon : il est dfini comme la fabrication ou lassemblage dun bien meuble par
un entrepreneur au moyen de matires et dobjets que son cocontractant lui a confis
cette fin
la mise disposition de marchandises (except les biens immobiliers) ;
la mise disposition dun garage pour vhicules ou dun espace pour marchandises ;
la fourniture dun logement meubl ou dun emplacement de camping ;
la fourniture de nourriture et de boisson ;
139
loctroi dun droit dentre dans des installations culturelles, sportives ;
les services relatifs la tldistribution, la tlcommunication et la radiodistribution ;
la mise disposition de supports publicitaires.
Agences de voyages
Pour l'application de la T.V.A., les activits des agences de voyages sont classes en trois
catgories en fonction de leur nature :
catgorie 1 : les activits consistant fournir des prestations directement et par ses propres
moyens.
catgorie 2 : les activits consistant intervenir en qualit de courtier ou de mandataire au
nom et pour le compte de prestataires de services qui proposent par exemple des services
de transport ou d'htellerie
catgorie 3 : les autres activits (par ex, les cas o les hteliers et autres prestataires de
services ne facturent pas directement leur prix au voyageur, mais bien l'agence de
voyages ; ou encore, les cas o une agence de voyages vend en qualit d'intermdiaire les
services d'un voyagiste rsidant l'tranger).
Exonrations
Les personnes qui exercent une activit exempte de T.V.A. ou pour laquelle elles ne sont
pas assujetties, peuvent s'associer en un groupement indpendant dans le but de rpartir
entre les membres les frais des services associatifs. Ces services sont exempts de T.V.A..
Concrtement, il peut s'agir par exemple d'une association d'hpitaux qui ensemble louent
leurs appareils mdicaux. Trois conditions sont lies cette exemption de T.V.A. :
les services doivent tre directement ncessaires l'exercice de l'activit exonre des
membres;
les groupements peuvent seulement rclamer des membres, le remboursement de leur
juste quote-part dans les dpenses collectives de ces services;
l'exonration ne peut conduire des distorsions de concurrence.
Les restitutions de la T.V.A.
Le Code T.V.A. prvoit 7 cas de restitution :
trop de T.V.A. paye lorigine ;
une rduction de prix a t accorde un co-contractant ;
les emballages sont retourns
le contrat a t rompu avant que les marchandises ne soient livres ou le service prest ;
le contrat a t annul ou dissous ;
la marchandise a t restitue dans les 6 mois de la livraison ;
le recouvrement du prix est totalement ou partiellement perdu.
En cas dannulation ou de dissolution de contrat, la T.V.A. est toujours rembourse. En cas
de rupture, la T.V.A. originelle est seulement rembourse dans 2 cas, savoir lorsque le
contrat est rompu avant que les marchandises ne soient livres ou les services prests et
lorsque le bien est renvoy endans les 6 mois. En cas de faillite ou de liquidation, la T.V.A.
140
peut tre rembourse sur base dune attestation individuelle du curateur ou du liquidateur,
do il ressort que lentreprise recevra un dividende
14.3 Obligations de lassujetti
Dclaration relative l'activit professionnelle.
Lorsqu'une personne commence une activit qui lui confre la qualit d'assujetti la T.V.A.,
elle doit au pralable en faire la dclaration l'office de contrle de la T.V.A. dont elle relve.
La dclaration doit tre introduite pralablement au dbut de lactivit conomique. La
dclaration de commencement dactivit ne doit pas tre introduite lorsque lactivit
conomique ne donne pas lieu dduction
La comptence territoriale de l'administration de la T.V.A. est, depuis le 1er janvier 1996,
pour les personnes physiques, fixe en fonction de leur domicile et non plus en fonction de
leur sige d'exploitation, lorsque les deux adresses diffrent.
Le numro d'identification T.V.A.
Depuis le 1er janvier 1993, l'attribution d'un numro d'identification la T.V.A. est reprise
dans le code. Etant donn que l'identit des parties concernes par une opration taxable
est importante pour dterminer dans quel Etat membre la T.V.A. est exigible (cf livraisons et
services), chaque numro d'identification la T.V.A. doit dsormais tre prcd des initiales
de L'Etat membre qui accorde le numro d'identification. Pour la Belgique, le numro
didentification consiste en les lettres BE suivies de 10 chiffres
L'introduction de la dclaration priodique la T.V.A
Les assujettis qui ont droit la dduction, sont tenus de dposer des dclarations
priodiques la TVA.
Par le biais de la dclaration priodique la TVA, l'assujetti fait notamment connatre
l'administration :
* le montant des oprations effectues avec la clientle (oprations la sortie) et la TVA
due sur ces oprations
* le montant des oprations ralises avec les fournisseurs (oprations l'entre) et la
TVA due et dductible sur ces oprations
Le but de la dclaration est de dgager la diffrence entre les taxes dues et les taxes
dductibles.
Dclaration mensuelle
En principe, tout assujetti doit dposer une dclaration mensuelle la TVA qui doit tre
introduite au plus tard le 20e jour du mois qui suit le mois civil auquel elle se rapporte.
Le paiement ventuel de la TVA doit s'effectuer dans le mme dlai que l'introduction de la
dclaration.
Au plus tard le 24e jour du mois de dcembre, tout assujetti doit verser un acompte sur la
taxe due pour les oprations du mois de dcembre. Le montant de l'acompte est gal la
taxe due pour les oprations effectues entre le 1er et le 20 dcembre de l'anne en cours.
141
Le montant de l'acompte peut aussi tre fix forfaitairement sur la base de la taxe due pour
les oprations du mois de novembre de l'anne en cours.
Dclaration trimestrielle
L'assujetti, l'exception de celui qui effectue des livraisons d'huile minrales, ne peut
remettre qu'une dclaration par trimestre condition :
* que son chiffre d'affaire annuel, hors TVA, ne dpasse pas 500 000 euros
* qu'il paie un acompte gal au tiers des taxes qui taient dues pour le trimestre civil
prcdent
La dclaration doit tre introduite pour chaque trimestre civil, au plus tard le 20e jour du mois
qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte. Le paiement du solde de la TVA doit
s'effectuer dans les mmes dlais.
L'acompte doit tre pay au plus tard le 20e jour du 2e ou du 3e mois de chaque trimestre
civil.
Dclaration lectronique
L'introduction de la dclaration lectronique se fait obligatoirement via l'application Intervat.
L'identification se fait au moyen de la carte d'identit lectronique ou au moyen d'un certificat
digital (Global Sign, Isabel ou Certipost).
Certains assujettis sont nanmoins dispenss de cette obligation :
les petits dtaillants dont le chiffre d'affaires annuel ne dpasse pas 5.580 ;
les exploitants agricoles soumis au rgime agricole particulier pour l'ensemble de leur
activit;
les assujettis sans droit dduction.
Demande de restitution
Demande expresse et mandat bancaire (cocher la case)
Rgularit dans le paiement et le dpt
Priode (fixe par l'administration) et montant suffisant
Si le crdit d'impt (de l'anne prcdente) est suprieur 12.390
Si titulaire d'une autorisation spciale
Toutes les conditions doivent tre remplies simultanment
Remarques
La dclaration est dposer mme s'il n'y a eu aucune opration
Si le dpt est tardif
o amende fiscale
o taxation d'office
142
o non remboursement d'un crdit d'impt
143
L'arrt royal du 31 janvier 2007 a marqu la fin de la traditionnelle dclaration
"papier" la TVA. Une disparition en 3 tapes:
1. depuis le 1er juillet 2007, la dclaration lectronique est obligatoire pour les assujettis
dont le chiffre d'affaires HTVA excdait 50 millions d'euros en 2005 (environ 2.000
socits);
2. le 1er fvrier 2008, l'obligation a t largie tous ceux qui devaient introduire une
dclaration mensuelle (environ 20.000 socits);
3. depuis le 1er janvier 2009, l'obligation concerne aussi les assujettis dposant une
dclaration trimestrielle, partir de celle du 1er trimestre 2009 ( introduire avant le
20 avril). Ils devront introduire lectroniquement, non seulement cette dclaration et
les suivantes, mais aussi, ds le 1e juillet 2009, le listing clients et le relev
intracommunautaire.
Les 2 premires tapes ont surtout proccup les professionnels du "chiffre", les comptables
internes ou les bureaux externes, car elles ne ciblaient que les entreprises d'une certaine
taille (moins de 10% des assujettis). Par contre, la 3e tape concerne pratiquement tous les
assujettis, y compris les indpendants titre complmentaire ne bnficiant pas du rgime
spcial de franchise *, donc un grand nombre d'indpendants introduisant eux mmes leurs
dclarations trimestrielles.
Le rgime de la "franchise" est possible (jamais obligatoire) pour les petites entreprises
(indpendants ou socits), dont le chiffre d'affaires annuel ne dpasse pas 5.580 .
Ce rgime a pour objectif de simplifier la tche des assujettis au niveau des formalits
TVA accomplir.
1. Il faut reprendre des indications prcises sur les factures de sortie (ventes).
Les factures dlivres pour des livraisons de biens ou des prestations de services
ne peuvent faire apparatre la taxe, et doivent porter la mention: "Petite
entreprise soumise au rgime de franchise de la taxe, TVA non applicable".
La facturation se fait donc toutes taxes incluses.
2. L'assujetti est dispens de tenir des facturiers.
La petite entreprise sous rgime de franchise est dispense de la tenue des
facturiers d'entre et de sortie, mais elle doit cependant conserver les factures et
documents suivant un ordre de srie ininterrompu de classement.
3. La tenue dun journal des recettes journalires est exige.
Les recettes doivent tre inscrites globalement au jour le jour dans le journal des
recettes journalires, comme n'importe quel autre assujetti.
4. Il y a une dispense de dclarations TVA: les assujettis qui bnficient du rgime
de la franchise sont dispenss de la rdaction des dclarations TVA priodiques.
Si ces facilits sont apprciables, cet allgement des contraintes administratives a
galement pour consquence que l'entreprise qui profite du rgime de la franchise ne
peut pas dduire la TVA concernant les achats des biens ou des services achets ou
utiliss pour raliser le chiffre d'affaires.
144
Depuis plusieurs annes, l'administration fiscale propose une application informatique
permettant d'introduire lectroniquement les dclarations priodiques la TVA: Intervat.
http://minfin.fgov.be/portail2/fr/e-services/intervat/index.htm
http://minfin.fgov.be/portail2/fr/e-services/intervat/faq/index.htm
Cette application a t largie, de sorte qu'il est aussi possible de dposer par cette voie les
relevs intracommunautaires et les listings clients.
L'introduction des donnes peut s'effectuer de 2 manires:
1. un encodage manuel,
2. un transfert de fichiers informatiques sous le format XML.
La signature manuscrite n'tant plus possible, l'authentification du dclarant doit s'effectuer
au moyen d'une signature lectronique. Il existe plusieurs types de signature lectronique,
caractriss surtout par des degrs de fiabilit diffrents. Actuellement l'administration fiscale
exige une signature lectronique lie un certificat numrique de "classe 3", qui doit tre
install sur l'ordinateur. Les certificats de classes infrieures, tels que ceux dcerns sur de
nombreux sites Internet, ne sont pas accepts.
Actuellement en Belgique, 3 entreprises ont obtenu des autorits publiques les agrments
pour dcerner des certificats de ce type : Certipost, Isabel et Globalsign.
Ces certificats ont un cot, souvent sous la forme d'une redevance (licence annuelle, de
l'ordre de quelques dizaines d'euros par an).
Pour les dclarations TVA, l'administration fiscale n'accepte pas actuellement que
l'authentification du dclarant se fasse suivant un mot de passe et un token (un jeu
alatoire de codes), systme pourtant trs simple et gratuit qui a t trs largement
adopt pour les dclarations annuelles sur les revenus.
14.4 Le listing annuel des clients assujettis
Avant le 31 mars de chaque anne, l'assujetti est tenu de remettre une liste reprenant
chaque assujetti auquel il a livr des biens ou fourni des services au cours de l'anne civile
prcdente, en mentionnant chaque fois le montant total des oprations et le montant total
des T.V.A. portes en compte. Lacheteur/assujetti sans droit dduction ne doit pas tre
mentionn sur ce listing
Tous les assujettis la T.V.A., y compris les agriculteurs au forfait, l'exclusion des
assujettis exonrs en application de l'article 44 (mdecins, notaires, coles, hpitaux, etc...)
sont tenus de dposer le listing annuel national. En principe, les petites entreprises
franchises (assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excde pas ou 5.577,60 ) doivent
aussi dposer un listing annuel.
Facture lectronique
Les assujettis qui souhaitent obtenir une autorisation individuelle de lAdministration de la
T.V.A. pour appliquer le systme EDI Electronic Data Interchange sont tenus dintroduire
un dossier comportant au moins les mentions ou descriptions suivantes :
le nom, la dnomination sociale et le numro didentification du demandeur la T.V.A. ;
145
le type dautorisation (factures dentre et/ou sortie) ;
la confirmation que la facture lectronique contient toutes les mentions lgales
obligatoires ;
la description de lavis et de la mise en page ;
le mode darchivage et la description du systme darchivage;
en matire de protection : la faon dont des garanties sont donnes concernant,
notamment, lauthenticit des avis, le caractre immuable, la non-rpudiation,
lidentification du(des) cocontractant(s), lintgrit du systme ;
le type de rseau ;
une description succincte du systme informatique (interne) et des flux dinformation ;
une numration des pices mises disposition lors dun contrle et la forme sous
laquelle elles le sont ;
un relev de la documentation disponible ;
la planification et la procdure dinstauration de la facturation lectronique
La comptabilit.
Tous les assujettis la T.V.A. doivent tenir une comptabilit qui reflte l'application exacte de
la T.V.A. et qui en permet le contrle. Les assujettis sans droit de dduction en sont
exempts. Tous les assujettis concerns par des services exonrs en rapport avec des
oprations financires et d'assurance doivent tenir une comptabilit T.V.A. intgrale.
Les principaux documents tenir sont :
le facturier d'entre;
le facturier de sortie;
le journal des recettes.
le tableau des biens d'investissement.
la tenue des comptes clients.
le registre de restitution
Toute comptabilit doit comprendre au moins les 3 premiers livres. Les 3 autres livres
doivent tre tenus pour certaines oprations.
Les diffrents taux de tva :
Le taux de TVA applicable dpend de la nature de l'activit exerce.
Le taux normal est de 21%. La loi a toutefois dfini un certain nombre de catgories de biens
et de services auxquels s'appliquent des taux plus avantageux de 0%, 6% et 12%.
Le tarif de 0% - qui est en fait une exemption de tva - s'applique aux cigarettes, aux
assurances, aux frais de notaire, aux journaux
Le tarif de 6% s'applique la livraison des biens suivants :
animaux vivants;
produits vgtaux;
denres alimentaires (sauf entre autres margarine, caviar, certains crustacs,
coquillages et mollusques);
distribution d'eau;
146
produits pharmaceutiques;
livres et certains priodiques;
oeuvres d'art originales, objets de collection et antiquits (uniquement pour
importation de certaines oeuvres d'art bien prcises, certains objets de collection et
antiquits bien prcis ainsi que pour certaines livraisons et acquisitions intra-
communautaires d'ouvres d'art bien prcises dans certaines conditions);
vhicules automobiles pour transport de personnes invalides;
cercueils;
certains appareils mdicaux et remdes;
livraisons de biens pour institutions finalit sociale ;
ainsi qu'aux services suivants :
services agricoles;
transport de personnes;
entretien et rparation de certains biens mentionns ci-dessus;
institutions culturelles, sportives ou de loisirs;
droits d'auteur, ralisation de concerts et de spectacles;
htels;
campings;
services d'entreprises de pompes funbres;
certaines interventions portant sur des habitations prives de plus de 5 ans;
certaines interventions portant sur des habitations prives de personnes handicapes
et des institutions pour personnes handicapes;
des services rendus par des institutions finalit sociale;
quelques autres services.
Le taux de 6% s'applique de manire temporaire :
aux travaux immobiliers et certaines interventions portant sur des habitations
prives de plus de 5 ans (dans certaines conditions);
la rparation de vlos;
la rparation de chaussures et articles de maroquinerie;
la rparation et la retouche de vtements et linge de maison.
Le tarif de 12% s'applique la livraison de:
phytopharmacie
margarine
147
pneus et de chambres air pour roues de machines agricoles et de tracteurs,
certains combustibles solides (entre autres charbon, lignite et coke),
les chanes de tlvision payantes
le logement social sont soumis au taux de 12% .
Oprations exonres de TVA :
Les exemptions peuvent tre scindes en deux groupes :
activits qui sont exonres de TVA et qui permettent ceux qui effectuent ces
activits de dduire la TVA sur les biens et services qui leur ont t livrs (par
exemple en cas d'exportation).
activits exemptes, dont les exonrations reposent principalement sur des
considrations sociales et culturelles, mais qui ne permettent pas ceux qui exercent
ces activits de dduire la TVA sur les biens et services qui leur sont livrs (par
exemple des services prests par des notaires, avocats, hpitaux, tablissements
d'enseignement, etc.).
14.5 Le rgime forfaitaire
14.5.1 Mcanisme
Le mcanisme du forfait est le suivant : la base imposable va tre dtermine par une
valuation effectue partir des entres ou des prestations.
La raison en est la suivante: les dtaillants vendent ou prestent en gnral au comptoir ,
sans facture (en tout cas, sans obligation d'en dlivrer). Ds lors, ils devraient porter leurs
recettes au journal ad hoc, pour pouvoir les dclarer; mais cela pose problme, dans la
mesure o les ventes s'effectuent par petites quantits de nombreux clients; on a donc
voulu supprimer ce journal des recettes, afin de faciliter la gestion de ces entreprises, et la
tche des agents de l'Administration chargs du contrle.
En l'absence d'un journal des recettes, on dterminera les ventes de ces entreprises partir
de bases forfaitaires tablies par l'administration, en accord avec les groupements
professionnels concerns.
14.5.2 Les bases forfaitaires
Le forfait est un lment de tarification, dfini lavance et indpendant des quantits
consommes ou produites.
Le forfait a pour but de dterminer les recettes du commerant sans que celui-ci ne doive
tenir un livre de recettes journalier. Cela lui simplifie donc la tche.
L'assujettissement au rgime de forfait n'est pas automatique, l'assujetti qui dsire choisir ce
rgime doit le mentionner dans la "dclaration du commencement d'activit".
L'avantage le plus immdiat est l'absence d'obligation de la tenue d'un livre de recettes
journalier dtaill. Les commerces de dtail non soumis ce rgime doivent en effet se plier
148
cette obligation souvent fastidieuse, mme avec une caisse enregistreuse (laquelle n'est
pas obligatoire, mais vite beaucoup de soucis en cas de contrle fiscal).
La plus grande difficult des assujettis soumis au rgime du forfait consiste clater
adquatement les achats de biens et services dans les diffrents groupes tablis par
l'Administration (qui permettent de calculer les forfaits).
Deux autres inconvnients majeurs existent encore :
1. Lorsque l'activit dgage des pertes, elles ne sont pas dductibles.
2. Le forfait est un rgime o l'assujetti est en effet cens (sauf preuve contraire comme
l'tablissement d'un inventaire) avoir vendu tous les biens qui lui ont t livrs.
La TVA est, de ce fait, exigible immdiatement sur le prix de vente prsum.
Il existe trois mthodes pour dterminer la base imposable:
partir des marges bnficiaires brutes (fixes par Arrt Royal), que l'on additionne au
montant des achats hors T.V.A.. Cette mthode est applique aux dtaillants, dont le chiffre
d'affaires imposable consiste principalement en livraison de biens. Les marchandises sont
rparties en groupes, et, pour chaque groupe, on fixe un coefficient tabli sur base du
bnfice brut moyen pris par les dtaillants; les coefficients rsultent de donnes collectes
dans tout le pays par l'Administration et par les groupements professionnels; c'est sur base
de ces donnes que le Collge des forfaits tablit les moyennes nationales;
partir des rendements normaux estims par produits, en fonction de leur nature. Cette
mthode est applique dans des secteurs d'activit o le chiffre d'affaires dpend du
rendement de matires premires ou de produits achets ou imports (boulangerie,
boucherie, ...);
partir des prestations prsumes, dtermines forfaitairement. Cette mthode est
applique dans les petites entreprises fournissant principalement des services; le chiffre
d'affaires est alors obtenu en multipliant le nombre prsum d'heures ou de jours de travail
effectus par l'assujetti par la rmunration horaire ou la recette journalire prsume.
14.5.3 Conditions d'admission au forfait.
Ce rgime est un rgime simplifi applicable sa demande, tout assujetti qui remplit les
conditions suivantes :
* lassujetti doit tre une personne physique (indpendant), une SNC ou une SPRL ;
* le chiffre daffaires hors TVA ne peut excder 750.000 ;
* au minimum 75 % du chiffre daffaires ne doit pas ncessiter la dlivrance dune facture.
Ce minimum requis de 75% peut tre ramen 60% dans certains cas particuliers ;
* une base forfaitaire doit exister pour le secteur d'activit concern (voire liste plus bas).
Les assujettis ce rgime ne sont pas soumis lobligation dtablir un livre journalier et le
chiffre daffaires servant dassiette pour la collecte de la TVA est dtermin forfaitairement (la
TVA est calcule sur base des achats et on prsume que tout ce qui a t achet sera
immdiatement vendu; il est cependant possible transmettre l'administration fiscale un
inventaire des invendus en fin dexercice afin de procder un ajustement).
149
Remarques :
* si un mme assujetti exerce plusieurs activits conomiques, il y a lieu d'additionner les
chiffres d'affaires raliss dans les diffrentes activits;
* si plusieurs assujettis exercent des activits conomiques en indivision ou en
association, il y a lieu de prendre en considration le chiffre d'affaires total de ces activits,
ralis en commun;
Il existe des forfaits pour les secteurs d'activit suivants :
* Bouchers-charcutiers
* Boulangers et boulangers-ptissiers
* Cafetiers
* Coiffeurs
* Cordonniers
* Dtaillants en chaussures
* Dtaillants en produits laitiers, crmiers et laitiers ambulants
* Dtaillants en poisson et poissonniers ambulants
* Dtaillants en alimentation gnrale
* Dtaillants en gibiers et volaille
* Dtaillants en produits du tabac
* Dtaillants en produits textiles divers et en maroquinerie
* Dtaillants en quincaillerie et en outillage
* Dtaillants en journaux et priodiques
* Droguistes
* Exploitants de friteries
* Forains
* Glaciers
* Libraires
* Marchands de chaussures
* Marchands de journaux
* Mdecins avec dpt de mdicaments
* Pharmaciens
* Poissonniers
* Poissonniers ambulants
L'assujetti peut opter pour le rgime normal, condition d'en avertir son contrleur par
recommand avant le 15 mars; l'option prend cours le 1er avril, et lie l'assujetti pour 2 ans.
L'assujetti forfaitaire n'est pas dispens de tenir un facturier de sortie, o il classera les
factures qu'il a d dlivrer compte tenu de la lgislation en vigueur. De mme, s'il fournit des
produits non prvus au forfait, il doit tenir, pour ceux-l uniquement, un journal des recettes.
Calcul du chiffre daffaires: situations particulires
Si Alors
un mme assujetti exerce plusieurs
activits conomiques
(par ex. boulanger et picier)
il y a lieu d'additionner les chiffres
d'affaires raliss dans les diffrentes
activits;
plusieurs assujettis exercent des activits
conomiques en indivision ou en
association
il y a lieu de prendre en considration le
chiffre d'affaires total de ces activits,
ralis en commun;
des poux exercent sparment une
activit conomique (par ex. mari cafetier
et pouse picire)
il y a lieu de considrer distinctement le
chiffre d'affaires ralis par chacun des
poux, quel que soit le rgime matrimonial.
150
14.6 Lacquisition intracommunautaire
AI = Achat de bien par un assujetti un autre assujetti faisant partie d'un autre pays de l'UE
LI = Vente de biens par un assujetti un autre assujetti faisant partie d'un autre pays de l'UE
3 Conditions pour avoir une AI ou une LI
1. Dplacement physique de bien - pas de prestation de services !
2. entre 2 assujettis la TVA
3. faisant partie de 2 tats membres de l'UE
Document :
Facture tablie par le vendeur SANS TVA et avec la mention : " exempt de TVA en vertu de
l'article 39bis"
AI (acheteur) LI (vendeur)
Principe du pays de destination
Il doit sacquitter de la Tva son
administrateur local sur base de la facture
Compte de dette (451 TVA due sur AI)
Il peut rcuprer la TVA dans la mesure de
lusage professionnel du bien
Principe du pays de destination
Il ne doit pas reprendre la TVA sur la facture
mais mentionner exempt de TVA en vertu
de larticle 39bis
Si l'acheteur est non assujetti
acheteur vendeur
Principe du pays dorigine
Lacheteur est non assujetti = particulier
Aucune criture chez le particulier
Principe du pays dorigine
151
CHAPITRE 15 : ELEMENTS DE FISCALITE
15.1 Structure du systme fiscal belge
L'impt peut tre comme "un prlvement effectu par les pouvoirs publics, sur les
ressources des personnes existant sur le territoire".
Personnes assujetties l'impt
L'impt des personnes physiques est d par les habitants du royaume, c'est--dire par les
personnes qui ont tabli en Belgique leur domicile ou le sige de leur fortune. Sauf preuve
contraire, sont considres comme ayant en Belgique leur domicile ou le sige de leur
fortune, toutes les personnes physiques inscrites au Registre National.
Sont galement assujettis l'impt des personnes physiques :
les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrire belges accrdits
l'tranger ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur foyer;
les autres membres de missions diplomatiques belges et les autres membres du
personnel consulaire de carrire belge, en poste l'tranger, ainsi que les membres de
leur famille vivant leur foyer, non compris les fonctionnaires consulaires honoraires;
les autres fonctionnaires, reprsentants et dlgus de l'Etat belge ou d'une des
subdivisions politiques ou d'un organe belge de droit public, qui possdent la nationalit
belge et qui exercent leurs activits l'tranger dans un pays o ils ne sont pas rsidents
permanents.
Ne sont pas assujettis l'impt des personnes physiques :
les agents diplomatiques trangers et les agents consulaires de carrire trangers
accrdits en Belgique ainsi que les membres de leur famille vivant leur foyer;
sous condition de rciprocit, les autres membres des missions diplomatiques trangres
et les autres membres du personnel consulaire de carrire tranger en poste en Belgique
sous condition de rciprocit, les fonctionnaires, agents, reprsentants et dlgus
d'Etats trangers, qui nexercent pas leur fonction dans le cadre dune activit industrielle
ou commerciale.
Dans notre pays, les impts & taxes sont prlevs par
ltat Fdral;
les Rgions;
les Communauts ;
les Provinces;
les Communes.
On distingue traditionnellement les IMPOTS DIRECTS (sur le revenu ou la fortune), et les
IMPOTS INDIRECTS (sur la dpense).
152
Les IMPOTS DIRECTS prlevs par lEtat Fdral sont:
L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP), qui frappe l'ensemble des revenus des
personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Belgique (c'est--dire l'argent que nous
gagnons, vous et moi);
L'IMPOT DES SOCIETES (Isoc), frappant l'ensemble des revenus des socits ayant leur
domicile fiscal en Belgique (c'est--dire essentiellement les BENEFICES des socits);
L'IMPOT DES PERSONNES MORALES (IPM), qui concerne essentiellement certains
revenus des ASBL;
L'IMPOT DES NON-RESIDENTS (INR), qui frappe les revenus BELGES des personnes
physiques et morales ayant leur domicile fiscal l'tranger.
Les IMPOTS INDIRECTS prlevs par ltat Fdral sont:
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE (TVA) (taxe la consommation);
LES DROITS D'ENREGISTREMENT, sur la vente de biens immobiliers (12,5 % au taux
normal), sur le capital des socits (0,5 %),
LES DROITS D'HYPOTHEQUE, LES DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION, LES
DROITS DE GREFFE ET DE TIMBRES,
LES DROITS DE DOUANES, frappant certaines importations;
LES DROITS D'ACCISES, frappant l'importation, la fabrication ou la vente de certains
produits : carburants, tabacs, alcools, eaux et huiles minrales, ...;
LA TAXE DE PATENTE (dbit de boissons alcoolises) et LA TAXE D'OUVERTURE
(dbit de boissons fermentes).
Les Rgions (Bruxelloise, Flamande, Wallonne) sont galement dotes d'un pouvoir fiscal,
qui leur permet de lever des impts dans des matires non encore utilises par l'tat. En
outre, les pouvoirs locaux, savoir les PROVINCES et les COMMUNES, sont libres de crer
et de lever des impts, dans certaines limites; ces pouvoirs locaux se financent d'abord par
des ADDITIONNELS des impts nationaux (sur l'immobilier, sur l'IPP [communes
uniquement]), puis par un ensemble de taxes, sur les chevaux, la force motrice, le personnel
occup, les vitrines, les enseignes lumineuses, ...
Cette liste est loin d'tre exhaustive, l'imagination tant, dans ce domaine en tout cas, au
pouvoir !
15.2 L'IPP Impt des Personnes Physiques
Le Code des Impts (ciR) distingue quatre grandes catgories de revenus, pour les
personnes physiques
les revenus immobiliers, provenant de la proprit foncire;
les revenus mobiliers, provenant essentiellement du placement de capitaux ou de
l'pargne;
les revenus professionnels ou de remplacement, provenant d'une activit professionnelle
de salari ou d'indpendant, ou encore d'indemnits (chmage, mutuelle, ...) ou de
pensions;
les revenus divers (exemple le plus courant : les rentes alimentaires).
Notre systme d'impt sur le revenu des personnes est bas sur quatre grands principes:
la PROGRESSIVITE de l'impt;
la GLOBALISATION des revenus;
la PERCEPTION par voie de PRECOMPTES;
la PERSONNALISATION de l'impt.
153
a) La PROGRESSIVITE de l'impt: plus le revenu d'une personne est lev, plus elle paie
proportionnellement d'impts.
b) La GLOBALISATION signifie qu'en principe, Tous les revenus de la personne, quelle que
soit leur origine, sont pris en compte. Ainsi, un salari, travaillant pour un patron, et tant
indpendant aprs ses heures, se verra additionner la fois son salaire et ses bnfices en
vue de la taxation; de mme; s'il possde une maison, le revenu de cet immeuble sera
additionn aux deux premiers.
Exception ce principe : les revenus mobiliers et divers, taxs le plus souvent des taux
particuliers.
c) La PERCEPTION par voie de PRECOMPTES se situe dans la logique de l'organisation du
systme.
Ainsi, le calcul de l'impt sur les revenus de l'anne n (ex : 2000) ne sera tabli qu'en n+1
(ex.: 2001); pour viter une perte d'argent ltat, et galement pour viter au contribuable
de mauvaises surprises en fin d'anne, ce dernier est tenu de payer une AVANCE d'impt,
appele PRECOMPTE (ou VERSEMENT ANTICIPE dans le cas des indpendants).
Lorsque l'administration calculera l'impt dfinitif, elle dduira de celui-ci les prcomptes,
pour trouver le solde que le contribuable doit payer (ou recevoir !).
d) La PERSONNALISATION de l'impt signifie que lors du calcul de l'impt, il est tenu
compte de la situation personnelle et familiale du contribuable; ainsi, des diminutions d'impt
son consenties aux mnages un seul revenu, aux chmeurs, aux retraits, aux invalides,
aux contribuables ayant des personnes charges, ...
15.3 La dclaration.
Le contribuable est tenu de dposer l'Administration une dclaration d'impt qui lui est en
principe fournie par l'Administration, dans le courant du 2 trimestre de l'anne.
Toutefois, si tel n'est pas le cas, le contribuable doit le rclamer au plus tard le 1er juin.
La dclaration doit rentrer au Contrle pour la date prvue, (mentionne sur le document), la
limite que se fixe l'administration tant en gnral le 30 juin. Le directeur rgional peut
accorder des dlais. La dclaration doit tre certifie exacte, date et signe (chacun des
poux doit signer).
L'absence de dclaration, ou le dpt d'une dclaration entache d'un vice de forme
(incomplte, non signe, ...) peut entraner la taxation d'office.
Le formulaire de dclaration comporte 2 parties:
la partie I, destine tous les contribuables;
la partie II, destine aux indpendants, aux dirigeants d'entreprise (administrateurs et
grants de socits), et aux titulaires de professions librales.
Chaque mnage doit rentrer une dclaration. Un mnage peut tre compos d'une personne
isole, ou d'un couple mari, avec ou sans enfant(s) charge, ou encore, par exemple d'un
154
divorc avec enfant. Par contre, deux personnes vivant en concubinage devront remplir deux
dclarations distinctes.
Une notion importante dans ce contexte est celle de personne charge.
Peuvent tre personne charge du contribuable:
les ascendants directs et ceux de son conjoint;
les descendants directs et ceux de son conjoint;
les enfants (totalement ou principalement charge);
les collatraux jusqu'au 2` degr;
les personnes qui ont eu prcdemment le contribuable charge, condition:
de faire partie du mnage du contribuable au 1/1;
de ne pas disposer de ressources nettes imposables suprieures 1.884 ;
de ne pas avoir peru de revenus qui constituent une charge pour le contribuable.
Le contribuable bnficie, pour les personnes charge, de rductions d'impt.
Comment remplir la dclaration?
En mme temps que votre dclaration fiscale, vous recevez un document prparatoire la
dclaration qui sert de brouillon.
Par scurit, remplissez tout d'abord ce document en vous aidant ventuellement de la
brochure jointe intitule "Explications - Pour vous aider remplir la partie 1 de votre
dclaration limpt des personnes physiques".
Depuis cet exercice d'imposition (2009), la dclaration officielle ne comporte plus de codes
pr-imprims. Vous devez donc reporter vous-mmes les codes 4 chiffres, suivi du nombre
de contrle deux chiffres et enfin ct le montant dclarer (qui doit tre align
droite; les deux dernires cases servant uniquement aux centimes).
Si pas de centimes, inscrire "00"
Si vous devez inscrire un "pourcentage", alignez-le droite; les deux dernires cases
servant uniquement aux centimes. Si vous devez indiquer un pourcentage rond (sans
centimes), inscrivez "00" dans les deux dernires cases.
Lorsque vous devez inscrire un nombre, alignez-le droite, en laissant les deux cases aprs
la virgule vides.
155
Pour inscrire une "date", vous devez l'aligner droite mais sans utiliser les deux espaces
aprs la virgule et dans le format JJMMAAAA (J=Jour; M=Mois; A=Anne)
Lorsque vous devez cocher une case, inscrivez une croix (X) dans la case gauche de la
virgule, en laissant les deux cases prvues pour les centimes vides.
Les parties rserves aux informations complmentaires (sous forme de texte) se trouvent
sur la quatrime face de la dclaration. Celles-ci sont classes par cadre.
Vrifier que vos donnes personnelles (en premire page) sont toujours correctes. Il est
possible de les modifier dans les cases prvues cet effet.
Datez et signez la dclaration dans les espaces prvus. Si vous compltez une dclaration
commune, vous devez signer chacun le formulaire.
Le document prparatoire (partie 1) est subdivis en douze cadres. Les cadres I et II doivent
tre remplis par tout le monde; ils concernent respectivement des renseignements d'ordre
gnral; tels que modification ou premire communication de votre compte bancaire et
renseignements d'ordre personnel et charges de famille.
Les autres cadres sont remplir selon votre situation; ils correspondent :
Cadre III: Revenus de biens immobiliers
Cadre IV: Traitements, salaires, allocations de
chmage, indemnits lgales de maladie-
invalidit, revenus de remplacement et
prpensions
Cadre V: Pensions
Cadre VI: Rentes alimentaires perues
Cadre VII: Pertes antrieures et dpenses dductibles
Cadre VIII: Intrts et amortissements en capital
d'emprunts et primes d'assurance-vie
individuelles donnant droit un avantage
fiscal
Cadre IX: Dpenses donnant droit des rductions
d'impt
Cadre X: Crdit d'impt pour l'acquisition d'actions
du Fonds Arkimedes
Cadre XI: Versements anticips relatifs l'exercice
d'imposition 2009
Cadre XII: Comptes l'tranger
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
15.4 Taxation par prcomptes
15.4.1 Le revenu cadastral
Le revenu cadastral est un revenu forfaitaire fix par l'Administration du cadastre, de
l'enregistrement et des domaines (Secteur Cadastre). Le revenu cadastral (R.C.) constitue la
base pour la perception du prcompte immobilier et pour la dtermination des revenus
immobiliers imposables l'Impt des Personnes Physiques.
Tout propritaire d'immeuble est suppos bnficier d'un revenu. Ce revenu n'est pas ais
valuer;
Pour contourner cette difficult, l'administration fixe elle-mme les revenus immobiliers: c'est
le REVENU CADASTRAL (R.C.).
Le R.C. est le revenu moyen normal net qu'un immeuble procure son propritaire au cours
d'une anne, c.--d. la valeur locative moyenne du bien immeuble l'poque de rfrence.
Nette, parce que la valeur locative brute est diminue des charges fixes forfaitairement
40% pour un immeuble bti et 10% pour un immeuble non bti.
Pour quelqu'un qui va habiter sa propre maison, on ne peut pas parler de prix de location. Le
R.C. de l'habitation sera alors fix en comparant celle-ci un ensemble d'immeubles de
rfrence. Les RC sont indexs chaque anne.
15.4.2 Le revenu cadastral index
Depuis la loi du 28/12/1990 le revenu cadastral (R.C.) pris en considration notamment en
matire d'enrlement du prcompte immobilier et pour votre dclaration d'impt est le revenu
cadastral adapt l'indice des prix la consommation, c.--d. le revenu cadastral index.
Cette adaptation est ralise l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne
des indices des prix de l'anne qui prcde celle des revenus par la moyenne des indices de
prix des annes 1988 et 1989.
A CHAQUE IMMEUBLE CORRESPOND UN REVENU CADASTRAL
Tout propritaire d'immeuble va devoir chaque anne acquitter un impt appel
PRECOMPTE IMMOBILIER, qui se calcule en pourcentage du revenu cadastral, et rsulte
de l'addition de trois taux:
le taux fix par la RGION (1,25 % en Wallonie);
le taux fix par la PROVINCE (17,375 % Namur);
le taux fix par la cote (36,25 % Namur).
Ainsi, le propritaire d'un bungalow sis Namur, et dont le RC index est de 1.240 , paiera
un prcompte immobilier de 1.240 * 54.875%, soit 680,15 . Si ce propritaire a des enfants
charge, il pourra obtenir une rduction.
Le prcompte est en principe une avance sur l'impt d; ce n'est toutefois pas le cas du
prcompte immobilier, qui est confisqu par les pouvoirs publics autres que l'tat
fdral. C'est pourquoi le propritaire subira, ultrieurement et via sa dclaration fiscale, un
second impt au profit de l'tat.
166
Ainsi que nous l'avons soulign plus haut, la dclaration relative un exercice fiscal
concerne les revenus de l'anne prcdente. L'tat ne pouvant attendre un an (ou plus) ses
recettes fiscales, il va donc faire payer au contribuable des avances d'impt, dnommes
PRCOMPTES d'une part, VERSEMENTS ANTICIPES d'autre part.
15.4.3 Le prcompte immobilier
Le prcompte immobilier est un impt rgional sur les biens immobiliers situs en Belgique.
Cet impt est calcul un taux du revenu cadastral index. Ce taux diffre en fonction de la
situation de l'immeuble.
Le taux du prcompte immobilier comprend le taux de base et les additionnels provinciaux et
communaux.
Ce sont les Rgions qui sont comptentes pour modifier le taux de base et les exonrations
en matire de prcompte immobilier. En Rgion bruxelloise, le taux de base est fix
1,25%, un taux quivalent s'appliquant par ailleurs au matriel et outillage.
Ces taux sont majorer dans chacun des cas des centimes additionnels provinciaux et
communaux. Ainsi, si le taux de base est de 1,25%, 3.000 centimes additionnels gnreront
un taux complmentaire de 37,5% : le taux global du prcompte immobilier sera donc de
38,75%.
Le montant des centimes additionnels exig peut varier chaque anne de commune
commune et de province province, car il est fix tous les ans par les conseils communaux
et provinciaux.
Le prcompte immobilier est d chaque anne pour une priode imposable allant du 1er
janvier au 31 dcembre par :
le propritaire (personne qui le bien appartient) ;
lusufruitier (personne qui a le droit de disposer dun bien comme sil en tait
propritaire et den recueillir les fruits, condition de conserver ce bien en bon tat) ;
lemphytote (personne qui prend un bail long terme 27 99 ans) ;
167
le superficiaire (personne qui a le droit driger, suite un acte enregistr, des
btiments, des constructions ou des plantations sur un terrain appartenant une
autre personne) ;
le possesseur (personne qui se comporte comme le propritaire du bien et en
recueille les fruits, quil soit de bonne ou de mauvaise foi).
Le prcompte immobilier ne peut jamais tre mis charge du locataire.
Le prcompte immobilier est gal un pourcentage (taux) du revenu cadastral index du
bien immeuble. Ce pourcentage varie en fonction de la Rgion, de la province et de la
commune o se situe le bien.
Pour avoir droit la rduction pour enfants charge, vous devez, au 1er janvier de l'exercice
d'imposition, avoir au moins 2 enfants en vie dont l'un au moins est encore votre charge.
L'occupant (propritaire ou locataire) obtient une rduction de 125 euros pour chaque enfant
non handicap charge.
Pour avoir droit la rduction pour personnes handicapes charge, vous devez, au 1er
janvier de l'exercice d'imposition, avoir votre charge une personne handicape qui est
atteinte 66% au moins d'une insuffisance ou diminution de capacit physique ou psychique
du chef d'une ou plusieurs affections, constates avant l'ge de 65 ans.
L'occupant (propritaire ou locataire) obtient une rduction de 250 euros pour chaque
personne handicape charge, y compris le conjoint ou le cohabitant lgal.
15.4.4 Prcompte mobilier
Un revenu mobilier est celui que procure le placement de capitaux ou la location de biens
mobiliers:
intrts sur comptes bancaires, obligations, fonds publics; dividendes d'actions ou de parts
dans des socits (SPRL, SA, SCRL, ...)
Les contribuables n'apprcient en gnral pas l'impt sur les fruits de leur pargne, d'autant
plus que cette pargne rsulte normalement d'un revenu professionnel dj tax. Ils vont
donc user de "ficelles", lgales ou non, afin d'viter l'impt:
placement l'tranger, dans des "paradis fiscaux" (lgal; ce qui est illgal, c'est "d'oublier"
de dclarer les intrts !);
recours des produits bancaires, belges ou trangers, ne produisant pas de revenus
taxables (lgal =* SICAV).
Le systme actuel est le suivant : le bnfice d'un revenu mobilier peru en Belgique se voit
impos, lors du paiement d'un PRECOMPTE MOBILIER de
15 % sur les titres revenus fixes (comptes bancaires, obligations, bons de caisse, ...);
25 % sur les dividendes.
Ce PRM est libratoire, cela signifie qu'une fois qu'il l'a acquitt, le contribuable n'est plus
tenu de dclarer les revenus concerns (On parle de revenu dclaration facultative; le
contribuable peut les dclarer; en pratique il est conseill de ne pas le faire, sauf bien sr si
le contribuable y a avantage; ce sera le cas si son taux moyen d'imposition est infrieur au
168
taux du prcompte). Par contre le contribuable doit dclarer tous les revenus qui n'ont pas
subi le PRM. Signalons enfin que les livrets d'pargne bnficient d'une immunisation sur
1.730 d'intrts calculer par mnage.
15.4.5 Prcompte professionnel
Toute personne qui travaille sous contrat d'emploi peroit un salaire, en gnral calcul
selon des barmes fixs par les conventions collectives de travail (CCT). Par salaire, il faut
entendre:
la rmunration brute normale;
les primes, le pcule de vacances;
les avantages en nature (ex. : voiture de socit utilise titre priv);
Sur le salaire brut est d'abord prleve une cotisation de scurit sociale, actuellement
13.07%. Le solde constitue le brut imposable, sur lequel l'employeur va prlever au bnfice
du fisc un PRECOMPTE PROFESSIONNEL. Ce prcompte dpend du montant du revenu
et du nombre d'enfants charge que supporte le travailleur.
Afin de remplir sa dclaration fiscale, le contribuable recevra de son employeur une fiche
281.10, reprenant l'ensemble de ses rmunrations et de ses prcomptes pour l'anne.
Les dirigeants d'entreprise (grants, administrateurs) sont galement soumis au PP.
15.4.6 Impact des prcomptes
En attente de l'impt global, les diffrents revenus sont assujettis des prcomptes,
imputables sur l'impt dfinitif.
15.4.6.1 Prcompte immobilier
Indexation du revenu cadastral
La non rvaluation priodique gnrale des revenus cadastraux par le biais d'une
prquation gnrale a t compense, dans une certaine mesure, pour le trsor public par
l'indexation des revenus cadastraux partir de l'anne de revenus 1991.
Cette indexation s'opre en multipliant le revenu cadastral par un coefficient. Aprs
application de ce coefficient, on arrondit la centaine suprieure ou infrieure selon que le
chiffre des dizaines atteint cinq ou non. Le revenu cadastral index s'applique aussi bien au
calcul de l'impt des personnes physiques qu'au calcul du prcompte immobilier.
Pour l'exercice d'imposition 2010, le coefficient d'indexation du revenu cadastral s'lve
1,5461.
Revalorisation du revenu cadastral
Lorsquun dirigeant dentreprise donne un immeuble bti (dont il est propritaire, possesseur,
emphytote, superficiaire ou usufruitier) en location sa socit ou association, le revenu
locatif quil peroit est requalifi en un revenu professionnel si ce revenu locatif excde 5/3
du revenu cadastral revaloris.
Le coefficient de revalorisation du revenu cadastral pour lexercice dimposition 2011 est fix
3,87.
169
Le taux du prcompte immobilier s'lve 1,25% du revenu cadastral pour les biens
immobiliers situs en Rgion wallonne et en Rgion de Bruxelles -Capitale (0,8% pour les
habitations sociales). Pour les biens situs en Rgion flamande, il est de 2,5% (1,6% pour
les habitations sociales).
Globalement le prcompte immobilier atteint en moyenne 30 40% du revenu cadastral. A
ct des cas de remise ou de rduction de prcompte immobilier en raison entre autres d'un
revenu cadastral infrieur 743,68 (non-index) ou d'enfants charge, il existe dans les
diffrentes rgions un rgime spcifique pour ce qui concerne la possibilit de rduction en
fonction de l'improductivit des biens immobiliers.
15.4.6.2 Prcompte mobilier
Le prcompte mobilier est un pourcentage qui est retenu sur le Revenu mobilier.
Il existe une exonration du prcompte mobilier pour la premire tranche des revenus de
carnets de dpt.
Pour les personnes physiques, le prcompte mobilier est libratoire c'est--dire que le
contribuable n'est plus tenu de mentionner ses revenus mobiliers dans sa dclaration fiscale.
Le taux de prcompte mobilier appliqu sur le revenu mobilier diffre en fonction de la
source.
Le taux de prcompte mobilier appliqu sur les intrts est de :
* 15% pour les intrts de titres mis depuis le 1er mars 1990
* 25* pour les intrts de titres mis avant le 1er mars 1990
Le taux de prcompte mobilier appliqu sur les dividendes est de :
* 15% pour les actions ou parts mises par appel public l'pargne partir du 1er janvier
1994
* 15% pour les actions ou parts mises partir du 1er janvier 1994 la suite d'apports en
capitaux et qui, depuis leur mission, ont fait l'objet soit d'une inscription nominative chez
l'metteur, soit d'un dpt dcouvert auprs d'un intermdiaire financier
* 25% pour les autres actions et parts
* 10% pour les boni de liquidation
Le prcompte mobilier est libratoire depuis le 1.1.1984 tant entendu que le contribuable
peut toujours, nonobstant ce caractre libratoire, dclarer ses revenus l'impt des
personnes physiques pour bnficier d'un ventuel rgime plus favorable.
15.4.6.3 Prcompte professionnel
Celui-ci est prlev sur les traitements, salaires, rentes, pensions, etc....Il est calcul,
nonobstant qu'il s'agisse de rmunrations mensuelles ou de pensions, en 4 tapes :
dtermination du revenu annuel brut;
conversion du revenu annuel brut en revenu annuel net;
calcul de l'impt annuel;
calcul du prcompte professionnel (sur un impt annuel augment de 6% pour les taxes
communales et d'agglomration, et de 2% pour l'impt complmentaire de crise)
170
Depuis le 1er fvrier 1999, le prcompte professionnel est d :
par les personnes physiques ou morales rsidants en Belgique et qui versent des
rmunrations, pensions, rentes ou allocations, indpendamment qu'elles soient payes
ou accordes en Belgique ou l'tranger;
par les non-rsidents qui versent des rmunrations, pensions, rentes ou allocations,
indpendamment qu'elles soient payes ou accordes en Belgique ou l'tranger,
condition qu'il s'agisse de frais professionnels dductibles de leurs revenus imposables
en Belgique;
sur les rmunrations accordes ou payes l'tranger des non-rsidents par des
rsidents ou des non-rsidents;
sur les rmunrations accordes ou payes l'tranger des habitants du Royaume par
des non-rsidents;
sur les pensions, rentes et allocations accordes ou payes l'tranger des habitants
du Royaume ou des non-rsidents par des rsidants ou des non-rsidents.
Aucun prcompte professionnel nest redevable sur les rmunrations des tudiants dans le
cadre dun contrat crit de travail dtudiant, pour lequel la mise au travail durant les mois de
juillet, aot et septembre nexcde pas un mois et ce condition que pour ces rmunrations
aucune cotisation en excution de la lgislation sur la scurit sociale ne soit exigible,
except la cotisation de solidarit.
Pour les rmunrations des travailleurs salaris, le prcompte professionnel est vers par le
dbiteur des revenus imposables en fonction d'un barme align sur l'I.P.P. et tenant compte
des charges de famille et des charges professionnelles forfaitaires. On dtermine d'abord le
revenu annuel brut en dduisant les retenues effectues en excution de la lgislation
sociale ou d'un statut lgal ou rglementaire assimil. Le revenu annuel brut est ensuite
transform en revenu annuel net imposable en le diminuant des charges professionnelles
forfaitaires.
Dans une 3me tape, on dtermine l'impt de base l'aide de l'unique barme repris ci-
dessous:
Pour l'exercice d'imposition 2010 (revenus 2009, les barmes d'imposition l'impt des
personnes physiques sont les suivants :
Les premiers 7.900 25 %
De 7.900 11.240 30%
De 11.240 18.730 40%
De 18.730 34.330 45%
A partir de 34.330 50%
171
Pour rappel, avant d'effectuer le calcul de l'impt, un montant non imposable est calcul.
15.5 Les versements anticips
Les versements anticips concernent les bnfices des indpendants et ceux des socits,
ainsi que les revenus des professions librales.
Pratiquement, l'indpendant doit effectuer 4 VERSEMENTS ANTICIPES (VA) par an, et ce
pour les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 20 dcembre. Thoriquement, chaque VA doit tre
gal au quart de 109% de l'impt estim sur le bnfice de l'anne.
VA thorique =109% de l'impt estim / 4
Si l'indpendant n'effectue pas de VA, ou pas assez, il se verra pnalis. Le taux de pnalit
est gal au taux des avances de la Banque Nationale de Belgique (BNB) au 1/1, multipli par
un coefficient: 3 au 10/4, 2.5 au 10/7, 2 au 10/10 et 1.5 au 20/12.
Exemples (en )
1. Le taux de la BNB est de 6%, et le contribuable a un impt final ( 109%) de 40.000. II a
vers chaque date prvue 10.000 de VA.
taux moyen de pnalit: (18 + 15 + 12 + 9)/4 = 13.5%
pnalit pour celui qui ne verse aucun VA: 40.000 * 13.5% = 5.400
Chaque versement annule la pnalit, donc:
10/4: 10.000 * 18% = 1800
10/7: 10.000 * 15% = 1500
10/10: 10.000 * 12% = 1200
20/ 12: 10.000 * 9% = 900
TOTAUX 40.000 5400
Le contribuable a bien pay les 40.000 et a annul la pnalit de 5400
2. Mme exemple, mais le contribuable a effectu les versements suivants:
10/4: 8.000 * 18% = 1440
10/7: 8.000 * 15% = 1200
10/10: 10.000 * 12% = 1200
20/12: 10.000 * 9% = 900
TOTAUX 36.000 4740
Le contribuable a pay trop peu (4.000 ); son dcompte va donc s'tablir comme suit:
impt: 40.000 - 36.000 = 4000
pnalit: (5400 - 4740) * 90% = 594
A payer 4594
Diverses stratgies sont possibles, compte tenu du fait que lorsque le contribuable verse
trop, il peut bnficier de bonifications. Les exemples ci-dessus montre l'importance
d'effectuer les VA. Notez que les indpendants en premire installation sont dispenss de
VA pendant 3 ans.
15.6 Schma gnral d'imposition
15.6.1 Revenus immobiliers
Les revenus immobiliers sont les revenus qui proviennent de biens immobiliers.
Vous devez, pour chaque bien immobilier, dclarer le revenu cadastral (R.C.) qui lui a t
attribu.
172
Les revenus de biens immobiliers doivent tre dclars par:
* le propritaire;
* le possesseur;
* l'emphytote;
* le superficiaire;
* l'usufruitier;
Par contre, le nu-propritaire d'un immeuble ne doit pas le dclarer.
Montant imposable :
Le revenu cadastral (R.C.) est un lment important pour la dtermination de limpt d sur
les revenus immobiliers ; il est cens reprsenter le revenu moyen normal net de limmeuble
aux prix de lanne ayant servi de rfrence.
Dans le cas de la maison dhabitation, le revenu imposable est le revenu cadastral index,
mais il est gnralement diminu dune dduction pour habitation.
La base imposable est constitue du revenu cadastral index major de 40 % lorsquil sagit
dimmeubles :
qui ne sont pas donns en location (autres que la maison dhabitation) ;
qui sont donns en location des personnes physiques qui ne les affectent pas
lexercice dune activit professionnelle ;
qui sont donns en location des personnes morales qui ne sont pas des socits en
vue de les mettre disposition soit dune personne physique pour occupation
exclusivement des fins dhabitation.
Lorsque limmeuble est affect totalement ou partiellement par le propritaire lexercice de
son activit professionnelle, le revenu cadastral correspondant nest pas imposable en tant
que revenu immobilier : il est cens tre compris dans les revenus de lactivit
professionnelle.
Des exonrations et rductions du revenu cadastral sont accordes dans certains cas
Si un contribuable ou un occupant, ne poursuivant aucun but de lucre, affecte, soit
l'exercice public d'un culte ou de lassistance morale laque, soit l'enseignement, soit
l'installation d'hpitaux, d'hospices, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de
homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnes, ou d'autres oeuvres analogues
de bienfaisance.
Le revenu cadastral est rduit dans une mesure proportionnelle la dure et l'importance
de l'inoccupation, de l'inactivit ou de l'improductivit de revenus;
lorsqu'un bien immobilier bti, non meubl, est rest totalement inoccup et improductif
de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant de l'anne :
173
dans le cas o la totalit du matriel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci
reprsentant au moins 25% de leur revenu cadastral est reste inactive pendant au
moins 90 jours dans le courant de l'anne;
dans le cas o la totalit soit d'un bien immobilier bti, soit du matriel et de l'outillage, ou
une partie de ceux-ci reprsentant au moins 25% de leur revenu cadastral, est dtruite.
Le contribuable est tenu de dclarer les revenus de ses diffrentes proprits; la
dtermination de la base taxable dpend de l'affectation de celles ci :
a) l'habitation propre du contribuable
dclarer : RC
Base taxable : le propritaire occupant bnficie d'un abattement, qui a pour effet de
ramener, dans de nombreux cas, la base taxable 0.
b) les locaux professionnels propres du contribuable
A dclarer : RC
Base taxable : nulle
c) les immeubles lous titre priv (ou 2de rsidence)
dclarer : RC
Base taxable : RC index * 1,40
d) les immeubles lous titre professionnel
A dclarer : RC et loyer brut
Base taxable : le loyer moins les charges, savoir le plus petit des montants suivants : -
loyer * 40
RC*2/3*3,15 Les intrts hypothcaires sont dductibles des revenus immobiliers
imposables.
15.6.2 Revenus mobiliers
En rgle gnrale les dividendes, revenus de bons de caisse, dpts d'argent, obligations et
autres titres revenu fixe subissent le prcompte mobilier lors de leur encaissement : de tels
revenus ne doivent pas ncessairement tre dclars.
Doivent tre dclars :
les revenus d'origine trangre qui ont t directement perus l'tranger;
les revenus des livrets d'pargne ordinaire
les revenus de capitaux affects dans des socits coopratives agrs ainsi que les
revenus allous ou attribus par des socits finalit sociale
les autres revenus qui ne sont pas soumis au prcompte tels que les revenus des rentes
viagres ou des rentes temporaires.
Le contribuable n'est pas oblig de dclarer les revenus mobiliers qui ont subi la retenue du
prcompte mobilier libratoire. Par contre, il est tenu de dclarer les autres (donc, y compris
174
les revenus perus l'tranger); ceux-ci seront en principe taxs distinctement, soit 15 %,
soit 25 %.
15.6.3 Revenus professionnels
Les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement,
d'activits de toute nature, savoir :
les bnfices;
les rmunrations;
les profits;
les bnfices ou profits d'une activit professionnelle antrieure;
les pensions, rentes et allocations en tenant lieu.
Les rmunrations.
Seule subsiste une distinction entre :
les rmunrations des travailleurs;
les rmunrations des dirigeants d'entreprise.
Les rmunrations des travailleurs
sont toutes rtributions des personnes tombant sous la lgislation relative aux contrats de
louage de travail ou sous un statut lgal ou rglementaire analogue.
Si, en rgle gnrale, les revenus de remplacement sont imposables, certains transferts
sociaux sont exonrs. Il s'agit du minimex, des allocations familiales lgales, des allocations
de naissance et des primes d'adoption lgales, des allocations qui sont octroyes aux
handicaps charge du Trsor et en excution de la lgislation y relative, des pensions de
guerre.
Les allocations mensuelles octroyes des indpendants faillis et insolvables dans le cadre
de l'assurance sociale en cas de faillite, sont imposables au titre de revenus de
remplacement4.
Les rmunrations des dirigeants dentreprise :
sont celles alloues out attribues une personne physique qui :
exerce un mandat dadministrateur, de grant, de liquidateur ou des fonctions analogues
exerce au sein de la socit une activit ou une fonction dirigeante de gestion
journalire, dordre commercial, technique ou financier, en dehors dun contrat de travail.
175
Les revenus qui sont imposables titre de rmunrations de dirigeant d'entreprise,
comprennent notamment :
les tantimes, jetons de prsence, moluments et toutes autres sommes fixes ou
variables alloues par des socits,
les rmunrations proprement dites, les indemnits et les avantages de toute nature;
La base taxable des revenus d'indpendant est obtenue comme suit:
A titre de frais professionnels sont dductibles les frais que le contribuable a faits ou
supports durant la priode imposable en vue d'acqurir ou de conserver des revenus
imposables et dont il justifie la ralit et le montant au moyen de documents probants, ou,
quand cela n'est pas possible, par tous les moyens de preuve admis par le droit commun,
sauf le serment.
Toutefois, certaines dpenses ne sont pas admises
Totalement : impts, amendes, vtements non spcifiques; 25 % : frais de voiture (sauf
carburants et intrts;
50 % : frais de restaurant, de rception et de cadeaux d'affaires (liste non exhaustive)
L'indpendant pourra attribuer un maximum de 30 % de ses revenus professionnels son
conjoint aidant, pour autant que celui-ci ait effectivement aid et n'ait pas bnfici de
revenus professionnels propres > 9.741 .
Dpenses dductibles
Sont dductibles des revenus du contribuable (liste non exhaustive)
a) les rentes alimentaires verses, raison de 80 % de leur montant;
b) b) les libralits attribues des organismes agrs;
c) les frais de garde des enfants de moins de 3 ans, raison de 80 % de leur montant, avec
une limite de 11 /jour.
15.6.4 Avantages en nature
Les rmunrations comprennent galement les avantages de toute nature obtenus en raison
ou l'occasion de l'exercice de l'activit professionnelle.
Les travailleurs sont donc notamment imposables sur les avantages en nature qu'ils
reoivent de leur employeur. Constituent notamment des avantages imposables, la
disposition gratuite d'une habitation, la fourniture gratuite de chauffage, de l'lectricit et de
vtements, les prts avantageux, l'utilisation gratuite d'un vhicule..
Titres repas
Depuis le 1er avril 1998, les titres -repas sont considrs comme des avantages sociaux
exonrs dans le chef du travailleur dans la mesure o certaines conditions sont remplies.
176
Utilisation dune voiture de socit
Depuis le 1er janvier 1995, lutilisation dune voiture de socit est imposable mme lorsque
le bnficiaire verse une indemnit correspondant au cot rel de la voiture utilise. Le
calcul de cet avantage rsulte de la multiplication du nombre de kilomtres rellement
parcourus (dplacement domicile-lieu de travail et autres dplacements) par le forfait
correspondant (0,15 au km). Si le nombre de kilomtres annuellement parcourus est
infrieur 5000, on considre nanmoins quun minimum de 5000 kilomtres servira de
base au calcul de lavantage de toute nature.
Prts hypothcaires
Pour les prts hypothcaires taux fixe conclus en 2000, le taux de rfrence est fix 5,75
% pour le calcul de lavantage de toute nature rsultant de ces prts bon march, lorsque le
prt est assorti dune assurance mixte et 6,5%. Pour les prts taux variable, il y a lieu de
consulter les index de rfrence qui sont publis la fin de chaque mois au moniteur belge
15.6.5 Les profits
Les profits sont tous les revenus d'une profession librale, charge ou office et tous les
revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considrs comme des bnfices ou des
rmunrations.
Bnfices et profits d'une activit professionnelle antrieure
revenus obtenus ou constats en raison ou l'occasion de la cessation complte et
dfinitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession librale,
revenus qui sont obtenus ou constats postrieurement la cessation et qui proviennent
de l'activit professionnelle antrieure ;
pensions, rentes et allocations en tenant lieu
15.7 Revenus imposables distinctement
Certains revenus professionnels doivent tre mentionns sparment par le travailleur parce
qu'ils sont imposs un taux spcial. Il s'agit :
du pcule de vacances anticip (qui sera soumis au taux affrent lensemble des
autres revenus imposables)
des arrirs de rmunrations dont le paiement tardif est d aux pouvoirs publics ou
l'existence d'un litige
des bnfices ou profits d'une activit professionnelle antrieure
Revenus exonrs.
177
La loi numre une srie d'allocations et d'indemnits qui sont exonres vu leur caractre
social ou culturel.
Des allocations de naissances, allocations familiales et primes dadoption lgales lesquelles
sont totalement exonres. Sous certaines conditions, les titres-repas. D'autres lments
sont partiellement exonrs, notamment les indemnits alloues aux travailleurs en
remboursement de leurs frais de dplacement.
15.8 Dpenses donnant droit rduction d'impt
Certaines dpenses donnent droit des rductions d'impt, calcules soit au taux marginal,
dans le cas de certains prts hypothcaires, soit au taux moyen spcial. Ce dernier se dfinit
comme le rapport entre l'impt dEtat, calcul sans tenir compte des personnes charge, et
le revenu qui a servi de base au calcul.
Ces dpenses sont (liste non exhaustive)
les amortissements de prts hypothcaires (plus la prime d'assurance solde restant d),
avec un plafond pour le prt et un plafond absolu pour la base de la dduction;
les primes d'assurance vie, avec un maximum pour la base de la dduction, en outre, le
cumul des remboursements de prt hypothcaire et des primes d'assurance-vie ne peut
excder ce mme plafond;
les montants verss dans le cadre de l'pargne pension avec un maximum
les intrts de prts hypothcaires, dans la. mesure o ils excdent la partie utilise en
dduction des revenus immobiliers, et uniquement dans le cas de construction neuve ou
de rnovation lourde.
Tout contribuable a droit une quotit du revenu exempte d'impt. Ce montant varie en
fonction de la situation familiale de celui-ci. Cette exemption est calcule sur les tranches de
revenus les plus bas, commencer par celle de 25%, puis de 30% et ainsi de suite.
Une premire tranche de revenus est exonre dimpt. A partir de lanne 2004 (exercice
dimposition 2005), la tranche de revenus exonre dimpt est identique pour les isols et
pour les conjoints.
A compter de lexercice dimposition 2005, les cohabitants lgaux sont totalement assimils
aux contribuables maris sur le plan de limpt des personnes physiques
Les intrts notionnels
Dduction pour capital risque ou "intrts notionnels":
La dduction fiscale pour capital risque est une dduction dintrts fictifs (dits intrts
notionnels) calculs sur base des fonds propres dune socit et qui peuvent tre dduits de
faon plafonne de la base imposable de celle-ci.
Objectifs recherchs:
Rduire la discrimination entre le financement des socits par fonds de tiers et le
financement par fonds propres: une entreprise qui se finance par crdits bancaires peut
dduire de sa base taxable les intrts lis ce type de financement mais par contre une
178
entreprise qui se finance grce ses fonds propres na pas la possibilit de dduire de sa
base taxable ce qu'elle reverse ses actionnaires.
Soutenir les centres de dcisions et les centres de coordination en Belgique en leur offrant
une mesure fiscale favorisant leurs rsultats, de manire les retenir sur le territoire belge.
On dduit de la base imposable de l'impt des socits un montant quivalent une
rentabilit fictive des capitaux propres.
Le pourcentage de la dduction sera fix chaque anne en fonction du taux des obligations
linaires long terme de lEtat belge, avec un plafond de 6,5 % (7 % pour les petites
socits qui bnficient dun taux augment de 0,50 %).
15.8.1 Frais professionnels
Charges professionnelles forfaitaires exercice 2011 revenus anne 2010
* tranche de 0 5190 28,7% du revenu
* tranche de 5190 10310 10% du revenu
* tranche de 10310 17170 5% du revenu
* au-del de 17170 3% du revenu
Plafond des charges professionnelles forfaitaires : 3.590 .
De plus, un complment de charges professionnelles forfaitaires peut tre accord
uniquement au travailleur pour lequel, au 1er janvier, la distance entre son domicile et son
lieu de travail est dau moins 75 kilomtres.
Pour une distance du domicile au lieu de travail de 75 100 km, le forfait complmentaire
slve 75 .
Si elle est de 101 125 km, le forfait complmentaire slve 125 .
Si elle est suprieure 125 km, le forfait complmentaire est de 175 .
Pour les rmunrations des dirigeants dentreprise et des conjoints aidants, des charges
forfaitaires sont accordes concurrence de 3 % de la base de calcul (3 % du montant brut
des revenus diminu des cotisations dues en excution de la lgislation sociale), avec un
maximum de 2.150 pour lexercice dimposition 2011 (revenus de 2010).
Les frais professionnels dductibles sont
Les rmunrations du personnel
y compris les charges y affrentes (charges sociales, cotisations patronales..), dans le chef
de l'employeur. Sont considres comme frais professionnels, les cotisations patronales
verses dans le cadre de l'assurance complmentaire contre la vieillesse et le dcs.
Les primes d'assurance
179
contre les risques divers que le contribuable encourt dans l'exercice de sa profession (
l'exclusion de primes d'assurance qui couvrent l'assur uniquement contre les accidents
corporels).
Les loyers et des charges locatives
affrents aux immeubles ou parties d'immeubles affects l'exercice de l'activit
professionnelle et tous les frais gnraux rsultant de leur entretien, chauffage, clairage,
etc.
Les frais "financiers"
notamment les intrts des capitaux emprunts des tiers et engags dans l'exploitation tels
que les intrts d'emprunts pays pour les versements anticips d'impt, ainsi que toutes
charges, rentes ou redevances analogues relatives l'exploitation.
Les commissions, courtages,
ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires, gratifications, rtributions ou
avantages de toute nature qui, pour les bnficiaires constituent des bnfices ou des profits
caractre professionnel.
Les frais de voiture
les frais de voiture, l'assurance, l'amortissement, l'entretien, les rparations et la taxe doivent
tre prouvs l'aide de pices justificatives, tandis que le cot du carburant peut tre
dtermin forfaitairement sur la base du kilomtrage. Ces frais professionnels relatifs
l'usage de voitures, voitures mixtes et minibus ne sont dductibles qu' concurrence de 75 %
de leur montant.
A partir du 1er janvier 2006
Nouvelle dfinition fiscale des camionnettes.
En Belgique, les vhicules principalement destins au transport de marchandises bnficient
dun rgime fiscal plus favorable que les voitures, voitures mixtes et minibus.
Lvolution technique et certaines lacunes dans le droit interne et europen ont permis
doffrir sur le march belge des vhicules qui, moyennant quelques adaptations techniques,
bnficient (comme vhicules utilitaires) dun rgime fiscal plus favorable qui ne leur est pas
destin.
Il est donc ncessaire dintroduire une dfinition fiscale.
La dfinition fiscale scarte de la dfinition technique retenue par les services comptents
du SPF Mobilit et Transport en ce qui concerne le rapport longueur de lespace de
chargement/empattement. Pour le SPF Finances, cette longueur doit atteindre au moins 50
% de lempattement, alors quelle doit atteindre 30 % pour le SPF Mobilit et Transport.
Les vhicules de type pickup seront, quelle que soit leur configuration, toujours traits
fiscalement comme des camionnettes.
Pour ce qui concerne les vhicules de type camionnette, les conditions techniques
auxquelles ils doivent satisfaire pour bnficier du traitement fiscal avantageux diffrent
selon leur configuration.
180
Pour les camionnettes cabine simple (range unique de siges) :
- lespace de chargement doit tre spar de celui rserv aux passagers par une cloison
dune hauteur minimale de 20 cm ou par le dossier de lunique range de sige.
- en outre, la longueur de cet espace de chargement, mesur dans laxe longitudinal du
vhicule, doit atteindre au moins 50 % de la longueur de lempattement et tre pourvu, sur
toute sa surface, dun plancher horizontal fixe exempt de tout point dattache pour des
banquettes, siges ou ceintures de scurit complmentaires.
Les camionnettes cabine double (deux ranges de siges):
- outre quil doit tre satisfait au rapport de 50 % plateau de chargement/empattement et la
prsence dun plancher horizontal fixe exempt de tout point dattache pour des banquettes,
siges ou ceintures de scurit complmentaires sur toute la surface de chargement,
lespace de chargement doit imprativement tre totalement spar, sur toute la largeur et
hauteur de lespace intrieur, au moyen dune cloison rigide, inamovible et indivisible, de
lespace rserv aux passagers.
La vrification des caractristiques techniques propres la dfinition fiscale des vhicules
viss sera exerce dans les stations de contrle technique o chaque vhicule utilitaire (tant
neuf que doccasion) doit tre prsent avant sa mise en circulation.
Les vhicules immatriculs comme camionnette dans la rglementation de la DIV qui ne
rpondent pas aux conditions prcites seront ds lors considrs comme des voitures
particulires et imposs fiscalement comme tels.
Les frais de dplacement du domicile au lieu de travail
depuis l'exercice d'imposition 1993, les frais de dplacement du domicile un lieu de travail
fixe effectus en voiture, sont fixs forfaitairement 0,15 (6 BEF) par kilomtre parcouru.
Seul le lieu de travail fixe est exig; l'irrgularit ventuelle qui survient lors des
dplacements est sans importance. Le forfait est galement d'application dans les cas o le
contribuable exerce son activit en deux endroits diffrents. Ce forfait ne peut tre accord
au contribuable que si le vhicule en question :
soit est sa proprit;
soit est immatricul son nom;
soit est mis sa disposition de faon permanente ou habituelle en vertu d'un contrat de
location ou de leasing;
soit appartient son employeur ou sa socit et que l'avantage ventuel dcoulant de
l'utilisation de ce vhicule est tax dans son chef.
Les amortissements
il s'agit de dprciations dues l'usure ou au caractre vtuste de l'quipement. Ces
amortissements sont considrs comme des frais professionnels dans la mesure o ils sont
bass sur la valeur d'investissement ou de revient. Ils doivent tre ncessaires et
correspondre une dprciation rellement survenue pendant la priode imposable.
L'amortissement ne peut tre appliqu quen ce qui concerne les immobilisations corporelles
telles que l'outillage (outils, mobilier,...) et les btiments professionnels, les immobilisations
incorporelles (telles que brevets, licences,...) ainsi que les frais d'tablissement.
En rgle gnrale, on considre comme normaux les pourcentages d'amortissements
suivants :
btiments commerciaux : 3%
bureaux commerciaux : 3%
181
Btiments industriels : 5%
mobilier (matriel et machines de bureau) : 10%
installations, machines et outils : 10%
matriel roulant, garage : 20%
appareil lectronique et informatique : 20%
petit outillage : 33%
Le contribuable peut, sous certaines conditions, tre autoris pratiquer le double
amortissement linaire
Il est nanmoins possible d'appliquer dans certains cas le rgime de l'amortissement
dgressif.
L'amortissement dgressif est la prise en charge d'un investissement tal sur une priode
donne de faon prendre plus en charge au dbut que la fin. L'amortissement annuel est
calcul de manire dgressive ou dcroissante en appliquant un taux fixe la valeur restant
amortir ou valeur rsiduelle.
Conditions
Vous devez expressment signifier votre choix d'amortir d'une manire dgressive
la place de linaire. Pour cela il vous faut joindre un formulaire la dclaration aux
impts sur les revenus.
La premire anne, vous amortissez en appliquant un taux fixe n'excdant pas le
double du taux d'amortissement linaire la valeur d'investissement de
l'immobilisation.
En outre, l'annuit de l'amortissement ne peut excder 40 % de la valeur
d'investissement.
Les annes suivantes, vous appliquez ce taux fixe la valeur rsiduelle, c--d. la
valeur d'investissement diminue des investissements admis jusqu' la fin de la
priode imposable antrieure.
Ds que l'annuit, calcule sur base de ce taux fixe appliqu la valeur rsiduelle,
n'excde plus l'annuit linaire, vous pouvez sans aucune formalit opter pour le
rgime linaire.
Mthode de calcul:
1
re
phase :
o La valeur de l'investissement (10.000 )
o La dure de l'amortissement (4 ans)
2
e
phase
o Le pourcentage de l'amortissement (on va amortir en quatre ans, 1 / 4 = 0,25
=> le taux de base sera donc de 25%)
o La valeur de l'amortissement = (valeur nette comptable de la priode
prcdente * le pourcentage d'amortissement*2 )
Pour la premire anne (10.000 * 0,40 = 4.000 ) ou on utilise 40% car
l'amortissement ne peut excder 40 % de la valeur d'investissement
182
Pour la deuxime anne (6.000 * 0,50 = 3.000 ) ou on utilise 50% car
double du taux d'amortissement linaire
Pour la troisime anne (10.000 * 0,25 = 2.500 ) on repasse sur base
de l'amortissement linaire car le rsultat de l'amortissement dgressif
est infrieur celui de l'amortissement linaire
Anne
Valeur comptable
au dbut de
l'exercice
Annuit
d'amortissement
Amortissements
cumuls
Valeur comptable
nette en fin
dexercice
1 10.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00
2 6.000,00 3.000,00 7.000,00 3.000,00
3 3.000,00 2.500,00 9.500,00 500,00
4 500,00 500,00 10.000,00 0,00
Avantages
Par cette mthode d'amortissement dgressif, les amortissements dductibles titre de frais
professionnels sont plus levs durant les premires priodes imposables que par la
mthode d'amortissement linaire, et la dure normale d'amortissement sera en gnrale
plus courte que la dure normale d'utilisation.
Les cotisations sociales
ce sont celles que le contribuable est tenu de verser dans le cadre du statut social des
travailleurs indpendants, telles que les cotisations pour la pension normale et
complmentaire lgale des indpendants, pour l'assurance obligatoire contre la maladie
(gros risques), pour les allocations familiales et pour l'assurance libre contre les petits
risques.
Les impts, taxes et prcomptes.
En principe les impts qui frappent les revenus imposables ne sont pas admis en frais
professionnels. Quelques exceptions drogent ce principe, notamment :
le prcompte immobilier affrent un immeuble ou partie d'immeuble affect l'exercice
de l'activit professionnelle
la taxe de circulation sur les vhicules automobiles qui sont affects l'exercice de la
profession, notamment l'Eurovignette
Les frais de restaurant, de rception et de rclame
ne sont dductibles qu' concurrence de la moiti. Exception lavantage des reprsentants
du secteur alimentaire. Lorsquils ont des frais de restaurant et quils prouvent que, dans
lexercice de leur activit professionnelle, ils sont ncessaires dans leurs relations clients -
fournisseurs, ils sont entirement dductibles en tant que frais professionnels.
Les frais de restaurant sont galement entirement dductibles lorsquils ont trait des
manifestations organises en faveur du personnel (St Nicolas, nouvel-an, nol ou une fte
patronale).
183
Les frais de rclame et de publicit, des frais de correspondance et de tlphone.
Les articles publicitaires sont intgralement dductibles, condition que :
les dpenses soient ralises pour des objets, gadgets et articles utilitaires qui en
premier lieu sont des rclames ;
quils soient destins une large diffusion (donc pas pour une catgorie limite de clients
ou de relations daffaires) ;
quils aient une faible valeur pour le bnficiaire ;
quils soient frapps de la dnomination de lentreprise.
Les frais vestimentaires relatifs aux vtements de travail rglementaires imposs ou aux
vtements spciaux obligatoires, ncessaires ou d'usage.
15.8.2 Quotient conjugal - conjoint aidant
Le quotient conjugal est destin attnuer la charge fiscale des mnages dans lesquels un
seul des conjoints bnficie de revenus professionnels.
Il consiste octroyer "fictivement" 30 % des revenus professionnels nets imposables du
conjoint qui travaille celui qui ne bnficie pas de revenus professionnels sans pouvoir
excder 9.280 pour lexercice dimposition 2010.
Attribution au conjoint aidant
Les indpendants qui sont aids par leur conjoint peuvent attribuer celui-ci une quote-part
de leur revenu professionnel.
Sont considrs comme conjoint aidant ceux qui nexercent aucune activit
professionnelle ni ne bnficie de prestations sociales ouvrant des droits propres des
prestations dans un rgime obligatoire de pension, dallocations familiales et dassurance
maladie-invalidit au moins gales celles du statut social des travailleurs indpendants.
La quote-part des revenus est attribue condition que le conjoint aide effectivement.
Elle doit correspondre la rmunration normale des prestations fournies. Elle est limite,
en principe, 30 % des revenus nets de lindpendant, sauf preuve du contraire. Les
avantages de lattribution dune quote-part au conjoint aidant tiennent la taxation spare
des revenus professionnels des poux.
Il est noter que dans ce cas, le conjoint aidant est galement redevable des versements
anticips. Lexcdent des VA de lun des conjoints est report sur lautre.
15.8.3 Dductions : limites maximales des dpenses dductibles
Les dpenses suivantes peuvent tre dduites de l'ensemble des revenus nets des
diffrentes catgories, sous certaines conditions et dans les limites fixes, dans la mesure
o elles ont t effectivement payes au cours de la priode imposable:
184
1 80% des rentes, rgulirement payes par le contribuable des personnes auxquelles il
doit des aliments conformment au Code civil ou au Code judiciaire et qui ne font pas partie
de son mnage, ainsi que 80% des capitaux tenant lieu de telles rentes;
2. 80% des rentes ou des rentes complmentaires dues par le contribuable mais qui sont
payes aprs la priode imposable au cours de laquelle elles sont dues suite une dcision
judiciaire qui en a fix ou augment le montant avec effet rtroactif;
3. Rmunration d'un employ de maison
- Montant minimum de la rmunration : 3.460
- Montant maximum de la dduction : 7.070
4. De 80 100 % des frais de garde, par enfant de moins de trois ans charge du
contribuable, la condition que la garde soit effectue par une institution agre, des
parents d'accueil indpendants ou une crche reconnue. La dduction maximale est de
11,20 par jour et par enfant de moins de 12 ans (ou 18 en cas de handicap lourd).
5.les libralits d'au moins 40,00 faites une srie d'institutions reconnues par l'Etat et
ayant un but scientifique, culturel, social ou humanitaire.
L'ensemble de ces libralits n'est toutefois dductible qu' concurrence de 500.000,00
6. les intrts d'emprunts hypothcaires contracts pour une dure minimum de 10 ans, en
vue:
soit de la construction ou de l'acquisition l'tat neuf d'une habitation sise en
Belgique constituant la seule habitation en proprit;
soit de la rnovation totale ou partielle d'une habitation sise en Belgique
7. les montants pays par des fonctionnaires au Trsor en raison d'un cumul d'activits;
Dpenses non-dductibles
1) dpenses ayant un caractre personnel : telles que le loyer et les charges locatives des
immeubles ou parties d'immeubles qui ne sont pas affects la profession, les frais
d'entretien du mnage, les frais d'instruction et les frais exposs pour la garde des enfants.
2) amendes, confiscations, pnalits; except pour les amendes proportionnelles infliges en
matire de T.V.A. (absence de paiement, paiement tardif,..)
3) avantages sociaux (il est fait exception cette rgle pour un certain nombre d'avantages
collectifs);
4) la partie des intrts qui dpasse le taux pratiqu sur le march
5) 25 % des dpenses professionnelles affrentes l'utilisation de voitures, voitures mixtes
et minibus, l'exception de celles affrentes la consommation de carburant, aux frais de
financement d'une voiture et aux frais de tlphonie;
6) 50 % de la quotit professionnelle des frais de restaurant, de rception et de cadeaux
d'affaires (sauf exceptions);
7) les impts sur les revenus imposables
185
8) les intrts, redevances pour concession, de lusage de brevets dinvention, indemnits
payes pour prestations de services un holding tabli l'tranger, qui y bnficie d'un
rgime fiscal de faveur;
9) frais de vtements professionnels non spcifiques et le montant qui est rembours ce
titre des tiers;
10) toutes autres dpenses ou charges pour autant qu'elles excdent manifestement et de
manire draisonnable les besoins professionnels ou ne sont pas prouves selon la loi ;
11) la cotisation spciale de scurit sociale.
Abattement immeuble personnel
Abattement forfaitaire
Le contribuable a droit un abattement forfaitaire sur le revenu cadastral de limmeuble quil
occupe personnellement des fins dhabitation. Il slve pour lexercice dimposition 2012
4.737 major de 395 pour le conjoint et pour toute autre personne charge.
Si lensemble des revenus nets du contribuable nexcde pas 33.230 (exercice dimposition
2012), labattement forfaitaire est major de la moiti de la diffrence entre le RC de
lhabitation et labattement.
Labattement ordinaire et complmentaire ne peut excder le montant du revenu cadastral
index.
Immunisation d'intrts d'pargne
On appelle compte d'pargne ordinaire un compte qui satisfait aux conditions permettant de
bnficier d'une immunisation fiscale des intrts
Les premiers 1730 d'intrts ne sont pas soumis au prcompte mobilier de 15%. Au-del,
ils sont soumis au prcompte de 15%. Ce montant immunis augmente chaque dbut
d'anne.
Forfait kilomtrage voiture
Ces frais professionnels se montent 0,15 (forfait) par kilomtre parcouru.
Le forfait de 0,15 euros s'applique exclusivement aux dplacements effectus entre le
domicile et le lieu fixe de travail, c'est--dire le lieu o est exerce, organise, dirige ou
administre une activit professionnelle. Il peut s'agir d'un bureau, d'une usine, d'un atelier,
d'un magasin, d'un cabinet, etc.
Si vous n'effectuez pas de dplacements "domicile-lieu de travail" avec ce vhicule
d'entreprise mais uniquement des dplacements privs, le nombre minimum lgal prendre
en considration s'lve 5 000 km.
186
Frais professionnels forfaitaires.
A dfaut des preuves vises les frais professionnels sont fixs forfaitairement. Le forfait de
frais professionnels s'applique aux rmunrations des travailleurs, ainsi qu'aux profits des
titulaires de professions librales, charges, offices ou occupations lucratives. Il est cens
couvrir tous les frais professionnels de la priode imposable lexception des cotisations
sociales personnelles et des cotisations contre les petits risques qui doivent tre
pralablement dduites des revenus bruts ; il n'est pas applicable aux indemnits de
chmage, d'assurance maladie- invalidit, aux revenus de remplacement, aux pensions et
prpensions.
15.9 Dcumul des revenus professionnels pour les mnages deux revenus.
Pour les mnages dont les deux conjoints bnficient chacun d'un revenu professionnel, le
dcumul des revenus professionnels est instaur intgralement, c'est dire sans limite
aucune de revenus.
Pour pouvoir bnficier du coefficient conjugal, il est indispensable dtre considr comme
mari sur le plan fiscal. Celui qui est mari mais qui reste considr comme isol dans des
buts fiscaux, nentre pas en ligne de compte. Des poux spars de fait sont en ralit
toujours maris, mais lanne suivant la sparation relle, ils sont fiscalement considrs
comme des isols et nont donc pas droit lapplication de ce coefficient conjugal.
187
Revenus auxquels s'applique le dcumul
Le quotient conjugal est applicable uniquement en ce qui concerne les revenus
professionnels, c'est- - dire les revenus d'activits, allocations de chmage, pensions etc..
Les autres revenus du mnage (revenus de biens immobiliers, revenus des capitaux et biens
mobiliers et revenus divers) sont ajouts au revenu professionnel du conjoint qui en a le
plus.
15.10 Calcul de l'impt.
Pour calculer l'impt, il faut en principe procder aux oprations suivantes :
calculer l'impt d compte tenu du barme;
dterminer l'impt affrent la quotit du revenu exempte;
calculer l'impt rellement d en effectuant la diffrence entre ces deux montants et en
dduisant du solde les prcomptes et autres lments imputables.
Pour les conjoints, l'impt est calcul distinctement pour chacune des bases imposables.
Le barme ci-dessus ne tient pas compte de la taxe communale additionnelle, ni de la taxe
dagglomration additionnelle, ni de la contribution complmentaire de crise (CCC).
Quotits du revenu exemptes
Tout contribuable a droit une quotit du revenu exempte dimpt. Ce montant varie en
fonction de la situation familiale de celui-ci. Cette exemption est calcule sur les tranches de
revenus les plus bas, commencer par celle de 25%, puis de 30% et ainsi de suite.
A partir de lexercice dimposition 2005, lexonration tant pour les couples maris que les
isols ou les cohabitants est traite de la mme manire. Elle slve 6.430 EUR par
contribuable pour lexercice 2011.
Majorations en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticips
En cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticips dans le chef des indpendants
l'impt est major d'un certain pourcentage fix annuellement. (6,75%)
Bonification pour versement anticip de l'impt
Le contribuable qui pour quelque raison que ce soit doit payer chaque anne un supplment
d'impt, peur obtenir une bonification en effectuant des versements anticips.
Accroissements d'impt
En cas d'absence de dclaration ou de dclaration incomplte ou inexacte, des
accroissements d'impt peuvent tre appliqus :
188
soit sur l'intgralit de l'impt d aprs imputation des prcomptes, versements anticips,
rductions d'impt et bonifications;
soit sur une partie de cet impt lorsque l'infraction ne porte que sur une partie de la base
imposable.
Le taux des accroissements varie de 10 200 % en fonction de la nature et de la gravit de
l'infraction.
Impositions distinctes
La loi prvoit plusieurs exceptions au principe de la globalisation des revenus: certains
revenus doivent, en effet, tre imposs distinctement des taux d'imposition spciaux.
15.11 Impt des Socits - ISOC
Est une "socit", toute socit, association, tablissement ou organisme quelconque :
rgulirement constitu;
qui possde la personnalit juridique;
se livre une exploitation ou des oprations de caractre lucratif
Les socits rsidentes sont les socits de droit belge et de droit tranger :
qui ont en Belgique leur sige social, leur principal tablissement ou leur sige de
direction ou d'administration;
et qui ne sont pas exclues du champ d'application de l'impt des socits.
15.12 Socits assujetties l'ISOC
Les socits rsidentes sont assujetties l'impt des socits. Sont galement assujetties
l'impt des socits partir du 1er janvier 1995, les Caisses d'pargne communales vises
l'article 124 de la nouvelle loi communale.
Toutefois, sont exclus de la taxation l'impt des socits, les socits, associations,
tablissements, organismes et qui sont passibles de l'impt des personnes morales. Sont
galement exclues, les socits commerciales irrgulirement constitues, les socits
agricoles (si elles ont opt pour l'assujettissement l'impt des socits); les personnes
morales charges d'une mission particulire, les groupements d'intrt conomique et les
associations de copropritaires.
Si, en ce qui concerne l'impt des personnes physiques, la priode d'imposition correspond
toujours l'anne calendrier, en matire d'impt des socits, la priode d'imposition
189
correspond l'exercice comptable et le lien entre la priode d'imposition et l'anne
d'imposition est tablie sur base de la date laquelle l'exercice comptable est cltur.
Les ASBL ne sont pas soumises l'impt des socits, pour autant que leurs activits ne
soient pas en contradiction avec leur forme juridique. Le statut d'ASBL ne lie pas
automatiquement l'administration fiscale qui peut, si elle le juge ncessaire, soumettre le
bnfice l'impt des socits.
La loi prcise qu'un certain nombre d'oprations ne sont pas productives de bnfices :
les oprations isoles ou exceptionnelles;
les oprations qui consistent en des dpts de fonds prvus par les statuts;
les oprations qui ne relvent pas directement d'une activit industrielle ou commerciale,
mais qui sont excutes en complment des activits industrielles, commerciales ou
agricoles.
15.13 Base et calcul de l'impt
Sous rserve des drogations ci-aprs, les revenus passibles de l'impt des socits ou
immuniss dudit impt sont, quant leur nature, les mmes que ceux qui sont envisags en
matire d'impt des personnes physiques. Leur montant est dtermin d'aprs les rgles
applicables aux bnfices.
Rgime ordinaire de taxation
Le bnfice imposable est en principe dtermin sur le montant total du bnfice. Les
socits sont en principe imposables sur le montant des bnfices de l'anne comptable, c-
-d. la somme des trois composants suivants :
les bnfices rservs imposables;
les dpenses non admises,
les dividendes distribus
Revenus exonrs
Les plus-values : ct des rgles gnrales applicables aux plus-values, il y a quelques
rgles spcifiques applicables aux socits :
plus-values sur actions ou parts : sont intgralement exonres, les plus-values ralises
sur des actions dont les revenus ventuels sont susceptibles d'tre dduits des
bnfices.
plus-values exonres ou provisoirement non exonres:
immeubles non btis : contrairement l'impt des personnes physiques, les plus-values
ralises sur des immeubles non btis d'exploitations agricoles ou horticoles ne sont pas
exonres d'impt. Les plus-values ralises par les socits de crdit au logement
l'occasion de la cession d'immeubles non-btis situs en Belgique sont par contre
exonres.
190
15.14 Montants dductibles
Sont susceptibles d'tre dduits des revenus imposables :
Les dpenses professionnelles
(Notamment les appointements, charges sociales connexes, pensions) l'exclusion entre
autres des impts non-dductibles, accroissements, frais et intrts de retard concernant ces
impts.
Les lments non-imposables
les dons, l'exonration pour personnel supplmentaire affect la recherche scientifique
Les pertes professionnelles antrieures.
La dduction de toutes les pertes professionnelles antrieures est dsormais autorise sans
limite partir de l'exercice d'imposition 1998.
La dduction pour investissements
Subsides en capital
Les subsides en capital perus en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations
incorporelles ou corporelles sont soumis un rgime fiscal particulier : ces subsides ne sont
pas taxs en une fois, mais de manire tale dans le temps, proportionnellement aux
amortissements et rductions de valeur fiscalement admis sur les immobilisations
subventionnes.
15.15 Calcul de l'ISOC
Crdit d'impt.
En vue d'encourager les P.M.E. et les indpendants renforcer leurs fonds propres, un
crdit d'impt leur est attribu. A l'impt des socits, le crdit d'impt s'lve 7,5% de la
diffrence positive entre :
le capital libr en numraire la fin de la priode imposable;
et le montant le plus lev du capital libr en numraire la fin d'une priode imposable
quelconque qui a t retenu antrieurement pour dterminer l'octroi du crdit d'impt, ou
dfaut le montant le plus lev atteint par celui-ci la fin de l'une des trois priodes
imposables antrieures.
Le taux d'imposition des socits s'lve 33,99 % (en incluant la contribution
complmentaire de crise de 3 %).
Pour les socits dont le revenu imposable ne dpasse pas 322 500 euros, il existe un tarif
rduit progressif.
191
Le taux rduit est applicable lorsque le revenu imposable ne dpasse pas 322.500 . Le
taux rduit, ou plutt les taux rduits, sont les suivants :
- Sur la tranche de 0 25.000 : 24,98 %
- Sur la tranche de 25.000 90.000 : 31,93 %
- Sur la tranche de 90.000 322.500 : 35,54 %
Ces taux sont toujours soumis la contribution complmentaire de crise de 3 %.
Ces taux rduits dpendent des conditions suivantes :
- La socit ne dtient pas des participations pour plus de 50 % de son capital et de ses
rserves
- La socit nest pas dtenue par une ou plusieurs autre(s) socit(s) pour au moins
50 %
- La socit nest pas une socit cooprative agre
- La socit ne fait pas partie dun groupe auquel appartient un centre de coordination
- La socit alloue au moins un des ses dirigeants une rmunration dau moins
24.500 (la rgle du million).
Achat d'actions propres
L'achat d'actions propres consiste en le rachat par la socit de ses propres actions auprs
de ses actionnaires. La socit paie une somme contre rception de ses propres actions.
L'autorisation d'achat doit en principe obtenir l'approbation d'une majorit de 80% de l'AG
des actionnaires, mais il peut tre dcid statutairement que le Conseil d'administration
dcide de manire autonome de racheter les actions afin d'viter un prjudice.
Une socit peut au maximum retenir 10% de ses propres actions et pour l'opration d'achat
recourir seulement des moyens susceptibles d'tre verss, c'est--dire que l'actif net de
l'entreprise ne peut descendre en dessous du niveau du capital vers et des rserves non
ralisables.
15.16 Impt des personnes morales
En ce qui concerne les personnes morales, c'est--dire les ASBL et les autres personnes
morales qui ne se livrent aucune exploitation ou aucune opration de caractre lucratif, la
priode imposable concide, en matire d'impt des personnes morales, avec l'anne qui
prcde celle qui dsigne l'exercice d'imposition.
Personnes morales assujetties l'impt
Sont assujettis l'impt des personnes morales :
1 l'Etat, les Communauts, les Rgions, les Provinces, les agglomrations, les fdrations
de communes, les communes, les centres publics d'aide sociale, les centre publics
intercommunaux d'aide social et les institutions publiques ecclsiastiques;
2 les personnes morales qui, en vertu de l'article 180 du C.I.R. 1992, ne sont pas assujetties
l'impt des socits, savoir entre autres:
192
les intercommunales rgies par la loi du 22 dcembre 1986;
la "Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", la
Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, la rgie portuaire
communale d'Anvers, la rgie portuaire communale d'Ostende et les ports autonomes de
Lige, Charleroi et Namur;
l'Office national du Ducroire;
la Compagnie belge pour le Financement de l'industrie;
la Loterie nationale;
le Fonds de participation;
la Socit rgionale wallonne de transport public de personnes et les socits
d'exploitation qui lui sont lies;
la Socit flamande des Transports et les units d'exploitation autonome existant en son
sein;
la Socit des transports intercommunaux de Bruxelles;
les socits d'puration des eaux rgies par la loi du 26 mars 1971;
la socit de droit public finalit sociale coopration technique belge.
3 les personnes morales qui ont en Belgique leur sige social, leur principale installation ou
leur sige de direction et qui n'exploitent pas d'entreprise ou qui n'effectuent pas des
oprations dans un but de profit ou qui ne sont pas assujetties l'impt des socits.
Sont notamment vises, les associations d'assurances mutuelles
15.17 Base de l'impt des Personnes morales
A l'impt des personnes morales, tous les contribuables sont imposables sur :
le revenu cadastral des proprits immobilires sises en Belgique, lorsque ce revenu
cadastral n'est pas exonr du prcompte immobilier;
les revenus et produits de capitaux et biens mobiliers et certains revenus divers dont
elles ont bnfici ou dispos.
193
CHAPITRE 16 : LES AUTRES TAXES
16.1 Les droits d'accises
Les droits d'accises sont des impts indirects frappant la consommation ou l'utilisation de
certains produits, qu'ils soient fabriqus l'intrieur du pays, qu'ils soient introduits d'un Etat
membre de l'Union ou imports d'un pays tiers l'Union. On distingue les droits d'accise
(ordinaires) et les droits d'accise spciaux. L'accise totale est la somme de ces deux
catgories.
On distingue :
les accises UEBL (taux identiques en Belgique et au Luxembourg) : ce sont les droits
d'accise (ordinaires) perus sur l'alcool, la bire, le vin, les boissons fermentes
les accises propres la Belgique (accises autonomes) : les droits d'accise (ordinaires)
sur les boissons non alcoolises et le caf.
16.2 Les Ecotaxes
Les cotaxes sont des taxes assimiles aux accises, frappant un produit mis la
consommation en raison des nuisances environnementales qu'il est rput gnrer.
Deux catgories de produits, chacune ayant son propre rgime, sont soumises l'cotaxe :
les rcipients pour boissons,
les autres produits,
L'Administration des douanes et accises est charge de la perception et du contrle des
cotaxes. Tous les fabricants et producteurs de produits cotaxs, ainsi que les importateurs
et les introducteurs de produits ( partir d'un autre Etat membre de l'Union europenne) et
qui se situent au premier stade de la commercialisation doivent se faire connatre
l'Administration des douanes et accises.
En vertu de l'A.M. du 2 mai 19963, l'cotaxe est due lors de la mise la consommation des
produits, c'est--dire normalement lors de leur livraison au dtaillant.
RECIPIENTS POUR BOISSONS
Il sagit dune combinaison dun cobonus en faveur des emballages rutilisables (verre
consign, bouteille en PET) et dun prlvement sur les emballages qui ne le sont pas
(canette, verre perdu, plastique jetable). La mesure sapplique toutes les boissons (bire,
vin, alcool, eau, limonade, jus de fruits, mousseux, cidre), lexception du lait et est de 9,85
cent par litre depuis juillet 2005.
194
RECUPEL
Depuis juillet 2001, une solution est prvue pour l'obligation de reprise pour les fabricants et
importateurs dappareils lectriques et lectroniques.
Le financement des activits est assur par la cotisation Recupel paye par le
consommateur lachat dun nouvel appareil.
La Directive Europenne dfinit 10 catgories D'EEE soumises l'obligation de reprise:
1. Gros appareils mnagers
2. Petits appareils mnagers
3. quipements informatiques et de tlcommunication
4. Matriel grand public
5. Matriel d'clairage
6. Outils lectriques et lectroniques ( l'exception des gros outils industriels fixes)
7. Jouets, quipements de loisir et de sport
8. Dispositifs mdicaux ( l'exception de tous les produits implants et infects)
9. Instruments de surveillance et de contrle
10. Distributeurs automatiques
AUTRES PRODUITS
Pour les autres produits soumis lcotaxe, savoir les appareils photos jetables, les piles
et les rcipients contenant certains produits industriels, la loi stipule toujours quils peuvent
tre munis dun signe distinctif.
Elle prvoit en outre toujours lobligation de mentionner le numro denregistrement sur ces
produits, lexception des produits consigns.
COTISATION SUR L'ENERGIE.
La cotisation sur l'nergie est une imposition indirecte frappant la mise la consommation ou
l'utilisation dans le pays, de carburants, de combustibles fossiles et d'nergie lectrique
quelle que soit son origine.
Le niveau de la cotisation est calcul selon le principe de l'quivalence d'imposition par unit
nergtique au prorata du pouvoir calorifique et ce, par rfrence l'imposition fixe pour le
gasoil de chauffage.
16.3 Droits denregistrement, dhypothque et de greffe
Les droits d'enregistrement sont un impt peru par l'Etat lors de l'enregistrement d'un acte
ou d'un crit dans un registre.
195
Voici quelques exemples d'actes ou d'crits qui doivent tre enregistrs :
* les actes notaris
* les baux
* les actes et procs verbaux des huissiers de justice
* les arrts et jugements des cours et tribunaux belges
* les actes relatifs des biens immeubles situs en Belgique
* les actes passs l'tranger prvoyant l'apport de biens des socits belges
possdant une personnalit juridique
*
L'enregistrement implique :
* la perception d'un impt (les droits d'enregistrements)
* le fait d'attribuer une date "certaine" des actes passs sous seing priv (c'est--dire
sans l'intervention d'un notaire)
* le rassemblement d'informations relatives aux personnes et leur patrimoine. Sur base
de ces donnes, l'administration peut, dans certains cas, fournir divers renseignements.
C'est ainsi, par exemple, que l'on peut savoir pour un immeuble dtermin, au bureau
d'enregistrement comptent, qui est propritaire et quel titre.
La preuve de l'enregistrement est la mention appose sur l'acte ou sur l'crit lors de
l'enregistrement. La mention comporte : le bureau, la date de l'enregistrement, le renvoi au
registre, le nombre de pages et de renvois de l'acte ainsi que les sommes perues.
Il y a trois types de droits d'enregistrement : les droits proportionnels, les droits fixes
spcifiques et le droit fixe gnral.
Les droits d'enregistrement proportionnels s'lvent chaque fois un pourcentage de la base
de perception :
vente de biens immeubles : le droit est fix 12,5% pour les ventes, changes et toutes
conventions translatives titre onreux de proprit ou d'usufruit de biens
Pour les ventes de petites proprits rurales et d'habitations modestes, ce droit est rduit
6%;
La constitution d'hypothque sur un bien immeuble situ en Belgique est assujettie un droit
de 1% calcul sur le montant garanti par l'hypothque;
La vente publique de biens meubles corporels est assujettie un droit de 5% calcul sur le
prix et les charges
Les droits fixes spcifiques sont ceux dont le montant est une somme fixe qui peut toutefois
varier d'aprs la nature de l'acte (ex : acte de prott 4,96 ).
Le droit fixe gnral s'lve 25 et est peru sur tous les actes qui ne sont pas repris
explicitement dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothque et de greffe tels que
par exemple les contrats de mariage, les testaments, la plupart des annexes aux actes
authentiques, certains baux,.....
196
CHAPITRE 17 : LES INCOTERMS
Source : http://www.eur-export.com/francais/apptheo/logistique/transport/incoterms.htm
Les incoterms (International Commercial Terms) visent uniformiser les termes
commerciaux les plus utiliss dans le commerce international en dfinissant par un terme
unique, interprtable d'une faon identique de par le monde, une relation donne entre un
client et un fournisseur. Ils reprsentent un langage commun la disposition de
commerants de langues et de pratiques commerciales diffrentes.
Ils ont t mis au point par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en 1936 et font
l'objet de rvisions rgulires. Ils ont pour but de rgler :
la rpartition des frais lis au transport des marchandises ;
le transfert des risques au cours du transport des marchandises.
Les incoterms sont dfinis par des sigles rpartis en trois catgories :
1. les incoterms de vente au dpart (familles des E, C ou F) o les charges et les
risques lis au transport principal sont supports par l'acheteur;
2. les incoterms de vente l'arrive (famille des D) o les charges et les risques lis au
transport principal sont supports par le vendeur;
3. l'incoterm DAF, o le vendeur supporte les frais et les risques de transport jusqu'
une frontire donne, au-del de laquelle l'acheteur prend le relais.
Le choix d'un incoterm rsulte de la ngociation commerciale, mais aussi des capacits
organisationnelles de l'entreprise et de facteurs extrieurs tels que les habitudes de marchs
et les pratiques des entreprises concurrentes. Ce choix conditionnant le montant du contrat
de transport, il est important de respecter certaines recommandations.
La langue dorigine des incoterms est langlais, les incoterms sont un langage international.
1/ les incoterms de vente au dpart
* EXW
* FCA
* FAS
* FOB
* CFR
* CIF
* CPT
* CIP
EXW = EX Works (...named place) - A l'usine (...lieu convenu)
Tous modes de transport
L'unique responsabilit du vendeur est de mettre la marchandise la disposition de
l'acheteur, en son tablissement. Le vendeur n'est pas responsable du chargement de la
marchandise sur le vhicule fourni par l'acheteur, sauf convention contraire.
197
Le transfert des risques et des frais se fait au moment de la mise disposition de la
marchandise l'acheteur. L'acheteur supporte tous les frais et risques inhrents au transport
de la marchandise, de ce point au lieu de destination. Ce terme reprsente l'obligation
minimum pour le vendeur.
FCA = Free Carrier (... named place) - Franco-transporteur (... lieu convenu)
Tous modes de transport
C'est l'acheteur qui choisit le mode de transport et le transporteur et qui le paye. Le vendeur
remplit ses obligations lorsqu'il dlivre les marchandises entre les mains du transporteur
dsign par l'acheteur au point convenu dans l'incoterm. Le transfert des frais et des risques
intervient au moment o ce transporteur " prend en charge " la marchandise.
* Si le lieu convenu est les locaux du vendeur, la livraison est effectue lorsque les
marchandises sont charges sur le vhicule fourni par le transporteur nomm par l'acheteur.
* Si le lieu convenu n'est pas les locaux du vendeur, la livraison est effectue lorsque la
marchandise est mise disposition du transporteur nomm par l'acheteur sur le vhicule du
vendeur non dcharg.
Le vendeur est responsable, ses risques et frais, de fournir l'acheteur toutes les
autorisations ncessaires l'exportation des marchandises (licences, formalits douanires,
...).
FAS = Free Alongside Ship ( ... named port of shipment) - Franco le long du navire (... port
d'embarquement convenu)
Exclusivement maritime ou par voies navigables intrieures
D'aprs ce terme, les obligations du vendeur sont remplies lorsque la marchandise a t
place le long du navire, sur le quai ou dans des allges (barges ou pniches). Le vendeur
fournit la marchandise accompagne de la facture et des documents spcifis dans le
contrat et ddouane l'exportation (!!! Renversement par rapport aux incoterms 1990 !!!).
Les frais et risques sont transfrs du vendeur l'acheteur au moment de la livraison. Cela
signifie que l'acheteur doit, partir de ce moment, supporter tous les frais et risques de perte
ou de dommage aux marchandises. C'est l'acheteur qui dsigne le navire et paye le fret
maritime.
FOB = Free On Board ( ... named port of shipment) - Franco bord (... port d'embarquement
convenu)
Exclusivement maritime ou par voies navigables intrieures
Le vendeur doit acheminer les marchandises au port dembarquement convenu et placer
celles-ci bord du bateau. Le transfert des risques entre lacheteur et le vendeur a lieu
lorsque les marchandises ont pass le bastingage du bateau. Cest lacheteur qui choisit le
navire et paye le fret maritime. Les formalits dexportation incombent au vendeur.
CFR = Cost and Freight ( ... named port of destination) - Cot et Fret (... port de destination
convenu)
Exclusivement maritime ou par voies navigables intrieures - pour du transport multimodal, il
y a lieu de prfrer l'incoterm CPT
198
C'est le vendeur qui choisit le navire et paye le fret maritime jusqu'au port convenu et qui
effectue le chargement sur navire et les formalits douanires d'exportation. Le risque de
perte ou de dommages aux marchandises, ainsi que toute augmentation des frais sont
transfrs du vendeur l'acheteur lorsque la marchandise passe le bastingage du navire au
port d'embarquement. Le point de transfert de risque est donc le mme qu'en FOB.
CIF = Cost, Insurance and Freight ( ... named port of destination) - Cot, Assurance et Fret
(... port de destination convenu)
Exclusivement maritime ou par voies navigables - pour le transport multimodal, il y a lieu de
prfrer l'incoterm CIP
C'est le vendeur qui choisit le navire, paye le fret maritime jusqu'au port convenu et fournit
une assurance maritime contre le risque de perte ou de dommages aux marchandises en
cours du transport maritime. La police d'assurance ou toute autre preuve de garantie
contracte auprs d'un assureur sera transmise la partie dsigne dans le contrat. C'est le
vendeur qui paye la prime, mais la marchandise voyage aux risques et prils de l'acheteur.
La position du transfert de risque est le passage du bastingage du bateau au port
d'embarquement. Le chargement sur navire et les formalits douanires d'exportation sont
la charge du vendeur.
CPT = Carriage Paid to ( ... named place of destination) - Port pay jusqu' (...lieu de
destination convenu)
Tous modes de transport, y compris le transport multimodal
Le vendeur choisit le transporteur et paye le fret pour le transport de la marchandise au lieu
de destination convenu. C'est l'acheteur qui payera l'assurance transport. Le risque de perte
ou de dommage est transfr l'acheteur ds remise de la marchandise au transporteur. Si
des transporteurs successifs sont utiliss : le risque est transfr la remise au premier
transporteur. Les marchandises seront ddouanes l'export par le vendeur.
CIP = Carriage and Insurance Paid to ( ... named place of destination) - Port pay,
assurance comprise, jusqu' ( ... point de destination convenu)
Tous modes de transport, y compris le transport mulitmodal
Le vendeur choisit le transporteur et paye le fret pour le transport de la marchandise au lieu
de destination convenu. C'est galement le vendeur qui payera l'assurance transport. Le
risque de perte ou de dommage est transfr l'acheteur ds remise de la marchandise au
transporteur. Si des transporteurs successifs sont utiliss : le risque est transfr la remise
des marchandises au premier transporteur. Les marchandises seront ddouanes l'export
par le vendeur. Le vendeur a de plus l'obligation de fournir une assurance transport contre
les risques d'avarie la marchandise ou de sa perte pendant le transport. Cette assurance
doit tre souscrite afin que l'acheteur ou toute autre personne ayant un intrt dans la
marchandise soient en droit de prsenter directement sa rclamation l'assureur. La police
d'assurance ou toute autre preuve de garantie contracte auprs d'un assureur seront
transmises la partie dsigne dans le contrat.
199
2/ Les incoterms de vente l'arrive
Les incoterms de vente larrive ne librent le vendeur de ses obligations que lorsque les
marchandises arrivent destination. Les cots et les risques lis au transport principal sont
charge du vendeur. Le vendeur dcharge ainsi lacheteur de toute une srie dobligations
et de risques, ce qui peut constituer un excellent argument de vente. De plus, il est parfois
prfrable pour le vendeur de rester matre du transport de ses marchandises jusqu leur
livraison. Une des consquences ngatives cependant de lutilisation des incoterms de cette
famille est que le moment de la livraison et donc, souvent, le moment du paiement du solde
du prix est postpos l'arrive des marchandises destination. En outre, ces incoterms
seront vits par le vendeur sil ne dispose daucune exprience en matire de transport,
notamment vers la destination vise par lincoterm.
Les incoterms de ventes larrive regroupent quatre termes :
* DES
* DEQ
* DDU
* DDP
DES = Delivered Ex Ship ( ... named port of destination) - Rendu Ex Ship (...port de
destination convenu)
Transport maritime, par voies navigables intrieures ou transport multimodal
C'est le vendeur qui choisit le navire, paye le fret et l'assurance, et supporte les risques du
transport maritime. Il n'est pas tenu, par contre, de faire assurer la marchandise. Le transfert
des frais et des risques se fait bord du navire au point de dchargement usuel du port de
destination convenu.
DEQ = Delivered Ex Quay ( ... named port of destination) - Rendu quai (...port de
destination convenu)
Transport maritime, par voies navigables intrieures ou transport multimodal
Ce terme signifie que les transferts de risques et de frais ont lieu lorsque le vendeur met la
marchandise disposition de l'acheteur, non-ddouane (!!! Renversement par rapport aux
incoterms 1990 !!!) et sur le quai du port de destination convenu. Le vendeur doit supporter
tous les risques inhrents l'acheminement de la marchandise y compris le dchargement
au port de destination, mais ne supporte aucune obligation de faire assurer la marchandise.
DDU = Delivered Duty Unpaid ( ... named place of destination) - Rendu Droits Non Acquitts
(...lieu de destination convenu)
Tous modes de transport
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a t mise
disposition, non-dcharge, au lieu convenu dans le pays d'importation. Le vendeur
supportera les frais et risques inhrents l'acheminement de la marchandise (mais ne
supporte aucune obligation de faire assurer la marchandise) jusqu' ce lieu, l'exclusion des
formalits d'importation, droits, taxes et autres charges officielles exigibles du fait de
l'importation.
200
DDP = Delivered Duty Paid ( ... named place of destination) - Rendu Droits Acquitts (...lieu
de destination convenu)
Tous modes de transport
C'est le vendeur qui s'occupe de toutes les oprations lies au transport (assurance,
transport, formalits douanires et acheminement jusqu' destination) jusqu' livraison chez
l'acheteur. Le transfert des risques et des frais se fait la livraison chez l'acheteur, ou sur
site. Sauf stipulation contraire, le dchargement au lieu de destination convenu est la
charge de l'acheteur. Si les parties souhaitent exclure des obligations du vendeur le
paiement de certains frais payables du fait de l'importation de la marchandise, il faudra le
spcifier. Par exemple : Rendu Droits Acquitts, TVA non acquitte (DDP, VAT unpaid).
Ce terme reprsente l'obligation maximale pour le vendeur.
3/ L'incoterm DAF
DAF = Delivered at Frontier ( ... named place) - Rendu Frontire (...lieu convenu)
Tous modes de transport, condition qu'il y ait une frontire terrestre
Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a t livre ddouane
l'exportation, au point convenu la frontire de sortie mais avant la frontire douanire du
pays d'entre suivant. Il importe donc de toujours dfinir la frontire en question en prcisant
le point et le lieu dans le terme. Les frais de transport et les risques sont assums jusqu' cet
endroit par le vendeur mais il n'a aucune obligation de faire assurer les marchandises. Sauf
mention contraire dans le contrat de vente, la marchandise est livre non-dcharge par le
vendeur.
Les prcautions prendre dans l'utilisation des Incoterms sont les suivantes :
* Bien connatre la signification des incoterms et leur sigle.
* L'usage des incoterms est facultatif (aucun texte de loi ne les rend obligatoires). Pour s'en
prvaloir, les parties doivent clairement y faire rfrence dans le contrat de vente en
mentionnant bien le lieu convenu. Par exemple : CIF Le Havre, CCI 2000.
* Des variantes des incoterms existent et sont susceptibles de porter confusion. Utilisez
ces variantes avec parcimonie sans quoi vous pourriez perdre le bnfice de la rfrence
aux incoterms. Exemple : FOB aux Etats-Unis comporte six interprtations diffrentes.
* Faire suivre le sigle utilis du lieu de rfrence (port, frontire, etc.), information sans
laquelle l'incoterm n'a aucune signification. Exemples : FOB doit toujours tre suivi du port
choisi, DAF doit toujours tre suivi de la frontire concerne.
* Tenir compte du mode de transport. Tous les incoterms ne sont pas utilisables pour tous
les modes de transport. Exemple : pour une expdition terrestre, le sigle FOB est
irrecevable.
201
* L'incoterm ne rgle pas le problme du transfert de proprit de la marchandise, mais
uniquement le transfert des risques et des frais entre acheteur et vendeur. Le transfert de
proprit est rgi par des rgles juridiques diffrentes selon les pays.
* Toute dviation une des obligations de l'incoterm doit tre clairement exprime ct de
celui-ci (ex.: DDP SINGAPOUR TVA non-acquitte - Incoterm 2000 CCI).
* Lorsque les parties en prsence stipulent dans leur contrat de vente des conditions
diffrentes de celles de l'incoterm officiel, c'est le contenu du contrat qui prvaut.
* Dans le cas d'achats "dpart", il est impratif pour le client de vrifier que l'assurance
transport a bien t souscrite par le fournisseur s'il s'agit d'une obligation requise soit par
l'incoterm (seuls les incoterms faisant mention d'une assurance impliquent la souscription de
celle-ci), soit par le contrat commercial.
* Le choix d'un incoterm dmontre le niveau de service que soit votre fournisseur vous
apportera, soit vous apporterez votre client. Il est donc vident qu'une marchandise sera
vendue ou achete des prix largement diffrents selon l'incoterm utilis. Soyez-y vigilant
lors de vos ngociations et de l'tablissement de votre devis ! De mme, si vous demandez
diffrentes remises de prix pour un mme achat, d'importantes diffrences de prix peuvent
apparatre. Soyez alors attentif aux incoterms qui y sont mentionns et au degr de service
en matire de transport qui est attach l'offre.
Critres de choix
* Pour les entreprises sans exprience l'export, la simplification des oprations logistiques
est prfrable, il est ds lors prfrable qu'elles se tournent vers les incoterms EXW, FOB ou
FCA.
* Pour les entreprises ayant une exprience export, les incoterms commenant par C sont
privilgier. En effet, ils permettent la matrise du transport principal et par consquent des
dlais et conditions de livraison. En revanche, ils n'incluent aucun frais sur le territoire de
destination, ce qui permet de ne pas prendre de risque vis--vis d'administrations trangres
(douane). Enfin, un prix utilisant un incoterm en C autorise l'acheteur une meilleure
comparaison avec les offres locales.
* Dans le cadre dun paiement par crdit documentaire, l'incoterm EXW est proscrire si
vous tes exportateur. Dans le cadre de cet incoterm, lacheteur a toutes les obligations du
transport sa charge. Vous naurez donc pas la matrise sur les documents prouvant
lexpdition, or ces documents conditionnent le paiement des marchandises par la banque,
puisque toute la scurit de cette technique de paiement repose sur le document de
transport.
* Lincoterm DDP est celui qui fournit les obligations maximales au vendeur, du pr-
acheminement au post-acheminement des marchandises chez lacheteur. Cet incoterm met
entre autres les formalits dimportation ainsi que les droits et les taxes qui en rsultent la
charge du vendeur. Il ne doit pas tre utilis si le vendeur nest pas certain de pouvoir
remplir sans difficults le ddouanement larrive et obtenir la licence d'importation. Or ce
nest pas toujours chose aise dans un pays dont on ne connat pas ladministration en
place.
* Lincoterm EXW met les formalits douanires la charge de lacheteur. Or il peut tre
difficile pour lacheteur de procder lui-mme aux formalits dexportation dans le pays de
202
dpart. Sa mise en uvre du point de vue de lacheteur peut donc tre plus dlicate que
pour les incoterms qui ne recourent pas cette obligation.
Crdit documentaire :
Engagement bancaire, limit dans le temps, de payer au bnficiaire une somme dtermine
si le donneur d'ordre n'a pas satisfait l'une ou l'autre de ses obligations. A l'appui de sa
demande, le bnficiaire devra produire un ou plusieurs documents, allant de la simple
dclaration signe, qui certifiera que le donneur d'ordre n'a pas rempli ses obligations, des
pices manant de tiers.
203
CHAPITRE 18 : LA LOGISTIQUE
La logistique est souvent dfinie comme tant "l'art et la manire de mettre disposition un
produit donn au bon moment, au bon endroit, au moindre cot et avec la meilleure qualit".
La logistique regroupe l'ensemble des activits qui permettent de grer les flux physiques et
d'information dans le but d'en minimiser les cots, et ce, de l'amont l'aval de la "chane
logistique" (c--d tout le process industriel et/ou commercial) en respectant des conditions
satisfaisantes en termes de dlais et de qualit.
Bref aperu de quelques mthodes logistiques
La mtode ABC (ou loi de Pareto ou mthode 80/20)
La mthode ABC est une mthode consistant classer un rfrentiel (des produits ou des
services) par ordre dcroissant des sorties. On se base sur l'ide communment admise
qu'environ 20% des rfrences reprsentent 80% des ventes. Lors d'une analyse il est donc
primordial de s'attaquer en priorit ces rfrences (le groupe A).
On divise donc le rfrentiel en trois groupes :
le groupe A est compos des rfrences constituant 80% des sorties (reprsentant
gnralement 20% des rfrences),
le groupe B est compos des rfrences constituant 15% des sorties (reprsentant
gnralement 30% des rfrences),
et le groupe C est compos des rfrences constituant 5% des sorties (reprsentant
gnralement 50% des rfrences).
Cette mthode permet de connatre les rfrences qui mritent une attention particulire.
Le classement peut galement tre effectu pour constituer des groupes en fonction d'autres
critres tels que les volumes, les achats ...
La mthode des Zros
En raction aux limites du Taylorisme et du Fordisme, le Toyotisme apporte des notions de
ractivit (flux tendus), et de qualit de la main d'oeuvre (polyvalence, tches plus varies et
plus motivantes). Pour rduire les cots et de lutter contre les gaspillages, la mthode des
zros est nonce. A l'origine, cette mthode tait celle des 3 zros (0 dfaut, 0 dlai, 0
stock). Depuis de nombreux autres lments on enrichi cette mthode :
- 0 dfaut
- 0 dlai
- 0 stock
- 0 conflit
204
- 0 accident
- 0 papier
- 0 pollution
- Etc.
Le taylorisme est une mthode de travail qui tire son nom de celui de l'ingnieur amricain Frederick
Winslow Taylor (1865-1915). Reposant sur une division du travail en actes simples et rptitifs
individuellement optimiss et sur le paiement des employs au rendement. Taylor rencontra une
grande efficacit dans la sidrurgie et il formalisa sa mthode dans un livre intitul The Principles of
Scientific Management.Ce systme est bien mis en vidence dans les procds de travail la chane
Le fordisme se dfinit comme un approfondissement du taylorisme. L'utilisation d'un convoyeur
accrot la productivit. Les changements qui s'oprent affectent galement la nature des objets : la
production devient de plus en plus standardise et s'inscrit dans une phase d'accumulation intensive.
Si donc le fordisme est un mode d'organisation de travail, il est aussi bien plus que cela. Les
transformations auxquelles on assiste ne se limitent pas l'enrichissement des classes laborieuses,
symbolis par la progression des taux d'quipement en biens durables, mais correspondent en outre
la diffusion du salariat, l'urbanisation, la fminisation des emplois ou la gnralisation des loisirs.
La consommation de masse est ainsi rendue possible par l'avnement d'un nouveau rapport
salarial. Cette expression dsigne l'organisation de la production ainsi que le mode de formation et
d'utilisation du revenu des salaris.
Le Toyotisme
Les caractristiques essentielles de ce systme sont: l'autonomation, le just-in-time, le travail en team,
le management by stress, la flexibilit du travailleur, la sous-traitance et le management participatif.
Le premier lment est l'autonomation. Il s'agit d'un nologisme cr partir d'automation et
d'autonome. C'est la capacit d'une machine s'arrter ds qu'elle rencontre un problme. Cela
permet l'ouvrier de ne pas surveiller constamment cette machine et donc de pouvoir travailler sur
plusieurs machines. C'est donc un instrument qui lve la productivit d'une faon trs importante.
Mais c'est surtout valable pour les dpartements hautement mcaniss, notamment ceux qui
fabriquent les moteurs.
Le second lment est le just-in-time. C'est la fourniture des produits adquats en quantit requise, au
bon moment et l'endroit exig. C'est une gestion de la production l'envers, par rapport au fordisme.
Suivant les principes tablis par Ford, il fallait produire d'abord, ensuite approvisionner et enfin vendre.
Le toyotisme inverse cette relation: il faut d'abord vendre et c'est au fur et mesure que l'on vend les
voitures qu'on les produit et qu'on commande les composants ncessaires l'assemblage. De cette
manire, le flux de production, c'est--dire le passage continuel de l'objet qui doit tre transform d'un
stade de la production un autre est "tir" par la demande. C'est la demande qui fixe directement la
quantit et les caractristiques de voitures que l'on assemble. Les stocks sont alors limins, ce qui
permet de rduire l'investissement en capital mais surtout de rationaliser le travail d'une faon radicale
et de minimiser lobsolescence et le volume dinvendus.
Le troisime lment est le travail en "team" ou "teamwork". Le fordisme tait fond sur une dfinition
des tches par ouvrier. La tche tait dlimite par la vitesse laquelle la production devait tre
ralise. Ainsi, dans un systme deux quipes de 8 heures, s'il faut produire 960 voitures par jour
(c'est--dire 60 voitures par heure), chaque tche est dfinie suivant un multiple d'une minute. Si
l'ouvrier reoit une minute, il doit travailler sur chaque voiture; s'il a deux minutes, il est occup sur une
voiture sur deux et un autre doit faire l'autre voiture qui passe sur la chane, etc. Toyota dfinit les
tches en groupe. Cela veut dire que la rationalisation ne porte pas sur la minute qu'un ouvrier
travaille une voiture, mais sur les dix minutes que le groupe de dix hommes ont pour raliser les
205
oprations la voiture. C'est ce principe de rationalisation qui est la base de l'introduction du
teamwork chez Toyota.
Le quatrime lment est le management by stress. Le fordisme avait un moyen de pression extrieur
pour augmenter la productivit: les contrematres. Avec le toyotisme, ce poste change de fonction. La
pression n'est plus extriorise, mais intriorise travers le travail en groupe. Cela se droule en
trois temps. Primo, l'absence quasiment de stocks permet la transmission presque instantane des
variations de la demande sur la chane de montage. L'adaptation des travailleurs doit tre
permanente. Premire source de stress. Secundo, la direction fournit des ressources insuffisantes aux
groupes pour raliser leurs objectifs. De cette faon, la chasse aux "temps morts" est poursuivie
assidment par les membres du team pour parvenir quand mme l'objectif assign par la direction.
Par exemple, la direction donne neuf minutes et demie un groupe de dix hommes, ce qui les oblige
tenir, alors qu'ils sont surchargs de travail. Seconde source de stress. Tertio, la pression du groupe
impose chaque membre de se dpenser au maximum, parce que, sinon, ce sont les autres
membres qui sont pnaliss. Troisime source de stress.
Le cinquime lment est la flexibilit du travailleur. Comme la demande peut varier, il faut que les
ouvriers adaptent quasi immdiatement la production en fonction de la demande. Cela peut signifier
produire plus de voitures avec des toits ouvrants, par exemple, si les commandes l'exigent. Ou
produire cinq fois 960 voitures par jour durant une semaine et cinq ou six fois 1.152 voitures par jour
durant une autre semaine. C'est au travailleur de s'adapter.
Le sixime lment est la sous-traitance. Toyota se concentre sur la conception des modles,
l'assemblage des voitures et la fabrication de quelques pices essentielles comme les moteurs. Le
reste est sous-trait. Le but est double. D'abord, il s'agit de profiter des conditions, plus favorables, de
la main-d'oeuvre chez les sous-traitants. Les salaires des ouvriers dans la sous-traitance sont
effectivement plus bas: cela va, au Japon, de 20 50%, suivant la taille de l'entreprise.
Le septime lment est le management participatif. Celui-ci s'appuie au Japon sur trois vnements.
D'abord, il y a eu l'limination des syndicats radicaux dans les annes 40 et 50. Ensuite, il y a eu le
mouvement du contrle de la qualit dans les annes 60. C'est partir de l que les constructeurs
nippons ont encourag leurs salaris proposer des suggestions pour amliorer la qualit de la
productivit. Enfin, Toyota a dvelopp un systme de promotion interne permettant aux travailleurs
de s'lever dans la hirarchie.
Avec le management participatif, l'ouvrier devient en quelque sorte un petit manager, celui qui est
responsable de la bonne production du team et qui se bat pour les objectifs fixs au groupe. De cette
faon, il a tendance se nier comme travailleur. Il devient solidaire de son patron.
206
CHAPITRE 19 : LE SEPA
Le SEPA, qui signifie Single Euro Payments Area est la zone de paiement europenne
unique. Lobjectif du SEPA est de permettre aux citoyens et aux entreprises de rgler leurs
paiements dans toute la zone euro, et par la suite dans toute lEurope, en utilisant des
instruments de paiement identiques (cartes, virements, domiciliations).
Liste des pays adhrents
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne (+ Iles Canaries, Ceuta et
Melilla)
Estonie
Finlande
France (+ Guadeloupe, Martinique,
Guyane franaise et Runion)
Grce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Mayotte
Pays-Bas
Pologne
Portugal (+ les Aores et Madre)
2
Roumanie
Royaume-Uni (+ Gibraltar et l'Irlande du
Nord)
Saint Pierre et Miquelon
Slovnie
Slovaquie
Sude
Tchquie
Islande
Liechtenstein
Monaco
Norvge
Suisse
Andorre, le Groenland, l'Ile de Man, les Iles anglo-normandes, les Iles Fro, Saint Marin et
le Vatican ne font pas partie du SEPA.
Virements
Le virement europen remplace le virement national, ainsi que les virements transfrontaliers.
Pour les virements europens, le systme SEPA demande certains paramtres, notamment
lInternational Bank Account Number (IBAN) du bnficiaire et du Bank Identifier Code BIC
(parfois nomm SWIFT) de sa banque.
Quest-ce que lIBAN ?
Le numro de compte bancaire international est un numro de compte qui, jusqu prsent,
tait utilis pour les paiements transfrontaliers mais qui, dans le cadre de lespace unique de
paiement en euros, est galement utilis dans le trafic de paiement belge usage national.
LIBAN est une extension du numro de compte belge devant lequel quatre positions sont
rajoutes : les deux premires sont BE (pour Belgique), les deux suivantes sont un
chiffre de contrle, suivi des 12 positions du numro de compte belge. LIBAN se prsente
en 4 groupes de 4 caractres pour les comptes belges. Les IBAN dautres pays (France et
Italie notamment) possdent une structure plus longue.
Quest-ce que le BIC ?
Le code BIC (Bank Identifier Code) est un code identifiant la banque du bnficiaire ou du
donneur dordre. Le code BIC de la banque du bnficiaire est souvent dj renseign sur le
bulletin.
2
Vous aimerez peut-être aussi
- Aspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleD'EverandAspects fiscaux de la comptabilité et technique de déclaration fiscaleÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Mémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)D'EverandMémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)Pas encore d'évaluation
- Etablissement de la déclaration I.Soc. - Cas pratique: Etude de cas 2015 (Belgique)D'EverandEtablissement de la déclaration I.Soc. - Cas pratique: Etude de cas 2015 (Belgique)Pas encore d'évaluation
- La Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerD'EverandLa Convention collective: Savoir la négocier, l'interpréter, l'appliquerÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Rapport D'activités CPIDocument11 pagesRapport D'activités CPIalexis61700Pas encore d'évaluation
- La Comptabilit de Lauto-Entrepreneur Toute BiDocument71 pagesLa Comptabilit de Lauto-Entrepreneur Toute BitsifaPas encore d'évaluation
- La LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmeD'EverandLa LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmePas encore d'évaluation
- PCN 1975 - SCF 2010 CompareDocument34 pagesPCN 1975 - SCF 2010 Compareabdelaziz_hattabPas encore d'évaluation
- Artcles Ohada Portant Sur Les Etats Financiers Annuels de SyntheseDocument9 pagesArtcles Ohada Portant Sur Les Etats Financiers Annuels de SyntheseFefe ArtefPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 ComptabilitéDocument7 pagesChapitre 1 ComptabilitéEddy Ayem100% (1)
- Tableau de Correspondance Ancien-Nouveau Plan de ComptesDocument140 pagesTableau de Correspondance Ancien-Nouveau Plan de ComptescabeaureyPas encore d'évaluation
- Cours Compta GénéraleDocument49 pagesCours Compta GénéraleHamza Mokhtari100% (1)
- FICHECFE13Document1 pageFICHECFE13Melissa MANSEURPas encore d'évaluation
- OHADA - AU Droit CommercialDocument80 pagesOHADA - AU Droit CommercialPrisca DAKPOGANPas encore d'évaluation
- Les 20 Erreurs À Éviter Dans Une Présentation PowerpointDocument2 pagesLes 20 Erreurs À Éviter Dans Une Présentation PowerpointCanevet100% (3)
- 004 Lexique Abrégé de Comptabilité CompletDocument37 pages004 Lexique Abrégé de Comptabilité Completsouleymane_thiamPas encore d'évaluation
- 1191 Ac 0512Document17 pages1191 Ac 0512Zakariya BsraouiPas encore d'évaluation
- 4060 Comptabilite Approfondie Mme de Fabregues l3 Eco-GestionDocument4 pages4060 Comptabilite Approfondie Mme de Fabregues l3 Eco-GestionHasna HasnaPas encore d'évaluation
- Approche Financière de L'entreprise: ChapitreDocument8 pagesApproche Financière de L'entreprise: ChapitreHT MPas encore d'évaluation
- Sage Direct. Version 4.00. Manuel de Référence. 2012 SageDocument167 pagesSage Direct. Version 4.00. Manuel de Référence. 2012 SageBAHPas encore d'évaluation
- Affectation Des Résultat-Cours-4.4profDocument9 pagesAffectation Des Résultat-Cours-4.4profmekdis50% (2)
- Modele Detats Financiers Comptes Sociaux Et Consolides en Regles FrancaisesDocument71 pagesModele Detats Financiers Comptes Sociaux Et Consolides en Regles FrancaisesMamadou Saliou Diakite100% (1)
- Les DépréciationsDocument4 pagesLes Dépréciationsanon-372392100% (2)
- Corrige Cas Pratique 1Document45 pagesCorrige Cas Pratique 1Mamadou DiaPas encore d'évaluation
- Presentation Du Plan Comptable FinancierDocument20 pagesPresentation Du Plan Comptable FinancierAdel AriesPas encore d'évaluation
- 521-3. - Modele de Compte de Resultat (En Tableau)Document2 pages521-3. - Modele de Compte de Resultat (En Tableau)axime1100% (1)
- Liasse FiscaleDocument22 pagesLiasse FiscaleBechir FarhaniPas encore d'évaluation
- PROGRAMME Formation ComptabilitéDocument3 pagesPROGRAMME Formation ComptabilitébayarPas encore d'évaluation
- Cursus Expertise ComptableDocument14 pagesCursus Expertise Comptableazza skikenPas encore d'évaluation
- Abonnement Des Charges Et Des ProduitsDocument4 pagesAbonnement Des Charges Et Des ProduitsMarie Camille NiangoranPas encore d'évaluation
- Fonctionnement Des Comptes NSCFDocument130 pagesFonctionnement Des Comptes NSCFaissanis100% (1)
- Mémentos StocksDocument46 pagesMémentos Stocksstovenski3Pas encore d'évaluation
- Manuel de Procédure de Clôture MensuelleDocument16 pagesManuel de Procédure de Clôture MensuelleZAKARIA EL FADILIPas encore d'évaluation
- Brochure Decogef 2022 2023Document2 pagesBrochure Decogef 2022 2023franck hermann kadjaPas encore d'évaluation
- Guide ComptaDocument50 pagesGuide ComptajeanphilippePas encore d'évaluation
- Cas Pratiques Comptabilité Financière Approfondie SND PREPA DESCOGEF 2017Document44 pagesCas Pratiques Comptabilité Financière Approfondie SND PREPA DESCOGEF 2017Accounting ConsultingPas encore d'évaluation
- Sage 100 Comptabilité PDFDocument128 pagesSage 100 Comptabilité PDFady dioufPas encore d'évaluation
- Algorithmique IDocument5 pagesAlgorithmique IJeelian M LukusaPas encore d'évaluation
- Sage 100 Strucfici 7Document734 pagesSage 100 Strucfici 7ياسين دخيسن0% (1)
- Microsoft PowerPoint - Applications SYSCOHADADocument113 pagesMicrosoft PowerPoint - Applications SYSCOHADAEphrem KPODZOPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - La Constitution Des Sociétés - La Société Anonyme Warriner - CorrigéDocument2 pagesChapitre 1 - La Constitution Des Sociétés - La Société Anonyme Warriner - Corrigéalmoustaph_diarraPas encore d'évaluation
- Mauritanie Code CommerceDocument186 pagesMauritanie Code CommercePapis WeshPas encore d'évaluation
- Affectation Resultats AGODocument5 pagesAffectation Resultats AGOoumhamdPas encore d'évaluation
- 05 Le Tableau de FinancementDocument3 pages05 Le Tableau de FinancementHassan Huit Douz100% (3)
- Le Retraitement Des Comptes Individuels Pour Etre ConsolidéDocument2 pagesLe Retraitement Des Comptes Individuels Pour Etre Consolidéchristian rodrigue noutsaPas encore d'évaluation
- Etats Financiers AnnuelsDocument29 pagesEtats Financiers Annuelssamassafatoumata59Pas encore d'évaluation
- PCCOMPTADocument156 pagesPCCOMPTAdgdfgdPas encore d'évaluation
- Cours Travaux D InventaireDocument26 pagesCours Travaux D InventaireAyman DoguiPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Révision de ComptabilitéDocument24 pagesChapitre 1 - Révision de ComptabilitéLaure 53Pas encore d'évaluation
- de 3 FD 8Document17 pagesde 3 FD 8Koffi Fortune BEYLLAHPas encore d'évaluation
- M345 Cpta Appro 2007 D F 1 PDFDocument127 pagesM345 Cpta Appro 2007 D F 1 PDFissoufou AmadouPas encore d'évaluation
- Les Fondement de La ComptabilitéDocument25 pagesLes Fondement de La ComptabilitéSaid Mrf100% (1)
- SUJET ET CORRIGE (Analyse Du Bilan) El MostainDocument3 pagesSUJET ET CORRIGE (Analyse Du Bilan) El MostainMamadou Moustapha NdiayePas encore d'évaluation
- L'Actif ImmobiliséDocument3 pagesL'Actif ImmobiliséstrapolPas encore d'évaluation
- ESLSCA - Normes IFRS - 2020 - MBA Finance 1 - 301220Document200 pagesESLSCA - Normes IFRS - 2020 - MBA Finance 1 - 301220Mohamed Lamine SanohPas encore d'évaluation
- DF1 Conduite DiagnosticDocument8 pagesDF1 Conduite Diagnosticseka_dallePas encore d'évaluation
- Les Documents de Synthèse de L'entrepriseDocument50 pagesLes Documents de Synthèse de L'entrepriseBassirou ToéPas encore d'évaluation
- Horticultura PDFDocument92 pagesHorticultura PDFfascicolaPas encore d'évaluation
- Ghid de Cultura A Tomatelor PDFDocument188 pagesGhid de Cultura A Tomatelor PDFfascicolaPas encore d'évaluation
- Finance FARBER Carte Important PDFDocument321 pagesFinance FARBER Carte Important PDFfascicolaPas encore d'évaluation
- Choix Investissement PDFDocument106 pagesChoix Investissement PDFfascicolaPas encore d'évaluation
- Recueil D'exercices Corrigés de MicroéconomieDocument134 pagesRecueil D'exercices Corrigés de MicroéconomieOverDoc100% (15)
- Diagnostic FinancierDocument95 pagesDiagnostic Financierapi-2642018488% (16)
- Ifrs 1 FDocument10 pagesIfrs 1 FfascicolaPas encore d'évaluation
- © Autorité de Régulation Des Télécommunications 1/12Document12 pages© Autorité de Régulation Des Télécommunications 1/12da sasaPas encore d'évaluation
- Syllabus STAT MPDEV-19-20Document4 pagesSyllabus STAT MPDEV-19-20Benjamin KinviPas encore d'évaluation
- Rapport Amen Bank 2019Document140 pagesRapport Amen Bank 2019Samaali TakouaPas encore d'évaluation
- Liste Des Prix Essafwa de Cembre 2023Document47 pagesListe Des Prix Essafwa de Cembre 2023Sadro RehimetPas encore d'évaluation
- Deliberation Fixant Taux Promotion Avancement Grade CT Collectivite Modele Acte CGFPDocument2 pagesDeliberation Fixant Taux Promotion Avancement Grade CT Collectivite Modele Acte CGFPmairie treziouxPas encore d'évaluation
- Formation Resell VintedDocument3 pagesFormation Resell VintedAmine ElfatehyPas encore d'évaluation
- Presentation 2S FIRMS Spécialistes Des ONG - 2018 PDFDocument20 pagesPresentation 2S FIRMS Spécialistes Des ONG - 2018 PDFSelim KouidhiPas encore d'évaluation
- Al Omrane MeknesDocument17 pagesAl Omrane MeknesLamiae ChakriPas encore d'évaluation
- QCM Revision Java CorrigeDocument4 pagesQCM Revision Java Corrigewassim257% (7)
- Concurrence Et Ion CoursDocument19 pagesConcurrence Et Ion CoursWilmer DíazPas encore d'évaluation
- Rapport Pfa AkditalDocument54 pagesRapport Pfa AkditalikhrichiPas encore d'évaluation
- How To-Cloner Un Disque DurDocument5 pagesHow To-Cloner Un Disque DurAbu Abdou SiyahyaPas encore d'évaluation
- Test FR Clasa A IxaDocument2 pagesTest FR Clasa A IxaValentina GandraburPas encore d'évaluation
- Pfe 2 El Attari Oilid Et Ibrahim Ouazzani Hassani 2Document53 pagesPfe 2 El Attari Oilid Et Ibrahim Ouazzani Hassani 2OILID EL ATTARI100% (1)
- MW#31186 9-P-100 Triplex Mud Pump FR 1Document49 pagesMW#31186 9-P-100 Triplex Mud Pump FR 1Muss777Pas encore d'évaluation
- Comparer Pronostics Pour Le Turf Favoris V Rifier Votre Site Pour.20121119.205107Document1 pageComparer Pronostics Pour Le Turf Favoris V Rifier Votre Site Pour.20121119.205107anon_769772086100% (1)
- Analyse Strategique AppleDocument80 pagesAnalyse Strategique AppleYoussef Don RajawiPas encore d'évaluation
- Linux Part1 2013 2014Document11 pagesLinux Part1 2013 2014Ghenima Ahmed SaidPas encore d'évaluation
- DCG 2016 Corrige Ue6Document8 pagesDCG 2016 Corrige Ue6Mr ForestierPas encore d'évaluation
- m2 Cat Generale FraDocument43 pagesm2 Cat Generale FraJavier F. Via Giglio100% (1)
- Resumer TvaDocument6 pagesResumer TvaEKPAO KossiPas encore d'évaluation
- Votre Kit D'urgence: Les Premières 72 HeuresDocument1 pageVotre Kit D'urgence: Les Premières 72 Heuresnonoleponey16Pas encore d'évaluation
- Froid154-Entrainement Au Depannage Sur Une Chambre Froide Negative Carte Mindmap PDFDocument1 pageFroid154-Entrainement Au Depannage Sur Une Chambre Froide Negative Carte Mindmap PDFe-genieclimatique.comPas encore d'évaluation
- Article AzizaDocument16 pagesArticle AzizasamiPas encore d'évaluation
- La Contribution Professionnelle UniqueDocument20 pagesLa Contribution Professionnelle UniqueHafsa BadidiPas encore d'évaluation
- Rapport de Cheick B Sissoko LAB3Document43 pagesRapport de Cheick B Sissoko LAB3Gilbert Coulibaly100% (1)
- Chapitre 1Document35 pagesChapitre 1Youssef El AzharPas encore d'évaluation
- Comptabilite Analytique Exercices CorrigDocument180 pagesComptabilite Analytique Exercices Corrigjalal198489Pas encore d'évaluation
- DelfoufNardjes DjebariNDocument94 pagesDelfoufNardjes DjebariNsousou01Pas encore d'évaluation
- Les Techniques de Transport Maritime:: Avantages: InconvénientDocument9 pagesLes Techniques de Transport Maritime:: Avantages: InconvénientAnwar RajawiPas encore d'évaluation