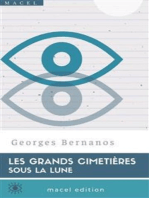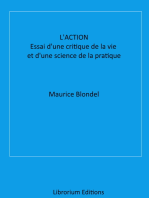Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Louis Lavelle (1883-1951)
Louis Lavelle (1883-1951)
Transféré par
Isaac AlvesCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Louis Lavelle (1883-1951)
Louis Lavelle (1883-1951)
Transféré par
Isaac AlvesDroits d'auteur :
Formats disponibles
LOUIS LAVELLE
[1883-1951]
Membre de lInstitut
Professeur au Collge de France
(1947)
DE LTRE
Un document produit en version numrique par un bnvole, ingnieur franais
qui souhaite conserver lanonymat sous le pseudonyme de Antisthne
Villeneuve sur Cher, France. Page web.
Dans le cadre de: "Les classiques des sciences sociales"
Une bibliothque numrique fonde et dirige par J ean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web: http://classiques.uqac.ca/
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 2
Politique d'utilisation
de la bibliothque des Classiques
Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite,
mme avec la mention de leur provenance, sans lautorisation for-
melle, crite, du fondateur des Classiques des sciences sociales,
J ean-Marie Tremblay, sociologue.
Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent
sans autorisation formelle :
- tre hbergs (en fichier ou page web, en totalit ou en partie)
sur un serveur autre que celui des Classiques.
- servir de base de travail un autre fichier modifi ensuite par
tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support,
etc...),
Les fichiers (.html, .doc, .pdf, .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site
Les Classiques des sciences sociales sont la proprit des Classi-
ques des sciences sociales, un organisme but non lucratif com-
pos exclusivement de bnvoles.
Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et personnel-
le et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation des fins com-
merciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute
rediffusion est galement strictement interdite.
L'accs notre travail est libre et gratuit tous les utilisa-
teurs. C'est notre mission.
J ean-Marie Tremblay, sociologue
Fondateur et Prsident-directeur gnral,
LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 3
Cette dition lectronique a t ralise par un bnvole, ingnieur franais de
Villeneuve sur Cher qui souhaite conserver lanonymat sous le pseudonyme de
Antisthne,
partir du livre de :
Louis Lavelle
DE LTRE.
Paris : Fernand Aubier, aux ditions Montaigne, 1947, 307 pp.
Collection : Philosophie de lesprit. Nouvelle dition entirement re-
fondue et prcde dune introduction la Dialectique de lternel
prsent. Premire dition, 1928.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times New Roman, 14 points.
Pour les citations : Times New Roman, 12 points.
Pour les notes de bas de page : Times New Roman, 12 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word
2008 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format : LETTRE US, 8.5 x 11.
dition numrique ralise le 31 dcembre 2013 Chicoutimi,
Ville de Saguenay, Qubec.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 4
Louis Lavelle
DE LTRE
Paris : Fernand Aubier, aux ditions Montaigne, 1947, 307 pp.
Collection : Philosophie de lesprit. Nouvelle dition entirement re-
fondue et prcde dune introduction la Dialectique de lternel
prsent. Premire dition, 1928.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 5
[4]
Du mme auteur
_______
uvres philosophiques :
LA DIALECTIQUE DU MONDE SENSIBLE. (Belles-Lettres.)
LA PERCEPTION VISUELLE DE LA PROFONDEUR. (Belles-Lettres.)
LA DIALECTIQUE DE LTERNEL PRSENT :
* DE LTRE. (Aubier.)
** DE LACTE. (Aubier.)
*** DU TEMPS ET DE LTERNIT. (Aubier.)
LA PRSENCE TOTALE. (Aubier.)
INTRODUCTION A LONTOLOGIE. (Presses universitaires de France.)
uvres morales :
LA CONSCIENCE DE SOI. (Grasset.)
LERREUR DE NARCISSE. (Grasset.)
LE MAL ET LA SOUFFRANCE. (Plon.)
LA PAROLE ET LCRITURE. (LArtisan du Livre.)
Chroniques philosophiques :
I. LE MOI ET SON DESTIN. (Aubier.)
II. LA PHILOSOPHIE FRANAISE ENTRE LES DEUX GUERRES. (Aubier.)
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 6
[5]
PHILOSOPHIE DE LESPRIT
Collection dirige par L. LAVELLE et R. LE SENNE
LA DIALECTIQUE DE LTERNEL PRSENT
*
DE LTRE
PAR
LOUIS LAVELLE
NOUVELLE DITION
ENTIREMENT REFONDUE ET PRCDE DUNE
INTRODUCTION A LA DIALECTIQUE DE LTERNEL PRSENT
MCMXLVII
AUBIER, DITIONS MONTAIGNE, PARIS
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 7
REMARQUE
Ce livre est du domaine public au Canada parce quune uvre pas-
se au domaine public 50 ans aprs la mort de lauteur(e).
Cette uvre nest pas dans le domaine public dans les pays o il
faut attendre 70 ans aprs la mort de lauteur(e).
Respectez la loi des droits dauteur de votre pays.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 8
[305]
Table des matires
__________
Introduction la dialectique de lternel prsent [9]
Premire partie. Lunit de ltre.
Chapitre I. De la primaut de ltre.
A. Primaut de laffirmation par rapport la ngation [39]
B. Primaut de ltre par rapport lintelligence [42]
C. Primaut de ltre par rapport au moi [45]
D. Primaut de ltre par rapport au bien [49]
E. Privilge de la mthode analytique [52]
Chapitre II. De luniversalit de ltre.
A. Les diffrentes espces de laffirmation [55]
B. Le possible comme mode de ltre [57]
C. Le temps ou la relation entre les modes de ltre, et non point entre ltre
et le nant [60]
D. Privilge ontologique de linstant [70]
Chapitre III. De lunivocit de ltre.
A. Ltre abstrait et ltre concret [76]
B. Lide de hirarchie et celle de repre [87]
C. Univocit ontologique et hirarchie axiologique [91]
D. La prsence en tout point de lacte crateur [96]
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 9
Deuxime partie. La multiplicit de ltre.
Chapitre IV. De lextension et de la comprhension de ltre.
A. Analyse de ltre [101]
B. Ltre un et infini [105]
C. Distinction et solidarit de tous les concepts [110]
D. Distinction et solidarit de toutes les qualits [118]
E. Du concept lessence, cest--dire lide [126]
F. Dualit de la conscience ou rupture de ltre pur [133]
Chapitre V. Du jugement dexistence.
A. Ltre et la relation [140]
B. Le jugement dinhrence et le jugement de relation [147]
C. Ltre comme attribut et ltre comme sujet [153]
D. La copule et le verbe [158]
Chapitre VI. De ltre du tout et de ltre des parties.
A. Ltre du tout [163]
B. Ltre de la partie, cest--dire du phnomne [170]
C. La connaissance, ou la relation entre la partie et le tout [178]
D. Le tout comme acte et le tout comme spectacle [183]
Troisime partie. Lintriorit de ltre.
Chapitre VII. De ltre du moi.
A. La pense, mdiatrice entre le moi et ltre [195]
B. Le moi qui se limite et qui se dpasse [207]
C. Le moi ou la liaison de la pense et du corps [213]
Chapitre VIII. De lide de ltre.
A. Adquation de ltre et de lide de ltre [219]
B. Lide de ltre, ou la puissance infinie de laffirmation [227]
C. Lunivocit de ltre et de lide de ltre, ou le secret de largument onto-
logique [231]
D. Ltre et le connatre [240]
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 10
Chapitre IX. De la prsence de ltre.
A. La prsence et le temps [248]
B. La prsence totale et les prsences mutuelles [256]
C. Absence sensible et prsence spirituelle [265]
D. Le possible et laccompli [274]
Conclusion [285]
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 11
[7]
DE LTRE
INTRODUCTION
LA DIALECTIQUE
DE LTERNEL PRSENT
Retour la table des matires
[8]
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 12
[9]
Lorsque nous avons fait paratre en 1928 la premire dition de
ce livre, nous avions dj publi deux ouvrages : La Dialectique du
monde sensible et La Perception visuelle de la profondeur, qui
avaient t prsents comme thses de doctorat, et dont le premier
avait t compos dans la solitude de la captivit au camp de Gies-
sen en Allemagne, de 1916 1918. Mais ces deux livres taient loin
dexprimer les premires dmarches dune pense destine ensuite
slargir ; car celle-ci demeurait attache depuis longtemps la
considration de limmdiation entre le moi et ltre, cest--dire de
ce pouvoir que jai de dire moi, ou de prendre contact avec ltre
dans ma propre participation ltre : l a toujours t pour nous
lexprience primitive que toutes les autres spcifient.
Et que lon nous permette de dire que, bien avant que le mot de
philosophie et un sens pour nous, nous pouvons voquer deux mo-
tions de notre tout jeune ge qui nont cess daccompagner pour
nous la conscience mme de la vie, et dont aucune autre nest venue
ternir la fracheur : la premire, issue de la dcouverte de ce miracle
permanent de linitiative par laquelle je peux toujours introduire
quelque nouveau changement dans le monde, par exemple remuer le
petit doigt, et dont le mystre rside moins encore dans le mouve-
ment que je produis que dans ce fiat tout intrieur qui me permet de
le produire, et la seconde de la dcouverte de cette prsence toujours
actuelle dont je ne russis jamais mvader, dont la pense de
lavenir ou celle du pass tentent vainement de me divertir, de telle
sorte que le temps lui-mme, loin de faire de ma vie une oscillation
indfinie entre le nant et ltre, me permet seulement, grce une
relation entre les formes diffrentes de la prsence dont ma libert
est larbitre, de constituer dans ltre un tre qui est le mien.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 13
Cependant, avant que ces thmes pussent tre approfondis, [10]
les loisirs de la captivit nous avaient conduit nous demander,
dans une sorte de parenthse, mais o nous devions trouver une
contre-preuve de ces deux intuitions fondamentales, ce que pouvait
devenir le monde des choses et comment pouvaient apparatre la
qualit et lensemble des donnes sensibles si ltre ntait rien de
plus quun acte qui ne devenait notre tre propre que par une dmar-
che de participation. Cest ainsi que nous avions t conduit mon-
trer que les diffrents sensibles limitent et achvent les diffrentes
oprations par lesquelles se ralise notre propre participation
ltre, et que la vue jouit dans la reprsentation du monde dun privi-
lge vident, puisque, bien quelle moblige percevoir lobjet dans
son rapport avec moi, cest--dire comme phnomne, elle le dta-
che pourtant du moi en lui donnant une sorte dindpendance appa-
rente, grce prcisment la profondeur.
Mais il fallait ensuite essayer dapprhender la notion de ltre
dans son extrme puret au risque dtre accus de ne plus saisir que
le vide dune abstraction, l o prcisment on aspirait dcrire la
gense concrte de notre existence elle-mme. Telle tait la tche
laquelle nous nous sommes consacr dabord. Cependant cette tude
de ltre ntait son tour que le premier moment dune entreprise
plus vaste laquelle nous donnions dj le nom de Dialectique de
lternel Prsent et qui devait elle-mme comprendre cinq volu-
mes : de ltre, de lActe, du Temps, de lAme et de la Sagesse, dont
les trois premiers ont dj paru, dont les deux derniers sont encore
sur le chantier. Mais au moment o lon nous demande de rditer
ce petit livre de ltre par lequel une telle dialectique tait inaugu-
re, il peut tre utile de confronter les principes quil avait poss et
qui, dans leur sobrit presque excessive, ne pouvaient manquer de
produire certains malentendus, avec les dveloppements quils ont
reus ultrieurement et qui peuvent servir en justifier la significa-
tion et en montrer la fcondit. Peut-tre mme nous saura-t-on gr
de dfinir leur relation avec les thmes fondamentaux de cette philo-
sophie de lexistence qui est accueillie avec tant de faveur par la
conscience contemporaine et qui en exprime si fidlement ltat de
crise.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 14
[11]
I
Introduire de nouveau le problme de ltre dans la philosophie
pouvait apparatre il y a une vingtaine dannes comme une sorte de
paradoxe : il ny avait pas de notion qui ft alors plus dcrie, il ny
en a pas qui nous soit devenue plus familire. Mais on nous avait
habitu un asctisme intellectuel qui faisait de ltre tantt une no-
tion vide et tantt un objet hors datteinte. Le positivisme et le kan-
tisme avaient triomph : nous ne pouvions rien esprer connatre de
plus que les phnomnes, leur mode de coordination, ou les condi-
tions logiques qui nous permettent de les penser. Fallait-il se rsi-
gner dire que les phnomnes se suffisent eux-mmes et quils
ne sont les phnomnes de rien ? Ou quil y a derrire eux une chose
inaccessible et qui sera jamais pour nous comme si elle ntait
rien ? Le positivisme est une sorte de synthse objective du savoir
qui demeure muette sur la possibilit la fois du savoir et de cette
ralit dont il est le savoir. Et, dans le kantisme, le savoir lui-mme
dont on prtend nous expliquer la formation nous laisse cependant
tranger ltre : il est le produit dune union mystrieuse entre une
activit purement formelle, qui est celle de lentendement, et une
matire purement subjective que la sensibilit ne cesse de nous
fournir ; et si ltre vritable se rvle nous dans lacte moral, en-
core ne russit-on pas montrer comment cet acte mme suppose
comme sa condition ou comme son effet lopposition de cette forme
et de cette matire dont notre exprience est prcisment la synth-
se.
Ce livre exprimait par consquent une raction contre le subjec-
tivisme phnomniste lintrieur duquel la philosophie avait fini
par nous enfermer. Pourquoi en effet fallait-il, ou bien nier ltre, ou
bien affirmer quil tait au del de tout ce qui pouvait nous tre don-
n, alors quil y avait pourtant un tre du donn et que, dans sa natu-
re propre de donn, il portait en lui le mme caractre de ltre qui
appartenait ce non-donn auquel on voulait le rduire, mais que
lon ne pouvait concevoir son tour que comme un donn possible ?
[12] Il y a plus : nous ne pouvions faire autrement que dattribuer
ltre la fois au sujet et au phnomne et mme de les considrer
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 15
lun et lautre comme des aspects de ltre obtenus seulement par
lanalyse. Que le sujet lui-mme ft lauteur de cette analyse, cela
ne pouvait empcher de le considrer aussi comme en tant le pre-
mier objet au sein dune ralit infinie qui le dpassait de toutes
parts et laquelle il ne russissait jamais tre co-extensif. Et
quaucun des modes de cette ralit ne pt lui apparatre autrement
que dans ses rapports avec lui, cela ne russissait point prouver
que ctaient l autant de modes de son propre moi, puisque ce moi
lui-mme se dfinissait au contraire par opposition avec eux. Car le
moi ne peut se poser autrement quen posant le tout de ltre, de tel-
le sorte que ce tout de ltre est non pas postrieur la position du
moi par lui-mme, mais suppos et impliqu par elle comme la
condition de sa propre possibilit. Cest une prsence laquelle je
participe ; et mme on peut dire que je dcouvre la prsence toute
pure, qui est la prsence de ltre au moi, avant de dcouvrir la pr-
sence subjective, qui est la prsence du moi ltre. Celle-ci appa-
rat comme tant un effet de la rflexion ; cest elle qui me permettra
de pntrer dans lintimit mme de cet tre qui ntait dabord pour
moi que limmensit dune chose. Ainsi je pourrai distinguer des
formes diffrentes de ltre, chercher quelles sont leurs relations et
lorigine mme de ces diffrences et de ces relations. J e ne mvade
jamais de ltre ; et il est contradictoire que je puisse le nier, puisque
je pose, en le niant, mon tre qui le nie. Imaginer quil ny a rien,
cest substituer au monde son image qui nest pas rien ; vouloir se
placer avant la naissance de ltre ou aprs son abolition, cest le
penser encore soit comme une possibilit, soit comme un souvenir ;
et me refouler moi-mme dans le nant o jensevelis tout ce qui est,
cest supposer quil existe quelquun qui en juge et mriger moi-
mme en tmoin de son existence idale. Toutes les formes particu-
lires de ltre peuvent disparatre : on a montr justement que poser
le nant, cest tendre au tout, par une extrapolation illgitime, ce
qui ne convient qu la partie et que la destruction de la partie com-
me telle, cest toujours son remplacement par un autre. [13] Il y a
plus : une telle opration ne saurait dans aucun cas entamer ltre
mme qui la fait ; et ceux qui voudraient faire la place la plus grande
au nant ne russissent le poser que par un acte de nantisation qui
non seulement suppose ltre quil nantit, mais encore, en tant quil
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 16
est constitutif de la conscience, lui donne elle-mme son tre idal
(ou spirituel)
1
Ce que nous voulions dmontrer par cette critique, cest donc que
nous sommes de plain-pied avec ltre, quil est vain de vouloir d-
finir le sujet, comme on le fait presque toujours, en disant quil se
constitue soit en se sparant de ltre, soit par une qute de ltre :
car, dune part, cette sparation, mme si elle tait possible, ferait de
lui seulement un tre spar, bien quelle consistt plutt dans un
privilge accord cette forme de ltre qui est moi en tant quelle
peut servir de repre toutes les autres ; et, dautre part, cette qute
de ltre nest pas trangre ltre, car il y a un tre de la qute el-
le-mme qui nous permet seulement de mesurer la distance entre
ltre qui dit moi et le tout dont il participe. Il est donc impossible
dimaginer que je ne sois pas de niveau avec ltre. J e ne men dta-
che quafin de fixer mes propres limites que jentreprends toujours
de dpasser. Et bien que je lui sois toujours uni de fait, je cherche
faire de cette union un acte subjectif qui fonde et difie ltre qui est
mon tre.
.
Cest donc une mme chose dexclure le nant et daffirmer
luniversalit de ltre. On a confondu quelquefois le nant avec
ltre pur, cest--dire avec ltre priv de toute dtermination. Mais
la simplicit du mot tre ne doit pas nous abuser, car ltre pur, cest
non pas sans doute le total, mais [14] la source de toutes les dter-
minations que lon obtient non pas en y ajoutant, mais en le divisant,
en actualisant sparment toutes les puissances quil recle. Quant
luniversalit de ltre, elle clate ds que lon aperoit quil est im-
possible de rien poser autrement quen posant ltre mme de ce que
lon pose, de telle sorte que la nature mme de ce que lon pose
1
Les difficults dune telle entreprise sont comparables celles quavait ren-
contres Descartes lorsquil avait voulu dmontrer quil nexiste de mouve-
ment que dans le plein. Et sans doute la solution la plus facile serait de donner
au temps une valeur absolue et de faire merger ltre du nant de manire
faire parcourir aux choses tout lintervalle qui spare le nant de ltre. Mais il
nous a sembl que, si notre vie temporelle se dployait toujours dans le temps
comme le passage de lun de ses modes un autre, ctait par la solidarit de
tous ces modes quelle acqurait son caractre de gravit en tmoignant du re-
tentissement de la moindre de ses dmarches sur la totalit mme de ltre.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 17
nest prcisment, lgard de ltre, quune de ses dterminations
possibles parmi une infinit dautres.
On rencontrera plus de difficults admettre lunivocit de
ltre ; et la rsurrection de ce mot emprunt au Moyen Age a mon-
tr que la querelle qui opposait les scotistes aux thomistes nest pas
encore teinte. Pourtant luniversalit et lunivocit ne sont que les
deux expressions qui dfinissent lunit de ltre quand on le consi-
dre tour tour au point de vue de lextension et au point de vue de
la comprhension. Mais quel paradoxe malgr tout de dire quil ny
a pas de degrs de ltre, que cest le mme tre qui est dit du tout et
de la partie, de lme et du corps, dun songe et dun vnement, de
lide et de la chose, de laction spirituelle la plus pure et de la va-
peur la plus fugitive ! Cependant, outre que le paradoxe serait peut-
tre dintroduire le plus et le moins au cur de ltre lui-mme et
non pas seulement dans ses dterminations, il importe de remarquer
que lchelle de ltre serait toujours une chelle entre ltre et le
nant, alors quentre ces deux termes il ny a point dintermdiaire.
Cest un infini qui les spare : aussi de chaque chose faut-il dire
quelle est ou quelle nest pas ; et encore dire quelle nest pas,
cest dire quelle nest pas ce quon croit quelle tait et quelle est
autre chose. Mais ltre, cest toujours ltre absolu ; il ny a rien au-
dessous de lui, il ny a rien au-dessus. Il ny a pas en particulier der-
rire lui de principe plus haut qui le fonde, par exemple le possible
ou la valeur, car de ces principes mmes il faudrait dire quils sont
(bien que dune autre manire que ltre tel quil nous est donn
dans une exprience sensible). Sils ntaient pas, quelle efficacit
pourrait-on leur prter ? Comment pourrait-on en avoir lide, ou
seulement les nommer ? Ainsi nous sommes astreints considrer
toute raison dtre comme intrieure ltre, ou bien encore, ds que
nous cherchons justifier ltre comme [15] nous justifions les exis-
tences particulires, dire quil est lui-mme sa propre justification.
Mais on objectera peut-tre que lunivocit ne pourrait tre main-
tenue quen faisant de ltre, contrairement notre dessein, la plus
abstraite des notions et telle quen exprimant seulement la position
de tout ce qui peut tre, elle resterait trangre au contenu de ce qui
est. Cependant on ne ngligera pas la valeur ontologique de cet acte
de position sans lequel rien ne pourrait tre pos et qui, loin dtre
indiffrent ce quil pose, en est lessence constitutive. Ensuite, on
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 18
noubliera pas que ltre dune chose nest pas distinct de cette cho-
se, mais quil est cette chose elle-mme considre, si lon peut dire,
dans la totalit actuelle de ses attributs. Ce nest pas tout encore : car
cette chose ne peut tre isole, circonscrite dans des frontires sus-
ceptibles de dfinir son tre spar, en tant quil est vritablement
indpendant de tous les autres. Car elle est suspendue dans le tout
par des relations qui lunissent toutes les parties du tout. Ainsi
ltre qui lui est propre rside dans ses relations avec le tout ; cest
son inscription dans le tout ou son appartenance au tout qui donne
ltre chaque chose, si misrable quelle puisse tre. Tel est le sens
vritable de lunivocit dont on voit quelle rside moins dans un
caractre unique, prsent dans chacun des modes de ltre, que dans
lunit concrte de ltre dont ils sont tous un aspect et sans laquelle
aucun deux ne serait capable de subsister. De l le prestige incom-
parable de la notion de relation qui nexprime rien de plus dans le
langage de la gnosologie que lidentit de ltre et du tout dans le
langage de lontologie.
On comprend ds lors comment la notion dtre est antrieure
non pas seulement la distinction du sujet et de lobjet, mais encore
la distinction de lessence et de lexistence et contient en elle ces
deux couples dopposs. Car le sujet et lobjet se distinguent de
ltre partir du moment o le moi se constitue comme un centre de
rfrence auquel le tout peut tre rapport comme un spectacle. Et la
distinction de lessence et de lexistence nat dans le moi ds quil
fait de ltre tout entier un tre de pense dans lequel il actualise cet-
te forme dtre qui sera lui-mme.
[16]
Cependant lunivocit de ltre ne porte aucune atteinte, comme
on le pense, lanalogie de ltre, bien que ces deux termes aient t
opposs avec beaucoup de vigueur. Et mme les deux notions
sappellent au lieu de sexclure. Ce sont deux perspectives diffren-
tes et complmentaires sur ltre dont la premire considre son uni-
t omniprsente et la seconde ses modes diffrencis. Ceux-ci ne
mritent le nom dtre que par ltre mme que le tout leur donne,
mais chacun lexprime sa manire et de telle sorte que, si lon
considre son contenu, il y a toujours une correspondance entre la
partie et le tout dont la correspondance entre les parties est le corol-
laire. Cest cette double correspondance qui est lobjet propre de la
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 19
philosophie et qui permet de considrer ltre et la relation comme
deux termes insparables.
II
Cependant la description qui prcde a besoin dtre approfondie.
Aussi longtemps que lon ne dpasse pas la notion dtre, il nous
semble, tant nous sommes habitus considrer toute ralit comme
affectant la forme dune chose, quil y ait un primat de lobjectivit
sur la subjectivit. Et si nous nous bornons montrer que ltre que
nous saisissons, cest un tre qui nous est propre en tant quil impli-
que un tre qui nous dpasse et dans lequel il est pour ainsi dire si-
tu, nous continuons obscurment considrer cet tre qui nous est
propre comme un corps qui occupe une place dtermine dans
linfinit de lespace. Mais ce nest l quune image quil faut inter-
prter. Il importe de montrer maintenant que ltre est acte, comment
toute description est une gense et pourquoi la relation elle-mme ne
prend sa vritable signification que si elle se change en participa-
tion.
Or, il est facile de voir que rien de ce qui est objet ou chose na
de sens autrement que par rapport un sujet qui le pense comme
extrieur lui, bien quil ne soit actualis que par lui, ce qui est jus-
tement le sens que nous donnons au mot apparence ou phnomne.
Quant ce sujet lui-mme, il rside dans lacte intrieur quil ac-
complit et que lon ne [17] peut pas rduire la pense dun objet
ou dune chose, car le propre de cet acte, cest dengager lexistence
mme du moi, cest de la faire tre dans une opration quil lui faut
accomplir et sans laquelle il ne serait rien, par laquelle il dispose du
oui et du non, que lon peut dfinir comme tant sa libert, qui fait
de lui chaque instant le premier commencement de lui-mme, et
porte le nom de pense ds quelle sapplique quelque objet pour
se le reprsenter et le nom de volont ds quelle sapplique lui
pour le modifier. Encore est-il vrai que cet objet ne cesse de le d-
passer et que le moi ne russit jamais le rduire sa propre opra-
tion, qui, dans lordre intellectuel, garde toujours un contenu percep-
tif ou conceptuel et, dans lordre volontaire, ne parvient jamais
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 20
pousser la modification jusqu linfini, cest--dire en faire une
cration.
Cet acte intrieur est insparable la fois de linitiative qui le
met en jeu et de la conscience qui lclaire. Cest l seulement o il
sexerce que nous pouvons dire moi. Il est notre tre mme au point
o il se fonde sans quil nous soit possible de le rcuser. Il est vri-
tablement un absolu qui nest lapparence ou le phnomne de rien.
Son essence est de se produire lui-mme avant de produire aucun
effet, qui doit tre considr comme extrieur lui et comme tant
la marque la fois de sa manifestation et de sa limitation, bien plu-
tt que de sa puissance et de sa fcondit. Et la philosophie com-
mence l o prcisment ltre cesse dtre confondu avec lobjet,
mais sidentifie avec cet acte intrieur et invisible et qui est tel quil
faut seulement laccomplir pour quil soit.
On voit ds lors labsurdit quil y aurait vouloir que cet acte
constitutif du moi ft lui-mme situ dans un monde form seule-
ment dobjets et de phnomnes. Les objets ou les phnomnes sont
les marques propres de sa limitation, quil ne cesse lui-mme
dprouver : mais ils nexpriment pas seulement cette limitation ou,
du moins, ils lexpriment en lui apportant aussi, sous la forme de
donnes quil est oblig de recevoir ou de subir, tout ce qui lui man-
que et qui lui fait croire que sans elles il ne possderait rien : do il
conclut facilement que sans elles il ne serait rien. Cependant la limi-
tation du moi lui est, en un certain sens, intrieure. Ou encore [18] le
moi nest pas intriorit pure ; en lui lintriorit est toujours lie
lextriorit : il a un corps, il y a pour lui un monde. Quelle que soit
en lui la puissance dabstraction ou de mditation, son intriorit ne
peut jamais tre ni parfaite, ni spare. Elle souvre devant lui com-
me un infini auquel le moi ne russit jamais sgaler. On com-
prend alors que la passivit puisse reculer en nous sans jamais
sabolir. Notre acte peut toujours devenir plus pur. Ainsi
lexprience intrieure que nous prenons de nous-mme et qui est
insparable de lexprience de nos limites, nappelle pas seulement
une extriorit qui les exprime, mais une intriorit qui les fonde et
dans laquelle nous pouvons pntrer toujours plus profondment. Et
il est bien remarquable que le moi puisse penser saccrotre tantt
en exerant une domination de plus en plus tendue sur le monde
des objets et tantt au contraire en se repliant toujours davantage sur
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 21
le monde secret o il trouve lorigine et la signification de son exis-
tence manifeste.
Le moi se dcouvre lui-mme dans lacte de la pense, cest--
dire dans la participation un univers de pense qui dpasse singu-
lirement sa pense actuelle et exerce. Il implique laffirmation non
seulement de luniversalit de la pense dont il participe, mais de
luniversalit de ltre dont sa pense le rend participant. Par cons-
quent on peut dire que je ne puis saisir ma propre intriorit comme
imparfaite que par la limitation et la participation dune intriorit
parfaite qui est premire par rapport elle, ou que lacte que
jaccomplis (dont limperfection sexprime peut-tre par le fait quil
ne peut tre quun acte de consentement ou de refus) est insparable
dun acte sans passivit dont il est lui-mme la limitation et la parti-
cipation.
On demandera maintenant quel est le sens de cette subjectivit
qui dpasse ma subjectivit propre, de cette intriorit qui est au de-
l de lintriorit du moi, de cet acte qui transcende lacte que
jaccomplis. Toutefois il ny a sans doute aucune contradiction
admettre que le moi soit dbord vers le dedans aussi bien que vers
le dehors, puisquil est prcisment la relation qui les unit et que
peut-tre mme le dehors nest rien de plus que le dedans mme, en
tant que le moi le subit au lieu dy pntrer. De plus, on demandera
comment [19] pourrait se produire le progrs dans le sens de
lintriorit autrement que par une intriorit absolue quil faut dfi-
nir non pas objectivement comme un univers ralis, mais subjecti-
vement comme le moteur suprme de tous les mouvements par les-
quels nous sommes capables de nous intrioriser toujours davantage.
Enfin cette dcouverte initiale qui est la dcouverte de la prsence
du moi dans ltre et que nous dfinissons comme une exprience de
participation permet de donner un sens aux deux mots de transcen-
dant et dimmanent, de comprendre pourquoi ils sont pour nous
comme deux contraires, mais qui sopposent au point mme o ils se
rejoignent. Car le transcendant, cest cela mme qui me dpasse tou-
jours, mais o je ne cesse jamais de puiser, et limmanent cest cela
mme que jai russi y puiser et que je finis par considrer comme
mien en oubliant la source mme do il ne cesse de jaillir. La doc-
trine de la participation, cest en effet celle dun tre-source et dont
il faut dire que je ne le saisis que dans ses effets, bien que ces effets
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 22
mmes soient pour moi comme rien si je ne retrouve pas en eux le
got de la source.
Ce serait une erreur grave sur la participation que de penser que
ltre dont je participe par un acte puisse tre lui-mme autre chose
quun acte. Mais on lvera des difficults contre la possibilit m-
me de cette participation dun acte par un acte, l o prcisment le
propre de lacte, cest, semble-t-il, de fonder la sparation,
lindpendance et mme la suffisance de ltre qui laccomplit. Tou-
tefois, sil y a une exprience reconnue et pour ainsi dire populaire
de la participation, si le mot mme a un sens et dsigne une sortie de
soi par laquelle chacun prouve la prsence dune ralit qui le d-
passe, mais quil est capable de faire sienne, cette participation, qui
est toujours active ou affective, et active jusque dans laffection
quelle produit, est aussi une coopration, cest--dire non point une
opration rpte et imite, mais une action commune, et dont cha-
cun prend sa part ou quil consent assumer. A mon gard et aussi
longtemps que je ne laccomplis pas, une telle action nest rien de
plus quune puissance pure : mais comment pourrais-je la mettre en
uvre et en faire un facteur de communion avec autrui, si [20] elle
nimpliquait pas au-dessus de lui et de moi comme une efficacit
toujours disponible et qui, selon la manire dont nous lui livrons ou
lui refusons passage, nous spare ou nous unit ? Aussi faut-il dire
que nous ne participons jamais lexistence des choses, mais seu-
lement la vie des personnes, ou lexistence des choses dans la
mesure o elle est pour la vie mme des personnes un moyen de
communication charg de signification spirituelle, et la vie des
personnes dans la mesure o elle suppose entre celles-ci et nous une
communaut dorigine et de fin.
Il y a plus : il ne peut y avoir de participation qu un acte qui
nest pas ntre, et que nous ne parvenons jamais faire tout fait
ntre. Cest donc elle qui fonde la fois notre indpendance et notre
subordination lgard de tout ce qui est. Notre indpendance rside
dans cet acte mme proportion du pouvoir que nous avons prci-
sment de le faire ntre, notre subordination dans la distance qui
nous en spare et qui sexprime par tout ce que nous sommes obli-
gs de subir.
Si dun tel acte on prtend que nous ne pouvons rien dire, sinon
prcisment dans la mesure o nous laccomplissons, et quil nous
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 23
enferme dans nos propres limites, on rpondra non seulement que
tout acte apparat comme un dpassement, et que lexprience que
nous avons de ses limites, cest prcisment lexprience de tout ce
qui en nous prsente un caractre de passivit, mais encore que tout
acte qui sexerce en nous est lactualisation dune possibilit et que
toute possibilit est pour nous insparable du tout de la possibilit.
Or, il y a entre le tout de la possibilit et la possibilit que nous ac-
tualisons comme ntre une relation qui, dans le monde intrieur,
nest pas sans rapport avec la relation que nous tablissons dans le
monde extrieur entre le corps qui nous affecte et que nous sentons
comme ntre et la totalit des corps qui remplissent lespace et qui
ne sont notre gard que de simples reprsentations. Lanalogie est
ici si profonde que, par comparaison notre propre corps, les repr-
sentations se rduisent pour nous des actions possibles. Nous vi-
vons donc dans un monde de possibles. Et ces possibles ne sont pas
invents par nous ; ils nous dpassent, ils simposent nous ; cest
en eux que nous constituons ce [21] que nous sommes et jusque l
ils ne sont pour nous que de simples objets de pense.
Cependant le mot de possible na de sens, ou du moins il ne
soppose ltre, que lorsquil sagit de cet tre que nous actuali-
sons par une opration qui est ntre. En lui-mme il est un tre, et en
disant quil est un tre de pense nous marquons assez nettement
quil est un tre spirituel qui ne sest pas encore incarn. Les possi-
bles, il est vrai, ne se prsentent jamais nous que sous une forme
spare ; ils sont en tant que possibles le produit mme de cette s-
paration qui est son tour la condition de la participation ; entre
tous ces possibles, il nous appartiendra de choisir celui qui
saccomplira en nous. Mais le tout de la possibilit nest plus un
possible : cest ltre mme considr comme participable et non
plus comme particip. En soi, il nest plus ni particip, ni participa-
ble ; il est labsolu considr comme un acte sans passivit,
lintrieur duquel toute existence particulire se constitue elle-mme
par une double opposition, dune part, entre la possibilit qui la d-
passe et lopration quelle accomplit et, dautre part, entre cette
opration elle-mme et la donne qui lui rpond. Et cest labsolu
que le sujet emprunte par analyse non seulement la possibilit, telle
quil la conoit dabord par son entendement avant de lactualiser
par sa volont, mais encore la force mme de lactualiser. La disso-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 24
ciation entre lentendement et la volont est la condition la fois de
la naissance de la conscience et de lexercice de la libert. On ne
manquera pas toutefois de remarquer que la possibilit, loin dentrer
avec ltre dans une relation dopposition, comme on le croit pres-
que toujours, exprime seulement une relation entre deux aspects de
ltre, ici entre le tout de ltre et une existence particulire. Mais
cette relation est susceptible dtre renverse, car si le tout de ltre
nest quune possibilit infinie lgard de toute existence particu-
lire qui ne parvient jamais lactualiser, ce sont les existences par-
ticulires qui, lgard du tout de ltre o elles sactualisent, ne
sont plus, comme le montre le rle jou en elles par le temps et par
le dsir, que des possibilits toujours remises sur le mtier. Il est
remarquable enfin que la thologie puisse dire de Dieu la fois quil
est ltre de tous les [22] tres (vers lequel chaque tre tend pour
saccomplir) et quil est aussi le tout-puissant, comme si la puissan-
ce tait au-dessus de lexistence qui lactualise notre niveau.
Il importe cependant encore de rpondre une triple objection,
car :
1 on peut allguer que lacte pur ou absolu doit possder une
suffisance parfaite et que lon voit mal comment il aura besoin de
crer, mme si cette cration consiste uniquement communiquer
son tre mme ou le faire participer par dautres tres. Mais peut-
tre faut-il dire prcisment que la suffisance parfaite consiste non
pas dans une fermeture sur soi, mais dans cette puissance infinie de
crer, cest--dire de se donner, l o le propre de la crature en tant
quelle est passive et imparfaite est toujours de recevoir. Ce que lon
vrifierait peut-tre dans les rapports que les hommes ont les uns
avec les autres, et o les lois de lactivit spirituelle trouvent encore
une application imparfaite et approche.
2 On nous dira aussi que nous ne savons rien de ces rapports
dont nous parlons toujours entre Dieu et les cratures, quil y a l
une hypothse invrifiable, et que toute dialectique descendante est
par consquent impossible. Mais la rplique sera que lorigine de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 25
toute dialectique, cest lexprience de la participation o nous sai-
sissons le rapport vivant de notre tre propre et de ce qui le dpasse,
non point comme un pur au-del dont on ne peut rien dire, mais
comme une prsence o nous puisons sans cesse et qui ne cesse de
nous enrichir.
3 Et on rpondra facilement au reproche de panthisme en mon-
trant que Dieu ne peut communiquer un autre tre que ltre mme
qui lui est propre, cest--dire un tre qui est causa sui, de telle sorte
que tout rapport que nous avons avec lui nous libre, comme tout
rapport que nous avons avec la nature nous asservit, ou encore quil
ne cre lui-mme que des liberts, le monde tant linstrument de
cette cration plutt quil nen est lobjet.
[23]
III
Si lexprience initiale est lexprience de la participation par la-
quelle le moi constitue lexistence qui lui est propre, on comprend
sans peine quelle soriente en deux sens diffrents ou quelle com-
porte deux extrmits entre lesquelles elle ne cesse dosciller et dont
aucune ne peut tre considre isolment. Lune est celle de lacte
pur, ou de lacte qui nest quacte (et que lon retrouve sous une
forme moins dpouille dans les expressions de puissance cratrice
ou mme dlan vital et dnergie cosmique, mais laquelle il faut
maintenir une intriorit spirituelle absolue pour la mettre au-dessus
de toute limitation et par consquent de toute passivit et de toute
donne) et lautre est forme par le monde, o linfinit de lacte
accuse encore sa prsence par cette infinit de choses et dtats qui
semblent natre de la participation elle-mme et qui traduisent indi-
visiblement la fois en nous et hors de nous ce qui la dpasse et ce
qui lui rpond
2
2
Cette analyse montre assez nettement pourquoi lintelligible et le sensible
doivent toujours la fois sopposer et se correspondre, sans que le premier ab-
sorbe jamais lautre. Cest de cette opposition et de cette correspondance que
nous avions essay de donner un premier exemple dans notre Dialectique du
monde sensible (1923).
.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 26
Nous dirons du monde quil remplit lintervalle qui spare lacte
pur de lacte de participation. Cest pour cela que ce monde est un
monde donn, mais cest pour cela aussi que sa richesse est inpui-
sable. Et loin de penser qu mesure que lactivit intrieure se d-
veloppe davantage, elle fait reculer la reprsentation que nous avons
de lunivers extrieur et tend la dissoudre, il faut dire au contraire
que le propre de cette activit intrieure, cest de multiplier linfini
les distinctions qualitatives que nous pouvons tablir entre les cho-
ses, de telle sorte que le monde, qui apparat comme une masse
confuse la conscience naissante, dcouvre une conscience plus
dlicate et plus complexe une varit daspects de plus en plus gran-
de. Il est vrai que tous ces aspects du donn, lintelligence, mesure
quelle crot, tentera de les couvrir dun rseau de plus en plus serr
de relations conceptuelles, [24] que lart cherchera en eux
lexpression des exigences les plus raffines de la sensibilit, que la
volont en fera le vhicule de plus en plus docile de tous les actes
par lesquels elle cherchera obtenir une communion avec les autres
volonts.
Cependant la question est dabord de savoir comment sexerce
cette libert par laquelle le moi pose son existence propre comme
une existence dont il est lauteur. Or, si toutes les liberts puisent
dans le mme acte dont elles participent linitiative mme qui les
fait tre, il faut la fois quelles lui demeurent unies et quelles sen
dtachent, cest--dire que leur concidence actuelle avec ltre ne
cesse jamais de saffirmer et quelles puissent constituer pourtant en
lui un tre quelles ne cessent elles-mmes de se donner. Cette dou-
ble condition se trouve ralise prcisment lintrieur du prsent,
qui est une prsence totale, cest--dire la prsence mme de ltre,
et qui est telle que nous pouvons distinguer en elle des modes diff-
rents et, par les relations que nous tablirons entre eux, constituer
prcisment ltre qui nous est propre. Mais cette relation entre les
diffrents modes de la prsence, cest le temps, o nous distinguons
dabord une prsence possible ou imagine, cest--dire que nous
navons pas encore faite ntre, mais qui le deviendra par une action
quil dpend de nous daccomplir (cette prsence, cest lavenir) ;
qui est appele elle-mme se convertir en une prsence actuelle ou
donne dans laquelle notre existence et notre responsabilit se trou-
vent engages lgard de lensemble du monde (cest la prsence
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 27
dans linstant) ; qui se convertit son tour en une prsence remmo-
re ou spirituelle (cest la prsence du pass) qui constitue notre se-
cret, qui na de sens que pour nous, et qui est proprement tout ce que
nous sommes.
La liaison de lavenir et du possible justifie le caractre indter-
min la fois de lun et de lautre : mais il ny a de possibilit qu
partir de la participation, soit que nous considrions celle-ci comme
une analyse de ltre imparticip, et plus prcisment comme un ac-
te de pense destin anticiper un acte du vouloir, soit que nous
considrions dans chaque possible laccord dont il doit tmoigner
la fois avec les autres possibles et avec leurs formes dj ralises,
afin [25] que lunit de ltre ne soit pas rompue. La liaison de
lexistence avec le prsent accuse dune part limpossibilit de ne
point considrer comme actuel tout acte saccomplissant soit dans sa
forme pure, soit dans sa forme participe, et dautre part la ncessit
dintroduire notre moi lui-mme dans un monde donn, o
sexprime sa solidarit avec tous les autres modes de lexistence en
tant que nous leur imposons notre action ou que nous subissons la
leur. La liaison de notre tre ralis avec le pass montre assez
comment il se libre alors la fois de son indtermination, qui ne
cessait de laffecter aussi longtemps quil ntait quun tre possible
et de la servitude laquelle il tait rduit aussi longtemps quil tait
engag dans le monde des corps : cest notre pass qui pse sur nous
comme poids tranger ; mais notre pass prsent exprime le choix
vivant que nous avons fait de nous-mmes ; il est cet tre spirituel et
invisible o notre libert ne cesse la fois de sprouver et de se
nourrir. Notre incidence avec le monde nous avait permis dentrer
en communication avec tout ce qui est et qui nous dpasse ; tous ces
contacts ont t spiritualiss ; il ne subsiste plus deux maintenant
que leur essence significative et dsincarne.
*
* *
Cette thorie du temps dfini comme le moyen mme de la parti-
cipation est destine prparer une thorie de lme humaine. Car
lme nest point une chose, mais une possibilit qui se choisit et qui
se ralise. Dune manire plus prcise, elle est le rapport qui
stablit dans le temps entre notre tre possible et notre tre accom-
pli. Elle est une conscience, mais dans laquelle on ne trouve jamais
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 28
rien de plus que la pense du pass et de lavenir dont il faut dire
quils ne trouvent quen elle leur subsistance. Et comme en tmoi-
gne lintrospection ds que nous linterrogeons, la conscience est un
mouvement continu et rciproque entre la pense de ce qui nest
plus et la pense de ce qui nest pas encore : elle ne cesse de passer
de lun lautre et de les convertir lun dans lautre. Dans le prsent
instantan elle ne trouve pas autre chose quune ralit donne,
cest--dire le monde ou la matire. [26] Elle se constitue en sen
dtachant. Mais cest dans linstant aussi quelle exerce son acte
propre, qui est un acte de libert, et cet acte ne peut saccomplir
quen sarrachant la prsence donne afin de crer le temps, cest-
-dire le rapport de lavenir et du pass ; le temps est donc le vhi-
cule mme de la libert. Seulement la conversion de lavenir en pas-
s exige une traverse de la prsence donne o notre conscience
tmoigne de sa limitation et par consquent de sa solidarit avec
toutes les autres consciences ; cest ici que lme fait lexprience
de sa relation avec le corps et avec le monde dont on voit assez bien
le rle, qui est de fournir aux diffrentes consciences les instruments
qui les sparent et aussi qui les unissent. Or, le possible et le souve-
nir ne peuvent pas appartenir lesprit pur : ils ne rompent jamais
tout rapport avec le corps dont on peut dire que sans lui lun ne
pourrait pas tre appel, ni lautre rappel ; le corps les distingue et
les joint ; il dissocie le temps de lternit, mais ly situe.
Une telle analyse permet dtablir un tableau systmatique des
diffrentes puissances du moi ; il faut en effet quil puisse se consti-
tuer lui-mme dans le temps grce une double puissance volitive et
mnmonique qui, en sexerant, forme tout le contenu de notre vie
intrieure ; quil puisse atteindre par une double puissance reprsen-
tative et notique, cest--dire sous la forme dun objet qui est donn
et dun concept qui est pens, cela mme qui le dpasse et qui nest
quun non-moi en rapport avec moi ; il faut enfin quune communi-
cation puisse stablir entre moi et lautre que moi, grce une puis-
sance affective insparable elle-mme dune puissance expressive.
Et peut-tre faut-il reconnatre que la distinction dun triple domai-
ne, celui de la formation du moi, de lexploration du non-moi et de
la dcouverte dun autre moi, avec la corrlation, dans chacun de ces
domaines, dune action quil faut accomplir et dune donne qui lui
rpond, suffit dterminer dune manire assez satisfaisante les re-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 29
pres fondamentaux par lesquels on peut mesurer le champ de la
conscience et dcrire le jeu infiniment vari de ses oprations et de
ses tats.
[27]
*
* *
On montrera enfin que, si le propre de la sagesse, cest de cher-
cher obtenir cette matrise de soi qui nous empche de nous laisser
jamais troubler, ni accabler par lvnement, celle-ci ne peut tre
obtenue par une tension de notre activit spare, qui, pour marquer
que nous sommes capables de nous suffire, accuse notre conflit avec
lunivers et cache mal une dfaite continue en cherchant la trans-
former en une apparente victoire. Cest seulement dans la mesure o
notre activit se reconnat elle-mme comme une activit de partici-
pation toujours sollicite par une prsence qui ne lui manque ja-
mais et qui demande delle un consentement quelle donne seule-
ment quelquefois et quelle marchande toujours quelle sera ca-
pable de surmonter cette triple dualit entre ce quelle dsire et ce
quelle a, entre son effort et la rsistance que le monde lui oppose,
entre le moi quelle assume et le moi dautrui, do drivent tous les
malheurs insparables de la condition mme de la conscience. La
sagesse nest pas de les approfondir, mais de les apaiser.
Elle ny parvient nullement par lemploi des deux moyens qui lui
sont souvent proposs tantt sparment et tantt simultanment :
savoir en premier lieu par une rsignation indiffrente lgard de
la ralit telle quelle nous est donne et que lon nous demande de
considrer comme nous tant trangre ; car cette ralit donne est
mle notre vie comme la matire et leffet de notre action, de tel-
le sorte quune parfaite indiffrence son gard nest ni possible ni
dsirable ; en second lieu par une sorte dabdication de notre activit
propre en faveur dune activit qui agirait en nous sans nous et par
laquelle il suffirait de se laisser porter, comme on le voit dans le
quitisme et dans certaines formes de labandon ; mais si le sommet
de la participation est aussi le sommet de la libert, il ne faut pas
quen poussant la premire jusqu la limite, on accepte de ruiner
lautre.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 30
Cest que la sagesse nest donc rien de plus que la discipline de
la participation, cest--dire une certaine proportionnalit que nous
savons tablir entre nos actes et nos tats, [28] o la dualit de la
nature humaine se trouve respecte, mais o, au lieu de permettre
que nos actes soient dtermins par nos tats, nos tats dessinent si
exactement la forme de nos actes quils paraissent les exprimer et
les suivre et quils sen distinguent peine. Les Anciens avaient tou-
jours li le bonheur la sagesse, comme si la sagesse rsidait dans
une certaine disposition de lactivit dont le bonheur ft le reflet ou
leffet dans notre vie affective. Et il y avait pour eux une union si
troite entre les deux termes quaucun des deux ne pouvait exister
sans lautre, comme sils taient les deux faces dune mme ralit :
tel est le point sans doute o la participation reoit sa forme la plus
parfaite. Et on peut bien aujourdhui la considrer comme impossi-
ble atteindre. Mais ce serait un mauvais signe si on la mprisait et
si la conscience spuisait dans la recherche dtats plus violents et
finissait par se complaire dans sa propre impuissance et son propre
tourment. Car o la conscience croit saiguiser davantage, elle est la
proie des forces quelle ne domine plus : la lumire lui est te. On
rabaisse vainement comme trop facile ce qui ne peut tre obtenu que
par une force que lon a perdue.
IV
Bien que nous nous abstenions en gnral de toute polmique et
mme que nous jugions toute polmique inutile, bien que chaque
doctrine doive ncessairement apparatre, dans une philosophie de la
participation, comme exprimant un aspect de la vrit et une certai-
ne perspective sur la totalit du rel, il semble pourtant que nous ne
puissions pas nous dispenser de confronter notre conception de
ltre avec une conception qui en est, dune certaine manire,
linverse et qui a obtenu dans ces derniers temps un retentissement
considrable bien au del des cercles o senferme presque toujours
la pense philosophique. Ainsi entre ces deux perspectives diffren-
tes, le lecteur sera conscient du choix quil pourra faire et des
consquences quil implique, tant en ce qui concerne la reprsenta-
tion de lunivers que la conduite de la vie.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 31
[29]
La nouvelle philosophie de lexistence nous propose tout dabord
dopposer ltre en soi et ltre pour soi. Mais on ne peut pourtant
mettre en doute que len soi et le pour soi ne soient deux aspects dif-
frents de ltre total ou, si lon veut, quils ne soient contenus en
lui. On rpondra sans doute en prtendant que ltre total est prci-
sment ltre en soi, puisque ltre pour soi le suppose et nest obte-
nu son gard que par une dmarche de ngation ou de nantisa-
tion . Et largument que ltre en soi ne peut tre apprhend
pourtant que sous la forme du phnomne, on rpliquera que celui-ci
enveloppe et dj affirme un tre dont il est le phnomne, cest--
dire dont la transphnomnalit nous oblige le considrer comme
se suffisant lui-mme indpendamment de lacte de conscience qui
le pose. Ce qui est la signification mme du ralisme en tant quau
lieu de raliser le phnomne, il le greffe sur la chose en soi. Inver-
sement, ltre pour soi, ou ltre mme de la conscience, le seul qui
puisse dire moi, sera non seulement un tre incapable de se suffire,
mais qui se constitue pour ainsi dire en fonction de cette insuffisan-
ce mme, non pas quil soit simplement, comme on la dit souvent,
recherche, inquitude ou privation, mais parce quil introduit le
nant en lui pour tre, ou que son tre mme rside dans la nantisa-
tion de len soi.
Or la position que nous avons adopte est toute diffrente. Nous
pensons quil ny a den soi ou de soi que l o une conscience est
capable de dire moi. L est le seul point du monde o ltre et la
connaissance concident. Ltre pour soi est donc le seul tre en soi,
qui est un absolu parce quil nest le phnomne de rien. Cependant
il reste vrai que la conscience est toujours conscience de quelque
chose, mais qui na dtre que pour elle et par rapport elle, et qui
est prcisment ltre dun phnomne. Aussi loin que lon dpasse
laspect que lobjet peut nous offrir, il est encore un objet qui nous
offre un nouvel aspect de lui-mme ; il est toujours ce qui se montre
ou qui pourrait se montrer quelquun. Lexpression dobjet absolu
est une contradiction : cest ce qui, nayant dexistence que par rap-
port au pour soi du sujet, devrait tre pos pourtant indpendamment
de ce rapport. Or l o ce rapport cesse, nous ne pouvons assigner
lobjet [30] aucune autre existence que celle dun pour soi qui lui est
propre et qui est seul capable de fonder son en soi : telle est, en ef-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 32
fet, la thse essentielle de la monadologie, et aussi de toutes les doc-
trines qui rduisent le monde une action que Dieu exerce sur les
consciences, un langage quil ne cesse de leur faire entendre.
Derrire cette nantisation apparente destine fonder ltre du
pour soi, il y a une dmarche qui est bien familire aux philosophes
et laquelle Descartes a donn une forme particulirement saisis-
sante, mais qui reoit ici un sens oppos celui quil avait voulu lui
donner. Nul mieux que Descartes na marqu comment le cogito lui-
mme se fonde non pas seulement sur le doute, mais sur cet anan-
tissement du monde qui nen laisse subsister que la pure pense, et
qui en ralise en quelque sorte labsence. Mais ce ntait pas pour
introduire le nant au cur de la conscience (bien quelle se dter-
mine elle-mme comme finie dans sa relation vivante avec linfini) ;
ctait au contraire pour lui donner accs dans labsolu de ltre par
la possibilit quelle a de se mettre au-dessus de tous les phnom-
nes et mme de les nier en vertu prcisment de lascendant ontolo-
gique quelle a sur eux ; et cest en eux quelle nous dcouvre cette
insuffisance dtre, ou cette part de nant, qui fait que ltre mme
quils possdent leur vient dailleurs, du moi ou de Dieu, et quil a
toujours besoin dtre ressuscit.
On conviendra que la philosophie de lexistence a le grand mrite
de fonder lexistence sur la libert
3
3
On remarquera que cette philosophie de lexistence est comme une ellipse
deux foyers : car tantt il semble que cest len soi qui apparat comme expri-
mant le fond mme de ltre, tantt il semble que cest la libert, qui pourtant
suppose cet en soi quelle nantise. Mais il suffirait de partir au contraire de la
libert comme du seul et vritable en soi pour que len soi dont le phnomne
nous rvle et nous cache la prsence ne ft plus quune chimre. Nous nous
trouverions ainsi amens passer de len soi transphnomnal un en soi en
quelque sorte cisphnomnal. Et la rduction de ltre lacte permettrait de
considrer le phnomne comme exprimant dans la libert la fois sa mani-
festation et sa limitation.
en faisant, il est vrai, non point
proprement de lexistence un dfaut du nant , mais de la libert
elle-mme une sorte dirruption du nant dans ltre. Ds lors on
nprouvera pas de peine [31] accorder que lexistence elle-mme
prcde lessence, au lieu dtre fonde sur elle et den tre seule-
ment la forme manifeste. Car on acceptera la fois lidentit de
lexistence et de la libert, et la primaut de lexistence par rapport
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 33
lessence, mais condition de rsoudre certaines difficults qui sont
insparables de ces deux thses : car on demandera comment cette
libert est engage elle-mme dans une situation, ce que lon ne peut
expliquer quen faisant de la libert et de la situation les deux as-
pects corrlatifs de lacte de participation. De plus, on ne se laissera
pas arrter par cette affirmation que cest cette libert absolue que
Descartes prte Dieu quil faut attribuer lhomme, car, bien que
Descartes lui-mme ait soutenu que la libert est indivisible et
quelle est en nous ce quelle est en Dieu, toutefois il ne faut pas
oublier quelle nest pas associe en Dieu une nature, quelle nest
point affronte en lui comme en nous des possibles dont il semble
quils viennent dailleurs et entre lesquels on peut dire quelle aura
choisir, mais sans quil lui appartienne de les crer. Car si lon ne
demande pas quelle est lorigine de la libert, qui est toujours le
premier commencement delle-mme, on peut du moins demander
quelle est lorigine de ces possibles qui lui sont offerts et qui rem-
plissent lintervalle qui spare la libert divine de la ntre.
Ainsi la primaut de lexistence par rapport lessence suppose,
semble-t-il, deux postulats, savoir : le premier, que le propre de la
libert, cest de faire clater dans le tout de ltre des possibles sans
lesquels elle ne serait rien ; or ces possibles ne sont pas leffet de la
nantisation de ltre en soi, car ils appartiennent eux aussi au do-
maine de ltre, en tant prcisment quils dpassent le domaine de
ltre ralis ; et le second, que lessence a plus de valeur que
lexistence, ou du moins quelle est la valeur qui doit justifier
lexistence, puisque cest vers elle que lexistence tend, quelle a
seulement pour objet de lacqurir. Nous savons par consquent que
lexistence se trouve entre une possibilit que la participation fait
jaillir de lacte pur comme la condition mme de sa libert, et une
essence que cette libert forge peu peu au cours du temps par
lactualisation de cette possibilit.
On a beaucoup admir en gnral les analyses consacres [32]
dans ltre et le nant la conscience de soi et la relation entre le
moi et les autres. La conscience de soi est caractrise par la mau-
vaise foi, une mauvaise foi en quelque sorte constitutionnelle, puis-
quelle est insparable dun tre qui nest pas ce quil est et qui est
ce quil nest pas. Quest-ce dire, sinon quil sagit dun tre qui se
cre et ne peut jamais faire de lui-mme une chose cre ? Ne faut-il
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 34
pas dire alors que la sincrit est une entreprise vaine et quon ne
peut jamais produire la concidence avec soi ? Mais cela signifie
simplement quil ne faut jamais parler de soi comme dune chose, ni
mme peut-tre jamais parler de soi, ou encore que ltre du moi
rside dans une possibilit quil npuise pas, de telle sorte quil ne
peut se rduire lui-mme, ni une possibilit dj ralise et quil
dpasse toujours, ni une possibilit encore en suspens et quil
prouve en lui, sans quil soit jamais assur de la rendre relle. De l
cette ambigut de la conscience qui fait que le moi semble toujours
se chercher sans russir se trouver. Mais la mauvaise foi ou ce
quon appelle de ce nom nat quand on transporte sur le plan thori-
que, o le rel est considr comme dj donn, cet tre qui na de
subsistance que sur le plan pratique, cest--dire dont ltre est de se
faire, et qui tente vainement de transformer en donn lacte mme
par lequel il se fait.
On le voit bien dans le rapport que le moi de chacun de nous sou-
tient avec le moi des autres. Car la connaissance que nous en avons
fait que les autres hommes sont pour nous des objets ou des corps,
alors que nous savons pourtant quils sont aussi pour nous des cons-
ciences comme nous. Et cest parce que nous savons quils sont eux-
mmes des consciences, quils peuvent nous rduire eux aussi
ltat dobjets ou de corps. De l ces analyses pntrantes et dj
clbres du regard et de lamour o lon dcrit dans le moi une dou-
ble oscillation entre un moi qui se sait moi pour lui-mme, alors
quil peut considrer les autres comme des objets, et un moi qui, sa-
chant que les autres aussi peuvent dire moi, sent quil peut tre son
tour rabaiss par eux au rang dun objet. Faut-il en conclure que
chacun soit oblig tantt de se subordonner lautre, en faisant de lui
un objet, soit spontanment, soit volontairement, par une sorte de
jalousie et de [33] cruaut, et tantt de se subordonner lautre en
sentant quil nest quun objet pour lui et par une sorte
dabaissement et de complaisance ntre pour lui rien de plus ?
Cest nier quil puisse y avoir une relation entre les sujets, cest--
dire une communication entre les consciences, puisque chaque sujet
est astreint faire des autres un objet en devenant son tour un ob-
jet pour lui, bien que chacun deux sache de lautre quil est aussi un
sujet et nen profite que pour lavilir ou demander quil lavilisse.
Cest que la communication entre les consciences nest possible
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 35
sans doute quau-dessus de lune et de lautre et dans une intriorit
profonde et secrte qui leur est commune o chacune delles pntre
par la mdiation de lautre. Mais l o cette intriorit fait dfaut, l
o elle est mise en doute, les individus restent affronts comme des
ennemis : ils habitent ensemble dans un Enfer o la subjectivit dun
autre nest pour la mienne quun chec ou un scandale ; lune des
deux doit tre nie ou asservie, cest--dire rduite cet objet, ou
ce corps, qui la limite, et dont on voit bien quil est pour elle un
moyen de porter tmoignage et non point de dtruire ou de se laisser
dtruire.
Cependant le malheur de notre condition provient, nous dit-on,
de lopposition entre le pour soi et len soi et de lambition que nous
avons de vouloir quils concident. Ce serait pour nous devenir
Dieu. Mais cette ambition est irralisable, elle est une contradiction,
sil est vrai quil faut que le nant sinsinue dans len soi pour cons-
tituer ltre du pour soi. Seulement les choses se passeraient tout
autrement si ctait dans le pour soi que se dcouvrait nous
labsolu de ltre ou du soi. Et sans doute il est vrai quil ne se d-
couvre jamais que sous une forme participe, cest--dire o
lintriorit est toujours mle dextriorit ; mais, au lieu de dire
quil est absent de nous, comme une fin que nous ne pouvons ja-
mais atteindre, il faut dire quil nous est prsent comme une
source que nous ne pouvons jamais puiser. Alors le dsespoir qui
nat du dsir idoltre de possder un objet infini qui recule toujours
se change en la joie dune activit qui ne saurait dfaillir et nous ap-
porte une rvlation qui ne sinterrompt plus.
[34]
On peut conclure sur la philosophie de lexistence en disant
quelle est une expression cruelle de lpoque o nous vivons, qui
ne pouvait manquer de sy reconnatre, quelle dcrit en traits singu-
lirement amers la misre de lhomme en tant quil se sent abandon-
n dans le monde, prisonnier de sa solitude et incapable de la vain-
cre, ignorant de son origine, livr un destin incomprhensible, et
certain seulement dune chose, cest quil est vou la mort, qui un
jour lengloutira. On ne stonnera pas que le primat de lexistence
sexprime par un primat du moi individuel en tant quil ny a pas
pour lui dautre existence vritable que la sienne. Mais comment la
dcouvrirait-il autrement que par lmotivit et, dans lmotivit
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 36
mme, par les motions les plus vives qui sont toujours des mo-
tions ngatives et le sparent dun monde qui lignore, qui lui est
toujours tranger et peut-tre mme hostile ? De l le privilge de
linquitude, de langoisse et du souci. De l, labsurdit de toutes
choses, bien que nous voyions mal dans un pareil monde do peut
venir la raison qui les juge telles. De l la nause que nous prou-
vons devant elles et qui suppose pourtant en nous une dlicatesse
qui nen tolre pas le spectacle. On ne peut sempcher de juger
quil y a beaucoup de complaisance dans cette considration de la
pure misre de lhomme que lon pense relever seulement par la
conscience mme quon en prend. Mais cette conscience ne suffit
pas. Ou du moins elle na de valeur que si elle devient un moyen qui
nous dlivre. Cela nest possible que par cette transfiguration de
lmotion qui, au lieu de la rduire un branlement subjectif, la
porte elle-mme jusqu cette extrme pointe o lamour et la raison
ne font quun, que par cette transfiguration de la libert qui, au lieu
dun pouvoir arbitraire de lindividu, en fait la volont claire de la
valeur. Lhomme, dit-on, se dpasse vers lavenir, mais il faut quil
ait le pouvoir de le faire ; ce nest pas lavenir qui est le transcen-
dant, mais une puissance trans-temporelle laquelle nous partici-
pons et qui nous ouvre sans cesse un nouvel avenir. La philosophie
de lexistence est une psychologie de lhomme dchu et malheureux,
mais qui nentend point se relever de sa dchance ni sarracher
son malheur. Elle ne trouve un succs profond que dans les [35]
mes dj dsespres, ou qui veulent ltre. Elle voque Pascal, et
plus prs de nous Kierkegaard, mais pour ne retenir que lune des
faces de cette double exprience de grandeur et de misre qui est
constitutive leurs yeux de la condition humaine. Elle se dfinit el-
le-mme comme une phnomnologie. Elle ne peut pas tre tenue
pour une mtaphysique. Elle veut tre un humanisme, mais qui
considre lhomme isolment et brise toutes ses attaches avec ltre
o il trouve sa propre raison dtre, la lumire qui lclaire,
lternit qui le soutient et la clef de sa propre vocation temporelle.
Il ny a que deux philosophies entre lesquelles il faut choisir :
celle de Protagoras selon laquelle lhomme est la mesure de toutes
choses, mais la mesure quil se donne est aussi sa propre mesure ; et
celle de Platon qui est aussi celle de Descartes, que la mesure de
toutes choses, cest Dieu et non point lhomme, mais un Dieu qui se
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 37
laisse participer par lhomme, qui nest pas seulement le Dieu des
philosophes, mais le Dieu des mes simples et vigoureuses, qui sa-
vent que la vrit et le bien sont au-dessus delles, et ne se refusent
jamais ceux qui les cherchent avec assez de courage et dhumilit.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 38
[37]
DE LTRE
Premire partie
LUNIT DE
LTRE
Retour la table des matires
[38]
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 39
[39]
Premire partie. Lunit de ltre
Chapitre I
DE LA PRIMAUT
DE LTRE
A. PRIMAUT DE LAFFIRMATION
PAR RAPPORT LA NGATION
Retour la table des matires
ART. PREMIER : Ltre est le terme premier, puisque tout autre terme
le suppose et lexprime en le limitant.
Ltre est lobjet universel. Le mot objet nest point pris ici
comme corrlatif du mot sujet. Laffirmation de ltre est antrieure
la distinction du sujet et de lobjet et les enveloppe lun et lautre.
Il est pris dans une acception purement logique et dsigne tout terme
possible dune affirmation. Par consquent, on ne saurait demble
invoquer une primaut du sujet qui affirme par rapport lobjet de
laffirmation. Car ce sujet lui-mme, en tant que sujet, est lobjet
dune affirmation qui montre assez bien, par cette sorte de redou-
blement, que le rle de laffirmation elle-mme est de nous enfermer
dans le cercle de ltre et que, comme ltre nest rien de plus que
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 40
lobjet de laffirmation possible, laffirmation son tour nest rien
de plus que ltre en tant quil y a en lui une conscience qui
laffirme.
Ds lors on peut le nommer le terme premier, puisque tout autre
terme le suppose et lexprime en le limitant.
Mais, en parlant une langue plus prcise, on reconnatra que les
mots premier ou dernier nont de sens quau regard dune multiplici-
t ; et comme il nest pas possible dopposer ltre dautres termes
qui seraient extrieurs lui, ces mots visent seulement un ordre rela-
tif entre des formes particulires de ltre, ds que le temps a appa-
ru. Lordre ne peut [40] tre tabli entre ltre et autre chose, mais
seulement lintrieur de ltre et entre ses formes, grce la d-
marche dun sujet fini qui poursuit quelque dessein privilgi, com-
me de reconstruire le monde dans labstrait. Cest au contraire le
caractre exclusif de ltre, si lon distingue en lui des parties, de
requrir aussitt leur implication rciproque.
Quand on parle de la primaut de ltre, il sagit donc dune pri-
maut absolue qui est la primaut mme de labsolu lgard du re-
latif, dun relatif qui, au lieu dtre distinct de labsolu comme un
terme dun autre terme dans la relation qui les unit, est contenu lui-
mme dans labsolu comme lexpression dans ce quelle exprime. Il
ne sagit ni dune primaut simplement chronologique qui suppose
une conscution relle entre plusieurs termes, ni mme dune pri-
maut logique qui ferait de cette conscution relle une conscution
idale. Car cette primaut nest point celle dun premier terme dans
une srie. Elle est celle de ce tout omniprsent et immanent la s-
rie elle-mme et dans lequel les termes de la srie sont distingus
par analyse et ordonns selon la loi mme de la srie. La primaut
de ltre nest point une primaut selon le temps chronologique, ni
logique, puisque le temps qui fait partie de ltre le suppose et que,
si lon pouvait imaginer contradictoirement un ordre temporel entre
ltre et le temps, cest le temps tout entier qui serait postrieur
ltre.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 41
ART. 2 : Il ne peut y avoir de passage du nant ltre, ni par
consquent de naissance de ltre.
On demandera si la primaut absolue telle que nous lavons dfi-
nie ne doit pas tre attribue au nant plutt qu ltre.
Lmergence de ltre serait aussi le commencement du Temps. Ce-
pendant, il faut renoncer lambition de passer un jour du nant
ltre, comme on passe dun terme un autre dans une dduction de
concepts ou dans un enchanement de phnomnes. Cest, sans le
vouloir, douer le nant lui-mme dune sorte dtre privatif dans une
srie plus vaste, dont ltre positif serait le second terme. Mais on
voit tout de suite que cette srie son tour devrait tre place au de-
dans de [41] ltre total, cest--dire quil faudrait opposer ltre
lui-mme pour la former.
Nommer le nant, cest dj lui donner ltre. Mais, puisque les
diffrents aspects de ltre ne peuvent apparatre dans une conscien-
ce que sous une forme successive, la ralit actuellement donne de
chacun deux semble entraner labolition de tous les autres. Ils en-
trent tour tour dans un nant relatif aux yeux dun sujet qui vit
dans le temps, mais qui garde encore le pouvoir de se les reprsenter
aprs leur disparition en opposant le souvenir la sensation. De l il
ny a quun pas imaginer un nant absolu dans lequel disparatrait
ltre tout entier ou qui prcderait sa naissance. Mais il ne peut pas
y avoir de naissance de ltre. Cette expression repose sur une assi-
milation du tout la partie qui est intolrable. Les choses particuli-
res sexpliquent les unes par les autres. Mais vouloir que ltre tout
entier tire son origine du nant constitue une double impossibilit,
puisquil faut supposer dabord, pour poser le nant, un sujet qui le
pose et qui doit faire partie de ltre, ensuite une dure idale qui,
mme dans son essence la plus dpouille, est une forme de ltre, et
quon ne peut se dispenser dimaginer pour essayer dy surprendre
lavnement de ltre lui-mme.
En ralit, le nant ntant rien de plus quune ngation suppose
ltre pour le nier. Il est ltre ratur, mais dans une opration illu-
soire qui ajoute ltre ratur lopration qui le rature et revendique
seulement, lintrieur de ltre lui-mme, la primaut sur ltre
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 42
donn de lopration qui se le donne. Telle est la thse sur laquelle
nous fonderons ltude de lintriorit de ltre dans la troisime
partie et qui recevra tout son dveloppement dans le second volume
de cet ouvrage o nous tudierons dans ltre lacte mme qui le fait
tre.
Bien que cet acte, comme tel, soit tranger au temps et quil le
fonde au lieu de le supposer, on comprend bien quau lieu de dire,
comme il est vrai, quil est lexclusion ternelle du nant, on prfre
dire, pour ne pas rompre le couple de ltre et du nant, quil est le
passage ternel du nant ltre ou quil lengendre lui-mme ter-
nellement.
Cependant cette primaut absolue de ltre peut tre conteste :
on peut prtendre que, sur le terrain logique o nous [42] sommes
placs, la primaut appartient lintelligence qui en fonde la possi-
bilit, que, sur le terrain gnosologique, elle appartient au moi qui
en pose lexistence, que sur le terrain axiologique enfin, elle appar-
tient au bien qui en donne aussi la raison dernire. On pourrait, il est
vrai, se contenter de soutenir que lontologie enferme en elle la lo-
gique, la gnosologie et laxiologie la fois ou que lintelligibilit,
la subjectivit et la valeur sont galement des modes de ltre qui le
dterminent et par consquent le supposent. Mais il convient de pro-
cder ici un examen plus dtaill.
B. PRIMAUT DE LTRE
PAR RAPPORT LINTELLIGENCE
Retour la table des matires
ART. 3 : Ltre, antrieur lintelligibilit et la ncessit, ne
peut tre saisi que dans une exprience pure.
Prtendre quen renonant une gense de ltre on le dpouille
de son intelligibilit, et, par suite, de toute ncessit inhrente sa
nature, qui ne peut plus se rvler nous que comme un fait ou une
donne, cest mconnatre la fonction relle de lintelligence, le sens
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 43
de lide de ncessit et peut-tre mme la dignit dune certaine
exprience pure.
Car, sur le premier point, loin que lintelligence puisse ds le
principe sarroger la prminence et soumettre ltre sa juridiction,
il est vident quil faut lui attribuer ltre avant de savoir si ltre
son tour se confond avec elle : ce sera pour nous un problme de
chercher si lintelligence le recouvre exactement et lpuise dans son
intgralit. Lintelligence est fille de ltre ; elle imite sa puissance
productrice ; elle dvoile la multiplicit systmatique de ses formes ;
elle nengendre pas la matrice qui les contient toutes et qui la
contient elle-mme.
En second lieu, lide de ncessit est contemporaine de
lintelligence et il ny a pas de diffrence entre la ncessit et
lassimilation de ltre par lintelligence. Aussi les choses sont-elles
ncessaires, non pas en elles-mmes, mais les unes par rapport aux
autres, car le propre de lintelligence cest, ds que le multiple sest
manifest, dintroduire en lui le rapport [43] qui est une sorte
dunit drive, une image de lunit de ltre.
La distinction de ltre et de lintelligence apparat comme la
forme primitive et sans doute le principe de toute multiplicit. On
peut donc concevoir dj entre ces deux termes un rapport ncessai-
re. Mais toute ncessit est conditionnelle. Or, cest le conditionn
qui est ncessaire et non pas la condition, sinon rebours et pour
que le conditionn puisse tre pos. Par consquent, si dans lordre
de la connaissance, lintelligence appelle ltre comme sa condition
ncessaire, dans lordre ontologique, cest ltre qui intgre
lintelligence par une implication ncessaire comme le tout intgre
la partie et la lumire lclairement. Mais parler dune ncessit in-
trieure ltre mme, cest introduire en lui une dualit, cest faire,
au cur de son essence, une distinction illgitime entre le principe
qui le pose et le fait pour lui dtre pos. Ltre est suprieur la
ncessit prcisment parce quil la fonde et quil ny a rien de n-
cessaire que par rapport lui.
Troisimement, puisque ltre est la condition la fois actuelle et
universelle sans laquelle tout conditionn naurait plus quune n-
cessit hypothtique, au lieu dune ncessit objective, il est vident
que ltre devra tre saisi par une exprience. Car, si la logique nous
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 44
permet datteindre lintelligibilit dune chose, cest--dire son ide,
la chose ne peut tre atteinte elle-mme que dune manire imm-
diate, et par suite, dans une exprience : or ltre est prcisment le
caractre qui fait que les choses sont des choses. Lexprience que
nous avons de lui mrite le nom dexprience pure, non seulement
pour se distinguer de toutes les expriences particulires qui
limpliquent, mais encore parce quelle est la seule qui soit assure
de concider avec son objet ; en effet, la reprsentation quelle nous
donne saisit dj ltre en se saisissant elle-mme comme un tre.
Cette exprience est donc une intuition intellectuelle, elle est la ra-
cine commune de la pense logique, qui la suppose pour ne pas tre
un vain jeu dialectique, et de lexprience sensible, qui lapproprie
aux conditions particulires o nous sommes placs ; mais elle est
suprieure toutes deux, car leur distinction [44] explicite la dis-
tinction de ltre et de son ide, tandis que lide de ltre, prcis-
ment parce quelle possde ltre elle-mme, fait la preuve immdia-
te de la prsence en elle de son objet.
ART. 4 : La distinction de ltre et de lintelligence nest quune
distinction de droit qui ne porte pas atteinte la primaut de ltre
par rapport lintelligence.
Lintelligence, insparable de ltre quelle se donne par sa pro-
pre opration, peut avoir lillusion quelle le produit, et cette illusion
a dautant plus de vraisemblance que ltre est indivisible et partout
prsent tout entier. De fait, cette aptitude de lintelligence
sinscrire dans ltre par son acte mme et, dautre part,
limpossibilit de distinguer entre ltre de lintelligence et ltre en
gnral, conduisent pntrer trs profondment dans la nature de
ltre et le dfinir par lexclusion de toute passivit.
Mais il faut conserver ltre sa primaut par rapport
lintelligence, dabord parce que cest une question de savoir sil ny
a pas dtre en dehors de lintelligence, tandis que nous savons bien
quil ne peut rien y avoir en dehors de ltre (ainsi lintelligence ap-
parat comme une espce de ltre avant que lon puisse dmontrer
quelle est un caractre qui puise son essence), ensuite, parce que
lintelligence, qui le pose en se posant, lui donne par l mme une
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 45
dtermination particulire qui est lintelligibilit et sastreint
dmontrer ultrieurement que toutes les autres dterminations dont
il peut tre lobjet sont, non seulement impliques, mais effective-
ment contenues dans cette dtermination primitive par laquelle il se
rvle lui-mme.
Cette rvlation de ltre lui-mme ne peut tre que totale : elle
ne peut atteindre son objet quen sidentifiant avec lui. Si elle sen
distingue, cest parce que, dans ltre fini assujetti une vie tempo-
relle, elle nest jamais pleinement consciente, et comme elle est
pourtant prsente tout entire, ce ne peut tre quen puissance.
Ainsi, poser ltre dabord et concevoir lintelligence comme une
de ses formes, qui sen dtache, puis sy applique, cest [45] vi-
demment placer le mouvement dune pense discursive entre ltre,
conu comme lintelligibilit virtuelle qui soutient et alimente ind-
finiment la conscience, et une intelligibilit actuelle qui, rejoignant
ltre et le recouvrant dans sa totalit, est le terme ncessaire de tous
les efforts dun esprit fini, mais ne pourrait tre rencontre par celui-
ci que dans labolition de ses limites, cest--dire dans sa propre
disparition.
C. PRIMAUT DE LTRE
PAR RAPPORT AU MOI
Retour la table des matires
ART. 5 : La distinction de ltre et de lintelligence ne devient une
distinction de fait que pour un moi qui, se dtachant de ltre pour
le penser, acquiert, en le pensant, ltre qui lui est propre.
Lexprience pure, telle que nous lavons dcrite, par opposition
toutes les expriences particulires, est lexprience dune prsen-
ce dont celui qui lobtient ne sait pas encore, avant toute analyse,
cest--dire, avant toute qualification, si elle concide avec la sienne,
ou si elle la dpasse. Seulement avec une telle exprience, lanalyse
commence. Mais ltre et lintelligence ne se distinguent que pour
moi. Cest grce cette distinction que ce moi se constitue, quil
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 46
affirme son indpendance et se donne lui-mme ltre qui lui ap-
partient. Comment pourrait-il acqurir une existence propre autre-
ment quen participant par un acte de conscience lexistence tota-
le ? Dune part, la conscience quil a de lui-mme serait un miracle
insulaire si elle ne sidentifiait pas avec la conscience de lunivers
dont il fait partie. Telle est la raison pour laquelle toute conscience
est une conscience intellectuelle. Dautre part, sil nen tait pas ain-
si, on ne pourrait expliquer comment les consciences communi-
quent, alors que chacune delles constitue un tout ferm comme le
grand univers qui se reflte en elle ; et de fait, ce nest pas entre el-
les quelles communiquent, mais avec le principe commun qui leur
donne toutes la vie et la lumire. Lunion des esprits est la fois
lacte et leffet par lesquels sexprime et se ralise lunit de ltre
pur.
[46]
Cest dire que ltre est premier par rapport au moi comme il est
premier par rapport lintelligence. Cest lintroduction du moi dans
ltre qui fait de la distinction possible entre ltre et lintelligence
une distinction relle. Mais lantriorit de ltre par rapport nous
nest pas seulement le signe de notre limitation ; elle atteste encore
la ncessit pour lindividu de devenir un tre pensant par une op-
ration qui lui est propre et que nul ne peut accomplir sa place ;
nous montrerons pourquoi cette opration doit seffectuer dans le
temps.
ART. 6 : Le moi, cest la rencontre dune opration et dune don-
ne, ce qui lui permet de constituer son tre propre, par un consen-
tement tre qui fait de lui un tre libre.
La distinction et la liaison de ltre et du moi se ralisent grce
lopposition dune opration et dune donne. Cette opration, cest
ltre en tant quil peut dire moi, quil a une intimit et quil assume
la responsabilit de lui-mme. La donne est ltre en tant quil me
dpasse, quil simpose moi, quil nexiste que par rapport moi et
quil est pour moi un objet ou une apparence. Puisque je suis un tre
sans tre le tout de ltre, je ne suis pas seulement un moi, cest--
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 47
dire une opration pure : ma propre existence mest en mme temps
donne, cest--dire que jai un corps. Et la primaut de ltre par
rapport au moi se rvle ici dune manire nouvelle : car cette op-
ration nest pas seulement postrieure ltre parce quelle a ltre
pour objet et parce quelle nous introduit elle-mme dans ltre ; elle
lest encore en un sens plus profond parce quelle est dabord ltre
dune possibilit quil dpend de nous dactualiser ; mais il faut
consentir le faire. Et cest ce consentement tre, ce passage de
ltre possible ltre ralis, qui me constitue comme moi.
De l cette apparence pour celui qui considre dabord ltre sous
laspect de la subjectivit que le moi est contenu dans ltre comme
corps avant de le contenir lui-mme comme conscience. Mais la
conscience implique un acte quil faut accomplir et il est impossible
de laccomplir sans affirmer du [47] mme coup sa valeur. Cest di-
re que la dialectique par laquelle chaque conscience doit paratre se
dtacher dabord de ltre non-pens pour chercher lembrasser
ensuite par la pense, au lieu davoir pour seule fin de dmontrer
lidentit mtaphysique de ltre et de lintelligible, comportera une
interprtation et mme une justification thiques. Il ne peut pas en
tre autrement si ltre est acte et si notre tre propre, qui semble
dabord donn comme une chose, doit en ralit tre obtenu par une
opration.
Tout se passe comme si chacun de nous tait identique dabord
ce petit fragment de matire auquel sa vie est attache, et qui nest
lui-mme quune sorte de nud o viennent se croiser toutes les in-
fluences venues de tous les points de lespace et du temps, mais
pouvait se servir de ce support pour saffranchir de lespace et du
temps en les pensant lun et lautre.
Par l il nous est loisible de fonder notre vie spirituelle, de conte-
nir ltre en nous aprs avoir t dabord contenu en lui, et de choi-
sir entre deux voies opposes : lune qui conduit vers des fins mat-
rielles, nous asservit au corps, nous dtruit avec lui en rejetant celui-
ci vers dautres combinaisons, o la vie ternelle propose sans cesse
des individus nouveaux une participation dans laquelle ils sem-
blent tous entrans, mais qui ne peut devenir effective que grce
un acquiescement intrieur, que tous ne veulent pas donner,
lautre qui, se dtournant de la matire et labandonnant sans regret
son destin, nous conduit vers un foyer quil fallait avoir quitt
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 48
pour avoir la joie de le retrouver, qui nest donn qu ceux qui le
cherchent et qui laiment, dont tous ceux qui en sont privs procla-
ment justement le nant puisquil na de ralit que dans le cur de
ceux qui le possdent, mais qui est assez accueillant pour recevoir
tous ceux qui se souviennent de lui et qui ont subi la loi commune
de sen tre spars comme des trangers pour pouvoir y rentrer
comme des htes.
Lidentification de ltre et de lacte nous permettra de dfinir
notre tre propre par la libert. Nous crons notre personne spirituel-
le comme Dieu cre le monde. Mais il faut que nous fassions partie
du monde comme une chose avant [48] de pouvoir nous unir Dieu
par un libre choix. Lacte pur ne comporte aucun choix ; mais il rend
possibles tous les choix chez un sujet qui, participant sa nature,
peut sattacher, par un consentement qui fonde sa personne mme,
au principe intrieur qui lanime et le fait tre, ou bien sabandonner
la ncessit par laquelle lensemble de tous les tres finis, dter-
mins par leurs bornes mutuelles, exprime encore la suffisance de
ltre pur.
la limite, et pour un tre qui serait une passivit absolue (mais
un tel tre ne peut pas exister, car, pour quun tat puisse apparatre,
ne faut-il pas quil soit senti en quelque mesure, cest--dire saisi
par un acte qui, il est vrai, reoit aussitt une limitation ?), ltre ab-
solu ne pourrait se manifester que comme une immense donne.
Ainsi, quand nous disons que Dieu cre le monde, nous voulons dire
que, si Dieu cessait dtre pour soi, et sil devenait un spectacle pour
un spectateur qui serait plac hors de lui, grce une sorte de
contradiction, puisque tout spectacle exige une opration de celui
qui le contemple et que toute opration nous fait participer intrieu-
rement lessence de Dieu dfini comme un acte pur, le monde
serait sa forme visible et sa rvlation. Cest prcisment parce quil
ny a pas de donne sans quelquun pour qui elle soit telle, que le
monde, bien quil se distingue de Dieu, ne peut pourtant pas sen
dtacher. Un tre limit ne peut apparatre ses propres yeux et par
ses limites mmes que comme une partie du monde, en attendant
que lactivit de sa vie spirituelle lui permette de crer son tre int-
rieur en retrouvant en lui ltre intrieur dont le monde dpend. Ain-
si lon peut dire que, comme la cration du monde est la transforma-
tion de lacte en donne, la cration de nous-mme consiste inver-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 49
sement, quand le donn est manifest, faire ntre lacte qui le tra-
verse et qui le soutient, au lieu de laisser ce donn apparatre et dis-
paratre dans linpuisable varit dun spectacle pur.
Recevoir la vie matrielle nest quun moyen pour nous
dacqurir lautre. Nous navons point demand natre. Notre tre
est une pice dun ensemble plus vaste qui nobit pas notre vo-
lont. La vie matrielle nous doit parce quelle nest pas propre-
ment ntre, et quainsi elle ne peut pas nous [49] apparatre comme
la vie vritable, parce quelle est borne et incapable de remplir tou-
te notre capacit, enfin parce quelle est en perptuel danger et que
la mort finit toujours par lengloutir. La mort doit-elle donc rconci-
lier tous les tres dans le mme chec ? Pourtant cette vie qui nous a
t impose, qui ne nous satisfait pas, et dont nous pouvons cha-
que instant nous dlivrer en la dtruisant, est la condition dun choix
par lequel tout individu est appel accomplir un acte spirituel
dacceptation ou de renoncement. Il faut quil se donne lui-mme
la vie ternelle, qui suppose lunion avec ltre pur et rside tout en-
tire dans une opration qui fonde sa personnalit, au lieu de la lais-
ser se dissoudre et sanantir dans le tout, ou quil laisse
lunivers poursuivre sans lui cet admirable mouvement dans lequel,
sans se lasser, mais sans subir dans son essence aucun enrichisse-
ment ni aucune diminution, il propose de nouveaux tres le salut
qui est accept par le petit nombre et repouss par la multitude.
Nous ne recevons dans le corps lapparence de la vie que pour pou-
voir vritablement nous donner nous-mmes la vie ou la mort.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 50
D. PRIMAUT DE LTRE
PAR RAPPORT AU BIEN
Retour la table des matires
ART. 7 : Ltre ne dpend pas du Bien, puisque le Bien est int-
rieur ltre et exprime le caractre par lequel la conscience re-
connat dans ltre une plnitude qui, non seulement, remplit sa
propre capacit, mais la dborde.
On pourrait soutenir que ltre trouve dans le Bien sa justification
dernire non plus par la considration de sa possibilit, comme il
arrive pour lintelligible, ni par la considration de lexprience ac-
tuelle que nous en avons, comme il arrive pour le moi pensant, mais
par la considration que ce bien seul donne ltre sa signification
et peut faire de lui le terme o notre vouloir et notre pense se repo-
sent. Telle est la thse que lon trouve dans toutes les doctrines o le
Bien est dfini soit comme la source dont ltre drive, soit comme
la fin vers laquelle il tend. Mais ltre na ni source, ni fin. Car toute
source et toute fin doivent tre intrieures [50] ltre lui-mme, de
telle sorte quelles ne peuvent avoir de sens que par rapport un tre
particulier quand on cherche expliquer son devenir en lui assignant
une origine et une destination. Mais si ltre est premier par rapport
au devenir, cest dire quil est premier partout ou quen lui, il ny a
pas de distinction entre premier et dernier : cette distinction est la
marque dun tre fini astreint recevoir lexistence, au lieu de se la
donner, et la perdre comme il la reue.
Pourtant la primaut du Bien par rapport ltre sest exprime
de plusieurs manires dans lhistoire de la pense philosophique :
dabord dans le platonisme qui met lide du Bien au-dessus de
ltre et dans une certaine mystique chrtienne qui en est inspire et
qui, sexprimant par une thologie ngative, met Dieu lui-mme au-
dessus de ltre. Mais il est vident que ltre dont il sagit ici, cest
ltre en tant que donn ou que ralis, non point en tant quacte et
que ralisateur. Or ltre considr comme tel, cest--dire dans son
intimit et non point dans sa phnomnalit, devient en effet le mo-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 51
teur suprme de toutes les existences particulires ; il est donc invi-
table quil devienne aussi leur bien, puisquil leur donne tout ce
quelles possdent et quelles ne peuvent puiser quen lui la satisfac-
tion de tous leurs dsirs, mme des plus hauts. Seulement, comme
notre exprience ne contient rien de plus que des tres particuliers,
de telle sorte que ltre semble une dnomination qui leur est com-
mune, on comprend que le bien puisse tre rejet au del de ltre,
au lieu dtre ltre mme dans sa parfaite suffisance, en tant que
tout tre particulier et insuffisant sen dtache pour sy unir. Cepen-
dant ce langage mystique na pas prvalu et on prfre identifier
Dieu avec ltre que de lui refuser ltre, comme sil y avait l une
sorte de sacrilge, quitte nattribuer ensuite aux tres particuliers
quune sorte dombre dexistence
4
[51]
.
Nous ne dirons pas du bien quil est une dtermination de ltre
et que cest pour cela quil est second par rapport lui, mais quil
est laspect sous lequel il se rvle tous les tres qui en participent
par des dterminations particulires quil dpasse toujours. De l
cette tendance commune la plupart des mtaphysiciens de consid-
rer le Bien comme un autre nom de ltre, de soutenir que le mal est
dans la dtermination, cest--dire dans la finitude, de telle sorte que
ltre auquel on ne peut rien ajouter et au del duquel on ne peut
rien dsirer apparat sous la forme du Bien tout tre qui se dfinit
lui-mme par le manque et par le dsir.
4
On ferait la mme observation en ce qui concerne largument ontologique
dont la signification sera analyse avec plus de dtails dans la 3
e
partie au
chapitre VIII et o lexistence parat une suite de la perfection et engendre
par elle. Car on ne peut ngliger que dans un tel argument la perfection est
toujours insparable de linfinit : de telle sorte que cest linfinit quest at-
tribue dabord sa vertu concluante ; lide tant elle-mme un tre, il est dif-
ficile dadmettre quelle ne contienne dj la totalit de ltre dont elle est
lide ; enfin la force et la faiblesse de largument rsident sans doute dans ce
passage la limite par lequel, observant dans tous les tres particuliers que
cest lide du Bien qui est le facteur de toutes leurs acquisitions, nous ten-
dons la totalit de ltre une sorte dlan de la mme forme, mais contract
et immobile, qui nous permet dvoquer dans la formule causa sui une gense,
lintrieur mme de ltre, de ltre quil est par le bien quil devient pour
toutes les existence qui en procdent.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 52
On peut conclure en disant que le bien nest pas premier par rap-
port ltre comme le terme qui le prcde et le justifie, car le Bien
nest quune perspective que nous prenons sur ltre ; il introduit en
lui une dualit, il suppose une sensibilit aussi pure quon le vou-
dra, qui le gote, il nest que la louange ternelle par laquelle les
tres particuliers attribuent ltre absolu le principe de cette abon-
dance spirituelle et de cette joie sans limites quils se donnent eux-
mmes en sunissant lui.
La connaissance que nous pouvons acqurir de ltre nous donne
nous-mme notre tre intrieur. Par consquent, si le moi sastreint
dans chacune de ses dmarches garder avec ltre le contact le plus
troit, et si les oprations par lesquelles il se ralise sont rellement
accomplies et non pas seulement conues comme possibles, la preu-
ve de leur valeur rsidera dans leur efficacit : la constitution de no-
tre personne, le sentiment de la prsence constante de ce tout spiri-
tuel auquel nous adhrons, le contentement de notre tat et cette re-
lative, mais exacte suffisance qui ne peut nous tre donne que par
un principe qui, tant lui-mme la suffisance plnire, abolit tous les
dsirs en les comblant et en [52] les dpassant, une srnit et une
force toujours renouveles, mais toujours semblables elles-mmes,
tels sont les effets qui montreront la fcondit des tapes successives
de notre action
5
5
On trouvera une confirmation de cette analyse dans notre Introduction
lontologie o les catgories ontologiques sont tudies avant les catgories
axiologiques : car il faut que les premires dfinissent les diffrents modes
daccs dans ltre avant que les secondes donnent ces diffrents modes leur
signification intrieure. On comprend ds lors pourquoi nous avons d mon-
trer dans ce chapitre que ltre porte dj en lui la fois lintelligible et le
bien, au lieu de pouvoir tre driv soit de lun, soit de lautre, bien quil ne
reoive sans doute cette double dtermination qu partir du moment o la
participation intervient et fonde elle-mme lopposition de lentendement et
du vouloir.
.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 53
E. PRIVILGE DE
LA MTHODE ANALYTIQUE
Retour la table des matires
ART. 8 : La primaut de ltre dmontre que lesprit ne peut ja-
mais faire usage dune autre mthode que de la mthode analytique.
Les observations qui prcdent nous permettent de conclure que
tous les objets de la pense sont intrieurs ltre, ainsi que toutes
ses dmarches, que ltre par suite ne peut pas tre driv, parce
quil faudrait le driver de lui-mme, enfin quil est premier non
point en ce sens quil prcde logiquement ou historiquement tout le
reste, mais en ce sens qutant contemporain de toutes les formes
quil peut revtir, celles-ci ne peuvent tre poses quen lui et par
lui : ce sont des dterminations qui le limitent et non des caractres
nouveaux qui viendraient sy ajouter et qui, trangers dabord
ltre, auraient la charge mystrieuse de lui confrer une ralit quil
navait pas.
La seule mthode dont la pense puisse faire usage est donc la
mthode analytique. On ne doit demander rien de plus la connais-
sance quune description de ltre, mais cest une description qui, au
lieu de rester extrieure son objet, atteint son essence, parce que, si
elle est fidle, elle ne fait que nous solliciter accomplir lopration
par laquelle, en participant sa nature, nous dcouvrons dj notre
identit avec elle.
[53]
Elle affectera ncessairement une forme cyclique, non seulement
parce que la pense individuelle, se dveloppant dans le temps et se
nourrissant de lternit, exige de retrouver la fin comme son acte
propre lacte lui-mme qui lui a donn naissance, mais parce que la
psychologie na de fondement que dans lontologie, parce quil faut
que le tout nous soit prsent pour que nous puissions lui devenir
prsent, et parce quil nous a fallu reconnatre que nous tions enve-
lopp dans ltre avant de pouvoir au fond de nous-mme reconna-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 54
tre que nous enveloppons ltre notre tour. Ds lors, le temps ap-
paratra la fois comme une forme particulire de ltre et une
condition de toute analyse. Tout ce qui vit se meut dans ltre, et le
mouvement des corps dans un espace immobile, qui forme la subs-
tance de chacun deux, est une figure de cette communication inces-
sante qui stablit entre le tout et la partie, lorsque la partie, incapa-
ble de se sparer du tout, fait la dcouverte de son omniprsence.
On remarquera que les dmarches de la volont aussi bien que
celles de lintelligence ont elles-mmes un caractre analytique. De
mme que le mouvement est une analyse de lespace par une distinc-
tion entre diffrents points, corrlative dune distinction dans le
temps entre diffrents instants et que la synthse nest quun effet de
la continuit de ces points, corrlative de la continuit de ces ins-
tants, de mme que lacte de lintelligence consiste dans une analyse
de ltre en reprsentations, en objets ou en ides, selon quon lui
donne une application abstraite ou une application concrte, de m-
me lacte de la volont consiste dans une analyse de mon tre propre
en possibilits diffrentes quil assume tour tour. Cependant, cette
analyse est elle-mme leffet dun choix dont on peut dire quil est
crateur. Car tous ces points distincts, ces objets distincts, ces ides
et ces possibilits distinctes nont dexistence que par lacte mme
qui les distingue. Cest lanalyse qui les fait tre. Et cest par cette
analyse que je me donne ltre moi-mme. Il ne sert de rien de pr-
tendre que chacune de ces analyses est elle-mme subordonne un
dessein qui lui donne son unit, de telle sorte que la synthse prc-
de lanalyse qui nest que le moyen par lequel elle se ralise. Car
cette synthse est elle-mme [54] une premire analyse qui a le tout
de ltre pour support et qui se poursuit par des analyses plus fines
qui peuvent elles-mmes tre pousses jusqu linfini.
Ainsi le moi se cre lui-mme par une analyse de ltre qui fait
apparatre devant lui la reprsentation du monde. Lunit de ltre
est donc corrlative dune multiplicit qui est pose avec elle et sans
laquelle elle ne pourrait pas tre pose comme unit. Cest ce second
aspect de ltre que nous tudierons dans la deuxime partie de cet
ouvrage : mais il faut auparavant approfondir la nature de cette unit
qui ne justifie sa primaut que par son universalit et son univocit.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 55
[55]
Premire partie. Lunit de ltre
Chapitre II
DE LUNIVERSALIT
DE LTRE
A. LES DIFFRENTES ESPCES
DE LAFFIRMATION
Retour la table des matires
ART. PREMIER : Ltre contient tout, le rel et lapparence,
lintelligible et le sensible, lacte et la donne, le vrai et lillusoire.
Que ltre soit un terme universel, cest l une affirmation que
personne ne met en doute. Dire que le nant est un terme ngatif,
cest le rendre inoprant contre ltre pur, cest--dire contre la puis-
sance de laffirmation en gnral, puisque, pour le poser, il faudrait
du mme coup le dtruire en le faisant entrer dans une affirmation.
Le nant, tant un terme ngatif, ne pourra donc tre lobjet que
dun jugement de ngation : le nant nest pas. Mais, si le nant na
aucune prise sur ltre, il est au contraire parfaitement lgitime de
nier dun tre particulier un caractre ou une qualit qui appartien-
nent un autre : ce nant relatif exprime une analyse qui seffectue
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 56
lintrieur de ltre mme ; ce que jai de nant est ncessairement
ltre dautre chose.
Ltre contient donc en lui toutes choses : tous les objets de notre
rflexion et notre rflexion elle-mme doivent venir galement
sinscrire en lui ; les distinctions entre la ralit et lapparence, entre
lintelligible et le sensible, sont des distinctions que lon peut faire
entre ses modalits, mais qui natteignent pas lindivisibilit de son
essence.
Dira-t-on quapparatre, cest tre seulement pour autrui, et que
ltre pour autrui diffre par consquent de ltre en soi ? Mais, pris
en lui-mme, ltre pour autrui est une certaine [56] manire dtre
en soi et qui a autant de ralit quautrui qui il apparat ; le sujet et
sa reprsentation sont des ralits qualifies et font partie de la rali-
t totale. Et le tout demeurerait ternellement enferm dans sa soli-
tude et dans son inefficacit sil cessait dapparatre et de se reflter
dans la conscience des tres finis, auxquels il donne ltre en leur
fournissant une image de lui-mme, quil unit entre eux par leur d-
pendance commune son gard, gardant la fois vis--vis de cha-
cun deux et de tous une prsence plnire et une surabondance infi-
nie.
On ne fera pas non plus renatre la querelle entre le sens com-
mun, qui napplique ltre quau sensible, et la mtaphysique, qui
lidentifie avec lintelligible. Le sensible et lintelligible appartien-
nent tous les deux ltre, mais ils nous en font connatre un aspect
diffrent ; le sensible lactualise tout entier aux yeux dun tre limi-
t, lintelligible fait participer celui-ci lopration par laquelle
ltre pur, pntrant dans le multiple pour lilluminer, distingue et
relie entre elles les formes diffrentes quil revt. Cest pour cela
que le sensible et lintelligible sont insparablement associs dans le
concret : leur opposition est un effet de lanalyse ; en fait, chaque
sensation est en rapport avec un acte dtermin de lintelligence, elle
exprime le caractre abstrait et inachev quun tel acte doit conser-
ver dans la conscience du sujet fini pour que celui-ci reste en contact
avec ltre total, sans se confondre avec lintelligence pure.
On se sert en gnral du nom dtre pour dsigner une donne ;
mais lacte par lequel cette donne est saisie fait partie de ltre lui
aussi. Et mme lintriorit de ltre ne peut tre atteinte que sous la
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 57
forme de lacte. Le matrialisme attribue ltre la donne et ngli-
ge lacte. Lidalisme ne voit que lacte ; et il y a un idalisme em-
pirique qui fait de lacte lui-mme une donne. Quant au contraste
qui clate dans lunit de ltre entre lacte et la donne, il nest pas
insurmontable si lon remarque quun acte, au moment mme o il
sexerce, cesse dtre une puissance pour devenir en un certain sens
une donne, quune donne, en la prenant sous sa forme la plus
concrte, est indiscernable de lacte par lequel on se la donne et que
ltre du monde est sans doute un acte, [57] mais qui devient inces-
samment une donne pour un sujet qui, faisant partie du monde,
considre nanmoins comme un spectacle tout ce qui dborde sa
propre opration.
On nous accordera que lillusion la plus misrable, une fois
quelle est donne, trouve place dans ltre, quelle est leffet, il est
vrai, dune perspective troite et confuse sur le rel qui rvle son
insuffisance ds quelle sagrandit, mais que cette illusion est tou-
jours suprieure quelquautre plus misrable encore, quelle lest
infiniment laveuglement pur, et quelle exprime sa manire un
des aspects de la richesse du monde qui il manquerait quelque
chose si on voulait lanantir : ce serait retirer ses bienfaits la lu-
mire que de vouloir la rduire son foyer et de ne pas admirer en-
core la perfection de son essence dans la pnombre la plus incertaine
et jusque dans ses jeux et dans ses mirages.
B. LE POSSIBLE
COMME MODE DE LTRE
Retour la table des matires
ART. 2 : Le possible nest ni antrieur, ni extrieur ltre : il en
est un aspect.
Mais si lacception universelle de ltre nous contraint de ratta-
cher son empire, antrieurement toutes les qualifications par les-
quelles on les distingue, aussi bien le subjectif que lobjectif,
lapparent que le rel, le sensible que lintelligible et mme en un
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 58
sens lillusoire aussi bien que le vrai, une nouvelle difficult se pr-
sente lorsquon se demande sil ny a pas entre le nant et ltre une
essence intermdiaire qui serait le possible. Et mme entre ltre
plein et actuel dune part et le nant de lautre, comme entre deux
limites extrmes, le possible est-il rien de plus quun tre de pense
qui ne sest pas encore actualis, une aspiration tre qui na pas
encore trouv se satisfaire ? Mais si le possible est une existence
pense, il a autant de ralit que la pense elle-mme : loin quon
puisse le regarder comme une forme dexistence attnue et dont
lexistence proprement dite sortirait par voie de dveloppement, il
semble plus juste de faire du possible un tre intellectuel qui
senrichit et sappauvrit la fois quand il sactualise, cest--dire
quand il est reu par lintermdiaire [58] de lespace et du temps
dans la sensibilit des tres finis. Il senrichit en ce sens quil ac-
quiert une dtermination quil navait pas. Mais il sappauvrit aussi
en cet autre sens, cest quil exclut dautres dterminations quil
portait en lui en puissance et qui maintenant sont fltries. Cependant
le possible nest pas la ngation de toute dtermination, puisquil ne
pourrait alors se distinguer daucun autre possible. Cest donc que
tous les possibles sont des espces de ltre. Il ny a pas despces
du nant. Et nul possible nest sans rapport avec les dterminations
qui lui manquent, puisquil en est prcisment la possibilit. Il y a
donc en lui un caractre par lequel il les soutient et dj les appelle,
puisquil ne peut subsister sans elles, bien quelles doivent cesser de
coexister ds quelles se ralisent.
Mais si on rplique que le possible trouve en effet son achve-
ment dans ltre et que jusque-l il nest quune aspiration tre, on
rpondra quune aspiration tre peut bien se distinguer de ce
quelle sera quand elle sera satisfaite, mais que la condition de son
action, cest dabord son inscription dans ltre comme telle. Ce que
lon veut, cest, la limite, lui retirer ltre en lui laissant le caract-
re dune aspiration. Or il y a l une contradiction manifeste qui
confirme encore ce que nous avons dit du nant, puisquen voulant
la considrer elle-mme comme absolument antrieure ltre, on
lui refuse simplement la forme dtre vers laquelle elle tend.
Cette analyse permet dintroduire une rforme profonde dans la
conception classique des catgories de la modalit o les trois ter-
mes de possibilit, dexistence et de ncessit semblent chelonns,
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 59
selon une sorte de progrs qui va dun minimum un maximum
dtre, dun tre qui cherche pour ainsi dire lexistence un tre qui
ne peut plus sen vader. Mais la possibilit nest pas infrieure
lexistence, elle en est un aspect. De mme, la ncessit ne lui est
pas suprieure. Il ne peut y avoir de monde qui soit en de de ltre
par une sorte de dfaut, ni au del de ltre par une sorte dexcs.
Lopposition entre le possible et le ncessaire rsulte des relations
qui stablissent entre les formes de ltre. De mme que le possible
est le caractre de ltre simplement pens dans son rapport avec
une exprience qui nest pas donne, [59] le ncessaire est un tre
encore pens, mais dans son rapport avec une exprience dont on ne
peut plus le dtacher. Entre les deux, il y a cette forme de ltre qui
se dcouvre nous dans une exprience actuelle et donne, de telle
sorte quau lieu de passer du possible au ncessaire par
lintermdiaire de ltre, il faut dire que ltre contient en lui la
fois le possible et le ncessaire qui traduisent les rapports de ltre
pens et de ltre donn tantt pour accuser leur indpendance et
tantt pour la surmonter.
On ne saurait objecter que le possible ou le ncessaire, dont nous
faisons des modes de la pense, peuvent exister sans quils soient
penss. Sans tenir compte de cette observation que ce serait les ins-
crire dans ltre dune autre manire, on pourrait se demander si le
possible non-pens nest pas lui-mme la possibilit dune possibili-
t, cest--dire une pense qui a besoin dtre acheve dans la pen-
se elle-mme avant de ltre dans une exprience, si paralllement
le ncessaire non-pens nest pas la pense dune ncessit qui lais-
se encore indtermines lide et lexprience quelle accorde : le
possible et le ncessaire, par opposition ltre tel quil est donn
une sensibilit, accusent le double caractre de ltre tel quil se r-
vle lintelligence quand il est engendr par elle dabord comme
lessai, ensuite comme la preuve de sa puissance. Mais ltre sensi-
ble et ltre intelligible se recouvrent. Ou plutt ltre sensible, ds
quil se manifeste nous, non plus par un choc qui nous meut, mais
par une opration qui lillumine, met nu ltre intelligible quil
dissimulait
6
6
On comprend pourquoi ltude de luniversalit de ltre doit commencer par
une tude du rapport entre ltre et le possible. Car dune part le possible est
.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 60
[60]
C. LE TEMPS OU LA RELATION
ENTRE LES MODES DE LTRE
ET NON POINT ENTRE LTRE ET LE NANT
Retour la table des matires
ART. 3 : Le temps est intrieur ltre et non pas ltre intrieur
au temps.
Nous avons montr que les ides de nant, de subjectif et de pos-
sible ne constituaient aucun chec luniversalit de ltre. Mais ces
diffrentes ides nont pu sintroduire dans la pense que grce
une distinction ralise par le temps entre les diffrents aspects de
ltre, cest--dire entre les diffrentes manires dont ltre rvle sa
richesse aux yeux dun individu fini. Le possible en particulier ne
peut pas tre pens indpendamment de lide dun avenir qui nest
pas encore ralis. Cest donc lide de temps quil faut maintenant
examiner. En ralit, si on doute parfois de luniversalit de ltre,
cest parce quon oppose au prsent un pass qui nest plus et dans
considr comme tant une sorte dintermdiaire entre ltre et le nant ; et
dautre part on ne voit pas comment on pourrait caractriser aucun objet de
laffirmation qui dborde laffirmation de ltre autrement que comme un non-
tre absolu (et par consquent impossible) ou relatif (cest--dire qui contient
encore en lui ltre dune possibilit). Il y a plus : si cest le temps qui est
linstrument de la participation, on voit aussitt et lexprience confirme que
cest le temps qui, opposant sans cesse ltre lui-mme, semble tablir un
rapport entre ltre et le nant, de telle sorte que lavenir et le pass nous appa-
raissent, par contraste avec le prsent, comme les deux seules formes positives
du non-tre. Nous chercherons donc dans ce qui suit dmontrer quelles sont
lune et lautre incluses dans ltre et nexpriment rien de plus quune certaine
relation entre ses modes (cette relation tant elle-mme constitutive de chaque
essence individuelle). Quant au possible lui-mme, il trouve son explication
dans la nature mme du temps non pas seulement, comme on la montr dans
Du Temps et de lternit, parce quil est la catgorie propre de lavenir, mais
parce quil est encore la catgorie du pass, du moins en tant que le pass
nest pas un souvenir qui sest dj actualis, mais un souvenir qui peut ltre.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 61
lequel ltre semble stre abm, un avenir qui nest pas encore et
o sommeillent des types dexistence qui nont pas encore clos.
Ainsi lexistence du pass et de lavenir dont tmoigne la mmoire,
puisquelle montre galement que le premier sest vanoui et que le
second sest ralis, semble une sorte dexprience de lexistence du
nant.
Cependant le temps lui-mme est une forme intelligible de ltre.
Ou bien nous ne pensons pas le temps et alors, toujours nouveaux
ltre, mais ne le sachant pas, puisque nous ne pouvons comparer ce
que nous sommes avec ce que nous tions ni avec ce que nous
ntions pas, nous vivons dans une sorte dternit o nous sommes
toujours insparables de ltre et pourtant incapables de percevoir
soit notre identit, soit notre mobilit. Ou bien nous pensons le
temps, et alors [61] cest condition de le dominer, de pouvoir saisir
la fois, bien que dune manire distincte, la ralit du prsent avec
celle du pass et de lavenir. Or, cela nest possible que si nous nous
trouvons placs prcisment en ce point de transition o la percep-
tion ne cesse de se transformer en souvenir : lide mme du futur
ne prend une forme positive que grce une sorte dinversion de la
mmoire, car la distinction de ce que nous sommes par rapport ce
que nous avons t prouve quil y avait devant nous un avenir qui
sest ralis. Ainsi il ny a rien de plus dans le temps quun passage
continu de la perception au souvenir, cest--dire dune forme
dexistence une autre : il ny a rien qui sorte de ltre ou qui pn-
tre en lui du dehors.
Toutes les difficults concernant lide de ltre ont leur origine
dans lexprience que nous avons du Temps. Il y a une sorte
dantinomie entre ltre et le temps, de telle sorte que laffirmation
de ltre est toujours tourne contre le devenir et celle du devenir
contre ltre. Il semble que le devenir soit toujours un mixte de
ltre et du nant et que lexprience quil nous donne, ce soit prci-
sment celle du nant en tant que ltre ne cesse den sortir pour sy
replonger. Mais si le devenir est tout entier dans ltre, au lieu
denvelopper ltre tout entier, alors on saperoit quil introduit
seulement dans ltre un nant relatif, savoir le nant de lun de
ses modes par rapport un autre mode quil appelle en disparaissant.
Il ny a rien qui nappartienne ltre et qui ne doive tre pos tour
tour comme pass, comme prsent et comme futur. Mais on ne
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 62
peut exclure aucun terme de lun de ces modes de lexistence sans
linclure aussitt dans lun des deux autres. Seulement ce nest pas
ainsi quon lentend gnralement. Car on prtend au contraire les
dissocier et par l chacun de ces modes, incapable de se soutenir iso-
lment, est invoqu comme une sorte de tmoignage en faveur du
nant qui rsulte aussi bien de la considration de chacun deux que
de celle de leur assemblage. Car le prsent ntant quune transition
ou un passage na point de contenu : il nest quune position sur la
ligne du temps, mais qui nest rien, pas plus que le point. Or nous
disons du pass qui le prcde quil nest plus et de lavenir qui le
suit quil nest pas [62] encore, cest--dire que lun et lautre ne
sont rien. Ainsi, cest ltre mme qui semble chass de partout.
On ne peut donc maintenir luniversalit de ltre quen montrant
quil y a une forme dexistence propre au prsent, au pass et
lavenir et que nul tre particulier ne se ralise autrement que par la
relation qui les unit.
ART. 4 : Le prsent, loin dexclure la totalit de ltre, la contient
et quand, sous le nom dinstant, on en fait une coupure entre le pas-
s et lavenir, cest lui tout la fois qui les oppose et qui les lie.
Largument dialectique qui consiste exclure ltre du prsent
sous prtexte que le prsent nest rien de plus quune limite entre le
pass et lavenir, de telle sorte quon smerveille quil nait point
de contenu, nest que la contrepartie produite par la rflexion de cet-
te affirmation instinctive et populaire que le prsent, cest ltre
mme et quil ny a dtre que dans le prsent. Or cest cette affir-
mation quil sagit de maintenir : seulement, au lieu de considrer le
prsent comme refoulant hors de lui le pass et lavenir, il faut dire
quil les contient dune certaine manire et que leur diffrence avec
le prsent ne consiste nullement dans le contraste entre ltre et le
nant, mais dans un contraste entre des modes diffrents de
lexistence. Il est vident que je nai jamais moi-mme quitt ce pr-
sent et quon ne gagne rien en disant que ce nest jamais le mme
prsent. Car il y a une diffrence entre les objets qui peuvent mtre
prsents, par exemple entre une perception prsente et le souvenir
prsent que jen ai gard, mais non point dans le prsent commun o
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 63
je les reois. Le temps ne consiste pas dans la relation dune prsen-
ce et dune non-prsence, mais dans la substitution la prsence
dun objet de la prsence dun souvenir. Et lon en dira autant de
lavenir en tant quavenir : je ne puis le dcouvrir que par une pen-
se prsente que je puis regarder comme une pense indtermine et
qui, quand cet avenir se ralisera, me donnera une perception pr-
sente : ainsi, ds que je considre lavenir, le temps devient pour
moi en ralit un rapport entre deux prsences.
[63]
Mais il faut dire que, puisque toute prsence pense comme futu-
re soutient avec une prsence pense comme passe, travers une
prsence actuelle, ou, si lon veut, objective, un rapport de liaison et
dexclusion, mais qui affecte une forme oriente, il y a un autre sens
du mot prsence qui dfinit le prsent de linstant et qui nest rien de
plus en effet, semble-t-il, que la coupure entre ce qui vient dtre et
ce qui va tre, cest--dire une imminence pure. Seulement il est
curieux que de ce caractre de coupure quon lui attribue et par
consquent de son absence radicale de contenu on veuille tirer parti
contre son existence. Il semble plutt au contraire que cest dans
linstant considr comme une coupure sans contenu que nous sai-
sissions le mieux lessence mme de ltre en tant quil est tranger
toutes les dterminations, mais prcisment parce quil les dpasse
et quil les engendre. Dans le prsent qui enveloppe tout ce qui est,
ltre nous dcouvre la multiplicit infinie de ses formes. Dans
linstant qui est au centre de tout ce qui est, mais o aucune forme
particulire de ltre ne se distingue plus, ltre nous dcouvre sa
puissance indivisible et sans mesure. Cest pour cela quil ne faut
pas dire quil exclut le pass et lavenir, mais quil les lie. Cest
dans cette imminence pure que toutes les formes particulires de
ltre vont surgir. Chacune delles surgit comme un avenir qui ne
peut se dterminer quen dterminant du mme coup son propre pas-
s. Nous ne parlons dinstants successifs que lorsque nous consti-
tuons la chane du temps par une suite dvnements homognes
pour la pense et auxquels nous cherchons assigner des positions
distinctes et immobiles. Alors nous parlons contradictoirement
dinstant pass ou dinstant futur : ce qui vritablement na aucun
sens. Faut-il dire alors que cest le mme instant qui se dplace ?
Mais ce serait retomber dans la mme erreur et sobliger inventer
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 64
un nouveau temps dans lequel ce dplacement devrait se produire. Il
ny a donc quune solution, qui est de ne plus associer linstant
lvnement, mais dobliger tous les modes de lexistence venir se
confronter avec le mme instant o se produit lacte ternel qui les
ralise. Cest la participation qui, au lieu de les situer dans le temps
comme autant de blocs juxtaposs, dissocie en chacun [64] deux
pour les convertir lun dans lautre le possible et laccompli, cest--
dire deux termes htrognes et incapables de subsister isolment,
qui nentrent dans un ordre successif que par le rapport qui les unit
et qui nest jamais le mme. Mais cest le mme prsent qui les
contient toujours et cest dans le mme instant que vient toujours
sinsrer lopration dans laquelle ce rapport sactualise.
ART. 5 : Le pass ne retourne pas au nant : le souvenir que nous
en gardons na de sens que par sa relation avec une perception ini-
tiale dont il exprime non pas labolition, mais la limitation.
Contre lobjection qui exclut le pass de ltre et le considre
comme proprement ananti, on peut faire valoir cet argument que le
pass subsiste comme pass dans le prsent du souvenir.
Mais cette rponse doit tre approfondie si lon veut rsoudre
certaines des difficults quelle soulve : car le souvenir prsent, en
voquant un objet peru autrefois, montre prcisment quil nest
plus rien aujourdhui, non plus que la perception que nous en
avions. Le souvenir, au lieu dtre le tmoignage de leur survie, est
au contraire celui de leur disparition. Si le souvenir ne donne pas
lobjet peru lui-mme une nouvelle existence momentane, du
moins le caractre relatif de lensemble auquel ils appartiennent tous
les deux prouve que ctait par une illusion que lon attribuait soit
lun soit lautre une existence indpendante ; la perception et le
souvenir sont les termes concrets de cette relation originale quon
appelle le temps et, de mme que le souvenir naurait pas de contenu
idal sans la perception quil reproduit, la perception serait dpour-
vue de corps matriel si elle ne contrastait avec le souvenir qui nous
dcouvre ses limites, la place unique quelle occupe dans la dure, et
en dgage loriginalit dans lacte mme par lequel il vient se substi-
tuer elle.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 65
On admet facilement que la perception est la condition du souve-
nir qui nest souvenir que delle et par elle. Il est plus [65] difficile
dapercevoir que le souvenir est aussi la condition de la perception
qui ne nous dcouvre que par contraste avec lui la prsence en elle
de lobjet : nous ne savons ce quelle est que quand elle nest plus.
Mais ni la perception, ni le souvenir ne perdent jamais la forme pro-
pre de prsence qui leur appartient : ce sont deux termes qui
sexcluent et sappellent tout ensemble. Ils servent dfinir la rela-
tion temporelle en tant quelle possde elle-mme une existence in-
temporelle : le peru et le remmor en sont les aspects ; le passage
indfini de lun lautre, au lieu dexprimer labolition absolue du
premier et son entre dans le nant, atteste au contraire
limpossibilit de le sparer de ltre en mme temps que les bornes
dans lesquelles il faut lenfermer.
Cest que chaque forme de ltre est insparable de ltre ternel
et il en est de mme du temps qui, par la totalit de son dveloppe-
ment, exprime son immobile fcondit ; or cest en pntrant dans le
temps que chaque forme marque sa finitude, mais aussi sa solidarit
avec toutes les formes finies qui la prcdent ou qui la suivent. Ainsi
lon peut dire que ce qui disparat dans lobjet peru, cest ce qui le
limite et non pas ce quil est, de telle sorte que son implication avec
les autres termes de la srie dont il fait partie et la manire mme
dont il semble leur cder la place sont destines lui permettre de
raliser la plnitude de son essence et de participer la totalit de
ltre. Ds lors, la distinction de la perception et du souvenir donne
simultanment chaque conscience la possibilit de constituer sa
propre existence subjective et lessence de chaque chose de nous
rvler la fois sa limitation et son inscription dans un ordre ternel.
La perception qui disparat nest donc pas une forme dexistence
qui retourne au nant avec son objet. Il serait mme plus lgitime de
dire que la ngation de ltre peru au moment o il retombe dans le
pass et tmoigne de son caractre fini lintrieur mme de la rela-
tion temporelle est la ngation dune ngation et na de sens que
pour faire apparatre comme contre-partie un nouveau mode
dexistence qui lui donne une ternit spirituelle.
La distinction mme entre le temps dans lequel lobjet est engag
et le temps dans lequel sengage la perception de [66] lobjet doit
retenir notre attention : elle nous montre que comme, dans lordre
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 66
subjectif, nos tats se succdent parce quaucun deux npuise notre
capacit de percevoir, dans lordre objectif les phnomnes se suc-
cdent aussi parce que chacun deux nexprime quun aspect de
ltre. Le propre de la mmoire est dattester, travers le double re-
nouvellement la fois corrlatif et spcifique du contenu de
lunivers et du contenu de notre conscience, que tous les aspects de
ltre lui sont essentiels, comme tous les tats du moi sont essentiels
au moi. La distinction du phnomne primitif et du souvenir qui
nous en reste est donc la condition sans laquelle nulle forme
dexistence ne pourrait, tout en demeurant limite, prendre place
dans luniversalit de ltre : et ds lors, il ne faut pas stonner si
cette distinction na de sens que pour des phnomnes limits ou, ce
qui revient au mme, pour la connaissance que peuvent prendre des
phnomnes des tres limits.
ART. 6 : dfaut du souvenir rel, le souvenir possible suffit,
pour assurer lobjet peru sa place permanente dans le tout de la
dure.
Ne semble-t-il pas que largument par lequel nous venons de
sauvegarder lexistence de la perception et du souvenir, leur place
respective dans un temps form par leur contraste, doit nous interdi-
re de garder encore quelque ralit lvnement pass, lorsquil ne
laisse dans la mmoire aucun cho ? Cependant il faudrait alors le
retirer du temps ; car nous sommes incapables videmment de situer
une forme dexistence dans un moment particulier du temps sans
que notre pense soit aussitt invite dborder ce moment par une
opration prsente lgard de laquelle lobjet peru acquiert
demble un caractre purement spirituel.
La mmoire sans doute est ncessaire pour que nous puissions
penser le temps, car elle est ncessaire pour que nous puissions pen-
ser son contenu. Mais elle est elle-mme borne et notre mmoire
individuelle trouve son fondement dans une sorte de mmoire uni-
verselle, une mmoire de droit plutt [67] que de fait, qui ne laisse
rien perdre de ce qui a t et qui conserve lobjet disparu sa place
originale dans lhistoire du monde. Cette histoire est relle. Nous ne
pouvons faire quun vnement qui a eu lieu ne se soit pas produit.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 67
Cest quil y a donc une existence du pass comme tel. De mme
quun objet peut exister sans tre reu dans une conscience particu-
lire, ce qui signifie pourtant quil trouverait place dans une cons-
cience illimite, un vnement qui ne laisse de trace dans aucune
mmoire en laisserait une pourtant dans une mmoire infiniment
agrandie. La multiplicit des consciences et des mmoires reprsen-
te dans le particulier un effort dadquation ltre total ; et
loriginalit du particulier ne se maintient qu condition que cet
effort se poursuive sans cesse et que son but ne soit jamais atteint.
Faire tomber dans le nant un terme qui nest lobjet daucun
souvenir, cest dtacher le moment o il sest produit de tous les au-
tres moments du temps sans lesquels on ne pourrait le dfinir, cest
laffranchir de la relation temporelle, en faire contradictoirement un
absolu en lui laissant pourtant ses qualits distinctives et ses limites
propres. La solution de notre difficult se trouve donc dans ce para-
doxe apparent : savoir quon ne peut considrer lobjet pass
comme un pur nant parce que ce serait supposer justement quon
lavait considr dabord, au moment o il tait peru, comme un
absolu qui se suffisait lui-mme : il ne pouvait svanouir sans re-
tour qu condition que chaque moment ft cr, puis dtruit, cest-
-dire que le temps, qui est la relation ternelle de tous les moments,
cesst dtre. Ce serait attribuer la partie un caractre qui ne
convient quau tout et qui prcisment lve celui-ci au-dessus des
vicissitudes de la dure.
ART. 7 : Lavenir exprime la possibilit pour ltre fini de partici-
per par une opration qui lui est propre lacte immuable de la
cration.
On pourrait penser que les observations prcdentes permettent
de rsoudre symtriquement le problme de lavenir. [68] Mais cela
nest pas tout fait vrai : car, bien que le prsent daujourdhui soit
lavenir dhier, nous ne pouvons nous contenter de le saisir dans cet-
te sorte dimage renverse que la mmoire nous donne. Et de fait,
loriginalit de lavenir provient prcisment de ce quil reste ind-
termin devant nous, incapable par suite de fournir une image de lui-
mme jusquau moment o il est converti en pass. Nous
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 68
nessaierons pas non plus de le confondre, pour lui donner
lexistence, avec un acte de volont, un dsir ou une puissance qui le
contiendraient en germe avant quil se ralise. Outre quil y a sou-
vent disparit entre notre tat prsent et celui qui en procde et qui
dpend encore de circonstances extrieures souvent imprvisibles, il
est clair que la question nest pas de savoir si le germe que lon a
sous les yeux doit tre inscrit dans ltre avec ses virtualits actuel-
les, mais de savoir quel est le genre dexistence quil faut attribuer
lavenir, en tant quavenir, avant quil se soit manifest. Or, ici, il ne
sert rien de dire quune connaissance plus parfaite que la ntre le
percevrait comme dj prsent aprs avoir fait le tour de toutes les
causes dont il dpend. Car cest le caractre minent de la connais-
sance de suivre ltre au lieu de le prcder. Nos prvisions ne sont
des images anticipes que parce quelles ont commenc par tre des
images conscutives. Et ainsi la connaissance que nous prendrions
par avance de lavenir lui terait son trait essentiel dtre encore
natre. Peut-on viter par consquent que la ralisation de lavenir
apparaisse comme un enrichissement de ltre ?
Mais si, revenant sur un principe tabli antrieurement, on
consent considrer le temps comme intrieur ltre et non pas
ltre comme intrieur au temps, on verra comment le temps doit
permettre notre tre fini un accroissement indfini sans supposer
pour cela le moindre accroissement de ltre pur.
Cependant, il ne faut imaginer dans aucun cas que celui-ci
contienne en lui intemporellement tous les vnements qui nont pas
encore eu lieu et toutes les actions que nous pourrons jamais produi-
re. Il y a un prjug dans lequel tombent facilement les partisans
trop zls de lomniprsence, qui consiste supposer faussement
que les choses sont en Dieu [69] comme elles sont en nous, imagi-
ner le devenir comme le droulement dun spectacle o, primitive-
ment, tout est donn la fois et, par consquent, sinterdire en
mme temps de regarder les choses sensibles comme un spectacle
qui dpend de notre nature et les actions humaines comme des ini-
tiatives qui dpendent de notre volont. La nature divine surpasse
infiniment en richesse le spectacle qui nous est actuellement offert,
mais elle en contient le principe et la clef. Car les choses particuli-
res ne peuvent exprimer la totalit de ltre que par lordre ncessai-
re qui les relie entre elles dans lespace et dans le temps. De mme,
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 69
la nature divine ne rend possible linitiative que nous allons prendre,
elle ne la soutient, elle ne la nourrit, elle ne la rend efficace que par
cette sve spirituelle surabondante qui la remplit elle-mme et la-
quelle nous ouvrons sans cesse dans notre tre intrieur des canaux
plus ou moins nombreux et plus ou moins larges. Cest dire que
lavenir existe ternellement en Dieu comme un acte auquel il nous
appartient de participer sans cesse par une opration qui nous est
propre et dont leffet sera de le rendre ntre en le convertissant en
tat. Mais lavenir nexiste donc pas en Dieu comme un tat et, au
moment o il saccomplit pour chacun de nous, il reoit une forme
sensible qui le limite en ladaptant la fois notre capacit et nos
desseins. Ainsi on peut expliquer comment lavenir qui, comme ob-
jet empirique et pour un tre fini, nest rien avant quil se produise
pas mme une image antcdente appartient pourtant ltre
ds le prsent par cette sorte dexcs infini de ressources o il puise,
tantt par ncessit et tantt par choix, la force suffisante pour se
phnomnaliser.
En rsum, le contraste entre le souvenir ou lanticipation et la
perception ne doit pas nous conduire penser quil y a des choses
dans lunivers qui se sparent de ltre et dautres qui viennent y
prendre place. Ce serait paradoxalement faire du temps, qui est la
forme de toute relation, un absolu et non un relatif ; ce serait faire
dpendre ltre du temps, au lieu de faire dpendre le temps de
ltre. Lordre selon lequel les choses se prsentent nous ne peut
tre considr comme un caractre immanent ltre mme. Car
nous nous mouvons [70] dans ltre ; et si le principe de relativit
trouve une application entre les choses particulires, il ne vaut pas
entre la partie et le tout, entre le temps et lternit ; rien ne peut
nous autoriser penser que ltre tout entier se meut par rapport
nous et que la position que nous occupons marque la limite entre ce
quil a cess dtre et ce quil va devenir.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 70
D. PRIVILGE ONTOLOGIQUE
DE LINSTANT
Retour la table des matires
ART. 8 : Ltre peut tre figur tour tour par une perception to-
tale ou par une mmoire parfaite ou, plus profondment, par une
opration universelle.
Loin de pouvoir tre invoque contre luniversalit de ltre, la
distinction entre les phases du temps tmoigne en sa faveur : et
puisque ltre est partout prsent tout entier, le pass, lavenir et
linstant mme qui les joint, au lieu de rejeter notre pense vers le
nant, lui permettent denvelopper, chacun pour son compte, la tota-
lit mme de ltre.
Linstant, il est vrai, bien quvanouissant, jouit cet gard dune
sorte de privilge. Il est comme une rencontre que la conscience fait
de ltre dans une concidence fugitive et je me plains seulement de
ne pas pouvoir la conserver, de ne point pouvoir transformer
linstantanit en omniprsence. Ce privilge de linstant peut tre
justifi par deux raisons : la premire, cest que linstant est une pr-
sence dans laquelle le pass et lavenir ne sont pas seulement nis,
mais en mme temps, impliqus ; la seconde, cest que la prsence
qui mest dcouverte dans linstant est la prsence de lobjet, cest-
-dire une prsence qui mest impose et qui me dpasse et non plus
une prsence simplement subjective comme celle que je pourrais
attribuer soit au pass, soit lavenir. J e me trouve ainsi conduit
me reprsenter les choses telles quelles sont en elles-mmes ou, ce
qui revient au mme, telles quelles sont dans lintellect divin,
comme susceptibles dtre figures par une perception simultane et
infinie qui schelonnerait dans le temps seulement aux yeux de tous
les tres finis, car ma perception recle un lment de passivit, elle
na de sens qu lgard de mon corps ; il est de son essence dtre
partielle [71] et momentane, elle nchappe pas totalement la sub-
jectivit. Elle semble plus prs de ltre que toutes les autres repr-
sentations parce quelle permet ltre fini un contact direct avec le
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 71
tout dans linstantan ; mais ce contact nest possible qu condition
de faire entrer le tout dans une perspective personnelle, de telle sorte
quune perception qui serait totale et cesserait dexprimer une rela-
tion de lunivers avec moi deviendrait une contradiction. Pourtant si
je consens considrer dans linstant non pas le spectacle passager
du monde, mais lacte par lequel je pense aussi ce qui le prcde et
ce qui le suit, je me dlivre du mme coup de cette interprtation de
ltre qui, le rduisant linstant, mais ne retenant dans linstant que
le peru au lieu du percevant, constitue justement ce que lon dsi-
gne sous le nom de matrialisme.
On peut montrer maintenant que lactualit de linstant qui lui
donne son privilge lgard de ltre nest point sans contre-
partie : celle-ci rside prcisment dans sa liaison mme avec la per-
ception dont lessence est la fois dtre phnomnale et dtre
transitoire. Ds lors, ne pourrait-on pas emprunter la mmoire une
notion plus adquate de ltre pur ? Car la mmoire donne tout le
pass une sorte de perptuit et mme de simultanit dans laquelle
chacun puise les images dont il a besoin dans un ordre toujours r-
versible. De plus, malgr ses imperfections et ses erreurs, elle nous
prsente notre vie dans un tableau spirituel o les vnements appa-
raissent avec une sorte de lumire quils navaient pas au moment
o ils saccomplissaient : ils semblaient obscurcis alors par les pr-
occupations de lintrt et les fumes de la passion. Ainsi tout le
prsent de la perception est destin devenir un jour du pass, en
servant ainsi de voie daccs une sorte domniprsence spirituelle
de ltre total, o la mmoire nous permettrait de retrouver dsor-
mais toutes les capacits de la ralit grce un acte qui recommen-
ce toujours. Linstant nest une transition temporelle que pour nous
donner le moyen de pntrer dans un prsent ternel.
Cependant, bien que la mmoire semble affranchir la connaissan-
ce de toute liaison actuelle avec les sens, la ralit des choses en el-
les-mmes serait aussi mal figure par une [72] mmoire universelle
que par une perception universelle. Car le souvenir na de sens que
par son opposition avec la perception : il ny a que ce que nous
avons peru qui entre dans notre mmoire. Bien plus, pris en lui-
mme, le souvenir est une donne comme la perception : nous de-
vons le prendre tel quil est, car nous ne pouvons pas faire que le
pass nait pas t ; en un sens, nous en sommes esclaves, et sil est,
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 72
comme la perception, suspendu un acte sans lequel il ne pourrait
pas devenir conscient, cest seulement afin de nous permettre de le
recrer dans une image, mais non pas de nous identifier pleinement
lui dans cet acte mme.
Si nous voulions par consquent essayer de saisir la nature intime
de ltre, au lieu de tourner les yeux vers le double spectacle par le-
quel il se rvle toute conscience engage dans le temps, il faudrait
le surprendre en quelque sorte dans son avnement mme, cest--
dire se placer au point o nous constituons notre tre propre en par-
ticipant son essence par une opration. Une telle opration se re-
trouvant dj dans la perception et dans la mmoire suffit pour gar-
der ltre son caractre duniversalit. Or, le passage du prsent
lavenir, tel quil est ralis par notre volont, peut contribuer nous
la suggrer, mais la suggrer seulement. Car il faudrait liminer de
la volont la notion de dveloppement qui la caractrise, la dualit
de la puissance et de la donne et la conversion de lune dans
lautre, afin datteindre, derrire les maladresses de laction, la pure-
t de lacte quelle imite et qui la rend possible. Il faudrait substituer
la gaucherie dun effort toujours born la parfaite facilit dune
grce toujours prsente. Cest la raison pour laquelle lactivit intel-
lectuelle nous donne de ltre une notion plus adquate que lactivit
volontaire : elle consiste bien, elle aussi, dans une dtermination de
lavenir, puisquelle est un passage de lignorance la connaissan-
ce ; seulement, si on la considre non point dans la priode o elle
recherche la vrit, mais dans la priode o elle la possde, elle se
dgage des limites du corps et du temps et ralise lidentit plnire
de la pense et de son objet. Il subsiste pourtant entre les deux ter-
mes une distinction de raison quil faudrait effacer encore avant de
rencontrer ltre pur.
[73]
ART. 9 : Le temps exprime la ncessit pour chaque mode fini de
lexistence de sactualiser travers linstant par une conversion de
son tre possible en un tre accompli : mais ltre pur surpasse cet-
te distinction et la fonde.
Au point o nous sommes parvenus, il est ais de montrer pour-
quoi ltre reoit une application rigoureusement universelle. Cest
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 73
quen effet tout ce qui est a t futur avant de devenir pour nous pr-
sent et pass : dans le passage du prsent au futur, nous saisissons le
principe qui le fait tre ; nous en devenons participant dans les op-
rations de la volont et de la connaissance. Nous cessons dtre une
pure donne enferme dans ses limites propres au moment o nous
les dpassons pour enrichir notre nature. Mais ce principe, qui fait
que les choses sont, ne peut jamais tre spar des choses elles-
mmes, sans quoi elles cesseraient dtre. Et cest pour nous seule-
ment quaprs avoir t des actes auxquels nous collaborions, elles
deviennent soit dans la perception, soit dans la mmoire, un specta-
cle que nous ne pouvons plus que contempler. Ce spectacle nest pas
une vaine apparence, parce que derrire lui ne cesse de subsister,
pour le soutenir et le produire sans trve, lacte ternel auquel nous
nous sommes unis pendant un moment. Il ny a point pour lui de
donnes ; mais cest encore lui quil faut sunir dans une opration
drive et secondaire pour rendre prsentes dans la conscience ces
donnes qui flotteraient sans lui dans lindtermination absolue ;
elles seraient semblables cette matire pure qui a toujours proc-
cup les philosophes et qui nest quune simple limite, la limite vers
laquelle sabaisserait lunivers lgard dun tre fini qui, ralisant
lide absolue du fini (mais cessant par l mme de mriter le nom
dtre) se verrait refuser toute activit de participation.
Telle est la raison pour laquelle chacune des phases du temps ex-
prime lgard de ltre un caractre de ngativit : car linstant
nest quun passage, le pass nest quune pense, lavenir nest
quune virtualit. Ce qui suffit pour accuser la distance qui spare
ltre temporel de ltre ternel : celui-ci ne connat pas la distinc-
tion entre ces trois modes de lexistence. [74] Mais tout tre particu-
lier est tenu de les traverser tour tour et son tre propre consiste
dans leur union. Ils ne sont isols lun de lautre que par un effet de
lanalyse qui permet dexprimer en les liant ce triple caractre de
ltre dtre toujours naissant, toujours actuel et toujours subsistant.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 74
[75]
Premire partie. Lunit de ltre
Chapitre III
DE LUNIVOCIT DE LTRE
Retour la table des matires
ART. I : Luniversalit de ltre a pour fondement son univocit.
J usquici nous avons tudi lextension du terme tre. Nous
lavons compar tous les termes quil semble laisser en dehors de
lui. Nous avons montr que le nant, le possible, le pass et lavenir
reprsentent certaines de ses formes et quil est impossible de lui
trouver des limites parce quil faudrait placer en lui cela mme qui
le limite. Nous avons maintenant un nouvel effort faire : nous de-
vons considrer non plus les rapports qui peuvent exister entre ltre
et autre chose, mais les rapports entre les formes de ltre elles-
mmes et chercher sil ny a pas entre elles des diffrences de degr.
Aprs avoir mesur ltendue de ses applications, il nous faut va-
luer la force mme avec laquelle il saffirme de chaque objet. Or, en
ce qui concerne la comprhension de ltre, nous allons aboutir
une vue analogue celle qui concernait lextension : nous dirons
que ltre est univoque comme il est universel et que, si tout est pr-
sent en lui, il faut aussi quil soit partout prsent tout entier
7
7
On voit sans peine que cest de lide de ltre considr comme tout que d-
rivent la fois son universalit et son univocit, son universalit qui envelop-
pe tous ses modes rels ou possibles et son univocit qui les enveloppe dans le
mme tout.
.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 75
Et mme le fondement de luniversalit ne peut tre que dans
lunivocit. Car, si ltre pouvait recevoir une multiplicit
dacceptions diffrentes, il ny aurait aucune raison pour ne pas le
laisser smietter en une multiplicit de notions. Nous serions obli-
gs propos de chaque objet particulier de [76] nous demander
quelle est celle de ces notions qui lui convient. Nous ne pourrions
affirmer a priori que cet objet, ds quil est susceptible de recevoir
une dtermination quelconque, est contenu dans ltre total : ainsi la
connaissance de ses qualits lui donnerait une sorte dtre qualitatif,
loin que ltre en gnral quil dtermine doive tre suppos pour
que la richesse intrieure de celui-ci vienne trouver une expression
dans la varit infinie des qualits particulires. Lunit de lunivers
naurait plus de point dappui, le multiple serait pos avant lun. Et
dans chacun de ces mondes diffrents, chacun de ces objets, dont
nous disons quil est, serait un vritable nant lgard de ltre tel
quon le dfinirait dans tous les autres.
Pourtant, on conserve le mme nom dtre pour recouvrir tant
dacceptions diffrentes et, par l, une communication reste possible
entre ces mondes spars. Or cela revient dire que tous ces mondes
font partie du mme univers ou quil existe une certaine significa-
tion du mot tre que lon retrouve sans altration travers toutes les
formes particulires que ltre est capable de recevoir. Nest-ce pas
retrouver lunivocit au moment o lon croyait lui avoir chapp ?
A. LTRE ABSTRAIT
ET LTRE CONCRET
Retour la table des matires
ART. 2 : Ltre univoque, cest ltre concret qui est suppos par
la notion abstraite de ltre et la fonde.
On prtendra alors que cette communaut de sens entre les for-
mes de ltre nest possible que si lon fait de ltre le plus abstrait
de tous les genres, une sorte de schma sans contenu qui prend un
caractre de ralit par les dterminations successives que lui assi-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 76
gne notre esprit. Cest l lobjection fondamentale qui a t dirige
de tout temps contre les entreprises de lontologie. Mais ltre dont
nous parlons, cest ltre concret, et nous dirions volontiers quil
faut le poser dabord pour que cette notion abstraite et gnrale de
ltre ne soit pas un pur fantme, pour quelle soit en effet suscepti-
ble de devenir elle-mme lobjet dune pense relle, et pour que les
dterminations par lesquelles [77] nous prtendons lenrichir trou-
vent leur tour une place dans le systme des choses.
Prise en elle-mme, la notion abstraite de ltre est destine seu-
lement traduire linscription dans le mme tre de toutes ses for-
mes particulires. Car luniversalit abstraite de ltre a son fonde-
ment dans sa totalit concrte. Lerreur est de penser que lon peut
poser ltre comme une dficience et non point comme une plnitu-
de. Mais loin que la plnitude soit une dficience remplie, cest la
dficience qui est une plnitude vide. On imagine par une supersti-
tion singulire que ltre est un caractre commun qui appartient
tous ses modes particuliers, et qui sajoute aux caractres par les-
quels ils se dfinissent, au lieu de voir quil est le tout dans lequel ils
prennent place et dont ils expriment seulement les dterminations,
cest--dire la limitation.
Mais si ltre nappartient quau tout, il nest pas seulement la
plus concrte de toutes les notions : il possde en mme temps une
unit indivisible, de telle sorte que dire quune chose existe, ce nest
point lui attribuer une proprit distincte, mais reconnatre quelle
fait partie du tout et ne peut tre pose quen lui et avec lui. Il serait
donc absurde de penser que la notion dtre pt tre elle-mme mul-
tivoque, ce qui peut tre dit en un certain sens de toutes les notions
particulires, puisque chacune delles naccde ltre quen se r-
alisant dans des individus diffrents. Au lieu quil en va dune ma-
nire justement contraire quand il sagit de lide de ltre, qui fait
pntrer dans le mme tout toutes les choses particulires. On pour-
rait allguer, il est vrai, que lide de ltre, ne pouvant pas tre s-
pare de ltre dont elle est lide, il doit y avoir autant despces
dtre que de termes diffrents dont ltre peut tre affirm. Cepen-
dant il est facile de voir quaucun de ces termes ne peut tre spar
de tous les autres et que cest la liaison avec eux qui constitue prci-
sment son tre propre.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 77
Ainsi ltre auquel on reproche prcisment dtre la plus abstrai-
te de toutes les notions ne se rvle nullement nous comme un des
lments constitutifs du rel qui, en se runissant dautres, nous
permettrait de retrouver le concret. Une proprit ne peut tre isole
par lanalyse qu condition [78] de pouvoir se reconnatre, et par
consquent se distinguer de toutes les autres. Cest dire quil faut
quelle soit une partie de ltre et non pas ltre mme. Loriginalit
de ltre est denglober en lui toutes les autres proprits, au lieu de
pouvoir leur tre oppos. Il y a un paradoxe certain vouloir que
ltre soit contenu dans chaque chose existante, ce qui serait nces-
saire sil tait un abstrait, alors que chaque chose existante est
contenue dans ltre et reoit de lui ce qui en fait une chose concr-
te. Cest une telle vidence que Kant lui-mme semble avoir em-
prunt largument par lequel il prouve que lespace est une intuition
et non pas un concept. Mais Kant avait remarqu dj
lhtrognit des catgories de la modalit par rapport aux autres ;
et sil navait pas mis en valeur la prminence de lexistence
lgard de la possibilit et de la ncessit qui la dterminent, sil re-
jetait aussi le caractre univoque de lexistence (en distinguant une
existence empirique, formelle et transcendantale), du moins voyait-il
clairement que lexistence ne peut poser la reprsentation qu
condition de ne pas faire partie de sa comprhension. Mais elle nen
fait pas partie parce quelle en est la totalit mme. De telle sorte
que nous ne pouvons pas opposer la possibilit lexistence, mais
seulement parler dune existence conue et dune existence perue,
qui sont des modes de ltre corrlatifs et insparables. Cest dire
que lexistence, si on lui donne, comme nous lavons fait, un carac-
tre universel, au lieu dtre la plus abstraite de toutes les proprits,
se confond avec le tout concret que lanalyse dcompose en propri-
ts.
ART. 3 : La notion abstraite de ltre ( laquelle on substituera la
simple notion de la relation) nest voque que pour nous permettre
dentreprendre une synthse du rel chimrique et inoprante.
Ainsi nous ne confondons nullement avec une notion abstraite
lide plnire et adquate de ltre que nous dfinirons seulement
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 78
au chapitre VIII. Mais nous remarquons quil est naturel de faire de
ltre le plus vide de tous les genres ds que [79] notre esprit se
donne lui-mme la tche ambitieuse de reconstruire lunivers syn-
thtiquement. Cet tre se distingue peine du nant, de telle sorte
quen paraissant laccrotre par des qualits de plus en plus proches
du concret, on se donne lillusion dune gense intgrale du rel. En
fait, on visait une limination de ltre en soi, sans quoi la cons-
truction que lon proposait avouerait son impuissance avant mme
dtre commence. Mais le terme mme auquel on voulait aboutir
tenait pourtant toute la ralit qui lui appartenait de cet tre en appa-
rence si dpouill et si voisin du nant sur lequel tout ldifice repo-
sait. Ctait par sa liaison fugitive et mme purement nominale avec
ltre que cette suite doprations synthtiques retrouvait finalement
la ralit dont elle ne stait en fait jamais spare : et ce qui lui
donnait le mouvement et la fcondit, ctait dj la pense de ltre
concret vers lequel elle tendait, mais qui tait prsente notre esprit
dans la plus humble de ses dmarches. Et on oubliait quil faut ins-
crire dans ltre notre esprit lui-mme pour que son activit com-
mence sexercer, et que cette activit consiste pour lindividu
essayer de ressaisir comme un tout le vaste ensemble dont il sest
dtach dabord comme une partie.
Mais il tait trop visible que, mme si le simple nom de ltre
tait retenu comme le premier terme dun enchanement synthtique
de notions, on pouvait craindre encore le reproche de dvelopper
seulement le contenu de sa nature, au moment o lon prtendait y
joindre les dterminations ncessaires qui lui donnent une forme
concrte. Aussi a-t-on fait vanouir cet tre pourtant si appauvri au
profit de la pure relation, sans rflchir que celle-ci doit tre conte-
nue dans ltre son tour ; et quant aux deux termes dtre et de
nant quil fallait maintenir au moins idalement pour que la rela-
tion qui les unit devint elle-mme intelligible, il ne servait rien de
passer vite sur leur opposition, car on ne pouvait dissimuler ni que le
premier contient dj en lui tout ce qui pourra survenir ensuite, ni
que le second na de sens qu lintrieur de ltre, et par lexclusion
mutuelle de ses formes qualifies. La mthode synthtique, en se
donnant elle-mme comme programme limmensit dun vide
remplir, [80] montre ce quelle est, cest--dire le renversement de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 79
la vritable mthode de la connaissance, qui est lanalyse dune r-
alit plnire et suffisante.
Si nous avons insist sur les vices de la mthode synthtique,
ctait pour prouver que lon ne peut pas tablir une opposition entre
ltre abstrait et ltre concret, que le second seulement a le droit au
nom dtre et quil faut ncessairement le poser pour que ltre abs-
trait puisse tre apprhend en lui par lanalyse. Singulire entrepri-
se que de vouloir constituer ltre vritable en joignant une notion
de ltre, que lon prive elle-mme de lexistence, dautres notions
qui seraient charges de la lui donner, sans pourtant la possder.
Au moment o nous navions encore en vue que luniversalit de
ltre, nous avons protest contre une conception analogue qui, met-
tant dabord le possible en dehors de ltre pour en faire un objet
intermdiaire entre ltre et le nant, finissait par dfinir la possibili-
t comme la forme attnue de ltre et la ncessit comme sa forme
renforce. Mais tous les efforts pour passer du possible ltre res-
tent vains si on ne fait pas dabord du possible un tre intellectuel,
cest--dire une pice de ltre total et le ncessaire alors, au lieu de
rien ajouter ltre mme, au lieu dtre une relation entre ltre et
autre chose, exprime, au sein de ltre, ltre de la relation
8
.
ART. 4 : Ltre de chaque chose, cest la totalit de ses caract-
res, qui ne diffre pas de sa relation avec la totalit des autres cho-
ses.
Lunivocit de ltre nest donc pas fonde sur le vide de sa no-
tion, mais au contraire sur lidentit de cette notion [81] avec celle
de compltude, dachvement ou de perfection. Et puisquon ne peut
8
Cet article 3 doit tre interprt en se rfrant la pense dHamelin qui don-
ne presque toujours une plus grande satisfaction que celle de Bergson tous
ceux qui gardent avant tout le souci de maintenir la description de
lexprience son caractre systmatique. Et pourtant nous navons cess de
nous opposer au caractre synthtique de son entreprise, persuad que la d-
duction des catgories doit avoir comme principe ltude des conditions de
possibilit de la participation et ne peut tre leffet que dune analyse cratri-
ce.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 80
dire de rien quil nest pas, lexistence de chaque chose, au lieu
dtre une proprit distincte de cette chose, consiste dans la totalit
de ses proprits.
Sans doute il y a une diffrence entre la chose et son ide. Mais
lide possde elle-mme, en tant quide, une existence complte
qui lui est propre : elle consiste moins dans la manire dont elle en-
veloppe le tout que dans la manire dont le tout lenveloppe. Et la
diffrence entre lide de la chose et la chose qui ne doit pas ex-
clure leur accord vient de ce que lide contient les seuls caract-
res que lon connat et mme, dune manire plus limite, les seuls
caractres que lon peut restituer par une opration de la pense,
tandis que la chose joint ces caractres conceptuels dabord les
caractres sensibles, ensuite tous les caractres que lon ne connat
pas encore, mais quune analyse exhaustive permettrait de dcou-
vrir.
Dune manire gnrale, poser lexistence dune forme insuffi-
sante de lexistence, cest--dire laquelle on sait quil manque
quelque chose pour tre, cest poser ltre dautre chose, cest--dire
ltre mme de ce qui lui manque, et dun seul mot ltre du tout
qui rien ne manque. Cest parce que lide de ltre ne se distingue
pas de son objet quelle est elle-mme une infinit toujours actuelle
et cratrice.
Si on allgue que chaque objet diffre alors profondment et
mme, pourrait-on dire, totalement, de tous les autres, on rpondra
quil en serait ainsi si les objets particuliers pouvaient tre poss iso-
lment et indpendamment les uns des autres, mais que ce qui rend
un objet complet et achev, cest bien, si lon veut, la totalit des
caractres intrinsques qui le forment, mais cest plus encore la tota-
lit des relations qui lunissent tous les autres objets particuliers,
lui assignent une place dans le monde, fixent son originalit et for-
ment les soutiens de son essence. Est-il possible dailleurs de conce-
voir une diffrence entre les caractres intrieurs par lesquels un ob-
jet se dfinit et la multiplicit infinie des influences parties de tous
les points de lunivers et qui viennent se rejoindre en lui pour consti-
tuer sa nature ? Peut-on concevoir autrement que chaque objet soit
une image du [82] tout ? Peut-on concevoir autrement la possibilit
de son existence ? Celle-ci svanouirait ncessairement si elle dif-
frait de la manire mme dont il est suspendu dans le grand uni-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 81
vers. Nous sommes incapables sans doute de faire daucune chose
un terme spar dont nous pourrions demander ensuite quelle est la
forme dexistence qui lui convient parce que nous apercevrions vite
que tous les caractres que nous cherchons lui attribuer
lintrieur des limites qui la circonscrivent ne sont eux-mmes que
les extrmits des relations qui lunissent toutes les autres choses ;
de telle sorte que, si ces relations venaient tout coup
sinterrompre, la chose perdrait tous ses caractres et par voie de
consquence, son existence elle-mme. Cest donc parce que ltre
nappartient quau tout que ltre de toutes les choses particulires
consiste dans leur inscription lintrieur du mme tout.
Nous venons de rencontrer le vritable fondement de lunivocit.
Si lexistence tait une notion abstraite, elle pourrait tre applique
une multiplicit de termes diffrents grce une rptition. Mais
comment ltre pourrait-il se multiplier ? Le multiple trouve place
en lui et participe sa nature, non pas comme celle dun ensemble
quil dnombre, mais comme celle dun visage unique dont il ex-
prime les divers aspects. Chacun de ces aspects na de ralit que
dans le visage dont on la dtach ; il est solidaire de tous les autres.
On devrait lui refuser ltre si on pouvait le considrer comme ind-
pendant de ceux-ci : pris avec eux, il a autant de ralit que le visage
mme dont il manifeste lindivisible prsence dans une perspective
particulire. On comprend donc pourquoi toute existence spare ne
pourrait tre quune existence phnomnale : mais le phnomne
prcisment ne peut pas tre spar du tout dont il est un aspect ex-
trieur et manifest. Il ny a donc pas de choses spares : car cha-
que chose particulire est une perspective sur la totalit des choses.
Et lon peut dire que, en tant que cette perspective est distincte de
toutes les autres, elle a un caractre exclusivement subjectif. Mais
cette perspective qui contient le tout subjectivement est contenue par
lui objectivement : elle donne au tout une existence pour moi com-
me le tout o il prend place donne au moi une existence pour soi.
Ainsi il [83] y a une liaison ncessaire entre lexistence des choses
et lexistence du moi : car il ny a de choses particulires que pour le
moi qui analyse le tout et qui rapporte chaque chose la reprsenta-
tion quelle lui donne. Ce qui montre assez clairement pourquoi
ltre est tout entier prsent en chaque point dans une unit pourtant
infiniment diffrencie.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 82
On aboutit ainsi dcouvrir le vritable sens de la relation, qui
nest pas un moyen dchapper ltre, ni un moyen den obtenir
une reprsentation synthtique. Le rle de la relation, cest seule-
ment de faire apparatre limpossibilit pour une chose de se suffire
indpendamment de ses connexions avec toutes les autres dans
lunit du mme tout. Ainsi la relation est pour ainsi dire le moyen
de lui donner lexistence. Et cette existence qui est celle du tout des
relations, est toujours la mme, bien quelle soit en mme temps
propre chaque chose qui constitue dans le tout lui-mme un centre
unique et irremplaable.
Une telle analyse nous permettra maintenant de comprendre
lantinomie apparente de ltre et du connatre et la corrlation qui
les unit. Car on ne peut sempcher de penser que dire dun terme
quil est, cest le considrer isolment dans cette indpendance par
laquelle il semble quil se suffise au lieu que le connatre, cest
lexpliquer, cest--dire le quitter, dclarer son insuffisance et sa
relation avec tous les autres. Il y aurait donc une contradiction entre
lordre de ltre et lordre du connatre qui ruinerait notre concep-
tion, au lieu de servir la confirmer : lordre de ltre nous oblige-
rait dnouer chaque chose de la relation et lordre du connatre
ly subordonner. Cette contradiction apparente tmoigne seulement
que, si ltre nappartient en droit qu labsolu, il est naturel que
nous cherchions dans lindpendance de chaque chose lgard de
toutes les autres cette relation immdiate avec labsolu qui devient
la figuration de son existence. Mais ds que nous cherchons rali-
ser cette relation ou, si lon veut, lactualiser, cest toujours par la
mdiation imparfaite et discursive de ses relations avec les autres
choses, que nous nommons justement la connaissance.
[84]
ART. 5 : Lunivocit de ltre est celle de lacte dont toutes les
donnes sont des limitations.
Ltre se rpand du tout sur les parties, il ne peut leur communi-
quer que ltre quil possde lui-mme ; il le leur communique soli-
dairement. Que chacune ne puisse tre pense sans toutes les autres,
cest la preuve que, malgr son originalit qualitative, ltre dont
elle dispose ne se distingue pas de ltre de celles-ci, cest--dire de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 83
ltre mme du tout lintrieur duquel il faut ncessairement les
poser toutes. Il y a donc une diffrence entre les qualits, mais non
pas dans ltre de ces qualits. Leur htrognit ne les empche
pas dtre de la mme manire, dans le mme sens, et avec la mme
force. Car leur tre consiste dans leur inscription commune
lintrieur du mme tout dont elles expriment un aspect particulier
insparable de tous les autres. Ltre ne se divise pas parce quil est
le tout donn avec chaque partie, prsent avec elle et en elle, loin
quon puisse le regarder comme une runion de parties dont chacune
possderait antrieurement lui une existence indpendante.
En faisant de ltre le caractre commun de tous les objets parti-
culiers, on croit lui laisser son unit, mais cest une unit purement
formelle, et lon est oblig de soutenir que ltre concret, cest--
dire le seul qui ait le droit au nom dtre, doit tre cherch dans les
objets ; de l le sens du vieil axiome : il ny a dtre que du particu-
lier ; ltre sparpille alors dans le multiple. Nous avons suivi une
mthode oppose : nous avons refus dabord de donner le nom
dtre autre chose quau concret, cest--dire lobjet considr
avec la totalit de ses caractres, et nous navons pas fait de ltre
mme un caractre spar ; par suite ltre, au lieu de se renouveler
et de se modifier avec les objets particuliers, tait dans chacun deux
sa plnitude mme. Or cette plnitude ne peut appartenir qu un
terme qui se suffit ; en droit elle nappartient donc qu lunivers,
mais elle appartient aussi toutes ses parties, puisque ce qui fait
loriginalit de chacune delles, cest la manire dont elle tient tou-
tes les autres. Cest pour cela que lunivers est plein en chaque
point. [85] En acceptant didentifier ltre avec la concrtit quali-
fie de chaque objet, on fonde par consquent son univocit, puisque
les objets particuliers ne deviennent concrets que par la place quils
occupent et le rle quils jouent dans un mme et vaste tout qui se
suffit entirement lui-mme.
Il est donc bien vrai de dire que ltre est toujours le mme, bien
que ses formes soient toujours diffrentes. Cest seulement si ltre
tait une ide abstraite quil y aurait plus dtre en deux tres quen
un seul. Mais le principe des indiscernables exprime lunit de
ltre, au lieu de la ruiner. En effet, lunivers est un individu. Aucu-
ne de ses parties ne peut en tre spare : car o se rfugierait-elle ?
Elle imite donc sa manire et sans y parvenir la suffisance du tout
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 84
dans lequel elle subsiste. Si ce tout cessait de lui tre prsent et de la
soutenir, sil cessait de lui donner, sans le diviser, ltre quil poss-
de, elle serait anantie. Aussi sa richesse concrte ne diffre-t-elle
pas de son tre mme. Le contenu de chaque tre est un regard sur la
totalit de ltre. Et cest pour cela que cette adhrence ltre par
laquelle notre conscience, au moment o elle se constitue, fonde no-
tre vie personnelle et notre bonheur, au lieu de senrichir par les in-
cursions que lhistoire nous permet de faire travers la dure et le
mouvement travers lespace, risque plutt de sy relcher et de sy
perdre : cest le signe que, si lon ne trouve point ltre en un point,
on ne le trouvera point en mille, que sa forme en apparence la plus
humble et la plus troite le contient dj tout entier, que celui qui
court le monde pour le chercher ne fait que le fuir, puisquil est tout
prs de nous et quil suffit douvrir la main pour le possder.
Cest parce que ltre nest pas une ide abstraite quil ne peut
pas tre distingu de la chose mme dont il est lide. Cest
quaucune ide, sauf la sienne, npuise le contenu de son objet.
Lide de lhomme ne se confond avec aucun homme rel, ni lide
de blanc avec aucune chose blanche, car il faudrait ajouter lune et
lautre une infinit de caractres pour rejoindre le concret. Mais
cest ce concret mme o lanalyse puise sans cesse qui constitue la
vritable ide de ltre. Que lon ne se plaigne pas de sa pauvret,
puisque cest elle qui fournit indfiniment une matire nouvelle
[86] toutes les oprations de la connaissance ; elle accompagne tou-
tes ces oprations et, sans ltre lintrieur duquel elles se dve-
loppent, aucune delles ne pourrait possder ni le mouvement qui
lanime, ni lobjet auquel elle sapplique. Il ny a pas dide de ltre
spare de ltre mme et susceptible dtre groupe avec dautres
ides diffrentes dans une forme complexe qui les contiendrait et les
dpasserait toutes. Ou plutt cest cette forme complexe laquelle il
faut donner le nom dtre et non un de ses lments : mais elle est
une avant davoir t divise, et mme elle demeure une au cours
des divisions quon lui fait subir, car toutes les autres ides sont abs-
traites, cest--dire ne peuvent pas se dtacher de lide de ltre et
tiennent delle ltre mme qui permet de les penser. Lune des dif-
ficults essentielles de la thorie de ltre provient de lidentification
que lon tablit instinctivement entre ltre et le donn. Telle est la
raison pour laquelle nous nous sommes attachs montrer quil
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 85
contenait encore lacte et le possible. Quant lacte, il possde un
privilge par rapport au donn puisquil jouit seul dune existence
en soi et dune intriorit vritable, au lieu que le donn suppose
toujours un acte qui se le donne. Sous le nom dtre on consentirait
volontiers entendre la totalit du donn. Mais cela ne saurait nous
suffire, moins quon reconnt quen embrassant la totalit du don-
n dans son unit, le donn comme tel viendrait sabolir dans lacte
qui le fait tre ou dont il drive par limitation. Ds que lopration et
la donne commencent sopposer, ltre doit tre attribu lune et
lautre (au sens o nous lavons dfini comme universel) ; mais il
ne peut ltre qu toutes deux, cest--dire cette rencontre o elles
se joignent et se rpondent (au sens o nous le dfinissons mainte-
nant comme univoque). Alors lopration exprime la subjectivit
essentielle chaque mode de ltre et le donn tout ce qui dans ltre
la dborde et se dcouvre comme une objectivit actuelle ou possi-
ble. Mais la subjectivit de lopration est une subjectivit ontologi-
que qui, en fondant lobjectivit de la donne, la rduit une subjec-
tivit phnomnale.
[87]
B. LIDE DE HIRARCHIE
ET CELLE DE REPRE
Retour la table des matires
ART. 6 : Il ny a pas de degrs de ltre : on ne peut pas tablir de
hirarchie par rapport ltre, mais seulement par rapport un
tre qualifi.
Il y a un paradoxe certain soutenir que ltre na ni htrogni-
t ni degrs, dautant plus violent que nous paraissons nous tre
ferm par avance toutes les issues, soit en lui subordonnant la dis-
tinction classique de lexistence et de la ralit, soit en refusant de
faire entrer dans un mme genre abstrait limmense varit et
ladmirable hirarchie de ses formes. Mais si ltre de toutes les
formes, quelle que soit loriginalit de chacune delles, consiste dans
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 86
leur agrgation au mme tout, on comprendra mieux pourquoi il ne
diffre pas de lune lautre et pourquoi aussi chacune exprime
adquatement, malgr ses limites, la totalit de ltre. Ce nest pas
seulement parce quil y a ltre total prsent avec elle, encore quau
del de ses limites, mais parce que cest lui qui la limite et que le
contenu mme des limites est leffet dune action qui vient de par-
tout. Quant lide des degrs de ltre, il est impossible de lui don-
ner un sens autrement quen faisant renatre lide du nant et en
remplissant par une srie continue, dont tous les termes participe-
raient la fois de ltre et du nant, lintervalle qui sparerait ces
deux extrmes. En fait on ne rencontrerait ceux-ci nulle part : le pas-
sage la limite qui nous fournirait ltre pur sous une forme spare
est aussi illgitime que celui qui nous fournirait le nant. A la srie
des termes et chaque terme nous donnons lexistence simple et in-
divisible ; de plus, limperfection dans lexistence mme implique
quon labolit au moment o on la pose : car la rarfaction de
lexistence consiste introduire en elle contradictoirement le vide,
cest--dire le nant. Ce nant apparent, cest la richesse totale de
ltre qui se rvle nous aussitt que labstraction essaie den iso-
ler un aspect limit.
Si ltre convient absolument chacun des lments de lunivers,
prcisment parce que cet lment ne peut pas [88] tre dtach de
tous les autres ou encore parce quil y a entre eux une implication
mutuelle totale, que devient lide mme de la hirarchie des tres ?
Ltre ne doit-il pas ressembler plutt une sorte de foyer qui r-
pandrait sa chaleur et sa lumire sur tous les objets qui lentourent
proportionnellement la distance qui les en spare ? Chaque objet
naurait-il pas pour ltre une capacit, une puissance de rceptivit
plus ou moins grande qui permettrait de lui assigner une place dans
une sorte dchelle ontologique ? Nous ne le pensons pas. Car ltre
ne mesure pas ses dons. Il se donne tout entier chacun de ses
membres. Sa prsence ne peut tre que totale. Cest seulement si on
le considrait comme distinct des objets auxquels il sapplique quil
pourrait se diviser ingalement entre ceux-ci, comme la lumire se
rpartit dans la diversit des clairements. A partir du moment o
nous concevons lide dune hirarchie, ce nest pas ltre mme
que nous avons en vue, ce sont ses qualits, ce quil y a en lui de
diffrent et non pas ce quil y a en lui didentique.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 87
Mais, dira-t-on, ces qualits sont indiscernables de ltre, puisque
vous ne voulez pas que ltre soit une proprit spare. Ds lors,
concevoir une hirarchie de qualits, nest-ce pas concevoir une hi-
rarchie de ltre lui-mme ? Nous rpondrons que cest parce que
cette hirarchie est intrieure ltre total quelle naffecte pas la
nature de celui-ci. Toute hirarchie porte sur des valeurs, et la plus
humble de toutes les valeurs a sa place dans ltre au mme titre que
la plus haute ; celui-ci les contient toutes ; il rserve toutes le m-
me accueil gnreux.
Mais do provient alors la diffrence que nous faisons entre el-
les ? Cette diffrence suppose un critre dvaluation qui ne peut pas
tre ltre, puisquil ny a rien en dehors de ltre et que tout est gal
devant lui. Mais si nous prenons dans ltre une de ses formes privi-
lgies, et que nous jugions de tout le reste par rapport elle, on
comprend sans peine comment nous pouvons constituer une chelle
hirarchique, dont chaque terme prsente une valeur plus ou moins
grande lgard du type que lon aura adopt comme repre, selon
quil lui ressemblera plus ou moins, quil rpondra plus ou [89]
moins bien ses besoins les plus essentiels ou les plus dlicats, quil
se rapprochera plus ou moins de la perfection propre ce type et
vers laquelle il tend sans jamais latteindre. Mais que lon change de
repre, et tous les termes de la hirarchie prendront une valeur et
une place nouvelles dans une hirarchie diffrente.
Il est naturel lhomme de tout juger en fonction de lui-mme.
Et il na tort que lorsquil convertit en un ordre de perfection onto-
logique lordre relatif des valeurs humaines. Il y a des mondes avec
lesquels lhomme a peu de contact et o il pntre peine ; il cher-
che restreindre leur participation lexistence dont ils ne seraient
que des bauches ou des fragments rsiduels ; mais cest quils ne
sont pas sa mesure : que lon change la mesure, et lon dcouvri-
rait en eux une abondance infinie o toutes les lois de la science
trouveraient une application, o les formes les plus varies de lart
le plus subtil auraient encore sexercer, o, au-dessous de la forme
apparente, dautres formes, qui demeureront peut-tre ternellement
caches, ne cesseraient de multiplier lingniosit de leurs combi-
naisons : ct delles, si on pouvait les connatre, notre propre
forme humaine paratrait dune immense grossiret. Ce qui doit
nous rendre prudents, quand nous voulons juger de ltre la mesure
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 88
de lhomme, cest que nous ne sommes pas moins incapables de voir
ce qui nous surpasse trop en grandeur que ce qui est trop loign de
nous par sa petitesse, et quainsi nous mettons le nant au sommet
de lchelle comme lautre bout.
Il y a une infinit dchelles, toutes galement situes dans
ltre ; mais il ne se rgle sur aucune delles. Dans lchelle des
biens naturels, lordre des valeurs nest pas le mme pour lhomme,
le chien ou labeille. Or ltre total, souverainement impartial et f-
cond, sans se laisser entraner par aucune complicit, fournit gale-
ment tous, lanimal et lhomme, lme et au corps, les
moyens de raliser leur destine et de discerner en lui des valeurs
subjectives quil justifie sans tre inclin par elles.
[90]
ART. 7 : Une hirarchie relative lide de ltre fini en gnral
et non plus de tel tre qualifi, est elle-mme intrieure ltre to-
tal, et naltre pas lunivocit.
Dirons-nous que les valeurs reconnues par lhomme et les formes
de connaissance qui lui sont propres peuvent tre objectives, prci-
sment parce que lhomme, au lieu de les fonder sur les caractres
individuels de sa nature, est le seul tre qui, nayant gard dans les
uvres de sa pense qu sa participation luniversel, cest--dire
la prsence en lui de la raison, a le droit didentifier lordre quil
tablit avec lordre mme des choses et de se donner lui-mme, en
mme temps qu tous les tres, la place qui lui revient dans la hi-
rarchie de lunivers ?
Cest seulement au moment o le rel est reconstruit par
lhomme qui, quoiquil participe luniversel, garde encore sa natu-
re finie, quil peut se rvler sous la forme dune chelle ontologi-
que. Le rel, qui apparaissait primitivement comme un donn in-
puisable, se rsout alors en un systme dides grce auquel lunit
de lesprit, pntrant ce donn par une multiplicit doprations dis-
tinctes et pourtant lies, le rend intelligible, et par consquent le
convertit en un monde qui lui est dsormais intrieur. Cest donc
parce que le sujet demeure un tre fini, et mme, si lon veut (car
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 89
cest en cela que consiste sans doute la nature de la raison), cest
parce quil dcouvre en lui lide pure du fini considr dans ses
rapports avec linfini o il est situ et quil cherche assimiler, quil
peut tablir une chelle de ltre tout entier. Mais celle-ci na-t-elle
pas ds lors un caractre universel, puisque notre individualit pro-
pre nen est plus ltalon ? Ds quil a conu linfini, le fini aperoit
en lui-mme linfinit des puissances par lesquelles, sans jamais y
parvenir, il essaiera pourtant de sgaler lui. Si donc la raison est
capable de fonder une hirarchie des tres ou une hirarchie des va-
leurs, cet ordre pourra ne pas tre relatif seulement lhomme. tant
relatif lide de ltre fini en gnral, il doit permettre lhomme
de fixer sa propre place dans le monde par rapport des formes
dtre suprieures lui, cest--dire un idal [91] quil na pas en-
core atteint. Cest aussi pour cela que cette hirarchie parat objecti-
ve et non pas seulement subjective.
Cependant, tout ce quon peut demander pour quelle le soit,
cest non pas quelle soit donne dans ltre comme tel, mais quelle
apparaisse ncessairement comme vraie ds que ltre total peut tre
reprsent par un tre fini. Sans doute cette reprsentation du monde
indpendante de tout individu particulier, mais non point de lide
mme dun individu, est lobjet propre de notre science, et cest sur
sa possibilit que se fonde toute dduction des catgories : on com-
prend par consquent tous les privilges que nous sommes en droit
de lui attribuer. Mais elle a sa place dans ltre total dont elle expri-
me seulement une certaine qualification. Et il ne faut pas oublier
que, bien quelle soit justifie et alimente par lui, et quil y ait des
lois selon lesquelles celui-ci manifeste sa nature aux yeux dun tre
fini, ltre pur, considr dans sa nature propre, ne peut tre ni divi-
s, ni diminu, ni accru, de telle sorte qu lgard de toutes les for-
mes quil peut revtir, et qui trouvent place dans la hirarchie, il re-
oit toujours la mme signification simple et univoque.
En rsum, lgard de tout tre fini, qui, sans mme quon le
suppose qualifi, a des intrts satisfaire et une destine remplir,
lunivers, incapable dtre embrass par une apprhension unique,
doit apparatre comme une diversit infinie et hirarchise linfini.
Mais chacun des lments de cette diversit, si on le prend en tant
qutre et dans son adhrence ltre, jouit dune existence identi-
que celle de tous les autres, et mme la ralit de ceux-ci se trouve
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 90
dj prsente en lui par les relations mutuelles qui les unissent soli-
dairement lintrieur du mme tout.
C. UNIVOCIT ONTOLOGIQUE
ET HIRARCHIE AXIOLOGIQUE
Retour la table des matires
ART. 8 : Il y a des degrs de la conscience, sans quil y ait pour
cela des degrs de ltre.
On croit parfois que la conscience, tant un regard sur ltre lui-
mme, jouit dune sorte de privilge par rapport [92] tous ses au-
tres caractres. Ne faut-il pas accorder plus dtre lindividu pen-
sant quau corps inerte, et proportionner ltre quon lui donne
ltendue et la distinction de sa pense ? Puisque la conscience
enveloppe en droit luniversel, nacquiert-elle pas le droit
dobjectiver la hirarchie quelle tablit entre les formes de ltre et
de laffranchir de toute relativit ? Mais en ralit, elle est une exis-
tence subjective, une existence que nous nous donnons, greffe sur
celle que nous avons reue. Or, soit que son contenu se dilate, soit
que la lumire qui lclaire savive, cela ne lui donne pas plus
dtre : cela accrot seulement notre personnalit, mais non point
ltre de notre personnalit. Quant prtendre que nous introduisons
ici une distinction illgitime entre la personnalit et ltre de la per-
sonnalit, quoique ltre ne soit pas une proprit spare, nous r-
pondrons que la personnalit peut en effet tre considre sous deux
aspects : savoir comme une expression de ltre qui limplique tout
entier ( cet gard ltre et la personnalit ne font quun) ou bien
comme un aspect de ltre diffrent de tous les autres (et qui se ca-
ractrise par cette diffrence mme). Or le caractre diffrentiel de
la personnalit, cest prcisment de se constituer elle-mme au sein
de ltre en absorbant la diffrence qui la spare des autres formes
de ltre, ou qui spare ces formes les unes des autres, dans lunit
dune perspective subjective capable de senrichir indfiniment.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 91
Si on allguait maintenant que ltre est partout tout entier et
quil importe peu par consquent que la conscience embrasse un
champ plus ou moins vaste, nous rpondrions que cela importe peu
en effet au regard de ltre en soi, qui ne se trouve ni accru, ni dimi-
nu par ce mouvement intrieur de la conscience qui lassimile et
sunit lui, mais quil en est tout autrement lgard de cette qualit
de ltre en soi quon appelle quelquefois ltre pour soi (sans rus-
sir rompre pour cela lunivocit) et qui en ralit, poussant sur le
sol de ltre en soi, ne parat sen affranchir quafin de lenvelopper
dans une individuelle possession.
Ds lors, on comprendra fort bien aussi la possibilit dune hi-
rarchie des valeurs morales. Mais le mal ne doit pas avoir moins de
ralit que le bien (ni lerreur que la vrit). Ce [93] nest pas une
des moins singulires consquences dune interprtation ontologique
des tables de valeurs que de nous contraindre faire du mal (et de
lerreur) des aspects diffrents du nant. Mais partir du moment o
la nature de lhomme a t dfinie, o on sait en quoi consiste
lessence de la volont (ou de lintelligence), on peut concevoir dif-
frents types de pense ou daction qui expriment plus ou moins
bien cette essence, qui favorisent son dveloppement ou qui
lentravent. A lintrieur de cette chelle humaine, on pourra main-
tenir lexistence des diffrentes chelles individuelles, et on admet-
tra sans difficult que chacun de nous doive, pour faire son salut
personnel, respecter dabord la nature humaine, et ensuite donner un
plein panouissement son gnie propre.
ART. 9 : Lunivocit de ltre ne porte pas atteinte la hirarchie
axiologique.
On conoit bien le danger dans lequel la doctrine de lunivocit
menace de nous faire tomber. De mme quelle nous faisait craindre
de voir sabolir la diffrence ontologique non seulement entre les
tres particuliers eux-mmes, mais encore entre ltre relatif et ltre
absolu, de telle sorte quelle paraissait nous incliner ncessairement
dans le sens du panthisme, de mme elle doit nous faire craindre de
voir toutes les diffrences entre les valeurs sabolir :
lindiffrenciation ontologique aurait pour consquence
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 92
lindiffrenciation axiologique. Ainsi en demeurant fidle
laxiome : ens et bonum convertuntur, on verrait les degrs de ltre
impliquer ncessairement les degrs de la valeur et nier ces degrs
dans lun des deux domaines, ce serait aussi les nier dans lautre.
Mais il ne subsisterait alors de ltre et de la valeur quune simple
dnomination. Toutefois comme nous avons essay de montrer que
lunivocit de ltre le rend tout entier prsent en chaque point dans
une forme dunit chaque fois unique, nous dirons de mme que la
valeur est indivisible, mais quelle nest pas abstraite, cest--dire ne
se rpte pas et quelle est en chaque point du monde un absolu ini-
mitable. Le mystre de lUn concret, cest de se propager dans une
diversit [94] indfinie qui, loin de se rompre, le laisse partout gal
lui-mme.
Toutefois on demandera dans quelle mesure la formule ens et bo-
num convertuntur est capable dtre maintenue. Car ltre pris en
lui-mme, sil exclut le nant, contient en lui le mal avec le bien ; et
cest sans doute pour maintenir malgr tout lassimilation de ltre
et du bien quon a voulu faire du mal une ngation ou une privation.
Mais il ne peut pas en tre ainsi. Et en disant que la douleur nest
rien, que lerreur nest rien, que le pch nest rien, on viole par une
sorte de dfi le sentiment immdiat de la conscience. Cest que le
mal et le bien ne sopposent et par consquent ne peuvent tre dfi-
nis qu partir du moment o la participation a commenc, cest--
dire o la distinction de lintellect et de la volont sest dj ralise
lintrieur de la conscience. Le Bien alors, cest ltre lui-mme,
mais en tant quil est la fin de notre volont, en tant quil est le
moyen par lequel nous devenons capables dactualiser nos propres
puissances. Nous pouvons nous-mmes tre inscrits dans ltre tan-
tt par le jeu des actions qui viennent de partout et que nous nous
contentons de subir, et tantt par une action purement intrieure qui
assume en nous ltre de tout lunivers en mme temps que notre
tre propre. Mais notre condition rsulte toujours dune certaine
composition qui stablit dans notre conscience entre notre passivit
et notre activit. Le mal est du ct de la passivit qui nous assujettit
nos limites, la souffrance, lgosme, toutes les complaisan-
ces en faveur du moi particulier. Le bien est du ct de lactivit qui
assure notre intriorisation, notre libration, notre participation la
suffisance absolue de ltre pur. Entre cette activit et cette passivit
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 93
il y a toujours une compensation qui empche que lunit de ltre
puisse tre rompue. Et la prdominance de lactivit sur la passivit
peut tre plus ou moins grande, de telle sorte que nous parlons lgi-
timement des degrs du Bien. Pourtant il est difficile de donner ces
degrs un coefficient proprement quantitatif et mme le rle du bien
est dabolir la quantit au profit de la qualit pure qui est comme la
perfection originale et indivisible de ltre en chaque point. Aussi
faut-il montrer beaucoup de prudence dans lutilisation [95] du lan-
gage de la participation qui (se fondant sur la distinction de la partie
et du tout) pourrait nous inviter penser que le bien est pour nous
un accroissement dtre alors que cest seulement un progrs de no-
tre intriorisation. Ce qui trouverait une sorte de confirmation dans
cette remarque que le bien est pour nous non pas un enrichissement
intrieur (sur le modle de lavarice ou de lambition), mais plutt
un dpouillement intrieur qui, repoussant lattachement tous les
modes particuliers de lexistence, ne laisse subsister en nous que la
source intrieure dont ils dpendent et qui leur donne leur significa-
tion. Cest que la quantit ne trouve place que dans labstrait, l seu-
lement o lon peut ajouter de lidentique de lidentique comme en
mathmatiques : elle est exclue de lordre ontologique.
On pourrait exprimer autrement encore la compatibilit entre
lunivocit de ltre et les degrs de la valeur. Il suffirait de remar-
quer que, bien que ltre pris au sens strict ne puisse tre quacte, il
est puissance pourtant lgard de chaque tre fini qui en participe
et ne cesse de lactualiser pour le faire sien. Ltre au sens large
comprend donc en lui la fois la possibilit et lactualit, puisque la
possibilit ne diffre de lactualit que selon la perspective dun tre
particulier qui fonde dans ltre total lexistence qui lui est propre.
En chaque point, il se produit une offre de participation qui tablit
toujours une sorte de compensation entre la possibilit et lactualit ;
et cest dans cette conversion de lun dans lautre que sintroduisent
linitiative et le mrite de toutes les volonts individuelles. Le temps
est ncessaire pour cela, qui fait de chaque fin que nous nous assi-
gnons un objet de poursuite dont il semble que nous nous rappro-
chions de plus en plus. Mais cette fin est elle-mme intrieure
ltre et cest nous seulement quil appartient, pour la rendre ntre,
de la dissocier en un terme imagin et dsir avant dtre atteint et
possd. Si le Bien, cest ltre mme en tant quil se virtualise pour
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 94
fournir chaque tre particulier le moyen de se raliser, on com-
prend trs bien que le bien doive toujours nous apparatre comme
infini, ou comme idal, cest--dire comme un terme qui dans le
temps recule toujours, et que pourtant il y ait dans chacune des
conditions o nous [96] sommes placs un bien spcifique qui ex-
prime, lintrieur mme du relatif, le caractre absolu de ses rela-
tions avec labsolu.
Ainsi lide des degrs de la valeur naltrerait pas moins son es-
sence qualitative que lide des degrs de ltre naltrait cette uni-
vocit qui, au lieu de se fonder sur son abstraction, tait lexpression
de sa plnitude en chaque point. Mais la distinction entre ltre et la
valeur, cest celle que nous pouvons tablir entre le participable en
soi considr indpendamment de toute participation relle et le
mme participable en tant quil est lobjet et la fin dun acte de par-
ticipation rel
1
.
D. LA PRSENCE EN TOUT POINT
DE LACTE CRATEUR
Retour la table des matires
ART. 10 : Il y a univocit entre ltre du crateur, de la cration et
de la crature.
En slevant maintenant au-dessus du monde jusqu lacte qui le
soutient, et dont nous montrerons quil est lessence de ltre, on
aboutira cette conclusion, cest quil ny a pas de diffrence, sous
le rapport de ltre, entre Dieu et sa cration. Personne noserait pr-
tendre que cest relever la dignit de Dieu que de considrer sa cra-
tion comme une illusion absolue. Mais mme cette illusion, dont
1
On trouverait une solution de ces difficults en acceptant le vocabulaire que
nous proposons dans notre Introduction lOntologie : savoir que le Bien
est ltre mme en tant quil est la source de la participation et quil la rend
possible, que la Valeur est la participation en acte, en tant quelle fonde plus
particulirement le mrite et lIdal, la participation encore, mais en tant
quengage dans le donn, elle exige toujours quil soit dpass.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 95
on peut se complaire considrer la nature comme imparfaite et re-
lative, il faut, telle quelle est, attribuer lexistence pure et simple. Si
lon se place au point de vue de la fcondit ou de la suffisance, il
peut donc y avoir un abme entre Dieu et le monde. Mais il est im-
possible que Dieu, dans la gnrosit sans rticence de lacte cra-
teur, appelle les choses bnficier [97] dune autre existence que
de celle dont il jouit lui-mme ternellement. Il ny a pas
dexistence diminue ou btarde, parce que lexistence de chaque
objet, cest la prsence en lui de lacte divin sans lequel il ne serait
rien.
Nous nous rendons pleinement compte des difficults auxquelles
se heurte la pense dans laffirmation de lunivocit. Mais ces diffi-
cults ne doivent pas nous conduire altrer la puret des notions.
Ltre fini ne parat faire chec lunivocit que si lon confond son
tre non pas mme avec ses qualits, mais seulement avec la finitude
de ses qualits. On montrera que si chaque individu nexiste que par
son inscription dans le tout, ce qui videmment lenferme lui-mme
dans des limites, il faut non seulement que le tout lui soit prsent
grce aux liens qui lattachent de proche en proche tout ce qui
lenvironne, mais encore que le tout soit prsent en lui grce une
participation personnelle et active pour laquelle la conscience est
ncessaire. Alors le moi sunit lacte en devenant acte, et la pr-
sence de Dieu, au lieu de se raliser dans le monde par une opration
qui nous chappe et que nous subissons, se ralise en nous par une
opration qui nous est propre et qui nous libre de nos limites en
nous identifiant avec le principe qui nous fait tre.
Seule lunivocit entre la cration, le crateur et la crature peut
lier ces trois termes lun lautre et tablir entre eux une solidarit
relle.
Mais afin dachever de saisir pourquoi ltre nest pas une ide
abstraite, il faut examiner maintenant quel est le rapport que soutient
avec lunit de ltre la multiplicit infinie de ses formes. Car ltre
soffre nous la fois comme un et comme multiple. Et le propre de
la dialectique ne peut tre ni de diviser lun, ni dunifier le multiple,
puisque ces deux caractres sont insparables, mais de montrer
comment la multiplicit, au lieu de dtruire lunit, la requiert et at-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 96
teste en quelque sorte lefficacit omniprsente de son opration. On
tablira dabord un lien entre luniversalit et lunivocit en cher-
chant ce que deviennent lgard de ltre les notions classiques
dextension et de comprhension.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 97
[99]
DE LTRE
Deuxime partie
LA MULTIPLICIT
DE LTRE
Retour la table des matires
[100]
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 98
[101]
Deuxime partie.
La multiplicit de ltre
Chapitre IV
DE LEXTENSION
ET DE LA COMPRHENSION
DE LTRE
A. ANALYSE DE LTRE
Retour la table des matires
ART. 1: Ltre nest ni une classe ni une qualit, puisque la distinc-
tion des classes ou des qualits ne peut seffectuer quen lui.
On ne se propose point, dans cette deuxime partie, de dduire la
multiplicit de ltre. Elle est donne en mme temps que son unit.
Les deux termes sont corrlatifs. Cest parce que ltre est un quil
est aussi multiple. Et telle est la raison pour laquelle la multiplicit,
au lieu de faire chec lunit, en tmoigne. On justifiera simple-
ment la concidence de luniversalit et de lunivocit : ce qui nest
possible que par ldification dune logique interne de ltre qui doit
nous conduire du rapport abstrait entre son extension et sa compr-
hension, par lintermdiaire du jugement dans lequel lexistence est
affirme, au rapport concret entre le tout et ses parties. Il sagit donc
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 99
dabord de montrer comment lextension et la comprhension,
confondues dabord dans lunit de ltre, et qui sopposent lune
lautre ds que commence lanalyse conceptuelle, se confondent
nouveau dans chacun des modes de ltre, ds quon entreprend de
lui restituer sa dignit ontologique.
Lorsque nous fixons les yeux sur ltre dune chose, nous disons
tour tour quelle est contenue dans ltre et quelle possde ltre
(cette dernire expression impliquant la prsence en elle du caract-
re qui la fait tre et non pas seulement laffirmation dun tel caract-
re par une conscience). Est-ce [102] faire de ltre dans le premier
cas un genre et dans le second une qualit ? Il y a cependant une dif-
frence cet gard entre lide de ltre et toutes les autres ides,
car, lorsque nous disons dun objet quil est blanc et dun individu
quil est juste, nous pouvons bien considrer le blanc et le juste
comme faisant partie de leur nature, mais nous ne pouvons pas in-
versement dire que cet objet est contenu dans la blancheur ou cet
individu dans la justice. Il nous faut constituer une classe forme par
les objets blancs ou par les tres justes lintrieur de laquelle nous
pouvons placer, il est vrai, le terme considr, mais qui est forme
dindividus spars dont le nombre est susceptible de crotre et de
diminuer, puisquelle contient la fois des tres rels et des tres
possibles et puisque toute qualit, tant un lment du devenir,
change incessamment de sujet. De plus, la circonscription que nous
lui donnons est une vue de la pense et possde un caractre plus ou
moins artificiel : car les objets les plus dissemblables par ailleurs
peuvent tre runis dans la mme classe, condition que nous dis-
cernions en eux une mme qualit sur laquelle porte actuellement
notre regard, et qui peut tre la plus superficielle de toutes.
Pour sapercevoir que cette opration na pas de porte ontologi-
que, il suffit de remarquer quun genre ne participe ltre que si,
replaant la qualit qui le dfinit dans le faisceau infiniment com-
plexe do nous lavons tire, nous assignons celle-ci une place
dans lunivers en lindividualisant. Ltre, au lieu dtre dcouvert
par cette analyse abstraite, doit tre au contraire suppos par elle : ce
qui le prouve, cest la ncessit o nous sommes non pas seulement
de joindre cette qualit beaucoup dautres, mais encore de lui don-
ner un aspect original et unique, den faire telle nuance de la blan-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 100
cheur ou tel mode de la justice pour quelle ne perde point ses atta-
ches avec lui.
Ds lors, il y a une contradiction certaine vouloir faire de ltre
une qualit comme les autres, et mme la plus indtermine et la
plus strile de toutes, alors que ltre ne peut se rencontrer que l o
toutes les qualits sont runies. Cest pour cela quil nest nulle part
comme terme spar et que la pense ne peut pas en faire un objet
comme de tous les autres [103] termes auxquels elle sapplique.
Mais cest pour cela aussi quil est partout puisquon ne peut poser
aucun terme particulier quen posant le tout dont celui-ci se dtache.
Ajoutons encore que, si ltre est une synthse de qualits, ce nest
pas pourtant cette synthse imparfaite que nous obtenons en asso-
ciant les unes aux autres les qualits dont nous avons reconnu en lui
la prsence ; cest la synthse totale reclant en elle linfini et que
nous devons commencer par supposer pour que lanalyse puisse
commencer. Cette analyse appuye sur ltre ne lpuise jamais ;
mais lappui que ltre donne toutes les oprations de la pense
justifie leur valeur objective et permet dinscrire notre connaissance
dans ltre en maintenant entre elle et lui une distance quelle ne
franchira jamais et lintrieur de laquelle seffectuent tous ses pro-
grs.
Par consquent, en disant quune chose possde ltre, nous ne
voulons pas dire quelle le possde comme une qualit, mais que
nous la considrons en totalit, dans ce quelle nous rvle et dans
ce quelle nous cache, cest--dire dans ses rapports avec tout
lunivers et non pas seulement dans ses rapports avec nous. De m-
me, quand nous disons quune chose est contenue dans ltre, nous
ne voulons pas dire quelle y est contenue comme dans un genre,
mais quelle en est une partie et mme une partie qui suppose le tout
et qui lexprime sa manire. Cest parce que ltre nest pas une
qualit quil nest pas non plus une classe. Cette classe ne pourrait
tre forme dindividus spars, car comment imaginer une lacune
qui les spare sans ressusciter lide de nant ? Elle ne serait pas
susceptible de crotre ou de diminuer, car o retomberait ce qui lui
serait retir, o serait puis le surcrot qui pourrait lui venir ? Il y a
un devenir incessant des formes de ltre, mais il se produit
lintrieur de ltre qui demeure lui-mme sans changement, sem-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 101
blable lespace qui ne laisse voir en lui aucune trace du mouve-
ment qui la travers.
[104]
ART. 2 : La sparation des tres individuels et lanalyse des ca-
ractres sont deux oprations solidaires.
On oppose en gnral la division lanalyse. La division nous
permettrait de distinguer dans le monde des tres spars ; chacun
deux formerait une sorte de tout complet, fini sans doute et qui voi-
sine avec dautres, mais qui nen est pas moins une pice originale
de lunivers concret. La division laisse ltre intact : il subsiste dans
la pense tel quil est en lui-mme. Au contraire, lanalyse isolerait
dans un tre particulier un caractre qui na dexistence spare que
pour la pense et que nous concevons aussitt comme susceptible de
se retrouver dans une multiplicit dtres diffrents ; sans doute dans
chacun de ces tres il recevra une forme distinctive et unique : mais
cest comme si, partir du moment o il a pntr dans la pense et
o il a t assimil par elle, il participait sa fcondit et son infi-
nit ; cest comme si la pense, le portant en quelque sorte en elle et
avec elle, se donnait le droit que lexprience limitera de le
retrouver dans tous les objets auxquels elle sapplique.
Cependant ces deux oprations de la division et de lanalyse sont
beaucoup plus solidaires que lon ne croit. Chacune delles tmoigne
par elle-mme de la liaison ncessaire de ltre particulier avec
ltre total : dune part en effet chaque individu a t dtach de
lunivers et doit y tre aussitt replac par les relations qui
lunissent avec tous les autres individus, et dautre part chaque qua-
lit est comme un fil dans une trame continue dont la pense se bor-
ne dfaire et refaire sans cesse les mailles pour nous montrer
comment elle est tisse.
Mais ces oprations tmoignent dune manire beaucoup plus
subtile de la liaison entre la partie et le tout : car chacune delles
nest possible que par une sorte de rfrence lautre, quelle ne
suppose pourtant que pour en dtruire tous les effets. On ne peut en
effet distinguer dans le tout un individu particulier autrement quen
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 102
lui attribuant certaines qualits propres ; et pourtant il nest un indi-
vidu concret que si ces qualits sont la fois innombrables et ins-
parables, [105] et par consquent sil devient pour lanalyse un objet
sur lequel il faut quelle porte, mais quelle ne doit jamais parvenir
rsoudre. Inversement, il est impossible de discerner les qualits s-
pares autrement quen reconnaissant leur prsence dans un individu
diffrent de tous les autres ; et pourtant, si ces qualits doivent tre
penses part, il faut que chacune delles reoive luniversalit,
cest--dire une infinit de droit, et que lesprit, lentranant partout
avec lui, constitue un genre dobjets possibles qui sera dfini par
elle et dont lindtermination sera encore une expression abstraite du
tout auquel elle demeure suspendue.
Ainsi un individu ne peut tre spar de tous les autres qu
condition de demeurer dune certaine manire concret, cest--dire
de contenir indivisiblement en lui toutes les qualits. Une qualit ne
peut tre distingue de toutes les autres qu condition de devenir
abstraite, cest--dire de recevoir comme la pense une puissance
dapplication illimite.
B. LTRE UN ET INFINI
Retour la table des matires
ART. 3 : Ltre est un et infini la fois en extension et en compr-
hension.
Si la pense discursive comporte ncessairement deux oprations
en quelque sorte corrlatives, lune qui consiste isoler une dter-
mination particulire, lautre considrer le champ sur lequel elle
rgne, ces deux oprations sont insparables et confirment, au lieu
de la briser, lunit indivisible de ltre qui ne donne prise aucune
affirmation limite quen lobligeant toujours regagner par son
tendue ce qui manque son contenu ou par son contenu ce qui
manque son tendue. Telle est lorigine de la loi fameuse qui
nonce la variation inverse de lextension et de la comprhension.
Celle-ci ne vaut cependant que du concept. Et ltre lui oppose une
rsistance comme le montre lembarras que lon prouve aux deux
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 103
extrmits de lchelle des concepts o la loi devrait recevoir une
application singulire. Car au sommet on trouve un concept qui
stendant tout ce qui est devrait tre sans contenu et la base un
concept dont le contenu serait infini, [106] mais qui ne
sappliquerait qu un seul individu. Or cest dans ces deux extrmi-
ts que le concept perd le pouvoir qui lui est propre et vient rejoin-
dre ltre, mais pour tmoigner de deux caractres qui le dfinis-
sent : car il est universel, cest--dire quil ny a rien en dehors de
lui, mais dune universalit concrte, cest--dire telle quil est en
effet un individu, mais qui contient en lui tous les autres.
La plnitude de ltre trouve une double expression, soit quen
chaque point on considre labondance infinie des qualits qui se
croisent en lui, soit quelle nous commande dembrasser par un seul
regard la totalit des choses. Car la comprhension de ltre est n-
cessairement la mme partout o on le retrouve : elle ne se distingue
pas de lextension qui dilate lun dans le tout, comme la comprhen-
sion resserre le tout dans lun. Ainsi, lunit de chaque objet expri-
me lunit de lunivers. Mais ds que lanalyse dcompose cette uni-
t pour la rsoudre en lments, elle y distingue linfinit des quali-
ts associes ou des objets juxtaposs.
Linfinit de ltre est, au regard de lanalyse, lexpression de la
vue intuitive par laquelle nous saisissons son unit. Au point de vue
de lextension, lunit permet de considrer le monde comme un in-
dividu, et linfinit comme une multitude innombrable dtres parti-
culiers. Au point de vue de la comprhension, lunit nous permet
de considrer ltre comme indivisiblement prsent en tous points,
et linfinit comme une abondance inpuisable de caractres donns
la fois.
Ds lors, les rapports entre lextension et la comprhension de
ltre peuvent tre exprims par quatre formules diffrentes dont les
deux premires seulement vrifient laxiome classique. Il faut avoir
en vue pour obtenir celles-ci soit lunit dans lextension et
linfinit dans la comprhension : ltre est alors un individu dont on
ne dnombrera jamais toutes les proprits soit lunit dans la
comprhension et linfinit dans lextension : alors ltre redevient
un genre dont la dfinition est si pauvre quil est impossible de
lnoncer. Au contraire, si lon considre lunit ou linfinit la
fois dans lextension et dans la comprhension, les formules que
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 104
lon obtient contredisent laxiome classique : car dans le premier
[107] cas, ltre est un individu, mais il est en mme temps dune
parfaite simplicit qui est un effet cette fois de la plnitude et non de
lindigence et dans le second cas, ltre manifeste simultanment
lexcs dbordant de sa richesse intrieure par la multiplicit sans
bornes des individus qui le reoivent et les caractres qui le forment.
ART. 4 : Cest que lunit de ltre total, en surmontant la multi-
plicit des individus et des classes, abolit la distinction de
lextension et de la comprhension.
Dire que ltre est linfini la fois dans lordre de lextension et
dans lordre de la comprhension, cest se rfrer encore aux rsul-
tats obtenus soit par la division, soit par lanalyse, et de l, on glisse
complaisamment vers les thses qui font de ltre une somme idale,
cest--dire qui ne sachve jamais, mais qui nen mettent pas moins
leur confiance dans les ambitions synthtiques de lesprit. Aussi pr-
frons-nous faire de ltre une unit dans lordre de lextension,
cest--dire un individu et non pas une classe, et une unit dans
lordre de la comprhension, cest--dire non pas une qualit isole,
mais cette implication parfaite de toutes les qualits dans laquelle
chacune delles ne peut tre distingue quen sopposant toutes les
autres, et par consquent en les appelant, puisquelle en est solidai-
re.
Bien plus, alors quon choque toutes nos habitudes de langage en
soutenant que le tout est prsent dans chaque partie, il ne peut y
avoir aucune difficult admettre que lun, incapable de se morce-
ler, puisse tre lobjet de diffrentes perspectives et donner encore
chacune delles son unit caractristique. La distinction de
lextension et de la comprhension na pas lieu en lui parce quelle
ne peut se produire qu partir du moment o cesse son indivision ;
mais partir de ce moment, nous discernons en lui quelque caractre
qui fait lobjet dun concept, et dont nous ne pouvons essayer de
maintenir lexistence isole (sans rompre ses attaches avec le tout),
qu condition de lui attribuer la gnralit en change. En ce qui
concerne ltre au contraire, la ncessit dtreindre [108] la fois,
pour poser sa comprhension, la totalit des qualits et
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 105
limpossibilit de voir en lui un caractre isol que lon pourrait
joindre dautres pour reconstituer le rel, doivent nous obliger en
faire un individu unique indiscernable de tous les caractres qui le
forment. Quest-ce dire, sinon que lextension et la comprhension
sidentifient dans ltre comme dans la source commune o
lanalyse pourra les distinguer en les opposant ? Aussi peut-on indif-
fremment, soit en disant que ltre est le tout, lui donner comme
comprhension son extension elle-mme, soit en disant que le tout
est un, rduire son extension lindivisibilit plnire de sa compr-
hension.
Limpossibilit de considrer ltre comme le plus vaste de tous
les genres apparat donc comme vidente ds que lon mdite sur le
caractre de toute classe de supposer une distinction entre les indi-
vidus quelle contient. Au moment en effet o on atteint la classe
qui est la plus grande de toutes, celle qui contient toutes les autres
classes et tous les individus de chacune delles, il est ncessaire
dabolir toutes les distinctions qui leur permettaient prcisment de
fonder leur multiplicit et leur indpendance relative. Comment, en
effet, imaginer une classe qui, au lieu de se distinguer par quelque
caractre spcifique dune autre classe qui la contient ou quelle
contient, au lieu de permettre que les individus qui la forment lui
ajoutent toujours quelque nouveau caractre, runirait en elle les
caractres de toutes ces classes et de tous ces individus la fois ?
Nous sommes parvenus en un point o la continuit de ltre concret
ne peut plus tre rompue par la diversit corrlative des tres parti-
culiers et des espces qualifies. Nous nous trouvons dsormais en
prsence dun immense individu au sein duquel nous pouvons il est
vrai discerner des parties, mais qui nont de sens que par rapport au
tout, qui ne pourraient subsister isolment, et dont chacun exprime
la fois une fonction du tout et une perspective sur le tout.
Luniversalit de ltre nest pas celle dun concept universel, mais
celle de lindividu-univers.
Cest par un argument analogue (comme on la montr dj
propos de la ncessit de situer chaque chose dans ltre, au lieu de
faire de ltre la proprit dune chose cf. Premire Partie, Chap. III,
art. 3) que Kant dmontrait le caractre [109] intuitif et non concep-
tuel de lespace et du temps. Lun et lautre lui apparaissaient non
pas comme contenus dans une multitude infinie de reprsentations
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 106
( la manire dun caractre abstrait), mais comme contenant en soi
une multitude infinie de reprsentations ( la manire dun tout dont
les reprsentations exprimeraient la richesse et la varit). Or il est
vrai de dire, en effet, que linstant et le lieu ne peuvent pas tre d-
tachs de la totalit de lespace et du temps, que lespace nest pas
une somme de lieux, ni le temps une somme dinstants, et que, bien
que tous les instants et tous les lieux soient rigoureusement indivi-
duels, chacun deux reprsente cependant un regard sur linfinit
mme de lespace et du temps, quil a fallu poser dabord pour que
la solidarit mutuelle de chaque lieu et de chaque instant avec tous
les autres permette, dans une seule opration, de dgager leur origi-
nalit et leur commune dpendance lgard du milieu qui les sou-
tient tous. Maintenant, sil est vrai que lespace et le temps sont les
deux caractres les plus proches du tout, ou du moins ceux par les-
quels ltre rvle de la manire la plus saisissante sa totalit aux
yeux des tres finis, il ne faut pas stonner de trouver en eux la
mme abondance inpuisable, la mme continuit, la mme indivi-
sibilit que dans ltre lui-mme. Ce ne sont pas non plus des classes
parce que nul objet nchappe leur juridiction, et sils paraissent
garder leur caractre conceptuel en sopposant lun lautre, on sait
quil nest pas possible pourtant dimaginer un monde de la dure
spar du monde de lespace, que, comme les faits physiques sont
entrans dans la dure, les actes psychologiques supposent toujours
quelque rfrence un objet tendu proche ou lointain, dont ils ex-
priment le rapport original avec notre tre subjectif, de telle sorte
que, dans la manire dont lespace et le temps viennent se croiser
ncessairement en chaque point de lunivers, nous trouvons un t-
moignage des caractres que nous avons attribus ltre, mais mis
la porte de ses modes finis, auxquels leur limitation impose de se
prsenter sous la forme de donnes distinctes les unes des autres et
dacqurir leur tre propre par un dveloppement o saccuse leur
mutuelle solidarit. Mais, afin de mieux comprendre le sens des
deux notions dextension et de comprhension, [110] et afin de sai-
sir pourquoi elles doivent sidentifier dans ltre pur et se sparer
pour varier en raison inverse lune de lautre dans les tres particu-
liers, il faut examiner de plus prs le mcanisme de lanalyse.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 107
C. DISTINCTION ET SOLIDARIT
DE TOUS LES CONCEPTS
Retour la table des matires
ART. 5 : Grce lexercice de la pense conceptuelle, lunivers
nous donne le spectacle de nos propres puissances.
Dans chacune des oprations de la pense, il y a une infinit en
puissance qui exprime non pas seulement lambition de notre pen-
se, mais son unit, cest--dire la perfection mme du tout dont elle
mane et vers lequel elle tend. Et le mot mme de tout, bien quil se
rfre des parties et que par consquent il suppose dj lanalyse,
vise plutt ltre indivis, o nous pourrons inpuisablement recon-
natre de nouvelles parties, que ltre totalis, puisque cette totalisa-
tion sera toujours inacheve.
Ce langage mme qui oppose ltre fini le tout dont il fait partie
est plus conforme lapparence qu la ralit et a besoin dtre ex-
pliqu. Car dune part, nous pouvons dire quen chaque point
dunivers il y a place pour une perspective particulire qui embrasse
en elle tout lunivers et qui est constitutive dun tre individuel ; et
dautre part un tre individuel nest pas seulement solidaire du tout
par les relations qui lunissent toutes ses parties, nous pouvons di-
re encore que sa subjectivit, cest la possibilit mme du tout quil
actualise par une sorte doprations qui na jamais de fin. Ajoutons
enfin que ce tout compos de parties ne prexiste pas aux oprations
par lesquelles le sujet individuel le divise et ne cesse de le pntrer.
Plus ces oprations deviennent nombreuses, dlicates et complexes,
plus elles dilateront le spectacle mme que les choses nous donnent,
mais plus aussi elles rapprocheront ce spectacle de nous-mmes,
plus elles lui donneront dintimit et le rendront adquat aux exi-
gences de notre propre conscience : cest donc comme si lindividu
[111] avait commenc par souvrir dans une sorte de vaste aspiration
sur le tout dans lequel il est situ, et comme si, incapable de conna-
tre ce tout autrement que dans ses rapports avec lui-mme, il devait
refermer cette vaste aspiration sur sa propre nature dans laquelle, il
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 108
est vrai, il retrouve alors une image du tout forme de toutes les in-
fluences qui, venues de tous les points de lunivers, se croisent en
elle. Ainsi sexplique comment le monde, qui dabord, lorsque nous
ne sommes nous-mmes quun corps au milieu des autres, semble
nous envelopper, est la fin envelopp par nous, lorsque nous deve-
nons un esprit qui rduit le monde un systme de concepts et de
qualits.
Sil existe, comme nous le montrerons au chapitre VIII, une ide
qui, ne sopposant aucune autre, les renferme toutes, qui soit ind-
finissable, non pas parce quelle est obscure et indtermine, mais
parce que toutes les dfinitions, toutes les dterminations et toutes
les circonscriptions que lon pourra faire soprent en elle, qui ne
puisse pas tre divise parce quelle est parfaitement une ou, ce qui
revient au mme, parce quelle porte linfinit en elle, alors on pour-
ra tre assur quune telle ide, contrairement toutes les autres, ne
peut pas se distinguer de son objet, et qutant lide mme du
concret, elle est aussi lide adquate de ltre. Cest en elle que se
produit la distinction entre le concept et lide particulire, selon
que lanalyse isole dans le sujet une opration en rapport avec une
donne quelle cherche expliquer ou dans chaque forme de
lexistence, la puissance mme qui la ralise.
Mais, puisque ltre est en nous tout entier, il ny a rien hors de
nous qui soit dcisivement impermable notre connaissance. Et les
formes dexistence en apparence les plus htrognes la ntre r-
pondent pourtant dans une certaine mesure quelque accord entre le
rel et nous, quelque action des sens ou de lentendement par la-
quelle nous entrons en contact avec lui. Lunivers extrieur nous
offre par consquent dans une sorte de spectacle le tableau de nos
diffrentes puissances ; et si nous ne crons pas ce spectacle, du
moins lui donnons-nous, en mettant en jeu ces puissances, la lumire
qui lclaire. On comprend bien comment chacune de ces puissances
va naturellement linfini : mais elle ne se [112] distinguerait pas
des autres et au lieu de nous permettre seulement de nous appliquer
un objet, elle nous identifierait avec lui, elle surmonterait notre
nature finie, elle nous obligerait confondre notre entendement avec
lentendement divin et la connaissance avec la cration, si son infi-
nit tait une marque de plnitude plutt que dinachvement.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 109
ART. 6 : Toute connaissance objective, mme celle dun autre tre
individuel, est abstraite ; elle exprime lacte conceptuel par lequel
le moi divise le tout pour le reconstruire.
Nous ne parvenons saisir le concret, cest--dire lactualit pl-
nire de ltre que dans notre propre nature individuelle et non pas
mme dans lindividualit dun autre, puisque celle-ci, tant ext-
rieure nous, la connaissance que nous en avons se distingue de son
objet et quelle nest jamais assez parfaite pour tre assure de ne
pouvoir sappliquer qu lui seul ; au contraire, quand il sagit de
nous, la conscience que nous avons de notre tre, se confondant
avec notre tre mme, possde le caractre dunicit qui ne peut ap-
partenir qu lintimit : seulement une telle connaissance nest ja-
mais celle dun objet, cest celle dun ensemble de puissances qui ne
sactualisent que par degrs.
Par contre, toute connaissance objective est elle-mme abstraite,
et ce qui le prouve, cest que, pour atteindre lindividuel comme tel,
il faudrait essayer de le surprendre non pas dans ce que nous appe-
lons une chose particulire, mais dans les perceptions successives
que nous en avons. Entre celles-ci nous discernons des ressemblan-
ces assez troites pour les confondre ou du moins pour les interpr-
ter comme tant des perspectives diffrentes sur un mme original.
Mais si le concret cest lacte de la perception et non pas lobjet per-
u, on comprendra sans peine pourquoi cest sur le modle de la r-
alit spirituelle quil faudra concevoir la nature de ltre pur. Seule-
ment, tandis que notre conscience individuelle lgrne dans la du-
re, le privilge de labstraction est de ly soustraire, de telle sorte
que nous ne pouvons nous reprsenter sa permanence qu condition
de resserrer sa richesse [113] dans des cadres o elle acquiert
limmobilit en chappant la vie. Les objets empiriques sont les
premiers de ces cadres : aussi le temps de lunivers est-il un temps
construit, diffrent de la dure de la perception. Ces objets sont sus-
ceptibles dentrer leur tour dans des cadres de plus en plus troits,
o la succession objective devient une pure conscution logique, en
attendant que, pour pntrer dans le cadre de ltre abstrait, ils lais-
sent sextnuer tout ce qui faisait leur diversit et leur ordre, mais en
mme temps leur ralit.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 110
La connaissance intrieure de soi, tant la seule connaissance
concrte, prsente un caractre dimmdiate possession et cette infi-
nit pleine dchos laquelle nous donnons le nom de sentiment.
Toute autre connaissance la suppose ; elle lanalyse et la dilate.
Mais une connaissance qui cesse dtre confuse pour devenir dis-
tincte et qui cesse dtre totale pour isoler un aspect du rel na plus
la chaleur et la plnitude insparables de lintriorit dun tre lui-
mme. Elle sera donc considre comme une connaissance extrieu-
re. La constitution de la science montre prcisment que cest dans
ses parties les plus abstraites et lorsquelle sloigne le plus du sen-
sible quelle a les plus grandes prtentions lobjectivit. Cepen-
dant, loin de considrer les thories contemporaines qui font de la
pense conceptuelle un jeu de conventions plus ou moins arbitraires,
mais justifies par le succs, comme une sorte de renoncement la
connaissance de labsolu, il faut, en les poussant jusqu lextrmit,
les incorporer notre doctrine de ltre. Car tous les actes de
lintellect ont leur foyer dans cet tre total dont la conscience tmoi-
gne quil est intrieur nous comme nous sommes intrieurs lui ;
grce leur accomplissement, nous dtachons de nous-mmes, pour
le saisir sous une forme divise, une exprience objective avec la-
quelle notre propre activit formera contraste par son caractre ra-
mass et global. Si ces actes trouvent leur confirmation dans une
pratique qui russit, cest parce que la nature laquelle ils paraissent
sadapter si bien est non point une matire htrogne laquelle ils
sappliquent, mais une autre forme dexpression du mme tre o ils
salimentent. Notre moi faisait corps avec lui depuis lorigine, et si
nous trouvons en elle des sillons dans lesquels [114] sengagent
avec tant daisance lintelligence et la volont, cest parce que ces
facults elles-mmes nont acquis lindpendance que corrlative-
ment ce monde abstrait et mme ce monde sensible dont elles
reprsentent en quelque manire la forme cratrice.
Nous ne saisissons donc la comprhension infinie de ltre
concret que dans notre propre nature. Hors de nous, lindividu est
dj un abstrait form par une imprgnation de perceptions multi-
ples et successives ; mais, pour pouvoir se reprsenter conceptuel-
lement cet univers dsormais extrieur nous, dont nous avons
dabord senti en nous la prsence totale, il faut que nous puissions
lembrasser par la pense sans lidentifier avec nous : ce qui nest
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 111
possible quen le vidant de toute substance. Entre cet tre sans
contenu et la ralit plnire de notre tre propre, nous introduirons
une hirarchie de concepts de plus en plus complexes, qui restrein-
dront le champ de leur application mesure que nous laisserons p-
ntrer en eux un plus grand nombre de qualits diverses filtres par
lanalyse de notre exprience intime. Avec les dbris de cette analy-
se, nous nous donnerons lillusion de reconstruire le monde synth-
tiquement.
ART. 7 : Chaque concept, retenant ou excluant certains caractres
du rel, exprime une dmarche particulire de notre esprit, qui en
appelle une infinit dautres.
Si chaque concept, isol du tout subjectif dans lequel il a pris
naissance, possde en droit une extension sans limite, cest afin de
tmoigner quil ne subsiste pas isolment ; en stendant tout le
possible, il faut quil regagne idalement cette solidarit avec le tout
quil avait en apparence perdue au moment o lanalyse avait cir-
conscrit sa comprhension. Mais si chaque concept garde une puis-
sance dapplication infinie, comment les diffrents concepts peu-
vent-ils en mme temps former des classes contenues les unes dans
les autres ? Cest en effet dans la constitution de ces classes que se
rvle loriginalit de la pense logique : elles sont comme des infi-
nis de diffrents ordres qui, sans rien abandonner de leur infinit,
[115] ont entre eux certains rapports dimplication. Cette question
est solidaire dune autre que nous essaierons de rsoudre larticle 8
du prsent chapitre, quand nous nous demanderons comment les ob-
jets rels se distinguent les uns des autres si toutes les qualits sont
prsentes dans chacun deux.
Sur le premier point, on voit sans peine que, si nous pouvons
considrer un caractre part, nous pouvons aussi, sans le replonger
encore dans le tout o nous avons discern sa prsence, le rejoindre
tour tour beaucoup dautres ; et comme tous les caractres
simpliquent mutuellement, nous pourrons faire entrer le mme ca-
ractre dans des synthses varies formes avec plus ou moins de
bonheur selon lappel de nos besoins ou les exigences de notre en-
tendement. Ces synthses elles-mmes viendront toujours sinscrire
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 112
de proche en proche dans un concept plus gnral dfini seulement
par les caractres qui leur sont communs. Si enfin chacun des
concepts subordonns les uns aux autres, au lieu de grouper les ca-
ractres au hasard comme leur implication rciproque semblerait
lautoriser, ne peut accepter en lui certains dentre eux quen en ex-
cluant dautres incompatibles avec les premiers, cest parce que
limplication totale ne se ralise que dans ltre pur et que chaque
aspect de ltre, bien quil suppose tous les autres, enferme seule-
ment en lui lensemble cohrent et dfini des lments qui sont sus-
ceptibles de prendre place dans la perspective sous laquelle on le
considre. Ainsi, lorsque la prsence dun caractre entrane
labsence dun autre, cest que celui-ci, situ soit au mme rang, soit
en un rang diffrent, dans la hirarchie conceptuelle, exprime un
autre aspect de ltre ralis sous une forme visible en un autre
point, mais quil faut opposer au prcdent pour que lanalyse soit
possible et que les diffrentes qualits, confondues lorigine dans
le mme tout, viennent se dgager et ressortir grce leur contraste
mme. Cest parce que lobjet individuel est lui-mme un abstrait
que la pense discursive loppose dautres objets et quelle soumet
sa constitution interne la loi de contradiction, qui ne reoit pour-
tant un sens que dans le systme de reprsentation propre chaque
conscience, puisque lobjet considr [116] en soi ne se distinguerait
pas du tout dans lequel toutes les perspectives subjectives vien-
draient se rejoindre et sidentifier.
Lune des illusions les plus tenaces de lesprit humain consiste
regarder les classes, ou plutt les groupes de caractres par lesquels
chacune delles est dfinie, comme des formes de ltre rellement
distinctes, et mme comme des principes antrieurs ltre concret,
dissimuls en quelque sorte par lui, et dont la fonction propre serait
dexpliquer la gense du tout, au lieu de trouver en celui-ci
lexplication dont ils ont eux-mmes besoin. Mais deux observations
devraient pourtant nous mettre en dfiance contre le crdit quon
accorde labstrait : dune part, en effet, labstrait est un moyen
dont nous nous servons pour faire sortir par degrs ltre du nant
par un processus denrichissement graduel ; or, cette opration
consiste seulement ordonner avec habilet les rsultats de
lanalyse et nous ne pouvons leffectuer que dans un temps logique,
qui est une cration artificielle de notre esprit, intermdiaire entre
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 113
lternit, que nous attribuons ltre, et le temps rel dans lequel le
monde dploie ses formes particulires aux yeux dun tre fini.
Dautre part, labstrait, qui ne parvenait donner une figure de ltre
quen le vidant de cette abondance intrieure sans laquelle il nest
que dficience et nant, ne peut assimiler son tour la qualit, en la
retirant du concret o lanalyse la dcouvre, quen lui donnant un
caractre anonyme qui la rend mconnaissable et nous interdit de la
raliser sans lindividualiser nouveau. Les nominalistes ont bien
raison de ne pas vouloir que lide du vertbr ait dexistence objec-
tive hors de tel animal qui est pourvu de vertbres, ni lide de blan-
cheur hors de tel objet particulier dans lequel on trouve telle nuance
unique de blanc. Et lon sait bien que linvention des genres est la
fois leffet de notre subtilit, de lart avec lequel nous rapprochons
par dingnieuses comparaisons des termes en apparence diffrents,
et leffet de notre grossiret et de notre ignorance, qui nous emp-
chent de pousser lanalyse jusquau dernier point et de reconnatre
dans chaque individu le caractre unique et incomparable de tous ses
lments, des plus saillants comme des plus cachs.
[117]
Pour redonner un sens cette diversit de concepts qui
sembotent les uns dans les autres, il faut abandonner le point de
vue de ltre pur, puisque celui-ci, antrieur la distinction soit des
qualits sensibles, soit des concepts, ne pourrait tre robtenu, grce
une construction de la pense, que par une rencontre en un mme
point de toutes les qualits ou de tous les concepts ; et de fait, en ce
point, la diffrence entre le concept et la qualit svanouirait, puis-
que le concept recouvrerait son caractre concret, et que la qualit
perdrait le caractre de passivit par lequel elle se manifeste aux
yeux dun sujet comme une pure donne. On verrait alors la distinc-
tion entre lextension et la comprhension sabolir non plus seule-
ment dans le tout, mais en chacun de ses points, comme on le mon-
trera dans les articles 8 et 9 du prsent chapitre. Entre le tout parfai-
tement plein, mais confus pour nous, qui continuons encore en fai-
re partie alors mme que nous nous en sparons idalement, et ce
tout divis dont on pourrait dire quil demeure toujours inachev,
que lintelligence nous permet de nous reprsenter, le sujet fini a
introduit ses dmarches originales et un chelonnement dans la du-
re au cours de laquelle il a constitu sa propre nature. Ainsi les dif-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 114
frents concepts ne peuvent retrouver un sens que pour un tre fini
dont lactivit, bien que toujours une, se diversifie pourtant et multi-
plie indfiniment ses oprations afin dessayer datteindre ce mme
tout auquel il est ncessairement li, mais qui dborde sans cesse les
efforts quil fait pour lassimiler.
Cest la multiplicit des concepts qui accuse le caractre abstrait,
cest--dire lincompltude de chacun deux. Aussi est-il vrai de dire
que tous les concepts simpliquent, et que, quel que soit celui que
lon adopte comme premier terme, il y a entre eux une sorte dappel
rciproque. Mais cet appel cache lunit de ltre do ils ont t
tirs et dont ils expriment les aspects diffrents.
[118]
D. DISTINCTION ET SOLIDARIT
DE TOUTES LES QUALITS
Retour la table des matires
ART. 8 : Toutes les qualits distingues par lanalyse peuvent tre
retrouves synoptiquement par le mme individu dans des objets
diffrents.
Ltre concret ne se rencontre en acte que dans ce tout qui nest
jamais une somme de dterminations, mais lacte qui les soutient
toutes, ou dans lindividu qui ne se rduit jamais ses dtermina-
tions, mais qui les renferme toutes en puissance et qui les fait appa-
ratre successivement selon le rapport qui stablit chaque instant
entre la situation o il est plac et les dmarches de sa libert dans
un procs qui ne sachve jamais.
Telle est la raison pour laquelle le tout lui-mme, en tant quil est
dfini comme une somme de dterminations ou, si lon veut, en tant
quil est considr dans sa pure objectivit, nest jamais ralis.
Toutes les dterminations trouvent pourtant dans ltre pur leur rai-
son actuelle et suffisante : il enveloppe lui-mme le temps comme la
condition de leur apparition ; et tout tre particulier, par sa liaison
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 115
avec le tout de ltre, les appelle lexistence tour tour, sans que
leur infinie possibilit pourtant parvienne jamais spuiser.
On peut bien dire par consquent que, comme dans une srie
convergente, la somme infinie des dterminations toujours naissan-
tes et toujours prissantes tend la limite vers cet acte pur qui les
contient toutes en elles sans laisser subsister entre elles aucune spa-
ration. Et lon peut dire encore que cest le mme tre qui est pr-
sent en acte dans le tout et en puissance dans chacune de ses parties.
On voit mme comment on russirait par l obtenir une conciden-
ce entre le tout de la subjectivit et le tout de lobjectivit, puisque
tout objet est une apparence pour une conscience et que, dans son
essence propre, il ne fait quun avec la puissance quil actualise. L
o cest le tout qui apparat, et l o toute puissance sactualise,
nous retombons galement sur ltre pur.
Mais cest un point de vue que nous devons dpasser [119] enco-
re. Car en rappelant lopposition des genres et des qualits on objec-
tera que toutes les qualits nappartiennent pas chaque objet indi-
viduel, sans quoi il ny aurait plus dindividualit, puisque chaque
objet serait identique tous les autres. De mme les genres corres-
pondant ces qualits nont pas une extension sans limites, puis-
quils diffrent en gnralit. Sil en tait autrement, lanalyse de
ltre serait une illusion incomprhensible. Mais cette double ob-
servation on peut rpondre en dfinissant prcisment la fonction
originale du particulier dans le monde. Car sil appelle luniversel,
ce nest pas pour sy engloutir. Tout dabord chaque qualit nest ce
quelle est que par son contraste avec toutes les autres ; elle na de
ralit originale mme pour la pense que par son opposition avec
elles, qui la soutiennent dans lexistence : autrement toutes les quali-
ts se confondraient dans lunit de ltre do il serait impossible
de les dtacher, ce qui montre assez clairement que la qualit ne
peut appartenir un autre monde quau monde de la relation.
Dautre part, en ce qui concerne les degrs de gnralit des diff-
rents genres, si chacun deux exprime une possibilit infinie, mais si
ce sont, comme on la vu, des infinis de diffrents ordres qui
senveloppent les uns les autres, dans chacun deux le tout est pr-
sent tout entier par limpossibilit o nous sommes den poser un
sans les poser tous. Mais la distinction des qualits et des genres qui
leur correspondent suppose un tre fini qui reconnat dans le monde
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 116
des aspects diffrents dont la nature et lampleur sont proportion-
nes la forme et au rayonnement de son activit et de ses besoins.
Et bien que ltre soit prsent tout entier en tout point, chaque indi-
vidu constitue son originalit propre grce la perspective particu-
lire sous laquelle il embrasse les choses. Thoriquement la diversi-
t des choses est corrlative non pas mme de lexistence dune
multiplicit dindividus, mais de lexistence dun seul, cest--dire
de ltre fini en gnral aux yeux duquel ltre pur ne peut rvler sa
prsence, en sauvegardant sa propre indpendance, que par
labondance infinie de ses modes. Si pourtant nous prenons chaque
mode, il est impossible que ltre fini qui le contemple voie en lui
dautres caractres que ceux qui peuvent [120] entrer dans le point
de vue particulier que sa nature et sa position lui permettent davoir
sur le monde. Ainsi lobjet dpasse toujours la perception que nous
en avons et chacun sait bien quen poussant plus loin lanalyse, il
trouverait en lui une richesse toujours croissante. Si cette richesse
est infinie, cest parce quelle est elle-mme reprsentative du tout.
On sera donc frapp de voir comment lactivit qui reste en puissan-
ce dans le sujet et qui ne russit jamais sexercer tout entire, cor-
respond une possibilit dans lobjet qui elle-mme ne sera jamais
puise.
Mais que subsiste-t-il alors de lhtrognit du rel, de la dis-
tinction effective entre des formes dexistence caractrises par des
qualits diffrentes ? Faut-il considrer cette htrognit comme
ayant seulement une valeur subjective et comme cre par lindividu
grce une sorte de mirage dans lequel il peroit le reflet de ses
propres limites ? Cependant, il faut remarquer dune part que chaque
objet connu est confront avec la totalit de notre nature, et quil
doit prsenter nos yeux autant despces de qualits quil y a de
modes selon lesquels le fini et lunivers o il prend place peuvent
communiquer : ainsi il y a dans chaque objet un caractre par lequel
il rpond soit lexercice de nos diffrents sens, soit aux diffrentes
actions que nous pouvons accomplir, mais que nous accomplissons
en ralit dune manire incomplte et successive. Toutefois, ce ca-
ractre nest pas toujours actualis, parce quil peut tre pour nous
sans intrt, soit momentanment, soit constamment. Dj par
consquent on pressent que la diversit des objets tale dans
lespace une richesse que chacun deux pourrait nous livrer si toutes
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 117
les puissances de la conscience trouvaient en lui leur application.
Dautre part, aucun des objets qui forment lunivers na notre
gard la mme situation : et sils taient identiques dans leur fond,
cest--dire dans ltre quils possdent, ils nen seraient pas moins
profondment diffrents par leur position vis--vis de nous. Cest
cette diversit de position qui sexprime dans la varit des qualits
que nous leur prtons ; ceux qui nous paraissent les plus riches sont
ceux qui entrent avec nous dans les relations les plus troites et les
plus complexes ; mais ceux qui sont en apparence les plus pauvres et
les plus dnus [121] dvoileraient une abondance gale sils se rap-
prochaient de nous ou si lchelle selon laquelle nous les voyons
tait modifie. Il y a ici une relation qui stablit entre la qualit et la
quantit et qui est singulirement instructive. Car nous voyons les
choses changer daspect selon la distance qui nous en spare, qui
nest elle-mme quune expression de la diffrence dintrt quelles
ont pour nous. Nous pouvons imaginer ds lors une conversion des
qualits les unes dans les autres selon la proximit ou lloignement
qui tmoigne indirectement du rapport de toutes les formes du rel
avec notre propre disposition leur gard. Enfin, comme notre natu-
re nest point altre quand nous observons les parties de lunivers
avec lesquelles nous avons des relations diffrentes, comme nous
gardons les mmes sens, les mmes besoins, les mmes catgories,
il est vident que lhtrognit des qualits par lesquelles chaque
objet se rvle nous nest pas dcisive et absolue ; on retrouve en
elle lexpression des mmes oprations de lindividu appropries au
parti diffrent quil peut tirer de chaque objet. Ainsi il y a une cor-
respondance entre les qualits en apparence les plus opposes et lon
peut tablir une sorte de tableau synoptique qui permettrait de passer
dun objet lautre et de considrer les qualits de chacun deux
comme traduisant dans une langue originale les qualits de tous les
autres. Ainsi ltude de la correspondance dialectique entre les diff-
rents sensibles nous apparat comme une vrification des conclu-
sions de lontologie dans le langage de lexprience la plus commu-
ne.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 118
ART. 9 : Toutes les qualits peuvent tre retrouves synoptique-
ment par des individus diffrents lintrieur du mme objet.
Linfinit ouverte lanalyse nous permet de nous engager main-
tenant dans une autre voie ; car si les qualits que nous sommes ca-
pables de reconnatre dans tel fragment de lunivers sont en rapport
avec notre constitution et avec nos tendances un moment donn,
tout linconnu que nous pressentons derrire notre reprsentation
actuelle nous oblige imaginer que toutes les qualits qui nous
chappent sont [122] distingues ou pourraient ltre par des indivi-
dus placs autrement que nous, situs autrement et regardant le
monde une autre chelle. Ainsi le mme tout que chaque conscien-
ce cherche atteindre travers la multiplicit des objets diffrents
se trouverait reprsent lintrieur de chaque objet par la multipli-
cit des diffrentes consciences. On observe ici une nouvelle expres-
sion de la solidarit entre la richesse qualitative de chaque mode de
ltre et la multiplicit sans nombre de ces modes. De part et dautre
nous trouvons une figure de ltre pur. Mais il y a l plus quune fi-
gure. Ltre est prsent tout entier dans chacun de ses modes, sans
subir dmiettement. Ils ne peuvent tre distingus que les uns
lgard des autres. De chacun deux, chaque tre particulier ne saisit
que quelques traits. Mais tous les tres particuliers y trouveraient la
mme totalit que chacun deux essaie vainement datteindre en em-
brassant par la pense des formes dexistence de plus en plus nom-
breuses.
Cette conception nous permet de considrer la totalit des quali-
ts comme donne en chaque point de lunivers. Mais la ralit dis-
tincte des qualits na de sens que par rapport lindividu ; la diver-
sit des objets dans chaque exprience particulire et dans
lexprience des diffrents individus provient de ce que chaque tre
puise dans chaque objet une matire plus ou moins riche qui est
lexpression et le reflet de sa propre originalit.
Dira-t-on que nous formulons ici une hypothse que rien ne vri-
fie ? Mais dabord il nest pas ncessaire pour la justifier que nous
tablissions quil y a en effet une pluralit infinie dtres particuliers
qui se rpartissent pour ainsi dire la perception de la comprhension
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 119
infinie de ltre en chaque point. Il suffit que lon puisse concevoir
ces tres particuliers comme autant dtres possibles. Car lgard
de ltre total, chaque tre particulier nest lui-mme quun possible
qui sactualise selon les lois gnrales de lexprience, par exemple
selon les lois de la gnration, sans que cette actualisation introduise
aucun changement dans la relation ternelle de lindividuel et de
luniversel. Il suffit que laspect du rel que notre perception actua-
lise ait pour corrlatifs une infinit dautres aspects qui restent en
puissance dans des consciences possibles.
[123]
Ensuite lexprience nous fournit dans un grand nombre de cas
particuliers une voie dapproche par laquelle notre thse pourrait
recevoir un commencement de confirmation. Car non seulement
nous voyons les perceptions dun mme objet par diffrents indivi-
dus qui se compltent au lieu de se contredire, mais encore
lhtrognit des sens, quand on passe dune espce une autre,
suggre un changement du rgime qualitatif de la perception suscep-
tible denrichir dune infinit de nouveaux aspects le spectacle que
tout objet nous montre
9
9
Cest la mme ide qui permet par exemple Carlyle de dire dans un article
curieux sur Novalis (Foreign Review, n 7) : Amenez un tre sentant avec
des yeux un peu diffrents, avec des doigts un peu plus doux que les miens : et
pour lui cette chose que jappelle arbre sera jaune et molle aussi srement
quelle est pour moi verte et dure. Faites-lui un tissu nerveux qui soit en tout
point linverse et ce mme arbre ne sera pas combustible ni producteur de cha-
leur, mais dissoluble et producteur de froid, non pas haut et convexe, mais
profond et concave.
. Loin que de telles observations servent
seulement appuyer le prjug traditionnel que les qualits subjec-
tives ne sont rien de plus que des illusions de la conscience indivi-
duelle ou spcifique dtermines par des conditions organiques, el-
Dans le mme sens Crookes se demandait aussi ce que deviendraient les
objets si nos yeux, au lieu dtre sensibles la lumire, ltaient aux vibrations
lectriques ou magntiques. Le verre et le cristal deviendraient alors des corps
opaques, les mtaux seraient plus ou moins transparents et un fil tlgraphique
suspendu dans lair paratrait un trou long et troit traversant un corps dune
solidit impntrable. Une machine lectro-dynamique en action ressemblerait
un incendie tandis quun aimant raliserait le rve des mystiques du Moyen
Age et deviendrait une lampe perptuelle brlant sans se consumer et sans
quil faille lalimenter de quelque manire que ce soit.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 120
les nous assurent au contraire de leur ralit qui ne peut rsider que
dans le pur rapport du sujet percevant et de lobjet peru : mais ces
deux termes ne prexistent pas leur conjugaison qui les cre lun et
lautre. Au point o toutes les perceptions viendraient croiser leur
contenu, on rencontrerait lobjet avec la totalit de ses proprits ;
au point o elles viendraient croiser leur opration, on rencontrerait
lacte mme qui lui donne ltre : mais ces deux points se confon-
dent dans une sorte de limite commune o cesse toute distinction
entre lopration et son contenu.
Une telle thse est fonde sur les exigences mmes de notre des-
cription ontologique qui nous obligeait, pour empcher [124]
lanalyse de briser lunit de ltre, de retrouver sa prsence totale
en chaque point. Elle demeure une hypothse au sens que
lexprience qui devrait la confirmer ne peut pas tre pousse jus-
qu la limite ; mais cest une hypothse de travail par laquelle cette
exprience mme peut tre entreprise et indfiniment poursuivie.
Elle permet de considrer la division du monde peru comme in-
sparable de lapparition dun sujet fini et solidairement dune mul-
tiplicit infinie de sujets finis. Sans ces sujets finis, ltre pur, loin
de se confondre avec lacte et de tmoigner de sa prsence par
lexercice de leur activit propre, serait emprisonn, comme un
monde qui se rduirait la matire, dans une ncessit inerte et im-
participable. Bien plus, cette matire serait purement indtermine,
et mme il serait impossible, strictement parler, de poser une ma-
tire, cest--dire une donne, qui ne peut exister prcisment que
pour un sujet quelle limite et qui se la donne.
Mais on voit ds maintenant que, si ltre se manifeste comme
infiniment vari et mme comme infiniment vari dune infinit de
manires, cela ne peut porter atteinte au principe de lunivocit,
puisque ses qualits sappellent pour se complter, que chacune
delles correspond une qualit diffrente dans un autre objet et
que, dans le mme objet, elle subit une transmutation pour des tres
diffrents. Par consquent, dans chaque objet on retrouve la totalit
de ltre si on joint les unes aux autres toutes les perspectives sous
lesquelles on peut le considrer. Et dans tous les objets quil peroit,
chaque individu agrandit et multiplie la mme vision de ltre total
qui lui avait rvl dans chaque objet un de ses aspects particuliers.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 121
Les termes ne diffrent donc les uns des autres en comprhension
que par une vue plus ou moins complte quils nous donnent de
ltre. Mais cette ingalit naltre dans ltre lui-mme ni sa sim-
plicit, ni sa plnitude. Ces termes nont de sens que par rapport
nous ; avec le plus humble dentre eux, ltre est dj prsent tout
entier. On ne peut ni enrichir ni diminuer cette prsence totale, on ne
peut que la dterminer subjectivement grce la projection momen-
tane de notre nature en elle. Aussi nest-ce pas en restreignant
[125] par degrs la comprhension dun terme jusqu la faire va-
nouir que lon peut esprer rencontrer la notion dtre. Ltre nest
pas lindtermin, mais la dtermination parfaite ; il nest pas
labsence de comprhension (car on a bien vu que, si on retire
ltre tout ce dont on laffirme, il ne peut rien subsister en lui, de
telle sorte quil ne se distingue plus du nant), il est la comprhen-
sion infinie, celle que lon rencontrerait dans un individu qui, au lieu
dtre born par dautres, les contiendrait tous en lui.
Sil y a donc une implication ncessaire de toutes les qualits d-
couvertes par lanalyse, si ces qualits qui se manifestent nos yeux
dans des objets diffrents peuvent tre retrouves dans le mme ob-
jet par des sujets diffrents, cest que la diffrence dans la compr-
hension des termes nengage pas ltre lui-mme ; elle est une ex-
pression de nos limites. Telle est la raison pour laquelle nous consi-
drions larticle 6 toute connaissance objective comme une
connaissance abstraite. Mais cest l une affirmation quil est possi-
ble maintenant de dpasser, car le caractre inachev de toute opra-
tion abstraite ne peut empcher quen tout point auquel on
lapplique nous ne rencontrions ltre concret, cest--dire une infi-
nit actuelle, qui contraste avec son infinit virtuelle ; ainsi nous ne
trouverons dans le monde que des tres particuliers auxquels nous
prtons, par comparaison avec nous, mais sans lapprhender, ce
caractre dinterne totalit dont nous navons pu faire lexprience
quen nous-mme. Pour que le spectacle que le monde nous offre
nous apparaisse comme bien fond, pour quil ne soit pas seulement
une apparence qui na de sens que pour nous, mais un tre auquel
nous appartenons, il faut que nous puissions retrouver dans chacun
de ses lments une indpendance et une suffisance comparables
la ntre. Notre croyance en leur objectivit est lgitime parce que,
aprs avoir reconnu que notre propre individualit, en ralisant une
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 122
image du tout, participe son existence, nous sommes obligs
dattribuer chacune des parties du spectacle qui est devant nous,
prcisment parce que nous en sommes une, la mme existence qu
nous-mme.
[126]
E. DU CONCEPT LESSENCE,
CEST--DIRE LIDE
Retour la table des matires
ART. 10 : Le concept abstrait nest que le signe dune essence
concrte dont les individus sont les membres distincts, mais inspa-
rables.
Une opration abstraite, tant incapable dpuiser soit notre natu-
re soit celle daucun individu, mais exprimant pourtant une de nos
puissances, devra tmoigner de sa liaison avec le tout en
lembrassant dans une sorte dtreinte indtermine, cest--dire
dans une treinte qui ne se referme pas.
Cela nest possible qu deux conditions : il faudra premirement
que le concept sapplique des individus spars les uns des autres
lintrieur du tout. Car, faute dun intervalle qui les spare, il ny
aurait plus de place entre eux pour des termes diffrents susceptibles
de fournir une matire dautres concepts ; de telle sorte que
linachvement interne du concept naurait pas de rpondant hors de
lindividu dans le tout dont lindividu est un fragment. Tous les
concepts sappliquant galement la masse la fois une et continue
du concret, et cessant de se combiner dans des groupes htrognes,
se confondraient nouveau dans lunit de ltre do ltre fini a pu
les tirer en constituant une exprience adapte et proportionne ses
facults. Cest donc parce que le concept traduit seulement un aspect
de lindividu, et parce que lindividu son tour nest quune partie
de lunivers, que le concept, pour garder son infinit, doit
sappliquer une multiplicit indfinie dindividus, qui doivent
montrer pourtant quils ne se confondent pas avec le tout grce
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 123
lintervalle mme qui les spare. Cependant une deuxime condition
est encore ncessaire pour que la notion de classe soit constitue ; il
faut en effet que ces individus spars les uns des autres, auxquels le
mme concept sapplique, soient eux-mmes diffrents : sans quoi il
ne serait pas indispensable quil y en et plusieurs ; et il faut quil y
en ait plusieurs non seulement, comme le pensait Platon, pour que la
perfection du modle soit imite et dans quelque mesure approche
[127] par cette srie desquisses imparfaites calquant sur lui leurs
formes individuelles, mais pour que la limitation interne du concept
et sa liaison avec le tout reoivent un tmoignage dans la diversit
des tres quil contribue former par sa combinaison sans cesse re-
nouvele avec tous les autres aspects de ltre.
Ce qui dmontre que les caractres distingus par lanalyse ne
peuvent pas tre isols les uns des autres en gardant lexistence, ce
nest pas seulement limpersonnalit et la gnralit quils reoivent,
ds quon les retire du terme o on les a dcouverts pour les appli-
quer dautres, cest surtout limpossibilit o nous sommes de ne
pas les rejoindre entre eux dans une systmatisation mutuelle ds
que nous voulons soit fixer chacun deux par la pense une fonc-
tion qui le rende intelligible, soit, ce qui revient sans doute au m-
me, larticuler lintrieur du rel.
Il est clair en effet que la couleur nest point un caractre suscep-
tible dtre pos antrieurement telle couleur : mais telle couleur,
par son contraste avec toutes les autres, les implique toutes. Ainsi
la couleur abstraite que les couleurs particulires viendraient colo-
rer, puisquelle aurait le nom de couleur sans en avoir la coloration,
nous opposons lide dune totalit concrte du color dont chaque
nuance originale viendrait manifester un aspect la fois distinct et
solidaire de tous les autres. De mme, le mammifre nest pas un
vertbr auquel on a joint le caractre dallaiter ses petits. Car si on
ne rencontre de vertbres que chez le mammifre, le reptile, le ba-
tracien, le poisson ou loiseau, cest parce que la prsence des vert-
bres appelle certaines proprits qui, si elles ne sont pas donnes
la fois, sont corrlatives les unes des autres, en dehors desquelles le
type du vertbr naurait pas de ralit, et dont la totalit exprime la
richesse concrte de ce type. Chaque espce de vertbr ne rvle-
rait alors quun aspect de cette richesse et supposerait lexistence de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 124
toutes les autres espces par lesquelles tous les aspects du mme ty-
pe recevraient une forme manifeste.
On aboutirait ainsi, en suivant une voie inverse de celle dans la-
quelle sengage la pense abstraite, regarder comme de plus en
plus proches de ltre total et concret les termes [128] en apparence
de plus en plus gnraux qui comprennent en eux des individus de
plus en plus nombreux ; car les individus dont il sagit, bien qutant
des individus rels si on les considre avec la totalit de leurs carac-
tres, limitent lessence quils expriment, au lieu dy ajouter ds
quon les oppose les uns aux autres. La comprhension et
lextension varieraient alors en raison directe lune de lautre et la
loi du tout se retrouverait dans les parties ; lespce et le genre au-
raient infiniment plus de proprits que lindividu ; les proprits
qui sexcluent dans les individus dune mme espce, ou dans les
espces dun mme genre, entreraient pourtant dans une correspon-
dance ou une symtrie dont les essences concrtes, corrlatives de
lespce ou du genre, fondent la ncessit interne. Chacune de ces
essences contiendrait en elle la racine commune de toutes les pro-
prits qui viendraient spanouir ensuite en plusieurs rameaux : une
telle racine commune est le contraire de la gnralit abstraite qui
sobtient par llimination des caractres diffrents et non pas par le
retour vers une puissance primitive et indivise do ils jaillissent et
qui ne cesse de les fconder. Comme, de proche en proche, ces pro-
prits nont de sens que dans la mesure o elles se rpondent en
sopposant, il faut videmment quelles trouvent toutes la fin leur
justification dans lunit du mme tre.
A lgard de celui-ci, cest lindividu qui est un abstrait, comme
il tait dj un abstrait lgard de la conscience qui en avait fait un
terme distinct delle et extrieur elle. Mais lchelle de
labstraction doit tre renverse selon quon la constitue par rapport
la totalit de ltre en acte, ou par rapport la conscience, qui est
la totalit de ltre en puissance. Dune part lindividu sans doute est
le faisceau de toutes les qualits isoles par lanalyse et rparties
dans la comprhension de tous les genres subordonns les uns aux
autres ; comme tel, il est un lment de lunivers rel, dj engag il
est vrai par la conscience dans le monde anonyme de la pense
conceptuelle, mais qui reste adhrent ltre concret o il occupe
une place unique et dont il manifeste un aspect dtermin : il nest
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 125
donc quune pice particulire de lunivers, mais qui lexprime tout
entier parce quelle est solidaire de toutes les autres. Dautre part,
celles-ci forment, [129] en se joignant lui selon un ordre rgl,
lessence plus riche et plus concrte des diffrents genres : ds lors
le genre qui tout lheure tait un abstrait par rapport lindividu,
napparat plus comme tel que par rapport ltre plein et parfait
do son essence est tire ; mais cest aussi sa manire un individu
dont les tres particuliers sont alors les membres disperss, et qui,
en un autre sens, est donc moins abstrait queux.
ART. 11 : La considration de lessence concrte, aussi bien que
celle du tout, fonde une relation de proportionnalit directe entre
lextension et la comprhension.
Il ny a que le tout et lindividu, dans la mesure o il est la fois
une partie concrte et une image du tout, qui soient sans lacunes.
Sans doute les tres vivants, bien que distants les uns des autres dans
lespace, tiennent encore les uns aux autres soit directement soit in-
directement par la gnration ; mais il faut quils scartent dans
lespace pour devenir indpendants les uns lgard des autres et
pour que chacun deux figure le tout sa manire : et cest par cet
cart lgard mme de leurs parents quils dtachent deux leur
propre individualit. plus forte raison les corps bruts, quils aient
ou non la mme origine, ne peuvent affirmer leurs caractres pro-
pres qu condition de contraster avec les corps voisins, et mme de
se retrouver au milieu des corps les plus diffrents.
Si cette forme dindividualit, plus vaste que ltre particulier,
constitue par le genre ou par lespce prsente un caractre lacunai-
re, cest donc pour que lindpendance de ltre particulier soit sau-
vegarde ; et sil faut que dans lespce ou dans le genre il y ait une
multiplicit dindividus qui, rptant le mme type, nen expriment
pourtant quun aspect, cest parce que, sil nen tait pas ainsi, cest-
-dire si le type ne se ralisait que par un seul individu, cet individu
qui aurait encore ses limites propres vis--vis du tout dont il fait par-
tie, nen aurait plus vis--vis de lui-mme et serait incapable de tout
dveloppement dans la dure puisque, [130] du premier coup, il au-
rait atteint son point de perfection. Cest la raison pour laquelle les
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 126
thologiens ont discut pour savoir si parmi les esprits purs, cest--
dire dans les churs des anges, il ne fallait pas assigner chaque
espce un seul individu qui en raliserait toute lessence. Nous aper-
cevons donc ici la vritable fonction du temps qui est la ranon du
caractre imparfait et limit des cratures et qui les oblige, pour tre,
se faire, cest--dire devenir leur tre mme.
Ainsi la thorie des classes trouve son fondement : en consid-
rant chaque classe comme un fragment du tout et en lui appliquant
ce que nous avons dit de lindividu, on comprendra comment les
diffrentes classes pourront tre contenues les unes dans les autres.
Mais alors mesure que lextension des classes crot, leur compr-
hension crot aussi, puisque cette comprhension, au lieu de retenir
seulement par abstraction le caractre commun toute la classe et
qui, en tant que commun, est proprement inexistant, contiendra en
elle la totalit concrte des caractres dont chaque individu ne rali-
se quune partie.
Ds lors, en poursuivant lopration que nous avons dcrite, nous
rencontrerons ltre lui-mme lintrieur duquel nous avions dis-
tingu tous ces individus et toutes ces classes ; en fait, nous ne pour-
rons jamais lobtenir sous la forme dune somme, mais cest que
prcisment la somme tait faite avant que les lments qui la com-
posent aient t isols et pour quils puissent ltre. Cependant, la
relation entre les individus et les classes justifie les caractres que
nous avions antrieurement attribus ltre, car, puisque la richesse
du rel crot mesure que le regard stend, on ne doit pas tre sur-
pris si dans ltre absolu la totalit plnire des qualits concide
avec luniversalit concrte.
ART. 12 : La distinction entre le concept et lide permet
dexpliquer pourquoi les rapports entre lextension et la compr-
hension peuvent tre interprts en deux sens opposs.
Le paradoxe apparent qui consiste dans la possibilit de consid-
rer lextension et la comprhension comme croissant [131] dune
manire inversement ou directement proportionnelle selon que lon
fixe le regard sur le genre abstrait ou sur lessence concrte trouve
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 127
une expression assez claire dans la distinction entre le concept et
lide. On viterait alors de confondre le passage de lindividu au
concept par une limination des caractres particuliers permettant de
conserver seulement ces caractres communs qui rpondent une
opration identique de notre esprit avec ce passage de lide
lindividu qui ne se ralise que par une limitation telle que tous les
individus sont appels collaborer pour lui restituer sa plnitude.
On le voit bien par lopposition du concept de lhomme et lide de
lhomme. Le concept de lhomme est un schma que le propre de
chaque homme est prcisment de remplir. Mais lide de lhomme
est pour chaque homme un idal quil est bien loin de pouvoir at-
teindre ; et cet idal est en mme temps la source dans laquelle il
puise cette activit mme qui lui permet de raliser quelques-uns des
caractres de la nature humaine. On voit combien il serait faux de
dire quelle a moins de richesse que lindividu qui tient delle la
puissance mme qui le fait tre, la possession de ce quil a et le dsir
de ce qui lui manque. Lide runit en elle dans le mme foyer tous
les caractres qui reoivent une existence empirique dans des indi-
vidus spars ; car elle ne retient deux que leur positivit, alors que
cest la ngation qui est lorigine de la sparation entre les individus.
Elle est le pur pouvoir de les produire : aussi chacun de ces caract-
res ne se prsente-t-il en elle que sous une forme active et dynami-
que, de telle sorte quelle porte dans une efficacit indivise la plu-
ralit infinie des formes individuelles quil est capable de recevoir.
On demandera sil ne subsiste pas du moins une sparation entre
les ides comparable la sparation entre les individus, puisque
chacune est unique dans son ordre, la manire dun individu. Seu-
lement lunicit de lindividu est fonde sur les conditions spatiales
et temporelles qui leur permettent de se raliser, au lieu que lunicit
de lide est fonde sur labolition de ces conditions. Toutes les
ides non seulement sappellent les unes les autres, mais convergent
les unes vers les autres dans lunit plnire de lintelligible qui est
lunit mme de lintelligence en acte.
[132]
Mais lopposition entre le concept et lide est beaucoup plus
profonde quon ne pense. Et si elle produit un renversement dans le
rapport de lextension et de la comprhension, ce nest pas seule-
ment pour exprimer la dualit de la dialectique ascendante et de la
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 128
dialectique descendante, cest parce que le concept nest que lacte
dune conscience particulire qui essaie de faire concider ses pro-
pres oprations avec lexprience du monde, telle quelle leur est
donne, cest--dire qui se contente de refaire le monde dans
labstrait (ou tente dabord den fonder la possibilit), tandis que
lide est, dans les choses elles-mmes, le principe interne do pro-
cde lacte vivant par lequel elles se font, et non point un artifice
destin nous permettre de les construire. Telle est la raison pour
laquelle la science ne sintresse quau concept et lart qu lide :
la science peut mme se contenter de concepts purement conven-
tionnels, condition quils rpondent au dessein mme que nous
avons sur les choses, alors que lart essaie de suggrer lide, cest-
-dire la forme cratrice travers lapparence qui la figure. Et il
cherche toujours obtenir une rencontre miraculeuse entre lacte
mme par lequel nous entreprenons de les reproduire et lacte par
lequel elles se font.
Aussi les rapports du concept et de lide avec le sensible sont-ils
bien diffrents. Le concept se rgle sur le sensible qui lui demeure
en quelque sorte extrieur et htrogne : mais le sensible est une
matire qui lui rsiste et que son ambition est dliminer. Au lieu
que lide engendre le sensible comme le corps dans lequel elle
sincarne, qui exprime lefficacit de son action et la rend manifeste
tous les regards. La dualit du conceptuel et du sensible est un ef-
fet des conditions mmes de la connaissance, de lopposition entre
une donne qui simpose nous et une opration qui sy applique et
par laquelle nous cherchons la rduire. Mais cette dualit, lide la
surmonte plutt quelle ne labolit. Elle anime le sensible et cest en
lui quelle sactualise. Le sensible traduit limpuissance du concept,
ce qui lui manque pour tre, et la fcondit de lide, qui lpanouit
et la multiplie.
Telle est la raison pour laquelle il y a une ide de ltre, mais non
point de concept de ltre, le concept de ltre ne [133] pouvant tre
que le genre le plus abstrait dont on a bien vu quil ne peut plus tre
distingu du nant, au lieu que lide de ltre, cest ltre mme
considr dans sa vertu gnratrice. Et telle est la raison pour laquel-
le, mme si on vite la confusion de lide et du concept, aucune
ide particulire, quelle que soit sa prminence par rapport
lindividu qui lincarne, nest capable de subsister isolment. Cest
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 129
lide de ltre qui la soutient dans lexistence : car cette ide est la
seule qui puisse poser immdiatement ltre qui lui est propre et qui,
en nous obligeant dissocier partout ailleurs ltre de son ide, rend
possible le passage de lune lautre par un acte de participation.
F. DUALIT DE LA CONSCIENCE
OU RUPTURE DE LTRE PUR
ART. 13 : Ltre pur ralise une parfaite intriorit lui-mme
qui fonde, avec lexistence mme de ma conscience, la correspon-
dance du conceptuel et du sensible dans tous les actes quelle ac-
complit.
Lidentification du tout avec un individu, mais avec un individu
qui, comprenant tous les autres, ne soppose aucun deux, sinon
par sa totalit mme et comme notre corps soppose nos mem-
bres nous contraint lui attribuer un caractre de parfaite intrio-
rit. Mais tant rigoureusement intrieur lui-mme, rien ne pourra
lui apparatre comme extrieur, ni prendre pour lui le caractre
dune chose. Il ne sera son tour lui-mme extrieur rien et ne
pourra tre une chose pour personne. Telle est la raison pour laquel-
le nous navions pu nous-mme rencontrer le concret que dans
lintimit de notre propre conscience. Ltre ne peut donc tre peru
que comme lintimit totale ou comme un moi universel. Cest ce
moi universel qui fonde et qui nourrit la ralit du moi individuel, et
comme mon corps suppose la prsence de lespace dans lequel il se
circonscrit et qui supporte toute sa ralit, le moi individuel recon-
nat sa solidarit avec un moi plus vaste qui lui demeure toujours
prsent, [134] que lon peut dfinir comme lintelligibilit parfaite et
qui est semblable une lumire qui mclaire, mais qui se manifeste
aussi dans les limites troites du moi sous la forme dune chaleur
laquelle je donne le nom de sentiment. La distinction du corps et de
lesprit est une expression de mes limites ; mais ni comme corps, ni
comme esprit, je ne puis mopposer lunivers, je ne puis que dis-
tinguer en lui ma nature propre ; et en dcouvrant ma propre intimi-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 130
t, je dcouvre lintimit mme de ltre laquelle je suis uni et que
ma participation ne peut ni diviser ni puiser.
Le rapprochement au sein de lintimit entre ltre particulier et
ltre universel pourrait servir justifier par une exprience concrte
les caractres duniversalit et dunivocit que nous avions dabord
attribus ltre.
De plus, il permettra de donner la critique que nous avons faite
des oprations de la pense abstraite une sorte de contre-partie. Car
lopration nest abstraite qu lgard des formes sensibles de
ltre, tandis quelle exprime, en tant quopration, une participation
lintimit concrte de ltre pur. Nous avons montr dj que cha-
que ide rpond une puissance particulire du sujet : mais cette
puissance nest pas arbitraire, si elle a sa source dans lintriorit de
ltre lui-mme. On doit achever maintenant de raliser le renver-
sement dans lchelle de labstraction qui est lobjet propre de cet
article, en regardant lacte pur comme le type parfait du concret et le
sensible comme son expression divise. La conscience se meut entre
ces deux extrmits ; elle cherche les rejoindre et, faute dexercer
lacte dans sa plnitude, il arrive quelle le renie en confondant
ltre avec lobstacle sur lequel elle mesure les limites mmes de sa
puissance individuelle.
Faut-il dire alors quelle procde par lappauvrissement graduel
de ltre concret poursuivi jusqu cette exhaustion de toute qualit
qui devrait nous fournir lide pure de ltre, mais dun tre para-
doxalement dpourvu de ralit, et qui ne pourrait en retrouver que
grce une srie doprations synthtiques accomplies dans un
temps logique, laide des lments anonymes et dcolors quune
analyse pralable nous aurait permis disoler. Dj nous savons que
cette [135] analyse ne saurait o se prendre, quelle naurait aucune
raison de dtacher les uns des autres les diffrents caractres du rel,
si elle ne pouvait confronter chacun deux avec une des puissances
de notre nature. On a not bien souvent que la dcouverte du gnral
semble correspondre une certaine constance de nos ractions en
rapport avec la diversit des objets. Mais la conclusion quon en tire,
savoir que la connaissance intellectuelle possde un caractre
dimperfection et de grossiret, et quelle ne saisit dans le rel que
le dessin schmatis de nos mouvements les plus familiers, est infi-
niment loigne de celle que nous voudrions suggrer. Nous croyons
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 131
en effet que, si les qualits que nous cherchons extraire du rel
nont plus quun caractre abstrait et nominal, lorsquon veut en fai-
re une application en dehors de ltre particulier o nous les avons
observes (de telle sorte que lassociation qui va du semblable au
semblable est leffet de notre ignorance et non pas de notre science),
en revanche, les oprations que lesprit accomplit au contact du rel
ont un caractre singulirement concret et vivant : leur intimit et le
fait mme quelles sont des actes que lon effectue et non pas des
images que lon se reprsente, suffisent prouver quil y a dans leur
source une perfection et une suffisance que lide du sensible, cest-
-dire du donn, est incapable datteindre. Ces oprations sont les
moyens par lesquels le fini et linfini communiquent : mais de tels
moyens ont une porte objective ; ils sont le seul aspect intelligible
de la nature ; ils figurent ce quil y a en elle duniversel.
Il ny a pas lieu de svertuer prouver la correspondance nces-
saire du rationnel et du rel : cela nous astreindrait la tche impos-
sible, aprs avoir pos une raison dont on ignorerait lorigine, puis-
quelle serait au moins en droit trangre au rel, et quil faudrait la
dfinir comme une intelligibilit pure qui ne serait encore
lintelligibilit de rien, de montrer son accord avec une ralit qui, si
elle ne confre pas ltre cette raison en lengendrant en elle com-
me une lumire (qui, une fois ne, la pntre elle-mme dans toutes
ses parties), doit lui demeurer dcisivement htrogne et imper-
mable. Mais, dans notre conception, ltre est pos antrieurement
la raison, et par une opration dont la raison [136] peroit la n-
cessit conditionnelle, sans que ce soit elle qui laccomplisse ; elle
sefface alors devant une intuition qui permet de linscrire elle-
mme dans le rel et valide sa comptence objective. Car la raison a
besoin dtre dduite, et cest mme en se dduisant elle-mme
quelle constitue et quelle justifie en mme temps sa nature propre.
De fait, elle exprime par les principes qui la dirigent et les ides
quelle conoit la possibilit pour tout tre fini en gnral dentrer
en relation avec ltre pur grce certains moyens dfinis, de la
mme manire que le sensible, par la varit des formes quil revt,
exprime la possibilit pour tout tre fini particulier de poursuivre
lapplication de ces moyens jusquau moment o, dans un contact
original avec le concret, il appellera du mme coup lexistence son
individualit subjective et le spectacle empirique que la nature lui
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 132
offre. Ds lors, on comprendra sans peine, puisquon ne peut tre un
tre fini sans devenir tel tre fini, comment la raison et le sensible
saccordent, et comment la raison pntre incessamment dans le
sensible sans parvenir lpuiser.
De mme que le sensible exprime la totalit de ltre, mais sous
une forme passive et dans sa relation avec tel sujet fini qui ne peut le
saisir que comme une donne avec laquelle il ne sidentifie pas,
lacte intellectuel exprime une participation de tout sujet
lintriorit mme de ltre. Mais cette participation doit tre totale,
en vertu de lunivocit de celui-ci ; et pourtant le sujet ne peut gar-
der ses limites qu condition denvelopper le tout seulement en
puissance : cest dire que lacte intellectuel sera tenu de sappliquer
au sensible et quil ne conciderait avec lui, ou quil npuiserait sa
nature, que sil tait considr en lui-mme et non plus dans sa r-
fraction travers tel sujet fini. Il en rsulte que chaque acte, au lieu
de rpondre certaines exigences de notre nature propre riges en
absolu, et avec lesquelles les caractres du rel ne pourraient
concorder que dune manire approximative et fortuite, exprime une
partie de lessence des choses ; il y a entre elles et notre esprit une
compntration intrieure fonde non point sur une mystrieuse
harmonie entre ces deux termes, non point sur une lgislation impo-
se par lesprit une matire trangre, mais sur [137]
limpossibilit pour lesprit dtre autrement que par un acte et de
constituer sa nature autrement que par une participation ltre sans
condition.
ART. 14 : Lopposition de lextension et de la comprhension ap-
parat grce la rupture dun acte spirituel unique o toutes les
oprations de la conscience puisent leur origine commune.
Si notre esprit tait capable de se hausser jusqu lacte pur, il
saurait renfermer dans une unit intemporelle la richesse infinie du
rel. Le rel ne soffrirait jamais lui sous la forme dune donne
sensible ; et au lieu de dire que lesprit serait rduit une puissance
indtermine de connatre jusquau moment o il viendrait
sappliquer cette donne, il faudrait dire que, comme il arrive dans
les moments heureux o nous jouissons de la plnitude de notre ac-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 133
tivit intrieure, il sentirait se produire en lui une sorte de dclin sil
fallait que son opration, ne se suffisant plus elle-mme, vnt se
consommer dans lapprhension dun objet : celle-ci introduirait en
lui une dualit, une passivit vis--vis de lui-mme qui rendrait le
crateur vassal de sa propre cration.
Cependant, bien que notre entendement fini ne puisse point se
sparer du sensible, on ne dira pas quil retient seulement de lacte
pur auquel il est uni et qui anime toutes ses dmarches une simple
impulsion la fois gnrale, imprcise et condamne demeurer
sans fcondit et sans efficacit jusqu ce quelle entre en rapport
avec les objets particuliers dont elle fixe les contours, et qui lui don-
neront elle-mme son caractre dachvement et son objectivit.
Car, si lacte intellectuel semble aboutir ainsi des schmas de plus
en plus complexes et qui le rapprochent par degrs de limage indi-
viduelle, il ne faut pas croire quil enrichisse par l son essence pro-
pre : cest limage seule qui reoit dans cette opration un perfec-
tionnement ; lintelligibilit pntre en elle. Mais lorsque la lumire
claire les objets particuliers, lorsquelle en dessine les contours,
quelle en fait saillir les reliefs et sinsinue dans leurs replis, elle
nacquiert pas pour cela plus de puissance ni dclat ; elle najoute
rien de nouveau [138] son rayonnement. Tout au contraire, il faut
dire quelle le divise ; elle le met la porte de notre regard qui ne
pourrait pas le soutenir si elle ne le rpandait dans lobscurit afin
de dgager, au sein de celle-ci, ces formes opaques qui
napparaissent dans la lumire que parce quelles ne se laissent pas
traverser par elle, ces traits dombre qui modlent les objets parce
quils forment autant de digues menues entre lesquelles un flot si
subtil scoule et se rpartit. En opposant un obstacle la lumire,
lobjet sensible est lui-mme illumin. Cest de la mme manire
que lacte intellectuel, ds quil sapplique aux corps matriels, qui
nont de sens que pour exprimer nos limites et nous prsenter le
monde comme un ensemble de donnes, doit se diversifier et se r-
soudre en une multiplicit de concepts qui sont comme la face que
tous ces corps offrent la lumire. Nous consentons volontiers
reconnatre le progrs ralis par le sensible quand il se laisse ainsi
pntrer et envelopper par elle : car alors le monde de lexprience,
tel quil sest appropri notre nature limite, rvle ses articula-
tions et son caractre systmatique, cest--dire sa liaison avec le
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 134
principe qui le fait tre. Comment notre exprience, en demeurant
celle dun tre fini, serait-elle indpendante de lintelligibilit totale
qui seule peut rendre compte de la manire dont la forme sunit la
matire, ds quune matire apparat pour que le monde puisse tre
donn une conscience ?
Les genres ne sont pas des termes premiers quil nous suffirait de
dnombrer et qui seraient la condition initiale de toute connaissan-
ce : il faut les dduire, et ils expriment les lois selon lesquelles
seffectue la communication entre la partie et le tout o elle est pla-
ce. Ils ne produisent quune intelligibilit imparfaite et divise, et
on ne peut leur donner un sens quen stablissant dabord dans cet
acte sans passivit, plein et achev en lui-mme, indpendant du
temps parce quil ne peut subir aucun accroissement, principe int-
rieur de ltre et fondement de son unit, partout prsent par une sor-
te de grce aise, exclusive de tout effort, et quil suffit de sentir
oprer en nous pour dcouvrir avec le sens de notre propre vie
llment dintelligibilit que reclent les choses particulires. Cest
dire quil faut passer de lordre [139] intellectuel lordre spirituel
pour que les actes intellectuels eux-mmes tmoignent de leur rali-
t la fois concrte et suffisante. Ou plutt, cest quand lordre in-
tellectuel se dtache de lordre spirituel en sopposant au sensible, et
pour recouvrir celui-ci, quil perd sa porte ontologique, quil de-
vient abstrait, et quil parat se compliquer et senrichir au moment
o il limite son champ dapplication pour arriver par degrs se
confondre avec le sensible.
Ainsi, si la fonction intellectuelle est ramene vers sa source, on
saperoit alors que cest en enveloppant le sensible quelle le haus-
se vers ltre, au lieu davoir besoin dacqurir ltre elle-mme en
descendant vers le sensible. Cest que ltre pur ne se distingue pas
de lintelligibilit totale ; les tres particuliers sont prsents en lui
sans morceler son unit ; sa comprhension est infiniment plus riche
que la leur ; ou plutt leur comprhension suppose la sienne quelle
ne limite quen isolant arbitrairement un individu de tous les autres ;
mais la multiplicit des individus est la ranon de cette limitation.
Ainsi lextension et la comprhension sont deux notions qui
sopposent et deviennent corrlatives ds que lunit de ltre est
rompue. Dans ltre pur elles sidentifient : cest un individu infini,
cest--dire le seul terme qui soit rellement un individu, et que lon
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 135
ne puisse pas diviser en parties spares, puisque ces parties de-
vraient continuer ncessairement tre enfermes sans aucun inter-
valle lintrieur de sa substance. Et lorsquon distingue en lui des
genres, on peut, soit en fixant les yeux sur les individus particuliers,
faire de ces genres des abstractions dautant plus vides quelles se
rapprochent davantage de ltre pur, soit, en observant que les tres
particuliers ne sont que des formes limites et solidaires de ltre
total, en faire des oprations relles qui participent la puissance
par laquelle le tout donne ltre aux parties qui le forment, interm-
diaires et mdiatrices entre ltre et les aspects quil revt, et qui,
empchant ceux-ci de tomber au rang de pures donnes, leur assu-
rent encore lintelligibilit, la signification intrieure et la vie.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 136
[140]
Deuxime partie.
La multiplicit de ltre
Chapitre V
DU J UGEMENT DEXISTENCE
A. LTRE ET LA RELATION
Retour la table des matires
ART. 1: Tous les termes de la pense sont lobjet dun jugement
dexistence identique dans la forme et qui ne diffre que par son
contenu.
Si lacte de lintelligence consiste essentiellement dans le juge-
ment, nous ne saisirons pleinement loriginalit de ltre par rapport
ses dterminations particulires quen analysant la nature du ju-
gement dexistence. Or, ce qui nous frappe dabord, cest que tous
les termes de la pense doivent tre lobjet dun jugement
dexistence, et mme dun jugement dexistence identique dans la
forme. Il ny a que du nant que lon puisse dire quil nest pas.
Mais tous les autres jugements ngatifs sont des jugements positifs
dissimuls. Car, dire dun terme quil nest pas, cest dire quil nest
pas tel quon limagine, et par consquent quil est autre. On
minvite seulement rformer et prciser la dfinition que jen
donne afin de la rendre plus adquate.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 137
cet gard, la manire dont le pass et lavenir sopposent au
prsent est une premire source de confusion. Quand je dis dun
terme qu il nest plus , cela veut dire quil nest pas mon
contemporain, mais quil est insparable dans ma mmoire de telle
priode du pass, et que son image est actuellement prsente dans
ma pense. Quand je dis dun terme qu il nest pas encore , cela
veut dire quil ne peut tre lobjet daucune perception actuelle,
mais que jassocie actuellement son ide dans ma conscience avec
celle dun avenir prochain. Ainsi ces formules expriment que ces
termes participent [141] ltre dans le prsent, si on considre
leurs ides et dans une autre priode du temps, si on considre leurs
formes sensibles.
Si nous prenons dautres exemples de jugements dans lesquels
lexistence parat exclue, nous verrons que leur objet est toujours de
substituer une forme dexistence une autre. Dire que les illusions
de nos rves nexistent pas, cest dire quelles nexistent que comme
images, et quil ne faut pas les prendre pour des perceptions. Dire
mme que le cercle carr nexiste pas, cest dire que les deux ides
de cercle et de carr existent sparment et que la conscience ne
peut pas les fondre dans une synthse.
Enfin, dire dun terme quil est possible, cest lui attribuer une
existence dans la pense et non plus dans lexprience objective,
bien quil puisse acqurir celle-ci en entrant en concurrence avec
dautres termes possibles, tantt poss par une pense distincte, tan-
tt envelopps dans une pense globale, mais do lanalyse pourra
les faire surgir.
Nous retrouvons ici les deux caractres duniversalit et
dunivocit par lesquels nous avons dfini ltre dans le premier li-
vre : lunivocit est exprime par lidentit de forme du jugement
dexistence, quel que soit lobjet auquel on lapplique et
luniversalit par la ncessit o nous sommes, condition de bien
dterminer son contenu, de lui donner pour contenu tout objet possi-
ble de la pense.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 138
ART. 2 : La relation, qui est la condition de tout jugement, ne
nous donne lillusion dengendrer ltre que parce quon la inscrite
en lui tout dabord.
On ne peut identifier une forme dexistence que grce la rela-
tion. En effet, si on considre cette forme isolment, il est vident
quelle fait partie de ltre en quelque manire : mais notre esprit na
pas de prise sur elle ; il est incapable den reconnatre la nature pro-
pre ; il ne peut y russir que par lanalyse, qui commence par
lopposer toutes les autres en disant ce quelle nest pas, et qui ne
peut dire ce quelle est qu la condition de distinguer en elle au
moins deux lments et de les runir par une relation.
[142]
On observera encore : 1 que distinguer ou opposer deux termes
dans le mme tout, cest dj les unir par une relation, puisque cette
distinction et cette opposition les enveloppent lun et lautre dans
une seule et mme comparaison et 2 quil y a une relation de cha-
que chose avec toutes les autres qui est constitutive de sa nature et
dont la relation de ses lments entre eux nest sans doute que la r-
plique.
Ainsi, tandis que lobjet, antrieurement lanalyse,
nenveloppait ni vrit ni erreur, tandis quil demeurait pour lesprit
une pure donne dont on constatait la prsence sans la penser, la re-
lation nous permet den prendre possession ; elle implique une af-
firmation qui porte sur la coexistence empirique ou sur la solidarit
logique de deux termes, et comme lesprit, ds quil dispose de plu-
sieurs termes, devient capable de les combiner de diffrentes mani-
res, il arrive que quelques-unes de ces combinaisons se heurtent,
sans quil sen doute, un dmenti de lexprience ou une impos-
sibilit rationnelle (en laissant de ct la question de savoir si toute
synthse empirique ne dissimule pas une synthse intellectuelle trop
subtile et trop complexe pour que nous puissions leffectuer). Cest
alors que lerreur se produit.
partir du moment o on a distingu dans le rel, pour sen ren-
dre matre par la pense, des lments qui taient donns la fois, il
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 139
devient possible soit dassocier ces lments, ce qui nous permettra
de reconstituer le rel par des oprations dont on pourra dsormais
comprendre le sens et vrifier lapplication, soit de distribuer les
tres particuliers dans des classes que lon aura dfinies par la pr-
sence, en chacun des individus qui les forment, soit dun de ces
lments isols, soit dun certain ensemble de ces lments runis
dune manire plus ou moins heureuse.
Ds lors, la relation montre comment le concept et le jugement
sont insparables. Le concept est une solidification du jugement,
tandis que le jugement est lacte intrieur qui la dgage et qui ne
cesse de la soutenir. De l considrer le jugement, et plus particu-
lirement la relation qui est la forme commune de tous les juge-
ments, comme le principe gnrateur de tout le rel, il ny a quun
pas. Le sens commun slvera-t-il contre une telle prtention, en
allguant que toute relation [143] suppose des termes qui lui sont
antrieurs, et hors desquels elle ne pourrait pas tre pense ? On
naura pas de peine rpondre que ces termes eux-mmes ne peu-
vent tre saisis qu condition dtre envelopps leur tour dans de
nouvelles relations. Dire que lon sengage ainsi dans un progrs qui
va linfini, cest reconnatre que la relation est elle-mme un abso-
lu, au del duquel on ne remonte pas, et dont la dialectique nous
permettra de faire sortir, grce une srie de dmarches dans les-
quelles la relation sera tour tour oppose et noue avec elle-mme,
la suite des termes qui nous mnent jusquau concret
10
Mais de ce quil est impossible de dterminer la nature des cho-
ses particulires autrement quen les faisant entrer dans des rela-
tions, il ne suit nullement que la relation se suffise elle-mme.
Loin de se substituer ltre et de le rendre inutile, elle le suppose et
tient de lui toute lefficacit quon lui prte. On passe vite, sans dou-
te, sur lopposition quelle est cense rsoudre entre les deux termes
galement indtermins dtre et de nant. Cependant, on est oblig
de reconnatre, dune part, que le nant ne peut tre pos par aucun
artifice ni antrieurement la relation, ni au sein de la relation quil
dtruirait sil en devenait un lment, et dautre part, que ltre, ds
.
10
On reconnat ici la mthode dHamelin qui, de lindtermination mme de la
relation, prtend driver toutes ses spcifications et par consquent les termes
mmes qui la dterminent.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 140
quil est pens, exige que lon inscrive en lui tout le reste, y compris
la relation elle-mme. La relation exprime sans doute le mouvement
le plus simple que nous puissions attribuer un esprit fini lorsquil
analyse le rel ; mais vouloir tout y rduire, cest oublier que nous
avons implicitement commenc par accorder ltre lesprit, son
opration et mme un objet infiniment vaste dont celle-ci sest d-
tache et auquel elle sapplique, mais sans prtendre lpuiser. Ainsi
la fcondit que lon dcouvre dans la relation est emprunte et non
pas primitive. Et la connaissance na de comptence certaine
lgard de ltre que parce que nous sommes obligs de lui confrer
ltre elle-mme, ds sa premire dmarche.
[144]
ART. 3 : Une relation entre des termes particuliers est le seul
moyen dont dispose ltre fini pour penser le tout en se distinguant
de lui.
Les observations prcdentes nous permettent de comprendre la
signification ontologique du jugement. Notre pense, au moment o
elle stablit dans ltre, sen distingue en prenant conscience delle-
mme comme dun tre la fois dterminant et dtermin. Ainsi
ltre qui la dpasse ne peut pas tre, comme on le croit, vide et d-
pourvu de sens : lunivocit suffirait prouver le contraire ; car
loriginalit de cette forme de ltre que nous appelons notre pense,
cest prcisment dtre la manifestation en nous et la rvlation de
cet tre total qui ne cesse de la soutenir elle-mme et de lalimenter ;
mais elle lenveloppe seulement en puissance, de telle sorte quelle
ne pourra sexercer qu condition de sengager dans un mouvement
indfini ; elle passera sans cesse dun terme un autre, mais ce se-
cond terme, tant quon ne lavait pas encore atteint, pouvait appara-
tre comme un pur nant : ctait un aspect de ltre avec lequel nous
navions pas eu encore de contact. Autant il est difficile dexpliquer
comment notre pense, si elle nest pas situe dans un tre plus
grand avec lequel elle cherche sunir, pourra prouver un senti-
ment dinsatisfaction, recevoir un branlement qui lui permette de
faire fructifier ses puissances et daccrotre sa richesse intrieure,
autant il est ais de lui donner ce mouvement par lequel, en dcou-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 141
vrant sans cesse de nouvelles formes de ltre, elle alimente et cons-
titue peu peu sa nature propre, quand on accepte dinscrire dabord
le sujet dans le tout, au lieu de vouloir contradictoirement faire jail-
lir le tout de lactivit dun sujet qui en fait partie.
Puisquil est impossible que la pense sorte jamais delle-mme,
nous devons avoir lillusion, dans cet accroissement sans bornes de
nos connaissances, de tirer de notre propre fonds toutes ces richesses
nouvelles qui viennent merger successivement la lumire de notre
conscience. Cest lobservation qui a conduit Platon la thorie de
la rminiscence et Leibniz au passage continu, lintrieur dune
mme monade, [145] des perceptions confuses aux perceptions dis-
tinctes. Mais la ncessit o lon est alors dtablir une ligne de d-
marcation entre des connaissances en puissance et des connaissances
actualises, doit recevoir une interprtation ; et nous nen voyons
pas dautre, du moins sil faut admettre la fois une identit de na-
ture et une adhrence impossible rompre entre ltre fini et ltre
total, que cette sorte de circulation du premier lintrieur du se-
cond, au cours de laquelle notre conscience ne cesse de se dilater et
de recevoir en elle une lumire de plus en plus vive.
La mme distinction que fait une pense entre son tre propre et
le tout lintrieur duquel elle est place et quelle cherche saisir
doit se retrouver lintrieur de son opration elle-mme, ds
quelle sexerce, faute de quoi celle-ci ne pntrerait pas
lintrieur du tout et ne marquerait pour nous aucun accroissement.
Pour que notre pense demeure une pense finie, il faut quelle
cherche treindre ce tout, mais quelle ny russisse jamais : car
autrement elle se confondrait avec lui. Chaque opration de la pen-
se consistera donc dans une transition dun terme particulier un
autre terme particulier ; seulement, comme cette transition est effec-
tue par une pense dont lunit interne est une figure du tout qui
elle doit ltre qui la supporte et qui lanime, il en rsulte que la dis-
tinction que nous devons faire entre ces deux termes diffrents, au
moment de passer de lun lautre, appelle une synthse par laquelle
nous affirmons la relation qui les unit. La relation exprime prcis-
ment cette distinction entre les termes qui est la condition et le
moyen de leur union par la pense, laquelle son tour est pour ainsi
dire lattestation de leur union dans le mme tout. Ainsi, sous sa
forme premire, la relation ne peut pas tre un lien entre ltre et le
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 142
nant, mais seulement entre la conscience et le tout quelle envelop-
pe, et dans lequel elle sinscrit : telle est la participation prise dans
toute sa gnralit ; mais dans son application discursive, cest un
lien entre deux aspects de ltre, entre la partie que nous venons de
saisir et celle que nous saisissons, soit que celle-ci nous apparaisse
comme insparable de la premire autrement que par la pense, soit
qu [146] travers leur corrlation leur dualit demeure saisissable
lintrieur de notre exprience elle-mme.
Cependant un temps logique est ncessaire pour que le jugement
puisse concevoir deux termes la fois comme distincts et comme
unis. Or, ce temps logique exprime la manire dont lunit de notre
pense surmonte sans labolir une succession de perceptions dont
nous avons dcouvert la raison. La succession nous fournit bien une
sorte dillusion subjective qui voque le passage du nant ltre ;
mais les termes successifs et le temps mme o la succession se
produit appartiennent galement ltre. Non seulement le nant de
chacun deux est toujours ltre dun autre ; mais encore, le terme
dont sloigne mon attention prsente, au moment o elle lui associe
un terme nouveau, est encore retenu dans la mmoire ; ce terme
nouveau, je lappelle dj et je limagine par une sorte dexigence
qui se trouve dans le premier et qui lempche de subsister seul : et
la pense actuelle du lien qui les unit est le signe de leur commun
sjour lintrieur de ltre total do on les a dtachs lun et
lautre.
Si la relation est la forme de connaissance propre toutes les
choses particulires, ou si, en dautres termes, on ne peut connatre
un objet quen distinguant en lui plusieurs proprits constitutives,
ou en dterminant sa place par rapport quelque autre objet, il y a
donc abus vouloir considrer la relation comme tant par rapport
au tout un principe gnrateur, puisque la relation suppose
lexistence du tout dans lequel, aprs avoir reconnu des lments, on
est tenu de montrer comment ils sarticulent, remdiant en quelque
sorte leur insuffisance par lappui mutuel quils ne cessent de se
donner. Cependant linsuffisance de chaque terme a pour contre-
partie la suffisance parfaite du tout et, en faisant de la relation un
terme premier dont tous les autres drivent, non seulement on gn-
ralise illgitimement en lappliquant au tout la condition de possibi-
lit de la partie comme telle, mais encore on lve contradictoire-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 143
ment jusqu labsolu lide mme de linsuffisance, comme si
linsuffisance pouvait tre sentie autrement que par son contraste
avec la suffisance dont elle porte en elle lide, comme si elle pou-
vait tre comble autrement que par sa participation une suffisance
[147] relle qui la soutient, fait natre en elle le dsir et lui fournit
indfiniment la matire de son accroissement.
De plus, partir du moment o un sujet fini insre dans le tout la
conscience de lui-mme, cest--dire la conscience de ses propres
limites, il ne pourra embrasser le tout par une vision subjective qu
condition den rompre lunit, faute de quoi il ne pourrait ni se dis-
tinguer du tout ni se distinguer des autres sujets finis. La multiplicit
des qualits ou des objets particuliers nest donc dans chaque cons-
cience que la forme visible sous laquelle lunivers doit ncessaire-
ment se prsenter aux yeux dun tre qui en fait partie, mais qui ne
sidentifie pas avec lui.
Cependant cet tre, prcisment parce quil est insparable de
ltre total et quil porte en lui lindivisibilit de son essence,
soblige dans chacune de ses dmarches rtablir lunit de celle-ci
aussitt quil la rompue. Et cest la raison pour laquelle aucun des
termes distingus par lanalyse ne peut subsister isolment : affirmer
une relation entre deux termes, ce nest pas seulement les inclure
tous les deux dans un ensemble dfini par elle, cest sous-tendre
chacun deux et la relation elle-mme lunit totale de ltre dont
chaque mode particulier appelle la prsence (selon un ordre rgl
qui tend toujours se refermer sur lui-mme, comme si, en devenant
une image du tout, il pouvait prtendre une suffisance propre),
dabord des modes les plus voisins et de proche en proche de tous
les autres. Ainsi le tout tend se constituer sous la forme dune infi-
nit de systmes qui senveloppent les uns les autres, mais de telle
manire que la relation qui les engendre porte partout avec elle la
prsence mme du tout et limpossibilit de lgaler.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 144
B. LE J UGEMENT DINHRENCE
ET LE J UGEMENT DE RELATION
Retour la table des matires
ART. 4 : Le jugement dinhrence exprime la fonction analytique
de toute pense finie.
On distingue habituellement les jugements dinhrence des ju-
gements de relation, bien que linhrence soit elle-mme une [148]
relation. Dautre part, cest parce que lon considre justement
linhrence comme la plus simple des relations que lon a voulu r-
duire linhrence toutes les autres relations. Cette rduction a eu
les plus graves consquences mtaphysiques, car la distinction clas-
sique entre la substance et ses qualits nest quune objectivation de
la distinction logique entre le sujet et ses attributs. La multiplicit et
la variabilit des qualits que lon peut attribuer au mme sujet
conduit faire du sujet un terme indpendant, dou la fois de per-
manence et dunit, et qui supporterait les qualits sans se confondre
avec elles ; ainsi, comme on ne peut rien connatre du sujet sinon les
qualits, le sujet tend devenir une mystrieuse entit cache derri-
re elles et dont le rle serait seulement de les soutenir. Lanalyse du
jugement dinhrence, jointe une interprtation ontologique de la
diffrence entre le sujet et lattribut, devait avoir pour dernire
consquence la croyance dans lexistence dune chose en soi, que
toute philosophie intellectualiste sefforce dliminer, mais que lon
retrouve implicitement dans toutes les formes de lidalisme : car, si
lidalisme transcendantal appuie sur laffirmation expresse de la
chose en soi la conception dun monde dapparences qui ne se dis-
tingue du monde de nos rves que par la liaison plus parfaite de ses
parties, il subsiste jusque dans lidalisme absolu un souvenir de la
chose en soi, laquelle on se rfre encore lorsquon soutient que
ltre nest que pense, au lieu de mettre laccent sur ltre, et de
montrer que la pense, loin de le limiter, voque au contraire son
intriorit et sa suffisance plnires.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 145
Tous les jugements dinhrence ont en droit un caractre analyti-
que. Sans doute, on fera remarquer que je puis associer une ide
soit un caractre qui, sans faire partie de sa dfinition, est ncessai-
rement pos en mme temps quelle, soit une qualit qui ne coexiste
avec cette ide quaccidentellement ou momentanment : et jaurai
affaire dans le premier cas une synthse a priori, dans le second
une synthse empirique. Mais ces synthses montrent seulement
comment ma connaissance se constitue : elles marquent lcart qui
spare ltre de la connaissance et elles ont pour objet de remdier
lincompltude de celle-ci, soit par lopration [149] de la raison,
soit par le tmoignage des sens. Cependant, le simple nonc du ju-
gement dinhrence prouve quil exprime une analyse de ltre, une
distinction entre la connaissance que jen possdais et une qualit
sur laquelle porte actuellement mon attention et qui, soit que je
lisole dans cette connaissance mme, soit que je ly ajoute, fait
corps avec lobjet de cette connaissance et forme avec lui et en lui
une sorte de bloc ontologiquement indivisible. Si maintenant le sujet
du jugement dinhrence, au lieu dtre un concept abstrait, rigou-
reusement dlimit par la pense, et qui est dfini par ce jugement
mme, consiste dans un terme rel et concret et quil faut inscrire
lintrieur de lunivers, nul ne doute que lon naura jamais puis
toutes les qualits quil sera possible de lui attribuer. Et cette infinit
des qualits incluse dans chaque sujet est prcisment le signe de
lomniprsence de ltre total.
Ainsi le jugement dinhrence atteste la prsence totale de ltre
en chaque point : car il est un effet de la fonction analytique de la
pense, non pas seulement par la sparation quil effectue entre le
sujet et son attribut, mais par la constitution mme de ce sujet parti-
culier, qui nest particulier que dans la perspective originale sous
laquelle notre connaissance actuelle lenvisage, et qui, ds quon
lapprofondit, recle en lui la totalit des attributs.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 146
ART. 5 : Le jugement dinhrence est un jugement de relation in-
dtermin.
Avant dexaminer le rapport diffrent que soutiennent avec ltre
le sujet, lattribut et la copule, il est ncessaire de chercher sil exis-
te un jugement de relation dune autre nature que le jugement
dinhrence et qui lui serait irrductible. On na pas de peine mon-
trer que ce serait fausser le vritable caractre du jugement A est
la cause de B que de voir dans la cause de B une proprit que lon
attribuerait A. Il est vident, en effet, que la relation ici, cest la
causalit elle-mme et que A et B sont les deux termes quelle unit.
Mais on peut montrer par deux arguments que la diffrence [150]
entre linhrence et la relation est plus superficielle quil ne le sem-
ble. Le premier de ces arguments consiste dcouvrir dans
linhrence une relation indtermine qui demande tre approfon-
die. Ainsi, quand je dis que A est blanc ou quil est chaud, je ne me
borne pas, comme on le croit en gnral, admettre lexistence dun
support encore sans qualits et que la couleur et la chaleur vien-
draient recouvrir : je songe deux espces de relations toutes diff-
rentes, dune part la relation de A avec le sens visuel, dautre part
sa relation avec le sens thermique. Si maintenant je laisse au ju-
gement son objectivit, jai affaire deux nouvelles relations fort
complexes de A avec la lumire dune part, avec lnergie calorifi-
que dautre part. Le jugement dinhrence porte donc en lui, dune
manire confuse, des jugements de relation trs diffrents ; il pose le
sujet au point de rencontre de toutes les relations et il lanalyse en
proprits distinctes qui ne reoivent pourtant une explication que
des relations qui les engendrent.
Le second argument consiste montrer que, dans le jugement de
relation, on met laccent non pas sur le rapport des lments avec le
tout indtermin qui les contient, mais sur le rapport entre les l-
ments, dont on donne une expression prcise, de telle sorte que le
tout devient alors un systme. Ainsi, en passant du jugement
dinhrence au jugement de relation, nous passons dune connais-
sance globale et descriptive une connaissance explicative et consti-
tutive. Non seulement lanalyse est pousse plus loin, mais elle
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 147
substitue la simple numration des lments runis au mme
point la dtermination du lien qui les unit.
On peut prsenter les choses autrement : car dans le jugement
dinhrence, on na affaire qu un seul terme, le sujet, que lon cir-
conscrit dans le tout de lunivers afin de reconnatre les lments qui
le forment. Au lieu que la cause et leffet, par exemple, sont deux
termes spars et qui demeurent encore spars dans la relation qui
les joint. Ainsi le jugement dinhrence comporte, semble-t-il, deux
oprations qui sont toutes deux des oprations danalyse : la premi-
re qui circonscrit le sujet dans le tout et la seconde qui y distingue
des lments. Quand on lui prte un caractre [151] synthtique,
cest quon pense quil nous apprend constituer le concept du su-
jet : ds que celui-ci est constitu, le mme jugement retrouve son
caractre analytique. Mais il ny a que le jugement de relation qui,
en posant dabord les lments spars que lanalyse lui a livrs,
puisse montrer comment ils se joignent : cela mme suffit montrer
pourquoi il prsente seul un caractre synthtique.
On voit bien maintenant comment il est impossible de pntrer la
signification du jugement dinhrence et de lui donner une forme
rigoureuse sans mettre nu le jugement de relation quil enveloppe.
Et lindtermination de la relation dinhrence apparat assez clai-
rement si lon pense quelle se rduit soit la relation de contenant
contenu, soit la relation de support chose supporte, cest--dire,
dans les deux cas une juxtaposition plutt qu une connexion r-
elle entre les deux termes.
En fait, tous les jugements de relation impliquent eux-mmes,
soit deux termes qui sont juxtaposs dans lespace, soit deux termes
qui se succdent dans la dure : et toutes les relations logiques ex-
priment les diffrentes manires dont la juxtaposition ou la succes-
sion peuvent tre interprtes ou produites par la pense. Cest que
lespace et le temps forment le double champ o tout le rel est d-
ploy. Bien plus, le temps lui-mme est le moyen subjectif sans le-
quel les parties de lespace ne pourraient tre ni distingues, ni r-
unies. Ds lors, on peut schmatiquement ramener toutes les formes
de la relation la succession qui les engendre comme elles la spci-
fient.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 148
Or la succession, qui est la condition de toute analyse, soutient
encore le jugement dinhrence pour que la distinction du sujet et de
lattribut puisse tre faite ; mais, comme cette succession ne reoit
aucune dtermination, elle na de valeur que pour le sujet et non
pour lobjet. Et de fait, dans lobjet la qualit et le terme qui la sou-
tient sont ncessairement donns la fois. Il suffira donc, dune
part, que les termes du jugement dinhrence soient connus distinc-
tement et que lon puisse passer de lun lautre par une transition
relle pour que ce jugement devienne un jugement de relation (car si
lon voulait rduire cette transition une implication pure, [152] le
jugement deviendrait tautologique). Il suffira, dautre part, que cette
mme transition relle cesse dtre dtermine et se convertisse en
une simple concidence, dont le sujet reprsente la forme indivise
et lattribut un lment isol, pour que lon glisse insensiblement du
jugement de relation au jugement dinhrence.
Ce nest pas dtruire loriginalit du sujet par rapport lattribut.
Car le sujet ne peut tre quun ensemble de qualits au milieu des-
quelles on discerne lattribut. Et la caractristique du jugement
dinhrence, cest lhomognit des termes quil runit et sans la-
quelle ils ne formeraient pas un tout solidaire. Ce qui le prouve en-
core, cest quil ny a pas de jugement dinhrence qui ne soit rci-
proque. Le type le plus clair et peut-tre le type primitif des juge-
ments dinhrence, cest celui qui est form par le rapport de
ltendue et de la couleur, car ltendue apparat bien comme une
sorte de support apte recevoir une diversit de couleurs qui la d-
terminent : mais on voit tout de suite quil est galement lgitime de
dire ltendue est colore, blanche ou noire ou de dire toute
couleur est tendue . Si lon nous presse en disant que les deux
propositions nont pas le mme sens, que dans la premire ltendue
se joint la couleur pour devenir visible, tandis que dans la seconde
la couleur se joint ltendue comme une condition de possibilit,
nous rpondrons que cest apporter la preuve de lindtermination
o reste le rapport dinhrence jusquau moment o lon a dcouvert
entre les deux termes quil associe quelque relation plus prcise.
Par suite, si le propre de linhrence, cest de lier des qualits
dans un mme terme, tandis que le propre de la relation, cest de lier
entre eux des termes qualifis dans un mme ensemble, on verra
svanouir par degrs toutes les diffrences qui les sparaient, puis-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 149
quun terme nest lui-mme quun ensemble de qualits et puisque
chercher la loi de cet ensemble, cest chercher entre ses qualits la
relation originale qui les unit.
Mais ce rapport entre le jugement dinhrence et le jugement de
relation nous permet de vrifier lidentit dans ltre entre la com-
prhension et lextension : car, pour noncer la comprhension de
ltre, il faut ncessairement en faire le [153] sujet dune infinit de
qualits ; et cette infinit ne peut tre pense distinctement qu
condition que, sans se rompre, elle fonde lordre de lextension,
cest--dire permette aux diffrentes qualits de se grouper selon des
relations dfinies dans des tres particuliers, qui seront unis leur
tour par dautres relations dfinies lintrieur dun systme total
auquel nous donnons le nom dunivers.
C. LTRE COMME ATTRIBUT
ET LTRE COMME SUJ ET
Retour la table des matires
ART. 6 : Regarder ltre tour tour comme lattribut de tous les
sujets et comme le sujet de tous les attributs, cest rejoindre, grce
la copule, sa notion abstraite son essence concrte.
Puisque ltre peut tre affirm universellement de tous les ob-
jets, et puisquil est un terme dune telle richesse que tous les attri-
buts dveloppent son essence, mais quaucun ne lpuise, on a pu le
considrer comme tant la fois lattribut de tous les sujets et le su-
jet de tous les attributs, de telle sorte que le jugement dinhrence
(avec les rserves que nous avons faites sur la distinction de ce ju-
gement et du jugement de relation) nous permettra de reconnatre
plus aisment, grce la simplicit de son dessein, comment ltre
est envelopp dans laffirmation. De plus, lunivocit nous oblige
considrer la diversit des relations comme affectant les formes par-
ticulires de ltre et non pas ltre lui-mme ; car, une fois que ces
formes ont t dfinies, nous dirons de chacune delles quelle est
dans le mme sens et avec la mme force. A cet gard encore,
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 150
linhrence, qui est laspect lmentaire et la racine commune de
toutes les relations, se prte mieux quaucune autre espce de juge-
ment lexamen des caractres de ltre pur. Et il est remarquable
que le jugement ltre est , par lequel sexprime avec le plus de
hardiesse lambition ontologique de la pense, semble la fois r-
sumer dans la perfection de sa tautologie lessence de tous les juge-
ments dinhrence et fournir ceux-ci un cadre immuable quil leur
appartient de remplir.
Dans la possibilit de prendre indiffremment le terme tre [154]
comme sujet de tout attribut et comme attribut de tout sujet, il ny a
pas seulement une application particulire de cette rciprocit des
termes qui nous a paru caractriser tous les jugements dinhrence.
Ou plutt cette rciprocit trouve ici son fondement. Car, sil a fallu
reconnatre tout lheure que des deux propositions ltendue est
colore et la couleur est tendue , la premire cache une pro-
gression vers le concret et par consquent une implication empiri-
que, tandis que la seconde cache une rgression vers labstrait et par
consquent une implication logique, cest videmment parce que la
copule, fournissant un trait dunion entre le concret et labstrait,
permet galement danalyser le premier et de dterminer le second.
Or que fait-on de plus, en prenant ltre comme un attribut univer-
sel, que de voir en lui le plus indtermin et le plus abstrait des gen-
res et, en le prenant comme un sujet universel, que de le confondre
avec la totalit concrte, cest--dire avec la synthse parfaite des
qualits ? En effet, cest la faveur de la distinction entre cet tre
absolument plein et cet tre absolument dficient, cest en quelque
sorte dans lintervalle qui les spare que viennent sintercaler tous
les jugements particuliers dans lesquels je dfinis les diffrents
concepts : ils peuvent tre interprts eux-mmes soit, dans le lan-
gage de lextension, comme incluant un terme dans une classe, soit,
dans le langage de la comprhension, comme analysant le contenu
dune essence.
Cependant, la ncessit didentifier dans ltre lextension et la
comprhension et de les considrer comme infinies lune et lautre,
et non plus comme rgies par un rapport inverse, doit nous conduire
nous demander sil est lgitime de faire de ltre tour tour un su-
jet et un attribut. En tout cas, ce nest ni un attribut ni un sujet com-
me les autres : cest que lopposition du sujet et de lattribut na de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 151
sens que quand on dtermine des concepts particuliers et quelle a
pour objet soit de les constituer, soit de les expliciter. Mais elle nest
pas valable pour le tout. Sil devenait un attribut, il faudrait quil
entrt comme lment dans un concept plus riche, ce qui est contra-
dictoire. Sil devenait un sujet, il faudrait quil pt tre dfini par ses
qualits : or, les qualits issues de lanalyse sopposent entre elles et
ne conviennent par suite quaux [155] parties et non au tout. Cest
prouver que la distinction du sujet et de lattribut va de pair avec
celle de lextension et de la comprhension.
ART. 7 : Ltre ne peut pas tre identifi avec lattribut universel
parce que, au lieu dtre contenu dans tous les sujets, il les contient
tous.
En ralit, ltre ne joue jamais le rle dun vritable attribut, car
ce serait vouloir en faire une qualit spare, alors quil est non pas
mme la somme de toutes les qualits, mais lunit plnire dont les
qualits expriment les diffrents aspects. Cest pour cela quil est
faux de vouloir le poser sparment lintrieur de chaque sujet,
alors quil est lacte par lequel tout sujet est pos. Luniversalit
mme de ltre devrait suffire nous mettre en dfiance sur la lgi-
timit de son rle attributif, sil est vrai que lattribut est toujours
une qualit et si les qualits ne peuvent apparatre que dans ltre et
grce leur opposition mutuelle.
J amais ltre nest attribu un terme comme une proprit int-
grante de ce terme et le langage lui-mme rsiste en faire une qua-
lification. Nous disons A est ; pour dire A est existant il faut
non seulement voquer lanalogie dun jugement comme A est
blanc , mais violenter le mouvement naturel de la pense qui sent
bien quaprs avoir dit A est , nous avons dit tout ce quon pou-
vait dire de A relativement lexistence, puisque nous lavons ins-
crit dans lunivers. Dire quil est existant, cest la fois un plonas-
me, puisque lide exprime par lpithte est dj acquise, et un
cercle, puisque cest laisser croire que lon peut distinguer ltre
lintrieur de A autrement quen distinguant dabord A lintrieur
de ltre. Le mme enveloppement rciproque trouve une expression
adquate dans ltre de la conscience qui est contenu par son acte
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 152
dans la totalit de ltre et le contient en puissance comme pour
fournir le tmoignage vivant de son indivisible unit.
On a vu que Kant refusait avec raison de faire de lexistence un
lment de la comprhension des termes ; mais [156] sil avait rai-
son, ce nest pas, comme il la cru, parce que lexistence est extrin-
sque par rapport lide, cest parce que lide suppose toujours
ltre et quelle le limite en le dterminant, de telle sorte que, toutes
les qualits tant dans ltre, ltre ne peut sidentifier avec aucune
delles. Il nous appartiendra, en le dterminant, de dire sil
sapplique un objet prsent, pass ou futur, une perception ac-
tuelle ou limage actuelle dune perception possible, une donne
contingente ou un acte ncessaire de la pense. Mais cest parce
que ltre a t suppos que le terme a pu tre dfini : il doit tou-
jours tre inscrit dans ltre de quelque manire et cest en le dfi-
nissant correctement quon ly inscrit correctement.
ART. 8 : Ltre ne peut pas tre identifi avec le sujet universel,
prcisment parce quil est indiscernable de la totalit de ses attri-
buts.
Les critiques prcdentes ne montrent-elles pas que, si ltre
nest pas lattribut universel, cest sans doute parce quil est le sujet
universel ? Nest-ce pas alors lui restituer son abondance concrte,
que tous les attributs que nous pourrons jamais connatre manifes-
tent sans lpuiser ? La mtaphysique classique, en identifiant ltre
avec la substance, nen fait-elle pas implicitement le sujet de tous
les jugements dinhrence ?
Cependant, la distinction mme que lon na jamais manqu de
faire entre la substance et ses qualits et que lon retrouve sans ces-
se, soit dans lopposition du permanent et du variable, soit dans celle
de lessence et de laccident, nous conduit refuser au sujet la va-
leur privilgie quon lui attribue quand on cherche en lui une repr-
sentation adquate de ltre. Car nous consentons bien voir en lui
la totalit des qualits que lanalyse dialectique jointe, chez un tre
fini, lanalyse empirique parviendra en faire jaillir. Mais il faut
se garder alors dinterprter la distinction entre la substance et les
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 153
qualits, comme ne manque pas de le faire un certain ralisme mta-
physique, en imaginant une existence [157] autonome de la substan-
ce prive de qualits dans un monde diffrent de notre monde sensi-
ble et o la raison seule nous permettrait de pntrer. Cest faire
alors de ce que nous voyons un ensemble de fantmes quil faudrait
placer paradoxalement hors de ltre vritable et non point en lui. Et
cest justement contre cette conception que nous ne cessons de nous
lever : persuads quil nous est impossible de sortir des limites de
ltre et de perdre avec lui ce contact dont nous ne cessons de rece-
voir notre tre propre, nous pensons la fois quil y a une exprien-
ce vritable de ltre, et que toute notre exprience, ds que son ori-
gine, sa nature et ses frontires auront t dfinies, devra tre leve
la dignit de ltre. Or, pour cela, il faut que la substance et ses
qualits apparaissent comme ontologiquement insparables, que
ltre et les aspects de ltre ne fassent quun.
Quelle que soit par consquent linclination naturelle de la pen-
se identifier ltre concret avec le sujet du jugement plutt
quavec son attribut, en remarquant que le sujet universel est le sup-
port commun de toutes les formes que ltre pourra recevoir, on se
mfiera pourtant dune assimilation en apparence si lgitime. Ce
support en effet devrait toujours tre imagin comme diffrent en
quelque manire de ce quil supporte, alors quil est manifestement
impossible de ne pas le confondre avec la totalit des choses suppor-
tes, dont chacune est une dtermination particulire de ltre.
Ainsi, en distinguant le sujet de lattribut, on est ncessairement
conduit faire de ltre qui serait le sujet de tous les attributs un
terme aussi abstrait que de ltre qui tait lattribut de tous les sujets.
Ctait pourtant ce que lon voulait viter. Mais un sujet absolu ca-
pable de recevoir tous les attributs, et nen possdant essentielle-
ment aucun, nest quune entit logique qui nous obligerait, par une
sorte de mouvement inverse de celui vers lequel nous portait la cri-
tique dun tre purement attributif, revenir prcisment vers
lattribut pour chercher en lui la ralit vritable.
Si on allgue maintenant que ltre de ce sujet ne consiste pas
dans cette forme que nous supposons dpouille de caractres, mais
dans lensemble des caractres essentiels, nous rpondrons quil ny
a, lgard de ltre, aucune diffrence [158] entre les caractres
essentiels et les caractres accidentels, quils sont tous galement
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 154
prsents lintrieur de ltre total, quenfin, en identifiant ltre
avec quelques-uns de ses attributs, on abolit, en ce qui les concerne,
la distinction et le sens original des mots sujet et attribut, puisquil
ne peut plus y avoir dattribut l o il ne subsiste aucun sujet ind-
pendant pour le recevoir.
En serrant la question de plus prs, ltre ne peut pas tre identi-
fi avec le sujet pour une double raison : la premire, cest que le
sujet veille lide dun support purement statique des attributs,
cest--dire dune chose extrieure une conscience et pose par
elle, au lieu que ltre est caractris essentiellement par son intrio-
rit lui-mme, ce qui nous oblige le dfinir comme un acte capa-
ble denvelopper en lui une infinit doprations ; la seconde, qui est
solidaire de la prcdente, est que cette identification de ltre avec
le sujet et qui nous conduirait le considrer comme le faisceau de
tous les attributs donnerait chacun de ceux-ci un intolrable privi-
lge en laissant supposer quil pourrait exister indpendamment de
sa runion avec tous les autres : or il est seulement un effet de
lanalyse ou, plus exactement, de la relation avec lActe pur dune
conscience qui en participe et fait apparatre tous les attributs com-
me les corrlatifs de ses propres oprations.
D. LA COPULE ET LE VERBE
Retour la table des matires
ART. 9 : La copule du jugement dinhrence nexprime quune li-
mitation du jugement universel ltre est par lequel se dcouvre
la puissance absolue de laffirmation.
dfaut du sujet ou de lattribut, ltre ne serait-il pas plus jus-
tement identifi avec la copule de tous les jugements dinhrence,
cest--dire avec lacte mme de laffirmation ? On dit en gnral
que le mot tre comporte deux sens diffrents, selon quon
lemploie pour dsigner lexistence dun terme, cest--dire son ins-
cription dans lunivers, ou la simple liaison de lattribut et du sujet
lintrieur dune affirmation. [159] Comme on lui donne le nom de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 155
copule quand il est pris dans la deuxime acception, on pourrait lui
donner le nom de verbe quand il est pris dans la premire.
Si nous rduisions le verbe la copule, nous ferions de la relation
considre dans sa forme la plus lmentaire le principe la fois de
la connaissance et des choses. Mais si au contraire la copule suppose
le verbe, si elle explicite la puissance daffirmation qui est en lui, de
telle manire que le monde puisse apparatre un entendement fini
comme form de parties distinctes et pourtant lies entre elles, alors
nous aurons russi fonder sur ltre tout ldifice de la connaissan-
ce et nous aurons confr ltre la relation elle-mme.
Tout dabord, on peut observer que le jugement dexistence est
impliqu dans tous les autres jugements, car il faut bien que le sujet
soit, que lattribut soit, et mme que le rapport dinhrence qui les
unit soit en quelque manire lui aussi pour que deux termes puissent
tre poss et quils puissent ltre solidairement. Le jugement
dexistence nest rien de plus que le tmoin de luniversalit de
ltre, telle que nous lavons dfinie dans le chapitre II de la premi-
re partie. Ds lors, la copule ne soppose pas au verbe, elle le sous-
entend, le dtermine et limite son application. Ltre fini ne peut
connatre le tout dans lequel il est plac, se distinguer de lui et pour-
tant lassimiler, quen projetant en lui ses propres bornes et par
consquent en le considrant comme form dune infinit dtres
finis comparables lui-mme : lexistence dun seul tre fini entra-
ne corrlativement celle de tous les autres. Un tre fini ne pourra
donc rien connatre autrement quen distinguant des formes
dexistence spares et il pourra pousser cette distinction indfini-
ment. Mais chaque forme dexistence doit tre dfinie par certains
caractres originaux : nous ne pouvons linscrire dans ltre quen la
dterminant et dire quelle est quen disant ce quelle est. Ltre de
la copule nest donc pas sans parent avec ltre du verbe, cest seu-
lement un tre emprunt et divis qui exprime ce que la connaissan-
ce a retenu de ltre absolu ; la copule nous montre comment
lesprit, aprs avoir bris lunit de celui-ci, sastreint le dtermi-
ner en chaque point grce laffirmation [160] de certains caract-
res par lesquels chaque tre particulier se distingue de tous les au-
tres.
Mais si ltre est tout entier prsent en chaque point, on peut dire
que lanalyse qui dcouvre en lui certains caractres particuliers y
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 156
dcouvrirait tous les autres si elle tait pousse elle-mme assez
loin, de telle sorte que le jugement dinhrence, en dfinissant cha-
que terme particulier, montre le niveau o sest arrte momentan-
ment lanalyse pour rpondre lintrt actuel de celui qui la fait.
Elle trace la fois dans la conscience et dans lobjet une ligne de
dmarcation entre ltre en puissance et ltre actualis.
Remarquons en mme temps quil ny a point de caractre qui
puisse former lattribut dun jugement dinhrence en dtachant un
tre particulier du tout dont il fait partie et qui en mme temps ne ly
replonge. Car ce caractre ne peut servir dterminer un individu
que par lassociation quil forme avec beaucoup dautres : en lui-
mme, il possde une gnralit qui permet de lattribuer une infi-
nit dindividus entre lesquels il cre une parent et de comprendre
pourquoi ce serait ncessairement connatre le Tout que de connatre
le tout de chaque partie. Mais le jugement dinhrence, considr
indpendamment du jugement de relation, nexprime encore rien de
plus que la possibilit de cette analyse indfinie que nous pouvons
diriger et suspendre selon nos besoins : il nous rvle la prsence
des caractres et non pas les connexions qui les unissent. Tel est au
contraire le rle du jugement de relation qui donne au jugement
dinhrence la prcision qui lui manquait et, en liant entre eux les
lments rvls par lanalyse, cherche retrouver partout non pas
seulement lunit du tout, mais sa systmacit.
La copule et la relation sont galement les signes de
limpossibilit o nous sommes de poser isolment aucun terme par-
ticulier. La solidarit mutuelle de tous les caractres distingus par
lanalyse est la preuve quils sont dtachs du tout, et que la
connaissance aspire les y faire rentrer, sans toutefois que son u-
vre puisse jamais tre acheve, ni par consquent concider avec
ltre total dans lequel elle trouve la fois une origine et un champ
dapplication illimit. Lapparition de ltre fini rpond la dhis-
cence du tout. Notre [161] entendement ne peut que poursuivre in-
dfiniment dans le tout une analyse qui ne spuise point, mais dont
les rsultats doivent chaque pas pouvoir sinscrire dans une affir-
mation par lintermdiaire du jugement dinhrence ou du jugement
de relation.
Le jugement dexistence est donc impliqu par les autres juge-
ments. Dans lactivit caractristique de cette opration par laquelle
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 157
lesprit prend possession du rel, la synthse est corrlative dune
analyse pralable et lapparente construction est subordonne un
acte de soumission au rel. Cest cette soumission qui est exprime
par le jugement dexistence : les jugements de connaissance retien-
nent en eux celui-ci ; ils en manifestent la richesse, mais ils la limi-
tent en la proportionnant la capacit de notre apprhension.
Cest quen effet, si ltre est universel et univoque, il ne peut y
avoir quun seul jugement dexistence. Sans doute nous pouvons
dire de A quil est, et mme nous pouvons le dire de tous les termes
particuliers dans le mme sens et avec la mme force. Mais cela
veut dire que tous ces termes font partie du mme tre. Aussi, quand
nous choisissons A comme sujet, nous ne nous attendons nullement
entendre affirmer de lui son existence, mais ses qualits ; cest sa
manire dtre qui nous intresse et le rle du jugement dinhrence
est prcisment de nous la rvler. Nous sommes mme choqus que
lon prtende borner notre affirmation lexistence de A, comme si
cette existence pouvait tre saisie part, alors que, comme nous
lavons montr souvent, elle ne se distingue pas de A lui-mme
considr dans la totalit de ses caractres, de ceux que nous
connaissons et de ceux que nous ne connaissons pas, mais que nous
pourrions connatre. Bien plus, le jugement A est nous parat un
jugement incomplet et inachev, lamorce de tous les jugements de
connaissance et le cadre quils doivent remplir.
Mais ce jugement incomplet est pourtant le plus parfait de tous,
car ce que cherche lintelligence, cest ltre. Cest en lui quelle
puise, cest vers lui quelle tend. Et les jugements de connaissance
nous en rvlent les fragments. La ncessit o nous sommes
dattribuer ltre tous les termes que lanalyse nous permet disoler
dans le monde, le malaise [162] que nous prouvons, en ce qui
concerne chacun deux, quand nous bornons notre affirmation son
tre sans le dterminer, le sentiment assur que ltre ne convient
pleinement aucun objet particulier, mais seulement au tout dont il
fait partie avec tous les autres, nous obligent admettre quil ny a
quune seule forme du jugement dexistence qui soit lgitime : cest
celle qui sexprime en disant ltre est . On peut sans doute all-
guer sa strilit, son vidence intuitive dans laquelle on retrouve
volont une exprience universelle et une tautologie. Ces caractres
mmes tmoignent de sa primaut, de sa dignit et de sa grandeur.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 158
Car ni la raison ne peut le rejeter, ds quon la suppose, ni
lexprience loublier, ds quelle commence sexercer. Cette af-
firmation en apparence vide de contenu, cest laffirmation du tout
o nous distinguons des parties qui sans lui ne seraient rien. Cest
donc la puissance absolue de laffirmation et, loin de croire que les
affirmations particulires y ajoutent, il faut dire quelles ne seraient
pas possibles sans elle, quelles en reoivent toute la sve qui les
anime et qui les nourrit.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 159
[163]
Deuxime partie.
La multiplicit de ltre
Chapitre VI
DE LTRE DU TOUT
ET DE LTRE DES PARTIES
A. LTRE DU TOUT
Retour la table des matires
ART. 1: Il ny a pas dautre tre que ltre du tout ; et attribuer
ltre la partie, cest dire quil faut linscrire elle-mme dans le
tout.
Lexamen des rapports entre le jugement dexistence et le juge-
ment de relation trouvera une confirmation dans la comparaison en-
tre ltre du tout et ltre des parties. Car, si ltre appartient primi-
tivement au tout et sil est univoque, il nappartient aux parties que
parce quelles sont contenues dans le tout et quen un autre sens el-
les lenveloppent. Elles possdent toutes le mme tre parce quelles
sont toutes des aspects du mme tout.
Dj dans le chapitre prcdent, nous avions retrouv, propos
du jugement dexistence, cette affirmation qui nous tait familire,
savoir que ltre nest pas un caractre spar, mais quil est la fois
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 160
partout et nulle part : il est partout parce que nulle forme de ltre ne
peut se dgager du tout dont elle exprime un aspect ; et il nest nulle
part parce quaucun aspect de ltre ne lpuise et ne reprsente,
aussi longtemps quon le prend isolment, lindivisibilit de son es-
sence.
Cest la raison pour laquelle le jugement dexistence, ds quil
cesse dtre laffirmation tautologique de ltre ou du tout, se
convertit en un jugement de relation dans lequel ltre, en trouvant
une dtermination, appelle toutes les autres ; le jugement
dexistence parat donc sans objet et dpourvu [164] dapplication,
non pas cause de sa vacuit, mais cause de cette parfaite plnitu-
de qui empche tout entendement fini dembrasser adquatement la
totalit de son contenu : un entendement fini, comme on la montr
larticle 3 du chapitre prcdent, ne peut se distinguer du tout
quen distinguant dans le tout des objets finis quil unit entre eux par
la relation. Par leur inscription dans le tout, nous disons de ces ob-
jets quils possdent ltre et le mme tre que le tout ; mais nous ne
pouvons saisir cet tre, qui nest pas distinct de leur nature mme,
autrement quen caractrisant celle-ci : dire ce quelle est, cest fixer
les yeux sur la manire dont elle nous apparat, et cest apercevoir ce
qui lui manque pour tre le tout, cest donc discerner ses relations
avec le reste des choses, cest considrer ce qui lui appartient com-
me un effet de sa liaison avec lunivers entier.
Le mouvement par lequel on passe de lun au multiple se
confond avec le mouvement par lequel on passe de ltre la
connaissance ; mais le multiple ne peut tre pos en dehors de la re-
lation qui dfinit ses lments en les unissant entre eux ; il envelop-
pe donc lunit, et cest pourquoi la connaissance la plus misrable
pose son tre propre en enveloppant ltre tout entier. Ainsi une bel-
le image qui se reflte dans un vaste miroir se retrouve encore tout
entire dans chacun des fragments quand le miroir vient tre bris.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 161
ART. 2 : Le tout nest pas la somme des parties, mais le principe
idologique qui les fonde et qui permet une analyse toujours ina-
cheve de les engendrer indfiniment.
Il suffirait, semble-t-il, dvoquer luniversalit et lunivocit de
ltre pour apercevoir aussitt que ltre sapplique au tout. Mais le
nom de tout peut nous faire illusion, au moins dans une certaine me-
sure, et donner toute notre analyse lapparence dun cercle. Car on
dira peut-tre quil ne peut y avoir un tout que l o il y a des par-
ties, et que ces parties doivent possder ltre pour que le tout son
tour puisse le recevoir. Or nous pensons avoir suffisamment montr
que le tout dont il sagit nest pas un tout de fait obtenu [165] par la
totalisation de parties actuellement donnes, et qui videmment ne
pourrait jamais tre embrass, mais que cest au contraire un tout de
droit quil est ncessaire de poser dabord pour que des parties
soient possibles, et qui est seul capable de confrer celles-ci une
existence de participation identique celle dont il jouit lui-mme
essentiellement ; cest en quelque manire un tout qui peut tre d-
compos en parties sans tre lui-mme compos de parties.
On dira, si lon veut, que le tout que lon a pos dabord est un
tout en ide, auquel lexprience que nous prenons des parties est
seule capable de donner un contenu et une forme concrte ; mais il
est pourtant remarquable que ces parties, une fois quelles auront t
dcouvertes, apparatront ncessairement comme tenant leur exis-
tence de leur inscription dans ce tout idologique ; elles lactualisent
nos yeux, mais elles tiennent de lui la fois leur possibilit et leur
tre mme. Aussi ne stonnera-t-on pas que, comme on le montrera
au chapitre VIII, lide de ltre soit de toutes les ides la seule qui
concide avec son objet. On saperoit alors que ce tout antrieur
aux parties qui, au lieu de rsulter de leur addition, les engendre
dans son sein sans recevoir aucun accroissement, et qui se dcouvre
comme identique sa propre ide, ne peut tre dfini lui-mme que
comme un acte. Lunivers nest donn un tre fini que sous la for-
me dun ensemble de parties juxtaposes, enfermes dans les bornes
de son horizon, qui se multiplient indfiniment mesure que son
regard stend, sans jamais lui permettre denvelopper par leur in-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 162
termdiaire le tout dont il les a dtaches. Mais lide vritable du
tout doit tre cherche dans une autre direction, savoir dans le
principe intrieur qui lui donne ltre lui-mme, qui le rend sup-
rieur lobjet en lui permettant de le penser, qui linvite exercer
cette activit (dont les limites nont de sens que par rapport lui)
que lon retrouve sous une forme identique dans tous les tres finis,
et qui, considre dans tous les points o elle sexerce la fois,
constitue la possibilit totale, cest--dire lactualit parfaite.
On ne dira donc pas que le tout rsulte de lnumration exhaus-
tive de tous les termes auxquels le nom dtre peut tre appliqu,
mais quil est le fondement de leur existence. [166] Car ces termes
sont obtenus par une analyse du tout, loin que le tout soit une syn-
thse qui les runit. Le tout nest pas une dnomination extrinsque
qui sajouterait aprs coup une diversit donne dabord pour que
lesprit puisse la parcourir dun seul regard ; il est la perfection de
cette unit concrte qui ne peut se manifester lindividu que par
une abondance infinie de qualits ; car lindividu, sil tient delle
son tre et sil ne cesse de lui demeurer prsent, ne peut sen distin-
guer quen poursuivant sa propre vie dans la dure, cest--dire, en
rendant la prsence de ltre effective pour lui grce une suite
dincidences momentanes.
On comprend par l quel est le rapport que nous pouvons tablir
entre le tout et linfini. Il semble en effet, premire vue, que ces
deux notions doivent sexclure : car le tout auquel il ne manque rien
ne peut jamais tre pens que comme achev. Mais cette notion sup-
pose que lon a cherch obtenir le tout par une addition de parties :
alors en effet le tout est ncessairement fini, au moins en droit, m-
me si, en fait, on ne peut jamais poursuivre laddition des parties
jusquau bout. Ou bien alors cette addition est en droit indfinie :
dans ce cas cest la notion mme de tout qui est une chimre. Il nen
est pas ainsi si le tout prexiste aux parties. En ralit, le tout est un,
avant dtre tout : il ne mrite le nom de tout qu lgard des parties
que lon pourra distinguer en lui et cest son unit qui fait que, ds
que lanalyse commence, elle ne peut plus sachever. Mais alors il
ny a rien de contradictoire supposer quelle cre une suite indfi-
nie de termes et, comme tous ces termes, aussi bien ceux quelle a
dj poss que ceux quelle pourrait poser encore, sont contenus
dans le mme un, celui-ci mrite bien leur gard le nom de tout. Et
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 163
de ce tout on pourra dire aussi quil est un infini actuel, bien
quaucune conscience ne puisse actualiser les diffrents termes
quelle y pourra distinguer autrement quen les faisant entrer dans
des sries elles-mmes indfinies.
[167]
ART. 3 : Lexistence, tant corrlative de lindpendance parfaite,
ne peut appartenir primitivement quau tout, et nappartient
quaccessoirement aux parties qui trouvent en lui une place et
limitent encore leur manire.
Que lexistence appartienne primitivement au tout et accessoire-
ment aux parties, cest une consquence dun autre caractre de
ltre qui na point encore t examin. Dire dune chose quelle est,
en effet, cest lui attribuer une sphre propre dans laquelle ses puis-
sances sexercent, cest lui assigner une initiative intrieure, une in-
dpendance lgard de ce qui nest point elle. Quon lui retire cette
indpendance, et lon sent bien que son existence se rsorbe et se
fond dans lexistence mme dont elle dpend.
Cest ce qui se produit dans le jugement dinhrence lgard de
la qualit qui na pas dexistence en dehors du sujet quelle dtermi-
ne. Et telle est la raison pour laquelle le jugement dexistence, pre-
nant le terme dont lexistence est affirme comme un terme suffi-
sant, se termine cette affirmation mme, sans y joindre un caract-
re qui, en lenrichissant, montrerait que ce terme ne possde pas par
lui-mme toutes les ressources requises pour exister. Quand je dis
A est blanc , janalyse la comprhension de A, mais A et blanc
nont t distingus que dune manire abstraite ; cette abstraction,
avec les oprations de dcomposition et de recomposition quelle
implique, na de sens que pour la connaissance. Au contraire, dire
A est , cest circonscrire A avec sa blancheur et toutes les quali-
ts quil contient, le dnouer des relations qui lunissent tout le
reste et lui confrer une sorte dautonomie et de subsistance propre.
On voit donc que lon ne pourra attribuer lexistence aux parties
que parce que, tant inscrites dans le tout, elles limitent leur ma-
nire. Mais, avant de montrer en quel sens la relation soppose
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 164
ltre et le reoit en mme temps, il convient de mditer un moment
sur cette admirable convenance qui stablit entre ltre et le tout,
ds quon a aperu que ltre comporte ncessairement lintriorit
lui-mme, la suffisance plnire et la parfaite indpendance. Il ny a
[168] point dautre terme que le tout en effet qui puisse tre enferm
absolument en soi, qui tienne tous ses caractres de lintimit de son
essence et qui soit libr de toute influence de quelque objet ext-
rieur lui. Comment pourrait-on le subordonner ses parties, puis-
que ces parties nont de sens que les unes par rapport aux autres,
cest--dire par la place quelles occupent en lui, par le vaste en-
semble quelles contribuent former et au sein duquel il avait bien
fallu dabord les discerner ? Dira-t-on quil est la loi des parties ?
Mais cette loi est aussi la raison des parties, le principe de leur appa-
rition. Nous lui donnons le nom de loi parce que nous lavons d-
couverte aprs les parties entre lesquelles elle tablit un lien intelli-
gible. Cest seulement pour nous quelle est abstraite et parce que
lunivers se prsente dabord nous comme une diversit donne :
mais en elle-mme, elle est une unit active et linfinit des formes
par lesquelles elle se rvle ne la morcelle pas ; toujours indivisi-
blement prsente en tous les points de lespace et du temps, elle se
retrouve identique elle-mme dans toutes les perspectives sous
lesquelles nous la considrons, nous contraignant seulement tablir
entre celles-ci un ordre travers lequel elle devient en quelque sorte
reprsentable par tous les sujets finis qui participent son essence
sans se confondre avec elle.
Ainsi, puisque tre, cest tre soi et subsister par ses propres for-
ces, au lieu de recevoir un appui du dehors qui ferait de ltre ltre
dautre chose et non pas son tre propre, il est vident que ltre ne
peut appartenir quau tout et que ltre de chaque partie, cest ltre
du tout prsent en elle et qui la soutient avec toutes les autres par-
ties. Nous ne dirons pas que cest ltre par soi. Car cela semblerait
impliquer que le principe de causalit sapplique ltre aussi bien
qu ses formes. Mais si ces formes sexpliquent les unes par les au-
tres, on aurait tort de soutenir que ltre de chacune delles
sexplique aussi par ltre dune autre, et non par ltre du tout ;
plus forte raison, au moment o lon rencontre celui-ci, toute dis-
tinction entre ce quil est et la raison de ce quil est serait-elle sou-
verainement illgitime, puisque cette raison devrait possder ltre
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 165
avant den rendre compte. Il ny a pas dautre intelligibilit du tout
que celle quil donne aux parties [169] en assignant chacune
delles une place par rapport toutes les autres dans un rseau de
relations dont il dtermine la fois lunit, la richesse et le dessin.
Cependant, on peut montrer avec vidence que, lorsquon appli-
que ltre un terme particulier sans songer au tout dont il fait partie
et qui le lui confre, cest quon considre ce terme comme une sor-
te de tout qui se suffit lui-mme. Il est remarquable en effet que,
pour dire dun terme quil est, on se borne le circonscrire et le
dfinir, essayer de le poser indpendamment de tous les termes
voisins et du sujet mme qui le pose. Et ctait largument sur lequel
on stait appuy pour prouver que ltre dun objet ne se distingue
pas de sa nature mme, dont il nonce lachvement, et quil nest
dans aucun cas un caractre qui sy surajoute. De l on peut conclu-
re aussi que lanalyse est linstrument fondamental de toute mthode
ontologique. Car cest parce que ltre appartient au tout, qui est la
suffisance plnire, quil se rpand sur les parties et quil donne en-
core chacune delles une sorte dautonomie aux yeux dun sujet
fini qui ne peut la penser quen sen distinguant et en sy opposant :
et lon ne pourrait sans doute lui attribuer aucune indpendance sans
lui assigner une intriorit et fonder sa propre suffisance sur lacte
mme qui la fait tre.
Cest que la partie nest jamais proprement parler un lment
du tout : elle en est une expression. Si lon considre les parties en
elles-mmes, elles sont individualises jusquau dernier point : ds
lors, comment formeraient-elles un tout en se juxtaposant ? Mais si
au contraire lunit du tout est pose dabord, et si cest elle qui ap-
pelle les parties lexistence, on comprend que ces parties doivent
la fois, pour tre, manifester une indpendance mutuelle, par laquel-
le elles imitent lindpendance du tout, et pour montrer que cet tre
est emprunt, le recevoir sous la forme dun caractre identique, qui
est le signe de lidentit du tout qui leur donne naissance. Cest dans
cette observation que se trouve la solution dune difficult que nous
avions signale plus haut, savoir que lexistence est univoque sans
tre un caractre spar : elle est leffet de la runion dans lunit du
tout dune infinit dtres particuliers tous diffrents les uns des au-
tres ; [170] et cest pour cela que dans chacun deux lexistence ne
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 166
se ralise que par lachvement et la perfection de toutes les dter-
minations individuelles.
B. LTRE DE LA PARTIE,
CEST--DIRE DU PHNOMNE
Retour la table des matires
ART. 4 : Chaque partie, en acqurant une indpendance apparen-
te, ne peut pourtant pas se sparer dune conscience qui nest elle-
mme quun tout en puissance, inscrit dans le tout en acte.
Cette indpendance que nous venons dessayer dattribuer la
partie en faisant delle une image du tout, rvle aussitt son carac-
tre relatif et ses limites. Car non seulement la perfection de
lindividualit est en ralit le produit dune influence exerce sur
elle par tout lunivers, mais encore elle est ncessairement pense
par une conscience qui, en sparant chaque partie de toutes les au-
tres grce une opration danalyse, ne russit pourtant pas en s-
parer aucune delle-mme.
Cependant ces parties ne sont pas disjointes, puisque cest le
mme sujet qui les pose sparment : elles forment toutes un en-
semble parce quil y a entre elles ce caractre commun dtre appr-
hendes par un esprit identique. Et cest pour cela que tout idalisme
implique lunit dun univers dont le sujet est la fois le centre et
lartisan. Alors lunit du tout se trouve rtablie, mais elle reoit une
forme subjective. Et les termes que nous considrions tout lheure
comme des tres ne nous apparaissent plus que comme des objets de
connaissance. Cest que nous voyons bien alors quil est impossible
de les penser, soit indpendamment les uns des autres, soit indpen-
damment du sujet qui sans doute les contient tous, mais ne peut tenir
leur gard la place du tout quen les accueillant en lui comme des
reprsentations.
On aboutit ainsi cette sorte de paradoxe, cest que la partie,
bien quelle tienne ltre du tout, ne parat possder ltre que lors-
quelle est considre isolment, tandis quau contraire, ds quelle
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 167
est runie toutes les autres parties, elle semble perdre son tre pro-
pre pour acqurir un tre purement [171] reprsent dans la cons-
cience qui la peroit. Mais ce paradoxe doit trouver une explication.
Sans doute on pourrait admettre, comme le soutient lidalisme,
que lunivers ne se distingut pas de la reprsentation elle-mme et
que son unit ft lunit mme de notre conscience. Mais notre
conception ontologique nous oblige dpasser les limites de
lidalisme en attribuant la mme existence au sujet et lobjet. Or
comment pourrait-on appliquer la mme notion dexistence des
termes si diffrents, sinon en raison de leur inclusion commune
lintrieur du mme tout qui les oppose lun lautre, mais en les
enveloppant dans sa propre unit ? Ainsi sexplique cette parfaite
rciprocit qui fait que, si lobjet est pos par un sujet qui le pense,
le sujet lui-mme nest pos que par sa pense, cest--dire par
lobjet mme quil pense. Le caractre relatif de ces deux termes
montre que leur opposition a son origine dans lidentit du mme
tre : ce qui ne porte pourtant aucune atteinte leur htrognit,
sil est vrai que le sujet exprime notre propre participation intrieure
ltre et si lobjet est une donne qui, dans le tout de ltre, est cor-
rlative de cette participation, comme si elle en exprimait la fois
linsuffisance et le complment.
Il y a plus : le sujet de la reprsentation ne peut se penser lui-
mme comme un sujet fini, capable la fois de faire partie de
lunivers et de se le reprsenter quen sinscrivant dans le tout en
acte comme un tout en puissance. De fait notre caractre fini trouve
une double expression dabord dans notre passivit lgard de la
donne et dans la ncessit ensuite pour notre reprsentation de se
dvelopper et de senrichir indfiniment travers la dure. Lors-
quon approfondit par suite ce caractre fini de notre nature, on le
trouve confirm, mieux encore que par les limites de notre corps,
par les caractres propres de notre conscience. Non seulement ltat
de conscience ne nous apparat pas comme se confondant avec la
chose quil nous reprsente, car une perspective sur une chose nest
pas plus identique cette chose quelle ne lui est htrogne, puis-
que la chose est la croise de toutes les perspectives possibles que
lon peut prendre sur elle, mais encore cet tat de conscience ne se
confond pas davantage avec le [172] sujet conscient, qui nest
quune puissance indfiniment renouvele et indfiniment actualise
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 168
par la suite mme de ses tats. Ainsi, pour que le sujet cesst de se
reconnatre comme fini, il faudrait que notre conscience elle-mme
dispart, soit dans la concidence rigoureuse de la chose et de la re-
prsentation, soit dans la concidence rigoureuse de notre activit et
de notre tat. Mais ces observations ont besoin dtre approfondies
davantage.
ART. 5 : Une partie de ltre, nayant jamais de sens que pour une
conscience, est toujours ltre dun phnomne : ce qui permet
dinterprter la distinction entre la reprsentation et son objet.
Reprenons maintenant lide de cette chose particulire dont
nous avions cru tout lheure pouvoir faire un tre en lui accordant
une indpendance prcaire la fois vis--vis des autres choses et
vis--vis du sujet. Nous aurons ralis dans notre argumentation un
progrs remarquable si nous parvenons montrer quelle ne peut
tre quun phnomne. Mais commenons par observer que, dans la
mesure o on regarde les choses comme diffrentes les unes des au-
tres et cherchant se suffire, leur incompltude clate tous les
yeux : cest alors que nous en faisons naturellement des phnomnes
plutt que des tres, des objets de connaissance plutt que des cho-
ses relles. Ds que le multiple se produit, le monde des apparences
nat. On ne voit pas que lon ait jamais pu attribuer la pluralit au
rel, ltre, ni mme la chose en soi ; mais, que la pluralit
sintroduise dans le monde, le rel, ltre et la chose en soi fuient
pour ne laisser subsister que leurs phnomnes. Cependant, la n-
cessit o nous sommes de confrer encore ltre aux phnomnes
eux-mmes et de les considrer comme des pices intgrantes de
lunivers rel nous interdit de rompre tous les liens qui les unissent
ltre, en relguant celui-ci derrire eux : il ny a pas de diffrence
entre ltre et la totalit des phnomnes, condition de joindre
tous les phnomnes donns tous les phnomnes possibles, puisque
notre vie scoule dans le temps et [173] demeure toujours inache-
ve et puisque tout le possible subsiste lui-mme dans ltre au m-
me titre que le ralis.
Or, il est impossible de supposer un phnomne sans supposer du
mme coup une conscience et mme une conscience finie dans la-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 169
quelle il apparat. Une conscience ne participe ltre que par sa
connaissance de ltre, et elle ne connatrait rien si elle ne pouvait
pas tout connatre. Elle ne peut se distinguer du tout et pourtant lui
demeurer unie quen lenveloppant en puissance ; cest pour
lactualiser en elle quelle le divise et le phnomnalise.
Que chaque partie de ltre soit tenue dapparatre
11
Naccordera-t-on pas tout dabord que la reprsentation nest ja-
mais pour nous quune vue imparfaite de lobjet, quelle est suscep-
tible de gagner indfiniment en prcision et en richesse, que, sous
peine de cesser dtre une reprsentation et de se confondre avec son
objet, elle doit garder jusquau bout la possibilit de progresser en-
core, mais quenfin la limite, et en lui attribuant par avance toute
la suite des caractres que notre conscience ne parviendra jamais
dnombrer et puiser, toute diffrence serait abolie entre elle et la
chose quelle reprsente ?
et dtre re-
lie toutes les autres lintrieur dune conscience, cest dj la
marque de son caractre phnomnal. Et on aurait vrifi quelle ne
peut tre lgard du tout quun phnomne si, en sengageant dans
une voie inverse de celle quon vient de suivre, on parvenait ta-
blir que la partie considre dans sa ralit propre ou, si lon veut,
comme chose en soi et dgage de la reprsentation troite que le
sujet parvient sen faire, cesse ncessairement dtre limite et ac-
quiert cette parfaite plnitude qui la rend indiscernable du tout dans
lequel on lavait dabord isole.
Ne trouverait-on pas maintenant dans cette observation une ex-
plication du double caractre dhomognit et dhtrognit que
lanalyse philosophique aussi bien que le bon sens populaire sem-
blent sefforcer dassigner la relation de la chose et de son ide ?
Car, dune part, personne ne renoncera [174] volontiers ce vieil
axiome que le semblable seul peut connatre le semblable, faute de
quoi la connaissance serait illusoire, dpourvue dobjectivit et de
porte, et deviendrait une connaissance qui ne serait la connaissance
de rien ; or, ds que laxiome est admis, il importe peu que lon
considre lide comme tant le reflet du rel, ainsi que le soutien-
nent les matrialistes, ou le rel comme tant la perfection de lide,
11
Cest ce que vrifie le langage, sil est prfrable de parler non point des par-
ties, mais seulement des aspects de ltre.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 170
ainsi que le soutiennent les idalistes. Le monisme vers lequel on
sachemine transforme le conflit de ces deux doctrines en un dbat
de vocabulaire. Mais, dautre part, il ny a point de monisme qui ne
soit tenu dexpliquer la diffrence entre les deux termes dont il par-
vient nous faire ressaisir lunit. Or on reconnatra sans doute
quentre la reprsentation et son objet il y a une diffrence non pas
de nature, mais de degr, que la reprsentation se place demble au
cur de lobjet, mais quelle claire seulement en lui les aspects qui
sont en accord avec notre constitution propre, avec notre nature et
avec nos besoins. La connaissance najouterait rien au rel, elle lui
retrancherait plutt : ou plus exactement elle ne lui donnerait une
physionomie individuelle quen le resserrant dans une treinte qui
nous permette de lapprhender et qui est en mme temps la marque
de nos propres limites. La dilatation infinie de notre connaissance
aboutirait la fois dissoudre notre propre moi et labsorber dans
lobjet auquel il sapplique. Cependant cet objet est encore pour
nous un objet particulier, de telle sorte que, sil nous parat toujours
au del de la reprsentation, il ne saurait en tre distingu que com-
me une reprsentation possible dune reprsentation actuelle quelle
ne cesse denrichir. J usque-l nous ne sortons pas du domaine de la
reprsentation, ni des limites de lidalisme. Seulement supposer la
connaissance acheve, ce serait labolir non pas seulement dans sa
concidence avec son objet, mais dans sa concidence avec le tout
dont on sait bien quil est prsent partout pour soutenir lexistence
de chaque partie qui nest quun nud de relations avec toutes les
autres. De telle sorte que ltre dun objet particulier, si on voulait le
distinguer de ltre de sa reprsentation, se rduirait ltre du tout.
Mais, est-ce accuser encore avec assez de force le contraste [175]
que nous sentons tous entre la fragilit de la connaissance et la
consistance du rel que dtablir entre ces deux termes une simple
diffrence de richesse ? Et ne semble-t-il pas que la connaissance
nest pas une simple partie du rel, mais quelle est par rapport lui
une sorte de virtualit, et quelle garderait ce caractre, mme si elle
pouvait contradictoirement parvenir sachever ? Cest ici prcis-
ment que ressort dans une lumire parfaite lindivisible plnitude
que nous avons antrieurement attribue ltre. Bien que la
connaissance en effet se meuve ncessairement au sein de ltre et
que les aspects quelle y discerne soient des aspects de ltre, il nous
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 171
est impossible de les considrer comme prsents en soi dans ltre
mme, qui semble transcendant leur gard, prcisment parce quil
est le tout o ils sont puiss, cest--dire leur raison commune et non
pas un milieu qui les recle sous une forme distincte. La totalisation
de ces aspects ne rejoindra jamais le tout do ils ont t tirs : elle y
tend seulement. Autrement dit, ce sont des aspects, cest--dire
quils nont de sens qu lintrieur dun spectacle et pour le specta-
teur qui le contemple. Ce qui justifie la formule en apparence para-
doxale quune partie de ltre est ncessairement ltre dun phno-
mne. Mais nul phnomne na dexistence dans le tout que comme
une possibilit quil appartient la conscience de raliser : il est son
uvre et il scroule avec elle.
ART. 6 : Seul le concours de toutes les consciences est capable
dobtenir en chaque point la transformation du phnomne en tre.
On a montr dans larticle prcdent quil ne suffit pas
lindividu de concevoir lobjet comme tant la limite de toute la s-
rie des vues de plus en plus distinctes quil pourrait prendre sur lui
dans une vie infiniment prolonge. Car ces vues gardent, le long de
la srie, la marque de leur origine subjective, et bien que, dans le
terme vers lequel elles tendent, il semble que lon vise la conciden-
ce de lobjet et du sujet, ce ne saurait tre pourtant la concidence
dun objet particulier [176] avec un sujet particulier. Car si cet objet
est en lui-mme infiniment riche et que le sujet ne puisse latteindre
quaprs avoir actualis linfinit de ses propres puissances, on est
bien oblig dadmettre que cette concidence purement idale ferait
clater les limites de tel objet ou de tel sujet.
Cependant, il nous reste encore une tape franchir pour montrer
que lobjet qui se trouve impliqu derrire chaque reprsentation
particulire nest pas un objet particulier, mais ltre total, et que le
sujet qui est suppos par chaque opration de la conscience est lacte
pur et non pas le moi individuel. En fait, lobjet particulier ou le moi
particulier ne peuvent tre dfinis que comme le point o sarrtent,
dans lobjet, lanalyse de ses proprits et, dans le sujet, lexercice
de ses puissances. Cest ici le moment de faire appel la multiplicit
infinie des autres consciences, qui doivent tre toutes capables
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 172
dentrer en rapport avec le mme objet selon des points de vue la
fois diffrents, puisquils expriment loriginalit de chacune delles,
et pourtant concordants, faute de quoi lidentit de lobjet serait
anantie. De mme que le phnomne, ds quil a t isol par la
conscience, implique aussitt une infinit dautres phnomnes avec
lesquels il se trouve li dans le systme de notre exprience, la limi-
tation de notre conscience, qui est la ranon de son originalit, im-
plique aussitt une infinit dautres consciences dont elle se distin-
gue et avec lesquelles pourtant elle communique. Et mme il y a
corrlation entre ces deux formes de la multiplicit. Car, pour que
ltre soit prsent tout entier en chaque point, en demeurant la plus
riche et non pas la plus vide de toutes les notions, il faut dune part
quil rvle en ce point une conscience finie un de ses aspects seu-
lement, car sil lui rvlait leur totalit, cette conscience se confon-
drait avec lui et par consquent disparatrait (or cela oblige chaque
conscience, pour demeurer lie au tout dont elle porte en elle la
puissance, percevoir les autres aspects de ltre comme rpartis en
tous les points de lespace et du temps et faire de tous ces aspects
une synthse subjective dont elle reste le centre, bien quelle en pro-
longe la porte infiniment au del du double horizon spatial et tem-
porel quelle peut embrasser), et il faut dautre part que [177]
linfinit des aspects de ltre quelle a ngligs en chaque point
soient eux-mmes discerns par dautres consciences, sans quoi
ltre total serait suppos, mais non point actualis en ce point. Ain-
si naissent une infinit de synthses subjectives qui, si on pouvait les
superposer, rvleraient la prsence totale, dans chacune de leurs
parties, de cet tre parfaitement un dont elles poursuivaient vaine-
ment le mirage travers lespace et le temps. Toutefois, lespace et
le temps lintrieur desquels chaque tre limit sent si vivement
ses limites, et ne cesse pourtant de les repousser, lui permettent aus-
si dclairer, grce un ensemble de symboles, les oprations int-
rieures par lesquelles il fonde son indpendance, communique avec
le tout o il est plac et sunit lui en participant son essence cra-
trice. La double multiplicit des consciences et des objets ne brise
donc quen apparence lunit de ltre pur : nous dirons plutt
quelle en est le tmoignage. Limpossibilit pour ces deux formes
de la multiplicit dtre isoles, leur rciprocit, la ncessit pour
elles de converger et de se recouvrir, cette aptitude de chaque cons-
cience enfermer en elle le tout subjectivement et de chaque objet
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 173
nourrir une infinit de consciences diffrentes ne dissimulent point
les vritables caractres de ltre : elles en fournissent mieux que
lillustration, savoir la ralisation.
Cette analyse nous permet de dcouvrir lintrieur de ltre pur
et dans leur application la qualit et au concret les principes de la
thorie de la relativit dont certaines consquences universellement
connues concernent les concepts despace et de temps et
linterprtation de leurs rapports. Mais dj on vrifie que la consi-
dration de la relativit pousse jusquau dernier point et le retour
une thorie de ltre absolu sont deux conceptions solidaires.
Dautre part, on se rappelle que, par une voie diffrente, on avait
t conduit antrieurement admettre quune qualit donne nest
pas elle-mme une chose fixe et immuable, mais quelle peut se
transformer pour dautres tres en qualits diffrentes, de telle sorte
que la merveilleuse bigarrure de lunivers pare la totalit de sa sur-
face pour chaque conscience et se retrouve pour toutes les conscien-
ces runies dans chacun des points de cette surface. Nous savons
que si lexprience [178] ne permet pas de confirmer jusquau bout
largument dialectique, cest que nous considrons seulement des
consciences trs voisines les unes des autres, tandis quil faudrait
pouvoir tenir compte de lextrme diffrence des chelles et des
points de vue qui peuvent exister chez tous les tres et mme de
lacuit indfiniment variable et de la nature peut-tre indfiniment
htrogne de tous leurs sens.
La science gnrale du relatif doit tre regarde comme une re-
cherche absolument nouvelle dont nous ne possdons encore que
quelques rudiments : pour la constituer, il faudrait tudier systma-
tiquement la variation totale qui se produit dans la reprsentation
qualitative des choses selon le grossissement et selon lloignement,
les carts assignables entre les perceptions dun mme objet par les
diffrents individus et, si on le pouvait, par les diffrentes espces,
la correspondance entre limage que nous nous faisons de
linfiniment grand et limage que nous nous faisons de linfiniment
petit, les ressources identiques que les uns tirent des objets les plus
diffrents ainsi que les ressources si diffrentes que les autres tirent
du mme objet, enfin le tableau synoptique des diffrents sensibles
auquel on na prt jusquici que certains modes dexpression poti-
ques.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 174
C. LA CONNAISSANCE, OU LA RELATION
ENTRE LA PARTIE ET LE TOUT
Retour la table des matires
ART. 7 : La connaissance poursuit, travers le jeu infini des rela-
tions, la possession du mme tre qui lactualise elle-mme par sa
prsence totale en chaque point.
En montrant que dans lobjet viennent se rejoindre non pas seu-
lement toutes les vues quun sujet fini pourra prendre sur lui, mais
encore toutes les vues que pourront jamais en obtenir tous les sujets
finis, nous avons tabli non seulement que ltre particulier suppose
ltre universel, mais encore quen tant qutre, il ne sen distingue
pas. Pour sassurer de cette identification, il faut comparer ltre
avec la connaissance et nous demander en quoi consiste ltre mme
de [179] la connaissance. Car il semble premire vue que la
connaissance soit un intermdiaire entre ltre auquel elle sapplique
et ltre mme quelle reoit. En fait, cette remarque doit nous clai-
rer. On ne connat que des choses particulires, mais on ne les
connat que dune manire abstraite, cest--dire par la relation.
Comment en serait-il autrement, puisque la connaissance implique
une dualit du sujet et de lobjet, et que laspect particulier quelle
sastreint saisir dans lobjet, incapable de subsister isolment,
semble fuir devant le regard et doit appeler tout autour de lui
lunivers entier pour le soutenir ?
Bien plus, lentendement ne se trouve laise que dans la rela-
tion, qui est lopration caractristique de sa nature, puisque cest
par elle quil remdie indfiniment sa propre finitude en croyant
remdier exclusivement la finitude du phnomne. Ainsi non seu-
lement le particulier implique une relation entre tous les particuliers,
mais encore, si rien ne peut tre vritablement connu que par la rela-
tion, le particulier lui-mme tend se dissoudre dans le rseau des
relations.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 175
Cependant il est de lessence de la relation de poursuivre indfi-
niment ses conqutes, sans pouvoir se refermer sur le tout de mani-
re lenclore. Elle est lie lide de puissance et lide de temps.
Elle est la condition offerte un tre fini pour se distinguer du tout,
mais en y prenant place. Comment y prendrait-il place autrement
quen distinguant dans le tout dautres tres finis comme lui ? Mais
il faut que ces tres lui apparaissent : ils ne sont donc pour lui que
des phnomnes, cest--dire des aspects particuliers du monde qui
ne peuvent subsister que dans une conscience, cest--dire par la re-
lation qui les lie. La connaissance exprime donc bien la totalit de
ltre, mais une totalit en puissance, cette totalit toujours ouverte,
figure par le terme dinfinit, et dont il faut ncessairement admet-
tre la possibilit pour que lindividu reste distinct du tout dans
lopration mme par laquelle il cherche lenvelopper.
Plaons-nous maintenant du ct de ltre et non plus du ct de
la connaissance. Ce terme particulier que nous venons de dissiper
dans le jeu des relations doit pourtant tre considr [180] par nous
comme rel et, dans la ralit qui lui est propre, il surpassera tou-
jours infiniment la connaissance que nous en prendrons. Il est im-
possible den faire une analyse exhaustive : car nous savons que les
influences manes de tous les points de lunivers viennent se re-
joindre en lui. Ce terme, dira-t-on, existe pourtant hic et nunc : mais
cest prcisment pour cela quil est solidaire de tout lespace, que
tout le pass du monde aboutit en lui, que tout lavenir en dpend.
Bien plus, ce nest rien de dire quil est reli tous les autres termes
par des fils infiniment tnus : linfluence exerce par un terme sur
un autre terme, cest, au sens le plus rigoureux de ce mot, la prsen-
ce du premier dans le second, du moins sil est vrai, comme nous le
montrerons, que ltre est indiscernable de lacte mme quil ac-
complit.
Mais alors le monde entier se trouve dans chacune de ses parties.
Et lon ne gagne rien en soutenant quil ny est que partiellement et
que chaque lment du monde se distingue de celui qui agit sur lui,
mais qui agit en mme temps sur tous les autres. Car, puisque ceux-
ci leur tour agissent sur le premier, qui subit ainsi une action qui
vient de partout, il est vident que la ralit de tous les lments du
monde, cest--dire laction quils peuvent exercer, se retrouve en
entier dans chacun deux, tantt directement et tantt indirectement.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 176
Cest mme du rapport entre cette action directe et cette action indi-
recte, cest--dire celle quil accomplit et celle quil subit, ou encore
entre son activit et sa passivit que rsultent les caractres distinc-
tifs de chaque individualit finie. Ce nest donc pas assez daffirmer,
comme on la fait, que chaque tre particulier est un miroir du mon-
de, il faut aller plus loin et soutenir que ltre qui se trouve derrire
chaque phnomne, cest ltre total, mais que la conscience nous
invite en constituer limage dans une sorte de miroir sans bords,
partir du moment o elle en a discern quelque aspect qui, voquant
tous les autres, doit encore tre li avec eux par la relation.
Cependant ltre total qui se trouve prsent derrire le phnom-
ne particulier est bien diffrent de linfini que la connaissance cher-
chait vainement embrasser tout lheure ; il est ce qui donne au
phnomne lui-mme son actualit. [181] Tandis que la connaissan-
ce est une puissance qui nachve jamais de sexercer, et qui ne de-
meure la connaissance qu cette condition, tout phnomne concret
est actuel, et son actualit dpasse lacte par lequel je viens den
prendre conscience, puisque cest au contraire grce cette actualit
que ma puissance intellectuelle est susceptible de passer lacte.
Cette actualit exprime lactualit ternelle du tout auquel le sujet
fini doit demeurer attach afin de pouvoir donner une valeur objec-
tive la suite indfinie des analyses et des synthses par lesquelles il
sefforce de lassimiler.
Limpossibilit pour le sujet de rduire, comme il cherche le
faire, lobjet la relation, la rsistance du concret qui ne se laisse
pas dissoudre par labstraction, quelles que soient sa subtilit et sa
complexit, la ncessit invitable o nous nous trouvons de tendre
les rapports entre des termes, si dpouills quon les suppose, mais
qui donnent cependant au rapport lui-mme sa ralit, et, pour em-
ployer le langage dAristote et de Kant, limpitoyable opposition de
la matire et de la forme attestent la fois limplication, par chacune
des oprations de la connaissance, du tout en acte que lentendement
essaiera vainement dgaler dans un temps indfini grce un en-
semble de liaisons logiques. Mais la grandeur mme de cet effort ne
saurait nous tromper sur sa fragilit ; il ne cessera jamais de nous
apparatre comme une sorte de jeu conventionnel si nous ne le lions
pas fortement dans chacune de ses tapes lintuition immdiate du
concret ; elle seule nous donne le contact avec le rel sans lequel
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 177
notre intelligence tournerait vide. Cest que, comme on la dit, cel-
le-ci qui est le tout en puissance, ne peut sexercer que par la vertu
dun tout en acte ; dans lintervalle qui les spare naissent le temps
et la pense discursive.
ART. 8 : La relation est corrlative dune opration analytique
par laquelle le sujet distingue dans le tout, selon la direction de son
intrt, des parties ou des qualits diffrentes.
Si lanalyse est linstrument par excellence de la connaissance,
cest parce quelle distingue dans le rel des lments [182] qui,
nexistant pas isolment en dehors de la pense, sont une matire
admirable pour toutes les reconstructions que la pense pourra faire
de lunivers ; et ces lments, soit quon les considre sous leur
forme sensible, soit quon les considre sous leur forme conceptuel-
le (qui doivent ncessairement se correspondre comme on le montre-
ra larticle 9), sont prcisment les moyens dont on peut dduire la
nature et le nombre et sans lesquels le fini et linfini ne pourraient
pas communiquer. Mais dautre part, lanalyse peut tre pousse
aussi loin quon le voudra, on sait quelle ne peut pas puiser
labondance infinie du rel en chaque point.
Diviser le tout, cest y reconnatre des parties, et lanalyser, cest
proprement y reconnatre des qualits ; mais la partie et la qualit
nont de ralit que par leur contraste mme, et elles tiennent toutes
deux leur existence du tout o on les a dcouvertes. La partie est un
faisceau de qualits : lanalyse peut le distendre de manire dve-
lopper devant nos yeux dans lespace et dans le temps toute la ri-
chesse du monde, car elle ne multiplie les parties quen apparence et
comme supports des qualits. Le mme faisceau se trouve resserr
par lintuition en une sorte dunit indivisible, mais dune surabon-
dance infinie et qui abolit en tout lieu la limitation mme de la par-
tie.
la relation il faut accorder ltre, et ltre quon lui accorde est
prcisment ltre de la reprsentation. Lapparition de la relation
est corrlative de limperfection de toute analyse. Car si nous pou-
vions puiser dun seul coup lanalyse dun terme particulier quel-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 178
conque, nous naurions plus besoin de le lier avec dautres, ni de lier
ses qualits entre elles. Nous dcouvririons immdiatement en lui la
totalit du rel.
Lopposition de la qualit et de la partie est un tmoignage de la
distinction entre ltre et la reprsentation en mme temps que de
leur solidarit. La partie ne possde ltre que par linfinit actuelle
quelle recle : mais elle ne serait pas une partie et ne se distingue-
rait pas des autres parties, ni du sujet, si son analyse pouvait tre
poursuivie jusquau bout. Et mme cette analyse ne commencerait
jamais. Car lanalyse est une opration qui permet notre personna-
lit de se dtacher de lunivers : pour se constituer, il faut que cette
personnalit [183] cesse dtre absorbe par le tout, quelle y distin-
gue ce qui lintresse et, par consquent, quelle sinterrompe en un
point donn dans une analyse dont le mouvement est en principe
indfini. Ainsi se constitue du mme coup pour nous le phnomne,
dont le caractre objectif vient de ce quil enveloppe une vrit
beaucoup plus riche que nous ne faisons queffleurer. Mais cette
opration analytique ntait possible que si nous avions notre dis-
position un temps pour la poursuivre et un espace pour assurer, dans
chacune des tapes de lanalyse, lactualit du tout qui se disperse-
rait autrement dans la suite dun dveloppement temporel. Le sujet
se trouve donc dans lobligation de percevoir chaque instant dans
lespace, sous la forme dun ensemble de phnomnes bien lis, une
image du tout que lanalyse stait efforce de dissoudre en chaque
point.
D. LE TOUT COMME ACTE
ET LE TOUT COMME SPECTACLE
Retour la table des matires
ART. 9 : Le tout pourra tre saisi de deux manires, soit par une
synthse discursive indfiniment poursuivie, soit en chaque point
par un extrme approfondissement de la conscience de soi.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 179
La multiplicit infinie des sujets, tant corrlative de lapparition
dun seul sujet fini, permet sans doute de retrouver, par la varit
des perspectives sous lesquelles ils considrent chaque objet, la pr-
sence du tout lintrieur de celui-ci. Mais chaque sujet est lui-
mme pour son propre compte oblig de distinguer entre le tout o il
prend place, et dont il nactualise chaque instant quun aspect, et le
tout quil cherche envelopper et qui ds lors devient ncessaire-
ment un systme de relations. Sans le second, le premier semblerait
born ; sans le premier, le second semblerait abstrait. Leur opposi-
tion et leur solidarit expriment la possibilit pour la conscience
dun sujet fini de sunir ltre pur et den raliser lide.
Il est donc galement vrai de dire du tout quil contient les par-
ties et de chaque partie quelle contient le tout ; la [184] dfinition
mme du tout semble indiquer quil ne peut se raliser que par les
parties qui le forment, et pourtant, si lon fait abstraction de la ma-
nire dont la partie est apprhende par le sujet et si on la considre
en elle-mme, cest le tout qui lui donne son tre propre.
On aboutit par consquent admettre que dans ltre il ny a pas
de distinction entre la partie et le tout, et que cest linadquation
entre la connaissance et ltre qui fait apparatre les parties. Mais,
puisque la connaissance est intrieure ltre et quelle se confon-
drait avec ltre si elle tait pousse jusqu son point de perfection,
il ne faut pas stonner quelle attende une rencontre avec ltre soit,
dans chaque terme, dune analyse acheve, soit, dans lensemble de
tous les termes, de lachvement du systme de relations dans lequel
on les fera entrer. Et cette double rencontre apparatrait comme n-
cessaire si lon voulait voir que linfluence mutuelle quexercent les
uns sur les autres tous les points de lunivers, et que la science
sefforce de schmatiser, se confond avec la prsence en chaque
point dune action qui vient de partout, cest--dire avec ltre total
(du moins en acceptant que ltre ne puisse se distinguer de
lopration mme quil accomplit).
La relation est le contraire de ltre, comme linsuffisance est le
contraire de la suffisance ; mais elle est un appel vers ltre, et cet
appel participe ltre lui aussi. Elle exprime leffort par lequel la
conscience, aprs stre reconnue elle-mme comme le tout en puis-
sance, essaie de sactualiser. Nous savons quelle ne le peut quavec
le concours de toutes les autres consciences : mais le tout quelle
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 180
cherche, cest lacte mme qui lanime et avec lequel elle vise ob-
tenir, en se le reprsentant comme une fin, une union de plus en plus
intime. De ce tout, le mot de relation exprime mal la nature, puis-
quil voque des termes qui tiennent de lui leur existence mme. Il
vaudrait mieux employer pour le dsigner le mot de position, en
marquant avec force quil sagirait dune position tout intrieure
elle-mme et dont le caractre propre serait non pas dtre pose,
mais de se poser.
Nous avons donc affaire une double ide de la totalit, premi-
rement une totalit en quelque sorte abstraite et indfinie qui ne
reoit un caractre de ralit que par lactualit [185] de chacune de
ses parties, deuximement une totalit concrte prsente en chaque
point, mais qui ne peut tre apprhende par la connaissance discur-
sive que grce une analyse qui nous rejette vers la totalit abstrai-
te.
Tous les degrs de la connaissance doivent tre situs entre ces
deux extrmes, car je ne puis comprendre un monde dont je suis
moi-mme un lment quen essayant soit de le reconstruire synth-
tiquement, soit de le pntrer directement jusqu son intimit la
plus cache : la premire mthode suppose lusage de tous les artifi-
ces de lentendement et la deuxime un extrme approfondissement
de la conscience de soi ; mais il y a des intermdiaires par o elles
se rejoignent, comme le font lesprit de finesse et lesprit de gom-
trie.
ART. 10 : Lobjet se prsente sous la forme dune donne pour
accuser les limites de lopration intrieure ltre par laquelle
lesprit entreprend de sgaler celui-ci.
Si lobjet particulier nous semble plus prs de ltre que
lopration par laquelle on le pense, qui est pourtant intrieure
ltre par son essence et infinie par sa puissance dapplication, cest
parce que lobjet possde en lui-mme une plnitude concrte et in-
dividualise, tandis que lopration ne tient son infinit que de son
inachvement. Le premier est donn dans le prsent, la seconde doit
se renouveler dans la dure. Le premier est au del de la conscience
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 181
individuelle qui, dabord passive son gard, lui oppose pour le
vaincre la subtilit dune analyse qui lentame sans le rduire : il ne
semble limit que pour paratre la mesure de lindividu dans un
univers o celui-ci projette partout ses propres limites. La seconde
est une forme dactivit qui semble propre lindividu, et dont
lextension ne parat sans limites que parce quelle enveloppe une
pure possibilit.
On dira peut-tre que lobjet particulier nous reprsente mieux
linfinit dans lordre de la comprhension et lopration intellec-
tuelle linfinit dans lordre de lextension. Mais cette vue risquerait
de nous induire en erreur. Car lobjet particulier ne peut apparatre
au sujet de la connaissance [186] que comme un phnomne, tandis
que le sujet participe ltre du dedans prcisment par lacte qui
lui permet de penser tout le reste : cet acte prsente un caractre
dintimit, de distinction, dadquation qui exige quon modle sur
lui le rel, au lieu de faire le contraire.
Cest la destine dun tre fini de ne pouvoir saisir le concret que
dans le particulier, et de ne pouvoir embrasser le tout que dans une
treinte subjective impossible refermer. Il y a l deux expressions
diffrentes dune mme impuissance de lentendement. Cependant
la puissance et limpuissance vont ici de pair. Cest parce que
lentendement est ingal au tout quil entreprend de lassimiler. Il
faut donc que par sa propre nature il ne lui soit pas tranger. Or il ne
peut y avoir de solidarit parfaite ni de distinction prcise entre la
partie et le tout que si la partie constitue son tre propre en laissant
sexercer en elle la mme activit qui gouverne le tout, et dont le
dveloppement, pour tre actualis, devrait tre pouss linfini :
mais cela nest pas possible, sans quoi la partie viendrait se confon-
dre avec le tout, et cela doit ltre pourtant de quelque manire pour
que linsertion de la partie dans le tout soit lgitime ; il ne reste donc
quune solution, cest que le tout, bien quhomogne lactivit de
la pense, ne cesse de la dborder en chaque point et pourtant den
tre insparable. Ds lors, si la partie ne peut saisir le tout lui-mme
que dans ses parties, du moins faut-il quen faisant delle-mme un
sujet, elle puisse se dfinir comme une puissance infinie, qui, vo-
quant sans cesse de nouvelles parties, appelle corrlativement la
prsence de linfini en acte lintrieur de chacune delles, bien
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 182
quen les pensant comme des parties, elle en fasse autant dobjets,
cest--dire les apprhende seulement comme des phnomnes.
ART. 11 : Les choses particulires sont en un sens telles quon les
voit, puisque derrire elles il ny a que le tout dont elles expriment
un aspect appropri notre nature.
La remarque prcdente recevra une confirmation dans une sorte
de tmoignage emprunt au sens commun. Car [187] lorsque nous
voulons que derrire la connaissance il y ait lobjet, nous entendons
par l plutt un objet en gnral que tel objet qui ressemblerait la
connaissance. Cependant il y a homognit entre la connaissance et
le rel en ce sens que la connaissance est situe lintrieur du rel
et fragmente lunit de lunivers de manire lapproprier la natu-
re dun tre fini. Les objets particuliers sont indiscernables de la
connaissance que nous en prenons : pour un tre diffrent de nous,
les lignes de dmarcation qui les sparent et la systmatisation qui
les runit seraient tout autres. Par l le ralisme populaire trouve une
sorte de fondement, car les choses que lon voit sont bien telles
quon les voit. Derrire elles, il y a ce quon nen connat pas encore
qui forme avec ce quon en connat le tout dans lequel tous les tres
puisent les lments du spectacle quils se donnent en regardant le
monde. Rien ne peut confrer plus de valeur ni plus de porte la
connaissance, car elle est une analyse imparfaite du tout, une vue
borne que nous avons sur lui chaque instant. Ainsi on sexplique
que ces vues puissent concorder ; car cest sur le mme tout quelles
sont prises. Chacune porte en elle une sorte dinachvement, et m-
me un inachvement toujours nouveau. Car un tre qui vit dans le
temps est toujours multiple et divis avec lui-mme. Mais cest le
tout qui fournit notre tre fugitif avec une inlassable fcondit la
matire de toutes ses connaissances et les ressources de tous ses ac-
tes. Cest donc le tout le seul objet qui se trouve derrire les repr-
sentations particulires. Toutefois cette conception se heurte deux
objections qui nous obligent lui donner une forme plus prcise : la
premire, cest que, dans lindtermination du tout, lanalyse semble
arbitraire et capable dvoquer nimporte o nimporte quel objet, de
telle sorte que lon ne voit plus comment lexprience du monde
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 183
peut former un systme ; la seconde, lie la prcdente, cest que
cette analyse diffrencie suppose elle-mme des individus diff-
rents, mais dont il faut que les diffrences se correspondent de quel-
que manire. A la premire objection, on rpondra que cest lunit
du tout qui nous oblige, aprs avoir distingu en lui une partie quel-
conque, dvoquer toutes les autres selon un ordre rgl afin que
lunit du tout ne soit [188] pas rompue, et la seconde que la diff-
rence entre les individus najoute rien la diffrence entre les par-
ties, sinon pour faire de chaque partie le centre dune perspective o
toutes les autres se trouvent enveloppes et que laccord entre les
individus drive des conditions gnrales qui font de chacun deux
un individu avant den faire tel individu.
Il est remarquable maintenant que, malgr tous les dmentis de
lexprience, nous nous obstinions considrer comme le caractre
essentiel de lobjet la permanence ou la stabilit. Ainsi nous nous
croyons dautant plus assurs datteindre lobjet que nous nous trou-
vons en prsence dun terme qui varie moins ; et mme nous som-
mes disposs quelquefois nous contenter de certaines approxima-
tions fort grossires, comme de la duret des corps solides, o nous
voyons une meilleure image de ltre que dans la fluidit de lair ou
de la fume, comme des schmas conceptuels de la science, que
lentendement sait substituer avec tant dadresse la diversit ind-
finie des donnes sensibles. Mais nous savons bien que la stabilit
parfaite ne peut appartenir quau tout dans lequel les parties, cest--
dire les phnomnes, ne cessent ternellement de natre et de mou-
rir : et les lois de lunivers ne sont rien de plus que lexpression de
la prsence du mme tout la diversit fuyante des phnomnes
12
12
Une difficult se prsente pourtant en ce qui concerne lexistence des essences
particulires. Mais on remarquera que cette existence peut tre conteste la
fois par ceux qui, rejetant notre thse sur luniversalit de ltre, les opposent
ltre et, en les posant, les posent comme irrelles, et par ceux qui ne veulent
pas quil y ait dintermdiaire entre le tout et lindividu. Si du moins les es-
sences ne sont pas entranes comme les phnomnes par le devenir, ne faut-il
pas les invoquer de prfrence au tout pour soutenir les phnomnes, puisque
le tout qui fonde leur appartenance au mme tre ne peut pas suffire expli-
quer leur diversit dans ltre ? Toutefois, on noubliera pas que le privilge
de lessence sur le phnomne vient de ce quelle a une intimit, quelle est
une pense et non point seulement un objet de pense, mais la pense par la-
quelle la chose se fait plutt que la pense par laquelle nous la pensons et que
.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 184
[189]
ART. 12 : La conscience est mdiatrice en chaque point entre
lexistence actuelle du tout et lexistence phnomnale de la partie.
En cherchant quelle est la forme dexistence qui appartient la
partie, on na pu lui attribuer que celle mme qui appartient au tout.
Mais on a exprim cette sorte dinclusion du tout dans la partie par
deux formules en apparence contradictoires : la premire demandait
la partie de chercher comme le tout sa suffisance en elle-mme ; la
seconde faisait de la partie une sorte de nud de tous les chemins
provenant de toutes les autres parties.
Cependant aucun objet ne peut tre regard comme se suffisant
lui-mme, tant quil apparat dans une conscience ; de mme cette
conscience ne peut pas non plus articuler lobjet peru avec tous les
autres objets, mais seulement avec les objets voisins et selon son
intrt immdiat ou prochain. Cette insuffisance du phnomne et
cette limitation des relations dans lesquelles la conscience le fait en-
trer suggrent que les deux formules contradictoires par lesquelles
on voulait dfinir lexistence de la partie se rejoindraient si on les
poussait jusqu la limite, et que sa suffisance plnire se confon-
drait alors avec la totalit actuelle des relations qui la runissent
lunivers entier.
De plus, les relations que le sujet conscient soutient avec un objet
quelconque permettent dimaginer en les transposant les relations
que celui-ci pourrait avoir avec tous les autres si on le prenait lui-
mme dans le monde comme un repre privilgi. Ainsi il pourrait
acqurir comme partie une suffisance relative prcisment en ces-
sant dexister pour un autre sans tre confondu pourtant encore avec
nous tentons sans y russir de faire concider avec elle. Lacte constitutif de
lessence est une participation du tout, au lieu que le phnomne nen est
quun aspect objectif. Et notre conscience a seulement de la parent avec
lessence, sans tre elle-mme une essence comme lme de Platon avec
lide : car elle se dfinit, par la libert qui fait delle un tre en puissance,
ambigu, incarn dans une situation et qui nachve jamais de saccomplir.
Lme engage dans le temps et toujours aux prises avec les phnomnes ne
peut avoir dautre fin que de devenir sa propre essence.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 185
le tout et par suite en devenant une existence pour soi, cest--dire
une conscience dans laquelle tous les autres termes recevraient une
fois de plus une forme subjective et phnomnale. En ralit, la
conscience ne peut accorder la partie une vritable [190] indpen-
dance quen lui accordant la forme dindpendance dont elle jouit
elle-mme. Alors seulement la partie cesse dtre une reprsentation
solidaire de toutes les autres pour devenir un sujet qui se reprsente
tout le reste, cest--dire qui, en demeurant intrieur lui-mme,
sefforce dgaler le tout et se considre comme lui tant en droit
coextensif.
Inversement nos propres limites ne peuvent devenir manifestes
qu condition quen mme temps que nous enveloppons lunivers
par la reprsentation nous soyons aussi envelopps nous-mmes
dans lunivers : ce qui nest possible que si chacun des termes que
nous nous reprsentons est capable dacqurir une forme dexistence
comparable la ntre, et de constituer par consquent un repre par
rapport auquel tous les autres termes, et nous-mmes parmi eux, ob-
tiendront leur tour une place originale dans une perspective qui lui
est propre. Cest dire que tout objet doit tre apte devenir un sujet
capable dembrasser la totalit des choses lintrieur de sa cons-
cience individuelle : il en rsulte entre lobjet et le sujet une rcipro-
cit merveilleuse ; car, le mme objet qui nous apparaissait, tant
quil ntait quune reprsentation, comme un carrefour de toutes les
liaisons qui unissent entre eux tous les termes finis, se convertit en
un principe qui les produit, ds quon en fait un centre de reprsen-
tations rel ou possible. Et la limitation qui semblait lui appartenir
en propre, quand on ne voyait en lui quune chose, devient, lgard
de sa nouvelle fonction de sujet, la limitation du monde quil se re-
prsente et quil ne cesse de dpasser.
Que lon soit ainsi conduit considrer chaque partie de
lunivers comme ne pouvant exister par elle-mme quen devenant
une conscience, cela pourrait nous conduire dune certaine manire
vers une conception dallure monadologique. Mais, bien que cette
conception exprime avec clart comment le mme tre est la fois
intrieur lui-mme et au tout, comment il peut dcouvrir, grce
lintuition de lui-mme, la mme abondance concrte quil retrouve,
grce la pense discursive, dans le spectacle de lunivers qualifi,
on peut craindre quelle paraisse laisser les diffrentes consciences
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 186
dans un certain tat disolement. De fait, celles-ci [191] ne commu-
niquent point entre elles directement, mais seulement par le principe
identique qui fonde leur ralit. Et ds lors, il ne faut pas stonner
quelles puissent sentendre, soit par la contemplation dun spectacle
appropri en chacune delles au point de vue original sous lequel
elle regarde le tout, soit par cette union plus troite que lamour r-
alise entre elles et qui, tant le seul moyen dont elles disposent pour
dpasser la connaissance des phnomnes et leur propre limite sub-
jective, pose la fois en elles et hors delles une forme dexistence
comparable la leur, et les intriorise lune lautre en les rappro-
chant la fois de la source commune de leur tre.
Mais de toute manire il importe de retenir que ce serait une
double idoltrie de vouloir distinguer le moi du faisceau de relations
quil soutient avec la totalit des choses, et de vouloir distinguer
ltre total de ce faisceau infini de sujets la fois indpendants et
interdpendants auxquels il ne cesse de donner une puissance ind-
finie daccroissement et de communication mutuelle.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 187
[193]
DE LTRE
Troisime partie
LINTRIORIT
DE LTRE
Retour la table des matires
[194]
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 188
[195]
Troisime partie.
Lintriorit de ltre
Chapitre VII
DE LTRE DU MOI
A. LA PENSE MDIATRICE
ENTRE LE MOI ET LTRE
Retour la table des matires
ART. 1 : Le moi est la fois une partie de ltre et le facteur de sa
division en parties.
Nous voici parvenus au point le plus dlicat de notre analyse.
Ltre avait t dfini dans la premire partie comme lobjet univer-
sel (chapitre I, art. 2) non point, il est vrai, au sens o un objet
soppose un sujet, mais au sens o ltre est lui-mme le terme de
toute affirmation possible et surmonte par consquent la distinction
du sujet et de lobjet : il ntait encore pour nous que lunit dune
totalit. Pourtant nous avons montr, dans la deuxime partie, que
cette totalit nest pas une somme de parties, mais quelle est lunit
dun acte susceptible dtre particip et, par cette participation m-
me, de faire apparatre dans ltre une multiplicit de parties. Ainsi,
cest la subjectivit de la conscience qui nous rend intrieur ltre :
cest delle aussi que lobjectivit est drive, puisquil ny a dobjet
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 189
que pour une conscience qui le pose. De l on peut tirer un privilge
de la subjectivit sur lobjectivit ds que lon cherche atteindre
ltre sa racine mme. Il est alors ncessairement intrieur lui-
mme. Et cette intriorit se montrera nous sous un triple aspect,
dabord dans le moi o nous en avons une sorte dexprience imm-
diate, ensuite dans lide de ltre o elle dpasse le moi sans pro-
duire pourtant dextriorit, mais de telle sorte que le moi lui est in-
trieur plutt quelle nest intrieure au moi, enfin dans la prsence
de ltre par [196] laquelle il communique au moi sa propre intrio-
rit, au lieu de la recevoir de lui, et qui est le point o lobjectivit et
la subjectivit ne se distinguent plus. Ainsi, cest ltre du moi, qui
nous permet, en vertu de lunivocit, de pntrer dans ltre du tout :
mais, en disant que ltre est une ide qui contient en elle le moi
plutt encore que le moi ne la contient, nous dcouvrons le cercle o
lide de ltre et ltre de lide se rejoignent, et qui achve de jus-
tifier cette primaut de ltre dont nous tions dabord partis, en la
rduisant une prsence ternelle au del de laquelle on ne remonte
plus. Ce qui montre que la mtaphysique de ltre se prolonge dans
une logique et spanouit dans une psychologie.
On pourrait penser quil est inutile dtudier part les rapports de
ltre et du moi, car premirement, si le moi doit se considrer lui-
mme comme une partie du tout, ce que nous avons dit dans le cha-
pitre prcdent de limplication du tout dans chaque partie devrait
sappliquer aussi au moi. Or ne faut-il pas concevoir le moi comme
ntant par rapport au tout quune partie, puisque le moi possde des
dterminations qui le limitent, puisquon ne peut le poser que par
son opposition au non-moi, et puisquenfin il y a dans le moi une
aspiration qui, soit quelle puisse tre remplie, soit quelle ne le
puisse pas, suppose un milieu dans lequel elle salimente ou qui lui
fait obstacle ?
En second lieu, et si on voulait allguer que le moi possde par
rapport toutes les autres parties de lunivers une originalit ind-
niable, nest-il pas vrai que cette originalit a t marque avec une
force suffisante, puisque lapparition des parties nous a paru corrla-
tive de celle du moi et que, si lunivers souvre devant lui avec une
abondance infinie dans laquelle il ne cesse de puiser la matire de sa
connaissance, du moins le moi ne peut transformer cet univers en
reprsentation quen y distinguant des objets limits comme lui, et
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 190
qui ne peuvent prendre un sens pour lui quen devenant ses yeux
des phnomnes ?
Mais alors prcisment nous sommes contraints dexpliquer quel-
le est lessence propre de ce moi qui est la fois une partie du mon-
de et le facteur de sa division en parties, qui est suprieur aux ph-
nomnes, puisquil faut quil soit pos pour [197] que les phnom-
nes deviennent possibles et qui, sil est envelopp dans la totalit du
rel, enveloppe son tour celle-ci dans lacte de la connaissance. En
montrant dans le chapitre prcdent la solidarit entre les parties et
le tout, nous avons suppos que le mme moi, en se distinguant lui-
mme du tout, distingue aussi dans le tout des parties qui lui sont
extrieures. Mais ces deux oprations, bien quinsparables lune de
lautre, nont pas la mme signification et ne se produisent pas de la
mme manire. Car la premire est une opration intrieure ltre
par laquelle le moi constitue ltre qui lui est propre. Au lieu que la
seconde est une opration qui fait surgir de ltre une multiplicit
daspects en rapport avec les puissances du moi, au moment o,
pour sactualiser, elles reoivent dailleurs ce qui leur manque.
Quant la connexion qui les unit, elle apparat avec une particulire
clart, si lon songe que dire du moi quil est une partie du tout, ce
nest pas dire quil est un objet parmi dautres objets, mais quil se
cre lui-mme par une participation au tout qui emprunte au tout sa
substance. Mais pour que cette participation ne soit rien de plus
quune participation, cest--dire quelle ne sachve jamais, il faut
que le moi ait des limites, et par consquent quil soit en mme
temps un objet parmi les objets ou quil ait un corps. Or il semble
impossible au sujet, partir du moment o il a dcouvert son tre
propre, de ne pas ladopter comme un repre par rapport auquel il
jugera de ltre en gnral. Et comme il ne peut faire que sa propre
ralit soit rien de plus quune forme particulire et limite de la r-
alit totale, il sattache lide de cette particularit et de cette limi-
tation, de telle sorte que sa propre existence devient une existence
relative et imparfaite dont dpend pourtant lexistence de tous les
objets de la pense. Alors ltre lui-mme est un immense objet qui,
par un vritable renversement, recevant du moi ce quil lui a prt,
se trouvera abaiss au-dessous de lui ; il cessera dtre le corps pour
devenir lombre dune ombre. Cest cette consquence que
lidalisme a abouti : il y a l une illusion tenace et pour ainsi dire
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 191
ncessaire qui semble insparable du tmoignage immdiat de la
conscience. On ne pourra la dissiper quen sattachant au principe de
lunivocit et en soumettant [198] une analyse critique rigoureuse
largument cartsien je pense, donc je suis , ainsi que la concep-
tion kantienne du sujet de la connaissance.
ART. 2 : Largument je pense, donc je suis inscrit la pense
dans ltre, et non pas ltre dans la pense.
Les esprits les moins prvenus sont prts reconnatre que si, en
disant je pense , Descartes apprhende du mme coup sa propre
existence, cela ne signifie pas que lexistence en gnral soit post-
rieure la pense et fonde par elle, mais seulement que cest dans
sa propre pense quil saisit indubitablement la premire rvlation
de lexistence. Or sil y a identit entre sa pense et ltre de sa pen-
se, cest parce que, comme nous lavons toujours soutenu, ltre
nest pas un caractre spar. De plus, que lexistence dborde au
moins en droit la sphre de sa propre pense, cest ce qui apparat,
comme on le sait, non pas seulement dans le dveloppement de la
doctrine lorsque Descartes attribue lexistence la fois ltendue
et Dieu, mais dans une remarque explicite par laquelle, restrei-
gnant la porte quil faut accorder la primaut du moi pensant, il
reconnat lui-mme que le doute na point aboli certaines notions
primitives parmi lesquelles il cite la notion mme de ltre.
Il ne suffit pas maintenant dobserver que cette notion est pure-
ment abstraite et problmatique jusquau moment o lexprience
concrte de ma propre pense vient lui donner un caractre de rali-
t. Sans allguer encore cet argument quune notion, mme abstrai-
te, doit possder ltre son tour et par consquent supposer le tout
dont elle se dtache comme un aspect, sans prtendre mme, comme
on le montrera dans le chapitre suivant, quil ny a aucune distinc-
tion entre lide de ltre et ltre actuel (ce qui constituera plus tard
pour Descartes lui-mme le fondement de largument ontologique,
et ce qui justifiera la mthode de lEthique), il suffira dobserver que
la force de la preuve je pense, donc je suis provient non pas de la
subsomption de la pense sous lide abstraite de ltre, mais de son
inscription immdiate et ncessaire lintrieur de ltre concret.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 192
[199]
On ne peut concevoir le progrs insparable de ce clbre raison-
nement, et qui est marqu assez clairement par le donc introductif de
la conclusion, que comme lacte par lequel, aussitt que jai pris
conscience du moi pensant, je reconnais que, malgr son caractre
limit, il ne peut pas tre un simple fantme, mais quil adhre
ltre absolu dont il est la premire forme saisissable. Sans doute il
est vrai que Descartes a rapproch troitement les deux propositions
je pense, je suis au point dabolir parfois la conjonction qui les
liait, mais qui aussi les sparait. Cependant ctait afin de mieux r-
pondre ceux qui voulaient confondre son argument avec un syllo-
gisme. Et contre tous ceux-l on a encore raison de soutenir que cet
argument dveloppe une intuition, savoir lintuition de la prsence
de mon tre pensant dans ltre total. L o il semble que cest par
une analyse de ltre que je dcouvre ltre du moi, il conviendrait
plutt de dire que cest par lexprience du moi que je dcouvre le
tout de ltre dont le moi fait partie. Au contraire, si lon avait affai-
re un syllogisme, le moi se trouverait plac dans le genre de ltre
abstrait, et la connaissance nobtiendrait aucun enrichissement rel.
La vigueur, et, si lon peut dire, lternelle jeunesse de la preuve
cartsienne viennent de ce que, au lieu de lier ltre le sujet de tou-
te pense en gnral, ce qui naurait pas permis de comprendre la
prfrence accorde la pense sur toutes les autres dterminations
de ltre (puisquune pense qui nest pas la mienne ne peut tre
pour moi quun objet de pense), Descartes a senti quil fallait partir
de sa propre pense, cest--dire du seul terme dont on ait une exp-
rience intime et directe, et quon obtenait en elle le contact ou la
possession de ltre lui-mme. Contact et possession qui se recrent
indfiniment, puisque notre pense est une activit qui ne cesse de
se renouveler, qui prouvent une homognit certaine entre ltre et
la pense, et qui rendent notre pense comptente pour la connais-
sance de ltre, puisquelle est tre elle-mme. Seule mon intriorit
mon tre propre, cest--dire ma pense, pouvait massurer de mon
intriorit ltre pur : mais au moment o je perois les limites de
ma pense, je ne conois pas pour cela les limites de ltre auquel
elle participe. Descartes, en affirmant [200] un tel principe, montrait
prcisment quel point il tait loign de lidalisme subjectif.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 193
Il suffit ici davoir montr que le privilge de ma pense, cest de
me rvler intuitivement et pour la premire fois ltre du monde
indivisible de son tre propre. Le lecteur attentif de Descartes sait
bien que sa proccupation essentielle, et pour ainsi dire dramatique,
est de dcouvrir un terme qui lui permette de sassujettir dans ltre.
De tous les termes quil aurait pu choisir, la pense, parce quelle a
seule lexprience immdiate delle-mme, possde exclusivement
ce privilge. Mais elle reoit de ltre sa force et sa solidit, comme
ltre reoit delle la dtermination qui nous le rvle. Il y a en lui
dautres dterminations, et elles tiennent toutes de la pense la lu-
mire qui les claire ; si celle-ci est coextensive ltre, cest ltre
qui lengendre ; il faut quen lui elle se distingue de lui pour sy ap-
pliquer et chercher lembrasser. Mais personne ne consentira
croire quen disant je pense, donc je suis , Descartes ait t plus
soucieux de confrer lexistence le caractre de la pense qu la
pense le caractre de lexistence.
La porte ontologique de largument apparatra mieux encore si
lon songe que Descartes na pas limit la valeur de lexistence qui
convenait la pense. Et sil distinguait trois sortes dexistences :
objective, formelle et minente, il attribuait au moi une existence
formelle, dans un sens tout diffrent de celui que Kant donnait ce
mot, et qui lopposait lexistence minente par limperfection du
terme auquel on lappliquait, mais non par son rang infrieur dans
lordre de la modalit.
ART. 3 : Le moi lui-mme ne peut tre pos que par une limitation
de la pense en gnral qui implique lapparition de laffectivit.
Il est beaucoup plus facile, en disant je pense , de poser la
pense en gnral que de limiter exactement ma pense particulire.
Sans doute on dira que cest moi qui pense. Mais, comme le deman-
dait Descartes, quel est ce moi qui pense et dont toute lessence est
de penser ? Il ne se confond point [201] avec ltat prsent de sa
pense : il se distingue de son objet momentan. L o lon pose la
pense, peut-on faire autrement que de la poser dans son indtermi-
nation et son infinit, si lon considre le champ de son application,
et dans son indivisible totalit, si lon considre en chaque point
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 194
lactualit de son essence ? Pour que lon puisse penser quelque
chose, il faut que lon puisse tout penser : il nest rien que la lumire
ne puisse clairer, et les diffrences quelle nous rvle dans les
choses ne proviennent pas delle, mais de la manire dont elle est
rpartie ou retenue. En disant ma pense , jaccuse ce caractre
dintriorit parfaite qui est insparable de toute pense : elle est
lintimit, la subjectivit par soi, une sorte de prsence de ltre
lui-mme.
Lacte par lequel je participe une pense qui me dpasse fait, il
est vrai, de cette pense ma pense ; or je sais bien que mon moi,
bien quil soit uni cette pense tout entire, la limite. De mme que
la pense tait une dtermination de ltre, et non inversement, le
moi est aussi une dtermination de la pense, et non point le contrai-
re. On dira peut-tre quen saisissant lexistence dans lacte de la
pense, en refusant de disjoindre lexistence et la pense dans la
conscience du moi pensant, Descartes a rendu dcisivement
lexistence immanente et la resserre dans les limites de la cons-
cience, au moins en ce qui concerne laffirmation initiale qui
lapprhende. Et pourtant il faudrait sur ce point encore viter une
mprise essentielle : quand Descartes disait je suis pensant , il
entendait beaucoup moins faire de lexistence lobjet de sa pense
que de sa pense la dtermination et la rvlation de son existence ;
car, bien quil y ait une sorte de rciprocit entre la pense et
lexistence de la pense, ce sont deux actes diffrents de dire : je
pense lide de mon existence, et de dire : je vois clairement par ma
pense que, si je ntais pas, je ne penserais pas. Le premier acte est
sans doute la condition du second, mais si on sarrte au premier,
comme le fait lidalisme, ce nest plus quune affirmation sans for-
ce et sans efficacit qui, au lieu de fonder la pense ainsi quon
lattendait, extnue lexistence en la rduisant un mode de cette
pense quelle tait pourtant destine soutenir.
[202]
Sil est vident que ltre total est immanent lui-mme, et si
chaque terme particulier se confond en droit avec sa propre existen-
ce prcisment parce quil est le point de croisement de linfinit des
influences qui viennent de partout cest--dire parce que la totali-
t de ltre est actuellement prsente en lui il est vident aussi
que ce terme particulier, si nous le considrons avec ses limites et si
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 195
nous le distinguons de tous les autres, ne sera plus quun phnomne
et que ltre, cest--dire le tout dont on la dtach, aura par rapport
lui un caractre transcendant. Il faut donc la fois poser demble
avec mon tre pensant la totalit de ltre, et faire du moi un terme
particulier, cest--dire un phnomne qui, bien quil soit le moyen
par lequel ltre se manifeste, est infiniment surpass par lui ; cest
dire quil y a une ambigut du moi, qui est la fois un acte de pen-
se et un objet de pense, mais qui ne peut se rduire cet acte de
pense, sans quoi il ne se distinguerait ni de la pense totale, ni par
consquent daucun autre moi, non plus qu cet objet de pense,
sans quoi il ne serait lui-mme quune chose parmi les autres. Cest
cette liaison privilgie dun acte de la pense avec un objet de pen-
se dont il ne se dtache jamais et qui devient un centre de rfrence
pour tous les autres objets qui constitue ltre propre du moi.
En droit, la pense est toujours universelle : elle suppose un su-
jet, mais non pas tel sujet. Il faut donc, pour que tel sujet puisse tre
pos, que la pense enferme en elle-mme quelque objet qui la limi-
te, lgard duquel elle est passive et dont elle reste toujours soli-
daire : cet objet est le corps. Si le sujet ntait rien de plus quun su-
jet, il resterait absolument indtermin. On ne pourrait mme pas le
dfinir comme une pure puissance de penser, car nous ne verrions
pas pourquoi cette puissance ne serait pas tout entire exerce. Il est
la condition commune laquelle tout sujet particulier doit satisfaire
pour jouer le rle de sujet. Cependant le corps lui donne des fronti-
res : il manifeste sa prsence dune manire singulirement aigu
ds quil commence maffecter ; et laffectivit est elle-mme en-
veloppe dans la pense en gnral laquelle elle donne un caract-
re troit et personnel, une sorte de chaleur confuse et pleine de vie.
[203] Le sujet abstrait de la pense nest pas moi. Hors de sa liaison
avec laffectivit et avec le corps, il pourrait peut-tre encore dire
ma pense , mais au sens seulement o toute pense est subjecti-
ve par son essence mme : et on naurait point affaire un moi indi-
vidualis, distinct de tous les autres, et qui participe la pense,
sans se confondre avec la plnitude de son acte ralis. On aurait
affaire, si lon peut sexprimer ainsi, au fondement commun de toute
subjectivit plutt qu une subjectivit concrte et effective.
Ces observations nous conduisent une interprtation nouvelle
de largument cartsien qui nest point conforme sans doute au sens
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 196
de Descartes, mais qui, en lobligeant envelopper dj la liaison de
ltre et du corps, nous permettrait dchapper toutes les difficults
que le problme devait soulever plus tard et de triompher du repro-
che danglisme auquel devait lexposer la primaut inconditionne
accorde la pense pure. Au contraire, si largument cartsien pose
non pas la pense en gnral, mais une pense qui est la mienne et
non pas celle des autres, il faut que ce soit aussi une pense qui
maffecte, de telle sorte que le moi qui pense toutes choses, l o il
est prsent, ne peut que se sentir et non point se penser, comme Ma-
lebranche la vu admirablement. Autrement il se confondrait soit
avec lacte de la pense, qui ne suffirait pas lindividualiser, soit
avec un objet de pense qui le rendrait tranger lui-mme.
ART. 4 : Le moi sinscrit dans ltre par la pense, mais sen dis-
tingue en nattribuant sa pense que luniversalit en puissance,
qui lui permet de sopposer lui-mme dautres tres possibles ca-
pables aussi de dire moi.
Il y a donc dans largument cartsien trois termes successifs et
non point deux : le moi dcouvre sa propre nature lintrieur de la
nature pensante qui, en sinscrivant dans ltre, y inscrit le moi du
mme coup. La pense est mdiatrice entre le moi et ltre ; elle si-
tue le moi comme un terme particulier lintrieur du tout, et elle
permet au moi denvelopper le tout par une treinte de plus en plus
vaste et qui [204] ne se referme jamais. Il est vident que la srie
des trois termes : moi, pense et tre, pourra tre parcourue dans les
deux sens, selon quon ira du conditionn la condition ou de la
condition au conditionn. Cependant, luniversalit en puissance que
jattribue ncessairement ma propre pense devient le seul moyen
par lequel je puis concilier le caractre limit du moi et sa solidarit
avec ltre total. J e ne midentifie chaque instant quavec une des
oprations de ma pense : mais elle appelle toutes les autres et il est
impossible que ltre se distingue de leur totalit.
Il y a absurdit vouloir poser soit la pense, soit le moi ind-
pendamment de ltre et antrieurement lui : car ltre est univer-
sel parce que le nant implique sa propre ngation, tandis que la
pense et le moi, tant des termes indtermins lun et lautre, appel-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 197
lent ncessairement dautres termes avec lesquels ils contrastent. Le
pens na de sens que par rapport au non-pens, qui fait encore par-
tie de ltre en droit sinon en fait puisque, si tout est pens, cest
dabord parce que tout est pensable, de telle sorte que lopposition
de la pense actuelle et de la pense possible est le seul moyen que
nous ayons de distinguer ltre de la pense. (Que lon nallgue pas
que dans le mme sens on peut distinguer de ltre actuel ltre sim-
plement possible, car le possible est un mode de ltre et non pas
ltre un mode du possible ; ainsi nous pouvions faire rentrer le pen-
sable dans un genre suprieur la pense, qui tait le genre de ltre,
tandis que le possible est subordonn ltre, au lieu de faire partie
avec lui dun genre suprieur tous les deux.)
Dans le mme sens o le pens est corrlatif du non-pens, le
moi est corrlatif du non-moi, et comme le non-pens ne peut tre
que le pensable, il faut que le non-moi soit aussi un moi possible :
car, puisque le moi prtend lui aussi luniversalit, il faut que, l
o il ne rgne pas, il pense quil pourrait rgner un autre moi. Ils
seraient compris alors tous les deux dans la pense, comme la pen-
se actuelle et possible taient comprises toutes les deux dans ltre.
Mais prcisment parce que la pense ne se distingue pas de
lintelligibilit de ltre, il y a en elle la mme continuit que dans
ltre lui-mme ; ainsi son actualit et sa possibilit ne se distin-
guent quau [205] regard du moi, tandis que le moi, bien quil en-
ferme lunivers entier dans les limites dune perspective subjective,
appelle une multiplicit discontinue de perspectives diffrentes, en-
fermes dans le mme univers et sans lesquelles sa perspective pro-
pre se confondrait avec ltre, ce qui dtruirait, en mme temps que
ses limites, sa conscience et sa personnalit elle-mme. Ainsi la liai-
son que nous avons cherch tablir entre ltre et le moi trouve une
dernire confirmation dans cette observation, cest que, si on ne peut
penser ltre que comme se suffisant lui-mme, on ne peut penser
le moi que comme ne se suffisant pas lui-mme, non seulement
parce quil implique ltre quil limite, mais parce que, lintrieur
de ltre, il implique lexistence de tous les autres mois auxquels il
soppose, et avec lesquels il ralise, sous la forme dune sorte de
total, un symbole de cette mme unit qui anime chacun deux et qui
leur permet de communiquer.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 198
ART. 5 : Le noumne kantien assume un rle qui ne peut apparte-
nir quau tout, lintrieur duquel le moi rel fonde chaque ins-
tant, grce lopposition de sa forme et de son contenu, son exis-
tence participe.
La difficult que soulvent le problme du moi ainsi que les rap-
ports du moi avec ltre apparat nettement dans la distinction ta-
blie par Kant entre trois sens diffrents du mot moi et trois sortes
dexistence quon peut lui attribuer. Il y a en effet, selon Kant, un
moi noumnal qui est un objet de la pense pure auquel aucune in-
tuition ne correspond, et qui est la fois un moi rel et un moi dont
je ne puis rien connatre ; il y a un moi formel qui se confond avec
lunit de laperception, et que je ne puis pas dterminer comme un
objet prcisment parce quil est le principe qui dtermine tous les
objets, ds quune matire lui est offerte par la sensibilit ; il y a en-
fin un moi empirique qui se dveloppe dans le temps et dont lunit
concrte est exprime par le caractre. Mais il faut bien quil y ait
quelque lien interne entre ces trois formes du moi, et les distinctions
que Kant faisait entre elles nous paraissent fournir une solution des
rapports entre le moi et ltre, pourvu quon garde celui-ci son
univocit.
[206]
Car il y a videmment un paradoxe faire de lexistence une ca-
tgorie, ce qui ne permettrait de lappliquer quau caractre empiri-
que et soutenir quil faut pourtant poser au-dessus de lui un moi
formel et un moi noumnal qui, bien quincapables de se transfor-
mer lun et lautre en objets de connaissance, jouissent en droit
dune existence antrieure et par consquent irrductible
lexistence dfinie par la catgorie. Cest le moi noumnal qui pos-
sde cette existence inconditionne, qui est la seule existence vrita-
ble, et Kant ne peut pas sen passer, car si lon presse la significa-
tion profonde du kantisme, on voit que le moi formel tient son tre
du moi noumnal et le transfre au moi empirique par
lintermdiaire de la catgorie, grce une sorte de dgradation qui
lamenuise en connaissance. Le moi formel nappartient ni lordre
de ltre, ni lordre du connatre, mais il est une sorte de mdiateur
entre le moi qui est et le moi qui est connu, et comme il nous oblige
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 199
voquer derrire le moi apparent le moi rel, il permet celui-ci de
venir trouver son expression dans une exprience.
La fonction du moi noumnal est daffermir le moi lintrieur
de ltre total. Mais poser un moi indpendant de la conscience,
mme sil la soutient mystrieusement, cest poser lexistence du
moi hors du moi lui-mme. Cest donc poser une existence qui nest
pas celle du moi. Ltre noumnal, cest ltre du tout auquel le moi
participe et avec lequel il communique : cest l o se produit cette
participation, l o cette communication a lieu, que rside le moi
vritable. Mais il ny a point de noumnes particuliers, car si une
chose se distingue dune autre, ltre dune chose est le mme que
ltre de toutes les autres. On dfinit chaque chose en lui donnant
une circonscription, mais affirmer quelle existe, cest lui donner
une place lintrieur de ltre incirconscrit. Il ny a point de moi
qui soit au del de la conscience ; mais il y a un tre plus grand dans
lequel le moi plonge ses racines, qui lui permet de subsister et dans
lequel il ne cesse de se nourrir.
Si le moi noumnal assume par rapport la conscience le rle qui
en fait doit appartenir ltre total, nous comprendrons mieux
lopposition du moi formel et du moi empirique. [207] Car, puisquil
y a homognit de nature, bien quingalit de richesse, entre ltre
et le moi, et puisque, dautre part, le moi nexiste que par lacte qui
lui permet de participer ce tout avec lequel il ne cesse dentrer en
communication par des rapports de plus en plus nombreux, mais qui
le dpasse toujours infiniment il faut qu chaque instant nous
soyons capables de distinguer dans ltre du moi sa puissance de son
contenu. Or sa puissance est sans limite et son contenu est toujours
limit. Sans doute la puissance dun tre fini est limite de plusieurs
manires suivant que lon a gard son corps, la force qui en
mane, la sensibilit qui est dans la conscience une sorte de reflet
de sa prsence. Mais si lon considre sa pense, elle enveloppe en
droit la totalit de lespace et la totalit du temps ; et nous ne disons
pas quelle est sans rapport avec le corps, nous disons seulement que
cest parce quelle est associe au corps quelle se dveloppe dans le
temps, et quau lieu de possder cette plnitude actuelle qui
lidentifierait avec ltre, elle comporte toujours une sorte
dinachvement et cette inadquation son objet qui lui permet pr-
cisment den avoir conscience. Ainsi la puissance de penser est
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 200
dans ltre fini le tmoignage de sa liaison avec ltre total : cest le
tout prsent en lui sous la forme dune srie indfinie doprations
accomplir ; et comme en fait nos oprations relles demeurent tou-
jours enfermes entre les deux termes assez rapprochs de la nais-
sance et de la mort, on comprendra comment le moi empirique, sans
tre aussi troitement limit que le corps, est assujetti pourtant des
limites variables dont le corps demeure la condition.
B. LE MOI QUI SE LIMITE
ET QUI SE DPASSE
Retour la table des matires
ART. 6 : Le moi ne cesse de se chercher lui-mme dans une opra-
tion par laquelle il constitue et repousse la fois ses propres limi-
tes.
Nous ne croyons pas que ltre du moi soit aussi primitif ni aussi
facile saisir quon le suppose en gnral soit dans la croyance po-
pulaire, soit dans une certaine forme didalisme [208] plus ou
moins directement inspire de largument cartsien. Cest que le moi
nest pas une ralit donne, mais une ralit qui ne cesse point de
se chercher elle-mme ; elle est mobile et fuyante et perptuellement
en voie de constitution. Lide de ltre total et inconditionn est
plus claire et plus ferme que lide du moi ; elle nest pas obtenue
par une sorte dextension de ltre du moi : on ne comprendrait ni la
possibilit ni la lgitimit de cette extension si lhorizon de la
connaissance ne dpassait pas ds lorigine lhorizon du moi. Cest
parce que ltre est donn avant le moi, pour que le moi puisse fon-
der en lui avec sa propre vie la connaissance de soi et de tout le res-
te, que le moi apparat toujours comme limit, sans que pourtant ses
limites puissent jamais tre fixes avec une exactitude qui chappe
toute contestation.
Y a-t-il aucun homme, parmi tous ceux qui rflchissent sur eux-
mmes, qui puisse tracer une dmarcation rigoureuse entre ce qui lui
appartient et ce qui lui demeure tranger ? Le dbat commence
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 201
propos du corps. Confondrai-je mon corps avec moi ? Non sans dou-
te, puisque je puis regarder ce corps comme un objet et que, sil est
la condition sans laquelle je naurais point de sensibilit, il ny a de
moi qu partir du moment o apparat cette forme originale
dintriorit quon appelle une conscience et dans laquelle le corps
lui-mme se trouve envelopp. Aussi dirai-je de ce corps quil est
mien sans oser dire quil est moi. Il est pourtant ce qui donne mon
tre propre des limites et un caractre individuel, ce qui le distingue
de tous les autres, ce quon ne peut pas supposer aboli sans sobliger
concevoir luniversalit dune pense possible qui ne serait plus
ma pense propre, et qui ne se distinguerait pas sans doute de la to-
talit dun univers non-pens ?
En disant que le moi rside dans la sensibilit, on retombe dans
la mme alternative, car la sensibilit est un reflet du corps, et lon
pourra tour tour soutenir que les sentiments constituent la seule
partie de ma nature qui possde un caractre dintimit inalinable
ou que ces sentiments appartiennent la partie passive de mon
tre, et quen mlevant dans la vie spirituelle, je vois natre peu
peu le moi vritable qui devient un spectateur de lautre, et qui re-
garde les [209] plaisirs et les douleurs de celui-ci comme les plaisirs
et les douleurs dune sorte dtranger.
Ne faut-il pas alors reconnatre que le moi consiste seulement
dans la connaissance ? Mais une nouvelle difficult se produit. Car
lon peut tre tent de soutenir, avec certains idalistes, que je suis
tout ce que je connais, de telle sorte quen identifiant lacte de la
connaissance avec son objet, on laisse perdre les limites du moi pen-
sant, et lon confond celui-ci avec lunivers reprsent. Distinguera-
t-on alors dans la connaissance son acte et son objet, en dclarant
que lobjet est toujours particulier, tandis que le moi est une puis-
sance universelle, que lobjet ne fait pas partie du moi, mais seule-
ment lacte par lequel je le pense, que, comme cela semble vident,
le moi nest ni larbre, ni le triangle, ni la justice quil conoit, mais
seulement lopration par laquelle il les conoit ? On nobtiendrait
encore aucun bnfice et le moi continuerait encore nous chap-
per. Car, si nous considrons cet acte en lui-mme, indpendamment
de ses limites, cest--dire du corps qui chelonne son opration
dans le temps et oblige celle-ci sappliquer toujours un objet par-
ticulier, il perd tout caractre individuel, il est le mme en moi et en
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 202
autrui, il ne subit aucune altration en prsence des objets les plus
divers, il est semblable une lumire qui nest rflchie par aucun
obstacle et nest capte par aucun il, une science universelle qui
ne serait la science daucun savant.
Le mme inconvnient reparat si lon prtend que lessence pro-
pre du moi rside dans la volont, car il existe pour la volont des
obstacles qui la font hsiter dans son choix, qui exigent delle un
effort pour les surmonter et un temps pour dployer cet effort. Or,
faut-il rendre le moi solidaire de lobstacle, de leffort et du temps ?
Ces conditions lui sont videmment imposes par le corps. Si lon
considre dans la volont ce qui mappartient vritablement, cest le
consentement et la persvrance. Quest-ce dire sinon quil existe
en moi une activit constamment prsente qui manime mais qui me
dpasse, laquelle jouvre en moi une sorte daccs quil marrive
souvent de lui refuser. Leffort qui est li au temps et au corps nen
est que la forme entrave. Mais cette activit ne peut tre confondue
avec le moi car, bien [210] quelle constitue la ralit la plus pro-
fonde du moi, chaque moi ne se distingue prcisment de tous les
autres que parce quil a pour elle une ouverture limite qui est sus-
ceptible de slargir ou de se rtrcir dune infinit de manires. Par
suite, si nous considrons la limite qui soppose au dploiement de
cette activit, elle nest pas le moi, puisquelle nest quune chose, et
si nous considrons cette activit hors de sa limite, elle nest pas le
moi non plus, puisquelle est universelle et toute-puissante. Cest
pour cela que le moi est si malais atteindre, il est lopration ins-
table et toujours recommence par laquelle une activit qui na pas
de limites se trouve capte lintrieur de certaines limites quelle
cherche sans cesse refouler.
En rsum, la difficult du problme du moi tient
limpossibilit de le dfinir soit comme une chose, soit comme un
acte. Car on ne peut pas le confondre avec le corps, bien quil ne
puisse tre pos sans le corps dont il subit la loi, comme laffectivit
le dmontre. Et quand on lidentifie avec la pense, on ne peut pour-
tant pas le faire concider avec le contenu de sa pense, cest--dire
avec ses ides, puisque les ides ne lui appartiennent pas, quil se
borne y participer et que lide mme du moi nest pas le moi,
mais seulement lune de ces ides. On ne peut pas davantage le d-
finir par lopration actuelle qui les pense, puisquelle tient tout son
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 203
tre dune activit qui la dpasse. On peut encore moins donner le
nom de moi cette activit elle-mme considre dans sa plnitude,
car le moi ne lactualise pas tout entire, et le seul nom qui convien-
ne celle-ci est Dieu. Nous navons point dautre ressource que de
faire du moi une forme mixte et fuyante de ltre, enveloppe dans
ltre par son corps, mais capable de lenvelopper en soi par la pen-
se, une puissance totale qui aspire vers ltre total, qui reoit de
ltre total le mouvement et la vie, qui ne sactualiserait quen
sanantissant et laquelle des limites sont imposes afin prcis-
ment que ltre pur, loin dapparatre comme une donne, demeure
un acte ne devant son existence qu lui-mme et puisse raliser
ternellement sa propre essence en tous les points de son immensit
sans contour.
[211]
ART. 7 : Lexprience de nos limites, cest celle de linscription
dans ltre dune perspective subjective sur le tout de ltre, qui est
notre tre mme et qui slargit toujours davantage.
Si on allgue que le moi, en prenant conscience de lui-mme,
prend naturellement conscience de ses limites, mais reste incapable
de les franchir, on demandera alors comment il peut les connatre.
Une telle connaissance nimpliquerait-elle pas lexprience dune
ralit qui se trouverait au del de ces limites elles-mmes ? Mais
nest-ce point l une sorte de contradiction ? Et pourtant il semble
impossible davoir lexprience dune limite si celle-ci nappelle,
comme toute ngation, lide mme de la ralit quelle nie. En fait,
nous trouvons ici lapplication dune vue beaucoup plus gnrale sur
la fonction de toute exprience qui napprhende le rel que par
lanalyse. La dcouverte du moi par lui-mme, qui est aussi lacte
par lequel il constitue sa propre nature, est la premire dmarche de
cette analyse. Puis-je en effet parler du moi autrement que par
contraste avec le non-moi, qui doit bien mtre donn de quelque
manire, au moins en ide, pour que je men distingue ? Sans cela le
moi pourrait-il tre non pas seulement limit, mais mme qualifi ?
Car il ny a pas de diffrence entre contenir en soi toutes les qualifi-
cations la fois et nen contenir aucune. Cest l une observation
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 204
que lon a dj faite propos de ltre pur, en le dfinissant comme
une unit antrieure la distinction des qualits et qui exclut sans
doute le nant, mais dune manire absolue et non point en
sopposant lui comme une espce qualifie dans un genre plus g-
nral qui les comprendrait tous les deux.
Il ne faut pas oublier sans doute que dcouvrir lexistence du
moi, cest non pas dcouvrir la prsence de ltre lintrieur du
moi, mais la prsence du moi lintrieur de ltre. Pourtant on ob-
jecte que dans cette connaissance de ltre le moi ne sort pas de lui-
mme. Et ne serait-il pas contradictoire quil pt connatre ltre au-
trement que dans son tre propre ? Faut-il donc interprter
lunivocit, en disant que tout se passe ici comme si lon devait ac-
corder au moi une existence primitive qui sirradierait ensuite sur les
diffrents [212] objets auxquels sa connaissance sapplique ? Mais
cette observation elle-mme va nous permettre de rsoudre notre
difficult. Car ltre ne peut venir lobjet comme au sujet que du
tout o ils prennent place lun et lautre. Ce nest donc pas ltre que
le sujet confre lobjet en le pensant, mais seulement ltre par
rapport lui, cest--dire la forme subjective. On maintiendra donc
avec fermet ces deux principes : savoir que tout objet, pour tre
connu, doit ncessairement affecter un caractre subjectif, et que le
moi est assujetti poser dabord lexistence objective de sa propre
subjectivit. La subjectivit du moi sinscrit elle-mme dans ltre
en inscrivant ltre en elle sous une forme purement reprsente.
Cest en tant que ltre du moi se rduit une perspective sur le tout
de ltre quil peut tre dfini comme une limitation de ltre sans
limites. Cest le caractre le plus profond de la connaissance de
constituer ltre du moi par un rapport du non-moi avec le moi qui
seffectue lintrieur mme de ltre.
Cependant nous savons que ltre, tant universel et univoque,
est indivisiblement prsent dans chacune de ses dterminations,
cest--dire que chaque dtermination appelle aussitt toutes les au-
tres. Par consquent, dans le spectacle que le moi se donne il y a une
figure du tout. Dire que dans ce spectacle le moi son tour occupe
une place dtermine, cest dire qu lintrieur de la reprsentation,
la propre ralit du moi limit na de sens que par rapport celle du
non-moi, cest--dire de proche en proche, par rapport la totalit
des choses reprsentables. Cela pos, nul ne pourrait soutenir que le
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 205
moi continuerait encore exister sil cessait dtre un point de vue
original sur tout lunivers, cest--dire un lieu privilgi o se ren-
contrent les influences qui proviennent des points les plus loigns
de lespace et du temps et les ractions qui, partant de lui comme
centre, se propagent leur tour indfiniment.
Le non-moi doit donc tre distinct du moi et pourtant en tre in-
sparable ; pour que le moi puisse fixer ses propres limites grce la
connaissance mme du non-moi, il faut que le non-moi devienne une
forme dexistence pour le moi sans pourtant sidentifier avec lui.
Autrement le moi naurait [213] aucune indpendance et se confon-
drait avec ltre total. Ainsi le moi sera astreint penser le non-moi
comme une reprsentation o chaque objet devra tre reli tous les
autres dans le systme total de lunivers, tandis quil les reliera tous
sa propre pense dans le systme par lequel il se les reprsente.
Ds lors, le corps sera ncessaire pour obliger le moi se situer lui-
mme dans le monde des reprsentations, tandis que la pense, pour
se distinguer de lobjet reprsent, devra sexercer dans le temps et
trouver sans cesse devant elle un avenir o elle pourra recevoir un
nouvel enrichissement. Par suite cette pense apparatra comme
ntant pas cratrice, comme ngalant le tout quen puissance et
comme place au sein dune pense infinie dont elle est la fois
lcho et linstrument.
Mais si le moi a le sentiment si vif de ses limites, cest quil y a
en lui une aspiration la possession du tout, qui nest que la prsen-
ce en lui de lide du tout corrlative de sa propre prsence dans le
tout. Cette aspiration se ralise graduellement au cours de sa vie in-
dividuelle et dans la suite des gnrations. Si cette insatisfaction ini-
tiale de tout tre fini ntait pas le signe de sa participation ltre
total, au sein duquel il doit fonder sa propre destine par une com-
munion volontaire de tous les instants, elle serait une illusion dont
on serait hors dtat dexpliquer lorigine et la possibilit. Ainsi,
cest le temps qui tmoigne de nos limites, mais aussi de nos atta-
ches avec le tout et de notre capacit daccroissement.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 206
C. LE MOI OU LA LIAISON
DE LA PENSE ET DU CORPS
Retour la table des matires
ART. 8 : Le moi est lauteur de lexprience dans laquelle il se
donne lui-mme un corps.
Dans lanalyse de lide de subjectivit, on trouve une explica-
tion de la manire dont se produit la connexion de ltre et du moi.
Car, si ltre est essentiellement intrieur lui-mme, chaque partie
de ltre doit tre intrieure la fois elle-mme et ltre total.
[214]
Or la conscience nous confre lintriorit nous-mme ; dans
cette forme dintriorit le monde entier nous est donc prsent, mais
dune manire purement reprsente. Pour que le moi sen distingue,
il faut que cette reprsentation soit toujours incomplte et inacheve,
de telle sorte que le temps apparat comme la condition de toute sub-
jectivit. Par suite, il est ncessaire que le moi sattribue lui-mme
comme sujet une puissance adquate au tout, qui sexerce dans le
tout, mais qui ne doit jamais tre pleinement exerce, faute de quoi
son originalit disparatrait ; cependant, cest avec lacte de la pen-
se que nous pntrons le plus profondment dans lintimit de
ltre, que nous sentons le mieux son universalit et son infinit :
mesure que cet acte sexerce dune manire plus parfaite, notre per-
sonnalit saffermit et stend en mme temps que notre amour-
propre recule, lopposition et mme la simple diffrence entre
lunivers et le moi cessent de saccuser et la loi du tout gouverne
avec complaisance lindividu clair et consentant.
Dautre part, si le moi ne peut avoir lexprience de ltre qui le
dpasse quen sen donnant lui-mme la reprsentation ou le spec-
tacle, il faut que ce spectacle nous apparaisse aussi comme envelop-
pant la totalit des choses : autrement lhomognit de ltre serait
rompue. Ds lors dans la trame des phnomnes on ne rencontre rien
de plus que des phnomnes : mais cest le mme sujet qui les ren-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 207
contre en lui et qui les embrasse tous. Le monde se trouve alors ac-
tualis tout entier comme un systme de donnes empiriques ; et il
ne peut ltre que par la puissance du moi, mais dun moi qui
sassujettit lui-mme faire partie de ce spectacle dont il est lui-
mme le centre, ce qui veut dire quil a un corps.
Quant au sujet lui-mme, il sactualisera donc de deux manires :
premirement comme esprit, cest--dire comme auteur de cette ex-
prience o ltre tout entier ne cesse dtre prsent, bien quen droit
comme en fait le temps oblige non point ltre lui-mme, mais
lexprience que nous en prenons senrichir et se perfectionner
indfiniment ; et, deuximement, comme corps, cest--dire comme
une pice de cette exprience dans linfinit de laquelle il est perdu
et comme [215] cras, bien quil y soit soutenu en mme temps par
linfinit des relations qui lunissent tous les autres corps.
Cest pour cela que le moi nest rien en dehors de son corps, et
en dehors de cette conscience de lunivers entier, qui sans le corps
ne serait pas possible. Non pas que le corps la produise comme un
mystrieux piphnomne, mais pour que la conscience soit possi-
ble, il faut que nous nous distinguions de ltre et que nous puissions
lembrasser dans une perspective dont le corps est le repre et qui
constitue notre exprience du monde. Tandis que la partie du monde
qui est enferme dans notre corps et qui forme notre chair et notre
sang se refltera dans cette conscience sous les espces du senti-
ment, le reste du monde son tour ne pourra devenir prsent celle-
ci que par une reprsentation. Mais le tout de lunivers nest lui-
mme que le tmoin du tout de lacte, qui rend possible et qui justi-
fie lintuition que nous avons de notre moi : cest en lui que celui-ci
trouve le principe de son tre et de son accroissement. Cest quil
ny a rien de plus dans le moi que la conscience de ce qui le dpasse
(car le corps propre nest point la matire du moi, mais seulement le
moyen de son avnement) : cette conscience se constitue dans la
marge qui spare linfinit de la puissance et linfinit de lacte et
qui, par lintermdiaire du temps, leur permet de se raliser en
communiquant lune avec lautre, mais sans jamais concider : cest
le monde qui les spare.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 208
ART. 9 : Le moi opre une dissociation entre lacte de la pense et
lobjet de la pense, quil cherche faire concider, mais qui se d-
passent lun lautre indfiniment.
Il ne faut pas stonner si la ralit du moi est la fois primitive
et impossible saisir. Car tout dabord le moi ne peut penser tout le
reste que par rapport lui-mme. Mais dautre part, comment pour-
rait-il se penser lui-mme autrement quen pensant ltre tout en-
tier ? Comment pourrait-il avoir un objet diffrent ? Il ne peut se
confondre ni avec la puissance de penser qui enveloppe tout ce qui
est, o le moi cherche son tre propre, ni avec le spectacle quil se
donne, en [216] y comprenant mme le corps dont lide est pour-
tant insparable dune rsonance intime dans la sensibilit : car ce
spectacle est pour nous sans tre nous, et notre corps lui-mme est
un tranger auquel nous sommes attachs comme un instrument
qui permet la conscience de natre, de le contenir en elle et de le
dpasser.
Ainsi le moi ne cesse de se chercher, de sagrandir et de se rtr-
cir selon les degrs de sa communication avec ltre ; mais cest
ltre du tout qui fait son tre mme, ou plutt cest par la qute de
ltre quil se donne ltre dans une opration tout intrieure. Car il
ne possde ltre que dans le double mouvement par lequel il le fuit
et le retrouve indfiniment. Mais soit quon suppose que ltre lui
chappe, soit quon suppose quil le rencontre, dans les deux cas
loriginalit du moi se dissipe : cest quelle rside tout entire dans
le mouvement par lequel, ayant pris naissance au sein de ltre, il
consomme sa destine en sunissant lui. Et lintervalle qui spare
ici son point de dpart de son point darrive est le signe visible que
ltre total rside dans un acte universel dont lessence est de fournir
tous les tres particuliers les moyens de fonder leur propre nature
dans lexercice ternellement multiple et renouvel de leurs diverses
puissances.
Nul ne peut donc considrer comme soi ni la pense, ni lobjet de
la pense, qui stendent tous deux au del. Mais lopposition mme
de la pense et de son objet disparat dans ltre total et elle suppose
pour se raliser une pense toujours imparfaite et un objet toujours
limit dont la concidence indfiniment phmre constitue
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 209
lactualit du moi : cependant il y a dans la pense une puissance qui
stend bien au del de lobjet quelle apprhende et dans lobjet de
la pense une richesse que tout leffort de la pense ne parviendra
jamais puiser ; cest le propre du moi dopposer ces deux termes
lun lautre, de chercher les rejoindre, dy russir un instant,
mais sans pouvoir empcher quils ne se dpassent lun lautre ind-
finiment. Il y a ds lors entre lobjet de la pense et la pense un jeu
de poursuite par lequel chacun semble chercher rejoindre lautre,
latteint un instant, et presque aussitt le dpasse.
Ltre du moi ne peut donc se distinguer de ltre du tout. [217]
Mais si celui-ci est acte, ltre du moi est acte lui aussi. En tant quil
est lacte propre du moi, cest un acte limit et inachev, une sorte
dacte naissant. En disant que cest un acte de participation, nous
exprimerons bien comment nous ne cessons jamais de laccomplir
sans parvenir pourtant le mener jusquau bout : il est prsent en
nous indivisiblement, mais nous ne savons pas nous le rendre pr-
sent tout entier. Et lidalisme sent bien que, ds quil commence
sexercer, le tout est dj actuellement en lui ; mais les rsistances
du ralisme expriment limpossibilit pour ce tout dtre jamais ac-
tuellement possd par nous.
On ne russit par suite faire du moi ni un acte, ni une chose.
Car, si on le dfinit comme un acte, il ne se distingue pas de Dieu, et
si on le dfinit comme une chose, il ne se distingue pas du corps.
Mais il faut, pour quil y ait un moi, que cet acte soit particip sans
rien perdre en lui-mme pourtant de sa perfection ; il faut aussi que
ce corps soit dpass par une pense qui, pour lui fixer des limites,
le situe parmi les autres corps : je sens bien que cet acte par lequel je
pense mon propre moi est un autre moi plus grand que mon moi in-
dividuel, et je sens inversement que mon corps nest quun fragment
dans une exprience beaucoup plus vaste qui est tout entire conte-
nue dans ma conscience.
Ainsi sans le corps, lacte de la pense universelle ne pourrait pas
recevoir de limitation. Mais pour que cette limitation affecte lacte
de la pense du dedans et non pas seulement du dehors, il faut que
ce corps lui-mme participe en quelque manire lintimit de la
pense, cest--dire quil ne soit pas un objet pur ou un pur phno-
mne. Cest ce que jexprime en disant quil est mon corps. Et par
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 210
une sorte de retour paradoxal, cest lui du mme coup qui fait que
lintimit de la pense peut devenir lintimit de ma propre pense.
Ds lors le moi, intermdiaire entre la pense et le corps, a moins
dtendue que la premire et plus que le second. Il tient de la pense
cette lumire dans laquelle il enveloppe la fois le corps et tout
lunivers ; il tient du corps cette chaleur plus obscure qui, captant la
lumire dans une sorte de foyer driv, lui permet, aprs lavoir re-
ue, de se lapproprier avant de la transmettre comme si elle manait
de lui-mme. [218] Cest par son lien avec la sensibilit et avec la
dure que la pense devient notre pense ; et il faut quelle le de-
vienne pour que lacte pur ne cesse de saccomplir sous la forme
dune grce ou dun don, et que lunivers entier apparaisse au moi
sous la forme dune immense donne qui lui fait sentir ses limites et
lui permet de passer indfiniment au del.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 211
[219]
Troisime partie.
Lintriorit de ltre
Chapitre VIII
DE LIDE DE LTRE
A. ADQUATION DE LTRE
ET DE LIDE DE LTRE
Retour la table des matires
ART. 1 : Lide de ltre, bien que pense par le moi, est adquate
ltre.
Le chapitre prcdent a prpar lexamen des rapports entre ltre
et son ide. Car ltre ne peut tre connu que par son ide. Dautre
part lide est ncessairement pense par un sujet. Il semble donc
quil fallait examiner le genre dexistence qui convient au moi avant
de savoir si lide de ltre ne doit pas tre subordonne au moi et
sil nest pas invitable dentrer dans les voies de lidalisme subjec-
tif.
Mais dj nous avons t conduit remarquer que ltre du moi
nest pas un autre tre que ltre mme du tout, de telle sorte que,
sil y a une ide de ltre, il faut quelle participe de ltre du moi
qui la pense et qui, considr dans sa nature propre dtre et abstrac-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 212
tion faite de ses limites, ne diffre pas de ltre sans condition. Nous
retrouverions donc ici, sous une forme dtourne, une consquence
que faisait prvoir lunivocit, savoir que ltre de lide ne peut
tre moindre que ltre dont elle est lide.
Cependant une autre remarque encore nous permettait de franchir
les bornes du subjectivisme : cest que si, au moment o le moi pen-
se une ide, la conjugaison momentane de lopration et de son ob-
jet constitue la nature propre du moi, lobjet quil pense, cest--dire
lide, nappartient pas plus au moi que la puissance universelle par
laquelle il est capable de penser cette ide avec toutes les autres. De
telle sorte que lide de ltre, tant pour le moi son objet, [220]
mais non point sa proprit et encore moins son essence propre, il
ny a plus de difficult admettre que le moi, aprs lavoir pense
par une de ses oprations, se pense lui-mme comme un de ses mo-
des.
Sil ny avait pas une identit rigoureuse entre ltre et son ide,
tout le bnfice de notre analyse serait perdu. Car cest ltre absolu
que nous avons cherch atteindre en montrant quil tait impliqu
dans la plus humble de ses formes. Si par consquent nous nous
trouvions maintenant en prsence dune simple ide susceptible
dtre distingue du terme dont elle est lide, nous aurions saisi
lombre en croyant saisir la proie. Au contraire, si nous russissons
prouver que ltre et son ide se confondent, cette preuve sera en
mme temps une vrification dialectique de toutes les observations
que nous avons faites.
ART. 2 : Nulle ide particulire, en tant quide, na moins dtre
que son objet, mais son contenu, tant abstrait, ne concide point
avec celui de son objet.
Dire que ltre est univoque, cest dire que nulle ide na moins
dtre que son objet, lide dun homme moins dtre quun homme
rel, ni, selon une formule clbre, cent thalers possibles moins
dtre que cent thalers rels. Nous laisserons protester le bon sens
populaire, et nous donnerons une explication de cet apparent para-
doxe en ce qui concerne toutes les ides particulires, pour montrer
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 213
ensuite quelle est cet gard la position privilgie de lide mme
de ltre.
Il faut bien quil y ait quelque convenance entre lide et son ob-
jet pour quelle soit prcisment lide de cet objet, et cest prendre
lexistence dans un sens quivoque que de dire de lobjet quil exis-
te, et non pas lide. Celle-ci existe dans lentendement comme ce-
lui-l dans lexprience sensible. La diffrence qui les spare rside
dans leur dfinition et non pas dans lexistence quil faut leur attri-
buer une fois quon les a dfinis. Ainsi nous croyons quil faut ren-
verser la relation classique quon tablit entre lide et son objet
quand on soutient que leur comprhension est la mme, mais que
[221] leur modalit est diffrente, que la possibilit convient lide
et lexistence au seul objet. Car la possibilit est une forme de
lexistence. Il faut inscrire la fois lide et lobjet dans ltre, et
dans le mme tre ; mais on ne peut pas en faire le mme usage :
lide tant la signification de lobjet, notre corps na de rapports
quavec lobjet et notre esprit quavec son ide. Cependant, bien
quil soit impossible de concevoir notre esprit indpendamment de
notre corps, ils possdent ltre lun et lautre. Il en est de mme de
lide si on la compare lobjet.
On ne peut pas concevoir lobjet spar de son ide : une telle
expression enveloppe dj une vritable contradiction. Car tout objet
est corrlatif dun sujet : de telle sorte quil nest dobjet que pour la
pense ou que tout objet est un objet de pense. Bien plus, poser la
ralit de lobjet, cest poser la perfection de son ide, dune ide
qui, au lieu dtre pense par un autre esprit qui se distingue de cet
objet par un intervalle et lui fait subir la contamination de sa propre
nature, serait lide que cet objet se ferait de lui-mme, sil parve-
nait clairer jusque dans ses replis les plus cachs la totalit de son
essence. On voit donc que, pour surmonter cette dualit de lobjet et
de lide, il sagit moins de chercher obtenir leur identit en mode-
lant lide sur une ralit donne quen rduisant lobjet lacte qui
le fait tre. Mais cette identit ne peut tre obtenue qu la limite. Et
cest pour cela que, si lon ne peut concevoir lobjet spar de son
ide, il semble que lon puisse concevoir, du moins, lide spare
de son objet : elle implique seulement la possibilit de celui-ci. Cet-
te possibilit, il est vrai, ne serait rien si elle ne formait pas dj
lactualit mme de lide. Cependant, cette ide, bien que situe
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 214
elle-mme dans le prsent, peut tre en relation avec un objet pass
ou futur, mais non pas tre sans relation avec tout objet quel quil
soit. La pense domine le temps, tandis que la perception nous y as-
servit. Lide, en dgageant lobjet du lieu et de linstant, lui donne
une sorte dternit. Et comme il sagit dun objet particulier, cette
opration a sa ranon : lobjet ne peut acqurir limmutabilit quen
perdant parmi ses caractres ceux prcisment qui insrent sa ralit
en tel point de ltendue et de la dure, [222] cest--dire en deve-
nant un abstrait. (Cest seulement en ce qui concerne ltre total que
cette distinction cesse dtre ralisable : son ide est la seule qui ne
puisse pas se rduire un simple concept.) Cependant nulle ide
nest abstraite qu lgard du sensible quelle appelle ; en elle-
mme et lgard de lesprit qui la pense, elle est relle et concrte :
elle exprime lacte identique par lequel lesprit retrouve soit entre
lobjet et lui, soit entre les lments de lobjet, la constance de cer-
taines relations.
ART. 3 : Lide de ltre est la seule qui soit adquate parce que
ltre auquel elle sapplique est indiscernable de ltre quelle re-
oit : elle est donc le vritable terme premier.
Si toute ide, bien que diffrente de son objet, na pas moins
dtre que lui, et si elle nen diffre que par le contenu qui est moins
riche et exclusivement virtuel, on rencontre, ds quil sagit de
lide de ltre, une sorte de nud dans lequel ltre et la connais-
sance de ltre senveloppent dune manire beaucoup plus primitive
et beaucoup plus intime. Lide de ltre ne serait lide de rien si
elle ne concidait pas avec ltre lui-mme. Or, en vertu de
lunivocit, on ne peut pas poser lide de ltre sans apercevoir aus-
sitt que ltre de cette ide est le mme que ltre dont elle est
lide.
Au contraire, quand il sagit dune ide particulire, bien que
lide et son objet participent lune et lautre de la mme existence,
il y a une triple inadquation dune part entre lide et cet objet, et
dautre part entre lide et lobjet, limits tous les deux, et ltre
dont ils sont la limitation. Cest que la distinction entre les objets
particuliers est corrlative dune distinction, dune part, entre cha-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 215
cun deux et ltre dans lequel il sinscrit et, dautre part, dans cha-
cun deux, entre les caractres qui lindividualisent et lacte qui les
apprhende. Au contraire, en voquant lide de ltre, toutes ces
distinctions svanouissent : ni lide nenveloppe une pluralit
dobjets diffrents, ni aucun de ces objets ne peut tre par cons-
quent distingu du tout dont il fait partie, ni lide na moins
dindividualit que lobjet dont elle est lide.
[223]
Ainsi, ltre nest pas seulement le terme auquel lide
sapplique : du fait mme que lide possde ltre elle-mme, une
adquation parfaite se manifeste entre lide et son objet ; il ny a
rien de plus ni de moins dans lun que dans lautre ; et la distinction
entre lide et son objet, qui tait trs lgitime lgard des termes
particuliers, revt lgard de ltre un caractre exclusivement ver-
bal. De telle sorte que lon pourra dire indiffremment que ltre est
ide et que lide est tre.
Penser tout autre objet, cest distinguer lopration par laquelle
on le pense du terme auquel cette opration sapplique. Cest pour
cela que nul ne confond lide de lhomme avec ltre de lhomme,
et, que dans la mesure o ltre, qui nest pas un caractre spar,
est considr dans sa relation avec les termes dont on laffirme et
non point avec le tout qui les supporte, nul ne confond ltre de
lhomme avec ltre de lide de lhomme : ce qui montre assez
pourquoi lunivocit rencontre tant de rsistance. Mais si lide dun
homme nest point un homme, lide de ltre, par luniversalit
mme de son objet, est elle-mme un tre. Et si lon nous pressait en
disant que, comme dans lexemple prcdent, ltre de cette ide ne
peut pas tre confondu avec ltre dont elle est lide, nous rpon-
drions que la distinction ne peut tre fonde que sur la particularit
de lobjet et de son ide, mais que l o luniversalit absolue appar-
tient galement aux deux termes, il faut ncessairement quils se re-
couvrent avec exactitude : ainsi il ny a rien dans ltre que lide de
ltre nenveloppe, ni rien dans lide de ltre que ltre aussi
nenveloppe.
On ninsistera jamais assez sur cette possibilit de convertir
lide de ltre en ltre de lide qui ne se vrifie que pour cette
seule ide, comme on sen aperoit aisment, sur lexemple de lide
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 216
de lhomme. Le cercle dans lequel nous entrons ici est caractristi-
que dun terme premier, o la pense implique ltre et le dcouvre
tout ensemble. Ce nest pas l seulement le premier anneau dune
chane dont tous les autres anneaux seraient lis les uns aux autres et
qui naurait sur eux que le privilge dtre le premier : mais il est
premier en ce sens beaucoup plus profond que chaque anneau de la
chane lui est rattach immdiatement et reoit de lui lintelligibilit
[224] et ltre, avant de dterminer ses limites par sa liaison avec
celui qui le prcde et celui qui le suit.
Car qui persuadera-t-on que le dterminisme des phnomnes
puisse suffire rendre compte dune manire plnire de chacun
deux, avant quon ait justifi dabord dductivement leur participa-
tion ltre et leur aptitude prendre place dans le mme univers ?
Les discussions sans issue qui se prolongent autour de la notion de
premier terme viennent de la confusion presque invitable qui
stablit entre une primaut historique, qui ne saurait tre conue
dans une dure qui na aucun bord, et une primaut mtaphysique
par rapport laquelle ltre fini doit dduire les ides mmes de
temps et de finitude.
ART. 4 : Lide de ltre abolit lopposition entre labstrait et le
concret, entre le virtuel et lactuel, entre lintriorit et lextriorit,
entre lidalisme et le ralisme.
Sans doute on continuera faire de nombreuses objections cette
thse dont nous dtournent la fois la considration des relations
auxquelles nous sommes accoutums entre les objets particuliers et
les ides qui les reprsentent et la rpugnance naturelle que nous
prouvons accepter quun passage la limite puisse concider avec
la rencontre dune intuition.
La premire objection consiste dire que lide de ltre est en
effet la plus abstraite de toutes et vritablement une ide sans conte-
nu qui ne diffre pas de lide de nant ou qui nest quun nant
dide, mais que ltre est au contraire cette plnitude du tout qui
surpasse toute ide et ne saurait tre reprsente ni plus forte rai-
son puise par aucun. On distend par consquent jusqu linfini
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 217
lintervalle qui spare dans chaque cas particulier labstrait de lide
du concret de la chose. Mais il se trouve prcisment quau moment
o cet intervalle sinfinitise, il sabolit. Car on demandera ce qui
permet de dire de ltre quil est la plnitude du tout sinon lide
mme que nous en avons. Et si lon allgue quil y a bien de la dif-
frence entre cette plnitude pense et cette plnitude actualise, on
rpondra que cest bien cette plnitude [225] pense qui est en effet
lide mme de ltre, et qui ne peut jamais tre pense sans doute
comme actualise (ce qui na lieu que par degrs et pour une cons-
cience particulire), mais parce quelle est cette puissance infinie
dactualisation laquelle nous ne cessons de participer et dont il
faut reconnatre quelle est en mme temps lide de ltre et ltre
mme.
On insistera par une deuxime objection o lon montrera que
lide de ltre, bien quactuelle en tant quide comme toutes les
autres ides, est virtuelle elle aussi par rapport lobjet dont elle est
lide. Mais que veut-on dire quand on dit quune ide est virtuelle
par rapport son objet sinon quelle exprime la possibilit de le ren-
contrer ou de le faire surgir selon des rgles particulires
lintrieur dune exprience dtermine ? De toute ide qui nest pas
une chimre pure, nous esprons quelle pourra un jour sincarner
dans un objet, ce qui est le seul moyen que nous ayons de donner
sa virtualit elle-mme une signification relle. Or le propre de
lide de ltre, prcisment parce que la considration de lobjet
nous enferme dans le phnomne, cest quil est impossible de lui
assigner aucun objet, de telle sorte quelle est condamne demeu-
rer toujours une pure virtualit. Mais cet argument est inoprant
pour une double raison : la premire, cest que lactualit de cette
virtualit infinie ne recherche point dautre objet quelle-mme ;
cest elle qui est ltre auquel lactualit des objets particuliers
najoute rien puisquelle ne fait que le diviser sans jamais parvenir
lpuiser. La seconde, cest que lon ne peut nous presser en invo-
quant lexemple des ides particulires et prtendre que lobjet le
plus humble a plus dtre que lide la plus vaste, sans quon veuille
avoir gard leffet dun passage la limite o lobjet et lide
concident ; on rpondrait alors que lobjet le plus humble ne pou-
vant lui-mme tre isol nous oblige seulement actualiser le tout
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 218
de ltre non plus cette fois dans la simple puissance qui
lenveloppe, mais dans son processus de ralisation.
Enfin, on prtendra, et cest l peut-tre lobjection la plus
grave, que lide na dexistence que dans une conscience de telle
sorte que, loin de nous donner accs dans [226] ltre, elle nous en-
ferme au contraire dans notre propre subjectivit. Cest l videm-
ment non pas seulement rduire lide un simple objet de pense,
mais soutenir que tout objet de pense est lui-mme dans la pense,
cest--dire ngliger la fois cet argument que lide peut tre un
acte de la pense qui na pas dautre objet que lui-mme et cet autre
argument que, si elle est pense par un sujet, elle nest pas pour cela
contenue dans ce sujet, mais elle exprime seulement, comme lont
marqu avec force les phnomnologues en reprenant sur ce point
lopinion de la conscience commune, cette ligne de direction de
lattention du sujet dont lobjet est le terme. Il y a plus : car cette
ide de ltre est pense par nous prcisment comme nous dpas-
sant, ce qui noffre point de difficult si lon songe que la conscien-
ce est moins, comme on le croit, une fermeture sur soi de ltre par-
ticulier, que cette ouverture sur la totalit de ltre par laquelle il
sort pour ainsi dire perptuellement de lui-mme. Que cette ide
puisse ainsi dpasser le moi et mme le dpasser infiniment, nest-ce
pas le signe quelle est ltre mme lintrieur duquel le moi ins-
crit son tre propre en noubliant pas pourtant que cet tre est acte et
que le moi ne peut sy inscrire que par une opration qui le suppose
et qui le limite ?
Si nous sommes remont un point o la distinction de lide et
de lobjet valable pour toutes les connaissances particulires
sabolit, et si cette concidence la fois initiale et terminale est
pourtant une condition de possibilit et de validit de toutes les
connaissances particulires, nous comprendrons par l mme et en
mme temps nous surmonterons lopposition classique de
lidalisme et du ralisme. Car lide dun tre particulier ne se
confond jamais avec celui-ci, puisquelle implique un autre tre qui
la pense et qui se distingue ncessairement du premier (ce qui est
vrai mme pour lide que nous nous formons de notre propre moi).
Or le propre de lidalisme, cest dabolir cette dualit, comme si
lobjet ntait rien de plus quune ide que nous naurions jamais
achev de penser. Le ralisme, au contraire, exploite lcart entre
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 219
lide et son objet et, remarquant que celui-ci est beaucoup plus ri-
che que lide, en dduit tort leur htrognit. La concidence
entre lide et lobjet ntant possible [227] que dans lide de ltre
et nonant simplement ltre de lide de ltre, lidalisme et le
ralisme se trouvent tous deux rfuts en ce qui concerne les tres
particuliers et tous deux confirms en ce qui concerne ltre total.
B. LIDE DE LTRE,
OU LA PUISSANCE INFINIE
DE LAFFIRMATION
Retour la table des matires
ART. 5 : Cest lintrieur de lide de ltre que nous pensons
lide du moi et toutes les ides particulires ; et les relations qui
les unissent sont destines combler lintervalle qui spare chacune
delles de ltre de son objet, qui est lui-mme identique ltre du
tout.
Lide de ltre peut seule nous mettre en prsence dun terme
vritablement premier que le je pense, donc je suis de Descartes
ne pouvait pas nous fournir. Car le moi nest quune limitation de
lexistence, une des ides possibles lintrieur de cette ide totale.
On a dj remarqu les difficults singulires auxquelles se heurte la
dtermination de lide du moi. Cest quen effet ltre, considr
dans son pur rapport avec lui-mme et non plus avec lun de ses
modes, ne peut tre quune intriorit infinie, un moi coextensif au
tout, incapable de sortir de soi, et dans lequel notre moi fini, comme
tous les autres mois, ne cesse de natre, de crotre ou de diminuer, et
de svanouir. Sans doute cette ide de ltre devra tre pense par
chaque individu : mais ce nest pas parce quil appartient
lindividu de la produire, cest seulement parce quil lui appartient
de constituer en elle sa propre nature.
Cependant la diffrence que nous tablissons cet gard entre
lide de ltre et toutes les autres exige quelques claircissements
complmentaires. Chaque ide particulire soppose en effet toutes
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 220
les autres ides, tandis que lide de ltre les contient toutes. Il ny
a pour nous quun moyen de la penser, qui est de nous inscrire en
elle avec lacte mme qui la pense. Or aucune ide particulire ne
peut se suffire elle-mme ; elle implique de proche en proche tou-
tes les autres ides particulires sans lesquelles elle ne pourrait ni
tre dfinie, ni subsister ; ds quon sengage dans le jeu des rela-
tions, [228] on entre dans un labyrinthe qui na pas dissue. Mais
lobjet rel auquel cette ide rpond porte en lui une infinit actuel-
le, et son existence surpasse infiniment toutes les relations par les-
quelles on se flatte de lpuiser. Cest pour cela que, considr dans
son tre mme, nul objet particulier ne se distingue daucun autre.
Ce nest point en raison de la pauvret de lide de ltre. Cest en
raison au contraire de sa richesse sans mesure : car ltre des objets
particuliers ne peut tre que ltre de lunivers ou du tout dont ils
font galement partie, et que chacun deux exprime sa manire aux
yeux dun individu fini qui constitue sa propre nature dans le temps
grce lanalyse.
Par consquent, les ides particulires sont multiples et
sopposent entre elles de manire former un tout solidaire. Chacu-
ne delles rvle donc son impuissance abstraite figurer non seu-
lement le tout, mais mme le terme concret dont elle est lide. Il ne
peut pas en tre autrement si ce terme nest concret que par la pr-
sence actuelle du tout o il prend place et que lon retrouverait en
lui si lon pouvait employer une analyse exhaustive. Luniversalit
et lunivocit de ltre cachaient donc limpossibilit o nous tions
dattribuer des termes particuliers et finis une forme dtre qui leur
conviendrait en propre et qui ne cesserait alors de se renouveler et
de se diversifier : le seul tre qui leur appartient, cest ltre sans
condition quils dissimulent, mais quils manifestent en recevant le
pouvoir de se dnouer de leurs limites et de fonder leur autonomie
par leur union avec lui.
Les mmes raisons qui nous empchaient didentifier lide dun
objet avec ltre de cet objet, et qui nous obligeaient multiplier les
ides en resserrant les relations qui les unissaient entre elles, de ma-
nire diminuer lcart qui spare chacune delles de lexistence
plnire quil faut ncessairement attribuer chaque objet, nous
contraignent donc, puisque lide de ltre non seulement contient
toutes les autres ides, mais encore est suppose par elles, consid-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 221
rer une fois de plus cette ide comme la seule qui, par son caractre
dunit et de suffisance, rejoint rellement son objet et se confond
ncessairement avec lui. Ce serait seulement si nous avions adopt
une mthode synthtique, et si nous avions [229] fait de ltre un
caractre spar, le premier de tous et le plus abstrait, quil faudrait
le remplir et le complter par toutes les qualits particulires dont la
gense est un effet de lanalyse ; mais lide de ltre au contraire
nexprime rien de plus que la runion absolue de toutes les qualits
que nous pourrons distinguer en lui et quil faut videmment poser
dabord runies pour quelles fassent partie de lunivers actuel et
que labstraction puisse les y discerner. Loin davoir besoin dtre
complte, lide de ltre est la compltude mme qui manque
toute ide particulire, mais qui est implique et appele par elle.
Lide du concret est la seule ide qui ne peut tre abstraite et qui,
sous peine de ne rien reprsenter, doit sidentifier avec le concret
mme dont elle est lide.
ART. 6 : Au moment o il pose lide de ltre, le moi reconnat en
lui une puissance daffirmation illimite qui fonde et qui dpasse
toute affirmation ralise.
Il ne suffit pas de dfinir lide de ltre comme lide toujours
identique elle-mme qui rduit lunit la multiplicit des ides
particulires en les conduisant pour ainsi dire leur point de perfec-
tion, ni de rappeler que ltre de chaque objet ne peut tre que ltre
du tout dont il fait partie, il faut encore, en serrant le problme de
plus prs, reconnatre que le sujet qui pense une ide sattribue lui-
mme une puissance daffirmation qui dpasse infiniment lide
mme quil affirme : car dire que cette ide en implique une infinit
dautres, cest dire quune telle puissance daffirmation nachvera
jamais de sexercer pendant notre vie tout entire. Pourtant, chacun
de nous sent bien quelle est indivisiblement prsente dans chacune
de ses oprations. Si on ne commet pas la faute de considrer cette
puissance comme irrelle pour donner seulement le nom dtre
lobjet auquel elle sapplique, cest--dire qui la limite, et si on ad-
met, dune manire gnrale, que la multiplicit des effets manifeste
toujours lunit de la puissance, mais sans altrer, accrotre ni dimi-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 222
nuer son essence, il est vident quil y a dans lactivit de la pense
une abondance et une ductilit infinies dont la varit des ides est
un tmoignage imparfait et toujours renouvel.
[230]
Faut-il dire que cette varit vient des choses et que lunit que
nous rtablissons entre elles exprime seulement leur aptitude com-
mune prendre place dans une conscience identique ? Cependant la
diversit qui rgne entre les choses semble moins une consquence
de leur tre mme que de leur limitation mutuelle, de la perspective
particulire dont chacune delles est le centre, de lopration par la-
quelle chaque individu constitue ce quil a de propre, corrlative-
ment une analyse qui divise le monde dans lespace et le temps de
manire lui permettre dy retrouver les conditions et la matire de
son originale vocation. Mais puisque la forme de ltre en apparence
la plus humble implique la prsence actuelle de sa ralit plnire,
ne faut-il pas conclure que la diversit sintercale entre la puissance
infinie de laffirmation et la totalit parfaite de lobjet affirm, que
celles-ci sidentifient en droit et ne se distinguent quen fait et pour
un tre fini dont la puissance propre na jamais achev de sexercer,
qui ne peroit jamais lobjet que par fragments, et qui tour tour
peut considrer cette puissance et cet objet comme se surpassant
mutuellement, afin quil puisse crer lui-mme sa propre nature dans
un univers dont il est la fois le spectateur et louvrier ? Lunit
universellement fconde que lon rencontre dans lactivit de la pen-
se pure, lunit universellement prsente que lon rencontre dans
ltre ralis ne peuvent tre confrontes sans que lide de ltre
apparaisse aussitt comme exprimant la totalit actuelle de ltre
aux yeux dune conscience finie, qui opposait et cherchait vaine-
ment faire concider lobjet et lide dans chaque connaissance
particulire. Elle reconnat alors que la puissance de laffirmation,
qui est la fois indivisible et infinie, ne peut jamais se distinguer de
la plnitude parfaite de ltre quelle affirme.
On rsumera toute largumentation prcdente dune manire
sans doute plus aise saisir en disant que, si ltre de chaque chose
particulire, cest ltre du tout, lide dune chose particulire ne
peut jamais se confondre avec la ralit de cette chose, tandis que
lide de ltre ou lide du tout, ne faisant pas de distinction entre
les choses et ne les opposant point entre elles, les surpassant au
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 223
contraire et les comprenant [231] en soi, ne laisse subsister hors
delle aucun objet vis--vis duquel elle pourrait se montrer inad-
quate.
C. LUNIVOCIT DE LTRE
ET DE LIDE DE LTRE, OU LE SECRET
DE LARGUMENT ONTOLOGIQUE
ART. 7 : Largument ontologique ne nous permet pas daborder
dans un monde transcendant lide : il nous oblige actualiser
ltre lui-mme dans son ide.
Les remarques prcdentes vont nous permettre de mesurer le
sens et la vritable porte de largument ontologique. Car il y a dans
cet argument une conscience trs aigu de lidentit entre ltre et
son ide, bien que la forme logique quon lui donne, au lieu de pr-
parer lintuition de cette identit, semble plutt la dissimuler en
nous donnant lillusion daborder, par lintermdiaire de lide, dans
un monde diffrent situ au del. Il en est de cette preuve comme du
je pense, donc je suis qui dj limplique et o la force de la
conclusion nexprime rien de plus que lvidence dune relation sai-
sie dans lunit dune intuition. Ainsi, on est frapp, en lisant Des-
cartes, de la rapidit pour ainsi dire dcevante avec laquelle il non-
ce le corps mme de largument, savoir que lexistence est conte-
nue dans lide de Dieu de la mme manire que lgalit des trois
angles deux droits est contenue dans lide du triangle, et du soin
minutieux avec lequel il prpare la preuve prliminaire sans laquelle
largument principal scroulerait, savoir quil y a vritablement
une ide de Dieu, que cette ide nest pas une apparence, une fiction
ou un simple nom, en dautres termes que cette ide existe, comme
si, aprs avoir tabli quelle possde ltre, il allait de soi quelle ft
reprsentative dun tre.
On voit de mme Leibniz sabstenir de contester la validit de
largument une fois quon aura russi dmontrer la possibilit
mme de lide : cest l ses yeux le point essentiel sur lequel il ne
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 224
cesse dinsister et quil reproche Descartes de navoir pas suffi-
samment lucid, reproche peu fond sans doute si Descartes, en
prouvant lexistence objective de [232] lide, entendait par cette
expression peu prs ce que Leibniz entendait par sa possibilit, et
si, en faisant de cette ide lide de la souveraine ralit, par cons-
quent lide de tout le positif, il en excluait ncessairement toute
dtermination ngative et par consquent toute contradiction.
Enfin, il faut remarquer que, dans la rfutation mme que donne
Kant de largument ontologique, lobjection porte non pas contre la
validit logique de la conclusion, mais contre linterprtation quil
faut donner de lexistence tire de lide : de lide selon lui on ne
peut tirer quune existence en ide, de telle sorte que, si ltre est
univoque, il suffira davoir reconnu ltre de lide pour poser aussi-
tt ltre dont elle est lide.
Toute la difficult consiste donc justifier la ralit dune ide
de ltre. Bien que cette ide soit lobjet dune apprhension imm-
diate ou dune intuition, elle nest pas saisie isolment, mais
conjointement avec ses formes qualifies, dont elle est non pas le
caractre commun, mais en quelque sorte la totalit qui est la fois
implique par linsuffisance de chacune delles, ncessaire pour les
soutenir et postule par lopration analytique qui les discerne sans
les crer. Loin de contester la prsence en nous dune ide de ltre,
il faut dire que cest la seule ide dont il nous soit impossible de
nous sparer jamais, la seule qui accompagne ncessairement toutes
les oprations et tous les objets de la pense. Et il suffit de constater
quelle est, au lieu de demander quelle nous rvle un tre distinct
delle, pour quelle apparaisse comme nous rvlant immdiatement
lactualit mme de ltre.
Le caractre essentiel de largument cartsien est donc de nous
permettre de reconnatre que lide de ltre est une ide relle, car
poser cette ide suffit poser ltre quelle pose. Ainsi on na pas
besoin de sortir de ses limites pour dcouvrir sa valeur ontologique :
cest par elle que notre esprit sassujettit demble dans ltre ; cest
sur elle que toutes les oprations ultrieures assureront leur objecti-
vit.
Descartes avait bien raison de vouloir quon lui accordt simple-
ment que le fini suppose dj linfini. Sans doute il y a de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 225
lindtermination dans linfinit : cest une tautologie [233] de dire
que la connaissance de ltre fini ne peut pas lembrasser ; aussi
bien le mot infini nexprime pas un caractre de ltre lui-mme,
mais la marge qui spare toujours ltre de la connaissance discursi-
ve la plus parfaite. Cependant lopposition de lun et du multiple a le
mme sens : car lun apparat comme infini ds quon cherche le
diviser, tandis que toute multiplicit relle est videmment finie. Or
lun est le caractre qui appartient ltre, et le propre de la cons-
cience, cest de se constituer en lui, de participer sa nature sans
lpuiser : elle vit de lanalyse quelle en fait. Mais elle retrouve son
unit partout, la fois dans sa propre essence et dans son objet, et
cest cette unit qui se rsout en une infinit ds que, isolant soit,
dans un terme particulier, la multiplicit des caractres quelle a d-
j discerns, soit, dans lensemble de son exprience, la multiplicit
des termes particuliers avec lesquels elle est dj entre en contact,
elle considre les caractres ou les termes quelle ne connat pas en-
core comme capables, en sajoutant sans trve les uns aux autres, de
restituer lunit de ltre, telle quelle lui est actuellement donne.
Au lieu de considrer ltre comme contenu par dfinition dans
lide de la perfection infinie car ce mode dexposition de la
preuve ontologique laisse toujours lesprit une certaine inscurit
et lexpose au soupon de verbalisme il faut donc que cette ide
de la perfection infinie nous apparaisse non pas comme enveloppant
ltre la manire dun des lments qui forment sa comprhension,
mais comme se confondant avec ltre mme, comme ayant la mme
essence et la mme tendue : car ltre, cest ce qui est pos comme
complet et achev, quoi il ne manque aucune dtermination pour
subsister et cest l ce quexprime lide de la perfection cest
aussi ce que notre conscience, ds quelle sengage dans le temps,
ne parviendra pas puiser et cest l ce quexprime lide de
linfinit. De telle sorte que les mots perfection et infinit ne sem-
blent contradictoires que parce que le premier exprime la position de
ltre, et le second leffort par lequel la connaissance cherche le
reconstruire.
Nous voudrions rassurer la susceptibilit de tous ceux qui consi-
drent largument ontologique comme ne nous mettant pas seule-
ment en contact avec la ralit de lide de Dieu, [234] mais comme
concluant lexistence dun Dieu transcendant, extrieur lunivers
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 226
dans lequel nous vivons. Car Dieu ou ltre pur est transcendant
tout le sensible et mme tous les termes particuliers. Mais person-
ne na demand sans doute quil soit transcendant son ide, cest-
-dire que sa ralit soit autre que spirituelle, du moins si lon a soin
de distinguer lide (pense par un tre fini) de lopration momen-
tane par laquelle il la pense. La forme la plus parfaite de la croyan-
ce en lexistence de Dieu ne consiste-t-elle pas le faire habiter
lintrieur de chaque conscience, et sans doute ly faire habiter in-
divisiblement, ce qui est une manire de considrer notre propre
conscience comme habitant en lui, comme trouvant en lui sa lumire
et son aliment ?
ART. 8 : Le possible ne tend pas vers ltre, mais ltre contient le
possible qui sen dtache pour permettre ltre fini de sactualiser.
On pourrait penser que nous nous bornons prsenter ici
largument ontologique non plus sous la forme dune simple impli-
cation logique, mais sous une forme dynamique qui permet mieux
de saisir son originalit. Ainsi on a dit dj quil y a dans chaque
possible une sorte dappel lexistence proportionnel son degr de
perfection, cest--dire son degr de ralit, ou encore la richesse
de sa comprhension. Ds lors, lide de la toute perfection, cest--
dire dune comprhension infinie, aurait un titre infini tre, et par
consquent on verrait la limite la possibilit se confondre avec
lexistence. Cependant lide dune srie de termes qui seraient
mi-chemin entre le nant et ltre, si elle donne une grande satisfac-
tion lesprit qui, passant dans le temps dune manire continue
dune forme dexistence lautre, a limpression de fondre leur di-
versit dans leur unit, constitue une extension illgitime dune m-
thode qui montre sa fcondit lintrieur de ltre et ds quil est
pos, mais qui est tout fait impuissante engendrer ltre lui-
mme. Entre le nant qui, tant lexclusion de ltre, exclut son tre
propre, et ltre qui, pour tre pos, doit ltre simplement et abso-
lument sous peine de ne pas ltre du tout, il y a une arte [235] vi-
ve : aucun lien ne sera jamais trouv pour les unir. Et les efforts de
Platon pour rompre lalternative de Parmnide taient vous un
chec certain. On ne perdra jamais de vue dabord que le jugement
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 227
de ngation exprime une analyse par laquelle nous refusons un as-
pect de ltre un caractre que nous affirmons implicitement au m-
me moment de ltre total, ensuite, que toute possibilit, ainsi que la
tendance exister quon lui prte, doivent primitivement tre inscri-
tes dans ltre, de telle sorte que lon se heurterait soit un cercle
vicieux, soit une distinction contre laquelle nous navons cess de
protester entre ltre du possible et ltre mme du rel, sil ny avait
pas, derrire ce langage mystrieux, une vue concrte compatible
la fois avec luniversalit et avec lunivocit.
Et de mme quon ne peut pas russir abolir ltre de
laspiration en lextnuant par degrs, on ne russit pas davantage
dans lopration inverse et corrlative qui consiste accrotre telle-
ment labondance de cette ide, dpouille de ltre, mais qui y aspi-
re, quelle finirait par concider avec lui. Elle nobtient par l que ce
quelle possdait dj. En fait, une telle preuve de lexistence de
Dieu drive de lopposition que font les tres finis entre lexistence
sensible et lexistence intellectuelle. Mais lexistence sensible nest
point sans doute un progrs sur lexistence intellectuelle : la premi-
re ne peut tre applique quau monde et na de sens que pour
lhomme.
Sil ny a dtre en effet que ltre du tout, on comprendra sans
peine comment chaque ide particulire ne parviendrait reprsen-
ter ltre de son objet que par sa solidarit avec toutes les autres
ides particulires, tandis que lide de ltre ou du tout est la seule
qui soit immdiatement reprsentative de ltre lui-mme. Ainsi,
toute ide particulire ne parat tre un possible tendu vers ltre que
parce quelle est un aspect de ltre quon en dtache, mais qui le
suppose. Et lide de ltre son tour ne parat tre un possible ca-
pable de rejoindre ltre par linfinit interne de sa puissance que
parce que, tant la rvlation de la prsence immdiate de ltre, elle
apparat en mme temps la connaissance comme le terme que cel-
le-ci obtiendrait par son propre achvement.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 228
[236]
ART. 9 : Largument ontologique est moins une promotion de
largument je pense, donc je suis que son modle absolu et le
ressort sans lequel il serait incapable de conclure.
On peut considrer largument ontologique comme tant un sim-
ple dveloppement de largument je pense, donc je suis et cest
ainsi que Descartes lui-mme le prsente. Car le moi qui se dcou-
vre dans le je pense est un moi imparfait et qui doute (ce qui suf-
firait rfuter la thse de ceux qui veulent que le je du je pen-
se soit le je de la pense en gnral, au lieu dtre proprement
non pas simplement le je individuel, mais ce je lui-mme en
tant quil dcouvre en soi la participation de la pense en gnral).
Or, si le fini ne peut pas tre pos sans linfini dont il est la limita-
tion, il est vident que lide de linfini est suppose par lide du
moi ; de telle sorte que, comme lide du moi implique ncessaire-
ment lexistence, et que lide du moi ne peut pas tre pose sans
lide de linfini (qui est lide de Dieu), il semble que lexistence
du moi implique elle-mme lexistence de Dieu. Cest dans le moi
que sopre notre rencontre avec lexistence ; mais puisque le moi a
ncessairement linfini pour support, il faut quil communique
lide de linfini la mme existence dont il a fait lexprience en lui-
mme.
Telle est la manire dont on peut exposer le passage du je pen-
se, donc je suis largument ontologique. Cependant, si lon ne
perd pas de vue quil nous a dcouvert seulement la primaut de
linfini par rapport au fini, il est vident que cest lide du moi qui
nous conduit historiquement vers lide de linfini et nous apprend
prouver son existence, mais quinversement cest lide de Dieu qui
contient lide du moi et qui la fonde ontologiquement. Il faut donc
que nous apprenions comparer de plus prs le passage de lide
lexistence quand il sagit du moi et quand il sagit de Dieu.
Or, on peut dire que le moi qui dcouvre son existence comme
insparable de la pense tablit entre ces deux termes une triple rela-
tion qui est : 1 une coexistence empirique dont la conscience ne
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 229
cesse de tmoigner ; 2 une conscution logique justifie par le prin-
cipe que pour penser il faut tre et dont largument fournit une sorte
dillustration concrte ; [237] 3 une gense mtaphysique, puisque
cest lacte de la pense qui introduit le moi dans ltre.
Mais cette triple relation telle que nous lobservons dans le moi
nest quune sorte dapplication ou de prise de conscience de la ma-
nire mme dont elle se ralise dans labsolu car : 1 il y a une exp-
rience proprement spirituelle dont le caractre essentiel, cest que la
pense de Dieu nous donne sa prsence elle-mme ; 2 limplication
logique qui a donn sa forme classique largument ontologique et
qui nous permet de passer de lide de Dieu lexistence de Dieu est
la justification du donc dans je pense, donc je suis , lorsquon
veut en faire un raisonnement et non pas une simple intuition ; 3
enfin, la concidence de fait et limplication logique entre ltre et la
pense trouvent leur origine premire dans cette cration de soi par
soi qui est la marque dun esprit infini et que nous imitons nous-
mmes notre manire par lacte de pense qui nous fait tre.
Sans doute on peut dire que nous ne nous sommes pas crs
nous-mmes, pas plus que nous ne possdons nous-mmes une exis-
tence indpendante. Nous disposons dune puissance de penser quil
dpend seulement de nous dactualiser. Cest cette distinction de la
puissance et de lacte qui est caractristique de tout tre fini et qui
lui permet de se faire par son initiative propre sans rompre pourtant
ses attaches avec labsolu. La relation entre le je pense, donc je
suis et largument ontologique fait paratre ici un entrecroisement
singulier entre les deux notions de puissance et dacte. Car cest seu-
lement dans le moi que jai lexprience de lactualisation dune
puissance : de telle sorte que linfini demeure toujours, lgard du
moi, ltat de puissance pure. Mais Descartes lui-mme nous met
en garde contre une telle interprtation : car la puissance, cest le
signe mme de limperfection et de la limitation, de telle sorte que
linfini nest en puissance que lorsque nous partons du fini pour es-
sayer de lembrasser, au lieu que, si nous le posons comme la condi-
tion du fini, il ne peut tre pos que comme un infini actuel sans le-
quel le fini mme ne pourrait pas tre actualis. A lgard du fini
actualis, linfini est toujours une puissance pure : mais il postule
pour sactualiser un infini actuel, [238] lgard duquel cest le fini
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 230
qui redescend ltat dune puissance qui ne sactualise pas tou-
jours.
ART. 10 : Largument ontologique exprime le passage de lide de
linfini en tant quil est lobjet de notre pense, cest--dire un d-
passement de tout le fini, lide de linfini en tant quil est lacte
suprme dune pense gnratrice delle-mme et de tout ce quelle
peut poser.
Contre largumentation prcdente on peut faire valoir cette ob-
jection quil ny a pas seulement entre ltre du moi et ltre absolu
la relation du fini et de linfini, de telle sorte que pour passer de lun
lautre, il suffirait de voir que cest le fini qui appelle linfini dans
lordre de la connaissance, tandis que cest au contraire linfini qui
fonde le fini dans lordre de lexistence. La difficult essentielle
consiste dans la disparit entre le je qui est un acte de la pense
et lide de Dieu qui nest quun objet de cette pense. De l la pr-
minence que lon a accorde au moi sur lide de Dieu et
lobligation de prouver qu cette ide elle-mme correspond une
existence, ou encore quelle nest pas un pur objet de pense. Mais
cette opposition rvle seulement une ambigut singulire et que
nous avons dj signale dans lacception du mot ide. Car lide
peut tre considre en effet tantt comme un objet pour la pense,
et tantt comme une source dans laquelle elle puise. Au premier
sens, le moi nest pas une ide, et cest pour cela quon a toujours
lgitimement protest contre la lgitimit dune connaissance du
moi par lui-mme qui lanantirait en le transformant en objet ;
mais, au second sens, on peut bien dire du moi quil est une ide qui
se ralise : se connatre alors, cest prendre conscience de soi, des
puissances que lon porte en soi et chercher les raliser. Or, quand
nous parlons de lide de Dieu, il semble quelle ne puisse tre
quun objet pour le moi : mais alors les contradictions saccumulent,
car Dieu, tant un esprit infini alors que le moi ne lest que par par-
ticipation, est aussi ce qui par excellence ne saurait jamais devenir
un objet : et Dieu nest plus quune puissance nue dont nous ne sa-
vons pas sil est possible quelle sactualise, puisque nous
nactualisons nous-mmes linfini [239] que par chelons. Nous
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 231
sommes tenus par consquent dessayer de prouver, en franchissant
la limite de la conscience o cette ide nous avait dabord enferms,
quil y a en effet une existence qui lui correspond. Cependant le
propre de lide de Dieu, cest de ntre aucun degr une ide-
objet, mais seulement une ide-source, de telle sorte que, loin dtre
subordonne de quelque manire au moi qui la pense, elle exige que
le moi sy subordonne, puisque cest elle quil emprunte lactivit
mme sans laquelle il ne pourrait ni penser, ni tre. Lessence de
largument ontologique consiste dans le passage de lide-objet
lide-source, de la pense que jai de Dieu un acte de pense su-
prme dans lequel se dtermine ma propre pense et sans lequel elle
serait incapable de se soutenir, dun infini qui nest dabord que le
dpassement de tout le fini, un infini qui est la condition sans la-
quelle aucun terme fini ne pourrait tre pos. Lide de Dieu com-
mence par apparatre comme un produit de notre pense pour deve-
nir bientt cette efficacit pure do notre pense elle-mme proc-
de : il semblait quelle et besoin du moi pensant comme cause
avant quelle nous rvlt la prsence mme de ltre en tant quil
est cause de soi, et de tout ce qui peut tre, en particulier du moi en
tant quil a le pouvoir de se poser et de poser tous les objets particu-
liers de sa pense. Ainsi largument ontologique exprime la dcou-
verte, au del de lintriorit du moi, de lintriorit mme de ltre
laquelle le moi nous permet seulement de participer. Il permet de
substituer la subordination de ltre au moi, la subordination du
moi ltre : il nous montre que ces deux termes ne peuvent pas tre
dissocis. Il ralise cette inscription dans ltre du moi et de tous les
objets auxquels le moi sapplique par le renversement dune pers-
pective qui atteint ce double effet : dune part dobliger la conscien-
ce se reconnatre comme participant de cette ide de ltre, qui est
ltre mme, et qui semblait dabord participer de la conscience elle-
mme, et dautre part de convertir lobjectivit dans laquelle ltre
se rvle nous quand nous essayons de le penser, en une subjecti-
vit plus radicale que celle de notre pense elle-mme qui reoit
delle la puissance mme quelle a de dire : je ou moi .
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 232
[240]
D. LTRE ET LE CONNAITRE
Retour la table des matires
ART. 11 : Le connatre sidentifie avec ltre lorigine et au ter-
me de ses oprations.
La discussion prcdente, en identifiant ltre avec lide de
ltre, donne un fondement assur la connaissance. Car ltre et le
connatre eux-mmes apparaissent alors comme insparables : il est
vident que ltre ne peut tre pos que par le connatre et que le
connatre lui-mme, au lieu dtre extrieur ltre, lui est intrieur.
On peut dire la fois quil lenveloppe et quil en est une dtermina-
tion. Cest cette homognit de ltre et du connatre qui fonde la
comptence du connatre lgard de ltre (mais condition, com-
me on la montr dans larticle 4, de ne pas prtendre le connatre
comme nous connaissons un objet). Cependant on peut concevoir de
diffrentes manires le rapport de ltre et du connatre : et de celle
que lon adoptera dpendra le sort de la mtaphysique elle-mme.
Car le problme est toujours de savoir si ltre est engendr par la
connaissance comme la consommation de ses dterminations, ou sil
est suppos par elle comme la condition de leur possibilit. On na
sans doute pas assez remarqu que lobjet de la connaissance ne
peut tre que de reconstruire une ralit qui lui est donne primiti-
vement, que ltre ne peut tre conu comme le point vers lequel
tendent toutes ses oprations que parce que chacune delles trouve
en lui sa condition et son appui, quon ne peut pas se dispenser
dinscrire dans ltre la conscience elle-mme et que sa seule origi-
nalit par rapport lui est de se mouvoir dans une sorte dintervalle
entre ltre dans lequel elle plonge au moment o elle nat et ltre
avec lequel elle sunit au moment o elle steint dans sa propre per-
fection.
On ferait les mmes constatations en considrant les rapports en-
tre lide et le jugement. Car il est bien vrai de dire que toute
connaissance sexprime ncessairement par un jugement ; mais le
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 233
jugement peut tre considr soit comme lopration qui dveloppe
le contenu de lide, soit comme lopration qui la constitue. Ces
deux interprtations sont solidaires [241] et rciproques ; le juge-
ment implique la relation : or toute relation est sans doute en un sens
synthtique ; mais cette synthse est un moyen pour nous de prendre
conscience dune solidarit dlments lis entre eux dune certaine
manire dans le monde intelligible, et que le jugement retrouve, au
lieu de la crer. Le jugement est le seul moyen que nous ayons de
penser lide grce une sorte de dhiscence ou de rupture de son
unit, et le jugement est une opration discursive qui exige la pr-
sence dun temps logique dans lequel il se dploie.
Franchissons maintenant un pas de plus : nous verrons quaucune
ide particulire ne se suffit elle-mme, mais que le rapport entre
lide et ltre est du mme ordre que le rapport que nous venons
dtablir entre le jugement et lide. De mme en effet que le juge-
ment est une analyse de lide, lide est une analyse de ltre ; mais
de mme que lide semble engendre par le jugement, qui est la
forme de toute connaissance, nous cherchons ltre postrieurement
lide et nous oublions quelquefois quil la fonde, en songeant
quon ne peut le saisir que grce son intermdiaire. Enfin, de m-
me quune seule ide apparat comme capable de suffire une mul-
tiplicit de jugements, il faut dire du mme tre quil donne naissan-
ce une multiplicit dides. Bien plus, puisquil ny a dtre que du
tout, on atteint ici un dernier point qui ne peut plus tre dpass :
cest dans un seul et mme tre que toutes les ides trouvent gale-
ment racine. Lide en gnral ne parat avoir une supriorit mta-
physique sur le jugement que parce quelle est mdiatrice entre le
jugement et ltre. Car seule lide qui, au lieu de nous fournir une
reprsentation dun aspect de ltre, nous fournit une reprsentation
de ltre tout entier, exige dtre confondue avec lui.
ART. 12 : Lide de ltre, qui est lexigence dune concidence
idale de ltre et de la connaissance, est ncessaire pour que celle-
ci puisse non seulement sachever, mais mme commencer.
Si lon rsiste cette assimilation de ltre et de lide, qui est le
fondement ontologique de toute connaissance, cest [242] parce que
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 234
chaque ide particulire est hors dtat de rejoindre la totalit
concrte implique par la ralit de son objet, de telle sorte que la
distance qui la spare de cet objet ne parat pouvoir tre franchie que
par un enrichissement graduel de son contenu dans le temps. En
imaginant de la mme manire que lide de ltre est une ide abs-
traite, les partisans de la mthode synthtique la rejettent dans le
monde des notions sans contenu, puisque lide de ltre, tant ds
lors labstraction pousse jusqu sa limite, verrait svanouir ce que
chaque ide particulire garderait encore de positif, et ils identifient
alors ltre rel avec le terme vers lequel tendent les oprations de la
connaissance.
Mais on peut faire trois remarques pour montrer que cette
conception des rapports entre ltre et son ide, si on linterprte
comme il convient, justifie au lieu de la dtruire la plnitude absolue
de lide de ltre : car, en premier lieu, si toute ide particulire est
abstraite par rapport son objet, cest parce que cet objet porte en
lui, par ses relations avec tous les autres, la totalit de ltre dont
cette ide semble le dtacher. Mais lide nest pourtant reprsenta-
tive dun tel objet qu condition dvoquer cette totalit. Au lieu
dimaginer quen pensant dans cet objet son tre et non pas ses qua-
lits, on lappauvrit indfiniment, il faut dire au contraire que penser
son tre, cest penser, au del de lide particulire que nous en
avions dabord, la totalit actuelle de ses qualits, de celles que nous
ne connaissons pas comme de celles que nous connaissons. Ici aussi
lide se dcouvre nous peu peu comme enveloppant une infinit
en puissance. Et si on rpond que cest l une ide fictive, puisque
cest une ide dont il nous est prcisment impossible de dployer
tout le contenu, nous rpondrons que le propre dune ide, cest de
contenir en elle une richesse que lon naperoit pas dun seul coup
et que le rle des actes de lintelligence est dexpliciter. Aucun
homme ne peut se vanter, lorsquil pense une ide, den faire jaillir
immdiatement tout ce que lanalyse pourra y dcouvrir. Cela est
vrai mme des ides dont lessence purement abstraite semble en-
ferme dans leur dfinition, comme les ides gomtriques, car la
dmonstration nachvera jamais le recensement de toutes leurs pro-
prits. Que [243] dire cet gard de lide de ltre quil est impos-
sible de poser sans y inscrire davance tout ce qui nous sera jamais
rvl ? Elle aurait cependant peu de fcondit si les formes de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 235
ltre ne pouvaient tre nos yeux que des modes dapprhension
empiriques ; mais si au contraire on peut les rattacher toutes lide
de ltre par une articulation dialectique, cette ide ne contiendra pas
seulement une richesse possible que lexprience seule nous dcou-
vrira, mais une richesse relle, qui appelle cette exprience et qui la
fonde. De toute manire, lide de ltre, au lieu dapparatre comme
lunit de labstrait, doit tre dfinie comme lunit du concret, et
cest pour cela que les objets particuliers avec leurs ides doivent
venir prendre place en elle pour quils aient un contenu et pour que
lanalyse qui les oppose sans les dsunir ne soit pas sans fondement
intelligible.
En second lieu, il y a une ambigut quil importe de dissiper sur
le sens que lon donne labstrait et sur le caractre dirralit quon
lui attribue. Une ide, mme abstraite, nest pas un pur nant : elle
est une forme particulire de ltre ; si elle est lopration dun esprit
fini, ni cette opration, ni lesprit qui laccomplit ne peuvent tre
considrs comme tant en dehors de ltre. Et puisque, partout o
ltre est donn, il est donn tout entier, lide abstraite ne pourra
subsister sans toutes les autres ; elle les appelle donc non pas
lexistence, puisquelles sont toutes contenues dans ltre pour quil
soit possible de les y dcouvrir, mais la conscience qui les dcou-
vre lune aprs lautre dans la dure et qui postule ds lorigine,
pour justifier sa propre nature, la solidarit de toutes les formes in-
telligibles qui pntreront jamais en elle. Cependant lide de ltre
ne possde pas seulement la mme existence que toutes les ides
abstraites ; elle donne celles-ci lexistence mme quelles poss-
dent. Si une ide ne tient pas son existence delle-mme, elle ne peut
la tenir que dune autre ide qui la contient : mais il ne faut pas que
cette ide soit elle-mme abstraite, sans quoi la mme difficult re-
natrait indfiniment ; elle ne peut tre que lide concrte du
concret, et cette ide, si on la compare aux ides abstraites, les sur-
passe infiniment, prcisment parce quelle se confond avec leur
totalit. Cest cette totalit actuelle, [244] mais qui ne peut pas tre
totalise, du moins si la connaissance est une analyse et non une
synthse, qui nous donne cette motion parfaite insparable de tout
contact avec ltre et qui se produit aussi bien devant ses formes les
plus humbles que devant les plus grandioses.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 236
Troisimement, lidentit de ltre et de lide est confirme plu-
tt que ruine par le dveloppement mme de la connaissance. Car
lesprit prend pied dans ltre ds quil entreprend de connatre et
mme ds quil prend conscience de lui-mme. Cependant
lambition propre notre esprit fini nous porte penser quil ny a
rien nulle part l o il ny a encore rien pour nous : et ds lors, ltre
ne sera rien avant dtre connu ; il concidera avec lachvement de
la connaissance.
De fait, il est impossible que nous puissions nous reprsenter
ltre autrement que comme une connaissance laquelle il ne man-
querait rien, comme une synthse totale, ou, si lon emprunte le lan-
gage de lanalyse, comme une vision assez subtile et assez pntran-
te pour que la totalit du rel pt apparatre au regard avec une
transparence parfaite. Cependant il faut ncessairement poser le rel
pour aspirer le connatre, puisque ce pouvoir de connatre faisant
partie de ltre ne peut pas le prcder. Mais cest le propre de la
connaissance de chercher contenir en elle lunivers dans lequel
elle est ne ; elle mettrait en doute sa valeur et sa lgitimit, elle ac-
cepterait de se mutiler, cest--dire de se nier, si elle pouvait admet-
tre quil y et rien dans ltre qui lui chappt dune manire essen-
tielle et dcisive et qui pt demeurer hors datteinte pour elle, mme
si elle tait arrive son point de perfection. En ce point du moins,
il ny aurait plus de distinction entre ltre et son ide. Ds lors,
puisque ctait de ltre que tout le mouvement de lesprit avait d
partir, cest que cet tre tait dj indiscernable de lide qui devait
le retrouver. Ici lopposition que lon voudrait tablir, pour sauve-
garder leur originalit, entre le connatre et ltre, entre labstrait et
le concret, le possible et le rel, la confusion initiale et une analyse
acheve, ne saurait tre maintenue, car il est vident que, si la
connaissance tait pousse jusqu sa limite, elle svanouirait en se
consommant ; lintervalle [245] qui spare le sujet de lobjet serait
aboli, et ltre avec lequel elle viendrait sidentifier au terme de ses
oprations, ne diffrerait en aucune manire du tout indivis avec
lequel elle tait entre en contact dans sa premire dmarche. Ainsi
la ncessit o nous sommes de confondre ltre avec son ide aux
deux extrmits de luvre de la connaissance, pour quelle puisse
commencer et pour quelle puisse sachever, justifie lopposition et
la connexion de ltre et de son ide dans toutes les oprations par
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 237
lesquelles un tre fini constitue sa propre vie au cours de la dure ; il
est lui-mme comme une ide quil soblige actualiser grce la
rencontre incessante de nouvelles limites quil doit toujours dpas-
ser.
ART. 13 : Puisque ltre cest le tout, et que le tout ne peut tre
quune ide, le connatre, cest ltre mme en tant quil sanalyse.
Si ltre est identique au tout, ce tout ne peut apparatre aux yeux
dun tre fini qui ne concide pas avec lui que comme une ide, mais
cette ide qui tait dabord un objet pour la pense en devient bien-
tt la source. Ds lors, il ne faut pas stonner quelle fonde non
seulement la possibilit, mais lexistence de la partie comme telle et
de la conscience elle-mme en tant quelle analyse le tout et y d-
couvre des parties. Il y a donc homognit entre la partie et le tout,
bien que ltre de la partie soit ltre dun phnomne, et entre ltre
et la conscience bien que ltre de la conscience soit ltre dune
subjectivit.
Et cest pour cela quil est indiffrent de considrer, la manire
des idalistes, lindividu et le tout comme deux ides, mais condi-
tion que lide ne soit pas un simple objet pour une conscience, ou
dinclure, la manire des ralistes, lexistence de lindividu
lintrieur de celle du tout, mais condition de reconnatre que cette
inclusion est la participation de la conscience un acte qui la dpas-
se. Cela revient dire que lopposition de ltre et de lide, dont
nous avons montr quelle nest valable que pour les tres particu-
liers et non [246] pour ltre total, est un moyen dassurer au tout et
lindividu la possibilit de se distinguer lun de lautre et pourtant
de communiquer.
Lide de ltre, cest donc ltre mme. Dj nous avions remar-
qu quil ny a pas dide spare de ltre. Mais chaque ide parti-
culire implique toutes les autres, et ltre consiste dans cette impli-
cation totale quil faut ncessairement poser pour quelles puissent
ltre.
Il y a dans la pense une infinit en puissance, comme il y a dans
ltre une infinit actuelle ; mais pour que cette distinction puisse
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 238
tre faite, il faut que nous nous trouvions en prsence dun sujet in-
dividuel qui, en limitant la pense, manifeste en elle un pouvoir qui
dborde son objet, et, en limitant lobjet de la pense, dcouvre en
lui une richesse qui dborde sa propre opration. Retirez lobjet par-
ticulier, ou plutt considrez la totalit des objets, cette distinction
svanouit comme elle svanouit aussi si vous retirez le sujet indi-
viduel et considrez la pense dans son universalit ; alors la pense
et ltre se recouvrent. Ds que lanalyse la rtablit, on retrouve le
conflit entre une pense qui semble une existence diminue, et une
existence qui semble une intelligibilit imparfaite. Toute ide parti-
culire est donc inadquate ; car penser adquatement un objet quel-
conque ce serait proprement penser le tout dont il est solidaire. Tout
acte intellectuel sinscrit par consquent dans lide de ltre et tend
la rejoindre ; celle-ci est la seule qui ne soit pas dpasse par son
objet ; car son objet est en elle, puisquelle est : elle est indiscerna-
ble de cet objet mme. Ltre dont elle est lide est le mme qui lui
donne ltre. La pense senveloppe donc ici dans un cercle qui t-
moigne, comme on la montr, que nous sommes en prsence dun
terme premier.
La plus grave erreur que lon pourrait commettre dans cette in-
terprtation analytique de la connaissance serait de penser que tout
ce que lanalyse pourrait jamais dcouvrir lintrieur de ltre sy
trouvait dj contenu sous la forme mme o elle le dcouvre. Cest
mal comprendre le rle de lanalyse et sa fonction proprement cra-
trice. Elle suppose ltre, mais seulement en tant quil est lunit
dun [247] acte qui soutient la possibilit de tous ses modes. Il est
leur fondement et non point leur somme : cest la participation qui
les actualise. Ainsi toute opration que la conscience accomplit est
elle-mme corrlative dune donne qui lui rpond et qui change
chaque instant le visage du monde.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 239
[248]
Troisime partie.
Lintriorit de ltre
Chapitre IX
DE LA PRSENCE DE LTRE
A. LA PRSENCE ET LE TEMPS
Retour la table des matires
ART. PREMIER : Le moi dcouvre ltre en dcouvrant sa propre pr-
sence ltre.
Il ny a pas dexprience plus mouvante que celle qui rvle la
prsence du moi ltre. Et si ltre est univoque, on comprend
quon ne puisse dcouvrir la prsence du moi sans dcouvrir du
mme coup la prsence totale de ltre. La perfection de lmotion
insparable de cette premire dcouverte peut tre interprte de
deux manires : car les uns, la fois heureux et indignes davoir pris
place dans ltre, le confisquent aussitt leur profit, lenferment
jalousement lintrieur de leurs propres limites et ny participent
plus dsormais que pour en tirer de vaines jouissances damour-
propre ; mais ces jouissances spuisent vite ; elles ne portent que
sur les modes, et les modes privs de leur principe divertissent le
moi et le ruinent. Les autres ne retiennent de la prsence du moi
ltre que le vhicule qui leur permet dprouver la prsence mme
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 240
de ltre ; ils savent que cette prsence du moi ne peut pas tre iso-
le, quelle est sans cesse soutenue et alimente par la prsence de
ltre, quelle en est la forme manifeste, que le moi ne peut subsis-
ter et saccrotre que par une adhrence ltre qui doit tre en m-
me temps une adhsion, par un dtournement de soi et une circula-
tion dans le tout qui lui permet de constituer sa nature propre, de
dcouvrir et de remplir sa vocation.
On ne peut nier que cette prsence simultane de ltre [249] et
du moi et de lun lautre ne soit une exprience mtaphysique la
fois primitive et permanente, dont nul ne peut saffranchir, qui est
suppose et dveloppe par toutes nos relations avec les autres tres,
avec nous-mme et avec Dieu, et que celles-ci ont seulement pour
objet danalyser et dapprofondir, cest--dire de raliser. Mais les
hommes croient en gnral quil suffit dadmettre implicitement cet-
te double prsence et ils se rejettent aussitt vers la curiosit et
lamour des choses particulires. Alors ltre se venge dtre oubli :
il te aux choses particulires toute leur saveur ; aucune dentre el-
les nest plus capable de nous satisfaire ; cest quelles demandent
tre gotes en lui et par lui ; hors de sa prsence quelles actuali-
sent, ce sont des images qui nous fuient et qui ne suscitent en nous
que le dsir ou le regret. Elles nous asservissent par tout ce qui leur
manque. Elles font de nous des esclaves mcontents. Latmosphre
et le sentiment aigu de la prsence leur donnent un sens vif et plein,
accord avec le moi vivant, lui permettent de retrouver en elles le
tableau et leffet de ses puissances et les rendent aptes du mme
coup remplir toute sa capacit.
Cest cette dcouverte de la participation du moi ltre qui a
fait natre dans la conscience contemporaine le sentiment dangoisse
dont on a fait une rvlation mtaphysique plus profonde que le je
pense cartsien. Et lon peut dire en effet que tandis que le je
pense avait moins individualiser le moi qu montrer comment il
peut envelopper en droit le tout de ltre par la connaissance, au
contraire langoisse nous donne une conscience dchirante de
lintimit de notre moi, de son unicit subjective, la fois solitaire et
accable par limmensit et les tnbres qui lenveloppent.
Langoisse est le sentiment personnel de notre participation ltre
considre sous laspect de la dficience : non seulement elle ras-
semble en elle la triple intuition de la douleur, de la mort et du
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 241
temps qui nous menace et nous fuit tout ensemble, mais encore elle
situe notre vie sur le tranchant dune lame entre ltre et le nant. La
participation a aussi un aspect positif par lequel, dcouvrant le tout
de ltre dont nous ne pouvons pas tre spars, et toujours assujettis
dans le prsent, nous prouvons une joie faite de scurit, de posses-
sion et desprance [250] tout la fois. Le propre de la conscience
est dosciller entre ces deux extrmes comme entre les deux ples
opposs de la participation.
ART. 2 : Notre vie ne sort jamais de ltre, ni par consquent du
prsent.
On sait bien que nous ne pouvons parler de ltre quau prsent et
que le pass ou lavenir, si on les prenait en eux-mmes indpen-
damment du prsent o on les pense, appartiendraient au nant. Il ne
faut pas considrer le prsent comme tant un abstrait pur, une limi-
te vanouissante entre ce qui nest plus et ce qui nest pas encore. Le
prsent est le caractre fondamental de ltre, non pas seulement ce-
lui par lequel il nous est rvl, mais celui par lequel il se pose lui-
mme ; nous imaginons le temps pour expliquer lapparition dun
tre fini qui accde dans le prsent et qui sen retire, tandis quil se-
rait contradictoire pour ltre sans condition dchapper lternelle
prsence.
Mais il ne faut pas faire du temps un mythe qui nous dvore, et
ltre avec nous : il est seulement le moyen sans lequel nous ne
pourrions pas nous donner ltre nous-mme. Sans lui, nous ne
serions quune chose parmi les choses : encore voit-on mal comment
chacune delles pourrait se distinguer de toutes les autres. Nous re-
cevrions ltre au lieu de le crer ; cest dire que, si ltre est lui-
mme un acte, et non point une donne, nous ne participerions pas
son essence, et notre vie ne pourrait plus tre ce quelle doit tre :
incessant veil, contact indfiniment renouvel et continu, accrois-
sement immobile et mouvante possession. Le rle dune donne ne
peut tre que dappuyer llan qui la dpasse ; mais dans le temps
encore, ltre ne peut faire que nous ne soyons entran comme une
chose si nous lui refusons notre consentement spirituel, si nous ne
voulons pas nous associer son action cratrice par lexercice de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 242
notre libert. Il ny a de temps quafin dassurer le contraste de cette
donne et de cet lan, qui les rend possibles tous les deux, et qui les
relie lun lautre dans un acte transitif indivisible que lon ne peut
imaginer quen laccomplissant et qui ne se ralise que dans le pr-
sent.
[251]
De fait, notre vie tout entire scoule dans le prsent. Comment
pourrait-elle en sortir ? Il faudrait quelle sortt des limites de ltre.
Quand on dit quelle y pntre ou quelle labandonne, ce nest
quen apparence. Elle ne recouvre pas toute ltendue du prsent :
elle y participe selon des modalits diffrentes, mais dont aucune ne
sen spare jamais. Elle est limite et, en tant que telle, laisse bien
des choses hors delle : mais elle est tout entire dans ltre, qui est
la prsence elle-mme. Et si lon prtend que cette vie son tour est
compose dtats qui sont dans le temps, et par suite extrieurs dans
une certaine mesure les uns aux autres, on rpondra pour chacun de
ces tats ce quon a dit de la vie en gnral : cest quil na jamais
t ailleurs que dans le prsent, et que, sil y occupe une place limi-
te, cela ne veut pas dire quil ait jamais pu la quitter.
On considre tort le prsent comme une pointe mobile se d-
plaant en mme temps que ltre tout entier, mais ce sont seulement
les diffrents aspects de ltre qui, en se dtachant les uns des autres
grce lanalyse, acquirent au regard dune conscience finie une
prsence subjective variable. Cette prsence est une vue sur la pr-
sence totale : elle nous rvle celle-ci, qui la fonde. La prsence el-
le-mme ne change pas, quel que puisse tre son contenu : elle est
lide la plus pure que nous puissions nous faire de limmuable ; elle
est lternit concrte. Mais son contenu se renouvelle sans cesse
parce quil faut quil se mesure sur notre ouverture, sur ce que nous
pouvons vouloir et accueillir. Ce nest donc pas la prsence de ltre
que nous crons, mais notre prsence ltre. Cest comme si nous
devions faire chaque instant un choix sans cesse recommenc dans
un tre infini et omniprsent lintrieur duquel il nous faudrait
constituer du mme coup notre existence et notre nature. Mais elles
ne le sont jamais, car nous ne sommes nous-mmes que par ce choix
qui, sil venait cesser, nous ferait cesser dtre ou nous rduirait
ltat de chose. Il y a l une participation la prsence totale qui est
toujours limite par son objet, mais totale par la prsence mme de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 243
cet objet. Et sans doute le temps sinsinue alors de manire accuser
la disparit entre la totalit de la prsence et la limitation de lobjet
prsent, mais [252] on ne peut jamais faire ni que la prsence elle-
mme disparaisse, ni que lobjet, bien quil nen occupe quune par-
tie, russisse sen affranchir.
Nous navons pas besoin sans doute de demander quon interpr-
te correctement la notion de lomniprsence, telle que nous venons
de lexposer : nous navons pas voulu dire que la totalit du rel doit
tre considre comme tant en soi une sorte de pass intgralement
droul par avance et dont les diffrents individus seraient les spec-
tateurs passagers. Le pass prcisment nexiste comme pass, cest-
-dire comme spectacle, que pour un individu qui la vcu comme
prsent, et qui par consquent la cr. Faut-il dire ds lors quil
nexistait jusque-l que comme possible ? Oui sans doute, si lon
veut avoir gard non plus ltre en soi, mais aux liberts particuli-
res qui fondent en lui leur tre particip ; car le mot de possibilit
na de sens qu lgard de ces liberts : il reprsente le champ dans
lequel elles peuvent sexercer, cest--dire leurs puissances aux deux
sens de ce mot, qui exprime une limitation par opposition ltre
actuel et linitiative par laquelle elles sactualisent. Par contre, il ny
a point de possible en soi : peut-tre peut-on dire que ce qui reste
ltat de possibilit pour un individu est toujours actualis par un
autre. Mais il suffit pour le moment dobserver que, puisque chacun
deux se ralise grce un acte de participation qui lui est propre, on
peut dfinir la prsence totale non point comme celle de tous les
possibles la fois, mais plutt comme lacte qui fournit tous les
tres particuliers assez defficacit pour poser tous les possibles et
pour quaucun de ces possibles ne demeure jamais ltat de pure
possibilit.
ART. 3 : Le prsent ne se confond pas avec linstant, et comprend
en lui le pass et lavenir sous la forme dides prsentes, dont les
relations entre elles et avec linstant permettent notre personnalit
de se constituer.
Subordonner ltre au temps, cest le subordonner lune de ses
dterminations. Le prsent ne se confond pas avec linstant : il com-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 244
prend en lui le pass et lavenir ; comment [253] pourrait-on les pla-
cer hors du prsent autrement quen les plaant hors de ltre, cest-
-dire en admettant que ltre ne cesse de natre du nant et dy re-
tomber ? Le pass, dira-t-on, a t un objet prsent et lavenir le de-
viendra ; mais, en tant que pass et en tant quavenir, ils sont exclus
du prsent. Or, quest-ce que cela veut dire, sinon quaux yeux de tel
sujet dtermin, assujetti vivre dans le temps, ils doivent tre dfi-
nis maintenant comme des ides prsentes ? Peu importe quelles
soient actuellement penses ou quelles soient seulement suscepti-
bles de ltre ; peu importe quelles apparaissent la mmoire
comme des ralits dj fixes et quelle voquera avec plus ou
moins de fidlit, ou quelles apparaissent la volont comme des
possibilits encore indtermines et entre lesquelles elle pourra
choisir. Le point important, cest que lon ne puisse jamais faire sor-
tir un terme du prsent de la sensation que pour le faire entrer dans
le prsent de limage.
Cette doctrine ne serait choquante que si on lui donnait un sens
grossirement matriel, cest--dire si lon admettait que le prsent
subsiste en soi avec les caractres que lui donnait la sensation quand
nous cessons de le sentir comme prsent, ou quil prexiste en soi
avec les caractres quelle lui donnera, alors quil nest encore pour
nous que futur. La prsence de lide du pass ou de lide du futur
ne cache pas la subsistance objective dune sensation conserve ou
anticipe. Ce nest pas le mme vnement qui est prvu, ralis,
puis rappel ; cest seulement la faveur de cette identit suppose
que lon est oblig de lexclure du prsent, cest--dire de ltre ds
quon ne peut plus le penser comme pass ou comme futur. Mais en
ralit il y a l trois vnements qui, il est vrai, ont entre eux un rap-
port privilgi, et tous les trois appartiennent galement au prsent :
on ne dira pas quils sont simultans, parce que la possibilit de les
distinguer est prcisment la dfinition mme de ce quon appelle
une succession ; mais cette succession ne peut pas nous dissimuler
que ni lun ni lautre na jamais t comme tel, ni pass, ni futur et
que ces mots dsignent seulement le contraste peru par nous entre
des aspects diffrents de la prsence totale. On pourrait exprimer la
mme ide autrement, en disant quun [254] vnement ne ralise
son essence que sil revt ces diffrents aspects tour tour et sil les
convertit lun dans lautre selon un ordre proprement irrversible.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 245
Cest cette irrversibilit qui nous empche de reconnatre la signifi-
cation privilgie de la prsence et denfermer en elle le remmor
et le dsir aussi bien que le peru. Nous sommes aveugls par la
prsence du corps qui fait cran des prsences plus subtiles et plus
intimes. Inversement on ne doit pas stonner quil faille obturer cel-
le-l pour que celles-ci puissent se produire : en sopposant entre
elles comme le pass avec le futur, elles donnent lesprit son mou-
vement travers la prsence sensible o sopre le passage de lune
lautre.
Que nous ne puissions pas nous rendre lobjet prsent par la sen-
sation, et quelle ne puisse pas nous rendre prsent tout lunivers
la fois, cest dj le signe de nos limites ; mais cest aussi la condi-
tion de lopposition entre la sensation et limage et par consquent
de notre distinction subjective lgard du tout, cest--dire de notre
existence et de notre indpendance spirituelles. Que dans le monde
des images, celles qui reprsentent le pass aient en droit un caract-
re unique et irrformable, cest le signe de notre esclavage lgard
de ce que nous avons fait. Que celles qui reprsentent lavenir soient
multiples, inacheves et flottantes, cest le signe de notre ignorance
lgard de ce que nous ferons : aussi bien ny a-t-il de science que
de ce qui est fait, cest--dire du pass. Mais sans cet esclavage, qui
nous enchane nous-mmes et non point un autre, nous ne ferions
pas corps avec ltre que nous nous sommes donn, et sans cette
ignorance, qui est essentielle et non accidentelle, nous ne participe-
rions ltre que comme une chose qui pourrait se contempler elle-
mme, et non comme un acte qui ne cesse de sengendrer. Ainsi
nous crons chaque pas lobjet mme dont la mmoire est la scien-
ce.
Ds lors, bien que notre moi ne sorte jamais du prsent, il faut
quil se sente attach ltre qui le limite : cest la sensation ; il faut
aussi quil sen distingue grce lopposition de la sensation et de
limage. Dune manire gnrale, notre vie consiste dans la transi-
tion ou le passage de lune lautre : cette transition seffectue dans
le prsent ; elle a lieu en deux [255] sens selon que nous allons de
limage indtermine la sensation ou de la sensation limage d-
termine. Mais, puisque ni la sensation, ni aucune de ces deux ima-
ges ne subsistent hors du prsent, cest la relation intemporelle que
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 246
nous tablissons entre elles qui fait apparatre lide de temps et qui
dtermine son cours.
Le temps exprime lhtrognit entre les aspects du prsent ; il
introduit dans ltre la relation qui est le moyen de la participation ;
la double permutation entre la sensation et limage prouve que notre
tre spirituel est consubstantiel ltre total et ne cesse de se nourrir
des contacts sans cesse renouvels quil a avec lui. Cependant la
transformation de lanticipation en souvenir par lintermdiaire de la
sensation est un acte : il prouve que nous ne nous bornons pas su-
bir la pression de lunivers, mais que nous sommes simultanment
les crateurs de notre personnalit et de lunivers lui-mme.
Lessence de ltre se rvle nous non plus comme une chose,
mais comme un acte auquel nous collaborons et qui est notre acte
propre. Et cette impression laquelle aucun homme nchappe quil
ny a rien hors du prsent reoit sa confirmation quand on pense que
ltre est acte et que, si une chose peut encore subsister quand on la
oublie et avant quon lait dcouverte, un acte ne peut subsister que
lorsquil saccomplit.
On nallguera donc pas que le prsent est seulement une dter-
mination du temps et quen identifiant ltre avec le prsent, nous
interprtons en lhypostasiant le contraste que le temps permet de
reconnatre entre ce qui est et ce qui nest plus ou ce qui nest pas
encore. Car le prsent nest pas linstant, qui nest quune limite
vanouissante, le point o se rencontrent et se croisent les diffrents
modes de la prsence. Le temps suppose le prsent et non pas inver-
sement. Car cest le prsent qui est vcu et non pas le temps, comme
on le croit presque toujours : le temps nest que pens. Au prsent
appartiennent la fois la sensation, limage et la transition de lune
lautre. Et la sensation, quand elle a disparu, ne doit pas tre
considre comme retire la fois de ltre et du prsent : le sujet
na plus daccs ltre quelle reprsente autrement que par
limage, qui est un tat nouveau [256] et un tat prsent. Mais cette
distinction de la sensation et de limage ne peut avoir de sens que
pour le sujet qui les peroit lune aprs lautre : elle est non pas un
des caractres de ltre, mais une des conditions de notre participa-
tion ltre. Ltre fini, toujours insparable du prsent, se distingue
du tout grce au temps, qui est un milieu quil imagine, et dans le-
quel se dploie sa vie subjective, qui est une vie dimagination. Sans
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 247
elle, il ferait corps avec ltre total et il naurait aucune indpendan-
ce. Cest par elle quil ne cesse de fonder et de renouveler sa per-
sonnalit prsente qui, bien quassujettie dans ltre, nen actualise
jamais quune partie, mais retient pour toujours en elle-mme com-
me un bien qui lui est propre tout ce quelle a peru, en mme temps
quelle prvoit et contribue produire les oprations nouvelles par
lesquelles elle ne cessera de senrichir.
Mais si le prsent nest pas un lment du temps, il nen est pas
non plus la ngation : il en est au contraire le fondement et le sou-
tien, car le temps nat de la distinction et de la relation qui stablit
entre les formes diffrentes de la prsence, et plus prcisment de la
conversion dune prsence sensible en une prsence spirituelle.
Dune manire gnrale, le temps, qui est la condition de toute ana-
lyse concrte, est lui-mme le schma abstrait de toute analyse pos-
sible, qui est lanalyse dun ternel prsent, dans lequel ltre fini,
sans quil sen dtache jamais, russit pourtant fonder sa personna-
lit, cest--dire dterminer ses acquisitions et les maintenir.
B. LA PRSENCE TOTALE
ET LES PRSENCES MUTUELLES
Retour la table des matires
ART. 4 : La prsence nest pas confre ltre par le moi, mais
au moi par ltre.
On dirigera sans doute contre la notion de prsent les mmes ob-
jections que contre la notion dtre. On fera remarquer premire-
ment que, comme la notion dtre ne peut tre saisie quavec le moi
et mme en un certain sens dans le moi, cest--dire sous une forme
subjective, la notion de prsent, [257] dune manire beaucoup plus
vidente encore, suppose une conscience qui se rende ltre prsent,
de telle sorte que dfinir ltre par le prsent serait aggraver son ca-
ractre subjectif par un caractre accidentel. Et on ajoutera en se-
cond lieu que, si la notion dtre est la plus vide et la plus abstraite
de toutes, aussi longtemps quon la prive de ses qualifications, cela
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 248
est plus visible encore de la notion de prsent, qui est manifestement
une forme sans contenu, car ce qui nous intresse avant tout, cest
beaucoup moins la prsence dune chose que la nature mme de cet-
te chose qui nous est prsente. Mais le rapprochement mme de ces
objections sert confirmer lidentit de ltre et du prsent et
conduit penser que, si les moyens employs pour tablir que ltre
ntait pas une notion purement subjective et abstraite taient bons,
ils doivent encore ici nous mener au succs et nous permettre
dapercevoir dans le prsent une objectivit essentielle que toute ex-
prience actuelle se borne reconnatre, et une plnitude concrte
que toute dmarche positive de la conscience divise pour la mettre
notre porte.
En ralit, il est bien vrai de dire que la prsence ne peut se ma-
nifester que sous la forme dune concidence momentane entre
ltre du moi et ltre de lobjet. Mais ce serait sans doute une illu-
sion de penser que le moi sinstalle dabord dans le prsent pour
confrer ensuite lobjet une sorte de prsence drive et qui serait
le reflet de sa propre prsence lui-mme. Outre que la prsence du
moi lui-mme suppose, au sein de la conscience, une dualit qui
redouble, au lieu de le rsoudre, le problme de notre prsence
ltre, il faut nous souvenir que si, pour lidalisme, le moi
sattribuait en effet une existence subjective qui sirradiait ensuite
sur tous les objets de sa reprsentation, nous avons montr, au
contraire, que la conscience de notre existence, au lieu dtre celle
de notre existence spare, consiste dans son inscription lintrieur
dun tout o nous prenons la fois notre racine et notre dveloppe-
ment et qui nous prte ltre avant de le recevoir de nous en tant
quapparence dans la reprsentation que nous nous en donnons. Et
nous dirons de mme que lopration par laquelle nous nous rendons
ltre prsent est subordonne une relation mtaphysique plus pro-
fonde et [258] dont cette opration est lexpression intellectuelle,
cest--dire la relation de notre prsence propre avec la prsence
indivisible du tout dont aucun tre fini ne saurait jamais tre dta-
ch.
Si on prtendait maintenant que cest le caractre distinctif dun
tre fini dtre engag dans le temps, de natre et de mourir, et mme
de natre et de mourir chaque instant, on rpondrait que, comme
ltre total ne peut comprendre tous les tres finis autre part que
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 249
dans sa prsence ternelle, nul dentre eux inversement, dans aucune
des phases de son existence, ne peut faire autrement que dexpliciter
un des aspects de cette prsence totale. Ainsi, comme le moi ne
pourrait pas tre pos si ltre ne ltait dabord, et comme le moi
affecte ensuite ltre tout entier de cette subjectivit qui renvoie
celui-ci, sous la forme dun reflet, ltre mme quil nous a donn,
cest aussi de la prsence absolue que nous recevons notre prsence
particulire ; et nous confrons naturellement lunivers une pr-
sence comparable celle de linstant, bien que linstant, qui tient de
la prsence sa ralit, ne nous la rvle jamais que sous une forme
prcaire et vanouissante. Seulement, comme nous ne cessons de
nous lever de ltre donn par lequel sexprime notre limitation
lacte qui le fait tre et dont nous participons, nous ne cessons de
nous lever aussi dune prsence sensible qui nous asservit au
temps, une prsence spirituelle qui nous en dlivre.
ART. 5 : Toute prsence particulire est mutuelle et se fonde sur
la distinction de lacte et de la donne, qui suppose son tour la
prsence absolue du tout, dont elle est une spcification produite
par lanalyse.
Si lon peut accepter, malgr les scrupules de lidalisme, de po-
ser ltre comme un terme qui se suffit, un en soi ou un absolu, il
ne saurait en tre de mme, dira-t-on, de la notion du prsent. Le
prsent nest-il pas par essence une relation ? Ne suppose-t-il pas
deux termes corrlatifs et dont la nature est prcisment dtre pr-
sents lun lautre ? Et navons-nous pas lexprience de cette rela-
tion dans notre propre prsence ltre ?
[259]
Mais si ltre ne peut jamais cesser dtre prsent, nous pouvons
cesser de lui tre prsent : cest alors pour nous cesser dtre. Cette
absence se produit sous des formes trs diffrentes : mais, comme la
prsence de tout tre particulier nest quune prsence renouvele
dans linstant, elle ne peut tre obtenue et maintenue que par un acte
de participation ltre pur, cest--dire la prsence ternelle ; et
lorsque cet acte flchit ou cesse, il ny a rien de chang dans ltre,
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 250
mais la forme limite quil avait revtue sextnue et disparat. Ainsi
cette mme prsence, qui est un caractre incessible de ltre absolu,
doit tre ralise en chacun de nous grce une opration qui nous
est propre, faute de quoi nous ne possderions point ltre intrieu-
rement, et toute participation serait apparente au lieu dtre effecti-
ve.
Nous pouvons distinguer, sans rompre lunivocit, deux manires
dtre, ltre pour soi et ltre pour autrui, lacte et la donne qui,
bien que compris galement dans luniversalit de la notion, la divi-
sent par leur opposition de manire rendre possible lavnement du
fini et faire apparatre la multiplicit des genres et des qualits.
Lopposition de lacte et de la donne permet au temps de natre et
au moi de devenir prsent ltre grce une participation person-
nelle. Ltre fini est prcisment un mixte dans lequel lacte et la
donne viennent se croiser, ou plutt, cest un acte imparfait et ina-
chev qui ne se confond pas avec le monde et ne peut le penser que
comme une donne. Cest cet acte original par lequel, au lieu de
crer le monde, il le retient devant lui comme un spectacle, qui
constitue sa vraie nature.
Pourtant si, l o il y a une conscience, il faut toujours quil y ait
opposition entre un acte et une donne, une telle dualit doit tre
caractristique, sinon de la prsence elle-mme, du moins de la
conscience que nous en prenons. Cest dire que notre exprience de
la prsence met toujours en vidence deux formes de ltre dont la
prsence mutuelle traduit lunit de ltre lintrieur de laquelle
elles ont t distingues par lanalyse. Si toute prsence est une co-
prsence, cest quaucun tre fini ne peut tre pens en dehors de
ltre total.
Mais la prsence, au sens mtaphysique que nous donnons [260]
ce mot, ne peut pas tre rduite la simultanit dans linstant :
car dune part, un intervalle despace assez grand pour soustraire
lobjet notre apprhension immdiate suffit crer labsence aussi
bien quun pur intervalle de temps, comme le suggre lexprience
commune dont la thorie de la relativit fournit une sorte
dinterprtation rationnelle. Dautre part, nul intervalle de temps ne
peut abolir cette prsence au moins possible dans une conscience
sans laquelle ni le pass, ni le temps ne pourraient tre penss.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 251
Cest donc parce que ltre est fini que la prsence a un caractre
mutuel. Et ce caractre se manifeste sous quatre formes la fois dis-
tinctes et solidaires auxquelles la corrlation de lacte et de la don-
ne fournit seulement un cadre abstrait et schmatique :
1 Ltre apparat dabord comme prsent au moi, et cest sur
cette prsence subjective que se trouve fonde la connaissance m-
me de ltre : alors ltre nest plus quune reprsentation ;
2 Le moi apparat comme prsent ltre et cette prsence, rci-
proque de la premire et implique par elle, fonde lexistence du
moi ; mais cest le moi alors qui est donn lui-mme ;
3 Les tres particuliers apparaissent comme prsents les uns aux
autres dans le mme univers, mme sils ne possdent pas une cons-
cience capable de rendre cette prsence sensible leurs propres
yeux. Mais cest dire quils sont compris ou quils peuvent ltre
sous forme de reprsentations lintrieur dune autre conscience
dont lunit subjective est la fois limage et lincarnation de lunit
mme de ltre ;
4 Enfin, bien que chaque conscience soit enferme en elle-
mme, comme lest en soi ltre tout entier, et puisquil est de
lessence de chaque conscience dtre finie, il faut que toutes les
consciences soient prsentes les unes aux autres, afin quelles ex-
priment la totalit de ltre sans en dtruire lunit. Mais alors, au
lieu dtre prsentes lune lautre simplement par la connaissance
en devenant rciproquement objet et sujet lune pour lautre, il faut
quelles puissent nouer entre elles des relations relles o chacune
gardera sa propre essence de sujet sans tre oblige de la convertir
en objet pour en faire une prsence reprsente ; ainsi se ralisera
[261] cette socit des esprits, qui nest possible que par leur com-
mune participation un mme acte spirituel qui se cre lui-mme
ternellement. Le monde rel, toujours prsent tout entier toutes
les consciences travers la varit indfiniment renouvele de ses
aspects, est la fois le moyen de leur sparation et de leur union ; il
faut quil apparaisse chaque conscience sous la forme dune repr-
sentation originale pour que cette conscience puisse se distinguer de
toutes les autres, et par consquent exister, et il faut pourtant quil
ny ait quun monde et quil soit pens par des oprations identiques
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 252
pour que chaque conscience puisse par son moyen entrer en com-
munication avec toutes les autres.
Nous conclurons donc en disant que ltre est indiscernable du
prsent, et que, si toute prsence est mutuelle, ltre total se confond
avec la mutualit de toutes les prsences relles ou possibles.
ART. 6 : La prsence subjective est la fois une image et un effet
de la prsence totale de ltre lui-mme.
La prsence subjective est rvlatrice de la prsence absolue :
mais notre propre subjectivit est objectivement prsente dans le
tout de ltre. La prsence de ltre au moi a son fondement dans la
prsence du moi ltre. Comment concevoir que ce soit ltre qui
vienne participer au prsent de lindividu alors quil est manifeste
que toute lexistence de lindividu exprime au contraire sa participa-
tion au prsent de ltre ? Mais si la prsence ne se manifeste nos
yeux que sous une forme subjective, cela ne prouve point que ce soit
une prsence diminue : au contraire elle tmoigne par l quelle est
une prsence intrieure au cur mme de ltre, et cest seulement
parce que notre subjectivit est limite que nous devons linscrire
elle-mme dans une prsence qui la dpasse.
La prsence na donc un caractre de dualit quafin de nous
permettre de saisir lunit ontologique des termes quelle confronte.
Et si elle ne peut se manifester que par lanalyse, qui fait apparatre
la diversit, cest que le rle de la diversit est de la rendre sensible,
mais non de la crer. Cest un [262] des effets les plus constants de
notre mthode de nous permettre de retrouver dans les formes les
plus humbles de ltre son essence totale et inaltre.
Nous retrouvons ici sous une forme psychologique, dans
lanalyse de la prsence, les caractres duniversalit et dunivocit
que nous avions attribus dabord ltre sous une forme logique :
et ce recouvrement des exigences intellectuelles par les conditions
de lexprience interne confirme leur double objectivit mtaphysi-
que. Car de mme que ltre peut sappliquer des objets diverse-
ment qualifis, mais toujours en relation les uns avec les autres, et
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 253
qui ne diffrent pas entre eux sous le point de vue de ltre, la pr-
sence est capable de recevoir en elle des tats aussi htrognes que
des perceptions, des images ou des ides qui sont eux-mmes inter-
dpendants et dont on ne peut dire prcisment quils sont que parce
quils sont accueillis dans cette prsence identique.
Ainsi la prsence du moi lui-mme, cest--dire la conscience,
est limage la plus parfaite que nous puissions concevoir de la pr-
sence plnire de ltre tous ses modes : car il ny a pas de cons-
cience sans dualit, et cest pourtant lunit de lacte intellectuel qui
seul explique comment nous pouvons dire la fois que tous les ob-
jets de la pense nous sont prsents, que nous leur sommes prsents
et quils sont prsents les uns aux autres. Nous retrouvons dans no-
tre conscience finie un cho des caractres fondamentaux de ltre
pur dont il nous est possible deffectuer grce elle une sorte de lec-
ture empirique.
ART. 7 : La prsence nest pas une forme pure que les objets vien-
nent remplir, mais une ralit plnire dont la conscience les dta-
che en la divisant.
Il est possible maintenant de rpondre lobjection toujours re-
naissante que nous avions signale encore larticle 4 du prsent
chapitre, et qui reproche la prsence, comme ltre, dtre un mot
creux et mme dpourvu de signification, aussi longtemps quon ne
connat ni le contenu de la prsence, ni les qualits de ltre. Mais
nous nous tions tonn dj que lon pt voir dans ltre la plus
abstraite des notions, en faisant [263] remarquer prcisment quil
nest pas un caractre spar, quon ne peut ni le percevoir, ni le
concevoir hors de ses dterminations, et quil exprime la totalit et
la consommation de toutes les qualits que lon pourra jamais dis-
cerner en lui. Et lon conviendra quil y a bien de la diffrence entre
une thse qui fait de ltre une pure matire logique laquelle les
qualits viendraient mystrieusement se joindre pour lui permettre
dexister rellement et la thse qui, posant dabord ltre avec cette
totalit et cette suffisance sans lesquelles il na pas droit au nom
dtre, fait apparatre ensuite les qualits comme la gerbe des as-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 254
pects particuliers et complmentaires par lesquels il rvle son infi-
nie richesse aux yeux dune conscience finie.
Cette identification de ltre avec le tout pos avant lanalyse et
pour que lanalyse soit possible, loin de rduire le tout une donne
inerte laquelle lanalyse najoute rien, nous oblige faire de ce
tout un acte inpuisable auquel notre conscience ne cesse de partici-
per en faisant apparatre toujours en lui de nouvelles dterminations
qui nont dindpendance pourtant que par sa propre opration.
On peut faire sur la prsence des observations analogues. La pr-
sence ne demande pas tre remplie par des objets nouveaux mer-
geant tour tour dune longue absence et qui viendraient la peupler,
cest--dire la raliser. Il faut dire au contraire que la prsence est en
droit infiniment plus pleine et plus abondante que toutes les repr-
sentations par lesquelles elle se divise et smiette pour sadapter
la capacit des diffrentes consciences. Que lon nallgue pas non
plus que sous le nom de prsence, nous posons par avance et dun
seul coup toutes les reprsentations qui deviendront prsentes plus
tard au cours de toute exprience possible : la prsence est une et les
reprsentations sont multiples ; elle nest pas leur somme, elle est
plutt leur condition et leur raison, le principe commun qui les ac-
tualise sans se confondre avec aucune delles puisquil est le mme
dans toutes. Et lon demandera de mditer sur cette remarque : cest
que, si une chose est ce quelle est par ses qualits, elle nest pour-
tant que par la prsence de ce quelle est.
Lunanimit de la prsence prise en elle-mme ne laisserait [264]
pas subsister lindpendance des tres particuliers. Celle-ci suppose
la conscience par laquelle la prsence objective et la prsence sub-
jective ne cessent de sopposer et de sassocier lune lautre. Puis-
quune prsence unanime abolirait la conscience, il faut que lobjet
prsent, pour que nous en restions distincts, nous paraisse toujours
plus riche que sa reprsentation prsente, il faut dune manire gn-
rale, lgard de la connaissance comme lgard du vouloir, quun
progrs indfini souvre devant nous dans lequel nous opposerons
ce que nous avons dj acquis ce que nous pourrons acqurir encore.
Les modes infiniment varis de la prsence psychologique expri-
ment les moyens par lesquels ltre partiel communique avec ltre
total : la prsence sensible, imaginaire et conceptuelle permettent
la personnalit de se crer, la conscience dentrer en rapport avec
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 255
lunivers et avec les autres consciences et fournissent le fondement
dun tableau des diffrentes fonctions de la vie mentale.
Cest seulement parce que lhomme est attentif dabord son
corps, par lequel il inscrit son tre individuel dans lunivers visible,
quil est port confondre la prsence objective avec la prsence
relle. Elle exprime seulement ce qui dans la prsence dpasse notre
opration. Mais cest par la prsence subjective seule que nous p-
ntrons dans lintriorit mme de ltre. Aussi toute prsence vri-
table est-elle une prsence spirituelle : la prsence du corps se chan-
ge en la prsence de lide du corps et la prsence de la sensation, en
la prsence de lide de la sensation. La varit des ides, la manire
dont elles sappellent et dont elles sexcluent permettent une sorte
de filtrage de la prsence dans la conscience qui ne sen dtache ja-
mais, bien quelle la mette sa porte et qui, ne cessant de puiser
dans un monde ternellement actuel, mais qui nest pour elle quun
monde possible, actualise et fait sien un autre monde qui est luvre
propre de sa libert, mais qui son tour, au regard de lacte pur, ne
sera jamais quune pure possibilit.
[265]
C. ABSENCE SENSIBLE
ET PRSENCE SPIRITUELLE
Retour la table des matires
ART. 8 : Lespace et le temps sont les deux vhicules de labsence.
Le prsent du verbe semble par excellence le temps de ltre ; et
on veut en gnral quil soit le temps de la perception, comme le
pass est le temps du souvenir et le futur le temps du dsir et de la
volont. Mais ces temps diffrents tablissent seulement des distinc-
tions entre certains caractres des tats prsents ; ils ne permettent
pas de permuter lessence de lun dans lessence de lautre, comme
on le croit trop souvent quand on admet lobjectivit du temps, ce
qui conduirait imaginer entre eux la plus trange transsubstantia-
tion. Cependant, grce au rapport rgl qui les lie, notre personnalit
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 256
va se constituer elle-mme sans cesser dadhrer au prsent et en
appelant indfiniment par un effort actuel, mais spirituel et tendu
vers lavenir, la ralisation sensible dun bien quelle nest capable
de possder ensuite que sous la forme spirituelle, mais actuelle,
dune image passe. Alors le prsent nest plus simplement, il est
vrai, le temps de la perception, ce qui na de sens qu lgard de
lobjet : il est le temps de lacte qui actualise aussi bien le souvenir
et le dsir que lobjet peru et la relation qui les unit.
Si le prsent ntait pas le caractre essentiel de ltre, il faudrait
quon pt concevoir une sorte dabsence absolue qui ne ft pas un
simple loignement dans lespace et le temps. Or lespace ralise
seulement lide totale des prsences indfiniment prochaines, et
cest pour cela que, en le rduisant la simultanit, le matrialisme
et le bon sens populaire le considrent comme le lieu mme de
ltre. Par contre, le temps ne cre-t-il pas entre les diffrents ins-
tants une absence impossible vaincre ? Le pass nest-il pas une
forme dtre subsistant encore, bien quen dehors de toute atteinte,
lorsque nous avons, en progressant, perdu avec lui tout contact sen-
sible ? Lavenir nest-il pas aussi une forme dtre vers laquelle
nous tendons les mains, mais qui chappe nos prises ? [266] Ce-
pendant, si on ne consent pas matrialiser le temps, alors on
sapercevra que la ralit du pass, en tant quil tait autrefois peru,
est seulement puise, comme la ralit dune figure limite dans
lespace est puise ds quon franchit ses contours, et que la ralit
de lavenir, avant quil saccomplisse, est celle dune possibilit s-
pare de son actualit par un intervalle qui est, si lon peut dire, le
produit mme de leur relation. Dune manire plus gnrale, partir
du moment o ltre total vient sexprimer par une diversit infinie,
il faut que cette diversit se ralise non pas seulement dans le simul-
tan, mais dans le successif, puisquautrement lespace, immuable
en chacun de ses points, serait une substance, cest--dire ltre
mme, au lieu dtre une forme des apparences, cest--dire la ma-
nire dont il se manifeste la conscience dun tre fini : mais il faut,
pour quil garde ce caractre en tmoignant pourtant de sa liaison
avec ltre total, quil puisse en chaque point recevoir dans linfinit
du temps linfinit des qualits, et assure aussi, par lintermdiaire
du mouvement, la communication entre tous ces points ou, ce qui
revient au mme, mette en vidence cette relativit qui lui est pro-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 257
pre, sans laquelle il serait non pas une unit vivante, mais un bloc
rigide dlments dcisivement spars. On voit maintenant la rai-
son pour laquelle les moments du temps qui paraissent sexclure
beaucoup plus profondment que les points de lespace, puisque le
pass et le futur appartiennent un autre monde que celui de
linstant (de telle sorte quil y aurait une espce de contradiction
les penser ensemble), sappellent pourtant mutuellement de manire
lier les uns aux autres les points de lespace, qui restent irrducti-
blement distants avant que lon passe de lun lautre par le mou-
vement ; on voit aussi pourquoi le parcours spatial ne cesse pas de
nous paratre prsent chaque instant quand il a lieu, et pourquoi,
quand il a eu lieu, son trac est encore une image prsente do la
notion de tout intervalle temporel a disparu.
Il demeure, il est vrai, cette diffrence entre lloignement dans
lespace et lloignement dans le temps, que le premier nous permet,
grce au mouvement, de franchir corporellement la distance, et par
consquent de retrouver toujours, [267] sous la forme de perceptions
videmment nouvelles, tous les points de son universelle prsence,
au lieu que lloignement dans le temps, ds quon limmobilise, ne
peut tre franchi que par lesprit et grce au contraste dune percep-
tion actuelle et dune image remmore ou anticipe. Mais
lopposition de la perception et de limage na de sens que pour un
sujet fini : elle est le moyen par lequel la personnalit se forme. Il
faut pour cela quil y ait irrversibilit dans lordre de ses tats,
comme il faut quil y ait rversibilit dans lordre de lespace pour
que celui-ci soutienne les dmarches de la libert, quil rende possi-
ble le devenir sans tre entran par lui, et quil figure sur le terrain
de lexprience sensible et au sein mme de la dure lobjectivit de
ltre pur.
On remarquera dailleurs que cette opposition nest pas dcisive
et irrductible, que tout intervalle est spatial et temporel la fois,
que des points trop loigns de nous dans lespace ne peuvent aussi
nous devenir prsents que par des images et que, comme il faut,
avant que linfluence quils exercent sur nous nous parvienne, un
certain temps pendant lequel leur tat se sera modifi ainsi que le
contenu mme de notre conscience, il est de toute ncessit, aprs
avoir distingu lintervalle temporel et lintervalle spatial, de les as-
socier lun lautre dune manire extrmement troite en utilisant
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 258
le premier et admirable modle que les relativistes ont fourni dans la
mcanique de lunivers physique.
Si la prsence et labsence semblent deux contraires qui
sappellent et ne peuvent tre penss que lun par rapport lautre,
cela nest vrai par consquent que pour un sujet particulier et dont
lexprience se constitue dans lespace et dans le temps. Lespace
implique une prsence objective et simultane de tous ses points,
mais qui ne peut tre actualise par chaque conscience que dans les
limites de son horizon ; au del rgne une absence subjective. Le
temps, de son ct, qui est le lieu mme o se dploie toute subjec-
tivit cre une distinction entre deux modes de la prsence : celle de
la perception et celle de limage (dtermine on indtermine) ; cet-
te seconde forme de la prsence est elle aussi subjective, et lgard
de la premire elle peut tre nomme une absence. Par son opposi-
tion et par sa connexion avec elle, elle exprime [268] la condition
la fois de notre subordination au tout de ltre et de notre indpen-
dance spirituelle. Mais ces diffrents modes de la prsence et de
labsence ne sont que des dterminations particulires de la prsence
absolue qui nest elle-mme corrlative daucune absence.
ART. 9 : Labsence est toujours subjective et corrlative de la
constitution de notre conscience dans le temps.
Cest un mme acte de prsence, identique dans son essence bien
que trs diffrent dans son contenu, ou plutt qui na un contenu que
pour nous, qui fonde la fois ltre universel et notre tre propre.
Mais ds que la multiplicit sest introduite dans le monde, on com-
prend la possibilit dune absence relative et subjective. Tout
dabord les phnomnes nont de sens que comme donnes et aux
yeux dune conscience qui se les donne comme objet dune contem-
plation relle ou possible. Or, si elle se donnait tous les phnom-
nes, elle se donnerait la fois tout lunivers, cest--dire quelle se
confondrait avec ltre pur et quil ny aurait plus de phnomnes.
Labsence, qui est une notion ngative, na donc aucune valeur m-
taphysique : cest une notion psychologique corrlative de la pr-
sence subjective qui est caractristique de la conscience. Aussi les
phnomnes matriels sont-ils entrans dans le mme devenir que
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 259
les consciences individuelles selon une suite irrversible contempo-
raine du devenir de celles-ci. Car ils nont dexistence que prsente,
cest--dire au moment o ils sont actuellement perus ou bien au
moment o ils pourraient ltre. Leur tre ne se distingue donc pas
de leur prsence. Ils sont limits dans leur prsence, comme dans
leur nature. Mais la prsence elle-mme ne lest pas.
Loin de notre pense lide quils pourraient subsister ternelle-
ment hors de notre regard, tels quils taient lorsque notre regard
portait sur eux. Ce serait mconnatre leurs limites et les conditions
mmes de la phnomnalit. Mais il est ternellement vrai que lacte
qui soutient et fonde leur existence en les appelant dans le mme
prsent et qui les enchane indfiniment des conditions et des
effets sans lesquels chacun deux usurperait lindpendance du tout
[269] au lieu de lexprimer sa place et selon un aspect particulier,
contient en lui intemporellement la raison dtre du temps et de cette
merveilleuse proprit qui le dfinit : savoir que chacun de ses
moments considr en lui-mme ne peut tre que prsent, mais qu
lgard de tous les autres il peut devenir indiffremment pass ou
futur ; or le pass et le futur semblent un mlange de ltre et du
nant, ce qui ne peut avoir un sens que si nous savons distinguer la
perception de limage et par consquent notre prsence objective
ltre de notre prsence subjective nous-mme. Il faut que nous
puissions devenir absent la perception pour que nous cessions de
nous confondre avec les choses et pour que nous puissions avoir un
devenir autonome dans lequel nous allons entraner les choses elles-
mmes.
Labsence nat donc dun certain contraste qui se produit dans le
prsent entre deux formes de notre vie psychologique qui ne cessent
de svincer. On conclura donc que, si ltre est la prsence ternelle
et que nul tre particulier ne puisse lpuiser ni sen sparer, les
tres particuliers, par contre, peuvent tre absents les uns aux autres,
et mme ils le sont toujours dans quelque mesure, sans quoi ils
nauraient pas dindpendance mme relative.
La prsence est si bien un caractre insparable de ltre que
nous la concevons encore comme la proprit par laquelle lobjet
subsiste, mme quand il cesse dtre donn notre conscience.
Quant labsence, elle est une notion ngative non pas en ce sens
quelle abolit la prsence de lobjet, mais en ce sens quelle labolit
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 260
seulement pour nous. Elle ne peut tre dfinie que par rapport cet
acte qui nous rend les choses prsentes et que nous naccomplissons
plus. Dire dun objet quil est absent, cest dire que nous ne pouvons
pas nous le rendre prsent. Encore ne pouvons-nous le penser que
par rfrence une prsence possible et lopration dune cons-
cience qui lactualise. Labsence est donc toujours leffet dune li-
mitation ou dune dficience, ce qui explique assez comment je puis
devenir absent un objet particulier, un autre tre, au monde ou
moi-mme sans que le lien de chacun de ces modes et de la prsence
absolue soit lui-mme atteint.
[270]
ART. 10 : Le temps qui nous affranchit par le mouvement de la
servitude du lieu, nabolit chaque instant la prsence sensible que
pour la convertir en une prsence spirituelle.
Nous avons montr que lespace et le temps sont, si lon peut di-
re, les deux vhicules de labsence. Et mme on distinguerait mal
labsence temporelle de labsence spatiale, si celle-ci ntait pas une
prsence de droit que la limitation de notre perception ne permet pas
de transformer en prsence de fait, bien que cette transformation
semble devenir possible par le mouvement, cest--dire en dplaant
notre propre centre de perspective sur le monde. Il suffirait encore
dimaginer un mouvement dune vitesse infinie pour voquer le
point qui remplit tout dont Pascal a parl. Ainsi, par une sorte de
paradoxe, le temps qui est la plus dure des chanes, puisquil nous
attache linstant en dehors de tout consentement, quil ne peut tre
ni ralenti ni ht, ni retourn ni anticip, est aussi linstrument de
notre libration puisquil nous affranchit en un certain sens de la
servitude du lieu.
Toutefois on fera une double observation : car, dune part, le
temps ne nous permet dabolir labsence spatiale quen la convertis-
sant en une prsence future, de telle sorte que lexprience de la d-
couverte de nouveaux lieux ne prsente un privilge sur une autre
suite dvnements que parce quelle suppose dj la simultanit de
lespace, l o il semble seulement quelle la vrifie. Dautre part,
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 261
on noubliera pas que, par une sorte daction en retour, le temps lui-
mme a pu tre considr comme une sorte despace et ses moments
assimils des points que nous serions tenus de parcourir tour
tour. Cest donc, si lon peut ainsi parler, une spatialit sans dis-
tance que nous empruntons le modle de lternit.
Mais il suffit, semble-t-il, danalyser les caractres propres du
temps, sans avoir recours une comparaison avec lespace qui le
matrialise, pour comprendre comment, par le moyen mme de la
succession qui nabolit que les formes objectives et phnomnales
de ltre, nous russissons les rintgrer dans notre propre intrio-
rit et pntrer par l nous-mmes dans lintriorit de ltre. Car,
cest le temps qui, sans nous [271] sparer jamais du prsent, sans
sparer mme du prsent toutes ces formes particulires de ltre qui
ne svadent point elles-mmes du prsent de linstant, donne pour-
tant celles-ci une sorte dimmortalit subjective dans le souvenir,
comme pour nous faire prsager que nous atteignons mieux
lessence de ltre dans sa forme spirituelle que dans sa forme mat-
rielle, et que, si la sensation est un contact ncessaire avec ltre par
lequel se marquent notre passivit et nos limites, ce contact va-
nouissant ne doit pas nous dcevoir comme sil avait d nous appor-
ter lui-mme la possession dun bien immuable : car il nous donne
davantage, savoir la possibilit de retrouver indfiniment ce que
nous pensions avoir perdu par un acte qui le transfigure et quil d-
pend de nous daccomplir.
Et de fait, que pouvons-nous possder sinon nos propres opra-
tions ? Que peut-il y avoir en nous que lon ne puisse jamais bannir
du prsent, sinon lacte mme que nous accomplissons, soit quil
sagisse de la perception dun objet loign dans lespace et qui dj
sest modifi au moment o son influence nous parvient, soit quil
sagisse de la rminiscence dun vnement loign dans le temps et
que nous nhsitons pas rejeter dans le pass, bien que nous ne
puissions pas dtacher du prsent lopration actuelle qui le ressus-
cite ? Ce sont seulement nos tats qui peuvent tre chasss du pr-
sent, condition quon les isole arbitrairement de lacte qui les ren-
dait vivants. Le contenu de notre vie scoule dans le temps, mais
non point notre vie elle-mme ; celle-ci tient ltre par un acte in-
discernable du prsent, qui illumine un univers dont on peut dire
quil ne cesse de se le donner, dans lequel par consquent il subsiste
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 262
assez de souplesse pour que la libert puisse y insrer un effet de
son choix, que la mmoire accueille aussitt comme une possession
spirituelle imprissable. Et le jeu qui se produit dans le temps entre
ces diffrents aspects de la conscience naltre pas la simplicit de
la prsence ternelle o ils sont tous situs.
[272]
ART. 11 : La mort cre une absence corporelle qui est rvlatrice
dune prsence plus pure.
Les objets sont absents les uns aux autres proportion moins de
leur loignement que de lexigut et de la lenteur des moyens par
lesquels il peuvent agir les uns sur les autres. Ce qui confirme que
lacte parfait doit se confondre avec luniverselle prsence.
La prsence dun corps compos dans le monde est faite de tou-
tes les forces de cohsion qui, maintenant les diffrents lments qui
le forment les uns contre les autres, assurent une certaine permanen-
ce soit de sa figure, soit de sa structure. Et nous disons quil est d-
truit lorsque lune et lautre cessent dtre visibles, bien que les l-
ments subsistent sous une forme dissmine. Ils ne restent pas eux-
mmes sans altration, comme on le croit trop souvent ; mais cela
importe peu : le compos est devenu absent lorsquils nagissent
plus les uns sur les autres selon la loi qui dfinit le compos, bien
quau sein du compos leur altration ne ft pas moindre souvent
que dans leur tat disolement. Tout ce que nous avons dit du com-
pos est encore vrai du simple, qui nest quun compos plus subtil.
Mais de tous les composs, celui dont la destruction nous intresse
et nous meut le plus profondment, cest notre propre corps. Aussi
la mort est-elle considre comme le type le plus parfait et le plus
irrparable de labsence.
Cependant le caractre tragique de la mort provient non pas de la
dissolution du compos corporel, mais de la destruction au moins
apparente de la conscience par laquelle nous pouvions croire, en
pensant le phnomne et le temps, nous tre lev au-dessus deux
et jouir en Dieu de cette ternit que nous avions dcouverte et avec
laquelle, ds cette vie, nous tions uni. Mais, outre que lternit de
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 263
notre tre spirituel nimplique pas limmortalit dans le temps de sa
partie individuelle, il semble ncessaire dtudier de plus prs,
propos de la mort elle-mme, le contraste de la prsence et de
labsence.
Tout dabord labsence nest pas rciproque, et si la mort [273]
fait pour nous des absents de tous ceux qui vivent aprs nous, nous
ne perdons pour ceux-ci que la prsence corporelle. Bien plus, lors-
que celle-ci cesse et quon na plus lespoir de la retrouver, la pr-
sence spirituelle acquiert souvent plus dacuit ; elle est proportion-
nelle lamour que lon porte ceux qui sont morts. On peut se ren-
dre compte alors que la prsence du corps nen tait que lapparence
et le symbole et que souvent elle en tenait lieu et la dissimulait.
Aussi la mort actualise, cest--dire transforme en un acte de cons-
cience, cette prsence latente que la familiarit qui rgne entre les
corps nous dispensait et souvent nous empchait de raliser. Nous
sommes plus prs des morts que nous avons aims que des vivants :
la proximit charnelle de ceux-ci nous rassurait sur leur prsence ;
nous en laissions la charge la nature, sans penser quil tait tou-
jours ncessaire dy contribuer nous-mme intrieurement. Ds que
la nature est dfaillante, cette ncessit apparat : cest sur nous seul
que repose dsormais le soin de maintenir leur prsence vivante.
Aussi devenons-nous capable de percevoir avec une intensit singu-
lire, non seulement des dtails de leur vie abolie qui nous avaient
peine frapp, mais encore certaines occasions de communiquer avec
eux que nous avons manques et qui font que nous ne pouvons que
dans labsence puiser les bienfaits de leur prsence. Cette jouissan-
ce plus parfaite deux-mmes que nous obtenons aprs leur mort, et
pour ainsi dire grce celle-ci, nous laisse un remords et comme un
sentiment de culpabilit leur gard ; nous nous reprochons de les
avoir mconnus, de ne pas avoir accompli vis--vis deux tout notre
devoir, de ne pas avoir ralis avec eux cette union parfaite que nous
ralisons si bien avec leur ide. Et ce scrupule montre que nous ne
sommes point dlivr de tout prjug matrialiste : nous croyons
encore que leur vritable nature consistait dans leur corps plutt que
dans leur ide. Cependant, aussi longtemps quils vivaient de la vie
du corps, cette ide ne pouvait tre dgage et isole : elle demeurait
implique dans une suite dtats et dvnements par lesquels ils
paraissaient la raliser progressivement ; leur nature ntait pas en-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 264
core accomplie. La mort les a dpouills de laccidentel et du transi-
toire : elle nous a mis en prsence de leur essence immuable ; [274]
et le souvenir que nous gardons de leur vie temporelle nest quun
moyen pour nous dentrer dj dans le temps en contact avec leur
ternit.
D. LE POSSIBLE ET LACCOMPLI
Retour la table des matires
ART. 12 : Le temps est ncessaire la transformation de notre
tre possible en un tre accompli ; mais ceux-ci concident dans
lternit.
Il est impossible de se contenter dune simple immortalit dans le
souvenir qui nest quune survivance peine un peu plus longue
dans une conscience elle-mme prissable. Elle est le signe de
limmortalit plutt que sa substance. Nous avons montr quen ce
qui concerne les ides particulires nous ne pouvons confondre au-
cune delles avec ltre mme dont elle est lide. De plus, il y a
dans tout tre une activit autonome de participation distincte de
celle par laquelle une conscience trangre le pense sous la forme
dune ide. Si la ralit dun tre est ide, cette ide ne peut tre
pense par autrui et peut-tre par lui-mme que dune manire ina-
dquate. Cest ici surtout que se vrifie la distinction que nous avons
tablie antrieurement entre lide par laquelle une chose est pense
(mme si cette chose tait notre propre moi) et lide par laquelle
cette chose se fait. Enfin deux tres finis ne peuvent jamais tre
pleinement prsents lun lautre : cest labsence qui les spare,
qui en fait aussi deux tres distincts ; ce nest pas pour les morts une
vritable survivance que celle quils gardent dans la mmoire des
vivants. Il faut donc chercher une autre signification du mot immor-
talit qui, au lieu de dsigner simplement la continuit de lexistence
dans le futur, cest--dire dans la conscience des autres tres assujet-
tis encore une vie temporelle, nous dcouvre la manire dont se
ralise, par le moyen du temps, linscription de notre tre propre
lintrieur de ltre absolu. Cela revient dire que cest hors du
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 265
temps et non dans le futur quil faut chercher limmortalit vrita-
ble ; et puisque ltre nest pas un mode du temps, mais le temps un
mode de [275] ltre, nous trouverons quen mourant dans le temps
nous accusons notre caractre fini, comme nous le faisons par nos
limites spatiales, mais sans nous retirer pour cela de ltre total qui
comprend ternellement en lui avec notre propre moi le moi de tous
les tres finis. Il ne nous refuse jamais sa prsence bien que notre
propre prsence son gard ne puisse sexercer qu lintrieur de
nos limites au del desquelles il ne rencontre la rciprocit de la pr-
sence que dans dautres tres limits comme nous. Au cours de notre
vie temporelle, nous ne cessons de nous rendre ltre prsent : avant
notre naissance et aprs notre mort cela nest plus possible, puisque
ce serait sortir de nos limites ; mais nous ne cessons pas pour cela
dtre prsent ltre total dune prsence qui nest plus momenta-
ne, ni divise, cest--dire qui ne connat plus ni davant, ni
daprs.
Toutes nos difficults proviennent dune fausse objectivation du
temps ; mais le temps qui nous rend sensibles nos limites et o
sexerce notre libert, nous fournit linstrument de notre liaison avec
le tout et travers linstant opre, grce la sensation, une trans-
formation de la possibilit en souvenir. Or qutions-nous avant de
natre sinon un possible ternel ? Que devenons-nous aprs notre
mort sinon un ternel accompli ? Entre les deux notre vie temporelle
tait ncessaire pour que nous puissions donner une sorte dadhsion
analytique et constructive, renouvele par un acte personnel et dans
les bornes de notre nature, cette mme ternit dans laquelle le
temps nous inscrit, au lieu de nous en sparer : en effet, sans le
temps ce possible ne pourrait pas saccomplir, nous ne pourrions pas
distinguer entre notre nature possible et notre nature ralise et notre
personnalit ne serait pas notre uvre.
Mais que lon prenne garde que, si cest seulement dans le temps
que nous pouvons oprer cette distinction et cette conversion entre
notre nature possible et notre nature relle, le possible est pourtant
un aspect de ltre qui na jamais t donn indpendamment de
ltre qui le ralise, et le rel nest pas, comme le souvenir, post-
rieur lacte qui laccomplit, mais contemporain de cet acte mme.
Ce nest donc point avant notre naissance quil faut placer notre tre
possible, [276] ni aprs notre mort quil faut placer notre tre rel :
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 266
lun et lautre se confondent en Dieu, cest--dire dans leur essence
intemporelle ; leur opposition, telle quelle se manifeste par che-
lons au cours de notre dure, est le signe que notre moi rside dans
un acte, mais dans un acte discursif insparable de la prsence totale
et dont le caractre personnel et imparfait clate dans la subjectivit
de la prsence quil se donne et dans les limites lintrieur des-
quelles elle demeure enferme.
ART. 13 : La mort produit labsence ou la prsence ternelle en
consommant le choix que nous avons fait pendant cette vie : dans le
premier cas elle est figure par la distraction et loubli, dans le se-
cond par cet exercice parfait de lactivit spirituelle dans lequel la
conscience temporelle est dpasse.
Une vieille maxime scolastique dclare que ltre sidentifie avec
ce quil connat, cest--dire avec tout ce quoi il peut devenir pr-
sent par un acte intrieur. On comprend ds lors pourquoi il est si
difficile, comme on la remarqu au chapitre VII, de saisir la nature
propre du moi : cest quelle ne se distingue pas de la portion de
lunivers quelle claire subjectivement ; elle se dilate et se rtrcit
comme celle-ci. Il suffit ds lors quune partie de lunivers se retire
du champ de la conscience pour que le moi se replie et senveloppe
dans une sorte de possibilit sans objet. On saisit bien la manire
dont le moi flchit et sabandonne lui-mme par un refus de prsen-
ce ltre en tudiant la distraction et loubli.
Dans la distraction, en effet, nous avons le sentiment dune perte
de contact avec ltre, mais du mme coup la ralit du moi se dissi-
pe peu peu et finit par se dtruire. Que reste-t-il encore du moi
dans une distraction totale, comme la syncope ou comme un som-
meil sans rves ? Pourtant nous nassistons pas l un anantisse-
ment de notre tre propre. Car, outre que subjectivement il ny a
point en nous dtat rigoureusement dnu de toute pense, comme
le soutenaient la fois Descartes et Leibniz, on ne peut pas confon-
dre ltre avec la forme subjective quil reoit dans une conscience.
[277] Quand nous cessons dtre pour nous-mme, nous pouvons
encore tre pour un autre, il est vrai comme corps : plus forte rai-
son ne cessons-nous pas dtre lintrieur de ltre total et cette
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 267
fois non plus comme corps, mais comme essence, une essence qui
nest lgard de la conscience quune possibilit quelle nactualise
point. Et mme si lon veut que notre essence soit une ide, et que le
propre dune ide soit toujours dtre pense, les distinctions prc-
dentes paratront ncessaires, condition que lon ne veuille pas
confondre lacte par lequel je pense une ide avec lacte par lequel
je sais que je la pense (mais sur ce point la psychologie contempo-
raine ne fait que confirmer par lexprience une vue mtaphysique
fort ancienne et dont Descartes sest servi).
Lanalyse de cette forme plus subtile de la distraction quest
loubli donne un sens plus concret aux remarques que nous venons
de faire : car loubli nous rend absent non pas lgard de lunivers,
mais lgard de nous-mme, cest--dire lgard de cette forme
subjective de lexistence que notre prsence lunivers venait de
crer. Or loubli qui nous empche dactualiser un souvenir en laisse
aussi subsister en nous la possibilit. Et cette possibilit est toujours
prsente. Cest dire que notre moi lui-mme, form par la totalit
accumule de notre pass, ne cesse pas dtre lorsque nous cessons
de le percevoir. Nous pouvons tre absent nous-mme, et mme
nous le sommes toujours jusqu un certain point, puisque sans cette
absence partielle nous nous confondrions avec notre essence telle
quelle rside dans ltre total et nous naurions plus une conscience
distincte, ni de lunivers, ni de nous-mme.
Cest donc sur le modle de la distraction et de loubli quil faut
nous reprsenter la mort : aucun de ces vnements ne dtruit notre
tre, mais ils rendent seulement impossible le ddoublement caract-
ristique de la conscience temporelle. Cependant, si une telle cons-
cience est un effet de notre existence participe et si elle est requise
pour que nous puissions fonder notre indpendance et devenir notre
propre ouvrage, tout le monde sent bien quelle est un moyen plutt
quun but. Mdiatrice entre notre tre possible et notre tre accom-
pli, elle est charge dassurer leur union ; mais elle disparatrait si
cette union tait consomme. Cest ce qui se produit dans les [278]
moments les plus heureux de notre vie o notre activit sexerce
avec tant daisance et de plnitude quelle abolit le reflet que sa tra-
ce laisse habituellement en nous. Il y a un tat qui est au-dessous de
la conscience et un tat qui est au-dessus delle. Le rle de la cons-
cience est prcisment de conduire de lun lautre.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 268
Ds lors, si nous ne pouvons considrer limmortalit que comme
la possession acheve de notre propre nature, comment aurait-elle
encore besoin de la conscience temporelle pour se guider et du
temps lui-mme pour senrichir ? Navons-nous point lexprience
dune conscience intuitive quelle analyse et qui la surpasse ? Et si
notre moi a toujours t ce quil est ds avant notre naissance, quel
besoin avait-il de sengager dans la dure ? Mais dire quil existe
ternellement, ce nest point dire quil existe invisiblement au del
des termes qui le bornent dans le temps, cest--dire dans un pass et
un avenir qui ne se convertissent en prsent qu lgard de certains
modes de la participation qui ne sont pas les siens. Rver dune im-
mortalit qui accrotrait indfiniment notre dure, cest montrer une
ambition mdiocre, une avidit de dsirer plutt que de possder.
Notre vie temporelle, comme le temps tout entier, existe ternelle-
ment, et le temps est ncessaire pour que, par un acte qui nous est
propre et qui, par consquent, doit se dtacher de lacte pur et nous
engager dans une suite dactions limites destines vainement
lgaler, nous puissions faire un choix entre deux manires de vivre
et de mourir : car nous pouvons nous attacher aux objets particuliers
qui ne cessent de se renouveler et de passer et alors notre me est
envahie par le regret, le dsir et la crainte, la conscience est pour
elle un tourment, et en voyant nous quitter tous les biens que nous
aimions nous mourons continuellement nous-mme ou bien
nous pouvons, refusant de confondre aucun des aspects de ltre
avec ltre lui-mme, jouir travers eux de la prsence totale, voir
dans leurs limites un moyen de penser lillimit, et en mourant la
partie mortelle de notre nature, vivre ternellement et nous identifier
avec cette partie divine de nous-mme qui ne peut pourtant devenir
ntre que par notre propre consentement.
[279]
ART. 14 : Il nous appartient de retrouver dans chaque prsence
particulire la prsence du tout dont nous lavons dtache.
Bien que nous soyons toujours port confondre la prsence
avec la donne considre sous sa forme immdiate, il convient de
remarquer quon ne comprendra bien sa nature que si on fixe
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 269
lattention sur lacte par lequel nous nous donnons nous-mme cet-
te donne. La prsence de la perception nest pas une proprit de
son contenu, mais de lacte par lequel nous apprhendons celui-ci.
La prsence du souvenir nest pas la simple occupation de la cons-
cience par lui : cest lacte par lequel nous le faisons revivre en le
crant nouveau. Et cest pour cela que, si le vritable caractre de
la prsence ne peut tre saisi que dans lacte par lequel nous nous
rendons une chose prsente, cet acte se manifeste dune manire
plus parfaite et plus pure dans lopration par laquelle nous appelons
lexistence un avenir qui dpend de nous que dans la reprsenta-
tion de cet avenir ralis, soit comme perception, soit comme sou-
venir. Cest que la prsence de ltre nest pas la prsence dune
donne qui en ferait un phnomne et le rendrait extrieur lui-
mme, cest la prsence mme de lacte qui le fait tre, qui fonde
toutes les autres formes de la prsence et ne saurait sy rduire. Dans
la perception et dans le souvenir il y a une prsence de fait qui limite
lopration et ne lui devient jamais tout fait adquate. Car lune et
lautre expriment dans la participation ce qui la surpasse et nous fait
connatre la nature de lunivers ou notre propre pass sans puiser ni
lun ni lautre. Au contraire, lacte qui dtermine lavenir nous rv-
le la participation en tant quelle cre notre propre prsence ltre,
quelles que soient la limitation ou les rsistances quil pourra ren-
contrer dans sa ralisation.
Pour saisir ce que lon pourrait entendre par cette prsence totale
qui se retrouve dans toutes les prsences particulires, bien quelle y
soit limite par un objet, il faudrait donc voquer lopration par la-
quelle notre propre activit sintroduit dans le monde, en la dpouil-
lant la fois de la donne quelle [280] dpasse et qui la rend tribu-
taire dun monde quelle na pas cr, de la fin quelle produit, qui
nest quune modification de cette donne et qui la rend esclave
son tour, enfin de lintervalle de temps qui la borne et dont elle a
besoin pour dployer un effort qui est la marque de son insuffisance.
Quant ltre parfait, cest une opration qui na point de sujet ni
dobjet, dont la fonction spuise dans son pur exercice, qui est im-
mdiate parce quelle ignore tous les obstacles et quelle nest point
engage dans le temps, qui est universelle enfin parce quelle est
une et quelle est ncessairement prsente en tous les points de
lespace et en tous les moments du temps, ds que ces deux formes
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 270
de toute diversit auront apparu. Lespace et le temps seront les
moyens donns tout tre fini pour diviser la prsence, en distin-
guer des formes diffrentes et, par le rapport quelle tablit entre
elles, fonder sa propre prsence lui-mme et la maintenir ou la
laisser chapper. Il ne faut pas stonner que la prsence totale, qui
soutient toutes les prsences particulires, paraisse sidentifier avec
celles-ci : leur caractre mutuel et leur diversit infinie forment le
visage mobile o sexprime la prsence ternelle du tout toutes les
parties que lanalyse y discernera jamais.
Nous dirons donc que la prsence nest point un abstrait : elle en
est mme le contraire, puisque ce quon appelle un abstrait, cest un
terme que lon dtache autant quon le peut des autres termes au mi-
lieu desquels il se trouve engag et avec lesquels seulement il jouit
dune prsence relle. Encore faut-il, pour quon puisse le poser,
quil soit prsent une pense qui la dcouvert et pour ainsi dire
cr par son analyse. Il ny a point de danger non plus que la pr-
sence puisse tre considre comme vide : elle est plutt cette plni-
tude parfaite qui se dissocie pour un tre fini en reprsentations par-
ticulires instantanes et vanouissantes. Mais toute la ralit de
chacune delles provient de sa participation la prsence dans
linstant. Linstant nous rvle la prsence, mais ne se confond point
avec elle : nous passons dun instant lautre lintrieur dune pr-
sence unanime. Limage et la perception sont deux tats prsents et
qui diffrent seulement en qualit. La diversit des tres cre la pos-
sibilit [281] dune absence subjective de lun lautre, de chacun
deux lui-mme et ltre total. Mais lunit de ltre total le rend
prsent tous. Le moi nest quun pouvoir de se crer et de se re-
nouveler par un acte de prsence. Il na point de contenu original et
qui diffre du champ mme de ltre sur lequel sa prsence stend :
et le peu quil embrasse dans des perspectives sans cesse nouvelles
fait apparatre la varit des qualits. Ontologiquement, sinon psy-
chologiquement, sa prsence ltre ne se distingue pas de sa pr-
sence lui-mme. Et la plupart de ses misres proviennent de ce
quil espre, en multipliant indfiniment les prsences particulires,
accrotre sa nature, se donner lui-mme la puissance et le bonheur
qui doivent nous fuir indfiniment aussi longtemps que nous
ignorons que dans chaque prsence particulire, si humble soit-elle,
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 271
ltre est donn tout entier et quil peut se donner nous tout entier
grce une communion o chacun fait lautre un appel auquel ce-
lui-ci consent.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 272
[283]
DE LTRE
CONCLUSION
Retour la table des matires
[284]
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 273
[285]
I
Il semble utile, au terme de cette tude, de dfinir la perspective
que la considration de ltre nous donne sur lensemble de la sp-
culation philosophique, la signification quelle assigne notre pro-
pre vie et au monde o celle-ci se droule, enfin les raisons pour
lesquelles, aprs avoir t pendant longtemps lobjet suprme de la
rflexion, elle a fini par paratre strile et mme dangereuse sans
cesser pourtant de nous attirer comme une sorte de mirage.
Si lon cherche caractriser lessence de lesprit, on voit quelle
rside sans doute dans la puissance daffirmer ; or il semble que le
propre de la puissance daffirmer, ce soit de porter ncessairement
sur un objet : et cest cet objet que lon appelle en gnral ltre.
Ds lors, il est naturel de commencer par identifier ltre avec
lobjet universel de laffirmation. Seulement le rle de la rflexion,
ds quelle nat, cest prcisment de reconnatre non seulement que
lobjet affirm nest rien sinon par sa relation avec le sujet qui af-
firme (ce que lon exprime assez clairement en disant quil est une
apparence, un phnomne, une reprsentation ou seulement un ob-
jet), mais encore que le sujet qui affirme ne peut rien affirmer sans
saffirmer lui-mme et par consquent quil est lui-mme un acte
dauto-affirmation insparable de toute affirmation particulire.
Ds lors, on voit assez nettement comment prend naissance cette
suite de propositions en apparence contradictoires et qui engendre le
conflit des doctrines selon le choix quon en fait, ds quon refuse
dapercevoir le lien qui les unit. Car en confondant dabord ltre
avec lobjet, cest--dire en oubliant le sujet qui le pose et sans le-
quel il ne serait rien, on obtient le ralisme du sens commun qui,
sous une forme plus labore, devient le ralisme du savant. Le sujet
est alors un spectateur [286] pur, qui sefforce seulement dobtenir
du spectacle une reprsentation de plus en plus cohrente.
Mais lintervention du philosophe consiste prcisment nous
montrer que cet objet que nous confondions avec ltre nest en effet
rien de plus quun spectacle : tel est pour ainsi dire le signe de re-
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 274
connaissance de la pense philosophique dans tous les temps et
lunique point peut-tre o se produit une unanimit entre les doc-
trines. Elles saccordent toutes dans un relativisme de la connaissan-
ce objective qui continue passer vulgairement pour un paradoxe et
qui na de vrit que pour la rflexion ds quelle entreprend de
sexercer.
Cependant cest ici que les divergences commencent. Car on peut
refuser de revenir au ralisme initial et se contenter du relativisme
ou mme sy complaire ; alors le relativisme se change en scepti-
cisme : lhomme est la mesure de toutes choses et on ne sait pas ce
quest lhomme, car il nest lui-mme quun objet parmi les objets
auquel tous les autres objets sont accidentellement rapports.
Mais lhomme renonce difficilement croire quil atteint dans
lobjet lui-mme ltre dans lequel il avait cru dabord pouvoir
stablir. Or, puisquon ne peut douter que cet objet soit rien de plus
quune reprsentation, cest que ltre est au del de la reprsenta-
tion ou, comme on le dit, quil est transcendant par rapport elle.
Telle est la position de lontologie traditionnelle qui est assujettie
imaginer dans le sujet une pense pure capable de traverser la repr-
sentation et datteindre ltre en tant que tel dans une prsence ad-
quate.
Quant lexistence de cette pense pure, elle peut tre mise en
doute : on peut montrer prcisment quelle est elle-mme sans objet
ou, ce qui revient au mme, que tout objet est ncessairement un ob-
jet de reprsentation. Cest cette dmonstration qui a fait le succs
du Kantisme. Il tait donc naturel que le Kantisme ft dabord
considr comme une forme de scepticisme philosophique. Il ltait
ncessairement dans la mesure o, sous le nom de chose en soi
ou mme de noumne, il laissait entendre quil existe un tre en
soi qui est un objet absolu, cest--dire htrogne et irrductible
toute reprsentation. Comment imaginer cet objet pourtant autre-
ment que comme une reprsentation [287] encore, mais dans laquel-
le ltre reprsent nous apparatrait pour ainsi dire dans une parfaite
transparence ? Cest une telle chimre que poursuivent presque tou-
jours les philosophes de lintuition. Ainsi, bien que personne nait
russi mettre dans une aussi vive lumire que Kant le rle jou par
le sujet dans la constitution de lobjet reprsent, il renonait si peu
pour son compte la conception de ltre-objet que non seulement il
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 275
ne croyait pas pouvoir viter laffirmation dun objet transcendant
en gnral, mais quencore il refusait de faire du sujet lui-mme un
tre par la double impossibilit o tait ce sujet en tant que sujet de
saffirmer lui-mme aussi bien comme objet reprsent que comme
objet transcendant toute reprsentation. Et cest pour cela quavec
son extrme prudence Kant sabstenait de se prononcer sur ltre du
sujet et quil adoptait pour le caractriser ce mot ambigu de trans-
cendantal qui exprime sa transcendance simplement formelle
lgard du contenu de la reprsentation, mais lui dnie toute trans-
cendance ontologique, au sens o cette transcendance serait elle-
mme une transcendance objective .
Toutefois cette position moyenne qui devait satisfaire tant
desprits modrs ne pouvait pas tre maintenue. Le privilge du
sujet qui avait t si bien marqu quand il sagissait de la connais-
sance de lobjet ne pouvait pas tre aussitt restreint sous le prtexte
quil ne rpondait plus cette ide dun objet absolu avec lequel on
voulait identifier ltre, ds que lobjet de reprsentation avait d-
montr son caractre relatif. Et Kant lui-mme, au del du monde de
la connaissance, dcouvrait dans le sujet une activit non-formelle,
ou qui du moins par sa forme mme se donnait elle-mme sa pro-
pre matire et savrait, dans lordre pratique, comme cratrice
delle-mme et de ses propres dterminations. Or navions-nous pas
affaire ici une concidence de lacte du sujet avec son tre mme,
alors que la connaissance le mettait toujours en face dun donn qui
lui tait jusqu un certain point tranger et auquel il ne pouvait im-
poser quune unit proprement reprsentative ? Telles sont les
considrations qui expliquent la formation de la doctrine de Fichte
qui est sans doute le modle le plus parfait de lidalisme, [288]
cest--dire de toute doctrine qui, identifiant ltre avec le sujet, tend
montrer que lobjet reprsent nest rien de plus que le produit
dune activit subjective.
Cependant lalliance de ltre et de lobjet est pour nous la fois
si naturelle et si pressante que nous considrons presque invincible-
ment lidalisme comme une conception qui, en faisant dpendre de
la subjectivit de la pense lobjectivit des choses, annihile celle-ci
et nous chasse du monde de ltre auquel il nous demande de substi-
tuer une sorte de rve qui aspirerait se suffire. Cest donc que,
malgr toutes les bonnes raisons qui nous obligent apprhender
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 276
ltre seulement dans lintriorit de notre tre propre, et ne saisir
dans lobjet que sa forme reprsente, lidalisme nest parvenu ni
donner au sujet lui-mme, pris isolment, cette consistance que lon
requiert de ltre lui-mme partout o il affirme, ni sauvegarder
cette prsence contraignante de lobjet tel quil est donn dans
lexprience la plus commune, ni dfinir lopration par laquelle le
sujet pourrait rduire lindpendance apparente de lobjet sans pour-
tant labsorber ni le dtruire.
On le voit bien dans toutes les rsistances que lidalisme a pro-
voques lpoque moderne : par exemple dans le succs obtenu par
le no-ralisme dont loriginalit a t de marquer avec une force
extraordinaire ce qui dans lobjet dpasse toujours la puissance du
sujet, sa richesse infinie et inpuisable, sa nouveaut toujours im-
prvisible, cette sorte de densit actuelle et presque impermable,
qui fait que le sujet, au lieu de lui imposer sa propre loi, semble au
contraire la recevoir de lui, quil en pouse tous les contours et
saccrot seulement [de] tous les contacts quil ne cesse davoir avec
lui. On ferait des observations analogues sur la phnomnologie qui
non seulement refuse disoler cette notion du sujet pur auquel
lidalisme avait attach sa fortune, mais encore ne veut connatre
de lui que ses formes manifestes et pour ainsi dire incarnes : il
substitue donc la description de ce qui est, tel quil nous est donn,
la drivation de ce qui est partir des exigences dun sujet qui le
pose. De ce sujet lui-mme on ne sait rien qu travers les dmar-
ches concrtes qui le rvlent : tre pour lui, cest tre dans le mon-
de. Son existence [289] relle, cest son existence exprime, avec
laquelle il fait corps et dont on ne pourrait pas le sparer sans
labolir. Il en est de mme dans lexistentialisme qui ne veut point
dpasser lui non plus la sphre phnomnologique, mais dont le
succs vient peut-tre dune certaine disqualification du sujet pur
qui ne se constitue que par une opration de ngativit lgard de
la vritable ralit qui rside elle-mme dans lobjectivit de l
en soi , et qui, en affirmant le primat de lexistence par rap-
port lessence, ne considre la pense que dans son engage-
ment mme, cest--dire dans la corrlation dune libert et dune
situation. Tels sont les signes de ce retour au concret, o lon peut
voir une sorte de retour vers ltre, et qui peut apparatre comme une
raction contre lidalisme, au moins dans la mesure o lidalisme
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 277
avait cru exorciser la notion mme de ltre en labsorbant dans la
pense, qui nest quune de ses formes.
II
Or cest prcisment cette notion de ltre concret que nous
avons essay de retrouver, au moment o elle semblait oublie.
Nous sommes ici bien au del de la distinction traditionnelle entre le
sujet et lobjet : ltre les comprend lun et lautre, il rside dans
leur relation elle-mme, sans que lon puisse imaginer un privilge
ni du sujet, comme dans lidalisme, o le sujet porte en lui la pos-
sibilit de lobjet, ni de lobjet comme dans lempirisme, o le sujet
devient une superstructure de lobjet. De l ces trois propositions
quivalentes : que ltre exclut le nant, ce qui est, semble-t-il, une
tautologie, mais qui dnonce la contradiction quil y aurait invo-
quer une puissance daffirmation capable de sanantir elle-mme
dans lacte par lequel elle anantit son objet ; que ltre est univer-
sel, cest--dire quil ny a rien que lon puisse affirmer et qui lui
chappe, ou encore quil est gal non seulement tout laffirm,
mais tout laffirmable ; que ltre est univoque, cest--dire que,
partout o il se prsente, il est prsent tout entier, et que lon peut
bien tablir une hirarchie entre ses modes, mais non point dans
ltre de ces modes [290] de telle sorte que la relation mme qui les
unit nest quune expression ou un autre nom de lunivocit.
On voit maintenant dans quel sens nous avons t amens iden-
tifier ltre avec le Tout. Et quelles que soient les difficults dune
telle proposition et le soupon de panthisme quelle ait pu faire na-
tre, il nous semble que ni le sens commun, ni la rflexion ne sont
capables de lviter. Seulement cest sur cette notion du Tout quil
sagit de sentendre. Car nous sommes habitus considrer un tout
comme une somme de parties que nous pouvons dnombrer et jux-
taposer cest--dire totaliser : il semble donc que lessence du tout
ce soit prcisment de pouvoir tre circonscrit et achev. Cependant
ce nest l quun tout et non point le Tout : cest dire quil nest lui-
mme quune partie du tout que nous avons isole afin den prendre
possession et de le reconstruire notre mesure, encore quil nous
montre, dans linfinie divisibilit de ses parties elles-mmes, quel
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 278
point il dpasse, par son tre mme, la reprsentation que nous
croyons en obtenir. La notion du Tout non totalisable, et qui fonde
lexistence des parties, au lieu de la supposer et den tre la somme,
et la notion dinfini sappellent au lieu de sexclure. Et la notion
dinfini, comme celle de Tout, na de sens qu notre gard, selon
que nous considrons dans ltre la ncessit o nous sommes de le
poser et limpossibilit o nous sommes de lembrasser.
Ici cependant commencent les difficults. Car si la totalit de
ltre nous est donne, comment esprer y rien ajouter ? Toute pen-
se, toute action sont davance frappes de strilit : la philosophie
et la vie elle-mme se trouvent termines avant dtre commences.
Mais ce reproche ne nous atteindrait que si nous acceptions cette
proposition que le Tout est en effet un tout donn : or le donn nest
pour nous quun aspect du Tout, dont nous venons de dire quil est
la fois le Tout et linfini, et qui recle en lui le pens aussi bien que
le donn, le possible aussi bien que le temps. Cest par un prjug
contre lequel nous ne cessons de lutter que lon se reprsente ltre
sur le modle de lobjet tel quil soffre nous dans une exprience
instantane. Le pass, lavenir, le mouvement qui les lie sont autant
de ses modes. Nous [291] incorporons ltre la totalit des appa-
rences prcisment parce que nous ne voulons pas disqualifier cel-
les-ci et faire de ltre un objet immuable et qui napparatrait pas.
Ltre est comme une mer immense anime de mouvements int-
rieurs quil sagit pour nous non point de nier, mais de dcrire. En
voquant sa totalit, nous voquons indivisiblement les abmes de
lespace et du temps. Mais ils ne nous dcouvrent encore que ltre
manifest : ce que nous cherchons, cest son intriorit, non point
pour abolir la manifestation, car elle aussi est contenue dans ltre,
mais pour atteindre le secret dont elle procde et sans lequel elle ne
serait rien.
cette objection quen distinguant entre le secret de ltre et sa
manifestation nous risquons de rompre lunivocit, nous rpondons
que, sans donner un privilge au secret sur la manifestation qui
lexprime et souvent le trahit, nous nemployons pourtant les deux
mots que pour parler encore de ltre secret et de ltre manifest, ce
qui nous conduit relever singulirement la dignit de lapparence,
qui ne risque de nous dcevoir que lorsquelle est considre tort
comme tant le tout de ltre, mais qui est essentielle ltre comme
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 279
la condition sans laquelle il serait incapable dactualiser sa propre
possibilit. Ce qui montre les dangers insparables dune doctrine
symtrique dun phnomnisme sans intriorit et dans laquelle on
prtendrait garder lintriorit en excluant le phnomne.
Que si on nous presse en nous demandant ce qui nous autorise
distinguer dans ltre ltre secret et ltre manifest, nous rpon-
drons que cest lexprience que nous avons de nous-mme, qui est
la seule exprience dans laquelle ltre puisse nous tre rvl. Car
comment pourrions-nous connatre ltre autrement que par notre
propre concidence avec ltre, cest--dire prcisment dans ltre
que nous sommes ? Or cest cette exprience qui nous oblige nous
situer nous-mme dans un tre qui nous dborde, mais qui est tel
que ce par quoi nous en participons rside en effet dans un acte int-
rieur et secret, que nul ne peut accomplir notre place et que ce qui
le dborde est extrieur nous, mais non pas sans rapport avec nous
et doit tre considr seulement comme un tre manifest. Cepen-
dant il faut que notre tre secret porte [292] tmoignage de lui-
mme dans ltre manifest, sans quoi il ny aurait pas communica-
tion entre lun et lautre et lunit de ltre serait rompue. Cest ce
que lon exprime en disant que nous sommes nous-mme dans le
monde, bien que nous ny soyons que par lacte mme qui le marque
de notre empreinte et par la limitation quil nous impose. Mais ds
lors, on comprend facilement que lon puisse prendre sur ltre une
double perspective, idaliste et raliste, et que ces deux perspectives
soient insparables : car lidalisme, cest la dcouverte de notre
tre intrieur apprhend dans lacte mme qui le fait tre, de telle
sorte que tout ce qui le dpasse nest pour lui que ltre du phno-
mne, et le ralisme, cest laffirmation mme de ce dpassement,
qui est tel que lobjet ne puisse jamais tre rduit une opration du
sujet et ne cesse jamais de lui fournir, cest--dire de lenrichir.
Mais lidalisme et le ralisme marquent les deux positions extr-
mes dans lesquelles on espre pouvoir rduire lun des termes
lautre ; seulement la rduction ne se ferait jamais dans le sens que
lon espre, car en poussant chacun deux jusqu la limite, au lieu
dabsorber lautre, il se changerait dans lautre, ce qui quivaut
dire que la participation serait abolie et que lon retomberait sur
lunit de ltre imparticip. Mais cest l une chimre, car dun tel
tre, nous ne savons rien, mme pas sil est de telle sorte que,
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 280
comme le propre de lexistence, cest de mettre en uvre la partici-
pation et de la porter toujours plus avant, le propre de la pense,
cest non seulement de la fonder et den dcrire les diffrentes for-
mes, mais encore de montrer comment, dans chacune de ces formes,
il existe une correspondance rgle entre lacte qui la pose et la
donne quun tel acte fait surgir.
Pourtant on ne stonnera pas de la primaut quil faut accorder
dans la dfinition de ltre, lActe sur la donne. Car on peut dire
que lacte, cest ltre considr dans son intriorit, dans son en
soi en tant quil se donne ltre lui-mme, quil ny a rien hors
de lui dont il dpend et qui le dtermine. Et lon voit bien que le
propre de la donne, cest au contraire dexprimer dans lacte lui-
mme son degr dimpuissance, ce quil nest pas plutt que ce quil
est, mais [293] qui est toujours ltre dautre chose. Ainsi la partici-
pation naltre pas lunivocit de ltre, mais au contraire la confir-
me. Et une telle conception de ltre, loin dtre le fruit de la spcu-
lation, est la lecture de lexprience la plus commune. Car qui ne
vrifie chaque instant au fond de lui-mme la formule traditionnel-
le, qutre, cest agir ? Qui nprouve que lacte est une initiative
personnelle et secrte, o le moi dispose dune puissance omnipr-
sente et qui le dpasse, mais qui se change ncessairement en action
ds quelle rencontre une borne quelle essaie de vaincre, mais qui
la dtermine et lui donne, pour ainsi dire, un objet ou un contenu ?
tre, cest tmoigner. Cest par le tmoignage que la participation
saffirme et quelle se propage. Car il ne suffit pas de dire quagir,
cest participer, cest encore se faire participer. Aussi ny a-t-il pas
dtre dans le monde qui ne soit la fois participant et particip.
Chacun deux est comme un passage dans lequel il ne cesse de rece-
voir et de rendre : et peut-tre mme ne peut-il recevoir que ce quil
est capable de rendre. Lacte par lequel il se donne est le mme acte
par lequel tout lui est donn. Si cest en cela que consiste la loi m-
me de ltre, on comprend quelle dfinisse dans sa puret ltre
mme de Dieu dont on peut dire sans doute, comme de ltre absolu,
quil est particip sans participer lui-mme de rien, mais qui nest
Dieu pourtant que dans la mesure o loin dtre indiffrent la par-
ticipation elle-mme, il est prsent en elle, cest--dire associ ses
succs et ses checs, ses souffrances comme sa gloire.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 281
III
Sil ny a pas dtre spar, il est absurde plus forte raison de
vouloir imaginer ltre lui-mme sans ses dterminations, le Cra-
teur sans la cration et lActe pur sans la participation dans laquelle
son essence propre dacte ne cesse de saffirmer et de saccomplir.
Et les objections que lon peut lever contre notre conception de
ltre proviennent toutes, semble-t-il, de limpossibilit o lon est
de nommer seulement [294] ltre sans vouloir en faire un objet par-
fait distinct de tous les autres, alors que, mme dans une perspective
objective, il ne serait opposable pourtant aucun objet, puisquil
serait lobjectivit de tous. Mais lobjet nest encore quune forme
particulire sous laquelle ltre nous est rvl, et dune manire
plus gnrale, cest ltre en tant quil se rvle quelquun. Or
ltre de ce quelquun ne peut pas tre rduit ltre de lobjet,
cest--dire ltre en tant quil lui apparat. Nous avons affaire
alors ce que nous pouvons appeler le dedans mme de ltre,
ltre en tant quil saffirme et se cre lui-mme par un acte de cons-
cience, ou, ce qui revient au mme, par un acte de libert. Cest cet
acte illimit en droit, mais toujours limit en fait, que nous appelons
lacte de participation. Il exprime lexprience que nous avons de
lexistence en tant quelle est elle-mme une insertion de notre pro-
pre moi dans le tout de ltre. Il nous semble que cette exprience
est la fois lexprience initiale et lexprience constante dans la-
quelle chacun de nous ne cesse de se mouvoir et que toutes les au-
tres supposent ; nous ne cessons dy revenir. Elle nous dcouvre
linfinit de notre propre virtualit qui ne sactualise jamais que
dans des penses ou des actions particulires. Elle fait de chaque
conscience le centre dun monde tout entier dploy autour delle et
qui saccorde avec le monde reprsent par toutes les autres cons-
ciences mais sans jamais le rpter. Lobjet mme qui, en tant que
tel, na de ralit que pour une conscience en gnral et, en tant que
reprsent, pour une conscience individuelle, suppose la totalit de
ltre pour le soutenir : savoir la totalit de lunivers reprsent
dans chaque conscience, et sans lequel aucune reprsentation ne
pourrait tre pose comme relle, et la totalit des consciences
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 282
sans laquelle aucune delles ne pourrait se poser elle-mme par un
acte qui la ralise.
quoi on peut ajouter deux remarques : la premire, cest que
chaque conscience peut tre dfinie par une proportionnalit instable
qui stablit en elle entre lopration et la donne, non point en ce
sens, comme on pourrait le croire, que ce quelle donne lopration
doive tre retir la donne, mais en ce sens au contraire que plus
lopration a dintensit ou de complexit, plus le monde des don-
nes a lui-mme [295] de relief et de richesse, comme une sphre
qui, en se dilatant indfiniment, entrerait en contact avec ce qui la
dborde et du mme coup serait elle-mme limite par des points de
plus en plus nombreux. La seconde remarque, cest quil nous est
impossible de sortir de lhorizon de la participation et que par
consquent on ne peut ni dsirer ni atteindre un absolu indpendant
de la participation (car il ny a sans doute dabsolu que dans lacte
mme qui la fonde), ni prtendre sen tenir une donne capable de
se suffire (car il ny a de donne que par quelquun qui elle est
donne et qui dj la transcende).
Mais cette analyse suffit montrer que de ltre on peut dire la
fois quil est prsent partout et quil nest prsent nulle part : car il
est prsent partout par limpossibilit o nous sommes de poser au-
cune partie ou aucun aspect de ltre, mme un ftu de paille, sans
poser du mme coup toutes ses autres parties, tous ses autres aspects
qui en sont solidaires et supportent son existence. Et il nest prsent
nulle part, par limpossibilit o nous sommes dune part de lisoler
de ses modes, dautre part de le confondre soit avec aucun deux,
soit avec leur somme. Il est lacte qui les fait tre et, comme on voit
que lacte crateur est indivisiblement prsent en tous les points de
la cration, lacte participable, qui nen est quun autre nom, est lui-
mme impliqu par toute participation actuelle, mme la plus chti-
ve. Ce qui explique assez bien la double idoltrie de ceux qui, spa-
rant violemment ltre et le monde, font de ltre un objet transcen-
dant (ou de Dieu un acte imparticipable) et de ceux qui, en sens
contraire, et ne voulant rien connatre de plus que le monde, mais au
nom de la mme confiance dans une existence objective et spare,
en excluent la fois ltre et Dieu, qui ne trouvent dans le monde
aucune place dtermine et observable.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 283
Lunivocit dont on a tant dbattu, et autour de laquelle nous ne
voulons pas raviver danciennes querelles, vite ces consquences.
Elle seule peut donner notre vie ce srieux, cette gravit qui se
perdraient autrement, puisque le monde o nous sommes, la vie qui
nous est donne ne seraient que des ombres de ltre vritable. Mais
il ny a dtre quabsolu [296] ou de participation qu labsolu
13
Cependant lide de ltre prsente un caractre privilgi par
rapport toutes les autres ides, car si celles-ci se distinguent tou-
jours de leur objet et peuvent lui tre opposes prcisment parce
quelles expriment une certaine dtermination de ltre laquelle
une donne doit rpondre, il ne peut pas en tre ainsi de lide de
ltre parce quil y a, condition que lunivocit soit maintenue, un
cercle admirable entre ltre de lide et ltre dont elle est lide.
Cest cette concidence entre ltre de lide et ltre dont elle est
lide qui, travers des mises en forme diffrentes et qui lont expo-
s tant de critiques, fait la force imprissable de largument onto-
logique. Mais on na peut-tre jamais russi pleinement la dgager.
. Il
est craindre, il est vrai, que ceux qui se dclarent contre lunivocit
invoquent en leur faveur la participation, qui pourtant ne serait pas
possible sans elle : mais la participation pourrait leur paratre favo-
rable lintroduction de degrs dans ltre et une sorte
dchelonnement des existences entre ltre et le nant. Cependant
entre ces deux termes il y a une coupure dcisive et cest pour cela
que lide nest point un tre diminu par rapport ltre dont elle
est lide, comme le pensent tous ceux qui nont de regard que pour
lobjet, ni un tre pleinement tre que le sensible dissimule, comme
le pensent tous ceux qui suivent Platon. Une telle opposition tou-
jours renaissante doit tre dfinitivement surmonte. On ny par-
vient que si on considre lobjet et lide comme diffrents par leur
situation dans ltre et non par leur tre mme, de telle sorte que si
lobjet nest rien que par rapport notre corps qui nous individualise
et nous fait entrer dans lexistence, lide nest rien que par rapport
lesprit qui donne lobjet sa signification transindividuelle.
13
Kierkegaard lui-mme emploie cette formule saisissante pour dfinir
lindividu quil est une relation absolue labsolu. Vrit dont aucune cons-
cience ne doute au fond delle-mme et qui, au lieu dopposer, comme on le
fait presque toujours, la relation labsolu les rend insparables ; mais cest
dire alors que la relation ne fait quun elle-mme avec la participation.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 284
On peut penser encore que cest cette identit entre ltre de lide et
lide de ltre qui constitue le germe commun du ralisme et de
lidalisme : les [297] deux doctrines sopposent lune lautre ds
que la participation a commenc ; mais elles convergent au sommet.
Enfin, si on naccepte pas que lide de ltre soit la plus abstrai-
te de toutes les ides, si elle est elle-mme la ngation de
labstraction comme telle, on vite difficilement le soupon quune
telle ide nous donne seulement la possibilit de ltre, et non point
ltre mme. Mais alors, largument rebondit : car cette possibilit,
qui nest pas rien, ne peut pas tre dissocie de ltre. Elle nest rien
de plus que ltre lui-mme considr dans son rapport avec le moi
qui en participe. Or participer, cest pour lui actualiser cette possibi-
lit. Mais ce serait une double erreur de penser soit que par cette ac-
tualisation nous puissions rien ajouter ltre mme, bien que nous
ajoutions sans cesse au monde (car ltre contient minemment tous
les mondes possibles), soit que ltre contienne en lui toutes ces
possibilits comme dj distinctes et pour ainsi dire figures (car
cest le propre de notre libert non seulement de les choisir avant de
les actualiser, mais mme de les faire natre en tant que possibilits
de cet Acte infini qui les soutient toutes et lgard duquel il ny a
rien de possible sinon cette actualisation mme que nous en faisons).
Il y a donc, au moins en apparence, une sorte de renversement du
possible et de ltre selon que nous considrons ltre en tant quil
est la source mme de la participation (et qui nest notre gard
quune possibilit infinie) ou ltre en tant quil est particip, cest-
-dire en tant quil constitue indivisiblement ltre du moi et ltre
du monde (et qui nest pourtant lgard de lActe pur quune pos-
sibilit toujours remise sur le mtier).
On naura jamais fini sans doute de rpondre aux objections tou-
jours renouveles qui tendent rduire ltre lobjet, et qui refu-
sent ltre lacte mme par lequel lobjet est pos et qui ne cesse
pourtant de le limiter et de lui fournir. Cela est si vrai, que ceux
mme qui, pour sauver lintriorit, veulent mettre lide au-dessus
de lobjet ne craignent pas de faire de lide un objet plus pur que
lintelligence seule est capable de saisir. Mais cest mconnatre que
lide ne se change en objet que lorsquelle sincarne dans une for-
me sensible. En elle-mme elle est une mdiation entre lacte et
[298] lobjet : et cest pour cela que lobjet ne lpuise jamais. Elle
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 285
est la signification de lobjet qui nest rien que pour le moi lui-
mme en tant quil est engag dans la participation et tenu de rali-
ser sa propre existence dans le temps, mais dans un temps qui
sinscrit tout entier dans ltre, au lieu dmerger sans cesse du
nant pour y retomber sans cesse. Ainsi dune part, cest
lexprience de lobjet qui permet au moi dentrer en contact avec
ltre qui le dpasse, mais dune manire vanouissante et telle quil
ne puisse jamais tre confondu avec aucun objet et quil ait toujours
du mouvement pour passer au del. Et, dautre part, cest linstant
qui ralise la croise du temps et de lternit, par cette double pro-
prit quil a dtre la fois lunique point dattache entre la parti-
cipation et lAbsolu dont elle procde et laxe du devenir, cest--
dire le centre o lavenir se change sans cesse en pass, o le possi-
ble saccomplit, o toute prsence sensible devient une prsence spi-
rituelle, o les choses ne laissent subsister delles que leur pur sou-
venir et o notre existence enfin acquiert son essence
14
.
IV
Nous avons essay dans le prsent ouvrage, qui inaugure notre
Dialectique de lternel prsent de relever ce beau mot dtre, le
plus beau du langage humain, et dont lusage, comme lavait bien vu
Rousseau donner un sens ce petit mot dtre sert carac-
triser lhomme, beaucoup mieux que la stature droite. Car cest le
propre de lhomme sans doute de pouvoir penser ce tout dans lequel
il sinscrit [299] et auquel il est ingal du moins en acte, mais non
pas en puissance. Cest le propre de lhomme aussi de ne point se
contenter de subir sa nature, mais de slever au-dessus delle et de
14
Dans notre livre intitul Introduction lontologie, nous avons prcis les
aspects diffrents sous lesquels ltre se rvle nous travers la perspective
de la participation : alors il nous a sembl que le mot dtre pouvait servir
caractriser la source de la participation, le mot dexistence lacte mme de la
participation par lequel se fonde ltre qui nous est propre et la ralit (res)
ltre en tant quil nous est donn, cest--dire en tant quil limite cet acte
mme, mais quil lui correspond. On pourrait dire encore que ltre, cest le
prsent ternel, et que dans ce prsent, dont nous ne pouvons pas sortir,
lexistence regarde vers lavenir et la ralit vers le pass.
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 286
devenir lui-mme lauteur de ce quil est, de nappartenir pas seule-
ment enfin au monde des cratures, mais dtre invit au conseil de
la cration.
Nous avons d commencer par des propositions trs simples, et
reconnues comme vraies par la conscience commune, sur la contra-
diction quil y aurait poser le nant, cest--dire en faire une
forme dtre, sur luniversalit de ltre, cest--dire sur
limpossibilit de rien affirmer qui ne soit compris dans ltre, sur
son univocit, cest--dire sur la ncessit pour ltre dtre partout
prsent tout entier et pour ses modes les plus diffrents dappartenir
tous au mme tre. Mais ces propositions, la rflexion les oublie vi-
te, car elle senveloppe presque aussitt dans ses propres rets dont il
lui semble quelle ne peut plus sortir pour apprhender ltre, com-
me si ce ntait pas dans ltre mme et avec de ltre quelle les
avait tisss. Le propre de la philosophie, cest prcisment de le re-
trouver toujours, non point sans doute en annulant la rflexion, mais
en la poussant jusqu son point dorigine o ce quelle tche de sai-
sir, cest ltre mme considr dans sa gense. Ainsi la rflexion,
en fondant lintriorit du moi, loin de nous sparer de ltre, nous
permet de pntrer dans son intriorit mme.
Car ltre ne peut tre quintrieur lui-mme. De mme quil
ny a rien dextrieur ltre, ltre nest lui-mme extrieur rien.
Il est tout entier en soi. Or cet en soi o le contenant et le contenu ne
font quun ne saurait tre un objet qui est toujours extrieur lacte
qui le pose, mais seulement cet acte mme considr en tant quil se
pose lui-mme ou, si lon peut dire, en tant quil fait de lui-mme
son unique objet. Non pas que nous puissions exclure de ltre
lobjet lui-mme, comme ceux qui distinguent deux domaines spa-
rs : celui de ltre et celui de lapparence, ou, si lon veut, celui du
transcendant et celui de limmanent, et ne veulent pas quil y ait en-
tre eux de communication. Car lapparence ne peut pas tre dtache
de cet tre dont on veut quelle soit lapparence, sans quoi elle ne
serait rien, [300] mme pas une apparence. De mme le transcendant
et limmanent appartiennent tous les deux ltre et cest dans ltre
mme que se fait leur opposition. Bien plus, lapparence ne se dis-
tingue de ltre que l o nous avons affaire des tres particuliers
qui, ntant eux-mmes intrieurs ltre que jusqu un certain
point, phnomnalisent encore tout ltre qui les dpasse et dont ils
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 287
ne peuvent pas tre spars : ainsi nat le monde. Dans le mme
sens, il ny a de transcendance que par rapport une immanence
quelle fonde. Et cest sans doute une erreur grave qui compromet la
signification de notre vie tout entire que de vouloir rompre entre les
deux termes ou, si lon veut, de penser que notre rle est de trans-
cender limmanence et non point dimmanentiser la transcendance.
Il ny a sans doute que lActe qui possde ltre immdiatement,
prcisment parce quil se le donne lui-mme. Mais nous nen
avons lexprience que dans lacte de participation, cest--dire dans
un acte qui est toujours corrlatif dune donne, dont on voit quelle
lexprime la fois et le limite, et qui est comme lombre projete
par notre acte propre dans linfinit mme de ltre. Cest de l que
nous partons : mais ce serait une erreur de penser quun tel acte nous
resserre invitablement dans les limites de notre moi. Car il ne se
constitue quen les dbordant ; cest pour cela que luniversalit et
lunivocit de ltre nexpriment rien de plus que la comptence du
moi pour juger de ltre prcisment parce quil est lui-mme tre.
Que nous ne saisissions ltre lui-mme que dans la participation,
cela nous montre quil est sans doute de son essence dtre particip,
car l o il ne le serait pas, l o on essaierait de limaginer, dune
manire sans doute contradictoire, comme antrieur la participa-
tion, il lui manquerait aussi tous les caractres qui le dfinissent
comme tre : savoir la prsence, lefficacit et cette puissance
dexpansion ou ce don perptuel de soi qui nous interdit de
lenfermer jamais dans aucune clture.
Il est remarquable que les critiques diriges contre lide mme
de ltre oscillent entre ces deux extrmits : ou bien qutant la plus
abstraite de toutes, elle nest lide de rien, ou bien quelle a
limmobilit du roc, et que comblant aussitt, [301] cest--dire par
avance, toutes les aspirations de la conscience, il est impossible de
lbranler et par consquent den tirer rien
15
15
On trouve chez tous nos contemporains cette unique proccupation de ne pas
laisser ltre se ptrifier en chose. Mais il est impossible pourtant de ne point
tre sensible ce curieux paradoxe, cest que les choses en apparence les plus
immuables sont toutes entranes par la mobilit du devenir, au lieu que lacte
qui les fonde ne peut tre considr que comme la puissance ternelle soit de
les crer, soit de les reprsenter.
. Mais cest mconna-
tre la fois la fcondit de lide comme telle, que lentendement
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 288
npuise jamais, et cette puissance cratrice immanente ltre et
qui constitue son essence mme. Cest oublier que ltre est acte et
que le propre de lacte, cest de saffirmer lui-mme, avant de per-
mettre laffirmation de tout le reste, qui na de sens que par lui et
par rapport lui, cest--dire na point dautre tre quun tre de
participation. Lidentit de ltre et de lActe est la clef de la mta-
physique. Elle nous oblige remonter toujours du donn jusqu
lacte qui se le donne, cest--dire confondre ltre avec le Verbe
et non point avec la chose. Ainsi cet tre-Acte serait dit bien plus
justement lActe dtre. Telle est la signification implique par le
verbe tre que les grammairiens avaient appel le verbe-substantif,
et qui est tel que cest par son participe et mme par son participe
prsent que je dois minscrire moi-mme dans ltre comme un
tant . Nous sommes ici au sommet, ou, si lon veut, la source
mme de la participation. Ds que la participation commence, une
distinction apparat aussitt entre lopration imparfaite et la donne
qui la surpasse et devient en quelque sorte la mesure de son imper-
fection. Mais, par une sorte de modestie naturelle, nous mettons
ltre du ct de la donne en tant quelle simpose nous et nous
rsiste, et non pas du ct de lopration sans laquelle pourtant, et
mme sans la dficience de laquelle, il ny aurait point pour nous de
donne. Or cela nest point sans raison puisque la donne qui mar-
que les limites de lopration lui fournit sans cesse ce qui lui man-
que. Mais l o lintriorit de ltre est parfaite, il ny a plus de
donne : celle-ci se rsorbe dans lopration ; tre et acte ne se dis-
tinguent plus.
De l on tire une lumire singulire en ce qui concerne les rap-
ports de ltre et du connatre. Car : 1 nul ne doute que [302] ltre
ne soit au-dessus du connatre, que connatre, comme on le dit sou-
vent, ne soit postrieur ltre, et mme ne puisse tre dfini com-
me une forme ou comme un mode de ltre. Seulement, ltre nest
point un objet tout fait dont la connaissance serait limage. Car un
acte ne rside que dans son seul accomplissement. Dun tel acte, il
ne peut pas y avoir reprsentation, bien que lacte mme de la
connaissance en participe : mais cest parce quil en participe seu-
lement quil se donne lui-mme un contenu ou un objet, ou quil
affecte une forme reprsentative ; 2 il est donc naturel de penser
que cest dans lobjet de la connaissance que nous prenons contact
Louis Lavelle, De ltre. (1947) 289
avec ltre. Mais cest le rle de la philosophie, sans porter atteinte
cette richesse de surpassement qui caractrise la prsence de
lobjet
16
Ainsi apparat pour nous le Monde : il remplit comme donne ac-
tuelle et toujours changeante lintervalle infini qui spare de
labsolu, cest--dire de lacte pur, lacte de participation. Et lon
comprend sans peine quil y ait des conditions ncessaires fondes
sur lunit de lActe pur et sur la possibilit de lacte de participa-
tion en gnral, qui puissent nous faire penser que nous vivons tous
dans le mme monde, et qui donnent ce monde sa structure (telle
que Kant par exemple avait essay de la dcrire dans la Critique de
la Raison pure), mais quil y ait aussi une infinit de modes de la
participation qui, par un effet de notre libert, [303] nous permettent
de choisir dans ce monde la perspective mme o nous vivons (sen-
sible ou spirituelle, goste ou altruiste, passionne ou raisonnable) :
or de ces perspectives on peut dire quelles sont toutes vraies si on
na gard qu leur foyer propre, bien quelles puissent tre ordon-
nes hirarchiquement, selon leur degr dtendue ou de profondeur,
cest--dire de valeur.
, de chercher ltre l o lobjet trouve sa propre condition
de possibilit, savoir dans lacte mme qui le fonde et dont il ex-
prime pour ainsi dire le point dinterruption. tous ceux qui
stonneraient que lon pt parler ainsi dun acte que lon ne connat
pas, on rpondra en disant que toute connaissance contribue nous
le rvler, non point sans doute dans son tat de non-participation,
o peut-tre il ne serait plus rien, mais dans lopration mme qui en
participe et qui nous donne la fois ltre qui nous est propre et une
reprsentation du Tout qui est notre mesure.
Fin
16
En ralit on observera toujours un double surpassement de lacte par la don-
ne et de la donne par lacte, qui tmoignent galement du caractre fini de la
participation et de linfinit qui souvre devant elle tantt du ct du partici-
pable et tantt du ct du particip.
Vous aimerez peut-être aussi
- Pascal Ecrits Sur La GrâceDocument512 pagesPascal Ecrits Sur La GrâceLucian Petrescu100% (1)
- Dictionnaire de Spiritualite Ascetique Et Mystique Doctrine Et HistoireDocument6 pagesDictionnaire de Spiritualite Ascetique Et Mystique Doctrine Et HistoireFrumoase Amintiri Din GrințieșPas encore d'évaluation
- Lavelle Conscience de SoiDocument182 pagesLavelle Conscience de SoiVâneaMelloAmaralPas encore d'évaluation
- Louis Lavelle - Traite Des Valeurs V II PDFDocument529 pagesLouis Lavelle - Traite Des Valeurs V II PDFMarcus Vinícius100% (2)
- Emmanuel Mounier - Le Personnalisme PDFDocument122 pagesEmmanuel Mounier - Le Personnalisme PDFntofb90100% (1)
- Un Théologien Hans Urs Von BalthasarDocument22 pagesUn Théologien Hans Urs Von BalthasarMaxime Porco100% (1)
- Levinas - Parole Et SilenceDocument85 pagesLevinas - Parole Et SilenceStephanie Hernandez100% (1)
- Introductionltud00gils PDFDocument380 pagesIntroductionltud00gils PDFJessick Smith Corao100% (3)
- De L'acteDocument557 pagesDe L'acteJênisson Santos Lima100% (1)
- Panorama Doctrines PhiloDocument174 pagesPanorama Doctrines PhiloLucas MeloPas encore d'évaluation
- Moi Et Son DestinDocument135 pagesMoi Et Son DestinRafael CensonPas encore d'évaluation
- Lavelle de L EtreDocument288 pagesLavelle de L EtreZouhaierBouhouli100% (1)
- Lavelle de L ActeDocument558 pagesLavelle de L ActeZouhaierBouhouliPas encore d'évaluation
- BERDIAEV. Esprit Et LibertéDocument354 pagesBERDIAEV. Esprit Et Libertéjffweber100% (1)
- Ontologie trinitaire: Penser et vivre à la lumière de la TrinitéD'EverandOntologie trinitaire: Penser et vivre à la lumière de la TrinitéPas encore d'évaluation
- Louis Lavelle - La Présence TotaleDocument128 pagesLouis Lavelle - La Présence TotaleFelipe Augusto100% (1)
- Michel Henry Par Falque PDFDocument13 pagesMichel Henry Par Falque PDFJoseph D. Quang-Minh BuiPas encore d'évaluation
- Paul Gilbert SJ, Le Tournant Ontologique de La Phénoménologie Française NRT 124-4 (2002) p.597-617Document22 pagesPaul Gilbert SJ, Le Tournant Ontologique de La Phénoménologie Française NRT 124-4 (2002) p.597-617aminickPas encore d'évaluation
- Etienne Gilson - Index Scolastico CartésienDocument434 pagesEtienne Gilson - Index Scolastico CartésienBach45Pas encore d'évaluation
- Louis Lavelle - La Perception Visuelle de La ProfondeurDocument79 pagesLouis Lavelle - La Perception Visuelle de La ProfondeurJosé Augusto NetoPas encore d'évaluation
- Tome 17Document416 pagesTome 17Anonymous e34JgdPqoDPas encore d'évaluation
- Bachelard. Le Matérialisme Rationnel PDFDocument264 pagesBachelard. Le Matérialisme Rationnel PDFPedro Sosa100% (1)
- Michel Henry Phenomenologie de La Vie Tome I de La Phenomenologie PDFDocument219 pagesMichel Henry Phenomenologie de La Vie Tome I de La Phenomenologie PDFGeorgy Chernavin100% (2)
- A.-J. Festugière, OP. Actes Du Concile de Chalcédoine. Sessions III-VI (La Définition de La Foi), Traduction Française. Préface Par H. ChadwickDocument3 pagesA.-J. Festugière, OP. Actes Du Concile de Chalcédoine. Sessions III-VI (La Définition de La Foi), Traduction Française. Préface Par H. Chadwickcrtm2012Pas encore d'évaluation
- M. Blondel, La Pensée IIDocument453 pagesM. Blondel, La Pensée IIJeanPas encore d'évaluation
- Cogito Me CogitareDocument19 pagesCogito Me CogitareFrédéric DautremerPas encore d'évaluation
- UNESCO Et Sa PhilosophieDocument157 pagesUNESCO Et Sa Philosophiecanislupus5Pas encore d'évaluation
- GUSDORF - Georges - Naissance de La Conscience Romantique Au Siecle Des LumieresDocument578 pagesGUSDORF - Georges - Naissance de La Conscience Romantique Au Siecle Des LumieresmlstaffaPas encore d'évaluation
- Gaston Fessard - Cinquante Ans de Philosophie FrançaiseDocument64 pagesGaston Fessard - Cinquante Ans de Philosophie FrançaisejdPas encore d'évaluation
- ANALOGIE ET UNIVOCITÉ SELON DUNS SCOT.O. BoulnoisDocument24 pagesANALOGIE ET UNIVOCITÉ SELON DUNS SCOT.O. BoulnoisNicolas Di BiasePas encore d'évaluation
- (Verdier Poche) Jan Patočka-Essais Hérétiques Sur La Philosophie de L'histoire-Ed. Verdier (2007) PDFDocument198 pages(Verdier Poche) Jan Patočka-Essais Hérétiques Sur La Philosophie de L'histoire-Ed. Verdier (2007) PDFsirjan84100% (1)
- Philosophie, Un Art de Vivre, LaDocument14 pagesPhilosophie, Un Art de Vivre, LaOhossié Aurèle LaëlPas encore d'évaluation
- Dieu N Est Pas L Etre (Cohen-Levinas) PDFDocument16 pagesDieu N Est Pas L Etre (Cohen-Levinas) PDFAndrés Upegui JiménezPas encore d'évaluation
- GUSDORF, Georges - Les Origines de L'herméneutique PDFDocument567 pagesGUSDORF, Georges - Les Origines de L'herméneutique PDFMaria CinthiaPas encore d'évaluation
- Structures Et Mouvement Dialectique Dans La Phenomenologie de Lespirit de Hegel - LabarriereDocument158 pagesStructures Et Mouvement Dialectique Dans La Phenomenologie de Lespirit de Hegel - Labarrierejorgefcomaldonado100% (2)
- Écriture Et Culture Philosophique Dans La Pensée de Grégoire de NysseDocument144 pagesÉcriture Et Culture Philosophique Dans La Pensée de Grégoire de NysseDanut GPas encore d'évaluation
- Brunschvicg Leon - La Raison Et Religion (1939)Document281 pagesBrunschvicg Leon - La Raison Et Religion (1939)rebecca.geo1789Pas encore d'évaluation
- Julien Benda - Le Bergsonisme, Ou Une Philosophie de La Mobilité PDFDocument144 pagesJulien Benda - Le Bergsonisme, Ou Une Philosophie de La Mobilité PDFlouiscorax100% (1)
- Gabriel Marcel Les Grans ThèmesDocument128 pagesGabriel Marcel Les Grans ThèmesHammadi Abid100% (1)
- L'amour Est L'acte Suprême de L'être 1Document14 pagesL'amour Est L'acte Suprême de L'être 1Maxime PorcoPas encore d'évaluation
- Bergson BiblioDocument20 pagesBergson BibliokairoticPas encore d'évaluation
- SCHNELL Alexander La Genese de L ApparaitreDocument185 pagesSCHNELL Alexander La Genese de L ApparaitreWalter Benjamin Seminario Permanente100% (2)
- 82 - 21 - Le Sens de La Phénoménologie Dans Le Visible Et L'invisibleDocument24 pages82 - 21 - Le Sens de La Phénoménologie Dans Le Visible Et L'invisibleAnonymous gjnlEwb2oPas encore d'évaluation
- Saint Bonaventure Et Les Luttes Doctrinales de 1267-1277 (1922)Document274 pagesSaint Bonaventure Et Les Luttes Doctrinales de 1267-1277 (1922)Sergius PaulusPas encore d'évaluation
- F. Van Steenberghen - Les Lettres D'étienne Gilson Au P. de Lubac PDFDocument9 pagesF. Van Steenberghen - Les Lettres D'étienne Gilson Au P. de Lubac PDFMarisa La Barbera100% (1)
- Giordano BrunoDocument13 pagesGiordano BrunowebylomePas encore d'évaluation
- GILSON. Etienne - Introduction À L'etude de Saint Augustin (1949, Librarie Philosophique J. Vrin) PDFDocument400 pagesGILSON. Etienne - Introduction À L'etude de Saint Augustin (1949, Librarie Philosophique J. Vrin) PDFAndré DiasPas encore d'évaluation
- (Epimetée) Michel Henry-Phénoménologie de La Vie, Volume 2 - de La Subjectivité-Presses Universitaires de France - PUF (2011)Document191 pages(Epimetée) Michel Henry-Phénoménologie de La Vie, Volume 2 - de La Subjectivité-Presses Universitaires de France - PUF (2011)Fábio Costa100% (2)
- Leon Brunschvicg-Leon Brunschvicg. Ecrits Philosophiques - Tome 3e. Science, Religion. Textes Reunis Et Annotes Par Mme A.-R. Weill. Brunschvicg Et M. Claude Lehec, Suivis D'une Bibliog PDFDocument347 pagesLeon Brunschvicg-Leon Brunschvicg. Ecrits Philosophiques - Tome 3e. Science, Religion. Textes Reunis Et Annotes Par Mme A.-R. Weill. Brunschvicg Et M. Claude Lehec, Suivis D'une Bibliog PDFLeila Jabase100% (1)
- Maître Eckhart Et Jan Van RuusbroecDocument254 pagesMaître Eckhart Et Jan Van RuusbroecLeCroaePas encore d'évaluation
- Emilio Brito SJ, Pour Une Logique de La Création. Hegel Et Saint Jean de La Croix NRT 106-4 (1984) p.493-512Document20 pagesEmilio Brito SJ, Pour Une Logique de La Création. Hegel Et Saint Jean de La Croix NRT 106-4 (1984) p.493-512aminickPas encore d'évaluation
- L'action: Essai d'une critique de la vie et d'une science de la pratiqueD'EverandL'action: Essai d'une critique de la vie et d'une science de la pratiquePas encore d'évaluation
- Presence TotaleDocument171 pagesPresence Totalelucaslourencxs9955Pas encore d'évaluation
- DecouverteDocument240 pagesDecouverteAndré BernardesPas encore d'évaluation
- Vitrac, Bernard - Logistique Et Fractions Dans Le Monde HellénistiqueDocument18 pagesVitrac, Bernard - Logistique Et Fractions Dans Le Monde HellénistiqueDamaskiosPas encore d'évaluation
- Leroi-Gourhan - La Grotte Du Loup, Arcy-sur-Cure (Yonne) PDFDocument14 pagesLeroi-Gourhan - La Grotte Du Loup, Arcy-sur-Cure (Yonne) PDFDamaskiosPas encore d'évaluation
- Lefebvre, David - Aristote, Lecteur de PlatonDocument30 pagesLefebvre, David - Aristote, Lecteur de PlatonDamaskiosPas encore d'évaluation
- Boehm, Rudolf - Le Fondamental Est-Il L'essential (Aristote, Métaphysique Z 3)Document18 pagesBoehm, Rudolf - Le Fondamental Est-Il L'essential (Aristote, Métaphysique Z 3)DamaskiosPas encore d'évaluation
- Bachelard, Gaston - La Dialectique de La DuréeDocument146 pagesBachelard, Gaston - La Dialectique de La DuréeDamaskiosPas encore d'évaluation
- Conscience Et Subconscience (Pratique)Document4 pagesConscience Et Subconscience (Pratique)TafitaPas encore d'évaluation
- Chapitre3-Canaux DiscretsDocument12 pagesChapitre3-Canaux DiscretsHamid BouassamPas encore d'évaluation
- Ift615 1.4 Agents Intelligents Types AgentsDocument8 pagesIft615 1.4 Agents Intelligents Types AgentsJalila Ben AmorPas encore d'évaluation
- La Méthodologie TraditionnelleDocument7 pagesLa Méthodologie TraditionnelleNelson Aminosse Zavale100% (3)
- Psychologie Du Développement de l'ENFANT BESANCONDocument116 pagesPsychologie Du Développement de l'ENFANT BESANCONmermet.fannyPas encore d'évaluation
- Psychologie CognitiveDocument16 pagesPsychologie CognitiveKasira SidibePas encore d'évaluation
- Curriculum D'informatique - 1ère AnnéeDocument10 pagesCurriculum D'informatique - 1ère AnnéeHamdi Ben MansourPas encore d'évaluation
- Copie de UE4 Histoires Des Idées en Psychologie 1Document38 pagesCopie de UE4 Histoires Des Idées en Psychologie 1Tifou Pep'sPas encore d'évaluation
- Le Dieu InconscientDocument5 pagesLe Dieu InconscientjndlistsPas encore d'évaluation
- Book of Abstracts 2024Document25 pagesBook of Abstracts 2024api-728452115Pas encore d'évaluation
- Feuille de Route TDADocument5 pagesFeuille de Route TDAMeurant Françoise100% (1)
- MémoireDocument76 pagesMémoireNADJET OUISPas encore d'évaluation
- Grammaire S2Document15 pagesGrammaire S2Khalid MontasifPas encore d'évaluation
- Expression de Lieu en LatinDocument1 pageExpression de Lieu en LatinDutrone NgounyoPas encore d'évaluation
- Documents - Proba - DissertationDocument12 pagesDocuments - Proba - Dissertationmamadou saliou balde75% (4)
- Maela PaulDocument31 pagesMaela Paulali 161100% (1)