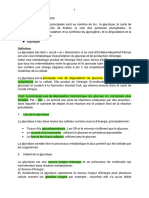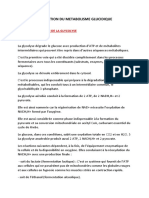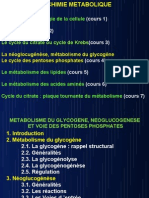Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Glycogen e
Glycogen e
Transféré par
LyesCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Glycogen e
Glycogen e
Transféré par
LyesDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
COURS DE METABOLISME
Chapitre 6
Pr C. ZINSOU
METABOLISME DU GLYCOGENE
1 INTRODUCTION GENERALE
2 DEGRADATION DU GLYCOGENE
2.1 - ETAPES ENZYMATIQUES
2.1.1 Phosphorolyse du glycogne
2.1.2 - Phosphorolyse du glycogne
2.1.3 -Conversion du glucose-1-phosphate en glucose-6-phosphate
2.2 DEGRADATION LYSOSOMALE DU GLYCOGENE
2.3 - REGULATION DE LA DEGRADATION DU GLYCOGENE
3 - SYNTHESE DU GLYCOGENE OU GLYCOGENOGENESE
3.1 - SEQUENCE DES REACTIONS
3.1.1 - Isomrisation du glucose 6- P en glucose 1- P
3.1.2 - Transfert du rsidu glucosyle sur UTP (formation de l'UDP glucose).
3.1.3 Synthse dun primer pour initier la synthse du glycogne
3.1.4 Elongation de la chane par la glycogne synthase
3.1.5 Formation des chanes latrales
3.2 - REGULATION DE LA GLYCOGENOGENESE
4 REGULATION RECIPROQUE DE LA DEGRADATION ET DE LA SYNTHESE DU
GLYCOGENE
5 - PATHOLOGIES LIEES AU METABOLISME DU GLYCOGENE.
5.1 DEFICIENCE EN GLYCOGENE PHOSPHORYLASE DANS LES MUSCLES
SQUELETTIQUES
5.2 DEFICIENCE EN GLUCOSE 6-PHOSPHATASE DU FOIE
5.3 DEFICIENCE EN GLUCOSIDASE LYSOSOMALE
NB : Voir illustrations et figures sur le document de travail
1 INTRODUCTION
Une source constante de glucose sanguin est absolument indispensable la vie
humaine. Le glucose est le substrat nergtique prfrentiel du cerveau, ou une source
dnergie fondamentale pour certaines cellules sans mitochondries comme les globules
rouges. Les muscles squelettiques, en contraction rapide, ont besoin dun
approvisionnement important en glucose, qui seul, par lintermdiaire de la glycolyse,
fournit lnergie requise. Le glucose sanguin provient de 3 origines :
-
glucose alimentaire ingr au moment de la prise des repas,
la noglucogense, voir le chapitre correspondant,
le glycogne (polymre du glucose) du foie
La source du glucose alimentaire (disaccharide, amidon et glycogne) est
sporadique et nest pas fiable. La noglucogense est souvent trop lente pour rpondre
une demande immdiate. En revanche lorganisme des animaux a dvelopp dans le foie
et dans les muscles stris un processus de mobilisation rapide en rponse une demande
immdiate en labsence du glucose alimentaire. Ce processus est la glycognolyse ou
dgradation du glycogne. Alors que le glycogne hpatique est mobilis pour maintenir le
taux du glucose sanguin et pour alimenter les tissus priphriques, le glycogne stock
dans les muscles est mobilis et consomm sur place pour leur fonctionnement.
Les rserves en glycogne du foie augmentent quand les animaux sont bien nourris
et peuvent diminuer pendant le jene prolong jusqu puisement. Les rserves en
glycogne des muscles sont peu affectes par un jene prolong, et elles peuvent tre
reconstitues aprs une activit qui en a consomm une partie. Que ce soit dans le foie ou
dans les muscles, le glycogne est synthtis partir de glucose 6- comme prcurseur.
La synthse du glycogne est la glycognogense.
2 - DEGRADATION DU GLYCOGENE OU GLYCOGENOLYSE
Lenzyme principale de la dgradation du glycogne endogne (hpatique et
musculaire) est la glycogne phosphorylase qui libre des glucose1- et une dextrine
limite. Deux autres enzymes, une glycosyltransfrase et une (1-6) glucosidase
interviennent dans la conversion complte du glycogne en glucose 6-. Seul le foie peut
transformer le glucose-6- en glucose, excrt dans le sang.
2.1 SEQUENCE DES REACTIONS ENZYMATIQUES
2.1.1 - Phosphorolyse du glycogne
La phosphorolyse proprement dite est catalyse par la glycogne phosphorylase.
Cette enzyme coupe la liaison (1-4) partir de l'extrmit non rductrice et fixe, sur le
carbone 1 du glucose libr, un groupement phosphate, apport par l'ATP, en donnant du
glucose 1-. La phosphorolyse est rpte de faon squentielle sur le glycogne jusqu'
4 rsidus glycolyses sur chaque chane avant la liaison (1-6). La structure rsiduelle est
appele dextrine limite, rsistant laction plus pousse de la phosphorylase (voir figure
25).
2.1.2 - Glycosyl-4,4-transfrase
La glucosyl-4,4-transfrase intervient sur la dextrine limite en enlevant sur chaque
chane de la dextrine limite un oligosyle form de 3 rsidus glucose pour aller allonger une
autre chane de la dextrine limite permettant ainsi la reprise de la phosphorolyse sur cette
chane. Aprs laction de cette enzyme il demeure la place de la chane latrale un
glucose li par la liaison (1-6).
2.1.3 (1- 6) Glucosidase)
Enfin une -glucosidase hydrolyse les rsidus glucose relis par la liaison (1-6) et
libre les glucose.
Aprs laction de ces trois enzymes le glycogne libre essentiellement du glucose 1 (par phosphorolyse) et une faible quantit de glucose (hydrolyse). Le glucose1- est
isomris en glucose-6- par la phosphoglucomutase. Le glucose 6- peut entrer dans
la glycolyse dans le foie et dans le muscle. Mais lobjectif de la dgradation du glycogne
hpatique est avant tout le maintien de la glycmie. Pour ce faire seul le foie, aprs
dgradation du glycogne, dispose de la glucose 6-phosphatase, permettant lhydrolyse
du glucose 6- en glucose et lexcrtion de ce dernier dans le sang. Les deux ractions
catalyses sont les suivantes :
Glucose 1- Glucose 6-
Glucose 6- + H2O Glucose + Pi
(Phosphoglucomutase)
(Glucose 6-phosphatase)
Lensemble de la squence des ractions de dgradation du glycogne est rsum
sur la figure 25.
2.2 Dgradation lysosomale du glycogne
Une faible quantit du glycogne est dgrade par une (1-4)glucosidase
lysosomale. Le rle de cette dgradation est inconnu. Mais une dficience en cette enzyme
provoque une accumulation du glycogne dans les vacuoles, et constitue une vritable
maladie du stockage du glycogne du type II (Maladie de POMPE).
2.3 - REGULATION DE LA DEGRADATION DU GLYCOGENE
Le mtabolisme du glycogne fait partie intgrante du mtabolisme nergtique. Il
est sous contrle hormonal. Ladrnaline et le glucagon dirigent le catabolisme et la
production de lnergie ; linsuline contrle lanabolisme orient vers le stockage de
lnergie. Les effets de ces 2 groupes dhormones sont antagonistes, ce qui ncessite une
rgulation coordonne que nous verrons plus loin. En ce qui concerne la dgradation du
glycogne nous distinguerons la rgulation hormonale et la rgulation par les ions Calcium
2.3.1 - Rgulation hormonale
Le glucagon et ladrnaline (pinphrine) sont les deux principales hormones qui
contrlent la dgradation ou la mobilisation du glycogne. Pour bien comprendre le
mcanisme mis en jeu, il est indispensable de connatre dabord les lments qui y
participent.
Il existe deux glycogne phosphorylases, l'une musculaire et l'autre hpatique.
Chacune existe sous deux formes, forme a (active) et forme b (pratiquement
inactive). La phosphorylase musculaire est forme de 4 sous-units, groupes en
dimres (forme inactive), possdant chacune un groupement sryle. Lorsque les OH
des srines sont phosphoryls, les dimres s'assemblent en ttramre (forme
active). La phosphorylase hpatique est dimrique. La forme dimrique (b) inactive
peut passer la forme dimrique (a) active par phosphorylation. Les deux formes,
que ce soit dans le muscle ou dans le foie, s'interconvertissent l'une dans l'autre
grce l'action de deux enzymes : la phosphorylase kinase (passage de la forme
inactive la forme active par phosphorylation) et la phosphorylase phosphatase
(hydrolyse du groupement phosphate). Voir figure 26.
La phosphorylase kinase qui phosphoryle la phosphorylase hpatique ou
musculaire existe aussi sous deux formes : l'une active (phosphoryle) et l'autre
inactive (dphosphoryle). L'interconversion entre la forme inactive et la forme
active est assure par une protine kinase.
La protine kinase est forme de deux sous-units dont l'une est catalytique
(active) et l'autre rgulatrice. La forme inactive est lassemblage des deux sousunits, la sous unit rgulatrice masquant le site catalytique de la sous-unit active.
L'activation de la protine kinase est assure par l'AMPc (AMP cyclique) qui en se
combinant la partie rgulatrice libre le site catalytique de la sous-unit active.
L'AMPc est form dans le cytosol partir de l'ATP par ladnylate cyclase
membranaire, qui est active par deux hormones principales : adrnaline
(pinphrine) ou le glucagon.
La rgulation hormonale est en fait le rsultat de la transduction dun signal
chimique conduisant des effets intracellulaires qui correspondent ici la mobilisation du
glycogne. Les mcanismes daction de ladrnaline et du glucagon sont similaires, une fois
que chacune de ces hormones est fixe sur son rcepteur membranaire spcifique. La
formation du complexe rcepteur-ligand dclenche une cascade de ractions que nous
pouvons rsumer ainsi (Voir figure 26) :
La fixation de chacune des hormones sur son rcepteur membranaire spcifique
entrane lactivation dune adnylate cyclase (adnylcyclase) membranaire.
Ladnylate cyclase active catalyse, par hydrolyse de lATP, la formation de lAMP
cyclique (AMPc), considr comme un second messager.
LAMPc se fixe sur une protine kinase A (AMPc dpendante) et se combine la sousunit rgulatrice pour librer la sous-unit catalytique (Protine kinase A active).
La protine kinase A (active) phosphoryle, en prsence de lATP, la glycogne
phosphorylase kinase qui devient active sous forme phosphoryle.
Enfin cette dernire phosphoryle la glycogne phosphorylase en la faisant passer de
la forme b la forme a qui catalyse la phosphorolyse du glycogne.
2.3.2 REGULATION PAR LE CALCIUM
La glycogne phosphorylase kinase active par phosphorylation est lenzyme
dterminante qui initie le processus de la mobilisation du glycogne. Nous avons vu plus
haut le mcanisme de contrle hormonal. Un autre processus, de moindre importance mais
actif dans les muscles stris, est dclench par le relargage de grandes quantits dions
Ca2+ par le rticulum endoplasmique. Le mcanisme fait intervenir une petite protine, la
calmoduline, qui fixe 4 ions Ca2+ pour former un complexe calmoduline-Ca2+ actif. Ce
dernier se comporte ensuite comme une sous-unit activatrice dune protine kinase
calmoduline dpendante (figure 75). La protine kinase active, en prsence dATP,
phosphoryle la glycogne phosphorylase kinase. Ainsi la rgulation par le calcium peut
venir renforcer la rgulation hormonale et amliorer la dgradation du glycogne surtout
dans les cas o il faut anticiper les besoins en glucose.
3 SYNTHESE DU GLYCOGENE
La synthse du glycogne a pour but la mise en rserve, dans le foie, dune partie
du glucose excdentaire lissue dune alimentation riche en glucides et en protines, et
dans les muscles la rgnration du stock glycognique dont une fraction a t
consomme par une activit physique. La synthse du glycogne se droule
essentiellement dans le foie et dans le muscle. Lenzyme principale est la glycogne
synthase. Le prcurseur est le glucose 6-.
3.1 - SEQUENCES DES REACTIONS ENZYMATIQUES
3.1.1 - Isomrisation du glucose 6 en glucose 1-
L'enzyme qui catalyse cette raction est la phosphoglucomutase
Glucose 6- glucose 1-
3.1.2 - Transfert du rsidu glucosyle sur UTP (formation de l'UDPglucose).
Le donneur du rsidu glucose dans la raction de polymrisation des glucoses en
glycogne est UDP-glucose. Sa formation est assure par lUDP-glucose
pyrophosphorylase qui transfre le radical glucosyle sur lUDP avec libration du
pyrophosphate (PPi). Lhydrolyse de ce dernier par une pyrophosphatase favorise la
raction.
UTP + glucose 1- UDP-glucose + PPi
3.1.3 Synthse dun primer pour initier la synthse du glycogne
La glycogne synthase qui assure la formation de la liaison (1-4) est une enzyme
dlongation et ne peut initier de novo la synthse du glycogne partir du glucose. Il faut
un primer (ou une amorce) qui peut tre obtenu de diffrentes faons :
utilisation dun fragment de glycogne sous forme de dextrine
En labsence de ce fragment, intervention dune protine spcifique : la
glycognine. Elle possde une chane latrale de tyrosine qui sert daccepteur,
grce sa fonction -OH, au premier rsidu glucosyle provenant de lUDPglucose. La formation de la premire liaison osidique est catalyse par une
glycogne synthase initiatrice. La glycognine, elle-mme, peut rajouter
quelques units glucose lies par des liaisons (1-4) pour terminer le primer (8
units de glucose). Voir figure 27.
3.1.4 Elongation de la chane par la glycogne synthase
Llongation de la chane est assure par la glycogne synthase qui transfre le
rsidu glucosyle de lUDP-glucose lextrmit non rductrice de la chane du primer ou du
glycogne en longation et ralise de faon squentielle la liaison (1-4) suivant la
raction
Glycogne (n glucose) + UDP-glucose glycogne[(n+1)]glucose + UDP
LUDP est reconverti ensuite en UTP par une nucloside diphosphate kinase en
prsence de lATP.
ATP + UDP UTP + ADP
3.1.5 Formation des chanes latrales
A tous les 8 rsidus glucose sur la chane linaire synthtise par la glycogne
synthase, se forme une branche donnant au glycogne une structure fortement ramifie,
ce qui accrot le nombre dextrmits non rductrices, favorables lactivit de la glycogne
phosphorylase au moment de la mobilisation des rserves glycogniques. Cette
ramification lui assure aussi une solubilit trs grande par rapport lamylose qui possde
une structure uniquement linaire. Les ramifications sont assures par une enzyme
branchante : amylo(-1,4 -1,6) transglycosylase ou glycosyl(4,6)transfrase. Elle
prlve un oligoside de 5 8 rsidus glucose de lextrmit non rductrice de la chane en
longation et lattache sur un rsidu glucosyle de la chane principale par une liaison (1-6)
(Voir figure 27).
3.2 - REGULATION DE LA GLYCOGENOGENESE
La rgulation de la synthse du glycogne est assure par la possibilit pour la
glycogne synthase dexister sous deux formes : forme active (dphosphoryle) et forme
inactive (phosphoryle). Linterconversion entre les deux formes est sous le contrle dune
protine phosphatase insulino-dpendante et de la protine kinase A. Lactivation de la
glycogne synthase est le rsultat dune srie de ractions en cascade provoques par
linsuline, qui est une hormone polypeptidique scrte par les cellules des lots de
Langerhans du pancras. Les molcules indispensables dans le mcanisme sont les
suivantes :
Une protine phosphatase : elle devient active par phosphorylation catalyse par
une protine kinase insulino-dpendante.
La phosphatase kinase mentionne ci-dessus : elle est lavant-dernire tape
dune srie de ractions de phosphorylations inities par la tyrosine kinase du
rcepteur catalytique de linsuline.
Le rcepteur catalytique de linsuline, constitu de 4 sous units protiques
enchsses dans la membrane de la cellule-cible. Le dimre 2 forme le domaine
de fixation de lhormone. Le dimre 2 possde sur chaque sous-unit, sur la face
interne de la membrane, une tyrosine kinase.
Le mcanisme de lactivation de la glycogne synthase se rsume ainsi :
Linsuline se fixe sur son rcepteur et forme un complexe rcepteur-iinsuline. La
tyrosine kinase du rcepteur phosphoryle une tyrosine spcifique de chaque sousunit (autophosphorylation).
La tyrosine kinase phosphoryle ensuite la tyrosine dun premier substrat protique
appel IRS-1 (Insulin receptor substrate 1). IRS-1- va initier une srie de ractions de
phosphorylations en cascade dont la dernire tape est lactivation, par
phosphorylation, dune protine phosphatase (dite insulino-dpendante).
Cette dernire dphosphoryle la glycogne synthase (rendue inactive par
phosphorylation par la protine kinase A) et lui restitue son activit. La synthse du
glycogne est ainsi initie ou relance. La figure suivante montre le mcanisme de
lactivation de la protine phosphatase par linsuline.
Il faut ajouter que linsuline favorise lactivit de lestrase qui hydrolyse AMPc en
AMP, ce qui rduit la teneur de la protine kinase A active et, par voie de consquence,
favorise la synthse du glycogne
Insuline
EXTERIEUR
EXTERIEUR
Membrane
plasmique
Membrane
plasmique
Cytosol
+n
nATP
ATP
Tyr
Tyr
Cytosol
Tyr-P
Tyr-P
IRS-1
IRS-1-P
Phosphatase
Phosphatase
phosphoryle
Phosphatase
dphosphoryle
Figure : Mcanisme dactivation de la protine phosphatase par linsuline.
4 REGULATION RECIPROQUE DE LA DEGRADATION ET DE LA SYNTHESE DU
GLYCOGENE
La rgulation de la dgradation et celle de la synthse du glycogne sont
rciproquement coordonnes par les hormones. Elles sont sous le contrle de deux
enzymes : une protine kinase A (AMPc dpendante) active par le glucagon ou par
ladrnaline, et une protine phosphatase active par linsuline.
Lorsque la protine kinase A est active elle phosphoryle la glycogne
phosphorylase kinase et initie la squence de ractions conduisant la dgradation du
glycogne. En mme temps, elle phosphoryle la glycogne synthase qui devient inactive,
ce qui occasionne larrt de la synthse du glycogne.
En revanche lorsque la protine phosphatase insulino-dpendante est active
elle dphosphoryle, dune part, la glycogne synthase phosphoryle en lui restituant son
activit et, dautre part, la glycogne phosphorylase kinase et la glycogne
phosphorylase. La dphosphorylation de ces deux dernires enzymes inhibe la
dgradation du glycogne.
Ainsi lorsque la synthse du glycogne est initie, sa dgradation est arrte. Nous
voyons comment par lintermdiaire de deux enzymes, la protine kinase A et la protine
phosphatase insulino-dpendante sexercent, dune part, la rgulation rciproque de la
dgradation et de la synthse du glycogne, dautre part, les effets antagonistes de
linsuline (hormone effet anabolique) et du glucagon et de ladrnaline (hormones effet
catabolique). Le mcanisme est rsum sur la figure ci-dessous.
Figure : Rsum du mcanisme de la rgulation rciproque de la dgradation et de
la synthse du glycogne.
5 PATHOLOGIES LIEES AU METABOLISME DU GLYCOGENE
Il y a un grand nombre de maladies gntiques lies au mtabolisme du glycogne,
qui peuvent affecter sa dgradation, sa synthse, sa structure ou son stockage. Les
enzymes concernes doivent tre recherches dans les tissus spcifiques. Certaines
peuvent tre trs graves et conduire une mort prmature pendant lenfance ou avoir peu
de consquences ne menaant pas la vie. Quelques-unes de ces maladies sont rsumes
ci-dessous.
5.1 DEFICIENCE EN GLYCOGENE PHOSPHORYLASE DANS LES MUSCLES
SQUELETTIQUES: SYNDROME DE Mc ARDLE
Dans le syndrome de Mc ARDLE les muscles sont dficients en glycogne
phosphorylase. Cette dficience naffecte pas la glycogne phosphorylase hpatique. La
structure du glycogne dans les muscles stris est normale. Alors que le dveloppement
mental du patient nest pas affect on relve les symptmes suivants :
Faiblesse et crampes musculaires aprs exercice
Absence dlvation de lactate dans les muscles aprs exercice extnuant
Myoglobinurie lge avanc
Teneur leve en glycogne musculaire
5.2 DEFICIENCE EN GLUCOSE 6- DU FOIE : MALADIE DE VON GIERKE
Dans cette maladie la structure du glycogne est normale. La maladie affecte le
foie, les reins et lintestin. Le glucose 6-, issu de la dgradation du glycogne, nest plus
hydrolys en glucose, raction fondamentale, indispensable au maintien de la glycmie.
Les principaux symptmes rencontrs sont :
Hypoglycmie svre pendant le jene
Hyperlactacidmie (hyperacidose lactique) et hyperuricmie
Accroissement des rserves glycogniques hpatiques
5.3 DEFICIENCE EN -GLUCOSIDASE LYSOSOMALE : MALADIE DE POMPE
Cette dficience affecte le foie, le cur et les muscles. La structure du glycogne et
la glycmie sont normales. Le dfaut en -glucosidase lysosomale est hrite. Bien que le
pourcentage du glycogne dgrad dans les lysosomes soit faible et sans quon sache
vraiment son utilit mtabolique, cette maladie est trs grave avec les traits suivants :
Concentrations leves en glycogne dans les vacuoles, donnant un aspect
anormal au cytosol.
Cardiomgalie svre
Mort habituellement prcoce
______________________
Vous aimerez peut-être aussi
- Poly 03-Metabolisme Des GlucidesDocument52 pagesPoly 03-Metabolisme Des Glucidessafemind100% (1)
- Métabolisme Du GlycogèneDocument7 pagesMétabolisme Du GlycogèneaxelPas encore d'évaluation
- 01.6 Métabolisme Du GlycogèneDocument7 pages01.6 Métabolisme Du Glycogènewassimm31Pas encore d'évaluation
- Cours 8 A GLYCOLYSEDocument15 pagesCours 8 A GLYCOLYSELina BernoussiPas encore d'évaluation
- Biochimie2an-Metabolisme Glucogene2019Document48 pagesBiochimie2an-Metabolisme Glucogene2019Kenza KassabPas encore d'évaluation
- Le Métabolisme Du Glycogène Enregistré AutomatiquementDocument8 pagesLe Métabolisme Du Glycogène Enregistré AutomatiquementKouadioPas encore d'évaluation
- Metabolisme Des GlucidesDocument29 pagesMetabolisme Des GlucidesSylvert DjéranéPas encore d'évaluation
- Biochimie2an-Metabolisme Glucogene2019kouiderDocument10 pagesBiochimie2an-Metabolisme Glucogene2019kouiderrahma bouadamPas encore d'évaluation
- Fonction Glycogenique Du FoieDocument7 pagesFonction Glycogenique Du FoieMariettePas encore d'évaluation
- Glycolyse - Wikipédia PDFDocument8 pagesGlycolyse - Wikipédia PDFwxcvbnnbvcxwPas encore d'évaluation
- Cours - 4 Regulation - Du - Metabolisme - Des - GlucidesDocument18 pagesCours - 4 Regulation - Du - Metabolisme - Des - Glucidesmiss anthropocenePas encore d'évaluation
- Le Métabolisme Du GlycogèneDocument8 pagesLe Métabolisme Du GlycogèneSalomon JosephPas encore d'évaluation
- Bioch Pharm2an-Metabolisme GlucidesDocument28 pagesBioch Pharm2an-Metabolisme GlucidesmaryPas encore d'évaluation
- Metabolisme Du GlycogeneDocument4 pagesMetabolisme Du GlycogeneJérémie barakaPas encore d'évaluation
- Cours3 Métabolisme GlucidesDocument15 pagesCours3 Métabolisme GlucidesOrnel RistelPas encore d'évaluation
- Cours de MetabolismeDocument69 pagesCours de Metabolismeleonce kadjiPas encore d'évaluation
- Genie BiochimieDocument41 pagesGenie Biochimieddiouk2Pas encore d'évaluation
- Métabolisme Des Glucides PR CherkaouiDocument25 pagesMétabolisme Des Glucides PR CherkaouiOumayma El YamaniPas encore d'évaluation
- Métabolisme Du Glycogéne 2021 TransmisDocument35 pagesMétabolisme Du Glycogéne 2021 TransmisGuy Morel KouacouPas encore d'évaluation
- Bioch2an27 NeoglucogeneseDocument9 pagesBioch2an27 NeoglucogeneseIngenieur AgroPas encore d'évaluation
- Biochimie1an Glycolyse2022ferganiDocument8 pagesBiochimie1an Glycolyse2022ferganiKhelassi OussamaPas encore d'évaluation
- 1 GlycolyseDocument56 pages1 Glycolysesoubin kimPas encore d'évaluation
- NEOGLUCOGENEDocument7 pagesNEOGLUCOGENEMira45Pas encore d'évaluation
- 03-Glycolyse 2021Document7 pages03-Glycolyse 2021Mery Sage100% (1)
- Cour Regu 1Document10 pagesCour Regu 1rekik hibaPas encore d'évaluation
- 3 Le GlycogèneDocument34 pages3 Le GlycogèneSamar AouinaPas encore d'évaluation
- Métab Des Glucides GlycolyseDocument107 pagesMétab Des Glucides GlycolyseHanane AmnanouPas encore d'évaluation
- Cours NéoglucogenèseDocument8 pagesCours NéoglucogenèseaxelPas encore d'évaluation
- Metabolisme Du GlycogeneDocument42 pagesMetabolisme Du Glycogenemkdqhp8rwdPas encore d'évaluation
- Le Controle Des Flux de Glucose Source Essentielle D Energie Des Cellules Musculaires Cours CompletDocument6 pagesLe Controle Des Flux de Glucose Source Essentielle D Energie Des Cellules Musculaires Cours CompletJulien LEMOINEPas encore d'évaluation
- Fichier Produit 1984 PDFDocument25 pagesFichier Produit 1984 PDFManel MedPas encore d'évaluation
- Biochimie2an Glycolyse2019kouiderDocument11 pagesBiochimie2an Glycolyse2019kouiderrahma bouadamPas encore d'évaluation
- Chapitre 5-La Glycolyse (Voie D'embden-Meyeroff-Parnas)Document17 pagesChapitre 5-La Glycolyse (Voie D'embden-Meyeroff-Parnas)stephen njemsPas encore d'évaluation
- Biochimie A1Document21 pagesBiochimie A1Joseph YaoPas encore d'évaluation
- 8 - GlycogeneDocument46 pages8 - Glycogenesimaedouaaron067Pas encore d'évaluation
- Biochimie NeoglucogeneseDocument5 pagesBiochimie NeoglucogeneseHind BerradiPas encore d'évaluation
- Microsoft Word - NeoglucogeneseDocument8 pagesMicrosoft Word - NeoglucogeneseDaniel PardejoPas encore d'évaluation
- Biochimie - GlucidesDocument51 pagesBiochimie - GlucidesmimiPas encore d'évaluation
- Chapitre 8Document9 pagesChapitre 8yvesPas encore d'évaluation
- Cour Régulation Des Gènes Université MentouriDocument16 pagesCour Régulation Des Gènes Université Mentourimonecole2018Pas encore d'évaluation
- Métabolisme ÉnergétiqueDocument71 pagesMétabolisme ÉnergétiqueSara ChPas encore d'évaluation
- Régulation Du Métabolisme Glucidique - ÉtudiantsDocument48 pagesRégulation Du Métabolisme Glucidique - ÉtudiantsfafoulolPas encore d'évaluation
- 1.métabolisme Des Glucides GlycolyseDocument39 pages1.métabolisme Des Glucides GlycolyseboubouothnielPas encore d'évaluation
- WWW Cours Pharmacie Com Biochimie Metabolisme Des Glucides HDocument17 pagesWWW Cours Pharmacie Com Biochimie Metabolisme Des Glucides HMerahi AbdelDjalilPas encore d'évaluation
- Le GlucagonDocument6 pagesLe GlucagonRacem Boudghene stambouliPas encore d'évaluation
- TD GlucidesDocument4 pagesTD GlucidesModou KebePas encore d'évaluation
- 04 - La Glycolyse (COURS)Document6 pages04 - La Glycolyse (COURS)zitounikhawla05Pas encore d'évaluation
- Support Au Tutorat de Biochimie Des Glucides 2Document23 pagesSupport Au Tutorat de Biochimie Des Glucides 2Ab UubPas encore d'évaluation
- La GlycolyseDocument3 pagesLa GlycolyseFayad BouraimaPas encore d'évaluation
- Glycol YseDocument40 pagesGlycol YseHanne ZamelPas encore d'évaluation
- Régulation de La GlycémieDocument9 pagesRégulation de La GlycémieSnawa DangoaPas encore d'évaluation
- 01.2 GlycolyseDocument5 pages01.2 Glycolysewassimm31Pas encore d'évaluation
- Biochimie CliniqueDocument26 pagesBiochimie CliniqueelrodchristPas encore d'évaluation
- CH1 Glycolyse Et FermentationDocument59 pagesCH1 Glycolyse Et Fermentation6f2gf2tqy5Pas encore d'évaluation
- Chapitre Voies MétaboliquesDocument57 pagesChapitre Voies MétaboliquesMBAÏADOUM NGARGUINAM RodriguePas encore d'évaluation
- Devoir de BiochimieDocument1 pageDevoir de BiochimieherodevincentPas encore d'évaluation
- Fichier Produit 1945Document64 pagesFichier Produit 1945Antz DanielPas encore d'évaluation
- Biochimie MetaboliqueDocument32 pagesBiochimie Metabolique[AE]88% (8)
- Glucides: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandGlucides: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Méthode de la Déesse du Glucose : Votre Guide Complet pour une Santé Métabolique OptimaleD'EverandLa Méthode de la Déesse du Glucose : Votre Guide Complet pour une Santé Métabolique OptimalePas encore d'évaluation
- Cours MRE SORODocument21 pagesCours MRE SOROAlexandre OuffouePas encore d'évaluation
- Catécholamines Et Autres Sympathomimétiques DirectsDocument13 pagesCatécholamines Et Autres Sympathomimétiques Directsdrlauri100% (1)
- Physiologie Endocrinienne C01Document45 pagesPhysiologie Endocrinienne C01amael saint-louisPas encore d'évaluation
- Les Récepteurs Membranaires Les Récepteurs Couplés Aux Protéines G (RCPG)Document79 pagesLes Récepteurs Membranaires Les Récepteurs Couplés Aux Protéines G (RCPG)Acide OléiquePas encore d'évaluation
- Cours 1Document62 pagesCours 1kaddour sofianePas encore d'évaluation
- Recepteurs Yamoun AssiaDocument77 pagesRecepteurs Yamoun AssiaYamounAssia100% (2)
- Membrane PlasmiqueDocument38 pagesMembrane PlasmiqueOumarou KontaPas encore d'évaluation
- Le GlucagonDocument6 pagesLe GlucagonRacem Boudghene stambouliPas encore d'évaluation
- RegulationDocument30 pagesRegulationYannick DsprbsPas encore d'évaluation
- Glycogen eDocument9 pagesGlycogen esaidhassanefilsPas encore d'évaluation
- TD Hormonologie - 2013Document3 pagesTD Hormonologie - 2013Amina MelouahPas encore d'évaluation