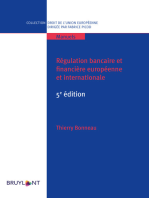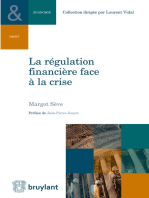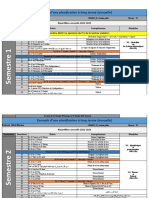Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Micro Economie
Micro Economie
Transféré par
Zachary DidiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Micro Economie
Micro Economie
Transféré par
Zachary DidiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Micro-Economie
Cest une branche de lanalyse conomique qui a pour objet dtudier les comportements individuels et les interactions possibles entre les individus.
Bibliographie :
M. Varian : Introduction la micro-conomie. Deboeck Universit. Robert Pindyck : MicroEconomie. Pearson Education. Jacques Gnreux : Economie politique, introduction et micro tome 1. Fondamentaux d'Hachette. Gilles Rotillon. Introduction la microconomie. La dcouverte collection Repres.
Introduction gnrale
La micro-conomie est la branche de lanalyse conomique qui a pour objet dtudier les comportements individuels, et les interactions possibles entre les individus, ces derniers sont des acteurs conomiques qui composent une conomie de march on va parler dun consommateur, le producteur, ltat, et ces individus sont runis entre eux par le march. La micro-Economie a une porte explicative, elle va expliquer les prix et la formation des prix sur le march. Elle a aussi une porte normative cest--dire quelle veut pouvoir expliquer la meilleure situation possible, il y aura donc des critres defficacit. On va modliser ou formaliser les comportements. La premire chose que lon va faire cest de modliser le march, le march de concurrence pure et parfaite. Cest un modle thorique qui va nous permettre de mieux comprendre la ralit. Car lorsque toutes les conditions sont runis cest le systme le plus ecace. Mais pour comprendre la ralit, il nous faut un cadre danalyse. Deuxime hypothse les individus sont rationnels cest dire quil procde un calcul conomique et qui maximise ses objectifs sous contrainte. Les 5 hypothses de la concurrence pure et parfaite : 1. Atomicit de loffre et la demande : Multitude doffreurs et de demandeurs sur le march. Cela veut dire que chaque individu prit isolment est de petite taille. Les individus nont donc aucun pouvoir sur le prix. Par exemple, supposons un march avec 1000 entreprises en concurrence, et que 3 dcident de sentendre sur le prix, sur les mille a ne change rien. Sil ny a que 6 entreprises, alors si 3 dcident de sentendre, alors les entreprises ont le pouvoir de march. En concurrence on dit que les individus sont preneurs de prix. Chacune des entreprises ne possde pas une taille susante du march pour quelle ait un pouvoir sur le prix. Par contre toute les entreprises runis font le prix du march.
2. Lhomognit du produit : Le produit est considr comme homogne au yeux des consommateurs, cela veut dire que le consommateur est tout fait indiffrent lorigine du produit. La concurrence devrait se faire seulement par le prix. 3. La mobilit des facteurs de production : Capital et travaille se dirige toujours vers les emplois ou ils seront le mieux rmunrs. Les entreprises vont sinstaller sur un march il y aura des possibilits de produits. Capital et travail sont capables de passs dun march un autre. 4. Libre entre et libre sortie du march : A tout moment une entreprise peut venir sinstaller sur le march. Il ny a pas dobstacles lentre (un brevet est une barrire, ou une licence). Libre sortie cela veut dire que tous les cots sont rcuprables, il y a absence de cots irrcuprable. 5. La transparence : sur le march linformation est parfaite. Cela veut dire quelle disponible tous et sans cot. L information est vhicul par les prix sur le march. La micro-economie dcoule de lanalyse noclassique. (Marshall, Walras). Le march par la exibilit des prix permet la situation optimale. La micro-conomie tudie le comportement entre les individus. Cela veut dire que les individus recherchent leur propre intrt. Il y a des mcanisme dajustement qui sont luvre et qui permette de coordonner les comportements. Sur le march (rencontre de lore et la demande) il y a un change car jai besoin de choses car il y a des choses que je ne peux pas procurer autrement que sur le march. Ainsi on introduit la raret des ressources. Mes besoins sont illimits, mais les biens qui sont ma disposition nexiste quen quantit limite, il faut donc pour lutter contre la raret produire les biens. Donc la base de lconomie il y a change entre les individus. A partir du moment ou je considre que les ressources sont rares, il faut respecter un principe de non gaspillage. Donc le terme defficacit il faut le comprendre en principe de non gaspillage. Puisque les ressources sont rares, il va falloir choisir comment les utiliser, le travail, les biens, le temps et rare. Donc la raret des ressources suppose de choisir comment utiliser au mieux les ressources rare. Cest pour a que la micro va devenir les thorie des choix. Le choix peut tre contraint, mais on est oblig de choisir. Ce qui est important dans le choix, cest ce dont quoi on renonce. Choisir cest renoncer quelque chose. Il apparat ce quon appelle un cot de renonciation, ou un cot dopportunit : quest-ce que je perd en choisissant. Ces cots dopportunit rels sont croissant, plus je renonce plus a va me manquer.
Chapitre 1 : Elments fondamentaux de loffre et de la demande, et structures de march concurrentiels
La structure dun march est caractrise par le nombre dindividus prsent sur ce march. Sur un march se rencontrent offre et demande dun mme bien, cest lquilibre partiel. On va expliquer comment fonctionne le march dun bien. Puis aprs on verra lquilibre gnral, cest--dire lquilibre sur tous les marchs.
Section 1 : Demande, offre et quilibre de march.
I/ La demande et la courbe de demande
A/ Dnition et facteurs explicatifs
La demande dun bien traduit les intentions dachats pour tous les niveaux de prix possibles de ce bien. On parle de la demande totale dun bien adresse un march. La demande totale cest la somme des demandes individuelles :
Le premier facteur explicatif de la demande dun bien est le prix de ce bien. Toute chose gale par ailleurs (et ceteris paribus) la demande est une fonction dcroissante du prix.
Dautres facteurs inuence la demande dun bien, cest--dire que ces facteurs peuvent modis la relation qui existe entre prix et quantit demande ce prix. 1. La demande est aussi explique par le got ou les prfrences des consommateurs. 2. Autre variable explicative le revenue, la demande dun bien dpend videmment du revenu. 3. Enn la demande dpend du prix des autres biens. Ainsi certains biens sont dits substituables cela veut dire que le consommateur peut consommer lun ou lautre. Si le prix dun bien substituables diminue, cela veut dire que les variations du prix du bien substituable vont entr dans nos variables.
B/ Construction de la courbe de demande et prix de rserve
La courbe de demande est la reprsentation graphique entre le prix et la quantit demande de ce bien. Pour construire la demande il faut connatre ce que chaque individu est disposer payer pour obtenir le bien, il nous faut sa disposition payer cela revient connatre le prix maximum que lacheteur est prt payer pour obtenir le bien. Ce prix maximum est appel prix de rserve () si sur le march le prix de vient suprieur alors le consommateur n'achte pas le bien.
On se place sur le march du logement locatif. Et sur ce march on connat les disposition payer de 6 individus.
Prix de rserve
1000 900 800 700 600 500
Individu
1 1 1 1 1 1
Courbe de demande : 1000
750 Prix de rserve
500
250
0 1 2 3 4 5 6 Nombre dindividu Si les variations de prix sont inniment petites, elles deviennent marginales et si les variations de biens sont inniment petites aussi. Les biens sont divisibles, donc les variations peuvent tre inniment petites, dans ce cas la courbe de demande est continue. et la demande scrire :
Exemple : On se place du sur le march dun bien et sur le march de ce bien D(p) = 250 - 10p et /que P> donc D= 0
Donc :
Ne pas oublier le prix de rserve !
Ds lors que le prix diminue de plus en plus de consommateur sont interesss pour acheter le bien.
C/ Les variations de la demande
Il faut distinguer : Les modications de la demande suite une variation du prix du bien. Dans ce cas on tudie les dplacement le long de la courbe. Et dautre part les modication de la courbe suite une variation des autres facteurs explicatifs. Toute modication des facteurs explicatifs qui entrane une augmentation de la demande, par exemple l'augmentation du prix des autres biens, l'augmentation du revenu, se traduit par un dplacement vers la droite de la courbe de demande. Supposons que le revenu des consommateurs augmente. Toute modication dun facteur explicatif qui entrane une diminution de la demande se traduit par une translation vers la gauche.
II/ Loffre et la courbe doffre A/ dnition et facteur explicatif
L offre dun bien dcrit les intentions de vente pour tous les niveaux de prix possible de ce bien. Toute chose gale par ailleurs, sur le march loffre est une fonction croissante du prix. Le prix du march est donc le prix de vente du bien. Donc lorsque sur le march le prix augmente, il y a plus de possibilits de prots.
Dautres facteurs inuencent lore cest--dire, inuence la relation entre prix et quantit offerte : 1. Le cot du production. L ore est dpendant du cot de production, cest -dire le cot des facteurs de production prix du travail, du capital. 2. La technologie, les entreprises peuvent faire des gains de productivit, la technologie va inuencer lore, toute amlioration technlogique permet daugmenter la quantit oerte pour les mmes quantit de prix.
B/ Construction de la courbe doffre
La courbe dore est le reprsentation graphique de la relation prix/quantit oerte. Il existe un prix tel que le producteur dcide dorir le bien. Cela signie que si le prix de march diminue et passe en dessous de ce niveau de prix alors certains producteurs norent plus le bien. Il existe un seuil de rentabilit, un prix de rentabilit (Pr), cest dire un prix minimum qui incite les producteurs orir le bien. Donc si le prix de march devient infrieur ce prix de rentabilit alors lore totale est nulle. Et si le prix de march devient suprieur ce prix de rentabilit alors loffr est une fonction croissance du prix. Ce seuil est dirent selon les oreurs. Si le nombre doreurs est important (et cest le cas on est en concurrence) et que les variations de prix sont inniment petites, alors la courbe dore est continue.
Exemple : sur le march du bien lore est de la forme S(p)=-350+40p
Pour rsumer : Pour calculer Pb ou Pmax on fait : D(p)=0 Pour calculer Pr ou Pmin on fait S(p)=0
Courbe doffre 12
0 0 150
C/ Les variations de loffre
Il faut distinguer les variations de lore quand le prix du bien varie, se sont les mouvements le long de la courbe dore. Ainsi que les modications de la courbe dore lorsquun autre facteur explicatif varie. Toute modication dun facteur explicatif qui entrane une augmentation de loffre se traduit par un dplacement vers la droite de la courbe doffre. Toute modication dun facteur explicatif qui entrane une diminution de lore se traduit par un dplacement vers la gauche. Pour le mme niveau de prix les intentions dachats sont moins levs.
III/ Lquilibre du march
Sur le march ore et demande voluent de faon contraire par rapport aux variations de prix. Et le march est en quilibre lorsque loffre est gale la demande. Donc la rencontre de lore et de la demande permet de dterminer ce quon appelle un prix dquilibre, car ce prix quantit offerte gale quantit demande. Et comme lun est croissante et lautre est dcroissante il nexiste quun seul prix. Sur le march du logement. A court terme lore sur le march du logement est gale 3.
Demande 100 75 50 25 0 0 Q*
Offre
Ce prix dquilibre est unique sur le march, il nexiste quun seul prix pour lequel ore et demande sont gales. Je suppose un prix P1 suprieur au prix dquilibre, la demande a baiss, car il y a une partie des consommateurs qui nachtent pas le bien car le prix est trop important pour eux. Pour un prix P1 suprieur au prix dquilibre, lore augmente. A un prix P1 jai bien une ore suprieure la demande, lore est excdentaire. La concurrence va entraner une baisse des prix, ce qui va augmenter la demande et diminuer loffre et donc on va retourner lquilibre. En situation dexcdent le prix tendance a baisser pour retourner lquilibre. Il existe des forces qui tendent rguler les prix pour retourner lquilibre. Pour un prix P2 infrieur au prix dquilibre on a loffre qui est infrieur la demande, cest situation de pnurie sur le march. Cette situation entraine une augmentation des prix sur le march, et donc certains consommateurs vont se retirer du march (baisse de la demande) et de nouveaux producteurs vont entrs sur le march (hausse de lore) donc retour lquilibre. On appelle cela le rationnement par le prix. Dans la ralit les prix ne sont pas totalement exibles sur les marchs, ce que nous tudions est le critre de rfrence. Toute modication de lenvironnement conomique va entraner une modication des courbes dore et demande et va donc entraner un dplacement de ces courbes ce qui conduit une modication de lquilibre du march. Toute modication de lenvironnement conomiuqe qui a pour effet de modier loffre (cest un choc doffre) entrane un dplacement de la courbe dore dans le plan, sil y a augmentation de lore la droite se dplace vers la droite dans le plan. A demande constante le prix dquilibre baisse et les quantits changes augmentent. A linverse toute diminution de loffre se traduit par un dplacement vers la gauche de la courbe doffre, cela entrane une augmentation du prix dquilibre, et une diminution des quantits changes. Toute modication dun facteur qui entrane une modication de la demande se traduit par un dplacement parallle de la demande dans le plan.
Tout facteur qui entrane une augmentation de la demande, se traduit par un dplacement vers la droite de la courbe de demande, pour les mmes niveaux de prix on consomme plus. A ore constante le prix dquilibre a augment et les quantits changes lquilibre ont augments. Par contre toute modication dun facteur qui entrane le dplacement vers la gauche de la courbe de demande, ce qui entrane donc que pour les mmes niveaux de prix possibles du bien, il y a moins de demande, le prix de rserve baisse et ore constante, le prix dquilibre baisse et les quantits changes ce prix sont plus faibles.
IV/ Les surplus
Au prix dquilibre (P*) certains consommateurs sont exclus se sont ceux qui ne sont pas disposer a payer ce prix dquilibre pour obtenir le bien. Par contre certains consommateurs taient disposer payer un prix plus lev que le prix dquilibre pour obtenir le bien. Il se passe la mme chose du ct des producteurs, au prix dquilibre, certaines entreprises noffrent pas le bien, car ce prix dquilibre est considr comme trop bas. Par contre ce prix, certaines entreprises taient disposes le vendre moins cher que le prix dquilibre. Le surplus du consommateur est la diffrence entre le prix effectivement pay par le consommateur pour obtenir le bien (p*) et le prix de rserve, cest--dire le prix quil tait dispos payer. Le surplus total des consommateurs cest la somme des surplus individuels. Graphiquement ce surplus total des consommateurs est la surface situ entre la courbe de demande et le prix effectivement pay. On peut calculer le surplus du consommateur en calculant lair de cette surface. (hauteur*base /2) De la mme faon le surplus du producteur est la diffrence entre le prix effectivement reu par le producteur et le prix de rentabilit, cest--dire le prix minimum quil tait prt accepter pour fabriquer le bien. Le surplus total des producteur (Sp) est la somme des surplus individuels. Et graphiquement il sagit de la surface situ entre le prix reu et la courbe doffre. Le surplus global cest la somme du surplus total des producteur et du surplus total des consommateurs. On reprend lexemple P*800 et q*=3 Le surplus total des individus cest la somme des surplus individuels : SC1 = 1000 - 800 = 200 SC2 = 900 - 800 = 100 SC3 = 800 - 800 = 0 SCt = SC1 + SC2 + SC3 = 300 D(p) = 250 - 10p S(p) = -35 +40p
En situation non optimale on va pouvoir calculer grce au surplus lecacit de la situation. Si la situation dquilibre ne joue on dispose dun outil pour calculer.
Section 2 : Les consquences de lintervention de ltat
L tat intervient par un systme de taxation et de subvention et cela modie les conditions dquilibre et donc pour analyser les eets de cette intervention de ltat on va analyser les courbes dore et demande.
I/ Le contrle des prix
Le contrle des prix consiste instaurer des prix seuils sur les marchs. Plus prcisment des prix planch ou des prix plafonds. Un prix planch cest un prix minimum. Le prix plafond consiste instaurer un prix maximum, cest--dire que le prix du march ne peut excder ce prix. Concrtement cela veut dire que les prix ne peuvent plus sajuster librement sur le march. Donc lajustement par la exibilit ne va plus jouer. Selon la catgorie dindividus que ltat veut favoriser il instaurera un prix minimum ou un prix maximum sur le march. Sil veut favoriser les offreurs, il instaurera un prix minimum, par contre sil veut favoriser un demandeur il instaurera un prix maximum. L intervention de ltat se justie lorsque lallocation opre par les prix semble injuste.
Etude dun prix plafond : On considre un march et sur march ltat dcide de faire un prix plafond. Demande 100 Offre
75 P* Pmax
50
25 Qsmax 0 0 Q* Q QpMax
Pour Pmax < P* => Qsmax < Qmax Donc cela crer une situation de pnurie, le prix tant infrieur au prix dquilibre cer-
10
tains producteurs sont exclus. Ce prix nest pas susamment rentable pour tous pour fabriquer le bien. La surface A est la variation du surplus des producteurs. La quantit rellement change est la quantit la plus petite. Certains consommateurs sont gagnant car ils obtiennent le bien moins cher, par contre certains sont rationns, et ne peuvent obtenir le bien alors mme quil est dsir. La quantit change est forcement la plus petite. Dans la mesure ou les prix discriminent plus puisquils ne peuvent plus bouger, il faut une autre mthode de rationnement et donc une autre mthode de rationnement. Cette situation de pnurie favorise le phnomne de le dattente, cela veut dire que la discrimination se fait par le temps, qui fait la queue ? Celui qui a la disposition attendre le plus longtemps, cest celui qui est gagnant en perdant son temps. Dans ce systme en situation de pnurie le vendeur un certain pouvoir. Le prix planch. Le prix planch favorise les oreurs, donc ce prix planch Demande Pb 100 C Pmin 75 Offre
P*
50 Surplus des producteurs.
Pr
25
0 Q* Q Qsmax QpMax Exemple le SIMC. On es en situation dore excdentaire. Le prix tant plus lev que sur le march dquilibre, certains consommateurs sont exclus. Certains producteurs sont intresss pour fabriqus le bien. Certains oreurs sont gagnants car le prix a augment C = Surplus des consommateurs. 0
II/ Impact des taxes
La production dune taxe va avoir un impact sur le prix du bien concern. Comme pour le contrle des prix, nous allons utiliser la courbe dore et de demande pour analyser comment les producteurs et les consommateurs sont touchs et analyser les consquences.
11
On distingue deux types deux taxes : Les taxes lunit : Dans ce cas un certain montant est prlev par une unit vendue. Les taxes ad valorem : Une taxe proportionnelle la valeur du produit. La TVA par exemple. Quel que soit la taxe, elle est paye par le consommateur et le producteur la reverse ltat. Il va apparatre deux prix : un prix dore et un prix de demande. Le prix pay par les acheteurs est suprieur au prix reu par les oreurs. Dans le cadre dune taxe lunit le prix de demande, cest le prix dore + la taxe : Dans le cadre dune taxe ad valorem le prix dore multipli par un certain pourcentage :
Demande Pb 100
Offre
75 Pd
Surplus des consommateurs
A
P* Ps 50
25
0 0 Q* Q
donc :
12
Ce prix de demande est plus lev que le prix dquilibre. B sont exclus car sans la taxe ils pourraient acheter le bien. L tat peut galement intervenir par lintermdiaire des subventions, cela veut dire que ltat veut soutenir les producteurs. Par cette subvention ltat veut soutenir les producteurs. Cela veut dire que le prix dore (le prix que va recevoir le producteur va tre le prix de demande plus la subvention) :
III/ Libre change et protectionnisme
Demande Pb 100
Offre
75 Pd
P* Pm
50
25
0 0 Q* Q
13
Au prix dquilibre lore nationale est gale la demande nationale. L conomie est ouverte donc le march de ce bien est mondiale, et donc en libre-change cest le prix sur le march mondial qui prvaut. L tat dcide dintervenir pour soutenir lore nationale et instaure un droit de douane.
Demande Pb 100
Offre
75 Pd
P* Pm
50
Pn+T
25
0 0 Q* Q
Normalement on sapprovisionne Pm (prix mondial). Un taux de droit de douane qui correspond lquilibre national est compltement prohibitif.
14
Chapitre 2 : Les lasticits de loffre et de la demande
L'lasticit prix est un indicateur qui permet de mesurer la raction des offreurs et des demandeurs suite une variation du prix. De faon simple on sait comment ragissent offre et demande, la fonction et une nition dcroissante du prix alors que lore est une fonction croissante du prix, ce qui nous intress maintenant est de savoir dans quelle mesure il varie, et cest llasticit qui va nous donner cette mesure. Cest lindicateur de base pour comprendre le comportement des demandeurs.
Section 1 : Elasticit prix de la demande
L lasticit prix directe de la demande mesure la sensibilit dun bien aux variations de son prix tout chose gale par ailleurs.
I/ 1re approche du concept d'lasticit
L lasticit prix directe va nous indiquer les variations du prix.
Demande 100
75
Pa 50
Pb
25
0 0 Q* Q
15
II/ dnition et calcul de llasticit
Llasticit prix directe de la demande indique le pourcentage de variation de la demande. Conscutif une variation de 1% du prix toute chose gale par ailleurs.
Cest un nombre sans dimension. L 'lasticit na pas dunit. E(D/P). Conformment la loi de la demande (fonction dcroissante du prix) llasticit est normalement ngative. Si llasticit de E(D/P) = -2 et que les prix augmente de 10 % la demande diminue de 20 % si le prix augmente de 5% la demande diminue de 10 %. Pour interprter llasticit il faut tudier sa valeur absolue. Si llasticit de la demande par rapport au prix est gale -1 cest 1 en valeur absolue, cela signie que la variation de la demande est proportionnelle la variation du prix. On appelle cela llasticit unitaire. Lorsque llasticit est comprise entre 0 et 1 en valeur absolue cest dire entre -1 et 0 cela signie que les variations de la demande sont moins que proportionnelle la variation du prix. Dans ce cas l on dira que l'lasticit est faible ou que la demande est faiblement lastique. Lorsque llasticit est suprieure 1 en valeur absolue ou infrieure moins 1 cela signie videmment que les variations de la demande sont plus que proportionnelle la variation du prix. Et on dira que la demande est fortement lastique ou encore que les consommateurs sont trs sensibles une variation du prix. Si llasticit est nulle on dira que la demande est parfaitement inlastique, cela veut dire que la variation du prix na aucune incidence sur le comportement des consommateurs. Lorsque les courbe de demande sont linaires (lorsque je passe une fonction continue et drivable) lelasticit scrit :
L lascit se mesure en un point de la courbe de demande. L lasticit dpend de la pente de la courbe de demande mais elle dpend aussi du prix et de la quantit demande.
On avait trouv p* = 12 et q* = 130
16
Demande 100
Pb
75
50
25
0 0 Q* Q
Au point A le prix est lev et la quantit est faible la demande est fortement lastique.. Au point B llasticit est faible, le prix est faible, la demande est faiblement lastique. Entre les deux il existe un point intermdiaire pour lequel llasticit est gal 1.
III/ Les facteurs qui inuence le niveau de llasticit.
Le premier facteur, cest le type de bien concern, et les possibilits de substitut proche ce bien. Plus il existera un bien substituable plus les consommateurs sont sensibles au prix. Puisque lon va pouvoir substituer le bien ds que le prix augmente. A linverse sil nexiste pas de substitut proche au bien alors on est contraint, mme si le prix augmente.
17
Le deuxime facteur cest le dlai dajustement qui existe entre la variation du prix et la raction des consommateurs. Dans cette optique on distingue lasticit court terme et lasticit long terme. En conomie la distinction entre court terme et long terme est lie la plus ou moins grande capacit des acteurs conomiques sadapter aux variations de prix. De faon plus prcise en conomie on va appeler court terme un laps de temps, tel que lajustement ne se fait pas. Au niveau de la demande cest li aux habitudes de consommations. En revanche le long terme se dnit comme un laps de temps au cours duquel lajustement est possible. Donc en gnral llasticit sera plus leve long terme qu court terme. Il y a des biens pour lesquels cest caractristiques. Sur du trs court terme la demande par rapport aux prix de lessence est pratiquement nulle.
IV/ Prix quantit demande, dpenses totales et recettes totales
A chaque prix possible du bien, on peut calculer la dpense totale du consommateur. Cest dire le prix multipli par les quantits demandes.
On tudie ce qui se passe quand le prix passe de Pa Pc.
Demande Pb 100 Pa
75 Pc
50
25
0 0 Q* Q
18
On sait que en haut de la courbe de demande au point A, les quantites demandes sont faibles et le prix est lev. Donc llasticit est leve. Par contre en bas de la courbe de demande les quantits demandes sont leves et le prix est faible. Donc llasticit est faible. On passe du prix Pa Pc. La dpense totale est la surface en rouge. Le rectangle bleu reprsente la baisse de la demande totale. La surface relative la dpense supplmentaire est suprieure la surface relative la baisse de la dpense totale. En haut de la courbe de demande il y a une compensation qui seectue. Cela veut dire que lon consomme dans des proportions plus importantes la baisse du prix.
Demande 100
75
50
Dpense en moins lorsque le prix est de B 25 Dpense en plus 0 0 Q* Q
Malgr la baisse du prix et les quantits consommes en plus la dpense totale diminue. Lorsque la demande est fortement lastique. Une baisse du prix entrane une augmentation de la quantit demande dans une proportion plus importante, de sorte que la dpense totale augmente. Par contre lorsque la demande est relativement inlastique, laugmentation de la quan-
19
tit demande est moins que proportionnelle la baisse du prix, donc la depnse totale diminue. On retient donc qune baisse du prix augmente la dpense totale pour des prix lev, auxquelles la demande est trs sensible. Et une baisse du prix diminue la dpense totale pour des prix faibles lesquels la demande est relativement inlastiques. Donc il existe un prix tel quune baisse de prix laisse la dpense totale inchange. L 'lasticit unit est le prix pour lequel llasticit est gale 1 en valeur absolue. On peut faire le lien avec la recette totale des entreprises donc des producteurs, du ct producteur la recette totale, cest le prix multipli par les quantits vendues et elle conditionne le prot des entreprises.
Recettes totales et dpenses totales atteignent un maximum au point ou la demande une lasticit unitaire. La connaissance de llasticit permet au producteur de savoir sil doit augmenter ou diminuer les prix pour maximiser son prot.
Section 2 : Les autres lasticits de la demande I/ Llasticit prix croise de la demande
Elle mesure la sensibilit de la demande dun bien, aux variations du prix dun autre bien toute chose gale par ailleurs. On suppose le bien B1 et B2. Le prix du B1 est de P1 et le prix de B2 est de P2. La demande de B1 est de la forme D1 (P1;P2) et B2 de D2 (P1;P2).
Si E(D1/P1) et E(D2/P1) > 0 Alors on dira que les biens sont substituables. Ils varient dans le mme sens. Lorsque le prix de B2 augmente cela fait diminuer la demande de B2, mais cela fait aussi augmenter la demande en B1 donc on dit que les biens sont substituables, puisque le consommateur sest tourn vers le B1. Si E(D1/P1) et E(D2/P1) < 0 cela veut dire que a varie en sens contraire. Donc lorsque le prix de B2 diminue la demande en B1 diminue aussi. Et de la mme faon lorsque la demande en B1 diminue celle de B2 diminue aussi. On parle alors de produits qui sont complmentaires. Les deux biens vont ensembles. Si E(D1/P1) et E(D2/P1) = 0 Cela veut dire que le B1 ne dpend pas du prix de B2 et vice versa, on dira que les deux biens sont indpendants.
20
II/ Elasticit revenu de la demande
Elle mesure la sensibilit de la demande au variations du revenus toute chose gale par ailleurs.
Si E(D/R) > 1 on dira quil sagit dun bien de luxe. Si E(D/R) >0 <1 lorsque le revenue augmente la augmente mais dans des proportions moins importantes. Cest ce quon appelle les biens normaux de premire ncessit. Si E(D/R) = 1 cest l'lasticit unitaire, les variations sont proportionnelles. SI E(D/R) < 0 Cela veut dire que lorsque le revenu augmente la demande pour ces biens diminuent. Cest les biens infrieurs avec un effet de qualit.
Section 2 : L'lasticit de loffre
L 'lasticit de lore par rapport aux prix mesure la sensibilit de lore dun bien au prix de ce bien, toute chose gale par ailleurs. Elle indique le pourcentage de variation de lore conscutif une variation de 1% du prix du bien considr.
Lorsque lore est une fonction continue et drivable elle scrit :
dS/dP : La drive est constante lorsquil sagit dune droite. L lasticit varie en tout point de la courbe dore, et elle est positive. L lasticit a donc une valeur diffrente en tout point de la courbe doffre. Si (S/P) = on dira que lore est parfaitement lastique Si E(S/P)=0 On dira que llasticit est parfaitement rigide. Comme pour la demande on peut introduire les mme distinctions pour le court terme et le long terme pour les mme raisons. Gnralement lore de long terme est plus lastique aux prix que l'ore court terme. En eet dans le court terme, les entreprises sont confrontes des contraintes de capacit de production. Dans le court terme les entreprises sont capable daugmenter leur production si le prix augmente, elles vont utiliser plus le personnel en place. Elles sont capables de produire plus, notamment en faisant travailler plus. Les quantits oertes augmenteront beaucoup plus si elles ont le temps de sadapter cest--dire de dvelopper leur capacit productive.
21
Pour certains biens lore est parfaitement inlastique court terme. Cest le cas nottemment du logement locatif urbain.
22
Chapitre 3 : Les prfrences du consommateur et son environnement conomique
Sur un march la demande totale reprsente le comportement des acheteurs sur ce march. Cest--dire que la demande D(p) est la somme des demandes individuels. Il sagit analyser le comportement de consommation dun individu reprsentatif sur le march dun bien. Et concrtement face lensemble des biens qui lui sont propos, lindividu eectue des choix de consommation. Puisquil effectue des choix de consommation, thoriquement on va tenter dexpliquer comment le consommateur arrive concilier ce quil aimerait faire avec ce quil peut faire. Il y a deux choses fondamentales dans le comportement du consommateur : Une dimension objective (cest la contrainte du consommateur) Une dimension subjective (ses gots et ses prfrences). La thorie micro-conomique pose une hypothse de comportement les individus sont rationnels et agissent au mieux de leurs intrts.
Section 1 : Les prfrences du consommateur et la fonction dutilit
On va essayer dapprhender les gots des consommateurs, et les prfrences dun individu reprsentatif. Il est trs dicile dun point de vue scientique dapprhender les gots des consommateurs, et ce pour deux raisons : 1. Les prfrences sont propres tout individu. Les gots ne sont pas universels. Nos gots sont totalement indpendant du prix des biens. 2. Il est trs dicile de mesure les prfrences, les gots de les quantier. Notre problme va tre de dire comment va-t-on rvler que jaime quelque chose.
I/ Panier de biens et utilit du consommateur
Gnralement un individu consomme plusieurs biens la fois. Donc les gots des consommateurs, les prfrences, vont porter sur un ensemble de biens, et on va appeler panier de biens un ensemble de plusieurs biens. Pour simplier lanalyse on va considrer que les paniers de biens ne comportent que deux biens. Cela veut dire quun panier de bien va comporter x1 quantit de B1 et x2 de B2. Le consommateur retire de la satisfaction la consommation de ces paniers de biens. Cette satisfaction on va lappeler le plus souvent utilis. Un bien conomique est un bien utile. Graphiquement on peut reprsenter toutes
23
Panier A 100
75
50
25
0 2007 2008
Les biens composants un panier peuvent tre substituables. Il est donc possible de remplacer une quantit donne dun bien par une quantit donne de lautre bien. On parlera de substitut parfait lorsquon peut substituer totalement un bien par lautre. Cela veut dire quon ne pourra avoir quun seul bien dans le panier. Et on parle de substitut imparfait lorsquune certaine quantit des deux biens est dsire dans le panier. Enn les biens peuvent tre complmentaires, exemple une voiture et son assurance ; cela signie quils sont consomms ensemble dans des proportions xes. Le problme est celui de la mesure de lutilit ou satisfaction. Comment mesurer le niveau dutilit qui dcoule de lutilisation dun bien. La thorie micro ne retient pas une mesure quantitative de la satisfaction, mais elle va retenir le concept dutilit ordinale : on considre que le consommateur est capable dordonner les paniers de biens et de dire ceux qui lui procurent le plus de satisfaction.
II/ La modlisation des prfrences et la fonction dutilit
On va considrer deux paniers de biens et ces deux paniers appartiennent lespace des marchandises. Les prfrences du consommateur sont exprims en terme de comparaison des paniers de biens qui appartiennent son espace de marchandise. Cela signie quil est capable dexprimer sil prfre un panier lautre, et il est capable dexprimer si ces paniers sont quivalents. Il est capable de dire si A>B ou B>A ou si A--B. Il y a aura aussi la prfrence faible . Cela ne sut pas. Comme le consommateur est suppos rationnel. Le classement rete une certaine cohrence. Les choix sont forcment cohrents. > = prfr. La cohrence des choix est exprim travers ce quon appelle laxiomatique des prfrences, on va poser des hypothses qui doivent tre respecter pour que les choix soient cohrents :
24
1. La relation de prfrence est rexive : un panier de biens est toujours au moins aussi dsirable que lui-mme. 2. La relation de prfrence est transitive : On considre trois paniers de biens : A, B, C si A>B et B>C alors A>C. 3. Le consommateur est capable de classer tous les paniers de biens. Si on a deux paniers A et B. Le consommateur est capable de dire si A>B ou B>A ou B--A. Quand ces trois hypothses sont runis on dit que la relation de prfrence forme un prordre complet. Il existe une quatrime hypothse : 4. Cest une hypothse de non saturation : cela signie que le consommateur prfre toujours des quantits additionnelles de biens dans son panier. Cette hypothse porte aussi le nom de monotonicit des prfrences. Supposons deux paniers : : si et alors A>B. Si la relation de prfrence forme un prordre complet. Il est possible de modliser les prfrences du consommateur par une fonction dutilit. Une fonction dutilit est une fonction qui associe tout panier de biens A un nombre rel u(A). Et cette fonction dutilit nous la nottons donc si A>B alors u(A)>u(B) ; et si A--B alors u(A) = u(B). Dans la mesure ou seul le classement est important plusieurs fonctions dutilit peuvent reprsenter le mme classement. Donc la fonction dutilit nest pas unique.
III/ Les courbes dindiffrence et le taux de substitution des biens
A(5,10) B(8,15)C(3,5) D(3,4)E(7,7) Panier A Panier E 15 2 11,25 3 7,5 4 1 Panier B Panier C Panier D
3,75
0 3 5 7 8
25
La relation de prfrence ne dit rien pour les zones 2, 4 et pour les axes. En revanche, tous les paniers de biens considrs comme quivalent A seront forcement dans cette zone. Dans la thorie microconomiqe du consommateur on s'intresse au paniers de biens que le consommateurs considre comme quivalent. Si les paniers de biens sont quivalents cela signie que laugmentation de la quantit dun bien dans le panier, compens la diminution des quantits de lautre bien dans le panier. D--A donc En substituant les deux biens, la satisfaction du consommateur est reste inchange. Il faut connatre la proportion dans laquelle, les deux biens ont t substitus an de maintenir constant ce niveau dutilit. Le taux de substitution des biens TSB(x1,x2) mesure la quantit dun bien laquelle le consommateur accepte de renoncer pour augmenter la quantit de lautre bien dans le panier an de maintenir constant le niveau dutilit.
Exemple avec D->A Vx1 = +2 Vx2 = -4 donc TSB^d=2 Cela signie que pour eectuer cette substitution le consommateur compare les deux biens, cest--dire quil compare la valeur quil attribue chaque bien. Donc le taux de substitution des biens est bien un taux dchange subjectif, qui dpend de la valeur que le consommateur attribue au bien. TSB=Ce que vaut une unit de B11 en terme de B2, cest dire quil mesure la valeur relative du B1 pour le consommateur. Ici on note que le TSB est dcroissant quand les x1 augmentent. Si le panier A le panier D et le panier E sont quivalents(A--D--E) alors on dit quils appartiennent la mme courbe dindiffrence, cela veut dire quils procurent le mme niveau dutilit. Une courbe d'indiffrence est le lieu gomtrique de tous les paniers de biens qui procurent le mme niveau de satisfaction au consommateur. La courbe dindirence ne peut pas avoir de pente positive. Tout panier de bien prfr A, se situe au dessus de la courbe dindirence passant par A. La forme de la courbe dindirence montre comment le consommateur est prt substituer les biens. Les prfrences convexes sont qualies de prfrences normales. Et elles montrent que les biens sont substituables. Dun point de vu mathmatiques il sagit dune fonction qui dcrot de plus en plus faiblement, donc la pente en chaque point est de plus en plus faible. Cette hypothse de convexit est trs importante car elle aura une signication conomique. La courbe dindirence passant par le panier A dlimite un ensemble convexe, et la partie hachure reprsente lensemble des paniers, meilleurs ou quivalents ceux situs sur la courbe dindirence. Cet ensemble est lensemble des paniers faiblement prfr au panier A. La convexit montre que le consommateur prfre la diversit cest dire que la combinaison de deux paniers sera toujours prfr la consommation dun panier extrme. Graph 2 Les paniers D et E sont des paniers extrmes. La combinaison de deux paniers sera prfre. Il y a donc 3 hypothses :
26
1. Les courbes d'indiffrences sont dcroissantes 2. Les courbes dindiffrence sont convexes lorsque TSB est dcroissant et quand x1 augmente. 3. Deux courbe dindiffrences ne peuvent pas se couper. Lorsque la relation de prfrence est complte, les prfrences sont modliss par une fonction dutilit, on peut dterminer lquation de la courbe dindirence, correspondant un niveau de satisfaction donn. Donc : pour x1 et x2 >0.
CI convexe <=> TSB dcroissant Le TMS cest lindicateur de prfrence des consommateurs.
IV/ Fonction dutilit, utilit marginale et Taux Marginal de Substitution des Biens.
L utilit marginale mesure le supplment dutilit conscutif une variation de lun des deux biens la quantit de lautre bien demeurant inchang.
On admet en conomie la loi de lutilit marginale, loi de Gaussen, qui nous dit que lutilit marginale est dcroissante. Cela signie que le niveau de satisfaction ressentie pour la dernire unit de bien consomm est infrieure au niveau ressentie pour lunit prcdence, et cette loi est toujours vrie. Cela signie que la valeur marginale dun bien dpend des quantits dj possde de ce bien.
27
Intuitivement le TMS est gal au rapport des utilits marginales :
Le consommateur pour eectuer la substitution entre les deux biens, compare la valeur quil attribut chacun des deux biens. La variation de lutilit, il varie lorsque je fais vari les quantits de B1 et les quantits de B2.
Lorsque jai une fonction dutilit continue et drivable, lutilit marginale du B1 cest la drive partielle de la fonction dutilit par rapport x1. Et lutilit marginale du B2 cest la drive partielle de la fonction dutilit.
V/ Les autres formes de courbe dindiffrence
Lorsque les biens sont parfaitement substituables, le consommateur peut compltement remplacer un bien par un autre dans son panier. Les courbes dindiffrences sont des droites dans le plan des biens, elles sont dcroissantes dans le plan. Dans ce cas-l, la substitution se fait toujours dans les mmes proportions, donc cela signie que le TMSB est constant.
28
Rgion 1 80
60
40
20
0 2007 2008 2009 2010 Sans titre 1
Les fonctions dutilits sont de la forme U(X1 ; X2) : aX1 + bX2 = aX1 + bX2 aX1 = bX2 < = > X2 = (/b) (a/b)X1 Lorsque les biens 1 et 2 sont complmentaires, ils sont consomms ensemble dans des proportions xes. Donc, cela veut dire que si on augmente la quantit de lun sans augmenter la quantit de lautre, cela naugmente pas la satisfaction du consommateur. Graphique 1
Section 2 : Lenvironnement conomique du consommateur
Lenvironnement conomique du consommateur est reprsent par le revenu du consommateur et les prix des biens sur le march. Pour consommer, le consommateur est limit par son revenu, il ne peut pas dpenser plus que son revenu. Mais, avec un mme revenu, il peut obtenir des quantits diffrentes de biens. Ce que peut acheter lindividu dpend de son revenu mais aussi de la comparaison des prix des diffrents biens. 1 La contrainte budgtaire du consommateur On suppose que le revenu du consommateur est connu. Donc, on ne va pas sintresser la faon dont se forme son revenu, mais comment le consommateur va allouer son revenu entre diffrentes consommations. Ltude revient analyser lallocation de ce revenu entre diffrentes consommations possibles. On va noter R le revenu du consommateur. On va noter X1 les quantits de biens 1 et X2 les quantits de biens 2. On va noter P1 le prix du bien 1 sur le march et P2 le prix du bien 2 sur le march. La contrainte budgtaire dcrit lensemble des paniers de biens accessibles au consommateur pour un revenu et des prix donns. Ou encore elle dcrit ce qui est possible dacheter compte tenu de son revenu et du prix des biens. Donc R P1X1 + P2X2
29
On ne peut pas dpenser plus que son revenu. Lensemble des paniers accessibles dlimits par cette contrainte budgtaire est appel lensemble budgtaire. La droite de budget reprsente lensemble des paniers de biens qui cotent exactement le revenu, cest--dire tous les paniers de biens que peut se procurer le consommateur sil dpense la totalit de ses revenus. La droite de budget : R = P1X1 + P2X2 : on dit que la contrainte est sature. On peut reprsente cette droite de budget dans le plan des biens. Si le consommateur ne dcide que de consommer le bien 2, alors X1 = 0, donc on connat la quantit de biens 2, R = P2X2, donc X2 = R/P2. Cela correspond la quantit maximale de bien 2 que le consommateur peut sacheter, cest aussi le pouvoir dachat en terme de biens 2. A linverse, si le consommateur ne veut consommer que du bien 1, cest--dire que X2 = 0, donc les quantits de biens 1 = R = P1X1, donc X1 = R/P1. Cela correspond la quantit maximale de biens 1 quil peut consommer, cest donc aussi le pouvoir dachat en terme de biens 1. Entre ces deux situations, il existe une innit de combinaisons de biens 1 et de biens 2 qui cotent le mme revenu. Dans le plan, la droite a pour quation : DB : X2 = (R/P2) (P1/P2)X1 Pour une quantit donne de bien 1, quelle est la quantit de bien 2 que je pourrais consommer sans dpasser ma contrainte budgtaire. Donc : DB : y = b ax Avec sa pente : P1/P2 GRAPHIQUE 2 Le panier A puise le revenu du consommateur et le panier B aussi. La diffrence est que le panier B contient plus de biens 1 que le panier A mais moins de biens 2 que le panier A. Le passage du panier A au B montre que le consommateur doit renoncer une certaines quantit de biens 2 pour rajuster sa consommation avec plus de quantit de biens 1 pour respecter sa contrainte budgtaire. La question est de savoir combien de biens 2 le consommateur doit sacrier pour augmenter la quantit de bien 1 dans son panier tout en respectant sa contrainte budgtaire. Le consommateur doit connatre la valeur des biens et doit comparer la valeur des biens. Or la valeur des biens est donne par le march. La valeur du bien 1 sur le march est P1, et la valeur du bien 2 sur le march est P2. Il doit donc dterminer le prix relatif du bien 1, cest--dire P1/P2. Le prix relatif de bien 1 est ce que cote une unit de bien 1 en terme de bien 2 sur le march. Donc la pente de la droite de budget, en valeur absolue, cest--dire P1/P2, est le taux auquel on peut substituer les biens en respectant la contrainte budgtaire. Cest un taux objectif dchange. Cest le taux de substitution permis par le march. II/ Modication de lenvironnement conomique du consommateur A/ Variation du revenu et structure de prix inchange On analyse les effets dune augmentation ou diminution du revenu toute chose gale par ailleurs, cest--dire les prix des biens demeurant inchangs. Donc, puisque les prix des biens ne varient pas, la pente de la droite de budget ne se modie pas, donc la pente sera la mme. Donc, cela veut dire que graphiquement, suite une variation du revenu, la
30
droite de budget se dplacera de faon parallle dans le plan, en gardant la mme pente, elles seront donc parallle. On part dune situation initiale, cest--dire dune contrainte sature de la forme R = P1X1 + P2X2 DB X2 = (R/P2 ) (P1/P2)X1 Avec pour X1 = 0 X2 = R/P2 et pour X2 = 0 X1 = R/P1 GRAPHIQUE 3 B/ Variation du rapport des prix On tudie le cas dune variation diffrencie des prix, cest--dire que le prix du bien 1 et le prix du bien 2 ne se modient pas de la mme faon. Donc, si les prix varient de faon diffrencie, la pente de la droite de budget est modie, toute chose gale par ailleurs, cest--dire le revenu demeurant inchang. Hypothse : On suppose une variation du prix du bien 1 alors que le prix du bien 2 ne bouge pas. R P1X1 + P2X2 CB sature R = P1X1 + P2X2 DB X2 = (R/P2) (P1/P2)X1 X1 = 0 X2 = R/P2 et si X2 = 0 X1 = R/P1 GRAPHIQUE 4 Suite a cette augmentation du prix du bien 1, on remarque que lensemble des paniers accessibles du consommateur ont diminus. On remarque quavec la baisse du prix du bien 1, lensemble des paniers accessibles du consommateur ont augments. Lorsque le prix du bien 1 varie mais pas le prix du bien 2, on dit que la droite de budget pivote autour de lordonne lorigine. Si cest le prix du bien 2 qui varie sans variation du prix du bien 2, alors la droite de budget pivote autour de l'abscisse lorigine.
Chapitre 4 : Le choix optimal du consommateur et les demandes individuelles de biens
Le choix optimal du consommateur est celui qui dcoule de son comportement rationnel, donc le consommateur va choisir un panier de biens qui maximise sa satisfaction compte tenu de sa contrainte budgtaire. Ce choix optimal correspond un quilibre, le consommateur ne peut plus amliorer sa situation. Par contre, sil na pas atteint cet quilibre, cela signie quil peut encore modier la composition de son panier et que cette modication augmente son utilit. Parmi lensemble des paniers accessibles, le consommateur choisira le panier qui lui procure le plus de satisfaction. Et, en hypothse de non saturation, la contrainte budgtaire du consommateur est sature.
Section 1 : Le choix optimal
I/ Approche graphique Graphiquement, on sait reprsenter la contrainte des budgets. GRAPHIQUE 5
31
Lorsque lon est au panier C, on peut encore augmenter la quantit des deux biens dans notre panier pour amliorer notre satisfaction. Le panier D est inaccessible, on ne peut pas lacheter. Don on sait quon va se situer sur la droite de budget. Il existe une courbe dindiffrence qui passe par le panier C. Elle nous permet un niveau dutilit 1, de mme pour D, 3. Mais ce quon remarque, cest quon a deux paniers, A et B, qui sont sur la courbe dindiffrence 1 et qui respecte les contraintes. Supposons quon passe du panier A au panier A, et on veut savoir si en changeant la composition du panier, on amliore notre situation sans dpasser les contraintes. On voit que A amliore notre situation car on peut tracer une courbe dindiffrence audessus de 1 sans dpasser nos contraintes. Donc A nest pas solution optimale. Ici on se demande si le panier A est le panier optimal, et on voit que si on continuer a progresser sur la courbe des contraintes aprs le point A, la courbe dindiffrence passe en dessous. Donc le choix optimal est le panier A. Donc, le point A est un point de contact entre la courbe dindiffrence et la courbe des budget, les deux courbes sont tangentes. Tant quil existe deux points dintersection entre la courbe dindiffrence et la droite de budget, il existe une courbe dindiffrence plus leve dont un panier respecte la contrainte budgtaire. Et cela, cest la dnition de la convexit. Le point A est solution optimale, et la courbe dindiffrence et la droite de budget ont la mme pente. Donc, TMSB = P1/P2. Lundi 16 mars 2009 TMSB <> P1/P2 = substitution entre les deux biens = Augmentation de lutilit TMSB = Um1/Um2 = Ce que vaut une unit de biens 1 pour le consommateur/Ce que vaut une unit de biens 2 pour le consommateur. Donc cest la valeur relative de biens 1 par rapport aux biens 2. Donc cest ce que vaut la valeur dune unit de bien 1 en terme de bien 2. P1/P2 = Le rapport des prix, cest le prix relatif de bien 1, cest ce que vaut le prix du bien 1 par rapport au bien 2. Si Um1/Um2 > P1/P2 = Le consommateur augmente les quantits de biens 2 et cela augmente son utilit. Cela veut dire que son utilit est plus grande que la valeur du bien sur le march. Mais comme les utilits marginales sont dcroissantes, cela veut dire qu un moment la valeur relative quil attribut au bien 1 deviendra gale la valeur du march, et l il naura plus augmenter ses biens 1. linverse, si Um1/Um2 < P1/P2, cela veut dire que la valeur relative du bien 1 pour le consommateur est infrieur la valeur du march, et donc il va baisser les biens 1 pour les biens 2, mais comme lutilit est dcroissante, alors les biens 2 vont augmenter et atteindre la valeur sur le march car les biens 1 baissent. Donc lutilit augmente galement. Donc, lquilibre, le prix des biens rete leur valeur relative et vis versa. II/ Approche analytique Formellement : Il sagit de maximiser lutilit, sachant quon ne considre que deux biens dans le panier, sous contrainte budgtaire (RP1X1+P2X2)
32
max U(X, X2) Sous Contrainte RP1X1+P2X2 A lquilibre, le TMSB doit tre gale au rapport des prix : TMSB = P1/P2, et la contrainte doit tre sature : R = P1X1 + P2X2 Exemple : U(X1, X2) = X1X2 P1 = 10 P2 = 20 R = 200 U = < = > = X1X2 < = > X2 = /X1 pour X1 > 0 X2 = /X1, dX2/dX1 = X2 = /X12 < 0 pour X1 > 0 Courbe dindiffrence dcroissante d2X2/dX12 = X2 = 2 1/X13 > 0 pour X1 > 0 Donc la courbe dindiffrence est convexe. Choix optimal pour P1 = 10 ; P2 = 20 et R = 200 Donc, le consommateur va maximiser sa fonction dutilit, sa satisfaction, sous contrainte dun revenu. Max U(X1 ; X2) = X1X2 Sous contrainte : R P1X1 + P2X2 Max U(X1 ; X2) = X1X2 Sous contrainte : 200 10X1 + 20X2 Choix optimal (X1 ; X2) tel que : Um1/Um2 = P1/P2 R = P1X1 + P2X2 TMSB (X1 ; X2) = Um1/Um2 = X2/X1 X2/X1 = 10/20 = 1/2 200 = 10X1 + 20X2 X2 = 1/2 X1 (1) 200 = 10X1 + 20X2 (2)
(1) dans (2) : 200 = 10X1 + 20((1/2)X1) = 10X1 + 10X1 < = > 200 = 20X1 < = > X1 = 10 X2 = 5 La rsolution du programme de maximisation permet de dterminer les fonctions de demandes de biens Max U(X1, X2) SC RP1X1 + P2X2 TMSB (X1 ; X2) = P1/P2 R = P1X1 + P2X2 X1 = D1(R ; P1 ; P2) X2 = D2(R ; P1 ; P2) SC : Max U(X1 ; X2) SC RP1X1 + P2X2
33
TMSB (1 ; 2) = P1/P2 R = P1X1 + P2X2
X2/X1 = P1/P2 R = P1X1 + P2X2
X2 = (P1/P2)X1
R = P1X1 + P2((P1/P2)X1) R = 2P1X1 X1 = D1(R ; P1 ; P2) = R/2P1 X2 = P1/P2 R/2P1) X2 = D2(P1 ; P2 ; R) = R/2P2 Une fonction de demande individuelle de biens exprime les quantits optimales consommes de ces biens, en fonction des prix et du revenu auquel le consommateur est confront.
Section 2 : Lanalyse de la demande du consommateur
Sur le court terme, on considre que les prfrences du consommateur sont stables, cest-dire qu court terme, les gots changent peut. court terme, si le prix des biens varient et si le revenu varie, le consommateur modie son panier optimal. I/ Ajustement de la demande aux variations du revenu On tudie les effets dune variation du revenu sur la demande du consommateur toute chose gale par ailleurs (cest--dire que les prix ne bougent pas). Graphiquement, puisque les prix ne changent pas, la pente de la droite des budgets ne changent pas. Donc, une variation du revenu entrane un dplacement parallle de la droite de budget. Donc, prix (P1 et P2) donns et xs, les fonctions de demandes scrivent : X1 = D1(R) X2 = D2(R) A/ Courbe consommation-revenu ou chemin dexpansion du revenu On part dune situation initiale dquilibre, le revenu du consommateur est R, la contrainte budgtaire est de R P1X1 + P2X2 et la contrainte budgtaire sature est R = P1X1 + P2X2 avec X2 = R/P2 (P1/P2)X1 Si X2 = 0 < = > X1 = R/P1 Si X1 = 0 < = > X2 = R/P2 [Prfrences convexes] TMSB = P1/P2 R = P1X1 + P2X2 E (X1 ; X2) GRAPHIQUE 1 Si on relie les diffrents paniers de biens demands par le consommateur lorsque son revenu varie, on obtient la courbe consommation-revenu ou encore le chemin dexpansion du revenu. Cette courbe est le lieu gomtrique de lensemble des paniers optimaux du consommateur lorsque le revenu varie. On peut dterminer lquation de cette courbe avec P1 et P2 donns X1 = D1(R) < = > f(X1) X2 = D2(R) < = > f(X2) On obtient son quation dans le plan des biens.
34
Exemple : X1 = D1(R) = R/2P1 = R/2 avec P1 = P2 = 1 X2 = D2(R = 3R/2P2 = 3R/2 R = 2X1 R = 2X2/3 2X2/3 = 2X1 X2 = 3X1 pour P1 = 1 et P2 = 1 B/ Typologie des biens Ltude de linuence dune variation du revenu sur la composition dun panier permet de mettre en vidence une typologie du bien. On appelle un bien normal les biens normaux qui sont des biens dont la demande varie dans le mme sens que le revenu. Cela veut dire que si le revenu augmente, la demande augmente, et si le revenu baisse, la demande baisse. Parmi les biens normaux on distingue les biens normaux de premire ncessit, ce sont des biens pour lesquels la demande augmente de faon moins importante que le revenu. Ce sont des biens pour lesquels llasticit-revenu est compris entre 0 et 1. La part de ces biens dans le budget diminue. 0 < (X1/R) < 1 Il y a les biens neutres, ce sont les biens pour lesquels la variation de la demande est proportionnelle la variation du revenu, donc la part de ces biens dans le budget est stable. (X1/R) = 1 Enn, il y a les biens de luxes, la variation de la demande est plus importante que la variation du revenu, donc la demande varie plus que proportionnellement par rapport au revenu, donc la part du budget augmente. (X1/R) > 1 Les biens infrieurs, ce sont les biens pour lesquels lorsque le revenu augmente, la demande diminue, donc la drive est ngative. On peut reprsenter directement la relation quantit demande de biens et revenus, pour des prix connus. Cette relation est exprime au travers de la courbe dEngel. Cest la reprsentation dans le plan de X1 = D1(R) et dans le plan de X2 = D2(R) SC : X1 = D1(R) = R/2 X2 = D2(R) = (3/2)R II/ Ajustement de la demande aux variations de prix Ici on considre que les prix varient toute chose gale par ailleurs, cest--dire que les revenus ne bougent pas. Pour mener notre tude, on prend lexemple du bien 1 et on considre lvolution du panier optimal lorsque le prix du bien 1 varie. B1 P1 donc R et P2 x. En rgle gnrale, la demande est une fonction dcroissante du prix, et cet effet est accentu sil existe des possibilits de substitution. Lorsque le prix du bien 1 varie, cest la pente de la droite des budget qui se modie. On part dune situation dquilibre, dun panier optimal. RP1X1 + P2X2 Au moment du choix : R = P1X1 + P2X2 X2 = R/P2 (P1/P2)X1 X1 = 0 < = > X2 = R/P2
35
X2 = 0 < = > X1 = R/P1 Choix optimal tel que MAX U et RP1X1 + P2X2 Donc : TMSB = P1/P2 <= DB et CT tangentes R = P1X1 + P2X2 GRAPHIQUE 2 P1 < P1 < = > X2 = R/P2 (P1/P2)X1 La pente est moins forte en valeur absolue Les points de contact avec les axes : X1 = 0 < = > X2 = R/P2 X2 = 0 < = > X1 = R/P1 > R/P1 Avec un prix plus bas, on consomme plus de biens Le nouveau panier optimal : E (X1 ; X2) tel que TMSB : P1/P2 et R = P1X1 + P2X2 Si on relie lensemble des paniers optimaux lorsque le prix du bien 1 varie, on obtient la courbe-prix, cest--dire le chemin dexpansion du prix. On peut dterminer lquation de ce chemin dexpansion du prix dans le plan des biens. P2 ; R donns, xs X1 = D1(P1) et X2 = D2(P1) P1 = f(X1) P1 = f(X2) Si la demande en bien 2 ne dpend pas du prix du bien 1, lquation de cette droite dans le plan des biens est : X2 = constante. Lorsquon tudie linuence de la variation du prix sur les quantits demandes on peut distinguer deux types de biens : 1. Les biens ordinaires : Ce sont des biens pour lesquels la demande varie en sens inverse de la variation du prix. Ils sont ordinaires car ils correspondent la loi de la demande, cest--dire demande fonction inverse du prix. Les drives sont ngatives et llasticit prix est ngative 2. Il existe des biens pour lesquels, lorsque le prix augmente, la demande ne diminue pas. Ce sont des biens pour lesquels la loi de la demande ne sapplique pas. Dune part, cela correspond aux biens de Giffen. Lorsque le prix dun bien augmente, et que ce bien affecte de faon importante le budget de lindividu, cest le cas pour les faibles revenus, le consommateur est contraint de supprimer certains autres biens dans son panier et daugmenter la consommation du bien dont le prix a augment. Les biens de Giffen sont des biens infrieurs, mais pas tous les biens infrieurs ne sont pas des biens de Giffen. Une lasticit-prix positive sexplique aussi par un effet de snobisme, ou encore ce que lon appelle leffet VEBLEN III/ Mise en vidence de leffet de substitution et de leffet revenu On analyse le comportement des consommateurs, suite une modication dans la structure du prix des biens, le revenu du consommateur demeurant inchang. X1 = D1(R ; P1 ; P2) X2 = D2(R ; P1 ; P2) On considre laugmentation du prix du bien 1
36
A/ Premire approche du comportement des consommateurs Laugmentation du prix du bien 1 va entraner une modication du panier optimal, donc si le prix du bien 1 augmente, le consommateur modie ses choix et dnit un nouveau panier optimal. On peut dcomposer leffet global, total, dune variation du prix du bien 1 sur les quantits demandes de biens 1 et de biens 2 (X1 et X2) en un effet substitution et un effet revenu. Donc, cela veut dire que leffet total sur le bien 1, cest--dire les variations de X1 = ES1 + ER1 ET2 = X2 = ES2 + ER2 Laugmentation du prix du bien 1 modie le prix relatif du bien 1 (P1/P2). Si P1 > P1 alors cest P1/P2 le nouveau prix relatif. Laugmentation du prix du bien 1 rend le bien 1 relativement plus cher, sous entendu le bien 1 est devenu relativement plus cher que le bien 2. Dans un premier temps, comme le bien 1 est devenu relativement plus cher, le consommateur prfre consommer du bien 2 au lieu du bien 1, donc ils substitue les deux biens. Par contre, le consommateur s'aperoit que cette augmentation du prix du bien 1 correspond une perte du pouvoir dachat. Leffet revenu correspond la variation de la demande, la quantit demande suite la diminution du revenu rel du consommateur. Lundi 23 mars 2009 B/ Lapproche graphique On retient la dcomposition de John Hicks. On part dune situation initiale On considre des prfrences normales R = P1X1 + P2X2 DB1 : X2 = R/P2 (P1/P2)X1 X1 = 0 X2 = R/P2 X2 = 0 X1 = R/P1 GRAPHIQUE 1 An disoler leffet substitution et leffet revenu, on met en vidence une situation intermdiaire. 1) Leffet substitution
Lindividu enregistre laugmentation du prix du bien 1, mais il veut conserver son utilit constante, cest--dire que malgr laugmentation du prix du bien 1, il veut maintenir son niveau de satisfaction. Donc graphiquement, il enregistre que la pente de la droite des budgets a augment. Donc notre consommateur sait que le bien 1 est devenu relativement plus cher, mais on a dit quil veut maintenir son niveau de satisfaction, cest--dire que graphiquement il veut se situer sur la courbe dindiffrence 1. Le prix de bien 1 tant devenu plus cher, il a diminu ses quantits et biens 1 mais il a augment ses biens 2 pour rester sur la mme courbe dindiffrence. 2) Effet revenu
Cest le passage de la situation intermdiaire la situation nale.
37
Le signe de leffet de substitution na aucun effet, en effet, il joue en sens inverse du prix. Le signe de leffet revenu est indtermin, et va dpendre de la nature du bien concern. Si on mesure leffet dune augmentation de P1, si le bien 1 est un bien normal, leffet substitution sur le bien 1 est ngatif, leffet revenu est ngatif sur le bien 1, et donc leffet total est ngatif, car cest la somme des deux. Si le bien 1 est un bien infrieur, leffet de substitution est ngatif, mais leffet revenu est positif, donc leffet total est indtermin, cest en fonction de la force dun des deux effets. Si le bien 2 est un bien normal, alors leffet de substitution est positif, leffet revenu est ngatif sur le bien 2, donc leffet total sur le bien 2 est indtermin. Si le bien 2 est un bien infrieur, leffet de substitution est positif, leffet revenu est positif, donc leffet total est positif.
Chapitre 5 : La production et le choix optimal du producteur
On va tudier le comportement du producteur, ou de lentreprise, a prix donn, cest--dire quon va analyser le comportement du producteur prix donn, quil ne peut donc pas modier. En micro-conomie, lentreprise se dnit comme une unit technique o se produisent des biens et des services, quelle met en vente sur le march. Lactivit de production ncessite la combinaison de facteurs de production. Donc on appelle facteur de production ou encore Inputs, les biens ou services utiliss pour obtenir des outputs, cest-dire des quantits de biens produites. Alors il existe videmment plusieurs facteurs de productions, des matires premires, nergie, machine, terrain, btiment, travail humain, donc ce sont tous les entrant qui, combins, entrane la production dun bien. Une combinaison productive est un processus mis en uvre par un producteur qui consiste a associer, dans une certaine proportion, diffrents facteurs de production an dobtenir une certaine quantit de biens. Donc la toute premire contrainte laquelle est confronte lentreprise est la contrainte technologique.
Section 1 : Lapproche technique de la production : fonction de production et productivit
Les quantits produites dun bien dpendent des quantits de facteurs utilises et de la technique de production utilise, cest--dire de la technologie. I/ Facteurs de production et fonction de production Les facteurs de production sont tous les biens et services utiliss pour fabriquer un autre bien ou service. Une premire approche des facteurs de production suppose que lon considre la production sur un certain laps de temps. Selon la priode considre, cest--dire la courte priode ou longue priode, les facteurs pourront tre ajusts plus ou moins rapidement par les producteurs. A court terme, les capacits de production des entreprises sont considres comme constantes, mais une adaptation est tout de mme possible. Certains facteurs de production, notamment le travail, sont variables, court terme. La courte priode est caractrise par la prsence de facteurs xes et variables. A long terme, lentreprise peut sadapter et donc faire varier librement tous les facteurs de production. Donc la longue priode est caractrise par la prsence de facteurs de production variables, donc cela veut dire que lentreprise peut les substituer. La relation entre quantit de facteurs utiliss et niveau de production dpend de la technologie disponible. Dans notre analyse, on considre que la technologie est donne, cela veut dire quon est a progrs technologique constant, on est dans un tat donn de la
38
technologie, donc dans notre analyse, il ny a pas de progrs technique. Cela signie que les techniques de productions sont connues, et cette technologie est une contrainte puisquelle dlimite les processus de production possibles. Dautre part, la technique de production doit respecter le principe de non gaspillage. Donc cela signie que lentreprise se limite au processus de production techniquement efcient. Dans notre analyse, pour simplier, on ne va considrer que la fabrication dun bien est le rsultat de deux facteurs de production. Ces facteurs de production X1 (Quantit de facteurs 1) et X2 (Quantit de facteurs 2) ou bien K (Quantit de fonction Capital) et L (Quantit de fonction travail). Si on combine des facteurs de production pour fabriquer un bien, cela signie quil faut utiliser les deux facteurs. Par contre, ces deux facteurs de production peuvent tre plus ou moins substituables. On parlera de facteurs de production substituables lorsque la diminution des quantits dun facteur peut tre compens par laugmentation des quantits de lautre facteur, pour produire le mme niveau de production. Des facteurs de production seront parfaitement substituables lorsquun facteur peut tre compltement remplac par lautre. La technologie peut imposer dassocier une quantit donne dun facteur une quantit xe de lautre facteur. Dans ce cas-l, on parlera de facteurs complmentaires. Les facteurs de production sont utiliss dans des proportions xes. Lorsque les biens et les facteurs de productions sont parfaitement divisibles, ils peuvent varier de faon inniment petite, donc on peut formaliser la relation entre quantits produites et quantits utilises de facteurs de production par une fonction de production. Cette fonction de production est donc continue et drivable sur son domaine de dnition. On va noter Y la quantit produite de biens. On note X1 la quantit de facteur 1 On note X2 la quantit de facteur 2 Y = f(X1 ; X2) La fonction de production reprsente la quantit maximale qui peut tre obtenue partir de tout volume donn dinputs, la technologie tant donne. Cette fonction de production rsume les contraintes techniques auxquelles fait face le producteur et elle est compose des processus de production efcients. La forme gnrale de cette fonction de production est croissante concave. Cela veut dire que les drives premires partielles sont positives croissantes et les drives secondes sont ngatives, cest--dire concave. La fonction augmente de moins en moins vite. On peut reprsenter graphiquement une fonction de production de court terme. A court terme, il y a prsence de facteurs xes, et on considre que la quantit de facteurs 2 est x a Xbarre2 donc la producton et le rsultat de la combinaison Y : F(X1 ; X2) volume donn de X2, pour une augmentation de la production, il faut augmenter X1 (facteur 1). GRAPHIQUE 2 La fonction de production dlimite un ensemble de production, mais la courbe reprsente le lieu gomtrique de toutes les combinaisons productives efcaces. On dit que cest la frontire des techniques de production efcace. Donc on se situera toujours sur la courbe. II/ Productivits et rendement factoriel On se place en courte priode, donc on va tudier le rendement associ un seul facteur de production. La productivit totale dun facteur mesure la quantit de biens pouvant tre obtenus avec ce facteur, videment volume donn de lautre, cest--dire lautre facteur tant considr comme une constante. Donc, si X2 = Xbarre2, la productivit totale du facteur 1 : PT1 = f(X1 ; Xbarre2) Et pour X1 = Xbarre1, la productivit totale du facteur 2 : PT2 = f(Xbarre1 ; X2)
39
La productivit moyenne dun facteur mesure la quantit produite par unit de ce facteur, volume donn de lautre. Donc, volume donn de facteur 2, la productivit moyenne de facteur 1 est : PM1 = Y/X1 = f(X1 ; Xbarre2)/X1 A volume donn de facteur 1, la productivit de moyenne de facteur 2 est : PM2 = Y/X2 = f(Xbarre1 ; X2)/X2 La productivit marginale dun facteur mesure la variation de la quantit produite de biens conscutive la variation dune unit de la quantit utilise de ce facteur, a volume donn de lautre facteur. X2 = Xbarre2 Pm1 = Y/X1 = (f(X1 + X1 ; Xbarre2) f(X1 ; Xbarre2))/X1 X1 = Xbarre1 Pm2 = Y/X2 = (f(Xbarre1 ; X2 + X2) f(Xbarre1 ; X2))/X1 Dans le cas dune fonction de production continue et drivable, la productivit marginale du facteur 1 est la drive de la fonction de production sur la drive du facteur 1 (X1) Pm1 = dY/dX1 = fX1 La productivit marginale du facteur 2 est la drive de la fonction de production sur la drive du facteur 2 (X2) Pm2 = dY/dX2 = fX2 Donc la productivit marginale mesure la productivit de la dernire unit de facteur utilise. X1 Y? Xbarre2 X2 Y? Xbarre1 Elle mesure ce que vaut une unit supplmentaire de facteur en terme doutput. Elle mesure ce que rapporte une unit de facteur supplmentaire en terme de bien.ctz
40
I/ Les droites disocot
Pour eectuer son choix sur les facteurs de production le producteur doit connatre ce que lui cote lutilisation des deux input. On se place dans le cas de deux facteurs substituables
1/ Dnition et reprsentation graphique
A p1 et p2 donn le cot de production reprsente la somme de lutilisation des deux facteurs de production. CT = p1x1 + p2x2 cest quon appelle lquation du cot le cot des facteurs. Une droite disocot reprsente lensemble des combinaisons dinput 1 et 2 qui conduisent au mme cot de production cest dire la mme dpense. Pour un niveau de cot donn CT on a CTb = p1 x1 + p2x2. On peut reprsenter cette droite dans le plan des facteurs
P1/P2 = Prix relatif du facteur 1 prix dune unit de facteur 1 en fonction de facteur 2 sur la courbe. SCAN1
COPIER SUR LE COUR DE MICKAEL LES FORMULES.
B/ Modication et dplacement de la droite disocot
Si les prix relatifs se modient il y a modication de la pente de la droite disocot. Par contre si les prix varient de faon simultane et proportionnelle la pente ne se modie pas. Si la structure des prix varie la droite disocot pivote autours de lordonne de lorigine ou de l'abscisse lorigine selon une modication de P1 et de P2. SCAN2 Il existe une innit de droite disocot dans le plan des facteurs correspondant dirents niveau de dpense possible. Pour des prix P1 et P2 constants il existent une innit de droite disocot parallles. PLus on sloigne de lorigine plus Un dplacement parallle de la droite disocot signie dune part que les prix relatifs ne varient pas donc la pente est la mme et dautre part un niveau de cot dirend.
II/ La minimisation du cot et fonction de demande conditionelle de facteur.
L objectif principal du producteur est de maximiser le prot, or le prot cest la recette totale moins le cot totale, donc ce que cherche faire le producteur cest de maximiser cet cart. On considre que le producteur dsire produire une certaine quantite doutput et compte tenu de cette contrainte sur le niveau de production la combinaison optimale de facteur sera celle qui assure le niveau de dpense le plus bas possible pour produire cette quantite doutput.
41
Donc le calcul du producteur consiste minimiser le cout total sous contrainte du niveau de production donn : CT = p1x1 =P2x2 sc yb = f(x1,x2). Graphiquement lensemble des combinaisons de facteurs 1 et 2 qui permettent de produire yb est reprsent par une isoquante. Parmis toute ces combinaons de facteurs : il faut dterminer la plus eecicace cest dire la moins cher. Cest dire celle qui cote le moins possible. Graph 3 Sur ce graphique on peut aussi reprsenter direntes droite disocot (cest dire dirents niveau de dpenses possibles). Donc la combinason * doit se situer sur lisoquante de niveau yb et sur la droite disocot la plus basse possible. Les combinaisons A et B sont-elles des solutions optimales ? Lorsque je suis sur A le producteur peut fabrique Yb avec un cot plus bas. Donc il na pas intrt dutiliser la combinaison productive C. Lorsque je suis sur B qui est caractris par une utilisation plus intensive de facteur 1, mais en utilisant la combinaison D je peux produire Yb un coup plus faible. La combinaison optimale est celle pour laquelle isoquante et droite disocot sont tangeantes. Si elles sont tangeantes le producteur ne peut pas produire Y a un prix plus bas. Si droite disocot et isocoampe sont teangeantes cela veut dire quelles se coupent. Donc lquilibre TMST = P1/P2 Le TMST cest la valeur relative du facteur 1 en fonction du prix du facteur 2. A lquilibre le producteur compare la valeur relative du facteur 1 au prix relative du facteur 1. Si le TMST est infrieure au prix relatif le producteur aura intrt diminu . Au point A on a
Le comportement du producteur est tel quil veut minimiser la dpense sous contrainte du niveau de production CT = p1x1 +p2x2 sous ocndition y = f(x1,x2) Condition doptimabilit = TMST P1/P2 y = f(x2 , x1) Donc on a P
Les quantits optimales de facteur 1 et 2 dtermins par ce programme de minimisation du cot reprsentent les fonctions de demande conditionnelles de facteurs. Donc en fait x1* est une fonction de demande qui dpend de P1 P2 et de Y. Les quantits de facteurs sont exprims en fonction de la quantit produite.
42
III/ Modication de lquilibre du producteur et sentier dexpansion de lquilibre.
L quilibre du producteur peut se modier si la structure du prix des facteurs se modie. L quilibre du producteur peut se modier aussi si le producteur dcide aussi dune nouvelle quantit doutput produire. Enn lquilibre du producteur peut se modier si ses ressources nancires varient. Chaque point tangeance dune isocampe et dune droite disocot est le rsultat dun programme dune minimisation du cot, le sentier dexpansion de lentreprise est le lieu gomtrique des combinaisons optimales dinput. Le long de ce sentier les prix des facteurs sont constants et le niveau de production volue. Graph4 Toute entreprise rationelle ne choisira que des combinaisons se situant sur ce sentier. A noter que dans le cas ou les fonctions de productions sont homognes le sentier dexpansion est une droite. On peut dterminer son quation dans le plan des facteurs, et pour la dterminer on fait : TMST = P1/P2
Par exemple on considre une entre prise : Recopier lexemple sur mickael. L utilisation des facteurs de production est lorigine dun cot le cot des facteurs. Et lentreprise recherche la dpense minimum pour produire un niveau doutput. Donc il est possible dassocier chaque niveau de production un cot minimum. On passe du cot des facteurs au cot de production cest dire au cot en fonction de la quanti produite.
43
Chapitre 6 : Lanalyse des cot et la dcision doffre de lentreprise
L ore de lentreprise associe la quantit produite doutput au prix de vente de loutput sur le march. Donc si je note Y la quantit doutput elles est fonction de p le prix de vente du bien sur le march.
Section 1 : Lanalyse des cots de production.
Le programme de minimisation du cot permet de dterminer les fonction de demandes conditionelles de facteurs. Donc pour toute valeur de y, donc pour tout niveau de production on peut dterminer la combinaison optimale dinput. Chaque point du sentier dexpansion donne le cot minimum associ un niveau de production donn. Graph 5 : La fonction de cot total associe compte tenu du prix des facteurs le cot minimum de production la quantit produite. Cette fonction est notte CT(y) : La fonction de cot total est construite partir de la fonction de production donc cela veut dire que sa forme va dpendre des rendements de production. Elle se construit partir du programme de minimisation du cot. Recopier formule sur la fueille de Mickael.
I/ Typologie des cots de productions. A/ Le cot total de production
A chaque fois on va distinguer le court-terme du long terme.
A court terme le cot total de production se dcompose en cot xe et en cot variable. A court terme la prsence dun facteur xe entraine des cots xes de production. Ce quon appelle un cot xe cest un cot indpendant de la quantit produite. Les cots variables dpandent de la quantit produite. Si y=0 il ny a pas de cots variables mais on supporte quand mme les cots xes.A long terme tous les cots sont variables.
B/ Le cot moyen de production
Cest le cot par unit produite ou encore le cot unitaire de production. Cest ce que cot en moyenne la production dune unit de bien. Cest donc :
A long terme cest donc :
CM(y) = cout xe moyen + cot variable moyen.
44
Lorsque la quantit de produits augment le cot xe moyen diminue et pour le cot variable tout va dpendre de la productivit moyenne du facteur.
45
Vous aimerez peut-être aussi
- Présentation NIKEDocument41 pagesPrésentation NIKEVincent Dibo75% (8)
- GMM CoursDocument39 pagesGMM CoursMoham EdPas encore d'évaluation
- Finance Stochastique PDFDocument169 pagesFinance Stochastique PDFLarbiBenAllalPas encore d'évaluation
- S5 OffreDemande ExercicesDocument11 pagesS5 OffreDemande ExercicesNora ParaisoPas encore d'évaluation
- Régulation bancaire et financière européenne et internationale: 5e éditionD'EverandRégulation bancaire et financière européenne et internationale: 5e éditionÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Les joint ventures dans le commerce internationalD'EverandLes joint ventures dans le commerce internationalPas encore d'évaluation
- Tableau de Bord Gestion Parc AutomobileDocument21 pagesTableau de Bord Gestion Parc AutomobileChrys Laura80% (5)
- MicroDocument215 pagesMicroEL Hafa Abdellah100% (3)
- Economie de L'incertainDocument34 pagesEconomie de L'incertaindeezy100% (1)
- DuopoleDocument5 pagesDuopoleAyoub RamadanPas encore d'évaluation
- Concurrence Pure Et Parfaite PDFDocument8 pagesConcurrence Pure Et Parfaite PDFmedPas encore d'évaluation
- OligopoleDocument4 pagesOligopoleGuillaumeKouassiPas encore d'évaluation
- Economie Industrielle 2Document11 pagesEconomie Industrielle 2Anonymous kcGWvFPas encore d'évaluation
- Cours CPP - Monopole S3Document53 pagesCours CPP - Monopole S3Taha752Pas encore d'évaluation
- Choix Intertemporel Du ConsommateurDocument16 pagesChoix Intertemporel Du Consommateurnaaoumi0% (1)
- Introduction À La Microéconomie CH 7Document22 pagesIntroduction À La Microéconomie CH 7karim kobeissiPas encore d'évaluation
- Corrigé Du Thème - Dans Quelles Circonstances Les Entreprises Ont-Elles Un Pouvoir de MarchéDocument64 pagesCorrigé Du Thème - Dans Quelles Circonstances Les Entreprises Ont-Elles Un Pouvoir de MarchéMme et Mr Lafon100% (1)
- ACPDocument5 pagesACPrami fekiPas encore d'évaluation
- Arch GarchDocument17 pagesArch Garchvotrebush100% (2)
- La MicroéconomieDocument4 pagesLa MicroéconomiematusjuanPas encore d'évaluation
- Le Modèle de LucasDocument39 pagesLe Modèle de LucasOURIQUAPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Micro IIDocument51 pagesChapitre 3 Micro IIMzoughi Dorsaf100% (1)
- Concurrence Monopolistique EppDocument11 pagesConcurrence Monopolistique EppEl Mekki ZekraouiPas encore d'évaluation
- 2022 Examen Econometrie L2Document1 page2022 Examen Econometrie L2Guillaume KOUASSIPas encore d'évaluation
- Analyse Des Déterminants de La Consommation Des Ménages Au Bénin: Une Approche Par Le Modele A Correction D'erreurDocument74 pagesAnalyse Des Déterminants de La Consommation Des Ménages Au Bénin: Une Approche Par Le Modele A Correction D'erreurbohoun_ghis100% (2)
- Chapitre 1 Microeconomie CDocument30 pagesChapitre 1 Microeconomie CalaPas encore d'évaluation
- Cours de Microeconomie Licence 2ème Année 2017-2018Document39 pagesCours de Microeconomie Licence 2ème Année 2017-2018F. Bruce-Vital KonéPas encore d'évaluation
- Cours Econometrie S6 Polycopie A Mettre Sur Site 2013Document30 pagesCours Econometrie S6 Polycopie A Mettre Sur Site 2013simo ab100% (1)
- Tests de L'efficience Du Marché Financier MarocainDocument17 pagesTests de L'efficience Du Marché Financier MarocainVenise003Pas encore d'évaluation
- Microéconomie L2 S3etS4Document67 pagesMicroéconomie L2 S3etS4Ibrahim El-ismailiPas encore d'évaluation
- Défaillance de MarchéDocument3 pagesDéfaillance de MarchéFloPas encore d'évaluation
- Economie Monetaire Et FinanciereDocument322 pagesEconomie Monetaire Et FinanciereepoptaePas encore d'évaluation
- Modele Is LM Economie FermeDocument50 pagesModele Is LM Economie Fermenajm nojomPas encore d'évaluation
- Les Asymetries de L'informationDocument4 pagesLes Asymetries de L'informationTahaElGamouji100% (1)
- Le MonopoleDocument4 pagesLe MonopoleManal MounaPas encore d'évaluation
- TD Taux de Change Prof MCDocument5 pagesTD Taux de Change Prof MCMehdi BelouarakPas encore d'évaluation
- Chp5 - Marché - ObligataireDocument28 pagesChp5 - Marché - Obligataire11 FATIPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Processus StochastiqueDocument20 pagesChapitre 2 Processus Stochastiqueemna benabdallahPas encore d'évaluation
- CH 1 Processus StochastiqueDocument22 pagesCH 1 Processus StochastiqueHassen BenrebahPas encore d'évaluation
- Risque de Change Et PDT DérivésDocument25 pagesRisque de Change Et PDT DérivésHicham HichamPas encore d'évaluation
- La Theorie Quantitative de La MonnaieDocument3 pagesLa Theorie Quantitative de La MonnaieRana IsmailPas encore d'évaluation
- Théorie Du ConsommateurDocument12 pagesThéorie Du ConsommateurAmador YusufPas encore d'évaluation
- Eco in Certain 03 01Document176 pagesEco in Certain 03 01Ciobănică VeronicaPas encore d'évaluation
- Cours de L'économie Industrielle 2021Document77 pagesCours de L'économie Industrielle 2021Hamza KfPas encore d'évaluation
- Thème Commerce InternationalDocument7 pagesThème Commerce InternationalGuy FandioPas encore d'évaluation
- Fiche 34 - Quelles Sont Les Principales Défaillances Du MarchéDocument7 pagesFiche 34 - Quelles Sont Les Principales Défaillances Du MarchéMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Fiche de Révision Micro PDFDocument5 pagesFiche de Révision Micro PDFsami0% (1)
- Serie 3Document2 pagesSerie 3Ghazi Ben JaballahPas encore d'évaluation
- Les Marchés ContestablesDocument23 pagesLes Marchés Contestablesgillesk100% (9)
- Poly Cours Monte Carlo m1 ImDocument55 pagesPoly Cours Monte Carlo m1 ImJoe Castro100% (1)
- Concepts Normatifs Surplus Et Optimalité de ParetoDocument20 pagesConcepts Normatifs Surplus Et Optimalité de ParetoAbdlghni RahmouniPas encore d'évaluation
- Theorie de La FirmeDocument18 pagesTheorie de La FirmeToli NgamokoubaPas encore d'évaluation
- La Concurrence Monopolistique PDFDocument22 pagesLa Concurrence Monopolistique PDFAbdlghni RahmouniPas encore d'évaluation
- Regression Linéaire MultipleDocument5 pagesRegression Linéaire Multiplesimao_sabrosa7794Pas encore d'évaluation
- Défaillance Du MarchéDocument86 pagesDéfaillance Du MarchéSeydinaFNPas encore d'évaluation
- Cours D Arbitrage Pour Le PricingDocument43 pagesCours D Arbitrage Pour Le PricingAchraf SymPas encore d'évaluation
- 17janv EconometrieDocument54 pages17janv EconometrieLeonard Stanley MILLOGOPas encore d'évaluation
- TD N - 1 E - Conomie Mone - Taire Et Financie - ReDocument6 pagesTD N - 1 E - Conomie Mone - Taire Et Financie - ReimaneeePas encore d'évaluation
- 532801ead3935 PDFDocument43 pages532801ead3935 PDFsimao_sabrosa7794Pas encore d'évaluation
- La situation des marchés des produits agricoles 2018: Commerce agricole, changement climatique et sécurité alimentaireD'EverandLa situation des marchés des produits agricoles 2018: Commerce agricole, changement climatique et sécurité alimentairePas encore d'évaluation
- Titre 2 CH 2 Principes Et Champ D'application Des BICDocument6 pagesTitre 2 CH 2 Principes Et Champ D'application Des BICkyliefabiola13Pas encore d'évaluation
- Le Marche Du Tabac Au MarocDocument16 pagesLe Marche Du Tabac Au Marocsamih.khorchafPas encore d'évaluation
- LAlhambra Et LalhambresqueDocument38 pagesLAlhambra Et Lalhambresquelegrandjules22Pas encore d'évaluation
- SB 21Document4 pagesSB 21vazrodriPas encore d'évaluation
- Dualité Part3 Orthogonalité Et TranspositionDocument7 pagesDualité Part3 Orthogonalité Et TranspositionAlwansharizi AfroPas encore d'évaluation
- L'Office Français de L'immigration Et de L'intégration (... ) - La France Au SénégalDocument3 pagesL'Office Français de L'immigration Et de L'intégration (... ) - La France Au SénégalJeanPas encore d'évaluation
- Makrout Au FourDocument2 pagesMakrout Au FourfelefelPas encore d'évaluation
- Devoir de Synthèse N°1 1er Semestre - Français - 8ème (2018-2019) MR JaberDocument3 pagesDevoir de Synthèse N°1 1er Semestre - Français - 8ème (2018-2019) MR JaberHechmi ChermitiPas encore d'évaluation
- Ange de La MortDocument2 pagesAnge de La MortMister ZombiePas encore d'évaluation
- Série D'exercices - Math Dénombrement - 3ème Math (2012-2013) MR Abderrazek BerrezigDocument2 pagesSérie D'exercices - Math Dénombrement - 3ème Math (2012-2013) MR Abderrazek Berrezigahmed tounsiPas encore d'évaluation
- Canada 3Document209 pagesCanada 3zoila sisoPas encore d'évaluation
- Planification AnnuelleDocument3 pagesPlanification AnnuelleIbtissame AbbadPas encore d'évaluation
- Questionnaire Charlie Choco CorrectionDocument7 pagesQuestionnaire Charlie Choco Correctionمريم الراجحيPas encore d'évaluation
- Bernard-Marie Koltes (Roberto Zucco (Zucco, Roberto) ) (Z-Library)Document80 pagesBernard-Marie Koltes (Roberto Zucco (Zucco, Roberto) ) (Z-Library)Abdelillah KrimPas encore d'évaluation
- 2-La Vision Des Couleurs DR HIMEUR M ADocument45 pages2-La Vision Des Couleurs DR HIMEUR M ASärra ĞhPas encore d'évaluation
- Les Réseaux Informatiques Réseau Poste À Poste Sous XPDocument6 pagesLes Réseaux Informatiques Réseau Poste À Poste Sous XPfatiha100% (1)
- Adoui 2Document98 pagesAdoui 2Kita BelaPas encore d'évaluation
- Igc Syllabus Summary v1 Nov 14 Spec For Trans64201611926Document10 pagesIgc Syllabus Summary v1 Nov 14 Spec For Trans64201611926Tita EricPas encore d'évaluation
- Examen Et Corrige Francais 2010 2ASS T2Document4 pagesExamen Et Corrige Francais 2010 2ASS T2fattahPas encore d'évaluation
- Telephone Alphabet in FrenchDocument1 pageTelephone Alphabet in FrenchVeronicaGelfgren100% (1)
- نقل الحركةDocument36 pagesنقل الحركةRizouga AbdallahPas encore d'évaluation
- Pompe A Chaleur Air Eau Informations Relatives Au Emplacement Des Unites ExterieursDocument10 pagesPompe A Chaleur Air Eau Informations Relatives Au Emplacement Des Unites Exterieursd.artigas.hPas encore d'évaluation
- Orquestra Na Rua - ViolonceloDocument55 pagesOrquestra Na Rua - ViolonceloJovani FariaPas encore d'évaluation
- 1 Fondation ExerciceDocument2 pages1 Fondation Exerciceclaude_badrPas encore d'évaluation
- Rapport GIP Décembre 2019 LE PROCÈS ENVIRONNEMENTAL Pour Mise en Ligne 29112019Document320 pagesRapport GIP Décembre 2019 LE PROCÈS ENVIRONNEMENTAL Pour Mise en Ligne 29112019alcanarssalvatoresPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 - Thermodynamique MIPC (Section A) - PPTX-1Document53 pagesChapitre 3 - Thermodynamique MIPC (Section A) - PPTX-1dahbyamine37Pas encore d'évaluation
- Exposé AdictionDocument3 pagesExposé Adictiondarkaissa85Pas encore d'évaluation
- Achat Et Vente Sans TvaDocument4 pagesAchat Et Vente Sans TvaJoice OndoPas encore d'évaluation