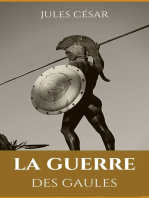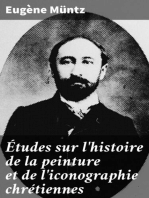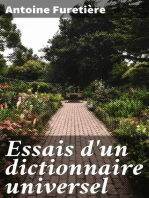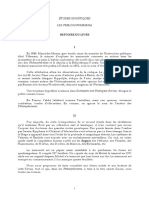Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Amalthée - Mélanges D'archéologie Et D'histoire
Transféré par
LeCroaeTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Amalthée - Mélanges D'archéologie Et D'histoire
Transféré par
LeCroaeDroits d'auteur :
Formats disponibles
Reinach, Salomon (1858-1932). Amalthe : mlanges d'archologie et d'histoire. 1930.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numriques d'oeuvres tombes dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur rutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n78-753 du 17 juillet 1978 :
*La rutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la lgislation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La rutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par rutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
labors ou de fourniture de service.
Cliquer ici pour accder aux tarifs et la licence
2/ Les contenus de Gallica sont la proprit de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis un rgime de rutilisation particulier. Il s'agit :
*des reproductions de documents protgs par un droit d'auteur appartenant un tiers. Ces documents ne peuvent tre rutiliss, sauf dans le cadre de la copie prive, sans
l'autorisation pralable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservs dans les bibliothques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signals par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invit s'informer auprs de ces bibliothques de leurs conditions de rutilisation.
4/ Gallica constitue une base de donnes, dont la BnF est le producteur, protge au sens des articles L341-1 et suivants du code de la proprit intellectuelle.
5/ Les prsentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont rgies par la loi franaise. En cas de rutilisation prvue dans un autre pays, il appartient chaque utilisateur
de vrifier la conformit de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage respecter les prsentes conditions d'utilisation ainsi que la lgislation en vigueur, notamment en matire de proprit intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prvue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dfinition, contacter reutilisation@bnf.fr.
S. REINACH
Conservateur des Muses
Nationaux,
membre de l'Institut
AMALTHE
MLANGES
D'ARCHOLOGIE ET D'HISTOIRE
TOME I
OUVRAGE ILLUSTR DE
76
GRAVURES
LIBRAIRIE ERNEST LEROUX
28,
RUE BONAPARTE :-: PARIS
AMALTHE
MEMORIM,
FRATRVM
S. REINAGH
Conservateur des Muses
Nationaux,
membre de l'Institut
AMALTHEE
Mlanges d'Archologie
et d'Histoire
TOME I
OUVRAGE ILLUSTR DE
76
GRAVURES
LIBRAIRIE ERNEST LEROUX
28,
RUE
BONAPARTE,
28
1930
OUVRAGES DU MME AUTEUR
Manuel de
Philologie classique,
2
(vol.,
1883-1884
(nouveau
ti-
rage, 1907).
Trait
d'pigraphie grecque,
1885.
Grammaire
latine,
1886.
La colonne
Trajane,
1886.
Conseils aux
voyageurs archologues,
1886.
Catalogue
sommaire du Muse de
Saint-Germain,
1887
(3e
d.,
1899).
E. PoTTiEit et S.
REINACH,
La
ncropole
de
Myrina,
2
vol.,
1887.
Atlas de la
province
romaine d'A-
frique,
i883.
Voyage archologique
de Le Bas en
Grce et en Asie
Mineure,
1888.
Esquisses archologiques,
1888.
Epoque
des alluvions et des
cavernes,
1889.
Minerva,
1889
(6e
d.
1909).
Les Gaulois dans l'art
antique,
1889.
L'histoire du travail en
Gaule,
1890.
Peintures de vases
antiques,
1891.
KONDAKOF,TOLSTO,
S.
REINACH,
Antiquits
de la Russie mridio-
nale,
1891.
Chroniques d'Orient,
2
vol., 1891,
1896.
-Antiquits
du
Bosphore
cimmrien,
1892.
L'origine
des
Aryens,
1892.
A. BERTRANDet S. REINACH,
Les
Celles du P et du Danube,
1894.
Bronzes
figurs
dela Gauleromaine,
1894.
O. MONTELIUSet S.
REINACH,
Les
Temps prhistoriques
en
Sude,
.
1895.
pona,la
desse
gauloise
des
chevaux,
1895.
Pierres
graves,
1895.
La
sculpture
en
Europe
avant les
influences grco-romaines,
1896.
Rpertoire
de la statuaire
grecque
et
romaine,
5
vol.,
1897-1924.
Rpertoire
devases
grecs
et
trusques,
2
vol.,
1899-1900.
Guide illustr du Muse de Saint-
Germain,
1899
(nouv.
d.
1922).
H. C. LE
A,
Histoire de
l'Inquisition,
trad.
par
S.
REINACH,
3 vol..
1900-1902.
La
reprsentation
du
galop, '1901,
(nouvelle dition, 1926).
L'album de Pierre
J acques,
1902.
Recueil dettes
antiques,
1903.
Un manuscrit de la
Bibliothque
de
Philippe
le Bon Saint-Pters-
bourg,
1904.
Apollo,
histoire
gnrale
des
arts,
1904
(lie d 1926).
Rpertoire
de
peintures
du
moyen
ge
et de la
Renaissance,
t. I-V.
1905-1923.
Cultes,
mythes
et
religions,
1.
I-V,
1905-1922.
Tableaux indits ou
peu
connus,
1906.
Album des
moulages
et modles en
vente
Saint-Germain,
1908.
Rpertoire
de
reliefs grecs
et
romains,
3
vol.,
1909-1912.
Rpertoire
del'art
quaternaire,
1913.
Orpheus,
histoire
gnrale
des reli-
gions,
1909
(30e d.,
1924).
Chronologie
de la
guerre,
10
vol.,
1915-1919.
Histoire de la
[premire]
Rvolution
russe,
1918.
Histoire sommaire de la
guerre
de
quatre ans,
1919.
,
Catalogue
illustr duMuse deSaint-
Germain,
2
vol., 1917,
1921.
Rpertoire
de
peintures grecques
et
romaines,
1922.
A short
hislory oj Christianily
1922.
Monuments nouveaux de l'art anti-
que,
2
vol.,
1925.
Lettres Zo sur l'histoire des
phi-
_losophies,
3
vol.,
1926.
phmrides
de
Glozel,
t.
I,
1928.
Glozel,
la
dcouverte,
la controverse.
1928.
PRFACE
Il
y
avait une fois un
archologue,
ami de Wieland
connu,
mais
peu
estim de Goethe
dont on lit encore
l'ouvrage,
intitul
Sabine,
sur la toilette des dames
romaines;
il
s'appelait Charles-Auguste Boettiger
et fut
membre de l'Institut de France
(1760-1835).
A
l'ge
de
soixante et un
ans,
il
commena
la
publication,
acheve
en trois volumes
(1821-1825),
de
petits
crits relatifs
la
mythologie figure
des Grecs et des Romains et l'in-
titula Amalthea. J e
prends
son titre
Boettiger,
en le
francisant un
peu ; je
le trouve
court,
harmonieux et
non dnu de sens. En
effet,
Amalthe n'est
pas
seule-
ment le
joli
nom de la chvre
qui
nourrit
J upiter
enfant
en
Crte,
et fut
rcompense
de ses services
par
une
place
au ciel
;
elle avait une corne
qui,
s'tant brise
par accident, devint,
par
la faveur de son
nourrisson,
ce
que
l'on
appelle
une corne d'abondance ou corne
"
Amalthe, remplie
de toute sorte de
plantes,
de fleurs
et
de fruits. La
lgende
ne dit
pas qu'ils
fussent tous
des
meilleurs, mais,
du
moins,
il
y
en avait
beaucoup
et
la
provision
s'en renouvelait mesure
qu'on
se
permet-
tait
d'y puiser.
Amalthe est donc un titre bien choisi
pour
la runion des essais les moins
phmres
d'un
polygraphe
sans doute un
peu trop
fcond.
Quiconque
se
rimprime
a le devoir de se
corriger.
J e ne suis
point,
crivait Boileau en
1701,
de ces
auteurs
fuyant
la
peine, qui
ne se croient
plus obligs
de rien raccommoder leurs
crits,
ds
qu'ils
les ont
une fois donns au
public.
Boileau,
comme
presque
toujours,
a raison. Mais
quand
un auteur conserve ses
crits leurs
dates,
il
y
a une distinction faire. Tout
VIII PREFACE
ce
qui
est
lapsus, solcisme,
omission
grave,
doit tre
corrig
tacitement,sans
qu'on
en avertisse le lecteur
qui
c'est
gal ;
mais ce
que
l'auteur
ajoute pour
l'avoir
appris depuis, doit,
s'il est tout fait
honnte,
paratre
entre
crochets,
avec la date du
raccommodage, pour
employer l'expression
si
juste
de Boileau. J e me suis
conform cette
rgle
de bonne foi et de bon sens.
On trouvera notamment ici de
longues pages
sur
la Vnus de
Milo,
autrefois ensevelies dans la rare srie
de la
Chronique
des Arts. J e crois avoir rendu
quelques
bons offices la connaissance
que
nous avons de ce
chef-d'oeuvre et
je
me suis souvent
aperu que
l'on
continuait draisonner son
sujet malgr
les faits
que j'ai
clairement tablis
(1).
J 'ignore
combien de volumes suivront
celui-ci,
mais
j'y
travaillerai
pendant
le reste de mes
jours.
Archologues, philologues, historiens,
nous ne devons
pas
laisser d'autres le soin de runir nos
petits
crits
;
cela tait bon
autrefois,
alors
qu'on
avait de vri-
tables
lves;
aujourd'hui,
sauf
exceptions
rares,
on
se
prpare
seulement des successeurs.
S. REINACH.
Muse de
Saint-Germain-en-Laye.
J uillet 1929.
(1) Voir, par ex.,
A. W.
Lawrence,
Later Greek
sculpture, 1927,
p.
37
;
Classical
Sculpture, 1929, p.
307.
I
CHARLES
PERRAULT, CRITIQUE
D'ART
1
Dans une thse de doctorat autrefois
clbre,
YHistoire
de la
querelle
des anciens et des modernes
(1856), Hip-
polyte Rigault
a
longuement analys
les
quatre
volumes
publis
en 1688
par
Charles
Perrault,
de l'Acadmie
Franaise
(et
de l'Acadmie des
Inscriptions)
: Paral-
lle des anciens et des
modernes,
en ce
qui regarde
les
arts et les sciences. L'anne
prcdente,
l'occasion
de la convalescence de Louis
XIV,
Charles
Perrault,
contrleur
gnral
des btiments du
roi,
frre de Claude
Perrault,
l'architecte de la colonnade du
Louvre 2,
avait
lu,
dans une sance solennelle de l'Acadmie
Franaise,
un
pome
intitul : Le sicle de Louis le
Grand,
dbutant
par
ces vers
qui
en font assez connatre
l'esprit
:
La belle
antiquit
fut
toujours vnrable,
Mais
je
ne crus
jamais qu'elle
ft adorable.
J e vois les anciens sans
plier
les
genoux
:
Ils sont
grands,
il est
vrai,
mais hommes comme
nous,
Et l'on
peut comparer,
sans crainte d'tre
injuste,
Le sicle de Louis au beau sicle
d'Auguste.
Les
partisans
des anciens
furent fort
irrits,
et
Boileau
plus
que
les autres. Perrault se dcida redire
en
prose
ce
qu'il
avait dit en vers. Pour
cela,
il choisit
1.
[Revue archologique, 1909, II, p. 203-215.]
2. J e
rappelle que
Charles
Perrault est l'auteur des admirables
Contes
qui
ont fait vivre et conserveront son nom.
S. REINACH t
A CHARLES
PERRUALT, CRITIQUE
D ART
la forme du
dialogue
;
les interlocuteurs sont un Pr-
sident,
un Abb et un Chevalier
;
l'Abb
exprime
les
sentiments de Perrault.
Sainte-Beuve
1
et
Rigault
2
n'ont
pas
insist hur les
pages
du Parallle
qui
ont
pour objet
de
comparer
l'art ancien celui de la Renaissance et l'art du sicle
de Louis XIV
;
la
critique
littraire de Perrault les
a naturellement
plus
intresss 3. J e crois
qu'on
n'a
pas
assez
remarqu,
dans ce Parallle
plus
clbre
que
lu,
des textes
qui,
dfaut d'autre
mrite,
nous donnent
une ide des
jugements ports
sur l'art
grco-romain
prs
de cent ans avant Winckelrnann 4. J e
reproduis
ici, d'aprs
l'dition de
1692,
les
passages qui peuvent
apprendre quelque
chose aux
archologues
et me
contente de rsumer ce
qui
concerne l'art de la Renais-
sance, que
Perrault sacrifie sans hsiter celui de
Le Brun et de Girardon.
T.
I, p.
150 : Il
y
a des curieux si entts de ces beaux
secrets
d'optique
et si aises de les dbiter
que je
leur ai ou
soutenir
qu'une
des
jambes
de la Vnus
{de Mdicis],
celle
qui
est un
peu plie,
tait
plus longue que
celle
qui
est droite et
sur
laquelle
la
figure
se
soutient,
parce que,
disent-ils,
elle fuit
1.
Lundis,.t. V, p.
206-221.
2. Histoire de la
querelle
des anciens et des
modernes, p.
174-208.
3. Le
bibliophile
J acob
(Paul Lacroix)
a
rimprim,
dans la Revue
universelle des Arts
(t. XVII, 1863, p. 257,312),
la
partie
de
l'ouvrage
de Perrault relative aux arts
;
il a fait
prcder
cette
rimpression
de
quelques lignes,
mais ne l'a
accompagne
d'aucun commentaire.
4. On
songe
naturellement Winckelrnann et sa thorie de l'imi-
tation de
l'antique quand
on lit ces
lignes
de Perrault
(t. I, p. 11)
:
J e soutiens
qu'on
fait tous les
jours
des choses trs excellentes
sans le secours de l'imitation . Cela
pour rpondre
au Prsident
,
suivant
lequel
la beaut de Versailles ne tenait
qu'aux antiques
qu'on y
avait
transports
ou imits : Ses
plus grandes
beauts
consistent dans l'amas
prcieux
des
figures antiques
et des tableaux
anciens
qu'on y
a
ports... ;
le
surplus
de ce Palais ne
peut
tre
considrable
qu'autant que
les ouvriers
qui y
ont travaill ont eu
l'adresse de bien imiter dans leurs
ouvrages
la
grande
et noble
manire des anciens
(t. I, p. 10).
CHARLES
PERRAULT, CRITIQUE
D ART
l'oeil et
que
le
sculpteur judicieux
lui a rendu ce
qu'elle perd
pour
tre vue de cette sorte. J e les ai mesures toutes deux fort
exactement et
je
les ai trouves telles
qu'elles
m'ont
toujours
paru, je
veux dire
parfaitement gales
et en
longueur
et en
gros-
seur. J e vois encore tous les
jours
d'autres curieux
qui
assurent
que
les bas-reliefs du haut de la colonne
Trajane
sont
plus grands
que
ceux du bas de la mme
colonne, parce que
cela devrait
tre
ainsi,
suivant les beaux
prceptes qu'ils
dbitent
;
cepen-
dant on
peut
voir au Palais
Royal,
o sont tous ces bas-reliefs
\
qu'il n'y
a aucune diffrence des uns aux autres
pour
la hauteur.
L'oeil n'a
pas
besoin d'tre secouru en
pareilles
rencontres
;
de
quelque
loin
qu'on
voie un homme on
juge
de sa taille...
(p. 158).
J e suis
persuad que
les anciens n'ont
jamais pens
la moiti des finesses
qu'on
leur attribue et
que
le hasard a fait
plus
des trois
quarts
des beauts
qu'on s'imagine
voir dans leurs
ouvrages
.
T.
I, p.
177 : Nous avons des
figures antiques
d'une beaut
incomparable
et
qui
font
grand
honneur aux anciens... Mettez
autour de vous
l'Hercule, l'Apollon,
la
Diane,
le
Gladiateur,
les
Lutteurs,
le
Bacchus,
le Laocoon et deux ou trois encore de la
mme force...
(L'Abb).
L'avis est
bon,
mais il ne faut
pas y
en
appeler d'autres; car, par exemple,
si vous
y
mettiez la
Flore,
dont la
plupart
des curieux font tant de
cas,
il serait ais de vous
forcer de ce ct-l... C'est une
figure
vtue
;
aussi il en faut
regarder
la
draperie
comme une
partie principale. Cependant
cette
draperie
n'est
pas agrable
et il semble
que
la desse soit
vtue d'un
drap
mouill... Si c'tait une
nymphe
des
eaux,
la bonne
heure,
encore cela serait-il bizarre
;
car il faut
suppo-
ser
que
les vtements de ces sortes de divinits sont de la mme
nature
que
le
plumage
des oiseaux
aquatiques, qui
demeurent
dans l'eau sans se mouiller. Le
sculpteur n'y
a
pas
fait assur-
ment de rflexion
;
il a mouill la
draperie
de son modle
pour
lui faire
garder
les
plis qu'il
avait
arrangs
avec soin et ensuite
il les a dessins fidlement. Rien n'tonne
davantage que
de
voir un morceau d'toffe
qui,
au lieu de
pendre
plomb
selon
l'inclinaison naturelle de tous les
corps pesants,
se tient coll
le
long
d'une
jambe plie
et retire en dessous. La mme chose
se voit encore l'endroit du
sein,
o la
draperie
suit exac-
tement la rondeur des mamelles. Il
y
a d'autres manires
plus
ingnieuses que
celles-l
pour marquer
le nu des
figures
et faire
valoir leurs
justes proportions...
La
plupart
des anciens
n'y
1. Les
moulages
excuts
par
ordre de Colbert
;
voir
plus bas, p.
6.
4 CHARLES
PERRAULT,
CRITIQUE
D ART
trouvaient
point
d'autre finesse
que
de serrer les
draperies
contre le nu et de faire un
grand
nombre de
petits plis
les uns
auprs
des autres.
Aujourd'hui,
sans cet
expdient,
on fait
paratre
la
draperie
aussi mince
que
l'on
veut,
en donnant
peu
d'paisseur
aux naissances des
plis
et aux endroits o ces mmes
plis
sont
interrompus...
Les anciens n'ont
pas
excell de ce ct-l et il en faut demeu-
rer
d'accord 1,
comme il faut convenir
qu'ils
taient admirables
pour
le nu des
figures.
Car
j'avoue que
dans
l'Apollon (du
Bel-
vdre),
la Diane
(de Versailles),
la Vnus
(de Mdicis),
l'Her-
cule
(Farnse),
le Laocoon et
quelques
autres
encore,
il me
semble voir
quelque
chose
d'auguste
et de
divin, que je
ne trouve
pas
dans nos
figures
modernes
;
mais
je
dirai en mme
temps que
j'ai
de la
peine
dmler si les mouvements d'admiration et de
respect qui
me saisissent en les
voyant
naissent
uniquement
de
l'excs de leur beaut et de leur
perfection,
ou s'ils ne viennent
point
en
partie
de cette inclination naturelle
que
nous avons
tous estimer dmesurment les choses
qu'une longue
suite de
temps
a comme consacres et mises au-dessus du
jugement
des
hommes 2. Car
quoique je
sois
toujours
en
garde
contre ces sortes
de
prventions,
elles sont si fortes et elles
agissent
sur notre
esprit
d'une manire si cache
que je
ne sais si
je
m'en dfends
bien. Mais
je
suis trs bien
persuad que
si
jamais
deux mille
ans
passent
sur le
groupe d'Apollon, qui
a t fait
pour
la
grotte
du
palais
o nous sommes
3
et sur
quelques ouvrages
peu prs
de la mme
force,
ils seront
regards
avec la mme admiration
et
peut-tre plus grande
encore .
Le Chevalier. Sans attendre deux mille
ans,
il serait ais de
s'en claircir dans
peu
de
jours ;
on sait faire de certaines eaux
rousses
qui
donnent si bien au marbre la couleur des
antiques
qu'il n'y
a
personne qui n'y
soit
tromp ;
ce serait un
plaisir
1. C'est ce
que rptera
Falconet,
le
sculpteur, qui reprit
la thse
de Perrault
(contre Winckelrnann)
dans des articles
aujourd'hui
trop
oublis
(OEuvres
concernant les
arts, Didot, 1787,
t.
III, p. 42).
M. Edmond Hildebrandt a
publi
une
biographie
illustre de
Falconet
(Leben,
Werke und
Schriften
des Bildhauers
Falconet,
1716-1791
; Strasbourg, 1908).
2. On voit assez
que
ce n'est ni
Caylus,
ni
Winckelrnann,
ni
l'effet des fouilles de
Pompi qu'il
faut attribuer
l'engouement
pour l'antique, ou,
comme disait
nergiquement
Falconet
(OEuvres,
t.
III, p. 61)
: Le credo ultramontain :
l'antique
ne
peut
avoir tort .
3. A Versailles. La
description
du
palais
et des
jardins
de Ver-
sailles,
dans le
Parallle,
mrite d'tre lue avec attention.
CHARLES
PERRAULT, CRITIQUE
D ART 5
d'entendre les acclamations des curieux
qui
ne sauraient
pas
la
tromperie
et de voir de combien de
piques
ils les mettraient
au-dessus de tous les
ouvrages
de notre sicle.
L'Abb. Nous savons le commerce
qui
s'est fait de ces sortes
d'antiques,
et
qu'un galant
homme
que
nous connaissons tous
1
en a
peupl
tous les cabinets des curieux novices. Un
jour que
je
me
promenais
dans son
jardin,
on m'assura
que je
marchais sur
une infinit de bustes enfouis dans la terre
qui
achevaient l de
se faire
antiques
en buvant du
jus
de fumier. J 'ai vu
plusieurs
de
ces bustes
; je
vous
jure qu'il
est difficile de
n'y
tre
pas tromp.
Le Chevalier. Pour
moi, je n'y
vois
pas
de
diffrence,
si ce
n'est
que
les faux
antiques
me
plaisent davantage que
les vri-
tables, que
la
plupart
ont l'air
mlancolique
et font de certaines
grimaces
o
j'ai
de la
peine
m'accoutumer.
L'Abb. Si le titre d'ancien est d'un
grand poids
et d'un
grand
mrite
pour
un
ouvrage
de
sculpture,
la circonstance
d'tre dans un
pays loign
et
qu'il
en cote
pour
le voir un
voyage
de trois ou
quatre
cents
lieues,
ne contribue
pas
moins
leur donner du
prix
et de la
rputation. Quand
il fallait aller
Rome
pour
voir le
Marc-Aurle,
rien n'tait
gal
cette fameuse
figure questre,
et on ne
pouvait trop
envier le bonheur de ceux
qui
l'avaient vue.
Aujourd'hui que
nous l'avons
Paris 2,
il
n'est
pas croyable
combien on la
nglige, quoiqu'elle
soit moule
trs exactement et
que,
dans une des cours du Palais
Royal
o on l'a
place,
elle ait la mme beaut et la mme
grce que
l'original.
Cette
figure
est
assurment
belle;
il
y
a de
l'action,
il
y
a de la
vie,
mais toutes choses
y
sont outres. Le cheval lve
la
jambe
de devant
beaucoup plus
haut
qu'il
ne le
peut
et se
ramne de telle sorte
qu'il
semble avoir l'encolure
dmise,
et la
corne de ses
pieds
excde en
longueur
celle de tous les mulets
d'Auvergne.
Le Chevalier. La
premire
fois
que je
vis cette
figure, je
crus
que l'empereur
Marc-Aurle montait une
jument pouli-
1.
Qui
? La discrtion de Perrault
pose
ici un
problme que je
suis
incapable
de rsoudre. Le comte
Philippe
de
Caylus
n'tait
pas
n cette
poque.
2. Nous savons
par
Falconet
(OEuvres,
t.
III, p. 136) que
le mou-
lage
du
Marc-Aurle n'existait
plus
de son
temps
:
Sa
perte
n'a
excit aucun
regret parmi
les artistes.
Un
premier moulage
de cette
statue,
fait
pour Franois Ier, figura longtemps
dans une cour de
Fontainebleau, qui s'appelle
encore Cour du cheval blanc
(ibid.,
p. 138).
Falconet a
longuement
dmontr l'incorrection du cheval
de Marc-Aurle
(ibid., p. 49-145).
0 CHARLES
PERRAULT,
CRITIQUE
D ART
nire,
tant son cheval a les flancs
larges
et
enfls,
ce
qui oblige
ce bon
empereur
avoir les
jambes
horriblement
carquilles.
Le Prsident. Plusieurs croient
que l'original
s'est ainsi
largi
par
le ventre
pour
avoir t accabl sous la ruine d'un btiment.
L'Abb. Comment cela
peut-il
avoir t
pens?
Et
qui
ne
sait
que
de la bronze
(sic)
fondue se casserait cent fois
plutt
que
de
plier?,..
T.
I, p.
188. L'Abb. La
sculpture
est,
la
vrit,
un des
plus
beaux arts
qui occupent l'esprit
et l'industrie des
hommes,
mais on
peut
dire aussi
que
c'est le
plus simple
et le
plus
born
de
tous, particulirement lorsqu'il
ne
s'agit que
de
figures
de
ronde bosse. Il
n'y
a
qu'
choisir un beau
modle,
le
poser
dans
une attitude
agrable
et le
copier
ensuite fidlement... Les
anciens ont donc
pu
exceller dans les
figures
de ronde bosse
et n'avoir
pas
eu le mme
avantage
dans les
ouvrages
des autres
arts
beaucoup plus composs
et
qui
demandent
un
plus grand
nombre de rflexions et de
prceptes.
Cela est si vrai
que,
dans
les
parties
de la
sculpture
mme o il entre
plus
de raisonnement
et de
rflexion,
comme dans les
bas-reliefs,
ils
y
ont t beau-
coup plus
faibles. Ils
ignoraient
une infinit de secrets de cette
partie
de la
sculpture
dans le
temps
mme
qu'ils
ont fait la
colonne
Trajane,
o il
n'y
a aucune
perspective
ni aucune
dgra-
dation 1. Dans cette colonne les
figures
sont
presque
toutes sur
la mme
ligne ;
s'il
y
en a
quelques-unes
sur le
derrire,
elles
sont aussi
grandes
et aussi
marques que
celles
qui
sont sur le
devant
;
en sorte
qu'elles
semblent tre montes sur des
gradins
pour
se faire voir les unes au-dessus des autres.
Le Chevalier. Si la colonne
Trajane
n'tait
pas
un morceau
d'une beaut
singulire,
M.
Colbert,
dont
je
vous ai ou louer
plus
d'une fois le
got exquis pour
tous les beaux
arts,
n'aurait
pas envoy
Rome mouler cette colonne et n'en aurait
pas
fait
apporter
en France tous les moules et tous les bas-reliefs mouls
chacun deux
fois,
ce
qui
n'a
pu
se faire sans une
dpense
consi-
drable.
L'Abb. Il
parat
la vrit
que
M. Colbert a donn en cela
une
grande marque
de son estime
pour
la
sculpture
des anciens
;
mais
qui peut
assurer
que
la
politique n'y
eut
pas quelque
part!
? Pensez-vous
que
de
voir,
dans une
place
o se
promnent
1. Ces
critiques
ont t
reprises
et
dveloppes par
Falconet
(OEuvres,
t.
III, p. 286-300).
2. Par une rencontre
singulire,
on a dit la mme chose Rome
lorsque
la colonne Aurlienne
y
fut moule aux frais de
l'empereur
allemand Guillaume II.
CHARLES
PERRAULT,
CRITIQUE
D ART /
sans cesse les
trangers
de toutes les nations du
monde,
une
construction immense d'chafauds les uns sur les autres autour
d'une colonne de
vingt-six pieds
de
haut,
et
d'y
voir fourmiller
un nombre infini
d'ouvriers,
pendant que
le Prince
qui
les fait
travailler est la tte de cent mille hommes et soumet ses
lois toutes les
places qu'il attaque
ou
qu'il
menace seulement
pensez-vous, dis-je, que
ce
spectacle,
tout
agrable qu'il
tait,
ne ft
pas
en mme
temps
terrible
pour
la
plupart
de ces tran-
gers
et ne leur ft
pas
faire des rflexions
plus
honorables cent
fois la
France, que
la
rputation
de se bien connatre aux beaux
ouvrages
de
sculpture?...
J e veux bien
que
le seul amour des beaux arts ait fait mou-
ler et venir ici la colonne
Trajane
!
Voyons-en
le succs.
Lorsque
les bas-reliefs furent dballs et
arrangs
dans le
magasin
du
Palais
Royal,
on courut les voir avec
impatience ;
mais comme si
ces bas-reliefs eussent
perdu
la moiti de leur beaut
par
les
chemins,
on
s'entre-regardait
les uns les
autres,
surpris qu'ils
rpondissent
si
peu
la haute
opinion qu'on
avait
conue
1.
On
y remarqua
la vrit de trs beaux airs de tte et
quelques
attitudes assez
heureuses,
mais
presque point
d'art dans la
composition,
nulle
dgradation
dans les
reliefs,
et une
profonde
ignorance
de la
perspective.
Deux ou trois
curieux,
pleins
encore
de ce
qu'ils
en avaient ou dire
Rome, s'panchaient
en
louanges
dmesures sur l'excellence de ces
ouvrages ;
le reste
de la
compagnie s'efforait
d'tre de leur
avis,
car il
y
a de
l'honneur tre charm de ce
qui
est
antique ;
mais ce fut inu-
tilement,
et chacun s'en retourna
peu
satisfait. Les bas-reliefs
sont demeurs
l,
o ils
occupent beaucoup
de
place,
o
personne
ne les va
copier
et o
peu
de
gens
s'avisent de les aller voir.
Le Chevalier. J e me souviens
qu'un
de ces curieux zls
pour
l'antique,
voulant faire valoir
quelques-uns
de ces
bas-reliefs,
passait
et tournait la main dessus en cartant les
doigts
et
disait : Voil
qui
a du
grand,
voil
qui
a du beau! On le
pria
d'arrter sa main sur
quelque
endroit
qui
mritt
particulire-
ment d'tre admir
;
i] ne rencontra
jamais
heureusement.
D'abord ce fut sur une tte
qui
tait
beaucoup trop grosse,
et
il en demeura d'accord
;
ensuite sur un cheval
qui
tait beau-
1. Tout cela est intressant et tout fait nouveau
pour
moi
;
du
reste,
il semble
que
les diteurs de la colonne
Trajane
n'en ont rien
su. M. Froehner
(t. I, p.
xix de l'd.
in-fol.)
dit
que
les
moulages
de
la colonne se
voyaient
au Louvre en 1706 dans la salle des Cent-
Suisses
;
les
creux, d'aprs
une tradition
orale,
auraient servi
combler la Cour carre sous le
premier Empire.
8 CHARLES
PERRAULT,
CRITIQUE
D'ART
coup trop petit. Cependant
il
persista toujours
soutenir
que
le tout ensemble en tait admirable.
L'Abb. Si l'on examine bien la
plupart
des bas-reliefs
antiques,
on trouvera
que
ce ne sont
point
de vrais
bas-reliefs,
mais des reliefs de ronde bosse scis en deux du haut en
bas,
dont la
principale
moiti a t
applique
et colle sur un fond
tout uni. Il ne faut
que
voir le bas-relief des Danseuses
;
les
figures
en sont assurment d'une beaut
extraordinaire,
et rien
n'est
plus noble, plus
svelte et
plus galant que l'air,
la taille et
la dmarche de ces
jeunes
filles
qui
dansent
;
mais ce sont des
figures
de ronde
bosse,
scies en
deux,
comme
je
viens de
dire,
ou enfonces de la moiti de leur
corps
dans le
champ qui
les
soutient. Par l on connat clairement
que
le
sculpteur qui
les
a faites
manquait
encore de cette adresse...
par laquelle
un
sculpteur,
avec deux ou trois
pouces
de
relief,
fait des
figures
qui
non seulement
paraissent
de ronde bosse et dtaches du
fond,
mais
qui
semblent s'enfoncer les unes
plus,
les autres
moins
dans le lointain du bas-relief. J e
remarquerai
en
passant
que
ce
qu'il y
a de
plus
beau au bas-relief des Danseuses a t
fait
par
un
sculpteur
de notre
temps,
car
lorsque
le Poussin
l'apporta
de Rome en
France,
ce n'tait
presque qu'une
bauche
assez
informe,
et
c'a
t l'oeuvre des
Anguiers qui
lui a donn
cette
lgance
merveilleuse
que
nous
y
admirons 1.
Ce
qui
suit
(t. I, p. 197)
concerne la
peinture,
dont
l'abb cherche montrer le
progrs depuis Apelle
jusqu' Raphal
et
depuis Raphal
Le Brun. Pour
se convaincre du
peu
de beaut des
peintures antiques,
il sufft de
rappeler
l'histoire des raisins de
Zeuxis,
o un
simple trompe-l'oeil
est clbr comme une mer-
1. Il
s'agit
videmment des Danseuses
Borghse (Clarac,
d.
R., 1.1,
p. 58),
mais non de
l'original, qui
n'entra au Louvre
que
sous le
premier Empire.
M. R. Eisler
(Burlington Magazine,
sept.
1904,
p.
597)
a cit un
passage
de la vie du Poussin
par
Bellori d'o il rsulte
qu'en
1641 Poussin fit mouler
Rome,
au
jardin Borghse,
alcune
vergini
che ballano
;
c'est ce
moulage qui
dut tre
reproduit
en bronze et
retouch
par
un des
Anguier.
Le bronze en
question
est
probable-
ment celui de la collection
Wallace,
o M. Claude
Philipps
vit un
ouvrage
italien du xvie sicle et M. Bode un travail
franais
du
xvme
;
M. Michon
opina
avec raison
pour
le xvne
(Mon. Piot,
t.
XII, p. 170).
Le
passage
de
Perrault,
rest
inaperu,
tranche la
question.
CHARLES
PERRAULT, CRITIQUE
D'ART 9
veille,
celle du rideau de Parrhasius et celle du
trait
dli
d'Apelle, qui
n'est
pas plus
mritoire
que
l'O
de Giotto. Il
y
a
dj longtemps que
ces sortes
d'adresses ne sont
plus
d'aucun mrite
parmi
les
peintres
. Suit un
passage
curieux sur les
primitifs
:
T.
I, p.
208 :
Quelques
annes avant
Raphal
et le
Titien,
il
s'est fait des
tableaux,
et nous les avons
encore,
dont la beaut
principale
consiste dans cette finesse de linaments
;
on
y compte
tous les
poils
de la barbe et tous les cheveux de la tte de
chaque
figure.
Les
Chinois, quoique
trs anciens dans les
arts,
en sont
encore l. Ils
parviendront peut-tre
bientt dessiner correc-
tement,
donner de belles attitudes leurs
figures
et mme des
expressions
naves de toutes les
passions ;
mais ce ne sera
pas
de
longtemps qu'ils
arriveront
l'intelligence parfaite
du clair-
obscur,
de la
dgradation
des
lumires,
des secrets de la
pers-
pective
et de la
judicieuse
ordonnance d'une
grande compo-
sition
1
.
Perrault
distingue
trois choses dans la
peinture
:
la
reprsentation
des
figures, l'expression
des
passions
et la
composition
de tout l'ensemble. Il
y
a aussi
trois
parties
dans l'homme
par
o il en est touch :
les
sens,
le coeur et la raison . A son avis
(p. 214)
:
Il a suffi aux
Apelles
et aux
Zeuxis, pour
se faire admirer
de toute la
terre,
d'avoir charm les
yeux
et touch le
coeur,
sans
qu'il
leur ait t ncessaire de
possder
cette troisime
partie
de la
peinture, qui
ne va
qu'
satisfaire la raison
;
car bien loin
que
cette
partie
serve charmer le commun du
monde,
elle
y
nuit fort souvent et n'aboutit
qu'
lui
dplaire.
En
effet,
com-
bien
y
a-t-il de
personnes qui
voudraient
qu'on
ft les
personnages
loigns
aussi forts et aussi
marqus que
ceux
qui
sont
proches,
afin de les mieux
voir, qui
de bon coeur
quitteraient
le
peintre
de toute la
peine qu'il
se donne
composer
son tableau et
dgrader
les
figures
selon leur
plan,
mais surtout
qui
seraient
1. Il
y
avait
dj
des
objets
d'art chinois dans la collection de
Mazarin
;
mais
je
ne connais
pas
de texte antrieur celui-ci o le
style
des artistes chinois soit
apprci.
10 CHARLES
PERRAULT,
CRITIQUE
D'ART
bien aises
qu'on
ne ft
point
d'ombres dans les
visages
et
par-
ticulirement dans les
portraits
des
personnes qu'ils
aiment!
L-dessus le Chevalier raconte l'histoire d'une dame
qui prenait pour
une tache et
reprochait
son
peintre
l'indication,
sur son
portrait,
de l'ombre
porte par
son
nez. Les
amis
de la dame
haussaient les
paules
sur
la fantaisie
qu'ont
tous les
peintres
de barbouiller les
visages
avec leurs ombres ridicules et
impertinentes
.
Puis il raconte une autre histoire amusante :
T.
I, p.
216 :
Quand
on
porta
Saint-tienne-du-Mont la
pice
de
tapisserie
o le
martyre
de ce saint est
reprsent,
les
connaisseurs en furent assez
contents,
mais le menu
peuple
de la
paroisse
ne le fut
point
du tout. J e me trouvais
auprs
d'un bon
bourgeois qui
avait dans ses Heures une
petite image
de saint
Etienne sur vlin. Ce saint tait
plant
bien droit sur
ses deux
genoux
avec une
dalmatique rouge cramoisi,
borde tout alen-
tour d'un filet d'or
;
il avait les bras tendus et tenait dans l'une
de ses mains une
grande palme
d'un vert d'meraude. Voil
un
saint
Etienne, disait-il,
en
parlant
ses deux voisins
;
il
n'y
a
pas
d'enfant
qui
ne le reconnaisse.
Eh,
mon Dieu !
que
messieurs les
peintres
ne
peignent-ils
comme cela !...
Il
y
a
bien de
prtendus
connaisseurs Paris
qui s'expliqueraient
comme ce bon
bourgeois
s'ils ne
craignaient
d'tre raills. Gn-
ralement,
ce
qui
est le
plus
fin et de
plus spirituel
dans tous les
arts a le don de
dplaire
au commun du monde. Cela se
remarque
particulirement
dans la
musique
;
les
ignorants
n'aiment
point
l'harmonie
de
plusieurs
parties
mles ensemble
;
ils trouvent
que
tous ces
grands
accords et
toutes ces
fugues qu'on
leur fait
faire,
en
quoi
consiste
pourtant
ce
qu'il y
a de
plus
charmant et
de
plus
divin dans ce bel
art,
ne font
qu'une
confusion dsa-
grable
et
ennuyeuse ;
en un
mot,
ils aiment
mieux,
et ils le
disent
franchement,
une belle voix toute seule.
On devine ce
que
Perrault aurait
pens
du dessin
au
trait,
sans aucune
ombre,
que l'esthtique
de Winc-
kelrnann mit la mode. Ce
got
du linarisme a t
considr
comme un effort d'abstraction
philosophique
;
en
croire
Perrault,
dont la
comparaison
avec la
CHARLES
PERRAULT,
CRITIQUE
D'ART 11
musique
est trs
ingnieuse,
ce serait
plutt
un retour
l'esthtique
un
peu
nave des
bourgeois
.
T.
I, p.
219. L'Abb : J e
peux
encore
prouver
le
peu
de suffi-
sance des
peintres
anciens
par quelques
morceaux de
peinture
antique qu'on
voit Rome en deux ou trois endroits
;
car
quoique
ces
ouvrages
ne soient
pas
tout fait du
temps d'Apelles
et de
Zeuxis,
ils sont
apparemment
dans la mme
manire,
et
tout ce
qu'il peut y
avoir de
diffrence,
est
que
les matres
qui
les ont
faits,
tant un
peu
moins
anciens, pourraient
avoir
su
quelque
chose
davantage
dans la
peinture.
J 'ai vu celui des
Noces
qui
est dans la
vigne
Aldobrandini et celui
qu'on appelle
le
Tombeau d'Ovide. Les
figures
en sont bien
dessines,
les atti-
tudes
sages
et naturelles et il
y
a
beaucoup
de noblesse et de
dignit
dans les airs de tte
;
mais il
y
a trs
peu
d'entente
dans le
mlange
des couleurs et
point
du tout dans la
perspec-
tive ou dans l'ordonnance. Toutes les teintes sont aussi fortes
les unes
que
les autres
;
rien
n'avance,
rien ne recule dans le
tableau,
et toutes les
figures
sont
presque
sur la mme
ligne,
en
sorte
que
c'est bien moins un tableau
qu'un
bas-relief
antique
color 1! Tout
y
est sec et
immobile,
sans
union,
sans liaison et
sans cette mollesse des
corps
vivants
qui
les
distingue
du marbre
et de la bronze
(sic) qui
les
reprsentent.
Suit la
comparaison, dj
cite
par
Sainte-Beuve,
des Plerins d'Emmaus de Paul Vronse avec la
Famille de Darius de Le
Brun,
l'un et l'autre dans l'an-
tichambre du
grand appartement
du Roi Versailles 2.
Un
prlat
italien avait dit
que
le tableau de Le Brun
tait trs
beau,
mais
qu'il
avait le malheur d'avoir
un mchant
voisin,
voulant faire entendre
que, quelque
beau
qu'il ft,
il ne l'tait
gure
ds
qu'on
venait le
1. C'est la formule mme
qu'on
a souvent
applique
aux
grands
tableaux de
David,
conformes
,1'esthtique no-grecque
de Winc-
kelrnann.
2. Cf.
Falconet, OEuvres,
t.
III, p. 268, qui
rfute ce
jugement
de
Voltaire : La famille de Darius
qui
est Versailles n'est
point
efface
par
le coloris de Paul Vronse
qu'on
voit vis--vis.
Voltaire,
bien
que
favorable aux anciens
,
a fait
plus
d'un
emprunt
au
Parallle de Perrault.
12 CHARLES
PERRAULT, CRITIQUE
D'ART
comparer
avec celui de Paul Vronse . Tel n'est
pas
l'avis de l'abb
(Perrault)
:
Les
Franais, dit-il,
ne sont
pas
moins
ports
mpriser
les
ouvrages
de leur
pays
que
les Italiens sont
soigneux
de relever toute ren-
contre le mrite de ceux de leurs
compatriotes.
J e ne
doute
pas que
ce bon mot n'ait t
reu
avec
applau-
dissement et
que plusieurs personnes
ne se fassent
honneur de le
redire,
pour
faire entendre
qu'ils
ont un
got exquis
et un
gnie
au-dessus de leur nation .
Puis il
critique
en dtail la
peinture
de
Vronse,
o
il trouve
trois tableaux diffrents
plutt qu'un
seul,
et exalte celle de Le
Brun,
un vritable
pome
o toutes les
rgles (d'Aristote !)
sont observes
(p. 226).
La discussion
porte
ensuite sur deux tableaux de
Raphal qui
taient
Versailles,
le
petit
Saint-Michel
et la
petite
Sainte Famille. L'abb les
qualifie
de
chefs-d'oeuvre
incomparables
;
mais il fait aussitt
des rserves
(p. 233)
:
Raphal
a si
peu
connu la
dgradation
des lumires et cet
affaiblissement des couleurs
que
cause
l'interposition
de
l'air,
en un mot ce
qu'on appelle
la
perspective arienne, que
les
figures
du fond du tableau sont
presque
aussi
marques que
celles du
devant, que
les feuilles des arbres
loigns
se voient
aussi distinctement
que
celles
qui
sont
proches,
et
que
l'on
n'a
pas
moins de
peine
compter
les fentres d'un btiment
qui
est
quatre
lieues
que
s'il n'tait
qu' vingt pas
de dis-
tance.
Perrault
parle
ici de l'action du
temps, qui
embel-
lit les tableaux
en amortissant ce
qui
est
trop
vif . L'vnement ne lui a
pas
donn raison
quand
il
crit :
T.
I,
p.
235 :
Qui
sait le
degr
de beaut
qu'acquerront
la
Famille de
Darius,
le
Triomphe d'Alexandre,
la Dfaite de Porus
et les autres
grands
tableaux de cette force
quand
le
temps
aura
CHARLES
PERRAULT, CRITIQUE
D'ART
13
achev de les
peindre
et
y
aura mis les mmes beauts dont il
a enrichi le Saint-Michel et la Sainte Famille! Car
je remarque
que
ces
grands
tableaux de M. Le Rrun se
peignent
et s'embel-
lissent tous les
jours...
Ces
grands
tableaux
sont devenus si
dplaisants
qu'ils dparent
une des
plus
belles salles du Louvre
;
leurs
qualits, qui
sont
pourtant
relles,
ne
peuvent
plus
tre
apprcies que
dans les admirables
gravures
de Girard Audran.
A la fin du
premier
volume de la
Querelle
le seul
dont
je
veuille
m'occuper
ici
est
rimprim
le
pome
que
Perrault avait lu l'Acadmie en
1687, mlange
de bons et de trs mauvais vers. Le
passage
sur la
sculpture
est intressant cause d'une
critique
justifie
du
Laocoon, que
Perrault n'a
pas rpte
dans
le Parallle :
Si du Laocoon la taille vnrable
De celle de ses fils est
par trop dissemblable,
Et si les moites
corps
des
serpents
inhumains
Au lieu de deux
enfants enveloppent
deux nains
;
Si le fameux Hercule a diverses
parties,
Par des muscles
trop
forts un
peu trop ressenties,
Quoique
tous les savants de
l'antique entts,
rigent
ces dfauts en de
grandes beauts,
Doivent-ils nous forcer ne voir rien de rare
Aux chefs-d'oeuvre nouveaux dont Versailles se
pare,
Que
tout homme
clair, qui
n'en croit
que
ses
yeux,
Ne trouve
pas
moins
beaux, pour
n'tre
pas
si vieux ?
Dans l'norme
(et excellente) bibliographie qui
fait
suite la
description
du Laocoon
par
M. W. Ame-
lung 1,
il
n'y
a
pas
de renvoi Perrault ni aucun auteur
franais antrieur,
l'exception
de G. Audran
(Les
proportions
du
corps
humain, Paris, 1683).
M. Ame-
lung
n'omet naturellement
pas
de
signaler
l'erreur trs
souvent
reproche
au
sculpteur
du
Laocoon,
le dessin
1.
Amelung,
Die
Sculpturen
des Vaticanischen
Musums,
t. II
(1906), p.
202.
14 CHARLES
PERRAULT, CRITIQUE
D'ART
fautif des
fils, qui
ne sont
pas reprsents
comme des
enfants,
mais comme des adolescents de dimensions
rduites . Il
rappelle,
comme il l'avait fait en
19051,
que dj
certains
groupes pergamniens prsentent
la
mme
particularit,
le
personnage principal
tant
plus grande
chelle
que
les
personnages
accessoires
;
mais
cela ne constitue
pas
une
explication
et cette
erreur de
proportions parat
encore
plus trange
une
poque (vers
50 av.
J .-C.)
o il
y
avait
plutt
excs
que
dfaut dans l'observation et dans le savoir .
J e voudrais
pouvoir
dire
quel
connaisseur remonte
la
critique
dont Perrault s'est fait l'cho et dont
je
ne
trouve
pas
trace dans l'histoire de l'art de Winckel-
rnann
2
;
sans doute elle se transmettait de bouche en
bouche
Rome,
dans le monde des
sculpteurs
et des
peintres qui
tudiaient le Laocoon.
1. Romische
Mitteilungen, 1905, p.
220.
2. M.
Amelung
m'a fait observer
que
la
critique
de Perrault a t
cite
par
J usti,
Winckelrnann
(lre d.,
t.
I, p.
473
;
2e
d., p. 471).
Voltaire,
l'article Encliantement des
Questions
sur
VEncyclopdie,
crit
que
Laocoon est
reprsent
comme un
gant
et ses
grands
enfants comme des
pygmes.
Ce
jugement, inspir
de
Perrault,
a t combattu
par
Falconet
(OEuvres,
t.
III, p.
275 et
suiv.)
;
ce
propos,
Falconet dcrit un
petit groupe
de bronze du
Laocoon,
qu'il
vit dans le cabinet de Smeth
Amsterdam,
fort diffrent du
marbre du Vatican et
que
Falconet
croyait antique (
il fut
rapport
de Grce
par
un
voyageur qu'on
m'a dit
s'y
bien connatre
, p. 284).
Il
y
a bien d'autres dtails curieux dans les crits de Falconet sur
les
arts.
II
L'HISTOIRE DES GESTES
Le
geste
est un mouvement du
corps
ou d'un membre
du
corps qui exprime
une
pense
ou une motion.
Suivant la
remarque
de
Diderot,
le
geste
est
quelque-
fois aussi sublime
que
le
mot,
et tout le monde sait
qu'il
existe un
langage
lmentaire et instinctif des
gestes.
On
peut
tablir une distinction de sens entre le
geste
et
l'attitude,
car l'attitude n'est
pas
un
mouvement,
mais le rsultat d'un mouvement
;
ainsi l'on
parlera
de l'attitude du
sommeil,
non du
geste
du sommeil.
Mais,
dans
l'usage courant,
ces mots sont souvent
synonymes,
le
geste
tant comme
fig par
l'attitude
;
ainsi l'on
parlera
du
geste
ou de l'attitude de la
prire
(les
mains ouvertes et
jointes),
ou mme du
geste
ou
de l'attitude de la
surprise.
Cela
dit,
je passe
ce
qui
est le vif de mon
sujet.
Il existe en art une histoire des
gestes,
comme une
histoire des coles d'art et des artistes. L'histoire des
gestes
est
beaucoup
moins connue
;
elle est trs diffi-
cile
crire. Cela tient au nombre
presque
infini des
monuments de
l'art,
leur
dispersion,
la difficult
de les dater. Pour crire une histoire des
gestes,
il fau-
drait
disposer
de dizaines de milliers de
reproductions
d'oeuvres
d'art, accompagnes
de
lgendes prcises,
1.
[Confrence
faite
Paris,
au Petit
Palais,
le 28 mai 1920 et
publie
Revue
archologique,
1924, II, p. 04-79].
16 L'HISTOIRE DES GESTES
commodes classer dans diverses
sries,
suivant
qu'un
des
personnages reprsents
fait tel ou tel
geste qui
est
l'objet
de
l'enqute.
J 'ai tent
quelque
chose
pour
faciliter cette tude en
publiant
dix-neuf volumes de
dessins au
trait,
d'aprs
les oeuvres de l'art
prhisto-
rique,
les
sculptures
et vases
antiques,
les
peintures
antiques
et de la Renaissance
;
mais
pour oprer
sur
des sries de documents suffisamment
compltes,
il
faudrait au moins dix fois
plus
de matriaux. Ce sera
l'oeuvre de ceux
qui
continueront mon travail
; pour
l'instant,
il faut se contenter de ce
qu'on
a sous la
main,
sans se
permettre d'affirmer, par exemple, que
tel
geste
ne se rencontre
pas
avant telle date. Il faut tou-
jours
formuler cette
rserve,
et
je
la formule une
fois
pour
toutes : dans Vtat de mes connaissances. Du
jour
au
lendemain,
un monument rest
ignor,
miniature
ou manuscrit
dat,
peinture
ou
sculpture, peut obliger
de retirer ou de restreindre une affirmation.
Personne ne niera
que
les
gestes
aient une histoire
dans les arts encore nafs et
qui
cherchent leur
voie,
l o l'artiste ne
possde pas
encore l'habilet
technique
qui
lui
permette
de rendre toute sa
pense.
Les Grecs
savaient
dj que
les
sculpteurs primitifs
avaient
repr-
sent les hommes avec les bras colls au
corps
et les
jambes
serres
;
ils faisaient honneur
Polyclte,
vers
450,
d'avoir le
premier,
dans la
statuaire,
fait
porter
le
poids
du
corps
sur une seule
jambe.
Les historiens
modernes de l'art ont montr
par quels progrs,
diffi-
ciles dater
exactement,
les
sculpteurs grecs
ont
dtach les bras du
corps
et leur ont donn diffrentes
attitudes
significatives, par exemple
celle du
repos
(une
main sur la
hanche)
ou du discours
(un
bras
tendu).
Ils ont mis en
lumire,
mais de notre
temps
seulement
(1892),
le
passage
de ce
qu'on appelle
la
frontalit
la libert des mouvements du
corps.
Cette
frontalit
caractrise l'art
grec jusque
vers l'an 500 et
L'HISTOIRE DES GESTES
17
celui de tous les
peuples primitifs.
Elle ne
permet pas
que
le cou ou la
partie
infrieure du tronc s'cartent
d'une
ligne
verticale mdiane
qui
va du sommet du
crne au bas du ventre. Par
suite,
les mouvements ne
peuvent
tre
reprsents que
d'une manire raide et
imparfaite
: c'est comme
l'expression plastique
d'un
tat de civilisation o la convention et l'habitude
emprisonnent
l'existence des individus. Le bas-relief
chappa
d'abord cette loi en Grce
;
la
sculpture
en
ronde bosse ne
commena
s'y
soustraire
qu' l'poque
des frontons
d'gine. Aujourd'hui
mme,
toutes les
figures
en ronde bosse de l'art
ngre,
de l'art
polyn-
sien et mme de l'art vraiment
populaire
dans nos
pays
d'Occident obissent la loi de frontalit.
Une fois les difficults
techniques surmontes,
l'ar-
tiste devenu matre de son motif et de sa
matire,
il
semblerait
que
l'art dt
conqurir rapidement
le domaine
immense des
gestes
et des attitudes
possibles
et
pr-
senter,
cet
gard,
la mme varit
que
la nature.
Mais une visite
rapide
dans un muse nous convainc
qu'il
n'en a
pas
t ainsi. Laissons l'art
gyptien,
encore
soumis,
malgr
sa
perfection technique,
la
frontalit
1,
et
parcourons
les salles
d'antiques
du Louvre : une fois
notre attention veille sur ce
sujet,
nous serons
frapps
de la
monotonie,
du
petit
nombre des
gestes,
des
rp-
titions sans fin de
gestes connus,
devenus convention-
nels. L'art
byzantin
et l'art chrtien occidental
ajou-
trent
quelques
motifs au
rpertoire
cr
par
l'art
paen,
mais combien ils en laissrent tomber dans
l'oubli ! Ceux-ci furent en
partie
remis la mode
par
la
Renaissance
;
mais cette
priode mme, malgr
le
gnie
de
quelques grands
hommes,
notamment de Donatello
et de
Michel-Ange,
fut loin de
puiser
librement au
trsor
que
la nature lui offrait. Sans
doute,
le
plus
1. Il
y
a des
exceptions,
surtout dans la
petite sculpture.
S. REINACH
18 L'HISTOIRE DES GESTES
illustre des thoriciens de l'art cette
poque,
Lo-
nard de
Vinci,
avait insist sur la varit infinie dos
choses et de leurs
aspects
;
il avait vivement recom-
mand
qu'on y
chercht des
enseignements directs,
car
l'artiste,
disait-il
spirituellement,
devait tre le
fils et non le
petit-fils
de la nature. Dans la
pratique,
surtout
en ce
qui
concerne les
mouvements,
les conseils
du matre furent
peu
suivis
;
ils ne l'ont t
que
de
loin en loin
jusqu'
nos
jours.
N'incriminons
pas
seule-
ment la timidit des artistes
;
c'est le
public
surtout,
le
public qui juge
et
qui
achte,
dont cette
pauvret
inventive de l'art accuse le
got
routinier. Le
public
est essentiellement
conservateur,
hostile aux nou-
veauts
;
il
apprcie
le
plus
souvent les oeuvres non
d'aprs
leur valeur
expressive propre,
non
d'aprs
leur
conformit avec l'ide
qu'il
s'est faite de la nature ou
du
caractre,
mais suivant leur ressemblance avec
d'autres oeuvres
plus
anciennes
qu'il
s'est habitu
admirer. 11
juge
surtout
par
la
mmoire,
sa mmoire
de visiteur de muse. Celui
qui,
au xvie
sicle,
com-
mande une Sainte Famille ou une Adoration des
Mages,
veut bien
que
ce ne soient
pas
des
copies,
mais il ne
veut
pas
non
plus
d'oeuvres
trop originales qui
le dcon-
certeraient
;
c'est
lui,
au moins autant
que
l'artiste,
qui
assure la lenteur de
l'volution,
la fixit relative
des
types,
des attitudes et des mouvements.
Ainsi l'art
qui
semble le domaine de la
libert, qui,
cet
gard, parat
contraster avec le mcanisme et le
dterminisme de la vie
physique,
est
soumis, quand
on
regarde
distance ses manifestations
pendant plu-
sieurs
sicles,
aux mmes lois d'volution
lente,
stimu-
le de
temps
en
temps par
des variations fcondes dont
l'instrument est un artiste de
gnie;
et
mme, quand
on
regarde
d'assez
prs,
il semble
que
ces nouveauts
qui
nous
frappent
ont t
longuement
et obscurment
prpares,
ou
qu'elles
sont nes d'une influence tran-
L'HISTOIRE DES GESTES 19
gre,
d'un art voluant
pour
son
compte,
d'une ren-
contre de courants.
L'exemple
le
plus frappant peut-tre que
l'on
puisse
citer
j'y
ai consacr
jadis
tout un
petit
volume
1
est celui de la
reprsentation
des animaux aux allures
vives. Tous les chevaux du Parthnon
galopent
de
mme,
appuys
sur un seul sabot
d'arrire,
attitude
exacte,
mais
monotone,
et
qui
ne
correspond qu'
un
seul
temps
de cette allure. Un sicle
aprs,
cette
figu-
ration est abandonne :
depuis 350,
tous les chevaux
galopent appuys
sur les deux sabots
d'arrire,
ce
qui
n'est
pas
l'aDure de la
course,
mais celle du cheval
cabr. Pendant des sicles on ne trouve
pas
autre
chose
;
la seule diffrence est
que
les
jambes
d'arrire
sont tantt
tendues,
tantt inflchies. La Renaissance
copie l'antique ; personne
n'innove
jusqu'
la fin du
xvme sicle et
alors,
sous des influences
que j'attribue
l'art de
l'Extrme-Orient, qui
avait
adopt
des
conventions
diffrentes,
on commence
reprsenter
des chevaux au
galop qui planent
dans
l'air,
les
quatre
jambes tendues,
sans toucher le sol. C'est l'attitude
des chevaux de course de
Gricault, emprunte
des
modles
anglais,
attitude
physiquement impossible,
except
dans le saut d'une
barrire,
et
qui implique que
l'animal
,
un moment
aprs,
retombe avec ses
quatre
sabots sur le sol. Rien
que
la trace des sabots des ani-
maux
galopant
dans un
mange
aurait d rvler
l'absurdit d'une telle attitude
;
mais le
public y
a
pris
got;
il
l'exige
non seulement des
peintres
de
batailles,
de chasses et de
courses,
mais des
lithographes,
des
graveurs
sur
bois,
des
sculpteurs mme,
et cela
jusqu'en
1885 au moins.
Alors,
clairs
par
la
photographie
instantane,
quelques
artistes,
en
premire ligne
Aim
1. S.
Reinach,
la
Reprsentation
du
galop
dans Fart ancien et
moderne, Paris, Leroux,
1901
(extrait
de la Revue
archologique,
1900-1901; rimprim
en 1925 avec
additions).
20
L'HISTOIRE DES GESTES
Morot,
au Salon de
1886,
montrent des chevaux
qui
galopent
vraiment
;
le
public
est
ahuri,
il
regimbe,
et la
critique
se fait
l'interprte
du dsarroi du
public.
De
quel
droit
gne-t-on
ses habitudes visuelles ? Il
faudra dix ans encore
pour que
le dernier cheval sus-
pendu
en l'air comme un livre une broche retrouve
l'quilibre qui
lui
permet
de se mouvoir
et son indis-
pensable point d'appui
sur le sol.
Autre
exemple.
L'art de la
Renaissance,
la diff-
rence de celui du
moyen ge,
se
permet
de
reprsenter
la nudit
;
mais on a vite fait le
compte
des
aspects
sous
lesquels
il l'a offerte nos
yeux.
Ce
qui
nous
parat
le
plus
nouveau et le
plus
hardi n'est souvent
qu'une
rsurrection de
l'antique
: ainsi
Michel-Ange
lui-mme
emprunte
sa Lda et sa Nuit un
sarcophage
romain
;
Titien
copie
sur le Laocoon son Christ couronn
d'pines.
C'est encore
l'antique qu'il emprunte
un motif
compl-
tement
inco^tokde
la haute Renaissance et
qui
a fait
une
clatanl(W^^ine.
L'art
grec,
ds le me sicle avant
notre
re,
avait
figur
des
nymphes
ou des
hermaphro-
dites couchs sur le
ct,
sans
voiles,
rvlant au
spec-
tateur toutes les
splendeurs
de leur torse. Nouveaut
un
peu
tardive, d'ailleurs,
car
depuis que
les femmes
se couchent
pour
dormir,
on en a vu dans cette
attitude,
et l'art
grec, qui reprsente
des femmes nues ds le
ve
sicle,
a mis deux cents ans les
figurer
ainsi cou-
ches. Mais cette
nouveaut,
due
probablement
la
peinture,
eut un
grand
succs :
jusqu'
la fin de l'anti-
quit,
mme sur des
sarcophages,
tant en
sculpture
qu'en peinture,
on trouve sous cet
aspect
des
nymphes
pies par
des
satyres,
Ariane endormie Naxos atten-
dant Bacchus. Ce
qu'il y
a d'un
peu
sensuel dans ce
motif devait naturellement le bannir de l'art
chrtien;
mais
pourquoi
la Renaissance ne l'a-t-elle
pas repris,
elle
qui ignorait
ces
scrupules,
elle dont les
Suzanne,
les
Bethsab,
les Diane
surprises par
Acton sont sou-
L'HISTOIRE DES GESTES
21
vent si libres d'allures ? Est-ce
que
Lonard de
Vinci
Michel-Ange
et
Raphal
n'avaient
jamais
vu un
modle couch ? Cherchez cette attitude dans l'art
de la Renaissance : moins d'tre
plus
heureux
que
moi,
vous n'en
trouverez,
comme
moi, qu'un
seul
exemple,
datant de 1570 environ. C'est dans un
tableau
de l'extrme vieillesse du
Titien,
au muse de
Vienne,
qui reprsente
une
nymphe
couche et un
berger
assis
prs
d'elle 1. Titien a-t-il retrouv ce motif
pour
l'avoir
observ, pour
en avoir ressenti le charme ? Certaine-
ment non. Il l'a
emprunt
un bas-relief
antique. Et,
cette
fois,
la nouveaut reste
isole,
sans doute
parce
que
le tableau du
Titien,
dont on
ignore l'histoire,
demeura cach dans
quelque palais.
Pour trouver un
second
exemple,
il faut descendre
jusque
vers 1655 :
c'est la Vnus couche de
Vlasquez $
la Galerie natio-
nale de Londres.
Vlasquez
a-t-il vu et imit le tableau
du Titien ?
A-t-il,
son
tour,
vu en Italie un bas-relief
antique
? J 'incline vers la
premire hypothse.
J e ne
poursuis pas
l'histoire de ce motif au xvme
sicle,
o
il devient assez
frquent
dans l'art des boudoirs
;
mais
je
constate
qu'il
l'est surtout dans le dernier tiers du
xixe sicle et
j'en
trouve encore une
explication que
me fournissent les curieux souvenirs du
marquis
de
Chennevires,
ancien directeur des Beaux-Arts. Au
Salon de
1863, Baudry exposa
le tableau intitul la
Vague
et la Perle
;
la
Vague
est une admirable
figure
dans la
posture
dont
je parle.
J e ne chercherai
pas
ce
qu'il peut
devoir
Ingres,
ni ce
que Ingres
lui-mme
doit
l'antique
: cela m'entranerait
trop
loin. Le
succs de
Baudry
fut
grand. L'impratrice Eugnie
acheta cette
peinture. Aussitt,
tous les artistes vou-
1.
Rp.
de
peintures,
t.
VI, p.
244. J 'ai
signal
rcemment la mme
attitude dans le
croquis,
seul
conserv,
d'un tableau vnitien dis-
paru, appartenant peut-tre
au dbut du xvie sicle
(Rev. arch.,
1923, II, p. 359).
22
L'HISTOIRE DES GESTES
lurent
imiter l'oeuvre clbre.
Ce
fut,
dit
Chennevires,
le commencement de cette interminable suite d'tudes
de femmes nues dont nos Salons n'ont
pas
encore,
aprs
vingt
ans
(il
crivait en
1883), puis
la srie.
Pourtant,
je
le
rpte,
il
s'agit
d'un motif
qui
n'a rien de rare ou
d'instantan
;
c'est un motif
qui,
ds les
temps pr-
historiques,
s'est
prsent
continuellement aux
yeux
des
hommes,
dont la nature a t aussi
prodigue que
des bienfaits mmes du sommeil.
Or, que
constatons-
nous ? Une
reprsentation qui
a du succs vers 300
avant J .-C. et
qui
trouve des imitateurs
jusque
200 ans
aprs, pendant cinq
sicles
;
puis,
rien
pendant
treize
sicles
;
puis,
deux
exemples
en 1570 et en 1655
;
puis
quelques
exemples
mais
pas, que je sache,
dans le
grand
art
au
xvme,
et enfin une
vogue excessive,
presque agaante,
de 1863 nos
jours,
motive
par
un
succs de vente au Salon.
Voil,
si
je
ne me
trompe,
une
preuve
bien
frappante que l'art,
celui mme des
plus grands
artistes,
n'est
pas
dans la
dpendance
troite de la nature et
qu'il
ne suffit
pas que
les motifs
existent,
qu'ils
crvent,
pour
ainsi
dire, lesyeux, pour que
l'art consente les traiter. Si
donc,
depuis Lysippe,
le
sculpteur
favori
d'Alexandre,
il s'est trouv nombre de
matres
pour prtendre qu'ils
n'avaient eu d'autre
matre
que
la
nature,
ces artistes se sont
trangement
abuss
;
ils ont sans doute demand conseil la
nature,
mais leur activit s'est surtout exerce dans la voie
trace
par
leurs
prdcesseurs
immdiats et
par
le
got
du
public que
ces
prdcesseurs
avaient form. Du
reste,
s'il en tait
autrement,
si le
gnie
mme
pouvait
prtendre
la
spontanit qu'il
revendique
si volon-
tiers,
on
verrait,
par exemple,
un Delacroix au xve sicle
et un
Mantegna
au xixe. Loin de l : si l'on
parcourt
un muse de
peintures ranges par coles,
comme celui
du
Louvre,
on
distingue
bien les matres crateurs de
la foule de leurs
imitateurs,
mais il
n'y
a ni
disparate,
L'HISTOIRE DES GESTES 23
ni solution
brusque
de continuit. La lenteur vidente
de l'volution
vrifie,
dans le domaine de
l'art,
le mot
d'un
personnage
de Beaumarchais : On est
toujours
le fils de
quelqu'un
! Si l'on a dit
depuis que
l'oeu-
vre d'art tait la nature vue travers un
temprament,
c'est
qu'on
a fait
abstraction de ce
qui
constitue la
trame mme de l'art et de sa vie
collective,
savoir
l'enseignement
de l'cole et la tradition.
Passons un autre
exemple qui
me semble trs
digne
d'intrt.
Est-il
un
geste plus frquent, plus
facile observer
que
celui de l'enfant embrassant des deux bras le cou
de sa mre ? C'est le
geste par
excellence de la tendresse
enfantine.
Il est familier aux visiteurs du Louvre
par
le charmant tableau de Mme
Vige-Lebrun qui
la
repr-
sente avec sa fille.
Maintenant,
allons au Louvre et cherchons des
exemples,
dans l'art
ancien,
de ce motif vieux comme
le monde
ou,
du
moins,
comme la maternit. Nous
ferons des kilomtres sans tre
rcompenss
de notre
zle.
L'Egypte
a souvent
figur
le
groupe
d'Isis et
d'Horus
;
la Grce nous montre
Aphrodite
et
ros,
la Paix et
l'Abondance,
figure par
un tout
jeune
enfant,
les divinits mres dites
Kourotrophes.
J 'ai
cherch
partout
l'enfant entourant de ses bras le cou
de sa mre :
je
ne l'ai
point
rencontr. Peut-tre serons-
nous
plus
heureux en
passant
l'art du
moyen ge
?
Mais,
dans le haut
moyen ge,
la
Vierge
ne caresse
pas
l'Enfant, qui
ne la caresse
pas davantage
: elle le
prsente,
comme dans la scne de l'Adoration des
mages,
l'adoration des fidles. Ce
type
de
majest
s'adoucit et s'humanise au xme
sicle,
surtout au xive
;
l'enfant se tourne vers sa
mre,
il la
cline,
il semble
causer avec elle
;
mais
d'exemple
du motif dont
je
parle, je
n'en connais
point.
Mon attention fut
appele
sur ce
sujet
en
1915,
24 L'HISTOIRE DES GESTES
lorsque
l'on
exposa
au Petit
Palais, parmi
d'autres
oeuvres d'art sauves de la
dplorable
ruine
d'Ypres,
un
petit panneau qui
avait
dj figur
Bruges
l'Exposition
des
primitifs
flamands 1. Ce n'est certes
pas
un chef-d'oeuvre et ce n'est mme
pas,
propre-
ment
parler,
un
primitif,
car il a t
peint,
sans doute
Anvers,
vers la moiti du xvie
sicle, par
un artiste
qui
n'avait rien
d'original. Mais,
l'analyse,
il offre
pour
nous le mme intrt
qu'une
statuette de
l'poque
romaine o l'on
pressent
la
copie
d'un
original grec.
Cette
Vierge,
effondre dans de vastes
draperies
aux
plis multiples,
serrant contre elle un enfant
qui
s'at-
tache
son
cou,
est
beaucoup trop
bonne
pour
le
peintre qui
l'a excute.
Tout, jusqu'au
fond du
pay-
sage aperu
d'un
point
de vue trs
lev,
rappelle
les
grandes
oeuvres flamandes de la
premire
moiti
du xve sicle. Les Anversois du xvie sicle
furent,
en
grande partie,
les
imitateurs,
souvent les
pla-
giaires,
des
Brugeois
illustres du sicle
prcdent ;
cela est vrai mme du
plus
dou des Anversois avant
Rubens, Quentin Metsys,
car
je crois,
avec M. W.
Cohn,
que
ses
Changeurs
du
Louvre, par exemple,
sont
l'imitation d'un tableau
perdu
d'un des Van
Eyck.
C'est encore aux Van
Eyck que
me fait
penser
la
petite Vierge d'Ypres
;
mais il ne suffit
pas
de com-
muniquer
cette
impression
en
passant
: il faut la
justi-
fier.
Voici un tableau hollandais du Muse de Berlin
que
nous
pouvons
dater avec
quelque prcision
et o le
geste
de tendresse
c'est ainsi
que je
le
dsignerai
dornavant
parat
tellement
identique
ce
qu'il
est
dans
le tableau
d'Ypres que
l'hypothse
d'une
1.
Rp.
de
peintures,
t.
V, p.
305. La
question
du motif dont
je
parle
ici a t traite dans le beau livre de Fr.
Winkler,
Der Meister
vonFlmaUe, 1913; je l'ignorais quand j'ai
commenc moi-mme
en recueillir des
exemples.
L'HISTOIRE DES GESTES 25
origine
commune n'est
pas
dmontrer 1. Ce
tableau,
qui
est de fort belle
qualit, reprsente
la
Vierge
et
l'Enfant avec saint J rme en
cardinal,
une sainte
anonyme
et de nombreux dvots des deux sexes
age-
nouills. Une
inscription
en hollandais sur le cadre
nous
apprend que
les
petits personnages
sont les
membres de la famille de Horn et
que
le tableau com-
mmore le dcs de la comtesse J eanne de Horn en
1461. Nous savons
que
le
plus jeune
des fils devint
vque
de
Lige
en 1482
;
il lui fallait encore au moirs
vingt
ans
pour pouvoir prtendre
cette
dignit.
La
peinture
est donc
approximativement
de 1462.
Ce Hollandais
anonyme
aurait-il invent le motif
de tendresse ? Cela n'est
pas
admissible un instant
;
comme le
peintre
du tableau
d'Ypres,
il a d l'em-
prunter,
et
l'emprunter
un
original
clbre,
de ceux
qui
ont trouv de tout
temps
des imitateurs.
Heureusement,
je peux
en fournir la
preuve. Voyez
cette
peinture
de l'ancienne collection
Cernuschi,
dont
j'ignore
le
possesseur
actuel : elle a t
photographie
quand
elle
passa
en vente Paris en
1900,
sous le nom
ambitieux de
Rogier
van der
Weyden (1400-1464)
2.
C'est un
sujet
fort rare : un
donateur,
qui
a l'allure
d'un roi
mage,
s'avance vers la
Vierge
assise
que
cou-
ronnent deux
anges
et
auprs
de
laquelle
se tient
saint
J oseph.
La scne se
passe
sous un
portique
soutenu
par
des colonnettes romanes
analogues
celles
qu'on
voit dans le tableau de Van
Eyck
au Louvre
;
le mouvement des
anges
couronnant la
Vierge rappelle
le mme chef-d'oeuvre. D'autre
part,
le saint
J oseph
est bien dans
le
style
de
Rogier
ou d'un de ses imi-
tateurs immdiats. J e suis au
regret
de n'avoir
jamais pu
dchiffrer
l'inscription
moiti efface du
1.
Rp.
de
peintures,
t.
I, p.
264. 2.
2.
76irf.,
t.
II, p. 113,
1.
26 L'HISTOIRE DES GESTES
cartel,
qui permettrait peut-tre
de
prciser.
Mais l'as-
pect
du tableau suffit me convaincre
qu'il y
a l une
oeuvre de second
ordre,
inspire
la fois de Van
Eyck
et de
Rogier,
excute
peut-tre
dans l'Italie du
Nord,
o l'avait
acquise Cernuschi,
mais certainement
par
un artiste
plagiaire.
Le motif de tendresse
s'y
retrouve
pareil
ce
qu'il
est dans les deux tableaux
prcdents.
Que Rogier
ait trait ce
motif,
nous en avons la
preuve
dans un dessin de Dresde
qui
lui est attribu
depuis longtemps
et
qui,
du
moins,
reproduit
un de
ses cartons. Mme
portique
colonnettes
romanes,
mme
geste
de tendresse
;
entre ce dessin et le tableau
Cernuschi,
il
y
a certainement un
rapport
troit.
Avant d'aller
plus
loin et de remonter
plus haut,
je
veux dmontrer
que l'original
du
geste
de tendresse
devait tre bien
clbre,
parce qu'il
trouva des imita-
teurs trs
suprieurs
aux artistes dont
j'ai
dcrit
jus-
qu' prsent
les tableaux. Voici une
Vierge
embrasse
par
l'Enfant de la collection Bordonaro Paenne 1.
Le
style
est celui du
Brugeois
Grard
David,
1460
1523, plutt
de sa
jeunesse,
vers 1485. Mais ce n'est
pas
un
original.
C'est une des trs nombreuses
rpliques
d'un tableau
perdu
ou du moins d'un
original que je
n'ai
pas
vu. J e connais
plus
d'une douzaine de
copies
anciennes de cette
peinture
;
il
y
en a une trs bonne
dans une
glise
de Loudun
;
Paris
mme,
au courant
d'un
hiver, j'en
ai vu deux dans des
boutiques
d'anti-
quaires
de la rive
gauche
2. Le nombre de
rpliques
d'un tableau est la
preuve
certaine de la faveur dont il
a
joui.
Or,
le
geste
de tendresse
qui
est ici
parfaitement
1.
Rpertoire,
t.
III, p.
396.
2. En
1917, j'en
ai vu une Paris chez le
sculpteur Bigot
;
Puvis
de
Chavannes,
me
dit-on,
en faisait
grand
cas. Il
y
en a
plusieurs
Bruges,
une autre
l'abbaye
du Parc
prs
de
Louvain,
etc. La
liste de
rpliques
donne
par
Winkler
(op. I., p. 65)
est
insuffisante,
mais il
n'y
a
pas grand
intrt la
complter.
L'HISTOIRE DES GESTES 27
rendu n'est
pas
de l'invention de Grard David vers
1485, puisque
nous en avons
dj
vu des
exemples
de
vingt
et trente ans
plus
anciens
;
si donc Grard
David a
figur
ce
geste,
dans un tableau maintes fois
copi,
c'est
qu'il
en a lui-mme
copi
ou imit de
prs
un autre
qui
devait avoir fait sensation au cours de la
gnration prcdente.
Le charmant
Quentin
Metsys
du
Louvre, lgu par
Rattier 1,
est une imitation
beaucoup plus
libre
;
la
composition
a d'ailleurs cela de
particulier que
la mre
et l'enfant
changent
un baiser.
C'est,
ma connais-
sance,
le
premier exemple
de ce baiser dans l'art
;
Metsys,
vers
1490,
a souvent
rpt
cette
composition.
Empruntant
un matre
plus
ancien le
geste
de ten-
dresse,
il l'a
complt par
ce dtail du
baiser,
qui
trans-
forme dfinitivement le
sujet religieux
en
sujet
de
genre.
J ean de Mabuse ou de
Maubeuge,
aussi
appel
Gos-
saert,
n vers
1470,
nous
fournit,
dans un
joli
tableau
italianisant de
Madrid 2,
un nouvel
exemple
du motif
de
tendresse,
videmment driv de la mme
source,
probablement par
l'entremise de son matre Grard
David.
J e
pourrais
m'arrter
Rogier
van der
Weyden et,
sur la foi du dessin de Dresde
qu'on
lui
attribue,
sup-
poser qu'il
avait
peint
vers 1450 le motif de tendresse
et
que
son
tableau,
aujourd'hui perdu,
avait
t sou-
vent imit. Mais
j'ai
la raison
que
voici de remonter
plus
haut.
Le
plus jeune
des frres Van
Eyck, J an,
meurt en
1441. Nous avons de lui une srie de
petits
chefs-
d'oeuvre
signs
et dats. Le
plus
rcent est de 1439 :
c'est la
Vierge
et l'Enfant dite
Vierge
la
fontaine
du
Muse d'Anvers.
1.
Rpertoire,
t.
IV, p. 409,
2.
2.
Ibid.,
t.
I, p.
197.
28
L'HISTOIRE DES GESTES
Ici,
l'enfant enlace d'un bras le cou de sa
mre,
mais
il carte
l'autre, qui
tient une branche de corail.
Des annes 1437
1441,
nous avons trois tableaux
de J an Van
Eyck
: la Sainte Barbe inacheve
d'Anvers,
le
portrait
de sa femme
Bruges
et la
Vierge
d'Anvers.
Nous savons aussi
qu'au
moment de sa mort il travaillait
un
triptyque,
abominablement
dfigur
aujourd'hui
par
des
repeints, qui
se trouve dans la collection
Van
Hellepute
en
Belgique
et a t montr
Bruges
l'Exposition
des
primitifs
flamands.
Hautement
apprci partout,
en Flandre et en Bour-
gogne
comme en Italie et en
Portugal,
J an Van
Eyck
ne s'est certainement
pas
content de
peindre
un tableau
par
an. J e ne crois
pas qu'on puisse
encore
esprer,
mme en
Espagne,
dcouvrir des Van
Eyck
inconnus
;
mais
je
suis
persuad que
les
Brugeois
et les Anver-
sois de la fin du xve et du commencement du xvie sicle
connaissaient,
ne ft-ce
que par
des
dessins,
nombre
d'oeuvres de lui
que
nous ne
possdons plus
ou dont
nous n'avons
que
des
copies.
Une
de ces
copies
est la variante de la
Vierge
la
fontaine
qui, longtemps
attribue au matre
lui-mme,
a
pass
de la
galerie
du roi de Hollande en
Angleterre,
puis
chez
Sedelmeyer
Paris et enfin au Muse mtro-
politain
de New-York.
Ici, pas
de doute : c'est le
geste
de
tendresse,
les deux
bras de l'enfant entourant le cou de la
Vierge.
J e n'ai
pas
vu ce tableau
;
les meilleurs
juges
refusent
d'y
reconnatre un
original.
J e suis de leur
avis,
mais
je
n'admets
pas que
ce soit une
simple
variante
post-
rieure du tableau d'Anvers : c'est la
copie
d'un tableau
perdu
de Van
Eyck contemporain
de
celui-l, par
consquent
de 1439 ou
peu prs.
En mme
temps que
ce tableau de la
Vierge
debout
enlace
par
l'enfant,
J an Van
Eyck
a
pu peindre
une
Vierge
assise
(analogue
la Sainte Barbe
d'Anvers),
L'HISTOIRE DES GESTES
29
galement
enlace
par
le
petit
J sus. Il
y
a
quelque
chose de fort
approchant
sur un des volets extrieurs
du tableau de
Hellepute.
Ce tableau
que je postule,
parce qu'il
me semble ncessaire
pour expliquer
les
autres,
serait
l'original
du tableau
d'Ypres
;
il aurait
aussi t imit
par Rogier qui,
comme tous les Fla-
mands,
a
puis
des
leons
dans les oeuvres des Van
Eyck.
J e n'en veux
pour preuve que
le tableau de
Rogier
reprsentant
saint Luc
peignant
la
Vierge,
connu
par
trois
exemplaires
Munich, Petrograd
et
Boston,
o
l'imitation de la
Vierge
du chancelier Rollin au
Louvre,
tableau
peint par
J an Van
Eyck
vers
1430,
ne saurait
tre conteste.
Peut-on
remonter,
dans l'histoire du
geste
de ten-
dresse,
au del de 1439 ?
Oui,
mais
pas
en Flandre :
en Italie.
Aux environs de
1425,
en
effet,
on trouve un certain
nombre de stucs florentins
reprsentant
la
Vierge
et
l'Enfant
mi-corps,
o l'attitude de l'Enfant est exac-
tement celle du
geste
de tendresse 1. Ce sont des oeuvres
de
prdcesseurs
immdiats de Luca dlia Robbia.
Cet artiste de
gnie,
n en
1400,
mort en
1482, est,
avec
Donatello, 1386-1466,
le vritable crateur du
grand
art italien
;
il est
Raphal, qui
se rattache troitement
lui,
ce
que
Donatello est Lonard et
Michel-Ange.
La
longue
et admirable srie de ses mdaillons de terre
cuite maille
et
peinte
a
t,
de nos
jours, l'objet
de
nombreux travaux
qui
en ont
permis,
dans une cer-
taine
mesure,
le classement
chronologique.
L'un des
mdaillons de
Luca,
dont il existe
plusieurs
variantes 2,
a
pass
de la collection
Emile Gavet Paris dans celle
de M. Bliss New-York. Le
geste
de tendresse est ici
figur
de la manire la
plus prcise
et la
plus
char-
mante. Pour la
date,
les estimations des
spcialistes
1.
Venturi, Storia,
t.
VI, fig. 131,
148
;
La
Madonna, p.
26.
2. Allan
Marquand,
Dlia Robbias in
America, p.
8.
L HISTOIRE DES GESTES
varient de 1437 1450
; j'incline
prfrer
la date
la
plus
haute,
par
cette raison entre autres
que
le
geste
de
tendresse, qui
ne se trouve
pas
ailleurs dans l'oeuvre
de
Luca,
se
rencontre,
comme
je
l'ai
dit,
dans
quelques
stucs
qui
ont
prcd
la srie de ses mdaillons 1. C'est
donc
Florence,
vers
1425, que
l'on
peut,
dans l'tat
de mes connaissances
ce
qui
n'exclut nullement la
possibilit
d'une
grosse
erreur
placer
la
premire
apparition
de ce
geste
dans l'art.
Si,
comme nous l'avons
vu,
il
parat
dans l'art flamand en
1439,
on
peut
admettre,
soit deux inventions
indpendantes
des
dates
voisines,
ce
qui
est une solution un
peu trop
commode,
soit l'influence d'un modle florentin sur J an
Van
Eyck.
Cette solution est la mienne.
L'influence de l'Italie sur les Van
Eyck
est
aujour-
d'hui incontestable. Sinon les deux Van
Eyck,
du
moins l'un d'eux a t
prendre
contact avec l'art de
l'Italie crivait mon minent ami Paul Durrieu 2.
Six ou
sept peintures
des Van
Eyck
montrent au fond
des
montagnes
couvertes de
neige,
souvenir vident
d'un
voyage
en Suisse et en Italie
;
on
y
a aussi reconnu
des
palmiers
et d'autres
plantes
de la flore mridionale.
Enfin,
M. Durrieu a
signal
des
analogies
incontes-
tables entre le Calvaire de Hubert Van
Eyck
l'Ermi-
tage
et la
composition
d'Altichieri et
J acopo
da Avanzi
Padoue, qui
a t
peinte
vers 1360. On doit d'ailleurs
rappeler que
J an Van
Eyck
n'a
pas
t seulement
attach au duc de
Bourgogne
en
qualit
de
peintre ;
de
1426
1436,
il
reut
des rtributions
spciales pour
certains
voyages
lointains dont les
comptes
ne
spci-
fient
pas l'objet,
en dehors de ceux
qu'il
fit en
Aragon
et en
Portugal (1427-1428).
On a tout lieu de croire
qu'il
alla aussi en Italie.
J e ne suivrai
pas davantage,
faute de connaissances
1.
Venturi, Storia, VI, p.
232.
2. Gazette des
Beaux-Arts, 1920, I, p.
100.
L'HISTOIRE DES GESTES
31
assez
tendues,
l'histoire du
geste
de tendresse
;
j'en
connais,
dans la seconde
partie
du xve sicle et au
xvie,
un
petit
nombre
d'exemples italiens,
flamands
et
allemands
;
mais la
preuve que
ce
geste
familier et
naturel
resta,
dans l'art du
moins,
un
geste rare,
c'est
que je
ne le trouve dans aucune Madone de Lo-
nard,
de
Raphal,
de
Corrge,
de Titien. Raison de
plus,
je crois,
pour
lui attribuer une
origine unique quand
on le rencontre en Italie et en Flandre aux environs de
1430,
dans deux
coles d'art entre
lesquelles
les rela-
tions devaient tre
nombreuses,
non seulement
par
suite
des
voyages
des
artistes,
mais en
consquence
de la
migration
des oeuvres
portatives
petits tableaux,
miniatures et reliefs de stuc.
Mon
objet principal,
dans ce
qui prcde,
a t
d'appeler
l'attention sur
l'importance
de l'histoire des
motifs
;
pour peu que
l'on essaie de reconstituer celle
d'un motif
quelconque,
une course travers les Muses
ou
simplement
l'tude d'une collection de
photographies
prend
un intrt nouveau et un surcrot d'attrait. J 'ai
aussi
signal
avec insistance la lenteur avec
laquelle
les
motifs,
mme les
plus frquents
dans la
nature,
acquirent
droit de cit dans l'art. A cet
gard,
toute-
fois,
une
conqute
rcente de la science a
complte-
ment modifi l'tat de choses antrieur :
je parle
de
la
photographie instantane,
annonce ds 1878
(par
exemple
dans le
Magasin pittoresque),
mais dont
l'in-
fluence sur l'art n'est devenue sensible
qu'
partir
de
1885 environ.
Si,
vers
1950,
on fait une
exposition
d'un sicle d'art
franais,
on sera
frapp,
bien
plus qu'on
ne
peut
l'tre
aujourd'hui,
des rsultats
artistiques
de cette dcouverte. Les
gestes
nous sont devenus
familiers,
non seulement dans leur aboutissement sta-
tique, qui
est
l'attitude,
mais dans toute la varit
de leurs
progrs,
o ils
chappaient
la
prise
de la
vision. Le
plus grand
dessinateur
moderne, Degas,
le
32 L'HISTOIRE DES GESTES
premier qui
ait
reprsent par
centaines des
gestes
et
des attitudes encore inconnus de
l'art 1,
est
inexplicable,
dans sa maturit si
fconde,
sans la
photographie
ins-
tantane. N en
1834,
mort
plus qu'octognaire
de nos
jours, Degas
a
pu
connatre les rsultats de la
photo-
graphie
instantane
depuis l'ge
de 45 ans environ.
Le ciel me
garde
de dire
qu'il
en ait
calqu
ou
copi,
bien
que je
ne voie
pas
ce
qu'il pourrait y
avoir l de
blmable,
Lonard lui-mme s'tant servi d'un
moyen
mcanique
comme la chambre
claire,
dont on
prtend
qu'il
aurait t l'inventeur
;
mais
que Degas,
dessina-
teur de femmes et de
chevaux,
matre incontest de la
figuration
du
mouvement 2,
ait t instruit
par
la
pho-
tographie
instantane
et son driv immdiat le
film,
c'est ce dont l'vidence des oeuvres de son
ge
mr
ne me
permet pas
de douter. J 'ai nomm
Degas
;
j'en pourrais
nommer d'autres. Si
l'exposition
de
1950,
que quelques-uns
d'entre nous
verront, comprend aussi,
comme il faut
l'esprer,
des
dessins,
les observateurs
attentifs de ce
temps-l
saisiront le
passage
entre l'art
ancien,
o dominent encore les
formules,
et l'art nou-
veau
qui largit
immensment son domaine et
pntre
tous les secrets du
mouvement,
recherchant de
prf-
rence ceux
qui
n'ont
pas
t
dj
mille fois
figurs,
se
complaisant
dans l'indit et
l'inattendu,
mme dans
le bizarre. Sur la
priode
intermdiaire
qui
vit et voit
encore
s'oprer
cette
grande transformation,
cet accrois-
sement extraordinaire du
pouvoir
de la vision affranchie
de son infirmit
naturelle,
l'historien de l'art inscrira
ces mots comme tte de
chapitre
:
PREMIERS EFFETS DE LA PHOTOGRAPHIE
INSTANTANE
1. Voir surtout le
catalogue,
trs abondamment
illustr,
de la
vente de ses dessins.
2. Voir maintenant P.
J amot, Degas, Paris,
1924.
111
GRANDS ET PETITS BRONZES
Ds le dbut des recherches sur l'histoire de l'art
antique,
on s'est
aperu qu'il
existait
plusieurs
exem-
plaires
de certaines statues de
marbre,
toutes ex-
cutes
l'poque
romaine. Les restaurateurs de statues
antiques
ont
appris
de bonne heure tirer
parti
de
deux ou
plusieurs rpliques
mutiles
pour obtenir,
en les
combinant,
une statue
complte.
Winckelrnann
a dit
quelque
chose ce
sujet
au livre X de son Histoire
des arts du dessin chez les anciens
(d. Fea,
t.
II, p. 280)
:
Le
prix
lev
que
l'on
payait
alors
(aprs
Alexandre
le
Grand) pour
les vieux livres induisit les faussaires
attribuer leurs
propres
oeuvres des crivains
clbres;
par
la mme
raison,
des artistes vendirent leurs oeuvres
sous les noms des
grands
matres des beaux
temps
de
l'art... C'est vraisemblablement alors
que
commena
l'poque
des
copistes, auxquels
il faut
rapporter
ces
nombreux
Satyres
tous semblables entre
eux, qui
me
paraissent copis
du clbre
Satyre
de Praxitle. On
peut
en dire autant de
quelques
autres
figures qui
reproduisent
le mme
modle, par exemple
deux
Silnes tenant dans leurs bras Bacchus
enfant,
au
palais
Ruspoli, qui
sont absolument semblables au fameux
Silne de la villa
Borghse [aujourd'hui
au
Louvre],
ainsi
que
des diverses
reproductions
de
l'Apollon
Sau-
1.
[Mmoire
lu l'Acadmie des
Inscriptions
le 25 aot 1922
(Comptes rendus, p. 298)
et
publi
Revue
archol., 1924, I, p.
227-237.]
S. REINACH 3
34 GRANDS ET PETITS BRONZES
roctone,
copies
sans doute de celui de
Praxitle,
qui
tait clbre sous ce nom. On connat aussi
beaucoup
de Vnus dans la mme attitude
que
celle de ce
sculp-
teur,
ainsi
que
des
figures d'Apollon
avec le
cygne
ses
pieds,
le bras
reposant
sur sa tte.
L'abb Fea
fait
observer,
en note de l'dition
italienne, qu'on peut
ajouter
cette liste des
copies
du Discobole de
Myron
;
mais, dit-il,
comme
l'original
du Discobole tait en
bronze,
ainsi
que l'Apollon
Sauroctone de
Praxitle,
les
copies
de ces statues en marbre n'ont
pu
tre ex-
cutes
pour tromper
les acheteurs. Fea
remarque
encore
que
Winckelrnann, parlant
des nombreuses Vnus
semblables entre
elles,
a sans doute entendu
parler
des
rpliques
de la Vnus de Mdicis Florence
plutt
que
des deux imitations de la Vnus de Cnide existant
au Vatican.
Les
archologues
ont
pris
et conservent la fcheuse
habitude
d'employer
d'une
faon
peu prcise
et
presque
comme
synonymes
les termes de
rplique,
de
copie,
d'exemplaire
et d'imitation. Dans un mmoire sur les
copies
de
statues,
publi
en
1896, Furtwaengler essaya
de
prciser
le sens de ces termes. Il
distingua
les
copies
libres,
excutes
d'aprs
des
maquettes
et au
jug,
des
copies exactes,
vritables
rpliques,
pour lesquelles
on se servait
l'exemple
de
Pasitle, pensait-il
de
moulages
en
pltre.
L'anne
suivante,
dans un
compte
rendu de son travail
(Reue critique,
1897, I,
p. 46)
et
depuis
plusieurs reprises 1, j'ai
insist sur une
distinction
qu'il
n'avait
pas
faite et
qui
me
parat
essentielle. Des textes de Lucien et de
Plutarque
prouvent que
les
anciens,
du moins
l'poque
grco-
romaine,
moulaient des statues de bronze
;
mais il
n'est
jamais question
du
moulage
d'une statue de
marbre,
encore moins de celui d'une statue
chrysl-
1. Voir S. Reinach. Cultes, t.
II, p.
338 et suiv.
GRANDS ET PETITS BRONZES 35
phantine.
Cela se
comprend
aisment,
car les statues
chryslphantines
taient
fragiles
et les statues de
marbre taient revtues d'une
polychromie que
le mou-
lage
aurait dtruite ou altre.
J 'expliquais
ainsi
Furtwaengler
en tomba d'accord
pourquoi
nous
possdons
des
copies
exactes en marbre de
bronzes
clbres,
le Discobole de
Myron,
l'Amazone et
plu-
sieurs athltes de
Polyclte, l'Apollon
Sauroctone de
Praxitle,
l'original
de bronze
(attribu par
Mahler
et moi
Lysippe)
de la Vnus de
Mdicis,
tandis
qu'il
n'existe
que
des imitations infidles et
discordantes
du Zeus
d'Olympie
et de l'Athna Parthnos de Phi-
dias,
de
l'Aphrodite
cnidienne de
Praxitle,
des
marbres
les
plus
admirs
d'Alcamne,
de
Scopas,
etc. Du fait
qu' l'poque grco-romaine
on a moul des bronzes
et
copi
exactement ces bronzes en
marbre,
il
rsulte
que,
si l'on
possde
deux ou
plusieurs rpliques
concor-
dantes d'une statue
antique,
on
peut
conclure
ou,
du
moins, supposer
avec trs
grande
vraisemblance
que
l'original
tait en bronze. Mais la difficult consiste
tablir
qu'il s'agit
bien de
rpliques
fidles et concor-
dantes dans tous les dtails essentiels. Pour
cela,
des
photographies
mme
grande
chelle ne
peuvent
suf-
fire,
moins
qu'elles
n'aient t
prises
exactement sous
le mme
angle.
Mme des
moulages peuvent
induire en
erreur cause des modifications souvent considrables
auxquelles
les
originaux
mutils ont t soumis
par
les
restaurateurs. II faudrait
poursuivre
de
pareilles
tudes
dans un muse de
moulages
extrmement
riche,
comme
il n'en existe encore nulle
part,
o toute restauration
moderne serait
indique par
une teinte sur le
moulage
mme. Arthur
Malher, quelque temps privat-docent
Prague, qui
mourut
pendant
la
Guerre,
avait
conu
le
projet
d'un a Recueil de
rpliques
(Replikenschatz),
o il devait numrer
pour chaque type,
en le
figurant
par
la
photographie,
les
rpliques existantes,
les
copies
36 GRANDS ET PETITS BRONZES
libres et les imitations. Il
y
avait l du travail
pour
toute une vie et il est craindre
que
nous n'attendions
longtemps
la ralisation du
projet
de Mahler. Mme
les muses de
moulages
les mieux
fournis,
ceux de Stras-
bourg, Lyon,
Dresde et
Berlin,
sont insuffisants
pour
une
pareille tude,
car les trois
quarts
des
sculptures
qu'ils exposent
sont des oeuvres
clbres, toujours
les
mmes dans les diffrents
muses,
ce
qu'explique
assez
le but
pdagogique
de ces institutions
;
le nombre
immense de torses
isols,
ou
qui
ont servi
fabriquer
des
statues
mdiocres,
n'attire
pas,
sauf
exception,
l'at-
tention des mouleurs. Bien des constatations
impor-
tantes, qui
seraient autant de
dcouvertes,
sont donc
rserves un avenir
plus
ou moins lointain.
Une
longue
familiarit avec la statuaire
antique
me
permet aujourd'hui
de
complter
ce
que j'ai
crit en
1897,
en
nonant
les deux
principes
suivants,
le
pre-
mier remontant cette
date,
le second nouveau et
quelque peu imprvu
:
1 A
l'poque grco-romaine,
on moule en
pltre
des
bronzes seulement et on les
copie
ainsi
fidlement
en
marbre
;
2 A
l'poque grco-romaine, ft-ce
sur le Rhin ou sur
le
Danube,
il
n'y
a
pour
ainsi dire
pas d'exemples
de
bronzes, grands
ou
petits, qui
soient des
reproductions
fidles d'originaux
en marbre ou
chryslphantins.
Ainsi,
les
grands
bronzes de la
galerie
Denon au
Louvre
(fontes
de Primatice et des
Keller), qui
sont des
reproductions fidles,
excutes
d'aprs
des
moulages,
d'originaux
en
marbre, rpondent
au
got
moderne,
mais auraient t
jugs
intolrables
par
les
anciens,
sauf dans le cas o les
originaux
en marbre surmou-
ls ne sont eux-mmes
que
des
copies
anciennes en
marbre
d'originaux
en bronze
(Apollon
du
Belvdre,
Aphrodite
de
Mdicis, etc.).
Nos demeures sont
pleines
de
petites copies
fidles en bronze de la Vnus
GRANDS ET PETITS BRONZES 37
de
Milo,
du Mose de
Michel-Ange,
de la J eanne d'Arc
de
Chapu, etc.,
autant de
sculptures
conues
par
des
marbriers,
excutes en marbre : il
n'y
a rien de tel
dans
l'antiquit.
J e ne connais de
petits
bronzes ni
d'aprs
le Zeus
d'OIympie,
ni
d'aprs
l'Athna Parthnos ou la Hra
d'Argos
;
je
n'en connais
pas davantage d'aprs
les
marbres
d'Alcamne,
de
Scopas,
de
Praxitle,
ni
d'aprs
le
groupe
des trois Grces dont
l'original,
comme en
tmoignent
les
divergences
trs fortes des
exemplaires
conservs,
tait certainement en marbre. On
objec-
tera
peut-tre
l'Herms
portant Dionysos
enfant,
autre-
fois dans la collection Danicourt au Muse de Pronne
1
;
mais c'est bien tort
qu'on
a mis ce
joli
bronze en
rapport
avec le marbre de Praxitle
Olympie ;
c'est
bien
plutt
une
copie
du bronze de
Cphisodote, qui
reprsentait
le mme
sujet.
J e concde
que parmi
les
bronzes de la collection De
Clercq,
il s'en trouve un
qui reproduit
le motif de la Cnidienne
2
;
mais on
peut
douter
qu'il
soit
antique.
Voici ce
qu'en
a dit De Ridder
(p. 6)
:
Bronze assez
mdiocre, auquel
sa mauvaise
patine
donne un faux air de
surmoulage,
mais
qui
est
la
copie
mal venue d'un bon
original.
Les bronzes
suspects
et
plus que suspects
ne sont
pas
rares dans la
collection De
Clercq
comme ailleurs.
Des
objections plus spcieuses pourraient
tre fondes
sur les
copies
en bronze de deux
figures
clbres, l'Aphro-
dite
accroupie
et
l'Aphrodite
debout tant ou remet-
tant sa sandale. Les
petits
bronzes
qui reproduisent
le
second motif sont trs nombreux
;
du
premier,
j'en
1.
Rp. stat., II, p. 173,
4.
2. Coll. De
Clercq. Bronzes, p. II,
n. 4. Les nM 5 et 6 ne sont
que
des
imitations trs libres. Il est
clair,
crit A. de
Ridder, que
l'artisan
ne cherche aucunement
copier
la statue de
Cnide, que
sans
doute
il n'a
jamais
vue
;
tout au
plus
essaie-t-il d'en
rappeler
l'attitude,
sans se
piquer
aucunement de fidlit.
38
GRANDS ET PETITS BRONZES
connais
aujourd'hui
trois
(Muse britannique,
collec-
tion Bonnat
Bayonne,
collection
Durighello),
ce der-
nier
exemplaire
d'assez
grande
dimension
(prov.
indi-
que
:
Beyrouth). Or,
Pline
signale
Rome, parmi
les
marbres
clbres 1,
une Vnus
qui
se
lave,
oeuvre de
Doidalss 2,
et une Vnus debout de
Polycharmos,
o
j'ai propos,
en
1906,
de reconnatre la Vnus
ajustant
sa sandale 3.
Depuis Visconti,
on considre les
Aphro-
dites
accroupies
de nos muses comme des
copies plus
ou moins libres du marbre de
Doidalss, appel
autre-
fois tort Daidalos. Il semble
donc,
au
premier abord,
que
ma thse soit en dfaut : deux statues de marbre
nous seraient connues la fois
par
des marbres et des
bronzes. Mais
l'objection
n'est
pas
difficile carter. En
ce
qui concerne, d'abord, l'Aphrodite pose
sur un
pied,
les
exemplaires
en marbre et en bronze
prsentent
tant
de
divergences qu'il
est
impossible
de les faire remonter
un mme
original.
Le motif a d tre cr avant
Poly-
charmos
;
le
sculpteur
a
excut,
en
marbre,
une
Aphro-
dite
pose
sur un
pied,
comme nous
disons, par exemple,
que
Falconet a
sculpt
une
baigneuse,
mais sans
impli-
quer que
le
type
de la
baigneuse
ait t cr
par
Fal-
conet. Du
reste, pour
sduisante
que
me
paraisse
encore
mon
hypothse
sur la stans
(pede
in
uno)
de
Polychar-
mos,
cela reste une
hypothse
et l'on
peut
s'abstenir
de
btir des conclusions l-dessus.
Avec l'oeuvre de Doidalss nous sommes sur un
terrain
plus
solide.
L'opposition indique,
dans le texte
de
Pline,
entre la Venus lavons et la Venus
stans, prouve
que
la
premire
tait
figure accroupie.
Mais il est bon
de
rappeler que
cette attitude tait connue de l'art
grec longtemps
avant
l'poque
o l'on
peut placer
le
sculpteur bithynien
Doidalss. Une
pierre grave
4.
Pline, XXXVI,
35.
2. Th.
Reinach,
Gazette des
Beaux-Arts, 1897, I, p.
314.
3.
Comptes
rendus de
l'Acad., 1906, p.
306.
GRANDS ET PETITS BRONZES 39
trouve dans la Russie Mridionale
1
et le clbre vase
de Gamiros au Muse
britannique
2
prouvent que
le
motif de la femme nue
accroupie
existait avant la fin
du ve sicle. D'autre
part,
les
exemplaires
bien connus
de
l'accroupie
abstraction faite de marbres restau-
rs outrance et
qu'il
vaut mieux carter du dbat
permettent
de
distinguer
au moins
quatre
varits
de
motifs,
qui
ne
peuvent
tre ramens un
original
commun : 1 Le bras droit est
coud,
la main releve
vers le sein
gauche,
le bras
gauche
abaiss vers le milieu
du
corps
;
type
du Vatican
3
et du bronze de
Beyrouth;
2 Les deux bras sont couds
paralllement
comme
pour
saisir et
presser
des mains deux torsades de che-
veux; type
d'une terre cuite de
Myrina
4;
3 Sur un
sarcophage
du
Louvre,
la desse
(ici
une Artmis au
bain)
tient dans ses bras couds des torsades de
cheveux,
tandis
qu'un ros,
plac
derrire
elle,
lui verse sur le dos
le contenu d'un vase
6
;
4 La desse lve le bras droit
et touche de sa main droite le sommet de sa tte
;
type
d'une statue de Madrid 6.
J 'ajoute que
dans
deux
exemplaires
du
type
I,
de Vienne
(Isre)
et
de
Tyr,
l'un et l'autre au
Louvre,
on
distingue
sur
le dos de la desse les restes de la main d'un
ros,
occup,
comme dans le
type
III,
verser de l'eau sur la
desse ou la frictionner
aprs
le bain.
Il ressort de ce
qui prcde que
le
type
I doit driver
d'un
original
de
bronze,
ce
qui peut
encore tre confirm
par
deux
arguments
: 1
L'apparence mtallique
des
plis
sur le ventre de
l'Aphrodite
de Vienne
;
2 Le fait
qu'un moulage partiel
de cette statue a
permis
de
1.
Steph'ani,
Atlas des
Comptes rendus, 1859, pi.
III.
2.
Rayet
et
Collignon, Cramique, p.
76.
3.
Amelung, Vatikan, II, 76, 427, p.
680.
4. Pottier et
Reinach,
La
Ncropole
de
Myrina, pi.
3.
5.
Rp. stat., I, p.
4.
6.
Ibid., p. 348,
2.
40 GRANDS ET PETITS
BRONZES
complter
le
fragment
de
Tyr
au
Louvre, preuve que
ces deux
sculptures reproduisent
exactement un mme
original.
Si donc on admirait Rome une
Aphrodite
accroupie
en marbre de
Doidalss,
elle devait tre
conforme,
non au
type I,
mais l'un des trois autres
que
nous avons
distingus
1.
Les fabricants de statuettes de bronze dans
l'Empire
romain avaient sans dout leur
disposition,
comme
modles,
des
moulages
de bronzes
clbres,
surtout
des
ttes,
et des rductions fidles de
grands
bronzes.
J uvnal dit
qu'on
trouve
partout
des
pltres
de
Chry-
sippe,
d'Aristote et de
Pittacus, pris
sans doute sur des
bustes en bronze de ces
philosophes.
Mais
pourquoi
ces
fabricants de bustes et de statuettes
pour
laraires et
appartements
n'auraient-ils
pas possd
des imitations
plus
ou moins
exactes,
en terre cuite
par exemple,
des
colosses
chryslphantins,
des marbres de
Phidias,
d'Alcamne,
de
Scopas,
de Praxitle ? De
pareilles
imi-
tations devaient
exister,
puisque
nous
voyons que
les
marbriers anciens en ont tir
parti.
Si donc il
parat
que
les bronziers n'en ont fait aucun
usage,
c'est
qu'ils
avaient
pour
cela
quelque
raison dont les textes litt-
raires ne
parlent point
et
qui
doit mme sembler assez
singulire
aux
yeux
des
modernes,
lesquels,
nous l'avons
vu, depuis
le xvie
sicle,
n'ont
pas
hsit
copier
des
marbres en
bronze,
comme
aussi,
mais
beaucoup plus
rarement,
des bronzes en
marbre, juste
l'inverse de ce
que
faisaient les anciens.
J e crois
que
cette raison doit tre
cherche dans la
diffrence
capitale qui
existe entre le
bronze,
matire
dure et
opaque,
et le
marbre,
matire demi
transpa-
rente et facile entailler. Si l'on
copie
du bronze en
marbre,
procd conomique lorsque
le marbre est
1.
[J e
suis revenu sur le
type grec
de
l'accroupie
dans les Monu-
ments
Piot, 1924, p. 119-139.]
GRANDS ET PETITS BRONZES 41
pied d'oeuvre,
le marbre
patin
et
peint peut
rivaliser
en
opacit
avec le
bronze,
en rendre la
prcision
et la
scheresse. Au
contraire,
un marbre
copi
en bronze
conserve les
qualits
du model
que
l'on
dsigne
dans
les ateliers
par
le mot de
flou ;
ces
qualits
ne con-
viennent
pas
au bronze et se tranforment en dfauts.
Cette
constatation une fois faite
et le
grand
nombre
de marbres dits de nos
jours
en bronze
permet
ais-
ment de la contrler
les ateliers
anciens,
depuis
les
plus importants jusqu'aux plus humbles,
auront admis
ce
principe
: une statue de marbre ne doit
pas
tre
copie
en bronze. De mme
aujourd'hui,
et dans les sicles
passs, personne
n'a
song, que je sache,
copier
en
cire
peinte
une
figure emprunte
un tableau
clbre,
par exemple
une
Vierge
de
Raphal.
Il
y
a des
prin-
cipes
de
got qui
se
comprennent
et se transmettent
sans tre noncs. Celui
que
nous
postulons, parce
que
l'tude des bronzes
antiques
le
vrifie,
n'a rien
d'ailleurs
que
de rationnel
;
la seule chose
qui
doive
nous
tonner,
c'est
qu'il
en ait t si exactement tenu
compte,
mme dans les lointains ateliers
provinciaux,
et cela
jusqu'
la fin de
l'antiquit.
Si
j'ai raison,
ce
principe
nouveau
pourra
souvent
tre
invoqu
dans cette
importante partie
de l'histoire
de l'art
qui
se
propose
de
reconstituer,
l'aide de des-
criptions antiques
et de
copies,
l'oeuvre des matres
grecs
et romains. Ainsi Pline
parle
brivement d'une
Aphrodite
de
Scopas qui
tait de son
temps
Rome
et
qu'il
considre comme un chef-d'oeuvre 1. Ce devait
tre un
marbre, puisque
le
passage
de Pline se trouve
dans un
chapitre
concernant les statues de cette matire.
L'Aphrodite
de
Scopas
est d'ailleurs
compltement
inconnue.
Publiant,
dans les Monuments Piot
(I, pi. 21),
une belle statuette en bronze
d'Aphrodite
dcou-
1. Pline. Hist. Nat..
XXXVI,
26.
42 GRANDS ET PETITS BRONZES
verte
Sidon,
M. J amot estimait
que
le nom de
Scopas
pouvait
venir assez naturellement
l'esprit
si l'on
cherchait
dsigner l'original. Or,
le
principe
nonc
plus
haut
permet
d'carter sans hsitation
pareille
hypothse
: une statuette de bronze ne
peut
driver
d'un modle de marbre.
Une autre
application
parmi
celles
qui
me viennent
l'esprit
peut
tre faite la clbre statue du Louvre
connue sous le nom de Venus
genetrix.
J 'en ai
numr,
en
1887,
une soixantaine de
rpliques
et d'imitations
libres,
sans
distinguer
assez exactement entre
elles,
beaucoup
ne m'tant connues
que par
des
descriptions.
Mais si l'on
dfalque
les imitations
pour
s'en tenir aux
rpliques
dont on
peut
constater la
fidlit,
il reste un
grand
nombre de monuments assez semblables entre
eux
pour qu'on puisse postuler
l'existence et
l'emploi
d'un
moulage.
A cela vient
s'ajouter
le fait
que
nous
connaissons deux ou trois rductions
en bronze de la
mme
figure. Donc, l'original
tait en bronze. Du
coup
tombe
l'hypothse,
trs
gnralement adopte,
de
Furtwaengler, qui
considrait cette statue comme une
copie
de
l'Aphrodite
dans les
jardins d'Alcamne 1,
car
cette dernire est mentionne
par
Pline
(XXXVI, 16)
parmi
les statues de marbre. Du
reste,
la scheresse
de la
draperie,
dans
l'exemplaire
du Louvre
qui
est le
meilleur,
suffit veiller l'ide d'un
original
de
bronze,
ce
qui
concorde avec la conclusion
indique plus
haut.
S'il
n'existe,
ma
connaissance,
aucun
petit
bronze
antique qui reproduise
un
original
de marbre ou
chrysl-
phantin,
il faut
ajouter que
nombre
d'originaux
clbres
de
bronze,
que
nous
pouvons
restituer l'aide de
rpliques
en marbre
par exemple
le
Satyre
versant,
attribu
Praxitle,
dont on numre une
quinzaine
1. Cf. Rev.
arch., 1905, I, p. 394,
o
j'ai repris
le
sujet
dans son
en emble avec un
peu plus
de
critique
et de savoir
qu'en
1887.
GRANDS ET PETITS BRONZES 43
de
rpliques
1
ne sont
reprsents,
dans nos collec-
tions, par
aucune
figurine
de bronze.
D'autres,
comme
du Discobole de
Myron,
du Sauroctone de
Praxitle,
il
n'existe
qu'un
seul
exemplaire
de
bronze,
et nous
.avons vu
qu'il n'y
en a
que
deux ou trois d'une
figure
aussi souvent
copie
en marbre
que
la Genetrix. Force est
d'en conclure
que
les
petits
bronzes
romains,
la diff-
rence des statues de marbre de la mme
poque,
ne sont
-qu'exceptionnellement
des
copies
de monuments du
grand
art. Les
bronziers,
commme d'ailleurs les
peintres
de
vases,
les
coroplastes
et les
peintres
avaient leur
rpertoire
eux et s'en contentaient.
Quand
on
runit,
comme
je
viens de le faire
[1922],
des
reproductions
de
toutes les
peintures antiques connues,
on s'tonne de
n'y
rencontrer
pas
un seul
exemple
des motifs les
plus
fameux
de l'art
antique,
tels
que
le Zeus et les Athnas de Phi-
dias,
le Discobole de
Myron,
les athltes et l'Amazone
de
Polyclte, l'Aphrodite
de
Cnide, l'Aphrodite
de
Mdicis,
les Hracls de
Lysippe ; l'unique exception,
car
je
n'en ai
pas
not
d'autre,
est le
groupe
alexandrin
des trois Grces
nues,
commun la
peinture
et la
sculpture. Quelque
chose
d'analogue,
comme
j'ai
eu
l'occasion de le
dire 2,
se constate dans les miniatures
flamandes du xve
sicle,
o certaines des
grandes
oeuvres
contemporaines
de la
peinture,
comme le rtable des
Van
Eyck
Gand,
ne sont
jamais copies
mme
par-
tiellement.
Pourtant,
les miniaturistes se sont
beaucoup
copis
entre
eux,
comme se
copiaient
entre
eux,
dans
l'antiquit,
les
peintres
de
vases,
les dcorateurs de
parois,
les marbriers et les bronziers
; mais,
sauf
l'excep-
tion trs
importante
des marbriers romains
qui
ont
copi
sans cesse les oeuvres des
bronziers,
on
diraitqu'il
existt,
entre ces diffrentes
spcialits,
des cloisons tanches.
1.
Furtwaengler, Masterpieces, p.
310.
2.
Comptes
rendus de
l'Acad., 1921, p.
260.
44 GRANDS ET PETITS BRONZES
A des
poques
o il n'est
pas
encore
question
de lois sur
la
proprit artistique,
il
semble donc
qu'on
se conforme
certaines lois non
crites,
et
peut-tre
n'est-il devenu
ncessaire de les crire
que
du
jour
o l'on a cess de
s'y
conformer.
Pour en revenir au
scrupule qui,
comme
j'ai
cru le
reconnatre,
a
empch
les
bronziers
antiques
de
copier
les oeuvres des
marbriers,
scrupule qui peut
avoir son
fondement dans le caractre diffrent des
matriaux,
je
dois
ajouter qu'une
statuette de
bronze, reprodui-
sant une statue
antique
de marbre
qui
ne
peut
elle-
mme driver d'un
original
en bronze
par exemple
une des
Caryatides
de
PErechthion,
une des danseuses
de
Delphes,
la 'Nmsis de
Rhamnus,
le
groupe
de
Pythis
au Mausole
d'Halicarnasse,
la Nik de Samo-
thrace
doit,
a
priori,
tre considre comme moderne.
Inversement,
lorsque
une statuette de
bronze,
comme
le Guerrier bless dit de
Bavai 1,
au Muse de Saint-
Germain,
offre un
type
conforme une statue
antique
en
l'espce,
le
guerrier
bless de Crsilas
dont on
sait, par
les textes
antiques, qu'elle
tait de
bronze,
il
y
a
l,
pour
la
petite copie,
une
prsomption
d'au-
thenticit contre
laquelle pourraient
seuls
prvaloir
des
arguments
sans
rplique qu'un scepticisme
facile
s'est
jusqu'ici
bien
gard
de fournir 2.
1. Gazette des
Beaux-Arts, 1905, I, p.
193.
2. Voir ce
sujet,
en dernier
lieu,
Rev.
arch., 1921, II, p.
190.
IV
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
>
Quand
on visite la section
archologique
de l'admi-
rable Muse national irlandais
Dublin, appartenant
l'Acadmie
royale
d'Irlande,
on est
frapp
de la
quan-
tit considrable
d'objets
d'or
qui
ont trouv asile dans
cette collection. Ds
1862,
on en
comptait prs
de
trois
cents*;
il
y
en a sans doute
cinq
cents
aujourd'hui.
Une tude
quelque peu
attentive
permet
de
rpartir
ces
objets
en trois sries : 1 ceux
qui,
dcors
gom-
triquement, prsentent
les caractres d'une
antiquit
trs recule
;
2 ceux
qui,
dcors avec
plus
de fan-
taisie, rappellent
les caractres de l'art
appel
late
celtic en
Angleterre
;
3 ceux
qui,
orns d'entrelacs
ou
pourvus d'inscriptions,
doivent tre attribus au
moyen ge. D'objets
d'or attestant l'imitation de
modles
grecs
ou
romains,
il
n'y
a
pas
trace.
Nous
ne nous
occuperons
ici
que
de la
premire
srie.
Si les
bijoux
d'or sont nombreux dans la collection
nationale irlandaise
comparable,
cet
gard,
celles
de
Copenhague,
de Stockholm et de
Saint-Ptersbourg
ce n'est
pas qu'elle
contienne la
totalit,
ni mme
une
partie
considrable de ceux
qui
ont t dcouverts
dans l'le. Il faut se souvenir de la manire dont cette
1.
[Mmoire
lu l'Acadmie des
Inscriptions (Comptes
rendus,
1900, p. 111)
et
publi
Revue
celtique, 1900, p. 75-97, 166-175.]
2.
Wilde, Catalogue, Gold, p.
2.
46 LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
collection a t forme
pour
concevoir la richesse
norme dont ses trsors ne sont
qu'un
faible dbris.
Nulle
part
on n'a
pratiqu
de fouilles
systmatiques
et
rgulires
;
partout, pendant
des
sicles,
on a livr
aux fondeurs les
bijoux
d'or
que
l'on dcouvrait 1. La
collection de l'Acadmie irlandaise date seulement
de 18292, C'est
depuis
le mois d'avril 1861 seulement
qu'il
existe une loi
obligeant
les auteurs de dcouvertes
d'en donner avis aux autorits locales
(Treasure
trove
rgulations). Donc,
ce
qui
subsiste,
tant Dublin
qu'
Belfast,
Edimbourg, Liverpool
et
Londres,
sans
compter
quelques
collections
particulires,
n'est
qu'une
fraction
minime de ce
qui
a exist autrefois et a t rendu la
lumire
avant
l'organisation
du Muse national 3.
On a
justement
fait observer
que
le nombre des
objets
d'or conservs Dublin est encore moins
significatif
que
l'lvation de leur
poids moyen (de
20 40
onces)
4
;
c'est l un indice irrcusable
de l'abondance du mtal.
D'aprs
M.
Coffey,
conservateur de la
collection,
le
poids
total des
objets
d'or
appartenant
au Muse atteint
570 onces
(16 kilogr.
et
demi),
alors
que
l'ensemble
des trouvailles du mme
genre
faites en
Angleterre,
en Ecosse et dans le
pays
de
Galles,
telles
qu'elles
sont
reprsentes
au British
Musum,
ne
pse que
20
onces,
c'est--dire
vingt-cinq
fois moins.
Il est fcheux
que
les
provenances
des
objets
d'or
conservs Dublin soient
presque toujours vagues.
Les uns ont t recueillis dans des
tourbires,
les autres
en labourant le sol ou sous des rochers
;
il
n'y
en a
pas
1. Cf.
Wilde, ibid., p.
4.
2.
Ibid., p.
2.
3. Tout rcemment
encore,
une
grande
trouvaille
d'objets
en or
a t faite sur la cte nord-ouest de l'Irlande
;
voir la
publication
de M. Arthur
Evans, Archaeologia,
t. LV
(1897), p.
397-408.
4.
Coffey,
Origins of prehistoric
ornament in
Ireland, Dublin, 1897,
p.
39. On doit
regretter que
ce beau travail n'ait t
publi qu'
50
exemplaires.
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 47
(du
moins de
provenance irlandaise) qui
soient issus
d'un milieu
archologique
bien
dfini,
par exemple
d'une
spulture.
De
l, pour
la
science,
la difficult
de leur
assigner
une date
;
on en est
presque
rduit,
comme nous le
verrons,
des
conjectures,
autorises
par
le
style
des
objets
et le caractre de leur dcoration.
Parmi les
bijoux
d'or irlandais de la srie
que
nous
tudions,
il
y
a deux
types reprsents par
un
grand
nombre d
exemplaires.
Le
premier
est
un anneau
ouvert,
de dimensions trs
variables,
mais
presque toujours trop
petit pour
avoir entour un
poignet
et
se
terminant
par
deux
disques
ou cu-
pules
1
;
ces
objets peuvent
avoir servi
rassembler les
plis
de
certaines
toffes,
comme aussi serrer et orner des
boucles de cheveux 2. La dcoration en
est tantt
nulle,
tantt trs
simple,
consistant en stries dans le sens de la
longueur
et en
incisions croises la
naissance des
disques
;
ces derniers sont le
plus
sou-
vent sans ornements 3. Un
objet
de cette
catgorie,
long
deO m. 027 et
pesant
20
grammes,
a t
acquis
en
1887,
d'un marchand de
Londres, pour
le
muse de Saint
-
Germain-en-Laye (fig. 1).
1. Unclosed
hoop
with terminal
cups (Wilde, op. laud., p. 56).
2. Cf. les attaches de boucles en or mentionnes dans les textes;
grecs, ap. Helbig, pope homrique, p.
309.
Le
gnral Vallancey,
un des
premiers
auteurs
qui
les ait
dcrits, y voyait
des
patres
deux
ttes, ayant
servi des libations aux deux divinits
principales-
des Irlandais
paens,
Budh et son fils
Pharamon,
ainsi
qu'au
Soleil
et la Lune
(Wilde, p. 61).
3. Le
serre-plis appartenant
Trinity-College (Dublin),
dont les
cupules
terminales sont richement
dcores de cercles
concentriques
et
de
triangles inciss,
est tout fait
exceptionnel (Coffey,
On thetumuli
atNewr
Grange,
extr. des Transact.
oftheRoy.
Irish
Academy,, p. 23,
fig. 5).
Pour d'autres
exemples,
voir les
Proceedings of
the
Royal
Soc.
of
antiquaries, 1897, p. 366,
et le
catalogue
de
Wilde, p.
57 et suiv.
I'io. 1.
Anneau
d'or
irlandais,
au
Muse de Saint-
Germain.
48 LES CROISSANTS D OR IRLANDAIS
La seconde classe
d'objets
dcouverts de nombreux
exemplaires
est
beaucoup plus
intressante. Ce sont des
croissants
dcoups
dans de minces feuilles
d'or,
ter-
mins
simplement
en
pointes
ou
par
de
petits disques
1.
L'vque
irlandais
Pococke,
en
1773,
leur a donn le
nom de
lunulae,
sous
lequel
on les connat encore 2.
On
ajoute qu'en
vieil-irlandais ils
s'appelaient
mind
ou
minne 3,
mais rien ne
prouve que
ce mot dsi-
gne,
dans les anciens
textes,
l'objet qui
nous
occupe.
Une
glose
d'un
vang-
liaire de Turin
(ixe sicle)
donne mind comme
l'qui-
valent du latin diadema
;
or,
les croissants ne sont
pas
des diadmes et rien
n'autorise croire
qu'on
les connt encore en Ir-
lande,
du moins en
qualit
d'objets usuels,
au ixe si-
cle de notre re.
La
dcoration,
obtenue au
burin,
rarement au
poin-
on,
est
presque toujours
caractrise
par
des
triangles
inciss et ombrs l'aide de
lignes parallles
l'un des
cts latraux
;
on trouve aussi des
chevrons,
des dents
de
loup,
de
petits
carrs,
hachurs ou
vides, disposs
en cases de damier. Dans un
exemplaire
seulement,
cette dcoration consiste
en une srie de
petits
cercles
obtenus au
poinon
5. On ne constate
jamais
ni
spirales,
ni cercles
concentriques
;
c'est la dcoration
gom-
1. Voir
Wilde, p.
15-27.
2.
Archaeologia,
t.
II, p.
36.
3.
Wilde, p.
10
; Wakeman,
Handbook
of
Irish
Antiquities, p.
278.
4.
Wilde, op. laud., p.
11.
5.
Ibid., op. laud., fig.
548
; Wakeman, p.
279.
FIG. 2.
Lunule d'or au Muse
de Dublin*.
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 49
trique rectiligne
dans toute sa
rigueur.
Les deux
spci-
mens de lunulae
que
nous
reproduisons ici,
l'un
d'aprs
un dessin de
Wilde,
l'autre
d'aprs
un
estampage
de
Frazer,
suffisent donner une ide de leur
style
aussi
lgant que
sobre
(fig.
2 et
3).
On
remarquera que
la
dcoration de la surface est limite aux cornes et
que
la
partie moyenne
de
l'objet,
la
plus large
et la
plus
considrable,
est
simplement
encadre de deux bandes
o dominent les chevrons.
L'tude des lments de cette dcoration ne laisse
gure
de doute sur
l'poque
laquelle
il convient de
l'attribuer. Ils
sont,
en
effet, identiques
ceux
qui
caractrisent l'ornementation de la
poterie
et du mtal
1. Trouve en 1890 dans le comt de Westmeath et
publie
dans le
J ournal
of
the
Royal Society of Antiquaries of Ireland, 1897, p.
55.
S. REINACH 4
FIG. 3.
Lunule d'or au Muse de
Dublin 1.
50 LES CROISSANTS D OR IRLANDAIS
pendant
la
premire partie
de
l'ge
du
bronze,
non seu-
lement en
Irlande,
mais dans toute
l'Europe
1.
Nous
possdons,
de cette
poque,
un
grand
nombre
de vases en
argile,
de
provenance
irlandaise, qui pr-
sentent exactement les mmes motifs. Celui du
triangle,
en
particulier,
se retrouve sur les
pierres
du monument
de
New-Grange
2
et
parat
avoir t trs familier l'in-
dustrie de l'Irlande. Nous ver-
rons
plus
loin
qu'il existe,
cet
gard,
une
analogie
assez
troite entre l'art
prhistorique
de l'Irlande et celui de la
p-
ninsule
ibrique.
Enfin,
les croissants en
ques-
tion ne sont
pas
isols dans
l'archologie prhistorique.
Ceux
qu'on
a dcouverts en
France
sont,
la
vrit,
des
articles
d'importation ;
mais
il n'en est
pas
de mme de cer-
tains
objets
de mme
type
recueillis en
pays
Scandinave.
Nous
signalerons
d'abord un croissant en or dcouvert
au Danemark
(fig. 4). Evidemment,
c'est une imitation
du
type irlandais,
et une imitation assez
pauvre, puisque
la dcoration
gomtrique
en est absente. Il serait
donc tout fait
illogique
de se fonder sur cet
objet
pour supposer que
les croissants irlandais soient d'im-
portation
Scandinave
erreur
o, d'ailleurs,
aucun
archologue
n'est tomb. Le second
croissant, gale-
ment de
provenance danoise,
est encore
plus signifi-
1.
Voir, par exemple,
les intressants tableaux
publis par
M. So-
phus Mller,
Ornamente aus der
jungeren Steinzeit,
dans Nordische
Alterthumskunde,
t. I
(1897), p. 158,
159.
2.
Coffey,
On the turnuli ai
New-Grange, p.
93.
3.
Montelius-Reinach, Temps prhist.
en
Sude, fig.
151.
FIG. 4.
Croissant en or de
type
irlandais. Danemark*.
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
51
catif
(fig. 5).
La forme
gnrale
est bien celle des lunules
irlandaises
;
mais la dcoration consiste en
spirales qui
ne
paraissent jamais,
avant le
moyen ge,
sur les
objets
mtalliques
de
l'Irlande,
alors
qu'elles
sont extrme-
ment
frquentes
dans l'art Scandinave
l'poque
du
bronze. Nous avons donc l une imitation
vidente,
mais
accommode au
got Scandinave,
d'un
type
de
bijou
irlandais.
On
possde quelques renseignements
sur une dcou-
verte faite en
Cornouailles,
Harlyn, prs
de
Padstow,
qui
fournit une indication
pr-
cieuse sur la date des croissants.
Un ouvrier trouva dans cette
localit,
la
profondeur
d'en-
viron six
pieds,
deux croissants
en or associs une hache de
bronze
plate,
dont le
type
carac-
trise la
premire phase
de
l'ge
du bronze en
Grande-Bretagne
2.
Il
y
avait aussi l un second
bronze, qui
n'a malheureuse-
ment
pas
t conserv
;
l'auteur
de la dcouverte dclara seulement
qu'il
ressemblait
un
fragment
de boucle.
Une autre
constatation,
due O.
Montelius,
vient
confirmer cet indice. Certaines haches de bronze
plates
d'un
type particulier,
trs
frquent
dans les les Bri-
tanniques,
et l
seulement,
se sont rencontres Fionie
et Schonen
3
;
ce sont
probablement
des
objets impor-
ts,
de fabrication
britannique. Or,
la dcoration de
ces haches
rappelle
d'une manire
frappante
celle des
1.
Worsaae,
Nordiske
Oldsager, p. 50,
n 226.
2.
Evans,
Bronze
implements, p.
42
; Montelius,
Archiv
fur
Anthro-
pologie,
t.
XIX, p.
9.
3. Archiv
fur Anthropologie,
t.
XIX, p. 8, fig.
5 et 6
;
Montelius-
Reinach, Temps prhist.
en
Sude, p. 57, fig.
59.
FIG. 5.
Croissant enbronze.
Danemark 1.
52 LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
lunules irlandaises
;
c'est le mme
emploi
de
triangles
remplis
de hachures
parallles,
de dents de
loup,
de
chevrons,
etc.
Puisque
les haches
plates
n'ont
pas
sur-
vcu la
premire phase
de
l'ge
du bronze
(vers
1400 avant
J .-C,
suivant la
chronologie
d'O. Mon-
telius),
c'est une
poque
antrieure
l'an 1000 avant
J .-C.
qu'il
faudrait attribuer les croissants d'or irlan-
dais. Cette date nous semble trs vraisemblable et ne
peut effrayer que
les
personnes
non inities aux rsul-
tats
acquis, depuis quinze
ans, par
les tudes d'ar-
chologie prhistorique.
Nous donnons
ici,
pour
faciliter la
comparaison,
les
dessins de trois haches de
bronze,
dcouvertes
la
pre-
mire
en
Irlande,
la seconde Perth et la troisime
Schonen
(fig.
6,
7 et
8). L'analogie
de ces haches entre
elles et l'affinit de leur dcoration avec celle des crois-
1.
Evans,
Bronze
implements, p.
66, fig.
35.
L'objet appartenait
sir J ohn
Evans, qui
l'a
acquis
comme
provenant
d'Irlande.
2.
Evans, ibid., fig.
24. Collection de J ames
Beck.
3.
Montelius,
Archiv
fur Anthropologie,
t. XXVI
(1899), p.
459.
On trouvera d'autres haches
analogues
dans
Worsaae, Oldsager,
p. 37,
n
179,
dans le
catalogue
de
Wilde, fig. 297, 301,
et dans Wake-
man,
Handbook
of
Irish
antiquities, p. 290,
291.
FIG. 6.
Hache d'Irlande 1.
FIG. 7.
Hache de Perth2.'
FIG. 8.
Hache de Schonen
3
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
53
sants irlandais sont tellement videntes
qu'il
serait
superflu d'y
insister.
C'est donc avec
surprise que j'ai
vu M.
Frazer,
dans
un travail
spcial
consacr aux
croissants 1,
prtendre
qu'ils appartiennent
l'poque
de
l'Empire
romain et
qu'ils
ont t
fabriqus
avec le mtal d'aurei
romains,
butin des
pirates
scots dans leurs
expditions
sur les
ctes de
Grande-Bretagne
2.
M. Frazer tant mort
peu aprs
la
publication
de
ce
travail,
il ne lui a
pas
t
rpondu
en Irlande
;
en
France,
la Revue
Celtique
en a donn une
analyse
sans
apprciation
3
et il serait craindre
que
les rsultats
indiqus par
l'auteur ne trouvassent crance
auprs
des
personnes qui
ne connaissent les
objets
en
question
ni
directement,
ni
par
de bonnes
gravures.
Parmi les
arguments allgus par
M.
Frazer,
il en est
un
qui,
bien
que spcieux
au
premier
abord,
me
parat
absolument sans valeur.
L'analyse
d'un croissant irlan-
dais a
donn, dit-il, 11,05
d'argent,
0,12
de cuivre et
un
poids spcifique
de
17,528 ; or,
l'or
indigne
du comt
de Wicklow donne environ 7
d'argent
et 15 comme
poids spcifique.
Rien
n'empche cependant
d'admettre
que
les orfvres irlandais aient
augment
la
proportion
d'argent
dans leur
alliage,
ou
que
l'or dont ils ont fait
usage
diffrt
quelque peu
de celui de Wicklow. En
revanche,
M. Frazer est
oblig
de reconnatre
que
le
poids spcifique
des aurei romains est notablement
suprieur
celui des croissants irlandais. Il se tire d'af-
faire en
allguant que
les orfvres irlandais ont
aug-
ment la
proportion d'argent.
Mais
que
reste-t-il alors
de son
premier argument
? En
pareille
matire,
le chi-
miste doit s'effacer devant
l'archologue.
Nous ne
savons
pas quelles manipulations
subissait l'or natif
;
1. J ournal
of
(lieSoc.
of antiquaries of Ireland, 1897, p.
53.
2. Sur ces
attaques,
voir Revue
Celtique, 1897, p.
354.
3. Revue
Celtique,
1898,
p.
94.
54 LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
mais nous savons
que
la dcoration exclusivement
go-
mtrique
caractrise une
phase
de l'industrie en
Europe
et ne se rencontre
pas
dans les
phases subsquentes.
Il
y
a l des faits
positifs,
solidement tablis et dont le
tmoignage
ne
peut plus
tre rcus.
En
ralit,
si Frazer s'est
tromp
aussi
lourdement,
la faute n'en est
pas
la chimie. Cet amateur n'a fait
que
tomber,
une fois de
plus,
dans l'erreur familire
la
plupart
des
archologues
irlandais,
erreur avec
laquelle
le
plus
minent d'entre
eux,
M.
Coffey,
n'a
pas
encore tout fait
rompu,
tmoin sa tentative rcente
pour
identifier le cairn de
Knockmanny,
antrieur
l'an 1500 avant
J .-C,
avec le tombeau de
Baine,
morte
en 111
aprs
notre re 1. Cette erreur vient de l'influence
tenace
qu'exerce
sur les rudits de ce
pays
la lecture des
Annales des
Quatre Matres,
avec leurs
mythes
evh-
mriss et leur
chronologie
fictive. Un des caractres les
plus
fcheux de cette
compilation pseudo-historique,
c'est
qu'elle
met des monuments trs anciens en rela-
tion avec des
personnages ayant
vcu aux
premiers
sicles de l're chrtienne 2. Ceux
qui
la
prennent
au
srieux en arrivent
placer
l'rection des dolmens vers
la fin de
l'poque impriale
et refuser l'Irlande
toute civilisation matrielle antrieure ses
premiers
1.
Royal
Soc.
of antiq. of Ireland, 1898, p.
111. M.
Coffey, d'ailleurs,
n'est
pas dupe
de cette
chronologie ;
on dirait
qu'il
se contente de
saluer,
en
passant,
un
prjug
national.
2.
Frazer,
loc.
laud., p.
54 : Le
port
des lunules
par
les femmes est
mentionn de bonne heure dans le Livre de Leinster. Au festin de
Teamair,
le voleur Gorman droba le diadme d'or de la reine... Le
nom du roi tait
Cathair-Mor, qui
fut tu en 177
ap.
J .-C. La mme
histoire se trouve dans les livres de
Ballymote
et de
Lecan,
de sorte
qu'on peut
dire
qu'elle
s'est transmise
pendant
dix sicles avant
que
le
plus
ancien de ces livres ait t
rdig.
D'abord,
il faudrait
prouver que
les lunules sont des diadmes
;
puis, que
Cathair-Mor
est un
personnage historique ; enfin, que
la date
assigne
sa mort
repose
sur une donne
positive quelconque.
Frazer n'a
pas song
tout cela.
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 55
contacts avec le
monde romain. Ceux mme
qui
ne
vont
pas
aussi loin ne
peuvent
se dfendre du
prjug
scolastique
suivant
lequel
les
peuples, qualifis
de
barbares
par
les
anciens,
ont vritablement mrit
ce nom
les
uns,
jusqu'
la
conqute romaine,
les
autres,
jusqu'au triomphe
du christianisme. Au lieu
d'en
croire,
sur
l'Irlande,
les monuments dcouverts
dans ce
pays,
ils en croient
Strabon,
qui n'y
tait
pas
all.
Or,
il est
permis
de
poser
en
principe que, lorsque
les textes et les monuments sont en
dsaccord,
c'est le
tmoignage
de ceux-ci
qu'on
doit
prfrer.
Il serait
cependant
bien
temps
de reconnatre
qu'un
pays
comme F
Irlande, spar par quelques
heures de mer
seulement de la
Grande-Bretagne qui,
elle-mme,
est en
vue des ctes
celtiques,
n'a
pu prsenter
une volution
industrielle toute diffrente de celle de
l'Europe
occiden-
tale et de
l'Europe
du Nord 1. Entrane dans le mme
mouvement,
elle a connu successivement les
poques
de
la
pierre polie,
du
cuivre,
du bronze et du fer
;
cha-
cune de ces
poques correspondent
des
types
et un
style
dcoratif
qui
ne sont
pas identiques
ceux des
priodes
correspondantes
dans telle ou telle
rgion
de
l'Europe
car l'Irlande avait une industrie
indigne
mais
qui prsentent
avec ceux-ci une incontestable affinit.
1. M.
Coffey,
bien
qu'entretenant
des ides trs errones sur le
commerce des Phniciens dans
l'Atlantique,
a eu
parfaitement
rai-
son d'crire
(Origins of prehist. ornament, p. 39)
: On admet
gnra-
lement
que
l'Irlande tant
plus loigne
du continent
que
la Bre-
tagne,
les
priodes correspondantes
ont t
plus
tardives en Irlande
et la civilisation
plus grossire.
J e ne crois
pas que
ces conclusions
soient
justifies.
Les monuments attestent
que
la civilisation de
l'Irlande
l'ge
de bronze
tait, pour
le
moins,
aussi
dveloppe
que
celle de la
Bretagne.
J 'ajoute qu'une comparaison
de la cra-
mique
irlandaise
primitive
avec celle de l'le de
Bretagne,
telle
qu'on
peut
la faire aisment au Muse
britannique,
dmontre absolumeni
la
supriorit
de l'art irlandais sur l'art breton
pendant
toute la dure
de
l'ge
du bronze. L'observation en a
dj
l faite
par
Greenwell,
British
Barrows, p.
62.
56 LES CROISSANTS D'0R IRLANDAIS
Vers 1870 on
pouvait
encore admettre
que
les
pays
loigns
de la Mditerrane avaient
toujours
t en
retard de
cinq
ou six sicles sur les
pays
mditerranens
-
que, par exemple,
les Gaulois du
temps
de Csar se
servaient encore
d'pes
de
bronze,
comme le
croyaient
Quicherat
et
Mrime 1,
comme l'affirmait
plus
rcem-
ment M. de
Champeaux
2. On
supposait que l'ge
du
fer,
dont le
rgne
commence vers l'an 800 avant J .-C.
dans
l'Europe
mridionale,
n'avait
dbut,
en Scandi-
navie,
que
vers
l'poque
de l're chrtienne. Telle tait
encore
l'opinion
de
Worsaae,
dont Alexandre Bertrand
se faisait l'cho en 18753 :
De
quelque point
de l'Asie
que
nous soit venu ce
progrs (la mtallurgie),
il est
incontestable,
aujourd'hui, qu'il part
de l. Une autre
vrit non moins vidente est
l'ingalit profonde
exis-
tant,
suivant les
pays,
dans la marche en
Europe
du
mouvement
qui produisit
ces transformations.
Le
fer,
que
les
Egyptiens possdaient
3500 ans au moins avant
notre
re,
ne
pntre
en Grce
qu'au
xve sicle avant
J .-C,
en
Italie,
suivant toute
probabilit, qu'au
xne,
au vne seulement en Gaule. Il
faut
attendre l're chr-
tienne
pour
le rencontrer en Danemark et en Sude.
Peu
aprs
les dcouvertes de Schliemann
Mycnes,
on
commena
ragir
contre ces erreurs. En
1882,
Igvald
Undset mit
l'opinion que
le fer avait
pntr
en Scandinavie au cours du deuxime
ge
du fer euro-
pen (poque
de
Latne)
4. M.
Montelius,
adversaire
rsolu de la thorie du
retard, qu'il
a
plus
contribu
que
tout autre bannir de la
science,
alla
plus
loin
qu'Undset
et affirma
que l'ge
du fer Scandinave
tait
contemporain
de la fin du
premier ge
du fer
dans
l'Europe
centrale
(environs
de l'an 500 av.
1. Cf. Revue
archol, 1899, I, p.
213.
2. Article Bronze de la Grande
Encyclopdie, p.
138.
3. A.
Bertrand,
Archol.
celtique
et
gauloise,
2e
d., p.
38.
4. I.
Undset,
Dos erste
Aujireten des
Eisens, p.
388.
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 57
J .-C.)1.Peut-tre
est-il
possible
de le reculer encore 2.Assu-
rment,
il
n'y
a
pas synchronisme
absolu entre les
tapes
de l'volution industrielle d'un bout de
l'Europe
l'autre;
mais,
si l'on met
part
le domaine
scythique (
l'est
de la
ligne
du commerce de
l'ambre),
on
peut
affirmer
qu'il
ne s'est
pas pass plus
de deux ou trois sicles entre
l'poque
o les
pes
de bronze ont cess d'tre
employes
en
Irlande,
en
Gaule,
en
Scandinavie,
en Hon-
grie
et en Grce. Le commerce de
l'ambre,
celui des
mtaux
prcieux
et de
l'tain,
sans
parler
de la
pira-
terie et du trafic des
esclaves, ont,
depuis l'antiquit
la
plus
haute,
cr des relations entre ces diffrentes
rgions
de
l'Europe,
tel
point qu'un progrs
essentiel
accompli
dans l'une d'elles devait ncessairement avoir
sa
rpercussion
dans les autres et
y
susciter des imita-
tions.
En
Scandinavie,
la dmonstration de ce
qu'on peut
appeler
par opposition
la thorie du retard
le
synchronisme
industriel,
est due aux fouilles de
Vedel,
dans l'le de Bornholm 3. Ces
fouilles, portant
sur des
milliers de
tombes,
ont tabli
qu'
une
poque
o il
n'est
pas
encore
question d'importations
romaines en
Scandinavie,
ce
pays possdait dj
des
objets
de fer
tout fait
comparables
ceux
qui
caractrisent,
dans
l'Europe
centrale et
occidentale, l'poque
dite de
Latne,
dont l'volution tait
dj
trs avance en Gaule
au moment de la
conqute
romaine.
Depuis
les fouilles
de
Vedel,
on a constat la
prsence d'objets
du
type
de Latne au J utland et
Fionie 4;
il est donc inad-
missible
que
l'le de Bornholm ait
joui
d'une civili-
1.
Montelius-Reinach, Temps prhist.
de la
Sude, p.
143.
2. Il ne faut
pas
oublier
que
le
premier ge
du fer en
Europe (poque
de
Hallstatt)
est moins un
ge
du fer
que
le
passage
de
l'ge
du bronze
l'ge
du fer.
3. Mm. de la Soc. des
Antiquaires
du
Nord, 1872, 1878-79,
1890.
4. Mm. de la Soc. des
Antiquaires
du
Nord, 1890, p.
171.
58 LES CROISSANTS D OR IRLANDAIS
sation
qui
serait reste inconnue des
pays
voisins.
L'tude des relations
prhistoriques
de l'Irlande avec
les autres
rgions
de
l'Europe
est une des tches essen-
tielles
qui
incombent
aujourd'hui
aux
archologues
1.
Trois rsultats de la
plus
haute
importance peuvent
dj
tre tenus
pour acquis
:
1 A
l'poque
de la
pierre polie,
on trouve en Irlande
des
pointes
de flche en
silex,
en forme de
losanges,
polies
sur les deux
faces
et retouches trs adroitement
sur les bords
(fig. 9).
Des
pointes
similaires se rencon-
trent au
Portugal,
mais ne se
sont,
jusqu' prsent,
ren-
contres
que
l et en Irlande
(fig. 10)
4. Les
gravures
ci-
1. On trouvera
beaucoup
d'indications cet
gard
dans
l'ouvrage
rudit,
mais sans
critique,
de
Borlase,
The dolmens
of
Ireland
(voir
notamment t.
II, p.
523.
674, 686).
2.
Wakeman, Handbook, p.
270
; Wilde, Catalogue, fig.
27.
3.
Cartailhac, Ages prhistoriques
de
l'Espagne
et du
Portugal,
fig.
86
;
cf.
fig. 87, 88,
90.
4.
Evans,
Ancient stone
implements of
Great
Britain,
2e d.
(1897),
p.
372 : The class
having
both
faces polished, though
still
only chippcd
.at the
edges,
like Wilde
fig. 27,
has
not, except
in
Portugal,
as
yet
occur-
FIG. 9.
Pointe de flche irlandaise 2.
FIG. 10.
Pointe de flche
portugaise
3.
LES CROISSANTS D OR IRLANDAIS 59
jointes permettront
de saisir l'identit
technique
de
ces
objets, qui
ne
peut
tre due
au hasard. Cette identit
est confirme
par
une autre
observation. Le
Portugal
a fourni des
objets
en
ardoise,
de destination
inconnue,
orns de dessins au trait
par-
mi
lesquels
domine le
triangle
et
qui
offrent une ressem-
blance
frappante
avec les
haches en bronze ornes de
l'Irlande
que
nous avons si-
gnales plus
haut
(fig. 11)
1.
Enfin,
si l'on
compare
les dol-
mens de l'Irlande avec ceux
de
l'Allemagne
et de la Scan-
dinavie,
d'une
part,
ceux du
Portugal
et de
l'Espagne,
de
l'autre,
on reconnatra
qu'ils
prsentent (voir
leur
profil
en
tronc de
pyramide)
une ind-
niable
analogie
avec ces der-
niers,
et avec ces derniers
seulement. Ces faits viennent
l'appui
d'une tradition
laquelle
on
aurait
tort de refuser toute valeur histo-
rique, d'aprs laquelle
une
partie
de la
population pri-
mitive de l'Irlande serait venue du
pays
du
couchant,
c'est--dire de
l'Espagne
2. Le fait de relations suivies
red out
of
Ireland.
Une belle
pointe
irlandaise de ce
genre
a t
publie par
M.
Knowle,
J ourn.
of
the
Roy.
Soc.
of antiquaries of
Ire-
land, 1897, p.
15.
1.
Plaques
d'ardoise de la Casa de
Moura, Cartailhac, Ages prhist.
de
l'Esp.
et du
Portugal, fig. 96, 97, 100,
101
; Vasconcellos, Religioes
da
Lusitania,
t.
I, fig. 24, 25,
26. M. Cartailhac a
dj rapproch
de
ces ardoises une hache orne conserve Sorze
(Tarn)
et
que
l'on
croit de
provenance
irlandaise. Voir aussi
Wilde, p. 390,
391.
2.
D'aprs
la tradition
indigne, qui peut
fort bien contenir un
grain
de
vrit,
la dernire
immigration
en
Irlande,
celle des Mac-
Miled
(Milsiens),
tait
partie
de
l'Espagne.
(Windisch,
Kel-
tische
Sprachen, p. 139).
Cf.
Nennius,
Hist.
Brit.,
13 : Et
postea
FIG.11.
Pendeloque portugaise
en ardoise.
60 LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
entre la
pninsule ibrique
et l'Irlande semble aussi tre
attest
par
la
croyance
des anciens
que
l'Irlande tait
situe entre la
Bretagne
et
l'Espagne (Hibernia
medio
inter Britanniam
atque Hispaniam
sita, Tacite,
Agric,
24).
C'est donc
qu'il
existait une
navigation
directe
entre
l'Espagne
et
l'Irlande,
comme
entre
l'Espagne
et
les les
Cassitrides;
ces deux routes commerciales n'-
taient
pas
seulement
connexes,
mais elles se confon-
daient
pendant
la
plus grande partie
de leur
parcours
;
2 Les relations de l'Irlande avec le monde Scandi-
nave sont nettement attestes ds le dbut de
l'poque
des
mtaux, que
l'on
peut placer
au moins
quinze
sicles avant l're chrtienne. En
effet,
si l'on
rapproche,
avec M.
Coffey 1,
les
spirales
incises au marteau sur les
pierres
de
New-Grange,
de
Lough Crew,
de
Dowth, etc.,
des ornements
analogues gravs
sur des
objets
Scan-
dinaves datant du dbut de
l'ge
du
bronze,
on
devra,
d'abord,
convenir
qu'il y
a eu
emprunt.
Mais
l'emprunt
ne
peut
avoir
t fait
par
la Scandinavie
l'Irlande,
car,
dans cette
le,
les
spirales,
inconnues sur les
objets
mtalliques,
se trouvent seulement sur des monuments
de
pierre,
o il est
beaucoup plus
facile de les
graver
2.
M.
Coffey
a
dress,
pour
l'Irlande et la Grande-Bre-
tagne,
la carte des monuments de
pierre
avec
spirales
3
;
venerunt trs
filii cujusdam
militis
Hispanici... apud
ilos. On ne doit
pas
oublier
que
Tacite attribue une
origine ibrique
aux Silures de
la cte ouest de
Bretagne (Agric, xi),
de mme
qu'il
considre les
Caldoniens comme des Germains
(ibid.).
Bien
qu'il n'allgue,
l'appui
de son
opinion, que
des
arguments
d'ordre
anthropologique
(colorati vultus,
rutilae
comse, magni artus),
on n'a
pas
le droit de
supposer qu'il
n'en et
pas
d'autres. Des relations commerciales trs
anciennes entre la Caldonie et le
pays
de l'ambre sont vraisem-
blables; quant
celles de
l'Espagne
avec la
rgion
stannifre de la
Bretagne,
elles sont
peu prs
certaines
(cf.
mon article sur le com-
merce de l'tain dans
l'Anthropologie 1899, p. 397).
1. J ourn.
of
the Soc.
of antiq. of Ireland, 1897, p.
42.
2.
Coffey, Origins of prehist. ornament, p.
89.
3.
Ibid., p.
112.
Les
pierres
spirales
se trouvent
presque
exclu-
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 61
il semble avoir ainsi mis en
vidence,
de la
faon
la
plus
certaine, que
l'influence s'est exerce de l'est vers
l'ouest,
non inversement
1
;
3 A la mme
poque,
des relations se sont tablies
entre l'Irlande et notre
Armorique.
Elles sont attestes
par
la
similitude, depuis longtemps
constate,
entre la
dcoration des
pierres
de
New-Grange
et celles du monu-
ment de Gavr'inis dans le
golfe
du Morbihan 2. Ces
pierres
de
Gavr'inis,
avec leurs trois ornements en
spi-
rale et leurs nombreux demi-cercles
concentriques
creuss dans le
granit,
sont tout fait isoles en
Gaule,
o la
spirale prhistorique
ne
parat jamais
3,
de mme
sivement sur la cte nord-est de l'Irlande et sur la cte ouest de l'An-
gleterre
;
il
n'y
en a
pas
un seul
exemple
ni dans le sud de
l'Irlande,
ni dans le sud de
l'Angleterre,
mais on en trouve aux
Orkneys.
M.
Coffey
croit
que
la
spirale
fut
apporte
de Scandinavie dans le
nord de l'Irlande et
passa
de l sur la cte
oppose
de Grande-Bre-
tagne.
Avant
lui,
on admettait
qu'elle
avait
pass
de Gaule en Bre-
tagne
avec les
Belges
et de
Bretagne
en Irlande
(Evans,
J ourn.
of
Hell.
Studies,
t.
XIV, p. 327).
1. Il est
possible
et mme
probable que l'ambre,
trs
frquent
en
Irlande,
a t
import
de la
Baltique
l'ge
du bronze
(Coffey, p. 67);
mais l'existence d'ambre
indigne
sur la cte orientale de la Grande-
Bretagne empche
d'tre affirmatif cet
gard (ibid., p. 65).
J e
ne
m'occupe pas
ici des influences irlandaises en Scandinavie au
moyen ge.
Il suffit de
rappeler que
les
ncropoles
de l'le de Born-
holm
prsentent, pendant
environ deux sicles
(700-900 aprs J .-C),
des
bijoux
de
style
irlandais
(Mm.
Soc.
Antiq.
du
Nord., 1890,
p. 11)
et
que
ce
style
caractrise un
grand
nombre de monuments recueillis
Gotland
(Montelius-Reinach, Temps prhist.
en
Sude, fig.
404-
406, p. 291).
2. Voir le mmoire de M.
Coffey,
On the tumuli and inscribed stones
at
New-Grange, etc.,
dans les Transactions
of
the
Roy.
Irish
Acad.,
vol. XXX
(1892),
dont les
planches
sont la
premire publication
exacte des
gravures
de
New-Grange.
Celles de Gavr'inis ont t bien
reproduites
dans leDictionnaire
archologique
de la
Gaule;
il en existe
des
moulages
Saint-Germain.
3. M. Paul du Chtellier a
publi
en
1898,
dans le Bulletin archol.
du Comit des trav. hist.
(pi.
XV et
XVI),
une
grosse pierre
trouve
Kermaria
(Finistre),
o
figurent
une croix
gamme
et des
spirales.
e
btyle, jusqu' prsent unique,
ne semble
pas
antrieur
l'ge
du fer. La croix
gamme
ne
parat jamais
sur les monuments
mga-
lithiques.
62 LES CROISSANTS 'oR IRLANDAIS
qu'elle
ne
parat jamais,
du moins
l'ge
du
bronze,
dans
le
reste de
l'Europe,
l'ouest de la
ligne
suivie
par
le commerce
mycnien
de
l'ambre,
c'est--dire dans
la valle du
Rhin,
en
Gaule,
en
Bretagne
et dans l'Italie
du nord 1.
Comme l'a dmontr M.
Montelius,
c'est ce commerce
qui
a fait
parvenir
dans
l'Europe
du nord le motif
de la
spirale,
ainsi
que
d'autres
types
dcoratifs
2
d'o l'erreur de certains
archologues,
notamment de
L.
Stephani, qui,
trouvant un caractre Scandinave aux
objets
d'or dcouverts
par
Schliemann
Mycnes,
ont
pens qu'ils
avaient
appartenu
des
peuples
du
Nord,
au moment des
grandes
invasions du ive au ve sicle
aprs
J .-C. De
Scandinavie,
la
spirale passa
en Irlande
et de l en
Armorique,
mais sur un
point
seulement.
Que
l'Irlande
ait,
cet
gard,
la
priorit
sur la
Gaule,
c'est
ce
qui
ne ressort
pas
seulement de l'isolement de
Gavr'inis dans l'histoire de l'ornementation en
Gaule,.
1.
Montelius-Reinach, Temps prhist.
en
Sude, p.
62.
2. Aux
archologues toujours prompts
rpondre que
les motifs-
d'ornementation ne
prouvent rien, ayant pu
tre dcouverts ind-
pendamment
sur diffrents
points (ce qui
est vrai en
principe),
on
peut
recommander ces rflexions trs senses de M.
Sophus
Mller
(Nordische Alterthumskunde,
t. I
[1897], p. 296)
:
Assurment,
nous connaissons des
spirales
de
l'Amrique
et de la
Nouvelle-Zlande,
pays
si
loigns qu'on
ne
peut
admettre une communication entre
eux et les vieilles
rgions
civilises de la Mditerrane. La
spirale
est un motif si
simple qu'elle peut
fort bien avoir t
imagine
en
divers lieux et diverses
poques.
Mais les ornements du nord et
du sud de
l'Europe que
nous tudions ici
prsentent
des
analogies
si troites
qu'il
est
impossible qu'ils
ne soient
pas apparents.
Ils
sont relis entre eux
gographiquement,
car il n'existe
pas
de
vaste
rgion
intermdiaire o la
spirale manque ;
ils sont rlis chro-
nologiquement,
car ils remontent
partout
au del de l'an 1000 avant
J .-C.
;
la
ressemblance dans les dtails et dans la
composition
est
trop grande pour
tre accidentelle
et, enfin,
l'ornementation
spira-
liforme, partout
o on la
rencontre, depuis
la Grce
jusqu'en
Scandi-
navie, appartient
une civilisation du
bronze,
uniforme dans ses-
lments essentiels.
L'analogie
doit donc tre
explique ]3ar
un lieni
de
parent.
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 63:
mais du fait
que
les dcorations du monument armo-
ricain,
compares
celles de
New-Grange,
attestent une
vidente dcadence
;
les
spirales y
sont
rares,
alors
que
les cercles
concentriques
sont trs nombreux.
Or,
il
y
a
longtemps que
les
archologues
ont dmontr
que
les
cercles
concentriques peuvent
tre des
spirales dg-
nres
(debased spirals) 1,
le dernier terme d'une vo-
lution dont les deux
premiers
sont la
spirale
vraie et
la
fausse
spirale (compose
de cercles runis
par
des
tangentes rectilignes).
Si,
comme tout
parat l'indiquer,
le
monument de
l'lot de Gavr'inis est
irlandais,
il est difficile de ne
pas
admettre
que,
vers l'an 1400 avant
J .-C,
il existait
dj
une marine irlandaise
puissante,
des navires de
haute mer monts
par
des
pirates qui
venaient
occuper
des lots sur les ctes
armoricaines,
comme les Nor-
mands,
au ixe
sicle, occupaient
les les de la Seine.
En
gnral,
rien n'est
plus
loin de la vrit
que
l'ide
trs
rpandue d'aprs laquelle
la
navigation
au
long
cours aurait
t,
dans
l'Europe .occidentale,
le mono-
pole
d'armateurs
phniciens.
Les relations directes entre
Tartessos
(Gads)
qui
tait un
port
ibre avant d'tre
un
comptoir phnicien
-
et les les
Cassitrides,
ne
sont
pas
contestables 2;
l'existence de nombreux dol-
mens dans les les des ctes de la France et de
l'Angle-
terre
prouve qu'elles
taient
frquentes par
les navi-
gateurs
ds
l'poque
de la
pierre polie;
la flotte de
gros
navires
que
Csar eut combattre chez les Vntes
3:
atteste,
chez ces
peuples,
un
dveloppement plusieurs
fois sculaire de l'art naval et des constructions
qu'il
1. La
question
a t trs bien
expose par
M.
Coffey, Origins of
prehistoric ornament, p.
27 et suiv. Les cercles
concentriques,
trs
rares dans la dcoration
gyptienne, dominent,
au
contraire,
dans
celle de l'art
europen.
2. Cf.
L'Anthropologie, 1899, p.
397.
3.
Csar,
De bello
gallico, III,
8.
64 LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
comporte.
Enfin,
les
gravures respestres
de la Sude
mridionale et les bronzes dcouverts dans ce
pays
1
prsentent
un
grand
nombre
d'images
de
bateaux,
et
des
images analogues, quoique plus grossires, qui
paraissent rpondre
des
types
d'embarcations iden-
tiques,
ont t constates tant en Irlande
( Dowth)
2
que
sur des
pierres
de dolmens armoricains 3.
Les relations directes entre l'Irlande et l'ouest de la
Gaule semblent avoir
persist jusqu'au moyen ge.
Ainsi,
vers la fin du vie
sicle,
il est
question,
dans la
Vie de saint
Colomban,
d'un navire nantais
qui
commer-
ait
avec l'Irlande
(quae
vexerat commercia cum Hiber-
nia)*.
C'est
probablement
ces relations avec la Gaule
que
Tacite fait allusion
quand
il dit
que
les
ports
de
l'Irlande sont familiers aux
navigateurs
et aux commer-
ants
(aditus portusque per
commercia et
negotiatores
cogniti)
5. Car le commerce maritime de l'Irlande avec le
continent ne
pouvait
avoir
pour ports
d'attache
que
ceux de
l'Armorique,
de l'embouchure de la Loire et
de la Vende
;
4 Si l'Irlande a
reu
de Scandinavie le motif de la
spirale et,
probablement
aussi,
de
grandes quantits
d'ambre,
elle lui a
envoy,
en
revanche,
le
produit
de ses mines d'or. Cette
assertion,
mise d'abord
par
0.
Montelius, choque
assurment certaines ides
pr-
1. Gravures
rupestres, ap. Montelius-Reinach, Temps prhist.
en
Sude, fig. 145, 146,152, 153, 154,155 ; bronzes, ibid., fig.
176
;
Worsaae,
Nordiske
Oldsager, p.
36
; Bertrand,
Archol. celt. et
gaul.,
2e
d.,
p.
xix.
2.
Coffey, Shipfigure
at
Dowth,
dans les
Proceedings of
the
Royal
Irish
Academy, 1897, p.
586. Un modle en or d'un bateau irlandais
primitif
a t dcouvert en 1896
(Archaeologia,
t.
LV, p. 399).
3.
Coffey,
Trans.
Roy.
Irish
Academy,
t.
XXX, p. 34, auquel appar-
tient la
priorit
de cette observation
(1890).
Elle a t
reprise,
sans
mention du travail de M.
Coffey,
dans la Revue mensuelle de l'cole
d'Anthropologie, 1894, p.
285.
4.
Coffey, Origins of prehist. ornament, p.
44.
5.
Tacite, Agricola,
XXIV.
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 65
conues,
mais n'en est
pas
moins aussi
digne
de crance
que
si elle
s'appuyait
sur un
tmoignage
littraire. En
1875,
Lindenschmit
pouvait
dire
que
les
objets
d'or si
nombreux en Irlande avaient tous t
imports
dans l'le
1
et
Morlot,
en
1866, pouvait assigner
une
provenance
ouralienne l'or du
Mecklembourg
et du
Danemark,
trs
frquent parmi
les trouvailles de
l'ge
du bronze en
ces
pays
2. Renchrissant sur ces
assertions,
M. Schrader
a conclu du mot irlandais
or, cymrique
awr,
latin aurum
pour
*
ausum, que
le mot et la chose avaient t trans-
mis d'Italie en
pays celtique postrieurement
au
ph-
nomne du
rhotacisme,
c'est--dire vers le ive sicle
avant J .-C.
3
;
comme si le terme latin n'avait
pas pu,
l'poque impriale, prendre
la
place
d'un mot indi-
gne
! M.
Ridgeway
a fait
justement
observer,
ce
propos, que
l'or se dit en albanais
<?Xpi
(du
nom des
florins
de
Florence)
;
en raisonnant comme M.
Schrader,
on conclurait
que
l'or n'a t connu en Albanie
que
lors de la
prosprit
commerciale de Florence au
moyen
ge
4
!
L'archologie permet
de rduire nant toutes
les
hypothses
sur la
pntration
tardive de l'or dans
le nord-ouest de
l'Europe.
Elle nous montre des
objets
en or dans les
spultures nolithiques
de la Gaule et
de la
Bretagne,
comme dans les stations lacustres de
la
Suisse,
une
poque
antrieure de
plus
de dix sicles
la fondation de Rome. Elle nous
apprend que
ces
objets
ne sont
jamais
des imitations de modles
romains,
mais
que
leur dcoration est
toujours
celle des bronzes
et de la
poterie indignes, longtemps
avant
qu'il puisse
tre
question
de l'influence de l'Etrurie sur les
pays
1.
Lindenschmit,
Alterthumer unserer heidn.
Vorzeit,
t.
III, i,
Beilage, p.
20 et 21.
2.
Morlot,
Mm. dela Soc. des
Antiq.
du
Nord, 1866, p.
29.
3.
Schrader, Sprachvergleichung
und
Urgeschichte,
2e d.
(1890),
p.
254.
4.
Ridgeway, Origin of
metallic
currency, p.
61.
S. REINACH 5
66 LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
transalpins.
Le fait
que
de l'or irlandais a t
import
en Scandinavie
peut
d'ailleurs tre tabli avec
prcision.
Les
pays
Scandinaves ont fourni des
objets
d'or de
type
irlandais,
alors
que
l'Irlande n'a
pas
donn
d'objets
d'or de
type
Scandinave. Cela
dmontre,
sans
conteste,
que
de l'or ouvr a t
export
d'Irlande en
pays
Scan-
dinave et
que
le mouvement inverse ne s'est
pas pro-
duit. Si les imitations des
objets imports
sont
rares,
c'est
que
la Scandinavie
possdait
une industrie dve-
loppe,
un
got propre
;
les
bijoux qu'elle acqurait,
soit
par
le
commerce,
soit
par
des
expditions guer-
rires,
taient
gnralement
fondus et transforms
suivant le
got
des
indignes,
comme l'ont
t, plus
tard,
dans le mme
pays,
les
grandes quantits
d'or
romain dont les
peuples
du Nord se sont
empars.
D'un
autre
ct,
les
objets
en or dcouverts en Danemark
et en Sude et remontant
l'poque
du bronze sont
tellement nombreux
que
l'or
indigne
d'ailleurs trs
rare en Scandinavie
n'a
pu
en fournir la matire
;
et si l'on
allgue,
avec
Morlot, que
cet or venait de
l'Oural,
il faut
rpondre qu'il n'y
a aucune trace de
relations anciennes entre la Scandinavie et la
rgion
curalienne. Ces relations auraient ncessairement
port
sur d'autres
objets d'change
et les
produits
de
l'ge
du bronze ouralien ressembleraient ceux de
l'ge
du
bronze Scandinave
; or,
on ne
constate entre ces deux
sries aucun
rapport.
Cela
dit,
il est inutile d'insister
sur les
analyses
de l'or Scandinave
qu'a rapportes
M. Montelius
;
il suffit de dire
qu'il s'y trouve,
comme
dans l'or natif
irlandais,
de
l'argent
et des traces de
platine.
Mais
l'argument
tir des
types
industriels est
beaucoup plus
concluant
1
;
5
Enfin,
les
rapports
commerciaux de l'Irlande avec
les ctes occidentales de la France
(et
non
pas
seulement
1. C'est aussi l'avis de M.
Coffey,
The
Origins, p.
64.
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 67
l'Armorique)
sont
tablis,
ds
l'ge
du
bronze,
par
la
dcouverte,
faite sur la rive
franaise
de
l'Atlantique,
de
plusieurs
croissants irlandais videmment
imports.
Ceci nous amne
parler
de la distribution
gogra-
phique
de ces
objets.
Frazer en a numr
plus
de
60,
dont 32
Dublin,
11 au Muse
britannique,
4 Edim-
bourg,
1
Belfast,
3 dans des collections
prives
anglaises,
9
signals
lors de leur
dcouverte et
perdus
depuis,
2 recueillis Slande et Fionie
(au
muse de
Copenhague)
1,
4 dcouverts en France. A cette liste
je peux ajouter
d'abord deux croissants conservs au
muse de
Liverpool,
o
j'ai
eu rcemment occasion de
les voir
; puis
deux autres
exemplaires,
rests inconnus
de M.
Frazer,
qui
ont t exhums en France. Il a
cit,
la
vrit,
celui de Saint-Potan
(Ctes-du-Nord), appar-
tenant M. Paul du Chatellier Kernuz
2
et trois
croissants
disparus
dcouverts dans le
Cotentin,
Tour-
laville et
Valognes, qui
furent
fondus
presque
aussitt
aprs ;
mais il n'a
pas rappel
un
quartier
de lune
en or
dcouvert en 1759 dans
l'tang
de
Nesmy
(Vende)
et un
objet analogue
trouv Bourneau
(Vende)
en 18333.
Les croissants irlandais doivent tre considrs
comme des colliers ou des hausse-cols.
Frazer, aprs
d'autres,
a eu l'ide
d'y
voir des diadmes et de les assi-
miler aux ornements de ce
genre qui
ornent la tte des
impratrices
romaines sur les monnaies 4. Mais la forme
1. Worsaae
Oldsager, fig.
249 et Arch.
fiir Anthrop.,
t.
XIX,
p.
9.
2. P. du
Chatellier,
Ornement de tte en or dcouvert
Saint-Potan,
Vannes,
1892. M. du Chatellier dclare cet
objet
antrieur la
conqute certainement, et,
sinon de
l'poque
du
bronze,
tout au moins
de
l'poque gauloise
(p. 7) [Il
est
entr,
avec la collection P. du
Chatellier,
au Muse de
Saint-Germain].
3. Cf. Revue
archol, 1879, II, p.
255.
4. Cette
hypothse
a
dj
t examine
par Wilde, Catalogue,
Gold, p. 12, qui
a fait
valoir,
mais sans les
accepter,
les
arguments
qu'oi.
retrouve dans le mmoire de Frazer.
68
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
seule des extrmits suffit condamner cette
explica-
tion
;
si ces croissants avaient servi de
diadmes,
ils
devraient
s'vaser
obliquement
vers la
nuque,
au lieu
de
prsenter,
sur leurs deux
bords,
une courbure uni-
forme. Le croissant de
Valognes,
connu seulement
par
la
gravure
de
Caumont 1,
fournit un dtail essentiel
qui
ne doit
pas
tre
perdu
de vue. Un des coins se termine
par
un
crochet,
alors
que
la corne
oppose
est munie
d'une chanette.
Frapp
de cette
particularit,
M. Paul
du Chatellier a mis
l'opinion que
les croissants taient
faits
pour s'agrafer
sur la tte
des femmes et sous leur chi-
gnon, lequel passait
travers
la
partie
vide. Mais M. Car-
tailhac
2
a
justement object
que
les
extrmits,
seules dco-
res avec
soin,
auraient
t,
dans cette
hypothse,
absolu-
ment invisibles. La
prsence
d'un crochet et d'une chanette
s'expliquent,
au
contraire,
fort
bien,
s'il
s'agit
d'un
gorgerin
ou d'un hausse-col. C'est le nom
qu'ont
donn ces
objets
les
premiers antiquaires franais
qui
s'en soient
occups,
Millin et
Gosselin,
et nous
croyons qu'il
faut
le conserver. Si l'ouverture est
parfois
trs
petite,
c'est
que
les
bijoux
de ce
genre pouvaient
tre
ports par
des enfants.
D'ailleurs,
dans la
plupart
d'entre
eux,
elle est assez
large pour qu'un
col de femme
puisse
aisment s'en accommoder 3.
1.
Reproduite
en dernier lieu dans Y
Anthropologie,
t.
V, p.
206.
2. Ibid.
3.
nderson,
Scotland in
pagan times,
t.
I, p.
222 : The central
opening
is
large enough
to admit
of
the ornament
being
worn either
on the head as a
diadem,
or on the neck as a
gorget.
G. de
Mortillet,
en 1867
(Matriaux, II, p. 334),
se demandait aussi s'il fallait voir
dans ces croissants des diadmes ou des hausse-cols.
[J 'incline
FIG. 12.
Croissant d'or
dcouvert
Valognes
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 69
Ainsi,
longtemps
avant
l'poque
o les
lgions
romaines et les armes des
princes grecs
d'Asie s'ton-
naient du luxe des
torques
d'or
ports par
les
Gaulois,
une mode
analogue
existait en Irlande. Mais dans cette
le,
comme
parmi
les tribus
gauloises
du second
ge
du
fer en
Champagne,
les colliers taient exclusivement
rservs aux femmes.
Si,
une
poque postrieure,
le
torques
est devenu aussi un ornement des
guerriers,
cela tient
peut-tre
l'influence
exerce,
sur les Gaulois
de la
Cisalpine, par
les
trusques,
dont le
got pour
les
parures
du cou est attest
par
les monuments.
Revenons maintenant la
question que
nous avons
dj aborde,
celle de la
production
de l'or en Irlande
l'ge
du bronze.
L'Irlande semble avoir
t,
vers l'an 1500-1000 avant
J .-C,
un vritable Eldorado. Le souvenir de cette
richesse n'tait
pas perdu
l'poque historique,
bien
que
les textes
grecs
et romains n'en
parlent pas.
Au
xne
sicle,
le livre de Leinster mentionne l'extraction
de
l'or,
dont les
premiers lingots
auraient t fondus
par
le roi milsien
Tighearnmas
dans les forts situes
l'est de la rivire
Liffey
1. Au sicle dernier
encore,
on
exploita
avec succs de l'or d'alluvion dans le
comt de
Wicklow,
la suite de la
dcouverte,
due au
hasard,
d'une
ppite pesant
22 onces dans un affluent
de l'Ovoca. Pendant six
semaines,
toute la
population
des
alentours,
abandonnant le travail des
champs,
accourut vers le
placer.
Bientt le
gouvernement
inter-
vint et institua lui-mme des recherches
qui,
de 1796
1798,
donnrent
pour plus
de 100.000 francs de
mtal
;
les
particuliers
en avaient
retir, dit-on,
pour
aujourd'hui
penser que
les croissants d'or sont des ex-voto et des
ornements d'idoles en bois
plutt que
des
objets
de
parure.
1929].
1.
Wilde, Catalogue, Gold, p.
6.
70 LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
plus
de 250.000.
Depuis 1795,
le
produit
du mme
district,
irrgulirement exploit,
a t valu
750.000 francs 1. Il
parat
vident
que
l'or de Wicklow
constituait une sorte de
poche, nglige, par
hasard,
l'poque
de
l'exploitation prhistorique
;
ces deux
ou trois cents
kilogrammes
d'or recueillis la
surface,
dans
quelques valles,
donnent une ide de ce
que
pouvait
tre la richesse naturelle de l'le entire avant
que
les hommes n'eussent commenc
y
recueillir le
prcieux
mtal. L'Irlande
prhistorique,
comme
My-
cnes,
a t
iroXdxpuoo; mais,
la diffrence de
Mycnes,
elle
produisait
son or elle-mme
et,
loin de le tirer du
dehors,
semble l'avoir
export
au loin.
Humboldt a fait cette
remarque profonde que l'or,
toutes les
poques,
est venu de
pays qui
sont comme
les marches de la civilisation 2. Il
parat
ainsi reculer
devant
elle, parce qu'elle
se rue sur lui et
l'puis.
L'or
est
peut-tre,
de tous les
mtaux,
le
plus rpandu,
bien
qu'il
se trouve
partout
en
quantits
relativement
faibles. Il
n'y
a
gure
de
pays qui
ne
possde
de fleuves
aurifres
3
;
ceux de la Gaule roulaient autrefois de l'or
en abondance 4. Ne
s'oxydant pas,
se
prsentant
sous
l'aspect
de
paillettes
brillantes ou de
ppites,
l'or devait
attirer de trs bonne heure l'attention des hommes.
1.
Encyclop. Bril.,
8e
d.,
art.
Ireland, p.
218. Voir aussi
Wilde,
Catalogue, Gold, p.
2et
suiv.,
et les mmoires cits
par Coffey, Origins,
p. 40,
notamment J ourn.
Roy.
Geol. Soc.
of Ireland,
t.
VI, p.
147. L'or
irlandais est au titre de 21
3/8
21
7/8
carats et alli
d'argent,
mtal
qui,
comme le
plomb,
est fort
rpandu
en Irlande. En
1854,
date de
l'apoge
de l'industrie minire dans ce
pays,
10
compagnies
tirrent d'Irlande 2.210 tonnes de
plomb
et 18.000 onces
d'argent.
2. Cf. L. de
Launay,
Revue
gnrale
des
sciences, 1895, p.
363.
3.
Fournet,
De
l'influence
du mineur sur les
progrs
de la civilisa-
tion
(Lyon, 1861), p.
116.
4.
Diodore, V,
27. Sur la richesse en or de la
Gaule,
atteste
par
Strabon,
Diodore et.
Pline,
voir
Ridgeway, Origins of
metallic
currency,
p.
88 et suiv. Strabon
signale
de l'or en
Grande-Bretagne ;
il
y
en a
encore dans le
pays
de Galles et en Ecosse
(Ridgeway, p. 95).
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
71
J e suis
convaincu
qu'on
l'a recueilli tout
d'abord,
et
que
la
mtallurgie
si
simple
de l'or a ouvert la
voie
celle du
cuivre, qui
est autrement difficile et
complique.
L'ide
que
l'or a t le
premier
mtal connu et
qu'il
peut
tre
question
d'un
ge
de l'or
contemporain
de
la fin de
l'ge
de la
pierre
a t
dveloppe
ds 1861
par
Fournet dans son excellent livre De
l'influence
du
mineur sur les
progrs
de la civilisation 1.
Reprise depuis
(sans
mention de
Fournet) par
M.
Ridgeway
2,
elle me
semble conforme la fois au bon sens et aux faits archo-
logiques
connus.
Non seulement l'or a
t, parmi
les
mtaux,
le
pre-
mier
que
l'homme ait
recueilli 3,
mais il a donn l'ide
de travailler les
autres,
notamment le
cuivre,
qui,
une fois
dgag
de son
minerai,
ressemble l'or
par
son clat. Certaines traditions
religieuses prouvent que
J e cuivre a t
longtemps
considr comme mtal
sacr,
l'exclusion du
fer, qui
est
d'emploi plus
rcent
4;
1.
Fournet,
Le
mineur, p.
111 : On est invitablement amen
penser que
l'orfvrerie
naissante, que
le
premier ge
de l'or sont
contemporains
de celui de la
pierre.
2.
Ridgeway,
The
origin of
metallic
currency
and
weight standards,
p.
58.
3.
Fournet, p.
112 : Le mtal
prcieux
se rencontre
quelquefois
en masses
passablement volumineuses,
dans des
positions
tout fait
superficielles.
Il se trouve aussi au milieu d'anciennes
alluvions,
composes
de sables et de
graviers
dont
l'exploitation
fut amene
par
la
simple
raison
que
les
pluies,
les
ravines,
les torrents et les
rivires mettent continuellement en vidence ces
grains,
ces
paillettes,
ces
poudres
d'or de
plus
en
plus
attnues. Il ne
s'agissait
donc
pas
ici de travaux miniers comme
pour
obtenir le silex. Le mtier d'or-
pailleur
se borne d'abord imiter la
nature, qui,
avec ses
eaux,
emporte
au loin les
parties
terreuses ou sableuses des
dpts
en ne
laissant sur
plafce que
les matires
lourdes,
au milieu
desquelles
le
mtal
prcieux
s'arrte naturellement cause de sa
grande pesan-
teur.
4. Cf.
Bertrand,
Archol.
celtique
et
gauloise,
2e
d., p. 22, qui pro-
pose d'ailleurs, pour
ces
faits,
une
explication
inadmissible. Le texte
capital
est celui de Macrobe
(V, i)
: Omnino ad rem divinam
pleraque
aenea adhiberi
solita,
multa indicio sunt.
72 LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
mais il
y
a aussi des traditions
comme celle o
parat
la faucille d'or des
Druides 1,
rapprocher
de la faucille
de cuivre de la
magicienne
de
Virgile
2
d'o l'on
peut
conclure
que l'emploi
de l'or est encore
plus
ancien
que
celui du cuivre. La raret et le
prix
de ce mtal
aux
poques historiques expliquent qu'il
se soit conserv
trs
peu d'objets
d'or remontant une
poque
trs
lointaine;
on connat toutefois des colliers et des clous
d'or
recueillis,
en France
mme,
dans des monuments
appartenant
la fin de
l'poque nolithique
3. C'est
une chose trs
digne
de
remarque que
l'or s'est rencontr
avec cette substance
d'origine mystrieuse,
la
callas,
qui
est
frquente
dans les
grands
dolmens
armoricains,
mais ne
parat jamais
dans les
dpts
ou cachettes de
bronze. En
Grande-Bretagne
comme en
Armorique,
de
petits
rivets d'or
employs
comme clous se trouvent
dans des monuments de la fin de
l'poque nolithique
4.
On a recueilli de
l'or,
dans des barrows
anglais,
avec
des
perles
d'ambre et des
poignards
de
bronze 5;
ces
derniers
objets
caractrisent
nettement les dbuts de
l'ge
du bronze dans nos
pays, puisqu'ils
se sont ren-
contrs
quelquefois
dans des dolmens
d'o,
en
revanche,
on n'a
jamais
exhum ni une
perle
d'ambre,
ni une
pe
de
bronze,
ni une
pe
de fer.
1.
Pline, XVI,
250 : Sacerdos candida veste cultus arborera
scanditt
falce
aurea
demetit,
etc.
2.
Virg., Aen., IV,
513 : Falcibus et messae ad lunam
quaeruntur
ahenis Pubentes herbae...
3. A l'intrieur d'un tumulus de la
Loire-Infrieure,
il
y
avait, des
perles
d'or en forme de
tubes,
un vase
caliciforme,
une admirable
pointe
de flche en silex et une
tige
de bronze
(L'Anthropologie,
1894,
p. 329).
Fournet, p.
109 : Dans la Suisse on a
trouv,
comme
appartenant
l'ge
de
bronze,
de
petites tiges (d'dfr)
enroules en
tire-bouchons
et,
de
plus,
une fine lamelle cannele
qui indique
l'emploi
du
laminoir,
instrument vraiment
remarquable pour
une
si haute
antiquit,
mais
qui
se conciliait fort bien avec les damas-
quinures
d'tain
dj
mentionnes
pour
les
poteries.
4.
Archaeologia,
t.
XXXIV, p.
254
;
Revue
archol, 1890, II, p.
320.
5.
Greenwell,
British
Barrows, p.
55.
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 73
Un autre
mtal, l'tain,
se trouve aussi sous la forme
de
paillettes
brillantes
qui
ont d de bonne heure
appe-
ler l'attention 1.
Or,
prcisment,
on a recueilli dans les
stations lacustres de la Suisse d'assez nombreux
objets
en tain
pur 2,
ainsi
que
des
fragments
de
poterie
comme
damasquine
avec de
l'tain, preuve que
ce mtal fut
employ
d'abord sans
alliage
et
qu'il
n'a
pas
t
import,
dans
l'Europe oc-cidentale, par je
ne sais
quelle
tribu de
bronziers venus du fond de l'Asie. En second
lieu,
il
est
remarquable que
l'tain se trouve souvent associ
l'or dans les mmes
gisements,
notamment en Saxe
8
et dans le centre de la
France,
o la
plupart
des
anciennes mines d'or
s'appellent
encore Laurire ou
L'Aurire. II
y
a des
traces
d'tain,
en Irlande
mme,
dans le district de
Wicklow,
qui
est
prcisment
le
plus
riche en or 4. N'est-il
pas
naturel de conclure de
l
que
la recherche de l'or mit sur la voie de la dcou-
verte
de
l'tain 5, puis que l'puisement
de l'or donna
l'ide d'extraire le cuivre de ses
oxydes
et
que
le nou-
veau mtal fut alli
l'tain,
dont on avait bientt
reconnu le
peu
de rsistance ? Tout cela
put
et dut se
faire,
indpendamment,
dans
l'Europe occidentale,
dans
l'Europe centrale,
en
Asie,
partout
o existent
la fois de
l'or,
du cuivre et de l'tain et o les hommes
1.
L'argent, qui
ne se rencontre
presque jamais
l'tat
pur,
n'a
t recueilli et travaill
que plus
tard.
2. Parmi ceux
qui
se trouvent
aujourd'hui
au muse de
Lausanne,
il
y
en a dont
l'antiquit
m'a
paru
bien
suspecte.
3.
Fournet, op. laud., p.
115.
4.
Coffey, Origins of prehist. ornament, p.
39.
5.
Fournet, op. laud., p.
119 :
Les ailuvions
(aurifres) peuvent
aussi tre stannifres et l'or tant mme
quelquefois
demeur soud
aux cailloux
d'oxyde d'tain,
on
conoit
comment ces enchanements
facilitrent les dcouvertes
respectives.
Enfin
j'admets que
si l'or
a t connu ds
l'ge
de la
pierre,
l'tain a d tre
obtenu,
sinon
au mme
moment,
du moins
peu
de
temps aprs.
Le retard relatif
ne
provient
que
de la difficult
qu'il y
eut d'inventer les
procds
pour
rduire son minerai l'tat
mtallique.
74 LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
furent assez dous
pour profiter
de ces heureuses cir-
constances. Des trois mtaux
que
nous venons de
nommer,
l'tain est celui dont les
gisements
sont les
plus rares,
ce
qui explique
le
petit
nombre des centres
de fabrication du bronze
prhistorique.
Mais
l'hypo-
thse
d'un centre
asiatique unique
devrait tre enfin
abandonne,
comme inconciliable avec la vraisem-
blance et avec les faits.
J 'ajoute que
ce n'est
pas
seulement en
Gaule,
mais
dans bien d'autres
pays, que
la recherche et mme
l'extraction de l'or
appartiennent
l'poque prhis-
torique.
Dans des travaux souterrains
effectus,
en
Sibrie, pour
l'extraction de
l'or,
Pallas a
signal,
au
xvme
sicle,
des
objets
tranchants en
bronze,
ant-
rieurs, par suite,
la connaissance des outils de fer
dont le bronze ne
put
soutenir la concurrence 1.
Agathar-
chide
racontait
que,
de son
temps,
vers l'an 100 avant
J .-C,
on trouvait dans les anciennes mines d'or de
l'Egypte
les ciseaux de bronze des ouvriers
d'autrefois,
qui, ajoute
le
gographe,
ne connaissaient
pas
encore
l'usage
du fer 2. Plus
anciennement,
les
Egyptiens
avaient tir leur
or,
l'tat de
ppites
et de
poudre,
de la
Nubie,
dont le nom
(Nub
=
or) correspond
exac-
tement celui d'El Dorado. Sur les bords de la mer
Rouge,
les Anciens mentionnent un
peuple,
les
Debae,
qui possdaient
de l'or et n'taient
pas
encore mtal-
lurgistes,
car ils
changeaient
leur
prcieux
mtal contre
du
cuivre,
du fer et de
l'argent
3.
Presque
toutes les
mines d'or situes sur les rives de
l'Archipel
taient
dj
abandonnes du
temps
de Strabon
;
mais on conser-
1.
Pallas, Voyages,
t.
IV, p.
601
; Congrs
internat, de
Budapest,
p.
319.
2.
Geogr. minores,
d.
Didot,
t.
I, p.
128-129 :
Epcy.ov-rai
Sa ITI
y.ai xaO'
^iit
v
TO
xPucr''
T0'?
TT' sxsivtov/.XTatr/.e'jaa-feo-i
\a~o[i.i5i [v
y^aXxa,
i T
J X^TTU TTJ V
TOO
iTirjpou
y.o.~'XEVOV TOV
ygbvovfvcoptc-Oxi y^zionv.
3.
Strabon,
p.
661,
45
; Diodore, III, 45,
4.
LES
CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 75
vait en Grce le
souvenir d'une
poque, correspondante
l'ge
du
bronze,
o elles avaient fourni d'immenses
richesses
Tantale,
aux
Plopides,
Priam,
Cadmos,
Midas 1. Hrodote nous dit
qu'au
ve sicle encore avant
J .-C. certaines tribus
scythiques
avaient des vases
d'or,
mais ne se servaient ni
d'argent
ni de cuivre 2. Ainsi
l'exploitation
des
filons,
toujours postrieure
celle
des alluvions et des
placers,
semble avoir t surtout
florissante
l'poque
du bronze et l'on
peut approuver
cette conclusion de
l'ingnieur
Zannoni :
L'or me
parat
caractriser le maximum du
dveloppement
de
la
premire priode
des mtaux. Mon ide sera-t-elle
trange
en disant
(sic) que l'ge
du bronze a
pass
l'ge
du fer sur un tout
petit pont
d'or ?3
Mais
partout
o les hommes ont renonc la vie
nomade
pour
la vie
sdentaire,
ils ont
rapidement
puis
les
quantits
d'or
parses
sur leur sol
4
;
d'o ce
rsultat,
encore constat de nos
jours, que
l'or se rvle
seulement dans les
pays
o la civilisation vient de
pntrer.
Ce
qui
se
passe aujourd'hui
dans l'Alaska
et dans le sud de
l'Afrique
a d se
produire
bien des
fois dans
l'antiquit.
La dcouverte de l'or a t le
plus puissant
stimulant de l'industrie naissante
et du
commerce,
mais aussi une cause de luttes meurtrires
et de
guerres
d'extermination.
Toutefois,
l'or
puis
ou devenu
rare,
la
rgion
aurifre a
gard,
d'une manire
plus
ou moins
durable,
le bnfice de sa fcondit mtal-
lique.
D'autres
produits
du sol ont t recherchs
comme
objets d'change ;
les relations
commerciales,
1.
Ridgeway, op. laud., p.
72.
2.
Hrodote, IV,
71.
3.
Congrs
international de
Budapest, p.
319.
4. Sur la
rapidit
avec
laquelle
les
gisements
d'or
s'puisent,
voir
L. de
Launay,
Rev.
gn.
des
sciences, 1895, p.
365. En
Australie,
il
suffit de 23 30 ans
pour que
l'or ait
disparu
la surface d'un district.
Les mines mmes se vident trs
vite,
tmoin celles de la
Californie,
qui produisaient
336 millions d'or en
1853,
et 64 seulement en 1891.
76 LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
une fois
cres,
se sont maintenues en se transformant
;
l'industrie s'est tourne vers
l'exploitation
et la mise
en oeuvre des autres mtaux
;
en un
mot,
la civilisa-
tion s'est
implante,
avec la richesse durable
qu'elle
apporte,
dans les
rgions
dont les richesses
superficielles
avaient t
rapidement puises.
L'puisement
de l'or
irlandais, ou,
du
moins,
de la
quantit
d'or facile
recueillir,
doit tre bien antrieur
la
conqute
de la
Grande-Bretagne,
car les Romains
ne savaient
pas qu'il y
et de l'or en Irlande et ils l'au-
raient
probablement conquise
s'ils l'avaient su. D'autre
part, quand
on
constate,
dans les
Muses,
le
grand
nombre des
bijoux
d'or irlandais vers l'an 1500 avant
J .-C. et la
pnurie
relative
d'objets
en or
appartenant
l'poque
du
fer,
on est tent de croire
que l'puise-
ment du mtal
jaune
a d se
produire
bien avant le
ve sicle. Cette
hypothse, qui
se
prsentait
avec force
mon
esprit
dans
les salles du muse de
Dublin, per-
mettrait
d'expliquer
ce
qu'il y
a de
singulier
dans le
dveloppement
de la civilisation matrielle en Irlande
tel
qu'il
nous est actuellement
permis
de l'entrevoir.
Avant l'an
1000,
une
grande richesse,
des monuments
magnifiques,
une
cramique
trs
dveloppe,
des rela-
tions commerciales suivies avec la Scandinavie et la
Gaule,
peut-tre
mme la
prise
de
possession, par
des
Vikings irlandais,
de
quelques points
de notre littoral.
Puis une dcadence
brusque,
une
quasi-disparition
de
la civilisation
matrielle,
comme si une invasion de
Barbares venus de l'Ecosse ou de la Scandinavie avait
touff la civilisation du bronze et celle de l'or. De la
premire
poque
du
fer,
presque
rien
;
de la
seconde,
des
objets remarquables,
mais d'un
style
tardif et sans
originalit propre, qu'on pourrait
croire
fabriqus
en
Grande-Bretagne
ou en
Ecosse,
parce qu'on y
trouve
les mmes
objets
en
plus grand
nombre. A
l'poque
romaine, presque rien,
nouvelle
clipse;
enfin,
la
grande
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
77
Renaissance irlandaise
qui
commence vers le ve sicle
et,
sous l'influence de
Byzancc jointe
celle de la
Scan-
dinavie,
produit
un art
nouveau,
d'une
perfection
tech-
nique admirable,
dont le Muse de Dublin montre avec
orgueil
les
chefs-d'oeuvre,
en
particulier
la chsse
pyrami-
dale en
or et en
argent qui
abrite, depuis
le xie
sicle,
la cloche de saint Patrice.
Il semble bien
que
l'Irlande n'ait
pas
t la seule
victime d'une dcadence
que
l'on
peut placer
vers la
fin de
l'ge
de
bronze,
aux environs de l'an
1000,
et
dont les effets se firent sentir
pendant
des sicles.
Quand
un
archologue,
familier avec le
dveloppement
de
l'ge
du bronze en
Grande-Bretagne,
lit dans Csar
que
les Bretons doivent
importer
leur cuivre ou leur
bronze 1,
alors
que
les minerais de cuivre et l'tain sont
trs communs dans l'ouest de la
grande
le,
il hsite
d'abord
ajouter
foi au
tmoignage
du
conqurant
romain. Mais il n'est vraiment
gure
admissible
que
Csar et
reprsent
les Bretons comme vivant dans
un tat aussi
primitif
si l'activit industrielle dont
tmoignent
les restes de
l'ge
du bronze n'avait
pas
t
alors arrte
depuis longtemps.
L
aussi,
comme en
Irlande,
bien
qu'
un moindre
degr,
il
y
eut un recul
de la
civilisation,
un retour vers la
barbarie,
pareil
celui
qui
se
produisit
en Asie Mineure la suite de la
conqute turque.
Un
phnomne analogue
est trs
apparent
dans l'est de la Gaule. Les stations lacustres
de
l'ge
du bronze
disparaissent
en
pleine prosprit,
comme
frappes par
une
catastrophe
soudaine
;
le
premier ge
du fer
tmoigne
d'une civilisation
plus
rude,
dont le caractre
est
plutt guerrier qu'industriel.
En
prsence
de ces
faits,
nous
songeons
naturellement
la ruine de la civilisation achenne
par
l'effet de
l'invasion des Doriens et sommes tents d'admettre
1.
Csar,
Bell,
gall., V,
12 : Are utuntur
importato.
78 LES CROISSANTS D'OK IRLANDAIS
une corrlation
historique
entre des vnements
peu
prs contemporains
et
ayant prsent
le mme carac-
tre. On a
parl
avec raison d'un
premier moyen ge
grec, l'poque
o s'labora
l'pope homrique ; je
ne suis
pas loign
d'admettre au mme
moment,
et
sous l'influence de causes
analogues,
un
premier moyen
ge celtique.
N'est-il
pas permis
de rattacher le dbut de ce
moyen
ge
la
premire invasion,
dans les Iles
britanniques,
des tribus
qui y
ont introduit les
langues celtiques
?
Les donnes
chronologiques auxquelles
on est arriv
par
d'autres voies concordent bien avec cette
hypo-
thse. En
1892, j'ai
mis
l'opinion que
le mot
kassiteros,
signifiant l'tain, qui
est
dj
dans
Homre,
tait un
vocable
celtique, dsignant
la
rgion loigne
d'o
provenait
ce mtal 1. Deux ans
aprs,
dans la seconde
dition de son livre Les Premiers habitants de
l'Europe,
M. d'Arbois de J ubainville crivait
2
:
Si l'on admet
la doctrine nouvelle mise
par
M. Salomon
Reinach,
si l'on crot
que kassiteros,
nom
grec
de
l'tain, dj
dans
l'Iliade,
est en mme
temps
un nom
celtique
de la
Grande-Bretagne,
il faut conclure
que
les Celtes du
premier
ban sont arrivs dans cette le avant la
priode
homrique,
950-800 avant
J .-C,
et
que
la chute du
p
indo-europen
en
celtique
a
prcd
cette date. J e
crois
toujours que
kassiteros est un mot
celtique
et
que,
par
suite,
il
y
avait des Celtes en
Bretagne,
ou du moins
sur la cte
oppose
de la
Gaule,
vers l'an 900 avant J -.C.
Il est donc raisonnable d'attribuer une
poque
un
peu antrieure,
c'est--dire aux environs de l'an
1000,
la
premire
invasion
celtique
en
Bretagne ; or,
cette
invasion s'est certainement tendue l'Irlande dont la
langue
drive de celle des Celtes
du
premier
ban .
1.
L'Anthropologie,
1892, p.
275.
2. D'Arbois de J ubainville. Les
premiers
habitants de
l'Europe,
2e
d.,
t.
II, p.
283.
LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 79
D'autre
part,
M. d'Arbois de J ubainville a montr
que
les Celtes du second
ban,
les
Belges, qui
envahirent
la
Grande-Bretagne
vers l'an 200 avant
J .-C,
sont
alls,
eux
aussi, jusqu'en
Irlande 1. Car Ptolme cite dans
l'Irlande du Sud la ville de
Menapia
2, qui rappelle
singulirement
le nom des
Menapii, peuplade belge
qui
habitait aux environs de
Cassel,
dans le
dparte-
ment actuel du Nord. C'est cette seconde invasion
qu'il
faudrait attribuer
l'introduction,
en
Irlande,
d'objets
du
style
de Latne
(le
Marnien des archo-
logues franais),
dont nous avons
signal plus
haut le
caractre tardif et le
manque d'originalit.
En
effet,
les
origines
du
style
de Latne
remontant,
en
Gaule,
aux environs de l'an 500 avant
J .-C,
il est naturel
que
les
spcimens
de ce
style,
recueillis en Grande-
Bretagne
et en
Irlande,
appartiennent
l'une des
dernires
phases
de son volution dcorative. C'est ce
qu'il
est facile de
constater,
quand
on connat le
style
de Latne sur le
continent,
en examinant les
objets
analogues
tant au British Musum
qu'au
Muse natio-
nal de Dublin.
Ainsi
l'Irlande,
la fin de
l'ge
de
bronze,
a t vio-
lemment
celtise,
et l'on n'a
pas
le droit de
qualifier
de
celtique
la civilisation
primitive
de ce
pays,
dont les
affinits sont
plutt ibriques.
C'est la barbarie
qui fut
celtique.
Antrieurement cette
crise,
la civilisation
du bronze
et de l'or fut aussi florissante dans le nord-ouest
que
dans le sud-est de
l'Europe;
l'Irlande d'alors
put pres-
que
se
comparer
la Grce
mycnienne. Aprs
l'an
1000,
la civilisation
europenne rtrograde
ou
s'tiole,
tandis
que
la
rgion
orientale de la
Mditerrane,
grce
la
proximit
de la
Babylonie
et de
l'Egypte, reprend rapi-
1.
D'Arbois, op. laud., p.
297.
2.
Ptolme, II, 2,
7.
80
LES
CROISSANTS D'OR IRLANDAIS
dment son
essor,
pour
introduire
plus
tard,
dans l'Eu-
rope
occidentale reste ou redevenue
barbare,
la civi-
lisation
grco-romaine.
En
Irlande,
cette civilisation
ne
pntra qu'avec
le christianisme et
y
trouva un
terrain
propice.
Mais ce n'tait
pas
un terrain
vierge.
Les couches
profondes
de l'le recelaient et nous ont
rendu les monuments d'un
pass
lointain,
alors com-
pltement
oubli,
o l'Irlande avait
jou
le rle d'un
foyer
industriel et
commercial, peut-tre
aussi
car
le Druidisme a
pu
natre l o il est all mourir
d'un
centre
religieux
et
philosophique.
V
LE COLLIER D'EVORA*
J e voudrais soumettre
l'apprciation
de la Socit
un
objet
indit
qui
me semble bien mriter tude et
discussion. J e n'ai
pas apport
ici
l'original,
masse d'or
fort lourde d'une valeur de
prs
de
300,
parce que
des
masses d'or ne doivent
pas voyager
sans
escorte;
mais
l'atelier du Muse de Saint-Germain en a fait une
copie
galvanoplastique
et un
dveloppement
de la dco-
ration, qui peuvent
circuler sans inconvnient. Le
fac-simil sera
expos
au
Muse, l'original
restant dans
notre
coffre-fort,
asile tout
dsign pour
les lourds
joyaux qui
ont une tendance
migrer
vers le creuset
du
fondeur, ports par
des mains non autorises
(fig. 13).
Cet extraordinaire collier
appelons-le
ainsi sans
en
prjuger l'usage
est en or
massif,
au titre de
800,
et
pse
2.300
grammes.
Il
passe pour
avoir t exhum
en 1883 ou vers cette
poque
au
Portugal,
dans la
pro-
vince
d'Alemtejo,
non loin
d'Evora, par
un
paysan qui
creusait la terre au
pied
d'un arbre. La bche dut tre
manie
nergiquement,
car elle a entam le mtal en
six
points
voisins. J e ne
pense pas que
ces entailles
aient t faites
par
l'inventeur afin de reconnatre si
l'objet
tait vraiment en or. On m'a dit
qu'il
avait
1.
[Publi
d'abord en
anglais,
sous forme d'une confrence
faite
la Socit des
Antijjuaires
de
Londres,
le 27 novembre
1924,
dans
VAntiquaries J ournal,
2 avril
1925,
t.
V,
n
2, p. 123-133].
S. REINACH 6
82 LE COLLIER D EVORA
trouv trois colliers semblables et
que
les deux
plus
petits
furent immdiatement
fondus,
ce dont
j'ai
quelque
raison de douter.
Le
plus grand
fut d'abord
acquis par
une dame
portugaise
du nom de
Mattos,
qui
le
lgua
sa fille
;
celle-ci le vendit au
pre
de
M.
J oaquim
Avantes Ferreira da Silva
qui, aprs
avoir
vainement
essay
de le revendre au Muse de
Lisbonne,
alors court de
fonds,
s'en
spara
au
profit
du Muse
de
Saint-Germain,
o il fut
enregistr
sous le n 67.071
(juin 1920),
mais n'a
pas
encore t
expos
ni
publi.
Bien
plus
lourd et
plus
habilement dcor
que^tout
objet
de ce
genre
ma
connaissance,
du moins
-
ce
collier n'est
pas
tout fait
unique.
Emile Cartailhac
et Pierre Paris en ont
signal
un autre du mme
style,
Fig.
13.
Collier d'or
provenant
d'Evora.
LE COLLIER D EVORA 83
qui
aurait t dcouvert
Penella
(fig. 14) ;
on connat
deux localits de ce
nom,
l'une au nord de
Combre,
l'autre dans la
province
d'Oviedo. Ce
collier,
aussi en
or
massif,
ne
pse que
1.800
grammes
1. Non seulement
la dcoration est trs semblable celle du
ntre,
mais le
systme
de fermeture est
identique,
comme le montre
la
figure publie par
Cartailhac et
reproduite par
Paris.
Cartailhac crivait en 18962
que
M. da Silva avait
eu la bonne fortune
d'acqurir pour
le Muse de Lis-
bonne en 1882
l'objet
trouv
Penella, Estrmadure,
1. Une admirable
planche
en couleur de ce collier a
paru
en Por-
tugal ;
une
preuve,
offerte
par
cele chevalier da
Silva,
directeur
du Muse de Lisbonne
existe la
bibliothque
du Muse de Saint-
Germain. La
lgende
est la suivante : Grande
argola
di
ouro,
achada
em
Portugal
na
provincia
da Estremadura em
1883,
da
grandesa
do
original.
J e n'ai vu cette
planche
dans aucune
publication.
Cartail-
hac l'a
reproduite
sans
indiquer
sa source et P. Paris l'a
prise
Car-
tailhac.
2.
L'Anthropologie, 1896, p.
374.
Fig.
14.
Collier d'or
provenant
de Penella.
84
LE COLLIER D EVORA
qu'il
(Cartailhac)
avait
publi
en 1886. crivant
la
mme
anne 1,
M.J Leite
de Vasconcellos dit
que
ce col-
lier avait t
acquis par
le roi Ferdinand II. Evidem-
ment,
ni Cartailhac ni Paris ne l'ont vu. En
1886,
Cartailhac dit
que
le collier est en deux
parties,
runies
d'une
faon
que
M. J . da Silva
n'explique pas
suffisam-
ment 2. Dix ans
aprs,
Cartailhac nous dit
que
le che-
valier da
Silva,
Lisbonne,
est
plus qu'octognaire.
J e crois
qu'il
tait le
pre
de M.
J oaquim
Arantes
Ferreira da
Silva, qui
a cd le collier le
plus
lourd
Saint-Germain.
1. 0
Archeologo portugus, 1896, p.
21.
2.
Cartailhac, Ages prhistoriques
de
l'Espagne
et du
Portugal,
p.
297.
Fig.
15.
Collier d'or
provenant
de Cintra.
LE COLLIER D EVORA 85
Quant
la
provenance,
il est ais de concilier les
deux indications
donnes,
car une Penella est entre
Combre et
Evora,
dans l'Estrmadure du
Portugal.
Un autre collier
lusitanien,
dcouvert
prs
de Cintra
dans les rochers en 1895 et rvl Cartailhac
par
le
mme chevalier da
Silva,
doit d'autant
plus
tre
rap-
pel
ici
qu'il
est conserv maintenant au Muse britan-
nique (fig. 15)
1. Le
poids
de l'or est de 1.262
grammes.
Au lieu d'tre une masse
solide,
ce collier se
compose
de trois
tubes
adhrents, dispositif qu'on
voit
parfois
dans
l'Europe
du
Nord et dont il
y
a un
exemple
aux les Balares 2. Les ornements
gomtriques
des tubes sont les
mmes
que
ceux du collier de
Penella,
mais le
systme
de fer-
meture est tout autre. La diff-
rence
principale,
c'est
que,
dans
le collier de
Cintra,
la
priphrie
est dcore de
petites
coupes
formant
saillies,
ce
qu'on
voit
quelquefois
sur
des
objets
du
premier ge
du fer
3
et,
pour
citer un
exemple intressant,
sur un beau cercle d'or ou
pendant
d'oreille du tumulus des Mousselots
(Cte-d'Or),
ainsi
orn de 16
petites coupes (fig. 16)
4. Des saillies
ana-
logues
se trouvent sur un
objet
d'or
espagnol
de date
plus
tardive,
le bandeau dit de
Cacrs,
o la dcoration
n'est
plus gomtrique,
mais se
compose
de cavaliers
et de
guerriers
travaills au
repouss
5.
1.
L'Anthropologie, 1896, p.
373
;
0
Archeologo portugus, 1897,
p.
17
;
P.
Paris, Espagne primitive, p.
424
;
Brit.
Mus.,
Bronze
ge
Guide, p.
158.
2.
Cartailhac,
Monuments
primitifs
des
Balares, 1892, fig.
63.
3.
Montelius,
Ital.
septentr.,
B, pi.
54
; Forrer, Lexikon, pi.
84. 9.
4.
Dchelette, Manuel,
t.
III, fig.
363.
5.
Paris, op. cit., II, pi.
9.
Fig.
16.
Pendant d'or
des Mousselots
(Cte-d'Or)
86 LE COLLIER D'EVORA
Ceci nous mne la
question
: les colliers d'Evora et
de Cintra
appartiennent-ils
au
premier ge
du fer?
Il
y
a bien
quelques
raisons de le
croire,
par exemple
l'existence d'une srie de bracelets de
bronze, parfois
dor,
en forme de tonnelets
(fig. 17), qui,
dcouverts
dans l'est de la
France,
sont dcors dans le
style
gomtrique
le
plus
riche et incontestablement halls-
tattiens 1. Le collier de Cintra a t attribu
l'poque
de Hallstatt
par
M. P.
Paris,
mais
je
crois
que
son
dernier
diteur,
M.
Reginald Smith,
a eu bien raison
de le rclamer
pour l'ge
du bronze.
J e suis d'ailleurs certain
que
le collier
d'Evora est de
beaucoup
le
plus
an-
cien. En
rgle gnrale,
le dcor de
l'ge
du bronze ne
peut
tre
distingu
rigoureusement
de celui du
premier
ge
du fer
;
c'est surtout affaire
d'apprciation.
Mais il
y
a un autre
argument
faire valoir. Comme on
l'a
remarqu
bien des
fois,
les
objets
en or sont
plus
rares la
priode
de
Hallstatt
qu'auparavant
et les
spci-
mens hallstattiens ne sont
jamais
mas-
sifs et
lourds,
mais
gnralement
creux,
pour
conomiser
le mtal. Cela
peut s'expliquer
aisment comme la cons-
quence
de
l'puisement
de l'or
superficiel qui, spciale-
ment dans l'ouest de
l'Europe,
tait encore trs abon-
dant dans la
premire partie
de
l'ge
du
bronze,
mais ne
tarda
pas
tre recueilli. Ds
1866,
Gabriel de Mor-
tillet estimait
que
les
paillettes
d'or avaient
dj
t
ramasses
l'poque nolithique.
De lourds anneaux
comme ceux dont il a t
question plus
haut, pesant
2.300, 1.900,
1.260
grammes,
n'ont
pu
tre
fabriqus
qu'
une
poque
o l'or tait abondant
et,
bien
que
1.
Dchelette, Manuel, III, fig.
340.
Fig.
17.Tonne-
let debronze des
Moydons (J ura).
LE COLLIER D'EVORA 87
recherch avec
diligence,
n'tait
pas
encore rare. Tel
fut notamment le cas en
Irlande, qui
tait encore un
vritable Eldorado au deuxime millnaire avant J .-C.
Il
importe peu que
les
bijoux
trs lourds ne soient
pas
frquents
dans nos
Muses,
car
l'exception
est
que
de
pareils objets
arrivent
jusqu'
nous. Ce
qui
reste n'est
qu'une partie
minime de ce
qui
a t exhum et dtruit
il
y
a des sicles. L'histoire de ces
trouvailles, qui
n'a
pas
encore t
crite,
serait celle d'un
long
vandalisme.
Mme dans un
pays
de vieille civilisation comme la
France,
o les collectionneurs
d'antiques
ont t sur
le
qui-vive depuis
la
Renaissance,
nous connaissons
un
grand
nombre de dcouvertes
d'objets
en or
n'ayant
laiss d'autres traces
qu'une
brve mention ou un
modeste
croquis.
Aussi avons-nous
le droit de
juger
de l'tat civilisation d'un
pays
au
point
de vue de
sa richesse en
or,
non
pas
ncessairement
d'aprs
le
nombre des
joyaux conservs,
mais
d'aprs
leur carac-
tre et leur
qualit.
Il est
temps que je
passe
la
description
du col-
lier d'Evora. Si nous considrons comme sa base la
section
parfaitement cylindrique
entre les deux ouver-
tures,
le reste du cercle
s'largit progressivement
de
la base au sommet. Le dcor est strictement
gomtrique
et rectilinaire. De
chaque ct,
vers le
milieu,
il
n'y
a
pas
de
dcor,
mais un
espace
libre entre deux
groupes
d'ornements,
au-dessus et au-dessous. Une
descrip-
tion dtaille du dcor est rendue inutile
par
les deux
dessins
dvelopps,
dus M. B.
Champion, que je
reproduis (fig.
18 et
19).
Ainsi
nous
pouvons
aisment
reconnatre les lments du
dcor, gravs
sur l'or avec
une merveilleuse sret de main et de trs'rares irr-
gularits.
Ces lments sont : des
losanges
ou des
triangles
avec hachures
transversales,
des
triangles
avec ou sans ces
hachures,
des chevrons continus et
lisses,
courant entre des
triangles hachurs,
des fais-
88 LE COLLIER D EVORA
ceaux de
lignes parallles
toutes
diriges
vers le centre
de l'anneau. Ces faisceaux
peuvent
tre une survivance
de fils
mtalliques, employs
autrefois
pour
runir
des
tubes,
comme dans la
figure
15
; ici,
ils
remplissent
videmment
le rle de
cadres, sparant
les
groupes
symtriques
d'ornements dont ils intensifient l'effet.
Ils sont au nombre de
onze, cinq
de
part
et d'autre
du
faisceau
central,
qui
court travers la
partie
la
plus
large
de l'anneau.
Ce mme
principe
raffin de dcor
gomtrique,
impliquant
l'existence d'une vritable
cole,
d'une
tradition
artistique,
parat
sur un certain nombre
peu considrable,
d'ailleurs
d'objets
de
bronze,
gravs
avec le
plus grand
soin et
probablement
d'un
caractre
religieux.
Parmi ces derniers il faut mention-
Fig.
18 et 19.
Dveloppement
des ornements du collier d'Evora.
LE COLLIER D'EVORA 89
ner les
mystrieux sphrodes que
Dchelette attri-
buait la
quatrime priode
de
l'ge
du
bronze 1,
bien
que j'incline
les croire
plus
anciens. Sur le
sphrode
de
La Fert-Hauterive Moulins dans l'Allier
(fig. 20),
nous
pouvons distinguer
tous les lments des
gravures
d'Evora,
y compris
les faisceaux de
lignes parallles
convergeant
vers le centre. Mais ici l'ornement couvre
toute la surface
;
nous ne trouvons
pas
cette alternance
de lumire et
d'ombre,
d'incisions et de surfaces lisses
qui,
dans le collier
d'Evora,
tmoigne
de
scrupules
artis-
tiques
et d'une dlicatesse
presque
moderne du
got.
Le
style
austre et
purement rectilinaire,
avant
de se
dvelopper
dans le dcor du
mtal,
apparat
dans une srie de
plaques
d'ardoise
qui
se trouvent
presque
exclusivement au
Portugal.
La silhouette de
quelques-unes
de ces
palettes
est celle d'une
figure
humaine trs
stylise
et
dgnre ;
d'autres font
penser
au lituus romain et
la crosse
ecclsiastique
1.
Dchelette, Manuel, II, p.
298.
Fig.j,20. Sphrode
de bronze
provenantde^
La Fert-Hauterive
(Allier).
90 LE COLLIER D'EVORA
{fig. 22)l.
La dcoration
grave
consiste essentiellement
en
ranges superposes
de
triangles
hachurs,
au-dessus
1
Siret, Chronologie ibrique, 1913, pi. 6, p.
41
; Religions del'Ibrie,
Fig.
21.
Lunules d'or trouvs en Irlande.
LE COLLIER D EVORA 91
desquels
est un
triangle plus grand,
renvers,
sans
hachures,
entour de zones en ventail. Ces
objets,
videmment
religieux, peut-tre
des
ftiches,
sont
antrieurs
l'ge
du bronze et
appartiennent
au dbut
de
l'poque nolithique, qui
vit natre et
grandir
le
systme
dcoratif de
l'poque
suivante.
Au
Congrs
international de
Lisbonne,
en
1880,
l'historien Henri Martin fit observer
que
les crosses
du
Portugal paraissent
aussi sur certains dolmens de
Bretagne
et
mme,
bien
plus
tard,
sur des monnaies
autonomes de la mme
rgion.
D'autres savants ont
insist sur les crosses des
Etrusques,
des
Hittites,
ainsi
que
sur celles
qu'on
voit sur certaines statues
grossires, probablement nolithiques, qui
ont t
dcouvertes
Collorgues (Gard)
1. Il semble
prmatur
de tirer de ces faits des conclusions
ethnographiques,
mais ce sont des
faits.
L'existence d'un mme instru-
1908, pi.
7
; Cartailhac, op. cit., p.
92
; Schulten-Gimpera, Hispania,
pi.
3.
1. S.
Reinach,
Statuaire en
Europe, p.
15.
Fig.
22.
Crosse de schiste trouve au
Portugal.
92 LE COLLIER D'EVORA
ment ou
symbole
en
Portugal,
en
Provence,
en Armo-
rique,
dans l'Italie
centrale,
en Asie
Mineure,
et non
ailleurs,
ne
peut
tre attribue au hasard. Il faut tenir
compte
de ce
problme,
dfaut de le rsoudre.
Au cours de ces trente dernires
annes,
la
pnin-
sule
ibrique,
ce
magasin d'antiquits
encore mal con-
nues,
a rvl une srie riche et dlicate de
poteries
incises,
appartenant
l'poque nolithique
et se
poursuivant
aussi dans la
premire partie
de celle du
bronze. Cette
poterie
a t recueillie en
quantit
Palmella
prs
de
Lisbonne,
Ciempozuelos prs
de
Madrid,
en
compagnie
de
petits
instruments de
cuivre,
mais non de haches. Les
motifs,
strictement rectili-
naires,
sont semblables ceux des ardoises
graves
;
nous
y
observons aussi des faisceaux de
lignes paral-
lles
sparant
les
groupes
dcoratifs. Un fait encore
inexpliqu, qui suggre
une
rgression
ou
quelque grand
dsastre,
est le
pauvre dveloppement
de
l'ge
du
bronze de la
Pninsule,
o
pourtant
le cuivre et l'tain
se rencontrent en
abondance,
de sorte
que
la
pauvret
que
nous
signalons
a
quelque
chose de
paradoxal
;
mais le dbut de
l'ge
du bronze est trs riche en belle
poterie,
et celle-ci a certainement exerc une influence
notable sur la
poterie
d'une
grande partie
de l'Eu-
rope.
Une
preuve
de cette influence est la diffusion des
vases
gravs
en forme de
tulipe,
dont les admirables
cramiques
de
l'ge
du bronze
britannique
ne sont
que
des drivs
indpendants.
M.
Siret, l'archologue belge
tabli en
Espagne, qui
est aussi hardi
que
savant,
et
parfois
mme
davantage,
a rcemment
propos
tout un
systme pour expliquer
cela. Il
part
de l'observa-
tion
que
l'or et
l'argent
sont trs rares dans les
dpts
de
l'ge nolithique
en
Espagne,
alors
que
ces
dpts
contiennent
beaucoup d'objets imports
d'Orient : oeufs
d'autruche,
petits
vases en
albtre,
ivoires. Plus
tard,
l'ge
du
bronze,
il
n'y
a
plus
de
petits objets
orien-
LE COLLIER D'EVORA 93
taux,
mais ceux d'or et
d'argent
se trouvent en
grand
nombre.
Reprenant
donc les thses de Movers
et de Nils-
son,
M. Siret nTisite
pas
admettre, depuis
le dbut
du
nolithique,
la
prsence
de marchands
sidoniens,
travaillant,
vers 1500 avant
J .-C,
pour
leurs
patrons
gyptiens.
Ces
ngociants
orientaux introduisaient
leurs
marchandises dans la
pninsule
et en
tiraient,
en
change,
l'or et
l'argent.
Vers
1200,
l'invasion cel-
tique obligea
les Sidoniens se retirer
Gads,
d'o
ils tendirent
leur commerce aux ctes de
l'Atlantique
et mme la Scandinavie. Les envahisseurs
celtiques
gardaient
l'or
pour
eux et en faisaient des
bijoux.
Entre
temps,
les artistes
ibriques qui pouvaient chapper
la
tyrannie
des Celtes
portrent
leur
industrie,
en
par-
ticulier leur art
cramique,
dans
l'Europe
occidentale
et centrale.
Un savant
plus prudent,
M. Nils
Aoberg
1,
bien
que
n'admettant
pas
tout le roman de M.
Siret,
pense
aussi
que
l'industrie
ibrique
s'est
rpandue,
par vagues
successives,
jusqu'
la Sude et la Carlie.
Non
que l'Europe
ait t envahie
par
des hordes ib-
riques ;
les nombreuses
rgions
intermdiaires o les
objets
de
type ibrique
sont inconnus excluent
pareille
hypothse.
Mais de
grandes
lacunes dans nos informa-
tions
peuvent
tre
justifies
si nous admettons
que
des
groupes
industriels, originaires
d'Ibrie et
voyageant
vers
l'Est,
se sont
transports rapidement,
la
faon
de
tsiganes,
d'une
rgion hospitalire
une autre. Si
l'on fait abstraction des Sidoniens et des
Celtes,
dont
il a raison de ne
pas s'occuper, puisque
ces noms soul-
vent des difficults
chronologiques
insolubles,
il
appert
que
les ides de M.
Aoberg
ne diffrent
gure
de celles
de M. Siret et en ont videmment subi l'influence.
L'tat de nos connaissances conseille sans doute la
1. Nils
Aoberg,
La civilisation
nolithique
dans la
pninsule ibrique,
Paris,
1922.
94 LE COLLIER D'EVORA
prudence,
mais nous devons
apprendre
nous incliner
devant
l'vidence,
au lieu
d'opposer paresseusement
des
fins de non recevoir. Il est
vident,
mon
avis, qu'une
poterie presque identique apparat
en
Espagne (la
cramique d'Argar
ou de
l'ge
du
bronze)
et en
Bohme
; que
l'art dcoratif de Palmella et
Ciempo-
zuelos, qui
est
nolithique,
se trouve sur nombre de
bronzes
inciss,
notamment en
Saxe,
de sorte
que
le
style gomtrique
du
Portugal
l'ge
du cuivre
peut
tre considr comme le
prototype
d'une bonne
partie
de la dcoration
europenne
;
que
les hallebardes des
poques
du cuivre et du dbut du
bronze,
nombreuses
en
Espagne,
en
Irlande,
en
Ligurie,
dans certaines
par-
ties de
l'Allemagne,
mais tout fait inconnues dans
le
proche Orient,
sont
d'origine ibrique.
La
puis-
sance d'un courant occidental ne
peut
tre
nie,
quelque explication qu'on
en
propose. L'hypothse
celtique
de M. Siret n'est
pas
satisfaisante
;
bien
plus,
elle est
chronologiquement impossible.
Au
fait,
j'ignore
ce
qu'on
entend
par
la dcoration
celtique ;
j'ignore
si les tribus
guerrires qui parlaient
des
langues
cel-
tiques possdaient
un
systme
dcoratif
;
il est
plus
probable qu'elles adoptrent
celui des tribus
qu'elles
soumirent,
comme
lorsque
les Arabes soumirent les
Persans, que
les Turcs soumirent les Arabes. Mais ce
que
je
vois clairement c'est
que,
si nous laissons de ct
comme
trop loigne
la
poterie peinte gomtrique
de
Suse,
les
spcimens
les
plus parfaits
du
style gom-
trique
ne doivent
pas
tre cherchs dans la Grce
post-
mycnienne,
mais en
Lusitanie,
et
qu'ils
sont
beaucoup
plus
anciens en Lusitanie
qu'en
Grce.
J e n'ai
pas
encore fait allusion au
rapprochement
le
plus frappant suggr par
le collier d'Evora : la
dcoration n'est
pas
seulement
analogue,
mais
presque
identique
celle des lunules irlandaises. En
1900,
aprs
un court
sjour
Dublin, j'ai
trait de ces lunules
LE COLLIER D'EVORA 95
dans la Revue
Celtique (1)
et
j'ai
montr
que,
loin d'tre
postrieures
notre
re,
comme le
croyaient
encore
quelques
savants
irlandais,
elles
appartiennent
une
poque
trs lointaine. MM.
Coffey, Armstrong l'et
d'autres, je
suis heureux de le
dire,
ont souscrit
[ma
manire de voir. L'identit du dcor des lunules et du
collier d'Evora
peut
tre saisie au
premier coup
d'ceil
si l'on
regarde
les bons dessins
publis par Armstrong
(fig. 21)
2. On dirait
que
ces
bijoux
d'or avec
gravures
incises sont sortis d'un mme atelier. Ici
encore,
nous
remarquons que
la dcoration est
discrte,
limite
une
partie
du
croissant,
dont le reste est seulement
poli
avec soin.
"i
Que
les civilisations de l'Irlande et du
Portugal,
l'poque nolithique
et au dbut de
l'ge
du
bronze,
offrent
beaucoup
de caractres
communs,
c'est ce
qui
a
t
dit, je crois, ponr
la
premire
fois en
1880,
au Con-
grs d'archologie
de
Lisbonne, par
Henri
Martin,
Caza-
lis de
Fondouce,
Cartailhac et J ohn
(plus
tard sir
J ohn)
Evans. Des
types
semblables de
pointes
de flche en
silex se rencontrent en
Irlande,
sur la cte
franaise
de
l'Atlantique
et souvent en
Provence,
de sorte
que
Cazalis
put
mettre
l'hypothse que
cette civilisation
tait
ligure.
A
quoi
l'on
peut ajouter que
les mmes
hallebardes
mtalliques, qui
sont
figures
aussi sur
des rochers
ligures,
se rencontrent en Irlande et au
Portugal.
L'une et l'autre
rgion
tait riche en or
;
ici,
les
gisements
de
Wicklow,
encore
exploits
au
xixe sicle
; l,
les sables aurifres du
Tage, opaci
arena
Tagi,
comme dit
J uvnal,
du
Douro,
du
Mondego,
du Mino. Les textes relatifs l'or irlandais et ib-
rique
ont t souvent runis et comments
;
il suffit
1. Voir
plus
haut
p.
45-80.
2. J e
regrette
de ne
pouvoir publier
le dessin d'une lunule
qui
curait t dcouverte dans un dolmen
prs
d'Allariz en Galice
;
voir
Breuil,
Proc.
Royal
Irish
Academy,
avril
1921, p.
8.
96 LE COLLIER D'EVORA
d'en
signaler
ici
l'importance
des
poques
recules.
Au
Congrs dj
mentionn de
1880,
J ohn Evans
mit
l'hypothse que
des Lusitaniens avaient
pass
la mer et s'taient tablis en Irlande. En
fait,
les anciens
croyaient que
l'Irlande faisait face la
Lusitanie,
ce
que peuvent expliquer
les courants de
l'Atlantique.
L'hypothse
contraire
l'tablissement d'Irlandais en
Lusitanie
est moins
vraisemblable, parce que
le
dveloppement
de la dcoration
gomtrique, depuis
l'ge
du
cuivre,
trouve une
explication
satisfaisante au
Portugal,
mais non en Irlande.
La
chronologie
relative des lunules irlandaises a t
heureusement tablie
par
la
dcouverte,
faite en
1864,
de deux
lunules,
en contact avec une hache de bronze
de
type archaque.
La
chronologie
absolue est encore
matire discussion. A en croire Montelius
et Hubert
Schmidt, l'ge
du
bronze,
dans
l'Europe
occidentale,
a commenc vers 2500 ou 2300 avant notre re.
Coffey,
ragissant
contre un
systme
accrdit de dates
basses,
place
les lunules vers
1500,
ce
qui
est
encore,
mon
avis, trop prs
de nous. D'autre
part,
M.
Siret,
esti-
mant
que l'Europe
occidentale a
toujours
t fort en
retard sur le
proche Orient, pense que l'ge
du bronze
occidental n'a
pas
commenc avant 1200. Il a t amen
cette
conclusion,
qui
me semble tout fait inadmis-
sible,
par
son
hypothse
sidonienne, qui l'obligeait
synchroniser l'ge
du cuivre
ibrique
avec la XVIIIe
dy-
nastie
gyptienne.
S'il avait su
que
les rcentes fouilles
franaises
en
Syrie
nous inclinent considrer la civi-
lisation
phnicienne
comme
plus
ancienne de huit ou
dix sicles
qu'on
ne le
supposait,
il aurait
pu
retoucher
sa
chronologie
en une certaine mesure sans abandonner
sa thse
principale.
La vrit
peut
tre entre les
opi-
nions de Montelius et celle de
Siret,
mais certainement
plus prs
de
Montelius,
dont les dates ont t
regardes
comme
trop
hautes
par
lord
Abercromby
et sir Arthur
LE COLLIER D'EVORA 97
Evans,
mais sont
gnralement acceptes par
les savants
franais
comme d'accord avec la dure et
l'importance
des
poques
du cuivre et du bronze dans leur
pays.
A
quoi
servait le collier d'Evora ? J e n'admets
pas
un instant
qu'il
ft
port
comme ornement
par
une
personne vivante, prtre
ou roi
;
il
est,
pour
cela,
beau-
coup trop
lourd. Mais
quand
nous
voyons,
au ve sicle
et
plus tard, quels magnifiques
et
pesants joyaux
char-
geaient
les statues
ibriques
de
divinits,
telles
que
celles d'Elche et du Cerro de los Santos
coutume
qui
a survcu dans
l'Espagne catholique
nous
pouvons
bien
souponner qu'
une
poque plus
ancienne et
sans
images
un arbre sacr a t orn de lourds anneaux
spcialement fabriqus
cet effet. Le
pote Lucain,
qui
tait
espagnol
de
naissance,
dcrit un chne sacr
sublimis in
agro, qui porte
les anciens
trophes
de
guerre
du
peuple
et les
prsents
consacrs des chefs :
Exuvias veteres
populi sacrataque gestans
Dona ducum...
A ces
exuviae,
ces dona
ducum, suspendus
aux
branches d'un vieux chne
ce
qui explique qu'ils
puissent
s'ouvrir et se fermer
appartiennent, je
crois,
les anneaux et cercles de mtal
qui
sont
trop
lourds
pour
tre des
parures.
Bien
entendu,
ces
objets
pouvaient
tre aussi conservs dans un
sanctuaire,
non
en
plein champ
comme les exuviae de Lucain
;
mais
ce
qui m'importe,
c'est
qu'ils
devaient tre
suspendus,
non
ports
comme des ornements
personnels.
Avant
d'orner les rois l'or orna les dieux.
Un cas
parallle,
bien
plus tardif, peut-tre emprunt
au
chroniqueur
Guillaume de
J umiges.
Vers
910,
le
premier
duc de
Normandie, Rollon,
avait
suspendu
ses bracelets d'or aux branches d'un
chne,
o ils
restrent trois
ans,
sans
que personne
ost
y
tou-
S. REINACH
98 LE COLLIER D'EVORA
cher 1.
Evidemment,
bien
que
le
chroniqueur
ne l'ait
pas
compris
ainsi,
c'tait une offrande
religieuse, protge
par
un tabou : sacrata... dona ducis.
Ayant
eu le
plaisir
de
prsenter
cette docte
compa-
gnie
un
spcimen
de
premier
ordre de dessin
gom-
trique,
on
pourrait
attendre de moi
que j'abordasse
une
fois de
plus
la vieille
question
de
l'origine
de ce
style,
dont l'intrt a encore t raviv
par
la dcouverte extra-
ordinaire de la
cramique peinte
de
Suse, appartenant
l'ge
du
cuivre,
mais considre comme
plus
ancienne
de dix sicles
que l'ge
du cuivre
europen
2. Mais ce
problme
est
trop compliqu pour
tre trait in tran-
st'ftt,
et
je
me contenterai ici de
quelques aphorismes
:
1 Le dcor
gomtrique
doit tre absolument dis-
tingu
du
style gomtrique,
le
premier
existant
presque
partout,
dans le Nouveau comme dans l'Ancien
Monde8,,
le second tant
beaucoup plus
rare et le
produit
d'une
longue
laboration
;
2 Les arts du textile et de la
sparterie
ont certaine-
ment
influenc,
leurs
dbuts,
les diffrents
styles
gomtriques,
mais
n'expliquent
ni leurs
progrs
ni
leur
qualit suprieure,
intimement lis un instinct
essentiel de
l'esprit
humain,
la facult et le
got
de
l'abstraction
;
3 Il semble rsulter de l
qu'aucune explication
monogniste
n'est
vraisemblable,
bien
que
certains,
groupes
de
styles gomtriques, quand
ils ne sont
pas
gc graphiquement trop loigns
-
comme l'Elam du
Portugal
^-
doivent tre
compars
et,
si
possible,
ramens une source commune
;
4 Le fait
que
l'art
primitif,
l'poque
du
renne,,
est naturaliste et incline vers la
stylisation,
ne doit
pas
1. H.
Martin,
Histoire de
France, II, p.
502.
2.
Dlgation
de la Perse, t.
XIII, p. 1,
41
sq-, ; Morgan,
Premires-
civilisations, p.
197 et suiv.
3.
Morgan, p.
202
; Pottir, Catalogue
de
vases, I, p.
220.
LE COLLIER D'EVORA 99
servir
d'argument
en faveur de la thse actuellement
fort
rpandue qui
considre tout ornement comme le
rsidu d'une
pictographie
par exemple
tout
losange
comme
l'image
conventionnelle d'un
poisson,
tout
triangle
comme
l'image dgnre
du sexe fminin.
Ceux
qui
soutiennent ces
opinions
oublient
que
de
longs
sicles avant
l'ge
du
renne,
les beaux silex de
saint Acheul et de Solutr
tmoignaient
d'un
got
incontestable
pour
la
symtrie,
les
lignes
harmonieuses
de ce
que
nous
pouvons appeler,
dans
l'esprit
de Pla-
ton, l'esthtique gomtrique.
Si l'art naturaliste
dg-
nre aisment et
partout
en
stylisation,
c'est
parce que
la
gomtrie,
dernier
produit
de la
stylisation,
exerce
par
elle-mme un immense attrait sur
l'esprit
humain
et la facult d'abstraction
qui
le caractrise. A
l'appui
de ce
que je
viens de
dire,
on
peut, aujourd'hui mme,
invoquer
le
tmoignage
des enfants
qui
tracent dans
le sable des
triangles,
des
carrs,
des
cercles, qui
s'amu-
sent tailler des
figures gomtriques
et
symtriques
dans une feuille de
papier plie
en deux ou en
quatre,
mme avant
qu'ils
n'essaient de dessiner un animal ou
un homme. Pour les
sauvages contemporains,
cela est
moins clair
;
mais alors
qu'on
a
signal
leurs
pictogra-
phies,
traites ou non d'une manire
conventionnelle,
je
me demande si l'on a observ avec la mme attention
les effets de leur
got
naturel
pour
la
symtrie
1.
1.
[Sir
Arthur
Evans, rpondant
cette communication la fin
de la sance,
s'exprima
ainsi :
Ayant
revis
quelques-unes
de mes
opinions, je
suis
prt
reporter
bien
plus
haut
l'ge
du bronze occi-
dental,
en
particulier
sur la foi de
perles
de verre
importes d'Egypte.
La thse de M. Reinach contribue rvler l'ancienne civilisation
de l'extrme Ouest.
Pourtant, lorsque
les dcouvertes d'Alvao et
deGlozel nous
dvoilrent,
dans toute son
antiquit
et son
originalit,
la civilisation
protonolithique
de
l'Europe occidentale,
Sir Arthur
Evans ne trouva rien de
mieux,
pour
maintenir le
mirage
oriental,
que
de dnoncer les
objets
exhums comme oeuvres de faussaires !
Voir mes
phmrides
de
Glozel, 1927, p.
238 et 260.
1929.]
VI
LE CORAIL DANS L'INDUSTRIE
CELTIQUE*
On sait
quel
rle ont
jou
le commerce de l'ambre
et celui de l'tain dans l'tablissement des
plus
an-
ciennes relations entre les
pays
mditerranens et ceux
que baigne
la mer extrieure
(Ocan,
Manche,
mer du
Nord).
S'il
peut
encore subsister
quelque
incertitude
sur la
provenance europenne
de l'tain et de l'ambre
employs
en
Egypte
ds le trentime sicle avant notre
re 2,
il ne
parat pas
douteux
que
ces matires n'aient
t
apportes
au monde
mycnien,
vers le xve
sicle,
des
rgions
stannifres et lectrifres situes au nord-
ouest de
l'Europe.
En ce
qui
concerne la route de
l'ambre,
les indices d'ordre
archologique
ne font
pas
dfaut.
Ainsi,
M. Montelius a
insist,
aprs
d'autres
savants,
sur
l'analogie frappante qui
existe entre cer-
taines
antiquits mycniennes
et les bronzes Scandi-
naves du
premier ge
du bronze
(1700-500
av.
J .-C.) ;
le mme
style,
caractris
par l'emploi
des
spirales,
se
constate en
Hongrie,
en
Autriche,
en
Bohme,
dans le
nord-est de
l'Allemagne,
le
Danemark,
la Sude et
la
Norvge,
alors
que
le reste de
l'Europe
n'en
prsente
pas d'exemples
cette
poque
recule. Il est donc
clair,
conclut Pminent conservateur du muse de
Stockholm, que
cette dcoration nous est venue
par
1.
[Revue Celtique, 1899, p. 12-29, 117-131.].
2. Cf. S.
Reinach,
Le
Mirage oriental, p.
33.
LE CORAIL DANS L'INDUSTRIE
CELTIQUE
101
la route de
l'Elbe,
qui
mettait le sud-est de
l'Europe
en communication avec le nord. La
prsence,
dans les
tombes de
Mycnes qui
renfermaient les
objets
orns
de
spirales,
de
plusieurs
centaines de
perles d'ambre,
atteste de la manire la
plus
formelle
que
la route du
nord tait
dj frquente
cette
poque
;
il est
possible
qu'elle
ft mme ouverte
depuis
trs
longtemps.
L'analyse chimique
a
prouv que
l'ambre exhum
Mycnes
tait bien
originaire
de la
Baltique.
Les
tombes o on l'a recueilli datent des environs de l'an
1500 avant J .-C1.
J e voudrais
appeler
l'attention sur une autre subs-
tance
prcieuse qui,
une
poque recule, quoique
moins ancienne
que
celle dont il vient d'tre
question,
a donn lieu des relations commerciales entre le midi
et l'est de la
Gaule,
d'une
part
la
Gaule, l'Egypte
et la cte occidentale de
l'Inde,
de l'autre. Cette subs-
tance est le
corail, c'est--dire,
comme on le sait
depuis
1723,
un calcaire marin
d'origine animale,
oeuvre de
certains
polypiers. L'antiquit,
le
moyen ge,
la Renais-
sance et mme le xvne sicle ont cru
que
les coraux
taient des
pierres
ou des
plantes
marines
ptrifies
2
;
c'est
Peysonnel,
mdecin
marseillais,
qu'on
doit la
rfutation de ces erreurs.
Trs
employ, depuis
le
moyen ge
et
aujourd'hui
encore,
par
la
bijouterie
de demi-luxe
et,
en
particulier,
par
la
bijouterie religieuse, qui
en fait des
chapelets
et des
patentres,
le corail a t
presque compltement
nglig,
en tant
que
matire
dcorative,
par
les
Grecs,
les
Etrusques
et les Romains
;
il ne
parat
avoir t
travaill ni en
Egypte,
ni en
Babylonie,
ni en
Perse;
1.
Montelius,
Les
temps prhistoriques
en
Sude,
trad. S.
Reinach,
p.
62.
2.
AiOdSevSpov(Dioscoride),
Xio6aX<7<rio
pupato(Hsychius).
Voir
les textes dans le Thsaurus
d'Estienne,
d.
Didot,
s. v.
xopXXtov,
et
Pottier,
art. Corallium dans le Dictionnaire de
Saglio.
102 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
en
revanche,
on trouve
beaucoup d'objets mtalliques
rehausss de corail en
Gaule,
mais seulement dans une
certaine
rgion
de la Gaule et
pendant
une
priode
dter-
mine de son histoire. Trs
frquent
dans une
partie
de la Gaule
indpendante,
le corail est inconnu la
Gaule romaine et la Gaule
franque.
A cet
gard,
il
y
a un contraste
digne
d'attention entre l'ambre et le
corail. L'ambre se montre en Gaule vers la fin de
l'poque nolithique (grottes
du
Petit-Morin)
et ne cesse
d'y
tre recherch
jusqu'
l'tablissement dfinitif du
christianisme
;
le corail entre en scne
plus
tard,
vers
la fin du
premier ge
de
fer, pour
se
multiplier
l'poque
suivante et
disparatre
ensuite
pendant plu-
sieurs sicles. 11
y
a l une srie de
phnomnes
en
apparence
fort
singuliers, paradoxaux
mme, qu'il
est ncessaire d'tudier de
prs
avant d'en
entreprendre
l'explication.
I
La
premire question
examiner est celle de
l'origine
du corail.
Pline l'Ancien crit
1
qu'on pche
le corail le
plus
estim autour des les Stoechades
(les d'Hyres)
2,
des
les Eoliennes
(Lipari)
et du
cap Drepanum (Trapani
en
Sicile).
Il en vient aussi
prs
de Graviscae
(sur
la
cte de
l'Etrurie)
et devant
Neapolis
de
Campanie
(Naples).
Toutes ces localits sont situes sur la cte
mridionale de la Gaule et sur la cte occidentale de
l'Italie,
sur un arc de cercle dont le
rayon
ne
dpasse
pas
150 lieues. Les autres
provenances que
mentionne
Pline taient certainement sans
importance
au
point
de vue commercial. Dans la mer
Rouge
et dans le
golfe
Persique,
nous
dit-il,
le corail est noir
; or,
le corail
1.
Pline,
Hist.
nat., XXXII,
21
(d. Littr,
t.
II, p. 374).
2. Voir
Desjardins, Gogr.
de la Gaule
romaine,
t.
I, p.
180. Les
Stoechades
s'appelaient
aussi
AiyucrtSE(Etienne
de
Byzance).
LE CORAIL DANS L'INDUSTRIE
CELTIQUE
103
noir n'est
que
du corail
pourri,
altr
par l'hydrogne
sulfur
que produit,
dans la
vase,
la
putrfaction
des
rameaux 1,
et
bien
qu'on l'emploie quelquefois,
Naples,
pour
les
bijoux
de
deuil,
il ne semble avoir
joui
d'au-
cune estime chez les
Anciens. Pline
parle
encore du
corail
d'Erythre,
mais en
ajoutant qu'il
est tendre
et,
par
cette
raison,
sans valeur
(molle
et ideo vilissi-
mum).
Ainsi le corail
du commerce
provenait,
titre
exclusif,
de la mer
Tyrrhnienne
2. L'auteur de
l'article Corallium du Dictionnaire
des
Antiquits
crit,
il est vrai
(p. 1.504)
:
On le rcoltait
principalement
dans les eaux de la Mditerrane et sur les ctes de
Gaule et de
Bretagne.
Mais l'ide
que
l'on recueillait
du corail dans
l'Ocan rsulte d'un malentendu.
On
lit,
en
effet,
dans
Ausone
3
:
La cte tout entire des
Bretons de Caldonie offre un
spectacle
semblable
quand
le reflux laisse nu les
algues
vertes et ces
rouges coraux 4,
et ces blanches
perles, vgtations
des
coquillages
Ce texte n'est
qu'une amplification
de rhteur. Il
y
avait bien des
perles
sur les ctes
d'Ecosse,
et
plusieurs
auteurs latins en ont fait men-
tion
5
;
mais
personne n'y signale
le corail en dehors
d'Ausone, qui,
dans
l'espce,
ne mrite
pas
d'tre cru.
De
mme,
on aurait tort de
prendre
la lettre ce
que
dit
Denys
le
Prigte
des bouches de l'Indus
(v. 1103)
:
niv-n) ypXi6o{
arv
pupoOxoupaXioto
nvn]
'av
TOTprjciv
iro
tpX6s
voucri
Xpu<jE)i; /.jdvffi
TS
xaXrjv
izk&y.a.
csMieipoio.
1. Voir l'art. Corail dans la Grande
Encyclopdie, p.
920.
2. Dans les
Cynegetica
de Gratius Faliseus
(v. 404),
il est
question
de coraux de
Malte,
Melitensia
curalia,
dont on faisait des colliers
pour prserver
les chiens de la
rage.
J e ne connais
pas
d'autre mention
du corail maltais.
3.
Ausone, Moselle,
69
(trad.
La Ville de
Mirmont).
4. Cum virides
algas
et rubra coralia nudat Aestus...
5.
Sutone,
Div.
J ulius,
47
; Tacite, Agric,
12
;
Mla.
III, 6,
5
;
Pline, IX,
116 ;
Ammien, VI,
88.
104 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
Denys parle
ici de richesses minrales contenues
dans le
sol,
non des
produits
de la mer
;
la
pierre qu'il
appelle
X6o
puOpoDxoupaiUoto
peut
tre un
grenat oriental,
ou
plutt
le coralloachates de
Pline 1, pierre rouge
comme
le corail et
parseme
de
gouttes
d'or, qui
se trouvait
prcisment
en Inde 2. Ce n'est certainement
pas
le
corail marin.
Aujourd'hui,
le centre
principal
de la fabrication des
objets
en corail est
Naples,
et la
plus grande partie
du
corail
employ
cet effet
provient
des ctes
d'Algrie
et de Tunisie. En
1885, cinquante-quatre
bateaux,
monts
par
340
hommes,
ont t
employs
la
pche
du corail dans les seuls
quartiers
de La Calle et de Bne 3.
Mais ces
pcheries,
devenues de nos
jours
si
importantes,
taient
compltement
inconnues dans
l'antiquit ;
on
n'en trouve aucune mention ni dans Pline ni
ailleurs,
alors
que
les
renseignements
fournis
par
les textes sur
cette
partie
du bassin
de la Mditerrane sont
singulire-
ment abondants et
prcis*.
1.
Pline, XXXVII,
153.
2. On la recueillait
galement
en Crte
(Solin, V,
25
;
d.
Mommsen,
p. 59).
3. Grande
Encyclopdie,
art.
Corail, p.
920.
4. Tissot crit
(Gogr.
de la
prov.
rom.
d'Afrique,
t.
I, p.
321
)
:
La
pche
du corail et des
ponges,
si fructueuse encore sur les ctes
barbaresques,
a d
tre,
dans
l'antiquit,
une des
principales
indus-
tries du littoral
libyen.
Pline ne nomme
pas l'Afrique parmi
les
contres
qui produisaient
le corail le
plus estim,
mais il n'en est
pan
moins
probable que
les bancs de Thabraca et de
quelques
autres
points
des ctes numides devaient tre activement
exploits, puisque,
au
tmoignage
mme du naturaliste
romain, l'exportation
avait
rendu cette matire si rare
qu'on
ne la
voyait plus gure,
de son
temps,
dans les
pays qui
la
produisaient.
Tissot a mal
compris
le
texte de
Pline, qui
parle
seulement de la raret du corail en
Gaule,
comme le
prouve
videmment le contexte. Du
reste,
la suite du
pas-
sage
fournit Tissot un
argument
contre ses
propres
conclusions.
Pline, par contre, parle
plusieurs reprises
des
ponges d'Afrique.
Celles des
Syrtes
laissaient sur les rochers une couleur
rougetre,
etc.
Comme Pline mentionne les
spongiaires
de cette
rgion
du littoral
mditerranen
(Hist. Nat., XXXI, 47),
il est clair
que,
s'il ne dit mot
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
105
II
J e vais montrer maintenant
que,
dans
l'antiquit,
l'usage
dcoratif du corail se constate
presque
exclusi-
vement en
pays celtique
et dans les
rgions
o l'in-
fluence des Celtes s'est exerce.
En Asie
(Babylonie, Assyrie,
Perse, Phnicie, etc.)
et en
Egypte, je
ne sache
pas qu'on
ait encore dcou-
vert un seul
morceau de corail travaill. En
Grce,
o
la
premire
mention de corail
parat,
au Ve
sicle,
dans
Pindare 1,
le
corail ouvr est
galement
inconnu.
Une
inscription
de
Magnsie
2
mentionne,
la
vrit,
des
KopaXAioirXcTai
et le mot
[Kop]<XXiov
se lit dans une
inscription attique qui
numre des
ex-voto 3;
mais
il est
probable qu'il s'agit
l de
poupes, Kdpai, que
KopAwv
est un diminutif de
Kdpv]
et
que
le
K6paAXtoitA(TTY]
est un fabricant de
petites poupes
4. Une
pitaphe
athnienne a donn
le nom de femme
KopXXiov,
dimi-
nutif familier
que Pape
et Benseler traduisent
par
Puppel
5
.
M. Perrot
signale, d'aprs
M.
Pais,
une amulette en
corail dcouverte en
Sardaigne, qui reprsente
deux
uraeus
gyptiens
6. Si cet
objet
tait
authentique,
il serait
des
polypiers,
c'est
qu'il
en
ignore
l'existence et
que
les
pcheries
admises
par
Tissot n'existaient
pas
du
temps
des Romains.
1.
Pindare, Nem., VII,
116.
Le nom
n'y
est
pas,
mais la
priphrase
employe parat
bien
dsigner
le corail. Cf.
Blmner, Terminologie
and
Technologie,
t.
II, p.
378.
2.
Corp.
inscr.
graec,
3408.
3.
Corp.
inscr.
attic, III, i,
n 238 a.
4. Comme le fait
remarquer
M. Blmner
(Terminologie,
t.
II,
p. 379),
leverbe TtXo-o-Eiv conviendrait fort
peu
au travail d'une matire
dure comme le corail.
5. Dans
Alciphron, Epist., I, 39, 8,
le mot
xopXXiovparat signifier
figurine
. Hercher traduit
imaguncula (Epistolographi graec,
d.
Didot).
6.
Pais,
La
Sardegna, p.
50
;
Perrot et
Chipiez,
Histoire
de
l'art,
t.
III,
p.
861.
106
LE CORAIL DANS L'INDUSTRIE
CELTIQUE
fort
intressant,
car on ne
pourrait gure
l'attribuer
qu'
l'industrie
phnicienne ;
mais comme on
fabrique,
dans l'Italie
contemporaine,
un trs
grand
nombre
d'amulettes en
corail,
il est
permis
de
supposer que
cette
trouvaille isole est le rsultat de
quelque supercherie.
J e
n'prouve pas
moins de mfiance l'endroit des
objets
en corail runis autrefois
par
un collectionneur
de
Prouse,
M.
Guardabassi,
et dcrits
(mais
non
figu-
rs) par
lui 1. L'auteur commence
par rappeler qu'il
existe au muse de
Naples
deux morceaux de corail
travaill,
dcouverts
Pompi ; puis
il
signale,
dans
son
propre
cabinet : 1 deux colliers de
corail,
provenant
d'Arna, prs
de
Prouse;
un des
grains reprsente
un Triton soulevant une Nride
;
2 un morceau de
corail,
acquis
Rome,
portant
deux
inscriptions juges
trusques par
Conestabile
;
3 un chaton de
bague
en
corail,
avec
gravure reprsentant
le buste d'un Faune
et
quelques
caractres romains. Ces
objets
sont
suspects
par
le fait mme des
singulires inscriptions qu'ils
portent.
En
revanche,
on
peut
admettre l'authenticit
d'une
figurine
en corail mentionne sous le n 3.490
dans le
Catalogue
de la
Bibliothque impriale par
M. Chabouillet
;
elle a t donne cet tablissement
par
J . de
Witte,
mais on n'en connat
pas
la
provenance
(sans
doute
italienne).
Nous savons aussi avec certitude
qu'on
a trouv du
corail dans les anciennes
ncropoles
voisines de
Bologne.
Parmi les
objets
du tombeau n
108,
non combuste
(fouilles
De
Lucca), j'ai
dcouvert un
joli
morceau
de corail
rouge
non
faonn
et
qui
a
gard
en
partie
sa couleur
;
dans le mme
tombeau,
il
y
avait aussi
*
un morceau d'ambre
rougetre,
non
faonn, perc
l'une des extrmits. Sur une fibule en bronze trouve
dans le tombeau n
73,
fouilles
Benacci, j'ai
vu aussi
1. Bullettino dell' Institulo di
Corrispond. archol, 1876, p.
92.
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
107
des dbris de deux boutons en corail
rouge
un
peu
calcin 1. Ce
tmoignage
de M.
Capellini, juge comp-
tent,
est formel. Mais les tombes dont il
s'agit n'appar-
tiennent ni
l'poque ombrienne,
ni
l'poque
romaine : ce sont des tombes
gauloises.
Les tudes sub-
squentes
de MM. Brizio et Zannoni ont mis hors de
doute le caractre
celtique
d'une
partie
des tombes
explores
dans les
predii
Benacci et De Lucca 2. Ces
spultures,
toutes
inhumation,
ont fourni des armes
et des
bijoux identiques
ceux
qu'on
recueille dans les
tombes
gauloises
de la
Champagne
o,
comme nous le
verrons tout
l'heure,
le corail est extrmement fr-
quent.
Les tombes
gauloises
des environs de
Bologne
appartiennent
au ive sicle
;
les
plus
anciennes doivent
tre voisines de l'an 400 avant J .-C
3
;
les
plus
rcentes
ne
peuvent gure
tre
postrieures
l'an 2004. Ce sont
l des dates
qu'il
ne faut
pas
oublier
quand
on cherche
fixer
l'poque
des vastes cimetires
gaulois
de la
Champagne,
ncessairement
contemporains,
ou
peu
s'en
faut,
des cimetires
analogues
du Bolonais.
Des
objets mtalliques
rehausss de corail se sont
rencontrs dans les
ncropoles celtiques
de
l'Allemagne
5.
Aucune liste de ces
objets
n'a encore t dresse
et,
dans l'tat actuel de nos
connaissances,
on ne
peut gure
songer
tenter un
pareil travail,
mme au
prix
d'un
voyage
travers tous les muses allemands. En
effet,
il n'en est
pas
du corail comme de
l'ambre,
qui peut
1.
Congrs
international
a"anthropologie.
Session de
Budapest.
Compte rendu,
t.
I, p.
447.
2. Voir Bertrand et
Reinach,
Les
Celtes, p.
172 et suiv.
3. Voir 0.
Montelius,
La civilisation
primitive
en
Italie,
t.
I, p.
356.
4. Liv.
XXXVII,
57
; XXXIX,
55
;
cf.
Brizio,
Tombe e
necropoli
galliche
dlia
provinc.ia
di
Bologna, p.
3.
5. C'est
tort,cependant,qu'il
a t
questionde poignes d'pes
de
Hallstatt
incrustes d'ambre et de corail
(Bertrand
et
Reinach,
Xe,9
Celtes, p. 145) ;
on a bien dcouvert de l'ambre
Hallstatt,
mais
pas
de corail.
108 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
tre reconnu avec certitude
premire
vue. Le corail
blanchit souvent avec
l'ge,
sous l'influence de diverses
actions
chimiques
1
;
rest
rouge
ou devenu
blanc,
il se
distingue
difficilement de certaines
ptes
vitreuses
qui
ont t
employes
de la mme manire la dcoration
du mtal. Le recours au
microscope
ne suffit
pas
lever les doutes : il faut sacrifier un
fragment
de la
matire
pour
en tirer une lamelle
(Dnnschliff).
Dans
ces
conditions,
on
comprend que
la dtermination
scientifique
des coraux soit
parfois
trs malaise et
que
des confusions
puissent
facilement se
produire.
Ainsi,
en
1885,
0. Tischler a
analys
certaines incrustations
pratiques
dans les cavits d'un collier de bronze dcou-
vert Saalfeld et conserv au muse de
Meiningen
;
on
croyait que
la matire de ces incrustations tait la
dent de castor
;
Tischler tablit
qu'il s'agissait
de corail 2.
Lindenschmit a
signal
des incrustations de corail
blanchi sur des fibules des muses du
Hanovre,
de Ber-
lin et de
Prague
3.
Le muse de Carlsruhe conserve une fibule tim-
bale
(Paukenfibel),
dcouverte avec des
objets
de la
fin de
l'poque
de Hallstatt dans le tumulus d'Allen-
bach
(Bade)
;
cette fibule est incruste de corail*.
1. Voir
Olshausen, Verhandlungen
der Berliner
Gesllschaft fur
Anthropologie,
t.
XX, p.
147
; Lindenschmit, Alterthumer,
t.
III, i,
Beilage, p.
33. Il
existe,
il est
vrai,
l'tat
naturel,
une varit blanche
du Corallium
rubrum, qui
se
trouve,
bien
que rarement,
dans la
Mditerrane,
et les anciens
croyaient que
le
corail,
blanc et mou
sous
l'eau, rougissait
et durcissait
quand
on le
portait
l'air
(Pline,
Hist.
Nat., XXXII,
21
; Solin, II,
41
;
d.
Mommsen, p. 45)
;
mais
comme le corail
rouge
tait seul
estim,
il est
probable que
les coraux
blancs de nos muses sont le
produit
d'une
altration,
consistant
en la
disparition
d'une matire
organique ferrugineuse
instable.
2. 0.
Tischler, Sitzungsberichte
der
physik.
oekon.
Gesellschaft
zu
Koenigsberg, 1886, p.
42. Le collier en
question
est
grav
dans Lin-
denschmit, Alterthumer, IV, 3,
I.
3.
Lindenschmit, Alterthumer, III, i, Beilage, p.
33.
4. 0.
Tischler,
Prhistorische Arbeiten des Provinzialmuseums zu
Knigsberg
im J ahre
1883, p.
22
(14).
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
109
A
Schwabsburg,
dans la Hesse
Rhnane,
entre Sel-
zen et
Nierstein,
on a recueilli la base d'un tumulus
une fibule en bronze dont les deux extrmits affectent
la forme d'une tte et d'un col de
cygne.
En
1864,
lorsque
Lindenschmit
publia
cet
objet 1,
il
qualifia
d'mail
rouge
la matire
qui remplit
les
yeux
des
oiseaux.
Depuis,
la demande de M.
Virchow,
M. Ols-
hausen a tudi cette fibule et a reconnu
que
le
pr-
tendu mail
rouge
tait du
corail,
corallium
nobile,
fix l'aide d'une rsine dans des alvoles
pratiques
ad hoc 2.
M. Naue m'crit
que
dans les tombes de la dernire
priode
de
Hallstatt, explores par
lui dans le Haut-
Palatinat,
il a
plusieurs
fois ramass des fibules de
bronze avec incrustations
blanches,
qui peuvent
tre
du
corail,
mais ne le sont
pas
ncessairement. La mme
rgion
a fourni trois fibules du
type
de Latne avec
corail
incrust, provenant
de
Staufersbach,
Mutten-
hofen et
Wimpasing.
Dans un collier de
bronze,
trouv Leimersheim
(Palatinat bavarois),
de
petites
rosaces en or
occupent
le centre de cabochons de corail 3.
Un
fragment
de corail a t dcouvert dans la station
lacustre du
Persanzigersee, prs
de
Neustettin,
en
Pomranie, qui appartient
l'poque
du fer et a fourni
de la
poterie
faite au tour*.
0.
Tischler, qui
connaissait admirablement les muses
germaniques,
affirmait,
en
1887, que
le corail
parat,
comme dcoration de fibules et
d'pingles,
dans les
tumulus de
l'Allemagne
mridionale ds la fin de
l'poque
de
Hallstatt, pour
devenir trs
frquent,
l'poque
de
Latne, depuis
la France
jusqu'en
Hon-
1.
Alterthiimer, I, 4, 3,
i.
2. Verhandl der berliner
Gesellschaft,
t.
XX, p.
140.
3.
Ranke,
Der
Mensch,
2e
d.,
t.
II, pi.
en couleur la
p.
636.
4.
Munro, Lakedwellings of
Europe, p.
315.
110 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
grie
et se montrer mme isolment dans
l'Allemagne
du Nord. Il
citait,
l'appui
de cette dernire
assertion,
des fibules coraux de l'Altmark conserves au Musum
fur
Vlkerkunde de Berlin 1.
Dsireux d'tre
renseign
sur les dcouvertes du
corail en
Hongrie, je
me suis adress M.
Hampel,
conservateur du muse de
Budapest.
Ce savant m'a
rpondu qu'il
connaissait deux dcouvertes de ce
genre,
appartenant
l'une et l'autre
l'poque
de Latne.
La
premire
a t faite Hatvan et
comprend cinq
petites pendeloques
de
corail,
trouves en
compagnie
d'une fibule
oeillet,
forme rcente de la fibule
queue
retrousse 2. La seconde est celle d'un
petit
morceau de
corail serti dans l'arc d'une fibule du
type moyen
de
Latne,
conserve au muse de Szkesfehrvr 3.
J e connais aussi des
exemples
de fibules du
type
de Latne ornes de corail
parmi
les riches
produits
des
ncropoles prromaines
de la Bosnie*.
Quelques
trouvailles de corail ont t
signales
dans
la Russie mridionale et au Caucase
;
mais
j'ignore
si
l'on a
procd
des
analyses chimiques permettant
d'affirmer
qu'il s'agit
bien rellement de corail :
1 Collier de basse
poque grecque (?),
dcouvert
Panticape (Kertch),
avec
pendeloques
enchssant des
coraux
(Kondakoff,
Tolsto, Reinach, Antiquits
de la
Russie
mridionale,
p.
318,
fig. 282) ;
1. 0.
Tischler,
Eine Emailscheibe von
Oberhof (Koenigsberg, 1887),
p.
7.
2. Bla de
Posta,
Arch.
Ertersit,
vol.
XV, p.
9.
3.
Hampel, ibid.,
vol.
XIV, p.
279.
4. A J ezerine
(Wissenschaftliche Mittheilungen
aus
Bosnien,
t.
III, 1895, p. 151, fig.
441
;
cf.
ibid., fig.
454 et
455).
Comme
en
Hongrie,
ce sont des fibules des
types moyen
et
tardif,
alors
qu'en
Gaule les fibules corail
appartiennent
la
premire priode
de Latne. Preuve nouvelle
que
la Gaule a t le centre de cette
fabrication,
comme d'ailleurs de toute l'industrie de
Latne,
l'encontre de
l'opinion qui
en cherche les dbuts sur le Bas-
Danube.
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
111
2 Collier en or massif dcouvert Novotcherkask
(province
du
Don),
avec coraux incrusts
; poque
tout
fait incertaine
(ibid., p. 491)
;
3
Appliques
de vtement en
or,
incrustes de
coraux,
provenant
de la mme dcouverte
(ibid., p. 494) ;
4 Boucles d'oreille en or du
Caucase,
formes d'une
tige mtallique qui supporte
une
perle
fine ou une
perle
de corail
(ibid., p. 465) ;
5 Perles de corail dans un tumulus du Turkestan
(ibid., p. 360) ;
6
Plaques
sibriennes en
or,
incrustes de
ptes
de
verre et
de corail
(ibid., p. 396).
Parmi les
objets que je
viens
d'numrer,
il n'en
est
pas
un seul dont la date
puisse
tre fixe avec
quelque
certitude.
Cependant
ces trouvailles
isoles,
supposer que
la dtermination de la matire soit
correcte, prsentent
un vif intrt
pour
ma
thse,
l'archologie
de la Russie mridionale offrant encore
d'autres
points
de ressemblance avec celle de la Gaule
avant les Romains 1.
De
Grande-Bretagne,
nous
possdons
un
magnifique
spcimen
de coraux dcorant un
objet mtallique
:
c'est le
grand
bouclier de bronze dcouvert dans la
rivire Witham et
aujourd'hui
conserv au Muse
britannique
2. Sur ce bouclier tait
fixe,
au
moyen
de
petits rivets,
une
plaque mtallique dcoupe,
affec-
tant la silhouette d'un
sanglier
trs
stylis;
le centre de
l'umbo est orn de
cinq
morceaux de corail. Sur un
bouclier
analogue,
dcouvert dans la
Tamise 3,
les orne-
ments
rouges
dont est
parseme
la surface du mtal
1. Cf. ce
que j'ai
crit en 1894 sur le domaine
celto-scythique ,
par opposition
au domaine mditerranen ou
grco-romain
(Bronzes
figurs
del Gaule
romaine, p.
let
suiv.) et,
sur les
rapports
dela Gaule
orientale avec la Russie
mridionale,
A.
Evans, Archaeohgia,
t.
LU,.
2, p.
369.
2. Kemble et
Franks,
Horae
Fernles, pi.
XIV.
3.
Ibid., pi.
XV.
112 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
ne sont
pas
du
corail,
mais de l'mail
rouge (oxyde
de
plomb
colori avec du
protoxyde
de
cuivre)
1. Franks
a
prouv que
ces
objets,
dont la dcoration rvle un
style
tout
particulier,
ne sont ni saxons ni
romains,
mais bien des
produits
de l'industrie
indigne
antrieure
la
conqute (le
late celtic de Franks
correspond
ce
que
les
archologues
continentaux
appellent l'poque
de
Latne)
2.
Des tombes char tout fait
analogues
celles de la
Marne,
dcouvertes sur la cte sud-est de
l'Angleterre,
ont fourni des
objets
rehausss de coraux en mme
temps que
des bronzes maills 3.
III
Arrivons maintenant la
Gaule,
celui de tous les
pays
o le corail
est
le
plus frquent;
le Muse de Saint-
Germain,
lui
seul,
possde plus d'objets mtalliques
orns de coraux
que
tous les autres muses
du monde
runis. Mais la distribution de ces
objets
est loin d'tre
uniforme. J e n'en connais de
spcimens
ni en
Armorique,
ni dans le bassin de la
Garonne,
ni en
Aquitaine ;
on
n'en a
signal qu'un
seul dans la
partie
mridionale
du bassin du Rhne. Le corail
parat quelquefois
dans
1. Kemble et
Franks, op.
cit., p.
68.
2. Il est vraisemblable
que
les maux
rouges signals
sur nombre
d'objets
late celtic
sont,
en
partie
du
moins,
des coraux. Mais les
archologues anglais
n'ont
pas
encore tudi cette
question.
3.
Majgaret Stolees,
<?ntne use
of
red enamel in
Ireland,
extr. des
Transactions
of
the R. Irish
Academy,
tome
XXX, part
v
(mai 1893,
p. 284)
: The
graves
on the Yorkshire coast still
yield
the remains
of iron chariots and
horse-trappings,
and armour decorated with
enamel and the red Mediterranean coral. Thse discoveries were made
in the tumuli in the East
Riding
of Yorkshire, At
Grimthorp,
a skele-
ton was found with a
spear-head
and
sword,
both of
iron,
the latter in a
curious sheath of
bronze,
decorated
with studs
of
red coral. See
Elton,
Origins of
English
history, p.
292 and
Archaeohgia,
t.
XLIII, p.
475.
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
113
la
partie septentrionale
de ce bassin et en Alsace
;
il
n'est trs
frquent que
dans les
plaines
de la Cham-
pagne,
en
particulier
dans le
dpartement
de la Marne.
L'essai de
statistique que je publie ci-aprs
et
qui
comprend
tous les bronzes rehausss de corail du Muse
de
Saint-Germain-en-Laye,
donnera une ide de la
rpartition
trs
ingale
des
objets
de cette srie 1. Il ne
faut
cependant pas
oublier
que
le
dpartement
de
la Marne a t
beaucoup
mieux
explor que
les
autres,
cause de
l'encouragement qu'apportait
aux
fouilleurs,
entre 1860 et
1870,
la
prsence
annuelle de
Napolon
III
au
camp
de Chlons.
BASSIN DU RHNE.
M. Chantre a
signal
des
fibules ornes de corail
rouge
dans
plusieurs
tumulus
de la
rgion
des
Alpes
et du Rhne
2
. Nous
pouvons
citer les
spcimens
suivants :
Hautes-Alpes.
Cimetire de
Peyre-Haute,
com-
mune de Guillestre.
Plaque
de fibule
(fin
de
l'poque
de
Hallstatt),
orne de
cinq petites perles
de corail 3.
Doubs.
De
Flagey,
bracelet en bronze
tige
ronde,
pourvu
de
protubrances perfores
et
longitudinales,
destines au
passage
du lien fixant la
pice
les olives
de corail
qui
en font l'ornementation. Muse de Besan-
on*.
De
Servigney,
fibule dont la
tige
est munie d'une sorte
de
gouttire
dans
laquelle
sont enchsses des
perles
de corail. Muse de
Besanon
5.
Gard.
Du
Chteau-Brard,
prs
d'Uzs,
fibule
queue
retrousse en col de
cygne, s'panouissant
l'extrmit en un
disque
sur
lequel
huit
fragments
de
1.
[Les
listes
que j'ai
dresses en 1898
pourraient
tre fort
aug-
mentes,
mais cela ne
changerait
rien aux conclusions
gnrales
du
prsent
mmoire.
1929.
2.
Congrs
de
Budapest, p.
454.
3.
Chantre,
Premier
ge
du
fer, pi. I,
7.
4.
Ibid., p.
33 et
pi.
XXXVII. 4.
5.
Ibid., pi. XXX,
8.
S. REIXACH
114
LE CORAIL DANS L'INDUSTRIE
CELTIQUE
corail taient fixs
par
des rivets de bronze. Cet
objet
A t dcouvert dans une tombe incinration
qui
appartient,
comme la fibule
elle-mme,
la seconde
priode
de Latne
(collection Saint-Venant)
1.
ALSACE.
Dans
quelques
tumulus de la fort de
Haguenau,
M. Nessel a trouv des
pingles
cheveux en
bronze,
surmontes d'un bouton de corail blanchi 2. Il
semble
qu'il
faille reconnatre du
corail,
et non de
l'ambre,
dans les boutons fixs sur
quelques
bronzes des
tombes
d'Heidolsheim 3,
ainsi
que
dans la dcoration
d'une fibule
queue
retrousse
provenant
de la fort
de
Schirrhein*,
et d'un bracelet de bronze exhum d'un
des tumulus 'Ensisheim
;
mais aucun de ces
objets
n'a t sousmis une
analyse chimique,
et la seule chose
que
l'on
puisse affirmer,
c'est la
prsence
de
quelques
grains
de corail dans les environs de
Haguenau.
CHAMPAGNE.
Les
objets
suivants ont t dcou-
verts dans le
dpartement
de la Marne
;
nous les exa-
minerons en suivant l'ordre
alphabtique
des
prove-
nances.
Bouy (et Varilly,
commune de
Bouy). Torques cisels,
avec cabochons de corail.
Trois
appliques
de harna-
chement en bronze
dcoup,
avec cabochons de corail.
Bouclier en bois entour d'une
garniture
en
fer,
avec
deux
manipules
et deux umbo de mme
mtal,
surmonts d'un cabochon de corail 6.
Tronon
de
corail
perfor,
d'un centimtre de
longueur
7.
Collier
1. Bulletin
archologique
du
Comit, 1897, p.
488.
2. Faudel et Bleicher. Matriaux
pour
une tude
prhistorique
de
l'Alsace,
IV
(1885), p.
112.
3. Max. de
Ring,
Tombes
celtiques
de
l'Alsace,
2e
d., Strasbourg,
1861, pi. III, 2, 5,
10.
4.
Ibid.,
nouv.
suite, Strasbourg, 1865,
pi. III,
8.
5. Le
mme,
Tombes
celtiques d'Ensisheim, Strasbourg, 1859,
pi.
III,
3.
6. Bulletin de la Socit des
Antiquaires, 1884, p.
149.
7. Faudel et
Bleicher,
Matriaux
pour
une tude
prhistorique
de
l'Alsace, V, p.
08.
LE CORAIL DANS L'NDUSTRIE
CELTIQUE
115
compos
de cent
perles
de
corail,
d'une
fusaole en
terre
cuite,
d'une
coquille,
d'une
perle
d'ambre,
d'une
canine de
sanglier
et d'un
fragment
de vertbre hu-
maine 1.
Epe
de fer dans un fourreau de
bronze,
avec bouterolle orne.de coraux 2.
Bussy-le-Chteau.
Fibule dont la
queue
est orne
de corail
(Saint-Germain,
n
13266).
Trois
grandes
branches de corail
perfores (S.-G.,
n
13193).
Chlons
(environs
du
camp).
Deux
magnifiques
appliques
ou bossettes de forme
conique,
en
fer,
garnies
extrieurement de lamelles de corail fixes
par
des
rivets
(S.-G.,
n 13672
;
Revue
encyclopdique, 1898,
p. 961,
photogravures).
Perles de corail
perfores
(S.-G.,
n
15996).
Cuperly.
58
grains
ou
perles
de corail
perfors (S.-G.,
nos
5007, 5008).
Flavigny (canton d'Avize).
Lance en fer. Les deux
clous
qui
traversent la douille
pour
fixer la
hampe
ont
la tte orne d'une matire rose enchsse dans une
capsule
de cuivre.
Il
s'agit
sans doute de corail 3. Une
ceinture,
dcouverte dans la.mme
localit,
comprend
dix-sept
lments, orns,
suivant M. de
Baye,
d'une
pte rouge
maille 4.
Gorge-Meillet.
Les
objets
rehausss de
corail,
dcou-
verts
par
M.
Fourdrignier
dans la tombe char de la
Gorge-Meillet (territoire
de
Somme-Tourbe), appar-
tiennent tous au Muse de Saint-Germain. Ce sont :
deux
grandes
croix de
bronze,
neuf boutons et un
casque
de
bronze,
orns de
boules,
d'olives et de cercles de
corail dont la couleur
rouge
s'est
parfaitement
con-
1.
Nicaise,
Bull, de la Soc. des
Antiquaires, 1884, p.
148
;
Revue
archol.
1884, I, p.
354,
2. Ancienne collection Nicaise.
Moulage
au Muse de Saint-Ger-
main,
n 31763. Cf. Bull, de la Soc. des
Antiquaires,
1884.
p.
148.
3. De
Baye,
Revue
archol, 1877, II, p.
41.
4. Muse
archologique, 1875, p.
235 et
pi.
IX.
116 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
serve 1. Les croix et les boutons faisaient
partie
du
harnachement des chevaux.
La
Croix-en-Champagne. Torques
en
bronze,
orn de
cabochons de corail sur le fermoir
(S.-G.,
n
18047).
Trois fibules ornes de corail
(S.-G.,
nos
13144, 13146).
Deux rondelles de
bronze,
l'une orne de 9 cabo-
chons de corail
(S.-G.,
n
18070),
l'autre
prsentant
au
centre un cercle en os ou en corail
(n 13153).
Poi-
gnard
de
fer,
dans un fourreau de bronze dont la bou-
terolle est orne de corail
(S.-G.,
n
20391).
Mesnil-les-Hurlus. Fibule avec cabochon de
corail,
trouve dans une tombe contenant un anneau d'or.
Collection Morel Reims
2
[acquise par
le British
Musum].
Pleurs. Fibule avec bouton de corail fix
par
un rivet.
Autre fibule dont l'arc est couvert extrieurement de
lamelles de corail fixes
par
des rivets. Collection Morel
Reims 8.
Prunay (et
les
Champs-Cugniers,
commune de Pru-
nay).
Collier
compos
de branches de
corail,
de
perles
d'ambre et de verroteries.
Le collier en corail se com-
pose
de 38 branches de cette substance l'tat
naturel;
l'extrmit la
plus
forte de
chaque
branche a t
aiguise
plat
et
perce
d'un
petit
trou
pour y passer
le fil
qui
a d les runir.
Deux fibules ornes de rosaces de
corail,
recueillies sur le mme
squelette
de femme
que
le collier. Collection Bosteaux
Cernay-les-Reims*.
Saint-tienne-au-Temple.
Deux belles bouterolles de
fourreau en bronze
ajour,
ornes de cabochons de corail
(S.-G.,
n
12808).
-
Deux bracelets avec incrustations
1. Voir les
planches
en couleur
publies par
M.
Fourdrignier,
Double
spulture gauloise
dela
Gorge-Meillet, Paris,
1878
(pi. IV, VII,
VIII).
2.
Morel,
La
Champagne souterraine, pi. XLI,
5.
3.
Ibid., pi. XXVII, 3,
4.
4. Association
franaise pour
l'avancement des
sciences,
session
de
1887, p.
743.
LE CORAIL DANS L'INDUSTRIE
CELTIQUE
117
de corail
(S.-G.,
salle
VII,
vitrine
9).
Cinq
fibules de
bronze
(S.-G.,
ns
3099, 12828)
et une fibule de
fer
(S.-G.,
n
12838),
ornes de cabochons de corail.
Six
petites
branches de corail troues
(S.-G.,
n
12728).
Saint-J ean-sur-Tourbe. Deux
magnifiques phalres
de
bronze,
bordure
ajoure,
avec saillie centrale
termine
par
un bouton de corail
(S.-G.,
n
33284).
Dix ornements
glandulaires
et six ornements
ajours
en
bronze,
tous orns de corail
(S.-G.,
nos
33286,
33287).
Grande
pe
de fer avec fourreau de bronze dont la
bouterolle est orne de corail
(ancienne
collection
Nicaise
; moulage
Saint-Germain,
n
31762)
1.
Saint-Rmy.
Trois fibules de bronze ornes de corail
;
l'une d'elles
prsente
une rosace orne de
quatre ptales
de cette substance
(S.-G.,
ns
4831, 4835, 4838).
Sept-Saulx.
Grande
spulture
char
;
en
avant de
la roue droite tait
plac
le
corps
d'un
sanglier,
dont le
squelette
montrait
encore,
enfonc entre les
ctes,
un
long
coutelas avec
poigne
en os. Cette belle tombe a
fourni : 1 une
rosace-applique
avec bouton en forme
d'umbo
saillant,
termin
par
un cabochon en corail
;
2 les
fragments
d'un
casque
avec crochets orns de
cabochons de corail servant attacher la
jugulaire,
un
bouton terminal avec cabochon de corail au centre
et une cocarde
(?)
avec cabochon de corail 2.
Somme-Bionne. Deux
phalres
circulaires en
bronze,
avec boule de corail au centre 3.
Boutons de bronze
tte
conique,
recouverte d'une calotte de corail
fixe
par
un rivet*.
Branches de corail
ayant
servi
d'amulettes, quelques-unes
cercles de
bronze 5;
l'une
1. Cf. Bull, de la Soc. des
Antiquaires, 1884, p.
149.
2.
Nicaise,
Bulletin de la Socit des
Antiquaires, 1884, p.
147
;
Association
franaise, 1884, II, p.
421.
3.
Morel,
La
Champagne souterraine, pi.
II.
4.
Ibid., pi.
9 et
p.
33 du texte.
5.
Ibid., pi.
13.
118
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
d'elles,
brise
anciennement,
a t restaure au
moyen
d'un
ligament
de
bronze,
ce
qui
atteste la valeur de la
matire
employe
1.
Somme-Tourbe. Fibule orne de corail
(S.-G.,
n
33317).
Wargemoidin.
Broche circulaire de bronze avec des
morceaux de corail en cercle sur le
pourtour,
un cercle
de coraux
plus
voisin du centre
et,
au centre
mme,
une
boule de corail 2.
Nombreux
grains
de corail
perfors
(S.-G,,
salle
IX,
vitrine
11).
J e dois mentionner ici
quelques objets remarquables
de la mme
srie,
qui
ont certainement t dcouverts
dans le
dpartement
de la
Marne,
mais dont
l'ignore
la
provenance
exacte :
1
pe
en fer du
type
de la Tne. Une
partie
du
fourreau est en
bronze,
l'autre est en fer. La
partie
en
bronze est orne sur
plusieurs points
de morceaux de
corail
rouge.
La
poigne
de
l'pe
elle-mme
prsente
plusieurs
cavits
remplies
de
grains
de corail. Ces
frag-
ments de corail sont ou sertis ou bien fixs
par
un
petit
rivet de bronze
;
mais le
plus
souvent ils sont sertis
3
;
2 Lance en fer d'une forme trs
lgante
et d'une
belle
conservation,
orne de deux
petits
coraux
rouges
fixs l'aide de rivets en bronze
4
;
Flavigny?
3
Fibule en
filigrane
de bronze
garnie
entirement
de
petits
morceaux de corail. Ils sont tous attachs avec
des rivets. Il
y avait,
en
outre,
de
petites
chanes
qui
entouraient cette
fibule,
l'extrmit
desquelles pen-
daient des
fragments
de corail finement
travaills5;
4
Bouterolle en bronze
d'pe,
orne de 3
-f-
3
+
1
cabochons de
corail 6;
1.
Morel,
La
Champagne souterraine, p.
81 du
texte.
2.
Ibid., pi.
36
(n<
6 et
7).
3. J . de
Baye. Congrs
de
Budapest, p.
445.
4. Ibid.
5. Ibid.
.
6. Morel. La
Champagne
souterraine,
p.
38
(n 1).
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
119
5 Fibule o
l'arc,
la tte et la
queue
sont
galement
recouverts de morceaux de corail
(S.-G.,
n
12967).
Quelque incomplet que puisse
tre l'essai de cata-
logue qui prcde,
il
suggre
des observations
impor-
tantes.
Le corail se
trouve,
dans des
spultures
inhuma-
tion,
en
compagnie
de
perles d'ambre,
de
verroterie,
de
bijoux
d'or
;
il ne se rencontre
pas
avec des monnaies.
Les branches de
corail,
gnralement perfores,
servent d'amulettes et de
pendeloques
dans des colliers.
Travaill,
le corail affecte la forme de cabochons ou
de
petites
boules
hmisphriques
;
on le taillait aussi
en forme
d'olives,
de lamelles trs minces et de
perles.
Le corail sert surtout dcorer les
objets
de
bronze,
rarement ceux de fer et d'or 1. Il est tantt serti ou
incrust,
tantt fix
par
des rivets de bronze ou de fer.
On le trouve
principalement
l'extrmit de la
queue
des fibules du
type
de
Latne, plus
rarement sur l'arc
et les autres
parties
des fibules. Les autres
objets
rehaus-
ss de corail sont des boutons de
bronze,
diverses
parties
du harnachement des
chevaux,
des bouterolles
de
fourreaux,
des
poignes d'pe (rares),
des
pointes
de lance
(rares),
des boucliers
(rares),
des
casques,
des
bracelets,
des
torques,
des
chanettes,
des ttes
d'pingle.
Tous les
objets
orns de corail
que
nous avons nu-
mrs
l'exception
de ceux de la Russie mridionale
et du
Caucase,
dont la date est incertaine
-
appar-
tiennent une
poque archologique
bien dlimite.
C'est la fin de
l'poque
de Hallstatt et la
premire
partie
de celle de
Latne,
caractrises
par
les fibules
1. On n'a
signal,
notre
connaissance,, d'objets
en or rehausss
de corail
que
dans la Russie mridionale.
120 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
timbale,
bouton et
queue
retrousse. J amais on
n'a dcouvert
d'objets
orns de corail en
compagnie
d'une
grande pe
de fer du
type
de
Hallstatt,
d'une
fibule arc
simple, serpentiforme
ou
disque mdian,
d'une monnaie
gauloise
ou
romaine,
d'un tesson de
poterie rouge
reliefs
;
d'autre
part,
il
n'y
a de corail
ni au mont
Beuvray (Bibracte),
ni
Alesia,
ni dans la
station
helvtique
de Latne
appartenant,
comme
les deux autres
que
nous venons de
nommer,
la fin
du second
ge
du fer en Gaule. Il faut donc conclure
que l'emploi
dcoratif du corail a t trs limit dans
l'espace
et dans le
temps.
En ce
qui
concerne
l'espace,
nous avons montr
que
l'immense
majorit
des trou-
vailles ont t faites sur le territoire des
Rmi,
et nous
ne
croyons pas impossible
de
prciser
le sicle
qui
a
vu fleurir l'industrie du corail dans cette
rgion.
L'ab-
sence de monnaies
gauloises
nous
avertit, d'abord,
qu'il
faut remonter au del du 111e sicle avant J .-C. En
second
lieu,
la tombe de la Marne la
plus
riche en
coraux,
celle de la
Gorge-Meillet,
contenait une oenocho en
bronze de
style grec qui
ne
peut
tre
postrieure
de beau-
coup
l'an 400.
Enfin,
une oenocho toute semblable
a t
dcouverte,
avec des
objets
orns de corail et
une
coupe peinte
figures rouges,
dans la
grande
tombe
de Somme-Bionne 1.
Autrefois,
avant les fouilles
pro-
fondes excutes sur
l'Acropole
d'Athnes,
on attri-
buait une
poque
basse,
voisine de 250 avant
J .-C,
les
quelques
vases
peints
de
style grec qu'on
a recueillis
dans des
spultures celtiques
ou
germaniques
2.
Aujour-
d'hui
que
l'histoire de la
cramique
figures rouges
est mieux
connue,
on sait
que
cette fabrication devait
avoir tout fait cess au ine sicle et
qu'elle
tait
dj
1.
Morel,
La
Champagne
souterraine,
pi.
IX.
2. Voir
Bertrand, Archologie celtique
et
gauloise,
2e
d., p. 342,
o est
reproduite l'opinion
de J . de
Witte, que
ne
partage plus
aucun,
archologue comptent.
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
121
en
pleine
dcadence au milieu du ive.
Or,
les vases
peints
de
Somme-Bionne,
de
Courcelles-en-Montagne,
de
Klein-Aspergle,
de
Rodenbach,
de
l'Uetliberg
ont
t dcouverts en
compagnie d'objets
de bronze dont
les
types,
nettement
archaques,
sont ceux du ve sicle
;
en
outre,
ces
poteries,
bien
que
d'un travail
expditif,
ne sont nullement des
produits
de la
dcadence,
puis-
qu'on n'y
trouve aucun de ces rehauts
blancs, violets,
dors, etc., que
les cramistes de la base
poque
ont
prodigus
1.
Donc,
c'est aux environs de l'an
400,
entre
420 et 380 av.
J .-C, que
nous
placerons l'apoge
de la
civilisation caractrise
par
les
grandes
tombes
char de la Marne et
l'usage
de dcorer le mtal avec
du corail
;
cette civilisation a
pu durer,
sans modifica-
tions
notables,
jusque
vers l'an
300,
ou mme un demi-
sicle au
del,
mais
je
ne saurais admettre
qu'elle
se
soit
prolonge,
comme l'ont cru
quelques archologues,
jusqu' l'poque
de la
conqute
des Gaules
par
Csar.
Il
y a,
en
effet,
des diffrences
essentielles,
fondamen-
tales,
entre la civilisation rvle
par
les
ncropoles
de la Marne et celle des
contemporains
de
Vercing-
torix. Ces diffrences sont mises en lumire
par
le
tableau
ci-aprs.
C'est bien en vain
qu'on
a voulu contester ou loca-
liser l'assertion de Csar
2
touchant la
pratique
de l'in-
cinration chez les Gaulois 3. Cette assertion est confir-
1.
L'aryballe
de
Tgersweilen (canton
de
Thurgovie),
trouve-
isole dans un
champ,
n'est
pas grecque,
mais
grco-italique,
comme le
prouvent
les nombreux rehauts blancs et la mollesse du
stvle
(Lindenschmit, Alterthttmer, III, 7, i).
"2.
Csar,
Bell.
Gall., VI,
19. Cf.
Mla, III, 2,
et
Diodore, V,
28.
3.
Voir, par exemple,
Ed.
Fleury, Antiquits
et monuments du
dpar-
tement de
l'Aisne,
t. II
(1878), p.
73. M.
Fleury
ne
peut
se dfendre
du
prjug,
d'ailleurs trs
rpandu, qui
reconnat les Gaulois de-
Csar dans les inhums des
plaines
de la
Champagne. Cf., pour-
d'autres
exemples
du mme
prjug,
Bull. Soc.
Antiq., 1890, p.
285
;
Bertrand, Archologie celtique
et
gauloise,
2e
d., p. 356,
et mon Cata-
logue
sommaire du Muse de
Saint-Germain-en-Laye,
lre
d.,
p.
162.
122 LE CORAIL DANS L INDUSTRIE
CELTIQUE
nie,
sans doute
possible, par l'archologie
elle-mme.
qui
connat d'ailleurs
peu
de tombes
gauloises
contem-
poraines
de Csar : c'est
que
l'incinration! faisait alors
disparatre presque
tous les
vestiges
non seulement
des
morts,
mais des
objets que
l'on brlait avec eux 1.
Les habitants de la
Champagne
au iTe sicle
Inhument leurs morts
;
Ont des chars de
guerre
;
N'ont
pas
de
monnaies;
Emploient
le corail.
Les Gardois de Csar
Incinrent leurs
morts;
N'ont
pas
de chars de
guerre;
Ont des
monnaies;
N'emploient pas
le corail.
1. Les
ncropoles
incinration du second
ge
du fer
(poque
de
la
conqute
romaine en
Gaule)
sont encore trs
imparfaitement
connues.
Cochet,
dans sa Normandie
souterraine,
a
appel
l'attention
sur des
spultures
incinration
o,
ct des
urnes,
il
y
avait des
pes
de fer recourbes avec leur
fourreau,
de
type identique
I'pce
d'Alesia. On en a trouv dans- la Seine-Infrieure
(Robet-le-Dable,.
Saint-VancTrille-Ranopj),
dans l'Eure
(Vandreuil),
dans la Somme
(Port-le Grand, prs
de
Saint-Valry). Tisclier,
en
1883,
a
signal
des tombes
analogues, comprenant
des
groupes considrables,
sur
la rive du.
Rhin,
notamment
prs-
de
Mayence- ;
on suit l'a trace de
ces
ncropoles
d'une
part jusqu'
la Vistule et en
Bohme,
de l'autre
jusqu'
l'le de
Bbrnholm,
en
Scandinavie,
o Vedel a tudi
plus
de
2.500'
spultures
incinration avec armes et fibules de la seconde
et de la troisime
poque
de Latne.. En
France,
depuis
l'abb
Cochet,
on a encore dcrit
quelques
tombes
appartenant
la mme srie :
1
Bibracte,
o des urnes cinraires ont t rencontres le
long
du
mur
'enceinte,
entre les maisons et mme dans les ateliers
(Biilliot,
Cit
gauloise, p>.190) ;
2 sur le
bas-Rhne,
dans le
pays
des Voikes
Areomiques,
aux environs
d'Uzs,
de
Nmes,,
de
Sommires,
de
Remoulins,
de
Saint-Rmy (Saint-Venant,
Bulletin
archologique
du
Comit, 1897, p. 481,
travail
important)
;
3 dans
l'Aisne,
Saint-Audebert
(Album Casranda,
coll.
Moreau) ;
4 dans la
Marne,
Cernon-sur-Coole. avec une
pe appartenant
la deuxime
priode
die-Latne
(Nieaise,,
Bull,
archologique, 1897, p. 553).
Toutes
ces
spultures
incinration sont relativement rcentes
;
M. dteSaint
-
Venant a eu raison de
rapporter
celles du
pays
des
Arcomiques
au
beuvraysien
de. G. de Mortillet. Mais
lorsque
ce- dernier archo-
logue, ignorant
les travaux de Tischler ou refusant d.**tenir
compte,
a
prtendu
diviser le second
ge
de fer en deux
priodes,
le marnien
et k
beuvrayisien,
il n'a fait
qu'introduire-
un
adjeefiif
barbare dans
la science
qui
admettait
dj,
avec
raison.,
une divisik'
tripartite
de
cet
ge.
En
Grande-Bretagne aussi,
l'poque
de
Csar,
l'inein-
ration a
remplac
l'inhumation
(Archaeol.,
t.
LU,
2.
p. 386.)
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
123
D'autre
part,
entre la civilisation rvle
par
les
tombes de la
Champagne
et celle des
contemporains
de
Csar,
il
n'y
a
pas
de solution de
continuit,
car les
armes
offensives,
en
particulier
les
pes,
sont
presque
identiques
en
Champagne
et Alesia : ce sont
toujours
les
types
de
l'poque
de
Latne, qui
se
subdivise,
comme
l'a vu
Tischler 1,
en
plusieurs priodes.
Les tombes de
la Marne
appartiennent
la
premire,
la station de
Latne la
deuxime,
Bibracte et Alesia la dernire.
Dans
l'intervalle,
il a
pu
se
produire
des invasions
ou des infiltrations
germaniques
2
qui
ont modifi le
facis
de la civilisation dans le nord-est de la
Gaule,
sans
pourtant y
substituer une civilisation nouvelle.
Nous sommes mal informs cet
gard,
de mme
que
nous
ignorons
encore o la civilisation de Latne a
pris naissance 3,
comment elle s'est
rpandue,
comment
elle s'est
superpose
celle de Hallstatt
ou,
dans cer-
taines
rgions, juxtapose
cette dernire. L'archo-
logie
laisse entrevoir des rvolutions
politiques
et des
mouvements de
peuples
sur
lesquels
les textes
qui
malheureusement
manquent
pourraient
seuls nous
renseigner
avec
prcision.
D'o venait le corail dont on se
servait,
en Cham-
pagne, pour
dcorer les
objets
de mtal ? La
rponse
cette
question
ne saurait tre douteuse : il venait des
les
d'Hyres,
des
Stoechades,
o Pline
signale
les
pche-
1.
Tischler,
Ueber
Gliederung
der La Tne
Priode,
dans le Cor-
respondenzblatt
der deutschen Ges.
fiir Anthrop., 1886, p.
157. Cf.
Antiqua, 1890, pi.
III
(type
des
pes
aux trois
priodes
de la
Tne
; par
une malencontreuse
confusion,
insuffisamment
corrige
au
moyen
d'un cartel
jaune,'
les trois
types d'pes reproduits
dans
la
Correspondenzblatt, 1886, p. 172,
sont
accompagns
de
lgendes
errones).
2. Les Rmi
parlrent
de ces invasions
Csar,
Bell.
Gall., II,
4
;
cf.
Tacite, Germ.,
2.
3. Pour ma
part, aprs
l'avoir crue
d'origine danubienne, je
suis
persuad
aujourd'hui qu'elle
a eu
pour
centre l'est de la
Gaule,
o
elle
prsente
un
facis plus archaque qu'ailleurs.
124 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
ries de corail les
plus importantes,
et ce sont les commer-
ants
marseillais
qui l'apportaient
dans la valle de la
Marne,
en mme
temps,
sans
doute, que
les verroteries
et
quelques objets
de
luxe,
tels
qu'oenochos
de bronze
et vases
peints. Que
recevaient-ils en
change
? Nous
l'ignorons.
Peut-tre
exportaient-ils
de
l'ambre,
matire
trs abondante dans les tombes de la
Champagne
;
peut-tre
venaient-ils seulement
y
chercher des esclaves.
Quoi qu'il
en
soit,
l'abondance du corail mditerranen
dans une
rgion
relativement
peu
tendue atteste une
activit commerciale
qui
serait
inexplicable
si cette
rgion
n'avait
pas
t,
au ve et au ive
sicle,
une des
plus
riches et des
plus
civilises de la Gaule.
Au dbut de ce
travail,
nous avons
reproduit
les
tmoignages
des anciens touchant la
provenance
du
corail. Il faut revenir un instant sur ce
sujet,
afin de
faire
justice
d'une erreur. M.
Blmner,
gnralement
trs
exact,
crit en effet : Les meilleurs coraux
venaient,
il est
vrai,
du
golfe
indien
,
et il renvoie
Pline,
Hist.
nat., XXXII,
211. Mais Pline ne dit rien
de tel. Voici le texte :
Gignitur
et in Rubro
quidem mari,
sed
nigrius;
item in Persico
vocatur lace
lauda-
tissimum in
gallico
sinu circa Stoechadas insulas et in
siculo circa Aeolias ac
Drepana.
Pline dit donc
que
l'on
trouve,
la
vrit,
du corail dans la mer
Rouge,
et dans
le
golfe Persique,
mais
qu'il y
est
noir; or,
le corail noir
est du corail
pourri
et les anciens n'estimaient
que
le
corail
rouge (probatissimum quam
maxime
rubens,
dit
Pline).
Ainsi l'on ferait tout fait fausse route
si,
partageant
l'erreur de M.
Blmner,
on voulait attribuer
une
provenance
orientale aux coraux des
spultures
champenoises.
Les rsultats
auxquels l'archologie
nous a conduits
abondance du corail dans la Gaule
indpendante,
1.
Blmner, Terminologie
und
Technologie,
t.
II, p.
378.
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
125
absence du corail dans la Gaule romaine
sont bril-
lamment confirms
par
la suite du mme
passage
de
Pline,
que
nous
avons,
dessein,
omis de citer
jusqu'
prsent. Aprs
avoir dit
que
le corail est extrmement
recherch
par
les
Indiens,
cause des vertus
prophy-
lactiques qu'on
lui
attribue,
le naturaliste romain
ajoute
:
Avant
qu'on
et connu la
prdilection
des
Indiens
pour
le
corail,
les Gaulois en ornaient leurs
glaives,
leurs boucliers et leurs
casques. Maintenant,
l'exportation
rend cette matire si rare
qu'on
ne la voit
que
trs rarement dans les
pays qui
la
produisent
1.
Les Gaulois dont
parle
Pline
sans doute
d'aprs
un auteur
grec renseign par
les
commerants
de Mar-
seille
sont les
Champenois
dont il a t
question.
Nous avons vu
qu'en
effet on trouve dans les tombes
de la
Champagne
des
glaives,
des boucliers et des
casques
orns
de corail.
Mais,
l'poque
de
Pline,
le corail est devenu trs
rare en Gaule
(in
suo
orbe,
preuve nouvelle,
s'il en fallait
une,
qu'il s'agit
bien du corail des
Stoechades).
Le
commerce l'a dtourn des voies
qu'il
suivait ancienne-
ment et cela s'est
produit,
dit
Pline,
lorsqu'on
a su
l'avidit des Indiens
pour
cette matire.
Or,
il est vident
que
les Indiens n'ont
pu
se montrer
avides du corail de Marseille
que lorsque
le commerce
grec
et
pntr
dans
l'Inde,
c'est--dire
aprs
la mort
d'Alexandre,
partir
de la fin du ive sicle.
Est-ce un
simple
hasard si cette indication concorde
si nettement avec la conclusion
que
nous avons tire
des trouvailles
elles-mmes,
savoir
que
l'industrie
du corail avait fleuri en Gaule au Ve et au ive
sicle,
pour disparatre peu
peu
au sicle suivant ?
Pline
indique
clairement
que
l'Inde absorbait le
1. Prius
quarn
hoc
notesceret,
Galli
gladios, scuta, gale.as
adornabant
eo. Nunc tanta
penuria
est vendibili merce ut
perquam
raro cernatur
in suo orbe.
126 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
corail
disponible,
au
point
d'en
priver l'Europe
occi-
dentale. Il dit aussi
que
le corail tait estim des Indiens
autant
que
les
perles (qui provenaient
de
l'Inde)
dans le
monde romain 1. Il laisse ainsi entrevoir l'existence
d'un commerce trs
actif,
fond sur
l'importation
des
perles
et sur
l'exportation
du corail. Un document de
premier
ordre,
presque contemporain
de
Pline,
mais
tout fait
indpendant
de
lui,
vient confirmer et
pr-
ciser ces dductions. C'est
l'ouvrage grec qui
nous est
parvenu
sous le titre de
Priple
de la mer
Rouge.
Ce
prcieux petit livre,
autrefois attribu tort
Arrien,
occupe
une
place
part
dans la littrature
antique.
Ce n'est ni un
portulan,
ni un rcit de
voyage,
mais un
guide
l'usage
des
commerants d'Alexandrie,
rdig
sans doute
par
l'un d'eux. L'auteur est surtout
proccup
de faire connatre les
produits qu'Alexandrie
peut envoyer
dans les diffrents
ports
et les marchan-
dises
qu'elle peut
en
rapporter
2.
Or,
au
premier rang
de ces marchandises
exporter figure
le corail.
28
(Geographi
Minores de
Didot,
t.
II, p. 279)
:
A Cane
(sur
la cte mridionale de
l'Arabie,
dans la
rgion
de
l'encens)
on
importe d'Egypte...
du
cuivre,
de
l'tain,
du corail
;
on
exporte
de l'encens et de
l'alos.
39
(G. M.,
t. I.
p. 287)
:
Aux bouches de
l'Indus,
on
importe...
du
corail,
de
l'encens,
des vases de verre
et
d'argent
;
on
exporte
des
pierres prcieuses,
des
peaux sriques,
de la
soie,
etc.
49
(G. M.,
t.
I,
p. 293)
:
A
Barygaza (prs
de
Surate),
on
importe (d'Egypte)
du
vin,
du
cuivre,
de
l'tain,
du
plomb,
du corail...
;
on
exporte
de
l'ivoire,
de
l'onyx,
des
pierres prcieuses,
de la
soie,
du
poivre.
1.
Quantum apud
nos Indicis
margaritis pretium est,
tantum
apud
Indos curalio
;
namque
ista
persua.sione gentium
constant.
2. Cf.
Bunbury, Hislory of
ancient
geography,
t.
II, p.
443-477
(avec carte, p. 476).
LE CORAIL DANS L'INDUSTRIE*
CELTIQUE
127
56
(G. M.,
t.
I,
p. 298)
:
A Bacare
(prs
de
Manga-
Iore,
sur la cte sud-ouest de
l'Inde),
on
importe
(d'Egypte)...
du
corail,
du
verre,
du
cuivre,
de
l'tain,
du
plomb,
du
vin,
en
change d'pices,
de
perles,
d'ivoire,
de
soie,
de
pierres prcieuses.
La date du
Priple
a
pu
tre dtermine avec certi-
tude. En
effet,
il
y
est dit
que
le roi Zoscales
rgne
sur
le
royaume thiopien
d'Auxuma
; or,
ce Zoscales est
le Za Hakale
qui. d'aprs
les annales
abyssines, occupa
le trne de 77-89
ap. J .-C,
c'est--dire sous les
rgnes
de Titus et de Domitien. Le
Priple
a donc t crit
une dizaine d'annes
aprs
la mort de
Pline,
vers
85
aprs
.J .-C. 1.
Le corail
que
les navires
gyptiens apportaient
en
Inde ne
provenait
ni de la mer
Rouge,
o le corail est
noirtre,
ni
d'Erythre,
o il est friable
;
le texte de
Pline, que
nous avons cit
plus haut, prouve que
c'tait
le corail des Stoechades
et, accessoirement,
celui de
la cte
campanienne
2.
Donc,
pour
cette
substance,
Alexandrie n'tait
qu'une tape
entre Marseille et
l'Inde. En
1894,
j'ai appel
l'attention sur les relations
commerciales de Marseille et de la Gaule romaine avec
l'Egypte; mais, parmi
les articles
d'change, je
ne citais
alors
que
le
papyrus
3. On voit maintenant
que
le corail
jouait,
dans ces
relations,
un rle
plus important que
le
papyrus
et
que
le commerce dont cette matire tait
l'objet
remonte une
poque
trs
ancienne, probable-
ment la fin du ive sicle av. J .-C. Il
y
a l une cons-
tatation d'un intrt
capital pour
l'tude,
encore trs
arrire,
des
rapports
de la Gaule
indpendante
avec le
monde
hellnique
et oriental.
1.
Bunbury, op. laud.,
t.
II, p.
445.
2.
Rappelons que
les anciens
n'exploitaient pas
encore le corail
des ctes
barbaresques
;
du moins n'en est-il
pas question
dans les
auteurs.
3. Bronzes
figurs, p.
11.
128 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
Pourquoi
une
petite rgion
de la Gaule
indpendante
s'est-elle
montre autrefois si friande de corail ? La
rponse
cette
question
est donne
par Pline,
lorsqu'il
parle
de la valeur attribue au corail
par
les
Indiens :
ista
persuasione gentium
constant.
C'est,
en
effet,
affaire
de
superstition
et de mode. Nous savons en
quoi
con-
sistait la mode chez les
populations
de la
Champagne,
puisque
nous
possdons
leurs
objets
de bronze rehausss
de corail
;
quant
aux ides
superstitieuses qu'ils y
attachaient,
et
qu'atteste l'emploi
de branches de
corail
en
pendeloques,
Pline va nous
permettre
de nous en
faire une ide : Une branche de corail
pendue
au cou
d'un enfant
passe pour
le mettre en sret.
Calcin,
pulvris
et bu dans de
l'eau,
le corail est bon
pour
les
tranches,
les affections vsicales et calculeuses. Pris
de la mme
faon
dans du
vin, ou,
s'il
y
a de la
fivre,
dans de
l'eau,
il est
soporatif.
Il rsiste
longtemps
au
feu. On
ajoute que
ce
mdicament,
pris
souvent
l'intrieur,
consume la rate. Il est excellent
pour
ceux
qui rejettent
ou
qui
crachent du
sang.
On en incor-
pore
la cendre aux
compositions ophtalmiques ;
il
est,
en
effet, astringent
et
rfrigrant.
Il
remplit
les creux
des ulcres
;
il efface les cicatrices 1.
On se demandera si les
superstitions
ainsi numres
par
Pline ne sont
pas
celles des Indiens. J e crois
pou-
voir
affirmer
que
cette
hypothse
est inadmissible et
qu'il s'agit
de
superstitions celtiques.
En
effet,
Pline
vient de
parler
de
l'emploi que
les Gaulois faisaient
autrefois du corail
pour
dcorer leurs
armes, et,
dans la
phrase prcdente,
il
avait mentionn en ces termes les
croyances
des Indiens :
Les
grains
de corail sont aussi
estims dans
l'Inde,
mme
par
les
hommes,
que
les
grosses perles
de l'Inde le sont
par
nos femmes
;
leurs
aruspices
et
leurs devins
pensent que
c'est une amulette
1.
Pline,
trad.
Littr,
t.
II, p.
375.
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
129
excellente
pour
carter les
prils ;
de la
sorte,
le corail
est
pour
eux un
objet
d'ornement et de
religion.
Cela
dit sur les
Indiens,
Pline
passe
aux Gaulois
;
il est donc
hors de doute
(bien qu'on
ne
paraisse pas
encore s'en
tre
aperu) que
les
lignes
traduites
plus
haut rsument
des
croyances gauloises.
On sait
que
Pline,
qui
avait
rsid en
Gaule,
tait assez bien inform des choses
de ce
pays
et,
en
particulier,
des
superstitions
mdi-
cales
qui y
avaient cours 1.
A
l'appui
de ce
que
nous venons de
dire,
on
peut
aussi
relever la
phrase
de Pline : Cinis eorum
(des coraux)
miscetur oculorum medicamentis. La Gaule tant
pres-
que
le seul
pays
o l'on ait dcouvert des cachets
d'oculiste,
on a tout lieu de
supposer que
la science ou
le charlatanisme des oculistes
y
taient
plus dvelopps
qu'ailleurs
2.
Le
corail,
nous l'avons
vu,
a t introduit dans l'int-
rieur de la
Gaule, puis transport
Alexandrie, pour
aller de l en
Inde, par
le commerce de Marseille. A
quelle langue
se rattache le nom de cette
substance,
xop&klioy
chez les
Grecs, corallium,
coralium ou curalium
chez les Latins ?
Les Grecs ont
propos
des
tymologies absurdes, qu'il
est inutile de
discuter, par exemple
/.oup. ls,
toison de
la mer. La forme
xoupXiov,
latin
curalium,
est d'ailleurs
aussi bien atteste
que
la forme
vulgaire
xopXXtov
ou
xociXiov.
Quand
il
s'agit
d'une substance
prcieuse,
on
songe
volontiers une
tymologie smitique.
Mais il n'existe
pas
de racine
smitique
KRL ou GRL
qui rponde,
mme
approximativement,
au sens
exig.
Force est
donc de chercher ailleurs.
1. Voir les extraits de Pline dans Dom
Bouquet,
Recueil des histo-
riens,
t.
I, p.
62 et suiv.
2. Les oculistes
gallo-romains
introduisaient de l'ambre
pil
dans
leurs
collyres (Rev. arch., 1893, I, p. 300).
S. REINACH
9
130 LE CORAIL DANS L'NPUSTRIE CELTIQUE
J e crois
que
le mot corail est
celtique
ou
ligure
et
j'en
donne les raisons suivantes
:
lo Les Grecs n'ont
pu
recevoir
ce mot
que
de Mar-
seille, qui parat
avoir
t, pendant
six ou
sept
sicles au
moins,
le
centre du commerce du
corail;
2
Un nomm Cambavius
Corali
filius parat
dans une
inscription
d'El Padron
en
Espagne
1,
Or,
Cambavius
est certainement un nom
celtique (cf.
Cambarius,.
Cambaules, etc.) ;
c'est sans doute
pour
ce
motif
que
M.
Holder
a fait
figurer
le nom Coralus dans
son
Sprmhschatz.
J e crois
qu'il
a
eu raison de
l'accueillir;
3 M. Holder n'a
pas
accueilli le nom de
peuple
des
oralli,
et
je
crois
qu'il
a eu tort. Les Coralli me sem-
blent avoir t
celtiques,
comme
je
l'ai
dj
dit ailleurs*.
A
l'poque
de
Strabon,
ils habitaient entre l'Hmus et
le Pont-Euxin. Ovide les dcrit comme
blonds, flavos,
et vtus de
peaux, pellitos
9
;
mais ce
que
nous savons
de
plus prcis
leur
sujet
nous est rvl
par
Valerius
Flacus*, J e
reproduis
ici ce
que j'ai
crit
en 1894 dans
un mmoire sur
la cateia et la
francisque
5
:
Le
passage
du VIe livre des
Argonautiques,
o Valerius Flaccus
numre les
guerriers
de la
Scythie,
est fort intressant
pour
la
question qui
nous
occupe (celle
de l'armement
des
Barbares).
Il est vident
que
ses
descriptions s'ap-
pliquent
des tribus
celtiques
ou
celtises,
dont l'arme-
ment,
aux
yeux
des Grecs et des
Romains,
tait celui
des Barbares en
gnral.
Voici d'abord les chariots
couverts de cuir des Coraltes ou
Ccelaltes,
d'o les
enfants lancent la
cateia :
FA
puer
e
primo torquens
temone cateias
(VI, 83).
1.
Corp.
inscr.
lat.,
t.
II,
5629.
2. Bertrand et
Reinach,
Les
Celtes, p.
196.
3.
Ovide, Pontiques, IV, 2,
37 et
8,
85.
4. YaleriuB
Flacaus, Argon., VI,
88.
5. Les
Celtes, p.
195.
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
131
Plus
loin,
ce sont les
Coralles,
voisins de
Tomi,
qui
ont
pour enseignes
des roues
(les
rouelles
celtiques)
et des
sangliers
:
Densique
levant vexilla Coralli
Barbaricae
qus signa
rotae
serrataque
dorso
Forma suum
C'est ensuite
Teutagonus qui
conduit les Bater-
nes,
etc.
Tout,
dans les vers
que
nous avons
cits,
est
celtique
:
les
chariots couverts de cuir
(covini constrati, Lucain,
I, 426) 1,
la
cateia,
les
enseignes
surmontes de
rouelles,
les
sangliers-enseignes,
enfin le nom de
Teutagonus.
J 'en conclus
que
les Coralli sont
galement celtiques,
et
j'insiste
surtout sur le fait
que
les
enseignes
surmontes
de
sangliers
sont un caractre distinctif des
peuples
gaulois.
Elles
figurent
sur les monnaies des Aulerci
Eburovices,
des
Caltes,
des
Vliocasses,
des
Leuci,
des
Eduens,
parmi
les
trophes
de l'arc
d'Orange,
sur une
stle du muse de
Metz,
sur la cuirasse
sculpte
de la
statue
d'Auguste
dcouverte dans la villa de Livie 2.
En
Germanie,
Tacite les
signale
chez les
Aestii 3,
dont
la
langue,
comme il le
remarque expressment,
tait
celtique (lingua
britannicae
proprior),
et
aussi,
sans
que
le
passage
soit aussi
net,
chez les Bataves 4.
Assurment,
le
sanglier-enseigne
se rencontre
galement
chez d'autres
peuples,
entre autres chez les Romains avant Marius
;
mais
je
ne
vois,
dans toute
l'antiquit, que
les Celtes
auxquels
on en attribue constamment
l'usage.
D'ail-
leurs,
dans le
passage
de Valerius
Flaccus,
la mention
1. Les mss. ont monstrati
;
la lecture constrati
s'impose,
mon
avis,
et celle
qu'adopte
l'dition
Teubner,
non
strati,
est
rejeter.
2. Voir les rfrences dans mes Bronzes
figurs, p.
256.
3.
Tacite, Germ.,
45.
4.
Tacite, Hist., IV,
22.
132 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
accessoire des
roues-enseignes
vient
l'appui
du senti-
ment
que
nous
exprimons.
Nous concluons
que
le nom mme du corail est
ligure
ou
celtique, peut-tre emprunt par
la
langue celtique
la
langue ligure.
Quant
la
signification
du
mot,
on
ne
peut
mettre ce
sujet que
des
conjectures.
La
plus
naturelle est
d'y
voir la
dsignation
de la couleur du
corail : la tribu des
Coralli, qualifis
de
flan par Ovide,
serait,
dans cette
hypothse,
la tribu des Roux.
La mode des bronzes rehausss de corail a t courte
;
mais,
l'poque
suivante,
nous trouvons en Gaule des
bronzes rehausss d'mail
rouge
; l'emploi
de
l'mail,
l'exclusion du
corail,
continue
pendant l'poque
romaine
et,
au moment des invasions
barbares,
nous
voyons paratre
des
objets
en
mtal,
armes ou
bijoux,
rehausss de
grenats
cloisonns en tables ou de verro-
teries
rouges
imitant les
grenats.
Ces faits
suggrent
l'ide d'une survivance industrielle et semblent
justifier
une thorie
que j'ai
rsume
jadis
en ces termes
1
:
A
l'poque
des
grandes
tombes de la
Champagne,
on se
sert... de corail
; plus tard,
le corail tant recherch
par
les
Romains 2,
les Gaulois excellrent dans l'maille-
rie,
art
qui
consiste dcorer le mtal l'aide de subs-
tances vitreuses colores. La verroterie cloisonne est
comme le dernier terme d'un
dveloppement qui,
commenc en
pays celtique, parat
s'tre achev dans la
rgion
mridionale de la
Russie,
d'o les Goths furent
chasss et
pousss
vers
l'Europe
occidentale
par
l'inva-
sion des
Huns,
vers 380
aprs
J .-C.
En
ralit,
les choses se sont
passes
un
peu
moins
simplement.
Les trois
techniques
de la sertissure du
1.
Le Muse de
Saint-Germain,
5e
confrence.
La Gaule chrtienne
et la Gaule
franque (collection
du Muse
pdagogique).
Antrieure-
ment,
plusieurs reprises, j'avais
insist sur cette thorie dans mon
cours de l'Ecole du Louvre.
2. J 'aurais d crire :
par
les Indiens .
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
133
corail,
de l'maillerie et du
cloisonnage
des verroteries
ne se sont
pas
succd comme les
gnrations
d'une
mme famille. L'mail
parat dj
dans les
ncropoles
du
premier ge
de Latne
1
;
la dcoration du mtal
l'aide de verroteries se constate ds
l'poque
de Hall-
statt
2
et
ensuite,
en
pleine
floraison de l'industrie de
l'mail,
Bibracte
3
; enfin,
il
y
a des diffrences
impor-
tantes,
au
point
de vue
technique,
entre l'maillerie
gauloise
et l'maillerie
gallo-romaine 4,
tel
point qu'on
ne
peut affirmer, jusqu'
nouvel
ordre, que
celle-ci
drive directement de celle-l.
Mais,
d'une
faon
gn-
rale,
on
peut dire,
comme l'avait
dj
fait
Tischler 5,
que
l'mail
rouge
des Gaulois a t un succdan du
corail devenu rare en Gaule
par
suite du commerce
avec l'Inde
;
on
peut
dire aussi
que,
vers la fin du
ine sicle
aprs
J .-C,
lorsque
les
corporations
d'mail-
leurs
dgnrrent
ou
disparurent,
le
cloisonnage
des
grenats apparut
comme un succdan de l'mail. Une
1. Cf. Verhandl. der Berl. Ges.
filr Anthrop.,
t.
XX,
p.
142. Dans la
ncropole
de
Flavigny (Marne),
M. J . de
Baye signale,
ct d'une
pointe
de lance rehausse de
coraux,
une ceinture de bronze avec
17
pices
mailles
rouges,
et fait ce
sujet
les rflexions suivantes
(Rev. archol., 1877, II, p. 44)
: Il
y
a lieu de conclure
que
l'maillerie
tait connue chez les Gaulois
longtemps
avant l'tablissement des
ateliers duens et
que
cet art avait une
perfection
de
procd
et
d'excution bien
suprieure
ce
que
l'industrie duenne nous a
lgu
dans les fouilles du
Mont-Beuvray.
La
priorit
de cette obser-
vation trs intressante
appartient
M. J . de
Baye.
2. Voir le
poignard
de
Hallstatt,
dont la
poigne
est
parseme
de
verres de
couleur, ap. Kemble,
Horae
ferales, pi. XVII,
A.
3. Fibule ronde en
bronze,
avec un
grain
de verre bleu enchss
sur un
pdoncule qui
en
occupe
le centre
(Bulliot,
Mm. de la Soc.
des
Antiquaires,
t.
XXXIII, p. 92).
4. Voir Kondakoff. Lesmaux
byzantins (Collection Zwnigorodsko),
p.
25. L'maillerie
gallo-romaine
a
probablement
subi l'influence
de
l'Egypte (cf. ibid., p. 7).
5.
Daher ist dus
gallische
Email
jedenfalls
zuerst als Imitation der
Koralle enstanden
(Tischler,
Prhistorische Arbeiten des Provinzial-
museums zu
Knigsberg, p.
22
[14]).
Les assertions contraires de
M. Kondakoff
(op. laud., p. 18)
n'ont aucune valeur.
134 LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
discussion
plus ample
de ces difficiles
questions
nous
entranerait sur le terrain
glissant
de l'histoire de
l'mail,
o il est bien difficile un
archologue
de s'avan-
cer s'il n'est
pas guid
et second
par
un chimiste.
Les
Gaulois,
comme d'ailleurs tous les
peuples
bar-
bares,
avaient le
got
des couleurs clatantes et
bigar-
res. On nous
parle
des armes du roi arverne
Bituitus,
rehausses de couleurs
varies,
en 121 av. J .-C.
1
;
Dio-
dore de Sicile dit
que
les boucliers des Celtes taient
bigarrs
suivant une mode
particulire,
ireiroixiAf/iva
SoiTprfxw2; ailleurs,
il est
question
du roi des Gsates
Viridomaros
(222
av.
J .-C),
dont les armes
resplendis-
saient de couleurs
diverses, (iocpaT
xai irai
rcoixftf/.afftv
3.
A. Franks a
rappel
le texte de Diodore
propos
des
magnifiques
dcorations en mail
que prsentent
des
boucliers et des
objets
de harnachement dcouverts en
Grande-Bretagne*.
Il
semble,
en
effet,
que
ces
expres-
sions ne conviennent
qu'
des
objets mtalliques
mail-
ls,
et non des armes
parsemes
de boutons de corail.
Ainsi,
ds le dbut du ine sicle av.
J .-C,
date du
plus
ancien texte
que
nous avons
cit,
les Gaulois
qui
taient
en contact avec les Romains maillaient leurs armes de
luxe
;
raison de
plus pour
attribuer les armes rehausses
de corail une date
plus
ancienne,
conformment aux
considrations d'ordre divers
que
nous avons
dvelop-
pes plus
haut.
En
rsum,
je
crois avoir montr
qu'il
faut
distinguer
dsormais,
dans l'histoire de l'industrie
gauloise,
une
poque
du corail. L'attention des auteurs de fouilles
1. Bituitus discoloribus in armis
(Florus, I, 37).
2.
Diodore, V,
30.
3.
Plutarque, Marcellus, 7, p.
301. Cf. d'Arbois de
J ubainville,
Reue
archol., 1877, II,
p.
218, qui
me
parat
tort
parler
des a couleurs
des vtements
propos
des
TtoixXpuxTa
de Viridomaros.
4. Kemble et
Franks,
Horae
ferales, p.
63.
LE CORAIL DANS L'iNDUSTRIE
CELTIQUE
135
doit tre vivement attire sur cette substance
qui,
moins anciennement et moins
gnralement apprcie
que l'ambre,
a
cependant
donn
naissance,
comme
l'ambre,
des relations commerciales dont la civilisa-
tion de
l'Europe
occidentale a tir
profit.
VII
IDES GNRALES
SUR L'ART DE LA GAULE
AU DBUT DU VINGTIEME SIECLE
(l)
Rserve
faite, peut-tre,
de l'orfvre saint
loi,
dont
on ne sait d'ailleurs
pas grand'chose,
nous
ne
connais-
sons
pas
la
biographie
d'un seul artiste
qui
ait travaill
en Gaule antrieurement l'an 1000
aprs
notre re.
Et
cependant,
il
peut
tre
question
de l'histoire de l'art
en Gaule aux
poques prhistorique, celtique, gallo-
romaine et
franque.
C'est
que
l'histoire de l'art n'est
pas
l'histoire des
artistes,
mais celle des
styles.
Qu'est-ce que
le
style
?
Si,
comme on le dit souvent
tort,
c'tait chose
individuelle,
s'il tait vrai
que
le
style,
c'est l'homme
,
il
n'y
aurait d'histoire des
styles
que
l o le
grand jour
de l'histoire
gnrale permet
de
dmler des individualits et de
rpartir
entre elles avec
certitude les oeuvres
que
le
temps
a
pargnes. Or,
antrieurement l'an
1000,
nous ne
possdons,
comme
oeuvres
signes
en
Gaule, qu'un
certain nombre de
cramiques d'poque
romaine, principalement
des
figu-
1.
[Reue archologique,
1905, II, p.
306-313. Confrence faite au
Petit Palais
pendant l'Exposition
de 1900. Le texte en a t
imprim
d'abord en russe et en
franais,
dans un recueil
publi
Saint-
Ptersbourg
et rest inconnu des
archologues
d'Occident
(je
ne le
possde pas moi-mme).
J 'ai
ajout cinq
courtes
notes,
mais il m'a
sembl
prfrable
de ne
pas
introduire la mention de dcouvertes
postrieures
'
1900,
comme celles des
peintures
et des
gravures
sur les
parois
des
cavernes].
IDES SUR L'ART DE LA GAULE 137
rines en terre
cuite, qui
sont des
produits
industriels
mdiocres et nous
apprennent
fort
peu
de chose sur
l'histoire de l'art. Cela
n'empche pas que
l'on ne
puisse distinguer
nettement dans ce
pays
la succession
et l'volution des
styles, parce que
les
styles
ne sont
pas individuels,
mais sont le
propre
des coles d'art.
Partout o il
y
a de
l'art,
ou mme
simplement
de
l'industrie,
il
y
a des
coles;
il
y
a des matres et des
lves,
un
enseignement
et une tradition. Si
chaque
artiste
s'inspirait
directement et immdiatement de la
nature,
il
n'y
aurait
que
des
artistes,
il
n'y
aurait
pas
d'coles.
Quand
on voit les choses de
trop prs,
on
peut
se faire illusion cet
gard ;
on
peut s'imaginer que
les
individus
importent plus que
les
traditions,
parce que
ce
qui frappe
surtout
alors,
ce sont les diffrences. Mais
prenez
du
recul, regardez
un
groupe
de marbres
grecs
du ve
sicle,
un
groupe
de tableaux florentins ou
ombriens du xve. Il faut un travail minutieux d'ana-
lyse pour reconnatre,
dans chacun
d'eux,
l'accent
personnel ;
encore cela est-il souvent
impossible.
Ce
qui
domine,
ce
qui
se
dgage,
ce
qui
nous charme ou nous
intresse,
c'est le
style
collectif de l'cole une certaine
phase
de son
dveloppement.
Les
artistes,
il est
vrai,
se sont
presque
tous crus des
crateurs, beaucoup
se
sont vants de n'avoir eu
pour
matresse
que
la nature
;
mais
replacez-les
dans leur milieu
qu'ils
ont cru domi-
ner,
avec
lequel
ils ont
parfois
cru
rompre
violemment,
et tout
s'enchane,
tout se
coordonne,tout s'harmonise;
il
y
a encore des
varits,
comme les teintes diverses
d'une fort vue
distance,
mais
pas
de
disparates
;
on ne trouve ni un Delacroix au xve
sicle,
ni un Man-
tegna
au xixe. C'est
qu'on
est
toujours,
comme disait
un
personnage
de
Beaumarchais,
le fils de
quelqu'un;
cela est vrai au
spirituel
comme au
physique,
et
Hip-
pocrate
n'avait
pas
tort
quand
il faisait
jurer
aux mde-
cins
grecs
d'honorer leurs matres
l'gal
de leurs
138 IDES SUR L'ART DE LA GAULE
parents.
Cette thorie n'exclut
pas
l'initiative
per-
sonnelle,
ni ce
qu'on appelle l'originalit
et
l'invention;
seulement,
ces
qualits
toutes relatives sont
impuis-
santes faire sortir un artiste de son milieu
;
elles ne
font
que
hter l'volution des
germes prexistants
dont il a subi et dont il
multiplie
l'influence. Les arts
o les hommes de
gnie
font dfaut n'voluent
pas
ou
voluent trs lentement
;
l'homme de
gnie
est celui
qui
acclre l'volution
; quant
aux crateurs au sens
strict du
mot,
il
n'y
en a
pas,
du moins
parmi
les
mortels.
Ces considrations
s'imposent
nous au moment
o nous allons
jeter
un
coup
d'oeil sur fart de la Gaule
depuis
les dbuts de la civilisation dans ce
pays jus-
qu'
la fin de
l'poque
romaine. Ds
l'origine,
ds
l'poque quaternaire, l'ge
du renne et du
mammouth,
nous trouvons des
spcimens parfois
tonnants de
sculpture
et de
gravure
sur ivoire et sur bois de renne
;
les
plus
belles collections
d'objets
de ce
genre,
runies
par
MM. Piette et
Massnat,
ont t
exposes
au
Muse du Trocadro
1. Comment se fait-il
que
ces
oeuvres de l'enfance de l'art n'aient rien du caractre
des oeuvres des
enfants, qu'elles
soient souvent d'une
sret de dessin
merveilleuse, qu'elles
ressemblent
rarement des
gribouillages
d'coliers
?
Diffrentes
rponses
ont t faites cette
question.
Le
professeur
Virchow a
prtendu que
si les chasseurs de rennes dessi-
naient naturellement si
bien,
c'est
qu'il n'y
avait
pas
encore d'coles de dessin
cette
poque
recule. Bou-
tade
spirituelle,
si l'on
veut,
mais
profonde
erreur.
Admettre
qu'un
art
pareil
soit
spontan, qu'il
soit n
ex nihilo avec des caractres de
perfection
aussi remar-
1. La collection Massnat est
aujourd'hui
Clermont,
aux mains
de M.
Girod, qui
l'a
publie
;
la collection Piette a t
donne,
en
1902,
au Muse de
Saint-Germain,
mais n'est
pas
encore ouverte
au
public.
[Celle
de Massnat est venue
l'y rejoindre.]
IDES SUR L'ART DE LA GAULE 139
quables, qu'il
se soit transmis sans
enseignement,
c'est
donner un dmenti toutes les lois de la
psychologie
et de l'histoire. Nous
ignorons
o cet art a balbuti
d'abord,
o il s'est form
; peut-tre
s'est-il
constitu
dans les
rgions
du nord de
l'Europe,
d'o les
chasseurs
de rennes sont descendus vers la Gaule lors du refroi-
dissement du climat
marqu par l'poque glaciaire.
Mais ce
qui
est
sr,
c'est
que
l'art des abris de
Thayn-
gen,
de la
Madelaine,
de
Brassempouy,
n'est ni un art
spontan,
ni un art ses dbuts
;
c'est un art
qui
a
derrire lui un
long dveloppement
et dont les oeuvres
prsentent,
d'un bout l'autre de la
Gaule,
un air
de famille
qui implique
l'existence d'une
cole,
d'une
tradition. Saluons
donc,
l'aurore de la civilisation
de notre
pays,
l'cole des
sculpteurs
et des
graveurs
contemporains
du mammouth et du renne
;
elle n'a
pas
moins de
ralit,
nos
yeux, que
celles des mail-
leurs de
Limoges
ou des ivoiriers de
Dieppe,
bien
que
nous
soyons
condamns ne
jamais
savoir dans
quelles
conditions et sous
quelles
influences les
premiers
ensei-
gnements
de l'art
s'y
sont transmis.
Il
y
eut aussi une cole d'art la fin de
l'poque
des
dolmens,
cole bien infrieure la
prcdente
et dont
les
oeuvres sont rares et
grossires,
mais dont l'homo-
gnit,
caractre distinctif d'une
cole,
est indniable.
Sur les
parois
de
grottes
dans la valle du Petit
Morin,
sur des
pierres
de dolmens en
Normandie
et en Seine-
et-Oise, puis,
en descendant vers le
Sud,
dans
l'Avey-
ron,
dans le
Tarn,
dans le
Gard,
dans
l'Hrault,
on a
observ de nos
jours
des
sculptures
et des reliefs troi-
tement
apparents,
o le
type
dominant est celui de la
femme assise ou
debout,
dans une attitude
hiratique.
Quelques moulages
de ces oeuvres
singulires
sont au
Muse de Saint-Germain. Les
plus importantes,
celles de
l'Aveyron,
sont des menhirs
anthropodes,
c'est--dire
des
pierres
debout
auxquelles
on a
donn,
par quelques
140 IDES SUR L'ART DE LA GAULE
coups
de
ciseau, l'aspect
de statues rudimentaires.
D'autres
figures analogues
ont t dcouvertes dans
les les
normandes,
en
Angleterre,
dans le nord de l'Alle-
magne,
dans la Russie mridionale
;
on en suit la tra-
dition
jusque
dans les les de
l'Archipel
et sur les ctes
de l'Asie Mineure.
Quel
a t le centre de
rayonnement
de ce
type primitif
? Nous
l'ignorons
et notre curiosit
reste inassouvie autant
qu'excite lorsque
nous consta-
tons,
sans
pouvoir
en rendre
compte, l'analogie
de
figures
fminines dcouvertes
dans les ruines de Troie
avec d'autres
que
l'on a trouves rcemment dans le
Rouergue.
Mais les
faits
sont
l,
les ressemblances sont
trop prcises pour qu'on puisse
les attribuer au hasard.
Inclinons-nous devant les faits... et attendons
qu'il
s'en
produise
d'autres
pour
nous clairer.
A
l'poque
des
dolmens,
comme celles du bronze
et du fer
qui
lui font suite
jusqu'
la
conqute
romaine,
les monuments
figurs
sont excessivement rares
;
il
y
a des coles d'art industriel en
Gaule,
il
n'y
a
pas
d'coles de
sculpture.
En dehors des
images primitives
que j'ai signales
tout
l'heure,
on ne trouve
plus,
jusqu'aux
environs de l're
chrtienne,
une seule
figure
humaine
sculpte qui
soit
digne
de ce nom. Les
Gaulois,
on
peut
l'affirmer
aujourd'hui,
n'ont
pas
eu d'idoles.
Il est vrai
que
J ules Csar a
paru
dire le contraire : il
nous
apprend que
le dieu
principal
des Gaulois est Mer-
cure et
qu'ils
lui lvent de nombreux
monuments,
plurima
simulacra. Mais ces simulacres n'taient
pas
des statues : c'taient les
pierres
debout
que
nous
appelons
menhirs.
Quelquefois, exceptionnellement,
un art
grossier
intervenait
pour prciser
la
signification
de ces
pierres ; mais,
en
gnral,
elles restaient brutes.
Il en tait de mme des troncs de chne non
quarris
qui,
aux
yeux
des
Gaulois,
taient des
images
de dieux.
La loi
religieuse,
dont les
dpositaires
taient les
Druides,
interdisait la
reproduction
de la
figure
humaine;
IDES SUR L'ART DE LA GAULE 141
c'est une des raisons
pour lesquelles
les anciens ont
rapproch
leur doctrine de celle de
Pythagore,
qui
tait
galement
iconoclaste,
systmatiquement
hostile
l'anthropomorphisme
des
Grecs,
des
Egyp-
tiens et des
Assyriens.
Mais il suffit de
jeter
un
coup
d'oeil sur les
lgantes
pes
de
bronze,
sur les
plaques
de
bronze
ajoures,
sur les colliers d'or
qui figurent
dans les vitrines de
M.
Morel 1,
du Muse de
Lons-le-Saulnier,
du Muse de
Toulouse,
pour
se
persuader que
les
Celtes,
tout en
igno-
rant ou en
rprouvant
la
reprsentation
des tres
anims,
avaient un
style,
ou
plutt plusieurs
styles,
dont on
peut
suivre l'volution
depuis
les stations lacustres de
l'Helvtie
jusqu'aux
derniers
temps
de leur
indpen-
dance.
Ces
styles
ont en commun la
simplicit
et la
clart
; l'esprit gomtrique y
domine
;
il
n'y
a rien
de
confus,
de
capricieux,
de boursoufl
;
tous les motifs
peuvent
tre
reproduits
au
moyen
de la
rgle
et du
compas.
A
l'poque
du
fer,
vers l'an 800 avant
J .-C,
ou
peut-tre plus tt,
se manifeste le
got pour
les orne-
ments de mtal
ajours, got persistant qu'on
retrouve,
plus
de mille ans
aprs,
l'poque mrovingienne
et
dont il n'est
pas
interdit de reconnatre l'influence
jusque
dans les dentelles de
pierre
et les rosaces de nos
glises gothiques.
Vers l'an 500 avant J .-C. intervient
un lment
nouveau,
la
polychromie.
Les
Gaulois,
surtout dans l'est de la
Gaule,
aiment relever l'clat
du bronze
par
celui des cabochons de corail
qu'ils y
sertissent avec art. Cette
technique
tait bien
propre
aux
Gaulois,
car la Grce l'a
ignore
et
on n'en trouve
de traces en Italie
que
l o les Gaulois ont
pntr.
Le corail dont les Gaulois faisaient
usage
venait des
les
d'Hyres
;
ils en dcoraient leurs
casques,
leurs
pingles
de sret ou
fibules,
les fourreaux de leurs
1. La collection Lon Morel est
aujourd'hui
au British Musum.
142 IDES SUR L'ART DE LA GAULE
pes.
Un crivain romain nous l'a dit et
l'archologie
a confirm son
tmoignage
: des bronzes
gaulois
orns
de corail ont t dcouverts en
grand
nombre dans les
tombes de la
Champagne.
Cette tude de
l'emploi
dcoratif du corail est fconde
en
enseignements.
A
partir
d'une certaine
poque,
voi-
sine de l'an 200 avant
J .-C,
le corail
disparat
;
seule-
ment,
comme rien ne se
perd,
comme tout se trans-
forme et
volue,
une autre
technique remplace
celle-l,
produisant
des effets
analogues
: c'est
celle
des
maux,
que
l'on
emploie
comme des cabochons de corail
d'abord,
puis
l'tat de
plaques
multicolores intro-
duites dans les cavits du mtal. Cette
technique dure,
en se
transformant, jusqu'
la fin de
l'poque
romaine
;
on en constate encore des survivances
l'poque
franque,
mais alors elle est
remplace par
une
autre,
celle de la verroterie cloisonne. Ainsi l'volution dans
la dcoration
polychrome
du mtal se
poursuit,
sur le
sol de la
Gaule,
travers ces trois
phases
: le
corail,
l'mail,
la verroterie.
Quelle preuve frappante
de la
continuit des arts
dcoratifs,
de la
logique suprieure
qui prside
au
dveloppement
du
got artistique,
domi-
nant et refrnant au besoin les
caprices
du
tempra-
ment individuel !
Si les Gaulois renoncrent au corail
pour
Vmail,
ce
fut par l'effet
des relations commerciales de
l'Egypte
avec l'Inde. Ainsi
nonce,
cette
proposition parat
extravagante ;
elle est
pourtant
la vrit
mme,
car
nous avons des textes
prcis
qui
l'attestent 1.
Aprs
les
conqutes
d'Alexandre,
les Grecs d'Alexandrie com-
mencrent entretenir des relations actives avec les
ctes de l'Arabie et de
l'Inde,
comme avec celles de
l'Italie et de la Gaule.
Qui
dit
commerce,
dit
change
;
1. Voir le mmoire
que j'ai publi
ce
sujet
dans la Reue
celtique,
1899, p. 12-29, p.
117-131
[plus
haut, p. 100-135].
IDES SUR L'ART DE LA GAULE 143
or,
nous savons
par
un document
grec, rdig par
un
Grec
gyptien, que
les Hindous achetaient du corail aux
marchands
d'Egypte
et leur
donnaient,
en
change,
des
perles
et des
pices.
Nous savons
aussi,
par Pline,
que
ces marchands
d'Egypte accaparrent peu
peu
tout le corail
pch
aux environs des les
d'Hyres
pour l'envoyer
en
Inde,
o on le
payait
au
centuple
de sa valeur. Du
temps
de
Pline,
70 ans
aprs
J .-C,
le corail tait introuvable en
Gaule;
depuis
deux sicles
au
moins,
il
y
tait devenu si
cher,
vu la concurrence
gyptienne, qu'on
avait d
songer
le
remplacer par
une autre substance. Cette substance fut
l'mail,
dont
les mmes Grecs
d'Egypte, accapareurs
du corail
gau-
lois,
avaient
peut-tre
introduit
quelques spcimens
en Gaule et dont la fabrication devint bientt assez
active
pour
tre
signale,
comme une
spcialit
du
pays,
par
les crivains
grecs.
La
conqute
de Csar brisa la
puissance
des Druides.
Les
religions
celtiques
ne
disparurent pas,
mais elles
tendirent se fondre
(extrieurement,
du
moins)
avec
celle des Romains.
J usque-l,
les Gaulois n'avaient
pas
eu d'idoles
reprsentant
des
hommes,
mais seule-
ment
quelques figures
d'animaux,
notamment de san-
gliers,
dont ils dcoraient le sommet de leurs
enseignes.
Cependant
leurs dieux
et
leurs desses avaient une
individualit
propre,
des
noms,
des
lgendes,
des attri-
buts
;
ce n'taient
pas plus
des dieux romains
que
la
Minerve trusco-romaine n'tait l'Athn
hellnique,
et
quelques-uns
d'entre
eux,
comme la desse
protectrice
des
chevaux,
le
tricphale,
le vieux dieu
cornu,
le
serpent
tte de
blier,
n'avaient
pas d'analogues
dans le
pan-
thon
grco-romain.
Une fois
que
la dfense de
fabriquer
des idoles eut t leve
par
la ruine des
Druides,
les
artisans
gaulois
se mirent en
sculpter,
tant en
pierre
qu'en mtal, s'inspirant
d'une
part,
cet
effet,
de leurs
vieilles traditions
religieuses,
de
l'autre,
des
images
144 IDEES SUR L ART DE LA GAULE
des dieux romains
qui, par
leur
caractre,
se
rappro-
chaient le
plus
ou
s'loignaient
le moins des
leurs. Ce
serait une
grande
erreur de croire
que
les dieux romains
s'emparrent
de la
Gaule comme d'une terre
inoccupe
;
ils
n'y prirent
racine
qu'
la condi-
tion de subir des
changements
pro-
fonds, qui
les accommodrent non
seulement aux
croyances gauloises,
mais ce
style particulier
dont nous
avons
signal
tout l'heure les traits
distinctifs. Si les
religions celtiques
ne
perdirent pas
leurs
droits,
l'art
celtique, pris
de
gomtrie
et de
symtrie, peu
soucieux de vie et de
mouvement, n'abdiqua pas
davan-
tage
les siens. Nous en trouvons une
preuve frappante
dans cette statue
colossale du Mercure de Lezoux
la
plus grande,
avec celle de
l'Apol-
lon
d'Entrains, que
l'on ait dcou-
verte en Gaule
dont la libralit
de M.
Plicque
a
permis que
le Petit
Palais
pt
s'enlaidir
(fig. 23)
1.
Car elle est
laide,
cette
statue,
elle
est fort laide dans sa raideur hira-
tique,
dans sa carrure
qui
fait
songer
une
pierre
mise
debout,
un men-
hir,
dans son
aspect
rbarbatif et
grognon qui suggre
l'ide des
marais
et des forts sombres de la
Gaule
plutt
que
des bois d'oliviers et des collines enso-
leilles de la Grce.
L'inscription grave
sur la
poitrine
1. Cette
statue, acquise par
le Muse de
Saint-Germain, aprs
^'Exposition
de
1900,
est
expose
au fond de la cour du Chteau.
J E
"FIG.F23.
Statue
^
colossale de Mer-
l
<ure dcouverte
Lezoux
(Puy-de-
Dme),
au Muse
de Saint-Ger-
main-en-Laye.
IDES SUR L'ART DE LA GAULE 145
est ainsi
conue
: Mercurio et
Augusto sacrum,
consacr
Mercure et
Auguste.
Mercure,
c'est ce
dieu
principal
des Gaulois dont Csar assure
que
les simulacres taient
nombreux
;
ces
monuments,
nous l'avons
dit,
taient des
menhirs et la statue de Lezoux est
presque
un menhir
sculpt.
Suivant
Csar,
le dieu
gaulois qu'il
assimilait
Mercure tait le
protecteur
du commerce et des arts
;
or,
prcisment,
le colosse de Lezoux a t dcouvert
l'entre d'immenses ateliers de
cramique,
se
prolon-
geant
sur une
longueur
de
plusieurs
kilomtres,
qui'ont
t fouills avec succs
par
le Dr
Plicque pendant
une
vingtaine
d'annes. C'tait aussi le dieu de
l'loquence,
qualit qui
fut de tout
temps
en honneur
parmi
les
Gaulois.
Mais,
chez
ces
peuples
demi-barbares,
on
ne se
figurait pas
un artisan
habile,
un orateur
puissant
sous les
traits,
chers la
Grce,
d'un
phbe
imberbe :
le Mercure des Arvernes tait un vieux
dieu,
comme
l'Herms des Grecs antrieur
l'poque classique.
Or
et c'est ici
que
se manifeste
l'originalit
de l'art
gallo-romain, qui
n'est
pas
un art
d'emprunt,
mais un
art
adapt
au moment o fut dresse la statue de
Lezoux,
vers l'an 50
aprs
l're
chrtienne,
il
y
avait
au moins
quatre
sicles
que
les Grecs et les Romains
avaient transform le
type
de
Mercure, qu'ils
en avaient
fait un
jeune
homme sans barbe au
menton, rayonnant
de sant
athltique, lgant
et
souple,
comme il conve-
nait au
messager
divin des dieux de
l'Olympe.
Les Gau-
lois de Lezoux ne voulaient
pas
de ce
Mercure-l;
il
leur fallait celui de leurs
lgendes,
barbon
expert
la
faon
de
l'Ulysse homrique, qui fabrique
lui-mme
son lit et sait
tenir,
l'occasion,
de
sages
et
persuasifs
discours. C'est ce Mercure
que
l'artisan de Lezoux a
reprsent ;
il lui a
donn,
comme au Mercure
romain,
des
ailerons,
un
ptase,
un caduce
;
il l'a fait escorter
d'un blier et d'un
coq;
mais ce sont l des attributs en
quelque
sorte adventices
;
l'expression
dominante est
S. REINACH
10
146 IDES SUR L'ART DE LA GAULE
bien
celtique.
Ce Mercure est un dieu de la
Gaule, affubl,
par respect pour Auguste,
de
quelques oripeaux
du dieu
grco-romain
dont il
prend
le nom. Notez
que
l'ins-
cription
ne dit
pas
: Mercurius
Augusto
sacrum
;
ce
n'est
pas
un Mercure consacr
Auguste
;
c'est un dieu
anonyme
consacr Mercure et
Auguste, qui
rend
hommage,
si l'on
peut dire,
au dieu et
l'empereur
des
conqurants,
mais
qui
reste bien
lui-mme,
rudement
arverne,
en attendant
qu'avec
les
progrs
de la
conqute
morale et de la romanisation de la Gaule il tende
s'identifier avec le dieu
tranger
dont les attraits sont
si
suprieurs
aux siens.
A la mme
poque
o un tailleur de
pierres indigne
sculptait
le dieu de
Lezoux,
la cit des
Arvernes fai-
sait
excuter,
par
le Grec
Znodore,
une statue colos-
sale de Mercure
assis,
en
bronze, qui
cota 400.000 ses-
terces et dix ans de travail. Znodore travailla ensuite
Rome,
o il fit une
image
colossale de Nron. Le Mer-
cure du
Puy-de-Dme
a
disparu
sans laisser de
traces,
mais il est certain
que c'tait,
par
l'attitude et le
style,
un Mercure
grco-romain.
Ainsi se
dessine,
dans une
mme
rgion
de la Gaule et la mme
poque,
le con-
traste entre l'art
import
et l'art national
;
par
un
caprice significatif
du
sort,
des deux
colosses,
c'est celui
de l'art
gaulois
et
populaire qui
a survcu.
L'Apollon
en bronze de
Vaupoisson, expos par
le
Muse de
Troyes,
offre des caractres
d'originalit plus
discrets,
mais
cependant
bien reconnaissables. Sa
grce
est toute
d'emprunt
et dissimule mal une corce ru-
gueuse ;
l'hiratisme
celtique transparat
dans son
attitude,
dans sa
physionomie revche,
dans ses extr-
mits lourdes et
puissantes.
Voyez
aussi le dieu au maillet du Muse de Beaune.
Ici,
le
problme qui
se
posait
aux artistes
gaulois
tait
particulirement
difficile. Il
s'agissait
de
reprsenter
un dieu
gaulois
de caractre
infernal,
mais
qui
tait en
IDES SUR L'ART DE LA GAULE 147
mme
temps,
comme le
J upiter
romain,
le dieu de la
foudre. On se tira d'affaire en
empruntant
l'Egypte
grecque
le
type
de son
J upiter
infernal, Srapis,
mais
on lui mit une blouse
gauloise,
serre la taille
par
une
ceinture, pour
lui conserver son caractre national.
La Gaule tait laborieuse et
prospre
;
elle tait
habite
par quantit
de riches Romains ou de Gau-
lois
parfaitement
romaniss
auxquels
le luxe et l'art
de la civilisation
grco-romaine
taient devenus aussi
indispensables que
ceux de Paris nos colons canadiens
ou africains. Ainsi
s'explique,
en
Gaule,
la
prsence
de
marbres et de bronzes
qui reproduisent
les
plus
beaux
modles de l'art
hellnique.
Nous avons ici des chefs-
d'oeuvre de ce
genre,
comme le Mercure
portant
le
jeune
Bacchus de
Promie,
imitation d'un modle
grec
du
ive
sicle,
le Sommeil ou
Hypnos
trouv
taples,
le
timon de char de
Toulouse,
la tte de desse en ivoire
du Muse de Vienne. J 'en
passe
et non des
moindres,
parce que
ces
objets
sont
plutt grco-romains que
gallo-romains.
Les uns ont
pu
tre
imports,
les
autres
fabriqus
en Gaule mme
;
mais le
gnie qui
les
inspire
n'est
pas celtique
: il est entirement
grec.
La richesse de la Gaule cette
poque
et l'activit
de ses ateliers sont encore attestes
par
les nombreux
spcimens
de vases
peints
ou
reliefs,
de verreries
et de
bijoux qui
se
pressent
dans les vitrines de
Mme
Plicque,
de M.
Boulanger
et d'autres amateurs.
Ici
encore,
il
y
a une distinction essentielle faire entre
les
objets
de luxe ou de
demi-luxe,
rservs aux riches
et dont le caractre est surtout
grco-romain,
et les
objets
de
pacotille,
comme les terres cuites
blanches,
qui,
destins la classe
laborieuse,
au tiers
tat,
s'ins-
pirent,
avec une tnacit
singulire,
du
got indigne.
Un
pays
a beau
importer
des oeuvres
trangres
ou
former une cole
trangre
des ouvriers d'art : il ne
peut
constituer de la sorte un art
national,
ni mme
148 IDES SUR L'ART DE LA GAULE
un art dou d'une vitalit
quelconque.
A
peine
les
pre-
miers flots de Barbares ont-ils
balay
la Gaule
que
la
tradition
grco-romaine disparat
:
le
style celtique
reprend
le dessus dans la
cramique,
dans la
bijouterie,
dans ce
qui
reste de la
sculpture.
Il
y
a
plusieurs annes,
j'ai
avanc
que
l'art de la Gaule
barbare,
de la Gaule
de
l'poque
des
invasions,
tait une survivance
et,
quelques gards,
une renaissance du
style celtique
d'avant la
conqute, style que
les Celtes avaient trans-
mis aux
peuples germaniques
et
que
ceux-ci leur res-
tituaient comme un
dpt.
Cette manire de
voir,
tout
oppose
celle
qui
reconnat dans l'art du Ve et du
vie sicles une
simple dgradation
de l'art romain ou
une
importation byzantine,
tend,
je crois,
prvaloir
aujourd'hui
dans la science
;
elle est d'ailleurs conforme
aux
enseignements
de
Courajod, qui
remontait aussi
l'art
populaire
de la Gaule romaine
pour y
chercher
sinon la
source,
du moins une des sources de l'art romain
et
franais
1. A
priori,
il
est
probable que
nous avons
raison,
car l'historien a
toujours
chance d'tre dans le
vrai
quand
il
revendique,
mme en
dpit
des
appa-
rences,
le
principe
de la continuit des
styles, envisage
comme
l'expression
d'un
temprament rgional
ou
national.
L'ensemble de l'art
gallo-romain, compar
celui
des
poques suivantes, permet
fort
bien,
en vertu mme
de ses
disparates, d'apprcier
la
justesse
de cette
manire de voir. Ce
qui
est
plus grec que celtique
ne
dure
pas ;
c'est une
parure
de fleurs
phmres qu'une
tempte emporte;
ce
qui
est
plus celtique que grec
ou
romain survit et se
dveloppe,
mme au milieu des
bouleversements
qui remplissent
les
premiers
sicles
du
moyen ge,
bien
plus,
la faveur de ces bouleverse-
1.
[J 'ignorais,
en
1900, que
la thorie dont il est
question
a l
propose longtemps
avant
Courajod
et
moi.]
IDES SUR L'ART DE LA GAULE 149
ments.
Si donc il est
lgitime,
comme l'ont cru les
organisateurs
de ces confrences et comme
je
le crois
moi-mme,
de faire de l'art
gallo-romain
la
prface
d'une histoire de l'art
franais,
c'est la condition de ne
pas perdre
de vue
que,
dans ce
mlange,
ce
qui
flatte
notre
got
actuel est ce
qui importe
le moins et
que
l'in-
trt
historique
des oeuvres
gallo-romaines
tient surtout
aux lments
celtiques qu'elles
renferment.
QUELQUES
TOMBES MYCNIENNES
EXPLORES EN CRTE
1
L'intrt extraordinaire
qu'offrent
la science les
fouilles de Cnossos et de Phaestos en Crte ne doit
pas
dtourner l'attention des
archologues
d'autres
explo-
rations
qui
se
poursuivent
dans la mme
le,
en
parti-
culier dans les
ncropoles
ou
groupes
de tombes dont
plusieurs
ont
dj
t tudies
mthodiquement. Voici,
d'aprs
une
publication
rcente en
langue grecque,
quelques renseignements prcis
ce
sujet
2.
A deux heures
d'Hracle,
au lieu dit
Artsa,
entre les
villages
d'Ela et de Kat
Vatheia,
un laboureur dcou-
vrit,
en
janvier 1903,
une
petite
tombe couloir et
coupole
creuse dans
le roc. Des
spultures
semblables,
de
type mycnien,
ont
dj
t
signales
en
Crte,
notamment Milatos et
prs
de Phaestos. Le tombeau
d'Artsa contenait deux
rcipients quadrangulaires
en
terre cuite avec
couvercle,
dans
lesquels
taient
dposs
deux
squelettes (fig. 24).
L'un des
coffres,
bien
conserv,
contenait un
squelette
dont on a
pu
relever exactement
la
position (fig. 25).
Le mort tait enseveli les
jambes
replies,
la tte tourne vers le
nord,
c'est--dire vers
l'entre de la tombe.
J usqu' prsent, beaucoup
d'ar-
1.
[L'Anthropologie, 1904, p. 645-656.]
2.
Xanthoudidis, 'EoerjfiEpi^aioXo^ix-fj, 1904, p.
1 et suiv.
TOMBES MYCENIENNES EN CRETE 151
chologues pensaient que
les coffres crtois en terre
cuite,
orns de
peintures
et de
reliefs,
taient destins
recevoir des cendres
;
il est dsormais certain
qu'on
y plaait
des cadavres. Au Muse
d'Hracle,
on a fait
prendre
la
position replie
un homme haut de 1 m. 70
et l'on a constat
qu'il n'occupait
ainsi
qu'une
lon-
gueur
de 1 m.
18,
dimension
qu'atteignent
la
plupart
des coffres crtois. Ceux
qui
sont notablement
plus
petits
ont d servir des enfants.
Comme les deux
squelettes
ensevelis dans les coffres
sont,
l'un celui d'un
homme,
l'autre celui d'une
femme,
il est
probable qu'ils
taient les chefs de la famille
laquelle appartenait
le caveau.
Quelquefois
on a trouv
plusieurs squelettes
dans un
mme
rcipient.
M. Xanthoudidis
explique
cela en
Fie, 24.
Coffre funraire en terre cuite
d'Artsa,
152 TOMBES MYCENIENNES EN CRETE
admettant
que
les morts d'une mme famille avaient
d'abord chacun son
sarcophage
;
puis, quand
la
place
manqua
dans le
caveau,
on
prit
les ossements d'un
ou de deux coffres voisins
pour
les
placer
dans un
troisime,
de manire rendre
disponibles
ceux
que
l'on vidait ainsi. D'autres
fois,
on se
contenta,
comme
dans le caveau
d'Artsa,
de
dposer
terre les nouveaux
venus.
Une
opinion rpandue, qui
a t
adopte par
MM. Orsi
et
Perrot,
veut
que
les coffres crtois
rectangulaires-
FIG. 25. -r
Spulture
inhumation
d'Artsa.
soient faits l'imitation de maisons ou de cabanes. A
cela M. Xanthoudidis
rpond que
ces
objets appar-
tiennent tous la fin de
l'poque mycnienne,
alors
que
le
type
des habitations tait tout autre.
D'ailleurs,
l'architecture de ces
rcipients
trahit bien
plutt
l'in-
fluence des coffres de
bois,
tels
qu'Homre
les dcrit
dans les
maisons,
o ils servaient surtout la
garde
des
vtements et des
objets
de
prix.
D'autres
sarcophages
en terre
cuite,
assez
frquents
en
Crte,
affectent la
forme de cuves ou de
baignoires ;
ce sont l encore des
imitations
d'objets mobiliers,
dont on a retrouv des
spcimens
tant
Tirynthe qu'
Cnossos. Homre men-
tionne des
baignoires
en
argent,
mais il
parle
deux fois
de
baignoires
bien
polies ,
ce
qui permet
de croire
qu'elles pouvaient
tre en bois ou en
argile.
Si l'on s'est
TOMBES MYCENIENNES EN CRETE 153
servi de cuves de bois comme de
sarcophages,
il est natu-
rel
que
nous n'en
ayons pas
conserv de
spcimens.
On a vu
que
les coffres
d'argile peinte appartiennent
la fin de
l'poque mycnienne.
C'est une
priode
d'appauvrissement gnral,
de troubles
politiques
et
de
guerres,
ce
qui
ex-
plique que
l'on trouve
rarement des
objets
de
valeur dans les tombes
coffres. M. Xanthou-
didis a fouill
prs
de
Phaestos une dizaine
de tombeaux en cou-
pole
taills dans le
roc,
o il
n'y
avait
pas
un
seul
coffre,
mais beau-
coup
de belles et riches
offrandes
;
tout
prs
de
l,
la mission italienne
a
explor
une ncro-
pole pleine
de
coffres,
mais o les offrandes
faisaient
peu prs
dfaut.
Dans la terre du ca-
veau
d'Artsa,
on a d-
couvert
quatre vases,
dont une oenocho
peinte
et un vase trier
(fig.
26
et
27), preuve
nouvelle
que
ce dernier
type
cra-
mique,
considr autrefois comme
caractristique
de
toute
l'poque mycnienne,
en
marque
surtout la
dcadence et la fin. Au mme endroit on a recueilli
un rasoir de bronze
(fig. 28),
dont le manche
-
sans
doute en ivoire
a
disparu.
Des
objets analogues
se sont rencontrs assez souvent en Crte et
My-
cnes
;
il est intressant de les
rapprocher
de ceux
FIG. 26.
-
Vase
peint
dcouvert Artsa.
154 TOMBES MYCNIENNES
EN CRTE
qu'ont
fournis
les
stations
lacustres,
les tombes du
pre-
mier
ge
du fer et celles de
la
Carthage phnicienne.
Dans les environs de
Siteia,
au lieu dit Mou-
liana,
trois tombes ont t
explores
en 1903. Ce sont
des
spultures
souter-
raines,
construites en en-
corbellement,
sans
couloir,
o l'on
pntrait
en enle-
vant la
pierre
du haut
(fig.
29).
Dans la
premire,
on re-
marque,
au milieu d'un des
petits
cots;,
une fosse
troite
qui parat
avoir
servi des libations et
peut
dater d'une
poque plus
rcente
que
la construc-
tion du caveau 1. En
effet,
en
juger par
ls trou-
vailles,
cette tombe a t
employe
deux
fois,
d'abord
la fin de
l'poque
mycnienne, puis
au
dbut de
Fpoque
des
vases
gomtriques
;
le
rite de la
premire
poque
tait l'inhu-
mation,
celui de la
seconde,
l crmation.
A celle-l
appar-
tiennent trois vases
peints
trier,
trois
pes (fig. 30)
et une
petite
fibule
de bronze
(fig. 31) ;
cette fibule a nwicella est
1. On en connat un seul
exemple
de
l'poque mycnienne (
Vapnio) ;
mais M. Pfuhl en a rencontr
beaucoup
dans la
ncropole
archaque
de
Thra.
Fus. 27.
Vase trier
dcouvert Artsa.
FIG. 28.
Rasoir CBbronze dcouvert
Artsa.
TOMBES MYCNIENNES EN CRETE 155
curieuse, parce qu'elle
fournit un
type
de transition
entre la fibule
mycnienne
en archet et celle de
l'poque
Fie. 29.
Tombe de Mouliana.
FIG. 30.
pes
de Mouliana.
156 TOMBES MYCNIENNES EN CRTE
du
Dipylon
1.
L'pe
la mieux conserve a 0 m. 58 de
long
;
elle est donc
plus
courte
que
les
pes analogues
de
l'Europe
centrale et
occidentale;
la
forme, dj
connue
par plusieurs spcimens
de
Mycnes,
est aussi
bien moins
lgante.
A
l'poque gomtrique appar-
tiennent : 1 un trs
grand
cratre en terre
rouge,
revtue d'un enduit
jaune,
sur
lesquel
sont
peintes,
avec une extrme
grossiret,
des
figures rouge-
brun;
c'est le second vase
go-
mtrique
figures que
l'on si-
gnale
en Crte 2. La scne
prin-
cipale reprsente
un chasseur
lanant
un
javelot
sur une
chvre
sauvage
;
une autre
chvre s'enfuit vers la
gauche
(fig. 32). Quelle
distance entre
cet art de
Peaux-Rouges
et
celui des
fresques
de Cnossos ou
de Phaestos! La
peinture oppo-
se,
reprsentant
un cavalier
type quasi
inconnu
l'poque mycnienne
est d'un dessin tout aussi
pri-
mitif. Un dtail
noter,
c'est
que
la
peinture rouge-
brun est releve de
blanc, procd
o M. Xanthou-
didis reconnat avec raison une survivance du
style
de
Kamars,
celui
qui
a
prcd,
en
Crte,
la
cramique
mycnienne.
Des vases
gomtriques
rehauts blancs
ont
dj
t dcouverts
par
M.
Hogarth
dans la ncro-
pole
gomtrique
de
Cnossos;
2 un
grand
vase
cylin-
drique (fig. 32,
en bas
gauche),
d'un
type qui
s'est
rencontr dans le
palais
de Phaestos et dans d'autres
milieux
mycniens,
mais d'une dcoration nettement
gomtrique,
bien
que
l'on
y puisse
reconnatre encore
1. Une fibule
analogue
a t trouve
Gournia,
dans un milieu
mycnien, par
Miss
Boyd.
2. Le
premier
a t
publi par
Miss
Boyd,
American
journal, 1901,
p.
145.
FIG. 31.
Fibule de
Mouliana.
TOMBES MYCENIENNES EN CRETE 157
le motif
stylis
de la double hache
mycnienne ;
3 deux
anneaux d'or trs
simples ;
4 de
petits fragments
d'une
pe
et d'un couteau en
fer.
Le second
tombeau,
5 mtres du
premier,
tait tout
fait intact et contenait deux
corps,
l'un dans une cuve
en
argile,
l'autre sur un lit de sable
;
tous les 'deux
avaient les
jambes replies,
la tte tourne vers l'ou-
verture du caveau.
Les trouvailles
appartiennent
toutes
l'poque
mycnienne.
La
cuve, longue
de
1 m.
04,
munie de
quatre
anses de
prhension, porte
une dcoration
rouge-brun
o l'on
remarque
un motif
en
chiquier, dj employ
l'poque mycnienne,
mais
beaucoup plus frquent
l'poque
suivante
(fig. 33).
Des
quatre vases,
tous
trier, que
contenait la
tombe,
deux
portent
sur l'embouchure une dcoration fort
FIG.32.
Vases
gomtriques
de Mouliana.
158 TOMBES MYCNIENNES EN CRETE
intressante dont M. Xanthoudidis a
publi
le
dvelop-
pement (fig. 34);
il
y
a reconnu trs
justement
des
FIG 33
Cuve funraire de Mouliana.
FIG. 34.
Dveloppement
du dcor d'un vase
de Mouliana.
TOMBES MYCNIENNES EN CRETE 159
poulpes styliss,
o les
yeux
de l'animal sont
devenus
des
ornements,
o ses membres et ses tentacules se sont
transforms en
spirales
et en
lignes
ondules. La mme
tendance la
stylisation,
mais
beaucoup
moins
pro-
nonce,
se
remarque
sur un
grand
coffre en terre
cuite
dcouvert Siteia
(fig. 35),
dcor sur les
petits
cts
de
poulpes, qui
a t recoll l'aide de nombreux
frag-
ments et
transport
au Muse d'Hracle
(longueur
1 m.
05).
En fait
d'objets
en
mtal,
la tombe renfermait
deux
grands disques
de
bronze,
deux
pes
et deux
pointes
de lance du mme
alliage.
Les
disques
ont
pu,
la
rigueur,
servir de
cymbales ;
on n'en connaissait
pas
encore de
l'poque mycnienne.
M.
Xanthoudidis,
d'ordinaire trs
circonspect,
se hasarde
beaucoup
ici
en
voyant
dans ces
objets
une
preuve
de l'invasion du
culte des divinits
asiatiques
en Crte. Mme s'il
tait
FIG. 35.
Coffre funraire de Siteia.
160 TOMBES MYCNIENNES EN CRETE
,
prouv que
ces
disques
sont des
cymbales,
ce
que je
ne crois
pas,
la conclusion
qu'on
veut en tirer ne s'im-
poserait pas.
La
plus grande pe
a 0 m. 55 de
long
;
elle est d'un
type
un
peu plus archaque que
celle du
premier
tom-
beau
(fig. 30).
Dans les deux
pointes
de
lance,
le clou
servant de rivet s'est conserv la base
(longueur
0 m. 185 et 0 m.
095). Enfin,
la mme
spulture
a donn
une
bague
en
or,
un
petit masque
du
mme
mtal, perc
sur les bords de
sept
trous 1,
un
fragment
d'un
petit objet
en fer et deux
plaquettes
d'ivoire, ayant
probablement
servi
d'appliques.
Non loin de
l,
Vourlia,
un
paysan
dcouvrit,
il
y
a
quinze ans,
d'autres
tombes
coupole qui
furent mises au
pillage ;
mais le
paysan
avait conserv une belle
bague
en or
(fig. 36), que
M. Xanthoudidis a
pu acqurir
pour
le Muse d'Hracle.
Post-scriptum.
La Revue
archologique
de
juillet
1896
insrait,
ma
demande,
la lettre suivante :
Monsieur le
Directeur,
J e crois avoir reconnu
que
dans les statues anciennes de
l'Aveyron (Mortillet,
Rev. de Vcole
d'anthrop., 1893, pi.
IV-
VII;
S.
Reinach,
La
sculpture
en
Europe, fig. 22-32),
ce
que
l'on
prenait pour
des
jambes
n'est autre chose
que
les bouts de la
ceinture orns de
franges.
Mon
opinion
se fonde sur
quelques
statuettes en terre cuite
chypriotes
ou
carthaginoises que je
me
propose
de faire connatre
prochainement.
g Dj^CY
Mon vieil ami E.
d'Acy
m'avait fait alors
il
y
a
prs
de neuf ans !
la confidence de ce
que je
consi-
1.
J usqu' prsent,
on ne
connaissait,
de
l'poque mycnienne,
que
les
masques
en or dcouverts
Mycnes.
FIG.36.Bague
en or de Vour-
lia.
TOMBES MYCNIENNES EN CRETE 161
drais comme une
importante
dcouverte
;
le
voyant
dj
trs affaibli et
malade, je rdigeai
moi-mme et
le
priai
de
signer
cette
petite
lettre, qui
avait
pour
but
de
sauvegarder
ses droits de
priorit.
En 1897 et en
1898,
M.
d'Acy
runit et fit mme
reproduire
en
hliogravure
nombre de
figurines
archa-
ques qui
viennent
l'appui
de sa thse. Malheureu-
sement,
il ne
publia
rien
et,
partir
de
1900,
l'tat
de sa sant devint tel
que
toute activit
scientifique
lui fut interdite et rien ne fut
publi.
C'est une chose bien
trange qu'une
constatation
nos
yeux
si vidente n'ait
pas
t faite
depuis par
d'autres
archologues ;
du moins n'en
ai-je pas
trouv
trace dans la vaste littrature
priodique que je
n'ai
pas
encore
perdu
l'habitude de lire.
Mais voici
que
M.
Myres
vient de
publier
une ton-
nante statuette de femme en terre cuite
peinte
dcou-
verte Petsofa
(Palaikastro)
en Crte
;
elle
porte
une
grosse
ceinture
longs bouts,
dont
l'analogie
avec celles
de nos statues de
l'Aveyron
est vidente
(fig.
37,
38).
Cette statuette n'est
pas mycnienne,
mais
minoenne;
elle remonte l'an 2000 avant J .-C. ou mme au
del;
c'est,
de
beaucoup,
le
plus
ancien
exemple
de la srie
que
M.
d'Acy
aurait voulu constituer et
publier,
srie
qui comprend
aussi la terre cuite de Siteia en
Crte,
autrefois
publie par
moi dans
l'Anthropologie,
mais
qualifie
inexactement de
mycnienne
s1.
M.
Myres
ne s'est
pas rappel
les statues-menhirs
de
l'Aveyron;
en
revanche,
il est entr dans des consi-
drations du
plus
haut intrt sur les affinits du cos-
tume minoen avec le costume
europen, par oppo-
sition au costume
asiatique,
et il a crit cette
phrase,
bien faite
pour rjouir
l'auteur du
Mirage
oriental :
1.
L'Anthropologie, 1902, p.
32. La statuette de Siteia est
minoenne .
S. REINACH 11
162 TOMBES MYCENIENNES EN CRETE
Les
analogies
entre le costume
primitif
des
gens
et des
Europens
doivent rsulter
plutt
d'une ancienne
communaut de civilisation
que
d'une invasion
paci-
fique
ou
politique.
La Crte se montre nous une
fois
de
plus
la Cnossos
nolithique
autorisait
dj
la
mme
opinion
comme un
poste
avanc vers l'est de
l'Europe chalcolithique,
sinon de
l'Europe nolithique
1.
Nous
reproduisons
cte
cte,
la mme
grandeur,,
la statuette de Petsofa
2
et le menhir
anthropode
de
Saint-Sernin
(fig.
37 et
38).
Il n'est nullement
prouv
pour
moi
que
le menhir soit
plus
ancien
que
la sta-
tuette
;
ce
peut
tre la traduction en
pierre
d'un motif
FIG. 37.
Statuette
de Petsofa.
38.
Menhir
anthropode
de Saint-Sernin.
1. Annual
of
the British
School, 1902-3, p.
385.
2.
Ibid., pi.
VIII.
FIG.
TOMBES MYCNIENNES EN CRETE 163
sculpt
en bois
qui
avait
dj
volu
pendant plusieurs
sicles avant
qu'on
ait
song
le
reproduire
en
pierre.
Mais il est vident
que
le
corsage
ouvert,
la double
ceinture et les
longs
bouts
pendants
de celle-ci consti-
tuent les lments de deux costumes fminins trs
caractristiques
et trs nettement
apparents.
Dans la statuette de
Petsofa,
les bouts ne se terminent
pas par
des
franges;
mais des
franges, pouvant
donner
l'illusion de
cinq doigts,
se reconnaissent dans
plusieurs
figurines phniciennes
et
grecques qui
ont t runies
par
M.
d'Acy
1.
1.
[Voir
mon
Catalogue
illustr du Muse de
Saint-Germain,
t.
I,
p.
231-2. On n'a
pas
retrouv les matriaux runis
par
E.
d'Acy
l'appui
de sa thse.
1929.]
IX
ADOLF FURTWAENGLER
ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
L'ouvrage
de M.
Furtwaengler,
Les
chefs-d'oeuvre
de la
plastique grecque,
est le
plus important qui
ait
encore
paru
sur l'histoire de l'art
antique.
On
y
admire
presque
chaque page
la vaste rudition de
l'auteur,
l'indpendance
de son
jugement,
la nettet incisive
de son
style.
L'excution matrielle est
luxueuse,
sans
excs. Il faut aussi remercier les diteurs
qui, pouvant
abuser d'un nom
dj
illustre
pour
ranonner
le
public,
ont fix le
prix
de vente avec une modration
dont la librairie allemande donne
peu d'exemples
(60 marks)
2.
M.
Furtwaengler
n'a
pas
voulu crire une histoire
suivie de l'art
grec.
Il a runi
quatorze essais,
tous
indits,
dont les
plus importants
concernent
Phidias,
Crsilas, Myron, Polyclte, Scopas,
les deux
Praxitle,
Bathycls,
Smilis. On voit
que
l'ordre suivi n'est
pas
chronologique
: il a
plutt
t
inspir
l'auteur
par
l'importance
relative de ses tudes. L'unit est dans
la mthode. Aucun de ces articles n'est un
rsum,
1. Adolf
Furtwaengler,
Meislerwerhe der
griechischen Plastik,
Leipzig
et
Berlin,
1893.
[Reue critique,
5
fvrier, 1894,1, p.
97-
116.]
2. Les
phototypies
sont
presque
toutes excutes
d'aprs
des mou-
lages ;
ceux
qui
connaissent les conditions
d'clairage
de la
plupart
des Muses le
regretteront,
mais ne s'en tonneront
pas.
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
165
un
expos
de l'tat de la science sur tel ou tel
problme
:
il
s'agit toujours
de solutions
nouvelles, appuyes
sur
des monuments indits ou
peu
connus. Dans la
prface,
M.
Furtwaengler
s'lve contre la socordia des faiseurs
de manuels
qui,
dlaissant la tradition de
Winckelmann,
confinent sans cesse leurs observations un
petit
nombre de monuments cent fois
publis.
Il croit
que
les
muses
contiennent,
parmi
leurs trsors
indits,
non
seulement des
copies
exactes
d'originaux clbres,
mais
quelques fragments
de ces
originaux
eux-mmes
;
il
ragit
contre l'ide trs
rpandue que
l'art romain
,
ayant copi
ou combin
librement,
n'aurait rien
nous
apprendre
sur l'art
hellnique
de la belle
poque ;
il
pousse jusqu'
la minutie
l'analyse
de ces dtails de
conformation
physique 1,
de
coiffure,
de
costume, etc.,
qui permettent
non seulement de
grouper
les
oeuvres,
mais de reconnatre un cho du Ve sicle dans une
copie
excute six cents ans
plus
tard. Cette
mthode,
fcon-
de
par
une
aptitude
extraordinaire aux
combinaisons,
a
produit
des rsultats
qui
ne sont
pas
tous,
tant
s'en
faut,
bien
assurs,
mais dont aucun ne
pourra
tre
ddaign
l'avenir. Disons tout de suite
que
M.
Furtwaengler
a les dfauts de ses
qualits.
Il est
d'une
intemprance peu
commune dans l'affirmation.
Baptiser, dbaptiser, rebaptiser
sont des
oprations
qui
ne lui cotent rien. On est
parfois,
il faut bien le
dire, agac
de ce
dogmatisme, qui rappelle
celui de
Morelli et
pourra provoquer
d'aussi vives
rpliques.
Mais l'ensemble
produit l'impression
d'une force
impo-
sante,
comme disait le
sculpteur
Guillaume d'une
statue de
Polyclte.
En
somme,
la lecture de ce livre
ne saurait tre
trop
vivement
recommande,
la condi-
tion, toutefois,
que
l'on
n'accepte
rien sans
contrle,
i. Il
y
a de trs bonnes observations sur la forme des
oreilles,
p.
31 et
passim
166 AU. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
que
l'on
conserve,
l'endroit de M.
Furtwaengler,
l'in-
dpendance
dont il fait
preuve
non seulement envers
ses
prdcesseurs (qu'il
tance
parfois
avec une
rigueur
excessive),
mais envers M.
Furtwaengler lui-mme,
le
Furtwaengler
d'il
y
a dix ou douze ans. Le mot
sugges-
tif,
dont on fait
grand abus,
est trs
applicable
au
prsent
ouvrage
;
mais ceux
qui
seraient tents d'en
adopter
servilement toutes les conclusions se montreraient
rfractaires
l'esprit
de libre
critique
dans
lequel
il
a t
conu
et
rdig.
Discuter les mille et une ides mises
par
M. Furt-
waengler
est
impossible ;
se confiner dans l'examen
de tel ou tel
chapitre
serait
injuste.
Nous allons le
suivre,
essai
par essai,
en tchant de
marquer
les rsul-
tats
qui
s'en
dgagent;
toute controverse devant nous
entraner
trop loin,
il suffira
d'indiquer brivement,
l'occasion,
les
points
sur
lesquels
nous restons en dsac-
cord avec l'auteur.
I.
PHIDIAS ET SON GROUPE
Deux statues du Muse de Dresde sont des
copies
exactes de l'Athna Lemnia de Phidias. Le Muse de
Bologne possde
une
rplique
de la tte
(sans casque)
que
Brizio et
Heydemann
ont tort dclare moderne.
Dj
Schorn avait reconnu dans ce
type
une cration
de Phidias. La
clrouquie
athnienne tant
partie pour
Lemnos entre 451 et
447,
c'est vers cette
poque que
l'Athna lemniennne aurait t
excute,
trois ou
quatre
ans avant la
Parthnos,
que
M.
Furtwaengler juge
infrieure. Ce
type
de l'Athna
pacifique,
tenant son
casque
la
main,
n'est
pas
une invention de Phidias
;
mais la manire dont il l'a traite est la
plus
haute
manifestation de son
gnie.
Preller a touch
juste
en
comparant
la Lemnienne la J eanne d'Arc de Schiller
;
AD.
FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
167
la tte de
Bologne
a
longtemps pass pour
virile et
M.
Furtwaengler
pense qu'elle
a t imite
par
l'auteur
de l'Antinous
Mondragone
au Louvre.
On
a cru
gnralement que
la Lemnienne tait une
oeuvre de la maturit de
Phidias,
n vers 500.
Erreur,
dit M.
Furtwaengler ;
nous ne connaissons
pas
d'oeuvre
de
Phidias antrieure aux environs de 450. Le Phi-
dias cimonien est un
mythe,
n d'une erreur de Pau-
sanias. Ce
gographe
est mal
renseign
sur
Phidias,
auquel
il
attribue
tort,
outre
la
Promachos,
la Nm-
sis de
Rhamnus,
la Mre des dieux
Athnes,
l'Athna
d'Elis,
le
groupe
des
Marathonomaques
Delphes.
Il est vrai
que
M. Gurlitt a rcemment cru
prouver que
la
Promachos,
encore vue au dbut du xme sicle
par
Nictas,
ressemblait la statue d'Antnor et ne
pouvait
tre
plus
rcente
que
470
;
mais M.
Furtwaengler rpond
que
le
tmoignage
de Nictas est
erron,
que
d'ailleurs
la Promachos n'est
pas
de
Phidias,
mais de Praxitle
Vancien. Le torse
Mdicis, dit-il,
est une
rplique
de la
Promachos
(hypothse dj
mise
par
M. K.
Lange) ;
or,
ce torse est
apparent
la Parthnos
; donc,
la
Promachos ne
peut
tre cimonienne.
Mais il
y
a l
tout
simplement
un cercle
vicieux,
car si la Promachos
est
cimonienne,
on ne
peut pas
chercher en voir une
copie
dans le torse Mdicis. Un artiste ne cre
pas
du
premier coup
un chef-d'oeuvre
comme la
Lemnienne ou
la Parthnos. Suo le bouclier mme de la
Parthnos,
Phidias est
figur
sous les traits d'un homme
mr,
presque g.
Si M.
Furtwaengler
nie
qu'il y
ait l un
portrait
de
Phidias,
malgr Plutarque,
il ne
donne
aucune bonne raison de son
scepticisme.
Tout cela est
fort aventureux. J e continue croire un Phidias
cimonien,
dont le
gnie
ne s'est affranchi
que
sur le
tard. Mais l'identification de l'Athna Lemnienne
parat
dfinitivement
acquise,
et c'est l un rsultat d'une
haute
importance.
168 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
La Lemnienne
devient,
pour
M.
Furtwaengler,
le
point
de
dpart
d'un srie de combinaisons
et d'iden-
tifications
qu'il
faut
indiquer rapidement
sous forme
d'aphorismes.
Le torse indit du
Louvre,
n
2.903,
drive de Phidias. La Promachos a t excute en 445
l'occasion de la
paix
de Cimon
;
une
rplique
de la
tte est dans la collection J acobsen. Contrairement
l'opinion reue,
le Zeus
d'Olympie
ne
peut
tre antrieur
la Parthnos
;
Phidias l'a commenc vers 438
(456
suivant M.
Loeschcke) ;
son
procs
Athnes et sa
mort sont
postrieurs
de dix ans. L'romne de Phi-
dias, Pantarks,
fut
vainqueur
en 436
Olympie.
Il
est vrai
que
le
temple d'Olympie
est
plus
ancien
que
le
Parthnon,
mais la cella a
pu
rester sans
image pen-
dant dix-huit ans. Le
J upiter Talleyrand
n'est
pas
la
copie
d'une oeuvre de
450, dj imprgne,
comme
on l'a
dit,
de l'influence du Zeus
d'Olympie,
mais l'imi-
tation archasante d'un travail
argien
de 500 environ.
Les
mtopes
du Parthnon ne
tmoignent qu'en partie
de
l'influence de Phidias
;
d'autres se rattachent
l'cole de Kritios et Nsiots. La frise est un
peu plus
rcente
;
les frontons ont t excuts en dernier lieu
(aprs 438).
Contrairement M.
Puchstein,
M. Furt-
waengler pense que
ces travaux ont bien t
dirigs
par Phidias;
ce
qu'on remarque
de
pittoresque
dans les
frontons se retrouve sur le bouclier de la Parthnos
et confirme le
renseignement
de
Pline,
suivant
lequel
Phidias aurait commenc
par
la
peinture.
La Hra
Farnse
(plutt
une
Artmis) appartient,
comme les
mtopes
de
Slinonte,
l'cole de Kritios. En
revanche,
l'influence de Phidias se reconnat dans
l'Apollon
du
Tibre,
apparent
l'Apollon
de Mantoue et d'autres
oeuvres drivant
d'Hagladas. L'Apollon
de Mantoue
et une tte en bronze de
l'Acropole (Muses
d'Athnes,
pi.
xvi)
sont de
Hgias,
matre de Phidias et lve
d'Hag-
ladas. L'Herms Ludovisi et sa
rplique
de Broadlands
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
169
se
rapportent plutt
Tlphane qu'
Phidias. Mais
c'est la
jeunesse
de Phidias
que
M.
Furtwaengler
attribue,
outre le
grand
bas-relief
d'Eleusis,
le
proto-
type
d'une tte fminine connue
par
des
rpliques
de
l'Ermitage
et de la collection Barraceo. A
l'poque
de la
Parthnos
(445-440) appartient
la statue d'Anacron
dont il existe
plusieurs rpliques ;
M. Kkul l'avait
donne Crsilas et
j'avais,
de mon
ct,
mis en avant
le nom de Kolots. Une tte barbue du muse Tor-
lonia et une
autre du muse Chiaramonti
appartiennent
la mme
priode
de la vie de Phidias 1. Les ttes dites
de
Sapho
sont
contemporaines
de la Parthnos
;
elles
reprsentent Aphrodite
et drivent d'une
Aphrodite
drape
de Phidias
(Romae
in Octaviae
operibus)
;
la
tte runie celle-l dans un double herms de
Madrid est celle d'un ros de Phidias. L'Athna
Hope,
dont
l'Athna Farnse n'est
qu'une
variante
post-
rieure,
drive de
Phidias,
peut-tre
de la statue de
bronze
rapporte
Rome
par
Paul-Emile.
L'Athna Albani est une
rplique
de l'Athna Itonia
rjortant Vados
kun,
associe Hads
par Agoracrite
;
le mme air de tte se
retrouve dans la Hestia Gius-
tiniani
(Torlonia), l'Aspasie, l'Apollon
l'Omphalos
et
l'aurige
du
Capitole, qui
sont un
peu
antrieurs.
Ces
ouvrages
drivent de
Calamis,
dont
l'lve,
Pra-
xias,
peut
avoir
sculpt l'original
de l'Athna Albani.
Il
y
a bien d'autres monuments de cette cole de Cala-
mis ct de ceux de l'cole de Phidias : la Dmter
voile
de
Berlin,
l'admirable tte d'Hracls du mme
muse. Revenant l'Athna
Farnse,
M.
Furtwaengler
trouve
que
la tte de cette statue est
apparente
trois autres : la Hra ou Dmter du
Capitole,
la Vnus
Genetrix,
la Hra Barberini. Or, la Genetrix est une
1. Il va sans dire
que
les ttes en
question
ne sont
que
des
copies
prsumes ; mais, pour
viter de
rpter
sans cesse la mme
phrase,
nous en
parlerons
comme s'il
s'agissait d'originaux.
170 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
oeuvre d'Alcamne
;
donc l'Athna Farnse est du
mme
sculpteur
et nous montre comment il a imit
Phidias. D'Alcamne seraient encore un torse d'H-
phaestos
Cassel,
l'Ars
Borghse
du
Louvre,
une
tte d'Athna
Brescia,
l'Ars colossal du
palais
Bor-
ghse.
M.
Furtwaengler explique,
dans l'Ars du
Louvre,
le lien de la
cheville,
par
l'histoire de l'enchane-
ment d'Ares
par Hphaestos.
Cette statue n'a rien de
commun avec
Polyclte.
M.
Furtwaengler
n'admet
plus
l'existence d'un Alcamne
l'ancien,
le
tmoignage
de Pausanias sur les frontons
d'Olympie
tant sans
valeur. Les
ouvrages d'Agoracrite
sont trs
analogues
ceux d'Alcamne
;
M.
Furtwaengler
attribue au
premier
de ces artistes
l'original
de la Crs colossale
du Vatican.
Revenant Phidias
(l'ordre
n'est
pas
la
qualit
matresse de M.
Furtwaengler),
l'auteur met
l'hypo-
thse hardie
que
les Dioscures du Monte Cavallo sont
vraiment des
copies
des deux colosses de Phidias et
de Praxitle l'ancien. Les
originaux
taient des
bronzes,
dont l'un est
identique
au Colossicon nudum de Pline
(XXXIV, 54).
Praxitle Ier a d travailler vers 445-
425
;
lui se
rapporteraient
encore le
prtendu
Virgile
du Louvre
(Iacchos),
une tte
d'Apollon
Petworth,
une tte de
jeune
homme la villa
Albani,
enfin le
J upiter
de Versailles
(plutt
un
Nep-
tune).
Les monnaies de la Grande Grce montrent le
reflet des diffrentes manires de Phidias
;
ce sont
surtout les colons de Thurii et de
Napolis qui rpan-
dirent son
style
en Italie. De Phidias drive le
type
d'Arthuse sur les monnaies de
Cimon,
comme l'Athna
de face sur les ttradrachmes d'Eucleidas. Dans tout ce
monnayage,
l'influence de Phidias a
produit
une rvo-
lution
partir
de 440. Dans le domaine de la
cramique
aussi,
le
style pittoresque
de Phidias
(bouclier
de la
Parthnos) parat
subitement sur les vases
(cratres,
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
171
hydries, amphores
volutes)
de l'Italie
mridionale,
produits
de
fabriques
nouvelles cres vers 440. Ces
vases
apuliens (tarentins)
sont les anctres des vases
lucaniens. Les
origines
en sont toutes
attiques
et
doivent tre cherches dans le cercle de
Polygnote
et
de Phidias. C'est encore la fondation de Thurii
qui
a t
dcisive cet
gard.
L'art de Phidias se
rpandit
d'ailleurs
plus
loin : la ciste
Ficoroni, grave
Rome
par
un
Romain,
est
un enfant
lgitime
de l'art de
Polygnote
et de Phidias
et la date doit en tre
reporte
aux environs de l'an 400.
II.
LE TEMPLE D'ATHNA SUR L'ACROPOLE
Reprenant,
mais
apparemment
sans la
connatre,
une
conjecture
de M.
Laloux 1,
M.
Furtwaengler
croit
que
le vieux
temple (A)
dcouvert
par
M.
Doerpfeld
est l'ancien
rechthion, temple
double consacr
Athna et rechthe. La
partie
ouest n'est
pas
le
trsor,
mais
simplement
la demeure d'rechthe. Le
premier
Parthnon,
dit Parthnon cimonien
(B),
aurait
t commenc vers 479
(471, Doerpfeld; 454, Koepp),
antrieurement Cimon
qui,
loin d'en tre
l'auteur,
en
interrompit
la construction. C'est
le
parti
de Thmis-
tocle
qui
l'avait commenc. Le travail ne fut
repris,
sur un
plan
modifi, qu'en
447. Dans
le nouveau Par-
thnon
(C),
il
n'y
avait
plus
de
place pour
rechthe,
d'o la ncessit de lui conserver comme demeure le
temple
A,
restaur tant bien
que
mal
aprs
480. La
cella du fond dans A
s'appelle
le
Parthnon,
tandis
que
la cella orientale est
l'Hkatompdon.
Ce nom de
Parthnon n'a rien voir avec Athna Parthnos :
1. Cf. mes
Chroniques d'Orient,
t.
I, p.
451.
172 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
c'est le
parthnon (cf. andrn, gynaikn),
ou
demeur
des
jeunes
filles.
Or,
ces
vierges
sont bien connues :
ce sont les filles d'rechthe et de
Ccrops.
Athna leur
est naturellement associe
;
elle se
plat
dans la
compagin
des
vierges, Korai, que reprsentent
les statues archa-
ques
de
l'Acropole,
offrandes Athna
(Studniczka,
Micbaelis).
Comme Athna tait elle-mme
Parthnos,
le
langage populaire
tendit au
temple
entier la dsi-
gnation
de Parthnon. Cette cella
postrieure
n'a
jamais
abrit le trsor des Allis
;
elle
a seulement servi de
bureau et de
magasin
aux tamiai d'Athna et des autres
dieux.
L'opisthodome,
dont il est d'abord
question
en
435
(Corpus
inscr.
attic, I, 32),
n'est
pas,
comme l'a
cru M.
Doerpfeld,
le
temple
A
;
il est
identique
au Parth-
non des redditions de
comptes.
Cela
pos,
rien n'autorise
plus l'hypothse
de M.
Doerpfeld
sur la conservation
du
temple
A au ive sicle. L'arkhaios nes n'a
jamais
dsign que
l'rechthion ou le
temple
d'Artmis
Brauron;
l'rchthion tait
qualifi
d'
ancien
temple
parce qu'il
contenait la vieille statue de
culte,
nes en
hi to arkhaion
agalma,
comme il est dit dans les
comptes
de construction du Parthnon.
Pricls avait d'abord voulu
transporter
dans le
nouveau
temple (C)
la vieille statue de la desse. La
crmonie de la remise du
peplos, reprsente
au milieu
de la frise
orientale, prouve que
le
sculpteur pensait
l'ancienne
statue, qui
seule
pouvait
tre
pare
ainsi.
Ce fut sans doute le
parti
conservateur,
oppos
la
construction du
temple
C, qui empcha d'y
transfrer
Yarkhaion
hdos,
comme il entrava la construction des
Propyles d'aprs
le
plan primitif.
Dans la frise du Par-
thnon,
la
prsence
des douze dieux
s'explique par
l'ide
de la thoxnie
;
c'est
pour
ces htes divins
que
les
diphrophores
apportent
des
siges.
Les douze dieux
sont,
gauche,
Herms,
Dionysos, Dmter, Ares,
Hra,
Zeus
;
droite,
Athna, Hphaestos, Posidon,
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE 173
Apollon,
Artmis,
Aphrodite.
Hestia,
attache au
foyer,
n'tait
pas
convie au
banquet.
Les dix hommes
placs
devant les dieux sont les tamiai hirn chrmatn
tes thou
;
celui
qui prend
livraison du
peplos
n'est
pas
un
trsorier,
mais un
hirope.
Pour assurer la vieille
image
un asile
digne d'elle,
le
parti conservateur,
aprs
la
paix
de
Nicias,
fit com-
mencer l'rechthion
;
c'est Nicias et non Alcibiade
qui
en aura
pris
l'initiative. Du
temple
A,
on ne
laissa
subsister
que
le
stylobate
formant
terrasse;
dj, peut-
tre
l'poque
de la construction du
temple B,
on avait
encastr dans le mur du nord de
l'Acropole
une
partie
de la colonnade du
pourtour. L'arrangement
intrieur
de l'rechthion devient
intelligible quand
on
admet,
chez
l'architecte,
l'ide arrte
d'y reproduire
les divi-
sions du
temple
A. Il
y
a deux
parties,
l'une
plus
leve
l'est,
cella
d'Athna,
avec un
portique
du ct de
l'autel d'Athna
;
l'autre
plus basse,
mais
plus grande,
l'ouest,
avec
portiques
au nord et au
sud,
demeure de
Poseidon-rechthe. La
partie ouest,
adjoignant
au
portique
des
Korai,
s'appelle
aussi
Ccropion
;
le vieux
temple possdait
encore un sanctuaire de
Ccrops
dans
la cella de l'ouest. Au culte de Buts tait rserve la
cella du sud. L'architecte du
temple
fut
Callimaque,
l'inventeur du
chapiteau
corinthien et l'introducteur
Athnes de
l'acanthe, qui
est cit comme le donateur
de la
lampe
d'or de l'rechthion. Ami du conservateur
Nicias,
Callimaque
fut un artiste
archasant,
comme
le montre un bas-relief dans le
style
de Calamis
qui porte
son nom
(Friederichs-Wolters,
n
435).
Les Saltantes
Lacaenae
que
lui attribue Pline sont des danseuses
du
calathiscos, frquentes
sur les bas-reliefs archasants.
L'Artmis de Munich est
galement
de lui.
Callimaque
parat
donc comme l'artiste
conservateur,
le conti-
nuateur de Calamis
aprs
Phidias.
Qu'on
ne se rcrie
pas
l'ide d'un archasme factice ds l'an 400
;
M. Hau-
174 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
ser tait arriv la mme conclusion 1. C'est Calli-
maque que
M.
Furtwaengler
attribue l'autel des
Quatre
Dieux sur
l'Acropole,
dont on a voulu faire une oeuvre
archasante
d'poque
romaine,
ainsi
que
le Puteal de
Corinthe,
non moins mal dat. La mode
archasante,
due l'influence
politique
de
Nicias,
gagna
mme
Alcamne,
comme en
tmoigne
sa
triple
Hcate,
connue
par
de nombreuses
rpliques, qui
est
contemporaine
de
petit temple
de Nik 2. Ce dernier
temple
est
plus
rcent
que
les
Propyles
: c'est encore une oeuvre du
parti oppos
Pricls,
construite l'occasion des
succs de Nicias et de Dmosthne
en 426 et
antrieur,
par consquent,
l'rechthion. La commission nom-
me entre 350 et 320
pour
restaurer une statue d'Athna
Nik avait
pour objet
la
rparation
du Xoanon
pour
lequel
avait t construit le
petit temple.
Le motif de
la statue est encore archasant
;
peut-tre
tait-elle
l'oeuvre de
Callimaque
lui-mme. La desse tait
repr-
sente sous les traits d'une Athna
pacifique,
donne
conforme aux ides
politiques
de Nicias
;
les bas-reliefs
de la
frise,
commmorant des luttes contre
l'tranger
(la
bataille de
Plates)
et le conseil des dieux runis
pour
le salut de la
Grce,
sont
inspirs
du mme
esprit.
Athnes et
Sparte
n'avaient-elles
pas
alors lutt
ensemble
pour
la mme cause ? Le
style
de la frise
rappelle
celui des Korai de
l'rechthion, que
M. Fur-
waengler
attribue aussi
Callimaque.
Or, Callimaque
a
apport
l'acanthe d'Ionie en
Attique
et la frise du
temple
de Nik
prsente
prcisment
des traces d'io-
1. J e
peux
citer
l'appui
un bas-relief de
Panticape, aujourd'hui
Odessa, qui
n'a rien voir avec l'cole de
Pasitle,
mais remonte-
incontestablement au vie sicle.
Quand j'ai prsent
une
photogra-
phie
de ce morceau la Socit
des tudes
grecques,
tous les archo-
logues prsents
m'ont
object
Pasitle
; j'espre qu'on m'pargnera
l'avenir l'ennui de rfuter
cet anachronisme
[voir plus bas, p. 197].
2. Cf. ce
que j'ai
crit ce
sujet
dans YAlbum des
Muses, p.
107'
et
suiv.,
travail
que
M.
Furtwaengler
n'a
pas
connu.
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
175
nisme, qui
la
rapprochent
des bas-reliefs de Xanthos et de
Trysa.
On en vient donc
admettre, aprs Phidias,
une
seconde influence de l'Ionie sur l'art
attique ;
les
plus
clatantes manifestations de cette influence sont les
bas-reliefs de la Balustrade
(409-408).
Cet admirable
chapitre
se termine
par
un excursus
sur
l'interprtation
des frontons du Parthnon.
D'abord,
il faut faire abstraction de
l'Anonyme
de
Nointel, qui
n'est
qu'un copiste
incorrect de
Carrey.
M. Sauer
ayant
prouv qu'il y
avait dix
figures
dans
chaque
moiti
du fronton
oriental,
on doit en admettre autant dans
le fronton ouest. Le torse I
(Michaelis)
doit tre
rapport
ce
fronton,
dont il faut
exclure,
en
revanche,
le
frag-
ment de Venise
(Arch.
Zeit., 1880,
pi. 7), qui
n'a rien
faire avec le Parthnon. Il
n'y
a
pas
lutte entre Posidon
et Athna : les deux divinits se trouvent en
prsence
sur
l'Acropole,
Athna avec
Herms,
Posidon avec
Iris
;
l'une et l'autre ont
pris possession
du sol sacr
en donnant un
signe
manifeste de leur
puissance (l'oli-
vier et le
myrte).
D'un
combat,
d'un
triomphe
d'Ath-
na,
il
n'y
a
pas
trace
;
le vase de
Saint-Ptersbourg
ne doit
pas
induire en erreur cet
gard.
Les
person-
nages
derrire les chars ne sont nullement des arbitres.
Aux
angles,
on a vu tort des fleuves ou des sources
personnifies
1,
car la scne se
passe
sur
l'Acropole;
ce
sont
simplement
les
indignes
du lieu. Les
spectateurs
sont
Ccrops,
ses trois
filles,
rysichthon,
d'un ct
;.
rechthe et ses trois
filles,
avec Ion sur les
genoux
de
Creuse de l'autre. Dans
l'angle,
droite
d'reh-
the,
sont Buts et sa
femme, auxquels Buzygs
et sa
femme font face
l'oppos.
M.
Furtwaengler
a raison
d'tre fier de cette
interprtation,
la fois
ingnieuse
et
simple.
Les difficults sont moindres
pour
le fronton
1. Cette
interprtation
se fonde sur la
description
des frontons
d'Olympie par Pausanias, que
M.
Furtwaengler
considre comme
errone, parce qu'on
ne
personnifiait pas
ainsi les fleuves au ve sicle
176 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
occidental,
dont le bas-relief de Madrid est une
copie
partielle. Hphaestos
ne doit
pas
tre
plac
derrire
Athna,
mais derrire Zeus
;
H
(de Michaelis)
est un
dieu
tonn,
dont on
ne
peut
deviner le nom. A
gauche,
derrire
Zeus,
est Hra
;
droite,
derrire
Athna,
est
Posidon. La
prtendue
Iris est
Hb,
comme l'a vu
M. Brunn. La divinit
qui correspond
Hlios,
sur
la
droite,
est
Nyx (hypothse
de Miss
Sellers).
La dno-
mination de
Moires,
propose par
Visconti
pour
le
groupe
des trois
femmes,
doit tre conserve
;
les deux
femmes
qui
leur
correspondent
gauche
sont les Heures
(Brnsted)
;
la
figure
virile
que
les
accompagne
n'est
pas
Hracls,
mais le beau chasseur
Cphale.
On
remarquera que
M.
Furtwaengler, ragissant
contre
un
prjug rpandu,
attribue sans hsiter la
concep-
tion des deux frontons Phidias.
Un second excursus traite des acrotres en marbre
de
Dlos,
datant de 425 environ. M.
Furtwaengler
les
croit ioniennes. Prs de la
figure
de Bore court un
petit
cheval, prs
de celle d'os un chien.
Or,
une acrotre
en terre cuite de
Lanuvium,
datant du dbut du
ve
sicle, prsente dj
un dtail
analogue, preuve
que
l'artiste dlien a suivi une tradition
antrieure,
spcialement
ionienne. Le
style
ionien domine dans les
acrotres des
temples trusques,
latins et
companiens
;
la mode d ces acrotres est elle-mme
d'origine ionienne,
comme le
prouvent
les
fragments
du vieux
temple
d'phse.
C'est
par
Corinthe et Caere
que
l'art ionien
a
pntr
en
Italie,
o il s'est rencontr avec les
influences de
Chalcis,
venues
par Cym.
Troisime excursus : le
roc,
au nord du
Parthnon,
porte l'inscription
Gs
Karpophorou
kata manteian.
L s'levait la statue dont
parle
Pausanias,
la Terre
implorant
la
pluie
de Zeus. Un sceau
attique, reprsen-
tant une divinit
suppliante
sortant
mi-corps
d'un
chariot, peut
donner une ide de cette statue.
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
177
Le chariot
signifie,
comme dans la
mythologie ger-
manique,
la nue
d'orage.
Le Vaisseau
panathnaque
n'est
pas
autre chose
;
Athna
y
est
promene
sur
une
barque
roues,
comme la Nerthus des Suves
sur un char sacr.
Quant
aux chars votifs en bronze
de
l'Europe centrale,
les
Kesselwagen,
ils n'ont rien
voir, quoiqu'en
aient dit
Piper
et
Undset,
avec les
chaudrons roues du
temple
de Salomon
; c'est, pense
M.
Furtwaengler,
une des erreurs les
plus graves
de
l'archologie prhistorique
d'avoir
reconnu,
dans ces
objets,
une influence de l'Asie sur la vieille
Europe.
M.
Furtwaengler
croit
que
ces chars taient des
symboles religieux
de la nue
d'orage, explication
qui
me semble trs douteuse. Le chariot de
J udenburg
(Styrie)
nous fait incliner
plutt
y
voir
simplement
des
symboles
des chars en bois sur
lesquels
on
prome-
nait solennement les divinits.
III. CRSILAS ET MYRON
Nous
possdons
des
rpliques
du
portrait
de Pricls
par
Crsilas. Ses
signatures
montrent
qu'il
travaillait
vers 440
Athnes,
o il tait venu de
Crte; plus
tard,
on le trouve
Argos,
Outre le
Pricls,
M. Furt-
waengler
lui attribue un buste de
stratge
Berlin,
qui parat
bien infrieur. Le vulneratus
deficiens
de Pline
est bien
Diitrphs,
mais un
Diitrphs
Ier, grand-pre
du
stratge
de 414
(Thucydide, III, 75), qui
combat-
tit en
Egypte
et en
Chypre
vers 450. Le motif de la
statue est conserv
par
un
lcythe
de la collection
de
Luynes (hypothse
de M.
Six), qui peut
n'tre
pas
antrieur 450
(?)
et se retrouve sur une
pierre grave
de Berlin. Le
prtendu gladiateur
Farnse en serait
une
rplique.
Le
prtendu
AIcMade du Vatican
est,
en
ralit,
une
image aniconique
du coureur
Crison
S.REINAGS
12
178 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
d'Himre, vainqueur
en
450,
et
parat
remonter Cr-
silas. L'Amazone blesse du mme
sculpteur
est celle du
Capitole
1,
qui
offre,
surtout dans le dessin des
yeux,
des
particularits caractristiques
de Crsilas
;
elle
doit
dater,
comme ses
congnres,
de 440 environ.
M.
Furtwaengler rapporte
aussi Crsilas la Pallas
de Velletri
(Louvre)
et le buste Albani
(Munich),
dont la tte d'Eubulids Athnes est une imitation 2.
Le Diomde de
Munich,
dont il
y
a une
rplique
au
Louvre
(n 2.138),
entre naturellement dans la mme
srie
; l'original
a t
sculpt
vers 435
pour Argos.
Il
se trouve aussi
reproduit
sur un vase
peint
de la fin du
ve sicle
(Monum.
dell.
Inst., II, 36).
Mais voici une nou-
velle
surprise
: la Mduse Rondanini
(Munich),
consi-
dre comme une oeuvre
hellnistique,
serait de Cr-
silas !
Une statue
d'athlte,
dont il existe
quatre
rpliques,
drive aussi d'un bronze de Crsilas. Cet
artiste fut souvent
copi
et
imit, par exemple par
l'au-
teur de
l'Apollon Pourtals,
autrefois Giustiniani
(au
British
Musum).
De
quelle
cole sortait Crsilas ? Un
grand
buste
du
palais Riccardi, antrieur,
mais
analogue
au Dio-
1. J 'avais
suppos qu'il
fallait la chercher dans l'Amazone de
Vienne, que
M.
Furtwaengler
considre comme une oeuvre archasante
de la classe du
J upiter Talleyrand.
M.
Furtwaengler
admet
que
nos
statues d'Amazones blesses
reprsentent quatre types,
dus
Poly-
clte, Phidias,
Crsilas et Phradmon
;
le
type
de Phradmon ne serait
encore connu
que par
un torse de la villa Panfili. La tte de l'Amazone
de
Phidias, appuye
sur sa
lance,
qui manque
toutes les
rpliques,
serait celle d'un herms de la villa d'Herculaneum
qui
faisait face
celui du
Doryphore.
M. Michaelis
y
avait reconnu l'Amazone de
Polyclte,
mais M.
Furtwaengler
contredit
nergiquement
cette
opinion
: la tte en
question
ne ressemble
pas
celle du
Doryphore,
mais celle de la Lemnienne.
2. Pline mentionnerait cette Athna de Crsilas au Pire en l'at-
tribuant
Cephisodorus (Cephisodotus
dans les
ditions) ;
c'est une
Athna Soteira. M. Milchhoefer avait reconnu l'Athna Soteira du
Pire dans la Pallas de
Velletri,
mais en l'attribuant
Cphiso-
dote Ier.
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
179
mde,
nous ramne
Myron,
dont Crsilas fut le conti-
nuateur. Une tte d'athlte
Dresde,
dont il existe
des
rpliques,
se
rapporte plutt
Pythagore
de Rh-
gium
;
la tte d'Inc Blundell Hall est
plus
voisine de
Myron ;
celle de l'athlte de
Tarse,
Constantinople
(juge
bien svrement
par
M.
Furtwaengler)
n'est
qu'un
cho du
style myronien.
En
revanche,
une
tte de Brescia
reproduit
une oeuvre de
Myron
antrieure
au
Discobole,
dans un
style
encore voisin de celui
d'Hagladas.
Une tte de la villa Albani et une autre
de
l'Ermitage appartiennent
la mme
priode
;
la
grande
tte d'Hracls Londres est un
peu postrieure.
A ct de ces
ttes,
nous
possdons
des statues
qui
sont
des
copies
d'oeuvres de
Myron
: le Discobole et le Mar-
syas, d'abord 1, puis (ceci
est
nouveau)
un Mercure du
Vatican,
un
prtendu
Posidon du mme
Muse,
un
prtendu Asclpios
de
l'Ermitage (en
ralit un
Zeus),
un
Apollon
du
Louvre,
dont la meilleure
rplique
est
Cassel. Ces oeuvres montrent nettement en
Myron
le successeur
d'Hagladas
et le
prcurseur
de Crsilas.
Le Perse de
Myron
est connu
par
deux
rpliques
(Londres
et
Rome),
dont
l'analogie
avec
l'Apollon
de
Cassel saute aux
yeux ;
la tte de Mduse en relief
que
tenait Perse a t
copie
sur l'intaille de Sosos
et le came de Diodote
;
elle montre encore en
Myron
le
prcurseur
de
Crsilas,
auteur de la Mduse Ronda-
nini. Le
type
fminin cr
par Myron
est
reprsent
par
une tte de Florence
(moulage
l'cole des Beaux-
Arts).
A la dernire
priode
de la vie du matre
appar-
tiennent l'Hracls assis du
palais Altemps,
le
prtendu
Diomde du
palais
Valentini
(hoplitodrome),
une tte
barbue du muse Chiaramonti
(rechthe),
une autre
Londres
(portrait). L'Esculape
de Florence
(Zeus
Mei-
1. La meilleure
rplique
du
Marsyas est, je crois,
au Muse de Cons-
tantinople.
180 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
lichios), que
l'on a
plus
tard
group
avec une
Hygie,
comme Mars avec
Vnus,
est de la
jeunesse
de
Myron ;
deux
rpliques
libres de la
tte,
Londres et au
Louvre,
annoncent
le
type
de Zeus
Srapis.
L'athlte versant
de l'huile
(Munich, Paris)
a t faussement
rapport
Myron.
A
Munich,
une statue de
Zeus,
crue
polycl-
tenne, rappelle Hagladas,
l'auteur de
l'original
de la statue dite de
Stphanos
;
suivant M. Furt-
waengler,
c'est l'oeuvre d'un artiste
argien
vers
465,
le Zeus Eleutherios lev
Syracuse aprs
466. Un torse
colossal
d'Olympie
est la
copie
d'un Zeus d au mme
artiste encore inconnu.
Notre rsum laisse entre-
voir la
composition
relche de ce
chapitre, qui
a
plu-
tt l'allure d'une
leon,
faite au hasard des
inspirations
et des
rencontres,
dans un trs riche muse de mou-
lages
comme nous avons
toujours
le
regret
de n'en
point
avoir.
IV.
POLYCLTE
L'Amazone datant de 440 environ et le
Doryphore
lui tant
antrieur,
Yakm de
Polyclte
se trouve
place
vers 450
;
il ne
peut
ds lors avoir t directement l'lve
d'Hagladas.
La statue de Hra est de 420. Les tra-
vaux mentionns en 405
Amycle
sont
probablement
de
Polyclte
le
jeune,
dont on a voulu tort faire un
contemporain
de
Lysippe d'aprs
une
inscription
de
Thbes
regrave aprs
316
; parmi
les bases
d'Olym-
pie
au nom de
Polyclte,
celle d'Aristion
(Loewy,
n
92) appartient
Polyclte
II.
Au
point
de vue du
style,
le
Doryphore
est inter-
mdiaire entre le Zeus de
Munich,
o l'on trouve
dj
le motif de la
marche,
et
un
petit
athlte en bronze
du muse de Berlin. Il se rattache encore l'ancien
canon
par
la direction de la tte dans le sens de la
jambe qui porte.
Le nom de
Doryphore
est
impropre
et
date d'une
poque postrieure
: en
ralit,
nous avons
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
181
l une statue d'athlte
vainqueur,
leve
Argos
1. II est
probable que
le
Doryphore
et le canon ne font
qu'un.
Les oeuvres
qui
se rattachent celle-l sont un Pan
juvnile
de bronze
(Cabinet
des
Mdailles), original
sorti du cercle mme de
Polyclte,
le bas-relief
d'Argos,
une statue de la villa
Albani,
trois statuettes en bronze
d'Ares,
etc. L'Herms du
jardin
Boboli et celui de Trzne
remontent l'cole de
Polyclte, peut-tre
Naucyde,
Le
type
du
Doryphore reparat,
diversement
modifi,
dans de nombreux bronzes romains
;
le
plus
beau est
un Mercure du Muse
britannique,
trouv en
Gaule,
avec un
torques
mobile au cou. D'autres
originaux
de
Polyclte, apparents
au
Doryphore,
nous sont
connus,
en tout ou en
partie, par
des
rpliques
: ce sont un
Hracls
jeune,
un Herms
(?),
un enfant
vainqueur
(Louvre).
Le Diadumne est
galement reprsent par
de nombreuses
rpliques,
la
plupart mutiles,
mais
meilleures
que
la statue
presque
intacte de
Vaison,
o la
tte, notamment,
a t entirement retravaille.
Le
type
vritable de la tte est connu
par
la terre cuite de
la collection
Blacker,
les bustes de Dresde et de
Cassel,
surtout
par
une statue de Madrid. Le
Diadumne, post-
rieur au
Doryphore,
est
contemporain
de la Hra.
Le Dia-
dumne Farnse
(Londres)
ne remonte
pas
Poly-
1. Une
copie
en marbre a t dcouverte dans l'Altis
d'Olympie.
Beaucoup
d'autres
rpliques,
des torses
pour
la
plupart,
existent
dans les muses
;
les deux meilleures sont aux Offices
(en
basalte
vert)
et Berlin
(ancienne
collection
Pourtals).
On a aussi
plusieurs
rpliques
de la
tte,
dont la meilleure est Thermes en bronze
d'Apol-
lonius
(Naples).
J 'ajoute que
des torses drivant de
Polyclte,
encore tout fait
inconnus,
font
partie
de la collection Somze
Bruxelles, qui
renferme aussi une
grande
statue dans le
style d'Hag-
laidas.
[Instruit par
cette
note, Furtwaengler
se rendit
Bruxelles, y
vit
la collection
d'antiques
runie
par Somze, disperse depuis,
et en
publia
le beau
catalogue
illustr
que j'ai
annonc dans la Reue cri-
tique, 1898, I, p.
50-53. La statue
que j'attribuais
Haglaidas,
acquise par Waroqu,
est
aujourd'hui
au Muse du chteau de
Mariemont
prs Charleroi, catalogu par
Fr. Cumont.
1929.]
182 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
clte,
mais
Phidias, qui est, par
suite,
l'inventeur du
motif.
Un
pugiliste
de Cassel
reproduit
une autre imi-
tation de
Polyclte
;
une trs belle tte
d'phbe (Turin)
a la mme
origine.
L'Amazone est
plus
voisine du
Dory-
phore que
du Diadumne
;
avec elle
parat
le motif
du bras
relev,
pos
sur la
tte, qui
fut
frquemment
employ par
Praxitle.
Les bases de statues
signes
de
Polyclte
Olympie
permettent, par
la cavit
qu'elles prsentent
la sur-
face,
de se faire une ide des
figures qu'elles suppor-
taient.
L'hypothse
de M. Benndorf sur le nudus talo
incedens
(marchant
sur un
d)
n'est
pas
soutenable
;
il faut lire telo
(hypothse
de
Klein).
La statue de
Kyniskos
est connue
par plusieurs rpliques ;
la meil-
leure
copie
de la tte est
l'Ermitage.
Le motif est
celui d'un athlte
qui
se couronne lui-mme 1. Le
Victor certamine
gymnico palmam
tenens
d'Eupompe
en
tait
inspir ; peut-tre
faut-il reconnatre l'influence
d'un modle
antique analogue
dans le Christ ressusci-
tant de Fra Bartolomeo au
palais
Pitti. Sur la base
d'Hellanicos de
Lpron, vainqueur
en
424,
les traces
correspondent
la
figure
dite d'Hadrien dans le
groupe
de saint Ildefonse
(Madrid).
L'athlte versant de l'huile
de Petworth drive aussi de
Polyclte
;
ce motif a t
trait
par plusieurs
artistes et les
exemplaires que
nous
en avons se
rpartissent
en trois
groupes
: 1
Munich,
oeuvre de
Lycios,
fils de
Myron
;
2
Dresde,
cole d'Al-
camne
;
3
Petworth,
cole de
Polyclte.
La statue
de Florence est un
apoxyomne
;
le
destringens
se de
Polyclte,
mentionn
par
Pline,
n'est encore connu
que
par
deux intailles. Deux sries de statues se rattachent
la base de
Pythocls (Loewy,
n
91).
C'est d'abord un
athlte du Vatican
(rplique
Munich),
d'un
style
voi-
1. La tte tant dans la direction de la
jambe qui
ne
porte pas,
comme dans l'Amazone de
Crsilas,
M.
Furtwaengler
admet une
influence de cette dernire statue.
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
183
sin du
Doryphore
et sous l'influence du Diomde de Cr-
silas, puis
une statuette en bronze d'Athnes
(Monum.,
VIII, 53),
un
jeune
athlte de
Dresde, copie
d'un bel
original
de
Polyclte,
un autre
Saint-Ptersbourg
(dit Mercure),
un Pan
Leyde,
un
Dionysos
Dresde,
le
prtendu
Narcisse de
Berlin, qui
est
plutt
un Ado-
nis,
etc. La troisime
base,
celle de
Xnocls, portait
une statue
analogue
au n 1.368 du Louvre 1. La base
d'Aristion,
oeuvre du
jeune Polyclte,
est celle d'une
statue dans l'attitude du
repos,
comme les anciennes
images
de l'cole
argienne ;
l'Herms
Lansdowne,
remontant
Naucyde, peut
nous en donner une
ide,
et
il ressort de l
que
l'cole
argienne
survcut
Polyclte
comme celle de Calamis Phidias. Le mme
type
fut
modernis dans l'cole de
Lysippe (statue d'Atalanti).
Quant
la statue en bronze de
l'Helenenberg (Vienne),
M.
Furtwaengler
ne croit
pas,
comme M. R. de Schnei-
der, qu'elle
soit un
original grec
: c'est une oeuvre romaine
imite d'une statue
analogue
l'Idolino, peut-tre
de
Patrocle. Une tte en bronze de Bnvent
(Louvre),
qui
est un
magnifique original grec,
accuse une double
influence
argienne
et
attique ;
la tte d'un enfant
vainqueur
Munich
tmoigne
du mme
compromis
entre
Polyclte
et Phidias.
V.
SCOPAS, PRAXITLE,
EUPHRANOR
Le
progrs
de la science montre
que
les
types
de
l'art
grec
ont
t, pour
la
plupart,
crs ds le ve sicle 2.
1. Un bronze
grec
du
Louvre,
n
214, reprsente
le mme
motif,
mais l'athlte est un homme
mr,
non
plus
un enfant. L'Idolino de
Florence ne remonte
pas
Polyclte mme,
mais
peut-tre
son
jeune
frre Patrocle
;
il n'a rien de commun avec
Myron, auquel
l'avait
attribu M. Karl Robert.
2. C'est l un rsultat
auquel
M. Kalkmann
(qui
m'en a fait
part)
est arriv
depuis longtemps par
la mensuration des
statues, procd
laborieux,
mais
parfaitement lgitime,
dont il est vraiment
trop
commode de se
moquer.
184 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
Le courant de la tradition
artistique
du ve sicle
persiste
travers le ive sicle tout entier
(rien
n'est
plus juste).
Cphisodote, qu'on
considrait
gnralement
comme un
prcurseur
des matres du ive
sicle, appartient
tout
entier cette
poque
;
il n'est
pas
le
pre,
mais vrai-
semblablement le frre an de Praxitle 1. L'Eirn
(Munich)
est de 3712
;
elle est tout fait dans la tra-
dition de Phidias. A ct de l'influence de l'ancienne
cole
attique,
on reconnat celle de l'cole
argienne
dans l'Hracls
Lansdowne,
o nous
voyons
la transi-
tion de
Polyclte
Scopas.
Un
Esculape juvnile (Carls-
ruhe) prsente aussi,
avec des souvenirs de
Polyclte,
le caractre d'une oeuvre de
Scopas ;
un Herms du
Palatin,
aux formes
polycltennes,
annonce
l'Apoxyo-
mne de
Lysippe par
le
motif,
tout en
rappelant
l'Hra-
cls de
Scopas (Louvre,
n
1524).
Ces oeuvres
peuvent
remonter des
sculptures
de
Scopas jeune, peut-tre
aussi celles de son
pre
Aristandros de
Paros,
qui
travailla avec
Polyclte
II
comme aussi l'Herms de
la base
d'phse (Muse britannique)
et tablissent
en tous les cas l'influence de ce matre sur
Lysippe.
C'est
Scopas,
et non
Lysippe, que
la
sculpture
en ronde
bosse doit le motif du
pied
relev
(Motiv
des
aufge-
sttzten
Fusses,
Conr.
Lange),
tmoin
l'Apollon
Smin-
thien. Un autre motif
pittoresque,
celui des mains
passes
autour des
genoux,
est d
galement
Scopas
(Ares Ludovisi).
Un
type
d'Athna toute
jeune,
une
sorte de J eanne d'Arc
,
remonte
Scopas,
auteur
d'une Athna
Thbes,
voisine du lieu
prsum
de
la
thophanie.
La manire de
Scopas
a
prouv
une
modification considrable vers le milieu
du ive sicle
;
le mme
changement
s'observe chez
Praxitle,
1. Cette
hypothse, que je
crois
inadmissible,
est
presque impose
M.
Furtwaengler par
sa
chronologie
de Praxitle
;
mais cette chrono-
logie
ne me semble
pas
tenir debout.
2. Cette date est
beaucoup trop basse,
de
vingt
ans au moins.
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
185
dont M.
Furtwaengler
aborde maintenant l'tude.
Comme l'Herms
d'Olympie
se
rapproche
des derniers
ouvrages
de
Scopas
et non des
premiers,
M. Furtwaen-
gler
croit,
avec M.
Kekul,
qu'il appartient
la maturit
de Praxitle. La forme de la
base,
retrouve
Olympie,
concorde avec celle des bases de la deuxime moiti
du ive sicle. Aussi M.
Furtwaengler repousse-t-il
la
date de 363
que j'avais propose pour
cette
statue 1,
tout en admettant avec moi
que
le
groupe symbo-
lise une union de l'Arcadie avec l'Elide. Mais il
place
cette union en 343
(Diod.,
XVI, 63). Praxitle,
la
mme
poque,
aurait
sculpt
le
Dionysos
d'Elis.
Or,
nous connaissons de Praxitle des
ouvrages
antrieurs
de trente
ans,
ce
qui
fixerait son activit entre 370
et 330. Les Muses de Mantine sont de sa
premire
manire
(362).
Le
Satyre versant,
trs souvent
copi,
remonte
certainement une statue de bronze : c'est
le Peribotos de Pline
; or,
cette statue diffre de l'Her-
ms en ce
qu'elle
suit encore la tradition du ve
sicle,
ce
qui permet
de la
placer
entre 370 et 360. A la mme
poque appartient
l'ros du
Palatin,
si mal restaur
par
Steinhaeuser
(Louvre). L'Apollon
du Louvre
(n 74)
et le
Dionysos
de
Tarragone
ne remonteraient
qu'
des
oeuvres
d'cole;
en
revanche,
l'ros de
Naples,
avec
sa
rplique
de
Centocelle,
est la
copie
d'une statue
importante
de
marbre,
l'ros consacr
par Phryn
Thespies (370-360).
J e m'tais autrefois
appliqu
reconstituer la
chronologie
de la vie de
Phryn,
ne
vers
375,
arrive tout enfant Athnes
aprs
la des-
truction de
Thespies par
les Thbains
(373); je plaais,
par consquent, l'Aphrodite
de Praxitle vers 350.
M.
Furtwaengler
me donne tort et
place
la naissance
de
Phryn
vers
385,
ce
qui
lui
permet
de faire d'elle
la matresse de Praxitle ds 365. Mais
je pense que
sa
1. Reue
archologique, 1888, I, p.
1-4.
186 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
thorie n'est
pas
d'accord avec la date de la naissance
d'Hypride,
fixe
par
Th.
Reinach
en 389
(Rev.
des
tudes
grecques,
t.
V, p. 251).
On ne
peut
admettre
qu'Hypride,
dans le
procs que
l'on
sait,
ait eu
peu
prs
le mme
ge
que
Phryn
; je persiste
donc croire
que
ma
chronologie
est correcte 1.
L'ex-voto de
Phryn
devait
compter
trois
figures,
un
ros,
un
portrait
de la courtisane
et une
Aphrodite
;
ce
groupe
tait
analogue
celui du
jeune Satyre
entre
Dionysos
et
Meth,
d
galement
Praxitle. M. Furt-
waengler pense que l'Aphrodite
nous est conserve
par
la Vnus d'Arles
; l'analogie
de cette statue avec
'Eirn et le
Satyre
versant attesterait
qu'elle appar-
tient la
jeunesse
de l'artiste. Elle doit tre restitue
avec un miroir dans la main
gauche.
La Vnus d'Ostie
(Londres)
est
analogue
la Vnus d'Arles
;
ce serait
une
rplique
de la
Phryn
de
Delphes, plus
rcente
que
la Vnus de
Thespies.
Des deux
portraits
entre
lesquels
elle tait
place,
ceux d'Archidamos de
Sparte
et de
Phryn,
nous avons des
copies provenant
de
la villa d'Herculaneum. Arrivant
l'Aphrodite
de
Cnide, qu'il place
comme moi vers 3502. M. Furtwaen-
gler
donne une liste des vraies
rpliques
de cette
statue,
distinguer
des imitations
;
parmi
ces dernires
figure
la
petite
tte
d'Olympie,
o M. Michaelis avait
voulu voir la meilleure
rplique
de la tte de la
Cnidienne. De
mme,
la statue de Munich n'est
qu'une
imitation
loigne.
Quant
l'Aphrodite
velat
specie,
M.
Furtwaengler
veut la
retrouver,
avec Visconti
(qui
aurait d tre nomm
ce
propos),
dans une mau-
vaise statue du
Louvre, reprsentant Aphrodite
voile
groupe
avec
Eros,
sur la base de
laquelle
on lit :
1. J e l'ai
expose
dans la Gazette
archologique, 1887, p.
283.
2. Mais
alors,
dans
l'hypothse
de M.
Furtwaengler,
le modle
aurait t une femme de
trente-cinq
ans ! C'est
beaucoup,
mme
pour
une
Phryn.
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
187
Praxitls
epoiei.
J e dois
protester
contre cette identi-
fication. Le seul fait
que, parmi
les terres cuites de
Myrina,
ct de nombreuses imitations de la Cni-
dienne et de la Genetrix
(o je
reconnais la transfor-
mation, par Praxitle,
d'un
type
cr
par Alcamne)x,
il
n'y
a
pas
une seule statuette conforme au n 151 du
Louvre,
sufft montrer combien
l'hypothse
de
M.
Furtwaengler
est inadmissible.
L'inscription
est
simplement
une de ces fraudes
antiques
dont le fabu-
liste Phdre a
parl.
Avec M.
Studniczka,
M. Furt-
waengler pense que
l'Artmis Brauronia
(de 346)
est la
Diane de Gabies. Une seconde
Artmis,
de la
jeunesse
de
Praxitle,
est connue
par plusieurs copies
dont
la meilleure est Dresde. D'autres encore
(Villa
Bor-
ghse, Turin)
drivent d'une Athna de Praxitle
;
une tte d'Athna Berlin
proviendrait
d'une seconde
Athna du mme artiste. La
petite
Artmis de
Chypre (
Vienne)
serait un
original
de
Praxitle,
opinion que
le traitement de la
draperie
me
parat
devoir carter.
La
prtendue
Hra Ludovisi est la
rplique
romaine
d'une Latone de
Praxitle,
modifie
pour reprsenter
une
impratrice.
L'Artmis
d'Anticyre
a
inspir
la Diane
de Versailles
(Louvre).
Une autre Artmis de
Praxitle,
appuye
sur une stle comme le
Satyre
au
repos (meil-
leure
rplique
au
Louvre),
est connue
par
un torse
Chiaramonti,
un buste de
l'Ermitage
et un bas-relief
votif de la villa Albani. J e m'tonne
que
M. Furtwaen-
gler
n'ait rien dit de l'Artmis de
Constantinople, qui
est
videmment dans la manire de Praxitle 2. M. Furt-
waengler
maintient
que
l'Eubouleus est bien un ori-
ginal, qu'il
faut seulement ne
pas juger d'aprs
1'
ab-
[1.
Plutt
par
Calamis ou
par Callimaque ;
voir mon
ouvrage
Ttes
idales, 1903, p. 93.]
2. J e l'ai
publie
dans YAmerican J ournal
of archeology, 1885,
p.
319.
[Dans
la Reue
archologique, 1904,1,
p. 28, j'ai
attribu l'ori-
ginal
de ce marbre
Strongylion.
1929.]
188 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
scheuliche restauration de Zumbusch 1. Un
Triptolme
de
Praxitle, analogue
l'Eubouleus,
est connu
par
une
tte du Palais Pitti. Le Sauroctone est donn Pra-
xitle
depuis longtemps ;
l'ros de Parium a t
jus-
tement identifi
par
M. Benndorf au Gnie
Borghse
du Louvre.
Aprs
ces oeuvres se
placerait
l'Herms
d'Olympie, auquel
se rattachent
l'Apollon
au
repos,
le bras droit
appuy
sur la
tte,
et le
Dionysos
dans
la mme attitude. Le
prtendu
Antinous du Belvdre
remonte
peut-tre
seulement un des fils de Praxi-
tle. Un Herms de
Florence, analogue
celui
d'Olym-
pie,
drive d'un
original
du matre. L'ros dcrit
par
Callistrate n'est connu
que par
un
petit
bronze. A
l'Herms de Florence sont
apparentes plusieurs
statues
d'Hracls
(villa
Albani,
muse
Chiaramonti) ; or,
la
tte de cet Hracls
rappelle
celle du
J upiter
d'Otri-
coli, qui parat
avoir fait
partie
d'une statue ddie
Olympie
en 332. Un bronze de J anina
(Bull,
de
corresp.
hell., 1885, pi. XIV)
en serait la meilleure
rplique.
Le
type
d'Otricoli se
rapporte
donc
plutt
Praxitle
qu' Lysippe, auquel
on l'attribue
gnralement.
Euphranor
a d travailler entre 375 et 330. C'est
un
contemporain
de
Praxitle,
mais
qui
n'a
pas pro-
gress
comme lui. Par son matre
Aristide,
il se rattache
Polyclte.
Une de ses
statues,
conserve Rome
sous le nom de Bonus Eventus
et
reproduite
sur des
monnaies et des
gemmes, rappelle beaucoup
l'Idolino.
Il faut attribuer
Euphranor
le
Dionysos
rcemment
dcouvert Tivoli
(Monum.,
t.
XI, pi. 51)
: c'est du
Polyclte
la mode du ive sicle. Cela
pos (ou plutt
suppos),
d'autres statues viennent
grossir
l'oeuvre du
mme artiste : le bronze
acphale
de la collection Sabou-
roff
(Berlin),
un
Apollon
de la collection
Grau,un
autre
1. Comment M.
Furtwaengler peut-il parler
deux fois
(p. 567)
de
la raffinerie d'une
sculpture
? Cela n'est ni
franais
ni allemand
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
189
de Londres. L'influence
d'Euphranor parat
dans
plu-
sieurs statues d'Antinous. La statuette de
Dionysos
(Photiads,
Sambon, Louvre), que
l'on a voulu attribuer
Praxitle,
est bien
plus
voisine
d'Euphranor;
au
reste,
la valeur
artistique
en a t
grandement exagre
1. Le
prtendu
Adonis du Vatican est la
rplique
d'un
Apollon
Patros
d'Euphranor
et continue une vieille tradition de
l'cole
argienne;
c'est une oeuvre de la
jeunesse
de l'ar-
tiste 2. La tte d'un
Dionysos analogue
est connue
par
des
rpliques.
Un herms d'Hracls
(Ludovisi)
est
probablement
la
rplique
d'un autre
herms,
autrefois
Rome,
sur
lequel
taient
gravs
les mots Hrakls
Euphranoros.
Une tte souvent
copie
du
Phrygien
Paris est une
rplique
d'une
sculpture
clbre d'Eu-
phranor
;
le Faune
Winckelmann,
Munich,
reven-
dique
la. mme
origine.
Le
type
de l'Athna
Giustiniani,
mlant aussi des lments du ve et du ive
sicles,
remonte
la statue d'Athna
par Euphranor que
Pline mentionne
Rome. M.
Furtwaengler
attribue enfin au fils du
mme
sculpteur,
Sostratos,
l'original
d'une statue
d'phbe
conserve au
Capitole.
VI.
LA VNUS DE MILO
M.
Furtwaengler
soutient : 1
que l'inscription
dis-
parue appartenait
bien la base
;
2
que
le bras
gauche,
tenant la
pomme, s'appuyait
sur une colonnette
engage
dans la base
(analogie
avec une statuette de bronze
et
une
pierre grave) ;
3
que
le bras droit
s'avanait
vers la
draperie,
sans la
toucher;
4
que
la statue du
Louvre,
excute au Ier sicle avant
J .-C,
remonte
indirectement un bronze de
Scopas,
mais
que
le motif
1. J e suis un des
coupables
et reconnais
que
M.
Furtwaengler
raison.
2. Ceci est un
peu fort,
si l'on rflchit
qu'on
ne connat
pas
une
Meule
rplique
d'une oeuvre incontestable
d'Euphranor
!
190 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
original
a t
altr,
d'une manire
peu
heureuse,
en ce
qui
touche la
draperie
et l'attitude des
bras, par
la
combinaison de deux motifs diffrents : celui de la
Tych
de Mlos
(connu par
une monnaie et un bas-
relief de
l'le)
et celui de la Vnus de
Capoue,
driv
romain d'un
type
du ive sicle
;
5
qu'une
terre cuite
de
Myrina,
Berlin,
montre comment la statuaire
grecque
a su tirer un bien meilleur
parti
du motif de
Scopas
: la desse a le bras
gauche loign
du
corps,
tenant l'extrmit d'une
draperie qui
fait voile
jusqu'
la hauteur de la ceinture et vient ensuite s'enrouler
sur les
jambes.
Chemin
faisant,
M.
Furtwaengler
a
publi
une admi-
rable tte en marbre de Vnus conserve Petworth
;
il
y
reconnat un
original
de
Praxitle,
mais
j'ai
l'im-
pression que
le travail en est
postrieur.
Il a aussi
exprim l'opinion que l'original
de la Vnus de Mdicis
serait d aux fils de Praxitle et a rattach
Scopas
diffrentes
sculptures,
la tte de la J unon du
Capitole,
l'Aphrodite
Caetani
Rome,
la Lda de
Florence,
la
Psych
de
Capoue, l'Hypnos
de
Madrid,
le buste
d'Aphrodite
de Tralles
( Smyrne).
En ce
qui
concerne la statue de
Milo,
M. Furtwaen-
gler
ne nous a
pas
convaincu. Le
peu
de cas
qu'il
fait
du dessin de
Voutier,
suivant
lequel l'inscription appar-
tiendrait l'un des
herms,
n'est
pas justifi par
les
arguments qu'il allgue.
M.
Furtwaengler
crit encore
(p. 652)
: Ce n'est
pas l'inscription qui
nous
oblige
rajeunir
ainsi la statue : c'est le
style.
Si la
draperie
se
rapproche
du
style
du
Parthnon,
cela tiendrait
ce
que
l'auteur
appartenait
la Renaissance du
ne
sicle,
comme celui du torse du
Belvdre,
et ra-
gissait
contre l'art
hellnistique.
Deux statues du
palais
Valentini Rome
reproduisent
une
figure
drape,
dans une attitude
analogue
la Vnus de
Milo,
dont
l'original
remonterait la
gnration qui
suivit
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
19
Phidias,
probablement
Agoracrite.
Un
rayon
de ce
soleil a t
capt par
l'artiste de Mlos
(p. 655).
Fort
bien ! Mais
pour
faire croire
que
la Vnus a
pu
tre
sculpte
vers 100 avant
J .-C,
il faudrait nous
montrer,
de cette
poque,
un morceau de marbre
sculpt compa-
rable au torse de notre statue. Voil ce
que
M. Furt-
waengler
n'a
point
dcouvert. Voil ce
qu'on
ne dcou-
vrira
peut-tre jamais.
VIL
L'APOLLON DU BELVDRE
La statuette
en
bronze de la collection
Stroganoff,
sur
laquelle
on se fonde
depuis
trente ans
pour enseigner
que l'Apollon
du Belvdre tenait de la main
gauche
une
gide,
est tout
simplement
moderne
(ein
moderne
Machwerk). Quel
bon dbarras
pour l'archologie
et
quel
remerciement nous devons de ce chef M. Furt-
waengler
!
La statue du Vatican tenait une branche de
laurier dans la main
droite,
un arc dans la main
gauche
Le dieu s'avance travers son
empire
sans
que
l'ar-
tiste ait eu en vue aucun
pisode particulier
de la
lgende.
On sait
que
M. Winter a rcemment mis en
lumire la
parent
de
l'Apollon
avec le
Ganymde
de
Lochars, que
M.
Koepp
a tabli
l'analogie
du
type
de la tte avec celui
que
l'art
prte
Alexandre.
La statue
originale (en bronze)
fut
sculpte,
comme
la Diane de Versailles
(Louvre),
aux environs de 330
;
on
peut
les attribuer toutes les deux Lochars. La
tte Steinhaeuser n'est
pas
une
copie plus
fidle,
mais
une
rplique simplifie.
Les monnaies
d'Amphipolis
montrent,
d'autre
part, que
ce
type
n'est
pas
une inven-
tion de Lochars
;
il en a exist un
prototype
dans
l'cole de
Phidias,
vers 430. Une tte
d'Apollon
Londres et une autre
Naples
sont des
copies
d'une
oeuvre de cette
srie,
antrieure la statue de
Lochars^
M.
Furtwaengler
les donne Praxitle l'ancien et les
192 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
croit
identiques
l'Apollon Parnopios
sur
l'Acropole,
que
Pausanias attribuait Phidias. Une statuette
d'Athna
Epidaure,
remontant un
original
du
temps
de
Phidias,
montre
comment,
dans l'cole de ce
dernier,
on savait
dj reprsenter
les allures
vives,
mme les
mouvements tumultueux.
VIII. UNE TTE
ARCHAQUE
DE BRONZE
Une tte de bronze de
l'Antiquarium
de
Berlin,
qui
passait pour moderne,
s'est
rvle, aprs suppression
des
parties ajoutes,
comme un
original argien, repr-
sentant un
jeune
athlte
apparent
au Tireur
d'pine
(de Pythagore
de
Rhgium ?),
mais
plus archaque
et
d'un artiste moins habile.
IX.
LE TRNE DE L'APOLLON AMYCLEN
Le bel essai de restitution de M.
Furtwaengler,
.compltement
diffrent de ceux
qui
l'ont
prcd, place
le dieu debout sur une sorte de scne construite avec des
poutres croises,
supporte par
un d central et des
piliers
latraux
;
entre le d et les
piliers
sont des
figures
de femmes sur
lesquelles repose
aussi la
longue
trave. Ce
qui correspond
au mur de la scne est un
grand
dossier dans
lequel
sont encastrs les bas-reliefs
que
Pausanias a dcrits. Les fouilles rcentes de
M. Tsountas ont fait
reparatre
les fondations d'une
partie
du d
central,
en forme de demi-cercle encastrant
un mur
quadrangulaire.
Ce demi-cercle
marque
le
tombeau
(beaucoup plus ancien)
de
Hyakinthos, qui
tait surmont d'un autel et formait en mme
temps
le bathron du colosse. Trne et dossier taient en bois
plaqu
de bronze
et non
d'or,
comme on l'a
gnrale-
ment admis. Le
style
des
bas-reliefs,
insrs dans les
youssures du
dossier,
tait celui de la
plastique
ionienne
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
193
de la seconde moiti du vie sicle
(poque
de
Crsus).
Un
coup
d'oeil sur le dessin restitu
qu'a publi
M. Furt-
waengler
sera
plus
instructif
qu'une description;
il me
parat
certain
qu'il
a
dcouvert,
du moins dans ses
lignes essentielles,
la solution d'un
problme qui
embar-
rasse
l'archologie depuis
cent ans.
A la suite de ce
mmoire,
M.
Furtwaengler
tudie
l'origine
de l'art
samien, auquel
M. Klein a rattach
Bathycls
et le trne
d'Amycles.
Au vne
sicle,
l'art
ionien commence exercer son influence sur le Plo-
ponnse
;
il
y prend
une certaine duret dont
tmoigne
l'Apollon
de Tna.
Dipoinos
et
Scyllis
ne sont
pas
crtois,
mais ioniens
;
c'est l'Ionie
qui
avait
reu
de
Naucratis le
type archaque
dit
d'Apollon.
Celles des
figures
de cette srie
qu'on
a trouves en
pays
ionien
sont
les
plus rapproches
des modles
gyptiens. Smilis,
l'auteur de la Hra de
Samos, qui
vint travailler
Olympie,
n'tait
pas
un
ginte,
mais un Samien.
L'Apol-
lon du Ptoon est samien et trahit la fois des influences
gyptiennes
et
syriennes. L'hypothse
de M. Sauer
sur l'cole naxienne est
exagre ;
le marbre
pouvait
provenir
de Naxos et le travail se faire Samos. Cette
le se servait du marbre de
Naxos,
comme Milet et
phse
du Paros. De ces centres de civilisation l'art
se
porta
vers
l'ouest,
et il se forma de nouveaux ateliers
ioniens Naxos et Paros. Plus on
s'loigne
de
Samos,
plus l'esprit hellnique
fait valoir ses droits. C'est cette
seconde
priode
de
l'archasme,
vers
550, qu'appartient
Bathycls, qui reprsente,
Samos
mme,
l'tat d'un
art
plus qu'
demi
mancip.
A
Naxos,
comme centre
d'activit
artistique,
succda Paros : c'est de l et de la
cte ionienne
que
l'art ionien a
gagn
Athnes. Ainsi
les Korai de
l'Acropole,
dont M. Winter a reconnu le
caractre
ionien,
ressemblent tout
fait, par
les dtails
de
l'excution,
aux
fragments
de
sculptures archaques
trouves
phse.
=
. BEINATH 13
194 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
Un second excursus traite de Smilis. Pausanias en
fait un
ginte, parce qu'il oppose
les
gintes
aux
Ddalides,
comme les auteurs de statues aux
jambes
colles celles d'une allure
plus
libre.
Or,
nous savons
que
la Hra de Samos tait du
type gintique,
une
statue en forme de
gaine ;
de l l'erreur attribue
par
M.
Furtwaengler
Pausanias. En
ralit,
selon
lui,
Smilis tait samien. De
mme,
Pausanias fait venir
de Crte
Dipoinos
et
Scylls, parce qu'on
les
comptait
dans l'cole de
Ddale,
et
que
Ddale,
suivant la
lgende,
s'tait
rfugi
dans la
grande
le.
Le troisime excursus concerne le coffret de
Cyp-
sle,
rem tritissimam. M.
Furtwaengler
rfute
l'opinion
de M.
Sittl,
suivant
lequel
la lad aurait t une
kypsl
circulaire. C'tait bien un coffret
quadrangulaire,
lar-
nax, qui
ne fut identifi
que
trs tard une
kypsl,
par
suite du lien tabli entre ce coffret et les
Cypslides
de Corinthe. Il
y
avait
cinq registres,
orns de tableaux
que
Pausaiiijs
n'a
pas
tous
compris.
Le
premier,
le
troisime et le
cinquime
partir
du haut taient
d'un seul tenant
;
le deuxime et le
quatrime registres
se
composaient
de
petits
tableaux
isols, encadrs, que
Pausanias a bien
expliqus parce qu'ils
taient
pour-
vus de
lgendes.
Le deuxime et le
quatrime registres
taient
plus
hauts
que
les autres
; l'ingalit
des re-
gistres
et la division en cadres de deux d'entre eux
devaient
produire
un effet
pittoresque que
M. Furt-
waengler
a rendu sensible
par
un
croquis.
Dans les additions
(p. 736-748),
il
y
a encore
assez d'ides
pour
alimenter
plusieurs
brochures.
L'Athna de
Pergame
est l'imitation d'une oeuvre
inspire
la fois de Phidias et de Calamis. Un sar-
cophage anthropode
de
Sidon,
Copenhague, pr-
sente une tte
analogue
celle de l'Harmodios de
Nsiots
; or,
les
sarcophages anthropodes
sont
pariens,
hypothse dveloppe
rcemment
par
M. Furtwaen-
AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
195
gler
1
;
donc Nsiots tait
parien galement.
Une statue
de
jeune garon
la villa Albani
(n 316)
remonte un
original
de la
jeunesse
de Phidias. Le
disque
des Niobides
Londres est
authentique, quoiqu'en
ait dit Overbeck
(un
de ceux
que
M.
Furtwaengler
malmne le
plus).
Les
petites copies
en terre cuite de la frise du
Parthnon,
signales par
M.
Waldstein,
sont
authentiques
2;
M. Furt-
waengler
les croit de
l'poque d'Auguste
et
suppose
qu'elles
ont t excutes l'aide de
moulages
des
originaux. Enfin,
l'auteur combat
l'opinion,
mise
par
M.
Wolters,
qui
attribue l'Athna d'Herculaneum
Cphisodote ;
c'est une oeuvre de l'cole de Phidias.
L'ouvrage
se termine
par
des index trs
soigns
;
l'index
musographique
surtout facilitera les recherches dans
ce livre si
plein
de
choses,
si riche en vues
originales,
sur
lequel
nous avons
beaucoup
insist sans en
puiser
les
enseignements.
* *
Publier des monuments nouveaux est bien
;
les
expliquer
est
mieux;
les mettre en circulation est mieux
encore,
et surtout
beaucoup plus
difficile. L'immense
mrite du livre de M.
Furtwaengler,
c'est
qu'il
double
la
quantit
de matriaux utilisables
pour
l'histoire de la
sculpture
au ve et au ive sicles.
Hardiment,
avec une
srnit
d'olympien,
il soulve de leurs
pidestaux
des
sculptures ignores,
laisses dans l'ombre comme
ro-
maines
et les
pousse
en avant dans la
mle,
sur le
champ
de bataille de la
controverse,
chacune son
rang.
Dussent-elles encore souvent
changer
de
place,
elles
y sont,
elles
y
resteront
;
c'est l un
grand
rsultat
acquis.
Mais
que
de
tmrits, dira-t-on, que d'hypo-
1. Cf. ma XXVIIe
Chronique d'Orient, p.
38.
2.
[Erreur
norme
que Furtwaengler
a fini
par
reconnatre et
que je
n'avais cess de
dnoncer;
voir Reue
critique, 1886,1, p.
404 et
suiv.
1929.]
196 AD. FURTWAENGLER ET LA
PLASTIQUE GRECQUE
thses
gratuites!
J e conviens
qu'il y
en
a,
bien
que l'pi-
thte de
tmraire,
applique
sans
faon
un tel
ouvrage,
soit
quelque peu
malsante et doive d'autant
plus
tre
vite
qu'on
est sr de l'entendre
prodiguer par
des
gens
qui
ont le secret de faire des livres sans
y
mettre
une ide
qui
leur
appartienne.
Au
fond,
la mthode de
M.
Furtwaengler
n'est
pas
si nouvelle
qu'elle
le
parat.
Elle est la
consquence lgitime
de la
multiplication
des
photographies,
des
moulages,
de la facilit croissante
des
dplacements. Burger
chez
nous,
Bode en Alle-
magne,
Morelli en Italie n'ont
pas procd
autrement
dans leurs recherches sur les arts modernes
;
et bien
qu'ils
eussent
pour point
de
dpart
de nombreuses
oeuvres
signes
et
dates,
les rsultats
auxquels
ils
sont arrivs ne laissent
pas
d'tre souvent contradic-
toires. Il faut moins s'tonner
que
M.
Furtwaengler
ne
dmontre
pas
tout ce
qu'il avance,
qu'admirer
les bien-
faits d'une mthode
qui
introduit un commencement
d'ordre dans le chaos. Puisse cette
mthode, malgr
les
prils qu'en
offre
l'application,
trouver des imita-
teurs
parmi
nous ! Il est
grand temps que
l'histoire de
la
sculpture antique
cesse de
pitiner
autour des cent
soixante
gravures
d'Overbeck et
qu'elle aspire
du
moins la connaissance
directe, intgrale,
des mille
monuments dont
parle
la formule connue de Gerhard 1.
1.
[Furtwaengler
me; remercia vivement de ce
long article,
le seul
qui
ait
paru
en
France,
avec l'article illustr
que je
lui consa-
crai dans la Gazette des Beaux-Arts de 1894
(rimprim
dans Monu-
ments nouveaux de l'art
antique,
t.
I, p. 201-222).
L'anne suivante
(1895),
Miss Sellers
publia
Londres une traduction
anglaise
de
cet
ouvrage (M
aster
pices),
en
partie augmente,
en
partie
rduite,
qui
est
aujourd'hui plus
souvent cite
que l'original. J usqu'
sa mort
prmature
en 1907
(voir
mes notices dans la Rev.
archol.,
1907, II, p.
326-7 et dans la
Chronique
des
Arts, 1907, p. 309-311),.
je
ne cessai de rendre
compte
des crits de ce. savant
(Rec.
cr., 1897, , p. 46-52, Statuenkopien,
Intermezzi
;
1898, I, p. 50-53,
Sammlung
Somze :
1900, II,
p.
102-108,
Die antiken
Gemmen,
etc.), qui
n'a t
remplac
ni en
Allemagne
ni ailleurs. Personne
n'hrita de sa
grande
et
lgitime
autorit.
1929.]
X
UN BAS RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
AU MUSE D'ODESSA
1
La
grande
influence exerce
par
l'art ionien sur l'art
attique
dans la
priode qui
a
prcd
celle de Phidias
FIG. 39.
Bas-relief de
Panticape
au Muse d'Odessa.
a t mise en lumire d'une manire clatante
par
la
dcouverte des statues fminines de
l'Acropole.
On a
1. Les
parties
essentielles de ce mmoire ont. t
communiques
la Socit des Etudes
grecques
le 1er
juin
1893
(Reue
des tudes
grecques, 1893, p.
295
;
cf. Reue
critique, 1894, I, p. 103,
note
1).
Il a
paru
dans les Monuments
Piot,
t.
II, i895, p. 57-76.]
198 UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
reconnu
que
le
raffinement,
la recherche de la
grce pous-
se
jusqu'
la
manire,
comme aussi
l'usage
et l'abus des
formules
qu'entrane toujours
et
partout
le
manirisme,
avaient t les caractres dominants de l'art
attico-ionien,
avant
que
l'intervention des coles doriennes ne rament
le
got
dans une voie
plus large
et
plus
austre. Cette
raction ne se
produisit pas
seulement dans le domaine
de la
sculpture
: nous savons
par
les auteurs
classiques
qu'elle
s'tendit aux moeurs et mme au costume. Les
environs de l'anne 460 voient se
dessiner,
dans l'hell-
nisme
occidental,
la
supriorit
de
l'esprit
dorien sur
celui de la sensuelle et molle Ionie. Le sicle de Pricls
doit sa
grandeur
cette
victoire,
si l'on
peut
dire,
du
gnie
de la Grce
propre
sur celui de la Grce
asiatique.
Les oeuvres de
sculpture
dcouvertes sur
l'Acropole
nous fournissent de nombreux
spcimens
de l'art
ionien
implant
en
Attique pour
la
priode qui
s'tend
de 520 environ 480. De 480
450,
nous ne savons
presque
rien : l'histoire de la formation de l'art
classique
nous
chappe
encore.
L'Ionie mme a donn
peu
d'oeuvres d'art
que
l'on
puisse rapporter
au dbut du ve sicle.
Presque
toutes
celles
que
l'on connat sont
plus
anciennes. De
Smyrne,
nous n'avons rien
;
de
Milet,
seulement les statues des
Branchides, qui
sont certainement antrieures 530.
C'est
Athnes,
Dlos et dans la Grce du nord
que
nous trouvons les monuments les
plus
nombreux de
l'archasme ionien.
La Grce du nord ne s'arrte
pas
l'Hellespont.
Ds
le milieu du vnie
sicle,
la
plus
riche des villes
ioniennes,
Milet,
avait
envoy
des colons sur la rive
septentrionale
du Pont-Euxin.
Panticape, qu'Ammien
Marcellin
appelle
la mre de toutes les cits maritimes du
Bosphore
1
,
fut fonde au
plus
tard en 540 avant notre
1.
Ammien, XXII, 8,
26.
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
199
re 1. La richesse extraordinaire des tombeaux de Kertch
en vases et en
bijoux grecs
du ve sicle atteste la
pros-
prit
de cette
ville,
centre d'une civilisation ionienne
quelque peu
mle de barbarie
scythique,
dont l'in-
fluence sur
l'Europe
centrale n'a commenc tre recon-
nue
que
de notre
temps.
Comme dans toutes les villes maritimes
qui
n'ont
pas
cess d'tre
habites,
il n'existe Kertch
que peu
de
vestiges
d'difices anciens et l'on n'a
pu y
recueillir
qu'un
trs
petit
nombre de
sculptures.
Parmi celles
que
l'on attribue
l'poque grecque,
la
plus importante,
dcouverte
auprs
des ruines d'une
glise
du xe
sicle,
sous le
vocable de saint J ean le
Prcurseur,
se trouve
aujourd'hui
au Muse de la Socit
archologique
d'Odessa. J 'ai
pu
en obtenir une
photographie
due
un
amateur, par
l'entremise de deux membres de la
Socit,
le
gnral
Berthier de
Lagarde
et le
professeur
J ourguivitch (fig. 39).
Ce bas-relief est
sculpt
dans un marbre
gros grains,
qui
m'a
rappel
celui de Thasos. Il a 1 m. 10 de
long,
sur une hauteur de 0 m. 61 et une
paisseur
de 0 m. 092.
L'extrmit
gauche
a
beaucoup
souffert
;
la tranche de
droite,
qui
est en
partie intacte, s'adaptait
sans doute
une autre
plaque
semblable
qui
lui faisait suite. Nous
avons donc l certainement le
fragment
d'une
frise,
mais il n'est
pas probable que
ce ft une frise de
temple.
On se
figure plus
volontiers une dcoration de ce
genre,
compose
de dix ou douze
personnages,
comme ornant
la base d'un
pidestal
ou d'un
autel,
peut-tre
aussi
le rebord d'un
puits.
Bien
que
la surface du marbre soit
altre 3,
on recon-
1.
Boeckh,
dans le
Corpus inscriptionum grsecarum,
t.
II, p.
91.
2. N 82 du
Catalogue
du Muse d'Odessa
par
M.
J ourguivitch
(en russe).
3.
Quand j'ai
vu lerelief au Muse
d'Odessa,
il tait abandonn sur le
plancher
d'une salle au lieu d'tre fix un mur.
Quelques pau-
frures m'ont
paru
toutes rcentes.
200 UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
nat au
premier coup
d'oeil
que
le travail des
figures
est
trs
soign.
La mieux
conserve,
celle de
droite,
prsente
une fine
draperie
traite avec une
souplesse charmante;
il
y
a aussi des dtails
exquis
dans la
figure
mutile
qui
lui fait
pendant.
Les rehauts de couleur ont
compl-
tement
disparu; mais,
comme nous aurons l'occasion
de le
montrer,
il est certain
que
la
peinture
intervenait
pour complter
l'oeuvre du ciseau.
Trois des
personnages
sont faciles
dnommer,
grce
aux attributs
qui
les caractrisent : ce sont
Artmis,
Apollon Daphnphore
et Herms. Le
quatrime peut
tre une
Charit,
Aphrodite
ou Peitho : nous
adopterons
cette dernire
dsignation, qui
a
dj pass
dans
l'usage
pour
une
figure
tout fait
analogue
du
puteal
corin-
thien 1.
Le caractre du bas-relief de Kertch est celui des
oeuvres attico-ioniennes vers la fin du vie et le commence-
ment du ve sicle.
L'impression gnrale qui
s'en
dgage
est celle d'une
prciosit
un
peu gauche,
d'un effort
continu,
mais
ingalement heureux,
vers
l'lgance
et la distinction. On
pense
involontairement des
sculp-
tures
franaises
du xme
sicle,
des
peintures
italiennes
du
temps
de Giotto et de Memmi. L'artiste est
proc-
cup par-dessus
tout d'viter ce
qui pourrait
donner
l'ide de la brutalit ou de la lourdeur. Les
personnages
s'avancent d'un
mouvement
rythmique qui rappelle
souvent l'allure de la danse
;
leurs
pieds
effleurent la
terre
plutt qu'ils
ne
s'y posent ;
leurs
doigts
semblent
craindre de serrer les
objets qu'ils
tiennent
;
leurs
longues draperies,
moelleuses et
diaphanes,
s'envolent
ou se
dchiquettent
en
petits plis,
la fois
trop rguliers
et
trop capricieux. Enfin,
les
figures
se dtachent d'un
relief trs faible sur un fond uni
;
il
n'y
a ni
multipli-
cit de
plans,
ni entre-croisement de
lignes appartenant
1. J ournal
of
Hellenic
Studies, 1885, pi.
LVI.
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
201
des
figures
diffrentes. C'est la
composition que
les
archologues
allemands
appellent paratactique,
et
qui
s'oppose
la
composition pittoresque
du relief alexan-
drin.
En
prsence
d'un monument comme celui
qui
nous
occupe,
la
premire question qui
se
pose
est celle-ci :
Faut-il
y
voir un travail
archaque
ou une oeuvre archa-
sante,
un
original
du dbut du ve sicle ou une imita-
tion,
un
pastiche
d'une
poque
voisine de l're chr-
tienne ?
Parmi les
archologues comptents qui
ont vu ce
bas-relief, l'un,
M.
Kondakoff,
le dclare
archaque
1
;
l'autre,
M.
Furtwaengler,
le croit
archasant
2. Cette
dernire
opinion
est aussi celle de M. Hauser
3
;
mais
l'auteur des Neu-attische
Reliefs
ne connaissait le
marbre de Kertch
que par
un
calque
de l'informe
gra-
vure
qu'en
a
publi
M. Kondakoff.
Nous allons discuter la
question
notre
tour,
avec
l'esprance
d'arriver un rsultat
prcis.
D'abord,
nous
concdons,
comme tout le
monde,
qu'
l'poque
de Csar et celle
d'Hadrien,
probablement
aussi,
comme a
essay
de le faire voir M.
Hauser,
ds
le ive
sicle,
il a exist des oeuvres
archasantes,
c'est--
dire des imitations rflchies d'oeuvres
archaques,
nes
soit du dsir
pieux
de
perptuer
des
types hiratiques,
soit du dsir
profane
de satisfaire certains amateurs.
Ces deux mobiles de l'archasme factice sont d tous les
temps ;
l'un
prvaut
dans la Russie
actuelle,
o la
peinture religieuse
est encore toute
byzantine ;
l'autre
a
inspir
l'cole dite nazarnienne en
Allemagne
et
celle des
prraphalites anglais.
J e ne
parle pas
des
1. Mmoires de la Socit
archologique d'Odessa,
t. X
(1877), pi. I,
3. Cf.
Kondakoff, Tolsto, Reinach, Antiquits
de la Russie mridio-
nale, p.
106. *
2. Berliner
philologische Wochenschrift, 1S88, p.
1.516.
3.
Hauser,
Die neu-attischen
Reliefs, 1889, p. 163,
n 3.
202 UN BAS-RELIEF DE PANTICAPEE
(KERTCH)
oeuvres
fabriques
dans une intention de fraude et
que
l'antiquit
a
dj
connues
;
on
peut
d'ailleurs les
ranger
sans
peine
dans la seconde des
catgories que
nous dis-
tinguons.
Les vases de marbre avec reliefs
signs
de noms des
artistes athniens
Salpion,
Sosibios et Pontios
1
sont
des
spcimens
irrcusables d'oeuvres
d'imitation,
car
les
inscriptions qu'ils portent
sont
plus
rcentes de
plusieurs
sicles
que
les
types reproduits
et la
faon
dont ils sont
juxtaposs.
Si toutes les oeuvres de cette classe
prsentaient,
ct d'lments
emprunts
l'art
archaque,
des l-
ments incontestablement
plus modernes,
comme le
seraient,
dfaut
d'inscriptions,
des imitations de
types
crs
par
Praxitle ou
par Lysippe,
la
question
ne se
poserait
mme
pas
: on
pourrait
tout au
plus
hsiter
placer
telle ou telle
sculpture
au nie sicle avant notre
re
plutt qu'au
11e
aprs.
Il
existe,
en
effet,
des oeuvres de ce
genre, que
M. Hau-
ser a
tudies,
et
pour
celles-l toute discussion est
superflue
: on
peut
s'accorder les
qualifier
de
pastiches.
Mais ce ne sont
pas,
tant s'en
faut,
les seules. Il
y
a encore
les
sculptures (nous
ne
parlons
ici
que
des
bas-reliefs)
o des lments
archaques
sont traits avec une froi-
deur
qui
invite au doute : tel est l'Autel des Douze
Dieux au
Louvre, qui
est
probablement
une ancienne
copie.
Il
y
en a enfin
qui
ne
paraissent pas prter
cette
critique,
mais
pour lesquelles
on
peut toujours
se
demander si les
types
assembls sont bien contem-
porains,
si l'on n'est
pas
en
prsence
d'un
pastiche
habile
qui
se trahit
par quelque
menue
inconsquence.
En ce
qui
concerne le marbre de
Kertch,
on
pourrait
soutenir une des trois thses
que
voici :
1.
Baumeister, Denkmaeler,
t.
I, p.
438
;
t.
III, p.
1688
;
Butlettino
dlia Commiss.
municipale,
t.
III, pi. XII,
XIII.
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
203
1 C'est la
copie
exacte d'un bas-relief
archaque;
2 C'est un
pastiche d'poque
tardivecelle de Pasi-
tls, par exemple
obtenu
par
la contarninatio de
motifs
emprunts
l'art du
vie,
du ve et du ive sicles
;
3 C'est un bas-relief
archaque, attico-ionien,
remon-
tant aux environs de l'an
470,
c'est--dire
l'poque
encore mal connue dont l'art se
personnifie pour
nous
dans
le
nom de Calamis.
La
premire
thse ne
pourrait
se fonder
que
sur des
considrations de
technique.
Encore ces considrations
n'ont-elles
presque jamais
une
prcision
suffisante
pour
entraner la conviction de tous.
D'ailleurs,
si une
copie
est assez fidle
pour
donner le
change, peu importe
l'poque
o elle a t excute : ft-elle du
temps
d'Hadrien,
elle serait
pour
nous
l'quivalent
exact d'un
ouvrage
de six cents ans antrieur. Il ne resta donc
qu'
examiner la seconde
thse,
et cet examen
comporte,
je
crois,
les lments
que
voici :
1 Existe-t-il dans les attributs des
personnages
quelque
dtail inadmissible au dbut du Ve sicle ?
2 Mme
question pour
le dessin des
figures
et leur
costume
;
3 Mme
question pour
leurs attitudes
;
4 L'oeuvre a-t-elle t dcouverte dans un milieu
o l'on
puisse
raisonnablement
supposer qu'une
cole
d'artistes archasants ait fleuri ?
Commenons
par
la
premire question.
Personne ne trouvera de motifs de
suspicion
dans
la
lyre
et la branche de laurier
que porte Apollon.
Il
suffit d'ailleurs de
rappeler
une
amphore
de Nola
1
o une divinit fminine
prsente
une
lyre
Apollon
debout,
tenant un
grand
rameau de laurier
appuy
contre le sol.
Le cas d'Herms est
plus
difficile. Le
ptase
ail
1. lite des Monuments
cramographiques,
t.
III, pi.
XIV.
204 UN BAS-RELIEF DE PANTICAPEE
(KERTCH)
est,
en
effet,
trs rare dans l'art
archaque.
Trs
rare,
mais non sans
exemple
: on
peut
citer
1
un vase
figures
noires
publi par
Gerhard
2
et un
lcythe,
figures
noires
galement (fig.40), publi par
M.
Benndorf 3,
o le
dieu, reprsent
sous le
type archaque, porto
le
ptase
ail. Ces oeuvres sont fort antrieures l'an
470,
mais nous nous
rapprochons
de cette date avec
un beau vase
figures rouges
du Muse de Berlin
(n 2.160),
o M.
Furtwaengler
reconnat la manire de
Brygos
:
Herms, dsign par
une
inscrip-
tion,
y porte
la fois un
ptase
ail et des talonnires 4. Le
ptase
ail,
mais cette fois sans les talon-
nires,
se voit
galement
sur une
figure
d'Herms assistant au
juge-
ment de
Paris, peinte
sur un vase
de Nola
figures rouges
et de beau
style,
c'est--dire de l'an 450 envi-
ron 5. Il est
peine
ncessaire de
rappeler que
l'on trouve sou-
vent le
ptase
ail sur les
lcythes
blancs athniens.
Les talonnires d'Herms
prtent
d'autres obser-
vations. Tout le monde connat
par
des
gravures
l'original ayant disparu
le
puteal
de
Corinthe,
autre-
1.
Scherer, ap.
Roscher Lexikon der
Mythologie,
art.
Herms,
p.
2400.
2.
Gerhard,
Auserlesene
Vasenbilder, pi.
CX. Ce vase
appartenait
Durand
;
la vente de cet amateur il fut
acquis par
Panckoucke,
dont la collection a
pass presque
en entier au Muse de
Boulogne-
sur-Mer.
3. Griechische und Sicilische
Vasenbilder,
pi.
XLII,
4.
4. Hoher Petasos mit
Flugeln ;
hohe
Stiefel
mit
Zugstck
nach corn
und
grossen Flugeln
nach hinten
(Furtwaengler,
Vasensammlung,
p. 485).
Cevase a t
publi par Gerhard,
Etruskische und
campanische
Vasen, pi. VIII,
IX
;
cf.
Muller-Wieseler, Denkmler,
t.
II,
n 486.
5.
Furtwaengler, op. laud.,
n 2536
; Welcker,
Alte
Denkmler,
t.
V, pi. B,
2.
FIG. 40.
Profil d'Her-
ms
archaque, d'aprs
Benndorf,
Griech. und
Sicil.
Vasenbilder,
pi.
XLII 4,
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
205
fois Londres chez lord Guilford
1
;
ce monument
est un de ceux
qui
se
rapprochent
le
plus
du bas-relief
de
Kertch,
non seulement
par
le
sujet,
une
procession
de
divinits,
mais
par
l'extrme ressemblance de
certaines
figures,
notamment de l'Herms et de la
Peitho
(fig.
41,
42).
Bien
qu'Otfried
Mller n'ait
pas
hsit le considrer comme vritablement
archaque 2,
l'opinion
de
Gerhard,
qui
le
croyait archasant,
a
pr-
valu.
Dans la troisime dition de son histoire de la
sculp-
J . M. Michaelis a
publi
des
phototypies d'aprs
le mauvais mou-
lage qui
existe encore de
quatre
seulement des
figures qui compo-
saient la dcoration du
puteal (J ournal of
Helenic
Studies, 1885,
pi. LVI-LVII).
Le
puteal
est connu
par
deux
dessins,
l'un excut
par Pomardi,
le
compagnon
de
voyage
de
Dodwell,
et
publi par
ce
dernier dans son Classical Tour in
Greece,
t.
II, p.
200-202
;
l'autre
fait
par Stackelberg
et
publi par
Gerhard,
dans ses Antike Bild-
werke, pi.
XIV-XVI. Le dessin de Gerhard est celui
qui
a t le
plus
souvent
reproduit (voyez par exemple Miiller-Wieseler, Denkmler,
t.
I,
n 42 :
Michaelis,
loc.
laud., p. 48).
Nous avons
prfr
le dessin
de
Dodwell,
bien
qu'il
ne mrite
pas
une entire confiance
; mais,
comme l'a reconnu M.
Michaelis,
il est matriellement
plus exact,
au moins
pour
les
quatre figures
dont les
moulages
ont t conservs.
2. Echt alten
Styles (0. Miiller,
Die
Dorier,
t.
I, p. 431).
FIG. 41.
Puteal de
Corinthe,
d'aprs Dodwell,
Classical Tour in
Greece,
t.
II,
p.
200-202.
206
_
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
ture 1,
M. Overbeck avait encore maintenu la manire
FIG. 42.
Puteal de
Corinthe, d'aprs
Dodwell.
de voir d'O. Mller
;
mais il l'a abandonne
depuis,
1.
Overbeck,
Geschichte der
griech. Plastik,
t.
I, p.
143.
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
207
en se fondant sur un
argument
tir des talonnires
de
l'Herms,
que
M. Hauser considre tort comme
dcisif 1. Dans les oeuvres
archaques authentiques,
nous
dit-on,
c'est--dire dans les
peintures
de
vases,
le dieu
porte
des chaussures
ailes, itiEpdVTa nSiAa,
et
les ailerons ne sont
pas
directement fixs ses
pieds. Or,
dans le bas-relief du
puteal
de
Corinthe,
comme dans
celui de
Kertch,
Herms a des talonnires sans chaus-
sures. En ce
qui
concerne le
puteal,
on
peut rpondre
qu'il
est
toujours
hasardeux de chercher dans la
pein-
ture des critres
pour apprcier l'antiquit
des
sculp-
tures,
d'autant
plus que
l'lment
pictural
de la
sculp-
ture
antique
est
prcisment
celui
qui
nous
chappe
aujourd'hui. Mais,
en ce
qui
touche le bas-relief
de
Kertch,
la
remarque
de M. Overbeck n'est mme
pas
applicable.
M. Hauser
observe,
en
effet,
que,
dans le
bas-relief funraire de
Myrrhine, qui appartient
sans
conteste la
premire
moiti du ive
sicle,
les talon-
nires d'Herms adhrent directement son
pied ;
seulement,
ajoute-t-il,
les sandales sont
indiques
par
la
sculpture,
ce
qui
nous
oblige
d'admettre
que
le
reste de la chaussure tait
peint. Or,
dans le bas-
relief de
Kertch,
les sandales d'Herms sont
parfaite-
ment
visibles
; donc,
supposer
mme
que
l'observa-
tion de M. Overbeck ft
exacte,
elle ne trouverait
pas
son
application
dans le cas
prsent.
Mais cette observation est
inexacte. M.
Furtwaengler
a
rappel
ce
propos
2
les
plaques
d'ivoire
sculpt pro-
venant de
Tarquinii qui
sont conserves au Muse
du Louvre et
qui
ont t attribues
par
MM.
Helbig,
Perrot et
Martha un atelier
chypriote
3.
Quelle que
soit
1.
Hauser,
Die neu-attischen
Reliefs, p.
162.
2.
Furtwaengler, Meisterwerke, p. 204,
note 5.
3. Monumenti dell'
Instit.,
t.
VI, pi.
XLVI
; Martha,
L'Art
trusque,
p.
306 et
fig.
206
; Helbig, Annali, 1877, p.
398
;
Perrot et
Chipiez,
Histoire de
l'Art,
t.
III, p.
853.
20S UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCu)
leur
provenance, grecque
ou
trusque,
ce sont incon-
testablement des monuments de l'art ionien au vie sicle.
Or,
sur l'une de ces
plaques,
on
aperoit
Herms,
dont
les
pieds, compltement nus,
sont
pourvus
d'ailerons
(fig. 43).
Il
suffit d'un
exemple
aussi concluant
pour
rendre toute discussion
superflue.
M.
Hauser, qui
attribue le
puteal
aux environs de
l'an
350,
date
qui
me semble
trop
basse de
plus
d'un
sicle,
dit encore
que
les talonnires
recoquilles
sont
un
archasme,
un
emprunt
des monuments
plus
anciens
que
le ve sicle
et
par
suite en contra-
diction avec d'autres
dtails du mme bas-
relief. De ce
que
des
talonnires de cette
forme
paraissent
sur des
monuments remontant
l'an 550
environ,
il ne
s'ensuit
pas que
la forme en
question
ft tombe en dsu-
tude soixante-dix ans
plus
tard. Et
puis,
o se rencon-
tre-t-elle ? M. Hauser cite en note des
reprsentations
des
Borades,
de
Perse,
de Nik
;
il n'en
allgue
aucune
d'Herms,
bien
qu'il
et
pu rappeler
un vase
figures
noires
publi par
Ch. Lenormant et J . de Witte 1. C'est le
seul monument
archaque que je
connaisse o Herms
ait des talonnires
recoquilles
;
mais comment conclure
de l
que
cette manire de les
figurer
ait d
passer
compltement
de mode au ve sicle ? Cela est d'autant
moins
probable que
les ailes
recoquilles
sont,
d'une
manire
gnrale,
trs
frquentes
dans les
figures
de
l'art
alexandrin,
notamment dans les terres cuites
;
il est donc raisonnable de
penser que
cette forme
grco-
orientale,
c'est--dire
ionienne,
n'a
jamais
cess d'tre
i. lite des Monuments
cramographiques,
t.
III, pi.
XCIII.
FIG. 43.
Herms avec
talonnires,
sur une
plaque
d'ivoire de
Tarquinii.
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
209
employe par
les artistes. Si c'tait un
archasme et
un
anachronisme,
il serait
singulier
de le trouver dans
les deux seuls bas-reliefs
qui puissent
tre attribus
au dbut du Ve sicle et o
paraisse
la
figure
entire
d'Herms,
le marbre de Corinthe et celui de Kertch.
D'ailleurs,
il en est de l'observation de M. Hauser
comme de celle de M. Overbeck : elle est matrielle-
ment errone. La
preuve
nous en est fournie
par
les
dbris d'un des chefs-d'oeuvre de l'art
grec, qui
a
pr-
cisment t dcouvert tout
prs
de
Kertch,
dans le
clbre tumulus de Koul-Oba.
L'migr
Dubrux, qui
fouilla ce tumulus en
1830,
signala
dans son
rapport, parmi
les
trouvailles,
des
dbris en bois de buis orns de
gravures.
Ces
fragments
ont t
reproduits,
avec la
lgende Objets
en
bois,
sur
les
planches
LXXIX et LXXX des
Antiquits
du Bos-
phore
Cimmrien. Bien
que
la dtermination de la sub-
stance ft due un
botaniste, Fischer,
on
s'aperut,
vers
1865,
qu'elle
tait
inexacte,
et
Stephani s'empressa
d'annoncer
que
les
prtendus
buis
sculpts
n'taient
autre chose
que
des
plaques
d'ivoire 1. Chose
singu-
lire ! Une erreur toute
pareille,
et non moins
tenace,
tait
commise un
peu plus
tard en
France,
o l'on a
souvent
rpt que
le Muse de
Vienne,
dans
l'Isre,
possdait
une tte romaine en bois d'un admirable
travail. C'est seulement en
1894, lorsque
ce
prcieux
objet
fut
envoy
au Muse de Saint-Germain
pour
tre
restaur,
que
M. Abel
Matre, inspecteur
des ateliers
du
Muse,
s'aperut qu'il
n'tait
pas
en
bois,
mais en
ivoire. L'existence d'une
patine
brune sur la tte du
Muse de Vienne
explique
l'erreur
que
M. Matre a
reconnue.
Sur un des
fragments
de
Koul-Oba, qui
a
probable-
1.
Stephani, Compte
rendu de la Commission
impriale pour 1866,
p.
6.
S. BEINACU
14
210 UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
ment
appartenu
au revtement d'une
lyre,
on
distingue
la
partie
infrieure d'une
jambe
chausse d'un brode-
quin
et munie d'un
grand
aileron
recoquill
1
(fig. 44). Or,
le contenu du tombeau Koul-Oba
permet
de le dater avec
quelque
exactitude. Parmi les
objets qu'on y
a recueillis
figurent
les clbres mdaillons en or sur
lesquels
est
estampe
la tte de l'Athna Parthnos de Phidias 2.
Cette statue datant environ de
445,
nous avons
l,
pour
le caveau de
Koul-Oba,
une date
suprieure
extrme.
D'autre
part,
le
style
encore
archaque
des
objets
en
or,
o M.
Furtwaengler
a trs
justement
reconnu des monu-
ments de l'orfvrerie
ionienne, empche
de descendre
plus
bas
que
le dernier tiers du ve sicle. C'est donc aux;
environs de l'an 430
qu'appartient
le revtement de
lyre
sur
lequel
nous avons
signal
une
jambe
d'Herms avec
talonnire
recoquille.
On voit
que
M. Hauser a commis
une erreur de fait en affirmant
que
l'art du Ve sicle
ignore
les talonnires
recoquilles
;
mais son erreur
n'a
pas
t sans
avantage, puisqu'elle permet
main-
tenant de mettre en lumire le caractre ionien de ce
dtail.
J e
passe
aux
objections que
l'on
peut
fonder sur le
dessin des
figures,
leurs
gestes
et leurs
draperies.
1.
Antiquits
du
Bosphore, pi. LXXX,
16.
2.
Ibid., p.
63 de mon dition.
'
FIG. 44.
Gravure sur ivoire de Koul-Oba.
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
211
En ce
qui
concerne le
dessin, d'abord,
on
peut
tre
frapp
de la taille mince d'Herms
et du dve-
loppement exagr
de ses hanches. C'est l encore un
caractre de l'art vers 530
et,
comme il se
rtrouve
dans la
figure correspondante
du
puteal,
M. Hauser
crit
1
:
Une silhouette comme celle
d'Herms,
avec
sa taille fine et ses
puissantes
cuisses,
tait dmode
(ueberwunderi)
vers la fin du vie sicle. Si l'artiste
qui
sait modeler si finement le
corps
de Peitho
reprsente
Herms comme il l'a
fait,
eh bien ! il
archase,
quelque
poque que
se
place
son travail.
Cette
phrase
peut
s'appliquer,
sans
y changer
un
mot,
au bas-relief de
Kertch,
o
reparat,
ct du mme
Herms,
la mme
figure
de Peitho.
Voyons
si
l'objection
fonde sur cet
argument
a
quelque
valeur.
Comment M. Hauser sait-il
que,
vers la fin du
vie
sicle,
ou mme au commencement du
ve,
on ne
reprsentait plus
les hommes avec une taille trs mince
et des hanches trs saillantes ? En
publiant
l'Hracls
tirant de l'arc de la collection
Carapanos,
bas-relief
probablement
corinthien comme le
puteal,
et dont
l'authenticit n'aurait
jamais
d tre
conteste,
Rayet
faisait
remarquer que
les caractres en
question
se
retrouvent dans les vases
peintures
noires,
dont
les
plus
beaux datent des dernires annes du vie et
des
premires
du ve sicle2. Ces dates sont
trop basses,
car
Rayet
crivait avant les fouilles de
l'Acropole;
mais,
d'autre
part,
il
rapprochait justement
la tte
de cet Hracls de celle de l'Harmodios du
groupe
des
Tyrannicides
au Muse de
Naples.
Or,
cette
figure
est
une
copie
de celle
qui
fut
rige par
les Athniens en
477,
ce
qui
nous
rapproche singulirement
de cette
date de
470,
considre comme
l'zixv]
du manirisme
1.
Hauser,
Neu-attischen
Reliefs, p.
162.
2.
Rayet,
Monuments de l'Art
antique,
t.
I, pi.
XXIII.
212
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
ionien, qui
continua fleurir assez
longtemps aprs
la chute des
Pisistratides,
comme
le
style
Premier
Empire
survcut la rvolution de 1815.
Il n'est
pas permis, rptons-le,
de dater les bas-
reliefs
d'aprs
les oeuvres de la
peinture.
La
peinture,
moins asservie la
matire,
par
suite aussi moins esclave
de la
tradition,
est
presque toujours
en avance sur la
statuaire. Nous le savons avec certitude
pour Athnes,
o
Polygnote
est le vrai
prcurseur
de Phidias. Les
par-
ticularits de structure
qui,
vers
490,
se reconnaissent
encore dans les
peintures cramiques d'Euphronios,
pouvaient
bien,
en
470, prvaloir
dans le domaine de
la statuaire. Dans le cas
particulier qui
nous
occupe,
la structure du
corps
viril tel
que
l'a
compris
l'archasme
en
particulier
l'archasme ionien
n'est
pas
tant
l'effet d'une
ignorance
tenace des
proportions
naturelles
que
celui d'une
prfrence
raisonne
pour
certaines
formes. Dans les Nues
d'Aristophane,
la J ustice
pro-
met au
jeune
homme
qui
suivra ses conseils un
grand
dveloppement
des
paules
et des
hanches,
pu pey/lou,
jtupiv ixEyXTjv
1.
Que
l'on
regarde
certaines
gravures
populaires
vers 1885 : on
y
verra la beaut du
corps
fminin
dfigure par
des
exagrations analogues, qui
avaient leur
rpercussion
dans des artifices
aujourd'hui
condamns de la toilette. Pour en revenir l'art
ionien,
on
peut
dire
qu'il
a
prsent,
comme la civilisation de
ce
temps-l,
une alliance
singulire
de brutalit et de
raffinement
;
cette alliance
parat
trs
nettement,
notre
avis,
dans le contraste de la
figure
d'Herms
avec
l'exquise
Peitho
qui
lui fait
pendant.
Attribuer
cette
juxtaposition significative
au
caprice
d'un archa-
sant de l'an 350 ou de l'an 50 avant notre
re,
un
contemporain
de Praxitle ou de
Pasitle,
c'est faire
la fois
trop
d'honneur son sens
historique
et
trop
1.
Aristophane, Nues,
v.
1013,
1014.
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
213
d'injure
son
got
d'artiste,
clair
par
une
longue
suite
de chefs-d'oeuvre.
Ce
qui prcde
me
permettra
d'tre bref sur le cha-
pitre
des
gestes
et des
draperies.
Les deux
figures
fmi-
nines relvent un
pan
de leur
longue tunique
avec un
geste
si manir
qu'on
serait tent d'abord
d'y
voir
une invention de la basse
poque.
Ce serait oublier
que
la
simplicit
du
grand art,
la
simplicit
noble et la
dignit
tranquille,
comme dit
Winckelmann,
est le
privilge
d'poques
trs courtes
qui
sont,
pour
ainsi
dire,
enca-
dres d'autres
plus longues
o domine le
prcieux
ou
le violent. On
pourrait
en accumuler les
exemples,
montrer le
raffinement,
dans Praxitle
lui-mme,
attei-
gnant dj
les confins du
manirisme,
mettre en
paral-
lle l'affectation de
prraphalites
comme Botticelli
avec celle d'un
Sassoferrato,
d'un Guido
Reni,
d'un
Pierre de
Cortone, poursuivre enfin,
dans le domaine
littraire,
les
multiples applications
de la mme loi.
Tel bas-relief
attique
dcouvert sur
l'Acropole,
datant
de l'an 500 au
plus tard,
et aussi
presque
toutes les
statues
fminines, y compris
celle
d'Antnor,
sont des
oeuvres
prcieuses, guindes,
o
gestes
et
draperies
sont
galement conventionnels,
aussi
loigns
de
l'observation de la nature
qu'pris
du
joli
et du
dis-
tingu
. L'allure
rythmique
de la
marche,
l'attitude
manire des
doigts,
le
plissement fignol,
les envo-
lements
multiples
des
draperies,
sont des caractres
de l'archasme
vrai, que
les archasants du
temps
de
Praxitle ou de Pasitle n'ont
pas
invents 1. Henri
Brunn avait
dj
observ,
en
1867, que
nombre de
caractres attribus aux oeuvres dites archasantes se
rencontrent dans les
peintures
des vases
attiques
du
beau
style
: il en avait
conclu,
avec une
logique impla-
1. C'est ce
que
M. Hauser a mis en lumire d'une manire dfi-
nitive, op. laud., p.
164 et suiv. Voir
par exemple,
les vases
publis
dans les Monumenti dell'
Instituto,
t.
I, pi.
X
;
t.
X, pi.
XXXVII.
214 UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
cable,
qu'Euphronios,
Hiron et
Brygos
taient des
archasants. Cette erreur d'un
grand esprit
a t fconde.
Comme les fouilles de
l'Acropole
ont dmontr
que
les
matres de la
cramique
figures rouges
travaillaient
dj
avant les
guerres mdiques,
comme d'ailleurs les
observations de Brunn sont l'vidence
mme,
force
est de convenir
que
les
oeuvres dites archasantes sont
presque
toutes soit des
copies
minutieuses d'oeuvres
archaques,
soit des oeuvres
archaques
dont la date
et le
caractre ont t obstinment mconnus 1.
La
figure
de
Peitho,
qui
se trouve sur le
puteal
de
Corinthe,
reparat
encore
ailleurs,
par exemple
dans un
joli
bas-relief
attique
du ive sicle
reprsentant
une
nymphe
dansant devant
Pan,
type
troitement
appa-
rent celui de la danseuse voile
que
nous connaissons
par
les vases et les terres cuites 2. Il est tentant de
pr-
tendre
que
ce
type
date du ive
sicle et
que
les auteurs
de
prtendus pastiches
comme les bas-reliefs de Kertch
et de Corinthe
l'ont introduit inconsidrment dans leurs
compositions,
ct d'autres d'un sicle ou deux
plus
anciens. Mais cela ne rsiste
pas
l'examen : le motif
en
question
remonte au dbut du ve sicle et mme
plus
haut.
En
effet, d'abord,
dans la
Peitho de
Kertch,
les trois
boucles de
cheveux
qui
descendent sur la
poitrine
ont
un caractre
archaque
incontestable :
imagine-t-on
un
pasticheur qui,
empruntant
une
figure
du ive
sicle,
l'aurait
archase
par
ce seul dtail ? Si l'on va
jusque-l,
on
devra accorder
que
ce
personnage
avait
le sentiment de la diffrence des
styles
: alors
pourquoi
allait-il
prendre pour
modle un
type
du ive
sicle,
lorsque
le ve
ou la fin du vie devaient lui en fournir
qui
n'avaient
pas
besoin de retouches ? Cet archasant
1. Voir
Hauser, op. laud., p.
166.
2.
Heuzey
Bulletin de
correspondance hellnique, 1892, p. 73;
Le
Bas-Reinach,
Monuments
figurs, pi.
LIX.
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
215
des thoriciens de l'archasme factice aurait t la
fois trs
ignorant
et trs
astucieux,
trs
impuissant
et trs
imaginatif.
J e ne
pense pas qu'un
pareil
homme
ait
jamais
exist. Il
y
a eu des
pasticheurs ignorants,
ou
plutt
indiffrents
;
mais
quand
ils ont
juxtapos
des
figures d'poques diverses,
ils ne se sont
pas impos
la tche de les mettre en harmonie
par
des additions
dignes
d'un
archologue
!
M. Hauser a d'ailleurs donn d'excellentes raisons
pour
faire admettre
que
le
type
de la Peitho n'est autre
que
celui de la Sosandra de Calamis. De cette statue
clbre,
le chef-d'oeuvre de la
premire
dcadence
ionienne,
nous ne savons
gure que
ce
que
nous a dit
Lucien.
Or,
que
nous
apprend-il
?
Qu'elle
se
prsentait
sous
l'aspect
d'une
danseuse, puisque
le rhteur vante
en elle
T
epue^ov
xod T
xEy0?YlY1['iV0Vj expressions qui
dsi-
gnent
moins une danse vritable
qu'une
sorte de mou-
ment
rythmique
et de dmarche affecte. Il nous dit
encore
qu'elle
tait vtue d'une manire la fois
modeste
et
coquette,
T
eataX
SI xc
xcpiov TYJ vaoX-rj.
Ses
qualits
matresses taient la
lgret
et la
grce,
XitTOT]
xo
%dpi.
Tout cela conviendrait
parfaitement
notre Peitho et l'on chercherait
vainement,
dans
l'art
archaque,
une
figure
laquelle
ces indications
s'ajustent
aussi bien. Si l'on voulait en trouver une
l'poque
de la Renaissance
italienne,
il faudrait la
choisir dans le
Printemps
de
Botticelli,
celui de tous les
matres modernes dont les
qualits,
comme les
dfauts,
rappellent
le
plus
les vieux matres ioniens.
Quoi
d'tonnant
qu'un type
cr
par
Calamis,
ou
rendu clbre
par
lui 1,
ait t imit et mme
dvelopp
par
l'art
attique
du ive
sicle,
surtout
lorsqu'on
rflchit
aux
relations,
certaines
quoique obscures, qui jettent
1. Ce
type n'est,
en
somme, que
celui des
Kpai
de
l'Acropole pas-
sant du
repos
au mouvement. Il serait tout fait
inexplicable qu'on
et attendu un sicle
pour
le dcouvrir.
216 UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
comme un
pont
entre Calamis et Praxitle ? Pline a
racont
que
Praxitle avait
complt
une oeuvre de
Calamis et M. Klein a fort bien vu
que
ce
renseigne-
ment contenait un
tmoignage authentique
sur la colla-
boration de Calamis avec Praxitle
l'Ancien, peut-tre
le
pre
de
Cphisodote
et l'aeul du
sculpteur
de l'Her-
ms. M.
Furtwaengler
a montr rcemment
que
la
tradition de Calamis fut continue
jusqu'
la fin du
Ve
sicle,
et mme au
del,
par Callimaque
et le dco-
rateur de la Balustrade.
Quoi qu'il
en
soit,
on
peut
considrer comme
tabli,
ce
que Rayet
avait
dj
souponn
1, que
le
grand
matre du ive sicle n'est
pas
de la
ligne
de Phidias : il drive surtout de Calamis
et de
Myron.
Enfin,
il ne faudrait
pas
refuser au ve
sicle,
ni mme
au
vie,
le talent et le
got
de
reprsenter
des toffes
collantes. Les vases
peints
du beau
style
montrent
combien elles taient alors la mode.
Rappelons
seu-
lement la
coupe d'Euphronios,
o l'on voit un homme
barbu assis
auprs
d'une danseuse 2. Il est vrai
que,
sur
ce
vase,
le
peintre
a sillonn l'toffe
transparente
de
mille
petits plis
;
mais
qui
nous dit
qu'il
n'en ft
pas
de mme sur le
bas-relief,
d'o toutes les traces de
coloration ont
disparu
? Il
y
a
cependant
une
grave
objection
: ce sont les
draperies
termines en
queue
d'aronde,
qui
se trouvent tant sur le bas-relief de
Kertch
que
sur le
puteal.
M. Hauser les
qualifie
nette-
ment d'archasantes
;
elles sont
mme,
ses
yeux,
un
caractre irrcusable de l'archasme factice 3.
Dans
l'art
archaque
vrai, crit-il,
on
trouve,
et
l,
un
arrangement analogue
du vtement
;
mais alors les
contours extrieurs des
pans
d'toffe sont
parallles,
tandis
que,
dans l'art
archasant,
ils
divergent.
Et le
1.
Rayet,
Etudes
d'archologie
et
d'art, p.
10
(crit
en
1880).
2.
Klein, Euphronios,
2e
d., p.
98.
3.
Hauser,
Die neu-attischen
Reliefs, p.
165.
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
217
savant allemand
ajoute qu'il
n'en a dcouvert
qu'un
seul
exemple
vraiment
archaque,
sur un
fragment
de
coupe publi par
M. Benndorf 1. Cette fois
encore,
le
mme dbris de la
lyre
du tumulus de
Koul-Oba, qui
a
chapp
l'attention de M.
Hauser,
vient nous
per-
mettre de lui donner tort en cartant la dernire diffi-
cult. On
y reconnat,
finement
grav
sur
l'ivoire,
un
pan
d'toffe
pliss,
termin en
queue
d'aronde,
dont
l'analogie
avec la ceinture de
l'Apollon,
sur le bas-
relief de
Kertch,
ne
laisse
absolument rien dsirer
(fig. 44). Or,
nous avons l une oeuvre ionienne de 430
environ,
dcouverte dans la mme
rgion que
le bas-
relief de Kertch
et, par suite,
nettement concluante
en faveur de
l'opinion que
nous soutenons. Cette
opi-
nion,
c'est
que
l'archasme ionien du
premier
tiers du
ve sicle nous est
peu prs
inconnu
; que
nous avons trs
peu
de documents dats sur la suite de cette
tradition,
tant Athnes
qu'en pays
ionien
;
que, par
suite,
nous
ne
pouvons
rcuser comme archasants les monuments
qui
nous
restent,
sous
peine
de ne
pouvoir expliquer
les
caractres d'un archasme factice
qui
n'aurait
pas
eu, pour
modle et
pour
soutien,
un archasme rel.
J 'arrive au dernier
point
: est-il vraisemblable
qu'on
ait recueilli
Panticape
l'oeuvre d'une cole de
sculp-
teurs archasants ?
Cela est tout fait invraisemblable
pour
deux rai-
sons. La
premire,
c'est
que
nous avons
reconnu,
dans
le
bas-relief du Muse
d'Odessa,
les caractres
propres
l'archasme ionien vers
470, que Panticape
est une
ville ionienne de
premire importance
fonde vers 540
et
qu'a priori
la dcouverte d'une vieille
sculpture
ionienne en cet endroit est la chose du monde la
plus
naturelle. En second
lieu, Panticape
n'a
pas
t,
comme
telles villes de
l'Italie,
comme Corinthe
elle-mme,
un
1.
Benndorf,
Griechische und Sicilische
Vasenbilder, pi. XI,
n 4.
218 UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
centre de civilisation et
d'lgance
l'poque
de la domi-
nation romaine : l'tude de la
ncropole
de
Kertch,
dont les
produits
sont
l'Ermitage
et
Odessa,
celle
de ses sries
montaires, qui
sont
reprsentes partout,
concordent
prouver qu'elle
tait alors
appauvrie
et dchue. On
conoit
un Pasitle
Rome,
en Cam-
panie,
Corinthe mme : dans la
Panticape romaine,
il n'et
pas
t
beaucoup
moins
dplac que
dans la
Tomi d'Ovide.
Quelques
statues
municipales
ou
imp-
riales, quelques
mauvais bas-reliefs
funraires,
d'un
style prmaturment byzantin,
voil ce
qu'il
fallait
alors ces villes dont le courant commercial s'tait
dtourn. Rome recevait son bl de la
Sicile,
de la Mau-
ritanie et de
l'Egypte,
et Athnes
elle-mme, dpeuple
et
appauvrie,
n'avait
plus
besoin de
payer
en oeuvres d'art ou
en artistes les rcoltes de la
Scythie
mridionale. L'Italie
seule,
cette
poque, pouvait
faire vivre un
sculpteur
archasant,
et nous
voyons,
en
effet,
que
les archasants
grecs
eux-mmes sont venus travailler dans ce
pays.
C'est
l
qu'ont
t dcouvertes celles de leurs oeuvres
signes
qui
donnent la mesure du vrai
style
d'imitation.
Dira-t-on enfin
que
ce bas-relief de
Kertch,
recueilli
dans les ruines d'une
glise
du xe
sicle,
a
pu y
tre
transport
au
moyen ge par quelque
bateau venant
de
l'Archipel
ou de la cte d'Asie ? Mais
qui
ne sent
combien cette
hypothse
est
gratuite
?
Qui
ne voit
combien le hasard aurait t
prvoyant
et rflchi en
restituant la
mtropole
des villes ioniennes du Bos-
phore
un monument de l'archasme ionien ?
On devine o tendent les conclusions de notre tude
;
mais il faut encore
prvenir
un malentendu
possible.
Le bas-relief de Kertch ne saurait tre une oeuvre ori-
ginale
au sens
strict, puisque
deux de ses
figures
au
moins se retrouvent dans des oeuvres
analogues.
On
n'admettra
jamais, par exemple, que
l'auteur du bas-
relief de
Panticape
ait eu sous les
yeux
celui de
UN BAS-RELIEF DE PANTICAPE
(KERTCH)
219
Corinthe,
ou
rciproquement.
Il est vident
que
l'un et
l'autre,
quelque poque qu'on
les
place,
ont d
puiser
une source
commune,
dans un trsor de
types
et de
motifs
qui
tait
devenu,
pour
ainsi
dire,
la
proprit
de tous. Un
dtail,
sur
lequel
on a
appel
mon
attention,
pourrait
mme donner
penser que
l'auteur de notre
relief a eu sous les
yeux
un monument circulaire
;
en
effet,
dans un monument de cette
forme,
on
compren-
drait mieux
que
dans une
composition plane
la situa-
tion
respective
de
l'Apollon
et de l'Herms
qui
se tour-
nent le
dos. Il a d
exister,
Athnes,
une ou
plusieurs
oeuvres
clbres,
remontant
l'poque
de
Cimon,
dont
les
figures
ou les
groupes
de
figures
sont entrs
rapide-
ment dans la circulation. Le mme fait s'observe dans
les bas-reliefs
d'poque postrieure,
ceux
qui repr-
sentent,
par exemple,
des batailles d'Amazones
;
les
mmes
types,
les mmes mouvements
y reparaissent
sans cesse et autorisent
l'hypothse
d'une source com-
mune,
telle
que
les
peintures
de
Micon,
excutes au
portique
Poecile Athnes.
En
rsum, je
ne conteste
pas
l'existence d'oeuvres
archasantes,
mais
je
crois
que
l'on est
toujours
dis-
pos
abuser de ce mot. Mme M.
Hauser,
dans sa
tentative de raction contre les ides
rgnantes,
a eu
tort de s'arrter mi-chemin.
N'ayant pas vu,
non
plus que personne vivante, l'original
du
puteal
de
Corinthe, je
ne veux
pas
mettre
d'opinion
formelle
cet
gard,
bien
que j'incline pour
de nombreuses
raisons vers le sentiment d'Otfried Mller et
que je
considre celui de M. Hauser comme mal fond. Mais
en ce
qui
touche le bas-relief de
Kertch, que j'ai
eu
l'occasion d'tudier de
prs, que j'ai
revu tous les
jours
pendant
des
semaines, je
crois avoir le droit de me
prononcer
nettement : c'est une oeuvre attico-ionienne
sculpte
vers l'an
470,
sous l'influence des modles
athniens
qu'admiraient
les
contemporains
de Cimon,
XI
LE J UPITER DE SAINT-CME
(
Lot
-
et
-
Garonne)
1
En
1857,
J . Boudon de Saint-Amans
publia
Agen
un in-8 illustr sous ce titre : Essai sur les
antiquits
de Lot-et-Garonne. A la
p.
198 de cet
ouvrage
est dcrite
la statuette de bronze
qui
fait le
sujet
du
prsent
article :
Petite statue de
J upiter
en bronze trouve Saint-Cme
prs d'Aiguillon.
On ne saurait voir en ce
genre
rien de
plus
parfait que
cette
figurine...
Cette
petite statue,
haute de six
pouces,
dont les
yeux
et les extrmits du
pnis
sont en
or,
appartient
M. le vicomte de
Vivens,
membre du Conseil
gnral
du
dpartement
de Lot-et-Garonne.
La
planche
XXII du livre de Boudon donne une
mdiocre
gravure
au trait de la statuette
;
faute de
mieux,
et en cherchant o avait
pass l'original, je
l'ai
fait
reproduire
dans le
Rpertoire
de la statuaire
(1898,
t.
II,
p. 10,
n
2).
Trois ans
plus tard,
en
juillet 1901,
cette
statuette,
appartenant
alors au
marquis
du
Poyen,
Barry prs
de Clairac
(Lot-et-Garonne),
fut offerte aux Muses
nationaux. J e
pus l'acqurir pour
le Muse de Saint-
Germain au
prix
modr de 1.250 francs.
Cette
figurine
a
presque
exactement 0 m. 15 de
1.
[Publi
en,
anglais
avec une
planche
en
ph.ototypie
dans le
J ournal
of
Roman
Studies,
t.
I, 1911, p. 64-67.]
LE J UPITER DE SAINT-COME 221
haut
;
elle est couverte d'une belle
patine vert-sombre,
qui prend
une teinte vert-clair sur le bras droit. La
surface du torse n'est
pas
en trs bon tat
;
il
y
a de
nombreuses rosions. La main
gauche
est
presque
dtache du bras
;
un trou assez
grand
se voit au
revers de la cuisse
gauche.
Il n'est
pas exact,
malgr
l'affirmation de
Boudon, que
les
yeux
et l'extrmit
du
pnis
soient en
or;
ce dernier semble seulement avoir
t frott et a
pris
l'clat du cuivre
pur.
Les
yeux
sont
incrusts
d'argent
et les
globes
oculaires concaves.
J 'ai lieu de croire
que
les extrmits des
pectoraux
FIG.
45,
46.
Le
J upiter
de Saint-Cme
(Lot-et-Garonne).
222 LE J UPITER DE SAINT-COME
taient
galement
incrustes
d'argent
;
mais le
mtal
prcieux
a
disparu
et la
prsence
n'en est
plus
atteste
que par
deux
petites dpressions
circulaires. Les san-
dales sont d'un travail trs
soign
et d'une
parfaite
conservation.
Il ne
peut y
avoir de doute au
sujet
des attributs.
La main
gauche,
entr'ouverte,
donnait
passage
un
sceptre ;
la main droite tient le manche d'un
foudre,
dont la
partie
infrieure a t brise.
Le
type reprsent par
ce bronze est bien connu et
t
l'objet,
dans ces derniers
temps,
de nombreuses
tudes. La liste des
rpliques,
donne
par Overbeck 1,
a t
pourvue
d'un
complment par
M.
Amelung
et
pourrait
encore tre accrue l'aide de mon
Rpertoire.
J usqu' prsent,
on n'a
signal qu'un
seul
exemplaire
en marbre et c'est une
petite
statue de Zeus conserve
Palerme 2. Le mme
motif,
trait dans un
style
archa-
sant,
parat
sur le bas-relief bien connu du
Vatican,
dcoration d'un candlabre dcouvert dans la villa
d'Hadrien Tibur 3. Les autres
rpliques
sont en bronze*.
La
plus soigne
et
peut-tre
la
plus
semblable l'ori-
ginal
est une statuette
exquise
de Florence
qui,
comme
l'a montr M.
Amelung,
offre
beaucoup d'analogies
avec
l'Apollon
de
Cassel,
bien
qu'elle
drive d'une
statue un
peu plus
tardive 5. M.
Amelung
est revenu
sur ce
sujet
dans le dernier volume de son
grand
cata-
1.
Overbeck, Kunst-Mythologie,
t.
II, p.
14. La
premire
statue
de la liste
d'Overbeck,
autrefois chez le comte J ames de
Pourtals,
est maintenant au Muse Cond
Chantilly ;
elle a t dcouverte
Besanon,
en mme
temps qu'une
Athna archasante
publie
par
M.
Heuzey
dans les Monuments
Piot,
t.
IV, pi.
1-2.
2.
Arndt-Amelung, Einzlaufnahmen,
n. 547.
3.
Visconti,
Mus. Pio
Clem.,
t.
IV, pi.
2.
4. Il existe aussi des imitations du mme
type
dans une
peinture
(Gazette archol., 1883, pi. 15)
et sur
plusieurs
monnaies.
5.
Amelung,
Florentiner
Antiken,
n. 7 et Fiihrer in
Florenz, p.
263.
Il
y
a une bonne
lithographie d'aprs
cette statuette dans la Kunst-
mythologie d'Overbeck,
t.
II, fig.
17.
LE J UPITER DE SAINT-COME 223
logue
des
sculptures
du
Vatican,
propos
du cand-
labre archasant de la Galleria dlie statue 1. La
figure
de
Zeus, crit-il,
drive incontestablement d'un modle
appartenant
au troisime
quart
du ve sicle
;
nous
pos-
sdons encore
plusieurs copies
de
l'original, parmi
les-
quelles
un trs beau bronze de
Florence,
qui
est cer-
tainement de travail
grec. L'original
doit avoir t
sculpt
l'poque
de la
jeunesse
de Phidias. M. Hauser
a
prouv qu'il
tait connu Athnes
;
M.
Amelung,
qu'il
tait clbre
l'poque impriale
et
que
le
type
s'en
rpandit
dans tout
l'Empire ;
mais il nous est
impossible
d'en
dsigner
l'auteur.
D'autres
archologues
ont t moins rservs. M. Bo-
tho
Graef 2,
avec l'assentiment de M.
Furtwaengler,
mit ce
type
en
rapport
avec l'art de Phidias
(in
Ver-
bindung
mit dem
phidiasischen Kreis)
et M.
Perdrizet,
insistant sur
l'expression placide
et bienveillante
du
visage
dans la
rplique
de
Florence,
a
assign
l'original
Phidias lui-mme 3. M.
Furtwaengler,
frapp
de l'absence de
rpliques
en
marbre,
sup-
posa jadis que l'original pouvait
avoir t lui-mme
une
statuette,
tout en
admettant,
dans une
note, que
la statuette en marbre de Palerme ressemblait beau-
coup,
mme dans les
dtails,
au bronze florentin. Cela
suffit
prouver, je crois, que l'original
n'tait
pas
une
statuette. Si nous
considrons,
d'autre
part, que
la
mme attitude des bras
parat
dans
plusieurs
statues
du milieu du ve
sicle,
ainsi
que
dans des
copies
et
imitations romaines de
pareilles statues*,
en
particu-
lier dans le
roi
hroque
de Munich et
l'Apollon
du
Muse national
Naples,
nous ne
pouvons gure
viter
1.
Amelung, Sculpturen
des Vaticanischen
Musums,
t. II
(1908),
p. 634-635,
n 413.
2. Aus der Anomia.
p.
69.
3. Article
J upiter
dans le Dictionnaire des
Antiquits, p.
703.
4.
Brunn-Bruckmann,
n"
3
122, 301, 302, 462,
463.
224 LE J UPITER DE SAINT-COME
la conclusion
que
Phidias ou
Calamis,
mais
plus
vrai-
semblablement le
premier,
doit tre l'auteur de ce
type
de Zeus
debout,
si
frquemment
imit
par
les bronziers
l'poque d'Auguste. Or,
comme le mme
type
se
voit dans des statues un
peu
antrieures
Phidias,
p.
ex.
l'Apollon
de
Cassel,
il faut admettre
que
Phi-
dias,
ici comme
ailleurs,
n'a
pas cr,
mais seulement
modernis. Une statue de bronze due Phidias devait
ncessairement trouver
beaucoup
d'amateurs
l'poque
d'Auguste
;
celle
d'Hadrien,
le
sculpteur
du cand-
labre de Tibur
peut
avoir fait une concession
l'esprit
d'archasme alors la mode en
prenant pour modle,
non la statue de
Phidias,
mais une de celles
qui
lui
avaient
fray
la voie. M.
Furtwaengler
a trs
juste-
ment fait
remarquer que
le
J upiter
du candlabre
avait t
qualifi
tort de
rplique par
M.
Graef;
c'est, disait-il,
une imitation
libre,
fortement
modifie,
traduite dans un
style plus
svre,
avec une coiffure
tout fait diffrente et une
draperie qui
diffre
gale-
ment. Mais
pourquoi
attribuer l'artiste romain
cette
traduction en un
style plus
svre
,
au lieu de
croire,
comme
j'en
ai la
conviction, que
cet artiste
prenait pour
modle une
statue
plus
ancienne de la
mme
ligne, probablement
des environs de l'an
460,
dont celle de Phidias tait elle-mme une
adaptation
?
Le
procd d'adaptation
a t
pratiqu pendant
toute la dure de l'art
antique,
alors
que
la tendance
moderne
l'originalit,
la dcouverte de thmes
nouveaux,
tait,
sinon
inconnue,
du moins
beaucoup
plus
rare
qu'aujourd'hui.
Les artistes
provinciaux
de
l'poque d'Auguste
n'ont
pas
invent
l'clectisme,
non
plus que
leurs matres de
l'poque hellnistique
;
ils ont
simplement persvr
dans une ancienne tradition.
Les
sculpteurs
en
marbre,
comme l'a montr Furt-
waengler, copiaient souvent,
et
copiaient
servilement,
puisqu'ils
se servaient de
moulages
excuts sur des
LE J UPITER DE
SAINT-COME 225
bronzes
;
mais des artisans d'un
ordre
infrieur,
qui
fabriquaient
des statuettes de bronze
pour
des
temples
ou deslaraires
privs,
ont d travailler aussi
d'aprs
des
recueils de dessins
qu'ils
combinaient et modifiaient
librement 1. C'est
pourquoi
nous
possdons
si
peu
de
bronzes
qui puissent
tre considrs comme des
copies
fidles
d'originaux
clbres,
alors
que
nous en avons
des centaines
qui
sont des variantes
plus
ou moins libres
de ces chefs-d'oeuvre. Si les imitations du
type
de Zeus
dont nous nous
occupons
ici taient toutes moules et
runies,
nous reconnatrions sans
peine qu'il n'y
en
a
pas
deux
qui
soient
identiques.
Le bronze de Saint-
Cme offre comme la combinaison du dessin de Phi-
dias,
du model de
Polyclte,
de la libert
d'expression
et de traitement de
Lysippe (dans
la
face,
les cheveux
et la barbe du
dieu).
On
peut
en dire autant de la
plus
grande
et de la
plus
belle statue de Zeus
qui
ait t
dcouverte en
Gaule,
celle du Viel-Evreux 2. En
publiant
le
premier (1890)
une
reproduction digne
de ce chef-
d'oeuvre, j'mis l'opinion qu'il
tait
lysippen, parce
que j'avais
surtout t
frapp par
la tte et
parce que
Furtwaengler
n'avait
pas
encore crit ses Meisterwerke.
Aujourd'hui, je pense que
la tte est
lysippenne
et le
corps polyclten,
ou,
du
moins,
imit d'un modle
du ve sicle. Ce n'est
pas
une
copie
d'un
original clbre,
mais une
combinaison,
une
adaptation
d'un
type
svre
au
got
d'un
public
tout
imprgn
du
baroque grec
et
qui
ne
pouvait pas
renoncer
compltement
son amour
de 1' effet . Pour me servir des termes de
Michaelis,
ce bronze
gallo-romain,
comme tant
d'autres,
est le
1.
Voir,
ce
sujet,
les observations de
Furtwaengler
sur l'herms
de bronze
polyclten
trouv en
Gaule,
conserv au Muse britan-
nique (Meisterwerke, p. 427.)
2. J 'ai
publi
deux excellentes
hliogravures
de cette
statue,
l'une
dans YAlbum
(inachev)
des Muses de
procince (1890),
l'autre en
frontispice
des Bronzes
figurs
de la Gaule romaine
(1894).
S. REIXACH 15
226 LE J UPITER DE SAINT-COME
produit
d' une tendance
artistique... qui
combinait
l'imitation des
exemplaria grseca
de
l'poque classique
avec les
conqutes
de
l'poque
hellnistique
dans les
domaines de la
technique
et du
style
1.
Entre Saint-Cme et
Aiguillon,
o le
J upiter aujour-
d'hui Saint-Germain a t exhum en
1827, passe
la
voie romaine de Bordeaux
Agen
;
au
voisinage
s'lve une tour massive
qui
a environ 4 mtres de
haut et 9 mtres de
diamtre]
2.
Aiguillon (Acilio ?)
marque
certainement
l'emplacement
d'une ville cel-
tique, plus
tard
gallo-romaine ;
on
y
a dcouvert des
monnaies des Volkes
Tectosages
3. J e ne sache
pas qu'on
y
ait
pratiqu
des fouilles
;
la dcouverte du
J upiter
a sans doute t due au hasard. Mais la rencontre d'une
statuette aussi
prcieuse,
dans une
rgion
o les bronzes
romains sont relativement
rares, implique,
semble-
t-il,
l'existence d'un
temple ou,
du
moins,
celle d'une
riche villa avec lararium. Des
archologues disposs
remuer le sol devraient bien
y
aller voir.
1.
ine kiXnstlerische
Richtung...
welche den Anschluss an die
exemplaria graeca
der klassischen Zeit mit den technischen und
stilistischen
Errungenschaften
der hellenistischen
Epoche
cerband
(J ahrbuch
der
Instituts, 1898, p. 197.)
2.
Boudon, op. cit., p.
23.
3. Dictionn. archol. de la
Gaule,
s. v.
Aiguillon.
XII
UN HRACLS DE POLYCLTE
Dans ses
Schriftquellen, ouvrage publi
en
1868,
Overbeck
distinguait
encore deux statues d'Hracls
par Polyclte,
un Hracls
Hageter
Rome et un Hra-
cls tueur de
l'Hydre (Hydratdter)
2. Pour l'Hracls
Hageter,
le
professeur
de
Leipzig
se fondait sur un
passage
de Pline dont la
ponctuation,
rtablie avec
certitude de nos
jours,
ne
permet plus
d'admettre
que
le mot
Hageter
soit une
pithte
d'Hercule. Voici
le texte
(Pline, XXXIV, 56)
:
Polycletus... fecit...
Mercurium
qui fuit Lysimachise,
Herculem
qui Romse,
hageter
a arma sumentem...
Donc,
Polyclte
tait l'au-
teur d'un Mercure
qui
fut
Lysimachie,
d'un Hercule
qui
tait Rome
(du temps
de
Pline)
et enfin d'un chef
militaire
(pj-njp)
au moment de
prendre
les armes. On
a
remarqu que
la forme dorienne de ce mot
(frypp pour
*rCF4?) prouve que
la source
grecque que
suit ici Pline
drivait elle-mme d'une
pigramme place
sous
l'image
du
guerrier
en
question.
L'Hracls tueur de
l'hydre
tait
attest,
aux
yeux
d'Overbeck, par
un
passage
du De Oratore de Cicron
(II, 16, 70) qui
ne
parat pas
avoir t bien
interprt
par
les
archologues.
Cicron dit
que lorsqu'on
s'est
1. Mmoire lu l'Acadmie des
Inscriptions
en 1908
(Comptes
rendus, p.
480
;
cf. Rec.
archol., 1908, II, p. 107,
o a
paru
un rsum
de ce
mmoire). [Ici d'aprs
Reue des tudes
anciennes, 1910, p. 1-19].
2.
Overbeck, Schriftquellen,
n** 944 et 945.
228 UN HERACLES DE POLYCLETE
rendu
capable, par
l'tude ou la
pratique,
de discuter
les
affaires,
on
trouve
facilement,
en toute
circonstance,
des mots
pour exprimer
ce
que
l'on veut dire : hune de
toto illo
gnre reliquarum
orationum non
plus quaesi-
turum esse
quid dicat, quam
Polycletum
illum,
cum Her-
culem
fingebat, quemadmodum
pellem
aut
hydram fingeret,
etiamsi haec
nunquam sepa-
ratim
facere
didicisset.
Th. Gaillard a traduit
par-
faitement cette
phrase
: On
n'est
pas plus
embarrass
pour exprimer
tout ce
qu'on
veut dire
que
ne le fut
Poly-
clte,
en travaillant son
Hercule, pour
rendre
l'hydre
ou la
peau
du
lion, quoiqu'il
n'et
jamais
fait une tude
particulire
de ces dtails 1.
Donc,
il n'est
pas question
ici
d'Hercule tuant
l'hydre.
M.
Collignon
crit,
dans son
Histoire de la
Sculpture
grecque (t.
I, p. 502)
:
Poly-
clte avait trouv dans le
cycle hroque
le
sujet
de
quelques-unes
de ses statues.
Tel tait l'Hracls tuant
l'hydre
de Lerne et couvert
de la
peau
du lion de
Nme;
ce bronze avait t
transport
Rome.
Les mots
que j'ai souligns
ne sont
pas
autoriss
par
les textes. D'autre
part,
il est
possible
1.
Cicron,
d.
Nisard,
t.
I, p.
232.
FIG47.
Hercule de bronze
del'ancienne collection W. Rome
UN HRACLS DE POLYCLETE 229
que
M.
Collignon
ait raison d'identifier
la statue
signa-
le
par
Cicron
lequel
ne dit
point qu'elle
ft
Rome
avec celle dont
parle Pline,
en disant
express-
ment
qu'elle s'y
trouve
;
mais il
n'y
a l
qu'une
possibilit,
non une certitude.
Revenons au texte de Cicron.
Puisqu'il
ne dit
pas
qu'Hercule
est
reprsent
combattant
l'hydre,
ou la
tuant,
il faut
expliquer
autrement la mention de
l'hydre
dans ce
passage.
J e trouve cette
explication
dans deux
demi-vers de l'Hercule
furieux
de
Snque (v. 45-46).
J unon,
dont le
long
discours ouvre cette
tragdie,
dcrit Hercule de
faon
trs
plastique
et comme si le
pote
avait eu sous les
yeux
ou dans
l'esprit
une statue
du hros :
Pro telis
gerit
Quae
timuit et
quae fudit
: armatus cenit
Leone et
hydra.
C'est--dire
que
les armes d'Hercule sont les ennemis
qu'il
a redouts
1
et terrasss : il vient arm du lion et de
l'hydre. Quelques
commentateurs
prtendent que
cela
veut dire : Hercule est vtu de la
peau
de lion et arm
de flches
trempes
dans le
sang
de
l'hydre.
C'est l
une
glose
absolument inadmissible
;
l'Hercule de
Snque
porte
la
peau
du lion et la
peau
de
l'hydre
comme des
trophes,
comme des
dpouilles
de monstres vaincus
dont il se
pare, peut-tre
aussi
(dans
la tradition
pri-
mitive)
comme des armes
magiques, comparables
au
Gorgoneion
d'Athna ou de Perse. Pellem
(leonis)
aut
hydram,
crit Cicron
;
leone et
hydra,
dit
Snque.
La concordance est
parfaite. Remarquons
toutefois
que
Cicron dit
pellem
aut
hydram ;
cela
n'implique
pas
absolument
que
la statue dont il
parle
ft revtue
la fois de deux
peaux,
mais
qu'une
statue d'Hercule
pouvait
runir ces deux attributs.
Donc,
supposer
1. Timuit
;
ne faut-il
pas
crire domuit ?
230 UN HRACLS DE POLYCLTE
que
l'Hercule de
Polyclte,
mentionn
par
Cicron,
soit
identique
celui dont
parle
Pline et celui
que
Snque
avait en
vue,
il
y
a tout au moins une
possi-
bilit
que
cette statue clbre se soit
distingue par
deux
attributs du
hros,
la
peau
du lion et la
peau
de
l'hydre;
il n'est
pas question
dans ces textes de la massue.
Botho Graef et
Furtwaengler
1
ont
propos
de recon-
natre non
pas
la
copie,
mais l'imitation d'une tte
d'Hracls due
Polyclte
dans un buste d'Herculaneum
dont il existe
plusieurs rpliques.
Le buste en
question
est certainement
polyclten ;
mais comme la tte
est
nue,
sans autre attribut
qu'un
bandeau,
il
n'y
a
pas
de raison
pour y
voir Hracls
plutt qu'un
athlte,
un
vainqueur
aux
jeux.
De mon
ct,
en
publiant
la tte du Louvre
qui
porte
le nom d'Iole ou
d'Omphale,
cause du mufle
de lion
qui
la couvre
(fig. 47), j'en
ai
signal
les
caractres
polycltens
: Il
faut, disais-je, que
l'ar-
tiste se soit
inspir
d'oeuvres
plus
anciennes,
car les
yeux
trs
ouverts,
le nez et la
bouche,
avec sa forte
lvre
infrieure,
se rattachent l'art de
Polyclte
2.
Avant
moi,
M.
Sieveking, parlant
de cette tte dans
une note de l'article
Omphale
du Lexikon de Roscher
(p. 892),
avait mis
l'opinion qu'il
fallait
y
voir un
Hracls
juvnile
de la fin du ve
sicle,
fminis
par
une restauration arbitraire. Cette dernire observa-
tion est
inadmissible,
car la restauration a
port
seu-
lement sur une
partie
du front et du sourcil
gauche,
la
peau
de lion derrire et sur les cts du
visage,
l'oreille
et les cheveux
droite,
le cou et le buste. Comme le
buste s'arrte au-dessus des
seins,
dont il
n'y
a
pas
la
moindre
indication,
on ne
peut
incriminer le restaura-
teur. Mais M.
Sieveking
semble nanmoins avoir eu
1. Athen.
Mitth., 1889, p.
202
; Masterpiecet, p.
234.
2. S.
Reinach,
Ttes
antiques, pi. 193, p.
154.
UN HRACLS DE POLYCLTE
231
raison de considrer cette tte
comme virile et il a
FIG. 48.
Prtendue Iole ou
Omphale.
Muse du
Louvre,
(d'aprs Bouillon).
232 UN HERACLES DE POLYCLETE
certainement t dans le vrai en la
rapportant
un
prototype
du ve sicle.
Une tte d'Hercule
analogue
et coiffe de
mme, qui
appartient
au Muse de
Berlin,
a t
publie par
Furt-
waengler
1. Le savant
archologue y
reconnaissait une
oeuvre du ve
sicle,
mais ne
risquait pas
d'attribution
;
elle
appartient,
crivait-
il,
au
groupe
des
contemporains
de
Phidias,
mais avec une individualit
et un caractre
particuliers.
La forme
de l'oeil
y
est moins
polycltenne que
dans la
prtendue
Iole du
Louvre,
ce
qui peut
tenir la mdiocrit de la
copie.
La tte en bronze du
Doryphore,
au
Muse de
Naples, permet
de
prciser
trs exactement les caractres des ttes
viriles de
Polyclte, qui
se
retrouvent,
d'ailleurs,
dans le Diadumne
(fig. 49),
dans l'admirable Herms
polyclten
des Fins
d'Annecy (collection Dutuit),
dans le
Kyniskos
de Londres et dans
d'autres oeuvres de la mme srie. Yeux
trs
ouverts,
un
peu bombs,
avec
pau-
pires
fines,
dont la
ligne suprieure
dborde un
peu
sur le contour de 1
oeil, glandes lacry-
males
accuses,
nez fort et
large,
bouche
ondule, lg-
rement tombante aux
coins,
lvres
paisses
et sensible-
ment
gales
2. Ces
caractres,
ainsi
runis,
n'ont rien de
banal
;
ils
contrastent, par
leur
archasme,
avec ceux
des ttes
grecques
du ive
sicle,
et si les ttes des m-
topes
du Parthnon s'en
rapprochent plus que
celles
des
frises,
c'est
que celles-ci,
comme on l'a
dj reconnu,
1. Master
pices, p. 83, fig.
32.
2. S.
Reinach,
Ttes
antiques, p.
37.
FIG. 49.
Copie
romaine du Dia-
dumne de Po-
lyclte.Muse
du
Louvre.
UN HERACLES DE POLYCLETE 233
sont dues une cole un
peu
moins avance
que
celles-l.
J e crois
pouvoir
me fonder sur ces
critres,
ainsi
que
sur d'autres
que je signalerai plus
loin,
pour
reconnatre la
copie
exacte d'un Hracls de
Poly-
clte dans une admirable statuette en bronze haute de
9
pouces
et
demi, qui, aprs
avoir fait
partie
de la col-
lection de feu W.
Rome,
Londres,
a t vendue aux
enchres en dcembre 1907
(fig. 46).
W. Rome avait
expos,
vers
1892,
sa collection d'an-
tiques
au Guildhall. J 'eus l'occasion de
l'y
tudier
et
d'y
retrouver le vase
peint
figures rouges,
avec
une
image
d'Athna sur un
pilier, qui,
autrefois
dessin
par
Politi,
avait
disparu depuis longtemps.
Le
possesseur
me
permit
d'en faire excuter une
pho-
tographie
et des dessins
que j'ai communiqus
l'Aca-
dmie et
publis
dans la Revue des Etudes
grecquesx.
J 'avais d aussi
l'obligeance
de W. Rome des
pho-
tographies,
malheureusement
petite
chelle,
d'aprs
les
bronzes,
les terres cuites et les
objets gyptiens
de
sa collection. La statuette
qui
fait
l'objet
du
prsent
mmoire
n'y figure pas ;
sans doute W.
Rome,
qui
frquentait
les ventes de
Londres,
o il avait form sa
collection,
l'aura
acquise depuis
ma visite. La
photo-
graphie
me fut
envoye,
au commencement de
1908,
par
M.
Offord,
alors
que
la
statuette, qui
avait t
vendue 160 livres
(4.000 francs),
tait chez des anti-
quaires
de
Piccadilly,
MM.
Spink.
M.
Arndt,
de
Munich,
que j'interrogeai
ce
sujet
et
qui j'envoyai
une
preuve
de la
photographie,
me
rpondit que
cette
statuette, qu'il
considrait comme un
chef-d'oeuvre,
avait t
porte depuis par
des marchands
Munich,
o elle ne trouva
pas preneur,
et
de l
Vienne,
1. Reue des Etudes
grecques, 1907, p.
409. Ce beau vase a
depuis
pass
aux Etats-Unis.
234 UN HRACLS DE POLYCLTE
o il
pensait qu'un
collectionneur l'avait
acquise.
M. Arndt
ajoutait que
la
patine
en tait
irrpro-
chable et
qu'il
l'attribuait un atelier
grco-trusque,
mais
plutt grec qu'trusque.
A la
vrit,
il
importe
assez
peu
de savoir o cette statuette a t fondue
;
l'essen-
tiel,
c'est
qu'elle reproduit
un modle incontestable-
ment
grec,
incontestablement du ve
sicle, et, j'ajoute,
non moins incontestablement
polyclten.
Tous les
caractres du
style
de
Polyclte
se retrouvent dans
la
tte,
notamment la
grande
ouverture des
yeux
et
l'paisseur
des lvres. Le
type
est tout fait
imberbe,
d'accord avec l'observation de
Quintilien que Polyclte
n'a
jamais
reprsent
d'hommes barbus
(nil
ausus ultra
laeves
gnas).
La
pose,
avec le
poids
du
corps portant
sur une seule
jambe,
est celle dont les anciens attri-
buaient l'invention
Polyclte,
bien
qu'il
semble
n'avoir fait
que
la
populariser par
ses chefs-d'oeuvre.
La
position
de la main droite sur la hanche est celle
de deux
figures dj rapportes par Furtwaengler
et
d'autres
Polyclte, l'phbe
de la collection Bar-
racco
1
et la
Tych
de bronze de la
Bibliothque
Natio-
nale
2
; enfin,
le model des
pectoraux,
du
ventre,
des
jambes,
avec leurs
larges
surfaces
spares par
de
profondes dpressions,
la musculature accuse du bras
droit et du thorax sont autant
d'indices,
peut-tre
mme
exagrs par
le
copiste,
de
l'origine polycl-
tenne de ce bronze.
Remarquons,
en
passant, qu'alors
qu'on
ne connat
pas
encore une seule statuette de
bronze
qui reproduise
srement un
original
de
Phidias,
les oeuvres de
Polyclte
ont t souvent
copies
ou
imites en
mtal,
jusque
dans les ateliers
gallo-romains.
La
dpouille
du lion est noue sur le devant au-des-
sous du
cou,
enserre la
tte,
retombe sur le dos et les
1.
Furtwaengler, Masterpieces, p. 237, fig.
97.
2.
Ibid., p. 276, fig.
116.
UN HRACLS DE POLYCLTE 235
paules
et vient s'enrouler sur le bras
gauche
avanc. Ce
bras,
dont les
doigts
sont
briss,
tenait
peut-tre
la mas-
sue
que
le hros
appuyait
sur son
paule gauche
;
c'est l
un motif
que
l'on constate dans
plusieurs
statues d'Her-
cule. Parmi ces trs nombreuses
statues,
il en est
qui
montrent le hros la main sur la
hanche,
la massue
contre
l'paule,
la tte recouverte de la
peau
de lion
;
mais
je
n'en connais
pas qui
soit
identique
ou mme
analogue
dans son ensemble celle de la collection
Rome. Ce n'est
pas
l une raison
pour
mettre en doute
qu'elle reprsente
un
original
de
Polyclte,
car la
statue des Fins
d'Annecy
est dans le mme cas
;
on
n'en a
pas
encore
signal
de
rplique.
Du
reste,
les
statues d'Hercule
qui remplissent
nos Muses ont
presque
toutes t si fort restaures et souvent d'une
faon
si arbitraire
qu'une rplique
du bronze de la
collection Rome
peut
trs bien
s'y
dissimuler notre
insu 1.
En
1890,
M.
Heinrich-Ludwig
Urlichs a
publi
une
statuette
mutile, provenant
de Rome et conserve
au Muse universitaire de
Wurzbourg.
Elle
reprsente
Hracls
debout,
le bras
gauche
abaiss et tenant
sur ce bras la
dpouille
de
l'hydre,
dont la
tte,
qui
est
celle d'une
jeune fille,
vient
s'appuyer
contre son
paule (fig. 50, 51)
2. Le
style
de cette statuette
accuse,
sans doute
possible,
un
original grec
du ve
sicle,
assez
voisin de la
figure juvnile
de
Stephanos
la villa Albani.
Mais comme la
reprsentation
de
l'hydre
avec tte de
jeune
fille ne s'est
pas
encore rencontre avant
l'poque
1. M. A. Manier acru
justement
reconnatre l'influence d'un modle
polyclten
dans une statue en marbre
d'Hercule,
de la collection
de
Ny Carlsberg, qui
est traite dans le
style
de
Scopas.
Le
type
de
cette statue
rappelle
celui du bronze
que
nous
publions (Polyklet,
p. 143, fig. 46).
2. Cf. H. L. Urlichs. Herakles und die
Hydra,
1890
pi.
I
;
Bonn.
J ahrb., XCV, p.
90
; Arndt-Amelung, Einzelaufn.,
n
883, 884; Rp.
stat.,
t.
II, p.
238 et 796.
236
UN HERACLES DE POLYCLETE
hellnistique 1,
on a t tent de
supposer que
la sta-
tuette de
Wurzbourg
tait le rsultat d'une sorte de
contaminatio
opre
l'poque romaine,
de l'alliance d'un
type
ancien d'Hracls avec un
type beaucoup plus
rcent de
l'hydre. Toutefois,
M.
Bulle, auquel
s'est
prsente
cette
hypothse
2,
s'est
object
lui-mme
qu'une reprsentation gracieuse
et
simplifie
de
l'hydre
avait
pu
fort bien tre
adopte plus
tt
par
la
plastique
en ronde
bosse,
vu la difficult de
figurer plusieurs
ttes et cols de
serpent mergeant, pour
ainsi
dire,
d'un
grand corps.
Il
y
a certainement eu des contaminations
l'poque
romaine
;
mais il ne faut
en admettre
que
1. Rom.
Mitth., 1895, p.
210.
2. Dans le texte des
Einzelaufn.. p.
47.
FIG. 50.
Hercule et
l'Hydre
Statuette de
Wurzbourg.
FIG. 51.
Hercule et
l'Hydre.
Statuette de
Wurzbourg.
UN HRACLS DE POLYCLETE 237
lorsque
les lments d'une statue ou d'un
groupe
accu-
sent des diffrences inconciliables de date et de
style.
N'est-ce
pas
le cas de
rappeler
ici les textes de Cic-
ron,
de Pline et de
Snque que
nous avons cits
plus
haut ? Ces textes tablissent la
possibilit
de l'existence
d'une statue d'Hercule
par Polyclte, transporte
Rome ds
l'poque
de
Cicron,
dont le
type
tait
juv-
nile et
qui
tait reconnaissable deux attributs : la
peau
de lion et
l'hydre. Si,
au lieu d'une
massue,
la sta-
tuette de l'ancienne collection W. Rome
tenait,
comme
celle de
Wurzbourg,
la
partie
infrieure du
corps
de
l'hydre
de
la main
gauche
avance,
ne serions-nous
pas
autoris reconnatre
que
ce
type
d'Hrakls
l'hydre
remonte
Polyclte
et,
que
le
petit
bronze
qui
fait le
sujet
de ce mmoire nous a rendu une de ses
crations les
plus
clbres ?
XIII
UN PORTRAIT MYSTRIEUX
1
Une des
nigmes
les
plus
irritantes de
l'iconographie
antique
est celle
que pose
une tte de
vieillard,
la
bouche ouverte comme s'il chantait ou
dclamait,
la
physionomie nergique
et
intelligente,
la face et le col
sillonns de rides
profondes,
les cheveux
hirsutes,
la
barbe courte et
irrgulire
;
on en connat environ
trente
exemplaires,
tous malheureusement
dpourvus
d'inscription.
Bien
que plusieurs
des
rpliques
de ce buste
soient d'une
antiquit
douteuse,
la
plupart
sont certai-
nement
authentiques.
Celles dont la
provenance
est ta-
blie ont t dcouvertes en Italie ou en
Afrique ;
on n'en a
encore trouv ni en Grce ni en Asie Mineure 2. Le
plus
bel
exemplaire,
en
bronze,
a t recueilli dans la villa
des Pisons
Herculaneum,
en
compagnie
de trois
autres bustes
galement anonymes,
mais o l'on incline
reconnatre des
philosophes.
Dans un seul
exemplaire,
dcouvert Rome et conserv au Muse des
Thermes 3,
la tte est ceinte d'une couronne de lierre
;
nous verrons
plus
loin
l'importance
de ce dtail.
Depuis
Fulvio
Orsini,
on
proposa
de reconnatre
dans cette tte celle de
Snque
le
philosophe,
en se
1.
[Reue archol., 1917, II, p. 357-368.]
2. La
provenance grecque assigne
l'exemplaire
de l'ancienne
collection Somze
repose
sur un on-dit sans valeur.
[Une
bonne r-
plique
a t trouve au thtre de
Carthage;
nous la
reproduisons
ici,
fig. 52].
3.
Bernoulli,
Griechische
Ikonographie,
t.
II, pi.
XXII.
UN PORTRAIT
MYSTERIEUX
239
fondant sur
l'analogie prtendue
des traits avec ceux de
Snque
sur un mdaillon contorniate
aujourd'hui
perdu, qui appartenait
alors au Cardinal Maffei. Cette
dsignation
fit fortune
; ainsi, lorsque
Rubens voulut
reprsenter
la mort de
Snque,
il donna au
philosophe
romain les traits du
portrait qui
nous
occupe
1. Mais elle
a t
dfinitivement
ruine,
en
1813,
par
la dcouverte
d'un herms double de Socrate et de
Snque, dsigns
par
leurs
noms, qui
est
aujourd'hui
au Muse de Berlin
(n 391). Snque y
est
reprsent,
comme il fallait
1. A l'ancienne
Pinacothque
de Munich
(A. Rosenberg,
P. P.
Rubens, p. 28.)
FIG. 52.
Tte dcouverte
au thtre de
Carthage.
240
UN PORTRAIT MYSTRIEUX
s'y
attendre,
sous les traits d'un Romain
d'ge mr,
compltement
ras;
il n'a rien de com'mun avec le
type
du vieillard barbu
1
(fig. 53).
Tous les savants
modernes,
sauf
Comparetti,
se sont
accords voir dans le
vieillard,
barbu un Grec.
Compa-
retti
prtendit y
reconnatre
Calpurnius
Pison,
le rival
de Cicron
;
mais cette
hypothse
n'a t
accepte
de
personne
et n'est
rappele
ici
que pour
mmoire.
Presque
tous les savants ont vu dans le vieillard
barbu un
pote
;
la seule
exception
est Bernoulli
qui
propose,
mais trs
dubitativement, d'y
voir le docte
Eratosthne. Cette
dsignation
ne tient
pas compte
de la couronne de lierre
qui
ceint la tte de
l'exemplaire
du Muse des
Thermes;
il
y
a d'autant moins lieu de
la discuter
que
l'auteur ne
parat pas y
attacher
beaucoup
de
prix
lui-mme et termine une excellente
tude sur notre buste en
disant
qu'il
faut renoncer
pour
le moment le dnommer 2.
Parmi les autres
archologues qui
ont considr
ce
portrait
comme celui d'un
pote grec,
la
plupart
ont
song
un
pote
de
l'poque
alexandrine. Il
est,
en
effet,
vident
que
le travail raliste de
l'original
d'o drivent toutes nos
rpliques
-
original qui
devait
tre une oeuvre d'art de
premier
ordre
remonte au
nie ou au 11e sicle avant notre re et se rattache soit
l'cole
grco-gyptienne,
soit l'une des coles
grco-
asiatiques
de ce
temps.
Le
style
offre une
parent
vi-
dente avec celui de marbres bien
connus,
comme la
Femme ivre de
Munich,
le Vieux
pcheur
du
Vatican,
la Marchande au
panier
de
New-York,
les
portraits
1.
D'aprs
la
premire publication,
trs
bonne,
de Lorenzo
R,
Seneca e Socrate.
Erme
bicipite,
1816 (Dissert. Accad. Romana, I, p.
188).
2.
Bernoulli,
Griechische
Ikonographie,
t.
II, p.
160-177. J e renvoie
cette tude
pour
les rfrences aux travaux modernes sur le mme
sujet.
UN PORTRAIT MYSTERIEUX
241
d'Homre au Louvre et ailleurs. M. J an
Six,
professeur
Amsterdam,
a mme
essay
de dterminer
l'auteur,
qui
serait celui de la Femme
ivre, copie
d'un
original
que
Pline attribue tort au clbre
Myron
;
ce
Myron
serait le
sculpteur
de
Thbes,
connu
par
une
signature
sur une
base de
Pergame
et
qui
aurait
pu
fort bien
travailler aussi
Smyrne,
o
l'original
du buste d'Ho-
mre
pourrait
avoir t
sculpt par
lui. Cette
ingnieuse
conjecture
est fonde sur des indices assez
faibles,
mais
n'en est
pas
moins
digne
d'attention.
Myron
de Thbes
tait actif vers l'an 250 avant J .-C.
On a le choix entre les
potes
de
l'poque
alexandrine,
parce que,
peu d'exceptions prs,
il n'en est
pas
dont
on connaisse avec certitude la
physionomie.
Pourtant,
il
faut,
pour qu'une dsignation
de notre
portrait
soit
S. REINACH 16
FIG. 53.
Herms double :
Snque
et Socrate. Villa Albani Rome.
(Muse
de
Berlin)
242 UN PORTRAIT MYSTRIEUX
vraisemblable,
tenir
compte
de trois
lments,
savoir :
1 ce
qu'il y
a de hirsute et
d'agreste
dans le modle
;
2 son
grand ge;
3 la clbrit dont
tmoigne
le
grand
nombre des
rpliques
dcouvertes en Italie.
Ces considrations
permettent
d'carter les
noms,
mis en avant et
parfois accepts,
de
Callimaque,
de
Philtas,
de
Thocrite,
qui
furent, plus
ou
moins,
des
potes
de
cour,
certainement des
potes
bien
peigns
,
ainsi
que
celui de
Philiscos,
pote tragique (qu'on
veut
maintenant confondre avec le
pote comique
du mme
nom),
dont la
grande rputation
l'poque
romaine
n'est ni avre ni vraisemblable.
En
revanche,
le nom de
Philmon, propos par
M.
Studniczka, parat,
au
premier
abord,
bien
justifi.
M. Studniczka se fonde surtout sur un herms
double,
dcouvert
Rome,
o la tte du
pseudo-Snque
est
accole celle d'un
jeune
homme imberbe en
qui, par
d'autres
raisons,
il reconnat Mnandre. La
juxtapo-
sition de Mnandre et de
Philmon,
le
plus
illustre et
le second
pote
de la comdie
nouvelle,
se
conoit
sans
peine,
comme celle d'Homre et
d'Hsiode,
de
Thucy-
dide et
d'Hrodote,
etc. En
outre,
nous savons
que
Phi-
lmon a vcu
prs
d'un
sicle,
tandis
que
Mnandre
est mort
cinquante-deux ans;
le contraste entre le
jeune
homme et le vieillard n'aurait
pas
besoin d'autre
explication.
Pourtant, quelque
sduisante
qu'elle soit,
cette
hypothse
est
insoutenable,
et cela
pour
les raisons
que
voici : 1
Philmon,
bien
que
lou
par Quintilien
et
compar par Apule
Mnandre,
est loin d'tre un
des
potes grecs
dont les Romains ont fait
grand cas;
pourquoi
le
portrait
isol de Philmon aurait-il t si
souvent
copi
en Italie ? 2 En
admettant,
ce
qui
n'est
pas prouv,
mais
parat
trs
vraisemblable, que
le
pen-
dant du
pseudo-Snque
soit
Mnandre,
il faudrait
que
son
contemporain
et concurrent ft
reprsent
imberbe
UN PORTRAIT MYSTERIEUX 243
comme lui. Le fait
que
Philmon
atteignit
un
ge
trs
avanc
n'explique
nullement
qu'on
l'ait
oppos
M-
nandre comme un vieillard un homme
jeune.
De
Philmon, qui l'emporta plus
d'une fois sur son
rival,
il devait
exister,
comme de
Mnandre,
un ou
plusieurs
portraits
le
reprsentant
la fleur de
l'ge ;
ce sont
ces
portraits-l qui
auraient t
copis
l'poque gr-
co-romaine.
Lorsqu'un
portrait
devenu
classique repr-
sente un
pote
trs
g
l'exemple qui
s'offre natu-
rellement est celui d'Homre
c'est
que
ce
pote
est devenu clbre dans sa vieillesse seulement. Homre
a t
jeune
comme tout le
monde,
mais l'histoire
littraire ne connat
que
le divin vieillard
aveugle
;
c'est sous ces traits
que
l'art l'a
reprsent
et le
figure
encore. Il
n'y
avait aucune raison d'en
agir
de mme
avec Philmon.
Comme
je
l'ai
dj dit,
il existe une ressemblance
trs troite entre le buste souvent
copi
d'Homre
et celui du
pseudo-Snque ;
cette ressemblance est
telle,
surtout dans la
rgion
des
yeux
on la cons-
tate trs facilement sur une
planche
de
l'ouvrage
de
Hekler,
o les deux
ttes,
orientes de
mme,
sont
jux-
taposes
1
que j'ai
t
tent,
pendant quelque temps,
de voir
simplement,
dans le
second,
un autre
type
d'Ho-
mre,
un Homre non
plus
calme et
silencieux,
mais
obissant
l'inspiration qui l'agite.
Il
est,
en
effet,
bien certain
qu'il
a d exister
plusieurs types
d'Ho-
mre;
on n'a aucune raison de croire
que
le beau
type
d'o drive
l'exemplaire
du Louvre ait t le seul et
j'ai
montr moi-mme
qu'un
type
assez diffrent exis-
tait
Smyrne,
en
publiant
une tte en terre cuite
trouve dans cette ville et
qui reprsente
certainement
Homre 2.
Pourtant, j'ai
renonc mon
hypothse
avant
1. A.
Hekler,
Greek and Roman
Portraits, p.
118.
2.
Mlanges
H.
Weil, p.
407 et suiv.
244 UN PORTRAIT MYSTERIEUX
de l'avoir
exprime,
cause du caractre
inquiet
et
tourment de la
physionomie
du
pseudo-Snque ;
on
pouvait
concevoir ainsi un
philosophe,
un
satirique,
peut-tre
un
lyrique,
mais
Homre,
mme
inspir
et
dans l'acte de rciter ses
pomes,
ne devait
pas
tre
compltement dpourvu
de la srnit
olympienne
dont son oeuvre entire est comme claire.
Que
l'Homre soit un
portrait
de
fantaisie,
bien
qu'videmment sculpt d'aprs
un modle
vivant,
c'est ce
que
nous savons
par
Pline et ce
que
nous sau-
rions d'ailleurs sans
lui,
puisqu'il
ne
peut
tre
question
de
portraits grecs
ralistes ou mme ressemblants avant
le milieu du ve sicle environ. Mais
l'analogie
de l'Ho-
mre avec le
pseudo-Snque
une fois
constate,
on
pouvait
se demander si le
pseudo-Snque,
bien
que
drivant comme l'Homre d'un modle
alexandrin,
n'tait
pas,
lui
aussi, l'image
conventionnelle de
quelque
homme illustre de la vieille Grce dont on n'avait
pas
de
portrait authentique.
Pariunt desideria non tra-
ditos
ultus,
comme le dit Pline
propos
du
portrait
d'Homre
1
;
le
pieux
besoin de se rendre
prsents
les
grands
hommes a fait
imaginer
leurs
portraits.
Cette manire de voir a t celle de P. Arndt et
d'A.
Furtwaengler ; je
la crois absolument
lgitime.
Seulement,
les
dsignations proposes par
ces deux
savants me semblent
galement
inadmissibles : voici
pourquoi.
Arndt a
propos Archiloque,
le
pote
des
iambes,
dont nous ne
possdons pas
de
portrait
assur. Mais
si
l'association
d'Archiloque
avec
Mnandre,
dans le
double
herms,
est
parfaitement
recevable
(les
deux
plus grands potes grecs aprs Homre),
le buste barbu
ne
rpond pas
l'ide
que
les anciens
pouvaient
se faire
d'Archiloque.
Mort les armes la
main,
dans la
guerre
1. Pline. Hist.
Nat., XXV,
9.
UN PORTRAIT MYSTRIEUX
245
entre Chalcis et
rtrie,
il n'a
jamais
d atteindre un
grand ge
;
cet
argument
n'est
pas
le
seul,
mais
dispense
d'en chercher d'autres
pour
carter la
dsignation pro-
pose par
Arndt.
Furtwaengler songeait
au
pote
des
choliambes,
Hipponax, par
la raison
que,
suivant les
anciens,
Hip-
ponax
tait
petit
et laid
notabilis
foeditas vultus,
crit Pline 1.
Hypothse
trs
malheureuse, car, d'abord,
Hipponax
n'a
pas
t autrement clbre
l'poque
romaine; puis,
l'association
d'Hipponax
avec Mnandre
n'a
pas
de raison
d'tre; enfin,
bien
que
l'on
puisse
toujours
diffrer
d'opinion
sur la beaut ou la laideur
des
vieillards,
personne, je crois,
ne voudrait suivre
Furtwaengler
en dclarant
que
la tte du
pseudo-
Snque
est celle d'un homme
singulirement
laid .
Ce
qu'il y
a de
juste
dans la
plupart
des
dsignations
que je
viens d'numrer et de
rfuter,
c'est le senti-
ment, inspir par
l'tude directe du
buste, que l'original
devait tre la fois un
pote
et un
penseur,
avec
quelque
inclination vers la satire. Mais la couronne de
lierre,
si
visible sur
l'exemplaire
du Muse national de
Rome,
nous conseille et
peut-tre
nous
oblige
de chercher
parmi
les
potes scniques plutt que parmi
les
lyriques
ou les
gnomiques.
On
objecte que
cette couronne ne
figure que
sur un seul
exemplaire.
D'accord
;
mais
l'auteur de cet
exemplaire
savait ce
qu'il faisait, quel
portrait
rel ou de convention il
copiait ;
s'il a
ajout
la couronne
dionysiaque,
c'est
que
le nom du modle
l'y
autorisait. D'autre
part,
il n'est
pas
tout fait
impossible qu'un pote quelconque,
autre
qu'un pote
scnique,
ait t
figur
avec une couronne de
lierre;
mais cela n'est
pas,
a
priori,
vraisemblable et il
faudrait,
pour
l'admettre,
des
arguments qui
font dfaut dans
le cas
prsent.
1.
Pline,
Hist.
Nat., XXXVI,
12.
246 UN PORTRAIT MYSTRIEUX
Un
pote scnique grec,
la fois
pote
et
penseur,
clbre Rome et en
Italie,
considr comme chef
d'cole et
pouvant
tre associ
Mnandre,
arriv
dj
vieux la clbrit et mort trs
g
:
voil,
si
je
ne me
trompe,
les termes
prcis
dans
lesquels
se
pose
le
problme.
Un nom tentant
qu'il
faut
exclure,
c'est celui d'Aris-
tophane.
Nous n'avons
pas
de
portrait authentique
d'Aristophane;
mais nous savons
par
les textes
que
ce
pote
tait chauve comme
Eschyle;
on ne l'aurait donc
jamais reprsent
avec la chevelure hirsute du
pseudo-
Snque.
J e renonce
galement,
bien
que j'y
aie souvent
pens,
mettre en avant le nom de
Cratinos, qui
con-
viendrait certes bien des
gards,
mais
auquel
on
peut
faire cette
grave objection qu'il
n'a
pas
t clbre
chez les Romains. Reste donc un nom
qui
n'a
pas
encore
t
propos, que je sache,
et
auquel je
ne vois
pas,
pour l'instant, qu'une objection
srieuse
puisse
tre
faite : celui du fondateur de la comdie
dorienne,
de
l'auteur
prsum
de
pomes philosophiques
et de sen-
tences dont
s'inspira
ou
que
traduisit Ennius
du
vieux
pote
sicilien
Epicharme.
J e n'ai
pas
l'intention d'crire ici une
biographie
d'Epicharme.
J e sais
que
des
critiques
modernes ont
tent de rduire trs
peu
de chose ce
que
les anciens
nous ont dit de
lui, allguant que
nombre de leurs
informations sont tires des crits
qui
lui taient attri-
bus et
que
d'autres sont des inventions
ayant pour
objet
de le mettre en relation avec
Pythagore.
Ces
questions
n'ont
pas
d'intrt
pour
le
problme
d'ico-
nographie qui
nous
occupe.
Ce
qui
nous
importe,
ce
n'est
pas
ce
qu'Epicharme
a vraiment t et ce
qu'il
a
crit
d'authentique,
mais l'ide
que
se faisaient de lui
les auteurs
postrieurs
Alexandre,
dont
Diogne
Larce et les
lexicographes
nous ont transmis en
partie
les
tmoignages.
Or, pour
ces
auteurs,
Epicharme,
n
UN PORTRAIT MYSTERIEUX 247
vers 540 Cos et venu tout enfant
Mgare
en
Sicile,
appartenait
une famille
d'Asclpiades;
il
commena
par
exercer la mdecine et
par s'occuper
de sciences na-
turelles.
Aprs
la destruction de
Mgare
en Sicile
par
Glon
(484),
il s'tablit
Syracuse
et
y
vcut la cour
du roi
Hiron,
o il connut
Eschyle.
Il serait mort trs
g,
90 ans suivant les
uns,
97 ans suivant d'autres.
La ville de
Syracuse
lui leva une statue dont
Diogne
Larce nous a conserv
l'inscription;
il
y
est dit
qu'Epi-
charme l'a
emport
en
sagesse
sur les autres hommes
autant
que
le soleil
l'emporte
sur les toiles et la mer
sur les fleuves. La vieille comdie
mgarienne, qu'on
croyait plus
ancienne
que
celle
d'Athnes,
avait
pass
de la Grce
propre
en
Sicile;
Epicharme,
au tmoi-
gnage
d'Aristote,
donna un caractre nouveau et
plus
littraire ces bouffonneries. Il aurait commenc
composer
des drames
(car
le mot de comdies est im-
propre,
ces
pices
ne
comprenant pas
de
kmos)
six
ans avant la
guerre mdique,
c'est--dire en 485
environ;
cette
poque
il aurait t
g
de 56
ans,
c'est--dire
que,
tout comme
Cratinos,
il aurait t
presque
un
vieillard
quand
il se mit crire
pour
la scne. On fait
de lui un
disciple
de
Pythagore
et l'on insiste sur le
caractre
philosophique
de ses
pices,
ou du moins des
sentences
qu'on y
lisait. Les
trente-cinq
titres et les
quelques fragments qui
nous restent montrent
qu'Epi-
charme traita tantt des
sujets mythologiques,
tantt
des
sujets analogues
ceux de la comdie nouvelle.
Aristophane
s'en
inspira ;
Platon et Cicron firent
grand
cas de
lui,
sans doute cause de ses tendances
philosophiques.
Ennius avait crit un
pome
intitul
Epicharmus,
dont on sait
peu
de
chose,
mais
qui,
comme YEvhemerus du
mme,
comme le De Natura
rerum de
Lucrce,
devait avoir
pour
but de familiariser
les Romains avec la
sagesse
d'un
penseur grec.
Celle
d'Epicharme
ne s'tait
pas exprime
seulement dans
248 UN PORTRAIT MYSTRIEUX
des
drames,
mais dans des crits
(authentiques
ou
non,
mais crus tels
par
les
Romains),
traitant de
physique,
de morale et de mdecine
((puotoXo^eT,
^pi^olo^tX, laTpoXoys,
dit
Diogne Larce).
En
voil assez
pour
tablir
qu'
Rome on lui
assignait
une
place
minente tant dans
l'histoire du thtre
que
dans
celle de la
pense phi-
losophique
des Grecs.
Reprenons
ce
que
nous avons
appel
les termes
prcis
dans
lesquels
se
pose l'nigme.
Un
pote grec
Epi-
charme est le matre de la comdie dorienne
la
fois
pote
et
penseur
nous venons
de le voir
clbre
Rome et en Italie
Ennius et Cicron en tmoi-
gnent
arriv
dj
vieux la clbrit et mort trs
g
il a 56 ans
quand
il donne son
premier
drame
et meurt
presque
centenaire. Reste montrer
qu'on
a eu raison de l'accoler Mnandre dans un double
herms. Nous avons
dj
dit
que
les titres de
plusieurs
de ses
pices indiquent qu'il
fut un vritable
prcurseur
de la comdie nouvelle
;
mais il
y
a
plus.
Ce sont les
vers bien connus d'Horace dans son
ptre
Auguste
(II,
1,
57 et
58)
:
Dicitur
Afrani toga
convenisse
Menandro,
Plautus ad
exemplar
Siculi
properare Epicharmi.
Quel que
soit ici le sens de
properare, qui peut impli-
quer
une
critique
ou faire allusion
l'emploi
du mtre
trochaque {t?ly.m, currere, properare), qui
fut
employ
de
prfrence par Epicharme,
nous avons dans ces vers un
exemple frappant
du
rapprochement
de Mnandre et
d'Epicharme.
Ce
qu'Horace
a
pu
faire ainsi bon
escient,
car il lisait ces auteurs dont nous ne
possdons que
des
paves,
le
sculpteur
de l'herms double de la villa Albani
y
tait
galement
autoris. Ainsi le nom
d'Epicharme
satisfait, semble-t-il,
toutes les donnes du
problme,
alors
que
tous les noms
proposs jusqu'ici n'y
satis-
UN PORTRAIT MYSTRIEUX 249
font
point. J 'ajoute pourtant,
et cette observation est
essentielle,
que
les donnes en
question
sont
peu
nom-
breuses
;
si
quelque
dcouverte vient les
complter
par
un lment
disparate,
mon
hypothse
ira
rejoindre
les
prcdentes.
J e ne
prtends
donc
pas qu'elle
soit
dfinitive,
ni
que
le
problme
du buste de vieillard
soit
rsolu,
mais seulement
que,
dans l'tat actuel de
nos
connaissances,
le nom
d'Epicharme, pote
et
phi-
losophe,
est le seul
qu'on puisse
lui attribuer avec
vraisemblance,
sans la certitude d'tre en dehors de
la vrit
(1).
1.
[En
1914
(Rec.
des tudes
anciennes, p. 405-6),
M. Ph. Le-
grand
a mis en avant le
mimographe
Philistion,
trs clbre vers la
fin de
l'antiquit
et
plus
d'une fois
compar
Mnandre
;
il tait
contemporain d'Auguste.
Mais alors il devrait tre ras
; d'ailleurs,
sa clbrit est
postrieure
l'ge
du bel art
grco-romain,
alors
que
l'original
du
portrait que
nous a
occup
doit tre fort antrieur la
naissance de Philistion. Voir ma note dans la Rev.
archol., 1918,
II,
p.
350.
1929].
XIV
LA VNUS DE MILO EN 1890
J e ne sais si
je
suis bien autoris venir
parler
d'une
statue clbre
qui
a
provoqu
non moins de
polmiques
que
d admiration. Il est vrai
qu
a
l'exemple
de bien d'autres
j'ai
fait le
plerinage
de l'le o ce chef-d'oeuvre
a t rendu la lumire
;
je
me suis
laiss
montrer,
par
le fils du consul
Brest,
dont cette dcouverte a immor-
talis le
nom,
l'endroit
(aujourd'hui
compltement transform)
o la desse
de Milo est
apparue pour
la
premire
fois,
dans sa cachette dix ou
quinze
fois
sculaire,
aux
yeux
du
paysan
Yorgos.
S'il m'est
permis
de
l'ajouter,
j'ai
lu
peu prs
tout ce
qu'on
a crit
sur la Vnus de Milo et
j'ai pris part
moi-mme
quelques-unes
des contro-
verses o la
question
de la restitution
de ses bras est
agite depuis plus
d'un
demi-sicle. Mais tout cela n'est
rien,
parce qu'il
me
manque
une chose
essentielle,
une
qualit
qui, d'antiquaire
amateur,
est
presque toujours
com-
municative : la foi en l'une des nombreuses
opinions,
soi-disant
inattaquables, qu'on
a mises au
sujet
de
1.
[Gazette
des
Beaux-Arts,
1er mai
1890, p. 376-394].
FIG. 54.
La V-
nus restaure
avec un bouclier
ou un miroir.
(Restitution
de
Millingen).
LA VNUS DE MILO EN 1890 251
cette statue. J 'aime mieux l'avouer tout
d'abord, pour
pargner
mes lecteurs une dsillusion dont ils
pour-
raient rendre
responsable
la science elle-mme
;
je
suis
indcis,
trs
indcis,
presque sceptique
sur la
possibilit
d'une solution dfinitive et
je rpte aujourd'hui
ce
que j'crivais
il
y
a dix ans : La Vnus
de Milo est un
mystre.
J e me
trompe,
il
n'y
a
pas qu'un
seul
mystre
attach la Vnus : il
y
en a
trois. Dans
quel tat,
en
compagnie
de
quels fragments
a-t-elle t dcouverte ?
A
quelle poque
et
par qui
a-t-elle t
sculpte
?
Quelle
attitude et
quels
attri-
buts le
sculpteur
inconnu lui a-t-il don-
ns ?
Autant de
questions
dont les
deux dernires me
paraissent
encore
insolubles et dont la
premire,
comme
nous le verrons
bientt,
est loin elle-mme
de
comporter
une
rponse
certaine.
Voila
donc,
pour parler
le
langage
des
sermonnaires,
les trois
points que je
me
propose
de
dvelopper.
Comme
je
le
disais en
commenant,
on a normment crit sur
la Vnus et
je
ne crois
pas
me
tromper
en valuant
deux ou trois mille
pages
in-8 l'ensemble des disserta-
tions
qu'elle
a
provoques.
Mais dans tous ces
livres,
articles ou
mmoires,
il
y
a infiniment de
redites,
de
paroles
oiseuses et de
suppositions
vaines
1
:
j'espre
pouvoir
faire tenir en
quelques pages
tout ce
qu'il
est essentiel de connatre sur ce
grand sujet.
J 'ai
peine
besoin de
rappeler que
l'le de Mlos
fait
partie
du dlicieux
archipel
des
Cyclades
;
elle
1. On trouvera les indications essentielles cet
gard
dans les
deux
ouvrages
suivants : Goeler von
Ravensburg,
Die Venus von
Milo, Heidelberg, 1879, p.
195-197;
Veit
Valentin,
Ueber
Kunst,
Kilnstler, etc., Francfort, 1889, p.
313-328.
FIG. 55.
Vnus
la
pomme
cl
Thermes.
(Restitution
de
Tarral.)
252 LA VNUS DE MILO EN 1890
est
volcanique
et n'a
gure que vingt-cinq
kilomtres
dans sa
plus grande longueur.
Son histoire nous est
mal connue : colonie dorienne
l'origine,
elle fut
prise
et dvaste en 416
par
les
Athniens, qui passrent par
les armes la
population
mle et
y
installrent des colons
venus de
l'Attique.
Les
Spartiates
la
reprirent
en 404
et en
expulsrent
les Athniens :
partir
de cette
poque,
nous n'avons
presque plus
aucune informa-
tion son
sujet.
C'est donc
pendant
un
espace
de douze
ans,
de 416
404,
que Mlos, partie intgrante
de l'em-
pire athnien, parat
avoir atteint le
plus
haut
degr
de richesse et de
splendeur. Cependant
son
thtre,
ses
tombeaux,
d'autres statues
importantes qu'on y
a
dcouvertes et
qui
datent d'une
poque postrieure
de
beaucoup
au Ve
sicle, prouvent qu'elle
n'a
pas
cess
d'tre riche et habite
par
une
population
assez nom-
breuse. Le christianisme
s'y dveloppa
de bonne
heure,
comme l'attestent de vastes catacombes encore
peine explores.
La ville
principale, appele
Castro,
est situe sur une hauteur
abrupte qui
domine le
port.
Les environs de ce
port
sont couverts de
ruines,
dont la
plus remarquable
est un
grand
thtre bien conserv.
C'est
cinq
cents
pas
de ce thtre
que
l'on a dcouvert
la Vnus.
Nous
possdons,
sur les circonstances de cette trou-
vaille,
trois
tmoignages
d'une valeur srieuse. Le
pre-
mier
qu'on
ait
publi
est celui du clbre Dumont d'Ur-
ville,
qui
vit la statue Milo
quelques jours aprs
sa
dcouverte,
le 19 avril 1820
;
le second est celui de
M. de
Marcellus, publi
en 1839
seulement,
mais fond
sur
des
impressions personnelles
de dix-neuf ans ant-
rieures. Le troisime
groupe
de
tmoignages,
connu
depuis 1874,
est la collection des lettres
changes
entre
l'agent
consulaire
franais
de
Milo, Brest,
le consul
gnral
de
Smyrne,
David,
et l'ambassadeur
franais
Constantinople,
M. de Rivire.
LA VNUS DE MILO EN 1890
253
J e laisse de
ct,
ou
plutt j'carte systmatique-
ment,
les
tmoignages
oraux recueillis dans l'le
une
poque plus
tardive et un document d'un nomm
Matterer, qui
a t
publi
en 1874
par
M. Aicard. Les
premiers
sont videmment altrs
par
de vritables
mensonges
et le
second n'est
gure qu'une mystifica-
tion d'un bout l'autre. Nous aurons
cependant
y
faire tout l'heure
quelques
allusions.
Voici d'abord ce
que
nous
apprend
Dumont d'Urville.
La
gabare
la
Chevrette,
bord de
laquelle
l'minent
marin servait comme
enseigne,
mouilla dans la rade
de Milo le 16 avril 1820. Le
19,
Dumont alla voir la
Vnus. Il raconte
que
trois semaines environ
aupara-
vant,
un
paysan grec,
bchant son
champ,
avait ren-
contr des
pierres
de taille : en creusant
plus avant,
il
dblaya
une
espce
de niche
dans
laquelle
il trouva
une statue en
marbre,
deux herms et
quelques
autres
morceaux
galement
en marbre...
La statue tait de
deux
pices, jointes
au
moyen
de deux forts tenons en
fer. Le Grec avait fait
porter
dans une table la
partie
suprieure
avec
les deux herms
;
l'autre tait encore
dans la niche le 19 avril. On
pense,
sans en tre
certain,
que
la
partie suprieure
avait t dcouverte avant le
reste. Il faut citer ici le texte mme de la relation :
La
statue,
dont
je
mesurai les deux
parties sparment,
avait,
trs
peu
de chose
prs,
six
pieds
de haut
;
elle
reprsentait
une femme
nue,
dont la main
gauche
releve tenait une
pomme
et la droite soutenait une
ceinture habilement
drape
et tombant
ngligemment
des reins
jusqu'aux pieds
;
du
reste,
elles ont t l'une
et l'autre mutiles et sont actuellement dtaches du
corps.
Et
plus
loin : Les cheveux sont retrousss
par
derrire et retenus
par
un bandeau... Les oreilles ont
t
perces
et ont d recevoir des
pendants.
Tous ces
attributs semblent assez convenir la Vnus du
J uge-
ment de
Paris,
mais o seraient alors
J unon,
Minerve
254 LA VNUS DE MILO EN 1890
et le beau
berger
? 11 est vrai
qu'on
avait trouv en
mme
temps
un
pied
chauss d'un cothurne
et une troi-
sime main
;
d'un autre
ct,
le nom de l'le de Mlos a
le
plus grand rapport
avec le mot
p^ov, qui signifie
pomme.
Ce
rapprochement
de mots
ne serait-il
pas
indiqu par
l'attribut
principal
de la statue
?
Tous les termes de cette
dposition
d'un honnte
marin doivent tre
pess
attentivement.
Ils
prouvent
clairement, remarquons-le, que
la Vnus a t trouve
sans ses
bras,
mais
qu'on
a dcouvert
avec elle deux
bras
mutils,
une troisime
main,
un
pied
et deux her-
ms, qui peuvent
n'avoir aucun
rapport
avec la statue
;
enfin,que
Dumont
d'Urville, ayant
vu les deux
tronons
spars,
a fait une
simple conjecture
en disant
que
la main droite retenait la
draperie
tandis
que
a
main
gauche
tenait une
pomme.
Continuons.
Aprs
avoir dcrit les deux
herms,
Dumont
ajoute que
l'entre de la niche tait
surmonte
d'un
grand
marbre
portant
une
inscription
dont
il a
pu
lire
quelques
mots. C'est la ddicace d'une
exdre,
c'est--dire d'une sorte de belvdre orn
de
siges,
Herms et Hracls. Encore un marbre sans relation
avec la
Vnus,
un marbre
que
le hasard seul a
rapproch
d'elle !
L'auteur termine en disant
que
lors de son
passage
Constantinople,
l'ambassadeur
le
questionna
sur
cette statue et
qu'il
remit M. de
Marcellus,
secrtaire
de
l'ambassade,
la
copie
de la notice dont nous venons
de donner un rsum. La
gabare
la Chevrette avait
quitt
Milo le 24 avril.
Avant Dumont
d'Urville,
un autre officier de notre
marine, Dauriac,
commandant la
Bonite,
avait
pass
Milo et vu la Vnus. Le 11 avril
1820,
il crivait
David,
consul de France
Smyrne, qu'une
statue
reprsentant
Vnus recevant la
pomme
de Paris
avait t dcouverte trois
jours auparavant,
c'est--
LA VNUS DE MILO EN 1890 255
dire le 8 avril. On n'a dans le
moment, disait-il,
que
le buste
jusqu'
la ceinture.
Peut-tre n'avait-il
t admis voir
que
le morceau
transport
dans
l'table de
Yorgos.
Le mme officier nous
apprend
que
Louis
Brest, agent
consulaire de
France,
voulait
acheter la statue et
qu'en
attendant des instructions
de
Smyrne,
il avait obtenu des
primats
de l'le
qu'elle
ne ft
pas
vendue
jusqu'
nouvel ordre. Ds le 12
avril,
Brest
signalait
au consul David la dcouverte des deux
herms et de la statue
;
il dcrivait celle-ci comme
Vnus tenant la
pomme
de discorde dans sa main
et
ajoutait
: Elle est un
peu
mutile
;
les bras sont
casss et elle est
partage
en deux
pices par
la cein-
ture. Le
25,
David en rfra M. de
Rivire,
ambas-
sadeur de France
Constantinople
;
celui-ci rsolut
de
prendre
les mesures ncessaires
pour
assurer l'ac-
quisition
de la Vnus.
Lorsque
la Vnus de Milo arriva au
Louvre,
le comte
de
Clarac,
alors conservateur des
antiques,
en fit
l'objet
d'une
monographie
o l'on trouve nombre d'autres
dtails
qui
lui avaient t conts
par
M. de Marcellus.
Mais Marcellus n'arriva Milo
qu'assez longtemps
aprs
Dauriac et Dumont d'Urville
;
il tira ses infor-
mations du consul Brest et de
paysans grecs
de
l'le, qui
avaient tous
l'imagination
assez vive et dont les affirma-
tions doivent tre accueillies avec rserve. Aussi le con-
tenu de la
monographie
de M. de
Clarac,
comme celui
des Souvenirs de M. de
Marcellus,
ne nous
inspire-t-il
pas
une confiance aussi
grande que
les
lettres,
si
simples
de
ton,
crites au moment de la dcouverte. A ct de
dtails
suspects,
on en a donn
plus
tard
qui
doivent
tre absolument condamns : on a
dit, par exemple,
que
la statue avait t trouve intacte dans la
grotte
et
pose
debout sur son
pidestal.
Celui
qui ajoute
foi
de
pareilles histoires,
aprs
les documents
vridiques
que
nous avons fait
connatre,
n'a de la
critique qu'une
256 LA VNUS DE MILO EN 1890
ide bien
imparfaite
et
peut
tre abandonn ses
erreurs.
Un
archologue qui
visita Milo en
1838,
Morey,
a
pu
voir encore cette
grotte mystrieuse, qui
a
compl-
tement
disparu depuis.
Sa
description
ne
permet pas
de douter
que
ce ft une
grande
tombe
et,
ds
lors,
il est
parfaitement
certain
que
la statue
n'y
tait
pas
sa
place. Pourquoi
et comment
l'y
avait-
on introduite ? On a hasard ce
sujet
une
hypothse
assez sduisante : lors
du
triomphe
du christianisme
Milo,
quelque paen
ami des arts aurait ainsi
cach la Vnus
pour
la
prserver
de la
fureur
stupide
des iconoclastes.
Toutefois,
cette
explication romanesque
ne rend
pas compte
d'un fait
capital
:
c'est
qu'on
a trouv
auprs
de la
statue,
dans la mme
grotte,
deux herms et
plusieurs fragments
de
marbre,
tels
que
le
pied
chauss d'un cothurne
que
Dumont
d'Urville a
signal.
J 'ai la
presque
certi-
tude
qu'il n'y
avait
pas
l une
cachette,
mais un
magasin
de chaufournier. Pen-
dant tout le
moyen ge
et malheureuse-
ment aussi de notre temps, on a fabricru
de la chaux avec des marbres
antiques.
La Vnus et les
autres
fragments
dcouverts en mme
temps
taient
destins subir le mme sort. On
peut imaginer qu'un
boulement ou tout autre incident heureux les en
prserva
en
dissimulant l'entre du caveau.
En ce
qui
concerne les
fragments
de
bras, je
veux
encore
insister sur deux faits.
D'abord,
lors du trans-
port
de la statue sur
l'Estafette,
on
n'embarqua,
au
tmoignage
de
Marcellus,
qu'
un avant-bras informe
et
une moiti de main tenant une
pomme
;
ces
frag-
ments sont au
Louvre,
mais la troisime main et le
FIG. 56.
V-
nus sa toi-
lette.
(Res-
titution de
Hasse.)
LA VNUS DE MILO EN 1890 257
pied que
mentionne Dumont d'Urville ont
disparu.
En second
lieu,
le 16 novembre
1820, aprs
le
dpart
de la
Vnus,
Brest crit au
charg
d'affaires de France
Constantinople qu'il
a t
pri par
l'ambassade de
faire des recherches
pour
trouver les bras et autres
dbris de la
statue,
mais
que, pour
cela
faire,
il tait
urgent
d'obtenir un
bouyourouldou
. Ceci
permet
de
relguer
une fois
pour
toutes au
rang
des
fables,
pour
ne
pas
dire
pis,
ce
qui
a t
publi
en
1874,
savoir
que
les bras de la statue taient adhrents au moment
de la dcouverte et furent briss au cours d'une rixe
entre les marins
franais
et les Turcs.
Marcellus s'tait
embarqu
sur
l'Estafette
et aborda
le 23 mai 1820 Milo. Dans
l'intervalle,
c'est--dire
la fin d'avril ou au commencement de
mai,
un
prtre
grec, qui
voulait s'assurer les bonnes
grces
du
drog-
man de l'arsenal de
Constantinople,
acheta la statue
et la fit
transporter
sur le bord de la mer
pour
l'embar-
quer.
Marcellus arriva
temps pour rompre
le march
et faire amener la Vnus sur le navire
franais.
Il la
paya
550
francs,
chiffre attest
par
la
correspondance
officielle :
or,
dans ses
Souvenirs,
M. de Marcellus
parle
de 6.000 francs 1. On voit
que
nous avons
quelque
raison
de ne
pas trop
nous
appuyer
sur ses
tmoignages,
sans
incriminer d'ailleurs sa bonne foi.
Aussitt
l'Estafette disparue
l'horizon,
le
prtre
grec porta plainte
au
drogman
de l'arsenal et fit
infliger
une norme amende aux
primats
de
Milo, coupables,
selon
lui,
d'avoir laiss
partir
la Vnus.
Brest,
outr
de cette
injustice,
s'adressa l'ambassadeur et celui-ci
obtint de la Porte
que
les sommes indment
perues
1. M. de Marcellus a sans doute
ajout
aux 550 francs
pays pour
la statue les 7.000
piastres qui
furent rembourses
par
M. de Rivire
aux
primats
de
Milo, lorsque
la
Porte, aprs
le commencement
de l'in-
surrection
hellnique,
refusa de leur remettre les sommes
extorques
par
le
drogman
de l'arsenal.
S. REINACH
17
258 LA VNUS DE MILO EN 1890
fussent rembourses aux
primats
1. M. de Rivire se
chargea
de leur
porter
lui-mme cette bonne nouvelle
et arriva le 15 novembre Milo. Il
s'empressa
natu-
rellement de visiter le thtre de la dcouverte et
y
recueillit
quelques
nouveaux
fragments
de
sculpture
:
c'taient,
entre
autres,
l'inscription
de l'exdre vue
par
Dumont d'Urville et
peut-tre
2
une base de statue avec
inscription. Quand
un aussi
gros personnage qu'un
ambassadeur de France
Constantinople
cherche des
marbres dans une le
grecque,
il est sr
qu'on
en trou-
vera sur sa
demande,
mais rien ne
prouve qu'ils
auront
t
dcouverts l'endroit mme
que
les
paysans
indi-
queront.
C'est le cas
pour
cette base de statue avec
inscription, qui
a
jou
et
joue
encore un si
grand
rle
dans le
mystre
de la Vnus. Mais si nous avons raison
de considrer la
niche comme le
magasin
d'un chau-
fournier,
la dcouverte d'autres
marbres,
en cet endroit
mme, peut
s'expliquer
aisment,
sans
qu'il
soit besoin
de les mettre en relation avec la
grande
statue. Ceci
est d'une
importance capitale,
car la base en
question
porte
la
signature
d'un artiste
qui
ne saurait tre ant-
rieur l'an 220 avant
J .-C,
et si l'on
admet,
comme le
font encore
trop d'archologues, que
cet artiste est
l'auteur de la
Vnus,
on sera
oblig d'assigner
ce
chef-d'oeuvre une date tout fait
incompatible
avec
son
style.
Ce serait le renversement de ce
que
nous
croyons
savoir de
plus
sr touchant l'histoire de l'art
grec
: on ne
peut pas
ainsi
dmolir la
lgre
un difice
que
trois
gnrations
de travailleurs ont consolid !
Un
profond
mystre plane
sur les destines de cette
base. On sait
qu'elle
arriva au Louvre
;
on est
aujour-
d'hui sr
qu'elle n'y
est
plus. L'inscription
lue
par
Du-
mont d'Urville et recueillie
par
M. de Rivire a
gale-
1. Ce remboursement ne fut
pas
fait
par
la Porte
;
voir la note
prcdente.
2. C'est l un
point qui
n'a
pu
tre encore tabli avec certitude.
LA VNUS DE MILO EN 1890 259
ment
disparu
sans
qu'on
sache comment. Une
chose,
du
moins,
est
pour
nous
presque
certaine : c'est
que
la
base n'a
pas
t trouve avec la
statue,
dans son voi-
sinage immdiat,
sans
quoi
Dumont
d'Urville, qui
a
bien
copi
la ddicace
Herms,
n'aurait certainement
pas nglig
d'en dire un mot 1. Si l'on s'est obstin
soutenir le
contraire,
c'est
parce qu'il
existe un
dessin,
fait au Louvre en
1821,
o la statue est
place
sur un
pidestal qui porte
cette
inscription.
Mais ce dessin
ne
peut
tre lui-mme
qu'une
restitution
conjecturale ;
si la base inscrite s'tait
adapte parfaitement
la
plinthe
de la
statue,
elle aurait t mise en
place
avec
elle et nous la
possderions
encore. Maintenant
que
l'original
a t
perdu
ou
dtruit,
toute vrification est
impossible,
mais les
apparences
concordent nous
per-
suader
qu'il
n'a
jamais appartenu
la Vnus.
J e
passe
au second
point
:
quelle poque
et
par
quel
artiste notre statue a-t-elle t
sculpte
?
Chacun sait
que
notre connaissance de l'art
grec
est encore trs
fragmentaire,
mais nous avons
cependant,
grce
surtout aux dcouvertes du xixe
sicle,
des
points
de
repre
absolument srs. L'histoire
politique
nous
apprend que
Milo devint athnienne en 416 et le resta
jusqu'en
404
;
l'histoire de l'art nous
permet
d'affirmer
que
le
style
de la Vnus de Milo est celui des
sculptures
attiques
de la mme
priode,
c'est--dire des lves
et des successeurs de Phidias. J e sais bien
qu'il
est
aujourd'hui
de mode en
Allemagne
d'attribuer la Vnus
une
poque beaucoup plus rcente; mais,
sans m'at-
tarder dmler dans cette
opinion
un
parti pris
de
dnigrement auquel
nos chefs-d'oeuvre eux-mmes
n'chappent pas, je
me contente de dire
que l'analogie
de
style,
d'excution,
de
sentiment, que
l'on constate
1. Dumont d'Urville
signale
bien une
inscription, qu'il
dit illi-
sible,
sur le
pidestal
d'un herms
;
mais la
signature
d'artiste
rap-
porte par
M. de Rivire
tait,
au
contraire, parfaitement
distincte.
260 LA VENUS DE MILO EN 1890
entre la Vnus de Milo et les
sculptures
des frontons
du
Parthnon,
suffit rfuter toute
hypothse qui
placerait
l'auteur de notre statue
plus
bas
que
la
pre-
mire moiti du ive sicle.
Puis-je
dmontrer cela
comme un
gomtre, qui prouve que
les trois
angles
d un
triangle quivalent
ensemble a
deux
angles
droits?
Non,
sans
doute,
mais la certitude
mathmatique
n'est
heureusement
pas
la seule forme de
la certitude. Le
got
a ses
vrits,
comme la raison et le coeur
;
ces
vrits ne
s'imposent pas
tous avec
une
gale vidence,
mais elles ont cela
de commun
qu'elles produisent
en
nous,
leur
contact,
un sentiment
de satisfaction
et,
si
j'ose
dire de
pl-
nitude
qui
nous
oblige
nous incliner
devant elles.
C'est l un
point,
du
reste,
sur
lequel je
me
garderai
d'insister
; je
n'essayerai pas
non
plus
de faire sen-
tir la
perfection
d'un chef-d'oeuvre
qui parle
assez clairement et assez haut
par
lui-mme. On
demandait un
philosophe
ancien :
Qu'est-ce que
le
beau ?
Questions d'aveugle , rpondit-il.
A
celui
qui
demanderait ce
qu'il y
a d'admirable dans la
tte,
dans le
torse,
dans la
draperie
mme de la Vnus
1
questions d'aveugle
!
rpondrais-je,
et
je
lui don-
nerais le conseil de la belle Vnitienne
J ean-J acques
Rousseau : Lascia le donne e studia la matematica !
1.
[Mme d'Agoult
crivait de
Florence,
propos
de son ami et
por-
traitiste
Bartolini, appel par
elle le
premier
statuaire
d'Europe
:
Bartolini est un artiste fort
curieux,
il ne croit
pas
au beau idal.
Il trouve
l'Apollon
du Belvdre une chose
dtestable,
le Laocoon
stupide,
et dit
que
la Vnus de Milo n'a de beau
que
les
jambes
et. les
pieds.
(Mercure
de
France,
1er fvrier
1929, p. 542.)]
FIG.56 bis.
Baigneuse surprise.
;
(Restitution
de
Veit
Valentin.)
LA VNUS DE MILO EN 1890 261
Nous
possdons,
depuis
1877,
un
chef-d'oeuvre
authentique
de
Praxitle,
l'Herms
portant Dionysos,
que
les
Allemands ont dcouvert
Olympie ;
nous
pouvons aussi, grce
diverses
rpliques,
nous faire
une ide assez exacte de la fameuse Vnus de
Cnide,
sculpte par
le mme artiste vers 350 avant J sus-Christ.
Eh bien ! dans l'une et l'autre de ces belles
statues,
le
regard
le moins exerc
reconnatra une tendance aux
raffinements,
la
coquetterie, je
dirais
presque
la
manire, qui
est absolument
trangre
la sublime
desse de Milo. Si donc la Vnus est une oeuvre
attique
comme
l'indique
son
style,
c'est entre Phidias et Praxi-
tle
que
son auteur a d vivre :
qu'on songe
Alcamne
le J eune ou
Scopas, je
le
veux
bien,
mais ces noms et
d'autres ne
pourront jamais
tre
que
des
hypothses.
Ceux
qui
nient
que
la Vnus soit de l'cole de Phidias
sont
obligs
de la faire descendre
l'poque
alexan-
drine, poque qui
a
produit
de trs
grands
artistes et
o bien des traditions de l'cole de Phidias ont refleuri.
Mais
pas
une
des belles statues fminines
que
nous
connaissons de cette
priode
ne
peut
affronter la
compa-
raison avec la Vnus sans en tre crase au
premier
coup
d'oeil ! C'est encore
l, je l'avoue,
une
impression
qui
ne se dmontre
point.
Plusieurs
archologues
ont raisonn comme il suit.
L'art
grec,
l'poque
la
plus ancienne,
n'a
pas figur
de femmes nues. Il existe des statues
analogues
la
Vnus o le haut du
corps
est recouvert d'une
draperie.
Donc,
la Vnus est une
rplique,
une
copie
libre d'une
oeuvre
plus
ancienne dont
l'auteur,
inventeur du
motif,
avait recul devant ce
qu'une
demi-nudit mme a de
hardi.
Si l'on serre les choses de
plus prs,
tout ce
raisonnement
parat
bien
fragile. D'abord,
Phidias
dj
avait
sculpt
une
figure
fminine nue. En second
lieu,
l'emploi
des toffes
transparentes, qui
sont loin
d'tre
plus
chastes
que
le
nu,
remonte
l'poque
mme
262 LA VNUS DE MILO EN 1890
de Phidias.
Enfin,
le mme motif
ayant
servi la
repr-
sentation de divinits
diffrentes,
il est
parfaitement
possible que
celui de la Vnus de
Milo,
invent
pour
une
figure
moiti
nue,
ait t imit
plus
tard
par
un
sculpteur qui, ayant
figurer
une
Muse, par exemple,
obit la tradition en la
reprsentant
toute vtue.
Divers indices ont
port
croire
que
la Vnus avait t
sculpte d'aprs
un modle
vivant,
ce
qui
ne
permet-
trait
pas d'y
voir une
copie ; je
n'attache
pas trop
d'importance
ces
indices,
mais
j'en
attache une trs
grande
la Vnus
elle-mme, qui
ne
peut pas
tre
autre chose
qu'un original.
Cela ne veut
point
dire
que
l'on n'ait
pas reprsent
antrieurement une femme
debout dans une attitude
analogue
;
mais dira-t-on
que
telle
Vierge
de
Raphal
soit une
copie, parce qu'on
retrouve le mme motif dans un tableau de son
matre,
le
Prugin
?
J 'ajoute qu'on
a
grandement
raison de
rapprocher, pour
en former des
sries,
les
sculptures
antiques qui prsentent
des ressemblances
d'attitude,
mais le tort consiste vouloir
arranger
chacune de ces
sries en une sorte d'arbre
gnalogique
vertical. J 'ima-
gine qu'un sculpteur
ou un
peintre,
vers 450 avant
notre
re,
ait le
premier figur
une
femme, drape
compltement
ou
moite,
dans l'attitude de la Vnus
de Milo
;
ce motif trs
simple
aura
pu
tre
repro-
duit
simultanment, indpendamment, par cinquante
artistes, peintres
ou
sculpteurs, qui
l'auront vari de
toutes les
manires,
suivant leur
inspiration personnelle,
et
parce que
l'ide de la
copie
servile est
trangre
l'art
grec.
Il est
donc,
mon
avis,
tout fait
chimrique
de vouloir tablir des relations
chronologiques
entre
les diffrentes variantes d'un
type plastique gnral
;
si l'on
appliquait
cette manire de raisonner aux
pro-
duits de l'art
moderne,
dont la
chronologie
est
connue,
on arriverait de bien
tranges
conclusions
!
J e
passe
la dernire
question,
la
plus
difficile, j'allais
LA VNUS DE MILO EN 1890 263
dire la
plus
dsespre
de toutes :
Comment
faut-il
se
figurer
la Vnus de Milo avant la mutilation
qui
l'a
prive
de ses bras ?
Tout
d'abord, je
fais observer
que
les
copies,
les
gravures
et les
photographies
de la
Vnus,
qui
ont t
rpandues
dans le
commerce avant
1883,
prsentent
une
inexac-
titude
grave qui
a donn naissance des ides
fausses.
Lorsque
la statue fut installe au
Louvre,
en
1822,
on
commit une erreur en
rajustant
le torse sur le
bas du
corps.
Par suite de circonstances matrielles dont le
dtail serait
long
donner,
le torse fut
rejet
sur la
droite
par
l'insertion de deux cales en bois. Ces cales
n'ont
disparu que
de notre
temps.
M.
Ravaisson,
conser-
vateur des
antiques,
en constata l'existence en
1871,
lorsque
la Vnus fut remonte sur son
pidestal aprs
la
guerre,
o elle avait t cache dans une cave de la
Prfecture de
police. Malheureusement,
la dcouverte
de M. Ravaisson
gnait
des habitudes
acquises ;
on
insista
pour
que
la statue ft rtablie dans l'attitude
qu'elle
avait
auparavant.
C'est en 1883 seulement
que
sa
position
originale
lui a t rendue. C'est alors aussi
qu'on
a fait
disparatre
le
pied gauche,
mauvaise addi-
tion en
pltre
remontant
1821,
ainsi
que beaucoup
d'autres
petites rparations
de la mme
poque
dont
l'effet tait assez
disgracieux.
Chose
plus importante,
on
a
supprim
le socle moderne dans
lequel
la
plinthe
antique
tait
engage
et l'on a donn la base nouvelle
une forme
circulaire, qui
laisse intacte cette
question
litigieuse
: sous
quel aspect,
de trois
quarts
ou de
profil,
la Vnus doit-elle tre considre ? Disons tout de
suite
que
le ct
gauche
du
visage
et de la
draperie
tant
beaucoup
moins
soign que
le ct
droit,
c'est
proba-
blement de
profil que
la statue devait tre
regarde.
Le
premier problme qui
se
pose, lorsqu'on
cherche
restituer les bras de la
Vnus,
est
singulirement
compliqu
et difficile. Le
fragment
de main
gauche
264 LA VNUS DE MILO EN 1890
tenant une
pomme, qui
a t dcouvert en mme
temps,
lui
appartient-il
? Le marbre est le
mme,
les dimen-
sions concordent un millimtre
prs,
mais le travail
est de
beaucoup
infrieur celui du reste de la statue.
On a
suppos parfois que
ce bras avait t donn
la Vnus
par
une restauration faite dans
l'antiquit.
Nous ne
pouvons
rien en savoir et
j'ai dj trop
sou-
vent,
en ce
qui
me
concerne, chang
d'avis sur ce
point
pour risquer
de me contredire encore une fois.
Si l'on rsout cette
question par l'affirmative,
comme
la
pomme
est un attribut traditionnel de
Vnus,
le
nom
qu'on
a donn ds l'abord la desse se trouve
dfinitivement
justifi.
Mais si l'on carte ce
fragment
comme
indigne,
il n'en est
plus
de mme et l'on
peut
croire,
avec
quelques archologues, que
la
prtendue
Vnus est
plutt
une Victoire ou une
Nymphe
locale.
A vrai
dire,
la nudit du torse et les traces de
pendants
d'oreilles viennent
l'appui
de la
dsignation gnrale-
lement
admise,
mais ces indices ne
permettent pas
de
la considrer comme tout fait sre. Celle de
Notre-
Dame de Beaut
,
que proposait spirituellement
Henri
Heine,
a
l'avantage
d'tre moins
compromet-
tante...
Sur ce
point
encore,
je
suis donc trs sobre d'affirma-
tions.
Toutefois,
de ce
que
la statue a t trouve
prs
du thtre de
Milo,
on n'a
pas
le droit de conclure
qu'elle reprsente
une
Muse,
erreur o
quelques
auteurs
sont
tombs;
en
effet,
les textes nous
apprennent
qu'il y
avait des statues de Vnus dans les thtres et
la belle Vnus d'Arles a
prcisment
t exhume dans
les ruines du thtre romain de cette ville.
En
gnral, lorsqu'il s'agit
de restituer une oeuvre
antique mutile,
les
archologues peuvent invoquer
le secours de
rpliques plus
ou moins
exactes,
sculp-
tures, bas-reliefs, peintures, mdailles, monnaies, qui
forment
quelquefois, pour
un mme
type,
des sries
LA VNUS DE MILO EN 1890 265
extrmement nombreuses. Ce secours fait
peu prs
dfaut
pour
la
Vnus,
et ce n'est
pas
l une des moins
surprenantes particularits
de ce chef-d'oeuvre. Nous
avons
sans doute un certain nombre de
figures
dans
une attitude
analogue,
Victoires crivant sur un bou-
clier,
Vnus tenant la
pomme ou^groupes
avec un
per-
sonnage
viril. Aucun de ces
tmoignages
n'a relle-
ment d
importance.
En
enet,
d a*
bord,
ces
prtendues rpliques
ne
ressemblent
que
de fort loin la
desse de Milo : ce sont des dri-
ves trs
divergentes
d'un
type
du
ve sicle dont l'auteur de la Vnus
lui-mme s'est
inspir.
En second
lieu,
le
type gnral
une fois
cr,
une fois admis dans le vocabulaire
de
l'art,
a naturellement
servi,
comme
les termes du vocabulaire en litt-
rature,
l'expression
d'ides diff-
rentes. Il faut tre bien novice en
archologie pour prtendre
restituer
avec certitude la Vnus de
Milo,
parce qu'une
statue de
femme, por-
tant sur le
pied
droit et relevant un
peu
le
pied gauche,
aura t dcou-
verte avec tel ou tel attribut dans une main.
Seule,
une
rplique
exacte et intacte de notre
statue,
avec le mme
regard portant
au
loin,
la mme diffrence de niveau
entre les
paules, pourrait
autoriser une conclusion
srieuse. Cette
rplique
est encore dcouvrir.
J e crois
qu'en
l'tat actuel de la
science,
on a
dj
fait un
progrs quand
on a reconnu
que
le
problme
de la restitution de la Vnus est insoluble. J e ne veux
pourtant pas
m'en tenir l et
je
dois
exposer rapidement
les
cinq principales
restitutions
qui
ont t tentes :
1 celle de
Tarral,
o la Vnus est debout
prs
d'un Her-
FIG. 57.
Vnus et
Mars.
Restitu-
tion de Zur Stras-
sen.
266 LA VNUS DE MILO EN 1890
mes
;
2 celle de
Hasse,
o elle est
occupe
sa toilette
;
3 celle de Veit
Valentin,
o elle
parat
dans l'attitude
d'une
baigneuse surprise
;
4 celle de MM.
Quatremre
de
Quincy
et
Ravaisson,
o elle est
groupe
avec le
dieu Mars
;
5 celle de
Millingen
et
d'Overbeck,
o elle
tient un bouclier.
Vers
1860,
un mdecin
anglais,
Claudius
Tarral, qui
exerait
son art
Paris, proposa
une restitution de la
Vnus fonde sur la conviction o il tait
que
le
frag-
ment tenant la
pomme
avait
appartenu
l'original.
Sa
restauration,
excute en
pltre,
fut
expose
en 1861
et accueillie avec une faveur
marque.
Tarral a
group
la Vnus avec un des Herms
qui
ont t dcouverts
au mme endroit et il a fait
figurer
sous cet Herms
la
signature
d'artiste dont
j'ai
eu l'occasion de
parler.
Ceux
qui
trouveront
que
le mouvement du bras tenant
la
pomme rpond
l'ide de la
grce,
ou mme une
ide
quelconque, partageront l'opinion
de
Tarral,
mais
non la mienne. Il est vrai
que
la
pomme par
elle-mme,
symbole
bien connu
d'Aphrodite,
est en mme
temps
le
symbole parlant
de
l'le,
puisque pomme
se dit
melon en
grec
;
mais dans la restauration de
Tarral,
Vnus semble
plutt jongler
avec une
pomme que
la
prsenter
la manire d'un attribut doublement
expres-
sif. On
peut
se demander aussi si le mouvement du bras
droit n'est
pas disgracieux, parce que
la
draperie
est
suffisamment retenue
par
l'avance du
genou
et n'a
pas
besoin du secours d'une main
prte
s'y poser.
M. C.
Hasse,
professeur
d'anatomie l'Universit
de
Breslau, affirme,
son tour
que
le
fragment
de bras
gauche
et la main
gauche
tenant la
pomme
ont
appar-
tenu l'un et l'autre la statue. Il
y
reconnat
l'image
de Vnus
qui,
sur le
point
d'entrer dans la
mer,
relve
sa
draperie
de la main
droite,
tandis
que
sa main
gauche
lui sert dnouer ses cheveux. Mais
l'objet
sculpt
dans cette main n'est
pas
une
pomme,
comme
LA VNUS DE MILO EN 1890 267
sa
petitesse
suffit d'ailleurs
l'indiquer
: c'est l'extr-
mit,
roule sur
elle-mme,
du lien
qui
retient sa che-
velure. La restitution de Hasse
parat
tre reste
inconnue en France
;
ce
qu'il
dit de la
pomme repose,
je crois,
sur une erreur
1
et
je
ne suis nullement
dispos
admettre,
pour
une statue comme notre
Vnus,
le
motif frivole
que
l'anatomiste de Breslau a
imagin.
Un
archologue allemand,
s'inspirant
d'une obser-
vation faite
par
l'minent
antiquaire anglais
Millin-
gen,
a
pens que
l'attitude du
corps
de la Vnus indi-
quait
comme un mouvement d'tonnement et de
rpul-
sion.
Aprs
avoir d'abord
suppos que
la desse reculait
pour
se soustraire
quelque
familiarit
amoureuse,
il a rcemment modifi son
hypothse;
il s'incline
reconnatre dans la desse la chaste
Artmis,
surprise
au moment du bain
par
Acton 2. Se trouvera-t-il
per-
sonne,
en dehors de M. Veit
Valentin, pour
voir une
baigneuse
alarme dans la
majestueuse
desse de Milo ?
J 'espre
bien
que
non.
Voici maintenant une tentative
plus
srieuse. Ds
l'arrive de la statue
Paris,
l'illustre
archologue
Quatremre
de
Quincy pensa qu'elle
tait
groupe
avec
un second
personnage,
et
que
ce
personnage
tait Mars.
Cette ide a
depuis
t
reprise
et
prcise par
M. Ravais-
son, qui, aprs
des hsitations
nombreuses,
tmoi-
gnage
de la sincrit de ses
tudes,
est arriv la conclu-
sion suivante :
Aphrodite
est
place
ct de Mars
;
elle
appuie
sur
l'paule
du dieu son bras
gauche qui
tient la
pomme ;
sa main droite se relve comme
pour
indiquer qu'elle parle
au dieu.
Quant
celui-ci,
il doit
tre
figur
sur le modle d'une statue de travail
grec
conserve au Louvre et
qu'on appelle,
cause de la
1. Clarac a
dj
fait observer
que
cet
objet peut
tre aussi bien
une
grenade qu'une pomme,
mais il est certain
que
c'est un fruit.
2. M. Veit Valentin insiste sur le
motif,
mais ne
propose
le nom
d'Artmis
que
sous rserve.
268 LA VNUS DE MILO EN 1890
collection dont elle a fait
partie,
le Mars
Borghse.
Malheureusement,
M. Ravaisson n'a
pas
encore
publi
son essai de restitution
et,
comme il arrive
trop
sou-
vent chez
nous,
il
s'est laiss devancer
par
un
tranger
sur le
propre
terrain de ses tudes. C'est un
sculpteur
allemand
qui a,
le
premier,
restitu en
pltre
un
groupe
de Mars et Vnus
d'aprs
les ides de M. Ravaisson et
qui
en a fait
paratre
une
gravure
dans une revue
illustre. Nous
reproduisons
les
lignes principales
de
cette
gravure,
faute d'un meilleur document
;
la res-
titution, compare
celle de M.
Ravaisson, prsente
des diffrences de dtail assez
importantes,
mais elle
est
conforme,
dans son
ensemble,
aux vues de l'ancien
conservateur du Louvre 1.
Ce
projet
se fonde sur un
argument srieux,
savoir
le fait
que
le ct
gauche
de la statue est
plus ngli-
gemment
travaill
que
le reste. Mais il se
heurte,
d'autre
part,
de
graves objections.
Rien
n'y explique
la direc-
tion du
regard
de la
Vnus, qui
ne semble nullement
s'occuper
du dieu
plac auprs
d'elle. L'histoire de l'art
ne connat aucun
groupe
de Mars et Vnus remon-
tant au Ve sicle avant notre re.
Enfin,
rien ne
peut
prvaloir,
mon
sens,
contre
l'impression qui
se
dgage
de l'tude du marbre
lui-mme,
fait
pour
se suffire
dans sa
majestueuse grandeur
et ne
pouvant qu'tre
gt par
le
rapprochement
avec un autre
personnage.
Il est vrai
qu'on
a
signal
des
groupes d'poque
romaine
o une femme
drape,
dans une attitude assez sem-
blable celle de la
ntre,
est
place
ct d'un
guerrier
ressemblant au Mars
Borghse ;
mais nous savons
que
1. M. Ravaisson
pense que
le bras droit de la Vnus tait relev
et n'admet
pas qu'elle
saist de la main droite le bras de Mars. J e
ne me crois
pas
autoris insister ici sur d'autres
divergences,
M. Ravaisson
ayant
seul
qualit pour
le faire. Le
plus grave
dfaut de la tentative de M. Zur
Strassen,
c'est
qu'il
a tourn
arbitrairement vers la
gauche
la tte de sa Vnus.
LA VENUS DE MILO EN 1890 269
les motifs
isols,
crs
par
les
grands sculpteurs
de la
belle
poque,
ont trs souvent t associs d'autres
motifs dans les
groupes
en ronde bosse et les
bas-reliefs
d'une
poque postrieure.
Loin donc
qu'il y
ait l un
argument
en faveur de
l'hypothse
du
groupe pri-
mitif, j'y
vois la
preuve
que
ce
groupe
est inad-
missible,
car dans toutes
les
compositions
romaines
dont
je parle,
l'inclinaison
de la tte et du torse de
la Vnus est diffrente de
ce
que
l'on voit dans notre
statue.
En
gnral,
il ne faut
pas
se fier aux
prten-
dues
rpliques
de la Vnus
dans la
statuaire,
car les
bras ont
toujours plus
ou
moins souffert et leur
as-
pect
actuel est d aux
restaurateurs modernes.
Nous attacherons
plus
d'importance
aux
figures
des
bas-reliefs,
que
le
temps
a
beaucoup
mieux
respects.
Il en est
une,
notamment, qui
ne
parat pas
avoir t assez remar-
que
: c'est une Victoire faisant
partie
de ce
magni-
fique
ensemble de trois mille
figures qui
se droule
sur le ft de la Colonne
Trajane
Rome
(fig. 58).
Elle
rappelle
d'une manire
frappante
une Victoire en
bronze dcouverte
Brescia, qui
doit avoir tenu
ga-
lement un
bouclier 1,
et aussi une Vnus trouve au
thtre de
Capoue,
dont l'attitude
prsente
une ana-
1. Le bouclier actuel a t
ajout par
un restaurateur.
FIG. 58.
Victoire,
relief de la
Colonne
Trajane
Rome.
270 LA VNUS DE MILO EN 1890
logie
souvent
signale
avec celle de la Vnus de Milo.
Faut-il conclure de l
que Millingen
et d'autres
savants ont eu raison de donner un bouclier
pour
attri-
but la Vnus
victorieuse,
soit comme un
miroir,
soit comme une tablette o elle inscrivait des
noms,
soit comme un
tmoignage
de sa victoire sur
Mars,
rappelant
ainsi ces vers de Musset :
... le bonheur
suprme,
Aprs qu'on
a
vaincu,
c'est d'avoir dsarm !
J e m'en
garderai bien, parce que
cette
hypothse, pour
tre dfinitivement
acceptable, impliquerait que
la
main
gauche
tenant la
pomme, qui
est conserve au
Louvre,
est
trangre
la statue ou
appartiendrait,
comme on l'a
gratuitement suppos,
une restauration
faite dans
l'antiquit.
J e me suis content de
poser
le
problme
de la
restitution,
de montrer les difficults
qu'il soulve,
mais
j'ai
dit d'avance
que je
ne le rsou-
drais
pas. Franchement,
si
ce
problme
tait actuelle-
ment
soluble,
se
figure-t-on que
les minents savants
qui s'occupent depuis
soixante-dix ans de la Vnus
m'auraient laiss
le
plaisir
et l'honneur
d'tre,
moi
tard-venu,
moi
chtif, l'OEdipe
de ce
Sphinx
?
Peut-tre
ai-je
tort,
et
je
m'en
accuse, d'employer
cette
comparaison mythologique.
Le
Sphinx
faisait rouler dans
l'abme les malaviss
qui
ne devinaient
pas
son
nigme,
mais la Vnus de Milo est
plus
clmente. Elle semble
savoir
gr
tous,
en les
rcompensant par
la
plus
vive
des
jouissances,
des efforts
qu'ils
font
pour pntrer
son
secret. Car ces efforts les mettent en contact avec le chef-
d'oeuvre le
plus accompli
de l'art
antique
: ils
y
trouvent
sans cesse des raisons nouvelles de l'admirer
davantage
et,
loin
d'expier par
une chute mortelle
l'impuissance
o ils
sont de tout
savoir,
ils s'lvent la suite de la desse
dans ces
rgions
sereines o les
splendeurs
de l'art hell-
nique,
victorieuses des
sicles,
brillent d'un clat ternel.
XV
DOCUMENTS ET
HYPOTHSES RCENTES
SUR LA VNUS DE MILO
i
Le document
Trogoff
1
L'Illustration du 12 dcembre 1896 a
publi
un
extrait des notes de
voyage prises par
M. de
Trogoff,
aspirant
sur la corvette
l'Esprance,
au
printemps
de
1820. Voici le
passage
intressant la Vnus :
1.
[Chronique
des
arts,
9
janvier 1897, p. 16-17,
et 16
janvier 1897,
p. 24-26.]
2.
[Voir l'Illustration,
12 dc.
1896, p. 470, d'aprs
les documents
graphiques
fournis
par moi,
et Monuments nouveaux de l'art
antique,
t.
I, p.
263-265. La restauration de
Ravaisson, excute en
pltm
(au Louvre),
a t
publie
Rev.
archol., 1890, II, pi. XV].
1 2 3 4 5 6 7
FIG. 59.
Restitutions de la Vnus de
Milo,
proposes par Quatremre (1),
un
sculpteur
viennois
(2),
un
sculpteur anglais (3), Furtwaengler (4),
Saloman
(5)
Stillman
(6)
et Ravaisson
(7)
*.
272 DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO
Lors de notre relche
Milo,
un
paysan grec,
en labourant
son
champ,
trouve
que
la terre rsiste aux
coups
redoubls de
sa
pioche,
et, l'ayant retire,
il
aperoit
une sorte de vote.
Piqu par
la curiosit et
par l'espoir
de
quelque
dcouverte
prcieuse,
il creuse tout autour et reconnat une
espce
de niche.
Enfin, aprs beaucoup
de
travail,
trouvant
l'ouverture-porte,
il
s'y prcipite
et
voit,
son trs
grand
tonnement,
une
magni-
fique
statue de
femme,
ayant
ses cts deux herms.
Elle est bien conserve. Dans une de ses mains elle tient une
pomme,
ce
qui
l'a fait
prendre pour
la desse de l'le
parce
que
melon,
en
grec, signifie pomme
;
mais on
peut
tout
aussi bien la
prendre pour
une Vnus. Elle est d'une
grande
beaut
;
les
draperies
sont d'un fini admirable.
Les
premiers
mots de ce document : lors de notre
relche
Milo,
sont
prciss,
nous
dit-on, par
le livre
de bord : Y
Esprance
relcha Milo du 4 au 11
mars,
pour
aller de l
Smyrne.
L'auteur de l'article de l'Illustration a conclu de ce
nouveau
tmoignage
: 1
Que
la Vnus a bien t dcou-
verte au commencement du mois de mars
1820,
et non
le 8
avril;
2
qu'elle
a bien t dcouverte
intacte,
avec
ses bras.
Ce seraient
l,
sans
doute,
des rsultats
d'une
grande importance;
mais
je
ne les crois fonds
sur rien. La note de M. de
Trogoff,
comme
je
vais le
dmontrer,
n'a
pas
mme t
rdige
Milo.
Remarquons
d'abord
que
M. de
Trogoff
ne dit
pas
avoir vu la statue
;
il raconte la dcouverte
d'aprs
un
rcit
qui
lui a t fait. En
outre,
quand
il crit ceci :
Dans une de ses
mains,
elle tient une
pomme,
ce
qui
l'a
fait prendre pour
la desse de l'le
,
il fait clairement
allusion un commencement de
controverse,
entre
gens
d'une certaine
instruction,
sur le nom
qu'il
conve-
nait de donner la statue.
En ce
qui
touche la date de la
dcouverte,
voici
ce
qu'on pourrait appeler
les
phmrides
de la Vnus.
J 'ai
compos
le tableau suivant l'aide des
ouvrages
imprims
et d'une note trs dtaille sur les mouve-
DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO 273
ments de l'escadrille
franaise,
qu'a
bien voulu me
communiquer
M. le Directeur des Archives de la Marine.
Dans mes
rfrences,
l'abrviation Rav. renvoie la
page
du dernier mmoire de M.
Ravaisson-Mollien,
La
Vnus de
Milo, Paris, Klincksieck,
1892. J e ne
fais,
naturellement,
aucun
usage
du document Matterer
,
publi par
Aicard,
en
1874, que je
considre comme
une
mystification
1.
4 mars 1820.
La division navale du
Levant,
com-
pose
de Y
Esprance (commandant
baron Des
Rotours,
chef de la
division),
de la Lionne et de Y
Estafette,
mouille
le 4 mars Milo. M. de
Trogoff
tait bord
del'Esp-
rance,
M. Voutier sur Y
Estafette.
12 mars 1820.
UEsprance part pour Smyrne.
Le
gros temps l'oblige
chercher un
refuge
l'entre du
golfe
d'Athnes. Ce btiment
repart
le 21 mars
;
un
nouveau
coup
de vent le contraint mouiller au Port-
Olivier
(le
de
Lesbos),
d'o il
repart
le 28
mars, pour
mouiller le mme
jour
Smyrne.
La Lionne et
VEstafette
restent Milo.
29 mars.
Le 19
avril,
dans un
rapport
adress
au commandant de la
Chevrette,
Dumont-d'Urville
crit
que
la statue a t dcouverte
trois semaines
environ avant notre arrive Milo. Cette indication
conduirait
placer
la dcouverte de la statue vers le
29 mars
;
elle est videmment
approximative
et sans
valeur
(Rav., 27).
1.
[M.
Ravaisson en afait
justice
dans le Mmoire cit ci-dessus en
prouvant qu'il
n'a
pas
t
rdig
avant 1838
;
les
soupons qu'il
exprime
sur l'authenticit de cedocument ne
paraissent pas
d'ailleurs
fonds. Voir aussi
Aicard,
Le roman d'une
statue,
dans le
suppl-
ment illustr de la Revue
hebdomadaire,
19 octobre
1912.]
S. REINACH 18
274 DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO
8 avril.
Le
paysan Yorgos
dcouvre la
Vnus,
que
voit aussitt
Voutier,
lve de
premire
classe
bord de
Y
Estafette.
La date est fournie
par
une lettre
de
Dauriac,
capitaine
de
frgate,
commandant la
Bonite,
lettre du 11 avril adresse au consul de
France,
Pierre
David,
et dbutant ainsi : Il a t
trouv,
il
y
a trois
jours, par
un
paysan,
etc.
(Rav., 10).
Le tmoi-
gnage
de M. Voutier a t
publi
en 1874
(Dcouverte
et
acquisition
de la Vnus de
Milo)
1.
Les
prcieux croquis
faits
par
le mme au moment
de la
dcouverte,
montrant la Vnus en deux
morceaux,
sans
bras,
ont t
reproduits par
M. Ravaisson dans
l'ouvrage
cit
plus
haut
(pi.
II
;
ici
fig. 60).
Voutier,
dans sa
brochure,
confirme
qu'il
n'avait d'abord t
dcouvert
que
la moiti
suprieure
de la
statue, ajou-
tant
qu'il
avait trouv ensuite la moiti infrieure et
un
fragment
destin tre
plac
entre les deux moitis
2
.
1. Cette brochure a t
imprime
Hyres ;
on la trouve la Biblio-
thque
Nationale.
2.
Ecrite, cinquante-quatre
ans
aprs
les
vnements, par
un
homme videmment
fatigu,
la brochure de M. Voutier doit tre
FIG. 60.
Dessins de Voutier faits Milo.
DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO 275
10 avril.
Note des Archives de la Marine :
Les
deux autres btiments de la
division,
la Lionne et
l'Estafette,
taient rests
Milo 1,
o ils
reurent,
le
consulte avec
grande prcaution.
Comme elle est des
plus
rares
et
que
M. Ravaisson n'en a cit
que quelques lignes, je
crois utile
de rsumer ici ce
qui
concerne la dcouverte :
P. 7: En
1820, je
faisais
partie
de la station du
Levant, embarqu
sur la
golette l'Estafette.
Dans le loisir d'une relche
Milo, je
voulus faire des fouilles...
Aprs
avoir examin les
lieux,
il fut hors de doute
que je
devais
commencer mes recherches au
pied
du rocher
escarp
sur
lequel
avait t situe la ville
antique,
dont les
dbris,
sa
destruction,
devaient
y
avoir t
prcipits.
En
effet, je
ne tardai
pas
rencon-
trer un nombre infini de
fragments
du
plus
beau marbre de
Paros,
architecture, sculpture,
un buste dont la tte avait t
change
plusieurs fois,
un
pied
de bon
travail,
deux statues
drapes
du meil-
leur
style,
sans
tte,
ni
mains,
ni
pieds. Interrompu par
l'aventure
qui
fait
l'objet
de cet
crit, je
fis enfouir tout cela
pour
le mettre
l'abri des vicissitudes
jusqu'
un moment favorable. Pendant
que je
surveillais mes
travailleurs,
deux braves marins de
l'Estafette,
vingt
pas
de
nous,
un
paysan
tirait des
pierres
d'une
petite chapelle
enfouie
par
l'exhaussement du sol et
qui
montrait encore des traces de
pein-
tures intrieures. Le
voyant
s'arrter et
regarder
avec attention
au fond de son
trou, je m'approchai ;
il venait de mettre au
jour
la
partie suprieure
d'une statue en fort mauvais tat
et,
comme elle
ne
pouvait
servir dans la
construction,
il allait la recouvrir de
dcombres.
Quelques piastres
la
firent,
au
contraire,
sortir. Elle n'avait
pas
de
bras,
le nez et le noeud de la chevelure taient
casss,
un trou
grossirement
fait dans le ct droit
indiquait
une ancienne et bar-
bare restauration... J e
pressai
mon homme de chercher l'autre
partie.
Il ne tarda
pas
la
rencontrer,
mais les deux
parties
ne
pouvaient
s'ajuster
: il
manquait
un
tronon
intermdiaire...
Beaucoup
de
pa-
tience et de nouveaux
encouragements
firent aussi dcouvrir ce bloc
ncessaire.
Alors, je
fis dresser la statue. Aussitt Voutier va aver-
tir
l'agent
consulaire
franais
et retourne bord chercher son album.
Cependant,
le
paysan
continuait sa fouille et dcouvrait deux termes
avec
inscriptions,
ainsi
qu'un
bras si fruste
qu'il
tait
impossible
d'en tirer
parti
(p. 10).
Le dessin de Voutier
prouve qu'il
se
trompe
sur un
point
:
malgr
la dcouverte du bloc ncessaire
,
il ne fit
pas
tout de suite dresser la
statue,
mais en dessina d'abord
spar-
ment les deux
tronons.
Mais Voutier raconte avec dtail comment il
fit dresser la
Vnus,
avec l'aide du
paysan grec,
sur lelieu de la trou-
vaille, puis
bord,
avec celle de ses
gabiers (p. 18-10).
1. Voutier se
trompe
donc
quand
il crit
(p.l7):
J e suis sr
qu'aucun
autre btiment de
guerre que
le ntre n'tait sur les lieux au
temps
de la dcouverte. On
peut, cependant,
admettre
que
la Lionne avait
momentanment
quitt
le
port pour
des exercices.
276 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
10
avril, par
la Bonite rentrant en
France,
l'ordre du
chef de division de rallier Y
Esprance
Smyrne.
Ces
btiments sont arrivs
Smyrne
le 26
avril,
retards
Milo et dans leur traverse
par
les calmes et vents
contraires
(d'aprs
le
rapport
du commandant Des
Rotours.
)
Cette note officielle fait autorit
;
il est
donc faux : 1
que
le
commandant de
l'Estafette,
sur la
vue des documents de
Voutier,
ait
appareill pour
Constantinople,
afin d'instruire de la dcouverte notre
ambassadeur,
M. de Rivire
(Rav., O1)^
0
que
la Bonite
ne soit arrive Milo
que
le 11 avril.
11 avril.
Dauriac,
commandant de la
Bonite,
crit
P.
David,
consul
Smyrne, que
la statue a t trouve
1. M. Ravaisson a
emprunt
cette assertion Voutier. Ce dernier
raconte
qu'il
tait all avertir le commandant Robert
qui,
sur
l'heure,
dcide notre
dpart pour Constantinople,
afin de faire
appel
notre
ambassadeur. M. de
Rivire,
la vue des dessins et de notre
chaleureuse
admiration,
ordonna un de ses secrtaires d'ambas-
sade,
M. de
Marcellus,
d'aller immdiatement traiter cette brillante
affaire. Le vent nous avait favoriss
;
en
peu
de
jours
nous tions
de retour. Nous entrions
joyeusement
dans la
rade, quand
nous
aper-
mes
une
chaloupe
lourdement
charge, qui
se
dirigeait
vers un
brick
ragusais.
Nous disions en riant : a
Voil notre statue
qu'on
nlve ! Ce n'tait
que trop
vrai.
Suit l'histoire de l'heureuse inter-
vention de Marcellus. Voutier a brouill les dates. La dcouverte
est du 8 avril
; or, l'Estafette,
amenant Marcellus de
Constantinople
Milo,
n'arriva dans le
port
de cette le
que
le 23
mai;
elle en
partit
le 26 avec la statue. Dans l'intervalle entre le 10 avril et le 23
mai,
l'Estafette
avait t
Smyrne,
avec le reste de
l'escadrille,
et ce
que
dit Voutier sur un
voyage rapide
et direct de Milo
Constantinople
est absolument controuv. J 'en
puis
encore donner comme
preuve
une lettre du consul David M. de
Rivire,
date de
Smyrne
le
25 avril 1820
(Goeler,
Die
Venus, p. 190),
o il rsume la lettre
que
Dauriac lui crivait le 11 avril et
ajoute
:
M. le commandant de
VEstafette
l'a vue aussi et trouv le torse bien model
;
il
pourra
don-
ner
plus
de dtails Votre Excellence. Comme il n'est
pas question
du commandant de
l'Estafette
dans la lettre de
Dauriac,
il faut ad-
mettre : 1
que
le commandant avait
parl
de la statue
David,
lors de son arrive
Smyrne
vers le 25 avril
;
2
qu'
cette date il
allait
partir
ou venait de
partir pour Constantinople.
DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO 277
par
un
paysan
il
y
a trois
jours, qu'elle reprsente
Vnus recevant la
pomme
de Paris et
ajoute
: On
n'a,
dans ce
moment, que
le buste
jusqu'
la ceinture. J 'ai
t la voir. La tte me
parat
bien
conserve,
ainsi
que
la
chevelure. Le bout d'un des seins est cass.
(Rav., 10).
M. Ravaisson a
pens que
Dauriac avait seulement vu
la
partie suprieure
de la
statue, transporte
dans
la
cabane du
paysan grec,
sans doute avec la main tenant
une
pomme, qui
avait t trouve au mme endroit.
Autrement,
d'o aurait-il
pu
induire
que
la desse
recevait de Paris la
pomme
de Discorde ? Cette conclu-
sion
peut
tre discute. Voutier
crit,
en effet
(p. 19)
:
Leur
disposition (des plis),
d'accord avec toute la
partie suprieure
de la
draperie,
m'avait donn l'ide
de Vnus laissant tomber son voile et recevant la
pomme.
Le mouvement
qu'on peut
reconnatre aux
bras se
prte
cette
hypothse.
Donc, Voutier,
tmoin
oculaire de la
dcouverte,
n'a
pas remarqu que
le
fragment
de bras dont il
parle
tnt une
pomme.
S'il
dit
vrai,
ceux
qui
ont
parl aprs
lui de Vnus recevant
la
pomme
de Paris n'ont fait
que rpter
son
hypothse,
qui
trouva crance d'autant
plus
aisment
que
Voutier
passait pour archologue.
12 avril.
Brest, agent
consulaire
de
France,
crit
David
(Rav., 11)
: Un
paysan
vient de trouver trois
statues en marbre
reprsentant,
l'une,
une Vnus
tenant la
pomme
de discorde la main. Elle est un
peu
mutile
;
les bras sont casss. Elle est
partage
en deux
pices par
la ceinture1... Les
opinions sont.cependant
trs
partages,
car il
y
a de ces messieurs les
officiers
1. Brest dit
expressment que
les deux autres statues sont le
dieu Herms et un
jeune
enfant
;
M. Ravaisson se
trompe
en son-
geant
deux statues de femmes
acphales qui
avaient t dessines
par
Voutier
(Rav., p. 11).
278 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
qui
l'ont
observe, qui
disent
que
ce n'est
pas grand'chose,
et
d'autres,
au
contraire,
disent
que
c'est un
fort
bel
ouvrage
(Rav., 11).
On avait donc
dj
discut sur la Vnus.
II
1
M. Ravaisson crit
(p. 12)
:
Peu
aprs,
M. Duval
d'Ailly,
commandant de la station navale du Levant
et mont sur la
gabare
la
Lionne,
arrivait Milo
;
il
voyait,
lui
aussi,
dans la chaumire de
Yorgos,
la
partie
suprieure
de la Vnus et il crivait M. David en des
termes tout semblables ceux dont s'tait servi M. Dau-
riac. Il
y
a
l, je crois,
deux
petites
erreurs rectifier.
Duval
d'Ailly
commandait la
Lionne,
et non la station
du
Levant, qui
avait
pour
chef M. Des Rotours
;
la
Lionne n'arriva
pas
Milo
peu
de
jours aprs
,
attendu
qu'elle y
tait en station
depuis
le 4 mars
2
et
partit
da l
pour Smyrne
le 10 ou le 11 avril.
16 avril.
Dumont
d'Urville, enseigne
de vaisseau
sur la
gabare
la
Chevrette,
aborde Milo.
19 avril.
Dumont d'Urville va voir la Vnus et
adresse,
ce
sujet,
un
rapport
au commandant du
navire
;
ce
rapport
a t
publi (Rav., 27).
En voici
les
phrases
essentielles :
Un
paysan grec... parvint
dblayer
une
espce
de niche dans
laquelle
il trouva
une statue en
marbre,
deux herms et
quelques
autres morceaux
galement
en marbre. La statue tait
de deux
pices, jointes
au
moyen
de deux forts tenons
1.
[Chronique
des
Arts,
16
janvier 1897.]
2. Il est
toujours possible que
le navire se ft momentanment
loign
de la cte le 8 avril.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 279
en fer 1. Le Grec... en avait fait
porter...
dans une
table,
la
partie suprieure,
avec les deux herms
;
l'autre
tait encore dans la niche. J e visitai le tout attenti-
vement... La statue...
reprsentait
une femme
nue,
dont la main
gauche
releve tenait une
pomme
et la
droite maintenait une ceinture habilement
drape
et
tombant
ngligemment
des reins
jusqu'aux pieds ;
du
reste,
elles ont t l'une et l'autre mutiles et sont
actuellement dtaches du
corps...
Tous ces attributs
sembleraient assez convenir la Vnus du
J ugement
de Paris
;
mais o seraient alors
J unon,
Minerve et
le beau
berger
? Il est vrai
qu'on
avait trouv en mme
temps
un
pied
chauss d'un cothurne et une troisime
main;
d'un autre
ct,
le nom de
l'le, Mlos,
a le
plus
grand rapport
avec le mot
melon,
qui signifie
pomme.
Ce
rapprochement
de mots ne serait-il
pas indiqu par
l'attribut
principal
de la statue ?
Les
lignes qui prcdent prsentent
une
grande
analogie
avec la fin de la note de M. de
Trogoff
2. Il
n'est
pas croyable que
deux
jeunes
officiers de marine
soient
arrivs, indpendamment
l'un de
l'autre,
rapprocher
le nom de l'le du mot
grec qui signifie
pomme
. Ils se sont faits les chos d'une mme
hypo-
thse,
qui
avait sans doute
pris
naissance dans l'entou-
rage
du consul Brest.
Trogoff
n'tait
pas
Milo
quand
on a dcouvert la statue
;
il aura
reu
ce
sujet
une
lettre
Smyrne,
o se trouvait son btiment. Notez
qu'il
ne dit
point
avoir vu la Vnus
;
il dit seulement
qu'elle
a t trouve
lors de notre relche
et cette erreur de
date
pourrait s'expliquer
aisment, puisque
la date
1.
Voutier, p.
5 : Il
n'y
avait aucune
apparence
d'un tenon de fer
unissant les deux blocs. Cette dclaration est
importante.
Nous
voyons par
l
que
Dumont d'Urville
affirme,
dans sa
relation,
ce
que
l'examen des
objets
le conduisait seulement
supposer.
La confiance
que j'avais
autrefois en cette relation s'est de
plus
en
plus
affaiblie.
2. O l'on trouve aussi
l'expression
une
espce
de niche.
280 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
du 8 avril est la seule
qui
soit srieusement tablie
par
le
tmoignage
de Dauriac. Dumont d'Urville
indique approximativement
le 29
mars; Brest,
dans
une lettre
Marcellus,
date du 26
mai,
indique
non
moins
approximativement
le 26 avril
( lorsque
cette
statue fut trouve il
y
a un mois
, Rav., p. 14);
d'autres ont
plac
la dcouverte
vers la fin du mois
de fvrier
(Froehner,
Notice sur la
sculpt., p. 172.)
Mais
je
crois
qu'il n'y
a
pas
d'erreur
proprement
parler.
Comme nous l'avons
vu,
sur trois btiments arrivs
Milo le 4
mars,
deux
y
taient rests
jusqu'au
10 avril
;
l'Esprance
seule,
avec le commandant Des Rotours
et
Trogoff,
tait
partie pour Smyrne.
Ce navire tant
celui du chef de la
division, Trogoff
a fort bien
pu rap-
peler
un vnement
qui
s'tait
produit
lors de notre
relche
,
entendant
par
ces mots
lors de la relche de
notre escadrille.
Nous concluons de l
que
le nouveau
tmoignage
est sans
valeur,
non seulement en ce
qui
touche la
date,
mais en ce
qui
concerne l'attitude et les attributs
de la statue. Il faudrait
cependant
en finir une bonne
fois avec cette
lgende
de la Vnus dcouverte intacte.
Le 26 novembre
1820,
Brest crit au
charg
d'affaires
de France
Constantinople
:
Son Excellence m'a laiss
des ordres
pour
faire des recherches
pour
trouver les bras
et autres dbris de la statue. Cette
phrase
ne suffit-elle
pas
dissiper
tous les doutes
1
?
Si l'on fait abstraction du rcit de
Voutier,
la
ques-
tion
des bras se
prsente
comme il suit. Le 11
avril,
Dauriac
parle
de Vnus recevant la
pomme
de Paris
;
le
12,
Brest dit
qu'elle
tient la
pomme
de discorde la
main et
ajoute que
les bras sont casss.
Donc,
ce n'est
1. Si Brest a dit
plus
tard tout le
contraire, par exemple
MM. Pis-
catory
et
Doussault,
c'est
qu'il
a fini
par
croire lui-mme un conte
qu'il
avait
imagin.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 281
pas
un bras
qu'on
avait trouv avec la
Vnus,
mais
une main tenant la
pomme
:
c'est, vraisemblablement,
celle
qui
est au
Louvre,
bien
qu'il
soit fort douteux
qu'elle
ait
appartenu
la statue. Dumont d'Urville
crit,
le 19
avril,
qu'on
a trouv en mme
temps
une
troisime main
(notez qu'il parle
d'une main et non
d'un
bras) ;
il dit aussi
que
les mains
(dont
l'une tenait
la
pomme
et l'autre soutenait une
ceinture)
sont l'une
et l'autre mutiles et dtaches du
corps. Donc,
il aurait
exist,
dans la mme cachette
que
la
Vnus,
trois
mains,
dont l'une tenait une
pomme;
Dumont d'Ur-
ville a
suppos que
l'une des deux autres soutenait
la ceinture de la
Vnus; mais, ici,
de deux choses
l'une : ou cette main tenait un morceau de
draperie,
et alors elle ne
pouvait pas appartenir
la
Vnus,
dont
la
draperie
ne
porte
aucune trace d'une main
qui
aurait
servi la
soutenir;
ou cette main n'tait
qu'un frag-
ment,
et alors
ce
qui
me semble avr
Dumont
d'Urville aura
simplement indiqu,
comme l'avait
dj
fait
Dauriac,
une restitution
qui
lui
paraissait
possible
et
qui
ne l'est
pas.
Avec le rcit de
Voutier,
l'obscurit
augmente.
Car,
comme nous 1avons fait
observer,
Voutier mentionne
la dcouverte d'un bras
si fruste
qu'il
tait
impossible
d'en tirer
parti ;
il ne dit
pas que
ce bras se termint
par
une main
qui
tenait une
pomme ;
il dit formelle-
ment
qu'il
est
arriv, par hypothse,
l'ide d'une
Vnus recevant la
pomme
de Paris. Cela est
possible;
mais alors il faut admettre
que
Voutier connaissait
seulement le
fragment
de bras
qui
est au Louvre
(Rav.,
pi. III,
nl),
et
que
la
main
avec la
pomme (ibid.,
n
2)
ne fut trouve ou
remarque que plus
tard.
Disons encore
qu'il
ne faut
pas
serrer de
trop prs
le texte de Dumont d'Urville :
On avait trouv
en mme
temps
un
pied
chauss d'un cothurne et
une troisime main. En conclure
qu'on possdait
282 DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO
dj
deux mains de la
Vnus,
serait excessif
;
la
troisime main
peut-tre simplement
une main iso-
le, juge trop grande
ou
trop petite pour
avoir
appartenu
la Vnus. Peut-tre cette
main,
comme
le
pied
chauss du
cothurne, provenait-elle
non de la
cachette
de la
Vnus,
mais des fouilles
que
Voutier
avait faites dans le
voisinage
et au cours
desquelles
il dit avoir dcouvert un
pied
de bon travail
Voutier a dessin les deux herms
1
sur leurs
pi-
douches
(Rav., pi. II).
M. Ravaisson a bien voulu me
communiquer
une
photographie prise
sur le dessin
original
de Voutier. Cette
photographie
montre
que
la
publication
de ce
dessin,
dans le mmoire de M. Ravais-
son,
est
fautive,
car elle
reproduit
un
calque
du
dessin,
et non
l'original. L'inscription
d'un des
herms,
telle
que
l'a donne M.
Ravaisson,
est
inintelligible.
Voici
les lectures
que
m'a fournies l'examen de la
photo-
graphie.
Le
pidouche
de
Thermes tte
juvnile porte
l'ins-
cription
:
ANAI INIAO
IOXEYSAnOMAIANAAO
EnOIHSEN
C'est,
avec une faute la seconde
ligne,
la fameuse
inscription que
M.
Furtwaengler
et d'autres s'obs-
tinent mettre en relation directe avec le
pidestal
de la Vnus. On sait
qu'elle
a t
transporte
au
Louvre,
o elle fut dessine
par Debay,
et
qu'elle
a
disparu
mystrieusement peu
ds
temps aprs.
Le
pidouche
de Thermes tte barbue
porte
une
inscription que
M. Ravaisson n'a
pas
transcrite et
1.
Il
n'y
avait
que
deux herms et non trois.
(Voutier, p. 5).
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 283
qu'il
semble avoir considre comme une suite de carac-
tres mal
copis.
Sur la
photographie, je
lis clairement :
E0AQPI2AL AAIEinPATOZ
ce
qui
doit se restituer ainsi :
soSiopcSa 'AyvjatCTTpTOU
Nous obtenons ainsi un nom nouveau de
sculpteur,
Thodoridas fils
d'Agsistratos (in-ne
sicle av.
J .-C).
M.
Furtwaengler (M
aster
pices, p. 375)
dit
que
Ton
a sans doute dcouvert avec la Vnus deux
pidouches
portant
au milieu
une cavit carre et
que
Voutier
aura arbitrairement
superpos
les herms ces
pi-
douches. Cette
hypothse
ne
supporte pas
l'examen.
En
effet,
le dessin de Voutier
comprend
: 1 le torse
de la Vnus
jusqu'
la
ceinture;
2 le bas du
corps;
3 et 4 les herms. Si Voutier avait t en veine de
restitutions,
il aurait dessin l'ensemble de la Vnus.
En second
lieu,
Dumont d'Urville
note,
le
19, que
le
pidestal
d'un des herms a d
porter
aussi une
inscrip-
tion
,
en
ajoutant que
les caractres en
sont tellement
dgrads qu'il
m'a t
impossible
de les dchiffrer .
Ceci
parat prouver qu'entre
le 10 et le 19
avril,
Ther-
mes
juvnile
avait t
spar
de son
pidouche;
restait
l'autre,
dont
l'inscription devait,
en
effet,
tre
peu
lisible
puisque
Voutier Ta transcrite avec
cinq
fautes sur
vingt
et une lettres. J 'ai dmontr
rcemment,
l'aide de
copies d'inscriptions
faites en 1819
par
Dumont d'Ur-
ville et conserves dans les
papiers
de
Clarac,
que
ce
brave marin ne
pouvait
dchiffrer
que
les textes faciles 1.
Ainsi,
Thra,
il
copie
un
fragment
comme il suit :
niNrniNin rus
1. Revue
archol., 1896, I, p.
122.
284 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
c'est--dire d'une manire tellement fautive
qu'aucune
restitution n'est
possible,
du moins
pour
moi.
M.
Furtwaengler suspecte
Voutier
parce que,
sur
son dessin de la
partie
infrieure de la
Vnus,
la
plinthe
dessine un
rectangle parfait.
C'est l une restauration
sans aucune
importance,
un
simple
trac
gomtrique
1.
Mais la meilleure
preuve
de l'exactitude de
Voutier,
c'est
qu'il
n'a
pas
dessin un
fragment
destin tre
plac
entre les deux moitis de la
statue,
fragment qui
ne fut
rajust
au torse
que postrieurement
l'excution
du dessin. Du
reste,
dans un
post-scriptum
sa brochure
(p. 28),
Voutier flicite M. Ravaisson d'tre
oppos
aux restaurations des statues
antiques,
et il
ajoute
:
Mais
grce pour
le nez de la
Vnus,
sans intrt
pour
l'art et dont la mutilation
donnerait, j'en
suis
sr,
au
puriste
le
plus
svre le mme sentiment
pnible qui
l'a
fait
rtablir dans mon
dessin,
tandis
que
les autres
(sic)
taient d'une exactitude
scrupuleuse.
Un homme
qui
s'accuse
ainsi,
aprs cinquante-quatre
ans,
d'avoir
rtabli un bout de
nez,
n'tait
pas capable
de
figurer,
sous les
herms,
deux
pidouches
avec
inscriptions
qui
n'auraient
pas appartenu
ces marbres.
Ainsi, je
crois
qu'on peut affirmer,
sans
hsitation,
que
le
sculpteur
d'Antioche du Mandre n'est
pas
l'auteur de la
Vnus,
conclusion directement
oppose
celle de M. Furt-
waengler
et d'une
grande importance pour
la date de la
Vnus.
Un
critique
allemand des Meisterwerke de M. Furt-
waengler
crivait rcemment
que
la
question
de la
Vnus
tait rsolue. Pour
quiconque
sait lire avec
soin ce
qui prcde,
il doit tre vident
qu'elle
est encore
1. Voutier
(p. 19)
crit
que
la
plinthe
tait
large,
intacte et hori-
zontale
,
ce
qui permettait
de dresser la statue sur le
pont
d'une
golette
en mouvement. Intacte est de
trop
;
mais il est certain
que
la
base,
telle
qu'elle tait,
suffisait
parfaitement
supporter
la statue.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 285
rsoudre 1, puisque
la thse soutenue
par
M. Furt-
waengler
est inconciliable avec les faits.
III
Thodoridas,
fils de Lastratos
2
Quelques jours aprs
la
publication
de l'article
pr-
cdent, je
reus
la visite d'un savant
allemand,
M. Hiller
von
Gaertringen, qui s'occupait
alors de
runir, pour
l'Acadmie de
Berlin,
les
inscriptions
de
Milo,
de Thra
et d'autres les.
Quand je
lui montrai celle
qu'avait
copie
Voutier,
il se souvint aussitt d'en avoir vu une
semblable
;
aprs quelques
instants
de
recherches,
nous l'avons retrouve. Cette
inscription
me
parat
fort
importante pour
tout l'ensemble des
problmes que
soulve la Vnus
;
peut-tre
mme en donnera-t-elle
la solution.
Elle a t
copie
en 1878 Milo
par
feu Charles Tissot
et se lit ainsi :
0EOAQPIAAS AAIETPATO
nOZEIAANI
c'est--dire :
Thodoridas,
fils de
Lastratos,
Posi-
don
3
. Tissot l'a
copie
au vieux
port,
sur un
pidestal
de statue
(Bulletin
de
Correspondance hellnique,
t.
II,
p. 522).
Or,
comme le nom de Thodoridas est assez
rare,
on est
surpris
de
rencontrer,
Milo,
un Thodoridas
fils
d'Agsislratos (inscription
de
Voutier)
ct d'un Tho-
1. C'est aussi
l'opinion
de M.
Collignon,
Histoire de la
sculpture
grecque,
t.
II,
p.
473.
2.
[Chronique
des
Arts,
30
janvier 1897, p. 42-4.]
3.
[J e corrige partout
Dastratos,
lecture
fautive,
en Lastratos
1929
J ].
286 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
doridas
fils
de Lastratos
(inscription
de
Tissot)
;
on se
demande si ces deux
personnages
ne seraient
pas
iden-
tiques,
ce
qui impliquerait,
chez
Voutier,
une erreur de
copie
en
plus
de celles
que
nous avons constates.
Cette
hypothse
devient
presque
une certitude
quand
on
compare
les deux mots :
AAIEILTPATOZ
(Voutier),
AAIS TPATO
(Tissot).
Voutier a
simplement rpt,
en
copiant,
les lettres
12.
Donc,
il faut
restituer,
sur le
pidouche
de
Thermes,
le nom du mme
personnage qui figure
sur le
pidestal
vu
par
Tissot :
Thodoridas, fils
de Lastratos.
Ce
pidestal a,
depuis,
t
transport
au Muse
central d'Athnes
(n237
du
catalogue
de M.
Cavvadias).
Tissot en avait transcrit
l'inscription
en caractres
appartenant,
au
plus tard,
au milieu du IVe sicle av.
J .-C;
M. Cavvadias attribue les lettres
la belle
poque
de l'art
grec
(p. 194).
En
outre,
la forme dialectale
rioaetSvt
et
Tpel AaitrtpaTO
(au
lieu de
AaiaTpaiou)
sont
des indices d'une
poque
assez ancienne.
Si
Thodoridas,
fils de
Lastratos, qui
a offert une
ddicace
Posidon,
est
identique
celui
qui
a consacr
Thermes
trouv avec la
Vnus,
cet herms est certaine-
ment antrieur Alexandre le Grand. 11
n'y
a
plus
lieu,
d'ailleurs,
de considrer Thodoridas comme un
sculpteur;
l'inscription
vue
par
Voutier doit tre une
ddicace,
non une
signature.
Mais voici o les choses se
compliquent (il
est dit
que, partout
o la Vnus de Milo est en
jeu,
on se heurte
des difficults
imprvues !)
Au mois de mars
18781,
un nomm J ean
Nostrakis,
propritaire
d'un
jardin
situ au bord de la
mer,
Milo,
1.
[Comme
on le verra
plus loin,
la date de
1877,
donne dans l'ar-
ticle de la
Chronique
des
arts,
tait
errone,]
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 287
dans la localit dite
Klima, plantait
des
citronniers.
Au cours de son
travail,
il rencontra
quatre
statues
de
femmes,
sans
tte,
une statue
questre
mutile et
une statue colossale de
Posidon,
haute de 2 m. 17 et
bien
conserve, quoiqu'en fragments.
Charles Tissot
tait alors ministre de France Athnes. Dsireux
d'acqurir
le Posidon
pour
le
Louvre,
il se rendit
Milo sur un btiment de
guerre,
le San. Mais Brest
le fils de
l'agent
consulaire
qui
avait contribu
l'acquisition
de la Vnus et
agent
consulaire lui-mme
parat
s'tre montr
peu diplomate
en cette occur-
rence
1
: bien
que
le ministre de l'Instruction
publique
2
et autoris Tissot donner 40.000 francs du
Posidon,
que
Tissot
appelait
le frre de la Vnus de Milo
,
l'acquisition
fut
impossible, parce qu'on
en avait bruit
le
projet.
Le
gouvernement grec
acheta le Posidon et
trois
autres marbres
provenant
de la mme trouvaille
au
prix
de 27.000 drachmes et les fit
transporter
Athnes. Le Posidon ne fut reconstitu et
expos
au
public qu'en
1889
;
M.
Collignon
en donna alors
une
hliogravure (Bulletin
de
Corresp. hellnique, 1889,
pi.
III et
p. 498).
Outre
'
le
Posidon,
le Muse central d'Athnes
possde
les marbres
suivants,
dcouverts en 1878 au
mme endroit :
N 236. Statue colossale de femme
drape ;
N 237. Statue d'homme sans
tte, drap,
de
grandeur
natu-
relle
;
N 238. Statuette de femme
(Aphrodite?)
Or, d'aprs
une note remise M.
Collignon par
1. J 'ai vu Brest Milo dans l'automne de 1880. Il
rejetait
l'in-
succs sur
Tissot, qui
avait donn l'veil au
gouvernement grec
en
arrivant dans l'le sur un croiseur de l'escadre
;
en
revanche,
Tissot
accusait Brest d'avoir voulu
far
da se.
2.
[C'tait
alors Bardoux
; j'avais parl
tort de J .
Ferry.]
288
DOCUMENTS
SUR LA VNUS DE MILO
M.
Carteron,
consul de France
Syra,
on avait
trouv,
avec le
Posidon,
quatre
statues de femmes et une statue
questre.
Cette dernire a
disparu
x
;
d'autre
part,
la
note de M. Carteron ne mentionne
pas
l'homme
drap
(n
237 du muse
d'Athnes).
Tout cela n'est
pas
facile
dbrouiller,
mais ne concerne
pas
directement notre
propos.
La statue d'homme
drap
est
expose
au muse
d'Athnes sur le
pidestal
vu
par
Tissot au vieux
port,
qui porte Tincription
Thodoridas Laistrato Poseidani.
M.
Cavvadias,
dans son
catalogue,
n'met aucun doute
sur la connexit de la statue et de la base.
J usqu'
nouvel ordre
(j'ai
demand ce
sujet
des informa-
tions
Athnes),
la chose me semble douteuse.
Si,
toutefois,
M. Cavvadias a
raison,
il en
rsultera les
consquences que
voici : Thodoridas a consacr
Posidon une statue colossale entoure
d'autres statues
;
Tune de ces dernires tait sa
propre image,
sur le
pi-
destal de
laquelle
il a fait inscrire : Thodoridas
Posidon. Mais nous avons vu
que
ce mme
Thodoridas
a ddi l'un des herms dcouverts avec la Vnus
;
si la Vnus est
contemporaine
de cet
herms,
elle est
donc aussi
contemporaine
du Posidon.
Tissot,
M.
Collignon et, aprs lui,
M.
Furtwaengler
ont insist sur les
analogies que prsentent
la Vnus
et le Posidon.
Comme la Vnus de
Milo,
crit M. Col-
lignon,
la statue est faite de deux blocs
rapports, qui
se
rajustent par
une section horizontale la hauteur
de la ceinture.
La Vnus fut dcouverte dans une
niche
; or,
le
Posidon,
dit M.
Collignon,
tait des-
tin
figurer
soit dans une
niche,
soit contre une
paroi ,
parce que
le travail du revers est tout fait
nglig.
La valeur
artistique
du Posidon semblait mdiocre
1.
[Elle
a t retrouve dans l'le et
je
l'ai
publie, Cultes,
t.
IV,
1912, p. 426.]
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 289
M.
Collignon, qui
en trouvait l'attitude
conqurante
et
quelque peu tapageuse
;
il
l'attribuait au 11e sicle
avant J .-C. et
ajoutait
:
La statue de
jeune homme,
qui porte
la ddicace de
Thodoridas,
offre le mme
style
facile et
banal,
le mme
geste
de la main
pose
sur la hanche
;
j'inclinerai
la croire
contemporaine
de la statue
qui
nous
occupe.
On en
peut
dire autant
d'une statue colossale de femme
(n
236 du muse
central),
o le travail des
draperies,
les
gros plis
masss
en bourrelet
pais
autour de la ceinture dnotent une
excution fort mdiocre.
Ce
qui prcde
serait admissible si
l'inscription
de
Thodoridas
pouvait appartenir
au 11esicle avant J .-C.
Mais,
moins
que
Tissot n'en ait fait une
copie
de fan-
taisie,
cela est absolument
impossible;
il faut
remonter,
pour
trouver de
pareils
caractres,
jusqu'au
milieu
du ive sicle. J 'ai demand des informations
Athnes;
si
je
viens
apprendre que l'inscription
de Thodoridas
peut
tre du 11e
sicle, je
me hterai d'en convenir
;
mais,
dans l'tat actuel de notre
savoir, je
dois la
placer
au ive
sicle,
avec la Vnus et le Posidon 1.
M.
Furtwaengler place
la Vnus et le Posidon au
11e sicle avant J .-C.
J usqu' prsent, pour
tablir
la date de la
Vnus,
on
disposait
des lments
que
voici :
1 La mention d'Antioche du
Mandre,
fonde entre
281-261, patrie
du
sculpteur qui
a
sign
sur la base
d'un des herms
;
cette mention ne donne videmment
qu'une
limite
suprieure;
2 les caractres de cette
inscription,
vue
par
Clarac,
mais connue
depuis par
une
gravure seulement,
l'original ayant disparu.
Clarac
pensait que l'inscription pouvait
dater du ine
sicle,
mais la
plupart
des autres
critiques
l'ont attribue
au Ier sicle avant J .-C.
Maintenant,
on va
pouvoir
1.
[La publication
du fac-simil ne laisse aucun doute :
l'inscription
de Thodoridas est bien du ive sicle. Voir
Cultes,
t.
IV, p.
425,
fig
2.
1929.]
S.
BEjNACH
19
290 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
s'autoriser de l'autre
inscription
de
Thodoridas,
qui
existe
Athnes;
car il
n'y
a aucun motif de tenir
compte
de
l'inscription
d'un des herms et de
ngliger
l'autre. Si cette
inscription
remonte au ive
sicle,
comme celle
qui
lui fait
pendant
est certainement
pos-
trieure 280
(
cause de la mention
d'Antioche),
il
faudra conclure
que
les deux herms ne sont
pas
contemporains, qu'ils
ne sont
pas davantage contempo-
rains de la Vnus et
que
la
question
de la date de notre
statue doit tre entirement laisse
l'apprciation
des historiens de l'art. En
revanche,
si elle
peut appar-
tenir au ne
sicle,
il sera ncessaire d'admettre la thse
de M.
Furtwaengler
: savoir
que
la
Vnus,
les herms
et le Posidon ont t
sculpts
vers Tn 100 avant J . -C.
On sent de
quelle importance
sera,
pour
les discussions
venir,
le fac-simil de
l'inscription
de Thodoridas.
Il est un
point,
en tous les
cas,
sur
lequel
M. Furt-
waengler
a cause
perdue.
Dans sa restauration de la
Vnus,
il annexe la
plinthe
actuelle de la statue le
fragment disparu
avec^
l'inscription, fragment qui por-
tait,
sa
partie suprieure,
un
large
trou
rectangulaire
(dessin
de
Debay).
Dans ce
trou,
M.
Furtwaengler
insre un
pilier
sur
lequel
la Vnus
appuie
son bras
gauche. Or,
le dessin de Voutier a irrvocablement
dmontr
que l'objet
insr dans le trou n'tait
pas
un
pilier,
mais un herms. Cet herms est
trop
bas
pour que
le bras de la Vnus
puisse s'appuyer
sur lui. Si donc
le
fragment
avec
l'inscription, qui supportait
Thermes,
a t
rajust,
ds
l'antiquit,
la
plinthe
de la
statue 1,
la seule restauration admissible est celle de Tarral :
Vnus, ayant
un herms ct
d'elle,
relve son bras
gauche
vers sa chevelure. L'attitude ainsi obtenue tant
1. Dans le dessin de
Voutier,
comme dans celui de
Debay,
le
pi-
douche avec
inscription prsente,
sur la
gauche,
une cassure en
biseau,
qui rpond
peu prs
la cassure
diagonale
de la
plinthe
de la
Vnus,
droite du
spectateur.
DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO 291
fort
disgracieuse,
on ne se rsoudra
pas
aisment
l'attribuer l'auteur de la
Vnus,
et Ton reviendra
l'hypothse, dj ancienne,
d'une restauration
faite
dans
l'antiquit,
vers le ier sicle avant J .-C. La Vnus
serait alors une statue
attique
de la
premire
moiti
du ive sicle au
plus
tard
;
victime d'un accident
quel-
conque, mutile,
elle aurait t
restaure,
avec un
herms ct
d'elle,
par
un
sculpteur
d'Antioche du
Mnandre, peut-tre
aux frais du riche Thodoridas.
Le bras relev tenant la
pomme proviendrait
de la
mme restauration.
Cette
hypothse
n'aurait rien
d'invraisemblable,
vu
que
nous avons de nombreux
exemples
de
statues,
de
bas-reliefs,
de vases
peints,
etc.,
qui
ont t restaurs
dans
l'antiquit.
Mais on sent
que, pour adopter
une
pareille solution,
il faut avoir
dsespr
d'en trouver
une autre. Attendons ce
que
nous
apprendra
l'tude
de
l'inscription
de Thodoridas !
IV
1
Louis Brest et la Vnus de Milo
(D'aprs
des documents
indits)
Pendant Tt de
1896,
les
journaux parisiens
annon-
crent
la mort de
Brest,
vice-consul de France
Milo,
en
ajoutant qu'il
avait
dcouvert
la Vnus
;
il tait
presque centenaire,
suivant les
uns,
plus que
cente-
naire,
suivant les autres. Ces autres calculaient
bien,
car Louis
Brest,
en
1896,
aurait eu
peu prs
110 ans.
En
ralit,
Louis Brest est mort vers
1870, octognaire;
c'est son
fils,
vice-consul de France son
tour, qui
s'est.
teint en 1896.
Quand je
vis Brest
fils,
en
1880,
il me
1.
[Chronique
des
Arts,
20 fvrier
1897, p. 72-74.]
292 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
dit
qu'il
avait
cinq
ou six ans lors de la dcouverte de
la Vnus
;
il mourut donc
quatre-vingts
ans
passs.
Le
pre
et le fils Brest ont racont un nombre
infini de fois l'histoire de la trouvaille mmorable
laquelle
reste associ leur nom. Les btiments de
guerre
naviguant
dans
l'Archipel
ont
toujours
touch Milo
pour y prendre
des
pilotes grecs; chaque
fois
qu'un
navire
franais
y jetait l'ancre,
les officiers invitaient
les Brest
djeuner;
neuf fois sur
dix,
sans
doute,
la
Vnus de Milo faisait les frais de la conversation. Vers
1838,
peut-tre
un
peu plus
tt,
Brest
pre, qui croyait
avoir eu se
plaindre
de M. de
Marcellus, commena
donner ses rcits une couleur
romanesque, propre
rehausser la
part qu'il
avait
prise
l'affaire. Avec les
annes,
il finit
probablement par
croire l'histoire
trs extraordinaire
qu'il
racontait. Mais il ne
publia
rien
lui-mme.
Quelques personnes, qui
l'entendirent
causer,
montrrent moins de rserve. C'est ainsi
que
le
gologue
Fouqu,
dans la Revue des Deux Mondes de 1867
(t. LXIII), imprima
des choses invraisemblables tou-
chant la dcouverte de la Vnus relate
par
Brest.
L'architecte
Morey
en fit autant vers la mme
poque
1.
Aprs
la mort du
vice-consul,
un
architecte,
Dous-
sault,
remplit
toute une brochure avec les rcits fan-
taisistes
qu'il
avait recueillis de la bouche de
Brest,
trente ans
auparavant,
la table de
Piscatory,
ministre
de France Athnes
(La
Vnus de
Milo, Paris, 1877).
Le fils Brest se
plut
rpter
les mmes histoires.
J ules
Ferry,
ministre de France
Athnes, qui
visita
l'le en mars
1873,
fut sa
plus
illustre
dupe.
Il
imprima
dans le
Temps (16
avril
1874)
une
lettre,
fort dnue de cri-
tique,
fonde tout entire sur les racontars de Brest fils et
sur ceux d'un nomm Antonio
Bottonis,
beau
vieillard,
1.
Morey,
La Vnus de
Milo,
dans les Mm. de l'Acad. de
Nancy,
1868, p.
7.
Morey
avait visit Milo en
1838,
avec R. Rochette.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 293
qui prtendait
tre le fils de
Yorgos,
avoir contribu
dterrer la statue et se souvenir merveille de son atti-
tude 1. Ace moment
(1874),
le futur acadmicien Aicard
venait de
publier,
dans le
Temps (9, 10,
11 avril
1874),
son tude sur la Vnus de
Milo,
d'aprs
la relation
indite de
Matterer, qui
tait second
capitaine
de la
Chevrette en avril 1820. Cette
relation,
o rien de ce
qui
est nouveau ne
peut
tre
pris
au
srieux,
mit en
moi les amateurs
d'archologie.
Il fallut
que
M. de Vo-
gu,
alors ambassadeur de France
Constantinople,
exhumt les lettres crites en 1820
par
Brest
David,
pour
rduire nant
du moins aux
yeux
des
gens
bien informs le roman suivant
lequel
la Vnus aurait
t dcouverte
presque intacte,
debout sur un
pidestal,
puis
mutile au cours d'une rixe sur la
plage,
etc. 2.
En dehors de lettres fort
courtes, je
ne sache
pas
qu'on
ait encore rien
publi
sous la
signature
de Brest.
J ules
Ferry
crivait en 1874 : Pour achever la lumire
et rallier les
plus
obstins,
un seul document resterait
trouver : c'est le
premier rapport
adress
par
M. Brest
pre
l'ambassadeur de France
Constantinople.
Ce
rapport
a t
publi par
le frre de
Marcellus;
il
est trs bref et
n'apprend pas grand'chose,
sinon
que
Brest avait renonc
acqurir
la
statue,
dont on deman-
dait 20 30.000 francs 3. En
revanche,
je
suis en mesure
de faire connatre une relation dtaille adresse
par
Brest,
en
1862,
M.
Boure,
ministre de France
Athnes. Voici comment elle est venue entre mes mains.
Un mdecin
anglais
tabli
Paris,
o il mourut en
mars
1886,
Claude
Tarral,
avait consacr de
longues
annes l'tude des marbres
antiques
du Louvre
et,
1. La lettre de J .
Ferry
a t
reproduite par Aicard,
La Vnus
de
Milo, Paris, 1874, p.
188.
2.
Comptes
rendus de l'Acad. des
Inscriptions,
anne 1874
(Paris,
1875, p. 152-160).
3.
Aicard,
La
Vnus, p.
202
; Goeler,
Die
Venus, p.
191.
294 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
en
particulier,
de la Vnus de Milo. A une
poque
o
presque
tous les
archologues pensaient autrement,
Tarral soutint les thses suivantes : 1 La Vnus n'a
pas
t restaure dans
l'antiquit;
elle n'a
pas
t
mutile en
1820;
2 le
fragment
de
bras,
avec la main
tenant la
pomme, appartient
la
statue;
3 la
partie
droite de la
plinthe, aujourd'hui perdue,
avec la
signa-
ture du
sculpteur Agsandre d'Antioche,
lui
appar-
tenait
galement;
4 sur cette
partie
de la
plinthe
tait
dress un
herms, qui
se
trouvait, par suite,
la
gauche
et tout
prs
de la
Vnus;
5 la desse relevait le bras
gauche
et abaissait
le bras droit vers sa
draperie.
Tar-
ral
pensait
encore
qu'Agsandre
tait le
sculpteur
nomm
par
Pline comme un des auteurs du
Laocoon,
et il
prtendait
trouver une
analogie
troite entre
l'excution du
groupe
du Vatican et celle du chef-
d'oeuvre du Louvre.
S'inspirant
de ces
principes,
Tarral
exposa,
en
1862,
un modle restaur de la
Vnus,
qui
a t
reproduit
en
phototypie
dans le livre de Goeler
(Die Venus, pi. 4)
et ailleurs
(voir fig. 54).
Pour
justifier
sa
restauration,
Tarral avait accumul les
matriaux d'une
longue
mono-
graphie,
dont il crivit mme
quelques chapitres ;
mais il
mourut avant d'avoir rien
publi
1.
Aprs
sa
mort,
un di-
teur
photographe
de Paris avec
lequel
il tait
li,
M. Don-
tenvil,
apporta
M. de Ville fosse une norme liasse de
papiers,
dont Tarral avait voulu
que
le conservateur
des
antiques
du Louvre devnt le
dpositaire.
Sachant
que je m'occupais
nouveau de la
Vnus,M.
de Ville-
fosse a eu
l'obligeance
de mettre ma
disposition
les
papiers
de Tarral. Le
dpouillement auquel je
les ai sou-
mis ne m'avait rien fourni
d'intressant,et j'tais
sur le
point
de
regretter
le
temps perdu, lorsque je
tombai
1. Goeler von
Ravensburg
a t en
correspondance
avec Tarral
et s'est
inspir
de ses lettres dans sa
monographie,
encore
prcieuse,
sur la Vnus
(Heidelberg, 1879).
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 295
sur une
copie
du
rapport
encore indit de Louis Brest.
Dans un
chapitre
manuscrit de son
ouvrage,
crit
vers 1877 en
rponse
aux
publications
de J .
Ferry
et
d'Aicard,
Tarral a
expliqu
comment il s'tait
procur
la
copie
en
question. Honor,
sous
l'Empire,
de la bienveillance de Mme la
princesse Mathilde,
il
s'tait adress la cousine du souverain
pour
obtenir
une
dposition officielle
du vieux Brest. La
princesse
fit
prier Boure,
alors ministre de France Athnes
(1862),
de demander un
rapport
crit au vice-consul
de Milo. Ce
rapport, rdig
une
poque
o Brest
s'tait
fait,
depuis longtemps,
une habitude d'altrer
la
vrit, tmoigne cependant
d'une certaine rserve
;
crivant son
ministre,
Brest ne
pouvait pas
donner
cours son
imagination
comme
lorsqu'il conversait,
inter
pocula,
avec des officiers de marine ou des tou-
ristes.
Quoi qu'on pense, d'ailleurs,
des inexactitudes
qui s'y rencontrent,
c'est le seul document man de
Brest lui-mme
que
Ton
puisse
dsormais
allguer
ct de ses lettres de 1820
; je
crois
donc ncessaire
de le
publier
in extenso.
J 'indiquerai
chemin
faisant,
en
note,
les
principales
erreurs de fait
commises
par
Brest
;
mais
je
dois me rserver d'insister
plus
tard
sur les informations nouvelles
que
nous lui devons et
qui
sont loin d'tre toutes
mprisables.
V
Rapport
de Louis Brest
1
Milo,
le 3
juin
1862.
Monsieur le
ministre,
J e
reois aujourd'hui
mme la lettre
que
vous m'avez fait
l'honneur de m'crire le 26 du mois dernier et
m'empresse
de
1.
Chronique,
27 fvrier
1897, p.
84-87.
296 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
vous faire un
expos
dtaill relatif la
dcouverte,
l'achat et
l'embarquement
de la Vnus de
Milo,
achete
par
moi et remise
M. le vicomte de
Marcellus, d'aprs
l'ordre de S. E. M. le mar-
quis
de
Rivire,
ambassadeur
Constantinople, pour
tre
envoye
en
France,
au Muse du
Louvre,
Paris,
vers la fin de
l'anne 1819 K
Un certain
paysan
du
pays,
nomm Thodore Kendro-
tas 2,
labourant son
champ
situ
prs
de
l'amphithtre,
vit
crouler un rocher
qui,
en
tombant,
fit une ouverture o il
put apercevoir
une statue : cette statue fut la Vnus. Le
paysan
s'tant mis
dblayer l'emplacement
o
gisait
la
Vnus,.
envoya
son fils me
prvenir
de cette
dcouverte,
et au
reu
de
cet
avis, je
m'tais de suite rendu sur les lieux d'o
j'ai pu
exa-
miner de
prs,
reconnatre et admirer la beaut de la statue. Sur
la demande
que j'avais
adresse audit Kendrotas s'il voulait
me la
vendre,
il me
rpondit qu'il
me la cderait de
prfrence
tout
autre, moyennant
le
prix
de six cents
piastres, plus
d'uni
habillement
pour
lui de la valeur de dix-huit
piastres,
en tout
six cent dix-huit
piastres
du G. S.
La statue
peine dgage
et enleve de sa
niche, je
la fis
transfrer en ma
prsence
et
pour
ma
tranquillit
chez
moi,
et le lendemain
je
m'tais
empress
de donner avis S. E. M-
le
marquis
de Rivire de
l'acquisition
de cette
antiquit, que je
venais de faire
pour
618
piastres, que je croyais digne pour
le
muse de
France,
et de le
prier
en mme
temps
de
m'envoyer
le-
plus
tt
possible
un navire de
guerre pour
venir la chercher
d'ici 3.
Un mois s'tait coul et aucune
rponse je
ne recevais de la
part
de M. l'ambassadeur
Constantinople
;
quelque temps
aprs,
une corvette
anglaise, qui
avait bord deux
lords, ayant
appris
Smyrne, par
les officiers des btiments de
guerre
fran-
ais,
que j'tais possesseur
d'une belle
statue,
vint Milo et
les deux
voyageurs
me demandrent la
permission
de la leur
montrer,
ce
que je
leur avais accord
par complaisance.
Aprs
l'avoir bien
examine,
les deux visiteurs m'ont inter-
rog
si
je
voulais vendre
l'antiquit
et
quel prix pouvais-je
la leur cder
; je rpondis
ces messieurs
qu'elle
n'tait
pas
1. La dcouverte est de 1820 seulement.
2. Peut-tre
s'appelait-il
aussi
Yorgos ;
c'est le nom
que
lui donnent
les autres versions.
3. Il n'est
pas
vrai
que
la statue ait t transfre chez Brest
;
il
n'est
pas
vrai
qu'il
l'et
acquise.
La lettre de Brest au consul de
Smyrne (et
non
l'ambassadeur)
est du 12 avril.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 297
vendre, que je
ne l'avais
point
achete
pour
en
spculer
dessus,
mais
pour
la ddier au Muse de ma
nation, lorsque
MM. les
Anglais m'ajoutrent qu'ils
me donnaient deux mille tallaris
et
qu'ils pouvaient
mme
porter
le
prix
trois mille
;
leur
ayant
donn la mme
rponse,
ils ont
quitt
ma maison
et,
en
partant,
ils ont
ajout qu'ils pouvaient
me la
payer jusqu' quatre
mille
tallaris *.
Aussitt
aprs
leur
dpart, j'avais
de nouveau crit S. E.
M. l'ambassadeur
Constantinople
en lui rendant
compte
en
mme
temps
de la visite et de la
proposition que
MM. les
Anglais
m'avaient faite relativement la statue. M. le
marquis
de
Rivire m'avait la fin crit
que
dans
quelques jours
M. le
vicomte de
Marcellus,
troisime secrtaire de
l'ambassade,
par-
tirait bientt sur la
golette
du
roi,
Y
Estafette, pour
aller visiter
J rusalem et
qu'il
donnerait l'ordre de toucher Milo
pour
voir
la statue et
que,
s'il la trouvait
belle,
il la
prendrait
;
en atten-
dant,
il me
priait
de la bien conserver
jusqu'
son arrive Milo.
A la
rception
de la lettre de Son
Excellence, j'avais
fait trans-
porter
la statue au bord de la mer et mise en
magasin,
atten-
dant l'arrive de la
golette.
MM. les
Anglais, piqus
de la
rponse
que je
leur avais donne
par rapport
la
statue,
en
partant
d'ici,
s'taient rendus Chio o se trouvait alors le
drogman
du
capa-
dan
pacha (grand amiral),
nomm Mourusi
(c'tait
l o tous
les
primats
des les de
l'archipel
devaient se rendre
pour payer
le tribut
d'usage),
et ils ont obtenu de lui
d'envoyer
un
bengardi
(dcret)
menaant
fortement les notables du
pays pour
lui faire
avoir la
Vnus, pour que
le susdit Mourusi
pt
la
porter
au
capa-
dan
pacha
sa rentre
Constantinople
2.
L'homme du
drogman porteur
dudit dcret tait arriv ici
l'effet de rclamer la
statue,
mais
je
m'tais luifortement
oppos,
en lui dclarant
que je croyais lgale l'acquisition que je
venais de
faire et aucunement contraire aux traits et
capitulations
exis-
tant entre les deux
gouvernements ; que, d'ailleurs,
la statue irait
Constantinople
et
que
le
capadan pacha pourrait
la rclamer
de M. l'ambassadeur de
France,
en sorte
que, aprs
bien des dis-
cussions, l'envoy
du
drogman partit
seul. Un misrable
prtre
grec,
nomm
Vergis Milioti,
ami du
drogman Mourusi,
est rest
1. Tout cela
parat
invent
; personne
n'a
jamais
entendu
parler
de ces lords
anglais.
C'est seulement
aprs
l'enlvement de la Vnus
qu'un
btiment
anglais
vint Milo.
2. Rien de cela n'est vrai ni vraisemblable. C'est la
premire
fois
qu'on
voit intervenir la
perfide
Albion dans cette affaire.
298 DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO
ici et n'a cess de menacer et
d'effrayer
les
primats
de l'le.
Dans le courant du mois de mai
1820,
la
golette
du
roi,
Y
Estafette, ayant
bord M. de
Marcellus,
tant arrive en ce
port
et
pendant que je
me trouvais
bord,
le hardi
prtre Vergis
se rendit au
magasin
o
j'avais dispos
la
statue,
enleva la
moiti et la
porta
bord d'un btiment
rayas
de
Ghalaxidis,
en relche en ce
port,
allant
Constantinople.
Sorti
peine
terre de la
golette
et
appris
le vol
qui
nous avait t
fait,
aussi-
tt avoir
embarqu
l'autre moiti de la statue et les deux
autres
pices reprsentant
Herms et
Hyracls, je
m'tais embar-
qu
bord de la
grande chaloupe
de la
golette, accompagn
de
son
digne lieutenant,
M.
Berranger,
et de douze hommes et nous
fmes bord du navire
agresseur.
Au
commencement,
ils ont
voulu nous dfendre de monter
;
mais nous
y
sommes
parvenus
de
force d'enlever et de
porter
la statue bord de la
golette
1.
Cette affaire
finie,
M. le vicomte Marcellus et moi nous tions
monts chez
moi,
o nous avions trouv -runis tous les
primats
de
l'le,
tout
effrays
et
tremblants, craignant
les avanies du
drogman
Mourusi. Le mchant
prtre Vergis
avait nolis un
petit
bateau et il s'tait rendu Chio
pour
aller
porter plainte
contre eux au
drogman.
Touchs de leur
position,
nous avions
fait tout notre
possiblepour
les
tranquilliser ; je
me
rappelle que
nous deux leur avions mme formellement
sign
et livr un
document
officiel, par lequel
nous dclarions
que si, par
suite
de
l'acquisition
faite
par moi,
Milo,
d'une statue
reprsentant
une femme en
marbre,
les
primats
et notables de l'le
essuyaient,
de la
part
du
drogman, quelque injustice
ou
disgrce,
M. l'am-
bassadeur de France leur
promettait
de les
protger
et de les
assister en cette occasion.
Les
premiers jours
du mois de
juillet,
le
drogman
Mourusi vint
Syphante,
d'o il avait
envoy
un officier de l marine
turque,
l'effet de saisir d'ici et d'amener
auprs
de lui les trois
primats
du
pays,
les sieurs Pietro
Tataruky,
Av.
(sic) Chiniandrity
Michel
et le vieux conome
Arminy ;
arrivs
Syphante,
il les avait
mis d'abord en
prison et, ensuite, aprs
leur avoir fait donner la
bastonnade,
il les a
obligs
de
payer
une amende de six mille
cent
piastres, quivalant
alors autant de francs. Inform de
cet
incident, j'avais
crit Son Excellence
Constantinople,
pour
la
renseigner
sur
l'injuste
et brutale conduite du
drogman
envers les trois
primats
de l'le.
1.
Ainsi, pas
de bataille
terre, pas
de statue trane sur le
rivage ;
il
n'y
a
plus trace, ici,
du roman
que
Brest et Matterer ont racont.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 299
La
golette l'Estafette,
bord de
laquelle
il
y
avait M. de
Marcellus, ayant
relch l'le de Paros d'o il devait se rendre
Antiparos pour
visiter la fameuse
grotte
de
stalactites,
il m'cri-
vit une lettre
par laquelle
il me disait
que
nous avions fait une
excellente
acquisition antique
et
que
notre statue faisait l'admi-
ration de tous les connaisseurs
;
la
rception
de sa
lettre,
j'avais
nolis un bateau et tais all sa rencontre
pour
l'infor-
mer et du mauvais traitement et de l'avanie
que
les trois malheu-
reux
primats
avaient souffert du
drogman
Mourusi
;
malheu-
sement,
arriv
Paros,
j'avais
trouv
partie l'Estafette,
et
mon retour
Milo, j'avais
de nouveau crit ce
sujet
M. l'am-
bassadeur
Constantinople.
Au
reu
de ma
lettre,
M. le
marquis
de Rivire
avait,
en
effet,
entretenu de cette affaire le
capadan
pacha, qui
lui avait
promis qu'
l'arrive
Constantinople
du
drogman
non seulement il l'aurait
rprimand
de ce
qu'il
avait
fait,
mais
qu'il
l'aurait
oblig
restituer la somme
injustement
enleve aux trois
primats.
Dans le courant du mois de novembre
1820,
M. le
marquis
de
Rivire,
allant en France sur la
gabare
La
Lionne,
avait
exprs
relch en ce
port
et il m'a remis le
bengardy que j'ai
l'honneur de vous renfermer
ci-joint
et dont
je
vous
prie, aprs
en avoir
pris connaissance,
de me le retourner.
En cette occasion
j'avais
runi chez moi tous les
primats
du
pays
et leur en avais donn lecture
;
malheureusement aucune satis-
faction ne leur fut
accorde,
attendu la rvolution
grecque qui
allait clater alors et
qu' peine
le
drogman
Mourusi rentr
Constantinople
au commencement de
1821,
fut
souponn
comme
complice
de la rvolte et
dcapit
ainsi
que
son frre.
D'aprs
la
pronjtesse par
crit
que
M. de Marcellus et moi avions
donne aux
primats
et notables du
pays
de leur faire donner
justice
en cas
d'avanie,
ces messieurs venaient tous les
jours
chez moi me demander le remboursement de l'amende
qu'ils
avaient
paye ;
toutes mes
plaintes
et rclamations
auprs
de
mes chefs
directs,
ambassadeur ou
charg
d'affaires Constan-
tinople
et au consulat
gnral
de
Smyrne,
tant restes sans
aucun
effet, j'ai
t
forc
de
payer
la
fin,
de
moi-mme,
ladite
somme de six mille cent francs.
Son Excellence M. le
marquis
de
Rivire,
arriv en
France,
avait cd la Vnus au Muse du Louvre son nom direct comme
un
objet par
lui dcouvert et lui
appartenant,
sans vouloir
faire donner le mrite celui
qui, par
ses
grands soins,
l'avait
achete et
sauvegarde
le
premier,
souffert tant de
peine jus-
qu'
ce
qu'il
ait
parvenu
lui donner la destination
qu'il
lui a
dsigne
ds le
premier jour
de sa dcouverte et
l'embarquer
300 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
pour
la France. Bien
que
la chose ft autrement de ce
qu'elle
a t
prsente
Paris,
Son Excellence M. le
marquis
de
Rivire,
tant alors un
personnage
bien
puissant
et trs influent
auprs
du
roi, personne
n'a os le contredire.
M. de
Beaurepaire, protg
de M. le
marquis
de
Rivire,
tant
rest alors
charg
d'affaires
Constantinople, par
crainte sans-
doute
que je
ne fisse
publier par
des
journaux
de
l'opposition,
en
France,
quelque
article concernant la dcouverte de la Vnus
(chose que je
n'aurais
jamais faite),
m'avait crit et ordonn de
lui
envoyer
toute la
correspondance regardant.
cette
acquisi-
tion,
consistant en
cinq
lettres de Son
Excellence,
trois de
M. le vicomte de
Marcellus,
la caution
que
nous avions
signe
et
dlivre aux
primats
et
que j'avais
retire de ces
messieurs,
plus tard, aprs
les avoir
pays,
et les
reus
et
quittances
des
primats pour
les sommes
que je
leur avais
payes,
sous
prtexte
et
promesse
de les examiner et de me les rendre
quelques jours
aprs, promesse que
M. de
Beaurepaire
n'a
pas
maintenue.
Malgr
mes
prires
maintes fois
ritres, malgr
les bonts de
tous ces chefs
pour moi, personne
n'a
jamais
voulu crire en
ma
faveur,
sur cette
affaire,
au
dpartement
des Affaires tran-
gres, par crainte, toujours,
de contrarier le susdit
grand
et
puissant personnage.
Onze douze ans
aprs,
M. le
marquis
de Rivire tant
presque
en
agonie,
sur le
point
de
mourir,
assist
par
M. l'abb
J anson
Forbin,
son
confesseur,
celui-ci lui avait dit
quelques
mots en ma faveur et alors il avait donn ordre au nomm
Auguste Castagne,
son
protg,
chancelier de notre ambassade
Constantinople,
de me rembourser la somme de six mille cent
francs
;
c'est ce
que j'ai reu plus tard,
avec la diffrence
qu'
cette
poque-l
le franc valait deux
piastres
et trente
paras,
de
sorte
que j'avais essuy
une
perte
de
cinq
mille
piastres
environ,
sans
compter
les intrts de dix
ans,
les frais de
transport
de la
statue et d'autres
dpenses que personne
ne m'a
jamais payes.
En
voici,
Monsieur le
ministre,
tout le
rcit,
concernant la
dcouverte,
l'achat et
l'embarquement
de la Vnus.
J e
reviens, maintenant,
au reste de vos
questions.
1 Vous me
questionnez
: Dans
quelle
attitude tait la Vnus ?
Elle fut trouve dans sa nichex
;
il
y
avait
galement
debout
les deux autres statues de Herms et
d'Hracls.
2 Avait-elle ou n'avait-elle
pas
ses bras ?
Elle n'en avait
point,
la
partie suprieure
de la niche
ayant
1. Il est certain
qu'elle
tait en deux morceaux.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 301
croul les aura
peut-tre
casss et fit aussi une
lgre grati-
gnure
au nez de la statue.
3
Si elle les
avait,
comment se sont-ils briss ?
Comme la statue n'en avait
pas, je prsume qu'ils
se sont
briss de la manire
que je
dis
plus
haut.
4 Dans ce
cas, quelle
tait la
pose
et comment se
fait-il qu'ils
aient t
perdus
?
J e vous dirai ce
que je
sais ce
sujet
la demande suivante.
5 Si on les a
envoys
en France
tardivement, par quel
bti-
ment sont-ils
partis
et
quelle
maison la caisse tait-elle adresse ?
Aprs
le
dpart
de Son Excellence
pour
la
France,
conform-
ment son
dsir, j'avais
fait des recherches l'endroit o la
statue s'tait trouve
et, parmi
les cailloux et la
terre, j'avais
trouv
beaucoup
de morceaux de marbre
provenant
de statues
mutiles, quelques
offrandes,
telles
que
des
pieds d'enfants,
des
mains et autres et les deux bras
que j'ai
cru
appartenir
la
Vnus,
le bras droit
(sic)
en trois
morceaux,
dont les
doigts
de la
main ferme tenaient une
pomme,
et le
gauche
en deux morceaux
ayant
les trois
doigts
ferms et le
pouce
et l'index
joints parais-
sant
qu'ils
aient tenu
quelque
chose. J 'avais le tout emball
dans une caisse et
envoy
en France vers le commencement de
1821
par
un brick
franais
et si
je
ne me
trompe pas,
c'tait le
Saint-Esprit
ou bien la
Confiance
en
Dieu,
capitaine Riquier,
l'adresse
qui
m'avait t donne
par
Son Excellence de M. Bede-
fort, ngociant
Toulon.
6 Pensez-vous
que
des
fouilles faites
sur le terrain voisin
seraient
permises par
le
propritaire,
et
que
ces
fouilles
amne-
raient
quelques
dcouvertes ?
J e ne
pourrais
rien vous assurer ce
sujet ; je
vous dirai
seulement
que pendant
la rvolution des
Grecs, que
tout le
monde avait la
permission
de faire des fouilles
;
le sieur Thodore
Xenos de
Patmos,
alors
ngociant
tabli
Smyrne, plus
tard
consul
gnral grec
en ladite
ville,
se
trouvait
Milo, rfugi
avec sa famille et celle de son frre
J ean,
s'tant
arrang
avec
le
propritaire
du
champ
de la
Vnus,
avait fait des excavations
dans une
poque
o
je
me trouvais absent de l'le avec M. l'ami-
ral de
Rigny, que j'accompagnai
de
partout par
ordre minis-
triel,
en
qualit d'interprte ;
mon retour
ici, j'avais appris
que
M. Xenos avait
trouv,
l'est de la niche de la
Vnus,
un
emplacement
rond
ayant
trois
pieds
de
hauteur, pltr
d'un
blanc trs
luisant, portant
en trois
lignes
de
grandes lettres,
crites l'encre
rouge, ayant
au milieu une
espce
de demi-
colonne en
pierre,
avec un trou au centre
;
cet
emplacement
302 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
avait la
grandeur
d'une
chambre,
mais ronde. J e
pense que:
c'tait un offertoire o l'on
portait
les
objets
offerts la desse.
Le sieur Xenos avait dmoli cet endroit si curieux et il n'a
pas
mme
copi l'inscription qui
se trouvait tout autour. Le mme
avait fait des fouilles de l'autre ct de la niche de la
Vnus,
vers
l'ouest,
et il a
rencontr une nouvelle niche avec de
grandes
pices
de marbre
portant
des
inscriptions.
Au-dessus du
champ
d la
Vnus,
environ 15 20
pieds
vers
le
sud,
il
y
a un terrain
appartenant
au nomm Antoine
Vergis,
pilote
en chef des
Anglais,
alors
embarqu
avec le
commodore.
Hamilton,
sur la
frgate
Le
Cambrian,
et
qui, par
ordre et
pour
compte
de son
commandant,
avait fait des fouilles en
ligne
droite
de la niche de la Vnus.
Ayant
trouv une statue
reprsentant
un
homme tout fait
nu, manquant
de tte et de
bras,
on disait
que
c'tait un hros
qu'on
avait
plac
l'entre de Nomos
(sic) (1),
et
quelques
chandeliers en bronze.
J e vous dirai en
outre,
Monsieur le
ministre,
qu'en
1817
M.
de
Forbin,
conservateur du muse du
Louvre, ayant pass
par Milo,
avec la division commande alors
par
M. le
capitaine
de vaisseau
Halgan, j'avais
achet
pour
son
compte
deux statues
mutiles,
sans tte ni
bras, pour
trente
piastres
du G. S. J e
me,
rappelle que
ce monsieur avait dit
que
les deux statues en
ques-
tion
reprsentaient
J unon et Minerve
;
dans ce mme terrain
dcouvert se trouvait une autre statue en
marbre,
mais encore
prive
de tte et de
pieds ;
on disait
que
c'tait Paris et
que
les
Anglais
l'ont
galement pris
2.
7 Serait-il trs
difficile d'exporter
les
objets
trouvs?
Rsidant la
capitale,
vous ne devez
pas ignorer,
Mon-
sieur le
ministre, que
les fouilles sont
prohibes par
le
gouver-
nement
grec
et
que,
sans une autorisation du ministre de T Int-
rieur,
on ne
peut pas
en faire
ici,
et ensuite il
y
a dans le
pays
un
soldat
invalide, pay
ad hoc
par
le
gouvernement,
l'effet
d'empcher
tous ceux
qui
travaillent sans
permission
et de sur-
veiller les fouilles autorises.
Lorsqu'on
dcouvre
quelque
ce soit
antiquit,
le surveillant et le
propritaire
du terrain sont
obligs
de la dnoncer
l'parque ;
celui-ci
l'envoie,
ainsi
que
le
propritaire,
Athnes,
o elle est estime
par
une commission
d'archologie (bien entendu,
estimation minime et
prjudicieuse
1.
[Peut-tre
du dromos.
1929.]
2. Ceci est fort
important
;
on se
rappelle que Voutier,
Dumont
d'Urville et
Brest ont cru
que
la Vnus
appartenait
un
groupe
reprsentant
le
jugement
de Paris.
L'origine
de cette
singulire hypo-
thse se trouve enfin
explique.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 303.
pour
le
propritaire),
et on lui
paie
la moiti de sa valeur.
Le
propritaire
a aussi le droit de
garder
chez lui
l'antiquit
trouve,
s'il ne veut
pas
la vendre au
gouvernement, pourvu'
qu'il
fournisse une caution en toute
rgle qu'il
ne
l'expor-
tera
pas
l'tranger.
Si Votre Excellence dsire faire faire des
fouilles, je
crois
que
ce n'est
pas
difficile d'obtenir
la, permission
;
en ce
cas,
vous,
voudrez bien m'en donner
avis,
afin
que je puisse
faire
prparer
les outils et instruments ncessaires
pour
les
excavations,
et
je
prends
sur moi le soin de les faire
rigoureusement
surveiller.
Quant
la
permission
obtenir du
propritaire, je
me
charge
de
la
solliciter,
bien entendu en le
ddommageant.
Par le
behgardy
que
vous trouverez
ci-annex,
vous verrez
par
son
contenu,
Monsieur le
ministre,
que
Son Excellence M. le
marquis
de
Rivire ne dit
pas
dans la
plainte porte
au
capadan pacha que
lui ou son
secrtaire,
M. de
Marcellus,
avait trouv ou achet
une statue
Milo,
mais
que
cette statue avait t achete
par
les
Franais
et
pour
la France
; c'est,
bien
entendu, par l'agent,
consulaire de cette nation rsidant Milo 1.
Telle
est,
d'aprs
ce
que je
me
rappelle,
Monsieur le
ministre^
l'histoire de la Vnus
que,
conformment vos
ordres, je
me suis
empress
de vous raconter en dtail.
J 'ai l'honneur
d'tre,
avec le
plus profond respect,
Monsieur le
ministre,
Votre trs humble et trs obissant
serviteur,
Louis
BREST.
VI
2
Conclusions arrtes en 1898.
J e demande ici la
permission
de rsumer en
quelques?
lignes
les conclusions
auxquelles je
suis arriv 3:
1. On se
dcourage
au milieu de tant de
mensonges
! Brest avait
crit Rivire :
J 'ai voulu contracter avec le
propritaire.
Mais
les habitants de l'le lui
ayant
fait croire
qu'elle (la statue)
valait
20 30.000
francs, je
n'en ai rien fait. Tout ce
que
Brest obtint
(et
c'tait
beaucoup)
fut
que
la statue ne ft
pas
donne au
capitan
pacha jusqu'
nouvel ordre
(Brest
David,
12 avril
1820).
2.
[Chronique
des Arts. 9
juillet 1898, p. 224-226].
3. Voir aussi un article sm? le mme
sujet
dans The
Nation,
(New-
304 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
1 Le
rapport,
enfin
exhum,
du consul Brest tablit
dfinitivement
que
la statue tait
prive
de ses
bras
;
2 Les dessins de M.
Voutier,
reproduits
en 1892
par
M.
Ravaisson,
prouvent qu'elle
fut trouve en
compagnie
de deux herms et de deux
inscriptions
(fig.
60);
3 L'une de ces
inscriptions, signature
d'un artiste
postrieur
Tan
260, Agesandros,
tait
grave
sur un
bloc de marbre dans
lequel
tait
pratique
une cavit
;
Voutier a
figur
Thermes imberbe
pos
verticalement
sur le bloc de marbre
;
4 L'autre
inscription, portant
le nom de Thodoridas
fils
de
Lastratos 1, servait,
suivant le dessin de
Voutier,
de base Thermes barbu
;
mais comme le bloc
portant
cette
inscription
a
disparu,
on
peut
douter
qu'il
existt,
l'origine,
un
rapport quelconque
entre
l'inscription
et Thermes. Ce dernier a
pu
fort
bien,
lors de la dcou-
verte de la
statue,
tre
pos
debout
pour
faire
pendant
Thermes
juvnile 2,
dont le socle
portait
la
signature
d'artiste
postrieure
Tan 260 avant J .-C.
Ce
qui prcde
suffit
prouver que
la restauration
de la
Vnus,
prconise par
M.
Furtwaengler,
est abso-
lument
inadmissible.
En
effet,
le savant
archologue
de Munich croit
que
la base avec
signature (gare
malheureusement
depuis plus
d'un
demi-sicle) s'adap-
tait ce
qui
reste de la base de la Vnus
; seulement,
dans la cavit
que prsente
le bloc
inscrit,
il
imagine
une colonnette de marbre sur
laquelle
se tenait
appuy
le bras
gauche
de la Vnus. Il est dsormais vident
York), 1897, p. 222, rimprim
dans la Revue
archologique, 1897,
II, p. 298,
avec
quelques changements.
i.
[J e rpte que j'cris
Lastratos au lieu de
Daistratos, pre-
mire lecture
;
il est certain
qu'il y
a un
A,
non un
A.]
2. J e fis dresser la statue crit Voutier dans sa brochure. Il a
sans doute fait dresser aussi les herms.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 305
que
la base inscrite n'a
jamais pu supporter qu'un
herms,
et non une colonnette.
Donc,
si la base inscrite
s'adaptait
vraiment celle de la
Vnus,
la seule restau-
ration admissible serait celle de Tarral : la Vnus
debout,
ct d'un
herms,
avec le bras
gauche
relev et non
appuy (fig. 54).
Mais si Ton admet
que
la base
inscrite,
avec
signature
d'artiste,
tait bien celle de la
Vnus,
il faut
placer
cette statue
aprs
260 avant J .-C.
Furtwaengler,
il est
vrai,
d'accord avec
beaucoup d'archologues
alle-
mands,
n'hsite
pas
la faire descendre
jusqu'aux
environs de Tan 100 avant l're chrtienne
;
mais le
style
du chef-d'oeuvre ne cesse de
protester
contre cette
hypothse, que
le
tmoignage
le
plus explicite (et
il
n'y
en a
point)
ne suffirait
gure
nous faire admettre.
Or,
en
l'espce,
comme nous l'avons
montr,
c'est
trop peu
de dire
que
la
Vnus,
au cas o la base
signe
d'Agesandros
serait la
sienne,
devrait tre attribue
une
poque
bien basse
;
il faudrait encore se rsoudre
accepter
l'affreuse restitution de
Tarral,
contre
laquelle
le
got
de
Furtwaengler
s'est
insurg,
puisqu'il
lui en a substitu une
autre,
d'ailleurs im-
possible
dfendre
(fig. 59,4).
Donc
et ceci est d'une
rigueur presque mathmatique
les admirateurs de la
Vnus,
s'ils veulent tre
consquents,
doivent
poser
en
principe que
le
fragment
de
base,
avec la
signature
d'Agesandros
et
Thermes,
n'a rien de commun avec la
statue.
D'aprs
un dessin fait au Louvre avant la
perte
ou la destruction de ce
fragment,
on voit
que
la
ligne
de
brisure,
sur la
gauche, s'ajustait par
peu prs
la
ligne
suivant
laquelle
est
brise,
droite,
la base
de la
Vnus. C'est l un
simple
hasard. S'il
y
avait eu corres-
pondance
exacte entre les deux surfaces
brises,
on
les aurait
rejointes
et
l'inscription
ne serait
pas gare.
Il
n'y
avait certainement
qu'un
peu prs.
L'herms
8. REINACH 20
306 DOCUMENTS SUR LA VENUS
DE MILO
et la base
signe
-sont les
fragments
d'un
groupe quel'
conque ;
la Vnus est une
figure
isole.
On savait
dj que
Ton avait
dcouvert,
avec la
Vnus,
des morceaux de
sculpture
appartenant
d'autres statues et des
poques
diverses. C'est
pour-
quoi j'avais
mis
l'opinion,
en
1890,
que
la niche o
elle a t trouve avait servi de
dpt
un chaufour-
nier 1. J e maintiens cette
opinion,
bien
qu'Edmond
Le
Blant,
dans
l'intervalle,
ait soutenu
que
la Vnus
avait t cache
par quelque paen,
ami du
beau,
au
moment du
triomphe
du christianisme
et de la fureur
iconoclaste
qu'il
dchana
2. S'il en tait
ainsi,
on aurait
trouv la Vnus seule ou avec d'autres statues
compltes,
comme les herms
qui
lui tenaient
compagnie
;
on
ne l'aurait
pas
exhume avec un troisime bras
(de
dimensions
trop grandes pour
la
statue),
un
pied,
des
inscriptions,
etc 3.
De ces
inscriptions,
celle
que
Voutier a lue sur le bloc
qu'il
donne
pour
base Thermes barbu
prend
une
importance singulire,
la lumire des observations
que
j'ai
faites en 1897 et
que je puis complter aujourd'hui.
L'inscription
se lit : Thodoridas
Laistratou,
c'est--
dire :
Thodoridas fils de Lastratos.
Comme elle est
perdue,
et
que
le dessin de Voutier
est trs
sommaire,
on ne
peut
en estimer la date
par
l'tude de la forme des
lettres
;
mais il se trouve
que
ce Thodoridas est connu
d'ailleurs. C'est lui
qui
a ddi
Posidon,
vers 370
avant
J .-C,
la statue d'hommesans doute son
propre
portrait
que j'ai reproduite d'aprs
un dessin fait
par
M. Gilliron au Muse d'Athnes *.
1. Gazette des
Beaux-Arts, 1890, I, p.
376-394, (plus haut, p. 256),
2. E. Le
Blant, Mlanges
de
Rome,
t.
X, p.
389.
3. Voir le
tmoignage
de Dumont
d'Urville, Chronique
des
Arts,
1897, p.
25
(plus haut, p. 279).
4.
[Voir Cultes, mythes, etc.,
t.
IV, p.
425 et
Rp. stat.,
t.
II,
p.
662,
5.]
DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO 307
La base de la statue a t dcouverte ancienne-
ment,
transporte
au vieux
port
et
publie
en 1878
;
la
statue a t exhume la
mme
anne,
au lieu dit
Klima 1.
M. Cavvadias et tous les
archologues qui
l'ont vue
debout sur son
pidestal
affirment,
sans aucune r-
serve, que
la base
appar-
tient bien la statue 2.
L'inscription grave
sur
cette base se traduit ainsi :
Thodoridas,
fils de Las-
tratos,
Posidon.
Or,
la statue de Tho-
doridas faisait
partie
d'un ensemble. En mme
temps qu'elle
on a dcou-
vert une statue colossale
de
Posidon,
haute de
plus
de 2
mtres,
qui
est
aujourd'hui
au Muse
d'Athnes
3
(fig. 61).
Il est
assez naturel de
penser que
Thodoridas,
ayant
consacr le
colosse
de Posidon
en
1.
[M. Lallier,
vice-consul de France
Milo,
m'a crit la lettre sui-
vante
(Chronique, 1898, p. 275)
: Le lieu dit Klima est le nom donn
aux
jardins qui
sont dans le terrain au bord de la mer : la Vnus a
t trouve sur le flanc de la
montagne
au-dessus de ces
jardins,
prs
du thtre et environ 150 mtres du bord de la mer. Le
Nep-
tune a t trouv
par
M. J ean
Nostrakis,
notaire
Milo, auprs
de la
tour Mavro
Tkho,
peu
de distance de l'endroit o fut dcouverte
la Vnus.
].
2.
Cavvadias, Glypta,
t.
I, p. 193,
n 237.
3. S.
Reinach, Rpertoire
de la
statuaire,
t.
II, p.
28
;
Gazette des
Beaux-Arts, 1890, I, p.
389.
Fi?.
61.
Le Posidon de Milo.
308 DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO
mme
temps que
d'autres
statues,
ait voulu
aussi
consacrer au dieu sa
propre image,
comme celle d'un
respectueux
adorateur. Les ddicaces de ce
genre
sont
frquentes
en Grce
;
les textes littraires en ont con-
serv
plus
d'un
exemple.
Cela
tant,
il est bien
probable que
la statue de Po-
sidon doit tre
contemporaine
de la ddicace de Tho-
doridas,
moins
qu'on
ne veuille
supposer que
le
Posidon de Thodoridas ait t
remplac plus
tard
par quelque
autre
image
du mme dieu.
Assurment,
cela est
possible
1
; mais,
en bonne
mthode,
il faut
raisonner
d'aprs
les
vraisemblances,
ds
qu'un
motif
grave
ne nous
oblige pas
raisonner autrement.
Donc,
jusqu' preuve
du
contraire, j'admettrai que
le Posi-
don de Milo a t
sculpt
vers 370 avant
J .-C,
c'est--
dire
l'poque
o l'cole de
Phidias,
continue
par
Alcamne et
par Cphisodote
le
Vieux,
allait faire
place
celle de
Scopas
et de Praxitle.
Cette conclusion
peut paratre trange, parce que
tous les
archologues, jusqu' prsent,
ont
plac
le
Posidon, d'aprs
le
style,
vers Tan 150 avant J .-C. Mais
les
archologues peuvent
s'tre
tromps
sur ce
point.
M.
Furtwaengler
ne vient-il
pas,
tout rcemment
encore,
de
signaler
Venise des
originaux
de la
plus
belle
poque
grecque, que
Ton s'accordait considrer
comme des
oeuvres alexandrines ou romaines
2
? Et
si,
pour
un chef-d'oeuvre comme la Vnus de
Milo,
les
plus
habiles
archologues
n'ont
pu
se mettre
d'accord,
les uns la
plaant
vers
400,
les autres vers 100 avant
J .-C,
n'a-t-on
pas
le
droit, quand
il
s'agit
d'une oeuvre
moins
parfaite,
quoique
sans conteste d'une belle
allure,
d'arguer
de la latitude
que
nous laisse notre connais-
sance
encore rudimentaire des
styles grecs
?
1.
[C'est
ce
que je
crois
aujourd'hui.
1929.]
2. Voir Mmoires de l'Acadmie de
Bavire,
1. XXI
(1898).
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 309
Non seulement le Posidon
est,
comme la
Vnus,
de dimensions
colossales,
mais il
prsente
avec
celle-ci
des
analogies incontestables,
en
particulier
dans la
disposition
et le traitement des
draperies.
Ces ana-
logies
avaient
frapp
trs vivement M.
Furtwaengler;
elles ne le
gnaient
d'ailleurs
pas, puisqu'il plaait
Posidon et Vnus vers 150 avant J .-C. Elles ne nous
gnent pas davantage,
nous
qui croyons
les deux statues
de
plus
de deux cents ans antrieures. Il
y
a donc
moyen
de s'entendre.
Et la statue de Thodoridas ? Elle est sans
tte,
ce
qui
enlve
toujours
un lment
d'apprciation.
Avouons franchement
qu' premire
vue on l'attri-
buera volontiers
l'poque romaine,
o les
figures
drapes
de la sorte sont trs nombreuses. Mais les
artistes romains n'ont
pas
invent cela
;
leurs
types
convenus d'hommes
draps,
de femmes
drapes,
sont
imits de motifs
grecs
de la belle
poque,
en
particulier
du ive sicle. Si le travail de la statue de Thodoridas
n'est
pas
trs
bon,
cela
n'empche pas
du tout d'attri-
buer cette
figure
au ive sicle
;
il
y
a certes moins de
diffrences,
comme
qualit,
entre le Thodoridas et le
Posidon
qu'entre
le Posidon et la Vnus 1.
Or,
Posidon
et Vnus doivent tre
contemporains.
Et tout fait
penser que
ces deux
figures taient,
l'origine,
sinon
groupes,
du moins
places
peu
de distance Tune de
l'autre. C'est ce
qui explique
et
je
ne vois
gure
comment
l'expliquer
autrement
qu'une inscription
au nom du mme
Thodoridas,
li indissolublement
au Posidon de
Milo,
se soit
rencontr,
teste
Voutier,
ct de la Vnus.
J e
suppose qu'il y
avait Milo un sanctuaire de
1. M.
Collignon, qui place
le Posidon au ne
sicle,
croit le Tho-
doridas de la mme
poque.
M.
Furtwaengler
et M.
Collignon
trouvent
que
le Posidon ressemble la Vnus.
Donc,
il
n'y
a
pas trop
de
tmrit
rapprocher
de la Vnus notre statue de Thodoridas.
310 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
Posidon,
consacr
par
un riche
citoyen
du nom de
Thodoridas
peut-tre
un armateur
et tout
rempli
de statues. Le nom de Thodoridas devait tre
grav
sur d'autres marbres
que
celui
qui
servait de
pi-
destal la statue du donateur. Le
jour
des
catastrophes
et de la barbarie
venu,
quelques
ex-voto de Thodo-
ridas restrent en
place ;
la
Vnus,
avec d'autres
frag-
ments de mme
provenance,
fut
transporte par
un
chaufournier en lieu sr.
L'inscription
au nom de
Thodoridas
que
Ton a exhume avec elle semble dcla-
rer bien
hautement,
notre
avis,
qu'elle
vient du
mme endroit
que
le Posidon.
La Vnus !
Que
de fois cette
dsignation d'Aphro-
dite a t
rvoque
en doute ! On a
song
une Vic-
toire,
une
Nymphe
de
l'le,
une
Muse, que sais-je
encore ?
Aprs
tout,
il faut bien avouer
que
la
dsigna-
tion traditionnelle
ne
repose
sur rien de bien solide.
La
desse, dit-on,
avait les oreilles
perces pour
recevoir
des
pendants.
Cela
suffit-il,
en
archologie, pour
affirmer
qu'une
desse
s'appelle
Vnus ? Les
pendants
d'oreille
sont-ils des attributs divins ?
Il semble donc
que,
tout en
maintenant, jusqu'
nouvel
ordre,
la
dsignation traditionnelle,
on soit
libre d'en chercher et mme d'en
proposer
une autre.
Or, voici,
pour
terminer,
une
hypothse nouvelle; je
la donne comme une
hypothse,
car
je
ne suis
pas
du
tout convaincu
qu'elle
soit
justifie;
mais
j'aime
au-
tant,
aprs
l'avoir rumine
pendant plus
d'un
an,
m'en dlivrer en la soumettant nos lecteurs.
Philochore,
historien
grec qui
crivait vers Tan 300
avant
J .-C,
nous
apprend qu'il
existait,
dans Tle
de
Tnos,
deux statues de Posidon et
d'Amphitrite,
hautes de neuf
coudes, qui
taient l'oeuvre du
sculpteur
athnen Tlsias. Par
Strabon,
nous savons
que
le
temple
et le bois sacr de Posidon Tnos taient
situs en dehors de la
ville;
Tacite aussi
parle
du culte
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 311
de Posidon Tnos. J e
rappelle
ces deux textes
pour qu'on
ne soit
pas
tent de
remplacer,
dans le
passage
de
Philochore,
le nom de Tenos
par
celui de
Melos.
Tlsias
est, d'ailleurs,
compltement
inconnu.
Mais,
comme Philochore crivait vers
300,
on
peut sup-
Fig.
62.
Le Posidon de
Milo,
restitu au Muse
d'Athnes,
et la
maquette
de la Vnus
(Amphi-
trite),
excute
par
P.
Weber,
suivant le
projet
de
S.
Reinach,
au Muse de
Paint-Germain.
poser que
Tlsias a vcu au ive sicle avant J .-C. A
cette
poque et,
a
fortiori,SM
ve
sicle,
il ne
peut gure
tre
question
d'une
Amphitrite groupe
avec un Posi-
don,
mais on
peut parfaitement
admettre la
juxta-
position,
dans un
temple
ou en
plein air,
de deux statues
de ces divinits de la mer.
Les statues de Tnos avaient neuf coudes de
haut,
ce
qui
fait exactement 4
mtres,
presque
le double du
Posidon de
Milo,
haut de 2 m. 45
(cinq
coudes et
312 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE
MILO
demie).
La Vnus de Milo a 2 m. 038 de
haut
(quatre
coudes et
demie).
Il
n'y
a donc aucune relation directe
tablir entre ces statues.
Mais s'il existait
Tnos,
au ive
sicle,
un sanctuaire
de Posidon avec des statues de ce dieu et
d'Amphi-
trite, pourquoi
l'le voisine de Mlos n'aurait-elle
pas
possd,
la mme
poque,
deux statues
d'Amphi-
trite et de
Posidon,
ornant
quelque
sanctuaire du dieu
marin ?
Dans
l'hypothse
o la Vnus de Milo serait une
Amphitrite
1,
on
s'explique
enfin la direction
singulire
de son
regard.
H. Brunn a trs
justement
fait
remarquer
que
les divinits marines
regardent
au
loin,
comme si
elles voulaient sonder l'horizon.
Or,
cette
particula-
rit de la Vnus de Milo est
prcisment
de celles
qui
ont le
plus
embarrass les auteurs des
restitutions;,
c'est la
grande objection
la restauration de
Millingen,
qui
la concevait comme se mirant dans un bou-
clier.
Le Posidon de Milo retient sa
draperie
de la main
gauche et,
de la main droite
leve,
il tient un
trident..
Si la Vnus de Milo est une
Amphitrite
et si elle a
fait
pendant
au
Posidon,
force est d'admettre
qu'elle
retenait sa
draperie
de la main droite
2
et
qu'elle
tenait
un trident de sa main
gauche
leve
(fig. 62).
Aux artistes voir si cette restitution est
accep-
table.
Puisse-t-elle,
du
moins,
ne
pas
scandaliser les.
archologues
!
1.
[Comparable
celle
qui figure,
ct de
Posidon,
sur une-
mosaque
africaine au
Louvre, publie
Archol.
Zeitung, 1860, pi.
144
et Eranos
Vindobonensis, p.
196.
1929].
2. Elle
pouvait porter
la main vers sa
draperie
sans la reUnir-
stricto sensu.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 313
VII
Dcouverte,
au Louvre
mme,
de la base-
de Thodoridas
1
On lit dans le
compte
rendu officiel de la sance de
l'Acadmie des
inscriptions,
tenue le 14
septembre
1900 :
M. HRON DE VILLEFOSSE annonce l'Acadmie
qu'on
vient de retrouver au Muse de Louvre une base
de marbre orne d'une
inscription grecque qui porte
le
nom de Thodoridas
fils
de
Lastratos,
dcouverte
Milo en mme
temps que
la clbre Vnus du Louvre..
Ce monument n'tait connu
que par
le
croquis
d'un
officier de marine nomm
Voutier, prsent
la dcou-
verte,
croquis publi par
M. Ravaisson et tudi
par
M. Salomon Reinach. Au
Louvre,
cette
base avait t
malencontreusement
accouple,
une
poque dj
lointaine,
avec un monument funraire de basse
poque,,
et les lettres de
l'inscription, passes
au
rouge,
avaient
t dnatures. Ce
qui
est
particulirement intressant,,
c'est
que
l'un des herms dcouverts avec la Vnus
de Milo entre exactement dans une cavit
pratique
la
partie suprieure
de la
base;
les
moulages prsents
l'Acadmie
par
M. Hron de Villefosse le dmontrent
avec vidence. Il est donc certain
que
Voutier n'avait
pas
runi arbitrairement cette base et cet
herms,
comme
on Ta
suppos;
les historiens de l'art
antique pourront
utiliser ce document dans leurs tudes.
M. SALOMON REINACH insiste sur
l'importance
de
la,
dcouverte annonce
par
M. Hron de Villefosse. Cette
dcouverte
permet,
son
avis,
d'carter d'une
faon
1.
[Comptes
rendus de l'Acadmie des
Inscriptions,. 14'sept. 1900,^
p.
463 et
suiv.]
314 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
dfinitive
l'opinion
de M.
Furtwaengler, qui
attribue
la Vnus de Milo aux environs de Tan 100 avant J .-C.
M. Reinach
pense qu'elle confirme,
en
revanche,
la
thse
qu'il
soutient
depuis plusieurs
annes,
consistant
placer
vers 380 avant
J .-C,
non seulement la Vnus
de
Milo,
mais le
Neptune
de Milo... Ce
Neptune
a
pro-
bablement t offert
par
le mme Thodoridas
qui
a
oonsacr la base de Thermes retrouve
par
M. de Ville-
fosse, laquelle, d'aprs
les caractres de
l'inscription,
est antrieure Tan 350 avant J .-C. M. S. Reinach
croit
que
la Vnus de Milo
considre
par
lui
comme une
Amphitrite
a t associe autrefois au
Neptune,
et
que
ces deux
oeuvres,
d'excution
ingale,
mais
apparentes par
la
conception,
sont sorties du
mme atelier.
La note de M. H. de
Villefosse, publie
in extenso
dans les
Comptes
rendus
(1900, p. 465-472)
avec deux
planches,
mrite de ne
pas
rester enfouie dans ce recueil.
J e la
reproduis intgralement
:
Dans le mmoire
que
notre savant et
regrett
confrre Flix
Ravaisson a
publi
sur la Vnus de
Milo 1,
il a fait connatre
des
croquis
trs
intressants,
excuts au mois d'avril
1820,
au moment mme de la
dcouverte, par
un
jeune
officier de
marine nomm
Voutier,
qui tait,
cette
poque,
lve de
pre-
mire classe bord de
l'Estafette,
navire de la division navale du
Levant mouill Milo. Ces
croquis, reproduits
sur la
planche
II
du
tirage
parta,
sont au nombre de
quatre.
Les deux
premiers
(1-2) reprsentent
la moiti
suprieure
et la moiti infrieure de
la Vnus
;
les deux autres
(3-4) reprsentent
deux
herms,
l'un
imberbe,
l'autre
barbu,
trouvs en mme
temps que
la statue et
exposs aujourd'hui
au Louvre
3
;
les
tmoignages
de Dumont
1. Mm. de l'Acad. des
Inscr.,
t.
XXXIV,
lre
partie.
2. Cf.
ibid., p.
9 et 10.
3.
Froehner,
Notice de la
sculpture antique,
n
08
194 et 209.
Cata-
logue sommaire,
n
08
404 et 405.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 315
d'Urville,
de Brest et de Voutier s'accordent
pour
nous
apprendre que
ces deux herms furent dcouverts Milo en
mme
temps que
la Vnus.
Mais,
dans les
croquis
de
Voutier,
les
deux herms sont soutenus
par
des
bases, galement
dcouvertes
avec la statue et
portant
toutes deux des
inscriptions ;
ils
semblent
s'y adapter
trs naturellement. M.
Furtwaengler pense
que
Voutier avait arbitrairement
superpos
les herms ces bases 1.
C'est l une
impression
tout fait
personnelle,
car la
preuve
du
fait est
impossible
tablir. On
peut
facilement soutenir la thse
contraire. L'examen des monuments doit
cependant
nous
per-
mettre de rechercher si cette
adaptation
est vraisemblable.
La
premire
de ces
inscriptions, signature
d'un artiste
origi-
naire d'Antioche du
Mandre,
et
par
suite
postrieure
l'anne
260,
tait
grave
sur un bloc de marbre bris
droite;
la
partie majeure
de ce bloc avait t
pratique
une cavit carre.
On connat ce dtail d'une
faon positive par
un dessin trs
prcis d'Auguste Debay,
excut en
1821, lorsque
le marbre
arriva Paris. Le dessin de
Debay
a t
reproduit par
le comte
de
Clarac 2, qui
voulait reconnatre dans le marbre en
question
un morceau de la
plinthe
de la Vnus 3.
Voutier,
au
contraire,
tmoin de la
dcouverte,
a
reprsent,
dans son
croquis,
Thermes
imberbe
plac
verticalement sur ledit marbre et
s'adaptant
dans
la cavit.
Malheureusement,
cette
base,
entre au Louvre en
1821,
en mme
temps que
la Vnus de
Milo,
est celle dont tous
les
archologues dplorent
la
perte
et
que
les conservateurs du
Louvre ont recherche en vain
depuis plus
de
cinquante
ans.
Elle semble avoir
disparu mystrieusement peu
de
temps aprs
avoir t dessine
par Auguste Debay
4. On ne
peut
donc,
pour
le
moment,
faire aucune constatation au
sujet
de la runion de
Thermes imberbe et de la
premire
base.
La seconde
inscription, grave
sur une seconde base
qui,
dans
1. Meisterwerke der
griech. Plastik, p.
601 et suiv.
2. Sur la statue
antique
de Vnus
Victrix,
1821
pi.
1. Il est remar-
quable que Debay,
dans son
dessin,
et
Voutier,
dans son
croquis,
indpendants
l'un de
l'autre,
s'accordent
pour reprsenter
cette
premire
base sans aucune moulure, avec des faces absolument unies.
Cf. Hiller von
Gaertringen,
Inscr.
gr. insularum,
fasc.
III,
n 1241.
3.
Clarac, op. cit., p.
48 et suiv. On
voit, par
le texte de
Clarac,
que
le conservateur des
Antiques
tait rest
tranger
la dcision
prise
au
sujet
de ce bloc de marbre.
4.
Longprier,
dans sa lettre Friederichs cite
plus
loin,
insinue
que
les architectes du
Louvre, qui
avaient alors la haute main sur
les travaux de restauration des
antiques,
ont
pu
l'avoir fait dbiter !
316 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
le
croquis
de
Voutier,
sert de soutien Thermes
barbu,
tait
encore inconnue avant la
publication
de ce
croquis,
ou tout au
moins elle tait trs inexactement
connue,
comme on le verra
tout l'heure. M. Ravaisson ne l'avait
pas
transcrite. M. Salo-
mon Reinach a eu la
pense
de l'tudier l'aide d'une
photo-
graphie prise
sur le dessin
original
de
Voutier,
et il a obtenu la
transcription
:
OeoScopiSaAy/joiarpTou
1.
Sur les indications de M. Hiller de
Gaertringen,
M. S. Reinach
rapproche
cette
inscription
d'un autre texte
copi
Milo en
1878
par
M. Charles
Tissot,
et mentionnant une ddicace
Posidon faite
par
un certain
Thodoridas, fils
de Daistratos 2.
Ces deux Thodoridas
paraissant identiques,
M. S. Reinach
supposa que
Voutier avait commis une erreur de
copie et,
par
une correction trs
vraisemblable,
il
proposa
de
lire,
sur le
croquis
de
Voutier,
le nom de Daistratos au lieu de celui
d'Age-
sistratos.
Cette heureuse correction se trouve confirme de la manire
la
plus
clatante
par
la dcouverte de la base dessine
par
Vou-
tier. Ce n'est
pas
Milo
qu'elle
a t retrouve : c'est au Muse
du
Louvre,
o
personne
assurment n'en
souponnaitl'existence.
Clarac n'en dit
pas
un mot et on en cherche en vain le dessin dans
son atlas des
Inscriptions grecques
et romaines du Louvre.
Ce
fait,
rapproch
de la
disparition
de la
premire
base,
semble
prouver,
comme le
pensait Longprier, que
les
fragments
arrivs
Paris avec la Vnus de Milo n'avaient
pas
t laisss sous
la
garde
du conservateur des
Antiques
et
qu'ils
avaient t
dpo-
ss dans un
magasin dpendant
directement du service des
architectes. Ce
qui
est
particulier,
c'est
que
VInventaire du
rgne
de Louis
XVIII,
sous le n
299,
ne mentionne en 1821
que
l'entre de la Vnus de Milo
;
il n'est
pas question
des autres
fragments. Quoi qu'il
en
soit,
la seconde base existe et
j'ai
l'honneur d'en
prsenter
un
moulage
l'Acadmie. J 'ai fait
mouler
galement
Thermes barbu
;
il est facile de constater
qu'il
s'adapte
merveille dans la cavit creuse la
partie suprieure
de la base. L'assertion de M.
Furtwaengler, qui
consiste dire
que Voutier,
dans son
croquis,
avait arbitrairement
superpos
Thermes barbu cette
base,
est trs
discutable,
car il
n'y
a
pas
de
raison
pour rejeter
a
priori
une
adaptation
faite
par
un tmoin
de la dcouverte et dont on
peut
vrifier l'exactitude.
L'original,
dont la forme est
rectangulaire,
est en marbre
pen-
1.
Chronique
des
Arts, 1897, p.
26.
2.
Chronique
des
Arts, 1897, p.42 ;
cf. Inscr.
gr. insularum,
fasc.
III,
n 1096
;
le marbre
porte
AAITPATO
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 317
tlique.
Il est orn de moulures sur la face antrieure et sur les
deux faces latrales
;
la face
postrieure,
destine tre
appli-
que
contre le
mur,
est reste
peine dgrossie.
La hauteur totale
est de 0 m. 28
;
la
largeur
sur la face antrieure est de 0 m. 46
;
la
profondeur
sur les faces latrales est de 0 m. 42. Entre les
moulures
(petite
corniche et
plinthe),
la hauteur de la surface
plane
est de 0 m.
19;
cette surface
plane
a t
gradine
;
les
moulures sont restes sous le ciseau. La cavit creuse la
partie
suprieure
mesure en
profondeur
0 m. 04
;
en
longueur
0 m. 207
;
en
largeur
0 m. 17.
Sur la face
antrieure,
au-dessus de la
corniche,
on lit :
eoSuptSa Aaictpa-ro Ep[jia..
La
premire
lettre a t enleve
par
une
cassure de la
pierre ;
les trois dernires sont trs effaces et se
lisent avec une certaine difficult
;
la fin il reste la
place
d'une
lettre maintenant illisible. Sans aucun doute on doit transcrire :
[0]EoSiopt(5aAtxiaTpTo('j) 'Fp|j.c[i]
1
J 'ai dit
plus
haut
que
ce texte tait
jusqu'ici
trs inexacte-
ment connu. Il avait t
cependant publi par
M. Froehner en
1865a. Mais
auparavant,
et
depuis plusieurs
annes
dj,
selon
l'antique
et
dplorable usage,
les lettres avaient t
passes
au
minium et dnatures
;
de
plus,
comme on
ignorait,
au
Louvre,
la
provenance
du
marbre,
il avait t trs malencontreusement
accoupl,
une
poque dj lointaine,
avec un
petit
monument
funraire de basse
poque, galement
sans
provenance
connue.
Cet
assemblage
monstrueux avait donn naissance une ins-
cription galement
monstrueuse :
IloxXtou
Fpavt'ou
"EpWTO]
Sur la
plinthe [jEoSiopijaowa Ai<rrpaTO(sic).On
reconnat faci-
lement,
dans cette dernire
ligne,
le texte
dfigur
de la base de
Milo.
Pendant
longtemps,
ce monument bizarre fut
dpos
sous la
colonnade du
Louvre,
dans l'ancienne
galerie africaine,
rare-
ment ouverte au
public
et
qui
avait fini
par
servir de
magasin.
J e me souviens trs bien de
l'y
avoir vu autrefois. C'est
seule-
1. La restitution
ZTJ V propose par
Hiller de
Gaertringen,
Inscr.
gr. insularum,
fasc.
III,
n
1092,
est
rejeter.
2. Les
inscriptions grecques (du Louvre),
n 178.
318 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
ment il
y
a une dizaine
d'annes, lorsqu'on
donna cette
galerie
au
dpartement gyptien, que
le monument fut
transport par
les marbriers du Louvre sous l'escalier Daru o de nombreux
fragments antiques
se trouvaient
dj dposs.
Il
y
a
quelques
semaines,
en mettant de l'ordre dans ce recoin
obscur,
M. Etienne
Michon,
conservateur
adjoint
des
Antiques
et
moi,
nous avons dcouvert cette
base, toujours
surmonte de son
petit
monument funraire
;
M. Michon
y
a immdiatement reconnu
la base de
Thodoridas,
dessine
par
Voutier et tudie
par
M. S. Reinach.
Les caractres de
l'inscription peuvent appartenir
au ive sicle
;
Thermes barbu entre exactement dans la cavit
suprieure.
Il existe donc un
rapport
certain entre
l'inscription
et Thermes.
Le
Thodoridas,
fils de Lastratos
(et
non
Daistratos), qui
a consacr le monument
Herms,
est certainement le mme
qui
a fait Milo une ddicace
Neptune.
J e laisse ceux de nos confrres
qui
se sont
plus spcialement
occups
de la Vnus de Milo et du
Neptune
de
Milo,
dont on
peut
voir en ce moment un
moulage
l'Exposition universelle,
devant
le
palais
de la
Grce 1,
le soin de tirer de ma communication des
consquences
utiles
pour
l'histoire de ces deux statues. Il me
suffit de
rpter que
Voutier n'a
pas agi
arbitrairement en
runissant la base et Thermes. J e
m'empresse,
en
outre,
d'annon-
cer l'Acadmie
que
le monument rtabli dans sa
position
vri-
table est
expos
maintenant
auprs
de la Vnus de Milo. J e
souhaite
que
le dieu
qui prside
aux trouvailles heureuses nous
favorise encore de sa
protection pour
retrouver la
premire
base
qu'on
recherche au Louvre
depuis
si
longtemps.
J 'ajouterai quelques
mots au
sujet
d'une autre
inscription
dcouverte en mme
temps que
la Vnus. C'est la ddicace de
Texdre Herms et Hracls
par Bacchios,
fils de Sattos 2.
Dans sa Notice
publie
en
1821,
Clarac a donn le texte
(p. 25)
d'aprs
une
copie
de Dumont d'Urville
;
il ne l'avait donc
pas
sous les
yeux ;
le marbre n'tait donc
pas
encore Paris cette
poque.
M. Hiller de
Gaertringen,
dans son recueil des
inscriptions
grecques
de
Milo,
insre une note tendant
prouver qu'il n'y
est
jamais
venu :
Lapidem
Parisiis in museo conservari falso
scripsit
Boeckh
;
Meli relictum tradit vie. de
Marcellus,
Sou-
1. Ce
moulage
entrera au Louvre
aprs l'Exposition.
Le
gouverne-
ment
grec
a bien
voulu,
sur ma
demande,
en faire don au
gouverne-
ment
franais.
3.
Collignon,
Hist. de la
sculpture grecque, II, p.
470
;
Hiller de
Gaertringen,
Inscr.
gr. insularum, III,
n 1091.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 319'
venirs de
l'Orient, I,
148
sq.
not. A. Schiff.
Boeckh avait
raison,
et M. de Marcellus n'avait
pas
tort. La
premire publication
de
Clarac
prouve
bien
que l'inscription
n'tait
pas
arrive Paris en
mme
temps que
la
Vnus,
mais elle
y
vint
plus
tard. En
effet,
dans le tome
II,
2e
partie, p. 853,
du Muse de
sculpture antique
et
moderne, qui porte
la date de
1841,
Clarac crit
propos
de
cette
inscriptionl
: J e la
publiai
dans la notice
que je
fis
paratre,
en
1821,
sur ce chef-d'oeuvre
(la
Vnus de
Milo).
Mais ce fut une
copie fautive,
et mon
inscription
le fut aussi. Le marbre tant
arriv
Paris, je pus
la
copier
avec
exactitude,
et
je
la rtablis
telle
qu'elle
est dans l'article sur la Vnus de Milo
que je
fi
pour
le Muse
royal,
etc..
Elle est donc arrive au
Louvre, peut-tre
en mme
temps que
la base de
Thodoridas,
mais elle ne
s'y
retrouve
plus depuis
longtemps. Ainsi,
de ces deux
textes,
celui
qui
a t tudi et
signal par
le comte de
Clarac,
conservateur des
Antiques,
est
aujourd'hui gar ;
il a subi la mauvaise fortune
qui
s'est
attache aux
inscriptions
dcouvertes avec la Vnus de Milo
;
celui,
au
contraire,
qui
tait rest dans l'ombre et dont on
ignorait
la
prsence
au
Louvre,
est sorti de son obscurit. J e
ne
dsespre pas
de retrouver un
jour
le marbre de
Bacchios,
car
je
ne
puis ajouter
foi aux accusations de
Longprier
contre
les architectes du Louvre 2.
VIII
Nouveaux
tmoignages
relatifs la Vnus de Milo
*
M. E. Michon vient de
publier
4
un intressant article
sur la dcouverte de la
Vnus,
son arrive et son
expo-
1. Cf. l'atlas des
Inscriptions grecques
et romaines du muse du
Louvre,
dat de
1839, pi.
LIV. Dans la
Description
de la
sculpture
antique,
dition de
1847,
n
802,
Clarac dit encore :
Tromp par
une
copie
inexacte
qui
en avait t fournie avant
que
le marbre
ft
Paris... etc. .
2. Cf. la lettre d'A. de
Longprier
dans K.
Friederichs, Bausteine,
1868, I, p.
334. Cette curieuse lettre n'a
pas
t
reproduite
dans la
seconde dition... Voir les rflexions de M.
Froehner,
Notice de la
sculpture antique
du
Louvre, I, p. 176,
note 2.
3.
[Chronique
des
Arts,
22 dcembre
1900, p. 388-390.]
4. Revue des tudes
grecques, 1900, p.
302-370,
320 DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO
sition au Louvre. J e me
propose
de
signaler
brivement
ce
que
cet article
apporte
de nouveau et de
discuter,
chemin
faisant, quelques points
sur
lesquels je
ne suis
pas
d'accord avec l'auteur.
Le
marquis
de Rivire revint en France sur la
Lionne,
o avaient t
embarqus
la Vnus et les autres marbres
recueillis Milo. Il avisa aussitt
le comte de
Forbin,
directeur des Muses
royaux, qu'il
dsirait offrir ces
objets
au roi. Forbin crivit au
marquis
de
Lauriston,
ministre de la Maison du
Roi, pour
lui demander l'au-
torisation de faire
dbarquer
et encaisser la statue
Toulon
par
les soins du
peintre
Rvoil
(22
dcembre
1820).
Six
jours aprs,
comme on
paraissait
craindre
la
dpense,
Forbin revint la
charge (28 dcembre).
Enfin,
le 4
janvier
1821,
il
put
transmettre
Rvoil,
alors
Aix,
l'invitation de se rendre Toulon
pour pro-
cder aux
oprations
ncessaires. Le 12
janvier,
il
crivit au comte
Missiessy,
vice-amiral commandant
Toulon,
pour
le
prier
de
prter
son concours Rvoil.
La Vnus arriva Paris en fvrier
(on ignore
la date
exacte)
et la donation fut annonce
par
le Moniteur
du 7 mars
;
elle avait t
accepte par
le roi le 1er
mars,
au cours d'une audience accorde Rivire.
Ds le 2
mars,
Forbin demande Lauriston l'auto-
risation de faire enlever ce monument
qui
embarrasse
beaucoup
M. de Rivire
;
il
ajoute
:
J e vais faire faire
un
procs-verbal
de l'tat dans
lequel
elle
(la statue)
se
trouve, qui exigera d'importantes
restaurations.
Ce
procs-verbal manque.
Une lettre de Forbin
Ernest David
(13 septembre 1821)
affirme
qu'
il
n'existe au Muse
royal
aucun
procs-verbal
relatif
l'enlvement de la statue.
Mais,
la fin de
1822,
Forbin
composa
une
note,
destine l'Acadmie des
Inscriptions, qui, publie
en 1852 seulement dans la
Revue
contemporaine,
a t exhume
par
M. Michon
;
cette
note,
dont la
rimpression occupe cinq pages,
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 321
a
pour
but de
suppler,
dans une certaine
mesure,
l'absence du
procs-verbal
d'enlvement. Forbin dit
l'avoir
rdige
l'aide de documents
communiqus
par
les Affaires
trangres (correspondance
des consuls
de
l'Archipel)
et une note dtaille remise
par Marcellus;
cette dernire avait t soumise
par
lui au vieux
Fauvel,
consul de France
Athnes,
dont Forbin
publia
la
rponse,
d'ailleurs verbeuse et sans intrt.
Voici deux assertions de Forbin
qui prsentent
un
certain caractre de nouveaut : 1 La statue aurait
t exhume en
fvrier
1820
;
2 Marcellus aurait fait
transporter
la statue du bord du brick
grec
sur son
vaisseau
, aprs
l'avoir
paye,
alors
que
le
moine
grec
Oikonomos l'enlevait sans la
payer.
M. Michon
pense
que
la date de fvrier est
exacte,
tandis
que j'ai
conclu
d'une lettre de Dauriac
que
la Vnus avait t dcou-
verte le 8 avril
(
il
y
a trois
jours ,
crit Dauriac
David,
le 11 avril
1820).
J e maintiens mon
opinion.
Les auteurs
qui indiquent
la date de
fvrier, Clarac,
Forbin, Quatremre, Froehner,
se sont tous
inspirs
du
rapport
de Marcellus et leurs
tmoignages
se rdui-
sent,
en
fait,
ce dernier.
Marcellus assure
1
que Yorgos
trouva le buste la
fin de fvrier
et,
deux semaines
aprs,
la
partie
infrieure.
Cela est en contradiction formelle avec le rcit de Vou-
tier, qui
dit avoir vu dcouvrir le mme
jour
les deux
parties
de la statue 2. Non seulement il le
dit,
mais il le
prouve par
le dessin de son album
qu'a publi
M. Ra-
vaisson. Il tait all
bord, dit-il, pour
chercher cet
album
;
se serait-il
drang
s'il ne s'tait
agi que
de
dessiner
la
partie infrieure
d'une statue ? D'autre
part,
le dessin rfute l'assertion
d'aprs laquelle
Yor-
gos
aurait
transport
la
partie
infrieure de la Vnus
1.
Marcellus,
Souvenirs de
l'Orient,
t.
I, p.
237.
2.
Chronique
des
Arts, 1897, p.
17
(plus haut, p. 275).
S. REINACH 21
322 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
dans sa cabane. Voutier doit avoir dit la
vrit; or,
le bateau o il tait lve se trouvait bien Milo le
8 avril.
Quant
la
question
du
paiement,
elle est
singulire-
ment obscure. Le moine
parat
bien avoir
pay
la
Vnus,
mais au
prix
drisoire
qu'il
lui convint de fixer
(750 fr.);
Marcellus
compta
Yorgos
un tiers en sus. Mais com-
ment remboursa-t-il le moine
qui, furieux, s'embarqua
presque
aussitt
pour
Chios ? Il me
parat probable
qu'il
ne le remboursa
pas
du tout et
qu'il
se
persuada
ne lui rien
devoir, parce que
le
moine, pensait-il,
n'avait
rien
pay.
Dans le
rapport envoy par
Brest Boure
(1862),
que j'ai
dcouvert dans les
papiers
de
Tarral, (plus haut,
p. 295),
il est dit
que
M. de
Forbin,
en
1817, passa par
Milo
et
y acquit, par
l'entremise de
Brest,
deux statues muti-
les
qu'il appela
J unon et Minerve. Brest
ajoute
: Dans
le mme terrain dcouvert
(sic)
se trouvait une autre sta-
tue
en
marbre,
mais encore
prive
de tte et de
pieds;
on
disait
que.c'tait
Paris et
que
les
Anglais
l'ont
galement
pris.
Donc,
ds
1817,
Brest avait entendu
parler par
Forbin du
J ugement
de Paris
;
comme on connais-
sait le beau
berger
et deux des
desses,
on devait s'at-
tendre rencontrer la
troisime,
Vnus. Ainsi
s'explique,
comme
je
l'ai fait observer en
18971, pourquoi,
sitt
la Vnus de Milo
exhume,
Voutier et Dumont d'Ur-
ville,
forts de l'rudition
que
Brest devait
Forbin,.
se mirent
parler
d'un
groupe reprsentant
le
J uge-
ment de Paris.
Cette
conclusion,
pourtant
bien
logique, n'agre pas
M. Michon. Il
prtend que
la statue virile
mutile,
mentionne
par
Brest en
1862,
serait le n 200 de
Berlin, dcouvert,
au
tmoignage
de Brest lui-mme
(dans
une lettre crite en italien Gerhard en
1830)
1.
Chronique
des
Arts, 1897, p.
87
(plus haut, p. 301).
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 323
en
1827,
dans le mme
champ
o avait t trouve la
Vnus. Mais cela est fort invraisemblable.
Brest, qui
avait
correspondu
avec Gerhard au
sujet
de cette
statue et lui avait
envoy copie
de la
signature
d'ar-
tiste
qu'elle porte,
n'aurait
pas
oubli cela au
point
de dire
qu'elle
avait t
emporte par
les
Anglais.
Il me semble vident
que
le
prtendu
Paris
de Brest
est diffrent de la statue de Berlin
;
ce devait tre un
fragment
sans
intrt,
comme les deux statues
acquises
par
Forbin et
dont on n'a
plus jamais
entendu
parler.
Mais,
alors mme
que
M. Michon aurait raison d'iden-
tifier les deux statues viriles dont il a t
question,
mon raisonnement resterait trs
acceptable
: c'est la
demi-science de
Forbin, reue
et transmise
par Brest,
qui
est
responsable
des
propos
de
Voutier,
de Dumont
d'Urville et de Brest lui-mme au
sujet
de la
Vnus,
considre comme victorieuse dans le concours de
beaut sur le mont Ida.
A la
p.
339 de son
mmoire,
M. Michon
publie pour
la
premire
fois le
petit
herms barbu dcouvert avec
la
Vnus, plant
sur la base retrouve au Louvre en
1900. On sait
que
cette base
porte
une ddicace de
Thodoridas
(voir p. 282)
;
sur
l'original
on a
pu
lire,
la suite du nom du
pre
du
ddicant, Lastratos,
celui
du dieu
auquel
la ddicace est faite : Herms. Il faut
donc modifier
l'tiquette
du Louvre
qui qualifie
ce
buste de
Bacchus,
erreur commise
par
la
plupart
des
archologues
et, d'ailleurs,
facile commettre. 11 est
sr,
absolument
sr, que
le
pidouche
est bien celui de
Thermes
; donc,
M.
Furtwaengler
a eu tort d'incriminer
la
fides
de Voutier
et,
en mme
temps,
il
appert que
ce
dernier a eu raison de
figurer
le second
herms,
celui
d'Hercule
jeune (qualifi
de Mercure
par l'tiquette),
sur le
fragment
de base avec la
signature
du
sculp-
teur d'Antioche
Il me semble vident
que
ces deux
herms, qui
n'ont
324
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
rien de commun avec la
Vnus,
n'ont rien de commun
entre
eux,
car la tte
barbue
est encore
phidiesque,
tandis
que
la tte imberbe est
hellnistique.
Donc
puisqu'on
ne
peut imaginer
un artiste d'Antioche
signant
un
simple
herms
1
le terme
juvnile
a d
tre
associ,
comme le sont souvent
les
termes,
une
statue
perdue.
Cette statue ne
pouvait
tre la Vnus :
1
parce que
le bras
gauche
de celle-ci tait lev et
qu'elle
n'aurait eu aucun
rapport
avec le terme
voisin,
ce
qui
est sans
exemple
dans Tart
grec ;
2
parce que
le
style
est tout diffrent. En
outre, j'ai
observ rcemment
que
la
partie suprieure
et
postrieure
de la tte du
terme imberbe est
entame,
comme si une main ou
un attribut avait autrefois
repos
sur elle. On
peut
donc
reconstituer
par
la
pense
un
groupe
o le terme aurait
sa
place,
mais d'o la Vnus serait absente.
J 'ajoute
que
le
style
du terme imberbe est
parfaitement
d'accord
avec la date
indique par l'inscription
du
sculpteur
d'Antioche
(200-150
avant
J .-C).
M. Michon a
peur d'adopter
sans rserves mes conclu-
sions, parce que,
l'poque
o le
fragment
de la base
inscrite fut
transport
au
Louvre,
on crut
remarquer
qu'il s'adaptait
sur la droite la
plinthe
de la Vnus.
Il revient
timidement,
il est vrai
-
l'hypothse
d'une restauration
antique.
Mais cette restauration
aurait t
absurde,
Thermes
juxtapos
la Vnus ne
signifiant
rien. J e
rpte
donc
que
la
juxtaposition par
peu prs
de la
plinthe
et de
l'inscription
ne
pou-
vait tre autre chose
qu'un
hasard
;
s'il
y
avait eu
concordance
parfaite, l'inscription
et t
rajuste
la
plinthe
et nous
l'y
lirions encore. On se laisse
facilement
tromper par
la similitude des surfaces de
cassure,
alors mme
que
les morceaux
rapprochs
1. J e ne connais
pas d'exemple
d'un herms
isol,
en
marbre,
portant
une
signature,
l'exception peut-tre
d'un herms
portrait.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 325
n'ont rien de commun. Au dbut des fouilles de
Myrina,
il m'est arriv de runir des ttes de terre cuite des
torses,
des
bras,
des
paules,
etc.,
et de ne
m'apercevoir
de Terreur
que
le
lendemain. J e faisais alors ce
qu'on
a
d faire au
Louvre,
aprs
avoir
rapproch
de la
plinthe
de la Vnus le
fragment
de base inscrite
; je prononais
le divorce
pour
incompatibilit.
Si Ton carte
-
comme
le
fait,
bien
entendu,
M. Michon
l'hypothse gratuite
et
injurieuse
d'une destruction volontaire du
fragment
de
base 1,
la seule
explication plausible
est
qu'on
Ta
loign parce qu'on
a reconnu
qu'il
ne
s'adaptait
pas,
et
qu'on
Ta ensuite
gar, parce qu'on n'y
attacha
plus
aucune
importance.
M. Michon a donn des dtails
piquants
et nouveaux
sur les
tiraillements et les
petites querelles auxquelles
donna lieu l'installation de la Vnus au Louvre.
Clarac,
conservateur des
Antiques,
se
plaignait
de n'tre con-
sult ni sur
la
restauration,
ni sur le
placement
de la
statue.
Forbin,
directeur des
Muses,
rejetait
ce
manque
d'gards
sur l'Institut et sur
Quatremre
de
Quincy,
tout en
revendiquant, d'ailleurs,
le droit de
prendre
les dcisions
qui
lui convenaient sans en rfrer
pra-
lablement Clarac.
Comment se
fait-il,
crivait ce
dernier vers le mois de mai
1821, que j'aie
trouv hier
tous
les
prparatifs (sic) pour placer
cette
statue,
sans
que j'en
aie
reu
encore
avis ? Il
n'y
a
personne
qui
ne trouvt
extraordinaire
qu'une
statue de cette
importance
soit venue mon
insu,
et conduite
par
MM. les
architectes,
se
placer
au Muse et en chasser
une autre
qu'on
a
relgue je
ne sais o .
1. Cette
hypothse,
chre aux
archologues allemands,
est fonde
sur une
lettre
particulire
adresse
par Longprier
Friederichs.
M. Michon a
reproduit
cette lettre et en a montr les
impossibilits
et les
quivoques.
Il faut
dire,
la
dcharge
de
Longprier, qu'il
ne
pouvait pas
se douter
que
Friederichs aurait l'indiscrtion de
publier
sa
boutade.
326 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
La Vnus fut d'abord
expose pendant quelques
jours,
au moment de la
donation,
dans ce
qui
est
aujour-
d'hui la salle
Lacaze,
puis
dans la salle
d'Auguste,
ensuite dans la salle de la
Paix, puis
dans la salle du
Tibre,
enfin
(vers 1853)
dans l'ancienne salle de
TIsis,
o elle est encore. La
correspondance
de
1822,
entre
Forbin et l'architecte
Fontaine,
dont le mauvais vouloir
tait trs difficile
vaincre,
est une des
parties
amu-
santes du mmoire de M.
Michon;
mais l'intrt archo-
logique
en est nul. Le mmoire se termine
par
une
notice sur deux
projets
destins
commmorer
la
donation de la Vnus au roi : l'un concernait l'excu-
tion d'un vase de
Svres,
dcor d'
un
sujet
relatif
l'acquisition
de la statue et
l'hommage que
M. le mar-
quis
de Rivire en a fait Sa
Majest
(il n'y
fut
pas
donn
suite) ;
l'autre
comportait
la
frappe
d'une
mdaille
commmorative dont le coin existe encore
la Monnaie
(M.
Michon en a
publi
un
dessin),
mais
qui
ne
parat pas
avoir t distribue. La
lgende
ne
fait aucune mention de la donation de M. de Rivire
;
singulier
exemple d'ingratitude royale
!
On
voudrait savoir si Brest a eu
raison,
en
1862,
de se
plaindre
des
procds
de
Rivire, qui
laissa
sup-
porter
au
pauvre agent
consulaire les frais de l'amende
inflige
aux habitants de l'le
de
Milo,
et ne le ddom-
magea qu'in
articulo mords
(plus haut,p. 300).M.
Michon
se
contente,
cet
gard,
de
reproduire
une lettre de
Forbin
Rivire,
alors
capitaine
des
gardes
du
corps
du Roi
(8
avril
1825), par laquelle
il lui transmet
une
rclamation adresse
par
les
primats
de Milo
M. de
Rigny, capitaine
des vaisseaux du Roi. D'autre
part,
M. Ravaisson a crit
que
la
quittance
en
grec,
dli-
vre
par
les
primats
M. de
Rivire,
qui
les ddom-
magea
de sa
bourse,
existe aux Archives nationales.
Ce document mriterait d'tre
publi
avec sa
date, que
.
M.
Ravaisson n'a
pas indique.
DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO 327
A diverses
reprises,
en lisant le travail si conscien-
cieux de M.
Michon, j'ai
t
frapp
de ce fait
que
cer-
taines
circonstances,
indubitablement
authentiques,
ne sont
plus
attestes
que par
la notice de M. Froehner
sur la Vnus de
Milo,
dans son
catalogue,
si remar-
quable pour l'poque,
de 1869
(p. 168-179).
C'est
donc
qu'il
a
dispos
de documents ou recueilli des
traditions orales dont il tait seul
profiter.
Dans
le mme ordre
d'ides,
je
ferai observer
que
M. Michon
ne cite
jamais
le dossier relatif la Vnus de
Milo,
qui
devrait tre au
Louvre; or, je
me suis assur
qu'il n'y
est
pas.
Comme M. Ravaisson n'a
pas toujours
t
soigneux
dans l'indication de ses
sources, je
ne suis
pas
certain
qu'il
ait
dispos
lui-mme d'un dossier de la
Vnus
;
toutefois,
dans les nombreuses et
longues
conversations
que j'ai
eu l'honneur d'avoir avec lui
au
sujet
de sa statue
favorite,
il ne m'a
jamais
dit
que
ce dossier
manqut.
Il est donc
possible qu'il
se soit
gar
ou
qu'il
ait t
dplac,
et Ton
peut esprer, par
consquent, qu'on
russira
quelque jour
le dcouvrir.
J 'ai vu avec
plaisir que
M. Michon incline
l'hypo-
thse
que j'ai
mise en 1898
(plus haut,
p. 310),
consis-
tant
qualifier
notre Vnus
d'Amphitrite
et l'as-
socier
(non pas
la
grouper)
avec le
Neptune
de Milo 1.
VIII
La ddicace de la niche o se trouvait
la Vnus de Milo
2
Dumont
d'Urville,
au mois d'avril
1820,
copia
Milo
une ddicace
qui
surmontait l'entre de la niche o
1. Voir
p. 312,
propos
de la
mosaque
de Constantine au
Louvre,
o
Amphitrite
est debout ct de
Neptune,
dans une attitude et
un costume
analogues
ceux de la Vnus. Voir aussi Y
Amphitrite
du muse
d'Avignon (Rp.
de la
statuaire,
t.
II, 334, 4).
2.
[Chronique
des
Arts,
9 fvrier
1901, p. 44-46.]
328 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
Yorgos
et Voutier avaient dcouvert la Vnus. L'entre
de la
niche, crit-il,
tait surmonte d'un marbre de
quatre pieds
et demi environ de
longueur,
sur six
huit
pouces
de
largeur.
Il
portait
une
inscription
dont
la
premire
moiti seule a t
respecte par
le
temps
;
l'autre est entirement efface...
Nanmoins,
j'ai copi
avec soin les caractres
qui
restaient encore de cette
inscription
et
je puis
les
garantir tous, except
le
pre-
mier,
dont
je
ne suis
pas
sr. Le nombre
que j'indique
pour
la
partie
efface a t estim
d'aprs l'espace
qu'occupent
les lettres
apparentes.
La
premire ligne
contient le nom du ddicant et de la
fonction
qu'il
a
remplie (woYupoKHapx'/aa),
la seconde
ligne
mentionne les
objets ddis,
-rvTE
s'Spav
xai
TO... suivis de
treize
points
;
la troisime
ligne
donne les noms des divi-
nits
auxquelles
est faite la ddicace :
'Ep[Aa'HpaxXe,sans
indication de lettres illisibles
ni
gauche
ni droite.
Cette
inscription
ne
figure pas
dans les neuf
pices
que
M. de Marcellus
embarqua
Milo le 26 mai 1820.
M. de Marcellus a mme
expressment
affirm
qu'il
l'avait laisse dans l'le. D'autre
part,
il dit non moins
expressment qu'elle
a t
emporte
au mois de
novembre de la mme anne
par
le
marquis
de Rivire :
M. de
Rivire,
en
quittant l'Archipel,
dsira voir le
champ qui
m'avait cd sa Vnus. Il s'arrta donc
Milo, y
renouvela ses
libralits,
reconnut la niche et le
champ d'Yorgos
et en
rapporta
deux bras
informes,
d'un marbre diffrent de celui de la statue...
Ils taient
sortis de terre
depuis
mon
dpart
l'endroit mme
o fut exhume la Vnus. M. le
marquis
de Rivire
emporta
la
longue inscription que j'avais copie
et
qui
dbute
par
ArXEOS ATIOT
(1).
Cette lecture
ArXEOS ATIOT
est
identique
celle
1. Revue
contemporaine, XIII, p.
291
(Loewv, Inschriften griech.
Bildhauer, p. 214).
DOCUMENTS SUR LA
VNUS DE MILO 329
de Dumont d'Urville
;
en
ralit,
il faut lire BAKXIOS
HATTOT
(x).
H
serait
singulier que
Dumont d'Urville
et M. de Marcellus eussent l'un et l'autre omis de
copier
un des deux . La conclusion
qui s'impose,
c'est
que
M. de Marcellus n'a
pas copi
la
pierre,
mais le
rapport
de Dumont d'Urville. Nous savons en effet
que
ce
rap-
port
lui avait t
communiqu
au commencement de
mai 1820.
Dans le tome II du Muse de
Sculpture
de
Clarac,
publi
en
1841,
se
trouve,
la
planche
LIV,
n
441,
un
fac-simil de la ddicace. Ce fac-simil est videmment
trs
soign
et n'a
pu
tre excut
que d'aprs l'original.
Ainsi, quand
mme nous n'aurions
pas
le
tmoignage
de
M. de
Marcellus,
il serait ncessaire d'admettre
que
le
marbre est arriv au Louvre.
C'est donc tort
que
M. Hiller von
Gaertringen,
le savant diteur des
inscriptions
de Milo dans les
Inscriptions graecae
insularum
(fascicule III, 1898),
crit
propos
de ce texte : Boeckh a dit faussement
que
ce marbre est conserv Paris au Muse
;
le vicomte
de Marcellus
rapporte qu'il
a t laiss Milo.
C'est
Marcellus lui-mme
qui
nous a
appris
le contraire 2.
M. Hiller n'a
pas
non
plus jug
ncessaire de
figurer
par
des
points
les lettres dclares illisibles
par
Dumont
d'Urville. Aussi
admet-il,
quoique
avec un
?,
la seconde
ligne,
le
complment propos
en 1893
par
M. Furt-
waengler
:
TOVTE
^pav
zal T
yaj/.a.
M.
Furtwaengler
a
propos
ce
complment
dans la
pense que
la ddicace de Bakkhios tant
postrieure
Tan
200,
comme la
prtendue signature
de la Vnus de
Milo
par
l'artiste d'Antioche sur le
Mandre,
la construc-
tion et la ddicace de
Texdre,
la statue et les deux her-
ms sont
contemporains
3.
T
yaX^a
dsignerait
la Vnus.
1. Correction de M.
Collignon.
2. Cf.
Michon,
Revue des tudes
grecques, 1900, p.
333.
3.
Furtwaengler, Masterpieces, p.
377.
330 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
M.
Furtwaengler
admet
cependant qu'il pouvait y
avoir
T
d^al^ct. 'AopoSt-nj.
D'aprs
Dumont
d'Urville,
il
y
avait les traces de
treize lettres
aprs
TO. Le mot
faXiAcc
n'en donne
que
six,
ce
qui
est
trop peu ; YaXfAa 'A'fpo<Sr/]
en donne
quinze,
ce
qui
est
trop.
J e laisse de ct la
singularit
d'une ddicace ainsi conue :
Bakkhios,
fils de
Satts,
ayant
t
hypogymnasiarque,
ddie Texdre et la
statue
d'Aphrodite
Herms
et Hracls
,
o
l'importance
d'une statue comme la Vnus est bien
peu
mise en lumire. Il suffit de dire
que,
matrielle-
ment,
les restitutions de M.
Furtwaengler
sont
impos-
sibles.
Sur la
pierre, aprs
TO,
il
y
a l'amorce d'un
X
ou d'un
a. Si Ton crit
TXIGIVV
so,
cela fait exactement onze
lettres.
Or,
la
premire ligne,
o la restitution
jiroYupamapxTJ aa
est
certaine,
il
y
a dix lettres l o
Dumont d'Urville ne
marquait que
huit
points;
on
peut
donc admettre
qu'il
a
pu
commettre une
lgre
erreur
dans l'valuation des lettres
manquantes.
On obtien-
drait exactement les treize lettres si Ton crivait :
T XtSivv
(rcyo.
De toutes
faons,
il ne
peut
tre
question
de la
ddicace de la Vnus
par Bakkhios,
et ainsi s'croule un
des
arguments
mis en avant
par
M.
Furtwaengler pour
abaisser la date de la statue.
Hracls et Herms sont les
patrons
ordinaires des
gymnases.
11devait
y avoir,
dans le
gymnase
de
Milo,
bien des ddicaces Herms et
Hracls,
tantt
runies,
tantt
spares,
surmontes de
petits
termes
reprsentant
ces dieux. Le fait
que Bakkhios,
vers 200
avant
J .-C,
ddia une exdre Herms et Hracls
et
que,
dans cette mme
exdre,
ct de la
Vnus,
on a trouv deux herms d'Herms barbu et
d'Hracls,
ne
prouve
nullement
que
ces herms aient t ddis
par
Bakkhios et soient
contemporains
soit de
Texdre,
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 331
soit de la
grande
statue
qu'on y
a trouve. En admet-
tant
cela,
M.
Furtwaengler
est all
beaucoup trop
vite
en
besogne.
C'est ce
que dmontre, d'ailleurs,
l'tude
directe du terme d'Herms barbu
et de la
ddicace
de Thodoridas Herms
qu'il
surmonte.
D'abord,
cette ddicace tant au nom de
Thodoridas,
non de
Bakkhios,
il est
impossible
de l'attribuer ce dernier. En
second
lieu,
les caractres de cette ddicace sont du
ive
sicle,
tandis
que
ceux de la ddicace de
Bakkhios,
en
juger par
le fac-simil de
Clarac,
sont bien
post'
rieurs.
Enfin,
M.
Furtwaengler
n'aurait
pas
d se
contenter de dire
que
la tte
qui
surmonte ce terme est
antrieure
l'Empire;
le
style
je
m'en suis
aperu
de nouveau en tudiant
l'original
avec M.
Helbig
est celui de la
premire
moiti du ive
sicle,
pour
ne
pas
dire du dbut mme de ce sicle.
Il est
possible que Bakkhios, pour
orner son
exdre,
ait
pris
des termes
plus
anciens et en ait dcor sa cons-
truction
;
mais cette
simple possibilit
ne modifie en
rien les conclusions
auxquelles
nous sommes
arriv.
Prenons maintenant le second
herms,
celui dont la
tte est celle d'Hracls
jeune. Quoiqu'en
ait dit
M.
Furtwaengler,
sans doute
pour
l'avoir
regarde
trop
vite,
cette tte est
postrieure
celle de l'Herms
barbu. Il
y a,
dans
l'intervalle,
non seulement l'art de
Scopas,
mais celui de Praxitle
;
le rendu des
yeux,
en
particulier
celui de la
paupire
infrieure,
est abso-
lument diffrent. Rien
n'empche
d'attribuer la tte
d'Hracls
jeune
au 111e
sicle,
comme tout
oblige
placer
celle d'Herms barbu au ive.
Cet herms avait aussi un
pidestal, qui
n'est
plus
connu
que par
les dessins de Voutier et de
Debay,
et
sur
lequel
on lisait la
signature
du
sculpteur
d'An-
tioche du Mandre.
Il est inadmissible
qu'un sculpteur
ait
pris
la
peine
de
signer
tout au
long
un herms de facture courante.
332 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
videmment,
la
signature
tait celle d'un
groupe
dont
le terme ne formait
qu'un
lment.
Le terme sert d'ordinaire de
point d'appui
la
figure
principale
ou l'un de ses attributs. J e ne connais
pas
un seul
exemple
d'un terme
d'Hracls,
d'Herms
ou de
Priape pos
ct d'une statue
d'Aphrodite
et
sans relation avec elle. Cela est vrai des statues en
marbre ou en bronze comme des terres cuites.
Or,
le bras
gauche
de la Vnus de Milo tant
lev,
il
n'a
jamais pu s'appuyer
sur la tte d'un terme. D'autre
part,
cette tte est mutile en haut du front et
par
derrire
;
elle a donc fort bien
pu supporter
une main
ou un attribut d'une statue
plus grande place
sur la
gauche.
11 rsulte de l avec une
quasi
certitude :
1
Que
le terme d'Hracls et la Vnus de Milo
n'ont rien de commun
;
2
Que
la
signature
sur la base du terme d'Hracls
n'est
pas
celle de l'auteur de la Vnus
;
3
Que
les
hypothses
de M.
Furtwaengler
doivent
partager
le sort de celles de Tarral et
passer
au dbar-
ras de l'histoire de l'art.
IX
La dcouverte du
Neptune
de Milox
J 'ai relat
plus
haut
(p. 286)
2
les circonstances de la
dcouverte du
Neptune
de Milo en
1878, d'aprs
les
renseignements communiqus
M.
Collignon par
M.
Carteron,
consul de France
Syra,
et
publis par
M.
Collignon,
avec
l'hliogravure
du
Neptune,
en
1.
Chronique
des
Arts,
4 mai
1901, p.
139-141.
2.
Ibid.,
30
janvier 1897, p.
43.
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 333
18891. En
1898,
j'ai complt
ces informations
par
une
note de M.
Lallier,
vice-consul de France
Milo, qui
prcise
l'endroit o a t dcouverte la statue 2.
D'autre
part, j'ai
insist
plusieurs reprises
sur
l'importance
d'une
figure
virile
drape,
dcouverte en
mme
temps que
le
Neptune, qui
a t
place
au
Muse d'Athnes sur une base
portant
une ddicace
de Thodoridas Posidon 3. La base et la statue ont-
elles t exhumes au mme endroit? A
quelle poque
les a-t-on d'abord
rapproches?
Autant de
questions
qui
restaient en
suspens
ou dans le
vague.
Par les conversations nombreuses
que j'eus
autrefois
avec lui sur cette
affaire, je
savais
que
Charles
Tissot,
ministre de France Athnes de 1876
1880,
s'tait
rendu Milo sur un navire de
guerre,
le
San, peu
de
temps aprs
la dcouverte du
Neptune,
et avait
adress,
sur cet vnement
archologique,
un
rapport
M. Wad-
dington,
ministre des Affaires
trangres, qui
l'avait
transmis son
collgue
de l'Instruction
publique
et
des
Beaux-Arts,
M. Bardoux.
Aprs
de
longues
dmarches dont le dtail est sans
intrt, je
suis enfin en mesure de
publier
la
partie
essentielle du
rapport
de Charles Tissot. Malheureu-
sement,
les
quinze
dessins
qui l'accompagnaient
ont t
gars.
Une note inscrite sur la
dpche originale
porte qu'ils
ont t transmis au ministre des Beaux-
Arts
; mais, malgr l'obligeance
de M.
Roujon,
direc-
teur, qui
a
prescrit
des recherches rue de
Valois,
il n'a
pas
t
possible
de les retrouver.
Or,
ces dessins sont d'une
singulire importance.
Ils nous fourniraient
seuls,
si nous les
possdions,
des
renseignements prcis
sur l'tat
primitif
des
sculptures
qui
ont t exhumes Milo en 1878.
1. Bulletin de
correspondance hellnique, 1889, p.
498.
2.
Chronique, 1898, p.
275
(plus haut, p. 307).
3.
Chronique, 1897, p.
43
(plus
haut,
p. 285).
334 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
J 'esprais
trouver aussi un
croquis topographique
indiquant,
avec la
rigueur
de mise en
pareille matire,
l'emplacement
de la dcouverte
;
cette
esprance
a
t
due.
Voici,
sans
plus ample prambule,
ce
que
nous
apprend,
sur l'affaire du
Neptune,
la
correspondance
diplomatique
de Charles Tissot.
Le 19 mars
1878,
Tissot
tlgraphie
au ministre des
Affaires
trangres pour
lui annoncer la dcouverte de
cinq
statues de
style grec, probablement
de la fin
du
ive sicle.
11
ajoutait
:
La
principale,
un
Neptune,
est
de toute beaut et
comparable
la Vnus... J e vous
envoie mes dessins
par
courrier.
Ce
tlgramme
est
comment
par
une lettre de la main mme de ce
ministre, expdie
d'Athnes le 19 mars 1878
; j'en
extrais ce
qui peut
intresser
l'archologie
:
J 'ai l'honneur de transmettre
ci-joint
Votre Excellence
les dessins dont mon
tlgramme
de ce matin vous
annonait
l'envoi. Ces
croquis
se ressentent des conditions dfavorables
dans
lesquelles je
les ai excuts. La statue
questre
et Tune des
deux statues de femmes sont seules
places
de
faon
ce
qu'on
puisse
en saisir l'ensemble
;
les trois autres sont enfermes dans
une
pice
souterraine de six ou
sept pieds
carrs
qui
ne
reoit
la lumire
que par
une troite ouverture. Il m'a t
impossible
ds lors de les dessiner sous un
jour
convenable et une distance
suffisante
pour
viter les raccourcis. Mes dessins ne
peuvent
donc
donner
qu'une
ide trs
imparfaite
du mrite des oeuvres d'art
que je
vais
essayer
de dcrire.
La statue
questre (nos 1, 2,
3 et
4)
est
dplorablement
muti-
le. Du cavalier il ne reste
que
le buste
jusqu'
la naissance des
cuisses;
la
tte,
les
paules,
les
jambes
et les bras ont t briss.
Les
jambes
du cheval ont
galement disparu,
mais la
queue
et la tte ont t retrouves et sont
reprsentes
sous le n 4.
Le cavalier est revtu d'une cuirasse de forme
grecque,
c'est--
dire courte
taille,
orne d'une tte de Mduse et de deux ser-
pents.
Deux
ranges
de
ptryges, franges
l'extrmit,
des-
cendent sur la
tunique.
Les bandes de cuir de la
range
infrieure,
beaucoup plus longues qu'elles
ne sont dans le costume
romain,
recouvrent en
partie
l'encolure et la
croupe
du cheval. Le cava-
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 335
lier est ceint d'une zona et
porte
un
pallium
sur
l'paule gauche.
Le
cheval,
de
petite
taille et forte
encolure, appartient
videm-
ment la race
grecque.
Le harnachement est encore reconnais-
sable et on
distingue parfaitement
la ttire avec ses
bossettes,
le balteus
qui
ceint le
poitrail
et la housse
qui
recouvre la selle.
Le
groupe
est de
grandeur
naturelle.
La statue de femme
reproduite
dans le
croquis
n 5 est un
peu plus grande que
nature. La tte et les deux
bras,
forms de
morceaux
rapports,
ont
disparu.
Le buste est revtu d'une
tunique
serre
par
une taenia. La
partie
infrieure du
corps
est
enveloppe
dans un
pplum.
Le dessin n 6
reprsente
une autre statue de
femme,
de
grandeur naturelle, appuye
sur une cariatide et entirement
drape
dans un manteau sous
lequel
se dessine le bras droit.
Par son mouvement et
par l'ajustement
des
draperies,
cette
statue
rappelle
les
plus gracieuses figurines
de
Tanagra.
La
tte et Tavant-bras
gauche
n'existent malheureusement
plus.
Le marbre est couvert en
partie par
des concrtions sablon-
neuses dont il serait facile de le dbarrasser.
La statue
reprsente
sous le n 7
prsente
une certaine
mollesse de model. Elle ne vaut ni mieux ni moins
que
la
plu-
part
des
figures
masculines mises en scne dans les bas-reliefs
funraires du
Dipylon.
Elle est du mme
style
et
appartient,
je crois,
la mme
poque.
Des habitants de Milo m'ont affirm
qu'une
base
isole, portant l'inscription
suivante :
6E0AQPIAAS AA1XTPAT0
FOEEIAANI
avait t retrouve
ct de la statue et lui servait de
pi-
destal.
L'inscription
est
grave
en beaux caractres
;
le
sigma
est encore d'une forme ancienne et le
gnitif
en 0 semble indi-
quer
une date antrieure aux
premires
annes du ive sicle.
Comme toutes ces
statues, d'ailleurs,
ont t retrouves enseve-
lies
ple-mle
dans une sorte de
fosse, je
serais tent de croire
que
le
pidestal portant
une ddicace
Neptune appartient
plu-
tt la
cinquime
statue
qui
est,
de
beaucoup,
la
plus
remar-
quable
de toutes.
Haute de 2 m.
50,
elle
reprsente
un
Neptune
debout, appuy
sur son
trident, ayant
ses
pieds
le
dauphin qui figure parmi
les attributs de cette divinit. La main
gauche, applique
sur la
hanche,
retient les
plis
d'un manteau
qui
couvre la
partie
inf-
336 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
rieure de la statue et remonte sur
l'paule gauche.
Le dessin
n 8 donne l'ensemble de la
figure,
brise en
plusieurs fragments
qui
existent tous et se
rajustent
exactement. Les nos
9,
10 et 11
reprsentent
la
partie suprieure
de la statue sous trois
aspects
diffrents. J 'ai
prouv
un vritable
regret
de ne
pouvoir, par
suite des circonstances
que j'ai indiques,
la
reproduire plus
fidlement et avec
plus
de dtails. La tte est bien
conserve,
moins le
nez,
qui
est bris. La
chevelure,
la
barbe,
le
front,
les
arcades sourcilires sont traits
avec
une
largeur remarquable.
Les attaches du
cou,
les muscles de la
poitrine
et des ctes sont
models avec autant de finesse
que
de
vigueur.
J e ne connais
pas
de torse
antique
d'un travail
plus parfait.
Les
croquis
12 et
13,
qui
donnent la
partie
infrieure de la
statue,
de face et de
ct,
ne sont
que
de
simples
indications
;
ce
fragment
tant couch
par
terre,
sous une vote
basse,
il est
impossible
de saisir l'en-
semble. Les
croquis
nos 14 et
15, reprsentant
l'avant-bras
gauche,
le bras droit et le
pied gauche,
ont t
pris par
un des
officiers du San. La main droite est
complte,
moins l'index.
Le trident devait tre en bronze et former une
pice
mobile.
Le
Neptune
de Milo
est,
mon
avis,
une des oeuvres les
plus
remarquables
de l'art
hellnique.
Charles TISSOT.
Donc,
avec le
Neptune,
on a trouv une statue
questre,
deux statues de femmes
drapes
et une statue
d'homme
drap (Thodoridas) ;
l'information de M. Car-
teron,
qui parlait
M.
Collignon
de
quatre
statues
de
femmes, tait, par suite,
inexacte. Dans le
catalogue
du muse
d'Athnes,
les statues fminines
portent
les
ns
236, 238;
la statue d'homme est le n
237;
le
Nep-
tune est le 235
;
je
ne trouve
pas
trace du
groupe
questre (x).
1
[En effet,
ce
groupe colossal, d'poque
romaine
impriale,
tait
rest Milo
; grce
une
photographie
de M. Alfred
Schiff, j'ai pu
le
publier
dans la Revue
archologique
de
1902,
au cours d'un article
rimprim
en 1912 dans Cultes
(t. IV, p. 421-437). Quelques parties
de cet article rsument les tudes
reproduites
ici.
1929.]
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 337
X
M.
Furtwaengler
et la Vnus de Milox
J 'prouve parfois quelque peine, je l'avoue,
discu-
ter froidement avec M.
Furtwaengler
2. Il a une fureur
d'avoir
toujours raison,
mme
quand
il a
tort, qui
mettrait la
patience
d'un saint rude
preuve.
Cela
dit,
je
vais tre trs
objectif.
De la
publication
rcente de textes relatifs la
Vnus,
en
particulier
du
rapport
de
Xno 3,
et de ce
qu'on
savait
depuis longtemps,
M.
Furtwaengler
conclut
qu'il y
avait dans la ville de Milo un
gymnase,
dont les divinits
taient Herms et Hracls. Dans ce
gymnase
se trou-
vaient trois niches voisines : 1 une niche
carre,
conte-
nant la Vnus et surmonte de la ddicace de
Thypo-
gymnasiarque Bakkhios, lequel
avait consacr Herms
et Hracls Texdre
(c'est--dire
la
niche)
et autre
chose
(T<yaX[xa,
la statue de la
Vnus,
restitue M. Fur-
waengler) ;
la mme niche contenait le
fragment
de
signature
du
sculpteur
d'Antioche et deux
herms,
dont l'un
barbu,
l'autre
imberbe;
2
vingt pieds
de
l,
dans une seconde
niche,
tait une statue
d'Herms,
signe d'Antiphane
de Paros
(C.
I. G.
Ins., III,
1242);
3 la troisime niche contenait une statue dont les
pieds
seuls ont t trouvs en
place
: c'tait le
portrait
1.
Chronique
des
Arts,
14 mars
1903, p.
85-87.
2.
Furtwaengler,
Der Fundort der Venus von
Milo,
extrait des
Sitzungsberichte
de l'Acadmie de
Bavire, 1902, IV,
p.
456-461.
3.
Michon,
Revue des tudes
grecques, 1902, p.
24. Il
s'agit
d'une
lettre adresse en 1828 au
grec
Dmtrios
Capuda,
alors
charg
de
la vente d'une statue
signe d'Antiphans,
dcouverte le 3 fvrier
1827 Milo
(Muse
de
Berlin,
n
200), par
le
ngociant
hollandais
Thodore
Xno,
rsidant Milo. Il a fouill
prs
de l'endroit o l'on
a dcouvert la Vnus et
y
a trouv un mur avec deux niches o il
y
-avait des statues
(p. 31).
S. BEINACH 22
338 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
d'un certain
Hagsimns (ibid.,
III, 1090),
vou
par
son
pre
et
par
son frre Herms et Hracls.
M.
Furtwaengler
considre
aujourd'hui que
Thermes-
barbu,
avec
l'inscription
de
Thodoridas,
remonte la
fin du ve sicle
1
et
que
Thermes imberbe
appartient
au
milieu du ive sicle
2
;
l'un et l'autre
seraient,
son
avis,,
plus
anciens
que
la Vnus...
Ces deux
petits
herms,.
simples
offrandes au dieu de la
palestre, appartiennent
l'poque plus
ancienne du
gymnase
de Milo. Plus
tard, quand
les niches furent construites et
pourvues
de
grandes
statues,
au 11e ou au Ier sicle avant
J -C.,.
ils furent
employs
la dcoration de la niche ddie
par
Bakkhios
3
.
Ainsi,
Ton dcouvre ensemble une statue
d'poque
indtermine,
une
inscription
et un herms de
400,.
un herms de 350 et deux
inscriptions
de 150-100 avant
J .-C. M.
Furtwaengler
veut absolument
que
la statue
soit
contemporaine
des dernires
inscriptions,
et,
cet
effet,
il limine
purement
et
simplement
les deux herms.
comme
appartenant
l'poque plus
ancienne du.
gymnase.
On sait
que
Voutier a dessin la Vnus entre deux
herms : Thermes barbu sur la ddicace de
Thodoridas4,.
Thermes imberbe sur la
signature
de l'artiste d'An-
tioche. La thse de M.
Furtwaengler exige que
cette
signature
soit celle de l'auteur de la
Vnus; or,
comme
1. Il se contentait
autrefois,
de dire
qu'il
tait antrieur l'Em-
pire
;
c'est moi
qui
en ai fix la date
(Chronique, 1900, p. 389;:
1901, p.
45
; plus haut, p. 324).
2. Il considrait autrefois les deux herms comme
contemporains ;-.
c'est moi
qui
l'ai
dtromp (ibid.).
3. Cela est
emprunt
la mme
page
de la
Chronique
des Arts de-
1901
(plus haut, p. 331),
o
je signalais
cette
hypothse
comme une
simple possibilit
: Il est
possible que Bakkhios, pour
orner son
exdre,
ait
pris
des termes
plus
anciens et en ait dcor sa cons-
truction,
etc. .
4. Voir
l'expos
de la
question
dans la
Chronique
des Arts
1898,.,
p.
224
(plus haut,
p. 304).
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 339
il est vident
que
la Vnus
groupe
avec Thermes imberbe
forme un ensemble
parfaitement ridicule,
il
faut
que'
M.
Furtwaengler
nie
avec
passion,
contre toute vrai-
semblance,
l'exactitude du seul dessin d'un tmoin
de la
dcouverte,
celui de Voutier. Cet honnte
marin,
ayant
constat
que
Thermes barbu entrait dans le trou
de la base au nom de
Thodoridas,
se serait
imagin (!)
que
Thermes imberbe
s'adaptait
dans le trou de l'autre
bloc avec
inscription.
En
ralit,
il n'en tait rien
;
Thermes imberbe doit tre mis en
pnitence;
le trou
qu'il
a
usurp
donnait
l'hospitalit
un
pilier
carr en
marbre
(dont
on n'a
pas
trouv le moindre
fragment !)
et o devait
s'appuyer
le bras
gauche
de la Vnus 1.
M.
Furtwaengler prend
son
compte
tout ce
que j'ai
dit et
rpt
2
sur
l'impossibilit
de
grouper
la Vnus
avec Thermes imberbe. Au lieu d'en conclure
que,
Ther-
mes imberbe tant
insparable
de la
signature,
la Vnus
n'a rien voir ni avec la
signature,
ni avec
Thermes,
il envoie
promener
Thermes et
garde
la
signature.
Est-
ce l raisonner
sagement
?
L'minent
archologue
n'a
pas
dit un mot de ma
conclusion
pourtant,
ce me
semble,
bien
logique
:
savoir
que
Thermes imberbe et sa base
appartenaient
un
groupe
dtruit du 111e sicle
3
et
que
la Vnus
(Amphitrite)
n'avait rien voir avec ces marbres. Une
fois
que
M.
Furtwaengler
est
oblig
d'admettre
que
la
niche n 1 contenait des
objets
datant du ve au Ier
sicle,
1. M.
Furtwaengler
ne
peut cependant pas ignorer que j'ai
dmon-
tr
l'impossibilit
de cette restitution tendancieuse
(Chronique
des
Arts,
9 fvrier 1901
; plus
haut, p. 332).
2. Par
exemple Chronique
des
Arts, 1898, p.
224
(plus
haut
p. 305).
Il faut bien
que je rappelle
ces
textes,
M.
Furtwaengler tant,
ses
heures,
un trs
capricieux bibliographe.
3. Il est inadmissible
qu'un sculpteur
ait pris la
peine
de
signer
tout au
long
un herms de facture courante.
videmment,
la
signa-
ture tait celle d'un
groupe
dont ceterme ne formait
qu'un
lment .
(Chronique
des
Arts, 1901, p.
45
; plus haut, p.
324).
340
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
pourquoi
veut-il
joindre
tel ou tel d'entre eux la statue
et en carter les autres? C'est
purement
arbitraire.
Quel dommage que
le tribunal de La
Haye
ne
tranche
pas
les
litiges scientifiques
! J e donnerais
volontiers
rendez-vous M.
Furtwaengler
devant des
juges
non
archologues,
mais
prononant d'aprs
les
simples
lumires du bon sens et
d'aprs
les vraisem-
blances. Il
y passerait
un mauvais
quart
d'heure.
En
terminant,
M.
Furtwaengler
revient sur le lieu
de la dcouverte du Posidon 1. Ce
lieu, dit-il,
est
Klima,
qui
est loin du
gymnase
de la ville.
Que signifie,
au
juste,
cet adverbe
loin ? Munich est loin de
Paris,
mais la
Madeleine est-elle loin du Louvre? Entre le
gymnase
et
le
port
de
Milo,
il ne devait
pas y
avoir
beaucoup
de
chemin 2. Dans la niche I du
gymnase,
avec la
Vnus,
on trouve un herms ddi
par
Thodoridas;
Klima,
on trouve une ddicace du mme Thodoridas Posi-
don,
avec une statue de Posidon. Voil le fait
essentiel,
que je
suis heureux d'avoir le
premier
mis en lumire 3.
Si ledit Thodoridas a
ddi,
vers
400,
un
Posidon,
il
a
pu
lui donner comme
pardre
une
Amphitrite,
d'au-
tant
plus qu'on
nous
signale
un
groupe
colossal de Posi-
don et
d'Amphitrite
dans l'le voisine de Tnos et
que
ce
groupe
remontait au moins au ive sicle. Cette
Amphi-
trite a
pu
tre
employe plus
tard la dcoration d'un
gymnase
(M. Furtwaengler
admet maintenant la mme
hypothse pour
les deux
herms),
tandis
que
le Posi-
don,
vol
par quelque Romain,
tait
remplac par
une
mdiocre
copie,
celle
qui
est conserve
aujourd'hui
au muse d'Athnes. Telle
est,
aprs
diverses fluctua-
tions
qui tmoignent
de ma bona
fides, l'hypothse que
1. Voir mon article .
ce
sujet
dans la Revue
archologique,
1902,
II, p.
207 et suiv.
-.2.
Voir
la lettre de M. Lallier dans la
Chronique
des
Arts, 1898,
p.
275
(plus haut,
p. 307).
3.
Chronique
des
Arts, 1897, p.
42
(plus haut, p. 285).
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 341
je
crois la
plus
satisfaisante.
Qu'est-ce que
M. Furt-
waengler peut y opposer?
D'abord,
il
maintient,
contre
moi, que
le Posidon
d'Athnes et la Vnus sont
stylistiquement
et techni-
quement apparents ,
mais
que
le Posidon n'a rien
voir avec la
technique
et le
style
de l'art
imprial
romain
(p. 461).
Toutefois,
la
parent stylistique
est le
seul lien entre la Vnus et le
Posidon
;
cela
prs,
il
n'a rien faire avec la statue
d'Aphrodite
dcouverte
dans un
gymnase
de la ville sous le
patronage
d'Herms
et d'Hracls . Voil des
affirmations,
mais
pas
autre
chose. J 'ai
cru, autrefois, que
le Posidon tait contem-
porain
de Thodoridas
; aujourd'hui, je pense que
c'est
seulement une
copie
romaine de la statue voue
par
Thodoridas avec
TAmphitrite.
En
somme,
c'est l
une
question peu importante.
L'essentiel c'est
que,
de
l'affinit constate
par
moi comme
par
M. Furtwaen-
gler
entre le
type
de
TAmphitrite
et celui du
Posidon,
je
conclus un lien
historique
entre ces deux
figures,
tandis
que
M.
Furtwaengler
conclut seulement
qu'elles
sont
contemporaines,
et
que
le chef-d'oeuvre
(la Vnus)
doit tre
rabaiss,
descendu avec des cbles
jusqu'au
niveau du' colosse de
fabrique
courante
(le Posidon).
A mes
yeux,
la date du
couple
est donne
par
la belle
sculpture;
aux
yeux
de mon
contradicteur,
elle Test
par
la
plus
faible. L'un et l'autre nous
oprons
sur des
vraisemblances.
Mais,
alors
que
M.
Furtwaengler
est
oblig
d'admettre
qu'il y
avait
Milo,
vers 100 avant
J .-C,
un
sculpteur capable
d'excuter une merveille
digne
d'un lve de
Phidias,
ce
qui
est
plus
que
tm-
raire,
je
suis contraint la
simple hypothse qu'une
statue de
Posidon,
ddie vers 400
par
Thodoridas,
dont la ddicace de cette
poque
subsiste,
a t
remplace
par
une
copie
mdiocre
l'poque
romaine. De ce der-
nier fait il
y
a de trs nombreux
exemples,
alors
que
M.
Furtwaengler
doit
supposer
une sorte de
miracle,
342 DOCUMENTS SUR LA VNUS
DE MILO
c'est--dire,
suivant la dfinition de
Renan,
une chose
qui
ne se serait
produite qu'une
seule
fois.
Parmi les
statues du Ier sicle avant
J .-C,
copies
excellentes de belles oeuvres
grecques
du ve et du
ive
sicles, qu'Edhem-Bey
a rcemment exhumes
Tralles 1,
il
y
a une
figure
demi-nue,
sans
tte,
dont le
torse est model avec une
largeur qui rappelle
la Vnus
de Milo. J e
signale
cette
sculpture
M.
Furtwaengler,
comme une arme dont il
pourrait
se servir contre moi.
Mais il
y
a
pourtant
entre la statue de Tralles et
celle de Milo l'intervalle
qui spare
une
copie
d'un
original.
On
peut
dmontrer
que
toutes les statues de
Tralles sont des
copies
; donc,
il
existait,
au ive ou
au ve
sicle,
un
original analogue
la Vnus de Milo.
A la
rflexion,
cette dcouverte de
Tralles,
qui
m'avait
troubl
d'abord,
apporte
une confirmation la manire
de voir
que je soutiens,
sine ira nec
studio,
avec
l'esp-
rance de convaincre un
jour
mon minent ami et
contradicteur.
XI
La dcouverte de la Vnus de Milo
(Mmoire
indit de Tarral
2)
Il
y
a
juste quarante-quatre
ans
que
le hasard fit dcouvrir
l'adorable Vnus de
Milo,
la
perle
du Muse du Louvre. Malheu-
1.
[S. Reinach,
Monuments
nouveaux,
t.
I, p. 354.]
2. Revue
archologique 1906, I, p.
193-202.
Extrait des
papiers
de Tarral
qui
font
partie
de ceuxd'O.
Rayet.
Claudius
Tarral,
mde-
cin
anglais
tabli Paris sous le second
Empire,
avait vou un vri-
table culte la Vnus de Milo. Il en excuta une restauration
petite
chelle
qui
a t
publie par
Goeler von
Ravensburg
et
par
moi.
Cette
restauration,
mon
avis,
ne vaut rien et ne
prouve pas que
Tarral et un sentiment bien dlicat de l'art
antique. Pourtant,
comme il a fait effort
pour
dbrouiller les
problmes que
soulve la
clbre statue et
qu'il
est mort sans avoir
publi
le
grand ouvrage
qu'il prparait
ce
sujet,
il me semble utile
d'imprimer
le brouillon
d'un
mmoire sur la Vnus
qu'il
avait
l'intention,
en
1864,
de com-
DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO 343
reusement,
ce court
espace
de
temps
a vu
disparatre
les
princi-
paux personnages qui
ont
jou
un certain rle dans cette
splen-
dide
conqute
sur
l'antiquit.
Le
jeune enseigne
de
vaisseau,
Dumont
d'Urville, qui,
le
premier,
fut
frapp
de la beaut de ce
prcieux
marbre,
qui
le dessina et le dcrivit avec tant d'intel-
ligence,
a trouv une mort affreuse sur un chemin de fer. Fau-
vel,
le dernier dbris de
l'expdition Choiseul,
l'illustre savant
Quatremre
de
Quincy,
le studieux
Clarac,
Forbin
J anson,
le
marquis
de
Rivire,
merie
David,
ne sont
plus. Marcellus, qui
eut
l'insigne
honneur de recevoir la Vnus et de la
transporter
en
France,
est mort
rcemment, jeune
encore. Ainsi nous sommes
rduits
puiser presque
tous nos
renseignements
dans les crits
qu'ils
ont
lgus
la
postrit.
M.
Brest, l'agent
consulaire de
France
Milo,
qui dploya
une si louable activit dans
l'acqui-
sition de ce
chef-d'oeuvre,
est encore
parmi
nous
;
mais il est
plus
qu'octognaire
;
sa
mmoire, je
le
crains,
n'est
plus
trs fidle
;
il se croit victime
d'injustes procds
de la
part
de ses
sup-
rieurs et des historiens
;
notre ravissante
desse,
loin d'tre un
souvenir de
jouissance,
est
pour
lui un
sujet
d'une amertume
extrme
;
il faut
pourtant plaindre
ce vnrable vieillard si ses
griefs
sont
fonds, et,
dans ce
cas,
il serait encore
temps
d'adou-
muniquer
l'Acadmie des
Inscriptions.
J e
corrige
un
peu
le
style,
qui
est souvent d'une barbarie
rebutante,
et
je
donne la suite
quelques
indications
complmentaires.
M.
Froehner, interrog par
M. le commandant
Esprandieu,
a bien
voulu lui
donner,
sur
Tarral,
les
renseignements que
voici :
Tarral
tait le mdecin de lord Hertford
;
il fut
plus
tard celui de Richard
Wallace,
fils de ce lord. Il avait une
jolie
fortune et habitait un
petit
htel au Cours-la-Reine. C'tait un homme aimable
;
et trs bavard.
Il
croyait
avoir des connaissances
techniques,
surtout
minralogiques,
qui
le
qualifiaient pour
tudier la
sculpture antique.
C'tait un
dilettante. Il ne
s'occupait que
des
questions
les
plus difficiles,
sans
aucune
prparation.
Comme un
archologue
bien connu de notre
temps,
il avait le don de reconnatre la main d'un mme artiste dans
les oeuvres les
plus disparates.
Il
croyait que
le vase
Borghse
tait
de la mme main
que
les
Forges
de
Vulcain, qui
sont de la Renais-
sance. Mes relations avec lui taient trs cordiales. Il tait
reu
dans
tous les salons de
Paris, djeunait
tous les dimanches chez R. Wal-
lace
;
il a fait des
dmarches, aprs 1870, pour
me faire nommer
conservateur de la collection Wallace. Son intrieur n'tait
pas
heu-
reux. Sa femme
une
Italienne, je
crois
avait
perdu
la vue
et tait
sujette
des accs de folie
;
il vivait avec elle et une nice.
Bien
qu'Anglais
de
naissance,
Tarral
parlait
le
franais
correctement
et
presque
sans accent.
344 DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO
cir le
chagrin
de ses derniers
jours par
un
prompt
retour la
justice.
M. Beul
professe publiquement que
la France doit la
possession
de la Vnus de Milo M. Brest
;
cette
apprciation
mrite un examen
approfondi.
J 'ai sous les
yeux
un
rapport
indit,
trs
dtaill,
crit il
y
a deux ans
par
M.
Brest,
dans
lequel
il affirme avoir achet
pour
la
France,
vers la fin de
1819,
l'immortelle
Vnus,
d'un
paysan grec,
Thodore
Kendrotas, pour
la somme de 600
piastres, plus
un habillement de 18
piastres,
en tout 618
piastres, quivalant
alors autant de francs.
M. Brest la fit
transporter
tout de suite chez lui et la conserva
malgr
les menaces du
prince
Mourousi
; plus tard,
le torse est
vol et
plac
bord d'un btiment
raya
;
M.
Brest,
aid du lieu-
tenant
Berranger
et de douze hommes de
l'quipage
de la
go-
lette
Estafette,
le
reprend
de vive force
;
c'est encore M. Brest
qui
a d
payer
l'amende de 6.000
piastres impose
aux
primats
de l'le de Milo
par
le
despote Mourousi,
M. Brest les
ayant garan-
tis contre ses
vengeances ;
dix ans
aprs seulement,
M. Brest
est rembours de cette
somme,
mais alors la diffrence dans le
change
de
l'argent
lui est trs dfavorable et il subit une
perte
de 5.000 francs
;
cette
perte,
ainsi
que
d'autres
frais,
ne lui a
jamais
t rembourse. M. Brest affirme encore
que
M. de Beau-
repaire, charg
d'affaires
Constantinople, pendant
l'absence
du
marquis
de
Rivire,
a
su, par supercherie,
retirer de ses
mains toutes les
correspondances,
toutes les
quittances qui
cons-
tataient la vracit de ses assertions.
Voil, certes,
de
graves
accusations contre des morts
;
il faut les
accepter
avec
rserve,
car il se
peut que
la mmoire de M. Brest
l'gar
son insu.
Voici
quelques
motifs
pour
faire douter de l'exactitude de ses
rcits.
D'abord,
M. Brest n'a
jamais
rclam
publiquement
contre tant
d'iniquits.
Il soutient avoir achet la Vnus vers la
fin de 1819
;
peine dgage
et enleve de sa
niche,
il la fit
transfrer chez
lui; or,
cette dernire affirmation est rfute
par
Dumont d'Urville
qui,
au moins
quatre
mois
aprs (19
avril
1820),
vit la
partie suprieure
de la Vnus dans une table du
paysan grec
et trouva la
partie
infrieure de la statue encore dans
sa niche. M. Brest
prtend
aussi
qu'on
n'a
pas
trouv de bras
et
cependant
Dumont d'Urville a vu deux bras et une main
tenant une
pomme, qui
ont t livrs M. de Marcellus avec la
Vnus et d'autres
fragments.
M. Brest ne
parle que
de deux
Herms dcouverts avec Vnus
;
il
y
en avait trois. En voil assez
pour prouver que
M. Brest se
trompe
dans certains dtails histo-
riques ;
il
peut
avoir raison dans d'autres
;
c'est la chancellerie
de France de contrler ses
allgations
et s'il
y
a
lieu,
de lui faire
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
345
amende
honorable,
car il serait honteux
pour
la France
qu'une
pareille ingratitude pt
tre attache la
possession
d'un
monument d'une
gloire imprissable.
Voici un
petit abrg
de la dcouverte de la Vnus
;
il est bien
fcheux
que
les circonstances
qui s'y
rattachent aient t si
imparfaitement dcrites,
car
beaucoup
de
questions
archolo-
giques
de haut intrt
prsentent
une
perplexit
extrme. La
premire description
du
joyau
du Louvre est du
jeune
Dumont
d'Urville
;
elle est encore la meilleure. Sans tre un archo-
logue,
son instinct d'observation a donn une
leon
aux anti-
quaires ;
son
rapport remarquable
est
peu
connu
;
il mrite une
srieuse attention
et,
comme il confirme ma
restauration, je
cite-
rai les
passages
les
plus importants.
Le 19 avril
1820,
dit
Dumont d'Urville
(Annales maritimes,
par Bajot, 1821, p. 150),
j'allai
visiter
quelques
morceaux
d'antiquits
dcouverts
Milo
peu
de
jours
avant notre arrive. Trois semaines environ
avant notre arrive
Milo,
un
paysan grec,
bchant son
champ
renferm dans cette
enceinte,
site de
l'antique Mlos,
rencontra
quelques pierres
de taille
;
comme ces
pierres, employes par
les habitants dans la construction de leurs
maisons,
ont une
certaine
valeur,
cette considration
l'engagea
creuser
plus
avant,
et il
parvint
ainsi
dblayer
une
espce
de niche
dans
laquelle
il trouva une statue en
marbre,
deux herms
et
quelques
autres morceaux
galement
en marbre. La
statue tait de deux
pices, jointes
au
moyen
de deux
forts tenons en fer. Le
paysan, craignant
de
perdre
le fruit de
ses
travaux,
en avait fait
porter
et
dposer
dans une table la
partie suprieure,
avec les deux herms
;
l'autre tait encore
dans la niche. J 'ai visit le tout
attentivement,
et ces divers
morceaux me
parurent
d'un bon
got,
autant
cependant que
mes
faibles connaissances dans les arts me
permirent
d'en
juger.
La
statue,
dont
je
mesurai les deux
parties sparment, avait,
trs
peu
de chose
prs,
six
pieds
de haut
;
elle
reprsentait
une
femme
nue,
dont la main
gauche
releve tenait une
pomme,
et
la droite soutenait une ceinture habilement
drape
et tombant
ngligemment
des reins
jusqu'aux pieds ;
du
reste,
elles ont t
l'une et l'autre mutiles et sont actuellement dtaches du
corps.
Le seul
pied qui
reste est nu
;
les oreilles ont t
perces
et ont
d recevoir des
pendants.
Tous ces attributs sembleraient
assez convenir la Vnus du
J ugement
de Paris
;
mais o seraient
alors
J unon,
Minerve et le beau
berger?
Il est vrai
qu'on
avait
trouv en mme
temps
un
pied
chauss d'un cothurne et une
troisime main
;
d'un autre
ct,
le nom de
l'le, Mlos,
a le
346 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
plus grand rapport
avec le mot
melon, qui signifie pomme.
Ce
rapprochement
de mots ne serait-il
pas indiqu par
l'attribut
principal
de la statue ?
Les deux herms
qui l'accompagnaient
dans sa niche n'ont
rien de
remarquable
;
l'un est surmont d'une tte de femme ou
d'enfant,
et l'autre
porte
une
figure
de vieillard avec une
longue
barbe. L'entre de la niche tait surmonte d'un marbre de
4
pieds
et demi de
longueur
sur 6 8
pouces
de
largeur.
Il
portait
une
inscription
dont la
premire
moiti seule a t res-
pecte par
le
temps
;
l'autre est entirement efface. Cette
perte
est
inapprciable
:
peut-tre
eussions-nous
acquis par
l
quelques
lumires sur l'histoire de cette le
que
tout
prouve
avoir
t
jadis
trs florissante et dont le sort nous est
compltement
inconnu
depuis
l'invasion des
Athniens,
c'est--dire
depuis plus
de 22 sicles. Au moins eussions-nous
appris
quelle
occasion
et
par qui
ces statues avaient t consacres. J 'ai
copi
cette
inscription.
Le
pidestal
d'un des herms a d
porter
aussi une
inscription,
mais les caractres en sont tellement
dgrads
qu'il
m'a t
impossible
de les dchiffrer. Lors de notre
pas-
sage
Constantinople,
M. l'ambassadeur
m'ayant questionn
sur cette
statue, je
lui dis ce
que j'en pensais,
et
je
remis M. de
Marcellus la
copie
de la notice
qu'on
vient de lire. A mon
retour,
M. de Rivire
m'apprit qu'il
en avait fait
l'acquisition pour
le Musum. J 'ai su
depuis que
M. de Marcellus arriva Milo
au moment mme o la statue allait tre
embarque pour
une
autre
destination
; mais, aprs
divers
obstacles,
cet ami des
arts
parvint
enfin conserver la France ce
prcieux
reste
d'antiquit.
Ainsi donc le
jeune
naturaliste Dumont d'Urville a vu de ses
propres yeux
la moiti infrieure de la Vnus dans sa niche
;
il dit
que
la moiti
suprieure
tait runie l'infrieure
par
deux
forts tenons en fer
;
cela ferait croire
que
le
paysan grec
les
aurait
enlevs, que
la Vnus tait
entire,
et debout comme le
dit M. Brest
;
mais d'autres
tmoignages
affirment
que
la Vnus
a t trouve en deux morceaux
spars ;
les
coups
visibles de
bche dans le torse rendent cette dernire version vraisemblable.
Dumont d'Urville est trs
explicite
sur les deux
mains,
la
gauche
tenant la
pomme,
la droite soutenant la ceinture
;
il
se
trompe
sur la
dsignation
d'un
herms,
notre
petit
Mercure,
qu'il prend pour
une femme ou
pour
un
enfant,
ce
qui
atteste
peu
de science de
l'antiquit ;
il n'a
pu
dchiffrer
l'inscription
sur le socle de cet
herms,
ce
qui tmoigne
de son
peu
d'habitude
des recherches
pigraphiques.
La
copie qu'il
fit de
l'inscription
DOCUMENTS SUR LA VNUS
DE MILO 347
sur le marbre
plac
au-dessus de la niche est devenue trs
impor-
tante,
comme nous le dmontrerons
plus
bas. Il me semble
que
Dumont d'Urville a eu une trs
grande part
dans cette
acqui-
sition
;
M. Brest n'a aucune autorit dans les arts
;
son
opinion
ne
pouvait
influencer l'ambassadeur
Constantinople ;
mais
l'opinion
claire de Dumont d'Urville contribua
puissamment
sauver cet
unique
monument en faveur
de la France.
M. de Marcellus nous a
laiss,
sur la fouille de
Milo, quelques
dtails
qui paraissent exacts, quoiqu'ils
contredisent M. Brest :
Un Grec nomm
Yorgos, occup
bcher son
champ
vers la fin
de fvrier
1820,
dcouvrit une sorte de niche
oblongue,
btie
dans le roc
;
il
parvint
dblayer
cette
petite
construction,
ainsi
qu'une
cave troite enfonce de
cinq
ou six
pieds
au-des-
sous du niveau du sol actuel. Il
y
trouva
ple-mle
et confu-
sment couchs le buste de la statue
qu'il transporta
aussitt
dans son
table,
trois
herms, quelques
socles et d'autres dbris
de marbre
;
deux semaines
aprs,
en continuant ses
recherches,
il dcouvrit la
partie
infrieure de cette mme statue et
quelques
fragments
de
sculpture antique.
Voici maintenant la
descrip-
tion de la Vnus faite de visu
par
M. de Marcellus : La statue se
composait
de deux blocs unis entre eux
par
un tenon de fer
qui.
n' a
pas
t retrouv
;
la
draperie replie
sur le flanc
gauche
cachait la
ligne
o s'unissaient les deux marbres. La chevelure tout entire
tait dtache
(il
faut entendre
par
cette
expression
le
chignon
seulement),
mais assez bien conserve et d'une
grande lgance.
J e fis successivement taler sur le
pont
de la
golette
Y
Estafette
les trois herms et les
fragments antiques qui
tous m'avaient t
livrs . Dans une
note,
M. de Marcellus
ajoute
: Sur un marbre
de 4
pieds
et demi de
longueur
et de 8
pouces
de
largeur,
taient
des lettres
qui
ont
paru
ne se
rapporter
en rien la statue
;
cette
inscription,
en
partie efface,
est reste Milo .
Quelle incroyable
stupidit!
Et
pourtant l'intelligent
Dumont d'Urville l'avait
juge
trs
importante
et en
dplorait
la
dgradation
! M. de Mar-
cellus observe : Des volumes de dissertations laudatives sur la
Vnus virent le
jour ;
on
remarque parmi
ces crits les
pages
pleines
de
got
et de science de
Quatremre
de
Quincy,
de
Clarac et de Saint-Victor.
Quelques
dessins des
poses qu'on
cherchait retrouver avaient t soumis au Roi
;
on avait mme
tent
d'ajuster
aux
paules
de la statue deux bras et une main
tenant une
pomme, que j'avais galement rapports;
mais il
tait facile de reconnatre
que
ces bras informes n'avaient
pu
appartenir
la Vnus
que
dans un
premier
et
grossier
essai de
restauration attribu aux chrtiens du vme sicle. Il fut dmon-
348 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
tr
[par qui?] que
la statue
charge
de
vtements,
de
colliers
d'or et de
pendants
d'oreille avait
reprsent
la
Panagia (sainte
Vierge)
dans la
petite glise grecque
dont
j'avais
vu les ruines
a Milo . Voil bien des absurdits
;
la
diplomatie
ne donne
pas
du
jugement
l'archologue improvis.
J 'ai cit ses
paroles pour
prouver que
M. de Marcellus a rellement
rapport
en France
deux
fragments
de bras avec une main tenant une
pomme,
bras
et main
parfaitement
dcrits
par
Dumont d'Urville. Comment se
fait-il
que
Clarac
ignorait
ce fait et
qu'il
crit les
lignes
sui-
vantes : On
croyait que
le bras
gauche manquait
en
entier;
mais en
passant
Milo,
pour
s'assurer
par
lui-mme de tout ce
qui
avait
rapport
sa
statue,
le
marquis
de Rivire fit faire de
nouvelles excavations et Ton a heureusement trouv les
frag-
ments d'un bras et d'une
main, qu'
la
qualit
du
marbre,
au
travail,
on
peut
croire avoir
appartenu
notre
Vnus,
et Ton
voit
par
les trous du tenon et
par
l'arrachement
que
le bras
y
avait t fix . Ce bras et la main
gauche
sont-ils les mmes
qu'a
cits et
rapports
M. de Marcellus? En lisant M. de Marcellus
et en
regardant
la
gravure
de la Vnus o le
fragment
de bras
est
figur,
on est
dispos
taxer Clarac de confusion
; cependant,
dans le
rapport
indit de M.
Brest,
je
lis
qu'il
fut
charg
en effet
de faire de nouvelles fouilles Milo
par
M. de Rivire et
qu'on
dcouvrit alors deux bras
que
M. Brest crut avoir
appartenu
la Vnus. Le bras droit en trois morceaux dont les
doigts
de la
main ferme tenaient une
pomme,
et le
gauche
en deux mor-
ceaux
ayant
les trois
doigts
ferms et le
pouce
et l'index
joints,
paraissaient
tenir
quelque
chose . M. Brest affirme avoir
envoy
ces
fragments
Toulon l'adresse de M. Bedfort.
M.
Brest,
dans son
rapport indit,
affirme
que
la Vnus
n'avait
point
de bras : la
partie suprieure
de la niche
ayant
croul les aura
peut-tre
casss et fit
aussi une
lgre grati-
gnure
au nez de la statue .
Il
y
a bien des contradictions entre ces historiens. M. Brest
prtend que
la Vnus n'avait
point
de
bras,
mais M. Dumont
d'Urville les a vus et dit
que
la main
gauche
tenait la
pomme ;
M. de Marcellus
reut
ces
fragments
des mains de M. Brest et
les
rapporta
en France. Clarac
parle
d'une main
gauche
avec la
pomme,
M. Brest d'une main droite
; mais,
la
rigueur,
M. Brest a
pu
trs bien se
tromper
cet
gard ;
dans ce
cas,
on aurait dterr Milo deux
fragments
de
Vnus la
pomme.
Le muse du Louvre ne
possde aujour-
d'hui
qu'un fragment
du bras et de la main
gauche que j'ai
fait mouler et
qui appartiennent
incontestablement notre
DOCUMENTS SUR LA VNUS
DE MILO 349
statue
; je
crois ces deux
fragments
les mmes
que
ceux vus et
dcrits
par
Dumont d'Urville et
rapports
en France
par
M. de Marcellus. Clarac ne
parle que
d'un seul bras retrouv dans
la seconde excavation de Milo
;
M. Brest affirme en avoir dterr
deux. M. de
Sartiges,
ambassadeur
Rome,
visita il
y
a
quelques
annes Milo et il m'assure
que
M. Brest lui a
parl
des deux bras
qu'il
envoya
en France
;
Tanne
passe,
M.
Gobineau,
archo-
logue
trs
instruit, quoique diplomate
trs
habile,
de retour de
sa mission en
Perse,
rencontra
Constantinople
M.
Brest, qui
lui ritra les mmes assurances au
sujet
des deux bras. Ce
qui
est
positif
est
que
la Vnus en
plusieurs
morceaux,
des
fragments
de bras droit et
gauche,
et d'une main
gauche
tenant une
pomme,
de trois
herms,
d'un socle avec
inscription grecque,
d'un
frag-
ment de la
plinthe,
ont franchi les seuils du Louvre.
Ici,
nous
avons constater un fait
dplorable, inexplicable
: le Muse
ne
possde plus aujourd'hui
ni le bras
droit,
ni le
fragment
de la
plinthe,
ni le socle de Thermes Mercure orn d'une
inscription
grecque
d'une
grande importance.
M. de
Longprier
a fait de
minutieuses recherches
pour
les retrouver
;
il a fouill mme le
sol des caves
; peine inutile,
ces
fragments
sont
perdus
tout
jamais.
Dans les
arts,
comme dans la
politique,
la
passion
du
parti pris,
la
vanit, Tamour-propre
du
savant, l'ignorance
jouent
un
grand
rle. Les Grecs et les Romains avaient bien
raison de faire
rpondre
sur la vie des
gardiens
de la conserva-
tion de leurs trsors
artistiques.
Sous le
rgne
de Louis-Phi-
lippe,
un homme trs influent au muse du Louvre
proposa
au
Roi de lui faire de
superbes
dessus de tables avec les vnrables
monuments
gyptiens
; l'art,
disait ce savant
architecte,
n'y
perdrait rien,
le mobilier de la couronne
y gagnerait beaucoup.
J 'ai entendu un
peintre
trs en
vogue,
beau
parleur,
dclarer
que
s'il tait le directeur du
Louvre,
il mettrait tous ces vilains
gyptiens
la
porte.
Comment
expliquer
la
perte mystrieuse
de ces
fragments
de la Vnus? On soutenait
qu'ils
ne
pouvaient
avoir
appartenu
la statue de la
Vnus, que
c'taient des
restaurations, par consquent
des morceaux de marbre sans
intrt.
Clarac,
il est
vrai, regardait l'inscription
comme
importante ;
mais elle
gnait
sa conviction
que
la Vnus tait l'oeuvre de
Praxitle. Tout cela
exposait
ces
fragments
la destruction
;
toujours
est-il
que
leur
perte
sera une honte ternelle
pour
l'administration du Louvre
,
car la
plus grave
mutilation de la
Vnus s'est
accomplie
dans ce sanctuaire des arts !
Il
y
a
quarante-trois ans,
votre illustre secrtaire
perptuel,
350 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
Quatremre
de
Quincy,
est venu
rendre,
dans cette
enceinte,
un
hommage
clatant l'adorable Vnus de Milo
;
sa
parole
savante et
lgante produisit
une
profonde sensation, car,
alors comme
aujourd'hui,
la Vnus tait le
sujet
de la conversa-
tion de tous les
salons,
la
proccupation
de tous les artistes. Son
affreuse mutilation excitait
l'imagination
des
antiquaires ;
on se demandait
quelle tait,
avant sa
profanation,
l'attitude
de cette fire desse. Chacun disait tout bas son ide.
Qui
mieux
que
l'auteur du
J upiter Olympien
pouvait prtendre jeter
la lumire sur une
question
si difficile rsoudre?
Quatremre
expliqua,
avec sa science et sa clart
habituelles, que
la noble
figure reprsentait jadis
une Vnus victorieuse
groupe
ou en
colloque
avec Paris ou
Mars, qu'elle
tait l'oeuvre de Praxitle
ou de son cole.
Malgr
l'immense autorit de
Quatremre,
il
ne russit
pas
convaincre tout le
monde;
Clarac combattit
l'ide d'un
groupe
tel
que Quatremre
l'entendait
;
il
croyait
la
statue
isole,
mais en
rapport
avec d'autres
figures, qui pou-
vaient tre Paris et les deux
desses, auxquelles
avec fiert et
ddain elle montrait la
pomme, trophe
de sa victoire. La convic-
tion de Clarac fut de courte dure. Le savant
Millingen
trouva une
mdaille de Corinthe
frappe
sous
Septime Svre,
o une
figure
de femme
mi-drape
tient un bouclier dans ses mains et dans
lequel
elle semble se mirer
;
l'aide de cette
indication,
Millin-
gen
restaura la Vnus de
Capoue qui
a tant de
rapport
avec
notre fameux marbre
;
mais il oublia
que
la base de la statue de
Capoue portait jadis
deux
petits pieds
de
Cupidon ;
c'est
gal,
le
pauvre
Clarac est sduit
par Millingen,
la Vnus de Milo
dut aussi se mirer dans un bouclier
;
adieu la
pomme,
adieu sa
fiert et adieu le ddain de la victorieuse desse! meric David
soutenait
que
la Vnus n'a
jamais
fait
partie
d'un
groupe,
il
y voyait
une vritable statue : Elle ne
reprsente point
Vnus,
mais
plutt
la
nymphe
Mlos,
c'est--dire l'le de Mlos
person-
nifie
. M. Paillot de Montabert la dclare
plutt
une Muse.
Est-ce
plutt
la courtisane
Glycre d'Argos, joueuse
d'instru-
ments,
statue excute
par
cet Hrodote
d'Olynthe qui
travailla
en socit avec Praxitle la statue de
Phryn
? Ne
suppose-t-on
pas
naturellement la
lyre qu'elle
tenait de la main
gauche
et
que
l'autre main tait
prte
faire rsonner ?
Qui
osera dcider ces
questions?
M. P. de Montabert dclare seulement
que
notre
prcieuse
Vnus n'est
qu'une copie qu'aurait
renie Hrodote
d'Olynthe.
Enfin,
d'autres savants de la
trempe
de Montabert
prtendent que
la Vnus tait dans l'acte de tirer
Tare,
de se
coiffer,
de se mirer dans un
miroir,
en Muse crivant l'histoire
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 351
sur une norme tablette
qui
cacherait ncessairement sa
superbe
poitrine
1.
Enfin,
l'illustre historien
national,
M.
Thiers, pense
que
la Vnus est une Victoire sonnant la
trompette
;
il m'a
mme montr le
point
d'attache de la
trompette
au
genou;
c'est encore l un
petit pch
de ce
grand
admirateur des
arts...*
(Le
reste
manque.)
Cl. TARBAL.
Xll
Notes
complmentaires
sur la statue dite Vnus de Milo 3
Il est trs difficile d'tre au courant de ce
qui
concerne
la Vnus de Milo et il ne servirait de rien de donner
ici la
bibliographie
des nombreux articles et
chapitres
d'ouvrages qu'on
a
consacrs,
dans ces dernires
annes,,
cette statue. J e
profite
de l'occasion
que
me fournit la
publication qui prcde pour
dresser un tableau mtho-
dique, accompagn
de
rfrences,
des faits et des
hypo-
thses
qu'on
a fait valoir ce
sujet
supposant
connu
du lecteur ce
que
M.
Collignon
a crit sur la Vnus de
Milo dans le tome II de son Histoire de la
sculpture
grecque.
I.
Tmoignages
sur la dcouverte de la statue.
Topographie
de
Milo,
le lieu-dit Klima
(Chronique
des
arts, 1898, p.
275
;.
1903, p. 86).
phmrides
de la
dcouverte,
mouvements de
l'escadrille
franaise
(ibid., 1897, p. 16).
Les deux relations de
Dumont d'Urville
(Aicard,
La Vnus de
Milo, 1874, p.
173-
184
; Chronique, 1897, p. 25).
Lettre de
Dauriac,
11 avril!
1820
(Chronique, 1897, p. 17).
Lettre de Brest
David,
1. On
peut voir,
chez les
pltriers
de
Paris,
la Vnus restaure en
Muse,
crivant l'histoire sur une norme tablette
qui
cache la
plus.
belle
partie
de son
corps (Note
de
Tarral).
2. Cf. Rev.
archol., 1905, I, p.
132
(Thiers
et la Vnus de
Milo).
3.
[Rev. archol., 1906, I, p. 192-200].
352 DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO
12 avril 1820
(ibid.).
Lettre de David
Rivire,
25 avril
1820
(ibid.). Que
Dumont-d'Urville
copiait
malles
inscriptions
(Rev. arch., 1896, I, p. 122).
Relation de Forbin
(Chronique,
1900, p. 388) ;
de Marcellus
(ibid.) ;
lettre d'Edouard de Marcellus
(Aicard, op.
L, p. 199-200).
Rsum de la relation de Voutier
(Chronique,
1897,
p. 16).
Croquis
de Voutier
(Ravaisson,
La Vnus de
Milo, 1892,
pi.
II
;
cf.
Chronique,
1897, p. 16).
M.
Furtwaengler
nie
tort l'autorit du dessin de Voutier
reprsentant
Thermes
imberbe sur la base
signe (Chronique,
1903,
p. 86).
Relation de Matterer
(Aicard, op. /., p. 143-159).
Relation
de
Trogoff (Chronique, 1897, p. 16).
Rapport
de Brest Bou-
re
(ibid., 1897, p. 73-84).
Faux
tmoignages
de Brest
rpts
par Fouqu, Morey,
Doussault
(ibid., 1897, p. 72).
Faux
tmoignages
de Brest fils
rpts par
J ules
Ferry (Aicard, op.
L, p.
188-195
; Chronique,
1897,
p. 73).
Tmoignage (de
Xeno?)
sur les niches o taient
places
la Vnus et deux autres
-statues
(Rev.
des tudes
grecques, 1902, p. 24).
Pourquoi
Brest et Dumont d'Urville ont
pens
au
J ugement
de Paris
(Chronique, 1900, p. 389).
IL
Transport
de la Vnus et installation au Louvre.
Le dos-
sier de la Vnus retrouv au Louvre en 1901
(Rev.
des tudes
grecques, 1902, p. 11-31).
Arrive de la statue Toulon et
expdition
au Louvre
(ibid., 1900, p.
302-370
; Chronique, 1900,
p. 388).
Placement de la Vnus au Louvre
(Rev.
des tudes
grecques,
1902,
p.
13
; Chronique, 1900, p. 389)
III. Paiement aux
primats
de Milo.
Revue des tudes
grecques,
1902, p.
17
; Chronique, 1900, p.
390.
IV.
Disparition
de deux des
inscriptions rapportes
avec la
Vnus.
Lettre de
Longprier
Friederichs
(Bausteine, 1868,
t.
I, p. 334),
diffamant
(d'aprs
des
propos
de
Tarral),
les conservateurs ou les architectes du Louvre
(Loewy,
Inschriften griech. Bildhauer, p.
214
;
Furtwaengler,
Meister-
werke,
p.
603
;
Revue des tudes
grecques, 1900, p. 336).
Hypo-
thse suivant
laquelle
la
signature
du
sculpteur
d'Antioche tait
celle d'un
groupe perdu auquel appartenait
Thermes imberbe
(Chronique, 1901, p. 45).
Restitution de la ddicace de la
niche o se trouvait la Vnus
(ibid., 1901, p. 44).
V. Restaurations.
Hypothse
d'une restauration
antique
(Chronique, 1900, p. 389).
La Vnus serait une
Amphitrite,
-tomme celle du
sculpteur
Tlsias
que
Philochore
signale
dans
l'le de Tnos
(Chronique, 1898, p.
226
; 1900, p. 390).
Restaurations
graphiques
de
Millingen (Gazette
des Beaux-
DOCUMENTS SUR LA VENUS DE MILO 353
Arts, 1891, I, p. 376);
de Tarral
(ibid., p. 377);
de Hasse
(ibid.,
p. 381);
de Veit Valentin
(ibid., p. 385);
de Zur Strassen
(ibid.,
p. 389)
;
de Bell
(ibid., 1896, II, p. 331) ;
de
Furtwaengler (ibid.,
1896, II,
p. 332)
;
de G. Saloman
(ibid., 1896, II, p. 333) ;
de
Ravaisson
(Rev.
archol., 1890, pi. XV).
Il
y
a une restauration
en
marbre, grandeur
de I
original,
dans le
jardin royal
de
Stuttgart (fig. 63), conforme,
dans
l'ensemble,
un
petit
modle en
pltre
qui figure
dans la maison de Goethe Weimar.
La restauration de
Stuttgart,
oeuvre du
Hof-
bildhauer
Hofer,
a t
place
dans le
jardin
royal
en 1854.
VI. La
question
des herms et de la base de
Thodoridas
fils
de Lastratos.
L'herms
barbu sur une base avec
ddicace de Tho-
doridas
(Chronique, 1897, p. 26).
Cette
base est retrouve
par
M. Michon au Louvre
(Comptes
rendus de
l'Acad.,15 septembre
1900)
et
publie
avec Thermes
replac
sur elle
(Revue
des tudes
grecques, 1900, p. 339).
L'her-
ms imberbe a t vu
par
Voutier sur la base
avec la
signature
d'Agesandros (Chronique,
1897, p. 26).
VII. Dcouvertes d'autres statues Milo.
Acquisitions
de statues
par
Forbin en 1817
(Chronique, 1900, p. 389).
Fouilles de Rot-
tiers en 1825
(Rev.
des tudes
grecques. 1902,
p.
27).
Statue
signe d'Antiphane,
dcou-
verte en
1827,
tout
auprs
de
l'emplacement
de la Vnus
(ibid., 1902, p. 22-24).
Dcou-
verte du Posidon et d'autres statues en 1878
(Chronique, 1897, p. 43).
Relation de
lissot sur ces trouvailles
(ibid., 1901, p. 139).
La statue
questre (Rev. archol., 1902, II, p. 207).
Le
Posidon,
la statue
questre
et d'autres statues auraient
orn une
place publique (ibid., 1902, II, p. 219).
La statue
d'homme
drap, place
sur une base avec ddicace de Tho-
doridas
(Chronique, 1897, p. 42).
Relations
supposes
de
Thodoridas avec la Vnus
(ibid., 1898,
p. 224).
La base
de Thodoridas serait celle d'un
Posidon,
enlev
l'poque
romaine et
remplac par
la
copie
dcouverte en 1878
(Rev.
archol, 1902, II, p.
221
;
Chronique, 1903, p. 86-87).
Asso-
ciation
suppose
de Posidon et
d'Amphitrite (Chronique,
1898,
S. liEINACB 23
FIG. 63.
Restau-
ration delaVnus
deMiloenmarbre
(grandeur
natu-
relle) par
le
sculp-
teur Hofer
(1854).
J ardins
royaux
de
Stuttgart
(Wurtemberg).
354 DOCUMENTS SUR LA VNUS
DE MILO
p. 226).
Que
le motif de la
draperie"du
Posidon remonte au
ive sicle
(Rev. arch., 1905, I, p. 39).
Que
le motif de la
drape-
rie de la Vnus remonte au ive sicle
(Chronique,
1903, p. 87).
*
J e n'ai
jamais
cess de
relater,
dans la Revue
archologique,
les
hypothses nouvelles,
ou le renouvellement
d'anciennes
erreurs,
dont
la clbre statue du Louvre a t
l'objet.
Laissant de ct ce
qui
a t
publi
dans des
ouvrages
d'ensemble sur l'art
grec,
tous aisment
accessibles, je
renvoie ici
quelques
articles de
publications quoti-
diennes ou
priodiques qui
n'ont
pas
t mentionnes ci-dessus
:
Revue
critique, 1893, p.
445-7. Art. de S.
Reinach,
Ravaisson et la
Vnus de Milo. Il
appert
des desseins de Voutier
que l'inscription
se
rapporte uniquement
Thermes imberbe et
qu'elle
n'a aucune rela-
tion avec la Vnus
(p. 447).
Revue
archologique,
1901, II, p.
123. Brochure de Bitter : la Vnus
est une Danade versant de l'eau d'une urne.
Restauration,
dite
horrible
,
de Geskel Salomau et annonce de la
maquette
due
P. Weber
(plus haut, p.
311.
Ibid., 1905,1, p.
131. Thiers et la Vnus
(d'aprs Tarral).
P.
304,
dcouverte du thtre de Milo et des catacombes
par
deux
Franais
en 1735
(d'aprs
le R. P. J .
Brucker).
Ibid., 1907, II, p.
350. Nouvelle relation de Dumont
d'Urville,
dcouverte la
bibliothque
de
Caen,
et
publie
avec commentaires
par
M. Besnier. La
preuve
est faite
que
D. d'U. s'est
beaucoup
vant
et a commis des inexactitudes
pour grandir
son rle.
L'article de M.
Besnier, joint
celui de M. Michon
(Le
M** de
Rivire et la donation dela Vnus de
Milo,
Socit des Amis du
Louvre,
Paris, 1906),
forme une
importante
addition la
bibliographie
de la
Vnus donne Rev.
arch., 1906, I, p.
199-200.
Ibid., 1907, II, p.
457. Brochure de Miliarakis
d'aprs
une relation
d'Arist. Tatarakis
(1867),
o
reparaissent
les
lgendes
de la
bataille,
de la
perte
des
bras,
etc.
Ibid., 1909, II, p.
280. Un
ingnieur anglais anonyme
raconte
qu'on
a dcouvert en
1898, prs
de
Sidon,
un bronze haut de 0 m. 60
reprsentant
la Vnus
complte,
dont celle du Louvre ne serait
qu'une
copie ;
ses
pieds,
un ros dont la Vnus caresse la tte.
Ibid., 1911, I, p.
159.
Opinion
du
sculpteur
Rodin sur la Vnus
juge
comme oeuvre d'art.
Ibid., 1911, II, p.
189. Le Sicle rchauffe les hbleries de Matterer.
Dans le Bull. Soc.
anthrop.,
MM. Chaillon et Mac-Auliffe montrent
que
le buste de la Vnus est celui d'une femme
musculaire, oppose
aux femmes
respiratoires.
Ibid., 1918, I, p.
184. Suivant un
Espagnol,
la Vnus serait une
Proserpine.
Ibid., 1927,1,
259. M.
Keramopoullos
met
l'hypothse que
trois
DOCUMENTS SUR LA VNUS DE MILO 355
petites
lettres sans intrt de Boure
(1862),
dont il n'a
pu
lire la
signature,
taient de
Ravaisson et
renouvelle,
cette
occasion,
la
lgende
du
combat,
de la fracture des
bras,
etc..
Ibid., 1929, I, p.
182. Sous le titre de Sottisier dela Vnus de
Milo,
S. Reinach
reproduit
ou rsume des articles ou lettres de R. Puaux
et G. Bertrand
(avec
une lettre indite de
Fouqu,
de
Milo,
20
juil-
let
1866) qui
ritrent les assertions frauduleuses de Matterer et
de Brest
pre
et
fils. Ces documents ont
paru
dans le
Temps,
25 et
27 novembre 1928.
XII
piloguex
Le cavalier colossal tait rest Milo et ne fut
transfr au muse d'Athnes
qu'en
19012. Il tait
plac
sur une base dont
l'inscription,
en
caractres
d'poque
romaine 3, prouve que
le titulaire
s'appelait
Tiberius
Claudius
Frontonianus, qu'il
tait
citoyen
de l'le
et s'tait
distingu
la
guerre,
comme orateur et comme
grand-prtre
d'Asie. Cette statue colossale ne
peut
avoir
figur que
sur
l'agora
de
Melos,
d'o
proviennent
sans
doute les statues
qui
ont t trouves en mme
temps.
La Vnus et le
Neptune peuvent
avoir t dans le mme
cas et
y
avoir
occup
une
place
d'honneur.
Bien
que
Cavvadias ait cru certain
que
la statue
d'homme
drap
sans tte
(plus haut,
p. 228)
avait
figur
sur la base avec la ddicace de
Thodoridas,
Lechat
avait
exprim
des doutes ce
sujet
4
et ces doutes ont
t croissants. On a vu
que
Tissot
(p. 335) prfrait sup-
poser que
cette base avait
support
le
Neptune,
ex-voto
1. J e ne
rimprime pas
ici mon
article
publi
dans la Revue archo-
logique
de 1902
(t. II, p. 207-222)
sur
TAmphitrite
et le Posidon
de
Milo, parce que je
l'ai
dj reproduit
dans
Cultes, Mythes
et Reli-
gions,
t.
IV, p. 421-437;
mais
je
fais
quelques emprunts
ce dernier
travail.
2. S.
Reinach, Cultes,
t.
IV, p. 434,
avec
gravure, p.
426.
3. Inscr.
graec. insul., III,
1119.
4. Cf.
Cultes,
t.
IV, p.
422.
356
DOCUMENTS SUR LA VNUS
DE MILO
de Thodoridas vers 370. Pour le Posidon du Muse
d'Athnes,
cela est
impossible;
mais si
j'ai
eu raison de
supposer
que
Yex-voto
original
de
Thodoridas,
pendant
de la
Vnus,
avait t transfr Rome et
remplac
alors
par
une
copie vigoureuse,
mais assez
grossire,
on
est tent de
supposer que,
suivant leur
habitude,
les
Romains
n'emportrent pas
la base de cette statue et
qu'elle
resta
Milo,
sans
que
la
copie
excute dans
l'le
y
ft
place.
La
question
est loin d'tre
rsolue,
mais l'tude directe du Posidon d'Athnes ou mme
d'un
moulage (il
en existe un
Paris),
tout en confir-
mant
l'impression
de Tissot
que
le
Neptune
et la Vnus
sont frre et
soeur,
ne
permet pas
un instant d'admettre
que
l'excution de ces deux statues
puisse
tre attri-
bue la mme
poque.
Il n'en est
pas
de mme de la
conception.
En viendra-t-on
penser,
comme l'a
suggr
M. Edmond
Pottier 1, que
le
Neptune
puisse
tre une
imitation tardive de
TAmphitrite
laquelle
il devait
faire
pendant
sur la
place publique
de Mlos? J e ne le
pense pas,
car le Posidon a t ddi
par
Thodoridas,
irrvocablement
associ,
comme on Ta
vu,
la
Vnus,
et la ddicace de Thodoridas
Posidon, par
son
criture et
par
sa
langue,
ne
peut
descendre
plus
bas
que
le milieu du ive sicle.
L'hypothse
de M. Paul
Arndt 2, qui
voit dans l'ori-
ginal
du
Neptune
une oeuvre du
sculpteur
Lochars,
auteur du
Ganymde
dont nous avons des
copies,
est
contredite
par
la
palographie
de la
ddicace,
Locha-
rs
ayant
t
contemporain
d'Alexandre le Grand.
Cette
agora
de Melos devait tre un vritable muse
de statues. Il est bien dsirer
qu'un jour
on fouille
jusqu'au
roc tout
l'emplacement
dsign aujourd'hui
sous
le nom de Klima et les abords du thtre.
(1929).
1.
Cultes,
t.
IV, p.
436.
2.
Ibid., p.
435.
XVI
QUATRE
STATUES
FIGURES SUR LA COLONNE TRAJ ANE'
On a
publi
trois
listes,
toutes
incompltes
et fau-
tives 2,
des
rpliques
de la statue
clbre, connue,
depuis
Visconti,
sous le nom de Venus
genetrix
et dont le
plus
bel
exemplaire
est conserv au Louvre. A ces trois listes
manque
une
rplique
trs
importante qui
est
reprsente
en relief sur la Colonne
Trajane,
dans la scne de l'em-
barquement
des Romains
Ancne,
au commencement
de la seconde
guerre dacique (105 aprs J .-C).
J e
repro-
duis ici ce
relief,
d'aprs
une
photographie prise
sur
un
moulage partiel
excut au Muse de Saint-Ger-
main
(fig. 64).
Les
premiers
diteurs de la Colonne
Trajane
n'ont
pas
reconnu le motif de la
statue, qui
est
cependant
fort
clair. Dans la
gravure
de Bellori
(pi. 68),
elle soutient
son menton de sa main droite leve
;
le texte nous
avertit
obligeamment que
c'est la statue d'une
desse,
non celle de Dcbale
(nel
vestibulo... vedesi la statua
d'una
Dea,
non di
Decebalo).
G. Froehner
y
a vu une
Vnus marine tenant un
sceptre
de la main droite 3.
1.
[Revue archologique,
1905, I,
p. 393-403.]
2.
Bernoulli, Aphrodite, p.
86
;
S.
Reinach,
Gazette
archologique,
1887, p.
257
; Klein, Praxiteles, p.
55.
_
fefl
3.
Froehner,
La Colonne
Trajane (grande dition),
t.
I, p.
17.
Deux
temples
couronnent la
plate-forme
du rocher
qui
domine la
cte... Au second
plan
se dresse
un sanctuaire de
proportions
moins
considrables,
mais
plus gracieux
de forme
;
la statue de la divinit
358 STATUES SUR LA COLONNE TRAJ ANE
Le
sceptre
n'existe
pas ;
ce sont les
longs plis
du man-
teau
qui
donnent l'illusion de cet attribut. La vrit
a t reconnue
par
M. Benndorf et
accepte par
M.
Cichorius,
le dernier di-
teur et commentateur des
reliefs de la Colonne
(1900)*.
La Venus
genetrix
est
figure
ici comme la statue de culte
du
temple
de la
desse, qui
tait le
plus important
d'An-
cne
; l'emplacement
en est
occup aujourd'hui par
la ca-
thdrale de San Ciriaco. Vnus
tait la divinit
protectrice
d'Ancne 2,
dont les mon-
naies
portent
au revers son
effigie (tte
de
profil)
3.
Voil donc un document
irrcusable,
et
jusqu' prsent
unique, qui
nous montre la
Venus
genetrix
dans la cella
d'un
temple.
Il
y
a l un
tmoignage qui
mrite d'tre
pris
en srieuse considration
et
qui
n'a
pas,que je sache,
t
allgu
encore dans la discus-
sion, toujours ouverte,
sur la date et la destination de
l'original.
Nous savons
que
Csar avait
ddi,
en
46 avant
J .-C,
un
temple
Venus
genetrix,
son aeule et l'aeule
que
Ton voit l'intrieur
(le sculpteur
l'a
place
sur le seuil de la
)orte),
sur sa base de
marbre, reprsente
une femme
drape, appuyant
e bras droit sur un
sceptre.
C'est
probablement
une Vnus marine .
1. C.
Cichorius,
Die
Reliefs
der
Trajansule,
Dritter Textband.
Berlin, 1900, p. 12,
18.
2.
Catulle, XXXVI,
13
; J uvnal, IV,
40.
3.
Eckhel, Doctrina,
t.
I, p.
98.
FIG. 64.
Aphrodite figure
sur la Colonne
Trajane.
STATUES SUR LA COLONNE TRAJ ANE 359
<les
Romains, que
ce
temple
s'levait Rome et
qu'on
y
avait
plac,
avant mme
qu'elle
ft
acheve,
une
istatue de
culte,
oeuvre d'Arcsilas 1.
Du fait
que
la silhouette de a statue
appele par
les
modernes Venus
genetrix figure
sur les monnaies de
l'impratrice
Sabine avec la
lgende
VENERf GENE-
TRICI,
on avait conclu
que
la statue d'Arcsilas
repro-
duisait le mme motif. Mais d'autres monnaies offrent
des
images
diffrentes avec la mme
lgende,
et la mme
image
avec des
lgendes
diffrentes. On en tait donc
1.
Pline,
Hist.
Nat., XXXV,
155
(d'aprs Varron)
: Ab hoc
factam
Venerem
genetricem
in
foro
Caesaris et
priusquam
absolveretur
fes-
..tinatione dedicandi
positam.
FIG. 65.
Trois statues surmontant un arc de
triomphe
(Colonne Trajane).
360 STATUES SUR LA COLONNE TRAJ ANE
venu
rvoquer
en doute
que
le
type
de la Venus
gene-
trix et rien de commun avec la Vnus d'Arcsilas 1.
Le
tmoignage
de la Colonne
Trajane
semble donner
tort aux
sceptiques.
11 est assez naturel
que
le
temple
de Vnus
Ancne,
colonie romaine ds
l'poque
de^
Pline 2,
ait
possd
une statue
analogue
celle du
temple
de Vnus Rome. Le
type
de la Venus
genetrix
est trs
frquent
l'poque
romaine,
surtout en Italie
;
les
rpliques provenant
d'autres
parties
de
l'Empire
sont
fort rares. On est donc autoris croire
qu'un original
clbre et
s'imposant, pour
ainsi
dire,
l'imitation des
villes
provinciales
d'Italie existait Rome et
y jouis-
sait d'une faveur
particulire.
Cette
image
de l'Aenea-
dum
genetrix
a
pu
tre
copie quelquefois
hors de
l'Italie
;
mais c'est en Italie surtout
qu'elle
tait
significative
et avait sa raison d'tre en tant
que
statue de culte.
Ce
qui
n'est
pas
admissible,
c'est
qu'Arcsilas
ait
invent le motif
;
il Ta
emprunt
au fonds de la statuaire
grecque.
Mais
quel
artiste faire honneur de l'inven-
tion? On a
song
tour tour Praxitle
(l'Aphrodite
de
Cos),
Alcamne
(l'Aphrodite
des J ardins
d'Athnes),
Calamis
(la
Sosandra) ; j'ai propos,
en
18993,
d'attri-
buer
l'original
Callimaque,
artiste ionisant et archa-
sant
qui
travaillait Athnes et Plates vers 420*.
Cette
hypothse
est, je l'avoue,
un
peu
en
l'air;
mais
il me semble
que
toutes les autres sont
inacceptables,
ce
qui
ne veut
pas
dire
qu'on
ne
puisse
en dcouvrir
de meilleure.
Quoi qu'il
en
soit,
trois faits nouveaux
sont
signaler,
dont devront tenir
compte
ceux
qui
1.
Klein, Praxiteles, p.
53.
2.
Pline,
Hist.
Nat., III,
111.
3. Revue
critique,
1899, II, p.
277.
4. J e renvoie
l'expos que j'ai
donn de cette controverse dans,
mon Recueil de ttes
antiques, p.
91 et suiv. M. Lechat incline
par-
tager
mon
opinion (La sculpture attique
avant
Phidias, p. 490).
STATUES SUR LA COLONNE TRAJ ANE 361
aborderont dsormais ce
problme ;
il me reste les
indiquer
brivement :
1 De toutes les
rgions
du monde
antique,
aucune n'a
fourni autant de statuettes en marbre de Vnus
que
l'Egypte.
Nous savons
qu'on
les donnait en cadeaux de
noces
;
nous savons aussi
que
les artisans
qui
les fabri-
quaient
ne se mettaient
pas
en frais
d'imagination,
mais
copiaient
et
recopiaient
des modles connus.
Or, jusqu'
prsent,
sur
plusieurs
centaines de statuettes trouves
en
Egypte,
toutes drivant de l'art
grec
du ive
sicle,
aucune ne
reproduit
le
type
de la Venus
genetrix.
Cela suffit
faire carter dfinitivement l'attribution de ce motif
Praxitle
;
il doit tre ou
plus
ancien ou
plus
rcent
;
2 Une
petite copie
dcouverte Athnes offre une
variante trs
importante qui
dmontre l'anciennet du
motif.
Piscatory, qui
fut ministre de France en Grce
sous le
rgne
de
Louis-Philippe, acquit
un
groupe
en
marbre haut de 0 m.
40, aujourd'hui
chez sa
fille,
Mme
Trubert,
que j'ai
reproduit
dans mon
Rpertoire
de
la statuaire
1
(fig. 70).
La Venus
genetrix y
est associe
un ros de
style alexandrin, qui
est certainement
une addition du
copiste
et ressemble nombre
d'autres
ros associs des
Aphrodites
de Praxitle. Il
n'y
a
pas
lieu d'insister
sur ce dtail. Mais la coiffure de la
desse
prsente,
dans cet
unique exemplaire,
un
aspect
trs
archaque
;
elle descend
sur la
nuque
en une
large
nappe trapzodale.
Dira-t-on
que
ce trait caract-
ristique, qui suggre
un
original
antrieur 450 avant
J .-C,
soit d un
caprice
de
copiste?
Cela est absolu-
ment
impossible. L'original
tait sans doute
athnien,
la
copie
est athnienne
;
elle a
d,
sur ce
point impor-
tant,
se conformer
l'original. Donc,
il ne
peut
tre
question
d'attribuer le motif
Alcamne,
moins
qu'on
1.
Rp.
de la
stat., II, 378,
4.
[Aujourd'hui
chez M. Ternaux-Com-
pans.
Il
y
a un
moulage
Saint-Germain.
1929.]
362 STATUES SUR LA COLONNE TRAJ ANE
ne veuille
faire intervenir ici Alcamne
l'ancien,
le
rival et non l'lve de Phidias. Cela mme souffrirait
des
difficults,
car dans le fronton ouest du
temple
de
Zeus
Olympie, qui
est
probablement
d'Alcamne
l'ancien,
il
n'y
a
pas d'exemple
de cette
disposition
archaque
de la chevelure. tant donn le
type
de la
Genetrix,
cette coiffure fait l'effet d'un archasme
voulu,
ou,
du
moins,
d'un souvenir
archaque qu'on
attri-
buerait volontiers
Callimaque
1
;
1. M. Lechat a rcemment montre
(op. L, p. 497) que
le dos
d une
des Cariatides de
l'Erechthion,
o travailla
Callimaque,
est
pareil
celui des Kors athniennes des environs de 500.
FIG.
66,
67.
Aphrodite
et ros. Autrefois chez Mme Trubert Paris.
STATUES SUR LA COLONNE TRAJ ANE 363
3 La statue du Louvre a
pass,
au xixe
sicle, pour
avoir t dcouverte
Frjus ;
aussi en a-t-on
expos
un
moulage
au Muse de Saint-Germain. Mais c'est l
une
simple lgende d'antiquaire,
laquelle
il faut abso-
lument renoncer. Les faits relatifs l'histoire de la
statue du Louvre ont t raconts en dtail
par
M. Michon 1. On sait
que, peu
avant
1670,
une statue fut
dcouverte
Frjus
et donne au
prsident d'Oppde,
qui
la fit
transporter
Paris
;
mais rien ne dit
que
ce ft
une
Vnus,
ni
que
le
prsident d'Oppde
Tait donne
au roi. D'autre
part,
ds
1678,
la Venus
genetrix parat
aux Tuileries
2
;
elle fut
transporte
de l Versailles
et on la trouve en 1802 au Louvre. En
1811,
Millin dit
qu'une
Vnus Uranie
, provenant
de
Frjus,
avait t
envoye
Paris vers 16503
;
M.
Froehner,
dans son
catalogue
des
sculptures
du Louvre
(n 135),
crit
que
la Venus Genetrix a t
probablement
trouve
Frjus
en 1650
;
il ne restait
plus qu'
l'identifier la
statue
d'Oppde,
ce
que
Ton a fait sans motif. Non
seulement donc la
provenance
n'est
pas
tablie,
mais
celle
qu'on
admet est
invraisemblable,
car si une statue
aussi bien conserve et de cette
importance
avait t
dcouverte au xvne sicle
Frjus,
nous
possderions,
ce
sujet, plus qu'une simple
mention,
et mieux
que
l'indication du
sujet reprsent.
J e suis convaincu
que
la Venus
genetrix
a t dcou-
verte
Naples
vers 1520 et donne
Franois
Ier vers
1530
par
le condottiere Renzo da
Ceri,
lieutenant-
gnral pour
le roi dans
les
Etats de
Naples.
Dans l'au-
tomne de
1530,
elle
tait
au chteau d'Amboise. Cela
ressort,
mon
avis,
avec vidence de textes
publis
ou
runis rcemment
par
M.
Picot,
posies
latines
et fran-
1.
Michon,
Statues
antiques
trouves en
France,
in Mmoires de la
Socit des
Antiquaires,
t. LX
(1901), p,
79 et suiv.
2.
Ibid., p.
82.
3.
Millin, Voyage,
t.
II, p.
491.
364 STATUES SUR LA COLONNE TRAJ ANE
aises
relatives une statue de Vnus
qui
fut offerte en
1530
Franois
Ier 1. M.
Picot,
analysant
ces
textes,
a reconnu
qu'ils s'appliquent
une statue de marbre
de
Vnus,
tenant une
pomme
la main
2
;
mais il n'en
a
pas
tir une conclusion
que je
crois
vidente,
savoir
que
cette statue tait habille. En
effet,
les
potes
latins, qui
ont fait d'elle
l'objet
de leurs
pigrammes,
n'auraient
pas manqu
de vanter ses
seins,
ses
hanches,
ses
jambes, etc.,
si elle avait offert la vue ces trsors de
sa beaut. Leur
silence,
cet
gard,
est
significatif ;
crivant en
latin,
ils n'avaient aucune raison d'tre
prudes
ni de s'abstenir, de clbrer ce
qu'ils voyaient
3.
Donc,
la statue donne
Franois
Ier tait une Vnus
drape,
de
marbre,
tenant une
pomme,
et cette Vnus
fut loue comme un chef-d'oeuvre. A moins d'admettre
qu'elle
ait t
gare
ou
dtruite,
ce
qui
est invrai-
semblable,
il faut l'identifier la Venus
genetrix
du
Louvre. Peut tre est-elle reste au chteau d'Amboise
jusque
vers le milieu du xvne
sicle, poque
o elle fut
transporte
aux Tuileries.
J 'ai dit
que presque
toutes les
rpliques
de la Venus
genetrix
ont t dcouvertes en Italie. Celle dite de Fr-
jus,
la
plus
belle de
toutes,
semblait faire
exception
;
cette
exception
n'existe
pas.
La tte
de
la Vnus du Louvre est
sculpte
dans le
style
de la seconde moiti du ve
sicle,
comme celle d'une
des
copies
en terre cuite dcouvertes
Myrina.
Elle
1.
Picot,
Revue
archol., 1902, II, p.
222.
2. Cette
pomme est, dit-on,
restaure dans toutes les
rpliques
en
marbre
;
la restauration de
l'exemplaire
offert
Franois
Ier avait
peut-tre
t faite en Italie.
3. Une
pice
de vers
franais,
oeuvre de Marot
(Picot,
art.
cit,
p. 228),
confient les vers suivants
: Cette
desse,
avec sa ronde
pomme...
C'est du haut ciel
quelque
vertu
divine, Qui
de sa main
t'offre
la
pomme
ronde. Marot n'aurait
pas parl
ainsi d'une
figure
nue ou
mme demi-nue
;
il n'aurait
pas qualifi
de vertu divine une Vnus
quelque peu
oublieuse de la
pudeur.
STATUES SUR LA COLONNE TRAJ ANE 365
atteste donc l'influence d'un modle
qui
n'est
pas
l'original
la coiffure
archaque,
comme
pour
le
groupe
Piscatory,
mais une variante un
peu
modernise
de cet
original.
La statue
d'Arcsilas,
conforme au mme
type, marquait peut-tre
un
pas
de
plus
dans l'volution
qui Tloignait
de
l'archasme;
ce
pouvait
tre
simple-
ment une
copie libre,
comme on en a fait
beaucoup
cette
poque. Quoi qu'il
en
soit,
cela fait au moins trois
tals du
type
de la Genetrix. L'existence de ces tats
successifs n'a rien
d'extraordinaire;
le motif du Dia-
dumne,
par exemple,
a subi des transformations ana-
logues.
On se trouve ainsi ramen une
opinion
voisine
de celle
que j'exposais
en
1887; je
concluais alors
que
le
type,
cr
par
Alcamne,
avait t successivement
reproduit,
mutatis
quibusdam, par
Praxitle et
par
Arc-
silas 1. Au lieu de se refuser discuter cette
opinion,
ce
qui
est
trop
commode et d'ailleurs
impoli,
M. Klein
aurait bien d nous dire ce
qu'il pensait
de la Venus
genetrix
d'Arcsilas et nous
expliquer pourquoi
le motif
de la statue du Louvre a t
copi presque
exclusive-
ment en Italie 2.
*
* *
Dans la mme scne de
l'embarquement
Ancne,
sur la Colonne
Trajane,
on voit un arc de
triomphe
sur-
mont de trois statues
que je reproduis d'aprs
une
photographie
du
moulage (fig. 65).
L'arc de
triomphe
d'Ancne,
ddi
Trajan
en
115,
subsiste encore
3
et
l'emplacement qu'il occupe
est
parfaitement
conci-
liable avec celui
que
lui attribue le bas-relief 4. Mais ce
1. Gazette
archol,
1887, p.
280.
2.
Klein, Praxitles, p.
55.
3.
Rossini,
Archi
Triunfali, pi. 44; Baumeister, Denkmler, pi.
84.
4. Du haut de la
ville,
un escalier taill dans le roc conduit vers
l'arc d'honneur dress sur la cte. Ce monument est surmont d'un
groupe
de trois statues
colossales,
etc.
(Froehner).
Une vue de l'arc
d'Ancne est
grave
dans le texte de
Cichorius,
t.
III, p.
25.
366 STATUES SUR LA COLONNE TRAJ ANE
bas-relief est de 110 ou de 112 au
plus
tard,
c'est--dire
d'une
poque
o Tare tait encore en construction
1
ou mme seulement l'tat de
projet.
C'est ce
qui
explique que
Tare actuel ne ressemble
pas
exactement
celui du
relief;
ce dernier n'a
pas d'attique
et il est
surmont de trois statues
viriles,
alors
que
le sommet
de Tare actuel
porte
les traces d'une statue
questre
accompagne
de deux
figures
en mouvement 2.
Les trois statues ont bien
pu
n'exister
que
dans l'ima-
gination
d'un des estimables artistes
employs par
Apollodore
de Damas la dcoration de la Colonne
;
mais
il
est
plus simple
d'admettre
qu'il y
en avait de
pareilles
Ancne,
sur
quelque
monument l'entre
du
port.
J usqu' prsent,
on ne s'est
pas
mis d'accord
pour
leur
assigner
des noms 3.
M. Froehner
proposait,
titre de
conjecture, d'y
reconnatre Posidon entre
J upiter
arm du foudre et
Mercure
portant
le caduce. M. Benndorf a
pens
Neptune
entre les Dioscures. Enfin M.
Studniczka,
qui j'avais
fourni un
surmoulage
de ce
groupe,
a cru
y
voir Palmon-Portunus entre Castor et
Pollux,
hros
sauveurs
invoqus par
les
marins 4;
il s'est
persuad,
malgr
le
tmoignage
contraire de M.
J thner, que
les
deux
figures
droite
et
gauche portaient
des four-
reaux
d'pes,
attributs
qui
conviendraient aux Dios-
1. C'est aussi
l'opinion
de M. Benndorf
;
M. Cichorius admet l'exis-
tence d'un arc antrieur au mme endroit.
2. Voir l'article de Rohden dans les Denkmler de
Baumeister,
t.
III, p.
1877.
L'inscription
sur
l'attique apprend que
l'arc a t
ddi
Trajan,
sa femme Plotine et sa soeur Marciane
(Corp.
inscr.
lut., IX, 5894).
3. La
planche
de Bellori est trs inexacte
;
la tte de
Neptune y
est tourne
gauche.
Dans le
texte,
il est dit
que
les statues si
rife-
riscono ad Hercole et a Traiano. Une
photographie d'aprs
un mou-
lage,
fourni
parle
Muse de
Saint-Germain,
a t insre dans le t. III
du commentaire de M. Cichorius
(p. 13).
4.
Ap. Cichorius, op. laud.,
t.
III,
p.
22.
STATUES SUR LA COLONNE TRAJ ANE 367
cures,
mais
qui
ne sont
pas figurs
sur le bas-relief 1.
Cette
hypothse, d'ailleurs,
ne tient
pas compte
du
fait,
impossible
contester, que
la
figure
de
gauche
porte
une massue. C'est mme le seul attribut sur
lequel
on
puisse
se
prononcer
avec
certitude;
les autres ne sont
qu'bauchs.
Posidon est au
milieu,
dans une
attitude
bien
connue,
avec Hercule sa droite
;
il est inadmis-
sible
qu'un grand
dieu comme
J upiter
soit
plac
la
gauche.
La
figure
faisant
pendant
celle d'Hercule
doit tre aussi celle d'un hros. Le nom
qui s'impose
immdiatement
l'esprit
est celui de
Palmon 2,
iden-
tifi
par
les Romains Portunus
et, d'ailleurs,
mythi-
quement apparent
Hercule, puisque
nous connais-
sons,
dans la
mythologie grecque,
un Hercule-Pal-
mon 3. L'attribut ordinaire de Portunus est une
clef,
la
clef du
port ; peut-tre
l'attribut rest indistinct sur
la Colonne
est-il destin
reprsenter
une
longue
clef,
analogue
la clef de l'curie
que porte Epona
sur un
bas-relief
gallo-romain
de Gannat 4.
1. La
figure
du milieu tant ou
paraissant imberbe,
M. Studniczka
n'a
pas
voulu
y
voir Posidon
;
mais le
sculpteur pouvait-il s'occuper
de ce dtail ?
2. Pausanias
(II, 2, 1) signale
dans le
temple
de Palmon sur
l'isthme de Corinthe une statue de
Palmon,
ct de Posidon et
de Leucothe. Cf.
ibid., II, 1,
8.
3. Voir les rfrences dans le Lexikon de
Roscher,
s. v.
Palsemon,
p.
1255.
4. Revue
archol,
1898,
pi.
11.
XVII
LA VNUS D'AGENi
Quand
il
publia,
en
1879,
la belle statue
qui
fait
l'objet
du
prsent
mmoire,
J ules
Quicherat
crut
pouvoir
affirmer
qu'elle
serait bientt clbre 2. La
prdiction
de
l'minent
archologue
ne s'est
pas
encore ralise. La
Vnus dcouverte au Mas
d'Agenais
a t
reproduite
quatre
ou
cinq
fois en
France 8;
elle n'a
jamais
t,
que
je
sache,
mentionne
l'tranger.
Depuis que
le
Muse
de Saint-Germain en
possde
un
moulage, j'ai
souvent
pris plaisir
provoquer
l'admiration et la
surprise
des
archologues auxquels je
la faisais voir. A mon
avis,
sans
excepter
la Vnus
d'Arles,
la statue du Mas
d'Agenais
est le
plus
beau marbre
antique qui
ait t
dcouvert en
France; c'est,
sinon un
chef-d'oeuvre,
du moins une oeuvre trs
remarquable, que
les
plus
riches Muses
peuvent
envier celui
d'Agen.
Voil
1.
[Revue archologique, 1907, I, p.
369-376
; 1907, II,
p. 2*5-303.]
2.
Quicherat,
Rev. des Socits
savantes, 1879, p.
324 :
Ce
qu'il
importe
de
publier
avant
tout,
c'est le mrite de la statue comme
oeuvre d'art.
Lorsqu'elle
aura t vue d'un nombre suffisant de
connaisseurs et
qu'on
en aura
parl
comme il faut
parler
des choses
pour qu'elles acquirent
la
clbrit,
elle
prendra
certainement sa
place parmi
les
plus
beaux
produits
de la
sculpture antique
.
3.
Quicherat,
Revue des Socits
savantes, 1879,
t.
I, pi.
la
p.
324
;
Quicherat
et
Tholin,
Bull, de la Socit des
antiquaires,
21 mars
1877,
pi.
la
p.
100
;
Collignon,
Mmoires de la Socit
archologique
de
Bordeaux, 1877, p. 8, pi.
II
; Mommja,
La Vnus du Mas
d'Agenais,
dans la Revue de
l'Agenais,
t. XXVIII
(1901), p.
197-209
(tir.
p.)
;
S.
Reinach, Rpertoire
de la
statuaire,
t.
II, p. 335,
9.
LA VENUS D AGEN
369
pourquoi j'ai
cru devoir en faire
l'objet
d'une
petite
enqute,
dont les textes
imprims
et d'amicales
corres-
pondances
m'ont fourni
les lments.
^^^^ ^T^^.
Le
Brgnet
est le nom
d'un
petit village
situ
sur une minence natu-
relle
qui
domine le cours
de la Garonne
1
(
2 kilo-
mtres et demi du Mas
d'Agenais).
Bien
qu'on
n'y
ait
pas
recueilli d'in-
scriptions,
les traces de
l'occupation
romaine
y
sont
nombreuses
;
on
y
rencontre notamment
des tuiles rebords et
des
fragments
de vases
dits samiens 2.
A
quelques
centaines de mtres
plus
loin s'tend une
ncropole considrable,
celle de Saint-Martin de
Lesque
(commune
de
Caumont), qui
a t
explore par
un
savant
bordelais,
M. Nicola. Elle lui a fourni de nom-
breux
spcimens
de la
cramique
glaure rouge
des
ateliers
rutnes,
dont
beaucoup portent
des estam-
pilles
de
potiers
3.
1.
Tholin,
Bull. Soc.
Antiq., 1877, p.
102.
2. M.
Mommja
mentionne aussi des cubes de
mosaque (op. laud.,
P-
10)-. .
.,
3.
Nicola,
Le Mas
d'Agenais
et le amelire
gallo-romain
de Saint-
Martin, Bordeaux,
1896
;
cf.
Dchelette,
Vases
orns,
t.
I, p. 205,
272. Une belle
lampe
de bronze
provenant
de ce cimetire a t
S. RENACH 24
Fig.
68,
69.
La Vnus
d'Agen.
I
370 LA VNUS D'ACEN
Le Mas
d'Agenais,
chef-lieu de canton de l'arrondis-
sement de
Marmande,
45 kilomtres au nord-ouest
d'Agen,
d'une
superficie
de 2.112
hectares,
a t iden-
tifi
par Adolphe Magcn
la station romaine de Pom-
peiacum,
mentionne
par
les Actes du
martyre
de saint
Vincent 1. C'est l
que
fut
transfr,
un sicle et demi
aprs
sa
mort,
le
corps
du
saint;
on
y
leva une basi-
lique que
Fortunat dcrivit vers 5602. L'endroit o le
saint avait souffert le
martyre s'appelait ager Vellanus,.
Reonemensis
ruris,
et le texte du
martyrologe
nous dit
que
Reonemense tait
cinq
milles de
Pompeiacum.
Uager Vellanus, dpendant,
ce
qu'il semble,
du Rus
Reonemense, pouvait
en tre moins
loign.
Il est donc
possible que ager
Vellanus soit Le
Brgnet,
bien
qu'on
n'y
ait
pas
trouv de traces de la
premire basilique
de
Saint-Vincent,
leve au lieu du
martyre
du saint et
dtruite en 585
par
le roi Gontran 3. C'est
par
une
conjec-
ture
vraisemblable,
mais dont la dmonstration reste
fournir, qu'on place
au mme endroit le
temple appel
Vernemetis dans un
passage
clbre de
Fortunat 4;
l'vque
Leontius II de Bordeaux le consacra au vrai
Dieu et saint Vincent. On
peut allguer,
l'appui
de
cette
hypothse
: 1
que
saint Vincent fut tu
non loin
d'une
rivire,
sur une colline o s'levait un
temple
publie par
M. Tholin
(Rev.
des Socits
savantes,
5e
srie,
t..
VI,
p. 130).
1. Caslrum
quod
ah incolis
Pompeiacum dicitur, fere quinis
milibus
a Reonemense
separatum
(Acla
martyrii
S.
Vincentii,
dans la collec-
tion des
Bollandistes,
2
juin. p.
168
;
cf.
Longnon, Gographie
de la
Gaule au vie
sicle,
p. 550).
Suivant Ad.
Magen,
les dbris d'une
chapelle
du Mas
d'Agenais
et les
proprits
voisines ont conserv
le nom de
Pompjac.
2. Fortunat.
Carmina, I,
8.
3.
Gre<;. Tur.,
Hist.
Franc, VII,
35
;
cf.
Longnon, op. laud., p.
549-
4.
Fortunat, Carmina, I,
9. Le
pote
traduit Vernemetis
par fanain
ingens,
ce
qui parat
exact
;
mais on n'a
pas
le droit d'en infrer
qu'il
y
et l un
temple
colossal
ou mme un
grand temple
. Gran-
ville n'est
pas toujours
une
grande ville,
ni Grandmont un rival du
Mont Blanc.
LA VNUS D'AGEN 371
paen
s1
;
2
que
Leontius
pouvait
tre tent de convertir
ce
temple
mme en une
basilique
sous le vocable de
Saint-Vincent;
3
que
certaines versions des Actes
de saint Vincent
appellent
le thtre de son
martyre
Nemetum, dsignation
videmment
analogue
Verne-
metis 2.
Quant
au cimetire de
Saint-Martin,
on a
suppos
qu'il dpendait
de la ville
antique
d'Ussubium,mention-
ne
par
l'itinraire d'Antonin sur la voie
d'Agen
Bordeaux. Une
inscription portant
le nom de cette ville
ou de la divinit
topique
se trouve au Mas
d'Agenais,
mais a
pu y
tre transfre d'ailleurs 3.
II
La date exacte de la dcouverte de la statue de Vnus
au
Brgnet
ne m'est
pas
connue avec certitude. Dans la
notice de
Quicherat,
il est dit
qu'elle
fut exhume au
printemps
de
18774,
alors
que
la
planche grave pour
accompagner
cette notice la fait dcouvrir en 1876.
Il est
probable que
la trouvaille date des derniers mois
de cette anne. L'
inventeur
fut un
paysan
du nom
de
Rousseau, qui
creusait un trou
pour planter
un
arbre
5
et rencontra la statue moins d'un mtre de
pro-
fondeur. Un
peu plus
tard,
l'exploration
du
champ
fut
reprise;
on mit au
jour
un mur
droit,
de
peu
d'paisseur,
et de
gros quartiers
de ciment faisant
pavage
6.
Tout
autour, ajoute
M.
Tholin,
abondent les
1.
Longnon, op. laud., p.
550.
2.
Ibid., p.
550,
note 2.
3. Cf.
J ullian,
Inscr. de
Bordeaux,
t.
II, p. 183,
221
; Corp.
inscr.
lut.,
t.
XIII, 1, p.
119
; Allmer,
Rev.
pigr., 1906, p.
203.
4. Rev. des Soc.
savantes, 1879, I, p.
323.
5. Bull. Soc.
antiq., 1877, p.
100
(Tholin).
M.
Mommja
seul
parle
d'un laboureur
(op. laud., p. 10).
6.
Tholin,
Bulletin de la Socit des
Antiquaires, 1877, p.
102.
372 LA VNUS D'AGEN
dbris de tuiles
rebords,
dont
plusieurs
sont mar-
ques
par
des raies
parallles qui
dessinent des courbes
diverses
et
qui
ont t traces sur la
pte
frache au
moyen
d'un instrument muni de dents et de
pointes.
Il
y
a,
de
plus,
sur l'une des
tuiles,
une
marque
de
fabrique
de
grande
dimension. On a trouv aussi un
beau
fragment
de
poterie
dite
samienne,
orn de des-
sins en relief.
Dans la mme
notice,
M. Tholin a
signal
le
premier, je crois,
et le seul
jusqu' prsent
la
dcouverte de deux
fragments importants
d'une tte
sur
lesquels
nous aurons revenir avec dtail. J e trans-
cris
intgralement
ce
passage
l
:
Dans
l'esprance
de retrouver la tte et les bras
[de
la
statue],
on a fouill
sur un
grand espace
le
champ
du
Brgnet.
On a trouv
deux
fragments
d'une tte
qui
ne
s'ajuste pas
exactement
la statue. Le cou est
trop
mince,
ainsi
que
la
figure, qui
parat
avoir t mutile
par
le ciseau et
par
la
rpe.
Le crne avec sa chevelure
(qui
est
pareille
celle de
la Vnus de
Mdicis),
a t
spar par
un
sciage
de
l'autre
fragment qu'il
dborde un
peu
2. Le
grain
du
marbre de ces dbris a
paru
diffrer de celui du
corps.
Cette diffrence est
peu
sensible et
je
croirais volontiers
que
c'est bien rellement la tte de la statue
qui
a t
retrouve. Peut-tre ces
fragments appartiennent-ils
une restauration faite
l'poque
romaine. Ce
qui
a lieu
d'tonner,
c'est une mutilation
accomplie
d'une manire
systmatique,
au
moyen
des outils du
sculpteur
3
.
Un ancien lve de M.
Braquehaye (professeur
du
cours lmentaire des Beaux-Arts l'cole des Beaux-
1.
Tholin, ibid., p.
101.
2. En
ralit,
il
n'y
a
pas
eu division en deux
par sciage
: les deux
fragments
sont limits
par
des sections
planes,
comme on en a cons-
tat souvent dans les marbres de la meilleure
poque.
Cf. mon Recueil
de
Ttes, p. 127,
160
;
H. de
Villefosse,
Monuments
Piot,
t.
I, p.
71.
3. La note
prcdente rpond
sur ce
point
M. Tholin.
LA VNUS D'AGEN 373
Arts de
Bordeaux),
M.
Luflade, exerait,
cette
poque,
la
profession
de menuisier au Mas
d'Agenais
1. Il avisa
M.
Braquehaye
de la dcouverte et
ajouta que
le
pro-
pritaire
dsirait vendre sa statue. M.
Braquehaye
lui
rpondit sur-le-champ pour
lui conseiller de ne
pas
bruiter la
chose,
d'carter les marchands et d'avertir
M.
Tholin,
archiviste
Agen. Quelques jours aprs,
M.
Braquehaye
fit lui-mme le
voyage,
vit la statue et
l'admira. Le
propritaire
en demandait 2.500 francs et
dit
qu'il
l'avait
dj
offerte au muse
d'Agen,
o l'on
trouvait la somme
trop
forte. M.
Braquehaye
dclara
qu'
dfaut du muse il serait acheteur
lui-mme;
puis
il vit M. Tholin
Agen,
lui vanta la beaut de la
Vnus et revint
Bordeaux,
attendant la
photogra-
phie que
lui avait
promise
M. Luflade. Ds
qu'il
l'eut
reue,
il la soumit au
Congrs
des Socits
savantes,
dans la sance du 6 avril 18772.
Quelques jours aupara-
vant,
le 21
mars,
M.
Quicherat
avait montr
cette
photographie
la Socit des
Antiquaires
et avait lu
ce
sujet
une bonne
notice,
au nom de M.
Tholin,
associ
correspondant
de la Socit
Agen
;
cette
notice fut
publie
avec un dessin de M. L. Sellier 3.
Comme la communication de
Quicherat
la runion
des Socits savantes avait
pass presque inaperue,
le mme savant revint la
charge
lors de la runion de
1879 et
apporta,
au nom de M.
Braquehaye,
une
photo-
graphie plus grande qui
fut
reproduite,
sa
demande,
par l'hliogravure
4. Dans cette
notice, Quicherat
ne
1. Ce
qui
suit est fond sur une lettre de M.
Braquehaye (au
Muse
de
Saint-Germain).
2. Revue des Socits
savantes,
6e
srie,
t. V
(1877), p.
454 : M. Char-
les
Braquehaye
a soumis l'assemble la
photographie
d'une statue
romaine de bon
style, reprsentant
une
Vnus, que
l'on vient de
dcouvrir au Mas
d'Agenais.
3. Bull, de la Socit des
Antiquaires,
t.
XXXVII,
21 mars
1877,
avec
pi.
la
p.
100.
4. A la runion des Socits
savantes,
en
1877,
M.
Braquehaye
374 LA VNUS D'AGEN
fit aucune mention des
fragments
de tte dcouverts
dans le mme
champ
et il
proposa
une restitution tout
fait inadmissible de la statue en
Hb .
III
Entre
temps,
la Vnus du Mas
d'Agenais
avait t
acquise par
le Conseil
gnral
de
Lot-et-Garonne, qui
l'avait
dpose
dans le muse
d'Agen,
alors en voie de
formation. Tout cela ne s'tait
pas
fait sans
peine ;
voici les dtails
que
M. Lauzun
1
a bien voulu me fournir
ce
sujet d'aprs
les dlibrations
(manuscrites)
du
Conseil
gnral.
Vers la fin de
1876,
la Socit
acadmique d'Agen
prenait
l'initiative de la cration d'un
Muse, auquel
elle destinait comme local un bel htel de la Renais-
sance
qu'elle
sauva ainsi de la destruction. Dans un
rapport
du mois d'avril
1877,
le
prfet,
M. Flix
Renaud,
annona
au Conseil
gnral que
la statue dcouverte au
Mas
d'Agenais
tait vendre.
On
peut
craindre
chaque
jour, crivait-il, qu'elle
soit enleve. Des offres srieuses
de 2.000 francs ont t faites 2. Il
parat probable que
le
(secrtaire gnral
de la Socit
archologique
de
Bordeaux)
avait
dj apport
une
photographie,
mais
plus petite, qui
circula sous les
yeux
de l'assistance sans tre
remarque,
de sorte
que
la commu-
nication
passa inaperue.
M.
Braquehaye
a voulu la ritrer en
pro-
curant au comit une autre
image
dont la dimension ft mieux
appr-
cier le mrite de l'oeuvre... Le
Comit,
son
tour,
ne saurait mieux
faire
que
de
vulgariser
cette
image
au
moyen
d'une
gravure qui
en
dira
plus que
tous les discours
qu'on pourrait
tenir sur la statue du
Mas
d'Agenais.
(Quicherat,
Rev. des Soc.
sav., 1879, I, p. 325).
1. Secrtaire
perptuel
de la Socit des
sciences,
lettres et arts
d'Agen.
2. J ulien Grau
reprocha plus
tard M.
Braquehaye
d'avoir laiss
chapper
un marbre
qu'il
estimait de 50 60.000 francs.
Grau,
amateur et
commerant lui-mme,
savait le
prix
des belles choses
;
en
l'espce,
on ne
peut
dire
qu'il l'exagrt.
M.
Tholin,
en avril
1877,
crivait
(Bulletin monumental, 1877, p. 197)
: L'adminis-
tration du Louvre est
avertie,
afin de traiter de
Tacht,
si c'est
possible.
J e ne
possde pas
d'autres
renseignements
cet
gard.
LA VNUS D'AGEN 375
propritaire
cderait cet
antique pour
la somme de 3
4.000 francs. Ce
prix
est loin d'tre
exagr.
Le
prfet
insistait
pour que
le Conseil
gnral procdt
l'acqui-
sition ci donnt
mandat,
cet
effet,
la commission
dpartementale.
Le 12
avril,
le
rapporteur
de la com-
mission,
M.
Laporte, s'exprima
ainsi :
Tout en se ran-
geant
l'opinion
de M. le
Prfet,
la Commission d'admi-
nistration
gnrale
ne croit
pas
qu'il y
ait lieu d'ouvrir
pour
le moment un crdit
spcial.
Le motif
allgu,
c'est
qu'on
ne connaissait
pas
suffisamment la valeur
artistique
de la statue
;
le
rapporteur proposait
de
demander au ministre l'envoi d'un
expert.
En atten-
dant,
des
ngociations
seraient
engages
avec le
pro-
pritaire, que
l'on
prierait
de fixer son
prix,
la
ques-
tion devant revenir devant le Conseil la session
d'aot.
La raction monarchiste du mois de mai 1877 cota
sa
place
au
prfet
Renaud,
qui
fut
remplac par
M. Charles
Aylis.
Le nouveau
prfet
fut encore
plus
favorable
l'acquisition.
La Vnus tait
toujours
vendre
pour
4.000 francs. Une
premire
lettre adresse
au ministre tant reste sans
rponse,
le
prfet
en cri-
vit une seconde
pour
demander avec insistance un avis
sur la valeur de la statue. Le ministre
rpondit
:
Conformment votre
dsir, j'ai
soumis les
photogra-
phies
MM. les
inspecteurs
des Beaux-Arts
qui,
sans
porter
un
jugement
formel,
faute d'avoir vu
l'oeuvre,
ont
cependant
dclar d'un commun accord
que
le
prix
de
4.000 francs tait
modr,
eu
gard
son
impor-
tance.
M. Tholin avait aussi demand
l'opinion
de
Quicherat.
Celui-ci
rpondit
:
En faisant
l'acquisition
au
prix offert,
le
dpartement
ne
paiera pas trop
cher
une
pice qui
est incontestablement de
premier
ordre
;
il
s'apercevra qu'il
n'a
pas
fait une mauvaise affaire
ds
que
la Vnus sera
expose
dans un Muse o les
touristes
pourront
la visiter... Citez
l'exemple
de la
376 LA VNUS D'AGEN
ville de
Besanon
qui
donna 30.000 francs il
y
a
quelques
annes
pour empcher
d'aller en
Allemagne
un
petit
taureau de
bronze,
trouv dans le
pays, auquel
il
manque
trois
pattes
1.
Le
prfet
conclut
que
le
dpartement
devait
acqurir
la
statue,
voter un crdit de 4.000 francs
pour l'achat,
plus
200 francs
pour l'emballage
et le
transport.
Le Conseil
gnral
s'tant runi le 7
septembre 1877,
le
rapporteur
de la commission
d'administration,
M.
Sarrette,
dput,
conclut au
rejet
du crdit de
4.200 francs
parce qu'il n'y
a
pas
encore de Muse
et
qu'on
ne saurait o mettre la statue.
Le vicomte
Olivier de
Lupp,
conseiller
gnral
du Mas et
propri-
taire du chteau de
Revenac,
tout
proche
du
Brgnet,
combattit cette conclusion
et,
faisant valoir la beaut
de
l'oeuvre,
le
danger qu'elle passt
l'tranger, plaida
chaleureusement la cause de l'achat. Une
longue
dis-
cussion
s'engagea. Finalement,
et en
considration
du
fait
que
le Muse existait
dj
en
germe, grce
l'ini-
tiative de la Socit
Acadmique,
les conclusions de la
commission furent
rejetes
et le crdit de 4.200 francs
fut vot avec cette addition : Le choix du local
demeure rserv et il
y
a lieu de laisser au
prfet
le
soin d'assurer le
dpt provisoire (de
la
statue)
la
Prfecture,
jusqu'au jour
o le Muse
pourra
la rece-
voir.
Ds
lors,
la Socit des
Sciences,
Lettres et Arts
prit
l'affaire en mains. Par les soins de MM.
Magen, Tholin,
Marraud, etc.,
le
propritaire
reut
les 4.000
francs,
et la
statue,
transporte
Agen,
fut immdiatement
installe au
Muse,
devenu
depuis
Muse
municipal.
Mais la Vnus
n'appartient pas
la ville
d'Agen ;
elle est
proprit
du
dpartement, qui
l'a seulement
1. Ce bronze est
reproduit
dans le
Rpertoire
de la
statuaire,
t.
II,
p. 730,
n 5.
LA VNUS D'AGEN 377
dpose
au
Muse,
dont elle est
considre,
juste
titre,
comme le
plus
bel ornement 1.
IV
2
La Vnus
d'Agen
est
sculpte
dans un beau marbre
blanc
grain
fin et
compact
3,
dont il est difficile de
dterminer la
provenance.
Ce n'est
pas, quoi qu'on
en
ait
dit,
du
pentlique;
mais on
peut
hsiter entre un
marbre italien
(Carrare)
et un marbre de la
rgion pyr-
nenne
(Saint-Bat).
La mme incertitude
pse
sur une
partie
des
sculptures qui
ont t dcouvertes aux
Martres-Tolosanes 4. Pour ma
part, je
crois la
prove-
nance italienne
plus
vraisemblable.
Ds la dcouverte de la
statue,
on se
proccupa
d'en
restituer
le motif. Trois
hypothses
furent successive-
ment mises : 1 la
figure
tenait une
coupe
et une
aiguire;
ce serait une
Hb;
2 elle tenait un miroir
de la main
gauche
et
pressait
ses cheveux de la main
droite
;
3 elle
pressait
ses cheveux des deux mains.
A mon
avis,
ces trois
hypothses
sont
galement
mal
fondes;
il faut les examiner successivement.
1 La
premire
est due
Quicherat
5
:
L'ajustement
du
personnage, qui
consiste en un
pallium
retenu
sous l'aisselle
gauche
et laissant le devant du
corps
1. Pendant l't de
1906, je reus
la visite d'une
party
d'automo-
bilistes
anglais
et amricains
qui
venaient de voir la Vnus
Agen
et
m'annonaient obligeamment
sans savoir
qu'il y
en et un
moulage
Saint-Germain
qu'Agen possdait
une autre Vnus
de Milo. L'un des admirateurs de la statue tait le
critique
d'art
bien
connu,
M. B. Berenson.
2.
[Revue archologique,
1907, II, p. 245-303.]
3.
Tholin,
Bull, de la Soc. des
Antiquaires, 1877, p.
100.
4. Cf.
J oulin,
Etablissements
gallo-romains
de la
plaine
de
Martres,
1901, p.
95 et
suiv.; Esprandieu,
Recueil des
bas-reliefs
de la
Gaule,
t.
II, p.
29.
5. Rev. des Soc.
savantes, 1879, I, p.
324.
378
LA VNUS D'AGEN
presque
compltement
nu,
a fait
prendre
cette statue
pour
une statue de
Vnus, quoique
son attitude ne soit
celle d'aucune des
reprsentations
connues de Vnus.
Le bras
gauche,
tout fait
pli,
dnote
que
la main
qui
tait au bout tenait dress
quelque
chose comme une
coupe,
tandis
que
le
mouvement du bras
droit,
accus
par l'paule, justifierait
trs bien la
supposition que
le
personnage
avait une
aiguire
dans l'autre main. La con-
clusion serait
que
la divinit du Mas
d'Agenais
est une
Hb
plutt qu'une
Vnus. J e livre cette ide
pour
ce
qu'elle est,
c'est--dire
pour
une
simple conjecture.
Quicherat
avait raison de faire des rserves. Le motif
qu'il
a
suppos
n'est
pas antique;
il
jne
se trouve
gure
que
dans l'cole de Canova. Du
reste,
les traces de che-
veux sur le bras
gauche,
dont il sera
question plus bas,
dispensent
de toute discussion ce
sujet ;
2 tudiant la mme statue en
1877,
M. Max Colli-
gnon
crivait
1
:
Il est
peine
besoin de dterminer le
nom
qu'il
convient de lui attribuer. On reconnatra
premire
vue une Vnus tenant un miroir de la main
gauche et,
de la
droite,
arrangeant
les boucles de sa
chevelure. Ce marbre offre de
grandes analogies
avec
deux
statues,
l'une trouve Arles
(Clarac, 342, 1307),
l'autre,
sans indication de
provenance,
conserve au
Muse du Louvre
(Clarac,
342,
1315)
. Il
s'agit
de la
clbre Vnus
d'Arles,
dont il existe deux
rpliques,
l'une
exhume
prs
du thtre d'Athnes
(le
torse seule-
ment)
2,
l'autre au Louvre et
provenant,
comme l'a
montr rcemment M. Arthur
Mahler,
de la collection
Cesi
Rome 3. Rien ne
prouve que
la Vnus d'Arles doive
1. Mm. de la Socit
archologique
de
Bordeaux,
t. IV
(1877), p.
8.
2.
Brunn-Bruckmann, Denkmler,
n 300 A.
3.
Mahler,
Revue
archol., 1902, 1, p.
301 et
pi.
12
; Michon, ibid.,
1903, I, p.
39. Cf. mon Recueil de
ttes, p. 144,
o
j'ai
rapproch,
peut-tre
tort,
la Vnus d'Arles de l'Eirn de
Cphisodote ;
l'cartement des seins,
par rapport
leur
diamtre,
est fort diffrent
dans ces deux statues.
LA VNUS D'AGEN 379
tre restitue avec un miroir la main. M. Mahler a
donn des raisons
pour y
reconnatre une Fileuse
(la
Katyouaa
de
Praxitle1).
J e
crois,
cause de l'existence
de deux
rpliques
et du travail sec de la
draperie, que
l'original
tait en bronze.
M.
Mommja
a suivi M.
Collignon
: Concluons
que,
selon toutes les
probabilits,
la Vnus du Mas tait une
Aphrodite
sa
toilette, ajustant
sa coiffure de la main
droite et se mirant dans un miroir
que
soutenait sa
main
gauche
2
.
Si l'on
essaye
de restituer ainsi la
statue,
on
s'aperoit
que
le miroir
suppos
serait
beaucoup trop prs
du
visage;
en
outre,
comme nous le
verrons,
le mouvement
attribu au bras droit est inadmissible
;
3 En
1885,
aprs
avoir cart
l'opinion
de
Quicherat,
M. Tholin
s'exprimait
ainsi 3:
J 'ai constat une
singulire
ressemblance entre la
statue du Mas et une Vnus sa toilette du Muse de
Naples (n
280 du
Catalogue),
statuette en marbre
trouve
Pompi.
La tte est
penche
en
avant;
les
deux mains sont
appliques
l'arrangement
de la cheve-
lure,
ce
qui
donne aux bras le mme mouvement
que
nous
remarquons
dans la statue du Mas .
J 'ai moi-mme inclin vers
l'opinion
de M. Tholin
quand j'ai qualifi
la Vnus du Mas
d'Anadyomne*.
Mais,
en tudiant de
plus prs
le
moulage, je
me suis
assur, par
l'tat du marbre au-dessous de l'aisselle
droite,
que
le bras droit ne devait
pas
tre
relev,
mais
abaiss. Il me semble certain
qu'il
se
portait
vers le
milieu du
corps, pour
retenir la
draperie
et
l'empcher
de
glisser;
le mouvement
en avant de la cuisse droite
1.
Mahler.
Papers of
the American School in
Rome,
t.
I, p.
142.
2. Revue de
l'Agenais, 1901, p.
202.
3. Bull,
monumental, 1885, p. 5,
en note.
4. La Vnus
d'Alesia,
lecture faite la sance
publique
des
cinq
Acadmies,
25 octobre
1906, p.
2.
380 LA VNUS D'AGEN
rpond
la mme
proccupation.
Ce
geste
se trouve
parfois
dans des statues
d'Aphrodite qui n'appar-
tiennent
pas
au
type
des
Aphrodites pudiques,
mais leur
ont
emprunt
ce motif 1. J e me
figure
ainsi
l'Aphrodite
o
plutt l'Amphitrite
de
Milo,
le bras
gauche
tendu
tenant le
trident,
le bras droit ramen vers la
draperie
et
prt
la
saisir,
comme dans la restauration en
marbre
expose
au
jardin royal
de
Stuttgart
2.
V
M.
Mommja,
conservateur du muse
d'Agen,
a bien
voulu
communiquer
au Muse de Saint-Germain trois
fragments
de marbre dcouverts dans le mme
champ
que
la
statue;
ils ont t mouls
par
M.
Champion
et
considrs avec toute l'attention
qu'ils
mritent. J e
donne ici les conclusions de cette tude.
Un
petit fragment
du bras droit
s'y ajustait
avec une
exactitude
parfaite.
Ce
fragment
est
important,
car,
la
partie
interne,
on
y
voit la trace indiscutable d'une
boucle de cheveux
;
cela
prouve que
la main
gauche
de la
Vnus,
loin de tenir un
miroir, pressait
une
boucle de cheveux
qui
se
prolongeait
au del du sein.
Les deux autres
fragments
sont ceux d'un
visage
trs
mutil avec la
partie suprieure
du cou et d'un
occiput
couvert de cheveux. L'un et l'autre sont des
pices
de
rapport qui
taient
ajustes
suivant des sections
planes,
travailles assez
grossirement
l'outil
;
au milieu de la
premire
est creus un trou
qui parat
moderne et s'ex-
plique par
un essai de restauration.
Il a
dj
t
question
de ces deux
morceaux, signals
par
M.
Tholin;
ce
sont, dit-il,
deux
fragments
d'une
1.
Rpert.
de la
statuaire,
t.
I, p. 322,
1 et 2
;
t.
III,
p.
104,
7.
2. Revue
archol., 1906, I, p.
201
[plus
haut,
p. 353].
LA VNUS D'AGEN 381
tte
qui
ne
s'ajuste pas
exactement la statue . J e
sais,
par
M.
Mommja, qu'une
restauration de la tte
de la
Vnus,
l'aide de ces
morceaux,
avait t tente
au muse
d'Agen.
Des deux
fragments
dont vous avez
les
pltres,
m'crit M.
Mommja,
on avait
compos
une
tte
qu'on
avait
complte
avec du
mastic...;
c'tait
une relle horreur.
Une
exprience
faite au Muse
de Saint-Germain nous a convaincus
que
M.
Mommja
a
raison, qu'une
tte
compose
l'aide des deux
frag-
ments en
question
ne
peut qu'tre
horrible . En
effet,
ils
appartiennent
sans conteste deux ttes
diffrentes;
si l'on
superpose
le second morceau au
premier,
non
seulement il
n'y
a
pas
raccord,
mais le haut de la tte
est
beaucoup trop dvelopp pour
le
visage.
Le mieux
donc est de
ngliger
dfinitivement le second
fragment.
Quant
au
visage
mutil,
M. Tholin
pensait qu'il
pouvait
tre le reste d'une restauration de la statue
faite
l'poque
romaine. Cette
opinion peut
et
pourra
toujours
se soutenir
; pourtant,
la
prsence
d'une sec-
tion
plane,
caractre
souvent
signal
des
sculptures
de
bonne
poque,
m'incline croire
que
nous avons l
un dbris
authentique
de
l'original.
La cassure du cou est telle
qu'il
n'est
pas possible
de
l'ajuster
au torse sans le secours de
pltre ; mais,
dans
la restauration
adopte
Saint-Germain,
les
plans
du
cou et ceux de la
nuque
se suivent souhait et n'offrent
pas
le moindre dsaccord. On
peut
trouver
que
la tte
est un
peu petite pour
le
corps, que
le cou est un
peu
pais pour
la tte
;
c'est affaire
d'apprciation person-
nelle et
d'esthtique.
En
somme,
si la
lgitimit
de la
restauration est
probable, je
ne voudrais
pas
tre
plus
-affirmatif. Le second
fragment,
certainement
tranger
notre
statue,
prouve
qu'il y
avait,
au Mas
d'Agenais,
plusieurs figures
de marbre de dimensions
analogues
(environ
les
2/3
de la
grandeur naturelle) ;
s'il en exis-
tait
deux,
il
pouvait y
en avoir trois ou
davantage,
et
382
LA VNUS D'AGEN
le
visage
utilis dans notre restauration
pouvait appar-
tenir une troisime
figure.
Le doute ne
s'impose pas,
mais il est
permis
1.
VI
Nous avons vu
que
le motif des bras de la Vnus du
Mas est
rare,
mais non sans
exemple;
celui de la
drape-
rie,
laissant dcouvert la cuisse
gauche,
n'est
pas
non
plus
trs
frquent,
bien
qu'il
s'en rencontre des
spci-
mens
dans la
grande sculpture 2,
notamment dans la
belle
statue, aujourd'hui disparue
ou
dfigure par
des
restaurations,
qui
faisait
partie
de la collection Cesi
Rome au xvie sicle 3.
C'est un
grand
honneur
pour
la statue du Muse
d'Agen
d'avoir
suggr,
ds le moment de sa
dcouverte,
certains
rapprochements
avec un chef-d'oeuvre incon-
test de l'art
grec.
Il
y
a
quelque
chose dans la cam-
brure,
dans le mouvement
gnral
du
corps, qui rap-
pelle
le
type
de la Vnus de Milo
, crivait,
en
1877,
M. Tholin 4. Et
ailleurs,
la mme anne
5
: Une
drape-
rie,
retenue entre le coude
gauche
et le
flanc,
contourne
les reins et vient recouvrir entirement la
jambe
droite.
Elle est
peine indique
sur les
parties
saillantes telles
que
le
genou;
elle
forme,
au
contraire,
des
plis superbes
sur les
vides;
les bordures
qui
retombent verticalement
sont
profondment
fouilles. Cet
arrangement
de la
draperie
constitue une ressemblance
6
avec le
type
de la
1.
[J e
dirai
aujourd'hui qu'il s'impose
et
je
ne
reproduits pas
la
statue
complte par
une tte
trop petite pour
elle.
1929.]
2.
Rpertoire,
t.
I, p. 323,
8
;
p. 326,
3
; p. 327,
1
;
t.
II, p. 336,2
et 5
; p. 337,
6
;
t.
III, p. 103,
3 ; Rev.
archol, 1904, pi.
VI.
3. Album de Pierre
J acques, pi.
9 b.
4. Bull,
monumental, 1877,
p.
197.
5. Bull, de la Soc. des
Antiquaires, 1877,
p.
101.
6. On a
imprim par
erreur dissemblance.
LA VNUS D'AGEN 383
Vnus de Milo.
L'analogie
entre les deux statues est
surtout sensible dans la
cambrure,
dans le mouvement
gnral
du
corps. Seulement, pour
la statue du
Mas,
c'est la
jambe
droite
que
le
sculpteur
a donn le mou-
vement
qui,
dans la Vnus de
Milo,
est
report
sur la
jambe gauche.
En
somme,
la statue du
Mas,
vue de
profil
du ct
droit,
rappelle
d'une manire
frappante
notre chef-d'oeuvre du
Louvre,
vu de
profil
du ct
gauche
.
Beaucoup
de visiteurs du Muse
d'Agen
ont
eu la mme
impression
et l'ont
exprime (p. 377).
Il faut bien
dire,
cependant, que
la statue
d'Agen
est
de celles dont la
photographie
tend attnuer les
dfauts. Le torse sinueux et la
draperie
sur le devant
sont vraiment
admirables;
mais la
partie
infrieure de
la
jambe gauche, beaucoup trop grosse,
est mauvaise
;
elle
parat
ne
pas
avoir t
termine,
n'tant
pas
desti-
ne tre vue. Le
dos, qui
ne devait
pas
tre vu davan-
tage (la
statue tait sans doute
place
dans une
niche)
est
simplement indiqu,
d'un travail froid et
plat ;
enfin,
la
partie
infrieure du bras
qui
se relve est
singulirement
lourde. On a
l'impression
d'une bonne
sculpture qui
est l'cho affaibli d'une trs belle scul-
pture, presque
d'un
chef-d'oeuvre;
mais la
qualifi-
cation de chef-d'oeuvre ne convient
pas
la statue
d'Agen.
Cette
rgion
de la Gaule a
fourni,
notamment aux
Martres, beaucoup
de
copies
de statues
grecques
clbres;
je
crois
que
la Vnus du Mas est de ce nombre. Le fait
qu'il
n'en existe
pas
de
rpliques (pas plus que
de la
Vnus de
Milo) prouve simplement,
si l'on admet le
principe pos par
moi en
18971, que l'original grec
n'tait
pas
en
bronze,
mais en marbre
;
le
copiste
travaillait non
d'aprs
un
moulage,
mais
d'aprs
une
petite copie
ou un
dessin,
ce
qui expliquerait
les
imper-
1. Cf.
Cultes, mythes
et
religions,
t.
II, p.
346.
384 LA VNUS D'AGEN
fections de dtail l o son modle ne le
guidait pas
avec
prcision. L'poque
laquelle
appartient l'original
ne
peut
tre antrieure au milieu du ive
sicle,
car il
n'y
a aucun intervalle entre les
seins
1
;
il
y
en a mme un
peu
moins
que
dans la Vnus de Milo et
beaucoup
moins
que
dans la Vnus d'Arles. C'est donc l'cole
de
Praxitle,
non Praxitle
lui-mme, que j'attri-
buerais
l'original
en
question.
Vouloir
prciser
davan-
tage
serait
chimrique ;
je
me serais mme abstenu
de
prononcer
le nom de Praxitle si le model de la
draperie,
avec ses beaux effets de lumire et de clair
obscur,
ne faisait
songer
un des
plus
admirables mor-
ceaux de la
sculpture antique
: la
draperie
la
gauche
de l'Herms.
1. Voir
Comptes
rendus de
l'Acad., 1907, p.
228.
XVIII
RECHERCHES SUR LA VNUS DE MDICIS
1
La Vnus dite de
Mdicis,
ornement de la Tribune
des
Ufpzi
Florence,
a t
publie pour
la
premire fois,
en
1638,
dans le recueil des
statues du
Bourguignon
Perrier
(pi. 81-83,
face et
profil2).La partie suprieure
de la base
est
rapidement indique
sur la
planche 81,
mais on
n'y distingue
aucune trace
d'inscription.
La table
imprime
la fin du volume
(qui
est
dpourvu
de
texte)
dsigne
ainsi la statue : Venus
Aphroditis
in hortis
Mediceis.
En
1679,
une
gravure
de la Vnus
parut
dans la
Teutsche Akademie de
Sandrart;
ce dernier
ayant quitt
l'Italie avant
1635,
son dessin est
peut-tre
antrieur
celui dont Perrier a fait
usage.
Entre 1677 et
1679,
la
statue fut
transporte
de Rome Florence
par
les
soins de Cosme III de Mdicis.
La base de la Vnus de Mdicis
prsente
un
profit
ondul et
porte l'inscription
suivante :
, . KAEOMENHi:. AnOAAOAPOT
W
AOHNAIOi; EIQESEN
La modernit de cette
inscription
a t reconnue
par
Gori;
elle est d'ailleurs
grave
sur
un
morceau de marbre
moderne, qui
est comme
l'enveloppe extrieure,
trs
soigneusement rajuste,
d'une base
plus petite
et de
1.
[Mlanges
G.
Perrot, 1903, p. 285-290.]
2. F.
Perrier,
Icnes et
segmenta
nobilium
signorum, Rome,
1638.
S. REINACU 25
386 RECHERCHES SUR LA VNUS DE MEDICIS
forme
irrgulire
sur
laquelle reposent
les
pieds.
L'ou-
vrage
de Gori
(Musum Florentinum, 1731)
est le
premier
o il en soit fait mention.
Le Muse du Louvre
possde
une fonte de la Vnus
de Mdicis excute
par
J .-B. et J -.J . Keller
pour
Louis
XIV,
en 16871. Sur la
base,
de mme forme
que
celle de la statue de la
Tribune,
on lit :
m
KAEQMENHC AIIOAAOAQPOV
[U)
AOHNAIOO EnOIEI
MM. Michaelis et Schoene se sont demand si cette
inscription
n'avait
pas
t
grave aprs coup.
Une tude
attentive du bronze du Louvre ne laisse aucun doute
cet
gard. Lorsque
la statue a t
fondue,
la base ne
devait
porter
aucune
inscription ;
celle
qu'on
lit sur le
bronze n'est
pas
venue la
fonte,
mais a t incise
l'outil en lettres trs
profondes,
trs nettes et sans
style
2.
Cette
inscription
n'a
pas
t
imagine
Paris. Le
premier ouvrage imprim
o elle
paraisse
est le recueil
de statues de
Bishop (Episcopius), publi
vers 1671
;
la statue
y
est
grave
sous
plusieurs
faces
(pi. 47-50),
avec un texte
reproduisant l'inscription
a. M. Michaelis
l'a
galement signale
dans le
Diary d'Evelyn,
la
date du 29 novembre 1644.
En
1887,
Kaibel
3
appela
l'attention sur un feuillet
de manuscrit
ligorien
conserv
Turin,
o est
reprsent
un herms
d'Eros,
soi-disant trouv sur le mont Cac-
lius,
avec
l'inscription
:
EPQS TIANTAMATQP
(phallus)
KEOMENHS
W
AlIOAAOAUPOr A8HNAI0S
EIIQIXEN
1. Cf.
Clarac,
Revue
archol., 1846, p.
138.
2. Voir les fac-simils des deux
inscriptions
dans
Loewy, Inschrif-
ten
griechischer BUdhauer, p.
341.
3.
Kaibel, Herms,
t.
XXII, p.
153;
cf.
Inscript.
Graec. Ital.
(1890),
p. 16*,
n 143*.
RECHERCHES SUR LA VNUS DE MEDICIS 387
Le faussaire
Ligorio
florissait vers 15601. Entre cette
inscription
et les deux
signatures
a et
6,
il existe une
parent
vidente : ou bien
Ligorio
a connu et imit
l'inscription
de la Vnus de Mdicis
;
ou l'auteur de cette
dernire
inscription
s'est
inspir
d'un faux de
Ligorio ;
ou, enfin,
il existe une source commune
des
trois textes
a,
b et c. On
remarquera que
c est bien
plus
voisin
de b
que
de
a,
puisqu'on lit,
dans b et
c,
KAEOMENHS
(a, KAEQMENHC)
et les formes
EnQESEN,
EIIQI2EN
(a, EIIOIEI).
Du fait de la
publication
de
Kaibel,
il rsultait
que
b,
connu
seulement
depuis 1731,
avait
pu
exister ds
1560 : l'EIIQEZEN de
b,
mal
lu,
pouvait suggrer
Ligorio
le barbarisme
EIIQIXEN. On en vint mme
penser que Ligorio
tait l'auteur de b comme de c
;
mais
qui
donc lui aurait donn le nom de l'artiste ath-
nien
Clomne,
fils
d'Apollodore?
Mon
jeune
et savant ami
Seymour
de Ricci a
dpouill
la
Bibliothque
de Bruxelles un manuscrit de Phi-
lippe
de
Wingbe,
mort Florence en
1592, qui
est
la
copie
d'un recueil
d'inscriptions grecques
de
Rome,
copies
vers 1590
par
J ean l'Heureux dit
Macarius,
mort en 1614. On
y
lit
(fol. 7, verso)
: In basi
pulcherr.
Veneris in hort. Med. :
KAEDMENHE
, AnOAAOAOPOY
(sic)
w
A0HNAIOE
EIIGEEEN
Le texte de d est conforme celui de b
(sauf
la faute
AxoAoopou) ;
mais il
comprend quatre lignes
au lieu de
deux. Il en rsulte
que,
vers
1590,
la Vnus de Mdicis
tait
pose,
dans les
jardins
mdicens
Rome,
sur une
base
portant
la
signature
de Clomne. Cette
signature
1. Il mourut en 1593
(cf. Corp.
inscr.
lat.,
t.
VI, p. LI).
388 RECHERCHES SUR LA VENUS DE MEDICIS
a t connue et imite
par Ligorio
vers
1560(c).
Rien ne
permet
d'affirmer
ni
que l'inscription
rfsoit un
faux,
ni
qu'elle
soit la
signature
de l'auteur de la Vnus
;
cette
base
pouvait appartenir
une autre statue. Dans la
suite,
elle
s'gara
ou fut dtruite
;
Florence,
on fit
pour
la
Vnus une
plinthe
nouvelle
et,
postrieurement
1687,
on
y grava
en deux
lignes
le texte de
d,
sans doute
d'aprs
une ancienne
copie.
Sur la fonte de
Keller,
on
reproduisit l'inscription
a,
dj
donne
par Bishop
en
1671, d'aprs
une
copie
altre et soi-disant
corrige.
On
pourrait supposer que l'inscription
d,
la seule
dont l'authenticit soit
avre,
tait
grave
sur l'an-
cienne
plinthe
de la
Vnus, qui
a t insre dans la
plinthe
nouvelle;
mais la
disposition
du texte sur
quatre lignes
n'est
pas
favorable cette
hypothse.
On
pourrait
aussi
penser qu'elle
tait
grave
sur le
tronc d'arbre servant de
support, qui,
la
rigueur,
pouvait
tre
qualifi
de basis
par
Macarius
1
;
mais c'est
l une
simple possibilit.
Le fait
que
la Vnus de Mdicis n'est
reproduite
dans
aucun des recueils
archologiques
du xvie
sicle,
tels
que
ceux de
Lafrrie,
de
Cavallieri,
de
Vaccarius 2,
semble
prouver
d'une manire absolue
qu'elle
n'exis-
tait,
avant son
transport
dans les
jardins
Mdicis, qu'
l'tat de
fragment.
Cette
opinion
diffre de celle
qu'ont
accrdite les recherches de M. Michaelis
3
et a
besoin,
en
consquence,
d'tre
justifie.
Deux textes
(du Prospettivo
milanese* et
d'Albertini)
mentionnent,
en 1500 et en
1510,
des statues
antiques
au
palais
Dlia Valle Rome. En
1513,
lors de la
proces-
1. On trouve la mme confusion dans une lettre en italien de Brest
Gerhard au
sujet
de l'Herms de
Milo, aujourd'hui
Berlin
(Loewy,
op.
I, p. 250).
2. Cf.
Michaelis,
Archseol.
Zeit., 1880, p.
13.
3.
Voir,
en
particulier,
l'article de ce savant dans la
Kunstchronik,
1890, p.
297.
4. Atti dell' Accad. dei
Lincei, 1875-76, p.
39.
RECHERCHES SUR LA VENUS DE MEDICIS 389
sion
triomphale
de Lon X du Vatican au
Latran,
on
avait
dress,
devant le
palais
de
l'vque
Andra dlia
Valle,
un arc de
triomphe
orn de statues
antiques
;
dans le
nombre,
on cite une
Vnus, que
M. Michaelis
identifie la Vnus de Mdicis. Pour tre
employe
de la sorte l'ornement d'un
arc,
devait-elle
vraiment,
comme le
suppose
M.
Michaelis,
tre entire? La
conclusion
ne
s'impose pas,
et l'on
peut
aussi admettre
qu'il s'agit
d'une statue toute diffrente.
En
1550,
dans la cour du
palais
Dlia
Valle,
alors
habit
par
Quinzio
de'
Rustici,
Aldroandi
signale
une
statue de Vnus
(p. 212)
: Nel
frontispizio
a man dritta
una Venere
ignuda quando nacque
dlia
spuma
del
mare
;
onde ha un
delfino appresso
con la
spuma
in
bocca,
che
questa fittione
accenna. Ce texte vise videm-
ment une statue du
type
de la Vnus de Mdicis
;
mais
doit-on
en conclure
qu'elle
se
prsentt
ds lors sous le
mme
aspect qu'aujourd'hui?
D'abord,
si la statue avait
t
complte,
on ne l'aurait
probablement pas place
une certaine
hauteur,
nel
frontispizio ; puis, rptons
qu'on
ne
s'expliquerait pas qu'une
statue entire de
cette
importance
et t
nglige par
tous les
graveurs
du
temps.
A
y regarder
de
prs,
le texte d'AIdroandi
n'affirme
pas positivement que
la Vnus ft
accompa-
gne
d'un
dauphin.
Voici comment
je
l'entends : Sur
le
fronton,
main
droite,
est une Vnus
nue,
au moment
o elle nat de l'cume de la mer. C'est cause de cette
lgende que
les artistes
placent auprs
d'elle un
dauphin
avec de l'cume la bouche.
Ainsi,
la fin de la
phrase,
que
l'on a
prise pour
une
description
de la
statue,
n'est
peut-tre qu'un
commentaire
inspir
Aldroandi
par
une des nombreuses
rpliques
du mme
type.
Le dau-,
phin plac
gauche
de la Vnus de Mdicis n'a
point
d'cume la
bouche,
et il
porte
sur son dos
plusieurs
Amours,
dont Aldroandi aurait vraisemblablement
dit
un
mot,
s'il les avait vus. J 'en conclus
que
la statue dont
390 RECHERCHES SUR LA VNUS DE MDICIS
parle
Aldroandi en 1550 tait bien la Vnus de
Mdicis,
mais encore l'tat de
fragment.
En
1584,
les
antiques
des
palais
Dlia Valle et
Capra-
nica furent
acquis par
le cardinal
Fernand de
Mdicis,
qui
les
transporta
la villa Mdicis et dans les
jardins
de cette villa. L'inventaire des statues du
palais
Dlia
Valle
1
mentionne : Una Venere di naturale con tutti
i suoi membri con il
delfino, qui
fut vendue 250 ducats.
Cette statue est certainement la Vnus de
Mdicis, que
Macarius
vit,
quelques
annes
aprs,
sur une base
por-
tant une
inscription
dans les
jardins
Mdicis.
Donc,
entre 1550 et
1584,
la Vnus avait t restaure une
premire
fois. L'indication
prcise
de
l'inventaire,
con tutti i suoi membri con il
delfino,
se
justifierait
d'au-
tant mieux si l'auteur de cette restauration avait
prci-
sment
ajout
les
bras,
les
jambes
et le
dauphin.
Ici
intervient,
l'appui
de ma
thse,
un document
nouveau : c'est le dessin
reprsentant
la Vnus de
Mdicis,
sous trois
aspects, qui figure
la
planche
41 b
de l'Album de Pierre
J acques, sculpteur
Reims 2.
Ce feuillet est dat de 1576. La statue est
figure
sans
bras et le dessin s'arrte mi-hauteur
des*cuisses,
ce
qui
ne
prouve pas que
les
jambes
ne fussent
pas
conser-
ves
jusqu'aux genoux; mais,
si la statue avait t
entire sur un
pidestal,
il est croire
que
l'artiste
champenois
l'et
reproduite
dans son ensemble. Cette
statue est la seule
que
Pierre
J acques
ait dessine de
trois
cts,
de
face,
de dos et de
profil;
c'est donc
qu'il
en
apprciait
le model ferme et
souple, que
son dessin
a d'ailleurs un
peu
alourdi. Si l'on
ajoute
cette
considration
que
la
tte,
avec l'oreille
perce,
est bien
celle de la Vnus de
Mdicis,
on reconnatra
que j'ai
eu
raison,
dans mon dition de YAlbum de Pierre
1.
Documenti,
t.
IV, p.
380.
2. Voir l'dition
que j'ai
donne de cet
album, Paris, Leroux,
1902.
RECHERCHES SUR LA VNUS DE
MDICIS 391
J acques,
d'identifier la statue dessine
par
lui celle de
la Tribune. 11 est vrai
que
la
date, 1576,
n'est accom-
pagne
d'aucune indication de
lieu; mais,
sur les deux
feuillets
prcdents,
40 b et
41,
on voit une tte de
femme de
profil
et la mme tte de
face,
qui parat
bien
tre celle de la Vnus de
Mdicis; or,
la tte de
profil
est
accompagne
de la mention : Valle. En vain all-
.guerait-on que
le
profil
et la face en
question
diffrent
par
certains dtails de la tte de la Vnus de Mdicis
telle
qu'elle
est
aujourd'hui;
ces diffrences
s'expliquent
en
partie par l'imperfection
des
dessins,
en
partie par
le
fait
que
la tte de la Vnus a t audacieusement
racle et
retouche,
notamment vers la naissance des
cheveux. On
distingue
les traces de ce travail de
raclage
mme sur la
photographie
d'Alinari
(n 1332).
Donc,
P.
J acques
a
vu,
en
1576,
la Vnus de Mdicis
;au
palais
Dlia
Valle,
alors
qu'elle
n'tait encore ni
restaure,
ni
pose
sur une
base,
ni
accompagne
d'un
.dauphin.
Si les considrations
qui prcdent
sont
admises,
il
en rsultera cette
consquence imprvue que
les
jambes,
les
pieds,
le
dauphin
avec les Amours
qu'il porte
et le
tronc d'arbre
auquel s'appuie
le
dauphin
sont autant de
restaurations
excutes entre 1576 et 1584.
On admet
gnralement que
le bras droit et la
partie
infrieure du bras
gauche
de la Vnus de Mdicis sont
modernes. Devant
l'original,
au
printemps
de
1902,
il m'a sembl
que
la
partie suprieure
du bras
gauche,
entre le coude et
l'aisselle,
tait
suspecte.
Peut-tre
subsistait-il une trace du
bracelet,
dont on n'attribue-
rait
pas
volontiers l'invention un restaurateur
;
peut-tre aussi,
du
temps
de P.
J acques,
le haut du bras
tait-il en
magasin
et n'avait-il
pas
encore t
rajust
1.
1. Rendant
compte,
dans la Berliner
philologische Wochenschrift
{21 juin 1902, p. 788),
de mon dition de YAlbum de P.
J acques,
M.
Furtwaengler
admet
que
la
planche
41 b de l'Album
reprsente
392
RECHERCHES SUR LA VENUS DE MDICIS
Quant
aux
jambes,
partir
du milieu des
cuisses,
elles ont t tellement retravailles et
repolies qu'il
me semble
impossible
d'en affirmer
l'antiquit.
J 'en
dirai autant des
pieds, qui prsentent l'aspect
de ceux
du Rmouleur et
n'inspirent pas plus
de
confiance,
malgr
l'incontestable
lgance
du dessin. Le
dauphin
et les Amours m'ont sembl absolument
modernes,
ainsi
que
le tronc d'arbre
qui
les soutient.
On
objectera
les cassures et les
raccommodages qui
se voient sur toute la
partie
infrieure de la statue. Les
jambes
sont brises au-dessous des
genoux
et au-dessus
des chevilles
;
la
jambe
droite est brise mi-hauteur
du
mollet;
il
y
a de nombreux raccords dans le
dauphin
et dans les Amours. Mais il faut observer
que
ces rac-
cords sont trs
apparents
et
qu'ils
ont t excuts assez
grossirement
avec du
pltre
;
en
revanche,
il
y
a
d'autres raccords trs
soigns
o la couche de
pltre
interpose
ne
parat pas,
notamment en haut du
bras
gauche
et la cuisse
gauche.
J 'en conclus
que
la
Vnus avait t restaure trs habilement
Rome,
la
fin du xvie
sicle,
mais
que, pendant
le
transport
de
Rome
Florence,
elle se brisa en un
grand
nombre de
morceaux,
qui
furent
rajusts, plus
sommairement
cette
fois,
avec du
pltre.
Du
reste,
la tradition recueillie
par
Sandrart
(1679)
veut
que
la
statue,
au cours de son
voyage,
ait t brise en neuf
morceaux,
et l'on
apprend,
d'autre
part, que
les bras et les mains ont t
restaurs,,
en
1677,
par
Ercole Ferrata 1.
bien laVnus de
Mdicis,
et
ajoute
: J e viens de
m'assurer,
en tudiant
l'original, que
les deux bras ne sont nullement
antiques,
comme l'a
cru M.
Amelung ;
l'avant-bras
gauche
est
antique jusqu'au
coude
;
la
partie
infrieure du bras
gauche
et tout le bras droit sont modernes.
Mais l'avant-bras
gauche
tait
galement
dtach et a t
rajust ;
il se
peut
trs bien
qu'on
n'ait
procd
cette
rparation que post-
rieurement au dessin de P.
J acques.
1.
Loewy, Inschriften griechischer Bildhauer, p. 340,
avec les renvois.
aux textes.
RECHERCHES SUR LA VNUS DE MEDICIS 393
Les savants
qui
ont tudi la Vnus de Mdicis ne
sont
pas
d'accord sur les
parties restaures 1;
mais tous
admettent
qu'elle
a subi
diffrentes
rparations
(Visconti), qu'elle
a t
l'objet
de
raclages,
de
polis-
sages
et d'autres
oprations (Dtschke, Amelung).
M. Michaelis a bien voulu me
communiquer
la
copie
des notes
prises par
lui Florence en 1861.
J 'y
lis
cette
phrase
: Die Fusse sind wohl ohne
Frage ait,
aber
am
wenigsten vollendet,
wohl
infolge
von
Ueberarbeitung.
Cela
signifie que
l'illustre
archologue
a
prouv
d'abord
des doutes sur le caractre
antique
des
pieds
et
qu'il
a
fait effort
pour
se rassurer cet
gard.
J e crois
que
la
premire impression
de M. Michaelis tait la bonne et
que
les
pieds
sont modernes. Mais les
pieds
sont ins-
parables
de la
petite base,
encastre dans la
plinthe
reconnue moderne
par Gori;
et ce
qui
est vrai de cette
base doit l'tre du tronc
d'arbre,
du
dauphin
et des.
Amours.
En
rsum,
il
n'y
a
d'authentique
dans la Vnus de
Mdicis
que
le torse et l'amorce des
bras;
la tte est
antique,
mais retouche et l'on
peut
se demander-
si la statue ne
gagnerait pas
tre
ramene,
du moins
sous
l'aspect
d'un
moulage plac
tout
auprs,
son.
tat d'avant 15762.
1. M.
Amelung (Fiihrer
in
Florenz, p. 46)
dclare restaurs le-
bout du
nez,
le bras
droit,
les
doigts
de la main
gauche,
des morceaux
sous le sein droit et aux cuisses
;
du
dauphin,
la
queue
et la
nageoire
gauche
de devant
;
de l'Eros
suprieur,
les ailes et le mollet
gauche ;-
enfin,
tout le rebord de la base avec
l'inscription
.
2.
[M.
F.
Boyer (C. R.,
de l'Acad.
Insc, 1929,
p.
59)
a cit un
nouveau texte
(1585-1590) qui signale
une Vnus
nue, debout,
la
villa Mdicis
;
l'inventaire de 1590 semble bien viser la statue ds
la^
Tribune.]
XIX
STATUETTE D'APHRODITE
DCOUVERTE DANS LA BASSE-EGYPTE
i
J 'ai
dj plusieurs
fois
appel
l'attention sur les
statuettes en marbre
que
l'on dcouvre en
grand
nombre dans la
Basse-Egypte
2. Ces
sculptures
sont
sorties d'ateliers
grecs
dont l'activit
parat
avoir
t
grande depuis
le 111e sicle avant
J .-C,
sans
que
l'on
puisse
fixer
pour l'instant,
d'une manire
plus
prcise,
la limite
chronologique
infrieure de leur
production.
Ce
qui
est
certain,
c'est
que
les modles
en faveur dans ces ateliers furent ceux de la
grande
statuaire
grecque
du ive
sicle; je
ne connais
pas
de marbres de cette srie
qui reproduisent
des
oeuvres du ve sicle et
je
n'en connais
pas davantage
o se trahisse l'influence des coles de Rhodes ou de
Pergame.
M.
Amelung
a
montr,
en
1897, que
les mar-
briers de la
Basse-Egypte
ont t les imitateurs et les
copistes
de
Praxitle 3;
une collection de statuettes de
cette
provenance
serait une vritable
galerie
de l'art
attique
au ive sicle. C'est une raison de les recueillir
avec soin et d'en fixer le
souvenir,
avant
que
les hasards
du
commerce,
en les
dispersant
travers le
monde,
n'en
aient laiss
perdre
ou altrer l'tat civil.
1.
[Rev.
archjol,
1904, I, p. 374-381].
2.
Ibid., 1903, I, p. 232,
388.
3. Cf. ce
que j'ai
crit ce
sujet
dans mon Recueil de
ttes, p. 144,
:163; 208,
etc.
STATUETTE D APHRODITE 395
La statuette
que reproduit
notre
fig.
71
appartient
M.
Dattari,
au Caire. Elle a exactement un
pied
.
anglais
de haut. Le
possesseur
croit savoir
qu'elle
fut
dcouverte Mithrahine. J 'en dois des
photographies
a 1aimable entremise d un
amateur de
Londres,
M.
J oseph
Offord.
Le travail du marbre est fort
soign.
On
remarquera
toute-
fois la
grosseur
du bras droit
et de la
main,
qui paraissent
un
peu
massifs. A la diff-
rence des
petites copies
de sta-
tues
grecques que
l'on d-
couvre en
Syrie,
celles
qu'on
recueille en
Egypte
ne visent
pas
la
gracilit
et l'l-
gance ;
au
contraire,
les co-
pistes
ont un
peu
alourdi
leurs
modles,
tendance
qui
se
remarque galement
dans
le rendu des
bras,
des cuisses
et des hanches. L'cole des
copistes syriens,
sans doute
postrieure
celle des
copistes
alexandrins,
a d tenir
compte
d'un
changement
dans le
got
de la
clientle, analogue
ceux
qui
se sont
produits plusieurs
fois dans les
temps
modernes. Il
n'y
a
pas plus
loin
d'une
Aphrodite syrienne
une
Aphrodite gyptienne
que
d'une
Vierge
de Botticelli une
Vierge
de
Raphal.
Le bras et la main de la Sainte-Catherine de
Raphal
la National
Gallery
ne sont
pas beaucoup
moins
lourds,
notre
got, que
le bras et la main de
l'Aphro-
dite Dattari.
FIG. 70.
Aphrodite
et ros.
Muse du Vatican.
396 STATUETTE D'APHRODITE
Le
type
de cette
Aphrodite
est voisin de celui de
l'Aphrodite
de
Cnide,
mais il
y
a cette diffrence essen-
tielle
que
la main droite ramne sur le milieu du
corps
une
draperie qui
couvre entirement la
jambe
droite.
En
outre,
les
rpliques permettent
d'tablir
que l'Aphro-
dite,
ainsi
drape
demi,
tait
grou-
pe
avec ros. C'est ce
qu'a parfai-
tement tabli M.
Bernoulli, qui
a dcrit
une
quinzaine d'exemplaires
de ce
type
1.
La
desse, dit-il,
tient de la
main droite une
draperie
devant son
corps;
l'autre extrmit de cette dra-
perie,
qui
couvre la
partie postrieure
de la
figure,
est
passe
sur le bras
gauche qui
est
port
en avant. Sous
ce bras
gauche
est un
ros, qui
semble
s'lever vers la
desse,
tantt
plus
grand, quand
il est
pos
sur le
sol,
tantt
plus petit, lorsqu'il
est sur la tte d'un
dauphin,
et
plus petit
encore
lorsque
le
dauphin
lui-mme a
pour support
un rocher.
A cette
description rpondent plu-
sieurs statues
plus
ou moins restau-
res,
dont la
plus
clbre, plus grande que
nature,
dcore le Belvdre du Vatican
2
(fig. 70).
C'est un
groupe d'Aphrodite
avec
ros, qui parat
avoir t
dcouvert Rome au xve sicle
;
il faisait
dj par-
tie de la collection du
pape
J ules
II,
qui l'exposa
dans
le Cortile du Belvdre.
L'inscription
latine de la
base nous
apprend que
ce
groupe
a t ddi Venus
Flix
par
Sallustia et
Helpidus
:
1.
Bernoulli, Aphrodite, p.
268 et suiv.
2.
Helbig, Fuhrer 2,
n 146
; Visconti,
Mus. Pio
Clem., II,
52 ;
Clarac, 609,
1349
; Bernouili,
Rmische
Ikonographie,
t.
III, p.
107.
Fig.
71
Aphrodite,
statuette de mar-
bre dcouverte en
Egypte.
Ancienne
collection Dattari.
STATUETTE D'APHRODITE 397
Veneri
felici
sacrum Sallustia
Helpidus
d. d. 1.
Visconti a
suppos que
Sallustia et
Helpidus
taient
des affranchis de Sallustia Barbia
Orbiana,
une des
femmes d'Alexandre Svre. La tte de
l'Aphrodite
a
les
apparences
d'un
portrait
et l'on a voulu
y
recon-
natre,
l'aide des
monnaies,
celui de
l'impratrice
Sallustia. Mais la ressemblance a t
conteste,
entre
autres
par
MM. Bernoulli et
Helbig
;
elle
est,
en
effet,
plus que
contestable. Il vaut mieux s'en tenir au tmoi-
gnage
de la coiffure et de
l'inscription, qui
sont d'accord
pour
faire attribuer aux environs de l'an 150 le
groupe
ddi
par
Sallustia et
Helpidus.
Bien
que
le travail en soit trs
mdiocre,
ce
groupe
a
joui, pendant
deux
sicles,
d'une vritable clbrit 2.
C'est de lui
qu'entendent parler
tous les auteurs de
descriptions
de
Rome,
depuis
Fulvius
(1527) jusqu'
Mauro
(1556), lorsqu'ils signalent
la Vnus du Vati-
can . Elle fut
dessine,
entre 1535 et
1538,
par
Martin
van
Heemskerck,
et il est
probable que
Vasari en a
fait mention dans sa Vie de Bramante 3. En 1645
encore,
dans le
Diary
de
l'Anglais
J ohn
Evelyn,
elle est vante
comme une des
pices
rares de la collection.
Le sentiment de tant d'artistes et de connaisseurs ne
les
trompait pas.
Si le travail de la
copie
romaine est
de troisime
ordre,
le motif est vraiment
digne
d'un
grand sculpteur
;
la
petite rplique
Dattari suffirait
d'ailleurs attester
que l'original
doit
appartenir
au ive sicle. Voici ce
que
M. Bernoulli crivait en 1873
(je
traduis
librement 4)
: Si l'on ne
peut
reconstituer
tous les traits de
l'original
et si aucune des
rpliques
ne remonte
l'poque grecque,
il n'en est
pas
moins
1.
Corp.
inscr.
lat., VI, 1,
782.
2.
Michaelis,
J ournal
of
Hellenic
studies, 1887, p.
326.
3.
Vasari, Vite,
d.
Milanesi,
t.
IV, p.
157.
4.
Bernoulli, Aphrodite, p.
273.
398
STATUETTE D'APHRODITE
certain
que
la
composition
de
l'original
nous
est
connue avec
plus
de
prcision que
celle de la
plupart
des
groupes
analogues.
Celui-ci
comprend
deux
figures,
Aphrodite
et
ros,
avec cette
particularit qu'ros
ne
joue pas
un
simple
rle
dcoratif,
mais est associ
sa mre en vue de
quelque action,
sous les traits d'un
mellphbe
et non d'un enfant. Il est
probable qu'il
tait
plac
debout sur un animal
marin,
levant la
main
gauche
;
Aphrodite,
la
jambe
droite
drape,
la
draperie pose
sur le bras
droit,
tournait
lgrement
la tte vers la
gauche,
comme
pour
aller au-devant d'un
dsir
exprim par
le dieu de l'Amour. S'il
existait,dans
les textes
littraires,
une allusion
quelconque
un
pareil
groupe,
rien ne serait
plus
facile
que
de l'identifier
l'original impliqu par
nos
rpliques
; malheureusement,
les textes sont muets. M. Urlichs a bien
rappel,
ce
propos,
le
groupe
de
Scopas
Samothrace,
compos
d'Aphrodite groupe
avec Pothos ou Phathon
;
mais c'est l une
simple hypothse
dont la vrai-
semblance est encore attnue
par
le fait
que
le
groupe prsum parat postrieur
aux
Aphrodites
de
Praxitle.
L'assertion initiale do M.
Bernoulli, que
l'on ne
pos-
sde
pas
de
rpliques grecques
du mme
motif,
n'est
plus
exacte
aujourd'hui.
En dehors de la statuette
Dattari,
on
peut
en
allguer
deux
autres,
dcouvertes
l'une dans la Grce
propre,
l'autre Alexandrie 1.
Une trs belle
rplique fragmente,
connue
par
ma
publi-
cation de l'Album de Pierre
J acques (pi.
9
b),
existait
au xvie sicle Rome dans la collection Cesi. J e ne
sais si l'on a
dj remarqu qu'une Aphrodite
trs
semblable celle
qui
nous
occupe,
mais sans
ros,
tenant sa
draperie
de la main
gauche
et une
phiale
de
la main
droite, parat
dans le
magnifique
tableau de
1.
Rpertoire,
t..
II, p. 336,
2 et 5.
STATUETTE D'APHRODITE 399
Titien au
Prado, L'offrande
la desse des
Amours 1,
dont une
rplique,
avec
quelques variantes,
a fait
partie
de la collection Somze Bruxelles 2.
videmment,
le
grand peintre
de Cadore avait t
frapp,
lui
aussi,
de
la beaut du
motif,
dont il
put
voir Rome
plusieurs
exemplaires,
outre celui
qui porte
la ddicace Vnus
Flix.
Cette ddicace ne nous
apprend pas grand'chose.
Le
culte de Vnus Flix
parat
avoir t mis la mode
par Sylla
et un
passage
de
Plutarque
autoriserait
croire
que l'pithte grecque correspondant
Flix
tait
Eutychs
3
;
mais nous ne savons
rien,
en
Grce,
d'une
Aphrodite Eutychs
et il serait trs
hardi, pour
ne
pas
dire
plus,
de vouloir
justifier
cette
pithte par
l'ide de la mre
heureuse,
par
l'association
d'Aphrodite
avec son fils
dj grand.
Ainsi,
l'on entrevoit
aujourd'hui
avec certitude l'exis-
tence,
au ive
sicle,
d'un
groupe
clbre
reprsentant
Aphrodite groupe
avec
ros;
mais les
archologues
n'ont
pu
nous
renseigner,
ni sur
l'auteur,
ni sur
l'poque
prcise
de
l'original.
J e ne suis
pas convaincu, pour
ma
part, qu'il
doive tre
plac aprs l'Aphrodite
cnidienne,
qui
est de 350 environ avant
J .-C,
car au cours du
proces-
sus
qui,
dans la
premire
moiti du ive
sicle,
dpouilla
successivement
Aphrodite
de tous ses
voiles,
il est
assez naturel de
jDenser que
les
types
demi-draps
sont antrieurs ceux o la desse se montre toute nue.
Comme tous les
chefs-d'oeuvre,
la Cnidienne a une
pr-
histoire;
elle drive d'autres
sculptures
dont les textes
ne nous disent
rien,
mais
qui
sont des lments nces-
saires de la srie
iconographique
dont elle
marque
un des
dveloppements
essentiels.
Pourquoi
Praxitle
1. Archivio
dell'Arte, 1893, pi.
la
p.
284.
2.
Catalogue
Somze.
2e
partie (1904),
n
344, pi.
38.
3.
Plutarque,
De Fort.
Rom., IV, p. 318,
et
Sylla,
19. Cf.
Wissowa,
Religion
und Kult der
Rmer, p.
237.
400 STATUETTE D'APHRODITE
lui-mme n'aurait-il
pas sculpt l'original
de ce
groupe?
J e
puis,
cet
gard, invoquer
un
argument qui,
tout
faible
qu'il est,
mrite de ne
pas
rester
inaperu.
Pline
(XXXIV, 69) parle
d'une
Aphrodite
en bronze de Praxi-
tle
qui
fut
transporte
de Grce Rome et
figura long-
temps
devant le
temple
de
Flicitas,
o elle
prit
dans un incendie sous le
rgne
de Claude
;
elle
tait,
nous
dit-il,
aussi clbre
que
la Cnidienne : Praxiteles...
fecit
tamen ex are
pulcherrima opra... signa quse
unte Felicitatis aedem
fuere Veneremque quse ipsa
sedis
incendio cremata est Claudii
principatu,
marmorese Mi
suse
per
terras inclutse
parem.
Il rsulte de ce texte
qu'une
statue en
bronze
d'Aphrodite, par Praxitle,
tait
place
soit devant le
temple
de
Flicitas,
soit dans
ce
temple
mme
;
mais nous
savons,
d'autre
part, que
l'enceinte du
temple
de
Flicitas,
construit en 151 sur
la Voie
Triomphale par
Lucullus 1,
contenait d'autres
ouvrages
en marbre de
Praxitle,
en
particulier
les
Muses de
Thespies
2. Il est assez naturel
qu'une Aphro-
dite de
Praxitle,
place
dans le
temple
de Flicitas ou
dans l'enceinte de ce
temple,
ait t
qualifie
de
Venus
Flix,
comme l'on a nomm Venus Genetrix
une des statues du
temple
leve Vnus Genetrix
par
J ules Csar
3
; or,
c'est
prcisment
ce nom de
Venus Flix
que
nous lisons sur la base du
groupe
ddi
par
Sallustia et
Helpidus!
Cela
peut
n'tre
qu'une
con-
cidence,
mais il faut avouer
qu'elle
est curieuse et
suggestive.
Cicron dit
que
Mummius enleva de
Thespies
les
Thespiades (que
l'on identifie
aujourd'hui
des
Muses)
et d'autres statues
(cetera profana
ex Mo
oppido),
mais
1. Voir les textes dans 0.
Gilbert,
Geschichte und
Topogr.
der Stadt
Rom. t.
III, p.
106.
2.
Cic, Verr., II, 4,
4
; Pline, XXXVI,
39 et la note de Miss Sellers
sur ce
passage.
3. Cf. S.
Reinach,
Gazette
archologique, 1887, p.
272.
STATUETTE D'APHRODITE 401
qu'il
laissa en
place
l'ros de
Praxitle, qui
fut enlev
plus
tard et
expos
Rome dans les coles
d'Octavie 1.
Or, parmi
les cetera
profana,
il
y
avait une
Aphrodite
de
Praxitle,
statue en marbre
signale par
Pausanias
ct d'une
image
de
Phryn par
le mme
sculpteur
:
VT<xO0a jcswaToO
IIpa^triou 'A'-ppoST'/)
xo
<l>piiv'/]
cmv
EIV.VD,
XL'OOU
y.a
J Opv)
xal
)
Gs2. Nous
apprenons
en
outre,
par
Alci-
phron, que
la
Phryn
tait
place
entre
l'Aphrodite
et
l'ros 3.
Mais,
l'poque d'Alciphron, l'original
de l'ros
ayant
t
transport
Rome,
il avait t
remplac
Thespies par
une
copie
de l'Athnien
Mnodoros,
comme
nous
l'apprend
Pausanias : TVSE V
^s>v 'EpwTa
h
suitia
Ot7](?VA87]Va0 MvjvdSwpO
T
pyOV
X
Ipa^lTXoU fJ U[M)ti|AVO.
Il n'est
gure admissible,
si
l'Aphrodite
en marbre avait
t aussi
remplace par
une
copie, que
Pausanias l'et
ignor
ou n'en et rien dit.
Donc,
cette statue ne
put
tre
parmi
celles
qui figuraient
Rome dans l'enceinte
du
temple
de Flicitas
;
mais
l'Aphrodite
en bronze de
Praxitle, qui
fut consume
par
un incendie au ier
sicle,
pouvait
fort bien
provenir
elle-mme de
Thespies,
puisqu'il y
avait,
dans le mme
temple
romain,
des
statues de la mme ville
grecque,
attribues elles aussi
Praxitle.
Rappelons que Phryn,
le modle et la
matresse de
Praxitle,
tait de
Thespies
et
qu'on y
voyait,
au dire de
Pausanias,
sa statue en
marbre,
de
la main du
grand sculpteur
athnien.
Comme
Thespies
tait clbre
par
le culte
d'ros 4,
il
y
a tout lieu de croire
qu'une image d'Aphrodite,
Thespies,
devait tre associe
ros,
non
pas
l'ros
enfant des
Alexandrins,
mais l'ros
mellphbe
du
ive sicle. La desse et le
jeune
dieu
pouvaient
se faire
pendant,
comme dans le
groupe
en marbre de Praxi-
1.
Pline, XXXVI,
22.
2.
Pausanias, IX, 27,
5.
3.
Alciphr., Epist., frag.
3
(Overbeck, Schriftquellen, 1251).
4. Voir la note de Frazer sur
Pausanias, IX, 27,
1
(t. V, p. 145).
S. REINACn
26
402 STATUETTE D'APHRODITE
tle dont
parlent
Pausanias et
Alciphron
;
ils
pouvaient,
aussi tre troitement
unis,
comme dans le
groupe
dont
l'Aphrodite
Dattari est une
copie partielle.
En
rsum,
ce
que
nous savons de ce
groupe, joint
la ressemblance de la
figure principale
avec
l'Aphro-
dite de
Cnide,
nous incline l'attribuer
Praxitle;,
le fait
que
la
plus
grande
des
rpliques
connues fut
ddie au 11e sicle
aprs
J .-C. Vnus Flix fait
songer
au
temple
de Flicitas
Rome, qui possda plusieurs
oeuvres de
Praxitle,
parmi lesquelles
il
y
avait au moins
une
Aphrodite;
enfin,
l'origine thespienne
des statues
du
temple
de Flicitas et le fait
qu'ros
tait
l'objet
d'un culte
particulier
Thespies peuvent
aussi
suggrer
l'ide
nous ne
prtendons pas
dire
davantage
que
l'original
tait un
groupe
en bronze de
Praxitle, repr-
sentant
Aphrodite
avec ros
mellphbe
et
sculpt;
vers 355
pour Thespies
1.
1. On sait
que
M.
Furtwaengler
a voulu reconnatre
l'Aphrodite-
thcspienne
de Praxitle dans
l'Aphrodite
d'Arles,
dont il
y
a deux
rpliques
au Louvre et une Athnes
;
mais
je
ne crois
pas que
cette
opinion
soit fonde
(cf.
Recueil de
ttes, p. 144).
[Amelung,
dans son
grand catalogue
du Vatican
(t. II, p. 112),
a discut mon
hypothse
et
l'a
repousse
;
mais
je
n'admets
pas
ses-
objections.
1 Les
prtendues rpliques,
d'ailleurs
peu nombreuses,
ne seraient
pas,
proprement parler,
des
rpliques.
D'accord,
mais cela
prouve
seulement
que
le bronze
original
n'avait
pas
t
moul,
mais
copi
au
jug ;
2 Si l'on voulait
postuler
un
original
commun,
il devrait tre en
marbre,
non en bronzo.
J e ne vois
aucune raison
l'appui
de cette manire de voir.
Amelung
me con-
cde du reste
(p. 115) qu'on
a bien
pu qualifier
de Venus
felix
une
Vnus
place
devant le
temple
de
Flicitas; or,
c'est l l'observation
nouvelle sur
laquelle
mon
hypothse
est
btie,
cause du
passage
cit de Pline
(XXXIV 69).
J e ne vois donc aucune raison de
changer
d'avis,
et
je
continue considrer mon
hypothse
comme trs vrai-
semblable.
1929.]
XX
APHRODITE ET ROS
Groupe
de
Myrina
au muse d'Athnes
1
Un
ngociant originaire
de
Crigo, Misthos, qui
avait
acquis
une belle fortune
Smyrne,
acheta vers 1884
une trs
importante
srie de
figurines
en terre cuite
provenant
de la
ncropole
de
Myrina.
Vers
1890,
il
en fit cadeau au Muse National
d'Athnes,
o sa col-
lection fut installe et ouverte au
public
en 18922.
En
1891,
un
archologue
de
passage
Athnes,
dont
j'ai
le
regret
d'avoir oubli le
nom,
obtint la
permission
de
photographier
un certain nombre des
figurines
de la
collection Misthos et m'en adressa des
preuves
titre
confidentiel,
dsirant
que
le nom de Misthos ne ft
pas
prononc.
Dans la sance du 17 avril
1891, je
fus admis
prsenter
l'Acadmie des
Inscriptions quelques-unes
de ces
photographies;
je
dclarai
que
les
originaux pro-
venaient de
Myrina,
mais ne donnai
pas
d'informations
touchant leur
possesseur
3. Le but de ma communica-
1.
[Rev. archol, 1903, I, p. 205-212.]
2. L'installation de la collection Misthos a t
signale
dans leBul-
letin de
Corresp. hellnique,
1893, p.
191
;
cf. mes
Chroniques d'Orient,
t.
II, p.
218. Des
spcimens
de la collection Misthos ont t
publis
par
M. Perdrizet dans les Monuments
Piot,
t. IV
(1897), pi.
XVII
(ephedrkmos), pi.
XVIII
(ttes
de
Smyrne),
Bros et
Psych
sur un
lphant-poney
(p. 212),
femme nue
(Sapho
suivant l'diteur
!)
avec volumen
(p. 213),
Galate
(?)
de
fabrique smyrniote (p. 214).
3.
Comptes
rendus de
l'Acad., 1891, p.
121
;
Rev.
archol, 1891, I,
p.
393
;
Chronique
d'Orient,
t.
II, p.
58.
404 APHRODITE ET EROS
tion tait de
signaler
l'intrt de deux
groupes,
celui
que reproduit
notre
fig.
72 et un
autre,
encore
indit,
qui reprsente
un adolescent ail
parlant
une
jeune
fille,
sur
l'paule
de
laquelle
est
pos
un ros enfant.
Il
y
avait
l,
comme
je
le fis
observer,
une runion
peu
ordinaire des deux
types
attri-
bus
par
l'art
grec
ros,
le
type classique
du
mellphbe
et le
type
alexandrin de l'enfant.
Dans le
premier groupe, je
reconnus naturellement
Aphro-
dite,
arme d'une
sandale,
dont
elle chtie ou dont elle menace
ros. Ce motif n'tait
pas ignor
des anciens
archologues ;
mais
ils n'en
pouvaient
citer
que
deux exem-
plaires,
o la desse
tait d'ailleurs seule
figure.
Le
premier
est une statuette de
bronze dcouverte
Chypre, qui appartint
autrefois M. de Palin
Rome et
qui
fut
publi par Stackelberg
;
on
ignore
o elle se trouve
aujourd'hui
1. La desse est
debout,
toute
nue,
le bras
gauche
abaiss contre le
corps,
tenant de la main droite
leve un
objet qui
ressemble bien une sandale.
Le second monument est une statue de bronze
acquise
Damas, aujourd'hui
au muse de
Dorpat
en Livo-
nie,
qui
a t
publie par
L. Merklin en 18542.
1.
Stackelberg,
Graeber der
Hellenen, pi.
LXXI
;
inde Millier-Wiese-
ler, Denkmler,
3e
d.,
n 285 bet
Rpertoire, II, 346,
4.
2. L.
Merklin, Aphrodite
Nemesis mit der Sandale.
Dorpat,
1854
;
Rpertoire,
t.
II, 346,
6.
Fig.'
72.
Aphrodite
et ros.
Groupe
en terre
cuite,
provenant
de
Myrina,
au Muse d'Athnes.
APHRODITE ET EROS 405
L'attitude de la desse est
analogue,
sauf
que
le bras
droit est moins lev et
que l'objet qu'il
tient
-
du
moins sur la
gravure
de Merklin
ressemble moins
une sandale. On
n'avait
pas
tard
rappeler,
ce
pro-
pos,
le
passage
de Lucien o
Aphrodite
dit
qu'elle
a
frapp
ros avec sa
sandale,
en
spcifiant
la
partie
du
corps
sur
laquelle
avaient
port
ses
coups
1. Merklin
prtendit,
il est
vrai, que
c'tait l une invention du sati-
rique, qu'il s'agissait,
en
ralit,
de
Nmsis,
dans les
mains de
laquelle
une sandale tait le
symbole
du
pied,
c'est--dire de la mesure
(!) ;
mais Blmner et Frie-
derichs lui
objectrent
avec raison
qu'une conception
si
profonde
aurait revtu une forme
plus
solennelle 2;
Hubner et Bernoulli se
rangrent
l'opinion
de Friede-
richs 3.
En
1859,
Ch. Lenormant avait
signal
en
passant,
et
sans
expliquer
ce
qu'il
entendait
par l, l'importance
symbolique
de la sandale dans la main de Vnus :
On
ne saurait laisser
passer
sans
remarque (il s'agit
d'un
vase
peint)
la chaussure
enveloppant
tout le
pied que
porte
ici Vnus. La chaussure de cette desse est clbre
dans les traditions de l'Orient. Parmi les
types
varis
qu'offrent
les Vnus nues en
bronze,
dcouvertes
depuis
quelques
annes Tortose de la
Syrie,
et
envoyes
suc-
cessivement en
France,
o elles ont fait l'intrt domi-
nant de
plusieurs
ventes
d'antiquits,
on
remarque
la
figure qui
tient une sandale dans une de ses
mains;
on en voit un bel
exemplaire
dans la collection de
M. le vicomte de J anz. Sur la chaussure de
Vnus,
voir les
mythographes,
surtout
Hygin,
Poet.
Astron.,
1.
Lucien,
Dial.
Deor.,
XI :
"IIT)
SExal
irX]i
<XT VSTEIV<X t
Truy
TcravoXco.
2. Bliimner. Arch. Stud. zu
Lukian, p.
71
; Friederichs,
Berlin s
antike
Bildwerke,
t.
II, p. 393,
n 1843.
3. E.
Hubner,
Archol.
Zeit., 1870, p. 92, pi.
38
; Bernoulli, Aphro-
dite, p.
352.
406 APHRODITE ET EROS
I,
161 . A la suite de Ch.
Lenormant,
Bachofen
2
et
Fr. Lenormant
3
exprimrent
l'avis
que
la sandale tenue
par Aphrodite exprimait quelque
ide du
symbolisme
oriental. Wieseler n'a
pas
cru inutile de discuter cela.
Il convient
que
les deux seules
figures
lui connues
d'Aphrodite
la sandale
proviennent
l'une et l'autre
de l'Orient hellnis et
qu'il
en est de mme des sta-
tuettes indites
signales par
Ch. Lenormant.
Toutefois,
ajoute-t-il,
cette circonstance
n'oblige
nullement
chercher dans le
symbolisme
oriental une
explication
de la sandale. Dans la statuette de
Dorpat,
la sandale
qu'lve
la desse est bien la
sienne, parce qu'elle
a
exactement la dimension de son
pied
4.
Se trouverait-
il
aujourd'hui
un
archologue pour
discuter srieuse-
ment ces rveries?
A ct de ces deux ou trois
figures d'Aphrodite
la
sandale,
on en connaissait
quelques
autres o la desse
nue,
dans la mme
attitude,
tient de la main droite un
objet
assez
indistinct, qui
ressemble une
grosse
ban-
delette
replie.
Hubner en
publia une,
dcouverte
Alexandrie,
en 18705 et
exprima l'opinion qu'elle repr-
sentait
Aphrodite
menaant
ros ou Mars avec une
couronne ou une bandelette
qu'elle emploie
comme
lanire,
motif de
genre
dcrit dans le
petit pome
de
Reposianus
6
:
Verbera
saepe
dolens mentila est dulcia serto.
1. Lenormant et de
Witte,
Elite des monuments
cramographiques,
t.
IV, p. 109-110,
texte et note.
2.
Bachofen,
Die
Sage
von
Tanaquil, p.
57
(cit par Wieseler,
texte
des
Denkmdler, p. 429).
J e n'ai
pas
vrifi le
passage.
3. Fr.
Lenormant,
Gazette
archol.,
1877
(III), p.
148.
4.
Wieseler, op. laud., p.
430.
5. Archol.
Zeitung, 1870, pi.
38
; Friederichs-Wolters, Gipsabgilsse,
n 1740
; Rpertoire,
t.
II, p. 346,
1. On
trouvera,
sur la mme
page,
quatre figurines analogues.
6.
Reposianus,
De concubitu Marlis et
Veneris,
v. 80
(Riese,
Anthol.
Lat., p. 253).
APHRODITE ET l'.OS 407
Stephani, qui
avait le
gnie
de la ce
lradiction,
ne
voulut
point
entendre une
explication
aussi
simple
1
:
Il m'a
toujours
sembl
plus
vraisemblable
que
les
auteurs des deux statuettes de
bronze,
reprsentai;';
une femme nue
menaant
avec i:nc
sandale,
ont
son^
Omphale
et
non,
comme on l'a
gnralement suppo ;,
Aphrodite.
Car, videmment,
aux
yeux
des
anciens,
littrateurs et
artistes,
cette action tait
caractristique
d'Omphale
2,
alors
qu'elle
n'est
indique pour Aphrodite
qu'une fois,
et cela
par
allusion au chtiment ordinaire
inflig par
les mres leurs enfants 3. Les nombreux
monuments
qui reprsentent Aphrodite corrigeant
son
fils offrent
toujours
des motifs tout diffrents 4.
La nudit
complte d'Omphale
n'a rien
qui rpugne
son caractre
mythologique ;
la
peau
de lion et la
massue sont ici suffisamment
remplacs,
comme attri-
buts
caractristiques, par
la sandale.
D'aprs
cela il
faudra aussi rectifier
l'interprtation
de deux autres
statuettes de bronze
5
o la sandale est
remplace par
un autre attribut encore
inexpliqu, probablement
une
iro6u[x,
qui
ne conviendrait
pas
moins
Omphale.
Ce
qui
suffit ruiner
l'hypothse
de
Stephani,
c'est
que
nous ne connaissons
pas
un seul
exemple
de cette
prtendue Omphale nue, frappant Hercule, qui
soit
1.
Stephani, Compte
rendu
pour 1870-1871, p.
193.
2.
Lucien,
Dial.
Deor., XIII,
2 :
i:a.td|ievo
TT
TTJ <; 'OpicpXrjXP'J <T>
cavSXco.
Lucien, Quom.
conscr. sit
hist.,
10 :
TOxipiEvov
vizb
-rij
'0[icpXT]
TQ
<7av5aXik>,
Trence, Eunuch., V, 8,
2 : Hercules servivit
Omphalae
Utinam tibi
commitigari
videam sandalio
caput.
Il
y
a
peut-tre
une allusion
Omphale
dans YAnthol.
Palat., X, 55,
5 : el
8',
o
cravSaXiip, tp/j, T'J -iTojJ iat,
etc.
(rsum
de la note de
Stephani).
3. Sur cet
usage, J ahn,
ad
Pers., V,
169 et Schs.
Sitzungsber.,
1855, p.
224.
Stephani
ne connaissait
qu'un exemple figur,
Vasens.
der
Ermit.,
n 875.
4. Annali dell'
Instit.,
t.
XXXVIII, p.
90 et
Bull., 1871, p.
181.
5.
Hertz,
Catal.
of
the collection
of antiq., p. 130, pi.
2
;
Arch.
Zeit., 1870, p. 92, pi.
XXXVIII.
408 APHRODITE ET EROS
dsigne
comme
Omphale par
la massue et la
peau
du
lion
;
dire
que
la sandale tient lieu de ces attributs et
suffit faire connatre la matresse
d'Hercule,
c'est
proprement
se
moquer.
En
1894, publiant
le
Catalogue
raisonn des Bronzes
du Muse de
Saint-Germain,
j'ai
dcrit sous le n 45
un bronze
analogue
celui d'Alexandrie et
j'ai rpt,
ce
propos,
les observations de
Hubner, que je
continue
croire
judicieuses.
J e n'ai
pas manqu d'allguer
le
groupe
indit de
Myrina
l'appui
de
l'interprtation
admise
par
ce savant 1.
M. de Ridder m'a donn tort. Il a fait
connatre,
en
1900,
une statuette en bronze dcouverte
Athnes, qui
reprsente Aphrodite
nue tenant une sandale
pointe
fourchue de la main droite leve 2. Il connaissait le
groupe
Misthos et la mention
que j'en
avais faite en
1891
;
mais il n'admettait
pas que l'Aphrodite
debout
tenant une sandale ou une bandelette leve
pt
tre
considre comme faisant un
geste
de menace. Il
n'y
a rien
tirer, crit-il,
du
tmoignage
tardif de
Reposianus
cit
par
Hubner.
A
quoi j'objecterai que
ce
tmoignage
ne vaut
pas
moins
pour
tre tardif et
que,
d'ailleurs il n'est
pas isol,
car on lit dans la
VP
J dylle
d'Ausone
(v. 88)
:
... roseo Venus aurea serto
Maerentem
puist puerum...
Remarquons que pulsare
est sans doute
l'expression
consacre dans le vocabulaire des corrections fami-
lires,
car l o Ausone dit serto...
puist,
on lit dans
J uvnal solea
pulsare notes,
et le
complment
direct de
pulsare,
dans ce dernier
passage, rappelle
le texte de
Lucien :
i^y;
aOTi veiva
x
-roy
T<J >
travSaJ .w.
1. S.
Reinach,
Bronzes
figurs, p.
62.
2. Bulletin de
corresp. hellnique, 1900, p.
17.
APHRODITE ET ROS 409
Hic
magicos adfert cantus,
hic Thessala vendit
Philtra, quibus
valeat mentem vexare mariti
Et solea
pulsare
nates 1.
L'Aphrodite Misthos,
crit M. de
Ridder, est,
la
diffrence de notre bronze et de ses
rpliques,
demi
accroupie
vers le
sol,
et il fallait
qu'elle
le ft
pour
atteindre le
petit
ros
qui disparat presque
devant
elle.
Assurment;
mais il
y
a une diffrence entre
l'action de
frapper
un
petit
ros et celle de menacer un
homme, par exemple
Ares,
comme dans le
passage
de
Reposianus.
A ma
grande surprise,
M. de Ridder sembla
d'abord se rallier
l'explication
de
Stephani
:
Trois
textes
caractristiques,
dont deux
prcisment
du mme
Lucien,
parlent
de la sandale d'or dont
Omphale
aurait
frapp
Hracls. La
lgende parat
bien tablie et une
reprsentation
connue devait en avoir consacr le
motif. La
sandale,
dans
l'esprit
du dcorateur alexan-
drin,
serait un
signe
de la
sujtion
dans
laquelle
la reine
lydienne
tenait son
captif.
C'est,
n'en
pas douter,
le
sens de nos
figurines.
Mais M. de Ridder a senti
qu'il
allait
trop
loin et il a attnu son
explication
d'une
manire
plus ingnieuse que
convaincante :
Non
qu'elles reprsentent Omphale elle-mme;
la
figure
est
bien
Aphrodite, mais,
par
la sandale
qu'elle
brandit,
la desse menace
qui
voudrait se rvolter contre elle
;
elle le traiterait comme
Omphale
traitait Hracls et le
punirait
comme un enfant rebelle. Le
symbole
est
d'autant
plus
clair
que
le chtiment
par
la sandale a
parfois,
n'en
pas douter,
un sens
erotique.
Enfin,
M. de Ridder
suppose que
la statuette athnienne faisait
peut-tre,
du bras droit
qui manque,
le
geste
de la Vnus
pudique
:
Aphrodite, surprise,
se voilerait d'une main
et de l'autre menacerait les indiscrets.
1.
J uvnal, VI,
612. On
pourrait
citer ces vers de J uvnal comme
une allusion l'humiliation d'Hercule
par Omphale.
410 APHRODITE ET EROS
Il
y a, je crois,
quelque
invraisemblance dans cette
solution
clectique. D'abord,
les
rpliques
de
l'Aphro-
dite au bras lev ne la montrent
jamais
dans l'attitude
pudique ; puis,
une fois
que
M. de Ridder
admet
que
la
desse
fait un
geste
de
menace, aprs
avoir d'abord
sembl dire le
contraire, que peut-il
trouver blmer
dans
l'opinion
fonde sur le vers de
Reposianus, d'aprs
laquelle
la
desse,
arme de sa sandale ou d'une bande-
lette
replie,
menacerait Mars ou ros? On
peut
bien
menacer un enfant d'une
baguette
sans se courber
pour
se mettre son niveau
;
il sera
temps
de s'incliner
ainsi
quand
on
passera
de la menace l'excution 1.
Ce
qui prcde
suffit tablir
que
le
groupe
Misthos
n'a
pas
seulement
une valeur
artistique,
mais
qu'il peut
servir
autoriser
l'interprtation,
conteste
par
Merklin
et
Stephani,
d'une
petite
srie de
figurines analogues
au
repos.
Le fait
que
le
petit
ros
appartenait
au
groupe
n'est
pas
absolument dmontr
; toutefois,
il me semble
bien difficile de ne
pas l'admettre,
car il
faudrait,
dans
le cas
contraire, que
Misthos ou son fournisseur et
dcouvert ailleurs un
petit ros,
dans une attitude
suppliante, qui pt
tre
group
avec
l'Aphrodite
de
manire
expliquer
le
geste
de celle-ci.
Voici, d'ailleurs,
ce
qu'crit
ce
sujet
M. de
Ridder,
qui
a sur moi
l'avantage
d'avoir examin
l'original
:
On
voit,
sur
une mme
base,
la desse levant la sandale et un
petit
ros se blottissant
par peur
du chtiment.
Si,
comme il
est
possible,
les deux
figures appartiennent
au mme
ensemble,
on ne
peut gure
les
expliquer
autrement
que
ne l'a fait M. Reinach
2
.
1. M. de Ridder renonce
s'occuper
de la statuette de Damas
(
Dorpat), parce que
la
description
de Schwabe ne
peut
suffire une
tude.
Il oublie
que j'ai publi
cette
figurine
dcrite
par Schwabe,
Rpertoire,
t.
II, 346,
6.
2. Bull, de
corresp. hellnique, 1900, p.
21.
APHRODITE ET EROS 411
M. Cavvadias m'a fait l'amiti de
m'envoyer
un mou-
lage peint
dpos
au muse de Saint-Germain
de la main de la desse tenant la sandale. La sandale est
lgrement
fourchue l'extrmit et
assez
paisse
;
un
coup
assn avec cette chaussure ne devait avoir
rien de commun avec une caresse maternelle.
XXI
L'EX-VOTO D'ATTALE
ET LE SCULPTEUR PIGONOS
1
M. A. Michaelis vient de
publier,
dans l'Annuaire de
l'Institut
archologique allemand,
un travail du
plus
grand
intrt sur une srie de statues
qui prsente
une
importance
considrable non seulement
pour
l'histoire
de
l'art,
mais
pour
notre histoire nationale
2
: il
s'agit,
en
effet,
des
plus
anciennes
reprsentations
de
guerriers
gaulois par
l'art
hellnique,
dans la dernire
partie
du
111e sicle et au dbut du 11e sicle avant notre re.
On sait
que
les
Galates, ayant
envahi l'Asie Mineure
en 278 comme mercenaires d'un
prince bithynien, y
exercrent
pendant quarante
ans d'horribles
ravages.
Deux rois de
Pergame,
Attale Ier
(241-197)
et Eumne II
(197-159),
finirent
par
les refouler dans une
province
qui s'appela
dsormais la Galatie. En mmoire de ces
succs,
les
vainqueurs
ddirent en divers lieux des
groupes
de statues. On
admet, depuis
un travail de
H.
Brunn, publi
en
18703, que
nous
possdons
des
rpliques partielles
de deux de ces
groupes,
savoir
:
1 D'un
groupe,
ou
plutt
d'une srie de
groupes,
1.
[Mmoire
lu l'Acadmie des
Inscriptions
au mois de dcembre
1893 et
publi
dans la Revue des tudes
grecques, 1894, p. 37-44.]
2.
Michaelis,
J ahrbuch des
Instituts, 1893, p.
119 et suiv.
3.
Brunn,
Annali dell'
Instituto, 1870, p.
292.
L'EX-VOTO D'ATTALE ET EPIGONOS 413
ddis sur
l'Acropole
d'Athnes et mentionns
par
Pausanias,
il nous reste des Gaulois morts ou combat-
tants,
des
Amazones,
des Gants et des
Perses,
dcou-
verts Rome au dbut du xvie sicle. L'oeuvre
originale
comprenait quatre ranges
de
petites figures,
se
rap-
portant
aux luttes des dieux contre les
Gants,
des
Athniens contre les
Amazones,
des Athniens contre
les
Perses,
des Grecs d'Asie contre les Gaulois. Comme
on n'a
pas
trouv de statues
qui puissent
tre consid-
res comme celles des
vainqueurs,
il est
probable que
les vaincus seuls taient
reprsents ;
2 D'un ensemble de
grandes
statues
disposes
en
fronton,
sans doute sur
l'Acropole
de
Pergame,
il nous
reste le
prtendu
Gladiateur mourant du
Capitole, qui
est un
Gaulois,
et le
prtendu groupe
d'Arria et Paetus
(villa Ludovisi),
o Raoul Rochette a
dj
reconnu,
en
1830,
un Galate se tuant lui-mme
aprs
avoir tu sa
femme. Les
vainqueurs
font
galement
dfaut.
Dans un travail
publi
en
1889,
sous le titre : Les
Gaulois dans l'art
antique 1,
nous avons
essay
de runir
toutes les informations
que
l'on
possdait
ce
sujet
et
nous avons dcrit un certain nombre de
sculptures
et
de reliefs
qui
drivent,
directement ou
indirectement,
des ex-voto commands
par
les rois de
Pergame.
L'tude de M. Michaelis
ajoute
des
renseignements
nouveaux ceux
qu'il
nous a t donn de mettre en
oeuvre;
mais nous ne
pouvons pas
admettre toutes les
conclusions
qu'il
en a tires et
croyons pouvoir,
sur un
point essentiel,
en
proposer
une diffrente.
Touchant la dcouverte des
rpliques
Rome,
en
1514,
nous
possdons
deux
tmoignages,
l'un de
Filippo
Strozzi
(publi par Gaye) 2,
l'autre du
lyonnais
Claude
i.
Paris,
Leroux
(extrait
de la Revue
archol.),
76
pages,
avec 29
vignettes
et 2
planches
hors-texte.
2.
Gaye, Carteggio, II, p.
139. M. Miinlz a
rappel
l'attention
sur
ce texte dans la Revue
archologique
de 1882
(t. I, p. 35).
414 L'EX-VOTO D'ATTALE ET PIGONOS
Bellivre
(publi
par
M.
Bormann)
1. Les
statues,
que
l'on
prit
d'abord
pour
celle des Horaces et des
Curiaces,
furent exhumes dans la cave d'un couvent de femmes
dont l'identit
n'a
pas
encore t tablie. Ce couvent
parat
avoir t
plac
sous la
protection
d'Alfonsina
Orsini,
veuve de Piero de'
Medici,
mort en 1503. Bel-
livre vit six statues chez Alfonsina
;
une
septime
avait t
transporte
au Vatican
(ad papam
vecta
erat)
2.
Toutes taient
viriles,
sauf une
seule,
o Bellivre
reconnat la soeur des
Horaces,
tendue morte avec une
blessure au-dessus du sein
droit,
tandis
qu'un
enfant
est
suspendu
sa mamelle dessche 3. J 'crivais ce
sujet
en 1889 :
Klgmann
avait
pens que
c'tait
l'Amazone de
Naples, auprs
de
laquelle
un restaura-
teur de la Renaissance aurait
plac
un enfant. Cette
hypothse,
videmment
inadmissible,
a t
repousse
avec raison
par
M.
Mayer; d'aprs lui,
il
s'agirait
d'un
groupe analogue
celui
qui
est
figur
sur le
registre
suprieur
du
sarcophage
Ammendola. Pline
signale
un
groupe
semblable d au
sculpteur Epigonos
4;
ailleurs
encore,
le mme crivain
parle
d'un tableau d'Aristide
de
Thbes,
reprsentant
la
prise
d'une
ville,
o l'on voit
une mre blesse et mourante et un enfant
qui
se trane
en
ranrpant
vers le sein maternel. De
pareils
motifs ne
1.
L'historique que
nous rsumons est
aujourd'hui
bien connu
;
M. Mntz en a fait un
expos dtaill, qui
est encore
indit,
dans une
sance de l'Acadmie des
Inscriptions (juillet 1893).
On trouvera
les rfrences dans l'article cit de M. Michaelis.
2. J 'ai eu tort de
rvoquer
en doute l'identit de cette statue avec
celle
qu'a signale
Aldrovandi
(la
statua di un Curiatio
bellissima) ;
mais
je
continue ne
pas
considrer comme certain
qu'il s'agisse
du Perse combattant
aujourd'hui
au Vatican.
3. Horatiorum
soror, forma dcora, confossa paulo super
mamillam
dextram, quam prostratam infantulus
suus arida
sugens
ubera
amplec-
titur.
4.
Pline, XXXIV,
88 :
Epigonus
omnia
fere praedicla
imilatus
praecessit
in lubicine et matri
interfectae infante
miserabiliter blan-
dientc.
L'EX-VOTO D'ATTALE ET PIGONOS 415
se
prtaient pas
moins la statuaire
qu'
la
peinture;
les artistes de l'ex-voto d'Attale devaient naturel-
lement tre amens les
reproduire. Malheureusement,
le
groupe
vu
par
Bellivre a
disparu
;
mais il n'est
pas
draisonnable
d'esprer qu'on puisse
le retrouver
quelque jour.
En
1550,
Aldrovandi dcrivait le mme
groupe, ajou-
tant
que
l'enfant n'avait ni tte ni bras. A
partir
de ce
moment,
on en
perd
la trace.
Le
palais
Madama,
rsidence
d'Alphonsina Orsini,
passa aprs
elle
Marguerite
d'Autriche,
fille de Charles-
Quint, qui pousa
en 1538 Octave Farnse. Vers
1540,
des artistes
blois,
visitant
Rome, excutrent,
d'aprs
les statues
antiques qu'on y
conservait,
une srie de
dessins la
plume qui
sont
aujourd'hui
la
bibliothque
de Ble. M. Michaelis a eu le bonheur
d'y
dcouvrir
un
croquis reprsentant
une femme tendue sur le
sol,
dans le costume d'une
Amazone,
avec un enfant mutil
qui
semble lui
prendre
le sein 1.
Or,
l'Amazone est exac-
tement conforme celle
qui,
de la collection
Farnse,
a
pass
en 1796 au muse de
Naples
et
que
l'on a
rap-
porte depuis longtemps
l'ex-voto d'Attale.
Donc,
c'est un restaurateur du xvie sicle
qui,
trouvant le
fragment
de
putto
d'un effet
dsagrable,
en a fait dis-
paratre
les restes. Cette conclusion a t vrifie
Naples mme,
en
prsence
de
l'original, par
un
jeune
archologue,
M. B.
Sauer, qui
a clairement reconnu les
traces de la
petite figure
enleve
par
le
trop
zl
pra-
ticien.
Ainsi,
le
groupe suppos perdu
est
retrouv;
mais ici
se
prsente
une difficult trs
grave.
Nous
possdons
des
centaines
d'images d'Amazones,
en ronde
bosse,
en
relief,
en
peinture
: aucune n'est
accompagne
d'un
enfant. Ces
guerrires
de la fable n'taient
pas
des
1. Ce
croquis
est
reproduit
dans le
J ahrbuch, 1893, p.
122.
416 L'EX-VOTO D'ATTALE ET PIGONOS
vierges,
mais l'art a
toujours
omis de faire allusion
leur maternit. Faut-il
admettre,
avec M.
Michaelis,
que l'artiste,
travaillant
pour
Attale,
un
prince d'Asie,
ait
pu figurer
une Amazone avec son
enfant,
ce
que
n'aurait
jamais
fait un artiste
attique?
Il est bien diffi-
cile de se
ranger
cette
opinion.
La tradition
asiatique
rapporte que
les Amazones ne laissaient vivre
que
leurs
filles
; or,
ceux
qui
ont vu l'enfant du
groupe
Farnse
(le
dessin de Ble ne nous
renseigne pas
cet
gard)
l'ont
qualifi d'infantulus, putto,
ce
qui
semble bien
indiquer qu'ils
l'ont considr comme de sexe mle.
M.
Mayer
s'est
dj
demand si la
prtendue
Amazone
de
Naples
ne serait
pas
une Gauloise
;
on
sait,
en
effet,
que
chez les Gaulois et les Germains les femmes accom-
pagnaient
souvent leurs maris la bataille. Mais le
costume d'Amazone
que porte
la statue rend cette
explication
trs
prcaire
: la femme
gauloise,
dans le
groupe
dit d'Arria et
Paetus,
les femmes
gauloises figu-
res sur le
sarcophage
Ammendola, portent
de
longs
vtements ou des
pantalons
collants
qui
n'ont rien de
commun avec la tunica succincta des Amazones.
Tout
ce
qu'on peut admettre,
c'est
que
l'artiste, figurant
la
dfaite des
Amazones,
comme il
figurait
celle des
Perses et des
Gants, par
allusion celle des
Gaulois,
ait
prt
une Amazone le nourrisson d'une
Gauloise,
usant d'une licence
que
des
spectateurs grecs pouvaient
comprendre
et
qu'ils
avaient mme certains motifs
d'excuser. Nous verrons
plus
loin comment cette licence
se
justifie par
une considration
qui
a
chapp
M. Michaelis et
qui
nous
parat
seule de nature tran-
cher la difficult.
Dcouvert en
1514,
ce
groupe, quoique
mutil,
devait
frapper par
le
pathtique
du
sujet.
Il me semble en
reconnatre l'influence dans une
gravure
de Marc-
Antoine,
excute vers la mme
poque d'aprs
un des-
sin de
Raphal.
C'est la clbre
composition appele
L'EX-VOTO D'ATTALE ET PIGONOS
417
Il Morbetto
(la peste
de
Phrygie)
1. Sur la
gauche,
on
aperoit
une femme
morte,
dont un enfant saisit la
mamelle
pendant qu'un
homme fait effort
pour
l'en
carter. J e croirais volontiers
qu'il n'y
a
pas
l une
simple
rencontre et
qu'il
faut
ajouter
cet
exemple
ceux
que
l'on a
dj
cits des
emprunts
libres faits
par
Raphal
l'antique pendant
les dernires annes de
sa vie 2.
Deux autres Amazones combattant nous sont con-
nues
par
un dessin de Heemskerck
que
M. Michaelis a
publi
3. Ce sont des
fragments
trs
dgrads;
dans
l'un,
on
aperoit
le
pied
d'une
figure virile, qui parat
marcher ct de l'Amazone. M. Michaelis est
dispos
croire
que
ces
figures
ont fait
partie
d'une des
rpliques
de l'ex-voto
d'Attale;
mais alors il faudrait admettre
que
certaines des
figures qui
le
composaient
taient
troitement
groupes.
Si cette
hypothse
est
recevable,
on doit reconnatre ici une imitation du
groupe
d'Arria
et Paetus et non
pas,
comme l'a
pens
M.
Michaelis,
le
combat d'une Amazone avec un Grec. Cette considra-
tion est
importante pour
la suite de notre
tude,
mais
nous ne
pouvons y
insister
pour
le moment.
Il a
dj
t
question
d'un
tmoignage
de
Pline, qui
attribue au
sculpteur pigonos
une statue en bronze
prsentant
le mme motif
que
l'Amazone de
Naples,
matri
interfectae infans
miserabiliter blandiens.
Cinq
signatures
de cet
pigonos,
sur des bases de
statues,
ont t dcouvertes
Pergame,
au cours des fouilles
que
le
gouvernement
allemand
y
a
pratiques.
Plu-
sieurs de ces bases ont d
supporter
des
compositions
importantes,
excutes entre 265 et 230 avant J .-C.
1.
Mntz, Raphal,
2e
d., gravure
la
p.
610.
2. J e ne dis
pas que Raphal,
dans le
Morbetto,
ait imit l'Amazone
avec
l'enfant,
mais
je pense qu'il
a
trait,
sa
manire,
le
motif
pathtique que
la dcouverte de cette statue lui rvlait.
3.
J ahrbuch, 1893, p.
126.
S. REINACH
27
418 L'EX-VOTO D'ATTALE ET PIGONOS
Or,
il est
singulier que
Pline ne mentionne
pas pigo-
nos
parmi
les artistes
qui
clbrrent les victoires
d'Attale et d'Eumne sur les Galates : il nomme
Isigo-
nos, Phyromachos,
Stratonicos et
Antigonos.
Le nom
d'Isigonos
est
suspect, parce qu'il
n'existe,
son
sujet,
aucun autre
tmoignage
: M. Michaelis a donc certaine-
ment vu
juste lorsqu'il
a
remplac
ce
nom,
dans le
texte de
Pline, par
celui
d'Epigonos.
Dj Urlichs, que j'ai
suivi dans mon tude de
1889,
avait mis
l'hypothse que
le
prtendu
Gladiateur du
Gapitole
et le
groupe
Ludovisi taient des
copies
de
statues en bronze faites
par pigonos.
Pline
cite,
en
effet,
parmi
les oeuvres de cet
artiste,
un
tubicen,
c'est--dire
un sonneur de
trompe (tubicen,
dans
Pline,
est une
traduction
par
peu prs
du
grec
krauls ou
kratauls):
or,
sur la base du
prtendu Gladiateur, figure prcis-
ment un instrument de ce
genre ; l'hypothse
est donc
plus que
vraisemblable.
M. Michaelis est all
plus
loin. Au lieu
d'admettre,
comme on le faisait
jusqu' prsent, que
les
groupes
ddis sur
l'Acropole d'Athnes, composs
de
figures
plus petites,
soient
postrieurs
la
grande composition
de
Pergame,
il croit
y
reconnatre
galement
la main
d'Epigonos,
cause du
groupe
de l'Amazone avec son
enfant
qui correspond
la
description
de Pline. Ici
encore,
il nous est
impossible
de le suivre et nous
croyons
avoir
pour
cela de bonnes raisons.
Mme dans les
copies
de marbre
qui
nous en restent
copies excutes, d'ailleurs,
en marbre de Fourni et
probablement
dans un atelier d'Asie Mineure
le
Gladiateur du
Capitole
et les
figures
du
groupe
Ludo-
visi trahissent non seulement la mme
inspiration,
mais une excution
identique.
Les deux Gaulois
portent
une forte
moustache;
le
reste de leur
visage
est ras.
Le bouclier du
prtendu
Gladiateur offre exactement la
mme dcoration
que
celui du
prtendu
Paetus.
En
L'EX-VOTO D'ATTALE ET PIGONOS 419
revanche,
les statues du second
groupe, apparentes
entre
elles, diffrent,
par
le
style plus
sec comme
par
les
dtails,
des
grandes figures d'Epigonos.
Trois des
Gaulois sont
imberbes,
sans
moustache;
le
quatrime,
celui de
Venise,
est barbu. Le bouclier conserv dans la
figure
du Louvre ne
prsente pas
les ornements carac-
tristiques
des boucliers du Gladiateur et du Paetus.
Enfin,
la forme des ttes n'est
pas
la mme dans les
deux
grandes
statues et dans les
petites
: la saillie si
accuse de la mchoire infrieure est trs attnue
dans les
figures
du
groupe
athnien. En second
lieu,
je
ne crois
pas que l'original
de l'Amazone de
Naples
avec son
enfant, oeuvre,
tout
prendre,
de second
ordre,
ait
jamais pu
exciter l'admiration des anciens au
point
d'tre mentionn
par
l'auteur
grec que
suivait Pline
comme un titre de
gloire
d'un
sculpteur
clbre. Il
me
semble,
au
contraire,
fort
simple
d'admettre
l'hypo-
thse
suivante,
fonde sur le texte mme de Pline :
Epigonus praecessit
1
in tubicine et matri
interfectae
infante
miserabiliter blandiente. Si le tubicen a fait
partie
d'un
groupe
relatif aux victoires
d'Attale,
n'est-il
pas
vraisemblable
que
la mater
interfecta y
aura
galement
appartenu?
Or,
depuis
Otfried
Mller,
on admet
que
la
composition
due
pigonos prsentait,
comme celle
du
groupe
des
Niobides,
la forme
pyramidale, l'aspect
d'un fronton. Au centre devait se trouver la scne du
suicide,
c'est--dire le
groupe
Ludovisi;
un roi
galate
se
perant
de son
poignard parat galement
au centre
de la bataille
qui occupe
la face
principale
du sarco-
phage Ammendola,
et
j'ai
dmontr en 1889
que
le
Gaulois barbu de
Venise,
restaur tort comme se
dfendant contre un
cavalier,
tait
reprsent
au mo-
ment o il se donnait la mort. Cela
pos,
l'extrmit
droite du fronton
par rapport
au
spectateur
devait
1. Dans le
grec,
il
y
avait
probablement r^ic-teve,
a excell.
420 L'EX-VOTO D'ATTALE ET PIGONOS
tre
occupe par
le Gaulois mourant du
Capitole.
N'est-il
pas
tentant de restituer
gauche,
comme
pendant
cette
figure
de
tubicen,
la mater
interfecta
mentionne
par
Pline ct de cette dernire statue? Nous admet-
tons donc
que,
dans la
grande composition
de
Pergame,
pigonos
avait
figur
une Gauloise mourante ou morte
avec son enfant
auprs d'elle,
cherchant lui
prendre
le
sein ou la caresser. Ce dernier
type
une fois introduit
dans le
cycle
des
sculptures galatiques ,
consacr
par
le
suffrage
des
connaisseurs,
fut imit
par
l'auteur
-
trs infrieur
pigonos
du
groupe
d'Athnes. Cela
seul
peut expliquer,
du mme
coup, l'espce
de
conta-
mination dont l'Amazone de
Naples
offrait la trace
dans son tat
primitif.
Le
groupe
d'Athnes ne faisait
aucune
place
aux femmes
gauloises, qu'il remplaait par
des Amazones : un artiste eut l'ide d'assimiler une des
Amazones une
Gauloise,
en tirant
parti
d'un motif
touchant et
dj populaire
invent
par
son
prdces-
seur. Nous sommes certain
que
ses
emprunts
pigo-
nos ne se bornrent
pas
cela, puisque
le Gaulois de
Naples
est une
imitation,
d'ailleurs assez
mdiocre,
du
Gaulois mourant
d'Epigonos.
On a vu
plus
haut
que
le
groupe
central,
YArria et
Paetus,
avait
peut-tre
t
imit aussi Athnes. Nous
croyons
donc avoir retrouv
le motif de la statue
qui,
dans le
groupe pergamnien,
faisait
pendant
au Gaulois du
Capitole
et
qu'ainsi
le dessin de
l'Anonyme
de Ble nous
permet
de
jeter
quelque
lumire sur l'oeuvre du
premier sculpteur grec
qui
ait
reprsent
des Gaulois.
XXII
RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE
Dcouverts
Bulla-Regia
(Hammam Darradji)
1
I
On a fait un livre sur les coiffures des dames
romaines
;
les matriaux ne
manqueraient pas pour
en crire un sur les
miroirs.
En
s'exprimant ainsi,
dans un mmoire
publi
en
18722,
M. de Witte
paraissait
former un souhait
qui
n'a
pas
encore t ralis l'heure
actuelle. Les matriaux ont continu s'accumuler
;
au vaste trsor des miroirs
trusques, qui
avaient fait
l'objet
de la volumineuse
publication
de
Gerhard 3,
sont venus
s'ajouter
un
grand
nombre de miroirs
grecs,
parmi lesquels
il
y
a des chefs-d'oeuvre de la
priode
la
plus
florissante de
l'art 4; cependant
la science
regrette
encore le
manque
d'un travail d'ensemble'
qui
embras-
serait ce
sujet
dans toute son
tendue, qui
chercherait
des claircissements non seulement dans les textes
1.
[Collections
du Muse
Alaoui,
4e
livraison, 1890].
2. J . de
Witte,
Les Miroirs chez les
Anciens, Bruxelles,
1872
(27
pages),
extrait des Annales de l'Acadmie
d'archologie
de
Belgique,
t. XXVIII 2e
srie,
t.
VIII, p.
6 et suivantes.
3. E.
Gerhard,
truskische
Spiegel, Berlin, 1843-1867,
4 vol. avec
443
pi. L'ouvrage
est continu
par Klgmann
et
Krte,
1884 et suiv.
4.
Mylnas, 'EXXijvixxTonTpa, Athnes, 1876,
et surtout Dumont-
Pottier, Cramiques
de la Grce
propre,
t.
II, p.
175 et
suiv.,
o se
trouve un
catalogue complet, accompagn
de
rfrences,
des miroirs
historis dcouverts
jusqu'
ce
jour
en
pays grecs.
422 RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE
anciens et dans l'tude des miroirs
eux-mmes,
mais
dans les nombreuses
reprsentations
de miroirs
conser-
ves,
par
les vases
peints,
les
pierres graves,
les terres
cuites et les monuments divers de la
sculpture.
Celui
qui
aborderait
aujourd'hui
un
pareil
travail
ne devrait
pas
borner ses recherches la Grce et
Ptrurie
;
les
ncropoles
de
l'Afrique
romaine vien-
draient aussi lui fournir leur
contingent.
J usqu' prsent,
les miroirs
d'poque
romaine dcou-
verts en dehors de l'Italie et de la Grce ont t fort
ngligs
des
archologues.
La raison en est
simple
:
c'est
que
la
plupart
ne
prsentent pas
de dcoration. Ce
sont,
en
gnral,
des
plaques
circulaires du
genre
de
celles
que Caylus
avait
acquises
Arles et
qu'il
dcrivit,
en
1759,
dans le troisime volume de son Recueil
d'Antiquits
1. On m'a
envoy
d'Arles trois miroirs
l'usage
des Romains et tous trs bien conservs. Le
plus grand
est d'une forme absolument circulaire :
il
est inutile de le
dessiner,
il est renferm dans une
bote de forme
pareille
et de mme matire... On
peut
regarder
les deux autres miroirs comme
pareils
: ils le
sont
pour
le
diamtre,
on voit seulement
quelques
diff-
rences dans les cercles dont ils sont orns
;
l'un et l'autre
sont
parfaitement
ronds et trs bien
conservs;
la
matire dont ils sont
composs
et
l'tamage qui
leur
procure
la rflexion sont travaills avec soin.
L'anne
suivante,
le 28
janvier 1760, Caylus
crivait Paciaudi
2
:
J e vous dirai sur le miroir
que
vous m'annoncez
que
je
serai charm de le
comparer
aux trois
que j'ai dj
entiers et
trs conservs
; je
les ai eus
d'Arles,
o ils
ont t trouvs l'anne
passe.
J 'en ai
rapport
un dans
le troisime volume... Il a son
pareil exactement,
et
l'autre
que j'ai
eu
depuis
est considrablement
plus
i.
Caylus, Recueil,
t.
III, pi. LXXXIX, p.
331.
2.
Correspondance
indite du comte de
Caylus, publie par
Ch. Ni-
sard,
t.
I, p.
135.
RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE 423
grand
et s'est trouv avec sa bote ou son
tui,
tel
qu'il
tait autrefois 1.
On le
voit,
le savant amateur ne
songeait pas
encore
des miroirs
gravs
ou orns de
reliefs,
et l'intrt
qu'il
trouvait aux modestes
monuments entrs dans sa
collection
surprend aujourd'hui
les
archologues, plus
difficiles contenter
que Caylus.
Ce sont les
ncropoles
de l'trurie
qui
fournirent les
premiers spcimens
de miroirs
historis,
souvent accom-
pagns d'inscriptions
en caractres
trusques qui
dsi-
gnent
les
personnages par
leurs noms. Le nombre de
ces miroirs s'est tellement
accru, depuis
le commen-
cement du xixe
sicle,
qu'on
en
comptait,
il
y
a une
vingtaine
d'annes,
plus
de mille
;
il n'est
gure
de
collection
publique
ou
prive qui
n'en
possde quelques-
uns. La fabrication des miroirs
gravs, particulire-
ment active en
trurie,
o elle tait arrive de
Grce,
Tayonna
de l dans les
rgions voisines,
notamment dans
le Latium
; plusieurs
miroirs dcouverts Prneste
portent,
en
effet,
des
inscriptions
en
langue
latine 2.
Cependant,
l'poque
romaine,
les miroirs
gravs
ou
orns de reliefs deviennent rares
3
;
les
premiers
surtout
disparaissent presque compltement,
et Gerhard n'a
pu
citer
qu'un
seul miroir
grav, reprsentant
un
aurige,
comme
provenant
d'un tombeau romain 4.
En ce
qui
concerne les
reliefs,
notre
pnurie
est
peut-
tre
plus apparente que
relle
;
les muses contiennent
sans
doute,
sous le nom de
phalres,
de
patres, d'ap-
pliques, etc.,
de nombreux
objets
o une tude
plus
attentive reconnatrait des dcorations de miroirs.
Que
1. Sur une bote de miroir trouve en
Angleterre,
voir la notice de
Gage
dans
YArchaeologia,
vol. XXVII
(1838), p.
360 et
pi.
xxv.
2.
Fernique,
tude sur
Prneste, p.
162
;
J . de
Witte,
mm.
cit.,
p.
14
; J ordan,
Kritische
Beitrge, p.
3.
3.
Friederichs,
Kleinere Kunst und
Industrie, p.
85
; Gerhard,
\Elrusk.
Spiegel,
t.
I, p.
8.
4.
Gerhard, op.
laud., pi.
409.
424 RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE
la coutume d'orner les miroirs de reliefs ne se soit
pas
perdue
sous
l'Empire
romain,
c'est ce
qu'atteste,
ind-
pendamment
des
spcimens qui
font
l'objet
de la
pr-
sente
tude,
une curieuse notice rcemment
publie
par
M. Froehner : ce savant a
appel
l'attention sur
une srie de dix-huit miroirs de
poche
dont le revers
prsente,
en
guise d'applique,
une
grande
monnaie
en bronze de Nron 1.
Il semble bien
qu' l'poque
romaine la matire dont
taient faits les miroirs
importait plus
aux acheteurs
que
leur dcoration
artistique.
Pline nous
apprend
2
qu'on fabriquait
autrefois Brindes des miroirs d'tain
trs
estims,
mais
que plus
tard les miroirs
d'argent
devinrent si communs
que
les servantes mmes en fai-
saient
usage.
Quant
aux
miroirs de
verre, qui
ont
aujourd'hui
fait oublier tous les
autres,
l'antiquit
les
a certainement
connus,
et Pline
3
les mentionne comme
un
produit remarquable
des verreries de Sidon
4
;
mais il
n'en a
pas
encore t
dcouvert, que
nous
sachions,
un seul
spcimen
et tout
porte
croire
qu'ils
furent trs
peu rpandus.
Olivier
Rayet
a
propos pour
les miroirs
grecs
une
division en deux classes 5.
J usqu'au
milieu du ve
sicle,
ce sont des
disques
de bronze monts sur un
pied
en
1. Annuaire dela socit de
numismatique, Paris, 1889, p.
395. Dans
son
Catalogue
des bronzes
antiques
de la collection Grau
(Paris, 1885,
p. 124),
M. Froehner dcrit ainsi le n 611 : Bote miroir trouve
Avignon.
Dans le couvercle est enchss l'avers d'un
grand
bronze
de Nron et sur le dessous de la bote le revers de la mme
monnaie.
A
l'intrieur,
deux miroirs
argents,
d'une conservation
parfaite.
Le
couvercle d'une bote semblable a t trouv
Cologne
et
publi
dans les Bonner
J ahrbcher,
t.
LXXI,
p.
117. On connat en outre
une dizaine de
grands
bronzes de Nron transforms en miroirs de
poche
et
fabriqus
l'usage
des soldats.
2.
Pline,
Hist.
Nat., XXXIV,
48
(d. Littr,
t.
II, p. 455).
3.
Pline, ibid., XXXVI,
66
(d. Litre,
t.
II, p. 531).
4. Cf. J : de
Witte,
Mm.
cit., 8; Gerhard,
Etrusk.
Spieg..
t.
I, p. 78,.
note 38.
5. 0.
Rayet,
Monuments de l'art
antique,
notice de la
pi. 22, p.
2-
RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE 42S
forme
d'Aphrodite
;
ces miroirs sont de vrais meubles
de table toilette. Vers le ive
sicle,
le miroir devient
une
plaque
ronde sans
support
ni
poigne,
dont le
ct
poli
est souvent
argent
et l'autre orn d'une
gravure
au trait. Il est enferm dans une bote
charnire
1
dont le couvercle est souvent dcor d'une
applique
en relief
; parfois,
mais
rarement,
il
y
a des
reliefs des deux cts du couvercle2.A la fin du
ivesicle,
la bote couvercle
est
supprime;
le
disque porte
du
ct
poli
une
gravure
au
trait, qui n'empchait pas
le-
visage
de la
personne
de
s'y
rflchir,
et il est
orn,
de
l'autre,
d'une
applique
en relief. Les botes charnire-
ne sont
pas
d'ailleurs
les seules : on en trouve
qui
sont
formes de deux
parties qui
s'embotent,
comme les
bonbonnires
actuelles,
et alors le miroir
proprement
dit
est une
plaque mtallique polie
ou
argente
sur une
face, qui
se trouve
protge par
la bote contre la
pous-
sire et l'humidit. Il arrive enfin
que
la face intrieure
du couvercle de la bote est
polie
elle-mme et fait office
de miroir.
Mais,
de toute
faon,
le bas-relief se trouve-
toujours
l'extrieur,
tantt au dos de la
plaque qur
rflchit
l'image,
tantt sur la
partie apparente
de la
bote ferme.
1. On a
pens,
ds
l'antiquit,que
la bote
miroir, X09
EOV
crpoY-fXov,
tait mentionne dans les Nues
d'Aristophane (v. 746),
mais cette
expression
peut
tre
interprte
autrement
(cf.
le scholiaste sur ce
passage).
Le miroir charnire est souvent
figur
sur les oeuvres
d'art,
par exemple
sur une boucle d'oreille en
or,
o il est tenu
par
un ros .
(Antiquits
du
Bosphore
cimmrien, pi. VII,
n
12)
et entre les mains
de statuettes en terre cuite
(Pottier
et
Reinach, Ncropole
de
Myrina,^
p.
325
; Furtwaengler,
Collections
Sabourof, pi.
87
; Cartault,
Collection
Lecuyer, pi. M).
La
premire
bote miroir dcouverte en
Grce a t
publie par Stackelberg,
Graeber des
Hellenen, pi. VII,
n
08
9 et 10
;
M. Pottier en a numr 48
(Cram.
de la Grce
propre,
t.
II, p.
244 et
suiv.)
Couvercles
de
provenance
italienne :
Gerhard,
Etrusk.
Spieg.,t.
I, p. 86, pi.
XX,
XXI
;
J . de
Witte,
Collection Beu
gnot,
p. 131,
n 390. Les miroirs
trusques
dcors de reliefs et en forme:
de botes sont assez rares
(de Witte,
mm.
cit., p. 16.)
2.
Dumont-Pottier, Cramique
de la
Grce,
t.
II, p. 243,
244.
426 RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE
Ces bas-reliefs sont des
appliques
souvent trs minces
et
que
l'on dcouvre ordinairement dtaches de leur
support.
Celles
que
l'on a recueillies en
Afrique
sont
toutes travailles au
repouss
dans une
pice
de
cuivre,
qui parat
avoir t revtue d'une
lgre
dorure
;
on en
connat d'autres
provenances qui
ont t
coules dans
des moules.
Tous les miroirs dont
l'origine
est certaine ont t
trouvs dans des tombeaux. Ce fait doit nous
paratre
assez
naturel,
puisque
le mobilier funraire est
l'image
de
celui dont se servaient les vivants : il a
cependant
assez
surpris
les
archologues
de l'ancienne cole
pour
donner
lieu des
interprtations singulires.
Pendant
long-
temps,
les
antiquaires
italiens ont considr les miroirs
comme des
patres
servant des
libations; puis
ils
leur ont donn le nom de miroirs
mystiques, specchi
mistici. M. de
Witte,
en
1872,
tait encore sous l'in-
fluence de ces ides
lorsqu'il
crivait
1
: Le miroir est
nomm
parmi
les
objets symboliques
dont on faisait
usage
dans les
mystres,
et on sait
que
chez les Grecs
comme chez les
Romains,
le miroir
figurait
dans les
crmonies
religieuses.
Mais il
ajoute
avec raison un
peu plus
bas :
On aurait tort de
considrer
les
miroirs,
conservs dans nos
collections,
comme des miroirs
mys-
tiques, ayant
t
employs
exclusivement au culte des
dieux. Exclusivement est encore de
trop.
Un texte
ancien, jusqu' prsent unique,
fait allusion
l'usage
de
placer
des miroirs dans les tombes.
Pline, parlant
de la
pierre sarcophage d'Assos 2, dit,
en
effet,
d'aprs
Mucien,
qu'elle ptrifie
les
miroirs,
les
strigiles,
les vtements et
les chaussures
que
l'on enterre avec les morts. Le miroir
est un
objet
de toilette
;
le
strigile
est un instrument
usit dans les
palestres,
et
peut
tre considr
gale-
1. J . de
Witte,
mmoire
cit, p.
20.
2.
Pline,
Hist.
Nat., XXXVI,
132
(d. Littr,
t.
II, p. 521).
RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE 427
ment comme un accessoire de toilette
l'usage
des
hommes
; or,
miroirs et
strigiles
sont
galement
fr-
quents
dans les tombes. Le texte de
Pline,
tout laco-
nique qu'il est,
suffirait donc carter toute
interprta-
tion
symbolique
et rendre
plus qu'invraisemblable
l'hypothse
ainsi formule
par
M. Meester de Raves-
tein
1
:
On
plaait probablement (les miroirs)
dans les
tombeaux afin de
signifier que
le dfunt laissait dans le
monde son
enveloppe
mortelle
pour
se trouver face
face avec Dieu.
Si les anciens avaient voulu
exprimer
cette ide hautement
spiritualiste,
il faut croire
qu'ils
auraient su le faire moins
obscurment.
II
Dans sa
premire
notice sur les
ncropoles paennes
de
Bulla-Regia, publie
en
18902,
M. le Dr Carton num-
rait
parmi
ses trouvailles
quarante
miroirs en
airain,
ronds ou
rectangulaires;
la
plupart
sont
briss,
mais
quatre
d'entre eux
possdaient
un couvercle en cuivre
dor,
en
relief, qui prsente
des
sujets
fort curieux .
Trois de ces reliefs ont
figur
l'Exposition
du Cente-
naire 3,
o ils ont vivement
frapp
les
archologues,
surpris
de trouver dans
l'Afrique
romaine des
objets qui
n'avaient
gure
encore t
signals qu'en
Italie et dans
le
monde
hellnique
4.
Malheureusement,
leur conserva-
tion est dfectueuse. Le
plus grand
et le
plus
intres-
sant est tellement dtrior
qu'il
a t
impossible
d'en
1. Muse de
Ravestein, Lige, 1871,
t.
I, p.
526.
2. Revue
archologique, 1890, I, p.
16-28
;
voir
p.
26. Une notice
plus complte,
o l'on trouve des dessins au trait des
miroirs,
a t
publie par
M. Carton dans le Bulletin du
Comit, 1890, p.
149-226.
3.
Exposition
du service des
antiquits
et des arts dela
Rgence, p.
13.
4. La Grce
propre,
le
Bosphore
cimmrien et la cte
asiatique
;
ce dernier
pays
n'a encore fourni
qu'une
seule bote de miroir
reliefs, qui
a t dcouverte
Myrina.
428 RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE
publier
une
photogravure*;
il a fallu se contenter
d'en
reproduire
un dessin la
grandeur
d'excution,
qu'on peut comparer
avec
l'esquisse
rduite donne
dans le Bulletin du Comit 2. A
quelques
dtails
prs,,
ces deux
images
sont d'accord.
Dans
l'explication
des
sujets
de ces
reliefs,
nous exa-
minerons d'abord les trois
qui
ont
figur
l'Exposition
de
1889, pour passer
ensuite celui dont nous
prsen-
tons ici un dessin
(fig. 73).
I.
On
distingue
encore un homme
demi-nu,
couch
ur un lit
qui
est surmont d'une sorte de
baldaquin;
1. La colle forte sur
laquelle
il a t
plaqu
au moment de la dcou-
verte en a acclr la
destruction;
il n'en subsiste
plus que
des
frag-
ments
insignifiants.
2. Dr.
Carton,
Bulletin du
Comit, 1890, p. 198, fig.
24.
FIG. 73.
Miroir histori de
Bulla-Regia.
RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE 429
. ses
pieds
est une femme
assise;
de l'autre
ct,
une seconde
femme,
d'une silhouette assez
lgante,
lui
apporte peut-tre quelque breuvage.
On
songe
natu-
rellement aux scnes de
banquets,
si
frquentes
sur les
bas-reliefs
funraires 1;
mais l'tat de mutilation de
l'original
ne
permet que d'indiquer
ce
rapproche-
ment.
IL
Le second miroir est encore
plus
dtrior.
J 'y distingue clairement,
m'crit M. de La
Blanchre,
un
personnage
assis sous un
arbre,
droite,
tendant la
main
; vis--vis,
gauche,
un autre
personnage debout,
appuy
sur son
bouclier,
dont le bord
repose
sur son
genou
;
entre les deux se tient une femme debout.
La
photographie permet
de s'assurer
que
cette
descrip-
tion est
exacte;
mais
je
crois devoir m'abstenir de toute
hypothse
sur la nature de la scne
reprsente.
III.
Le troisime relief est bien
conserv,
mais sou-
lve une
question
difficile
(fig. 74). Quel
est le
personnage
dont le buste
apparat
ainsi entre deux fleurs et une
tte de
pavot? Malgr l'nergie
du
profil, qui
ne
manque
pas
de
noblesse, l'indication trs accuse des seins
oblige
d'y
reconnatre une femme. Sur les miroirs
grecs
et
trusques,
la
reprsentation
de
bustes,
tantt de
face,
tantt de
profil,
est assez
frquente;
on trouve ceux de
Dionysos, d'Aphrodite,
de
J upiter
Ammon, d'Athna,
d'une
Gorgone
2,
d'Attis coiff du bonnet
phrygien
3,
enfin des ttes fminines indtermines 4.
Ici,
l'attribut
du
pavot
ne nous
permet
de choisir
qu'entre
un
petit
nombre de noms
mythologiques.
Le
pavot
est associ
Dmter,
Cyble,
Persphone
et
Hcate,
Aphro-
dite,
Hypnos,
aux Heures et aux
Saisons,
aux Cha-
1. Miroir avec scne de
banquet, Gerhard,
Etrusk.
Spieg., pi.
419.
2. Cf.
Dumont-Pottier,
op. laud., p. 201, 202, 245, 246,
247
;
Gerhard, op. laud., pi.
243.
3.
Friederichs,
Kleinere
Kunst,
p.
83,
n 162.
4. Meester de
Ravestein, op. laud.,
t.
I, p. 534,
535.
430 RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE
rites,
aux
personnifications
de
villes 1, enfin,
bien
que
cela ne soit
pas
attest
par
les
textes,
Attis
;
Visconti
a,
en
effet,
cru reconnatre des ttes de
pavot parmi
les
attributs de la clbre
image
d'Attis
hermaphrodite
dcouverte Ostie 2. Sur un bas-relief du muse de Ber-
lin, qui reprsente Cyble
et
Attis,
la desse
tient dans
sa main droite une tte de
pavot
3. C'est entre
Cyble,
Crs et Attis
(ce
dieu tait considr comme
androgyne)
que
le choix des
archologues
nous semble devoir
por-
1. Cf.
Stephani, Compte
rendu de la commission
archologique
de
Saint-Ptersbourg pour 1869, p. 47,
o les textes
antiques
ont t
runis in extenso.
2. Annali dell'
Instituto, 1869, p.
224
; Monumenti,
t.
IX, pi. VIII,
a,
n 2
;
cf. Pottier et
Reinach, Ncropole
de
Myrina, p.
407.
3. Bonner
J arhbcher,
t.
XXIII, pi.
31.
FIG. 74.
Mdaillon de
Bulla-Rcgia
RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE
431
ter ici
;
la
dsignation
de Crs est
peut-tre
celle
qui,
en l'absence du bonnet
phrygien
et de la couronne
murale,
soulverait le moins
d'objections.
IV.
Dans l'tude du
quatrime
relief
(fig. 73),
il faut
avant tout insister sur la
petite figure d'ros,
debout sur
un
pidestal
ou un autel sur
lequel
est dessine une
flche. Cette
figure, qui
se retrouve dans d'autres
oeuvres
d'art,
par exemple
dans celle
que
nous
repro-
duisons
ci-dessus titre de
rapprochement (fig.75),
indique qu'il s'agit
d'une scne o le rle
principal
et
dcisif
choit l'Amour. Le dshabill de la
jeune
femme
debout
gauche
ne
peut
convenir
qu'
Vnus ou
l'une de ses
plus
chres
protges.
Le
jeune
homme
qui
la
regarde parat conquis
ou dsarm
par
les charmes
qu'elle
offre sa vue. Des deux autres
personnages,
l'un,
un vieillard
portant
un
rameau,
veille l'ide
d'un
messager
de
paix; l'autre,
tenant un bouclier de la
main
gauche, reprsente plutt
l'ide contraire.
Il ne
peut s'agir
ici du
J ugement
de Paris 1. Non seule-
1.
Remarquons cependant que
la
prsence
d'Eros ne contredirait
pas
cette
explication ;
sur une monnaie de
Scepsis
en
Troade,
o
Fin. 75.
Petit ct d'un
sarcophage d'Aquincum.
432 RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE
ment,
en
effet,
J unon est
absente 1,
mais le lieu de la
scne n'est
pas l'Ida, puisqu'il
est
marqu par
une
muraille dont
l'appareil
est
indiqu
avec
soin;
en second
lieu,
le costume de Paris ne ressemblerait en rien celui
que prtent
au
berger phrygien
toutes les oeuvres
d'art. Ces deux
objections
ne seraient
pas
moins
gnantes
si l'on voulait reconnatre Hracls entre
Aphrodite
et
Athna,
ou entre la
Volupt
et la
Vertu,
suivant la clbre
allgorie
de Prodicus 2.
D'ailleurs,
le
regard
du
jeune
homme est
dj
fix sur la femme
demi-nue dont ros est le
puissant
auxiliaire;
s'il
y
a
lutte,
c'est elle
qui l'emporte
: l'homme
qui opte pour
la
Volupt
n'est
pas
Hracls.
Peut-tre la
comparaison
avec une
sculpture
tout
rcemment
publie
nous aidera-t-elle sortir d'embar-
ras. M. J . Ziehen vient de faire connatre
3
un bas-relief
du Muse de
Pest,
sculpt
sur le
petit
ct d'un sarco-
phage qui provient,
ce
que
l'on
croit,
d'Aquincum.
Nous
reproduisons (fig. 75)
cette
composition,
dont
l'analogie
avec celle
qui
nous
occupe
est vidente.
Non seulement l'attitude de l'homme debout est
presque
identique,
mais
le
petit
ros
s'lanant
d'un
pidestal
ou d'un autel est commun aux deux
scnes,
et la femme
debout,
sur le relief du
miroir,
est exactement semblable
celle
que prsente
le
sarcophage.
Elle nous offre
l'attrait d'un dvtement
calcul,
plus provocant que
la
nudit
complte.
M. Ziehen incline reconnatre dans
le
bas-relief
d'Aquincum
une scne de
YIlioupersis
:
figure
la scne du
J ugement,
le
petit
dieu s'lance d'un
cippe
comme
sur le miroir de
Bulla-Regia (Head,
Historia
numorum, p. 474).
1. Il faut dire
que
J unon
manque parfois
cette
scne;
cf.
Gerhard,
Etrusk.
Spieg.,
t.
II, pi.
195
;
t.
IV, pi.
372
;
Auserlesene
Vasenbilder,
pi.
172
;
Millingen,
Ancient unedited
monuments, pi.
17
; Welcker,
Annali dell'
Instituto, 1845, p.
207.
2.
Xnoph.,
Mem.
Socr., II, i,
21.
3. J .
Ziehen,
Archseologisch-epigraphische
Mittheil. aus Oester-
reich, 1890,
t.
XIII, p. 65, fig.
19.
RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE 433
Mnlas,
rencontrant Hlne
pendant
le sac de
Troie,
s'arrte,
sduit
par
ses
charmes,
et remet dans son
fourreau
le
glaive
dont il
s'apprtait
la
frapper.
Les
monuments,
tant
grecs que romains,
ont bien des fois
reproduit
cet
pisode, qui symbolise,
comme le
dsar-
mement de Mars
par Vnus,
le
triomphe
de la beaut
sur la force brutale. Ainsi
s'explique
la
prsence d'ros;
ailleurs,
on trouve
Aphrodite
ou
Peitho,
Athna ou
Apollon
1. En
gnral,
surtout sur les
vases,
la scne de la
rencontre des
poux
est tumultueuse : c'est au moment
o il va tuer Hlne
que
Mnlas s'arrte.
Ici,
la fureur
du
guerrier
est
dj calme;
elle a fait
place
l'admi-
ration et l'on devine
que
l'amour renaissant aura bien-
tt
triomph
de toutes les rancunes. C'est la version
qu'avaient
suivie
Ibycus
et Leschs de
Pyrrha,
celle
dont
Aristophane
et
Euripide
nous ont conserv le
souvenir 2. La scne n'est
pas hroque,
comme sur les
vases
peints,
mais sensuelle et
dj presque erotique.
C'est ce
qu'indiquent
nettement ces vers
d'Aristophane
dans
Lysistrata
3
:
Quand
il vit la rondeur des seins
d'Hlne
nue, Mnlas, je crois, jeta
son
pe.
Dans
Euripide 4,
Pele
reproche
Mnlas de n'avoir
pas
tu
son
pouse
infidle,
mais d'avoir
jet
son
glaive
l'aspect
du sein d'Hlne
pour
tomber dans ses
bras,
vaincu
par
l'amour.
Une
peinture
d'un vase
figures rouges,
trouv
Vulci,
o les
personnages
sont
dsigns par
leurs
noms 5,
1. Cf. l'article
d'Engelmann
dans le Lexikon der
Mythologie
de
Roscher,
t.
I, p. 1946, 1948,
1971.
2. Sur les diffrentes versions de la rencontre d'Hlne et de M-
nlas,
cf.
Robert,
Bild und
Lied, p. 77,
et les articles
Helena, Iliouper-
sis,
dans les
lexiques
de Roscher et de
Baumeister.
3.
Aristoph., Lysislr.,
v. 155.
4.
Eurip., Androm.,
v. 628.
5. Museo
Gregoriano,
t.
II, 5,
2
; Overbeck,
Gallerie heroicher
Bildwerke, pi.
XXVI,
12
; Roscher, Lexikon,
t.
I, p.
1946
;
Baumeis-
ter, Denkmseler, fig.
798.
S. REINACH 2S
44 RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE
montre Mnlas courant vers
Hlne,
qui
s'est
rfugie
auprs
de l'idole d'Athna ou
Palladion;
entre les deux
personnages
se tient
Aphrodite,
dans une attitude la
fois
gracieuse
et svre.
L'pe
de Mnlas vient de
tomber; ros,
planant
entre lui et la
desse,
apporte
une
bandelette,
tandis
que Peitho,
de l'autre ct de la
composition,
tient un rameau de la main
gauche
leve.
Nous
reproduisons
ici cette belle
peinture,
dont la com-
paraison
avec le miroir de
Bulla-Regia
et le bas-relief
d'Aquincum
est fort instructive
(fig. 76).
On
remarquera
combien
le cramiste du Ve sicle insiste sur le ct
pathtique
de la scne et se contente
d'indiquer, par
la
prsence
d'ros,
le caractre
que
les artistes
post-
rieurs ont accus. Sur le
vase,
Hlne est
presque
enti-
rement
vtue; seule,
la
jambe
droite est dcouverte
jusqu'
la
hanche,
suivant la mode lacdmonienne
;
mais ce n'est
pas
l l'effet d'une
coquetterie
savante:
la vivacit du mouvement suffit
expliquer
ce dsordre.
Il n'en est
pas
de mme dans les deux
bas-reliefs,
o
l'pouse
a
pris
l'attitude d'une courtisane.
L'pisode
tragique
de la dernire nuit d'Ilion s'est
transform,
sous le ciseau des artistes
romains,
en un
pisode galant
d'une nuit de Suburra.
L'explication
du relief de
Bulla-Regia parat
donc
certaine. Si le
glaive
de Mnlas a t oubli sur le
bronze,
le
geste
du
hros,
sans doute consacr
par
la
FIG. 7G.
-
Peinture d'un vase de Vulci.
RELIEFS DE MIROIRS EN BRONZE 435
tradition,
suffisait en veiller l'ide. Pour le
person-
nage
droite,
on
peut
hsiter entre Athna et
Ulysse
:
le dessin
publi par
le Dr. Carton rend cette dernire
dsignation prfrable.
Les
murs
qu'on aperoit
au
fond du tableau
indiquent que
la scne se
passe
Troie.
Enfin,
le vieillard
qui
s'avance vers
Mnlas, portant
un rameau
d'olivier,
est un
suppliant qui joue,
dans
notre
scne,
le mme rle
que
la desse de la Persuasion
sur le vase de Vulci
figur plus
haut.
L'analogie
entre cette
composition
et celle du sarco-
phage d'Aquincum prouve qu'elles sont,
l'une et
l'autre,
la
copie
libre de
quelque original clbre, qui
faisait
partie
du
rpertoire mythologique
des artistes
romains. C'est
lorsqu'on
aura
publi, rapproch
et
class un
grand
nombre de ces scnes
qu'on peut esprer
reconstituer le curieux
portefeuille
de
croquis qui
s'ajoutait
au
bagage
de
chaque sculpteur
et de
chaque
peintre,
comme un carnet de formules et de vers tout
faits
accompagnait,
dans leurs
prgrinations
travers
l'Empire,
les
compositeurs d'pitaphes
versifies.
LISTE DES GRAVURES
Pages Pages
Corne d'Amallhe
Frontispice
-
26.
Vase
peint
FIG. 1.
Anneau d'or ir- d'Artsa 153
landais 47
-
27.
Vase trier
-
2,3.
Lunules d'or d'Artsa 154
irlandaises 48-49
-
28.
Rasoir en bronze
4.
Croissant, en or d'Artsa 154
du Danemark.. 50
-
29.
Tombe de Mou-
-
5.
Croissant en liana 155
bronze du Dane-
-
30.
pes
de Mou-
mark 51 liana
155
6, 7,
8.
Haches de
-
31.
Fibule de Mou-
bronze ornes 52 liana 156
-
9,
10.
Pointes de
-
32.
Vases
gom-
flches d'Irlande
triques
de Mou-
et de
Portugal..
58 liana 157
-
11.
Pendeloque por-
-
33.
Cuve funraire
tugaise
en ar- deMouliana.... 158
doise 59
-
34.
Dcor
d'un
-
12.
Croissant d'or vase de Moulia-
de
Valognes....
68 na
158
-
13.
Collier d'or
-
35.
Coffre funraire
d'Evora 82 deSiteia
159
-
14.
Collier d'or de
-
36.
Bague
d'or de
Penella 83 Vourlia
160
-
15.
Collier
d'or de
-
37.
Statuette
de
Cintra 84 Petsofa 162
-
16.
Pendant d'or
-
38.
-
Menhir anthro-
desMousselots.. 85
pode
de Saint-
-
17.
Tonnelet de Sernin
162
bronze du J ura.. 86
39.
Bas-relief de
-
18,19.
Ornements
Panticape
197
du collier
-
40.
Profil d'Herms
d'Evora 88
archaque
204
-
20.
Sphrode
de
-
41,
42.
Puteal de
l'Allier 89 Corinthe...
205-206
-
21.
Lunules d'or ir-
-
43.
Herms avec
landaises 90 talonnires
208
-
22.
Crossedeschiste
-
44.
Gravure sur
portugaise
91 ivoire de Koul-
-
23.
Mercure colossal Oba 210
deLezoux 144
-
45,
46.
J upiterde
-
24.
Coffre funraire Saint-Cme..... 221
d'Artsa 151
-
47.
Hracls de la
-
25.
Spulture
coll. W. Rome.. 228
inhumation
-
48.
Buste dit d'Iole
d'Artsa 152 au Louvre 231
438 LISTE DES GRAVURES
Pages
49. Tte du Diadu-
mne de
Poly-
clte 232
50,
51.
Hercule et
l'Hydre
236
52.
Tte
d'Epi-
charme,
de Car-
thage
239
53.
Snque
et
Socrate 241
54.
La Vnus de
Milo suivant
Millingen
250
55.
La Vnus de
Milo suivant
Tarral 251
56.
LaVnus deMilo
suivant Hasse... 256
56 bis. La Vnus de Milo
suivant V. Valen-
tin 260
57.
Vnus et Mars
suivant Zur
Strassen 265
58.
Victoire,
sur la
Colonne
Trajane
269
59.
Restitutions
diverges de la
Vnus de Milo.. 271
60.
Dessins de Vou-
tier
d'aprs
la
Vnus 274
61.
Le Posidon de
Milo 307
Pages
62.
Le Posidon et la
Vnus de Milo.. 311
63.
LaVnusdeMilo
restitue
Stuttgart
353
64.
Aphrodite
sur
la Colonne Tra-
jane
358
65.
Trois statues de
ia Colonne Tra-
jane....
359
66.
67.
Groupe
d'A-
phrodite
et
ros,
coll. Trubert.... 362
68,
69.
La Vnus
d'Agen
369
70.
Groupe d'Aphro-
dite et ros,
Vatican 395
71.
Aphrodite
dcouverte en
Egypte
396
72.
Aphrodite
mena-
ant ros,
de
Myrina
404
73.
Miroir histori
de
Bulla-Regia.
428
74.
Mdaillon de
Bulla-Regia....
430
75.
Petit ct d'un
sarcophage
d'Aquincum...
431
76.
Peinture d'un
vase de Vulci... 434
INDEX SOMMAIRE
Acy (E. d'),
160.
Adaptation
des modles
du ve
sicle,
224-5.
Agesandros, sculpteur,
283
sq.,
332.
Afforacrite, sculpteur,
170.
Aiguillon (Acilio),
226.
Ailerons aux
pieds
d'Herms,
207-8.
Alcamne
,
sculpteur,
170.
Alexandrie,
son com-
merce,
127.
Amazone
galate (?),414,
416
; types
des Ama-
zones dans
l'art,
178.
Ambre,
101
;
ambre et
or,
64.
Ampbitrite
ou
Aphro-
dite ?
310,
327.
Amycles,
trne
d',
192.
Anacron,
169.
Ancne,
arc
d',
366.
Anneaux ouverts avec
disques,
47.
Antinous
Mondragone,
167.
APHRODITE, accroupie,
de
Cnide,
debout sur
une
jambe,
37-9
;
d'Agen,
368-384
;
de
Cnide,
186
;
de
Milo,
189, 250-356
;
sa res-
semblance avec celle
d'Agen,
382
;
resti-
tutions
qu'on
en a
proposes, 265-8,271,
311,
353
;
sa biblio-
graphie,
351-5
;
de
Mdicis,
385-393
;
de
Mitrahine,
394-402
;
de
Myrina,
403-11
;
de
Petworth,
190
;
drape
de
Phidias,
169
;
du Belvdre
au
Vatican,
396
;
Genetrix, 42,
187
;
sur Colonne
Trajane,
357
; petite copie
Pes-
catory,
361
;
ex. du
Louvre, pas
de Fr-
jus,
363
sq.
Apollon
de
Vaupois-
son,
146
;
du Belv-
dre,
191.
Apoxyomne,
182.
Aquincum,
relief d',
432.
Arcsilas,sculpteur,359.
Archasme rel ou fac-
tice,
200
sq.
Ardoise,
pendeloques,
59,
91.
Ares
Borghse,
170.
Artmis de
Chypre,
187.
Artsa,
150-153.
Athna
Albani,
169
;
d'Herculaneum,
195.
Attale,
ex-voto
d',
412-
420.
Autel des Douze
dieux,
202.
Bakkhios,
ddicace
de,
329
sq.
Ble,
dessins
de,
415.
Bartolini, sculpteur,
260.
Bnvent,
tte
de,
183.
Bless de
Crsilas,
177.
Botes
miroir,
425.
Bornholm,
57.
Boure,
diplomate,
295.
Bouts de
ceinture,
160.
Brest
(L.),
consul,
291
sq ;
lettres
Boure,
295
;
David,
277
;
ses inventions, 292,
296, sq.
Bronzes
(grands
et
petits),
33-41.
Bulla-Regia,
427.
Cachette de la Venus de
Milo, 256,
306.
Calamis,
sculpteur,
169,
187,
215.
Callimaque, sculpteur,
174,
187.
Carthage,
tte trouve
au
thtre,
239.
Carton
(Dr),
trouve des
miroirs
reliefs, 427,
429.
Cavalier de
Milo,
355.
Celtes,
destructeurs de
civilisations,
79.
Cphisodote,
184.
Crs
{?),
buste
de,
430.
Chars
votifs,
177.
Chine, peinture juge
par
Perrault,
9.
Ciempozulos,
cra-
mique,
92.
Cintra,
collier
de,
84.
Ciste
Ficoroni,
171.
Clomne, sculpteur,
385,
sq.
Colliers
d'Evora, 81;
de
Penella 83
;
de
Cintra,
84.
Colonne
Trajane,
sta-
tues
figures
sur
la,
357-367
;
reliefs cri-
tiqus par
Perrault,
3
;
Victoire avec bou-
clier,
269.
Copies antiques
et r-
pliques,
33-35
;
on
ne
copie pas
le mar-
bre en
bronze,
mais
la
rciproque
n'est
pas
vraie, 36,
37.
Corail, tymologie, 129;
en Gaule et en
Inde,
142-3
;
dans l'in-
dustrie
celtique,
100-
135.
440 INDEX SOMMAIRE
Coralli,
130.
Corinthe,
Puteal
de,
205-6.
Cornouaille,
51.
Courant
occidental,
99.
Crsilas,
177
;
le
Bless,
44.
Crte,
tombes
myc-
niennes, 150-163;
poste
avanc de l'Eu-
rope chalcolithique,
162.
Croissants d'or irlan-
dais, 45-80,
90
;
chro-
nologie,
96.
Crosses de
schiste,
91.
Cuves funraires en
Crte, 151,
158-9.
Cypsle,
coffret
de,
194.
Danemark
prhis-
torique,
50.
Danseuses
Borghse,
8;
du
calathiscos,
173.
Dattari, collection,
395.
Dauriac, marin,
254.
Degas, peintre,
31-2.
Dlos,
acrotres
de,
176.
Dessin au
trait, peu
estim de
Perrault,
10.
Diadumne,
232
;
Far-
nse,
181.
Diane de
Gabics,
187.
Diitrphs,
177.
Dioscures du Monte-
Cavallo,
170.
Doidalss, sculpteur,
38.
Doryphore,
180-1.
Druidisme,
81.
Dumont
d'Urville, 253,
278,
281.
coles
d'art,
137-9.
pes
de
Crte,
154-5.
phmrieles
de la
Vnus de
Milo,
272-8.
Epicharme,
son
por-
trait, 238-249;
Epi-
charme et
Mnandre,
248.
Epigonos, sculpteur,
416-7.
Erechtheion,
171-3.
Etoffes
collantes, 3,
216.
Eubouleus,
187.
Euphranor, sculpteur,
188-9.
Evora,
collier
d',
81-
99.
Evreux,
J upiter
d',
225.
Ex-voto
suspendus
aux
arbres,
97.
Eyck
(les
Van)
27-
8
;
influences ita-
liennes,
30.
Falconet,
sculpteur,
sur
le
Laocoon,
14.
Faux
antiques
du
temps
de
Perrault,
5.
Flicit,
temple
de
la,
400.
Flix. Voir Vnus.
Femme nue
couche,
20-22.
Ferry (J ules), tromp
par Brest,
292.
Fibule
d'Artsa,
156.
Forbin
(Aug. de),
320.
Frontalit,
17.
Furtwaengler (Adolf)
,
son livre sur la
plas-
tique grecque,
164-
196
;
ses erreurs sur
la Vnus de
Milo,
263
sq, 304-5,
337
sq.
Galates,
statues
de,
412-
3.
Galop
dans
l'art,
19.
Gaule,
art de
la,
136-
149.
Gaulois du
Capitole,
418720.
Gauloise,
416.
Gavr'
Inis,
61.
Gomtrique, style,
98.
Gestes,
histoire
des,
15-
32
; geste
de ten-
dresse,
23-4.
Gobelets
gravs,
92.
Grenats,
succdans des
coraux,
132.
Haches de bronze
gra-
ves,
51-2.
Hagladas, sculpteurs,
180-1.
Hallebardes
prhisto-
riques,
94.
Hallstatt, poque
de,
123
sq.
Hanches
saillantes, 211;
lamain sur la
hanche,
234,
Hauser
(Fr.),
tudie les
reliefs
no-attiques,
20
sq.
Hgias, sculpteur,
168.
Hlne et
Mnlas,
433.
Helenenberg,
183.
Hracls de
Poly-
clte,
227-37
;
avec
hydre,
236-7
;
sur
'arc
d'Ancne,
367.
Hercule. Voir Hrakls.
Herms
d'Olympie,
185;
termes trouvs avec
la Vnus de
Milo,
323-4,
331.
Homre,
ses
portraits,
243.
Hydre,
attribut d'H-
racls, 229,
Idolino, statue,
183.
Inde,
commerce avec
1',
125.
Iole
(?),
230.
Ionien, art,
197.
Irlande,
civilisation
brillante et dca-
dence,
76
;
et Armo-
rique,
61
;
et Portu-
gal, 18,
95
;
riche en
or, 66,
69-70;
prhis-
torique
et
protohis-
torique,
54
sq.
J acques (Pierre),
390.
J upiter.
Voir Zeus.
Kalkmann
(A.),
183.
Kassiteros,
78.
Kertch. Voir Panli-
cape.
Korallioplastai,
105.
Koul-Oba,
tumulus
de,
209.
Kyniskos,
182.
INDEX SOMMAIRE 441
La Fert Hauterive.
89.
Laocoon, jug par
Per-
rault, Voltaire,
Fal-
conet,
13-14.
Latne,
civilation
de,
121
sq.
Le
Brun, compar
Vronse,
11-12.
Lochars,
sculpteur,
356.
Lezoux,
144.
Longprier,lettre
Frie-
derichs,
325.
Lucain,
sur les arbres
sacrs,
97.
Lunules. Voir Crois-
sants.
Macarius
(J oh.),
387.
Mahler
(A.),
35.
Manirisme
ionien,
213.
Marc-Aurle,
sa statue
Rome,
5.
Marcellus
(Ch. de), 255,
257.
Mariemont,
181.
Mas
d'Agenais,
369.
Matterer, 273.
Mduse
Rondanini,
178.
Mlodie sans
harmonie,
10.
Mlos,
Aphrodite de,
250-356
;
son
histoire,
252.
Mnlas et
Hlne,
433.
Menhirs
anthropodes,
139,
140-3.
Mercure de
Lezoux, 144;
oeuvre de
Znodore,
146;
prtendues
images
en
Gaule,
140.
Michaelis
(Ad.),
sur les
statues des Galates
412.
Michon
(E.),
sur la
Vnus de
Milo,
319.
Milo. Voir Melos.
Miniaturistes,
ne
copient
pas
de
peintures
au
xve
sicle, 43.
Minnes en
Irlande,
40.
Miroirs
reliefs,
421
sq.
Misthos,
collection,
403.
Monnaies
inspires par
Phidias,
170.
Morbetto
(il),
417.
Motif du
pied
lev,
184.
Moulages
anciens,
35.
Mouliana,
154-5.
Mousselots
(les),
85.
Moydons (les),
86.
Mycnes
et la Scan-
dinavie,
100. Voir
Crte.
Myres,
161.
Myron d'Eleuthres,
179
;
de
Thbes,
241.
New-Grange,
61.
Nik
aptre, temple
de,
174. Voir Victoire.
Noces
aldobrandines.ll.
11.
Nudit,
motifs nou-
veaux,
20-22.
Odessa,
muse
de,
197
sq.
Omphale (?) 230,
407.
Or, premier
mtal
connu,
11
;
recule
devant la civilisa-
tion,
70
;
et
tain,
73
;
dans
l'Europe
occidentale, 64
sq.
Ovide,
prtendu
tom-
beau
d',
11.
Palmon,
sur l'arc d'An-
cne,
367.
Palmella,
poterie,
92.
Panticape,
relief
de,
197-219.
Paris le
Phrygien,
198.
Parthnon, 168,
171
;
copies
en terre cuite
de la
frise,
195
;
interprtation
des
frontons,
175.
Peitho, 200,
214.
Penella,
collier
de,
83.
Pricls,
portrait de,
177.
Priple
delamer
Rouge,
126.
Perrault
(Ch.),
sa cri-
tique
del'art
antique,
1-14.
Petsofa,
161.
Phidias, 166, 169, 223.
Photographie
instan-
tane,
31-2.
Phryn,
185-6.
Polyclte, sculpteur,
181,
227
sq.
Portugal nolithique,
58.
Posidon de
Milo,
268
sq. ;
333
sq. ;
ana-
logue
la
Vnus,
288
;
original remplac par
une
copie,
341
;
sur
l'arc
d'Ancne,
367.
Praxitle, sculpteur,
185, 384,
400
;
l'an-
cien,
167.
Primitifs,
peu
estims
par
Perrault,
8.
Promachos.
Athna,
167.
Propyles,
172.
Querelle
des anciens et
des
modernes,
1.
Queue
d'aronde,
dra-
perie
en,
217.
Raphal jug par
Per-
rault,
12
;
son des-
sin du
Morbetto,
417.
Rasoir de
bronze,
153.
Ravaisson
(
F.
) ,
d-
couvre les cales de la
Vnus de
Milo,
263
;
propose
une restitu-
tion dela
statue,
268.
Reliefs de
miroirs,
421
35.
Rpertoire mytho-
logique
des
artistes,
435.
Retard,
thorie
du,
56.
Rivire
(Mis
Ch.
de),
299,328.
Robbia
(L. dlia),
29.
Rogier
van der
Wevden,
23,
26.
Rollon,
97.
Rome
(W.),
collection,
233.
442 INDEX SOMMAIRE
Saint-Cme, J upiter de,
220-6.
Saint-Germain,
muse
de,
collier d'or
por-
tugais,
81
;
J upiter
de
Saint
Cme, 220;
Mer-
cure de
Lezoux,
144.
Saint-Sernin,
menhir
anthropode,
162.
Samos,
cole
de,
193.
Sandale
d'Aphrodite,
405-11.
Sangliers celtiques,
131.
Schiste. Voir Ardoise.
Scopas,
184.
Snque, portrait sup-
pos,
238-49.
Serre-plis (?),
47.
Sitcia,
159.
Smilis, sculpteur,
194.
Somze, collection,
181.
Sosandra de
Calamis,
215.
Sphrode,
89.
Spirales,
62.
Stocchades, les,
124.
Stucs
florentins,
29.
Style gaulois,
147-8.
Stylisation,
98-9.
Ta'onnires
d'Herms,
208.
Tarquinii, ivoires,
207.
Tarral
(Cl.),
293
sq.;
son
mmoire sur laVnus
de
Milo,
342-51.
Tartessos,
63.
Tlsias,
sculpteur
311.
Terre
nourricire,
sta-
tue de
la,
176.
Thodoridas, citoyen
de
Mlos,
283
sq. ; 285,
307,
355
;
ddie au
ive sicle une of-
frande
Posidon,
285,
335 : son nom
lu
par
S. R. sur la
base d'un herms
trouv avec la
Vnus,
283,
317
;
cette ins-
cription
retrouve au
Louvre,
313.
Thespies,
401.
Tireur
d'pine,
192.
Tissot
(Ch.)
333
sq.
Torse
Mdicis,
167.
Trogoff,
document dit
de, 271,279.
Trne
amyclen,
192
sq.
Vaupoisson. Apollon de,
146.
Vnus. Voir
Aphrodite,
Vnus
felix, 397,
399-
Vronse, compar
Le
Brun,
11-12.
Victoire avec
bouclier,
sur la Colonne Tra-
jane,
269,
Vienne
(Isre),
tte
d'ivoire,
209.
Vourlias 160.
Voutier, 274, 275, 303,
339;
son dessi
d'aprs
la Vnus de
Milo,
274,
Vulci,
vase
de,
434.
Winckelmann,
33.
Wiirzbourg,
Hracls
de,
235.
Xanthoudidis, explo-
rateur de la
Crte,
150.
Xenos,
fouille
Milo,
301.
Ypres,
tableau
d', 24,
Znodore, sculpteur.
146.
Zeus de
Saint-Cme,
220-6: dit de
Talley-
rand,
168.
TABLE
ANALYTIQUE
DES MATIRES
Pages
PRFACE vii-vm
I. Charles
Perrault, Critique
d'art 1-14
Ch. Perrault et la
Querelle
des anciens et modernes
;
sa lecture
l'Acadmie,
1.
Le Parallle et la
critique d'art,
2.
Critique
de la Colonne
Trajane,
des
draperies mouilles, etc.,
3.
Antiques
et faux
antiques,
4-5.
Le Marc Aurle de
Rome,
5.
Le bas-
relief des Danseuses
Borghse,
8.
Critique
dela
peinture
romaine
et des
primitifs.
89.
La
peinture
de la
Chine,
9.
Le dessin au
trait
;
la
musique
sans
harmonie,
10.
Les noces Aldobrandines
;
letombeau
d'Ovide,
11.
Le
BrunetVronse, 11-12.Raphal,
12.
Critique
du
Laocoon,
13.
Voltaire et Falconet sur le
Laocoon,
14.
II. L'histoire des
gestes
15-32
Gestes et attitudes
;
difficult de l'histoire des
gestes,
15.
Progrs
dans la
reprsentation
des
gestes ; frontalit,16-17.
Len-
teur de
l'volution 18.
Reprsentation
du
galop,
19.
Nudits
;
lemotif de la femme couche dans
Titien, Velasquez, Baudry,
20-
22.
Aucun artiste n'est
lve
de la
nature,
22.
Le
geste
de
l'enfant embrassant le cou de sa
mre;
Kourotrophes
et
Vierges,
23.
Tableau
d'Ypres ;
les
peintres
anversois, 24.
Le
geste
de
tendresse
;
tableau de lafamille de
Horn,
24-25.
Tableau
d'aprs
Rogier
chez
Cernuschi,
23.
Dessin de
Rogier
Dresde
;
tableaux
d'aprs
Grard
David,
26.
J ean van
Eyck
et la
Vierge
la fon-
taine,
27-28.
Stucs florentins
;
Luca Dlia
Robbia,
29.
Influences italiennes sur les Van
Eyck,
30.
La
photographie
instantane instruit
Degas,
31-32.
III. Grands et
petits
bronzes 33-44
Winckelmann sur les
copies antiques,
33.
Copies
et
rpliques
;
thorie de
Furtwaengler
sur les
moulages, complte par
S.
Reinach,
34-35. Mahler et le
Replikenschatz,
35.Les anciens n'ont
pas copi
de
marbres en
bronze,
sauf
exceptions plus apparentes que relles,
36-37.La
Cnidienne,
l'Aphrodite accroupie, l'Aphrodite
debout sur
une
jambe,
37-39.
L'Aphrodite
de
Doidalss,
38.
Une statue de
marbre ne doit
pas
tre
copie
en
bronze,
40-41:
Applications
dece
principe,
41.
L'Aphrodite genetrix,
42.
Les miniaturistes
du xve sicle ne
copient pas
des
peintures,
43.
Le Bless de
Crsilas,
44.
IV. Ls croissants d'or irlandais 45-80
Richesse en or du Muse de
Dublin,
45.
Poids lev des
objets,
46.
Anneaux termins
par
des
disques ;
serre-plis,
47.
Crois-
444 TABLE
ANALYTIQUE
DES MATIERES
sants, lunules, minnes,
48.
Dcoration
limite,
toute
gom-
trique,
49.
Analogies
au
Danemark,
50.
Croissants trouvs
enCornouaillc avec haches debronze
plates,
51.
Haches debronze
anglaises
et danoises dcores comme les
lunules,
51-52.
Erreur
de Frazer sur ladate des
lunules,
53.La littrature et
l'archologie
en
Irlande,
54.
Vues
judicieuses
et erreurs de
Coffey,
54-55.
La thorie du retard de
l'Europe occidentale,
rfute
par
Monte-
lius,
56.
Fouilles de Vedel
Bornholm,
57.
L'Irlande et le
Portugal
l'poque nolithique ; pointes
de
flche,
58.
Pendelo-
ques portugaises
en
ardoise,
59.
Irlande,
Espagne
et
Scandinavie,
60.
Irlande et
Armorique; New-Grange
et
Gavr'inis,
61.
Migra-
tions de la
spirale,
62.
La marine irlandaise
; Tartessos,
63.
Ambre et
or,
64.
L'or dans
l'Europe occidentale,
65.
L'or
de l'Irlande en
Scandinavie, 66,
Distribution
gographique
des
lunules,
67.
Collier ou
hausse-col,
67-68.
Torques gaulois
69.
L'Irlande a t un
Eldorado,
69-70.
L'or recule devant
la
civilisation,
70.
L'or, premier
mtal recueilli
;
observations
de
Fournet,
71.
L'or
l'ge
dela
pierre polie,
72.L'or et
l'tain,
73.
L'or en
Sibrie,
en
Nubie,
74.
puisement rapide
des
gisements d'or,
75.
Civilisation brillante de
l'Irlande,
suivie
d'une dcadence
; phnomnes analogues
en Gaule et en
Grce,
76-77.
Le mot
kassiteros,
78.
Invasion des Celtes
;
la bar-
barie fut
celtique,
79.
Le druidisme
irlandais,
80.
V. Le collier d'Evora
81-99
Collier d'or
pesant
2.300
grammes
auMusede
Saint-Germain,
81.
La trouvaille
d'Evora,
81-82.
Collier de
Penella,
83.
Collier
de
Cintra,
84.
Pendant d'or des
Mousselots,
85.
Tonnelet
des
Moydons,
86.
Signification
des
bijoux lourds,
87.
Orne-
ments du collier
d'Evora,
88.
Sphrode
de La
Fert-Hauterive,
89.
Lunules d'or
d'Irlande,
90.
Crosse deschiste
portugaise
compare
d'autres
crosses,
91.
Poterie de Palmella et de Ciem-
pozuelos
l'ge
du cuivre
; gobelets gravs,
92.
Thses de Siret
et de Nils
Aoberg,
93.
Hallebardes,
94.
Irlande et
Portugal,
95.
Chronologie
des lunules
;
opinions
de Montelius et de
Siret,
96.
Ex-voto
suspendus
aux arbres
;
tmoignage
de
Lucain,
97.
Histoire de
Rollon,
97-98.
Dcor
gomtrique
et
style gom-
trique
;
art naturaliste et
stylisation,
98-99.
Arthur Evans
et le courant
occidental,
99.
VI. Le corail dans l'industrie
celtique
100-135
Mycnes
et Scandinavie
;
thse de
Montelius,
100.
Com-
merce de l'ambre et du
corail,
101.
Origine
du
corail,
102.
Corail de l'ouest de la
Mditerrane,
103.
Corail de
Tunisie,
104.
Korallioplaslae,
105.
Corail dans les
ncropoles
d'Ita-
lie,
106-107.
Corail dans les
ncropoles d'Allemagne,
107-
108.
Corail la fin du hallstattien
;
statistiques
d'O.
Tischler,
109.
Corail en
Hongrie
et en
Russie,
110-111.
Corail en
Grande-Bretagne,
111-112.
Corail en
Gaule,
distribution des
trouvailles,
112-119.
Emplois
dcoratifs du corail la fin de
l'poque
de Hallstatt et celle do
Latne,
119.
Chronologie ;
corail et vases
peints imports
en
Gaule,
120.
La civilisation de
TABLE
ANALYTIQUE
DES MATIERES 445
Pages
Latne o
parat
le corail n'est
pas
celle de la Gaule de
Csar,
121-122.
Ncropoles
dusecond
ge
du fer en
Gaule,122.Passage
de la civilisation de Hallstatt celle de
Latne,
123.
Le corail
des les
Stoechades,
124-125.
Tmoignage
de Pline sur
l'emploi
du corail en Gaule
;
commerce avec
l'Inde,
125.
Le
Priple
de
la mer
Rouge,
126-127.
Rle d'Alexandrie dans le commerce
du
corail,
127.
Superstitions celtiques
relatives au corail
;
le
corail en mdecine
; tymologie
du
mot,
128-129.
Les Coralli
voisins de
Tomi,
130-131.
Sangliers celtiques,
131.
Corail,
mail
rouge
et
grenats,
132-133.
Got des Gaulois
pour
les
couleurs
vives,
134.
Rle du corail dans la
civilisation,
135.
VII,
Ides
gnrales
sur l'art de la Gaule au dbut
du xxe sicle 136-149
L'histoire de l'art est celle des
styles,
136.
Pas d'art sans
coles,
137.
Paradoxe de Virchow sur les coles
d'art,
138.
L'cole des
sculpteurs
et
graveurs
de
l'ge
du renne et
l'poque
de
dolmens
;
menhirs
anthropodes,
139.
Prtendues
images
de Mercure mentionnes
par
Csar,
140.
Style
dcoratif en
Gaule
; polychromie,
141.
Corail en Gaule
; exportation
Alexandrie et de l en
Inde,
142-143.
Art
gallo-romain,
143.
Le Mercure de
Lezoux,
144.
volution du
type plastique
de
Mercure,
145.
Le Mercure de Znodore
;
l'Apollon
de
Vaupois-
son,
146.
Bronzes
gallo-romains ; objets
d'art
imports
ou
indiues,
147.
Le
style gaulois
survit la
conqute
romaine,
148-149.
VIII. Tombes
mycniennes
en Crte 150-163
Fouilles de Xanthoudidis
;
coffres
d'argile
funraires
d'Artsa,
150-151.
Imitation des coffres de
bois,
152.
Vases
mycniens
d'Artsa
;
rasoir de
bronze,
153.
Tombes de Mouliana
; pes
de
bronze,
154-155.
Fibules,
vases
gomtriques
et cuvefunraire de
Mouliana,
156-158.
Coffre
d'argile
de
Siteia,
159.
Tombes
de
Vourlia,
160.
Thse d'Ernest
d'Acy
sur les bouts de ceinture
franges pris pour
des
jambes,
160.
La statuette de
Petsofa,
161.
La
Crte, poste
avanc de
l'Europe chalcolithique,
162.
Menhirs
anthropodes,
160-163.
IV. Adolf
Furtwaengler
et la
plastique grecque...
164-196
Les Meisterwerke de
Furtwaengler,
164.
Application
de la
mthode de
Morelli,
165.
La Lemnia de
Phidias,
166.
La Pro-
machosdePraxitle l'ancien
;
letorse deMdicis
;
Phidias
rimonien,
167.
Le Zeus
d'Olympie
et les
sculptures
du
Parthnon,
168.
Aphrodite
et ros dePhidias
; Calamis,
169.
Alcamne
; Ago-
racrite
;
les Dioscures du Monte
Cavallo,
170.
Diffusion de l'art
de Phidias
;
le
temple
d'Athna sur
l'Acropole,
171.
Les
Propy-
leset
l'Erechtheion,
172-173.
Le
temple
de Nik
; Callimaque,
174.
Interprtation
des frontons du
Parthnon,
175.
Acro-
tres de
Dlos,
176.
Chars votifs
; Crsilas,
177.
Mduse
Rondanini,
178.
Myron,
179.
Polyclte,
181.
Le
Dory-
phore,
181.
Athlte versant de
l'huile,
182.
Idolino
;
tte
de
Bnvent,
183.
Scopas,
184.
Praxitle,
185.
Aphrodite
de
Cnide,
186.
Aphrodite Genetrix,
187.
Euphranor,
188.
446 TABLE
ANALYTIQUE
DES MATIERES
Pages
La Vnus de
Milo,189.
L'Aphrodite
de
Petworth,
190.
L'Apol-
lon du Belvdre,
191.
Le trne
amyclen,
192.
L'cole de
Samos,
193.
Smilis
;
le coffret de
Cypsle,
194.
-
Les
copies
en terre cuite dela frise du
Parthnon,
195.
Qualits
durables de
l'oeuvre de
Furtwaengler,
196.
X. Un bas-relief de
Panticape
au Muse d'Odessa. 197-219.
Influence de l'art ionien sur l'art
attique,
197.
La forma-
tion de l'art
classique
reste
obscure,
198.
Bas-relief de Pantica-
pe (Kertch),
199.
Artmis,
Apollon,
Herms, Peitho,
200.
OEuvre
archaque
ou archasante ?200.
Vases archasants
;
autel
des douze
dieux,
202.
Pas d'archasme factice dans le bas-relief
de
Panticape.
203.
Herms avec
ptase
ail,
204.
Putea! de
Corinthe,
205206.
Ailerons fixs aux
pieds
d'Herms,
207.
Talonnires
recoquilles,
208.
Ivoire du tumulus de
Koul-Oba,
209-210.
Taille mince et hanches
saillantes,
211.
Un
passage
des Nues
d'Aristophane,
212.
Le manirisme
ionien,
213.
La Peitho de Kertch et la Sosandra de
Calamis,
214215.
Les
toffes
collantes,
la
queue
d'aronde. 216-217.
Panticape
tait
dchue
l'poque rorr.aine,
218.
Diffusion des motifs ioniens
au ve
sicle,
219.
XL
Le
J upiter
de Saint-Cme 220-226
Premire
publication
en 1857 et achat
par
le Muse de Saint-
Germain en
1901,
220.
Beaut de cette
statuette,
221.
Type
trs
rpandu
de Zeus
debout,
222.
Rapports
de
l'originel
avec
Phidias,
223.Adaptation
des modles du ve
sicle,
224.-Combi-
naisons de diffrents
types,
comme dans le
J upiter
d'Evreux,
225.
Aiguillon,
localit
explorer,
226.
XII. Un Hracls de
Polyclte
227-237
Hracls
sculpt par Polyclte,
227.
Il n'est
pas
certain
qu'il
ait
sculpt
l'Hracls tuant
l'hydre,
228.
L'hydre
attribut
d'Hracls,
229.
L'Omphale
ou Iole du
Louvre,
230-231.
Caractres des ttes de
Polyclte ;
le Diadumne du
Louvre,
232.
Hracls dela collection W.
Rome,
233.
Attitude de la main
sur la
hanche,
234.
Statuette d'Hracls
Wrzbourg,
235.
Hracls
l'hydre, type
remontant
peut-tre
Polyclte, 236,
237.
XIII. Un
portrait mystrieux
238-249
Le
portrait
dit de
Snque,
238.
Exemplaire
trouv Car-
J J
thage,
239.
Eratosthne,
suivant
Bernoulli,
240.
Hypo-
thse de P. Six sur
Myron
de
Thbes,
sculpteur,
241.
Phil-
mon,
suivant
Studniczka,
242.
Portraits convenus
d'Homre,
243.
Archiloque,
suivant P.
Arndt,
244.
Hipponax,
suivant
Furtwaengler,
245.
On ne
peut songer
Aristophane,
mais
Epicharme,
246.
-
Caractre des crits
d'Epicharme,
247.
Epicharme
associ Mnandre dans un double herms et dans les
vers
d'Horace,
248.
Hypothse
de Ph.
Legrand
sur
Philistion,
249.
TABLE
ANALYTIQUE
DES MATIERES 447
Pages
XIV. La Vnus de Milo en 1890 250-270
Difficult des
problmes
soulevs
par
cette statue;
il
n'y
a
pas
un,
mais
plusieurs mystres, 250,
251.
Histoire sommaire
de
Milo,
252.
La dcouverte de la statue raconte
par
Dumont
d'Urville,
253.
-
Tmoignage
de
Dauriac,
253.
Tmoignage
de
Marcellus,
255.
Hypothse
d'Edm. Le Blant : la statue aurait
t cache
par
des
paens.
256.
Embarquement
de la statue
;
rlede
Marcellus,
257.
La
prtendue
base
inscrite,
258.
Contro-
verses sur la date de la
statue,
259.
Apprciations
de la statue :
Bartolini,
260.
Ecole
attique
ou
hellnistique
? 261.
Semi-
nudit,
262.
Dcouverte des cales
par Ravaisson,
263.
Vnus
et la
pomme
de
discorde,
264.
Cinq
tentatives de restitution
par
Tarral, Hasse,
V.
Valentin, Quatremre, Ravaisson,
265-
268.
La Victoire au bouclier de la Colonne
Trajane,
269.
Le
Sphinx
n'a
pas
dit son
nigme,
270.
XV. Documents et
hypothses
rcentes sur la Vnus de
Milo
271-356.
i. Le document
Trogoff.
Sept
restitutions
graphiques
de
la
Vnus,
271.
phmrides
de la
Vnus,
272-278.
Le
mmoire de
Matterer,
273.
Le dessin et le rcit de
Voutier,
274-275.
Lettre de Dauriac P.
David,
276.
Lettre de
Brest P.
David,
277.
il. La base inscrite et les herms.
Dumont
d'Urville,
278.
Trogoff dpend
de Dumont
d'Urville,
279.
La
question
des
bras,
280.
Critique
de la relation de Dumont
d'Urville,
281.
-
Bases
inscrites des deux herms
;
Agsandre
et
Thodoridas,
283.
Furtwaengler suspecte
tort
Voutier,
283.
Erreur fondamentale
de
Furtwaengler,
284.
m. Thodoridas et lePosidon deMilo.
Ex-voto de Thodoridas
Posidon,
285.
Dcouverte du Posidon de
Milo,
286.
Sta-
tues trouves au mme
endroit,
287.
Analogies
du Posidon et
de la
Vnus,
288.
La base de
Thodoridas,
avec caractres du
ive
sicle,
fixe la date de la
Vnus,
289.
Hypothse
d'une res-
tauration
antique
de la
Vnus,
290.
iv. Louis Brest et la Vnus deMilo.
Mort deBrest
;
le fils
Brest,
291.
Erreur deJ ules
Ferry,
292.
Thses de
Tarral,
293.
Ses
papiers,
294.
Rapport
de Brest
Boure,
295.
Inventions
de
Brest,
296-297.
La bataille
pour
la Vnus est un
mythe,
298.
Conduite
singulire
attribue
par
Brest, au M>"de
Rivire,
299.
La Vnus a t dcouverte sans
bras,
300.
Fouilles
de Xnos
Milo,
301.
Autres statues trouves
Milo,
302.
v. Conclusions
provisoires.
Importance
du
rapport
de Brest
et des dessins de
Voutier,
303.
Erreurs de
Furtwaengler,
304
305.
La Vnus tait dans un
dpt
de
chaufournier,
306.
La
base de la statue de
Thodoridas,
307.
Date du
Posidon,
309.
Vnus ou
Amphitrite
? 310.
Le
sculpteur
Tlsias,
311.
Association
de Posidon et
d'Amphitrite,
312.
vi.
Dcouverte au
Louvre de lu base de Thodoridas.
Commu-
nication de Hron de
Villefosse,
313.
Observations de S. Rei-
nach,
314.
Texte
intgral
de la note d'Hron de Villefosse
;.
la lettre de
Longprier
Friederichs, 314-319,
325.
448 TABLE
ANALYTIQUE
DES MATIERES
Pages
vu. Nouveaux
tmoignages relatifs
la Vnus deMilo.
Article
d'E.
Michon,
319.
Rle do
Forbin,
320.
Date de la dcouverte
de la
Vnus,
321.
La
lgende
du
J ugement
de
Paris,
322.
La ddicace de. l'herms
barbu,
323.
L'herms imberbe a
support
une
main,
324.
Dsaccords entre Clarac et les archi-
tectes du Louvre. 325.
Mdaille commmorative de
l'acqui-
sition dela
Vnus,
326.
M. Michon incline dnommer la statue
Amphithrite,
327.
vm. La ddicace de la niclie o se trouvait la Vnus.
Inscription emporte par
le M
18
de
Rivire,
328.
Ddicace de
Bakkhios,
329.
Bakkhios n'a
pas
ddi la
Vnus,
330.
Les
deux herms ne sont
pas contemporains,
331.
La
signature
sur la base de l'herms barbu n'a rien voir avec la
Vnus,
332.
ix.
La dcouvertedu Posidon de Milo.
Rle et
rapport
de
Charles
Tissot,
333-336.
x.
Furtwaengler
et la Vnus deMilo.
Hypothse
deFurtwaen-
gler
sur la Vnus et les herms dans le
gymnase
de
Milo,
337.
La statue serait
plus
rcente,
338.
Le dessin de Voutier serait
sans
autorit,
339.
Lelieudit
Klima,
340.
LePosidon de Milo
peut
tre une
copie
de
l'original emport par
les
Romains,
341.
La
statue de
Tralles,
342.
xi. La dcouverte de la Vnus de Milo.
Publication d'un
mmoire indit de
Tarral,
342-351.
XII. Notes
complmentaires
sur la Vnus.
Bibliographie
des
articles
qui
la
concernent,
351-354.
Hypothses
et erreurs
rcente son
sujet,
354-355.
xm.
pilogue.
-
Le cavalier colossal de Milo et la base de
Thodoridas, 355,
356.
Le Posidon
serait,
suivant P.
Arndt,
de
Lochars,
356.
XVI.
Quatre
statues
figures
sur la Colonne
Trajane.
357-367
Copie
de la Vnus
genetrix
sur la
Colonne,
357.
La statue
figurait
dans le
temple
d'Ancne,
358.
La statue d'Arcsi-
las,
359.
Arcsilas n'a
pas
invent le
motif,
360.
La
petite
copie Pescatory-Trubert,
361.
Caractre
archaque
de cette
copie
grecque,
362.
La statue du Louvre vient de
Naples,
non de
Frjus,
363.
Histoire de la Vnus
genetrix
du
Louvre,
364.
Dif-
frents tats du motif de la Vnus
drape,
365.
Les trois statues
sur l'arc
d'Ancne,
366.
Posidon,
Hracls et
Palmon,
367.
XVII. La Vnus
d'Agen
368-384
Opinion
de
Quicherat
sur cette
statue,
368.
Le
Brgnet
et LeMas
d'Agenais,
369.
Martyre
desaint
Vincent,
370.
Dcouverte de
la
statue,
371.
Dcouverte de
fragments
de
ttes,
372. Histoire
de
l'acquisition
dela
statue,
373-377.
Tentatives de
restitution,
377-380.
Fragment
d'un
bras,
380.
Essai
d'adapter
une tte
de mme
provenance
la
statue,
381.
Ressemblance avec la
Vnus de
Milo,
382.
Dfauts dela Vnus
d'Agen,
383.
L'ori-
ginal appartenait
l'cole de
Praxitle,
384.
.XVIII.
Recherches sur la Vnus de Mdicis 385-393
Prtendue signature
de
Clomne,
385.
La fonte de
Keller,
TABLE
ANALYTIQUE
DES MATIRES 449
Pages
387.
La
copie
de
Macarius,
387.
Le Vnus de Mdicis ne
fut d'abord
qu'un fragment,
388.
Texte
d'Aldroandi,
389.
Dessins de Pierre
J acques,
390.
Restaurations effectues
depuis
1576,
391.
Brisure nouvelle de la statue restaure lors de son
transport
Florence,
392.
Il
n'y
a
d'authentique que
le torse
et l'amorce des
bras,
393.
XIX. Statuette
d'Aphrodite
dcouverte dans la Basse-
Egypte
394-402
Influence de Praxitle sur les marbres de la
Basse-Egypte,
394.
Statuette de
Mitrahine,
dans la Collection
Dattari,
395.
Type
de
l'Aphrodite
du Belvdre au
Vatican,
396.
Cl-
brit decette
sculpture,
397.
Nombreuses
rpliques
et
imitations,
398.
Ddicace Vnus
Flix, 397,
398.
Statue de Praxitle
place
Rome devant le
temple
de
Flicitas,
400.
Elle
pro-
venait
peut-tre
de
Thespies,
401.
Objections d'Amelung
l'identification de
l'original
avec une
Aphrodite
et Eros de Praxi-
tle et
rponses
ces
objection?,
402.
XX.
Aphrodite
et
ros, groupe
de
Myrina
au Muse
d'Athnes 403-411
La collection
Misthos,
403.
Aphrodite
chtiant
ros,
terre-
cuite de
Myrina,
404.
La sandale aux mains dela
desse,
405.
Inutilit de faire intervenir le
symbolisme,
406.
Thse de Ste-
phani
:
Omphale
et non
Aphrodite,
407.
Rfutation de la thse
clectique
d'A. de
Ridder,
408-411.
XXI. L'ex-voto d'Attale et le
sculpteur pigonos...
412-420
Mmoire de Michaelis sur les statues de
Galates,
412.
Dcou-
verte des statues de Galates
Rome,
413.
La statue fminine
dite
Amazone-mre,
414.'Les dessins de
Ble,
415.
Amazone
ou Gauloise ? 416.
-
La
composition
de
Raphal
dite //
morbetto,
417. Le
sculpteur Epigonos,
416,
417.
-
La Mater
interfecia,
pendant
du Gaulois mourant du
Capitole,
418-420.
XXII. Reliefs de miroirs en bronze dcouverts Bulla-
Regia
421-435
Miroirs
grecs
reliefs,
421.
Raret des miroirs romains his-
toris, 422,423.Miroirs d'argent
et de
verre,
424.
Classification
des miroirs
grecs
;
botes
miroir,
425.
Des miroirs taient
placs
dans les
tombes,
426.
Dcouverte de miroirs avec cou-
vercle dor et reliefs
Bulla-Regia,
427.
Publication du Dr Car-
ton leur
sujet,
429.
Buste fminin sur un de ces
miroirs,
429.
Image
de Crs ? 430.
Miroir avec scne
mythologique,
431.
Comparaison
avec un relief
d'Aquincum,
432. Mnlas et
Hlne,
433.
Comparaison
avec une
peinture
de vase de
Vulci,
434.
Le
rpertoire mythologique
des artistes
romains,
435.
LISTEDESGRAVURES 437-438
INDEX SOMMAIREET TABLE
ANALYTIQUE
439-449
S. REIN'ACH 29
Fontenay-aux-Roses.
1929
Imprimerie
desPresses UniversitairesdeFrance.
Louis Bellenaad.
1.421
LIBRAIRIE ERNEST LEROUX
28,
RUE
BONAPARTE,
PARIS
(VIe)
SALOMON REINACH
Membre de
l'Institut,
Conservateur des Muses Nationaux
RPERTOIRE DE LA STATUAIRE
GRECQUE
ET ROMAINE
TOME I.
Clarac de
poche,
contenant les bas-reliefs
de l'ancien fonds du Louvre et les statues anti-
ques
du Muse de
Sculpture
de Clarac. Nouvelle
dition,
un volume in-12 40
TOME II.
Volume
I,
troisime dition 30
Volume
II,
seconde dition
puis
TOME III.
Seconde
dition,
un volume in-12 20
TOME IV.
Un volume in-12 20
TOME V.
En deux
volumes,
chacun 20
TOME VI.
Sous
presse.
RPERTOIRE DE PEINTURES
GRECQUES
ET ROMAINES
Un volume
grand
in-8 65
RPERTOIRE DE RELIEFS GRECS ET ROMAINS
Trois volumes
grand
in-8,
chacun 40
RPERTOIRE
DE PEINTURES
DU MOYEN AGE ET DE LA RENAISSANCE
Six volumes
in-i2j
chacun 40
RPERTOIRE
DES VASES PEINTS
GRECS
ET
TRUSQUES
Deux volumes in-12
(deuxime dition,
revue et
corrige),
chacun
30
Vous aimerez peut-être aussi
- Histoire de La GauleDocument400 pagesHistoire de La GauleMarius AndronePas encore d'évaluation
- Les Signes AlchimiquesDocument16 pagesLes Signes AlchimiquesJanWillPas encore d'évaluation
- Études sur l'histoire de la peinture et de l'iconographie chrétiennesD'EverandÉtudes sur l'histoire de la peinture et de l'iconographie chrétiennesPas encore d'évaluation
- Fichier Heraldique de La Haute Vienne - DocDocument182 pagesFichier Heraldique de La Haute Vienne - DocLutal100% (1)
- Au Temps Des CeltesDocument20 pagesAu Temps Des Celtesbibounette13Pas encore d'évaluation
- Griaule, M. Remarques Sur L'once Utérin Au Soudan (1954)Document16 pagesGriaule, M. Remarques Sur L'once Utérin Au Soudan (1954)Rafael PachecoPas encore d'évaluation
- La Langue Gauloise - ToponymieDocument4 pagesLa Langue Gauloise - ToponymieVirginio MantessoPas encore d'évaluation
- P Borgeaud L'Animal Comme Operateur SymboliqueDocument8 pagesP Borgeaud L'Animal Comme Operateur SymboliqueAngelo_ColonnaPas encore d'évaluation
- Dante 1Document12 pagesDante 1Birsan Marilena GianinaPas encore d'évaluation
- Meillet, Divinités Gauloises, Sucellus Et Nantosuelta, Epona, Dieux de 1925Document36 pagesMeillet, Divinités Gauloises, Sucellus Et Nantosuelta, Epona, Dieux de 1925MelenigPas encore d'évaluation
- Oeuvres de Tacite. Tome 6Document429 pagesOeuvres de Tacite. Tome 6Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- LA-1 OndineDocument7 pagesLA-1 OndineKubrick StanislasPas encore d'évaluation
- Le Culte Du Numen ImpérialDocument5 pagesLe Culte Du Numen Impérialilia83% (6)
- Leroi-Gourhan. Les Mains de Gargas. Essai Pour Une Étude D'ensemble PDFDocument17 pagesLeroi-Gourhan. Les Mains de Gargas. Essai Pour Une Étude D'ensemble PDFAngel MadariagaPas encore d'évaluation
- Cumont, F. 'Une Figurine Grecque D'envoûtement' CRAI 57.6 (1913) 412-21Document11 pagesCumont, F. 'Une Figurine Grecque D'envoûtement' CRAI 57.6 (1913) 412-21Mr. PaikPas encore d'évaluation
- Poésie Pour Tous - Les ÎlesDocument11 pagesPoésie Pour Tous - Les ÎlesRe ChabPas encore d'évaluation
- L'Osselet ToxiqueDocument1 pageL'Osselet Toxiqueleroi77Pas encore d'évaluation
- 3021-B - L'eau Et L'épiDocument7 pages3021-B - L'eau Et L'épiSmooth BigmackPas encore d'évaluation
- Quand La Pierre Devient CireDocument33 pagesQuand La Pierre Devient CireMarie-JoséeRizkallahPas encore d'évaluation
- Les Présages Lunaires de Virgile Et Les SelenodromiaDocument13 pagesLes Présages Lunaires de Virgile Et Les SelenodromiaceudekarnakPas encore d'évaluation
- La Fleur Des Belles Épées: L'épée de César BorgiaDocument7 pagesLa Fleur Des Belles Épées: L'épée de César BorgiaMel LewisPas encore d'évaluation
- Pironti - Entre Ciel Et GuerreDocument342 pagesPironti - Entre Ciel Et GuerrelynnsimhaserfatyhakimPas encore d'évaluation
- La Conquête de L'inutile. Les Géographies Imaginaires de L'eldoradoDocument51 pagesLa Conquête de L'inutile. Les Géographies Imaginaires de L'eldoradoJuan José Velásquez ArangoPas encore d'évaluation
- Khunrath Amphithéâtre (FR) 1609Document126 pagesKhunrath Amphithéâtre (FR) 1609Alexis S.33% (3)
- RT 09Document208 pagesRT 09Ivan BogdanovPas encore d'évaluation
- Annuaire Bretagne 1897 PDFDocument193 pagesAnnuaire Bretagne 1897 PDFrodPas encore d'évaluation
- Ninfas No Azulejos de Adriana VarejãoDocument19 pagesNinfas No Azulejos de Adriana VarejãoRenata LimaPas encore d'évaluation
- Essais d'un dictionnaire universel: Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des ArtsD'EverandEssais d'un dictionnaire universel: Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des ArtsPas encore d'évaluation
- Les Origines de L'AlchimieDocument529 pagesLes Origines de L'AlchimieurmuzroPas encore d'évaluation
- Mrugala Fabrice - Les Dieux La Mythologie Et La Religion Celte PDFDocument37 pagesMrugala Fabrice - Les Dieux La Mythologie Et La Religion Celte PDFtiennosPas encore d'évaluation
- Cumont, F. 'Les Enfers Selon L'axiochos' CRAI 64.3 (1920) 272-85Document15 pagesCumont, F. 'Les Enfers Selon L'axiochos' CRAI 64.3 (1920) 272-85Mr. PaikPas encore d'évaluation
- Le monde enchanté : choix de douze contes de fées: Précédé d'une Histoire des fées et de la littérature féerique en FranceD'EverandLe monde enchanté : choix de douze contes de fées: Précédé d'une Histoire des fées et de la littérature féerique en FrancePas encore d'évaluation
- Exposé GIOTTO Alexia OrfanoudakisDocument25 pagesExposé GIOTTO Alexia Orfanoudakisapi-3709589100% (1)
- Calderon de La Barca - Theatre 2Document356 pagesCalderon de La Barca - Theatre 2duckbannyPas encore d'évaluation
- Isis Dévoilée Clef Des (... ) Blavatsky H Bpt6k65334jDocument484 pagesIsis Dévoilée Clef Des (... ) Blavatsky H Bpt6k65334jrichardPas encore d'évaluation
- La Figure D'epistemon Rabelais, Condorcet, Castoriadis, DurandDocument22 pagesLa Figure D'epistemon Rabelais, Condorcet, Castoriadis, DurandGeorges J-f Bertin100% (1)
- Imprimeurs Et Libraires Parisiens Du (... ) Renouard Philippe Bpt6k58392504Document555 pagesImprimeurs Et Libraires Parisiens Du (... ) Renouard Philippe Bpt6k58392504James BetercorePas encore d'évaluation
- La Gorgone MeduseDocument2 pagesLa Gorgone MeduseMasurePas encore d'évaluation
- Empécocle CalcidiusDocument18 pagesEmpécocle CalcidiusWalter Benjamin Seminario PermanentePas encore d'évaluation
- La Police, Les Anormaux Et Leurs Archives Au XVIIIe SiècleDocument31 pagesLa Police, Les Anormaux Et Leurs Archives Au XVIIIe SiècleRone SantosPas encore d'évaluation
- Etudes Gnostiques Philosophumena PDFDocument6 pagesEtudes Gnostiques Philosophumena PDFGarry Deroy100% (1)
- Aliments Symboliques. Romans Arthuriens (A. Guerreau-Jalabert)Document35 pagesAliments Symboliques. Romans Arthuriens (A. Guerreau-Jalabert)theseus11Pas encore d'évaluation
- Auvers-Disque CeltiqueDocument15 pagesAuvers-Disque CeltiquealinhentPas encore d'évaluation
- PDF Les Anciens CeltesDocument5 pagesPDF Les Anciens CeltesH_WotanPas encore d'évaluation
- Descola PhilipeDocument24 pagesDescola PhilipeNian PissolatiPas encore d'évaluation
- CosmogonieDocument9 pagesCosmogonieفؤاد المراكشيPas encore d'évaluation
- L OeufDocument8 pagesL OeufJoe BuloniPas encore d'évaluation
- Vaquie-Le Mythe Du GraalDocument15 pagesVaquie-Le Mythe Du GraalRaphael888Pas encore d'évaluation
- Une Métaphysique Critique Pourrait Naître Comme Science Des DispositifsDocument29 pagesUne Métaphysique Critique Pourrait Naître Comme Science Des Dispositifsfalco5000Pas encore d'évaluation
- Dictionnaire de Sciences MédicalesDocument794 pagesDictionnaire de Sciences MédicalesDiego Fernando GuerraPas encore d'évaluation
- Laloy Miroir de La ChineDocument313 pagesLaloy Miroir de La ChineGera Janka100% (1)
- Le Mystérieux Artéfact de AiudDocument11 pagesLe Mystérieux Artéfact de AiudDocteknoPas encore d'évaluation
- Grasset Dor CetDocument9 pagesGrasset Dor CetwebylomePas encore d'évaluation
- Structuralisme en ArcheologieDocument12 pagesStructuralisme en ArcheologiesoloipsePas encore d'évaluation
- Bibliotheque D'humanisme Et Renaissance Tome Xii Nos. 1-3 - 1950 PDFDocument438 pagesBibliotheque D'humanisme Et Renaissance Tome Xii Nos. 1-3 - 1950 PDFVetusta MaiestasPas encore d'évaluation
- Arguments n23Document68 pagesArguments n23manoelnascimentoPas encore d'évaluation
- RT 07Document236 pagesRT 07Ivan BogdanovPas encore d'évaluation
- L'existence, La Substantialité Et L'âmeDocument30 pagesL'existence, La Substantialité Et L'âmeLeCroaePas encore d'évaluation
- La Doctrine de La SophiaDocument26 pagesLa Doctrine de La SophiaLeCroaePas encore d'évaluation
- Maître Eckhart Et Jan Van RuusbroecDocument254 pagesMaître Eckhart Et Jan Van RuusbroecLeCroaePas encore d'évaluation
- L'enseignement D'origène Sur La PrièreDocument90 pagesL'enseignement D'origène Sur La PrièreLeCroae100% (2)
- Travaux Pre Consolidation - PDFDocument60 pagesTravaux Pre Consolidation - PDFSPENCER DIVIN NZILA 1050534Pas encore d'évaluation
- Méthodologie Des Rapports de Stage Et MémoiresDocument30 pagesMéthodologie Des Rapports de Stage Et Mémoirescoralie SAKIPas encore d'évaluation
- Circulaire N 02 - LFC2020Document2 pagesCirculaire N 02 - LFC2020Laskri MejdiPas encore d'évaluation
- Maisons Et EnseignesDocument60 pagesMaisons Et EnseignesYan J. Kevin BolducPas encore d'évaluation
- Comptabilite Financiere PDFDocument11 pagesComptabilite Financiere PDFLatifa HadekPas encore d'évaluation
- Pour Commencer Avec Newlife Canada 17-09-2013Document5 pagesPour Commencer Avec Newlife Canada 17-09-2013عثمان البريشيPas encore d'évaluation
- Note Commune N 13 2019Document9 pagesNote Commune N 13 2019GhassenPas encore d'évaluation
- TD E1 Bis-2Document5 pagesTD E1 Bis-2Mohamed CHARIF100% (1)
- Chap 13 DROIT CorrDocument11 pagesChap 13 DROIT CorrLana TiniPas encore d'évaluation
- IPSASDocument4 pagesIPSASFatima Zahra RahaliPas encore d'évaluation
- Do - La Mazurka Di Whatsapp - FisarmonicaDocument2 pagesDo - La Mazurka Di Whatsapp - FisarmonicaEnzo Dell'AiraPas encore d'évaluation
- Lexique Dictionnaire Francais Arabe Presse Medias Economie Economique Politique MilitaireDocument6 pagesLexique Dictionnaire Francais Arabe Presse Medias Economie Economique Politique MilitairescribdPas encore d'évaluation
- Biblio Droits EnfantsDocument8 pagesBiblio Droits Enfants15jean1claude1Pas encore d'évaluation
- Note EmcDocument1 pageNote EmcSan SonaPas encore d'évaluation
- TD 2 (Ex & Sol)Document17 pagesTD 2 (Ex & Sol)eto 03100% (4)
- Géologie de JijelDocument19 pagesGéologie de Jijelabnou_223943920100% (3)
- TD Fiscalité Internationale Ennoncé CorrigéDocument4 pagesTD Fiscalité Internationale Ennoncé Corrigéwissalbachi01Pas encore d'évaluation