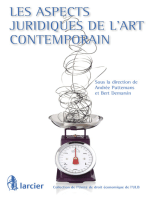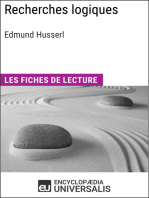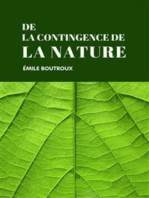Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bergson La Pensee Et Le Mouvant 1969
Transféré par
Darian MeachamCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bergson La Pensee Et Le Mouvant 1969
Transféré par
Darian MeachamDroits d'auteur :
Formats disponibles
Henri BERGSON (1859-1941)
LA PENSE ET
LE MOUVANT
ESSAIS ET CONFRENCES.
(Articles et confrences datant de 1903 1923)
Un document produit en version numrique par Mme Marcelle Bergeron, bnvole
Professeure la retraite de lcole Dominique-Racine de Chicoutimi, Qubec
et collaboratrice bnvole
Courriel: mailto:mabergeron@videotron.ca
Site web: http://www.geocities.com/areqchicoutimi_valin
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
dirige et fonde par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
Un document produit en version numrique par Mme Marcelle Bergeron, bnvole,
professeure la retraie de lcole Dominique-Racine de Chicoutimi, Qubec
courriel: mailto:mabergeron@videotron.ca
site web: http://www.geocities.com/areqchicoutimi_valin
partir de :
Henri Bergson (1859-1941)
La pense et le mouvant. Essais et
confrences.
(Recueil darticles et de confrences datant de 1903 1923)
Une dition lectronique ralise du livre La pense et le
mouvant. Paris :Les Presses universitaires de France, 1969, 79e
dition, 294 pages. Collection : Bibliothque de philosophie
contemporaine.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes
Microsoft Word 2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 14 aot 2003 Chicoutimi, Qubec.
Avec la prcieuse coopration de M. Bertrand Gibier, bnvole, professeur de
philosophie, qui a rcrit en grec moderne toutes les citations ou expressions
grecques contenues dans luvre originale : bertrand.gibier@ac-lille.fr.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
Table des matires
Avant-propos
I.
II.
III.
IV.
V.
Introduction (premire partie). Croissance de la vrit. Mouvement
rtrograde du vrai
Introduction (deuxime partie). De la position des problmes (22
janvier 1922)
Le possible et le rel. Essai publi dans la revue sudoise Nordisk
Tidskrift en novembre 1930
L'intuition philosophique. Confrence faite au Congrs de
Philosophie de Bologne le 10 avril 1911
La perception du changement. Confrences faites l'Universit
d'Oxford les 26 et 27 mai 1911
Premire confrence
Deuxime confrence
VI.
VII.
Introduction la mtaphysique
La philosophie de Claude Bernard. Discours prononc la
crmonie du Centenaire de Claude Bernard, au Collge de France,
le 30 dcembre 1913.
VIII.
IX.
Sur le pragmatisme de William James. Vrit et ralit
La vie et l'uvre de Ravaisson
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
Henri Bergson
(1869-1941)
La pense et le mouvant
Essais et confrences
Paris : Les Presses universitaires de France
Collection : Bibliothque de philosophie contemporaine.
__
1969, 294 pages
Retour la table des matires
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
La pense et le mouvant Essais et confrences.
Avant-propos
Retour la table des matires
Le prsent recueil comprend d'abord deux essais introductifs que nous
avons crits pour lui spcialement, et qui sont par consquent indits. Ils
occupent le tiers du volume. Les autres sont des articles ou des confrences,
introuvables pour la plupart, qui ont paru en France ou l'tranger. Les uns et
les autres datent de la priode comprise entre 1903 et 1923. Ils portent
principalement sur la mthode que nous croyons devoir recommander au
philosophe. Remonter l'origine de cette mthode, dfinir la direction qu'elle
imprime la recherche, tel est plus particulirement l'objet des deux essais
composant l'introduction.
Dans un livre paru en 1919 sous le titre de L'nergie spirituelle nous
avions runi des essais et confrences portant sur les rsultats de quelquesuns de nos travaux. Notre nouveau recueil, o se trouvent groups des essais
et confrences relatifs cette fois au travail de recherche lui-mme, sera le
complment du premier.
Les Delegates of the Clarendon Press d'Oxford ont bien voulu nous
autoriser reproduire ici les deux confrences, si soigneusement dites par
eux, que nous avions faites en 1911 l'Universit d'Oxford. Nous leur
adressons tous nos remerciements.
H. B.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
La pense et le mouvant Essais et confrences.
I
Introduction (premire partie)
Croissance de la vrit.
Mouvement rtrograde du vrai.
De la prcision en philosophie. Les systmes. Pourquoi ils ont nglig la question du
Temps. Ce que devient la connaissance quand on y rintgre les considrations de dure.
Effets rtroactifs du jugement vrai. Mirage du prsent dans le pass. De l'histoire et des
explications historiques. Logique de rtrospection.
Retour la table des matires
Ce qui a le plus manqu la philosophie, c'est la prcision. Les systmes
philosophiques ne sont pas taills la mesure de la ralit o nous vivons. Ils
sont trop larges pour elle. Examinez tel d'entre eux, convenablement choisi :
vous verrez qu'il s'appliquerait aussi bien un monde o il n'y aurait pas de
plantes ni d'animaux, rien que des hommes ; o les hommes se passeraient de
boire et de manger ; o ils ne dormiraient, ne rveraient ni ne divagueraient ;
o ils natraient dcrpits pour finir nourrissons ; o l'nergie remonterait la
pente de la dgradation ; o tout irait rebours et se tiendrait l'envers. C'est
qu'un vrai systme est un ensemble de conceptions si abstraites, et par consquent si vastes, qu'on y ferait tenir tout le possible, et mme de l'impossible,
ct du rel. L'explication que nous devons juger satisfaisante est celle qui
adhre son objet : point de vide entre eux, pas d'interstice o une autre
explication puisse aussi bien se loger ; elle ne convient qu' lui, il ne se prte
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
qu' elle. Telle peut tre l'explication scientifique. Elle comporte la prcision
absolue et une vidence complte ou croissante. En dirait-on autant des
thories philosophiques ?
Une doctrine nous avait paru jadis faire exception, et c'est probablement
pourquoi nous nous tions attach elle dans notre premire jeunesse. La
philosophie de Spencer visait prendre l'empreinte des choses et se modeler
sur le dtail des faits. Sans doute elle cherchait encore son point d'appui dans
des gnralits vagues. Nous sentions bien la faiblesse des Premiers
Principes. Mais cette faiblesse nous paraissait tenir ce que l'auteur, insuffisamment prpar, n'avait pu approfondir les ides dernires de la
mcanique. Nous aurions voulu reprendre cette partie de son uvre, la complter et la consolider. Nous nous y essaymes dans la mesure de nos forces.
C'est ainsi que nous fmes conduit devant l'ide de Temps. L, une surprise
nous attendait.
Nous fmes trs frapp en effet de voir comment le temps rel, qui joue le
premier rle dans toute philosophie de l'volution, chappe aux mathmatiques. Son essence tant de passer, aucune de ses parties n'est encore l quand
une autre se prsente. La superposition de partie partie en vue de la mesure
est donc impossible, inimaginable, inconcevable. Sans doute il entre dans
toute mesure un lment de convention, et il est rare que deux grandeurs, dites
gales, soient directement superposables entre elles. Encore faut-il que la
superposition soit possible pour un de leurs aspects ou de leurs effets qui
conserve quelque chose d'elles : cet effet, cet aspect sont alors ce qu'on
mesure. Mais, dans le cas du temps, l'ide de superposition impliquerait
absurdit, car tout effet de la dure qui sera superposable lui-mme, et par
consquent mesurable, aura pour essence de ne pas durer. Nous savions bien,
depuis nos annes de collge, que la dure se mesure par la trajectoire d'un
mobile et que le temps mathmatique est une ligne ; mais nous n'avions pas
encore remarqu que cette opration tranche radicalement sur toutes les autres
oprations de mesure, car elle ne s'accomplit pas sur un aspect ou sur un effet
reprsentatif de ce qu'on veut mesurer, mais sur quelque chose qui l'exclut. La
ligne qu'on mesure est immobile, le temps est mobilit. La ligne est du tout
fait, le temps est ce qui se fait, et mme ce qui fait que tout se fait. Jamais la
mesure du temps ne porte sur la dure en tant que dure ; on compte seulement un certain nombre d'extrmits d'intervalles ou de moments, c'est--dire,
en somme, des arrts virtuels du temps. Poser qu'un vnement se produira au
bout d'un temps t, c'est simplement exprimer qu'on aura compt, d'ici l, un
nombre t de simultanits d'un certain genre. Entre les simultanits se
passera tout ce qu'on voudra. Le temps pourrait s'acclrer normment, et
mme infiniment : rien ne serait chang pour le mathmaticien, pour le physicien, pour l'astronome. Profonde serait pourtant la diffrence au regard de la
conscience (je veux dire, naturellement, d'une conscience qui ne serait pas
solidaire des mouvements intra-crbraux) ; ce ne serait plus pour elle, du jour
au lendemain, d'une heure l'heure suivante, la mme fatigue d'attendre. De
cette attente dtermine, et de sa cause extrieure, la science ne peut tenir
compte : mme quand elle porte sur le temps qui se droule ou qui se droulera, elle le traite comme s'il tait droul. C'est d'ailleurs fort naturel. Son rle
est de prvoir. Elle extrait et retient du monde matriel ce qui est susceptible
de se rpter et de se calculer, par consquent ce qui ne dure pas. Elle ne fait
ainsi qu'appuyer dans la direction du sens commun, lequel est un
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
commencement de science : couramment, quand nous parlons du temps, nous
pensons la mesure de la dure, et non pas la dure mme. Mais cette dure,
que la science limine, qu'il est difficile de concevoir et d'exprimer, on la sent
et on la vit. Si nous cherchions ce qu'elle est ? Comment apparatrait-elle
une conscience qui ne voudrait que la voir sans la mesurer, qui la saisirait
alors sans l'arrter, qui se prendrait enfin elle-mme pour objet, et qui, spectatrice et actrice, spontane et rflchie, rapprocherait jusqu' les faire
concider ensemble l'attention qui se fixe et le temps qui fuit ?
Telle tait la question. Nous pntrions avec elle dans le domaine de la vie
intrieure, dont nous nous tions jusque-l dsintress. Bien vite nous reconnmes l'insuffisance de la conception associationiste de l'esprit. Cette
conception, commune alors la plupart des psychologues et des philosophes,
tait l'effet d'une recomposition artificielle de la vie consciente. Que donnerait
la vision directe, immdiate, sans prjugs interposs ? Une longue srie de
rflexions et d'analyses nous fit carter ces prjugs un un, abandonner
beaucoup d'ides que nous avions acceptes sans critique ; finalement, nous
crmes retrouver la dure intrieure toute pure, continuit qui n'est ni unit ni
multiplicit, et qui ne rentre dans aucun de nos cadres. Que la science positive
se ft dsintresse de cette dure, rien de plus naturel, pensions-nous : sa
fonction est prcisment peut-tre de nous composer un monde o nous
puissions, pour la commodit de l'action, escamoter les effets du temps. Mais
comment la philosophie de Spencer, doctrine d'volution, faite pour suivre le
rel dans sa mobilit, son progrs, sa maturation intrieure, avait-elle pu
fermer les yeux ce qui est le changement mme ?
Cette question devait nous amener plus tard reprendre le problme de
l'volution de la vie en tenant compte du temps rel ; nous trouverions alors
que l' volutionnisme spencrien tait peu prs compltement refaire.
Pour le moment, c'tait la vision de la dure qui nous absorbait. Passant en
revue les systmes, nous constations que les philosophes ne s'taient gure
occups d'elle. Tout le long de l'histoire de la philosophie, temps et espace
sont mis au mme rang et traits comme choses du mme genre. On tudie
alors l'espace, on en dtermine la nature et la fonction, puis on transporte au
temps les conclusions obtenues. La thorie de l'espace et celle du temps se
font ainsi pendant. Pour passer de l'une l'autre, il a suffi de changer un mot :
on a remplac juxtaposition par succession . De la dure relle on s'est
dtourn systmatiquement. Pourquoi ? La science a ses raisons de le faire ;
mais la mtaphysique, qui a prcd la science, oprait dj de cette manire
et n'avait pas les mmes raisons. En examinant les doctrines, il nous sembla
que le langage avait jou ici un grand rle. La dure s'exprime toujours en
tendue. Les termes qui dsignent le temps sont emprunts la langue de
l'espace. Quand nous voquons le temps, c'est l'espace qui rpond l'appel. La
mtaphysique a d se conformer aux habitudes du langage, lesquelles se
rglent elles-mmes sur celles du sens commun.
Mais si la science et le sens commun sont ici d'accord, si l'intelligence,
spontane ou rflchie, carte le temps rel, ne serait-ce pas que la destination
de notre entendement l'exige ? C'est bien ce que nous crmes apercevoir en
tudiant la structure de l'entendement humain. Il nous apparut qu'une de ses
fonctions tait justement de masquer la dure, soit dans le mouvement soit
dans le changement.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
S'agit-il du mouvement ? L'intelligence n'en retient qu'une srie de positions : un point d'abord atteint, puis un autre, puis un autre encore. Objecte-ton l'entendement qu'entre ces points se passe quelque chose ? Vite il
intercale des positions nouvelles, et ainsi de suite indfiniment. De la transition il dtourne son regard. Si nous insistons, il s'arrange pour que la mobilit,
repousse dans des intervalles de plus en plus troits mesure qu'augmente le
nombre des positions considres, recule, s'loigne, disparaisse dans l'infiniment petit. Rien de plus naturel, si l'intelligence est destine surtout prparer
et clairer notre action sur les choses. Notre action ne s'exerce commodment que sur des points fixes ; c'est donc la fixit que notre intelligence
recherche ; elle se demande o le mobile est, o le mobile sera, o le mobile
passe. Mme si elle note le moment du passage, mme si elle parat s'intresser alors la dure, elle se borne, par l, constater la simultanit de deux
arrts virtuels : arrt du mobile qu'elle considre et arrt d'un autre mobile
dont la course est cense tre celle du temps. Mais c'est toujours des
immobilits, relles ou possibles, qu'elle veut avoir affaire. Enjambons cette
reprsentation intellectuelle du mouvement, qui le dessine comme une srie de
positions. Allons droit lui, regardons-le sans concept interpos : nous le
trouvons simple et tout d'une pice. Avanons alors davantage ; obtenons qu'il
concide avec un de ces mouvements incontestablement rels, absolus, que
nous produisons nous-mmes. Cette fois nous tenons la mobilit dans son
essence, et nous sentons qu'elle se confond avec un effort dont la dure est une
continuit indivisible. Mais comme un certain espace aura t franchi, notre
intelligence, qui cherche partout la fixit, suppose aprs coup que le
mouvement s'est appliqu sur cet espace (comme s'il pouvait concider lui
mouvement, avec de l'immobilit !) et que le mobile est, tour tour, en chacun
des points de la ligne qu'il parcourt. Tout au plus peut-on dire qu'il y aurait t
s'il s'tait arrt plus tt, si nous avions fait, en vue d'un mouvement plus
court, un effort tout diffrent. De l ne voir dans le mouvement qu'une srie
de positions, il n'y a qu'un pas ; la dure du mouvement se dcomposera alors
en moments correspondant chacune des positions. Mais les moments du
temps et les positions du mobile ne sont que des instantans pris par notre
entendement sur la continuit du mouvement et de la dure. Avec ces vues
juxtaposes on a un succdan pratique du temps et du mouvement qui se plie
aux exigences du langage en attendant qu'il se prte celles du calcul ; mais
on n'a qu'une recomposition artificielle. Le temps et le mouvement sont autre
chose 1.
Nous en dirons autant du changement. L'entendement le dcompose en
tats successifs et distincts, censs invariables. Considre-t-on de plus prs
chacun de ces tats, s'aperoit-on qu'il varie, demande-t-on comment il pourrait durer s'il ne changeait pas ? Vite l'entendement le remplace par une srie
d'tats plus courts, qui se dcomposeront leur tour s'il le faut, et ainsi de
suite indfiniment. Comment pourtant ne pas voir que l'essence de la dure est
de couler, et que du stable accol du stable ne fera jamais rien qui dure ? Ce
qui est rel, ce ne sont pas les tats , simples instantans pris par nous,
encore une fois, le long du changement ; c'est au contraire le flux, c'est la
1
Si le cinmatographe nous montre en mouvement, sur l'cran, les vues immobiles
juxtaposes sur le film, c'est la condition de projeter sur cet cran, pour ainsi dire, avec
ces vues immobiles elles-mmes, le mouvement qui est dans l'appareil.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
10
continuit de transition, c'est le changement lui-mme. Ce changement est
indivisible, il est mme substantiel. Si notre intelligence s'obstine le juger
inconsistant, lui adjoindre je ne sais quel support, c'est qu'elle l'a remplac
par une srie d'tats juxtaposs ; mais cette multiplicit est artificielle, artificielle aussi l'unit qu'on y rtablit. Il n'y a ici qu'une pousse ininterrompue de
changement d'un changement toujours adhrent lui-mme dans une dure
qui s'allonge sans fin.
Ces rflexions faisaient natre dans notre esprit beaucoup de doutes, en
mme temps que de grandes esprances. Nous nous disions que les problmes
mtaphysiques avaient peut-tre t mal poss, mais que, prcisment pour
cette raison, il n'y avait plus lieu de les croire ternels , c'est--dire insolubles. La mtaphysique date du jour o Znon d'le signala les contradictions
inhrentes au mouvement et au changement, tels que se les reprsente notre
intelligence. surmonter, tourner par un travail intellectuel de plus en plus
subtil ces difficults souleves par la reprsentation intellectuelle du mouvement et du changement s'employa le principal effort des philosophes anciens
et modernes. C'est ainsi que la mtaphysique fut conduite chercher la ralit
des choses au-dessus du temps, par-del ce qui se meut et ce qui change, en
dehors, par consquent, de ce que nos sens et notre conscience peroivent.
Ds lors elle ne pouvait plus tre qu'un arrangement plus ou moins artificiel de
concepts, une construction hypothtique. Elle prtendait dpasser l'exprience ; elle ne faisait en ralit que substituer l'exprience mouvante et
pleine, susceptible d'un approfondissement croissant, grosse par l de rvlations, un extrait fix, dessch, vid, un systme d'ides gnrales abstraites,
tires de cette mme exprience ou plutt de ses couches les plus superficielles. Autant vaudrait disserter sur l'enveloppe d'o se dgagera le papillon,
et prtendre que le papillon volant, changeant, vivant, trouve sa raison d'tre et
son achvement dans l'immutabilit de la pellicule. Dtachons, au contraire,
l'enveloppe. Rveillons la chrysalide. Restituons au mouvement sa mobilit,
au changement sa fluidit, au temps sa dure. Qui sait si les grands problmes insolubles ne resteront pas sur la pellicule ? Ils ne concernaient ni le
mouvement ni le changement ni le temps, mais seulement l'enveloppe conceptuelle que nous prenions faussement pour eux ou pour leur quivalent. La
mtaphysique deviendra alors l'exprience mme. La dure se rvlera telle
qu'elle est, cration continuelle, jaillissement ininterrompu de nouveaut.
Car c'est l ce que notre reprsentation habituelle du mouvement et du
changement nous empche de voir. Si le mouvement est une srie de positions
et le changement une srie d'tats, le temps est fait de parties distinctes et
juxtaposes. Sans doute nous disons encore qu'elles se succdent, mais cette
succession est alors semblable celle des images d'un film cinmatographique : le film pourrait se drouler dix fois, cent fois, mille fois plus vite sans
que rien ft modifi ce qu'il droule ; s'il allait infiniment vite, si le droulement (cette fois hors de l'appareil) devenait instantan, ce seraient encore les
mmes images. La succession ainsi entendue n'y ajoute donc rien ; elle en
retranche plutt quelque chose ; elle marque un dficit ; elle traduit une
infirmit de notre perception, condamne dtailler le film image par image
au lieu de le saisir globalement. Bref, le temps ainsi envisag n'est qu'un
espace idal o l'on suppose aligns tous les vnements passs, prsents et
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
11
futurs, avec, en outre, un empchement pour eux de nous apparatre en bloc :
le droulement en dure serait cet inachvement mme, l'addition d'une
quantit ngative. Telle est, consciemment ou inconsciemment, la pense de la
plupart des philosophes, en conformit d'ailleurs avec les exigences de l'entendement, avec les ncessits du langage, avec le symbolisme de la science.
Aucun d'eux n'a cherch au temps des attributs positifs. Ils traitent la
succession comme une coexistence manque, et la dure comme une privation
d'ternit. De l vient qu'ils n'arrivent pas, quoi qu'ils fassent, se reprsenter
la nouveaut radicale et l'imprvisibilit. Je ne parle pas seulement des
philosophes qui croient un enchanement si rigoureux des phnomnes et
des vnements que les effets doivent se dduire des causes : ceux-l s'imaginent que l'avenir est donn dans le prsent, qu'il y est thoriquement visible,
qu'il n'y ajoutera, par consquent, rien de nouveau. Mais ceux mmes, en trs
petit nombre, qui ont cru au libre arbitre, l'ont rduit un simple choix
entre deux ou plusieurs partis, comme si ces partis taient des possibles
dessins d'avance et comme si la volont se bornait raliser l'un d'eux. Ils
admettent donc encore, mme s'ils ne s'en rendent pas compte, que tout est
donn. D'une action qui serait entirement neuve (au moins par le dedans) et
qui ne prexisterait en aucune manire, pas mme sous forme de pur possible,
sa ralisation, ils semblent ne se faire aucune ide. Telle est pourtant l'action
libre. Mais pour l'apercevoir ainsi, comme d'ailleurs pour se figurer n'importe
quelle cration, nouveaut ou imprvisibilit, il faut se replacer dans la dure
pure.
Essayez, en effet, de vous reprsenter aujourd'hui l'action que vous
accomplirez demain, mme si vous savez ce que vous allez faire. Votre
imagination voque peut-tre le mouvement excuter ; mais de ce que vous
penserez et prouverez en l'excutant vous ne pouvez rien savoir aujourd'hui,
parce que votre tat dme comprendra demain toute la vie que vous aurez
vcue jusque-l avec, en outre, ce qu'y ajoutera ce moment particulier. Pour
remplir cet tat, par avance, du contenu qu'il doit avoir, il vous faudrait tout
juste le temps qui spare aujourd'hui de demain, car vous ne sauriez diminuer
d'un seul instant la vie psychologique sans en modifier le contenu. Pouvezvous, sans la dnaturer, raccourcir la dure d'une mlodie ? La vie intrieure
est cette mlodie mme. Donc, supposer que vous sachiez ce que vous ferez
demain, vous ne prvoyez de votre action que sa configuration extrieure ;
tout effort pour en imaginer d'avance l'intrieur occupera une dure qui,
d'allongement en allongement, vous conduira jusqu'au moment o l'acte
s'accomplit et o il ne peut plus tre question de le prvoir. Que sera-ce, si
l'action est vritablement libre, c'est--dire cre tout entire, dans son dessin
extrieur aussi bien que dans sa coloration interne, au moment o elle
s'accomplit ?
Radicale est donc la diffrence entre une volution dont les phases
continues s'entrepntrent par une espce de croissance intrieure, et un
droulement dont les parties distinctes se juxtaposent. L'ventail qu'on dploie
pourrait s'ouvrir de plus en plus vite, et mme instantanment ; il talerait
toujours la mme broderie, prfigure sur la soie. Mais une volution relle,
pour peu qu'on l'acclre ou qu'on la ralentisse, se modifie du tout au tout,
intrieurement. Son acclration ou son ralentissement est justement cette
modification interne. Son contenu ne fait qu'un avec sa dure.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
12
Il est vrai qu' ct des consciences qui vivent cette dure irrtrcissable et
inextensible, il y a des systmes matriels sur lesquels le temps ne fait que
glisser. Des phnomnes qui s'y succdent on peut rellement dire qu'ils sont
le droulement d'un ventail, ou mieux d'un film cinmatographique. Calculables par avance, ils prexistaient, sous forme de possibles, leur ralisation.
Tels sont les systmes qu'tudient l'astronomie, la physique et la chimie.
L'univers matriel, dans son ensemble, forme-t-il un systme de ce genre ?
Quand notre science le suppose, elle entend simplement par l qu'elle laissera
de ct, dans l'univers, tout ce qui n'est pas calculable. Mais le philosophe, qui
ne veut rien laisser de ct, est bien oblig de constater que les tats de notre
monde matriel sont contemporains de l'histoire de notre conscience. Comme
celle-ci dure, il faut que ceux-l se relient de quelque faon la dure relle.
En thorie, le film sur lequel sont dessins les tats successifs d'un systme
entirement calculable pourrait se drouler avec n'importe quelle vitesse sans
que rien y ft chang. En fait, cette vitesse est dtermine, puisque le droulement du film correspond une certaine dure de notre vie intrieure,
celle-l et non pas un autre. Le film qui se droule est donc vraisemblablement attach de la conscience qui dure, et qui en rgle le mouvement.
Quand on veut prparer un verre d'eau sucre, avons-nous dit, force est bien
d'attendre que le sucre fonde. Cette ncessit d'attendre est le fait significatif.
Elle exprime que, si l'on peut dcouper dans l'univers des systmes pour
lesquels le temps n'est qu'une abstraction, une relation, un nombre, l'univers
lui-mme est autre chose. Si nous pouvions l'embrasser dans son ensemble,
inorganique mais entretissu d'tres organiss, nous le verrions prendre sans
cesse des formes aussi neuves, aussi originales, aussi imprvisibles que nos
tats de conscience.
Mais nous avons tant de peine distinguer entre la succession dans la
dure vraie et la juxtaposition dans le temps spatial, entre une volution et un
droulement, entre la nouveaut radicale et un rarrangement du prexistant,
enfin entre la cration et le simple choix, qu'on ne saurait clairer cette
distinction par trop de cts la fois. Disons donc que dans la dure, envisage comme une volution cratrice, il y a cration perptuelle de possibilit et
non pas seulement de ralit. Beaucoup rpugneront l'admettre, parce qu'ils
jugeront toujours qu'un vnement ne se serait pas accompli s'il n'avait pas pu
s'accomplir : de sorte qu'avant d'tre rel, il faut qu'il ait t possible. Mais
regardez-y de prs : vous verrez que possibilit signifie deux choses toutes
diffrentes et que, la plupart du temps, on oscille de l'une l'autre, jouant
involontairement sur le sens du mot. Quand un musicien compose une symphonie, son uvre tait-elle possible avant d'tre relle ? Oui, si l'on entend
par l qu'il n'y avait pas d'obstacle insurmontable sa ralisation. Mais de ce
sens tout ngatif du mot on passe, sans y prendre garde, un sens positif : on
se figure que toute chose qui se produit aurait pu tre aperue d'avance par
quelque esprit suffisamment inform, et qu'elle prexistait ainsi, sous forme
d'ide, sa ralisation ; conception absurde dans le cas d'une uvre d'art, car
ds que le musicien a l'ide prcise et complte de la symphonie qu'il fera, sa
symphonie est faite. Ni dans la pense de l'artiste, ni, plus forte raison, dans
aucune autre pense comparable la ntre, ft-elle impersonnelle, ft-elle
mme simplement virtuelle, la symphonie ne rsidait en qualit de possible
avant d'tre relle. Mais n'en peut-on pas dire autant d'un tat quelconque de
l'univers pris avec tous les tres conscients et vivants ? N'est-il pas plus riche
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
13
de nouveaut, d'imprvisibilit radicale, que la symphonie du plus grand
matre ?
Toujours pourtant la conviction persiste que, mme s'il n'a pas t conu
avant de se produire, il aurait pu l'tre, et qu'en ce sens il figure de toute
ternit, l'tat de possible, dans quelque intelligence relle ou virtuelle. En
approfondissant cette illusion, on verrait qu'elle tient l'essence mme de
notre entendement. Les choses et les vnements se produisent des moments
dtermins ; le jugement qui constate l'apparition de la chose ou de l'vnement ne peut venir qu'aprs eux ; il a donc sa date. Mais cette date s'efface
aussitt, en vertu du principe, ancr dans notre intelligence, que toute vrit
est ternelle. Si le jugement est vrai prsent, il doit, nous semble-t-il, l'avoir
t toujours. Il avait beau n'tre pas encore formul : il se posait lui-mme en
droit, avant d'tre pos en fait. toute affirmation vraie nous attribuons ainsi
un effet rtroactif ; ou plutt nous lui imprimons un mouvement rtrograde.
Comme si un jugement avait pu prexister aux termes qui le composent !
Comme si ces termes ne dataient pas de l'apparition des objets qu'ils reprsentent ! Comme si la chose et l'ide de la chose, sa ralit et sa possibilit,
n'taient pas cres du mme coup lorsqu'il s'agit d'une forme vritablement
neuve, invente par l'art ou la nature !
Les consquences de cette illusion sont innombrables 1. Notre apprciation
des hommes et des vnements est tout entire imprgne de la croyance la
valeur rtrospective du jugement vrai, un mouvement rtrograde qu'excuterait automatiquement dans le temps la vrit une fois pose. Par le seul fait
de s'accomplir, la ralit projette derrire elle son ombre dans le pass indfiniment lointain ; elle parat ainsi avoir prexist, sous forme de possible, sa
propre ralisation. De l une erreur qui vicie notre conception du pass ; de l
notre prtention d'anticiper en toute occasion l'avenir. Nous nous demandons,
par exemple, ce que seront l'art, la littrature, la civilisation de demain ; nous
nous figurons en gros la courbe d'volution des socits ; nous allons jusqu'
prdire le dtail des vnements. Certes, nous pourrons toujours rattacher la
ralit, une fois accomplie, aux vnements qui l'ont prcde et aux circonstances o elle s'est produite ; mais une ralit toute diffrente (non pas quelconque, il est vrai) se ft aussi bien rattache aux mmes circonstances et aux
mmes vnements, pris par un autre ct. Dira-t-on alors qu'en envisageant
tous les cts du prsent pour le prolonger dans toutes les directions, on
obtiendrait, ds maintenant, tous les possibles entre lesquels l'avenir, supposer qu'il choisisse, choisira ? Mais d'abord ces prolongements mmes pourront
tre des additions de qualits nouvelles, cres de toutes pices, absolument
imprvisibles ; et ensuite un ct du prsent n'existe comme ct que
lorsque notre attention l'a isol, pratiquant ainsi une dcoupure d'une certaine
forme dans l'ensemble des circonstances actuelles : comment alors tous les
cts du prsent existeraient-ils avant qu'aient t cres, par les vnements
ultrieurs, les formes originales des dcoupures que l'attention peut y
pratiquer ? Ces cts n'appartiennent donc que rtrospectivement au prsent
d'autrefois, c'est--dire au pass ; et ils n'avaient pas plus de ralit dans ce
1
Sur ces consquences, et plus gnralement sur la croyance la valeur rtrospective du
jugement vrai, sur le mouvement rtrograde de la vrit, nous nous sommes expliqu tout
au long dans des confrences faites Columbia University (New York) en janvier-fvrier
1913. Nous nous bornons ici quelques indications.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
14
prsent, quand il tait encore prsent, que n'en ont, dans notre prsent actuel,
les symphonies des musiciens futurs. Pour prendre un exemple simple, rien ne
nous empche aujourd'hui de rattacher le romantisme du dix-neuvime sicle
ce qu'il y avait dj de romantique chez les classiques. Mais l'aspect romantique du classicisme ne s'est dgag que par l'effet rtroactif du romantisme
une fois apparu. S'il n'y avait pas eu un Rousseau, un Chateaubriand, un
Vigny, un Victor Hugo, non seulement on n'aurait jamais aperu, mais encore
il n'y aurait rellement pas eu de romantisme chez les classiques d'autrefois,
car ce romantisme des classiques ne se ralise que par le dcoupage, dans leur
uvre, d'un certain aspect, et la dcoupure, avec sa forme particulire, n'existait pas plus dans la littrature classique avant l'apparition du romantisme que
n'existe, dans le nuage qui passe, le dessin amusant qu'un artiste y apercevra
en organisant la masse amorphe au gr de sa fantaisie. Le romantisme a opr
rtroactivement sur le classicisme, comme le dessin de l'artiste sur ce nuage.
Rtroactivement il a cr sa propre prfiguration dans le pass, et une explication de lui-mme par ses antcdents.
C'est dire qu'il faut un hasard heureux, une chance exceptionnelle, pour
que nous notions justement, dans la ralit prsente, ce qui aura le plus
d'intrt pour l'historien venir. Quand cet historien considrera notre prsent
nous, il y cherchera surtout l'explication de son prsent lui, et plus particulirement de ce que son prsent contiendra de nouveaut. Cette nouveaut,
nous ne pouvons en avoir aucune ide aujourd'hui, si ce doit tre une cration.
Comment donc nous rglerions-nous aujourd'hui sur elle pour choisir parmi
les faits ceux qu'il faut enregistrer, ou plutt pour fabriquer des faits en
dcoupant selon cette indication la ralit prsente ? Le fait capital des temps
modernes est l'avnement de la dmocratie. Que dans le pass, tel qu'il fut
dcrit par les contemporains, nous en trouvions des signes avant-coureurs,
c'est incontestable ; mais les indications peut-tre les plus intressantes
n'auraient t notes par eux que s'ils avaient su que l'humanit marchait dans
cette direction ; or cette direction de trajet n'tait pas plus marque alors
qu'une autre, ou plutt elle n'existait pas encore, ayant t cre par le trajet
lui-mme, je veux dire par le mouvement en avant des hommes qui ont progressivement conu et ralis la dmocratie. Les signes avant-coureurs ne sont
donc nos yeux des signes que parce que nous connaissons maintenant la
course, parce que la course a t effectue. Ni la course, ni sa direction, ni par
consquent son terme n'taient donns quand ces faits se produisaient : donc
ces faits n'taient pas encore des signes. Allons plus loin. Nous disions que les
faits les plus importants cet gard ont pu tre ngligs par les contemporains.
Mais la vrit est que la plupart de ces faits n'existaient pas encore cette
poque comme faits ; ils existeraient rtrospectivement pour nous si nous
pouvions maintenant ressusciter intgralement l'poque, et promener sur le
bloc indivis de la ralit d'alors le faisceau de lumire forme toute particulire que nous appelons l'ide dmocratique : les portions ainsi claires,
ainsi dcoupes dans le tout selon des contours aussi originaux et aussi imprvisibles que le dessin d'un grand matre, seraient les faits prparatoires de la
dmocratie. Bref, pour lguer nos descendants l'explication, par ses antcdents, de l'vnement essentiel de leur temps, il faudrait que cet vnement ft
dj figur sous nos yeux et qu'il n'y et pas de dure relle. Nous
transmettons aux gnrations futures ce qui nous intresse, ce que notre
attention considre et mme dessine la lumire de notre volution passe,
mais non pas ce que l'avenir aura rendu pour eux intressant par la cration
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
15
d'un intrt nouveau, par une direction nouvelle imprime leur attention. En
d'autres termes enfin, les origines historiques du prsent, dans ce qu'il a de
plus important, ne sauraient tre compltement lucides, car on ne les reconstituerait dans leur intgralit que si le pass avait pu tre exprim par les
contemporains en fonction d'un avenir indtermin qui tait, par l mme,
imprvisible.
Prenons une couleur telle que l'orang 1. Comme nous connaissons en
outre le rouge et le jaune, nous pouvons considrer l'orang comme jaune en
un sens, rouge dans l'autre, et dire que c'est un compos de jaune et de rouge.
Mais supposez que, l'orang existant tel qu'il est, ni le jaune ni le rouge
n'eussent encore paru dans le monde : l'orang serait-il dj compos de ces
deux couleurs ? videmment non. La sensation de rouge et la sensation de
jaune, impliquant tout un mcanisme nerveux et crbral en mme temps que
certaines dispositions spciales de la conscience, sont des crations de la vie,
qui se sont produites, mais qui auraient pu ne pas se produire; et s'il n'y avait
jamais eu, ni sur notre plante ni sur aucune autre, des tres prouvant ces
deux sensations, la sensation d'orang et t une sensation simple ; jamais n'y
auraient figur, comme composantes ou comme aspects, les sensations de
jaune et de rouge. Je reconnais que notre logique habituelle proteste. Elle dit :
Du moment que les sensations de jaune et de rouge entrent aujourd'hui dans
la composition de celle de l'orang, elles y entraient toujours, mme s'il y a eu
un temps o aucune des deux n'existait effectivement : elles y taient virtuellement. Mais c'est que notre logique habituelle est une logique de rtrospection. Elle ne peut pas ne pas rejeter dans le pass, l'tat de possibilits
ou de virtualits, les ralits actuelles, de sorte que ce qui est compos
maintenant doit, ses yeux, l'avoir t toujours. Elle n'admet pas qu'un tat
simple puisse, en restant ce qu'il est, devenir un tat compos, uniquement
parce que l'volution aura cr des points de vue nouveaux d'o l'envisager et,
par l mme, des lments multiples en lesquels l'analyser idalement. Elle ne
veut pas croire que, si ces lments n'avaient pas surgi comme ralits, ils
n'auraient pas exist antrieurement comme possibilits, la possibilit d'une
chose n'tant jamais (sauf le cas o cette chose est un arrangement tout
mcanique d'lments prexistants) que le mirage, dans le pass indfini, de la
ralit une fois apparue. Si elle repousse dans le pass, sous forme de possible,
ce qui surgit de ralit dans le prsent, c'est justement parce qu'elle ne veut pas
admettre que rien surgisse, que quelque chose se cre, que le temps soit efficace. Dans une forme ou dans une qualit nouvelles elle ne voit qu'un rarrangement de l'ancien, rien d'absolument nouveau. Toute multiplicit se rsout
pour elle en un nombre dfini d'units. Elle n'accepte pas l'ide d'une multiplicit indistincte et mme indivise, purement intensive ou qualitative, qui,
tout en restant ce qu'elle est, comprendra un nombre indfiniment croissant
d'lments, mesure qu'apparatront dans le monde les nouveaux points de
vue d'o l'envisager. Il ne s'agit certes pas de renoncer cette logique ni de
s'insurger contre elle. Mais il faut l'largir, l'assouplir, l'adapter une dure o
la nouveaut jaillit sans cesse et o l'volution est cratrice.
Telle tait la direction prfre o nous nous engagions. Beaucoup d'autres
s'ouvraient devant nous, autour de nous, partir du centre, o nous nous
1
La prsente tude a t crite avant notre livre Les deux sources de la morale et de la
religion, o nous avons dvelopp la mme comparaison.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
16
tions install pour ressaisir la dure pure. Mais nous nous attachions cellel, parce que nous avions choisi d'abord, pour prouver notre mthode, le
problme de la libert. Par l mme nous nous replacerions dans le flux de la
vie intrieure, dont la philosophie ne nous paraissait retenir, trop souvent, que
la conglation superficielle. Le romancier et le moraliste ne s'taient-ils pas
avancs, dans cette direction, plus loin que le philosophe ? Peut-tre ; mais
c'tait par endroits seulement, sous la pression de la ncessit, qu'ils avaient
bris l'obstacle ; aucun ne s'tait encore avis d'aller mthodiquement la
recherche du temps perdu . Quoi qu'il en soit, nous ne donnmes que des
indications ce sujet dans notre premier livre, et nous nous bornmes encore
des allusions dans le second, quand nous comparmes le plan de l'action o
le pass se contracte dans le prsent au plan du rve, o se dploie, indivisible et indestructible, la totalit du pass. Mais s'il appartenait la littrature
d'entreprendre ainsi l'tude de l'me dans le concret, sur des exemples individuels, le devoir de la philosophie nous paraissait tre de poser ici les conditions gnrales de l'observation directe, immdiate, de soi par soi. Cette observation interne est fausse par les habitudes que nous avons contractes.
L'altration principale est sans doute celle qui a cr le problme de la libert,
un pseudo-problme, n d'une confusion de la dure avec l'tendue. Mais il
en est d'autres qui semblaient avoir la mme origine : nos tats d'me nous
paraissent nombrables ; tels d'entre eux, ainsi dissocis, auraient une intensit
mesurable ; chacun et tous nous croyons pouvoir substituer les mots qui les
dsignent et qui dsormais les recouvriront ; nous leur attribuons alors la
fixit, la discontinuit, la gnralit des mots eux-mmes. C'est cette enveloppe qu'il faut ressaisir, pour la dchirer. Mais on ne la ressaisira que si l'on
en considre d'abord la figure et la structure, si l'on en comprend aussi la
destination. Elle est de nature spatiale, et elle a une utilit sociale. La spatialit
donc, et, dans ce sens tout spcial, la sociabilit, sont ici les vraies causes de la
relativit de notre connaissance. En cartant ce voile interpos, nous revenons
l'immdiat et nous touchons un absolu.
De ces premires rflexions sortirent des conclusions qui sont heureusement devenues presque banales, mais qui parurent alors tmraires. Elles
demandaient la psychologie de rompre avec l'associationisme, qui tait
universellement admis, sinon comme doctrine, du moins comme mthode.
Elles exigeaient une autre rupture encore, que nous ne faisions qu'entrevoir.
ct de l'associationisme, il y avait le kantisme, dont l'influence, souvent
combine d'ailleurs avec la premire, tait non moins puissante et non moins
gnrale. Ceux qui rpudiaient le positivisme d'un Comte ou l'agnosticisme
d'un Spencer n'osaient aller jusqu' contester la conception kantienne de la
relativit de la connaissance. Kant avait tabli, disait-on, que notre pense
s'exerce sur une matire parpille par avance dans l'Espace et le Temps, et
prpare ainsi spcialement pour l'homme : la chose en soi nous chappe ;
il faudrait, pour l'atteindre, une facult intuitive que nous ne possdons pas. Il
rsultait au contraire de notre analyse qu'une partie au moins de la ralit,
notre personne, peut tre ressaisie dans sa puret naturelle. Ici, en tout cas, les
matriaux de notre connaissance n'ont pas t crs, ou triturs et dforms,
par je ne sais quel malin gnie, qui aurait ensuite jet dans un rcipient artificiel, tel que notre conscience, une poussire psychologique. Notre personne
nous apparat telle qu'elle est en soi , ds que nous nous dgageons
d'habitudes contractes pour notre plus grande commodit. Mais n'en serait-il
pas ainsi pour d'autres ralits, peut-tre mme pour toutes ? La relativit de
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
17
la connaissance , qui arrtait l'essor de la mtaphysique, tait-elle originelle
et essentielle ? Ne serait-elle pas plutt accidentelle et acquise ? Ne viendraitelle pas tout bonnement de ce que l'intelligence a contract des habitudes
ncessaires la vie pratique : ces habitudes, transportes dans le domaine de
la spculation, nous mettent en prsence d'une ralit dforme ou rforme,
en tout cas arrange ; mais l'arrangement ne s'impose pas nous inluctablement ; il vient de nous ; ce que nous avons fait, nous pouvons le dfaire ; et
nous entrons alors en contact direct avec la ralit. Ce n'tait donc pas seulement une thorie psychologique, l'associationisme, que nous cartions, c'tait
aussi, et pour une raison analogue, une philosophie gnrale telle que le
kantisme, et tout ce qu'on y rattachait. L'une et l'autre, presque universellement acceptes alors dans leurs grandes lignes, nous apparaissaient comme
des impedimenta qui empchaient philosophie et psychologie de marcher.
Restait alors marcher. Il ne suffisait pas d'carter l'obstacle. Par le fait,
nous entreprmes l'tude des fonctions psychologiques, puis de la relation
psycho-physiologique, puis de la vie en gnral, cherchant toujours la vision
directe, supprimant ainsi des problmes qui ne concernaient pas les choses
mmes, mais leur traduction en concepts artificiels. Nous ne retracerons pas
ici une histoire dont le premier rsultat serait de montrer l'extrme complication d'une mthode en apparence si simple ; nous en reparlerons d'ailleurs, trs
brivement, dans le prochain chapitre. Mais puisque nous avons commenc
par dire que nous avions song avant tout la prcision, terminons en faisant
remarquer que la prcision ne pouvait s'obtenir, nos yeux, par aucune autre
mthode. Car l'imprcision est d'ordinaire l'inclusion d'une chose dans un
genre trop vaste, choses et genres correspondant d'ailleurs des mots qui
prexistaient. Mais si l'on commence par carter les concepts dj faits, si l'on
se donne une vision directe du rel, si l'on subdivise alors cette ralit en
tenant compte de ses articulations, les concepts nouveaux qu'on devra bien
former pour s'exprimer seront cette fois taills l'exacte mesure de l'objet :
l'imprcision ne pourra natre que de leur extension d'autres objets qu'ils
embrasseraient galement dans leur gnralit, mais qui devront tre tudis
en eux-mmes, en dehors de ces concepts, quand on voudra les connatre
leur tour.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
18
La pense et le mouvant Essais et confrences.
II
Introduction (deuxime partie)
De la position des problmes
Dure et intuition. Nature de la connaissance intuitive. En quel sens elle est claire.
Deux espces de clart. L'intelligence. Valeur de la connaissance intellectuelle.
Abstractions et mtaphores. La mtaphysique et la science. quelle condition elles
pourront s'entr'aider. Du mysticisme. De l'indpendance d'esprit. Faut-il accepter les
termes des problmes ? La philosophie de la cit. Les ides gnrales. Les vrais et
les faux problmes. Le criticisme kantien et les thories de la connaissance. L'illusion
intellectualiste . Mthodes d'enseignement. L'homo loquax. Le philosophe, le savant
et l'homme intelligent .
Retour la table des matires
Ces considrations sur la dure nous paraissaient dcisives. De degr en
degr, elles nous firent riger l'intuition en mthode philosophique. Intuition
est d'ailleurs un mot devant lequel nous hsitmes longtemps. De tous les
termes qui dsignent un mode de connaissance, c'est encore le plus appropri ;
et pourtant il prte la confusion. Parce qu'un Schelling, un Schopenhauer et
d'autres ont dj fait appel l'intuition, parce qu'ils ont plus ou moins oppos
l'intuition l'intelligence, on pouvait croire que nous appliquions la mme
mthode. Comme si leur intuition n'tait pas une recherche immdiate de
l'ternel ! Comme s'il ne s'agissait pas au contraire, selon nous, de retrouver
d'abord la dure vraie. Nombreux sont les philosophes qui ont senti l'impuis-
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
19
sance de la pense conceptuelle atteindre le fond de l'esprit. Nombreux, par
consquent, ceux qui ont parl d'une facult supra-intellectuelle d'intuition.
Mais, comme ils ont cru que l'intelligence oprait dans le temps, ils en ont
conclu que dpasser l'intelligence consistait sortir du temps. Ils n'ont pas vu
que le temps intellectualis est espace, que l'intelligence travaille sur le fantme de la dure, mais non pas sur la dure mme, que l'limination du temps
est l'acte habituel, normal, banal, de notre entendement, que la relativit de
notre connaissance de l'esprit vient prcisment de l, et que ds lors, pour
passer de l'intellection la vision, du relatif l'absolu, il n'y a pas sortir du
temps (nous en sommes dj sortis) ; il faut, au contraire, se replacer dans la
dure et ressaisir la ralit dans la mobilit qui en est l'essence. Une intuition
qui prtend se transporter d'un bond dans l'ternel s'en tient l'intellectuel.
Aux concepts que fournit l'intelligence elle substitue simplement un concept
unique qui les rsume tous et qui est par consquent toujours le mme, de
quelque nom qu'on l'appelle : la Substance, le Moi, l'Ide, la Volont. La
philosophie ainsi entendue, ncessairement panthistique, n'aura pas de peine
expliquer dductivement toutes choses, puisqu'elle se sera donn par avance,
dans un principe qui est le concept des concepts, tout le rel et tout le possible.
Mais cette explication sera vague et hypothtique, cette unit sera artificielle,
et cette philosophie s'appliquerait aussi bien un monde tout diffrent du
ntre. Combien plus instructive serait une mtaphysique vraiment intuitive,
qui suivrait les ondulations du rel ! Elle n'embrasserait plus d'un seul coup la
totalit des choses ; mais de chacune elle donnerait une explication qui s'y
adapterait exactement, exclusivement. Elle ne commencerait pas par dfinir
ou dcrire l'unit systmatique du monde : qui sait si le monde est effectivement un ? L'exprience seule pourra le dire, et l'unit, si elle existe, apparatra
au terme de la recherche comme un rsultat ; impossible de la poser au dpart
comme un principe. Ce sera d'ailleurs une unit riche et pleine, l'unit d'une
continuit, l'unit de notre ralit, et non pas cette unit abstraite et vide, issue
d'une gnralisation suprme, qui serait aussi bien celle de n'importe quel
monde possible. Il est vrai qu'alors la philosophie exigera un effort nouveau
pour chaque nouveau problme. Aucune solution ne se dduira gomtriquement d'une autre. Aucune vrit importante ne s'obtiendra par le prolongement
d'une vrit dj acquise. Il faudra renoncer tenir virtuellement dans un
principe la science universelle.
L'intuition dont nous parlons porte donc avant tout sur la dure intrieure.
Elle saisit une succession qui n'est pas juxtaposition, une croissance par le
dedans, le prolongement ininterrompu du pass dans un prsent qui empite
sur l'avenir. C'est la vision directe de l'esprit par l'esprit. Plus rien d'interpos ;
point de rfraction travers le prisme dont une face est espace et dont l'autre
est langage. Au lieu d'tats contigus des tats, qui deviendront des mots
juxtaposs des mots, voici la continuit indivisible, et par l substantielle, du
flux de la vie intrieure. Intuition signifie donc d'abord conscience, mais conscience immdiate, vision qui se distingue peine de l'objet vu, connaissance
qui est contact et mme concidence. C'est ensuite de la conscience largie,
pressant sur le bord d'un inconscient qui cde et qui rsiste, qui se rend et qui
se reprend : travers des alternances rapides d'obscurit et de lumire, elle
nous fait constater que l'inconscient est l ; contre la stricte logique elle
affirme que le psychologique a beau tre du conscient, il y a nanmoins un
inconscient psychologique. Ne va-t-elle pas plus loin ? N'est-elle que
l'intuition de nous-mmes ? Entre notre conscience et les autres consciences la
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
20
sparation est moins tranche qu'entre notre corps et les autres corps, car cest
l'espace qui fait les divisions nettes. La sympathie et l'antipathie irrflchies,
qui sont si souvent divinatrices, tmoignent d'une interpntration possible des
consciences humaines. Il y aurait donc des phnomnes d'endosmose psychologique. L'intuition nous introduirait dans la conscience en gnral. Mais ne
sympathisons-nous qu'avec des consciences ? Si tout tre vivant nat, se
dveloppe et meurt, si la vie est une volution et si la dure est ici une ralit,
n'y a-t-il pas aussi une intuition du vital, et par consquent une mtaphysique
de la vie, qui prolongera la science du vivant ? Certes, la science nous donnera
de mieux en mieux la physicochimie de la matire organise ; mais la cause
profonde de l'organisation, dont nous voyons bien qu'elle n'entre ni dans le
cadre du pur mcanisme ni dans celui de la finalit proprement dite, qu'elle
n'est ni unit pure ni multiplicit distincte, que notre entendement enfin la
caractrisera toujours par de simples ngations, ne l'atteindrons-nous pas en
ressaisissant par la conscience l'lan de vie qui est en nous ? Allons plus loin
encore. Par-del l'organisation, la matire inorganise nous apparat sans
doute comme dcomposable en systmes sur lesquels le temps glisse sans y
pntrer, systmes qui relvent de la science et auxquels l'entendement s'applique. Mais l'univers matriel, dans son ensemble, fait attendre notre conscience ; il attend lui-mme. Ou il dure, ou il est solidaire de notre dure. Qu'il
se rattache l'esprit par ses origines ou par sa fonction, dans un cas comme
dans l'autre il relve de l'intuition par tout ce qu'il contient de changement et
de mouvement rels. Nous croyons prcisment que l'ide de diffrentielle, ou
plutt de fluxion, fut suggre la science par une vision de ce genre.
Mtaphysique par ses origines, elle est devenue scientifique mesure qu'elle
se faisait rigoureuse, c'est--dire exprimable en termes statiques. Bref, le changement pur, la dure relle, est chose spirituelle ou imprgne de spiritualit.
L'intuition est ce qui atteint l'esprit, la dure, le changement pur. Son domaine
propre tant l'esprit, elle voudrait saisir dans les choses, mme matrielles,
leur participation la spiritualit, nous dirions la divinit, si nous ne
savions tout ce qui se mle encore d'humain notre conscience, mme pure
et spiritualise. Ce mlange d'humanit est justement ce qui fait que l'effort
d'intuition peut s'accomplir des hauteurs diffrentes, sur des points diffrents, et donner dans diverses philosophies des rsultats qui ne concident pas
entre eux, encore qu'ils ne soient nullement inconciliables.
Qu'on ne nous demande donc pas de l'intuition une dfinition simple et
gomtrique. Il sera trop ais de montrer que nous prenons le mot dans des
acceptions qui ne se dduisent pas mathmatiquement les unes des autres. Un
minent philosophe danois en a signal quatre. Nous en trouverions, pour
notre part, davantage 1. De ce qui n'est pas abstrait et conventionnel, mais rel
et concret, plus forte raison de ce qui n'est pas reconstituable avec des composantes connues, de la chose qui n'a pas t dcoupe dans le tout de la
ralit par l'entendement ni par le sens commun ni par le langage, on ne peut
donner une ide qu'en prenant sur elle des vues multiples, complmentaires et
non pas quivalentes. Dieu nous garde de comparer le petit au grand, notre
effort celui des matres ! Mais la varit des fonctions et aspects de l'intuition, telle que nous la dcrivons, n'est rien ct de la multiplicit des
significations que les mots essence et existence prennent chez Spinoza,
1
Sans pourtant inclure dans le nombre, telles quelles, les quatre acceptions qu'il a cru
apercevoir. Nous faisons allusion ici Harald Hffding.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
21
ou les termes de forme , de puissance , d' acte ,... etc., chez Aristote.
Parcourez la liste des sens du mot eidos dans l'Index Aristotelicus : vous
verrez combien ils diffrent. Si l'on en considre deux qui soient suffisamment
loigns l'un de l'autre, ils paratront presque s'exclure. Ils ne s'excluent pas,
parce que la chane des sens intermdiaires les relie entre eux. En faisant
l'effort qu'il faut pour embrasser l'ensemble, on s'aperoit qu'on est dans le
rel, et non pas devant une essence mathmatique qui pourrait tenir, elle, dans
une formule simple.
Il y a pourtant un sens fondamental : penser intuitivement est penser en
dure. L'intelligence part ordinairement de l'immobile, et reconstruit tant bien
que mal le mouvement avec des immobilits juxtaposes. L'intuition part du
mouvement, le pose ou plutt l'aperoit comme la ralit mme, et ne voit
dans l'immobilit qu'un moment abstrait, instantan pris par notre esprit sur
une mobilit. L'intelligence se donne ordinairement des choses, entendant par
l du stable, et fait du changement un accident qui s'y surajouterait. Pour
l'intuition l'essentiel est le changement : quant la chose, telle que l'intelligence l'entend, c'est une coupe pratique au milieu du devenir et rige par
notre esprit en substitut de l'ensemble. La pense se reprsente ordinairement
le nouveau comme un nouvel arrangement d'lments prexistants ; pour elle
rien ne se perd, rien ne se cre. L'intuition, attache une dure qui est
croissance, y peroit une continuit ininterrompue d'imprvisible nouveaut ;
elle voit, elle sait que l'esprit tire de lui-mme plus qu'il n'a, que la spiritualit
consiste en cela mme, et que la ralit, imprgne d'esprit, est cration. Le
travail habituel de la pense est ais et se prolonge autant qu'on voudra.
L'intuition est pnible et ne saurait durer. Intellection ou intuition, la pense
utilise sans doute toujours le langage ; et l'intuition, comme toute pense, finit
par se loger dans des concepts : dure, multiplicit qualitative ou htrogne,
inconscient, diffrentielle mme, si l'on prend la notion telle qu'elle tait au
dbut. Mais le concept qui est d'origine intellectuelle est tout de suite clair, au
moins pour un esprit qui pourrait donner l'effort suffisant, tandis que l'ide
issue d'une intuition commence d'ordinaire par tre obscure, quelle que soit
notre force de pense. C'est qu'il y a deux espces de clart.
Une ide neuve peut tre claire parce qu'elle nous prsente, simplement
arranges dans un nouvel ordre, des ides lmentaires que nous possdions
dj. Notre intelligence, ne trouvant alors dans le nouveau que de l'ancien, se
sent en pays de connaissance ; elle est son aise ; elle comprend . Telle est
la clart que nous dsirons, que nous recherchons, et dont nous savons
toujours gr celui qui nous l'apporte. Il en est une autre, que nous subissons,
et qui ne s'impose d'ailleurs qu' la longue. C'est celle de l'ide radicalement
neuve et absolument simple, qui capte plus ou moins une intuition. Comme
nous ne pouvons la reconstituer avec des lments prexistants, puisqu'elle n'a
pas d'lments, et comme, d'autre part, comprendre sans effort consiste
recomposer le nouveau avec de l'ancien, notre premier mouvement est de la
dire incomprhensible. Mais acceptons-la provisoirement, promenons-nous
avec elle dans les divers dpartements de notre connaissance : nous la verrons,
elle obscure, dissiper des obscurits. Par elle, des problmes que nous jugions
insolubles vont se rsoudre ou plutt se dissoudre, soit pour disparatre
dfinitivement soit pour se poser autrement. De ce qu'elle aura fait pour ces
problmes elle bnficiera alors son tour. Chacun d'eux, intellectuel, lui
communiquera quelque chose de son intellectualit. Ainsi intellectualise, elle
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
22
pourra tre braque nouveau sur les problmes qui l'auront servie aprs s'tre
servis d'elle ; elle dissipera, encore mieux, l'obscurit qui les entourait, et elle
en deviendra elle-mme plus claire. Il faut donc distinguer entre les ides qui
gardent pour elles leur lumire, la faisant d'ailleurs pntrer tout de suite dans
leurs moindres recoins, et celles dont le rayonnement est extrieur, illuminant
toute une rgion de la pense. Celles-ci peuvent commencer par tre intrieurement obscures ; mais la lumire qu'elles projettent autour d'elles leur revient
par rflexion, les pntre de plus en plus profondment ; et elles ont alors le
double pouvoir d'clairer le reste et de s'clairer elles-mmes.
Encore faut-il leur en laisser le temps. Le philosophe n'a pas toujours cette
patience. Combien n'est-il pas plus simple de s'en tenir aux notions emmaganises dans le langage ! Ces ides ont t formes par l'intelligence au fur et
mesure de ses besoins. Elles correspondent un dcoupage de la ralit selon
les lignes qu'il faut suivre pour agir commodment sur elle. Le plus souvent,
elles distribuent les objets et les faits d'aprs l'avantage que nous en pouvons
tirer, jetant ple-mle dans le mme compartiment intellectuel tout ce qui
intresse le mme besoin. Quand nous ragissons identiquement des perceptions diffrentes, nous disons que nous sommes devant des objets du mme
genre . Quand nous ragissons en deux sens contraires, nous rpartissons les
objets entre deux genres opposs . Sera clair alors, par dfinition, ce qui
pourra se rsoudre en gnralits ainsi obtenues, obscur ce qui ne s'y ramnera
pas. Par l s'explique l'infriorit frappante du point de vue intuitif dans la
controverse philosophique. coutez discuter ensemble deux philosophes dont
l'un tient pour le dterminisme et l'autre pour la libert : c'est toujours le dterministe qui parat avoir raison. Il peut tre novice, et son adversaire expriment. Il peut plaider nonchalamment sa cause, tandis que l'autre sue sang et
eau pour la sienne. On dira toujours de lui qu'il est simple, qu'il est clair, qu'il
est vrai. Il l'est aisment et naturellement, n'ayant qu' ramasser des penses
toutes prtes et des phrases dj faites : science, langage, sens commun,
l'intelligence entire est son service. La critique d'une philosophie intuitive
est si facile, et elle est si sure d'tre bien accueillie, qu'elle tentera toujours le
dbutant. Plus tard pourra venir le regret, moins pourtant qu'il n'y ait
incomprhension native et, par dpit, ressentiment personnel l'gard de tout
ce qui n'est pas rductible la lettre, de tout ce qui est proprement esprit. Cela
arrive, car la philosophie, elle aussi, a ses scribes et ses pharisiens.
Nous assignons donc la mtaphysique un objet limit, principalement
l'esprit, et une mthode spciale, avant tout l'intuition. Par l nous distinguons
nettement la mtaphysique de la science. Mais par l aussi nous leur attribuons une gale valeur. Nous croyons qu'elles peuvent, l'une et l'autre, toucher
le fond de la ralit. Nous rejetons les thses soutenues par les philosophes,
acceptes par les savants, sur la relativit de la connaissance et l'impossibilit
d'atteindre l'absolu.
La science positive s'adresse en effet l'observation sensible. Elle obtient
ainsi des matriaux dont elle confie l'laboration la facult d'abstraire et de
gnraliser, au jugement et au raisonnement, l'intelligence. Partie jadis des
mathmatiques pures, elle continua par la mcanique, puis par la physique et
la chimie ; elle arriva sur le tard la biologie. Son domaine primitif, qui est
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
23
rest son domaine prfr, est celui de la matire inerte. Elle est moins son
aise dans le monde organis, o elle ne chemine d'un pas assur que si elle
s'appuie sur la physique et la chimie ; elle s'attache ce qu'il y a de physicochimique dans les phnomnes vitaux plutt qu' ce qui est proprement vital
dans le vivant. Mais grand est son embarras quand elle arrive l'esprit. Ce
n'est pas dire qu'elle n'en puisse obtenir quelque connaissance ; mais cette
connaissance devient d'autant plus vague qu'elle s'loigne davantage de la
frontire commune l'esprit et la matire. Sur ce nouveau terrain on n'avancerait jamais, comme sur l'ancien, en se fiant la seule force de la logique.
Sans cesse il faut en appeler de l' esprit gomtrique l' esprit de
finesse : encore y a-t-il toujours quelque chose de mtaphorique dans les
formules, si abstraites soient-elles, auxquelles on aboutit, comme si l'intelligence tait oblige de transposer le psychique en physique pour le comprendre
et l'exprimer. Au contraire, ds qu'elle revient la matire inerte, la science
qui procde de la pure intelligence se retrouve chez elle. Cela n'a rien d'tonnant. Notre intelligence est le prolongement de nos sens. Avant de spculer, il
faut vivre, et la vie exige que nous tirions parti de la matire, soit avec nos
organes, qui sont des outils naturels, soit avec les outils proprement dits, qui
sont des organes artificiels. Bien avant qu'il y et une philosophie et une
science, le rle de l'intelligence tait dj de fabriquer des instruments, et de
guider l'action de notre corps sur les corps environnants. La science a pouss
ce travail de l'intelligence beaucoup plus loin, mais elle n'en a pas chang la
direction. Elle vise, avant tout, nous rendre matres de la matire. Mme
quand elle spcule, elle se proccupe encore d'agir, la valeur des thories
scientifiques se mesurant toujours la solidit de la prise qu'elles nous donnent sur la ralit. Mais n'est-ce pas l, prcisment, ce qui doit nous inspirer
pleine confiance dans la science positive et aussi dans l'intelligence, son
instrument ? Si l'intelligence est faite pour utiliser la matire, c'est sur la
structure de la matire, sans doute, que s'est modele celle de l'intelligence.
Telle est du moins l'hypothse la plus simple et la plus probable. Nous
devrons nous y tenir tant qu'on ne nous aura pas dmontr que l'intelligence
dforme, transforme, construit son objet, ou n'en touche que la surface, ou
n'en saisit que l'apparence. Or on n'a jamais invoqu, pour cette dmonstration, que les difficults insolubles o la philosophie tombe, la contradiction
o l'intelligence peut se mettre avec elle-mme, quand elle spcule sur
l'ensemble des choses : difficults et contradictions o il est naturel que nous
aboutissions en effet si l'intelligence est spcialement destine l'tude d'une
partie, et si nous prtendons nanmoins l'employer la connaissance du tout.
Mais ce n'est pas assez dire. Il est impossible de considrer le mcanisme de
notre intelligence, et aussi le progrs de notre science, sans arriver la conclusion qu'entre l'intelligence et la matire il y a effectivement symtrie,
concordance, correspondance. D'un ct la matire se rsout de plus en plus,
aux yeux du savant, en relations mathmatiques, et d'autre part les facults
essentielles de notre intelligence ne fonctionnent avec une prcision absolue
que lorsqu'elles s'appliquent la gomtrie. Sans doute la science mathmatique aurait pu ne pas prendre, l'origine, la forme que les Grecs lui ont
donne. Sans doute aussi elle doit s'astreindre, quelque forme qu'elle adopte,
l'emploi de signes artificiels. Mais antrieurement cette mathmatique
formule, qui renferme une grande part de convention, il y en a une autre,
virtuelle ou implicite, qui est naturelle l'esprit humain. Si la ncessit d'oprer sur certains signes rend l'abord des mathmatiques difficiles beaucoup
d'entre nous, en revanche, ds qu'il a surmont l'obstacle, l'esprit se meut dans
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
24
ce domaine avec une aisance qu'il n'a nulle part ailleurs, l'vidence tant ici
immdiate et thoriquement instantane, l'effort pour comprendre existant le
plus souvent en fait mais non pas en droit : dans tout autre ordre d'tudes, au
contraire, il faut, pour comprendre, un travail de maturation de la pense qui
reste en quelque sorte adhrent au rsultat, remplit essentiellement de la dure,
et ne saurait tre conu, mme thoriquement, comme instantan. Bref, nous
pourrions croire un cart entre la matire et l'intelligence si nous ne considrions de la matire que les impressions superficielles faites sur nos sens, et
si nous laissions notre intelligence la forme vague et floue qu'elle a dans ses
oprations journalires. Mais quand nous ramenons l'intelligence ses
contours prcis et quand nous approfondissons assez nos impressions sensibles pour que la matire commence nous livrer l'intrieur de sa structure,
nous trouvons que les articulations de l'intelligence viennent s'appliquer
exactement sur celles de la matire. Nous ne voyons donc pas pourquoi la
science de la matire n'atteindrait pas un absolu. Elle s'attribue instinctivement
cette porte, et toute croyance naturelle doit tre tenue pour vraie, toute
apparence pour ralit, tant qu'on n'en a pas tabli le caractre illusoire.
ceux qui dclarent notre science relative, ceux qui prtendent que notre
connaissance dforme ou construit son objet, incombe alors la charge de la
preuve. Et cette obligation, ils ne sauraient la remplir, car la doctrine de la
relativit de la science ne trouve plus o se loger quand science et mtaphysique sont sur leur vrai terrain, celui o nous les replaons 1.
1
Il va sans dire que la relativit dont nous parlons ici pour l'exclure de la science considre sa limite, c'est--dire pour carter une erreur sur la direction du progrs scientifique, n'a rien voir avec celle d'Einstein. La mthode einsteinienne consiste essentiellement chercher une reprsentation mathmatique des choses qui soit indpendante du
point de vue de l'observateur (ou, plus prcisment, du systme de rfrence) et qui
constitue, par consquent, un ensemble de relations absolues. Rien de plus contraire la
relativit telle que l'entendent les philosophes quand ils tiennent pour relative notre
connaissance du monde extrieur. L'expression thorie de la Relativit a l'inconvnient de suggrer aux philosophes l'inverse de ce qu'on veut ici exprimer.
Ajoutons, au sujet de la thorie de la Relativit, qu'on ne saurait l'invoquer ni pour ni
contre la mtaphysique expose dans nos diffrents travaux, mtaphysique qui a pour
centre l'exprience de la dure avec la constatation d'un certain rapport entre cette dure
et l'espace employ la mesurer. Pour poser un problme, le physicien, relativiste ou
non, prend ses mesures dans ce Temps-l, qui est le ntre, qui est celui de tout le monde.
S'il rsout le problme, c'est dans le mme Temps, dans le Temps de tout le monde, qu'il
vrifiera sa solution. Quant au Temps amalgam avec l'Espace, quatrime dimension d'un
Espace-Temps, il n'a d'existence que dans l'intervalle entre la position du problme et sa
solution, c'est--dire dans les calculs, c'est--dire enfin sur le papier. La conception
relativiste n'en a pas moins une importance capitale, en raison du secours qu'elle apporte
la physique mathmatique. Mais purement mathmatique est la ralit de son EspaceTemps, et l'on ne saurait l'riger en ralit mtaphysique, ou ralit tout court, sans
attribuer ce dernier mot une signification nouvelle.
On appelle en effet de ce nom, le plus souvent, ce qui est donn dans une exprience,
ou ce qui pourrait l'tre : est rel ce qui est constat ou constatable. Or il est de l'essence
mme de l'Espace-Temps de ne pas pouvoir tre peru. On ne saurait y tre plac, ou s'y
placer, puisque le systme de rfrence qu'on adopte est, par dfinition, un systme
immobile, que dans ce systme Espace et Temps sont distincts, et que le physicien effectivement existant, prenant effectivement des mesures, est celui qui occupe ce systme :
tous les autres physiciens, censs adopter d'autres systmes, ne sont plus alors que des
physiciens par lui imagins. Nous avons jadis consacr un livre la dmonstration de ces
diffrents points.
Nous ne pouvons le rsumer dans une simple note. Mais comme le livre a souvent t
mal compris, nous croyons devoir reproduire ici le passage essentiel d'un article o nous
donnions la raison de cette incomprhension. Voici en effet le point qui chappe
d'ordinaire ceux qui, se transportant de la physique la mtaphysique, rigent en ralit,
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
25
c'est--dire en chose perue ou perceptible, existant avant et aprs le calcul, un amalgame
d'Espace et de Temps qui n'existe que le long du calcul et qui, en dehors du calcul,
renoncerait son essence l'instant mme o l'on prtendrait en constater l'existence.
Il faudrait en effet, disions-nous, commencer par bien voir pourquoi, dans l'hypothse de la Relativit, il est impossible d'attacher en mme temps des observateurs
vivants et conscients plusieurs systmes diffrents, pourquoi un seul systme celui
qui est effectivement adopt comme systme de rfrence contient des physiciens rels,
pourquoi surtout la distinction entre le physicien rel et le physicien reprsent comme
rel prend une importance capitale dans l'interprtation philosophique de cette thorie,
alors que jusqu'ici la philosophie n'avait pas eu s'en proccuper dans l'interprtation de
la physique. La raison en est pourtant trs simple.
Du point de vue de la physique newtonienne par exemple, il y a un systme de
rfrence absolument privilgi, un repos absolu et des mouvements absolus. L'univers se
compose alors, tout instant, de points matriels dont les uns sont immobiles et les autres
anims de mouvements parfaitement dtermins. Cet univers se trouve donc avoir en luimme, dans l'Espace et le Temps, une figure concrte qui ne dpend pas du point de vue
o le physicien se place : tous les physiciens, quelque systme mobile qu'ils appartiennent, se reportent par la pense au systme de rfrence privilgi et attribuent l'univers
la figure qu'on lui trouverait en le percevant ainsi dans l'absolu. Si donc le physicien par
excellence est celui qui habite le systme privilgi, il n'y a pas ici tablir une distinction radicale entre ce physicien et les autres, puisque les autres procdent comme s'ils
taient sa place.
Mais, dans la thorie de la Relativit, il n'y a plus de systme privilgi. Tous les
systmes se valent. N'importe lequel d'entre eux peut s'riger en systme de rfrence, ds
lors immobile. Par rapport ce systme de rfrence, tous les points matriels de l'univers
vont encore se trouver les uns immobiles, les autres anims de mouvements dtermins ;
mais ce ne sera plus que par rapport ce systme. Adoptez-en un autre : l'immobile va se
mouvoir, le mouvant s'immobiliser ou changer de vitesse ; la figure concrte de l'univers
aura radicalement chang. Pourtant l'univers ne saurait avoir vos yeux ces deux figures
en mme temps ; le mme point matriel ne peut pas tre imagin par vous, ou conu, en
mme temps immobile et motivant. Il faut donc choisir ; et du moment que vous avez
choisi telle ou telle figure dtermine, vous rigez en physicien vivant et conscient,
rellement percevant, le physicien attach au systme de rfrence d'o l'univers prend
cette figure : les autres physiciens, tels qu'ils apparaissent dans la figure d'univers ainsi
choisie, sont alors des physiciens virtuels, simplement conus comme physiciens par le
physicien rel. Si vous confrez l'un d'eux (en tant que physicien) une ralit, si vous le
supposez percevant, agissant, mesurant, son systme est un systme de rfrence non plus
virtuel, non plus simplement conu comme pouvant devenir un systme rel, mais bien
un systme de rfrence rel ; il est donc immobile, c'est une nouvelle figure du monde
que vous avez affaire ; et le physicien rel de tout l'heure n'est plus qu'un physicien
reprsent.
M. Langevin a exprim en ternies dfinitifs l'essence mme de la thorie de la
Relativit quand il a crit que le principe de la Relativit, sous la forme restreinte
comme sous sa forme plus gnrale, n'est au fond que l'affirmation de l'existence d'une
ralit indpendante des systmes de rfrence, en mouvement les uns par rapport aux
autres, partir desquels nous en observons des perspectives changeantes. Cet univers a
des lois auxquelles l'emploi des coordonnes permet de donner une forme analytique
indpendante du systme de rfrence, bien que les coordonnes individuelles de chaque
vnement en dpendent, mais qu'il est possible d'exprimer sous forme intrinsque,
comme la gomtrie le fait pour l'espace, grce l'introduction d'lments invariants et
la constitution d'un langage appropri . En d'autres termes, l'univers de la Relativit est
un univers aussi rel, aussi indpendant de notre esprit, aussi absolument existant que
celui de Newton et du commun des hommes : seulement, tandis que pour le commun des
hommes et mme encore pour Newton cet univers est un ensemble de choses (mme si la
physique se borne tudier des relations entre ces choses), l'univers d'Einstein n'est plus
qu'un ensemble de relations. Les lments invariants que l'on tient ici pour constitutifs de
la ralit sont des expressions o entrent des paramtres qui sont tout ce qu'on voudra,
qui ne reprsentent pas plus du Temps ou de l'Espace que n'importe quoi, puisque c'est la
relation entre eux qui existera seule aux yeux de la science, puisqu'il n'y a plus de Temps
ni d'Espace s'il n'y a plus de choses, si l'univers n'a pas de figure. Pour rtablir des choses,
et par consquent le Temps et l'Espace (comme on le fait ncessairement chaque fois l'on
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
26
Nous reconnaissons d'ailleurs que les cadres de l'intelligence ont une
certaine lasticit, ses contours un certain flou, et que son indcision est
justement ce qui lui permet de s'appliquer dans une certaine mesure aux
choses de l'esprit. Matire et esprit prsentent un ct commun, car certains
branlements superficiels de la matire viennent s'exprimer dans notre esprit,
superficiellement, en sensations ; et d'autre part l'esprit, pour agir sur le corps,
doit descendre de degr en degr vers la matire et se spatialiser. Il suit de l
que l'intelligence, quoique tourne vers les choses du dehors, peut encore
s'exercer sur celles du dedans, pourvu qu'elle ne prtende pas s'y enfoncer trop
profondment.
Mais la tentation est grande de pousser jusqu'au fond de l'esprit l'application des procds, qui russissent encore au voisinage de la surface. Qu'on s'y
laisse aller, et l'on obtiendra tout simplement une physique de l'esprit, calque
sur celle des corps. Ensemble, ces deux physiques constitueront un systme
complet de la ralit, ce qu'on appelle quelquefois une mtaphysique. Comment ne pas voir que la mtaphysique ainsi entendue mconnat ce que l'esprit
a de proprement spirituel, n'tant que l'extension l'esprit de ce qui appartient
la matire ? Et comment ne pas voir que, pour rendre cette extension possible, on a d prendre les cadres intellectuels dans un tat d'imprcision qui leur
permette de s'appliquer encore aux phnomnes superficiels de l'me, mais qui
les condamne serrer dj de moins prs les faits du monde extrieur ? Est-il
tonnant qu'une telle mtaphysique, embrassant la fois la matire et l'esprit,
fasse l'effet d'une connaissance peu prs vide et en tout cas vague, presque
vide du ct de l'esprit, puisqu'elle n'a pu retenir effectivement de l'me que
des aspects superficiels, systmatiquement vague du ct de la matire,
puisque l'intelligence du mtaphysicien a d desserrer assez ses rouages, et y
laisser assez de jeu, pour qu'elle pt travailler indiffremment la surface de
la matire ou la surface de l'esprit ?
Bien diffrente est la mtaphysique que nous plaons ct de la science.
Reconnaissant la science le pouvoir d'approfondir la matire par la seule
force de l'intelligence, elle se rserve l'esprit. Sur ce terrain, qui lui est propre,
elle voudrait dvelopper de nouvelles fonctions de la pense. Tout le monde a
pu remarquer qu'il est plus malais d'avancer dans la connaissance de soi que
dans celle du monde extrieur. Hors de soi, l'effort pour apprendre est naturel ;
on le donne avec une facilit croissante ; on applique des rgles. Au dedans,
l'attention doit rester tendue et le progrs devenir de plus en plus pnible ; on
croirait remonter la pente de la nature. N'y a-t-il pas l quelque chose de
surprenant ? Nous sommes intrieurs nous-mmes, et notre personnalit est
ce que nous devrions le mieux connatre. Point du tout ; notre esprit y est
veut tre renseign sur un vnement physique dtermin, peru en des points dtermins
de l'Espace et du Temps), force est bien de restituer au monde une figure ; mais c'est
qu'on aura choisi un point de vue, adopt un systme de rfrence. Le systme qu'on a
choisi devient d'ailleurs, par l mme, le systme central. La thorie de la Relativit a
prcisment pour essence de nous garantir que l'expression mathmatique du monde que
nous trouvons de ce point de vue arbitrairement choisi sera identique, si nous nous
conformons aux rgles qu'elle a poses, celle que nous aurions trouve en nous plaant
n'importe quel autre point de vue. Ne retenez que cette expression mathmatique, il n'y
a pas plus de Temps que de n'importe quoi. Restaurez le Temps, vous rtablissez les
choses, mais vous avez choisi un systme de rfrence et le physicien qui y sera attach.
Il ne peut pas y en avoir d'autre pour le moment, quoique tout autre et pu tre choisi.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
27
comme l'tranger, tandis que la matire lui est familire et que, chez elle, il
se sent chez lui. Mais c'est qu'une certaine ignorance de soi est peut-tre utile
un tre qui doit s'extrioriser pour agir ; elle rpond une ncessit de la vie.
Notre action s'exerce sur la matire, et elle est d'autant plus efficace que la
connaissance de la matire a t pousse plus loin. Sans doute il est avantageux, pour bien agir, de penser ce qu'on fera, de comprendre ce qu'on a fait,
de se reprsenter ce qu'on aurait pu faire : la nature nous y invite ; c'est un des
traits qui distinguent l'homme de l'animal, tout entier l'impression du
moment. Mais la nature ne nous demande qu'un coup d'il l'intrieur de
nous-mmes : nous apercevons bien alors l'esprit, mais l'esprit se prparant
faonner la matire, s'adaptant par avance elle, se donnant je ne sais quoi de
spatial, de gomtrique, d'intellectuel. Une connaissance de l'esprit, dans ce
qu'il a de proprement spirituel, nous loignerait plutt du but. Nous nous en
rapprochons, au contraire, quand nous tudions la structure des choses. Ainsi
la nature dtourne l'esprit de l'esprit, tourne l'esprit vers la matire. Mais ds
lors nous voyons comment nous pourrons, s'il nous plat, largir, approfondir,
intensifier indfiniment la vision qui nous a t concde de l'esprit. Puisque
l'insuffisance de cette vision tient d'abord ce qu'elle porte sur l'esprit dj
spatialis et distribu en compartiments intellectuels o la matire s'insrera, dgageons l'esprit de l'espace o il se dtend, de la matrialit qu'il se
donne pour se poser sur la matire : nous le rendrons lui-mme et nous le
saisirons immdiatement. Cette vision directe de l'esprit par l'esprit est la
fonction principale de l'intuition, telle que nous la comprenons.
L'intuition ne se communiquera d'ailleurs que par l'intelligence. Elle est
plus qu'ide ; elle devra toutefois, pour se transmettre, chevaucher sur des
ides. Du moins s'adressera-t-elle de prfrence aux ides les plus concrtes,
qu'entoure encore une frange d'images. Comparaisons et mtaphores suggreront ici ce qu'on n'arrivera pas exprimer. Ce ne sera pas un dtour ; on ne
fera qu'aller droit au but. Si l'on parlait constamment un langage abstrait, soidisant scientifique , on ne donnerait de l'esprit que son imitation par la
matire, car les ides abstraites ont t tires du monde extrieur et impliquent
toujours une reprsentation spatiale : et pourtant on croirait avoir analys
l'esprit. Les ides abstraites toutes seules nous inviteraient donc ici nous
reprsenter l'esprit sur le modle de la matire et le penser par transposition,
c'est--dire, au sens prcis du mot, par mtaphore. Ne soyons pas dupes des
apparences : il y a des cas o c'est le langage imag qui parle sciemment au
propre, et le langage abstrait qui parle inconsciemment au figur. Ds que
nous abordons le monde spirituel, l'image, si elle ne cherche qu' suggrer,
peut nous donner la vision directe, tandis que le terme abstrait, qui est d'origine spatiale et qui prtend exprimer, nous laisse le plus souvent dans la
mtaphore.
Pour tout rsumer, nous voulons une diffrence de mthode, nous n'admettons pas une diffrence de valeur, entre la mtaphysique et la science. Moins
modeste pour la science que ne l'ont t la plupart des savants, nous estimons
qu'une science fonde sur l'exprience, telle que les modernes l'entendent,
peut atteindre l'essence du rel. Sans doute elle n'embrasse qu'une partie de la
ralit ; mais de cette partie elle pourra un jour toucher le fond ; en tout cas
elle s'en rapprochera indfiniment. Elle remplit donc dj une moiti du
programme de l'ancienne mtaphysique : mtaphysique elle pourrait s'appeler,
si elle ne prfrait garder le nom de science. Reste l'autre moiti. Celle-ci nous
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
28
parat revenir de droit une mtaphysique qui part galement de l'exprience,
et qui est mme, elle aussi, d'atteindre l'absolu : nous l'appellerions science,
si la science ne prfrait se limiter au reste de la ralit. La mtaphysique n'est
donc pas la suprieure de la science positive ; elle ne vient pas, aprs la
science, considrer le mme objet pour en obtenir une connaissance plus
haute. Supposer entre elles ce rapport, selon l'habitude peu prs constante
des philosophes, est faire du tort l'une et l'autre : la science, que l'on
condamne la relativit ; la mtaphysique, qui ne sera plus qu'une connaissance hypothtique et vague, puisque la science aura ncessairement pris pour
elle, par avance, tout ce qu'on peut savoir sur son objet de prcis et de certain.
Bien diffrente est la relation que nous tablissons entre la mtaphysique et la
science. Nous croyons qu'elles sont, ou qu'elles peuvent devenir, galement
prcises et certaines. L'une et l'autre portent sur la ralit mme. Mais chacune
n'en retient que la moiti, de sorte qu'on pourrait voir en elles, volont, deux
subdivisions de la science ou deux dpartements de la mtaphysique, si elles
ne marquaient des directions divergentes de l'activit de la pense.
Justement parce qu'elles sont au mme niveau, elles ont des points
communs et peuvent, sur ces points, se vrifier l'une par l'autre. tablir entre
la mtaphysique et la science une diffrence de dignit, leur assigner le mme
objet, c'est--dire l'ensemble des choses, en stipulant que l'une le regardera
d'en bas et l'autre d'en haut, c'est exclure l'aide mutuelle et le contrle
rciproque : la mtaphysique est ncessairement alors moins de perdre tout
contact avec le rel un extrait condens ou une extension hypothtique de la
science. Laissez-leur, au contraire, des objets diffrents, la science la matire
et la mtaphysique l'esprit : comme l'esprit et la matire se touchent, mtaphysique et science vont pouvoir, tout le long de leur surface commune,
s'prouver l'une l'autre, en attendant que le contact devienne fcondation. Les
rsultats obtenus des deux cts devront se rejoindre, puisque la matire
rejoint l'esprit. Si l'insertion n'est pas parfaite, ce sera qu'il y a quelque chose
redresser dans notre science, ou dans notre mtaphysique, ou dans les deux.
La mtaphysique exercera ainsi, par sa partie priphrique, une influence
salutaire sur la science. Inversement, la science communiquera la mtaphysique des habitudes de prcision qui se propageront, chez celle-ci, de la
priphrie au centre. Ne ft-ce que parce que ses extrmits devront s'appliquer exactement sur celles de la science positive, notre mtaphysique sera
celle du monde o nous vivons, et non pas de tous les mondes possibles. Elle
treindra des ralits.
C'est dire que science et mtaphysique diffreront d'objet et de mthode,
mais qu'elles communieront dans l'exprience. L'une et l'autre auront cart la
connaissance vague qui est emmagasine dans les concepts usuels et transmise
par les mots. Que demandions-nous, en somme, pour la mtaphysique, sinon
ce qui avait t dj obtenu pour la science ? Longtemps la route avait t
barre la science positive par la prtention de reconstituer la ralit avec les
concepts dposs dans le langage. Le bas et le haut , le lourd et le
lger , le sec et l' humide taient les lments dont on se servait pour
l'explication des phnomnes de la nature ; on pesait, dosait, combinait des
concepts : c'tait, en guise de physique, une chimie intellectuelle. Quand elle
carta les concepts pour regarder les choses, la science parut, elle aussi,
s'insurger contre l'intelligence; l' intellectualisme d'alors recomposait
l'objet matriel, a priori, avec des ides lmentaires. En ralit, cette science
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
29
devint plus intellectualiste que la mauvaise physique qu'elle remplaait. Elle
devait le devenir, du moment qu'elle tait vraie, car matire et intelligence
sont modeles l'une sur l'autre, et dans une science qui dessine la configuration exacte de la matire notre intelligence retrouve ncessairement sa
propre image. La forme mathmatique que la physique a prise est ainsi, tout
la fois, celle qui rpond le mieux la ralit et celle qui satisfait le plus notre
entendement. Beaucoup moins commode sera la position de la mtaphysique
vraie. Elle aussi commencera par chasser les concepts tout faits ; elle aussi
s'en remettra l'exprience. Mais l'exprience intrieure ne trouvera nulle
part, elle, un langage strictement appropri. Force lui sera bien de revenir au
concept, en lui adjoignant tout au plus l'image. Mais alors il faudra qu'elle
largisse le concept, qu'elle l'assouplisse, et qu'elle annonce, par la frange
colore dont elle l'entourera, qu'il ne contient pas l'exprience tout entire. Il
n'en est pas moins vrai que la mtaphysique aura accompli dans son domaine
la rforme que la physique moderne a faite dans le sien.
N'attendez pas de cette mtaphysique des conclusions simples ou des
solutions radicales. Ce serait lui demander encore de s'en tenir une manipulation de concepts. Ce serait aussi la laisser dans la rgion du pur possible.
Sur le terrain de l'exprience, au contraire, avec des solutions incompltes et
des conclusions provisoires, elle atteindra une probabilit croissante qui
pourra quivaloir finalement la certitude. Prenons un problme que nous
poserons dans les termes de la mtaphysique traditionnelle : l'me survit-elle
au corps ? Il est facile de le trancher en raisonnant sur de purs concepts. On
dfinira donc l'me. On dira, avec Platon, qu'elle est une et simple. On en
conclura qu'elle ne peut se dissoudre. Donc elle est immortelle. Voil qui est
net. Seulement, la conclusion ne vaut que si l'on accepte la dfinition, c'est-dire la construction. Elle est subordonne cette hypothse. Elle est hypothtique. Mais renonons construire l'ide d'me comme on construit l'ide de
triangle. tudions les faits. Si l'exprience tablit, comme nous le croyons,
qu'une petite partie seulement de la vie consciente est conditionne par le
cerveau, il s'ensuivra que la suppression du cerveau laisse vraisemblablement
subsister la vie consciente. Du moins la charge de la preuve incomberat-elle
maintenant celui qui nie la survivance, bien plus qu' celui qui l'affirme. Il
ne s'agira que de survie, je le reconnais ; il faudrait d'autres raisons, tires
cette fois de la religion, pour arriver une prcision plus haute et pour attribuer cette survie une dure sans fin. Mais, mme du point de vue purement
philosophique, il n'y aura plus de si : on affirmera catgoriquement je veux
dire sans subordination une hypothse mtaphysique ce qu'on affirme, dton ne l'affirmer que comme probable. La premire thse avait la beaut du
dfinitif, mais elle tait suspendue en l'air, dans la rgion du simple possible.
L'autre est inacheve, mais elle pousse des racines solides dans le rel.
Une science naissante est toujours prompte dogmatiser. Ne disposant
que d'une exprience restreinte, elle opre moins sur les faits que sur quelques
ides simples, suggres ou non par eux, qu'elle traite alors dductivement.
Plus qu'aucune autre science, la mtaphysique tait expose ce danger. Il
faut tout un travail de dblaiement pour ouvrir les voies l'exprience intrieure. La facult d'intuition existe bien en chacun de nous, mais recouverte
par des fonctions plus utiles la vie. Le mtaphysicien travailla donc a priori
sur des concepts dposs par avance dans le langage, comme si, descendus du
ciel, ils rvlaient l'esprit une ralit suprasensible. Ainsi naquit la thorie
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
30
platonicienne des Ides. Porte sur les ailes de l'aristotlisme et du noplatonisme, elle traversa le moyen ge ; elle inspira, parfois leur insu, les
philosophes modernes. Ceux-ci taient souvent des mathmaticiens, que leurs
habitudes d'esprit inclinaient ne voir dans la mtaphysique qu'une mathmatique plus vaste, embrassant la qualit en mme temps que la quantit.
Ainsi s'expliquent l'unit et la simplicit gomtriques de la plupart des philosophies, systmes complets de problmes dfinitivement poss, intgralement
rsolus. Mais cette raison n'est pas la seule. Il faut tenir compte aussi de ce
que la mtaphysique moderne se donna un objet analogue celui de la
religion. Elle partait d'une conception de la divinit. Qu'elle confirmt ou
qu'elle infirmt le dogme, elle se croyait donc oblige de dogmatiser. Elle
avait, quoique fonde sur la seule raison, la scurit de jugement que le
thologien tient de la rvlation. On peut se demander, il est vrai, pourquoi
elle choisissait ce point de dpart. Mais c'est qu'il ne dpendait pas d'elle d'en
prendre un autre. Comme elle travaillait en dehors de l'exprience, sur de purs
concepts, force lui tait bien de se suspendre un concept d'o l'on pt tout
dduire et qui contnt tout. Telle tait justement l'ide qu'elle se faisait de
Dieu.
Mais pourquoi se faisait-elle de Dieu cette ide ? Qu'Aristote en soit venu
fondre tous les concepts en un seul, et poser comme principe d'explication
universel une Pense de la Pense , proche parente de lIde platonicienne
du Bien, que la philosophie moderne, continuatrice de celle d'Aristote, se soit
engage dans une voie analogue, cela se comprend la rigueur. Ce qui se
comprend moins, c'est qu'on ait appel Dieu un principe qui n'a rien de
commun avec celui que l'humanit a toujours dsign par ce mot. Le dieu de
la mythologie antique et le Dieu du christianisme ne se ressemblent gure,
sans aucun doute, mais vers l'un et vers l'autre montent des prires, l'un et
l'autre s'intressent l'homme : statique ou dynamique, la religion tient ce
point pour fondamental. Et pourtant il arrive encore la philosophie d'appeler
Dieu un tre que son essence condamnerait ne tenir aucun compte des
invocations humaines, comme si, embrassant thoriquement toutes choses, il
tait, en fait, aveugle nos souffrances et sourd nos prires. En approfondissant ce point, on y trouverait la confusion, naturelle l'esprit humain, entre
une ide explicative et un principe agissant. Les choses tant ramenes leurs
concepts, les concepts s'embotant les uns dans les autres, on arrive finalement
une ide des ides, par laquelle on s'imagine que tout s'explique. vrai dire,
elle n'explique pas grand-chose, d'abord parce qu'elle accepte la subdivision et
la rpartition du rel en concepts que la socit a consignes dans le langage et
qu'elle avait le plus souvent effectues par sa seule commodit, ensuite parce
que la synthse qu'elle opre de ces concepts est vide de matire, et purement
verbale. On se demande comment ce point essentiel a chapp des philosophes profonds, et comment ils ont pu croire qu'ils caractrisaient en quoi
que ce ft le principe rig par eux en explication du monde, alors qu'ils se
bornaient le reprsenter conventionnellement par un signe. Nous le disions
plus haut : qu'on donne le nom qu'on voudra la chose en soi , qu'on en
fasse la Substance de Spinoza, le Moi de Fichte, l'Absolu de Schelling, l'Ide
de Hegel, ou la Volont de Schopenhauer, le mot aura beau se prsenter avec
sa signification bien dfinie : il la perdra, il se videra de toute signification ds
qu'on l'appliquera la totalit des choses. Pour ne parler que de la dernire de
ces grandes synthses , n'est-il pas vident qu'une Volont n'est volont
qu' la condition de trancher sur ce qui ne veut pas ? Comment alors l'esprit
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
31
tranchera-t-il sur la matire, si la matire est elle-mme volont ? Mettre la
volont partout quivaut ne la laisser nulle part, car c'est identifier l'essence
de ce que je sens en moi dure, jaillissement, cration continue avec
l'essence de ce que je perois dans les choses, o il y a videmment rptition,
prvisibilit, ncessit. Peu m'importe qu'on dise Tout est mcanisme ou
Tout est volont : dans les deux cas tout est confondu. Dans les deux cas,
mcanisme et volont deviennent synonymes d' tre , et par consquent synonymes l'un de l'autre. L est le vice initial des systmes philosophiques. Ils croient nous renseigner sur l'absolu en lui donnant un nom.
Mais, encore une fois, le mot peut avoir un sens dfini quand il dsigne une
chose ; il le perd ds que vous l'appliquez toutes choses. Encore une fois, je
sais ce qu'est la volont si vous entendez par l ma facult de vouloir, ou celle
des tres qui me ressemblent, ou mme la pousse vitale des tres organiss,
suppose alors analogue mon lan de conscience. Mais plus vous augmenterez l'extension du terme, plus vous en diminuerez la comprhension. Si vous
englobez dans son extension la matire, vous videz sa comprhension des
caractres positifs par lesquels la spontanit tranche sur le mcanisme, et la
libert sur la ncessit. Quand enfin le mot en vient dsigner tout ce qui
existe, il ne signifie plus qu'existence. Que gagnez-vous alors dire que le
monde est volont, au lieu de constater tout bonnement qu'il est ?
Mais le concept au contenu indtermin, ou plutt sans contenu, auquel on
aboutit ainsi, et qui n'est plus rien, on veut qu'il soit tout. On fait alors appel au
Dieu de la religion, qui est la dtermination mme et, de plus, essentiellement
agissant. Il est au sommet de l'tre : on fait concider avec lui ce qu'on prend,
bien tort, pour le sommet de la connaissance. Quelque chose de l'adoration
et du respect que l'humanit lui voue passe alors au principe qu'on a dcor de
son nom. Et de l vient, en grande partie, le dogmatisme de la philosophie
moderne.
La vrit est qu'une existence ne peut tre donne que dans une exprience. Cette exprience s'appellera vision ou contact, perception extrieure en
gnral, s'il s'agit d'un objet matriel ; elle prendra le nom d'intuition quand
elle portera sur l'esprit. Jusqu'o va l'intuition ? Elle seule pourra le dire. Elle
ressaisit un fil : elle de voir si ce fil monte jusqu'au ciel ou s'arrte quelque
distance de terre. Dans le premier cas, l'exprience mtaphysique se reliera
celle des grands mystiques : nous croyons constater, pour notre part, que la
vrit est l. Dans le second, elles resteront isoles l'une de l'autre, sans pour
cela rpugner entre elles. De toute manire, la philosophie nous aura levs
au-dessus de la condition humaine.
Dj elle nous affranchit de certaines servitudes spculatives quand elle
pose le problme de l'esprit en termes d'esprit et non plus de matire, quand,
d'une manire gnrale, elle nous dispense d'employer les concepts un
travail pour lequel la plupart ne sont pas faits. Ces concepts sont inclus dans
les mots. Ils ont, le plus souvent, t labors par l'organisme social en vue
d'un objet qui n'a rien de mtaphysique. Pour les former, la socit a dcoup
le rel selon ses besoins. Pourquoi la philosophie accepteraitelle une division
qui a toutes chances de ne pas correspondre aux articulations du rel ? Elle
l'accepte pourtant d'ordinaire. Elle subit le problme tel qu'il est pos par le
langage. Elle se condamne donc par avance recevoir une solution toute faite
ou, en mettant les choses au mieux, simplement choisir entre les deux ou
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
32
trois solutions, seules possibles, qui sont coternelles cette position du
problme. Autant vaudrait dire que toute vrit est dj virtuellement connue,
que le modle en est dpos dans les cartons administratifs de la cit, et que la
philosophie est un jeu de puzzle o il s'agit de reconstituer, avec des pices
que la socit nous fournit, le dessin qu'elle ne veut pas nous montrer. Autant
vaudrait assigner au philosophe le rle et l'attitude de l'colier, qui cherche la
solution en se disant qu'un coup d'il indiscret la lui montrerait, note en
regard de l'nonc, dans le cahier du matre. Mais la vrit est qu'il s'agit, en
philosophie et mme ailleurs, de trouver le problme et par consquent de le
poser, plus encore que de le rsoudre. Car un problme spculatif est rsolu
ds qu'il est bien pos. J'entends, par l que la solution en existe alors aussitt,
bien qu'elle puisse rester cache et, pour ainsi dire, couverte : il ne reste plus
qu' la dcouvrir. Mais poser le problme n'est pas simplement dcouvrir, c'est
inventer. La dcouverte porte sur ce qui existe dj, actuellement ou virtuellement ; elle tait donc sre de venir tt ou tard. L'invention donne l'tre ce qui
n'tait pas, elle aurait pu ne venir jamais. Dj en mathmatiques, plus forte
raison en mtaphysique, l'effort d'invention consiste le plus souvent susciter
le problme, crer les termes en lesquels il se posera. Position et solution du
problme sont bien prs ici de s'quivaloir : les vrais grands problmes ne sont
poss que lorsqu'ils sont rsolus. Mais beaucoup de petits problmes sont dans
le mme cas. J'ouvre un trait lmentaire de philosophie. Un des premiers
chapitres traite du plaisir et de la douleur. On y pose l'lve une question
telle que celle-ci : Le plaisir est-il ou n'est-il pas le bonheur ? Mais il
faudrait d'abord savoir si plaisir et bonheur sont des genres correspondant un
sectionnement naturel des choses. la rigueur, la phrase pourrait signifier
simplement : Vu le sens habituel des termes plaisir et bonheur, doit-on dire
que le bonheur soit une suite de plaisirs ? Alors, c'est une question de lexique qui se pose ; on ne la rsoudra qu'on cherchant comment les mots
plaisir et bonheur ont t employs par les crivains qui ont le mieux
mani la langue. On aura d'ailleurs travaill utilement ; on aura mieux dfini
deux termes usuels, c'est--dire deux habitudes sociales. Mais si l'on prtend
faire davantage, saisir des ralits et non pas mettre au point des conventions,
pourquoi veut-on que des termes peut-tre artificiels (on ne sait s'ils le sont ou
s'ils ne le sont pas, puisqu'on n'a pas encore tudi l'objet) posent un problme
qui concerne la nature mme des choses ? Supposez qu'en examinant les tats
groups sous le nom de plaisir on ne leur dcouvre rien de commun, sinon
d'tre des tats que l'homme recherche : l'humanit aura class ces choses trs
diffrentes dans un mme genre, parce qu'elle leur trouvait le mme intrt
pratique et ragissait toutes de la mme manire. Supposez, d'autre part,
qu'on aboutisse un rsultat analogue en analysant l'ide de bonheur. Aussitt
le problme s'vanouit, ou plutt se dissout en problmes tout nouveaux dont
nous ne pourrons rien savoir et dont nous ne possderons mme pas les termes
avant d'avoir tudi en elle-mme l'activit humaine sur laquelle la socit
avait pris du dehors, pour former les ides gnrales de plaisir et de bonheur,
des vues peut-tre artificielles. Encore faudra-t-il s'tre assur d'abord que le
concept d' activit humaine rpond lui-mme une division naturelle. Dans
cette dsarticulation du rel selon ses tendances propres gt la difficult
principale, ds qu'on a quitt le domaine de la matire pour celui de l'esprit.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
33
C'est dire que la question de l'origine et de la valeur des ides gnrales se
pose l'occasion de tout problme philosophique, et qu'elle rclame dans
chacun des cas une solution particulire. Les discussions qui se sont leves
autour d'elle remplissent l'histoire de la philosophie. Peuttre y aurait-il lieu de
se demander, avant toute discussion, si ces ides constituent bien un genre, et
si ce ne serait pas prcisment en traitant des ides gnrales qu'il faudrait se
garder des gnralits. Sans doute on pourra sans difficult conserver l'ide
gnrale d'ide gnrale, si l'on y tient. Il suffira de dire que l'on convient
d'appeler ide gnrale une reprsentation qui groupe un nombre indfini de
choses sous le mme nom : la plupart des mots correspondront ainsi une ide
gnrale. Mais la question importante pour le philosophe est de savoir par
quelle opration, pour quelle raison, et surtout en vertu de quelle structure du
rel les choses peuvent tre ainsi groupes, et cette question ne comporte pas
une solution unique et simple.
Disons tout de suite que la psychologie nous parat marcher l'aventure
dans les recherches de cet ordre si elle ne tient pas un fil conducteur. Derrire
le travail de l'esprit, qui est l'acte, il y a la fonction. Derrire les ides gnrales, il y a la facult de concevoir ou de percevoir des gnralits. De cette
facult il faudrait dterminer d'abord la signification vitale. Dans le labyrinthe
des actes, tats et facults de l'esprit, le fil qu'on ne devrait jamais lcher est
celui que fournit la biologie. Primum vivere. Mmoire, imagination, conception et perception, gnralisation enfin, ne sont pas l pour rien, pour le
plaisir . Il semble vraiment, entendre certains thoriciens, que l'esprit soit
tomb du ciel avec une subdivision en fonctions psychologiques dont il y a
simplement constater l'existence : parce que ces fonctions sont telles, elles
seraient utilises de telle manire. Nous croyons au contraire que c'est parce
qu'elles sont utiles, parce qu'elles sont ncessaires la vie, qu'elles sont ce
qu'elles sont : aux exigences fondamentales de la vie il faut se rfrer pour
expliquer leur prsence et pour la justifier s'il y a lieu, je veux dire pour savoir
si la subdivision ordinaire en telles ou telles facults est artificielle ou naturelle, si par consquent nous devons la maintenir ou la modifier ; toutes nos
observations sur le mcanisme de la fonction seront fausses si nous l'avons
mal dcoupe dans la continuit du tissu psychologique. Dirat-on que les
exigences de la vie sont analogues chez les hommes, les animaux et mme les
plantes, que notre mthode risque donc de ngliger ce qu'il y a de proprement
humain dans l'homme ? Sans aucun doute : une fois dcoupe et distribue la
vie psychologique, tout n'est pas fini ; il reste suivre la croissance et mme
la transfiguration de chaque facult chez l'homme. Mais on aura du moins
quelque chance de n'avoir pas trac des divisions arbitraires dans l'activit de
l'esprit, pas plus qu'on n'chouerait dmler des plantes aux tiges et feuillages entrelacs, enchevtrs, si l'on creusait jusqu'aux racines.
Appliquons cette mthode au problme des ides gnrales : nous trouverons que tout tre vivant, peut-tre mme tout organe, tout tissu d'un tre
vivant gnralise, je veux dire classifie, puisqu'il sait cueillir dans le milieu o
il est, dans les substances ou les objets les plus divers, les parties ou les
lments qui pourront satisfaire tel ou tel de ses besoins ; il nglige le reste.
Donc il isole le caractre qui l'intresse, il va droit une proprit commune ;
en d'autres termes il classe, et par consquent abstrait et gnralise. Sans
doute, dans la presque totalit des cas, et probablement chez tous les animaux
autres que l'homme, abstraction et gnralisation sont vcues et non pas
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
34
penses. Pourtant, chez l'animal mme, nous trouvons des reprsensations
auxquelles ne manquent que la rflexion et quelque dsintressement pour tre
pleinement des ides gnrales : sinon, comment une vache qu'on emmne
s'arrterait-elle devant un pr, n'importe lequel, simplement parce qu'il rentre
dans la catgorie que nous appelons herbe ou pr ? Et comment un cheval
distinguerait-il une curie d'une grange, une route d'un champ, le foin de
l'avoine ? Concevoir ou plutt percevoir ainsi la gnralit est d'ailleurs aussi
le fait de l'homme en tant qu'il est animal, qu'il a des instincts et des besoins.
Sans que sa rflexion et mme sa conscience interviennent, une ressemblance
peut tre extraite des objets les plus diffrents par une de ses tendances ; elle
classera ces objets dans un genre et crera une ide gnrale, joue plutt que
pense. Ces gnralits automatiquement extraites sont mme beaucoup plus
nombreuses chez l'homme, qui ajoute l'instinct des habitudes plus ou moins
capables d'imiter l'acte instinctif. Qu'on passe maintenant l'ide gnrale
complte, je veux dire consciente, rflchie, cre avec intention, on trouvera
le plus souvent sa base cette extraction automatique de ressemblances qui est
l'essentiel de la gnralisation. En un sens, rien ne ressemble rien, puisque
tous les objets diffrent. En un autre sens, tout ressemble tout, puisqu'on
trouvera toujours, ens'levant assez haut dans l'chelle des gnralits, quelque genre artificiel o deux objets diffrents, prix au hasard, pourront entrer.
Mais entre la gnralisation impossible et la gnralisation inutile il y a celle
que provoquent, en la prfigurant, des tendances, des habitudes, des gestes et
des attitudes, des complexes de mouvements automatiquement accomplis ou
esquisss, qui sont l'origine de la plupart des ides gnrales proprement
humaines. La ressemblance entre choses ou tats, que nous dclarons percevoir, est avant tout la proprit, commune ces tats ou ces choses, d'obtenir
de notre corps la mme raction, de lui faire esquisser la mme attitude et
commencer les mmes mouvements. Le corps extrait du milieu matriel ou
moral ce qui a pu l'influencer, ce qui l'intresse : c'est l'identit de raction
des actions diffrentes qui, rejaillissant sur elles, y introduit la ressemblance,
ou l'en fait sortir. Telle, une sonnette tirera des excitants les plus divers coup
de poing, souffle du vent, courant lectrique un son toujours le mme, les
convertira ainsi en sonneurs et les rendra par l semblables entre eux,
individus constitutifs d'un genre, simplement parce qu'elle reste elle-mme :
sonnette et rien que sonnette, elle ne peut pas faire autre chose, si elle ragit,
que de sonner. Il va sans dire que, lorsque la rflexion aura lev l'tat de
pense pure des reprsentations qui n'taient gure que l'insertion de la
conscience dans un cadre matriel, attitudes et mouvements, elle formera
volontairement, directement, par imitation, des ides gnrales qui ne seront
qu'ides. Elle y sera aide puissamment par le mot, qui fournira encore la
reprsentation un cadre, cette fois plus spirituel que corporel, o s'insrer. Il
n'en est pas moins vrai que pour se rendre compte de la vraie nature des
concepts, pour aborder avec quelque chance de succs les problmes relatifs
aux ides gnrales, c'est toujours l'interaction de la pense et des attitudes
ou habitudes motrices qu'il faudra se reporter, la gnralisation n'tant gure
autre chose, originellement, que l'habitude, remontant du champ de l'action
celui de la pense.
Mais, une fois dtermines ainsi l'origine et la structure de l'ide gnrale,
une fois tablie la ncessit de son apparition, une fois aussi constate l'imitation de la nature par la construction artificielle d'ides gnrales, il reste
chercher comment des ides gnrales naturelles qui servent de modle
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
35
d'autres sont possibles, pourquoi l'exprience nous prsente des ressemblances
que nous n'avons plus qu' traduire en gnralits. Parmi ces ressemblances il
en est, sans aucun doute, qui tiennent au fond des choses. Celles-l donneront
naissance des ides gnrales qui seront encore relatives, dans une certaine
mesure, la commodit de l'individu et de la socit, mais que la science et la
philosophie n'auront qu' dgager de cette gangue pour obtenir une vision plus
ou moins approximative de quelque aspect de la ralit. Elles sont peu nombreuses, et l'immense majorit des ides gnrales sont celles que la socit a
prpares pour le langage en vue de la conversation et de l'action. Nanmoins,
mme parmi ces dernires, auxquelles nous faisons surtout allusion dans le
prsent essai, on en trouverait beaucoup qui se rattachent par une srie d'intermdiaires, aprs toutes sortes de manipulations, de simplifications, de dformations, au petit nombre d'ides qui traduisent des ressemblances essentielles : il sera souvent instructif de remonter avec elles, par un plus ou moins
long dtour, jusqu' la ressemblance laquelle elles se rattachent. Il ne sera
donc pas inutile d'ouvrir ici une parenthse sur ce qu'on pourrait appeler les
gnralits objectives, inhrentes la ralit mme. Si restreint qu'en soit le
nombre, elles sont importantes et par elles-mmes et par la confiance qu'elles
irradient autour d'elles, prtant quelque chose de leur solidit des genres tout
artificiels. C'est ainsi que des billets de banque en nombre exagr peuvent
devoir le peu de valeur qui leur reste ce qu'on trouverait encore d'or dans la
caisse.
En approfondissant ce point, on s'apercevrait, croyons-nous, que les ressemblances se rpartissent en trois groupes, dont le second devra probablement se subdiviser lui-mme au fur et mesure des progrs de la science
positive. Les premires sont d'essence biologique : elles tiennent ce que la
vie travaille comme si elle avait elle-mme des ides gnrales, celles de genre
et d'espce, comme si elle suivait des plans de structure en nombre limit,
comme si elle avait institu des proprits gnrales de la vie, enfin et surtout
comme si elle avait voulu, par le double effet de la transmission hrditaire
(pour ce qui est inn) et de la transformation plus ou moins lente, disposer les
vivants en srie hirarchique, le long d'une chelle o les ressemblances entre
individus sont de plus en plus nombreuses mesure qu'on s'lve plus haut.
Qu'on s'exprime ainsi en termes de finalit, ou qu'on attribue la matire
vivante des proprits spciales, imitatrices de l'intelligence, ou bien enfin
qu'on se rallie quelque hypothse intermdiaire, toujours c'est dans la ralit
mme en principe (mme si notre classification est inexacte en fait) que se
trouveront fondes nos subdivisions en espces, genres, etc. gnralits que
nous traduisons en ides gnrales. Et tout aussi fondes en droit seront celles
qui correspondent des organes, tissus, cellules, comportements mme
des tres vivants. Maintenant, si nous passons de l'organis l'inorganis, de
la matire vivante la matire inerte et non encore informe par l'homme,
nous retrouvons des genres rels, mais d'un caractre tout diffrent : des
qualits, telles que les couleurs, les saveurs, les odeurs ; des lments ou des
combinaisons, tels que l'oxygne, l'hydrogne, l'eau ; enfin des forces physiques comme la pesanteur, la chaleur, l'lectricit. Mais ce qui rapproche ici les
unes des autres les reprsentations d'individus groupes sous l'ide gnrale
est tout autre chose. Sans entrer dans le dtail, sans compliquer notre expos
en tenant compte des nuances, attnuant d'ailleurs par avance ce que notre
distinction pourrait avoir d'excessif, convenant enfin de donner maintenant au
mot ressemblance son sens le plus prcis mais aussi le plus troit, nous
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
36
dirons que dans le premier cas le principe de rapprochement est la ressemblance proprement dite, et dans le second l'identit. Une certaine nuance de
rouge peut tre identique elle-mme dans tous les objets o elle se rencontre.
On en dirait autant de deux notes de mme hauteur, de mme intensit et de
mme timbre. D'ailleurs, tort ou raison, nous nous sentons marcher des
lments ou des vnements identiques mesure que nous approfondissons
davantage la matire et que nous rsolvons le chimique en physique, le
physique en mathmatique. Or, une logique simple a beau prtendre que la
ressemblance est une identit partielle, et l'identit une ressemblance complte, l'exprience nous dit tout autre chose. Si l'on cesse de donner au mot
ressemblance le sens vague et en quelque sorte populaire o nous le
prenions pour commencer, si l'on cherche prciser ressemblance par une
comparaison avec identit , on trouvera, croyons-nous, que l'identit est du
gomtrique et la ressemblance du vital. La premire relve de la mesure,
l'autre est plutt du domaine de l'art : c'est souvent un sentiment tout esthtique qui pousse le biologiste volutionniste supposer parentes des formes
entre lesquelles il est le premier apercevoir une ressemblance : les dessins
mmes qu'il en donne rvlent parfois une main et surtout un il d'artiste.
Mais si l'identique tranche ainsi sur le ressemblant, il y aurait lieu de
rechercher, pour cette nouvelle catgorie d'ides gnrales comme pour
l'autre, ce qui la rend possible.
Pareille recherche n'aurait quelque chance d'aboutir que dans un tat plus
avanc de notre connaissance de la matire. Bornons-nous dire un mot de
l'hypothse laquelle nous serions conduit par notre approfondissement de la
vie. S'il y a du vert qui est en mille et mille lieux diffrents le mme vert (au
moins pour notre il, au moins approximativement), s'il en est ainsi pour les
autres couleurs, et si les diffrences de couleur tiennent la plus ou moins
grande frquence des vnements physiques lmentaires que nous condensons en perception de couleur, la possibilit pour ces frquences de nous
prsenter dans tous les temps et dans tous les lieux quelques couleurs dtermines vient de ce que partout et toujours sont ralises toutes les frquences
possibles (entre certaines limites, sans doute) : alors, ncessairement, celles
qui correspondent nos diverses couleurs se produiront parmi les autres, quel
que soit le moment ou l'endroit : la rptition de l'identique, qui permet ici de
constituer des genres, n'aura pas d'autre origine. La physique moderne nous
rvlant de mieux en mieux des diffrences de nombre derrire nos distinctions de qualit, une explication de ce genre vaut probablement pour tous les
genres et pour toutes les gnralits lmentaires (capables d'tre composs
par nous pour en former d'autres) que nous trouvons dans le monde de la
matire inerte. L'explication ne serait pleinement satisfaisante, il est vrai, que
si elle disait aussi pourquoi notre perception cueille, dans le champ immense
des frquences, ces frquences dtermines qui seront les diverses couleurs,
pourquoi d'abord elle en cueille, pourquoi ensuite elle cueille celles-l plutt
que d'autres. cette question spciale nous avons rpondu jadis en dfinissant
l'tre vivant par une certaine puissance d'agir dtermine en quantit et en
qualit : c'est cette action virtuelle qui extrait de la matire nos perceptions
relles, informations dont elle a besoin pour se guider, condensations, dans un
instant de notre dure, de milliers, de millions, de trillions d'vnements
s'accomplissant dans la dure normment moins tendue des choses ; cette
diffrence de tension mesure prcisment l'intervalle entre le dterminisme
physique et la libert humaine, en mme temps qu'elle explique leur dualit et
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
37
leur coexistence 1. Si, comme nous le croyons, l'apparition de l'homme, ou de
quelque tre de mme essence, est la raison d'tre de la vie sur notre plante, il
faudra dire que toutes les catgories de perceptions, non seulement des
hommes, mais des animaux et mme des plantes (lesquelles peuvent se comporter comme si elles avaient des perceptions) correspondent globalement au
choix d'un certain ordre de grandeur pour la condensation. C'est l une simple
hypothse, mais elle nous parat sortir tout naturellement des spculations de
la physique sur la structure de la matire. Que deviendrait la table sur laquelle
j'cris en ce moment si ma perception, et par consquent mon action, tait
faite pour l'ordre de grandeur auquel correspondent les lments, ou plutt les
vnements, constitutifs de sa matrialit ? Mon action serait dissoute ; ma
perception embrasserait, l'endroit o je vois ma table et dans le court
moment o je la regarde, un univers immense et une non moins interminable
histoire. Il me serait impossible de comprendre comment cette immensit
mouvante peut devenir, pour que j'agisse sur elle, un simple rectangle, immobile et solide. Il en serait de mme pour toutes choses et pour tous
vnements : le monde o nous vivons, avec les actions et ractions de ses
parties les unes sur les autres, est ce qu'il est en vertu d'un certain choix dans
l'chelle des grandeurs, choix dtermin lui-mme par notre puissance d'agir.
Rien n'empcherait d'autres mondes, correspondant un autre choix, d'exister
avec lui, dans le mme lieu et le mme temps : c'est ainsi que vingt postes
d'mission diffrents lancent simultanment vingt concerts diffrents, qui
coexistent sans qu'aucun d'eux mle ses sons la musique de l'autre, chacun
tant entendu tout entier, et seul entendu, dans l'appareil qui a choisi pour la
rception la longueur d'onde du poste d'mission. Mais n'insistons pas
davantage sur une question que nous avons simplement rencontre en route.
Point n'est besoin d'une hypothse sur la structure intime de la matire pour
constater que les conceptions issues des perceptions, les ides gnrales
correspondant aux proprits et actions de la matire, ne sont possibles ou ne
sont ce qu'elles sont qu'en raison de la mathmatique immanente aux choses.
C'est tout ce que nous voulions rappeler pour justifier une classification des
ides gnrales qui met d'un ct le gomtrique et, de l'autre, le vital, celui-ci
apportant avec lui la ressemblance, celui-l l'identit.
Nous devons maintenant passer la troisime catgorie que nous annoncions, aux ides gnrales cres tout entires par la spculation et l'action
humaines. L'homme est essentiellement fabricant. La nature, en lui refusant
des instruments tout faits comme ceux des insectes par exemple, lui a donn
l'intelligence, c'est--dire le pouvoir d'inventer et de construire un nombre
indfini d'outils. Or, si simple que soit la fabrication, elle se fait sur un
modle, peru ou imagin : rel est le genre que dfinit ou ce modle luimme ou le schma de sa construction. Toute notre civilisation repose ainsi
1
On peut donc, et mme en doit, parler encore de dterminisme physique, lors mme qu'on
postule, avec la physique la plus rcente, l'indterminisme des vnements lmentaires
dont se compose le fait physique. Car ce fait physique est peru par nous comme soumis
un dterminisme inflexible, et se distingue radicalement par l des actes que nous
accomplissons quand nous nous sentons libres. Ainsi que nous le suggrons ci-dessus, on
peut se demander si ce n'est pas prcisment pour couler la matire dans ce dterminisme,
pour obtenir, dans les phnomnes qui nous entoureront, une rgularit de succession
nous permettant d'agir sur eux, que notre perception s'arrte un certain degr particulier
de condensation des vnements lmentaires. Plus gnralement, l'activit de l'tre
vivant s'adosserait et se mesurerait la ncessit qui vient servir de support aux choses,
par une condensation de leur dure.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
38
sur un certain nombre d'ides gnrales dont nous connaissons adquatement
le contenu, puisque nous l'avons fait, et dont la valeur est minente, puisque
nous ne pourrions pas vivre sans elles. La croyance la ralit absolue des
Ides en gnral, peut-tre mme leur divinit, vient en partie de l. On sait
quel rle elle joue dans la philosophie antique, et mme dans la ntre. Toutes
les ides gnrales bnficient de l'objectivit de certaines d'entre elles.
Ajoutons que la fabrication humaine ne s'exerce pas seulement sur la matire.
Une fois en possession des trois espces d'ides gnrales que nous avons
numres, surtout de la dernire, notre intelligence tient ce que nous
appelions l'ide gnrale d'ide gnrale. Elle peut alors construire des ides
gnrales comme il lui plat. Elle commence naturellement par celles qui
peuvent le mieux favoriser la vie sociale, ou simplement qui se rapportent la
vie sociale ; puis viendront celles qui intressent la spculation pure ; et enfin
celles que l'on construit pour rien, pour le plaisir. Mais, pour presque tous les
concepts qui n'appartiennent pas nos deux premires catgories, c'est--dire
pour l'immense majorit des ides gnrales, c'est l'intrt de la socit avec
celui des individus, ce sont les exigences de la conversation et de l'action, qui
prsident leur naissance.
Fermons cette trop longue parenthse, qu'il fallait ouvrir pour montrer
dans quelle mesure il y a lieu de rformer et parfois d'carter la pense conceptuelle pour venir une philosophie plus intuitive. Cette philosophie,
disions-nous, dtournera le plus souvent de la vision sociale de l'objet dj
fait : elle nous demandera de participer en esprit l'acte qui le fait. Elle nous
replacera donc, sur ce point particulier, dans la direction du divin. Est proprement humain, en effet, le travail d'une pense individuelle qui accepte, telle
quelle, son insertion dans la pense sociale, et qui utilise les ides prexistantes comme tout autre outil fourni par la communaut. Mais il y a dj
quelque chose de quasi divin dans l'effort, si humble soit-il, d'un esprit qui se
rinsre dans l'lan vital, gnrateur des socits qui sont gnratrices d'ides.
Cet effort exorcisera certains fantmes de problmes qui obsdent le
mtaphysicien, c'est--dire chacun de nous. Je veux parler de ces problmes
angoissants et insolubles qui ne portent pas sur ce qui est, qui portent plutt
sur ce qui n'est pas. Tel est le problme de l'origine de l'tre : Comment se
peut-il que quelque chose existe matire, esprit, ou Dieu ? Il a fallu une
cause, et une cause de la cause, et ainsi de suite indfiniment. Nous remontons donc de cause en cause ; et si nous nous arrtons quelque part, ce n'est
pas que notre intelligence ne cherche plus rien au del, c'est que notre
imagination finit par fermer les yeux, comme sur l'abme, pour chapper au
vertige. Tel est encore le problme de l'ordre en gnral : Pourquoi une
ralit ordonne, o notre pense se retrouve comme dans un miroir ? Pourquoi le monde n'est-il pas incohrent ? Je dis que ces problmes se rapportent ce qui n'est pas, bien plutt qu' ce qui est. Jamais, en effet, on ne
s'tonnerait de ce que quelque chose existe, matire, esprit, Dieu, si l'on
n'admettait pas implicitement qu'il pourrait ne rien exister. Nous nous
figurons, ou mieux nous croyons nous figurer, que l'tre est venu combler un
vide et que le nant prexistait logiquement l'tre : la ralit primordiale
qu'on l'appelle matire, esprit ou Dieu viendrait alors s'y surajouter, et c'est
incomprhensible. De mme, on ne se demanderait pas pourquoi l'ordre existe
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
39
si l'on ne croyait concevoir un dsordre qui se serait pli l'ordre et qui par
consquent le prcderait, au moins idalement. L'ordre aurait donc besoin
d'tre expliqu, tandis que le dsordre, tant de droit, ne rclamerait pas
dexplication. Tel est le point de vue o l'on risque de rester tant qu'on cherche
seulement comprendre. Mais essayons, en outre, d'engendrer (nous ne le
pourrons, videmment, que par la pense). mesure que nous dilatons notre
volont, que nous tendons y rabsorber notre pense et que nous sympathisons davantage avec l'effort qui engendre les choses, ces problmes formidables reculent, diminuent, disparaissent. Car nous sentons qu'une volont ou
une pense divinement cratrice est trop pleine d'elle-mme, dans son immensit de ralit, pour que l'ide d'un manque d'ordre ou d'un manque d'tre
puisse seulement l'effleurer. Se reprsenter la possibilit du dsordre absolu,
plus forte raison du nant, serait pour elle se dire qu'elle aurait pu ne pas tre
du tout, et ce serait l une faiblesse incompatible avec sa nature, qui est force.
Plus nous nous tournons vers elle, plus les doutes qui tourmentent l'homme
normal et sain nous paraissent anormaux et morbides. Rappelons-nous le
douteur qui ferme une fentre, puis retourne vrifier la fermeture, puis vrifie
sa vrification, et ainsi de suite. Si nous lui demandons ses motifs, il nous
rpondra qu'il a pu chaque fois rouvrir la fentre en tchant de la mieux
fermer. Et s'il est philosophe, il transposera intellectuellement l'hsitation de
sa conduite en cet nonc de problme : Comment tre sr, dfinitivement
sr, qu'on a fait ce que l'on voulait faire ? Mais la vrit est que sa puissance
d'agir est lse, et que l est le mal dont il souffre : il n'avait qu'une demivolont d'accomplir l'acte, et c'est pourquoi l'acte accompli ne lui laisse qu'une
demi-certitude. Maintenant, le problme que cet homme se pose, le rsolvonsnous ? videmment non, mais nous ne le posons pas : l est notre supriorit.
premire vue, je pourrais croire qu'il y a plus en lui qu'en moi, puisque l'un
et l'autre nous fermons la fentre et qu'il soulve en outre, lui, une question
philosophique, tandis que je n'en soulve pas. Mais la question qui se surajoute chez lui la besogne faite ne reprsente en ralit que du ngatif ; ce
n'est pas du plus, mais du moins ; c'est un dficit du vouloir. Tel est exactement l'effet que produisent sur nous certains grands problmes , quand
nous nous replaons dans le sens de la pense gnratrice. Ils tendent vers
zro mesure que nous nous rapprochons d'elle, n'tant que l'cart entre elle et
nous. Nous dcouvrons alors l'illusion de celui qui croit faire plus en les
posant qu'en ne les posant pas. Autant vaudrait s'imaginer qu'il y a plus dans
la bouteille moiti bue que dans la bouteille pleine, parce que celle-ci ne
contient que du vin, tandis que dans l'autre il y a du vin, et en outre, du vide.
Mais ds que nous avons aperu intuitivement le vrai, notre intelligence se
redresse, se corrige, formule intellectuellement son erreur. Elle a reu la
suggestion ; elle fournit le contrle. Comme le plongeur va palper au fond des
eaux l'pave que l'aviateur a signal du haut des airs, ainsi l'intelligence
immerge dans le milieu conceptuel vrifiera de point en point, par contact,
analytiquement, ce qui avait fait l'objet d'une vision synthtique et supraintellectuelle. Sans un avertissement venu du dehors, la pense d'une illusion
possible ne l'et mme pas effleure, car son illusion faisait partie de sa
nature. Secoue de son sommeil, elle analysera les ides de dsordre, de nant
et leurs congnres. Elle reconnatra ne ft-ce que pour un instant, l'illusion
dt-elle reparatre aussitt chasse qu'on ne peut supprimer un arrangement
sans qu'un autre arrangement s'y substitue, enlever de la matire sans qu'une
autre matire la remplace. Dsordre et nant dsignent donc rellement
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
40
ne prsence la prsence d'une chose ou d'un ordre qui ne nous intresse pas,
qui dsappointe notre effort ou notre attention ; c'est notre dception qui
s'exprime quand nous appelons absence cette prsence. Ds lors, parler de
l'absence de tout ordre et de toutes choses, c'est--dire du dsordre absolu et
de l'absolu nant, est prononcer des mots vides de sens, flatus vocis, puisqu'une suppression est simplement une substitution envisage par une seule de
ses deux faces, et que l'abolition de tout ordre ou de toutes choses serait une
substitution face unique, ide qui a juste autant d'existence que celle d'un
carr rond. Quand le philosophe parle de chaos et de nant, il ne fait donc que
transporter dans l'ordre de la spculation, leves l'absolu et vides par l
de tout sens, de tout contenu effectif, deux ides faites pour la pratique et
qui se rapportaient alors une espce dtermine de matire ou d'ordre, mais
non pas tout ordre, non pas toute matire. Ds lors, que deviennent les
deux problmes de l'origine de l'ordre, de l'origine de l'tre ? Ils s'vanouissent, puisqu'ils ne se posent que si l'on se reprsente l'tre et l'ordre comme
survenant , et par consquent le nant et le dsordre comme possibles ou
tout au moins comme concevables ; or ce ne sont l que des mots, des mirages
d'ides.
Qu'elle se pntre de cette conviction, qu'elle se dlivre de cette obsession : aussitt la pense humaine respire. Elle ne s'embarrasse plus des
questions qui retardaient sa marche en avant 1. Elle voit s'vanouir les difficults qu'levrent tour tour, par exemple, le scepticisme antique et le
criticisme moderne. Elle peut aussi bien passer ct de la philosophie
kantienne et des thories de la connaissance issues du kantisme : elle ne
s'y arrtera pas. Tout l'objet de la Critique de la Raison pure est en effet
d'expliquer comment un ordre dfini vient se surajouter des matriaux
supposs incohrents. Et l'on sait de quel prix elle nous fait payer cette
explication : l'esprit humain imposerait sa forme une diversit sensible
venue on ne sait d'o ; l'ordre que nous trouvons dans les choses serait celui
que nous y mettons nous-mmes. De sorte que la science serait lgitime, mais
relative notre facult de connatre, et la mtaphysique impossible, puisqu'il
n'y aurait pas de connaissance en dehors de la science. L'esprit humain est
ainsi relgu dans un coin, comme un colier en pnitence : dfense de
retourner la tte pour voir la ralit telle qu'elle est. Rien de plus naturel, si
l'on n'a pas remarqu que l'ide de dsordre absolu est contradictoire ou plutt
inexistante, simple mot par lequel on dsigne une oscillation de l'esprit entre
deux ordres diffrents : ds lors il est absurde de supposer que le dsordre
prcde logiquement ou chronologiquement l'ordre. Le mrite du kantisme a
t de dvelopper dans toutes ses consquences, et de prsenter sous sa forme
la plus systmatique, une illusion naturelle. Mais il l'a conserve : c'est mme
1
Quand nous recommandons un tat d'me o les problmes s'vanouissent nous ne le
faisons, bien entendu, que pour les problmes qui nous donnent le vertige parce qu'ils
nous mettent en prsence du vide. Autre chose est la condition quasi animale d'un tre qui
ne se pose aucune question, autre chose l'tat semi-divin d'un esprit qui ne connat pas la
tentation d'voquer, par un effet de l'infirmit humaine, des problmes artificiels. Pour
cette pense privilgie, le problme est toujours sur le point de surgir, mais toujours
arrt, dans ce qu'il a de proprement intellectuel, par la contre-partie intellectuelle que lui
suscite l'intuition. L'illusion n'est pas analyse, n'est pas dissipe, puisqu'elle ne se dclare
pas : mais elle le serait si elle se dclarait ; et ces deux possibilits antagonistes, qui sont
d'ordre intellectuel, s'annulent intellectuellement pour ne plus laisser de place qu'
l'intuition du rel. Dans les deux cas que nous avons cits, c'est l'analyse des ides de
dsordre et de nant qui fournit la contre-partie intellectuelle de l'illusion intellectualiste.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
41
sur elle qu'il repose. Dissipons l'illusion : nous restituons aussitt l'esprit
humain, par la science et par la mtaphysique, la connaissance de l'absolu.
Nous revenons donc encore notre point de dpart. Nous disions qu'il faut
amener la philosophie une prcision plus haute, la mettre mme de
rsoudre des problmes plus spciaux, faire d'elle l'auxiliaire et, s'il est besoin,
la rformatrice de la science positive. Plus de grand systme qui embrasse tout
le possible, et parfois aussi l'impossible ! Contentons-nous du rel, matire et
esprit. Mais demandons notre thorie de l'embrasser si troitement qu'entre
elle et lui nulle autre interprtation ne puisse se glisser. Il n'y aura plus alors
qu'une philosophie, comme il n'y a qu'une science. L'une et l'autre se feront
par un effort collectif et progressif. Il est vrai qu'un perfectionnement de la
mthode philosophique s'imposera, symtrique et complmentaire de celui
que reut jadis la science positive.
Telle est la doctrine que certains avaient juge attentatoire la Science et
l'Intelligence. C'tait une double erreur. Mais l'erreur tait instructive, et il sera
utile de l'analyser.
Pour commencer par le premier point, remarquons que ce ne sont gnralement pas les vrais savants qui nous ont reproch d'attenter la science. Tel
d'entre eux a pu critiquer telle de nos vues : c'est prcisment parce qu'il la
jugeait scientifique, parce que nous avions transport sur le terrain de la
science, o il se sentait comptent, un problme de philosophie pure. Encore
une fois, nous voulions une philosophie qui se soumt au contrle de la
science et qui pt aussi la faire avancer. Et nous pensons y avoir russi, puisque la psychologie, la neurologie, la pathologie, la biologie, se sont de plus en
plus ouvertes nos vues, d'abord juges paradoxales. Mais, fussent-elles
demeures paradoxales, ces vues n'auraient jamais t antiscientifiques. Elles
auraient toujours tmoign d'un effort pour constituer une mtaphysique ayant
avec la science une frontire commune et pouvant alors, sur une foule de
points, se prter une vrification. N'et-on pas chemin le long de cette
frontire, et-on simplement remarqu qu'il y en avait une et que mtaphysique et science pouvaient ainsi se toucher, on se ft dj rendu compte de la
place que nous assignons la science positive ; aucune philosophie, disionsnous, pas mme le positivisme, ne l'a mise aussi haut ; la science, comme
la mtaphysique, nous avons attribu le pouvoir d'atteindre un absolu. Nous
avons seulement demand la science de rester scientifique, et de ne pas se
doubler d'une mtaphysique inconsciente, qui se prsente alors aux ignorants,
ou aux demi-savants, sous le masque de la science. Pendant plus d'un demisicle, ce scientisme s'tait mis en travers de la mtaphysique. Tout effort
d'intuition tait dcourag par avance : il se brisait contre des ngations qu'on
croyait scientifiques. Il est vrai que, dans plus d'un cas, elles manaient de
vrais savants. Ceux-ci taient dupes, en effet, de la mauvaise mtaphysique
qu'on avait prtendu tirer de la science et qui, revenant la science par
ricochet, faussait la science sur bien des points. Elle allait jusqu' fausser
l'observation, s'interposant dans certains cas entre l'observateur et les faits.
C'est de quoi nous crmes jadis pouvoir donner la dmonstration sur des
exemples prcis, celui des aphasies en particulier, pour le plus grand bien de
la science en mme temps que de la philosophie. Mais supposons mme qu'on
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
42
ne veuille tre ni assez mtaphysicien ni assez savant pour entrer dans ces
considrations, qu'on se dsintresse du contenu de la doctrine, qu'on en
ignore la mthode : un simple coup d'il jet sur les applications montre quel
travail de circonvallation scientifique elle exige avant l'attaque du moindre
problme. Il n'en faut pas davantage pour voir la place que nous faisons la
science. En ralit, la principale difficult de la recherche philosophique, telle
que nous la comprenons, est l. Raisonner sur des ides abstraites est ais : la
construction mtaphysique n'est qu'un jeu, pour peu qu'on y soit prdispos.
Approfondir intuitivement l'esprit est peut-tre plus pnible, mais aucun
philosophe n'y travaillera longtemps de suite : il aura bien vite aperu, chaque
fois, ce qu'il est en tat d'apercevoir. En revanche, si l'on accepte une telle
mthode, on n'aura jamais assez fait d'tudes prparatoires, jamais suffisamment appris. Voici un problme philosophique. Nous ne l'avons pas choisi,
nous l'avons rencontr. Il nous barre la route, et ds lors il faut carter
l'obstacle ou ne plus philosopher. Point de subterfuge possible ; adieu l'artifice
dialectique qui endort l'attention et qui donne, en rve, l'illusion d'avancer. La
difficult doit tre rsolue, et le problme analys en ses lments. O sera-ton conduit ? Nul ne le sait. Nul ne dira mme quelle est la science dont
relveront les nouveaux problmes. Ce pourra tre une science laquelle on
est totalement tranger. Que dis-je ? Il ne suffira pas de faire connaissance
avec elle, ni mme d'en pousser trs loin l'approfondissement : force sera
parfois d'en rformer certains procds, certaines habitudes, certaines thories
en se rglant justement sur les faits et les raisons qui ont suscit des questions
nouvelles. Soit ; on s'initiera la science qu'on ignore, on l'approfondira, au
besoin on la rformera. Et s'il y faut des mois ou des annes ? On y consacrera
le temps qu'il faudra. Et si une vie n'y suffit pas ? Plusieurs vies en viendront
bout ; nul philosophe n'est maintenant oblig de construire toute la philosophie. Voil le langage que nous tenons au philosophe. Telle est la mthode
que nous lui proposons. Elle exige qu'il soit toujours prt, quel que soit son
ge, se refaire tudiant.
vrai dire, la philosophie est tout prs d'en venir l. Le changement s'est
dj fait sur certains points. Si nos vues furent gnralement juges paradoxales quand elles parurent, quelques-unes sont aujourd'hui banales ; d'autres
sont en passe de le devenir. Reconnaissons qu'elles ne pouvaient tre acceptes d'abord. Il et fallu s'arracher des habitudes profondment enracines,
vritables prolongements de la nature. Toutes les manires de parler, de
penser, de percevoir impliquent en effet que l'immobilit et l'immutabilit sont
de droit, que le mouvement et le changement viennent se surajouter, comme
des accidents, des choses qui par elles-mmes ne se meuvent pas, et en ellesmmes ne changent pas. La reprsentation du changement est celle de qualits
ou d'tats qui se succderaient dans une substance. Chacune des qualits,
chacun des tats serait du stable, le changement tant fait de leur succession :
quant la substance, dont le rle est de supporter les tats et les qualits qui se
succdent, elle serait la stabilit mme. Telle est la logique immanente nos
langues, et formule une fois pour toutes par Aristote : l'intelligence a pour
essence de juger, et le jugement s'opre par l'attribution d'un prdicat un
sujet. Le sujet, par cela seul qu'on le nomme, est dfini comme invariable ; la
variation rsidera dans la diversit des tats qu'on affirmera de lui tour tour.
En procdant ainsi par apposition d'un prdicat un sujet, du stable au stable,
nous suivons la pente de notre intelligence, nous nous conformons aux
exigences de notre langage, et, pour tout dire, nous obissons la nature. Car
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
43
la nature a prdestin l'homme la vie sociale ; elle a voulu le travail en
commun : et ce travail sera possible si nous faisons passer d'un ct la stabilit
absolument dfinitive du sujet, de l'autre les stabilits provisoirement dfinitives des qualits et des tats, qui se trouveront tre des attributs. En nonant
le sujet, nous adossons notre communication une connaissance que nos
interlocuteurs possdent dj, puisque la substance est cense invariable ; ils
savent dsormais sur quel point diriger leur attention ; viendra alors l'information que nous voulons leur donner, dans l'attente de laquelle nous les
placions en introduisant la substance, et que leur apporte l'attribut. Mais ce
n'est pas seulement en nous faonnant pour la vie sociale, en nous laissant
toute latitude pour l'organisation de la socit, en rendant ainsi ncessaire le
langage, que la nature nous a prdestins voir dans le changement et le
mouvement des accidents, riger l'immutabilit et l'immobilit en essences
ou substances, en supports. Il faut ajouter que notre perception procde ellemme selon cette philosophie. Elle dcoupe, dans la continuit de l'tendue,
des corps choisis prcisment de telle manire qu'ils puissent tre traits
comme invariables pendant qu'on les considre. Quand la variation est trop
forte pour ne pas frapper, on dit que l'tat auquel on avait affaire a cd la
place un autre, lequel ne variera pas davantage. Ici encore c'est la nature,
prparatrice de l'action individuelle et sociale, qui a trac les grandes lignes de
notre langage et de notre pense, sans les faire d'ailleurs concider ensemble,
et en laissant aussi une large place la contingence et la variabilit. Il
suffira, pour s'en convaincre, de comparer notre dure ce qu'on pourrait
appeler la dure des choses : deux rythmes bien diffrents, calculs de telle
manire que dans le plus court intervalle perceptible de notre temps tiennent
des trillions d'oscillations ou plus gnralement d'vnements extrieurs qui se
rptent : cette immense histoire, que nous mettrions des centaines de sicles
drouler, nous l'apprhendons dans une synthse indivisible. Ainsi la perception, la pense, le langage, toutes les activits individuelles ou sociales de
l'esprit conspirent nous mettre en prsence d'objets que nous pouvons tenir
pour invariables et immobiles pendant que nous les considrons, comme aussi
en prsence de personnes, y compris la ntre, qui deviendront nos yeux des
objets et, par l mme, des substances invariables. Comment draciner une
inclination aussi profonde ? Comment amener l'esprit humain renverser le
sens de son opration habituelle, partir du changement et du mouvement,
envisags comme la ralit mme, et ne plus voir dans les arrts ou les tats
que des instantans pris sur du mouvant ? Il fallait lui montrer que, si la
marche habituelle de la pense est pratiquement utile, commode pour la
conversation, la coopration, l'action, elle conduit des problmes philosophiques qui sont et qui resteront insolubles, tant poss l'envers. C'est prcisment parce qu'on les voyait insolubles, et parce qu'ils n'apparaissaient pas
comme mal poss, que l'on concluait la relativit de toute connaissance et
l'impossibilit d'atteindre l'absolu. Le succs du positivisme et du kantisme,
attitudes d'esprit peu prs gnrales quand nous commencions philosopher,
venait principalement de l. l'attitude humilie on devait renoncer peu
peu, mesure qu'on apercevrait la vraie cause des antinomies irrductibles.
Celles-ci taient de fabrication humaine. Elles ne venaient pas du fond des
choses, mais d'un transport automatique, la spculation, des habitudes
contractes dans l'action. Ce qu'un laisser-aller de l'intelligence avait fait, un
effort de l'intelligence pouvait le dfaire. Et ce serait pour l'esprit humain une
libration.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
44
Htons-nous d'ailleurs de le dire : une mthode qu'on propose ne se fait
comprendre que si on l'applique un exemple. Ici l'exemple tait tout trouv.
Il s'agissait de ressaisir la vie intrieure, au-dessous de la juxtaposition que
nous effectuons de nos tats dans un temps spatialis. L'exprience tait la
porte de tous : et ceux qui voulurent bien la faire n'eurent pas de peine se
reprsenter la substantialit du moi comme sa dure mme. C'est, disionsnous, la continuit indivisible et indestructible d'une mlodie o le pass entre
dans le prsent et forme avec lui un tout indivis, lequel reste indivis et
mme indivisible en dpit de ce qui s'y ajoute chaque instant ou plutt grce
ce qui s'y ajoute. Nous en avons l'intuition ; mais ds que nous en cherchons
une reprsentation intellectuelle, nous alignons la suite les uns des autres des
tats devenus distincts comme les perles d'un collier et ncessitant alors, pour
les retenir ensemble, un fil qui n'est ni ceci ni cela, rien qui ressemble aux
perles, rien qui ressemble quoi que ce soit, entit vide, simple mot. L'intuition nous donne la chose dont l'intelligence ne saisit que la transposition
spatiale, la traduction mtaphorique.
Voil qui est clair pour notre propre substance. Que penser de celle des
choses ? Quand nous commenmes crire, la physique n'avait pas encore
accompli les progrs dcisifs qui devaient renouveler ses ides sur la structure
de la matire. Mais convaincu, ds alors, qu'immobilit et invariabilit
n'taient que des vues prises sur le mouvant et le changeant, nous ne pouvions
croire que la matire, dont l'image solide avait t obtenue par des immobilisations de changement, perues alors comme des qualits, ft compose
d'lments solides comme elle. On avait beau s'abstenir de toute reprsentation image de l'atome, du corpuscule, de l'lment ultime quel qu'il ft :
c'tait pourtant une chose servant de support des mouvements et des changements, et par consquent en elle-mme ne changeant pas, par elle-mme ne
se mouvant pas. Tt ou tard, pensions-nous, il faudrait renoncer l'ide de
support. Nous en dmes un mot dans notre premier livre : c'est des mouvements de mouvements que nous aboutissions, sans pouvoir d'ailleurs
prciser davantage notre pense 1. Nous cherchmes une approximation un
peu plus grande dans l'ouvrage suivant 2. Nous allmes plus loin encore dans
nos confrences sur la perception du changement 3. La mme raison qui
devait nous faire crire plus tard que l'volution ne saurait se reconstituer
avec des fragments de l'volu nous donnait penser que le solide doit se
rsoudre en tout autre chose que du solide. L'invitable propension de notre
esprit se reprsenter l'lment comme fixe tait lgitime dans d'autres
domaines, puisque c'est une exigence de l'action : justement pour cette raison,
la spculation devait ici se tenir en garde contre elle. Mais nous ne pouvions
quattirer l'attention sur ce point. Tt ou tard, pensions-nous, la physique
serait amene voir dans la fixit de l'lment une forme de la mobilit. Ce
jour-l, il est vrai, la science renoncerait probablement en chercher une
reprsentation image, l'image d'un mouvement tant celle d'un point (c'est-dire toujours d'un minuscule solide) qui se meut. Par le fait, les grandes
dcouvertes thoriques de ces dernires annes ont amen les physiciens
1
2
3
Essai sur les donnes immdiates de la conscience, Paris, 1889, p. 156.
Matire et mmoire, Paris, 1896, surtout les p. 221-228. Cf. tout le chapitre IV, et en
particulier la p. 233.
La perception du changement, Oxford, 1911 (confrences reproduites dans le prsent
volume).
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
45
supposer une espce de fusion entre l'onde et le corpuscule, nous dirions
entre la substance et le mouvement 1. Un penseur profond, venu des mathmatiques la philosophie, verra un morceau de fer comme une continuit
mlodique 2.
Longue serait la liste des paradoxes , plus ou moins apparents notre
paradoxe fondamental, qui ont ainsi franchi peu peu l'intervalle de
l'improbabilit la probabilit, pour s'acheminer peut-tre la banalit.
Encore une fois, nous avions beau tre parti d'une exprience directe, les
rsultats de cette exprience ne pouvaient se faire adopter que si le progrs de
l'exprience extrieure, et de tous les procds de raisonnement qui s'y
rattachent, en imposait l'adoption. Nous-mme en tions l : telle consquence
de nos premires rflexions ne fut clairement aperue et dfinitivement accepte par nous que lorsque nous y fmes parvenu de nouveau par un tout autre
chemin.
Nous citerons comme exemple notre conception de la relation psychophysiologique. Quand nous nous posmes le problme de l'action rciproque
du corps et de l'esprit l'un sur l'autre, ce fut uniquement parce que nous
l'avions rencontr dans notre tude des donnes immdiates de la conscience . La libert nous tait apparue alors comme un fait ; et d'autre part
l'affirmation du dterminisme universel, qui tait pose par les savants comme
une rgle de mthode, tait gnralement accepte par les philosophes comme
un dogme scientifique. La libert humaine tait-elle compatible avec le dterminisme de la nature ? Comme la libert tait devenue pour nous un fait
indubitable, nous l'avions considre peu prs seule dans notre premier
livre : le dterminisme s'arrangerait avec elle comme il le pourrait ; il s'arrangerait srement, aucune thorie ne pouvant rsister longtemps un fait. Mais
le problme cart tout le long de notre premier travail se dressait maintenant
devant nous inluctablement. Fidle notre mthode, nous lui demandmes de
se poser en termes moins gnraux et mme, si c'tait possible, de prendre une
forme concrte, d'pouser les contours de quelques faits sur lesquels l'observation directe et prise. Inutile de raconter ici comment le problme traditionnel
de la relation de l'esprit au corps se resserra devant nous au point de n'tre
plus que celui de la localisation crbrale de la mmoire, et comment cette
dernire question, beaucoup trop vaste elle-mme, en vint peu peu ne plus
concerner que la mmoire des mots, plus spcialement encore les maladies de
cette mmoire particulire, les aphasies. L'tude des diverses aphasies, poursuivie par nous avec l'unique souci de dgager les faits l'tat pur, nous
montra qu'entre la conscience et l'organisme il y avait une relation qu'aucun
raisonnement n'et pu construire a priori, une correspondance qui n'tait ni le
paralllisme ni l'piphnomnisme, ni rien qui y ressemblt. Le rle du
cerveau tait de choisir tout moment, parmi les souvenirs, ceux qui pouvaient clairer l'action commence, d'exclure les autres. Redevenaient conscients, alors, les souvenirs capables de s'insrer dans le cadre moteur sans
cesse changeant, mais toujours prpar ; le reste demeurait dans l'inconscient.
Le rle du corps tait ainsi de jouer la vie de l'esprit, d'en souligner les
1
2
Voir ce sujet BACHELARD, Noumne et microphysique, p. 55-65 du recueil
Recherches philosophiques, Paris, 1931-1932.
Sur ces ides de Whitehead, et sur leur parent avec les ntres, voir J. WAHL, La
philosophie spculative de Whitehead, p. 145-155, dans Vers le concret, Paris, 1932.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
46
articulations motrices, comme fait le chef d'orchestre pour une partition
musicale ; le cerveau n'avait pas pour fonction de penser, mais d'empcher la
pense de se perdre dans le rve ; c'tait l'organe de l'attention la vie. Telle
tait la conclusion laquelle nous tions conduit par la minutieuse tude des
faits normaux et pathologiques, plus gnralement par l'observation extrieure. Mais alors seulement nous nous apermes que l'exprience interne
l'tat pur, en nous donnant une substance dont l'essence mme est de durer
et par consquent de prolonger sans cesse dans le prsent un pass indestructible, nous et dispens et mme nous et interdit de chercher o le
souvenir est conserv. Il se conserve lui-mme, comme nous l'admettons tous
quand nous prononons un mot par exemple. Pour le prononcer, il faut bien
que nous nous souvenions de la premire moiti au moment o nous
articulons la seconde. Personne ne jugera cependant que la premire ait t
tout de suite dpose dans un tiroir, crbral ou autre, pour que la conscience
vint l'y chercher l'instant d'aprs. Mais s'il en est ainsi de la premire moiti du
mot, il en sera de mme du mot prcdent, qui fait corps avec elle pour le son
et pour le sens ; il en sera de mme du commencement de la phrase, et de la
phrase antrieure, et de tout le discours que nous aurions pu faire trs long,
indfiniment long si nous l'avions voulu. Or, notre vie entire, depuis le
premier veil de notre conscience, est quelque chose comme ce discours
indfiniment prolong. Sa dure est substantielle, indivisible en tant que dure
pure. Ainsi nous aurions pu, la rigueur, faire l'conomie de plusieurs annes
de recherche. Mais comme notre intelligence n'tait pas diffrente de celle des
autres hommes, la force de conviction qui accompagnait notre intuition de la
dure quand nous nous en tenions la vie intrieure ne s'tendait pas beaucoup plus loin. Surtout, nous n'aurions pas pu, avec ce que nous avions not
de cette vie intrieure dans notre premier livre, approfondir comme nous
fmes amen le faire les diverses fonctions intellectuelles, mmoire, association des ides, abstraction, gnralisation, interprtation, attention. La psychophysiologie d'une part, la psycho-pathologie de l'autre, dirigrent le regard de
notre conscience sur plus d'un problme dont nous aurions, sans elles, nglig
l'tude, et que l'tude nous fit poser autrement. Les rsultats ainsi obtenus ne
furent pas sans agir sur la psycho-physiologie et la psycho-pathologie ellesmmes. Pour nous en tenir cette dernire science, nous mentionnerons
simplement l'importance croissante qu'y prirent peu peu les considrations
de tension psychologique, d'attention la vie, et tout ce qu'enveloppe le
concept de schizophrnie . Il n'est pas jusqu' notre ide d'une conservation
intgrale du pass qui n'ait trouv de plus en plus sa vrification empirique
dans le vaste ensemble d'expriences institu par les disciples de Freud.
Plus lentes encore se faire accepter sont des vues situes au point de
convergence de trois spculations diffrentes, et non plus seulement de deux.
Celles-l sont d'ordre mtaphysique. Elles concernent l'apprhension de la
matire par l'esprit et devraient mettre fin l'antique conflit du ralisme et de
l'idalisme en dplaant la ligne de dmarcation entre le sujet et l'objet, entre
l'esprit et la matire. Ici encore le problme se rsout en se posant autrement.
L'analyse psychologique toute seule nous avait montr dans la mmoire des
plans de conscience successifs, depuis le plan du rve , le plus tendu de
tous, sur lequel est tal, comme sur la base d'une pyramide, tout le pass de
la personne, jusqu'au point, comparable au sommet, o la mmoire n'est plus
que la perception de l'actuel avec des actions naissantes qui la prolongent.
Cette perception de tous les corps environnants sige-t-elle dans le corps
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
47
organis ? On le croit gnralement. L'action des corps environnants s'exercerait sur le cerveau par l'intermdiaire des organes des sens ; dans le cerveau
s'laboreraient des sensations et des perceptions inextensives : ces perceptions
seraient projetes au dehors par la conscience et viendraient en quelque sorte
recouvrir les objets extrieurs. Mais la comparaison des donnes de la psychologie avec celles de la physiologie nous montrait tout autre chose. L'hypothse
d'une projection excentrique des sensations nous apparaissait comme fausse
quand on la considrait superficiellement, de moins en moins intelligible
mesure qu'on l'approfondissait, assez naturelle cependant quand on tenait
compte de la direction o psychologie et philosophie s'taient engages et de
l'invitable illusion o l'on tombait quand on dcoupait d'une certaine manire
la ralit pour poser en certains termes les problmes. On tait oblig d'imaginer dans le cerveau je ne sais quelle reprsentation rduite, quelle miniature
du monde extrieur, laquelle se rduisait plus encore et devenait mme intendue pour passer de l dans la conscience : celle-ci, munie de l'Espace comme
d'une forme , restituait l'tendue l'intendu et retrouvait, par une reconstruction, le monde extrieur. Toutes ces thories tombaient, avec l'illusion qui
leur avait donn naissance. Ce n'est pas en nous, c'est en eux que nous
percevons les objets : c'est du moins en eux que nous les percevrions si notre
perception tait pure . Telle tait notre conclusion. Au fond, nous revenions
simplement l'ide du sens commun. On tonnerait beaucoup, crivionsnous, un homme tranger aux spculations philosophiques en lui disant que
l'objet qu'il a devant lui, qu'il voit et qu'il touche, n'existe que dans son esprit
et pour son esprit, ou mme, plus gnralement, n'existe que pour un esprit,
comme le voulait Berkeley... Mais, d'autre part, nous tonnerions autant cet
interlocuteur en lui disant que l'objet est tout diffrent de ce qu'on y aperoit...
Donc, pour le sens commun, l'objet existe en lui-mme et, d'autre part, l'objet
est, en lui-mme, pittoresque comme nous l'apercevons : c'est une image, mais
une image qui existe en soi 1. Comment une doctrine qui se plaait ici au point
de vue du sens commun a-t-elle pu paratre aussi trange ? On se l'explique
sans peine quand en suit le dveloppement de la philosophie moderne et
quand on voit comment elle s'orienta ds le dbut vers l'idalisme, cdant
une pousse qui tait celle mme de la science naissante. Le ralisme se posa
de la mme manire ; il se formula par opposition l'idalisme, en utilisant les
mmes termes ; de sorte qu'il se cra chez les philosophes certaines habitudes
d'esprit en vertu desquelles l' objectif et le subjectif taient dpartags
peu prs de mme par tous, quel que ft le rapport tabli entre les deux termes
et quelque cole philosophique qu'on se rattacht. Renoncer ces habitudes
tait d'une difficult extrme ; nous nous en apermes l'effort presque
douloureux, toujours recommencer, que nous dmes faire nous-mme pour
revenir un point de vue qui ressemblait si fort celui du sens commun. Le
premier chapitre de Matire et mmoire, o nous consignmes le rsultat de
nos rflexions sur les images , fut jug obscur par tous ceux qui avaient
quelque habitude de la spculation philosophique, et en raison de cette habitude mme. Je ne sais si l'obscurit s'est dissipe : ce qui est certain, c'est que
les thories de la connaissance qui ont vu le jour dans ces derniers temps,
l'tranger surtout, semble laisser de ct les termes o Kantiens et antiKantiens s'accordaient poser le problme. On revient l'immdiatement
donn, ou l'on y tend.
1
Matire et mmoire, avant-propos de la septime dition, p. II.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
48
Voil pour la Science, et pour le reproche qu'on nous fit de la combattre.
Quant l'Intelligence, point n'tait besoin de tant s'agiter pour elle. Que ne la
consultait-on d'abord ? tant intelligence et par consquent comprenant tout,
elle et compris et dit que nous ne lui voulions que du bien. En ralit, ce
qu'on dfendait contre nous, c'tait d'abord un rationalisme sec, fait surtout de
ngations, et dont nous liminions la partie ngative par le seul fait de proposer certaines solutions ; c'tait ensuite, et peut-tre principalement, un
verbalisme qui vicie encore une bonne partie de la connaissance et que nous
voulions dfinitivement carter.
Qu'est-ce en effet que l'intelligence ? La manire humaine de penser. Elle
nous a t donne, comme l'instinct l'abeille, pour diriger notre conduite. La
nature nous ayant destins utiliser et matriser la matire, l'intelligence
n'volue avec facilit que dans l'espace et ne se sent son aise que dans
l'inorganis. Originellement, elle tend la fabrication : elle se manifeste par
une activit qui prlude l'art mcanique et par un langage qui annonce la
science, tout le reste de la mentalit primitive tant croyance et tradition. Le
dveloppement normal de l'intelligence s'effectue donc dans la direction de la
science et de la technicit. Une mcanique encore grossire suscite une mathmatique encore imprcise : celle-ci, devenue scientifique et faisant alors surgir
les autres sciences autour d'elle, perfectionne indfiniment l'art mcanique.
Science et art nous introduisent ainsi dans l'intimit d'une matire que l'une
pense et que l'autre manipule. De ce ct, l'intelligence finirait, en principe,
par toucher un absolu. Elle serait alors compltement elle-mme. Vague au
dbut, parce qu'elle n'tait qu'un pressentiment de la matire, elle se dessine
d'autant plus nettement elle-mme qu'elle connat la matire plus prcisment.
Mais, prcise ou vague, elle est l'attention que l'esprit prte la matire.
Comment donc l'esprit serait-il encore intelligence quand il se retourne sur luimme ? On peut donner aux choses le nom qu'on veut, et je ne vois pas grand
inconvnient, je le rpte, ce que la connaissance de l'esprit par l'esprit
s'appelle encore intelligence, si l'on y tient. Mais il faudra spcifier alors qu'il
y a deux fonctions intellectuelles, inverses l'une de l'autre, car l'esprit ne pense
l'esprit qu'en remontant la pente des habitudes contractes au contact de la
matire, et ces habitudes sont ce qu'on appelle couramment les tendances
intellectuelles. Ne vaut-il pas mieux alors dsigner par un autre nom une
fonction qui n'est certes pas ce qu'on appelle ordinairement intelligence ?
Nous disons que c'est de l'intuition. Elle reprsente l'attention que l'esprit se
prte lui-mme, par surcrot, tandis qu'il se fixe sur la matire, son objet.
Cette attention supplmentaire peut tre mthodiquement cultive et dveloppe. Ainsi se constituera une science de l'esprit, une mtaphysique vritable, qui dfinira l'esprit positivement au lieu de nier simplement de lui tout ce
que nous savons de la matire. En comprenant ainsi la mtaphysique, en assignant l'intuition la connaissance de l'esprit, nous ne retirons rien l'intelligence, car nous prtendons que la mtaphysique qui tait uvre d'intelligence
pure liminait le temps, que ds lors elle niait l'esprit ou le dfinissait par des
ngations : cette connaissance toute ngative de l'esprit, nous la laisserons
volontiers l'intelligence si l'intelligence tient la garder ; nous prtendons
seulement qu'il y en a une autre. Sur aucun point, donc, nous ne diminuons
l'intelligence : nous ne la chassons d'aucun des terrains qu'elle occupait jusqu'
prsent ; et, l o elle est tout fait chez elle, nous lui attribuons une puissance que la philosophie moderne lui a gnralement conteste. Seulement,
ct d'elle, nous constatons l'existence d'une autre facult, capable d'une autre
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
49
espce de connaissance. Nous avons ainsi, d'une part, la science et l'art
mcanique, qui relvent de l'intelligence pure : de l'autre, la mtaphysique, qui
fait appel l'intuition. Entre ces deux extrmits viendront alors se placer les
sciences de la vie morale, de la vie sociale, et mme de la vie organique,
celles-ci plus intellectuelles, celles-l plus intuitives. Mais, intuitive ou intellectuelle, la connaissance sera marque au sceau de la prcision.
Rien de prcis, au contraire, dans la conversation, qui est la source
ordinaire de la critique . D'o viennent les ides qui s'y changent ? Quelle
est la porte des mots ? Il ne faut pas croire que la vie sociale soit une habitude acquise et transmise. L'homme est organis pour la cit comme la fourmi
pour la fourmilire, avec cette diffrence pourtant que la fourmi possde les
moyens tout faits d'atteindre le but, tandis que nous apportons ce qu'il faut
pour les rinventer et par consquent pour en varier la forme. Chaque mot de
notre langue a donc beau tre conventionnel, le langage n'est pas une convention, et il est aussi naturel l'homme de parler que de marcher. Or, quelle est
la fonction primitive du langage ? C'est d'tablir une communication en vue
d'une coopration. Le langage transmet des ordres ou des avertissements. Il
prescrit ou il dcrit. Dans le premier cas, c'est l'appel l'action immdiate ;
dans le second, c'est le signalement de la chose ou de quelqu'une de ses
proprits, en vue de l'action future. Mais, dans un cas comme dans l'autre, la
fonction est industrielle, commerciale, militaire, toujours sociale. Les choses
que le langage dcrit ont t dcoupes dans le rel par la perception humaine
en vue du travail humain. Les proprits qu'il signale sont les appels de la
chose une activit humaine. Le mot sera donc le mme, comme nous le
disions, quand la dmarche suggre sera la mme, et notre esprit attribuera
des choses diverses la mme proprit, se les reprsentera de la mme
manire, les groupera enfin sous la mme ide, partout o la suggestion du
mme parti tirer, de la mme action faire, suscitera le mme mot. Telles
sont les origines du mot et de l'ide. L'un et l'autre ont sans doute volu. Ils
ne sont plus aussi grossirement utilitaires. Ils restent utilitaires cependant. La
pense sociale ne peut pas ne pas conserver sa structure originelle. Est-elle
intelligence ou intuition ? Je veux bien que l'intuition y fasse filtrer sa
lumire : il n'y a pas de pense sans esprit de finesse, et l'esprit de finesse est
le reflet de l'intuition dans l'intelligence. Je veux bien aussi que cette part si
modique d'intuition se soit largie, qu'elle ait donn naissance la posie, puis
la prose, et converti en instruments d'art les mots qui n'taient d'abord que
des signaux : par les Grecs surtout s'est accompli ce miracle. Il n'en est pas
moins vrai que pense et langage, originellement destins organiser le travail
des hommes dans l'espace, sont d'essence intellectuelle. Mais c'est ncessairement de l'intellectualit vague, adaptation trs gnrale de l'esprit la
matire que la socit doit utiliser. Que la philosophie s'en soit d'abord contente et qu'elle ait commenc par tre dialectique pure, rien de plus naturel. Elle
ne disposait pas d'autre chose. Un Platon, un Aristote adoptent le dcoupage
de la ralit qu'ils trouvent tout fait dans le langage : dialectique , qui se
rattache dialegein, dialegesthai, signifie en mme temps dialogue et
distribution ; une dialectique comme celle de Platon tait la fois une
conversation o l'on cherchait se mettre d'accord sur le sens d'un mot et une
rpartition des choses selon les indications du langage. Mais tt ou tard ce
systme d'ides calques sur les mots devait cder la place une connaissance
exacte reprsente par des signes plus prcis : la science se constituerait alors
en prenant explicitement pour objet la matire, pour moyen l'exprimentation,
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
50
pour idal la mathmatique ; l'intelligence arriverait ainsi au complet approfondissement de la matrialit et par consquent aussi d'elle-mme. Tt ou
tard aussi se dvelopperait une philosophie qui s'affranchirait son tour du
mot, mais cette fois pour aller en sens inverse de la mathmatique et pour
accentuer, de la connaissance primitive et sociale, l'intuitif au lieu de l'intellectuel. Entre l'intuition et l'intelligence ainsi intensifies le langage devait pourtant demeurer. Il reste, en effet, ce qu'il a toujours t. Il a beau s'tre charg
de plus de science et de plus de philosophie ; il n'en continue pas moins
accomplir sa fonction. L'intelligence, qui se confondait d'abord avec lui et qui
participait de son imprcision, s'est prcise en science : elle s'est empare de
la matire. L'intuition, qui lui faisait sentir son influence, voudrait s'largir en
philosophie et devenir coextensive l'esprit. Entre elles cependant, entre ces
deux formes de la pense solitaire subsiste la pense en commun, qui fut
d'abord toute la pense humaine. C'est elle que le langage continue exprimer. Il s'est lest de science, je le veux bien ; mais l'esprit scientifique exige
que tout soit remis en question tout instant, et le langage a besoin de stabilit. Il est ouvert la philosophie : mais l'esprit philosophique sympathise avec
la rnovation et la rinvention sans fin qui sont au fond des choses, et les mots
ont un sens dfini, une valeur conventionnelle relativement fixe ; ils ne peuvent exprimer le nouveau que comme un rarrangement de l'ancien. On
appelle couramment et peut-tre imprudemment raison cette logique conservatrice qui rgit la pense en commun : conversation ressemble beaucoup
conservation. Elle est l chez elle. Et elle y exerce une autorit lgitime.
Thoriquement, en effet, la conversation ne devrait porter que sur les choses
de la vie sociale. Et l'objet essentiel de la socit est d'insrer une certaine
fixit dans la mobilit universelle. Autant de socits, autant d'lots consolids, et l, dans l'ocan du devenir. Cette consolidation est d'autant plus
parfaite que l'activit sociale est plus intelligente. L'intelligence gnrale,
facult d'arranger raisonnablement les concepts et de manier convenablement les mots, doit donc concourir la vie sociale, comme l'intelligence, au
sens plus troit, fonction mathmatique de l'esprit, prside la connaissance
de la matire. C'est la premire surtout que l'on pense quand on dit d'un
homme qu'il est intelligent. On entend par l qu'il a de l'habilet et de la
facilit marier ensemble les concepts usuels pour en tirer des conclusions
probables. On ne peut d'ailleurs que lui en savoir gr, tant qu'il s'en tient aux
choses de la vie courante, pour laquelle les concepts ont t faits. Mais on
n'admettrait pas qu'un homme simplement intelligent se mlt de trancher les
questions scientifiques, alors que l'intelligence prcise en science devient
esprit mathmatique, physique, biologique, et substitue aux mots des signes
mieux appropris. plus forte raison devrait-on l'interdire en philosophie,
alors que les questions poses ne relvent plus de la seule intelligence. Mais
non, il est entendu que l'homme intelligent est ici un homme comptent. C'est
contre quoi nous protestons d'abord. Nous mettons trs haut l'intelligence.
Mais nous avons en mdiocre estime l' homme intelligent , habile parler
vraisemblablement de toutes choses.
Habile parler, prompt critiquer. Quiconque s'est dgag des mots pour
aller aux choses, pour en retrouver les articulations naturelles, pour approfondir exprimentalement un problme, sait bien que l'esprit marche alors de
surprise en surprise. Hors du domaine proprement humain, je veux dire social,
le vraisemblable n'est presque jamais vrai. La nature se soucie peu de faciliter
notre conversation. Entre la ralit concrte et celle que nous aurions
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
51
reconstruite a priori, quelle distance ! cette reconstruction s'en tient pourtant un esprit qui n'est que critique, puisque son rle n'est pas de travailler sur
la chose, mais d'apprcier ce que quelqu'un en a dit. Comment apprciera-t-il,
sinon en comparant la solution qu'on lui apporte, extraite de la chose, celle
qu'il et compose avec les ides courantes, c'est--dire avec les mots dpositaires de la pense sociale ? Et que signifiera son jugement, sinon qu'on n'a
plus besoin de chercher, que cela drange la socit, qu'il faut tirer une barre
au-dessous des connaissances vagues emmagasines dans le langage, faire le
total, et s'en tenir l ? Nous savons tout , tel est le postulat de cette mthode. Personne n'oserait plus l'appliquer la critique des thories physiques ou
astronomiques. Mais couramment on procde ainsi en philosophie. celui qui
a travaill, lutt, pein pour carter les ides toutes faites et prendre contact
avec la chose, on oppose la solution qu'on prtend raisonnable . Le vrai
chercheur devrait protester. Il lui appartiendrait de montrer que la facult de
critiquer, ainsi entendue, est un parti pris d'ignorer, et que la seule critique
acceptable serait une nouvelle tude, plus approfondie mais galement directe,
de la chose mme. Malheureusement, il n'est que trop port lui-mme critiquer en toute occasion, alors qu'il n'a pu creuser effectivement que deux ou
trois problmes. En contestant la pure intelligence le pouvoir d'apprcier
ce qu'il fait, il se priverait lui-mme du droit de juger dans des cas o il n'est
plus ni philosophe ni savant, mais simplement intelligent . Il aime donc
mieux adopter l'illusion commune. cette illusion d'ailleurs tout l'encourage.
Couramment on vient consulter sur un point difficile des hommes
incomptents, parce qu'ils sont arrivs la notorit par leur comptence en de
tout autres matires. On flatte ainsi chez eux, et surtout on fortifie dans l'esprit
du public, l'ide qu'il existe une facult gnrale de connatre les choses sans
les avoir tudies, une intelligence qui n'est ni simplement l'habitude de
manier dans la conversation les concepts utiles la vie sociale, ni la fonction
mathmatique de l'esprit, mais une certaine puissance d'obtenir des concepts
sociaux la connaissance du rel en les combinant plus ou moins adroitement
entre eux. Cette adresse suprieure serait ce qui fait la supriorit de l'esprit.
Comme si la vraie supriorit pouvait tre autre chose qu'une plus grande
force d'attention ! Comme si cette attention n'tait pas ncessairement spcialise, c'est--dire incline par la nature ou l'habitude vers certains objets plutt
que vers d'autres ! Comme si elle n'tait pas vision directe, vision qui perce le
voile des mots, et comme si ce n'tait pas l'ignorance mme des choses qui
donne tant de facilit en parler ! Nous prisons, quant nous, la connaissance
scientifique et la comptence technique autant que la vision intuitive. Nous
croyons qu'il est de l'essence de l'homme de crer matriellement et moralement, de fabriquer des choses et de se fabriquer lui-mme. Homo faber, telle
est la dfinition que nous proposons. L'Homo sapiens, n de la rflexion de
l'Homo faber sur sa fabrication, nous parat tout aussi digne d'estime tant qu'il
rsout par la pure intelligence les problmes qui ne dpendent que d'elle : dans
le choix de ces problmes un philosophe peut se tromper, un autre philosophe
le dtrompera ; tous deux auront travaill de leur mieux ; tous deux pourront
mriter notre reconnaissance et notre admiration. Homo faber, Homo sapiens,
devant l'un et l'autre, qui tendent d'ailleurs se confondre ensemble, nous
nous inclinons. Le seul qui nous soit antipathique est lHomo loquax, dont la
pense, quand il pense, n'est qu'une rflexion sur sa parole.
le former et le perfectionner tendaient jadis les mthodes d'enseignement. N'y tendent-elles pas un peu encore ? Certes, le dfaut est moins accus
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
52
chez nous que chez d'autres. Nulle part plus qu'en France le matre ne provoque l'initiative de l'tudiant, voire de l'colier. Pourtant il nous reste encore
beaucoup faire. Je n'ai pas parler ici du travail manuel, du rle qu'il
pourrait jouer l'cole. On est trop port n'y voir qu'un dlassement. On
oublie que l'intelligence est essentiellement la facult de manipuler la matire,
qu'elle commena du moins ainsi, que telle tait l'intention de la nature.
Comment alors l'intelligence ne profiterait-elle pas de l'ducation de la main ?
Allons plus loin. La main de l'enfant s'essaie naturellement construire. En l'y
aidant, en lui fournissant au moins des occasions, on obtiendrait plus tard de
l'homme fait un rendement suprieur ; on accrotrait singulirement ce qu'il y
a d'inventivit dans le monde. Un savoir tout de suite livresque comprime et
supprime des activits qui ne demandaient qu' prendre leur essor. Exerons
donc l'enfant au travail manuel, et n'abandonnons pas cet enseignement un
manuvre. Adressons-nous un vrai matre, pour qu'il perfectionne le toucher
au point d'en faire un tact : l'intelligence remontera de la main la tte. Mais
je n'insiste pas sur ce point. En toute matire, lettres ou sciences, notre enseignement est rest trop verbal. Le temps n'est plus cependant o il suffisait
d'tre homme du monde et de savoir discourir sur les choses. S'agit-il de
science ? On expose surtout des rsultats. Ne vaudrait-il pas mieux initier aux
mthodes ? On les ferait tout de suite pratiquer ; on inviterait observer,
exprimenter, rinventer. Comme on serait cout ! Comme on serait
entendu ! Car l'enfant est chercheur et inventeur, toujours l'afft de la
nouveaut, impatient de la rgle, enfin plus prs de la nature que l'homme fait.
Mais celui-ci est essentiellement un tre sociable, et c'est lui qui enseigne :
ncessairement il fait passer en premire ligne tout l'ensemble de rsultats
acquis dont se compose le patrimoine social, et dont il est lgitimement fier.
Pourtant, si encyclopdique que soit le programme, ce que l'lve pourra
s'assimiler de science toute faite se rduira peu de chose, et sera souvent
tudi sans got, et toujours vite oubli. Nul doute que chacun des rsultats
acquis par l'humanit ne soit prcieux ; mais c'est l du savoir adulte, et
l'adulte le trouvera quand il en aura besoin, s'il a simplement appris o le
chercher. Cultivons plutt chez l'enfant un savoir enfantin, et gardons-nous
d'touffer sous une accumulation de branches et de feuilles sches, produit des
vgtations anciennes, la plante neuve qui ne demande qu' pousser.
Ne trouverait-on pas des dfauts du mme genre notre enseignement
littraire (si suprieur pourtant celui qui se donne dans d'autres pays) ? Il
pourra tre utile de disserter sur l'uvre d'un grand crivain ; on la fera ainsi
mieux comprendre et mieux goter. Encore faut-il que l'lve ait commenc
la goter, et par consquent la comprendre. C'est dire que l'enfant devra
d'abord la rinventer, ou, en d'autres termes, s'approprier jusqu' un certain
point l'inspiration de l'auteur. Comment le fera-t-il, sinon en lui embotant le
pas, en adoptant ses gestes, son attitude, sa dmarche ? Bien lire haute voix
est cela mme. L'intelligence viendra plus tard y mettre des nuances. Mais
nuance et couleur ne sont rien sans le dessin. Avant l'intellection proprement
dite, il y a la perception de la structure et du mouvement : il y a, dans la page
qu'on lit, la ponctuation et le rythme 1. Les marquer comme il faut, tenir
1
Sur le fait que le rythme dessine en gros le sens de la phrase vritablement crite, qu'il
peut nous donner la communication directe avec la pense de l'crivain avant que l'tude
des mots soit venue y mettre la couleur et la nuance, nous nous sommes expliqu
autrefois, notamment dans une confrence faite en 1912 sur L'me et le corps (Cf. notre
recueil L'nergie spirituelle, p. 32). Nous nous bornions d'ailleurs rsumer une leon
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
53
compte des relations temporelles entre les diverses phrases du paragraphe et
les divers membres de phrase, suivre sans interruption le crescendo du
sentiment et de la pense jusqu'au point qui est musicalement not comme
culminant, en cela d'abord consiste l'art de la diction. On a tort de le traiter en
art d'agrment. Au lieu d'arriver la fin des tudes, comme un ornement, il
devrait tre au dbut et partout, comme un soutien. Sur lui nous poserions tout
le reste, si nous ne cdions ici encore l'illusion que le principal est de
discourir sur les choses et qu'on les connat suffisamment quand on sait en
parler. Mais on ne connat, on ne comprend que ce qu'on peut en quelque
mesure rinventer. Soit dit en passant, il y a une certaine analogie entre l'art de
la lecture, tel que nous venons de le dfinir, et l'intuition que nous recommandons au philosophe. Dans la page qu'elle a choisie du grand livre du
monde, l'intuition voudrait retrouver le mouvement et le rythme de la
composition, revivre l'volution cratrice en s'y insrant sympathiquement.
Mais nous avons ouvert une trop longue parenthse. Il est temps de la fermer.
Nous n'avons pas laborer un programme d'ducation. Nous voulions seulement signaler certaines habitudes d'esprit que nous tenons pour fcheuses et
que l'cole encourage encore trop souvent en fait, quoiqu'elle les rpudie en
principe. Nous voulions surtout protester une fois de plus contre la substitution des concepts aux choses, et contre ce que nous appellerions la socialisation de la vrit. Elle s'imposait dans les socits primitives. Elle est naturelle
l'esprit humain, parce que l'esprit humain n'est pas destin la science pure,
encore moins la philosophie. Mais il faut rserver cette socialisation aux
vrits d'ordre pratique, pour lesquelles elle est faite. Elle n'a rien voir dans
le domaine de la connaissance pure, science ou philosophie.
Nous rpudions ainsi la facilit. Nous recommandons une certaine manire
difficultueuse de penser. Nous prisons par-dessus tout l'effort. Comment
quelques-uns ont-ils pu s'y tromper ? Nous ne dirons rien de celui qui voudrait
que notre intuition ft instinct ou sentiment. Pas une ligne de ce que nous
avons crit ne se prte une telle interprtation. Et dans tout ce que nous
avons crit il y a l'affirmation du contraire : notre intuition est rflexion. Mais
parce que nous appelions l'attention sur la mobilit qui est au fond des choses,
on a prtendu que nous encouragions je ne sais quel relchement de l'esprit. Et
parce que la permanence de la substance tait nos yeux une continuit de
changement, on a dit que notre doctrine tait une justification de l'instabilit.
Autant vaudrait s'imaginer que le bactriologiste nous recommande les maladies microbiennes quand il nous montre partout des microbes, ou que le physicien nous prescrit l'exercice de la balanoire quand il ramne les phnomnes
de la nature des oscillations. Autre chose est un principe d'explication, autre
chose une maxime de conduite. On pourrait presque dire que le philosophe qui
trouve la mobilit partout est seul ne pas pouvoir la recommander, puisqu'il
la voit invitable, puisqu'il la dcouvre dans ce qu'on est convenu d'appeler
immobilit. Mais la vrit est qu'il a beau se reprsenter la stabilit comme
une complexit de changement, ou comme un aspect particulier du changement, il a beau, n'importe comment, rsoudre en changement la stabilit : il
n'en distinguera pas moins, comme tout le monde, stabilit et changement. Et
antrieurement faite au Collge de France. Dans cette leon nous avions pris pour
exemple une page ou deux du Discours de la mthode, et nous avions essay de montrer
comment des alles et venues de la pense, chacune de direction dtermine, passent de
l'esprit de Descartes au ntre par le seul effet du rythme tel que la ponctuation l'indique,
tel surtout que le marque une lecture correcte haute voix.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
54
pour lui, comme pour tout le monde, se posera la question de savoir dans
quelle mesure c'est l'apparence spciale dite stabilit, dans quelle mesure c'est
le changement pur et simple, qu'il faut conseiller aux socits humaines. Son
analyse du changement laisse cette question intacte. Pour peu qu'il ait du bon
sens, il jugera ncessaire, comme tout le monde, une certaine permanence de
ce qui est. Il dira que les institutions doivent fournir un cadre relativement
invariable la diversit et la mobilit des desseins individuels. Et il comprendra peut-tre mieux que d'autres le rle de ces institutions. Ne continuentelles pas dans le domaine de l'action, en posant des impratifs, l'uvre de
stabilisation que les sens et l'entendement accomplissent dans le domaine de la
connaissance quand ils condensent en perception les oscillations de la matire,
et en concepts l'coulement des choses ? Sans doute, dans le cadre rigide des
institutions, soutenue par cette rigidit mme, la socit volue. Mme, le
devoir de l'homme d'tat est de suivre ces variations et de modifier l'institution quand il en est encore temps : sur dix erreurs politiques, il y en a neuf
qui consistent simplement croire encore vrai ce qui a cess de l'tre. Mais la
dixime, qui pourra tre la plus grave, sera de ne plus croire vrai ce qui l'est
pourtant encore. D'une manire gnrale, l'action exige un point d'appui
solide, et l'tre vivant tend essentiellement l'action efficace. C'est pourquoi
nous avons vu dans une certaine stabilisation des choses la fonction primordiale de la conscience. Installe sur l'universelle mobilit, disions-nous, la
conscience contracte dans une vision quasi instantane une histoire immensment longue qui se droule en dehors d'elle. Plus haute est la conscience, plus
forte est cette tension de sa dure par rapport celle des choses.
Tension, concentration, tels sont les mots par lesquels nous caractrisions
une mthode qui requiert de l'esprit, pour chaque nouveau problme, un effort
entirement nouveau. Nous n'aurions jamais pu tirer de notre livre Matire et
mmoire, qui prcda L'volution cratrice, une vritable doctrine d'volution
(ce n'en et t que l'apparence) ; ni de notre Essai sur les donnes immdiates
de la conscience une thorie des rapports de l'me et du corps comme celle
que nous exposmes ensuite dans Matire et mmoire (nous n'aurions eu
qu'une construction hypothtique), ni de la pseudo-philosophie laquelle nous
tions attach avant les Donnes immdiates c'est--dire des notions gnrales emmagasines dans le langage les conclusions sur la dure et la vie
intrieure que nous prsentmes dans ce premier travail. Notre initiation la
vraie mthode philosophique date du jour o nous rejetmes les solutions
verbales, ayant trouv dans la vie intrieure un premier champ d'exprience.
Tout progrs fut ensuite un agrandissement de ce champ. tendre logiquement
une conclusion, l'appliquer d'autres objets sans avoir rellement largi le
cercle de ses investigations, est une inclination naturelle l'esprit humain,
mais laquelle il ne faut jamais cder. La philosophie s'y abandonne navement quand elle est dialectique pure, c'est--dire tentative pour construire une
mtaphysique avec les connaissances rudimentaires qu'on trouve emmagasines dans le langage. Elle continue le faire quand elle rige certaines
conclusions tires de certains faits en principes gnraux applicables au
reste des choses. Contre cette manire de philosopher toute notre activit
philosophique fut une protestation. Nous avions ainsi d laisser de ct des
questions importantes, auxquelles nous aurions facilement donn un simulacre
de rponse en prolongeant jusqu' elles les rsultats de nos prcdents travaux.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
55
Nous ne rpondrons telle ou telle d'entre elles que s'il nous est concd le
temps et la force de la rsoudre en elle-mme, pour elle-mme. Sinon,
reconnaissant notre mthode de nous avoir donn ce que nous croyons tre
la solution prcise de quelques problmes, constatant que nous ne pouvons,
quant nous, en tirer davantage, nous en resterons l. On n'est jamais tenu de
faire un livre 1.
Janvier 1922.
Cet essai a t termin en 1922. Nous y avons simplement ajout quelques pages relatives
aux thories physiques actuelles. cette date, nous n'tions pas encore en possession
complte des rsultats que nous avons exposs dans notre rcent ouvrage : Les deux
sources de la morale et de la religion, Paris, 1932. Ceci expliquera les dernires lignes du
prsent essai.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
56
La pense et le mouvant Essais et confrences.
III
Le possible et le rel
Essai publi dans la revue sudoise
Nordisk Tidskrift en novembre 1930 1.
Retour la table des matires
Je voudrais revenir sur un sujet dont j'ai dj parl, la cration continue
d'imprvisible nouveaut qui semble se poursuivre dans l'univers. Pour ma
part, je crois l'exprimenter chaque instant. J'ai beau me reprsenter le dtail
de ce qui va m'arriver : combien ma reprsentation est pauvre, abstraite, schmatique, en comparaison de l'vnement qui se produit ! La ralisation
apporte avec elle un imprvisible rien qui change tout. Je dois, par exemple,
assister une runion ; je sais quelles personnes j'y trouverai, autour de quelle
table, dans quel ordre, pour la discussion de quel problme. Mais qu'elles
1
Cet article tait le dveloppement de quelques vues prsentes l'ouverture du meeting
philosophique d'Oxford, le 24 septembre 1920. En l'crivant pour la revue sudoise
Nordisk Tidskrift, nous voulions tmoigner du regret que nous prouvions de ne pouvoir
aller faire une confrence Stockholm, selon l'usage, l'occasion du prix Nobel. L'article
n'a paru, jusqu' prsent, qu'en langue sudoise.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
57
viennent, s'assoient et causent comme je m'y attendais, qu'elles disent ce que
je pensais bien qu'elles diraient : l'ensemble me donne une impression unique
et neuve, comme s'il tait maintenant dessin d'un seul trait original par une
main d'artiste. Adieu l'image que je m'en tais faite, simple juxtaposition, figurable par avance, de choses dj connues ! je veux bien que le tableau n'ait pas
la valeur artistique d'un Rembrandt ou d'un Velasquez : il est tout aussi
inattendu et, en ce sens, aussi original. On allguera que j'ignorais le dtail des
circonstances, que je ne disposais pas des personnages, de leurs gestes, de
leurs attitudes, et que, si l'ensemble m'apporte du nouveau, c'est qu'il me
fournit un surcrot d'lments. Mais j'ai la mme impression de nouveaut
devant le droulement de ma vie intrieure. Je l'prouve, plus vive que jamais,
devant l'action voulue par moi et dont j'tais seul matre. Si je dlibre avant
d'agir, les moments de la dlibration s'offrent ma conscience comme les
esquisses successives, chacune seule de son espce, quun peintre ferait de son
tableau : et l'acte lui-mme, en s'accomplissant, a beau raliser du voulu et par
consquent du prvu, il n'en a pas moins sa forme originale. Soit, dira-t-on ;
il y a peut-tre quelque chose d'original et d'unique dans un tat d'me ; mais
la matire est rptition ; le monde extrieur obit des lois mathmatiques
une intelligence surhumaine, qui connatrait la position, la direction et la
vitesse de tous les atomes et lectrons de l'univers matriel un moment
donn, calculerait n'importe quel tat futur de cet univers, comme nous le
faisons pour une clipse de soleil ou de lune. Je l'accorde, la rigueur, s'il ne
s'agit que du monde inerte, et bien que la question commence tre controverse, au moins pour les phnomnes lmentaires. Mais ce monde n'est
qu'une abstraction. La ralit concrte comprend les tres vivants, conscients,
qui sont encadrs dans la matire inorganique. Je dis vivants et conscients, car
j'estime que le vivant est conscient en droit ; il devient inconscient en fait l
o la conscience s'endort, mais, jusque dans les rgions o la conscience
somnole, chez le vgtal par exemple, il y a volution rgle, progrs dfini,
vieillissement, enfin tous les signes extrieurs de la dure qui caractrise la
conscience. Pourquoi d'ailleurs parler d'une matire inerte o la vie et la
conscience s'insreraient comme dans un cadre ? De quel droit met-on l'inerte
d'abord ? Les anciens avaient imagin une me du Monde qui assurerait la
continuit d'existence de l'univers matriel. Dpouillant cette conception de ce
qu'elle a de mythique, je dirais que le monde inorganique est une srie de
rptitions ou de quasi-rptitions infiniment rapides qui se somment en changements visibles et prvisibles. Je les comparerais aux oscillations du balancier de l'horloge : celles-ci sont accoles la dtente continue d'un ressort qui
les relie entre elles et dont elles scandent le progrs ; celles-l rythment la vie
des tres conscients et mesurent leur dure. Ainsi, l'tre vivant dure essentiellement ; il dure, justement parce qu'il labore sans cesse du nouveau et parce
qu'il n'y a pas d'laboration sans recherche, pas de recherche sans ttonnement. Le temps est cette hsitation mme, ou il n'est rien du tout. Supprimez
le conscient et le vivant (et vous ne le pouvez que par un effort artificiel
d'abstraction, car le monde matriel, encore une fois, implique peut-tre la
prsence ncessaire de la conscience et de la vie), vous obtenez en effet un
univers dont les tats successifs sont thoriquement calculables d'avance,
comme les images, antrieures au droulement, qui sont juxtaposes sur le
film cinmatographique. Mais alors, quoi bon le droulement ? Pourquoi la
ralit se dploie-t-elle ? Comment n'est-elle pas dploye ? quoi sert le
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
58
temps ? (Je parle du temps rel, concret, et non pas de ce temps abstrait qui
n'est qu'une quatrime dimension de l'espace 1. Tel fut jadis le point de dpart
de mes rflexions. Il y a quelque cinquante ans, j'tais fort attach la philosophie de Spencer. Je m'aperus, un beau jour, que le temps n'y servait rien,
qu'il ne faisait rien. Or ce qui ne fait rien n'est rien. Pourtant, me disais-je, le
temps est quelque chose. Donc il agit. Que peut-il bien faire ? Le simple bon
sens rpondait : le temps est ce qui empche que tout soit donn tout d'un
coup. Il retarde, ou plutt il est retardement. Il doit donc tre laboration. Ne
serait-il pas alors vhicule de cration et de choix ? L'existence du temps ne
prouverait-elle pas qu'il y a de l'indtermination dans les choses ? Le temps ne
serait-il pas cette indtermination mme ?
Si telle n'est pas l'opinion de la plupart des philosophes, c'est que l'intelligence humaine est justement faite pour prendre les choses par l'autre bout. Je
dis l'intelligence, je ne dis pas la pense, je ne dis pas l'esprit. ct de
l'intelligence il y a en effet la perception immdiate, par chacun de nous, de sa
propre activit et des conditions o elle s'exerce. Appelez-la comme vous
voudrez ; c'est le sentiment que nous avons d'tre crateurs de nos intentions,
de nos dcisions, de nos actes, et par l de nos habitudes, de notre caractre,
de nous-mmes. Artisans de notre vie, artistes mme quand nous le voulons,
nous travaillons continuellement ptrir, avec la matire qui nous est fournie
par le pass et le prsent, par l'hrdit et les circonstances, une figure unique,
neuve, originale, imprvisible comme la forme donne par le sculpteur la
terre glaise. De ce travail et de ce qu'il a d'unique nous sommes avertis, sans
doute, pendant qu'il se fait, mais l'essentiel est que nous le fassions. Nous
n'avons pas l'approfondir ; il n'est mme pas ncessaire que nous en ayons
pleine conscience, pas plus que l'artiste n'a besoin d'analyser son pouvoir
crateur ; il laisse ce soin au philosophe, et se contente de crer. En revanche,
il faut que le sculpteur connaisse la technique de son art et sache tout ce qui
s'en peut apprendre : cette technique concerne surtout ce que son uvre aura
de commun avec d'autres ; elle est commande par les exigences de la matire
sur laquelle il opre et qui s'impose lui comme tous les artistes ; elle
intresse, dans l'art, ce qui est rptition ou fabrication, et non plus la cration
mme. Sur elle se concentre l'attention de l'artiste, ce que j'appellerais son
intellectualit. De mme, dans la cration de notre caractre, nous savons fort
peu de chose de notre pouvoir crateur : pour l'apprendre, nous aurions
revenir sur nous-mmes, philosopher, et remonter la pente de la nature, car
la nature a voulu l'action, elle n'a gure pens la spculation. Ds qu'il n'est
plus simplement question de sentir en soi un lan et de s'assurer qu'on peut
agir, mais de retourner la pense sur elle-mme pour qu'elle saisisse ce pouvoir et capte cet lan, la difficult devient grande, comme s'il fallait invertir la
direction normale de la connaissance. Au contraire, nous avons un intrt
capital nous familiariser avec la technique de notre action, c'est--dire
extraire, des conditions o elle s'exerce, tout ce qui peut nous fournir des
recettes et des rgles gnrales sur lesquelles s'appuiera notre conduite. Il n'y
aura de nouveaut dans nos actes que grce ce que nous aurons trouv de
rptition dans les choses. Notre facult normale de connatre est donc essen1
Nous avons montr en effet, dans notre Essai sur les donnes immdiates de la conscience, Paris, 1889, p. 82, que le Temps mesurable pouvait tre considr comme une
quatrime dimension de l'Espace . Il s'agissait, bien entendu, de l'Espace pur, et non pas
de l'amalgame Espace-Temps de la thorie de la Relativit qui est tout autre chose.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
59
tiellement une puissance d'extraire ce qu'il y a de stabilit et de rgularit dans
le flux du rel. S'agit-il de percevoir ? La perception se saisit des branlements
infiniment rpts qui sont lumire ou chaleur, par exemple, et les contracte
en sensations relativement invariables : ce sont des trillions d'oscillations
extrieures que condense nos yeux, en une fraction de seconde, la vision
d'une couleur. S'agit-il de concevoir ? Former une ide gnrale est abstraire
des choses diverses et changeantes un aspect commun qui ne change pas ou
du moins qui offre notre action une prise invariable. La constance de notre
attitude, l'identit de notre raction ventuelle ou virtuelle la multiplicit et
la variabilit des objets reprsents, voil d'abord ce que marque et dessine la
gnralit de l'ide. S'agit-il enfin de comprendre ? C'est simplement trouver
des rapports, tablir des relations stables entre des faits qui passent, dgager
des lois : opration d'autant plus parfaite que la relation est plus prcise et la
loi plus mathmatique. Toutes ces fonctions sont constitutives de l'intelligence. Et l'intelligence est dans le vrai tant qu'elle s'attache, elle amie de la
rgularit et de la stabilit, ce qu'il y a de stable et de rgulier dans le rel,
la matrialit. Elle touche alors un des cts de l'absolu, comme notre
conscience en touche un autre quand elle saisit en nous une perptuelle efflorescence de nouveaut ou lorsque, s'largissant, elle sympathise avec l'effort
indfiniment rnovateur de la nature. L'erreur commence quand l'intelligence
prtend penser un des aspects comme elle a pens l'autre, et s'employer un
usage pour lequel elle n'a pas t faite.
J'estime que les grands problmes mtaphysiques sont gnralement mal
poss, qu'ils se rsolvent souvent d'eux-mmes quand on en rectifie l'nonc,
ou bien alors que ce sont des problmes formuls en termes d'illusion, et qui
s'vanouissent ds qu'on regarde de prs les termes de la formule. Ils naissent,
en effet, de ce que nous transposons en fabrication ce qui est cration. La
ralit est croissance globale et indivise, invention graduelle, dure : tel, un
ballon lastique qui se dilaterait peu peu en prenant tout instant des formes
inattendues. Mais notre intelligence s'en reprsente l'origine et l'volution
comme un arrangement et un rarrangement de parties qui ne feraient que
changer de place ; elle pourrait donc, thoriquement, prvoir n'importe quel
tat d'ensemble : en posant un nombre dfini d'lments stables, on s'en donne
implicitement, par avance, toutes les combinaisons possibles. Ce n'est pas
tout. La ralit, telle que nous la percevons directement, est du plein qui ne
cesse de se gonfler, et qui ignore le vide. Elle a de l'extension, comme elle a
de la dure ; mais cette tendue concrte n'est pas l'espace infini et infiniment
divisible que l'intelligence se donne comme un terrain o construire. L'espace
concret a t extrait des choses. Elles ne sont pas en lui, c'est lui qui est en
elles. Seulement, ds que notre pense raisonne sur la ralit, elle fait de
l'espace un rceptacle. Comme elle a coutume d'assembler des parties dans un
vide relatif, elle s'imagine que la ralit comble je ne sais quel vide absolu. Or,
si la mconnaissance de la nouveaut radicale est l'origine des problmes
mtaphysiques mal poss, l'habitude d'aller du vide au plein est la source des
problmes inexistants. Il est d'ailleurs facile de voir que la seconde erreur est
dj implique dans la premire. Mais je voudrais d'abord la dfinir avec plus
de prcision.
Je dis qu'il y a des pseudo-problmes, et que ce sont les problmes angoissants de la mtaphysique. Je les ramne deux. L'un a engendr les thories
de l'tre, l'autre les thories de la connaissance.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
60
Le premier consiste se demander pourquoi il y a de l'tre, pourquoi
quelque chose ou quelqu'un existe. Peu importe la nature de ce qui est : dites
que c'est matire, ou esprit, ou l'un et l'autre, ou que matire et esprit ne se
suffisent pas et manifestent une Cause transcendante : de toute manire, quand
on a considr des existences, et des causes, et des causes de ces causes, on se
sent entran dans une course l'infini. Si l'on s'arrte, c'est pour chapper au
vertige. Toujours on constate, on croit constater que la difficult subsiste, que
le problme se pose encore et ne sera jamais rsolu. Il ne le sera jamais, en
effet, mais il ne devrait pas tre pos. Il ne se pose que si l'on se figure un
nant qui prcderait l'tre. On se dit : il pourrait ne rien y avoir , et l'on
s'tonne alors qu'il y ait quelque chose ou Quelqu'un. Mais analysez cette
phrase : il pourrait ne rien y avoir . Vous verrez que vous avez affaire des
mots, nullement des ides, et que rien n'a ici aucune signification.
Rien est un terme du langage usuel qui ne peut avoir de sens que si l'on
reste sur le terrain, propre l'homme, de l'action et de la fabrication. Rien
dsigne l'absence de ce que nous cherchons, de ce que nous dsirons, de ce
que nous attendons. supposer, en effet, que l'exprience nous prsentt
jamais un vide absolu, il serait limit, il aurait des contours, il serait donc
encore quelque chose. Mais en ralit il n'y a pas de vide. Nous ne percevons
et mme ne concevons que du plein. Une chose ne disparat que parce qu'une
autre l'a remplace. Suppression signifie ainsi substitution. Seulement, nous
disons suppression quand nous n'envisageons de la substitution qu'une de
ses deux moitis, ou plutt de ses deux faces, celle qui nous intresse ; nous
marquons ainsi qu'il nous plat de diriger notre attention sur l'objet qui est
parti, et de la dtourner de celui qui le remplace. Nous disons alors qu'il n'y a
plus rien, entendant par l que ce qui est ne nous intresse pas, que nous nous
intressons ce qui n'est plus l ou ce qui aurait pu y tre. L'ide d'absence,
ou de nant, ou de rien, est donc insparablement lie celle de suppression,
relle ou ventuelle, et celle de suppression n'est elle-mme qu'un aspect de
l'ide de substitution. Il y a l des manires de penser dont nous usons dans la
vie pratique ; il importe particulirement notre industrie que notre pense
sache retarder sur la ralit et rester attache, quand il le faut, ce qui tait ou
ce qui pourrait tre, au lieu d'tre accapare par ce qui est. Mais quand nous
nous transportons du domaine de la fabrication celui de la cration, quand
nous nous demandons pourquoi il y a de l'tre, pourquoi quelque chose ou
quelqu'un, pourquoi le monde ou Dieu existe et pourquoi pas le nant, quand
nous nous posons enfin le plus angoissant des problmes mtaphysiques, nous
acceptons virtuellement une absurdit ; car si toute suppression est une
substitution, si l'ide d'une suppression n'est que l'ide tronque d'une substitution, alors parler d'une suppression de tout est poser une substitution qui n'en
serait pas une c'est se contredire soi-mme. Ou l'ide d'une suppression de tout
a juste autant d'existence que celle d'un carr rond l'existence d'un son, flatus
vocis, ou bien, si elle reprsente quelque chose, elle traduit un mouvement
de l'intelligence qui va d'un objet un autre, prfre celui qu'elle vient de
quitter celui qu'elle trouve devant elle, et dsigne par absence du premier
la prsence du second. On a pos le tout, puis on a fait disparatre, une une,
chacune de ses parties, sans consentir voir ce qui la remplaait : c'est donc la
totalit des prsences, simplement disposes dans un nouvel ordre, qu'on a
devant soi quand on veut totaliser les absences. En d'autres termes, cette
prtendue reprsentation du vide absolu est, en ralit, celle du plein universel
dans un esprit qui saute indfiniment de partie partie, avec la rsolution prise
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
61
de ne jamais considrer que le vide de sa dissatisfaction au lieu du plein des
choses. Ce qui revient dire que l'ide de Rien, quand elle n'est pas celle d'un
simple mot, implique autant de matire que celle de Tout, avec, en plus, une
opration de la pense.
J'en dirais autant de l'ide de dsordre. Pourquoi l'univers est-il ordonn ?
Comment la rgle s'impose-t-elle l'irrgulier, la forme la matire ? D'o
vient que notre pense se retrouve dans les choses ? Ce problme, qui est
devenu chez les modernes le problme de la connaissance aprs avoir t,
chez les anciens, le problme de l'tre, est n d'une illusion du mme genre. Il
s'vanouit si l'on considre que l'ide de dsordre a un sens dfini dans le
domaine de l'industrie humaine ou, comme nous disons, de la fabrication,
mais non pas dans celui de la cration. Le dsordre est simplement l'ordre que
nous ne cherchons pas. Vous ne pouvez pas supprimer un ordre, mme par la
pense, sans en faire surgir un autre. S'il n'y a pas finalit ou volont, c'est
qu'il y a mcanisme ; si le mcanisme flchit, c'est au profit de la volont, du
caprice, de la finalit. Mais lorsque vous vous attendez l'un de ces deux
ordres et que vous trouvez l'autre, vous dites qu'il y a dsordre, formulant ce
qui est en termes de ce qui pourrait ou devrait tre, et objectivant votre regret.
Tout dsordre comprend ainsi deux choses : en dehors de nous, un ordre ; en
nous, la reprsentation d'un ordre diffrent qui est seul nous intresser.
Suppression signifie donc encore substitution. Et l'ide d'une suppression de
tout ordre, c'est--dire d'un dsordre absolu, enveloppe alors une contradiction
vritable, puisqu'elle consiste ne plus laisser qu'une seule face l'opration
qui, par hypothse, en comprenait deux. Ou l'ide de dsordre absolu ne
reprsente qu'une combinaison de sons, flatus vocis, ou, si elle rpond
quelque chose, elle traduit un mouvement de l'esprit qui saute du mcanisme
la finalit, de la finalit au mcanisme, et qui, pour marquer l'endroit o il est,
aime mieux indiquer chaque fois le point o il n'est pas. Donc, vouloir
supprimer l'ordre, vous vous en donnez deux ou plusieurs. Ce qui revient
dire que la conception d'un ordre venant se surajouter une absence
d'ordre implique une absurdit, et que le problme s'vanouit.
Les deux illusions que je viens de signaler n'en font rellement qu'une.
Elles consistent croire qu'il y a moins dans l'ide du vide que dans celle du
plein, moins dans le concept de dsordre que dans celui d'ordre. En ralit, il y
a plus de contenu intellectuel dans les ides de dsordre et de nant, quand
elles reprsentent quelque chose, que dans celles d'ordre et d'existence, parce
qu'elles impliquent plusieurs ordres, plusieurs existences et, en outre, un jeu
de l'esprit qui jongle inconsciemment avec eux.
Eh bien, je retrouve la mme illusion dans le cas qui nous occupe. Au fond
des doctrines qui mconnaissent la nouveaut radicale de chaque moment de
l'volution il y a bien des malentendus, bien des erreurs. Mais il y a surtout
l'ide que le possible est moins que le rel, et que, pour cette raison, la possibilit des choses prcde leur existence. Elles seraient ainsi reprsentables par
avance : elles pourraient tre penses avant d'tre ralises. Mais c'est l'inverse
qui est la vrit. Si nous laissons de ct les systmes clos, soumis des lois
purement mathmatiques, isolables parce que la dure ne mord pas sur eux, si
nous considrons l'ensemble de la ralit concrte ou tout simplement le
monde de la vie, et plus forte raison celui de la conscience, nous trouvons
qu'il y a plus, et non pas moins, dans la possibilit de chacun des tats
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
62
successifs que dans leur ralit. Car le possible n'est que le rel avec, en plus,
un acte de l'esprit qui en rejette l'image dans le pass une fois qu'il s'est
produit. Mais c'est ce que nos habitudes intellectuelles nous empchent
d'apercevoir.
Au cours de la grande guerre, des journaux et des revues se dtournaient
parfois des terribles inquitudes du prsent pour penser ce qui se passerait
plus tard, une fois la paix rtablie. L'avenir de la littrature, en particulier, les
proccupait. On vint un jour me demander comment je me le reprsentais. Je
dclarai, un peu confus, que je ne me le reprsentais pas. N'apercevez-vous
pas tout au moins, me dit-on, certaines directions possibles ? Admettons qu'on
ne puisse prvoir le dtail ; vous avez du moins, vous philosophe, une ide de
l'ensemble. Comment concevez-vous, par exemple, la grande uvre dramatique de demain ? Je me rappellerai toujours la surprise de mon interlocuteur
quand je lui rpondis : Si je savais ce que sera la grande uvre dramatique
de demain, je la ferais. Je vis bien qu'il concevait l'uvre future comme
enferme, ds alors, dans je ne sais quelle armoire aux possibles ; je devais, en
considration de mes relations dj anciennes avec la philosophie, avoir
obtenu d'elle la clef de l'armoire. Mais, lui dis-je, l'uvre dont vous parlez
n'est pas encore possible. Il faut pourtant bien qu'elle le soit, puisqu'elle
se ralisera. Non, elle ne l'est pas. Je vous accorde, tout au plus, qu'elle
l'aura t. Qu'entendez-vous par l ? C'est bien simple. Qu'un
homme de talent ou de gnie surgisse, qu'il cre une oeuvre : la voil relle et
par l mme elle devient rtrospectivement ou rtroactivement possible. Elle
ne le serait pas, elle ne l'aurait pas t, si cet homme n'avait pas surgi. C'est
pourquoi je vous dis qu'elle aura t possible aujourd'hui, mais qu'elle ne l'est
pas encore. C'est un peu fort ! Vous n'allez pas soutenir que l'avenir
influe sur le prsent, que le prsent introduit quelque chose dans le pass, que
l'action remonte le cours du temps et vient imprimer sa marque en arrire ?
Cela dpend. Qu'on puisse insrer du rel dans le pass et travailler ainsi
reculons dans le temps, je ne l'ai jamais prtendu. Mais qu'on y puisse loger
du possible, ou plutt que le possible aille s'y loger lui-mme tout moment,
cela n'est pas douteux. Au fur et mesure que la ralit se cre, imprvisible
et neuve, son image se rflchit derrire elle dans le pass indfini ; elle se
trouve ainsi avoir t, de tout temps, possible ; mais c'est ce moment prcis
qu'elle commence l'avoir toujours t, et voil pourquoi je disais que sa
possibilit, qui ne prcde pas sa ralit, l'aura prcde une fois la ralit
apparue. Le possible est donc le mirage du prsent dans le pass : et comme
nous savons que l'avenir finira par tre du prsent, comme l'effet de mirage
continue sans relche se produire, nous nous disons que dans notre prsent
actuel, qui sera le pass de demain, l'image de demain est dj contenue
quoique nous n'arrivions pas la saisir. L est prcisment l'illusion. C'est
comme si l'on se figurait, en apercevant son image dans le miroir devant
lequel on est venu se placer, qu'on aurait pu la toucher si l'on tait rest
derrire. En jugeant d'ailleurs ainsi que le possible ne prsuppose pas le rel,
on admet que la ralisation ajoute quelque chose la simple possibilit : le
possible aurait t l de tout temps, fantme qui attend son heure ; il serait
donc devenu ralit par l'addition de quelque chose, par je ne sais quelle
transfusion de sang ou de vie. On ne voit pas que c'est tout le contraire, que le
possible implique la ralit correspondante avec, en outre, quelque chose qui
s'y joint, puisque le possible est l'effet combin de la ralit une fois apparue
et d'un dispositif qui la rejette en arrire. L'ide, immanente la plupart des
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
63
philosophies et naturelle l'esprit humain, de possibles qui se raliseraient par
une acquisition d'existence, est donc illusion pure. Autant vaudrait prtendre
que l'homme en chair et en os provient de la matrialisation de son image
aperue dans le miroir, sous prtexte qu'il y a dans cet homme rel tout ce
qu'on trouve dans cette image virtuelle avec, en plus, la solidit qui fait qu'on
peut la toucher. Mais la vrit est qu'il faut plus ici pour obtenir le virtuel que
le rel, plus pour l'image de l'homme que pour l'homme mme, car l'image de
l'homme ne se dessinera pas si l'on ne commence par se donner l'homme, et il
faudra de plus un miroir.
C'est ce qu'oubliait mon interlocuteur quand il me questionnait sur le
thtre de demain. Peut-tre aussi jouait-il inconsciemment sur le sens du mot
possible . Hamlet tait sans doute possible avant d'tre ralis, si l'on
entend par l qu'il n'y avait pas d'obstacle insurmontable sa ralisation. Dans
ce sens particulier, on appelle possible ce qui n'est pas impossible : et il va de
soi que cette non-impossibilit d'une chose est la condition de sa ralisation.
Mais le possible ainsi entendu n'est aucun degr du virtuel, de l'idalement
prexistant. Fermez la barrire, vous savez que personne ne traversera la voie :
il ne suit pas de l que vous puissiez prdire qui la traversera quand vous
ouvrirez. Pourtant du sens tout ngatif du terme possible vous passez
subrepticement, inconsciemment, au sens positif. Possibilit signifiait tout
l'heure absence d'empchement ; vous en faites maintenant une prexistence sous forme d'ide , ce qui est tout autre chose. Au premier sens du mot,
c'tait un truisme de dire que la possibilit d'une chose prcde sa ralit :
vous entendiez simplement par l que les obstacles, ayant t surmonts,
taient surmontables 1. Mais, au second sens, c'est une absurdit, car il est
clair qu'un esprit chez lequel le Hamlet de Shakespeare se ft dessin sous
forme de possible en et par l cr la ralit : c'et donc t, par dfinition,
Shakespeare lui-mme. En vain vous vous imaginez d'abord que cet esprit
aurait pu surgir avant Shakespeare : c'est que vous ne pensez pas alors tous
les dtails du drame. Au fur et mesure que vous les compltez, le prdcesseur de Shakespeare se trouve penser tout ce que Shakespeare pensera,
sentir tout ce qu'il sentira, savoir tout ce qu'il saura, percevoir donc tout ce
qu'il percevra, occuper par consquent le mme point de l'espace et du temps,
avoir le mme corps et la mme me : c'est Shakespeare lui-mme.
Mais j'insiste trop sur ce qui va de soi. Toutes ces considrations s'imposent quand il s'agit d'une uvre d'art. Je crois qu'on finira pas trouver vident
que l'artiste cre du possible en mme temps que du rel quand il excute son
uvre. D'o vient donc qu'on hsitera probablement en dire autant de la
nature ? Le monde n'est-il pas une uvre d'art, incomparablement plus riche
que celle du plus grand artiste ? Et n'y a-t-il pas autant d'absurdit, sinon
davantage, supposer ici que l'avenir se dessine d'avance, que la possibilit
prexistait la ralit ? Je veux bien, encore une fois, que les tats futurs d'un
systme clos de points matriels soient calculables, et par consquent visibles
dans son tat prsent. Mais, je le rpte, ce systme est extrait ou abstrait d'un
tout qui comprend, outre la matire inerte et inorganise, l'organisation.
1
Encore faut-il se demander dans certains cas si les obstacles ne sont pas devenus
surmontables grce l'action cratrice qui les a surmonts : l'action, imprvisible en ellemme, aurait alors cr la surmontabilit . Avant elle, les obstacles taient insurmontables, et, sans elle, ils le seraient rests.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
64
Prenez le monde concret et complet, avec la vie et la conscience qu'il
encadre ; considrez la nature entire, gnratrice d'espces nouvelles aux
formes aussi originales et aussi neuves que le dessin de n'importe quel artiste ;
attachez-vous, dans ces espces, aux individus, plantes ou animaux, dont chacun a son caractre propre j'allais dire sa personnalit (car un brin d'herbe ne
ressemble pas plus un autre brin d'herbe qu'un Raphal un Rembrandt) ;
haussez-vous, par-dessus l'homme individuel, jusqu'aux socits qui droulent
des actions et des situations comparables celles de n'importe quel drame :
comment parler encore de possibles qui prcderaient leur propre ralisation ?
Comment ne pas voir que si l'vnement s'explique toujours, aprs coup, par
tels ou tels des vnements antcdents, un vnement tout diffrent se serait
aussi bien expliqu, dans les mmes circonstances, par des antcdents autrement choisis que dis-je ? par les mmes antcdents autrement dcoups,
autrement distribus, autrement aperus enfin par l'attention rtrospective ?
D'avant en arrire se poursuit un remodelage constant du pass par le prsent,
de la cause par l'effet.
Nous ne le voyons pas, toujours pour la mme raison, toujours en proie
la mme illusion, toujours parce que nous traitons comme du plus ce qui est
du moins, comme du moins ce qui est du plus. Remettons le possible sa
place : l'volution devient tout autre chose que la ralisation d'un programme :
les portes de l'avenir s'ouvrent toutes grandes ; un champ illimit s'offre la
libert. Le tort des doctrines, bien rares dans l'histoire de la philosophie,
qui ont su faire une place l'indtermination et la libert dans le monde, est
de n'avoir pas vu ce que leur affirmation impliquait. Quand elles parlaient
d'indtermination, de libert, elles entendaient par indtermination une comptition entre des possibles, par libert un choix entre les possibles, comme
si la possibilit n'tait pas cre par la libert mme ! Comme si toute autre
hypothse, en posant une prexistence idale du possible au rel, ne rduisait
pas le nouveau n'tre qu'un rarrangement d'lments anciens ! comme si
elle ne devait pas tre amene ainsi, tt ou tard, le tenir pour calculable et
prvisible ! En acceptant le postulat de la thorie adverse, on introduisait
l'ennemi dans la place. Il faut en prendre son parti : c'est le rel qui se fait
possible, et non pas le possible qui devient rel.
Mais la vrit est que la philosophie n'a jamais franchement admis cette
cration continue d'imprvisible nouveaut. Les anciens y rpugnaient dj,
parce que, plus ou moins platoniciens, ils se figuraient que l'tre tait donn
une fois pour toutes, complet et parfait, dans l'immuable systme des Ides : le
monde qui se droule nos yeux ne pouvait donc rien y ajouter ; il n'tait au
contraire que diminution ou dgradation ; ses tats successifs mesureraient
l'cart croissant ou dcroissant entre ce qu'il est, ombre projete dans le temps,
et ce qu'il devrait tre, Ide assise dans l'ternit ; ils dessineraient les variations d'un dficit, la forme changeante d'un vide. C'est le Temps qui aurait tout
gt. Les modernes se placent, il est vrai, un tout autre point de vue. Ils ne
traitent plus le Temps comme un intrus, perturbateur de l'ternit ; mais volontiers ils le rduiraient une simple apparence. Le temporel n'est alors que la
forme confuse du rationnel. Ce qui est peru par nous comme une succession
d'tats est conu par notre intelligence, une fois le brouillard tomb, comme
un systme de relations. Le rel devient encore une fois l'ternel, avec cette
seule diffrence que c'est l'ternit des Lois en lesquelles les phnomnes se
rsolvent, au lieu d'tre l'ternit des Ides qui leur servent de modle. Mais,
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
65
dans un cas comme dans l'autre, nous avons affaire des thories. Tenonsnous-en aux faits. Le Temps est immdiatement donn. Cela nous suffit, et, en
attendant qu'on nous dmontre son inexistence ou sa perversit, nous constaterons simplement qu'il y a jaillissement effectif de nouveaut imprvisible.
La philosophie y gagnera de trouver quelque absolu dans le monde
mouvant des phnomnes. Mais nous y gagnerons aussi de nous sentir plus
joyeux et plus forts. Plus joyeux, parce que la ralit qui s'invente sous nos
yeux donnera chacun de nous, sans cesse, certaines des satisfactions que l'art
procure de loin en loin aux privilgis de la fortune : elle nous dcouvrira, par
del la fixit et la monotonie qu'y apercevaient d'abord nos sens hypnotiss
par la constance de nos besoins, la nouveaut sans cesse renaissante, la
mouvante originalit des choses. Mais nous serons surtout plus forts, car la
grande uvre de cration qui est l'origine et qui se poursuit sous nos yeux
nous nous sentirons participer, crateurs de nous-mmes. Notre facult d'agir,
en se ressaisissant, s'intensifiera. Humilis jusque-l dans une attitude
d'obissance, esclaves de je ne sais quelles ncessits naturelles, nous nous
redresserons, matres associs un plus grand Matre. Telle sera la conclusion
de notre tude. Gardons-nous de voir un simple jeu dans une spculation sur
les rapports du possible et du rel. Ce peut tre une prparation bien vivre.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
66
La pense et le mouvant Essais et confrences.
IV
Lintuition philosophique
Confrence faite au Congrs de Philosophie
de Bologne le 10 avril 1911
Retour la table des matires
Je voudrais vous soumettre quelques rflexions sur l'esprit philosophique.
Il me semble, et plus d'un mmoire prsent ce Congrs en tmoigne,
que la mtaphysique cherche en ce moment se simplifier, se rapprocher
davantage de la vie. Je crois qu'elle a raison, et que c'est dans ce sens que nous
devons travailler. Mais j'estime que nous ne ferons, par l, rien de rvolutionnaire; nous nous bornerons donner la forme la plus approprie ce qui
est le fond de toute philosophie, je veux dire de toute philosophie qui a
pleine conscience de sa fonction et de sa destination. Car il ne faut pas que la
complication de la lettre fasse perdre de vue la simplicit de l'esprit. ne tenir
compte que des doctrines une fois formules, de la synthse o elles paraissent alors embrasser les conclusions des philosophies antrieures et l'ensemble
des connaissances acquises, on risque de ne plus apercevoir ce qu'il y a
d'essentiellement spontan dans la pense philosophique.
Il y a une remarque qu'ont pu faire tous ceux d'entre nous qui enseignent
l'histoire de la philosophie, tous ceux qui ont occasion de revenir souvent
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
67
l'tude des mmes doctrines et d'en pousser ainsi de plus en plus loin l'approfondissement. Un systme philosophique semble d'abord se dresser comme un
difice complet, d'une architecture savante, o les dispositions ont t prises
pour qu'on y pt loger commodment tous les problmes. Nous prouvons,
le contempler sous cette forme, une joie esthtique renforce d'une satisfaction
professionnelle. Non seulement, en effet, nous trouvons ici l'ordre dans la
complication (un ordre que nous nous amusons quelquefois complter en le
dcrivant), mais nous avons aussi le contentement de nous dire que nous
savons d'o viennent les matriaux et comment la construction a t faite.
Dans les problmes que le philosophe a poss nous reconnaissons les questions qui s'agitaient autour de lui. Dans les solutions qu'il en donne nous
croyons retrouver, arrangs ou drangs, mais peine modifis, les lments
des philosophies antrieures ou contemporaines. Telle vue a d lui tre fournie
par celui-ci, telle autre lui fut suggre par celui-l. Avec ce qu'il a lu, entendu, appris, nous pourrions sans doute recomposer la plus grande partie de ce
qu'il a fait. Nous nous mettons donc l'uvre, nous remontons aux sources,
nous pesons les influences, nous extrayons les similitudes, et nous finissons
par voir distinctement dans la doctrine ce que nous y cherchions : une
synthse plus ou moins originale des ides au milieu desquelles le philosophe
a vcu.
Mais un contact souvent renouvel avec la pense du matre peut nous
amener, par une imprgnation graduelle, un sentiment tout diffrent. Je ne
dis pas que le travail de comparaison auquel nous nous tions livrs d'abord
ait t du temps perdu : sans cet effort pralable pour recomposer une philosophie avec ce qui n'est pas elle et pour la relier ce qui fut autour d'elle, nous
n'atteindrions peut-tre jamais ce qui est vritablement elle ; car l'esprit
humain est ainsi fait, il ne commence comprendre le nouveau que lorsqu'il a
tout tent pour le ramener l'ancien. Mais, mesure que nous cherchons
davantage nous installer dans la pense du philosophe au lieu d'en faire le
tour, nous voyons sa doctrine se transfigurer. D'abord la complication diminue. Puis les parties entrent les unes dans les autres. Enfin tout se ramasse en
un point unique, dont nous sentons qu'on pourrait se rapprocher de plus en
plus quoiqu'il faille dsesprer d'y atteindre.
En ce point est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si
extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais russi le dire. Et c'est
pourquoi il a parl toute sa vie. Il ne pouvait formuler ce qu'il avait dans
l'esprit sans se sentir oblig de corriger sa formule, puis de corriger sa correction ainsi, de thorie en thorie, se rectifiant alors qu'il croyait se complter,
il n'a fait autre chose, par une complication qui appelait la complication et par
des dveloppements juxtaposs des dveloppements, que rendre avec une
approximation croissante la simplicit de son intuition originelle. Toute la
complexit de sa doctrine, qui irait l'infini, n'est donc que l'incommensurabilit entre son intuition simple et les moyens dont il disposait pour
l'exprimer.
Quelle est cette intuition ? Si le philosophe n'a pas pu en donner la formule, ce n'est pas nous qui y russirons. Mais ce que nous arriverons
ressaisir et fixer, c'est une certaine image intermdiaire entre la simplicit de
l'intuition concrte et la complexit des abstractions qui la traduisent, image
fuyante et vanouissante, qui hante, inaperue peut-tre, l'esprit du philoso-
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
68
phe, qui le suit comme son ombre travers les tours et dtours de sa pense, et
qui, si elle n'est pas l'intuition mme, s'en rapproche beaucoup plus que
l'expression conceptuelle, ncessairement symbolique, laquelle l'intuition
doit recourir pour fournir des explications . Regardons bien cette ombre :
nous devinerons l'attitude du corps qui la projette. Et si nous faisons effort
pour imiter cette attitude, ou mieux pour nous y insrer, nous reverrons, dans
la mesure du possible, ce que le philosophe a vu.
Ce qui caractrise d'abord cette image, c'est la puissance de ngation
qu'elle porte en elle. Vous vous rappelez comment procdait le dmon de
Socrate : il arrtait la volont du philosophe un moment donn, et l'empchait d'agir plutt qu'il ne prescrivait ce qu'il y avait faire. Il me semble que
l'intuition se comporte souvent en matire spculative comme le dmon de
Socrate dans la vie pratique ; c'est du moins sous cette forme qu'elle dbute,
sous cette forme aussi qu'elle continue donner ses manifestations les plus
nettes : elle dfend. Devant des ides couramment acceptes, des thses qui
paraissaient videntes, des affirmations qui avaient pass jusque-l pour
scientifiques, elle souffle l'oreille du philosophe le mot : Impossible : Impossible, quand bien mme les faits et les raisons sembleraient t'inviter croire
que cela est possible et rel et certain. Impossible, parce qu'une certaine
exprience, confuse peut-tre mais dcisive, te parle par ma voix, qu'elle est
incompatible avec les faits qu'on allgue et les raisons qu'on donne, et que ds
lors ces faits doivent tre mal observs, ces raisonnements faux. Singulire
force que cette puissance intuitive de ngation ! Comment n'a-t-elle pas frapp
davantage l'attention des historiens de la philosophie ? N'est-il pas visible que
la premire dmarche du philosophe, alors que sa pense est encore mal
assure et qu'il n'y a rien de dfinitif dans sa doctrine, est de rejeter certaines
choses dfinitivement ? Plus tard, il pourra varier dans ce qu'il affirmera ; il ne
variera gure dans ce qu'il nie. Et s'il varie dans ce qu'il affirme, ce sera encore
en vertu de la puissance de ngation immanente l'intuition ou son image. Il
se sera laiss aller dduire paresseusement des consquences selon les rgles
d'une logique rectiligne ; et voici que tout coup, devant sa propre affirmation, il prouve le mme sentiment d'impossibilit qui lui tait venu d'abord
devant l'affirmation d'autrui. Ayant quitt en effet la courbe de sa pense pour
suivre tout droit la tangente, il est devenu extrieur lui-mme. Il rentre en lui
quand il revient l'intuition. De ces dparts et de ces retours sont faits les
zigzags d'une doctrine qui se dveloppe , c'est--dire qui se perd, se
retrouve, et se corrige indfiniment elle-mme.
Dgageons-nous de cette complication, remontons vers l'intuition simple
ou tout au moins vers l'image qui la traduit : du mme coup nous voyons la
doctrine s'affranchir des conditions de temps et de lieu dont elle semblait
dpendre. Sans doute les problmes dont le philosophe s'est occup sont les
problmes qui se posaient de son temps ; la science qu'il a utilise ou critique
tait la science de son temps ; dans les thories qu'il expose on pourra mme
retrouver, si on les y cherche, les ides de ses contemporains et de ses devanciers. Comment en serait-il autrement ? Pour faire comprendre le nouveau,
force est bien de l'exprimer en fonction de l'ancien ; et les problmes dj
poss, les solutions qu'on en avait fournies, la philosophie et la science du
temps o il a vcu, ont t pour chaque grand penseur, la matire dont il tait
oblig de se servir pour donner une forme concrte sa pense. Sans compter
qu'il est de tradition, depuis l'antiquit, de prsenter toute philosophie comme
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
69
un systme complet, qui embrasse tout ce que l'on connat. Mais ce serait se
tromper trangement que de prendre pour un lment constitutif de la doctrine
ce qui n'en fut que le moyen d'expression. Telle est la premire erreur
laquelle nous nous exposons, comme je le disais tout l'heure, quand nous
abordons l'tude d'un systme. Tant de ressemblances partielles nous frappent,
tant de rapprochements nous paraissent s'imposer, des appels si nombreux, si
pressants, sont lancs de toutes parts notre ingniosit et notre rudition,
que nous sommes tents de recomposer la pense du matre avec des fragments d'ides pris et l, quittes le louer ensuite d'avoir su comme nous
venons de nous en montrer capables nous-mmes excuter un joli travail de
mosaque. Mais l'illusion ne dure gure, car nous nous apercevons bientt que,
l mme o le philosophe semble rpter des choses dj dites, il les pense
sa manire. Nous renonons alors recomposer ; mais c'est pour glisser, le
plus souvent, vers une nouvelle illusion, moins grave sans doute que la
premire, mais plus tenace qu'elle. Volontiers nous nous figurons la doctrine
mme si c'est celle d'un matre comme issue des philosophies antrieures et
comme reprsentant un moment d'une volution . Certes, nous n'avons plus
tout fait tort, car une philosophie ressemble plutt un organisme qu' un
assemblage, et il vaut encore mieux parler ici d'volution que de composition.
Mais cette nouvelle comparaison, outre quelle attribue l'histoire de la
pense plus de continuit quil ne s'en trouve rellement, a l'inconvnient de
maintenir notre attention fixe sur la complication extrieure du systme et sur
ce qu'il peut avoir de prvisible dans sa forme superficielle, au lieu de nous
inviter toucher du doigt la nouveaut et la simplicit du fond. Un philosophe
digne de ce nom n'a jamais dit qu'une seule chose : encore a-t-il plutt cherch
la dire qu'il ne l'a dite vritablement. Et il n'a dit qu'une seule chose parce
qu'il n'a su qu'un seul point : encore fut-ce moins une vision qu'un contact ; ce
contact a fourni une impulsion, cette impulsion un mouvement, et si ce
mouvement, qui est comme un certain tourbillonnement d'une certaine forme
particulire, ne se rend visible nos yeux que par ce qu'il a ramass sur sa
route, il n'en est pas moins vrai que d'autres poussires auraient aussi bien pu
tre souleves et que c'et t encore le mme tourbillon. Ainsi, une pense
qui apporte quelque chose de nouveau dans le monde est bien oblige de se
manifester travers les ides toutes faites qu'elle rencontre devant elle et
qu'elle entrane dans son mouvement ; elle apparat ainsi comme relative
l'poque o le philosophe a vcu ; mais ce n'est souvent qu'une apparence. Le
philosophe et pu venir plusieurs sicles plus tt ; il aurait eu affaire une
autre philosophie et une autre science ; il se ft pos d'autres problmes ; il
se serait exprim par d'autres formules ; pas un chapitre, peut-tre, des livres
qu'il a crits n'et t ce qu'il est ; et pourtant il et dit la mme chose.
Permettez-moi de choisir un exemple. Je fais appel vos souvenirs professionnels : je vais, si vous le voulez bien, voquer quelques-uns des miens.
Professeur au Collge de France, je consacre un de mes deux cours, tous les
ans, l'histoire de la philosophie. C'est ainsi que j'ai pu, pendant plusieurs
annes conscutives, pratiquer longuement sur Berkeley, puis sur Spinoza,
l'exprience que je viens de dcrire. Je laisserai de ct Spinoza ; il nous
entranerait trop loin. Et pourtant je ne connais rien de plus instructif que le
contraste entre la forme et le fond d'un livre comme lthique : d'un ct ces
choses normes qui s'appellent la Substance, l'Attribut et le Mode, et le
formidable attirail des thormes avec l'enchevtrement des dfinitions, corollaires et scolies, et cette complication de machinerie et cette puissance
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
70
d'crasement qui font que le dbutant, en prsence de l'thique, est frapp
d'admiration et de terreur comme devant un cuirass du type Dreadnought ;
de l'autre, quelque chose de subtil, de trs lger et de presque arien, qui fuit
quand on s'en approche, mais qu'on ne peut regarder, mme de loin, sans
devenir incapable de s'attacher quoi que ce soit du reste, mme ce qui
passe pour capital, mme la distinction entre la Substance et l'Attribut,
mme la dualit de la Pense et de l'tendue. C'est, derrire la lourde masse
des concepts apparents au cartsianisme et l'aristotlisme, l'intuition qui fut
celle de Spinoza, intuition qu'aucune formule, si simple soit-elle, ne sera assez
simple pour exprimer. Disons, pour nous contenter d'une approximation, que
c'est le sentiment d'une concidence entre l'acte par lequel notre esprit connat
parfaitement la vrit et l'opration par laquelle Dieu l'engendre, l'ide que la
conversion des Alexandrins, quand elle devient complte, ne fait plus
qu'un avec leur procession , et que lorsque l'homme, sorti de la divinit,
arrive rentrer en elle, il n'aperoit plus qu'un mouvement unique l o il
avait vu d'abord les deux mouvements inverses d'aller et de retour, l'exprience morale se chargeant ici de rsoudre une contradiction logique et de
faire, par une brusque suppression du Temps, que le retour soit un aller. Plus
nous remontons vers cette intuition originelle, mieux nous comprenons que, si
Spinoza avait vcu avant Descartes, il aurait sans doute crit autre chose que
ce qu'il a crit, mais que, Spinoza vivant et crivant, nous tions srs d'avoir le
spinozisme tout de mme.
J'arrive Berkeley, et puisque c'est lui que je prends comme exemple,
vous ne trouverez pas mauvais que je l'analyse en dtail : la brivet ne
s'obtiendrait ici qu'aux dpens de la rigueur. Il suffit de jeter un coup d'il sur
l'uvre de Berkeley pour la voir, comme d'elle-mme, se rsumer en quatre
thses fondamentales. La premire, qui dfinit un certain idalisme et
laquelle se rattache la nouvelle thorie de la vision (quoique le philosophe ait
jug prudent de prsenter celle-ci comme indpendante) se formulerait ainsi :
la matire est un ensemble d'ides . La seconde consiste prtendre que les
ides abstraites et gnrales se rduisent des mots : c'est du nominalisme. La
troisime affirme la ralit des esprits et les caractrise par la volont : disons
que c'est du spiritualisme et du volontarisme. La dernire enfin, que nous
pourrions appeler du thisme, pose l'existence de Dieu en se fondant principalement sur la considration de la matire. Or, rien ne serait plus facile que de
retrouver ces quatre thses, formules en termes peu prs identiques, chez
les contemporains ou les prdcesseurs de Berkeley. La dernire se rencontre
chez les thologiens. La troisime tait chez Duns Scot ; Descartes a dit
quelque chose du mme genre. La seconde a aliment les controverses du
moyen ge avant de faire partie intgrante de la philosophie de Hobbes. Quant
la premire, elle ressemble beaucoup l' occasionalisme de Malebranche,
dont nous dcouvririons dj l'ide, et mme la formule, dans certains textes
de Descartes ; on n'avait d'ailleurs pas attendu jusqu' Descartes pour remarquer que le rve a toute l'apparence de la ralit et qu'il n'y a rien, dans aucune
de nos perceptions prise part, qui nous garantisse l'existence d'une chose
extrieure nous. Ainsi, avec des philosophes dj anciens ou mme, si l'on
ne veut pas remonter trop haut, avec Descartes et Hobbes, auxquels on pourra
adjoindre Locke, on aura les lments ncessaires la reconstitution extrieure de la philosophie de Berkeley : tout au plus lui laissera-t-on sa thorie
de la vision, qui serait alors son uvre propre, et dont l'originalit, rejaillissant
sur le reste, donnerait l'ensemble de la doctrine son aspect original. Prenons
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
71
donc ces tranches de philosophie ancienne et moderne, mettons-les dans le
mme bol, ajoutons en guise de vinaigre et d'huile, une certaine impatience
agressive l'gard du dogmatisme mathmatique et le dsir, naturel chez un
vque philosophe, de rconcilier la raison avec la foi, mlons et retournons
consciencieusement, jetons par-dessus le tout, comme autant de fines herbes,
un certain nombre d'aphorismes cueillis chez les no-platoniciens : nous
aurons passez-moi l'expression une salade qui ressemblera suffisamment,
de loin, ce que Berkeley a fait.
Eh bien, celui qui procderait ainsi serait incapable de pntrer dans la
pense de Berkeley. Je ne parle pas des difficults et des impossibilits
auxquelles il se heurterait dans les explications de dtail : singulier nominalisme que celui qui aboutit riger bon nombre d'ides gnrales en
essences ternelles, immanentes l'Intelligence divine ! trange ngation de la
ralit des corps que celle qui s'exprime par une thorie positive de la nature
de la matire, thorie fconde, aussi loigne que possible d'un idalisme
strile qui assimilerait la perception au rve ! Ce que je veux dire, c'est qu'il
nous est impossible d'examiner avec attention la philosophie de Berkeley sans
voir se rapprocher d'abord, puis s'entrepntrer, les quatre thses que nous y
avons distingues, de sorte que chacune d'elles semble devenir grosse des trois
autres, prendre du relief et de la profondeur, et se distinguer radicalement des
thories antrieures ou contemporaines avec lesquelles on pouvait la faire
concider en surface. Sans doute ce second point de vue, d'o la doctrine
apparat comme un organisme et non plus comme un assemblage, n'est pas
encore le point de vue dfinitif. Du moins est-il plus rapproch de la vrit. Je
ne puis entrer dans tous les dtails ; il faut cependant que j'indique, pour une
ou deux au moins des quatre thses, comment on en tirerait n'importe laquelle
des autres.
Prenons l'idalisme. Il ne consiste pas seulement dire que les corps sont
des ides. quoi cela servirait-il ? Force nous serait bien de continuer
affirmer de ces ides tout ce que l'exprience nous fait affirmer des corps, et
nous aurions simplement substitu un mot un autre ; car Berkeley ne pense
certes pas que la matire cessera d'exister quand il aura cess de vivre. Ce que
l'idalisme de Berkeley signifie, c'est que la matire est coextensive notre
reprsentation ; qu'elle n'a pas d'intrieur, pas de dessous ; qu'elle ne cache
rien, ne renferme rien ; qu'elle ne possde ni puissances ni virtualits d'aucune
espce ; qu'elle est tale en surface et qu'elle tient tout entire, tout instant,
dans ce qu'elle donne. Le mot ide dsigne d'ordinaire une existence de ce
genre, je veux dire une existence compltement ralise, dont l'tre ne fait
qu'un avec le paratre, tandis que le mot chose nous fait penser une
ralit qui serait en mme temps un rservoir de possibilits ; c'est pour cette
raison que Berkeley aime mieux appeler les corps des ides que des choses.
Mais, si nous envisageons ainsi l' idalisme , nous le voyons concider avec
le nominalisme ; car cette seconde thse, mesure qu'elle s'affirme plus
nettement dans l'esprit du philosophe, se restreint plus videmment la
ngation des ides gnrales abstraites, abstraites, c'est--dire extraites de la
matire : il est clair en effet qu'on ne saurait extraire quelque chose de ce qui
ne contient rien, ni par consquent faire sortir d'une perception autre chose
qu'elle. La couleur n'tant que de la couleur, la rsistance n'tant que de la
rsistance, jamais vous ne trouverez rien de commun entre la rsistance et la
couleur, jamais vous ne tirerez des donnes de la vue un lment qui leur soit
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
72
commun avec celles du toucher. Que si vous prtendez abstraire des unes et
des autres quelque chose qui leur soit commun toutes, vous vous apercevrez,
en regardant cette chose, que vous avez affaire un mot : voil le nominalisme de Berkeley; mais voil, du mme coup, la nouvelle thorie de la
vision . Si une tendue qui serait la fois visuelle et tactile n'est qu'un mot,
plus forte raison en est-il ainsi d'une tendue qui intresserait tous les sens la
fois : voil encore du nominalisme, mais voil aussi la rfutation de la thorie
cartsienne de la matire. Ne parlons mme plus d'tendue ; constatons simplement que, vu la structure du langage, les deux expressions j'ai cette perception et cette perception existe sont synonymes, mais que la seconde,
introduisant le mme mot existence dans la description de perceptions
toutes diffrentes, nous invite croire qu'elles ont quelque chose de commun
entre elles et nous imaginer que leur diversit recouvre une unit fondamentale, l'unit d'une substance qui n'est en ralit que le mot existence
hypostasi : vous avez tout l'idalisme de Berkeley; et cet idalisme, comme
je le disais, ne fait qu'un avec son nominalisme. Passons maintenant, si vous
voulez, la thorie de Dieu et celle des esprits. Si un corps est fait d'
ides , ou, en d'autres termes, s'il est entirement passif et termin, dnu
de pouvoirs et de virtualits, il ne saurait agir sur d'autres corps ; et ds lors les
mouvements des corps doivent tre les effets d'une puissance active, qui a
produit ces corps eux-mmes et qui, en raison de l'ordre dont l'univers
tmoigne, ne peut tre qu'une cause intelligente. Si nous nous trompons quand
nous rigeons en ralits, sous le nom d'ides gnrales, les noms que nous
avons donns des groupes d'objets ou de perceptions plus ou moins
artificiellement constitus par nous sur le plan de la matire, il n'en est plus de
mme quand nous croyons dcouvrir, derrire le plan o la matire s'tale, les
intentions divines : l'ide gnrale qui n'existe qu'en surface et qui relie les
corps aux corps n'est sans doute qu'un mot, mais l'ide gnrale qui existe en
profondeur, rattachant les corps Dieu ou plutt descendant de Dieu aux
corps, est une ralit ; et ainsi le nominalisme de Berkeley appelle tout naturellement ce dveloppement de la doctrine que nous trouvons dans la Siris et
qu'on a considr tort comme une fantaisie no-platonicienne ; en d'autres
termes, l'idalisme de Berkeley n'est quun aspect de la thorie qui met Dieu
derrire toutes les manifestations de la matire. Enfin, si Dieu imprime en
chacun de nous des perceptions ou, comme dit Berkeley, des ides , l'tre
qui recueille ces perceptions ou plutt qui va au-devant d'elles est tout l'inverse d'une ide : c'est une volont, d'ailleurs limite sans cesse par la volont
divine. Le point de rencontre de ces deux volonts est justement ce que nous
appelons la matire. Si le percipi est passivit pure, le percipere est pure
activit. Esprit humain, matire, esprit divin deviennent donc des termes que
nous ne pouvons exprimer qu'en fonction l'un de l'autre. Et le spiritualisme de
Berkeley se trouve lui-mme n'tre qu'un aspect de l'une quelconque des trois
autres thses.
Ainsi les diverses parties du systme s'entrepntrent, comme chez un tre
vivant. Mais, comme je le disais au dbut, le spectacle de cette pntration
rciproque nous donne sans doute une ide plus juste du corps de la doctrine ;
il ne nous en fait pas encore atteindre l'me.
Nous nous rapprocherons d'elle, si nous pouvons atteindre l'image
mdiatrice dont je parlais tout l'heure, une image qui est presque matire
en ce qu'elle se laisse encore voir, et presque esprit en ce qu'elle ne se laisse
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
73
plus toucher, fantme qui nous hante pendant que nous tournons autour de la
doctrine et auquel il faut s'adresser pour obtenir le signe dcisif, l'indication de
l'attitude prendre et du point o regarder. L'image mdiatrice qui se dessine
dans l'esprit de l'interprte, au fur et mesure qu'il avance dans l'tude de
l'uvre, exista-t-elle jadis, telle quelle, dans la pense du matre ? Si ce ne fut
pas celle-l, c'en fut une autre, qui pouvait appartenir un ordre de perception
diffrent et n'avoir aucune ressemblance matrielle avec elle, mais qui lui
quivalait cependant comme s'quivalent deux traductions, en langues diffrentes, du mme original. Peut-tre ces deux images, peut-tre mme d'autres
images, quivalentes encore, furent-elles prsentes toutes la fois, suivant pas
pas le philosophe, en procession, travers les volutions de sa pense. Ou
peut-tre n'en aperut-il bien aucune, se bornant reprendre directement
contact, de loin en loin, avec cette chose plus subtile encore qui est l'intuition
elle-mme ; mais alors force nous est bien, nous interprtes, de rtablir
l'image intermdiaire, sous peine d'avoir parler de l' intuition originelle
comme d'une pense vague et de l' esprit de la doctrine comme d'une
abstraction, alors que cet esprit est ce qu'il y a de plus concret et cette intuition
ce qu'il y a de plus prcis dans le systme.
Dans le cas de Berkeley, je crois voir deux images diffrentes, et celle qui
me frappe le plus n'est pas celle dont nous trouvons l'indication complte chez
Berkeley lui-mme. Il me semble que Berkeley aperoit la matire comme une
mince pellicule transparente situe entre l'homme et Dieu. Elle reste transparente tant que les philosophes ne s'occupent pas d'elle, et alors Dieu se montre
au travers. Mais que les mtaphysiciens y touchent, ou mme le sens commun
en tant qu'il est mtaphysicien : aussitt la pellicule se dpolit et s'paissit,
devient opaque et forme cran, parce que des mots tels que Substance, Force,
tendue abstraite, etc., se glissent derrire elle, s'y dposent comme une couche de poussire, et nous empchent d'apercevoir Dieu par transparence.
L'image est peine indique par Berkeley lui-mme, quoiqu'il ait dit en
propres termes que nous soulevons la poussire et que nous nous plaignons
ensuite de ne pas voir . Mais il y a une autre comparaison, souvent voque
par le philosophe, et qui n'est que la transposition auditive de l'image visuelle
que je viens de dcrire : la matire serait une langue que Dieu nous parle. Les
mtaphysiques de la matire, paississant chacune des syllabes, lui faisant un
sort, l'rigeant en entit indpendante, dtourneraient alors notre attention du
sens sur le son et nous empcheraient de suivre la parole divine. Mais, qu'on
s'attache l'une ou l'autre, dans les deux cas on a affaire une image simple
qu'il faut garder sous les yeux, parce que, si elle n'est pas l'intuition gnratrice de la doctrine, elle en drive immdiatement et s'en rapproche plus
qu'aucune des thses prise part, plus mme que leur combinaison.
Pouvons-nous ressaisir cette intuition elle-mme ? Nous n'avons que deux
moyens d'expression, le concept et l'image. C'est en concepts que le systme
se dveloppe ; c'est en une image qu'il se resserre quand on le repousse vers
l'intuition d'o il descend : que si l'on veut dpasser l'image en remontant plus
haut qu'elle, ncessairement on retombe sur des concepts, et sur des concepts
plus vagues, plus gnraux encore, que ceux d'o l'on tait parti la recherche
de l'image et de l'intuition. Rduite prendre cette forme, embouteille sa
sortie de la source, l'intuition originelle paratra donc tre ce qu'il y a au
monde de plus fade et de plus froid : ce sera la banalit mme. Si nous disions,
par exemple, que Berkeley considre l'me humaine comme partiellement
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
74
unie Dieu et partiellement indpendante, qu'il a conscience de lui-mme,
tout instant, comme d'une activit imparfaite qui rejoindrait une activit plus
haute s'il n'y avait, interpos entre les deux, quelque chose qui est la passivit
absolue, nous exprimerions de l'intuition originelle de Berkeley tout ce qui
peut se traduire immdiatement en concepts, et pourtant nous aurions quelque
chose de si abstrait que ce serait peu prs vide. Tenons-nous-en ces formules, puisque nous ne pouvons trouver mieux, mais tchons d'y mettre un
peu de vie. Prenons tout ce que le philosophe a crit, faisons remonter ces
ides parpilles vers l'image d'o elles taient descendues, haussons-les,
maintenant enfermes dans l'image, jusqu' la formule abstraite qui va se
grossir de l'image et des ides, attachons-nous alors cette formule et
regardons-la, elle si simple, se simplifier encore, d'autant plus simple que nous
aurons pouss en elle un plus grand nombre de choses, soulevons-nous enfin
avec elle, montons vers le point o se resserrerait en tension tout ce qui tait
donn en extension dans la doctrine : nous nous reprsenterons cette fois
comment de ce centre de force, d'ailleurs inaccessible, part l'impulsion qui
donne l'lan, c'est--dire l'intuition mme. Les quatre thses de Berkeley sont
sorties de l, parce que ce mouvement a rencontr sur sa route les ides et les
problmes que soulevaient les contemporains de Berkeley. En d'autres temps,
Berkeley et sans doute formul d'autres thses ; mais, le mouvement tant le
mme, ces thses eussent t situes de la mme manire par rapport les unes
aux autres ; elles auraient eu la mme relation entre elles, comme de nouveaux
mots d'une nouvelle phrase entre lesquels continue courir un ancien sens ; et
c'et t la mme philosophie.
La relation d'une philosophie aux philosophies antrieures et contemporaines n'est donc pas ce que nous ferait supposer une certaine conception de
l'histoire des systmes. Le philosophe ne prend pas des ides prexistantes
pour les fondre dans une synthse suprieure ou pour les combiner avec une
ide nouvelle. Autant vaudrait croire que, pour parler, nous allons chercher
des mots que nous cousons ensuite ensemble au moyen d'une pense. La
vrit est qu'au-dessus du mot et au-dessus de la phrase il y a quelque chose
de beaucoup plus simple qu'une phrase et mme qu'un mot : le sens, qui est
moins une chose pense quun mouvement de pense, moins un mouvement
qu'une direction. Et de mme que l'impulsion donne la vie embryonnaire
dtermine la division d'une cellule primitive en cellules qui se divisent leur
tour jusqu' ce que l'organisme complet soit form, ainsi le mouvement
caractristique de tout acte de pense amne cette pense, par une subdivision
croissante d'elle-mme, s'taler de plus en plus sur les plans successifs de
l'esprit jusqu' ce qu'elle atteigne celui de la parole. L, elle s'exprime par une
phrase, c'est--dire par un groupe d'lments prexistants ; mais elle peut
choisir presque arbitrairement les premiers lments du groupe pourvu que les
autres en soient complmentaires : la mme pense se traduit aussi bien en
phrases diverses composes de mots tout diffrents, pourvu que ces mots aient
entre eux le mme rapport. Tel est le processus de la parole. Et telle est aussi
l'opration par laquelle se constitue une philosophie. Le philosophe ne part
pas d'ides prexistantes ; tout au plus peut-on dire qu'il y arrive. Et quand il y
vient, l'ide ainsi entrane dans le mouvement de son esprit, s'animant d'une
vie nouvelle comme le mot qui reoit son sens de la phrase, n'est plus ce
qu'elle tait en dehors du tourbillon.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
75
On trouverait une relation du mme genre entre un systme philosophique
et l'ensemble des connaissances scientifiques de l'poque o le philosophe a
vcu. Il y a une certaine conception de la philosophie qui veut que tout l'effort
du philosophe tende embrasser dans une grande synthse les rsultats des
sciences particulires. Certes, le philosophe fut pendant longtemps celui qui
possdait la science universelle ; et aujourd'hui mme que la multiplicit des
sciences particulires, la diversit et la complexit des mthodes, la masse
norme des faits recueillis rendent impossible l'accumulation de toutes les
connaissances humaines dans un seul esprit, le philosophe reste l'homme de la
science universelle, en ce sens que, s'il ne peut plus tout savoir, il n'y a rien
qu'il ne doive s'tre mis en tat d'apprendre. Mais suit-il de l que sa tche soit
de s'emparer de la science faite, de l'amener des degrs croissants de gnralit, et de s'acheminer, de condensation en condensation, ce qu'on a appel
l'unification du savoir ? Permettez-moi de trouver trange que ce soit au nom
de la science, par respect pour la science, qu'on nous propose cette conception
de la philosophie : je n'en connais pas de plus dsobligeante pour la science ni
de plus injurieuse pour le savant. Comment ! voici un homme qui a longuement pratiqu une certaine mthode scientifique et laborieusement conquis ses
rsultats, qui vient nous dire : l'exprience, aide du raisonnement, conduit
jusqu'en ce point ; la connaissance scientifique commence ici, elle finit l ;
telles sont mes conclusions ; et le philosophe aurait le droit de lui rpondre :
Fort bien, laissez-moi cela, vous allez voir ce que j'en saurai faire ! La
connaissance que vous m'apportez incomplte, je la complterai. Ce que vous
me prsentez disjoint, je l'unifierai. Avec les mmes matriaux, puisqu'il est
entendu que je m'en tiendrai aux faits que vous avez observs, avec le mme
genre de travail, puisque je dois me borner comme vous induire et dduire,
je ferai plus et mieux que ce que vous avez fait. trange prtention, en
vrit ! Comment la profession de philosophe confrerait-elle celui qui
l'exerce le pouvoir d'avancer plus loin que la science dans la mme direction
qu'elle ? Que certains savants soient plus ports que d'autres aller de l'avant
et gnraliser leurs rsultats, plus ports aussi revenir en arrire et
critiquer leurs mthodes, que, dans ce sens particulier du mot, on les dise
philosophes, que d'ailleurs chaque science puisse et doive avoir sa philosophie
ainsi comprise, je suis le premier l'admettre. Mais cette philosophie-l est
encore de la science, et celui qui la fait est encore un savant. Il ne s'agit plus,
comme tout l'heure, d'riger la philosophie en synthse des sciences positives et de prtendre, par la seule vertu de l'esprit philosophique, s'lever plus
haut que la science dans la gnralisation des mmes faits.
Une telle conception du rle du philosophe serait injurieuse pour la
science. Mais combien plus injurieuse encore pour la philosophie ! N'est-il pas
vident que, si le savant s'arrte en un certain point sur la voie de la gnralisation et de la synthse, l s'arrte ce que l'exprience objective et le
raisonnement sr nous permettent d'avancer ? Et ds lors, en prtendant aller
plus loin dans la mme direction, ne nous placerions-nous pas systmatiquement dans l'arbitraire ou tout au moins dans l'hypothtique ? Faire de la
philosophie un ensemble de gnralits qui dpasse la gnralisation scientifique, c'est vouloir que le philosophe se contente du plausible et que la
probabilit lui suffise. Je sais bien que, pour la plupart de ceux qui suivent de
loin nos discussions, notre domaine est en effet celui du simple possible, tout
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
76
au plus celui du probable ; volontiers ils diraient que la philosophie commence
l o la certitude finit. Mais qui de nous voudrait d'une pareille situation pour
la philosophie ? Sans doute, tout n'est pas galement vrifi ni vrifiable dans
ce qu'une philosophie nous apporte, et il est de l'essence de la mthode
philosophique d'exiger qu' bien des moments, sur bien des points, l'esprit
accepte des risques. Mais le philosophe ne court ces risques que parce qu'il a
contract une assurance, et parce qu'il y a des choses dont il se sent inbranlablement certain. Il nous en rendra certains notre tour dans la mesure o il
saura nous communiquer l'intuition o il puise sa force.
La vrit est que la philosophie n'est pas une synthse des sciences particulires, et que si elle se place souvent sur le terrain de la science, si elle
embrasse parfois dans une vision plus simple les objets dont la science
s'occupe, ce n'est pas en intensifiant la science, ce n'est pas en portant les
rsultats de la science un plus haut degr de gnralit. Il n'y aurait pas place
pour deux manires de connatre, philosophie et science, si l'exprience ne se
prsentait nous sous deux aspects diffrents, d'un ct sous forme de faits
qui se juxtaposent des faits, qui se rptent peu prs, qui se mesurent peu
prs, qui se dploient enfin dans le sens de la multiplicit distincte et de la
spatialit, de l'autre sous forme d'une pntration rciproque qui est pure
dure, rfractaire la loi et la mesure. Dans les deux cas, exprience signifie
conscience ; mais, dans le premier, la conscience s'panouit au dehors, et
s'extriorise par rapport elle-mme dans l'exacte mesure o elle aperoit des
choses extrieures les unes aux autres ; dans le second elle rentre en elle, se
ressaisit et s'approfondit. En sondant ainsi sa propre profondeur, pntre-t-elle
plus avant dans l'intrieur de la matire, de la vie, de la ralit en gnral ? On
pourrait le contester, si la conscience s'tait surajoute la matire comme un
accident ; mais nous croyons avoir montr qu'une pareille hypothse, selon le
ct par o on la prend, est absurde ou fausse, contradictoire avec elle-mme
ou contredite par les faits. On pourrait le contester encore, si la conscience
humaine, quoique apparente une conscience plus vaste et plus haute, avait
t mise l'cart, et si l'homme avait se tenir dans un coin de la nature
comme un enfant en pnitence. Mais non ! la matire et la vie qui remplissent
le monde sont aussi bien en nous ; les forces qui travaillent en toutes choses,
nous les sentons en nous ; quelle que soit l'essence intime de ce qui est et de
ce qui se fait, nous en sommes. Descendons alors l'intrieur de nousmmes : plus profond sera le point que nous aurons touch, plus forte sera la
pousse qui nous renverra la surface. L'intuition philosophique est ce contact, la philosophie est cet lan. Ramens au dehors par une impulsion venue
du fond, nous rejoindrons la science au fur et mesure que notre pense
s'panouira en s'parpillant. Il faut donc que la philosophie puisse se mouler
sur la science, et une ide d'origine soi-disant intuitive qui n'arriverait pas, en
se divisant et en subdivisant ses divisions, recouvrir les faits observs au
dehors et les lois par lesquelles la science les relie entre eux, qui ne serait pas
capable, mme, de corriger certaines gnralisations et de redresser certaines
observations, serait fantaisie pure ; elle n'aurait rien de commun avec l'intuition. Mais, d'autre part, l'ide qui russit appliquer exactement contre les
faits et les lois cet parpillement d'elle-mme n'a pas t obtenue par une
unification de l'exprience extrieure ; car le philosophe n'est pas venu
l'unit, il en est parti. Je parle, bien entendu, d'une unit la fois restreinte et
relative, comme celle qui dcoupe un tre vivant dans l'ensemble des choses.
Le travail par lequel la philosophie parat s'assimiler les rsultats de la science
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
77
positive, de mme que l'opration au cours de laquelle une philosophie a l'air
de rassembler en elle les fragments des philosophies antrieures, n'est pas une
synthse, mais une analyse.
La science est l'auxiliaire de l'action. Et l'action vise un rsultat. L'intelligence scientifique se demande donc ce qui devra avoir t fait pour qu'un
certain rsultat dsir soit atteint, ou plus gnralement quelles conditions il
faut se donner pour qu'un certain phnomne se produise. Elle va d'un arrangement des choses un rarrangement, d'une simultanit une simultanit.
Ncessairement elle nglige ce qui se passe dans l'intervalle ; ou, si elle s'en
occupe, c'est pour y considrer d'autres arrangements, des simultanits
encore. Avec des mthodes destines saisir le tout fait, elle ne saurait, en
gnral, entrer dans ce qui se fait, suivre le mouvant, adopter le devenir qui est
la vie des choses. Cette dernire tche appartient la philosophie. Tandis que
le Savant, astreint prendre sur le mouvement des vues immobiles et cueillir
des rptitions le long de ce qui ne se rpte pas, attentif aussi diviser
commodment la ralit sur les plans successifs o elle est dploye afin de la
soumettre l'action de l'homme, est oblig de ruser avec la nature, d'adopter
vis--vis d'elle une attitude de dfiance et de lutte, le philosophe la traite en
camarade. La rgle de la science est celle qui a t pose par Bacon : obir
pour commander. Le philosophe n'obit ni ne commande il cherche
sympathiser.
De ce point de vue encore, l'essence de la philosophie est l'esprit de simplicit. Que nous envisagions l'esprit philosophique en lui-mme ou dans ses
uvres, que nous comparions la philosophie la science ou une philosophie
d'autres philosophies, toujours nous trouvons que la complication est superficielle, la construction un accessoire, la synthse une apparence : philosopher
est un acte simple.
Plus nous nous pntrerons de cette vrit, plus nous inclinerons faire
sortir la philosophie de l'cole et la rapprocher de la vie. Sans doute l'attitude
de la pense commune, telle qu'elle rsulte de la structure des sens, de
l'intelligence et du langage, est plus voisine de l'attitude de la science que de
celle de la philosophie. Je n'entends pas seulement par l que les catgories
gnrales de notre pense sont celles mmes de la science, que les grandes
routes traces par nos sens travers la continuit du rel sont celles par o la
science passera, que la perception est une science naissante, la science une
perception adulte, et que la connaissance usuelle et la connaissance scientifique, destines l'une et l'autre prparer notre action sur les choses, sont
ncessairement deux visions du mme genre, quoique de prcision et de
porte ingales. Ce que je veux surtout dire, c'est que la connaissance usuelle
est astreinte, comme la connaissance scientifique et pour les mmes raisons
qu'elle, prendre les choses dans un temps pulvris o un instant sans dure
succde un instant qui ne dure pas davantage. Le mouvement est pour elle
une srie de positions, le changement une srie de qualits, le devenir en
gnral une srie d'tats. Elle part de l'immobilit (comme si l'immobilit
pouvait tre autre chose qu'une apparence, comparable l'effet spcial qu'un
mobile produit sur un autre mobile quand ils sont rgls l'un sur l'autre), et par
un ingnieux arrangement d'immobilits elle recompose une imitation du
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
78
mouvement qu'elle substitue au mouvement lui-mme : opration pratiquement commode mais thoriquement absurde, grosse de toutes les contradictions, de tous les faux problmes que la Mtaphysique et la Critique
rencontrent devant elles.
Mais, justement parce que c'est l que le sens commun tourne le dos la
philosophie, il suffira que nous obtenions de lui une volte-face en ce point
pour que nous le replacions dans la direction de la pense philosophique. Sans
doute l'intuition comporte bien des degrs d'intensit, et la philosophie bien
des degrs de profondeur ; mais l'esprit qu'on aura ramen la dure relle
vivra dj de la vie intuitive et sa connaissance des choses sera dj philosophie. Au lieu d'une discontinuit de moments qui se remplaceraient dans un
temps infiniment divis, il apercevra la fluidit continue du temps rel qui
coule indivisible. Au lieu d'tats superficiels qui viendraient tour tour
recouvrir une chose indiffrente et qui entretiendraient avec elle le mystrieux
rapport du phnomne la substance, il saisira un seul et mme changement
qui va toujours s'allongeant, comme dans une mlodie o tout est devenir mais
o le devenir, tant substantiel, n'a pas besoin de support. Plus d'tats inertes,
plus de choses mortes ; rien que la mobilit dont est faite la stabilit de la vie.
Une vision de ce genre, o la ralit apparat comme continue et indivisible,
est sur le chemin qui mne l'intuition philosophique.
Car il n'est pas ncessaire, pour aller l'intuition, de se transporter hors du
domaine des sens et de la conscience. L'erreur de Kant fut de le croire. Aprs
avoir prouv par des arguments dcisifs qu'aucun effort dialectique ne nous
introduira jamais dans l'au-del et qu'une mtaphysique efficace serait ncessairement une mtaphysique intuitive, il ajouta que cette intuition nous
manque et que cette mtaphysique est impossible. Elle le serait, en effet, s'il
n'y avait pas d'autres temps ni d'autre changement que ceux que Kant a
aperus et auxquels nous tenons d'ailleurs avoir affaire ; car notre perception
usuelle ne saurait sortir du temps ni saisir autre chose que du changement.
Mais le temps o nous restons naturellement placs, le changement dont nous
nous donnons ordinairement le spectacle, sont un temps et un changement que
nos sens et notre conscience ont rduits en poussire pour faciliter notre action
sur les choses. Dfaisons ce qu'ils ont fait, ramenons notre perception ses
origines, et nous aurons une connaissance d'un nouveau genre sans avoir eu
besoin de recourir des facults nouvelles.
Si cette connaissance se gnralise, ce n'est pas seulement la spculation
qui en profitera. La vie de tous les jours pourra en tre rchauffe et illumine.
Car le monde o nos sens et notre conscience nous introduisent habituellement n'est plus que l'ombre de lui-mme ; et il est froid comme la mort. Tout y
est arrang pour notre plus grande commodit, mais tout y est dans un prsent
qui semble recommencer sans cesse ; et nous-mmes artificiellement faonns
l'image d'un univers non moins artificiel, nous nous apercevons dans
l'instantan, nous parlons du pass comme de l'aboli, nous voyons dans le
souvenir un fait trange ou en tout cas tranger, un secours prt l'esprit par
la matire. Ressaisissons-nous au contraire, tels que nous sommes, dans un
prsent pais et, de plus, lastique, que nous pouvons dilater indfiniment vers
l'arrire en reculant de plus en plus loin l'cran qui nous masque nousmmes ; ressaisissons le monde extrieur tel qu'il est, non seulement en
surface, dans le moment actuel, mais en profondeur, avec le pass immdiat
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
79
qui le presse et qui lui imprime son lan ; habituons-nous, en un mot, voir
toutes choses sub specie durationis : aussitt le raidi se dtend, l'assoupi se
rveille, le mort ressuscite dans notre perception galvanise. Les satisfactions
que l'art ne fournira jamais qu' des privilgis de la nature et de la fortune, et
de loin en loin seulement, la philosophie ainsi entendue nous les offrirait
tous, tout moment, en rinsufflant la vie aux fantmes qui nous entourent et
en nous revivifiant nous-mmes. Par l elle deviendrait complmentaire de la
science dans la pratique aussi bien que dans la spculation. Avec ses applications qui ne visent que la commodit de l'existence, la science nous promet le
bien-tre, tout au plus le plaisir. Mais la philosophie pourrait dj nous donner
la joie.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
80
La pense et le mouvant Essais et confrences.
V
La perception du changement
Confrences faites l'Universit d'Oxford
les 26 et 27 mai 1911
premire confrence
Retour la table des matires
Mes premires paroles seront des paroles de remerciement l'Universit
d'Oxford pour le grand honneur qu'elle m'a fait en m'invitant venir parler
chez elle. Je me suis toujours reprsent Oxford comme un des rares sanctuaires o se conservent, pieusement entretenues, transmises par chaque
gnration la suivante, la chaleur et la lumire de la pense antique. Mais je
sais aussi que cet attachement l'antiquit n'empche pas votre Universit
d'tre trs moderne et trs vivante. Plus particulirement, en ce qui concerne la
philosophie, je suis frapp de voir avec quelle profondeur et quelle originalit
on tudie ici les philosophes anciens (rcemment encore, un de vos matres les
plus minents ne renouvelait-il pas sur des points essentiels l'interprtation de
la thorie platonicienne des Ides ?), et comment, d'autre part, Oxford est
l'avant-garde du mouvement philosophique avec les deux conceptions extrmes de la nature de la vrit : rationalisme intgral et pragmatisme. Cette
alliance du prsent et du pass est fconde dans tous les domaines : nulle part
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
81
elle ne l'est plus qu'en philosophie. Certes, nous avons quelque chose de
nouveau faire, et le moment est peut-tre venu de s'en rendre pleinement
compte ; mais, pour tre du nouveau, ce ne sera pas ncessairement du
rvolutionnaire. tudions plutt les anciens, imprgnons-nous de leur esprit, et
tchons de faire, dans la mesure de nos forces, ce qu'ils feraient eux-mmes
s'ils vivaient parmi nous. Initis notre science (je ne dis pas seulement
notre mathmatique et notre physique, qui ne changeraient peut-tre pas
radicalement leur manire de penser, mais surtout notre biologie et notre
psychologie), ils arriveraient des rsultats trs diffrents de ceux qu'ils ont
obtenus. C'est ce qui me frappe tout particulirement pour le problme que j'ai
entrepris de traiter devant vous, celui du changement.
Je l'ai choisi, parce que je le tiens pour capital, et parce que j'estime que, si
l'on tait convaincu de la ralit du changement et si l'on faisait effort pour le
ressaisir, tout se simplifierait. Des difficults philosophiques, qu'on juge
insurmontables, tomberaient. Non seulement la philosophie y gagnerait, mais
notre vie de tous les jours je veux dire l'impression que les choses font sur
nous et la raction de notre intelligence, de notre sensibilit et de notre volont
sur les choses en seraient peut-tre transformes et comme transfigures.
C'est que, d'ordinaire, nous regardons bien le changement, mais nous ne
l'apercevons pas. Nous parlons du changement, mais nous n'y pensons pas.
Nous disons que le changement existe, que tout change, que le changement est
la loi mme des choses : oui, nous le disons et nous le rptons ; mais ce ne
sont l que des mots, et nous raisonnons et philosophons comme si le
changement n'existait pas. Pour penser le changement et pour le voir, il y a
tout un voile de prjugs carter, les uns artificiels, crs par la spculation
philosophique, les autres naturels au sens commun. Je crois que nous finirons
par nous mettre d'accord l-dessus, et que nous constituerons alors une philosophie laquelle tous collaboreront, sur laquelle tous pourront s'entendre.
C'est pourquoi je voudrais fixer deux ou trois points sur lesquels l'entente me
parat dj faite ; elle s'tendra peu peu au reste. Notre premire confrence
portera donc moins sur le changement lui-mme que sur les caractres
gnraux d'une philosophie qui s'attacherait l'intuition du changement.
Voici d'abord un point sur lequel tout le monde s'accordera. Si les sens et
la conscience avaient une porte illimite, si, dans la double direction de la
matire et de l'esprit, la facult de percevoir tait indfinie, on n'aurait pas
besoin de concevoir, non plus que de raisonner. Concevoir est un pis aller
quand il n'est pas donn de percevoir, et le raisonnement est fait pour combler
les vides de la perception ou pour en tendre la porte. Je ne nie pas l'utilit
des ides abstraites et gnrales, pas plus que je ne conteste la valeur des
billets de banque. Mais de mme que le billet n'est qu'une promesse d'or, ainsi
une conception ne vaut que par les perceptions ventuelles qu'elle reprsente.
Il ne s'agit pas seulement, bien entendu, de la perception d'une chose, ou d'une
qualit, ou d'un tat. On peut concevoir un ordre, une harmonie, et plus
gnralement une vrit, qui devient alors une ralit. Je dis qu'on est d'accord
sur ce point. Tout le monde a pu constater, en effet, que les conceptions le
plus ingnieusement assembles et les raisonnements le plus savamment
chafauds s'croulent comme des chteaux de cartes le jour o un fait un
seul fait rellement aperu vient heurter ces conceptions et ces raisonnements. Il n'y a d'ailleurs pas un mtaphysicien, pas un thologien, qui ne soit
prt affirmer qu'un tre parfait est celui qui connat toutes choses
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
82
intuitivement, sans avoir passer par le raisonnement, l'abstraction et la
gnralisation. Donc, pas de difficult sur le premier point. Il n'y en aura pas
davantage sur le second, que voici. L'insuffisance de nos facults de perception insuffisance constate par nos facults de conception et de raisonnement est ce qui a donn naissance la philosophie. L'histoire des doctrines
en fait foi. Les conceptions des plus anciens penseurs de la Grce taient,
certes, trs voisines de la perception, puisque c'est par les transformations d'un
lment sensible, comme l'eau, l'air ou le feu, qu'elles compltaient la sensation immdiate. Mais ds que les philosophes de l'cole d'le, critiquant
l'ide de transformation, eurent montr ou cru montrer l'impossibilit de se
maintenir si prs des donnes des sens, la philosophie s'engagea dans la voie
o elle a march depuis, celle qui conduit un monde supra-sensible :
avec de pures ides , dsormais, on devait expliquer les choses. Il est vrai
que, pour les philosophes anciens, le monde intelligible tait situ en dehors et
au-dessus de celui que nos sens et notre conscience aperoivent : nos facults
de perception ne nous montraient que des ombres projetes dans le temps et
l'espace par les Ides immuables et ternelles. Pour les modernes, au contraire,
ces essences sont constitutives des choses sensibles elles-mmes ; ce sont de
vritables substances, dont les phnomnes ne sont que la pellicule superficielle. Mais tous, anciens et modernes, s'accordent voir dans la philosophie
une substitution du concept au percept. Tous en appellent, de l'insuffisance de
nos sens et de notre conscience, des facults de l'esprit qui ne sont plus
perceptives, je veux dire aux fonctions d'abstraction, de gnralisation et de
raisonnement.
Sur le second point nous pourrons donc nous mettre d'accord. J'arrive alors
au troisime, qui, je pense, ne soulvera pas non plus de discussion.
Si telle est bien la mthode philosophique, il n'y a pas, il ne peut pas y
avoir une philosophie, comme il y a une science ; il y aura toujours, au contraire, autant de philosophies diffrentes qu'il se rencontrera de penseurs
originaux. Comment en serait-il autrement ? Si abstraite que soit une conception, c'est toujours dans une perception qu'elle a son point de dpart. L'intelligence combine et spare ; elle arrange, drange, coordonne ; elle ne cre pas.
Il lui faut une matire, et cette matire ne peut lui venir que des sens ou de la
conscience. Une philosophie qui construit ou complte la ralit avec de pures
ides ne fera donc que substituer ou adjoindre, l'ensemble de nos perceptions
concrtes, telle ou telle d'entre elles labore, amincie, subtilise, convertie
par l en ide abstraite et gnrale. Mais, dans le choix qu'elle oprera de cette
perception privilgie, il y aura toujours quelque chose d'arbitraire, car la
science positive a pris pour elle tout ce qui est incontestablement commun
des choses diffrentes, la quantit, et il ne reste plus alors la philosophie que
le domaine de la qualit, o tout est htrogne tout, et o une partie ne
reprsentera jamais l'ensemble qu'en vertu d'un dcret contestable, sinon
arbitraire. ce dcret on pourra toujours en opposer d'autres. Et bien des
philosophies diffrentes surgiront, armes de concepts diffrents. Elles
lutteront indfiniment entre elles.
Voici alors la question qui se pose, et que je tiens pour essentielle. Puisque
tout essai de philosophie purement conceptuelle suscite des tentatives antagonistes et que, sur le terrain de la dialectique pure, il n'y a pas de systme
auquel on ne puisse en opposer un autre, resterons-nous sur ce terrain, ou ne
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
83
devrions-nous pas plutt (sans renoncer, cela va sans dire, l'exercice des
facults de conception et de raisonnement) revenir la perception, obtenir
qu'elle se dilate et s'tende ? Je disais que c'est l'insuffisance de la perception
naturelle qui a pouss les philosophes complter la perception par la conception, celle-ci devant combler les intervalles entre les donnes des sens ou de
la conscience et, par l, unifier et systmatiser notre connaissance des choses.
Mais l'examen des doctrines nous montre que la facult de concevoir, au fur et
mesure qu'elle avance dans ce travail d'intgration, est rduite liminer du
rel un grand nombre de diffrences qualitatives, d'teindre en partie nos
perceptions, d'appauvrir notre vision concrte de l'univers. C'est mme parce
que chaque philosophie est amene, bon gr mal gr, procder ainsi, qu'elle
suscite des philosophies antagonistes, dont chacune relve quelque chose de
ce que celle-l a laiss tomber. La mthode va donc contre le but : elle devait,
en thorie, tendre et complter la perception ; elle est oblige, en fait, de
demander une foule de perceptions de s'effacer pour que telle ou telle d'entre
elles puisse devenir reprsentative des autres. Mais supposez qu'au lieu de
vouloir nous lever au-dessus de notre perception des choses, nous nous
enfoncions en elle pour la creuser et l'largir. Supposez que nous y insrions
notre volont, et que cette volont se dilatant, dilate notre vision des choses.
Nous obtiendrons cette fois une philosophie o rien ne serait sacrifi des
donnes des sens et de la conscience : aucune qualit, aucun aspect du rel, ne
se substituerait au reste sous prtexte de l'expliquer. Mais surtout nous aurions
une philosophie laquelle on ne pourrait en opposer d'autres, car elle n'aurait
rien laiss en dehors d'elle que d'autres doctrines pussent ramasser : elle aurait
tout pris. Elle aurait pris tout ce qui est donn, et mme plus que ce qui est
donn, car les sens et la conscience, convis par elle un effort exceptionnel,
lui auraient livr plus qu'ils ne fournissent naturellement. la multiplicit des
systmes qui luttent entre eux, arms de concepts diffrents, succderait
l'unit d'une doctrine capable de rconcilier tous les penseurs dans une mme
perception, perception qui irait d'ailleurs s'largissant, grce l'effort
combin des philosophes dans une direction commune.
On dira que cet largissement est impossible. Comment demander aux
yeux du corps, ou ceux de l'esprit, de voir plus qu'ils ne voient ? L'attention
peut prciser, clairer, intensifier : elle ne fait pas surgir, dans le champ de la
perception, ce qui ne s'y trouvait pas d'abord. Voil l'objection. Elle est rfute, croyons-nous, par l'exprience. Il y a, en effet, depuis des sicles, des
hommes dont la fonction est justement de voir et de nous faire voir ce que
nous n'apercevons pas naturellement. Ce sont les artistes.
quoi vise l'art, sinon nous montrer, dans la nature et dans l'esprit, hors
de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et
notre conscience ? Le pote et le romancier qui expriment un tat d'me ne le
crent certes pas de toutes pices ; ils ne seraient pas compris de nous si nous
n'observions pas en nous, jusqu' un certain point, ce qu'ils nous disent
d'autrui. Au fur et mesure qu'ils nous parlent, des nuances d'motion et de
pense nous apparaissent qui pouvaient tre reprsentes en nous depuis
longtemps, mais qui demeuraient invisibles : telle, l'image photographique qui
n'a pas encore t plonge dans le bain o elle se rvlera. Le pote est ce
rvlateur. Mais nulle part la fonction de l'artiste ne se montre aussi clairement que dans celui des arts qui fait la plus large place l'imitation, je veux
dire la peinture. Les grands peintres sont des hommes auxquels remonte une
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
84
certaine vision des choses qui est devenue ou qui deviendra la vision de tous
les hommes. Un Corot, un Turner, pour ne citer que ceux-l, ont aperu dans
la nature bien des aspects que nous ne remarquions pas. Dira-t-on qu'ils
n'ont pas vu, mais cr, qu'ils nous ont livr des produits de leur imagination,
que nous adoptons leurs inventions parce qu'elles nous plaisent, et que nous
nous amusons simplement regarder la nature travers l'image que les grands
peintres nous en ont trace ? C'est vrai dans une certaine mesure ; mais, s'il
en tait uniquement ainsi, pourquoi dirions-nous de certaines uvres celles
des matres qu'elles sont vraies ? o serait la diffrence entre le grand art et
la pure fantaisie ? Approfondissons ce que nous prouvons devant un Turner
ou un Corot : nous trouverons que, si nous les acceptons et les admirons, c'est
que nous avions dj peru quelque chose de ce qu'ils nous montrent. Mais
nous avions peru sans apercevoir. C'tait, pour nous, une vision brillante et
vanouissante, perdue dans la foule de ces visions galement brillantes, galement vanouissantes, qui se recouvrent dans notre exprience usuelle comme
des dissolving views et qui constituent, par leur interfrence rciproque, la
vision ple et dcolore que nous avons habituellement des choses. Le peintre
l'a isole ; il l'a si bien fixe sur la toile que, dsormais, nous ne pourrons nous
empcher d'apercevoir dans la ralit ce qu'il y a vu lui-mme.
L'art suffirait donc nous montrer qu'une extension des facults de percevoir est possible. Mais comment s'opre-t-elle ? Remarquons que l'artiste a
toujours pass pour un idaliste . On entend par l qu'il est moins proccup que nous du ct positif et matriel de la vie. C'est, au sens propre du
mot, un distrait . Pourquoi, tant plus dtach de la ralit, arrive-t-il y
voir plus de choses ? On ne le comprendrait pas, si la vision que nous avons
ordinairement des objets extrieurs et de nous-mmes n'tait une vision que
notre attachement la ralit, notre besoin de vivre et d'agir, nous a amens
rtrcir et vider. De fait, il serait ais de montrer que, plus nous sommes
proccups de vivre, moins nous sommes enclins contempler, et que les
ncessits de l'action tendent limiter le champ de la vision. Je ne puis entrer
dans la dmonstration de ce point ; jestime que beaucoup de questions
psychologiques et psycho-physiologiques s'claireraient d'une lumire nouvelle si l'on reconnaissait que la perception distincte est simplement dcoupe,
par les besoins de la vie pratique, dans un ensemble plus vaste. Nous aimons,
en psychologie et ailleurs, aller de la partie au tout, et notre systme habituel
d'explication consiste reconstruire idalement notre vie mentale avec des
lments simples, puis supposer que la composition entre eux de ces
lments a rellement produit notre vie mentale. Si les choses se passaient
ainsi, notre perception serait en effet inextensible ; elle serait faite de l'assemblage de certains matriaux dtermins, en quantit dtermine, et nous n'y
trouverions jamais autre chose que ce qui aurait t dpos en elle d'abord.
Mais les faits, quand on les prend tels quels, sans arrire-pense d'expliquer
l'esprit mcaniquement, suggrent une tout autre interprtation. Ils nous
montrent, dans la vie psychologique normale, un effort constant de l'esprit
pour limiter son horizon, pour se dtourner de ce qu'il a un intrt matriel
ne pas voir. Avant de philosopher, il faut vivre ; et la vie exige que nous nous
mettions des illres, que nous regardions non pas droite, gauche ou en
arrire, mais droit devant nous dans la direction o nous avons marcher. Notre
connaissance, bien loin de se constituer par une association graduelle
d'lments simples, est l'effet d'une dissociation brusque : dans le champ
immensment vaste de notre connaissance virtuelle nous avons cueilli, pour
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
85
en faire une connaissance actuelle, tout ce qui intresse notre action sur les
choses; nous avons nglig le reste. Le cerveau parat avoir t construit en
vue de ce travail de slection. On le montrerait sans peine pour les oprations
de la mmoire. Notre pass, ainsi que nous le verrons dans notre prochaine
confrence, se conserve ncessairement, automatiquement. Il survit tout
entier. Mais notre intrt pratique est de l'carter, ou du moins de n'en accepter
que ce qui peut clairer et complter plus ou moins utilement la situation
prsente. Le cerveau sert effectuer ce choix : il actualise les souvenirs utiles,
il maintient dans le sous-sol de la conscience ceux qui ne serviraient rien.
On en dirait autant de la perception. Auxiliaire de l'action, elle isole, dans
l'ensemble de la ralit, ce qui nous intresse ; elle nous montre moins les
choses mmes que le parti que nous en pouvons tirer. Par avance elle les
classe, par avance elle les tiquette ; nous regardons peine l'objet, il nous
suffit de savoir quelle catgorie il appartient. Mais, de loin en loin, par un
accident heureux, des hommes surgissent dont les sens ou la conscience sont
moins adhrents la vie. La nature a oubli d'attacher leur facult de percevoir
leur facult d'agir. Quand ils regardent une chose, ils la voient pour elle, et
non plus pour eux. Ils ne peroivent plus simplement en vue d'agir; ils
peroivent pour percevoir, pour rien, pour le plaisir. Par un certain ct
d'eux-mmes, soit par leur conscience soit par un de leurs sens, ils naissent
dtachs ; et, selon que ce dtachement est celui de tel ou tel sens, ou de la
conscience, ils sont peintres ou sculpteurs, musiciens ou potes. C'est donc
bien une vision plus directe de la ralit que nous trouvons dans les diffrents
arts ; et c'est parce que l'artiste songe moins utiliser sa perception qu'il
peroit un plus grand nombre de choses.
Eh bien, ce que la nature fait de loin en loin, par distraction, pour quelques
privilgis, la philosophie, en pareille matire, ne pourrait-elle pas le tenter,
dans un autre sens et d'une autre manire, pour tout le monde ? Le rle de la
philosophie ne serait-il pas ici de nous amener une perception plus complte
de la ralit par un certain dplacement de notre attention ? Il s'agirait de
dtourner cette attention du ct pratiquement intressant de l'univers et de la
retourner vers ce qui, pratiquement, ne sert rien. Cette conversion de
l'attention serait la philosophie mme.
Au premier abord, il semble que ce soit fait depuis longtemps. Plus d'un
philosophe a dit, en effet, qu'il fallait se dtacher pour philosopher, et que
spculer tait l'inverse d'agir. Nous parlions tout l'heure des philosophes
grecs : nul n'a exprim l'ide avec plus de force que Plotin. Toute action,
disait-il (et il ajoutait mme toute fabrication ), est un affaiblissement de la
contemplation (pantakhou d aneursomen tn poisin kai tn praxin
astheneian therias parakolouthma). Et, fidle l'esprit de Platon, il
pensait que la dcouverte du vrai exige une conversion (epistroph) de l'esprit,
qui se dtache des apparences d'ici-bas et s'attache aux ralits de l-haut :
Fuyons vers notre chre patrie ! Mais, comme vous le voyez, il s'agissait
de fuir . Plus prcisment, pour Platon et pour tous ceux qui ont entendu
ainsi la mtaphysique, se dtacher de la vie et convertir son attention consiste
se transporter tout de suite dans un monde diffrent de celui o nous vivons,
susciter des facults de perception autres que les sens et la conscience. Ils
n'ont pas cru que cette ducation de l'attention pt consister le plus souvent
lui retirer ses illres, la dshabituer du rtrcissement que les exigences de
la vie lui imposent. Ils n'ont pas jug que le mtaphysicien, pour une moiti au
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
86
moins de ses spculations, dt continuer regarder ce que tout le monde
regarde : non, il faudrait toujours se tourner vers autre chose. De l vient qu'ils
font invariablement appel des facults de vision diffrentes de celles que
nous exerons, tout instant, dans la connaissance du monde extrieur et de
nous-mmes.
Et c'est justement parce qu'il contestait l'existence de ces facults transcendantes que Kant a cru la mtaphysique impossible. Une des ides les plus
importantes et les plus profondes de la Critique de la Raison pure est celle-ci :
que, si la mtaphysique est possible, c'est par une vision, et non par une
dialectique. La dialectique nous conduit des philosophies opposes ; elle
dmontre aussi bien la thse que l'antithse des antinomies. Seule, une intuition suprieure (que Kant appelle une intuition intellectuelle ), c'est--dire
une perception de la ralit mtaphysique, permettrait la mtaphysique de se
constituer. Le rsultat le plus clair de la Critique kantienne est ainsi de
montrer qu'on ne pourrait pntrer dans l'au-del que par une vision, et qu'une
doctrine ne vaut, dans ce domaine, que par ce qu'elle contient de perception :
prenez cette perception, analysez-la, recomposez-la, tournez et retournez-la
dans tous les sens, faites-lui subir les plus subtiles oprations de la plus haute
chimie intellectuelle, vous ne retirerez jamais de votre creuset que ce que vous
y aurez mis ; tant vous y aurez introduit de vision, tant vous en retrouverez ; et
le raisonnement ne vous aura pas fait avancer d'un pas au del de ce que vous
aviez peru d'abord. Voil ce que Kant a dgag en pleine lumire ; et c'est l,
mon sens, le plus grand service qu'il ait rendu la philosophie spculative. Il
a dfinitivement tabli que, si la mtaphysique est possible, ce ne peut tre
que par un effort d'intuition. Seulement, ayant prouv que l'intuition serait
seule capable de nous donner une mtaphysique, il ajouta : cette intuition est
impossible.
Pourquoi la jugea-t-il impossible ? Prcisment parce qu'il se reprsenta
une vision de ce genre je veux dire une vision de la ralit en soi
comme se l'tait reprsente Plotin, comme se la sont reprsente en gnral
ceux qui ont fait appel l'intuition mtaphysique. Tous ont entendu par l une
facult de connatre qui se distinguerait radicalement de la conscience aussi
bien que des sens, qui serait mme oriente dans la direction inverse. Tous ont
cru que se dtacher de la vie pratique tait lui tourner le dos.
Pourquoi l'ont-ils cru ? Pourquoi Kant, leur adversaire, a-t-il partag leur
erreur ? Pourquoi tous ont-ils jug ainsi, quittes en tirer des conclusions
opposes, ceux-l construisant aussitt une mtaphysique, celui-ci dclarant la
mtaphysique impossible ?
Ils l'ont cru, parce qu'ils se sont imagin que nos sens et notre conscience,
tels qu'ils fonctionnent dans la vie de tous les jours, nous faisaient saisir
directement le mouvement. Ils ont cru que par nos sens et notre conscience,
travaillant comme ils travaillent d'ordinaire, nous apercevions rellement le
changement dans les choses et le changement en nous. Alors, comme il est
incontestable qu'en suivant les donnes habituelles de nos sens et de notre
conscience nous aboutissons, dans l'ordre de la spculation, des contradictions insolubles, ils ont conclu de l que la contradiction tait inhrente au
changement lui-mme et que, pour se soustraire cette contradiction, il fallait
sortir de la sphre du changement et s'lever au-dessus du Temps. Tel est le
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
87
fond de la pense des mtaphysiciens, comme aussi de ceux qui, avec Kant,
nient la possibilit de la mtaphysique.
La mtaphysique est ne, en effet, des arguments de Znon d'le relatifs
au changement et au mouvement. C'est Znon qui, en attirant l'attention sur
l'absurdit de ce qu'il appelait mouvement et changement, amena les
philosophes Platon tout le premier chercher la ralit cohrente et vraie
dans ce qui ne change pas. Et c'est parce que Kant crut que nos sens et notre
conscience s'exercent effectivement dans un Temps vritable, je veux dire
dans un Temps qui change sans cesse, dans une dure qui dure, c'est parce
que, d'autre part, il se rendait compte de la relativit des donnes usuelles de
nos sens et de notre conscience (arrte d'ailleurs par lui bien avant le terme
transcendant de son effort) qu'il jugea la mtaphysique impossible sans une
vision tout autre que celle des sens et de la conscience, vision dont il ne
trouvait d'ailleurs aucune trace chez l'homme.
Mais si nous pouvions tablir que ce qui a t considr comme du
mouvement et du changement par Znon d'abord, puis par les mtaphysiciens
en gnral, n'est ni changement ni mouvement, qu'il ont retenu du changement
ce qui ne change pas et du mouvement ce qui ne se meut pas, qu'ils ont pris
pour une perception immdiate et complte du mouvement et du changement
une cristallisation de cette perception, une solidification en vue de la pratique
et si nous pouvions montrer, d'autre part, que ce qui a t pris par Kant pour le
temps lui-mme est un temps qui ne coule ni ne change ni ne dure ; alors,
pour se soustraire des contradictions comme celles que Znon a signales et
pour dgager notre connaissance journalire de la relativit dont Kant la
croyait frappe, il n'y aurait pas sortir du temps (nous en sommes dj
sortis !), il n'y aurait pas se dgager du changement (nous ne nous en
sommes que trop dgags !), il faudrait, au contraire, ressaisir le changement
et la dure dans leur mobilit originelle. Alors, nous ne verrions pas seulement
tomber une une bien des difficults et s'vanouir plus d'un problme : par
l'extension et la revivification de notre facult de percevoir, peut-tre aussi
(mais il n'est pas question pour le moment de s'lever de telles hauteurs) par
un prolongement que donneront l'intuition des mes privilgies, nous
rtablirions la continuit dans l'ensemble de nos connaissances, continuit
qui ne serait plus hypothtique et construite, mais exprimente et vcue. Un
travail de ce genre est-il possible ? C'est ce que nous chercherons ensemble,
au moins pour ce qui concerne la connaissance de notre entourage, dans notre
seconde confrence.
Deuxime confrence
Retour la table des matires
Vous m'avez prt hier une attention si soutenue que vous ne devrez pas
vous tonner si je suis tent d'en abuser aujourd'hui. Je vais vous demander de
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
88
faire un effort violent pour carter quelques-uns des schmas artificiels que
nous interposons, notre insu, entre la ralit et nous. Il s'agit de rompre avec
certaines habitudes de penser et de percevoir qui nous sont devenues naturelles. Il faut revenir la perception directe du changement et de la mobilit.
Voici un premier rsultat de cet effort. Nous nous reprsenterons tout
changement, tout mouvement, comme absolument indivisibles.
Commenons par le mouvement. J'ai la main au point A. Je la transporte
au point B, parcourant l'intervalle AB. Je dis que ce mouvement de A en B est
chose simple.
Mais c'est de quoi chacun de nous a la sensation immdiate. Sans doute,
pendant que nous portons notre main de A en B, nous nous disons que nous
pourrions l'arrter en un point intermdiaire, mais nous n'aurions plus affaire
alors au mme mouvement. Il n'y aurait plus un mouvement unique de A en
B ; il y aurait, par hypothse, deux mouvements, avec un intervalle d'arrt. Ni
du dedans, par le sens musculaire, ni du dehors par la vue, nous n'aurions
encore la mme perception. Si nous laissons notre mouvement de A en B tel
qu'il est, nous le sentons indivis et nous devons le dclarer indivisible.
Il est vrai que, lorsque je regarde ma main allant de A en B et dcrivant
l'intervalle AB, je me dis : l'intervalle AB peut se diviser en autant de parties
que je le veux, donc le mouvement de A en B peut se diviser en autant de
parties qu'il me plat, puisque ce mouvement s'applique sur cet intervalle.
Ou bien encore : chaque instant de son trajet, le mobile passe en un certain
point, donc on peut distinguer dans le mouvement autant d'tapes qu'on
voudra, donc le mouvement est infiniment divisible. Mais rflchissons-y un
instant. Comment le mouvement pourrait-il s'appliquer sur l'espace qu'il
parcourt ? comment du mouvant conciderait-il avec de l'immobile ? comment
l'objet qui se meut serait-il en un point de son trajet ? Il y passe, ou, en
d'autres termes, il pourrait y tre. Il y serait s'il s'y arrtait ; mais, s'il s'y
arrtait, ce n'est plus au mme mouvement que nous aurions affaire. C'est
toujours d'un seul bond qu'un trajet est parcouru, quand il n'y a pas d'arrt sur
le trajet. Le bond peut durer quelques secondes, ou des jours, des mois, des
annes : peu importe. Du moment qu'il est unique, il est indcomposable.
Seulement, une fois le trajet effectu, comme la trajectoire est espace et que
l'espace est indfiniment divisible, nous nous figurons que le mouvement luimme est divisible indfiniment. Nous aimons nous le figurer, parce que,
dans un mouvement, ce n'est pas le changement de position qui nous intresse,
ce sont les positions elles-mmes, celle que le mobile a quitte, celle qu'il
prendra, celle qu'il prendrait s'il s'arrtait en route. Nous avons besoin d'immobilit, et plus nous russirons nous reprsenter le mouvement comme
concidant avec les immobilits des points de l'espace qu'il parcourt, mieux
nous croirons le comprendre. vrai dire, il n'y a jamais d'immobilit vritable, si nous entendons par l une absence de mouvement. Le mouvement est la
ralit mme, et ce que nous appelons immobilit est un certain tat de choses
analogue ce qui se produit quand deux trains marchent avec la mme vitesse,
dans le mme sens, sur deux voies parallles : chacun des deux trains est alors
immobile pour les voyageurs assis dans l'autre. Mais une situation de ce
genre, qui est en somme exceptionnelle, nous semble tre la situation rgulire
et normale, parce que c'est celle qui nous permet d'agir sur les choses et qui
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
89
permet aussi aux choses d'agir sur nous : les voyageurs des deux trains ne
peuvent se tendre la main par la portire et causer ensemble que s'ils sont
immobiles , c'est--dire s'ils marchent dans le mme sens avec la mme
vitesse. L' immobilit tant ce dont notre action a besoin, nous l'rigeons en
ralit, nous en faisons un absolu, et nous voyons dans le mouvement quelque
chose qui s'y surajoute. Rien de plus lgitime dans la pratique. Mais lorsque
nous transportons cette habitude d'esprit dans le domaine de la spculation,
nous mconnaissons la ralit vraie, nous crons, de gaiet de cur, des
problmes insolubles, nous fermons les yeux ce qu'il y a de plus vivant dans
le rel.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler les arguments de Znon d'le. Tous
impliquent la confusion du mouvement avec l'espace parcouru, ou tout au
moins la conviction qu'on peut traiter le mouvement comme on traite l'espace,
le diviser sans tenir compte de ses articulations. Achille, nous dit-on, n'atteindra jamais la tortue qu'il poursuit, car lorsqu'il arrivera au point o tait la
tortue, celle-ci aura eu le temps de marcher, et ainsi de suite indfiniment. Les
philosophes ont rfut cet argument de bien des manires, et de manires si
diffrentes que chacune de ces rfutations enlve aux autres le droit de se
croire dfinitives. Il y aurait eu pourtant un moyen trs simple de trancher la
difficult : c'et t d'interroger Achille. Car, puisque Achille finit par
rejoindre la tortue et mme par la dpasser, il doit savoir, mieux que personne,
comment il s'y prend. Le philosophe ancien qui dmontrait la possibilit du
mouvement en marchant tait dans le vrai : son seul tort fut de faire le geste
sans y joindre un commentaire. Demandons alors Achille de commenter sa
course : voici, sans aucun doute, ce qu'il nous rpondra. Znon veut que je
me rende du point o je suis au point que la tortue a quitt, de celui-ci au point
qu'elle a quitt encore, etc. ; c'est ainsi qu'il procde pour me faire courir. Mais
moi, pour courir, je m'y prends autrement. Je fais un premier pas, puis un
second, et ainsi de suite : finalement, aprs un certain nombre de pas, j'en fais
un dernier par lequel j'enjambe la tortue. J'accomplis ainsi une srie d'actes
indivisibles. Ma course est la srie de ces actes. Autant elle comprend de pas,
autant vous pouvez y distinguer de parties. Mais vous n'avez pas le droit de la
dsarticuler selon une autre loi, ni de la supposer articule d'une autre
manire. Procder comme le fait Znon, c'est admettre que la course peut tre
dcompose arbitrairement, comme l'espace parcouru ; c'est croire que le
trajet s'applique rellement contre la trajectoire ; c'est faire concider et par
consquent confondre ensemble mouvement et immobilit.
Mais en cela consiste prcisment notre mthode habituelle. Nous
raisonnons sur le mouvement comme s'il tait fait d'immobilits, et, quand
nous le regardons, c'est avec des immobilits que nous le reconstituons. Le
mouvement est pour nous une position, puis une nouvelle position, et ainsi de
suite indfiniment. Nous nous disons bien, il est vrai, qu'il doit y avoir autre
chose, et que, d'une position une position, il y a le passage par lequel se
franchit l'intervalle. Mais, ds que nous fixons notre attention sur ce passage,
vite nous en faisons une srie de positions, quittes reconnatre encore
qu'entre deux positions successives il faut bien supposer un passage. Ce passage, nous reculons indfiniment le moment de l'envisager. Nous admettons
qu'il existe, nous lui donnons un nom, cela nous suffit : une fois en rgle de ce
ct, nous nous tournons vers les positions et nous prfrons n'avoir affaire
qu' elles. Nous avons instinctivement peur des difficults que susciterait
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
90
notre pense la vision du mouvement dans ce qu'il a de mouvant ; et nous
avons raison, du moment que le mouvement a t charg par nous
d'immobilits. Si le mouvement n'est pas tout, il n'est rien ; et si nous avons
d'abord pos que l'immobilit peut tre une ralit, le mouvement glissera
entre nos doigts quand nous croirons le tenir.
Jai parl du mouvement ; mais j'en dirais autant de n'importe quel changement. Tout changement rel est un changement indivisible. Nous aimons
le traiter comme une srie d'tats distincts qui s'aligneraient, en quelque sorte,
dans le temps. C'est naturel encore. Si le changement est continuel en nous et
continuel aussi dans les choses, en revanche, pour que le changement ininterrompu que chacun de nous appelle moi puisse agir sur le changement
ininterrompu que nous appelons une chose , il faut que ces deux changements se trouvent, l'un par rapport l'autre, dans une situation analogue celle
des deux trains dont nous parlions tout l'heure. Nous disons par exemple
qu'un objet change de couleur, et que le changement consiste ici dans une
srie de teintes qui seraient les lments constitutifs du changement et qui,
elles, ne changeraient pas. Mais, d'abord, ce qui existe objectivement de chaque teinte, c'est une oscillation infiniment rapide, c'est du changement. Et,
d'autre part, la perception que nous en avons, dans ce qu'elle a de subjectif,
n'est qu'un aspect isol, abstrait, de l'tat gnral de notre personne, lequel
change globalement sans cesse et fait participer son changement cette
perception dite invariable : en fait, il n'y a pas de perception qui ne se modifie
chaque instant. De sorte que la couleur, en dehors de nous, est la mobilit
mme, et que notre propre personne est mobilit encore. Mais tout le mcanisme de notre perception des choses, comme celui de notre action sur les
choses, a t rgl de manire amener ici, entre la mobilit externe et la
mobilit intrieure, une situation comparable celle de nos deux trains, plus
complique, sans doute, mais du mme genre : quand les deux changements,
celui de l'objet et celui du sujet, ont lieu dans ces conditions particulires, ils
suscitent l'apparence particulire que nous appelons un tat . Et, une fois en
possession d' tats , notre esprit recompose avec eux le changement. Rien
de plus naturel, je le rpte : le morcelage du changement en tats nous met
mme d'agir sur les choses, et il est pratiquement utile de s'intresser aux tats
plutt qu'au changement lui-mme. Mais ce qui favorise ici l'action serait
mortel la spculation. Reprsentez-vous un changement comme rellement
compos d'tats : du mme coup vous faites surgir des problmes mtaphysiques insolubles. Ils ne portent que sur des apparences. Vous avez ferm les
yeux la ralit vraie.
Je n'insisterai pas davantage. Que chacun de nous fasse l'exprience, qu'il
se donne la vision directe d'un changement, d'un mouvement : il aura un
sentiment d'absolue indivisibilit. J'arrive alors au second point, qui est trs
voisin du premier. Il y a des changements, mais il n'y a pas, sous le changement, de choses qui changent : le changement n'a pas besoin d'un support. Il y
a des mouvements, mais il n'y a pas d'objet inerte, invariable, qui se meuve :
le mouvement n'implique pas un mobile 1.
1
Nous reproduisons ces vues sous la forme mme que nous leur donnmes dans notre
confrence, sans nous dissimuler qu'elles susciteront probablement les mmes malentendus qu'alors, malgr les applications et les explications que nous avons prsentes dans
des travaux ultrieurs. De ce qu'un tre est action peut-on conclure que son existence soit
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
91
On a de la peine se reprsenter ainsi les choses, parce que le sens par
excellence est celui de la vue, et que lil a pris l'habitude de dcouper, dans
l'ensemble du champ visuel, des figures relativement invariables qui sont
censes alors se dplacer sans se dformer : le mouvement se surajouterait au
mobile comme un accident. Il est en effet utile d'avoir affaire, tous les jours,
des objets stables et, en quelque sorte, responsables, auxquels on s'adresse
comme des personnes. Le sens de la vue s'arrange pour prendre les choses
de ce biais : claireur du toucher, il prpare notre action sur le monde extrieur. Mais dj nous aurons moins de peine percevoir le mouvement et le
changement comme des ralits indpendantes si nous nous adressons au sens
de l'oue. coutons une mlodie en nous laissant bercer par elle : n'avons-nous
pas la perception nette d'un mouvement qui n'est pas attach un mobile, d'un
changement sans rien qui change ? Ce changement se suffit, il est la chose
mme. Et il a beau prendre du temps, il est indivisible : si la mlodie s'arrtait
plus tt, ce ne serait plus la mme masse sonore ; c'en serait une autre, galement indivisible. Sans doute nous avons une tendance la diviser et nous
reprsenter, au lieu de la continuit ininterrompue de la mlodie, une juxtaposition de notes distinctes. Mais pourquoi ? Parce que nous pensons la srie
discontinue d'efforts que nous ferions pour recomposer approximativement le
son entendu en chantant nous-mmes, et aussi parce que notre perception
auditive a pris l'habitude de s'imprgner d'images visuelles. Nous coutons
alors la mlodie travers la vision qu'en aurait un chef d'orchestre regardant
sa partition. Nous nous reprsentons des notes juxtaposes des notes sur une
feuille de papier imaginaire. Nous pensons un clavier sur lequel on joue,
l'archet qui va et qui vient, au musicien dont chacun donne sa partie ct des
autres. Faisons abstraction de ces images spatiales : il reste le changement pur,
se suffisant lui-mme, nullement divis, nullement attach une chose
qui change.
Revenons alors la vue. En fixant davantage notre attention, nous nous
apercevrons qu'ici mme le mouvement n'exige pas un vhicule, ni le changement une substance, au sens courant du mot. Dj la science physique nous
suggre cette vision des choses matrielles. Plus elle progresse, plus elle
rsout la matire en actions qui cheminent travers l'espace, en mouvements
qui courent et l comme des frissons, de sorte que la mobilit devient la
ralit mme. Sans doute la science commence par assigner cette mobilit
un support. Mais, mesure qu'elle avance, le support recule ; les masses se
pulvrisent en molcules, les molcules en atomes, les atomes en lectrons ou
corpuscules : finalement, le support assign au mouvement semble bien n'tre
qu'un schma commode, simple concession du savant aux habitudes de
notre imagination visuelle. Mais point n'est besoin d'aller aussi loin. Qu'est-ce
que le mobile auquel notre il attache le mouvement, comme un
vhicule ? Simplement une tache colore, dont nous savons bien qu'elle se
rduit, en elle-mme, une srie d'oscillations extrmement rapides. Ce prvanouissante ? Que dit-on de plus que nous quand on le fait rsider dans un
substratum , qui n'a rien de dtermin puisque, par hypothse, sa dtermination et par
consquent son essence est cette action mme ? Une existence ainsi conue cesse-t-elle
jamais d'tre prsente elle-mme, la dure relle impliquant la persistance du pass dans
le prsent et la continuit indivisible d'un droulement ? Tous les malentendus proviennent de ce qu'on a abord les applications de notre conception de la dure relle avec
l'ide qu'on se faisait du temps spatialis.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
92
tendu mouvement d'une chose n'est en ralit qu'un mouvement de
mouvements.
Mais nulle part la substantialit du changement n'est aussi visible, aussi
palpable, que dans le domaine de la vie intrieure. Les difficults et contradictions de tout genre auxquelles ont abouti les thories de la personnalit
viennent de ce qu'on s'est reprsent, d'une part, une srie d'tats psychologiques distincts, chacun invariable, qui produiraient les variations du moi par
leur succession mme, et d'autre part un moi, non moins invariable, qui leur
servirait de support. Comment cette unit et cette multiplicit pourraient-elles
se rejoindre ? comment, ne durant ni l'une ni l'autre la premire parce que le
changement est quelque chose qui s'y surajoute, la seconde parce qui elle est
faite d'lments qui ne changent pas pourraient-elles constituer un moi qui
dure ? Mais la vrit est qu'il n'y a ni un substratum rigide immuable ni des
tats distincts qui y passent comme des acteurs sur une scne. Il y a simplement la mlodie continue de notre vie intrieure, mlodie qui se poursuit et
se poursuivra, indivisible, du commencement la fin de notre existence
consciente. Notre personnalit est cela mme.
C'est justement cette continuit indivisible de changement qui constitue la
dure vraie. Je ne puis entrer ici dans l'examen approfondi d'une question que
j'ai traite ailleurs. Je me bornerai donc dire, pour rpondre ceux qui voient
dans cette dure relle je ne sais quoi d'ineffable et de mystrieux, qu'elle
est la chose la plus claire du monde : la dure relle est ce que l'on a toujours
appel le temps, mais le temps peru comme indivisible. Que le temps implique la succession, je n'en disconviens pas. Mais que la succession se prsente
d'abord notre conscience comme la distinction d'un avant et d'un
aprs juxtaposs, c'est ce que je ne saurais accorder. Quand nous coutons
une mlodie, nous avons la plus pure impression de succession que nous
puissions avoir, une impression aussi loigne que possible de celle de la
simultanit, et pourtant c'est la continuit mme de la mlodie et l'impossibilit de la dcomposer qui font sur nous cette impression. Si nous la
dcoupons en notes distinctes, en autant d' avant et d aprs qu'il nous
plat, c'est que nous y mlons des images spatiales et que nous imprgnons la
succession de simultanit : dans l'espace, et dans l'espace seulement, il y a
distinction nette de parties extrieures les unes aux autres. Je reconnais
d'ailleurs que c'est dans le temps spatialis que nous nous plaons d'ordinaire.
Nous n'avons aucun intrt couter le bourdonnement ininterrompu de la vie
profonde. Et pourtant la dure relle est l. C'est grce elle que prennent
place dans un seul et mme temps les changements plus ou moins longs auxquels nous assistons en nous et dans le monde extrieur.
Ainsi, qu'il s'agisse du dedans ou du dehors, de nous ou des choses, la
ralit est la mobilit mme. C'est ce que j'exprimais en disant qu'il y a du
changement, mais qu'il n'y a pas de choses qui changent.
Devant le spectacle de cette mobilit universelle, quelques-uns d'entre
nous seront pris de vertige. Ils sont habitus la terre ferme ; ils ne peuvent se
faire au roulis et au tangage. Il leur faut des points fixes auxquels attacher
la pense et l'existence. Ils estiment que si tout passe, rien n'existe ; et que si la
ralit est mobilit, elle n'est dj plus au moment o on la pense, elle chappe
la pense. Le monde matriel, disent-ils, va se dissoudre, et l'esprit se noyer
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
93
dans le flux torrentueux des choses. Qu'ils se rassurent ! Le changement,
s'ils consentent le regarder directement, sans voile interpos, leur apparatra
bien vite comme ce qu'il peut y avoir au monde de plus substantiel et de plus
durable. Sa solidit est infiniment suprieure celle d'une fixit qui n'est qu'un
arrangement phmre entre des mobilits. J'arrive ici, en effet, au troisime
point sur lequel je voulais attirer votre attention.
C'est que, si le changement est rel et mme constitutif de la ralit, nous
devons envisager le pass tout autrement que nous n'avons t habitus le
faire par la philosophie et par le langage. Nous inclinons nous reprsenter
notre pass comme de l'inexistant, et les philosophes encouragent chez nous
cette tendance naturelle. Pour eux et pour nous, le prsent seul existe par luimme : si quelque chose survit du pass, ce ne peut tre que par un secours
que le prsent lui prte, par une charit que le prsent lui fait, enfin, pour sortir
des mtaphores, par l'intervention d'une certaine fonction particulire qui
s'appelle la mmoire et dont le rle serait de conserver exceptionnellement
telles ou telles parties du pass en les emmagasinant dans une espce de bote.
Erreur profonde ! erreur utile, je le veux bien, ncessaire peut-tre l'action,
mais mortelle la spculation. On y trouverait, enfermes in a nutshell ,
comme vous dites, la plupart des illusions qui peuvent vicier la pense
philosophique.
Rflchissons en effet ce prsent qui serait seul existant. Qu'est-ce au
juste que le prsent ? S'il s'agit de l'instant actuel, je veux dire d'un instant
mathmatique qui serait au temps ce que le point mathmatique est la ligne,
il est clair qu'un pareil instant est une pure abstraction, une vue de l'esprit ; il
ne saurait avoir d'existence relle. Jamais avec de pareils instants vous ne
feriez du temps, pas plus qu'avec des points mathmatiques vous ne composeriez une ligne. Supposez mme qu'il existe : comment y aurait-il un instant
antrieur celui-l ? Les deux instants ne pourraient tre spars par un
intervalle de temps, puisque, par hypothse, vous rduisez le temps une
juxtaposition d'instants. Donc ils ne seraient spars par rien, et par consquent ils n'en feraient qu'un : deux points mathmatiques, qui se touchent, se
confondent. Mais laissons de ct ces subtilits. Notre conscience nous dit
que, lorsque nous parlons de notre prsent, c'est un certain intervalle de
dure que nous pensons. Quelle dure ? Impossible de la fixer exactement ;
c'est quelque chose d'assez flottant. Mon prsent, en ce moment, est la phrase
que je suis occup prononcer. Mais il en est ainsi parce qu'il me plat de
limiter ma phrase le champ de mon attention. Cette attention est chose qui
peut s'allonger et se raccourcir, comme l'intervalle entre les deux pointes d'un
compas. Pour le moment, les pointes s'cartent juste assez pour aller du
commencement la fin de ma phrase ; mais, s'il me prenait envie de les
loigner davantage, mon prsent embrasserait, outre ma dernire phrase, celle
qui la prcdait : il m'aurait suffi d'adopter une autre ponctuation. Allons plus
loin : une attention qui serait indfiniment extensible tiendrait sous son regard,
avec la phrase prcdente, toutes les phrases antrieures de la leon, et les
vnements qui ont prcd la leon, et une portion aussi grande qu'on voudra
de ce que nous appelons notre pass. La distinction que nous faisons entre
notre prsent et notre pass est donc, sinon arbitraire, du moins relative
l'tendue du champ que peut embrasser notre attention la vie. Le prsent
occupe juste autant de place que cet effort. Ds que cette attention particulire
lche quelque chose de ce qu'elle tenait sous son regard, aussitt ce qu'elle
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
94
abandonne du prsent devient ipso facto du pass. En un mot, notre prsent
tombe dans le pass quand nous cessons de lui attribuer un intrt actuel. Il en
est du prsent des individus comme de celui des nations : un vnement
appartient au pass, et il entre dans l'histoire, quand il n'intresse plus directement la politique du jour et peut tre nglig sans que les affaires s'en
ressentent. Tant que son action se fait sentir, il adhre la vie de la nation et
lui demeure prsent.
Ds lors, rien ne nous empche de reporter aussi loin que possible, en
arrire, la ligne de sparation entre notre prsent et notre pass. Une attention
la vie qui serait suffisamment puissante, et suffisamment dgage de tout
intrt pratique, embrasserait ainsi dans un prsent indivis l'histoire passe
tout entire de la personne consciente, non pas comme de l'instantan, non
pas comme un ensemble de parties simultanes, mais comme du continuellement prsent qui serait aussi du continuellement mouvant : telle, je le rpte,
la mlodie qu'on peroit indivisible, et qui constitue d'un bout l'autre, si l'on
veut tendre le sens du mot, un perptuel prsent, quoique cette perptuit
n'ait rien de commun avec l'immutabilit, ni cette indivisibilit avec l'instantanit. Il s'agit d'un prsent qui dure.
Ce n'est pas l une hypothse. Il arrive, dans des cas exceptionnels, que
l'attention renonce tout coup l'intrt qu'elle prenait la vie : aussitt,
comme par enchantement, le pass redevient prsent. Chez des personnes qui
voient surgir devant elles, l'improviste, la menace d'une mort soudaine, chez
l'alpiniste qui glisse au fond d'un prcipice, chez des noys et chez des pendus,
il semble qu'une conversion brusque de l'attention puisse se produire,
quelque chose comme un changement d'orientation de la conscience qui,
jusqu'alors tourne vers l'avenir et absorbe par les ncessits de l'action, subitement s'en dsintresse. Cela suffit pour que mille et mille dtails oublis
soient remmors, pour que l'histoire entire de la personne se droule devant
elle en un mouvant panorama.
La mmoire n'a donc pas besoin d'explication. Ou plutt, il n'y a pas de
facult spciale dont le rle soit de retenir du pass pour le verser dans le
prsent. Le pass se conserve de lui-mme, automatiquement. Certes, si nous
fermons les yeux l'indivisibilit du changement, au fait que notre plus
lointain pass adhre notre prsent et constitue, avec lui, un seul et mme
changement ininterrompu, il nous semble que le pass est normalement de
l'aboli et que la conservation du pass a quelque chose d'extraordinaire : nous
nous croyons alors obligs d'imaginer un appareil dont la fonction serait
d'enregistrer les parties du pass susceptibles de reparatre la conscience.
Mais si nous tenons compte de la continuit de la vie intrieure et par consquent de son indivisibilit, ce n'est plus la conservation du pass qu'il s'agira
d'expliquer, c'est au contraire son apparente abolition. Nous n'aurons plus
rendre compte du souvenir, mais de l'oubli. L'explication s'en trouvera
d'ailleurs dans la structure du cerveau. La nature a invent un mcanisme pour
canaliser notre attention dans la direction de l'avenir, pour la dtourner du
pass je veux dire de cette partie de notre histoire qui n'intresse pas notre
action prsente, pour lui amener tout au plus, sous forme de souvenirs ,
telle ou telle simplification de lexprience antrieure, destine complter
l'exprience du moment ; en cela consiste ici la fonction du cerveau. Nous ne
pouvons aborder la discussion de la thorie qui veut que le cerveau serve la
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
95
conservation du pass, qu'il emmagasine des souvenirs comme autant de
clichs photographiques dont nous tirerions ensuite des preuves, comme
autant de phonogrammes destins redevenir des sons. Nous avons examin
la thse ailleurs. Cette doctrine a t inspire en grande partie par une certaine
mtaphysique dont la psychologie, et la psycho-physiologie contemporaines
sont imprgnes, et qu'on accepte naturellement : de l son apparente clart.
Mais, mesure qu'on la considre de plus prs, on y voit s'accumuler les
difficults et les impossibilits. Prenons le cas le plus favorable la thse, le
cas d'un objet matriel faisant impression sur l'il et laissant dans l'esprit un
souvenir visuel. Que pourra bien tre ce souvenir, s'il rsulte vritablement de
la fixation, dans le cerveau, de l'impression reue par l'il ? Pour peu que
l'objet ait remu, ou que l'il ait remu, il y a eu, non pas une image, mais dix,
cent, mille images, autant et plus que sur le film d'un cinmatographe. Pour
peu que l'objet ait t considr un certain temps, ou revu des moments
divers, ce sont des millions d'images diffrentes de cet objet. Et nous avons
pris le cas le plus simple ! Supposons toutes ces images emmagasines ;
quoi serviront-elles ? quelle est celle que nous utiliserons ? Admettons
mme que nous ayons nos raisons pour en choisir une, pourquoi et comment
la rejetterons-nous dans le pass quand nous l'apercevrons ? Passons encore
sur ces difficults. Comment expliquera-t-on les maladies de la mmoire ?
Dans celles de ces maladies qui correspondent des lsions locales du
cerveau, c'est--dire dans les aphasies, la lsion psychologique consiste moins
dans une abolition des souvenirs que dans une impuissance les rappeler. Un
effort, une motion, peuvent ramener brusquement la conscience des mots
qu'on croyait dfinitivement perdus. Ces faits, avec beaucoup d'autres, concourent prouver que le cerveau sert ici choisir dans le pass, le diminuer,
le simplifier, l'utiliser, mais non pas le conserver. Nous n'aurions aucune
peine envisager les choses de ce biais si nous n'avions contract l'habitude
de croire que le pass est aboli. Alors, sa rapparition partielle nous fait l'effet
d'un vnement extraordinaire, qui rclame une explication. Et c'est pourquoi
nous imaginons et l, dans le cerveau, des botes souvenirs qui conserveraient des fragments de pass, le cerveau se conservant d'ailleurs luimme. Comme si ce n'tait pas reculer la difficult et simplement ajourner le
problme ! Comme si, en posant que la matire crbrale se conserve travers
le temps, ou plus gnralement que toute matire dure, on ne lui attribuait pas
prcisment la mmoire qu'on prtend expliquer par elle ! Quoi que nous
fassions, mme si nous supposons que le cerveau emmagasine des souvenirs,
nous n'chappons pas la conclusion que le pass peut se conserver lui-mme,
automatiquement.
Non pas seulement notre pass nous, mais aussi le pass de n'importe
quel changement, pourvu toutefois qu'il s'agisse d'un changement unique et,
par l mme, indivisible : la conservation du pass dans le prsent n'est pas
autre chose que l'indivisibilit du changement. Il est vrai que, pour les changements qui s'accomplissent au dehors, nous ne savons presque jamais si nous
avons affaire un changement unique ou un compos de plusieurs mouvements entre lesquels s'intercalent des arrts (l'arrt n'tant d'ailleurs jamais que
relatif). Il faudrait que nous fussions intrieurs aux tres et aux choses, comme
nous le sommes nous-mmes, pour que nous pussions nous prononcer sur ce
point. Mais l n'est pas l'important. Il suffit de s'tre convaincu une fois pour
toutes que la ralit est changement, que le changement est indivisible, et que,
dans un changement indivisible, le pass fait corps avec le prsent.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
96
Pntrons-nous de cette vrit, et nous verrons fondre et s'vaporer bon
nombre d'nigmes philosophiques. Certains grands problmes, comme celui
de la substance, du changement, et de leur rapport, cesseront de se poser. Toutes les difficults souleves autour de ces points difficults qui ont fait
reculer peu peu la substance jusque dans le domaine de l'inconnaissable
venaient de ce que nous fermons les yeux l'indivisibilit du changement. Si
le changement, qui est videmment constitutif de toute notre exprience, est la
chose fuyante dont la plupart des philosophes ont parl, si l'on n'y voit qu'une
poussire d'tats qui remplacent des tats, force est bien de rtablir la
continuit entre ces tats par un lien artificiel ; mais ce substrat immobile de la
mobilit, ne pouvant possder aucun des attributs que nous connaissons
puisque tous sont des changements recule mesure que nous essayons d'en
approcher : il est aussi insaisissable que le fantme de changement qu'il tait
appel fixer. Faisons effort, au contraire, pour apercevoir le changement tel
qu'il est, dans son indivisibilit naturelle : nous voyons qu'il est la substance
mme des choses, et ni le mouvement ne nous apparat plus sous la forme
vanouissante qui le rendait insaisissable la pense, ni la substance avec
l'immutabilit qui la rendait inaccessible notre exprience. L'instabilit
radicale, et l'immutabilit absolue ne sont alors que des vues abstraites, prises
du dehors, sur la continuit du changement rel, abstractions que l'esprit
hypostasie ensuite en tats multiples, d'un ct, en chose ou substance, de
l'autre. Les difficults souleves par les anciens autour de la question du mouvement et par les modernes autour de la question de la substance s'vanouissent, celles-ci parce que la substance est mouvement et changement, celles-l
parce que le mouvement et le changement sont substantiels.
En mme temps que des obscurits thoriques se dissipent, on entrevoit la
solution possible de plus d'un problme rput insoluble. Les discussions
relatives au libre arbitre prendraient fin si nous nous apercevions nous-mmes
l o nous sommes rellement, dans une dure concrte o l'ide de dtermination ncessaire perd toute espce de signification, puisque le pass y fait
corps avec le prsent et cre sans cesse avec lui ne ft-ce que par le fait de
s'y ajouter quelque chose d'absolument nouveau. Et la relation de l'homme
l'univers deviendrait susceptible d'un approfondissement graduel si nous
tenions compte de la vraie nature des tats, des qualits, enfin de tout ce qui se
prsente nous avec l'apparence de la stabilit. En pareil cas, l'objet et le sujet
doivent tre vis--vis l'un de l'autre dans une situation analogue celle des
deux trains dont nous parlions au dbut : c'est un certain rglage de la mobilit
sur la mobilit qui produit l'effet de l'immobilit. Pntrons-nous alors de cette
ide, ne perdons jamais de vue la relation particulire de l'objet au sujet qui se
traduit par une vision statique des choses : tout ce que l'exprience nous
apprendra de l'un accrotra la connaissance que nous avions de l'autre, et la
lumire que celui-ci reoit pourra, par rflexion, clairer celui-l son tour.
Mais, comme je l'annonais au dbut, la spculation pure ne sera pas seule
bnficier de cette vision de l'universel devenir. Nous pourrons la faire
pntrer dans notre vie de tous les jours et, par elle, obtenir de la philosophie
des satisfactions analogues celles de l'art, mais plus frquentes, plus continues, plus accessibles aussi au commun des hommes. L'art nous fait sans
doute dcouvrir dans les choses plus de qualits et plus de nuances que nous
n'en apercevons naturellement. Il dilate notre perception, mais en surface
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
97
plutt qu'en profondeur. Il enrichit notre prsent, mais il ne nous fait gure
dpasser le prsent. Par la philosophie, nous pouvons nous habituer ne
jamais isoler le prsent du pass qu'il trane avec lui. Grce elle, toutes choses acquirent de la profondeur, plus que de la profondeur, quelque chose
comme une quatrime dimension qui permet aux perceptions antrieures de
rester solidaires des perceptions actuelles, et l'avenir immdiat lui-mme de
se dessiner en partie dans le prsent. La ralit n'apparat plus alors l'tat
statique, dans sa manire d'tre ; elle s'affirme dynamiquement, dans la
continuit et la variabilit de sa tendance. Ce qu'il y avait d'immobile et de
glac dans notre perception se rchauffe et se met en mouvement. Tout
s'anime autour de nous, tout se revivifie en nous. Un grand lan emporte les
tres et les choses. Par lui nous nous sentons soulevs, entrans, ports. Nous
vivons davantage, et ce surcrot de vie amne avec lui la conviction que de
graves nigmes philosophiques pourront se rsoudre ou mme peut-tre
qu'elles ne doivent pas se poser, tant nes d'une vision fige du rel et n'tant
que la traduction, en termes de pense, d'un certain affaiblissement artificiel
de notre vitalit. Plus, en effet, nous nous habituons penser et percevoir
toutes choses sub specie durationis, plus nous nous enfonons dans la dure
relle. Et plus nous nous y enfonons, plus nous nous replaons dans la
direction du principe, pourtant transcendant, dont nous participons et dont
l'ternit ne doit pas tre une ternit d'immutabilit, mais une ternit de vie :
comment, autrement, pourrions-nous vivre et nous mouvoir en elle ? In ea
vivimus et movemur et sumus.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
98
La pense et le mouvant Essais et confrences.
VI
Introduction la mtaphysique
Retour la table des matires
Si l'on compare entre elles les dfinitions de la mtaphysique et les
conceptions de l'absolu, on s'aperoit que les philosophes s'accordent, en dpit
de leurs divergences apparentes, distinguer deux manires profondment
diffrentes de connatre une chose. La premire implique qu'on tourne autour
de cette chose ; la seconde, qu'on entre en elle. La premire dpend du point
1
Cet essai a paru dans la Revue de mtaphysique et de morale en 1903, Depuis cette
poque, nous avons t amen prciser davantage la signification des termes mtaphysique et science. On est libre de donner aux mots le sens qu'on veut, quand on prend soin
de le dfinir : rien n'empcherait d'appeler science ou philosophie comme on l'a
fait pendant longtemps, toute espce de connaissance. On pourrait mme, comme nous le
disions plus haut (p. 43), englober le tout dans la mtaphysique. Nanmoins, il est incontestable que la connaissance appuie dans une direction bien dfinie quand elle dispose
son objet en vue de la mesure, et qu'elle marche dans une direction diffrente, inverse
mme, quand elle se dgage de toute arrire-pense de relation et de comparaison pour
sympathiser avec la ralit. Nous avons montr que la premire mthode convenait
l'tude de la matire et la seconde celle de l'esprit, qu'il y a d'ailleurs empitement rciproque des deux objets l'un sur l'autre et que les deux mthodes doivent s'entraider. Dans
le premier cas, on a affaire au temps spatialis et l'espace ; dans le second, la dure
relle. Il nous a paru de plus en plus utile, pour la clart des ides, d'appeler scientifique la premire connaissance, et mtaphysique la seconde. C'est alors au compte de
la mtaphysique que nous porterons cette philosophie de la science ou mtaphysique de la science qui habite l'esprit des grands savants, qui est immanente leur science
et qui en est souvent l'invisible inspiratrice. Dans le prsent article, nous la laissions
encore au compte de la science, parce qu'elle a t pratique, en fait, par des chercheurs
qu'on s'accorde gnralement appeler savants plutt que t mtaphysiciens s (voir, cidessus, les p. 33 45).
Il ne faut pas oublier, d'autre part, que le prsent essai a t crit une poque o le
criticisme de Kant et le dogmatisme de ses successeurs taient assez gnralement admis,
sinon comme conclusion, au moins comme point de dpart de la spculation philosophique.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
99
de vue o l'on se place et des symboles par lesquels on s'exprime. La seconde
ne se prend d'aucun point de vue et ne s'appuie sur aucun symbole. De la
premire connaissance on dira qu'elle s'arrte au relatif; de la seconde, l o
elle est possible, qu'elle atteint l'absolu.
Soit, par exemple, le mouvement d'un objet dans l'espace. Je le perois
diffremment selon le point de vue, mobile ou immobile, d'o je le regarde. Je
l'exprime diffremment, selon le systme d'axes ou de points de repre auquel
je le rapporte, c'est--dire selon les symboles par lesquels je le traduis. Et je
l'appelle relatif pour cette double raison : dans un cas comme dans l'autre, je
me place en dehors de l'objet lui-mme. Quand je parle d'un mouvement
absolu, c'est que j'attribue au mobile un intrieur et comme des tats d'me,
c'est aussi que je sympathise avec les tats et que je m'insre en eux par un
effort d'imagination. Alors, selon que l'objet sera mobile ou immobile, selon
qu'il adoptera un mouvement ou un autre mouvement, je n'prouverai pas la
mme chose 1. Et ce que j'prouverai ne dpendra ni du point de vue que je
pourrais adopter sur l'objet, puisque je serai dans l'objet lui-mme, ni des
symboles par lesquels je pourrais le traduire, puisque j'aurai renonc toute
traduction pour possder l'original. Bref, le mouvement ne sera plus saisi du
dehors et, en quelque sorte, de chez moi, mais du dedans, en lui, en soi. Je
tiendrai un absolu.
Soit encore un personnage de roman dont on me raconte les aventures. Le
romancier pourra multiplier les traits de caractre, faire parler et agir son
hros autant qu'il lui plaira : tout cela ne vaudra pas le sentiment simple et
indivisible que j'prouverais si je concidais un instant avec le personnage luimme. Alors, comme de la source, me paratraient couler naturellement les
actions, les gestes et les paroles. Ce ne seraient plus l des accidents s'ajoutant
l'ide que je me faisais du personnage, enrichissant toujours et toujours cette
ide sans arriver la complter jamais. Le personnage me serait donn tout
d'un coup dans son intgralit, et les mille incidents qui le manifestent, au lieu
de s'ajouter l'ide et de l'enrichir, me sembleraient au contraire alors se
dtacher d'elle, sans pourtant en puiser ou en appauvrir l'essence. Tout ce
qu'on me raconte de la personne me fournit autant de points de vue sur elle.
Tous les traits qui me la dcrivent, et qui ne peuvent me la faire connatre que
par autant de comparaisons avec des personnes ou des choses que je connais
dj, sont des signes par lesquels on l'exprime plus ou moins symboliquement.
Symboles et points de vue me placent donc en dehors d'elle ; ils ne me livrent
d'elle que ce qui lui est commun avec d'autres et ne lui appartient pas en
propre. Mais ce qui est proprement elle, ce qui constitue son essence, ne
saurait s'apercevoir du dehors, tant intrieur par dfinition, ni s'exprimer par
des symboles, tant incommensurable avec toute autre chose. Description,
histoire et analyse me laissent ici dans le relatif. Seule, la concidence avec la
personne mme me donnerait l'absolu.
C'est en ce sens, et en ce sens seulement, qu'absolu est synonyme de perfection. Toutes les photographies d'une ville prises de tous les points de vue
possibles auront beau se complter indfiniment les unes les autres, elles
1
Est-il besoin de dire que nous ne proposons nullement ici un moyen de reconnatre si un
mouvement est absolu ou s'il ne lest pas ? Nous dfinissons simplement ce qu'on a dans
l'esprit quand on parle d'un mouvement absolu, au sens mtaphysique du mot.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
100
n'quivaudront point cet exemplaire en relief qui est la ville o l'on se
promne. Toutes les traductions d'un pome dans toutes les langues possibles
auront beau ajouter des nuances aux nuances et, par une espce de retouche
mutuelle, en se corrigeant l'une l'autre, donner une image de plus en plus
fidle du pome qu'elles traduisent, jamais elles ne rendront le sens intrieur
de l'original. Une reprsentation prise d'un certain point de vue, une traduction
faite avec certains symboles, restent toujours imparfaites en comparaison de
l'objet sur lequel la vue a t prise ou que les symboles cherchent exprimer.
Mais l'absolu est parfait en ce qu'il est parfaitement ce qu'il est.
C'est pour la mme raison, sans doute, qu'on a souvent identifi ensemble
l'absolu et l'infini. Si je veux communiquer celui qui ne sait pas le grec
l'impression simple que me laisse un vers d'Homre, je donnerai la traduction
du vers, puis je commenterai ma traduction, puis je dvelopperai mon commentaire, et d'explication en explication je me rapprocherai de plus en plus de
ce que je veux exprimer ; mais je n'y arriverai jamais. Quand vous levez le
bras, vous accomplissez un mouvement dont vous avez intrieurement, la
perception simple ; mais extrieurement, pour moi qui le regarde, votre bras
passe par un point, puis par un autre point, et entre ces deux points il y aura
d'autres points encore, de sorte que, si je commence compter, l'opration se
poursuivra sans fin. Vu du dedans, un absolu est donc chose simple ; mais
envisag du dehors, c'est--dire relativement autre chose, il devient, par
rapport ces signes qui l'expriment, la pice d'or dont on n'aura jamais fini de
rendre la monnaie. Or, ce qui se prte en mme temps une apprhension
indivisible et une numration inpuisable est, par dfinition mme, un
infini.
Il suit de l qu'un absolu ne saurait tre donn que dans une intuition,
tandis que tout le reste relve de l'analyse. Nous appelons ici intuition la
sympathie par laquelle on se transporte l'intrieur d'un objet pour concider
avec ce qu'il a d'unique et par consquent d'inexprimable. Au contraire,
l'analyse est l'opration qui ramne l'objet des lments dj connus, c'est-dire communs cet objet et d'autres. Analyser consiste donc exprimer une
chose en fonction de ce qui n'est pas elle. Toute analyse est ainsi une
traduction, un dveloppement en symboles, une reprsentation prise de points
de vue successifs d'o l'on note autant de contacts entre l'objet nouveau, qu'on
tudie, et d'autres, que l'on croit dj connatre. Dans son dsir ternellement
inassouvi d'embrasser l'objet autour duquel elle est condamne tourner,
l'analyse multiplie sans fin les points de vue pour complter la reprsentation
toujours incomplte, varie sans relche les symboles pour parfaire la
traduction toujours imparfaite. Elle se continue donc l'infini. Mais l'intuition,
si elle est possible, est un acte simple.
Ceci pos, on verrait sans peine que la science positive a pour fonction
habituelle d'analyser. Elle travaille donc avant tout sur des symboles. Mme
les plus concrtes des sciences de la nature, les sciences de la vie, s'en tiennent
la forme visible des tres vivants, de leurs organes, de leurs lments anatomiques. Elles comparent les formes les unes aux autres, elles ramnent les
plus complexes aux plus simples, enfin elles tudient le fonctionnement de la
vie dans ce qui en est, pour ainsi dire, le symbole visuel. S'il existe un moyen
de possder une ralit absolument au lieu de la connatre relativement, de se
placer en elle au lieu d'adopter des points de vue sur elle, d'en avoir l'intuition
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
101
au lieu d'en faire l'analyse, enfin de la saisir en dehors de toute expression,
traduction ou reprsentation symbolique, la mtaphysique est cela mme. La
mtaphysique est donc la science qui prtend se passer de symboles.
Il y a une ralit au moins que nous saisissons tous du dedans, par
intuition et non par simple analyse. C'est notre propre personne dans son coulement travers le temps. C'est notre moi qui dure. Nous pouvons ne
sympathiser intellectuellement, ou plutt spirituellement, avec aucune autre
chose. Mais nous sympathisons srement avec nous-mmes.
Quand je promne sur ma personne, suppose inactive, le regard intrieur
de ma conscience, j'aperois d'abord, ainsi qu'une crote solidifie la surface, toutes les perceptions qui lui arrivent du monde matriel. Ces perceptions
sont nettes, distinctes, juxtaposes ou juxtaposables les unes aux autres ; elles
cherchent se grouper en objets. Japerois ensuite des souvenirs plus ou
moins adhrents ces perceptions et qui servent les interprter ; ces souvenirs se sont comme dtachs du fond de ma personne, attirs la priphrie
par les perceptions qui leur ressemblent ; ils sont poss sur moi sans tre
absolument moi-mme. Et enfin je sens se manifester des tendances, des
habitudes motrices, une foule d'actions virtuelles plus ou moins solidement
lies ces perceptions et ces souvenirs. Tous ces lments aux formes bien
arrtes me paraissent d'autant plus distincts de moi qu'ils sont plus distincts
les uns des autres. Orients du dedans vers le dehors, ils constituent, runis, la
surface d'une sphre qui tend s'largir et se perdre dans le monde extrieur.
Mais si je me ramasse de la priphrie vers le centre, si je cherche au fond de
moi ce qui est le plus uniformment, le plus constamment, le plus durablement
moi-mme, je trouve tout autre chose.
C'est, au-dessous de ces cristaux bien dcoups et de cette conglation
superficielle, une continuit d'coulement qui n'est comparable rien de ce
que j'ai vu s'couler. C'est une succession d'tats dont chacun annonce ce qui
suit et contient ce qui prcde. vrai dire, ils ne constituent des tats multiples que lorsque je les ai dj dpasss et que je me retourne en arrire pour en
observer la trace. Tandis que je les prouvais, ils taient si solidement
organiss, si profondment anims d'une vie commune, que je n'aurais su dire
o l'un quelconque d'entre eux finit, o l'autre commence. En ralit, aucun
d'eux ne commence ni ne finit, mais tous se prolongent les uns dans les autres.
C'est, si l'on veut, le droulement d'un rouleau, car il n'y a pas d'tre vivant
qui ne se sente arriver peu peu au bout de son rle ; et vivre consiste
vieillir. Mais c'est tout aussi bien un enroulement continuel, comme celui d'un
fil sur une pelote, car notre pass nous suit, il se grossit sans cesse du prsent
qu'il ramasse sur sa route ; et conscience signifie mmoire.
vrai dire, ce n'est ni un enroulement ni un droulement, car ces deux
images voquent la reprsentation de lignes ou de surfaces dont les parties
sont homognes entre elles et superposables les unes aux autres. Or, il n'y a
pas deux moments identiques chez un tre conscient. Prenez le sentiment le
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
102
plus simple, supposez-le constant, absorbez en lui la personnalit tout entire :
la conscience qui accompagnera ce sentiment ne pourra rester identique ellemme pendant deux moments conscutifs, puisque le moment suivant contient
toujours, en sus du prcdent, le souvenir que celui-ci lui a laiss. Une
conscience qui aurait deux moments identiques serait une conscience sans
mmoire. Elle prirait et renatrait donc sans cesse. Comment se reprsenter
autrement l'inconscience ?
Il faudra donc voquer l'image d'un spectre aux mille nuances, avec des
dgradations insensibles qui font qu'on passe d'une nuance l'autre. Un
courant de sentiment qui traverserait le spectre en se teignant tour tour de
chacune de ses nuances prouverait des changements graduels dont chacun
annoncerait le suivant et rsumerait en lui ceux qui le prcdent. Encore les
nuances, successives du spectre resteront-elles toujours extrieures les unes
aux autres. Elles se juxtaposent. Elles occupent de l'espace. Au contraire, ce
qui est dure pure exclut toute ide de juxtaposition, d'extriorit rciproque et
d'tendue.
Imaginons donc plutt un lastique infiniment petit, contract, si c'tait
possible, en un point mathmatique. Tirons-le progressivement de manire
faire sortir du point une ligne qui ira toujours s'agrandissant. Fixons notre
attention, non pas sur la ligne en tant que ligne, mais sur l'action qui la trace.
Considrons que cette action, en dpit de sa dure, est indivisible si l'on
suppose qu'elle s'accomplit sans arrt ; que, si l'on y intercale un arrt, on en
fait deux actions au lieu d'une et que chacune de ces actions sera alors
l'indivisible dont nous parlons ; que ce n'est pas l'action mouvante elle-mme
qui est jamais divisible, mais la ligne immobile qu'elle dpose au-dessous
d'elle comme une trace dans l'espace. Dgageons-nous enfin de l'espace qui
sous-tend le mouvement pour ne tenir compte que du mouvement lui-mme,
de l'acte de tension ou d'extension, enfin de la mobilit pure. Nous aurons
cette fois une image plus fidle de notre dveloppement dans la dure.
Et pourtant cette image sera incomplte encore, et toute comparaison sera
d'ailleurs insuffisante, parce que le droulement de notre dure ressemble par
certains cts l'unit d'un mouvement qui progresse, par d'autres une
multiplicit d'tats qui s'talent, et qu'aucune mtaphore ne peut rendre un des
deux aspects sans sacrifier l'autre. Si j'voque un spectre aux mille nuances,
j'ai devant moi une chose toute faite, tandis que la dure se fait continuellement. Si je pense un lastique qui s'allonge, un ressort qui se tend ou se
dtend, j'oublie la richesse de coloris qui est caractristique de la dure vcue
pour ne plus voir que le mouvement simple par lequel la conscience passe
d'une nuance l'autre. La vie intrieure est tout cela la fois, varit de
qualits, continuit de progrs, unit de direction. On ne saurait la reprsenter
par des images.
Mais on la reprsenterait bien moins encore par des concepts, c'est--dire
par des ides abstraites, ou gnrales, ou simples. Sans doute aucune image ne
rendra tout fait le sentiment original que j'ai de l'coulement de moi-mme.
Mais il n'est pas non plus ncessaire que j'essaie de le rendre. celui qui ne
serait pas capable de se donner lui-mme l'intuition de la dure constitutive
de son tre, rien ne la donnerait jamais, pas plus les concepts que les images.
L'unique objet du philosophe doit tre ici de provoquer un certain travail que
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
103
tendent entraver, chez la plupart des hommes, les habitudes d'esprit plus
utiles la vie. Or, l'image a du moins cet avantage qu'elle nous maintient dans
le concret. Nulle image ne remplacera l'intuition de la dure, mais beaucoup
d'images diverses, empruntes des ordres de choses trs diffrents, pourront,
par la convergence de leur action, diriger la conscience sur le point prcis o il
y a une certaine intuition saisir. En choisissant les images aussi disparates
que possible, on empchera l'une quelconque d'entre elles d'usurper la place
de l'intuition qu'elle est charge d'appeler, puisqu'elle serait alors chasse tout
de suite par ses rivales. En faisant qu'elles exigent toutes de notre esprit,
malgr leurs diffrences d'aspect, la mme espce d'attention et, en quelque
sorte, le mme degr de tension, on accoutumera peu peu la conscience
une disposition toute particulire et bien dtermine, celle prcisment qu'elle
devra adopter pour s'apparatre elle-mme sans voile 1. Mais encore faudra-til qu'elle consente cet effort. Car on ne lui aura rien montr. On l'aura
simplement place dans l'attitude qu'elle doit prendre pour faire l'effort voulu
et arriver d'elle-mme l'intuition. Au contraire, l'inconvnient des concepts
trop simples, en pareille matire, est d'tre vritablement des symboles, qui se
substituent l'objet qu'ils symbolisent, et qui n'exigent de nous aucun effort.
En y regardant de prs, on verrait que chacun d'eux ne retient de l'objet que ce
qui est commun cet objet et d'autres. On verrait que chacun d'eux exprime,
plus encore que ne fait l'image, une comparaison entre l'objet et ceux qui lui
ressemblent. Mais comme la comparaison a dgag une ressemblance, comme
la ressemblance est une proprit de l'objet, comme une proprit a tout l'air
d'tre une partie de l'objet qui la possde, nous nous persuadons sans peine
qu'en juxtaposant des concepts des concepts nous recomposerons le tout de
l'objet avec ses parties et que nous en obtiendrons, pour ainsi dire, un quivalent intellectuel. C'est ainsi que nous croirons former une reprsentation
fidle de la dure en alignant les concepts d'unit, de multiplicit, de continuit, de divisibilit finie ou infinie, etc. L est prcisment l'illusion. L est
aussi le danger. Autant les ides abstraites peuvent rendre service l'analyse,
c'est--dire une tude scientifique de l'objet dans ses relations avec tous les
autres, autant elles sont incapables de remplacer l'intuition, c'est--dire
l'investigation mtaphysique de l'objet dans ce qu'il a d'essentiel et de propre.
D'un ct, en effet, ces concepts mis bout bout ne nous donneront jamais
qu'une recomposition artificielle de l'objet dont ils ne peuvent que symboliser
certains aspects gnraux et en quelque sorte impersonnels : c'est donc en vain
qu'on croirait, avec eux, saisir une ralit dont ils se bornent nous prsenter
l'ombre. Mais d'autre part, ct de l'illusion, il y a aussi un trs grave danger.
Car le concept gnralise en mme temps qu'il abstrait. Le concept ne peut
symboliser une proprit spciale qu'en la rendant commune une infinit de
choses. Il la dforme donc toujours plus ou moins par l'extension qu'il lui
donne. Replace dans l'objet mtaphysique qui la possde, une proprit concide avec lui, se moule au moins sur lui, adopte les mmes contours. Extraite
de l'objet mtaphysique et reprsente en un concept, elle s'largit indfiniment, elle dpasse l'objet puisqu'elle doit dsormais le contenir avec d'autres.
Les divers concepts que nous formons des proprits d'une chose dessinent
donc autour d'elle autant de cercles beaucoup plus larges, dont aucun ne
1
Les images dont il est question ici sont celles qui peuvent se prsenter l'esprit du philosophe quand il veut exposer sa pense autrui. Nous laissons de ct l'image, voisine de
l'intuition, dont le philosophe peut avoir besoin pour lui-mme, et qui reste souvent
inexprime.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
104
s'applique sur elle exactement. Et pourtant, dans la chose mme, les proprits
concidaient avec elle et concidaient par consquent ensemble. Force nous
sera donc de chercher quelque artifice pour rtablir la concidence. Nous
prendrons l'un quelconque de ces concepts et nous essaierons, avec lui, d'aller
rejoindre les autres. Mais, selon que nous partirons de celui-ci ou de celui-l,
la jonction ne s'oprera pas de la mme manire. Selon que nous partirons, par
exemple, de l'unit ou de la multiplicit, nous concevrons diffremment l'unit
multiple de la dure. Tout dpendra du poids que nous attribuerons tel ou tel
d'entre les concepts, et ce poids sera toujours arbitraire, puisque le concept,
extrait de l'objet, n'a pas de poids, n'tant plus que l'ombre d'un corps. Ainsi
surgiront une multitude de systmes diffrents, autant qu'il y a de points de
vue extrieurs sur la ralit qu'on examine ou de cercles plus larges dans
lesquels l'enfermer. Les concepts simples n'ont donc pas seulement l'inconvnient de diviser l'unit concrte de l'objet en autant d'expressions symboliques ; ils divisent aussi la philosophie en coles distinctes, dont chacune
retient sa place, choisit ses jetons, et entame avec les autres une partie qui ne
finira jamais. Ou la mtaphysique n'est que ce jeu d'ides, ou bien, si c'est une
occupation srieuse de l'esprit, il faut qu'elle transcende les concepts pour
arriver l'intuition. Certes, les concepts lui sont indispensables, car toutes les
autres sciences travaillent le plus ordinairement sur des concepts, et la mtaphysique ne saurait se passer des autres sciences. Mais elle n'est proprement
elle-mme que lorsqu'elle dpasse le concept, ou du moins lorsqu'elle s'affranchit des concepts raides et tout faits pour crer des concepts bien diffrents de
ceux que nous manions d'habitude, je veux dire des reprsentations souples,
mobiles, presque fluides, toujours prtes se mouler sur les formes fuyantes
de l'intuition. Nous reviendrons plus loin sur ce point important. Qu'il nous
suffise d'avoir montr que notre dure peut nous tre prsente directement
dans une intuition, qu'elle peut nous tre suggre indirectement par des
images, mais qu'elle ne saurait si on laisse au mot concept son sens propre
s'enfermer dans une reprsentation conceptuelle.
Essayons, un instant, d'en faire une multiplicit. Il faudra ajouter que les
termes de cette multiplicit, au lieu de se distinguer comme ceux d'une
multiplicit quelconque, empitent les uns sur les autres, que nous pouvons
sans doute, par un effort d'imagination, solidifier la dure une fois coule, la
diviser alors en morceaux qui se juxtaposent et compter tous les morceaux,
mais que cette opration s'accomplit sur le souvenir fig de la dure, sur la
trace immobile que la mobilit de la dure laisse derrire elle, non sur la dure
mme. Avouons donc, s'il y a ici une multiplicit, que cette multiplicit ne
ressemble aucune autre. Dirons-nous alors que la dure a de l'unit ? Sans
doute une continuit d'lments qui se prolongent les uns dans les autres
participe de l'unit autant que de la multiplicit, mais cette unit mouvante,
changeante, colore, vivante, ne ressemble gure l'unit abstraite, immobile
et vide, que circonscrit le concept d'unit pure. Conclurons-nous de l que la
dure doit se dfinir par l'unit et la multiplicit tout la fois ? Mais, chose
singulire, j'aurai beau manipuler les deux concepts, les doser, les combiner
diversement ensemble, pratiquer sur eux les plus subtiles oprations de chimie
mentale, je n'obtiendrai jamais rien qui ressemble l'intuition simple que j'ai
de la dure ; au lieu que si je me replace dans la dure par un effort d'intuition,
j'aperois tout de suite comment elle est unit, multiplicit, et beaucoup
d'autres choses encore. Ces divers concepts taient donc autant de points de
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
105
vue extrieurs sur la dure. Ni spars, ni runis, ils ne nous ont fait pntrer
dans la dure mme.
Nous y pntrons cependant, et ce ne peut tre que par une intuition. En ce
sens, une connaissance intrieure, absolue, de la dure du moi par le moi luimme est possible. Mais si la mtaphysique rclame et peut obtenir ici une
intuition, la science n'en a pas moins besoin d'une analyse. Et cest d'une
confusion entre le rle de l'analyse et celui de l'intuition que vont natre ici les
discussions entre coles et les conflits entre systmes.
La psychologie, en effet, procde par analyse comme les autres sciences.
Elle rsout le moi, qui lui a t donn d'abord dans une intuition simple, en
sensations, sentiments, reprsentations, etc., qu'elle tudie sparment. Elle
substitue donc au moi une srie d'lments qui sont les faits psychologiques.
Mais ces lments sont-ils des parties ? Toute la question est l, et c'est pour
l'avoir lude qu'on a souvent pose en termes insolubles le problme de la
personnalit humaine.
Il est incontestable que tout tat psychologique, par cela seul qu'il
appartient une personne, reflte l'ensemble d'une personnalit. Il n'y a pas de
sentiment, si simple soit-il, qui ne renferme virtuellement le pass et le prsent
de l'tre qui l'prouve, qui puisse s'en sparer et constituer un tat autrement que par un effort d'abstraction ou d'analyse. Mais il est non moins
incontestable que, sans cet effort d'abstraction ou d'analyse, il n'y aurait pas de
dveloppement possible de la science psychologique. Or, en quoi consiste
l'opration par laquelle le psychologue dtache un tat psychologique pour
l'riger en entit plus ou moins indpendante ? Il commence par ngliger la
coloration spciale de la personne, qui ne saurait s'exprimer en termes connus
et communs. Puis il s'efforce d'isoler, dans la personne dj ainsi simplifie,
tel ou tel aspect qui prte une tude intressante. S'agit-il, par exemple, de
l'inclination ? Il laissera de ct l'inexprimable nuance qui la colore et qui fait
que mon inclination n'est pas la vtre ; puis il s'attachera au mouvement par
lequel notre personnalit se porte vers un certain objet ; il isolera cette attitude, et c'est cet aspect spcial de la personne, ce point de vue sur la mobilit de
la vie intrieure, ce schma de l'inclination concrte qu'il rigera en fait
indpendant. Il y a l un travail analogue celui d'un artiste qui, de passage
Paris, prendrait par exemple un croquis d'une tour de Notre-Dame. La tour est
insparablement lie l'difice, qui est non moins insparablement li au sol,
l'entourage, Paris tout entier, etc. Il faut commencer par la dtacher ; on ne
notera de l'ensemble qu'un certain aspect, qui est cette tour de Notre-Dame.
Maintenant, la tour est constitue en ralit par des pierres dont le groupement
particulier est ce qui lui donne sa forme ; mais le dessinateur ne s'intresse pas
aux pierres, il ne note que la silhouette de la tour. Il substitue donc l'organisation relle et intrieure de la chose une reconstitution extrieure et
schmatique. De sorte que son dessin rpond, en somme, un certain point de
vue sur l'objet et au choix d'un certain mode de reprsentation. Or, il en est
tout fait de mme pour l'opration par laquelle le psychologue extrait un tat
psychologique de l'ensemble de la personne. Cet tat psychologique isol n'est
gure qu'un croquis, un commencement de recomposition artificielle ; c'est le
tout envisag sous un certain aspect lmentaire auquel on s'est intress
spcialement et qu'on a pris soin de noter. Ce n'est pas une partie, mais un
lment. Il n'a pas t obtenu par fragmentation, mais par analyse.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
106
Maintenant, au bas de tous les croquis pris Paris l'tranger inscrira sans
doute Paris en guise de mmento. Et comme il a rellement vu Paris, il
saura, en redescendant de l'intuition originelle du tout, y situer ses croquis et
les relier ainsi les uns aux autres. Mais il n'y a aucun moyen d'excuter
l'opration inverse ; il est impossible, mme avec une infinit de croquis aussi
exacts qu'on voudra, mme avec le mot Paris qui indique qu'il faut les
relier ensemble, de remonter une intuition qu'on n'a pas eue, et de se donner
l'impression de Paris si l'on n'a pas vu Paris. C'est qu'on n'a pas affaire ici
des parties du tout, mais des notes prises sur l'ensemble. Pour choisir un
exemple plus frappant, un cas o la notation est plus compltement symbolique, supposons qu'on me prsente, mles au hasard, les lettres qui entrent
dans la composition d'un pome que j'ignore. Si les lettres taient des parties
du pome, je pourrais tcher de le reconstituer avec elles en essayant des
divers arrangements possibles, comme fait l'enfant avec les pices d'un jeu de
patience. Mais je n'y songerai pas un seul instant, parce que les lettres ne sont
pas des parties composantes, mais des expressions partielles, ce qui est tout
autre chose. C'est pourquoi, si je connais le pome, je mets aussitt chacune
des lettres la place qui lui revient et je les relie sans difficult par un trait
continu, tandis que l'opration inverse est impossible. Mme quand je crois
tenter cette opration inverse, mme quand je mets des lettres bout bout, je
commence par me reprsenter une signification plausible : je me donne donc
une intuition, et c'est de l'intuition que j'essaie de redescendre aux symboles
lmentaires qui en reconstitueraient l'expression. L'ide mme de reconstituer
la chose par des oprations pratiques sur des lments symboliques tout seuls
implique une telle absurdit qu'elle ne viendrait l'esprit de personne si l'on se
rendait compte qu'on n'a pas affaire des fragments de la chose, mais, en
quelque sorte, des fragments de symbole.
Telle est pourtant l'entreprise des philosophes qui cherchent recomposer
la personne avec des tats psychologiques, soit qu'ils s'en tiennent aux tats
eux-mmes, soit qu'ils ajoutent un fil destin rattacher les tats entre eux.
Empiristes et rationalistes sont dupes ici de la mme illusion. Les uns et les
autres prennent les notations partielles pour des parties relles, confondant
ainsi le point de vue de l'analyse et celui de l'intuition, la science et la mtaphysique.
Les premiers disent avec raison que l'analyse psychologique ne dcouvre
rien de plus, dans la personne, que des tats psychologiques. Et telle est en
effet la fonction, telle est la dfinition mme de l'analyse. Le psychologue n'a
pas autre chose faire qu' analyser la personne, c'est--dire noter des tats :
tout au plus mettra-t-il la rubrique moi sur ces tats en disant que ce sont
des tats du moi , de mme que le dessinateur crit le mot Paris sur
chacun de ses croquis. Sur le terrain o le psychologue se place, et o il doit
se placer, le moi n'est qu'un signe par lequel on rappelle l'intuition primitive (trs confuse d'ailleurs) qui a fourni la psychologie son objet : ce n'est
qu'un mot, et la grande erreur est de croire qu'on pourrait, en restant sur le
mme terrain, trouver derrire le mot une chose. Telle a t l'erreur de ces
philosophes qui n'ont pu se rsigner tre simplement psychologues en
psychologie, Taine et Stuart Mill, par exemple. Psychologues par la mthode
qu'ils appliquent, ils sont rests mtaphysiciens par l'objet quils se proposent.
Ils voudraient une intuition, et, par une trange inconsquence, ils demandent
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
107
cette intuition l'analyse, qui en est la ngation mme. Ils cherchent le moi, et
prtendent le trouver dans les tats psychologiques, alors quon n'a pu obtenir
cette diversit d'tats psychologiques qu'en se transportant hors du moi pour
prendre sur la personne une srie de croquis, de notes, de reprsentations plus
ou moins schmatiques et symboliques. Aussi ont-ils beau juxtaposer les tats
aux tats, en multiplier les contacts, en explorer les interstices, le moi leur
chappe toujours, si bien qu'ils finissent par n'y plus voir qu'un vain fantme.
Autant vaudrait nier que l'Iliade ait un sens, sous prtexte qu'on a vainement
cherch ce sens dans les intervalles des lettres qui la composent.
L'empirisme philosophique est donc n ici d'une confusion entre le point
de vue de l'intuition et celui de l'analyse. Il consiste chercher l'original dans
la traduction, o il ne peut naturellement pas tre, et nier l'original sous
prtexte qu'on ne le trouve pas dans la traduction. Il aboutit ncessairement
des ngations ; mais, en y regardant de prs, on s'aperoit que ces ngations
signifient simplement que l'analyse n'est pas l'intuition, ce qui est l'vidence
mme. De l'intuition originelle et d'ailleurs confuse, qui fournit la science
son objet, la science passe tout de suite l'analyse, qui multiplie l'infini sur
cet objet les points de vue. Bien vite elle arrive croire qu'elle pourrait, en
composant ensemble tous les points de vue, reconstituer l'objet. Est-il tonnant qu'elle voie cet objet fuir devant elle, comme l'enfant qui voudrait se
fabriquer un jouet solide avec les ombres qui se profilent le long des murs ?
Mais le rationalisme est dupe de la mme illusion. Il part de la confusion
que l'empirisme a commise, et reste aussi impuissant que lui atteindre la
personnalit. Comme l'empirisme, il tient les tats psychologiques pour autant
de fragments dtachs d'un moi qui les runirait. Comme l'empirisme, il
cherche relier ces fragments entre eux pour refaire l'unit de la personne.
Comme l'empirisme enfin, il voit l'unit de la personne, dans l'effort qu'il
renouvelle sans cesse pour l'treindre, se drober indfiniment comme un
fantme. Mais tandis que l'empirisme, de guerre lasse, finit par dclarer qu'il
n'y a pas autre chose que la multiplicit des tats psychologiques, le rationalisme persiste affirmer l'unit de la personne. Il est vrai que, cherchant cette
unit sur le terrain des tats psychologiques eux-mmes, et oblig d'ailleurs de
porter au compte des tats psychologiques toutes les qualits ou dterminations qu'il trouve l'analyse (puisque l'analyse, par dfinition mme, aboutit
toujours des tats) il ne lui reste plus, pour l'unit de la personne, que quelque chose de purement ngatif, l'absence de toute dtermination. Les tats
psychologiques ayant ncessairement pris et gard pour eux, dans cette
analyse, tout ce qui prsente la moindre apparence de matrialit, l' unit du
moi ne pourra plus tre qu'une forme sans matire. Ce sera l'indtermin et
le vide absolus. Aux tats psychologiques dtachs, ces ombres du moi dont
la collection tait, pour les empiristes, l'quivalent de la personne, le rationalisme adjoint, pour reconstituer la personnalit, quelque chose de plus irrel
encore, le vide dans lequel ces ombres se meuvent, le lieu des ombres,
pourrait-on dire. Comment cette forme , qui est vritablement informe,
pourrait-elle caractriser une personnalit vivante, agissante, concrte, et
distinguer Pierre de Paul ? Est-il tonnant que les philosophes qui ont isol
cette forme de la personnalit la trouvent ensuite impuissante dterminer
une personne, et qu'ils soient amens, de degr en degr, faire de leur Moi
vide un rceptacle sans fond qui n'appartient pas plus Paul qu' Pierre, et o
il y aura place, comme on voudra, pour l'humanit entire, ou pour Dieu, ou
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
108
pour l'existence en gnral ? Je vois ici entre l'empirisme et le rationalisme
cette seule diffrence que le premier, cherchant l'unit du moi dans les
interstices, en quelque sorte, des tats psychologiques, est amen combler
les interstices avec d'autres tats, et ainsi de suite indfiniment, de sorte que le
moi, resserr dans un intervalle qui va toujours se rtrcissant, tend vers Zro
mesure qu'on pousse plus loin l'analyse, tandis que le rationalisme, faisant
du moi le lieu o les tats se logent, est en prsence d'un espace vide qu'on n'a
aucune raison d'arrter ici plutt que l, qui dpasse chacune des limites
successives qu'on prtend lui assigner, qui va toujours s'largissant et qui tend
se perdre, non plus dans Zro, mais dans l'Infini.
La distance est donc beaucoup moins grande qu'on ne le suppose entre un
prtendu empirisme comme celui de Taine et les spculations les plus
transcendantes de certains panthistes allemands. La mthode est analogue
dans les deux cas : elle consiste raisonner sur les lments de la traduction
comme si c'taient des parties de l'original. Mais un empirisme vrai est celui
qui se propose de serrer d'aussi prs que possible l'original lui-mme, d'en
approfondir la vie, et, par une espce d'auscultation spirituelle, d'en sentir
palpiter l'me ; et cet empirisme vrai est la vraie mtaphysique. Le travail est
d'une difficult extrme, parce qu'aucune des conceptions toutes faites dont la
pense se sert pour ses oprations journalires ne peut plus servir. Rien de
plus facile que de dire que le moi est multiplicit, ou qu'il est unit, ou qu'il est
la synthse de l'une et de l'autre. Unit et multiplicit sont ici des reprsentations qu'on n'a pas besoin de tailler sur l'objet, qu'on trouve dj fabriques
et qu'on n'a qu' choisir dans un tas, vtements de confection qui iront aussi
bien Pierre qu' Paul parce qu'ils ne dessinent la forme d'aucun des deux.
Mais un empirisme digne de ce nom, un empirisme qui ne travaille que sur
mesure, se voit oblig, pour chaque nouvel objet qu'il tudie, de fournir un
effort absolument nouveau. Il taille pour l'objet un concept appropri l'objet
seul, concept dont on peut peine dire que ce soit encore un concept, puisqu'il
ne s'applique qu' cette seule chose. Il ne procde pas par combinaison d'ides
qu'on trouve dans le commerce, unit et multiplicit par exemple ; mais la
reprsentation laquelle il nous achemine est au contraire une reprsentation
unique, simple, dont on comprend d'ailleurs trs bien, une fois forme, pourquoi l'on peut la placer dans les cadres unit, multiplicit, etc., tous beaucoup
plus larges qu'elle. Enfin la philosophie ainsi dfinie ne consiste pas choisir
entre des concepts et prendre parti pour une cole, mais aller chercher une
intuition unique d'o l'on redescend aussi bien aux divers concepts, parce
qu'on s'est plac au-dessus des divisions d'coles.
Que la personnalit ait de l'unit, cela est certain ; mais pareille affirmation ne m'apprend rien sur la nature extraordinaire de cette unit qu'est la
personne. Que notre moi soit multiple, je l'accorde encore, mais il y a l une
multiplicit dont il faudra bien reconnatre qu'elle n'a rien de commun avec
aucune autre. Ce qui importe vritablement la philosophie, c'est de savoir
quelle unit, quelle multiplicit, quelle ralit suprieure l'un et au multiple
abstraits est l'unit multiple de la personne. Et elle ne le saura que si elle
ressaisit l'intuition simple du moi par le moi. Alors, selon la pente qu'elle choisira pour redescendre de ce sommet, elle aboutira l'unit, ou la multiplicit,
ou l'un quelconque des concepts par lesquels on essaie de dfinir la vie
mouvante de la personne. Mais aucun mlange de ces concepts entre eux,
nous le rptons, ne donnerait rien qui ressemble la personne qui dure.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
109
Prsentez-moi un cne solide, je vois sans peine comment il se rtrcit
vers le sommet et tend se confondre avec un point mathmatique, comment
aussi il s'largit par sa base en un cercle indfiniment grandissant. Mais ni le
point, ni le cercle, ni la juxtaposition des deux sur un plan ne me donneront la
moindre ide d'un cne. Ainsi pour la multiplicit et l'unit de la vie psychologique. Ainsi pour le Zro et l'Infini vers lesquels empirisme et rationalisme
acheminent la personnalit.
Les concepts, comme nous le montrerons ailleurs, vont d'ordinaire par
couples et reprsentent les deux contraires. Il n'est gure de ralit concrte
sur laquelle on ne puisse prendre la fois les deux vues opposes et qui ne se
subsume, par consquent, aux deux concepts antagonistes. De l une thse et
une antithse qu'on chercherait en vain rconcilier logiquement, pour la
raison trs simple que jamais, avec des concepts, ou points de vue, on ne fera
une chose. Mais de l'objet, saisi par intuition, on passe sans peine, dans bien
des cas, aux deux concepts contraires ; et comme, par l, on voit sortir de la
ralit la thse et l'antithse, on saisit du mme coup comment cette thse et
cette antithse s'opposent et comment elles se rconcilient.
Il est vrai qu'il faut procder pour cela un renversement du travail
habituel de l'intelligence. Penser consiste ordinairement aller des concepts
aux choses, et non pas des choses aux concepts. Connatre une ralit, c'est, au
sens usuel du mot connatre , prendre des concepts dj faits, les doser, et
les combiner ensemble jusqu' ce qu'on obtienne un quivalent pratique du
rel. Mais il ne faut pas oublier que le travail normal de l'intelligence est loin
d'tre un travail dsintress. Nous ne visons pas, en gnral, connatre pour
connatre, mais connatre pour un parti prendre, pour un profit retirer,
enfin pour un intrt satisfaire. Nous cherchons jusqu' quel point l'objet
connatre est ceci ou cela, dans quel genre connu il rentre, quelle espce
d'action, de dmarche ou d'attitude il devrait nous suggrer. Ces diverses
actions et attitudes possibles sont autant de directions conceptuelles de notre
pense, dtermines une fois pour toutes ; il ne reste plus qu' les suivre ; en
cela consiste prcisment l'application des concepts aux choses. Essayer un
concept un objet, c'est demander l'objet ce que nous avons faire de lui, ce
qu'il peut faire pour nous. Coller sur un objet l'tiquette d'un concept, c'est
marquer en termes prcis le genre d'action ou d'attitude que l'objet devra nous
suggrer. Toute connaissance proprement dite est donc oriente dans une
certaine direction ou prise d'un certain point de vue. Il est vrai que notre
intrt est souvent complexe. Et c'est pourquoi il nous arrive d'orienter dans
plusieurs directions successives notre connaissance du mme objet et de faire
varier sur lui les points de vue. En cela consiste, au sens usuel de ces termes,
une connaissance large et comprhensive de l'objet : l'objet est ramen
alors, non pas un concept unique, mais plusieurs concepts dont il est cens
participer . Comment participe-t-il de tous ces concepts la fois ? c'est l
une question qui n'importe pas la pratique et qu'on n'a pas se poser. Il est
donc naturel, il est donc lgitime que nous procdions par juxtaposition et
dosage de concepts dans la vie courante : aucune difficult philosophique ne
natra de l, puisque, par convention tacite, nous nous abstiendrons de
philosopher. Mais transporter ce modus operandi la philosophie, aller, ici
encore, des concepts la chose, utiliser, pour la connaissance dsintresse
d'un objet qu'on vise cette fois atteindre en lui-mme, une manire de
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
110
connatre qui s'inspire d'un intrt dtermin et qui consiste par dfinition en
une vue prise sur l'objet extrieurement, c'est tourner le dos au but qu'on
visait, c'est condamner la philosophie un ternel tiraillement entre les coles,
c'est installer la contradiction au cur mme de l'objet et de la mthode. Ou il
n'y a pas de philosophie possible et toute connaissance des choses est une
connaissance pratique oriente vers le profit tirer d'elles, ou philosopher
consiste se placer dans l'objet mme par un effort d'intuition.
Mais, pour comprendre la nature de cette intuition, pour dterminer avec
prcision o l'intuition finit et o commence l'analyse, il faut revenir ce qui a
t dit plus haut de l'coulement de la dure.
On remarquera que les concepts ou schmas auxquels l'analyse aboutit ont
pour caractre essentiel d'tre immobiles pendant qu'on les considre. J'ai isol
du tout de la vie intrieure cette entit psychologique que j'appelle une sensation simple. Tant que je l'tudie, je suppose qu'elle reste ce qu'elle est. Si j'y
trouvais quelque changement, je dirais qu'il n'y a pas l une sensation unique,
mais plusieurs sensations successives ; et c'est chacune de ces sensations
successives que je transporterais alors l'immutabilit attribue d'abord la
sensation d'ensemble. De toute manire, je pourrai, en poussant l'analyse assez
loin, arriver des lments que je tiendrai pour immuables. C'est l, et l
seulement, que je trouverai la base d'oprations solide dont la science a besoin
pour son dveloppement propre.
Pourtant il n'y a pas d'tat d'me, si simple soit-il, qui ne change tout
instant, puisqu'il n'y a pas de conscience sans mmoire, pas de continuation
d'un tat sans l'addition, au sentiment prsent, du souvenir des moments
passs. En cela consiste la dure. La dure intrieure est la vie continue d'une
mmoire qui prolonge le pass dans le prsent, soit que le prsent renferme
distinctement l'image sans cesse grandissante du pass, soit plutt qu'il tmoigne, par son continuel changement de qualit, de la charge toujours plus
lourde qu'on trane derrire soi mesure qu'on vieillit davantage. Sans cette
survivance du pass dans le prsent, il n'y aurait pas de dure, mais seulement
de l'instantanit.
Il est vrai que si l'on me reproche de soustraire l'tat psychologique la
dure par cela seul que je l'analyse, je m'en dfendrai en disant que chacun de
ces tats psychologiques lmentaires auxquels mon analyse aboutit est un
tat qui occupe encore du temps. Mon analyse, dirai-je, rsout bien la vie
intrieure en tats dont chacun est homogne avec lui-mme ; seulement,
puisque l'homognit s'tend sur un nombre dtermin de minutes ou de
secondes, l'tat psychologique lmentaire ne cesse pas de durer, encore qu'il
ne change pas.
Mais qui ne voit que le nombre dtermin de minutes et de secondes, que
j'attribue l'tat psychologique lmentaire, a tout juste la valeur d'un indice
destin me rappeler que l'tat psychologique, suppos homogne, est en
ralit un tat qui change et qui dure ? L'tat, pris en lui-mme, est un perptuel devenir. Jai extrait de ce devenir une certaine moyenne de qualit que j'ai
suppose invariable : j'ai constitu ainsi un tat stable et, par l mme,
schmatique. J'en ai extrait, d'autre part, le devenir en gnral, le devenir qui
ne serait pas plus le devenir de ceci que de cela, et c'est ce que j'ai appel le
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
111
temps que cet tat occupe. En y regardant de prs, je verrais que ce temps
abstrait est aussi immobile pour moi que l'tat que j'y localise, qu'il ne pourrait
s'couler que par un changement de qualit continuel, et que, s'il est sans
qualit, simple thtre du changement, il devient ainsi un milieu immobile. Je
verrais que l'hypothse de ce temps homogne est simplement destine
faciliter la comparaison entre les diverses dures concrtes, nous permettre
de compter des simultanits et de mesurer un coulement de dure par
rapport un autre. Et enfin je comprendrais qu'en accolant la reprsentation
d'un tat psychologique lmentaire l'indication d'un nombre dtermin de
minutes et de secondes, je me borne rappeler que l'tat a t dtach d'un
moi qui dure et dlimiter la place o il faudrait le remettre en mouvement
pour le ramener, de simple schma qu'il est devenu, la forme concrte qu'il
avait d'abord. Mais j'oublie tout cela, n'en ayant que faire dans l'analyse.
C'est dire que l'analyse opre sur l'immobile, tandis que l'intuition se place
dans la mobilit ou, ce qui revient au mme, dans la dure. L est la ligne de
dmarcation bien nette entre l'intuition et l'analyse. On reconnat le rel, le
vcu, le concret, ce qu'il est la variabilit mme. On reconnat l'lment ce
qu'il est invariable. Et il est invariable par dfinition, tant un schma, une
reconstruction simplifie, souvent un simple symbole, en tout cas une vue
prise sur la ralit qui s'coule.
Mais l'erreur est de croire qu'avec ces schmas on recomposerait le rel.
Nous ne saurions trop le rpter : de l'intuition on peut passer l'analyse, mais
non pas de l'analyse l'intuition.
Avec de la variabilit je ferai autant de variations, autant de qualits ou
modifications qu'il me plaira, parce que ce sont l autant de vues immobiles,
prises par l'analyse, sur la mobilit donne l'intuition. Mais ces modifications mises bout bout ne produiront rien qui ressemble la variabilit, parce
qu'elles n'en taient pas des parties, mais des lments, ce qui est tout autre
chose.
Considrons par exemple la variabilit la plus voisine de l'homognit, le
mouvement dans l'espace. Je puis, tout le long de ce mouvement, me reprsenter des arrts possibles c'est ce que j'appelle les positions du mobile ou
les points par lesquels le mobile passe. Mais avec les positions, fussent-elles
en nombre infini, je ne ferai pas du mouvement. Elles ne sont pas des parties
du mouvement ; elles sont autant de vues prises sur lui ; elles ne sont,
pourrait-on dire, que des suppositions d'arrt. Jamais le mobile n'est rellement en aucun des points ; tout au plus peut-on dire qu'il y passe. Mais le
passage, qui est un mouvement, n'a rien de commun avec un arrt, qui est
immobilit. Un mouvement ne saurait se poser sur une immobilit, car il
conciderait alors avec elle, ce qui serait contradictoire. Les points ne sont pas
dans le mouvement, comme des parties, ni mme sous le mouvement, comme
des lieux du mobile. Ils sont simplement projets par nous au-dessous du
mouvement, comme autant de lieux o serait, s'il s'arrtait, un mobile qui par
hypothse ne s'arrte pas. Ce ne sont donc pas, proprement parler, des positions, mais des suppositions, des vues ou des points de vue de l'esprit.
Comment, avec des points de vue, construirait-on une chose ?
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
112
C'est pourtant ce que nous essayons de faire toutes les fois que nous
raisonnons sur le mouvement, et aussi sur le temps auquel le mouvement sert
de reprsentation. Par une illusion profondment enracine dans notre esprit,
et parce que nous ne pouvons nous empcher de considrer l'analyse comme
quivalente l'intuition, nous commenons par distinguer, tout le long du
mouvement, un certain nombre d'arrts possibles ou de points, dont nous
faisons, bon gr mal gr, des parties du mouvement. Devant notre impuissance
recomposer le mouvement avec ces points, nous intercalons d'autres points,
croyant serrer ainsi de plus prs ce qu'il y a de mobilit dans le mouvement.
Puis, comme la mobilit nous chappe encore, nous substituons un nombre
fini et arrt de points un nombre indfiniment croissant , essayant ainsi,
mais en vain, de contrefaire, par le mouvement de notre pense qui poursuit
indfiniment l'addition des points aux points, le mouvement rel et indivis du
mobile. Finalement, nous disons que le mouvement se compose de points,
mais qu'il comprend, en outre, le passage obscur, mystrieux, d'une position
la position suivante. Comme si l'obscurit ne venait pas tout entire de ce
qu'on a suppos l'immobilit plus claire que la mobilit, l'arrt antrieur au
mouvement ! Comme si le mystre ne tenait pas ce qu'on prtend aller des
arrts au mouvement par voie de composition, ce qui est impossible, alors
qu'on passe sans peine du mouvement au ralentissement et l'immobilit!
Vous avez cherch la signification du pome dans la forme des lettres qui le
composent, vous avez cru qu'en considrant un nombre croissant de lettres
vous treindriez enfin la signification qui fuit toujours, et en dsespoir de
cause, voyant qu'il ne servait rien de chercher une partie du sens dans
chacune des lettres, vous avez suppos qu'entre chaque lettre et la suivante se
logeait le fragment cherch du sens mystrieux ! Mais les lettres, encore une
fois, ne sont pas des parties de la chose, ce sont des lments du symbole. Les
positions du mobile, encore une fois, ne sont pas des parties du mouvement :
elles sont des points de l'espace qui est cens sous-tendre le mouvement. Cet
espace immobile et vide, simplement conu, jamais peru, a tout juste la
valeur d'un symbole. Comment, en manipulant des symboles, fabriqueriezvous de la ralit ?
Mais le symbole rpond ici aux habitudes les plus invtres de notre
pense. Nous nous installons d'ordinaire dans l'immobilit, o nous trouvons
un point d'appui pour la pratique, et nous prtendons recomposer la mobilit
avec elle. Nous n'obtenons ainsi qu'une imitation maladroite, une contrefaon
du mouvement rel, mais cette imitation nous sert beaucoup plus dans la vie
que ne ferait l'intuition de la chose mme. Or, notre esprit a une irrsistible
tendance considrer comme plus claire l'ide qui lui sert le plus souvent.
C'est pourquoi l'immobilit lui parat plus claire que la mobilit, l'arrt
antrieur au mouvement.
Les difficults que le problme du mouvement a souleves ds la plus
haute antiquit viennent de l. Elles tiennent toujours ce qu'on prtend aller
de l'espace au mouvement, de la trajectoire au trajet, des positions immobiles
la mobilit, et passer de l'un l'autre par voie de composition. Mais c'est le
mouvement qui est antrieur l'immobilit, et il n'y a pas, entre des positions
et un dplacement, le rapport des parties au tout, mais celui de la diversit des
points de vue possibles l'indivisibilit relle de l'objet.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
113
Beaucoup d'autres problmes sont ns de la mme illusion. Ce que les
points immobiles sont au mouvement d'un mobile, les concepts de qualits
diverses le sont au changement qualitatif d'un objet. Les concepts varis en
lesquels se rsout une variation sont donc autant de visions stables de
l'instabilit du rel. Et penser un objet, au sens usuel du mot penser , c'est
prendre sur sa mobilit une ou plusieurs de ces vues immobiles. C'est, en
somme, se demander de temps autre o il en est, afin de savoir ce qu'on en
pourrait faire. Rien de plus lgitime, d'ailleurs, que cette manire de procder,
tant qu'il ne s'agit que d'une connaissance pratique de la ralit. La connaissance, en tant qu'oriente vers la pratique, n'a qu' numrer les principales
attitudes possibles de la chose vis--vis de nous, comme aussi nos meilleures
attitudes possibles vis--vis d'elle. L est le rle ordinaire des concepts tout
faits, ces stations dont nous jalonnons le trajet du devenir. Mais vouloir, avec
eux, pntrer jusqu' la nature intime des choses, c'est appliquer la mobilit
du rel une mthode qui est faite pour donner des points de vue immobiles sur
elle. C'est oublier que, si la mtaphysique est possible, elle ne peut tre qu'un
effort pour remonter la pente naturelle du travail de la pense, pour se placer
tout de suite, par une dilatation de l'esprit, dans la chose qu'on tudie, enfin
pour aller de la ralit aux concepts et non plus des concepts la ralit. Est-il
tonnant que les philosophes voient si souvent fuir devant eux l'objet qu'ils
prtendent treindre, comme des enfants qui voudraient, en fermant la main,
capter de la fume ? Ainsi se perptuent bien des querelles entre les coles,
dont chacune reproche aux autres d'avoir laiss le rel s'envoler.
Mais si la mtaphysique doit procder par intuition, si l'intuition a pour
objet la mobilit de la dure, et si la dure est d'essence psychologique,
n'allons-nous pas enfermer le philosophe dans la contemplation exclusive de
lui-mme ? La philosophie ne va-t-elle pas consister se regarder simplement
vivre, comme un ptre assoupi regarde l'eau couler ? Parler ainsi serait
revenir l'erreur que nous n'avons cess de signaler depuis le commencement
de cette tude. Ce serait mconnatre la nature singulire de la dure, en mme
temps que le caractre essentiellement actif de l'intuition mtaphysique. Ce
serait ne pas voir que, seule, la mthode dont nous parlons permet de dpasser
l'idalisme aussi bien que le ralisme, d'affirmer l'existence d'objets infrieurs
et suprieurs nous, quoique cependant, en un certain sens, intrieurs nous,
de les faire coexister ensemble sans difficult, de dissiper progressivement les
obscurits que l'analyse accumule autour des grands problmes. Sans aborder
ici l'tude de ces diffrents points, bornons-nous montrer comment l'intuition
dont nous parlons n'est pas un acte unique, mais une srie indfinie d'actes,
tous du mme genre sans doute, mais chacun d'espce trs particulire, et
comment cette diversit d'actes correspond tous les degrs de l'tre.
Si je cherche analyser la dure, c'est--dire la rsoudre en concepts tout
faits, je suis bien oblig, par la nature mme du concept et de l'analyse, de
prendre sur la dure en gnral deux vues opposes avec lesquelles je prtendrai ensuite la recomposer. Cette combinaison ne pourra prsenter ni une
diversit de degrs ni une varit de formes : elle est ou elle n'est pas. Je dirai,
par exemple, qu'il y a d'une part une multiplicit d'tats de conscience successifs et d'autre part une unit qui les relie. La dure sera la synthse de cette
unit et de cette multiplicit, opration mystrieuse dont on ne voit pas, je le
rpte, comment elle comporterait des nuances ou des degrs. Dans cette
hypothse, il n'y a, il ne peut y avoir qu'une dure unique, celle o notre
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
114
conscience opre habituellement. Pour fixer les ides, si nous prenons la dure
sous l'aspect simple d'un mouvement s'accomplissant dans l'espace, et que
nous cherchions rduire en concepts le mouvement considr comme reprsentatif du Temps, nous aurons d'une part un nombre aussi grand qu'on voudra
de points de la trajectoire, et d'autre part une unit abstraite qui les runit,
comme un fil qui retiendrait ensemble les perles d'un collier. Entre cette
multiplicit abstraite et cette unit abstraite la combinaison, une fois pose
comme possible, est chose singulire laquelle nous ne trouverons pas plus de
nuances que n'en admet, en arithmtique, une addition de nombres donns.
Mais si, au lieu de prtendre analyser la dure (c'est--dire, au fond, en faire la
synthse avec des concepts), on s'installe d'abord en elle par un effort
d'intuition, on a le sentiment d'une certaine tension bien dtermine, dont la
dtermination mme apparat comme un choix entre une infinit de dures
possibles. Ds lors on aperoit des dures aussi nombreuses qu'on voudra,
toutes trs diffrentes les unes des autres, bien que chacune d'elles, rduite en
concepts, c'est--dire envisage extrieurement des deux points de vue opposs, se ramne toujours la mme indfinissable combinaison du multiple et
de l'un.
Exprimons la mme ide avec plus de prcision. Si je considre la dure
comme une multiplicit de moments relis les uns aux autres par une unit qui
les traverserait comme un fil, ces moments, si courte que soit la dure choisie,
sont en nombre illimit. Je puis les supposer aussi voisins qu'il me plaira ; il y
aura toujours, entre ces points mathmatiques, d'autres points mathmatiques,
et ainsi de suite l'infini. Envisage du ct multiplicit, la dure va donc
s'vanouir en une poussire de moments dont aucun ne dure, chacun tant un
instantan. Que si, d'autre part, je considre l'unit qui relie les moments
ensemble, elle ne peut pas durer davantage, puisque, par hypothse, tout ce
qu'il y a de changeant et de proprement durable dans la dure a t mis au
compte de la multiplicit des moments. Cette unit, mesure que j'en approfondirai l'essence, m'apparatra donc comme un substrat immobile du
mouvant, comme je ne sais quelle essence intemporelle du temps c'est ce
que j'appellerai l'ternit, ternit de mort, puisqu'elle n'est pas autre chose
que le mouvement vid de la mobilit qui en faisait la vie. En examinant de
prs les opinions des coles antagonistes au sujet de la dure, on verrait
qu'elles diffrent simplement en ce qu'elles attribuent l'un ou l'autre de ces
deux concepts une importance capitale. Les unes s'attachent au point de vue
du multiple ; elles rigent en ralit concrte les moments distincts d'un temps
qu'elles ont pour ainsi dire pulvris ; elles tiennent pour beaucoup plus
artificielle l'unit qui fait des grains une poudre. Les autres rigent au
contraire l'unit de la dure en ralit concrte. Elles se placent dans l'ternel.
Mais comme leur ternit reste tout de mme abstraite puisqu'elle est vide,
comme c'est l'ternit d'un concept qui exclut de lui, par hypothse, le concept
oppos, un ne voit pas comment cette ternit laisserait coexister avec elle une
multiplicit indfinie de moments. Dans la premire hypothse on a un monde
suspendu en l'air, qui devrait finir et recommencer de lui-mme chaque
instant. Dans la seconde on a un infini d'ternit abstraite dont on ne
comprend pas davantage pourquoi il ne reste pas envelopp en lui-mme et
comment il laisse coexister avec lui les choses. Mais, dans les deux cas, et
quelle que soit celle des deux mtaphysiques sur laquelle on s'est aiguill, le
temps apparat du point de vue psychologique comme un mlange de deux
abstractions qui ne comportent ni degrs ni nuances. Dans un systme comme
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
115
dans l'autre, il n'y a qu'une dure unique qui emporte tout avec elle, fleuve
sans fond, sans rives, qui coule sans force assignable dans une direction qu'on
ne saurait dfinir. Encore n'est-ce un fleuve, encore le fleuve ne coule-t-il que
parce que la ralit obtient des deux doctrines ce sacrifice, profitant d'une
distraction de leur logique. Ds qu'elles se ressaisissent, elles figent cet
coulement soit en une immense nappe solide, soit en une infinit d'aiguilles
cristallises, toujours en une chose qui participe ncessairement de l'immobilit d'un point de vue.
Il en est tout autrement si l'on s'installe d'emble, par un effort d'intuition,
dans l'coulement concret de la dure. Certes, nous ne trouverons alors aucune
raison logique de poser des dures multiples et diverses. la rigueur il pourrait n'exister d'autre dure que la ntre, comme il pourrait n'y avoir au monde
d'autre couleur que l'orang, par exemple. Mais de mme qu'une conscience
base de couleur, qui sympathiserait intrieurement avec l'orang au lieu de le
percevoir extrieurement, se sentirait prise entre du rouge et du jaune, pressentirait mme peut-tre, au-dessous de cette dernire couleur, tout un spectre
en lequel se prolonge naturellement la continuit qui va du rouge au jaune,
ainsi l'intuition de notre dure, bien loin de nous laisser suspendus dans le
vide comme ferait la pure analyse, nous met en contact avec toute une continuit de dures que nous devons essayer de suivre soit vers le bas, soit vers le
haut : dans les deux cas nous pouvons nous dilater indfiniment par un effort
de plus en plus violent, dans les deux cas nous nous transcendons nousmmes. Dans le premier, nous marchons une dure de plus en plus parpille, dont les palpitations plus rapides que les ntres, divisant notre
sensation simple, en diluent la qualit en quantit : la limite serait le pur
homogne, la pure rptition par laquelle nous dfinirons la matrialit. En
marchant dans l'autre sens, nous allons une dure qui se tend, se resserre,
s'intensifie de plus en plus : la limite serait l'ternit. Non plus l'ternit
conceptuelle, qui est une ternit de mort, mais une ternit de vie. ternit
vivante et par consquent mouvante encore, o notre dure nous se
retrouverait comme les vibrations dans la lumire, et qui serait la concrtion
de toute dure comme la matrialit en est l'parpillement. Entre ces deux
limites extrmes l'intuition se meut, et ce mouvement est la mtaphysique
mme.
Il ne peut tre question de parcourir ici les diverses tapes de ce
mouvement. Mais aprs avoir prsent une vue gnrale de la mthode et en
avoir fait une premire application, il ne sera peut-tre pas inutile de formuler,
en termes aussi prcis qu'il nous sera possible, les principes sur lesquels elle
repose. Des propositions que nous allons noncer, la plupart ont reu, dans le
prsent travail, un commencement de preuve. Nous esprons les dmontrer
plus compltement quand nous aborderons d'autres problmes.
I. Il y a une ralit extrieure et pourtant donne immdiatement notre
esprit. Le sens commun a raison sur ce point contre l'idalisme et le ralisme
des philosophes.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
116
II Cette ralit est mobilit 1. Il n'existe pas de choses faites, mais
seulement des choses qui se font, pas d'tats qui se maintiennent, mais
seulement des tats qui changent. Le repos n'est jamais qu'apparent, ou plutt
relatif. La conscience que nous avons de notre propre personne, dans son
continuel coulement, nous introduit l'intrieur d'une ralit sur le modle de
laquelle nous devons nous reprsenter les autres. Toute ralit est donc
tendance, si l'on convient d'appeler tendance un changement de direction
l'tat naissant.
III. Notre esprit, qui cherche des points d'appui solides, a pour principale
fonction, dans le cours ordinaire de la vie, de se reprsenter des tats et des
choses. Il prend de loin en loin des vues quasi instantanes sur la mobilit
indivise du rel. Il obtient ainsi des sensations et des ides. Par l il substitue
au continu le discontinu, la mobilit la stabilit, la tendance en voie de
changement les points fixes qui marquent une direction du changement et de
la tendance. Cette substitution est ncessaire au sens commun, au langage, la
vie pratique, et mme, dans une certaine mesure que nous tcherons de
dterminer, la science positive. Notre intelligence, quand elle suit sa pente
naturelle, procde par perceptions solides, d'un ct, et par conceptions
stables, de l'autre. Elle part de l'immobile, et ne conoit et n'exprime le
mouvement qu'en fonction de l'immobilit. Elle s'installe dans des concepts
tout faits, et s'efforce d'y prendre, comme dans un filet, quelque chose de la
ralit qui passe. Ce n'est pas, sans doute, pour obtenir une connaissance
intrieure et mtaphysique du rel. C'est simplement pour s'en servir, chaque
concept (comme d'ailleurs chaque sensation) tant une question pratique que
notre activit pose la ralit et laquelle la ralit rpondra, comme il
convient en affaires, par un oui ou par un non. Mais, par l, elle laisse
chapper du rel ce qui en est l'essence mme.
IV. Les difficults inhrentes la mtaphysique, les antinomies qu'elle
soulve, les contradictions o elle tombe, la division en coles antagonistes et
les oppositions irrductibles entre systmes, viennent en grande partie de ce
que nous appliquons la connaissance dsintresse du rel les procds dont
nous nous servons couramment dans un but d'utilit pratique. Elles viennent
principalement de ce que nous nous installons dans l'immobile pour guetter le
mouvant au passage, au lieu de nous replacer dans le mouvant pour traverser
avec lui les positions immobiles. Elles viennent de ce que nous prtendons
reconstituer la ralit, qui est tendance et par consquent mobilit, avec les
percepts et les concepts qui ont pour fonction de l'immobiliser. Avec des
arrts, si nombreux soient-ils, on ne fera jamais de la mobilit ; au lieu que si
l'on se donne la mobilit, on peut en tirer par la pense autant d'arrts qu'on
voudra. En d'autres termes, on comprend que des concepts fixes puissent tre
extraits par notre pense de la ralit mobile ; mais il n'y a aucun moyen de
reconstituer, avec la fixit des concepts, la mobilit du rel. Le dogmatisme,
en tant que constructeur de systmes, a cependant toujours tent cette
reconstitution.
Encore une fois, nous n'cartons nullement par l la substance. Nous affirmons au
contraire la persistance des existences. Et nous croyons en avoir facilit la reprsentation.
Comment a-t-on pu comparer cette doctrine celle d'Hraclite ?
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
117
V. Il devait y chouer. C'est cette impuissance, et cette impuissance
seulement, que constatent les doctrines sceptiques, idalistes, criticistes, toutes
celles enfin qui contestent notre esprit le pouvoir d'atteindre l'absolu. Mais,
de ce que nous chouons reconstituer la ralit vivante avec des concepts
raides et tout faits, il ne suit pas que nous ne puissions la saisir de quelque
autre manire. Les dmonstrations qui ont t donnes de la relativit de notre
connaissance sont donc entaches d'un vice originel : elles supposent, comme
le dogmatisme qu'elles attaquent, que toute connaissance doit ncessairement
partir de concepts aux contours arrts pour treindre avec eux la ralit qui
s'coule.
VI. Mais la vrit est que notre esprit peut suivre la marche inverse. Il peut
s'installer dans la ralit mobile, en adopter la direction sans cesse changeante,
enfin la saisir intuitivement. Il faut pour cela qu'il se violente, qu'il renverse le
sens de l'opration par laquelle il pense habituellement, qu'il retourne ou
plutt refonde sans cesse ses catgories. Mais il aboutira ainsi des concepts
fluides, capables de suivre la ralit dans toutes ses sinuosits et d'adopter le
mouvement mme de la vie intrieure des choses. Ainsi seulement se
constituera une philosophie progressive, affranchie des disputes qui se livrent
entre les coles, capable de rsoudre naturellement les problmes parce qu'elle
se sera dlivre des termes artificiels qu'on a choisis pour les poser.
Philosopher consiste invertir la direction habituelle du travail de la pense.
VII. Cette inversion n'a jamais t pratique d'une manire mthodique ;
mais une histoire approfondie de la pense humaine montrerait que nous lui
devons ce qui s'est fait de plus grand dans les sciences, tout aussi bien que ce
qu'il y a de viable en mtaphysique. La plus puissante des mthodes
d'investigation dont l'esprit humain dispose, l'analyse infinitsimale, est ne de
cette inversion mme 1. La mathmatique moderne est prcisment un effort
pour substituer au tout fait ce qui se fait, pour suivre la gnration des
grandeurs, pour saisir le mouvement, non plus du dehors et dans son rsultat
tal, mais du dedans et dans sa tendance changer, enfin pour adopter la
continuit mobile du dessin des choses. Il est vrai qu'elle s'en tient au dessin,
n'tant que la science des grandeurs. Il est vrai aussi qu'elle n'a pu aboutir
ses applications merveilleuses que par l'invention de certains symboles, et
que, si l'intuition dont nous venons de parler est l'origine de l'invention, c'est
le symbole seul qui intervient dans l'application. Mais la mtaphysique, qui ne
vise aucune application, pourra et le plus souvent devra s'abstenir de
convertir l'intuition en symbole. Dispense de l'obligation d'aboutir des
rsultats pratiquement utilisables, elle agrandira indfiniment le domaine de
ses investigations. Ce qu'elle aura perdu, par rapport la science, en utilit et
en rigueur, elle le regagnera en porte et en tendue. Si la mathmatique n'est
que la science des grandeurs, si les procds mathmatiques ne s'appliquent
qu' des quantits, il ne faut pas oublier que la quantit est toujours de la
qualit l'tat naissant : c'en est, pourrait-on dire, le cas limite. Il est donc
naturel que la mtaphysique adopte, pour l'tendre toutes les qualits, c'est-dire la ralit en gnral, l'ide gnratrice de notre mathmatique. Elle ne
s'acheminera nullement par l la mathmatique universelle, cette chimre de
la philosophie moderne. Bien au contraire, mesure qu'elle fera plus de
1
Surtout chez Newton, dans sa considration des fluxions.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
118
chemin, elle rencontrera des objets plus intraduisibles en symboles. Mais elle
aura du moins commenc par prendre contact avec la continuit et la mobilit
du rel l o ce contact est le plus merveilleusement utilisable. Elle se sera
contemple dans un miroir qui lui renvoie une image trs rtrcie sans doute,
mais trs lumineuse aussi, d'elle-mme. Elle aura vu avec une clart suprieure ce que les procds mathmatiques empruntent la ralit concrte, et
elle continuera dans le sens de la ralit concrte, non dans celui des procds
mathmatiques. Disons donc, ayant attnu par avance ce que la formule
aurait la fois de trop modeste et de trop ambitieux, qu'un des objets de la
mtaphysique est d'oprer des diffrenciations et des intgrations qualitatives.
VIII. Ce qui a fait perdre de vue cet objet, et ce qui a pu tromper la science
elle-mme sur l'origine de certains procds qu'elle emploie, c'est que l'intuition, une fois prise, doit trouver un mode d'expression et d'application qui soit
conforme aux habitudes de notre pense et qui nous fournisse, dans des
concepts bien arrts, les points d'appui solides dont nous avons un si grand
besoin. L est la condition de ce que nous appelons rigueur, prcision, et aussi
extension indfinie d'une mthode gnrale des cas particuliers. Or cette
extension et ce travail de perfectionnement logique peuvent se poursuivre
pendant des sicles, tandis que l'acte gnrateur de la mthode ne dure qu'un
instant. C'est pourquoi nous prenons si souvent l'appareil logique de la science
pour la science mme 1, oubliant l'intuition d'o le reste a pu sortir 2.
De l'oubli de cette intuition procde tout ce qui a t dit par les philosophes, et par les savants eux-mmes, de la relativit de la connaissance
scientifique. Est relative la connaissance symbolique par concepts prexistants qui va du fixe au mouvant, mais non pas la connaissance intuitive qui
s'installe dans le mouvant et adopte la vie mme des choses. Cette intuition
atteint un absolu.
La science et la mtaphysique se rejoignent donc dans l'intuition. Une
philosophie vritablement intuitive raliserait l'union tant dsire de la
mtaphysique et de la science. En mme temps qu'elle constituerait la
mtaphysique en science positive, je veux dire progressive et indfiniment
perfectible, elle amnerait les sciences positives proprement dites prendre
conscience de leur porte vritable, souvent trs suprieure ce qu'elles
1
Sur ce point, comme sur plusieurs autres questions traites dans le prsent essai, voir les
beaux travaux de M.M. LE ROY, WINCENT et VILBOIS, parus dans la Revue de
mtaphysique et de morale.
Comme nous l'expliquons au dbut de notre second essai (p. 25 et suiv.) nous avons
longtemps hsit nous servir du terme intuition ; et, quand nous nous y sommes
dcid, nous avons dsign par ce mot la fonction mtaphysique de la pense : principalement la connaissance intime de l'esprit par l'esprit, subsidiairement la connaissance, par
l'esprit, de ce qu'il y a d'essentiel dans la matire, l'intelligence tant sans doute faite
avant tout pour manipuler la matire et par consquent pour la connatre, mais n'ayant pas
pour destination spciale d'en toucher le fond. C'est cette signification que nous attribuons au mot dans le prsent essai (crit en 1902), plus spcialement dans les dernires
pages. Nous avons t amen plus tard, par un souci croissant de prcision, distinguer
plus nettement l'intelligence de l'intuition, comme aussi la science de la mtaphysique
(voir ci-dessus p. 25 55, et aussi p. 134 139). Mais, d'une manire gnrale, le changement de terminologie n'a pas d'inconvnient grave, quand on prend chaque fois la peine
de dfinir le terme dans son acception particulire, ou mme simplement quand le
contexte en montre suffisamment le sens.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
119
s'imaginent. Elle mettrait plus de science dans la mtaphysique et plus de
mtaphysique dans la science. Elle aurait pour rsultat de rtablir la continuit
entre les intuitions que les diverses sciences positives ont obtenues de loin en
loin au cours de leur histoire, et qu'elles n'ont obtenues qu' coups de gnie.
IX. Qu'il n'y ait pas deux manires diffrentes de connatre fond les
choses, que les diverses sciences aient leur racine dans la mtaphysique, c'est
ce que pensrent en gnral les philosophes anciens. L ne fut pas leur erreur.
Elle consista s'inspirer de cette croyance, si naturelle l'esprit humain,
qu'une variation ne peut qu'exprimer et dvelopper des invariabilits. D'o
rsultait que l'Action tait une Contemplation affaiblie, la dure une image
trompeuse et mobile de l'ternit immobile, l'me une chute de l'Ide. Toute
cette philosophie qui commence Platon pour aboutir Plotin est le
dveloppement d'un principe que nous formulerions ainsi : Il y a plus dans
l'immuable que dans le mouvant, et l'on passe du stable l'instable par une
simple diminution. Or, c'est le contraire qui est la vrit.
La science moderne date du jour o l'on rigea la mobilit en ralit
indpendante. Elle date du jour o Galile, faisant rouler une bille sur un plan
inclin, prit la ferme rsolution d'tudier ce mouvement de haut en bas pour
lui-mme, en lui-mme, au lieu d'en chercher le principe dans les concepts du
haut et du bas, deux immobilits par lesquelles Aristote croyait en expliquer
suffisamment la mobilit. Et ce n'est pas l un fait isol dans l'histoire de la
science. Nous estimons que plusieurs des grandes dcouvertes, de celles au
moins qui ont transform les sciences positives ou qui en ont cr de
nouvelles, ont t autant de coups de sonde donns dans la dure pure. Plus
vivante tait la ralit touche, plus profond avait t le coup de sonde.
Mais la sonde jete au fond de la mer ramne une masse fluide que le
soleil dessche bien vite en grains de sable solides et discontinus. Et l'intuition
de la dure, quand on l'expose aux rayons de l'entendement, se prend bien vite
aussi en concepts figs, distincts, immobiles. Dans la vivante mobilit des
choses l'entendement s'attache marquer des stations relles ou virtuelles, il
note des dparts et des arrives ; c'est tout ce qui importe la pense de
l'homme s'exerant naturellement. Mais la philosophie devrait tre un effort
pour dpasser la condition humaine.
Sur les concepts dont ils ont jalonn la route de l'intuition les savants ont
arrt le plus volontiers leur regard. Plus ils considraient ces rsidus passs
l'tat de symboles, plus ils attribuaient toute science un caractre
symbolique 1. Et plus ils croyaient au caractre symbolique de la science, plus
ils le ralisaient et l'accentuaient. Bientt ils n'ont plus fait de diffrence, dans
la science positive, entre le naturel et l'artificiel, entre les donnes de
1
Pour complter ce que nous exposions dans la note prcdente (p. 216), disons que nous
avons t conduit, depuis l'poque o nous crivions ces lignes, restreindre le sens du
mot science , et appeler plus particulirement scientifique la connaissance de la
matire inerte par l'intelligence pure. Cela ne nous empchera pas de dire que la connaissance de la vie et de l'esprit est scientifique dans une large mesure, dans la mesure o
elle fait appel aux mmes mthodes d'investigation que la connaissance de la matire
inerte. Inversement, la connaissance de la matire inerte pourra tre dite philosophique
dans la mesure o elle utilise, un certain moment dcisif de son histoire, l'intuition de la
dure pure. Cf. galement la note de la p. 177, au dbut du prsent essai.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
120
l'intuition immdiate et l'immense travail d'analyse que l'entendement poursuit
autour de l'intuition. Ils ont ainsi prpar les voies une doctrine qui affirme
la relativit de toutes nos connaissances.
Mais la mtaphysique y a travaill galement.
Comment les matres de la philosophie moderne, qui ont t, en mme
temps que des mtaphysiciens, les rnovateurs de la science, n'auraient-ils pas
eu le sentiment de la continuit mobile du rel ? Comment ne se seraient-ils
pas placs dans ce que nous appelons la dure concrte ? Ils l'ont fait plus
qu'ils ne l'ont cru, beaucoup plus surtout qu'ils ne l'ont dit. Si l'on s'efforce de
relier par des traits continus les intuitions autour desquelles se sont organiss
les systmes, on trouve, ct de plusieurs autres lignes convergentes ou
divergentes, une direction bien dtermine de pense et de sentiment. Quelle
est cette pense latente ? Comment exprimer ce sentiment ? Pour emprunter
encore une fois aux platoniciens leur langage, nous dirons, en dpouillant les
mots de leur sens psychologique, en appelant Ide une certaine assurance de
facile intelligibilit et me une certaine inquitude de vie, qu'un invisible
courant porte la philosophie moderne hausser l'me au-dessus de l'Ide. Elle
tend par l, comme la science moderne et mme beaucoup plus qu'elle,
marcher en sens inverse de la pense antique.
Mais cette mtaphysique, comme cette science, a dploy autour de sa vie
profonde un riche tissu de symboles, oubliant parfois que, si la science a
besoin de symboles dans son dveloppement analytique, la principale raison
d'tre de la mtaphysique est une rupture avec les symboles. Ici encore l'entendement a poursuivi son travail de fixation, de division, de reconstruction. Il l'a
poursuivi, il est vrai, sous une forme assez diffrente. Sans insister sur un
point que nous nous proposons de dvelopper ailleurs, bornons-nous dire
que l'entendement, dont le rle est d'oprer sur des lments stables, peut
chercher la stabilit soit dans des relations, soit dans des choses. En tant qu'il
travaille sur des concepts de relations, il aboutit au symbolisme scientifique.
En tant qu'il opre sur des concepts de choses, il aboutit au symbolisme
mtaphysique. Mais, dans un cas comme dans l'autre, c'est de lui que vient
l'arrangement. Volontiers il se croirait indpendant. Plutt que de reconnatre
tout de suite ce qu'il doit l'intuition profonde de la ralit, il s'expose ce
qu'on ne voie dans toute son uvre qu'un arrangement artificiel de symboles.
De sorte que si l'on s'arrtait la lettre de ce que disent mtaphysiciens et
savants, comme aussi la matrialit de ce qu'ils font, on pourrait croire que
les premiers ont creus au-dessous de la ralit un tunnel profond, que les
autres ont lanc pardessus elle un pont lgant, mais que le fleuve mouvant
des choses passe entre ces deux travaux d'art sans les toucher.
Un des principaux artifices de la critique kantienne a consist prendre au
mot le mtaphysicien et le savant, pousser la mtaphysique et la science
jusqu' la limite extrme du symbolisme o elles pourraient aller, et o
d'ailleurs elles s'acheminent d'elles-mmes ds que l'entendement revendique
une indpendance pleine de prils. Une fois mconnues les attaches de la
science et de la mtaphysique avec l' intuition intellectuelle , Kant n'a pas
de peine montrer que notre science est toute relative et notre mtaphysique
tout artificielle. Comme il a exaspr l'indpendance de l'entendement dans un
cas comme dans l'autre, comme il a allg la mtaphysique et la science de l'
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
121
intuition intellectuelle qui les lestait intrieurement, la science ne lui
prsente plus, avec ses relations, qu'une pellicule de forme, et la mtaphysique, avec ses choses, qu'une pellicule de matire. Est-il tonnant que la
premire ne lui montre alors que des cadres embots dans des cadres, et la
seconde des fantmes qui courent aprs des fantmes ?
Il a port notre science et notre mtaphysique des coups si rudes
qu'elles ne sont pas encore tout fait revenues de leur tourdissement.
Volontiers notre esprit se rsignerait voir dans la science une connaissance
toute relative, et dans la mtaphysique une spculation vide. Il nous semble,
aujourd'hui encore, que la critique kantienne s'applique toute mtaphysique
et toute science. En ralit, elle s'applique surtout la philosophie des
anciens, comme aussi la forme encore antique que les modernes ont
laisse le plus souvent leur pense. Elle vaut contre une mtaphysique qui
prtend nous donner un systme unique et tout fait de choses, contre une
science qui serait un systme unique de relations, enfin contre une science et
une mtaphysique qui se prsenteraient avec la simplicit architecturale de la
thorie platonicienne des Ides, ou d'un temple grec. Si la mtaphysique
prtend se constituer avec des concepts que nous possdions avant elle, si elle
consiste dans un arrangement ingnieux d'ides prexistantes que nous
utilisons comme des matriaux de construction pour un difice, enfin si elle
est autre chose que la constante dilatation de notre esprit, l'effort toujours
renouvel pour dpasser nos ides actuelles et peut-tre aussi notre logique
simple, il est trop vident qu'elle devient artificielle comme toutes les uvres
de pur entendement. Et si la science est tout entire uvre d'analyse ou de
reprsentation conceptuelle, si l'exprience n'y doit servir que de vrification
des ides claires , si, au lieu de partir d'intuitions multiples, diverses, qui
s'insrent dans le mouvement propre de chaque ralit mais ne s'embotent pas
toujours les unes dans les autres, elle prtend tre une immense mathmatique,
un systme unique de relations qui emprisonne la totalit du rel dans un filet
mont d'avance, elle devient une connaissance purement relative l'entendement humain. Qu'on lise de prs la Critique de la raison pure, on verra que
c'est cette espce de mathmatique universelle qui est pour Kant la science, et
ce platonisme peine remani qui est pour lui la mtaphysique. vrai dire, le
rve d'une mathmatique universelle n'est dj lui-mme qu'une survivance du
platonisme. La mathmatique universelle, c'est ce que devient le monde des
Ides quand on suppose que l'Ide consiste dans une relation ou dans une loi,
et non plus dans une chose. Kant a pris pour une ralit ce rve de quelques
philosophes modernes 1 : bien plus, il a cru que toute connaissance scientifique n'tait qu'un fragment dtach, ou plutt une pierre d'attente de la
mathmatique universelle. Ds lors, la principale tche de la Critique tait de
fonder cette mathmatique, c'est--dire de dterminer ce que doit tre l'intelligence et ce que doit tre l'objet pour qu'une mathmatique ininterrompue
puisse les relier l'un l'autre. Et, ncessairement, si toute exprience possible
est assure d'entrer ainsi dans les cadres rigides et dj constitus de notre
entendement, c'est ( moins de supposer une harmonie prtablie) que notre
entendement organise lui-mme la nature et s'y retrouve comme dans un
miroir. D'o la possibilit de la science, qui devra toute son efficacit sa
1
Voir ce sujet, dans les Philosophische Studien de WUNDT (Vol. IX, 1894), un trs
intressant article de RADULESCU-MOTRU, Zur Entwickelung von Kant's Theorie der
Naturcausalitt.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
122
relativit, et l'impossibilit de la mtaphysique, puisque celle-ci ne trouvera
plus rien faire qu' parodier, sur des fantmes de choses, le travail d'arrangement conceptuel que la science poursuit srieusement sur des rapports. Bref,
toute la Critique de la raison pure aboutit tablir que le platonisme,
illgitime si les Ides sont des choses, devient lgitime si les ides sont des
rapports, et que l'ide toute faite, une fois ramene ainsi du ciel sur la terre,
est bien, comme l'avait voulu Platon, le fond commun de la pense et de la
nature. Mais toute la Critique de la Raison pure repose aussi sur ce postulat
que notre pense est incapable d'autre chose que de platoniser, c'est--dire de
couler toute exprience possible dans des moules prexistants.
L est toute la question. Si la connaissance scientifique est bien ce qu'a
voulu Kant, il y a une science simple, prforme et mme prformule dans la
nature, ainsi que le croyait Aristote : de cette logique immanente aux choses
les grandes dcouvertes ne font qu'illuminer point par point la ligne trace
d'avance, comme on allume progressivement, un soir de fte, le cordon de gaz
qui dessinait dj les contours d'un monument. Et si la connaissance mtaphysique est bien ce qu'a voulu Kant, elle se rduit l'gale possibilit de
deux attitudes opposes de l'esprit devant tous les grands problmes ; ses
manifestations sont autant d'options arbitraires, toujours phmres, entre
deux solutions formules virtuellement de toute ternit : elle vit et elle meurt
d'antinomies. Mais la vrit est que ni la science des modernes ne prsente
cette simplicit unilinaire, ni la mtaphysique des modernes ces oppositions
irrductibles.
La science moderne n'est ni une ni simple. Elle repose, je le veux bien, sur
des ides qu'on finit par trouver claires ; mais ces ides, quand elles sont
profondes, se sont claires progressivement par l'usage qu'on en a fait ; elles
doivent alors la meilleure part de leur luminosit la lumire que leur ont
renvoye, par rflexion, les faits et les applications o elles ont conduit, la
clart d'un concept n'tant gure autre chose, alors, que l'assurance une fois
contracte de le manipuler avec profit. l'origine, plus d'une d'entre elles a d
paratre obscure, malaisment conciliable avec les concepts dj admis dans la
science, tout prs de frler l'absurdit. C'est dire que la science ne procde pas
par embotement rgulier de concepts qui seraient prdestins s'insrer avec
prcision les uns dans les autres. Les ides profondes et fcondes sont autant
de prises de contact avec des courants de ralit qui ne convergent pas ncessairement sur un mme point. Il est vrai que les concepts o elles se logent
arrivent toujours, en arrondissant leurs angles par un frottement rciproque,
s'arranger tant bien que mal entre eux.
D'autre part, la mtaphysique des modernes n'est pas faite de solutions
tellement radicales qu'elles puissent aboutir des oppositions irrductibles. Il
en serait ainsi, sans doute, s'il n'y avait aucun moyen d'accepter en mme
temps, et sur le mme terrain, la thse et l'antithse des antinomies. Mais
philosopher consiste prcisment se placer, par un effort d'intuition, l'intrieur de cette ralit concrte sur laquelle la Critique vient prendre du dehors
les deux vues opposes, thse et antithse. Je n'imaginerai jamais comment du
blanc et du noir s'entrepntrent si je n'ai pas vu de gris, mais je comprends
sans peine, une fois que j'ai vu le gris, comment on peut l'envisager du double
point de vue du blanc et du noir. Les doctrines qui ont un fond d'intuition
chappent la critique kantienne dans l'exacte mesure o elles sont intuitives ;
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
123
et ces doctrines sont le tout de la mtaphysique, pourvu qu'on ne prenne pas la
mtaphysique fige et morte dans des thses, mais vivante chez des philosophes. Certes, les divergences sont frappantes entre les coles, c'est--dire, en
somme, entre les groupes de disciples qui se sont forms autour de quelques
grands matres. Mais les trouverait-on aussi tranches entre les matres euxmmes ? Quelque chose domine ici la diversit des systmes, quelque chose,
nous le rptons, de simple et de net comme un coup de sonde dont on sent
qu'il est all toucher plus ou moins bas le fond d'un mme ocan, encore qu'il
ramne chaque fois la surface des matires trs diffrentes. C'est sur ces
matires que travaillent d'ordinaire les disciples : l est le rle de l'analyse. Et
le matre, en tant qu'il formule, dveloppe, traduit en ides abstraites ce qu'il
apporte, est dj, en quelque sorte, un disciple vis--vis de lui-mme. Mais
l'acte simple, qui a mis l'analyse en mouvement et qui se dissimule derrire
l'analyse, mane d'une facult tout autre que celle d'analyser. Ce sera, par
dfinition mme, l'intuition.
Disons-le pour conclure : cette facult n'a rien de mystrieux. Quiconque
s'est exerc avec succs la composition littraire sait bien que lorsque le
sujet a t longuement tudi, tous les documents recueillis, toutes les notes
prises, il faut, pour aborder le travail de composition lui-mme, quelque chose
de plus, un effort, souvent pnible, pour se placer tout d'un coup au cur
mme du sujet et pour aller chercher aussi profondment que possible une
impulsion laquelle il n'y aura plus ensuite qu' se laisser aller. Cette impulsion, une fois reue, lance l'esprit sur un chemin o il retrouve et les renseignements qu'il avait recueillis et d'autres dtails encore ; elle se dveloppe,
elle s'analyse elle-mme en termes dont l'numration se poursuivrait sans
fin ; plus on va, plus on en dcouvre ; jamais on n'arrivera tout dire : et
pourtant, si l'on se retourne brusquement vers l'impulsion qu'on sent derrire
soi pour la saisir, elle se drobe ; car ce n'tait pas une chose, mais une incitation au mouvement, et, bien qu'indfiniment extensible, elle est la simplicit
mme. L'intuition mtaphysique parat tre quelque chose du mme genre. Ce
qui fait pendant ici aux notes et documents de la composition littraire, c'est
l'ensemble des observations et des expriences recueillies par la science
positive et surtout par une rflexion de l'esprit sur l'esprit. Car on n'obtient pas
de la ralit une intuition, c'est--dire une sympathie spirituelle avec ce qu'elle
a de plus intrieur, si l'on n'a pas gagn sa confiance par une longue camaraderie avec ses manifestations superficielles. Et il ne s'agit pas simplement de
s'assimiler les faits marquants ; il en faut accumuler et fondre ensemble une si
norme masse qu'on soit assur, dans cette fusion, de neutraliser les unes par
les autres toutes les ides prconues et prmatures que les observateurs ont
pu dposer, leur insu, au fond de leurs observations. Ainsi seulement se
dgage la matrialit brute des faits connus. Mme dans le cas simple et
privilgi qui nous a servi d'exemple, mme pour le contact direct du moi
avec le moi, l'effort dfinitif d'intuition distincte serait impossible qui
n'aurait pas runi et confront ensemble un trs grand nombre d'analyses
psychologiques. Les matres de la philosophie moderne ont t des hommes
qui s'taient assimil tout le matriel de la science de leur temps. Et l'clipse
partielle de la mtaphysique depuis un demi-sicle a surtout pour cause
l'extraordinaire difficult que le philosophe prouve aujourd'hui prendre
contact avec une science devenue beaucoup plus parpille. Mais l'intuition
mtaphysique, quoiqu'on n'y puisse arriver qu' force de connaissances
matrielles, est tout autre chose que le rsum ou la synthse de ces connais-
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
124
sances. Elle s'en distingue comme l'impulsion motrice se distingue du chemin
parcouru par le mobile, comme la tension du ressort se distingue des
mouvements visibles dans la pendule. En ce sens, la mtaphysique n'a rien de
commun avec une gnralisation de l'exprience, et nanmoins elle pourrait se
dfinir l'exprience intgrale.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
125
La pense et le mouvant Essais et confrences.
VII
La philosophie de Claude Bernard
Discours prononc la crmonie du Centenaire
de Claude Bernard, au Collge de France,
le 30 dcembre 1913
Retour la table des matires
Ce que la philosophie doit avant tout Claude Bernard, c'est la thorie de
la mthode exprimentale. La science moderne s'est toujours rgle sur l'exprience ; mais comme elle dbuta par la mcanique et l'astronomie, comme elle
n'envisagea d'abord, dans la matire, que ce qu'il y a de plus gnral et de plus
voisin des mathmatiques, pendant longtemps elle ne demanda l'exprience
que de fournir un point de dpart ses calculs et de les vrifier l'arrive. Du
XIXe sicle datent les sciences de laboratoire, celles qui suivent l'exprience
dans toutes ses sinuosits sans jamais perdre contact avec elle. ces recherches plus concrtes Claude Bernard aura apport la formule de leur mthode,
comme jadis Descartes aux sciences abstraites de la matire. En ce sens,
l'Introduction la mdecine exprimentale est un peu pour nous ce que fut,
pour le XVIIe et le XVIIIe sicles, le Discours de la mthode. Dans un cas
comme dans l'autre nous nous trouvons devant un homme de gnie qui a
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
126
commenc par faire de grandes dcouvertes, et qui s'est demand ensuite
comment il fallait s'y prendre pour les faire : marche paradoxale en apparence
et pourtant seule naturelle, la manire inverse de procder ayant t tente
beaucoup plus souvent et nayant jamais russi. Deux fois seulement dans
l'histoire de la science moderne, et pour les deux formes principales que notre
connaissance de la nature a prises, l'esprit d'invention s'est repli sur lui-mme
pour s'analyser et pour dterminer ainsi les conditions gnrales de la
dcouverte scientifique. Cet heureux mlange de spontanit et de rflexion,
de science et de philosophie, s'est produit les deux fois en France.
La pense constante de Claude Bernard, dans son Introduction, a t de
nous montrer comment le fait et l'ide collaborent la recherche exprimentale. Le fait, plus ou moins clairement aperu, suggre l'ide d'une explication ; cette ide, le savant demande l'exprience de la confirmer ; mais, tout
le temps que son exprience dure, il doit se tenir prt abandonner son
hypothse ou la remodeler sur les faits. La recherche scientifique est donc un
dialogue entre l'esprit et la nature. La nature veille notre curiosit ; nous lui
posons des questions ; ses rponses donnent l'entretien une tournure imprvue, provoquant des questions nouvelles auxquelles la nature rplique en
suggrant de nouvelles ides, et ainsi de suite indfiniment. Quand Claude
Bernard dcrit cette mthode, quand il en donne des exemples, quand il
rappelle les applications qu'il en a faites, tout ce qu'il expose nous parat si
simple et si naturel qu' peine tait-il besoin, semble-t-il, de le dire : nous
croyons l'avoir toujours su. C'est ainsi que le portrait peint par un grand matre
peut nous donner l'illusion d'avoir connu le modle.
Pourtant il s'en faut que, mme aujourd'hui, la mthode de Claude Bernard
soit toujours comprise et pratique comme elle devrait l'tre. Cinquante ans
ont pass sur son uvre ; nous n'avons jamais cess de la lire et de l'admirer :
avons-nous tir d'elle tout l'enseignement qu'elle contient ?
Un des rsultats les plus clairs de cette analyse devrait tre de nous
apprendre qu'il n'y a pas de diffrence entre une observation bien prise et une
gnralisation bien fonde. Trop souvent nous nous reprsentons encore
l'exprience comme destine nous apporter des faits bruts : l'intelligence,
s'emparant de ces faits, les rapprochant les uns des autres, s'lverait ainsi
des lois de plus en plus hautes. Gnraliser serait donc une fonction, observer
en serait une autre. Rien de plus faux que cette conception du travail de
synthse, rien de plus dangereux pour la science et pour la philosophie. Elle a
conduit croire qu'il y avait un intrt scientifique assembler des faits pour
rien, pour le plaisir, les noter paresseusement et mme passivement, en
attendant la venue d'un esprit capable de les dominer et de les soumettre des
lois. Comme si une observation scientifique n'tait pas toujours la rponse
une question, prcise ou confuse ! Comme si des observations notes passivement la suite les unes des autres taient autre chose que des rponses
dcousues des questions poses au hasard ! Comme si le travail de gnralisation consistait venir, aprs coup, trouver un sens plausible ce discours
incohrent ! La vrit est que le discours doit avoir un sens tout de suite, ou
bien alors il n'en aura jamais. Sa signification pourra changer mesure qu'on
approfondira davantage les faits, mais il faut qu'il ait une signification d'abord.
Gnraliser n'est pas utiliser, pour je ne sais quel travail de condensation, des
faits dj recueillis, dj nots : la synthse est tout autre chose. C'est moins
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
127
une opration spciale qu'une certaine force de pense, la capacit de pntrer
l'intrieur d'un fait qu'on devine significatif et o l'on trouvera l'explication
d'un nombre indfini de faits. En un mot, l'esprit de synthse n'est qu'une plus
haute puissance de l'esprit d'analyse.
Cette conception du travail de recherche scientifique diminue singulirement la distance entre le matre et l'apprenti. Elle ne nous permet plus de
distinguer deux catgories de chercheurs, dont les uns ne seraient que des
manuvres tandis que les autres auraient pour mission d'inventer. L'invention
doit tre partout, jusque dans la plus humble recherche de fait, jusque dans
l'exprience la plus simple. L o il n'y a pas un effort personnel, et mme
original, il n'y a mme pas un commencement de science. Telle est la grande
maxime pdagogique qui se dgage de l'uvre de Claude Bernard.
Aux yeux du philosophe, elle contient autre chose encore : une certaine
conception de la vrit, et par consquent une philosophie.
Quand je parle de la philosophie de Claude Bernard, je ne fais pas allusion
cette mtaphysique de la vie qu'on a cru trouver dans ses crits et qui tait
peut-tre assez loin de sa pense. vrai dire, on a beaucoup discut sur elle.
Les uns, invoquant les passages o Claude Bernard critique l'hypothse d'un
principe vital , ont prtendu qu'il ne voyait rien de plus, dans la vie, qu'un
ensemble de phnomnes physiques et chimiques. Les autres, se rfrant
cette ide organisatrice et cratrice qui prside, selon l'auteur, aux phnomnes vitaux, veulent qu'il ait radicalement distingu la matire vivante de
la matire brute, attribuant ainsi la vie une cause indpendante. Selon
quelques-uns, enfin, Claude Bernard aurait oscill entre les deux conceptions,
ou bien encore il serait parti de la premire pour arriver progressivement la
seconde. Relisez attentivement l'uvre du matre : vous n'y trouverez, je crois,
ni cette affirmation, ni cette ngation, ni cette contradiction. Certes, Claude
Bernard s'est lev bien des fois contre l'hypothse d'un principe vital ;
mais, partout o il le fait, il vise expressment le vitalisme superficiel des
mdecins et des physiologistes qui affirmaient l'existence, chez l'tre vivant,
d'une force capable de lutter contre les forces physiques et d'en contrarier
l'action. C'tait le temps o l'on pensait couramment que la mme cause,
oprant dans les mmes conditions sur le mme tre vivant, ne produisait pas
toujours le mme effet. Il fallait compter, disait-on, avec le caractre capricieux de la vie. Magendie lui-mme, qui a tant contribu faire de la physiologie une science, croyait encore une certaine indtermination du phnomne vital. tous ceux qui parlent ainsi Claude Bernard rpond que les faits
physiologiques sont soumis un dterminisme inflexible, aussi rigoureux que
celui des faits physiques ou chimiques : mme, parmi les oprations qui
s'accomplissent dans la machine animale, il n'en est aucune qui ne doive
s'expliquer un jour par la physique et la chimie. Voil pour le principe vital.
Mais transportons-nous maintenant l'ide organisatrice et cratrice. Nous
trouverons que, partout o il est question d'elle, Claude Bernard s'attaque
ceux qui refuseraient de voir dans la physiologie une science spciale,
distincte de la physique et de la chimie. Les qualits, ou plutt les dispositions
d'esprit, qui font le physiologiste ne sont pas identiques, d'aprs lui, celles
qui font le chimiste et le physicien. N'est pas physiologiste celui qui n'a pas le
sens de l'organisation, c'est--dire de cette coordination spciale des parties au
tout qui est caractristique du phnomne vital. Dans un tre vivant, les choses
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
128
se passent comme si une certaine ide intervenait, qui rend compte de
l'ordre dans lequel se groupent les lments. Cette ide n'est d'ailleurs pas une
force, mais simplement un principe d'explication : si elle travaillait effectivement, si elle pouvait, en quoi que ce ft, contrarier le jeu des forces physiques
et chimiques, il n'y aurait plus de physiologie exprimentale. Non seulement
le physiologiste doit prendre en considration cette ide organisatrice dans
l'tude qu'il institue des phnomnes de la vie : il doit encore se rappeler,
d'aprs Claude Bernard, que les faits dont il s'occupe ont pour thtre un organisme dj construit, et que la construction de cet organisme ou, comme il dit,
la cration , est une opration d'ordre tout diffrent. Certes, en appuyant sur
la distinction bien nette tablie par Claude Bernard entre la construction de la
machine et sa destruction ou son usure, entre la machine et ce qui se passe en
elle, on aboutirait sans doute restaurer sous une autre forme le vitalisme qu'il
a combattu ; mais il ne l'a pas fait, et il a mieux aim ne pas se prononcer sur
la nature de la vie, pas plus d'ailleurs qu'il ne se prononce sur la constitution
de la matire ; il rserve ainsi la question du rapport de l'une l'autre. vrai
dire, soit qu'il attaque l'hypothse du principe vital , soit qu'il fasse appel
l'ide directrice , dans les deux cas il est exclusivement proccup de
dterminer les conditions de la physiologie exprimentale. Il cherche moins
dfinir la vie que la science de la vie. Il dfend la physiologie, et contre ceux
qui croient le fait physiologique trop fuyant pour se prter l'exprimentation,
et contre ceux qui, tout en le jugeant accessible nos expriences, ne distingueraient pas ces expriences de celles de la physique ou de la chimie. Aux
premiers il rpond que le fait physiologique est rgi par un dterminisme
absolu et que la physiologie est, par consquent, une science rigoureuse ; aux
seconds, que la physiologie a ses lois propres et ses mthodes propres,
distinctes de celles de la physique et de la chimie, et que la physiologie est par
consquent une science indpendante.
Mais si Claude Bernard ne nous a pas donn, et n'a pas voulu nous donner,
une mtaphysique de la vie, il y a, prsente l'ensemble de son uvre, une
certaine philosophie gnrale, dont l'influence sera probablement plus durable
et plus profonde que n'et pu l'tre celle d'aucune thorie particulire.
Longtemps, en effet, les philosophes ont considr la ralit comme un
tout systmatique, comme un grand difice que nous pourrions, la rigueur,
reconstruire par la pense avec les ressources du seul raisonnement, encore
que nous devions, en fait, appeler notre aide l'observation et l'exprience. La
nature serait donc un ensemble de lois insres les unes dans les autres selon
les principes de la logique humaine ; et ces lois seraient l, toutes faites,
intrieures aux choses ; l'effort scientifique et philosophique consisterait les
dgager en grattant, un un, les faits qui les recouvrent, comme on met nu
un monument gyptien en retirant par pelletes le sable du dsert. Contre cette
conception des faits et des lois, l'uvre entire de Claude Bernard proteste.
Bien avant que les philosophes eussent insist sur ce qu'il peut y avoir de
conventionnel et de symbolique dans la science humaine, il a aperu, il a
mesur l'cart entre la logique de l'homme et celle de la nature. Si, d'aprs lui,
nous n'apporterons jamais trop de prudence la vrification d'une hypothse,
jamais nous n'aurons mis assez d'audace l'inventer. Ce qui est absurde nos
yeux ne l'est pas ncessairement au regard de la nature : tentons l'exprience,
et, si l'hypothse se vrifie, il faudra bien qu'elle devienne intelligible et claire
mesure que les faits nous contraindront nous familiariser avec elle. Mais
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
129
rappelons-nous aussi que jamais une ide, si souple que nous l'ayons faite,
n'aura la mme souplesse que les choses. Soyons donc prts l'abandonner
pour une autre, qui serrera l'exprience de plus prs encore. Nos ides, disait
Claude Bernard, ne sont que des instruments intellectuels qui nous servent
pntrer dans les phnomnes ; il faut les changer quand elles ont rempli leur
rle, comme on change un bistouri mouss quand il a servi assez longtemps. Et il ajoutait : Cette foi trop grande dans le raisonnement, qui
conduit un physiologiste une fausse simplification des choses, tient
l'absence du sentiment de la complexit des phnomnes naturels. Il disait
encore : Quand nous faisons une thorie gnrale dans nos sciences, la seule
chose dont nous soyons certains c'est que toutes ces thories sont fausses,
absolument parlant. Elles ne sont que des vrits partielles et provisoires, qui
nous sont ncessaires comme les degrs sur lesquels nous nous reposons pour
avancer dans l'investigation. Et il revenait sur ce point quand il parlait de ses
propres thories : Elles seront plus tard remplaces par d'autres, qui reprsenteront un tat plus avanc de la question, et ainsi de suite. Les thories sont
comme des degrs successifs que monte la science en largissant son
horizon. Mais rien de plus significatif que les paroles par lesquelles s'ouvre
un des derniers paragraphes de l'Introduction la mdecine exprimentale :
Un des plus grands obstacles qui se rencontrent dans cette marche gnrale et
libre des connaissances humaines est la tendance qui porte les diverses
connaissances s'individualiser dans des systmes... Les systmes tendent
asservir l'esprit humain... Il faut chercher briser les entraves des systmes
philosophiques et scientifiques... La philosophie et la science ne doivent pas
tre systmatiques. La philosophie ne doit pas tre systmatique ! C'tait l
un paradoxe l'poque o Claude Bernard crivait, et o l'on inclinait, soit
pour justifier l'existence de la philosophie soit pour la proscrire, identifier
l'esprit philosophique avec l'esprit de systme. C'est la vrit cependant, et une
vrit dont on se pntrera de plus en plus mesure que se dveloppera
effectivement une philosophie capable de suivre la ralit concrte dans toutes
ses sinuosits. Nous n'assisterons plus alors une succession de doctrines dont
chacune, prendre ou laisser, prtend enfermer la totalit des choses dans
des formules simples. Nous aurons une philosophie unique, qui s'difiera peu
peu ct de la science, et laquelle tous ceux qui pensent apporteront leur
pierre. Nous ne dirons plus : La nature est une, et nous allons chercher,
parmi les ides que nous possdons dj, celle o nous pourrons l'insrer.
Nous dirons : La nature est ce qu'elle est, et comme notre intelligence, qui
fait partie de la nature, est moins vaste qu'elle, il est douteux qu'aucune de nos
ides actuelles soit assez large pour l'embrasser. Travaillons donc dilater
notre pense ; forons notre entendement ; brisons, s'il le faut, nos cadres ;
mais ne prtendons pas rtrcir la ralit la mesure de nos ides, alors que
c'est nos ides de se modeler, agrandies, sur la ralit. Voil ce que nous
dirons, voil ce que nous tcherons de faire. Mais en avanant de plus en plus
loin dans la voie o nous commenons marcher, nous devrons toujours nous
rappeler que Claude Bernard a contribu l'ouvrir. C'est pourquoi nous ne lui
serons jamais assez reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est
pourquoi nous venons saluer en lui, ct du physiologiste de gnie qui fut un
des plus grands exprimentateurs de tous les temps, le philosophe qui aura t
un des matres de la pense contemporaine.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
130
La pense et le mouvant Essais et confrences.
VIII
Sur le pragmatisme
de William James
Vrit et ralit
1
Retour la table des matires
Comment parler du pragmatisme aprs William James ? Et que pourrionsnous en dire qui ne se trouve dj dit, et bien mieux dit, dans le livre saisissant
et charmant dont nous avons ici la traduction fidle ? Nous nous garderions de
prendre la parole, si la pense de James n'tait le plus souvent diminue, ou
altre, ou fausse, par les interprtations qu'on en donne. Bien des ides
circulent, qui risquent de s'interposer entre le lecteur et le livre, et de rpandre
une obscurit artificielle sur une uvre qui est la clart mme.
On comprendrait mal le pragmatisme de James si l'on ne commenait par
modifier l'ide qu'on se fait couramment de la ralit en gnral. On parle du
monde ou du cosmos ; et ces mots, d'aprs leur origine, dsignent
quelque chose de simple, tout au moins de bien compos. On dit l'univers ,
et le mot fait penser une unification possible des choses. On peut tre
spiritualiste, matrialiste, panthiste, comme on peut tre indiffrent la
philosophie et satisfait du sens commun : toujours on se reprsente un ou
plusieurs principes simples, par lesquels s'expliquerait l'ensemble des choses
matrielles et morales.
1
Cet essai a t compos pour servir de prface l'ouvrage de William JAMES sur le
Pragmatisme, traduit par E. LE BRUN (Paris, Flammarion, 1911).
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
131
C'est que notre intelligence est prise de simplicit. Elle conomise
l'effort, et veut que la nature se soit arrange de faon ne rclamer de nous,
pour tre pense, que la plus petite somme possible de travail. Elle se donne
donc juste ce qu'il faut d'lments ou de principes pour recomposer avec eux
la srie indfinie des objets et des vnements.
Mais si, au lieu de reconstruire idalement les choses pour la plus grande
satisfaction de notre raison, nous nous en tenions purement et simplement ce
que l'exprience nous donne, nous penserions et nous nous exprimerions d'une
tout autre manire. Tandis que notre intelligence, avec ses habitudes d'conomie, se reprsente les effets comme strictement proportionns leurs causes, la nature, qui est prodigue, met dans la cause bien plus qu'il n'est requis
pour produire l'effet. Tandis que notre devise nous est Juste ce qu'il faut,
celle de la nature est Plus qu'il ne faut, trop de ceci, trop de cela, trop de
tout. La ralit, telle que James la voit, est redondante et surabondante. Entre
cette ralit et celle que les philosophes reconstruisent, je crois qu'il et tabli
le mme rapport qu'entre la vie que nous vivons tous les jours et celle que les
acteurs nous reprsentent, le soir, sur la scne. Au thtre, chacun ne dit que
ce qu'il faut dire et ne fait que ce qu'il faut faire ; il y a des scnes bien dcoupes ; la pice a un commencement, un milieu, une fin ; et tout est dispos le
plus parcimonieusement du monde en vue d'un dnouement qui sera heureux
ou tragique. Mais, dans la vie, il se dit une foule de choses inutiles, il se fait
une foule de gestes superflus, il n'y a gure de situations nettes ; rien ne se
passe aussi simplement, ni aussi compltement, ni aussi joliment que nous le
voudrions ; les scnes empitent les unes sur les autres ; les choses ne
commencent ni ne finissent ; il n'y a pas de dnouement entirement satisfaisant, ni de geste absolument dcisif, ni de ces mots qui portent et sur
lesquels on reste : tous les effets sont gts. Telle est la vie humaine. Et telle
est sans doute aussi, aux yeux de James, la ralit en gnral.
Certes, notre exprience n'est pas incohrente. En mme temps qu'elle
nous prsente des choses et des faits, elle nous montre des parents entre les
choses et des rapports entre les faits : ces relations sont aussi relles, aussi
directement observables, selon William James, que les choses et les faits euxmmes. Mais les relations sont flottantes et les choses sont fluides. Il y a loin
de l cet univers sec, que les philosophes composent avec des lments bien
dcoups, bien arrangs, et o chaque partie n'est plus seulement relie une
autre partie, comme nous le dit l'exprience, mais encore, comme le voudrait
notre raison, coordonne au Tout.
Le pluralisme de William James ne signifie gure autre chose. L'antiquit s'tait reprsent un monde clos, arrt, fini : c'est une hypothse, qui
rpond certaines exigences de notre raison. Les modernes pensent plutt
un infini : c'est une autre hypothse, qui satisfait d'autres besoins de notre
raison. Du point de vue o James se place, et qui est celui de l'exprience pure
ou de l' empirisme radical , la ralit n'apparat plus comme finie ni comme
infinie, mais simplement comme indfinie. Elle coule, sans que nous puissions
dire si c'est dans une direction unique, ni mme si c'est toujours et partout la
mme rivire qui coule.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
132
Notre raison est moins satisfaite. Elle se sent moins son aise dans un
monde o elle ne retrouve plus, comme dans un miroir, sa propre image. Et,
sans aucun doute, l'importance de la raison humaine est diminue. Mais
combien l'importance de l'homme lui-mme, de l'homme tout entier, volont
et sensibilit autant qu'intelligence, va s'en trouver accrue !
L'univers que notre raison conoit est, en effet, un univers qui dpasse
infiniment l'exprience humaine, le propre de la raison tant de prolonger les
donnes de l'exprience, de les tendre par voie de gnralisation, enfin de
nous faire concevoir bien plus de choses que nous n'en apercevrons jamais.
Dans un pareil univers, l'homme est cens faire peu de chose et occuper peu
de place : ce qu'il accorde son intelligence, il le retire sa volont. Surtout,
ayant attribu sa pense le pouvoir de tout embrasser, il est oblig de se
reprsenter toutes choses en termes de pense : ses aspirations, ses dsirs,
ses enthousiasmes il ne peut demander d'claircissement sur un monde o tout
ce qui lui est accessible a t considr par lui, d'avance, comme traduisible en
ides pures. Sa sensibilit ne saurait clairer son intelligence, dont il a fait la
lumire mme.
La plupart des philosophies rtrcissent donc notre exprience du ct
sentiment et volont, en mme temps qu'elles la prolongent indfiniment du
ct pense. Ce que James nous demande, c'est de ne pas trop ajouter
l'exprience par des vues hypothtiques, c'est aussi de ne pas la mutiler dans
ce qu'elle a de solide. Nous ne sommes tout fait assurs que de ce que
l'exprience nous donne ; mais nous devons accepter l'exprience intgralement, et nos sentiments en font partie au mme titre que nos perceptions, au
mme titre par consquent que les choses . Aux yeux de William James,
l'homme tout entier compte.
Il compte mme pour beaucoup dans un monde qui ne l'crase plus de son
immensit. On s'est tonn de l'importance que James attribue, dans un de ses
livres 1, la curieuse thorie de Fechner, qui fait de la Terre un tre indpendant, dou d'une me divine. C'est qu'il voyait l un moyen commode de
symboliser peut-tre mme d'exprimer sa propre pense. Les choses et les
faits dont se compose notre exprience constituent pour nous un monde
humain 2 reli sans doute d'autres, mais si loign d'eux et si prs de nous
que nous devons le considrer, dans la pratique, comme suffisant l'homme et
se suffisant lui-mme. Avec ces choses et ces vnements nous faisons
corps, nous, c'est--dire tout ce que nous avons conscience d'tre, tout ce
que nous prouvons. Les sentiments puissants qui agitent l'me certains
moments privilgis sont des forces aussi relles que celles dont s'occupe le
physicien ; l'homme ne les cre pas plus qu'il ne cre de la chaleur ou de la
lumire. Nous baignons, d'aprs James, dans une atmosphre que traversent de
grands courants spirituels. Si beaucoup d'entre nous se raidissent, d'autres se
laissent porter. Et il est des mes qui s'ouvrent toutes grandes au souffle
bienfaisant. Celles-l sont les mes mystiques. On sait avec quelle sympathie
1
2
A Pluralistic Universe, London, 1909. Traduit en franais, dans la Bibliothque de
Philosophie scientifique , sous le titre de Philosophie de l'exprience.
Trs ingnieusement, M. Andr CHAUMEIX a signal des ressemblances entre la
personnalit de James et celle de Socrate (Revue des Deux Mondes, 15 octobre 1910). Le
souci de ramener l'homme la considration des choses humaines a lui-mme quelque
chose de socratique.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
133
James les a tudies. Quand parut son livre sur l'Exprience religieuse,
beaucoup n'y virent qu'une srie de descriptions trs vivantes et d'analyses trs
pntrantes, une psychologie, disaient-ils, du sentiment religieux. Combien
c'tait se mprendre sur la pense de l'auteur ! La vrit est que James se
penchait sur l'me mystique comme nous nous penchons dehors, un jour de
printemps, pour sentir la caresse de la brise, ou comme, au bord de la mer,
nous surveillons les alles et venues des barques et le gonflement de leurs
voiles pour savoir d'o souffle le vent. Les mes que remplit l'enthousiasme
religieux sont vritablement souleves et transportes : comment ne nous
feraient-elles pas prendre sur le vif, ainsi que dans une exprience scientifique, la force qui transporte et qui soulve ? L est sans doute l'origine, l est
l'ide inspiratrice du pragmatisme de William James. Celles des vrits
qu'il nous importe le plus de connatre sont, pour lui, des vrits qui ont t
senties et vcues avant d'tre penses 1.
De tout temps on a dit qu'il y a des vrits qui relvent du sentiment autant
que de la raison ; et de tout temps aussi on a dit qu' ct des vrits que nous
trouvons faites il en est d'autres que nous aidons se faire, qui dpendent en
partie de notre volont. Mais il faut remarquer que, chez James, cette ide
prend une force et une signification nouvelles. Elle s'panouit, grce la
conception de la ralit qui est propre ce philosophe, en une thorie gnrale
de la vrit.
Qu'est-ce qu'un jugement vrai ? Nous appelons vraie l'affirmation qui
concorde avec la ralit. Mais en quoi peut consister cette concordance ? Nous
aimons y voir quelque chose comme la ressemblance du portrait au modle :
l'affirmation vraie serait celle qui copierait la ralit. Rflchissons-y cependant : nous verrons que c'est seulement dans des cas rares, exceptionnels, que
cette dfinition du vrai trouve son application. Ce qui est rel, c'est tel ou tel
fait dtermin s'accomplissant en tel ou tel point de l'espace et du temps, c'est
du singulier, c'est du changeant. Au contraire, la plupart de nos affirmations
sont gnrales et impliquent une certaine stabilit de leur objet. Prenons une
vrit aussi voisine que possible de l'exprience, celle-ci par exemple : la
chaleur dilate les corps . De quoi pourrait-elle bien tre la copie ? Il est
possible, en un certain sens, de copier la dilatation d'un corps dtermin des
moments dtermins, en la photographiant dans ses diverses phases. Mme,
par mtaphore, je puis encore dire que l'affirmation cette barre de fer se
dilate est la copie de ce qui se passe quand j'assiste la dilatation de la barre
de fer. Mais une vrit qui s'applique tous les corps, sans concerner spcialement aucun de ceux que j'ai vus, ne copie rien, ne reproduit rien. Nous
voulons cependant qu'elle copie quelque chose, et, de tout temps, la philosophie a cherch nous donner satisfaction sur ce point. Pour les philosophes
anciens, il y avait, au-dessus du temps et de l'espace, un monde o sigeaient,
de toute ternit, toutes les vrits possibles : les affirmations humaines
taient, pour eux, d'autant plus vraies qu'elles copiaient plus fidlement ces
vrits ternelles. Les modernes ont fait descendre la vrit du ciel sur la
1
Dans la belle tude qu'il a consacre William JAMES (Revue de mtaphysique et de
morale, novembre 1910), M. mile Boutroux a fait ressortir le sens tout particulier du
verbe anglais to experience, qui veut dire, non constater froidement une chose qui se
passe en dehors de nous, mais prouver, sentir en soi, vivre soi-mme telle ou telle
manire d'tre...
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
134
terre ; mais ils y voient encore quelque chose qui prexisterait nos affirmations. La vrit serait dpose dans les choses et dans les faits : notre science
irait l'y chercher, la tirerait de sa cachette, l'amnerait au grand jour. Une
affirmation telle que la chaleur dilate les corps serait une loi qui gouverne
les faits, qui trne, sinon au-dessus d'eux, du moins au milieu d'eux, une loi
vritablement contenue dans notre exprience et que nous nous bornerions
en extraire. Mme une philosophie comme celle de Kant, qui veut que toute
vrit scientifique soit relative l'esprit humain, considre les affirmations
vraies comme donnes par avance dans l'exprience humaine : une fois cette
exprience organise par la pense humaine en gnral, tout le travail de la
science consisterait percer l'enveloppe rsistante des faits l'intrieur
desquels la vrit est loge, comme une noix dans sa coquille.
Cette conception de la vrit est naturelle notre esprit et naturelle aussi
la philosophie, parce qu'il est naturel de se reprsenter la ralit comme un
tout parfaitement cohrent et systmatis, que soutient une armature logique.
Cette armature serait la vrit mme ; notre science ne ferait que la retrouver.
Mais l'exprience pure et simple ne nous dit rien de semblable, et James s'en
tient l'exprience. L'exprience nous prsente un flux de phnomnes : si
telle ou telle affirmation relative l'un d'eux nous permet de matriser ceux
qui le suivront ou mme simplement de les prvoir, nous disons de cette
affirmation qu'elle est vraie. Une proposition telle que la chaleur dilate les
corps , proposition suggre par la vue de la dilatation d'un certain corps, fait
que nous prvoyons comment d'autres corps se comporteront en prsence de
la chaleur ; elle nous aide passer d'une exprience ancienne des expriences nouvelles c'est un fil conducteur, rien de plus. La ralit coule nous
coulons avec elle ; et nous appelons vraie toute affirmation qui, en nous
dirigeant travers la ralit mouvante, nous donne prise sur elle et nous place
dans de meilleures conditions pour agir.
On voit la diffrence entre cette conception de la vrit et la conception
traditionnelle. Nous dfinissons d'ordinaire le vrai par sa conformit ce qui
existe dj ; James le dfinit par sa relation ce qui n'existe pas encore. Le
vrai, selon William James, ne copie pas quelque chose qui a t ou qui est : il
annonce ce qui sera, ou plutt il prpare notre action sur ce qui va tre. La
philosophie a une tendance naturelle vouloir que la vrit regarde en arrire :
pour James elle regarde en avant.
Plus prcisment, les autres doctrines font de la vrit quelque chose
d'antrieur l'acte bien dtermin de l'homme qui la formule pour la premire
fois. Il a t le premier la voir, disons-nous, mais elle l'attendait, comme
l'Amrique attendait Christophe Colomb. Quelque chose la cachait tous les
regards et, pour ainsi dire, la couvrait : il l'a dcouverte. Tout autre est la
conception de William James. Il ne nie pas que la ralit soit indpendante, en
grande partie au moins, de ce que nous disons ou pensons d'elle ; mais la
vrit, qui ne peut s'attacher qu' ce que nous affirmons de la ralit, lui parat
tre cre par notre affirmation. Nous inventons la vrit pour utiliser la
ralit, comme nous crons des dispositifs mcaniques pour utiliser les forces
de la nature. On pourrait, ce me semble, rsumer tout l'essentiel de la conception pragmatiste de la vrit dans une formule telle que celle-ci : tandis que
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
135
pour les autres doctrines une vrit nouvelle est une dcouverte, pour le pragmatisme c'est une invention 1.
Il ne suit pas de l que la vrit soit arbitraire. Une invention mcanique
ne vaut que par son utilit pratique. De mme une affirmation, pour tre vraie,
doit accrotre notre empire sur les choses. Elle n'en est pas moins la cration
d'un certain esprit individuel, et elle ne prexistait pas plus l'effort de cet
esprit que le phonographe, par exemple, ne prexistait Edison. Sans doute
l'inventeur du phonographe a d tudier les proprits du son, qui est une
ralit. Mais son invention s'est surajoute cette ralit comme une chose
absolument nouvelle, qui ne se serait peut-tre jamais produite s'il n'avait pas
exist. Ainsi une vrit, pour tre viable, doit avoir sa racine dans des ralits ;
mais ces ralits ne sont que le terrain sur lequel cette vrit pousse, et
d'autres fleurs auraient aussi bien pouss l si le vent y avait apport d'autres
graines.
La vrit, d'aprs le pragmatisme, s'est donc faite peu peu, grce aux
apports individuels d'un grand nombre d'inventeurs. Si ces inventeurs
n'avaient pas exist, s'il y en avait eu d'autres leur place, nous aurions eu un
corps de vrits tout diffrent. La ralit ft videmment reste ce qu'elle est,
ou peu prs ; mais autres eussent t les routes que nous y aurions traces
pour la commodit de notre circulation. Et il ne s'agit pas seulement ici des
vrits scientifiques. Nous ne pouvons construire une phrase, nous ne pouvons
mme plus aujourd'hui prononcer un mot, sans accepter certaines hypothses
qui ont t cres par nos anctres et qui auraient pu tre trs diffrentes de ce
qu'elles sont. Quand je dis : mon crayon vient de tomber sous la table , je
n'nonce certes pas un fait d'exprience, car ce que la vue et le toucher me
montrent, c'est simplement que ma main s'est ouverte et qu'elle a laiss chapper ce qu'elle tenait : le bb attach sa chaise, qui voit tomber l'objet avec
lequel il joue, ne se figure probablement pas que cet objet continue d'exister ;
ou plutt il n'a pas l'ide nette d'un objet , c'est--dire de quelque chose qui
subsiste, invariable et indpendant, travers la diversit et la mobilit des
apparences qui passent. Le premier qui s'avisa de croire cette invariabilit et
cette indpendance fit une hypothse : c'est cette hypothse que nous adoptons couramment toutes les fois que nous employons un substantif, toutes les
fois que nous parlons. Notre grammaire aurait t autre, autres eussent t les
articulations de notre pense, si l'humanit, au cours de son volution, avait
prfr adopter des hypothses d'un autre genre.
La structure de notre esprit est donc en grande partie notre uvre, ou tout
au moins l'uvre de quelques-uns d'entre nous. L est, ce me semble, la thse
la plus importante du pragmatisme, encore qu'elle n'ait pas t explicitement
dgage. C'est par l que le pragmatisme continue le kantisme. Kant avait dit
que la vrit dpend de la structure gnrale de l'esprit humain. Le pragmatisme ajoute, ou tout au moins implique, que la structure de l'esprit humain est
l'effet de la libre initiative d'un certain nombre d'esprits individuels.
Je ne suis pas sr que James ait employ le mot invention , ni qu'il ait explicitement
compar la vrit thorique un dispositif mcanique ; mais je crois que ce rapprochement est conforme l'esprit de la doctrine, et qu'il peut nous aider comprendre le pragmatisme.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
136
Cela ne veut pas dire, encore une fois, que la vrit dpende de chacun de
nous : autant vaudrait croire que chacun de nous pouvait inventer le phonographe. Mais cela veut dire que, des diverses espces de vrit, celle qui est le
plus prs de concider avec son objet n'est pas la vrit scientifique, ni la
vrit de sens commun, ni, plus gnralement, la vrit d'ordre intellectuel.
Toute vrit est une route trace travers la ralit ; mais, parmi ces routes, il
en est auxquelles nous aurions pu donner une direction trs diffrente si notre
attention s'tait oriente dans un sens diffrent ou si nous avions vis un autre
genre d'utilit ; il en est, au contraire, dont la direction est marque par la
ralit mme : il en est qui correspondent, si l'on peut dire, des courants de
ralit. Sans doute celles-ci dpendent encore de nous dans une certaine
mesure, car nous sommes libres de rsister au courant ou de le suivre, et,
mme si nous le suivons, nous pouvons l'inflchir diversement, tant associs
en mme temps que soumis la force qui s'y manifeste. Il n'en est pas moins
vrai que ces courants ne sont pas crs par nous ; ils font partie intgrante de
la ralit. Le pragmatisme aboutit ainsi intervertir l'ordre dans lequel nous
avons coutume de placer les diverses espces de vrit. En dehors des vrits
qui traduisent des sensations brutes, ce seraient les vrits de sentiment qui
pousseraient dans la ralit les racines les plus profondes. Si nous convenons
de dire que toute vrit est une invention, il faudra, je crois, pour rester fidle
la pense de William James, tablir entre les vrits de sentiment et les
vrits scientifiques le mme genre de diffrence qu'entre le bateau voiles,
par exemple, et le bateau vapeur : l'un et l'autre sont des inventions humaines ; mais le premier ne fait l'artifice qu'une part lgre, il prend la direction
du vent et rend sensible aux yeux la force naturelle qu'il utilise ; dans le
second, au contraire, c'est le mcanisme artificiel qui tient la plus grande
place ; il recouvre la force qu'il met en jeu et lui assigne une direction que
nous avons choisie nous-mmes.
La dfinition que James donne de la vrit fait donc corps avec sa conception de la ralit. Si la ralit n'est pas cet univers conomique et systmatique
que notre logique aime se reprsenter, si elle n'est pas soutenue par une
armature d'intellectualit, la vrit d'ordre intellectuel est une invention
humaine qui a pour effet d'utiliser la ralit plutt que de nous introduire en
elle. Et si la ralit ne forme pas un ensemble, si elle est multiple et mobile,
faite de courants qui s'entre-croisent, la vrit qui nat d'une prise de contact
avec quelqu'un de ces courants, vrit sentie avant d'tre conue, est plus
capable que la vrit simplement pense de saisir et d'emmagasiner la ralit
mme.
C'est donc enfin cette thorie de la ralit que devrait s'attaquer d'abord
une critique du pragmatisme. On pourra lever des objections contre elle, et
nous ferions nous-mme, en ce qui la concerne, certaines rserves : personne
n'en contestera la profondeur et l'originalit. Personne non plus, aprs avoir
examin de prs la conception de la vrit qui s'y rattache, n'en mconnatra
l'lvation morale. On a dit que le pragmatisme de James n'tait qu'une forme
du scepticisme, qu'il rabaissait la vrit, qu'il la surbordonnait l'utilit matrielle, qu'il dconseillait, qu'il dcourageait la recherche scientifique dsintresse. Une telle interprtation ne viendra jamais l'esprit de ceux qui liront
attentivement l'uvre. Et elle surprendra profondment ceux qui ont eu le
bonheur de connatre l'homme. Nul n'aima la vrit d'un plus ardent amour.
Nul ne la chercha avec plus de passion. Une immense inquitude le soulevait ;
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
137
et, de science en science, de l'anatomie et de la physiologie la psychologie,
de la psychologie la philosophie, il allait, tendu sur les grands problmes,
insoucieux du reste, oublieux de lui-mme. Toute sa vie il observa, il exprimenta, il mdita. Et comme s'il n'et pas assez fait, il rvait encore, en
s'endormant de son dernier sommeil, il rvait d'expriences extraordinaires et
d'efforts plus qu'humains par lesquels il pt continuer, jusque par del la mort,
travailler avec nous pour le plus grand bien de la science, pour la plus
grande gloire de la vrit.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
138
La pense et le mouvant
IX
La vie et luvre
de Ravaisson
1
Retour la table des matires
Jean-Gaspard-Flix Lach Ravaisson est n le 23 octobre 1813 Namur,
alors ville franaise, chef-lieu du dpartement de Sambre-et-Meuse. Son pre,
trsorier-payeur dans cette ville, tait originaire du Midi ; Ravaisson est le
nom d'une petite terre situe aux environs de Caylus, non loin de Montauban.
L'enfant avait un an peine quand les vnements de 1814 forcrent sa
famille quitter Namur. Peu de temps aprs, il perdait son pre. Sa premire
ducation fut surveille par sa mre, et aussi par son oncle maternel, GaspardThodore Mollien, dont il prit plus tard le nom. Dans une lettre date de 1821,
1
Cette notice sur La vie et les oeuvres de M. Flix Ravaisson-Mollien a paru dans les
Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences morales et politiques, 1904, t. I, p. 686, aprs
avoir t lue cette Acadmie par l'auteur, qui succdait Ravaisson. Elle a t rdite
comme introduction Flix RAVAISSON, Testament et fragments, volume publi en
1932 par Ch. DEVIVAISE. M. Jacques Chevalier, membre du Comit de publication de
la collection o paraissait le volume, avait fait prcder la notice de ces mots : L'auteur
avait song d'abord y apporter quelques retouches. Puis il s'est dcid rditer ces
pages telles qu'elles, bien qu'elles soient encore exposes, nous dit-il, au reproche qu'on
lui fit alors d'avoir quelque peu bergsonifi Ravaisson. Mais c'tait peut-tre, ajoute
M. Bergson, la seule manire de clarifier le sujet, en le prolongeant.
Nous devons divers renseignements biographiques l'obligeance des deux fils de M.
Ravaisson : M. Louis Ravaisson-Mollien, bibliothcaire la bibliothque Mazarine, et M.
Charles Ravaisson-Mollien, conservateur adjoint au muse du Louvre.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
139
Mollien crit de son petit neveu, alors g de huit ans : Flix est un Mathmaticien complet, un antiquaire, un historien, tout enfin 1. Dj se rvlait
chez l'enfant une qualit intellectuelle laquelle devaient s'en joindre beaucoup d'autres, la facilit.
Il fit ses tudes au collge Rollin. Nous aurions voulu l'y suivre de classe
en classe, mais les archives du Collge n'ont rien conserv de cette priode.
Les palmars nous apprennent toutefois que le jeune Ravaisson entra en 1825
dans la classe de sixime, qu'il quitta le collge en 1832, et qu'il fut, d'un bout
l'autre de ses tudes, un lve brillant. Il remporta plusieurs prix au concours
gnral, notamment, en 1832, le prix d'honneur de philosophie. Son professeur de philosophie fut M. Poret, un matre distingu, disciple des philosophes
cossais dont il traduisit certains ouvrages, fort apprci de M. Cousin, qui le
prit pour supplant la Sorbonne. M. Ravaisson resta toujours attach son
ancien matre. Nous avons pu lire, pieusement conserves dans la famille de
M. Poret, quelques-unes des dissertations que l'lve Ravaisson composa dans
la classe de philosophie 2 ; nous avons eu communication, la Sorbonne, de la
dissertation sur la mthode en philosophie qui obtint le prix d'honneur en
1832. Ce sont les travaux d'un colier docile et intelligent, qui a suivi un cours
bien fait. Ceux qui y chercheraient la marque propre de M. Ravaisson et les
premiers indices d'une vocation philosophique naissante prouveraient quelque dsappointement. Tout nous porte supposer que le jeune Ravaisson
sortit du collge sans prfrence arrte pour la philosophie, sans avoir aperu
clairement o tait sa voie. Ce fut votre Acadmie qui la lui montra.
L'ordonnance royale du 26 octobre 1832 venait de rtablir l'Acadmie des
Sciences morales et politiques. Sur la proposition de M. Cousin, l'Acadmie
avait mis au concours l'tude de la Mtaphysique d'Aristote. Les concurrents, disait le programme, devront faire connatre cet ouvrage par une analyse
tendue et en dterminer le plan, en faire l'histoire, en signaler l'influence
sur les systmes ultrieurs, rechercher et discuter la part d'erreur et la part de
vrit qui s'y trouvent, quelles sont les ides qui en subsistent encore
aujourd'hui et celles qui pourraient entrer utilement dans la philosophie de
notre sicle. C'est probablement sur le conseil de son ancien professeur de
philosophie que M. Ravaisson se dcida concourir. On sait comment ce
concours, le premier qui ait t ouvert par l'Acadmie reconstitue, donna les
rsultats les plus brillants, comment neuf mmoires furent prsents dont la
plupart avaient quelque mrite et dont trois furent jugs suprieurs, comment
l'Acadmie dcerna le prix M. Ravaisson et demanda au ministre de faire les
fonds d'un prix supplmentaire pour le philosophe Michelet de Berlin, comment M. Ravaisson refondit son mmoire, l'tendit, l'largit, l'approfondit, en
fit un livre admirable. De l'Essai sur la mtaphysique d'Aristote le premier
volume parut ds 1837, le second ne fut publi que neuf ans plus tard. Deux
autres volumes taient annoncs, qui ne vinrent jamais ; mais, tel que nous
l'avons, l'ouvrage est un expos complet de la mtaphysique d'Aristote et de
l'influence qu'elle exera sur la philosophie grecque.
1
2
Nous empruntons ce dtail, avec plusieurs autres, la trs Intressante notice que M.
Louis Leger a lue l'Acadmie des Inscriptions et Belles-lettres, le 14 juin 1901.
Nous devons cette communication, ainsi que plusieurs dtails biographiques Intressants,
aux deux petits-fils de M. Poret, eux aussi professeurs distingus de l'Universit, MM.
Henri et Marcel Berns.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
140
Aristote, gnie systmatique entre tous, n'a point difi un systme. Il
procde par analyse de concepts plutt que par synthse. Sa mthode consiste
prendre les ides emmagasines dans le langage, les redresser ou les
renouveler, les circonscrire dans une dfinition, en dcouper l'extension et
la comprhension selon leurs articulations naturelles, en pousser aussi loin
que possible le dveloppement. Encore est-il rare qu'il effectue ce dveloppement tout d'un coup : il reviendra plusieurs reprises, dans des traits diffrents, sur le mme sujet, suivant nouveau le mme chemin, avanant
toujours un peu plus loin. Quels sont les lments impliqus dans la pense ou
dans l'existence ? Qu'est-ce que la matire, la forme, la causalit, le temps, le
lieu, le mouvement ? Sur tous ces points, et sur cent autres encore, il a fouill
le sol ; de chacun d'eux il a fait partir une galerie souterraine qu'il a pousse en
avant, comme l'ingnieur qui creuserait un tunnel immense en l'attaquant
simultanment sur un grand nombre de points. Et, certes, nous sentons bien
que les mesures ont t prises et les calculs effectus pour que tout se rejoignt ; mais la jonction n'est pas toujours faite, et souvent, entre des points qui
nous paraissaient prs de se toucher, alors que nous nous flattions de n'avoir
retirer que quelques pelletes de sable, nous rencontrons le tuf et le roc. M.
Ravaisson ne s'arrta devant aucun obstacle. La mtaphysique qu'il nous
expose la fin de son premier volume, c'est la doctrine dAristote unifie et
rorganise. Il nous l'expose dans une langue qu'il a cre pour elle, o la
fluidit des images laisse transparatre l'ide nue, o les abstractions s'animent
et vivent comme elles vcurent dans la pense d'Aristote. On a pu contester
l'exactitude matrielle de certaines de ses traductions ; on a lev des doutes
sur quelques-unes de ses interprtations ; surtout, on s'est demand si le rle
de l'historien tait bien de pousser l'unification d'une doctrine plus loin que ne
l'a voulu faire le matre, et si, rajuster si bien les pices et en serrer si fort
l'engrenage, on ne risque pas de dformer quelques-unes d'entre elles. Il n'en
est pas moins vrai que notre esprit rclame cette unification, que l'entreprise
devait tre tente, et que nul, aprs M. Ravaisson, n'a os la renouveler.
Le second volume de l'Essai est plus hardi encore. Dans la comparaison
qu'il institue entre la doctrine d'Aristote et la pense grecque en gnral, c'est
l'me mme de l'aristotlisme que M. Ravaisson cherche dgager.
La philosophie grecque, dit-il, expliqua d'abord toutes choses par un
lment matriel, l'eau, l'air, le feu, ou quelque matire indfinie. Domine par
la sensation, comme l'est au dbut l'intelligence humaine, elle ne connut pas
d'autre intuition que l'intuition sensible, pas d'autre aspect des choses que leur
matrialit. Vinrent alors les Pythagoriciens et les Platoniciens, qui montrrent
l'insuffisance des explications par la seule matire, et prirent pour principes les
Nombres et les Ides. Mais le progrs fut plus apparent que rel. Avec les
nombres pythagoriciens, avec les ides platoniciennes, on est dans l'abstraction, et si savante que soit la manipulation laquelle on soumet ces lments,
on reste dans l'abstrait. L'intelligence, merveille de la simplification qu'elle
apporte l'tude des choses en les groupant sous des ides gnrales,
s'imagine sans doute pntrer par elles jusqu' la substance mme dont les
choses sont faites. mesure qu'elle va plus loin dans la srie des gnralits,
elle croit s'lever davantage dans l'chelle des ralits. Mais ce qu'elle prend
pour une spiritualit plus haute n'est que la rarfaction croissante de l'air
qu'elle respire. Elle ne voit pas que, plus une ide est gnrale, plus elle est
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
141
abstraite et vide, et que d'abstraction en abstraction, de gnralit en gnralit, on s'achemine au pur nant. Autant et valu s'en tenir aux donnes des
sens, qui ne nous livraient sans doute qu'une partie de la ralit, mais qui nous
laissaient du moins sur le terrain solide du rel. Il y aurait un tout autre parti
prendre. Ce serait de prolonger la vision de l'il par une vision de l'esprit. Ce
serait, sans quitter le domaine de l'intuition, c'est--dire des choses relles,
individuelles, concrtes, de chercher sous l'intuition sensible une intuition
intellectuelle. Ce serait, par un puissant effort de vision mentale, de percer
l'enveloppe matrielle des choses et d'aller lire la formule, invisible l'il,
que droule et manifeste leur matrialit. Alors apparatrait l'unit qui relie les
tres les uns aux autres, l'unit d'une pense que nous voyons, de la matire
brute la plante, de la plante l'animal, de l'animal l'homme, se ramasser
sur sa propre substance, jusqu' ce que, de concentration en concentration,
nous aboutissions la pense divine, qui pense toutes choses en se pensant
elle-mme. Telle fut la doctrine d'Aristote. Telle est la discipline intellectuelle
dont il apporta la rgle et l'exemple. En ce sens, Aristote est le fondateur de la
mtaphysique et l'initiateur d'une certaine mthode de penser qui est la
philosophie mme.
Grande et importante ide ! Sans doute on pourra contester, du point de
vue historique, quelques-uns des dveloppements que l'auteur lui donne. Peuttre M. Ravaisson regarde-t-il parfois Aristote travers les Alexandrins,
d'ailleurs si fortement teints d'aristotlisme. Peut-tre aussi a-t-il pouss un
peu loin, au point de la convertir en une opposition radicale, la diffrence
souvent lgre et superficielle, pour ne pas dire verbale, qui spare Aristote de
Platon. Mais si M. Ravaisson avait donn pleine satisfaction sur ces points aux
historiens de la philosophie, nous y aurions perdu, sans doute, ce qu'il y a de
plus original et de plus profond dans sa doctrine. Car l'opposition qu'il tablit
ici entre Platon et Aristote, c'est la distinction qu'il ne cessa de faire, pendant
toute sa vie, entre la mthode philosophique qu'il tient pour dfinitive et celle
qui n'en est, selon lui, que la contrefaon. L'ide qu'il met au fond de
l'aristotlisme est celle mme qui a inspir la plupart de ses mditations.
travers son uvre entire rsonne cette affirmation qu'au lieu de diluer sa
pense dans le gnral, le philosophe doit la concentrer sur l'individuel.
Soient, par exemple, toutes les nuances de l'arc-en-ciel, celles du violet et
du bleu, celles du vert, du jaune et du rouge. Nous ne croyons pas trahir l'ide
matresse de M. Ravaisson en disant qu'il y aurait deux manires de dterminer ce qu'elles ont de commun et par consquent de philosopher sur elles. La
premire consisterait simplement dire que ce sont des couleurs. L'ide
abstraite et gnrale de couleur devient ainsi l'unit laquelle la diversit des
nuances se ramne. Mais cette ide gnrale de couleur, nous ne l'obtenons
qu'en effaant du rouge ce qui en fait du rouge, du bleu ce qui en fait du bleu,
du vert ce qui en fait du vert ; nous ne pouvons la dfinir qu'en disant qu'elle
ne reprsente ni du rouge, ni du bleu, ni du vert ; c'est une affirmation faite de
ngations, une forme circonscrivant du vide. L s'en tient le philosophe qui
reste dans l'abstrait. Par voie de gnralisation croissante il croit s'acheminer
l'unification des choses : c'est qu'il procde par extinction graduelle de la
lumire qui faisait ressortir les diffrences entre les teintes, et qu'il finit par les
confondre ensemble dans une obscurit commune. Tout autre est la mthode
d'unification vraie. Elle consisterait ici prendre les mille nuances du bleu, du
violet, du vert, du jaune, du rouge, et, en leur faisant traverser une lentille con-
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
142
vergente, les amener sur un mme point. Alors apparatrait dans tout son
clat la pure lumire blanche, celle qui, aperue ici-bas dans les nuances qui la
dispersent, renfermait l-haut, dans son unit indivise, la diversit indfinie
des rayons multicolores. Alors se rvlerait aussi, jusque dans chaque nuance
prise isolment, ce que l'il n'y remarquait pas d'abord, la lumire blanche
dont elle participe, l'clairage commun d'o elle tire sa coloration propre. Tel
est sans doute, d'aprs M. Ravaisson, le genre de vision que nous devons
demander la mtaphysique. De la contemplation d'un marbre antique pourra
jaillir, aux yeux du vrai philosophe, plus de vrit concentre qu'il ne s'en
trouve, l'tat diffus, dans tout un trait de philosophie. L'objet de la mtaphysique est de ressaisir dans les existences individuelles, et de suivre jusqu'
la source d'o il mane, le rayon particulier qui, confrant chacune d'elles sa
nuance propre, la rattache par l la lumire universelle.
Comment, quel moment, sous quelles influences s'est forme dans
l'esprit de M. Ravaisson la philosophie dont nous avons ici les premiers
linaments ? Nous n'en avons pas trouv trace dans le mmoire que votre
Acadmie couronna et dont le manuscrit est dpos vos archives. Entre ce
mmoire manuscrit et l'ouvrage publi il y a d'ailleurs un tel cart, une si
singulire diffrence de fond et de forme, qu'on les croirait peine du mme
auteur. Dans le manuscrit, la Mtaphysique d'Aristote est simplement analyse
livre par livre ; il n'est pas question de reconstruire le systme. Dans l'ouvrage
publi, l'ancienne analyse, d'ailleurs remanie, ne parat avoir t conserve
que pour servir de substruction l'difice cette fois reconstitu de la philosophie aristotlicienne. Dans le manuscrit, Aristote et Platon sont peu prs
sur la mme ligne. L'auteur estime qu'il faut faire Platon sa part, Aristote la
sienne, et les fondre tous deux dans une philosophie qui les dpasse l'un et
l'autre. Dans l'ouvrage publi, Aristote est nettement oppos Platon, et sa
doctrine nous est prsente comme la source o doit s'alimenter toute philosophie. Enfin, la forme du manuscrit est correcte, mais impersonnelle, au lieu
que le livre nous parle dj une langue originale, mlange d'images aux couleurs trs vives et d'abstractions aux contours trs nets, la langue d'un
philosophe qui sut la fois peindre et sculpter. Certes, le mmoire de 1835
mritait l'loge que M. Cousin en fit dans son rapport et le prix que l'Acadmie lui dcerna. Personne ne contestera que ce soit un travail fort bien fait.
Mais ce n'est que du travail bien fait. L'auteur est rest extrieur l'uvre. Il
tudie, analyse et commente Aristote avec sagacit : il ne lui rinsuffle pas la
vie, sans doute parce qu'il n'a pas encore lui-mme une vie intrieure assez
intense. C'est de 1835 1837, dans les deux annes qui s'coulrent entre la
rdaction du mmoire et celle du premier volume, c'est surtout de 1837
1846, entre la publication du premier volume et celle du second, que M.
Ravaisson prit conscience de ce qu'il tait, et, pour ainsi dire, se rvla luimme.
Nombreuses furent sans doute les excitations extrieures qui contriburent
ici au dveloppement des nergies latentes et l'veil de la personnalit. Il ne
faut pas oublier que la priode qui va de 1830 1848 fut une priode de vie
intellectuelle intense. La Sorbonne vibrait encore de la parole des Guizot, des
Cousin, des Villemain, des Geoffroy Saint-Hilaire ; Quinet et Michelet enseignaient au Collge de France. M. Ravaisson connut la plupart d'entre eux,
surtout le dernier, auquel il servit pendant quelque temps de secrtaire. Dans
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
143
une lettre indite de Michelet Jules Quicherat 1 se trouve cette phrase : Je
n'ai connu en France que quatre esprits critiques (peu de gens savent tout ce
que contient ce mot) : Letronne, Burnouf, Ravaisson, et vous. M. Ravaisson
se trouva donc en relation avec des matres illustres, un moment o le haut
enseignement brillait d'un vif clat. Il faut ajouter que cette mme poque vit
s'oprer un rapprochement entre hommes politiques, artistes, lettrs, savants,
tous ceux enfin qui auraient pu constituer, dans une socit tendance dj
dmocratique, une aristocratie de l'intelligence. Quelques salons privilgis
taient le rendez-vous de cette lite. M. Ravaisson aimait le monde. Tout jeune, peu connu encore, il voyait, grce sa parent avec l'ancien ministre
Mollien, s'ouvrir devant lui bien des portes. Nous savons qu'il frquenta chez
la princesse Belgiojoso, o il dut rencontrer Mignet, Thiers, et surtout Alfred
de Musset ; chez Mme Rcamier, dj ge alors, mais gracieuse toujours, et
groupant autour d'elle des hommes tels que Villemain, Ampre, Balzac,
Lamartine : c'est dans le salon de Mme Rcamier, sans doute, qu'il fit la connaissance de Chateaubriand. Un contact frquent avec tant d'hommes
suprieurs devait agir sur l'intelligence comme un stimulant.
Il faudrait tenir compte aussi d'un sjour de quelques semaines que M.
Ravaisson fit en Allemagne, Munich, auprs de Schelling. On trouve dans
l'uvre de M. Ravaisson plus d'une page qui pourrait se comparer, pour la
direction de la pense comme pour l'allure du style, ce qui a t crit de
meilleur par le philosophe allemand. Encore ne faudrait-il pas exagrer l'influence de Schelling. Peut-tre y eut-il moins influence qu'affinit naturelle,
communaut d'inspiration et, si l'on peut parler ainsi, accord prtabli entre
deux esprits qui planaient haut l'un et l'autre et se rencontraient sur certains
sommets. D'ailleurs, la conversation fut assez difficile entre les deux philosophes, l'un connaissant mal le franais et l'autre ne parlant gure davantage
l'allemand.
Voyages, conversations, relations mondaines, tout cela dut veiller la
curiosit de M. Ravaisson et exciter aussi son esprit se produire plus compltement au dehors. Mais les causes qui l'amenrent se concentrer sur luimme furent plus profondes.
En premire ligne il faut placer un contact prolong avec la philosophie
d'Aristote. Dj le mmoire couronn tmoignait d'une tude serre et pntrante des textes. Mais, dans l'ouvrage publi, nous trouvons plus que la connaissance du texte, plus encore que l'intelligence de la doctrine : une adhsion
du cur en mme temps que de l'esprit, quelque chose comme une imprgnation de l'me entire. Il arrive que des hommes suprieurs se dcouvrent de
mieux en mieux eux-mmes mesure qu'ils pntrent plus avant dans
l'intimit d'un matre prfr. Comme les grains parpills de la limaille de
fer, sous l'influence du barreau aimant, s'orientent vers les ples et se disposent en courbes harmonieuses, ainsi, l'appel du gnie qu'elle aime, les
virtualits qui sommeillaient et l dans une me s'veillent, se rejoignent, se
concertent en vue d'une action commune. Or, c'est par cette concentration de
toutes les puissances de l'esprit et du cur sur un point unique que se
constitue une personnalit.
Cite par M. Louis Leger.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
144
Mais, ct d'Aristote, une autre influence n'a cess de s'exercer sur M.
Ravaisson, l'accompagnant travers la vie comme un dmon familier.
Ds son enfance, M. Ravaisson avait manifest des dispositions pour les
arts en gnral, pour la peinture en particulier. Sa mre, artiste de talent, rvait
peut-tre de faire de lui un artiste. Elle le mit entre les mains du peintre Broc,
peut-tre aussi du dessinateur Chassriau, qui frquentait la maison. L'un et
l'autre taient des lves de David. Si M. Ravaisson n'entendit pas la grande
voix du matre, du moins put-il en recueillir l'cho. Ce ne fut pas par simple
amusement qu'il apprit peindre. plusieurs reprises il exposa au Salon, sous
le nom de Lach, des portraits qui furent remarqus. Il dessinait surtout, et ses
dessins taient d'une grce exquise. Ingres lui disait : Vous avez le charme. quel moment se manifesta sa prdilection pour la peinture italienne ?
De bonne heure sans doute, car ds l'ge de seize ou dix-sept ans il excutait
des copies du Titien. Mais il ne parat pas douteux que la priode comprise
entre 1835 et 1845 date l'tude plus approfondie qu'il fit de l'art italien de la
Renaissance. Et c'est la mme priode qu'il faut faire remonter l'influence
que prit et garda sur lui le matre qui ne cessa jamais d'tre ses yeux la
personnification mme de l'art, Lonard de Vinci.
Il y a, dans le Trait de peinture de Lonard de Vinci, une page que M.
Ravaisson aimait citer. C'est celle o il est dit que l'tre vivant se caractrise
par la ligne onduleuse ou serpentine, que chaque tre a sa manire propre de
serpenter, et que l'objet de l'art est de rendre ce serpentement individuel. Le
secret de l'art de dessiner est de dcouvrir dans chaque objet la manire
particulire dont se dirige travers toute son tendue, telle qu'une vague
centrale qui se dploie en vagues superficielles, une certaine ligne flexueuse
qui est comme son axe gnrateur 1. Cette ligne peut d'ailleurs n'tre aucune
des lignes visibles de la figure. Elle n'est pas plus ici que l, mais elle donne la
clef de tout. Elle est moins perue par l'il que pense par l'esprit. La
peinture, disait Lonard de Vinci, est chose mentale. Et il ajoutait que c'est
l'me qui a fait le corps son image. L'uvre entire du matre pourrait servir
de commentaire ce mot. Arrtons-nous devant le portrait de Mona Lisa ou
mme devant celui de Lucrezia Crivelli : ne nous semble-t-il pas que les
lignes visibles de la figure remontent vers un centre virtuel, situ derrire la
toile, o se dcouvrirait tout d'un coup, ramass en un seul mot, le secret que
nous n'aurons jamais fini de lire phrase par phrase dans l'nigmatique physionomie ?C'est l que le peintre s'est plac. C'est en dveloppant une vision
mentale simple, concentre en ce point, qu'il a retrouv, trait pour trait, le
modle qu'il avait sous les yeux, reproduisant sa manire l'effort gnrateur
de la nature.
L'art du peintre ne consiste donc pas, pour Lonard de Vinci, prendre par
le menu chacun des traits du modle pour les reporter sur la toile et en
reproduire, portion par portion, la matrialit. Il ne consiste pas non plus
figurer je ne sais quel type impersonnel et abstrait, o le modle qu'on voit et
qu'on touche vient se dissoudre en une vague idalit. L'art vrai vise rendre
l'individualit du modle, et pour cela il va chercher derrire les lignes qu'on
voit le mouvement que l'il ne voit pas, derrire le mouvement lui-mme
quelque chose de plus secret encore, l'intention originelle, l'aspiration fonda1
RAVAISSON, article Dessin du Dictionnaire pdagogique.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
145
mentale de la personne, pense simple qui quivaut la richesse indfinie des
formes et des couleurs.
Comment ne pas tre frapp de la ressemblance entre cette esthtique de
Lonard de Vinci et la mtaphysique d'Aristote telle que M. Ravaisson l'interprte ? Quand M. Ravaisson oppose Aristote aux physiciens, qui ne virent des
choses que leur mcanisme matriel, et aux platoniciens, qui absorbrent toute
ralit dans des types gnraux, quand il nous montre dans Aristote le matre
qui chercha au fond des tres individuels, par une intuition de l'esprit, la
pense caractristique qui les anime, ne fait-il pas de l'aristotlisme la philosophie mme de cet art que Lonard de Vinci conoit et pratique, art qui ne
souligne pas les contours matriels du modle, qui ne les estompe pas davantage au profit d'un idal abstrait, mais les concentre simplement autour de la
pense latente et de l'me gnratrice ? Toute la philosophie de M. Ravaisson
drive de cette ide que l'art est une mtaphysique figure, que la mtaphysique est une rflexion sur l'art, et que c'est la mme intuition, diversement
utilise, qui fait le philosophe profond et le grand artiste. M. Ravaisson prit
possession de lui-mme, il devint matre de sa pense et de sa plume le jour o
cette identit se rvla clairement son esprit. L'identification se fit au
moment o se rejoignirent en lui les deux courants distincts qui le portaient
vers la philosophie et vers l'art. Et la jonction s'opra quand lui parurent se
pntrer rciproquement et s'animer d'une vie commune les deux gnies qui
reprsentaient ses yeux la philosophie dans ce qu'elle a de plus profond et
l'art dans ce qu'il a de plus lev, Aristote et Lonard de Vinci.
La thse de doctorat que M. Ravaisson soutint vers cette poque (1838) est
une premire application de la mthode. Elle porte un titre modeste : De
l'habitude. Mais c'est toute une philosophie de la nature que l'auteur y expose.
Qu'est-ce que la nature ? Comment s'en reprsenter l'intrieur ? Que cache-telle sous la succession rgulire des causes et des effets ? Cache-t-elle mme
quelque chose, ou ne se rduirait-elle pas, en somme, un dploiement tout
superficiel de mouvements qui s'engrnent mcaniquement les uns dans les
autres ? Conformment son principe, M. Ravaisson demande la solution de
ce problme trs gnral une intuition trs concrte, celle que nous avons de
notre propre manire d'tre quand nous contractons une habitude. Car l'habitude motrice, une fois prise, est un mcanisme, une srie de mouvements qui
se dterminent les uns les autres : elle est cette partie de nous qui est insre
dans la nature et qui concide avec la nature ; elle est la nature mme. Or,
notre exprience intrieure nous montre dans l'habitude une activit qui a
pass, par degrs insensibles, de la conscience l'inconscience et de la volont
l'automatisme. N'est-ce pas alors sous cette forme, comme une conscience
obscurcie et une volont endormie, que nous devons nous reprsenter la
nature ? L'habitude nous donne ainsi la vivante dmonstration de cette vrit
que le mcanisme ne se suffit pas lui-mme : il ne serait, pour ainsi dire, que
le rsidu fossilis d'une activit spirituelle.
Ces ides, comme beaucoup de celles que nous devons M. Ravaisson,
sont devenues classiques. Elles ont si bien pntr dans notre philosophie,
toute une gnration s'en est tel point imprgne, que nous avons quelque
peine, aujourd'hui, en reconstituer l'originalit. Elles frapprent les contemporains. La thse sur l'Habitude, comme d'ailleurs l'Essai sur la mtaphysique
d'Aristote, eut un retentissement de plus en plus profond dans le monde
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
146
philosophique. L'auteur, tout jeune encore, tait dj un matre. Il paraissait
dsign pour une chaire dans le haut enseignement, soit la Sorbonne, soit au
Collge de France, o il dsira, o il faillit avoir la supplance de Jouffroy. Sa
carrire y tait toute trace. Il et dvelopp en termes prcis, sur des points
dtermins, les principes encore un peu flottants de sa philosophie. L'obligation d'exposer ses doctrines oralement, de les prouver sur des problmes
varis, d'en faire des applications concrtes aux questions que posent la
science et la vie, l'et amen descendre parfois des hauteurs o il aimait se
tenir. Autour de lui se ft empresse l'lite de notre jeunesse, toujours prte
s'enflammer pour de nobles ides exprimes dans un beau langage. Bientt,
sans doute, votre Acadmie lui et ouvert ses portes. Une cole se serait
constitue, que ses origines aristotliques n'auraient pas empche d'tre trs
moderne, pas plus que ses sympathies pour l'art ne l'eussent loigne de la
science positive. Mais le sort en dcida autrement. M. Ravaisson n'entra
l'Acadmie des Sciences morales que quarante ans plus tard, et il ne s'assit
jamais dans une chaire de philosophie.
C'tait en effet le temps o M. Cousin, du haut de son sige au Conseil
royal, exerait sur l'enseignement de la philosophie une autorit inconteste.
Certes, il avait t le premier encourager les dbuts de M. Ravaisson. Avec
son coup dil habituel, il avait vu ce que le mmoire prsent l'Acadmie
contenait de promesses. Plein d'estime pour le jeune philosophe, il l'admit
pendant quelque temps ces causeries philosophiques qui commenaient par
de longues promenades au Luxembourg et qui s'achevaient, le soir, par un
dner dans un restaurant du voisinage, clectisme aimable qui prolongeait la
discussion pripatticienne en banquet platonicien. D'ailleurs, regarder du
dehors, tout semblait devoir rapprocher M. Ravaisson de M. Cousin. Les deux
philosophes n'avaient-ils pas le mme amour de la philosophie antique, la
mme aversion pour le sensualisme du XVIIIe sicle, le mme respect pour la
tradition des grands matres, le mme souci de rajeunir cette philosophie traditionnelle, la mme confiance dans l'observation intrieure, les mmes vues
gnrales sur la parent du vrai et du beau, de la philosophie et de l'art ? Oui
sans doute, mais ce qui fait l'accord de deux esprits, c'est moins la similitude
des opinions qu'une certaine affinit de temprament intellectuel.
Chez M. Cousin, la pense tait tendue tout entire vers la parole, et la
parole vers l'action. Il avait besoin de dominer, de conqurir, d'organiser. De
sa philosophie il disait volontiers mon drapeau , des professeurs de philosophie mon rgiment ; et il marchait en tte, ne ngligeant pas de faire
donner, l'occasion, un coup de clairon sonore. Il n'tait d'ailleurs pouss ni
par la vanit, ni par l'ambition, mais par un sincre amour de la philosophie.
Seulement il l'aimait sa manire, en homme d'action. Il estimait que le
moment tait venu pour elle de faire quelque bruit dans le monde. Il la voulait
puissante, s'emparant de l'enfant au collge, dirigeant l'homme travers la vie,
lui assurant dans les difficults morales, sociales, politiques, une rgle de
conduite marque exclusivement au sceau de la raison. ce rve, il donna un
commencement de ralisation en installant solidement dans notre Universit
une philosophie discipline : organisateur habile, politique avis, causeur
incomparable, professeur entranant, auquel il n'a manqu peut-tre, pour
mriter plus pleinement le nom de philosophe, que de savoir supporter quelquefois le tte--tte avec sa propre pense.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
147
C'est aux pures ides que M. Ravaisson s'attachait. Il vivait pour elles,
avec elles, dans un temple invisible o il les entourait d'une adoration
silencieuse. On le sentait dtach du reste, et comme distrait des ralits de la
vie. Toute sa personne respirait cette discrtion extrme qui est la suprme
distinction. Sobre de gestes, peu prodigue de mots, glissant sur l'expression de
l'ide, n'appuyant jamais, parlant bas, comme s'il et craint d'effaroucher par
trop de bruit les penses ailes qui venaient se poser autour de lui, il estimait
sans doute que, pour se faire entendre loin, il n'est pas ncessaire d'enfler
beaucoup la voix quand on ne donne que des sons trs purs. Jamais homme ne
chercha moins que celui-l agir sur d'autres hommes. Mais jamais esprit ne
fut plus naturellement, plus tranquillement, plus invinciblement rebelle
l'autorit d'autrui. Il ne donnait pas de prise. Il chappait par son immatrialit.
Il tait de ceux qui n'offrent mme pas assez de rsistance pour qu'on puisse se
flatter de les voir jamais cder. M. Cousin, s'il fit quelque tentative de ce ct,
s'aperut bien vite qu'il perdait son temps et sa peine.
Aussi ces deux esprits, aprs un contact o se rvla leur incompatibilit,
s'cartrent-ils naturellement l'un de l'autre. Quarante ans plus tard, g et
gravement malade, sur le point de partir pour Cannes, o il allait mourir, M.
Cousin manifesta le dsir d'un rapprochement : la gare de Lyon, devant le
train prt s'branler, il tendit la main M. Ravaisson ; on changea des paroles mues. Il n'en est pas moins vrai que ce fut l'attitude de M. Cousin son
gard qui dcouragea M. Ravaisson de devenir, si l'on peut parler ainsi, un
philosophe de profession, et qui le dtermina suivre une autre carrire.
M. de Salvandy, alors ministre de l'Instruction publique, connaissait M.
Ravaisson personnellement. Il le prit pour chef de cabinet. Peu de temps
aprs, il le chargea (pour la forme, car M. Ravaisson n'occupa jamais ce poste)
d'un cours la Facult de Rennes. Enfin, en 1839, il lui confiait l'emploi
nouvellement cr d'inspecteur des bibliothques. M. Ravaisson se trouva
ainsi engag dans une voie assez diffrente de celle laquelle il avait pens. Il
resta inspecteur des bibliothques jusqu'au jour o il devint inspecteur gnral
de l'Enseignement suprieur, c'est--dire pendant une quinzaine d'annes.
plusieurs reprises, il publia des travaux importants sur le service dont il tait
charg en 1841, un Rapport sur les bibliothques des dpartements de
l'Ouest ; en 1846, un Catalogue des manuscrits de la bibliothque de Laon ;
en 1862, un Rapport sur les archives de l'Empire et sur l'organisation de la
Bibliothque impriale. Les recherches d'rudition l'avaient toujours attir, et,
d'autre part, la connaissance approfondie de l'antiquit que rvlait son Essai
sur la mtaphysique d'Aristote devait assez naturellement le dsigner au choix
de l'Acadmie des Inscriptions. Il fut lu membre de cette Acadmie en 1849,
en remplacement de Letronne.
On ne peut se dfendre d'un regret quand on pense que le philosophe qui
avait produit si jeune, en si peu de temps, deux uvres magistrales, resta
ensuite vingt ans sans rien donner d'important la philosophie : le beau mmoire sur le stocisme, lu l'Acadmie des Inscriptions en 1849 et 1851,
publi en 1857, a d tre compos avec des matriaux runis pour l'Essai sur
la mtaphysique d'Aristote. Pendant ce long intervalle, M. Ravaisson cessa-t-il
de philosopher ? Non, certes, mais il tait de ceux qui ne se dcident crire
que lorsqu'ils y sont dtermins par quelque sollicitation extrieure ou par
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
148
leurs occupations professionnelles. C'est pour un concours acadmique qu'il
avait compos son Essai, pour son examen de doctorat la dissertation sur
l'Habitude. Rien, dans ses nouvelles occupations, ne l'incitait produire. Et
peut-tre n'aurait-il jamais formul les conclusions o vingt nouvelles annes
de rflexion l'avaient conduit, s'il n'et t invit officiellement le faire.
Le gouvernement imprial avait dcid qu'on rdigerait, l'occasion de
l'Exposition de 1867, un ensemble de rapports sur le progrs des sciences, des
lettres et des arts en France au XIXe sicle. M. Duruy tait alors ministre de
l'Instruction publique. Il connaissait bien M. Ravaisson, l'ayant eu pour condisciple au collge Rollin. Dj, en 1863, lors du rtablissement de l'agrgation de philosophie, il avait confi M. Ravaisson la prsidence du jury. qui
allait-il demander le rapport sur les progrs de la philosophie ? Plus d'un
philosophe minent, occupant une chaire d'Universit, aurait pu prtendre
cet honneur. M. Duruy aima mieux s'adresser M. Ravaisson, qui tait un
philosophe hors cadre. Et ce ministre, qui eut tant de bonnes inspirations pendant son trop court passage aux affaires, n'en eut jamais de meilleure que ce
jour-l.
M. Ravaisson aurait pu se contenter de passer en revue les travaux des
philosophes les plus renomms du sicle. On ne lui en demandait probablement pas davantage. Mais il comprit sa tche autrement. Sans s'arrter
l'opinion qui tient quelques penseurs pour dignes d'attention, les autres pour
ngligeables, il lut tout, en homme qui sait ce que peut la rflexion sincre et
comment, par la seule force de cet instrument, les plus humbles ouvriers ont
extrait du plus vil minerai quelques parcelles d'or. Ayant tout lu, il prit ensuite
son lan pour tout dominer. Ce qu'il cherchait, c'tait, travers les hsitations
et les dtours d'une pense qui n'a pas toujours eu pleine conscience de ce
qu'elle voulait ni de ce qu'elle faisait, le point, situ peut-tre loin dans
l'avenir, o notre philosophie s'achemine.
Reprenant et largissant l'ide matresse de son Essai, il distinguait deux
manires de philosopher. La premire procde par analyse ; elle rsout les
choses en leurs lments inertes ; de simplification en simplification elle va
ce qu'il y a de plus abstrait et de plus vide. Peu importe d'ailleurs que ce
travail d'abstraction soit effectu par un physicien qu'on appellera mcaniste
ou par un logicien qui se dira idaliste : dans les deux cas, c'est du matrialisme. L'autre mthode ne tient pas seulement compte des lments, mais de leur
ordre, de leur entente entre eux et de leur direction commune. Elle n'explique
plus le vivant par le mort, mais, voyant partout la vie, c'est par leur aspiration
une forme de vie plus haute qu'elle dfinit les formes les plus lmentaires.
Elle ne ramne plus le suprieur l'infrieur, mais, au contraire, l'infrieur au
suprieur. C'est, au sens propre du mot, le spiritualisme.
Maintenant, si l'on examine la philosophie franaise du XIXe sicle, non
seulement chez les mtaphysiciens, mais aussi chez les savants qui ont fait la
philosophie de leur science, voici, d'aprs M. Ravaisson, ce qu'on trouve. Il
n'est pas rare que l'esprit s'oriente d'abord dans la direction matrialiste et
s'imagine mme y persister. Tout naturellement il cherche une explication
mcanique ou gomtrique de ce qu'il voit. Mais l'habitude de s'en tenir l
n'est qu'une survivance des sicles prcdents. Elle date d'une poque o la
science tait presque exclusivement gomtrie. Ce qui caractrise la science
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
149
du XIXe sicle, l'entreprise nouvelle qu'elle a tente, c'est l'tude approfondie
des tres vivants. Or, une fois sur ce terrain, on peut, si l'on veut, parler encore
de pure mcanique ; on pense autre chose.
Ouvrons le premier volume du Cours de philosophie positive d'Auguste
Comte. Nous y lisons que les phnomnes observables chez les tres vivants
sont de mme nature que les faits inorganiques. Huit ans aprs, dans le second
volume, il s'exprime encore de mme au sujet des vgtaux, mais des vgtaux seulement ; il met dj part la vie animale. Enfin, dans son dernier
volume, c'est la totalit des phnomnes de la vie qu'il isole nettement des
faits physiques et chimiques. Plus il considre les manifestations de la vie,
plus il tend tablir entre les divers ordres de faits une distinction de rang ou
de valeur, et non plus seulement de complication. Or, en suivant cette direction, c'est au spiritualisme qu'on aboutit.
Claude Bernard s'exprime d'abord comme si le jeu des forces mcaniques
nous fournissait tous les lments d'une explication universelle. Mais lorsque,
sortant des gnralits, il s'attache dcrire plus spcialement ces phnomnes
de la vie sur lesquels ses travaux ont projet une si grande lumire, il arrive
l'hypothse d'une ide directrice , et mme cratrice , qui serait la cause
vritable de l'organisation.
La mme tendance, le mme progrs s'observent, selon M. Ravaisson,
chez tous ceux, philosophes ou savants, qui approfondissent la nature de la
vie. On peut prvoir que, plus les sciences de la vie se dvelopperont, plus
elles sentiront la ncessit de rintgrer la pense au sein de la nature.
Sous quelle forme, et avec quel genre d'opration ? Si la vie est une
cration, nous devons nous la reprsenter par analogie avec les crations qu'il
nous est donn d'observer, c'est--dire avec celles que nous accomplissons
nous-mmes. Or, dans la cration artistique, par exemple, il semble que les
matriaux de l'uvre, paroles et images pour le pote, formes et couleurs pour
le peintre, rythmes et accords pour le musicien, viennent se ranger spontanment sous l'ide qu'ils doivent exprimer, attirs, en quelque sorte, par le
charme d'une idalit suprieure. N'est-ce pas un mouvement analogue, n'estce pas aussi un tat de fascination que nous devons attribuer aux lments
matriels quand ils s'organisent en tres vivants ? Aux yeux de M. Ravaisson,
la force originatrice de la vie tait de la mme nature que celle de la persuasion.
Mais d'o viennent les matriaux qui ont subi cet enchantement ? cette
question, la plus haute de toutes, M. Ravaisson rpond en nous montrant dans
la production originelle de la matire un mouvement inverse de celui qui
s'accomplit quand la matire s'organise. Si l'organisation est comme un veil
de la matire, la matire ne peut tre qu'un assoupissement de l'esprit. C'est le
dernier degr, c'est l'ombre d'une existence qui s'est attnue et, pour ainsi
dire, vide elle-mme de son contenu. Si la matire est la base de l'existence
naturelle, base sur laquelle, par ce progrs continu qui est l'ordre de la nature,
de degr en degr, de rgne en rgne, tout revient l'unit de l'esprit , inversement nous devons nous reprsenter au dbut une distension d'esprit, une
diffusion dans l'espace et le temps qui constitue la matrialit. La Pense
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
150
infinie a annul quelque chose de la plnitude de son tre, pour en tirer, par
une espce de rveil et de rsurrection, tout ce qui existe .
Telle est la doctrine expose dans la dernire partie du Rapport. L'univers
visible nous y est prsent comme l'aspect extrieur d'une ralit qui, vue du
dedans et saisie en elle-mme, nous apparatrait comme un don gratuit, comme un grand acte de libralit et d'amour. Nulle analyse ne donnera une ide
de ces admirables pages. Vingt gnrations d'lves les ont sues par cur.
Elles ont t pour beaucoup dans l'influence que le Rapport exera sur notre
philosophie universitaire, influence dont on ne peut ni dterminer les limites
prcises, ni mesurer la profondeur, ni mme dcrire exactement la nature, pas
plus qu'on ne saurait rendre l'inexprimable coloration que rpand parfois sur
toute une vie d'homme un grand enthousiasme de la premire jeunesse. Nous
sera-t-il permis d'ajouter qu'elles ont un peu clips, par leur blouissant clat,
l'ide la plus originale du livre ? Que l'tude approfondie des phnomnes de
la vie doive amener la science positive largir ses cadres et dpasser le pur
mcanisme o elle s'enferme depuis trois sicles, c'est une ventualit que
nous commenons envisager aujourd'hui, encore que la plupart se refusent
l'admettre. Mais, au temps o M. Ravaisson crivait, il fallait un vritable
effort de divination pour assigner ce terme un mouvement d'ides qui paraissait aller en sens contraire.
Quels sont les faits, quelles sont les raisons qui amenrent M. Ravaisson
juger que les phnomnes de la vie, au lieu de s'expliquer intgralement par
les forces physiques et chimiques, pourraient au contraire jeter sur celles-ci
quelque lumire ?Tous les lments de la thorie se trouvent dj dans l'Essai
sur la mtaphysique dAristote et dans la thse sur lHabitude. Mais sous la
forme plus prcise qu'elle revt dans le Rapport, elle se rattache, croyonsnous, certaines rflexions trs spciales que M. Ravaisson fit pendant cette
priode sur l'art, et en particulier sur un art dont il possdait la fois la thorie
et la pratique, l'art du dessin.
Le ministre de l'Instruction publique avait mis l'tude, en 1852, la question de l'enseignement du dessin dans les lyces. Le 21 juin 1853, un arrt
chargeait une commission de prsenter au ministre un projet d'organisation de
cet enseignement. La commission comptait parmi ses membres Delacroix,
Ingres et Flandrin ; elle tait prside par M. Ravaisson. C'est M. Ravaisson
qui rdigea le rapport. Il avait fait prvaloir ses vues, et labor le rglement
qu'un arrt du 29 dcembre 1853 rendit excutoire dans les tablissements de
l'tat. C'tait une rforme radicale de la mthode usite jusqu'alors pour
l'enseignement du dessin. Les considrations thoriques qui avaient inspir la
rforme n'occupent qu'une petite place dans le rapport adress au ministre.
Mais M. Ravaisson les reprit plus tard et les exposa avec ampleur dans les
deux articles Art et Dessin qu'il donna au Dictionnaire pdagogique. crits en
1882, alors que l'auteur tait en pleine possession de sa philosophie, ces articles nous prsentent les ides de M. Ravaisson, relatives au dessin, sous une
forme mtaphysique qu'elles n'avaient pas au dbut (comme on s'en convaincra sans peine en lisant le rapport de 1853). Du moins dgagent-ils avec
prcision la mtaphysique latente que ces vues impliquaient ds l'origine. Ils
nous montrent comment les ides directrices de la philosophie que nous
venons de rsumer se rattachaient, dans la pense de M. Ravaisson, un art
qu'il n'avait jamais cess de pratiquer. Et ils viennent aussi confirmer une loi
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
151
que nous tenons pour gnrale, savoir que les ides rellement viables, en
philosophie, sont celles qui ont t vcues d'abord par leur auteur, vcues,
c'est--dire appliques par lui, tous les jours, un travail qu'il aime, et modeles par lui, la longue, sur cette technique particulire.
La mthode qu'on pratiquait alors pour l'enseignement du dessin s'inspirait
des ides de Pestalozzi. Dans les arts du dessin comme partout ailleurs, disaiton, il faut aller du simple au compos. L'lve s'exercera donc d'abord tracer
des lignes droites, puis des triangles, des rectangles, des carrs ; de l il
passera au cercle. Plus tard il arrivera dessiner les contours des formes vivantes : encore devra-t-il, autant que possible, donner pour substruction son
dessin des lignes droites et des courbes gomtriques, soit en circonscrivant
son modle (suppos plat) une figure rectiligne imaginaire sur laquelle il
s'assurera des points de repre, soit en remplaant provisoirement les courbes
du modle par des courbes gomtriques, sur lesquelles il reviendra ensuite
pour faire les retouches ncessaires.
Cette mthode, d'aprs M. Ravaisson, ne peut donner aucun rsultat. En
effet, ou bien on veut apprendre seulement dessiner des figures gomtriques, et alors autant vaut se servir des instruments appropris et appliquer les
rgles que la gomtrie fournit ; ou bien c'est l'art proprement dit qu'on
prtend enseigner, mais alors l'exprience montre que l'application de procds mcaniques l'imitation des formes vivantes aboutit les faire mal
comprendre et mal reproduire. Ce qui importe ici avant tout, en effet, c'est le
bon jugement de l'il . L'lve qui commence par s'assurer des points de
repre, qui les relie ensuite par un trait continu en s'inspirant autant que
possible des courbes de la gomtrie, n'apprend qu' voir faux. Jamais il ne
saisit le mouvement propre de la forme dessiner. L'esprit de la forme lui
chappe toujours. Tout autre est le rsultat quand on commence par les courbes caractristiques de la vie. Le plus simple sera ici, non pas ce qui se
rapprochera le plus de la gomtrie, mais ce qui parlera le mieux l'intelligence, ce qu'il y aura de plus expressif : l'animal sera plus facile comprendre
que la plante, l'homme que l'animal, l'Apollon du Belvdre qu'un passant pris
dans la rue. Commenons donc par faire dessiner l'enfant les plus parfaites
d'entre les figures humaines, les modles fournis par la statuaire grecque. Si
nous craignons pour lui les difficults de la perspective, remplaons d'abord
les modles par leur reproduction photographique. Nous verrons que le reste
viendra par surcrot. En partant du gomtrique, on peut aller aussi loin qu'on
voudra dans le sens de la complication sans se rapprocher jamais des courbes
par lesquelles s'exprime la vie. Au contraire, si l'on commence par ces courbes, on s'aperoit, le jour o l'on aborde celles de la gomtrie, qu'on les a dj
dans la main.
Nous voici donc en prsence de la premire des deux thses dveloppes
dans le Rapport sur la philosophie en France : du mcanique on ne peut
passer au vivant par voie de composition ; c'est bien plutt la vie qui donnerait
la clef du monde inorganis. Cette mtaphysique est implique, pressentie et
mme sentie dans l'effort concret par lequel la main s'exerce reproduire les
mouvements caractristiques des figures.
son tour, la considration de ces mouvements, et du rapport qui les lie
la figure qu'ils tracent, donne un sens spcial la seconde thse de M.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
152
Ravaisson, aux vues qu'il dveloppe sur l'origine des choses et sur l'acte de
condescendance , comme il dit, dont l'univers est la manifestation.
Si nous considrons, de notre point de vue, les choses de la nature, ce que
nous trouvons de plus frappant en elles est leur beaut. Cette beaut va
d'ailleurs en s'accentuant mesure que la nature s'lve de l'inorganique
l'organis, de la plante l'animal, et de l'animal l'homme. Donc, plus le
travail de la nature est intense, plus l'uvre produite est belle. C'est dire que,
si la beaut nous livrait son secret, nous pntrerions par elle dans l'intimit du
travail de la nature. Mais nous le livrera-t-elle ? Peut-tre, si nous considrons
qu'elle n'est, elle-mme, qu'un effet, et si nous remontons la cause. La beaut
appartient la forme, et toute forme a son origine dans un mouvement qui la
trace : la forme n'est que du mouvement enregistr. Or, si nous nous demandons quels sont les mouvements qui dcrivent des formes belles, nous
trouvons que ce sont les mouvements gracieux : la beaut, disait Lonard de
Vinci, est de la grce fixe. La question est alors de savoir en quoi consiste la
grce. Mais ce problme est plus ais rsoudre, car dans tout ce qui est
gracieux nous voyons, nous sentons, nous devinons une espce d'abandon et
comme une condescendance. Ainsi, pour celui qui contemple l'univers avec
des yeux d'artiste, c'est la grce qui se lit travers la beaut, et c'est la bont
qui transparat sous la grce. Toute chose manifeste, dans le mouvement que
sa forme enregistre, la gnrosit infinie d'un principe qui se donne. Et ce n'est
pas tort qu'on appelle du mme nom le charme qu'on voit au mouvement et
l'acte de libralit qui est caractristique de la bont divine : les deux sens du
mot grce n'en faisaient qu'un pour M. Ravaisson.
Il restait fidle sa mthode en cherchant les plus hautes vrits mtaphysiques dans une vision concrte des choses, en passant, par transitions
insensibles, de l'esthtique la mtaphysique et mme la thologie. Rien de
plus instructif, cet gard, que l'tude qu'il publia en 1887 dans la Revue des
Deux Mondes sur la philosophie de Pascal. Ici la proccupation est visible de
relier le christianisme la philosophie et l'art antiques, sans mconnatre
d'ailleurs ce que le christianisme a apport de nouveau dans le monde. Cette
proccupation remplit toute la dernire partie de la vie de M. Ravaisson.
Dans cette dernire priode, M. Ravaisson eut la satisfaction de voir ses
ides se rpandre, sa philosophie pntrer dans l'enseignement, tout un mouvement se dessiner en faveur d'une doctrine qui faisait de l'activit spirituelle
le fond mme de la ralit. Le Rapport de 1867 avait dtermin un changement d'orientation dans la philosophie universitaire : l'influence de Cousin
succdait celle de Ravaisson. Comme l'a dit M. Boutroux dans les belles
pages qu'il a consacres sa mmoire 1, M. Ravaisson ne chercha jamais
l'influence, mais il finit par l'exercer la manire du chant divin qui, selon la
fable antique, amenait se ranger d'eux-mmes, en murailles et en tours, de
dociles matriaux . Prsident du jury d'agrgation, il apportait ces fonctions
une bienveillante impartialit, uniquement proccup de distinguer le talent et
l'effort partout o ils se rencontraient. En 1880, votre Acadmie l'appelait
siger parmi ses membres, en remplacement de M. Peisse. Une des premires
lectures qu'il fit votre Compagnie fut celle d'un important rapport sur le
1
Revue de mtaphysique et de morale, novembre 1900.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
153
scepticisme, l'occasion du concours o votre futur confrre M. Brochard
remportait si brillamment le prix. En 1899, l'Acadmie des Inscriptions et
Belles-Lettres clbrait le cinquantenaire de son lection. Lui, toujours jeune,
toujours souriant, allait d'une Acadmie l'autre, prsentait ici un mmoire sur
quelque point d'archologie grecque, l des vues sur la morale ou l'ducation,
prsidait des distributions de prix o, sur un ton familier, il exprimait les
vrits les plus abstraites sous la forme la plus aimable. Pendant ces trente
dernires annes de sa vie, M. Ravaisson ne cessa jamais de poursuivre le
dveloppement d'une pense dont l'Essai sur la mtaphysique d'Aristote, la
thse sur l'Habitude et le Rapport de 1867 avaient marqu les principales
tapes. Mais ce nouvel effort, n'ayant pas abouti une uvre acheve, est
moins connu. Les rsultats qu'il en publiait taient d'ailleurs de nature surprendre un peu, je dirai presque drouter, ceux mmes de ses disciples qui le
suivaient avec le plus d'attention. C'taient, d'abord, une srie de mmoires et
d'articles sur la Vnus de Milo ; beaucoup s'tonnaient de l'insistance avec
laquelle il revenait sur un sujet aussi particulier. C'taient aussi des travaux sur
les monuments funraires de l'antiquit. C'taient enfin des considrations sur
les problmes moraux ou pdagogiques qui se posent l'heure actuelle. On
pouvait ne pas apercevoir de lien entre des proccupations aussi diffrentes.
La vrit est que ses hypothses sur les chefs-d'uvre de la sculpture grecque,
ses essais de reconstitution du groupe de Milo, ses interprtations des basreliefs funraires, ses vues sur la morale et l'ducation, tout cela formait un
ensemble bien cohrent, tout cela se rattachait, dans la pense de M.
Ravaisson, un nouveau dveloppement de sa doctrine mtaphysique. De
cette dernire philosophie nous trouvons une esquisse prliminaire dans un
article intitul Mtaphysique et morale qui parut, en 1893, comme introduction la revue de ce nom. Nous en aurions eu la formule dfinitive dans le
livre que M. Ravaisson crivait quand la mort est venue le surprendre. Les
fragments de cet ouvrage, recueillis par des mains pieuses, ont t publis
sous le titre de Testament philosophique. Ils nous donnent sans doute une ide
suffisante de ce qu'et t le livre. Mais si nous voulons suivre la pense de
M. Ravaisson jusqu' cette dernire tape, il faut que nous remontions en de
de 1870, en de mme du Rapport de 1867, et que nous nous transportions
l'poque o M. Ravaisson fut appel fixer son attention sur les uvres de la
statuaire antique.
Il y fut amen par ses considrations mmes sur l'enseignement du dessin.
Si l'tude du dessin doit commencer par l'imitation de la figure humaine, et
aussi par la beaut dans ce qu'elle a de plus parfait, c'est la statuaire antique
qu'on devra demander des modles, puisqu'elle a port la figure humaine son
plus haut degr de perfection. D'ailleurs, pour pargner l'enfant les difficults de la perspective, on remplacera, disions-nous, les statues elles-mmes
par leurs reproductions photographiques. M. Ravaisson fut conduit ainsi
constituer d'abord une collection de photographies, puis, chose autrement importante, faire excuter des moulages des chefs-d'uvre de l'art grec. Cette
dernire collection, place d'abord avec la collection Campana, est devenue le
point de dpart de la collection de pltres antiques que M. Charles RavaissonMollien a runie au muse du Louvre. Par un progrs naturel, M. Ravaisson
arriva alors envisager les arts plastiques sous un nouvel aspect. Proccup
surtout, jusque-l, de la peinture moderne, il fixait maintenant son attention
sur la sculpture antique. Et, fidle l'ide qu'il faut connatre la technique d'un
art pour en pntrer l'esprit, il prenait l'bauchoir, s'exerait modeler,
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
154
arrivait, force de travail, une relle habilet. L'occasion s'offrit bientt lui
d'en faire profiter l'art, et mme, par une transition insensible, la philosophie.
L'empereur Napolon III, qui avait pu, diverses reprises, et notamment
lors de l'installation du muse Campana, apprcier personnellement la valeur
de M. Ravaisson, l'appelait, en juin 1870, aux fonctions de conservateur des
antiques et de la sculpture moderne au muse du Louvre. Quelques semaines
aprs, la guerre clatait, l'ennemi tait sous les murs de Paris, le bombardement imminent, et M. Ravaisson, aprs avoir propos l'Acadmie des
Inscriptions de lancer une protestation au monde civilis contre les violences
dont les trsors de l'art taient menacs, s'occupait de faire transporter au fond
d'un souterrain, pour les mettre l'abri d'un incendie possible, les pices les
plus prcieuses du muse des antiques. En dplaant la Vnus de Milo, il
s'aperut que les deux blocs dont la statue est faite avaient t mal assembls
lors de l'installation primitive, et que des cales en bois, interposes entre eux,
faussaient l'attitude originelle. Lui-mme il dtermina nouveau les positions
relatives des deux blocs ; lui-mme il prsida au redressement. Quelques
annes plus tard, c'est sur la Victoire de Samothrace qu'il excutait un travail
du mme genre, mais plus important encore. Dans la restauration primitive de
cette statue, il avait t impossible d'ajuster les ailes, que nous trouvons
maintenant d'un si puissant effet. M. Ravaisson refit en pltre un morceau
manquant droite ainsi que toute la partie gauche de la poitrine : ds lors les
ailes retrouvaient leurs points d'attache, et la desse apparaissait telle que nous
la voyons aujourd'hui sur l'escalier du Louvre, corps dans bras, sans tte, o le
seul gonflement de la draperie et des ailes qui se dploient rend visible l'il
un souffle d'enthousiasme qui passe sur une me.
Or, mesure que M. Ravaisson entrait plus avant dans la familiarit de la
statuaire antique, une ide se dessinait dans son esprit, qui s'appliquait
l'ensemble de la sculpture grecque, mais qui prenait sa signification la plus
concrte pour l'uvre sur laquelle les circonstances avaient plus particulirement dirig son attention, la Vnus de Milo.
Il lui apparaissait que la statuaire avait model, au temps de Phidias, de
grandes et nobles figures, dont le type tait all ensuite en dgnrant, et que
cette diminution devait tenir l'altration qu'avait subie, en se vulgarisant, la
conception classique de la divinit. La Grce, en ses premiers ges, adorait
dans Vnus une desse qu'elle appelait Uranie... La Vnus d'alors tait la
souveraine des mondes... C'tait une Providence, toute puissance et toute
bienveillance en mme temps, dont l'attribut ordinaire tait une colombe,
signifiant que c'tait par l'amour et la douceur qu'elle rgnait... Ces vieilles
conceptions s'altrrent. Un lgislateur athnien, complaisant envers la foule,
tablit pour elle, ct du culte de la Vnus cleste, celui d'une Vnus d'ordre
infrieur, nomme la populaire. L'antique et sublime pome se changea par
degrs en un roman tiss de frivoles aventures 1.
ce pome antique la Vnus de Milo nous ramne. uvre de Lysippe ou
d'un de ses lves, cette Vnus n'est, d'aprs M. Ravaisson, que la variante
d'une Vnus de Phidias. Primitivement, elle n'tait pas isole ; elle faisait
partie d'un groupe. C'est ce groupe que M. Ravaisson travailla si patiemment
1
Mmoire lu la sance publique des cinq Acadmies, le 25 octobre 1890.
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
155
reconstituer. le voir modeler et remodeler les bras de la desse, quelquesuns souriaient. Savaient-ils que ce que M. Ravaisson voulait reconqurir sur la
matire rebelle, c'tait l'me mme de la Grce, et que le philosophe restait
fidle l'esprit de sa doctrine en cherchant les aspirations fondamentales de
l'antiquit paenne non pas simplement dans les formules abstraites et gnrales de la philosophie, mais dans une figure concrte, celle mme que
sculpta, au plus beau temps d'Athnes, le plus grand des artistes visant la
plus haute expression possible de la beaut ?
Il ne nous appartient pas d'apprcier, du point de vue archologique, les
conclusions o M. Ravaisson aboutissait. Qu'il nous suffise de dire qu'il
plaait ct de la Vnus primitive un dieu qui devait tre Mars, ou un hros
qui pouvait tre Thse. D'induction en induction, il arrivait voir dans ce
groupe le symbole d'un triomphe de la persuasion sur la force brutale. C'est de
cette victoire que la mythologie grecque nous chanterait l'pope. L'adoration
des hros n'aurait t que le culte reconnaissant vou par la Grce ceux qui,
tant les plus forts, voulurent tre les meilleurs, et n'usrent de leur force que
pour venir en aide l'humanit souffrante. La religion des anciens serait ainsi
un hommage rendu la piti. Au-dessus de tout, l'origine mme de tout, elle
mettait la gnrosit, la magnanimit et, au sens le plus lev du mot, l'amour.
Ainsi, par un dtour singulier, la sculpture grecque ramenait M. Ravaisson
l'ide centrale de sa philosophie. N'avait-il pas dit, dans son Rapport, que
l'univers est la manifestation d'un principe qui se donne par libralit, condescendance et amour ? Mais cette ide, retrouve chez les anciens, vue travers
la sculpture grecque, se dessinait maintenant dans son esprit sous une forme
plus ample et plus simple. De cette forme nouvelle M. Ravaisson n'a pu nous
tracer qu'une esquisse inacheve. Mais son Testament philosophique en
marque assez les grandes lignes.
Il disait maintenant qu'une grande philosophie tait apparue ds l'aurore de
la pense humaine et s'tait maintenue travers les vicissitudes de l'histoire :
la philosophie hroque, celle des magnanimes, des forts, des gnreux. Cette
philosophie, avant mme d'tre pense par des intelligences suprieures, avait
t vcue par des curs d'lite. Elle fut, de tout temps, celle des mes vritablement royales, nes pour le monde entier et non pour elles, restes fidles
l'impulsion originaire, accordes l'unisson de la note fondamentale de
l'univers qui est une note de gnrosit et d'amour. Ceux qui la pratiqurent
d'abord furent les hros que la Grce adora. Ceux qui l'enseignrent plus tard
furent les penseurs qui, de Thals Socrate, de Socrate Platon et Aristote,
d'Aristote Descartes et Leibniz, se continuent en une seule grande ligne.
Tous, pressentant le christianisme ou le dveloppant, ont pens et pratiqu une
philosophie qui tient tout entire dans un tat d'me ; et cet tat d'me est celui
que notre Descartes a appel du beau nom de gnrosit .
De ce nouveau point de vue, M. Ravaisson reprenait, dans son Testament
philosophique, les principales thses de son Rapport. Il les retrouvait chez les
grands philosophes de tous les temps. Il les vrifiait sur des exemples. Il les
animait d'un nouvel esprit en faisant une part plus large encore au sentiment
dans la recherche du vrai et l'enthousiasme dans la cration du beau. Il
insistait sur l'art qui est le plus lev de tous, l'art mme de la vie, celui qui
faonne l'me. Il le rsumait dans le prcepte de saint Augustin : Aimez, et
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
156
faites ce que vous voudrez. Et il ajoutait que l'amour ainsi entendu est au
fond de chacun de nous, qu'il est naturel, que nous n'avons pas le crer, qu'il
s'panouit tout seul quand nous cartons l'obstacle que notre volont lui
oppose : l'adoration de nous-mmes.
Il aurait voulu que tout notre systme d'ducation tendt laisser son libre
essor au sentiment de la gnrosit. Le mal dont nous souffrons, crivait-il
dj en 1887, ne rside pas tant dans l'ingalit des conditions, quelquefois
pourtant excessive, que dans les sentiments fcheux qui s'y joignent... Le
remde ce mal doit tre cherch principalement dans une rforme morale,
qui tablisse entre les classes l'harmonie et la sympathie rciproques, rforme
qui est surtout une affaire d'ducation... De la science livresque il faisait peu
de cas. En quelques mots il traait le programme d'une ducation vraiment
librale, c'est--dire destine dvelopper la libralit, affranchir l'me de
toutes les servitudes, surtout de l'gosme, qui est la pire d'entre elles : La
socit, disait-il, doit reposer sur la gnrosit, c'est--dire sur la disposition
se considrer comme de grande race, de race hroque et mme divine 1.
Les divisions sociales naissent de ce qu'il y a d'un ct des riches qui sont
riches pour eux, et non plus pour la chose commune, de l'autre des pauvres
qui, n'ayant plus compter que sur eux-mmes, ne considrent dans les riches
que des objets d'envie. C'est des riches, c'est des classes suprieures qu'il
dpendra de modifier l'tat d'me des classes ouvrires. Le peuple, volontiers secourable, a conserv beaucoup, parmi ses misres et ses dfauts, de ce
dsintressement et de cette gnrosit qui furent des qualits des premiers
ges... Qu'un signal parte des rgions d'en haut pour indiquer au milieu de nos
obscurits, le chemin suivre afin de rtablir dans son ancien empire la
magnanimit : de nulle part il n'y sera rpondu plus vite que de la part du peuple. Le peuple, a dit Adam Smith, aime la vertu, tellement que rien ne
l'entrane comme l'austrit.
En mme temps qu'il prsentait la gnrosit comme un sentiment naturel,
o nous prenons conscience de la noblesse de notre origine, M. Ravaisson
montrait dans notre croyance l'immortalit un pressentiment non moins
naturel de notre destine future. Il retrouvait, en effet, cette croyance travers
l'antiquit classique. Il la lisait sur les stles funraires des Grecs, dans ces
tableaux o, selon lui, le mort revient annoncer aux membres de sa famille,
encore vivants, qu'il gote une joie sans mlange dans le sjour des bienheureux. Il disait que le sentiment des anciens ne les avait pas tromps sur ce
point, que nous retrouverons ailleurs ceux que nous avons chris ici-bas, et
que celui qui a aim une fois aimera toujours. Il ajoutait que l'immortalit
promise par la religion tait une ternit de bonheur, qu'on ne pouvait pas,
qu'on ne devait pas la concevoir autrement, ou bien alors que le dernier mot ne
resterait pas la gnrosit. Au nom de la justice, crivait-il 2, une thologie
trangre l'esprit de misricorde qui est celui mme du christianisme,
abusant du nom d'ternit qui ne signifie souvent qu'une longue dure, condamne des maux sans fin les pcheurs morts sans repentir, c'est--dire
l'humanit presque entire. Comment comprendre alors ce que deviendrait la
flicit d'un Dieu qui entendrait pendant l'ternit tant de voix gmissantes ?...
On trouve dans le pays o naquit le christianisme une fable allgorique
1
2
Revue bleue, 23 avril 1887.
Testament philosophique, p. 29 (Revue de Mtaphysique et de Morale, janvier 1901).
Henri Bergson, La pense et le mouvant Essais et confrences.
157
inspire d'une tout autre pense, la fable de l'Amour et de Psych ou l'me.
L'Amour s'prend de Psych. Celle-ci se rend coupable, comme l've de la
Bible, d'une curiosit impie de savoir, autrement que par Dieu, discerner le
bien du mal, et comme de nier ainsi la grce divine. L'Amour lui impose des
peines expiatoires, mais pour la rendre nouveau digne de son choix, et il ne
les lui impose pas sans regret. Un bas-relief le reprsente tenant d'une main un
papillon (me et papillon, symbole de rsurrection, furent de tous temps synonymes) ; de l'autre il le brle la flamme de son flambeau ; mais il dtourne la
tte, comme plein de piti.
Telles taient les thories, et telles aussi les allgories, que M. Ravaisson
notait dans les dernires pages de son Testament philosophique, peu de jours
avant sa mort. C'est entre ces hautes penses et ces gracieuses images, comme
le long d'une alle borde d'arbres superbes et de fleurs odorifrantes, qu'il
chemina jusqu'au dernier moment, insoucieux de la nuit qui venait, uniquement proccup de bien regarder en face, au ras de l'horizon, le soleil qui
laissait mieux voir sa forme dans l'adoucissement de sa lumire. Une courte
maladie, qu'il ngligea de soigner, l'emporta en quelques jours. Il s'teignit, le
18 mai 1900, au milieu des siens, ayant conserv jusqu'au bout toute la
lucidit de sa grande intelligence.
L'histoire de la philosophie nous fait surtout assister l'effort sans cesse
renouvel d'une rflexion qui travaille attnuer des difficults, rsoudre des
contradictions, mesurer avec une approximation croissante une ralit
incommensurable avec notre pense. Mais de loin en loin surgit une me qui
parat triompher de ces complications force de simplicit, me d'artiste ou de
pote, reste prs de son origine, rconciliant, dans une harmonie sensible au
cur, des termes peut-tre irrconciliables pour l'intelligence. La langue
qu'elle parle, quand elle emprunte la voix de la philosophie, n'est pas comprise
de mme par tout le monde. Les uns la jugent vague, et elle l'est dans ce
qu'elle exprime. Les autres la sentent prcise, parce qu'ils prouvent tout ce
qu'elle suggre. beaucoup d'oreilles elle n'apporte que l'cho d'un pass
disparu ; mais d'autres y entendent dj, comme dans un rve, le chant joyeux
de l'avenir. L'uvre de M. Ravaisson laissera derrire elle ces impressions trs
diverses, comme toute philosophie qui s'adresse au sentiment autant qu' la
raison. Que la forme en soit un peu vague, nul ne le contestera : c'est la forme
d'un souffle ; mais le souffle vient de haut, et nette en est la direction. Qu'elle
ait utilis, dans plusieurs de ses parties, des matriaux anciens, fournis en
particulier par la philosophie d'Aristote, M. Ravaisson aimait le rpter :
mais l'esprit qui la vivifie est un esprit nouveau, et l'avenir dira peut-tre que
l'idal qu'elle proposait notre science et notre activit tait, sur plus d'un
point, en avance sur le ntre. Quoi de plus hardi, quoi de plus nouveau que de
venir annoncer aux physiciens que l'inerte s'expliquera par le vivant, aux biologistes que la vie ne se comprendra que par la pense, aux philosophes que
les gnralits ne sont pas philosophiques, aux matres que le tout doit
s'enseigner avant les lments, aux coliers qu'il faut commencer par la perfection, l'homme, plus que jamais livr l'gosme et la haine, que le
mobile naturel de l'homme est la gnrosit ?
Fin du texte.
Vous aimerez peut-être aussi
- Richir Le Rien Et Son ApparenceDocument194 pagesRichir Le Rien Et Son ApparenceMihaiPas encore d'évaluation
- Méditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandMéditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Bergson - Essai Sur Les Données Immédiates de La ConscienceDocument105 pagesBergson - Essai Sur Les Données Immédiates de La ConscienceDante SimerPas encore d'évaluation
- 1 - Bergson - Matière Et Mémoire 1896Document147 pages1 - Bergson - Matière Et Mémoire 1896Michel GalabruPas encore d'évaluation
- Recherches logiques d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandRecherches logiques d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Emmanuel Levinas - Altérité Et Transcendance - ACTU PHILOSOPHIADocument10 pagesEmmanuel Levinas - Altérité Et Transcendance - ACTU PHILOSOPHIAToxophilus TheLuckyPas encore d'évaluation
- CRPDocument50 pagesCRPoiromdamPas encore d'évaluation
- Alexander, Robert - La Refondation Richirienne de La PhenomenologieDocument399 pagesAlexander, Robert - La Refondation Richirienne de La PhenomenologieGabriel Jiménez TaviraPas encore d'évaluation
- Hegel Et Le Possible RéelDocument26 pagesHegel Et Le Possible RéelGKF1789Pas encore d'évaluation
- Marc Richir - Recherches Phénoménologiques (L, II, III) - Fondation Pour La Phénoménologie Transcendantale I, II, IIIDocument276 pagesMarc Richir - Recherches Phénoménologiques (L, II, III) - Fondation Pour La Phénoménologie Transcendantale I, II, IIIJesús Guillermo Ferrer OrtegaPas encore d'évaluation
- Recherches PhénoménologiquesDocument150 pagesRecherches PhénoménologiquesMihaiPas encore d'évaluation
- Bourgeois Bernard (2005) - La Fin de L'histoire Selon Hegel - ASMPDocument14 pagesBourgeois Bernard (2005) - La Fin de L'histoire Selon Hegel - ASMPcouturatPas encore d'évaluation
- De La Révolution Phénoménologique Quelques Esquisses PDFDocument10 pagesDe La Révolution Phénoménologique Quelques Esquisses PDFpolix1Pas encore d'évaluation
- Interprétation de La Deuxième Considération Intempestive de Nietzsche by Martin HeideggerDocument214 pagesInterprétation de La Deuxième Considération Intempestive de Nietzsche by Martin HeideggerJairo RochaPas encore d'évaluation
- mémoireM2BOUDJEMA 1Document101 pagesmémoireM2BOUDJEMA 1Naïm BoudjemaPas encore d'évaluation
- Paris 1 - Philosophie Générale Complémentaire L2S3Document64 pagesParis 1 - Philosophie Générale Complémentaire L2S3Arthur HemonoPas encore d'évaluation
- Bergson - Durée Et SimultaneitéDocument137 pagesBergson - Durée Et SimultaneitéPenhaGPas encore d'évaluation
- Bergson Evolution CreatriceDocument257 pagesBergson Evolution CreatriceMarcel-Henri Proust-Bergson100% (1)
- Le Problème Moral Dans La (... ) Delbos VictorDocument604 pagesLe Problème Moral Dans La (... ) Delbos VictorFabianaPas encore d'évaluation
- HYPPOLITE, J. - Vie Et Philosophie de L'histoire Chez BergsonDocument7 pagesHYPPOLITE, J. - Vie Et Philosophie de L'histoire Chez BergsonFernando Delfino PoloPas encore d'évaluation
- Entretien D'emmanuel Faye Avec Philippe Lacoue-LabartheDocument9 pagesEntretien D'emmanuel Faye Avec Philippe Lacoue-LabartheprisissiPas encore d'évaluation
- Jeanluc Marion Figures de Phenomenologie Husserl Heidegger Levinas Henry Derrida 1Document222 pagesJeanluc Marion Figures de Phenomenologie Husserl Heidegger Levinas Henry Derrida 1Antonia FigueroaPas encore d'évaluation
- L'imagination Productrice Dans La Logique Transcendantale de Fichte PDFDocument22 pagesL'imagination Productrice Dans La Logique Transcendantale de Fichte PDFdfsdfsdftePas encore d'évaluation
- Cattin La Décision de PhilosopherDocument127 pagesCattin La Décision de PhilosopherGros Caca LiquidePas encore d'évaluation
- Jean Hyppolite - Genèse Et Structure de La Phénoménologie de L'esprit de Hegel - CHAPITRE 1Document11 pagesJean Hyppolite - Genèse Et Structure de La Phénoménologie de L'esprit de Hegel - CHAPITRE 1Calac100% (1)
- Cours Corps EbuissiereDocument421 pagesCours Corps EbuissiereFrancine Reinhardt RomanoPas encore d'évaluation
- Bachelard - L'expérience de L'espace Dans La Physique Contemporaine (1937)Document75 pagesBachelard - L'expérience de L'espace Dans La Physique Contemporaine (1937)Patrícia Netto100% (1)
- MALDINEY, Henri. L'Imagination.Document26 pagesMALDINEY, Henri. L'Imagination.Renato MenezesPas encore d'évaluation
- Berkeley - Des Principes de La Connaissance HumaineDocument8 pagesBerkeley - Des Principes de La Connaissance HumaineStephanie Hernandez100% (1)
- Chauvier MarxDocument161 pagesChauvier MarxGros Caca LiquidePas encore d'évaluation
- Meillassoux - EspérerDocument12 pagesMeillassoux - EspérerGros Caca LiquidePas encore d'évaluation
- Annales de Phénoménologie #20 2021Document388 pagesAnnales de Phénoménologie #20 2021Alavi AurélienPas encore d'évaluation
- Descartes CorrespondanceDocument33 pagesDescartes Correspondancemahrez00Pas encore d'évaluation
- Livret Agregation 2013Document35 pagesLivret Agregation 2013Lesabendio7Pas encore d'évaluation
- Les Méditations CartesiennesDocument26 pagesLes Méditations Cartesiennesjules borrelPas encore d'évaluation
- Philosophie de La Nature Et Artefact PDFDocument7 pagesPhilosophie de La Nature Et Artefact PDFLuis GonzálezPas encore d'évaluation
- Caron, M. Le Corps Chez HeideggerDocument22 pagesCaron, M. Le Corps Chez HeideggerJosé Carlos CardosoPas encore d'évaluation
- Nietzsche - Fragments PosthumesDocument6 pagesNietzsche - Fragments PosthumesscrazedPas encore d'évaluation
- Foucault Hermeneutique Du SujetDocument19 pagesFoucault Hermeneutique Du SujetRosa O'Connor AcevedoPas encore d'évaluation
- L'Idée Des Artistes Panofsky, Cassirer, Zuccaro Et La Théorie de L'art - TrotteinSDocument8 pagesL'Idée Des Artistes Panofsky, Cassirer, Zuccaro Et La Théorie de L'art - TrotteinSAhmed Kabil100% (1)
- Conférence de Q. Meillassoux Sur Mallarmé - Le Signifiant OpaqueDocument6 pagesConférence de Q. Meillassoux Sur Mallarmé - Le Signifiant OpaquepanoptericPas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze Leibniz 19800415 (Long)Document179 pagesGilles Deleuze Leibniz 19800415 (Long)humanity96Pas encore d'évaluation
- (Maine de Biran) Mémoire Décomposition Pensée Ii - LNPRDocument164 pages(Maine de Biran) Mémoire Décomposition Pensée Ii - LNPRNEMESIUS0% (1)
- Weber Max L Ethique Protestante Et L Esprit Du CapitalismeDocument155 pagesWeber Max L Ethique Protestante Et L Esprit Du CapitalismeindiigenaisPas encore d'évaluation
- Husserl PDFDocument211 pagesHusserl PDFnicomakhosPas encore d'évaluation
- Marc Richir, Les Structures Complexes de Limagination Selon Et Au Delà de HusserlDocument43 pagesMarc Richir, Les Structures Complexes de Limagination Selon Et Au Delà de HusserlGabriel Jiménez TaviraPas encore d'évaluation
- Entre Mimesis Et AnalogieDocument10 pagesEntre Mimesis Et AnalogieAxelle JéromePas encore d'évaluation
- Jean-Hugues Barthélémy, Jean-Claude Beaune-Penser L'individuation - Simondon Et La Philosophie de La Nature-Editions L'Harmattan (2005)Document254 pagesJean-Hugues Barthélémy, Jean-Claude Beaune-Penser L'individuation - Simondon Et La Philosophie de La Nature-Editions L'Harmattan (2005)Valentín HuartePas encore d'évaluation
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- De l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandDe l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Philosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moraleD'EverandPhilosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moralePas encore d'évaluation
- Être et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandÊtre et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Travaux en Cours Numéro 8Document189 pagesTravaux en Cours Numéro 8Athina MarkopoulouPas encore d'évaluation
- Album ZutiqueDocument14 pagesAlbum ZutiqueAthina MarkopoulouPas encore d'évaluation
- Fleurs de TénèbresDocument7 pagesFleurs de TénèbresAthina MarkopoulouPas encore d'évaluation
- Mémoire Αrtaud Athina MarkopoulouDocument104 pagesMémoire Αrtaud Athina MarkopoulouAthina MarkopoulouPas encore d'évaluation
- Artaud Reveneant Unsupportable - MarkopoulouDocument10 pagesArtaud Reveneant Unsupportable - MarkopoulouAthina MarkopoulouPas encore d'évaluation
- Travaux en Cours Numéro 8Document189 pagesTravaux en Cours Numéro 8Athina MarkopoulouPas encore d'évaluation
- Subordonnée RelativeDocument2 pagesSubordonnée RelativeHicham MAAKOULPas encore d'évaluation
- Layal - Kanaan 1507Document454 pagesLayal - Kanaan 1507Gabrielle 76Pas encore d'évaluation
- Fiche DiCog® Etal de L'artDocument53 pagesFiche DiCog® Etal de L'artCEN Stimco100% (1)
- FOUCAULT L'Ordre Du Discours (1971)Document25 pagesFOUCAULT L'Ordre Du Discours (1971)Jean-Philippe BABU100% (1)
- Conception MCD MLDDocument59 pagesConception MCD MLDlaminediallo9081Pas encore d'évaluation
- 2012 M2 Spe3 IUFM Marine - QUETIN Pauline - SOREZDocument63 pages2012 M2 Spe3 IUFM Marine - QUETIN Pauline - SOREZAna SousaPas encore d'évaluation
- Test Initial Ix L1Document7 pagesTest Initial Ix L1Simion AlexandraPas encore d'évaluation
- Caracteristique de L - Expression OraleDocument2 pagesCaracteristique de L - Expression OraleSanaa Sirta RababPas encore d'évaluation
- Acte de LangageDocument5 pagesActe de LangageOlesea MuraPas encore d'évaluation
- Méthodologie D'analyse Du DiscoursDocument2 pagesMéthodologie D'analyse Du DiscoursahmedaliiPas encore d'évaluation
- Langue Esperanto Ophrys Petit VocabulaireDocument133 pagesLangue Esperanto Ophrys Petit VocabulaireSorin YannickPas encore d'évaluation
- DE BAECQUE - DELAGE - de L'histoire Du Cinéma - Extraits1 PDFDocument46 pagesDE BAECQUE - DELAGE - de L'histoire Du Cinéma - Extraits1 PDFMireille BertonPas encore d'évaluation
- CoverbesDocument10 pagesCoverbesGina PadurariuPas encore d'évaluation
- Informations Psychopedagogiques Spécialisées DEA Version Finale - 111640Document21 pagesInformations Psychopedagogiques Spécialisées DEA Version Finale - 111640Papy Kabeya100% (1)
- Question Reponse de DeveloppementDocument7 pagesQuestion Reponse de DeveloppementKhalid TaoutiPas encore d'évaluation
- Futur Simple Ce1 Ce2Document6 pagesFutur Simple Ce1 Ce2Amina BenzekriPas encore d'évaluation
- Chercher Et Localiser Les DocumentsDocument4 pagesChercher Et Localiser Les Documentszakaria aissaouiPas encore d'évaluation
- L'élaboration D'une Consigne Pour L'instauration D'un CadreDocument31 pagesL'élaboration D'une Consigne Pour L'instauration D'un CadreHassan BouguarnePas encore d'évaluation
- Profil Sensoriel DominantDocument1 pageProfil Sensoriel DominantGratia Preoteasa100% (1)
- Pour Améliorer Ma Production Écrite - Grille D Autoévaluation (Ressource 2029) PDFDocument2 pagesPour Améliorer Ma Production Écrite - Grille D Autoévaluation (Ressource 2029) PDFTheGR3ddyPas encore d'évaluation