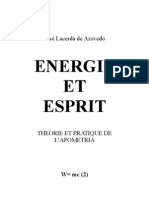Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Wahab Diop-CHIMIE 3e-Lsll PDF
Transféré par
lhajjiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Wahab Diop-CHIMIE 3e-Lsll PDF
Transféré par
lhajjiDroits d'auteur :
Formats disponibles
I.R.E.M.P.
T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
Notions de solutions
Situation problme
Keur Mbouki, village situ sur le bras de mer le Saloum, tire lessentiel de ses revenus de la
vente de sel produit localement. Chaque anne, pendant la saison sche, la forte chaleur
vapore progressivement leau de mer qui laisse alors se dposer une paisse couche de sel.
La population rcolte le sel de leau sature restante Lapparition des nuages annonant
lhivernage inquite toujours ces populations car ds les premires pluies le sel disparat
pour de longs mois encore.
1 - Indiquer les deux constituants de cette eau de mer.
2 - Pourquoi le sel ne se dpose-t-il que pendant la saison sche ?
3 - Que font les premires pluies pour faire disparatre le sel ?
1 - Mlanges et solutions
1-1 Procdons quelques mlanges.
eau + sel : dissolution du sel => mlange homogne = eau sale.
lait + sucre : dissolution du sucre = > mlange homogne = lait sucr.
eau + huile => mlange htrogne : mulsion.
L'eau sale et le lait sucre sont des mlanges homognes : ce sont des solutions.
Le mlange eau + huile est un mlange htrogne : ce n'est pas une solution.
1-2 Dfinition d'une solution.
Une solution est un mlange homogne.
N.B. les solutions sont souvent l'tat liquide mais on peut aussi parler de solutions solides (alliages)
et de solutions gazeuses (l'air).
1-3 Composition d'une solution.
Une solution est constitue de deux parties :
Le corps dissous appel solut : sel, sucre
Le corps qui dissout appel solvant : eau, lait
N.B. Une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l'eau.
2 - La solubilit.
2-1 Aspect qualitatif.
Le polystyrne est insoluble dans l'eau mais soluble dans
l'essence.
La solubilit d'un corps peut tre considre comme son aptitude
se dissoudre dans un autre.
Exemple : les graisses sont solubles dans le ttrachlorure de
carbone CCl4.
2-2 Aspect quantitatif.
Un solut n'est pas indfiniment soluble dans un solvant. La
quantit maximale soluble de tout solut est sa solubilit ;
elle dpend de la temprature.
Exemple : la solubilit du chlorure de sodium (sel de
cuisine) est de 350 g/L d'eau 20C.
cours de chimie troisime : Page 1
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
3 - Qualits d'une solution.
3-1 Solution sature.
Une solution est sature quand le solvant ne peut plus dissoudre le solut. Tout rajout de solut se
traduit par un dpt.
3-2 Solution non sature.
Une solution est dite non sature si le solvant peut encore dissoudre du solut.
3-3 Solution concentre.
Une solution concentre est une solution plus ou moins proche de la solution sature. Pour mieux
l'apprcier, il est ncessaire de connatre la quantit de solut par rapport celle du solvant. On dfinit
alors une grandeur caractristique de toute solution : sa concentration C.
N.B. On value la quantit :
de solut en grammes ou en moles
de solvant en litres.
4 - La concentration d'une solution
4-1 Concentration massique.
La concentration massique C d'une solution est la masse m de solut par volume v de solution. Elle est
exprime en g/L = gL-1
m
C= v
N.B. La concentration molaire d'un solut A dans une solution donne est note : A
La concentration molaire d'une solution est aussi appele sa molarit M. Exemple Une solution
molaire ou de molarit 1 M est une solution de concentration 1 molL-1
1 M = 1 molL-1
Application :
Enonc Solution :
La concentration molaire de la solution de soude
Trouver la concentration molaire de la est :
n
solution de soude obtenue en dissolvant 8 g de CNaOH =
v
m
cristaux d'hydroxyde de sodium NaOH dans nNaOH =
M
200 mL d'eau. mNaOH = 8 g
M(NaOH) = M(Na) + M(O) + M(H)
M(NaOH) = 23 + 16 + 1 = 40 g/mol
8
nNaOH = = 0,2 mol
40
V = 200 mL = 200 10-3 L = 0,2 L
0,2
CNaOH = = 1 mol L-1
0,2
Remarque : On peut aussi dduire la concentration molaire (ou massique) de la concentration
Cm
massique (ou molaire). Concentration molaire Cn =
M Concentration massique Cm = Cn . M
cours de chimie troisime : Page 2
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
5 - Prparation d'une solution de concentration donne
5-1 Par dissolution.
Exemple pratique.
Dans un laboratoire, on veut obtenir 40 mL d'eau sale de concentration 0,5 mol/L
a) - Trouver les quantits respectives de solut et de solvant utiliser.
b) - Indiquer le matriel et les produits ncessaires cette opration.
c) - Prciser la meilleure procdure
5.1-1 Les quantits respectives
de solvant : quantit de solvant = volume de solution : v = 40 mL
On admet que la dissolution d'un corps dans un liquide ne modifie pas le volume de solution obtenue.
de solut : masse de solut : m = n.M or
n = C.v donc m = C.v.M
La masse de chlorure de sodium NaCl est alors mNaCl = C.v.M
CNaCl = 0,5 molL-1
V = 40 mL = 4.10-2 L
M(NaCl) = 58,5 g/mol
mNaCl = 0,5. 4.10-2. 58,5 = 1,17 g
N.B. La masse de solut prendre est gale au produit de la concentration molaire de la solution par le
volume dsir que multiplie la masse molaire du solut.
m = C.v.M
5.1-2 Le matriel et les produits
1 bcher 40 mL : pour contenir la solution.
1 balance : pour mesurer la masse de solut.
1 prouvette gradue : pour mesurer le volume de solvant.
1 agitateur : pour faciliter la dissolution du solut.
L'eau = le solvant
Le sel NaCl = le solut.
5.1-2 Procdure.
Dissoudre la masse de solut mesure dans un minimum de solvant et complter au volume dsir en
ajoutant du solvant.
5-2 Par dilution.
5.2-1 Dfinition
Diluer une solution c'est y ajouter du solvant : on
diminue alors sa concentration.
Cp : concentration de la solution prleve
np : nombre de moles prleves
Cd : concentration de la solution dilue
nd :nombre de moles dans la solution dilue.
5.2-2 Principe de la dilution
Au cours d'une dilution, la quantit de solut ne varie
pas.
np = nd Cpvp= Cdvd
cours de chimie troisime : Page 3
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
Solutions acides - Solutions basiques
Situation problme
En arrivant dans le laboratoire presque labandon dun lyce, un technicien de laboratoire
dcouvre dans une armoire deux bouteilles contenant deux solutions quil ne peut distinguer.
Il ramasse, leur cot une tiquette tombe de lune delle sur laquelle il arrive
lire : Solution molaire de soude. Croyant que les deux solutions taient identiques, il en
mlange deux prlvements respectifs et note un dgagement de chaleur ; il dcouvre alors
que les deux solutions ne sont pas identiques. Par un test au BBT, il parvient les
distinguer.
1 Quest-ce que le BBT ? Comment a-t-il permis cette distinction ?
2 - Que fera-t-il pour rtablir ltiquette manquante de lune des solutions ?
1 - Classification des solutions
1-1 Par le bleu de bromothymol BBT.
1.1-1 Exprience
Dans chacune des solutions suivantes, versons quelques gouttes de bleu de bromothymol BBT et
observons
1.1-2 Observations
Les solutions, ne donnant pas la mme coloration avec le BBT sont donc de natures diffrentes.
Le BBT qui change de coloration suivant la nature de la solution est un indicateur color ; il existe
d'autres indicateurs colors tels que le tournesol, l'hlianthine, la phnolphtaline
1.1-3 Rsultats de l'exprience
Le classement
Jaune Acides
Vert Neutre
Bleu bases
.
1-2 Conclusions.
Les trois colorations observes conduisent l'identification de trois sortes de solutions dont les
dfinitions respectives partir du BBT sont :
1.2-1 Solution acide : C'est toute solution qui fait virer le BBT au jaune.
1.2-2 Solution basique : C'est toute solution qui fait virer le BBT au bleu.
1.2-3 Solution neutre : C'est toute solution qui laisse le BBT vert
2 - Quelques proprits des solutions.
cours de chimie troisime : Page 4
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
2-1 Proprits communes aux acides et bases.
2.1-1 Conductibilit lectrique.
En versant quelques gouttes d'acide ou de base, la D.E.L s'allume : le courant passe.
L'exprience montre que les solutions acides ou basiques conduisent le courant lectrique : ce sont des
lectrolytes
2.1-2 Actions sur les mtaux
Versons de l'acide nitrique (acide) sur du cuivre
et de la soude (une base) sur du zinc chaud.
Certaines solutions acides et certaines solutions
basiques ragissent dans certaines conditions
avec certains mtaux.
2-2 Proprits spcifiques.
2.2-1 Aux solutions acides
Les solutions acides ont un got piquant dit aussi acide. Elles attaquent le calcaire. Exemple :l'acide
chlorhydrique ragit avec le calcaire pour donner entre autres du gaz chlorhydrique.
CaCO3 + HCl CaCl2 + H2O + CO2
2.2-2 Aux solutions basiques
Les solutions basiques ont un got fade.
Attention ! Evitez, autant que possible, de goutter aux solutions du laboratoire ; elles sont
gnralement corrosives.
3 - Raction Acide - Base
3-1 tude qualitative de la raction entre l'acide chlorhydrique HCl et la soude NaOH.
Versons goutte goutte une solution de
soude NaOH dans une solution d'acide
chlorhydrique HCl
Leur raction produit :
3.1-1 Un dgagement de chaleur.
L'levation de la temprature que l'on note au niveau du thermomtre montre que la raction entre
l'acide et la base produit de la chaleur : c'est une raction exothermique.
3.1-2 Un sel et de l'eau.
Chauffons seccit la solution obtenue la fin de la
raction.
Des cristaux de sel apparaissent aprs l'vaporation de
l'eau : ce sel est du chlorure de sodium NaCl
communment appel sel de cuisine
cours de chimie troisime : Page 5
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
Conclusion : bilan de la raction
La raction entre l'acide chlorhydrique HCl et la solution d'hydroxyde de sodium NaOH. Dgage de la
chaleur et produit de l'eau H2O et du sel de cuisine NaCl.
HCl + NaOH NaCl + H2O
Gnralisation.
Une solution acide et une solution basique ragissent toujours entre elles. Leur raction exothermique
produit un sel et de l'eau
Acide + Base Sel + eau
N.B. Une raction chimique est dite : Exothermique si elle dgage de la chaleur.
Endothermique quand elle absorbe de la chaleur
Athermique si elle n'absorbe ni ne dgage de la chaleur.
3-2 tude quantitative.
3.2-1 La neutralisation.
Exprience
Laissons tomber goutte goutte une solution de
soude sur une solution d'acide chlorhydrique
additionne de quelques gouttes de BBT.
Attention ! La coloration verte est trs difficile
observer cause de l'invitable goutte de base de
trop : la solution devient bleue.
Observations.
L'acide et la base ragissent progressivement et la coloration jaune de l'acide persiste. La premire
goutte de base qui fait virer le BBT indique l'puisement de l'acide qui est alors neutralis par la base.
On parle alors de la neutralisation de l'acide par la base.
N.B. l'tape du virage de l'indicateur color est appele point d'quivalence de la neutralisation.
Relation de neutralisation
Le point d'quivalence ou virage du BBT traduit une quivalence (galit) entre le nombre de moles
d'acide na et le nombre de mole de base nb : c'est l'quivalence acido - basique.
na = nb
Or na = CaVa et nb = CbVb
donc on peut crire CaVa = CbVb
N.B. a pour l'acide chlorhydrique HCl et b pour la solution basique de soude NaOH.
3.2-2 Le dosage
Objectif.
Le dosage ou titrage d'une solution est la dtermination de
la concentration (titre) inconnue d'une solution partir de
celle (titre) connue d'une autre solution : c'est une
application de la neutralisation.
Le matriel.
Une burette : tube gradu avec un dispositif d'coulement
matrisable (robinet) fixe une potence.
cours de chimie troisime : Page 6
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
Un bcher ou un erlemeyer pour contenir la solution titrer
Une pipette jauge pour mesurer l'chantillon doser.
Un agitateur (souvent magntique) pour uniformiser la solution.
Protocole et schma de l'exprience
Introduire, dans la burette, la solution de concentration connue Cb : solution titrante NaOH
Prlever la pipette un volume Va de la solution de concentration inconnue Ca.
Placer la solution titrer prelev dans l'erlenmeyer (ou le bcher) en y ajoutant des gouttes de BBT.
Laisser tomber goutte goutte la solution titrante sur la solution titrer.
Arrter l'coulement ds le virage du BBTqui indique la neutralisation de l'acide par la base.
Lire alors, sur la burette, le volume Vb de la solution titrante verse.
Rsultat exprimental.
En appliquant la relation de neutralisation, on trouve la concentration Ca inconnue.
C bV b
CaVa = CbVb ==> Ca =
Va
cours de chimie troisime : Page 7
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
Les mtaux : Action de l'air et combustion.
Situation problme :
Dans la fourrire municipale dune ville, des lves en excursion dcouvrent un amas
htroclite de mtaux la merci des intempries de la rgion. Ils remarquent avec admiration
et curiosit la diffrence de comportement des diffrents mtaux identifis face lair humide
qui semble hostile leur prsence.
Dresser la liste des mtaux et des corps mtalliques que lon peut trouver dans la fabrication
dune voiture.
Indiquer, pour chacun des mtaux identifis, comment sest manifeste lhostilit de cet air ?
1 - Les mtaux
1-1 Proprites caractristiques.
Le mtal se distingue d'un non mtal par :
Son clat mtallique : poli, il prend un aspect brillant.
Sa plasticit : il est dformable et faonnable sans rupture.
Sa conductibilit lectrique : il conduit le courant lectrique.
Sa conductibilit thermique : il conduit la chaleur.
1-2 Corps mtalliques : les alliages.
Dans la vie quotidienne, on utilise rarement les mtaux l'tat pur. La plupart des objets que l'on dit
mtallique sont des alliages.
Un alliage rsulte du mlange de plusieurs corps dont un au moins est un mtal. Les alliages
amliorent les proprits physiques et mcaniques des mtaux purs principalement des mtaux usuels
dont l'aluminium,le cuivre, le fer, le plomb et le zinc.
N.B. Le choix des mtaux pour des usages pratiques est souvent guid par :
leurs proprits physiques : plasticit, conductibilits thermique et lectrique, fusion, densit
leurs proprits mcaniques : duret, tenacit, mallabilit, ductilit
1-3 Tableau comparatif de quelques proprits.
Aspect
Symbole
ou Densit Temprature Temprature Conductibilit Conductibilit
Mtaux
masse de fusion d'bullition lectrique thermique.
couleur /eau
atomique
s
Fe
Fer Gris 7,8 1530C 3230C 4 4
56 g/mol
Zn
Zinc Blanchtre 65,3 7,1 420C 920C 3 3
g/mol
Aluminiu Al
Blanc 2,7 660C 1800C 2 2
m 27 g/mol
Cu
Cuivre Rouge 63,5 8,9 1083C 2200C 1 1
g/mol
blancht Pb
Plomb 11,3 327C 1700C 5 5
re 207 g/mol
2 - Les mtaux dans l'air libre
Abandonns l'air libre, les mtaux se corrodent : ils perdent leur clat mtallique alors couvert. On
appelle corrosion, l'altration d'un mtal sous l'action de certaines substances (air humide, eau de mer,
solution acide ou basique)
cours de chimie troisime : Page 8
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
N.B. Dans lair, les facteurs de corrosion sont le dioxygne O2, la vapeur d'eau H2O, le
dioxyde de carbone CO2.
2-1 Oxydation froid.
2.1-1 du fer
A l'air libre, le fer se recouvre d'une couche poreuse (permable) de couleur brune appele rouille.
Celle-ci est le rsultat de l'action :
du dioxygne : le dioxygne de l'air attaque le fer froid et produit de l'oxyde ferrique Fe2O3
Fe + O2 Fe2O3
de la vapeur d'eau : la vapeur d'eau de l'air humidifie l'oxyde ferrique form. Le mlange oxyde
ferrique Fe2O3 et eau H2O est l'oxyde ferrique hydrat (Fe2O3 ; H2O) appel rouille.
Remarque :
La rouille tant poreuse, l'action se poursuit en profondeur. Pour empcher cette action le fer doit tre
protg en le recouvrant de peinture, de graisse, d'huile, d'autres mtaux (fer galvanis, fer blanc).
2.1-2 de l'aluminium
L'aluminium, dans l'air libre, se recouvre d'une couche superficielle, impermable et protectrice qui
ternit son clat mtallique Cette couche appele alumine Al2O3 est le produit de la raction entre
l'aluminium et le dioxygne.
Al + O2 Al2O3
N.B. L'alumine dont la temprature de fusion est 2000C est plus rfractaire et moins fusible que
l'aluminium ; il empche l'coulement de l'aluminium fondu liquide 660C.
Faisons brler un fil daluminium dans une flamme :
2.1-3 Les hydrocarbonates
A l'air libre, Le zinc, le cuivre et le plomb se recouvrent d'une couche impermable qui protge chacun
de ces mtaux. Cette couche est appele hydrocarbonate du mtal. Ainsi on a :
sur le zinc, l'hydrocarbonate de zinc (ZnCO3 ; H2O)
sur le cuivre, l'hydrocarbonate de cuivre (CuCO3 ; H2O)
sur le plomb, l'hydrocarbonate de plomb (PbCO3 ; H2O).
3 - Action du dioxygne chaud sur les mtaux usuels.
3-1 sur le fer.
Brlons un fil de fer ou saupoudrons une flamme de fer.
On observe un jaillissement d'tincelles qui sont des grains
d'oxyde magntique incandescents. Le fer ragit chaud avec
le dioxygne O2 pour donner de l'oxyde magntique Fe3O4.
Fe + O2 Fe3O4
Remarque : la plupart des minerais de fer sont sous forme
d'oxyde magntique.
3-2 sur le zinc.
La fume blanche qui se dgage est constitue d'oxyde de zinc ZnO
qui est le produit de la raction entre le zinc et le dioxygne.
cours de chimie troisime : Page 9
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
Zn + O2 ZnO
Remarque : l'oxyde de zinc entre dans la fabrication de certains
mdicaments et de certaines peintures.
3-3 sur l'aluminium.
Le jaillissement d'tincelles que l'on observe en projetant de la poudre
d'aluminium dans une flamme est constitu de grains d'alumine
incandescents. Cet alumine est le produit de la raction entre le dioxygne
et l'aluminium.
Al + O2 Al2O3
3-4 sur le cuivre.
On observe :
sur la partie trs chaude de la lame, on voit apparatre un oxyde noir dit
oxyde cuivrique CuO
Cu + O2 CuO
Sur la partie adjacente, moins chaude, apparat un
oxyde rouge appel oxyde cuivreux Cu2O.
Cu + O2 Cu2O
A chaud, la raction entre le cuivre et le dioxygne, donne deux oxydes suivant la
temprature : l'oxyde cuivrique noir CuO et l'oxyde cuivreux rouge Cu2O.
cours de chimie troisime : Page 10
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
Action froid des acides dilus sur les mtaux usuels
Situation problme :
Au bout dun certain temps, une mnagre remarque que la plupart des rcipients mtalliques
de sa vaisselle porte les stigmates de leur contact avec certaines solutions. Ce contact entre
acides et mtaux peut mme se traduire par une dgradation : des trous perceptibles. Citer
quelques mets contenant des solutions acides.
1 - Prsentation
1-1 de l'acide chlorhydrique.
L'acide chlorhydrique est une solution aqueuse de gaz chlorhydrique HCl. Cette solution est obtenue
grce la grande solubilit du gaz chlorhydrique HCl : 445 L/L d'eau 20C. On trouve l'acide
chlorhydrique concentr au laboratoire ; trs dilu pour ses usages domestiques car il est trs corrosif.
N.B. A ce niveau, on note l'acide chlorhydrique HCl. Sa masse molaire molculaire est de 36,5 g/mol.
1-2 de l'acide sulfurique.
L'acide sulfurique H2SO4 est liquide, il est corrosif surtout l'tat concentr. C'est un acide trs utilis
au laboratoire o il permet entre autre de :
synthtiser d'autres acides.
dshydrater certains produits par sa grande avidit d'eau.
C'est l'acide sulfurique que l'on trouve dans les batteries d'accumulateurs des voitures. Il pse 98
g/mol.
1-3 de l'acide nitrique.
L'acide nitrique HNO3 est un acide liquide miscible l'eau ; sensible la chaleur, il se dcompose
chaud. Ses ractions avec les mtaux donnent des produits complexes et quelquefois instables. Ceci
rend trs difficile, ce niveau, l'criture correcte des quations bilan correspondantes. Ces produits se
dgagent sous forme de vapeurs colors que l'on appelle vapeurs nitreuses. L'acide nitrique est trs
utilis pour la fabrication d'engrains chimiques et d'explosifs. il pse 63 g mol-1.
2 - Action froid des acides dilus
2-1 Exprience.
2.1-2 Observations
En versant l'acide dilu sur un mtal, on peut observer, au niveau du tube essais :
Une effervescence ou bouillonnement qui indique alors
qu'une raction chimique a lieu entre l'acide et le mtal et
qu'elle dgage un gaz.
N.B. le gaz produit est identifi la flamme : il est
inflammable et peut provoquer une lgre dtonation en
prsence d'une flamme. C'est du dihydrogne.
Remarque :
Le dgagement de dihydrogne est phmre pour la
raction entre le plomb et les acides car la raction s'arrte, bloque qu'elle est par le sel de plomb
insoluble qui s'est form.
Un dgagement de vapeurs colors qui montre l'effectivit de la raction entre l'acide nitrique et le
cours de chimie troisime : Page 11
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
mtal.
N.B. la complexit de la composition des vapeurs nitreuses dispense d'crire, ce niveau, les
quations bilan de ces ractions.
Aucune manifestation remarquable : il n'y a pas eu de raction entre l'acide et le mtal.
2-2 Rsultats exprimentaux.
Equations bilan
Ractifs Produits Observations
(quilibrer au besoin)
HCl dihydrogne
Raction . Fe + .HCl .FeCl2 + . H2
Fe chlorure ferreux
HCl dihydrogne
Raction . Zn + HCl ZnCL2 + H2
Zn chlorure de zinc
HCl dihydrogne
Raction Al + . HCl AlCl3 + H2
Al aluminium
HCl dihydrogne Raction
. Pb + HCl ..PbCL2 + H2
Pb chlorure de plomb Ephmre
HCl Pas de
Nant Nant
Cu Raction
Equations bilan
Ractifs Produits Observations
(quilibrer au besoin)
H2SO4 dihydrogne
Raction . Fe + . H2SO4 .FeSO4 + . H2
Fe sulfate ferreux
H2SO4 dihydrogne
Raction .Zn + . H2SO4 ZnSO4 + H2
Zn sulfate de zinc
H2SO4 Pas de
Nant Nant
Al Raction
H2SO4 dihydrogne Raction
. Pb + ... H2SO4 .PbSO4 + H2
Pb sulfate de plomb Ephmre
H2SO4 Pas de
Nant Nant
Cu Raction
cours de chimie troisime : Page 12
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
Ractifs Produits Observations Observations
HNO3
Vapeurs nitreuses raction Nant
Fe
HNO3
Vapeurs nitreuses raction Nant
Zn
HNO3 Pas de
Nant Nant
Al Raction
HNO3
Vapeurs nitreuses raction Nant
Pb
HNO3
Vapeurs nitreuses raction Nant
Cu
cours de chimie troisime : Page 13
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
Les hydrocarbures.
Situation problme :
De nos jours, le ptrole, source naturelle des hydrocarbures a remplac le charbon qui,
pendant longtemps a fait la puissance des nations. Dans notre environnement, le naturel est
devenu lexception et le synthtique la rgle grce au ptrole et ses drivs. Les glules et
autres comprims fabriqus par les pharmacies remplacent progressivement les racines,
corces et autres feuilles des plantes de nos forts.
Indiquer les avantages et inconvnients que cette tendance, si elle se maintient, apportera
lhumanit.
1 - Dfinition
Les hydrocarbures ou carbures d'hydrogne sont des corps organiques dont la molcule ne renferme
que du carbone et de l'hydrogne. Ce sont des composs binaires que l'on note CxHy.
1-1 Les diffrentes familles d'hydrocarbures.
Le grand groupe des hydrocarbures est constitu de sous-groupes appels familles. Ainsi on distingue :
1.1-1 La famille des alcanes.
Formule brute gnrale est CnH2n+2 avec n N- {0}
Les premiers alcanes
Valeurs de n Formules brutes noms
n=1 CH4 mthane
n=2 C2H6 thane
n=3 C3H8 propane
n=4 C4H10 butane
Le mthane CH4 est le plus simple des hydrocarbures, il est incolore, inodore et nettement mois dense
16
que l'air. d= = 0,55. Difficile liqufier, le mthane bout - 161,5C et se solidifie -184C. Il
29
est peu soluble dans l'eau : 0,04L/L d'eau la temprature ordinaire. Parmi ses nombreux drivs, le
chloroforme CHCl3 est le plus connu en tant qu'anesthsique gnral.
1.1-2 La famille des alcnes.
Formule brute gnrale est CnH2n avec n N- {0, 1}
Les premiers alcnes
Valeurs de n Formules brutes noms
n=2 C2H4 Ethne (thylne)
n=3 C3H6 Propne
n=4 C4H8 Butne
n=5 C5H10 pentne
28
L'thylne C2H4 est un gaz incolore, peu prs aussi dense (d = = 0,97) que l'air, plus facile
29
liqufier que le mthane. Il bout -102C et se solidifie -169C. A la temprature ordinaire, on ne
peut dissoudre que 0,15L d'thylne dans un litre d'eau.
L'alcool thylique est l'un de ses drivs les plus connus...
1.1-3 La famille des alcynes
Formule brute gnrale CnH2n-2 avec n N- {0, 1}
cours de chimie troisime : Page 14
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
Les premiers alcynes
Valeurs de n Formules brutes noms
n=2 C2H2 Ethyne (actylne)
n=3 C3H4 Propyne
n=4 C4H6 Butyne
n=5 C5H8 Pentyne
L'actylne est un gaz incolore plus facile liqufier que l'thylne, toutefois sa liqufaction peut
provoquer des explosions dangereuses. D'odeur dsagrable, il est lgrement moins dense que l'air
26
(d = = 0,9) et est plus facile dissoudre dans l'eau : 1L/L d'eau la temprature ordinaire.
29
2 - Sources d'hydrocarbures
Les sources naturelles d'hydrocarbures sont le ptrole brut et le gaz naturel qui sont extraits en grandes
quantits du sol o ils se sont forms trs lentement partir d'organismes animaux et vgtaux enfouis
depuis des millions d'annes.
Le gaz naturel contient principalement du mthane CH4, du butane C4H10, du propane C3H8 et de
l'essence (pour les moteurs explosion)
Le ptrole brut est un mlange d'hydrocarbures liquides solides et gazeux. Par la distillation
fractionne de ce ptrole, les raffineries produisent des gaz (butane et propane principalement), des
essences, du gasoil, du fuel, des huiles et du bitume.
3 - Combustions des hydrocarbures dans le dioxygne.
L'une des premires utilits des hydrocarbures est la production de chaleur lors de leurs combustions
dans le dioxygne.
Combustibles, leurs ractions avec le dioxygne sont exothermiques mais produisent des chaleurs dont
la quantit dpend aussi de la nature de la combustion. Ainsi on distingue :
3-1 La combustion complte.
La combustion complte a lieu quand la quantit de dioxygne est
suffisante : la flamme est alors bleue et le maximum de chaleur est
produit. L'hydrocarbure, en ragissant avec le dioxygne produit alors du
dioxyde de carbone et l'eau.
3.1-1 Combustion complte du mthane.
CH4 + O2 CO2 + H2O
Cette raction dgage une quantit de chaleur considrable soit 886,16 kJ/mol.
3.1-2 Combustion complte de l'thylne.
C2H4 + O2 CO2 + H2O
Bien que trs exothermique 1442,10 kJ/mol, la combustion complte de l'thylne est rarement utilis
comme source de chaleur.
3.1-3 Combustion complte de l'actylne
C2H2 + O2 CO2 + H2O
La combustion complte de l'actylne produit une quantit de chaleur
considrable : 1316,70 kJ/mol. C'est cette grande chaleur qui est utilise dans
le chalumeau oxyactylnique qui permet d'atteindre des tempratures
suprieures 3 000C ( la pointe du dard).
cours de chimie troisime : Page 15
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
I.R.E.M.P.T : DEPARTEMENT DE PHYSIQUE - CHIMIE
3-2 La combustion incomplte.
La virole ferme rend le dioxygne insuffisant, on observe alors une
flamme jaune clairante, des tincelles et une fume noire : la
combustion est incomplte.
La combustion incomplte a lieu quand la quantit de dioxygne est
insuffisante ; elle fournit moins de chaleur et donne un mlange
complexe de diffrents produits. La flamme produite est alors
clairante avec de la fume noire et quelques tincelles brillantes.
N.B. La complexit des produits fournis par la combustion incomplte rend difficile l'criture de
l'quation bilan. Dans le mlange de produits obtenus on peut trouver : du carbone, du monoxyde de
carbone, du dioxyde de carbone, de l'eau
Le danger de la combustion qui se produit gnralement au cours des incendies est li, entre autres,
la formation invitable du monoxyde de carbone CO qui est un gaz incolore, inodore, inflammable et
trs toxique.
cours de chimie troisime : Page 16
(C) Wahab Diop Ce document a t tlcharger sur le site: http://physiquechimie.sharepoint.com
Vous aimerez peut-être aussi
- DIONE PC Fascicule de Sciences Physiques 3èmeDocument40 pagesDIONE PC Fascicule de Sciences Physiques 3èmesoda loPas encore d'évaluation
- CORRECTION EVALUATION SP 3e N°1 2022 2023 1Document2 pagesCORRECTION EVALUATION SP 3e N°1 2022 2023 1Boubacar MballoPas encore d'évaluation
- Exercices-De-Chimie-4 EmeDocument3 pagesExercices-De-Chimie-4 Emeibamondo9Pas encore d'évaluation
- Devoir N°2 PC Semestre 1 3eme 2020 2021 2Document1 pageDevoir N°2 PC Semestre 1 3eme 2020 2021 2aminapote062Pas encore d'évaluation
- Repérage Cartésien CorrDocument7 pagesRepérage Cartésien Corrseexunaa looPas encore d'évaluation
- Devoir de Maison Physique ChimiqueDocument2 pagesDevoir de Maison Physique ChimiqueIbrahima NdiayePas encore d'évaluation
- Le Produit Scalaire en Seconde SDocument31 pagesLe Produit Scalaire en Seconde SPapa Moussa N GueyePas encore d'évaluation
- Fascicule 1èrec Vol 1Document45 pagesFascicule 1èrec Vol 1kalaoui Inoussa Hassane100% (1)
- Bepc Electrolyse EauDocument2 pagesBepc Electrolyse Eaukalaoui Inoussa Hassane100% (1)
- Devoir 2 PC 2nd L 1Document2 pagesDevoir 2 PC 2nd L 1Boubacar Balde100% (2)
- Exercices PC 1bac International FR 3 2Document14 pagesExercices PC 1bac International FR 3 2Romayssae100% (1)
- Electrolyse Et Synthese de Leau 1Document5 pagesElectrolyse Et Synthese de Leau 1Sacroquette 1285Pas encore d'évaluation
- Chimie 3 EmeDocument33 pagesChimie 3 Emetoto TOTOROTO100% (1)
- Collection Top Education SP 3e Octobre 2022Document38 pagesCollection Top Education SP 3e Octobre 2022sokhnaamygadiaga074Pas encore d'évaluation
- SOLUTIONS ACIDES BASIQUES ET NEUTRES - ValidéDocument10 pagesSOLUTIONS ACIDES BASIQUES ET NEUTRES - Validéniagne lambert100% (1)
- 2D-PC-CHAP 01 ExercicesDocument93 pages2D-PC-CHAP 01 ExercicesHSEE PUVPas encore d'évaluation
- SERIES D EXERCICES 4e PCDocument1 pageSERIES D EXERCICES 4e PCpapa samba sarrPas encore d'évaluation
- MathsDocument1 pageMathsALIOUMANPas encore d'évaluation
- PC 3ème - L7 - Les AlcanesDocument9 pagesPC 3ème - L7 - Les AlcanesGedion Doua100% (1)
- 2nde C 3Document5 pages2nde C 3BenoitPas encore d'évaluation
- Alcenes Et AlcynesDocument7 pagesAlcenes Et AlcynesSYLVAIN KOUADIOPas encore d'évaluation
- Exercices Sur La Géométrie AnalytiqueDocument2 pagesExercices Sur La Géométrie AnalytiqueAlban Landry Kanon100% (2)
- 2S - Wahab Diop-TD - Poids - 2010Document1 page2S - Wahab Diop-TD - Poids - 2010Mamadou djibril BaPas encore d'évaluation
- Les Reactions D Oxydo Reduction Exercices Corriges 1Document9 pagesLes Reactions D Oxydo Reduction Exercices Corriges 1Kawther MalkiPas encore d'évaluation
- TD PCDocument111 pagesTD PCkaderdeme505100% (1)
- Composition Cem 1er Semestre 3eme 2013Document2 pagesComposition Cem 1er Semestre 3eme 2013falilou loPas encore d'évaluation
- Fascicule 3eDocument39 pagesFascicule 3elebete100% (1)
- 1s p04 Exos Forces CDocument6 pages1s p04 Exos Forces CCamiiPas encore d'évaluation
- Serie Exo PC 1ere S Force Et ChampDocument14 pagesSerie Exo PC 1ere S Force Et ChampAly NdaoPas encore d'évaluation
- Prepa PC BEPCDocument51 pagesPrepa PC BEPCYao Stanislas Kouadio100% (1)
- Devoir Commun de Mathematiques 4eme - 2011 Version 1Document3 pagesDevoir Commun de Mathematiques 4eme - 2011 Version 1Didactic math ديداكتيك الرياضيات0% (1)
- PCT 3ème Seq 2 17 18Document4 pagesPCT 3ème Seq 2 17 18billy kanaPas encore d'évaluation
- Devoir PCDocument5 pagesDevoir PCAmadou KonfePas encore d'évaluation
- Litterature Française - 2ndec CamerounDocument1 pageLitterature Française - 2ndec CamerounAuguy Bayeke100% (1)
- D4 1S2 2019 LSLL Wahabdiop PDFDocument2 pagesD4 1S2 2019 LSLL Wahabdiop PDFAminata100% (2)
- Acice Fort Base Forte Exercice 1Document8 pagesAcice Fort Base Forte Exercice 1Hamidou Diatta100% (1)
- Compo 2s 2semDocument6 pagesCompo 2s 2semando100% (1)
- TD N°3 Notion de ForceDocument2 pagesTD N°3 Notion de ForceBassirou SOWPas encore d'évaluation
- 1er Devoir Du 1er Semestre Mathématiques 5ème 2022-2023 Ceg2 Abomey-CalaviDocument2 pages1er Devoir Du 1er Semestre Mathématiques 5ème 2022-2023 Ceg2 Abomey-CalaviSAMUEL YEVI100% (2)
- Serie C4-benzene-WahabDiopDocument2 pagesSerie C4-benzene-WahabDiophamd kabore100% (2)
- Exercices Ions CapDocument8 pagesExercices Ions CapFred RocherPas encore d'évaluation
- Devoir 3eme Pc-N°2Document2 pagesDevoir 3eme Pc-N°2ADJEPas encore d'évaluation
- 3 Epreuve Devoir Departemental Sciences PhysiquesDocument1 page3 Epreuve Devoir Departemental Sciences Physiquesleye38392Pas encore d'évaluation
- La Droite Dans Le Plan Exercices Corriges 1Document7 pagesLa Droite Dans Le Plan Exercices Corriges 1berrada mohamedPas encore d'évaluation
- QCM TrianglesDocument4 pagesQCM TrianglesGamerenflamme Nul67% (3)
- Fascicule Finale 2020Document98 pagesFascicule Finale 2020salikine71Pas encore d'évaluation
- Correction TDDocument5 pagesCorrection TDBasmã AlilechePas encore d'évaluation
- Devoir N° 27 1er S1 S2 - SunudaaraDocument4 pagesDevoir N° 27 1er S1 S2 - SunudaaraAhmadou Gueule SallPas encore d'évaluation
- Corrigé L2 2023 1er-GroupeDocument1 pageCorrigé L2 2023 1er-GroupeAlpha SissokoPas encore d'évaluation
- Kaba 2eme Physique SenegalDocument136 pagesKaba 2eme Physique SenegalLansana KabaPas encore d'évaluation
- TP1CHIMIEDocument4 pagesTP1CHIMIEKhalid ChrisPas encore d'évaluation
- Dev1 2s 2010 GB 2Document3 pagesDev1 2s 2010 GB 2AINAMONPas encore d'évaluation
- 1er Devoir Du 2ème Semestre PCT 2nde CD 2021-2022 Ceg Le NokoueDocument3 pages1er Devoir Du 2ème Semestre PCT 2nde CD 2021-2022 Ceg Le Nokoueedoh LABY100% (1)
- (5e) 0 Corrigé ExercicesDocument6 pages(5e) 0 Corrigé ExercicesAbđė Ěł ŁğđPas encore d'évaluation
- TD N°1 Solutions AqueusesDocument3 pagesTD N°1 Solutions AqueusesLinda Koundzi100% (1)
- Cours Complet ChimieDocument7 pagesCours Complet ChimieJacksonPas encore d'évaluation
- Cours Chimie 3eDocument16 pagesCours Chimie 3eYazine ZeidPas encore d'évaluation
- Cinetique Chimique PDFDocument10 pagesCinetique Chimique PDFlhajjiPas encore d'évaluation
- SMP5 Electronique Serie 2 2017-2018 PDFDocument1 pageSMP5 Electronique Serie 2 2017-2018 PDFlhajjiPas encore d'évaluation
- SMP5 Electronique Serie 3 Correction 2017-2018 PDFDocument13 pagesSMP5 Electronique Serie 3 Correction 2017-2018 PDFlhajjiPas encore d'évaluation
- SMP5 Electronique Serie 3 2017-2018 PDFDocument2 pagesSMP5 Electronique Serie 3 2017-2018 PDFlhajjiPas encore d'évaluation
- SMP5 Electronique Serie 1 2017-2018 PDFDocument1 pageSMP5 Electronique Serie 1 2017-2018 PDFlhajjiPas encore d'évaluation
- Enoncé CorigeDocument4 pagesEnoncé CorigelhajjiPas encore d'évaluation
- td1 2010Document6 pagestd1 2010lhajjiPas encore d'évaluation
- Devoir 210Document2 pagesDevoir 210lhajjiPas encore d'évaluation
- Serie1 Master GMDocument2 pagesSerie1 Master GMlhajjiPas encore d'évaluation
- Résonance Paramagnétique ÉlectroniqueDocument29 pagesRésonance Paramagnétique Électroniquelhajji100% (2)
- j2200 Mousses. Formation, Formulation Et PropriétésDocument14 pagesj2200 Mousses. Formation, Formulation Et PropriétésBENMESSAOUDPas encore d'évaluation
- Chapitre 09Document53 pagesChapitre 09ABELWALIDPas encore d'évaluation
- Fonctionnement - Groupe - Lectrog - Ne - Docx Filename - UTF-8''Fonctionnement Groupe ÉlectrogèneDocument42 pagesFonctionnement - Groupe - Lectrog - Ne - Docx Filename - UTF-8''Fonctionnement Groupe ÉlectrogèneZïrãkøv PolpoPas encore d'évaluation
- Analyse Spatiale Et Cartographie de La Régénération Forestière Post-Incendie Dans La Wilaya de TissemsiltDocument88 pagesAnalyse Spatiale Et Cartographie de La Régénération Forestière Post-Incendie Dans La Wilaya de TissemsiltÏnaÿ LïmPas encore d'évaluation
- CHP II - Generalite Sur La Mesure D - Une Grandeur Physique - 2Document37 pagesCHP II - Generalite Sur La Mesure D - Une Grandeur Physique - 2reda100% (1)
- Entree Agreg Fev 2014 AnalyseDocument6 pagesEntree Agreg Fev 2014 AnalysesaidPas encore d'évaluation
- Cours Systemes Hydrauliques Et PneumatiquesDocument82 pagesCours Systemes Hydrauliques Et Pneumatiquesagvass100% (1)
- Berreksi - Cours - Hydraulique 3 - l3 HuDocument55 pagesBerreksi - Cours - Hydraulique 3 - l3 HuBen Salah BambaPas encore d'évaluation
- Cours MEF2Document47 pagesCours MEF2tsumey10Pas encore d'évaluation
- Eléments Liés À La Potabilité de LDocument5 pagesEléments Liés À La Potabilité de LAmiraBenhammouPas encore d'évaluation
- Caractéristiques D'inertie Des SolidesDocument11 pagesCaractéristiques D'inertie Des SolidesAhmed fattoumPas encore d'évaluation
- 4sur4 Geotechnique Avant-Port PDFDocument604 pages4sur4 Geotechnique Avant-Port PDFAbdou Hababa100% (1)
- MS05Document36 pagesMS05tomas100% (1)
- FPDocument28 pagesFPTUBPas encore d'évaluation
- Annales RefractionDocument2 pagesAnnales Refractionsifer mohamedPas encore d'évaluation
- Note de Calcul AssemblageDocument8 pagesNote de Calcul AssemblageWissem TaktakPas encore d'évaluation
- SSP 186 Le Bus de Données CANDocument30 pagesSSP 186 Le Bus de Données CANMohammed MochrifPas encore d'évaluation
- Mecarat 2018-2019 Kolwezi 05-12-2018Document137 pagesMecarat 2018-2019 Kolwezi 05-12-2018Moîse Sairys MoîsePas encore d'évaluation
- BL2H IOM Manual Rev 0901 FrenchDocument24 pagesBL2H IOM Manual Rev 0901 FrenchahouaPas encore d'évaluation
- Thermocouple Table Type-JDocument3 pagesThermocouple Table Type-JAmir FauziPas encore d'évaluation
- NiveauDocument21 pagesNiveauzakiPas encore d'évaluation
- Guide ToituresDocument7 pagesGuide ToituresbarouniaminePas encore d'évaluation
- Densite App Agregats KeroseneDocument4 pagesDensite App Agregats KeroseneLaraba MohamedPas encore d'évaluation
- Soudage PlasmaDocument12 pagesSoudage PlasmaMadani MecheriPas encore d'évaluation
- Apometria Energie Et Esprit 2 José Lacerda de AzevedoDocument147 pagesApometria Energie Et Esprit 2 José Lacerda de Azevedoyannick100% (2)
- DFTDocument29 pagesDFTklouzazna100% (4)
- CCP Tsi 2017 Maths CorrigeDocument6 pagesCCP Tsi 2017 Maths CorrigeZH hasnaePas encore d'évaluation
- Courbe de NiveauDocument1 pageCourbe de NiveauALON?TSIE TANEZOUA ISRAELPas encore d'évaluation
- 50 Clés Pour Comprendre Les Maths - DunodDocument210 pages50 Clés Pour Comprendre Les Maths - Dunodyounes1980100% (6)