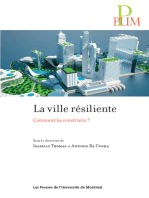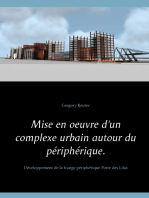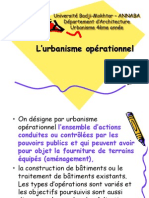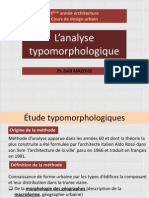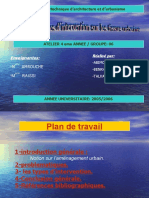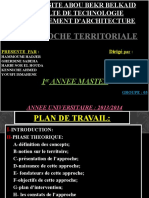Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Françoise Chouay - L'Urbanisme, Utopies Et Réalités
Transféré par
MohamedDjihad0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
542 vues4 pagesExtraits
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentExtraits
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
542 vues4 pagesFrançoise Chouay - L'Urbanisme, Utopies Et Réalités
Transféré par
MohamedDjihadExtraits
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
La société industrielle est urbaine. La ville est son horizon.
7 [la ville est l’horizon
des dramaturgies modernes, fascisme, - assemblements populaire- luttes de classes
– marxistes, instauration de la société de consommation : la ville étant devenue le
lieu des grandes dramaturgies politiques : construction [saint-Pétersbourg] et
destruction [Dresde] ]
… la racine des incertitudes et des doutes que soulève aujourd’hui toute nouvelle
proposition d’aménagement urbain. 8
[urbanisme] lourd d’ambiguïté.
Ce néologisme correspond à l’émergence d’une réalité nouvelle : vers la fin du XIX
e siècle, l’expansion de la société industrielle donne naissance à une discipline qui se
distingue des arts urbains antérieurs par son caractère réflexif et critique, et par sa
prétention scientifique. 8
Car l’urbanisme veut résoudre un problème (l’aménagement de la cité machiniste)
qui s’est posé bien avant sa création, dès les premières décades du XIXe siècle, au
moment où la société industrielle commençait à prendre conscience de soi et à
mettre ses réalisations en question. 9
Du point de vue quantitatif, la révolution industrielle est presque aussitôt suivie par
une impressionnante poussée démographique dans les villes, par un drainage des
campagnes au profit d’un développement urbain sans précédent. 10
Un nouvel ordre se crée, selon le processus traditionnel de l’adaptation de la ville à
la société qui l’habite. 11
Ensuite, la spécialisation assez poussée des secteurs urbains (quartiers d’affaires, du
nouveau centre, groupés dans les capitales autour de la Bourse, nouvelle Église ;
quartiers d’habitation périphériques destinés aux privilégiés) 11
La ville cesse d’être une entité spatiale bien délimité [ce qui n’est pas ramassé est
éclaté] 11
Or, dans le temps même où la ville du XIXe siècle commence à prendre son visage
propre, elle provoque une démarche nouvelle, d’observation et de réflexion. Elle
apparaît soudain comme un phénomène extérieur aux individus qu’elle concerne.
Ceux-ci se trouvent devant elle comme devant un fait de nature, au cours du XIXe
siècle, deux aspects bien différents. 11
…ils ressentent la grande ville comme un processus pathologique, et créent pour la
désigner les métaphores du cancer et de la verrue. [Note : Le Corbusier parle de
Paris comme un « cancer qui se porte bien ».] 13 Les uns sont inspirés par des
sentiments humanitaires : ce sont des officiers municipaux, des hommes d’Eglise,
surtout des médecins et hygiénistes, qui dénoncent, faits et chiffres à l’appui, l’état
de délabrement physique et moral dans lequel vit le prolétariat urbain. 13
L’autre groupe de polémistes est constitué par des penseurs politiques. Souvent leur
information est d’une ampleur et d’une précision remarquables…Dans ce groupe
de penseurs politiques, les esprits les plus divers ou même opposés, Matthew
Arnold et Fourier, Proudhon et Carlyle, Engels et Ruskin, se rencontrent pour
dénoncer l’hygiène physique déplorable des grandes villes industrielles : habitat
ouvrier insalubre fréquemment comparé à des tanières, distances épuisantes qui
séparent lieux de travail et d’habitation…L’hygiène morale est également mise en
cause : contraste entre les quartiers d’habitation des différentes classes aboutissant à
la ségrégation, hideur et monotonie des constructions « pour le plus grand
nombre ». 13-14
…les tares urbaines dénoncées apparaissent comme le résultat de tares sociales,
économiques et politiques. 14
Ce qui est ressenti comme désordre appelle son antithèse, l’ordre [l’onirisme
engendré par la ville appelle l’onirisme de Virgile songeant à la campagne]. 15
Ainsi va-t-on voir opposer à ce pseudo désordre de la ville industrielle, des
propositions d’ordonnancements urbains librement construites par une réflexion
qui se déploie dans l’imaginaire. Faute de pouvoir donner une forme pratique à sa
mise en question de la société, la réflexion se situe dans la dimension de l’utopie ;
elle s’y oriente selon les deux directions fondamentales du temps, le passé et le
futur, pour prendre les figures de la nostalgie ou du progressisme. 15
La révolution industrielle est l’événement historique-clé qui entraînera le devenir
humain et promouvra le bien-être. 17
« déterminer le système de construction le mieux adapté à sa nature »…17
Tout d’abord, l’espace du modèle progressiste est largement ouvert, troué de vides et
de verdure. 17
Cette importance accordée à l’impression visuelle indique assez le rôle de
l’esthétique dans la conception de l’ordre progressiste. 18
En dépit de ces dispositions, destinées à libérer l’existence quotidienne d’une partie
des tardes et des servitudes de la grande ville industrielle, les différentes formes du
modèle progressiste se présentent comme des systèmes contraignants et répressifs. 19
Son point de départ critique n’est plus la situation de l’individu, mais celle du
groupement humain, de la cité. 21
Le scandale historique dont partent les partisans du modèle culturaliste est la
disparition de l’ancienne unité organique de la cité, sous la pression désintégrante
de l’industrialisation. 21
La clé de voûte idéologique de ce modèle n’est plus le concept de progrès mais
celui de culture. 22
… dans le modèle culturaliste, la prééminence des besoins matériels s’efface devant
celle des besoins spirituels. 22
Dans son Eloge du gothique, J. Ruskin écrit : « une partie considérable des caractères
essentiels de la beauté est subordonnée à l’expression de l’énergie vitale dans les
objets organiques ou à la soumission à cette énergie d’objets naturellement passifs
et impuissants ». 23
…une désintégration par carence culturelle.
Dans tous les cas, la ville, au lieu d’être pensée comme processus ou problème, est
toujours posée comme une chose, un objet reproductible. Elle est arrachée à la
temporalité concrète et devient, au sens étymologique, utopique, c’est-à-dire de
nulle part. 25
La ville possède chez eux [Marx et Engels] le privilège d’être le lieu de l’histoire. C’est
là que dans, dans un premier temps, la bourgeoisie s’est développée et a joué son
rôle révolutionnaire. C’est là que naît le prolétariat industriel, auquel principalement
reviendra la tâche d’accomplir la révolution socialiste et de réaliser l’homme
universel. 26
Cette conception du rôle historique de la ville exclut le concept de désordre ; la ville
capitaliste du XIXe siècle est, au contraire, pour Engels et Marx, l’expression d’un
ordre qui fut en son temps créateur et qu’il s’agit de détruire pour le dépasser. 26
La ville n’est pour eux que l’aspect particulier d’un problème général et sa forme
future est liée à l’avènement de la société sans classe. 26 [La réalité des ville atteste
chez Broch de l’avènement d’un ordre nouveau]
Il est impossible et inutile, avant toute prise de pouvoir révolutionnaire, de chercher
à en prévoir l’aménagement futur. 26
La perspective d’une action transformatrice remplace pour eux le modèle, rassurant
mais irréel, des socialistes utopistes. 26 Les certitudes et les précisions d’un modèle
sont refusées au profit d’un avenir indéterminé, dont les contours n’apparaîtront
que progressivement, à mesure que se développera l’action collective. 27
Le refus du modèle [refus du totalitarisme]. On le trouvera chez l’anarchiste
Kropotkine pour qui « réglementer, chercher à tout prévoir et à tout ordonner
serait simplement criminel ». Les temps nouveaux.
La majorité des auteurs qui, dans l’Europe du XIXe siècle, ont critiqué la grande
ville industrielle, n’en étaient pas moins marqués par une longue tradition urbaine ;
à travers l’histoire, les cités européennes leur sont apparues comme le berceau des
forces qui transforment la société. L’inverse a lieu aux États-Unis, où l’époque
héroïque, des pionniers est liée à l’image d’une nature vierge. Aussi, avant même
que n’y soient perçus les premiers contrecoups de la révolution industrielle, la
nostalgie de la nature inspire dans ce pays un violent courant anti-urbain. 29
De cette volonté de recréer un passé mort, qui est finalement le moteur idéologique
de l’urbanisme culturaliste, on doit tirer deux conséquences critiques. A un premier
niveau – méthodologique et spéculatif – la valorisation inconsidérée du passé
conduit à une réificatfion du temps, qui est traité à la manière d’un espace, et
comme s’il était réversible. .45
Et la répétition quasi rituelle de conduites anciennes traduit l’inadaptation, la fuite
devant un présent inassumable. 46
Une ville n’est pas perçue par ceux qui l’habitent à la manière d’un tableau ; sa
perception est, pour eux, organisée de façon radicalement autre, à la façon des
séries de liens existentiels, pratiques et affectifs qui les attachent à elle. 72
A la racine de toute proposition d’aménagement, derrière les rationalisations ou
savoir qui prétendent la fonder en vérité, se cachent des tendance et des systèmes
de valeurs. 74 [non seulement son aménagement, mais la perception même de la
ville est relative à celle du système de valeurs]
A la présence de la cité se substituait alors son idée. Et, après avoir qualifié de
désordre l’ordre urbain existant, on s’efforçait de lui opposer des ordres idéaux, des
modèles, qui sont, en fait, les projections rationalisées d’imaginaires collectifs et
individuels.75
Les systèmes de valeurs sur lesquels l’urbanisme repose en dernier ressort ont été
masqués par l’illusion naïve et persistante d’une assise scientifique. 77
La ville n’est pas seulement un objet ou un instrument, le moyen d’accomplir
certaines fonctions vitales ; elle est également un cadre de relations inter-
conscientielles, le lieu d’une activité qui consomme des systèmes de signes
autrement complexes que ceux évoqués plus haut. 78
L’urbaniste doit cesser de concevoir l’agglomération urbaine en termes de modèles
et de fonctionnalisme. Il faut cesser de répéter des formules figées qui transforment
le discours en objet, pour définir des systèmes de rapports, créer des structures
souples, une présyntaxe ouvert à des significations non encore constituées. 81
Le langage urbanistique perdra sa spécificité pour conquérir un plan supérieur de
généralité ; indirectement, par sa référence à l’ensemble des autres systèmes
signifiants, il mettra à contribution et impliquera l’ensemble de la collectivité. 81
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours D Urbanisme Pp1Document16 pagesCours D Urbanisme Pp1Edouard Francis JarethPas encore d'évaluation
- A4 Urbanisme - CopieDocument51 pagesA4 Urbanisme - CopieAlvine LayingPas encore d'évaluation
- Cours UrbanismeDocument20 pagesCours UrbanismeMelchisedek MeignanPas encore d'évaluation
- Analyse SensorielleDocument10 pagesAnalyse SensorielleAna IsePas encore d'évaluation
- Analyse UrbaineDocument2 pagesAnalyse Urbainenadjiib19100% (1)
- Cours D'urbanisme Pp1Document16 pagesCours D'urbanisme Pp1Jingle Ball100% (1)
- Cours Et Atelier Urba Opérationnel L3 112022Document33 pagesCours Et Atelier Urba Opérationnel L3 112022Assiri Behibro Borgia Fourier KoffiPas encore d'évaluation
- Design Urbain CoursDocument54 pagesDesign Urbain Coursʚĩɞ Hadjer ʚĩɞPas encore d'évaluation
- Travaux Dirigés UrbanismeDocument7 pagesTravaux Dirigés UrbanismeValdess Tano100% (4)
- Pratiques managériales républicaines: Cadres, à l'action pour la république!D'EverandPratiques managériales républicaines: Cadres, à l'action pour la république!Pas encore d'évaluation
- Planification UrbaineDocument2 pagesPlanification UrbaineYassine YassinePas encore d'évaluation
- Les Étapes de L'urbanisme en AlgérieDocument12 pagesLes Étapes de L'urbanisme en AlgérieMohamed Tahar GrairiaPas encore d'évaluation
- Genèse d'un architecte: Casablanca, Clermont-Fd : Souvenirs d’enfance et d’adolescence, Architectures-architectes-villesD'EverandGenèse d'un architecte: Casablanca, Clermont-Fd : Souvenirs d’enfance et d’adolescence, Architectures-architectes-villesPas encore d'évaluation
- Mise en oeuvre d'un complexe urbain autour du périphérique.: Développement de la frange périphérique Porte des LilasD'EverandMise en oeuvre d'un complexe urbain autour du périphérique.: Développement de la frange périphérique Porte des LilasÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (3)
- Resume Des Cours D Urbanisme s2Document27 pagesResume Des Cours D Urbanisme s2Jean Luc Tchoffo100% (1)
- TPTU Cours N°4.3 Le Projet UrbainDocument8 pagesTPTU Cours N°4.3 Le Projet Urbainhayem boudjatit100% (2)
- Cours Relation Ville ArchitectureDocument23 pagesCours Relation Ville Architecturesandra massdezPas encore d'évaluation
- Cours IntroductifDocument19 pagesCours Introductifayoub el100% (1)
- Le maire, l'architecte, le centre-ville... et les centres commerciauxD'EverandLe maire, l'architecte, le centre-ville... et les centres commerciauxÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Organisation de L'espace Urbain Dans La Ville de Salé: Quartier de Sidi Moussa, Projet D'une Nouvelle Centralité Urbaine.Document234 pagesOrganisation de L'espace Urbain Dans La Ville de Salé: Quartier de Sidi Moussa, Projet D'une Nouvelle Centralité Urbaine.Hasnae At100% (1)
- K LynchDocument29 pagesK LynchHadjer Oubaid100% (2)
- Cours UbanismeDocument61 pagesCours UbanismemedPas encore d'évaluation
- Urbanisme OpérationnelDocument20 pagesUrbanisme OpérationnelFateh ßenouhiba100% (2)
- Cours D'urbanisme Pp1Document14 pagesCours D'urbanisme Pp1Modou MbayePas encore d'évaluation
- Théories de L'urbanismeDocument21 pagesThéories de L'urbanismeAbdellatif ALAHYANE100% (1)
- Analyse UrbaineDocument21 pagesAnalyse UrbaineTimeea TimiPas encore d'évaluation
- Cours Initiation À L'urbanime S3Document79 pagesCours Initiation À L'urbanime S3213024 213024Pas encore d'évaluation
- Reconstruction de La Ville Sur La VilleDocument361 pagesReconstruction de La Ville Sur La Villekatana131150% (2)
- Cours Complet UrbaDocument9 pagesCours Complet UrbaMelchisedek Meignan100% (2)
- Cours de Lotissement.2Document41 pagesCours de Lotissement.2lowangasarah7Pas encore d'évaluation
- Analyse Urbaine - NyonDocument66 pagesAnalyse Urbaine - Nyonlilbitcosmin100% (1)
- Dictionnaire Raisonne de l'Architecture Francaise, Tome 1D'EverandDictionnaire Raisonne de l'Architecture Francaise, Tome 1Pas encore d'évaluation
- Grille Équipement ٢٠٠٠Document48 pagesGrille Équipement ٢٠٠٠سناء المقدسيPas encore d'évaluation
- Dynamiques métropolitaines et développement touristiqueD'EverandDynamiques métropolitaines et développement touristiquePas encore d'évaluation
- Analyse Urbaine Et ArchitecturaleDocument14 pagesAnalyse Urbaine Et ArchitecturaletalebarchiPas encore d'évaluation
- L'urbanismeDocument33 pagesL'urbanismeAbdellatif ALAHYANE100% (1)
- Planification Urbaine Et StratégiqueDocument19 pagesPlanification Urbaine Et StratégiqueAya Mlm100% (1)
- Kettaf Fadila - Architecture Urbaine - Espace de La Ville, Projet Et Composition UrbaineDocument18 pagesKettaf Fadila - Architecture Urbaine - Espace de La Ville, Projet Et Composition UrbainePaige AsmaPas encore d'évaluation
- Cours Et Atelier Urba Opérationnel L2Document23 pagesCours Et Atelier Urba Opérationnel L2jules osy tamwo wato100% (1)
- Composition Et Esthétique Dans La Mise en Forme de L'espace Urbain Cas de La Brèche À Constantine Et Du Cours de La Révolution À AnnabaDocument181 pagesComposition Et Esthétique Dans La Mise en Forme de L'espace Urbain Cas de La Brèche À Constantine Et Du Cours de La Révolution À AnnabaKHELIFA100% (1)
- DesUrb Cours 7 NEO Rationalistes DefDocument25 pagesDesUrb Cours 7 NEO Rationalistes DefSaid MazouzPas encore d'évaluation
- Cours Architecture - Reglementation de La ConstructionDocument41 pagesCours Architecture - Reglementation de La ConstructionMohamedRmouch100% (2)
- Cours D'urbanisme PP1Document15 pagesCours D'urbanisme PP1Hazael BolarimonPas encore d'évaluation
- Manuel Normes Equipements Collectifs PDFDocument17 pagesManuel Normes Equipements Collectifs PDFAnonymous f0hFc1vaeA50% (2)
- Hotel de VilleDocument23 pagesHotel de VilleZo VaPas encore d'évaluation
- La Composition Urbaine PrincipesDocument24 pagesLa Composition Urbaine PrincipesAymen LALALIPas encore d'évaluation
- UrbanismeDocument68 pagesUrbanismeBen Mansour Sofien100% (1)
- ABCDocument92 pagesABCPipo La Trompette100% (2)
- Qu'est Ce Que L'urbanismeDocument15 pagesQu'est Ce Que L'urbanismeShamss Boucli HacenPas encore d'évaluation
- 3méthodologie D - Analyse Urbaine DDocument4 pages3méthodologie D - Analyse Urbaine DBibi Biba100% (1)
- Analyse Urbaine Approche TerritorialeDocument67 pagesAnalyse Urbaine Approche TerritorialeMama HbibaPas encore d'évaluation
- Panerai PhillipeDocument16 pagesPanerai PhillipeLavinia ConstantinPas encore d'évaluation
- Cours de L'urbanisme de l'EPAUDocument43 pagesCours de L'urbanisme de l'EPAUThenguyen Nguyen100% (4)
- Remy Allain La Morphologie UrbaineDocument34 pagesRemy Allain La Morphologie UrbaineAna Ise100% (2)
- Mémoire Sur Les Centralités UrbainesDocument37 pagesMémoire Sur Les Centralités Urbainesmalogohier312585% (13)
- 4.suite - Classification Des Structures PDFDocument10 pages4.suite - Classification Des Structures PDFSeif MansourPas encore d'évaluation
- Ernst Junger - Traité Du Rebelle (Deuxième Lecture)Document1 pageErnst Junger - Traité Du Rebelle (Deuxième Lecture)MohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Bernanos - La France Contre Les RobotsDocument7 pagesBernanos - La France Contre Les RobotsMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Philippe Muray - Après L'histoire IIDocument3 pagesPhilippe Muray - Après L'histoire IIMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Philippe Muray - L'Empire Du BienDocument5 pagesPhilippe Muray - L'Empire Du BienMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Bloy - Mon JournalDocument1 pageBloy - Mon JournalMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Kierkegaard - Journal Du SéducteurDocument1 pageKierkegaard - Journal Du SéducteurMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Danilo Kis - Un Tombeau Pour Boris DavidovitchDocument2 pagesDanilo Kis - Un Tombeau Pour Boris DavidovitchMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Dieu Et Le MalDocument7 pagesDieu Et Le MalMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Huysmans - Là-BasDocument1 pageHuysmans - Là-BasMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Bernanos - La JoieDocument1 pageBernanos - La JoieMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Bernanos - L'ImpostureDocument5 pagesBernanos - L'ImpostureMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Pessoa - L'Education Du StoïcienDocument2 pagesPessoa - L'Education Du StoïcienMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Cioran - La Chute Dans Le TempsDocument50 pagesCioran - La Chute Dans Le TempsMohamedDjihad100% (2)
- Henri Thomas - La Joie de Cette VieDocument1 pageHenri Thomas - La Joie de Cette VieMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Jean Paul - Un SongeDocument4 pagesJean Paul - Un SongeMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Venus Khoury-Ghata - Le Livre Des SuppliquesDocument148 pagesVenus Khoury-Ghata - Le Livre Des SuppliquesMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Nietzsche - Par Thomas MannDocument19 pagesNietzsche - Par Thomas MannMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Exemples RomansDocument4 pagesExemples RomansMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Thomas Bernhard - Le SouffleDocument3 pagesThomas Bernhard - Le SouffleMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Henri Thomas - La Joie de Cette VieDocument1 pageHenri Thomas - La Joie de Cette VieMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Kafka - Le TerrierDocument4 pagesKafka - Le TerrierMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Léon Bloy - L'InvendableDocument3 pagesLéon Bloy - L'InvendableMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Kafka - Le TerrierDocument4 pagesKafka - Le TerrierMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Jean Paul - Un SongeDocument4 pagesJean Paul - Un SongeMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Monique Wittig (Extrait)Document22 pagesMonique Wittig (Extrait)MohamedDjihad100% (1)
- Narratologie 6572Document15 pagesNarratologie 6572MohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Nietzsche - Par Thomas MannDocument19 pagesNietzsche - Par Thomas MannMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Pauvreté Et CapitalismeDocument4 pagesPauvreté Et CapitalismeMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Entretien Avec JaspersDocument8 pagesEntretien Avec JaspersMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Ebook Regis Debray - Bilan de FailliteDocument75 pagesEbook Regis Debray - Bilan de FailliteMohamedDjihadPas encore d'évaluation
- Divination Et Realité by Vernant, Jean-Pierre Et Al. PDFDocument161 pagesDivination Et Realité by Vernant, Jean-Pierre Et Al. PDFLíviaSilva100% (1)
- Birnbaum Universalisme MulticulturalismeDocument26 pagesBirnbaum Universalisme MulticulturalismeZobel ClemensPas encore d'évaluation
- Zen Et Cerveau de Paul ChauchardDocument5 pagesZen Et Cerveau de Paul Chauchardgabicretan6544Pas encore d'évaluation
- TermS 06 Explication Texte de Bergson Sur L ArtDocument4 pagesTermS 06 Explication Texte de Bergson Sur L ArtmedinaPas encore d'évaluation
- Cours Philosophie Terminale - Le Travail Et La Technique - LArtDocument7 pagesCours Philosophie Terminale - Le Travail Et La Technique - LArtHayet Ben SaidPas encore d'évaluation
- Manuel PhilosophieDocument1 pageManuel Philosophieportal L1ghtPas encore d'évaluation
- La Puissance de La PsychologieDocument147 pagesLa Puissance de La PsychologieOumar doumbia86% (7)
- Michel Vâlsan - Textes Sur La Connaissance Suprême.Document11 pagesMichel Vâlsan - Textes Sur La Connaissance Suprême.pemagesarPas encore d'évaluation
- René Schaerer-Epistēmē Et Technē - Étude Sur Les Notions de D Art (1930)Document119 pagesRené Schaerer-Epistēmē Et Technē - Étude Sur Les Notions de D Art (1930)aedicofidia100% (1)
- François Laure, Janksy Jarocki - Les Mots Pour Réussir Ensemble - Phrases Magiques Et Scripts Gagnants-DunodDocument175 pagesFrançois Laure, Janksy Jarocki - Les Mots Pour Réussir Ensemble - Phrases Magiques Et Scripts Gagnants-DunodNoraMatouPas encore d'évaluation
- La Critique Du Libéralisme (Tome 2)Document580 pagesLa Critique Du Libéralisme (Tome 2)IHS_MAPas encore d'évaluation
- Philosophie de La ReligionDocument81 pagesPhilosophie de La ReligionFadi Abdel NourPas encore d'évaluation
- R.S.K. Kwakye PDFDocument99 pagesR.S.K. Kwakye PDFAboubacar MahamadouPas encore d'évaluation
- Rosanvallon 1Document27 pagesRosanvallon 1Franck DubostPas encore d'évaluation
- Theorie Et Experience La Raison Et Le ReelDocument4 pagesTheorie Et Experience La Raison Et Le ReelAnna MPas encore d'évaluation