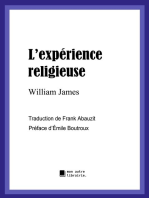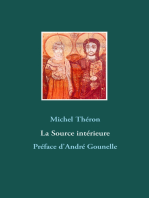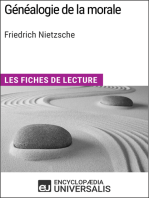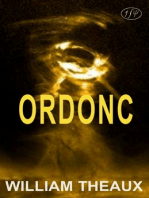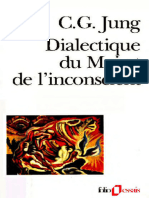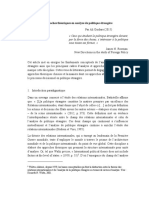Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1965 O "Percurso Interior" Do Pe. André Marc - Uma Introdução A Sua Obra Por Pe. Fontan 25p
Transféré par
Eduardo FigueiredoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
1965 O "Percurso Interior" Do Pe. André Marc - Uma Introdução A Sua Obra Por Pe. Fontan 25p
Transféré par
Eduardo FigueiredoDroits d'auteur :
Formats disponibles
l ' «ITINÉRAIRE INTÉRIEUR»
DU P ERE ANDR É MARC
Introduction à son œuvre
En définissant l'homme « un être debout ,, le P. André
Marc se définissait un peu lui-même. Ceux qui l'ont
connu ont gardé l'impression d'une grande unité, d'une
grande possession de soi. La fermeté du maintien, la
belie simplicité des traits ~t des attitudes, la lumière -èt
l'attention du regard, la cordialité sobre de l'entretien se
retrouvaient dans l'enseignement el dans l'œuvre écrite,
Tout, en lui, était d'un seul tenant : solidemen t articulé
et vivant d'une vie intense qui avançait toujours. Qu'il
éc.r ive ou qu'il parle, les mots retrouvaient, po.r lem· ordre
et par le mouvement, leur sève et leur sens originels. Pou,;
lui appliquer une de ses images, l'expression était « à
fleur d'acte ». Elle était acte elle-même, non ce bavardage
sérieux qui menace le professeur et que Paul Valéry
croyait habituel au prêtre quand il le définissait : « le
préposé aux choses vagues ». Cette invasion du mot eût
condamné, plus qu'un autre, le P. Marc. L'acte du signe,
« l'activité signifiante, « constituait la donnée inépuisa-
ble de sa méditation. C'était pour lui comme un lieu mé-
taphysique où se joignent et se révèlent Ja profondeur
de la personne, l'univers qu'elle assume, et le Verbe qui
les sous-tc.nd.
Il y avait là pour lui, un véritable carrefour des cho-
ses divines et humaines qu'il devait, sur le mode philo-
sophique, développer en trilogie : Psychologie Réflexive;
Dialectique de l'Affirmatio11, Dialectique de /' Agir. D'où,
autom· de ce centre, l'unité du trajet philosophique des-
siné par sa vie, reflété par ses ouvrages.
Ce trajet, le P. Marc, homme sans mystère et qui
s'analysait et se citait Jui-même avec le détachement du
spéculatif et l'étonnante simplicité des enfants de Dieu,
nous en a donné l'essentiel en des notes encore .inédia
18Z P. FONTAN
tea dont vo1c1 quelques extraits ils composent la plus
sfire introduction à son œuvre.
La rédaction de l'itinéraire Intérieur fut commencée
en janvier-février 1947. Le P. Marc avait alors cinquante-
cinq ans et se trouvait - après une typhoïde qui fit plu-
sieurs victimes autour de lui, le P. Descoqs notamment -
en convalescence à Marseille. Le besoin d'écrire. d'une
façon détendue, à l'usage de ses intimes, s'alliait à la
méditation très sereine et comme impersonnelle de son
fond le plus personnel.
Après avoir noté, p. 1 (du manuscrit), ce qui, à nos
ye ux, fut chez lui une vocation effectivement réalisée...
dans le monde des idées construites : c Je rêvais de ma-
chines, au point qu'être ingénieur dans les chemins de fer
me séduisait >, il démonte son propre mécanisme, s'ex-
plique lui-même, p. 2 :
u philosophe est en moi le résultat de mon tempérament et de la
formation intellectuelle et spirituelle donnée par la Compagnie : il ut
la synthè5e de l'homme et du religieux. Ma vocation philosophique
ut un développement de ma vocation religieuse ; et j'entends ces mots
comme exprimant une vérité de fait aussi bien qu'une néce5$ité logi-
que ( ... ) Ma philosophie est la conséquence de ma foi et cem foi est
à son tour justifiée par ma philosophie, sans que ce! deux formes
,•équivalent, puisqu'elles traduisent deux dimonstrations différentts et
complémentaires.
Ce texte est intéressant par ce qu'il dit, mais aussi
par ce qu'il dénote : un besoin extrême d'unir dans la
distinction, et celui h-ès particulièrement de rendre réci-
proques, sans le.s, bloquer, le logique et le r éel. Le te rrain
de cette réciprocité est à ses yeux l'être humain, dont la
contingence, étant celle d'une personne, porle en e.lle-
même, non sa contradictoire, mais sa justification. Cette
personne, Je P. Marc l'atteindra, tout au loug de son
existence, dans le Père Marc, puisque la réflexion dont
il se pr:-évaut a pour objet propre la compénétration du
singulier le plus proche et de l'universel le moins c: sub-
jectif >.
Cette réflexion était la grande affaire. Sa nécessité,
son essence et sa méthode, devaient se faire jour lente-
ment et avec effort. Résultat conditionné par un milieu
auquel le philosophe rend justice :
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC 18J
Si je n'avais pas orienté ma vie nra la Compagnie de Jésus, il ut
aûr que les préoccupations intellectuelles discernées après coup en moi
dans mes études secondaires n'auraient jamais affleuré i ma conscience
(... ) Je serais demeuré tout extérieur à moi. D evenir tant soit peu inté·
rieur à moi serait un assez rude travail (p. 28).
On songe à Hegel transposant Virgile ~ c Tantae rnolis
erat seipsam cognoscere rnentem >.
Mais le milieu ignatien ne nourrissait pas un philoso-
phe d ont le système dévorerait tout. L'homme est d 'abord
vaincu par Dieu, e( il le reste. Sans écrire les confessions
de saint Augustin, notre ami dit ou suggère l'essentiel,
sur son enfance et les années décisives.
Quant au débat avec Dieu, il fut violent et prolongé ; je n'en
veux dire rien de plus (p. 22).
( Le) souci des fins dernières [ qui fut d'un grand poids dans sa
décision d'entrer chez lu Jésuites] devait me rester. Je le retrouverais
exigeant. une fois devenu professeur. Mon systi:me ne bouclerait qu'avec
la morale gén!rale. lorsque j'aurais vu comment toutes les tbiories sur
la connaissance, la liberté, l'hre, y permettent à l'homme de se fixer
dant l'absolu. c'est ..i .. dir,a en D ieu. Cette tendance de mes réfJex_iont
se compléterait par une auue : définir le sens de la portée de la per·
sonne bumano-divine du Cbrin dans notre destinée (p. 27) .
...Mon élection rédigée [à l'issue de sa retra ire de fin d'études] ...
je la fis lire au P. V foal. .. : « C'est un petit cbef-d'œuvre. , J 'avoue
que e<tte remarque me consola en me flattant d'avoir été vaincu par
Dieu à force de logique franche.
Je cédais à un commandement intérieur. devenu irrésistible, et Dieu
me poussait dans la Compagnie de J ésus l'épée dans lu reins. Pourtant,
bien qu'il décerminât ma détermination, je la savais et je me savais
libre, car je comprenais que, malgré mts répugnances. elle répondait à
ma vraie nature, tt que la grâce. en sa puissance. était libératrice de
ma liberté très faible. En accomplissant la volonté de Dieu, j'accom·
plissais la mienne très certainement.
Si plus tard, le P. Marc devait être, en métaphysique,
l'homme des antinomies fortement articulées et définiti-
vement vaincues, c•est à la faveur d'une victoire inté-
rieure, d'ordre spirituel, où notre philosophe a toujours
reconnu la libération de la pensée à l'intérieur de la foi
et par celle-ci.
A l'occasion de ses ,Exercices et de la Méditation du
Règne, il écrit, p. 34 :
184 P. FONTAN
Je m'applique donc ce texte, qui me convient à la lettre : Fidt•
qcuu,ren, intellectum... Je concluerai d'ailleurs, un jour. que la raison
humaine se difinit réciproquement : lntellectu• quaerem fidem.
Notons le terme « définir ». Il exprime sinon une
c essence > (abstraite) du moins ce qui est, pour le P.
Marc, « l'essentiel » de la vie de l'esprit : de la pensée
philosophique, telle que sa conscience l'identüie en un
sujet lui-même animé et comme accompli par la foi.
C'est dans ce contexte spirituel qu'il faut comprendre
les études philosophiques, d'abord infructueuses. de ce-
lui qui n'est d'abord qu'un élève· dans un « scolastica~ , .
J e me disais expressément que toutes ces leçons ne m'apprenaient
guèrt ce qui se passe dans ma tête. lorsque je pense, ni ce que cela vaut,
ni comment ctl2 fonctionne (p. 46),
Exception faite pour le P. Auguste Valeosin (avec
lui « j'étais surpris ... de découvrir quelque chose, que ,je
comprenais >, p. 47), l'impression, en fin d'études, P.st
assez négative :
La philosophie ... me semblait ... une pure acrobatie de concepts, tout
~ucrc chose qu'unt vie ioc(:rjeurt (p. '49) .
Le trait de lumière, après ce purgatoire assez naturel
aux fortes personnalités, vint d'ailleurs. Nommé profes-
seur de 3•, le jeune Père est obligé, pour sa classe, d'af-
fronter, à même les textes et d'une façon concrète, le
problème de la construction et expression de la pensée.
Il découvre l es Exercices illustrés de Crouzet pour le
français et le latin...
Aidés d 'o uvrages sur l'art d'écrire, comme ceux d' Alba lat et Lan-
son, ils furent pour moi le livre providentiel ou le canot de sauve-
tage ... (p. 54).
A ce contact, les textes
devenaient impensables hors de l'activité de l'auteur qui les avaient
élaborés, et au55i bien hors de l'activité do ltcteut, qui à la suite de
l'auteur les reconstituait à son compte et devenait capable d'en produire
d'aulres personnellement (p. 55).
[Cette méthode] fut pour moi le lever do jour parce qu'elle était
pleinemen t réflexive (p. 5 5) .
L'enjeu éuit une prise de conscience de soi par la pensée expéri-
mentée dans son expression même (p. 55) ,
J'avais compris que la connaissance n'était pas inenie mais acti-
vité constructive puisqu'elle était essentiellement composition avant
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC 185
d'ttrt expression ... L'intelligence a beau être passive et recevoir, cela ne
lui suffit pas pour comprendre si die ne se donne actinment cc qu'elle
reçoit (p. 7 9).
Mais bien qu'elle construisit une représentation. la connaissance
était aune chose que cette représentation. Elle était la pensée se mai-
trisant, se possedanc, sr gouvernant au sein dt cette rtpré.sentation cons-
truite. Elle éuit quelque chose de la personne vivante, qui se connaît
elle-même. Plus tard, je nommerai cela : présence et lucidité d'esprit.
L'esprit consuuit sa représent.1tion pour croître en présence d'esprit,
Le P. Marc anticipe délibérément sur ses propres for-
mules, et aussi sur son propre système, don t Ja vue dis-
tincte viendra plus tard.
Je veux le répéter. Les résultats, que je discerne aujourd'hui dans
mes années de régence 1917-1920, ne m'apparaissaient point avec cette
netteté. Je les avais vécus, je les avais reconnus, inventoriés. C'était
mieux ainsi. Puisque la connaissance s'appuie sur l'être, ne faut-il pas
d'abord être en soi avant de se connaître 1 (p. 84).
Ce dernier principe sera mis en œuvre dans la psy-
chologie réflexive. L'être de la connaissance, et la valeur
que cet être emporte, ne seront pas dissociés. Toutefois
le jugement de valeur ne sera donné sous une forme
1>leinement distincte et explicite, qu'après une réflexion
sur la nature de notre activité intellectuelle, réflexion
constituant par elle-même un temps fort de cette activité.
Dans une philosophie fortement centrée sur la per-
sonne et son acte de penser, l'esprit pourrait sembler,
parfois, se satisfaire de lui-même, n'était ce poids du
réel qui vient la lester, de l'extérieur et de l'intérieur tout
e nsemble puisque la construction, loin d'être gratuite, est
fonction d'un donné effectivement reçu, et que son mode
mental est fonction du sujet en tant qu'être. Le principe
« agere sequitur esse » sera pris dans toute sa force, dans
toute sa profondeur.
- Le P . .Marc quitte la régence. La révélation philoso-
phique que furent pour lui ces classes d'humanités, va
trouv er son développement et son application dans les
années qui suivent, consacrées à la tlléologie et à la pré-
paration au sacerdoce.
Le guide, ou plutôt l'inspirateur, fut le P. Rousselot -
l'œuvre écrite du P. Rousselot.
J'allais vine et je vis encore par lui. De sa thèse, j, retenais sur-
tout le début, où il exposait que le véritable iuttlligible. le vrai con-
186 P. FONTAN
naissable, et n'ôtait point l'iliment conceptuel, abstrait, lts formuln
de la connaissance, mais l'tsprit subsistant. donc la persoaoe... (p. 83).
Plus que l'objet connu l'important itait donc l'activité du connais-
sant qui se découvre et se possède dans la maitrise et la possession des
expressions, par et dans lesquelles il St donne sa représentation. Ceue
remarque était capitale pour moi, car
1• je ne m'en étais guère douté dorant ma philosophie ;
2' elle mmair en lumière le fait de mon expérience de professeut
et les tendances cachies de toute ma vie ;
3' enfin tilt me révélait que le sujei connaissant ne se saisit que
dans la saisie d'un objei. Au lieu d'être un simple cogito cartésien tout
occupé de soi, la conscience tst relation. opposition sujet-objet.
Descartes, ou plutôt le schéma cartésien, paraît évité.
Kant le sera-t-il ? On sait comme il évite de clore le sujet
sur lui-même. Il le produit seulement dans sa relatiou
aux contenus d'ex périence. La conscience ne connaît
d'elle que ce rapport, compris comme information,
structuration, des phénomènes par un réseau, transcen-
dental, de lois. Elle aura pour le P. Marc, une autre di-
mension : une intériorité qui la met en quelque sorte à
dis tance de cette tâche. La conscience, à ses yeux, se con-
nait, non comme pur principe formel d'unité, mais comme
existence autonome, ouverte, par cette possession de soi,
à la profondeur métaphysique de ses objets, atteignant
ceux-ci en leur existence propre. A l'appui de cette thèse,
le P. Marc ne craindra pas de citer telle formule, telle
intuition métaphysique de Kant, peu accordée au criti-
cisme. Ce dernier système, considéré dans ses exclusives,
représentait alors pour la pensée chrétienne la difficulté
typique, celle qu'il fallait affronter à tout prix non seule-
ment pour une apologétique de circonstance, mais parce
qu'elle paraissait naître - indépendamment des contin-
gences historiques - de la critique naturelle el de l'iné-
vitable analyse du savoir humain. Nous verrons le P.
Marc reprendre à son compte et sur des bases très per-
sonnelles ce qu'il estimait être l'effort de Kant. pour
aboutir à des conclusions opposées.
L'opposition était inévitable dans la mesure où le
kantisme justifie cette conclusion de V. Delbos : < Kant
n'envisage le < moi > que comme principe des < for-
mes>, des < concepts >, des c idées > ... Ainsi il pose abs-
traitement un moi qui n'est d'une certaine façon à per-
sonne... > (Figures et Doctrines de Philosophes, p. 257-258).
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC 187
Le P. Marc avait trop conscience d'une vie intérieure
profondément sienne pour se laisser prendre, un jour, aux
pièges de l'analytique. E t ceci d'autant plus qu'à cette
époque, et définitivement, il prenait - au témoignage du
manuscrit - un sentiment très ferme et très vif de « son
rapport personnel à Dieu >.
C,tt, absmce d, soi hors de soi qoi caractéris, notre conscience à
l'état de voie. cette essentielle inadéquation de ce que nous sommes tt
de ce que nous connaissons de nous, le rôle du monde extérieur dans
le processus d'intériorisation de la connaissance. tout nia me formu-
lait ce que j'avais jusque-là vécu ... Avec la connaissance. l'amour et le
disir devenaient matière à réflexion. parce qu'ils étaient un des élé-
ments de la conna issance ec que je ne pouvais plus réfléchir sur elle,
sans rlflichir sur eux (p. 91) .
Ma is par-dessus tout, Dieu jaillissait du cœur de la conscience et de
l'êu, . non plus extérieur mais intérieur à eux. Il apparaissait présent à
moi, en moi. comme je ne l'avais encore jamais v u. Ce point était
bien plus important. puisqu'il justifiait. comme vie pleinement hu-
maine. la vie chrétienne et b vie religieuse, en rant que présence d•
Dieu et présence à D ieu. Pour moi ce fut une révolutioo, un véritable
émoi .
... Ce travail s'est échelonné sur plusieurs semaines et sur plusieurs
mois de l'année 1921. Mais il eut sa conclusion soudaine duranr le tri-
duum de rénovation à !'Epiphanie 1922....Dans un instant. je tins en
mon esprit le nœud de route ma vie. J'en fus remué pour plusieurs
jours au point d'avoir un peu de fièvre (p. 92).
Quelque fièvre a-t-elle précédé cette révélation ?
Quels furent, dans l'organisme et l'affectivité, les res-
sorts de ce « moment > qu'il n'est pas nécessaire de
rapprocher de Descartes et de Pascal puisque l'un et
l'autre, quel que soit leur génie, s'apparentent, en leur
c nuit :, lumineuse, à ces états de ferveur bien connus
dans les séminaires et les noviciats ?
Toujours est-il que, très maitre de soi, le jeune P. Mare
rédige alors un texte dont la p. 6 (citée, p. 93 du Mémoire)
a beaucoup d'élan.
L' aurore pointair aprh la nuit. Lu personnes er les choses bai·
gnaient dans une clarté matinale et chaleureuse. Jadis le P. Maîlte
m'avait dit qu'il me fallait quelque chose qui m'enthou1iasmâc l'âme :
j'avais découvert une pensée et un amour. Dieu, dont l'impérissable
jeuneSSt me ranimait.
Ces lignes, et d'autres semblables, montrent assez. que
le P. Marc n'est un cérébral qu'en un certain sens seule-
188 P. FONTAN
ment. Sa P sychologie réflexive et sa Dialectique de l'Agir
rattacheront sans doute le dynamisme spirituel à la con-
naissa nce comme suite naturelle et complément néces-
saire d'un réalisme intellectuel encore bien imparfait.
Mais ce moment d'intelligence, qui constitue la pre-
mière expression de l'esprit dans l'ordre analytique du
P. Marc, ouvr e sur une ~ présen ce d'esprit » que le con-
cept d'intelligence n'épuisera pas. N ous sommes en pré-
sence d'une intériorité si riche et si profonde qu'elle doit
être visée à travers des activités distinctes dont ch acune
exige l'a utre et reçoit de l'autre une nuance nécessaire
à son exacte dé.finition. L'expérience spirituelle dessinée
dans l'itinéraire, très particulièrement celle de ces années
1920-1923 (le P. Marc a trente ans), ne s'accommode pas
d'une version appauvrie ...
Nous percevons assez bien, dès maintenant, les sources
vivantes de l'œuvre. Il serait un peu simple de l' expliquer
p ar une conjonction providentielle des exercices de
Crouzet et des Exercices de saint Igna ce, les premiers
représentant la méthode, et les seconds l'âme profonde.
La « m éthode » se confond trop bien avec I' « esprit »
puisqu'elle est attention du sujet à lui-même à travers
l'acte et le mouvement. Elle-même est un retour à l'inspi-
ration profonde de la pensée, de la communication, de
l'action.
Et ce retour et cette inspiration ne sont p as, par défi-
nition, chose impersonnelle. Ils engagent la personnalité
du P. Marc, telle que la vie et la méditation religieuses
l'offr ent à sa méditation philosophique : à la fois comme
objet et comme foyer actif de cette méditation. 4: Dans la
mesure où le philosophe s'est attaché à la possession et
description du réel, écrit· H. Gouhier, l'ombre de l'homme
chrétien se profile sur le monde qu'i l voudrait offrir
à toutes les créatu res douées de raison. Si M. Gil-
son et M. Maritain tiennent si vivement à appeler chré-
tienne la philosophie de saint Thomas, c'est qu'ils la con-
naissent trop bien par l'intérieur et, an moment où l'uni-
vers des Sommes se met à tourner pour la joie intellec-
tuelle de tous les hommes, ils le sentent mû par la main
d'un sage chrétien. » (La Philosophie et son Histoire,
p. 44.).
Aux ap1>roches de son ordination sacerdotale, la
sagesse chrétienne du religieux est arrivée à ce point de
maturation et de ferveur qui exige désormais, sur Je mode
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC 189
philosophique très particulier à son tempérament, une
expression systématique, si l'on entend par système,
moins l'ordre formel des concepts que l'ordre naturel du
vivant.
Il était notoire qut cette prtmifre prise synthétique de conscien,~
dt moi était on tableau de ma vie et n on pas une doctrine théorique
intellectuelle. Cttte intellectualisation serait le travail. .. du reste de ma
vie : elle sera à la fois une mise en théorit tt une compréhension pins
grande de ma vie intérieure.. . Je fus particuliètement aidé dans cem
tâche par les P.P. Costa de Beauregard. Delaye et Monier-Vinard. L'ap-
profondissement de notre être et de notre connaissance serait un ap-
profondissement dt notre vie surnaturelle, une intelligence plus grande
du Christ.
J'avais un véritable besoin de < développtment > ; je stntais que
.développer ma pensée serait me développer tout entier. que l'exprimer
serait me posséder mieux (p. 94).
Pour l'instant, et par la force des choses en ce climat
de retraite, le « développement > appartient surtout au
genre « écrits spirituels •· L'émotion, qui vient de la
pensée animée par la foi, et qui nourrit cette même
pensée, soulève la phrase et accueille l'image :
Je lisais de Psichari Le voyage du Centurien et dan, ses voies
différentes des mitnnes, je discernais des resstmblances avec moi. Je
connaissais c la royale ivrtsse de l'intelligtnce qui a secoué ses chaî-
nes et qui se connaît •· Je me reconnais dans Maxence, à qui il fal-
lait c le pain de la substantielle vérité, non pas dans les douces rêve-
ries du cœur. mais le vol sévère de l'esprit tendu vesrs la possession
iternelle •· Comme lui, je • ne cherchais plus la griserie du voyagt,
car elle est trop parfumée, la terre où l'on s'est arcité ; l'on ne navi-
gue plus sur les mers mauvaises parce qut l'on a touvi le port et que
l'ancre a éti jttée dans l'incomparable béatitud·, {p. 95).
Cette vibration du centurion jésuite va persévérer. A
bien regarder, elle transparait dans les longs débats de
l'analyse réflexive ... Nul divorce, chez le P. Marc, entre
les effusions du cœur et l'algèbre de l'esprit.
Il écrit à cette époque, à titre d'exercice, un c sermon-
programme > qui fut c donné > devant ses maitres et
-condisciples. Il y fait part de sa découverte et de son
orientation. Ce texte fut remarqué et fit impression.
c Décidément, mon vieux Marc, vous êtes un esprit... >
Un professeur y discerne des traces de doctrines d'imma-
.nence. Fait assez curieux et qui mérite d'être souligné :
/90 P. FONTAN
il n'est pas sans explication, si l'on songe à certaines
phrases de l'itinéraire. Ainsi, à l'occasion du P. Rous-
selot,
Je réalisai, que c'éuit la présence de Dieu en moi : rien d'autr<
qae ma pré~enc:e i moi hitn entendue. non pa~ forré:ment formu1é-t.
mais authentiquement vécue ; conséquemment une affairt d e tous lu
instants comme les battements do cœur oa la respiration (p. 9 2).
Tout est, évidemment, de « bien entendre > la pré-
sence à soi-même, pour y trouver : « quelqu'un qui soit
en moi plus m oi-même que moi >, ce « plus > désignant
la transcendance divine et consacrant, sans équivoque,
la distinction. Cette explication q ui refuse de confondre
au moment où l'intimité la plus r a dicale se fait jour,
s era la tâchei très importante du P. Marc en face du dan-
ger inhérent à la méthode réflexive, de clore sur elle-
même la conscience, de la ramener, comme dit G. Marcel,
à cette chose « qui se réfléchit au lieu de s'accomplir >.
Quelle que soit la valeur technique de sa dialectique
future, le P. Marc était, dès cette époque, trop réfrac-
taire à pareil glissement pour imaginer qu'un lecteur
le soupçonnât d'équivoque. Tout, en lui, s'opposait à la·
« courbure réflexive » : son tempérament ouvert au monde
et très particulièrement aux personnes ; son sens méta-
physique d u rapport sujet-objet, fini-infini ; son sens
religieux s urtout, d'où nait, dans une vie exemplaire de
11rêtre, une conscience philosophique plus claire. Con-
science non pas de Dieu (Dieu n'est p as dans sa doctrine
objet présent d'intuition) m ais de la situation concrète
qui nous réfère à lui comme au principe de l'être, objet
ultime de l'affirmation et du désir. L'unité ainsi reconnue,
parce qu'elle n'est pas identité pure ni davantage confusion,
s'exprimera dans un dialogue - la prière - où con-
vergent vers Dieu toutes les affections d'un homme. Un
mot sur ces dernières dans le cas du P. Marc : elles expli-
quent, en bonne part du moins, les développements que
son œuvre va consacrer à l'amour, et plus profondément
l'orientation et la structure dynamique de sa philosophie.
La vocation du P. André Marc n'est pas celle d'une
nature indigente que la vie religieuse « compléterait >.
Elle est l'offrande et l'épanouissement d'une richesse
reconnue, consentie et maîtrisée. S'il devait écrire, plus
tard, sur la spiritualité conjugale et sur la vie consacrée.
des pages dont l'élévation est faite de réalisme, c'est par
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC 191
la force et l'équilibre d'un tempérament qui se retrouve
lui-même à l'intérieur de la foi, témoins ces extraits, cités
par l'itinéraire intérieur, qui datent de son ordination
sacerdotale et de sa première m esse.
[ Lettre à sa sœur religieuse) : Lt Christ esr une atmMph.re oil
nous nous mouvons. L'oiseau esc daus l'air qu'il rtspire ec qui le
porte, le pénètre, où s'2ppuient ses ailes ; ainsi je suis dans le Christ ...
L'homme ne peut vivre seul... Il lui faut s'uuir et se donner à un
autre... La fécondité des âmes n'a pas d'autre loi. Seul. l'homme est
stérile ; il lui faut le Christ tt son pouvoir de vie (p. 102).
(D'un sermon, Je jour de sa première messe en son pays normand] :
... Puis l'heure des séparations (familiales) sonna... L'union des
cœurs n'a pas cessi... Sur les sentiers de la vie intérieure, où, par le
détachement de toutes choses, Dieu les entraîne à grandes journées vers
Lui. ils se sont nncontrés, reconnus et stimulés joyeux... Ils marchent
la main dans la main, par la foi obscure, vers les surprises et le plein
midi de la gloire. Dieu ne les a séparés localement que pour les unir
ici-bas plus mystérieusement et dans les cieux éternellement (p. 103) .
[Ecrie à sa mère, le 20 novembre 1922 ] : Je fais de plus en plus
connajss.ance avec ceux qui m'entoucent, et connaissance intime, ptO·
fonde. Le contact s'établit à ce point de l'âme et de la conscience où
l'on est en rapport avu D ieu : c'est délicieux ... Autrefois je l'ignorais ... ,
extérieur aux autres, extérieur à moi-même et toujours un peu soli-
ta ire. Maintenant... j'ai trouvé mon équilibre et je n'ai plus de diffi·
colté à m'ouvrir, à p arler en toute simplicité ... Je sais ce qu'est la
société des âmes : il n'y a que Dieu et la vie religieuse pour la faire
aussi douce. aussi confiante, aussi fraternelle. Au ciel ce sera mieax
encore, mais ce ne sera pas aotrement... (p. 103 bis).
Laissons la « vie spirituelle > pour la philosophie
sans oublier ce que chacune doit à l'autre. La 2< (et der-
nière) partie de l'itinéraire intérieur nous fait assister à
l'élaboration du système jusqu'au moment où tout est en
place pour la composition de la somme que devait laisser
le P. Marc.
Pendant les deux années qui suivent l'ordination, le
P. Marc est élève de philosophie à l'Université Grégo-
rienne. Sa pensée prend déjà la forme technique qu'elle
ne dépouillera plus. Elle découvre et met en œuvre les
sources prochaines de sa synthèse.
Le P. Valensin montrait la fermeté, la tenue de l'acte de la connais-
aance attentive, qui se campe devant l'objet, tout en le campant en
elle et d evant elle ; il en analysait le caractère spiritoel. inétendu ; le
P. Joosse montrait Je rôle do corps et dt ses gestes ; Delacroix décoo-
192 P. FONTAN
vrait dans l'acte du signe tt du langage un travail d'analyse et de syn-
thèse : il établissait que cet acte, en tant qu'acte d'intelligence et dt
compréhension, était mémoire et prévision, c'est-à-dire simultané à soi
dans son entier ... (p. 123).
Rirn de rour cela ne s'opposait à ce que le P . Maréchal disait du
jugement, mais y ajoutait et l'illustrait avec une cohérence si parfaite,
que je discernais de mieux en mieux, dans son intégrité, l'acte de con-
naissance objective, dont il fallait entreprendre l'étude, si je voulais
pénétrer les conditions de notre connaissance ou celles d< l'objet, c'est-
à-dire aussi bien celles de l'être que dt l'esprit. L'approfondissement de
la connaissanc, devenait de plus en plus manifestement l'accès à la phi-
losophie tout entière et le moyen de la reconstruire en système (p. 124).
Au fond et problème étair le même que celui de la régence à propos
de l'analyse ou de la composition d'un texte, narration ou d·escription.
Seulement, au lieu de se borner à l'activité littéraire, mon attention
se portait sur l'acte de connaissance, en cour ce qu'il a de plus géné-
ral. selon qu'il charge un geste, un mouvement du corps, d'une signi-
fication intérieure, d' une intention spirituelle, pour le constituer signe.
Je me croyais là si bien au centre de tout, qu'une fois ce point élucidé.
je serais en mesure d'aborder tout et n'importe quel traité.
Ce travail de p récision aboutit à la thèse soutenue à
Rome, à Pâques 1928. Elle portait sur le jugement et con-
tenait, dit sou auteur, les lignes maîtresses de la psycho-
logie réflexive. Quant à la méthode, ce sera celle du
P. Marc :
Chaque chapitre débutait avec une question. qui constituait une
antinomie : il l'analysait er la résolvait, puis en terminant ouvrait sur
le suivant par une nouvelle antinom ie, la solution apportée n'étant que
partielle jusqu'à ce qu'elle fût exhaustive et totale ... J'ai donc vécu
cme méthode avant d'en avoir la théorie (p. 125).
Cette dernière phrase nous invite à voir dans ces
oppositions systématiquement déduites jusqu'à synthèse
finale, bien mieux qu'un procédé d'école obstinément et
heureusement exploité. C'est la pensée même de l'auteur
qui progressait de la sorte par un sentiment très vif des
contrastes. une conscience profonde et claire de leur
secrète unité, et aussi. ne l'oublions pas, un goût de la
dissertation et du développement intensifiés avec l'art et
la nécessité, pour Je P . Marc, de se « développer lui-
même >. Si nous avons de lui une métaphysique centrée
sur l'acte du signe, c'est qu'il n'avait rien d'un misologue
et que le discours chargé de sens et nourri de silence
était pour lui un grand besoin d'âme et de corps. D'où
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC 19J
sa vocation de professeur. D'où le fait, peut-être, que sa
mort suivra de près son impuissance dernière à donner,
de sa pensée, l'expression discursive caractéristique de
ses classes et de ses écrits,... ces derniers logiquement
parvenus à terme. Ce qui n'était pas, dans son optique,
une défaite, mais le prélude à l'intuition définitive réca-
pitulant le logos...
En 1926-1927, le P. Marc fait sa troisième année de
noviciat à Paray-le-Monial :
Je devais donc laisser à Dieu la libre disposition d, ma vie tan-
dis qut je m'étais jusqu'ici trop mêlé de le faire à mon gré ... J'en-
trais dans l'obéissaoct tant par l'intelligence que par la volonté puis-
que j'y disctrnais on effet de la vertu de foi. Il me fut tn conséquence
plus aisé à l'été 27 d'accepter la décision humainement déroutante, qui
me chargea dt la classe de seconde à Poitiers ; en vertu de tt ls prin-
cipes. cette surprise pour ma raison humaine me fit croire à une dis-
position providentielle et la suite a montré que je ne m'étais pas
trompé (p. 131).
Cet acquiescement de foi à quelque sagesse plus
haute est sous-jacent à la patience sans drame du philo-
sophe chrétien qui p r essent, par delà It!s autiuouùes,
l'unité conciliatrice.
C'est d'ailleurs la méthode d'opposition qui constitue
à cette époque - 1927-1928 - le centre d'intérêt du pro-
fesseur de seconde. Il parle même de c découverte >, pour
signifier sans doute qu'il identifie, à travers les textes,
comme procédé logique (et non simplement verbal), ce
qu'il avait déjà spontanément « vécu > dans l'élabora-
tion de sa thèse.
Je veux parler de la méthode d'opposition ou de création du idées
pu les contraires telle que je l'ai dépistée [à cem époque ) indépen·
damment de toutt métaphysique préconçue, simplement dans lt jeu
spontané dt l'intelligtnce chez les auteur& lu plus variés... J'ai appris
U à confronter ln idées opposées. qui stmblenr se détruire, pour tirt t
de ce face-à-face ltur hatmonie ~crète. montrtr comment elles s'appel-
ltnt et se confirment. De la sorte, une idée, au lieu de rencontrer dans
son contraire une objtction, qui la ruine, s'en sert comme d'un appui.
qui la consolide (p. 127).
En 1928 le P. Marc est nommé professeur de philo-
sophie au scolasticat de Jersey. Il ne quittera cet ensei-
gnement qu'en 1950, date de sa nomination à Paris. Dans
l'intervalle 1941-1946, auront été composés ses trois grands
ouvrages : Psychologie Réflexive, Dialectique de l'Affir-
194 P. FONTAN
mation, Dialectique de /'Agir, précédés, dès 1933, de
L'idée de l'Etre chez saint Thomas et la Scolastique pos-
térieure, et suivis, synthèse et conclusion qui devait parai-
tre en 1958, de L'Etre et /'Esprit.
La succession de ces ouvrages correspond à la logique
intérieure de l'auteur plus encore qu'aux circonstances.
Ces dernières allaient dans le sens d'une vocation philo-
sophique, puisqu'après avoir enseigné un moment l'on-
tologie, il devait être bientôt chargé de la psychologie
rationnelle, puis de la morale générale et de l'ontologie.
Il écrit p. 197 de !'Itinéraire :
De même que la métaphysique m'avait renvoyé à la psychologie
rationnelle, de même l'une et l'autre me renvoyèrent à la Morale comme
à leur couronnement.
Dès le début de sa tâche apparaît sa résolution et
sa netteté de vues.
Après une très belle présentation du cadre - Jersey,
le scolasticat - en un style plein de couleur, de mouve-
ment, de relief, le P. J',farc écrit :
. .. J•a1tais vivre d~ longues :année$ de réflexion 2cduc. s0Jit2ire, tt·
nace, obstinée, mais sans agitation ni fièvre. Tranquille et tenace, je
mettrais le siège devant les difficultés, sans jamais le lever. jusqu'à ce que
je force leur entrée ; je restais devant les obscurités jusqu'à ce qu'elles
s'éclairent...
J'avais deux principes fermes :
tout dégager de l'acte humain de connaissance par une analyse
réflexive ;
puis enchainer lu diverses affirmations les unes à partir des autres
par une méthode dialectique d'opposition (p. 155).
De ce forage personnel saint Thomas n'était pas
absent. Le P. Marc l'avait « renco ntré » à Rome et s'était
d'autant mieux reconnu son disciple que ses premières
études de philosophie avaient marqué l'échec, en lui, du
P. Decoqs et de Suarez - sans nommer Duns Scot.
La réinvemion des thèses thomistes. appuyée par la l«rure d• ••int
Thomas, s'accompagnait tn moi d'une expérience personnelle de mon
esprit qui se pensait et se découvrait dans l'être. Qu21orzt ou quinze
ans plus tard, le vocable d'existentialisme ferait son appatition pour
étiqueter des tendances philosophiques fort différentes bien qu'associées
dans un mêm, souci de l'individuel existant. Les tendances qui per-
çaient dans mon onrologie ainsi que dans mes réflexions de Rome. se
préoccupa ient de l'existant. de l'esse, de l'acte, de l'individu, de la per-
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC 195
sonne. Tournant le dos au,c philosophies de l'abstrait, dies optaient
sans rémission pour une philosophie du concret (p. 161).
Mais il ne s'agissait pas d'une simple a ttention à l'ex-
périence intérieure ou aux thèses thomistes qui lui font
droit. L e besoin d'articulation logique est égal chez le ·
P. Marc à son besoin de revenir, par contact, aux sources
mêmes du langage et a u surgissement de la personne :
Je rencontrais le système thomiste avec ses diversts thèses bien
déterminées mais plutôt juxtaposées qu'enchaînées les unes aux autres
de manière à s'engendrer les unes les autres. Je rêvais donc de la genèse
logique de cette doctrine avec toutes ses thèses à partir d'un principe
unique, qui contraignît :. entreprendre sa déduction en même temps
qu'il la dirigeât.
De même que j'avais cherché comment éraient construits !'Horace
de Corneille, le Britannicus de Racine, le Sermon sur le Christ-Roi de
Bossuet, de mime j'étais curieux d'examiner comment se bâtirait la phi·
losophie thomiste comme s'édifiait le système d'Hamelin. Je restais
bien toujours le même (p. 172).
D'où le premier ouvrage : L'idée de l'Etre chez saint
'J'hnma.< P:f rlnns la scola.<liq11P. poslérieurP..
Cette scolastique postérieure était celle qui fut d'abord
inculquée à l'auteur. Il l'analyse comme un souvenir bien
présent et lui oppose, quant au problème-clef de la méta-
physique, la souplesse qui évite de penser l'être comme
un invariant et qui en dit l'unité relative par l'affirmation
d'un rapport (essence-exister).
Le véritable titre ... tût dû être : L'idée de l'Em et le point de
dtpart de la déduction métaphysique ... Il m'est ainsi parfois arrivé de
ne bien comprendre ce que j'avais fait qu'après l'avoir hic (p. 174-
17 5).
L'auteur souligne, p. 176, les raisons et le caractère-
personnel de son thomisme :
Avec mon besoin de pensée construite pac la vertu d'une logiqut
intérieure. qui soit une ~coissance et une évolution en cout pareilles à
celles d'un organisme vivant. où toutes les parties se conditionnent réci-
proquement, j'étais intellectuellement plus satisfait chez saint Thomas
que chez Scoc. Suarez cc leocs partisans. Mon goût pour une pensée
qui respecte le réel, où elle s'alimente parce qu'il correspond à ses exi-
gt nces. déterminait encore mon choix de saint Thomas ec mon rejet de
l'idéalisme, tout en apaisant le sentiment qu'a celui-ci de notre esprit
comme acte et sujet. Je nt nie point cependant qu'en l'occurence j'ex-
plicitais le thomisme, et d'ailleurs comment faire autrement lorsque j~
196 P. FONTAN
le rappr0<bai, des modernes ? La conséquence eta1t que je penetrais
d'autant mieux les scolastiques et les modernes que je lts entendais par
contraste les uns avec les autrH, et que je me servais d' eux, expressions
particulières de l'esprit humain, pour découvrir une exprtssion plus
pleine encore de ce dernier.
Nous trouvons amorcée, dans cet ouvrage - où la
référence à Hamelin paraît capitale - le dialogue qui
servira de trame à tous les ouvrages du P. Marc, anciens
et modernes désignant par leurs oppositions mêmes, la
vérité intérieure : cette vie de l'esprit dont le P. Marc
fait son thème obstiné.
De l'accueil excellent qui fut fait à son œuvre, rele-
vons ici, comme indiquant l'orientation décisive de notre
philosophe, ces lignes du P. Simonin dans le Bulletin
thomiste 1934 (p. 9-13). Elles sont consignées dans l'iti-
néraire, p. 177 :
On ne peut évidemment repr0<her au P. Marc de n'avoir pas écrit
toute une métaphysique, on doit au contrait• le féliciter d'avoir écrie
une manière de prolégomènes à une métaphysique fucure.
,C'est tres exactement ce que le P. Marc avait voulu
faire, comme il le dira souvent depuis. ll s'agissait pour
lui, suivant ses propres expressions, d'écrire à la façon
de Kant et en un sens opposé, de nouveaux (et sans doute
définitifs) Prolégomènes.
Premier pas dans la réalisation de ce qui devait être
le programme de toute sa vie, en accord aYec le souci
constant des maitres qui l'avaient formé ou influencé -
le P. Maréchal notamment - : recommencer Kant contre
Kant lui-même, utiliser contre lui certaines fissures de
sa pensée, très particulièrement certain fond intuitif
avoué parfois de l'homme mais bien étranger au système.
Ce programme prend corps aussitôt après la publica-
tion, et le succès, de L'Idée de l'Etre.
Je sentais la nécessité d'explorer à fond lt domaine de la connais-
sance et dt la liberté, si je voulais bien dominer celui dt l'être. Puis-
qu• je dégageais dt l'acte de connaissance objective cette idée de l'être,
principe premier de toute idée comme de toute réalité, et que j'établis-
sais sa teneur par une description de cet acte, je croyais ne pas I• com·
pr•ndre pl•inement, si je ne pénétrais pas jusqu'aux assises d• cet acte,
dont •lit rst lt ressort. En face de Kant, pour lequel la métaphysique
est un• disp05ition naturtllt en même temps qu'une illusion de notrr
esprit. jr concluais que cHtt Métaphysique devait être otablit comme
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC 197
une inclination nécessaire et légitime de notre tsprit tn vertu d'une
autte critique de la raison. 11 devenait impossible de bâtir une ootolo-
gie en toute connaissanc~ de cause, sans reprendre tout le travail de
Kant. Mais c'était une tâche de géant, que ma paresse me retenait d'en -
treprendre pour le seul plaisir. Un événement se produisit alors qui m' y
décida d'emblée et me relança dans de oouvelles recherches pour de
nombreuses années (p. 183).
Cet événement : un enseignement nouveau, confié au
P. Marc. La Psychologie Rationnelle, et non plus )'Onto-
logie. Cette tâche nouvelle revenait, dans la pensée du
professeur, à reprendre sm· de nouveaux frais et dans
un sens opposé, l'entreprise kantienne:
Pour moi ... la Critique kantienne de la Raison Pure était une psy-
chologie ratio1nelle dans les perspectives de Kant (p. 188) .
Les p. 186-187 de l'llinéraire nous font assister aux
progrès du P. l\farc dans sa réflexion et nous donnent
un résumé de la doctrine ainsi élaborée.
L. Lavelle [ dont il venait de lire La P,é,ence totale et La Cons-
cience de soi] • parlait de cette conscience comme d'une présence d'es-
prit. Voilà les expressions que je déclare heureuses et dont je fais en-
core un des centres de mes réflexions. Jusque-là j'avais bien découvert
l'être au sein de notre jugement en tant qu' il est force d'affirmation dl
soi, de position de soi. Mais mon vocabulaire s'arrêtait là. Je savai.s
encore que nom jugement étaie un signe, mais je n'allais pas au delà.
Vus 1933, je saisis que l'être, td qu'il se révélait dans notre connais-
sance, était plus profondi:nent un acte de présence et de présence d'es-
prit ... Grâce au langage, le jugement, l'affirmatioo m'apparut comm,
un signe de connaissance, de conscience ou de présence d'esprit ...
L 'homme s'y trahissait toue entier dans la dualité comme dans l'unité
de la chair et de l'âme et aussi dans ses rapports avec son entourage...
(p. 186).
Par l'orchestration des termes (prenait naissance) one dialectique non
seulement de l'intelligence mais de la volonté, donc de notre activité
intégrale en face de son destin, dans l'hisctoire > (p. I 87).
Le dualisme kantien est donc évité : il n'y a pas deux
< critiques > chez le P. Marc, pas plus qu'il n'y a oppo-
sition et coupure entre le sujet et les choses, l'esprit étant
pour lui - il le note en ce point de !'Itinéraire -
c passivité active », dans l'acte commun du connaissant
et du connu. Cet acte commun nous reporte au schéma-
tisme, mais compris comme règle imposée par l'esprit à
198 P. FONTAN
l'image en fonction du réel et conformément à sa struc-
ture.
Par des voits parallèles à celles de Kant mais avec. d'autres princi-
pes. j'aboutissais à l'opposk. Je n'avais pas le sentiment de faire mauvaise
contenance devant lui (p. 191).
Le mouvement naturel du système, sinon la logique
abstraite, entraînent, par le réalisme revendiqué, une
philosophie de la volonté, ou plus exactement de l'amour,
à l'intérieur et non à côté de cette philosophie de la con-
naissance. C'est ainsi que le deuxième tome de la Psycho-
logie réflexive naitra spontanément du premier. I~ le fera
d'autant mieux au moment de la rédaction définitive qu'à
cette époque le ministère du P. Marc portera le philo-
sophe avec plus d'intensité et de mouvement vers ces
füèmes où le cœur et l'esprit composent une même vibra-
tion :
... Pour être aussi exact que possible, selon que les souvenirs me le
permettent, le second moment de cette dialectique fut moins développt
en cette rédaction dt 1933. li ne prit, du point de vue théorique. une
importance ,gale à l'autre qu'à l'occasion d'une retraite prêchée en sep-
tembre 1935 aux prêuts professeurs du diocèse de Poitim. li me sem-
ble qu'il en fut ainsi (p. 18 7).
Ce qui est certain, quel que fut l'appoint des circons-
tances, c'est le changement de ton, et presque de respi-
ration et de rythme, que manifeste le deuxième tome de
la Psychologie. L'auteur se libère des sécheresses de l'ana-
lyse appliquée au discours et parait déployer des ailes
trop longtemps repliées.
Mais nous sommes encore à la période de maturation.
Le projet d'écrire pour le public n'apparaît pas. Le
P. Marc médite et enseigne. Il approfondit l'unité de la
connaissance et de l'amour. Elle se manifeste en ceci que
leur terme commun (p. 191) consiste en des personnes. Il
écrit, p. 192 :
... Je sauni bien qu'à l'inverse peut-ôtre de ce qui se fait nop cou-
rammrnt, il faudrait en philosophie donner à l'amour un• pt.« au.si
importante qu'à la connaissance, car l'amour ut le subterfuge inventé
par l'esprit, pour surmonter les imperfections de la connaissance et con·
duire celle-ci à sa perfection.
Serait-ce un pléonasme et une infidélité au texte de
reconnaître cette imperfection de la connaissance dans
le fait précis que son réalisme n'est pas encore celui de
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC 199
l'amour ? Dans ce cas l'analyse de la connaissance est
comme aspirée par une dialectique complémentaire, et
définitive, porte ouverte à l'expérience religieuse parce
que commandée secrètement par celle-ci.
Mai1. le P. Marc est un psychologue métaphysicien et
c'est en termes métaphysiques, non dans les limites d'une
phénoménologie au sens étroit du mot, qu'il exprime le
lien de la spéculation et de la vie.
Il aboutit à cette conclusion, p. 194 :
Dans l'élaboration de cette Psychologie je constate deux tendances
le sens de l'incarnation et le sens de la transcendance de l'e,prit humain ...
u contraste du fini et de l'infini, source du tragique et du dramatique
de notre destin.
C'est donc naturellement que cette Psychologie se
transcende en morale, comme la Dialectique de l' Affir-
mation ouvrira plus tard sur la Dialectique de. l'Agir.
En 1936, l'enseignement de la morale vient à point
nommé, en dyptique avec !'Ontologie.
Vers le mois de juin 1936, il me fut offert de donner en 3" année
la Morale Génitale et l'Ontologie, chacune un semmre ; j'acceptai .
..•De tous les cours dont je fus chargé, la Moule Générale fut pour
moi le plus captivant ... {p. 198).
Elle l'était comme morale, parce que centrée sur
notre dynamisme et sa fin. Elle l'était comme générale,
parce qu'elle laissait ainsi au P. Marc l'horizon néces-
saire à son regard et l'espace nécessaire à son mouve-
ment.
Il rencontre, pour les faire rentrer dans son ordre,
les tentations et les états qui alimentaient déjà la litté-
rature philosophique : angoisse, désespoir, révolte, etc...
Tous ces thèmes soi-disant existentialistes sortaient d'eux-mêmes de
l'analyse réflexive de l'acre. Ils découlaient du contraste du fini et de
l'infini tn nous, contraste qui fait dt l'homme l'ttre le plus mouve-
menté, le plus déséquilibré peut-être, tant qu'il pritend se suffire de son
insuffisance. Or il est clair qu'un tel contraste suit immédiatement des
principes du thomisme, où l'acte est dt soi illimiti (p. 201).
Mais ce contraste n'est pas sans solution. Le P. Marc
lui donne, à ses yeux, toute sa force, par l'antithèse sui-
vante :
1) La mort est requise, qui libère l'âme du corps.
200 P. FONTAN
2) Alors l'intégrité dt nou, être n'est plus sauve. Pourtant si nous
voulons ê1re entièrement nous-mêmes et entièrement tout, etc ...
(p. 202).
C'est désespéré. Mais ce n'est pas grave, car l'itiné-
raire ajoute, p. 202, avec simplicité :
J'accumulais ainsi avec plaisir les difficultés pour jouer avec elles.
sachant bien que j'en viendrais à bout.
,Comme le Dieu de l a Bible jouait avec Léviathan,
l'enianl de Dieu devenu philosophe se meut avec aisance
et volupté parmi des monstres qu'il prend au sérieux
parce qu'il mesure ce qui les r end tels. Le ressort qui
les explique est, ou devient, le ressort central de la dia-
lectique de l'Agir : le désir naturel de voir Dieu.
S'il est un cas où l'idée d'un être ne me suffit pas, mais où la
réalité m-ême de l'être, dont j'ai l'idée, peut m'apaiser, c' est le sien ...
Pour être pleinement toutes choses et pour être pleinement mo,, il me
faut devenir lui ... Le seul moyen de tout perdre. au point de récupé-
rer ce qui semblait perdu, c'est d'être uni à lui. La mon, par là, n'est·
elle pas surmontée f (p. 202),
Ainsi, conune on l'a dit de l'art au Moyen-Age, le
P. Marc fait « mordre à la mort sa propre poussière 1>
par l'espoir de posséder l'infini.
Mais quelle possession ?
Celle d'abord qu'introduit l'amour :
Puisque Dieu nous dépasse infiniment, et que pat la connaissance
dont nous disposons, nous nous l'assimilons en l'assimilant à nous,
l'amour qui nous transporte en lui nous assimilera à lui, tel qu' il est en
lui-même. Au lieu de l'abaisser à nous. nous nous éièvecons à lui
(p. 202).
S'agit-il de l'élan naturel qui surgit nécessairement
d'une connaissance philosophique ? Certainement pas car
le P. Marc ajoute :
Rien là non plus que nous puissions réaliser. Le tout est de com-
prendre que Je possible ne se mesure pas seulement à ce don1 nous
sommes capables nous-mëmes, mais encore et surtout à ce que Dieu
peot et vtut faire de nous si nous y consentons.
La charité « théologale 1> est donc ici à l'horizon de
la philosophie, comme un point inaccessible dont cette
dernière est plus que le rêve.
Mais le P. Marc n'arrête pas le jeu de l'esprit à cette
unité dans l'amour. L'élan vers une intuition imprimant
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC ZO I
Dieu dans l'âme était l'objet central de son attention et
« la clef de vot'lte de l'édifice , . Sollicité, à certain
moment, de supprimer de son cours, pour des raisons de
personnes et de diplomatie, cette thèse sur le désir de
voir Dieu, il ne transige pas :
J'admets que quelqu'un ne fasse pas de cette thèse la plaque
tournante de son cours ; mais j'admets aussi er même mieux, qu'elle
soit considérée comme telle, rt je le fais. C'est une opinion libte ... Et je
n'accepte pas que la conséquence de la liberté que je laisse aux autres,
soit la suppression de la mienne (p. 205).
T out le poids d'un enseignement philosophique por-
tait do11c sur un te1·me et un bien que la philosophie
reconnaît simplement possibles, geste divin purement
gratuit dont la réalité est un point d'histoire - d' < his-
toire sainte » - à vérifier comme tel
L'angoisse, le tragique , Je dramatique de notre destin, c'est d'être
à la merci d'un événement, qui tout en ayant les d ehon et la banalité
des autres, peut cacher quelque chose d'unique et de di,•in, si bien
que nous pouvons le négliger er le laisser inaperçu, et tout perdre. au
lieu de tour 1ta11ner (p. 204).
Nous sommes assez loin de Spinoza, Brunschvicg et
Heidegger. La sérénité stoïcienne et l'angoisse simple-
ment terrestre sont surcoupées par une dialectique où
l'inquiétude et l'assurance s'allient, la crainte véritable
étant celle de ne pas entendre, dans l'histoire du monde
et notre histoire personnelle, un appel sauveur.
Vraiment : « La philosophie menait à la foi , . (p. 205).
Elle conduisait même aux Exercices de saint Ignace dont
Je P. Marc, philosophe et théologien devait un jour expo-
ser « la dialectique >, par un retour de l'analyse aux
sources spirituelles dont elle a toujours vécu.
Restait à composer et rédiger la Somme déjà pré-
sente dans la pensée et plus qu'ébauchée dans les cours
du P. Marc. Chez un homm e qui faisait du langage le
point de départ et la référence constante de ses médita-
tions, s'exprimer aussi distinctement, aussi logiquement
et aussi complètement que possible dans un ensemble
progressif où la construction serait un dialogue avec les
grands esprits, n'était pas un accident mais une voca-
tion rigoureuse, aussi bien qu'une joie.
Aux alentours de 1936-1 937. l'idée mt vint de transformer ces
cours en ouvrage$ composés à la façon de ceux de Blond'el, Hamelin,
zoz P. FONTAN
Lachelitr. Kant, etc .... qui constitutraient une sorte Je Somme cn mi-
niature... Je voulais un ouvrage en français comme ceux des univer-
aitairts, où je traiterais !es problèmes selon mes forces aussi à fond
que possible. En 1945, M.A. Forest me demanda quels lecteurs j'avais
en vue. c Aucun, lui répondis· je, si ce n'est des hommes tels que vous,
fort au couranr des questions. que je traite pour elles-mêmes de mon
mieux et pour le plaisir. > ·
... Je me proposais d, confronter les médiévaux, aussi les anciens.
avec les modernes et de les expliciter les uns par les autres. Av<c l'aid~
des philosophies comparée~. je voulais appliqu<r sciemment l'analyse
rîflexivt , puis engendrer dans leur détail l'ensemble des diverses thè.m .
en les articulant les unes aux autres, grâce à la méthode dialectique
d'opposition. Je voulais moderniser le thomisme pour dts esprits con·
tcmporains. lnversffllent. cela fait, j'entendais montrer quel apptofon·
dissement. qudle précision ce thomisme peut procurer à la pensée
moderne. pour aborder et trancher les problèmes... Ce travail me sem-
blait d'autant plus urgent, qu'il n'avait pas encore été entrepris sur
cette échelle. sauf pour Maréchal, bien qu'il répondit à des besoins
actuels.
Devant cene tâche je doutais dt moi, en même temps que j'éprou-
vais la tentation de la gloire ... Je me voyais au pied d'un Himalaya for-
midable ... Avec le temps tous ces débats intérieurs m'amenèrent à la
dicision de m'atttler à la besogne : une fois la plume en main. je ne
la diposerai pa1 de sitôt.
... Le terrain était plus que déblayé, puisqu'il était déjà parcouru
de routes toutts tracées, bordées elles-mêmes des fondements des édifi -
ces. que je n' avais plus qu'à construire... Lorsque j'avais commencé •
circuler dans lt pays de la métaphysique, je m'étais mis ,o route, sans
pnssenrir où j'allais. Maintenant je savais où j'avais abouti. Je n'avais
donc plus qu'à recommencer mon voyage, en prévoyant ce terme. de
maniore à y parvenir sans encombre, en toute sécurité, obligatoi rement.
Or ce point d'arrivée, c'était bel et bien la légitimation du fait chrétien,
en tant que le Christ, Homme-Dieu. est par l'incarnation l'insertion de
l' Absolu. de l'Eternel dans le temps et le contingent. Il fallait s'assu-
rer que cette synthèse du contingent et de l'absolu dans un fait, dont les
apparences peuvent être b,inales, était possible. ou du moins n'était pas
impossible et nt pouvait pas l'être (p. 205-206).
Voilà l'homme et déjà l'œuvre. Le P. Marc se dit
très clairement lui-même, avec une simplicité qui peut
surprendre, tant elle rend possible l'objection ou la cri-
tique par le démontage en quelque sorte impersonnel,
des intentions, des raisons, des procédés, des tentations
aussi.
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC ZOJ
La lecture de !'Itinéraire est d'ailleurs à cet égard si
éclairante qu'elle dissuaderait d'affronter dans le détail
un monument philosophique où chaque question est traitée
« aussi à fond que possible >, mais dont le secret et l'es-
sentiel nous paraissent donnés d'avance. Cet abandon
d'une tâche qui demande, il faut l'avouer, un certain
courage, ne serait pas cependant justifié.
Pour transparentes qu'elles soient, la genèse d'une
œuvre, son invention, son « idée >, sa méthode, ne sau-
raient être confondues avec le système effectivement
construit. Ce dernier peut les trahir par certaines de ses
pensées et logiquement conduire, à l'insu de son homme,
à ce qu'il pensait éviter. Toute organisation véritable a
sa valeur et sa vie propres. L'anticipation de l'œuvre, le
fait qu'au témoignage de l'auteur les avenues étaient
tracées, les constructions ébauchées et la fin connue et
atteinte avant la composition proprement dite, nous obli-
gent seulement à reconnaître - comme partout - un
temps d'invention et un temps d'exposé, sans bloquer l'un
et l'autre. Et l'œuvre matériellement produite, restée
toujours présente à cet exposé, est indispensable à l'intel-
ligence de sa création, quelles que soient les confidences
d'un grand esprit sincère sur son évolution et son travail.
L'itinéraire a son épilogue dans le Post-scriptum de
1950, publié par les Archives de Philosophie (janvier-mars
1962) peu après la mort du P. Marc. Ces pages sont elles-
mêmes suivies d'une note de quelques lignes, écrites deux
ans plus tard, où l'auteur définit l'intention qui fut tou-
jours la sienne : éclairer les discussions contemporaines,
comme avai t fait le P. Maréchal, par les principes pre-
miers de l'être et de l'esprit :
Comme Maréchal, je n'ai fait que recourir aux principes de saint
Thomas et je me suis aperçu qu'ils étaienr loin d'être utilisés autant
qu'il était possible, bien qu'ils ne fusoent pas ignorés.
Le texte même du Post-scriptum développe cette pen-
sée. Plus précisément il s'attache à situer le P. Marc
parmi les « tendances existentialistes, réflexives, phéno-
ménologiques, voire historiquement dialectiques d'aujour-
d'hui > (p. 10 du fascicule imprimé) . Il s'agit mieux que
d'une attention bienveillante accordée aux doctrines. Cha-
cune vit d'une vérité partielle mais indéniable que le
P. Marc intègre sans difficulté. II écrit, en regard des
philosophies de l'existence :
204 P. FONTAN
Mettre •n qu,stion l'ttrt revient à mt mettre en question dans l'êtte.
J'ai compris que j'étais un « être en situation > (p. 5).
Les questions ont tn pour moi l'aspect d'un mystère plus que
d'un problème... Le mystère <St ce qu'il faut aborder avant tout.
J'ai bien la certitude que l'homme est « laissé > aux mains de son
propre conseil « Derelictos > (p. 6) .
En regard du matérialisme dialectique
L'analyse du signe... livre le rapport Homme à Homme dans la
Nature. Cela implique le social, à travers le familial, à travers routes
les complexité, du biologique, de l'économique, du politique (p. 7 -8 ).
11 est légitime de voir Je principe de la dialectique dans le rapport
être-esprit... Il est légitime de partir de l'unité être-esprit et de vouloir
transformer Je monde selon que sa forme est inadéquate à notre puis-
sance sur lui (p. 9).
Tel est l'accueil. Mais c'est une intégration. Car : « Se
mettre en question » revient p our le P. Marc à « orga-
niser le système de l'être » (p. 6) sur un type classique,
thomiste plus précisément.
« Etre en situation >, c'est être mis en demeure de
dominer et comprendre les situations particulières d'un
point de vue universel, transcendantal (au sens où l'on dit
(JUe l'être, et l'être personnel, est un transcendantal (pp. 5
et 6).
Le « derelictus > emprunté à la Bible n'exprime pas
un état d'abandon ( « jeté là ») mais un appel à la libre
fidélité (pp. 6 et 7). Et la liberté ainsi évoquée est contra-
dictoire de la nécessité abstraite, mathématique, non de la
nécessité concrète, in telligible et mystérieuse tout ensem-
ble, issue de l'amour créateur. D'où les rapports du temps
et de l'éternité, de la m ort et de la vie : mystère qui n'est
pas sans angoisse, mais l'angoisse dont parle Je
P. Marc « est espérance en Dieu > (p. 7).
Quant au marxisme et sa dialectique : « il faut
admettre à la fois en nous le matérialisme et la trans-
cendance de l'esprit incarné » ... « Au réalisme impar-
fait de la représentation s'amorce le réalisme radical
de l'amour » par quoi « l'homme évite l'aliénation et
la relation menaçante du maître et de l'esclave : il y
substitue la relation d'amitié entre personnes libres >.
Mais alors : « la plus haute conscience n'est pas celle de
l'homme devant la nature, mais devant Dieu > (pp. 9·
et 10).
ITINERAIRE INTERIEUR DU P. MARC Z05
En ces contacts avec des pensées étrangères, le
P. Marc apparaît non un éclectique facile, mais plutôt
un c puissant réducteur ,. . Il ramène à soi, par voie
d'approfondissement et de synthèse, '.non les pensées
d'autrui, mais ce qui lui parait en elles dicté par le
rapport être-esprit tel qu'il le conçoit à partir de son
analyse du signe. Cette analyse aboutit à ce qu'elle
supposait dans son objet comme dans son acte :
Tout esc dans lts rapport$ des personnes entre elles. L'être unique,
original. c'est l'être individuel. surcout l'êcre personnel. D'ailleurs c'est
aussi le véritable universel. si l'idée d'individu est pour les scolastiques
un transcendantal (p. 5).
On le voit par le Post-scriptum comme par l'itiné-
raire, le P. Marc est plus sensible au contenu positif
des doctrines, à la c dialectique d'affirmation :. qu'elles
enferment à ses yeux, qu'aux limites internes qui les
définissent, à cet échec et cette butée de l'esprit dont un
philosophe dénué de consolations théologiques se réclame
parfois irréductiblement. Nous terminons sur cette remar-
que. F..lle n'est pas, dans notre esprit. un reproche,
puisqu'il est, en spéculation comme ailleurs, diverses
demeures et des grâces très diverses, celle de souffrir et
d'attendre dans l'opacité relative des choses et de l'esprit,
et celle de l'optimisme et de la force, de la montée dans
la lumière. Le Père André Marc, comme son maître
saint Thomas d'Aquin, est de ces derniers, de ces heu-
reux, en qui la grâce n'a pas été vaine...
P. FONTAN
Vous aimerez peut-être aussi
- Jacques Dupuis SJ, Éveil À Soi - Éveil À Dieu Dans L'expérience Spirituelle D'henri Le Saux NRT 111-6 (1989) p.866-879Document13 pagesJacques Dupuis SJ, Éveil À Soi - Éveil À Dieu Dans L'expérience Spirituelle D'henri Le Saux NRT 111-6 (1989) p.866-879aminickPas encore d'évaluation
- Merleau PontyDocument22 pagesMerleau PontyJean-Luc ayrollesPas encore d'évaluation
- Frithjof Schuon - Martin Lings Regard AutobigraphiqueDocument9 pagesFrithjof Schuon - Martin Lings Regard AutobigraphiqueNanard LegrandPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Paul Ricoeur. Paul Ricoeur Et L'acheminement Vers Le Soi 7 - 9 Nov. 1991Document16 pagesEntretien Avec Paul Ricoeur. Paul Ricoeur Et L'acheminement Vers Le Soi 7 - 9 Nov. 1991CarlosPas encore d'évaluation
- 1962 Andre Marc - Post Scriptum 10pDocument10 pages1962 Andre Marc - Post Scriptum 10pEduardo FigueiredoPas encore d'évaluation
- Onference de Ruxelles Sur L Ethique de La PsychanalyseDocument13 pagesOnference de Ruxelles Sur L Ethique de La Psychanalysemarin.domiPas encore d'évaluation
- Généalogie de la morale de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandGénéalogie de la morale de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Pensée de Plotin, Coll. SUP by Naguib Baladi, Review by Michel Prieur, Les Études Philosophiques January, 1971Document4 pagesLa Pensée de Plotin, Coll. SUP by Naguib Baladi, Review by Michel Prieur, Les Études Philosophiques January, 1971Ahmed NabilPas encore d'évaluation
- Miller, Réflexions Sur La Solution CliniqueDocument10 pagesMiller, Réflexions Sur La Solution CliniquediewumPas encore d'évaluation
- La Maladie À La MortDocument16 pagesLa Maladie À La MortAnisse ZemmaPas encore d'évaluation
- La Joie Sans Objet - L'Ultime Réalité - Jean KleinDocument549 pagesLa Joie Sans Objet - L'Ultime Réalité - Jean Kleingandhar100% (2)
- Richir M.Document7 pagesRichir M.lancasterpdPas encore d'évaluation
- Cours A Distance Les Figures Du MoiDocument30 pagesCours A Distance Les Figures Du Moihamzamoukdach.acPas encore d'évaluation
- Dialectique Du Moi Et de Linconscient (JUNG, Carl Gustav)Document222 pagesDialectique Du Moi Et de Linconscient (JUNG, Carl Gustav)auréPas encore d'évaluation
- MERLEAU PONTY Phénoménologie de La PerceptionDocument278 pagesMERLEAU PONTY Phénoménologie de La Perceptiondilapsuscalor100% (2)
- La Différence Ontologique Chez M. HeideggerDocument29 pagesLa Différence Ontologique Chez M. Heideggervince34Pas encore d'évaluation
- Michel Vâlsan, Remarques Préliminaires Sur L'intellect Et La ConscienceDocument13 pagesMichel Vâlsan, Remarques Préliminaires Sur L'intellect Et La ConscienceScienza SacraPas encore d'évaluation
- Carl Gustave Jung - Les Commentaires Des Morts TibetainsDocument20 pagesCarl Gustave Jung - Les Commentaires Des Morts TibetainsDispo Optimo100% (1)
- Thèse Le Sens de Notre Époque Chez Nicolas BerdiaevDocument114 pagesThèse Le Sens de Notre Époque Chez Nicolas BerdiaevKiraPas encore d'évaluation
- Le Merveilleux Enseignement Du Dialogue Avec L'angeDocument71 pagesLe Merveilleux Enseignement Du Dialogue Avec L'angedoopdoopPas encore d'évaluation
- Le Dieu InconscientDocument5 pagesLe Dieu InconscientjndlistsPas encore d'évaluation
- Pierre Ponsoye - L'Islam Et Le Graal (Extrait)Document14 pagesPierre Ponsoye - L'Islam Et Le Graal (Extrait)Nama Rupa100% (2)
- Pierre Ponsoye Islam Et Le GraalDocument113 pagesPierre Ponsoye Islam Et Le GraalKarim KhelifiPas encore d'évaluation
- Sublimation PDFDocument21 pagesSublimation PDFHellen KarllaPas encore d'évaluation
- Mon Cours de Philosophie Tome 2 Extrait Version PDFDocument66 pagesMon Cours de Philosophie Tome 2 Extrait Version PDFNoam 2311Pas encore d'évaluation
- Le Silence-R Guenon 03-3Document42 pagesLe Silence-R Guenon 03-3Tau Verecundus Trinita100% (3)
- 【Ponty, Merleau】Phenomenologie de la perceptionDocument554 pages【Ponty, Merleau】Phenomenologie de la perceptionPietrus GrahamPas encore d'évaluation
- Wotling - La Maudite IpsissimositéDocument20 pagesWotling - La Maudite IpsissimositéSherlock DestinyPas encore d'évaluation
- Luc Ferry Apprendre A Vivre Traite de Philosophie A L UsageDocument10 pagesLuc Ferry Apprendre A Vivre Traite de Philosophie A L Usageadresser0% (1)
- ExtraitDocument8 pagesExtraitogmios_94Pas encore d'évaluation
- Julien Benda - Le Bergsonisme, Ou Une Philosophie de La Mobilité PDFDocument144 pagesJulien Benda - Le Bergsonisme, Ou Une Philosophie de La Mobilité PDFlouiscorax100% (1)
- Merleau-Ponty - L'Oeuvre Et L'esprit de Freud (Parcours 2, Verdier, 2000)Document9 pagesMerleau-Ponty - L'Oeuvre Et L'esprit de Freud (Parcours 2, Verdier, 2000)kairoticPas encore d'évaluation
- Situations PhilosophiquesDocument204 pagesSituations PhilosophiquesSamir Essghaier100% (1)
- Dialectique Des Images Chez BergsonDocument86 pagesDialectique Des Images Chez BergsonmaxiPas encore d'évaluation
- L'Esprit: Sans LimitesDocument17 pagesL'Esprit: Sans LimitespublishitnowPas encore d'évaluation
- Paul Gilbert SJ, Une Anthropologie À Partir de Saint Jean de La Croix. À Propos D'un Ouvrage Recent NRT 103-4 (1981) p.551-562Document12 pagesPaul Gilbert SJ, Une Anthropologie À Partir de Saint Jean de La Croix. À Propos D'un Ouvrage Recent NRT 103-4 (1981) p.551-562aminickPas encore d'évaluation
- Du Sixieme Sens A La Quatrieme DimensionDocument79 pagesDu Sixieme Sens A La Quatrieme DimensionEttayib Ettayib100% (3)
- Jacques-Alain Miller - Religion, PsychanalyseDocument11 pagesJacques-Alain Miller - Religion, PsychanalysevracPas encore d'évaluation
- Colette PDFDocument18 pagesColette PDFElchoPas encore d'évaluation
- Nietzsche La Volonté de Puissance Ou L'exaltation de La VieDocument1 pageNietzsche La Volonté de Puissance Ou L'exaltation de La VieecobaptistePas encore d'évaluation
- À Propos de Trésors Du Bouddhisme: Jeanne-Marie GervyDocument3 pagesÀ Propos de Trésors Du Bouddhisme: Jeanne-Marie GervyLeiris JavaultPas encore d'évaluation
- Chauvire Nous Peirce Critique EgoismeDocument14 pagesChauvire Nous Peirce Critique EgoismeaaddieooPas encore d'évaluation
- Balthasar Nicolas. A La Recherche de L'unité Métaphysique PDFDocument32 pagesBalthasar Nicolas. A La Recherche de L'unité Métaphysique PDFCharlie XiPas encore d'évaluation
- Henry de Geymuller Swedenborg Et Les Phenomenes Psychiques Imprimerie de L'Ere Nouvelle Lausanne 1934Document480 pagesHenry de Geymuller Swedenborg Et Les Phenomenes Psychiques Imprimerie de L'Ere Nouvelle Lausanne 1934francis batt100% (4)
- 10 2307@41085958Document3 pages10 2307@41085958الاسراء و المعراجPas encore d'évaluation
- Spinozale MiracleDocument19 pagesSpinozale MiraclebenrabahPas encore d'évaluation
- Espace Maurice Blanchot - WWW - Blanchot.fr :: Présence de Maurice Blanchot Dans La Déclosion - Gisèle BerkmanDocument5 pagesEspace Maurice Blanchot - WWW - Blanchot.fr :: Présence de Maurice Blanchot Dans La Déclosion - Gisèle BerkmantchulhaPas encore d'évaluation
- La Connaissance de La Vie Aujourd'hui / Jean GayonDocument16 pagesLa Connaissance de La Vie Aujourd'hui / Jean GayonVincent RomagnyPas encore d'évaluation
- L'éducateur Comme Passeur de Sens, Par René BarbierDocument7 pagesL'éducateur Comme Passeur de Sens, Par René BarbierJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Lexique MystiqueDocument60 pagesLexique Mystiqueghaf01Pas encore d'évaluation
- Chasseguet-Smirgel, Les Chemins de L'Anti-Œdipe, 1974Document172 pagesChasseguet-Smirgel, Les Chemins de L'Anti-Œdipe, 1974Kevin McInnes100% (1)
- Johann Gottlieb Fichte - Destination de L'homme (La)Document237 pagesJohann Gottlieb Fichte - Destination de L'homme (La)Igor DamásioPas encore d'évaluation
- Le Sens Mystique de L Apocalypse 000001403Document409 pagesLe Sens Mystique de L Apocalypse 000001403LISBONNE100% (1)
- 1931 André Marc - La Méthode D'opposition en Ontologie ThomisteDocument22 pages1931 André Marc - La Méthode D'opposition en Ontologie ThomisteEduardo FigueiredoPas encore d'évaluation
- Joseph de FinanceDocument2 pagesJoseph de FinanceEduardo FigueiredoPas encore d'évaluation
- 1962 Andre Marc - Post Scriptum 10pDocument10 pages1962 Andre Marc - Post Scriptum 10pEduardo FigueiredoPas encore d'évaluation
- Pe. Fontan - L' ITINÉRAIRE INTÉRIEUR DU PÉRE ANDRÉ MARC: Introduction À Son ŒuvreDocument25 pagesPe. Fontan - L' ITINÉRAIRE INTÉRIEUR DU PÉRE ANDRÉ MARC: Introduction À Son ŒuvreEduardo FigueiredoPas encore d'évaluation
- Andre Marc - Le Point de Départ D'une Psychologie RationnelleDocument39 pagesAndre Marc - Le Point de Départ D'une Psychologie RationnelleEduardo FigueiredoPas encore d'évaluation
- 3131h19 Resume Chaps1 4Document8 pages3131h19 Resume Chaps1 4Khalifa-Assil BaouchePas encore d'évaluation
- Community Manager Mademoiselle DigitalDocument49 pagesCommunity Manager Mademoiselle DigitalTuSaisQui Officiel 226Pas encore d'évaluation
- 14 Principes de GestionDocument4 pages14 Principes de Gestionayman akroPas encore d'évaluation
- Asturias Leyenda AlbenizDocument7 pagesAsturias Leyenda AlbenizRavodPas encore d'évaluation
- Le Marketing Social: Un Oxymore Qui A Du Sens ? : Module Interprofessionnel de Santé PubliqueDocument40 pagesLe Marketing Social: Un Oxymore Qui A Du Sens ? : Module Interprofessionnel de Santé PubliqueMeryam MeryPas encore d'évaluation
- Equivalent Pier Theory For Piled Raft DesignDocument4 pagesEquivalent Pier Theory For Piled Raft DesignjpsorcererPas encore d'évaluation
- Les Question QCM Management Strategique P. JaouhariDocument7 pagesLes Question QCM Management Strategique P. JaouhariSiham AkachoudPas encore d'évaluation
- Activites Du CommissionnaireDocument67 pagesActivites Du CommissionnaireRIHANI MohamedPas encore d'évaluation
- Cartes Bruit Grenoble PDFDocument12 pagesCartes Bruit Grenoble PDFdssd433Pas encore d'évaluation
- Identification Et Mise en Évidence Des Formations Hydrogéologiques de La Wilaya de KhenchelaDocument133 pagesIdentification Et Mise en Évidence Des Formations Hydrogéologiques de La Wilaya de KhenchelaKHELIFA100% (3)
- ES Antragsformular FRDocument2 pagesES Antragsformular FRVincent KirchhofPas encore d'évaluation
- Contrat Type ArchitecteDocument19 pagesContrat Type ArchitecteAdel ShatlaPas encore d'évaluation
- CPS D'achevement Lot 09Document169 pagesCPS D'achevement Lot 09Abdellah MarniPas encore d'évaluation
- (PFS) (TD) PalanDocument2 pages(PFS) (TD) PalanHachmiPas encore d'évaluation
- 59 PDFDocument2 pages59 PDFBastien RabierPas encore d'évaluation
- Cours 2Document25 pagesCours 2jpPas encore d'évaluation
- EXERCICEDocument5 pagesEXERCICEMarius DimaPas encore d'évaluation
- Fichiers PDF Huiles EssentiellesDocument1 pageFichiers PDF Huiles EssentiellesChelsea0% (2)
- Pedagogie 1Document6 pagesPedagogie 1gerard1993Pas encore d'évaluation
- 7a - Note D'information Accueil Au Restaurant Scolaire 2022 2023Document2 pages7a - Note D'information Accueil Au Restaurant Scolaire 2022 2023cpd boualitPas encore d'évaluation
- Interphonie & Vidéophonie, Halima FerganiDocument23 pagesInterphonie & Vidéophonie, Halima Ferganifergani100% (1)
- Guide en 4 Étapes Pour Rejoindre DIGICALL PARTNERDocument1 pageGuide en 4 Étapes Pour Rejoindre DIGICALL PARTNERalaesahbouPas encore d'évaluation
- Bulletin Kine N°25Document32 pagesBulletin Kine N°25Arzhel MideletPas encore d'évaluation
- Limites Et Continuite Exercices Non Corriges 1 5Document2 pagesLimites Et Continuite Exercices Non Corriges 1 5Ali KhatibmknsPas encore d'évaluation
- Procedures D'executionDocument30 pagesProcedures D'executionVirane DantonPas encore d'évaluation
- Memo Lean Six SigmaDocument1 pageMemo Lean Six SigmamehdiPas encore d'évaluation
- MonEtiquetteRetour NA2305191713144 2Document2 pagesMonEtiquetteRetour NA2305191713144 2HADANGUE ChristopherPas encore d'évaluation
- Dzexams 1as Francais 829281Document3 pagesDzexams 1as Francais 829281Zakia Lechhab-laidaniPas encore d'évaluation
- Book PBCF FR WebDocument70 pagesBook PBCF FR WebMorgane patrick EffoutamePas encore d'évaluation
- Approches Theoriques en Analyse de Polit PDFDocument34 pagesApproches Theoriques en Analyse de Polit PDFJean KoffiPas encore d'évaluation