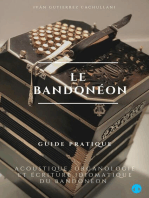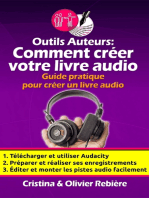Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bru 2
Transféré par
Kristen SaberhagenTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bru 2
Transféré par
Kristen SaberhagenDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les données de l'IBGE : « Bruit – Données de base pour le plan »
2. NOTIONS ACOUSTIQUES ET INDICES DE GÊNE
1. Définition du son
Du point de vue physique, un son peut être défini comme une variation de pression qui peut être
détectée par l’oreille humaine. Les variations de pression se propagent de proche en proche dans le
milieu (l’air par exemple). La variation de pression est appelée pression acoustique, elle est exprimée
en Pascal (1 Pa =1 N/m2).
2. Caractéristiques physiques du son
2.1. La fréquence
Le nombre de variations de pression par seconde est appelé fréquence, elle est exprimée en Hertz
(Hz). La fréquence d'un son définit son « ton », qu’on appelle aussi sa « hauteur ». Ainsi, plus la
fréquence est haute, plus le son est aigu (sifflement) ; plus la fréquence est basse, plus le son est
grave (grondement). Un son composé d'une seule fréquence est appelé « son pur ». Généralement un
son est la résultante de nombreux sons purs, de fréquences et d'amplitudes différentes. L'oreille
humaine perçoit les sons dans une plage de fréquences qui s'échelonne de 20 à 20.000 Hz.
2.2. L'amplitude
La variation de pression maximale atteinte par rapport à une pression de référence s’appelle
l’amplitude du son et correspond, dans le langage courant, au « volume » sonore. Elle se calcule
comme le rapport entre le niveau de pression acoustique mesuré (P) et le niveau de pression
acoustique de référence (Po). Le niveau de pression de référence correspond approximativement au
seuil de perception de l'oreille humaine ; il est égal à une pression acoustique de 2.10-5 Pa, ou 20 µPa.
Le seuil de douleur, par contre, se situe à environ 20 Pa, soit une pression acoustique un million de
fois plus élevée.
2.3. La durée
Le dernier paramètre qui caractérise un son est sa durée d’apparition. On distingue trois types de sons
en fonction de leur durée :
sons continus (ex : fontaine, chute d’eau) ;
sons intermittents (ex. : passages successifs de trains) ;
sons impulsionnels (ex. : coup de fusil).
3. Caractérisation et mesure du son
3.1. Le décibel et l’oreille humaine
Si l’oreille humaine est capable de supporter des variations de pression allant de 20 µPa à 20 Pa, elle
ne perçoit pas un doublement de pression acoustique comme un doublement de niveau de bruit. Pour
faciliter la manipulation des valeurs caractérisant l’amplitude d’un bruit, cette large plage de pressions
a été transposée en utilisant une fonction logarithmique qui a eu pour effet de « dilater » les valeurs les
plus faibles et de « comprimer » les valeurs les plus élevées. Les résultats de cette fonction
s’expriment en décibel. L’échelle ainsi obtenue s’échelonne entre 0 dB, seuil de perception (20 µPa) et
120 dB, seuil de douleur (20 Pa).
2. NOTIONS ACOUSTIQUES ET INDICES DE GENE
PAGE 1 SUR 7 – MARS 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT-IBGE, COLLECTION FICHES DOCUMENTEES, THEMATIQUE BRUIT
Les données de l'IBGE : « Bruit – Données de base pour le plan »
Tableau 2.1 :
Illustration de l'échelle des décibels
SENSATION NIVEAU
AMBIANCE EXTERIEURE CONVERSATION
AUDITIVE SONORE
Très bruyant 80 dB(A) Bordure d'autoroute En criant
75 dB(A)
Bruyant Rue animée, grand boulevard En parlant très fort
65 dB(A)
Relativement 60 dB(A)
Centre ville En parlant fort
bruyant 55 dB(A)
50 dB(A)
Relativement calme Quartier résidentiel
45 dB(A) A voix normale
Calme 40 dB(A) Cour intérieur
Très calme 30 dB(A) Ambiance nocturne en milieu rural
A voix basse
Silence 20 dB(A) Désert
Outre la large gamme de perception en amplitude, l'oreille humaine se caractérise par une très large
capacité d'audition en fréquence (de 20 à 20.000 Hz). Sa sensibilité varie en fonction de ces deux
grandeurs. Notre ouïe est relativement plus sensible aux fréquences comprises entre 800 et 4.000 Hz,
fréquences correspondant à la gamme de fréquences de la voix.
Afin de tenir compte de la sensibilité différenciée de l’oreille humaine selon les fréquences, les
instruments de mesure doivent « filtrer » le son et fournir une donnée reflétant ces différences
physiologiques de perception. Des « filtres de pondération fréquentielle » ont été établis à cet effet.
Ces filtres consistent en l’application, à chaque bande de fréquence considérée, d’un facteur correctif
au niveau de pression acoustique (exprimée en décibels) afin d’obtenir un spectre fréquentiel qui
corresponde à la sensibilité réelle de l’oreille. Il existe plusieurs filtres de pondération, dont notamment
ceux dénommés A, B et C. Les mesures effectuées avec ces filtres sont exprimées, suivant le cas, en
dB(A), dB(B) et dB(C).
Figure 2.2 : Pondérations fréquentielles A, B et C
2. NOTIONS ACOUSTIQUES ET INDICES DE GENE
PAGE 2 SUR 7 – MARS 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT-IBGE, COLLECTION FICHES DOCUMENTEES, THEMATIQUE BRUIT
Les données de l'IBGE : « Bruit – Données de base pour le plan »
Le dB(A) est le plus couramment utilisé pour les mesures de bruit dans l'environnement et en milieu
industriel. Il offre, en général, une bonne corrélation entre le phénomène physique qu’est le bruit et la
sensation ressentie par une personne. Il est en outre représentatif de la perception humaine au niveau
conversationnel.
Pour des niveaux sonores plus importants (supérieurs à 85 dB), l’utilisation du filtre de pondération C
doit être privilégiée. Ce filtre prend en compte la sensibilité de l’oreille humaine qui augmente pour les
basses fréquences au fur et à mesure que le niveau sonore global s’élève.
3.2. L’addition de sons
Une règle simple d’addition des niveaux sonores consiste à ajouter au niveau sonore occasionné par
la source la plus bruyante une valeur comprise entre 0 et 3 dB, cette valeur dépendant de la différence
entre les 2 niveaux acoustiques en jeu. Lorsque deux sources engendrent le même niveau sonore en
un endroit, il suffit d’y ajouter 3 décibels à la valeur du niveau sonore d’une source pour obtenir le
niveau sonore total, résultant de l’addition des deux sons. Par exemple, le niveau de bruit total de deux
sources sonores identiques produisant chacune 60 décibels est de 63 décibels (60 dB + 60 dB =
63 dB).
On parle par contre d’ « effet de masque » lorsque la différence des niveaux sonores des deux
sources est, au niveau de l’auditeur, plus grande ou égale à 10 dB. Dans ce cas, le niveau sonore
total, résultant de l’addition des deux sons, est égal au niveau sonore engendré par la source la plus
bruyante.
3.3. La mesure du son
La mesure physique la plus simple consiste à déterminer à l'aide d'un sonomètre le niveau de pression
acoustique. La pression acoustique est ainsi transformée en un signal électrique, comparable en
amplitude et en fréquence au phénomène acoustique. Le signal électrique peut être conditionné,
échantillonné et traité de manière à caractériser le bruit mesuré. On peut ainsi par exemple déterminer
des valeurs acoustiques exprimées en dB(A), effectuer des analyses fréquentielles, des analyses
statistiques, intégrer le signal sur une durée déterminée, ...
4. Les indices de gêne
4.1. Introduction
Les mesures de bruit permettent de caractériser les sons. Il existe un grand nombre de méthodes
d’analyse scientifique, de paramètres et d’indicateurs pour caractériser ceux-ci. Cette diversité
s’explique par la complexité du phénomène physique et par la difficulté d’objectiver la gêne ressentie
par l’individu (voir fiche documentée n°3).
Comme explicité ci-dessus, un bruit est un phénomène physique caractérisé notamment par son
niveau de pression acoustique et par sa composition fréquentielle. Ces paramètres constituent les
composantes objectives du bruit.
Pour tenir compte de la sensibilité de l’oreille humaine, ces paramètres physiques sont pondérés par
un « filtre fréquentiel », introduisant une première approche de la notion de gêne subie par l’individu
(voir point 3.1).
Mais un indicateur performant ne doit pas se limiter à caractériser la gêne à partir du niveau de
pression acoustique et d’un spectre de fréquences. D’autres caractéristiques constituent des
paramètres qu’il est essentiel d’intégrer dans un indice de gêne. Par exemple, un individu exposé
pendant un certain temps à une source de bruit « absorbe » une « dose » de bruit caractérisée par un
temps d’exposition. Un indice de gêne peut dès lors intégrer cette caractéristique.
Un indice de gêne est toujours défini en liaison avec des seuils de gêne. A chaque seuil correspond un
niveau de gêne spécifique : gênant, très gênant, insupportable, etc.
L’indice de gêne doit intégrer, en plus des composantes objectives, trois critères importants :
une évaluation correcte des effets du bruit sur la santé ;
une facilité d’utilisation et de manipulation ;
une simplicité suffisante pour être accessible au public.
2. NOTIONS ACOUSTIQUES ET INDICES DE GENE
PAGE 3 SUR 7 – MARS 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT-IBGE, COLLECTION FICHES DOCUMENTEES, THEMATIQUE BRUIT
Les données de l'IBGE : « Bruit – Données de base pour le plan »
On distingue deux grandes catégories d’indicateurs de bruit, à savoir :
- les indicateurs « globaux », introduisant une notion d’exposition « moyenne » sur une période de
temps déterminée ;
- les indicateurs « événementiels » représentatifs d’évènements acoustiques à caractère ponctuel.
4.2. Les indices de gêne globaux
4.2.1. Les niveaux acoustiques équivalents Leq,t
Le « niveau acoustique équivalent » (Leq,t exprimé en dB) d’un bruit stable ou fluctuant est équivalent,
d'un point de vue énergétique, à un bruit permanent et continu qui aurait été observé au même point
de mesure et durant la même période. Le niveau acoustique équivalent correspond donc à une « dose
de bruit » reçue pendant une durée de temps déterminée.
Il est le résultat du calcul de l'intégrale des niveaux sonores relevés à intervalles réguliers
(échantillonnage de 1,2,…n fois par seconde) et pour une période donnée, t (10 min, 1 heure, 24 h,
...). Si l'échantillonnage a été effectué avec une pondération fréquentielle (A par exemple), le niveau
équivalent, sera alors exprimé en dB(A) et symbolisé par LAeq,t.
Ce niveau est très régulièrement utilisé comme indicateur de gêne. On observe en effet, dans la
pratique, une bonne corrélation entre cette valeur et la gêne auditive ressentie par un individu exposé
au bruit (voir fiche documentée n°3). Cependant, l’indicateur LAeq,t gomme les pics d’amplitude de
courte durée observés durant la période considérée. C’est pourquoi, d’autres indicateurs de type
« événementiels » sont également utilisés (voir point 4.3).
4.2.2. Les niveaux fractiles Lx
Le « niveau fractile » est exprimé en dB et est symbolisé par le paramètre L x, où x est compris entre 0
et 100 (par exemple: L10, ..., L90, L95, ...). Il exprime le niveau sonore dépassé pendant le pourcentage
de temps x (10%, ..., 90%, 95%, ...) par rapport à la durée totale de la mesure.
Comme pour les niveaux équivalents, les niveaux fractiles sont déterminés sur base de niveaux
sonores relevés à intervalles réguliers (échantillonnage) et pendant une période donnée. L'analyse
statistique consiste à classer l'ensemble des échantillons ainsi récoltés en fonction de leur niveau et à
calculer la durée, exprimée en %, où un niveau de bruit donné a été dépassé. Les valeurs L1 et L5
caractérisent généralement les niveaux de pointes et permettent de prendre en compte la
caractéristique d’émergence forte de certains bruits tandis que les valeurs L 90 et L95 caractérisent les
niveaux de bruit de fond.
Si l'échantillonnage a été effectué avec une pondération (A par exemple), les niveaux fractiles seront
alors exprimés en dB(A) et symbolisés par LAx.
4.2.3. Les indicateurs de gêne globaux définis par la « directive bruit »
Au niveau européen, la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant (voir
fiche documentée n°41) a défini différents indicateurs globaux, en particulier :
Lday
Lday correspond au niveau de bruit moyen représentatif d’une journée (L Aeq (7h-19h)), déterminé sur
une année. Il constitue un indicateur de bruit associé à la gêne pendant la période diurne.
Levening
Levening correspond au niveau de bruit moyen représentatif d’une soirée (L Aeq (19h-23h)), déterminé sur
une année. Il constitue un indicateur de bruit associé à la gêne en soirée.
Lnight
Lnight correspond au niveau de bruit moyen annuel représentatif d’une nuit (L Aeq (23h-7h)). Il constitue
un indicateur de bruit associé aux perturbations du sommeil.
Lden
L'indicateur pondéré Lden (day-evening-night) représente le niveau annuel moyen sur 24h évalué à partir des
niveaux moyens de journée (07h-19h), de soirée (19h-23h) et de nuit (23h-07h). Dans son calcul, les
2. NOTIONS ACOUSTIQUES ET INDICES DE GENE
PAGE 4 SUR 7 – MARS 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT-IBGE, COLLECTION FICHES DOCUMENTEES, THEMATIQUE BRUIT
Les données de l'IBGE : « Bruit – Données de base pour le plan »
niveaux moyens de soirée et de nuit sont augmentés respectivement de 5 et 10 dB(A). En d’autres
termes, cet indicateur de bruit est associé à la gêne acoustique globale liée à une exposition au bruit
de longue durée et tient compte du fait que le bruit subi en soirée et durant la nuit est ressenti comme
plus gênant. Il est utilisé notamment pour l’établissement de cartes de bruit stratégiques. Il est calculé
selon la formule :
LAeq,19 23 5 LAeq, 237 10
1
LAeq, 7 19
LDEN 10 * log 12 *10 10
4 *10 10
8 *10 10
24
Ces indicateurs sont particulièrement indiqués dans le cadre de sources de bruit continu comme le
bruit du trafic routier. Par contre, pour des sources de bruit intermittent comme le bruit du trafic
ferroviaire ou le bruit du trafic aérien, il est indispensable d’utiliser en complément des indicateurs
représentatifs d’événements acoustiques (passages de train, passages d’avion…).
4.3. Les indicateurs événementiels
Parmi les indicateurs événementiels, on peut citer les indicateurs suivants :
LAmax (ou « niveau instantané maximum »)
Le LAmax est le niveau maximum de bruit mesuré (avec une pondération fréquentielle A) durant une
période de temps donnée. Il correspond à un niveau sonore qui n’est jamais dépassé et est donc égal
au niveau fractile LA0.
SEL (Sound Exposure Level)
Le SEL (ou LEA) est le niveau d’exposition acoustique. Il intègre à la fois le niveau de bruit et la durée
durant laquelle le bruit est présent. Le SEL est défini comme étant le niveau constant pendant une
seconde ayant la même énergie acoustique que le son original perçu pendant une durée donnée. Cet
indicateur acoustique est souvent utilisé pour quantifier l’énergie sonore d’un événement simple
(passage d’un véhicule) et pour comparer entre eux les évènements sonores issus d’une même
source. Le SEL se calcule suivant la formule :
SEL= LAeq,t + 10 * log(t)
avec t = durée de l’événement exprimée en secondes
Le graphique 2.3 ci-dessous constitue un exemple de mesure et d’enregistrement des niveaux
sonores. Il représente également les niveaux LAmin et LAmax, les indicateurs fractiles LA90 et LA5 ainsi que
le niveau acoustique équivalent relatif à la période de mesure. La figure 2.4 illustre quant à elle le
niveau d’exposition SEL.
2. NOTIONS ACOUSTIQUES ET INDICES DE GENE
PAGE 5 SUR 7 – MARS 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT-IBGE, COLLECTION FICHES DOCUMENTEES, THEMATIQUE BRUIT
Les données de l'IBGE : « Bruit – Données de base pour le plan »
Figure 2.3 : Exemple de bruit, détermination des niveaux fractiles et du niveau équivalent
(LAmax, LA5, LA90, LAmin et LAeq,t)
75
LAmax (=LA0)
70
65
Niveau sonore en dB(A)
60
LA5
55
LAeq
50
45
40 LA90
LAmin (=LA100)
35
30
0:30
0:31
0:32
0:33
0:34
0:35
0:36
0:37
0:38
0:39
0:40
0:41
0:42
0:43
0:44
Heure
Les indicateurs LA5 et LA90 correspondent aux niveaux sonores atteints ou dépassés durant
respectivement 5 et 90% du temps de mesure (15 minutes dans l’exemple du graphique). L AO (ou
LAmax) correspond au niveau sonore maximum et LA100 (ou LAmin) correspond au niveau sonore
minimum. Les indicateurs LA1 et LA5 sont souvent utilisés pour représenter des bruits de courte durée
et intermittents (bruits industriels, bruit des trains, bruit des avions, etc.). Inversement, les indicateurs
LA90 et LA99 caractérisent les moments les plus silencieux de la période de mesure et sont
représentatifs du bruit de fond.
Figure 2.4 : Exemple de bruit, détermination du niveau SEL
2. NOTIONS ACOUSTIQUES ET INDICES DE GENE
PAGE 6 SUR 7 – MARS 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT-IBGE, COLLECTION FICHES DOCUMENTEES, THEMATIQUE BRUIT
Les données de l'IBGE : « Bruit – Données de base pour le plan »
Au stade actuel, il n’existe pas encore de consensus international sur le choix et l’utilisation des
indicateurs de gêne. Les seuils de gêne sont définis par chaque pays de façon extrêmement
diversifiée. Les indicateurs de bruit ainsi que les normes et valeurs guides utilisés en Région
bruxelloise sont décrits dans la fiche documentée n°37.
Sources
1. DIRECTIVE 2002/49/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 juin 2002, relative
à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. JO L 189 du 18.07.2002. 14 pp. p.12-
25. Disponible sur : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:FR:PDF
2. BRUEL & KJAER, 1984. « Mesures acoustiques ».
3. BRUEL & KJAER, 2000. « Bruit de l’environnement ».
4. MIGNERON J.G., 1980. « Acoustique urbaine », Ed. Masson, 427 pp.
Autres fiches à consulter
Thématique « Bruit »
3. Impact du bruit sur la gêne, la qualité de vie et la santé
37. Les valeurs acoustiques et vibratoires utilisées en Région bruxelloise
41. Cadre légal bruxellois en matière de bruit
Auteur(s) de la fiche
BOULAND Catherine, DELLISSE Georges, DE VILLERS Juliette
Mise à jour : POUPÉ Marie
Date de mise à jour : Mars 2018
2. NOTIONS ACOUSTIQUES ET INDICES DE GENE
PAGE 7 SUR 7 – MARS 2018
BRUXELLES ENVIRONNEMENT-IBGE, COLLECTION FICHES DOCUMENTEES, THEMATIQUE BRUIT
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours de Sonorisation. Version 2009Document73 pagesCours de Sonorisation. Version 2009RAMAROSANDRATANA100% (6)
- Guide Complet de La Sonorisation 2009 PDFDocument73 pagesGuide Complet de La Sonorisation 2009 PDFtinasupf100% (2)
- 203035RO Cours 5 Echelle DB SPLDocument9 pages203035RO Cours 5 Echelle DB SPLsamickjoePas encore d'évaluation
- Guide de La Sonorisation PDFDocument84 pagesGuide de La Sonorisation PDFDavidLomazzi100% (3)
- AccousticDocument189 pagesAccousticantoine CharPas encore d'évaluation
- Expos É Accou Sti QueDocument36 pagesExpos É Accou Sti QueAtiampo Guy RogerPas encore d'évaluation
- Acoustique PhysiqueDocument7 pagesAcoustique PhysiqueManou Bakr100% (1)
- Cours Sti2d AcoustiqueDocument10 pagesCours Sti2d AcoustiquekouassisimeonaneyPas encore d'évaluation
- Cours Son PDFDocument7 pagesCours Son PDFWilliam Marilleau100% (1)
- Chapitre 1 - Le Son, Phénomène Vibratoire - Activité2Document2 pagesChapitre 1 - Le Son, Phénomène Vibratoire - Activité2Chloé Terreau100% (1)
- AILg Embrechts BruitDocument10 pagesAILg Embrechts Bruitzayd100% (1)
- 1 Campagne Bruit Les Differents Types de Bruits Et Leurs CaracteristiquesDocument2 pages1 Campagne Bruit Les Differents Types de Bruits Et Leurs CaracteristiquesEl Haddam AsmaePas encore d'évaluation
- JwjieDocument11 pagesJwjiebadorhanoPas encore d'évaluation
- Acoustique Étude Du SonDocument13 pagesAcoustique Étude Du SonËlÿås Şąďmî100% (1)
- Accoustique Sound Design - 1Document9 pagesAccoustique Sound Design - 1slyegogeePas encore d'évaluation
- Introduction Acoustique Des BatimentsDocument32 pagesIntroduction Acoustique Des BatimentsMehdimon KokoPas encore d'évaluation
- Dé Nition Du SonDocument12 pagesDé Nition Du SonMohammed RafikPas encore d'évaluation
- Expose AcoustiqueDocument26 pagesExpose AcoustiqueSourouPas encore d'évaluation
- La Pollution SonnoreDocument5 pagesLa Pollution Sonnoresafa hamdiPas encore d'évaluation
- PlanDocument13 pagesPlanMouad MelloukiPas encore d'évaluation
- Acoustique Ch2 Ctrl1 eDocument0 pageAcoustique Ch2 Ctrl1 eSamir Chouchane100% (1)
- Généralités Sur L'acoustiqueDocument16 pagesGénéralités Sur L'acoustiquePapa Abdoulaye GUEYEPas encore d'évaluation
- Batiments 2022Document83 pagesBatiments 2022Hanane El hammoutiPas encore d'évaluation
- Memo Technique Acoustique - AerauliqueDocument37 pagesMemo Technique Acoustique - AerauliqueLucaPas encore d'évaluation
- Bases Acoustique PDFDocument34 pagesBases Acoustique PDFmamarraoul100% (3)
- polycopie nuisancesDocument6 pagespolycopie nuisancesWafaa HmPas encore d'évaluation
- Arval - Guide AcoustiqueDocument10 pagesArval - Guide Acoustiqueju2675Pas encore d'évaluation
- Cours Acoustique NRADocument14 pagesCours Acoustique NRARémyCombesPas encore d'évaluation
- 2014 09 Metropole Exo2 Sujet CasqueReductionBruit 10ptsDocument5 pages2014 09 Metropole Exo2 Sujet CasqueReductionBruit 10ptsWilliam WalterPas encore d'évaluation
- Cours Son Esra1 GrabcDocument23 pagesCours Son Esra1 GrabcVirginie CordierPas encore d'évaluation
- Acoustique Du Batiment-1Document17 pagesAcoustique Du Batiment-1Inspec Trice100% (1)
- Designer & Business PowerPoint Theme IsolationDocument33 pagesDesigner & Business PowerPoint Theme IsolationRita NourPas encore d'évaluation
- Cours de SonorisationDocument74 pagesCours de SonorisationSam MenardPas encore d'évaluation
- Intensite Sonore Et Niveau D Intensite SonoreDocument2 pagesIntensite Sonore Et Niveau D Intensite SonorekentynPas encore d'évaluation
- Acoustique Du B - Timent - WEBDocument23 pagesAcoustique Du B - Timent - WEBVenveslas BALOUBIPas encore d'évaluation
- 法口3:27Document10 pages法口3:2713761713490Pas encore d'évaluation
- Cours Son Et ArchitectureDocument7 pagesCours Son Et ArchitectureYassine GC100% (1)
- Le Signal AudioDocument21 pagesLe Signal Audiosahliano100% (5)
- LacoustiqueDocument9 pagesLacoustiqueis guePas encore d'évaluation
- Acoustique CoDocument10 pagesAcoustique CoLaetitia Chaton100% (1)
- Travail6an-Surdite Professionnelle2020boumendjelDocument6 pagesTravail6an-Surdite Professionnelle2020boumendjelFarah B. BtoushPas encore d'évaluation
- Guide Bruit Sante Cidb 2017Document24 pagesGuide Bruit Sante Cidb 2017Gauthier AlexandrePas encore d'évaluation
- Acoustique Generale PDFDocument16 pagesAcoustique Generale PDFRah SaPas encore d'évaluation
- Son 1Document3 pagesSon 1Jean-Francois GOBEAUPas encore d'évaluation
- JJ0503 Initiation Métrologie 2014Document46 pagesJJ0503 Initiation Métrologie 2014meliodeetPas encore d'évaluation
- Acoustique AerauliqueDocument33 pagesAcoustique AerauliqueAnonymous 73gEYyEtLPas encore d'évaluation
- 1 - Les Ondes SonoresDocument7 pages1 - Les Ondes SonoresAdeline CostaPas encore d'évaluation
- Les Bases de LacoustiqueDocument19 pagesLes Bases de LacoustiqueagabuskasepaPas encore d'évaluation
- Fonction Sensorielle Cas de L' Audition: Gérard Maurel CHU Saint Antoine Février 2004Document191 pagesFonction Sensorielle Cas de L' Audition: Gérard Maurel CHU Saint Antoine Février 2004Sa RahPas encore d'évaluation
- FIche7 1 1Document4 pagesFIche7 1 1Dhia Eddine Ben YoussefPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 AcoustiqueDocument31 pagesChapitre 4 AcoustiqueSliman ChaimaPas encore d'évaluation
- Acoustique Du Semestre 2Document8 pagesAcoustique Du Semestre 2Vincent LaunayPas encore d'évaluation
- 3-Traitement Numerique Du SonDocument14 pages3-Traitement Numerique Du SonJad G. Ghosn100% (1)
- Presentation de L Analyse Frequentielle 2008 PDFDocument6 pagesPresentation de L Analyse Frequentielle 2008 PDFMustafa Moussaoui100% (1)
- Initiation A La MultimediaDocument4 pagesInitiation A La MultimediaWillis clifford RAKOTONDRAZAFY100% (1)
- Acoustique Du BatimentDocument24 pagesAcoustique Du BatimentAlainSafariPas encore d'évaluation
- Outils Auteurs: Comment créer votre livre audio: Guide pratique pour créer un livre audioD'EverandOutils Auteurs: Comment créer votre livre audio: Guide pratique pour créer un livre audioPas encore d'évaluation
- L'intonation juste enfin trouvée: Le système G : positions et expressivitéD'EverandL'intonation juste enfin trouvée: Le système G : positions et expressivitéPas encore d'évaluation
- Bru 55Document12 pagesBru 55Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 54 FRDocument14 pagesBru 54 FRKristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 58Document8 pagesBru 58Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Jumelage de LogesDocument29 pagesJumelage de LogesKristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 45 1Document13 pagesBru 45 1Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 11Document13 pagesBru 11Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 6Document12 pagesBru 6Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 8Document10 pagesBru 8Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 43Document12 pagesBru 43Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 57Document7 pagesBru 57Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 52Document10 pagesBru 52Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 12Document9 pagesBru 12Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 34Document11 pagesBru 34Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 5 1Document6 pagesBru 5 1Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 27Document8 pagesBru 27Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 47Document6 pagesBru 47Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 46 1Document7 pagesBru 46 1Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 49Document15 pagesBru 49Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 48Document6 pagesBru 48Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 44Document6 pagesBru 44Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 9Document8 pagesBru 9Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 42Document9 pagesBru 42Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 3Document7 pagesBru 3Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 7Document6 pagesBru 7Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 38Document8 pagesBru 38Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 41Document10 pagesBru 41Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 35Document4 pagesBru 35Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 33Document11 pagesBru 33Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Bru 4Document3 pagesBru 4Kristen SaberhagenPas encore d'évaluation
- Ex 3 OndesDocument3 pagesEx 3 OndesabdoPas encore d'évaluation
- Circuits Analogiques - Problemes Et Corriges - p189-197Document9 pagesCircuits Analogiques - Problemes Et Corriges - p189-197Sawat SiwarPas encore d'évaluation
- Mécanique Quantique I: SMP-SMCDocument17 pagesMécanique Quantique I: SMP-SMCKhalid ZegPas encore d'évaluation
- Chap11 (Oscillateurs Quasi-Sinusoidaux)Document52 pagesChap11 (Oscillateurs Quasi-Sinusoidaux)speratePas encore d'évaluation
- Td8 Filtrage Lineaire CorrDocument2 pagesTd8 Filtrage Lineaire CorrAdri LebPas encore d'évaluation
- Examen 2013-2014Document4 pagesExamen 2013-2014Naser AbosalmaPas encore d'évaluation
- CHM 1302 - 2005 - Part 1 - GiassonDocument16 pagesCHM 1302 - 2005 - Part 1 - GiassonMiskine FilsPas encore d'évaluation
- 01 Propagation Des Onde HertziennesDocument9 pages01 Propagation Des Onde HertziennessabersaberPas encore d'évaluation
- TPE Cymatique - Dossier FinalDocument40 pagesTPE Cymatique - Dossier FinalAwenPas encore d'évaluation
- FM PMDocument14 pagesFM PMOudjoud KeddourPas encore d'évaluation
- Question 1Document22 pagesQuestion 1Laine MoisePas encore d'évaluation
- Physique Des OndesDocument18 pagesPhysique Des OndesSilSantosPas encore d'évaluation
- TD Oscillateurs Forcés 2021Document1 pageTD Oscillateurs Forcés 2021Geordy AKPAKAPas encore d'évaluation
- Chap. 2 Ondes Mécaniques Progressives Périodiques - CopieDocument7 pagesChap. 2 Ondes Mécaniques Progressives Périodiques - Copiemohamed laghribPas encore d'évaluation
- Resume Ondes Mecaniques Progressives Periodiques 2bac BIOF Sciences Mathematiques A B Et Sciences Physiques 1Document3 pagesResume Ondes Mecaniques Progressives Periodiques 2bac BIOF Sciences Mathematiques A B Et Sciences Physiques 1Abdelwahed AkrifallaPas encore d'évaluation
- Ondes MecaniqueDocument9 pagesOndes MecaniqueMalik BeeryPas encore d'évaluation
- CoursDocument143 pagesCoursDankov2Pas encore d'évaluation
- MFEhouleDocument38 pagesMFEhoulePierre LeconPas encore d'évaluation
- 5 Antennes YMAHE IETRrbbDocument11 pages5 Antennes YMAHE IETRrbbbothaynaPas encore d'évaluation
- Azhari Propagation Et Optique PDFDocument419 pagesAzhari Propagation Et Optique PDFhamidPas encore d'évaluation
- TP1df CRDocument3 pagesTP1df CRSarah KebiriPas encore d'évaluation
- Enonce TD Ondes Electromagnetiques Partie 2 110538Document1 pageEnonce TD Ondes Electromagnetiques Partie 2 110538Mehdi M100% (1)
- Résolution de L'équation de L'helmholtz Pour Déterminer Les Paramètres D'un Faisceau LaserDocument71 pagesRésolution de L'équation de L'helmholtz Pour Déterminer Les Paramètres D'un Faisceau LaserMichel FoadiengPas encore d'évaluation
- TP - Electricité - ESMTDocument15 pagesTP - Electricité - ESMTOumarPas encore d'évaluation
- PropagExamen06 07 Sess1 CocodyDocument1 pagePropagExamen06 07 Sess1 CocodyissoufPas encore d'évaluation
- diapoOPC2 1 201609080834Document27 pagesdiapoOPC2 1 201609080834Aly OuedryPas encore d'évaluation
- 2a-Chapitre Ondes Lumineuses - MobDocument19 pages2a-Chapitre Ondes Lumineuses - Mobyaya dialloPas encore d'évaluation
- Réalisé Par : - Anas Mimouni - Otmane Oussouha - Ismail OuadjarDocument15 pagesRéalisé Par : - Anas Mimouni - Otmane Oussouha - Ismail OuadjarMOUMMOUPas encore d'évaluation
- TP L2AV AcPhi 2022-2023Document15 pagesTP L2AV AcPhi 2022-2023Qitai WEIPas encore d'évaluation
- TD Communication Analogique 6Document3 pagesTD Communication Analogique 6superzaki67% (3)