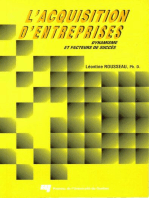Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Methodes de Prevision de La Demande en Eau PDF
Les Methodes de Prevision de La Demande en Eau PDF
Transféré par
fatimaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Methodes de Prevision de La Demande en Eau PDF
Les Methodes de Prevision de La Demande en Eau PDF
Transféré par
fatimaDroits d'auteur :
Formats disponibles
CIHEAM - Options Mediterraneennes
Dominique Geofiay
Lyonnaise des Eaux
Paris, France
RESUME - La prévision des demandes en eau en zone urbaine revêt un enjeu capital à deux
niveaux à la fois:
(a) au niveau du planificateur de la mobilisation des ressources en eau et de son programme
d’investissement.Celui-citendenpermanence à anticiperetréaliserenavanceles
extensions des infrastructures de mobilisation, d’adduction, de stockage et de distribution
qui permettraientdefairefaceaudéveloppementsocio-économiqueprojetépourles
agglomérations urbaines afin de ne pas tomberdans une situation de déficit en eau,
(b) auniveau du gestionnaire du servicededistributioneneau qui sans une prévision
convenable de la demande ne serait pas en mesure de projeter dans le futur ses comptes
d’exploitation et ses tarifs de ventes d’eau à même d’assurer sa viabilité financière et par
suite lui permettre de garantirà ses abonnés un niveau de service adéquat.
L’exposés’attachedans un premiertemps à présenterlesméthodesclassiquesles plus
utilisées pour la prévision des demandes en eau potable en zone urbaine.
II s’agit destrois méthodes suivantes:
(i)- méthodetendancielle,
(i¡)- méthode globale,
~ (i¡¡)- méthodeanalytique.
Les principes, les fondements etles limites de chaque méthodesont passés en revue.
La méthode analytique, méthode la plus utilisée actuellement, consiste en un modèle linéaire
qui comporte plusieurs paramètres de base. Cette méthode a l’avantage d’analyser dans un
premier temps, et de faGon relativement fine, la structurepassée de la consommation en eau de
l’agglomération. Ce qui permet d’expliquer les raisons saillantes des évolutions passées des
consommations en eau par type d’usager.
La variante de base de cette méthode prend en compte les paramètres principaux suivants (en
situations passée, actuelle et future):
Options Méditerranéennes,Sér. A / n W , 1997 Séminaires Méditerranéens
Serie A: Seminaires mediterraneens
CIHEAM - Options Mediterraneennes
162 D.Geopay
(a) démographie, taux de raccordement au réseau de distribution,
(b)nombred’abonnés selon lesdifférentescatégoriesd’usager(domestique,administratif,
industriel, point d’eau public, complexe touristique...etc.),
(c) consommations unitaires par type d’usager,
(d) rendement des ouvrages hydrauliques de production, d’adduction et de distribution,
La fiabilité de prévision par laméthode analytique reste étroitementliée à la qualité et l’étendue
des statistiques passées des consommations d’eau.
Chacun des paramètres de base est commenté. L‘accent est mis sur les dernières tendances
constatées à travers des études récentes du secteur de l’eau potable tout en précisant les
difficultés susceptibles d’entraver une bonne maîtrise de I’évolution passée et future de chaque
paramètre.
La méthode analytique peut &re étendue par la prise en compte de nouveaux paramètres
explicatifs dela demande en eau: il s’agit notamment dela prise en compte de la baisse possible
du niveau de consommation suite à une forte augmentation des tarifs de vente de l’eau (élasticité
de la demande en eau). De telles extensions nécessitent toutefois une grande rigueur dans le
suivi et le dépouillement des statistiques de consommation dela part de l’organisme chargé de
la distribution d’eau.
Laprévision en eau à uneéchelle plus fine(au pas detempsmensuel ou journalierpar
exemple) pourrait constituer un outil d’aide à la décision en temps réel et servir pour l’exploitant
à la définitionde la conduiteoptimaledesouvrageshydrauliques(battementsdesréservoirs,
pompages...) de manière à minimiser les coûts de production sur le pas de temps suivant. Un
tel outil pourrait prendre en compte d’autres types de paramètres explicatifs dela demande en
eau tels que: les conditions climatiques (températures, pluviométrieet humidité) et les variations
saisonnièresdecertainesactivités:professionnelles(finsdesemaine), scolaires(départsen
vacances), touristiques ou industrielles. La mise en oeuvre d’un tel outil nécessite un parc de
mesure et une informatisation relativement développés pourla collecte et le dépouillement des
données de base de l’outil d’aideà la décision en temps réel.
-
ABSTRACT Forecasting demand for water in urban areas becomes a vital challenge at two
levels at once:
a.forthepersonincharge of planningthemobilizationofwaterresourcesandforhis
investmentprogram.Thispersonwillcontinuallytendtoanticipateand be ahead in
expanding the infrastructures for mobilization, conveyance, storage and distribution which
will make it possible to face projected socio-economic development in urban areas, so as not
to fall into a situation of water shortage,
b. for the manager of the water distribution service who, without proper demand forecasting,
would be unable to plan his future operating accounts and water sales prices which would
ensure his financial viability, thus placing him in a position to guarantee satisfactory service
for the consumer.
This presentation will begin with a discussion of the most widely used classical methods for
predicting the demand for potable water in urban areas.
Serie A: Seminaires mediterraneens
CIHEAM - Options Mediterraneennes
des Prevision 163
The methods concerned are the following three:
(0 tendential
method,
global
method,
(ií)
(iii) analytic
method.
The principles, bases and. limits of each method are examined.
The analytic method, which is presently the most widely used, consists in a linear model which
comprises several basic parameters. The advantage of this method is that, in a first phase, it
analyzes the past structure of water consumption in a conglomeration, and does this rather
sharply. This enables one to explain the salient reasons for past evolution in water consumption
by type of consumer,
The basic variant of this method takes into account the following main parameters (in past,
present and future situations):
a. demography, ratio of connection to the distribution network,
b.numberofconsumersaccordingtodifferentusercategories(home,administrative,
industrial, public water spot, tourist complex, etc.),
c, consumption in units per type of user,
d. yield of hydraulic production, conveyance and distribution facilities.
The reliabilityof analytic method forecasts is closely linked to the quality and coverage of past
statistics for water consumption.
Each basic parameter is examined. The emphasis is on the latest trends observed in recent
studies of the drinking water sector, while attention is given to the difficulties which could hinder
the proper control of the past and future evolution of each parameter.
The analytic method canbe extended by including new parameters having explanatory value
forwaterdemand:inparticular,thepossibledropinthelevelsofconsumptionduetoa
significant increase in the selling price of water (elasticity of water demand). This type of
extension,however,requirescarefulanddisciplinedfollow-upandstudy of consumption
statistics on the part of the entity which is responsible for water distribution.
Water forecasting on a more detailed scale (on a monthly or daily basis, for instance) could
constitute a toolfor real-time decision support, and be used to enable the operator to define the
optimal management of hydraulic facilities (reservoir intervals, pumping ...) in viewof minimizing
production costs for the following time span. A tool such as this could include other types of
parametershavingexplanatoryvalueforwaterdemand,suchas:climaticconditions
(temperatures,rainfallandhumidity),seasonalvariationsforcertainprofessionalactivities
(week-ends), school (departures for holidays), tourism or industry. Implementing such a tool
requires a relatively well developed measurement and computing capability for the collection
and study of basic data for the real-time decision-support tool.
Serie A: Seminaires mediterraneens
CIHEAM - Options Mediterraneennes
164 D.Geofiay
1. INTRODUCTION
Nos agglomérations urbaines ont connu ces derniè- Dans ce cadre, la prévision en eau devient un outil
resdécennies un accroissement très important et de décision stratégique aussi bien pour le planifica-
très rapide. Ceci a été plus particulièrement constaté teur d'aménagement des ressources en eau que pour
dans les grandes mktropoles des paysen voie de dé- le distributeur d'eau. Tous les deux se basent sur les
veloppement. Devant, ces évolutions rapides parfois résultats de cette prévision qui ne doit être ni très
impossible à prévoir à l'avance, les acteurs économi- surestimée au risque de programmer des investis-
ques du secteur de l'eau potable se trouvent devant sements trop prématurément ni très sous-estimée au
un dilemme difficile à résoudre: risque d'être surpris à court terme par des déficits
chroniques d'eau potable qui pourraient avoir des
1. faut-il anticipersuffisamment à l'avancel'ac- conséquencesgravessur le développement éCo-
croissement des villes, tabler sur une évolution nomique de l'agglomération.
rapide desbesoins en eau et réaliserdèsque
possible les infiastructures de production et de
distribution d'eau pour éviter d'être confionté à 2. LES METHODES DEPREVISION
court ou à moyen termes à des déficits en eau
difficilement supportables pour les acteurs éCo- La prévision en eau consiste à établir un modèlequi
nomiques de l'agglomération, permet d'évaluer la demande en eau future. On se
limitera dans le présent exposé à la demande en eau
2. faut-il adopter une stratégie prudente et n'enga- en milieu urbain. La prévision de la demande en
ger des investissements que lorsque les ouvrages eau future peut être effectuée à court et long termes
de production commencent à s'approcher deleur avec un pas de temps des calculs d'une année comme
capacité. elle peut être effectuée à court ou à très court terme
avec un pas de temps mensuel voire journalier.
La première stratégie est une stratégie maximaliste Dans le second cas de figure,la prévision sert d'outil
et sécuritaire quifavorise la protection contre le de décision pour l'organisme de distribution et doit
risquederencontrer des déficitsd'eau à moyen prendre en compte une composante devariation sai-
terme. Elle a pour inconvénient de surdimensionner sonnière de la demande en eau. Cette composantede
les ouvrages à réaliser avec l'inconvénient de voir variation saisonnière peut être ignorée dans le pre-
ces ouvrages fonctionner avec un taux d'utilisation mier cas de figure (moyen et long termes) si la pré-
en dessous du seuil de leur rentabilité économique. vision a pour seul but de déterminer le programme
Cettestratégiecomporteégalementl'inconvénient d'investissementoptimaldemobilisationdes res-
de surestimer les volumes d'eau à vendre aux usa- sources en eau, puisque ce qui importe dans ce cas
gers et par suite gonfler les recettes qui en décou- précis c'est d'évaluer les volumes globaux à livrer
lent dans les comptesprévisionnelsd'exploitation annuellement par les ouvrages de mobilisation
de l'organisme distributeur d'eau. (barrages, nappes, sources ...etc.). Dans le cas du
dimensionnement des ouvrageshydrauliques de
La seconde stratégie consiste plutôt à adopter un transport et/ou de distribution d'eau, la composante
profil bas pour n'engager des investissements que de variation saisonnière est bien évidemment prise en
lorsque leur utilité devient nécessaire et urgente. compte, puisque les ouvrages doivent être dimen-
Elle s'expose toutefois à des risques de confronta- sionnés pour faire face à la demande en eau de la
tion de déficit en eau surtout si la période néces- journée (ou de la période)la plus chargée de l'année.
saire à la mise en oeuvre desprojets est importante.
Les méthodes classiques les plus utilisées pour la
I1 est certain quela réalité est souvent située entre ces prévision des demandes en eau potable en zone ur-
deux positions exb-êmes, chaque pays reste toutefois baine à moyen et long termes peuvent être classées
un cas spécifique en fonction des ressources ka
de n- en trois méthodes principales:
cement, des diverses opportunités de mise en oeuvre
des projets d'eau potableet surtout des durées de ma- i. -méthode
tendancielle,
turation des projets depuis leur conception jusqu'à la
mise en service. Plusieurs cas de figure sont rencon- ii. -méthodeglobale,
trésselonlescontextesstructurelsetconjoncturels
propres à chaque pays. iii. -méthodeanalytique.
Serie A: Seminaires mediterraneens
CIHEAM - Options Mediterraneennes
des Prévision 165
Les principes, les fondements et les limites de cha- de la tendancen'estpasdépourvued'ambiguïté
que méthode sont passés en revue ci-après. puisque selon l'importanceaccordée aux données
statistiques récentes, l'évolution future peut suivre
2.1. Méthode tendancielle: différents rythmes d'accroissement.
La méthode tendancielle est basée sur l'analyse sta- 2.2. Méthode Globale:
tistique des chiffres de production passée d'eauPO-
table. Elle consiste à prévoir l'évolution future des La méthode globale quant à elle essaie de relier la
besoins sur la base des tendances constatées dansle production en eau potable à un facteur explicatif de
passé. On appliquegénéralement un ajustement la consommation. I1 peut s'agir dela démographie ou
statistique (exponentiel ou linéaire) basé sur la mé- du nombre d'abonnés par exemple. La demande en
thode des moindres carrés. eau potable est alors reliée au facteur explicatif
(démographie ou nombre d'abonnés) par la dotation
Cette méthode nepeut bien évidemment être appli- brute unitaire globale qui s'exprime par le rapport de
quéequelorsqu'ondisposed'unelonguesériede ces deux variables en I/hab/jour en ouI/abonné/jour.
productions annuelles qui reflètent dans l'ensemble
une progression régulière dans le temps. Elle sous- La prévision consiste alors à émettre des hypothè-
entend non seulement que la série des statistiques ses sur l'évolution future de cette dotation sur la
passées est suffisamment homogèneet bien corrélée base des statistiques passées disponibles aussi bien
pour confirmer unetrès nette tendance passée, mais en matière de production d'eau quede démographie
également queles chiffres de production sontsuffi- ou du nombre d'abonnés.
samment fiable et traduisent effectivement la de-
mande de l'agglomération et pas seulement l'offre 2.3. Méthode analytique:
que permettentles ressources mobilisées.
Laméthodeanalytique,méthode la plus utilisée
La méthode tendancielle ne peut pas être appliquée actuellement,consisteen un modèle linéaire qui
sur des séries courtes ni sur des séries hétérogènes comporte plusieurs paramètres de base. Cette mé-
où la production connaît des évolutionsen dents de thode a l'avantage d'analyserdans un premier temps,
scie d'une année à l'autre. Unevariation erratique de et de fagon relativement fine,la structure passée de
la production est la caractéristique principale d'une la consommation en eau de l'agglomération selon
ville déficitaire où la production reflète non pas la les volumesconsommés pai chaquecatégorie de
demande mais l'offre (en volumes d'eau) qui a pu consommateur. Ce qui permet d'expliquer les rai-
être faiteaux usagers. sons saillantes des évolutions passées des consom-
mations en eau par type d'usager.
Cette méthode ignore les différentes composantes
constituant la consommation d'eau d'une agglomé- La variante de base de cette méthode prend en compte
ration et évalue la production füture sur la base des lesparamètres principaux suivants(ensituations
productions passées sans se préoccuper du rythme passée, actuelleet future):
de développement spécifique à chacun des secteurs
consommateurs d'eau (domestique, administrations, (a) démographie,taux de raccordement au ré-
industries et tourisme). Sur le plan systémique, seau de distribution,
cetteméthodeconsidère par conséquent une ag-
glomération comme une boîte noire qui consomme (b) nombre d'abonnés selon les dBérentes caté-
l'eau et dont on ne cherche pas à analyser dans le gories d'usager(domestique, administratif, indus-
détail les différents composants. triel, point d'eau public, complexe touristique..etc.),
I1 s'agit d'une méthodequi a connu son apogéedans (c) consommations unitaires par type d'usager:
les années 60, mais qui a très vite montré ses limi- consommation domestique (population raccor-
tes quand les bureaux d'étude et les distributeurs dée au réseau et celle desservie par points d'eau
d'eau ont commencé à prendre conscience des diffé- publics),consommationadministrative et mu-
rents paramètres et variables explicatifs des chan- nicipale(établissementspublics,bouchesd'in-
gements et variations que peut connaître la demande cendie ou d'arrosage des espaces verts publics...),
en eau potable. De plus, la notion de prolongation consommationindustrielle et touristiqueainsi
Serie A: Seminaires mediterraneens
CIHEAM - Options Mediterraneennes
166 D.Geoflay
que d'autres consommations relatives à certains dans la littérature spécialisée sur le sujet, on s'atta-
complexesparticuliersgrandsconsommateurs chera ci-après à passer en revue les différents para-
d'eau potable (ports, casernes militaires, centres mètres qui rentrent en compte dans l'application de
de loisir ...), la méthode analytiqueen précisant à chaque fois les
écueils qui peuvent se présenter pour cerner au
les pertes d'eau et les rendements des ouvra- mieux les valeurs à adopter. La fiabilité d'une pré-
ges hydrauliques de production, d'adduction et vision de demandeen eau dépend.
de distribution.
3.1. Démographie
Sur la base des évolutions passées de chacune des
consommations ci-dessus, des scénarios probables La démographie est un des facteurs les plus mar-
sont définis en matière d'évolution future, en pre- quants de la prévision en eau. La prévision de la
nant en compte le niveau de servicequi a été assuré consommation domestique, qui constitue une part
dans le passé par le distributeur d'eau (satisfaction prépondérantede la consommation en eau d'une
totale ou partielle dela demande en eau potable). agglomération, reste étroitement liée à la prévision
future dela population.
La fiabilité de prévision par la méthode analytique
reste étroitement liée à la qualité et l'étendue des Bien souvent, les concepteurs chargés de la prévi-
statistiques passées des consommations d'eau. Elle sion en eau adoptent les projections démographi-
suppose toutefois une bonne gestion des données ques officielles comme base et bâtissent dessus leur
statistiques de consommation au niveau de l'orga- modèle de prévision. Or il a été constaté ces demiè-
nisme chargé dela distribution d'eau potable. res années (et notamment dans les pays du Ma-
ghreb) que les prévisions officielles existantes sont
Bien souvent le bureau d'étude chargé d'établir les souvent très au dessus des valeurs constatées dans
prévisions en eau est confionté à des difficultés qui la réalité. Ceci est dû en fait à des constatations ré-
sont parfoisinsurmontables.L'une des questions centes relevées sur le terrain et decoulant des résul-
majeures qui se posent lors du dépouillement des tats d'enqustes nationales démographiquesà passages
donnéesdeconsommationd'eauconcernentla répétés. Ces résultats ont permis de mettre en évi-
multitude des données disponibles et malheureuse- dence une dynamiquedes variables démographi-
ment très souvent hétérogènes voire contradictoires. ques sans précédent:
On se rend compte en pratique que les statistiques
deconsommation diffirent énormément selon le (1) c'est ainsi que l'indice synthétique de fécondité
serviceou le départementqui les fournit au sein a connu une baisse importante sur la totalité du
même de l'organisme distributeur d'eau. Maghreb et plus particulièrement en Tunisie et
au Maroc. Tout porteà croire que les campagnes
De plus, des réajustements sont souvent opérés sur de sensibilisation sur la planification familiale
les chiffres bruts selon des objectifs précis de cha- commencent à porter leur M t sur le terrain,
que service mais sans qu'une véritable coordination
n'ait lieu avec les autres départements pour les tenir (2) l'espérance de vie à la naissance a également
informés de ces réajustements.Peu de traces écrites connu des changements notables (vers la hausse)
restent sur le pourquoi des multiplescorrections ces dernières années,
opérées au fil des ans. De sorte qu'avec les change-
ments des personnes, l'explication des diverses dis- (3) les migrations internes 9 l'échelle d'un pays en-
cordances existant entre les statistiques des services tre le milieu rural et le milieu urbain commen-
techniques et comptables devient quasimentim- cent à être mieux maîtrisées grâceà ces enquêtes.
possible.
Malgré les facteurs 2 et 3 ci-dessus qui tendraient à
accroître les chiffies deprojectionsdémographi-
3. LES FACTEURS DETERMINANTSDE LA ques, le facteur 1 relatifà l'indice synthétique reste
METHODE ANALYTIQUE prépondérant et la tendance des projections démo-
graphiques' va en général vers une révision à la
Sans rentrer dans le détail des définitions de chaque baisse des chiffies d'accroissement futur des popu-
terme employé que le lecteur pourra se procurer lations.
Serie A: Seminaires mediterraneens
CIHEAM - Options Mediterraneennes
ne des zonePrévision en en eau 167
3.2. Nombre d'abonnb et Taux de raccordement 3.4. Consommationstouristique et industrielle
Le nombre d'abonnés constitue un paramètre capital Les consommations industrielles et touristiques
du distributeur d'eau puisqueson système de recou- couvrent un éventail très large de types decon-
vrement et sa viabilité financièreen dépend. sommateurs. Cet éventail comprend aussi bien les
unités artisanales, les bains maures, les hôtels, les
Le taux de raccordement, qui s'exprime comme le villagesdevacances touristiques queleszones
rapport de la population raccordée au réseau à la d'ménagement industriel et lesunitésindustrielles
population totale de l'agglomération, constitue un diffùses au sein de l'agglomération. Il s'agit là, sans
paramètre de second ordre pour le distributeur d'eau. conteste, de la consommation la plus délicate à cer-
Ce paramètre traduit toutefois le niveau de service ner defagonprécise aussi bien dans la situation
eau potable qu'offie l'exploitant du réseau à l'en- présente que pourles projections futures.
semble des consommateurs domestiques.
La prévision en eau des zones touristiques est de-
La fixation du taux de raccordement constitue un puis toujours le point de discussions multiples entre
exercice fort délicat en pratique, puisqu'il dépend les différents experts du secteur. Deux démarches
de la connaissance du nombre d'abonnés effective- de prévision sont généralement envisagées:
ment domestiques et du nombre moyen d'habitants
desservis par chaque abonnement. Dans les quar- (1) soit se baser sur les prévisions officielles (Schéma
tiers d'habitat économique, un compteur peut des- d'Aménagement Urbain et/ou Ministère du
servir plusieurs logements à la fois. Ces ratios de Tourisme)concernantl'évolutiondel'équipe-
base sont spécifiquesà chaque quartier dela ville et ment hôtelier en nombre de lits programmés et
leur détemination nécessite des enquêtes deterrain en leur affectant une dotation unitaire de con-
qui peuventêtremenéespar les releveursdes sommation d'eau qui peut varier de 300 à 700
compteurs d'abonnement. (voire 1000) litres/lit/jour,
3.3. Les usagers dornestiques (2) soit relier cesconsommationstouristiques au
niveau d'activité généréedans l'agglomération qui
Pour les usagers domestiques, il y a lieu de distin- est supposée lié à la démographie, et retenir une
guer la population raccordée au réseau de distribu- consommation touristique unitaire par habitant.
tion (desservies par de l'eau courante chez soi) lade
population non raccordée (et qui est généralement Les deux méthodes aboutissent à des résultats très
desservie par des points d'eau publics). Cette dis- différents. La première méthodedonne toujours des
tinction dépend étroitement en pratique de la dé- consommations supérieuresà celles constatées dans
termination du taux de raccordement. La valeur de la réalité. Ceci s'explique par le fait que les prévi-
ce taux a des conséquences directes sur les valeurs sions officielles constituent davantage des objectifs
des consommations unitaires des populations rac- à atteindxe mais qu'en réalité le développement du
cordées et celles non raccordées au réseau. secteur touristique (comme l'industriel) est dû princi-
palement (et à plus de 90Y0)aux investissements
I1 y a lieu de rappeler quela dénomination d'abonné privés et connait de ce fait des rythmes de croissance
particulier (ou domestique) recouvre enréalité l'en- en paliers maistrès en degà des rythmes escomptés.
semble des petits abonnés (petit calibre de comp-
teur) qui ne peuvent être classés dans une autre ca- L'initiative du secteur privé reste difficilement pré-
tégoried'abonnés
(administratifs,
industriels ou visible, compte tenu des nombreux paramètres so-
touristiques).Cettecatégorieregroupeles petits cio-économiques qui régissentleséquilibresdes
commerces, les hôtels non classés et plus générale- marchés en matière d'offi-e et de demande. Ceci est
ment toutes les activités où l'eau ne rentre pas dans d'autant plus vrai dans le contexte du commerce
un processus de fabrication. Le nombre de petits international qui se caractérise actuellement par une
abonnésdont la consommationn'estpasspécifi- phase de mutationtrès mouvementée.
quement domestique peut représenter selon les ac-
tivitéspropres à chaqueagglomérationentre 5 à La deuxième méthode,bien que baséesur des hypo-
10% du nombretotal d'abonnés particuliers. thèses probables mais qui restent difficiles
à prouver,
Serie A: Seminaires mediterraneens
CIHEAM - Options Mediterraneennes
168 D.Geofsray
donnedesrésultats plus prochesdeschiffresde Comme pour les consommations touristique et in-
consommation constatées dansla réalité. dustrielle, la consommation administrative peut être
soit diffuse soit localisée. Dans la plupart des mé-
Comme pour la consommation touristique, la con- thodes de prévision, la dotation unitaire est généra-
sommationindustrielle peut être supposéeliée à lement rapportée à la population de l'agglomération
l'importancede la population,considéréecomme (en litres/ habitant./jour), sauf cas exceptionnels de
indicateur du niveau d'activité de l'agglomération. certainsgrandscomplexesadministratifsclassés
Onretientunedotationindustrielleunitaire en parmiles gros consommateursd'eau et pourles-
l/hab/j our. quels une analyse spécifique reste nécessaire.
Pour ces deux catégories de consommation, il y a lieu 3.6. Rendements des réseaux
de distinguer les consommations qui peuvent êtrelo-
calisées dans des quartiers réservésà ce type d'activité Le rendement des ouvrages de transport et de dis-
et celles qui restent réparties de façon diffuse sur tout tribution d'eau potable est paradoxalement à la fois
leterritoiredélimitéparl'agglomération. Le traite- le paramètre auquel la prévision d'eau est la plus
ment des statistiques de consommation par secteur de sensible et celui qui est le plus délicatà cerner. Des
relève permet de distinguer la part difise de la part difficultés techniques résident dans la détermination
localisée. et la maîtrise des rendements (qualité des comptages
abonnés et des comptages en tête des réseaux, confu-
En ce qui concerne, la consommation industrielle sions possibles entre rendement technique et rendement
localisée une dotation spatiale en m3/hectare/jour peut commercial).
également être retenue. Ce ratio pris forfaitairement
dans le passé égal à 60 m3/ha/j, s'avère d'après les Ce paramètrepeut être approché de diverses façons:
différentes statistiques d'une parttrès en dessous de
cette valeur (il se situe plutôt aux entre 25 et 35 (1) soit selon une approche globale à l'échelle de
m3/hdj) et connaît d'autre part des variations relati- l'agglomération, on détermine dans ce cas le rap-
vement importantes selon les types d'industries et port entreles volumes globaux distribués en tête
selon le degré d'intégration de l'eau dans les proces- de réseauet ceux facturés aux abonnés,
sus de fabrication.
(2) soit approché de fagon plus fine à l'aide d'un
I1 est à signaler par ailleurs que dès que la facture indice de perte annuellepar kilomètre de réseau
d'eau potable commenceà peser sur-les charges des (ou par abonné), qui peut être régionalisé selon
industriels (ou hôteliers), ceux-ci ont recours soit à les quartiers de la ville. Cette approche permet
des dispositifs permettantle recyclage de l'eau dans d'effectuer des diagnostics sur l'état du réseau
le processus de fabricationsoit à desressources mais nécessite une campagne systématique de
souterraines propres (puits ou forages notamment). détection des fuites sur les réseaux et sur Its
Cefacteurdevradans tous lescasêtreexaminé branchements ainsi que l'installation d'un parc
danslecadred'uneprévision en eau etdemande de compteurs généraux qui permettentde quan-
une connaissance de terrain relativement fme de la tifier et de suivre les transfertsd'eauentre
part du distributeur (enquêtes régulières de terrain). divers quartiers dela ville.
3.5. Dotation administrative 4.LES NOUVELLES TENDANCES
La consommation administrative regroupe des usa- Le secteur de l'eau potable est d'autant plus com-
gers aussi variés que nombreux, le seul point com- plexe qu'il est multidisciplinaire et se caractérise par
mun étant le statut de l'abonné. Une unité adminis- une multitude d'usagers avec des comportements de
trative peut concerner une zone plus ou moins vaste consommationtrèscontrastés. On rencontredans
selon sa vocation; cela peut aller de l'équipement une grande agglomération aussi bien des consom-
public d'un quartier (école, lycée, foyer de jeunes, mateursdomestiques,despetitscommerces,des
dispensaire, bains publics, piscines, centres de loisir, équipementspublics(établissementsscolaires,ca-
espaces verts, etc.) jusqu'à l'établissement d'une impor- sernesmilitaires, hôpitaux ...etc.),desindustries
tance régionale (universités, hôpitaux, casernesmilitai- (grandesconsommatricesd'eauparfois)quedes
res, etc.). complexestouristiquesetdeloisirs.Lesystème
Serie A: Seminaires mediterraneens
CIHEAM - Options Mediterraneennes
des Prévision zone urbaine 169
adopté pour la tarification de l'eau à chacune de ces (3) la réaction du consommateur d'eau face à des
catégories peut également influer sur le comporte- augmentations annuelles et continues des tarifs;
ment de l'usager. plus les tarifs augmentent et plus le consomma-
teur économise l'eaupour baisser le montant de
Parmi les constatations les plus marquantes relevées sa facture d'eau. Ce changement d'attitude du con-
ces dernières années dans le secteur de la distribu- sommateurface aux augmentationsdestarifs
tion de l'eau potable, une ressort defaçon très nette (élasticitéde la consommation au tarif) reste
dans la majorité des pays riverains dela Méditerra- toutefois très difficile à quantifier de façon dé-
née, il s'agit de la baisse des consommations unitai- taillée du fait de sa simultanéité avec plusieurs
res par abonné. Contrairement à ce que l'on admettait autres phénomènes tous aussi difficiles à quan-
généralement au débutdes années 80, et notamment tifier. De plus l'instauration récente des redevan-
lors dela mise au point des objectifs dela Décennie ces d'assainissement (cas du Maroc) tendra certa-
Internationale de l'Eau Potable et de l'assainisse- inement à amplifier ce phénomène à court terme.
ment(DIEPA), les consommationsunitairesne
croissent pasen permanence avecle développement Le deuxième facteur a également pour conséquence
du niveau de service de distribution d'eau en milieu un glissementde la structure des consommations
urbain. I1 a été constatéquecesdotationscrois- vers les faibles tranches de consommation qui sont
saient dans un premiertempslorsd'amélioration en général à bas tarif. Ce qui a un impact incontes-
importante du niveau de service pour permettre de table sur les recettes des organismes de distribution
passer d'une situation dedéficit à unesituation et qui est égalementinévitable avec la"démo-
d'alimentation permanenteet continue des abonnés. cratisation du service de l'eau potable". Ce glisse-
Toutefois, unefois un certain seuil atteint, on relève ment vers les tranches basses aboutit à des trans-
que la dotation unitaire moyennese met à régresser ferts de plus en plus importants en faveur des petits
très légèrement.L'explicationcomplètedecette consommateurs.
tendance n'est pas aiséeet les différents spécialistes
du secteur avancent certaines explicationssans pour Le facteur relatif à l'élasticité de la consommation
autant pouvoir cerner l'importance et l'impact rela- devrait toutefois être modulé et nuancé pour deux
tifs de chacune de ces explications sur cette ten- cas particuliersoù ce facteur devient insignifiant:
dance à la baisse des dotations unitaires.
(i) le niveau de service de la distribution d'eau relati-
Parmi les facteurs explicatifs trois méritent d'être vement bas dans certaines villes déficitairesoù le
soulignés à ce sujet: consommateur est très en dessous du seuilmini-
mal de consommation pour subvenir à ses besoins
(1) la sécheresseaiguë qui a sévi dansplusieurs en eau les plus vitaux,
pays méditerranéens durantla décennie 80, a eu
pour conséquence "bénéfique" que les états con- (ii) le niveauderevenu; plus le revenu ducon-
cernés soient plus attentifs à l'économie dans la sommateur est élevé et moins il attache d'atten-
gestion des ressources en eau. C'est ainsi que tion à sa facture d'eau.
descampagnesdesensibilisationpublicitaires
de lutte contre le gaspillage de l'eauont été lan- Lesquelquesétudesstatistiquesconcluantes sur
cé à travers les médiaset des comités techniques l'élasticité ont permis de montrer que le coefficient
ont été instaurés pour suivre de près les volu- reliant l'augmentation relative du tarif moyen de
mes consommés par les gros consommateurs et l'eau à la baisse relative de la consommation uni-
leur recommander quand c'est nécessaire des dis- taireparabonné, se situait entre: -0,15 et -0,30.
positions visantà baisser la consommation d'eau, Une augmentation de 10% du tarifmoyen de
l'eau serépercuterait, dans un systèmeidéal qui
(2) les programmes de branchements des usagers à obéirait parfaitement à la règle de l'élasticité, par
faible revenu ont certes contribuéà l'augmenta- unebaisse de
la
consommation unitaire à
tion du taux de desserte de façon notable, mais l'abonné de l'ordre de 1,5 à 3,0%. Cette baisse
ils ont également permis à de nouveaux abon- n'est en général supposée avoirlieu en pratique que
nés qui consomment peu d'eau d'être raccordés plusieurs mois après la modification des tarifs; le
au réseau d'où une baisse de la consommation temps que l'abonné reçoive sa facture et se rende
moyenne globale par habitant branché. compte desa variation à la hausse.
Serie A: Seminaires mediterraneens
CIHEAM - Options Mediterraneennes
170 D.Geoflay
CONCLUSION dont la dépendancea été jugée d'un ordre secondaire.
I1 ressort de la présente communication que la pré- Cetexposé s'est attaché à décrire quelquesmé-
vision en eau reste, comme pour la plupart des pré- thodes de prévision tout en essayant d'expliquer
visionsprospectives,un art relativementdifficile. certaines tendances saillantes constatées récemment
Une tentative d'explication des tendances constatées dans le secteur de l'eau potable. Ceci ne doit cepen-
récemment dans l'évolution des paramètres déter- dant pas faire oublier que la mise en oeuvre d'une
minants a été opérée. méthoden'estqu'unedesétapesd'unedémarche
plus large au cours de laquelle, le chargé de la pré-
Un facteur intrinsèque ressort cependantquelque vision en eau doit structurer les données statistiques
soit l'incertitude qui pourrait entacher uneprévision existantes, les expliquer et en interpréter les varia-
d'eau potable: c'est l'organisation de l'établissement tions les plus frappantes avant de choisir un modèle
chargé de la distribution d'eau et plus particulière- de prévision pour le faire évoluer par la suite et le
mentles circuits de transfert del'information au faire vivre pour l'améliorer et corriger les éventuels
sein de cet établissement. Car moins l'information dérapages par rapportaux valeurs enregistrées.
sur les données statistiques de consommation en eau
est entachée d'erreur et plus la qualité de la prévi- Un modèle de prévision ne traduit jamais la réalité
sion en eau qui en découle sera meilleure. Il s'agit complexe desvariations de la demande en eau et s'il
toutefois là d'une condition nécessaire et fortement est souhaitable' de minimiser les erreurs
de prévision
souhaitable, mais malheureusement pas suffisante, fùture, on ne peutjamais les supprimer totalement.
car nousavonsencorebeaucoup à apprendre en
matière de maîtrise des facteurs explicatifs des évolu- La prévision ne doit pas être considérée comme une
tions de la demande en eau. fin en soi mais plutôt comme un outil d'aide à la
prise de décision par les éclairages qu'elle fournit.
On se rend compte en pratique, comme pour des L'erreur de prévision doit être à chaque fois l'occa-
prévisionsdansd'autresdomaines(économétriques sion de mieux comprendre les interdépendances
par exemple), que l'explication et l'interprétation des complexes qui régissent la demande en eau en mi-
valeurs passées sont aussi importantes (voire plus) lieu urbain et motiver davantage les organismes
que les valeurs prédites pour le fùtur. Dégager l'in- distributeurs d'eau à mieux structurer leurs statisti-
fluence et l'interdépendance de certaines variables ques de consommation, en informatiser le dépouille-
dans le passé constitue le fondement même de la ment et le stockage et surtout les gérer en continu
construction du modèle de prévision avec des scé- pour déceler à temps les erreurs humaines ou maté-
narios ou variantes qui permettront de cerner les rielles d'enregistrement. Vue sous cet angle l'inévi-
fourchettes probables (et plausibles) de la variation table erreur de prévision peut être très riche en en-
fùture de la demande en eau. seignements pour le fitur. En outre une prévision
en eau potable ne doit pas seulement se limiter à
Quelquesoitledegrédecomplexitéqu'onveuille une organisation et un dépouillement des statisti-
accorder à LUI modèledeprévision,cedernierse quesdeconsommationmais doit êtreégalement
limite toujours à un nombre relativement limité des nourrie en permanence par des paramètres socio-
facteurs explicatifs des volumes d'eauet notamment économiques qui ressortent d'enquêtes menées
ceux pour lesquels une forte dépendance a été dé- régulièrement sur le terrain (taux de raccordement,
gagée par les valeurs relevées dans le pass& Le mo- enquêtes sur les gros consommateurs administratifs,
dèle néglige danstous les cas les facteurs explicatifs industriels et touristiques...).
Serie A: Seminaires mediterraneens
Vous aimerez peut-être aussi
- Exemple de Description Du SIC (À Faire)Document3 pagesExemple de Description Du SIC (À Faire)Adèle BinoisPas encore d'évaluation
- Résumé Methodologie D'étude de Cas PDFDocument2 pagesRésumé Methodologie D'étude de Cas PDFNorah Sahwane100% (1)
- Programme de Gestion de Trésorerie Et de Suivi Du Prévisionnel - Un Tableau de Bord Pour Faciliter Le Pilotage de L'entreprise PDFDocument43 pagesProgramme de Gestion de Trésorerie Et de Suivi Du Prévisionnel - Un Tableau de Bord Pour Faciliter Le Pilotage de L'entreprise PDFr_racPas encore d'évaluation
- Gestion Des Approvisionnements PDFDocument20 pagesGestion Des Approvisionnements PDFAbdelkrim Zerdi84% (58)
- Performance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsD'EverandPerformance économique des politiques publiques: Évaluation des coûts-avantages et analyse d'impacts contrefactuelsPas encore d'évaluation
- Planification et contrôle de la production et des stocks : techniques et pratiquesD'EverandPlanification et contrôle de la production et des stocks : techniques et pratiquesÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Politiques et management publics: L'heure des remises en questionD'EverandPolitiques et management publics: L'heure des remises en questionPas encore d'évaluation
- SUPPORT - CDG - GOL 3Document82 pagesSUPPORT - CDG - GOL 3MichelPas encore d'évaluation
- Intelligence Economique 2019-2020Document56 pagesIntelligence Economique 2019-2020Derka coulPas encore d'évaluation
- La Grande Distribution Alimentaire Dans Le Développement Territorial Et L'alimentation Des VillesDocument61 pagesLa Grande Distribution Alimentaire Dans Le Développement Territorial Et L'alimentation Des VillesAbdellah ESSAMLALIPas encore d'évaluation
- Conception Et Application D'une Méthodologie Multicritère (SIPOC)Document220 pagesConception Et Application D'une Méthodologie Multicritère (SIPOC)Kenzaa BenPas encore d'évaluation
- Chap3 - Collecte Et Analyse Des Données Sur Les Accidents de La RouteDocument102 pagesChap3 - Collecte Et Analyse Des Données Sur Les Accidents de La RouteCabrel FankamPas encore d'évaluation
- Cours Gestion Des OpérationsDocument53 pagesCours Gestion Des OpérationsMahamadou AmadaPas encore d'évaluation
- FCG Management StrtégiqueDocument132 pagesFCG Management StrtégiquecrepinPas encore d'évaluation
- Gestion de ProjetDocument22 pagesGestion de Projetsakho1Pas encore d'évaluation
- Les Grandes Fonctions de L'entreprise PPT (Enregistrement Automatique)Document141 pagesLes Grandes Fonctions de L'entreprise PPT (Enregistrement Automatique)raisa.tchifabePas encore d'évaluation
- 10-Le Tableau de Bord de GestionDocument12 pages10-Le Tableau de Bord de GestionImane ÍmáňěPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 CG & Concepts Et PréalableDocument12 pagesChapitre 1 CG & Concepts Et PréalableSeifeddine GuesmiPas encore d'évaluation
- EXAMEN 2e Session L3 Economie 2019 - QCM & SWOTDocument6 pagesEXAMEN 2e Session L3 Economie 2019 - QCM & SWOTKone EpervierPas encore d'évaluation
- CDG PART 5.pdf Version 1Document15 pagesCDG PART 5.pdf Version 1Mohamed Ennassiri100% (1)
- L École de La CréativitéDocument4 pagesL École de La CréativitéAbdessamad TirhzaouiPas encore d'évaluation
- Manuel de Procedure AeroDocument28 pagesManuel de Procedure AeroAyOubPas encore d'évaluation
- Projet & Planification FinancièreDocument21 pagesProjet & Planification Financièreseka_dalle100% (1)
- Manar - : Rapport de StageDocument42 pagesManar - : Rapport de Stagebblsshm XPas encore d'évaluation
- MODELISATIONDocument28 pagesMODELISATIONAlaouiPas encore d'évaluation
- Approche de La StratégieDocument3 pagesApproche de La StratégieSANAPas encore d'évaluation
- Projet de Fin D'étude (Final) Ghita El KHARTANIDocument43 pagesProjet de Fin D'étude (Final) Ghita El KHARTANIFarissi ChaimaaPas encore d'évaluation
- Controler Les Coùts D'exploitation ImsetDocument49 pagesControler Les Coùts D'exploitation Imsetessid hendaPas encore d'évaluation
- Syllabus Comptabilité de Gestion S5 L3 13-14Document3 pagesSyllabus Comptabilité de Gestion S5 L3 13-14Cheikh NgomPas encore d'évaluation
- Avant Projet LAMOURI V1Document2 pagesAvant Projet LAMOURI V1Khalil LamouriPas encore d'évaluation
- L'OrdonnancementDocument11 pagesL'OrdonnancementMøu Na100% (1)
- Management Projet Erp Ion Systemes D Information FusionDocument102 pagesManagement Projet Erp Ion Systemes D Information Fusionfroumf13100% (1)
- Résumé Cours Logistique MLTDocument11 pagesRésumé Cours Logistique MLTouijdane boumdianPas encore d'évaluation
- Econométrie Burundi SimulationDocument278 pagesEconométrie Burundi SimulationMartin Olinga100% (1)
- Epreuve Controle de Gestion 2011Document3 pagesEpreuve Controle de Gestion 2011asyPas encore d'évaluation
- Rapport Sur La Division Internationale Des Processus de Production Analyse Théorique Et Empirique&&Document23 pagesRapport Sur La Division Internationale Des Processus de Production Analyse Théorique Et Empirique&&oulboubamina8Pas encore d'évaluation
- Audit Organisationnel 0607Document1 pageAudit Organisationnel 0607Linge Maison Linge MaisonPas encore d'évaluation
- Aspects Internationaux Du Controle de Gestion PDFDocument18 pagesAspects Internationaux Du Controle de Gestion PDFMohamed DeraPas encore d'évaluation
- Etude Cas 1Document3 pagesEtude Cas 1HoudaElNmPas encore d'évaluation
- PND Burundi 2018-2027 Version Finale PDFDocument149 pagesPND Burundi 2018-2027 Version Finale PDFDative0% (1)
- La Gestion Des Achats Et Nouvelles TechnologiesDocument19 pagesLa Gestion Des Achats Et Nouvelles TechnologiesOussama SalihPas encore d'évaluation
- Cours GBDDocument27 pagesCours GBDAllaoua MoncefPas encore d'évaluation
- Evaluation de La Rentabilite D Un Projet D InvestissementDocument9 pagesEvaluation de La Rentabilite D Un Projet D InvestissementRochdi BahiriPas encore d'évaluation
- Gestion de ProjetDocument31 pagesGestion de Projetraissazeinab2Pas encore d'évaluation
- ABC Cours AppalicationDocument14 pagesABC Cours AppalicationTaha Hejjaj100% (1)
- La Logistique Et L'approvisionnementDocument18 pagesLa Logistique Et L'approvisionnementABADI NAHIDPas encore d'évaluation
- PlanDocument5 pagesPlandonePas encore d'évaluation
- CR - Sig - CafDocument16 pagesCR - Sig - CafIlyes BalePas encore d'évaluation
- Vieille Technologique Harina de XoconostleDocument7 pagesVieille Technologique Harina de XoconostlepanchitocartmanPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument6 pagesIntroductionSoumia MezroubPas encore d'évaluation
- Role Et Missions D Un Coordinateur de Projet 110125Document27 pagesRole Et Missions D Un Coordinateur de Projet 110125Othmane ElmouatamidPas encore d'évaluation
- Pratique Du Controle de GestionDocument41 pagesPratique Du Controle de GestionAwal ArzikaPas encore d'évaluation
- Rapport FinalDocument218 pagesRapport Finalxemo01Pas encore d'évaluation
- Le Cadre ConceptuelDocument15 pagesLe Cadre ConceptuelSami Jaballah100% (1)
- Rapport Final D'évaluation de La Phase II Projet IBAS - Guinée BissauDocument50 pagesRapport Final D'évaluation de La Phase II Projet IBAS - Guinée BissauAbdssamad AlaouiPas encore d'évaluation
- L' interaction entre les problèmes de gestion des ressources humaines et de santé et de sécurité au travail: Études de casD'EverandL' interaction entre les problèmes de gestion des ressources humaines et de santé et de sécurité au travail: Études de casPas encore d'évaluation
- La LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmeD'EverandLa LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmePas encore d'évaluation
- Introduction à la modélisation d'équations structurelles: AMOS dans la recherche en gestionD'EverandIntroduction à la modélisation d'équations structurelles: AMOS dans la recherche en gestionPas encore d'évaluation
- L'alena et le Mercosul - Volume 1: impacts du régionalisme économique de seconde génération sur les mouvements sociaux et les dynamiques des agriculteursD'EverandL'alena et le Mercosul - Volume 1: impacts du régionalisme économique de seconde génération sur les mouvements sociaux et les dynamiques des agriculteursPas encore d'évaluation
- CitrusDocument62 pagesCitrusMannouPas encore d'évaluation
- Statistiques Sous ExcelDocument26 pagesStatistiques Sous ExceltinetmilPas encore d'évaluation
- Statistique DescriptiveDocument196 pagesStatistique Descriptivefakhrou100% (1)
- Le Modèle de Black & LittermanDocument53 pagesLe Modèle de Black & Littermanoudet9977Pas encore d'évaluation
- Diagnostic PrésentationDocument22 pagesDiagnostic Présentationmrd9991Pas encore d'évaluation
- CM 1Document13 pagesCM 1EphemeresPas encore d'évaluation
- 2012 10 12 - QCM RONEOS N°5 - Méthode Statistique, Statistique DescriptiveDocument2 pages2012 10 12 - QCM RONEOS N°5 - Méthode Statistique, Statistique DescriptiveAngePas encore d'évaluation
- 1 Comprendrelavariation-3 InferenceDocument27 pages1 Comprendrelavariation-3 InferenceKader BakourPas encore d'évaluation
- TD1 Echantillonnage NOV14Document2 pagesTD1 Echantillonnage NOV14Youness Ahl FilaliPas encore d'évaluation
- N DRC 16 152376 00542a Intercomp Modeles Ville Rue CorrigeDocument57 pagesN DRC 16 152376 00542a Intercomp Modeles Ville Rue CorrigeclaraaPas encore d'évaluation
- TD StatDocument11 pagesTD StatZozo Zozo DiagnePas encore d'évaluation
- Mi Lessons06 Stat Inferentielle PDFDocument131 pagesMi Lessons06 Stat Inferentielle PDFEstelle MelonoPas encore d'évaluation
- TDEconométrieDocument7 pagesTDEconométrieSalmane AbadanePas encore d'évaluation
- StatistiquesDocument87 pagesStatistiquesA.BenhariPas encore d'évaluation
- Talay 1Document8 pagesTalay 1Mohamed CHARIFPas encore d'évaluation
- StatistiqueDocument143 pagesStatistiqueImad Hakkache100% (1)
- Inferene 3Document52 pagesInferene 3anasPas encore d'évaluation
- Inferene 4Document39 pagesInferene 4anasPas encore d'évaluation
- Plan D'échantillonnageDocument26 pagesPlan D'échantillonnageHamza ElmouhtadiPas encore d'évaluation
- Conditionnement Du Signal-3 PDFDocument189 pagesConditionnement Du Signal-3 PDFTaki BenazzouzPas encore d'évaluation
- ANOVA 1F 2F Hierarchique PDFDocument158 pagesANOVA 1F 2F Hierarchique PDFmedaliPas encore d'évaluation
- 91F0015MPF FRDocument72 pages91F0015MPF FRMavoungouPas encore d'évaluation
- Estimation EchantillonnageDocument37 pagesEstimation EchantillonnageLmehdi Ozil100% (3)
- 7 - Incertitude de MesureDocument14 pages7 - Incertitude de MesureBarbaraPas encore d'évaluation
- ProbStat - Fiche.TD.01 StatistiqueDescriptiveDocument4 pagesProbStat - Fiche.TD.01 StatistiqueDescriptiveDorian GreyPas encore d'évaluation
- HA0809 CorrigeDocument3 pagesHA0809 Corrigesidiabdelli_83761508Pas encore d'évaluation
- Analyse Factorielle TexteDocument31 pagesAnalyse Factorielle TexteSimozer CesarsimozerPas encore d'évaluation
- Exercices Stat InferentielleDocument11 pagesExercices Stat InferentiellesjaubertPas encore d'évaluation
- Methode Statistique Pour L'ingénieurDocument115 pagesMethode Statistique Pour L'ingénieurLemrozi ElmahdiPas encore d'évaluation