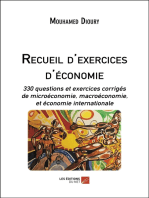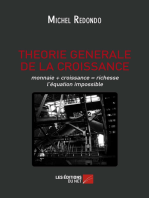Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Economie Publique Questions Examen
Economie Publique Questions Examen
Transféré par
interactif tchatcheuTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Economie Publique Questions Examen
Economie Publique Questions Examen
Transféré par
interactif tchatcheuDroits d'auteur :
Formats disponibles
Économie publique
Questions d'examen Licence 2 - Economie et gestion
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 1
1- La part de la dépense publique dans le PIB : tendances historiques
2- Facteurs d’explication
Introduction
Les dépenses publiques sont l’ensemble des dépenses réalisées par les
administrations publiques. Leur financement est assuré par les recettes
publiques (impôts, taxes, et cotisations sociales) et par le déficit public. Elles
englobent :
• les dépenses de fonctionnement des services publics : salaires des
fonctionnaires, entretien des bâtiments, etc.
• la fourniture de services publics (comme l’hospitalisation ou
l’enseignement…)
• les dépenses d’investissement : construction de bâtiments et
d’infrastructures (hôpitaux publics, bibliothèques, routes, etc…).
La part de leur dépense dans la richesse d’un pays est révélateur d’une
bonne santé économique, à l’instar des USA, 1er puissance mondiale, qui
connait une dette supérieure à la croissance de son PIB. Toutefois, celle-ci
peut aussi révéler de grandes difficultés financières et économiques, en citant
le cas Grecque, obligé d’assainir ses dépenses publiques pour éviter la faillite.
Connaitre l’évolution de la dépense publique est primordiale pour
comprendre et analyser la situation économique d’un pays.
La part de la dépense publique représente en moyenne 1/3 du PIB voir ½
selon les pays.
Données principales et grandes évolutions de la finance publique
On assiste à une croissance très importante des dettes. Prend une part de +
en + importante dans la richesse des pays. Historique : on peut distinguer 3
phases
- 1870-1914 : « plateau » des dépenses publiques des pays dvpés. Dep
pu de 10% env
- 1914-1945 : phase ascentionnelle abrupte
- 1945-1980 : l’expanssion se prolonge. Mais existe un certain désordre
vers les années 80 lié aux difficultés de l’Etat providence.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 2
Part de la dépense publique dans le PIB, 1870-1996
Depuis, la croissance de la dette continue. On peut noter des différences
entre les pays.
En effet la part des dépenses pu pour les pays européens sont >40%, 30% pour
les USA et le Jap. On assiste à un relatif tassement de la croissance de la
dette et une évolution différente selon les pays. Mais il n’y a pas d’arret
complet.
Part de la dépense publique dans le PIB, 1970-2002
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 3
2. Plusieurs facteurs d’explication
1870-1914 :
1914-1945 : effort de guerre
1945-1980 : le ralentissement de la croissance, l’apparition du chômage de
masse et la hausse de la dette publique ont mécaniquement accru la part
dans le PIB des dépenses liées à l’indemnisation du chômage, au soutien de
l’emploi et aux intérêts de la dette.
En outre, les politiques d’inspiration keynésienne, consistant à moduler le
niveau des dépenses publiques pour agir sur la conjoncture, apparaissent
aujourd’hui beaucoup moins efficaces que dans les années 1960. Plusieurs
raisons peuvent expliquer cette situation :
l’ouverture croissante de notre économie, qui réduit l’effet multiplicateur d’un
surcroît de dépenses publiques sur l’économie nationale ;
la libéralisation des marchés de capitaux ;
l’importance prise par les taux d’intérêt, qui risquent d’être plus élevés avec
une hausse des dépenses et des déficits publics ;
3- La composition de la dépense publique : tendances historiques par
grand postes de dépenses
Introduction
Les dépenses publiques sont l’ensemble des dépenses réalisées par les
administrations publiques. Leur financement est assuré par les recettes
publiques (impôts, taxes, et cotisations sociales) et par le déficit public. Elles
englobent :
• les dépenses de fonctionnement des services publics : salaires des
fonctionnaires, entretien des bâtiments, etc.
• la fourniture de services publics (comme l’hospitalisation ou
l’enseignement…)
• les dépenses d’investissement : construction de bâtiments et
d’infrastructures (hôpitaux publics, bibliothèques, routes, etc…).
Chaque pays, compte tenu de différents facteurs économique ou
sociologique, répartissent la dépense publique de façon différente. Il est
nécessaire d’analyser la composition de la dépense publique pour bien
comprendre la situation économique et sociale d’un pays.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 4
Dépense publique d’éducation, de santé, de retraite… dépense
sociale, sur la ressource humaine. On remarque une faible dispersion
entre les pays. Convergence à 5/6% en 90.
Dépense de la défense (fonction régalienne) + ou _ stable sur le LT,
mais peut connaitre de fortes variations en temps de guerre. La part
budgétaire de la défense baisse continuellement depuis les années 60.
On connait actuellement des minima historiques. Les USA dépense le
plus : 6%PIB quand l’UE n’en consacre que 2%.
Dépense d’éducation. 2ème place en France 73 milliards. Tendance à la
hausse pour tous les pays industrialisés. L’Europe consacre 5% PIB. >USA.
Frce : 80% salaires enseignent, 9% équipements et 4% bourses.
Dépense de santé. Uniformité dans les pays, dans les tendances
comme dans le temps. Les dépenses pu de santé ont émergé dans les
années 30 et se sont accélérées dans les années 60. Moitié pour
prestation sociale (remboursement médicament etc.) moitié dep
hopitaux.
Les pensions de retraite. Hausse globale. Emerge à l’entre 2 guerres.
Nous pouvons dire que la croissance de la dépense publique est plus
importante que la croissance du PIB et qu’elle est principalement attribuée
aux dépenses de défense, de santé et d’éducation.
Part de la défense dans le PIB, 1890-1996 USA: part de la défense dans le
PIB, 1870-2010 Part des dep d ’éduc ds le PIB 1870-1996
USA: part des dep d’éd° ds le PIB, 1900-2010 Part des dep de santé dans le
PIB, 1900-2000 USA: part des dep de santé1870-2010
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 5
L’évolution des déficits publiques et de la dette publique française depuis
1970
Introduction
Le déficit public est la situation dans laquelle les recettes de l’État (hors
remboursement d’emprunt) sont inférieures à ses dépenses (hors emprunt) au
cours d’une année. C’est donc un solde négatif.
.Il équivaut au besoin de financement de l’État et se traduit par le montant
des emprunts nouveaux qu’il doit contracter au cours de l’année. Les lois de
finances peuvent prévoir un déficit et autoriser l’État à emprunter à hauteur
de ce besoin de financement. La France connaît un déficit budgétaire
continu depuis plus de 25 ans, qui gonfle l’encours de sa dette (montant total
des emprunts).
La dette publique quant à elle représente l’ensemble des dettes de l’Etat
résultant des emprunts que ce dernier a émis ou garantis.
L’évolution du déficit et de la dette d’un pays est révélateur d’une bonne
santé économique, à l’instar des USA, 1er puissance mondiale, qui connait
une dette supérieure à la croissance de son PIB. Toutefois, celle-ci peut aussi
révéler de grandes difficultés financières et économiques, en citant le cas
Grecque, obligé d’assainir ses dépenses publiques pour éviter la faillite.
Connaitre l’évolution des déficits et de la dette publique est primordiale pour
comprendre et analyser la situation économique d’un pays.
1- Evolution du déficit et de la dette publique
Les déficits publiques de la France apparaissent en
même temps que les chocs pétroliers.
78-80 : gouvernement de R. Barre : tentative
d’équilibre des comptes publiques, juste avant
l’arrivé de la gauche au pouvoir.
5 épisodes d’aggravation brutale suivit d’un
rétablissement de l’équilibre : 4 liés à la crise
économique :
- 1er 1974-75 : choc pétrolier -7% PIB
- 2nd 80-82 : choc pétrolier + 1er gouv socialiste (gouv Moroy => po Keyn)
déficit publique
- 3ème 92-93 : récession de 93 (recul de l’activité pdt plus de 6mois). -
1,2%PIB
- 4ème 2001-2002 : crise après 9/11
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 6
Dette publique78 : trend de croissance régulière de
la dette. 78 : 20%. 08 : 80%. Maximum local à la fin
des années 90 à 60%. Puis ↘↗ mais – vite que le PIB.
Gouv Jospin a fait ↘ la dette.
Déficit et dette public en France : 2008-2009
France >moy UE 25
mais <moy zone euro. Dette pu 09 : 78% UE : 79%
Forte dispersion des situations nationales. Suède : 40% Belgique 100% grèce
Italie 115%
Frce : très forte augmentation de l’évolution de la dette.
Pic 2005 : 66,4%. Creux 2006 : 63,7%. 2012 : 87,4%
2- Les facteurs explicatifs
• Selon les économistes, le déficit budgétaire peut jouer différents rôles. Pour
John Maynard Keynes, il peut stimuler la croissance et l’emploi dans une
économie en récession. En revanche, les libéraux insistent sur les effets
néfastes de l’accroissement de la dette publique Ensemble des dettes de
l’Etat résultant des emprunts que ce dernier a émis ou garantis.
L’histoire au début des années 60 donnera raison au courant keynésianisme,
qui incite les Etats à s’endetter pour relancer l’activité économique.
D’autant que la France assiste dans les années 79 à un ralentissement de la
croissance, l’apparition du chômage de masse qui a fortement augmenté la
dette publique. L’Etat de devait d’assurer l’indemnisation du chômage, de
soutenir l’emploi et respecter les intérêts de la dette.
En outre, les politiques expansionnistes, consistant à moduler le niveau des
dépenses publiques pour agir sur la conjoncture, apparaissent aujourd’hui
beaucoup moins efficaces que dans les années 1960. Plusieurs raisons
peuvent expliquer cette situation :
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 7
l’ouverture croissante de notre économie, qui réduit l’effet multiplicateur d’un
surcroît de dépenses publiques sur l’économie nationale ;
la libéralisation des marchés de capitaux ;
l’importance prise par les taux d’intérêt, qui risquent d’être plus élevés avec
une hausse des dépenses et des déficits publics ;
4- La dette publique depuis 2000 : comparaison des évolutions francaises,
allemande et américaine.
La dette publique est, dans le domaine des finances publiques, l'ensemble
des engagements financiers pris sous formes d'emprunts par l'État, les
collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement
(certaines entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, etc.). Elle
est le produit de l'accumulation des besoins de financement passés des
administrations publiques, résultant des différences entre les produits (les
recettes fiscales, en particulier) et les charges (notamment les dépenses
budgétaires) de ces administrations. La dette augmente donc à chaque fois
qu'un déficit public est financé par emprunt
L’appartenance de la France et de l’Allemagne à l’Union économique et
monétaire européenne, depuis 1999, lie leur destin économique à celui des
autres nations européennes, et nécessite le respect de critères définis par le
traité de Maastricht, dont notamment un déficit public sous les 3 % du PIB et
une dette publique inférieure à 60 % du PIB.
Depuis 2000, la dette publique en pourcentage de PIB augmente, la France
se situe en terme de dette publique un peu au-dessus, mais un peu au
dessous de la moyenne en zone euro. La dette publique de France
represente 78% du PIB en 2009, 74% pour l’UE et 78,7 pour la zone euro.
France : La dette publique française se situe un peu en deçà du niveau
moyen de dette des pays de la zone euro (69,6 % en 2006)86, mais est
supérieure au niveau moyen de l’UE-27 (61,7 %)87. Son profil temporel est plus
inquiétant que celui des autres pays européens88. Au sein de la zone euro, la
dette publique est passée de 69,6 % du PIB en 200089 à 68,6 % en 2006, soit un
point de moins87. Sur la même période, en France, la dette publique est
passée de 57,3 % à 64,2 % soit 7 points de plus90.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 8
La dette prend le plus souvent la forme d'emprunts d'État, quoique les pays
les moins fiables au regard des marchés financiers puissent avoir recours aux
banques commerciales ou à des institutions internationales (Banque
mondiale, Fonds monétaire international, Banques régionales de
développement).
Au sein de la dette publique, on distingue la dette publique intérieure,
détenue par les agents économiques résidents de l'État émetteur et la dette
publique extérieure, détenue par des prêteurs étrangers. On distingue
également la dette de court terme (un an ou moins), à moyen terme (jusqu'à
dix ans) et à long terme (au-delà de dix ans).
Actuellement on se trouve dans une situation de forte dispersion (Belgique :
96,7%, Grèce : 115%, Italie : 115,7%, Suède : 47% du PIB).
Il y a un premier pic en 2005 à 66.4 points de PIB, un creux en 2006 à 64 points
de PIB et un pic prévu en 2012 à 87.4 points de PIB.
Dette publique en % PIB: comparaison internationale, 1977-2008
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 9
Si on compare avec des autres pays on voit une convergence. Les situations
sont assez différentes au début, mais à la fin on voit que toutes les courbes se
rejoignent. La Dette publique a un pourcentage du PIB aux USA de 120%. On
observe la même situation en 1945, la dette publique était égale aussi à
120%.
5. Les principes de justice de John Rawls
Introduction
Les économistes libéraux ont un paradoxe difficile à résoudre : d'une part ils
affirment que seul le marché de concurrence pure et parfaite assure
l'allocation optimale des ressources et d'autre part ils sont bien obligés de
constater que l'État intervient de plus en plus qu'il fournit des services
indispensables à la population et des services que le marché ne pourrait pas
fournir. D'où la nécessité pour ces adeptes du marché de faire une théorie de
l'État, théorie qui ne remette pourtant pas en cause la suprématie du
marché. C’est dans cet esprit que s’inscrit le principe de justice de John Rawls
La Théorie de la justice est un ouvrage de philosophie politique et morale du
philosophe américain John Rawls (1921-2002). Selon lui, un accord social sur
la conception de la justice est une condition
préalable indispensable à l’existence de toute société humaine. Toute
société, même lorsqu’elle recherche l’avantage mutuel, se caractérise à la
fois par des intérêts identiques et des intérêts conflictuels. C’est pour cela qu’il
est nécessaire de définir les principes de la justice sociale.
Dans son livre, Rawls veut résoudre le problème de la justice distributive en
critiquant l'utilitarisme. Il nomme la théorie qui en résulte Justice as Fairness, et
en tire ses deux principes de base de la justice : le principe de liberté et le
principe de différence.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 10
Cette théorie s’appuie sur 2 hypothèses : Les individus ignorent leur caractère
réel. Celui-ci n’a donc aucune influence. C’est le « voile d’ignorance ». En
effet, si un individu ne sait pas quelles sont ses chances dans sa propre
société, il est probable qu'il ne va pas accorder de privilèges à une classe
quelconque d'individus, mais concevoir un système de justice qui traite
chacun équitablement.
La 2 hypo est que la justice est issue d’un contrat. C’est une théorie du
nd
contrat social.
Le premier but que veut atteindre Rawls dans son livre est d’expliquer
comment et dans quelles circonstances les citoyens sont obligés de respecter
les lois, qui sont promulguées par l'État. Il énonce ainsi ses deux premiers
principes de justice:
1. Le principe d’efficacité
Chaque personne a un droit égal à la liberté fondamentale complète
compatible avec une liberté fondamentale identique pour les autres
2. Le principe de différence
les inégalités économiques et sociales doivent être agencées telles que
- On puisse raisonnablement estimer que leur existence bénéficie à tous
- Elles soient attachées à des positions/emplois accessibles à tous
Cette théorie est donc une critique de l'utilitarisme pour lequel les droits
fondamentaux sont subordonnés au principe de l'utilité sociale et qui légitime
donc la restriction des libertés individuelles au nom de l'efficience
économique (ou de la croissance). De plus pour Rawls la justice sociale
provient d’un contrat, tandis que l’utilitariste considère qu’elle est construite à
partir d’un « spectateur impartial »
Ces 2 théories ont toutefois des points communs : soucis d’impartialité et de
rationalité.
Les biens primaires pris en compte par Rawls sont : la liberté fondamentale, la
position d’autorité et de responsabilité, le revenu et la richesse.
Condition pour que l’inégalité soit juste : égalité des chances, égalité
d’accès et bénéficie à tous.
Pour Rawls, une société est considérée comme juste si elle assure une
répartition des biens primaires qui max l’allocation des moins bien lotis sous
cond : liberté fond max.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 11
6. La Loi de Wagner
Introduction
Les économistes libéraux ont un paradoxe difficile à résoudre : d'une part ils
affirment que seul le marché de concurrence pure et parfaite assure
l'allocation optimale des ressources et d'autre part ils sont bien obligés de
constater que l'État intervient de plus en plus qu'il fournit des services
indispensables à la population et des services que le marché ne pourrait pas
fournir. D'où la nécessité pour ces adeptes du marché de faire une théorie de
l'État, théorie qui ne remette pourtant pas en cause la suprématie du
marché. C’est dans cet esprit que s’inscrit la loi de Wagner.
Analyse positives de la croissance du secteur public
Il existe 2 manières d’analyser le secteur :
Analyse normative : notion de bonne façon de gouverner (notion d’équité et
d’efficacité sont les critères de bonne pratique gouvernementale).
Analyse positive son objet est de décrire le secteur publique tel qu’il est.
Cette analyse n’est pas opposé au normatif. Va chercher à identifier les
déterminants de l’action pu qui opèrent de la même manière en lieu et en
temps différents.
Adolf Wagner (1835-1917) était un économiste allemand réformiste et
favorable à une politique sociale. Il a décrit une tendance qui se développait
sous ses yeux et a voulu en faire une loi selon laquelle, sur le long terme, les
dépenses publiques augmentent davantage que la production nationale.
Cela résulte que le développement économique, en s’accroissant, devient
de plus en plus complexe : complication accru de l’organisation sociale
(spécialisation plus poussée, division du L) mais aussi complexification du droit,
un accroissement de l’urbanisation etc. Ceci implique des investissements
lourds, non rentables à court terme et qui nécessitent un financement public
qui doit entrainer une implication plus grande des pouvoirs publics
(administration, protection, législation, éducation, action sociale).
De plus, la poursuite de l’industrialisation entraîne d’importantes mutations
technologiques et des investissements lourds que seul l’Etat est en mesure de
réaliser.
Dans une moindre mesure, l’accroissement de l’urbanisation faisant émerger
un certain nombre de problèmes comme l’entretient, la sécurité etc. favorise
une intervention étatique.
Enfin, plus le niveau de vie de la population augmente, plus celle-ci accroît
sa consommation de biens dits supérieurs, comme les loisirs, la culture,
l’éducation, la santé… qui sont des biens dont l'élasticité-revenu est
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 12
supérieure à 1. En d’autres termes, la consommation de ces biens augmente
plus vite que le revenu de la population.
Taux 1300 1800 1950 2003 2030
d’urbanisation
France 8% 12% 48% 76,7%
Europe 10% 12% 51% 73%
USA 5% 57% 80%
Pays dvpés 52,5% 75% 81,7%
PVD 17,9% 40% 57%
Monde 29,9% 50% 60% Dette
publique
7. La loi de Baumol
Introduction
Les économistes libéraux ont un paradoxe difficile à résoudre : d'une part ils
affirment que seul le marché de concurrence pure et parfaite assure
l'allocation optimale des ressources et d'autre part ils sont bien obligés de
constater que l'État intervient de plus en plus qu'il fournit des services
indispensables à la population et des services que le marché ne pourrait pas
fournir. D'où la nécessité pour ces adeptes du marché de faire une théorie de
l'État, théorie qui ne remette pourtant pas en cause la suprématie du
marché. C’est dans cet esprit que s’inscrit la loi de Baumol.
La théorie se propose de dénouer le problème du financement public de
l'industrie du spectacle vivant.
En 1665, Baumol souhaitent expliquer les raisons pour lesquelles les salles de
spectacles de Broadway connaissent une augmentation croissante de leurs
coûts d'exploitation, de leur non-profitabilité chronique et d’une raréfaction
de leur public.
Selon cette loi, le bien culturel spectacle se développe dans un "secteur
archaïque" caractérisé par la stagnation de l'innovation technologique. Dès
lors, les gains de productivité sont quasi-inexistants (productivity lag). Le
facteur travail prédomine alors et reste incompressible (on ne peut par
exemple retirer les ténors dans un opéra). De plus, les salaires de l'industrie du
spectacle ont tendance à s'aligner sur les autres secteurs. Les coûts de
production s'élèvent dans les mêmes proportions. Les recettes quant à elles
croissent moins rapidement (earnings gap), engendrant des tensions
inflationnistes. Cette caractéristique est connue sous le nom de "maladie des
coûts"(Cost disease).
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 13
L'endiguement de cette dynamique est difficile car les économies d'échelle y
sont difficiles à réaliser. En effet, le nombre de représentations est limité. Le
prix de la place de spectacle est fixé avant le lancement. La fréquentation
(demande) est inélastique à la marge, la qualité étant prépondérante dans
une fourchette de prix raisonnable dans le choix. L'unique marge de
manœuvre reste l'augmentation qualitative.
Le public recherche toujours des spectacles plus audacieux, donc coûteux.
Les prix des billets sont toujours de plus en plus élevés, ne permettant pas de
séduire de nouveaux clients et risquant dans le pire des cas d'essouffler la
demande existante. Les producteurs du marché spectacle vivant sont alors
confrontés à un Manque chronique de liquidités (fonds propres)
Pour les pouvoirs publics se pose un dilemme : soit ils financent des spectacles
toujours plus coûteux, soit ils laissent de nombreux acteurs sortir du marché en
paupérisant l'offre. Baumol conclut au besoin de financements externes,
mécénat, fonds publics, prélevés auprès des secteurs modernes. D’où
l’accroissement des dépenses publiques.
Baumol admet une extension de sa loi qui explique l’augmentation des
dépenses publiques. En effet ce dernier, tout comme le spectacle vivant,
admet une fonction de production plus intensive au travail qu’en capital par
rapport au secteur privé et serait moins apte à réaliser des gains de
productivité de travail. On sait que la concurrence sur le marché du travail
permet d’égaliser les salaires du secteur. Or les gains de productivité du
secteur privé tire vers le haut la rémunération du travail dans ce secteur
d’activité. Donc, par le biais de l’égalisation des salaires du secteur privé et
public, les coûts de production du secteur publique augmentent à un niveau
de production donné.
On en conclut qu’à un niveau de production constant, la part des dépenses
publiques dans le PIB augmente.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 14
Le modèle d’équilibre bureaucratique : hypothèses comportementales,
conséquences
Introduction
Les économistes libéraux ont un paradoxe difficile à résoudre : d'une part ils
affirment que seul le marché de concurrence pure et parfaite assure
l'allocation optimale des ressources et d'autre part ils sont bien obligés de
constater que l'État intervient de plus en plus qu'il fournit des services
indispensables à la population et des services que le marché ne pourrait pas
fournir. D'où la nécessité pour ces adeptes du marché de faire une théorie de
l'État, théorie qui ne remette pourtant pas en cause la suprématie du
marché. C’est dans cet esprit que s’inscrit le modèle d’équilibre
bureaucratique, qui tente d’expliquer le comportement des administrations.
Cadre du modèle
- Le fonctionnaire est l’acteur principal.
- Unité de décision : « bureau » soit l’ensemble des fonctionnaires, qui
agit comme un agent rationnel.
- Y : P° de service du bureau
- Enveloppe budgétaire : B(y), fonction croissante et concave (B↗ - vite
que la P°)
Interprétation
L’évaluation (en termes monétaire) se fait en fonction de la production
du bureau (suivant les différents coûts de P°). Evaluation analogue à
celle d’une entreprise (π/C). La valeur créée n’est pas marchande,
mais dite sociale dans le cas d’une administration.
On suppose que le bureau a un certain pouvoir de décision portant sur
la P° y. Le bureau est comme une E : doit Max le CA B(y) (avantage
matériel, moral ou stratégique) sous contrainte technique (fonction de
cout)
Programme : {
On résout le programme. On trouve : B(y)+λ[B(y)-C(y)]. On suppose B(0)=C(0)
= 0 et B’(0)>C’(0)
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 15
B(y) C(y) C(y)
B(y)
solution
Y* Y
B(y)>C(y) B(y)<C(y)
Solution calculée : B’+λ(B’-C’)=0
B(y*)= C’(y*) avec λ>0
En particulier B’(y*)<C’(y*) : le budget est inférieur au Cm à l’optimum
bureaucratique y*.
Corollaire : le bureau dépense la totalité du budget B(y*)=C(y*). Le
comportement est-il socialement efficace ? non car l’A° produit trop.
Supposons en effet que le gouvernement soit capable d’évaluer
correctement (en €) la valeur sociale de y. La valeur sociale nette de y est
donc : B(y)-C(y). Un critère d’optimalité sociale naturel, pour décider de
l’efficacité de y est B(y)-C(y).
Rq : On peut donner une formulation précise à cet énoncé, en le déduisant
de l’efficacité parétienne.
On résout : Max B(y)-C(y)
CPO : B’(y**)=C’(y**)
Y**<y* : surproduction du bureau
Relativement à l’opt social
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 16
L’équilibre et l’optimum : représentation dans une boite d’Edgeworth
Le cadre d’analyse
Avant d’aborder le concept d’équilibre général, nous devons définir le cadre
dans lequel nous nous situons : celui de la concurrence parfaite. Les marchés
sont en concurrence parfaite lorsque les plans de consommation et de
production sont établis par un grand nombre d’agents de petite taille sur
lesquels ne pèse à l’équilibre aucune contrainte en quantité. La production
ou la consommation d’un agent n’influence pas l’utilité ou le profit des autres
agents. Cette définition permet de faire émerger quelques propriétés :
La faible importance relative de chaque consommateur ne permet pas la
possibilité d’une action individuelle sur les prix. Ces derniers sont considérés
comme des paramètres donnés aux agents. Ils constituent les seuls signaux
(information) dont ces agents ont besoin pour établir leurs plan de production
ou de consommation. On dit que ces derniers sont price taker, ou preneur de
prix.
Les biens sont homogènes, les agents sont parfaitement informés des prix et
de la qualité des produits.
Equilibre et optimum dans une économie publique
Dans une économie idéale, il faut préciser que
- les dépenses de consommation expriment les attentes, les besoins et
les préférences des consommateurs. Ce sont des valeurs
informationnelles.
- Ces dépensent financent la production
- Les prix de marché qui équilibrent l’offre et la demande sont de juste
prix (il n’y a pas de positions dominantes)
- Les transactions sont contractuelles (libre consentement)
L’ensemble de ces critères énonce que l’équilibre est efficace au sens de
Pareto.
Les conditions de fonctionnement de l’économie publique sont à préciser :
- Les prestations de service de l’administration ne sont pas payés par les
usagés (prix non marchands)
- La production de ces services est financée par les impôts.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 17
Représentation de l’équilibre dans la boite d’Edgeworth :
w Individu 2 w
W12+w22=1
X
*
Individu 1
W11+w12=1
x* max U s.c. p*xi*<p*w*
Le problème lié à l’information
Le planificateur affronte quatre problèmes cruciaux.
1) Le problème de la connaissance. Les informations sur les préférences et les
ressources ne sont pas disponibles ex nihilo. Il lui faut faire en sorte de les
obtenir.
2) Le problème des incitations. Il doit inciter les parties prenantes à révéler des
informations qu'ils n'ont peut-être pas intérêt à transmettre. Il doit aussi
contrôler le processus de coordination des plans individuels et être incité à le
faire.
3) Le problème du calcul. Dans un monde ouvert à toutes les finalités et en
constante évolution, il lui faut constamment modifier les paramètres qui lui
permettent de faire un calcul. Par ailleurs, dans un monde sans droit de
propriété, il est impossible de faire un calcul de coût d'opportunité.
4) Le problème du pouvoir. L'usage de la coercition dans la coordination des
actions individuelles donne un pouvoir à celui qui le détient. Ce pouvoir de
coercition est une source de rente qui le pousse à développer la coercition
dans le but de maximiser la rente qu'il peut s'approprier et non dans le but de
coordonner les actions individuelles.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 18
La solution naturelle possible se trouve donc par tâtonnement. Le
commissaire-priseur résout empiriquement le problème en augmentant
progressivement les prix des biens en excès de demande et en baissant ceux
en excès d’offre.
Les biens publics : caractérisation, exemples
La défense nationale est un service de protection rendu à l’ensemble de la
communauté. On ne peut pas individualiser la C° de la défense, ainsi que la
P°. On a donc un problème de rentabilité.
Typologie des biens publics, privé, de club, ressource commune
Définition biens ou service : les biens au sens étroit sont principalement des
objets. On peut donc les dénombrer physiquement. Par opposition, els
services sont à caractère immatériel et on les mesure en temps de travail.
Les B&S auquel on s’intéresse où l’on peut attacher une valeur monétaire
(cout de P°…) et parce qu’ils sont nécessaires à la Production d’autres biens
qui ont une valeur de ce type.
2 critères :
- Possibilité d’exclure ou non une personne de l’utilisation de la ressource
(possibilité technique ou légale)
Ex : défense : on ne peut pas exclure la défense d’une personne
Pain : une pers ne peut pas la consommée si elle n’est pas payée (droit de
propriété)
Péages routiers ; on subordonne l’accès des routes.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 19
G2
- Possibilité ou non d’une utilisation collective de la ressource. Si aucune
utilisation n’est possible, alors il y a
- une rivalité entre les utilisateurs. Dans le cas contraire, il y a non rivalité.
Défense : non rivalité
Pain : rivalité complète
Péage : collectif partiel
possible Impossible
Exclusion
Rivalité
Oui Bien privé (pur) Ressource
commune
(pêcheur)
non Bien de club Bien privé (pur)
Equilibre dans les interactions de la dette publique: sens on agit et réagit,
personne ne souhaite changer sa décision, stabilité dans les intérêts=>
(g1*,g2*) tel que gi* maximise ui(wi-gi,gi+gj*) pour tout i.
Résolution graphique de max u1(w1-g1,g1+g2): on représente la carte
d’indifférence de l’individu 1 dans le plan (g1,g2)
Utilité croissante g2 g1(g2) w
On note gi(gj) la contribution optimale de i étant donné gj
= fonction de réaction de i (aux décisions de j)
Idem pour individus 2 mais dans l’autre sens. G2
Sous Efficacité de l’équilibre=> sous production par G1
rapport au critère de Pareto, il est possible d’augmenter le bien être des 2
individus
simultanément en augmentant de façon appropriée la
production de bien public)
Graph: plan (g1,g2) individus 1 individus 2
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 20
g1,g2 réalisables unanimement préféré à (g1*,g2*), supposant g1>g1* et
g2>g2*
Unité croissante individu 1 ou 2
Equilibre
Les biens publics peuvent être fournis par les contributions des
consommateurs individuels par le gouvernement ou par une combinaison
des deux.
Dans la pratique, comme organisme de bienfaisance dons indiquent,
certains biens publics sont habituellement fournis par une combinaison de les
deux méthodes.
L'accent est désormais mis sur ce qui se passe dans le cas limite
alors que seulement les particuliers contribuent. Considérons une économie
qui a 2 consommateurs qui ont chacun des revenus et M1 M2. Ce revenu doit
être réparti entre les achats du bien privé unique, qui a prix de 1, et les
contributions au bien public.
Chaque ménage a un fonction d'utilité
Uh = Uh (xh,g) Uh = Uh (xh,G) , h = 1, 2,
où xh est la quantité de bien privé consommé, G = ∑ gh représente la
contribution de h.
P2
h=1
. En utilisant la contrainte M1 = x1 + g1 budget, l'utilité de
consommateurs 1 peut être écrite comme suit
U1 ¡
x1, G
¢
= U1 ¡
M1 - g1, g1 + g2 ¢
, (8,2)
et de même pour 2. Ménage 1 g1 choisit de maximiser (8,2) donnée g2 alors
que 2
choisit g2 g1 donnée.
Courbes d'indifférence des fonctions d'utilité ne peut être tirée en
¡
G1, G2
¢
espace.
L'augmentation de g2 conduira toujours à un niveau plus élevé possible de
U1 pour g1 donné. L'
courbes d'indifférence et la contrainte budgétaire pour le consommateur 1
sont établies dans la figure
8.2.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 21
Depuis ménage 1 prend la fourniture de 2 comme indiqué lors de leur choix,
le choix optimal de g1 g2 pour une valeur donnée * se produit à la tangence
de courbe d'indifférence et de la ligne horizontale au g2 *. C'est ce que
montre la figure 8.2.
Varier le niveau de g2 traces * le choix optimal de g1 proposée par le solide
locus. Ce lieu est connu comme la courbe de réaction Nash.
Cette construction peut être répété pour le consommateur 2 et conduit à la
figure 8.3.
L'équilibre se pose lorsque la paire de choix sont mutuellement cohérents et
ni consommateur a tout intérêt à modifier leur choix. Cela ne peut se
au point où la réaction courbes se croisent. L'équilibre est illustré dans
Figure 8.4 dans laquelle les fonctions de réaction sont simultanément remplies
à leur intersection.
Les propriétés de bien-être de cet équilibre sont faciles à décrire. De la
construction des fonctions de réaction, il s'ensuit que, à l'équilibre, le courbe
d'indifférence de 1 est horizontale et que de 2 est vertical. C'est ce que
montre dans la Figure 8.5. Il peut être vu de ce que, si les consommateurs en
même temps augmenter leurs contributions, le bien-être des deux va
augmenter. L'offre privée l’équilibre n’est donc pas efficace. L'ensemble des
améliorations de Pareto sont représentés par la zone ombragée.
Pas d'autres améliorations peuvent être faites lorsque les courbes
d'indifférence sont tangentes. Le lieu des allocations est également efficace
le montre la figure 8.5.
Cette analyse a montré comment les contributions privées sont déterminés. L'
l'équilibre n'est pas l'amélioration de Pareto efficace et locales dans le bien-
être peuvent être réalisé par une augmentation de la provision de biens
publics. Par conséquent, par rapport de Pareto allocations préféré, l'équilibre
offre privée conduit à une pénurie de biens publics. Pourquoi est-ce le cas?
La réponse peut être attribuée le free-riding qui a lieu. Le principe du free-
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 22
riding, c'est que chaque ménage se fonde sur l'autre de fournir à fournir le
bien public.
Chaque souhaite bénéficier de la disposition de l'autre et d'éviter ainsi la
nécessité de fournir eux-mêmes. Comme les deux tentent de free-ride de
cette manière, les deux ont une incitation à reposant en partie sur l'autre pour
fournir et trop peu
En l'absence d'intervention des pouvoirs publics, la fourniture du bien public
sera laissé pour les contributions privées des ménages. Le modèle de base de
l'offre privée que nous avons décrit est construit sur l'hypothèse d'un
comportement Nash avec chaque consommateurs de prendre la décision
d'autres comme une donnée. Le parasitisme a lieu et le résultant d'équilibre
est inefficace.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 23
II. Externalités
Définition
Par définition, lorsque quelqu'un use d'une ressource, d'un bien ou d'un
service, il supporte des coûts d'opportunité du fait même de son action. S'il
supporte ces coûts, c'est qu'il en espère des bénéfices. Habituellement on fait
l'hypothèse qu'il est le seul à supporter les coûts de ses actions et le seul à en
bénéficier.
Cependant il peut volontairement ou non faire supporter les coûts de
ses actions sur des tiers non consentants, les économistes parlent alors
d'externalités négatives. Quand une usine pollue et endommage la
qualité de vie de ses voisins, elle fait supporter une fraction du
coût de sa production sur des tiers non consentants. Si elle avait dû préserver
la qualité de cet environnement, elle aurait dû consacrer des ressources pour
éviter de polluer.
A l'opposé, lorsque l'individu supporte les coûts d'une action et que les autres
en tirent les bénéfices, les économistes parlent d'externalités positives !
Qui profite des gains de vos actions ?
Vous Les autres
Qui supportent Vous Bien privé Externalité
les couts de vos positive
actions ?
Les autres Externalité Bien collectif
négative
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 24
Nous pouvons de même distinguer les externalités pécuniaires et non
pécuniaires
Externalité pécuniaires si la relation d’interdépendance est véhiculée
seulement par les prix de marchés i.e. les décisions d’un agent ont de
l’influence sur les décisions d’autres agents a cause des prix du marché.
Externalité non pécuniaire elles sont associées au problème d’efficacité.
De même, nous pouvons distinguer les externalités de P° (lorsque
l’interdépendance affecte sur les profits) et externalités de
consommation (affecte l'utilité).
B/ Externalités non pécuniaires et inefficacité: illustration par un modèle
d’externalités de consommation
Le Modèle
- 2 consommateurs, 2 biens de consommation
- xij: consommation du bien j par l’individu i.
- Un externalité de consommation passe par les préférences des agents.
- Le bien 2 génère des externalités de consommation, qui peuvent être
négative (tabac) ou positive (ravalement de façade d’un immeuble).
- Fonction d’utilité de i:
Ui(xi1,xi2,xj2)=xi1/ui(xi2)+vi(xj2) externalités j≠i u’i>0 et ui’’<0
v’i > 0 si externalité positive
< 0 si externalité négative
- Le bien 1 n’est pas produit. On note wi1 la dotation de i en bien 1. Le bien 1
est le numéraire: p1=1
- Le bien 2 est produit, à partir du bien 1 (input: bien 1) par une entreprise
travaillant dans les conditions de la concurrence parfaite, avec rendement
d’échelle constant. Le prix d’équilibre du bien 2 est donc p2=p1=1 => Profit
nul à l’équilibre.
Détermination de l’équilibre de concurrence parfaite
- Calcul des demandes des consommateurs:
Max xi1+ui(xi2)+vi(xj2) s.c. xi1+xi2 ≤ wi1
λi : multiplicateur (utilité marginale de la richesse de i)
CPO: 1=λi (quasi linéarité) u’i(xi2)=1 xi2=(u’i)-1 (1)
u’i (xi2)=λi => xi1+xi2=wi => xi1=wi- (u’i)-1 (1)
xi1+xi2=wi
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 25
- On rappelle que les optima de Pareto sont obtenus en maximisant
µ1u1+µ2u2, avec des coefficients de pondération µ1 et µ2 ≥ 0 (l’un au moins
>0), sous les contraintes de ressources et contraintes techniques de
l’économie. Les pondérations µ1 et µ2 sont égaux à l’optimum aux inverses
des utilités marginales de la richesse.
- Quasi linéarité des utilités => utilité marginale de la richesse constante,
coefficients de pondérations =1, pour les 2 individus.
- On obtient donc, ici, les optima de Pareto en maximisant U1+U2 sous les
contraintes de ressource globale et contraintes techniques.
- Cas particulier d’un équilibre général marshallien: utilités quasi-linéaires +
rendements d’échelles constants.
- Contraintes:
De ressources globales bien 1: x11+x21 ≤ w11+w21
De ressources globales bien 2: x12 +x22 ≤ y où y= production de
bien 2.
Techniques: fonction de production de bien 2: y=z où z est la
quantité de bien 1 utilisé comme input
=> x11+x21+x12+x22 ≤ w11+ w22 En synthétisant les 3 contraintes en une
seule
- Optima de Pareto
Max u1( x11,x12,x22) + U2(x21,x22,x12) s.c. x11+x21+x12+x22 ≤ w11+ w21
On note ∂ le multiplicateur associé à la contrainte interprété comme
l’utilité marginale sociale de la richesse.
CPO: u’1(x12) + v’2(x12) = ∂ =1 externalité causée par x12
u’2(x22)+ v’1(x22) = ∂ externalité causée par x22
x11+x21+x12+x22 = w11+w21
- Différences entre CPO équilibre et optimum équilibre:
u’1(x12)=u’2(x22)p2=1
Optimum: u’1(x12)+v’2(x12)=u’2(x22)+v’1(x22) = ∂ =1
Calcul des optima de Pareto tient compte des effets externes, de façon plus
précise, la valeur sociale de la consommation (du bien 2 en
particulier) mesuré par ∂, incorpore les effets externes dans son calcul, alors
que le prix de marché n’en tient pas compte, il est entièrement déterminé
par la technique ==> Divergence entre l’allocation optimal et celle de
l’équilibre.
Si l’externalité est < 0 (tabac), v’2 (x12) et v’1(x22)<0, et les CPO de
l’optimum de Pareto impliquent alors u’1(x12) > 1 et u’2(x22) >1, et donc
puisque u’i diminue.
x12 > (u’1)-1(1)= consommation à l’équilibre de marché x22 > (u’2)-1(1)=
consommation de tabac de 2 à l’équilibre de marché
Conclusion: on consomme trop de tabac par rapport à l’optimum de Pareto.
Si l’externalité est > 0 (ravalement de façade) on montre de la même
manière que les consommation optimales (Pareto) sont supérieures aux
consommation de l’équilibre: pas assez de bien 2 à l’équilibre.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 26
C/ Exemple d’effets externes
Pollution d’une rivière
2 entreprises le long d’une rivière. i=1,2 Production identique.
L’entreprise amont pollue la rivière avec des conséquences négatives sur la
production de l’entreprise avale (externalité de production non pécuniaire).
Technologie: 2 inputs -> travail, eau de la rivière. Eau gratuite, taux de salaire
horaire w; fonction de production entreprise 1. y1= F(L1) L1= nombre
d’heures de travail; fonction de production entreprise 2, y2=F2(L2,L1) avec
∂F2/∂L1 < 0 i.e. plus l’entreprise 1 travaille, plus elle pollue, moins l’entreprise 2
est efficace. Externalité négative de production.
F’1>0 et ∂F1/∂L2>0. On normalise le prix du produit (=1).
On étudie l’équilibre, puis l’optimum et on les compare.
Equilibre:
Entreprise 1: Max F1(L1)-wL1 CPO: F’1=W
Entreprise 2: Max F2 (L2,L1)-w’L2
CPO ∂F2/∂L2=w, à l’équilibre L1=L1*
Propriété générale: optimum de Pareto avec production -> la maximisation
de la somme des profits (calculé par rapport au système de prix associé à
l’optimum).
Calcul de l’optimum de production: Max F1(M1)-wL1+ F2(L2,L1)-wL1
CPO: F’1+ ∂F2/L1=w
∂F2/L2=w
A comparer aux CPO de l’équilibre F’=w
∂F2/∂L2= w F1(L1)
=> La valeur sociale du travail calculer à l’optimum
incorpore l’effet externe négatif du travail effectuer par L1*
l’entreprise 1 sur le profit de l’entreprise 2, ce qui n’est pas le cas à
l’équilibre.
F’1+∂F2/∂L1<F’1 ce qui implique pour un w donné, un niveau d’activité de
l’entreprise 1 < à l’optimum à ce qu’il est à l’équilibre: l’entreprise 1 produit et
pollue trop à l’équilibre.
Congestion d’un réseau routier
Problème de coordination associé à une externalité de bien public.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 27
40 min Durée
d=20+x/2 où x est la proportion de la population qui choisit
la voiture
d: durée.
40
Chaque individu fait son choix de mode de transport de 1/2 Train
façon à minimiser son temps de trajet étant donné x. La 20
valeur de x à l’équilibre non coopératif est 40%.
Si x < 40%, tout le monde a intérêt à prendre la voiture
Optimum social utilitariste: x qui minimise la somme du temps de trajet
individuel => 40(1-x)+(20+x/2).x = temps de trajet total pour la population.
On calcule x pou minimiser ce temps de trajet agrégé: CPO : -20+x=0 <=>
x=20
«Tragédie des communs»
Garett Hardin «Tragedy of commons» 1968
Surexploitation des ressources communes.
- Digression sur la «Tragedy of commons» dans l’histoire sociale de l’Angleterre
au XVIII° siècle et avant: les «enclosure»: mouvement de privatisation
progressive (appropriation privée) des prés communaux: prés appartenant
à la commune, laisser en libre accès et servant de pâture au bétail, utiles
notamment comme élément de soutient à la subsistance des habitants les
plus pauvres.
- Hardin: modèle explicatif de la sur utilisation des ressources communes. Pas
(ou peu) de rapport avec «Tragedy of commons» historique: pas de
surexploitation avérée des prix communaux dans l’épisodes historique en
question.
- Le modèle, cas d’une pêcherie: problème de surpêche des ressources
halieutiques en accès libre. Lac exploité par pêcheur d’un village situé sur
ses rives. Les pêcheurs louent leurs bateaux, à un coût journalier c constant.
On note n le nombre de bateau, on suppose que le nombre moyen de
poisson pêchés par bateau est une fonction décroissante F(x) de x (F’<0).
On suppose pour simplifier une pêche identique C=F(x) pour tous les
bateaux.
Les pêcheurs choisissent entre aller pêcher ou travailler à terre pour un
salaire fixe w.
On normalise le prix du poisson (=1). Il choisit de pêcher sui F(x) - C ≥ w.
A l’équilibre non coopératif du ‘jeu’ joué par les pêcheurs, le nombre de
bateaux se fixe au niveau n* tel que: F(x*)-C = w. On traite x comme une
variable continue. Comparaison du nombre de bateaux d’équilibre au
nombre de bateaux optimal.
L’optimum de production est le nombre de bateau qui maximise la valeur
sociale nette des activités de pêche F(x) -c - w coût d’opportunité dû au
choix de pêcher. Profit de la pêche
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 28
CPO: F(x) = c+w-xF’(x) externalité
A comparer à la condition d’équilibre: F(x) = c+w F’<0 => c+w-xF’(x) >
c+w => nombre de bateau plus grand à l’équilibre qu’à l’optimum:
surpêche à l’équilibre non coopératif (les prix de marché ne prennent pas
en compte l’externalité induite par l’augmentation n).
Solution théoriques envisageables, 2:
- taxation optimale imposer une taxe aux loueur de bateaux égale à
l’externalité taxe=t= -xF’(x) prix de location devient c-xF’(x) Condition
d’équilibre devient: F(x) -( c - xF’(x))=w <=> F(x)=
c+w-xF’(x). L’équilibre et l’optimum coïncident. L’impôt est utilisé pour
corriger les déficiences du système du prix de marché.
- Quotas: on fixe autoritairement le nombre de bateau autorisés à
pêcher, niveau de l’optimum social.
D/ Exterrnalités et politiques publiques
Les prix de marché sont faux il s’agit de les rendre juste.
- On intervient directement sur l’allocation des ressources: imposer un niveau
socialement optimal de consommation (exemple du quotas de nombre de
bateau autorisés à aller pêcher).
- Agir en amont des action individuelles avec les incitations: prix reflètent
correctement la valeur d’une action individuelle. Peut prendre 3 formes:
- Forme fiscale
- Emission de licence ou de droit
- L’internalisation
Correction fiscale des externalités
On illustre le principe à l’aide du modèle théorique d’externalités de
consommation (tabac).
CPO pour l’optimum de Pareto:
u’1(x12)+v’2(x12)=1 x12: consommation de tabac de
l’individu 1
u’2(x22)+v’1(x22)=1 v’i(xji): effet externe de xji.
1: valeur sociale du bien 2.
L’utilité marginale sociale de la richesse et le prix de marché du bien 2 sont =1
dans le modèle.
u’1(x12)=1-v’2(x12)=q1 => Si l’individu 1 veut tenir compte de l’effet
externe, c’est le u’2(x22)=1-v’1(x22)=q2 prix qui va en
tenir compte.
qi= prix de tabac pour l’individu i = prix du marché-taxe de Pigou
Taxe de Pigou payé par i =-v’j(xi2) j≠i
= effet externe de xi2
Remarque: Si l’externalité est positive la taxe devient une subvention.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 29
Taxation (ou subvention) sur mesure, ajuste aux caractéristiques (préférences
technologie) des agents individuels.
Pose le même problème que le dispositif de contribution optimal au bien
public de Lindahl (prix personnalisé).
=> Double problème:
- Informationnel: l'information sur les caractéristique individuelles n’est
pas forcément facile à obtenir (coûts d’information)
- Problème de principe: Consumérisme et action publique.
Emission de licences et marchés de droits
- On détermine un niveau optimal d’externalité: quantité totale d’externalité
autorisé par le dispositif.
- Les agents individuels peuvent ensuite acheter une parti de ces droits.
- Ils peuvent ensuite être revendu
- Les agents peuvent se positionner par rapport au droit qu’ils ont d'émettre
des externalités => intégration d’un dispositif de marché => quotas assouplis.
L’externalisation des externalité
Regrouper les agents, dans l’exemple des 2 usines sur la rivière : les 2
entreprises deviennent plus qu’une.
Si de fusion en fusion les externalités disparaisse mais apparition de la
concurrence imparfaite.
Taxation pigovienne
Introduction
Une taxe pigouvienne est une taxe payée par le pollueur par unité de
pollution produite, égale au coût du dommage environnemental provoqué.
Ce type de taxe a donc pour objectif d’inclure dans le coût de production
d’un bien ou d’un service le coût environnemental induit par la dégradation
du milieu (pollutions, perte de productivité des sols, etc.). En termes
économiques, on parle d’internaliser les externalités (coûts
environnementaux) dans le coût de production. C’est l’économiste
britannique Arthur Cecil Pigou qui fut le premier à proposer une telle taxe en
1920. Les écotaxes basées sur le principe de pollueur-payeur qui découle de
ce type de taxe sont donc appelées taxes pigouviennes. À ce titre, le projet
d’une taxe carbone est une taxe pigouvienne.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 30
Illustration du modèle :
On illustre le principe à l’aide du modèle théorique d’externalité de C° (de
tabac dans notre exemple). CPO de Pareto :
u’1(x12)+v’2(x12)=1 x12: consommation de tabac de
l’individu 1
u’2(x22)+v’1(x22)=1 v’i(xji): effet externe de xji.
1: valeur sociale du bien 2.
L’utilité marginale sociale de la richesse et le prix de marché du bien 2 sont
=1 dans le modèle.
u’1(x12)=1-v’2(x12)=q1 => Si l’individu 1 veut tenir compte de l’effet externe,
c’est le u’2(x22)=1-v’1(x22)=q2 prix qui va en tenir
compte.
qi= prix de tabac pour l’individu i = prix du marché-taxe de Pigou
Taxe de Pigou payé par i =-v’j(xi2) j≠i
= effet externe de xi2
Rq : si l’externalité est positive, la taxe devient une subvention.
Taxation (ou subvention) sur mesure, ajuste aux caractéristiques (préférences
technologie) des agents individuels.
Pose le même problème que le dispositif de contribution optimal au bien
public de Lindahl (prix personnalisé).
Critique du modèle:
Connait une série de problèmes :
- Informationnel: l'information sur les caractéristique individuelles n’est
pas forcément facile à obtenir (coûts d’information)
- Problème de principe: Consumérisme et action publique.
L’alternative aux taxes pigouviennes pour internaliser les coûts
environnementaux consiste à mettre en place des marchés de droits ou
permis de polluer, comme celui des émissions de CO2 du protocole de Kyoto.
Si les taxes pigouviennes nationales sont plus utilisées que les marchés de
droits, elles s’appliquent plus difficilement au contexte international. Mais les
marchés de droits ont leurs propres défauts.
Economie publique M. Jean MERCIER-YTHIER 31
Vous aimerez peut-être aussi
- Recueil d'exercices d'économie: 330 questions et exercices corrigés de microéconomie, macroéconomie, et économie internationaleD'EverandRecueil d'exercices d'économie: 330 questions et exercices corrigés de microéconomie, macroéconomie, et économie internationalePas encore d'évaluation
- Corrigé Des Exercices de La Série 1 Microéconomie Approfondie M1EQDocument8 pagesCorrigé Des Exercices de La Série 1 Microéconomie Approfondie M1EQAbdellahi NafaPas encore d'évaluation
- Grands Problèmes Économiques Contemporains - Correction Des TDDocument16 pagesGrands Problèmes Économiques Contemporains - Correction Des TDEdward Elric100% (1)
- Economie Industrielle Exercices de RévisionDocument14 pagesEconomie Industrielle Exercices de Révisionعبداللهبنزنو100% (3)
- Cours de Micro ApprofondieDocument96 pagesCours de Micro ApprofondieGarba Aissatou100% (1)
- TD Corrigé - MicroéconomieDocument3 pagesTD Corrigé - Microéconomiemiya0100% (2)
- EXercices Externalité !!!Document9 pagesEXercices Externalité !!!yanes0% (1)
- TD2 MacroDocument3 pagesTD2 MacroWill Steven50% (2)
- Correction Controle TD Macroeconomie Seance 5 - Lundi Groupe 14h30Document4 pagesCorrection Controle TD Macroeconomie Seance 5 - Lundi Groupe 14h30Ysf100% (2)
- Exercices Corriges de Microeconomie PDFDocument2 pagesExercices Corriges de Microeconomie PDFNicole63% (8)
- Plan de Cours L2Document4 pagesPlan de Cours L2Ali Safia Balde100% (1)
- Cours de MicroéconomieDocument56 pagesCours de Microéconomiemawulus100% (2)
- Endettement PublicDocument24 pagesEndettement PublicBWETAPas encore d'évaluation
- Résumé de La Pensé ÉconomiqueDocument11 pagesRésumé de La Pensé Économiquemalaga04100% (1)
- Cours de Microéconomie S1Document62 pagesCours de Microéconomie S1Nidal Lee100% (1)
- Question Corrigé EconomieDocument61 pagesQuestion Corrigé EconomieHatim El Otmani100% (5)
- Microéconomie (Résumé)Document6 pagesMicroéconomie (Résumé)Rafael88% (8)
- Les 5 Hypothèses de La CPPDocument5 pagesLes 5 Hypothèses de La CPPMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Cours Magistral Économie Publique 2020Document34 pagesChapitre 1 Cours Magistral Économie Publique 2020ISMAEL NJIKAM100% (1)
- Biens Publics Et ExternalitésDocument30 pagesBiens Publics Et ExternalitésAbdlghni RahmouniPas encore d'évaluation
- Les Marchés ContestablesDocument23 pagesLes Marchés Contestablesgillesk100% (9)
- Chapitre Consommation Epargne Semaine Du 4 Au 8 Mai 2020Document48 pagesChapitre Consommation Epargne Semaine Du 4 Au 8 Mai 2020salahdin sehliPas encore d'évaluation
- Relation Économique InternationaleDocument22 pagesRelation Économique InternationaleAyoub AdardorPas encore d'évaluation
- 1-L'insuffisance de La Régulation Par Le MarchéDocument16 pages1-L'insuffisance de La Régulation Par Le MarchéZaid El Meziani71% (7)
- Relations Economiques InternationalesDocument19 pagesRelations Economiques Internationalesdocisitt100% (2)
- Eco FSJES SETTAT-s1-eco-introduction-a-leconomie-resume-des-chapitresDocument15 pagesEco FSJES SETTAT-s1-eco-introduction-a-leconomie-resume-des-chapitresCours-FSJES86% (7)
- Politique Économique (Résumé)Document3 pagesPolitique Économique (Résumé)MouradBardach100% (1)
- Chap 0 Economie PubliqueDocument15 pagesChap 0 Economie PubliqueMartìalPas encore d'évaluation
- ExternalitésDocument22 pagesExternalitésMonPlus Beau JourPas encore d'évaluation
- Fiche 1.1 Dans Un Monde Aux Ressources Limitées, Comment Faire Des ChoixDocument5 pagesFiche 1.1 Dans Un Monde Aux Ressources Limitées, Comment Faire Des ChoixMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Economie Internationale I-1Document13 pagesEconomie Internationale I-1Salma ElkhatebPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Les Limites de La Régulation Par Le MarchéDocument13 pagesChapitre 2 Les Limites de La Régulation Par Le MarchéMme et Mr Lafon100% (2)
- PROBLEMES ECONOMIQUES ET SOCIAUX Cours Complet-1Document50 pagesPROBLEMES ECONOMIQUES ET SOCIAUX Cours Complet-1Alixandar BidroPas encore d'évaluation
- Cours Micro DEADocument44 pagesCours Micro DEABiblio These100% (1)
- Les Biens Publics Et Les ExternalitésDocument2 pagesLes Biens Publics Et Les ExternalitésM'elle HàjàrPas encore d'évaluation
- 2 Exercices Corriges de MicroeconomieDocument7 pages2 Exercices Corriges de MicroeconomieHamid AzizPas encore d'évaluation
- Thème 1134 - Les Modèles de Croissance Endogène CorrigéDocument47 pagesThème 1134 - Les Modèles de Croissance Endogène CorrigéMme et Mr Lafon100% (1)
- Comptabilité Nationale Exercice & Correction td1Document10 pagesComptabilité Nationale Exercice & Correction td1Essoulahi Essoulahi50% (4)
- Avantage ConcurrentielDocument3 pagesAvantage Concurrentielmiya00% (1)
- Modéle de Domar - Croissance Et Emploi (S6 Economie)Document46 pagesModéle de Domar - Croissance Et Emploi (S6 Economie)MARYAM BAISSY100% (2)
- Cours Macro Économie INSEADocument121 pagesCours Macro Économie INSEAndt100% (3)
- Cours de Microéconomie 1 - PR AKONODocument82 pagesCours de Microéconomie 1 - PR AKONOAxelle MangaingPas encore d'évaluation
- Economie Generale Premiere AnneeDocument65 pagesEconomie Generale Premiere AnneeAndriambololosoa Hyacinthe TOVONIAINAPas encore d'évaluation
- Les Nouvelles Théories ÉconomiquesDocument17 pagesLes Nouvelles Théories ÉconomiquesRif SpiritPas encore d'évaluation
- Politique BudgetaireDocument11 pagesPolitique BudgetaireAfoudi MarouaPas encore d'évaluation
- ConjonctureDocument27 pagesConjonctureseydianPas encore d'évaluation
- La Croissance Économique Est Elle Compatible Avec La Préservation de L'environnement ?Document7 pagesLa Croissance Économique Est Elle Compatible Avec La Préservation de L'environnement ?Mme et Mr Lafon100% (2)
- LE MODELE DE Solow Slides - Chap2Document24 pagesLE MODELE DE Solow Slides - Chap2wicox80% (10)
- Exercices MicroéconomieDocument4 pagesExercices MicroéconomieTaha Can100% (1)
- Les Choix IntertemporelsDocument34 pagesLes Choix IntertemporelsÓthmãňe EřŕîfiPas encore d'évaluation
- Les nouvelles stratégies d'innovation 2018 - 2020: vision prospective 2030D'EverandLes nouvelles stratégies d'innovation 2018 - 2020: vision prospective 2030Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Gestion budgétaire et dépenses publiques: Description comparée des processus, évolutions et enjeux budgétaires du QuébecD'EverandGestion budgétaire et dépenses publiques: Description comparée des processus, évolutions et enjeux budgétaires du QuébecÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (2)
- L'analyse des données de sondage avec SPSS: Un guide d'introductionD'EverandL'analyse des données de sondage avec SPSS: Un guide d'introductionPas encore d'évaluation
- Etude Economique Et Developpement De La Region Ne Kongo En RdcD'EverandEtude Economique Et Developpement De La Region Ne Kongo En RdcPas encore d'évaluation
- Quel demain pour quel Maroc ?: Réflexions sur le développementD'EverandQuel demain pour quel Maroc ?: Réflexions sur le développementPas encore d'évaluation
- Economie Publique Chapitre1Document15 pagesEconomie Publique Chapitre1Viorica MardariPas encore d'évaluation
- Economie Europeenne-Professeur Alain RedslobDocument79 pagesEconomie Europeenne-Professeur Alain RedslobViorica Mardari100% (2)
- Exercices Corrigés de Statistiques Et ProbabilitésDocument69 pagesExercices Corrigés de Statistiques Et ProbabilitésViorica Mardari50% (2)
- Analyse Financière (Bertrand Vaur)Document3 pagesAnalyse Financière (Bertrand Vaur)Viorica MardariPas encore d'évaluation
- Analyse Financière (Tommy Sendra)Document29 pagesAnalyse Financière (Tommy Sendra)Viorica MardariPas encore d'évaluation
- Analyse FinancièreDocument144 pagesAnalyse FinancièreViorica Mardari100% (2)
- Constitution de La Republique Islamique de MauritanieDocument15 pagesConstitution de La Republique Islamique de MauritanieMohand BakirPas encore d'évaluation
- Confluence DagDocument89 pagesConfluence DagJacques DemongeotPas encore d'évaluation
- Arbitrage D'investissement Introduction Et Chap IDocument31 pagesArbitrage D'investissement Introduction Et Chap IGessica Mpuanga100% (1)
- Exposé Magistrat CompletDocument4 pagesExposé Magistrat CompletMatio ZaraPas encore d'évaluation
- Cours DOC Partie 1Document3 pagesCours DOC Partie 1Abbour ZaidPas encore d'évaluation
- Le Contentieux Administratif en Dehors Du JugeDocument379 pagesLe Contentieux Administratif en Dehors Du JugeAmira YangoPas encore d'évaluation
- Pièces Justificatives À Adresser Au Tribunal D'instance Aux Fins de Conclusion D'un Pacte Civil de SolidaritéDocument1 pagePièces Justificatives À Adresser Au Tribunal D'instance Aux Fins de Conclusion D'un Pacte Civil de SolidaritéDenis FouchierPas encore d'évaluation
- Justice Divine Selon Le SpiritismeDocument507 pagesJustice Divine Selon Le Spiritismesantsetesh100% (1)
- Cours Sur L'usager Du Service Public Définitif - CopieDocument34 pagesCours Sur L'usager Du Service Public Définitif - Copiekdidier253Pas encore d'évaluation
- Le Héraut de L'amour DivinDocument36 pagesLe Héraut de L'amour DivinDiego SilvaPas encore d'évaluation
- Méthode Commentaire D'arrêt Droit Civil PDFDocument8 pagesMéthode Commentaire D'arrêt Droit Civil PDFeden.sesay77Pas encore d'évaluation
- La Chute Dun Ange PDFDocument275 pagesLa Chute Dun Ange PDFNani VellankiPas encore d'évaluation
- Essay ArgumentatifDocument12 pagesEssay Argumentatifliviuanutian2171Pas encore d'évaluation
- Planning Des ExamsDocument2 pagesPlanning Des ExamssalaheddinePas encore d'évaluation
- La Suspension Et Modification Du Contrat de Travail - CamerlexDocument2 pagesLa Suspension Et Modification Du Contrat de Travail - Camerlexmakamba656Pas encore d'évaluation
- L'Internet Et Le DIP Un Mariage BoiteuxDocument23 pagesL'Internet Et Le DIP Un Mariage BoiteuxGaiwe GnowePas encore d'évaluation