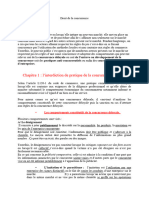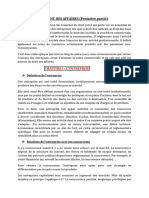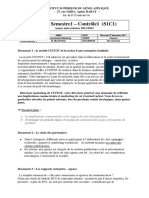Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Numéro D'étudiant: 113983
Numéro D'étudiant: 113983
Transféré par
Nicolas MoreauTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Numéro D'étudiant: 113983
Numéro D'étudiant: 113983
Transféré par
Nicolas MoreauDroits d'auteur :
Formats disponibles
Numéro d’étudiant
: 113983
Cas 1 :
Un propriétaire d'un magasin décide d'appliquer une réduction à certains produits qu'il a en
stock depuis plus d'un mois afin d'améliorer son chiffre d'affaires et faire disparaître son
stock.
Dans quelles mesures un commerçant est-il en droit d’appliquer des réductions sur certains
produits de son magasin ?
En droit, les ventes avec annonce d’une réduction des prix initiaux afin d’écouler de façon
accélérée les marchandises du stock doivent s’effectuer sur des produits proposés à la vente et
payés depuis au moins un mois. En revanche, la limitation de cette pratique incitative est fixée
par décret à deux périodes de six semaines.
En l’espèce, le propriétaire du magasin détient les produits dont il souhaite réduire le prix
depuis plus d’un mois. Il est alors en droit de réduire le prix de ses produits de 20% et de
l’afficher en vitrine.
En conclusion, le commerçant a le droit de réduire ses prix seulement s’il ne dépasse pas la
limitation de deux périodes de six semaines. Sinon, il risque une amende administrative.
Cas 2 :
Question 1 :
Une association utilise sur son site Internet une photo dont elle ne détient pas les droits
d’auteur, puisqu’ils appartiennent à l’Agence France Presse. Une entreprise dont les services
ont été demandés par cette dernière fait grief à l’association d’utiliser cette photo et lui
réclame une certaine somme en lui proposant de régler ce litige à l’amiable.
Dans quelles mesures les droits d’auteur s’applique-t-il sur l’utilisation d’une photographie ?
En droit, le droit d’auteur s’applique à toutes les œuvres sorties de l’imaginaire d’une
personne physique ou morale. Une œuvre, pour être protégée, doit bénéficier du caractère
« original », c’est-à-dire le reflet de la personnalité de l’auteur. De plus, elle doit être créée sur
un support durable, ce qui signifie que cela ne doit pas être une simple idée, mais une
réalisation physiquement identifiable. Une personne physique ou morale qui possède des
droits d’auteur est en droit de réclamer une indemnité à un tiers qui aurait utilisé l’œuvre de
façon illégale.
En l’espèce, l’œuvre protégée est une photographie mettant en scène deux hommes politiques.
Son caractère original permet à l’AFP de détenir les droits d’auteur sur celle-ci. L’entreprise
qui fait grief à l’association d’utiliser abusivement cette photographie est en droit de lui
réclamer une indemnité.
En conclusion, l’entreprise qui reproche à une association l’utilisation d’une photographie
sans en détenir les droits d’auteur est en droit de réclamer une indemnité.
Question 2 :
L’association peut se défendre en invoquant l’absence du caractère original de l’œuvre. En
effet, il s’agit simplement d’une photographie mettant en scène deux personnalités publiques
ne posant pas intentionnellement devant la caméra. Elle peut alors demander à l’entreprise qui
lui réclame le paiement d’une indemnité de prouver le caractère original et créatif de la
photographie. Si l’entreprise parvient à prouver le caractère original et créatif de cette
photographie, la meilleure solution pour l’association sera de négocier le montant de
l’indemnité pour éviter le recours en justice, qui sera plus coûteux, plus long et public.
Cas 3 :
Un directeur de magasin a fait recours aux services d’une agence publicitaire pour qu’elle
développe une publicité afin d’augmenter les ventes de l’un de ses produits. Le directeur
incite l’agent publicitaire au développement d’une publicité comparative. Celui-ci s’y attèle et
produit une publicité comparant les deux enseignes et rabaissant de façon directe le
concurrent.
Dans quelles mesures une pratique comparative est-elle déloyale ?
En droit, une publicité comparative doit porter sur des biens et services ayant le même
objectif, ne doit pas comporter de caractère trompeur (tels que des allégations ou indications
fausses) et doit mettre en avant des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et
représentatives des produits. Elle est considérée comme déloyale si elle est dénigrante,
parasitaire, créatrice de confusion ou constitutive d’imitation.
En l’espèce, la publicité porte bien sur des biens et services ayant le même objectif, en
revanche, elle ne comporte pas de caractéristiques pertinentes, mais plutôt dénigrantes et
dépréciatives vis-à-vis de l’enseigne concurrente. Cette publicité peut être considérée comme
une pratique comparative déloyale trompeuse car elle repose sur des suppositions qui ne sont
pas avérées et qui induisent donc en erreur les consommateurs.
En conclusion, en réalisant ce délit de pratique commerciale trompeuse, le directeur de
l’agence publicitaire risque des sanctions pénales (telles qu’une peine privative de liberté ou
une amende) ou civiles (nullité du contrat).
Vous aimerez peut-être aussi
- Merchandising PartielDocument8 pagesMerchandising PartielNicolas MoreauPas encore d'évaluation
- La Concurrence DéloyaleDocument4 pagesLa Concurrence DéloyaleHeusele ThomasPas encore d'évaluation
- Droit de La ConcurrenceDocument9 pagesDroit de La ConcurrenceAntoine ElnchrPas encore d'évaluation
- ExposeDocument9 pagesExposeAnonymous X0lEE5Mb5XPas encore d'évaluation
- Partiel Droit de La Consommation M2 DEDocument8 pagesPartiel Droit de La Consommation M2 DEChloé LIGEONPas encore d'évaluation
- Copie de Les Pratiques de CommercesDocument13 pagesCopie de Les Pratiques de CommercesMehdi BenaliPas encore d'évaluation
- RESUME LA PUBLICITÉ MENSONGÈREDocument5 pagesRESUME LA PUBLICITÉ MENSONGÈREutilisateur vPas encore d'évaluation
- Droit de La ConcurrenceDocument19 pagesDroit de La Concurrence2kvf5qm88yPas encore d'évaluation
- 8359 19904 1 SMDocument28 pages8359 19904 1 SMNaoual NaoualPas encore d'évaluation
- DRoitttDocument15 pagesDRoitttManar SamaaliPas encore d'évaluation
- Fiche ÉconomieDocument2 pagesFiche Économielroysds56Pas encore d'évaluation
- La Protection Du Consommateur Cours de DroitDocument10 pagesLa Protection Du Consommateur Cours de Droitnarcisse7777Pas encore d'évaluation
- Sdoc 03 15 SiDocument25 pagesSdoc 03 15 SirouphinameniePas encore d'évaluation
- Rapport DroitDocument13 pagesRapport DroitManar Samaali50% (2)
- Marketing FondamentalDocument54 pagesMarketing FondamentalBadr EddinePas encore d'évaluation
- DS 01 03 01 Audiotech CDocument2 pagesDS 01 03 01 Audiotech CFatima Ezzahra GhazaliPas encore d'évaluation
- مجلة منازعات الأعمال La protection du consommateur à travers la transparence des pratiques commerciales selon la loi 31-08 PDFDocument13 pagesمجلة منازعات الأعمال La protection du consommateur à travers la transparence des pratiques commerciales selon la loi 31-08 PDFMohammed AminePas encore d'évaluation
- مجلة منازعات الأعمال La protection du consommateur à travers la transparence des pratiques commerciales selon la loi 31-08 PDFDocument13 pagesمجلة منازعات الأعمال La protection du consommateur à travers la transparence des pratiques commerciales selon la loi 31-08 PDFMohammed Amine100% (3)
- Les Pratiques Interdites Pub Consomation Biens Et ServicesDocument5 pagesLes Pratiques Interdites Pub Consomation Biens Et ServicesCarmen BlancoPas encore d'évaluation
- Droit Marketing Partie IIDocument13 pagesDroit Marketing Partie IIBen Hmida RihabPas encore d'évaluation
- Chapitre 4Document23 pagesChapitre 4Moussa Amadou AlmoustaphaPas encore d'évaluation
- La Protection Du Consommateur Lors de La FormationDocument19 pagesLa Protection Du Consommateur Lors de La FormationhibaelissaPas encore d'évaluation
- Cifec MPC 1Document73 pagesCifec MPC 1Technologie G. VisionPas encore d'évaluation
- Bpifrance CréatDocument9 pagesBpifrance Créatbeyajudith48Pas encore d'évaluation
- Corrige Devoir Marches Non ConcurrentielsDocument3 pagesCorrige Devoir Marches Non ConcurrentielsKenny OuedraogoPas encore d'évaluation
- Exercices SES - Correction Et ConsignesDocument3 pagesExercices SES - Correction Et ConsignesidaPas encore d'évaluation
- S3 CEJMTh 2 Droit SynthèseDocument3 pagesS3 CEJMTh 2 Droit SynthèseJOSEPH-SYLVESTREPas encore d'évaluation
- Communication Marketing - BELAFHAILI - 4SIMC - S1C1 - DC 2011Document3 pagesCommunication Marketing - BELAFHAILI - 4SIMC - S1C1 - DC 2011Ait Oumakhir FaysSalPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument19 pagesIntroductionheninlouhPas encore d'évaluation
- Les Modalités D'application de L'action en Concurrence DéloyaleDocument6 pagesLes Modalités D'application de L'action en Concurrence Déloyalearvelinmayele1Pas encore d'évaluation
- Marketing IndustrielDocument36 pagesMarketing Industrielbest.ever.2010Pas encore d'évaluation
- Rupture Contrat TravailDocument15 pagesRupture Contrat Travailapi-236461864Pas encore d'évaluation
- Préparer Une Action Promotionnelle 2Document12 pagesPréparer Une Action Promotionnelle 2fatimazarah712Pas encore d'évaluation
- Preparer Une Action Promotionnelle Et Informer La Clientele - Le-Sav-Du-CommerceDocument4 pagesPreparer Une Action Promotionnelle Et Informer La Clientele - Le-Sav-Du-CommercejkacoubokoPas encore d'évaluation
- Droit Commercial 2 - L'entreprise Et Ses Concurrents - Polycopié 2Document5 pagesDroit Commercial 2 - L'entreprise Et Ses Concurrents - Polycopié 2badrelidrissijaghnane01Pas encore d'évaluation
- Droit Des Affaires TBSDocument72 pagesDroit Des Affaires TBSkaoutarbarik1Pas encore d'évaluation
- Le Comportement Du Consommateur Et de L'acheteur: SommaireDocument20 pagesLe Comportement Du Consommateur Et de L'acheteur: Sommaireéco MarocPas encore d'évaluation
- Secteur Publicitaire Au Maroc - Houda LAROUSSIDocument28 pagesSecteur Publicitaire Au Maroc - Houda LAROUSSIHouda LaroussiPas encore d'évaluation
- OpaleDocument18 pagesOpalejean lacroixPas encore d'évaluation
- Consommateur NouveauDocument6 pagesConsommateur Nouveauel badaoui hichamPas encore d'évaluation
- Le Droit de La Concurrence Et La Protection Du MarchéDocument8 pagesLe Droit de La Concurrence Et La Protection Du MarchéRacem GassaraPas encore d'évaluation
- La Politique de PRIX Support de CoursDocument8 pagesLa Politique de PRIX Support de CoursClo GueusPas encore d'évaluation
- Comment Convaincre Votre Client D'acheter Votre ProduitDocument5 pagesComment Convaincre Votre Client D'acheter Votre ProduitcabeaureyPas encore d'évaluation
- CORRECTION Chapitre 15Document7 pagesCORRECTION Chapitre 15Tylian RousseauPas encore d'évaluation
- DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE MARKETINGDocument7 pagesDEFINITIONS ET TERMINOLOGIE MARKETINGMARIAM EL MORABITPas encore d'évaluation
- 1 Les Pratiques Commerciales TrompeusesDocument13 pages1 Les Pratiques Commerciales TrompeusesAsmaa100% (2)
- Document Sans TitreDocument30 pagesDocument Sans TitreIbrahima DiopPas encore d'évaluation
- Droit À L'écoute Et À La Représentation Version Améliorée 18.11.2021Document15 pagesDroit À L'écoute Et À La Représentation Version Améliorée 18.11.2021Mystic MindPas encore d'évaluation
- Ue 211 Ca3 2111ac0312Document16 pagesUe 211 Ca3 2111ac0312kitoko21Pas encore d'évaluation
- Les Formes Dentreprenuriat 2Document3 pagesLes Formes Dentreprenuriat 2Elghoul RamziPas encore d'évaluation
- Copie de LES INFRACTIONS LIEES A LA PUBLICITE VFDocument27 pagesCopie de LES INFRACTIONS LIEES A LA PUBLICITE VFutilisateur vPas encore d'évaluation
- Institut Superieur de CommerceDocument6 pagesInstitut Superieur de CommerceSmart ConsultingPas encore d'évaluation
- Le Fonds de CommerceDocument4 pagesLe Fonds de CommerceWalid TsouliPas encore d'évaluation
- Cours Marketing2Document112 pagesCours Marketing2mosesmalonPas encore d'évaluation
- Devoir - Corrige - Défaillances - Marche 3Document4 pagesDevoir - Corrige - Défaillances - Marche 3noahchvsPas encore d'évaluation
- Marketing FondamentalDocument42 pagesMarketing FondamentalKhalid HallaouiPas encore d'évaluation
- Cours Marketing2Document119 pagesCours Marketing2samisimoPas encore d'évaluation
- Contrôle MarketingDocument23 pagesContrôle MarketingsorayaPas encore d'évaluation
- Immersion en EntrepriseDocument37 pagesImmersion en EntrepriselilamioforeverPas encore d'évaluation
- Les bases de l'acquisition client: Maîtriser la méthode TIPA pour exploser son audienceD'EverandLes bases de l'acquisition client: Maîtriser la méthode TIPA pour exploser son audiencePas encore d'évaluation
- Cours Data MindingDocument5 pagesCours Data MindingNicolas MoreauPas encore d'évaluation
- Eval Com PartielDocument7 pagesEval Com PartielNicolas MoreauPas encore d'évaluation
- Communication Partiels PlanDocument4 pagesCommunication Partiels PlanNicolas MoreauPas encore d'évaluation
- Cas Pratique 1:: Numéro D'étudiant: 113983Document3 pagesCas Pratique 1:: Numéro D'étudiant: 113983Nicolas MoreauPas encore d'évaluation