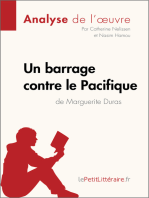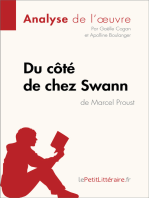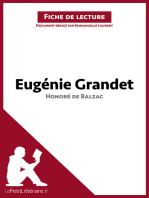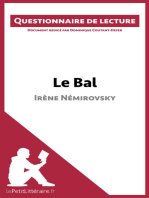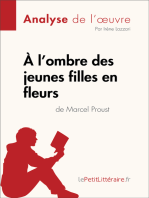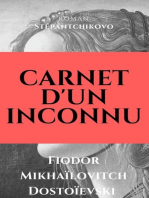Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Séance Mariage Et Comédie Sociale Dans La MCQP
Séance Mariage Et Comédie Sociale Dans La MCQP
Transféré par
SOFPRO MAXAIRTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Séance Mariage Et Comédie Sociale Dans La MCQP
Séance Mariage Et Comédie Sociale Dans La MCQP
Transféré par
SOFPRO MAXAIRDroits d'auteur :
Formats disponibles
Lundi 23 janvier
Séance 5 (étude transversale )
Mariage et comédie sociale dans la MCQP
1° Une intrigue autour du mariage à la manière d’une comédie classique
A. Des mariages avec des obstacles
-Joseph Lebas et Augustine : le commis des Guillaume est secrètement amoureux de la fille
cadette mais il n’en est pas aimé en retour et M. Guillaume ne veut pas marier sa cadette
avant l’ainée.
-Joseph Lebas et Virginie : L’ainée aime depuis longtemps le commis sans réciproque. Elle
apprend par hasard en espionnant ses parents pour le compte de sa sœur que son amoureux en
aime une autre.
-Augustine et Théodore : les deux jeunes gens partagent le même amour mais leur rang social
(une bourgeoise et un noble) les empêche de se voir et les parents d’Augustine sont opposés
d’abord à ce mariage car ils pensent que la fortune de leur fille serait mise à mal avec un mari
peintre même s’il est noble.
B. Augustine, la jeune fille de la comédie classique (une nouvelle Agnès)
-Elle est innocente par son éducation extrêmement morale et religieuse. Son seul loisir de sortie
est la messe, elle doit être chaperonnée par sa cousine pour pouvoir se rendre au musée. C’est
une jeune fille naîve et sensible : lorsque Théodore lui fait sa déclaration, elle est à la fois la proie
d’une culpabilité religieuse mais elle ruse aussi pour préserver son amour grâce à la pantomime
au musée.
-La découverte de son portrait peint par Théodore lui permet de se rendre compte du même coup
qu’elle est aimée. Elle est submergée par des émotions inconnues et en sort dans un état
physique fébrile et proche de l’extase. Page 51
-Elle est à la merci de ses parents : M. Guillaume ne souhaite pas qu’elle se marie avant son
ainée et sa mère est extrêmement sévère avec elle lorsqu’elle découvre qu’elle a un admirateur.
C. Les prétendants opposés
-Joseph Lebas aime depuis longtemps Augustine puisqu’ils vivent sous le même toit. Son amour
n’est pas partagé par Augustine car il représente le type même du commis ennuyeux et peu
intéressant comme le montre le décalage de leur conversation sur l’art à la page 60-61 (Joseph
confond art et artisanat et ne pense qu’à l’argent).
-Théodore de Sommervieux est un noble qui n’a pas besoin de l’argent d’Augustine puisqu’il
possède une fortune personnelle. Il a toutes les qualités d’un prince « charmant » et son amour
est extrêmement flatteur pour la jeune fille.
II. Mais Balzac caricature cette comédie classique pour se moquer de ses personnages
A. Théodore, un prétendant ridicule : cercle de lecteurs
Page 53 « Le matin où […] si bien examinés »
Page 66-67 « A six heures et demie […] ses futurs parents aimables ».
-Donner un titre à chacun de ces extraits
-Quels sont les éléments qui rendent compte du caractère de Théodore dans ces pages ?
A quoi voit-on qu’il est un peu ridicule ?
-Le jeune amant, transporté par l’amour a aussi un caractère excessif. Il s’emporte trop vite
dans cette histoire et se déclare de façon romanesque sans même connaître la jeune fille dont il
est amoureux. Page 53, 50.
-La stratégie qu’il met en place pour la conquérir semble tout droit sortir d’un roman, comme le dit
Mme Roguin à la page 65. Ils se font des signes de loin avec des pots de fleurs, il s’imagine
acheter une servante pour échanger des lettres et épie Augustine à l’église.
-Le peintre manque de discernement et de lucidité sur sa belle-famille qui, pourtant, ne lui cache
rien de ses goûts bourgeois comme lors du dîner de fiancailles à la page 66-67 (la conversation
sur le tableau offert par Théodore).
B. M. Guillaume et Joseph : un quiproquo douloureux
-l’éviction comme amoureux d’Augustine de Joseph, le commis, se fait aussi sur le mode
théâtral. En effet, son entrevue avec M. Guillaume est écrite comme un dialogue de théâtre (on
peut repérer des didascalies dans ce passage page 56-57).
C. Mme Roguin, une entremetteuse grotesque
-Elle joue les Frosine (entremetteuse dans L’Avare de Molière) qui parvient à rendre possible le
mariage entre Théodore et Augustine.
-Cette cousine de la famille s’identifie elle-même, de façon ridicule, comme « une colombe » de
la paix alors que la situation n’est pas une situation de guerre, elle prend donc beaucoup trop au
sérieux son rôle de « marieuse ».
-Son discours page 64, creux, n’insiste que sur la valeur pécuniaire (= argent) du mariage et les
avantages que les parents Guillaume peuvent en retirer.
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Mage Du Kremlin (Giuliano Da Empoli)Document253 pagesLe Mage Du Kremlin (Giuliano Da Empoli)Bigo Boss100% (6)
- Marguerite Duras Un Barrage Contre Le Pacifique Resume Personnages Et AnalyseDocument6 pagesMarguerite Duras Un Barrage Contre Le Pacifique Resume Personnages Et AnalysePatchari DECOCKPas encore d'évaluation
- CorrigéDissert Lagarce RaskineDocument3 pagesCorrigéDissert Lagarce RaskineSARAH SOUAYAHPas encore d'évaluation
- Analyses Linéaires ColetteDocument4 pagesAnalyses Linéaires ColetteElena MichelPas encore d'évaluation
- L'Avalée des avalés de Réjean Ducharme (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandL'Avalée des avalés de Réjean Ducharme (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Du côté de chez Swann de Marcel Proust (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandDu côté de chez Swann de Marcel Proust (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- 438 Duras Un Barrage Contre Le PacifiqueDocument16 pages438 Duras Un Barrage Contre Le PacifiqueSanja SekosanPas encore d'évaluation
- Sarrasine d'Honoré de Balzac (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandSarrasine d'Honoré de Balzac (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Les ParaventsDocument3 pagesLes ParaventsSombre Arcane Zine0% (1)
- Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandUn barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Le Bal de Irène Némirovski (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandLe Bal de Irène Némirovski (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Le Bal d'Irène Némirovsky (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandLe Bal d'Irène Némirovsky (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Le Bal des voleurs de Jean Anouilh (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandLe Bal des voleurs de Jean Anouilh (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- ColetteDocument99 pagesColetteRohayu -100% (1)
- Sobre Consuelo de Georges SandDocument13 pagesSobre Consuelo de Georges Sandpsyché2409Pas encore d'évaluation
- Les Miserables-EpilogueDocument17 pagesLes Miserables-EpiloguecastelotscripturePas encore d'évaluation
- Du côté de chez Swann de Marcel Proust (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandDu côté de chez Swann de Marcel Proust (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandUn barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Lecture Comparative: .1) Typologie Du Roman Et Mouvement LittéraireDocument4 pagesLecture Comparative: .1) Typologie Du Roman Et Mouvement LittéraireLea SimsPas encore d'évaluation
- MUNTEANU Iasmina-Andreea-Explication de TexteDocument6 pagesMUNTEANU Iasmina-Andreea-Explication de TexteIasmina MunteanuPas encore d'évaluation
- Présentation Sur Orgueil Et Préjugés de Jane AustenDocument2 pagesPrésentation Sur Orgueil Et Préjugés de Jane Austenjosephine.bourdin3Pas encore d'évaluation
- Les ConfessionsDocument4 pagesLes Confessionsİrem AksoyPas encore d'évaluation
- Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandEugénie Grandet d'Honoré de Balzac (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Le Bal d'Irène Némirovsky (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLe Bal d'Irène Némirovsky (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- ARSAKYAN Satenik - FLC0903T - Litterature Et Arts1Document3 pagesARSAKYAN Satenik - FLC0903T - Litterature Et Arts1Satenik ArshakyanPas encore d'évaluation
- Engénie Grandet CommentaireDocument11 pagesEngénie Grandet Commentairezeineb hkPas encore d'évaluation
- Le BalDocument7 pagesLe BalGuille Divi EscobarPas encore d'évaluation
- Analyse Lineaire sc1Document3 pagesAnalyse Lineaire sc1hortense.delcroix8Pas encore d'évaluation
- 501 Module 7 Exercice 2Document5 pages501 Module 7 Exercice 2yagnikaPas encore d'évaluation
- Fiche de LectureDocument4 pagesFiche de LectureM Zakaria Kacimi ElhassaniPas encore d'évaluation
- Le Pere GoriotDocument5 pagesLe Pere GoriotNT NT0% (1)
- Le Sagouin de François Mauriac (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandLe Sagouin de François Mauriac (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Exposé de FrançaisDocument6 pagesExposé de FrançaisdiopibousalifPas encore d'évaluation
- Le Père GoriotDocument19 pagesLe Père GoriotAna0% (1)
- CoursDocument2 pagesCoursdubrin duvalPas encore d'évaluation
- Eugénie GrandetDocument12 pagesEugénie GrandetMaria TeodoraPas encore d'évaluation
- Du Dramatique Au Tragique, La Scène Des Voeux Monastiques Interrompus (11 P.)Document12 pagesDu Dramatique Au Tragique, La Scène Des Voeux Monastiques Interrompus (11 P.)Jessyca kimberly RowlingPas encore d'évaluation
- 293 Soucy GaetanDocument40 pages293 Soucy Gaetantalia berroPas encore d'évaluation
- Exposé Le Père GauriotDocument9 pagesExposé Le Père GauriotmonekatapaulPas encore d'évaluation
- BALZACDocument2 pagesBALZACAntonio PetrafesaPas encore d'évaluation
- ++image Societe Dans Un Amour de SwannDocument10 pages++image Societe Dans Un Amour de SwannMimaPas encore d'évaluation
- Lagarce Juste La Fin Du Monde 0Document2 pagesLagarce Juste La Fin Du Monde 0mixscha personnePas encore d'évaluation
- Biographie ZolaDocument8 pagesBiographie ZolagfgfgfgfgfgfgfgfgfgfPas encore d'évaluation
- On Ne Badine Pas Avec L'amour - WikipédiaDocument13 pagesOn Ne Badine Pas Avec L'amour - Wikipédiapascalinepirwoth62Pas encore d'évaluation
- 61 Balzac Eugenie GrandetDocument5 pages61 Balzac Eugenie GrandethelouuPas encore d'évaluation
- On ne badine pas avec l'amour de Musset - Acte III, scène 8: Commentaire et Analyse de texteD'EverandOn ne badine pas avec l'amour de Musset - Acte III, scène 8: Commentaire et Analyse de textePas encore d'évaluation
- Présentation Du Livre Au Bonheur Des Dames Emile ZolaDocument4 pagesPrésentation Du Livre Au Bonheur Des Dames Emile ZolatropmimiPas encore d'évaluation
- CULIUC - Dumitrița - Le Conte Philosophique Gobseck - Représentation Symbolique de L'égoïsme de La Société FrançaiseDocument6 pagesCULIUC - Dumitrița - Le Conte Philosophique Gobseck - Représentation Symbolique de L'égoïsme de La Société FrançaiseDumitrita CuliucPas encore d'évaluation
- Fernando CIPRIANI: Deux Couples Au Clair de Lune: Sébastien Et Marguerite, Virginie Et PaulDocument8 pagesFernando CIPRIANI: Deux Couples Au Clair de Lune: Sébastien Et Marguerite, Virginie Et PaulAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Madame Bovary - Fiche de LectureDocument6 pagesMadame Bovary - Fiche de Lecturesafae.gueldiPas encore d'évaluation
- Le Bal d'Irène Némirovsky: Questionnaire de lectureD'EverandLe Bal d'Irène Némirovsky: Questionnaire de lecturePas encore d'évaluation
- Sélection Romans Printemps 2016Document8 pagesSélection Romans Printemps 2016sassenachPas encore d'évaluation
- Papy Goriot BalzacDocument6 pagesPapy Goriot BalzacMarco DifonzoPas encore d'évaluation
- Lisa Suarez, de Célestine La Révoltée À Anna La Douce: La Domestique CriminelleDocument11 pagesLisa Suarez, de Célestine La Révoltée À Anna La Douce: La Domestique CriminelleAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandÀ l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Carnet d'un inconnu (Stépantchikovo)D'EverandCarnet d'un inconnu (Stépantchikovo)Pas encore d'évaluation
- Fiche Enseignant Enfants-Ados A1Document6 pagesFiche Enseignant Enfants-Ados A1AuraPas encore d'évaluation
- Tableau Ou Action ? de La Dramaturgie de Diderot Et de LessingDocument10 pagesTableau Ou Action ? de La Dramaturgie de Diderot Et de LessingNicole BrooksPas encore d'évaluation
- Dossier PedagogiqueDocument17 pagesDossier PedagogiqueMostafaPas encore d'évaluation
- 2014 10 DP 95 en Attendant GodotDocument17 pages2014 10 DP 95 en Attendant GodotRoberto VailattiPas encore d'évaluation
- DNB-Dictée 2021Document2 pagesDNB-Dictée 2021MOKRANI LEILAPas encore d'évaluation
- Module Antigone AminaDocument26 pagesModule Antigone Aminaahmed taffachPas encore d'évaluation
- Texte NarratifDocument12 pagesTexte NarratifSimona Nikoleta100% (1)
- Victor 2Document1 pageVictor 2claire_speichPas encore d'évaluation
- Rives Bleues 4e LPPDFDocument10 pagesRives Bleues 4e LPPDFhoda100% (4)
- La Femme Qui en Savait Trop by Marie Benedict (Benedict, Marie)Document320 pagesLa Femme Qui en Savait Trop by Marie Benedict (Benedict, Marie)Yanis TamourtPas encore d'évaluation
- Dossier KhamsinDocument87 pagesDossier Khamsinultima_chamadaPas encore d'évaluation
- Hippo Et VanessaDocument2 pagesHippo Et Vanessaanna.loumeau3Pas encore d'évaluation
- Casting JMDocument7 pagesCasting JMViona AngeliaPas encore d'évaluation
- Metal Adventure - Metal FaktorDocument8 pagesMetal Adventure - Metal FaktorLeonarius NomadaPas encore d'évaluation
- Le Soliloque D 2Document2 pagesLe Soliloque D 2aairouche11Pas encore d'évaluation
- George Dandin, Ou Le Social en Représentation - R ChartierDocument34 pagesGeorge Dandin, Ou Le Social en Représentation - R ChartierJoão Ivo GuimarãesPas encore d'évaluation
- الامتحانات الجهوية الأولى باكالوريا في مادة اللغة الفرنسية مع عناصر الإجابة 2023.Document66 pagesالامتحانات الجهوية الأولى باكالوريا في مادة اللغة الفرنسية مع عناصر الإجابة 2023.خديجة منعم100% (1)
- WEILL-Dei Dreigroschenoper - ZuhälterballadeDocument7 pagesWEILL-Dei Dreigroschenoper - ZuhälterballadeGiuseppeDiStefanoPas encore d'évaluation
- Xxs 0294-1759 1993 Num 40 1 2998Document13 pagesXxs 0294-1759 1993 Num 40 1 2998No LugareniaPas encore d'évaluation
- DELF A1 Example 1 CE P.6-7Document2 pagesDELF A1 Example 1 CE P.6-7ycPas encore d'évaluation
- L'école Des FemmesDocument7 pagesL'école Des Femmesmoussa CISSE100% (1)
- Matilde Di ShabranDocument245 pagesMatilde Di ShabranMariodelonaka100% (1)
- Anthologie de La Répartie 2019 FRDocument313 pagesAnthologie de La Répartie 2019 FRfanch333Pas encore d'évaluation
- Tadla 2014Document2 pagesTadla 2014Betina SadikPas encore d'évaluation
- Lustrie - Capture ObjectifsDocument1 pageLustrie - Capture ObjectifsptitwattPas encore d'évaluation
- La Voix PassiveDocument6 pagesLa Voix PassiveLaura Andreea100% (1)
- QL 1000Document48 pagesQL 1000Adam Di SadaluccoPas encore d'évaluation