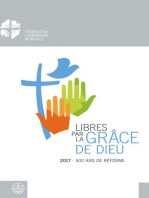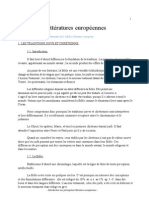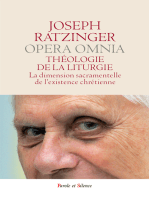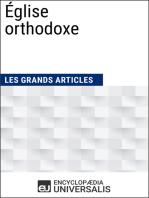Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Religions Et Textes Sacrés La Croix 2018 10 P
Transféré par
coco marine0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
15 vues10 pagesTitre original
Religions-et-textes-sacrés-La-Croix-2018-10-p
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
15 vues10 pagesReligions Et Textes Sacrés La Croix 2018 10 P
Transféré par
coco marineDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 10
Religions et textes sacrés
« La Croix » interroge le rapport des grandes religions avec leurs textes sacrés
(octobre-novembre 2018)
1. Lire la Bible dans le judaïsme (Mélinée Le Priol)
Quelle place occupe l’étude de la Bible dans le judaïsme ?
La Bible hébraïque est une collection de livres généralement répartis en trois parties : la Torah
(que les chrétiens connaissent sous le nom de Pentateuque, correspondant aux cinq premiers
livres de l’Ancien Testament), les Prophètes et les Écrits. L’étude de ces textes occupe une
place centrale dans le judaïsme. « Mais lire la Bible ne suffit pas : il faut l’interpréter »,
précise Gilbert Werndorfer, auteur d’un récent ouvrage de vulgarisation sur cette religion.
Pour Philippe Haddad, rabbin de la synagogue de la rue Copernic à Paris, l’exégèse juive
nourrit trois visées différentes : « Tirer de la Bible un mode de vie, en tirer des rituels… et
l’étude pour l’étude ! » Ce rabbin affirme en effet que l’étude d’une parole considérée comme
ayant été inspirée par Dieu revêt une valeur en soi : « Avec les bonnes actions et la prière,
l’étude de la Bible est l’une des trois principales manières de servir Dieu. »
L’exégèse est-elle réservée à quelques-uns ?
Nul besoin d’être rabbin pour se risquer à des interprétations de la Torah. Hommes et
femmes, jeunes et vieux, savants et ignorants, juifs et non-juifs peuvent étudier la Bible
hébraïque, qui s’adresse à l’ensemble de l’humanité – contrairement à la Loi (« Halakha »),
que seul le peuple d’Israël est tenu d’appliquer. « Tant qu’elle reste dans la cohérence de la
Bible, toute interpré- tation est légitime ! », insiste Philippe Haddad, membre du courant
libéral du judaïsme français.
Quand on pense à l’exégèse juive, vient souvent à l’esprit l’image de ces « yeshivot »,
nombreuses en Israël, où seuls des hommes de plus de 13 ans étudient les textes sacrés du
judaïsme, sous la direction d’un maître. Or dans ces centres, ce n’est pas tant la Torah qui est
étudiée que le Talmud, compilation de commentaires rabbiniques sur la Bible.
Qu’est-ce que le Talmud ?
Pour les sages juifs, à côté de la Torah écrite existe aussi une Torah orale, révélée par Dieu à
Moïse puis transmise à travers les générations. Celle-ci a été mise par écrit vers 220 av. J.-C.
à Tibériade : c’est la Mishna (« répétition » en hébreu). Ensuite, jusqu’au VIIe siècle, elle fut
enrichie de la Guemara (« complément » en araméen). La Mishna et la Guemara donneront
naissance au Talmud (« étude »), compilé sur plusieurs siècles et en deux lieux principaux : la
Galilée (Talmud dit « de Jérusalem », terminé au IVe siècle) et la Mésopotamie (Talmud dit
« de Babylone », terminé au VIe siècle).
Mettant à mal le principe selon lequel la Bible, texte sacré, ne saurait être touchée, le Talmud
constitue l’une des premières entreprises d’herméneutique moderne. Dialectique permanente,
faisceau de discussions entre des sages ayant parfois des avis contradictoires, cette œuvre
monumentale n’a rien d’un texte normatif qui donnerait une interprétation univoque de la Loi.
Qu’est-ce que le midrash ?
Issu de la racine drsh en hébreu (« examiner »), ce terme recouvre deux réalités différentes :
l’une des plus libres des méthodes d’exégèse du judaïsme, et un ensemble de commentaires
rabbiniques de la Bible, à distinguer du Talmud. Cette littérature s’étend depuis la chute du
second Temple (en 70) jusqu’au XIVe siècle.
Au début du Moyen Âge, le midrash se divise en deux branches : le midrash halakha (qui
scrute les versets des textes législatifs de la Torah, et a une portée plutôt juridique) et le
midrash haggada (de portée plus morale, et dont le style est parfois qualifié « d’improvisation
poétique »). Car, au-delà de la législation, les rabbins s’attachent à forger l’âme du peuple juif
et développent toute une littérature faite de maximes, de légendes et d’enjolivements du récit
biblique : c’est la haggada (« récit »).
Quelle marge de liberté pour interpréter la Bible ?
« Les sages ne considéraient pas seulement la Bible comme un récit de la Révélation divine
dans le passé, mais comme un texte s’adressant aux hommes du temps présent avec leurs
interrogations et leurs préoccupations », énonce le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme
(Cerf). Autrement dit, si la Loi reste la Loi et que nul ne peut la changer, on peut la
comprendre différemment selon l’époque à laquelle on vit.
Une telle appropriation du texte relève presque du devoir du croyant. « Tout ce que Dieu
donne, dans la foi juive, n’est pas voué à être maintenu tel quel, mais travaillé, bonifié,
rappelle le rabbin Philippe Haddad. Le texte biblique se doit d’être questionné, voire critiqué,
à l’aune de la subjectivité et de la culture de chacun. » Pour le philosophe Emmanuel
Levinas, qui était aussi talmudiste, le sens profond du texte se trouve toujours « au-delà du
verset », et l’on ne peut enfermer le texte dans une seule interprétation : c’est ce qu’il a appelé
la « lecture infinie ».« L’interprétation de la Torah ne peut être qu’insolente et impertinente,
ce qui ne veut pas dire irrespectueuse », renchérit Gilbert Werndorfer, paraphrasant le
Talmud. Cet « esprit » de l’exégèse juive a participé de la vitalité du judaïsme rabbinique
autant que de ses divisions : celles-ci sont souvent nées de désaccords d’interprétation.
Quel regard l’Église porte-t-elle sur l’exégèse juive ?
Au cours de l’histoire, et en particulier au Moyen Âge, le Talmud a fait l’objet de nombreuses
condamnations de l’Église catholique, en raison de commentaires perçus comme
blasphématoires sur Jésus et le christianisme. Ainsi, en 1242, le premier procès du Talmud
s’est conclu par la crémation de 24 charrettes remplies de manuscrits talmudiques sur la place
de Grève, à Paris.
Mais de nos jours, « le principe de la possibilité d’un éclairage des textes évangéliques par
les traditions rabbiniques n’est guère mis en doute », estime le père Michel Remaud. Depuis
la deuxième partie du XXe siècle, après la déclaration du concile Vatican II Nostra aetate sur
les rapports entre l’Église catholique et les autres religions, le recours à des sources juives est
de plus en plus fréquent pour l’exégèse et la théologie chrétiennes.
2. Lire la Bible dans le protestantisme (Marie Malzac)
Historiquement, quelle place occupe la Bible dans la foi protestante ?
Le rapport à la Bible a été déterminant dans la Réforme protestante du XVIe siècle. C’est sur
l’autorité de la Bible que s’appuya le moine catholique Martin Luther pour s’opposer aux
rappels à l’ordre du pape, avant la rupture définitive avec Rome. Dans son opposition, il
affirme notamment que sa « conscience est liée par la Parole de Dieu ». Le « sola Scriptura »
(« par l’Écriture seule ») est ainsi l’un des principes réformateurs fondamentaux, aux côtés
des quatre autres « soli », qui en découlent (« soli Deo Gloria », Dieu est le seul qu’il faut
prier et adorer, « sola gratia », la grâce seule permet d’obtenir le Salut, « solus Christus », le
Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, « sola fide », c’est la foi et non les
œuvres qui permet de contribuer au Salut).
« Si tous les chrétiens reconnaissent l’autorité normative de la Bible en matière de foi », ainsi
que le rappelle Céline Rohmer, maître de conférences en Nouveau Testament à l’Institut
protestant de théologie de Montpellier, et pasteure de l’Église protestante unie de France
(EPUdF, luthéro-réformée), l’Écriture est, chez les protestants, l’autorité suprême, sans besoin
d’une médiation interprétative venue de l’institution ou d’harmonisation avec une doctrine.
La Réforme va également rendre la Bible plus accessible, au-delà des cercles religieux, en
s’appuyant sur le développement de l’imprimerie. Le public du Moyen Âge n’avait accès à la
Bible que par la liturgie de la messe en latin et les homélies, les sculptures et peintures des
églises ou les pièces de théâtre jouées sur le parvis des églises à Noël ou Pâques. En
favorisant le passage aux langues d’usage, les réformateurs vont permettre un accès plus large
aux textes.
Quel type d’interprétation pratiquent les protestants ?
Dès les origines du protestantisme, ceux qui adhèrent à la Réforme vont s’atteler à retrouver
le sens littéral des textes bibliques, délaissant l’interprétation allégorique très en vogue au
Moyen Âge. Cette forme d’exégèse, qui prêtait aux mots d’autres sens (Jérusalem pouvait
renvoyer à l’Église et non pas à la ville de Judée), pouvait ainsi donner lieu à des
interprétations fantaisistes. Fils de leur époque, bercés par un humanisme florissant et le
progrès des sciences, les protestants vont privilégier un rapport au texte plus rigoureux. Le
réformateur Jean Calvin va avoir à cœur de replacer le texte biblique dans son contexte, afin
d’en faire une lecture à la fois savante et croyante. Les outils intellectuels – linguistique,
grammaire… – visant à obtenir le texte le plus fiable par rapport à la langue originale vont
ainsi être appliqués à la Bible.
« Chez les luthéro-réformés, l’exégèse consiste en une lecture critique de la Bible, en maniant
les outils issus des sciences humaines qui permettent de mettre à distance les textes, décrit
Céline Rohmer. Pour autant, ce n’est pas un travail d’historien. Du travail de distanciation
s’ensuit un travail d’appropriation. » De leur côté, les évangéliques vont préférer une
approche plus existentielle, plus littérale.
« Dans le protestantisme, l’exégèse est un balancier », soutient la bibliste baptiste Valérie
Duval-Poujol et auteure de Dix clés pour comprendre la Bible. Ainsi, ceux qui pratiquaient
l’approche historico-critique ont rapidement constaté sa « sécheresse » et privilégient
aujourd’hui de nouvelles méthodes, comme la narratologie, qui prend le texte « dans son état
final ». « Le but, insiste-t-elle, est que le texte nous rejoigne aujourd’hui. »
Ces différences entre les exégèses protestante et catholique persistent-elles ?
« Les progrès de l’œcuménisme font qu’il n’y a aujourd’hui presque plus de séparation
confessionnelle dans l’exégèse », se réjouit Valérie Duval-Poujol. « Dans un congrès
d’exégèse, il est impossible de distinguer qui est catholique et qui est protestant », confirme
pour sa part Antoine Nouis, théologien et bibliste, qui vient de publier un commentaire verset
par verset du Nouveau Testament. « La séparation est largement dépassée. »
Le domaine biblique est unanimement reconnu comme « le fleuron de l’œcuménisme », ajoute
Valérie Duval-Poujol. Ainsi, la Traduction œcuménique de la Bible (TOB) représente un
grand succès dans ce domaine, où la francophonie est pionnière, puisqu’il s’agit de la seule
traduction avec notes communes.
Catholiques et protestants travaillent aujourd’hui les textes bibliques avec une grande liberté.
Ce qui diffère, c’est la façon de l’interpréter. Les catholiques sont censés en tirer des
conclusions cohérentes avec les dogmes de l’Église, ce qui n’est pas le cas des protestants.
« Toutefois, rappelle Antoine Nouis, toutes les traditions chrétiennes se méfient des lectures
trop personnelles. »
« Au niveau de l’exégèse, l’approche des différents chrétiens est semblable. En revanche, il
n’existe aucun lieu où l’on réfléchit à nos herméneutiques, c’est-à-dire nos façons
d’interpréter », reconnaît Valérie Duval-Poujol.
Qu’est-ce qui caractérise aujourd’hui l’exégèse protestante ?
Dans le protestantisme, le maître-mot est toujours la diversité. Selon les facultés (luthéro-
réformées, évangéliques…), les approches vont donc varier, de même que les traductions. « À
une extrémité du spectre, on trouve les adeptes d’une lecture historico-critique pure et dure,
qui utilisent des outils scientifiques pour décortiquer le texte sans s’attacher à la dimension
existentielle, explique Valérie Duval-Poujol. De l’autre côté, on trouve une approche
bibliciste, qui va aborder la Bible comme un manuel de cuisine, composé de différentes
recommandations. Entre les deux, il y a de nombreuses nuances. »
La diversité des interprétations mène parfois à de profondes divergences notamment dans le
champ éthique. C’est ce qui a été observé lors du Synode de Sète de l’Église protestante unie
de France en 2015, où les débats ont été vifs concernant la question de la bénédiction des
couples de même sexe.
« Cette pluralité des approches résonne avec la pluralité des voix qui s’expriment dans la
Bible, assure Céline Rohmer. La Bible n’a rien à craindre de la science, même des
interprétations les plus libérales. Il peut arriver, parfois, que le texte se fasse Parole, c’est-à-
dire qu’il parle dans l’existence de celui qui le reçoit. Il devient alors une expérience. Et sur
cela, aucun type d’exégèse n’a la maîtrise. »
3. Lire la Bible dans le catholicisme (Claire Lesegretain)
Quelle place occupe l’étude de la Bible dans le catholicisme ?
Après avoir connu une éclipse entre la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, due en
partie à l’influence des Lumières, l’étude des Écritures occupe aujourd’hui une grande place
dans le catholicisme, notamment en France où de plus en plus de paroisses ont des groupes
bibliques. « L’étude de la Bible est très présente dans nos prédications et dans notre
culture », souligne le jésuite Pierre Gibert, exégète de l’Ancien Testament, auteur d’une Petite
histoire de l’exégèse biblique (Cerf, 1992) et de L’Invention critique de la Bible (Gallimard,
2010). C’est en France qu’a été théorisée l’exégèse critique dès le XVIIe siècle, par le
religieux oratorien Richard Simon (1638-1712) : son Histoire critique du Vieux Testament
était très lue à l’époque – alors même que sa première édition avait été interdite et détruite.
Pourtant, au début du XXe siècle en France, il se disait dans certaines familles catholiques
qu’il était interdit de lire et d’étudier la Bible chez soi. « Mais un tel interdit n’a jamais été
formulé par la hiérarchie ecclésiale, insiste le jésuite. Au contraire. »
« Depuis la Constitution dogmatique Dei Verbum en 1965, l’étude de la Bible est devenue
très importante dans l’enseignement en théologie où elle représente un tiers du temps des
étudiants », rappelle le père Philippe Abadie, spécialiste de littérature biblique à la faculté de
théologie de l’Université catholique de Lyon. Mais si la Bible est beaucoup étudiée, cela ne
signifie pas qu’elle est très connue. « Le rapport à l’Ancien Testament est toujours un peu
difficile car les catholiques considèrent encore souvent qu’il a moins d’importance que les -
Évangiles », constate l’enseignant lyonnais.
Quelles ont été les grandes étapes dans l’interprétation des textes bibliques ?
Dès le IIIe siècle, les Pères de l’Église commencent à vulgariser quelques livres des Saintes
Écritures par leurs prédications et leurs commentaires. Ils interprètent ces livres dans une
perspective christologique. Selon Origène (environ 185-253), tous les récits bibliques
préparent au Christ : ainsi, le sacrifice d’Isaac « annonce » la mort de Jésus sur la croix. Cette
« lecture allégorique » des Écritures restera en vigueur pendant une dizaine de siècles,
jusqu’à la fin du XIVe.
Avec Luther et le développement de l’imprimerie, on revient au texte biblique en lui-même,
Ce qui conduit, à la fin du XVIe siècle, à assumer que la Bible est pleine de « contrariétés »,
c’est-à-dire de contradictions, répétitions, incohérences… « Catholiques et protestants vont
s’apercevoir qu’il y a dans la Bible quelque chose d’inachevé. Ils vont échanger ensemble sur
ces contrariétés lors de premières réunions œcuméniques, au début du XVIIesiècle », poursuit
le père Gibert.
« L’exégèse contemporaine va naître de ce retour au texte, d’autant qu’à la fin du XIXe siècle
les découvertes archéologiques obligent à lire différemment des récits qui ne concordent pas
toujours avec les lieux » (1), poursuit le père Abadie. En Allemagne, le théologien protestant
Julius Wellhausen (1844-1918), fondateur de la « critique radicale », et son disciple Hermann
Gunkel (1862-1932), fondateur de la « critique des formes », mettent en place les grands
principes de l’exégèse critique qui exerceront une influence profonde sur l’étude de l’Ancien
Testament. « Cette exégèse critique se soumet aux règles de l’analyse historique (pour dater
un texte) et textuelle (pour repérer son genre littéraire) », résume le jésuite Pierre Gibert. Des
règles appliquées par l’École biblique et archéologique française de Jérusalem (Ebaf), fondée
en 1890 par le dominicain Marie-Joseph Lagrange (1855-1938) et qui prolongent les travaux
d’Alfred Loisy (1857-1940), déclencheur, en 1902, de la crise moderniste.
« Le pontificat de Pie X a condamné l’exégèse critique, et celle-ci ne s’en est jamais
totalement remise », estime le père Gibert, en regrettant que certains catholiques parlent
d’Adam et Ève comme de figures historiques. L’encyclique de Pie XII Divino afflante Spiritu
(1943), qui a officialisé la théorie des genres littéraires dans la Bible et reconnu ainsi que tout
n’est pas historiquement vrai dans la Bible, a eu un écho limité, compte tenu de sa date de
publication. Toutefois, depuis la Seconde Guerre mondiale, la méthode historico-critique est
admise dans tous les séminaires et Vatican II fait l’unanimité de tous les évêques sur ce point.
Qui peut interpréter la Bible dans le catholicisme ?
«Tout chrétien, de par son baptême, est apte à comprendre et à interpréter la Bible, ce qui
n’empêche pas qu’il y ait des spécialistes mandatés pour cela », affirme le père Abadie.
« Chacun peut lire les Saintes Écritures », ajoute le père Gibert en rappelant cependant que,
s’il existe une lecture culturelle de la Bible qui intègre la critique, l’interprétation à
proprement parler « ne peut se faire qu’à l’intérieur de la foi chrétienne ». Toutefois, des
personnes non chrétiennes témoignent souvent que la simple lecture de la Bible, seul ou en
groupe, a transformé leur vie. Ce fut le cas du Suisse André Zamofing qui a commencé à lire
la Bible en parcourant la Palestine à pied et qui a publié une Initiation à la Bible.
En quoi l’étude des deux Testaments se complète-t-elle ?
« La Parole de Dieu est unifiée, c’est le même Dieu qui parle dans l’un ou l’autre
testament », souligne le père Abadie en rappelant que Jésus se présente comme celui qui
permet de comprendre l’Ancien Testament. Mais du fait de la durée (huit à douze ans) et de la
complexité (plusieurs langues anciennes) des études d’exégèse, tous les exégètes sont obligés
de se spécialiser : « Les vétéro-testamentaires ne s’intéressent pas au Nouveau Testament et
les néo-testamentaires ne s’intéressent pas à l’Ancien Testament », regrette le père Gibert, qui
a lui-même été longtemps un spécialiste du Pentateuque (les cinq premiers livres de l’Ancien
Testament) et des prophètes, jusqu’au jour où il a enseigné l’histoire de l’exégèse à
l’Université catholique de Lyon.
4. Lire la Bible dans l’orthodoxie (Constance Vilanova)
Quelle place occupe l’interprétation de la Bible dans l’histoire de l’orthodoxie ?
Entre le IVe et le XVe siècle, l’Église orientale lit et étudie la Bible. Les Pères de l’Église
analysent les textes en puisant dans les savoirs d’Origène ou d’Irénée de Lyon (IIIe siècle).
« Lorsqu’en Occident, le latin devient langue officielle de l’Église, les orthodoxes, eux,
traduisent l’Écriture sainte en vieux slave, en géorgien, en copte : il n’y a pas de langue
sacrée », souligne le père Nikola Cernokrak, professeur de Nouveau Testament et doyen de
l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. « Après la chute de Byzance (1453), pour la
plupart des chrétiens orientaux intégrés dans l’Empire ottoman, l’accès au texte et les études
bibliques devinrent malaisés », ajoute Michel Stavrou, professeur à l’institut parisien, qui
précise : « L’orthodoxie a donc gardé un contact vivant et existentiel avec l’Écriture sainte à
travers la liturgie (lectures, chants, hymnes, icônes, etc.) et les sacrements et la vie spirituelle,
notamment monastique. »
C’est à Kiev, grande cité russe, que reprend au XVIIIe siècle l’enseignement biblique. Sous
l’impulsion du tsar Pierre le Grand (1682-1725) sont alors créées des académies à Moscou,
Saint-Pétersbourg ou Kazan. Conséquence des révolutions russes de 1917, une diaspora
d’intellectuels orthodoxes s’installe et fonde en 1925 l’Institut Saint-Serge à Paris. « Les
premiers professeurs avaient tous une formation d’historien et/ou de linguiste. Ils étaient déjà
préparés à une lecture scientifique et historique et à une interprétation occidentale de la
Bible », précise son doyen actuel.
Quels sont les grands principes de l’interprétation orthodoxe des textes ?
« La question ne se pose pas exactement en termes de théorie scientifique, car l’exégèse
orthodoxe n’est pas une science au sens purement universitaire », décrypte Michel Stavrou
pour reprendre : « C’est plutôt une praxis qui utilise des méthodes scientifiques et s’appuie
sur une tradition, mais elle vise la contemplation spirituelle et la transformation intérieure du
lecteur, non pas la production d’une signification objective des textes. »
Traditionnellement, l’étude de la Bible se fait à l’aide des méthodes et des commentaires des
Pères de l’Église avec la traduction grecque de la Septante comme texte de référence, une
version grecque ancienne de tous les textes bibliques. Après la Seconde Guerre mondiale, le
renouveau des études bibliques de toute la chrétienté occidentale a été suivi attentivement en
France par les théologiens de l’Institut Saint-Serge. En 1946, le père Alexis Kniazeff y fonde
ainsi un cours d’Ancien Testament s’appuyant sur l’exégèse littérale moderne. Une analyse
littéraire et historique des textes reconnue aujourd’hui comme indispensable par la plupart des
exégètes orthodoxes en Occident.
Cette interprétation critique était déjà perceptible chez les théologiens de l’Église ancienne
comme Cyrille d’Alexandrie ou Jean Chrysostome (IVe). « Il existe deux approches issues de
la tradition des Pères de l’Église : l’allégorie et la typologie. La première est une méditation
sur le texte, duquel on essaye de tirer un sens spirituel, explique le père Cernokrak. La
seconde, la typologie, s’attache au sens littéral et historique des textes et perçoit le texte
comme une image, une métaphore. Les deux interprétations cohabitent aujourd’hui et ne
s’opposent pas. »
Existe-t-il un renouveau de l’exégèse orthodoxe aujourd’hui ?
Selon le père Nikola Cernokrak, « en France, un réveil de l’exégèse existe bien à l’Institut
Saint-Serge qui participe depuis plusieurs années à une lecture biblique ouverte à tous, et
œcuménique ». En 2010, a été publiée conjointement par les Éditions du Cerf et la Société
biblique française, Bibli’O, une nouvelle version de la Traduction œcuménique de la Bible, la
TOB, à laquelle ont participé plusieurs exégètes orthodoxes dont le doyen actuel de l’institut,
lui-même vice-président de l’Association œcuménique pour la recherche biblique (AORB).
Au-delà de la contribution des orthodoxes aux annotations, sont inclus, dans cette édition, les
six livres « deutérocanoniques », propres à la tradition orthodoxe, utilisés dans le canon de
l’Église mais qui ne font pas partie de la Bible hébraïque. L’AORB prépare une nouvelle
traduction de la TOB à l’horizon 2020, avec le concours des exégètes catholiques et
protestants, comme la précédente, mais aussi la participation de grands historiens bibliques
juifs. En dehors de l’Hexagone, ce renouveau de l’interprétation des textes serait variable.
Michel Stavrou s’appuie ainsi sur deux exemples. « Malheureusement, dans les pays de l’Est,
l’un des effets du retour à la liberté religieuse est une hostilité latente, chez les chrétiens,
envers tout ce qui évoque la critique scientifique soviétique. La méthode historico-critique de
l’Écriture est souvent regardée avec suspicion », remarque le professeur. D’après lui, la
Grèce est aussi un berceau de ce renouveau de l’exégèse. La méthode historico-critique y a
bien trouvé sa place, portée par Sabbas Agouridis, puis Petros Vassiliadis, exégètes de
l’Université Aristote de Thessalonique, engagés dans le dialogue œcuménique.
Quelles différences avec l’exégèse des autres traditions chrétiennes, comme le
protestantisme réformé et le catholicisme ?
« Le poids de l’institution officielle, du magistère, est moins affirmé que dans l’Église
romaine, car chez les orthodoxes, c’est tout le peuple de Dieu qui est gardien de la vérité de
la foi », affirme Michel Stavrou qui complète : « Il n’y a pas d’approche individualiste de la
lecture biblique comme on la trouve d’ordinaire dans le monde protestant. »
L’orthodoxie préserverait un équilibre entre le sens communautaire et la liberté personnelle et
se rattache ainsi au sens de la tradition des Apôtres et des Pères de l’Église dans
l’interprétation de l’Écriture sainte. « Aujourd’hui, il y a plus d’unité que de séparation dans
l’interprétation de la Bible. Dans les milieux de l’exégèse catholique, orthodoxe ou
protestante, il existe des sensibilités différentes mais pas de radicalité », résume le père
Cernokrak.
5. Lire le Coran dans l’islam (Anne-Bénédicte Hoffner)
Quelle place pour l’étude du Coran chez les musulmans ?
Le mot Coran lui-même (Al-Qur’an en arabe) exprime l’idée d’une communication orale,
d’un message transmis sous forme de récitation à voix haute. Pour les musulmans, le texte est
« descendu » sur le prophète Mohammed, « dans un arabe clair » (‘arabîun mubîn), puis fixé
sous la forme d’un livre (mushaf) reprenant les énoncés mémorisés et collectés par ses
compagnons. L’immense respect que les musulmans vouent à l’objet lui-même vient du fait
que ce livre est une copie du Livre (kitâb) originel conservé auprès de Dieu.
Pour autant, il n’a jamais cessé d’être étudié et commenté, et ce, dès les premiers siècles de
l’islam. Son statut – bien connu – de livre « incréé » est d’ailleurs lui-même le résultat d’une
controverse. Au début du IXe siècle, alors que les mutazilites refusent de faire de la parole de
Dieu un attribut divin – pour préserver l’unicité de ce dernier – et prétendent faire usage de
leur raison pour déterminer le sens d’un texte, leurs opposants affirment, eux, que la parole de
Dieu ne peut être réellement comprise. Ce n’est que depuis la victoire de ces derniers (ahl al-
sunna, les gens de la Tradition, d’où « les sunnites ») que les versets « révélés » sont
considérés comme formant un « corpus clos » qui renferme tout, et capable de s’éclairer par
lui-même.
Quelles ont été les grandes étapes de l’interprétation ?
Plusieurs anecdotes conservées dans la vie du Prophète (la sirâ) ou dans les recueils
compilant des faits ou paroles prêtés à lui ou à ses compagnons (les hadith) montrent un fidèle
venant consulter Mohammed sur le sens de tel ou tel verset. « Après sa mort, ce besoin
d’explication et d’éclaircissement, loin de se tarir, ne fit que s’amplifier », note l’historien
François Déroche. « Ainsi vit le jour celle des sciences coraniques qui domine les autres :
l’exégèse. » Cet immense effort d’explication s’est déployé dans deux directions : pour
commenter le texte verset après verset (tafsîr), et pour en déchiffrer le sens allégorique ou
mystique (ta’wîl). Des milliers d’ouvrages d’exégèse ont été écrits, certains par de grands
auteurs comme Fakhr Al Din Al Razi (1150-1210).
Les commentateurs ont utilisé plusieurs méthodes : les uns s’aidaient de la linguistique et de
la grammaire arabe, avec le souci de résoudre les problèmes nés de la mise par écrit du
Coran ; d’autres de la lexicographie pour pénétrer le sens de certains mots rares ; d’autres
encore se sont penchés sur la récitation du texte… Les plus nombreux ont tenté d’expliquer le
sens des versets coraniques en s’appuyant sur les circonstances (asbâb al-nuzûl) dans
lesquelles ils ont été révélés au prophète.
Quelle est la situation actuelle ?
L’immensité des bibliothèques islamiques ne doit pas occulter la réalité : plutôt que
d’exégèse, il faut parler de « commentaire » du Coran. Seul le Coran lui-même ou la tradition
musulmane (hadith et sirâ) sont sollicités dans ces ouvrages pour éclairer la compréhension
du texte : non l’histoire, la géographie ou l’archéologie. Ni le tafsîr ni le ta’wîl ne vont dans le
sens d’une « critique historique, textuelle (…) telle que l’envisage l’exégèse scientifique »,
rappelle le frère Emmanuel Pisani, directeur de l’Institut de science et de théologie des
religions de l’ICP.
L’autre difficulté tient à l’influence croissante, et récente, d’un courant venu d’Arabie
saoudite : le salafisme. Son présupposé ? Il suffit d’ouvrir le Coran pour le comprendre. Pire,
se risquer à l’interpréter est source de discorde (fitna) et d’égarement.
« Croire qu’un texte, et spécialement un texte considéré comme saint, parle de lui-même et
qu’il suffit de l’ouvrir pour le comprendre est une illusion », rappelle toutefois le dominicain
Adrien Candiard, auteur de Comprendre l’islam ou plutôt pourquoi on n’y comprend rien
(Flammarion, 2016). « Tout texte appelle nécessairement une interprétation, et ceux-là mêmes
qui en nient la nécessité, qui prétendent pratiquer le littéralisme le plus rigoureux, proposent
en fait eux aussi une méthode de lecture et d’interprétation. »
Quelles sont les nouvelles méthodes proposées ?
Aujourd’hui, une pression se fait jour, de l’intérieur même du monde musulman, pour
reprendre un véritable travail d’interprétation. D’une part, les atrocités commises par Daech et
ses semblables au nom d’un retour à « l’islam des sources » ont montré à quel point celui-ci
s’impose à tout croyant, à chaque époque, par fidélité même au projet divin. Par ailleurs, les
avancées de la recherche universitaire rendent intenables certaines affirmations de la tradition
musulmane.
Certains croyants musulmans choisissent de rester dans le cadre traditionnel mais assument
une interprétation au-delà du simple commentaire. Ils s’efforcent de découvrir l’intention
profonde, la visée morale (maqâsid) du Coran. Ils plaident aussi pour une contextualisation du
texte en intégrant les acquis de la modernité, les droits de l’homme, etc.
Les chercheurs travaillent, quant à eux, dans deux directions principales. Soulignant
l’importance des personnages et épisodes bibliques dans le Coran, les uns insistent sur
l’inscription de ce dernier dans le contexte des querelles entre sectes juives et chrétiennes
dans la péninsule arabique. D’autres cherchent à remettre le Coran dans son contexte arabe,
celui des tribus vivant à La Mecque et à Médine au temps de Mohammed et ainsi à explorer
les différentes strates de signification de ses mots.
Reste désormais à réconcilier ces deux approches : confessante d’une part, scientifique de
l’autre, longtemps restées cloisonnées. En Europe, faute d’instituts musulmans de bon niveau,
un nombre croissant de jeunes musulmans se tournent vers les départements de langue et de
civilisation arabes à l’université et font l’expérience de l’approche historico-critique ou de
l’approche intertextuelle. Certains en viennent à réintroduire le questionnement dans
l’exégèse coranique traditionnelle et à « sortir le texte d’une lecture purement réductrice et
utilitariste », remarque Emmanuel Pisani. « Derrière cette posture herméneutique se dessine
un enjeu philosophique, celui de la conception de l’homme et de son identité, considéré
comme un être historique. »
Vous aimerez peut-être aussi
- Libéré par la grâce de Dieu: 2017 – 500 ans de RéformationD'EverandLibéré par la grâce de Dieu: 2017 – 500 ans de RéformationPas encore d'évaluation
- La pierre rejetée par les bâtisseurs: L’«intrication prophétique» des ÉcrituresD'EverandLa pierre rejetée par les bâtisseurs: L’«intrication prophétique» des ÉcrituresÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Initiation À La Lecture Du Nouveau Testament (Stanislas Longonga) (Z-Library)Document197 pagesInitiation À La Lecture Du Nouveau Testament (Stanislas Longonga) (Z-Library)maxonblansaint9192Pas encore d'évaluation
- Bible Et Interpretation - Philippe BoulangerDocument12 pagesBible Et Interpretation - Philippe BoulangerJohnRakotoHacheimPas encore d'évaluation
- Yod 65Document252 pagesYod 65Messan acerPas encore d'évaluation
- Claude Tresmontant Introduction A La Theologie ChretienneDocument424 pagesClaude Tresmontant Introduction A La Theologie ChretienneFayçal Khettaf100% (10)
- Le Message Du Coran Adressé Aux Gens Du LivreDocument67 pagesLe Message Du Coran Adressé Aux Gens Du LivreZAKARIA KOUYATEPas encore d'évaluation
- Louis Bouyer Anthropologie Liturgique ICP-Bernardins 2014Document9 pagesLouis Bouyer Anthropologie Liturgique ICP-Bernardins 2014Adamou NESTORPas encore d'évaluation
- Sciences Religieuses Bac 1 2022 2023Document38 pagesSciences Religieuses Bac 1 2022 2023sachmormontPas encore d'évaluation
- Qui Est Dieu - Jean SolerDocument144 pagesQui Est Dieu - Jean Solermirogika100% (5)
- Jacques Dupuis SJ, Le Dialogue Interreligieux À L'heure Du Pluralisme NRT 120-4 (1998) p.544-563Document20 pagesJacques Dupuis SJ, Le Dialogue Interreligieux À L'heure Du Pluralisme NRT 120-4 (1998) p.544-563aminickPas encore d'évaluation
- Le MidrashDocument8 pagesLe MidrashJean de Dieu KonanPas encore d'évaluation
- Theo Des Rel TPDocument9 pagesTheo Des Rel TPXavier MonteiroPas encore d'évaluation
- L'ame Apres La MortDocument152 pagesL'ame Apres La MortElénaBroscoi100% (1)
- Guide Des ReligionsDocument38 pagesGuide Des ReligionsgdackamPas encore d'évaluation
- B. Ugeux, Théologie Et Sciences HumainesDocument6 pagesB. Ugeux, Théologie Et Sciences HumainesBernard UgeuxPas encore d'évaluation
- Thlou 0080-2654 2003 Num 34 2 3289Document34 pagesThlou 0080-2654 2003 Num 34 2 3289Mwami JosePas encore d'évaluation
- Ries Julien. Mircea Eliade, Histoire Des Idées Religieuses, T1. de L'âge de La Pierre, Rev Théol de Louvain, 1976Document7 pagesRies Julien. Mircea Eliade, Histoire Des Idées Religieuses, T1. de L'âge de La Pierre, Rev Théol de Louvain, 1976Emmanuel Manolis KosadinosPas encore d'évaluation
- Reponse L-ADocument12 pagesReponse L-APaul MrllPas encore d'évaluation
- Traduction Et Texte SacréDocument4 pagesTraduction Et Texte SacréMohamedBenIssaPas encore d'évaluation
- Lectures de La Bible Au Moyen AgeDocument12 pagesLectures de La Bible Au Moyen AgeFlash FacebookPas encore d'évaluation
- Le Mystere de La Reunion Spirituelle deDocument351 pagesLe Mystere de La Reunion Spirituelle debobPas encore d'évaluation
- Parole de Dieu Et Écritures SaintesDocument14 pagesParole de Dieu Et Écritures SaintesKwihangana OlivierPas encore d'évaluation
- Adieu À Emmanuel Lévinas. Roland GoetschelDocument7 pagesAdieu À Emmanuel Lévinas. Roland GoetschelAlbert OrlandoPas encore d'évaluation
- LittératureseuropéennesDocument50 pagesLittératureseuropéennesroseetgris4435Pas encore d'évaluation
- Danileau PDFDocument4 pagesDanileau PDFSadek TaboubiPas encore d'évaluation
- La Religion NoachideDocument14 pagesLa Religion NoachideIsidoreBenoitPas encore d'évaluation
- PicdelaMirandole Cabale PDFDocument5 pagesPicdelaMirandole Cabale PDFLoreleiPas encore d'évaluation
- Traduction Des Textes Religieux CoranDocument11 pagesTraduction Des Textes Religieux CoranJamelsdPas encore d'évaluation
- Arnaud Desjardins - en Relisant Les Evangiles (Bible - Jesus Christ - Esoterisme.meditation - Zen.bouddhisme)Document306 pagesArnaud Desjardins - en Relisant Les Evangiles (Bible - Jesus Christ - Esoterisme.meditation - Zen.bouddhisme)Sharklo Kipetrovitchi100% (1)
- Intervention Jean-Claude BoutinonDocument11 pagesIntervention Jean-Claude BoutinonpasteursdefrancePas encore d'évaluation
- PhaddadDocument10 pagesPhaddadblockchaincontinentalPas encore d'évaluation
- Dialogue InterreligieuxDocument31 pagesDialogue Interreligieuxjerome NESTORETPas encore d'évaluation
- I 14 L Autorite de L EcritureDocument5 pagesI 14 L Autorite de L EcritureAdony Ndinga NdingaPas encore d'évaluation
- Aaron Kayayan - La Doctrine de L'écriture (3) - La Bible Et Sa TransmissionDocument3 pagesAaron Kayayan - La Doctrine de L'écriture (3) - La Bible Et Sa TransmissionNdjenaissem patrice NdjingaroPas encore d'évaluation
- Evangile de BarnabeDocument114 pagesEvangile de BarnabeLe Turc100% (1)
- LA NAISSANCE DE LA THEO PRAT WordDocument6 pagesLA NAISSANCE DE LA THEO PRAT WordOGAWINPas encore d'évaluation
- Thèse S Marculescu BadilitaDocument356 pagesThèse S Marculescu BadilitaNolan Hekhal100% (1)
- Les Sola' de La Réforme Relectures Protestantes Et CatholiquesDocument160 pagesLes Sola' de La Réforme Relectures Protestantes Et Catholiquesأحمت السباعيPas encore d'évaluation
- ExposeDocument8 pagesExposesenin pernidaPas encore d'évaluation
- Théologie de la liturgie: La dimension sacramentelle de l’existence chré tienneD'EverandThéologie de la liturgie: La dimension sacramentelle de l’existence chré tiennePas encore d'évaluation
- Chemin ChristDocument116 pagesChemin ChristLoup GrisPas encore d'évaluation
- LuthéranismeDocument23 pagesLuthéranismeWodeyaEricPas encore d'évaluation
- Le Christianisme Devant L'islam - Theologiens en Dialogue (Cahiers de La Revue Theologique de Louvain) (French Edition)Document178 pagesLe Christianisme Devant L'islam - Theologiens en Dialogue (Cahiers de La Revue Theologique de Louvain) (French Edition)أحمت السباعيPas encore d'évaluation
- Témoins de Jéhovah La Tour de GardeDocument20 pagesTémoins de Jéhovah La Tour de GardeLinux UbuntuPas encore d'évaluation
- Du serf arbitre de Martin Luther: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandDu serf arbitre de Martin Luther: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- De La Spiritualité Patristique Et ByzantineDocument31 pagesDe La Spiritualité Patristique Et ByzantineSahrianPas encore d'évaluation
- La Premiere Mystique MusulmaneDocument36 pagesLa Premiere Mystique MusulmaneEtienne DuplanPas encore d'évaluation
- LuthéranismeDocument6 pagesLuthéranismealdenaldensonnPas encore d'évaluation
- Sectes Et Hérésies, de Lantiquité À Nos Jours by Alain Dierkens, Anne MorelliDocument241 pagesSectes Et Hérésies, de Lantiquité À Nos Jours by Alain Dierkens, Anne MorelliLatifa SelmiPas encore d'évaluation
- L'islam Début 1 157Document77 pagesL'islam Début 1 157abdelrahime.ben03Pas encore d'évaluation
- Histoire de La Philosophie MOYEN ÂGEDocument61 pagesHistoire de La Philosophie MOYEN ÂGEIgor CurletPas encore d'évaluation
- RHR 2811 PDFDocument47 pagesRHR 2811 PDFSouleymaneKonePas encore d'évaluation
- Église orthodoxe: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandÉglise orthodoxe: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Problèmes de Théologie Fondamentale NRT 108-1 (1986) p.93-104 Léon Renwart SJDocument12 pagesProblèmes de Théologie Fondamentale NRT 108-1 (1986) p.93-104 Léon Renwart SJaminickPas encore d'évaluation
- Histoire de L'EgliseDocument27 pagesHistoire de L'EglisePère elie Assaad100% (1)
- Séminaire Philosophie Médiévale, Christophe Grellard 2014Document50 pagesSéminaire Philosophie Médiévale, Christophe Grellard 2014abasotoPas encore d'évaluation
- Introduction TDLDocument11 pagesIntroduction TDLpatricioafPas encore d'évaluation
- Número 27 PDFDocument57 pagesNúmero 27 PDFPedro HenriquePas encore d'évaluation
- Drogue Et Mystique: Sur Le SudDocument24 pagesDrogue Et Mystique: Sur Le SudEthan Mehdi IkapiPas encore d'évaluation
- Quand Le Christianisme Était Nouveau BELCOT PDFDocument201 pagesQuand Le Christianisme Était Nouveau BELCOT PDFkonan jean noel yaoPas encore d'évaluation
- Dom Gueranger Abbe de Solesmes (Tome 1)Document465 pagesDom Gueranger Abbe de Solesmes (Tome 1)IHS_MAPas encore d'évaluation
- Recevoir L EspritDocument5 pagesRecevoir L EspritgemagarciaferreraPas encore d'évaluation
- Les Messages de L'escorialDocument868 pagesLes Messages de L'escorialchretiencatholiquePas encore d'évaluation
- Leçon 13 La Marque de L'ennemiDocument7 pagesLeçon 13 La Marque de L'ennemiJean-yves DorafilsPas encore d'évaluation
- Les Voleurs Dans Le Temple PDFDocument238 pagesLes Voleurs Dans Le Temple PDFngari100% (2)
- COURS Biblique N°2 CorrespondanceDocument89 pagesCOURS Biblique N°2 CorrespondanceAdelphe Moukoko100% (1)
- Lettre Aux Confères N°5Document4 pagesLettre Aux Confères N°5France FidelePas encore d'évaluation
- Foyer ChretienDocument36 pagesFoyer ChretienKodjo Nestor KEDIKPOPas encore d'évaluation
- Lettre À PolycarpeDocument3 pagesLettre À Polycarpelesage_marc1552Pas encore d'évaluation
- Du Divin Sacrifice PDFDocument505 pagesDu Divin Sacrifice PDFJhon JanerPas encore d'évaluation
- MQ38211 PDFDocument100 pagesMQ38211 PDFJeferson AndreiPas encore d'évaluation
- Abraham Pere de Tous Les Croyants Louis PDFDocument34 pagesAbraham Pere de Tous Les Croyants Louis PDFKarim MerabetPas encore d'évaluation
- Patera 2010 Exorcisme Monde BizantinDocument11 pagesPatera 2010 Exorcisme Monde BizantinVeronica Giménez BéliveauPas encore d'évaluation
- BATIFFOL Pierre (1861-1929), Leçons Sur La Messe, Paris, J. Gabalda, 1927Document372 pagesBATIFFOL Pierre (1861-1929), Leçons Sur La Messe, Paris, J. Gabalda, 1927Thomas MicheletPas encore d'évaluation
- Cours 114 m2 Le Leadership DansDocument24 pagesCours 114 m2 Le Leadership DansMUTOMBOPas encore d'évaluation
- 365 TXT Priere PDFDocument367 pages365 TXT Priere PDFRigaud FleurivalPas encore d'évaluation
- Foutchantse, SJ - 50th JubileeDocument2 pagesFoutchantse, SJ - 50th JubileeTestPas encore d'évaluation
- DIEUDocument27 pagesDIEUGilbert100% (4)
- La Formule Baptismale Dans L'écriture Et HistoireDocument5 pagesLa Formule Baptismale Dans L'écriture Et HistoireEstebanPas encore d'évaluation
- Misel Fa Tedu Fane "Saint Michel": © Madifasn@Document2 pagesMisel Fa Tedu Fane "Saint Michel": © Madifasn@Michel NDOURPas encore d'évaluation
- 21 Le Saint Sacrifice de La MesseDocument4 pages21 Le Saint Sacrifice de La MessesedenoPas encore d'évaluation
- Dupont. La Philosophie de S. Augustin. 1881.Document264 pagesDupont. La Philosophie de S. Augustin. 1881.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (1)
- Les Grands Défis Contemporains de L École ECCEDocument19 pagesLes Grands Défis Contemporains de L École ECCEHANNY GERTRUDES FERNANDEZ CORONELPas encore d'évaluation
- L'ÉVALUATION DES DONS SPIRITUELS 1 Corinthiens 12.1-7Document9 pagesL'ÉVALUATION DES DONS SPIRITUELS 1 Corinthiens 12.1-7KoutosuissePas encore d'évaluation
- ST Spirodon 12 DécDocument4 pagesST Spirodon 12 DécJO_71Pas encore d'évaluation