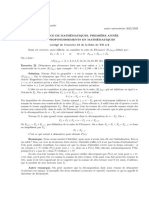Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Covid-19 Et Chloroquine Le Patient Infecte Peut-Il Choisir Son Traitement
Transféré par
Paris DE CHERBOURG0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues4 pagesTitre original
COVID-19 ET CHLOROQUINE LE PATIENT INFECTE PEUT-IL CHOISIR SON TRAITEMENT
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
7 vues4 pagesCovid-19 Et Chloroquine Le Patient Infecte Peut-Il Choisir Son Traitement
Transféré par
Paris DE CHERBOURGDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
COVID-19 ET CHLOROQUINE : LE PATIENT
INFECTE PEUT-IL CHOISIR SON TRAITEMENT ?
52199 lectures
Par Delphine Provence, Avocat.
- JEUDI 26 MARS 2020
Le refus d’administrer de la chloroquine à un patient atteint du Covid-19
constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à la
vie et au consentement du patient ?
(Article actualisé par l’auteur suite aux décrets des 25 et 26 mars 2020, et à la
décision du Conseil d’Etat du 28/03/2020.)
Dernière mise à jour : 30 mars 2020
Alors que la polémique autour de l’utilisation de la chloroquine (un médicament
traditionnellement indiqué dans le traitement et la prévention du paludisme) pour
enrayer les effets du nouveau coronavirus Covid-19 n’en finit plus de monter, la
question du choix du patient quant à la stratégie thérapeutique à adopter se pose avec
acuité.
Un patient atteint du Covid-19 a-t-il le droit d’exiger de bénéficier d’un traitement plutôt
que d’un autre ? Peut-il s’opposer au protocole thérapeutique décidé par le praticien
hospitalier ? Plus encore, peut-il imposer l’administration d’un traitement pour lequel il
n’existe pas (encore) de consensus scientifique mais à propos duquel une partie du
corps médical affirme qu’il pourrait lui sauver la vie ?
Depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002, le temps du paternalisme médical est révolu : le
patient est désormais émancipé, pleinement apte à assumer le rôle de décideur final des
soins qui le concernent.
L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique dispose que « toute personne prend, avec
le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il
lui fournit, les décisions concernant sa santé » et que « le médecin a l’obligation de
respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et
de leur gravité ».
Gravée dans la loi, l’obligation de respecter en toutes circonstances le consentement du
patient a été érigée au rang de liberté fondamentale par le Conseil d’Etat dans une
décision fondatrice du 16 août 2002 (CE, juge des Réf., Cts Feuillatey, req. n° 249552).
Il fut un temps où le patient ne pouvait pas agir en amont : sa volonté bafouée, il ne
pouvait qu’agir a posteriori sur le terrain de la responsabilité pour faute.
Depuis l’entrée en scène du référé-liberté en droit médical en 2002, le patient est mieux
armé.
L’article L. 521-2 du Code de justice administrative permet de demander au juge des
référés, lorsqu’il y a urgence, d’ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde
d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Le juge des
référés doit se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
Le droit au respect à la vie et le droit au respect du consentement du patient, tous deux
expressément reconnus comme des droits fondamentaux de la personne humaine,
bousculent le débat qui existe actuellement sur la prise en charge thérapeutique des
patients atteints du Covid-19.
D’aucuns reconnait qu’il n’existe aucun traitement validé à ce jour pour soigner la
maladie provoquée par le virus Sars-Cov-2, mais seulement des pistes encourageantes
de traitement.
L’article L. 1110-5 du Code de la santé publique consacre le droit pour toute personne,
compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert,
« de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et
de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la
meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard
des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de
traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire
courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ».
Dans cet énoncé, on entrevoit un impératif de qualité et de sécurité des soins : le
médecin doit donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs,
dévoués et conformes aux données acquises de la science. Le Conseil National de l’Ordre
des Médecins assigne une double exigence à l’exercice de la médecine : "morale, car cette
activité implique altruisme et dévouement, et scientifique, car elle impose, comme un
devoir, la compétence".
La loi impose donc au corps médical le respect du principe de proportionnalité, qui
renvoie au rapport bénéfice/risque inhérent à tout acte médical. Le praticien doit donc
apprécier la nécessité du traitement par rapport aux risques que le malade est
susceptible d’encourir.
Dans l’hypothèse où le patient ne serait pas d’accord avec la prise en charge
thérapeutique (ou l’absence de prise en charge) adoptée par l’hôpital, la question se
pose de savoir s’il pourrait saisir le juge des référés-liberté du tribunal administratif
pour que ce dernier ordonne la mise en place du traitement souhaité. En l’occurrence, un
patient contaminé par le Covid-19 pourrait-il demander au juge administratif d’imposer
le recours à l’hydroxychloroquine pour traiter son infection ?
La réponse n’est pas évidente et dépendra sans doute du profil clinique du patient.
Pour l’heure, le gouvernement a suivi l’avis rendu le 23 mars 2020 par le Haut Conseil de
la Santé Publique préconisant de restreindre l’utilisation de la chloroquine aux formes
les plus graves du coronavirus (comprendre « les patients atteints de pneumonie
oxygéno-requérante ou d’une défaillance d’organe »), traitées en milieu hospitalier, sur
décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte [1]. Le comité
scientifique a expressément exclu toute prescription par la médecine de ville et pour des
cas non sévères.
Les décrets publiés par le gouvernement les 25 et 26 mars 2020 reprennent les
recommandations du Haut Conseil en encadrant strictement la prescription et la
délivrance de la spécialité pharmaceutique Plaquenil (sulfate d’hydroxychloroquine), en
la réservant à un usage hospitalier et en interdisant aux officines de ville de la dispenser
en-dehors des indications de son autorisation de mise sur le marché. En l’absence
d’alternative thérapeutique appropriée, un médecin libéral reste toutefois libre de
prescrire l’hydroxychloroquine hors AMM pour traiter un patient atteint du Covid-19, à
la condition qu’il juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le
recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient. Mais
avec un aléa de taille : combien seront les officines à accepter de traiter ces
ordonnances… ?
Pour justifier sa position, le Haut Conseil retient que « l’hydroxychloroquine peut
provoquer des hypoglycémies sévères et entraîner des anomalies ou une irrégularité du
rythme cardiaque pouvant engager le pronostic vital », que « ce médicament comporte des
contre-indications notamment en cas d’association à d’autres médicaments » et « qu’un
surdosage peut entraîner des effets indésirables graves pouvant mettre en jeu le pronostic
vital. »
Autant d’effets secondaires que d’autres médicaments sont susceptibles de provoquer,
étant rappelé que tout traitement ou acte médical comporte des risques plus ou moins
rares et/ou plus ou moins sévères…
S’agissant de l’étude observationnelle réalisée par l’équipe du Professeur Didier Raoult,
Directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, sur 26 patients atteints
du Covid-19, le Haut Conseil de la Santé Publique indique que « ces résultats
exploratoires doivent être considérés avec prudence en raison du faible effectif de l’étude,
incluant en partie des patients asymptomatiques, de l’absence de bras témoin, du critère de
jugement uniquement virologique (pas de données cliniques) » et qu’ « ils ne permettent
pas de conclure à l’efficacité clinique de l’hydroxychloroquine ou de l’association
hydroxychloroquine + azithromycine, mais demandent à être confirmés (ou infirmés). »
Les mesures prises par le Premier Ministre n’ont pas tardées à être critiquées de tous
bords. Dans un communiqué diffusé le 26 mars 2020, l’Académie nationale de Médecine
considérait « que la libération par les pouvoirs publics de l’hydroxychloroquine pour les
malades hospitalisés en détresse respiratoire ne saurait être une réponse adaptée pour des
patients dont la charge virale est, à ce stade, le plus souvent inexistante et dont la maladie
n’est plus une virose stricto sensu mais une défaillance pulmonaire (syndrome de détresse
respiratoire aigu) liée à l’inflammation induite par le Sars- CoV-2 », rejoignant ainsi la
position exprimée par l’infectiologue français Didier Raoult. Ceci pose clairement la
question de la pertinence du protocole retenu en termes d’efficacité et de sa conformité
aux normes législatives et conventionnelles en vigueur.
Différents syndicats de médecins ont demandé au Conseil d’Etat, dans le cadre d’une
requête en référé-liberté déposée le 23 mars 2020, d’enjoindre à l’Etat de prendre toutes
mesures utiles notamment « pour fournir et autoriser les médecins et hôpitaux à prescrire
et administrer aux patients à risque l’association de l’hydroxychloroquine et de
l’azithromycine ».
Dans une Ordonnance rendue le 28 mars 2020 [2], le Conseil d’Etat rejette la demande
des requérants, estimant que les « études disponibles à ce jour souffrent d’insuffisances
méthodologiques » et que « l’essai clinique européen "Discovery", dont les premiers
résultats seront connus dans une dizaine de jours et qui doit inclure des patients pour
lesquels le traitement est initié suffisamment tôt pour apprécier l’incidence de la molécule
sur l’évolution de la maladie, permettra de recueillir des résultats plus significatifs. »
Précisons d’emblée que le Conseil d’Etat ne s’est pas vu communiquer la 2e étude
réalisée par l’institut hospitalo-universitaire de Marseille portant sur 80 patients mais
uniquement la première qui portait sur 26 patients, ce qui restreint considérablement la
portée de cette décision.
La Haute Juridiction précise également que, si le Premier ministre pouvait interdire la
dispensation de l’hydroxychloroquine en pharmacie d’officine en dehors des indications
de son autorisation de mise sur le marché, ces mesures sont « susceptibles d’évolution
dans des délais très rapides ». Le Conseil d’Etat ne ferme donc pas la porte et rappelle
qu’il se prononce « en l’état de l’instruction ». Sa position pourra donc être amenée à
évoluer très vite (le plus tôt étant le mieux au regard du contexte d’urgence sanitaire) en
présence de nouveaux éléments.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat réaffirme par ailleurs la liberté de prescription du
médecin, tout patient ayant le droit de recevoir « sous réserve de son consentement libre
et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le
médecin ». Interrogé sur un cas particulier, le Conseil d’Etat aurait donc très bien pu
avoir une approche différente.
Si le respect de la volonté du patient est aujourd’hui l’expression ultime de la liberté
individuelle et de la dignité humaine, il serait néanmoins faux de croire que cette liberté
a supplanté toutes les autres.
En effet, dans une décision rendue en référé le 26 juillet 2017 (CE, juge des réf., formation
collégiale, 26 juillet 2017, n° 412618), le Conseil d’Etat a jugé qu’un hôpital ne peut se
voir imposer de pratiquer sur un patient un traitement que l’équipe médicale n’a pas
choisi. Les juges du Palais Royal ont ainsi retenu qu’« aucune disposition ne consacre
un droit du patient à choisir son traitement », réaffirmant par là même la liberté
thérapeutique du médecin. Notons que cette affaire concernait la décision prise par trois
équipes hospitalières indépendantes d’administrer un traitement palliatif à un enfant
comateux atteint d’une leucémie aiguë et récidivante alors que les parents réclamaient
la mise en place d’une chimiothérapie curative, laquelle était jugée inappropriée par les
soignants compte tenu de la très forte probabilité de son inutilité ainsi que des grandes
souffrances et des risques élevés qu’elle devait entraîner pour l’enfant. Au regard des
faits litigieux, qui mettaient en cause la notion d’acharnement thérapeutique, la décision
rendue doit donc s’analyser avec prudence.
Quoiqu’il en soit, le médecin ne dispose pas d’un blanc-seing dans le choix du traitement
à mettre en œuvre. Le juge contrôle les diligences accomplies par l’équipe médicale en
charge du patient pour déterminer le traitement le plus approprié à son état de santé et
vérifie si la décision a bien été prise en tenant compte d’une part, des risques encourus
et, d’autre part, du bénéfice escompté. Le juge sera également sensible à l’existence de
plusieurs avis médicaux concordants pour un même cas donné.
Fort de ces éléments, la réponse à la question posée précédemment doit être nuancée :
un hôpital qui refuserait d’administrer à un patient la médication à base de chloroquine
déjà testée avec succès sur des dizaines de patients, sans lui offrir de traitement curatif
alternatif, alors même que ce patient ne présenterait pas de prédispositions négatives à
ce protocole thérapeutique et comporterait un risque sérieux de complications graves
ou de décès lié à son infection au Covid-19, pourrait se voir enjoindre par le juge des
référés l’obligation de délivrer ce traitement. A l’inverse, dans l’hypothèse où les risques
liés à l’utilisation d’un tel traitement étaient estimés supérieurs au bénéfice escompté
par le corps médical, l’hôpital ne violerait aucun droit fondamental à refuser de le
délivrer au patient.
Vous aimerez peut-être aussi
- 0512 Reanimation Vol14 N8 p727 - 735Document9 pages0512 Reanimation Vol14 N8 p727 - 735Dalila Miloud-AbidPas encore d'évaluation
- Refus SoinsDocument3 pagesRefus Soinslouisgdvalle100% (1)
- Les Droits Des PatientsDocument71 pagesLes Droits Des PatientsGhislain AssogbaPas encore d'évaluation
- Dictionnaire des Idées & Notions en Sciences de la vie et de la Terre: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire des Idées & Notions en Sciences de la vie et de la Terre: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- De La Propagation Obligatoire de L'épidémie de RhinocériteDocument9 pagesDe La Propagation Obligatoire de L'épidémie de RhinocériteMartinPas encore d'évaluation
- Patientenbehandlung F1Document60 pagesPatientenbehandlung F1Maria AluasPas encore d'évaluation
- Avis Conseil Scientifique 14 Mars 2020Document3 pagesAvis Conseil Scientifique 14 Mars 2020LeblancPas encore d'évaluation
- Droits de L'homme Et Du CytoyenDocument6 pagesDroits de L'homme Et Du Cytoyenmax1788Pas encore d'évaluation
- Csape Pass Sanitaire Et VaccinationDocument3 pagesCsape Pass Sanitaire Et VaccinationMio CelPas encore d'évaluation
- Bloc 1-Dossier Patient-Mod 7-Secret Medical Et Droits Du PatientDocument4 pagesBloc 1-Dossier Patient-Mod 7-Secret Medical Et Droits Du Patientchristelle.collardPas encore d'évaluation
- RCDocument12 pagesRCjihane amraniPas encore d'évaluation
- Bloc 1-Dossier Patient-Mod 6 - Transmission Dossier PatientDocument6 pagesBloc 1-Dossier Patient-Mod 6 - Transmission Dossier Patientchristelle.collardPas encore d'évaluation
- Responsabilité Médicale Civile Et Pénale (1)Document5 pagesResponsabilité Médicale Civile Et Pénale (1)prypadwryPas encore d'évaluation
- Information Et ConsentementDocument22 pagesInformation Et ConsentementTahar BenabdallahPas encore d'évaluation
- Réintégration Des Soignants Non Vaccinés - C'est Toujours NonDocument1 pageRéintégration Des Soignants Non Vaccinés - C'est Toujours NonFred EnuobuobPas encore d'évaluation
- 5 Declaration de Responsabilite Civile Et Penale Du MedecinDocument2 pages5 Declaration de Responsabilite Civile Et Penale Du MedecinLion LesagePas encore d'évaluation
- La Responsabilité Civile Du MedecinDocument15 pagesLa Responsabilité Civile Du Medecinmeryemlaf1996Pas encore d'évaluation
- L'obligation D'information Du MédecinDocument7 pagesL'obligation D'information Du MédecinBARRYPas encore d'évaluation
- Responsabilité Du MedecinDocument2 pagesResponsabilité Du MedecinSelma BakrPas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S0001407919340890 MainDocument13 pages1 s2.0 S0001407919340890 MainAbdou BouayadPas encore d'évaluation
- Code de Déontologie Médicale en République Du BéninDocument14 pagesCode de Déontologie Médicale en République Du BéninVictorin FANDREBOPas encore d'évaluation
- Ethique - ls5 - ls6 - Declaration Sur Les Droits Du PatientDocument4 pagesEthique - ls5 - ls6 - Declaration Sur Les Droits Du Patientaziz DoutiPas encore d'évaluation
- Fichier Produit 3004Document4 pagesFichier Produit 3004AirPas encore d'évaluation
- La Responsabilité Médicale Au MarocDocument4 pagesLa Responsabilité Médicale Au MarocHAMIDPas encore d'évaluation
- Actes Médicaux ObligatoiresDocument15 pagesActes Médicaux ObligatoiresBadLand NomadPas encore d'évaluation
- Responsabilité MédicaleDocument30 pagesResponsabilité MédicaleMahdi Safsafi100% (2)
- l15b4857 Avis Conseil EtatDocument17 pagesl15b4857 Avis Conseil EtatL'IndépendantPas encore d'évaluation
- Responsabilit - Professionnelle (PR BOUSSAYOUD)Document7 pagesResponsabilit - Professionnelle (PR BOUSSAYOUD)Alaa SenouciPas encore d'évaluation
- Droit Des PatientsDocument13 pagesDroit Des PatientsMOLAMOUPas encore d'évaluation
- Refus de Consentement Dans Le Cadre de La Vaccination Contre La Covid-19Document2 pagesRefus de Consentement Dans Le Cadre de La Vaccination Contre La Covid-19Lion LesagePas encore d'évaluation
- Lettre CMQ DSP CopieDocument14 pagesLettre CMQ DSP CopieJean Yves DumontierPas encore d'évaluation
- 01.rédaction de DocumentsDocument15 pages01.rédaction de DocumentsAhmed HoussemPas encore d'évaluation
- 09 Acte MédicalDocument6 pages09 Acte MédicalAhmed HoussemPas encore d'évaluation
- Covid Rapport Amblard Partie IDocument26 pagesCovid Rapport Amblard Partie ILe Quotidien du MédecinPas encore d'évaluation
- La Responsabilité Médicale ParamedicauxDocument56 pagesLa Responsabilité Médicale ParamedicauxTahar BenabdallahPas encore d'évaluation
- ch4, L'expérimentation Médicale Sur L'hommeDocument19 pagesch4, L'expérimentation Médicale Sur L'hommeemnaPas encore d'évaluation
- Arrete Code Deont Med FRDocument17 pagesArrete Code Deont Med FRMustafa LOUGHNIMIPas encore d'évaluation
- Memoire m2 PretDocument79 pagesMemoire m2 PretPoyouona mouliom OumarouPas encore d'évaluation
- Modeles CertificatsDocument22 pagesModeles CertificatsZoé JblPas encore d'évaluation
- Séance 7 Résumé Des Droits Des Personnes SoignéesDocument80 pagesSéance 7 Résumé Des Droits Des Personnes SoignéesKERARMICHAIMAEPas encore d'évaluation
- Résumé ContrôleDocument23 pagesRésumé ContrôleRania AttiaPas encore d'évaluation
- 2 - La Relation MédicaleDocument5 pages2 - La Relation Médicaleyannrh boukoungaPas encore d'évaluation
- 2022 07 22 Pourquoi Faut Il Réintégrer Les Soignants SLSDocument3 pages2022 07 22 Pourquoi Faut Il Réintégrer Les Soignants SLSassisteedPas encore d'évaluation
- Expose Loi 28 Mai Euthanasie 2015 08 20Document8 pagesExpose Loi 28 Mai Euthanasie 2015 08 20Aurelle GouethPas encore d'évaluation
- Dossier Médical Contenu Conservation Acces Du PatientDocument21 pagesDossier Médical Contenu Conservation Acces Du Patientsamyktg44Pas encore d'évaluation
- ConventionDocument46 pagesConventionAhmed KaramiPas encore d'évaluation
- Le Contrat Medical: DR P.PetonDocument3 pagesLe Contrat Medical: DR P.PetonYakoub HamdiPas encore d'évaluation
- Refus de Soins en Situation D Urgence TRES FAIBLEDocument10 pagesRefus de Soins en Situation D Urgence TRES FAIBLElouisgdvallePas encore d'évaluation
- Revdh 9267Document8 pagesRevdh 9267YangoPas encore d'évaluation
- Les Documents Médicaux 111Document5 pagesLes Documents Médicaux 111سبحان اللهPas encore d'évaluation
- Hcspa20201019 UtideladexetdautcordanlecovDocument34 pagesHcspa20201019 UtideladexetdautcordanlecovKarima GharsallahPas encore d'évaluation
- Consimtamant InformatDocument19 pagesConsimtamant InformatAndreea TopciuPas encore d'évaluation
- Vaccins Contre La Covid-19 - L'impossible - Amine UmlilDocument96 pagesVaccins Contre La Covid-19 - L'impossible - Amine UmlilSerge Risto100% (1)
- Cours Info Du PatientDocument18 pagesCours Info Du PatientAmarAoulmiPas encore d'évaluation
- Gates, Fauci, Et Daszak Sont Accusés de Génocide Dans Un Dossier Judiciaire - 2Document21 pagesGates, Fauci, Et Daszak Sont Accusés de Génocide Dans Un Dossier Judiciaire - 2Jellab MustaphaPas encore d'évaluation
- IndemnisationDocument19 pagesIndemnisationAya MRHPas encore d'évaluation
- Le Code Deontologie Medicale MaliDocument12 pagesLe Code Deontologie Medicale MaliNOUHOUM KEITAPas encore d'évaluation
- MAIRE de SECTEUR Renforcé Par Le CONSEIL D'ÉTAT Dans La Procédure D'ouverture D'une HALTE SOINS ADDICTIONS - 02 Octobre 2023Document6 pagesMAIRE de SECTEUR Renforcé Par Le CONSEIL D'ÉTAT Dans La Procédure D'ouverture D'une HALTE SOINS ADDICTIONS - 02 Octobre 2023Maria FloresPas encore d'évaluation
- Vida Simiti Ionut Raportul Dintre Raspunderea PDFDocument22 pagesVida Simiti Ionut Raportul Dintre Raspunderea PDFIoana Bugiag100% (1)
- L'évaluation et la réparation du dommage corporel: Questions choisies (Droit belge)D'EverandL'évaluation et la réparation du dommage corporel: Questions choisies (Droit belge)Pas encore d'évaluation
- Cours Pathologie Chirurgicale Digestive en Ligne PDFDocument152 pagesCours Pathologie Chirurgicale Digestive en Ligne PDFounzare.bahijaPas encore d'évaluation
- Ang3 Halloween SDocument2 pagesAng3 Halloween SParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- CCF Bacpro Fibre OptiqueDocument6 pagesCCF Bacpro Fibre OptiqueParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Calendrier Universitaire 2022 2023Document51 pagesCalendrier Universitaire 2022 2023Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Mineure Santé S2 AlcoolsDocument38 pagesMineure Santé S2 AlcoolsParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- CCF Stats Regression BacDocument5 pagesCCF Stats Regression BacParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Entrainement CCF Mathematiques Bac Pro Statistiques A Deux Variables001Document1 pageEntrainement CCF Mathematiques Bac Pro Statistiques A Deux Variables001Alexandre BACPas encore d'évaluation
- Nombres Chiffres Ce1 Fiche 03Document4 pagesNombres Chiffres Ce1 Fiche 03Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Corrigéexercice 21 Fiche 2 (Zeckendorf)Document1 pageCorrigéexercice 21 Fiche 2 (Zeckendorf)Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Bac Blanc 2023Document13 pagesBac Blanc 2023Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- COMPLterm2esessionjuin 2022Document2 pagesCOMPLterm2esessionjuin 2022Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Fiche Inscription Stages Hiver 2024Document1 pageFiche Inscription Stages Hiver 2024Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Pret Statistiques 2 Variables SuitesDocument5 pagesPret Statistiques 2 Variables SuitesParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- CCF MathDocument5 pagesCCF MathKalvin. Le GallPas encore d'évaluation
- Seconde - Résoudre Les Équations SuivantesDocument1 pageSeconde - Résoudre Les Équations SuivantesParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- COMPLterm 2esession2018Document2 pagesCOMPLterm 2esession2018Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Doubles Moities Niveau 1 A 10 Et Bonus en Lien Avec Le Jeu EducatifDocument22 pagesDoubles Moities Niveau 1 A 10 Et Bonus en Lien Avec Le Jeu EducatifParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- APPROFterm2esessionjuin 2023Document2 pagesAPPROFterm2esessionjuin 2023Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Liste 2020 Des Médicaments À Écarter Pour Mieux Soigner de La Revue PrescrireDocument13 pagesListe 2020 Des Médicaments À Écarter Pour Mieux Soigner de La Revue PrescrirebleuPDF100% (1)
- Approfmaths 2023 TD4Document4 pagesApprofmaths 2023 TD4Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- DistanceDocument2 pagesDistanceGladio 353Pas encore d'évaluation
- Guide Pratique La Prevention Des Difficultes Des EntreprisesDocument32 pagesGuide Pratique La Prevention Des Difficultes Des EntreprisesHâ ELmessaoudi100% (1)
- CR RenouvellementDocument4 pagesCR RenouvellementParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Verne Tour Monde PDFDocument465 pagesVerne Tour Monde PDFGuillaume C100% (1)
- Verne CentreDocument477 pagesVerne CentreAmendaPas encore d'évaluation
- Flyer Portes Ouvertes 2018Document2 pagesFlyer Portes Ouvertes 2018Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Notice 51949#02Document7 pagesNotice 51949#02Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- AmianteDocument81 pagesAmianteParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Referentiel Bts Sam Cse-2Document90 pagesReferentiel Bts Sam Cse-2Paris DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Memoire MouyaneDocument239 pagesMemoire MouyaneParis DE CHERBOURGPas encore d'évaluation
- Organisation de Chantier & Gestion de ProjetDocument97 pagesOrganisation de Chantier & Gestion de ProjetMisha LeiyaPas encore d'évaluation
- Mbembe - Pouvoir Violence Et AccumulationDocument18 pagesMbembe - Pouvoir Violence Et AccumulationNahuel Winkowsky PiutrinskyPas encore d'évaluation
- Documents de Travail Geo 1 3Document6 pagesDocuments de Travail Geo 1 3rkcrynkd2hPas encore d'évaluation
- YuyituDocument13 pagesYuyituMohamed OuaggaPas encore d'évaluation
- Etude Sur La Classe MoyenneDocument70 pagesEtude Sur La Classe MoyennesamirPas encore d'évaluation
- Finances Publiques Licence Économie Et Gestion S4/Gr C&D: PR Mohamed KARIMDocument17 pagesFinances Publiques Licence Économie Et Gestion S4/Gr C&D: PR Mohamed KARIMSiham hPas encore d'évaluation
- Marche Informatique ExposeDocument16 pagesMarche Informatique ExposeMaster kabondo100% (1)
- Le ChapeletDocument9 pagesLe ChapeletBARRYPas encore d'évaluation
- Réponses Du Quiz Français Authentique V2 PDFDocument3 pagesRéponses Du Quiz Français Authentique V2 PDFImane FirdawsPas encore d'évaluation
- Corrigé Du Thème - Dans Quelles Circonstances Les Entreprises Ont-Elles Un Pouvoir de MarchéDocument64 pagesCorrigé Du Thème - Dans Quelles Circonstances Les Entreprises Ont-Elles Un Pouvoir de MarchéMme et Mr Lafon100% (1)
- Livre Blanc RSEDocument16 pagesLivre Blanc RSEHassan El BarakaPas encore d'évaluation
- Refonte Du Systeme D Information Comptable CIHDocument61 pagesRefonte Du Systeme D Information Comptable CIHyacinovitch100% (1)
- Parties Du Corps - Mots Croisés FLEDocument1 pageParties Du Corps - Mots Croisés FLEDuver FotosPas encore d'évaluation
- Tubo - NFA 49341Document9 pagesTubo - NFA 49341TrimusPas encore d'évaluation
- Pfe Finnnnnn PDFDocument6 pagesPfe Finnnnnn PDFholidayman0% (1)
- Acsfo 0000-0000 1980 Act 1 1 872Document9 pagesAcsfo 0000-0000 1980 Act 1 1 872Azz IzzPas encore d'évaluation
- 2007 Esope PDFDocument868 pages2007 Esope PDFdaniel addePas encore d'évaluation
- 60Document704 pages60AL Saad0% (1)
- Séries Smart Viscosimètre Rotatif: Manuel D'instructionsDocument61 pagesSéries Smart Viscosimètre Rotatif: Manuel D'instructionsAhlam HamidaPas encore d'évaluation
- RECETTE MAGIQUE POUR ÊTRE ENTOURE DES FEMMES Savoir Vivre Spiritualité PDFDocument3 pagesRECETTE MAGIQUE POUR ÊTRE ENTOURE DES FEMMES Savoir Vivre Spiritualité PDFHadji BienfaiteurPas encore d'évaluation
- Arrêt Commission C. Conseil, 31 Mars 1971, CJCEDocument21 pagesArrêt Commission C. Conseil, 31 Mars 1971, CJCEDamien VERRIEREPas encore d'évaluation
- Cours 3 FirewallDocument46 pagesCours 3 FirewallKamilia bouhraouaPas encore d'évaluation
- Deputes Elus Au Premier TourDocument4 pagesDeputes Elus Au Premier Tourjosue loufoua lemayPas encore d'évaluation
- Cartes À Jouer Du XVIIIe Au XXe SiècleDocument34 pagesCartes À Jouer Du XVIIIe Au XXe SiècleB100% (1)
- (Clarinet Institute) Elgar, Edward - Salut D - AmourDocument5 pages(Clarinet Institute) Elgar, Edward - Salut D - Amourbk_saxPas encore d'évaluation
- Discontinued List May 2015Document218 pagesDiscontinued List May 2015Universal Music CanadaPas encore d'évaluation
- I Projet de Ferme Avicole Mitotomo Pour MinepatDocument17 pagesI Projet de Ferme Avicole Mitotomo Pour MinepatKARENS SORRHEPas encore d'évaluation
- Cours DiagnosticDocument5 pagesCours DiagnosticMohamed BoujnahPas encore d'évaluation
- Analyse Financière Du Bilan: ObjectifsDocument27 pagesAnalyse Financière Du Bilan: ObjectifsDjebien Ahmed Abu AbderrahimPas encore d'évaluation
- Traité de Droit Constitutionnel CongolaisDocument412 pagesTraité de Droit Constitutionnel CongolaisGlody mbembe100% (1)