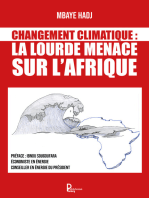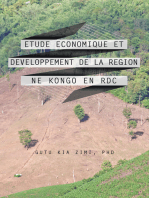Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Economie Des Ressources Naturelles 2022
Economie Des Ressources Naturelles 2022
Transféré par
cjjcmrznjpTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Economie Des Ressources Naturelles 2022
Economie Des Ressources Naturelles 2022
Transféré par
cjjcmrznjpDroits d'auteur :
Formats disponibles
UNIVERSITE CATHOLIQUE DU CONGO
Faculté d’Economie et Développement
ECONOMIE DES RESSOURCES NATURELLES
Manuel de cours
Licence 3
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL
Professeur Ordinaire
Juin 2022
Economie des ressources naturelles 2022
Table des matières
Introduction ........................................................................................................................................ 1
1. Hypothèses du cours............................................................................................................... 2
2. Objectifs et contenu du cours ................................................................................................. 2
3. Définition des concepts .......................................................................................................... 4
4. Classification des ressources naturelles ................................................................................. 4
CHAPITRE I : LES RESSOURCES NATURELLES EPUISABLES .................................................................. 6
1. Généralités .............................................................................................................................. 6
2. Classification des ressources naturelles épuisables ............................................................... 6
3. Mesure des stocks................................................................................................................... 7
4. L’exploitation des ressources épuisables : La règle d’Hotelling.............................................. 9
CHAPITRE II : LES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES ....................................................... 13
1. Généralités ............................................................................................................................ 13
2. L’exploitation des ressources renouvelables ........................................................................ 14
CHAPITRE III : LES RESSOURCES RENOUVELABLES EN PRATIQUE..................................................... 20
1. Les ressources halieutiques .................................................................................................. 20
2. La forêt .................................................................................................................................. 23
3. Le climat ................................................................................................................................ 25
4. L’eau ...................................................................................................................................... 27
CHAPITRE IV : LES RESSOURCES NATURELLES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ........ 32
1. Généralités ............................................................................................................................ 32
2. Les ressources épuisables ..................................................................................................... 33
3. Les ressources renouvelables ............................................................................................... 35
4. Maladie des ressources naturelles congolaises .................................................................... 36
CHAPITRE V : LE DEVELOPPEMENT DURABLE ................................................................................... 38
1. Introduction .......................................................................................................................... 38
2. Définitions, piliers et dimensions du développement durable............................................. 38
3. Finalités du développement durable .................................................................................... 40
4. Développement durable et croissance économique ............................................................ 40
CONCLUSION..................................................................................................................................... 42
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page i
Economie des ressources naturelles 2022
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................. 43
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page ii
Economie des ressources naturelles 2022
Introduction
L’univers est un bon travailleur de l’homme, qui met à la disposition de ce dernier, des
ressources naturelles indispensables pour la vie sur terre. Extraites, prélevées, purifiées ou
transformées, elles fournissent les matières premières permettant la satisfaction des besoins
essentiels de la vie : alimentation, habillement, logement, etc.
Ces ressources naturelles constituent un grand capital, appelé capital écologique, utilisé
depuis des générations, si bien qu’elle est à la base de tout développement économique.
Comment, en effet, Microsoft aurait été capable de réaliser un chiffre d’affaire de plus de 90
milliards, Apple de 229,23 milliards, s’il n’y avait pas de lithium, coltan, cobalt, platine,
palladium, pétrole, matières premières de base de l’industrie informatique ? Merci l’univers
pour les ressources !
Parmi les ressources naturelles, on distingue des ressources épuisables, aussi appelées
ressources de stock, comme le pétrole, le gaz naturel, le charbon, etc. et des ressources
renouvelables ou de flux : les forêts, les poissons, l’air,…
Le triste constat est que, avec la croissance démographique qui a surtout eu lieu au cours du
XXe siècle, on assiste à une consommation de plus en plus excessive de ces ressources, si
bien que cela affecte le capital constitué par l’écosystème, que nous avons appelé, capital
écologique.
Depuis le XIXe siècle, il s’est posé le problème de l’épuisement des ressources naturelles et
de ses conséquences sur la croissance économique, ainsi que le problème des dégradations
environnementales dues à nos modes de consommation et de production. Ce dernier
problème étant l’apanage de l’économie de l’environnement.
Les économistes classiques du XIXe siècle, comme Ricardo et Malthus, ont eu une
conscience aiguë de cette question au travers de leurs analyses du développement
économique et du rôle qu'y tenait la terre comme facteur de production. Le premier prévoyait
l’évolution de l’économie vers un état stationnaire à cause de la limitation des terres
cultivables et de leur fertilité décroissante, et le second voyait une contradiction indépassable
entre la croissance de la population et cette même limitation des terres. En 1865, dans The
Coal Question, Jevons annonçait la fin de la révolution industrielle en Angleterre à partir de
l’observation des limites physiques des gisements de charbon et du rôle de cette énergie pour
la croissance économique. Au XXe siècle, il a fallu attendre la publication du livre de
Forrester, World Dynamics (1971), et les travaux du club de Rome, avec le rapport Meadows
(1972), pour voir repris le même discours sur la limitation essentielle des ressources
naturelles conduisant à l’arrêt de la croissance.
En ce qui concerne l’étude économique de ces problèmes posés par l’utilisation des
ressources naturelles, ce qui est l’objet du cours d’économie des ressources naturelles, six
questions méritent l’attention de l’économiste : Quel est l’avenir de l’Economie lorsque les
ressources naturelles essentielles au mode de production arrivent à s’épuiser ? Quel est
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 1
Economie des ressources naturelles 2022
l’impact de l’épuisement des ressources naturelles sur la croissance économique ? Le progrès
technologique sera-t-il capable de mettre au point de nouvelles technologies d’extraction des
matières premières permettant d’exploiter de nouveaux gisements ? Comment utiliser les
ressources naturelles épuisables de façon durable ? Comment éviter la surexploitation des
ressources renouvelables ? Comment exploiter les ressources naturelles de manière à
satisfaire les besoins de notre génération et permettre ceux des générations futures à satisfaire
les leurs ?
Ces préoccupations constituent l’essentiel de la réflexion dans le cours d’Economie des
ressources naturelles.
1. Hypothèses du cours
En essayant de répondre de façon anticipative aux six questions soulevées dans ce cours,
nous émettons les hypothèses ci-après :
- si les ressources naturelles arrivent à s’épuiser, l’Economie s’adaptera dans ce sens
qu’il y aura des substituts qui seront compétitifs ;
- la croissance économique est liée à la croissance de consommation des matières
premières et cette consommation suit une tendance exponentielle. Si les ressources
naturelles qui sous-tendent une production économique arrivent à s’épuiser, il y aura
hausse des prix, et cela paralysera les pays producteurs et diminuera la
consommation ;
- si le progrès technologique arrive à mettre au point des nouvelles technologies
adéquates pour l’exploration et l’exploitation de nouveaux gisements, la contrainte
restera au niveau de l’environnement, mais aussi cela aura un impact sur le coût
d’extraction, car il y aura plus d’énergie pour par exemple des ressources fossiles ;
- si l’on diminue la quantité consommée des ressources épuisables non durables et on
fait le recyclage des ressources épuisables durables, l’épuisement peut être retardé ;
2. Objectifs et contenu du cours
L’objectif principal de ce cours est d’analyser la situation des ressources naturelles en rapport
avec le contexte de développement économique et social. L’étudiant devra se familiariser à
l’analyse économique appliquée à la gestion des ressources naturelles. De façon spécifique,
nous allons montrer que le concept économique de « ressources naturelles » demande à être
mieux précisé. Ceci nous conduira à faire une distinction fondamentale entre deux types de
ressources naturelles : les ressources épuisables et les ressources renouvelables.
Pour ce faire, le cours a cinq chapitres :
Le premier chapitre est consacré à l’étude des ressources épuisables. Puisque, par définition
l’utilisation d’une telle ressource réduit irréversiblement le stock disponible restant, à quel
rythme doit-on utiliser ces ressources ? La réponse, qui dépend bien évidemment des
conditions économiques de l’exploitation de la ressource, peut néanmoins trouver une
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 2
Economie des ressources naturelles 2022
formulation théorique simple : la règle d’Hotelling, du nom de l’économiste qui l’a mise en
évidence le premier en 1931. Il aborde le débat entre l’approche des géologues de la mesure
des stocks et l’approche des économistes. Le chapitre discute aussi la signification
économique d’une telle règle et en évalue la portée empirique. La seconde question posée par
l’exploitation d’une ressource épuisable est celle d’une mesure de sa rareté. Peut-on trouver
un indicateur qui nous renseigne suffisamment sur l’état des stocks encore disponibles ? Nous
présentons et discutons les principales réponses apportées à cette question.
Le second chapitre s’intéresse, quant à lui, à l’étude des ressources renouvelables. La
question du rythme d’exploitation est la même que celle concernant les ressources épuisables,
avec la contrainte supplémentaire, impliquée par la dynamique propre d’une telle ressource,
que ce rythme ne soit pas excessif et ne transforme pas la ressource renouvelable en ressource
épuisable. Potentiellement une ressource renouvelable est inépuisable, et le problème posé
par son exploitation tient précisément à la sauvegarde de ce potentiel. Là encore, la réponse
théorique à cette question prend la forme d’une règle simple qui est, pour les ressources
renouvelables, le pendant de la règle d’Hotelling pour les ressources épuisables. Comme dans
le chapitre précédent, nous dégageons la signification économique de ce résultat théorique et
nous en discutons la portée. La fin du chapitre prend acte de nombreux comportements de
surexploitation d’une ressource renouvelable. Il en analyse les causes et discute les
différentes solutions qui ont été proposées pour y mettre fin.
Le chapitre trois délaisse l’approche principalement normative et théorique du chapitre
précédent pour présenter quelques cas concrets d’exploitation des ressources renouvelables.
Y sont successivement présentés les ressources halieutiques, la forêt, le climat et l’eau.
Le chapitre quatre présente quelques ressources naturelles de la République Démocratique du
Congo. Il sera question de montrer les différentes ressources présentes en RDC ainsi que la
question de la malédiction des ressources naturelles sera abordée.
Enfin le dernier chapitre fait le lien entre deux périodes qui peuvent être schématiquement
distinguées concernant l’étude des ressources naturelles. La période de l’utilisation sans frein
de ces ressources et celle de la montée des préoccupations induites par les conséquences de
cette utilisation immodérée. Cette conjonction des deux côtés de la médaille se décline
aujourd’hui sous l’appellation de développement durable. Le succès de cette notion est tel
qu’il en devient problématique. Le développement durable semble aujourd’hui inspirer aussi
bien les hommes politiques que les chefs d’entreprises. Et pourtant, notre planète n’a sans
doute jamais paru aussi menacée à ses habitants.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 3
Economie des ressources naturelles 2022
3. Définition des concepts
- Economie des ressources naturelles
Étymologiquement, le mot « Economie » vient du grec oikounomia provenant de
l’association de deux mots grecs oikos (maison, famille) et nomos (loi, règle), ce qui signifie
littéralement « lois ou règles de la maison ».
Selon E. Malinvaud, cité par De Montbrial et Fauchart (2004), l’économie est la science qui
étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des
hommes vivant en société ; elle s’intéresse, d’une part, aux opérations essentielles que sont la
production, la distribution et la consommation des biens, d’autre part, aux institutions et aux
activités ayant pour objet de faciliter ces opérations.
L’économie des ressources naturelles est une branche de la science économique qui
comptabilise les ressources naturelles, les évalue sur le plan économique, et s’interroge sur
les modalités de leur usage afin de définir des politiques publiques pour une gestion efficiente
des ressources naturelles : réserves de matières premières, stocks de ressources non
renouvelables, biodiversité, ressources en eau, réserves halieutiques,…
- Ressources naturelles
D’après le dictionnaire de Science Economique (2016), les ressources naturelles sont des
biens qui ne sont pas produits par l’homme mais qui lui sont utiles soit comme facteur de
production (minerais, ressources énergétiques, eau, etc.), soit comme biens de consommation
(eau, poissons, gibiers, etc.).
Au sens économique, on parle de ressource naturelle quand la ressource sera utilisable avec la
technologie existante et exploitable avec les prix actuels. (Rotillon, 2005)
- Ressources épuisables
Ce sont celles qui se présentent dans la nature sous la forme de stocks finis d’un point de vue
physique, c’est-à-dire dont les stocks sont globalement limités et diminuent au fur et à mesure
des flux de prélèvements (énergie fossiles, réserves de minerais, etc.).
- Ressources renouvelables
Contrairement à celles épuisables, les ressources renouvelables ont une capacité de
reproduction propre, indépendamment de l’intervention de l’homme et sont potentiellement
inépuisables (forêts, poissons, énergie solaire, etc.).
4. Classification des ressources naturelles
Il est important de signaler, d’entrée de jeu, qu’à l’échelle de temps géologique, toutes les
ressources naturelles sont renouvelables. Ce qui n’est pas le cas à l’échelle de temps humain,
car les hommes ne peuvent vivre au-delà de 1 000 années. Ceci nous amène à adopter la
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 4
Economie des ressources naturelles 2022
classification générale des ressources naturelles. Il ressort de cette classification deux types
de ressources naturelles : les ressources épuisables et les ressources renouvelables. Les
ressources épuisables comme nous allons le voir dans la suite du cours, sont caractérisées par
la finitude de leurs stocks. Utiles à l’homme, leur usage peut conduire à leur disparition.
Tandis que les ressources renouvelables sont caractérisées par leur capacité de régénération
naturelle. Lorsqu’elles sont surexploitées, elles peuvent connaître l’extinction.
Signalons cependant, que, d’un point de vue strictement économique, toutes les ressources
sont en fait épuisables si on entend par épuisable la possibilité d’une utilisation qui conduise
à la disparition de la ressource. Les cris d’alarme de ce début de siècle sur la perte de
biodiversité et la disparition de nombreuses espèces animales montrent que cette possibilité
n’est pas seulement théorique. Néanmoins, la distinction précédente entre ressources
épuisables ou renouvelables du fait de l’existence ou non d’une capacité de régénération
naturelle est utile en ce qu’elle met l’accent sur les enjeux différents qu’induit leur usage. Du
fait de sa régénération naturelle, une ressource renouvelable est potentiellement inépuisable si
son usage prend correctement en compte sa dynamique propre, c’est-à-dire si son rythme
d’utilisation n’est pas systématiquement supérieur à son rythme de reproduction. La question
principale posée par l’utilisation de ces ressources est donc d’éviter leur extinction. Cette
question ne se pose pas pour les ressources épuisables au sens physique, puisque leur
utilisation conduit nécessairement à leur disparition.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 5
Economie des ressources naturelles 2022
CHAPITRE I : LES RESSOURCES NATURELLES EPUISABLES
1. Généralités
Les ressources naturelles épuisables, aussi appelées ressources non renouvelables ou encore
ressources de stock, se présentent dans la nature sous la forme de stocks finis d’un point de
vue physique et c’est cette caractéristique qui justifie leur dénomination. Quand ces
ressources sont essentielles au mode de production, comme le pétrole aujourd’hui, se pose la
question de l’avenir de l’économie, une fois cette ressource épuisée. Toutefois, l’estimation
de ces stocks est incertaine et cet avenir n’est pas facile à dater.
On doit constater que, dans le passé, l’humanité s’est trouvée confrontée à cette question.
C’était le fond de l’argumentation de Jevons (1865) à propos du charbon, pour lequel il ne
voyait pas de substitut disponible dans un proche avenir. A cette époque, le pétrole servait
surtout à l’éclairage sous forme de pétrole lampant, obtenu à partir de la distillation du
charbon. On peut comprendre qu’il n’était pas facile d’y voir un substitut futur de ce même
charbon.
Parmi les ressources naturelles épuisables, nous pouvons citer :
- les ressources fossiles : pétrole, gaz naturel, charbon, etc.
- les ressources minières : or, fer, argent, coltan, cuivre, etc.
- les sols : les sols sont considérés comme étant des ressources non renouvelables dans
ce sens que leur perte et leur dégradation ne sont pas récupérable au cours de la vie
humaine.
2. Classification des ressources naturelles épuisables
Il existe deux sortes de ressources naturelles épuisables : les ressources durables et celles non
durables.
Les ressources épuisables durables (exemple : or, argent) sont celles qui peuvent être recyclés
dans certains de leurs usages et peuvent être utilisés pour des usages futurs tandis que les
ressources épuisables non durables (pétrole) sont celles dont l’extraction et la consommation
les rendent inutilisables pour des usages futurs.
Signalons cependant que, le caractère durable des ressources épuisables peut retarder
l’épuisement de la ressource, mais ne peut l’empêcher définitivement.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 6
Economie des ressources naturelles 2022
3. Mesure des stocks
3.1. Approche des géologues
L’estimation des stocks de ressources naturelles épuisables, pour délicate qu’elle soit, est un
élément important de notre appréciation sur le devenir de notre système de production. On va
voir, cependant, que la mesure des quantités disponibles de ressources se heurte à de
nombreuses difficultés.
Jusqu’à la fin des années 1970, une grande confusion régnait dans le vocabulaire désignant
les ressources naturelles minérales. Ainsi, par réserves prouvées, on entendait aussi bien les
gisements de minerai de fer dont 85 % étaient estimés récupérables, le pétrole qui était estimé
récupérable à 100%, ou le charbon qu’il soit récupérable ou non. Progressivement, deux
agences américaines, l’US Bureau of Mines et l’US Geological Survey, ont proposé une
normalisation du vocabulaire qui est maintenant adopté par l’industrie et les autres pays, et
dont on trouvera en encadré quelques définitions.
Comme on peut le constater, la notion de réserve n’est pas purement physique, mais physico-
technico-économique. Il s’agit pourtant d’une normalisation qui est loin de régler tous les
problèmes.
Les Réserves
Réserves prouvées : ce sont des ressources découvertes et récupérables avec une
certitude raisonnable, et économiquement exploitables compte tenu des prix courants et
de la technologie disponible.
Réserves probables : ce sont des ressources découvertes mais non exploitées. Il s’agit
d’une extrapolation de ressources potentielles, fondée sur la connaissance des formations
géologiques et de leur lien avec la ressource. Ainsi, on sait que le pétrole se forme dans
les bassins sédimentaires dont 600 sont recensés dans le monde, les deux tiers ayant été
explorés. On considère généralement que ces ressources ont au moins 50% de chances
d’être exploitables avec la technologie et les conditions économiques du moment.
Réserves = Réserves prouvées + Réserves probables.
Ressources présumées : ce sont des ressources non découvertes mais qu’on suppose
pouvoir trouver un jour dans les sites connus et déjà explorés. Ainsi, on ne connaît pas le
potentiel de pétrole en mer du Nord.
Ressources spéculatives : ce sont des ressources non découvertes dans des sites non
encore explorés mais où on sait pouvoir trouver la ressource. La plupart des bassins
sédimentaires non encore explorés sont dans les fosses profondes du Pacifique que la
technologie actuelle ne permet pas de visiter mais dont on sait avec une quasi-certitude
qu’ils contiennent du pétrole. Il faut noter que, il y a une cinquantaine d’années, la mer du
Nord ne contenait que des ressources spéculatives.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 7
Economie des ressources naturelles 2022
Le tableau ci-dessous donne une estimation des réserves de quelques ressources dans le
monde en milliards de tonnes équivalent pétrole (tep).
Tableau n°1 : Estimation des réserves (en milliards de tonnes équivalent pétrole, tep)
Ressource Réserves prouvées Réserves probables
Pétrole 140 250
Gaz 120 130
Charbon 500 3000
Source : ADEME, cité par Rotillon (2005)
Toutefois, si le vocabulaire est commun, ni les définitions, ni les pratiques ne le sont. En
particulier, les Américains ne tiennent compte que des réserves prouvées quand la plupart des
autres pays considèrent les réserves (prouvées + probables) pour évaluer les stocks. En effet,
la Security & Exchange Commission (SEC) impose à toutes les compagnies enregistrées à la
Bourse américaine de ne déclarer que les réserves prouvées.
Le montant des réserves prouvées dépend aussi du coût auquel on considère que la ressource
ne sera plus exploitable du point de vue de sa rentabilité économique. Avec un prix du baril
de pétrole à 80 dollars, on n’utiliserait plus cette matière première mais des substituts parfaits
qui peuvent être produits à partir du charbon à un coût inférieur.
Au total, la notion de réserves prouvées est très ambiguë et introduit beaucoup d’incertitudes
dans l’évaluation des ressources.
3.2. Approche des économistes
Les évaluations fournies par les géologues du niveau des stocks et le calcul du ratio réserves
prouvées/production de l’année sont considérés de peu d’intérêt pour les économistes. Ceux-
ci comparent plutôt l’évolution de la consommation et celle des prix de la ressource, et
constatent que la consommation croit quand les prix diminuent, posant ainsi la question de la
réalité de l’épuisement des ressources. Au fur et à mesure que la ressource devient plus rare,
son prix augmente, reflétant cette rareté croissante, et son usage diminue, permettant à des
substituts de devenir compétitifs et, à terme, de la remplacer. C’est précisément cet
enchaînement que Jevons ou le Club de Rome n’ont pas pris en compte et qui mine leur
discours pessimiste. Il est cependant nécessaire d’y regarder de plus près.
Pour ce faire, on va examiner les différents éléments composant le coût total d’obtention du
pétrole du golfe Persique. On peut le décomposer en quatre parties : exploration,
développement, exploitation et transport. Les coûts de développement et les coûts
d’exploration pour découvrir de nouveaux gisements sont sans doute les plus complexes à
estimer. Les travaux d’Adelman (1973) évaluent l’investissement initial pour un nouveau
baril à 2,50 dollars. Toutefois, on doit tenir compte du taux d’intérêt, de la prime de risque
liée à l’activité pétrolière et d’un taux reflétant l’épuisement progressif de la ressource pour
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 8
Economie des ressources naturelles 2022
calculer le coût de développement ajusté selon la formule : Coût de développement ajusté
= investissement initial x (taux d’intérêt + prime de risque + taux d’épuisement)
En prenant les deux premiers taux égaux à 10% et le dernier à 2%, Adelman obtient un coût
de développement ajusté de 0,55 dollar par baril (2,50 dollars ×[0,1+0,1+0,02]). Quant aux
coûts d’exploitation et de transport, pour l’Arabie Saoudite, ils sont respectivement de 0,25
dollar et de 1,50 dollar par baril, ce qui conduit à un coût total de 2,30 dollars par baril
(0,55+0,25+1,50).
Un calcul semblable pour un baril de brut provenant de la mer du Nord d’Alaska le conduit à
un coût total de 15 dollars, la différence étant due à des conditions d’exploitation plus
difficiles (localisation géographique, climat), conduisant à utiliser des technologies plus
coûteuses. Il n’est donc pas surprenant que les coûts d’obtention d’un baril de brut soient très
différents selon la region de production, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau n° 2 : Coût technique (hors transport) d’un baril de brut (en dollars US)
Exploration Développement Production Total
Russie 3 3,9 5,1 12
Mer du Nord 2,4 3,6 5 11
Angola 2 4,5 3,6 10,1
Golfe du Mexique 1,5 3 4,5 9
Amérique latine 2 3 3,6 8,6
Mer Caspienne 1,5 2,4 4,1 8
OPEP- Moyen-Orient 0,4 1 1,6 3
Source : ENSPM FI, d’après ADL-1999 Long Terme Outlook, cité par Rotillon (2005)
En comparant les coûts d’obtention d’un baril de pétrole et les réserves disponibles, on
constate que la production de pétrole a augmenté dans les plus basses. Simultanément, la
production s’est réduite dans le golfe Persique où les réserves sont les plus importantes et les
coûts les plus faibles.
Par ailleurs, si on regarde l’évolution du prix du brut, on remarque qu’il était entre 15 et 20
dollars le baril pendant dix des onze années entre 1986 et 1998.
4. L’exploitation des ressources épuisables : La règle d’Hotelling
4.1. Cadre théorique
Le débat sur l’épuisement d’une ressource se cristallise autour de la mesure de sa rareté :
l’approche géologique, avec ses ratios, s’oppose à l’approche économique, davantage centrée
sur l’examen des prix et des coûts de production. C’est cette seconde voie que nous allons
explorer dans cette section avec l’examen de la règle d’Hotelling, dont l’objet est précisément
de construire un indicateur de rareté économique. Même si Lionel Gray (1914) en avait posé
les premières bases, c’est en effet Harold Hotelling qui donne le premier exposé rigoureux de
la théorie économique néoclassique des ressources épuisables. Dans son article, « The
Economics of Exhaustible resources », publié dans The journal of Political Economy (1931),
il détermine notamment la valeur d’un stock de ressource épuisable, l’évolution de cette
valeur et le rythme d’extraction de la ressource en fonction du régime économique
(concurrence, monopole, gestion centralisée) en vigueur.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 9
Economie des ressources naturelles 2022
Si l’analyse que présente Hotelling de l’exploitation d’une ressource épuisable et des
conséquences de cet épuisement sur le prix de la ressource et son rythme d’extraction est
formalisée en recourant au calcul des variations, l’intuition économique sous-jacente n’en est
pas moins très simple.
Un stock d’une ressource épuisable peut être considéré comme un actif particulier produisant
un revenu dans le temps. L’extraction, puis la consommation d’une unité de ressource
impliquent l’impossibilité d’extraire et de consommer cette unité plus tard, puisque le stock
(supposé ici fini et connu avec exactitude) est réduit suite à cette décision. Extraire
aujourd’hui entraîne donc la perte demain du revenu qu’aurait procuré cette unité que l’on
vient d’extraire.
Une firme qui cherche à maximiser la valeur actuelle de ses profits est alors placée devant un
coût d’opportunité, conséquence de l’arbitrage entre extraire et vendre aujourd’hui contre
perdre demain le revenu qu’elle aurait tiré de la ressource si elle n’avait pas été extraite. Si la
firme décide d’extraire une unité, la valeur de cette unité extraite, sa valeur d’extraction, est
égale à son prix de vente diminué du coût d’extraction. Si elle décide de ne pas extraire, c’est
que la valeur de la ressource en terre est pour elle plus importante que la valeur d’extraction.
Cette « valeur de non-extraction» est le coût d’opportunité d’épuisement de la ressource.
À la marge, c’est-à-dire pour la dernière unité extraite, il doit être égal à la valeur
d’extraction. En effet tant que la valeur d’extraction lui est supérieure, la firme a intérêt à
extraire et elle s’arrête juste avant que le coût d’opportunité de l’épuisement devienne
supérieur à la valeur d’extraction, puisque cela signifierait que cette dernière unité aurait plus
de valeur non extraite qu’extraite. Cet arbitrage, impliqué par la décision d’extraire ou non, se
posant à chaque instant, le raisonnement précédent implique que cette égalité entre valeur
d’extraction et coût d’opportunité d’épuisement doit aussi être vérifiée à chaque instant.
Ce coût d’opportunité est connu sous une variété de noms. On parle ainsi de coût d’usage,
pour refléter le coût de la moindre disponibilité future de la ressource. On le désigne aussi par
valeur in situ, ou valeur en terre, pour indiquer que la ressource non extraite a une valeur en
tant que telle. On le désigne enfin comme une rente de rareté, puisqu’on vient de voir qu’il
est égal à la valeur d’extraction, c’est-à-dire à la différence entre le prix de marché de la
ressource et son coût d’extraction (d’où la rente).
Dans un régime en concurrence parfaite, la règle d’Hotelling se traduit par :
p(t) = c(t)+λ(t)
avec p(t) le prix de la ressource à la date t, c’est-à-dire le prix unitaire auquel elle est vendue
sur le marché, c(t) le coût d’extraction à la même date et λ(t) la valeur en terre ou la valeur
d’extraction à la même date t.
Le coût d’extraction c(t) dépend du progrès technique et de la profondeur des gisements au
fur et à mesure de l’épuisement.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 10
Economie des ressources naturelles 2022
La valeur en terre ou d’extraction λ(t) croît avec le taux d’intérêt r(t).
D’où l’expression simple de la règle d’hotelling :
∆𝜆
𝑟(𝑡) =
∆𝑡
4.2. Interprétation de la règle d’Hotelling
En temps discret, si l’on considère deux périodes, le possesseur de la ressource peut : soit
vendre tout de suite pour obtenir une somme 𝑝𝑡 , qu’il place pour obtenir 𝑝𝑡 (1 + 𝑟) à la
période suivante (r étant le taux d’intérêt) ; soit vendre à la seconde période au prix 𝑝𝑡+1 .
Ainsi, on a par arbitrage, que 𝑝𝑡+1 = 𝑝𝑡 (1 + 𝑟)
En temps continue, supposons que la rente initiale soit 𝑝0 . L’arbitrage du possesseur de la
ressource est alors le suivant : soit il vend tout de suite à un prix 𝑝0 , soit il attend pour vendre
à un temps t. si on appelle 𝑝𝑡 le prix de vente de la ressource au moment t, on voit donc que
par arbitrage, 𝑝𝑡 = 𝑝0 𝑒 𝑟𝑡 .
Il découle de la règle d’Hotelling que si le prix augmente, la demande diminue et on tend vers
l’épuisement de la ressource (le stock q(t) diminue). Ceci est illustré dans la figure ci-
dessous, dans l’hypothèse où l’on extrait la même quantité à chaque date t.
q(t)
0 t
4.3. Indicateur de rareté d’une ressource épuisable
Si les ressources sont rares et si les usagers le savent, alors quel indicateur peut-il refléter
cette rareté ?
Les trois variables économiques précédentes (coût d’extraction, prix de marché et valeur en
terre) sont utilisées comme indicateurs de rareté. Les trois sont reliées par la relation :
𝑝(𝑡) = 𝑐(𝑡) + 𝜆(𝑡)
4.3.1. Le coût d’extraction comme indicateur de rareté
C’est le point de vue adopté par Barnett et Morse (1963) dans ce qui est considéré comme la
première tentative d’ampleur de mesurer la rareté de différentes ressources naturelles. Pour
Barnett et Morse, la découverte de nouveaux stocks de qualité supérieure à ceux qui sont
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 11
Economie des ressources naturelles 2022
exploités réduit le coût d’accès, de même que les progrès technologiques, tandis que
l’épuisement de la ressource l’augmente.
4.3.2. Le prix de marché
L’observation directe des prix auxquels s’échangent les réserves peut indiquer qu’une
ressource devient rare mais faut-il signaler que la hausse du prix peut aussi être due à d’autres
facteurs, le prix de la technologie dans le marché par exemple.
4.3.3. La valeur en terre comme indicateur de rareté
La valeur en terre λ étant dépendant du prix 𝑝 et du coût d’extraction 𝑐, lorsque le coût
d’exploitation excède le prix du marché.
Finalement, en pratique, chacune de ces trois variables précédentes apporte des informations
sur la rareté de la ressource et une analyse approfondie de son évolution doit toutes les
prendre en compte.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 12
Economie des ressources naturelles 2022
CHAPITRE II : LES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES
1. Généralités
Une ressource renouvelable est une ressource qui a une capacité de reproduction propre,
indépendamment de l’intervention humaine. C’est pourquoi, pour marquer la différence
d’avec les ressources épuisables, on parle généralement de population ou de biomasse pour
désigner le stock de ressource. Dans un écosystème donné, une ressource naturelle
renouvelable, par exemple une espèce de poissons, croit à un taux égal à la différence entre
son taux de natalité et son taux de mortalité. Ce taux n’est, en général, pas constant et dépend
notamment de l’importance de la population, elle-même étant fonction de son écosystème.
Quand les poissons sont peu nombreux, ils ont suffisamment de nourriture pour se reproduire
à un taux élevé, et, à l’inverse, quand la nourriture devient rare du fait d’un trop grand
nombre de poissons présents dans l’écosystème, le taux de croissance devient faible et peut
même s’annuler quand les taux de natalité et de mortalité s’équilibrent.
On retrouve la même dynamique dans l’évolution d’une forêt. Sur une surface donnée, la
forêt commence par croître rapidement parce que les arbres ont suffisamment d’espace mais,
au fur et à mesure que le nombre d’arbres augmente, chaque arbre nouveau dispose de moins
de terre, d’eau, a plus de difficultés à avoir accès au soleil.., et la croissance de la forêt se
réduit jusqu’à atteindre un équilibre où un nouvel arbre ne peut se développer que si un
ancien meurt.
Schématiquement, la croissance d’une ressource renouvelable est une fonction d’abord
croissante puis décroissante de la taille de la population. Elle est nulle quand il n’y a pas de
ressource et redevient nulle quand le taux de natalité s’équilibre avec le taux de mortalité. Le
niveau de la population correspondant à cette situation est la capacité de charge de la
ressource. C’est un équilibre stable, hors de toute intervention humaine, puisque, au-delà de
ce seuil: une unité de ressource supplémentaire implique un taux de mortalité supérieur au
taux de natalité et donc une réduction de la population qui revient à sa capacité de charge.
Inversement, si la capacité de charge n’est pas atteinte, la croissance de la population est
positive et sa taille se rapproche de sa capacité de charge jusqu’à la rejoindre finalement.
Par ailleurs, la forme de la relation entre la croissance de la population et sa taille implique
qu’il existe un niveau de stock où cette croissance est maximum 𝑋𝑝𝑚𝑒 . On nomme ce niveau
de stock le prélèvement maximum équilibré ou prélèvement soutenable maximum. En effet,
si l’homme ponctionne cette ressource d’un montant égal à la variation de population
correspondante, la taille de la population reste constante et égale à 𝑋𝑝𝑚𝑒. Enfin, un autre
paramètre est utile pour caractériser une ressource renouvelable, c’est son taux de croissance
intrinsèque, qui est la limite de son taux de croissance quand la taille de la population tend
vers zéro. Une ressource avec un taux de croissance intrinsèque élevé est une ressource qui se
développe très rapidement dès qu’elle compte quelques unités.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 13
Economie des ressources naturelles 2022
Il a été estimé pour plusieurs espèces de poissons dont le tableau suivant donne quelques
exemples avec la capacité de charge et la production soutenable maximum correspondantes.
Parmi les ressources naturelles renouvelables, nous pouvons citer :
- les ressources halieutiques (qui concernent la pêche) : sardines, harengs, anchois,
morues, etc.
- les ressources cynégétiques (qui concernent la chasse) ;
- la forêt ;
- l’énergie solaire ;
- l’énergie éolienne ;
- l’eau, etc.
2. L’exploitation des ressources renouvelables
Nous avons caractérisé les ressources renouvelables, en opposition avec les ressources
épuisables, comme des ressources qui ont une capacité naturelle de régénération. De ce fait, à
l’inverse de ces dernières, elles peuvent être indéfiniment exploitées, à condition de ne pas les
utiliser au-delà d’un seuil garantissant l’équilibre entre la ressource et son milieu. Si, pendant
la première moitié du XXème siècle, l’abondance des stocks pour la plupart des ressources
renouvelables exploitées par l’homme (eau, air, forêts, poissons) a été telle que le risque de
leur extinction ne s’est pas posé, l’apparition de plus en plus fréquente de problèmes de
surexploitation a conduit les économistes à en analyser les causes et à tenter d’y remédier.
C’est ce que nous tentons de présenter dans cette section.
2.1. L’exploitation optimale d’une ressource renouvelable
Que les ressources renouvelables soient potentiellement Inépuisables, cela ne nous dit pas à
quel rythme nous pouvons les utiliser. La capacité de reproduction naturelle de ces ressources
se traduit par la production d’un surplus. La totalité de ce surplus peut être prélevée sans que
le niveau initial du stock en soit modifié, c’est le prélèvement soutenable. Au-delà, le stock
diminue, en deçà il augmente. L’importance de ce surplus dépend essentiellement du niveau
initial du stock. On a vu à l’introduction de ce chapitre que l’on représentait généralement la
croissance d’une ressource renouvelable par une fonction d’abord croissante puis
décroissante du niveau du stock existant et qu’il y avait donc un niveau particulier du stock
(noté 𝑋𝑝𝑚𝑒 ) où cette croissance était maximum. Le prélèvement du surplus correspondant est
lui aussi maximum, d’où sa dénomination de production maximum équilibrée (PME). Cette
PME semble un bon candidat pour notre recherche d’un niveau optimal de prélèvement. Bien
entendu, il n’y a aucune raison pour que le niveau de la ressource soit justement égal à celui
où sa croissance est maximale au moment où l’on décide de l’exploiter, mais il permet de
définir une règle de gestion simple pour cette exploitation : rejoindre au plus vite le niveau du
stock où l’on pourra extraire la PME.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 14
Economie des ressources naturelles 2022
« Au plus vite » veut dire que, si le stock initial de la ressource est inférieur à 𝑋𝑝𝑚𝑒 , il ne faut
rien prélever pour qu’elle croisse, tandis que, s’il lui est supérieur, il faut exploiter la
ressource au maximum des capacités de prélèvement pour qu’elle décroisse jusqu’à
l’atteindre. Ensuite, on pourra extraire la PME indéfiniment sans modifier le niveau atteint.
Ainsi le niveau du stock correspondant à la PME est à la fois un objectif et un critère qui
permet de juger de l’existence ou non d’une surexploitation, tout stock en deçà de ce niveau
étant considéré comme surexploité.
Toutefois, malgré sa simplicité et son apparence raisonnable, puisqu’elle semble promettre un
prélèvement maximum, cette règle ne tient pas compte des conditions économiques de
l’exploitation de la ressource.
2.2. Règle fondamentale de gestion d’une ressource renouvelable
Cette section est consacrée à la présentation, pour une ressource renouvelable, de l’équivalent
de la règle d’Hotelling pour les ressources épuisables. C’est dire que, d’une part, nous
adoptons un point de vue normatif et d’autre part, que la règle obtenue n’est valide que sous
un certain nombre d’hypothèses, dont la principale est l’absence d’incertitude sur les stocks.
Historiquement, les économistes ayant abordé cette question de la gestion d’une ressource
renouvelable l’ont fait en considérant les ressources halieutiques et nous suivrons cette
tradition en utilisant le vocabulaire qui s’est progressivement imposé dans la littérature.
Toutefois, les problèmes de pollution ou de régénération des milieux naturels peuvent être
assimilés aux problèmes d’exploitation de ressources renouvelables. Rejeter des effluents
dans une rivière, des gaz dans l’atmosphère, des pluies acides sur des forêts ou des nitrates
dans une nappe phréatique est une forme d’exploitation d’un actif naturel qui utilise sa
capacité d’assimilation.
La règle fondamentale de gestion d’une ressource renouvelable repose sur la même notion
d’arbitrage qui nous a permis d’aboutir à la règle d’Hotelling : le stock d’une ressource
renouvelable peut en effet s’assimiler à un stock de capital pour lequel l’exploitant recherche,
à l’équilibre, un rendement identique à celui des autres actifs existants, à savoir le taux
d’intérêt. Nous présentons ici le modèle statique classique de Gordon (1954).
2.3. L’exploitation économique d’une ressource renouvelable
Nous supposons ici que cette exploitation se fait dans le cadre d’une concurrence parfaite,
c’est-à-dire que, pour les exploitants, le prix 𝑝 auquel ils peuvent vendre la ressource est une
donnée qui ne dépend pas de la quantité capturée. Cette capture dépend évidemment des
moyens utilisés (techniques de localisation de la ressource, moyens de transport, matériel de
capture...) qu’on résume généralement sous le terme générique d’effort.
C’est le niveau de cet effort qui constitue la variable de décision déterminant les conditions
de l’exploitation (combien de bateaux, quels types de filets, combien de jours de pêche...).
Pour un niveau d’effort 𝐸 fixé, l’hypothèse la plus simple est de considérer que la quantité
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 15
Economie des ressources naturelles 2022
totale capturée 𝐻 (Harvest en anglais), sera proportionnelle à la taille de la population 𝑋, soit
𝐻 = 𝐸𝑋 (on peut penser qu’il serait plus réaliste de considérer que si la population est peu
nombreuse, la quantité capturée pour un niveau d’effort fixé E sera plus faible que pour une
population importante, auquel cas on aurait 𝐻 = 𝐻(𝐸𝑋) où 𝐻 est une fonction croissante de
X. C’est sans doute vrai, mais l’hypothèse de proportionnalité ne changeant pas
qualitativement les résultats obtenus, nous la maintiendrons dans la suite). Ainsi, à un
moment donné, si on note 𝐹(𝑋) le surplus naturel provenant d’une population de taille 𝑋, la
croissance de cette population sera égale à la différence entre sa croissance naturelle et la
quantité capturée, soit 𝐹(𝑋) − 𝐸𝑋.
2.4. La culture des ressources renouvelables
La théorie de la gestion d’une ressource renouvelable, telle que nous l’avons ci-haut exposé,
concerne essentiellement les ressources présentes dans la nature indépendamment de l’action
humaine. Mais il en existe aussi d’autres qui sont introduites par l’homme pour ses propres
besoins et qui posent des problèmes de gestion très différents. En effet, pour ces ressources «
cultivées », le risque d’extinction n’existe pas puisqu’il est toujours possible de reconstituer
le stock. Il s’agit donc d’abord d’une activité industrielle, recherchant la rentabilité
économique sous la contrainte de la reproduction naturelle de la ressource (cette contrainte
est de plus en plus faible avec la croissance de l’industrialisation, comme on peut le voir en
agriculture où le cycle de reproduction des animaux est de plus en plus contrôlé, au risque
d’une baisse de qualité pouvant aller jusqu’à rendre la consommation dangereuse et posant
alors d’autres problèmes).
Les deux exemples les plus importants qui ont été étudiés par les économistes sont
l’aquaculture, qui s’oppose à la pêche de capture que nous avons considérée dans la section
précédente, et la plantation forestière. En 2001, l’aquaculture représentait 28,9 % de la
production mondiale contre 22,2 % en 1996, fournissant l’essentiel de son augmentation.
Mais si la pêche de capture a été le cas d’application privilégié de la théorie de l’exploitation
des ressources renouvelables non cultivées, c’est l’exploitation forestière qui a été celui des
ressources cultivées. C’est pourquoi nous en présenterons les principaux résultats à partir de
l’exemple de la forêt.
2.5. La gestion optimale d’une forêt de plantation
La gestion économique des forêts est l’un des plus vieux problèmes de l’économie des
ressources renouvelables. Dès le début du XIXe siècle, un débat public eut lieu en Allemagne
sur le choix de la meilleure date d’abattage des arbres, tout en tenant compte de leur
nécessaire régénération. C’est Martin Faustmann, dit Rotillon (2005), qui formula le
problème en le considérant comme un problème de maximisation de la valeur forestière se
répétant de période en période.
D’après Faustmann, cité par Rotillon (2005), ce qui distingue fondamentalement une
ressource renouvelable non cultivée, comme les ressources marines, des ressources
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 16
Economie des ressources naturelles 2022
renouvelables cultivées, Comme les forêts de plantation, c’est que, pour la pêche de capture,
il est impossible de ne prendre que des poissons du même âge, alors que C’est justement Ce
qui fait l’intérêt de la plantation à la même date de tous les arbres d’une forêt.
Dans une forêt de plantation, la seule question qui se pose est donc celle de sa date
d’abattage, compte tenu de la Croissance de l’espèce qui dépend de la nature de l’arbre. À
chaque période, si les conditions économiques le permettent, on replante complètement la
forêt et on la coupe quand les arbres sont à maturité, c’est-à-dire quand ils répondent à une
demande spécifique sur un marché. Si on s’intéresse à une espèce en particulier, et si le
contexte ne change pas (prix, taux d’intérêt, connaissances biotechnologiques) il est
intuitivement évident que les arbres seront abattus au même âge, définissant ainsi la période
optimale de rotation. Celle-ci est donc définie à la fois par un contexte économique et les
caractéristiques naturelles de l’espèce. Ainsi, l’eucalyptus ou l’acacia, vont connaître des
rotations entre six et douze ans pour un usage comme bois de chauffe domestique ou
industriel ou pour de la pâte à papier, taudis que pour le teck elles seront entre cinquante et
soixante-dix ans pour des usages décoratifs très valorisants.
Les pins ont, pour leur part, des rotations de vingt à trente ans à moins qu’ils ne soient plantés
pour leur pulpe, auquel cas les rotations sont plus courtes. Pour bien mettre en évidence la
spécificité du problème de la rotation optimale, nous allons supposer que l’exploitant cherche
à maximiser son profit dans un contexte économique stationnaire (prix du bois, des inputs et
taux d’intérêt constants). Comme toujours, cette maximisation sera réalisée quand le revenu
marginai tiré de la forêt sur la période sera égal à son coût marginal. Compte tenu des
hypothèses faites, son revenu ne dépend que de la date de l’abattage, qui détermine la taille
de l’arbre et donc la quantité vendue. Autrement dit, il ne dépend que de la fonction de
reproduction naturelle de l’espèce cultivée, et plus précisément de sa croissance.
2.6. Comment éviter la surexploitation ?
La source principale des risques d’extinction des ressources renouvelables tient dans la
conjonction de deux phénomènes le libre accès à la ressource et l’existence d’externalités de
production.
Une ressource renouvelable est en effet intermédiaire entre bien privé et bien public. Elle
partage avec le premier son caractère rival qui fait que sa consommation par un agent
l’interdit aux autres, et elle possède comme le second la difficulté d’exclusion de son usage.
La capture d’un poisson supplémentaire par un pêcheur entraîne une diminution de la taille de
la population, donc de sa taille future, et conduit à rendre plus difficiles et donc plus
coûteuses les captures ultérieures. On est là en présence d’une externalité de production, où
l’activité d’un pêcheur a des conséquences sur l’ensemble des exploitants (on entend ici par
externalité l’existence d’une différence entre le coût privé pris en compte par le pêcheur dans
sa décision de capture et le coût social supérieur qui sera supporté par la collectivité du fait de
cette décision, voir Bontems et Rotillon (2003) pour une présentation plus détaillée du
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 17
Economie des ressources naturelles 2022
concept d’externalité). La combinaison de ces deux facteurs, externalité d’exploitation et
accès libre, conduit à la « tragédie des biens communs » analysée par Hardin (1968).
2.6.1. Tragédie des biens communs
Telle que l’a présentée Hardin, la tragédie des biens communs se produit sur un pré
communal partagé par des éleveurs de bétail. Chacun est libre de choisir le nombre
d’animaux qu’il met en pâture sur le pré. Ajouter un animal augmente le profit individuel de
l’éleveur mais diminue la quantité de fourrage disponible pour chaque animal présent. Ainsi,
si le coût de l’élevage augmente du fait de la raréfaction du fourrage, ce coût est partagé avec
les autres éleveurs. Ce qui incite chacun d’entre eux à ajouter des animaux supplémentaires,
puisqu’ils s’approprient le gain privé correspondant sans avoir à supporter l’intégralité du
coût de leur décision, conduisant ainsi à la surexploitation du pré, voire à sa disparition totale.
Bien sûr, ajouter un animal peut aussi avoir un coût privé pour l’éleveur et limiter le nombre
d’animaux qu’il décidera de faire paître, ce que Hardin ne prenait pas en compte. Il n’en reste
pas moins que cette logique d’une recherche d’un profit individuel en présence d’une
externalité de production implique un stock final de ressource plus faible que celui qui
découlerait d’une gestion centralisée où cette externalité serait prise en compte.
Cependant, si la présence d’externalités de production et d’accès libre peut conduire à la «
tragédie » décrite par Hardin, il n’y a aucune nécessité à cet enchaînement fatal. Comme
l’écrit Ciriacy-Wantrup (1938), « la propriété commune des ressources naturelles n’est en
soi-même pas plus une tragédie en termes de dégradation environnementale que sa propriété
privée. Tout dépend des institutions sociales […] qui guident l’usage de ces ressources ».
L’institution sociale visant à empêcher la tragédie des biens communs la plus étudiée d’un
point de vue théorique prend la forme d’une agence chargée de définir les conditions d’accès
à la ressource.
2.6.2. La régulation centralisée
La mise en place d’une telle agence suppose que les droits de propriété de la ressource lui ont
été attribués, ce qui est évidemment plus facile dans un cadre national, où les règles
juridiques sont appliquées à tous, que dans un cadre international où ces règles doivent
émerger d’une négociation préalable. Il reste alors à l’agence à définir les conditions de
l’accès à la ressource, ce qui revient à chercher à moduler l’effort des exploitants.
Puisque l’effort de pêche, décidé par l’exploitant individuel, dépend de sa perception des
conditions économiques sous lesquelles se déroule son activité, la régulation de cet effort va
se faire en modifiant ces conditions. L’agence est en fait placée devant un problème classique
en économie de l’environnement, qui est l’internalisation d’une externalité, c’est-à-dire
l’élimination de l’écart entre le coût privé pour les exploitants et le coût social engendré par
leurs décisions non coordonnées.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 18
Economie des ressources naturelles 2022
Pour augmenter ses captures, un exploitant doit changer son bateau, acheter un sonar, utiliser
des filets plus grands... ce qui augmente le coût de son activité qui, de son point de vue,
dépend essentiellement de son niveau individuel de capture h, soit une fonction de coût de la
forme C(h), croissante en h. Mais la quantité capturée n’est pas le seul déterminant de ses
coûts. D’une part, ceux-ci vont aussi augmenter avec le nombre N de pêcheurs, puisque plus
ils sont nombreux, plus la ressource se raréfie et devient plus difficile, donc plus coûteuse, à
attraper. D’autre part, ils augmentent également si la taille X de la population elle-même se
réduit, que ce soit à cause des captures passées ou d’un déséquilibre de l’écosystème. Une
agence qui prendrait en charge la gestion de la ressource devrait tenir compte de ces deux
types d’effets sur les coûts, en considérant une fonction de coûts de la forme C(h, N, X).
La mise en place d’une instance de régulation est donc nécessaire pour éviter l’extinction de
certaines ressources renouvelables.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 19
Economie des ressources naturelles 2022
CHAPITRE III : LES RESSOURCES RENOUVELABLES EN PRATIQUE
Le chapitre précédent était, pour l’essentiel, consacré à présenter les bases de la théorie
économique des ressources renouvelables. Ce chapitre s’attache à traiter des problèmes et des
solutions qui ont été mises en place (ou qui tentent de l’être) pour réguler l’usage de certaines
ressources renouvelables.
1. Les ressources halieutiques
Les ressources halieutiques sont entièrement consacrées à l’alimentation. La production
mondiale, qui a dépassé les cent millions de tonnes en 2001, était destinée pour 75% à la
consommation humaine et pour 25 % à la fabrication d’aliments pour les élevages porcins et
l’aquaculture. Le secteur emploie près de trente-cinq millions de personnes, mais plus de
deux cents millions en dépendent soit par des liens familiaux, soit par leur emploi dans des
industries et activités connexes. C’est un secteur en crise, de nombreuses espèces étant
menacées d’extinction à cause d’une surexploitation des stocks. Le problème essentiel posé
par ces ressources est celui d’un retour à une exploitation qui ne menace pas leur caractère
renouvelable.
Une régulation efficace des pêcheries est donc indispensable, ce qui nécessite une bonne
connaissance de l’état des stocks et de l’effort de pêche. Des statistiques non fiables
impliquent, en effet, une baisse de confiance dans la capacité des gestionnaires des pêches à
taire leur travail, et ce aussi bien de la part des pêcheurs que du public.
1.1. État des stocks et effort de pêche
L’essentiel du suivi statistique des captures et de l’état des stocks est assuré par l’organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (deux autres organismes
interviennent également dans ce suivi : le Conseil International pour l’Exploration de la Mer,
CIEM, et l’International Commission for the North-West Atlantic Fisheries, ICNAF). Les
principaux indicateurs de l’état d’un stock sont la capture et l’effort de pêche (FAO, 2001).
La capture est exprimée en tonnes et s’évalue à partir de l’examen des livres de bord des
pêcheurs, des ventes aux principales criées, de campagnes spécifiques de comptage sur des
chalutiers spécialement équipés (sonars...) et de modèles théoriques où ces données sont
interprétées. L’effort de pêche correspond à l’ensemble des moyens mis en œuvre par les
pêcheurs pour la capture d’une quantité donnée durant une période déterminée. Il s’exprime
en temps de pèche, longueur de filet, taille des mailles, nombre d’hameçons... Le tableau ci-
dessous donne (en millions de tonnes) l’évolution de la production des pêcheries maritimes
pour quelques espèces dans le monde.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 20
Economie des ressources naturelles 2022
Tableau n°3 : Evolution de la production de pêcherie maritime (en million de tonnes)
1950 1960 1970 1980 1990 2001
Flets, flétans, soles 450 030 1 203 212 1 318 726 1087 951 1 221 409 973 694
Morues, merlus, églefins 3 266 851 4 766 431 10 482 650 10 690 670 11 589 920 9 224 573
Poissons côtiers divers 1 053 762 1 752 082 3 297 604 4 385 466 4 829 959 7 055 248
Harengs, sardines, anchois 5 001 046 10 065 520 21 341 530 15 464 050 22 228 170 20 460 640
Source : apps.fao.org, cité par Rotillon (2005).
Ce tableau indique bien la pression croissante sur les ressources halieutiques depuis les
années 1950.
1.2. L‘état de la surexploitation des stocks.
Les évaluations les plus récentes de l’état des stocks, réalisées par la FAO, datent de fin 1999.
On identifiait 590 types de stocks, avec des informations sur 441 d’entre eux. Ces statistiques
doivent être prises avec précaution, d’une part, parce qu’elles ne recouvrent pas l’ensemble
des stocks et, d’autre part, parce que ceux-ci sont en réalité des conglomérats de stocks (et
souvent d’espèces). Elles sont cependant confirmées par des enquêtes conduites à des
échelles plus fines et on peut considérer qu’elles donnent une bonne approximation des
tendances mondiales.
Les stocks sont classés en six catégories selon leur situation, en termes de biomasse et de
pression de pêche, par rapport aux niveaux de PME. Les stocks sous-exploités (U) et
modérément exploités (M) peuvent produire davantage à condition d’augmenter l’effort de
pêche (ce qui ne veut pas dire que c’est souhaitable). Les stocks pleinement exploités (F)
sont, par définition, à des niveaux proches de leur PME. Les stocks classés (O) sont
surexploités et ceux classés (D) épuisés. Enfin, les stocks classés (R) sont en reprise, c’est-à-
dire qu’ils sont très inférieurs à leurs niveaux antérieurs. En principe, l’effort de pêche y a été
réduit, mais il est possible qu’ils continuent néanmoins à baisser, par exemple s’ils sont
exploités de manière indirecte, en tant que captures accessoires dans une autre pêcherie. La
régulation s’impose pour tous les stocks de type F, O, D et R.
Compte tenu de son critère de surexploitation, la FAO considère que si 75 % des stocks
nécessitent une modification de l’effort de pêche, 72% sont encore capables de fournir leur
PME. En fait, C’est au moins 75 % des stocks sur lesquels on a des informations qui doivent
faire l’objet de mesures rigoureuses de diminution de l’effort de pêche. La surexploitation
varie fortement d’une zone d’exploitation à l’autre. Elle concerne 41 % des stocks dans le
Pacifique Centre-Est qui est le moins touché et 95 % dans l’Atlantique Centre-Ouest qui l’est
le plus. Globalement, dans la plupart des régions, au moins 70 % des stocks sont surexploités.
Les tendances d’évolution existantes confirment l’importance de la surexploitation. Depuis
1974, les stocks U et M ont régulièrement diminué, quand ceux de types O, D et R passaient
de 10 % au début des années 1970 à près de 30 % à la fin des années 1990. L’ensemble de
ces statistiques traduit bien l’importance de la régulation de l’effort de pêche, ce qui suppose
d’en avoir une estimation.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 21
Economie des ressources naturelles 2022
1.3. L’effort de pêche
On peut d’abord le mesurer par l’évolution du nombre de pêcheurs. L’emploi dans ce secteur
a continuellement augmenté dans de nombreux pays au cours des trente dernières années,
comme le montre le tableau ci-dessous donnant le nombre de pêcheurs dans le monde en
milliers
Les pêcheurs asiatiques représentent à eux seuls 85 % du total mondial, suivis des pêcheurs
africains (7,5 %). Le taux moyen d’augmentation du nombre de pêcheurs a été de 2,2 % par
an depuis 1990 (contre 7 % en aquaculture, principalement en Asie et tout particulièrement
en Chine). Cependant, l’emploi a baissé dans les économies développées comme le Japon ou
la Norvège, où la pêche est à forte intensité capitalistique.
Tableau n°4 : Nombre des pêcheurs dans le monde (en milliers)
1970 1980 1990 2000
Afrique 1 360 1 553 1 917 2 585
Amérique du Nord et Centrale 408 547 767 751
Amérique du Sud 492 543 769 784
Asie 9 301 13 690 23 656 29 509
Europe 682 642 654 821
Océanie 42 62 74 86
Total 12 285 17 036 27 837 34 536
Source : www.fao.org, cité par Rotillon (2005).
Cependant, l’effort de pêche ne dépend pas seulement du nombre de pécheurs, mais aussi des
moyens utilisés pour la capture et du temps passé en mer. L’estimation la plus récente de la
flotte mondiale de pêche recensait environ 1,3 million de navires pontés et 2,8 millions non
pontés, dont 65 % sans moteur.
Le contrôle de l’effort de pêche est donc très difficile, nécessitant soit la régulation de
nombreux paramètres (temps passé en mer, puissance des bateaux, moyens techniques de
pêche), soit celle de la prise annuelle. Un bon exemple des problèmes posés par la première
voie est donné par la pêche aux homards, par les pêcheurs des îles de la Madeleine, dans
l’Atlantique. Au nombre de 325, chacun d’entre eux pêche avec 300 casiers pendant neuf
semaines. Pourtant, malgré ces limitations strictes, on s’est aperçu que, à partir de 1975 et
jusqu’au début des années 1990, les débarquements de homards augmentaient régulièrement.
Face à la régulation qui leur était imposée, les pêcheurs ont joué sur les facteurs qui n’étaient
pas réglementés. Ils ont ainsi modifié leurs bateaux (taille, puissance, robustesse) et utilisé
des systèmes de navigation électronique et des sondeurs couleur qui les ont rendus plus
mobiles, leur permettant de passer d’une pèche d’interception à une pèche de poursuite. Ils
ont également modifié leurs casiers (taille, poids, anneau d’entrée, proportions, design) et leur
méthode de pêche (place des casiers sur les lignes, positionnement stratégique). L’ensemble
de ces transformations a ainsi contribué à l’augmentation des captures, et on conçoit qu’il soit
difficile de contrôler la totalité des paramètres impliqués.
C’est sans doute la raison pour laquelle le contrôle de la prise annuelle a été la mesure de
gestion la plus largement utilisée. Elle n’en présente pas moins ses propres difficultés, liées
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 22
Economie des ressources naturelles 2022
en particulier aux déclarations délibérément erronées ou aux non-déclarations des pêcheurs
opérant légalement et à la présence de pêche illégale, un problème critique dans les pays
développés et dans les pêcheries internationales, aux dires de la plupart des gestionnaires.
1.4. Les politiques de régulation
Comme toutes les politiques de ce type, elles se composent d’une part de l’édiction de règles
définissant la quantité de poissons qui peut être prise, par qui et par quels moyens, où et à
quel(s) moment(s), et, d’autre part, de la mise en place de contrôles à priori et/ou à posteriori
du respect de ces règles.
A l’heure actuelle, ces politiques rencontrent plus de difficultés que de succès, comme le
montre d’une manière générale l’état des stocks. La politique commune de pêche (PCP) de la
Communauté européenne est une bonne illustration de cette Situation. Prévue dès le traité de
Rome en 1957, elle repose sur quatre volets dont les bases ont été posées en 1983. Le premier
concerne la conservation des ressources et vise à limiter l’effort de pêche. Chaque année sont
fixés des totaux admissibles de capture (TAC) pour 120 stocks de poissons en Atlantique, en
mer du Nord, dans la Manche, la Baltique et la Méditerranée Les TAC sont ensuite répartis
en quotas nationaux en fonction de références historiques (principe du « grand-parentage » et
complétés par des mesures techniques (réglementation des engins de pêche, établissement de
périodes de pêche, fixation de tailles minimales de capture...). Le deuxième volet consiste en
programmes d’orientation pluriannuels (POP), prévoyant en particulier des réductions de
capacité assorties d’aides financières. Le troisième volet est l’organisation commune des
marchés, fixant un régime commun des prix et permettant le retrait d’une partie de la
production si les prix chutent en deçà d’un certain seuil. Enfin, le quatrième volet porte sur la
négociation des accords de pêche avec des pays tiers.
Les résultats de cette politique sont jugés décevants par la Commission de l’Union
européenne elle-même. Parmi les raisons invoquées, on trouve au premier rang la difficulté
des contrôles de l’effort de pêche et l’amélioration de l’efficacité de leurs bateaux par les
pêcheurs. Le fait que ces derniers ne soient pas assez associés à la définition de la PCP la
transforme en une contrainte imposée par la technocratie bruxelloise, ce qui ne contribue pas
à faciliter leur adhésion aux mesures conservatoires adoptées.
Certains pays ont pourtant réussi, comme l’Islande ou la Nouvelle-Zélande, à réformer leur
secteur halieutique en diminuant leur capacité de pêche et en imposant des quotas stricts. Du
même coup, la rentabilité s’améliore et les stocks se reconstituent.
En fait, le diagnostic est simple et tient en peu de mots, il y a trop de pêcheurs pour pas assez
de poissons et une mauvaise coordination internationale pour gérer cette ressource commune.
2. La forêt
Contrairement aux ressources halieutiques, la forêt se caractérise surtout par sa
multifonctionnalité : production (bois et produits non ligneux), biodiversité, protection des
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 23
Economie des ressources naturelles 2022
sols, cycle de l’eau et du carbone, tourisme.., il y a huit mille ans, elle couvrait la moitié de la
surface terrestre (Bail, 2001). Les statistiques de la FAO indiquent que, en l’an 2000, elle ne
couvrait plus que 3 869 millions d’hectares, soit 30 % de la surface du globe. Durant la
dernière décennie du XXème siècle, la forêt a perdu 9,4 millions d’hectares, se décomposant
en 14,6 millions d’hectares de déforestation et 5,2 millions d’hectares de forêts nouvelles. Le
tableau ci-dessous donne en millions d’hectares, la répartition des forêts par grandes régions.
Tableau n°5 : La répartition des forêts par régions (en millions d’hectares)
Région Surface de Forêt naturelle Plantation % de terre Variation % de forêt
terre par an
1990-2000
Afrique 2 978 642 8 22 5,3 17
Asie 3 085 432 116 18 0,4 14
Europe 2 260 1 007 32 46 0,9 27
Amérique du Nord 2 137 532 18 26 0,6 14
et centrale
Océanie 849 194 3 23 0,4 5
Amérique du Sud 1 755 875 10 51 3,7 23
Total 13 064 3 682 187 30 9,4 100
Source : www.fao.org, cité par Rotillon (2005).
Si ce tableau donne une photographie de la situation au début du XXIe siècle, il ne traduit pas
les évolutions passées. Historiquement, la déforestation a été beaucoup plus importante dans
les pays tempérés que dans les pays tropicaux, alors que c’est l’inverse aujourd’hui. Outre les
fluctuations climatiques, le principal facteur en a été le développement de l’agriculture, avec
un taux de déforestation moyen de deux cent cinquante mille hectares par an.
Actuellement, ce sont surtout les forêts primaires, c’est-à-dire celles qui n’ont jamais été
exploitées et qui sont évidemment les plus riches en multifonctionnalité, qui subissent le
déboisement. Cette déforestation concerne essentiellement les forêts tropicales, comme le
montre le tableau ci-dessous, qui fait le bilan de l’évolution des forêts naturelles de 1990 à
2000 (en millions d’hectares).
Tableau n°6 : Evolution des forêts naturelles de 1990 à 2000 (en million d’hectares)
Déforestation Conversion Expansion naturelle Changement net
en plantations
Forêt tropicale 14,2 1,0 +1 14,2
Forêt non tropicale 0,4 0,5 +2,6 +1,7
Total 14,6 1,5 +3,6 15,9
Source : www.fao.org, cité par Rotillon (2005).
Si la culture sur brûlis et la production de bois de feu jouent un rôle dans cette déforestation,
la principale cause en est aujourd’hui l’exploitation forestière, souvent illégale.
En 1992, la Conférence sur l’environnement et le développement des Nations unies a adopté
des principes visant à tenir compte de la multifonctionnalité de la forêt, faisant référence au
développement durable tel qu’il avait été défini dans le rapport Bruntland (cette notion est
maintenant tellement répandue dans les discours publics que nous nous dispensons ici de la
préciser davantage, renvoyant le lecteur au chapitre V pour une discussion approfondie). Une
des conséquences principales de cette conférence a été le démarrage de processus de
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 24
Economie des ressources naturelles 2022
certification, visant à développer des critères et des indicateurs pour évaluer la gestion
durable de la forêt, tant aux niveaux local et national qu’international.
Parmi les différents critères existant, nous pouvons citer les six critères d’Helsinki (nom de la
ville dans laquelle se tint la conférence interministérielle pour la protection des forêts en
Europe) :
- conservation et amélioration des ressources forestières et de leur contribution aux
cycles mondiaux du carbone ;
- maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers ;
- maintien et encouragement des fonctions de production des forêts ;
- maintien, conservation et amélioration de la diversité biologique dans les écosystèmes
forestiers ;
- maintien et amélioration des fonctions de protection de la gestion des forêts
(notamment vis-à-vis des sols et de l’eau) ;
- maintien d’autres bénéfices et fonctions socio-économiques.
Fin décembre 2000, il existait neuf initiatives d’élaboration de critères et d’indicateurs
concernant 149 pays, participant à au moins une d’entre elles la Paneuropéenne, Montréal,
Tarapoto, Dry Zone Africa, Near East, Lepaterique, Dry Forest Asia, et des actions initiées
par l’ITTO (International Tropical Timber Organisation) et l’ATO (African Timber
Organization). Si ces initiatives ont chacune leurs spécificités, elles ont une approche
commune et des objectifs similaires, concernant en particulier la recherche de critères sur
l’extension des ressources forestières, la biodiversité biologique ou les bénéfices socio-
économiques.
Les différences entre les pays concernés sont cependant très importantes, beaucoup d’entre
eux étant limités par l’absence de personnel compétent ou de moyens institutionnels pour
recueillir et analyser les informations.
3. Le climat
Le climat n’est pas à proprement parler une ressource renouvelable au sens où nous avons
défini ce concept. Il n’existe pas sous la forme d’un stock ayant une capacité naturelle de
régénération, mais il est le résultat de processus complexes, dont certains sont naturels,
comme les cycles de l’eau et du carbone, et d’autres, comme la pollution, d’origine humaine.
S’il peut être très différent d’une région à une autre, la fin du XXe siècle a vu émerger, au
niveau de la planète, le problème global dit de l’ « effet de serre », qui place l’humanité
devant des choix qui peuvent s’analyser dans le cadre de la gestion des ressources
renouvelables.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 25
Economie des ressources naturelles 2022
3.1. L’effet de serre
Les gaz à effet de serre (gaz carbonique, méthane, protoxyde d’azote, hydrofluorocarbones,
hydrocarbures perfluorés et hexafluorure de soufre) retiennent une partie du rayonnement
solaire réfléchi par la terre et contribuent à maintenir à sa surface une température suffisante
pour permettre le développement de la vie. En leur absence, celle-ci serait aux alentours de
moins 20 °C.
Ces gaz à effet de serre (GES) s’accumulent dans l’atmosphère et l’accroissement de cette
concentration s’accompagne d’une élévation de la température. En 1988, à l’initiative de
l’Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations unies pour
l’environnement, est créé le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC). Celui-ci a pour mission de faire le point sur les connaissances scientifiques
concernant les processus d’interaction entre les émissions et les concentrations de GES, les
scénarios d’évolution des émissions à long terme, les effets des concentrations sur les
phénomènes climatiques, l’incidence de ces phénomènes, les possibilités techniques de
prévention et d’adaptation des sociétés humaines, les conséquences socio-économiques et
écologiques de politiques caractérisées par une répartition temporelle différente des efforts de
maîtrise des émissions. Les conclusions de son troisième rapport (GIEC, 2001) sont claires
les concentrations de GES se sont accrues de façon significative depuis le début de l’ère
industrielle, ce phénomène excède la variabilité naturelle et il est attribuable à l’activité
humaine; sur la base de la compréhension théorique du climat (les lois de la physique), la
modélisation climatique conclut au diagnostic d’un réchauffement, en moyenne, du climat de
la Terre et à la possibilité d’importantes perturbations dues notamment à la rapidité avec
laquelle le changement se produit.
Selon les simulations climatiques, la température moyenne globale de surface pourrait
s’élever de 1,4 à 5,8°C en 2100 par rapport à 1990, principalement du fait des émissions de
GES. Fonte des glaces, montée des eaux, progression des déserts, bouleversement du cycle de
l’eau et du régime des précipitations, croissance en fréquence et en intensité des événements
climatiques extrêmes (cyclones, tempêtes, canicules...) sont quelques-unes des conséquences
attendues de ces rejets.
Ici, le stock (de GES résidant dans l’atmosphère) est au contraire à ne pas trop augmenter, à
cause des conséquences nocives qu’il implique, ce qui suppose de réduire de façon
importante les flux annuels d’émissions qui contribuent à le faire grossir. Et, de même que le
choix d’un taux de prélèvement modifie les coûts d’extraction de la ressource, celui d’un taux
de réduction modifie les coûts de production des secteurs où ces réductions sont faites.
3.1.1. La mobilisation internationale
Le problème posé par l’accentuation de l’effet de serre, suite à la croissance des émissions de
GES, n’est donc pas formellement différent de celui de la gestion durable d’une ressource
renouvelable. Même s’il existe des différences (l’impact climatique des émissions de GES est
indépendant de leur localisation, la variation des flux d’une année sur l’autre est bien
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 26
Economie des ressources naturelles 2022
moindre, le problème est planétaire), il partage même beaucoup des caractéristiques des
ressources halieutiques en haute mer : absence de droits de propriété bien définis,
interdépendance des décisions, risques d’irréversibilité, incertitude, asymétries
d’information... qui rendent à la fois indispensables et difficiles les négociations entre les
parties concernées.
Notre propos, dans cette section, n’est pas de faire l’histoire de la mobilisation internationale
contre l’effet de serre, mais de présenter dans le cas du climat, les solutions qui sont
progressivement mises en place pour tenter de résoudre ce problème.
Les engagements ont été pris en deux temps. À Rio en 1992, les pays industrialisés ont pris
l’engagement de faire leur possible pour ramener leurs émissions de GES en 2000 à leur
niveau de 1990, mais aucun instrument particulier n’a été mis en place pour atteindre cet
objectif. Constatant l’échec de cette approche « de bonne volonté, les pays signataires ont
voulu signer un protocole plus contraignant quant aux moyens à mobiliser par chacun. C’est
ainsi que l’on a débouché sur le protocole de Kyoto en 1997. Ce dernier prévoit que les pays
industriels identifiés dans l’annexe B du protocole (OCDE, pays d’Europe centrale en
transition, Russie, Ukraine) aient réduit en moyenne, sur la période 2008-2012, leurs
émissions de GES d’environ 5 % par rapport à leur niveau de 1990.
3.1.2. Kyoto, et après ?
La mobilisation d’un certain nombre de pays industriels face au risque de changement
climatique peut donner lieu à deux types d’interprétations, selon le modèle de la bouteille à
moitié vide ou à moitié pleine. On peut y voir le début de la prise de conscience collective
d’une menace pour les générations futures et la mise en œuvre, certes difficile mais réelle,
d’actions pour y faire face. On peut aussi mettre l’accent sur les difficultés et regretter que la
poursuite des intérêts particuliers à chaque pays, dont les États-Unis donnent un si bel
exemple, conduise à tant d’atermoiements et de faux départs.
Mais on peut aussi privilégier une lecture de Kyoto comme le premier pas nécessaire (donc
limité si on le veut réel) au début d’un processus dont l’objectif essentiel est l’intégration des
pays en développement, pour une coopération à la fois efficace et équitable.
4. L’eau
Il est difficile de caractériser l’eau en tant que ressource naturelle. Si d’un point de vue
écologique son cycle, parfaitement connu (évaporation, condensation, retour à la mer), en fait
une ressource renouvelable, l’eau douce, celle dont nous dépendons pour les usages
domestiques, industriels et agricoles, est plutôt une ressource épuisable. C’est d’ailleurs ainsi
que l’a caractérisée la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement qui s’est tenue à
Dublin en 1992 dans son principe n° 1: « L’eau douce — ressource fragile et non
renouvelable — est indispensable à la vie, au développement et à l’environnement. »
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 27
Economie des ressources naturelles 2022
Cependant, son caractère épuisable tient moins à ses caractéristiques physico-chimiques
propres qu’à la fragilité de son processus de reproduction naturelle. Cette fragilité est due,
d’une part, aux conflits d’appropriation et/ou d’usages engendrés par son inégale répartition
sur notre globe et, d’autre part, aux conséquences des multiples pollutions qu’elle subit.
Les ressources d’eau sont donc renouvelables (sauf certaines eaux souterraines), mais avec
des différences de disponibilité très importantes selon les régions du monde et des variations
considérables, en termes de précipitations saisonnières et annuelles (par exemple, les
précipitations en Inde sont concentrées sur quelques semaines avec la mousson).
D’un point de vue économique, l’eau potable est théoriquement un bien public dans les pays
riches, puisque le service d’eau est conçu pour être accessible à tous les habitants d’une
commune avec un tarif fixé de manière à n’exclure aucun usager et sans rivalité d’usage.
Pratiquement, l’exclusion des usagers qui ne paient pas leur facture peut la rapprocher d’un
bien de club. Dans les pays en développement, la pratique courante de la connexion illégale
au réseau fait de l’eau un bien commun.
La majorité de l’eau sur terre est de l’eau de mer, la quantité globale d’eau douce ne
représentant que 2,53 % du total. Sur ces 2,53 %, l’eau de surface (lacs et rivières) compte
pour 0,3 %, les eaux souterraines pour 29,9 % et les glaciers et les neiges éternelles pour 68
%, le reste correspondant aux mares, zones humides, etc. Le volume global d’eau douce
utilisable s’élève ainsi à 12 500 milliards de m3. Ce volume serait suffisant s’il était
équitablement réparti, ce qui n’est le cas ni dans l’espace, ni dans le temps. Le tableau ci-
dessous donne la disponibilité en eau par grandes zones géographiques par rapport à la
population.
Tableau n°7 : Disponibilité en eau par rapport à la population
Zones Disponibilité en eau Population
Amérique du Nord et centrale 15% 8%
Amérique du Sud 26% 6%
Europe 8% 13%
Afrique 11% 13%
Asie 36% 60%
Australie et Océanie 4% 1%
Source : site internet de l’UNESCO/PHI, cité par Rotillon (2005).
Ce tableau souligne bien la disparité entre continents et la situation difficile de l’Asie qui ne
possède que 36% de ressources alors qu’elle représente 60% de la population mondiale.
Du point de vue des usages, l’agriculture est de loin le secteur le plus consommateur avec 70
% du total, quand les usages industriels en représentent 22 % contre 8 % pour les usages
domestiques. Toutefois, les usages industriels augmentent en fonction du revenu des pays et
ils représentent 59 % du total dans les pays à revenu élevé et 10% dans les pays à faible
revenu et revenu moyen inférieur. L’augmentation prévue des usages industriels devrait se
faire, pour l’essentiel, dans les pays en développement.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 28
Economie des ressources naturelles 2022
Sur le plan de la qualité, la pollution affecte de plus en plus les réserves.
Environ deux millions de tonnes de déchets (effluents industriels, produits chimiques,
engrais, pesticides...) sont déversées chaque jour dans des eaux réceptrices et on estime que la
pollution mondiale pourrait atteindre 12 000 km3. Comme trop souvent, ce sont les
populations les plus pauvres qui sont les plus touchées, 50 % de la population des pays en
développement étant exposée à des sources d’eau polluées.
Le développement économique et la croissance démographique devraient accentuer la
raréfaction progressive de la ressource et, selon les estimations, c’est 2 à 7 milliards
d’individus dans 48 à 60 pays qui devraient souffrir de pénuries d’eau et des maladies qui lui
sont liées (paludisme, dengue, infections gastro intestinales) vers le milieu de ce siècle. C’est
pourquoi on parle aujourd’hui de crise mondiale de l’eau et que beaucoup y voient le grand
défi de ce début de troisième millénaire.
4.1. L’enjeu principal: satisfaire la demande
La priorité, c’est d’assurer l’accès à l’eau potable pour tous. À l’heure actuelle, 1,1 milliard
de personnes n’ont pas d’équipements leur permettant de s’approvisionner en eau et 2,4
milliards n’ont pas accès à des systèmes d’assainissement. Encore faut-il souligner que le
taux de raccordement d’une population à un réseau n’est pas synonyme d’accès à l’eau
potable car, dans certains cas, l’eau du réseau n’est disponible que quelques heures et avec
une pression variable.
Il est donc nécessaire non seulement de créer des réseaux performants, mais aussi de mettre
en place des systèmes : assainissement dans une approche par bassin qui est le niveau adéquat
de gestion de la ressource à cause de sa nature de bien collectif. Mais la demande c’est aussi
(surtout) celle de demain. Dans les trente prochaines années, on assistera à un doublement de
la population urbaine (60 millions supplémentaires par an). Une telle croissance en un laps de
temps si court pose des défis nouveaux que n’ont pas eu à relever les pays riches
d’aujourd’hui qui ont pu construire et financer leurs réseaux sur des temps beaucoup plus
longs et sans explosion démographique.
Il y a donc un problème de financement. Ainsi, la Banque mondiale chiffre à 180 milliards de
dollars par an jusqu’en 2025 le règlement des problèmes d’eau (tous usages compris :
hydroélectricité, eau potable, irrigation...). Toutefois, ces estimations sont obtenues à partir de
normes techniques prévalant dans les pays industrialisés et font ainsi l’impasse sur des
scénarios ayant recours à d’autres types de technologies, mieux adaptées aux pays en
développement, Comme le note Pierre-Noél Glraud (2002), « le modèle des grands réseaux
centralisés fournissant 100% d’eau potable et traitant 100% des eaux usées sans réutilisation
ni réinjection dans les aquifères, qui caractérise les pays riches, en particulier d’Europe, est et
restera beaucoup trop cher pour une large partie des populations urbaines du tiers-monde.
Mais s’il est clair que les populations des pays en développement n’ont pas les moyens
d’autofinancer les équipements nécessaires, leurs classes moyennes en voie de constitution
n’en sont pas complètement dépourvues. Toutefois, devant la mauvaise qualité des services
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 29
Economie des ressources naturelles 2022
existants, due précisément à leur dégradation par manque d’entretien, elles se réfugient dans
des solutions individuelles, pourtant plus coûteuses à la fois pour elles et socialement,
pérennisant ainsi la faiblesse du financement dans un cercle vicieux parfait.
Il est toutefois vain d’imaginer que les habitants des pays en développement auront une
capacité à payer l’eau suffisante pour couvrir les coûts. Ce qui revient à dire que les usages de
l’eau dans ces pays seront nécessairement subventionnés, puisqu’il y a subvention dès que le
prix payé par l’usager ne couvre pas le coût de fourniture du service, défini comme un coût
annuel de fonctionnement et de maintenance auquel il faut ajouter un coût d’amortissement
du capital (coût marginal de long terme). Généralement, les subventions sont synonymes
d’inefficacité, d’une part à cause du gaspillage qu’elles impliquent (l’usager ne reçoit pas le
bon signal sur le prix réel de la ressource et a tendance à la consommer excessivement), et,
d’autre part, à cause du manque de recouvrement des coûts qui conduit au cercle vicieux.
Pourtant, les réseaux des pays riches n’existeraient pas sans leur subventionnement par la
puissance publique et, si l’OCDE considère que les pays développés recouvrent 100 % de
leurs coûts de fonctionnement et de maintenance, ce n’est pas le cas pour les coûts
d’amortissement du capital. On voit donc mal comment les pays en développement
pourraient s’en passer. Et ce d’autant plus que ces subventions sont sans doute justifiées par
l’importance des externalités négatives associées à la mauvaise qualité des réseaux (maladies,
décès...).
Mais on touche là sans doute au cœur de la crise de l’eau.
4.2. Quelle(s) solution(s) à la crise de l’eau ?
Faire des problèmes (réels) de financement le cœur de la crise de l’eau, c’est mettre l’accent
sur la nécessaire intervention des grandes entreprises du secteur et lancer le débat stérile de
l’alternative public/privé. Stérile parce que la solution ne peut résider ni dans la seule
privatisation, impossible à cause des externalités liées à la ressource, à son caractère de bien
public ou commun et à la nécessité des subventions, ni dans la seule gestion publique qui ne
peut se passer de la compétence technique des majors de l’eau, qui s’est construite
historiquement au sein d’entreprises privées et qu’aucune entreprise publique ne possède
actuellement et ne pourrait acquérir rapidement.
Cette compétence ne peut s’obtenir qu’au prix «normal » de leurs services et suppose que les
pays en développement aient un environnement institutionnel suffisamment stable pour que
ces compagnies jugent les contrats qui leur sont proposés d’un risque acceptable. Ainsi, la
dévaluation du peso en Argentine en 2001 a coûté à Suez plus de 400 millions d’euros et lui a
fait porter l’affaire devant un tribunal arbitral international. Il a par la suite renoncé à
plusieurs contrats à l’étranger (Porto Rico, Djakarta, Manille) et la plupart des grands groupes
préfèrent investir aujourd’hui en Europe plutôt qu’en Asie ou en Amérique du Sud.
Il n’y aura pas de solution(s) à la crise de l’eau sans la coopération entre des institutions
publiques, crédibles et responsables, qui définissent des règles du jeu claires, et les grands
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 30
Economie des ressources naturelles 2022
fontainiers apportant leur savoir-faire (optimisation des réseaux, effets d’échelle...). Mais il y
faut aussi la participation des usagers dont les modalités d’implication font partie des défis à
résoudre. C’est ce dernier volet qui est aujourd’hui largement sous-estimé par les institutions
internationales qui ont surtout pensé à une sortie de crise fondée sur le système de la
délégation que connaissent les pays développés et qui parait de moins en moins adapté aux
pays en développement. En effet, dans ce système, les collectivités territoriales délèguent la
gestion de leurs services d’eau à une entreprise privée ou à un syndicat intercommunal, qui
peut lui-même la confier à un délégataire privé. En France, par exemple, les deux tiers des
36 000 communes se sont regroupées au sein d’environ 2 000 syndicats intercommunaux des
eaux et plus de 80 % de la population est desservie par une entreprise privée (dont Vivendi —
désormais Veolia-Environnement — 43 %, Suez-Lyonnaise 24 % et Saur-Cise — du groupe
Bouygues — 10 %). Ce mode de régulation est caractérisé par de nombreuses asymétries
d’information qui impliquent des contrôles coûteux qu’un pays en développement peut
difficilement mettre en place.
Dans cette équation où les trois inconnues sont les rôles de chaque partie (État, collectivités
locales comprises, firmes et usagers), il n’existe pas de solution unique, c’est sans doute la
seule chose dont on puisse être sûr. Pour le reste, le mieux à faire est d’analyser ce qui se fait
et de chercher à en tirer les leçons.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 31
Economie des ressources naturelles 2022
CHAPITRE IV : LES RESSOURCES NATURELLES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
1. Généralités
Lorsqu’il faut parler des ressources naturelles de la RDC, certaines opinions tant nationales
qu’internationales disent que le sol de la RDC est un scandale géologique et agricole.
Mais, il faudrait encore se poser la question de savoir si ce scandale géologique et agricole est
une fierté, ou une réprobation pour la RDC.
Le sous-sol de la RDC compte parmi les plus riches au monde au regard de la géologie et de
la minéralogie. Outre ses richesses minières, la RDC est le premier pays d’Afrique du point
de vue de l’étendue de ses forêts et le plus important pour la préservation de l’environnement
mondial.
A en croire certaines sources, telles que mentionnées par Ubole et Yumbi (2017), le gisement
congolais contient une cinquantaine des minerais recensés mais seulement une douzaine est
exploitée, notamment : le cuivre1, le cobalt2, l’argent, l’uranium, le plomb, le zinc, le
cadmium, le diamant3, l’or, l’étain, le tungstène, le manganèse et quelques métaux rares
comme le coltan4.
Voici la nomenclature des ressources minières par province (il est ici question de l’ancienne
configuration administrative avant le dénombrement) :
1. Diamant : Kasaï-oriental, Kasaï-occidental, Bandundu, Equateur, province orientale ;
2. Or : Province orientale, Maniema, Katanga, Bas-Congo, Nord-Kivu, Equateur ;
3. Cuivre : Katanga ;
4. Etain : Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema ;
5. Colombo tantalite (Coltan) : Nord-Kivu, Sud-Kivu, Katanga, Maniema ;
6. Bauxite : Bas-Congo ;
7. Fer : Katanga, Kasai-oriental ;
8. Manganèse : Katanga, Bas-Congo ;
9. Charbon : Katanga ;
10. Pétrole : Bas-Congo, Province orientale, Bandundu ;
11. Gaz Méthane : lac Kivu ;
12. Schistes bitumeux : Bas-Congo.
Il sied de signaler que la RDC est une République de diversité et même de biodiversité. En
effet, le sous-secteur exploitation forestière constitue en outre un important levier de la
1
La RDC a la 2ème réserve mondiale avec 10% du total recensé sur la planète.
2
La RDC détient les plus importantes réserves de cobalt (près de 50%).
3 ème
4 producteur mondial.
4
La RDC a les ¾ de réserves mondiales de coltan, utile pour la fabrication des ordinateurs et téléphones
portables.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 32
Economie des ressources naturelles 2022
locomotive économique congolaise. Premier pays africain du point de vue de l’étendue de ses
forêts, la RDC compte 8000 à 10 000 sortes de plantes.
Parmi les quelques 600 arbres répertoriés, plusieurs fournissent du bois haut de gamme et à
forte valeur commerciale.
Dans ce chapitre, nous allons faire un point sur les différentes ressources naturelles présentes
en RDC, et nous parlerons de la maladie des ressources naturelles, un concept expliquant le
paradoxe d’un pays riche en ressources et une population pauvre.
2. Les ressources épuisables
2.1. Les ressources minérales
La République Démocratique du Congo, un pays aux ressources minérales
considérables. Le sous-sol de la RDC est riche en minéraux. Plus de 1 100 minéraux
et métaux sont répertoriés. Il a plusieurs réserves estimées, dont celles de cuivre du Katanga
sont les deuxièmes plus importantes du monde après le Chili. Le pays détient les plus
importantes réserves de diamant (25% du total connu), de cobalt et d’or connu au monde. Ces
ressources sont reparties entre les différentes provinces du pays, suivant des disparités
géologiques importantes, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau n°8 : Répartition des principales ressources minérales par provinces
Province Minéraux
Bandundu Diamants, Or
Bas Congo Bauxite, phosphate, diamants, or, cuivre, zinc, calcaire, vanadium,
plomb, pétrole, uranium
Equateur Fer, cuivre, or, diamants
Province Oriental Or, diamants, fer, tungstène, coltan, étain
Kasai Oriental Diamants, fer, argent, nickel, cuivre, étain
Kasai Occidental Diamants, or, manganèse, chrome, nickel
Katanga Cuivre, cobalt, oxyde d’étain, tungstène, platine, manganèse, calcaire,
uranium, charbon, palladium, coltan, germanium, or, argent, diamant,
fer, plomb, zinc
Nord Kivu Or, Niobium, oxyde d’étain, tantalite, tungstène, platine, saphirs,
tourmaline, améthystes, quartz, et pierres semi-précieuses
Sud Kivu Or, Niobium, tantalite, oxyde d’étain, tungstène, platine, saphirs,
tourmaline, améthyste, quartz, pierres semi-précieuses, cuivre, gaz,
pétrole, cobalt
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 33
Economie des ressources naturelles 2022
Maniema Diamants, oxyde d’étain, coltan, or, tungstène
Source : Banque mondiale 2008 et Ministère des hydrocarbures de la RDC (2011), cité par Dmoergue, C., et
Mpoyi Mbunga, A., (2012).
Le Katanga, les deux Kivu, et la province du Maniema sont les provinces dont les
sous-sols recèlent les ressources minérales les plus diverses et les plus importantes.
L’ensemble des provinces de la RDC possède des sous-sols riches en minerais, métaux et
hydrocarbures ; mais les informations précises sur ce potentiel font défaut, et la majeure
partie de ces ressources sont supposées, inexplorées et inexploitées. Depuis le démarrage
de l’exploitation minière au début du vingtième siècle dans le Katanga, jusqu’en 2003, 18
millions de tonnes de cuivre furent produites, et les réserves estimées dans la ceinture de
cuivre de la province pourraient atteindre 70 millions de tonnes de cuivre, 5 millions de
tonnes de cobalt et 6 millions de tonnes de zinc. Des gisements de cuivre sont également
présents dans les sous-sols du Bas-Congo, mais de taille relativement modeste.
Les réserves de diamants estimées pourraient être importantes, avec 150 millions de carats.
Certaines estimations suggèrent même que jusqu’à 500 millions de carats pourraient
être présents dans les sous-sols du pays. Seuls 5% seraient de qualité supérieure. Les
gisements de diamants sont principalement présents dans les deux Kassaï, dans le
Katanga et les Kivu, et près de 75% de la production en terme de carat se fait par le biais
d’une production artisanale.
Les principales ressources aurifères se trouvent dans la région de l’Ituri, dans la province
Orientale, dans les Kivu et dans le Maniema. Les trois sites principaux considérés pour
l’exploitation industrielle d’or contiendraient environ 850 tonnes. Dans la région de
l’Ituri, dans les districts de Kilo et Moto, des ressources aurifères ont été exploitées, mais
les réserves ne sont pas connues avec précision. Les réserves du Moto s’élèveraient à 500
tonnes, et pourraient être plus importantes dans le Kilo, bien qu’aucune estimation
précise ne soit disponible à ce jour. Les gisements d’autres minéraux tels que le coltan ou la
cassitérite se trouvent principalement dans l’est et le sud du pays. Le potentiel de ces autres
minéraux demeure mal connu et leur exploitation se fait principalement de manière
artisanale. Cependant, un intérêt croissant à l’égard de ces minéraux, conduit des entreprises à
acquérir des permis d’explorations et d’exploitation pour déterminer le potentiel de certains
sites et s’engager dans l’exploitation semi-industrielle. Par exemple, l’entreprise MMR
(Mineral Mining Ressources – faisant partie du groupe SOMIKA), a conduit des explorations
aéroportées suivies de forage dans les zones de Kalemie et de Manono au nord du
Katanga, pour évaluer les ressources en coltan sur leurs différentes concessions.
2.2. Les ressources fossiles
Le sous-sol congolais n’est pas seulement riche en minerais, on y trouve aussi le pétrole et le
gaz. Les stocks identifiés du pétrole sont principalement situés dans trois bassins
sédimentaires. Le bassin côtier d’une superficie de 6 000 km2 ; le bassin géant de la cuvette
centrale, d’une superficie de 800 000 km2 ; et le bassin de la branche ouest du rif Est
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 34
Economie des ressources naturelles 2022
Africain, composé de 6 grabens, pour une superficie totale de 50 000 Km 2. Le bassin côtier
est le seul site d’exploitation actif depuis une trentaine d’année mais ayant une production
moyenne limitée à 25 000 barils (10 000 on shore et 15 000 off-shore) de brut par jours, ayant
atteint un pic à 28 000 barils en 2008, sur environ 300 puits, on et off-shore. La majorité des
sites pétroliers sont encore à l’état d’exploration.
3. Les ressources renouvelables
3.1. Les forêts en RDC
La RDC possède parmi les plus importantes ressources forestières du monde. Son
territoire est constitué à 62% ou 145 millions d’hectares de forêts. La diversité des
espèces et plantes situe la RDC au cinquième rang des pays ayant la biodiversité la plus
riche au monde. Le pays compte 5 sites classés au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO,
soit plus que la totalité de sites classés présents sur l’ensemble du continent africain.
Les forêts de la RDC peuvent être classifiées selon 4 grandes typologies. La forêt
dense humide couvre environ 37% du territoire national, la forêt claire 19%, la forêt
de type marécageuse 4% et la forêt de montagne 2%. Les ressources forestières de la
RDC couvrent les deux tiers du bloc forestier du Bassin du Congo qui est l’un des plus
importants massifs tropicaux du monde; le deuxième après la forêt amazonienne.
Les cinq parcs naturels de la RDC classés au patrimoine mondial de l’UNESCO sont
le Parc National de la Garamba, situé au Nord-est du pays et créé en 1938, le parc de la
Solonga situé dans le bassin central du pays. Le rif Albertin abrite trois parcs nationaux
classés : le parc national de Kahuzi-Biega, le parc national de la Maiko, et le parc national
des Virunga créé en 1925 qui est le plus ancien parc naturel d’Afrique.
L’ensemble de ces forêts situés sur le territoire congolais sont non seulement des
ressources cruciales à l’échelle planétaire, jouant un rôle de régulateur de l’environnement,
mais elles constituent également le milieu de vie et un moyen de subsistance pour près de
40 millions de congolais. La forêt leur fournit nourriture, plantes médicinales, sources
d’énergie et matériaux pour la construction d’habitats. En plus, la forêt joue un rôle
clé dans la régulation du climat global. Les forêts congolaises stockent plus de 140 giga
tonnes de CO2 dans leur biomasse. Ce patrimoine exceptionnel n’est pas seulement un enjeu
économique pour les populations locales vivant directement des ressources qu’elles abritent.
Les forêts de la RDC furent historiquement au cœur d’un double enjeu d’exploitation par
l’industrie forestière et de préservation historique de la biodiversité. Au-delà de ce double
usage, l’importance du couvert forestier pose un autre enjeu majeur pour le développement
économique de la RDC, nombre de ses ressources souterraines, et de ses terres fertiles
se situant sur des zones forestières. La gestion du patrimoine forestier est plus que jamais
un enjeu de développement économique et environnemental à l’échelle du pays et à
l’échelle mondiale.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 35
Economie des ressources naturelles 2022
3.2. L’eau, l’énergie hydroélectrique et les ressources halieutiques
Avec le fleuve Congo dont le bassin versant incorpore de manière assez étroite la totalité du
pays, avec un débit moyen de 41 000 m3, et des précipitations abondantes et régulières, la
RDC n’est pas dépourvu d’eau. Les eaux de surface de la RDC représentent environ 52% des
réserves d’eau en Afrique, ce qui fait du pays, le plus riche en eau dans le continent.
Cependant, l’abondance en eau contraste nettement avec l’approvisionnement effectif, estimé
en 2000 à seulement 7m3 par individu par an.
Cette riche hydrographie de la RDC lui confère un potentiel hydroélectrique estimé à 100 000
MW, soit 13% du potentiel hydroélectrique mondial. Les barrages d’Inga (Inga I, Inga II et
Inga III) sur le fleuve Congo, sont la principale source de production d’énergie
hydroélectrique.
En RDC, les ressources halieutiques d’eau douce peuplent les nombreux lacs, marais et
plaines d’inondation du pays alimentés par le riche système hydrographique du bassin du
fleuve Congo. Le pays dispose donc d’énormes potentialités halieutiques. Cependant, la
pêche au Congo se pratique encore de manière traditionnelle ou artisanale.
4. Maladie des ressources naturelles congolaises
La maladie des ressources naturelles ou la malédiction des ressources naturelles, ou encore la
maladie hollandaise est, selon Auty, R. (1993), la thèse selon laquelle les nations à forte
dotation en ressources naturelles affichent en moyenne un niveau de développement socio-
économique inférieur à celui des nations moins nanties par la nature.
La RDC semble, à bien des égards, concentrer les symptômes de cette maladie
des ressources naturelles. L’incroyable richesse de son sous-sol, la fertilité de ses terres,
l’importance de son couvert forestier et de ses ressources hydrauliques n’ont pas empêché
un niveau élevé de pauvreté, touchant aujourd’hui plus de 70 % de la population. Bien
au contraire, le cercle vicieux de la pauvreté et des faibles performances économiques du
pays depuis plus de trente ans, sont largement entretenues par une économie de rente
dont la capture par des intérêts catégoriels est avérée et la redistribution vers l’ensemble
de la population n’est guère assurée. Quelles en sont les causes ?
Katoka (2017), donne quatre causes de la maladie des ressources naturelles. La volatilité est
une première cause de la malédiction des ressources naturelles. En effet, les changements
rapides des prix des matières premières entrainent des incertitudes dans le niveau des revenus
et des dépenses publiques. Celles-ci sont susceptibles de nuire à la performance économique
et au bien-être social en entravant la capacité de l'État à fournir systématiquement les services
publics tels que la santé et l’éducation. Deuxièmement, une hausse des exportations de
produits miniers—boom minier—génère un accroissement des flux entrants de devises,
susceptibles de provoquer une hausse du taux de change et, à long terme, détériorer la
compétitivité du secteur manufacturier et/ou agricole. Un tel phénomène est appelé le « mal
Hollandais (Dutch disease en Anglais) ». Un manque de diversification économique, en
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 36
Economie des ressources naturelles 2022
particulier le secteur manufacturier, est une cause majeure de la baisse du taux de croissance
à long-terme. Troisièmement, les nations riches en ressources naturelles ont tendance à être
mal gouvernées. Cela tient notamment au fait que la rente provenant de l’exploitation minière
détourne les efforts du gouvernement à mettre en place des institutions fiscales fortes, et à
utiliser les revenus de manière à promouvoir le bien-être général des citoyens. En quelque
sorte la rente explique la faible capacité de mobilisation des ressources locales—taxes—dans
les pays riches en ressources naturelles. En outre, plusieurs études empiriques indiquent que
les ressources naturelles ont un impact négatif sur la performance socio-économique
uniquement dans les nations où règne la mauvaise gouvernance. Enfin, l’instabilité politique
et la prévalence des conflits armés constituent le quatrième facteur expliquant la malédiction
des ressources naturelles. En effet, la présence sur un territoire des ressources telles que
pétrole, or, diamant, ou coltan, est susceptible d’inciter aux conflits armés et à l’instabilité
politique, en particulier dans les sociétés souffrant de divisions ethniques, religieuses ou
politiques. Cela exacerbe la vulnérabilité aux prédateurs organisés tels que les groupes armés
et autres acteurs agissant parfois pour le compte des Etats voisins et des multinationaux.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 37
Economie des ressources naturelles 2022
CHAPITRE V : LE DEVELOPPEMENT DURABLE
1. Introduction
À la fin des années 1980, la montée des questions environnementales dites globales (effet de
serre, «trou » dans la couche d’ozone, pluies acides, etc.) a contribué à inverser la perspective
en remettant en cause l’idée de la nécessité d’une «croissance zéro » due à l’épuisement des
ressources naturelles, pour s’interroger au contraire, de façon plus positive, sur les conditions
qui rendraient compatibles croissance et environnement. C’est cette problématique qui a été
popularisée sous la dénomination de développement durable que nous allons examiner dans
ce chapitre.
On peut la dater de 1987, année de la publication du rapport final de la Commission mondiale
sur l’environnement et le développement, Our Comrnon Future, commission présidée par le
Premier ministre norvégien Gro Harlem Brundtland.
Très vite, l’expression a connu un succès extraordinaire, à tel point que, seulement deux ans
plus tard, Pezzey (1989) pouvait en dénombrer plus de soixante définitions différentes si bien
qu’il devient difficile depuis, de trouver une mesure économique ou politique, qu’elle soit
locale, nationale ou internationale, qui ne soit pas justifiée au nom du développement durable.
2. Définitions, piliers et dimensions du développement durable
2.1. Définitions
Selon Lester Brown (2001), qui fait écho aux principes opérationnels proposés par Herman
Daly, il faut entendre par là un développement « qui reposerait sur une utilisation modérée
des ressources non renouvelables, un usage des ressources renouvelables respectant leur
capacité de reproduction et une stricte limitation des rejets et déchets à ce qui peut être
recyclé par les processus naturels. Compte tenu de ces contraintes, le développement durable
appelle de profonds changements dans nos sociétés, en particulier en ce qui concerne leurs
modes de production et de consommation.
Défini par le rapport Brundtland, le développement durable est « la capacité à répondre aux
besoins des générations présentes sans compromettre celle des générations futures à
satisfaire les leurs». Si on considère qu’une génération représente approximativement vingt-
cinq ans, on est donc immédiatement confronté à un allongement de l’horizon. L’unité de
temps n’est désormais plus l’année mais le quart de siècle. Il ne s’agit plus de raisonner ou
d’agir à trois ou cinq ans, mais d’appréhender les conséquences de nos actes à vingt-cinq,
cinquante, soixante-quinze ans…
D’abord présenté comme une tentative pour concilier croissance et développement
économique, le développement durable insiste aujourd’hui sur l’existence d’un nouveau
modèle de gouvernance générant à la fois des perspectives économiques, sociales et
écologiques. En s’étendant à de nombreux domaines - on parle d’agriculture durable, de
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 38
Economie des ressources naturelles 2022
gestion forestière durable -, le développement durable s’inscrit davantage dans le contexte de
la durée plutôt que celui de l’effet de mode !
2.2. Piliers
Le développement durable repose sur deux piliers :
La compatibilité entre la satisfaction des besoins actuels et ceux des générations
futures ;
La conciliation entre le développement économique, la protection de l’environnement
et l’équité sociale.
2.3. Dimensions
Le développement durable a trois dimensions, qui constituent ses composantes :
La dimension économique ;
La dimension écologique (environnement) ;
La dimension sociale.
Il découle de ce qui précède que le développement durable doit être à la fois économiquement
efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif,
l’économie un moyen et l’environnement une condition.
Schéma du développement durable
ECONOMIQUE
viable ECOLOGIQUE
Durable
Equitable vivable
SOCIAL
Un développement n’est « durable » que s’il est conçu de manière à en assurer la pérennité
du bénéfice pour les générations futures.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 39
Economie des ressources naturelles 2022
3. Finalités du développement durable
Le développement durable a pour finalité :
La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ;
La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles ;
La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations ;
L’épanouissement de tous les êtres humains ;
Une dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables.
Chaque finalité est transversale aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques,
piliers du développement durable.
4. Développement durable et croissance économique
4.1. Stratégie des « 3R »
Selon E.Arnaud (2007), pour être durable, une croissance économique forte doit aller de pair
avec une utilisation raisonnée des ressources naturelles. L’utilisation de ces ressources peut-
être allongée grâce à la stratégie dite des « 3R » :
Réduire la consommation de matières premières incorporées dans les produits pour
diminuer les quantités à recycler en fin de vie ;
Réutiliser les produits et emballages pour diminuer les déchets ;
Recycler les matières premières. Le bénéfice du recyclage est important : protection
des ressources, réduction des déchets et création d’emplois.
4.2. Difficulté du développement durable
D’une part, l’idée de développement durable implique à la fois le développement, donc d’une
façon ou d’une autre une certaine forme de croissance, et le maintien des conditions de ce
développement. Or, la nécessité d’utiliser des ressources épuisables pour continuer la
croissance actuelle est sans doute l’obstacle principal à surmonter pour atteindre le
développement souhaité. On peut aussi penser à la pollution, c’est-à-dire à la dégradation de
l’environnement qui peut, à terme, rendre invivable notre planète, ou du moins interdire tout
développement. Néanmoins, d’un point de vue conceptuel, la pollution, qu’elle soit de flux
(fumées, particules en suspension...) ou de stock (effet de serre), est très semblable à une
ressource renouvelable et est donc moins problématique que l’utilisation d’une ressource
épuisable. S’il est possible de contrôler immédiatement la pollution en émettant moins de
polluants (c’est tout l’enjeu du protocole de Kyoto, qui montre d’ailleurs que possibilité ne
signifie pas facilité), il est impossible de faire voler les avions sans kérosène, du moins pour
l’instant.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 40
Economie des ressources naturelles 2022
D’autre part, le long terme impliqué par l’adjectif durable est nécessairement en contradiction
avec le caractère fini des ressources non renouvelables. Même si la fin du pétrole n’est pas si
proche que peuvent le dire certains prophètes, il est certain qu’un jour nous n’en aurons plus.
La seule manière de ne pas subir cet événement, c’est de trouver au pétrole des substituts
inépuisables (sinon le problème du développement durable n’est que repoussé). D’une
manière générale, c’est toute notre dépendance énergétique vis-à-vis des ressources fossiles
qui est la plus forte contrainte. Par exemple, il est possible de nourrir dix milliards d’habitants
sur terre si l’agriculture devient plus productive dans les pays en développement, mais cela
implique une considérable augmentation de la consommation mondiale d’énergie. En fait,
cette contrainte énergétique ne peut être dépassée qu’en la supprimant. Si l’on refuse la
croissance zéro, ce qui semble bien être le cas de la majorité des habitants de la planète, il ne
reste que le progrès technique. Mais lequel?
Résumons donc le point où nous sommes arrivés. Nous considérons une économie qui utilise
du capital 𝑘 et une ressource épuisable 𝑒 pour produire. La production à la date t, est utilisée
pour la consommation et l’investissement. Cette ressource est la seule contrainte que subit
l’économie.
Bien entendu, pour que le modèle soit complet, il faut se fixer un objectif, qui va traduire les
préférences de la société. Toutefois, le développement durable ne doit pas lui-même dépendre
de ces préférences particulières (ni dictature du présent, ni dictature du futur). La question qui
se pose peut alors se formuler de plusieurs manières équivalentes. Est-ce que la
représentation ainsi donnée de l’économie est compatible avec un concept de durabilité? Les
préférences traduites par l’objectif donné sont-elles cohérentes avec les contraintes du
fonctionnement économique? Quelles doivent être les caractéristiques des fonctions de
production et/ou de progrès technique pour qu’il existe un invariant (ou plusieurs) dans cette
économie?
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 41
Economie des ressources naturelles 2022
CONCLUSION
Les ressources naturelles sont indispensables pour assurer le fonctionnement des économies
modernes et pour atteindre et maintenir un niveau de vie élevé dans tous les pays. Par
exemple, les minerais et les autres minéraux sont des intrants essentiels dans la production de
tous les produits manufacturiers. Les combustibles fournissent l’énergie nécessaire au
transport des personnes et des marchandises, à l’éclairage des villes et au chauffage des
maisons et des lieux de travail. Les forêts et les océans constituent une source potentiellement
infinie de matériaux précieux ainsi qu’un habitat pour la faune et la flore sauvages. Enfin,
l’eau est indispensable pour soutenir la vie sur la planète. Il n’est pas exagéré de dire que la
façon dont le monde gère ces ressources naturelles déterminera en grande partie la viabilité
de l’économie mondiale.
Dans ce cours, nous avons relevé des questions révélant des craintes de plus en plus partagées
et mettant en cause notre mode de développement. Celui-ci reposant d'une part, sur
l'utilisation croissante de sources d'énergie primaire (pétrole, gaz, charbon, etc.) limitées,
donc épuisables, et d'autre part, sur des ressources qui, il y a moins de cent ans, semblaient
inépuisables (air) ou capables de se renouveler (eau, forêt, poissons).
Nous avons explicité la règle d'Hotelling tant pour une ressource épuisable, que pour une
ressource renouvelable. Ceci nous a amené à déterminer des indicateurs de rareté pour une
ressource épuisable: le coût d'extraction, la valeur en terre et le prix du marché), nous avons
également donné certaines règles pour éviter la surexploitation des ressources renouvelables
entre autres la régulation centralisée.
Au chapitre quatre, nous avons fait un point sur les ressources naturelles présentes en
République Démocratique du Congo et nous avons parlé de la maladie des ressources
naturelles en RDC, une thèse selon laquelle les nations à forte dotation en ressources
naturelles affichent en moyenne un niveau de développement socio-économique inférieur à
celui des nations moins nanties par la nature. Nous avons aussi traité quelques causes
empêchant l’économie congolaise de tirer, au maximum, profit des ressources naturelles du
pays.
Enfin, nous avons montré qu'aujourd'hui, la quête d'un développement durable est au cœur
des préoccupations et renouvelle l'interrogation sur les limites de la croissance permise par
l'utilisation des ressources naturelles.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 42
Economie des ressources naturelles 2022
BIBLIOGRAPHIE
ARNAUD, E., et al., (2007), Le développement durable, Nathan, Paris, France.
Auty, R., (1993), Sustainable Development in Mineral Exporting Economies: The Resource
Curse Thesis, Routledge, New York.
BONTEMS, P., et ROTILLON, G., (2003), L’Economie de l’environnement, La découverte,
coll. « Repères », 2è éd., Paris.
BROWN, L., (2001), Eco-Economy.Building an Economy for the Earth, Norton &Cie, New
York.
CHASSERIAUX, J.M., (1982), « une interprétation des fluctuations du prix du pétrole »,
Revue d’économie industrielle, n° 22, pp 24-38.
COSTES, F., et al. (2003), Développement durable et théorie de la croissance économique,
document de travail THEMA.
CROS, C., et GASTALDO, S., (2003), « Marchés de droits, expériences et perspectives pour
l’effet de serre », in GUESNERIE R., Kyoto et l’économie de l’effet de serre, rapport du
conseil d’analyse économique, La Documentation française.
DE MONTBRIAL, T., et FAUCHART, E., (2004), Introduction à l’économie, Dunod, 3è éd,
Paris.
DMOERGUE, C., et MPOYI MBUNGA, A., (2012), “La Gestion des Ressources Naturelles
pour une croissance durable”, in Johannes Herderschee, Daniel Mukoko Samba et Moїse
Tshimenga Tshibangu (éditeurs), Résilience d’un Géant Africain : Accélérer la Croissance et
Promouvoir l'Emploi en République Démocratique du Congo, Volume II : Etudes
sectorielles, MÉDIASPAUL, Kinshasa, pages 99-183.
EPAULARD, A., et POMMERET, A., (1998), « Gestion et valorisation des ressources
renouvelables en incertitude », in SCHUBERT K. et ZAGAME P. (éds),
L’environnement :une nouvelle dimension de l’analyse économique, Vuibert.
FAO (2001), "Directives pour la collecte régulière de données sur les pêches de capture",
document technique sur les pêches, n' 382.
FAUCHEUX, S., et NOEL, J.F., (1990) Les ménaces globales sur l’environnement, La
découverte, coll."Repères", Paris.
FAUCHEUX, S., et NOEL, J.F., (1995), Economie des ressources naturelles, Armand Colin,
Paris.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 43
Economie des ressources naturelles 2022
FORRESTER, J.M., (1971), World Dynamics, Wright-Allen Press, Cambridge.
FUENTES CASTRO, D., (2003), Surexploitation de ressources en régime de propriété
commune, sélection adverse et exclusion, thèse pour le doctorat de sciences économiques,
université Paris-X-Nanterre
GAUDET, G., (1982), « Rente minière, prix et marchés des ressources naturelles non
renouvelables », cahier de recherche, n°82-07, GREEN, université Laval.
GAUDET, G., (1984), « Théorie économique et prévision en économie des ressources
naturelles », cahier de recherche, n°84-08, GREEN, université Laval.
GIEC (2001), Climate Change 2001.The Scientific Basis, Cambridge university press,
Cambridge.
GIRAUD, P.N., (1989), l'Economie mondiale des matières premières, La découverte,
coll. « Repères », Paris.
GODARD, O., (1997), « Les enjeux des négociations sur le climat. De Rio à Kyoto: pourquoi
la convention sur le climat devrait intéresser ceux qui ne s'y intéressent pas », Futuribles,
n'224, p.33-66.
GODARD, O., (1999) « La dimension de l'équité dans les négociations sur le climat », Les
cahiers de Global chance, vol.12, pp 8-14.
GODARD, O., (2004) « La pensée économique face à la question de l'environnement »,
cahiers, n'2004-025, Laboratoire d'économétrie de l'école polytechnique.
GUESNERIE, R., (2003), Kyoto et l'économie de l'effet de serre, rapport du conseil d'analyse
économique, La Documentation française.
HOURCADE, J.C., et JOURNÉ, V., (2003), « Monsieur Homais, les guides de montagne et
le maître nageur », critique internationale, vol.18, p.65-79.
IFEN (2001), « propositions d'indicateurs de développement durable pour la France », Études
et travaux, n'35.
IFEN (2003), « 45 indicateurs du développement durable », Études et travaux, n'41.
JEVONS, W.S., (1865), The Coal Question, MacMillan and Co, Londres.
KATOKA, B., (2017), « Malédiction des Ressources Naturelles en RD Congo: Quelques
Propositions pour Renforcer la Bonne Gouvernance dans le Secteur Minier »
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 44
Economie des ressources naturelles 2022
LEFAUDEUX, D., (1998), « Gestion internationale d'une ressource renouvelable. Étude d'un
stock halieutique localisé en zone commune à plusieurs pays", thèse en sciences
économiques, Mémoires et Thèses, n'27, INRA.
LÉVÊQUE, E., (2004), Économie de la réglementation, La découverte, coll' "Repères", 2è
éd., Paris.
LLORENTE, M., (2002), Une approche néo-institutionnelle de la gestion urbaine de l'eau à
Delhi: quelle régulation pour quel service? thèse en sciences économiques, université Paris-
X-Nanterre.
MEADOWS, D.H., et al., (1972), The Limits to Growth, Universe Books, Newyork, et Earth
Island Press, Londres.
NKWEMBE UNSITAL, G.B., (2019), Géographie économique, Manuel de cours, 2 ème
Graduat, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Kinshasa.
PEZZEY, J., (1989), « Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable
Development », Document de travail, n°15, Banque mondiale, Washington, DC.
RICARDO, D., (1821,1993), Des principes de l'économie politique et de l'impôt,
Flammarion, Paris, 3è éd.
ROBBINS, L., (1947), Essai sur la nature et la signification de la science économique,
Librairie de Médicis, Paris.
ROTILLON, G., (1996), Introduction à la microéconomie, La découverte, coll « Repères »,
2è éd., Paris.
ROTILLON, G., (2005), Economie des ressources naturelles, La découverte,
coll. « Repères », Paris.
THIOMBIANO, T., (2004), Economie de l’environnement et des ressources naturelles,
L’Harmattan, Paris.
UBOLE, T., et YUMBI, P., (2017), RD.CONGO : Terre de potentialités, d’opportunités, de
convoitises et de pillages, des origines à nos jours, CEPAS, Kinshasa.
VIVIEN, F.D., (1994), Économie et écologie, La découverte, coll. "Repères", Paris.
Guy-Bernard NKWEMBE UNSITAL Page 45
Vous aimerez peut-être aussi
- Senegal - Etude OddDocument45 pagesSenegal - Etude OdddiourouPas encore d'évaluation
- Cours D'économie de L'environnement Et Des Ressources NaturellesDocument22 pagesCours D'économie de L'environnement Et Des Ressources NaturellesDjim Momath Seck100% (1)
- Cours Histoire Culture de La Paix 2022Document9 pagesCours Histoire Culture de La Paix 2022daoudaPas encore d'évaluation
- (FR) Maze Rats - Aventures en Selestya (OEF) (2020-03-13)Document97 pages(FR) Maze Rats - Aventures en Selestya (OEF) (2020-03-13)Gérard MenvussaPas encore d'évaluation
- Tobie Lolness - French DescriptionDocument7 pagesTobie Lolness - French DescriptionNina Eriksson100% (1)
- Economie Des Ressources MineralesDocument17 pagesEconomie Des Ressources MineralesJoseph ntambo100% (2)
- Les Risques Naturels en CIDocument115 pagesLes Risques Naturels en CIGUEU ARNOLD100% (1)
- Djermaya Solar EIES Centrale PV RevE v2Document413 pagesDjermaya Solar EIES Centrale PV RevE v2Kalosoiretrotchgmail.com KalosoPas encore d'évaluation
- Memoire de Delta C VFDocument212 pagesMemoire de Delta C VFSamy AttohPas encore d'évaluation
- GéopolitiqueDocument42 pagesGéopolitiqueGora NdoyePas encore d'évaluation
- Exposé Réchauffement Climatique ZeynaDocument10 pagesExposé Réchauffement Climatique ZeynaIboukhaliloulahh ThiamDollarsPas encore d'évaluation
- Gilles Rotillon - Économie Des Ressources Naturelles - Editions La Découverte (2005)Document123 pagesGilles Rotillon - Économie Des Ressources Naturelles - Editions La Découverte (2005)simplice tene penka100% (2)
- Gaz Naturel 1Document11 pagesGaz Naturel 1djetouPas encore d'évaluation
- 2014 FrancaisDocument3 pages2014 FrancaisKatcha nanklan enock hiliPas encore d'évaluation
- Cours D'économie de L'environnement Et Des Ressources NaturellesDocument22 pagesCours D'économie de L'environnement Et Des Ressources NaturellesLaar TVPas encore d'évaluation
- Analyse Économique Du Développement Du Secteur Minier Au Mali - FINAL PDFDocument87 pagesAnalyse Économique Du Développement Du Secteur Minier Au Mali - FINAL PDFMohamed Badian TraorePas encore d'évaluation
- PDF Administration GabonaiseDocument370 pagesPDF Administration GabonaiseGuyroel AnzoumanaPas encore d'évaluation
- Guinée - Wikipédia PDFDocument102 pagesGuinée - Wikipédia PDFamadou dialloPas encore d'évaluation
- Cours de Risques NaturelsDocument105 pagesCours de Risques NaturelsEnock KambalePas encore d'évaluation
- Gestion Ressources Burkina FasoDocument121 pagesGestion Ressources Burkina FasoFABPas encore d'évaluation
- 39.-M2R-Syllabus-Cours-EDD GoodDocument32 pages39.-M2R-Syllabus-Cours-EDD GoodADIL BENTALEBPas encore d'évaluation
- Support Du Cours Recherche OperationnelleDocument40 pagesSupport Du Cours Recherche OperationnelleAlbert DossaPas encore d'évaluation
- 2.la Rudologie 1ere PartieDocument27 pages2.la Rudologie 1ere Partierollinpeguy100% (1)
- Production Agricole Et Dégradation Des Sols Dans La Commune de Za Kpota KTTBZTDocument78 pagesProduction Agricole Et Dégradation Des Sols Dans La Commune de Za Kpota KTTBZTMariano OKEPas encore d'évaluation
- CH4Document5 pagesCH4عبد العزيز مروىPas encore d'évaluation
- Exposé: Changement Climatique Au NigerDocument7 pagesExposé: Changement Climatique Au NigerdangaPas encore d'évaluation
- Etat Des Unités IndustriellesDocument7 pagesEtat Des Unités Industrielleshama abdoulaye diallo aboubacar100% (2)
- Gestion Des Ressources Naturelles - WikipédiaDocument8 pagesGestion Des Ressources Naturelles - Wikipédiaabderrahmane ait maaitPas encore d'évaluation
- Nomenclature Des Metiers Et Services Agricoles 2019 VFDocument49 pagesNomenclature Des Metiers Et Services Agricoles 2019 VFEusèbe DAVAKANPas encore d'évaluation
- F2BC CONG.5.2 Periurbain Congo Rapport Final E 11 ConvertiDocument172 pagesF2BC CONG.5.2 Periurbain Congo Rapport Final E 11 ConvertiCedric Prince NSONDE-MONDZIEPas encore d'évaluation
- Causes Et Impacts de La Degradation Des Terres Et Des Eaux Du Bassin Du Fleuve NigerDocument34 pagesCauses Et Impacts de La Degradation Des Terres Et Des Eaux Du Bassin Du Fleuve Nigerva15la15100% (1)
- La Degradation Des Terres, Et Le Concept de Neutralité Comme SolutionDocument118 pagesLa Degradation Des Terres, Et Le Concept de Neutralité Comme SolutionLahcen BourziqPas encore d'évaluation
- FertilisationDocument194 pagesFertilisationtshimanga jeanPas encore d'évaluation
- Biostatistique Et Informatique AppliqueesDocument7 pagesBiostatistique Et Informatique AppliqueesFotouo Dzousse MichéePas encore d'évaluation
- Cours D'hisoire Classe 10èmeDocument23 pagesCours D'hisoire Classe 10èmeSékou Sidibé100% (1)
- Planification RégionaleDocument6 pagesPlanification RégionaleMonPlus Beau JourPas encore d'évaluation
- Etude Economique Et Developpement De La Region Ne Kongo En RdcD'EverandEtude Economique Et Developpement De La Region Ne Kongo En RdcPas encore d'évaluation
- Plan Communal de Developpement de SoaDocument289 pagesPlan Communal de Developpement de SoaBenjamin Nomo100% (1)
- Pejedec3 P172800 Cges PDFDocument214 pagesPejedec3 P172800 Cges PDFAkaPas encore d'évaluation
- Cours Campagne Et Ruralite Dans Le Monde - L2 - Geo-1Document15 pagesCours Campagne Et Ruralite Dans Le Monde - L2 - Geo-1Innocent Kouassi50% (2)
- Synthese Socio-EconomiqueDocument53 pagesSynthese Socio-Economiquebouaziz samiPas encore d'évaluation
- Impacts Environnementaux Et Socioéconomiques Des Inondations Dans La Commune Du Golfe 4: Cas Du Quartier Nyekonakpoè (Togo) .Document85 pagesImpacts Environnementaux Et Socioéconomiques Des Inondations Dans La Commune Du Golfe 4: Cas Du Quartier Nyekonakpoè (Togo) .Jean Paul Diwiniga TONFEAPas encore d'évaluation
- Mémoire - TRAORE Dramane - Version - DéfinitiveDocument124 pagesMémoire - TRAORE Dramane - Version - DéfinitiveDramane TRAOREPas encore d'évaluation
- CGES FA JigisemeJiri Rapportfinalapril25 PDFDocument113 pagesCGES FA JigisemeJiri Rapportfinalapril25 PDFLouis SamakéPas encore d'évaluation
- Memoire Corrigerbde Gestion Des Déchets Ménagers Dans Le Quartier KIKOTI/KikwitDocument51 pagesMemoire Corrigerbde Gestion Des Déchets Ménagers Dans Le Quartier KIKOTI/KikwitCharles KumakingaPas encore d'évaluation
- 1-Synthèse Modèle de Mundell-FlemingDocument3 pages1-Synthèse Modèle de Mundell-FlemingReda LambarkiPas encore d'évaluation
- Etude D'impact Sur L'environnementDocument49 pagesEtude D'impact Sur L'environnementAizen SosukePas encore d'évaluation
- Offre de Formation BTS-Vol 1Document166 pagesOffre de Formation BTS-Vol 1Mathieu TALLA100% (1)
- Mali Etude ApeDocument0 pageMali Etude Apeperico1962Pas encore d'évaluation
- Mémoire Samy UEA2022Document73 pagesMémoire Samy UEA2022Samuel100% (1)
- Plan Senegal Emergent Pse Et Changements Climatiques PDFDocument26 pagesPlan Senegal Emergent Pse Et Changements Climatiques PDFCheikhPas encore d'évaluation
- Securite Alimentaire en Afrique SubDocument26 pagesSecurite Alimentaire en Afrique SubLéonard RalisonPas encore d'évaluation
- Francais 2Document2 pagesFrancais 2Cyrille FleanPas encore d'évaluation
- Cours - MENDIL Djamila - MACROECONOMIEDocument66 pagesCours - MENDIL Djamila - MACROECONOMIEPaul HoungbddjiPas encore d'évaluation
- Memoire de Master Gire VDDocument63 pagesMemoire de Master Gire VDLawali Rabiou BinaddoPas encore d'évaluation
- Module Stratégie de Mobilisation Des Ressources Financières Locales Version FinaleDocument58 pagesModule Stratégie de Mobilisation Des Ressources Financières Locales Version FinaleMathieu EuroPas encore d'évaluation
- 4 - Mémoire Fla AGT Mouele - FlavienDocument109 pages4 - Mémoire Fla AGT Mouele - FlavienJason Reddigton IkapiPas encore d'évaluation
- PDC Dogo Version ReviseeDocument89 pagesPDC Dogo Version Reviseeharouna souley hegaPas encore d'évaluation
- Cours Environnement Et Developpement DurableDocument33 pagesCours Environnement Et Developpement DurableDïvok'sï Tëgrâ DïvôvâPas encore d'évaluation
- Madagascar Profil Environnemental AnosyDocument122 pagesMadagascar Profil Environnemental AnosyJohn James RahobisoaPas encore d'évaluation
- Geographie Tle A 2017-1Document34 pagesGeographie Tle A 2017-1lindadavis5611Pas encore d'évaluation
- Pauvreté, Marché Du Travail Et Croissance Pro-Pauvres Á Madagascar (BIT)Document134 pagesPauvreté, Marché Du Travail Et Croissance Pro-Pauvres Á Madagascar (BIT)HayZara MadagascarPas encore d'évaluation
- Aide Projet 1Document193 pagesAide Projet 1Flore MiyonePas encore d'évaluation
- Atlas IGN Des Cartes de L'anthropocèneDocument86 pagesAtlas IGN Des Cartes de L'anthropocèneFabrice Travignet100% (1)
- Lettre Ouverte Du Collectif Sauvegardons Le Pont de GaulleDocument3 pagesLettre Ouverte Du Collectif Sauvegardons Le Pont de GaulleFrance3 AlsacePas encore d'évaluation
- CGES - Annexes - 1PDVS Rev Paru - 28112022 VR 30 11 2022 1Document218 pagesCGES - Annexes - 1PDVS Rev Paru - 28112022 VR 30 11 2022 1bertrand dénis kablanPas encore d'évaluation
- Biom - 5 DGFRN - 1.12 - Rapport Annuel Eau Et Foret 2020Document110 pagesBiom - 5 DGFRN - 1.12 - Rapport Annuel Eau Et Foret 2020Olivier KergallPas encore d'évaluation
- Etude de La Viabilité de La Biodiversité Dans Le Parc National de Gouraya, Propositions Pour Un Plan D'actionDocument145 pagesEtude de La Viabilité de La Biodiversité Dans Le Parc National de Gouraya, Propositions Pour Un Plan D'actionFairouz MessatPas encore d'évaluation
- Afd La Gestion Des Dechets Solides Comprendre Pour Mieux Agir 2021Document41 pagesAfd La Gestion Des Dechets Solides Comprendre Pour Mieux Agir 2021James Cater Jean BathardPas encore d'évaluation
- C - E L'homme Et La NatureDocument3 pagesC - E L'homme Et La NatureIkram KikaPas encore d'évaluation
- Rapport Senat RDC Commission Enquete Senatoriale Pollution PerencoDocument221 pagesRapport Senat RDC Commission Enquete Senatoriale Pollution PerencoOlivier kimpesaPas encore d'évaluation
- Rapport Définitif Évaluation PGDRNDocument93 pagesRapport Définitif Évaluation PGDRNEMMANUEL SEGNOUPas encore d'évaluation
- Tpe DD de 5Document13 pagesTpe DD de 5NSANGOUPas encore d'évaluation
- PGC-001 FRDocument56 pagesPGC-001 FRsaratoubarro967Pas encore d'évaluation
- RavoanjanaharyT AGRO LIC 2018Document55 pagesRavoanjanaharyT AGRO LIC 2018FlorianPas encore d'évaluation
- Lettre Au Préfet de L'héraultDocument2 pagesLettre Au Préfet de L'héraultRadio RPHPas encore d'évaluation
- Eco Conception ProgresDocument19 pagesEco Conception ProgresLudø LescargøPas encore d'évaluation
- Dossier Historiens Et Geographes Le Tourisme en Mediterranee CorrigeDocument11 pagesDossier Historiens Et Geographes Le Tourisme en Mediterranee CorrigefilipePas encore d'évaluation
- Grâce À Eux, Avec Vous !: PropretéDocument36 pagesGrâce À Eux, Avec Vous !: PropretéLouis-Henri DEFRESNEPas encore d'évaluation
- Rapport de Formation ACC - PARSACC-ACCMR - Kaedi 9-12 Mars 2015Document48 pagesRapport de Formation ACC - PARSACC-ACCMR - Kaedi 9-12 Mars 2015Fadwa FakhfakhPas encore d'évaluation
- Examen D - Écologie 1er Année Agro 2021Document3 pagesExamen D - Écologie 1er Année Agro 2021imsaid730Pas encore d'évaluation
- Le Tinkle Bavard: Atlas Galactique: FaahDocument4 pagesLe Tinkle Bavard: Atlas Galactique: FaahASCUDPas encore d'évaluation
- Les Initiatives de Tourisme Responsable Dans Le Parc National de Banff, CanadaDocument21 pagesLes Initiatives de Tourisme Responsable Dans Le Parc National de Banff, CanadaJihane BenzidanePas encore d'évaluation
- Dossier D'informations Sur Les ONG EnvironnementalesDocument10 pagesDossier D'informations Sur Les ONG EnvironnementalesMorrakPas encore d'évaluation
- Rapport Peche FKF VFDocument27 pagesRapport Peche FKF VFGamuzPas encore d'évaluation
- Rapport 12e Reuniongs 2016 Final 0Document35 pagesRapport 12e Reuniongs 2016 Final 0RomainPas encore d'évaluation
- EMNA-PFE-COPIE FINALE 11062015 À ChokriDocument66 pagesEMNA-PFE-COPIE FINALE 11062015 À ChokriChokri Yaich100% (1)
- Rapport Les Impacts Du Changement Climatique Sur Les EspecesDocument21 pagesRapport Les Impacts Du Changement Climatique Sur Les EspecesSofiane MehadjiPas encore d'évaluation
- Faire Un Documentaire Animalier Devant Chez SoiDocument4 pagesFaire Un Documentaire Animalier Devant Chez SoiClaudia HABRAN AUGUSTINPas encore d'évaluation