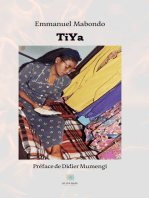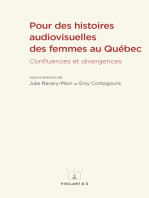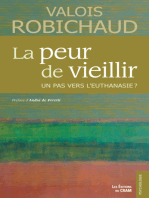Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Span 651
Transféré par
Emmanuel KoffiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Span 651
Transféré par
Emmanuel KoffiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Systèmes de pensée en Afrique noire
17 | 2005
L’excellence de la souffrance
Dominique Casajus (dir.)
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/span/651
DOI : 10.4000/span.651
ISSN : 2268-1558
Éditeur
École pratique des hautes études. Sciences humaines
Édition imprimée
Date de publication : 1 juin 2005
ISSN : 0294-7080
Référence électronique
Dominique Casajus (dir.), Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005, « L’excellence de la
souffrance » [En ligne], mis en ligne le 28 juin 2013, consulté le 26 septembre 2020. URL : http://
journals.openedition.org/span/651 ; DOI : https://doi.org/10.4000/span.651
Ce document a été généré automatiquement le 26 septembre 2020.
© École pratique des hautes études
1
De nombreuses sociétés marquent par de douloureux rituels l’entrée des jeunes gens
dans la vie adulte. Les souffrances souvent cruelles qui leur sont administrées en ces
occasions solennelles ont depuis longtemps retenu l’attention des ethnographes et
avant eux des voyageurs ; elles auront été le point de départ du travail collectif
présenté ici, mais le point de départ seulement. Car il est bien d’autres situations où
l’infliction de la souffrance est ainsi mise en scène, où celui qui la subit sous le regard
de tous doit l’endurer en silence à peine de déchoir.
NOTE DE LA RÉDACTION
Ce numéro 17, tiré à 600 exemplaires, est encore disponible en version papier.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
2
SOMMAIRE
Présentation
Dominique Casajus
« L’homme qui souffre et l’esprit qui crée »
Dominique Casajus
Écorchés vifs
Pour une anthropologie des affects
Caterina Pasqualino
Le travail de la souffrance
Parcours biographique du cultivateur sénoufo (Côte d’Ivoire)
Marianne Lemaire
Souffrance, compétence et résilience
Le cas des Témoins de Jéhovah
Régis Dericquebourg
Au cœur de la souffrance
Le projet de devenir psychothérapeute spirituel
Anne-Cécile Bégot
Sans douleur
Épreuves rituelles, absence de souffrance, et acquisition de pouvoirs en Inde
Gilles Tarabout
Les prophètes africains doivent-ils souffrir ?
Christine Henry
Infléchir le destin car la vraie souffrance est à venir
(Société maure-islam sunnite)
Corinne Fortier
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
3
Présentation
Dominique Casajus
1 De nombreuses sociétés marquent par de douloureux rituels l’entrée des jeunes gens
dans la vie adulte. Les souffrances souvent cruelles qui leur sont administrées en ces
occasions solennelles ont depuis longtemps retenu l’attention des ethnographes et
avant eux des voyageurs; elles auront été le point de départ du travail collectif présenté
ici, mais le point de départ seulement. Car il est bien d’autres situations où l’infliction
de la souffrance est ainsi mise en scène, où celui qui la subit sous le regard de tous doit
l’endurer en silence à peine de déchoir. Les articles rassemblés ici examinent donc une
série de telles situations, qui bien que fort éloignées parfois des rituels dits de passage
où s’originait notre réflexion collective, s’apparentent à eux en ce qu’elles mettent en
œuvre un dispositif relationnel analogue. Pour faire apparaître cette analogie,
rappelons d’un mot la forme que ce dispositif prend dans les rituels de passage. La
souffrance infligée aux novices l’est devant témoins. Même lorsque qu’ils sont torturés
à l’écart, sans autres témoins que leurs tortionnaires, leurs souffrances sont sues de
tous : les femmes restées au village savent que leurs garçons souffrent et que certains
mourront peut-être, parfois elles entendent leurs cris au loin1. Cela reste vrai encore
lorsque les souffrances sont endurées sans aucun témoin humain. L’Indien des plaines
qui, pour acquérir une vision, s’inflige dans la solitude d’abominables tourments
souffre en présence des divinités qu’il espère attendrir par le spectacle de son supplice 2.
Il ne s’agit pas seulement d’endurcir les novices en leur faisant subir des épreuves
douloureuses, mais de prendre à témoin la société tout entière de leur souffrance.
L’initié n’est pas seulement celui qui a souffert, mais celui dont tous savent – et dont
quelques-uns ont vu – qu’il a souffert. Il n’est devenu un être nouveau que parce que les
autres en jugent ainsi; et eux fondent leur jugement sur les souffrances qu’ils l’ont vu
endurer.
2 On retrouve ce schéma d’interaction dans les diverses situations examinées ici puisque
toutes mettent aux prises des acteurs qui souffrent et des témoins aux yeux de qui ces
souffrances sont source ou signe d’excellence. Ces situations ont été voulues les plus
disparates possible, notre objectif ayant été de considérer un schéma d’interaction en
tant que tel, indépendamment du contexte culturel où il est mis en œuvre. Un objectif
qui aura été atteint en plusieurs étapes. À l’automne 2000, des discussions très
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
4
informelles avec Michael Houseman, Marianne Lemaire et Véronique Duchesne
m’avaient permis de dégager une formulation encore très sommaire de ce schéma
d’interaction. J’en ai tiré la matière d’un texte programmatique que j’ai soumis à
plusieurs collègues, ethnologues ou sociologues, travaillant selon des perspectives ou
sur des terrains très variés. Nous nous sommes réunis périodiquement de l’automne
2000 au printemps 2002, chacun exposant à tour de rôle une étude de cas susceptible
d’illustrer – ou de réfuter – le texte qui lui avait été soumis. Pour certains, ces exposés
auront été le premier brouillon de leur contribution au présent volume; d’autres les ont
publiés ailleurs et livrent ici un état ultérieur de leur réflexion 3.
3 Les poètes touaregs présentent les souffrances qu’ils disent endurer, ou qu’ils infligent
au narrateur dolent mis en scène par leurs poèmes, comme la preuve qu’ils excellent
dans leur art (Dominique Casajus). Lorsque le narrateur s’écrie : « J’aime et je souffre »,
il faut imaginer l’auteur qui derrière lui murmure : « Je suis un authentique poète. »
Nous sommes donc ici dans un cas où c’est l’acteur souffrant lui-même qui prend le
public à témoin de ses souffrances, en lui demandant d’y voir une preuve d’excellence.
Cette réalisation particulière de notre schéma d’interaction se retrouve dans des
traditions poétiques aussi différentes que la poésie arabe archaïque ou la poésie
troubadouresque, et semble liée à une certaine forme de production et de diffusion de
la parole poétique. Comme Jean Lambert nous l’avait montré dans un exposé qui n’a pas
été reproduit ici, elle est également à l’œuvre dans la poésie yéménite contemporaine,
où elle donne lieu à un curieux partage des rôles : quoique cet étalage de sentiments
douloureux soit considéré comme un peu honteux, la honte n’en retombe pas sur les
poètes eux-mêmes, qui ne se produisent jamais en public, mais sur les interprètes, qui
appartiennent le plus souvent à des catégories sociales subalternes 4. Le cas d’une autre
poésie bédouine nous avait été exposé par Corinne Fortier, qui depuis l’a publié
ailleurs5 : en pays maure, où la poésie est un élément du commerce galant, les jeunes
gens font valoir les souffrances qu’ils y chantent comme autant de titres à la
bienveillance de celles qui les leur infligent : « Comment peux-tu ne pas m’aimer, moi
qui souffre tant de t’aimer. » Tout cela rappelle beaucoup la poésie troubadouresque,
sauf que le jeu amoureux est ici réel alors qu’il était probablement fictif chez les
troubadours. Caterina Pasqualino nous avait montré dans son exposé que, pour les
Gitans de Jerez, un chanteur de flamenco n’atteint le sommet de son art que s’il est en
proie à de grandes souffrances morales. Ici, le public impute à celui qui manifeste son
excellence des souffrances qui seules l’expliqueraient; magnifiée par elles, la
performance du chanteur est à son tour l’occasion d’une souffrance physique tenue
pour mortelle à terme. Il doit, en effet, exécuter son dernier couplet, le macho, sans
reprendre son souffle, et prononcer les derniers vers au bord de l’étouffement : « On
chante mieux quand on se sent perdu (perdido). » Exercice difficile auquel il ne se livre
pas impunément. On dit que si le macho est bien fait, « après avoir chanté, on vomit le
sang et cela tue »6. Les grands chanteurs finissent par mourir de phtisie, les poumons
ravagés pour avoir trop chanté. La contribution de Caterina Pasqualino dans le présent
volume reprend une partie de cet exposé, mais elle est surtout consacrée à un sujet
nouveau : la souffrance collective du peuple gitan7. Chez les Sénoufo de Côte d’Ivoire,
on retrouve semblablement une performance à l’accomplissement de laquelle la
souffrance morale est nécessaire (Marianne Lemaire). À l’époque où se pratiquaient
encore les concours de culture, les champions étaient ceux qui, tenaillés par un
douloureux désir de vaincre, acceptaient d’affronter jusqu’à leur paroxysme les peines
inséparables du travail agricole. Régis Dericquebourg avait fait apparaître dans son
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
5
exposé que, dans les religions dites de guérison, les fondateurs et les guérisseurs
situent volontiers une épreuve douloureuse à l’origine de leur vocation et de leurs
charismes; la contribution qu’il livre ici approfondit le cas particulier des Témoins de
Jéhovah. Eux aussi prennent le public à témoin de souffrances qu’ils tiennent comme
preuve de leur excellence. On retrouve la même démarche chez quatre malades du Sida
dont le cas est présenté par Anne-Cécile Bégot; dans leur recherche anxieuse d’une
thérapie salvatrice, ils avaient rencontré des thérapeutes de style Nouvel Âge puis
étaient devenus thérapeutes à leur tour, convaincus que leurs souffrances leur en
avaient donné l’aptitude. En revanche, les dévots du Kerala dont nous parle Gilles
Tarabout constituent une manière de contre-exemple puisqu’ils disent ne pas souffrir
malgré tous les tourments qu’ils s’infligent; dans leur cas, c’est l’absence de souffrance
qui est tenue pour preuve d’excellence. La contribution de Christine Henry, consacrée
pour l’essentiel à Oshoffa, le fondateur de l’Église béninoise dite du Christianisme
Céleste, propose elle aussi un contre-exemple. À la différence du Congolais Simon
Kibangu et du Libérian William Harris, eux aussi fondateurs d’Églises mais qui eurent à
endurer des persécutions où leurs disciples voient aujourd’hui la preuve de leur
sainteté, Oshoffa n’est ni un martyr ni un ascète : mes miracles, affirme-t-il
tranquillement, « ne sont pas accomplis par ma propre puissance, je ne suis que le
serviteur de Celui qui m’a envoyé », c’est pourquoi « je n’ai pas besoin de me livrer à
des assauts de prières, de veiller toute la nuit, de jeûner ou de m’infliger une
quelconque ascèse ». Une sainteté paisiblement revendiquée rend ici la souffrance
superflue. Dans sa contribution, qui présente des réflexions nouvelles par rapport à son
exposé, Corinne Fortier analyse le rôle des souffrances de l’Au-delà dans la théologie
musulmane. Hormis les saints et les martyrs, tous les hommes sont promis à l’Enfer, et
les Musulmans évoquent volontiers la cruauté de ces souffrances à venir pour
relativiser celles qu’ils ont à endurer ici-bas. Ils savent cependant que certains n’y
resteront que le temps d’expier leurs fautes, tandis que d’autres, notamment les
Infidèles, y demeureront à jamais. Pour les premiers, la souffrance est en un sens
source d’excellence puisqu’elle fait d’eux des justes, pas pour les seconds.
4 Il est clair que les souffrances alléguées dans ces diverses situations sont très
différentes les unes des autres. Celle que disent éprouver les poètes bédouins n’est pas
celle que disent éprouver les chanteurs gitans, ni celle qu’on attribue aux champions
sénoufo. Sans parler des Témoins de Jéhovah, dont Régis Dericquebourg montre qu’ils
assimilent leur sort à celui des premiers Chrétiens ou des victimes de la Shoah. Il aurait
été indécent de mettre sur le même plan les peines d’amour de la poésie élégiaque et les
souffrances de l’Holocauste. C’est pourquoi il nous fallait soumettre le terme même de
« souffrance » à un travail d’élaboration conceptuelle. Nous sommes partis pour cela
des distinctions que Simone Weil établissait dans un texte écrit peu avant sa mort,
« L’amour de Dieu et le malheur »8. Le malheur, écrivait-elle, est ce qui n’est pas choisi,
et il tend toujours à avoir une dimension sociale. Il suppose la souffrance physique, ou
du moins cette part irréductible du chagrin qui est « quelque chose comme une douleur
physique, une difficulté à respirer, un étau autour du cœur, ou un besoin inassouvi, une
faim, ou un désordre presque biologique causé par la libération brutale d’une énergie
jusque-là orientée par un attachement et qui n’est plus dirigée ». « Un chagrin qui n’est
pas ramassé autour d’un tel noyau irréductible, ajoutait-elle, est simplement du
romantisme, de la littérature. » En ce sens, les souffrances dont parlent les poètes
bédouins ne sont certes que de la littérature, mais les tourments qu’ils disent souffrir
sont toujours dépeints comme une souffrance physique, une soif mortelle, une brûlure
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
6
du corps autant que de l’âme. Peut-être y a-t-il plus ici qu’une simple métaphore. La
soif est un véritable malheur, puisque ces hommes du désert savent qu’on peut en
mourir. Qu’une souffrance morale soit ressentie dans le corps l’élève à la dimension du
malheur.
5 Pour les chanteurs de flamenco, nous retrouvons des traits comparables sinon dans
leurs compositions, du moins dans ce que le public raconte d’eux. On en parle comme
d’hommes frappés de multiples malheurs : tel chanteur a connu la prison, tel autre la
trahison, etc. De plus, les Gitans dans leur ensemble sont un peuple habité par le
malheur, au sens précis que Simone Weil donne à la notion lorsqu’elle insiste sur sa
dimension sociale. Et c’est cette condition de malheur collectif qui fait que leurs
chanteurs sont réputés avoir plus de sensibilité que les Payos, les non-Gitans. Il est
intéressant de noter que les Gitans de Jerez voient dans la Passion de Jésus-Christ la
préfigure de leur propre souffrance. Leur Christ n’est ni le rédempteur de la théologie
chrétienne ni le Christ un peu hétérodoxe d’une Simone Weil pour qui la crucifixion,
aboutissement d’un destin injuste, est l’extrême du malheur. Il est tout simplement un
des leurs. On le perçoit bien à la façon dont ils commémorent ses souffrances lors des
cérémonies de la semaine sainte9. Le mercredi saint, la statue de Nuestro Padre del
Prendimiento, « Notre Père de l’Arrestation », quitte l’église du quartier de Santiago
pour être portée en procession solennelle à travers la ville. Les Gitans de Santiago la
saluent de leurs saetas, louanges psalmodiées qu’ils font monter vers elle comme de
longues plaintes. Sur le captif du Mont des Oliviers, ils gémissent comme sur un frère
de misère, eux qui se souviennent de leur passé d’asservissement et des longues
journées de labeur dans les oliveraies des Payos. Le Vendredi saint, El Cristo de la
Expiración, qui réside dans l’ermitage de San Telmo, est à son tour porté dans les rues de
la ville. Les Gitans du quartier l’appellent Melena, « cheveux flottants », à cause de sa
longue perruque que la rumeur dit faite de cheveux de femmes. Ils racontent qu’à la fin
de la procession, au moment où on le ramène à San Telmo, le vent se lève pour faire
flotter ses cheveux. Mais est-ce vraiment le vent, se demandent-ils parfois, et ne serait-
ce pas plutôt le dernier souffle du Supplicié? Quoi qu’il en soit, le nom même de ce
Cristo de la Expiración le rend semblable au chanteur de flamenco lorsqu’il achève le
macho. Comment, en effet, au moment où il arrache de ses entrailles un dernier cri, le
flamenco expirant et perdido ne verrait-il pas un frère dans l’Abandonné qui mourut sur
la croix « en poussant un grand cri »? Quelques-uns, comme le grand Camarón de la Isla
dont Caterina Pasqualino nous parle dans sa contribution, ont un sentiment très vif de
cette fraternité.
6 Quant aux cultivateurs sénoufo, ils ne diraient sans doute pas en temps normal qu’ils
souffrent dans leur travail. Le travail agricole est assurément pénible, mais certains
d’entre eux, les kanwolo, s’y adonnent avec une lenteur et une nonchalance qui leur
épargnent de trop y souffrir. Si les champions de culture (les tegban) souffrent, c’est
parce que l’effort se double pour eux d’un tourment moral. Les xylophonistes qui les
accompagnent ont même pour tâche « de maintenir toujours vivace la souffrance
morale de leur tegban », une souffrance d’abord causée par le risque de l’humiliation et
de la défaite. État d’âme qui rend le champion insensible même à la douleur; comme le
dit un des interlocuteurs de Marianne Lemaire, « même s’il se tape avec la houe jusqu’à
toucher l’os, il ne le considère pas, il cultive ». On peut mettre ceci en parallèle avec ce
qui nous est dit du chanteur flamenco : « Un chanteur ne doit pas apaiser sa douleur
[morale], mais au contraire chercher à l’augmenter pendant sa performance. » On ne
peut pas dire que le champion sénoufo soit malheureux, puisqu’il est libre de ses choix.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
7
Sans doute n’est-il pas libre de la passion qui l’habite, mais un malheur n’en est pas un
lorsque la fatalité vient de soi-même. En revanche, le malheur le guette à terme. En
effet, les plus grands champions risquent de se voir frappés de deuils ou de désastres
qui sont autant d’injonctions surnaturelles à renoncer au travail agricole pour devenir
des devins et porter la parole des puissances dont viennent leurs malheurs. Tandis que
les malheurs passés du chanteur de flamenco le rendent apte à vivre avec talent un
destin fait d’une souffrance physique dont il finira par mourir, les malheurs qui
frappent les champions sénoufo les obligent à renoncer à leur gloire pour affronter un
nouveau destin, fait là encore d’une souffrance qui est à la fois morale et physique. Les
devins sont en effet poursuivis par une douloureuse incertitude : Suis-je sûr de dire la
vérité? Les malheurs où j’ai vu la marque d’une élection étaient-ils un signe
authentique? De surcroît, la pratique de la divination elle-même est physiquement
douloureuse. Tout comme le cultivateur, le devin « travaille “avec les mains”, et il les
“chauffe”. Tout comme lui, il “frappe”, et frappe non pas la terre, mais son propre
corps : là où il frappe, le sang “se coagule” de sorte que la peau devient noire et dure ».
Mais cette douleur est la promesse d’un apaisement de son tourment moral car elle
seule peut garantir la véridicité de son dire, et par là même donner un sens à son
malheur.
7 Les Témoins de Jéhovah étudiés par Régis Dericquebourg présentent un autre type de
configuration. D’avoir été capables d’affronter sans se renier les souffrances subies
dans les camps de concentration les rend à leurs propres yeux semblables aux martyrs
chrétiens. Mais un martyr n’est pas un malheureux, il est même, à la lettre, un
bienheureux. À les entendre, ce qui pour d’autres a été un malheur ne fut pour eux que
l’occasion de témoigner (martyrein) de leur foi. Là est, notons-le, le nœud du profond
malentendu qui a opposé Jean-Paul II aux survivants de l’Holocauste : en 1979, lors de
sa première visite comme pape à Auschwitz-Birkenau, il s’était écrié : « Auschwitz,
Golgotha du monde contemporain »10, paroles pour eux intolérables; car il donnait ainsi
un sens christique au drame de la Shoah, ce qui revenait à transformer ses victimes en
martyrs et partant à lui ôter toute dimension de malheur.
8 Dans un tout autre registre, George Catlin a fait en 1832 l’expérience du malentendu
inverse lorsqu’il a observé le o-kee-pa, le rituel de passage chez les Mandan.
Curieusement semblables au hook-swinging décrit par Gilles Tarabout pour le Kerala, les
supplices que ces Indiens de la Prairie infligeaient aux novices étaient recherchés,
méthodiques et interminables. Et pourtant11 :
During this painful operation, most of these young men, as they took their position
to be operated upon, observing me taking note, beckoned me to look them in the
face, and sat, without the change of a muscle, smiling at me whilst the knife was
passing through their flesh, the ripping sound of which, and the trickling of blood
over their clay-covered bodies and limbs, filled my eyes with irresistible tears.
9 Il y a plus que du courage, plus que de la bravade dans le sourire de ces adolescents.
Leur courage, ils savent bien que leur silence le prouve amplement, mais cet étranger
qui les observe, il ne le sait peut-être pas; avec lui, il faut donc être plus explicite. Car
c’est à Catlin qu’ils sourient et non à leurs tortionnaires, d’un sourire qui veut dire un
peu : ne va pas croire que nous sommes malheureux, nous que tu vois souffrir. Les
croyait-il malheureux? J’imagine que oui. D’ailleurs, il leur aurait suffi d’une chose pour
éprouver le malheur qu’il leur prête : se dire qu’eux aussi après tout auraient pu naître
comme lui dans un monde où ces supplices sont inconnus. Les Mandan d’alors
n’auraient pu concevoir de telles pensées, mais plus tard, si l’o-kee-pa n’avait pas été
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
8
interdit en 189012, peut-être serait-il arrivé parfois qu’elles effleurent l’esprit des jeunes
gens qu’ils suppliciaient. Ceux-là, n’en doutons pas, auraient été malheureux. C’est à cet
avènement du malheur qu’on a assisté lorsque des affaires d’excision sont venues
devant les tribunaux il y a quelques années. Quelques ethnologues se sont alarmés
qu’on pénalise ainsi des usages qui avaient à leurs yeux la banalité d’un objet d’étude 13.
Ils avaient contre eux des femmes qui militaient pour éviter à leurs filles ce qu’elles-
mêmes avaient enduré. Ces souffrances, elles l’avaient appris depuis pour leur malheur,
n’appartenaient pas à l’ordre inaltérable des choses. Elles savaient ce que les Mandan
de Catlin avaient pour quelque temps encore le bonheur d’ignorer.
10 Les jeunes Indiens qui sourient dans le livre de Catlin me paraissent l’image inversée
des pleurs qu’un autre livre perpétue depuis deux millénaires. Rappelons-nous. Nous
sommes au huitième chant de l’Odyssée, dans la haute salle du palais d’Alcinoos, où,
tandis qu’on banquette, Demodocos célèbre sur sa lyre la gloire impérissable des
Achéens. Un hôte est là, dont personne ne connaît le nom, et qui en entendant le vieil
aveugle ne peut retenir ses larmes. C’est la première fois depuis longtemps qu’Ulysse –
car c’est lui – goûte le bienfait d’un vrai repas, pris en commun à la table des hommes.
Et qu’apprend-il? Que sa gloire touche le ciel et résonne partout parmi les hommes
mangeurs de pain. Alors il se détourne et il pleure. Car il sait ce que ni l’aède ni
Alcinoos ne savent encore, et qu’il va bientôt leur apprendre. Ce n’est pas au souvenir
de ses peines sous les murs d’Ilion qu’il pleure. Elles sont le lot inévitable des héros, le
prix de leur gloire, comme Sarpedon le rappelait à Glaucos lorsqu’il le pressait de
marcher avec lui contre les Achéens14. Mais lui Ulysse, quelle gloire tire-t-il de ses dix
années d’errance sur la mer infertile15? Il n’est plus aujourd’hui qu’un malheureux
privé par les dieux du retour doux comme le miel. Il y a d’autres larmes dans l’épopée
homérique, et ce sont toutes des larmes de malheur – qu’elles soient versées par
Briséis, Andromaque, ou même Patrocle et Achille. Les jeunes Mandan sourient dans
leurs supplices; le glorieux Ulysse pleure dans son malheur. Les souffrances qui
donnent le renom, il ne les a pas endurées plus que les autres Achéens; mais ces dix
années d’un malheur inutile et sans gloire, lui seul les a connues. Il est à la fois divin et
souffrant, glorieux et misérable – comme le rappelle la locution polutlas dios Odusseus,
« le divin Ulysse qui a beaucoup enduré », dont il est systématiquement désigné quand
son nom apparaît au nominatif après la césure trochaïque 16.
11 La même sorte d’ambivalence, apparemment inaperçue de ceux qui s’empressent
aujourd’hui d’annexer la souffrance juive17, se laisse lire sur la figure de Jésus. Tout
appliqués eussent-ils été à faire de ses souffrances le paradigme de l’épreuve glorifiante
(« Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire 18? »),
les Évangélistes se sont quelquefois oubliés à leur donner la tonalité du malheur. Dans
les Synoptiques, il connaît à Gethsémani l’angoisse, l’effroi et la tristesse à en mourir,
au point de répandre, pire que des larmes, une sueur devenant comme du sang 19. Les
paroles que les rédacteurs mettent alors dans sa bouche (« Père, si tu le veux, éloigne
de moi cette coupe… ») et dont Jean qui pourtant l’a presque divinisé 20 se souvient
encore21, mettent dans l’embarras les fidèles ignorant qu’elles s’inspirent tout
simplement de la prière juive conseillée aux agonisants 22. Pour ne rien dire du Eli, Eli,
lama sabachthani que Marc et Matthieu lui font prononcer à l’heure ultime. Les
rédacteurs veillaient là encore à inscrire la scène dans le cadre de la piété juive
traditionnelle23 puisqu’il s’agit du début du Psaume 22, mais le lecteur non averti est
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
9
tenté d’y voir un signe du désespoir24. Les Gitans de Jerez pensent de même, et Simone
Weil aussi sans doute. Malentendu…
12 Il n’est pas question de prolonger plus avant cette digression, mais elle aura au moins
permis de pointer des malentendus dont nous avions nous-mêmes à nous garder.
Étions-nous sûrs, en effet, que notre grille d’interprétation n’était pas tout simplement
une réminiscence de la théodicée chrétienne de la souffrance? Ce qui aurait signifié que
c’est seulement parce que nous l’avions tiré de notre héritage culturel que ce schème
d’analyse nous paraissait si naturel et si efficace. Nous devions d’autant plus nous poser
la question que, dans trois des situations examinées (Régis Dericquebourg, Christine
Henry, Caterina Pasqualino), les acteurs eux-mêmes interprètent leurs souffrances en
se référant à la tradition chrétienne. C’est pourquoi il aura été important d’isoler cette
modalité spécifique de la souffrance que nous appelons ici le malheur : le malheur est la
souffrance qui ne témoigne de rien. Les malentendus que je viens d’évoquer reviennent
tous à oublier, dans un sens ou dans l’autre, la spécificité du malheur. Or, les
souffrances dont il est question ici ne prennent leur valeur de témoignage que dans le
champ clos du dispositif relationnel et axiologique à l’intérieur duquel tous les acteurs
consentent à se situer. Qu’une faille apparaisse dans ce consensus, comme lorsqu’une
société pratiquant les mutilations rituelles devient perméable à l’individualisme
éthique25, et elles deviennent d’irrémédiables malheurs.
13 Le cas étudié par Gilles Tarabout fait bien apparaître combien ce dispositif relationnel
est primordial. Il nous est impossible de savoir si le dévot qui meurtrit, transperce,
déchire sa chair, souffre ou non. Tout ce que nous savons est que le public pense qu’il
ne souffre pas, et seule cette opinion doit nous importer. Ce cas pourrait sembler
aberrant par rapport aux autres cas exposés ici, mais il faut noter, comme Gilles
Tarabout y insiste, que ce dévot est dans une situation où tout autre que lui souffrirait –
au point d’ailleurs que son immunité à la souffrance est explicitement présentée
comme un miracle. La souffrance est donc bien présente, au moins par prétérition.
D’ailleurs, les jeunes Mandan qui subissent à peu près les mêmes tortures souffrent, et
parfois jusqu’à la mort; c’est que, si la manipulation des corps est la même qu’au Kerala,
elle s’inscrit dans un dispositif relationnel qui change du tout au tout. Sur ce plan, le
dévot du Kerala se rapprocherait plutôt du champion sénoufo tout en s’en distinguant.
L’un et l’autre sont indifférents à la douleur, le premier parce qu’il s’est sanctifié par de
longues macérations préalables, le second parce que ses tourments moraux sont pires
encore que ses blessures. Il en est de même du prophète Oshoffa dont parle Christine
Henry. Certes, il se considère comme dispensé des pratiques ascétiques si en faveur
chez ses homologues de la région, mais on raconte tout de même qu’il a reçu l’Esprit
Saint au fond d’une forêt dont il ne sortit qu’après trois mois d’errance et alors que
certains déjà le croyaient mort. Si sa relation de l’épisode ne fait aucune place à la
souffrance, il semble bien qu’aux yeux de ses disciples seule la faveur du ciel lui a
épargné les douloureuses angoisses qu’une telle situation aurait normalement dû lui
faire éprouver.
14 Le contexte relationnel est tout aussi important pour appréhender le cas des
différentes poésies élégiaques examinées aussi bien dans ce volume que dans le
séminaire préalable. Le public attribue aux poètes une souffrance dont on ne peut
savoir si elle est réelle ou non, mais il est par ailleurs sensible au fait qu’il leur a fallu la
surmonter pour être à même de la chanter : nul ne croit qu’il suffit de souffrir pour
devenir poète. Les Indiens du Kerala admirent leurs dévots parce qu’ils ne souffrent
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
10
pas, les Sénoufo admirent leurs champions parce qu’ils « ne considèrent pas » leur
douleur, les Chrétiens Célestes vénèrent Oshoffa parce que le ciel lui a épargné la
souffrance, les Bédouins admirent des hommes capables de surmonter leur souffrance
et d’en faire des chants qui les émeuvent. On pourrait ajouter que les Témoins de
Jéhovah se jugent dignes de considération parce qu’ils ne se sont pas reniés malgré
leurs souffrances. Dans tous ces cas, c’est moins la souffrance que son dépassement qui
est signe d’excellence. Régis Dericquebourg donne une place centrale à la notion qui
apparaît ici, et que les psychologues appellent la résilience : la résilience est la capacité
à surmonter les épreuves de la vie. Sa contribution comporte en annexe le résultat
d’enquêtes qu’il a menées auprès d’échantillons d’étudiants, et qui font apparaître que
s’ils répugnent à tenir la souffrance pour un critère d’excellence – ou de compétence –,
ils ne refusent pas de voir un tel critère dans la résilience. Il y aurait donc sur ce point
un malentendu entre les Témoins de Jéhovah et le public qu’ils voudraient convaincre.
Selon eux, les souffrances qu’ils ont endurées ont donné à leur religion une estampille
d’authenticité comparable à celle que le sang des martyrs a donnée au christianisme.
Selon les étudiants interrogés par Régis Dericquebourg, c’est parce que les Témoins de
Jéhovah étaient authentiquement religieux qu’ils ont été capables de surmonter leurs
souffrances; autrement dit, elles ne leur ont rien apporté qu’ils n’aient pas déjà.
15 Il n’est pas inutile au terme de ce parcours de revenir aux rituels de passage où nous
avions puisé notre inspiration première. Ce retour s’impose d’autant plus que Pierre
Clastres, lorsqu’il commentait les rituels mandan décrits par Catlin, y voyait à l’œuvre
un schéma fort différent de celui dont nous avons ici testé la prégnance. J’ai rappelé
plus haut combien Catlin avait été impressionné par le stoïcisme des jeunes novices, et
les témoins de toutes les souffrances dont parlent les contributions du présent volume
ont le même genre de réaction. Pour Catlin, le courage des jeunes Mandan est la
marque de leur excellence, en l’espèce de leur force morale. Mais Clastres refuse de s’en
tenir là. Sans doute, admet-il, le silence que les novices opposent à la souffrance est-il
l’expression du courage que l’initiation doit mettre à l’épreuve; mais qu’en est-il des «
traces que laisse sur le corps l’opération du couteau ou de la pierre, les cicatrices des
blessures reçues »26? C’est, nous dit-il, qu’il faut que les initiés se souviennent de leurs
souffrances, que les marques imprimées sur leur corps les leur rappellent, car ce qu’ils
ont appris là est une loi qu’ils ne doivent pas oublier. « La loi qu’ils apprennent à
connaître dans la douleur, c’est la loi de la société primitive qui dit à chacun : Tu ne vaux
pas moins qu’un autre, tu ne vaux pas plus qu’un autre. […] La loi primitive, cruellement
enseignée, est une interdiction d’inégalité dont chacun se souviendra » 27. Clastres a
assurément raison de relever que ces rituels doivent laisser un témoignage indélébile
de ce qui a été enduré ce jour-là. Dans une étude beaucoup plus documentée, Anni
Peller ne fait rien d’autre28. Mais elle au moins ne se croit pas obligée d’invoquer une
société « primitive » et idéalement égalitaire qui n’a jamais existé ailleurs que dans nos
nostalgies. On veut bien admettre que les initiés mandan, compagnons d’une même
infortune, se considèrent désormais comme des semblables. Pour autant, il faut avoir lu
le texte de Catlin avec beaucoup de désinvolture pour affirmer qu’ils sont devenus des
égaux. Les chefs et les dignitaires sont attentifs à distinguer les plus endurants et les
plus braves d’entre eux, ceux qu’on pourra en temps de guerre placer à la tête d’un
groupe de guerriers ou à un poste exposé29; et des guerriers déjà initiés demandent à
subir à nouveau ces terribles ordalies, pour certains plusieurs fois au cours de leur vie,
ce qui accroît d’autant leur prestige30. De plus, et là je ne parle pas seulement des
Mandan, les marques que les initiés portent sur le corps en ont fait des êtres désormais
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
11
différents de ceux qui n’en porteront jamais. Ceux-là font précisément partie des
témoins auxquels les contributions de ce volume se sont intéressées. Sans témoins dont
certains au moins ne sont pas appelés à souffrir, les souffrances de l’initié ne signifient
rien. Ce qu’on écrit sur son corps n’est lisible que parce que d’autres corps restent
vierges de toute écriture31. Pierre Bourdieu n’avait pas tort quand il affirmait que l’effet
majeur des rites dits de passage n’est pas de faire « passer » une ligne aux nouveaux
initiés mais de consacrer la différence entre ceux que le rituel concerne et ceux dont le
destin est de lui rester étrangers (les hommes et les femmes dans les sociétés dont il
parle, mais la différence peut se situer ailleurs dans d’autres sociétés) 32.
16 Il convient également de situer notre réflexion par rapport aux travaux de Luc
Boltanski et Laurent Thévenot33, qui nous ont aidés à la préciser. Ce qu’ils appellent
« grandeur » est proche de ce que j’appelle ici « excellence », tandis que leur
« compétence » est la capacité que manifestent des acteurs engagés dans des querelles
lorsqu’ils argumentent leurs prétentions. Toutes les épreuves douloureuses dont nous
parlons ici sont le prix à payer pour l’acquisition d’une grandeur, à moins qu’elles ne
manifestent une grandeur déjà acquise. Là cependant s’arrêtent les analogies car la
grandeur revendiquée par ces acteurs souffrants est, du moins dans la plupart des cas,
d’un autre type que celle à laquelle pensent Boltanski et Thévenot. Elle réside moins
dans des savoir-faire où ils excelleraient que dans une qualité d’être qu’ils prétendent
avoir réalisée. Il faudrait bien sûr nuancer selon les cas. Les poètes bédouins maîtrisent
un savoir-faire et l’affirment hautement, mais ils représentent un cas limite; les
chanteurs de flamenco sont déjà différents, qui disent tenir leur talent de leurs
malheurs davantage que de techniques apprises (ce en quoi ils se distinguent des
chanteurs payos); il en est de même des thérapeutes de style Nouvel Âge dont nous
parle Anne-Cécile Bégot, lesquels savent très bien que les techniques qu’ils disent
maîtriser ne sont pas de celles qui s’acquièrent laborieusement à l’Université; les tegban
sénoufo utilisent leurs compétences d’une manière techniquement absurde lorsqu’ils
s’affrontent : à trop remuer la terre comme ils le font, ils finissent par rendre les
champs sur lesquels ils concourent à peu près impropres à la culture; quant aux dévots
du Kerala, aux prophètes béninois ou aux Témoins de Jéhovah – sans parler des
Musulmans qui gémissent dans les flammes de l’Enfer –, ils ne prétendent pas maîtriser
des savoir-faire. À des degrés certes variables, tous ces acteurs revendiquent plutôt une
dignité qu’une compétence au sens courant du terme, ou du moins font valoir que leur
compétence tient à une dignité particulière.
17 En la formulant dans des termes qui lui sont propres, Régis Dericquebourg analyse
longuement la distinction entre dignité et compétence qu’on voit apparaître ici. Elle
n’est, au demeurant, pas nouvelle. Pascal Boyer34 a opposé l’« expertise », somme de
savoirs acquis par l’apprentissage, et l’aptitude à tenir une parole de vérité, dont seul
est crédité celui qui peut exciper d’un certain parcours biographique. Un peu de la
même manière, Giorgio Agamben35 oppose l’expérience traditionnelle, forgée dans
l’épreuve et source d’autorité, à ce que nous appelons aujourd’hui expérience, source
de savoir. Ces deux auteurs ont cependant laissé un point en suspens : le processus
d’interaction au terme duquel les témoins acceptent ou non d’imputer à l’acteur qu’ils
ont sous les yeux un parcours biographique en lequel ils verront un critère
d’excellence. Le premier s’est simplement intéressé à l’appareillage cognitif dont ils
doivent disposer pour construire leurs inférences et s’est par méthode désintéressé des
jeux d’interaction dans lesquels seuls cet appareillage trouve à s’employer; le second
s’est contenté d’une fresque historique brillante mais cursive. Or une réputation ne se
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
12
construit que peu à peu, dans tout un jeu d’imputations et de supputations. Lorsque
l’épreuve douloureuse est mise en scène, cette performance est en elle-même un
processus. On le voit bien pour la séance de flamenco, dont le déroulement fait parfois
surgir le duende, ce moment de grâce dont il ne dépend pas de la volonté du chanteur ni
des auditeurs qu’il advienne ou non. Il est difficile d’appréhender ce qui le fait advenir,
mais on est sûr en tout cas qu’il naît d’une certaine interaction entre le premier et les
seconds36. Une carrière, succession de performances, est à son tour un processus au
cours duquel se fait ou se défait une réputation suffisant dans certains cas à garantir
effectivement l’excellence qui la fonde37. Pour ce qui est du poète bédouin, sa carrière
est inséparable de la diffusion de ses poésies. Portées au loin par les rhapsodes, elles
s’éloignent peu à peu de lui jusqu’à parvenir à des auditeurs qui ne l’ont jamais vu, et
qui imagineront sa vie d’après ses poèmes, puisque c’est tout ce qu’ils connaîtront de
lui. De sorte que les biographies de poètes qui circulent, et qui sont parfois mises par
écrit, se ressemblent toutes plus ou moins puisqu’elles se conforment aux canons selon
lesquels ils ont chanté leurs tourments38. Les Gitans ont eux aussi tendance à considérer
que la vie d’un grand chanteur se conforme à un certain patron : il est un homme dont
les malheurs passés ont fait un grand artiste et qui mourra d’avoir trop chanté. Le
champion sénoufo a pareillement un parcours typique : sa souffrance morale en fait un
champion, et sa carrière de champion l’expose au malheur. Quant aux prophètes dont
parle Christine Henry, bien plus que leur doctrine, c’est leur vie exemplaire et
singulière qui les désigne comme prophètes. Tous ces hommes tiennent leur réputation
d’excellence d’un parcours biographique allégué, mais ce qu’on dit de ce parcours se
réduit à ce qu’en laissent apparaître les épreuves où ils manifestent leur excellence. Ce
court-circuit est remarquable et justifierait un prolongement des recherches qui sont
exposées ici.
BIBLIOGRAPHIE
Agamben, G.
2000 [1978] Enfance et histoire, Paris, Payot.
Benedict, R.
1949 [1935] Patterns of Culture, Londres, Routledge & Kegan.
Bloch, M.
1986 From blessing to violence. History and ideology in the circumcision ritual of the Merina of
Madagascar, Cambridge, Cambridge University Press.
Boltanski, L.
1990 L’amour et la justice comme compétence. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, Éditions
Métaillé.
1993 La souffrance à distance, Paris, Éditions Métaillé.
Boltanski, L. & L. Thévenot
1991 [1989] De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Éditions Métaillé.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
13
Bourdieu, P.
1982 « Les rites d’institution », Actes de la Recherche en Sciences sociales 43, pp. 58-63.
Boyer, P.
1992 Tradition as truth and communication, Cambridge, Cambridge University Press.
Catlin, G.
1967 [1867] O-kee-pa. A religious ceremony and other customs of the Mandan, New-Haven/ Londres,
Yale University Press.
1992 [1844] Les Indiens d’Amérique du Nord. Introduction et textes rassemblés par Peter
Matthiessen, Paris, Albin Michel.
Clastres, P.
1974 La société contre l’État, Paris, Éditions de Minuit.
Demeuldre, M. (dir.)
2004 Sentiments doux-amers dans les musiques du monde, Paris, L’Harmattan.
Drewers, J. C.
1967 « Introduction », in G. Catlin, O-kee-pa. A religious ceremony and other customs of the Mandan,
New-Haven/ Londres, Yale University Press, pp. 1-33.
Droz, Y.
2000 « Circoncision féminine et masculine en pays kikuyu », Cahiers d’études africaines 158
[http://etudesafricaines.revues.org/document172.html].
Flusser, D.
2005 [1967] Jésus, Paris/Tel-Aviv, Éditions de l’Éclat.
Fortier, C.
2004 « “Ô langoureuses douleurs de l’amour”. Poétique du désir en Mauritanie », in M.
Demeuldre (dir.), Sentiments doux-amers dans les musiques du monde, Paris, L’Harmattan, pp. 15-25.
Friedriksen, P.
1992 De Jésus aux Christs, Paris, Cerf.
Gellner, E.
1969 Saints of the Atlas, Londres, Weidenfield & Nicholson.
Guignebert, Ch.
1969 [1933] Jésus, Paris, Albin Michel.
Hartog, F.
1996 Mémoire d’Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne, Paris, Gallimard.
Henry, C.
1993 Les îles où dansent les enfants défunts, Paris, Éditions du CNRS/Éditions de la MSH.
Houseman, M.
2001 « Is this play? Hazing in French preparatory schools » Focaal. European Journal of
Anthropology 37, pp. 39-47.
Jamous, R.
1977 Honneur et baraka, Paris, Éditions de la MSH/ Cambridge, Cambridge University Press.
Lambert, J.
1997 La médecine de l’âme. Le chant de Sanaa dans la société yéménite, Nanterre, Société d’ethnoogie.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
14
Léon-Dufour, X.
1979 Face à la mort. Jésus et Paul, Paris, Seuil.
Maritain, J.
1965 [1944] « La Passion d’Israël », in Le mystère d’Israël et autres essais, Paris, Desclée de Brouwer.
Parry, A.
1989 [1973] « The Language of Achilles », in The Language of Achilles and other Papers, Oxford,
Clarendon Press, pp. 1-7.
Parry, M.
1928 L’épithète traditionnelle dans Homère, Paris, Les Belles Lettres.
Pasqualino, C.
1998 Dire le chant. Les Gitans flamencos d’Andalousie, Paris, Éditions du CNRS/Éditions de la MSH.
Peller, A.
2003 « Non Pain No Gain. Zur Verbesserung sozialer Chancen das Ertragen von Schmerz », Africa
Spektrum 38 (2), pp. 197-214.
Renan, E.
1923 [1863] Vie de Jésus, Paris, Calmann-Lévy.
Turner
1972 [1968] Les Tambours d’affliction, Paris, Gallimard.
Weil, S.
1999 [1942], « L’amour de Dieu et le Malheur », in Œuvres, Paris, Gallimard, pp. 693-715.
Wood, R.
1973 [1769], An Essay on the Original Genius and Writings of Homer with a Comparative View of the
Ancient and Present State of the Troade, Washington, McGrath Publishing Company.
NOTES
1. Henry, 1993 : 117.
2. Benedict, 1949 : 58.
3. Signalons que, là où ce texte programmatique parlait de « compétence », terme que certains
contributeurs ont conservé à bon droit, j’ai préféré dans cette introduction parler
d’« excellence », terme au sens plus englobant. Ceci pour la simple raison que je fais plus loin
référence à des travaux de Luc Boltanski, où « compétence » a un tout autre sens. Sur les
acceptions du mot « compétence », voir dans ce volume la discussion très fouillée proposée par
Régis Dericquebourg.
4. Lambert, 1997.
5. Fortier, 2004. Admirablement introduit par son éditeur Michel Demeuldre, l’ouvrage dans
lequel cet article a paru (Demeuldre, 2004) parcourt un large éventail de traditions poétiques
comparables à celles qui sont évoquées ici.
6. Pasqualino, 1998 : 199 & 240.
7. On peut retrouver la matière de son exposé dans sa monographie (Pasqualino, 1998). Lorsqu’ils
ne proviennent pas de sa contribution dans le présent volume, les passages cités ici sont
empruntés soit à cette monographie, soit à son exposé oral.
8. Weil, 1999. Les passages cités proviennent des pages 693 et 694.
9. Pasqualino, 1998 : 160 & 198.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
15
10. La formule, on le sait, est inspirée de Jacques Maritain, qui disait en 1944 dans un message
radiophonique : « Ce que le monde nous donne à contempler dans les grandes persécutions
d’aujourd’hui, c’est Israël engagé lui-même dans la voie du Calvaire… » (Maritain, 1965 : 202).
11. Catlin, 1967 : 63. Catlin a publié plusieurs descriptions de l’okeepa, dont l’une est traduite dans
Catlin, 1992.
12. À cette date, les Mandan avaient été depuis longtemps décimés par la variole, et leur société
se survivait à elle-même (voir Drewers, 1967).
13. Voir l’appel à pétition que les collaborateurs de la Revue du Mauss (Mouvement Anti-Utilitaire des
Sciences Sociales) publièrent en 1989 dans le numéro 3 de leur revue (pp. 162163).
14. Iliade 12, 310-328; sur ces vers, parfaite expression d’une morale où l’acceptation de la
souffrance est le signe d’une supériorité aristocratique, voir Wood, 1973 : VII, A. Parry, 1989 : 3.
15. Voir Hartog, 1996 : 37 sqq.
16. Voir M. Parry, 1928.
17. La formule est d’Henri Tincq, dans « Auschwitz : la mémoire juive et la mémoire chrétienne »,
Le Monde du 29 janvier 2005.
18. Luc 24, 26.
19. Mt 26, 38; Mc 14, 33; Luc 22, 41-44.
20. Friedriksen, 1992.
21. Jean 12, 27.
22. Léon-Dufour, 1979 : 117.
23. Guignebert, 1969 : 506. Flusser 2005 : 157.
24. Même un Renan résiste mal à cette tentation (Renan, 1923 : 437).
25. On emprunte le terme à Y. Droz (2000), qui propose à propos des affaires de mutilations
rituelles une confrontation intéressante entre ce qu’il appelle respectivement la perspective
anthropologique et l’individualisme éthique.
26. Clastres, 1974 : 157.
27. Clastres, 1974 : 158-159.
28. Peller, 2003 : 204205.
29. Catlin, 1967 : 66.
30. Catlin, 1967 : 65-66.
31. La souffrance occasionnée par le marquage n’a d’ailleurs pas partout l’importance que lui
donnent les Mandan (voir là encore Peller, 2003). L’enfant qu’on circoncit sept jours après sa
naissance ne se souviendra pas de sa souffrance. Et même lorsque la circoncision est pratiquée à
un âge plus tardif, la souffrance n’en est pas toujours une composante nécessaire. Durant les
années où je demeurais parmi eux, les Touaregs d’Agadez commençaient à faire circoncire leurs
garçons à l’hôpital, où l’opération était pratiquée sous anesthésie.
32. Bourdieu, 1982. M. Bloch rapporte que lorsqu’un garçon mérina va être circoncis, les hommes
qui font cercle autour de lui s’écrient : « Un homme, c’est un homme! ». Les femmes, qu’on
maintient de force à l’écart, se jettent alors de la poussière sur elles-mêmes, en signe d’auto-
humiliation (Bloch, 1986, ch. 3). Dans un tout autre registre, voir Houseman, 2001.
33. On veut parler des trois ouvrages suivants : Boltanski et Thévenot, 1991; Boltanski, 1990;
quant à Boltanski (1993), les souffrances dont il y est question relèvent de la catégorie du
malheur; elles ne sont pas comme celles dont il est ici question éprouvées dans le cadre d’un
dispositif relationnel sur lequel tous s’accordent. Ce livre nous a cependant été utile pour repérer
par contraste certains traits caractéristiques des situations que nous examinions.
34. Boyer, 1992.
35. Agamben, 2000.
36. On pourrait invoquer le cas des séances de divination, au cours desquelles une certaine image
de la réalité s’impose peu à peu, et qui elles aussi font souvent intervenir des imputations
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
16
biographiques. Songeons par exemple à la divination ndembu observée par V. Turner (1972, ch.
3).
37. Pensons par exemple, bien qu’il ne soit pas abordé ici, au cas des religieux marocains étudiés
par Ernest Gellner (1969) et Raymond Jamous (1977), dont l’aptitude à apaiser les discordes est
inséparable de leur réputation de posséder cette aptitude : possède la baraka celui qui est réputé
la posséder.
38. Ce qui, soit dit en passant, distingue le cas de ces poètes de celui de notre poésie romantique :
eux n’arguent pas de la singularité de leur expérience pour faire valoir la poésie qu’ils disent en
avoir tirée, puisque, au bout du compte, cette expérience est dépourvue d’attribut singulier.
AUTEUR
DOMINIQUE CASAJUS
Directeur de recherche au CNRS. Centre d’études des mondes africains (CEMAf), CNRS/Université
de Paris 1/Université d’Aix-Marseille /EPHE
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
17
« L’homme qui souffre et l’esprit qui
crée »
“The man who suffers and the mind which creates”
Dominique Casajus
1 L’amour est, paraît-il, une invention du XIIe siècle. C’est du moins, comme chacun s’en
souvient, ce que Denis de Rougemont affirmait dans L’amour et l’Occident, en un temps
où l’Occident s’abîmait dans la haine. L’affirmation est excessive, bien sûr, comme
toutes celles qu’il risquait dans ce livre véhément et hâtif. Il n’en demeure pas moins
que l’amour est devenu dans l’Europe des troubadours « la grande affaire » de la poésie
et qu’il l’est resté depuis1. Nouvelle en Europe, cette association de l’amour et de la
poésie était depuis longtemps chose d’évidence pour les Arabes, et on n’a pas fini de
s’interroger sur ce que leur doivent nos poètes médiévaux. On pourrait également
évoquer le précédent plus lointain de la poésie érotique romaine, mais les troubadours
comme les Arabes s’en séparent sur un point : dans leurs compositions, l’amour est
avant tout une source de souffrance ; privé de l’objet de son désir, l’amant qu’ils
mettent en scène chante vers après vers sa solitude et sa souffrance. À ce titre, un
examen de ces deux traditions poétiques a sa place dans le présent volume. Avant de les
aborder, on considérera la poésie touarègue contemporaine, dont il y a tout lieu de
croire qu’elle a emprunté ses thèmes à l’ancienne poésie arabe. L’assemblage peut
paraître hétéroclite mais j’espère qu’il se justifiera à mesure que mon propos avancera.
Disons d’emblée que, outre les thèmes qu’ils partagent, les « poésies » ou les « chants »
(termes employés ici pour leur seule commodité et sans rien préjuger de la nature des
objets ainsi désignés) qui seront considérés présentent suffisamment de
caractéristiques communes pour justifier l’exercice comparatif. Il s’agit dans les trois
cas d’objets verbaux parfois écrits, parfois oraux, mais toujours destinés à une
récitation à voix haute, et pourvus de caractéristiques formelles qui les distinguent
sans ambiguïté des autres productions verbales des sociétés dont ils proviennent. De
plus, ils se donnent tous comme ayant un auteur qui s’y exprime à la première
personne, fait exceptionnel dans les sociétés auxquelles s’intéressent d’habitude les
ethnologues. Ainsi, pour prendre deux exemples bien connus, le barde fang ne prend
pas la responsabilité des paroles qu’il profère, laissant au contraire entendre à ses
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
18
auditeurs que des voix étrangères parlent à travers lui2; quant aux bardes serbo-croates
interrogés par Parry et Lord, ils prétendaient répéter sans en changer un mot des
textes légués par la tradition3. L’acteur souffrant sera ici un être fictif, puisqu’il n’existe
que dans un texte littéraire. Mais se posera à chaque fois le problème de sa relation
avec un autre acteur, réel celui-là : l’auteur présumé du poème. Tout autant que des
corpus eux-mêmes, je parlerai de cette interaction entre l’auteur et son public, entre
les revendications du premier et les attentes, les imputations ou les supputations du
second.
Une poésie de la solitude
2 Pour l’essentiel, la poésie touarègue nous est connue grâce à quatre ouvrages
représentant au total plusieurs dizaines de milliers de vers : un recueil de poésies
collectées en 1907 au Hoggar, et trois recueils contemporains, provenant de Touaregs
nigériens4. La plupart des pièces recueillies sont des élégies où un amant désaimé dit sa
déréliction. Sa situation douloureuse reçoit le nom d’esuf, terme qui désigne aussi bien
la situation et les sentiments du délaissé que les lieux désertés par les hommes. À ces
acceptions qu’il partage avec notre « solitude », le mot ajoute une connotation qui lui
est propre : celui dont les Touaregs disent qu’« il est dans l’esuf », ou que « l’esuf est en
lui » (iha esuf ou ih-é esuf), est accompagné dans sa solitude par le souvenir des moments
enfuis où elle ne l’habitait pas. L’esuf est la solitude mêlée au sentiment vif encore d’une
présence maintenant abolie. Fréquente dans les conversations comme dans les poésies,
une expression qu’on peut traduire par « il (ou elle) me manque » laisse bien percevoir
cette connotation : « son esuf est en moi » (ih-i esuf-nét). L’esuf de celui qui me manque
est une solitude pleine de sa présence.
3 Ce narrateur solitaire souffre des tourments dont on ne saurait dire s’ils sont causés par
l’ardeur de son amour ou l’aridité de la steppe déserte. Voici trois exemples tirés du
premier recueil5 :
Hier dans l’après-midi, Dieu le sait,
J’étais seul au pied de rochers surplombants ;
je m’évanouissais d’amour ; l’eau ne me désaltérait pas tant mon cœur brûlait.
Celle que j’ai quittée à l’heure du lever des troupeaux […],
c’est elle qui a allumé dans mon cœur un grand feu.
Son amour brûle comme la fièvre qui règne au temps de la maturité des premières
dattes,
il brûle comme le mal qui saisit celui à qui on a jeté un sort,
comme les élancements du foie, comme le brisement du tibia,
comme l’ophtalmie à laquelle on n’applique pas de remède,
comme la nouvelle de la mort d’une personne chérie…
Le confluent de la vallée d’I-n-ezzebâren en aval du col,
là où le pied des montagnes meurt auprès des dunes,
c’est là que j’étais la nuit passée, couché comme
un homme qui se meurt, à qui il ne reste qu’un souffle de vie.
Mon mal n’est pas une maladie, c’est l’amour d’une femme,
plus brûlant que de la terre sur laquelle est un brasier, plus brûlant
que les balles des Turcs reçues en plein front…
En ce jour que j’ai quitté Tella,
elle tenait une réunion galante pour les personnes présentes ; je suis parti
l’âme brûlée de douleur, le cœur embrasé,
semblable à un tison enflammé
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
19
sur lequel souffle le vent et qui brûle de tous côtés.
Je prie Dieu de me faire voir celle que j’aime
pour que je ne meure pas ici de la douleur de son absence…
Et deux autres dus au poète nigérien Kurman agg-Elselisu (1912-1989) 6 :
Mon cousin, j’ai dormi à l’entrée du vallon,
seul, près de deux buissons, comme un mort oublié ;
sans autre compagnie que d’amers souvenirs,
je répandais les pleurs dont s’inondaient mes yeux.
Dans mon âme brûlante, un brasier flamboyait
et je cherchais en vain l’eau dont me rafraîchir…
Les pleurs baignaient ma joue, mon âme était ardente ;
luttant contre le mal qui me torturait, je recherchais en vain un sommeil fuyant ;
démon, abreuve-moi, asperge mes aisselles, vois quel est mon tourment ;
je m’en vais au hasard et, quand revient le soir, peu m’importe ma faim ;
j’ai su dompter en moi et ma soif et mes jeûnes.
Je pense à toi, mignonne, et à ce cou gracile
que jalouse chez toi l’élégante gazelle
à la robe sombre et l’échine claire.
L’amour que j’ai pour toi brûle comme la soif…
4 Illustrations particulières du thème général de la solitude, deux motifs récurrents ont
certainement été empruntés à l’ancienne poésie arabe. Le premier met en scène un
narrateur méditant et pleurant sur les lieux où une femme aimée campa autrefois ; le
second le montre visité par son image, dont la fantomatique apparition lui rend plus
douloureuse encore la souffrance de la savoir loin de lui. Les deux motifs peuvent se
superposer, en ce qui devient comme une allégorie plénière de l’esuf : le narrateur erre
en un lieu infréquenté où l’absente lui devient trompeusement présente. L’exemple qui
suit vient d’un poème composé en 18997 :
J’ai passé la nuit dernière dans la tristesse de son absence
en mon âme je souhaitais d’aller à elle.
Comme je traversais la place abandonnée de son ancien campement,
la contemplant, voyant le petit amas de sable qui lui servait d’oreiller s’élever
encore sur le sol,
elle se présenta en image à mon esprit avec son sourire,
telle qu’elle est maintenant, au large et en bon air dans son pays.
Son éclat la faisait pareille à la lune, ou bien à sa compagne,
l’étoile que vous voyez au ciel…
5 Des lamentations si outrées n’appartiennent qu’à l’univers poétique, car les Touaregs
sont bien plus discrets dans l’expression de leurs peines. Mais cette outrance même fait
aux yeux du public la beauté des poèmes. Là où, dans la réalité, un homme éprouvé s’en
serait tenu à quelques allusions glissées dans l’oreille d’un compagnon d’âge, les poètes
arrachent au narrateur de leurs élégies des lamentations où ils mobilisent toutes les
ressources de la langue. Curieusement, à en juger par leurs exclamations apitoyées, les
auditeurs semblent parfois penser que c’est l’auteur lui-même qui s’exprime par la voix
du narrateur, comme si la beauté de ce qu’ils entendent, égarant leur jugement, leur
faisait oublier un instant combien ces lamentations sont irréalistes.
6 Il est probable qu’ils ne s’oublieraient pas ainsi s’ils étaient en présence du poète. Mais
un grand poète, de ceux justement dont l’œuvre suscite la compassion des auditeurs,
récite rarement ses compositions en public. Il se fait assister de rhapsodes qui se
chargent de les mémoriser et de les diffuser. Ainsi transmises, elles finissent par être
entendues fort loin de son lieu de résidence et parfois après sa mort. Les cercles dans
lesquels on les entend sont si larges que seuls quelques auditeurs en connaissent
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
20
l’auteur ; pour tous les autres, il n’est qu’un nom. Comment, alors, ne pas lui attribuer
une souffrance parcourant des vers qui sont tout, hormis son nom, ce qu’on connaît de
lui ? Lorsque, au cours d’une fête familiale, une soliste chante en battant le tambour
qu’elle se meurt d’amour pour l’un des danseurs présents, nul n’a l’idée de la croire.
Tandis que la compassion des auditeurs d’un poème se nourrit de l’absence même de
l’auteur.
7 Ceux-ci n’ont tout de même pas l’ingénuité de croire que la poésie naît spontanément
de la souffrance. En pays Touareg, ceux qui sombrent dans le mutisme ou la folie pour
avoir trop souffert de l’esuf ne sont pas rares. Tout en compatissant aux souffrances
qu’ils attribuent au poète, les auditeurs s’émerveillent qu’il n’y ait pas succombé
comme ces malheureux, et leur compassion ne serait qu’un apitoiement condescendant
si ne s’y mêlait pas de l’admiration pour la distance qu’il a su prendre avec elles.
D’ailleurs, le narrateur des poèmes lui-même est à la fois pitoyable et admirable
puisqu’il assume très souvent deux rôles ; en même temps qu’il se lamente, il dit
composer un poème dont on devine que c’est celui-là même qui le met en scène. Ainsi
dans ces deux fragments du poète déjà cité Kurman agg-Elselisu 8 :
Tandis qu’ils dorment tous, je dis mon chant d’amour,
sans cesse me faisant cortège les pensées
murmurées par un démon qui m’accable,
bouche puante, de conseils mauvais…
Sans autre compagnon que le Dieu tout-puissant,
je marche vers l’aval d’une étroite vallée
Près de Tin-Wezizel, laissant monter en moi
les mots de mon poème. Une flèche enfoncée
au-dessus de mon cœur m’a mis à l’agonie…
De même dans l’incipit de ces poèmes recueillis au nord du Niger :
Hier j’ai passé le jour au flanc de la montagne,
Le sentiment de la solitude (esuf) m’a saisi, mes pleurs se répandaient,
J’ai entonné mon chant, invoquant les filles de ma tribu 9…
La pensée tourmenteuse avec la solitude (esuf) depuis un mois sont mes compagnes,
sans cesse m’inspirant le rythme de mes chants10…
Elle m’a laissé dans une solitude immense (esuf), j’ai composé ce chant et je le
psalmodie11…
8 À la distance séparant la composition de l’exécution s’ajoute donc celle que le poète est
supposé avoir prise avec les souffrances qu’on lui attribue. Ces deux distances se
superposent et combinent leurs effets, comme on peut le voir en considérant le cas de
celui dont les Touaregs du nord du Niger se souviennent comme du plus grand de leurs
poètes : Ghabidin ag-Sidi Mokhammed (1850-1928). Les informateurs de Gh. Mohamed
et K. Prasse leur ont parlé de son amour pour la belle Hata, qu’il célébra dans plusieurs
poèmes, puis pleura dans ces vers12 :
Ah ! Que ma monture aille vers l’aval, que je visite le cimetière, cerné d’un mur,
où je contemplerai le tertre sous lequel elle repose bras étendus.
Ô Dieu, sois loué pour sa peau surpassant en beauté le lait qu’on dépose pour
recueillir la crème,
ce jour où elle était bleuie d’indigo, rappelant les vertes vallées du Paradis,
interdites à l’apostat.
Son cou était pareil à celui des biches élégantes paissant à Yen-Wäggar,
son œil limpide comme les sources de Tinaddamen, quand les agneaux ne les ont
pas encore troublées.
Et je sais aujourd’hui que ce monde m’est vide comme la place désertée d’un ancien
campement.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
21
9 Hata a-t-elle vraiment existé ? Ghabidin l’a-t-il pleurée ailleurs que dans ses vers ? Nous
n’en savons rien mais savons seulement que c’est là l’opinion de ceux qui aujourd’hui
les entendent. Et notre incertitude s’accroît si nous remarquons que ce fragment
reprend le motif classique de la déploration sur le campement abandonné. Qu’il l’ait
éprouvé ou non dans la réalité, Ghabidin a pris assez de distance avec son chagrin pour
le dire dans les mots reçus d’une tradition remontant jusqu’aux anciens Arabes. Son
innovation, car il y en a tout de même une, est purement littéraire : dans une admirable
amplification d’un thème poétique vieux de treize siècles au moins, le lieu désert sur
lequel gémit son narrateur s’est étendu aux dimensions du monde.
10 Et lui qui pour le chanter a mis son chagrin à distance, s’est de surcroît éloigné de ceux
qui écoutent aujourd’hui son chant. Loin de ses auditeurs, il l’avait toujours été comme
tous les poètes touaregs, mais son éloignement s’est accru aujourd’hui avec le temps.
Que reste-t-il du grand poète quatre-vingts ans après sa mort ? Hormis quelques
vieillards morts sans doute depuis, ceux qui récitaient encore de ses vers à l’époque où
je séjournais au Niger n’avaient jamais entendu sa voix. Et l’individu singulier qui porta
ce nom s’est effacé derrière le narrateur de ses poèmes. Tout ce qu’on sait aujourd’hui
de Ghabidin est qu’il se lamentait dans un monde aussi désert pour lui qu’un
campement abandonné. On pourrait en dire autant de tous les poètes touaregs. Leurs
auditeurs se font d’eux une image dépourvue de tout attribut singulier, calquée sur
celle du narrateur éploré que leurs poésies mettent toutes en scène. Guère plus fiables
en cela que les vidas des anciens troubadours, les consciencieuses « biographies »
publiées par Mohamed et Prasse ne racontent que l’invariable et monotone histoire
d’un homme peuplant sa solitude du souvenir d’une amante en allée.
La lamentation sur les ruines
11 Venons-en maintenant à la poésie arabe archaïque. On appelle ainsi un corpus de plus
de deux cent cinquante poésies colligées du Ie au IIIe de l’Hégire, et que la tradition tient
pour composées oralement dans le dernier siècle du paganisme ou aux premiers temps
de l’islam. L’authenticité n’en est pas certaine car les compilateurs sont soupçonnés
depuis longtemps d’avoir forgé autant que collecté13. Textes composés par des bédouins
illettrés des VIe et VIIe siècles ou pastiches dus aux savants de l’islam primitif, je doute
que nous puissions jamais trancher sur leur statut.
12 Genre le plus représenté dans ce corpus, l’ode (qaçida) se développe en trois
mouvements qu’un commentateur a joliment comparés aux trois mouvements de la
sonate14. Le prologue (nasîb) est presque toujours une variation sur le thème de la
séparation : le narrateur se lamente sur les « ruines » (atlal) désertées du campement de
l’aimée ; ou bien l’image de l’absente vient le visiter telle un fantôme ; ou bien encore, il
voit son palanquin s’éloigner peu à peu derrière l’horizon. Puis vient le rahil, récit d’un
cheminement dans un désert hostile où le narrateur ne rencontre que les traces rares
et lointaines d’une présence humaine. Enfin le fakhr, où le poète chante sa propre gloire
et les hauts faits de son clan. Comme nous l’avons vu, le thème du nasîb se retrouve sous
au moins deux de ses formes en pays touareg, où des recueils de poésie arabe archaïque
circulent depuis longtemps. On discerne également dans certains poèmes touaregs ce
qui pourrait être un souvenir du rahil ou du fakhr, mais comme les thèmes ne s’y
succèdent jamais de façon aussi rigide que pour la qaçida, l’influence arabe est ici plus
diffuse.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
22
13 Tout comme leurs homologues touaregs, il semble que les auteurs de ces vieux poèmes
les composaient dans la solitude et confiaient leur transmission à des rhapsodes,
connus dans la tradition arabe sous le nom de râwî. De plus, comme dans les poèmes
touaregs quoique moins fréquemment, le narrateur du nasîb se présente
indiscernablement comme amant désolé et comme poète. Ainsi, dans le nasîb d’une ode
attribuée à ‘Antara, l’un des grands noms de la poésie préislamique, la déploration sur
le campement abandonné est précédé d’un vers que J. Berque a traduit en suivant de
près le mot à mot de l’arabe15 :
Me laissent-ils, les poètes, un empiècement à rapporter ?
Reconnais-tu la demeure après l’avoir imaginée ?
14 Traduction un peu énigmatique, qu’il a glosée en ces termes16 : « Chaque poète, s’il
reprend les mêmes thèmes, les dispose selon un ordre personnel, excluant la simplesse.
[…] C’est là obéir aux règles d’un art fortement communautaire, tout en faisant valoir
un talent individuel. » La traduction libre de Jean-Jacques Schmidt s’accorde avec cette
glose et livrera peut-être mieux le sens de ce vers17 :
Les poètes ont-ils encore laissé quelque chose à dire ?
Et as-tu enfin reconnu l’endroit où séjournait l’aimée ?
15 L’auteur, qui s’inquiète dans le premier hémistiche de savoir s’il saura égaler ses
prédécesseurs, semble se distinguer du narrateur auquel il s’adresse dans le deuxième
hémistiche. Mais il y a tant de sollicitude, de complicité, dans la question qu’il lui pose,
qu’on le sent bien près de prendre à son compte la lamentation qu’il va lui faire
entonner dès le vers suivant.
16 Et de la même manière un poème attribué à Imru’ l-Qays, autre grand nom de la poésie
antéislamique, commence par ce vers18 :
Fais halte devant ces vestiges vieux d’une année,
Que nous pleurions comme pleurait Ibn Khidhâm !
17 Ibn Khidhâm est le nom du poète qui passe pour avoir été le maître d’Imru’ l-Qays. C’est
donc bien l’auteur qui parle dans ce vers, s’adressant là encore au narrateur, mais il
s’apprête à pleurer à ses côtés. S’ils ne se confondent pas, auteur et narrateur se
lamentent d’une même voix. L’infime décalage qu’on perçoit malgré tout entre l’un et
l’autre étant peut-être le signe qu’on savait bien, chez les anciens Arabes comme
aujourd’hui chez les Touaregs, que le poète resterait muet s’il ne mettait pas à distance
la souffrance où il laisse sombrer son narrateur.
18 De tout cela se dégage une figure assez comparable à ce que nous observons aujourd’hui
en pays touareg : un poète se cachant à peine derrière le narrateur à qui il confie ses
lamentations, et des rhapsodes qui pour lui les diffusent au loin. N’oublions pas
cependant que les textes parvenus jusqu’à nous ne sont pas ceux-là mêmes que les
bédouins de l’antéislam composaient dans les déserts arabes, mais un reflet tardif, fixé
par le calame des anthologues omayyades puis abbassides. Nous ne savons rien de bien
fiable sur la façon dont on percevait le poète à l’époque probable de leur composition ;
par contre, nous avons quelques informations sur la façon dont le percevaient ceux qui
les ont mis par écrit un ou deux siècles plus tard. En même temps que des recueils de
poèmes, les anthologues nous ont, en effet, laissé plusieurs « vies » de poètes, récits très
romanesques qui se sont très tôt répandus dans tout le monde musulman.
19 J’ai parlé ailleurs des romans d’Imru’ l-Qays et de ‘Antara, et m’attarderai ici sur un
autre récit, forgé entre le VIIe et le XI e siècle : le roman de Majnûn. Dès la fin du
premier siècle de l’Hégire (VIIe siècle), les anthologues commencèrent à citer des vers
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
23
attribués à un jeune poète de l’Arabie centrale auquel certains donnaient un nom et
une généalogie, mais qu’ils ne désignaient le plus souvent que comme le « Possédé des
génies » (Majnûn), le Fou. Son divan semble n’avoir été définitivement constitué que
vers le XIe siècle19. En même temps que ses vers, circulaient sur son compte des
rumeurs que Abû l-Faraj al-Içfahânî assembla au Xe siècle dans son Livre des chansons
(Kitâb al-aghâni), donnant au roman une trame sur laquelle d’autres auteurs broderaient
à leur tour jusqu’à nos jours20. L’histoire est bien connue : Majnûn aime sa cousine
Laylâ, qui l’aime et lui est promise. Mais il a l’imprudence de proclamer publiquement
cet amour, indiscrétion intolérable pour les bédouins de ce temps – comme d’ailleurs
pour ceux d’aujourd’hui. La famille de Laylâ interdit à Majnûn ses visites, et, dans
certaines versions du roman, la marie à un riche prétendant. Dès lors, Majnûn s’engage
jusqu’à la folie dans une longue errance où il ne cessera de chanter cet amour interdit
pour avoir été dit trop tôt.
20 Il faut avoir en tête, pour apprécier le sens de ce roman, qu’il a été élaboré à une
époque où la poésie archaïque était un modèle dont tous les poètes devaient s’inspirer.
Nul ne pouvait se prétendre poète s’il ne s’était nourri des poésies réputées archaïques
que les lettrés avaient mises par écrit depuis les débuts de l’islam. Ce bédouin
malheureux est censé être un contemporain de ses biographes, mais il ressemble moins
aux poètes qu’ils pouvaient rencontrer dans les grandes métropoles abbassides qu’à
l’image qu’ils se faisaient du poète archaïque. La chose apparaît dans son nom même : il
est « possédé des génies », comme l’étaient aux yeux de ses portraitistes les poètes de
l’antéislam21. Le roman ne fait au fond que montrer à quel point Majnûn mérite son
nom, et, partant, son titre de poète. Et cette qualité de poète, il l’affirme d’emblée
puisqu’il choisit dès le début du roman le dire de l’amour contre la réalité de l’amour,
les chants qui naissent ensuite de son errance et de sa démence n’étant que le fruit de
ce choix initial22. Selon certains anthologues, c’est même la célébrité des poèmes où il
chante son amour qui dissuade les parents de Laylâ de lui accorder leur fille 23. Selon
d’autres, il n’admet pour compagnie que le râwî qui vient recevoir ses poèmes pour
aller les diffuser24. On pourrait ajouter qu’il en est de l’élaboration du roman comme du
cheminement du héros : de même que le destin de Majnûn est le triste résultat de son
désir d’emblée affirmé d’être poète, de même le roman est le prolongement de vers qui
circulaient déjà lorsqu’on a commencé de l’écrire.
21 Plus précisément, on peut dire avec André Vadet que la figure de Majnûn emprunte les
traits que le poète assume dans le nasîb. Comme le poète gémissant devant le
campement abandonné de l’aimée, il ne cesse de revenir sur les lieux où a vécu Laylâ,
pleurant au souvenir des jours passés autrefois auprès d’elle. « Ce qui n’occupait dans le
nasîb qu’un moment de la vie du poète s’étend maintenant à toute son existence 25. »
Pour Ghabidin, le monde entier était devenu comme la place abandonnée d’un ancien
campement ; pour Majnûn, la vie est devenue une interminable lamentation sur un
campement déserté. Et comme chez le narrateur des poésies touarègues, la solitude
dont il gémit est aussi la source de son inspiration. Le montrent ces vers qui figuraient,
dit-on, dans sa poésie préférée, sa confidente26 :
On m’interdit sa vue ? On veut me faire un crime
d’aller où elle vit ? J’aurai toujours les rimes !
22 Un épisode du roman le montre même donnant aux rimes la préférence sur l’amour :
alors que Majnûn et Laylâ sont près de s’enlacer, elle le repousse et lui se détache d’elle
car ainsi le veut son destin de poète27. Ce renoncement rapproche Majnûn du narrateur
troubadouresque, comme nous le verrons. Il rapproche aussi son aventure d’une figure
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
24
de l’amour que les penseurs abbassides célébraient sous le nom d’amour odhrite à
l’époque où se forgea le roman. Dans le Livre des Fleurs (Kitâb al-Zahra) d’Ibn Da’ud, où
cette spéculation atteint sa forme la plus élaborée, l’amant idéal s’interdisait même de
dire son amour ; donnant à l’être aimé tout pouvoir sur lui, il se mettait ainsi en mesure
de vivre une forme terrestre de la soumission à la toute puissance de Dieu 28.
23 Pour en revenir à Majnûn, c’est tout l’univers poétique tel que les concevaient les
Arabes d’alors qui a imprégné peu à peu sa vie. Ainsi on le voit, à l’époque où il erre
ensauvagé dans le désert, étreindre une gazelle rencontrée sur sa route, « et pleure[r]
sur elle comme sur son impossible amour29 » : les gazelles sont devenues pour lui une
image de Laylâ, et bientôt il ira vivre parmi elles, gazelle au milieu des gazelles. Signe
de folie et de complet ensauvagement bien sûr, mais, comme le note A. Miquel, il n’est
pas indifférent que le signe choisi soit la gazelle et non le loup, le renard ou le lion : la
gazelle est aussi l’image de Laylâ, ce qui signifie que Majnûn s’identifie à sa Laylâ
perdue. De fait, il est censé avoir dit un jour : « Laylâ, c’est moi et je suis Laylâ 30. »
Disons plutôt qu’il s’identifie à Laylâ telle qu’il en parle dans ses poèmes : car c’est dans les
poèmes – touaregs aussi bien qu’arabes d’ailleurs – que les gazelles sont des femmes,
que le mot gazelle désigne l’aimée. C’est donc à son propre dire qu’il finit par
s’identifier. Le songe qui s’est épanché dans la vie du Fou est un songe poétique, fait de
l’étoffe dont sont faits les poèmes. Sa vie s’est figée dans le moment du nasîb, sa bien-
aimée s’est identifiée tout à la fois à lui-même et aux mots de son poème, comme si,
stade final d’une métamorphose universelle, il était entré dans son propre poème,
parole parmi les paroles. On raconte que, lorsqu’il mourut, les siens retrouvèrent sous
son corps un lambeau où étaient écrits ses derniers vers31. Lui qui avait serré contre lui
une gazelle qui était tout à la fois Laylâ, lui-même et un mot de poème, il est mort en
serrant contre lui les dernières paroles nées de sa folie.
24 On voit à quel point un ensemble de conventions et d’attentes littéraires a construit la
figure d’un poète mis à même de ne pouvoir composer que des textes qui y
répondissent. Et ce poète est un homme condamné à éprouver sa vie durant les
souffrances dont le narrateur de la qaçida gémit dans le nasîb. Cela explique à la fois la
faveur et l’embarras avec lesquels la légende a été reçue : le roman de Majnûn tient son
succès de ce que le nasîb est resté durant des siècles un modèle pour les poètes de
l’amour, mais les commentateurs n’ont pu contempler sans frémir ce destin trop
parfaitement conforme à leurs idéaux littéraires.
25 Notons de plus que, comme l’image que les Touaregs se font de leurs poètes, le roman
de Majnûn est né de l’éloignement. Les anthologues qui assemblaient son divan
n’auraient pas imaginé une telle histoire si d’aventure ils avaient connu l’identité et la
biographie réelles de l’auteur (ou des auteurs) des vers qui circulaient sous son nom. Et
ils savaient bien, quand ils forgeaient cette figure de poète dévoré par le désert, que la
poésie bédouine dont ils cultivaient l’idéal était désormais chose d’un passé aboli. La
propension du public à imputer au poète absent les souffrances dont gémit son
narrateur, qui ne se traduit chez les Touaregs que par des interjections apitoyées ou des
rumeurs éparses, a donné corps ici à un roman peu à peu enrichi par les siècles. La
différence, qui n’est que de degré, tient sans doute à ce que l’écrit a cristallisé chez les
anciens Arabes ce qui dans une société d’oralité comme celle des Touaregs, reste en
général plus diffus. Les biographies publiées par Mohamed et Prasse sont un début de
cristallisation, dont des romans naîtront peut-être quelque jour.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
25
Les poètes de l’amour parfait
26 Nous en arrivons donc aux troubadours, sujet immense où je ne puiserai que ce qui a
rapport avec mon propos. Les poètes auxquels nous donnons ce nom ont exercé leur art
du début du XIIe à la fin du XIII e siècle. Le plus ancien troubadour connu est
Guillaume IX d’Aquitaine (1071-1127) – si du moins il est bien l’auteur des textes
transmis sous son nom32 – tandis que Guiraut Riquier (1254-1292 ?) est généralement
cité comme le dernier d’entre eux33. On leur attribue environ 2 700 pièces, conservées
dans trente ou quarante chansonniers dont la rédaction s’est échelonnée pour
l’essentiel du XIIIe au XVe siècle34. Les textes y sont en général précédés de la biographie
de leur auteur supposé, sa vida, et alternent avec des razos, commentaires également
biographiques rendant « raison » de tel ou tel vers.
27 Tout cela, où la poésie se mêle au roman en prose, ressemble beaucoup aux
compilations des anciens anthologues arabes. La comparaison est d’autant plus fondée
que, tout comme les recueils de poésie arabe archaïque, les chansonniers sont pour la
plupart postérieurs à la date supposée de la composition de leur contenu. Il convient
cependant de ne pas la pousser trop loin. Les plus anciens chansonniers connus sont
contemporains des derniers troubadours, et il n’est pas exclu qu’un Guiraut Riquier,
par exemple, se soit chargé lui-même de la mise en recueil de ses compositions 35. De
plus, un grand nombre de vidas de poètes du XII e siècle seraient dues au troubadour Uc
de Saint Circ, dont on situe l’activité au début du siècle suivant. Sans être le
contemporain de ceux dont il imaginait la vie, il écrivait à une époque où l’art
troubadouresque – le trobar – se pratiquait encore. Tout en prenant garde qu’elles ne
nous sont connues que par des manuscrits bien postérieurs, on peut comparer les vidas
de Uc de Saint Circ à la courte biographie de Ghabidine que Mohamed et Prasse font
figurer dans leur recueil : elle est, en effet, écrite plusieurs décennies après la mort du
poète, mais alors que la tradition à laquelle il se rattache est encore vivace.
28 Le genre dominant de ce vaste corpus est la canso, la « chanson ». Les cansos sont pour la
plupart consacrées au thème de la fin’amors, cet « amour parfait » que les troubadours
ont célébré et dont ils ont débattu deux siècles durant, avant que les érudits n’en
fassent à leur tour l’objet de leurs polémiques savantes. « Élaboration la plus
audacieuse et la plus hérétique d’un paganisme mondain36 » pour Jean Frappier,
« amour chrétien transposé sur le plan séculier37 » pour Léo Spitzer ou Charles
Camproux38, leurre sous lequel se dissimulerait « un amour d’hommes » pour Georges
Duby39, la fin’amors est avant tout une création poétique, une « utopie littéraire 40 ». C’est
donc de poésie que je parlerai, et le fin amanz ne sera ici que le narrateur des cansos. Il
vaut la peine de citer un peu longuement le portrait que Pierre Bec en a proposé 41 :
Une des constantes de la fin’amor est la patience chez l’amant-poète, c’est-à-dire la
faculté pour lui, et la volonté, de supporter, plus ou moins longtemps et sans trop se
plaindre, toutes les tribulations qui lui viennent d’Amour et de sa Dame 42. Il y a là
une mise à l’épreuve quasi-ritualisée, destinée sans doute, du moins au départ, à
une certaine purification sentimentale afin d’isoler la vereia amors. Toute l’éthique
de la fin’amor est d’ailleurs dans cette longue attente ( sofrensa, atendensa, atente,
atendance, etc.) qui accepte ou exclut, cela est sans importance, la récompense finale
(guizardon/guerredon) : cette récompense pouvant à son tour accepter ou refuser le
fait, ou le plus, c’est-à-dire le couronnement sexuel. L’amant-poète est donc avant
tout un sofridor, quelqu’un qui supporte et attend, franchissant un à un tous les
degrés initiatiques qui le conduiront à l’état de drut (amant charnel). Cette attente,
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
26
le fin amanz doit savoir la subir […], quelle que soit la douleur qu’il en éprouve. En
l’occurrence, le lexème fondamental est évidemment sofrir « supporter, endurer ».
29 Sofrir, ajoute l’auteur, n’a presque jamais le sens de « souffrir », mais celui, qu’il gardera
dans la langue classique, de « supporter avec endurance » (ce qui, soit dit en passant,
n’est pas indifférent pour notre propos commun : sofrir est ici, à la lettre, faire preuve
d’une compétence). Mais il est le plus souvent complété par des éléments lexicaux qui
spécifient ce que le narrateur doit supporter : ses souffrances. En voici un exemple,
emprunté à Bernard de Ventadour43 :
J’ai plus de peine de l’amour (plus trac pena d’amor)
que Tristan l’amoureux
qui souffrit tant de douleur (que.n sofri manhta dolor)
pour Izeut la blonde.
30 Cet amant voué à une personne unique, prêt à persévérer dans une cour humble et
soumise quand même il n’espère d’autre faveur qu’un regard, une parole, un bel
semblan44, offre de surprenantes analogies avec le soupirant mauritanien que Corinne
Fortier a si bien évoqué45. Cependant, il présente aussi quelques traits qui sont propres
au lyrisme troubadouresque : sa capacité à endurer des souffrances est censée lui
attirer des mérites auprès de l’aimée, au point que la souffrance en vient à acquérir une
valeur positive, comme dans ce fragment dû à Rigaut de Barbezieux 46 :
Et pour cela je veux supporter la douleur (sofrir las dolors)
car par souffrir (sofrir) sont maintes riches joies atteintes…
et souffrir (sofrirs) fait maint amoureux en joie.
… quand elle ne devient pas délectable du simple fait d’être infligée par l’aimée.
Bernard de Ventadour encore47 :
Je l’aime tant de bon amour
et maintes fois j’en pleure
parce que meilleure saveur
m’en ont les soupirs.
ou Arnaud Daniel48 :
mais le tourment me devient plaisir, rire et allégresse,
car je suis affamé et avide de penser à elle.
31 Car le narrateur troubadouresque espère, alors que le narrateur touareg ou arabe
regrette et se souvient. Différence qui tient à une différence plus profonde. Les poètes
arabes et touaregs chantent moins l’amour que la solitude de l’amant délaissé. Alors
que les troubadours ont aussi chanté le joy (ou joi), autant et plus que le sofrirs.
Cependant, plutôt que la joie, ce mot à l’étymologie discutée 49 semble désigner, « entre
le désir certain et la joie incertaine50 », une exaltation où l’espérance est inséparable du
tourment51. Perceptible dans les fragments qui viennent d’être cités, cette ambiguïté est
magnifiquement rendue par ces vers d’Arnaud Daniel52 :
… souvent mon œil se mouille
de peine, de pleur
et de douceur
car de la joie me vient souffrance (car per joi ai que.m duoilla).
32 Avant Roubaud, Pierre Bec avait lui aussi parlé d’incertitude (à propos de Bernard de
Ventadour, mais la chose est vraie pour d’autres poètes), lorsqu’il évoquait une « zone
d’ombre et d’incertitude psychologique où le troubadour est en balansa et dans laquelle
la douleur est toujours à même de devenir joie et la joie de se transmuer en douleur 53 ».
Dans cette balansa est au fond la véritable souffrance du narrateur, dont on empruntera
là encore une expression à Bernard de Ventadour54 :
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
27
J’ai d’elle bonne espérance
mais cela m’aide bien peu
car elle me tient en balance
comme la nef sur la mer.
33 À côté de joy, on rencontre aussi des termes plus univoques qui, eux, dérivent
certainement du latin gaudium (« joie »), alors qu’on n’en est pas sûr pour joy : gaug,
jauzimen et jauzir ; mais plusieurs auteurs s’accordent à remarquer qu’ils apparaissent le
plus souvent dans des formules optatives ou négatives55, ce que l’un d’eux a
malicieusement formulé : « trobadors make love in the subjunctive 56. » Un peu comme dans
le nasîb et la poésie touarègue 57, la bienveillance de l’aimée n’est qu’un rêve, un
souvenir, une espérance… À moins qu’elle ne soit exclue : ainsi dans ce distique où
Jaufré Rudel n’est pas sans rappeler l’amant odhrite de l’Arabie médiévale 58 :
Je sais bien que jamais d’elle je n’eus de joie (ben sai c’anc de lei no.m jauzi)
ni que jamais demoielle n’aura de joie (nijademino.sjauzira).
34 En même temps qu’il gémit de sa souffrance ou qu’il chante une joie toujours menacée,
le narrateur ne cesse de protester de sa sincérité, se prévalant de sa disponibilité à la
souffrance comme d’un signe de l’authenticité de son amour 59. Ainsi dans cette joute
poétique (environ 1210/20) entre Albert et Gaucelm Faidit60 :
Gaucelm ceux qui aiment d’imposture
ne sentent pas les souffrances d’amour,
et nul ne peut grande valeur
avoir sans peine et sans ahan,
ni ne peut avoir du mérite
sans tourment ni sacrifice…
35 Les romanistes ont depuis longtemps renoncé à voir en ce narrateur souffrant un
porte-parole de l’auteur61. Mais, tout comme pour la poésie touarègue, le narrateur
troubadouresque joue le double rôle de l’amant et du poète62, et, dans ce second rôle, il
est certainement un porte-parole de l’auteur. Ainsi, dans ces deux strophes de Bernard
de Ventadour – dont chacune ouvre une canso –, l’amant proteste d’une sincérité où
l’auteur voit la source de son talent63 :
Chanter ne peut guère valoir
si du fond du cœur ne monte le chant ;
et le chant ne peut monter du cœur
si en lui il n’y a amour de cœur.
C’est pourquoi mon chant est parfait
car en la joie d’amour j’ai engagé
ma bouche mes yeux mon cœur mon sens.
Ce n’est pas merveille si je chante
mieux qu’aucun autre chanteur,
[car] plus me tire le cœur vers l’amour,
et je suis mieux fait à ses commandements :
cœur et corps et sens et savoir
et force et pouvoir en lui j’ai mis ;
tant me tire vers l’amour le frein
que je ne me soucie de rien d’autre.
36 On rencontre, il est vrai, d’autres textes où les deux rôles ne se mêlent pas aussi
parfaitement. C’est notamment le cas lorsque le narrateur se présente avant tout
comme un ouvrier, comme le fabriquant de son poème. Ainsi chez Guillaume IX 64 :
Je veux que tous jugent
si ce poème est de bonne couleur
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
28
je l’ai sorti de mon atelier (obrador)
je détiens de ce métier (mester) la fleur.
Ou chez Peire Ramon de Toulouse65 :
il faut qu’un nouveau chant je forge (fabrec)
en ce beau nouveau temps d’avril
et si ses mots sont de maîtrise (maestril)
il sera compris de chacun.
37 Mais même quand le narrateur manie la lime et le rabot, l’amour parfois se tient à ses
côtés, devenu ouvrier à son tour. Comme chez cet Arnaud Daniel que Dante présentera
au chant XXVI de son Purgatoire comme miglior fabbro del parlar materno 66 :
Sur cette mélodie précieuse et allègre
je fabrique des mots je les rabote je les aplanis
ils seront vrais et certains
quand j’aurai passé la lime
car amour polit et dore
mon chant qui d’elle vient.
Et le poème qu’ouvre cette strophe s’achève sur des vers qui rappellent curieusement
ceux de Majnûn cités plus haut67 :
Pour le tourment que je souffre,
de bien aimer je ne me détourne
bien que je me tienne en solitude (sitot me ten en desert)
car ainsi je mets les mots en rime.
38 Ce survol est bien cursif, mais je crois cependant que, mis en parallèle avec ce qui a été
dit de la poésie touarègue et du roman de Majnûn, il autorise à proposer l’hypothèse
suivante : les souffrances que le troubadour inflige à son narrateur et qu’il revendique
comme siennes sont autant de titres à la reconnaissance à laquelle il aspire en tant que
poète. Lorsque le narrateur s’écrie : « j’aime et je souffre », il faut imaginer que l’auteur
derrière lui murmure : « je suis un authentique poète, au contraire des amoureux
insincères, qui sont dans mon poème les rivaux en amour du narrateur, et dans la
réalité mes rivaux en poésie. » Dans ce que Pierre Bec décrit comme une mise à l’épreuve
quasi-ritualisée, je propose de voir l’image poétique des épreuves et du labeur que le
poète s’impose dans son obrador, afin qu’amour polisse et dore le chant qui d’elle vient – car
c’est bien de poésie qu’il s’agit et pas seulement d’amour. Tout comme les Touaregs et
les Arabes, les troubadours savaient que seul peut devenir poète celui qui met sa
souffrance à distance. On le voit notamment dans toutes ces cansos où le narrateur
commence par dire qu’il souffre trop pour chanter. Et pourtant il chante : c’est que
l’amant désaimé a su se faire ouvrier.
39 Cela n’a pas empêché les auteurs de vidas et de razos d’attribuer aux troubadours les
souffrances chantées par les narrateurs des cansos. Pour Michel Zink, leur erreur a été
de prêter à une poétique du XIIe siècle les caractères d’une poétique postérieure, qui
faisait une part plus grande à l’expression de la subjectivité 68. L’évolution de la
sensibilité littéraire a certainement joué un rôle, mais les exemples touareg et arabe
montrent que l’éloignement temporel pourrait constituer une explication suffisante. La
démarche des auteurs de vidas me paraît, en effet, semblable à celle des auditeurs
touaregs ou des anciens compilateurs arabes. Les chansonniers ont commencé à se
répandre alors que le trobar entrait en décadence et allait bientôt s’éteindre, de la
même manière que le roman de Majnûn est né de la disparition progressive du monde
qui avait vu naître le nasîb, et que la figure du poète touareg s’affirme à mesure que sa
parole s’éloigne de lui. Et tout comme dans l’ancien monde arabe, le recours à l’écrit n’a
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
29
pu que favoriser le processus. Comment les auteurs de chansonniers n’auraient-ils pas
été portés à croire à la réalité de souffrances devenues plus palpables encore d’être
confiées aux parchemins qu’ils calligraphiaient et enluminaient avec tant de soin ?
40 Les auteurs de vidas n’étaient sans doute pas plus naïfs que les Touaregs ou les anciens
Arabes ; ils n’ont fait que suivre jusqu’à l’extrême l’invincible pente où les poussaient
les textes qu’ils assemblaient. Limitons-nous à celle qui est sans doute la plus célèbre.
La vida de Jaufré Rudel le fait mourir dans les bras de la comtesse de Tripoli, enfin
rejointe après un voyage au-delà de la mer. C’est que les pieux biographes, qui savaient
lire, avaient bien compris que la fin’amors était destinée à rester une utopie. Le
narrateur des cansos atteint rarement le jauzimen – celui du troubadour de l’amors de
loing et de la terra lonhdana moins que tout autre. Le Jaufré Rudel de la vida, qui « s’était
énamouré, sans la voir, de la comtesse de Tripoli, pour le grand bien qu’il avait entendu
dire d’elle par les pèlerins qui venaient d’Antioche », ne l’atteint qu’à l’heure de sa
mort. Tout comme la mortelle folie de Majnûn était le signe de sa conformité à l’idéal
du nasîb, la mort en terre lointaine de Jaufré Rudel lui assigne un destin conforme à
l’exigence de la canso69. De plus, faisant de lui un martyr de l’amour70, elle sanctifie les
souffrances qu’il chanta durant sa vie et consacre pour l’éternité l’excellence de son
trobar. On peut comparer ce « martyre » à la mort christique où Camarón de la Isla
donna aux Gitans d’Andalousie la preuve ultime qu’il avait été un très grand chanteur
de flamenco71.
41 Chacun des trois corpus qu’on vient de parcourir rapidement garde, bien sûr, sa part
irréductible d’une spécificité rebelle à toute comparaison. Dans la poésie des Touaregs,
la déréliction du narrateur est la manifestation littéraire d’une sensibilité à la solitude
qui se manifeste par bien d’autres traits de leur culture ; de même, la méditation arabe
sur les « ruines » s’est développée après l’Hégire pour inspirer plus tard le domaine
immense de la poésie mystique ; enfin, je n’ai rien dit des vertus salvifiques prêtées à
l’ascèse du fin amanz, et dont on retrouve un souvenir jusque chez Dante. La
comparaison a cependant fait ressortir la récurrence d’un dispositif relationnel dont la
formule pourrait s’énoncer ainsi : le narrateur souffrant de certaines poésies
amoureuses tend à être vu par les auditeurs – ou les lecteurs – comme le porte-parole
de l’auteur, propension d’autant plus affirmée que l’auteur est plus lointain. Mais en
même temps que la preuve des souffrances de l’auteur, ses poèmes sont vus comme le
signe qu’il a su s’éloigner d’elles. De plus, les souffrances ainsi imputées à cet auteur
absent sont rapportées à un parcours biographique supposé. Or ces vies douloureuses
ne sont imaginées que d’après les œuvres qu’elles sont supposées avoir produites,
comme si, en dehors du moment où il avait ressemblé à son narrateur, l’auteur n’avait
pas vécu. En ce sens, il apparaît autant comme le produit de son œuvre que comme son
producteur.
42 Reste une question qu’il faut bien poser, quitte à la laisser sans réponse : pourquoi
l’amour ? Pourquoi faut-il que les souffrances où on croit que le poète puise son
inspiration soient des souffrances amoureuses ? Vivant dans un monde auquel les
troubadours ont transmis leur idéal poétique et amoureux, nous ne nous la posons
guère, mais elle se pose. Je n’y répondrai pas, mais ferai simplement remarquer ceci : le
narrateur de ces poèmes se met à la merci de celle qu’il dit aimer (« je me rends à elle et
me livre », écrit Guillaume IX), tout comme le poète livre au public un poème où il dit
je, c’est-à-dire une parole où il donne quelque chose de lui. Cette parole sera entendue
en son absence, et par elle l’amant d’une absente portera au loin son histoire.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
30
Correspondances qui, entre l’amour de loing et ces poèmes qu’au loin diffusent les
rhapsodes ou les scribes, marquent comme une connivence.
BIBLIOGRAPHIE
Akehurst, F.R.A.
1974 « Les étapes de l’amour chez Bernard de Ventadour », Cahiers de Civilisation médiévale 17, pp.
133-147.
Albaka, M. & D. Casajus
1992 Poésies et chants touaregs de l’Ayr, Paris, L’Harmattan.
Anglade, J.
1905 Le troubadour Guiraut Riquier. Étude sur la décadence de l’ancienne poésie provençale, Bordeaux,
Feret & Fils.
Appel, C.
1989 [1915] Introduction à Bernart de Ventadour, Moustiers Ventadour, Carrefour Ventadour.
Bec, P.
1968-69 « La douleur et son univers poétique chez Bernard de Ventadour », Cahiers de Civilisation
médiévale 11, pp. 545-571 & 12, pp. 24-33.
1992 Écrits sur les troubadours et la lyrique médiévale, Orléans, Éditions Paradigme.
Bencheikh, J.E.
1989 Poétique arabe, Paris, Gallimard.
Berque, J.
1995 Les dix grandes odes de l’Anté-Islam, Paris, Sindbad.
Berry, A.
1930 Florilège des troubadours, Paris, Libraire Firmin-Didot.
Blachère, R.
1952-66 Histoire de la littérature des Arabes des origines au XV e siècle, Paris, Adrien Maisonneuve, 3
tomes.
Boyer, P.
1986 Barricades mystérieuses et pièges à pensée, Nanterre, Société d’ethnologie.
Casajus, D.
2000 Gens de Parole, Paris, La Découverte.
Camproux, C.
1965 Le Joy d’amour des troubadours, Montpellier, Causse et Castelnau.
Castelli-Gattinara, G.C.
1992 Il Tuareg attraverso la loro poesia orale, Rome, Consiglo Nazionale delle Ricerche.
Dragonetti, R.
1960 La technique poétique des trouvères dans la chanson courtoise, Bruges, De Tempel.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
31
Duby, G.
1988 [1982] « À propos de l’amour qu’on dit courtois », Mâle Moyen Âge, Paris, Flammarion,
pp. 74-82.
Dumitrescu, M.
1969 « Èble II de Ventadorn et Guillaume IX d’Aquitaine », Cahiers de Civilisation médiévale 11,
pp. 379-403
Fortier, C.
2003 « Épreuves d’amour en Mauritanie », L’autre, Cliniques, cultures et sociétés 4(2), pp. 239-252.
Foucauld, C. de
1925-30 Poésies touarègues. Dialecte de l’Ahaggar, Paris, Leroux, 2 tomes.
Frappier, J.
1959 « Vues sur les conceptions courtoises dans les littératures d’oc et d’oïl au XII e siècle »,
Cahiers de Civilisation médiévale 2, pp. 135-156.
Guiette, R.
1972 [1949 pour une partie de l’ouvrage] D’une poésie formelle en France au Moyen-Âge, Paris,
Éditions A.-G. Nizet.
Huchet, J.-C.
1982 « La dame et le troubadour. “Fin’amors” et mystique chez Bernard de Ventadour »,
Littérature 47, pp. 12-30.
1987 L’Amour discourtois. La « Fin’Amors » chez les premiers troubadours, Toulouse, Éditions Privat.
Khairallah, A.
1980 Love, Madness and Poetry : An Interpretation of the Majnûn Legend, Beyrouth, Orient-Institut
der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.
Kilito, A.
1985 L’auteur et ses doubles, Paris, Éditions du Seuil.
Köhler, E.
1964 « Observations historiques et sociologiques sur la poésie des troubadours », Cahiers de
Civilisation médiévale 7, pp. 147-164.
Lazar, M.
1966 Bernard de Ventadour, troubadour du XIIe siècle, Chansons d’amour, Klincsieck, Paris.
1995 Fin’amor, in Akehurst & Davis (dir.), Handbook of the troubadours, University of California
Press, pp. 61-100.
Lord, A.
1960 The Singer of Tales, Cambridge & London, Harvard University Press.
Marrou, H.-I.
1971 Les troubadours, Paris, Éditions du Seuil.
Miquel, A.
1996 Deux histoires d’amour. De Majnûn à Tristan, Paris, Éditions Odile Jacob.
Miquel, A. & P. Kemp
1984 Majnûn et Laylâ : L’amour fou, Paris, Éditions Sindbad.
Mohamed, G. &, K. Prasse
1989-90 Poèmes touaregs de l’Ayr, University of Copenhagen, Copenhague, 2tomes.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
32
Monson, Don A.
1985 « Jaufré Rudel et l’amour lointain : les origines d’une légende », Romania 106 (421),
pp. 36-54
Pasqualino, C.
1998 Dire le chant. Les Gitans flamencos d’Andalousie, Paris, CNRS Éditions.
Rieger, A.
1983 « La dialecture du réel et du poétique chez les troubadours. Les quatre “protagonistes” de
la fin’amors », Revue des langues romanes 87 (2), pp. 241257.
Riquer, M. de
1992 Los trovadores. Historia literaria y textos, Barcelone, Ariel, 3 tomes.
Rosenstein, R.
1990 « Andalusian and Trobador Love-Lyric : From Source-Seeking to Comparative Analysis »,
Zeitschrift für Roman Philologie 106, pp. 339-353.
Roubaud, J.
1971 Les troubadours. Anthologie bilingue, Paris, Seghers.
1994 La fleur inverse, Paris, Les Belles Lettres.
Schmidt, J.-J.
1978 Les Mou’allaqât. Poésie arabe pré-islamique, Paris, Seguers.
Schnell, R.
1992 « L’amour courtois comme discours courtois sur l’amour », Romania 110, (437-438),
pp. 72-126 et (439-440), pp. 331-363.
Spitzer, L.
1970 « L’amour lointain de Jaufré Rudel et le sens de la poésie des troubadours », Études de style,
Paris, Gallimard, pp. 81-133.
Stetkevych, J.
1993 The Zephyrs of Najd. The Poetics of Nostalgia in the Classical Arabic Nasîb, Chigaco & London,
The University of Chicago Press.
Vadet, J.-C.
1968 L’esprit courtois en Orient, Paris, Éditions G.-P. Maisonneuve et Larose.
Zink, M.
1985 La subjectivité littéraire, Paris, PUF.
2003 Poésie et conversion au Moyen Âge, Paris, PUF.
Zumthor, P.
1972 Essai de poétique médiévale, Paris, Éditions du Seuil.
NOTES
1. Zink, 2003 : 42.
2. Boyer, 1986.
3. Lord, 1960.
4. Foucauld, 1925-1930 ; Mohamed & Prasse, 1989-1990 ; Albaka & Casajus, 1992 ; Castelli-
Gattinara, 1992.
5. Fragments composés respectivement en 1900, 1898, 1890 (voir Foucauld, 1925-1930, I : 283, 527,
340).
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
33
6. Albaka & Casajus, 1992 : 38, 50.
7. Foucauld, Ibid., I : 366.
8. Albaka & Casajus, Ibid. : 25, 31.
9. Retraduit d’après Mohamed & Prasse, 1989-1990, II : 489.
10. Retraduit d’après Mohamed & Prasse, 1989-1990, II : 586.
11. Retraduit d’après Mohamed & Prasse, 1989-1990, II : 95.
12. Retraduit d’après Mohamed & Prasse, 1989-1990, II : 93-94.
13. Blachère, 1952-1966, I : 83 sqq.
14. Stetkevych, 1993, chapitre 1. La question de savoir si cette tripartition correspond à une
réalité ou est une systématisation des anthologues a été abondamment discutée (voir un état
assez complet de la discussion dans Bencheikh, 1989). Mais Stetkevych montre de façon
convaincante que, si on l’interprète en un sens large, la thèse de la tripartition rend assez bien
compte du corpus disponible.
15. Berque, 1995 : 67.
16. Ibid. : 12.
17. Schmidt, 1978 : 161. Le beau livre de A. Kilito (1985) n’est au fond rien d’autre qu’un
commentaire de ce mystérieux vers.
18. Retraduit d’après Stetkevych, 1993 : 54. La traduction adoptée ici est plus proche de l’arabe.
19. Miquel & Kemp, 1984 : 21.
20. Miquel & Kemp, 1984 : 17-18 ; Blachère, 1952-1966, III : 595, 654 et 657.
21. Miquel, 1996 : 79. Faut-il en déduire que le poète de l’ancienne Arabie, tout comme le barde
fang, n’est pas l’auteur de ses dires. Je ne le crois pas, car il n’est nulle part dit qu’il s’exprime au
nom d’un autre que lui-même. Fou, mais proférateur d’un dire qui reste le sien.
22. Miquel & Kemp, 1984 : 154.
23. Khairallah, 1980 : 64.
24. Khairallah, 1980 : 63
25. Vadet, 1968 : 375.
26. Miquel & Kemp, 1984 : 171.
27. Miquel & Kemp, 1984 : 183.
28. Vadet, 1968 : 267 sqq.
29. Miquel & Kemp, 1984 : 73.
30. Miquel & Kemp, 1984 : 175.
31. Miquel & Kemp, 1984 : 254.
32. Ce qui n’est en rien assuré, et que certains ont contesté avec des arguments parfois
convaincants (Dumitrescu, 1969).
33. À tort, puisqu’il y a eu des troubadours après lui, mais il est un fait que l’art troubadouresque
ne fut plus après lui qu’une survivance (Bec, 1992 : 39).
34. Informations dans Marrou, 1971 : 6 & 13 ; Riquer, 1992, I : 11 sqq. ; Zink, 1985 : 50 ; Zumthor,
1972 ; Bec 1992.
35. Anglade, 1905 : 12.
36. Frappier, 1959 : 142.
37. Spitzer, 1970 : 83.
38. Camproux, 1965.
39. Duby, 1988 : 82. On trouve des idées semblables dans Köhler (1964) et, jusqu’à un certain
point, dans Huchet (1987, ch. 1).
40. Schnell, 1992 : 91.
41. Bec, 1968-1969 : 562.
42. Ici, l’auteur fait un renvoi à Dragonetti (1960 : 78) « Le service de l’amant n’est en effet qu’un
art d’attendre… : pour arriver à ses fins, il doit non seulement “patienter”, atendre, c’est-à-dire
“espérer”, mais “supporter les souffrances”, endurer. »
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
34
43. Traduction de Roubaud (1971 : 121)
44. Akehurst, 1974 : 143.
45. Fortier, 2003.
46. Traduction de Roubaud, 1971 : 18.
47. Traduction de Roubaud (1971 : 121), retouchée d’après Lazar (1966 : 76).
48. Retraduit d’après Riquer (1992, II : 638) et Berry (1930 : 193).
49. Cette discussion se poursuit encore : voir Camproux, 1965 : 124 sqq. ; Lazar, 1995 ; Huchet,
1982 : 26 ; Roubaud, 1994 : 165 sqq.
50. Roubaud, 1994 : 166.
51. Akehurst, 1974 : 144.
52. Retraduit d’après Roubaud (1971 : 231).
53. Bec, 1968-1969. : 551. Roubaud avance des idées très semblables (1994 : 171).
54. Retraduit d’après Roubaud (1971 : 121) et Lazar (1966 : 74).
55. Roubaud, 1994 : 160 ; Frappier, 1959. : 140 ; Huchet, 1982 : 27 ; Rosenstein, 1990 : 348.
56. Goldin, cité in Rosenstein, 1990.
57. Sur cet aspect de la poésie touarègue, non abordé ici, voir Casajus, 2000, ch. 4.
58. Retraduit d’après Riquer, 1992, I : 168.
59. Schnell, 1992 : 123-124.
60. Retraduit d’après Schnell, Ibid. : 124.
61. Robert Guiette est sans doute l’un des premiers à l’avoir fait, pour les trouvères, dans un
article célèbre dont la première publication remonte à 1949 (voir Guiette, 1972). Le grand
romaniste Carl Appel en était encore, en 1915, à rechercher l’identité des mystérieuses
destinataires des chansons de Bernard de Ventadour (Appel, 1989), recherche dont le dernier
éditeur de Bernard de Ventadour a montré la vanité (Lazar, 1966).
62. Le point a été souligné par Michel Zink dans un texte important (Zink, 1985 : 47-74). Voir
aussi Rieger, 1983 : 247.
63. Traductions de Roubaud (1971 : 113 et 115), légèrement retouchées. Le second de ces textes
semble avoir été très connu dès le Moyen-Âge puisqu’on le trouve dans 21 manuscrits (Lazar,
1966 : 48).
64. Traduction de Roubaud (1994 : 200).
65. Traduction de Roubaud, ibid.
66. Traduction de Roubaud, 1971 : 237.
67. Traduction de Roubaud (1971 : 239), légèrement retouchée.
68. Zink, 1985 : 57.
69. Voir sur ce point Spitzer, 1970 : 115, note 5.
70. Monson, 1985 : 54.
71. Pasqualino, 1998 : 54 et infra dans ce volume.
RÉSUMÉS
Les chansons des troubadours, les odes de l’Arabie antéislamique et les poésies touarègues
contemporaines ont en commun de mettre en scène un narrateur disant sa souffrance d’être
séparé de l’objet aimé. Les auditeurs – ou les lecteurs – tendent à voir dans ce narrateur souffrant
un porte-parole de l’auteur, propension d’autant plus affirmée que l’auteur est plus lointain dans
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
35
l’espace ou le temps. Ils sont cependant conscients que seul celui qui a su mettre sa souffrance à
distance peut devenir poète. L’auteur, de son côté, tend à présenter les souffrances qu’il inflige à
son narrateur comme la preuve de sa propre compétence de poète. De plus, les souffrances ainsi
imputées à l’auteur par son public sont rapportées à un parcours biographique supposé. Or ces
vies douloureuses ne sont imaginées que d’après les œuvres qu’elles sont supposées avoir
produites, comme si, en dehors du moment où il avait ressemblé à son narrateur souffrant,
l’auteur n’avait pas vécu.
The songs of the troubadours, odes from pre-Islamic Arabia and contemporary Tuareg poetry
have in common that they present a narrator who tells how much he has suffered because of his
separation from the loved one. Listeners (or readers) tend to see this suffering narrator as the
author’s spokesman – a tendency all the stronger insofar as the author is remote in space or
time. Nonetheless they are aware that only someone who knows how to stand back from his
suffering can become a poet. On the other hand, the author tends to present the suffering that he
has inflicted on his narrator like a test of his own competence as a poet. In turn, the suffering
that the public ascribes to the author is assumed to be related to biographical experiences. But
these painful experiences are only imagined with reference to the works of poetry that they
supposedly produced, as though the author had no life apart from the moment when he
resembled his suffering narrator.
INDEX
Mots-clés : troubadours, amour courtois, poésie, auteur, islam
Keywords : troubadours, courtly love, poetry, author, Islam, Tuareg
Population Touareg
Index géographique : Hoggar, Niger, Arabie, France
AUTEUR
DOMINIQUE CASAJUS
Directeur de recherche au CNRS. Centre d’études des mondes africains (CEMAf), CNRS/Université
de Paris 1/Université d’Aix-Marseille 1/EPHE
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
36
Écorchés vifs
Pour une anthropologie des affects
Raw to the bone: For an anthropology of affects
Caterina Pasqualino
L’ethnicité gitane
1 Sur quel critère anthropologique se fonder pour décrire et évaluer la souffrance d’un
individu ou d’une communauté? Cette question sera traitée ici à propos des Gitans, que
les auteurs décrivent depuis le XVIIIe siècle comme un peuple d’« écorchés vifs ». Ce
trait de caractère revient avec une telle constance qu’il apparaît comme l’un des plus
saillants de leur culture aux yeux des observateurs. Il n’est pourtant jamais pris en
considération dans les travaux qui s’interrogent sur l’identité gitane.
2 Dans les années 1930, Shirokogoroff (1936 : 85) avait tenté d’élaborer des critères
supposés définir l’« unité ethnique » d’une population. Il proposa cinq paramètres : une
langue commune; la conscience de former un tout dans lequel les membres jouissent
d’une compréhension réciproque; une identité culturelle; la conviction d’une origine
commune; la pratique de l’endogamie. Si les critères renvoyant à « la conscience de
former un tout », à la conviction d’une « origine commune » et à « l’identité culturelle »
restent flous, en revanche, ceux liés à la pratique d’une langue commune et à
l’endogamie sont sans équivoque. Or si l’on s’en tenait à ces deux critères, on pourrait
en déduire que les Gitans n’existent pas comme groupe distinct.
3 Même en admettant que le caló constitue la langue originelle du « peuple gitan », ce
dialecte n’est plus employé que sous une forme résiduelle. En Andalousie 1, l’étudier est
décevant : il ne comporte plus aucune forme grammaticale spécifique, et seules les
personnes âgées recourent à un vocabulaire domestique limité au corps humain et à la
nourriture. Les jeunes ne connaissent plus qu’une vingtaine de mots. Le critère
d’endogamie n’est pas plus pertinent. Les Gitans étant sédentarisés et côtoyant depuis
des siècles les Payos (non-Gitans), de nombreux couples mixtes se sont formés,
entraînant un métissage de la population. Le fait n’est pas occulté, et certains Gitans
disent franchement être de père ou de mère payo. Les Gitans ne disposant d’aucune
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
37
forme d’institutions structurantes (Pasqualino, 1999), il est tentant de conclure à une
acculturation. De fait, les Payos les plus hostiles aux Gitans ne leur reconnaissent pas de
culture spécifique. Ils affirment que les fameuses coutumes des Gitans auraient été
empruntées aux Payos.
4 Ces propos ne sont pas le seul fait d’un racisme ordinaire cherchant à dénigrer une
population dont la différence de mode de vie est encore, même après des siècles de
cohabitation avec les Andalous, mal acceptée. L’idée que les Gitans constituent une
population opportuniste de création récente est parfois relayée en haut lieu. Lorsque,
quelques années après la publication de mon ouvrage sur le flamenco des Gitans
d’Andalousie (Pasqualino, 1998a), je rencontrai à Jerez de la Frontera le directeur payo
de la Fundación Andaluza de Flamenco pour lui en proposer une édition espagnole, il
m’opposa un refus catégorique en affirmant que les Gitans n’existaient pas. Pour me le
prouver, il m’invita à contempler une reproduction exposée dans les couloirs de la
Fondation, intitulée Les Bohémiens. Il en fit l’interprétation suivante. Les cinq
« Bohémiens » étaient en réalité un Payo, un mulâtre, un Arabe, un Noir et, peut-être,
un Gitan, ce dernier représenté déchaussé et en train de mendier. Les Gitans sont, selon
lui, une pure invention. Le seul « dénominateur commun » de cette population aurait
été sa pauvreté : une simple classe sociale, en quelque sorte. Ce n’est que poussée par le
désir d’ascension sociale et l’appât du gain que cette communauté chercherait
aujourd’hui à s’approprier et à incarner le flamenco. Si absurde qu’elle soit, cette
affirmation est reprise par de nombreux flamencologues andalous – Payos –, qui nient
l’apport évident des Gitans au flamenco et le rôle de premier plan joué par les
interprètes gitans.
5 Depuis que les Gitans sont arrivés en Espagne, leur culture a toujours été dénigrée.
Plutôt que de reconnaître leur originalité, on les a régulièrement appréhendés comme
une population de voleurs, ce dont témoignent les lois édictées contre eux depuis le
XVIe siècle (Leblon, 1985). Il est choquant de constater qu’aujourd’hui certains
anthropologues évoluant entre populisme, mouvance régionaliste et tentations
indépendantistes (pour la création d’un Etat d’Andalousie), théorisent ces préjugés. Le
débat sur les origines du flamenco reste vif. Protestant contre sa folklorisation et son
aliénation à l’identité espagnole, ils prônent la restauration de valeurs flamencas
supposées « authentiques » et le retour à de prétendues « sources andalouses ». Dans le
même mouvement, ils passent sous silence la contribution essentielle des Gitans au
flamenco et font fi de la culture gitane en la banalisant (Moreno Navarro, 1996 : 17-18).
Certains légitiment cette attitude, avançant que trop parler des Gitans risque de
contribuer à les marginaliser ou, tout au moins, à défavoriser leur intégration. Il s’agit,
en somme, d’ignorer leur différence pour mieux les assimiler au « peuple andalou ».
6 Refusant de recourir à la notion d’ethnie, d’autres recherches ont abouti, par un effet
d’exagération, à nier la spécificité des groupes gitans. Ainsi Nancy Thède affirme que
les Gitans d’Andalousie ne possèdent pas de culture propre : l’auteur va jusqu’à se
demander si le fait de considérer avec « insistance » les Gitans comme une entité
spécifique n’aurait pas pour seul but de justifier le travail des ethnologues (Thède 1999 :
59). Il est difficile de ne pas réagir à cette accusation : s’il est établi que de nombreuses
« ethnies » sont une invention de l’époque coloniale, affirmer que les Gitans n’existent
pas, est non seulement absurde, mais tendancieux; ce serait conforter le mépris
séculaire que les Payos nourrissent envers les revendications identitaires des Gitans.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
38
Sous le prétexte de s’affranchir des travaux anthropologiques « classiques », l’auteur
reprend en réalité une thèse populiste largement diffusée par les xénophobes.
La recherche de nouveaux critères d’ethnicité
7 Il est vrai que la « pureté » de race et de sang que revendiquent les Gitans n’est qu’un
mythe vide de contenu. Mais les Gitans en sont-ils vraiment dupes? Rien n’est moins
certain. Certes, lorsqu’ils vantent leur légitimité historique, leur sens de l’égalité et de
la générosité, leur respect des anciens et des morts, les Gitans reprennent les traits les
plus saillants de la culture paya et ne font preuve d’aucune originalité. Mais les
commentaires orgueilleux des Gitans ne valent que comme documents d’enquête : ils
ne doivent pas être reçus comme une définition de leur spécificité. Dès lors qu’il s’agit
de dépasser une identité de façade empêtrée dans les clichés, définir cette population
par des traits distinctifs n’est pas aisé. Leonardo Piasere critique la recherche de
« traits originels tsiganes » en ces termes : « Si l’image idéale du “Tsigane traditionnel”
prévoyait qu’il soit un nomade de campagne, le Tsigane sédentaire habitant en ville,
avec seulement quelques traits différents des autres citoyens, devenait le prototype du
Gitan dégénéré. Les recherches effectuées dans différents pays d’Europe dans les
derniers dix ou quinze ans ont démontré, toutefois, qu’il n’y a pas de traits “originels
tsiganes” » (Piasere, 1991 : 214). Il faut ajouter à cela que leurs modes d’être, d’agir et de
penser sont multiples à l’intérieur d’une même aire géographique et changent selon les
circonstances.
8 L’approche traditionnelle a consisté à éviter de confronter les Tsiganes avec leur
environnement social et culturel. Pour assurer leur authenticité, il était en effet plus
commode de considérer qu’ils vivaient isolés, non « contaminés » par les non-Tsiganes.
Mais quelques chercheurs ont dérogé à la règle, se révélant « barthiens » avant la
lettre. Fredrik Barth, dont s’inspirent encore aujourd’hui les études tsiganes, a remis en
question, dans les années 1970, le concept d’ethnie en tant qu’entité en soi, affirmant
que l’ethnie n’existe qu’en fonction d’une interaction entre groupes sociaux (Barth,
1969). Considérant comme capitales les notions de stratégie et d’acteur, son approche
prend en compte, non pas la somme des différences sociales ou culturelles objectives,
mais ce que les acteurs sociaux considèrent eux-mêmes comme significatif. Cette
théorie apporte une lumière nouvelle sur la question de l’identité gitane; néanmoins,
elle peut conduire à des excès sur lesquels nous devons nous interroger. D’une part, il
est difficile d’affirmer, comme le fait Barth, que chaque membre d’une population est
un acteur conscient de son rôle et maître de ses stratégies; d’autre part, si l’on envisage
le cas des Gitans en privilégiant comme il le fait les relations qu’un groupe entretient
avec les groupes voisins, on en viendrait à affirmer qu’ils se soucient essentiellement de
se positionner par rapport aux Payos. Cette voie d’approche est sans doute aussi
excessive que celle qui consistait, auparavant, à couper totalement la communauté
gitane de son entourage. Considérer l’interaction des Gitans avec leurs voisins payos
n’interdit pas de prêter une certaine attention aux traits qu’ils perçoivent comme leur
étant propres, dans leurs parcours individuels ou dans les événements qui les
rassemblent et qui constitueraient leur mémoire communautaire. Si l’on peut certes
déplorer avec les Payos, flamencologues et anthropologues, l’utilisation imprudente et
abusive du concept de « culture gitane », on ne peut en revanche les suivre lorsqu’ils
prétendent en nier l’existence. Il est également impossible de laisser certains
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
39
anthropologues avancer que l’érosion des traditions gitanes annonce la disparition des
Gitans en tant qu’entité sociale. Tant que des individus se déclarent « Gitans », il n’y a
aucune raison de ne pas tenter d’expliciter leurs spécificités.
9 De nouvelles approches, plus convaincantes, tendent à considérer l’ethnicité comme un
concept dynamique. Elle ne serait plus transmise immuablement, mais elle serait en
partie réinterprétée par chaque individu et réinventée de génération en génération.
Labile, cette notion est aussi difficile à cerner dans les faits. Michael Fischer suggère
qu’elle pourrait être enracinée dans l’émotionnel et suivre des processus d’élaboration
comparables au rêve et aux transferts psychanalytiques (1986 : 195-196). Les Gitans,
échappant sans doute plus que d’autres aux critères traditionnels à la Shirokogoroff,
offrent à l’observation un « vivre ensemble » difficile à définir et incitant à
l’exploration de nouveaux arguments.
Le rôle de la mémoire collective
10 Les Gitans restent un peuple méprisé et en proie à de permanentes difficultés tant
matérielles que psychologiques. Globalement plus pauvres que les Payos, ils ont été
plus touchés par le chômage, puis par le trafic de drogue, et beaucoup d’entre eux ont
connu la prison. Tous semblent profondément marqués par l’histoire subie par les
leurs, même les plus jeunes qui, la plupart du temps, n’ont pas connu personnellement
de brimades. C’est comme s’ils avaient une conscience innée de la souffrance, ce qu’ils
expriment en parlant de souffrance por raza, c’est-à-dire inhérente « à leur race ». Le
terme de race surprend : jamais tombé en désuétude outre-Atlantique, en Europe il a
généralement été banni du vocabulaire courant. À l’époque où j’ai entrepris mes
premières enquêtes en Andalousie, je considérais ce terme comme une survivance.
Pourtant la guerre civile survenue en ex-Yougoslavie a cruellement fait resurgir des
revendications raciales que l’on croyait disparues. Faut-il donc accorder quelque crédit
à la « souffrance raciale » revendiquée par les Gitans? Celle-ci constituerait-elle un trait
de leur façon d’être et de penser, le fait de souffrir entre frères justifiant une différence
de sensibilité avec les Payos? Les Gitans expliquent, par exemple, que la souffrance qui
transparaît dans leurs interprétations flamenco tient au fait qu’ils ont souffert plus que
d’autres peuples.
11 Parce qu’ils ont été sans cesse persécutés, leur sort n’a rien eu, en effet, d’enviable.
Depuis l’Inquisition promulguée par les Rois Catholiques (1481-1483), l’Espagne a
imposé un ordre religieux autoritaire dont les Gitans ont souffert. Peu après leur
arrivée au XVIe siècle, la monarchie espagnole les a brimés, leur imposant la
sédentarisation, interdisant leurs fêtes et le parler caló, cherchant à plusieurs reprises à
les anéantir en séparant les hommes des femmes, les jetant sans motif en prison ou les
condamnant aux galères. Seuls quelques érudits gitans connaissent l’existence des
grands événements historiques qui les ont marqués, comme la grande rafle de 1749, sous
le règne de Ferdinand VI, ou les lois promulguées (les « Pragmatiques sanctions »)
durant des siècles, destinées à les anéantir. La plupart des Gitans, qui se désintéressent
de l’histoire (au sens académique du terme), ont cependant conscience d’avoir été
persécutés « depuis toujours » et d’être encore aujourd’hui maltraités. On trouve en
Europe de l’Est une situation comparable. L’Holocauste, qui a frappé très durement les
Roms, n’est l’objet d’aucune commémoration. Or Michael Stewart note que, malgré leur
rhétorique « présentiste », les Roms de Harango (Hongrie) se remémorent un passé
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
40
douloureux en l’associant à un quotidien émaillé de conflits violents avec les non-Roms
(2004 : 575).
12 Cette conscience d’une douleur partagée agite les élites gitanes d’Espagne, qui
cherchent à reprendre à leur compte les revendications des Roms d’Europe de l’Est
auprès du Parlement Européen. Lequel Parlement, quelque peu effrayé par l’imminence
de l’intégration des Roms à une Union Européenne sans frontières, a pensé en juillet
1990 à légiférer. Il leur a conféré le statut d’« ethnie européenne », leur accordant des
droits et reconnaissant officiellement le massacre dont ils ont été victimes pendant la
Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Pressés d’être eux aussi
reconnus par le Parlement européen, les Gitans espagnols se sont parfois, par la voix de
leurs associations, assimilés aux victimes de l’Holocauste, auquel ils ont pourtant
échappé2.
13 Ces déclarations du Parlement européen ont entraîné, sept ans plus tard, une réaction
de l’Église : en 1997, un premier Gitan est béatifié. Il s’agit de Ceferino Garcia Malla,
maquignon exécuté par les républicains pendant la guerre civile. Dans le discours qu’il
a prononcé devant des Roms venus du monde entier assister à l’événement, Jean-Paul II
a évoqué les souffrances des Roms durant l’Holocauste; comme s’il assimilait le sort des
Roms exterminés par les Nazis à celui des religieux assassinés par les républicains
espagnols (Pasqualino, 2005).
14 Pour les autorités, la souffrance qu’ont endurée les Gitans revêt ainsi, au gré des enjeux
et du contexte, de multiples visages. Les Gitans d’Andalousie se désintéressent de ces
débats; il n’en demeure pas moins que, quelles que soient les causes de la souffrance
qu’ils ont subie, ils font de celle-ci le fondement de leur identité.
Communautés de martyrs
15 Tiendrions-nous, avec ce sentiment partagé d’une souffrance collective et
immémoriale, un trait par lequel les Gitans se percevraient comme tels et
s’opposeraient à leurs voisins payos? Un trait que nous pourrions donc tenir comme
définitoire d’une identité, ou, si l’on veut, d’une « ethnie » gitane? C’est sur une
réponse plutôt positive à cette question que cet article veut déboucher, mais il faut
d’abord parler de la façon paradoxale dont cette souffrance s’exprime. Les Gitans
s’assimilent plus ou moins confusément aux premiers martyrs chrétiens. Autrement
dit, la souffrance où ils voient le paradigme de leurs séculaires tribulations n’a rien de
spécifiquement gitan.
16 Avant-poste de la chrétienté à l’époque de la Reconquista, l’Andalousie est restée
marquée par une attitude religieuse exaltée; ainsi, pour l’ensemble de la population, les
manifestations de piété sont souvent accompagnées de séances d’autopunition. Lors des
fêtes religieuses, les épreuves que les participants endurent jouent un rôle d’expiation
et de purification. Lors des processions de Semaine sainte par exemple, les porteurs de
chars (les costaleros) supportent de cruelles blessures aux épaules, provoquées par le
poids écrasant de leur charge : ils font ainsi acte de soumission à la puissance divine,
pour obtenir le pardon des fautes commises par les croyants 3.
17 En Semaine sainte, les Gitans ont un comportement apparemment plus joyeux. D’une
façon jugée blasphématoire par le clergé, ils suivent en dansant les statues des Christs
gitans de leurs quartiers. Les chants de Semaine sainte (saetas) qu’ils leur adressent
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
41
diffèrent de ceux des Payos (Pasqualino, 1998b). Ils y magnifient la souffrance qu’ils
endurent chaque jour alors que les souffrances expiatoires que s’inflige le costalero payo
sont une rupture avec son quotidien.
18 Les Gitans n’hésitent pas à revendiquer des liens de parenté avec la Sainte Famille. Dans
les chants de Noël (villancicos), ils ajoutent aux couplets traditionnels des paroles
affirmant que saint Joseph est payo, tandis que le Christ et la Vierge seraient gitans. Le
Christ exerce une véritable fascination sur les flamencos gitans, qui exaltent son
supplice. Certains cherchent à lui ressembler physiquement en apparaissant efflanqués,
barbus, les cheveux longs. D’autres se vêtent à la manière du Christ, tel Periquin qui
ramena d’une tournée en Turquie un habit de couleur pourpre dans l’intention de
ressembler davantage au Christ de son quartier. Ce mimétisme a parfois pris des
proportions troublantes. Le célèbre Camarón de la Isla, qui se savait atteint d’une
maladie incurable, se fit filmer torse nu et crucifié, dans un clip vidéo accompagnant la
sortie d’un album. En 1999, sa mort donna naissance à une légende directement
inspirée de la vie du Christ. Les Gitans rapportèrent que, de son vivant, il guérissait
simplement en imposant les mains et que ses derniers mots furent : « Mère, que
m’arrive-t-il? » – paroles où se mêlent le souvenir de Marc et Matthieu (« Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?) et celui de Luc (« Père, je remets mon esprit
entre tes mains »).
19 Cette adhésion à la foi catholique cache en réalité des enjeux identitaires. L’Europe
connaît plusieurs cas de détournements du dogme par des minorités dont le but est de
recourir à une mythologie qui légitime leur enracinement territorial. Ainsi, dans les
Pyrénées, lors des fêtes de Carnaval, on brûle un géant qui représente à la fois le Christ
en croix, porteur d’une vérité universelle, et un héros éponyme de la localité. Les
Gitans, pour leur part, n’avancent aucune revendication territoriale. Lorsqu’ils
revendiquent une relation privilégiée avec le Christ, ils signifient seulement que leur
communauté se fonde sur le partage d’une même souffrance. Assimilée à celle du Christ
sur la croix, cette souffrance l’est aussi au martyre des premiers chrétiens. Les Gitans
sont cependant indifférents à la signification que l’Église donne au sacrifice de Jésus et
au témoignage (martyrion) des martyrs chrétiens. Le Christ supplicié n’est qu’une image
de souffrance à laquelle le chanteur s’assimile : il souffre pendant sa performance
comme Jésus a souffert sur la croix, et comme les martyrs ont souffert dans l’arène,
mais il ne donne pas pour autant une signification chrétienne à cette souffrance.
20 Cette façon de voir est partagée par l’ensemble des Gitans, toutes confessions
confondues. Comme chez les catholiques, chez les évangélistes (de plus en plus
nombreux parmi les Gitans), le Christ est la figure la plus populaire. On y retrouve un
même attachement à l’icône du Christ en croix. Le même phénomène d’identification
également. Se voyant avant tout comme des déshérités, les Gitans évangélistes se
considèrent en cela comme un peuple élu. Un pasteur gitan de Azuaga (Extremadura)
m’a affirmé que pour porter la bonne parole auprès des Payos, le Seigneur a choisi le
peuple le plus démuni de la terre, le plus ignorant et le plus souffrant, ajoutant, pour
corroborer ses propos, que « les derniers seront les premiers ».
21 On voit donc que si les Gitans expriment leur souffrance avec des mots et des images
empruntés à un univers culturel qu’ils partagent avec le monde chrétien qui les
entoure, l’usage assez hétérodoxe qu’ils font de ces références culturelles leur est
propre. Ils disent dans les mots de tous quelque chose qu’ils sont les seuls à dire.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
42
Chanter, souffrir
22 Le flamenco est le lieu privilégié de la souffrance gitane. Nous avons effleuré le
flamenco quand nous avons évoqué les saetas de la Semaine sainte, et il faut maintenant
en parler plus largement. À l’époque où leur maîtrise des arts de la forge était appréciée
par une population encore largement rurale, les Gitans revendiquaient une origine
remontant à une souche commune d’« ancêtres forgerons » (Pasqualino, 1997).
Aujourd’hui que leurs chanteurs sont loués et sollicités dans le monde entier, la
communauté affirme descendre d’« ancêtres chanteurs ». On pourrait donc croire tenir
avec le flamenco un trait culturel spécifiquement gitan. Le problème est que, comme on
l’a dit plus haut, les Payos leur contestent la paternité du flamenco. Prenant argument
de ce que l’ostracisme subi par les Gitans, dès leur arrivée en Espagne au XVI e siècle, est
contemporain de l’expulsion des Maures et des Juifs, Blas Infante (1980) affirme, sans
preuve tangible, que l’origine du flamenco est le résultat de la promiscuité forcée de ces
trois populations persécutées et réfugiées dans les montagnes andalouses. Et il est un
fait que même l’interprétation que les Gitans estiment la plus authentique – c’est-à-dire
celle qui est pratiquée dans leurs réunions familiales – est, malgré leurs dénégations,
tributaire du regard que les étrangers portent sur eux. Par un jeu d’influences subtiles,
le succès obtenu par le flamenco au niveau international a non seulement suscité le
renouveau local de cet art, mais il a aussi fini par transformer en profondeur et les
interprétations et le répertoire.
23 La culture gitane n’a peut-être pas été immune au sentiment de souffrance qui s’est
développé dans une certaine littérature européenne du XIXe et du début du XX e siècle.
Ainsi, s’il est vrai que Garcia Lorca a été influencé par le flamenco gitan, on omet
généralement de dire qu’à l’inverse, son Romancero gitano est aujourd’hui une référence
et une source d’inspiration pour les auteurs gitans. La réciprocité des influences est
telle qu’on peut se demander si la figure du gitan « écorché vif » mise en scène dans le
flamenco n’est pas, au delà de l’œuvre de Lorca, liée à toute la littérature romantique
libertaire. A partir du XIXe siècle cette littérature, revenant sur l’obsession du christiano
viejo4, idéalise le marginal, le vagabond et le prolétaire. Diffusé non seulement par la
littérature mais aussi par la peinture et plus tard par le cinéma (Antonietto, 1985) et la
publicité, cet idéal fait du flamenco gitan un archétype. Contresens qui a au moins eu
pour effet, dès la fin du XXe siècle, de mettre sur scène d’authentiques Gitans dans des
rôles de figurants ou d’acteurs5 – en particulier dans des westerns tournés au sud de
l’Espagne et de la France6.
24 Aujourd’hui, ces jeux d’influence entre scène locale et internationale ont de fortes
répercussions. Camarón de la Isla, par exemple, a fait évoluer le style « traditionnel ».
Interprète considéré comme un pur héritier du flamenco gitan, il est en même temps
devenu une star du show business, enfreignant les règles canoniques du style familial
pour introduire des interprétations plus commerciales. L’engouement du public
international pour le flamenco a ainsi contribué, non seulement à faire évoluer le
répertoire et les interprétations, mais aussi à renforcer la culture flamenca des Gitans.
25 Un autre exemple de la transformation du regard que les Gitans portent sur eux-mêmes
est fourni par l’industrie du tourisme telle qu’elle se développe à Grenade. Cherchant à
fournir une prestation la plus typique possible, les Gitans de cette ville, qui se donnent
en spectacle aux touristes, mettent en avant le fait d’habiter dans un quartier
troglodyte et se vêtent de costumes postiches très colorés qui n’avaient jamais été
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
43
utilisés par le passé. Ils s’inspirent en réalité d’une imagerie qu’ils ont en partie repris
des opérettes (Carmen, par exemple) et en partie du folklore gitanisant tel qu’il s’est
incarné dans l’esprit populaire. Le paradoxe est que, ainsi contraints de jouer les Gitans
de pacotille pour gagner leur vie, leur sentiment de gitanitude est exacerbé. Comme le
montre Hosbwam, certaines « traditions », parfois d’invention récente, focalisent les
attentes identitaires et fonctionnent comme des signes de ralliement. Ce qui, au départ,
était faux, devient vrai, l’authenticité et l’inauthenticité se nourrissant
réciproquement. Comme l’affirme U. Eco, le « complètement réel se confond avec le
complètement faux » (1985).
26 Il n’en demeure pas moins, malgré tous ces jeux d’influence réciproque, que flamenco
payo et flamenco gitan diffèrent sur plusieurs points. Ces différences sont, à mon sens,
le trait par lequel les Gitans d’Andalousie se distinguent, objectivement et
subjectivement, de leurs voisins payos. Dans le flamenco payo, l’interprétation doit être
mélodique et harmonieuse. La diction des mots se doit d’être précise, au service de
paroles attachées à des descriptions de paysages bucoliques et à des situations
concrètes. Les paroles des chants gitans comportent en revanche peu de descriptions
détaillées et se contentent d’exprimer des états d’âme. Le rythme peut également sortir
des règles canoniques pour laisser place à l’improvisation. Certaines vocalises sont ainsi
démesurément allongées, tandis que les paroles peuvent être agrémentées d’ornements
syllabiques, de pauses impromptues, de coupures et de sons sans significations. Une
autre distinction tient à ce que le dernier vers, appelé macho, est chanté d’une voix
étranglée. À bout de souffle, les interprètes gitans créent des effets de surprise en
interrompant soudainement leur chant. Ils privilégient par-dessus tout l’émotion et
l’effet dramatique, préférant à la voix harmonieuse des Payos une voix rauque, voire
défectueuse. De fait, leurs interprétations n’invitent ni au sentiment nostalgique
qu’inspire le flamenco payo, ni au sentiment doux-amer du fado portugais. Elles
s’inspirent du désespoir et de la rage. Tandis que certains auteurs prétendent que les
Gitans sont victimes d’un atavisme génétique (leurs cordes vocales seraient plus dures
et calleuses que celles des Payos), eux-mêmes considèrent que leurs interprétations
« dysharmoniques » expriment la souffrance de leur peuple.
27 Exhiber la souffrance par le moyen du chant permet d’atteindre une sorte de sacralité.
En mettant en avant leurs drames sentimentaux ou leur déchéance, les chanteurs sont
auréolés d’une supériorité morale. Les Gitans affirment qu’il est impossible
d’interpréter des thèmes liés au dépit amoureux sans l’avoir préalablement ressenti
dans sa chair. Tout bon chanteur doit avoir souffert d’une rupture. Lorsqu’il s’agit
d’évoquer le talent exceptionnel d’un chanteur disparu, les Gitans vantent, non ses
dons musicaux, mais ses déboires sentimentaux. Les interprètes sont censés donner le
meilleur d’eux-mêmes lorsqu’ils sont affectés. Les plus beaux chants auraient été créés
sous le coup d’un violent tourment. Sous le coup du désespoir, la voix se « salit »,
devient enrouée et doit suggérer les sanglots.
28 Un deuxième type de souffrance « revendiquée » est lié à la privation de liberté. À
l’image du rossignol dont on crève les yeux pour qu’il chante mieux, être en prison
favoriserait l’épanouissement du talent. Antonio Agujeta en est un bon exemple.
Toxicomane, il a été incarcéré pour avoir agressé un chauffeur de taxi à l’arme blanche.
Purgeant une peine de seize ans, condamnation qui a été considérée comme
exorbitante en regard des faits incriminés, il incarne à merveille la figure héroïque du
martyr gitan. En prison, il devint l’un des meilleurs interprètes de carceleras, chants de
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
44
prisonniers interprétés sur un registre grave et accompagnés de frappements lents du
poing sur la table, exprimant l’amertume nourrie par l’impossibilité de revoir les siens.
Il y remporta le concours de chant flamenco qui le rendit célèbre.
29 Les chanteurs de flamenco s’efforcent de produire un timbre éraillé ou cassé, et les voix
graves sont plus appréciées que les aiguës. Les hommes âgés, qui ont plus de facilité
pour se placer sur ces registres, sont considérés comme de meilleurs interprètes. En
plus de la maîtrise due à leur expérience, on loue leur voix enrouée que l’on qualifie de
« rance » (rancia). Admirant leurs aînés, les jeunes travaillent leur timbre pour lui faire
perdre de sa clarté. Pendant la représentation, ils ont à leur disposition un verre de vin
blanc (fino) qu’ils consomment par petites gorgées. Ajoutée à l’atmosphère âcre, saturée
de fumée de cigarettes, la consommation d’alcool permet de « salir » sa voix. Pour
amplifier les effets du tabac et de la boisson, les bons chanteurs affirment qu’ils se
raclent la gorge au point de se faire mal. En recourant à ces procédés, il ne s’agit pas de
truquer la voix, mais, selon les Gitans qui considèrent la souffrance comme le cœur de
leur être, d’en révéler la vraie nature. Ils prétendent que, en devenant plus rauque et
« plus ancienne » (mas antigua) avec l’âge, la voix véhicule plus de vérité. Débarrassés
des faux-semblants, les anciens délaissent la parole commune et s’expriment par le
truchement de devises mi-chantées mi-parlées, prononcées sur un ton grave.
30 Émis à partir du ventre, le son est censé revenir dans la gorge pour retourner dans les
entrailles. On dit qu’à ce moment « le chant se lance et s’avale ». Cette technique n’est
pas considérée comme un jeu; l’interprète se dépasse : comme le torero, il doit prendre
un maximum de risques. Certaines comparaisons entre la tauromachie et le chant sont
éclairantes. D’un torero s’exposant dangereusement, on dit qu’il « chante sur le mode
de la siguiriya » (canta por siguiriya). Ce chant lent et triste nécessite de « lâcher tous ses
soupirs » au risque de perdre haleine et d’être incapable de dire le vers suivant. Sur le
dernier vers, le macho, l’interprète force sa voix, ce qui produit un râle évoquant
l’agonie. Ainsi, comme le torero tue le taureau, le chanteur « tue » sa voix. Le point
crucial est atteint lorsque l’interprète semble suffoquer par manque d’oxygène,
affirmant éprouver « une forte peine » mêlée d’orgueil. Il est comme étourdi, et son
regard se perd dans le vide. Il atteint une sorte d’état second. Ses paroles entrecoupées
se font difficilement compréhensibles, son phrasé comprend de plus en plus de sons
sans signification. Le public réagit en interpellant le chanteur et en lui lançant des
encouragements (jaleos). Quand sa voix s’étrangle, il « vomit le sang », « vomit ses
tripes ». C’est dans de tels moments que « les duendes sortent » – d’une locution
désignant le moment de grâce qui s’empare de tous, chanteurs et auditeurs. S’impose
alors un silence tendu. Les participants déclarent avoir à ce moment la chair de poule et
rester comme pétrifiés, ils se mettent parfois à pleurer. Brutalement introduit dans le
continuum des chants, des frappements de mains et des exclamations, le silence crée
un effet de rupture saisissant. Lorsque les Gitans s’assoient en cercle pour chanter, il
leur arrive d’évoquer la mémoire d’un ou de plusieurs chanteurs défunts. Cet acte
prépare l’avènement, au cœur de la nuit, de temps de silence. Le souvenir douloureux
de parents ou d’amis disparus crée un climat émotionnel qui renforce l’envie de
chanter. Dans la fête gitane (juerga), les participants interprètent leur chant sur un
mode proche du parler tout en travaillant une voix rocailleuse. Ils disent se débarrasser
de tout « sentiment de honte » pour s’adonner aux confidences les plus intimes.
L’atmosphère est dominée par un sentiment de douleur partagée. Ces séances, qui
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
45
prennent l’allure d’une communion, sont susceptibles d’éclairer sous un jour nouveau
la définition contestée de l’identité des Gitans.
Pour une anthropologie des affects
31 Depuis une vingtaine d’années, la notion d’ethnie a perdu de sa consistance. Des
anthropologues ont montré qu’elle procédait souvent d’une création arbitraire de la
part d’autorités occidentales soucieuses d’identifier et d’administrer les populations
colonisées. Il faut toutefois reconnaître que, d’un point de vue théorique, le problème
reste entier, puisque l’anthropologie a du mal à appréhender les éléments sur lesquels
certains groupes sociaux fondent le sentiment de leur spécificité. Si difficiles à cerner
qu’ils soient, les éléments exposés relatifs au sentiment d’une souffrance partagée et
exaltée fournissent dans le cas des Gitans un début de réponse. Les Gitans, qui
prétendent que les Payos sont incapables d’éprouver de fortes émotions, pourraient
avoir bâti une part importante de leur spécificité sur un sentiment de souffrance
hypertrophié.
32 Dès les années 1980, quelques auteurs ont envisagé que les émotions pourraient être un
élément constitutif des organisations sociales. Michelle Rosaldo (1980) considérait que
les champs de l’affectivité devaient être intégrés aux analyses classiques des
institutions, de la culture et de l’histoire d’un groupe social. Aujourd’hui n’est-il pas
possible de proposer, plus radicalement, que les affects seraient au fondement de
certaines constructions sociales et que la certitude de partager certains affects suffit
parfois à légitimer le sentiment de former une « entité ethnique »? Les Gitans
flamencos pourraient ainsi se concevoir comme une communauté élective fondée sur
un sentiment de souffrance partagée, ainsi que sur une manière propre d’aviver et
d’exprimer cette souffrance. Leurs séances de chant seraient un rituel où leur identité
se réactualise au sein d’une communauté d’affects7. Les recherches sont encore trop peu
nombreuses en ce domaine pour que l’on puisse s’assurer de la valeur heuristique d’une
telle hypothèse. Mais il est d’ores et déjà permis de penser que cette voie permettrait
de retrouver les travaux d’un Roland Barthes ébauchant une théorie du vivre ensemble
(2002) et de se confronter aux travaux plus récents d’un Anderson évoquant la
constitution de groupes sociaux en imagined communities (2002 : 20).
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
46
Procession de semaine sainte à Jerez de la Frontera, 2003.
Chanteur de saeta pendant la semaine sainte à Jerez de la Frontera, 2003.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
47
Diego Agujeta chantant une saeta, 2003.
BIBLIOGRAPHIE
Anderson, B.
2002 L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte.
Antonietto, A.
1985 « Le cinéma forain et… bohémien (Du “muet” au début du “parlant”) », Etudes Tsiganes 3,
pp. 9-20.
Barth, F.
1969 Ethnic Groups and Boundaries, Boston, Little Brown.
Barthes, R.
2002 Comment vivre ensemble? Cours et séminaires au Collège de France (1976-1977), sous la direction
d’Eric Marty, Paris, Seuil/IMEC (coll. « Traces écrites »).
Deleuze, G. & F. Guattari
1991 Qu’est-ce que la philosophie?, Paris, Éditions de Minuit.
Eco, U.
1985 La guerre du faux, Paris, Grasset.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
48
Fischer, M. J.
1986 « Ethnicity and the Post-modern Arts of Memory » in J. Clifford & G. Marcus (dir.), Writing
Culture : The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley, University of California Press, pp. 194-233.
Infante, B.
1980 Origenes de lo flamenco y origenes del cante jondo, Sevilla, Ediciones de la consejeria cultural de
la Junta de Andalusia.
Leblon, B.
1985 Les Gitans d’Espagne, le prix de la différence, Paris, P.U.F.
Moreno Navarro, I.
1996 « El flamenco en la cultura andalusa », in C. Cruces Roldan, El flamenco : identidades sociales,
ritual y patrimonio cultural, Jerez, Centro Andaluz de Flamenco, Junta de Andalucía, pp. 15-33.
Pasqualino, C.
1997 « Naissance d’un peuple. Les forgerons-chanteurs d’Andalousie », Social Anthropology 5, 2,
pp. 177-195.
1998a Dire le chant. Les Gitans flamencos d’Andalousie, Paris, CNRS-MSH.
1998b « Quand les yeux servent de langue. Le statut du regard chez les Gitans d’Andalousie »,
Terrain 30, pp. 23-43.
1999 « Hors la loi, les Tsiganes face aux institutions », Ethnologie française 4, pp. 617-626.
2005 « Un Saint Gitan », Etudes Tsiganes 20, pp. 64-74.
Piasere, L.
1991 Popoli delle discariche. Saggi di antropologia zingara, Roma, Cisu.
Rosaldo Michelle, Z.
1980 Knowledge and Passion. Ilongot Notions of Self & Social Life, Cambridge, Cambridge University
Press.
Shirokogoroff, S.M.
1936 « La théorie de l’Ethnos et sa place dans le système des sciences anthropologiques »,
L’ethnographie 32, pp. 85-115.
Stewart, M.
2004 « Remembering without Commemoration : The Mnemonics and Politics of Holocaust
Memories among European Roma », Royal Anthropological Institute 10, pp. 561-584.
Thède, N.
1999 Gitans et flamenco. Les rythmes de l’identité, Paris, L’Harmattan.
NOTES
1. Nous avons travaillé chez les Gitans de Jerez de la Frontera, Moron de la Frontera, Cadix,
Séville (Andalousie méridionale) pour lesquels le flamenco n’est pas seulement une musique mais
une vision du monde, une façon d’être et de penser (Pasqualino, 1998a).
2. Les Gitans espagnols partis en France pour échapper à la guerre civile utilisent, encore
aujourd’hui, le terme « camp de concentration » pour désigner les camps de réfugiés où ils furent
rassemblés en France.
3. Les Gitans, qui refusent de se soumettre à ce rituel payo, s’imposent parfois d’autres
pénitences. Il arrive qu’ils s’infligent des contraintes vestimentaires (porter le même vêtement
qu’une image sainte durant des semaines ou des mois), qu’ils pratiquent l’abstinence et
accomplissent des parcours de pèlerinage sur les genoux ou en rampant.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
49
4. L’obsession d’être cristiano viejo, de sang pur, sans mélange (juif, arabe ou gitan) est présente
dans la littérature espagnole jusqu’au XIXe siècle. Des exemples très connus sont ceux de La
gitanilla et de La illustre fregona, de Miguel de Cervantes, où l’héroïne, belle, pure et sage, se révèle
être une jeune aristocrate volée à sa naissance par les Gitans. Le schéma littéraire est celui du
jeune homme beau et intelligent, d’origine pauvre, dont on découvre à la fin de l’histoire qu’il est
noble. Ainsi, dans Le Trobador, de Angel Garcia Gutierrez, celui qu’on croyait gitan se révèle être
le frère d’un Comte.
5. Si, en 1895, Georges Méliès puisait dans le fantastique et le rocambolesque forain avec
Campement de Bohémiens, en 1907, des forains du Pays de Galles (les Haggar et les Mottershaw)
tournaient plusieurs films dont La vengeance des Romanis.
6. En Camargue, le baron de Baroncelli, protecteur des Gitans, encouragea les « tribus gitanes de
Saint- Gilles » à participer aux tournages (par exemple dans Rois de Camargue, en 1934).
7. Nous rejoignons ici Deleuze et Guattari (1991) selon lesquels la philosophie est une affaire de
concepts, tandis que les arts visuels renvoient aux percepts, et la littérature et la musique aux
affects. Le flamenco – association de littérature orale et de musique – semble bien correspondre à
une telle définition.
RÉSUMÉS
L’article est consacré aux Gitans de quelques villes de l’Andalousie méridionale (Jerez de la
Frontera, Moron de la Frontera, Cadix, Séville), pour lesquels le flamenco n’est pas seulement une
musique mais une vision du monde, une façon d’être et de penser. Qu’elle soit ancrée dans la
mémoire collective ou ritualisée et réactualisée lors de chaque réunion de chant, ces Gitans
placent la souffrance au coeur de leur identité. Estimant que les théories classiques sur l’ethnicité
sont impuissantes à les définir, l’auteur suggère ici de considérer les affects comme une voie
nouvelle pour comprendre cette population et, au-delà, pour réexaminer la notion d’ethnicité.
For Gypsies living in southern Andalusia (Jerez de la Frontera, Moron de la Frontera, Cadiz,
Seville), flamenco is not just a musical genre. It is also a world-view, a way of being and thinking.
Suffering, whether rooted in the group memory or ritualized and reactivated whenever songs are
performed, lies at the center of the Gypsy sense of identity. Since classical theories of “ethnicity”
are inadequate for defining this group, feelings and affects should be explored as a new way to
understand this population and to re-examine the notion of ethnic identities.
INDEX
Mots-clés : flamenco, identité ethnique, affects, minorités
Population Gitans
Index géographique : Espagne, Andalousie, Jerez de la Frontera, Moron de la Frontera, Cadix,
Séville
Keywords : flamenco, ethnic identity, affects, minorities, Gypsies, Spain
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
50
AUTEUR
CATERINA PASQUALINO
Chargée de recherche au CNRS. Laboratoire d’anthropologie des institutions et des organisations
sociales, CNRS
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
51
Le travail de la souffrance
Parcours biographique du cultivateur sénoufo (Côte d’Ivoire)
The work of suffering: The biographical itinerary of Senufo farmers
Marianne Lemaire
1 Les Sénoufo Tyebara, au nord de l’actuelle Côte d’Ivoire, ont très tôt retenu l’attention
des voyageurs puis des administrateurs coloniaux pour leur ardeur dans le travail
agricole. Mais chez ces observateurs, l’admiration le disputait toujours à la perplexité.
En effet, ce que les Sénoufo célèbrent sous le nom de faliwi n’est pas exactement notre
travail. Comme lui, le faliwi sénoufo incorpore une dimension de peine, de souffrance,
mais c’est une souffrance valorisée pour elle-même, sans égard pour les œuvres qu’elle
produit. De sorte que s’ils mettent dans la catégorie faliwi des activités que nous
considérons comme du travail, ce n’est pas pour les mêmes raisons que nous. Et ils y
incluent aussi des activités où il ne nous viendrait pas à l’esprit de voir du travail. C’est
uniquement en raison de la souffrance qui accompagne leur réalisation qu’ils
réunissent certaines de leurs activités sous la même catégorie faliwi, les élevant au rang
de « travaux ». Parmi ces « travaux » figurent en bonne place différentes activités
rituelles telles que celles accomplies par les novices lors de leur initiation au poro 1, ou
encore celles accomplies par ses proches et par les membres de son village lors des
funérailles d’un défunt. Mais plus encore que ces différentes activités rituelles, le
travail agricole fait figure de référence pour ces travaux sénoufo qui puisent leur valeur
dans le douloureux effort qu’ils occasionnent plutôt que dans leur finalité productive.
2 On ne s’étonnera pas de ce qu’une souffrance à ce point valorisée soit attentivement
évaluée en même temps que l’est la vaillance au travail de celui qui l’éprouve. Au
cultivateur d’exception est en effet imputée une souffrance plus grande qu’à ses
camarades. Mais cette souffrance en laquelle les Sénoufo voient un signe d’excellence
se distingue moins par son intensité que par sa singularité. La souffrance du cultivateur
d’exception est inattendue, et en augure une autre susceptible à son tour d’être
appréhendée comme la preuve d’une nouvelle compétence. Ainsi, cet article se propose
de retracer le douloureux parcours biographique que les Sénoufo réservent à leurs
cultivateurs d’exception pour, à travers lui, tenter de préciser la nature de la souffrance
qu’ils valorisent et situent à la source de l’excellence.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
52
La souffrance du champion de travail agricole
3 La souffrance du travail agricole atteignait autrefois toute sa mesure au cours de
concours de travail qui, sous leur forme la plus institutionnalisée, opposaient les
cultivateurs de deux villages distincts dans un champ d’ignames et mobilisaient un
public, des arbitres et des orchestres de xylophones. Que le travail agricole soit valorisé
pour la souffrance qui l’accompagne et indépendamment de ses fruits n’apparaissait en
effet jamais aussi clairement que dans le cadre de tels concours. Car la rivalité y
accentuait une souffrance qui conduisait les cultivateurs à se retirer les uns à la suite
des autres pour finalement céder la place aux seuls deux véritables rivaux dont ils
s’étaient tout d’abord efforcés de suivre le rythme : les tegbanbele (pl. de tegban) ou
champions de travail agricole de chacun des deux villages. « Trop de concurrence gâte
le champ », disent les Sénoufo : aussi vaillants que pouvaient être ces deux champions,
ils ne pouvaient à eux seuls accomplir le travail de tout un collectif et laissaient un
propriétaire de champ insatisfait face à une surface cultivée seulement en partie, et des
buttes d’igname montées trop haut pour être utilisables.
4 Mais la souffrance endurée par les deux rivaux n’était pas tout à fait la même que celle
endurée par le commun des cultivateurs. En effet, le champion sur lequel ses camarades
du même village et de la même classe d’âge comptent pour vaincre le champion du
village adverse ne ressent aucune souffrance physique. De l’avis de tous, il est celui qui,
alors que les autres cultivateurs s’épuisent à la tâche, ne sait pas qu’il en accomplit
une : « Vous souffrez, lui ne sait pas que vous faites quelque chose »; il est encore celui
qui dédaigne la douleur causée par une éventuelle blessure : « Même s’il se tape avec sa
houe jusqu’à toucher l’os, il ne le considère pas, il cultive »; il est enfin celui qui ignore
toute la journée durant les sensations de faim et de soif : « Il ne s’arrête pas pour
manger, il n’a pas l’envie de nourriture ».
5 Des qualités qui se trouvent « sur son corps » et dont ses camarades sont dépourvus
sont avancées pour justifier que le tegban soit comme épargné par la souffrance : ses os
sont « durs » et son cœur, « bien assis », ne « balance » pas. Ce n’est cependant pas « sur
son corps » que se situent les ressources du tegban, mais bien au plus profond de lui-
même, « sur son cœur ». En effet, si le tegban ne souffre pas physiquement, c’est qu’il
souffre d’une autre souffrance. « Son intérieur lui fait mal » : il est animé par une
douloureuse rage de vaincre, un désir profond de « trouver le nom » à travers la
réputation prestigieuse de meilleur cultivateur et de ne pas l’entacher par la honte et
l’humiliation consécutives à l’insuccès. C’est une telle détermination qui manque au
kanwolo, personnage qui s’oppose à celui du tegban sans pour autant se confondre avec
celui du paresseux, car loin de refuser le travail, le kanwolo cultive avec soin et
assiduité. Et si, malgré tout, les autres cultivateurs le dépassent parce qu’il ne cultive
pas suffisamment vite, c’est parce que « son intérieur ne s’est pas arrêté sur cela » :
parce qu’il n’est pas aussi douloureusement tendu vers la victoire que le tegban, il ne
parvient pas à s’efforcer, redoute de voir souffrir ses os en cultivant trop
énergiquement, de « sortir sous le soleil » ou de voir son cœur « se couper et
tomber » : « Si tu répètes que cela te fait mal, tu ne peux pas t’efforcer comme les
autres, tu vas rester derrière. »
6 Ainsi, la souffrance morale du tegban, en étouffant sa souffrance physique, constitue sa
meilleure assurance de le devenir ou de le rester : « Toute chose que tu veux faire, et
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
53
que tu veux faire avec le cœur, elle va se faire. Si tu as peur d’elle à l’intérieur, elle ne se
fera pas vraiment. » Aussi est-ce à l’élaboration progressive de cette souffrance
particulière que travaillent les xylophonistes tout au long du concours. En effet, deux
orchestres de xylophones sont postés au bord du champ, d’où chacun entonne des
chants adressés tantôt à l’ensemble des cultivateurs et tantôt au tegban de son village 2.
Qu’ils s’adressent à leur tegban, et les xylophonistes savent qu’ils ont à charge
d’aiguillonner la douleur morale dont la possession lui a permis d’accéder au statut de
tegban et dont l’exacerbation doit lui permettre de vaincre un adversaire lui-même
tegban. Responsabilité qu’ils confessent clairement dans un de leurs chants, en
soulignant que la « chose ronde tissée », autrement dit la calebasse reliée à chacune des
lamelles de bois que comporte leur instrument de musique, est mise en branle à seule
fin de susciter la souffrance intérieure qui doit conduire leur tegban vers la victoire :
La chose ronde tissée nous a jetés dans cette souffrance.
7 Pour maintenir toujours vivace la souffrance morale de leur tegban, les musiciens ont
recours à des chants qui portent sur le moment où plane l’incertitude concernant
l’identité du vainqueur et où, pour cette raison, la tension atteint son paroxysme :
Ils cultivent vraiment, personne ne connaît le vainqueur parmi eux.
8 Incertitude et tension sont encore volontiers entretenues par l’évocation des divers
accidents de parcours dont le tegban n’est jamais à l’abri et qui, s’ils survenaient, le
voueraient indubitablement à l’échec :
Le manche de la houe du tegban ne doit pas se casser.
9 Mais les chants ne contribuent jamais autant au renforcement de la souffrance
intérieure et, partant, au décuplement des forces du tegban tendu vers la victoire, que
lorsqu’une jeune femme y est évoquée. Car cette image suscitée par les paroles des
xylophones vient alors renforcer et magnifier deux autres figures féminines dont la
présence est indispensable au bon déroulement du concours : les jeunes filles qui,
munies d’une calebasse, offrent toute la journée durant de l’eau aux cultivateurs, et la
statuette que le tegban est susceptible de remporter chez lui en guise de trophée.
Sculptée au sommet d’une longue canne effilée à sa base, cette statuette, appelée
« jeune fille des cultivateurs à la houe » (tefalapitya)3, représente effectivement une
jeune femme tantôt debout, les bras le long du corps, tantôt assise sur un petit
tabouret, les mains sur les genoux, tantôt claire, tantôt plus sombre, coiffée
diversement et dotée d’attributs aussi divers qu’une houe, une jarre ou, plus rarement,
un enfant. Or et cette statuette et les jeunes filles rappellent aux cultivateurs, et plus
particulièrement au tegban, l’amie prénuptiale ou la future épouse pour laquelle ils
cultivent d’ores et déjà ou celle dont leur ardeur au travail, attentivement évaluée par
les aînés, pourrait leur faciliter l’obtention. Les xylophonistes, qui n’ignorent ni les
sentiments ni les projets matrimoniaux du tegban qu’ils ont la responsabilité de rendre
victorieux, s’appliquent à y conformer leur discours. Aussi leurs chants rappellent-ils
volontiers ses connaissances féminines à la mémoire du tegban, à moins qu’ils
n’évoquent une jeune personne connue de tous les villages à la ronde pour sa grande
beauté et à laquelle un jeune tegban, plus que tout autre, est en droit d’aspirer :
Si quelqu’un a envie de Tyeden,
qu’il parte dans le grand champ.
10 Que les xylophonistes soient véritablement résolus à lui frayer un chemin vers la
victoire, et ils ne se satisfont pas de susciter une joute du tegban avec lui-même; ils
s’appliquent également à amplifier la joute préexistante qui l’oppose à son principal
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
54
adversaire. Là encore, les musiciens ne taisent pas le moyen auquel ils ont recours pour
y parvenir : « jeter les deux tegbanbele l’un contre l’autre », c’est à dire prêter des
propos provocateurs à l’un pour aiguiser la souffrance et dans le même temps, la rage
de vaincre de l’autre :
Être debout et mettre certains en conflit.
11 Et c’est avec une grande satisfaction que les xylophonistes font finalement le constat de
l’efficacité de leurs chants :
Nabege, si on te provoque pour te jeter contre les cultivateurs
tu les cultives jusqu’à les gâter.
12 C’est ainsi une profonde souffrance qui est jugée indispensable à l’élévation d’un
cultivateur au rang prestigieux de tegban et qui est entretenue par les xylophonistes
tout au long du concours. Une profonde souffrance, mais une souffrance inattendue
dans un contexte de travail agricole : une souffrance dont la dimension morale est
continûment nourrie pour être en mesure d’étouffer sa dimension physique et de
mener le tegban vers la victoire. Or cette surprenante souffrance avec laquelle les
tegbanbele composent tout au long du concours, bien loin de prendre fin en même
temps que lui, préfigure celle avec laquelle ils vont devoir composer tout au long de
leur vie.
Parcours biographique du tegban
13 Que, en dépit de ses propres ressources et du soutien que lui ont apporté les
xylophonistes de son village, le tegban échoue à vaincre son adversaire, et il se sent
profondément humilié : son « intérieur » a été « noirci », et son « derrière »,
« arraché ». Il se voit également dépossédé de son prestige : s’il ne perd pas son titre au
sein de son propre village, il perd la statuette tefalapitya ainsi que la considération et
l’estime de son entourage, et ne les recouvre pas avant de remporter un prochain
concours. Sa défaite le plonge dans un désespoir à la mesure de sa détermination à être
le vainqueur, et encore augmenté par la déception des membres du village venus
l’encourager : le mutisme des xylophones, les remontrances des anciens et les pleurs
des jeunes femmes viennent encore théâtraliser l’échec ressenti douloureusement par
le tegban. Dès lors, il peut arriver que la honte s’ajoute à l’épuisement pour entraîner,
dès l’issue du combat, sa mort : le tegban ressent « l’envie de dormir, il se couche, il ne
se réveille pas ».
14 Vainqueur, le tegban est au contraire l’objet de nombreuses attentions. De retour au
village, il reçoit la meilleure part de nourriture et sa propre calebasse de bière. Les
xylophonistes lui adressent des chants de louange sur lesquels seuls des champions de
travail agricole aussi valeureux que lui sont autorisés à danser. Mais cet apaisement de
la souffrance du champion de travail agricole est de courte durée. Soit qu’il perde son
« nom », et avec lui son prestige, soit au contraire qu’il le garde. Car les vainqueurs trop
permanents de tous les concours auxquels ils participent s’exposent à une sanction
inéluctable. Non pas parce que la figure du tegban irait à l’encontre de l’éthique
égalitaire sénoufo. Tout occupé à accroître sa renommée et son prestige en participant
au plus grand nombre de concours dans les villages alentours, le champion n’est pas
assez souvent dans le sien pour prétendre y remplir des responsabilités. Si le tegban
incarne une menace, c’est bien plutôt à l’endroit de la rivalité elle-même. L’ostracisme
dont, comme on va le voir, il est bientôt l’objet évoque en effet celui qui, en Grèce
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
55
ancienne, frappait les vainqueurs, et que Nietzsche interprète comme la volonté
d’écarter ceux qui, par leur triomphe, mettaient en péril l’idée même de rivalité 4.
15 A leurs plus grands champions de travail agricole, les Sénoufo Tyebara réservent un
parcours douloureux tout au long duquel la statuette tefalapitya joue un rôle
déterminant. Avec cette statuette, le tegban entretient en effet une relation étroite qui
se révèle rapidement périlleuse. La tefalapitya n’est pourtant pas la propriété du tegban,
mais celle de sa classe d’âge : ce sont les membres d’une classe d’âge en effet qui en ont
fait ensemble la commande et payé le prix à un sculpteur, ou qui en ont hérité de leurs
aînés n’en ayant plus l’usage. Ce sont encore les membres d’une classe d’âge qui,
ensemble, choisissent de parer la statuette de boucles d’oreilles ou de colliers,
conviennent de la couleur du pagne qu’elle portera, partent en quête des deux plumes,
pareilles à celles arborées par le tegban, dont elle sera coiffée et qui, à la veille d’un
concours, la lavent et la frottent avec de l’huile. Il faut donc attendre le début d’un
concours pour que se précise, en même temps que sa relation très privilégiée avec le
tegban, la véritable identité de la tefalapitya.
16 Pendant un concours, la statuette de chacun des deux villages est fichée en terre
derrière son tegban et dans la dernière butte d’igname élevée par lui, un enfant étant
chargé de la déplacer à mesure que le tegban progresse. Au moment où l’affrontement
bat son plein, et où l’un des deux cultivateurs prend un avantage décisif sur son
adversaire, sa tefalapitya se met, dit-on, à rire, à frapper des mains et à transpirer aussi
abondamment que si on lui avait « versé du beurre de karité dessus ». Au même
moment, son adversaire, en voie d’être battu, doit se rendre à l’évidence : le corps de sa
statuette, comme le sien, blanchit. De fait, la tefalapitya est l’objet d’autres « soins » que
ceux évoqués plus hauts, soins qui n’ont plus pour objectif de l’embellir, mais de
l’animer, et qui ne sont plus du ressort des jeunes cultivateurs, mais des anciens et du
tegban. Cette dimension magique de la statuette n’est pas sans présenter quelque
danger pour celui dont elle est supposée renforcer les chances de victoire : par crainte
des procédés et substances magiques dont la tefalapitya est le support, le tegban doit se
garder de lui faire face, de piétiner son ombre ou d’en être recouvert, de la salir avec de
la terre et plus encore d’en projeter dans le trou formé par la canne de la statuette
après qu’elle a été déplacée. Qu’il néglige de respecter l’un de ces interdits, et il se voit
« attrapé par le médicament » qui devait le rendre invincible, mais qui, finalement, le
« cuit » : il se sent soudainement envahi par une fatigue et une mollesse insurmontables
qui lui interdisent de cultiver et le contraignent à s’asseoir.
17 Là ne sont cependant pas les pires ennuis que la tefalapitya peut attirer au cultivateur
d’exception. Elle est en effet au centre du parcours biographique semé d’embûches que
partagent la plupart des plus grands champions. Parcours qui débute presque toujours
ainsi : le cultivateur d’exception est aux prises avec des rêves étranges. Tel a été le cas
de Pana Silué, ancien tegban du village de Zemongokaha, aujourd’hui âgé d’environ
quatre-vingt dix ans. Pendant longtemps, Pana n’a pas dormi sans se réveiller avec, à
l’esprit, le souvenir d’un rêve étrange : une jeune femme pénétrant dans sa chambre,
s’adossant contre le mur puis venant se coucher près de lui. De ce rêve troublant,
nombreux sont les devins qui lui ont donné cette première interprétation : sans doute
Pana avait-il, « derrière lui », une « personne d’un autre accouchement » (seelasyOOn) –
une personne qui, parce qu’elle avait croisé Pana dans une vie antérieure et que celui-ci
lui avait causé du tort, s’échappait de temps à autre du pays des morts pour à son tour
semer le désordre dans sa vie. Car rêver chaque nuit d’une même femme n’affecte pas
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
56
seulement le sommeil, mais aussi le temps de veille du rêveur : sans qu’il comprenne
pourquoi, il entre en conflit avec tous les membres de son entourage, et tout
particulièrement avec ses membres féminins. Qu’il ne soit pas encore marié, et il voit
toutes les femmes le refuser; qu’il soit marié, et il constate que son épouse, outre qu’elle
est en constante opposition avec lui, n’enfante pas. Les devins consultés par Pana
avaient pu déterminer le clan d’appartenance de sa seelasyOOn : à une personne du
même clan Yeo qu’elle, il avait alors remis le nombre d’ignames, la quantité de riz, de
maïs et de condiments que les devins avaient estimé nécessaire pour qu’elle le
« quitte ». Comme rien n’y faisait, Pana a consulté de nouveaux devins qui lui ont
proposé une autre interprétation de son rêve : plutôt qu’une seelasyOOn, la femme qui le
poursuivait en rêve n’était autre que la tefalapitya, la statuette dont il était alors, en
tant que tegban, le détenteur. Ils ont ajouté cette précision : c’est parce que l’ardeur au
travail de Pana a plu à la tefalapitya que celle-ci le « colle » aujourd’hui avec autant
d’insistance.
18 Plus jeune que Pana d’une dizaine d’années, mais ancien champion de travail agricole
comme lui, Zananyene Soro, du village de Dihi, a également commencé par rêver
chaque nuit d’une même jeune femme. Les devins lui ont plus promptement qu’à Pana
exposé de quoi il retournait : « Les devins me l’ont dit : ils m’ont dit que le morceau de
bois avec lequel je cultivais, c’était ce qui s’était collé à moi. » L’époque des premiers
rêves de Zananyene a coïncidé avec le moment précis où sa classe d’âge transmettait la
tefalapitya à ses cadets. Il l’explique ainsi : tout d’abord séduite par son ardeur au
travail, la tefalapitya a par la suite si activement participé à accroître sa réputation de
tegban qu’elle n’a pu se résoudre à se séparer de lui : « Dans le champ, on aurait dit que
je ne cultivais pas tout seul. Quand nous avons eu fini de cultiver avec elle, de la
manière dont elle m’avait aidé dans le travail agricole, elle n’a pas accepté de me
quitter. » Fort de cette certitude que la tefalapitya s’était effectivement collée à lui « sur
le lieu du travail agricole », Zananyene a tout mis en œuvre pour qu’elle cesse de
l’importuner. Son premier geste a été de la dessiner : apercevant sa propre silhouette
tracée au kaolin sur le mur de la chambre de Zananyene, elle ne devait plus pouvoir y
pénétrer. Dans le même objectif, Zananyene enfumait quotidiennement sa maison en y
faisant brûler les mêmes herbes qu’il brûlait autrefois pour que la tefalapitya lui apporte
son soutien lors des concours entre cultivateurs. Mais tous ses efforts pour éloigner de
lui la tefalapitya se sont soldés par un succès aussi variable que temporaire. Elle est
toujours revenue, manifestant son mécontentement à l’égard de son « ami » à travers
des gestes meurtriers : deux des trois épouses de Zananyene sont mortes après avoir
donné naissance à des enfants qui n’ont eux-mêmes pas survécu. Aussi Zananyene a-t-il
fini par se plier à toutes les exigences de la tefalapitya. Il a en premier lieu fait sculpter
une statuette la représentant, puis quelques temps plus tard, une seconde statuette
masculine représentant l’« ami » qu’elle souhaitait avoir à ses côtés. Deux fois l’an il
sacrifie une poule au plumage roux à la statuette féminine sculptée à l’image de la
tefalapitya avec laquelle il cultivait, et un coq blanc à la statuette masculine. Il prend
alors soin de verser le sang à leurs pieds plutôt que sur leur tête, ainsi qu’elles le lui ont
réclamé par le biais des devins, et présente à chacune un plat de nourriture. Toujours à
leur demande, Zananyene a ensuite et tour à tour acquis pour les déposer près d’eux
tous les objets qui constituent l’équipement du devin : le bracelet en forme de python,
la calebasse-hochet, les icônes divinatoires et le panier des jumeaux. Zananyene s’est
enfin résolu à respecter le jour d’interdit de travail que la tefalapitya lui imposait – le
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
57
jour yalamusa, au cours duquel il s’abstient non seulement de cultiver, mais aussi de se
promener et de parler avec quiconque.
19 Il est cependant un point déterminant sur lequel Zananyene ne lui a jamais cédé.
Comme elle lui demandait depuis toujours de rejoindre le corps des initiés au sandogi,
l’ancien champion de travail agricole ne lui a jamais répondu en d’autres termes que
ceux-ci : « Je préfère que tu me tues. » Le terme sandogi désigne l’institution initiatique
dont la puissance du même nom est au centre et qui, contrairement au poro, recrute
presque exclusivement des femmes, et les recrute par voie d’élection : un ancêtre
utérin ou, plus fréquemment, un génie, « choisit » la petite fille ou la femme adulte que,
parce que celle-ci lui a plu ou, au contraire, déplu, il souhaite voir subir l’initiation au
sandogi. Le refus catégorique de Zananyene d’intégrer l’institution initiatique du sandogi
se comprend sans mal : le statut d’initié au sandogi (sandowi, pl. sandobele) va de pair
avec l’obligation d’observer quotidiennement un nombre considérable de prescriptions
et proscriptions. Parmi ces dernières figure un interdit plus redoutable et redouté que
tous les autres : un interdit de travail agricole. Il est fort probable en effet que le
premier mouvement d’un génie soit d’exiger de celui qu’il a élu de ne plus « se salir
avec la terre » et, partant, de « laisser la souffrance du travail agricole ». Certes, tous les
génies n’ont pas les mêmes exigences, et quelques rares initiés au sandogi sont autorisés
à cultiver sans aucune restriction, si ce n’est celle du jour hebdomadaire de repos que
son yigevOwi, son double protecteur, impose à chaque Sénoufo. D’autres, plus
nombreux, sont autorisés à cultiver dans les rizières, sinon dans la terre « sèche »;
d’autres encore sont autorisés à cultiver avec tel outil, sinon avec tel autre. Mais plus
nombreux encore, amplement majoritaires, sont les initiés au sandogi qui ne sont
autorisés à cultiver à aucun moment, sur aucune terre, avec aucun outil. Aux oreilles
des cultivateurs que sont les Sénoufo, une telle sommation du génie sonne comme une
condamnation sans appel. À celles du champion de travail agricole, elle sonne sans
aucun doute plus amèrement encore. Car c’est alors celui qui excellait dans le travail
agricole qui doit, en raison même de son excellence, y renoncer. C’est un tel
renoncement que Zananyene a, de justesse, pu éviter. Pana, comme la grande majorité
des champions de travail agricole, n’a pas eu la même chance.
20 Celle qui avait finalement été identifiée par les devins comme la tefalapitya perturbait
toujours son sommeil. Alors, Pana a continué de satisfaire ses requêtes successives et
notamment passé commande auprès d’un sculpteur de ses amis d’une statuette la
représentant, et la représentant telle qu’elle voulait être représentée : une jeune femme
sur le dos d’un cheval. Pendant un temps, la jeune démone ne s’est plus manifestée à lui
au cours de son sommeil. Mais elle est bientôt revenue, plus dure et plus tyrannique
que jamais : d’ores et déjà responsable des désagréments que ses rêves causaient à
Pana, elle s’est alors rendue responsable d’infortunes bien plus sérieuses : après qu’un
serpent l’a mordu, Pana a perdu deux doigts de son pied gauche et est resté alité toute
une année au cours de laquelle il a chaque jour pensé mourir le lendemain. C’est alors
que les devins lui ont précisé l’exigence ultime du génie masqué par la tefalapitya : il
devait cesser de cultiver et prendre le statut de sandowi. Pana s’y est très longtemps
refusé. Encore très jeune, il était peu disposé à mener la vie contraignante qui est celle
de l’initié au sandogi. Il regrette néanmoins son choix : eût-il plus rapidement accepté
de « porter » le sandogi et de cesser de cultiver ainsi que le génie le lui demandait, et il
n’aurait pas perdu consécutivement trois épouses et huit enfants. Il a fallu un dernier
événement pour que Pana se rende à l’évidence : alors qu’il cultivait, il a vu un petit
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
58
personnage rouge à ses côtés. Quand il s’est aperçu que lui seul le voyait, il a déposé sa
houe et ne l’a plus jamais reprise.
21 Comme l’avalanche de ses infortunes a cessé dès l’instant où il n’a plus cultivé, Pana
sait aujourd’hui que les devins disaient vrai : un génie abrité par la tefalapitya l’a choisi
« sur le lieu du travail agricole », et en raison de son ardeur au travail agricole. Mais il
sait aussi, comme Zananyene, qu’il doit à ce jeune génie femelle d’avoir dans un
premier temps conforté son statut de tegban. Séduite par son ardeur au travail, elle lui a
tout d’abord apporté son soutien lors des concours qui l’opposaient à d’autres
cultivateurs d’exception : « Au début, tu ne le sais pas. Mais si tu commences à cultiver,
tu n’es jamais rassasié de travail, tu as envie de cultiver, tu ne te fatigues pas. C’est
qu’elle cultive avec toi. » Jusqu’au jour où le même génie qui avait permis à Pana
d’atteindre le sommet de sa gloire a exigé qu’il cesse de cultiver : « Le jeune génie
femelle, c’est lui qui m’a dit de m’asseoir, d’arrêter le travail agricole. Elle n’a plus
voulu que je me salisse avec la terre, elle n’a plus voulu que la saleté reste près d’elle. »
22 Or « laisser la souffrance du travail agricole », ainsi que votre instance électrice vous le
demande, revient à en expérimenter une autre. Au cours de la même consultation
divinatoire où le devin vous apprend qu’un génie souhaite vous voir renoncer à votre
travail et vous « asseoir », il vous apprend également que ce génie souhaite vous voir
accomplir un autre travail : le sien. « Ton génie te dit de t’asseoir pour faire son
travail », « il te dit de prendre ses bagages » : à l’aide de ces différentes formulations, le
devin signifie à l’ancien champion de travail agricole que son génie souhaite le voir
rejoindre le corps des initiés au sandogi et transmettre sa parole à travers la divination.
La souffrance du devin
23 Les Sénoufo Tyebara pratiquent une technique divinatoire combinant des jets d’icônes
et des frappements de main. Les consultations se déroulent dans l’intimité de la maison
miniature dont dispose tout devin pour y abriter les différents objets composant ses
« bagages » d’initié. Lorsqu’il y pénètre, le client a pour premier geste de déposer le
prix de la consultation dans un petit panier prévu à cet effet. Puis il s’assoit aux côtés
du devin, dans le sens opposé. Les premiers mots du devin sont pour inviter les génies
dont il s’apprête à transmettre les paroles à le rejoindre. Quand il a le sentiment que ces
génies ont répondu à son appel et que, installés auprès de lui, ils sont attentifs et
disposés à répondre à ses questions, il procède à un premier lancer de ses icônes
divinatoires. Leur disposition sur le sol doit lui permettre de déterminer,
approximativement au moins, le motif de la venue de son client. Après avoir jeté ses
icônes autant de fois qu’il l’a jugé nécessaire, le devin saisit la main de son client. Il
adresse alors à ses génies une série de questions, auxquelles le mouvement que tendent
à prendre les mains jointes des deux partenaires donnera la réponse : positive si elles
viennent claquer sur la cuisse du devin, négative si elles se balancent au-dessus d’elle.
Au cours de cette étape centrale de la consultation, les réponses que lui apportent ses
génies permettent au devin de préciser les contours de l’infortune de son client,
d’identifier l’instance ou l’individu qui en est à la source et enfin de spécifier son mode
approprié de résolution. C’est seulement dans la troisième phase de la consultation
divinatoire que le client est invité à s’exprimer : ses questions peuvent éventuellement
nécessiter la réitération des lancers d’icônes divinatoires ou des frappements de main.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
59
24 Une fois engagé dans la divination, notre ancien champion de travail agricole souffre
d’une souffrance morale qui lui est familière pour l’avoir tenaillé lors des concours de
travail agricole mais aussi, plus tard, pendant son initiation au sandogi. En effet, tous les
devins appartiennent au corps des sandobele et la plupart d’entre eux ont eu à subir une
initiation moralement éprouvante. Composée de deux étapes principales, celle-ci
s’étend le plus souvent sur un an et demi. Il ne semble pas qu’au cours de ce laps de
temps, le novice ait à traverser des épreuves physiques aussi pénibles que celles des
novices du poro. Plus que son corps, c’est en effet son cœur que les épreuves initiatiques
du sandogi mettent à rude épreuve. Car au contraire des novices de l’initiation au poro,
le futur sandowi accomplit seul un travail dont il n’a jamais la certitude qu’il lui revient,
à lui, de l’accomplir. Il n’est jamais exclu en effet qu’un malveillant qui souhaite la mort
d’une personne force magiquement les devins à lui dire de « porter » le sandogi. Elle le
« porte », mais parce que tel n’était pas son destin, elle meurt. C’est pourquoi les
proches du novice l’observent attentivement tout le temps que dure son initiation, et
tout particulièrement au terme de la première semaine d’initiation au cours de laquelle
le novice « attache » le sandogi : si les devins ont réellement dit la vérité en affirmant
qu’il était élu, il doit avoir pris du poids. Quoi qu’il en soit, il n’est plus temps de revenir
en arrière : le sandogi est d’ores et déjà « soulevé ». La dernière étape de l’initiation,
intitulée « habiller le sandogi » comprend elle aussi son moment de vérité. De même que
« attacher le sandogi », elle s’étend sur une semaine; mais contrairement à elle, elle a
lieu au cours de la saison pluvieuse. Le novice est, avant toute chose, rasé une dernière
fois. Il est ensuite conduit en brousse où il lui est ordonné de prendre le tOriwi, un objet
connu des seuls initiés. Le temps qu’il lui faut pour trouver l’objet dissimulé est
inversement proportionnel au temps qu’il lui reste à vivre. Il se peut aussi qu’il le
cherche en vain : le sandogi qu’il a pourtant d’ores et déjà attaché n’était donc en réalité
pas le sien, et il le tuera sans doute prochainement. Il reste que les sandobele ne rentrent
jamais de brousse sans un chant à la bouche qui affirme avec conviction que « notre
enfant va vieillir, notre enfant va vivre ». Ainsi, l’initiation au sandogi se présente
comme une construction laborieuse de la certitude que, puisque le sandogi que l’on
« dépose » sur le novice est bien celui qu’il devait porter, il ne va pas le tuer 5.
25 Et encore le doute poursuit-il le sandowi bien au-delà de son initiation : tous les
membres de son entourage ne verront pas d’un bon œil sa dispense de travail agricole,
et il est même probable que quelques-uns l’interprètent comme de la paresse. C’est
d’ailleurs pour cette raison que les sandobele, quitte à « porter » un sandogi, préfèrent
« porter » celui que l’on trouve « sur le lieu du travail agricole ». Car c’est là la manière
la plus noble de le trouver, ou tout au moins celle qui éveille le moins la suspicion, ainsi
que l’explique Pana : « Ceux qui le trouvent ailleurs que dans le travail agricole, nous
les appelons paresseux. Car si quelqu’un ne veut pas cultiver, il ment et dit qu’un génie
s’est collé à lui. » Et c’est encore pour cette raison que les sandobele préfèrent que le
« travail » de leur génie ne consiste pas seulement à respecter une suite d’interdits,
mais comprenne également une prescription, celle de pratiquer la divination. Car au
sandowi est alors donné la possibilité d’exercer un nouveau travail appréhendé par tous
comme tel. Or si tous les sandobele ne sont pas devins, tous ceux qui le sont devenus en
tant que champions de travail agricole sont sommés par leur génie de transmettre sa
parole.
26 Mais une fois devin, l’incertitude continue de tenailler l’ancien champion de travail
agricole. Car l’une des plus grandes souffrances du devin est d’ignorer si, en
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
60
transmettant les paroles de ses génies, il dit la vérité. Simple médiateur, le devin
dépend de ses génies pour identifier correctement l’infortune de son client, pour lui en
proposer une interprétation juste et pour prescrire un mode de résolution approprié.
Une telle incertitude quant à la validité des réponses que ses génies donnent à ses
questions est à la source d’une profonde souffrance morale. Non qu’il puisse être jugé
coupable de « mensonges » qui ne sont pas les siens, mais qu’il puisse pâtir des
« mensonges » de ses génies. Car si les devins ne jouissent pas tous de la même
réputation, les devins réputés ne sont jamais assurés de pouvoir maintenir leur
renommée : « Ne me faites pas honte, n’abaissez pas ma tête avec vos mensonges. » Il
n’est pas question d’autre chose que de cette douloureuse incertitude dans cette prière
qui, au début d’une nouvelle saison pluvieuse, accompagnait un don sacrificiel de Pana
à son génie :
Tu me dis de donner un mouton, génie.
Au moment de ma jeunesse, tu m’avais choisi.
Je te dis de prendre la parole et de la donner aux gens de Sandope, qu’ils la
prennent et la donnent aux gens de GbE’ElO’O, qu’ils la prennent et la donnent aux
gens de Kondo, qu’ils la prennent et la donnent à mon père.
Tu dis que je n’ai pas accepté de prendre ton travail, que c’est pourquoi tu as
empêché ma réussite.
Je dis que je te demande pardon, le jour comme la nuit.
Je te dis de trouver quelque chose à me donner.
Donne-moi la santé, donne-moi le plat et la sauce, donne-moi un lieu où manger.
Le problème auquel je songe au fond de moi, mets-le dans ma main.
Ainsi que tu m’as dit de m’asseoir, je me suis arrêté pour m’asseoir.
Laisse les gens se regrouper, fais que le monde entier connaisse mon nom.
Que l’on dise : « Si tu vas chez Pana et qu’il ramasse du sable pour te le donner, cela
va faire de ta vie une réussite. »
Si tu entends qu’un génie a surpris une personne, il est son yigevOwi.
Si un homme ou une femme dit : « Je vais chez Pana pour faire du mensonge. »
Génie, si tu es vrai, laisse que je le sache, laisse que je connaisse cette personne.
C’est ta bouche qui m’a dit de m’asseoir, et je dis que j’ai accepté de m’asseoir.
Etre assis ne parle pas, c’est ce qui est derrière qui parle.
Tu avais dit que je te plaisais et tu m’avais choisi.
Je te dis de laisser les gens venir vers moi à tout moment.
Que les femmes viennent, que les hommes viennent.
Je suis assis, je ne cultive pas, et je te dis de laisser les gens me connaître.
Si ta personne doit mourir sans un [bon] nom, ce n’est pas la peine.
Les bagages que tu as chargés sur moi, ce ne sont pas les miens, ils restent les tiens.
C’est toi qui vas arracher la tête de ta faiblesse.
Si une personne ne me connaît pas, tu vas entendre de sa part : « Suis-je du genre
du génie de Pana, un génie de beaucoup de problèmes, il dit de donner une poule,
un bœuf, un mouton, il les tue et les mange parce qu’il a envie de manger de la
viande, mais il ne fait rien de bon. »
Plutôt qu’elle ne m’insulte, c’est toi que la personne insulte.
Si une femme se lève, si un homme se lève en disant « la tête de Pana », qu’elle se
perde.
Si une personne dit que je ne lui plais pas, permets que je la dépasse en marchant
dans la fraîcheur de son eau.
Si une personne éternue, elle ne vaut pas un génie, et je dis que je t’ai donné ma
tête.
Permets que les femmes le sachent, permets que les hommes le sachent.
Voici le mouton de la rentrée de la saison pluvieuse.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
61
27 Mais comme le champion de travail agricole qu’il était autrefois, le devin souffre
également d’une souffrance inattendue. Car pratiquer la divination est un véritable
« travail », et un travail comparable au travail agricole. De sorte que contre toute
attente, les Sénoufo imputent au devin une souffrance physique à la mesure de sa
souffrance morale et semblable à celle du cultivateur. Tout comme le cultivateur
abaissé sur son sillon, le devin a « mal au corps ». Tout comme lui, il travaille « avec les
mains », et il les « chauffe ». Tout comme lui, il « frappe », et frappe non pas la terre,
mais son propre corps : là où il frappe, le sang « se coagule » de sorte que la peau
devient noire et dure6. « Frapper avec la main » est d’ailleurs si douloureux que ses
génies ont récemment permis au vieux Pana d’y renoncer.
28 « Taper avec la main » serait cependant moins éprouvant si le devin sénoufo n’était pas
incité à frapper si fort. Quand, en effet, un simple frappement de main du devin contre
sa cuisse indique une réponse positive du génie, un puissant et retentissant frappement
de main du devin contre sa cuisse indique une réponse sans nul doute positive du génie.
Du devin réputé pour la constante véracité de ses dires, les Sénoufo diront qu’il devine
« avec force ». Tout se passe ainsi comme si l’effort et la souffrance investis par le devin
dans ses gestes investissaient à leur tour ses paroles d’authenticité, et soulageaient du
même coup sa souffrance morale.
29 Le parcours biographique du champion de travail agricole est celui d’un être
d’exception qui n’en est jamais quitte avec la souffrance. En effet, les Sénoufo imputent
une souffrance immense à celui qui excelle dans le champ du travail agricole avant
d’exceller dans celui de la divination. Mais cette souffrance, qu’elle conditionne
l’excellence du cultivateur ou celle du devin, est toujours surprenante. Car contre toute
attente, c’est une souffrance plus morale que physique qui est imputée au tegban, et une
souffrance aussi physique que morale qui est imputé au devin. Tout se passe en effet
comme si les Sénoufo complétaient la souffrance de leurs êtres d’exception en la
nourrissant de la dimension tantôt morale et tantôt physique qui lui fait le plus défaut.
Avant que de la situer à la source de l’excellence, les Sénoufo façonnent une souffrance
plénière.
30 Prenons garde cependant que cette souffrance plénière n’est pas une souffrance
augmentée. Les Sénoufo, certes, valorisent la souffrance, mais ils la valorisent en tant
qu’elle comprend en elle-même son propre soulagement. Et s’ils lui apportent un
complément, ce n’est en aucun cas dans le but de l’intensifier, mais dans celui de
l’édifier telle qu’ils la valorisent. C’est ainsi que la souffrance morale du champion de
travail agricole ne se surajoute pas à sa souffrance physique, pas plus que la souffrance
physique du devin ne se surajoute à sa souffrance morale. Bien au contraire, la
souffrance morale du champion soulage sa souffrance physique, quand la souffrance
physique du devin atténue sa souffrance morale. De tant souffrir au fond de lui-même,
le tegban en oublie de souffrir « sur son corps ». A l’inverse, de souffrir physiquement
donne au devin l’assurance de transmettre la vérité à ses clients, et adoucit son
tourment.
31 C’est ainsi bel et bien une souffrance entière que les Sénoufo situent à la source de
l’excellence du champion de travail agricole et du devin, mais c’est une souffrance qui,
parce qu’elle est entière, permet à celui qui l’expérimente d’y trouver les forces de la
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
62
surmonter. Un peu comme Saint Jean de la Croix pour qui, selon Alain Cugno 7, « la
mortification n’est pas un moyen pour augmenter en [s]oi la souffrance, mais au
contraire pour la diminuer, en faisant sentir à [s]on corps la douleur qui est tenable, par
opposition à la souffrance qui est intenable ». « De celui qui mord son poing parce qu’il
souffre trop », poursuit Alain Cugno, « il serait assez inexact de prétendre qu’il cherche
à augmenter sa souffrance. » Il n’en va pas autrement pour les Sénoufo Tyebara, qui
imputent à leurs êtres d’exception, dans les champs successifs où ils excellent – le
travail agricole puis la divination – une douleur tenable, construite de toutes pièces, à
même de soulager la souffrance véritable, celle, physique, du travail agricole et celle,
morale, du travail divinatoire. De sorte que si les Sénoufo ne conçoivent pas
d’excellence sans souffrance, ils ne conçoivent pas non plus de souffrance sans, en son
sein précisément, le moyen de la surmonter.
BIBLIOGRAPHIE
Cugno, A.
1972 Saint Jean de la Croix, Paris, Fayard.
Lemaire, M.
2000 « Chants de l’agôn, chants du labeur. Travail, musique et rivalité en pays sénoufo (Côte
d’Ivoire) », Journal des Africanistes 69 (2), pp. 35-65.
Nietzsche, F.
1992 [1870] « La joute chez Homère », in La philosophie à l’époque tragique des Grecs, Paris,
Gallimard, pp. 196-204.
Zempléni, A.
1993 « L’invisible et le dissimulé. Du statut religieux des entités initiatiques », Gradhiva 14, pp.
3-14.
1996 « Savoir taire. Du secret et de l’intrusion ethnologique dans la vie des autres », Gradhiva 20,
pp. 23-42.
NOTES
1. Deux articles d’Andras Zempléni (1993 et 1996) abordent la question de la souffrance
initiatique et de sa valorisation par les Sénoufo.
2. Les « chants de xylophones pour les cultivateurs à la houe » ont fait l’objet d’un précédent
article dont je reprends ça et là quelques formulations (cf. Lemaire, 2000).
3. Cette statuette n’a pas toujours revêtu la même forme au fil du temps. Il semble en effet qu’à la
mode de « la jeune fille des cultivateurs à la houe » ait succédé celle de « l’oiseau », un aigle dans
certains villages, un vautour dans d’autres.
4. Nietzsche, 1992, pp. 200-201.
5. Il semble que certains des sandobele qui le sont devenus au titre d’anciens champions de travail
agricole échappent à l’initiation qu’on vient de décrire. En tant qu’hommes en effet, ils ont déjà
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
63
subi l’initiation au poro. Or si les deux initiations ne sont pas incompatibles, elles ont leurs
interdits propres : leur cumul fait de la vie de l’individu doublement initié une vie truffée de
proscriptions et doublement exposée au risque de les transgresser.
6. Les Sénoufo aiment à rappeler que, comme le cultivateur également, le devin manipule, en
guise d’icône divinatoire déterminante entre toutes, une houe miniaturisée.
7. Cugno, 1972, p. 234.
RÉSUMÉS
Aux vainqueurs de leurs concours de travail agricole, les Sénoufo Tyebara imputent une
souffrance morale à même de leur faire oublier toute souffrance physique. Cette profonde
souffrance préfigure celle avec laquelle ils devront composer tout leur vie durant. Car le parcours
biographique des champions de travail agricole est un parcours semé d’infortunes, au terme
duquel ils sont contraints de renoncer au travail agricole pour pratiquer la divination. Une fois
devins, ils expérimentent encore une nouvelle souffrance dont la dimension physique vient
soulager la dimension morale. Ainsi, les Sénoufo valorisent une souffrance plénière, dont les
deux dimensions, physique et morale, sont nécessairement réunies pour pouvoir venir au secours
l’une de l’autre.
The Senufo Tyebara ascribe to the winners of farm labor contests (for the yam harvest) a moral
suffering capable of making them forget physical aches and pains. This deeply felt suffering
prefigures the suffering with which they must cope throughout life. The biography of a farm
champion is an itinerary marked with misfortunes. At its end, he is forced to give up farm labor
in order to practice divination. Once a diviner, he experiences a new form of suffering in which
the physical dimension brings relief to the moral dimension. The Senufo thus value a full-fledged
suffering of which the two dimensions, physical and moral, are necessarily brought together in
order to relieve each other.
INDEX
Population Sénoufo
Mots-clés : souffrance, travail agricole, divination
Index géographique : Côte d’Ivoire
Keywords : suffering, farm labor, divination, Senufo, Ivory Coast
AUTEUR
MARIANNE LEMAIRE
Chargée de recherche au CNRS. Centre d’études des mondes africains (CEMAf), CNRS/Université
de Paris 1/Université d’Aix-Marseille 1/EPHE
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
64
Souffrance, compétence et
résilience
Le cas des Témoins de Jéhovah
Suffering, competence and resilience : The Jehovah’s Witnesses
Régis Dericquebourg
Je remercie Claude Lemoine, professeur de psychologie sociale et du travail pour son dialogue à
propos de l’article.
1 La réflexion développée ici se fonde sur ce qui est depuis longtemps notre champ de
recherche : les groupes religieux minoritaires. Le cas examiné est celui des Témoins de
Jéhovah, qui s’inscrit naturellement dans la problématique développée dans ce volume
puisqu’ils insistent sur les souffrances endurées au cours de leur histoire. Nous ne nous
en sommes cependant pas tenu à ce premier examen. En effet, le lien que les Témoins
de Jéhovah font entre leurs souffrances et les compétences qu’elles leur auraient
permis de gagner repose sur des présupposés implicites qu’il nous a paru intéressant de
considérer en eux-mêmes. Pour cela, nous avons réalisé auprès d’échantillons
d’étudiants une série de tests visant à mesurer jusqu’à quel point ces présupposés
étaient partagés. Or à notre surprise, nous avons constaté que ces étudiants ne les
partageaient pas, mais qu’ils en avaient d’autres, les amenant à faire un lien, d’une tout
autre nature, entre souffrance et compétence.
Exposé du problème
2 La souffrance est d’abord un phénomène physique, émotionnel et cognitif individuel.
Elle est aussi un phénomène social tant par la manière dont elle est considérée (fait
biologique, punition divine) et traitée (médecine officielle, traitements psychologiques,
invocations, remèdes de rebouteux, cure de medecine-men) que par la manière dont elle
s’exprime (vocabulaire, catégories du langage) dans les différentes cultures et sous-
cultures. Elle est sociale, dans la mesure où elle est parfois provoquée par des
phénomènes collectifs tels que l’ostracisme, la discrimination, la sanction méritée ou
injuste, par des rituels, par des contraintes que la société impose au corps ou à la
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
65
conscience (telles que la formation d’une conscience morale stricte, cause de tourments
et de culpabilité obsédante chez certains). La souffrance est sociale encore en ce qu’elle
peut trouver son origine dans des formes de domination politiques (tortures...) et
organisationnelles comme l’a montré Déjours1.
3 La souffrance produit des effets sociaux. De multiples organisations humanitaires ont
été fondées pour informer le public de souffrances subies par des peuples ou des
groupements humains, pour tenter d’y remédier, voire pour exiger des gouvernements
qu’ils en éradiquent les causes. Enfin, socialement, la souffrance subie par un peuple ou
un groupe appartient à la mémoire collective et modifie parfois les conduites à leur
égard. Elle peut aussi provoquer des révoltes ou des révolutions.
4 Comme phénomène social, elle a suscité les réflexions des sociologues et, dans le
domaine qui nous occupe, des sociologues des religions. Ainsi, pour Max Weber :
1) La souffrance a été considérée comme le symptôme de la haine divine et d’une
culpabilité secrète (trouvant probablement sa cause dans une offense à Dieu). En ce cas,
elle prend une valeur exclusivement négative (la faute), ce qui indique que l’homme
souhaite que le bonheur qu’il atteint soit mérité et légitime (il n’a jamais commis de
fautes) ; il revendique un droit au bonheur pour peu qu’il ne fasse rien pour subir la
haine de Dieu. La religion y répond par une théodicée du bonheur 2. Le dépassement de
la souffrance devient une finalité de la religion de salut dans la mesure où elle propose
une éthique permettant à l’homme d’écarter la souffrance ou de s’en libérer 3.
2) Ce point de vue s’inverse avec la transfiguration religieuse de la souffrance. On passe
de la souffrance collective d’un peuple puni à la prise en compte de la souffrance
individuelle par la religion. Au plan magique, est apparue l’idée selon laquelle la
souffrance provoquée par des automortifications conduit à l’acquisition de forces
surhumaines de type magique. Des personnages peu ordinaires capables de délivrer
l’homme de sa souffrance (les mystagogues) deviennent des recours 4. En somme, la
souffrance volontaire obtenue par l’automortification et les mortifications de
l’abstinence et de la prière produit des états charismatiques 5.
3) La souffrance crée du lien social6 car des communautés se constituent sur la base
d’une souffrance commune, celle causée par des persécutions actuelles ou conservées
dans la mémoire collective et celle endurée par les martyrs.
4) La souffrance pose le problème du sens de la vie aux religions de salut. Les réponses
apportées à l’existence de la souffrance sont historiquement différentes. En un premier
temps7 des religions, le culte est avant tout communautaire. On intercède auprès des
dieux pour obtenir des avantages collectifs : la pluie, la victoire sur l’ennemi, du gibier
abondant. L’individu confie alors sa souffrance à des personnages en marge tels que les
sorciers, les magiciens, les mystagogues, dont les succès assurent la notoriété du dieu
qu’ils invoquent. Il se crée autour d’eux des groupements communautaires consacrés à
la souffrance individuelle et à sa délivrance. La cure d’âme est née. Dans les religions,
elle devient le privilège des prêtres. Ceux-ci peuvent déterminer les causes de la
souffrance (lors de la confession des péchés) et recommander des conduites
susceptibles de les éliminer. Un pas supplémentaire a été franchi lorsque s’est
développée une religiosité du Sauveur qui présupposait un mythe libérateur c’est-à-
dire une conception du monde où la souffrance est centrale. Chez les Juifs, la souffrance
d’un peuple fut d’abord placée au centre des espérances religieuses de délivrance.
Toutefois, le Sauveur ne pouvait garantir le salut de chaque individu qui s’adressait à
lui. Alors, presque toujours, les espérances de salut ont donné naissance à quelques
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
66
formes de « théodicée de la souffrance » où cette dernière devenait positive, ce qu’elle
n’était pas – on l’a dit plus haut – à l’origine8. Il s’agit d’expliquer la souffrance injuste
et imméritée comme Jean Chrysostome l’a fait9. Ceci n’empêche pas le recours à des
voies annexes de cessation de la souffrance : quand les promesses du Sauveur ou du
prophète ne répondaient pas suffisamment aux besoins de personnes socialement
dévalorisées, une religiosité secondaire de salut s’est développée à l’ombre de la
doctrine officielle (dévotions populaires ?).
5) Par ailleurs, dans Hindouisme et bouddhisme, Max Weber relève un autre mode de
rapport religieux à la souffrance. Ces religions proposent des ascèses qui procurent une
nouvelle compréhension du monde, via l’illumination, où l’on s’affranchit
définitivement de la souffrance10.
5 Dans ce relevé des considérations wébériennes sur la souffrance, deux idées-force
apparaissent : La souffrance est créatrice de lien social et la souffrance peut produire des états
charismatiques, c’est-à-dire des états reconnus comme non ordinaires par une
communauté d’individus, producteurs d’un don manifestant une virtuosité particulière.
Les religiosités asiatiques procèdent d’une manière inverse puisque le virtuose est celui
qui réussit dans la voie de l’extinction de la souffrance en atteignant l’illumination.
Dans les deux cas, la souffrance produit une virtuosité religieuse qui est une
compétence particulière. Mais peut-on aller plus loin et se demander si des
persécutions subies peuvent constituer un critère de compétence chez un groupe
religieux ? Nous pensons aux Témoins de Jéhovah, qui rappellent les souffrances qu’ils
ont endurées au moment où ils sont controversés dans la société française.
Les Témoins de Jéhovah : souffrance et volonté de
reconnaissance religieuse
6 Les Témoins de Jéhovah ont toujours présenté dans leurs ouvrages les persécutions
subies, mais depuis une dizaine d’années, ils les évoquent plus intensément. En France
surtout, car depuis la montée en puissance de la lutte antisecte, d’abord associative
(ADFI, CCMM11...) puis relayée au plan gouvernemental (Rapport Vivien, Mission
interministérielle de lutte contre les sectes, loi About-Picard), ils ont été mis en cause à
propos de l’éducation de leurs enfants, à propos du refus des transfusions sanguines, à
propos de leur insoumission à l’armée12. Un redressement fiscal très lourd leur a été
signifié13 car, n’ayant pas la pleine reconnaissance comme association cultuelle, ils ne
peuvent pas bénéficier de la capacité à recevoir des dons et des legs (loi de 1905-1907).
Par son importance, cette sanction fiscale pourrait mettre en cause leur présence dans
notre pays. L’association cultuelle des Témoins de Jéhovah a réagi sur deux plans : un
combat juridique pour bénéficier des mêmes avantages que les Églises établies 14 et un
appel à l’opinion publique pour contrer les affres subies au plan institutionnel mais
aussi au plan individuel car des fidèles ont été inquiétés dans leur vie professionnelle
ou privée en raison d’une appartenance religieuse devenue controversée.
7 Au plan juridique, ils ont demandé le statut de culte reconnu. Pour cela, ils ont exigé les
bénéfices que procure celui-ci. Ils ont refusé de payer les taxes foncières dont sont
exonérées les grandes confessions, ce qu’ils n’avaient jamais fait jusque-là puisque leur
statut légal leur importait peu. Ils ont plaidé leur cause avec succès devant les
tribunaux administratifs et devant le Conseil d’État. Toutefois, le bureau des cultes n’en
n’a pas tiré toutes les conséquences, à savoir leur accorder le statut plénier de culte
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
67
reconnu. Comme l’association cultuelle des Témoins de Jéhovah a toujours réussi à
exister sans exonération fiscale, on peut se demander si ce qu’ils recherchent en
revendiquant ce statut n’est pas en fait une reconnaissance comme « véritable
religion ». Le statut que le bureau des cultes est susceptible d’accorder n’a pas en
principe une telle valeur puisque l’État se prononce sans se préoccuper de la valeur des
croyances, mais il a bel et bien une valeur symbolique puisqu’il permet à l’association
qui l’obtient d’intégrer le cercle très fermé où figurent déjà les grandes confessions. Ce
statut n’est pas négligeable, comme on l’a vu dans l’affaire d’une Église Évangélique non
reconnue, pour laquelle l’État a demandé l’avis de la Fédération protestante de France,
interlocuteur reconnu.
8 Au plan public, l’élément majeur de l’action des Témoins de Jéhovah a consisté à
rappeler leurs souffrances passées. Ils ont fait circuler deux cassettes vidéo : Les
triangles violets (1996) et La fermeté des Témoins de Jéhovah face à la persécution nazie (1997).
Dans cette dernière, dix historiens européens et américains évoquent les souffrances
des Témoins sous le troisième Reich à côté d’une vingtaine de survivants des camps de
concentration. Par ailleurs, deux ouvrages ont été consacrés à leur période noire : The
Spirit and the Sword (texte et images d’une conférence donnée le 29 septembre 1994 au
Musée de l’Holocauste à Washington), et Les Témoins de Jéhovah face à Hitler 15. Enfin, le
Cercle européen des Témoins de Jéhovah anciens déportés et internés a organisé en
France une exposition itinérante sur la déportation des fidèles jéhovistes pendant la
seconde guerre mondiale.
9 Ainsi, au moment où ils sont controversés, les Témoins de Jéhovah rappellent avec plus
de force les persécutions subies. De cette manière, ils s’inscrivent dans la lignée des
groupes martyrisés (premiers chrétiens, juifs, protestants16). La même démarche a été
faite par les homosexuels au moment de « la sortie du placard », c’est-à-dire quand ils
ont commencé à se donner une visibilité et à revendiquer la même considération que
les hétérosexuels. Cette époque a été marquée par la publication d’ouvrages décrivant
l’ostracisation des homosexuels dans l’histoire et en particulier le sort des « triangles
roses » pendant la seconde guerre mondiale.
10 Les Témoins ne s’arrêtent pas aux affres de la Seconde Guerre mondiale. Le chapitre 29
de leur historique17 est une mise en perspective de toutes les autres persécutions
subies, qu’on peut lire comme un récit des souffrances endurées à cause de leur foi.
Certes, ils l’avaient déjà fait précédemment18 mais le récit de leurs vicissitudes était
moins étoffé. Toutefois, on y lisait déjà que le Christ était le premier Témoin de Jéhovah
(généalogie revendiquée) et que le Jéhovisme endurait depuis ses débuts la persécution
des premiers Chrétiens. Dans l’interprétation que les Témoins donnent de leur
souffrance, celle-ci apparaît comme :
• sublimée par la lutte contre le totalitarisme et pour les libertés religieuses. Ils illustrent cet
argument par une citation de l’historienne Christine King19 : « Les témoins de Jéhovah
lançaient un défi au concept totalitaire de cette nouvelle société, et ce défi, qui s’affirmait de
jour en jour, dérangeait les architectes de l’ordre nouveau. » La thèse des Témoins de
Jéhovah défenseurs des libertés fondamentales a également été développée par Gary
Botting20 et par James Penton 21, tous deux universitaires jéhovistes au moment de la
parution de leurs ouvrages ;
• voulue par Dieu. Pour les Témoins de Jéhovah, la Watchtower Society 22 est le canal prévu et
utilisé par Dieu pour répandre la vérité dans le monde. Ils affirment que « le Seigneur peut
susciter des Témoins dans n’importe quel pays pour tenir bien haut l’étendard de la vérité et
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
68
faire connaître le nom de Jéhovah »23. Le « n’importe quel pays » renvoie aux nations qui les
ont persécutés ;
• transcendée par une annonce prophétique. Les souffrances qu’ils ont endurées ne sont pas
sociologiquement interprétées en termes d’hostilité envers les non-conformismes religieux,
envers des pratiques sociales désapprouvées, envers une protestation socio-religieuse. Pour
eux, elles ont été prophétisées par Jésus. Nous lisons dans leur historique qu’au cours de la
dernière soirée que Jésus a passée avec ses apôtres avant de mourir, il leur a rappelé ceci :
« Un esclave n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi. S’ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Mais ils
feront tout cela à cause de mon nom » (Matthieu 24, 9)24. Ainsi la souffrance des Témoins de
Jéhovah est transcendée par une annonce prophétique et elle reçoit une plus-value
d’autorité dans la mesure où elle est identifiée à la souffrance du Christ ;
• légitimée par une cosmogonie et une éthique. Les Témoins se disent persécutés parce qu’ils
représentent une partie du cosmos : celle qui est sous l’emprise de Dieu et donc du Bien, haïe
par la partie du monde sous l’emprise de Satan et donc du Mal. Ils affirment : « Depuis
longtemps, les publications de la Société Watchtower montrent que le premier livre de la
Bible prédit dans un langage symbolique l’inimitié ou la haine que Satan, le Diable et ceux
qu’il domine éprouvent à l’égard de l’organisation céleste de Jéhovah et de ses représentants
sur la terre » (Gen. 3, 15 ; Jean 8, 33-44 ; Révél. 12, 9-17), à quoi ils ajoutent : « Il n’existe que
deux organisations principales : celle de Jéhovah et celle de Satan » 25 ;
• supportée avec une force peu commune. Les Témoins insistent sur le fait que leurs
croyances les ont aidés à surmonter leurs souffrances, en ces termes par exemple : « Si les
Témoins ont pu faire preuve de courage et de persévérance, c’est notamment parce qu’ils
étaient bien nourris spirituellement »26. Ils rappellent que dans les camps nazis, ils
pouvaient être libérés sur le champ s’ils signaient un acte de renonciation. Pour les Témoins,
le faible nombre d’apostasies exprime une acceptation volontaire de la souffrance au profit
de la vérité car ils s’identifient aux anges de Dieu : « La Bible dit que les anges de Dieu
joueraient un rôle capital dans ce domaine. C’est pourquoi la bonne nouvelle du royaume se
propagerait dans le monde comme une sonnerie de trompette d’origine supra-humaine » 27.
Pour eux, le fait que « dès 1935, leur message ait touché 149 pays au Nord et au Sud, à l’Est et
à l’Ouest, d’une extrémité de la terre à l’autre »28 en constitue la preuve. Il n’est donc pas
étonnant qu’ils aient intitulé « Fermeté » une de leurs cassettes opposant leur « ferme
conviction » à celle des nazis. En ce sens, ils citent à l’appui de leur thèse la phrase de
Christine King : « les Témoins étaient assurés de la fidélité totale et inflexible de leurs
membres, et ce jusqu’à la mort »29.
• socialement reconnue. Les Témoins ne manquent pas de citer des témoignages
reconnaissant leur caractère peu commun, comme la lettre de Geneviève De Gaulle (nièce du
général De Gaulle) parlant de sa déportation au camp de Ravensbrück où l’on comptait 500
Témoins de Jéhovah féminines : « J’ai pour elles une véritable admiration. Elles
appartenaient à différentes nationalités : allemandes, polonaises, russes ou tchèques et ont
subi pour leurs croyances de très grandes souffrances [...]. Toutes faisaient preuve d’un très
grand courage et finissaient par en imposer aux S.S. eux-mêmes. Elles auraient pu être libres
sur le champ si elles avaient renoncé à leur foi. Au contraire, elles ne cessaient de résister,
réussissant à introduire dans le camp des livres et des tracts » 30. Une lettre du même type a
été écrite par Léon Blum. Le courage et la conviction des Témoins ont été remarqués par l’un
de leurs geôliers, Rudolf Hoess, commandant d’Auschwitz, qui a témoigné d’exécutions de
Témoins de Jéhovah refusant d’abjurer leur foi. Il écrit : « C’est ainsi que je me représentais
les premiers martyrs du christianisme, debout dans l’arène en attendant d’être dévorés par
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
69
les bêtes fauves, avec une expression de joie extatique, les yeux levés au ciel, les mains
jointes pour la prière, ces hommes accueillirent la mort. Tous ceux qui avaient assisté à
l’exécution, même les soldats du peloton, étaient profondément émus » 31.
• valorisée par la condition modeste des Témoins de Jéhovah. Ces derniers affirment que,
comme Celse, philosophe romain du IIe siècle qui ironisait sur le fait que des gens modestes
soient prédicateurs de l’Evangile, on reproche à présent aux Témoins d’être des gens
ordinaires dont la position sociale n’en impose à personne 32. En ceci, les Témoins
s’identifient aux premiers chrétiens et aux apôtres de Jésus « eux-mêmes issus de la classe
ouvrière [sic] » et ils subliment leurs souffrances en en faisant celles des couches modestes
de la population espérant une nouvelle dispensation.
• surmontée et triomphante. Le récit des vicissitudes subies par les Témoins de Jéhovah
s’achève par la conclusion que ces derniers ont triomphé de leurs persécuteurs. La
souffrance endurée a été la source de leur victoire : « La persécution brutale et les
connaissances de la guerre totale n’ont pas pu empêcher que, comme prédit, des gens se
soient rassemblés dans une grande maison spirituelle de Jéhovah pour l’adorer (Isaïe, 2,
2-4). » Les dictateurs, les régimes politiques qui les ont fait souffrir ont disparu. Le clergé en
qui ils trouvent le moteur de leur persécution voit son audience faiblir. Ils en concluent
qu’« il est évident qu’il n’appartient à aucun homme, ni à aucun gouvernement d’autoriser la
pratique du culte pur »33.
11 On le voit, le récit des souffrances subies construit un destin de souffrance prophétisé
et victorieusement surmonté grâce à une force peu ordinaire d’« homme de Dieu ». En
reprenant la notion de type d’homme (Menschentyp) qui, chez Weber, désigne les figures
sociales de l’humanité (comme l’homme du gain) que les structures sociales façonnent,
les Témoins apparaîtraient dans une histoire revisitée par le judéo-christianisme
comme des « hommes de la souffrance », celle-ci étant sans cesse renouvelée et
surmontée.
12 En retournant à notre problème, on peut faire l’hypothèse que les Témoins de Jéhovah
rappellent leurs affres et leur victoire sur les persécuteurs pour obtenir la même
légitimité et la même reconnaissance que les premiers chrétiens, lesquels ont perduré
dans leur foi en dépit de leurs persécutions et ont engendré des Églises dont on ne
conteste pas le caractère religieux. Encore faut-il savoir ce qu’est une compétence.
La notion de compétence
13 Pour Claude Lévy-Leboyer, « compétence » est un mot qui s’est répandu récemment
dans le monde du travail34. Aussi est-ce du côté de la psychologie du travail et des
ressources humaines que l’on peut en chercher la définition. L’auteur insiste sur la
difficulté à décrire la compétence d’un salarié et les compétences en général. Ceci
provient de la multiplicité des références, tantôt liées à une tâche, tantôt à une activité
donnée ou encore à un ensemble d’activités, comme c’est le cas pour la compétence
linguistique ou la compétence d’encadrement. Il l’illustre en montrant que les listes de
critères de compétence d’un cadre établies par divers auteurs forment des ensembles
disparates. Par ailleurs, l’acquisition de compétences mobilise des compétences
différentes. Lévy-Leboyer propose sa propre définition : les compétences « constituent
un lien entre d’une part, les missions à accomplir et les comportements mis en jeu pour
ce faire et, d’autre part, les qualités individuelles nécessaires pour se comporter d’une
manière satisfaisante »35. Cette définition des compétences (et non de la compétence)
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
70
prend en compte des facteurs dispositionnels et des conduites évaluées par la
satisfaction du donneur d’ordres. D’une manière générale, on constate un glissement de
la compétence vers les compétences.
14 Pour David Courpasson et Yves Frédéric Livian36, la notion de compétence, dont
l’utilisation est abusive, déconstruit les métiers pour aboutir à des ensembles
professionnels diaphanes et inconsistants (comme les « personnels de contact », le
« personnel du management »). Ces derniers sont des catégorisations sociales
artificielles reposant plus sur la notion d’individualisme que sur la notion de groupes
professionnels qualifiés et reconnus sur la base d’un savoir ou d’une technique acquis,
et qui vont à l’encontre de la revendication d’une définition claire du métier chez les
salariés. L’ergonome Maurice de Montmollin affirme que les compétences
professionnelles sont des « ensembles stabilisés de savoirs et de savoir-faire, de
conduites types, de procédures standard, de types de raisonnement que l’on peut
mettre en œuvre sans apprentissages nouveaux. Les compétences structurent les acquis
de l’histoire personnelle, elles permettent l’anticipation des phénomènes, l’implicite
dans les instructions, la variabilité dans la tâche. Les compétences, cela permet ainsi de
savoir à qui l’on a affaire, sur qui on peut compter pour accomplir telle tâche. On prend
ainsi des risques car personne n’est jamais complètement fiable... »37. Globalement,
l’auteur émet des réserves sur cette notion car le salarié est un « opérateur humain »
dont le savoir-faire se rapporte à une tâche précise, à un poste de travail, à une
rémunération qui l’identifient dans l’entreprise (signification sociale de la
compétence). Dans un autre article38, l’auteur accentue sa réserve. Il refuse la notion de
« compétences génériques » au profit des connaissances et du savoir-faire généré par le
salarié selon les situations. Il illustre son point de vue en prenant l’exemple du pilote
confronté à une difficulté en vol. La personnalité est exclue du champ de l’évaluation
des compétences. En somme, il y aurait des compétences pour mais pas de compétence
en général.
15 Au cours de notre réflexion, nous nous sommes demandé si la souffrance pouvait être
prise en compte dans l’évaluation d’une compétence. Pour cela, nous avons réalisé une
étude auprès d’étudiants en psychologie et, parmi eux, auprès d’une promotion du
diplôme d’études spécialisées en psychologie du travail. Ces étudiants reçoivent un
enseignement sur l’évaluation des compétences et certains la pratiquent déjà pendant
les stages ou dans leur emploi. L’étude que nous avons menée (annexe 2) montre que
les étudiants en psychologie rejettent l’idée selon laquelle « se donner du mal »
(souffrance dans l’emploi) sur un poste de travail est un critère de compétence. En
revanche, l’appel à l’effort est très important dans l’acquisition de la compétence
scolaire, c’est-à-dire dans l’accès à un niveau de connaissance requis et objectivable.
Nous le montrons dans un échantillon de bulletins trimestriels de collégiens (annexe 1).
Or, nous avons constaté empiriquement que l’effort est lié à une souffrance (annexe 3).
Autrement dit, dans l’apprentissage scolaire, qui équivaut à l’acquisition de
compétences, et peut-être dans les autres apprentissages, on valorise une forme de
souffrance-effort. Ceci est en accord avec l’évaluation de l’item d’un autre
questionnaire (annexe 6) administré aux étudiants : « Un travail qui a été fait dans
l’effort doit être mieux apprécié subjectivement qu’un travail fait avec facilité même si
les deux aboutissent à la même note » (le mot « note » laissait entendre qu’il s’agissait
d’un travail scolaire). L’accord avec la proposition est positif de manière
statistiquement significative. Ceci rejoint les résultat d’une expérience de Weiner et
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
71
Kukla où 20 étudiants devaient évaluer des élèves. Les élèves motivés à l’effort, aptes ou
non aptes, sont plus récompensés que les élèves non motivés à l’effort 39, qu’ils soient
aptes ou non aptes. En revanche, la proposition : « L’acquisition de compétences
s’accompagne toujours d’une certaines souffrance » ne reçoit qu’une évaluation
moyenne. Le mot souffrance a sans doute été jugé excessif par les étudiants. Au plan du
groupe, la formule : « Les groupes qui ont souffert ont acquis une compétence dans la
vie » reçoit une note significativement supérieure à la moyenne. Nous concluons qu’il
existe un lien entre l’effort (associé à la souffrance) et l’acquisition de compétences à
l’exception de certaines situations comme le travail salarié.
La compétence en religion
16 Dans les groupes religieux, divers acteurs sociaux peuvent être définis par une
compétence. Celle des clercs consiste à administrer la grâce à travers un système
sacramentel dont leur Église est dépositaire et à faire la « cure d’âme ». S’y ajoutent des
activités plus temporelles telles que l’administration et l’animation d’une assemblée de
fidèles. De nombreuses études sont consacrées aux activités des ecclésiastiques 40. On a
même tenté de faire des études de type ergonomique sur la base de la méthode des
budgets-temps. Toutefois, Thomas Gannon41 fait remarquer que le clergé ne dispose pas
d’un savoir-faire technique applicable à la solution des problèmes empiriques : il
interprète les événements mais ne résout pas les problèmes. On peut ajouter que le
charisme institutionnel dont il est le transmetteur lui est donné et n’est pas éveillé par
une ascèse particulière, surtout douloureuse. Les théologiens officiels des Églises
auxquels on attribue une compétence pour interpréter les textes sacrés ne doivent
celle-ci qu’à l’étude et non à quelque mortification. Seuls les virtuoses qui atteignent
l’extase et éveillent des dons charismatiques à l’aide de mortifications acquièrent une
compétence exceptionnelle grâce à la souffrance. Dans les sectes, il n’existe pas de
qualifications particulières puisque ces mouvements de laïcs n’acceptent pas la notion
de clergé. Les fidèles peuvent prendre des charges, avec l’accord de l’assemblée.
Toutefois, on trouve parfois une spécialisation des fidèles pour occuper des tâches.
17 Dans le jéhovisme, le Collège central de Brooklyn, qui élabore la doctrine en
interprétant les Écritures, rédige les écrits diffusés par le mouvement et administre la
Watchtower Society, constitue un ordre-curie de permanents qui coiffe l’organisation
alors que dans la congrégation locale, la plupart des rôles pris par les « serviteurs »
sont tournants. Naturellement, il peut s’opérer des glissements. Les individus peuvent
être choisis par l’assemblée ou cooptés par les dirigeants en place sur la base d’une
fidélité dans l’engagement religieux, d’une confiance accordée ou d’une « sagesse »
attribuée. Max Weber évoque ceci à propos des sectes protestantes où ni un charisme
de fonction impersonnel, ni une formation théologique (quand elle existe, elle est une
simple condition technique préalable et son absence ne peut être invoquée à l’encontre
du candidat à une charge) ne sont requis pour diriger l’assemblée. La compétence serait
dans ce cas un « charisme de l’état de grâce », succédané du charisme de fonction,
reconnu par les fidèles, et qui a parfois donné lieu à des « certificats de qualification
religieuse » attribués sur la base d’enquêtes. Il n’empêche que pour l’auteur, un
glissement peut s’opérer en direction d’une charge institutionnelle comme dans le
méthodisme où la différence entre les prédicateurs ordonnés et les fidèles a été abolie
puis réintroduite par la création en 1836 d’une ordination formelle permettant de
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
72
donner les sacrements. Ceci a finalement abouti à la formation d’un nouveau clergé 42.
Mais en aucun cas, la souffrance n’intervient dans l’éveil du charisme de l’état de grâce.
18 Au plan collectif, il est encore plus difficile de définir la compétence d’un groupe
religieux car celle-ci renvoie à un modèle idéal de compétence religieuse. Néanmoins,
nous avons tenté de trouver des critères de compétence religieuse auprès d’un
échantillon d’étudiants pour voir si la souffrance du groupe y participait.
Critères empiriques d’une compétence religieuse
19 Nous avons demandé à un échantillon de 101 étudiants en psychologie de choisir dans
une liste de propositions celles qui pourraient caractériser une vraie religion (expression
qui selon nous opérationalise la compétence religieuse dans le contexte de la polémique
actuelle qui oppose les fausses religions aux vraies religions). Nous avons tenté de
traduire la compétence en critères objectifs, c’est-à-dire en termes de conduites et non
en termes d’idéologie ou de doctrine (annexe 4).
20 Les résultats sont a priori surprenants car ils s’éloignent de l’image classique d’une
religion. En effet, le premier critère définitoire d’une vraie religion serait de laisser le
fidèle libre de ne pas croire en Dieu. Les deux items qui viennent ensuite ex-aequo
(assez loin devant « défend les droits de l’homme ») sont « donner un sens à la vie » et
« permet à ses fidèles de surmonter les épreuves de la vie ». La place accordée au
premier de ces deux items rejoint l’enquête d’Antoine Delestre43 montrant l’importance
de la quête de sens chez les étudiants. Quant au second item, il marque l’importance
accordée à une compétence qui sera examinée plus loin : la résilience. L’image de la
vraie religion est plutôt le bouddhisme et certains groupes du Nouvel Âge.
Naturellement, cette représentation est limitée à notre échantillon mais on peut
admettre que des tendances aussi fortes se reflèteraient dans un public plus large.
Discussion
21 Un lien existe entre la souffrance et la compétence mais il n’apparaît pas stable. On le
trouve dans les situations d’apprentissage. Au plan collectif, les étudiants pensent que
les groupes qui ont souffert ont acquis une compétence particulière mais ils évaluent
négativement et de manière significative la proposition selon laquelle un groupe de
croyants ne devient une vraie religion que s’il a été persécuté dans ses débuts. Nous
n’évoquerons pas les propositions concernant la compétence de groupes particuliers
car les compétences soumises dans le questionnaire étaient certainement inadéquates.
En revanche, la capacité qu’une religion donne à ses fidèles de surmonter les épreuves
de la vie (manière euphémisée de nommer les souffrances de l’existence) est considérée
chez les étudiants comme le critère d’une vraie religion et de la validité des croyances.
Une des compétences religieuses serait d’éveiller chez les fidèles une capacité à
surmonter la souffrance. En insistant sur le fait qu’ils triomphent de la persécution et
de l’adversité, les Témoins de Jéhovah montreraient que leur socialisation religieuse
comporte un facteur de résilience.
22 La résilience est tantôt définie comme « la capacité de sortir vainqueur d’une épreuve
qui aurait pu être traumatique avec une force renouvelée – la résilience impliquant
l’adaptation face au danger, le développement normal en dépit des risques et le
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
73
ressaisissement de soi après un traumatisme »44 –, tantôt comme l’aptitude à
fonctionner de façon adaptée et à devenir compétent lorsque des événements de vie
stressants se présentent45. Dans ce cas, elle est considérée comme la capacité de
continuer à se développer et à augmenter ses compétences dans l’adversité. Pour
J.J. Detraux, la résilience est liée à l’acquisition de compétences individuelles qui
permettent de prendre le contrôle, de piloter des actions, de comprendre ce qui nous
arrive et de donner un contenant à un contenu douloureux, pénible. La notion de sens
donné aux événements est déterminante chez cet auteur46. Diane Pelchat, Hélène
Lefebvre, Carole Damiani47 font la même constatation pour le groupe familial lorsqu’il
est confronté à une situation douloureuse telle que la mort d’un enfant. La famille qui
« fait face » se transforme en donnant un sens positif à l’événement au sein d’un
processus de réadaptation. Boris Cyrulnik évoque d’autres facteurs de résilience comme
la sublimation, l’altruisme, l’humour, la rencontre avec des substituts affectifs 48.
23 Bruno Bettelheim utilisa un autre facteur de résilience. La transmission de son
expérience et le témoignage devinrent le fil directeur de sa vie depuis le moment de sa
libération du camp de Buchenwald jusqu’à sa mort49. Globalement, les chercheurs
s’accordent sur le fait qu’on ne peut être résilient tout seul. Ils supposent que les
parents, les groupes sociaux de base enseignent à mobiliser des ressources, la résilience
étant elle-même selon Boris Cyrulnik un apprentissage de la vie, l’éveil de nouvelles
compétences. A propos des Témoins de Jéhovah, Bruno Bettelheim avait fait la
constatation suivante : « Non seulement, ils faisaient preuve d’une dignité et d’un
comportement moral exceptionnels mais ils semblaient protégés contre l’influence du
milieu concentrationnaire qui détruisait rapidement les personnes que mes amis
psychanalystes et moi-même jugions bien intégrées… » Il ajoute : « Les témoins de
Jéhovah étaient détenus en tant qu’objecteurs de conscience. Ils étaient encore moins
affectés par leur détention et conservaient leur intégrité grâce à des convictions
religieuses rigides. Leur seul crime aux yeux des S.S. étant de refuser de porter les
armes, on leur offrait fréquemment de les libérer s’ils accomplissaient leur service
militaire. Ils refusaient toujours »50. De la même façon, Jorge Semprun, étonné de leur
résistance à la souffrance dans les camps, écrit : « Silencieux, dévoués et inusables, ils
attendaient patiemment la fin des maux apocalyptiques qu’avait provoqué la chute de
Satan sur la terre, en 1914, et le millenium qui s’ensuivait, à une date prochaine, encore
qu’indéterminée, ouvrant les portes d’un Monde Nouveau où les élus gouvernaient
depuis leur demeure céleste »51.
24 Revenons maintenant sur les deux volets de cet article. Les Témoins de Jéhovah
détaillent dans leurs publications leurs souffrances passées et actuelles, entendant
montrer qu’ils constituent une vraie religion, puisqu’ils ont connu le même sort que les
premiers chrétiens ou les autres groupes persécutés. Autrement dit, ils présentent leurs
souffrances comme la marque d’une compétence. Or cette vue ne rencontre pas d’écho
dans notre échantillon d’étudiants, lesquels n’établissent pas de lien entre souffrance et
compétence. Par contre, ceux-ci considèrent que l’aptitude à surmonter la souffrance
est une authentique compétence. Il y a un autre point de désaccord entre les
présuppositions implicites des Témoins de Jéhovah et les étudiants de notre
échantillon : pour ceux-ci, la reconnaissance comme « culte reconnu de plein exercice »
ne porte pas à une évaluation favorable. Une telle reconnaissance règlerait peut-être la
situation des Témoins de Jéhovah vis-à-vis de l’administration fiscale, mais elle
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
74
n’améliorerait pas nécessairement leur image dans l’opinion. En revanche, ils ont des
chances d’être entendus sur le point de la souffrance surmontée.
25 Exister encore après tant de persécutions et être plus fort que jamais serait un élément
favorable puisque notre échantillon considère la capacité à mobiliser des ressources
pour surmonter la souffrance comme une compétence religieuse. En un mot, les deux
volets de cette étude font apparaître la prégnance d’une image de la religion-résilience.
C’est certainement là un trait qui justifierait des recherches ultérieures.
Photo et commentaire tirés d’une jaquette de cassette vidéo distribuée par les Témoins de
Jéhovah, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, USA, 1997.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
75
BIBLIOGRAPHIE
Arnaud, M.
2003 La résilience. Surmonter les traumatismes, Paris, Nathan.
Bettelheim, B.
1972 Le cœur conscient, Paris, Robert Laffont.
Botting, G.
1993 Fundamentals freedoms and Jehovah’s Witnesses, Calgary, University of Calgary Press.
Canonici, G.
1998 Les Témoins de Jéhovah face à Hitler, Paris, Albin Michel, Préface de F. Bedarida.
Courpasson, D. & Y.F. Livian
1991 « Le développement récent de la notion de “compétence” », Revue de gestion des ressources
humaines 1, pp. 3-10.
Cyrulnik, B.
1999 Un merveilleux malheur, Paris, Odile Jacob.
Déjours, C.
1998 La souffrance en France, Paris, Seuil.
Delestre, A.
1977 Les religions des étudiants, Paris, L’Harmattan.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
76
Desrumaux, P.
1996 Explications causales et engagement contre ou pro-attitudinal. De l’internalité aux conduites pro-
attitudinales, Thèse de l’Université Charles de Gaulle-Lille.
Detraux, J.-J.
2002 « De la résilience à la bientraitance de l’enfant handicapé et de sa famille ; essai
d’articulation de divers concepts», Pratiques psychologiques 1, pp. 29-40.
Gannon,T. M.
1971 « Priest/Minister: Profession or Not Profession? », Review of Religious Research, pp. 66-79.
Houssier, F.
2002 « Clinique du traumatisme et résilience : regards sur le parcours de B. Betthelheim »,
Pratiques psychologiques 1, pp. 65-73.
King, C.E.
1982 « The Case of the Third Reich », in Eileen Barker (dir.), New religious movements: a perspective
for understanding Society, New York & Toronto, The Edwin Mellen Press, pp. 125-139.
Les Témoins de Jéhovah
1939 Fascisme ou liberté, Brooklyn, Watchtower Bible and Tract Society.
1971 [1959 pour l’édition anglaise] Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins, Brooklyn,
Watchtower Bible and Tract Society.
1993 Les Témoins de Jéhovah, prédicateurs du Royaume de Dieu, Brooklyn, Watchtower Bible and
Tract Society.
Lévy-Leboyer, C.
2004 [1996] La gestion des compétences, Paris, éditions de l’organisation.
Montmollin (de), M.
1993 « L’ergonome, le pilote et la femme du directeur », in J. d’Aubret, P. Gilbert et F. Pigeyre
(dir.), Savoir et pouvoir, les compétences en question, Paris, P.U.F., pp. 205-210.
2001 « La compétence », in J. Leplat et M. de Montmollin (dir.), Les compétences en ergonomie,
Toulouse, Octares, pp. 11-12.
Nowak, E.
1972 Le Chrétien devant la souffrance, étude sur la pensée de Jean Chrysostome, Paris, Beauchesne.
Pelchat, D., H. Lefebvre & C. Damiani
2002 « Deuil, appropriation de compétences. Transformation. » Pratiques Psychologiques 1, pp .
41-52.
Penton, J.
1976 Jehovah’s Witnesses in Canada, Toronto, Macmillan.
Séguy, J.
1982 « Le clergé dans une perspective sociologique. Que faisons-nous de nos classiques ? » in
Prêtres, pasteurs et rabbins dans la société contemporaine, Actes du VI e colloque de sociologie du
protestantisme, Paris, Cerf, pp. 11-85.
Weber, M.
1964 Ethique protestante et esprit du capitalisme, Paris, Plon.
1996 Sociologie de la religion, Paris, Gallimard.
2003 [1921] Hindouisme et Bouddhisme, Paris, Flammarion.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
77
Weiner & Kukla
1970 « An attributional analysis of achievement motivation », Journal of Personality and Social
Psychology 15, 1, 1-20.
Willaime, J.-P.
1989 Profession Pasteur, Genève, Labor et Fides.
Zuber, V. & J. Baubérot
2000 Une haine oubliée, l’antiprotestantisme avant le « pacte laïque » (1870-1905), Paris, Albin Michel.
ANNEXES
Annexe 1 : Souffrance et acquisition de compétences
Pour mieux cerner le rapport entre la compétence et la souffrance, nous nous sommes
intéressé à cette dernière dans l’acquisition des connaissances scolaires par le biais de
l’appel à l’effort. Faire un effort consiste à en « faire plus », c’est-à-dire à se dépasser en
s’imposant un temps de travail supplémentaire pris sur le temps de loisir et de détente,
à s’appliquer, c’est-à-dire à se concentrer davantage sur le travail que sur les autres
activités, chose que l’élève ne fait pas toujours, peut-être en raison de ses limites
personnelles et sociales. Nous avons voulu vérifier empiriquement que l’effort est lié au
déplaisir et à une forme de souffrance.
L’école a pour vocation d’élever les jeunes gens à un niveau de compétence, en
l’occurrence un niveau de connaissance ou de pratique (sport, musique, art) vérifiable
grâce à des épreuves correspondant à une gradation dans les exercices et dans des
épreuves d’évaluation standardisés (test des acquisitions scolaires).
Nous avons rassemblé un échantillon de 15 dossiers d’élèves scolarisés de la 6 e à la 3e
dans un collège public du nord de la France. Nous avons choisi au hasard les dossiers de
cinq élèves « forts » (moyenne calculée allant de 14,70 à 17,90), cinq élèves « moyens »
(moyenne calculée allant de 10,81 à 13,27) et de cinq élèves « faibles » (moyenne
calculée allant de 6,93 à 9,94). Chaque dossier comporte entre sept et douze bulletins
trimestriels selon la durée de la scolarité dans l’établissement.
Chaque bulletin comporte un espace par discipline portant des sous-divisions pour la
moyenne de l’élève, la moyenne de la classe et l’avis de l’enseignant donné selon trois
critères : « connaissances et compétence », « progrès dans le travail et comportement »
et « conseils pour progresser ». Les enseignants ne respectent pas toujours les cases et
préfèrent parfois écrire leurs remarques transversalement en une phrase ou en
plusieurs phrases courtes.
Sur l’ensemble des bulletins, l’appel à l’effort apparaît 308 fois (chiffre absolu donné à
titre indicatif car non comparé au nombre d’autres mots selon une analyse lexicale),
soit pour demander de poursuivre les efforts, soit pour demander d’en faire, soit pour
constater que l’élève en a fait. On trouve une différence de répartition du mot « effort »
puisque son occurrence est la suivante :
Bons élèves : 34 / Élèves moyens : 128 /Élèves faibles : 142.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
78
On retrouve le même ordre de répartition du mot « effort » dans l’appréciation globale
du professeur principal puisque sur l’ensemble des évaluations globales lisibles, le
pourcentage des unités de sens comportant le mot s’établit ainsi :
Bons élèves : 31 % / Élèves moyens : 54 % / Élèves faibles : 58 %.
Chez les forts, le mot « effort » est utilisé pour saluer ce dernier ou pour demander d’en
faire dans une discipline où il n’excelle pas ou tout simplement pour demander de le
poursuivre. L’hypothèse implicite est peut-être que l’élève réussit grâce à ses efforts
plus qu’à son intelligence ou à son appartenance à un milieu social favorable.
L’appel à l’effort apparaît important. Il est un axe de jugement explicite de l’élève. Le
recours à la notion d’effort est encore plus évident lorsqu’on étudie les conseils donnés
par les enseignants pour parvenir à un niveau de compétence requis ou pour le
maintenir. Les bulletins comportent en général deux types de conseils donnés aux
élèves : d’une part des incitations à faire des efforts, à les poursuivre ou à les
intensifier, d’autre part des conseils techniques. Ces derniers portent sur les modes
d’apprentissage (travailler l’écrit, réciter les leçons à quelqu’un, soigner la présentation
des travaux), sur des attitudes (se ressaisir, respecter la volonté de la classe de
travailler, ne pas se laisser distraire, ne pas s’absenter souvent). Nous avons relevé les
nombres d’appel à l’effort et de conseils techniques dans les bulletins à titre de
comparaison.
Appel Conseils
Niveau Total
à l’effort techniques relationnels
240 42
Forts 282
(85,10 %) (49,89 %)
151 152
Moyens 303
(49,83 %) (50,16 %)
180 204
Faibles 384
(46,87 %) (53,16 %)
Total 571 398 969
Il ressort de ce tableau que plus l’élève est faible, plus il reçoit de conseils. Les élèves
forts sont invités à poursuivre l’effort pour maintenir leur niveau de compétence,
tandis que les autres reçoivent plus de conseils techniques pour acquérir la compétence
requise bien que la différence entre les deux types de conseils soit relativement faible ;
et encore, on constate que les conseils techniques recouvrent le plus souvent des appels
tacites à l’effort (approfondissez le travail à la maison, concentrez-vous...) et relèvent
rarement de techniques d’apprentissage. Globalement, l’appel à l’effort est important.
Pour l’ensemble de l’échantillon, il est de 571 (58, 92 %) contre 398 (41,07 %).
L’appel à l’effort, donc à une forme de souffrance (cf. annexe 3), est un axe majeur dans
l’acquisition de connaissances.
Annexe 2 : La souffrance est-elle un critère de compétence dans le travail ?
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
79
Dans un second temps, nous avons voulu savoir si la souffrance dans l’exercice d’une
tâche professionnelle était reconnue comme un critère de compétence. Pour cela, nous
avons proposé à 71 étudiants de psychologie (1re et 2e année, licence, DESS de
psychologie du travail) une liste de compétences appliquées à un travail. La consigne
était de choisir trois critères et de les classer de 1 à 3 selon leur importance. En
attribuant une note 3 au premier choix, 2 au second choix et 1 au troisième choix nous
avons pu pondérer les choix. Nous obtenons donc le nombre de choix pour chaque item
et une note pondérée selon le rang pour chaque item.
Les résultats sont les suivants :
Nbre de Note de Note Note
Item
choix l’item maximale minimale
Maîtrise bien les techniques à son poste de travail 43 104 129 43
A suivi la formation professionnelle nécessaire à la
44 103 132 44
réalisation de la tâche
Suit l’évolution des connaissances dans sa
55 97 165 55
profession
Sait travailler en équipe 30 55 90 30
Se donne beaucoup de mal pour faire de son
15 26 45 15
mieux
N’est jamais débordé par son travail 5 9 15 5
Total 208* 426 624 208
* Il manque 5 choix
On constate que le critère connotant la souffrance, « se donne beaucoup de mal », ne
figure pas parmi les items les plus choisis. Il arrive à l’avant-dernier rang avec 15 choix
notés ensemble 26 (soit en dessous de la moyenne théorique qui est 30). Nous avons
pensé que l’expression « se donne beaucoup de mal » était peut-être excessive et
produisait un rejet. Aussi avons-nous testé la série avec l’item « fait des efforts pour
faire de son mieux » au lieu du précédent mais les résultats ne différent pas sur ce
point.
Interrogés sur ce point lors d’un feed-back, les étudiants du DESS de psychologie du
travail nous ont dit que « c’était normal » puisque quand on sait faire le travail
demandé, on ne se donne pas de mal.
Nous constatons donc que le critère « effort » – une forme de souffrance – est présent
dans l’acquisition des compétences mais qu’une fois celles-ci acquises, la souffrance en
est exclue. Les aspects techniques (savoir et savoir-faire) sont privilégiés dans
l’évaluation.
Annexe 3 : L’effort est-il associé à la souffrance ?
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
80
La réponse à cette question est un préalable à la première étude.
Pour savoir si l’effort réclamé aux élèves par les enseignants est associé à la souffrance,
nous avons proposé une épreuve d’associations de mots à partir du mot inducteur
« effort » à des étudiants en Administration économique et sociale et à la classe d’élèves
qui a fourni notre échantillon de dossiers scolaires. Chez les étudiants, nous avons
demandé dix mots et nous avons retenu les trois premiers, chez les élèves, l’enseignant
a demandé cinq mots, tous retenus dans le traitement. Chez les étudiants nous avons
disposé de 29 listes soit 87 termes que nous avons regroupés en dix catégories.
Nbre de
Catégorie % Connotation
mots
Difficulté (difficile, difficulté, se forcer) 16 18,39 négative
Travail (travail, labeur, études) 18 16,00
Sensations désagréables (sueur, peine épuisement, douleur) 17 19,54 négative
Aptitudes associées (courage, concentration, résistance, capacité,
19 21,83
rigueur, motivation…)
Résultats positifs (progresser...) 5 5,74
Sensations agréables 2 2,29 positive
But à atteindre 2 2,29 positive
La contrainte 3 3,44 négative
Mots positifs (espoir, utile) 2 2,29 positive
Hors catégorie (sport, soleil..) 5 5,74
Total 87 99,93
La somme des pourcentages de catégories négatives (41,37 %) est nettement supérieure
à celle des catégories positives (10,32 %). Chez les étudiants l’effort semble connoté
négativement. Il se situe plus du côté de la contrainte, des sensations désagréables que
du côté des sensations agréables. Il se situe à l’opposé du bien-être et, de ce fait, on peut
le rapprocher de la souffrance.
Chez les élèves de troisième de collège, nous avons obtenu 25 listes formant un total de
110 citations, certaines listes étant incomplètes.
Comme précédemment, nous avons procédé à un regroupement en 10 catégories.
Catégories Nbre de citations % Connotation
Mots exprimant la difficulté 13 11,83 Négative
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
81
Mots exprimant le travail 19 17,27
Sensations désagréables 20 18,08 Négative
Vocabulaire du sport 32 29,09
Aptitudes associées 17 15,45
Mots exprimant le but 1 0,90
Sensations agréables 1 0,90 Positive
Résultats positifs de l’effort 4 3,63 Positive
Mots sans statut 3 2,72
Total 110 99,97
Les élèves de collège ont privilégié le vocabulaire du sport, qui n’est pas présent chez
les étudiants. Cela tient sans doute aux préoccupations de l’âge. Toutefois, la distinction
entre les aspects négatifs de l’effort et les aspects positifs de celui-ci apparaissent
encore : 29,99 % des mots associés à l’effort le situent du côté négatif contre 4,53 % qui
le situent du côté positif. Les mots « souffrance » et « torture » apparaissent même
parmi les associations.
Il ne nous paraît pas utile d’étendre ce test à un échantillon plus grand à cause du
caractère répétitif des inductions d’un mot. La redondance est importante car le stock
de mots induits par un autre mot est limité. Nous pensons avoir montré grâce à ce test
la présence d’un lien entre l’effort, la pénibilité, le « forçage », qui nous semble proche
d’une définition large de la souffrance.
Annexe 4 : Les critères d’une vraie religion (compétence religieuse)
Pour tester le rôle de la souffrance dans la reconnaissance d’une compétence religieuse,
nous avons proposé à 101 étudiants une liste de critères de ce qui pourrait être une
« véritable religion ». Nous avons choisi cette expression pour éviter celle de
compétence religieuse qui n’évoquerait peut-être rien dans l’esprit des personnes
interrogées. Cette expression a pour avantage de renvoyer au vocabulaire que les
médias véhiculent – « fausse religion » opposée à la « vraie religion » – en reprenant les
termes des opposants aux sectes chrétiennes.
Parmi les critères proposés, certains se rapportent à la souffrance (les martyrs, le
soutien psychologique aux personnes en détresse, le fait de surmonter les épreuves de
la vie, la persécution). D’autres portent sur les aspects tangibles (clergé, cérémonies,
lieu de culte, sacralisation des passages de la vie). D’autres encore sur les buts
classiques de la religion (connaissance de Dieu, perfection morale, sens de l’existence,
conversion). D’autres enfin renvoient aux engagements dans le monde : défense des
droits de l’homme, protestation sociale, activités humanitaires. Deux items étaient
atypiques (« liberté laissée aux fidèles de ne pas croire en Dieu » et « développement
des capacités »).
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
82
Les étudiants avaient pour consigne de choisir trois critères caractérisant un
mouvement spirituel comme véritable religion et de les numéroter de 1 à 3 par ordre
d’importance. Une note de 3 pour le premier choix, 2 pour le second choix et 1 pour le
troisième choix permet de pondérer les choix (note de l’item).
Un mouvement spirituel est une véritable religion si :
Nbre de
Item Note
choix
Il a des activités humanitaires 13 23
Il a eu des martyrs à cause de ses croyances 1 1
Il soutient psychologiquement les personnes en détresse 20 52
Il proteste contre certaines pratiques sociales (corruption, injustices sociales,
8 14
société de consommation)
Il défend les droits de l’homme 28 66
Il demande aux hommes de se perfectionner moralement 29 57
Il permet de connaître Dieu 21 48
Il permet à ses fidèles de surmonter les épreuves de la vie 41 94
Il a un clergé 2 5
Il s’efforce de convertir les hommes 6 10
Il a des lieux pour se réunir et prier 20 28
Il a des cérémonies religieuses 8 11
Il aide les hommes à développer leurs capacités. 9 16
Il sacralise les moments importants de la vie (naissance, adolescence, mariage,
20 30
décès)
Il a été persécuté (ou il l’est encore) 1 1
Il laisse à ses fidèles la possibilité de ne pas croire en Dieu 33 97
Il donne un sens à la vie 43 94
On note que la dispersion des choix est grande à cause du nombre de propositions.
Parmi les principaux critères choisis par les étudiants pour qualifier une « vraie
religion », c’est-à-dire pour attribuer une compétence religieuse, on trouve par ordre :
« donner un sens à la vie » (43 choix), « permet à ses fidèles de surmonter les épreuves
de la vie » (41 choix), « laisse à ses fidèles la possibilité de ne pas croire en Dieu » (33
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
83
choix). La souffrance endurée par les fidèles et les martyrs viennent en dernier avec 1
choix chacun.
Les items les mieux notés sont par ordre : la possibilité laissée aux fidèles de ne pas
croire en Dieu (97), puis ex-aequo : « permet à ses fidèles de surmonter les épreuves de
la vie » et « donne un sens à la vie » (94). Beaucoup plus loin derrière arrivent la
défense des droits de l’homme (66), le perfectionnement moral (57) et le soutien
psychologique (52). La persécution et le martyre n’obtiennent qu’un point chacun.
Naturellement, il ne s’agit pas d’un cliché obtenu dans une population globale
représentative des Français, mais d’un coup de sonde. Néanmoins, dans notre
population étudiante, on aperçoit une tendance actuelle : l’image qui se dessine
derrière les critères de « vraie religion » est plutôt celle de religions asiatiques, de
groupes du Nouvel Âge et de religions de guérison : religion sans Dieu avec une voie de
la libération des souffrances et une cosmogonie qui donne un sens à la vie. Quoi qu’il en
soit, nous avons montré l’importance accordée au dépassement des souffrances et à
l’aide psychologique (facteurs de résilience). La souffrance seule n’est pas considérée
comme un critère de compétence.
Annexe 5 : La notion de culte reconnu et l’évaluation d’un mouvement religieux
Nous avons soumis deux questions suivies d’une courte introduction à une population
de 64 étudiants de l’UFR IDIST (documentation) et de psychologie.
En France, l’Etat a le pouvoir de donner à une religion le statut de « culte reconnu ». Ce
statut procure des avantages fiscaux et le droit de recevoir des dons et des héritages.
Tous les mouvements religieux n’en bénéficient pas.
1) Si vous aviez à donner votre opinion sur un groupe religieux, le fait qu’il soit
reconnu par l’Etat aurait-il un effet positif sur celle-ci ? Oui/Non/NSP.
2) Si oui, la reconnaissance par l’Etat signifie-t-elle pour vous que nous avons affaire à
une vraie religion ? Oui/Non/NSP.
Résultats
Première question Oui : 17 Non : 43 NSP : 4 T = 64
Deuxième question Oui : 4 Non : 12 NSP : 1 T = 17
Conclusions
Le fait d’être un culte reconnu ne contribue pas majoritairement à un avis favorable.
Dans le cas où cela contribue à un effet favorable, la reconnaissance n’est pas un
certificat de « vraie religion » (manière d’opérationaliser une compétence religieuse).
Annexe 6
Surpris par les résultats précédents, nous avons voulu vérifier une seconde fois
l’importance de divers critères de compétence en proposant un questionnaire à 70
étudiants de psychologie de tous niveaux.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
84
Cette fois nous avons demandé aux sujets de noter leur accord avec des propositions en
se situant sur une échelle visualisant la notation de 1 à 7 de chaque item sur lequel ils
étaient invités à se situer :
Il était précisé que 1 correspond à « désaccord total » et 7 à accord total et qu’ils
pouvaient utiliser la gamme de notation intermédiaire pour donner leur avis.
Chaque note moyenne de l’item a été comparée à la moyenne théorique 3,5 grâce à un
test de comparaison de moyennes (t de student).
Nous avons proposé 19 items que nous ne traiterons pas tous car certains n’apportent
rien à notre étude. Pour éviter un effet de contamination positif entre les réponses et
déceler les réponses désinvoltes nous avons inséré des items qui reçoivent une opinion
négative (test préalable) tels que : « les études et les diplômes ne servent à rien ». Les
résultats obtenus sont conformes à ceux du pré-test.
Les items qui reçoivent une note moyenne significative supérieure à la moyenne sont :
« Les groupes qui ont souffert et qui ont surmonté leur souffrances ont
acquis une compétence particulière dans la vie » (m = 3,74)
« Une personne qui a souffert a acquis une meilleure connaissance de la vie que celle
qui n’a pas souffert » (m = 3,98)
« Un travail qui a été fait dans l’effort doit être mieux apprécié subjectivement qu’un
travail fait avec facilité même si les deux aboutissent au même résultat » (m = 4,57)
« On peut être harcelé moralement à cause de sa compétence dans un domaine » (m =
5,2)
On trouve que l’item « L’acquisition de compétences s’accompagne souvent d’une
certaine souffrance » reçoit une note de 3,5, soit la moyenne théorique. En revanche
l’item « Un groupe de croyants ne devient une vraie religion que s’il a été persécuté
dans ses débuts » reçoit une note négative (m = 2,07, significatif).
L’item « Les Témoins de Jéhovah ont été persécutés sous le régime nazi et dans les pays
totalitaires. Ils ont survécu à leur souffrances en s’appuyant sur leurs croyances. Pour
cela, on peut leur accorder une compétence religieuse même si on n’est pas d’accord
avec eux » reçoit une moyenne de 3,24 (non-significative), donc du même ordre que la
moyenne théorique.
Les items liant les souffrances de groupes particuliers (Juifs, Protestants, Palestiniens) à
des compétences similaires (meilleure connaissance de la vie, de la société, meilleure
connaissance des hommes) sont négativement jugés (significatifs) alors que l’item
général « Les groupes qui ont souffert ont acquis une compétence particulière dans la
vie » reçoit une note significativement supérieure à la moyenne. Le paradoxe est à
expliquer. Les compétences attribuées étaient-elle inadéquates ? Les souffrances de ces
groupes évoquent-ils l’indignation plus que de l’attribution de compétence. Un autre
étude serait à faire pour expliquer le paradoxe.
De la même façon, le score obtenu par l’item « On peut être harcelé moralement à cause
de sa compétence dans un domaine » est surprenant. Un groupe religieux peut l’utiliser
comme le font les Témoins selon la formule « celui qui dit la vérité sera persécuté »,
mais l’accord avec l’item peut relever de la projection d’un sentiment de jalousie dans
une situation scolaire.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
85
Pour nous, il suffît de constater que la souffrance est liée à la compétence mais plus
encore à la souffrance surmontée. Ici encore les résultats confirment un hiatus entre
l’évaluation générale de la compétence par le fait de surmonter la souffrance et
l’évaluation de son application aux témoins de Jéhovah.
NOTES
1. Déjours, 1998 : 107-119.
2. Weber, 1996 : 337.
3. Ibid. : 416.
4. Ibid. : 338.
5. Ibid. : 342.
6. Ibid. : 419.
7. Ceci n’implique pas que Max Weber ait une conception évolutionniste de l’histoire.
8. Weber, 1996 : 341.
9. Cf. Nowak, 1972.
10. Weber, 2003 : 355.
11. Association de Défense des Familles et de l’Individu; Centre de documentation, d’éducation et
d’action Contre les Manipulations Mentales.
12. Réglée depuis par la circulaire Léotard et la fin de la conscription.
13. L’affaire n’est pas réglée ce jour.
14. En France, toute association à caractère spirituel ou religieux peut se proclamer « association
cultuelle » (loi de 1905). Toutefois, cela ne l’autorise pas à obtenir certains avantages dont
disposent les grandes confessions (catholicisme, protestantisme, judaïsme, islam) à savoir :
aumônerie de prisons, d’établissements secondaires et de l’armée, possibilité de recevoir des
dons et legs, exonérations des taxes foncières sur les édifices cultuels. Il faut pour cela obtenir
une « reconnaissance » en association cultuelle plénière donnée par le bureau des cultes du
ministère de l’Intérieur (loi de 1907). Comme l’ont fait remarquer le professeur Jacques Robert et
le doyen Carbonnier dans leurs études sur la loi de 1905, tous les cultes n’ont pas droit au même
traitement. On trouve d’une certaine manière l’introduction implicite d’un régime des cultes
reconnus.
15. Canonici, 1998.
16. Zuber et Baubérot, 2000.
17. Les Témoins de Jéhovah, 1993.
18. Les Témoins de Jéhovah, 1971.
19. King, 1982, voir note supra pp. 664-665. Voir aussi Fascisme ou liberté (Les Témoins de
Jéhovah, 1939), brochure distribuée en 1941. 5000 exemplaires furent saisis à Tervuren (Belgique)
chez Léon Floryn, qui fut déporté avec son épouse.
20. Botting, 1993.
21. Penton, 1976.
22. Le nom international de leur association est Watchtower Bible and Tract Society.
23. D’après La Tour de Garde (magazine d’information des Témoins de Jéhovah) du 1/02/1946.
24. Cité dans Les Témoins de Jéhovah, 1993.
25. Ibid. : 676.
26. Ibid. : 450.
27. Ibid. : 662.
28. Ibid. : 662.
29. King, cité ibid. : 664-665.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
86
30. Ibid. : 664.
31. King, cité ibid. : 663.
32. Ibid. : 548.
33. Ibid. : 696.
34. Levy-Leboyer, 2004.
35. Ibid. : 35.
36. Courpasson et Livian, 1991.
37. Montmollin, 2001 : 11-12.
38. Montmollin, 1993 : 205-210.
39. Weiner et Kukla, 1970. Voir aussi Desrumaux, 1996.
40. On en trouve déjà beaucoup de références dans Prêtres, pasteurs et rabbins dans la société
contemporaine, 1982, notamment dans la contribution de Jean Séguy. Voir aussi Jean-Paul
Willaime, 1989.
41. Gannon, 1971.
42. Sur cette question des charges et du charisme de l’état de grâce, voir Max Weber, 1964 :
283-286.
43. Delestre, 1977 : 284-287.
44. Arnaud, 2003 : 7.
45. Patterson et al. (1994) cité par Detraux, 2002 : 29-40.
46. Ibid. : 32.
47. Pelchat, Lefebvre et Damiani, 2002 : 46.
48. Voir par exemple Cyrulnik, 1999.
49. Houssier, 2002 : 69.
50. Bettelheim, 1972.
51. Canonici, 1998 : 306.
RÉSUMÉS
Une des attaques lancée par les militants antisectes et le gouvernement socialiste qui les a
relayés contre le jéhovisme en France durant les deux dernière décennies a consisté à le qualifier
de « pseudo-religion ». En réponse, et pour affirmer leur caractère religieux, les Témoins de
Jéhovah ont mobilisé des ressources pour rappeler leur sort dramatique sous le nazisme. De plus,
ils ont revisité leur histoire pour en faire un récit de martyrs de la « vraie croyance ». En se
fondant sur un cheminement empirique, l’article examine la valeur d’une stratégie qui associe la
compétence religieuse à la souffrance. Il montre que ce n’est pas la souffrance en tant que telle
qui est considérée comme un facteur de compétence mais le fait de l’avoir surmontée, ce qui
rejoint la thèse de la résilience.
One of the attacks launched during the last two decades in France against the Jehovah’s
Witnesses by anti-cult activists and, in their wake, the Socialist government involved qualifying
this group as a “pseudo religion”. In order to assert their religion, Jehovah’s Witnesses responded
by recalling their tragic fate under the Nazis. They reinterpreted their history so as to turn it into
a tale about martyrs of the “true faith”. This empirical approach examines the value of a strategy
that associates religious competence with suffering. What is taken to be a factor of competence is
less suffering as such than the fact of having overcome it, whence the thesis of resilience.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
87
INDEX
Index géographique : France
Keywords : suffering, competence, resilience, religious minorities, Jehovah’s Witnesses, France
Mots-clés : souffrance, compétence, résilience, groupes religieux minoritaires, Témoins de
Jéhovah
AUTEUR
RÉGIS DERICQUEBOURG
Maître de conférences à l’Universite Charles de Gaulle (Lille III). Groupe de sociologie des
religions et de la laïcité (EPHE/CNRS)
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
88
Au cœur de la souffrance
Le projet de devenir psychothérapeute spirituel
At the heart of suffering: Plans to become a spiritual psychotherapist
Anne-Cécile Bégot
Je souhaite remercier Françoise Champion pour son travail de relecture et ses remarques
stimulantes, ce qui n’empêche que les analyses développées dans ce texte n’engagent que son
auteur.
1 La question du statut professionnel des psychothérapeutes a été au centre du débat
politique français à la fin de l’année 2003, avec le projet de loi déposé par le député
Bernard Accoyer. L’objectif de ce projet est de réglementer la profession de
psychothérapeute, notamment en ne reconnaissant que les seuls diplômés (psychiatres
et psychologues)1, et en évinçant les autres (psychanalystes et psychothérapeutes) 2. La
polémique suscitée par ce projet tient, entre autres, au fait qu’il vise à médicaliser la
souffrance psychique mais aussi à délégitimer toute une partie de la profession, celle
qui exerce sans diplôme reconnu. L’un des arguments utilisés en faveur de ce projet de
loi est que n’importe qui peut se déclarer psychothérapeute. Une telle assertion mérite
attention, et ce notamment au regard du parcours d’individus rencontrés dans le cadre
d’une enquête réalisée pour l’Agence Nationale de Recherches sur le Sida (ANRS).
2 L’objectif de cette étude était d’étudier la place et le rôle de la spiritualité dans la
construction identitaire de personnes touchées par le VIH/Sida3. Un phénomène
relativement singulier est apparu lors de ces rencontres : un certain nombre de ces
personnes ont changé de profession, ou manifesté l’intention de le faire, pour devenir
psychothérapeute. Bien que ces cas soient peu nombreux (ils concernent quatre
personnes), et que l’enquête n’avait pas pour objectif d’étudier leurs parcours
professionnels4, ils suscitent l’attention et soulèvent une question à la fois simple et
complexe : comment devient-on psychothérapeute ? Pour y répondre, on s’attachera à
décrire le milieu spirituel dans lequel évoluent ces personnes pour, ensuite, dégager
certaines caractéristiques du psychothérapeute spirituel. Chaque parcours étant
singulier, on retracera la biographie des quatre personnes tout en mettant l’accent sur
les spécificités du métier qu’elles souhaitent exercer.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
89
Des psychothérapeutes mystiques-ésotériques
3 Le courant spirituel auquel appartiennent les quatre thérapeutes de l’enquête ANRS est
le Nouvel Âge (New Age). Il a émergé à la fin des années 1960 aux Etats-Unis, et au
début des années 1970 en Europe. Selon la typologie élaborée par G. Davie et D.
Hervieu-Léger (1996), il appartient à un vaste mouvement de renouveau spirituel,
qualifié de Nouveaux Mouvements Religieux ou NMR5.
4 Les NMR réunissent des groupes divers et variés et constituent une réponse (en fait
plusieurs réponses selon le type de groupe) à une société en crise. Plus précisément,
« l’émergence des Nouveaux Mouvements Religieux (NMR) s’inscrit dans le contexte
des larges remises en cause des orientations sociales et culturelles des sociétés
occidentales qui interviennent à partir de la fin des années 1960 » (Champion, 1995 :
13). Inscrits dans le processus de sécularisation (perte de vitesse des religions instituées
et prolifération de certaines croyances et pratiques), les NMR ont permis de saisir le
vaste mouvement de reconfiguration du religieux au sein des sociétés occidentales. Si
les termes NMR traduisent surtout l’absence de consensus entre sociologues sur un
autre terme (Champion & Hourmant, 1999), ils ont néanmoins permis de penser les
évolutions du fait religieux au sein des sociétés dites modernes.
5 Les termes Nouvel Âge ont également suscité des débats (voir Social Compass, 1999) car
ils caractérisent une nébuleuse qui ne correspond en rien aux concepts avec lesquels les
sociologues des religions travaillaient jusqu’alors (cf. idéaux types de la « Secte » ou de
l’« Église »). « On n’y trouve, précise H. Van Hove, ni doctrine ni système de croyances
intégré. Il [le Nouvel Âge] recouvre des phénomènes aussi divers que le GaiaMind
Project sur l’Internet, des best-sellers comme La prophétie des Anges, des formes
occidentalisées du Bouddhisme Zen, des cours de massage intuitif, des groupes locaux
de méditation pour le salut du monde, des livres d’astrologie s’inspirant de la
psychologie de Jung, des thérapeutes découragés qui, dans une étuve indienne, prient
pour la guidance, des responsables d’entreprise qui traversent nu-pieds un feu rituel
pour célébrer l’anniversaire de leur société » (Van Hove, 1999 : 115). L’absence
d’institutionnalisation n’empêche pas une large diffusion de cette nébuleuse dans
l’ensemble du monde occidental. Les activités du Nouvel Âge se déploient dans des
grands centres urbains (Alternatives à Londres, Oibibio à Amsterdam, The Open Center
à New York) mais aussi dans des centres locaux (Naple en Floride) voire même des
villages (Aups en Provence) (York, 1999 : 175).
6 Un nombre important d’adeptes du Nouvel Âge sont des « baby boomers » qui, après
avoir goûté au mouvement de la contre-culture, ont versé dans la spiritualité (Lewis &
Melton, 1992). Deux périodes doivent être distinguées dans le Nouvel Âge. La première
se caractérise par une tendance au messianisme et par l’espérance de temps nouveaux
(cf. passage de l’ère du Poisson, marquée par des luttes et tensions, à l’ère du Verseau,
temps de paix et d’harmonie). Durant les années 1980, le mouvement évolue, perd sa
dimension messianique et devient un vaste milieu où l’on pratique toutes sortes de
techniques et disciplines (yoga, méditation, transe…), empruntant à diverses religions
(religions orientales mais aussi chamanisme), à l’ésotérisme (astrologie, numérologie),
et aux nouvelles thérapies corporelles. Pour différencier ces deux périodes mais aussi
pour les caractériser, F. Champion (1995) désigne par « Nouvel Âge » le premier
mouvement, et par « Nébuleuse Mystique Ésotérique » le deuxième. La NMÉ a fait
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
90
l’objet d’une modélisation (construction d’un idéaltype) qui permet de saisir les lignes
de force de ce courant spirituel et les différences qui le traversent.
7 Sept orientations psychospirituelles caractérisent la Nébuleuse Mystique Ésotérique
(NMÉ) : la centralité donnée à l’expérientiel et son corollaire, « c’est à chacun de
trouver sa voie » ; la transformation de soi, notamment par des techniques psycho-
corporelles ou psycho-ésotériques ; le salut, intramondain (bonheur en ce monde),
passe par la voie mystique ; une vision unifiante du monde et le refus du dualisme des
religions abrahamiques ; un optimisme certain même s’il reste mesuré ; une éthique
d’amour ; et enfin un jeu du charisme (reconnaissance de l’autorité de certains leaders).
Par ailleurs, des lignes de tension existent au sein de la NMÉ : importance accordée ou
non aux expériences et situations dites « non ordinaires » ; accent mis sur l’expérientiel
et/ou l’autoperfectionnement ; respect des traditions religieuses et/ou bricolage
individuel ; orientation psychologique et/ou spirituelle ; pratiques magiques et/ou
spiritualisme humaniste (Champion, 1995).
8 À la suite et dans la continuité des travaux de F. Champion, V. Rocchi (2003 : 177) utilise
les termes de « nébuleuse psycho-mystique » (NPM). On retiendra cette terminologie
car, tout en insistant sur l’élément central de ce courant spirituel, à savoir sa dimension
mystique6, elle permet aussi d’insister sur le poids important accordé aux aspects
thérapeutiques7.
9 Les caractéristiques de la NPM sont présentes, à des degrés divers, dans le parcours des
psychothérapeutes rencontrés dans le cadre de l’enquête ANRS. Reste à déterminer
quelle formation ces derniers reçoivent pour exercer leur métier. Comment sont-ils
formés ? Par qui ? Comment légitiment-ils un savoir-faire acquis dans une nébuleuse
aux frontières floues ? Quels sont les critères de validation de ce savoir-faire ? Pour
répondre à ces questions, on mettra en exergue une thématique forte pour chaque
parcours biographique présenté.
La souffrance comme critère de compétence
10 Simon8, le plus jeune des quatre thérapeutes, a 24 ans quand il apprend sa
séropositivité au VIH, en 1991. Il pense avoir été contaminé par l’ami avec qui il vivait à
cette époque. D’origine catholique, il a cessé toute pratique religieuse relativement
jeune mais, durant son adolescence, il a été attiré par des croyances et pratiques
ésotériques telles que la réincarnation et l’astrologie. Il dit avoir un « don » de claire-
audience et ce, suite à cette voix qu’il a entendu avant de se savoir séropositif.
« Trois mois avant ma séropositivité, raconte-t-il, […] une voix m’a dit : “n’oublie
pas que la maladie n’est pas séparée de l’être”. Jusqu’à présent tout allait bien dans
ma vie, enfin c’est ce que je croyais, et je me suis dit pourquoi cette phrase me
tombe (dessus). Je l’ai entendue comme si on me parlait à côté, et pourtant j’étais en
train de faire les courses avec ma mère, je n’avais pas franchement l’esprit à penser
à quoi que ce soit, et sur le moment j’ai compris intuitivement ce que ça voulait
dire, ça voulait dire, quelle que soit la maladie […] ça n’est pas là par hasard. »
11 À l’annonce de sa séropositivité au VIH, l’engagement spirituel de Simon, jusqu’alors
exprimé sur un mode mineur, va devenir beaucoup plus intense. Il fréquente des
groupes bouddhistes mais ne poursuit pas dans cette voie, trop normative à son goût. Il
se passionne pour un livre écrit par une Américaine, Niro Asistent (1992), qui dit s’être
séronégativée, en passant d’un statut sérologique positif au VIH à un statut négatif 9. Il
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
91
poursuit ses investigations auprès d’un maître indien, Osho, qui enseigne la méditation
et lui permet de s’inscrire dans une tradition religieuse. Durant cette période, il arrête
tout traitement médicamenteux et croit en une possible guérison du Sida.
12 En 1995, il déclare le Sida avec un cytomégalovirus (CMV) oculaire et voit ses défenses
immunitaires s’effondrer. Durant six à huit mois, ses résultats biologiques ne
s’améliorent pas et les traitements qu’il prend le font souffrir : « Quand on m’a injecté
le produit pour remonter les globules blancs, dit-il, j’avais l’impression d’avoir les os du
thorax curés de l’intérieur. »
13 L’entrée dans la phase Sida bouleverse profondément la vie de Simon. Il réaménage son
système de croyances et considère que vivre l’instant présent est plus important que
d’obtenir une guérison, ce qui explique son recours aux médicaments. Ensuite, il estime
avoir changé de caractère : renfermé et peu enclin aux échanges, il dit s’être ouvert aux
autres. Enfin, il a effectué un travail sur lui-même : déconstruire certains principes
éducatifs et orienter sa vie en fonction de ses désirs et non des normes imposées par la
société. Dans cette perspective, il décide d’abandonner son métier de coiffeur pour
devenir psychothérapeute. Peu expérimenté, Simon ne vit pas encore de son nouveau
métier ; les résultats obtenus auprès des quelques clients qu’il a traités le confortent
néanmoins dans la voie qu’il a prise.
14 La formation reçue par Simon est celle qu’il a acquise au gré de stages et rencontres
dans la NPM (nébuleuse psycho-mystique). Ainsi, il suivra une thérapie de groupe avec
Niro Assistent quand elle s’installera à Paris, en 1998. Il sera également suivi par une
psychothérapeute durant un an et demi. L’absence de diplôme ne constitue pas un
critère discriminant au sein de ce milieu ; au contraire, au regard du parcours de
Simon, on se rend compte que la légitimité du psychothérapeute repose sur la maîtrise
de techniques psycho-ésotériques et de l’expérience d’une maladie grave.
15 Utilisant l’astrologie depuis de nombreuses années, Simon s’en servira comme
technique de discernement auprès de ses patients. Selon lui, elle l’aide « à comprendre
comment fonctionne la personne et surtout, ce qui est important, ce pour quoi elle [la
personne] est faite et ce vers quoi elle doit tendre donc ça permet de recentrer plus vite
les choses, de moins s’éparpiller, et surtout, d’aller beaucoup plus vite dans l’analyse
même si la personne a son temps à elle d’intégration et de transformation. […] Pour moi
le thème astral est une horloge, chaque chose se déclenche à des moments bien précis,
les choses doivent se comprendre petit à petit, les unes après les autres. » « De
formation réelle ? s’interroge Simon, non, je n’en ai pas mais y’a cette forme
d’empathie qui est très forte, et ça je ne pense pas que ça s’apprenne ; toutes les écoles
peuvent vous apprendre des tas de choses merveilleuses mais y’a quand même des
choses qu’on ne vous apprend pas c’est la compassion, le non-jugement des autres,
l’ouverture à l’autre. »
16 Pour Simon, la légitimité de ses compétences thérapeutiques repose sur son expérience
de la maladie, et en ce sens, il cherche à se différencier des psychothérapeutes
diplômés. « Un psychiatre, explique-t-il, n’a pas eu forcément à traverser une maladie
grave10 pour se remettre en question et appliquer tous ces principes que je viens
d’énumérer [compassion, absence de jugement, ouverture aux autres] et qui sont
vachement importants, qui sont essentiels pour pouvoir justement, humainement
parlant, s’ouvrir. On me dira que la personne peut l’apprendre au quotidien, en
fréquentant ses patients mais je dois dire que les maladies graves, quand même, vous ouvrent
des champs d’horizon11… » Pour Simon, la maladie ne correspond pas seulement à une
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
92
altération physiologique de l’être, elle est là pour signifier un mal-être de la personne.
« La maladie, dit-il, n’est pas là par hasard […] pour moi, c’est un signe [la maladie] que
la personne, d’une manière ou d’une autre, s’autodétruit. » Trouver la faille,
comprendre ce qui pose problème, telle est la démarche de Simon. Il conclut en ces
termes : « La maladie n’a fait que me révéler à moi-même. » Ce discours est
relativement fréquent chez les adeptes de la NPM, où la maladie est envisagée comme
« une épreuve bénéfique qui va permettre à l’homme de dépasser ses problèmes afin
d’accéder à un état d’être supérieur appelé “spirituel” » (Rocchi, 2003 : 179).
17 La maladie est initiatique dans le sens où elle ouvre à la spiritualité (connaissance et
ouverture sur le monde supra-empirique) et révèle le « don » de guérison 12. Ce cas de
figure est aussi évoqué par D. Glik (1990) à propos de groupes de guérison dont certains
sont issus de la mouvance Nouvel Âge. D’après ses observations, la légitimité du
guérisseur (le don qu’on lui reconnaît) repose sur la maladie ou l’épreuve qu’il est
parvenu à guérir ou surmonter car cela témoigne de sa foi et/ou de son accès au salut
(Glik, 1990 : 153). Dans le cas de Simon, encore relativement isolé, c’est son entourage et
plus précisément sa famille qui va le confirmer dans son nouveau statut : « Finalement,
dit-il, c’est ma famille qui me reconnaît comme tel [psychothérapeute et astrologue]
parce qu’avant j’étais incapable de les aider et maintenant […] j’arrive à les comprendre
au plus profond d’eux, ils arrivent à dépasser leurs problèmes, j’arrive à les aider. »
En défiance de la « médecine officielle »
18 Xavier, le plus âgé des quatre thérapeutes (une quarantaine d’années), apprend sa
séropositivité, en 1986, lorsqu’il décide de se sevrer de l’héroïne. Toxicomane depuis de
nombreuses années, il entreprend de suivre le programme des Narcotiques Anonymes
(NA) quand, trois mois plus tard, à la suite d’un test de dépistage, il apprend qu’il est
séropositif au VIH.
19 Calqués sur le modèle des Alcooliques Anonymes, les NA ont envisagé un chemin en
douze étapes pour parvenir à l’abstinence. L’une d’entre elles consiste à reconnaître
l’existence d’une puissance supérieure. Pour Xavier, il s’agira de Dieu. Selon lui, « la
drogue était pour moi la recherche d’un Dieu, la transcendance de quelque chose […]. Je
pense que la drogue était une forme de recherche, simplement, je m’étais trompé de
Dieu, c’était pas là où il fallait chercher ».
20 Son engagement au sein des NA est particulièrement intensif. Durant les premières
années, il se rend de manière quasi-quotidienne aux réunions prévues par le groupe et
parle constamment de Dieu. Il sera le parrain de nombreux filleuls, car le principe du
mouvement est qu’une personne abstinente aide (parraine) des néophytes. Il
participera aussi à l’organisation et à la structuration du groupe en France.
Progressivement, il s’éloignera du mouvement car il s’investit ailleurs (mariage,
naissance de son fils, participation à des groupes psycho-spirituels). Il lui reste
néanmoins attaché et témoigne occasionnellement, lors de réunions, de ses quinze
années d’abstinence.
21 Jusqu’en 1999, Xavier est dans une démarche thérapeutique alternative et ne ressent
pas de symptômes physiques alarmants. À cette date, les événements se bousculent. Il
se fait opérer pour une hernie mais, en sortant de l’hôpital, des maux de tête violents et
des vomissements l’alarment. Il retourne à l’hôpital où on lui décèle une méningite
triptocoque à laquelle s’ajoutera un CMV oculaire. Durant quatre mois, il est entre la
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
93
vie et la mort. Ses défenses immunitaires étant quasiment nulles (2 T4) 13, il maigrit
énormément (perte d’une trentaine de kilos), son audition baisse, sa vue est réduite, et
il perd une partie de son autonomie. Ce séjour à l’hôpital constitue une étape
importante dans le parcours de Xavier, notamment parce qu’il s’est vu se dégrader
physiquement mais aussi parce qu’il craignait de mourir dans la souffrance.
Régulièrement, l’équipe soignante lui demandait d’évaluer sa douleur sur une échelle
de un à dix pour lui administrer, en conséquence, des doses de morphine.
22 De l’annonce de sa séropositivité (1986) jusqu’en 1999, Xavier n’a donc pas reçu de
traitement médicamenteux pour le VIH et s’est orienté vers les médecines dites
« parallèles ». Ce choix, il le justifie par l’attitude de ses médecins. « À chaque fois que
je voyais des médecins, dit-il, je ressortais et j’avais peur. » Il ajoute que l’un d’entre
eux l’a menacé de mort : « Il m’a dit, si vous ne prenez pas l’AZT, vous allez mourir. »
Xavier sera conforté dans son choix (ne pas prendre d’AZT) en voyant des personnes
séropositives décéder malgré la prise de ce médicament.
23 Dans le domaine des médecines parallèles, Xavier dit avoir tout essayé : acupuncture,
homéopathie, digipuncture14, étiopathie15, ostéopathie16… et aussi d’y avoir laissé une
fortune. L’objectif étant de trouver un équilibre physique, psychologique et spirituel 17,
Xavier s’investira aussi dans des groupes religio-spirituels (zazen, tao sexuel, retraite
dans un monastère bouddhiste, intérêt pour l’hindouisme, la Bible…) et réalisera quatre
psychothérapies dont une basée sur la sophrologie18. Il est difficile de dissocier ces
pratiques car avec la NPM on a affaire « à un continuum au sein duquel il est impossible
d’établir des frontières nettes entre ce qui relèverait de la nébuleuse psycho-mystique-
ésotérique et ce qui relèverait simplement des médecines parallèles, des méthodes de
développement personnel, des psychothérapies en libre service, ou de libres
spiritualités » (Champion & Rocchi, 2000 : 249).
24 Par ailleurs, et le sociologue Jacques Maître l’a souligné, cette nébuleuse d’hétérodoxie
participe au « langage de désir » provoqué par les prouesses scientifiques et médicales.
« La modernité, écrit cet auteur, suscite plus d’espoir en la réalisation des désirs qu’elle
ne peut en réaliser effectivement, ce qui induit un surplus pour lequel les promesses ne
peuvent que venir d’ailleurs » (Maître, 1987 : 363). Ainsi, les thérapies alternatives
proposent des remèdes là où la médecine officielle est impuissante et surtout, elles
offrent un « supplément d’âme » dont est dépourvu le modèle allopathique.
25 Entre le milieu des années 1980 et le début des années 1990 diverses alternatives à la
médecine officielle vont émerger pour traiter le VIH/Sida. On peut citer la méthode
proposée par Guy Claude Burger, l’instinctothérapie, qui consiste à ne manger que des
aliments crus, et ce après les avoir humés. Ce théoricien de « l’erreur alimentaire »
envisage la maladie (dont le VIH/Sida) comme un moyen naturel de se purifier,
d’éliminer les substances nocives accumulées par l’organisme, et considère que
l’individu a en soi un « système guérisseur » capable de le guérir (Guérin & Paillard,
1999 : 47-49) Quant à Marc Griffiths, animateur du site Internet Sidasanté 19, il s’inscrit
dans un courant né aux Etats-Unis, sous l’impulsion d’un rétrovirologue, Peter H.
Duesberg. Ce dernier réfute l’équation VIH = Sida car il a pu observer des cas de Sida
chez des patients non séropositifs au HIV. Ce courant considère que la cause des
maladies rassemblées sous le nom de Sida est un affaiblissement du « terrain ». La
malnutrition, la pollution de l’alimentation, de l’air, de l’eau, les radiations, la
chimiothérapie, les transfusions, les excès de stress, les conditions de travail,… mais
aussi des médicaments, dont l’AZT, sont de ces éléments qui fragilisent le « terrain ».
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
94
26 Sans appartenir à ce courant alternatif, Xavier a longtemps adhéré à ces idées. On peut
replacer un événement important de sa vie dans ce contexte de défiance à l’égard de la
bio-médecine. Avant que les multithérapies ne soient mises sur le marché (1996), il a
tenté, avec sa femme qui est séronégative, de concevoir un enfant. Ils auront pour cela
des rapports sexuels non protégés durant une période de six mois, à raison de deux fois
par mois. Sa femme, restée séronégative, accouchera d’un petit garçon également
séronégatif. Face aux dangers que présentait cette grossesse, Xavier estime qu’ils ont
reçu une « grâce ».
27 Aujourd’hui, Xavier est moins critique à l’égard de l’institution médicale, et ce
notamment suite à son séjour hospitalier. Là-bas, dit-il, il a été accueilli par une équipe
« extraordinaire » et « humaine ». Quant à son médecin, s’il est un peu railleur et
ironique à son égard, il reconnaît qu’il lui a permis de se rétablir.
« Mon médecin, dit-il, est très très content de moi parce que je suis une grande
réussite pour lui, parce que tous mes résultats sont normaux c’est-à-dire que j’ai
une charge virale indétectable donc pour lui c’est une réussite, il est très content, il
m’aime beaucoup [rire], il est persuadé de m’avoir sauvé la vie, ce qui est en partie
vrai mais pour moi y’a pas que ça. »
28 Durant treize ans, la position adoptée par Xavier à l’égard de l’institution médicale a
été alternative ; il s’en est remis aux médecines parallèles et à diverses spiritualités
pour se soigner. Il explique son entrée dans la phase Sida par un relâchement de ses
pratiques (thérapeutiques et spirituelles). Lors de l’entretien, réalisé en 2001, il adopte
une posture complémentaire : il accepte de prendre un traitement médicamenteux
(multithérapie) mais considère cette voie comme insuffisante et continue de recourir à
la spiritualité (méditation essentiellement) et aux médecines parallèles (acupuncture
notamment).
29 Après s’être rétabli, Xavier concrétise un projet qu’il avait depuis quelque temps : il
décide d’exercer comme thérapeute. Il travaille à partir de techniques spécifiques,
acquises lors de stages effectués au sein de la NPM. Celle du « dialogue intérieur » lui
permet, selon ses termes, d’accéder aux différentes parties (sous-personnalités) qui
composent l’individu.
30 À la différence de Simon, Xavier ne souhaite pas vivre de ce métier qu’il estime
éprouvant. De ce fait, il poursuit son activité d’artisan et consacre une seule journée
par semaine à la psychothérapie. Sa crainte est de ne pas être à la hauteur face à ses
patients mais son thérapeute le rassure en lui affirmant qu’il a un « don » pour cela. Le
bilan hebdomadaire qu’il effectue avec ce dernier atteste, selon lui, de son sérieux et de
sa crédibilité.
Des techniques hétérodoxes dans un univers
immanent
31 Diane, la seule femme sur les quatre thérapeutes20, apprend sa séropositivité au VIH en
1989, au moment où son ami déclare la maladie ; elle est alors âgée de 27 ans. Quelques
années plus tard, en 1993, lorsque son compagnon décède, elle fait une dépression. À
l’hôpital où elle est traitée, elle rencontre une infirmière qui lui parle de Dieu. À la
différence de Simon et Xavier, Diane a abandonné toute pratique religieuse (catholique)
à l’adolescence. Plutôt critique à l’égard des religions, elle ne prête guère d’attention
aux propos de cette infirmière jusqu’au jour où elle accepte de rencontrer certains de
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
95
ses amis qui pratiquent la voyance. D’emblée, Diane est touchée par leur
« clairvoyance » car l’un d’entre eux emploie les mêmes termes que ceux de son défunt
ami. « Alors là, dit-elle, j’ai eu plein de frissons jusqu’aux oreilles, et j’ai commencé à
croire en la vie après la vie. » Ce premier contact est donc décisif.
32 Non diplômée, Diane a exercé plusieurs types d’emploi. Avant de se savoir séropositive,
elle travaillait dans le fret aérien. Licenciée par son entreprise, elle se débrouille pour
pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité. Cette situation lui permet de s’investir
dans le milieu de la mystique et de l’ésotérisme. Elle achète des livres sur le sujet
(spiritualités, médecines parallèles, pratiques ésotériques…), et poursuit son insertion/
socialisation dans le milieu en effectuant différents stages : astrologie, tarologie,
sophro-relaxation, énergie universelle, chromothérapie, ostéopathie, radiesthésie… Par
ailleurs, elle se connecte régulièrement à différents sites Internet psycho-ésotériques
pour se tenir au courant de l’actualité dans le milieu21, et « chate » avec des personnes
de même sensibilité qu’elle.
33 À la différence de Xavier et Simon, Diane s’inscrit d’emblée dans une démarche
thérapeutique complémentaire. Ainsi, quand elle déclare le Sida en 1995, pour se
soigner, elle combine médecines parallèles et multithérapies.
34 Deux aspects apparaissent essentiels dans l’engagement spirituel de Diane. En premier
lieu, il y a les contacts qu’elle a avec son défunt ami et qui lui permettent,
paradoxalement, d’en faire le deuil. Lorsqu’elle consulte des voyants, ces derniers lui
assurent que celui-ci est heureux là où il est. Plus tard, elle fera un voyage astral avec sa
grand-mère (décédée) qui lui fait traverser la terre entière pour retrouver son ami
qu’elle voit comme un « être de lumière ». Cette « expérience » lui permet de tourner
une page. « Maintenant, explique-t-elle, je sais que là où il est, il est heureux […] on dit
toujours qu’il ne faut pas pleurer les morts parce qu’on les retient sur terre ; leur âme
n’arrive pas à évoluer. Plus on les pleure, moins ils évoluent […] il faut penser que eux
sont bien là où ils sont. »
35 Le deuxième aspect à prendre en considération est son sevrage de l’héroïne.
Toxicomane durant une quinzaine d’années, Diane n’était pas parvenue à arrêter de se
droguer, et ce malgré différentes cures de désintoxication. Après avoir pris des
produits de substitution, elle s’en est remise à la spiritualité qui lui a permis, selon elle,
de s’en sortir.
36 La place occupée par la spiritualité dans la vie quotidienne de Diane est omniprésente
car sa vision du monde est immanente (cf. un monde où ne se distinguent pas forces
naturelles et forces surnaturelles). Selon elle, il n’existe pas de hasard dans la vie ; tout
événement, quel qu’il soit, est voulu par ses « guides spirituels ». Au moment de
réaliser l’entretien, Diane n’avait plus de voiture ; on la lui avait volée. Et d’expliquer :
« Je sais pourquoi on m’a volé ma voiture, c’est parce que j’étais trop dispersée, je
faisais trop de choses […] c’était pour me freiner un peu. » De même, elle considère que
les rencontres qu’elle a faites au cours de stages psycho-ésotériques ne sont pas dues au
hasard ; elles lui ont permis d’évoluer et d’avancer spirituellement. De la même façon,
l’expérience proche de la mort (Near Death Experience) qu’elle a vécue après être
tombée dans le coma a été, selon elle, un moyen de ne plus craindre la mort, qu’elle
envisage, désormais, comme un passage. Son univers spirituel se construit à l’abri de
tout contrôle institutionnel et puise dans différentes traditions religieuses et
spirituelles.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
96
37 Diane souhaite devenir naturopathe mais auparavant, elle tient à réaliser un
professorat de Chi Qong sur trois ans. Elle a déjà exercé comme thérapeute auprès de
son entourage en pratiquant des massages (masso-relaxation) et du reïki. « Quand je
fais des séances de reïki, dit-elle, je transmets des énergies, je sens tout mon corps, je
sens plein d’énergies dans mes mains, j’aime cette sensation. » Elle raconte qu’elle a dû
apprendre à dominer ses émotions et son ressenti car, tels les leveurs de maux (Camus,
1990), elle avait tendance à « prendre le mal » sur elle : « Je sentais la douleur des
autres et elle ne partait pas. » Un radiesthésiste va donc lui apprendre à « sentir les
énergies des autres mais à ne pas les garder ».
38 Parmi les multiples techniques hétérodoxes utilisées par les psychothérapeutes
spirituels, on peut dégager deux tendances : l’une est plutôt orientée vers la dimension
énergétique et la manipulation des corps (cas de Diane), alors que l’autre repose
davantage sur un travail d’introspection et d’anamnèse (cas de Xavier).
Parcours, cheminement et constitution d’un réseau
39 Thierry, le dernier cas de figure, apprend sa séropositivité en 1986, alors qu’il a vingt-
trois ans. Il pense aussi que c’est l’ami avec lequel il vivait qui l’a contaminé. Il décide
de terminer ses études et obtient un Diplôme de juriste-conseil d’entreprise et un
Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) en droit des affaires et fiscalité. En
sortant de l’université, il trouve rapidement un emploi et gagne relativement bien sa
vie.
40 Pourtant, au début des années 1990, plusieurs évènements vont le conduire à faire une
tentative de suicide. En premier lieu, ses examens biologiques sont mauvais et il
présente plusieurs symptômes liés au VIH. Ensuite, il n’apprécie pas la manière dont la
société dans laquelle il travaille « gère » le cancer de l’un de ses collègues (absence de
soutien, délégation du surplus de travail aux « valides »…). Enfin, sa relation avec son
ami se détériore et il rencontre des problèmes financiers.
41 Après cette tentative de suicide, il part se reposer quelque temps à la montagne. Là, il
décide de démissionner de son travail et trouve un poste de directeur juridique dans
une entreprise pharmaceutique. À la même période, il vit ce qu’on peut appeler une
conversion religieuse22, et ce par le biais d’une « guérisseuse », la sœur d’un ami, qui
pratique sur lui une harmonisation23. Cette expérience spirituelle va le transformer.
Ainsi, il explique qu’après cette harmonisation, il a passé quinze jours de rêve : « Je me
levais le matin, j’étais heureux, j’allais bosser, j’étais heureux, je rigolais tout le temps,
j’étais super bien. Mon ami me regardait un peu de loin, à la fois en m’encourageant
mais aussi en étant un peu dans le doute. Mon psychiatre me regardait de travers. Il y a
vraiment quelque chose qui s’est passé. »
42 De la même façon que Diane, Thierry a abandonné toute pratique religieuse
(catholique) à l’âge de l’adolescence, notamment quand il s’est découvert homosexuel.
Ce retour vers la spiritualité, ou plutôt la découverte d’un autre univers spirituel, le
séduit et l’entraîne dans une spirale qui paraît sans fin. Chercheur en spiritualité,
Thierry retrace son histoire en fonction des groupes et thérapeutes qu’il a rencontrés
et non en l’inscrivant dans une temporalité précise. Il prend tout d’abord contact avec
les groupes de Martin Brofman, l’initiateur de la pratique du corps-miroir
(harmonisation). Là, il rencontre un monde parallèle dont il ne soupçonnait pas
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
97
l’existence : il y est question de visualisations, d’auras … et il y apprend la technique de
l’harmonisation. Il assiste à des conférences, suit de multiples stages, se fait soigner par
un ostéopathe, pratique le Hatha-Yoga, se forme pour l’accompagnement des mourants
puis devient animateur de ces sessions, consulte une psychothérapeute jungienne, suit
une formation de chant où l’on applique la technique du dialogue intérieur, veut
mettre en place des ateliers d’improvisation sur certains textes bibliques… À la
recherche de ses racines religieuses, Thierry va à la rencontre des Rose-Croix d’Or, de
Shri Ram Chandra, un groupe religieux d’origine indienne (il ira en Inde rencontrer le
gourou de ce groupe, Chariji), des foyers de charité24 … pour finalement s’arrimer à un
groupe orthodoxe syncrétiste. Au cours de l’entretien, il manifeste son souhait de
s’engager dans des études de théologie pour devenir prêtre orthodoxe.
43 Régulièrement, au cours de l’entretien, Thierry fait référence à un monde traversé de
forces magiques. Ainsi quand, en 1995, il abandonne tout suivi médical pour le VIH (il
ne prend plus de traitement médicamenteux et ne fait plus d’examens biologiques), il
justifie cette prise de distance vis-à-vis de l’institution médicale en invoquant son
« immunité christique » : « Pour moi, dit-il, c’est la foi qui me porte, c’est le Christ qui
est mon immunité, ça peut paraître complètement hallucinant mais ça me réussit
plutôt bien. » Et, pour confirmer ses propos, il cite un médecin qu’il a consulté et qui lui
aurait tenu ces propos : « Je n’ai quasiment jamais vu ça, vous avez une très légère trace
du Sida dans votre ADN, mais y’a rien pour moi, vous êtes quelqu’un qui est en voie de
guérison. » Cette croyance dans la toute-puissance de la pensée ou des sentiments est
également présente quand il affirme que l’amour peut vaincre la contamination au VIH.
Ainsi, il raconte avoir eu des relations sexuelles non protégées pendant un an avec l’un
de ses compagnons sans que celui-ci ne soit contaminé car, dit-il, « au fond de moi-
même, dans mon cœur, je me dis que l’amour est plus fort que tout mais pas un amour
illuminé, un amour ancré, raisonnable qui prend toutes les dimensions de l’être, corps,
âme, esprit ». Ce mode de pensée magique existe souvent au sein de la NPM et aussi
chez Thierry, personne diplômée du supérieur et bien insérée socialement. Par ailleurs,
ces croyances magiques peuvent tout à fait cohabiter avec des dispositions éthiques et
une vie ascétique.
44 Dès son immersion dans la NPM, Thierry a l’idée de devenir psychothérapeute. L’un de
ses « maîtres » va le conforter dans cette voie : « Il [un thérapeute] n’arrêtait pas de me
dire : “Mais c’est incroyable, vous avez une sensibilité, c’est incroyable, j’ai rarement
rencontré quelqu’un comme vous, il faut que vous fassiez quelque chose avec, vous ne
pouvez pas continuer comme ça, il faut que vous vous formiez, vous avez certainement
quelque chose à faire dans l’univers du soin, etc.” » Pourtant, rien n’est acquis et, pour
constituer sa clientèle, Thierry doit se former et se faire connaître du milieu (Nouvel
Âge). La vente de son appartement et ses économies vont lui permettre de patienter en
attendant de satisfaire ces exigences.
45 Avant de véritablement se lancer dans ce métier, Thierry fait une expérience
malheureuse comme directeur d’une Maison de la danse. L’échec de cette tentative
(licenciement) le conduit à prendre une année sabbatique au cours de laquelle il
réfléchit à son avenir professionnel. Déjà à cette période, son réseau relationnel est
suffisamment vaste et important pour qu’on lui envoie des patients (deux ou trois par
semaine, dit-il). Il les traite avec les techniques qu’il maîtrise, notamment celles du
« corps-miroir ». Cette expérience étant, à ses yeux, concluante, il décide de s’engager
officiellement comme thérapeute spirituel en ouvrant un cabinet.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
98
46 À la différence des trois précédents témoignages, Thierry dit vivre de son métier (il a
deux cabinets de consultation, l’un à Paris, l’autre en province) ; il est aussi le seul à
faire le lien entre la difficulté d’exercer comme psychothérapeute spirituel et la gestion
du phénomène sectaire en France. À ce propos, il dit : « Je suis face à une problématique
que je n’ai toujours pas résolue qui est mon inscription sociale, qui est comment
m’inscrire dans cette société où il y a une lutte pathologique contre les sectes, que je
trouve complètement délirante, où je jongle avec un métier qui n’est pas reconnu
socialement. »
47 Le cas de Thierry permet de comprendre comment fonctionnent les réseaux au sein de
la NPM : ceux-ci s’imposent à l’adepte avant de devenir et/ou d’être envisagés comme
une ressource professionnelle. En effet, au départ, l’engagement au sein de la NPM est
motivé par une recherche personnelle ; les connaissances et techniques acquises au
cours des stages et conférences vont servir l’évolution spirituelle de l’adepte. À partir
de cette première expérience, celui-ci peut nourrir le projet d’en faire son métier.
Conclusion
48 Au regard des parcours présentés ci-dessus, trois aspects apparaissent comme
déterminants dans la formation du psychothérapeute spirituel.
49 En premier lieu, il y a l’expérience d’une maladie grave, en l’occurrence chronique et
létale25. Pour les thérapeutes rencontrés dans le cadre de l’enquête ANRS, cette
expérience va susciter ou accentuer une recherche de sens qu’ils effectueront dans ce
courant spirituel qu’est la « nébuleuse psycho-mystique » (NPM). Là, la maladie s’inscrit
dans un modèle étiologique endogène où l’individu est considéré comme responsable
de sa maladie, ce qui l’amène à réaliser un travail sur lui-même (transformation de soi),
et ce à l’aide de techniques psycho-corporelles ou psycho-ésotériques. Ce travail
constitue une phase initiatique dans le sens où elle le met en contact avec des éléments
ou des forces supra-empiriques (Dieu, « intuitions », « énergies »…) qu’il apprend
progressivement à manipuler. L’entrée dans la phase Sida suscite ou accentue ce
sentiment d’être possesseur d’un « don » particulier (claire-audience, manipulation
d’énergies…), don qui légitime, au regard de ces thérapeutes, le fait de soulager les
souffrances de l’autre.
50 En second lieu, tout psychothérapeute se doit d’avoir, faute d’une formation
universitaire et d’un diplôme d’État, une longue expérience au sein de la NPM,
expérience constituée de stages, de séminaires, de rencontres… Cette socialisation se
traduit par l’acquisition d’un langage spécifique visant à se conformer aux normes et
valeurs de tel ou tel groupe, de techniques thérapeutiques « hétérodoxes », et d’une
connaissance d’un milieu qui fonctionne en réseaux. Ainsi, les seuls qui exercent dans
un cabinet (Xavier et Thierry) sont dans le milieu depuis une dizaine d’années.
51 Enfin, en dernier lieu, le capital socio-économique joue un rôle indéniable dans la
construction de ce projet. En effet, ouvrir un cabinet nécessite des moyens financiers
considérables car la formation du psychothérapeute (cf. toutes les activités pratiquées
au sein de la NPM : stages, conférences, thérapies…) est payante et non remboursée. Ce
n’est pas un hasard si le seul à avoir fait aboutir son projet (vivre de ce métier) était
détenteur d’un capital social et économique conséquent (Thierry), ce qui n’était pas le
cas de Simon et de Diane.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
99
52 À l’origine, rien ne prédisposait Diane, Simon, Xavier et Thierry à (vouloir) devenir
psychothérapeute spirituel. Ce projet s’est construit en même temps que leur parcours
au sein de la NPM, c’est-à-dire en même temps qu’ils géraient leur séropositivité au
VIH. En d’autres termes, pour eux, le métier de thérapeute ne s’est pas improvisé ; il
s’est acquis au terme d’un long parcours où la souffrance et la maladie ont été
envisagées comme critères de compétence.
BIBLIOGRAPHIE
Asistent, N.
1992 Comment je me suis guérie du sida et suis redevenue séronégative, Annemasse, Éditions Vivez
Soleil.
Bowman, M.
1999 « Healing in the Spiritual Marketplace : Consumers, Courses and Credentialism », Social
Compass 46 (2), pp. 181-189.
Camus, D.
1990 Paroles magiques. Secrets de guérison. Les leveurs de maux aujourd’hui, Paris, Imago.
Champion, F.
1990 « La nébuleuse mystique-ésotérique. Orientations psychoreligieuses des courants
mystiques et ésotériques contemporains » in F. Champion & D. Hervieu-Léger (dir.), De l’émotion
en religion. Renouveaux et traditions, Paris, Centurion, pp. 17-69.
1995 « Religion et modernité. Nouveaux Mouvements Religieux et nouvelles religiosités
mystiques-ésotériques », Cahiers Français 273, pp. 13-18.
Champion, F. & L. Hourmant
1999 « “Nouveaux mouvements religieux” et sectes » in F. Champion & M. Cohen (dir.), Sectes et
démocratie, Paris, Seuil, pp. 59-85.
Champion, F. & V. Rocchi
2000 « Le soin des âmes et des corps en débat public : l’analyseur psycho-mystique-ésotérique »
in P. Bréchon, B. Duriez, J. Ion (dir.), Religion et action dans l’espace public, Paris, L’Harmattan, pp.
241-253.
Davie, G. & D. Hervieu-Léger
1996 « Le déferlement spirituel des nouveaux mouvements religieux » in G. Davie & D. Hervieu-
Léger (dir.), Identités religieuses en Europe, Paris, La Découverte, pp. 269-289.
Glik D.C.
1990 « The redefinition of the situation : the social construction of spiritual healing
experiences », Sociology of Health and Illness 12 (2), pp. 151-168.
Guérin A. & B. Paillard
1999 Médecines parallèles et sida, Paris, CETSAH.
Hervieu-Léger, D.
1999 Le pèlerin et le converti. La religion en mouvement, Paris, Flammarion.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
100
Lewis, J.R. & J.G. Melton
1992 Perspectives on the New Age, Albany, State University of New York Press.
Loriot, P.
2004 « Les psys, l’État et les charlatans », Le Nouvel Observateur, 22/1/2004.
Maître, J.
1987 « Régulations idéologiques officielles et nébuleuses d’hétérodoxies. À propos des rapports
entre religion et santé », Social Compass 34 (4),
pp. 53364.
Rocchi, V.
2003 « Des nouvelles formes du religieux ? Entre quête de bien-être et logique protestataire : le
cas des groupes post-Nouvel-Âge en France », Social Compass 50 (2), pp. 175-189.
Trincaz, J.
1975 « Le pouvoir thérapeutique des Ba-Pena (Casamance). Initiation et pouvoir libérateur »,
Psychopathologie africaine 11 (3), pp. 323-362.
Van Hove, H.
1999 « Introduction », Social Compass 46 (2), pp. 115-119.
York, M.
1999 « Le supermarché religieux : ancrages locaux du Nouvel Âge au sein du réseau mondial »,
Social Compass 46 (2), pp. 173-179.
NOTES
1. Voir Loriot, 2004 : 78.
2. Un amendement sénatorial du 10 juillet 2004 étend la reconnaissance aux psychanalystes. Les
psychothérapeutes qui ne sont ni diplômés ni psychanalystes en restent exclus.
3. Cette étude a été réalisée auprès de trente-huit personnes, sur Paris et sa banlieue, durant
deux ans (2000-2002).
4. Ce qui explique le manque de données, dans certains cas.
5. Ces auteurs ont élaboré une typologie des NMR en trois points : le courant spiritualiste dont
fait partie la nébuleuse mystique-ésotérique, le courant conversionniste (ex. les groupes
charismatiques) et le courant pré- ou post-millénariste (ex. les Enfants de Dieu), voir Davie &
Hervieu-Léger, 1996.
6. Selon Max Weber, deux voies de salut reposent sur l’auto-perfectionnement : la voie éthique
où le salut est attaché à un agir conforme à la volonté de Dieu, et la voie mystique où le salut
découle de la réalisation d’un certain état d’être, obtenu grâce à un travail de transformation de
l’intériorité même du sujet. Dans le cas de la NMÉ ou de la NPM, la voie de salut consiste en la
réalisation d’un certain état d’être ; « la dimension d’intériorité, de ressenti personnel, y est donc
tout à fait centrale » (Champion, 1990 : 27).
7. Pour V. Rocchi, « le terme “psycho” veut signifier la prédominance des activités
thérapeutiques sur les activités religieuses » (Rocchi, 2003 : 177).
8. Les prénoms des personnes ont volontairement été changés afin de préserver leur anonymat.
9. La méthode proposée par Niro Asistent repose sur différents aspects : concentration sur soi, se
détacher de ses soucis, se concentrer sur ses propres besoins, pratiquer la visualisation créatrice,
s’adonner à de l’exercice, s’entourer de personnes qui procurent du bien-être (Guérin & Paillard,
1999 : 64).
10. Souligné par nous.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
101
11. Souligné par nous.
12. Il existe, dans la littérature anthropologique, un schéma de ce type où celui qui est affecté par
la maladie devient guérisseur. Ainsi, on reconnaît un don de guérison aux thérapeutes mancagne
de Casamance, suite à une expérience de la maladie (Trincaz, 1975).
13. Il s’agit d’une sous-population de lymphocytes T qui constituent la cible privilégiée du VIH.
14. Méthode qui s’inspire de l’acupuncture mais sans utiliser des aiguilles.
15. « Médecine non officielle qui cherche à retrouver le point de départ d’un état pathologique,
d’une douleur, et à les traiter par manipulation » (Le nouveau petit Robert. Dictionnaire de la langue
française, 1994 : 832).
16. « Pratique thérapeutique faisant appel à des manipulations sur les os » ( Le nouveau petit
Robert. Dictionnaire de la langue française, 1994 : 1554).
17. Au sein du Nouvel Âge, la guérison est dite holistique quand elle tient compte des trois
aspects que sont le corps, le mental et l’esprit.
18. « Ensemble de pratiques visant à dominer les sensations douloureuses et les malaises
psychiques, afin d’atteindre un développement plus harmonieux de la personnalité » (Le nouveau
petit Robert. Dictionnaire de la langue française, 1994 : 2114).
19. http://perso.wanadoo.fr/sidasante/sousindex.htm
20. M. Bowman (1999) note, à la suite d’une étude faite dans la ville de Bath (Grande-Bretagne),
haut lieu de la spiritualité Nouvel Âge, que les « guérisseurs » sont, pour la plupart, des femmes
faiblement diplômées.
21. W. Bloom, auteur et porte-parole du Nouvel Âge, « avait déclaré que l’expansion prodigieuse
de la communication électronique et des réseaux d’information avait été le facteur clé de la
soudaine progression du Nouvel Âge » (cité par York, 1999 : 174).
22. Selon D. Hervieu-Léger (1999), trois types de conversion peuvent être envisagés : changement
de religion, conversion sans attache confessionnelle antérieure, et réaffirmation du converti de
l’intérieur. Avec Thierry, on se trouve dans le premier cas de figure : abandon de la religion
héritée et rencontre d’une nouvelle spiritualité.
23. Imposition des mains sur le corps afin de débloquer et/ou d’harmoniser les énergies.
24. Groupes se réclamant de Marthe Robin (1902-1981), une femme ayant reçu les stigmates.
25. Tout psychothérapeute n’a pas vécu une maladie grave mais, pour ceux qui l’ont vécue, cette
expérience contribue, selon eux, à légitimer leur efficacité thérapeutique.
RÉSUMÉS
Devenir psychothérapeute spirituel, si l’on désigne ainsi les psychothérapeutes qui se réfèrent
aux conceptions répandues dans la mouvance du Nouvel Âge, n’est pas, comme cela est souvent
envisagé, un projet accessible au tout venant. L’analyse d’entretiens réalisés auprès de personnes
en France souhaitant s’installer comme psychothérapeute spirituel ou l’étant déjà, tend à
montrer que plusieurs conditions doivent être réunies pour « réussir » dans ce milieu,
notamment la socialisation/insertion à la mouvance Nouvel Âge et la possession d’un capital
socio-économique. Dans les quatre cas examinés, l’expérience d’une maladie létale et chronique
(VIH/Sida) est néanmoins apparue comme l’élément déclencheur de ce parcours initiatique.
Unlike what is often imagined, becoming a spiritual psychotherapist in the sense of the
conceptions circulating in the New Age movement is not a possibility open to anyone. As this
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
102
analysis of interviews conducted with persons in France who want to become or already are
spiritual psychotherapists shows, several conditions have to be met in order to “succeed”; in
particular, the person must be socialized/integrated in the New Age movement and possess a
socioeconomic capital. In the four cases considered herein, the experience of a deadly, chronic
illness (HIV-infection/AIDS) turned out to be the factor that led them to set out on this initiatory
quest.
INDEX
Index géographique : France
Keywords : AIDS, spirituality, psychotherapy, experience, New Age, France
Mots-clés : spiritualité, Sida, psychothérapie, expérience, Nouvel Âge
AUTEUR
ANNE-CÉCILE BÉGOT
Groupe de sociologie des religions et de la laicité (GSRL), EPHE/CNRS
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
103
Sans douleur
Épreuves rituelles, absence de souffrance, et acquisition de pouvoirs en
Inde
Without pain: Ritual ordeals, the lack of suffering and the acquirement of powers
in India
Gilles Tarabout
1 En Inde comme ailleurs, il existe divers contextes où l’expérience de la souffrance est
valorisée. C’est le cas dans la poésie classique ou dans des hymnes dévots, où un thème
comme la séparation douloureuse d’avec l’être aimé – qui peut être Dieu – est l’objet
d’une élaboration esthétique poussée1. C’est aussi le cas, sans que cela soit une règle,
dans le domaine des pratiques divinatoires et de thérapeutique rituelle où, selon les
récits autobiographiques de certains spécialistes, l’acquisition de pouvoirs découle
d’une expérience de malheurs ou de souffrances corporelles infligée comme signe
d’élection par une divinité (Nabokov, 2000). À l’inverse, il existe également un certain
nombre d’épreuves rituelles volontaires où une souffrance prévisible se voit déniée.
Une telle absence de douleur, publiquement mise en scène, est proprement
extraordinaire aux yeux de tous. C’est à de telles épreuves, où le non-ressenti de la
souffrance est signe de succès, que la présente contribution est consacrée.
2 Les épreuves dont il s’agit sont des « macérations » rituelles – le terme sera préféré à
« mortifications » car il n’implique pas la notion d’expiation 2. Elles sont effectuées
comme actions de grâce par des dévots, qui s’y sont engagés auprès d’une divinité en
retour de la satisfaction d’une demande. Certaines de ces épreuves ont une réputation
qui a dépassé les frontières de l’Inde : marche « dans le feu », crocs ou aiguilles
enfoncés dans la peau ou la langue, etc. D’autres sont moins spectaculaires et moins
célèbres : cheminer à genoux jusqu’au temple, ou en se roulant par terre. Dans tous les
cas, il s’agit d’épreuves difficiles, qui procureraient en temps normal, dit-on, une vive
souffrance, mais qui sont pourtant accomplies sans éprouver ni blessure ni douleur.
3 L’étude qui suit portera sur les représentations et les discours où s’affirme ce paradoxe
délibéré. Certaines épreuves seront brièvement évoquées, et replacées dans un
ensemble de pratiques et de conceptions qui les rendent plus intelligibles. Le rapport à
une mythologie de l’ascèse sera souligné, l’hypothèse étant qu’une commune
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
104
dénégation de la souffrance, et l’obtention corrélative de pouvoirs, participe d’un
même type d’élaboration cognitive de l’expérience.
4 Les matériaux présentés sont principalement ethnographiques. Mon expérience de
terrain se limite à un Etat du sud de l’Inde, le Kérala, mais certains documents utilisés –
bandes dessinées, ouvrages populaires, observations d’autres ethnologues – relèvent
d’autres régions. De ce fait, la pertinence des situations et des conceptions exposées me
paraît dépasser le seul Kérala et s’appliquer à l’ensemble de l’Inde et au Sri Lanka.
Variations sur une mythologie de l’ascèse
5 La mythologie sanskrite comporte d’innombrables récits où des épreuves ascétiques
extrêmes permettent d’obtenir des pouvoirs extraordinaires. Il s’agit d’êtres fabuleux,
sages légendaires ou, à l’inverse, ennemis des dieux – parfois de dieux mêmes, comme
Siva, maître et modèle des ascètes. Sans nourriture, immobiles pendant
d’incommensurables durées, tandis que les plantes poussent sur leur corps et que les
termitières s’édifient le long de leurs jambes, ces ascètes, par l’intensité de leur
méditation, provoquent un échauffement (tapas, le mot désigne aussi les austérités) 3,
dont l’ampleur finit par menacer l’équilibre des mondes.
La naissance de l’asura-buffle. « Aux temps anciens, dans la bataille entre les dieux et
les démons [ici, les asura], les fils de Diti [= les asura] furent détruits pas les dieux.
Diti était accablée de chagrin, et dit à sa fille : “Va, ma fille, et pratique l’ascèse dans
une forêt […] pour obtenir un fils, afin que par ce fils Indra et les autres dieux, qui
maîtrisent leurs sens et savent se contrôler, n’existent plus, Ô fille aux belles
hanches.” En entendant les paroles de sa mère, sa fille s’inclina et prit la forme
d’une bufflesse. Elle alla dans la forêt et s’assit entre cinq feux [le 5 e étant le soleil].
Elle pratiqua une ascèse si terrifiante que les mondes se mirent à trembler, que le
triple monde fut agité de la peur de cette ascèse […]. Le sage Suparsva fut ébranlé
par cette ascèse et lui dit : “ Ô fille aux belles hanches, je suis satisfait. Tu auras un
fils avec une tête de buffle et un corps d’homme, et le nom de ton fils sera Mahisa
[= buffle]. Il aura pléthore de force, et opprimera les cieux et Indra et son armée.” »
D’après le Skanda Purana 3.1.6.8-42, texte anglais de W. O’Flaherty (1975 : 239) – ma
traduction en français.
6 L’ascèse, dans un tel cas, s’effectue malgré, ou contre les dieux. Par la menace qu’elle
fait peser sur l’ordre des mondes, elle exerce une contrainte. Pour la faire cesser, les
dieux n’ont d’autre alternative que d’accorder la faveur réclamée. Bien souvent, il s’agit
d’un pouvoir extraordinaire : possession d’une arme magique, impossibilité d’être tué.
Voici un autre exemple, pris dans une version orale contemporaine (condensée) d’un
mythe très répandu au Kérala :
L’ascèse de l’asura Darikan. Darikan, un asura, se soumet à de sévères austérités
(tapas) afin d’obtenir des dons de la part de Siva. Ses méditations s’avèrent sans
effet. Il se coupe les doigts de la main et les jette dans le feu. En vain. Il se coupe les
bras et les jette également dans les flammes. Siva, incommodé par la fumée qui s’en
dégage, consent alors à lui accorder ce qu’il demande, à savoir une canne de
commandement, un char royal, le pouvoir de se régénérer à volonté, le pouvoir de
ne pas être tué par un dieu ou par un homme [il dédaigne de mentionner les
femmes, et sera plus tard mis à mort par la déesse].
Recueilli en mars 1982 à Tiruvanantapuram (Kérala).
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
105
7 Les épreuves et les pouvoirs obtenus peuvent varier. Deux conditions sont toujours
essentielles :
• l’intensité et la durée de la concentration placent l’ascète hors du temps ordinaire et hors
des rapports sociaux ; l’imagerie ancienne des plantes et des termitières envahissant le corps
de l’ascète, parfois traduite dans l’iconographie, trouve encore aujourd’hui des échos
populaires : selon une anecdote qui m’a été racontée au Kérala en avril 1991, tel brahmane
était un jour plongé dans une méditation si profonde que les fourmis avaient recouvert son
corps sans qu’il s’en soit rendu compte ;
• une stricte abstinence sexuelle. Cette impérieuse nécessité participe de représentations plus
larges où la déperdition séminale est, en Inde comme dans d’autres cultures, synonyme de
consomption (Bottéro, 1992)4. Les dieux le savent bien, qui envoient une nymphe tentatrice
auprès d’un ascète dont les austérités deviennent menaçantes. Au moindre regard intéressé,
sa puissance ascétique s’anéantit, et il lui faudra tout recommencer à nouveau.
8 Dans ces récits, rien n’est explicitement dit de la souffrance possible de l’ascète durant
ses efforts, sinon qu’elle est nécessairement surmontée. Si le mot tapas renvoie à un
« échauffement douloureux » (Malamoud, 1989 : 47), l’ascète est présenté comme
demeurant parfaitement impassible. Il doit, comme les dieux de l’exemple cité plus
haut, parvenir à une maîtrise complète de ses sens et de lui-même. Alors, les pouvoirs
obtenus sont permanents.
9 Il existe une variante importante du schéma précédent, qui met l’accent sur une
relation dévotionnelle entre ascète et divinité. Les épreuves conservent leur caractère
inouï, mais une chose change : l’ascète cherche à se concilier un dieu. Son ascèse n’est
pas une contrainte, encore moins une nuisance, elle est une activité appréciée des
dieux, qu’ils récompensent en octroyant leur grâce. Une telle perspective dévotionnelle
est également ancienne, attestée dans des hymnes tamouls des premiers siècles de
notre ère, entre autres5. Elle a donc coexisté très longtemps avec la vision plus
« mécaniste » présentée ci-dessus, mais semble à l’heure actuelle devenir largement
prédominante, conformément à un usage de plus en plus étendu d’un langage
dévotionnel mieux adapté à un hindouisme « épuré » et moderne, et systématiquement
utilisé par les médias (Tarabout, 1997a). Dans les bandes dessinées, par exemple, elle
s’applique même aux ennemis des dieux : on voit ainsi Ravana, un « démon » raksasa à
dix têtes qui sera ensuite le principal ennemi du dieu Rama, s’imposer une ascèse au
cours de laquelle il coupe et jette dans le feu neuf de ses têtes. Au moment où il va
trancher et brûler sa dixième tête, le dieu Brahma apparaît et lui dit : « Je suis satisfait
de toi. Fais un vœu » (voir extrait de la bande dessinée p. 166, Biswas, 1979) – l’image
rend par ailleurs évident que Ravana ne souffre pas lorsqu’il se coupe ses têtes. Autre
exemple : l’asura-buffle, dont la procréation a été précédemment évoquée, s’impose lui
aussi une ascèse, « pour plaire à Brahma » selon le texte de la bande dessinée, qui
poursuit : « Satisfait par ses austérités, Brahma lui apparut » (Rao & Roy, 1978).
10 Une autre variante, encore, peut se repérer dans des représentations populaires de
pratiques dites « tantriques », destinées à obtenir des pouvoirs surhumains. Les
disciplines « tantriques », ésotériques, reposent sur des textes techniques extrêmement
élaborés, et mettent en jeu des représentations particulièrement complexes reliant
microcosme et macrocosme6. Un travail ascétique prolongé (sadhana), à la fois mental,
physique et rituel, permet à l’initié, sous la conduite d’un maître, de devenir divin ou
quasi divin, c’est-à-dire, pour les plus accomplis, de se libérer du cycle des renaissances
et de devenir des « délivrés » dès cette vie, tout en acquérant des capacités
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
106
extraordinaires (siddhi). Les conceptions variées qui sous-tendent ce processus sont au
cœur de la plupart des pratiques ascétiques actuelles des différents saddhu en Inde.
Elles ne nous concernent cependant pas ici, car les macérations dont il est question plus
loin, extrêmement peu techniques, ne mettent pas en œuvre ces représentations. Par
contre, la façon dont elles sont populairement imaginées est pertinente, car l’accent est
alors mis sur des épreuves – comparativement brèves mais comportant une souffrance
possible – débouchant sur l’acquisition de pouvoirs très concrets. Un exemple en est
fourni par un ouvrage d’imagination, Le Pouvoir du Tantra (Shrimali, 1988). Il inclut ce
qui est présenté comme étant un certain nombre de lettres de remerciement de
disciples de l’auteur, qui rapportent avec quel succès ses conseils ont été suivis. Voici
de brefs extraits d’une lettre attribuée à un certain Vasudev Sharma, qui a effectué une
sadhana pour obtenir les faveurs de la déesse Tara (Shrimali, 1988 : 108-114). Cette
sadhana, menée à domicile, est prévue pour durer quatorze nuits. Elle comporte dessin
et culte d’un diagramme mystique, méditation, récitation prolongée de formules
sonores spécifiques (mantra), divers gestes rituels. A la douzième nuit, des pierres
venues d’on ne sait où viennent heurter la porte de la pièce où il est enfermé. Les vrais
problèmes commencent la treizième nuit.
Les épreuves de Vasudev Sharma. « A une heure du matin, j’entendis les sonnailles
bruyantes d’anneaux de cheville, très proches, et quelqu’un s’approcher de moi à
pas lourds et retentissants. Je hurlai à la vision d’une femme énorme, monstrueuse,
qui se tenait devant moi. Longs cheveux défaits, yeux injectés de sang, longues
dents proéminentes, elle était terrifiante. Dans une main elle tenait une tête
humaine qui semblait avoir été fraîchement séparée du corps, car le sang en
dégoulinait. De son autre main, la femme recueillait le sang et le léchait. […] Elle
avait des ongles très longs et tout son corps était couvert de poils. Elle mit son pied
sur ma poitrine et dit : “Aujourd’hui, je dois boire ton sang à toi aussi.” Et elle éclata
de rire. Son rire ressemblait à des os qui s’entrechoquent, et son corps dégageait
une insupportable puanteur.
Je restai calme, même dans cette situation terrible. […] J’endurai des souffrances
insupportables lorsqu’elle commença à m’arracher la peau, à extirper des morceaux
de ma chair et à les manger avec une satisfaction bruyante. Mais à quatre heures du
matin, je terminai mon compte de 101 rosaires [dont les grains sont utilisés pour
marquer la récitation des mantra].
[Sharma s’endort, et constate au réveil que son corps est intact ; vient la
quatorzième nuit]
A environ trois heures du matin, une très belle femme s’approcha et se tint près de
moi. […] Un parfum enivrant se dégageait de son corps. Elle vint et s’approcha,
jusqu’à ce que nos genoux se touchent. Sa douce haleine caressait mon épaule. […]
Un instant, j’oubliai le mantra, mais je me repris et, fixant mon regard sur le mur
opposé, je continuai ma récitation [cette dernière épreuve surmontée, l’ascèse est
un succès]. Après un moment elle me dit : “Pourquoi m’as-tu appelée ? Je suis ici
parce que tu m’as appelée.”
Je dis : “Je vous ai appelée pour m’aider dans ma vie.”
Elle demanda : “Comme une mère ou comme une douce amie ?”
Je répondis : “Je n’obtiendrai rien de vous si vous êtes comme une mère. Je vous
veux pour douce amie. Mais sans sexe.”
[…] Elle avait un sourire ensorceleur, qui aurait dévoyé même le plus endurci des
ascètes. Elle dit : “Je veux bien être ta douce amie, mais sauras-tu me satisfaire ?”
Je dis : “Nous n’aurons pas de rapports sexuels. Je vous ai adressé ma prière. Comme
douce amie, vous devez me donner assez d’argent chaque matin pour me permettre
de bien vivre.”
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
107
[Tara, puisque c’est elle, promet. Après s’être endormi, Sharma se réveille]
Il n’y avait plus personne dans la pièce, mais une barre en or se trouvait là où était
ma tête, elle devait peser dans les 20 grammes. […] Je dors maintenant dans mon lit,
dans ma chambre, et trouve une barre d’or semblable sous mon oreiller, chaque
matin. »
11 Ce texte, au-delà de la fantaisie de sa rédaction, présente de nombreux points communs
avec les déclarations que l’on peut entendre à l’heure actuelle concernant l’acquisition
de pouvoirs « magiques » (au Kérala : mantravadam) : l’adepte, en méditation, doit éviter
de se laisser distraire par les bruits et les visions, et risque la folie s’il perd confiance en
lui-même (Tarabout, 1997b : 270) ; mais s’il finit par obtenir la vision de la divinité
choisie, alors il aura d’elle ce qu’il veut et pourra la convoquer « en un claquement de
doigts » (id., p.259) ; elle deviendra, selon certains, son esclave (id., p.263).
12 Dans l’ensemble des représentations évoquées, la continence sexuelle, l’observance
d’un jeûne et la fermeté d’esprit dans la résolution sont des conditions nécessaires,
mais non suffisantes, pour triompher. La souffrance n’est pas toujours niée, mais elle
est forcément surmontée : lorsqu’elle est mise en valeur, ce n’est pas pour elle-même
mais pour magnifier la force d’esprit ayant permis de rester impassible. L’échauffement
du tapas, explicite dans les récits mythologiques, n’est par contre plus en évidence dans
un texte populaire actuel comme celui qu’on vient de citer – sinon que l’adepte, au
cours de sa pratique, ressent une forte fièvre !
13 Dans les cas où l’ascèse est entreprise pour obtenir des pouvoirs, et non la délivrance
des renaissances successives, le rapport aux divinités paraît en quelque sorte
instrumentalisé, y compris lorsque le récit recourt au registre de la dévotion : c’est
finalement toujours un certain rapport de force qu’instaure l’ascète ayant des visées
mondaines, et son désir en vient presque nécessairement à être satisfait (dans le cas
d’une recherche de la délivrance, le rapport au divin peut cependant être tout autre).
Enfin, l’acquisition des pouvoirs est définitive : il n’est plus besoin, ensuite, de
renouveler l’ascèse (dans le cas des « magiciens » au Kérala, cette propriété peut même
se transmettre parfois aux générations suivantes, sans que celles-ci aient à accomplir
l’ascèse fondatrice de leur aïeul).
14 Venons-en maintenant aux macérations rituelles proprement dites. Ce qui vient d’être
vu permettra d’éclairer ce qui s’y passe.
Les corps miraculés
Un exemple ancien
15 A titre d’illustration, je traduis un extrait d’une brève communication, peu connue, de
A.M. Hocart, décrivant un rituel de suspension par des crochets tel qu’il a pu l’observer
dans les années 1920 (Hocart, 1927). La rubrique sous laquelle cette communication est
parue indique « Ceylon : Religion », mais la cérémonie est semblable, jusque dans le
détail, avec ce qui peut s’observer au Kérala – en contraste avec la région voisine du
pays tamoul ou le sud-est de Sri Lanka, où les procédures sont différentes :
Une suspension. « Parmi les nombreux types différents de fêtes religieuses pratiquées
dans ces régions, l’une des plus horribles est le tukkam [«suspension»] ou «Hook-
swinging». Elle est liée aux temples de Bhagavaty [un nom de la déesse] et est
supposée être la plus propice. Il s’agit généralement d’une cérémonie de temple,
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
108
mais il n’est pas rare qu’elle soit célébrée comme offrande votive.
L’homme qui doit avoir les crochets fait des bhajanam [chants dévotionnels], un
service pieux, durant une période de sept, douze, vingt et un ou quarante et un
jours, selon le cas. Pendant cette période de préparation, le coût de sa nourriture et
de son hébergement est pris en charge par les fonds du temple. Le jour de la fête, il
passe tout son temps dans le temple, jusqu’au moment fixé. Il est alors bizarrement
déguisé avec un costume cérémoniel, avec la coiffe, et on lui donne une épée et un
bouclier. Lorsque tout est prêt, il se précipite dehors accompagné d’une foule de
gens, dont quelques-uns portent épée et bouclier, jusqu’au lieu de rendez-vous où
est préparée une machine évoquant une grue [un cadre en bois muni de brancards,
portant une barre de bois mobile, comme un fléau de balance]. Il prend position sur
la grue [sur une planche du cadre]. La partie [de la barre de bois] portant les
crochets est abaissée et son assistant lui passe les crochets à travers la peau du dos,
tirée en arrière. Puis une poule est tuée et son sang est versé sur ses pieds. Ensuite,
un troisième homme, souvent un professionnel ayant une grande expérience de ce
travail, abaisse l’autre extrémité de la barre et la victime se trouve soulevée,
suspendue en l’air. Un groupe de gens prend la grue sur les épaules et court avec,
en procession. Au-devant, quelques hommes armés simulent un combat, ainsi que la
victime suspendue par les crochets, qui combat en l’air dans cette position
compliquée. Cela n’a rien d’une vision agréable. Si les voies de Dieu sont
merveilleuses, les façons de lui plaire sont bien cruelles » (Hocart, 1927 : 161-2).
Promesses et macérations
16 Les macérations rituelles observables au Kérala (en particulier des tukkam) ont fait
l’objet d’un travail ethnographique antérieur (Tarabout, 1986 : 262-358). J’en ai détaillé
les aspects théâtralisés (comme, parfois, mais pas exclusivement, un simulacre de
combat), dont le développement est un peu particulier à cette région. Dans la mesure
où ceux-ci n’ont pas ici de pertinence particulière, je n’y reviendrai pas. Seuls quelques
traits généraux sur les macérations, mis en évidence par cette étude et par d’autres
auteurs, seront présentés.
17 Il s’agit de rites qui sont toujours publics, organisés une fois l’an dans certains temples
à l’occasion de leur fête. Ces rituels ont généralement été promis à une divinité, en
retour de faveurs demandées, et reçues : ce sont donc avant tout des actions de grâce
(même s’il existe d’autres cas de figure). Les bienfaits sollicités sont souvent assez
prosaïques : santé, argent, réussite dans les études, obtention d’un emploi, succès dans
les affaires, etc. Si la demande est exaucée, la promesse faite à la divinité doit être
tenue. Leur nature peut être très diverse : dons d’argent, récitations de textes pieux,
etc. Les macérations n’en constituent donc qu’un cas particulier, et consistent en
pratiques jugées être, en temps normal, très pénibles, douloureuses, voire
« impossibles » : cheminements vers le temple ou autour du temple en portant des
charges plus ou moins lourdes, ou bien à genoux, en rampant, en roulant sur soi-
même ; fustigations ; marche « dans le feu » (de façon plus appropriée, sur un tapis de
braises) ; percements de peau avec des objets divers ; suspensions en l’air par des
crochets passés dans le corps (le fameux « hook-swinging » des documents britanniques
de la période coloniale). Nombre de ces épreuves ont été abondamment documentées,
et leur description ne sera pas reprise ici7. Beaucoup s’inscrivent dans une logique
sacrificielle, parfois très explicite : ainsi les crochets qui sont passés dans la peau des
dévots, au Kérala, portent le nom de « canines » (darmstram) et sont dits être les crocs
de la déesse dans sa forme terrible (Bhadrakali), qui assouvit ainsi sa soif de sang.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
109
18 S’il est fréquent que les macérations soient des formes d’« auto-sacrifice » 8, il arrive que
leur exécution – en particulier au Kérala – puisse être au contraire déléguée. Ainsi, la
mère d’un ami avait promis à la déesse de faire exécuter un rituel appelé « course peau
percée » (kuttiyottam) si son fils obtenait un poste de fonctionnaire – ce qui advint. Cette
« course peau percée » (Tarabout, 1986 : 332-335 ; Osella & Osella, 2005), une procession
nocturne, où de jeunes garçons marchent jusqu’au temple de la déesse avec deux
crochets (les « crocs ») insérés dans le dos, ne peut être accomplie après la puberté.
C’est donc un jeune cousin qui fut « sacrifié » en lieu et place, afin de tenir la promesse.
Dans un autre temple, au sud de la capitale, ce sont des spécialistes rétribués d’une
caste donnée qui sont suspendus en l’air et portent dans leurs bras les jeunes enfants de
ceux qui ont fait les promesses (et qui appartiennent à d’autres castes). Il y a là une
relation triangulaire entre celui qui fait le vœu, la divinité et celui qui est la « victime »,
qui n’est pas sans rappeler les schémas interprétatifs classiques du sacrifice.
Cependant, de façon plus générale, en dehors du Kérala, ce sont ceux qui font la
promesse qui se soumettent par la suite eux-mêmes aux épreuves.
L’ascèse préparatoire
19 Toutes ces macérations supposent une préparation rituelle, au moins de ceux qui les
effectuent, souvent également (lorsqu’il s’agit de personnes différentes) de ceux qui ont
pris l’engagement. Cette préparation consiste en un ensemble de prescriptions à
respecter durant une période déterminée, de quelques jours à plusieurs semaines :
jeûne plus ou moins sévère (en tout cas un régime strictement végétarien), continence
sexuelle, bains purificateurs fréquents, pratiques dévotionnelles intensives. Sans que
cela soit systématique, cette préparation se fait souvent de façon collective, les
participants étant alors rassemblés dans un lieu à part (souvent l’espace du temple), à
l’écart du rythme et des activités de la vie ordinaire. Dans l’exemple de la « course peau
percée » cité plus haut, le jeune cousin du bénéficiaire de la promesse, qui a effectué le
rituel en 1982 en remplacement de son aîné, faisait partie d’un groupe de 70 enfants
soumis à la même macération. Tous ont vécu dans l’enceinte du temple pendant une
semaine avant le rituel, en observant un jeûne et en multipliant les pratiques
dévotionnelles. Pour une marche sur les braises dont j’ai été le témoin en 1983, ceux qui
se préparaient au rite devaient respecter une période préalable de dix jours
d’observances.
20 Dans les données ethnographiques que j’ai pu recueillir, les opinions étaient unanimes :
cette période préparatoire est pénible, elle demande un effort de volonté considérable.
Ceux qui s’y soumettent ne parviennent pas tous à en respecter les contraintes, et
certains renoncent (ils n’affrontent donc pas la macération qui en est le but). Une telle
période est explicitement perçue comme étant comparable à une ascèse temporaire.
Mais cette ascèse n’a évidemment pas la dimension épique, et souvent violente, des
ascèses mythiques, ni le caractère extrêmement technique des pratiques initiatiques
tantriques. Elle s’inscrit dans un contexte fortement dévotionnel : la promesse a été
faite à une divinité précise d’un temple précis, où se fera la macération, et la
préparation est tout entière conçue comme un approfondissement de la relation
dévotionnelle qui lie émotionnellement chacun des fidèles à cette divinité. Enfin le
résultat de cette mini-ascèse s’énonce en terme de pureté : ceux qui ont respecté les
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
110
observances durant le temps prescrit atteignent un état de pureté hors de l’ordinaire
qui va leur permettre de se soumettre à la macération.
La mise en scène du miracle divin
21 Les macérations auxquelles se soumettent les dévots sont des épreuves que tous disent
devoir être normalement pénibles et douloureuses. Or, à l’opposé de cette situation de
« sens commun », elles sont affirmées être indolores pourvu que la période de
préparation préalable ait été correctement suivie : « Les brûlures ne se produisent que
si celui qui marche sur les braises a rompu l’une des interdictions » (Brewster, 1962 :
60). Ainsi, lors de la marche sur les braises observée au Kérala en 1983, seule la moitié
des hommes qui s’étaient préparés se sont finalement présentés devant le tapis de
braises pour le traverser (Tarabout, 1986 : 336-353). Les autres, disait-on, n’avaient pas
osé, impliquant par là qu’ils n’avaient pas été scrupuleux dans leur respect des règles
d’abstinence de la période préparatoire.
22 La question de l’expérience de la douleur, dans le cas des suspensions par les crochets, a
été abordée dans sa dimension historique par G. A. Oddie (1995) :
« C’était un point qui divisait les observateurs contemporains [XIX e siècle] de cette
pratique, et qui paraît avoir divisé également les participants.
En 1894, deux pratiquants de Trichinopoly [au pays tamoul], interrogés par le Sub-
magistrate après qu’un membre de leur groupe soit mort “des suites des blessures
causées par le [hook]-swinging”, firent des déclarations sous serment. Para Andy,
qui avait pratiqué depuis quarante ou cinquante ans, déclara : “La suspension cause
une vive douleur.” Et Para Periannan affirma : “Les personnes qui le font ne
peuvent travailler ni rien faire pendant un mois et demi, à cause de la douleur des
blessures occasionnées” [l’auteur renvoie à un rapport de police de 1894 ; la
pratique était alors bannie].
D’un autre côté, l’homme qui fut suspendu pendant une heure et quart lors d’une
reprise de la fête à Sholavanandan, près de Madura [pays tamoul], en 1891, déclara
aux officiels qui l’interrogeaient qu’il n’y avait “aucune douleur”. Et Ram Naid,
Deputy Magistrate de Khandesh dans la Présidence de Bombay, qui interrogea là
plusieurs praticiens, se vit dire la même chose. “Plusieurs personnes” qui avaient
fréquemment enduré la pénitence eux-mêmes, lui ont assuré que “sauf la première
fois, où ils avaient ressenti un certain choc lorsque les crochets avaient été
introduits dans leur dos”, ils avaient “toujours apprécié (enjoyed) la suspension,
plutôt qu’ils n’en avaient souffert” » [l’auteur cite un rapport de 1885].
23 Oddie cite également un travail de l’anthropologue G. Obeyesekere (1981), qui s’est
entretenu avec des dévots s’étant soumis à la suspension à Sri Lanka. Dans le cas d’une
femme (un cas de figure comparativement rare) qui avait été suspendue à un arbre par
six crochets (épaules, taille, mollets), celle-ci reconnaît : « J’ai senti une douleur légère
lorsque j’ai été percée avec les crochets, mais aucune lorsque je pendais de l’arbre. J’ai
vu ma mère s’évanouir – rien d’autre. Je ne pensais plus, je ne me rendais compte de
rien, c’était comme si j’étais inconsciente » (Obeyesekere, 1981 : 130) ; la même, à
propos de marches sur le feu, « ressent du plaisir, vinoda ; mon esprit est calme, je ne
sens pas de douleur » (id., p.128). Et un autre dévot, musulman, qui se soumet
régulièrement à la suspension lors du grand pèlerinage hindou/bouddhiste de
Kataragama, au sud-est de l’île, « affirme qu’il ne sent aucune douleur. Lorsque les
crochets en fer percent son corps, dit-il, il se sent froid, comme s’il était dans une
chambre frigorifique » (id., p.146).
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
111
24 Ma propre ethnographie au Kérala suggère la prédominance des discours qui dénient
l’existence de douleur. C’est là, sans doute, une spécificité par rapport aux épreuves
encourues dans diverses sociétés dans le monde, où la souffrance, sans être
nécessairement valorisée comme (autrefois) dans certaines pratiques chrétiennes
d’auto-flagellation, demeure ressentie mais est surmontée. Le discours et l’idéal, ici,
sont différents. Il s’agit de ne pas éprouver de douleur : « La souffrance serait signe
d’échec, d’absence de grâce » (Racine, 2002 : 357). S’il y a épreuve pénible, dans cette
perspective, elle est à chercher au plan de la période préparatoire. Mais la macération,
même la plus délibérément impressionnante, n’est pas, en principe, souffrance. De fait,
non seulement les dévots qui marchent sur les braises ou se suspendent par les
crochets le font généralement avec assurance, mais ils peuvent inviter à constater,
plante des pieds et peau du dos à l’appui, qu’il n’existe ensuite aucune blessure, le corps
est intact. C’est, bien entendu, la protection dont la divinité gratifie son dévot méritant
qui empêche celui-ci d’éprouver la douleur et d’être blessé. La réussite de la macération
est ainsi un miracle divin, et les dévots exposent aux yeux de tous leur corps miraculé 9.
Replacées dans cette perspective, les deux phases qui ont été évoquées prennent toute
leur richesse symbolique.
25 La préparation, nous l’avons vu, est une ascèse dévotionnelle. Elle purifie le dévot, et lui
permet par là d’être digne de recevoir la grâce divine. C’est pourquoi, dit-on, il est rare
que des femmes se soumettent à ces macérations – du fait de leur statut rituel inférieur
à celui des hommes (Obeyesekere, 1978 : 460). Elle est aussi, de facto, acquisition
temporaire d’un pouvoir, celui d’affronter en confiance la macération. Elle est enfin à
comprendre comme un moment de dévotion intense qui s’inscrit dans une tradition
sud-indienne (et plus particulièrement tamoule) de recherche et de partage de l’amour
(ampu) divin. C’est par « amour fou » de Siva que certains saints sivaïtes d’avant le XII e
siècle, selon leur hagiographie, se seraient livrés à des actes d’une violence sanglante
extrême, y compris sur eux-mêmes ou sur les membres de leur famille (Dennis Hudson,
1989) – nombreuses décapitations, mutilations diverses. Il s’agit d’un amour exclusif,
qui prend possession de tout l’être, et permet aux élus de ressentir et partager la
présence du dieu.
26 La macération elle-même est alors d’interprétation complexe et possède de multiples
dimensions :
27 – action de grâce, elle témoigne publiquement, au cours de la fête, que les demandes
individuelles initiales ont été exaucées par la divinité : « Lorsque nous voyons que la
réalisation des promesses est faite en très grand nombre durant la fête, nous savons
que plusieurs milliers [de dévots] ont reçu la bénédiction de Murukan » [pour lequel est
pratiquée une macération avec percements de peau, cf. infra] (Pfaffenberger, 1979 :
266) ;
28 – miracle de l’absence de souffrance, elle est une démonstration de la toute puissance
divine. De ce fait, elle possède une dimension délibérément spectaculaire ; d’une part,
elle est à l’heure actuelle fréquemment médiatisée par les journaux locaux ; d’autre
part, elle peut s’intégrer, comme c’est régulièrement le cas au Kérala, à la
théâtralisation rituelle d’un mythe (c’était aussi l’observation faite par Hocart), qui
comporte une élaboration esthétique parfois poussée (Tarabout, 1986). Enfin, il existe
une stupéfiante ingéniosité dans la recherche des dispositifs de macération les plus
impressionnants possibles ; dans les percements de peau pratiqués au cours de la
macération dédiée au dieu Murukan, par exemple, les objets perçants sont de toutes
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
112
sortes : reproductions, de différentes tailles, de la lance du dieu (certaines dépassent
deux mètres de longueur), qui sont passées à travers les joues ou à travers la langue ;
objets plus petits, comme des aiguilles, dont on perce la peau ; nombreux petits
crochets introduits dans la peau de la poitrine ou du dos et où sont accrochés des
citrons ; ou encore suspension en l’air (à différentes sortes d’échafaudages possibles)
par des crochets plus importants. Des combinaisons sont possibles : les lances peuvent
être multipliées et constituer des assemblages métalliques en queue de paon étalée,
perçant les flancs et le dos du dévot ; le dévot peut tirer de lourdes charges attachées à
des crochets passés dans le dos. La suspension en l’air s’est effectuée autrefois sur des
échafaudages rotatifs ; on recourt couramment aujourd’hui à des dispositifs mobiles,
des chariots ou brancards, qu’on fait parader en procession autour du temple 10 ; tout
est ainsi fait pour frapper d’admiration l’assistance, souvent très nombreuse ;
29 – la macération, en tant que miracle, peut être rapprochée des ordalies. Pour prouver
son innocence, un accusé pouvait être amené à plonger la main dans de l’huile
bouillante, dans un panier contenant des serpents, etc. ; la protection divine, si elle
était justifiée, assurait l’immunité et témoignait de la rectitude de celui qui était mis à
l’épreuve. Un test comparable (par exemple tenir dans la paume de la main du camphre
enflammé sans être brûlé) pouvait être appliqué au Kérala pour vérifier qu’un candidat
à la possession institutionnelle était bien l’élu de la divinité ; dans le cas des
macérations, l’absence de blessure et de douleur témoigne, là encore, de la rectitude et
de la pureté de corps et d’esprit du dévot, et de son « élection » par la divinité ;
30 – il s’agit aussi d’un sacrifice, où la victime (comme dans tout sacrifice en Inde) est
consentante. Ce sacrifice plaît à la divinité ; dans les rituels de percement de peau ou de
suspension effectués pour la déesse au Kérala, le sang du dévot est explicitement offert
« à boire » soit à celle-ci, soit à l’un des acolytes divins. Des mouvements réformateurs
de l’hindouisme qui condamnaient les pratiques de suspension par les crochets ont
réussi à les faire interdire dans la plupart des temples kéralais à l’heure actuelle. Or,
d’une part, des pratiques de substitution demeurent fréquentes (crochets passés dans la
peau, mais suspension par d’autres moyens, ou absence de suspension ; Tarabout,
1986) ; d’autre part, il arrive que les dévots affirment que la déesse, du coup, n’est plus
satisfaite et risque de ne plus les protéger : en dépit des interdictions, ils reprennent la
pratique, car la déesse exige les sacrifices ;
31 – la relation du dévot à la divinité est profondément ambivalente. Par sa préparation
dévotionnelle, il intensifie son amour pour elle, et participe de l’amour qu’elle lui voue :
cela conduit à une réalisation personnelle de l’immanence divine durant la macération,
que les observateurs ont souvent décrite en termes de « transe » ou d’« extase ». Par
ailleurs, les crocs de la déesse, la lance de Murukan, sont plantés dans le corps du
dévot ; comme dans bien des mythes où l’ennemi des dieux est « sauvé » et gagne le ciel
par le simple contact du dieu ou de la déesse qui le tue, contact qui est en lui-même une
grâce, il faut comprendre la pénétration physique de l’arme divine dans le corps du
dévot comme une bénédiction – il a, si l’on veut bien nous passer l’expression, la
divinité « dans le corps ». Offerte en sacrifice, la victime dévote est à l’image des
ennemis dont la divinité triomphe dans les mythes, tout en étant littéralement
pénétrée par la présence divine dont elle expérimente alors en elle la nature ;
32 – cette expérience est par nature temporaire ; les pouvoirs surhumains que le dévot
semble posséder en traversant sans souffrir la macération ne sont pas les siens, mais
ceux de la divinité. En cela, à la différence des ascèses dont il a été question, il n’y a pas,
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
113
en principe, acquisition durable de compétence ; si le dévot doit se soumettre l’année
suivante à la même macération, il devra à nouveau refaire l’ensemble du processus de
préparation. Cependant, la répétition, année après année, de la macération, jointe à un
mode de vie « pur », confèrent progressivement une autorité et un prestige croissants.
Les dévots expérimentés, souvent appelés sami, swamiyar, terme honorifique qui dans
ce contexte renvoie à une certaine sainteté, deviennent des guides, des initiateurs pour
les néophytes ; ils sont alors crédités d’un pouvoir spirituel particulier, permanent,
dont les effets débordent le cadre de la macération et peuvent, par exemple, s’exercer
dans le cadre de thérapeutiques rituelles (Racine, 2002). Souvent, ils s’imposent des
épreuves de difficulté croissante pour vivre plus intensément leur expérience
miraculeuse – et cela contribue à asseoir les pouvoirs qui leur sont attribués (id. ; cf.
également Obeyesekere, 1981 : 128 sqq.). Il y a donc bien acquisition possible de
pouvoirs durables aux yeux des autres dévots, mais par la répétition et un mode de vie
adéquat11.
Ascètes mythiques et dévots actuels
33 Pourquoi rapprocher les macérations rituelles actuelles de la mythologie de l’ascèse, y
compris dans ses formes populaires, et ne pas l’avoir fait avec les techniques
initiatiques « tantriques » dont se réclament la plupart des ascètes aujourd’hui ? Tout
d’abord parce que, dans les macérations comme dans l’image popularisée des ascètes
mythiques, les techniques ésotériques sont, précisément, réduites au minimum, voire
totalement absentes. Aucune complexité de l’image du corps, ou des relations
microcosme-macrocosme, aucune technique physiologique ou mentale particulière : la
description se ramène à évoquer une série de restrictions à observer, et des prouesses
surhumaines. Cela n’exclut pas que certains dévots, à titre individuel, et plus
particulièrement sans doute les sami, puissent posséder des connaissances de base
quant aux représentations et pratiques ésotériques, ni qu’ils puissent les appliquer.
Mais, d’une part, ce n’est pas ainsi que les pratiques sont évoquées parmi les dévots, et,
d’autre part, il s’agit de cas isolés et non de ce qui est demandé à la masse de ceux qui
pratiquent les macérations – ce n’est pas la condition de leur succès.
34 Macérations et ascèses mythiques ont également ceci de semblable qu’elles mettent en
avant l’excès de violence même des épreuves affrontées ; cependant, celles-ci sont
surmontées avec une relative facilité, sinon un certain plaisir : le plus éprouvant, on en
a souvent l’impression dans ces discours, c’est le célibat ! Autre point de
rapprochement : ascètes mythiques et dévots s’imposant les macérations s’inscrivent
dans une commune tension entre monde du désir, qui motive tant la recherche de
pouvoirs extraordinaires que les promesses votives, et monde de la discipline,
caractérisé par un contrôle de ses émotions et un détachement affirmé du monde
extérieur.
35 Il existe cependant aussi des différences immédiates. L’ascèse mythique est présentée
comme une progression continue dans l’épreuve, jusqu’à obtention définitive des
pouvoirs recherchés. Les macérations doivent être appréhendées comme un processus
dédoublé : d’une part, la préparation « ascétique » permet l’acquisition de la capacité à
affronter la macération proprement dite ; d’autre part, celle-ci n’est plus une ascèse au
sens strict, mais le spectacle du pouvoir divin. Et si les macérations, prises dans leur
ensemble, apparaissent comme une sorte d’ascèse de masse (les fêtes peuvent
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
114
rassembler plusieurs centaines, voire, à Kataragama, plusieurs milliers de macérations
à la fois), elles ne permettent pas en tant que telles l’acquisition de compétences
durables – sauf réitération sur plusieurs années.
Les prouesses sans les dieux
36 Les élites indiennes, depuis l’époque coloniale, et les Britanniques, ont condamné ces
pratiques comme étant des superstitions inutilement violentes, ce qui a conduit à
l’interdiction officielle de certaines d’entre elles (Oddie, 1995). Cela ne les a pas
empêchées de perdurer. Elles connaissent depuis quelques dizaines d’années un regain
de popularité, et même parfois une extension à des groupes pour qui ce n’était pas une
tradition religieuse – par exemple les bouddhistes à Sri Lanka (Obeyesekere, 1978). En
cela, loin d’être cantonnées à des pratiques archaïques et désuètes, elles doivent être
replacées dans les dynamiques complexes et parfois contradictoires de la
« modernité », qui accompagnent les profondes transformations sociales actuelles en
Asie du Sud (Obeyesekere, 1978 ; Tarabout, 1997a ; Racine, 2002).
37 Cela heurte bien entendu la sensibilité non seulement de ceux qui poussent à des
pratiques religieuses épurées, mais aussi de ceux qui militent pour une approche
rationnelle des innombrables phénomènes qualifiés en Inde de divins ou de
« surnaturels ». Dans le cas des macérations, deux stratégies sont alors suivies. L’une
consiste en une explication, en termes scientifiques, des faits observés. C’est par
exemple ce que rapporte un auteur qui a longtemps œuvré pour la défense du
rationalisme en Asie du Sud, Abraham T. Kovoor. Dans un ouvrage publié en 1980, il
consacre un chapitre aux suspensions. Après avoir rendu hommage à l’Association
Rationaliste de Sri Lanka pour avoir expliqué scientifiquement tant les suspensions que
les marches sur les braises, il expose en détail les arguments récusant les « sept
mystères » qui feraient des suspensions, selon les crédules, un miracle (Kovoor, 1980 :
149-154).
38 La deuxième stratégie consiste à exécuter effectivement les mêmes macérations hors de
la logique religieuse, afin de démontrer l’inanité de celle-ci. Ainsi, A.T. Kovoor indique
que « récemment, un jeune volontaire, d’esprit rationaliste, nommé N.C. Jayasuriya, a
publiquement rejeté toute aide divine, et a effectué la procédure [de la suspension] à
trois occasions distinctes, sans montrer un quelconque signe apparent de douleur » (id.,
p.150) ; il précise également que « M. Jayasuriya, qui n’avait pas invoqué d’aide divine,
n’a pas eu de blessure qui saignait à la suite des démonstrations de suspension qu’il a
données » (id., p.151). Dans la même perspective, il n’est pas rare de lire des annonces
dans les journaux annonçant qu’un militant rationaliste effectuera en public telle ou
telle prouesse, comme se briser sur la tête une centaine de noix de coco, afin de
démontrer qu’il n’y a là rien de miraculeux.
39 Sans avoir d’intention militante particulière, d’autres peuvent chercher à réaliser des
tours de force, comme preuve de leurs propres capacités. Voici un exemple final, tiré
du supplément dominical du journal kéralais Malayala Manorama, daté du 17 avril 1994.
Sous le titre « Le monde de la force », le journaliste, Dr. Rajan Chungath, évoque le cas
extraordinaire d’un homme de 75 ans, Pailippilla, qui s’impose un entraînement
physique quotidien et rigoureux, pour sa santé. Cette perspective hygiéniste l’a poussé
à reculer progressivement les limites de son endurance en s’imposant diverses
épreuves, comme supporter sur la poitrine des poids variant de 60 à 90 kilos, conduire
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
115
sa moto « Bullet » à 80 km/h sur les petites routes du Kérala durant des heures, ou
plonger sa main dans l’huile bouillante. Une photo12 de l’article le montre, en effet, la
main droite dans une grande bassine où des chips de banane sont en train de frire, à un
étal appartenant au marchand Abdullakutty : « Abdullakutty cherchait son écumoire
pour enlever des chips, et fut surpris par ce qu’il vit. Pailippilla avait plongé sa main
dans l’huile bouillante, prélevé quelques chips, et goûtait celles-ci. Tandis que le
marchand et les badauds regardaient stupéfaits, Pailippilla s’essuya les doigts dans son
mouchoir comme si de rien n’était, sourit d’un air innocent, enfourcha sa moto, et
disparut. » L’intéressé, interrogé par le journaliste, s’en explique : « Cela a commencé
en mettant la main au-dessus du feu. Ensuite j’ai commencé à prendre du sable brûlant,
et me suis mis à tremper ma main dans l’huile bouillante. Cela fait six ans que j’ai
commencé. Ce que je cherche, c’est à éliminer du corps la douleur. »
Pailippilla plonge la main dans l’huile bouillante pour retirer des chips de banane
Malayala Manorama, Sunday suplement, 17 avril 1994.
40 En se plaçant sur le terrain des miracles sans en adopter la logique, rationalistes et
hygiénistes réaffirment ainsi une même forme de construction de l’expérience, cruciale
en Asie du Sud, où la négation même de la souffrance, et non le seul fait de la supporter,
est marque de compétence.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
116
Macérations des dévots du dieu Murukan (pays tamoul, 1985)
Photo : Jean-Luc Racine
Photo : Jean-Luc Racine
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
117
Photo : Jean-Luc Racine
Photo : Jean-Luc Racine
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
118
Photo : Jean-Luc Racine
Ravana, ennemi des dieux, obtient de l’un d’eux, Brahma, qu’il exauce son vœu
In P. Biswas, The Lord of Lanka, 1979.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
119
BIBLIOGRAPHIE
Alter, J. S.
1992 The Wrestler’s Body. Identity and Ideology in North India, Berkeley & Los Angeles, University of
California Press.
Ananthakrishna Iyer, L.K.
1909-12 The Cochin Tribes and Castes, Madras, Higginbotham, 2 tomes.
Assayag, J.
1990 « La possession ou l’art de la guerre. Dévots chiens et «Héros d’or» du culte de Mailar en
Inde du Sud », L’Homme 115, pp. 48-70.
1992 « Invulnérables au fer et au feu. Soufisme et fakirisme dans le sud de l’Inde », Revue de
l’Histoire des Religions, CCIX (3), pp. 259-294.
Beck, B.
1969 « Colour and Heat in South Indian Ritual », Man, n.s. 4 (4), pp. 553-572.
Benoist, J.
1998 Hindouismes créoles. Mascareignes, Antilles, Paris, Editions du CTHS.
Biswas, P.
1979 The Lord of Lanka. Retold from the Ramayana, Bombay, India Book House Education Trust.
Bottéro, A.
1992 « La consomption par déperdition séminale en Inde et ailleurs », Annales de la Fondation
Fyssen 7, pp. 17-31.
Bouillier, V. & G. Tarabout (dir.)
2002 Images du corps dans le monde hindou, Paris, CNRS Editions.
Brewster, P. G.
1962 « Fire-Walking in India and Fiji », Zeitschrift für Ethnologie 87 (1), pp. 56-62.
Dennis Hudson, D.
1989 « Violent and Fanatical Devotion Among the Nayanars : A Study in the Periya Puranam of
Cekkilar », in A. Hiltebeitel (dir.), Criminal Gods and Demon Devotees. Essays on the Guardians of
Popular Hinduism, Albany, State University of New York Press, pp. 373-404.
Elmore, W. T.
1915 Dravidian Gods in Modern Hinduism. A Study of the Local and Village Deities of Southern India,
New York, (réimpression du vol XV-1, University Studies of the University of Nebraska, 1915).
Hasam Sah,
2004 Sassi (texte présenté, traduit du panjabi et annoté par Denis Matringe), Paris, Langues et
Mondes - L’Asiathèque.
Hiltebeitel, A.
1991 The Cult of Draupadi, II : On Hindu Ritual and the Goddess, Chicago, University of Chicago Press.
Hocart, A.M.,
1927 « Tukkam », Man 110, pp. 160-162.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
120
Hullet, A. & A. Munshi
1980-81 « Thaipusam. Silver Needles and Peacock Feathers », Geo-Australasia’s Geographical
Magazine 3 (4), pp. 70-83.
Kovoor, A. T.
1980 Gods, Demons and Spirits, Bombay, Jaico Publishing House.
Malamoud, C.
1989 Cuire le monde. Rite et pensée dans l’Inde ancienne, Paris, La Découverte.
Nabokov, I.
2000 Religion Against the Self. An Ethnography of Tamil Rituals, Oxford, Oxford University Press.
Obeyesekere, G.
1978 « The Fire-Walkers of Kataragama : The Rise of Bhakti Religiosity in Buddhist Sri Lanka »,
Journal of Asian Studies 37 (3), pp. 457-476.
1981 Medusa’s Hair. An Essay on Personal Symbols and Religious Experience, Chicago, The University
of Chicago Press.
Oddie, G. A.
1995 Popular Religion, Elites and Reform : Hook-Swinging and its Prohibition in Colonial India, 1800-1894,
Delhi, Manohar.
O’Flaherty, W.
1975 Hindu Myths. A Sourcebook translated from Sanskrit, Harmondsworth, Penguin Books.
Osella, F. & C. Osella
2005 « “Traditionalism”» versus « “Innovation” : the Politics of Ritual Change in South India », in
G. Colas & G. Tarabout (dir.), Rites hindous : transfers et transformations, Paris, EHESS (coll.
Purusartha, n°25).
Pfaffenberger, B.
1979 « The Kataragama Pilgrimage : Hindu-Buddhist Interaction and its Significance in Sri
Lanka’s Polyethnic Social System », Journal of Asian Studies 38 (2), pp. 253-270.
Porcher, M.-C.
1995 « Introduction », in Dandin, Histoire des dix princes (traduit du sanscrit, présenté et annoté
par Marie-Claude Porcher), Paris, Gallimard, pp. 7-58.
Racine, J.
2002 « Corps offert, corps meurtri : dévotion, grâce et pouvoir dans un culte villageois à
Murukan », in V. Bouillier et G. Tarabout (dir.), Images du corps dans le monde hindou, Paris, CNRS
éditions, pp. 341-365.
Rao, S. & S. Roy
1978 Tales of Durga. Stories of the Mother-Goddess Retold from the Markandeya Purana, Bombay, India
Book House Education Trust.
Roces, A.
1980-81 « A Matter of Mind over Matter », Geo -Australasia’s Geographical Magazine 3 (4), pp. 84-97.
Shrimali, Dr. N.
1988 The Power of Tantra, Delhi, Hind Pocket Books.
Srinivasa Raghavan, A.
1975 Nammalvar, New Delhi, Sahitya Akademi.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
121
Tanaka, M.
1991 Patrons, Devotees and Goddesses. Ritual and Power Among the Tamil Fishermen of Sri Lanka, Kyoto,
Kyoto University.
Tarabout, G.
1986 Sacrifier et donner à voir en pays malabar. Les fêtes de temple au Kérala (Inde du Sud) : étude
anthropologique, Paris, EFEO.
1997a « L’évolution des cultes dans les temples hindous. L’exemple du Kérala (Inde du Sud) », in
C. Clémentin-Ojha (dir.), Renouveaux religieux en Asie, Paris, EFEO, pp. 127-154.
1997b « Maîtres et serviteurs. Commander à des dieux au Kérala (Inde du Sud) », in A. de Surgy,
A. Padoux & P. Lory (dir.), Religion et pratiques de puissance, Paris, L’Harmattan, pp. 253-284.
Thurston, E. & K. Rangachari
1909 Castes and Tribes of Southern India, Madras, Government Press, 7 tomes.
Vanmikanathan, G.
1976 Manikkavachakar, New Delhi, Sahitya Akademi.
Weinberger-Thomas, C.
1996 Cendres d’immortalité. La crémation des veuves en Inde, Paris, Seuil.
Whitehead, H.
1921 [1916] The Village Gods of South India, Calcutta, Association Press.
NOTES
1. « Le plaisir esthétique qui naît de la peinture de la séparation [est] considéré par les poéticiens
comme le plus délectable de tous » (Porcher, 1995 : 39). Dans le domaine dévotionnel, recourant
souvent au registre de la passion amoureuse pour Dieu, voir par exemple les accents lyriques du
poète vishnouite Nanmalvar (entre le VIe et le IXe siècle de notre ère) s’adressant au dieu Krishna
: « Tu pars / Et la passion du désir s’embrase à nouveau / Et me dévore profondément »
(Tiruvaymoli 10.3.2, cf. Srinivasa Raghavan, 1975 : 40), ou bien, imprégnée de spiritualité soufie,
l’épopée de Sassi (Hasam Sah, 2004).
2. Le mot « macération » désigne au figuré une « mortification par jeûnes, disciplines et autres
austérités » (Littré). Je l’emploie ici en souhaitant le détacher de l’idée de pénitence ou
d’expiation (bien que les anglophones, en Inde, recourent volontiers au mot « penance » pour
désigner, à mon sens à tort, les faits dont il est ici question). Les procédures d’expiation ne sont
pas inconnues en Inde, mais il ne s’agit pas de macérations. Par ailleurs « macération » ne traduit
pas un terme vernaculaire. Les intéressés recourent soit à un terme générique désignant les
« vœux, promesses », soit à des termes descriptifs propres à chaque différente épreuve.
3. J’en reste ici à une mention très superficielle. Le tapas participe de représentations anciennes
plus larges et complexes sur la « cuisson du monde », pour reprendre les termes de l’analyse de
C. Malamoud (1989 : 47, 65).
4. Les lutteurs de Bénarès étudiés par J. Alter magnifient ainsi le respect du célibat,
brahmacarya : « Nous insistons sur le brahmacarya – ne jamais perdre son semen. C’est l’essence
de la puissance, l’essence de la force, l’essence de l’endurance, l’essence de la beauté » (Alter,
1992 : 129).
5. Par exemple, adressé à Siva : « Couverts de termitières et d’arbres / Avec pour nourriture l’air
et l’eau / Les habitants des sphères [célestes] et les autres / Se sont desséchés en Te cherchant »
(Tiruvacakam de Manikkavacakar, décade 23, cité par G. Vanmikanathan, 1976 : 41).
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
122
6. Pour les travaux en français sur les conceptions ésotériques « tantriques », on se reportera aux
différentes publications de Lilian Silburn, d’André Padoux et d’Hélène Brunner. Voir également
les contributions de David Gordon White, André Padoux, Richard Darmon et France Bhattacharya
dans Bouillier & Tarabout (dir.), 2002.
7. Pour le sud de l’Inde, quelques références : Thurston & Rangachari, 1909 (II-402sqq.) ;
Ananthakrishna Iyer, 1909-12 (I-322 sqq.) ; Elmore, 1915 ; Whitehead, 1921 ; Beck, 1969 ; Tarabout,
1986 ; Assayag, 1990 ; Hiltebeitel, 1991 ; Oddie, 1995 ; Racine, 2002 ; Osella & Osella, 2005. De telles
macérations sont (ou étaient autrefois) pratiquées dans le reste de l’Inde, ainsi qu’à Sri Lanka
(Obeyesekere, 1978 ; Tanaka, 1991) et dans de nombreux pays de la diaspora sud-indienne
(Benoist, 1998). Des épreuves comparables sont accomplies en Inde en milieu musulman
(Assayag, 1992).
8. Sur les auto-sacrifices en Inde, voir Weinberger-Thomas, 1996 (chap.2) ; dans les hagiographies
des saints sivaïtes tamouls, Dennis Hudson, 1989.
9. Sans pouvoir développer ici une approche comparative, il faut souligner à quel point l’on est
éloigné de l’élaboration de l’expérience dans d’autres cultures, qu’il s’agisse de la douleur
inhérente aux pratiques de pénitence chrétiennes, ou bien de la souffrance et de la maladie
comme signe d’élection telle que certaines « vies de saints » catholiques se complaisent à la
détailler, ou encore de la douleur surmontée (mais non niée) qui est au principe même de
nombreux rites d’initiation dans diverses sociétés.
10. Cf. Tarabout, 1986 ; Racine, 2002 ; pour un reportage photographique impressionnant des
célébrations effectuées par des Tamouls de Singapour, cf. Hullet & Munshi, 1980-1981, et Roces,
1980-1981.
11. Il faut sans doute distinguer ici le cas des « professionnels » des suspensions au Kérala, qui
sont payés pour les exécuter au nom de celui qui a pris le vœu, et qui pratiquent les macérations
chaque année mais ne sont pas crédités de pouvoirs spirituels particuliers.
12. Voir première photo ci-contre.
RÉSUMÉS
Il existe en Inde des épreuves volontaires, publiquement mises en scène, où une souffrance
prévisible se voit déniée. Il s’agit de « macérations » rituelles effectuées comme actions de grâce
par des dévots, qui s’y sont engagés auprès d’une divinité en retour de la satisfaction d’une
demande : marche dans le feu, crochets ou aiguilles enfoncés dans la peau ou la langue, etc. Ce
sont des épreuves qui, en temps normal, sont censées procurer une vive souffrance, mais que la
protection divine permet d’accomplir sans éprouver ni blessure ni douleur : ce sont des miracles.
L’étude porte sur les discours où s’affirme ce paradoxe sur la souffrance, et les rapproche de
diverses représentations populaires concernant l’ascèse. Elles participeraient, en effet, d’un
même type d’élaboration cognitive de l’expérience. Et si, récemment, certaines épreuves
comparables se situent délibérément hors du champ religieux, il faut constater qu’elles
participent de la même logique selon laquelle la négation même de la douleur, et non le seul fait
de l’endurer, est marque de compétence.
In India, certain ordeals are willingly undergone and publicly performed, but the foreseeable
suffering is denied. The pious perform these ritual “macerations” (walking in fire, hooks or
needles run through the skin or tongue, etc.) as acts of thanksgiving following a promise made to
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
123
a divinity who has satisfied their requests. Under normal circumstances, these ordeals would
cause intense suffering; but in this context, the divinity’s protection enables the person to
accomplish them without experiencing pain or being wounded: it is a miracle. The discourses
formulating this paradox are analyzed and compared to folk conceptions about asceticism, which
are part of the same cognitive work on experience. Although some such ordeals are now
deliberately placed outside the realm of religion, they should be seen as fitting into the same
rationale whereby the very negation of pain (and not just the fact of enduring it) is a sign of
competence.
INDEX
Index géographique : Inde
Mots-clés : ascèse, dévotion, sacrifice, épreuve
Keywords : asceticism, devotion, sacrifice, ordeals, India
AUTEUR
GILLES TARABOUT
Directeur de recherche CNRS. Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud, EHESS-CNRS.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
124
Les prophètes africains doivent-ils
souffrir ?
Do African prophets have to suffer ?
Christine Henry
Heureux ceux qui placent en toi leur appui !
Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout
tracés.
Psaumes, 84, 6.
1 Depuis Adam et Eve, condamnés le premier à gagner son pain à la sueur de son front et
la seconde à enfanter dans la douleur, la pensée chrétienne abonde en images de la
souffrance. La passion du Christ vient leur donner un sens et offre à toutes ces âmes
douloureuses l’avenir de la Rédemption. Ainsi Max Weber peut reconnaître, à la racine
de la douteuse théorie du ressentiment de Nietzsche, une intuition juste : celle « de
l’originalité culturelle du christianisme comme rare exemple historique d’une
“requalification religieuse” de la souffrance et de la douleur » 1. Dans la région du Golfe
du Bénin où sont nés les prophètes dont nous allons parler – et pour autant que l’on
puisse y retrouver aujourd’hui une pensée traditionnelle qui ne serait pas fortement
travaillée par l’islam et le christianisme –, serait plutôt cultivée ce que Weber appelle
une « théodicée du bonheur ». « L’homme heureux se contente rarement du fait d’être
heureux ; il éprouve de surcroît le besoin d’y avoir droit. Il veut aussi être convaincu
qu’il “mérite” son bonheur, et surtout qu’il le mérite par comparaison avec d’autres. Et
il veut donc également pouvoir croire qu’en ne possédant pas le même bonheur, le
moins fortuné n’a que ce qu’il mérite » (Weber, 1996 : 337). Gbehanzin, le dernier roi du
Dahomey libre, alors qu’il n’était encore que le prince Kondo, composa une cantilène
restée célèbre. Ce chant dépeint la vie comme un chemin semé d’embûches, comme une
montagne escarpée qu’il faut « gravir avec un fardeau sur la tête » 2. Comment
surmonter cette épreuve ? « Être fidèle fils à l’endroit de son père », « marcher “dans
les pas de ses aïeux” et ne point forligner », « vivre fidèle ami », rendre un culte à ses
ancêtres ; « Surmonter l’épreuve, vois-tu ? c’est tout cela », chante le prince Kondo.
Celui qui est ainsi « digne de la vie » sera « comblé de succès », le bonheur l’entourera,
les dieux recevront ses offrandes et le béniront. À l’inverse, celui qui ne sait pas
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
125
conduire sa vie, qui envie les autres et convoite leurs biens, abrège ses jours, et sans
même tomber malade meurt. « Ta maladie, c’est le mésusage que tu as fait de ton
bien », dit le prince. L’échec, la mort et la souffrance post-mortem – la non-
ancestralisation et l’errance qui résulteront de la mort prématurée – apparaissent
comme la punition méritée de l’incompétence, de l’inaptitude à surmonter les
difficultés de l’existence.
2 Un trait commun aux vies des plus célèbres prophètes africains tient aux souffrances
que leur a réservées le destin. William Wade Harris (env. 1850-1929) reçut de l’ange
Gabriel la mission de convertir les païens alors qu’il était en prison. Quand son message
souleva les foules en Côte d’Ivoire, il fut expulsé et reconduit manu militari dans son
pays. Quant à Simon Kimbangu (env. 1887-1951), c’est quand il échoue à devenir
pasteur3 que la voix du Christ lui ordonne de convertir ses compatriotes, action qui lui
vaudra d’être pourchassé par les autorités belges et de finir sa vie en prison. Ces
souffrances, vite assimilées par leurs adeptes à celles du Christ, leur permirent d’être
considérés comme de nouveaux messies, des christs noirs. René Bureau suggère, à
propos du harrisme, que ce sont ces persécutions qui font les « “prophétisme[s]
réussi[s]” selon l’expression de Roger Bastide ; si Harris était resté, son mouvement
aurait peut-être raté, tant il est vrai que la gestion prolongée du message est
généralement un piège pour son héraut »4. Les cas de Harris et de Kimbangu, bien que
trop rapidement évoqués, suggèrent que le malheur joue deux rôles différents dans
leur destin prophétique. Le premier est que leur vocation naît dans une situation
d’échec, la souffrance serait ici le déclencheur de la vocation 5. Le second tient à la
persécution qui suit la diffusion triomphante de leur Bonne Nouvelle, la souffrance
viendrait là authentifier l’importance et la pertinence de leur message.
3 La carrière des prophètes que nous allons présenter ne s’inscrit pas dans ce schéma. Ils
n’ont pas été persécutés et ont fondé des Églises qu’il leur a fallu gérer. Cet article se
propose d’examiner quel rôle joue la souffrance dans la vie de ces prophètes,
principalement dans celle de Samuel Oshoffa (1909-1985), qui fonda le Christianisme
Céleste à Porto-Novo (Bénin). Bien que cette Église résulte d’une vision reçue par son
fondateur, et qu’elle se prétende « unique » et « primitive », elle a été créée à
l’imitation de l’Ordre sacré des Chérubins et des Séraphins, une des premières Églises
du mouvement aladura6 dont Oshoffa fréquenta un temps une paroisse porto-novienne.
Nous commencerons donc par examiner quelques aspects de la biographie de l’un des
fondateurs de cette Église qui inspira Oshoffa. Enfin, l’exemple d’Oshoffa ayant suscité à
son tour nombre de vocations chez ses propres adeptes, nous verrons dans quelles
conditions Paul Sonounameto quitta le Christianisme Céleste pour fonder sa propre
dénomination : l’Église d’Évangélisation de la Parole du Christ au Monde. Précisons
préalablement que les événements biographiques dont nous allons faire état sont, pour
leur majorité, extraits de récits produits par ces prophètes ou par leurs épigones et
n’entretiennent donc avec la réalité des faits qu’un rapport qu’il est difficile de
déterminer. Ajoutons encore, pour dessiner à grands traits les contextes dans lesquels
ont émergé ces Églises, que les « Chérubins et Séraphins » et le Christianisme Céleste
ont été fondés pendant la période coloniale, le premier en 1925 à Lagos, le second à
Porto-Novo en 1947, tandis que « Parole du Christ au Monde » a été fondée en 1968, à
Cotonou. Les deux premières s’inscrivent dans le mouvement général qui portait alors
les Africains à vouloir reprendre en main les rênes de leur destinée, néanmoins elles
naissent dans des contextes très différents. La région de Lagos était à l’époque
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
126
durement touchée par une série d’épidémies (grippe espagnole en 1918 et peste en
1925-26) qui conduisit à la dépression économique et à la famine (1932). Nombre de
prêcheurs, qui s’étaient lancés sur les routes à la suite d’un appel divin, parcouraient la
région pour appeler à une foi exclusive en Dieu. Ils soutenaient l’idée que seule la prière
pouvait sauver et condamnaient tout recours aux ressources thérapeutiques de la
tradition et pour certains à la biomédecine. Les Églises qu’ils ont fondées, dites
« aladura », ont à leurs débuts surtout recruté dans un milieu citadin de jeunes
relativement instruits7. Quand Oshoffa fonde le Christianisme Céleste, il rencontre un
succès mitigé dans une ville moins troublée que Lagos vingt ans auparavant et par
conséquent moins demandeuse de recours mystiques nouveaux. Oshoffa va
essentiellement trouver des fidèles en milieu rural dans les villages de pêcheurs toffins
des environs de Porto-Novo. Ce n’est qu’à la fin des années 1960 que l’Église, qui a déjà
essaimé des paroisses au Nigeria et en Côte d’Ivoire, s’étoffe au Bénin, y commence un
développement urbain et recrute dans le milieu des cadres appartenant à la classe qui
va soutenir le gouvernement de Kérékou qu’un coup d’État porte au pouvoir en 1972.
Paul Sonounameto quitte le Christianisme Céleste, à cette époque, quand l’Église, sous
l’influence de sa nouvelle « clientèle », commence à s’organiser et à se bureaucratiser.
L’offre religieuse chrétienne s’est alors beaucoup diversifiée et la concurrence entre les
divers courants (prophétique, pentecôtiste, évangélique) est rude.
Moses Orimolade, l’enfant terrible
4 La fondation des « Chérubins et Séraphins » résulte de la rencontre d’un prêcheur
itinérant, Moses Orimolade, et d’une jeune fille, Abiodun Akinsowon, deux personnages
qu’en dehors de l’ardeur de leur foi tout opposait8. En effet quand ils se rencontrent,
Moses est un campagnard mal dégrossi, boiteux, peu instruit, relativement âgé (il a
dans les quarante-cinq ans) tandis qu’Abiodun est une très belle jeune fille de dix-sept
ans, instruite, qui a toujours vécu en ville. Moses Orimolade est né à Ikare 9, en 1879
croit-on. Selon sa biographie officielle, des événements mystérieux marquèrent son
enfance et même sa vie prénatale. On dit que sa mère, alors qu’elle était enceinte de lui
et s’occupait à ramasser du bois, l’entendit lui donner des conseils sur la manière de
charger son fagot. Elle raconta l’aventure à son mari, Tunolase, et ils décidèrent de
consulter un oracle qui déclara que l’enfant à venir serait un saint et prêcherait la
parole de Jésus-Christ, ce qui était d’autant plus étonnant que les missionnaires
chrétiens n’étaient pas encore arrivés dans leur village. Quand il naquit, il manifesta à
nouveau ses étranges capacités en se levant pour faire quelques pas. La femme qui
aidait à l’accouchement appuya fortement sur le bébé, tandis que le père récitait des
incantations dans l’idée qu’elles calmeraient le nouveau-né. Quand les missionnaires
parvinrent à Ikare, Moses fut l’un des premiers à se convertir. Peu de temps après, il fut
terrassé par une maladie inconnue10 et, paralysé, resta alité pendant sept ans. Son état
allait en empirant au point que tous croyaient qu’il allait mourir. Selon certains de ses
biographes, cet épisode se situe plus tôt dans la vie de Moses et est attribué aux
traitements malheureux qui lui avaient été infligés à sa naissance. Dans cette version, il
est dit que le père de Moses pensa que les incantations qu’il avait dites, interprétées
comme une malédiction, étaient la cause du malheur de son enfant. Sous le poids de
cette responsabilité, il tomba dans la mélancolie et mourut. Quoi qu’il en soit, Moses ne
fut partiellement guéri (il devait rester boiteux) que par la force de ses prières et à la
suite d’une vision qui lui commanda d’aller se baigner dans les eaux d’une rivière
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
127
voisine. Il trouva la force de se lever et en s’appuyant sur un parapluie, il parvint
jusqu’à la rivière, s’y baigna et recouvra la santé. Devenu dès lors prêcheur itinérant, la
puissance de la prière était un thème constant de ses prédications. Proche de l’Église
anglicane, il préférait néanmoins rester libre de toute affiliation officielle bien que de
nombreux pasteurs, impressionnés par la manière dont il citait la Bible alors qu’il était
quasiment illettré, eussent aimé l’enrôler dans leur troupe. Il prêcha dans tout le pays
et avait la réputation d’être un saint homme. Il vivait très modestement, s’habillait
d’une robe blanche et ne se coupait plus les cheveux depuis qu’il avait commencé à
prêcher. Il n’avait pas d’épouse, transportait son maigre bagage dans un simple panier
et refusait tout argent pour les nombreuses guérisons et miracles qu’il accomplissait,
seule la charité de ses hôtes lui permettait de subvenir à ses besoins. En 1924, il
s’installe à Lagos. Ses sermons en plein air, ses discussions publiques avec des maîtres
musulmans, les cantiques inspirés qu’il chantait pendant ses oraisons, les nombreux
miracles qu’il accomplissait le rendirent vite célèbre dans toute la ville. Il est un jour
appelé au chevet d’Abiodun Akinsowon que la vision d’un ange avait fait tomber dans
un profond coma. L’oncle de la jeune fille espérait que le saint homme saurait la
ranimer. Abiodun, conseillée par son ange, agréa l’intervention de Moses, et de leur
association naquit d’abord un groupe de prière puis l’Église des Chérubins et Séraphins.
Nous n’allons pas entrer plus avant dans ce récit. Contentons-nous de signaler, en
premier lieu, que c’est à la suite d’une épreuve surmontée (sa paralysie) et parce qu’une
vision lui indique une thérapie, que Moses se voue au « travail de Dieu ». En second lieu,
il faut noter que le récit de l’enfance de Moses, qui fonde la nature mystérieuse de ses
pouvoirs, emprunte ses traits à un cycle de contes yoruba dont le héros est un enfant,
nommé Ayantala. Né du pouce de sa mère, dès sa venue au monde Ayantala se montre
d’une force prodigieuse, parle comme un adulte et se montre si violent que sa mère
l’abandonne dans la forêt. Il y maltraite tellement les animaux qu’il y rencontre que le
Créateur est obligé de rappeler auprès de lui cet enfant si peu humain. Dans d’autres
versions de ce conte, « l’enfant plus rusé que son père » tue son naïf géniteur en le
faisant tomber dans un piège astucieusement monté et oblige sa mère à en manger le
foie11.
Samuel Oshoffa et les trois animaux
5 Sans être aussi étranges que celles de Moses Orimolade, les circonstances de la
naissance de Samuel Bileou Joseph Oshoffa font aussi signe. Le père d’Oshoffa, bien que
de confession méthodiste, avait six épouses, qui chacune lui avait donné des enfants,
mais tous étaient morts en bas âge à l’exception d’une fille. Désirant un fils, Oshoffa
senior supplia Dieu de lui accorder ce bienfait, ajoutant que s’il était exaucé, il le
vouerait au service de la divinité. Quand l’enfant naquit, il fut d’abord prénommé
Joseph comme son père, puis reçut les noms de Samuel, référence biblique à l’enfant
d’Anna et d’Elqana (1 Samuel, 1, 20), et de Bileou, début d’une devise yoruba qui
signifie : « Si tu veux vivre dans ce monde reste, dans le cas contraire pars, mais je sais
que je t’ai spécialement demandé à Dieu. » Ce prénom et la devise qui l’accompagnent
renvoient à la naissance des enfants dits abiku. Dans la région du Golfe du Bénin, une
suite de décès d’enfants en bas âge peut être interprétée comme les allées et venues
d’un même esprit perturbateur qui a pris la place de l’enfant dans la matrice de la
mère. Abiku peut se traduire en yoruba par « nous avons enfanté la mort » ou « né pour
la mort ». Herskovits en analysant les contes dahoméens associe les abiku aux jumeaux,
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
128
hohovi, et aux orphelins de mère, nochiovi, car les uns et les autres sont sous la
protection des esprits de la forêt, azizan. Il signale que « la logique de leur existence n’a
aucune justification en termes humains […] leur existence témoigne de l’immensité de
l’univers dont le monde des hommes n’est qu’une petite partie » (Herskovits &
Herskovits, 1958 : 30). Certains pensent qu’ils sont des messagers de Mawu et que cette
divinité les autorise, uniquement pour leur propre plaisir, à séjourner dans le monde
des hommes (Herskovits, 1967 : 260). Quand un enfant est reconnu comme abiku, ses
parents accomplissent de nombreux rites pour le retenir sur terre, mais ces cérémonies
restent sans effet s’ils ne réussissent pas à trouver et à détruire les objets magiques
cachés par l’enfant ou à lui faire avouer le nom qu’il porte dans le monde des esprits ;
dans l’un ou l’autre cas il s’agit de rompre son lien avec l’autre monde. Certains pensent
qu’un abiku même quand il a été fixé en ce monde conserve toujours une personnalité
hors du commun et des capacités surnaturelles.
6 Si la faveur divine voulut que Samuel survive, bien des malheurs devaient marquer son
existence, à commencer par la mort de sa mère qui survint alors qu’il était encore très
jeune. Pour accomplir sa promesse, son père le confia à un catéchiste méthodiste sévère
qui n’hésitait pas à frapper ses élèves. Mécontent des mauvais traitements que recevait
son fils, le père d’Oshoffa le reprit, Samuel suivit alors quelque temps l’enseignement
d’une école catholique. Il est ensuite placé chez un autre éducateur méthodiste où il
reste six ans, jusqu’au CM2, sans pouvoir obtenir son certificat car, à la suite d’un acte
de désobéissance, il est renvoyé de l’école en même temps que tous les autres élèves de
sa classe. Il a alors dix-neuf ans. Son père, voyant qu’il ne réussira pas dans les études,
lui fait apprendre la menuiserie et le prend dans son propre atelier. Pendant ses études,
Samuel s’était épris de Christiana, une jeune fille qui comme lui fréquentait l’école
méthodiste. Mais son père, pressé de voir ses petits-enfants, n’accepte pas qu’il épouse
Christiana qu’il juge trop jeune, et accueille sous son toit une femme enceinte que
Samuel refuse d’épouser. Sur ces entrefaites Christiana meurt. Samuel reste
inconsolable pendant près de trois ans, puis se résout sur l’insistance de son père à
épouser Loko, une vendeuse de poissons. Le mariage ne fera pas le bonheur de Samuel
car Loko se révèle coquette, infidèle et de surcroît stérile. En 1939, son père meurt.
Oshoffa abandonne alors le métier de menuisier et cherche à gagner sa vie comme
musicien, mais voyant que la profession est précaire, il s’oriente vers le commerce du
bois. Il prend une nouvelle épouse qui pas plus que Loko ne lui donnera d’enfant. Il
s’éloigne des méthodistes et entre dans l’Église des « Chérubins et des Séraphins » dont
une paroisse vient de s’installer à Porto-Novo. Il y rencontre Yaman, une femme
mariée, et est accusé de commettre l’adultère avec elle. Bien qu’il nie les faits, ils sont
tous les deux renvoyés de l’Église. Samuel épouse Yaman, qui se révélera une femme de
bons conseils, mais qui, également stérile, ne lui donnera pas d’enfant. A la suite de ses
déboires avec les « Chérubins et Séraphins », Oshoffa fréquente l’Église Christique
Primitive, mais il en est également renvoyé à la suite d’événements mal éclaircis. À
trente-huit ans, Oshoffa est sans descendance, il n’a plus aucun lien avec les Églises
qu’il avait précédemment fréquentées, et le destin clérical auquel l’avait voué son père
semble définitivement dans l’impasse. C’est alors qu’il a une première vision.
7 Nous sommes en mai 1947, Oshoffa, pour son commerce de bois, est allé en forêt
accompagné d’un piroguier qui est soudain pris de violentes douleurs intestinales.
Oshoffa prend sa bible, lui impose les mains et prie ; aussitôt le piroguier se sent mieux
et lui avoue qu’il lui avait dérobé de la nourriture. Il ajoute que Samuel doit être un
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
129
homme bizarre pour que son acte ait été aussi immédiatement sanctionné par des
douleurs. Après avoir dit cela, apeuré, il s’enfuit laissant Oshoffa seul dans la forêt et
condamné à attendre du secours car il ne sait pas pagayer. Il errait dans la forêt depuis
trois jours quand se produit une éclipse de soleil12. Il se jette à genoux pour prier, les
yeux fermés, et entend une voix qui lui dit « luli, luli », et lui en livre la signification :
« la grâce de Jésus-Christ. » Il ouvre les yeux et voit alors que l’être qui a prononcé ces
mots est un singe blanc ailé comme une chauve-souris, possédant deux dents à la
mâchoire supérieure et deux à la mâchoire inférieure. Il voit également un oiseau au
bec et pattes jaunes, qui ouvre de temps à autre une queue colorée semblable à celle
d’un paon, enfin il voit près de lui à sa droite un petit serpent marron au cou gonflé qui
semble prêt à le mordre. Oschoffa, sans peur d’être mordu, le saisit, le caresse et le
relâche tranquillement. Puis l’un après l’autre, le serpent en dernier, ces animaux
disparurent à ses yeux. Oshoffa prend alors conscience qu’un grand changement s’est
produit en lui.
8 Oschoffa n’a donné qu’un commentaire très elliptique de cette vision lors d’une
interview télévisée :
C’est de la bouche du singe que j’ai entendu « luli » ce qui veut dire la grâce de Dieu.
Le serpent : son explication est la trahison, comme nous le savons tous c’est le
serpent qui a trahi Adam et Eve dans le jardin d’Éden. Pour plus d’explication il s’est
enroulé et s’est déplacé de cette manière et non normalement en rampant sur le
tronc. Le paon veut dire l’orgueil au plus haut niveau, tel que celui qui a fait chuter
Adam. Voila l’explication que j’ai eue par le Saint Esprit.
9 Les chrétiens célestes sont peu portés à l’exégèse de la geste de leur prophète, aucun ne
semble connaître cette explication qui d’ailleurs est presque aussi mystérieuse que la
vision elle-même, et peu se hasardent à produire d’autres commentaires. Par contre,
leurs adversaires – les pasteurs des Églises évangéliques – ne manquent pas de dire que
ces animaux bizarres et surtout ce serpent sentent le soufre.
10 Pendant trois mois, Oshoffa continue à errer dans la forêt, il se nourrit uniquement de
restes de fruits que les oiseaux laissent tomber à terre et de miel d’abeilles dont il
enfume les essaims, et boit l’eau des flaques. Selon le récit de la Constitution 13, il arrive à
une colline appelée Fagbe (près de la ville de Zinvié) où il rencontre un homme (qui
rejoindra ensuite l’Église) et un grand nombre d’enfants. Il s’enfonce à nouveau dans la
forêt à la recherche de sa pirogue. La rivière étant en crue, il monte dans son
embarcation et s’abandonne au courant. Des serpents tombent du haut des arbres dans
la barque, mais il les saisit avec les mains et les jette dans le fleuve.
11 De cette période, Oshoffa ne gardait pas une claire conscience, il confie à Obafemi :
La seule et unique chose que j’ai mémorisée fut mes constantes et régulières
prières. Quelque temps après je retrouvai mes sens et une fois encore, je commençai
par sentir et agir comme à l’accoutumée. Ma première observation fut liée à l’état
de mes cheveux hirsutes et touffus. Ma couverture localement tissée à la main, qui
était un cadeau de mon père, était aussi sale. Mes habits étaient bien sûr aussi très
sales et déchiquetés comme ma couverture. Ce fut l’état de ces vêtements et de ma
chevelure qui me donna le premier signe que malgré mon bon état physique, j’étais
dans cette forêt depuis un bon bout de temps et qu’entre temps quelque chose
m’était arrivé. Et comme j’observais mon entourage, j’eus la conviction que les
choses ne pourraient plus être ce qu’elles étaient auparavant. Le SBJ Oshoffa
d’antan n’existait plus, l’Oshoffa actuel est une nouvelle créature. Je réalisai que je
fus immédiatement transformé après le départ du serpent et que je n’arrivais pas à
recoudre convenablement les événements après mon retour à la conscience
(Obafemi, s.d. : 77).
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
130
12 Oshoffa finit par arriver à Agongue où il rencontre une de ses connaissances de Porto-
Novo, Yesufu, qui prend peur en le voyant car on le croyait mort après sa disparition de
plus de trois mois. Dans une maison proche de la sienne à Agongue, Koulihoun, un
jeune méthodiste, gisait sur sa couche, mourant, le corps tout enflé. Oshoffa se présente
dans la maison et prie en lui imposant les mains. Au grand étonnement de tous les
assistants, l’homme éternua, secoua ses membres et s’assit sur sa couche. Oshoffa reste
quelques jours à Agongue pendant lesquels Yesufu retourne à Porto-Novo et annonce
aux parents d’Oshoffa qu’il était revenu, qu’il paraissait étrange « avec des cheveux
longs, mal soigné, un accoutrement grossier et débraillé tel un fou » et qu’il ressuscitait
les morts. A son retour à Porto-Novo, il est l’objet d’une grande curiosité et reçoit
beaucoup de visites. Trois jours après son retour, sa sœur aînée, Élisabeth, vient le voir
et en pleurant lui annonce que son fils, Emmanuel Mawunyon Guton venait de mourir.
Il se rend au domicile de sa sœur et y rencontre les nombreux guérisseurs traditionnels
qui avaient vainement essayé de guérir le malade et se livraient encore à des pratiques
occultes. Il leur demande de sortir de la chambre et prie en imposant la main sur son
neveu qui revient à la vie.
13 L’inspiration biblique de l’ensemble de ce récit est évidente : Oshoffa vit une traversée
du désert, une épreuve initiatique au sortir de laquelle, profondément changé et
grandi, il peut affronter son destin. Notons que le désert biblique n’est pas forcément
une étendue de sable, mais plutôt un lieu inculte, sauvage, peu propice à l’habitat
sédentaire. Ce lieu qui impose l’isolement et l’austérité de vie est le site idéal de la
retraite spirituelle. Et ce récit fait bien penser à différentes figures de prophètes
bibliques, particulièrement à Elie qui, sur l’ordre de Dieu, s’était retiré au désert près
d’un torrent. Il assiste à une sécheresse extraordinaire et, en sortant de cet endroit,
rend la vie au fils de son hôtesse. On peut penser aussi à Jean-Baptiste qui prêchait dans
le désert et ne mangeait que du miel, à Moïse qui fut abandonné aux flots et qui devait
être ensuite choisi par Dieu pour renouveler l’alliance conclue avec Abraham.
L’expérience mystique dont Oshoffa fait l’épreuve évoque également les paroles de
Marc (16, 17-18) :
Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ; par mon Nom ils
chasseront les démons, ils parleront en langues, ils prendront des serpents dans
leurs mains, et s’ils boivent quelque poison mortel, ils n’en éprouveront aucun mal ;
ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris.
14 Notons que le récit ne fait aucune allusion directe à une souffrance. Si Oshoffa est
désorienté quand son piroguier l’abandonne et effrayé au moment de l’éclipse de soleil,
dès qu’il a vu les animaux, il est selon ses propres termes « transformé » et semble ne
plus éprouver aucune des angoisses qui devraient être celles d’un homme perdu dans la
forêt. De même, ce n’est que lorsqu’il retrouve ses sens qu’il se rend compte de sa saleté
et de l’état de ses cheveux et qu’il peut constater qu’il est malgré tout en « bon état
physique ».
15 Albert de Surgy signale sans développer que l’aventure en forêt d’Oshoffa « est
étrangement semblable à la retraite initiatique qui s’impose à certains futurs chefs de
culte traditionnel lorsqu’ils se trouvent mystérieusement égarés par des génies de
brousse »14. Michel Guéry notait déjà que la « transformation » d’Oshoffa faisait penser
à celles des guérisseurs qui disent tenir leur pouvoir d’un passage au pays des morts.
Joël Noret établit un parallèle entre cet épisode de la vie du prophète et la réclusion
initiatique des adeptes du vodun15. Sans contester ces analogies, il nous semble que
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
131
cette partie du récit d’Oshoffa doit surtout être rapprochée des contes qui mettent en
scène des chasseurs16. Un type de contes raconte les aventures d’un chasseur pauvre qui
part en brousse et sauve un homme et trois animaux (parmi lesquels il y a toujours un
serpent) tombés dans un piège. Le chasseur est mis en danger de mort par la traîtrise
de l’homme qu’il a sauvé et ne doit son salut puis le rehaussement final de sa situation
qu’aux animaux reconnaissants qui l’aident à ressusciter le fils ou la fille d’un roi 17.
A. Irele rappelle que le personnage du chasseur représente l’idéal masculin, « un héros
“d’office” dans l’imagination yoruba »18. Le chasseur est l’homme supérieur par
excellence parce qu’il est amené à franchir constamment les frontières entre le village
et la brousse, entre le monde des hommes et celui des esprits, il tire capacité d’agir sur
la nature de la fréquentation continue des esprits de la forêt, les azizan, grands
pourvoyeurs de charmes (bo). Depuis huit ans, Oshoffa se rend régulièrement en forêt
pour cette forme de chasse qu’est la recherche de bois, son aventure solitaire de trois
mois n’est que l’acmé d’une longue relation avec cet univers. Il aimait lui-même
souligner que c’était en brousse, alors que ses « seuls compagnons étaient des serpents,
des crocodiles et des oiseaux », que sa transformation avait eu lieu 19. Bien qu’il attribue
son salut aux prières qu’il prononçait constamment, on peut penser aussi que le fait
qu’il se concevait comme un abiku a joué un rôle important dans son aventure. Les
esprits abiku en tant qu’ils sont les habitants naturels de la forêt n’ont rien à craindre
de leurs compagnons ordinaires : les animaux sauvages et les génies de la forêt.
16 Quelques mois plus tard, lors d’une seconde vision, un messager divin ordonne à
Oshoffa de fonder une Église qui sera « la dernière barque pour le salut » et de
commencer immédiatement à célébrer le culte dans sa maison, ce qu’il fait. Oshoffa
nous dit que les nombreux miracles, guérisons et prodiges, qui s’accomplissaient à
travers lui, attirèrent tant de fidèles venus des autres Églises que leurs représentants le
persécutèrent, particulièrement les prêtres catholiques. Il affirme à plusieurs reprises
que c’est à la suite de ces persécutions catholiques qu’il a dû quitter Porto-Novo,
d’abord pour la vallée de l’Oueme où il évangélisa les pêcheurs toffins, ensuite pour le
Nigeria quand ces pêcheurs ouvriront une paroisse sur la plage de Makoko (Lagos). Les
chrétiens célestes attribuent également à une menace, celle-là venue du pouvoir
politique, le fait qu’en janvier 1976, Oshoffa quitta définitivement le Bénin, où se
durcissait le régime marxiste-léniniste de Kérékou, pour s’installer au Nigeria. En 1981,
Oshoffa adresse une lettre à celui dont il avait fait le représentant de l’Église auprès des
autorités béninoises. Il écrit :
Notre Église est beaucoup plus surveillée par les autres Églises que par les autorités.
C’est à ce but que nous devons faire attention. Ce sont ces Églises qui donnent de
faux renseignements aux autorités contre notre Église parce qu’elle est puissante 20.
17 Malgré toutes ces allégations, il semble bien que l’Église en ses débuts n’ait fait l’objet
d’aucune répression particulière. Cette hantise qui marque le discours du prophète
semble plutôt être une réponse au mépris dans lequel on le tenait au Bénin. Penser que
votre puissance fait que l’on vous persécute est plus satisfaisant que reconnaître que
votre insignifiance fait que l’on vous ignore. Néanmoins, au plus fort de la période
marxiste-léniniste, l’Église fut interdite pendant trois ans et sa réouverture soumise à
une réduction du nombre de ses paroisses et à une sérieuse limitation de ses
manifestations publiques. Pendant cette période, les fidèles béninois purent à bon droit
s’abandonner à leurs sentiments de persécution et s’identifier à des martyrs du Christ.
Ce qu’ils font encore aujourd’hui quand ils doivent essuyer les critiques des pasteurs
évangéliques prompts à juger que les rites célestes sentent le fagot. En étudiant le
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
132
parcours de Paul Sonanoumeto, nous allons revenir sur le rôle que peut jouer le
sentiment de persécution dans la quête de légitimité, mais auparavant nous allons
évoquer certaines pratiques des fidèles qui pourraient donner à penser que l’Église
encourage fortement l’ascétisme.
18 Oshoffa a organisé, par le sacrement de l’onction, la redistribution de son charisme de
guérison. À chaque fois qu’un fidèle reçoit l’onction qu’Oshoffa (aujourd’hui son
successeur) est seul habilité à donner, il obtient la confirmation de ce pouvoir et a la
possibilité de monter en grade sur l’échelle de la hiérarchie céleste. Mais le charisme le
plus prisé est celui de prophétie ou de vision, dont on dit que seul Dieu peut le donner.
Ce don reste parfois caché et ne s’actualise que lorsque le fidèle en fait l’ardente prière
à Dieu. Pour obtenir le don de vision, beaucoup de chrétiens célestes sont prêts à faire
de grands sacrifices et particulièrement à se mortifier dans leur chair par
d’interminables séances de prière ou par le jeûne, bien que cette dernière pratique ne
fasse pas partie de celles que recommande leur prophète21. L’évangéliste Élisée Agré de
Côte d’Ivoire, en introduction à sa brochure Les principes de l’Église du Christianisme
Céleste, relate :
En février 1980, j’avais deux ans de vie chrétienne. Comme tout nouveau converti,
je passais le clair de mon temps dans la prière surtout à la recherche du don de
prophétie et de vision. Ainsi je jeûnais très souvent pendant sept jours, voire vingt-
et-un jours. Et comme aucun signe du don du Saint-Esprit ne se manifestait en moi,
un jour je résolus de jeûner quarante jours, ne buvant que de l’eau, le soir au
coucher. Je réussis à jeûner vingt-huit jours ; mais le vingt-neuvième jour, je tombai
gravement malade et le Saint-Esprit me demanda de ne plus continuer à mortifier
ma chair, car la grâce du Seigneur est déjà sur moi. Mais n’étant pas convaincu de
cette révélation, je me jetais dans les cérémonies de prière… tous genres de
cérémonies de prière ont été faites. Néanmoins après trois mois, je ne reçus
toujours pas de manifestations spirituelles dans ma chair (1995 : 9).
19 Les chrétiens célestes qui pensent qu’en châtiant leur chair ils grandiront en esprit
tiennent cette idée plus de la lecture de l’histoire des saints catholiques que des
enseignements de leur propre Église. Leurs prédicateurs leur rappellent souvent que
trop jeûner ne fera que les rendre malades, ce qui n’est pas une bonne manière de
respecter les ordres divins ; et comme ils aiment à illustrer leurs prêches d’anecdotes
propres à frapper l’imagination, l’un d’eux conta un jour celle-ci :
Un frère s’était mis en tête de jeûner pendant vingt-et-un jours. Après le septième
jour, il était endormi quand un ange est venu le voir pour lui dire : « Mon frère, il
faut donner des ordres à ta maison, parce que tu es tellement pur et saint
maintenant que tu ne peux plus vivre parmi les hommes. Je suis venu pour
t’emporter au ciel. Alors, donne des ordres à ta femme et à tes enfants et on va
t’emporter. » « Mais mon jeûne ce n’est pas pour la mort, c’est pour faire des
miracles ! », a répondu le frère. Alors il s’est réveillé, il a appelé sa femme. Il a dit :
« La sauce d’hier, est-ce qu’il en reste ? » La femme de lui dire : « Mais tu jeûnes,
non ? » Il a dit : « Quel jeûne ? Je ne jeûne plus. » Il s’est levé, il a mangé, la nuit-là,
pour dire à l’ange : je ne suis plus saint, je n’irai pas avec toi. Et depuis il ne jeûne
plus, même si on dit qu’il y a jeûne pour tout le monde, il dit : « Non ! Moi je suis à
part, je ne jeûne plus ! »
20 Si le Christ disait : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera
de plus grandes » (Jean 14, 12), les prophètes sont rarement aussi partageux de leurs
pouvoirs, car ils ne peuvent pas mettre à la portée de tous ce qui justement les
distingue au-dessus de tous. Oshoffa n’admettait pas que l’on puisse s’essayer à l’égaler.
Lors d’une réunion du comité directeur de l’Église à Porto-Novo, en 1975, visant des
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
133
fidèles qui prétendaient opérer des guérisons miraculeuses et en étaient tombés
malades, un assistant fait remarquer que personne ne doit chercher à outrepasser ses
dons spirituels. Oshoffa renchérit aussitôt en rappelant que ceux qui avaient cherché à
imiter saint Paul avaient dangereusement échoué dans cette voie, il poursuit en disant 22
:
J’ai été appelé, ils ne l’ont pas été avec moi, c’est moi qui les ai appelés à mon tour.
J’ai été le seul à passer trois mois en brousse et seul j’ai vu et écouté ce qui m’a été
révélé. Seul aussi, j’ai suivi et entendu le Christ qui m’était apparu. Que chacun se
contente donc de ce qui lui est donné et l’exerce dans son cadre précis sans
chercher à extrapoler...23
21 Le problème du prophète qui, comme le disait savamment Weber, consiste à savoir
sauvegarder « durablement l’existence économique de la distribution de la grâce » 24, est
exprimé de plaisante façon par un personnage de Wole Soyinka : le frère Jero qui est
prophète parmi beaucoup de ses collègues.
Mais attention, il y œuf et œuf. C’est la même chose pour les prophètes. Moi je suis
né prophète. Je crois que mes parents avaient remarqué que j’avais en naissant les
cheveux d’une épaisseur et d’une longueur inhabituelles. Ils me descendaient
jusqu’au yeux et jusqu’au bas de la nuque. Ce fut pour eux un signe indubitable :
j’étais désigné par la nature pour être prophète. Et ma foi, en grandissant j’ai pris
goût au métier. A l’époque, c’était un métier très respectable, et la concurrence
restait loyale. Mais depuis quelques années, la plage est devenue un endroit
tellement couru qu’on s’arrache littéralement les emplacements et la profession a
bien perdu de sa dignité (Soyinka, 1979 : 113).
Paul Sonounameto et l’Écriture
22 Paul Sonounameto ne se revendique pas « prophète » et se décrit simplement comme
un « serviteur de Dieu ». Il est né vers 1940, à Abomey. S’il écrit sa biographie (en 1986),
c’est, dit-il dans l’introduction de ce texte, pour faire « connaître les œuvres de notre
ennemi qui est Satan ou Diable et les œuvres de notre Dieu et de son fils Jésus-Christ ;
car ceux qui rentreront dans le Royaume de Dieu doivent souffrir par les œuvres de
Satan, de même ceux qui prêchent la vérité qui est dans la parole de Dieu doivent
souffrir par son plan ».
23 L’auteur se présente ensuite brièvement : il n’est jamais allé à l’école pour apprendre à
lire et à écrire et que dans sa jeunesse il exerçait le métier d’aide-cuisinier. Etant né
d’une lignée royale, il était adepte des cultes nesuxwe25 et avait également « pratiqué
tout ce qui se fait dans les couvents de kouvito26 c’est-à-dire revenants ». À la mort de
son père, il décide de se rendre à Cotonou et d’y apprendre un nouveau métier. Il
obtient son diplôme de menuisier et ouvre son propre atelier. C’est alors qu’il
commence « à aller avec les femmes impudiques dans les maisons de tolérance » et à
passer ses fins de semaine à s’enivrer au point de battre sans raison les apprentis qui
étaient chez lui. « Quelques temps après le diable m’a poussé à prendre la femme
d’autrui » explique-t-il. Elle lui donne un enfant, mais malgré tous les « gris-gris »
fabriqués pour sa protection l’enfant meurt. Il se sépare de cette femme et en épouse
une autre. Un couple de ses amis vient résider avec eux. Tous les « gris-gris » qu’ils
fabriquent pour se protéger s’avèrent vains. Cet ami se renseigne sur le Christianisme
Céleste et comprend « que les fidèles de cette secte sont protégés des gris-gris ». Les
deux couples entrent dans l’Eglise, celui de son ami ne tarde pas à la quitter, mais lui et
son épouse y restent car Paul Sonanoumeto cherchait « à comprendre leur prédication
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
134
et le livre dans lequel ils lisent la parole ; c’est-à-dire la Sainte Bible ». Un de ses cousins
s’étonne quand il voit qu’il s’est acheté une bible en gun, mais il lui rétorque que Dieu
peut l’aider, et tous les soirs, pose la bible sur une table et prie Dieu de l’aider à la lire. Il
finit par être exaucé. Selon une logique très caractéristique des nouveaux convertis, il
constate que c’est au moment où il est touché par la grâce que l’action satanique
redouble : « Le diable a animé ma femme dans l’assemblée. » Son épouse le trompe
ouvertement et va même jusqu’à le frapper dans l’église. Les fidèles lui conseillent de
lui infliger une sérieuse correction, mais il refuse car Dieu enseigne la patience et le
pardon. Les autres paroissiens se moquent de lui et pensent qu’il est fou. C’est alors
qu’il comprend « qu’il y a beaucoup de choses anormales » dans l’Église et qu’il
entreprend de les dénoncer. Sa femme continue à le tromper ouvertement avec
plusieurs fidèles puis finit par le quitter pour se mettre en ménage avec un visionnaire
de la paroisse. Les Anciens de l’Église décident de suspendre son ex-épouse, mais il s’y
oppose, de même qu’il refuse qu’on envoie le suborneur dans une autre paroisse. Non
seulement il cherche toujours à s’asseoir près du frère qui lui a pris sa femme, mais il
lui rend visite dans sa maison et lui prêche la bonne parole, de plus il donne de l’argent
à la mère de cet homme chaque fois qu’elle en a besoin et vient lui demander de l’aide.
Il interprète tous les fâcheux événements qui se sont succédé dans son existence en
terme de tentations diaboliques : « C’est bien moi que le diable cherchait par toutes ces
astuces […] Pour le diable je devrais haïr celui qui a pris ma femme afin que l’esprit de
Dieu m’abandonne. Voilà ce que le diable cherchait.» Après avoir rendu grâce à Dieu
qui lui a permis de surmonter cette épreuve, il enchaîne sur « les souffrances qui lui ont
été infligées par les responsables du Christianisme Céleste ».
24 Ayant constaté en étudiant la Bible que nombre des pratiques de l’Église ne sont pas
conformes aux saintes Écritures, il prévient les responsables de sa paroisse, qui
tombent d’accord avec lui, mais lui répondent qu’Oshoffa n’acceptera pas « qu’on
change les pratiques ». Il a l’occasion de rencontrer le fondateur et commence à lui
expliquer ses erreurs, mais ce dernier s’énerve et le congédie. Six mois plus tard, il le
rencontre à nouveau. Il a pris soin d’écrire sur une feuille de papier les références de
divers versets bibliques qui interdisent certaines cérémonies chrétiennes célestes et
demande au fondateur de les lui expliquer. De nouveau Oshoffa se fâche, le renvoie et
lui ordonne de ne plus revenir chez lui. « Ce même jour il m’a dit de sortir de son Église
et de ne plus mettre pied dans aucune paroisse de sa secte. » Mais Paul Sonounameto
s’obstine à fréquenter l’Église car, dit-il, il ne peut pas quitter la personne qui l’a
baptisé au nom de Jésus. Dans toutes les paroisses célestes où il se rend, les fidèles se
moquent de lui, l’insultent, l’outragent, le calomnient, le frappent « puisque c’est leur
Pasteur qui leur a donné l’ordre ». Ils vont même jusqu’à le faire convoquer au
commissariat de police en portant contre lui de fausses accusations. Nous résumons en
quelques lignes le récit des « tribulations » de notre auteur qui occupe plusieurs pages
dans sa brochure. Il pourrait en écrire bien d’autres, mais il dit qu’il s’arrête là car il
sait bien que ce ne sont pas ses frères et sœurs en Christ qui l’ont fait souffrir, « mais le
diable qui est notre ennemi ».
25 Contrairement au récit précédent, aucun fait extraordinaire, aucune vision, n’est
signalé comme étant ce qui a déclenché la création de son Église. Il dit simplement :
Mes Frères et Sœurs du monde entier, après tout cela nous avons déposé une
demande d’autorisation de professer notre foi, par la création d’une Assemblée
dénommée « Église d’Évangélisation de la Parole du Christ au Monde » auprès des
Autorités dans la même année27. C’était en 1969.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
135
26 Au moment où Paul Sonounameto écrit sa biographie, son Église a déjà connu deux
schismes. La suite du récit est consacrée à l’exposé des nouvelles souffrances que lui ont
fait subir ces brebis égarées qui ont quitté son Église en entraînant la majorité des
fidèles avec elles et sont allées en fonder de nouvelles en pensant qu’elles pouvaient
« devenir Chefs sans changer leurs mauvaises habitudes » 28. A nouveau, l’auteur
explique toutes les insultes et calomnies qu’il a dû essuyer de leur part et termine en
demandant leur pardon à Dieu et en constatant que ceux qui veulent marcher dans la
vérité doivent « souffrir obligatoirement par Satan ».
27 Bien que ce récit se présente comme une victoire sur Satan, il apparaît surtout comme
une victoire sur l’illettrisme29. Le seul « miracle » relaté est l’acquisition de la lecture,
fait qui sortira l’auteur de ses turpitudes ordinaires, mais déclenchera les foudres de
Satan. La connaissance de la Bible qu’il acquiert alors lui permettra de critiquer le
Christianisme Céleste, et causera sa seconde série de malheurs et son rejet de cette
Église. Comme un chrétien n’en a jamais fini avec Satan, il trouvera des ennemis au sein
de sa propre assemblée. La souffrance apparaît bien comme le moteur du récit, résultat
de la persécution, elle constitue la preuve que le héros marche dans le droit chemin,
comme Jésus le proclamait dans les Béatitudes.
28 Les Églises dont il a été question ici sont d’abord des lieux de guérison. Aux fidèles qui
les rejoignent pour trouver une solution à leurs maux, toutes proposent l’obéissance
aux lois divines comme seule véritable voie de la délivrance. Les nombreux guérisseurs
et devins de la place qui n’utilisent pas le registre chrétien, mais jouent sur celui de la
tradition, allient un savoir technique (des plantes médicinales ou d’un mode de
divination) avec une initiation qui leur confère une maîtrise particulière d’un savoir qui
sans elle resterait de l’ordre du commun. Les chrétiens souffrants attendent également
du fondateur de leur Église (ou des spécialistes de la guérison qu’il met en place dans
son institution) qu’il dispose de quelque chose de plus que le simple savoir que tout un
chacun peut acquérir en lisant la Bible. Ils le considèrent comme un intermédiaire
entre eux et la divinité qui mieux que d’autres peut comprendre la parole du dieu, le
toucher par sa prière, capter son pouvoir et en user à leur bénéfice. Pour répondre à
leurs attentes, les fondateurs d’Églises doivent construire leur personnage et choisir
une stratégie qui les légitimera.
29 Parmi les cas que nous avons examinés, seul Paul Sonounameto ne choisit pas d’avoir
recours au merveilleux chrétien (ou autre), parce que justement il construit son
personnage en s’opposant à une Église qui elle fait grand usage de prodiges. Il est
significatif qu’il quitte le Christianisme Céleste au moment où de nombreux cadres
l’intègrent et s’efforcent de lui donner une respectabilité à grands renforts de
règlements et d’écrits divers. Alors qu’il est illettré, Paul Sonounameto cherche à jouer
cette carte pour son propre compte et, voulant s’en tenir à une stricte orthodoxie
chrétienne, n’a pour seul recours que monter sa souffrance en épingle (et en écrits) en
se prétendant martyrisé par ses anciens frères et sœurs. Orimolade et Oshoffa ont usé
d’une toute autre tactique en faisant appel au merveilleux chrétien comme à celui des
contes populaires. Pour l’un et l’autre, il s’agit de mettre en place un dispositif qui joue
le même rôle que l’initiation et les produit « différents ». Dans le cas d’Orimolade, il
n’est pas sûr qu’il ait lui-même procédé à cette construction, peut-être résulte-t-elle
plutôt de l’idéalisation de ses premiers adeptes30. La différence de nature que doit
montrer le prophète est, dans son cas, attribuée à une conception merveilleuse qui
comme le frère Jero de Soyinka le fait « naître » prophète. La souffrance n’est pas
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
136
absente de cette destinée, mais elle apparaît sous la forme d’une épreuve surmontée qui
vient étayer son discours sur la foi comme seul recours thérapeutique.
30 Dans le cas d’Oshoffa, nous disposons de plus de matériaux pour examiner la manière
dont il construit son personnage. Dans une phrase que nous avons citée précédemment,
Oshoffa énonce les faits qui, selon lui, le rendent supérieur aux autres. Il constate qu’il a
« été appelé », entendant par là qu’il a reçu l’ordre divin de fonder une Église. Il dit
ensuite qu’il a passé trois mois en brousse où il a vu et écouté ce qui lui a été révélé,
enfin il dit que le Christ lui est apparu. L’autobiographie d’Oshoffa, telle qu’il l’a livrée
aux cours de divers prêches ou discours retranscrits dans la constitution de l’Église
nigériane, fait état, parmi de nombreux miracles et prodiges, de plusieurs visions du
Christ et de deux apparitions du fils de Dieu. Dans un contexte déjà fortement
concurrentiel, il faut bien le cumul de ces signes pour accréditer le prophète. Dans cette
énumération, l’idée d’épreuves endurées ou de tourments corporels est totalement
absente. L’imitation du Christ qui guide le comportement de l’anachorète ou du martyr
n’est pas ce qui conduit Oshoffa. À l’inverse, parce qu’il a été « appelé » et
« transformé », il pense qu’il peut exercer son charisme de guérison en dehors de toute
pratique ascétique. Après avoir narré une guérison miraculeuse, il commente :
Ces miracles ne sont pas accomplis par ma propre puissance, je ne suis que le
serviteur de Celui qui m’a envoyé. C’est pour cela que je n’ai pas besoin de me livrer
à des assauts de prières, de veiller toute la nuit, de jeûner ou de m’infliger une
quelconque ascèse (Église du Christianisme Céleste, 1980, article 56).
31 On ne saurait dire plus clairement que la souffrance n’est pas ici un critère
d’excellence. Ce qu’Oshoffa cherche à démontrer quand il nous expose son parcours
« spirituel » est que la volonté divine l’a instrumentalisé. Sa propre individualité a
disparu, il n’est plus que le réceptacle du divin que toute volonté d’homme échouerait à
transformer. Tel un prophète biblique, l’Éternel a mis en lui son esprit (Nombres 11,
24-29). Ses fidèles en sont bien convaincus qui, dans la doxologie qui doit être intégrée
à toute prière pour qu’elle soit efficace, s’adressent souvent au « Dieu d’Oshoffa »,
comme ils peuvent dire « Dieu de Moïse, Dieu d’Abraham, etc. » 31.
32 Toutes les vies de saints ou de prophètes se ressemblent en ce qu’elles organisent un
avant et un après autour d’une coupure radicale : le moment où est reçu la grâce, où
Dieu se saisit de sa créature et fait de sa vie un destin. Tout le travail des biographes (ou
des hagiographes) vise à construire le contraste entre les souffrances du monde de
l’avant et l’indifférence au monde de l’après. Pour prévenir la question du « pourquoi
lui ? » – que quelque sceptique pourrait se hasarder à émettre – des signes sont posés
qui jalonnent la vie d’avant la sidération comme autant d’indices qui la justifieront. Ce
modèle, tous les chrétiens le connaissent, alors faut-il s’étonner, quand ils choisissent
cette voie, qu’ils le suivent ? Ceux qui placent en Dieu leur appui trouvent en leur cœur
des chemins tout tracés !
33 Au delà de l’image d’eux-mêmes que nous tendent les fondateurs que nous avons
évoqués, il faut souligner que, de manières diverses, ils furent rejetés des Églises qu’ils
fréquentaient. Ce type d’échec comme l’incapacité à réussir une vie « normale » pèsent
sans aucun doute leur poids dans la décision de se faire berger d’âmes, mais il est
douteux qu’ils y suffisent. Les églises africaines sont pleines de malheureux qui ne se
transforment pas en fondateurs d’Église. A propos de ceux qui parviennent à transmuer
la souffrance quotidienne en réussite ecclésiale, il faut reconnaître, comme le disent les
chrétiens célestes quand on les interroge sur leur prophète, qu’il y a là un « mystère ».
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
137
BIBLIOGRAPHIE
Agré, É.
1995 Les principes de l’Église du Christianisme Céleste, Côte d’Ivoire, Les Éditions de la Pierre
Angulaire.
Balandier, G.
1971 [1955] Sociologie actuelle de l’Afrique Noire, Paris, PUF.
Belvaude, C.E.
1989 Amos Tutuola et l’univers du conte africain, Paris, L’Harmattan.
Bureau, R.
1975 « La religion du prophète » in Prophétisme et thérapeutique, Paris, Hermann, pp. 87-120
Coussy, Denise
1988 Le roman nigérian, Paris, Silex.
Église du Christianisme Céleste / Celestial Church of Christ
1972 Lumière sur le Christianisme céleste, Porto Novo, Imprimerie nationale.
1974 Lumière sur le Christianisme céleste provenant du Révérend Pasteur S.B.J. Oschoffa. Paroles
essentielles prononcées par le Révérend Pasteur S.B.J. Oschoffa, Lagos, s.e.
1980 Constitution, Celestial Church of Christ, Nigeria Diocese.
Guéry, M.
1973 Notes de travail sur le Christianisme Céleste, texte ronéoté, septembre 1972-1973.
Hackett, R.I.J.
1987 « Thirty Years of Growth and Change in a West African Independent Church: a Sociological
Perspective » in R.I.J. Hackett (dir.) New Religious Movements in Africa, New York, Edwin Mellen,
pp. 161-177.
Herskovits, M.J.
1967 [1938] Dahomey. An Ancient West African Kingdom, Evanston, Northwestern University Press,
2 vol.
Herskovits, M.J. & F.S.
1958 Dahomean Narrative, Evanston, Northwestern University Press.
Noret, J.
2001 L’Église invisible. Deuil, souci et statut des morts chez les Chrétiens célestes du Sud-Bénin, Mémoire
de licence en anthropologie, Université libre de Bruxelles.
Obafemi, O.
s.d. Samuel Bilewu Joseph Oshoffa, don du XXe siècle de Dieu à l’Afrique, traduction française de
Ayeboua-Aduayom E.P, Abeka, Jones Printing Press (1986 pour l’original anglais).
Olupona, J.K.
1987 « The Celestial Church of Christ in Ondo: A Phenomenological Perspective » in R.I.J.
Hackett (dir.), New Religious Movements in Africa, pp. 45-73.
Omayojowo, J.A.
1982 Cherubim et and Seraphim: The History of an Independent Church, New York, Nok Publishers.
Paulme, D.
1976 La mère dévorante. Essai sur la morphologie des contes africains, Paris, Gallimard.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
138
Peel, J.D.Y.
1968 Aladura: A Religious Movement among the Yoruba, Londres, IAI/Oxford, Oxford University
Press.
Quenum, M.
1983 [1936] Au pays des Fons. Us et coutumes du Dahomey, Paris, Maisonneuve et Larose.
Smith, P.
1979 « Naissances et destins : les enfants de fer et les enfants de beurre », Cahiers d’Études
Africaines 73-76, pp. 329-352
Sonounameto, P.
1986 Biographie du Serviteur de Dieu Paul Sonounameto, Fondateur de l’Église d’Évangélisation de la
Parole du Christ au Monde, Cotonou, texte ronéoté.
Soyinka, W.
1979 Les Tribulations de Frère Jéro, in Les gens des marais, traduction d’É. Janvier, Paris,
L’Harmattan (1964 pour l’original anglais).
Surgy, A. de
2001 L’Église du Christianisme Céleste, un exemple d’Église prophétique au Bénin, Paris, Karthala.
Weber, M.
1971 Economie et Société Paris, Plon.
1996 Sociologie des religions, textes réunis et traduits par J.-P. Grossein, Paris, Gallimard.
NOTES
1. J.-C. Passeron in « Introduction » à Sociologie des religions de Max Weber (1996 : 38).
2. Quenum, 1983 : 54.
3. Balandier, 1971 : 428.
4. Bureau, 1975 : 94.
5. Balandier dit à propos de Kimbangu : « Cet échec [au pastorat] constitue le choc favorisant (ou
suscitant) la séparation, faisant naître le besoin d’agir en marge de l’église officielle... » (1971 :
428).
6. Terme yoruba emprunté à l’arabe et signifiant « ceux qui prient ».
7. Sur l’histoire de ce mouvement cf. Peel, 1968.
8. Les informations qui suivent proviennent de Omayojowo, 1982 et de Peel, 1968.
9. Ikare est en pays yoruba, en Akoko, une région de collines au nord-est de Lagos.
10. Il existe plusieurs versions de la « maladie » de Moses, le seul fait sûr est qu’il était boiteux,
autour de ce handicap ont été brodés différents scénarios.
11. Cf. Coussy, 1988 : 6768. Pierre Smith a remarquablement analysé ces héros enfantins qu’il
appelle « enfants de fer » et oppose aux « enfants de beurre » (Smith, 1979 : 329-352).
12. Il s’est effectivement produit une éclipse totale de soleil visible de cette région le 20 mai 1947.
Lumière (Église du Christianisme céleste, 1972) indique le 22 mai comme jour de cet événement.
13. Église du Christianisme Céleste, 1980.
14. Surgy, 2001, note 15 de la page 21.
15. Guéry, 1973 : 2 ; Noret, 2001 : 37.
16. Le père d’Oshoffa était un chasseur. Une délégation de chasseurs traditionnels participa aux
funérailles du Pasteur (Hackett, 1987 : 177).
17. Pour une analyse de ce type de conte, cf. Denise Paulme, 1976.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
139
18. A. Irele, « Tradition and the Yoruba writer: D.O. Fagunwa, Amos Tutuola and Wole Soyinka »,
Odu, 11, 1975, p. 82 cité d’après Belvaude, 1989.
19. Entretien avec F. Olorunisola publié dans Drum Magazine, Janvier 1980, cité par J.K. Olupona
(1987).
20. Document du 4 août 1981 circulant dans l’Église, intitulé « Conseils à mon représentant de
l’Église du Christianisme Céleste au Bénin, l’Évangéliste Lucien N. Tiamou, par moi Révérend
S.B.J. Oschoffa, Prohète Pasteur Fondateur de l’Église du Christianisme Céleste en tournée au
Nigeria » (1 p.).
21. Le jeûne n’est observé que pendant la Semaine sainte. Oshoffa disait : « Notre jeûne est de
marcher pieds nus quand nous endossons notre robe de prière. Plus d’autres carêmes pour nous,
sauf pendant les six ou sept jours pour commémorer la semaine marquant la souffrance de Notre
Seigneur Jésus-Christ » (Église du Christianisme Céleste, 1974).
22. Ce qui suit est tiré d’un document intitulé « Procès-verbal de la réunion du comité directeur
supérieur de l’E.C.C. (élargie aux délégués des paroisses de l’Ouémé et de l’Atlantique tenue à
Porto-Novo le 15 février 1975) ». Une photocopie de ce document nous a été communiquée par le
secrétariat de la paroisse de Sikècodji.
23. Ces paroles évoquent Weber (1971 : 465) : « Il ne faut pas oublier un instant que Jésus
appuyait entièrement sa propre légitimation sur le charisme magique qu’il ressentait en lui, sur sa
prétention que lui, et lui seul, connaissait le Père... »
24. Weber, 1996 : 168.
25. Cultes vodun des ancêtres royaux.
26. Société de masques incarnant les ancêtres.
27. La doctrine soutenue par cette Église a évolué au cours du temps, d’abord proche de celle du
Christianisme Céleste, elle s’est rapprochée de celle des Eglises évangéliques, bien que les
responsables de ces dernières soient loin de lui accorder leur blanc-seing.
28. Le premier schisme a donné naissance à l’Église « Union et Renaissance des Hommes en
Christ » qui est une des plus grandes Églises évangéliques du Bénin. Les fondateurs de cette Église
disent qu’ils sont sortis de celle de Paul Sonounameto à cause de l’immoralité de ce dernier et
parce qu’il avait institué une mise en commun de tous les biens des fidèles dont il était le seul à
profiter.
29. Si Paul Sonounameto n’est jamais allé à l’école, c’est aujourd’hui un grand producteur de
brochures d’évangélisation.
30. Moses Orimolade est mort en 1933, peu de temps après la création de l’Église.
31. De même les fidèles des « Chérubins et Séraphins » s’adressent au « Dieu d’Orimolade ».
RÉSUMÉS
À partir d’éléments issus des biographies de trois fondateurs d’Églises ouest-africaines, l’article
s’interroge sur la place que la souffrance joue dans la genèse de leur destin de prophète. Les trois
ont vécu des événements douloureux, mais tous n’accordent pas la même valeur à la souffrance
dans leur récit. Pour chacun d’entre eux, il s’agit de se produire « différent » du commun des
mortels et « supérieurs » à leurs « collègues », la mise en exergue de la souffrance n’étant qu’une
voie parmi d’autres permettant la construction de leur singularité ecclésiale.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
140
Information drawn from the biographies of three founders of churches in west Africa is used to
inquire into the place that suffering has in the origin of their destiny as prophets. All three
experienced painful events, but not all their accounts assigned the same value to suffering. For
each of them, the intention was to make himself “different” from common people and superior
to colleagues. The emphasis on suffering was but one way among others to construct their
originality as founders of churches.
INDEX
Mots-clés : prophètes, épreuve, souffrance, Christianisme
Index géographique : Bénin, Nigeria
Keywords : prophets, ordeals, suffering, Christianity, Benin, Nigeria
AUTEUR
CHRISTINE HENRY
Chargée de recherche au CNRS. Centre d’études des mondes africains (CEMAf) CNRS/Université
de Paris 1/Université d’Aix-Marseille 1/EPHE
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
141
Infléchir le destin car la vraie
souffrance est à venir
(Société maure-islam sunnite)
Corinne Fortier
« Ce Jour-là, vous serez exposés en pleine
lumière;
aucun de vos secrets ne restera caché »
(Coran, trad. Masson, 1967, t. 2 : 714).
« Le châtiment dans la tombe est une réalité »
(Hadith, Bukhârî, 1964 : 92, § 13).
1 On ne peut comprendre la vie quotidienne des Musulmans chez lesquels la foi islamique
est profondément enracinée – comme c’est le cas des Maures 1 de Mauritanie – sans la
relier à cette autre vie qu’ils connaîtront dans l’au-delà (âkhira), qui est pour eux aussi
réelle que celle qu’ils vivent ici-bas (dunya). Mais ce fait, relevant de la foi individuelle
plus que du rituel collectif, de l’éthique religieuse plus que du comportement social, est
difficilement saisissable par les sciences sociales.
2 Il est assez rare, en effet, que les anthropologues travaillant dans des sociétés
musulmanes s’intéressent aux représentations eschatologiques islamiques et à leur
impact sur la vie des individus. Cela s’explique par plusieurs raisons. D’une part, cette
question demandant de se tourner vers l’islam et ses textes, ils l’ont considérée comme
ne relevant pas de leur domaine, mais plutôt de l’orientalisme. D’autre part, une telle
recherche, touchant non seulement aux représentations de l’au-delà mais aussi à la
manière dont elles déterminent les conduites individuelles, se révèle difficile à mener
puisqu’elle concerne les motivations des individus, qui restent souvent inconnaissables.
De plus, les intéressés eux-mêmes parlent peu de cette question; dans la mesure où elle
regarde le croyant dans son rapport à Dieu, elle appartient à la foi intime, qui ne
s’exhibe pas. Enfin, la dimension du salut étant fondamentalement religieuse, elle a été
négligée par un type d’explication qui cherche les raisons d’agir plutôt du côté de
l’organisation socio-culturelle alors même que certaines pratiques sociales sont le fruit
d’une démarche individuelle d’ordre religieux.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
142
3 Par ailleurs, c’est non seulement la conduite des Maures, en tant que musulmans, qui
est influencée par leur représentation de l’au-delà mais également leurs affects. Ainsi,
la manière dont ils accueillent la dimension du malheur dans leur vie, et en particulier
un deuil, est certes liée à leur soumission résignée devant la volonté divine mais dérive
aussi de la croyance selon laquelle cette souffrance est toute relative par rapport à celle
qui les attend après leur décès.
4 Les morts, en islam, sont en effet particulièrement malmenés à différentes étapes de
leur destin posthume, situation que les Maures redoutent pour eux-mêmes et pour
leurs proches; tout d’abord, lors de l’interrogatoire terrifiant imposé par les anges dès
l’inhumation, puis, dans un deuxième temps, par les châtiments physiques que les
morts pourront recevoir dans leur tombe en punition de leurs mauvaises actions,
ensuite, par le cataclysme que représentera pour chacun le jour du Jugement dernier,
et enfin par les tourments de l’enfer que beaucoup seront amenés à connaître.
5 Aussi, bien qu’une certaine vision occidentale de l’islam tende à se focaliser sur le
paradis musulman dans la mesure où il promet des bienfaits physiques qu’une morale
chrétienne juge peu spirituels2 et en dépit du fait que, du point vue de l’islam, tous les
fidèles aient un jour à connaître le paradis, c’est la dimension terrifiante de ce qui
attend les Maures après leur mort – entre autres, la période plus ou moins longue qu’ils
pourront éventuellement passer en enfer – qui les préoccupe prioritairement et oriente
de façon invisible nombre de leurs comportements.
Exprimer pieusement sa peine
6 Quoique les émotions ressenties au décès d’un proche relèvent du domaine individuel,
leur expression est plus ou moins codifiée socialement et peut prendre des formes
diverses allant de l’intériorisation individuelle à la représentation spectaculaire. Dans
la société maure, il n’existe pas, comme dans d’autres sociétés du Maghreb 3 et de
Méditerranée4, de pleureuses professionnelles, et on évite même de manifester son
émotion à la mort d’un proche, attitude qui paraît directement inspirée des sources
scripturaires sunnites fondamentales5.
7 Dans l’islam sunnite, la conduite à tenir en cas de deuil dérive de celle du Prophète 6.
Mahomet aurait déclaré à ce sujet : « Il est deux choses qui sont répandues chez les
gens et qui sont de la mécréance (kufr) : mettre en doute la généalogie de quelqu’un et
les gémissements outranciers pour pleurer les morts » (Nawawy, 1991 : 415).
8 Le fait que les lamentations soient assimilées dans ce hadith à la mécréance s’explique
en ce que ce type de conduite était caractéristique des mœurs sémitiques de l’époque.
Ainsi, on peut avancer l’hypothèse qu’en condamnant un tel comportement, l’islam
tient à se distinguer nettement des habitudes des anciens Arabes et des Juifs 7.
9 Si, dans la société maure et en islam sunnite, l’attitude des vivants vis-à-vis du mort
peut avoir des conséquences positives sur son salut (Fortier, 2005), elle peut aussi avoir
des effets négatifs comme le montre le fait que les lamentations nuisent aux défunts;
plusieurs hadith en témoignent : « Le mort sera châtié à cause des pleurs des siens »
(Bûkhârî, 1993 : 258, § 654) et « Les pleurs des vivants sur le mort sont pour lui un
supplice » (bukâ’al-hayyi al-mayyiti adhâbun li-l-mayyiti) (Wensinck et Mensing, 1967, t. 6 :
297)8.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
143
10 Par ailleurs, l’islam sunnite distingue les lamentations des pleurs sincères. La conduite
du Prophète est encore à la source de cette distinction, celui-ci n’ayant pu contenir son
émotion à la mort de l’un de ses fils : « Ibrahim, à l’âge de dix-sept mois mourut, sous
les yeux de son père qui ne put retenir un torrent de larmes. Ce que voyant et se
rappelant que le Prophète, en cas de deuil, avait interdit les lamentations et défendu de
se déchirer le visage et les vêtements, Abd al-Rahman ben Aouf lui dit : “Toi aussi, Ô
envoyé d’Allah.” “Ô Ben Aouf, lui répondit-il, les larmes sont en effet de la compassion,
et elles ne sont pas interdites comme les cris et les lamentations, qui sont des
protestations inspirées par le démon contre les décrets de la providence.” Puis, ses
larmes recommençant à jaillir avec plus d’abondance encore, il ajouta : “Les yeux
pleurent, le cœur est affligé, mais nous ne proférons aucune exclamation déplaisante au
Seigneur. C’est au premier choc que la véritable résignation se révèle, car, plus tard,
elle a le secours du temps. Ô Ibrahim, nous sommes dans une profonde tristesse causée
par ta séparation; mais nous appartenons à Allah, et à Lui nous devons retourner” »
(Dinet et Ben Ibrahim, s.d. : 229).
11 Dans ce hadith, les lamentations sont condamnées dans la mesure où elles apparaissent
comme l’expression d’une révolte contre la volonté divine. Par conséquent, plus encore
que pour se démarquer des usages sociaux ou religieux antérieurs, l’islam condamne les
lamentations en tant qu’elles témoignent de la non-acceptation de la puissance de Dieu
dont un des pouvoirs suprêmes est de donner la vie et la mort.
Accepter la volonté de Dieu
12 En cas de deuil, dans la société maure, l’attitude résignée des proches du défunt 9, qui
témoigne de leur acceptation de la fatalité (ridha bi-l-qadhâ’), est encouragée chez ceux
qui sont capables de surmonter leur peine; une telle attitude est préconisée par le droit
malékite : « Il ne sied pas de répandre des larmes à ce moment. Mais une patience
pleine de dignité et une noble résignation sont plus méritoires pour qui a assez de force
d’âme pour cela » (Qayrawânî, s.d. : 105).
13 Ainsi, le croyant est appelé dans ces circonstances à la patience (sabr) devant l’épreuve,
vertu considérée, en islam, comme cardinale (makârim al-akhlâq). Une des formules de
condoléances utilisée par les Maures fait allusion à cette vertu de constance dans
l’adversité : « Que Dieu vous donne la patience de supporter cela » (Allah yasbarkum
‘âlih). Quant aux proches du défunt, résignés face à cet événement irrémédiable, ils
répètent inlassablement : « Telle est la décision divine » (qadrat mulâna) et rendent par
ailleurs grâce à Dieu que leur infortune ne soit pas plus grande en proclamant :
« Louange à Dieu, par lequel cela n’est pas plus grave » (hamdulilah illi mahu a‘zam).
14 Lorsqu’un événement dramatique, comme un accident, provoque la disparition de
plusieurs êtres chers, reste la présence consolatrice de Dieu, ainsi que l’indique cette
formule religieuse utilisée dans la société maure : « Nous nous en remettons à Dieu, il
est notre meilleur garant » (hasbunâ Allah wa nima al-wakîl) (Sharaf, 1987 : 66). Dieu est
« le vivant-subsistant-par-soi » (hay al-qayyum) dont la présence est éternelle; il
représente un point fixe inébranlable pour les hommes, qui ne sont que de passage
dans ce monde.
15 Dans la société maure, l’attitude résignée qui sied aux proches s’étend également à
celui qui meurt. Cette digne acceptation de la mort au moment fatidique se manifeste
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
144
aussi bien lorsque l’individu décède de façon naturelle ou accidentelle. C’est ce que
montre le comportement d’un berger de Chinguetti qui mourut de soif après s’être
égaré dans le désert à la recherche de ses chameaux10. Il avait utilisé ses dernières
forces pour creuser sa tombe dans le sable. Puis, il s’y était étendu selon la position
religieuse recommandée, attendant pieusement que la mort vienne le prendre.
Auparavant, afin d’être en état de pureté, il avait enlevé son vêtement; ainsi, il avait été
retrouvé mort et enterré, son sarwâl à ses côtés.
16 L’islam étant soumission à la volonté divine, si Dieu a choisi de reprendre la vie qu’il a
créée, le fidèle ne peut que s’en remettre à sa décision comme le rappelle la formule
coranique (II, 156) prononcée à l’occasion d’un décès : « Nous sommes à Dieu et à lui
nous retournons » (innâ li-llâhi wa innâ ilayhi râji‘ûn).
17 Le mot même qui désigne la mort en arabe, wafât, renvoie au terme et à
l’accomplissement, la mort réalisant la fin du cycle de vie d’un être. Ce cycle,
prédéterminé par Dieu au moment où l’individu est encore dans le ventre de sa mère 11,
ne fait alors que s’actualiser lorsque cette durée arrive à son terme.
18 Aussi, un homme ne peut-il se donner la mort sans être sévèrement châtié dans l’au-
delà pour avoir rivalisé avec les desseins de Dieu; comme le déclare un hadith : « Celui
qui se suicide sera supplicié le jour du Jugement avec l’instrument de son suicide »
(Nawawy, 1991 : 406). À cet égard, nous n’avons jamais entendu parlé de cas de suicide
dans la société maure.
Vivre ici et maintenant en pensant à l’au-delà
19 Les Maures se préparent à l’instant de leur mort qui viendra tôt ou tard; comme le
suggère un proverbe arabe ancien connu en Mauritanie : « Le temps du malheur ne
prévient pas » (az-zar yûlad blâ dra). Ainsi, loin de fuir tout signe qui leur rappellerait
leur propre mort, ils conservent précieusement dans une malle le linceul, acquis de leur
vivant, qui les recouvrira le jour des funérailles. Car la mort signifie certes la fin de la
vie terrestre mais débouche également sur une autre vie, non moins importante; un
hadith suggère même sa précellence : « Ô Dieu, il n’y a d’autre vie que celle de l’Autre
Monde » (Bukhârî, 1964 : 87, § 2).
20 La présence de l’homme dans ce monde étant éphémère, il lui est conseillé de ne pas
trop s’y attacher; aussi la parole pleine de sagesse du Prophète connue en Mauritanie :
« Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un passant » est-elle relayée par celle
de l’un de ses compagnons, Ibn ‘Umar, : « Quand tu es au soir n’attends pas le matin, et
quand tu es au matin, n’attends pas le soir. Prends ta santé pour ta maladie, et ta vie
pour ta mort » (Bukhârî, 1993 : 876, § 2092).
21 Cette pratique du détachement participe d’une éthique de l’instant qui libère des
regrets du passé comme de la crainte de l’avenir; il faut savoir vivre au présent car
personne hormis Dieu ne sait de quoi demain sera fait. Cette morale semble remonter à
l’Arabie préislamique puisqu’on la retrouve dans ce vers non dépourvu d’épicurisme du
grand poète Imru’ al-Qays (m. 550) : « Aujourd’hui le vin, et demain autre chose » (al-
yawma khamr/wa ghadân amr).
22 L’incertitude de l’avenir est en soi une invitation à profiter pleinement du présent. Tel
est aussi le message porté dans tout le monde arabe par la chanteuse égyptienne Umm
Kulthum (m. 1977) lorsqu’elle déclame un vers en arabe classique du poète persan
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
145
‘Umar al-Khayâm (m. 1123) : « Demain m’est encore inaccessible, aujourd’hui
m’appartient » (ghadân bi zahri al-ghaybi/wa al-yawma li).
23 Une expression maure invite par ailleurs à prendre la vie comme elle vient (bâsh jât
ghazât). Tout événement mérite d’être vécu, y compris un malheur, celui-ci pouvant se
révéler bénéfique. De la même façon, il arrive qu’un événement heureux s’avère
funeste selon la conception métaphysique musulmane qui distingue l’apparence (zahr)
de l’essence (batn).
24 Étant donné que l’homme se situe dans un certain aveuglement vis-à-vis du cours de sa
vie, mieux vaut qu’il accueille ce qui lui arrive avec relativisme; le Coran (II, 216) avertit
ainsi le croyant : « Il est possible que vous ayez de l’aversion pour une chose qui est un
bien pour vous et il est possible que vous aimiez une chose qui est un mal pour vous.
Allah sait, alors que vous ne savez pas » (trad. Blachère, 1980 : 60).
25 De plus, comme le déclare explicitement un verset coranique (LIII, 42-44), Dieu donne
la vie et la mort, de la même façon qu’il prodigue les joies et les peines : « Qu’à ton
Seigneur tout revient, que c’est Lui qui fait rire et qui fait pleurer, que c’est Lui qui fait
vivre et qui fait mourir » (trad. Blachère, 1980 : 562).
26 Dans la mesure où tout ce qui advient en ce monde, bonheur ou malheur, est voulu par
Dieu, un proverbe arabe connu dans la société maure incite à ne pas maudire la vie :
« N’insultez pas la vie, car la vie c’est Dieu » (lâ tasubbû dahra inna dahra huwwa Allah).
Or, ce proverbe, après comparaison avec des traditions prophétiques, se révèle inspiré
du hadith : « Dieu a dit : “Les hommes insultent le sort. Or le sort c’est Moi, Qui tiens en
Mon pouvoir le jour et la nuit” » (Bukhârî, 1964 : 225, § 2).
La crainte de l’enfer et du Jugement dernier
27 De nombreux Maures vivent dans la crainte d’aller en enfer (jahannam) et dans la peur
de connaître les tourments de ses flammes. Ce qui caractérise en effet l’enfer c’est son
feu (nâr)12, dont la chaleur est d’une plus grande intensité que celui qu’on peut produire
ici-bas ; plus précisément, comme l’indique un hadith (Bukhârî, 1964 : 97, § 31), « le Feu
de l’Enfer a de plus que le feu terrestre soixante-neuf parties dont chacune a l’ardeur
du feu terrestre »13.
28 Les peines, même les plus légères, qui attendent celui qui va en enfer, sont d’une
grande violence, ainsi que l’atteste un hadith (Bukhârî, 1993, t. 2 : 888, § 2130) : « An-
Nou’man Ben Bachir a rapporté qu’il a entendu le Prophète dire : “Parmi les réprouvés
de l’Enfer qui subira le châtiment le moins douloureux, au jour de la résurrection, sera
un homme, on lui placera sur la plante du pied deux braises si ardentes qui feront
bouillir sa cervelle”… »
29 C’est aussi avec tremblement que les Maures pensent au jour du Jugement dernier, et
j’ai pu observer que les plus sensibles d’entre eux, comme les élèves coraniques,
pleurent parfois de peur lorsqu’ils récitent les passages catastrophiques du Coran qui y
font référence. Ce Livre (XXII, 2) donne en effet une description terrifiante du Jugement
dernier, jour où le lien qui apparaît comme le plus indéfectible, celui qui existe entre
une mère et son nourrisson, se trouvera rompu : « Le tremblement de terre de l’Heure
sera sûrement quelque chose de terrible! Le jour où vous le verrez : toute femme qui
allaite oubliera son nourrisson; toute femme enceinte avortera. Tu verras des hommes
ivres alors qu’ils ne le seront pas. – Le châtiment de Dieu sera très dur. »
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
146
30 Ce jour est celui où seront jugées les actions manifestes de l’homme mais également ses
intentions les plus secrètes. Dans ce face-à-face avec Dieu, l’âme de l’individu sera à nu,
car le créateur connaît le for intérieur de sa créature, ainsi que le montre un passage du
Coran (LXXXII, 1-16) : « Lorsque le ciel se rompra et que les étoiles seront dispersées;
lorsque les mers franchiront leurs limites et que les sépulcres seront bouleversés : toute
âme saura ce qu’elle a fait de bien et de mal. Ô toi, l’homme! Comment donc as-tu été
trompé au sujet de ton noble Seigneur qui t’a créé puis modelé et constitué
harmonieusement; – car il t’a composé dans la forme qu’il a voulue – Bien au contraire!
Vous traitez de mensonge le Jugement, alors que des gardiens veillent sur vous : de
nobles scribes qui savent ce que vous faites14. Oui, les hommes bons seront plongés dans
les délices et les libertins dans une fournaise où ils tomberont le Jour du Jugement sans
pouvoir y échapper » (trad. Masson, 1967, t. 2 : 744).
31 Cependant, tous les Musulmans goûteront un jour au repos voluptueux du paradis.
Certaines catégories de personnes y entreront plus rapidement que d’autres. C’est le
cas, d’une part, des martyrs islamiques tombés dans un juste combat (jihâd), qui
échapperont aux affres de l’enfer et n’auront pas à rendre compte de leurs actes au jour
du Jugement dernier; le Coran (III, 163) en parle en ces termes : « Et ne crois point que
sont morts ceux qui ont été tués dans le Chemin d’Allah! Au contraire! ils sont vivants
auprès de leur Seigneur, pourvus de leur attribution » (trad. Blachère, 1980 : 99).
32 D’autre part, l’islam semblant considérer qu’il n’est rien de plus funeste pour des
parents que de perdre plusieurs de leurs enfants, les tourments de l’enfer seront
épargnés à ceux qui ont vécu cette épreuve; comme le déclare un hadith
(Bukhârî, 1977 : 404-405) : « Il n’est pas un seul musulman, à qui la mort aura enlevé
trois enfants n’ayant pas atteint l’âge de pécher, que Dieu ne fasse entrer dans le
Paradis par suite de son extrême miséricorde envers les musulmans. »
33 Néanmoins, la plupart des Musulmans passeront une plus ou moins longue période en
enfer avant d’entrer au paradis15. Seuls les infidèles, à qui Dieu a interdit ce lieu de
félicité (Bukhârî, 1964 : 97, § 30) resteront en enfer éternellement, les croyants y
séjournant selon une durée variable16. Aussi mieux vaut-il, pensent les Maures, se
conduire pieusement dans cette vie pour espérer échapper aux tourments prolongés de
l’enfer.
34 Un hadith connu dans la société maure fait ainsi parler le défunt, selon qu’il a été pieux
ou non, au moment où il quitte la demeure des vivants pour celle des morts : « Quand le
cercueil est posé à terre et que les hommes le placent sur leurs épaules, le défunt s’il
était pieux s’écrie : “Hâtez-vous de m’emporter!” Mais s’il s’agissait d’un impie, il hurle
à l’intention de sa famille : “Malheur à moi, où m’emportez-vous?” » (Nawawy, 1991 :
262).
35 Mais une fois passé de vie à trépas, il est trop tard pour se repentir de ses mauvaises
actions; ainsi que l’indique le Coran (XXIII, 99-100) : « Lorsque la mort approche de l’un
d’eux, il dit : “Mon Seigneur! Qu’on me renvoie sur la terre, peut-être, alors,
accomplirais-je une œuvre bonne parmi les choses que j’ai délaissées.” Non!… C’est là,
seulement, une parole qu’il a prononcée; une barrière17 se trouve derrière les hommes
jusqu’au Jour où ils seront ressuscités » (trad. Masson, 1967, t. 2 : 427-428).
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
147
Œuvrer envers autrui et envers Dieu
36 Le statut des œuvres reste à définir en islam, dont la pensée oscille entre liberté et
prédestination, notions qui sont articulées comme suit dans un hadith : « Agissez, et
alors tout vous sera facilité pour ce en vue de quoi vous avez été créé; ceux qui seront
destinés à la Félicité, on leur facilitera les œuvres des gens destinés à la Félicité; et ceux
qui sont destinés au Malheur, on leur facilitera les œuvres des gens destinés au
Malheur » (Bukhârî, 1964 : 87-88, § 4).
37 Certaines paroles du Prophète affirment en effet que le destin (maktûb), scellé pour
chacun avant sa naissance, prévaut sur les œuvres : « Par Allâh, en dehors de Qui il
n’est pas d’autres divinité, chacun de vous aurait beau œuvrer comme l’ont fait ceux
destinés au Paradis, en sorte qu’il s’en approcherait à la distance d’une coudée, alors ce
qui a été écrit pour lui prévaudrait, et donc il accomplirait (quand même) les actions
des damnés, et il entrerait en Enfer. Et certes, chacun de vous aurait beau œuvrer
comme les damnés, au point de s’approcher de l’Enfer à la distance d’une coudée, alors
ce qui a été écrit pour lui prévaudrait, en sorte qu’il accomplirait les actions des élus et
qu’il entrerait (quand même) au paradis » (Bukhârî, 1964, ibid.).
38 La condition nécessaire pour entrer au paradis et ne pas connaître le feu éternel, et sur
laquelle les Maures n’ont aucun doute, consiste à croire en Dieu et en son Prophète
Mahomet; la foi en la révélation musulmane a en effet en islam le statut d’œuvre
comme le déclare le théologien sunnite Ghazâlî18 (1974 : 3) : « Adam dit : “Ô Seigneur,
quelles sont les œuvres des gens destinés au paradis?” Dieu répondit : “Elle sont de
trois sortes, la foi en moi, la confiance dans la véracité de mes Envoyés, et l’obéissance à
mon Livre, à ses commandements et à ses défenses.” » La miséricorde divine ne peut
donc s’appliquer à ceux qui ne croient pas en Allah ou à ceux qui lui associent d’autres
divinités. Cela explique en partie que la tendance des Maures au prosélytisme soit si
forte.
39 Ils savent en effet qu’un destin infernal attend celui qui ne s’est pas soumis à Dieu,
l’attitude de soumission désignant étymologiquement le Musulman. Le Coran décrit en
ces termes (XXII, 3-4) la destinée de l’infidèle : « Tel, parmi les hommes discute au sujet
de Dieu sans détenir aucune science; il suit tout démon révolté dont il est écrit : “Il
égare quiconque le prend pour maître et le dirige vers le châtiment de la flamme
brûlante” » (trad. Masson, 1967, t. 2 : 408).
40 Toutes les autres fautes, hormis la mécréance et l’associationisme (shirk), peuvent être
pardonnées si l’individu s’en repent et s’attache à ne pas récidiver. Ainsi, le Coran
promet la peine de l’enfer éternel (IV, 93) à celui qui commet l’homicide volontaire; il
s’agit en effet d’une faute majeure dans la mesure où non seulement le meurtrier
détruit la vie d’autrui mais aussi s’arroge un pouvoir de mort qui n’appartient qu’à
Dieu. Cependant, même cette faute peut être pardonnée par le Très-Haut si le coupable
s’en repent et ne la renouvelle pas.
41 Les propos de Ghazâlî (1974 : 78) à ce sujet sont tout à fait éclairants : « Parfois il arrive
que le Dieu Très Haut accorde son pardon, au moment où on règle les comptes et les
droits des hommes, sauf pour le meurtre avec préméditation, car ce crime n’obtient
jamais de pardon, non plus que l’idolâtrie, à moins que les idolâtres ne se convertissent
à l’islam, que les meurtriers ne se repentent sincèrement et qu’ils ne retombent plus
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
148
dans leur péché. Car celui qui tue donne la mort à un être auquel Dieu lui-même avait
donné la vie. »
42 En islam, la grâce divine peut s’exercer de façon absolue; c’est ce que suggère
l’expression arabe connue dans la société maure : « Par la grâce de Dieu et non par ton
mérite » (bi fadlika allahuma lâ bi ‘amali). Le Tout-Puissant est libre de prendre ou non en
compte les manquements des mortels tout comme leurs œuvres.
43 Parmi les œuvres, celles qui manifestent cette vertu essentielle qu’est la générosité
envers les plus nécessiteux est hautement valorisée et elle est largement pratiquée
dans la société maure; l’enfer est, entre autres, le lot de ceux qui auront manqué de
porter assistance aux plus démunis, comme l’indique le Coran (LXIX, 33-34) : « Il ne
croyait pas en Dieu l’Inaccessible; il n’encourageait personne à nourrir le pauvre »
(trad. Masson, 1967, t. 2 : 715).
44 Les Musulmans se doivent en effet de secourir hommes ou animaux; ainsi, le Prophète
déclara qu’une femme respectable qui avait laissé mourir de faim un chat après l’avoir
enfermé se retrouverait en enfer tandis qu’une prostituée irait au paradis pour avoir
donné de l’eau à un chien qui mourait de soif auprès d’un puits. Mais, dans la société
maure, comme dans d’autres sociétés, ce ne sont bien souvent que certaines espèces
d’animaux qui font l’objet d’attention tandis que d’autres peuvent être maltraitées 19.
Œuvrer pour les morts
45 Un hadith montre que le salut de l’âme d’un individu dépend non seulement de lui-
même, en particulier de ses œuvres charitables, comme une donation pieuse (waqf)
dont les retombées bénéfiques pour les vivants se répéteront de génération en
génération, mais également des invocations que ses descendants font en sa faveur :
« Lorsque meurent les fils d’Adam, leurs œuvres cessent à l’exception de trois d’entre
elles : une aumône dont les effets se perpétuent après sa mort 20, une science dont on
continue de tirer profit, un enfant pieux qui adresse à Dieu des requêtes en leur
faveur » (Nawawy, 1991 : 360).
46 Ainsi, dans la société maure, des invocations, mais aussi des prières, ou encore des
aumônes, peuvent être effectuées au nom d’un proche21 ou au nom de tous les morts en
général22; par exemple, on peut donner de façon effective une offrande à quelqu’un qui
en jouira matériellement alors que le bénéfice spirituel en reviendra à celui ou ceux
pour qui, en intention, l’aumône a été réalisée.
47 Il arrive aussi que certaines personnes, dans la société maure comme dans d’autres
sociétés musulmanes, accomplissent le cinquième devoir fondamental du Musulman
qu’est le pèlerinage (hajj) au nom d’un proche disparu qui n’a pu le faire de son vivant,
souvent pour des raisons financières ou de santé. Cet acte, recommandé par le
Prophète, influe favorablement sur le salut de l’âme du mort et ne peut être accompli
que par quelqu’un qui a déjà réalisé le pèlerinage « pour son propre compte ». Grâce à
un tel acte, l’individu cherche à assurer à la fois le salut de l’un de ses proches et le sien
propre.
48 Dans la société maure, c’est souvent à la place de sa mère qu’un homme se rend en
pèlerinage, sans doute en raison du fait que le fils est affectivement plus proche de sa
mère que de son père mais aussi parce que l’islam attache une grande importance au
respect dont elle doit être l’objet. Le statut quasi sacré qui lui est accordé autorise à
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
149
supposer qu’il est plus méritoire pour un homme d’accomplir le pèlerinage au bénéfice
de sa mère qu’à celui de toute autre personne.
49 Par ailleurs, les œuvres que l’individu accomplit entre l’instant de sa mort et celui de sa
résurrection sont prises en compte par Dieu et peuvent contribuer à son salut ou à celui
de ses proches. Ainsi, comme le raconte Ghazâlî (1974 : 80), un fils qui aurait manqué de
piété filiale durant sa vie peut espérer se rattraper après sa mort et, par cette attitude,
infléchir le destin de son père et le sien : « “Ô mon Dieu, j’ai vu que j’étais mis de côté
pour l’enfer, sans pouvoir l’éviter, car je me suis mal conduit à l’égard de mon père
dans le monde terrestre. Lui aussi se trouve mis de côté pour l’enfer comme moi.
Double plutôt ma punition en y ajoutant celle de mon père, et délivre-le de l’enfer”. Il
dit, et le Dieu Très Haut lui sourit en disant : “Tu as été un mauvais fils dans le monde
terrestre, mais tu te montres un bon fils dans celui-ci. Prends ton père par la main et
entrez ensemble au paradis.” »
Rappeler sa foi en l’islam
50 Lors des funérailles, dans la société maure, au moment où les participants ont fini de se
recueillir sur le corps du défunt, ils s’éloignent pour laisser la place aux anges qui
viennent interroger le mort dans sa tombe. Cette croyance trouve sa source dans un
hadith : « Lorsque le croyant a été mis dans son tombeau, que ses amis s’éloignent et
retournent chez eux, et alors qu’il entend encore le craquement de leurs sandales 23,
deux anges se rendent auprès de lui, le font mettre sur son séant et lui posent la
question suivante : “Que disais-tu de cet homme, Mahomet?” – “Je déclarais, répondra-
t-il, qu’il est le serviteur et l’Envoyé de Dieu.” Alors, les anges lui diront : “Regarde la
place que tu aurais occupée en enfer et celle que Dieu en échange t’a donnée dans le
paradis.” Et l’homme verra ces deux places. Quant au mécréant ou à l’hypocrite, il
répondra à la question posée : “Je ne sais pas; je répétais ce que tout le monde disait.”
Alors, on dira à cet homme : “Tu n’as rien su, tu n’as donc rien lu?” Et les anges le
frapperont une seule fois avec un maillet de fer entre les deux oreilles. L’homme
poussera un tel cri que tout le voisinage l’entendra, sauf les hommes et les génies »
(Bukhârî, 1977 : 430-431).
51 Les anges qui avaient tout d’abord retiré l’âme de la personne à l’instant de son décès,
la réintroduisent dans le corps le temps de l’interrogatoire afin qu’elle puisse répondre
à leurs questions. Ces deux anges, Munkar et Nâkîr24, ont, selon les Maures, un aspect
effroyable : ils ont des dents pointues qui entrent dans la terre et des yeux exorbités qui
jettent des flammes; menaçants, ils brandissent des sortes de massue.
52 La description qu’en fait Ghazâlî (1974 : 20) est à cet égard édifiante : « Ensuite
pénètrent auprès du mort les deux questionneurs du tombeau. Ce sont deux anges
noirs, qui déchirent la terre avec leurs dents; ils ont de longs cheveux flottants qui
traînent sur le sol; leur voix est comme le tonnerre qui gronde avec violence, leurs yeux
sont comme l’éclair qui brille, leur souffle est comme le vent impétueux. Chacun d’eux
tient à la main une barre de fer si énorme que les hommes et les génies, s’ils unissaient
leurs efforts, ne parviendraient pas à la soulever. Si ces deux anges frappaient d’un seul
coup de cette barre la montagne la plus gigantesque, ils l’anéantiraient. »
53 Dans la société maure, on redoute l’interrogatoire promis à celui qui vient de décéder
et, comme dans de nombreuses sociétés musulmanes, l’audition est le sens le plus
important (Fortier, 1997), on évoque particulièrement le ton tonitruant et terrifiant des
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
150
anges à ce moment. Seuls les Musulmans qui y auront été préparés trouveront la force
de répondre alors que les autres non seulement ne sauront pas quoi dire, mais, apeurés,
pourront perdre leur voix. Quant à celui qui hésite à répondre, il sera douloureusement
châtié et poussera d’horribles cris de douleur25 : « L’homme hésitant sera alors frappé à
grands coups de barres de fer, et il poussera des hurlements de douleur que tout
l’univers entendra, à l’exception des hommes, car, si les hommes les entendaient, ils
perdraient connaissance » (Ghazâlî, 1974 : 402)26.
54 Aussi, dans la société maure, non seulement les individus sont-ils informés de leur
vivant de l’interrogatoire qui les attend après leur mort, mais les réponses qu’ils
doivent donner leur seront rappelées au moment de leur inhumation afin qu’ils ne
manifestent aucune hésitation lorsque les anges les interpelleront sans ménagement.
En l’occurrence, à la fin de la prière des funérailles, alors que tous les fidèles se sont
retirés, l’imâm reste seul avec le défunt pour lui rappeler ce qu’il devra répondre aux
anges quand ceux-ci viendront l’interroger27; il lui tient alors ce discours : « Untel, dès
qu’ils viennent, ils te demanderont quel est ton dieu, quelle est ta religion, quel est ton
prophète, et quel est ton livre. Réponds-leur : mon Dieu est Allah, ma religion est
l’islam, mon Prophète est Muhâmmad, et mon Livre est le Coran. »
55 Lors de l’interrogatoire, en effet, le croyant doit affirmer sa foi en Dieu et en son
Prophète; comme l’indique un hadith : « Lorsque les deux anges feront s’asseoir le
croyant dans sa tombe, il témoignera qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu, et que
Muhammad est l’Envoyé de Dieu, ce témoignage sera en confirmation des paroles
divines » (Bukhârî, 1993 t. 1 : 270, § 688)28.
56 D’autre part, il est par ailleurs recommandé que l’individu récite peu avant de mourir
« le témoignage de la foi musulmane » (shahâda)29 ou que quelqu’un le fasse en son nom
s’il en est incapable (Qayrawânî, s.d. : 105), ce que font la plupart des Maures. L’identité
religieuse de l’individu est ainsi reconfirmée en fin de vie 30 exactement de la même
manière qu’elle l’avait été à la naissance (Fortier, 1998 : 207-208); car le fait de rappeler,
et ce jusqu’à la mort, sa foi en la révélation musulmane est essentiel en islam 31.
L’épreuve de l’interrogatoire
57 Les Maures plaignent celui qui, après l’interrogatoire, se révèlera être un infidèle dans
la mesure où déjà dans sa tombe il connaîtra les tourments qui l’attendent en enfer;
celle-ci s’assombrira, se réchauffera et la terre qui l’entoure viendra se resserrer
comme un étau jusqu’à faire éclater ses côtes32. La description de Ghazâlî (1974 : 24)
témoigne de la violence que lui inflige alors les anges : « Quant à l’impie, les deux anges
lui disent : “Qui est ton Seigneur?” Il dit : “Je n’en sais rien.” Ils lui disent : “Ah! Tu ne
sais pas qui il est, tu ne le connais pas!” Alors ils le frappent avec leurs barres de fer
jusqu’à ce qu’il soit englouti jusqu’à la septième terre. Puis la terre le rejette de
nouveau dans son tombeau, et ils le frappent à sept reprises » 33.
58 L’interrogatoire se déroule comme suit pour le croyant qui séjournera en enfer selon
une durée plus ou moins longue avant de rejoindre le paradis : « Ils (les anges)
l’apostrophent et le forcent à s’asseoir et à s’adosser. Puis ils lui disent : “Qui est ton
Seigneur, etc.?”, comme la première fois. Il répond sans aucune équivoque : “Dieu est
mon Seigneur, Mahomet est mon prophète, le Coran est mon guide, 1’Islâm est ma
religion, la Ka‘ba est ma Qibla, Abraham est mon père, sa foi est la mienne.” Ils lui
disent : “Tu as raison.” Puis ils agissent envers lui comme la première fois 34, sauf qu’ils
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
151
ouvrent une porte de son côté gauche, donnant sur l’enfer. Il peut ainsi contempler les
serpents de l’enfer, ses scorpions, ses chaînes et ses carcans, sa chaleur extrême, sa
nourriture infernale, sa boisson infecte et tout l’ensemble de ses tortures. Il en est tout
tremblant. Alors ils lui disent : “Il ne te sera pas fait de mal. Voici quelle aurait été ta
place en enfer, mais Dieu t’en a donné une autre en échange dans le paradis. Dors
heureux!” Puis ils referment la porte donnant sur l’enfer, mais ils ouvrent celle qui
donne sur le paradis. Le mort ne s’aperçoit pas du passage des mois, des années et des
siècles » (Ghazâlî, ibid. : 22).
59 En revanche, tout individu, dans la société maure, espère faire partie de ceux qui ne
connaîtront pas les flammes de l’enfer. Dans l’attente du jour de la résurrection, il sera
donné au bienheureux un avant-goût du lieu de délices que représente le paradis :
l’interrogatoire terminé, sa tombe s’élargira, s’embaumera et deviendra lumineuse et
fraîche.
60 Devant l’assurance émanant des propos de celui qui subit l’interrogatoire, ce qui
témoigne de sa confiance en Dieu, les anges lui procureront « luxe, calme et volupté »;
comme le décrit Ghazâlî (ibid. : 21) : « Alors ils lui disent : “Qui est ton Seigneur? Quelle
est ta religion? Qui est ton prophète? – Quelle est ta Qibla?” L’homme que Dieu a
secouru et qu’il a affermi par sa parole immuable leur répond : “Qui est-ce qui vous a
donné autorité sur moi? Qui est-ce qui vous a envoyés vers moi?” C’est là la réponse
que font les savants vertueux. Alors l’un des anges dit à son compagnon : “Il a raison!
Voici, nous l’avons suffisamment maltraité.” Puis ils agrandissent le tombeau au-dessus
de lui, en lui donnant la forme d’une voûte immense, et ils lui ouvrent de son côté droit
une porte qui donne sur le Paradis. Ensuite, ils lui apportent des vêtements de soie et
des parfums du paradis, ils lui font parvenir le zéphire et le repos du paradis. Sa
conduite vient vers lui, sous la forme de la plus aimable des créatures, pour qu’il
converse et s’entretienne avec elle, et le tombeau se remplit de lumière. Le mort ne
cesse pas de se réjouir et de s’égayer aussi longtemps que dure le monde terrestre,
jusqu’à la venue de l’heure du Jugement, et rien ne lui est plus agréable que de la voir
arriver. »
Le poids des œuvres
61 Lorsque l’interrogatoire concerne un Musulman préparé à réciter le témoignage de la
foi musulmane (shahâda), comme c’est le cas de tout individu en Mauritanie, la balance
entre ses œuvres et ses fautes s’avère déterminante pour conditionner sa destinée. Il
semble cependant que Dieu, dans sa grande miséricorde, ait tendance à augmenter la
valeur des bonnes actions (hasanât) par rapport aux mauvaises (sayyi’ât), et puisse
même pardonner ces dernières; c’est ce que montre un hadith (Bukhârî, 1964 : 100,
§ 40) : « Tout homme qui embrasse l’Islâm et qui pratique un bon Islâm, Dieu lui
pardonnera l’ensemble des fautes commises dans le passé par lui. Ultérieurement, la
rétribution pour chaque bonne action sera multipliée (en poids) par dix, ou plus,
jusqu’à sept cents. La mauvaise action ne sera comptée que pour elle-même, à moins
que Dieu ne la laisse impunie. »
62 Les anges demandent donc au défunt d’inscrire ses bonnes et mauvaises actions sous la
forme d’un « livre » que Dieu examinera le jour de la résurrection afin de déterminer le
temps que le croyant passera en enfer. Ainsi que le montre un passage de Ghazâlî (ibid. :
20), l’individu décédé utilise son linceul comme papier, et son index mouillé de salive
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
152
comme plume, à la demande de l’un des anges : « “Ô serviteur de Dieu, tu vas écrire
quelle a été ta conduite.” Le mort répond : “Je n’ai avec moi ni encrier ni papier.”
L’ange répond : “Comment donc! Ton linceul, voilà ton papier! Ta salive, voilà ton
encre! Ton doigt, voilà ta plume.” Puis il lui coupe un morceau de son linceul et le mort
se met à écrire, quand bien même il n’aurait pas su écrire pendant sa vie terrestre. Il se
souvient de ses bonnes et de ses mauvaises actions comme s’il ne s’agissait que d’un
seul jour. Ensuite, l’ange roule ce fragment d’étoffe et le suspend au cou du cadavre.
Puis, l’envoyé de Dieu récite le passage du Coran : “Nous avons suspendu au cou de chaque
homme sa destinée, à savoir sa conduite” »35.
63 La dialectique paradoxale entre destin scellé par Dieu et prise en considération des
œuvres s’applique également le jour ultime de la résurrection. En effet, certains versets
du Coran insistent sur le caractère individuel du Jugement, qui est strictement
déterminé par les actes de l’individu sans intervention possible d’un tiers, y compris
d’un proche : « Le jour où nulle âme n’aura plus pouvoir en faveur d’une autre »
(LXXXII 82, 89) et « Le jour où le coupable aimerait se racheter du tourment de ce jour-
là, par ses fils, par sa compagne, par son frère, par son clan qui le protège et par tous
ceux qui sont sur la terre, pour être sauvé » (LXX 11-14) (Sourdel, 1961 : 184).
64 Cependant, une histoire édifiante rapportée par Ghazâlî (ibid. : 79-80) témoigne que, le
jour même de la résurrection, les morts peuvent influer sur leur destinée, et ce dans un
sens ou dans un autre : « Au jour de la résurrection, on amène un homme dont les
bonnes et mauvaises actions se font exactement équilibre, et il n’est pas possible de
trouver chez lui une seule bonne œuvre qui fasse pencher la balance. Le Dieu Très Haut,
ému de compassion, lui dit : “Va au milieu des hommes et cherche quelqu’un qui te
donne une bonne action, grâce à laquelle je pourrai te faire entrer en paradis.” Il s’en
va donc et se met à chercher parmi les hommes; mais il ne trouve personne qui veuille
lui parler, et tous ceux à qui il adresse une demande lui répondent : “Je crains que ma
balance ne soit trop légère; j’ai plus besoin que toi de mes bonnes œuvres.” Il est donc
sur le point de désespérer, quand un homme lui dit : “Que cherches–tu?” Il répond : “Je
cherche une seule bonne action; je suis déjà passé auprès de gens qui en possèdent des
milliers, mais qui sont trop avares pour m’en céder une seule.” L’autre répond : “J’ai
déjà comparu devant le Dieu Très Haut, mais je n’ai trouvé sur mon feuillet qu’une
seule bonne action; je ne pense pas qu’elle puisse m’être d’aucune utilité : prends-la
donc, je t’en fais présent.” Cet homme s’en va en l’emportant, plein de joie et
d’allégresse, et le Dieu Très Haut lui dit : “Comment cela va-t-il?” (Or il le sait
parfaitement ; loué soit-il!). L’homme lui répond : “Il m’est arrivé telle et telle chose.”
Puis on appelle son compagnon, celui qui lui a fait don de cette bonne action. Le Dieu
Très Haut lui dit : “Ma générosité dépasse encore la tienne. Prends ton frère par la main
et entrez tous deux ensemble en paradis.” »
Sur-vies
65 La conduite des Maures pouvant déterminer le sort qui les attend dans l’au-delà, on ne
peut comprendre nombre de leurs actions sans considérer la dimension eschatologique
qui est au cœur de leur vie. La prise en compte de la foi dans la recherche réintroduit
alors la question de l’individu et du religieux dans l’analyse des comportements, y
compris parmi ceux qui peuvent avoir une portée sociale.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
153
66 Il en est ainsi par exemple de la pratique de l’hospitalité, bien connue en Mauritanie
comme dans d’autres sociétés musulmanes, et dont bénéficient les étrangers de
passage; elle est souvent assimilée à une coutume de type culturel qui occulte sa
dimension religieuse. Si elle est effectivement accomplie pour autrui dans le but d’en
faire un allié, ou encore vis-à-vis du voisinage afin d’acquérir un certain prestige, elle
est aussi réalisée dans la perspective de gagner son propre salut ou encore comme
moyen d’intercéder auprès de Dieu au bénéfice d’un tiers défunt.
67 Ce cas n’est pas isolé puisque de nombreux domaines relevant de ce qu’on pourrait
appeler l’« éthique », si l’on entend par là ce qui concerne le rapport aux autres et à soi-
même, sont largement déterminés par des conceptions religieuses. Car, en dépit de la
croyance à la toute puissance de la grâce divine en islam, les œuvres n’en sont pas
moins reconnues. Ainsi, certains des actes accomplis sur cette terre par un individu
peuvent influer sur sa destinée future.
68 Or les Musulmans qui préparent leur vie dans l’au-delà assurent simultanément celle
qui se prolonge ici-bas après leur mort dans le souvenir des vivants; comme le précise
un hadith : « Trois choses accompagnent le mort : deux reviennent, une seule reste avec
lui. Ce qui l’accompagne, c’est sa famille, sa fortune et ses œuvres; ce qui s’en retourne,
c’est sa famille et sa fortune; mais ses œuvres restent » (Bukhârî, 1964 : 93, § 15).
69 Si une action sociale peut être une action pieuse, l’inverse est également vrai, de sorte
que celui qui se conduit comme un bon Musulman gagne les faveurs de Dieu ainsi que
celles de ses contemporains. La réputation d’un individu lui survit, aussi constitue-t-
elle une motivation supplémentaire pour bien œuvrer.
70 Ce que la postérité retiendra d’une personne, c’est la manière dont elle a conduit sa vie,
ainsi que le suggère un aphorisme maure : « Dans ce monde, la vie est une histoire que
l’on relate, fais que la tienne soit belle à raconter » (dunya mrad rwaya wa li dhak izayan
rwaytu). De ce point de vue, un individu ayant fait le bien autour de lui ne meurt pas
dans la mesure où, comme l’énonce un vers de poésie arabe recueilli en Mauritanie :
« N’a pas vécu celui dont les actes ont été blâmables, et n’est pas mort celui qui laisse le
souvenir d’un homme de bien » (ma ‘âsha man ‘âsha madhmûman kasâ’ibihi/wa lam yamut
man yakun bi-l-khayri dhikrahu).
BIBLIOGRAPHIE
Bukhârî, M.
1964 L’Authentique tradition musulmane, Trad. de G.H. Bousquet, Paris, Sindbad.
1977 Les Traditions islamiques, t. 1, Trad. de O. Houdas et de W. Marçais, Paris, Adrien et Jean
Maisonneuve, 4 tomes.
1993 Le Sommaire du Sahih al-Boukhari, Beyrouth, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2 tomes.
Carra de Vaux, B.
1975 « Barzakh », Encyclopédie de l’islam, t. 1, Leiden, Brill et Paris, Maisonneuve, pp. 1103-1104.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
154
Casta, F.-J.
1979 « Le sentiment religieux des Corses face à la mort (Approches d’ethnologie religieuse) »,
Études Corses 12-13, pp. 77-104.
Coran
1967 Trad. de D. Masson, Paris, Gallimard, 2 tomes.
1980 Trad. de R. Blachère, Paris, Maisonneuve et Larose.
Dinet, E. et Ben Ibrahim, S.
s.d. La Vie de Mohammed, s. l., s. éd.
Fortier, C.
1997 « Mémorisation et audition. L’enseignement coranique chez les Maures de Mauritanie »,
Islam et Sociétés au Sud du Sahara 11, pp. 85-105.
1998 « Le corps comme mémoire. Du giron maternel à la férule du maître coranique », Journal
des Africanistes 68 (1-2), pp. 199-223.
2001 « “Le lait, le sperme, le dos. Et le sang?”. Représentations physiologiques de la filiation et
de la parenté de lait en islam malékite et dans la société maure de Mauritanie », Cahiers d’Études
Africaines 60 (1), pp. 97-138.
2003 « Soumission, pragmatisme et légalisme en islam », Topique, Spiritualités 85, pp. 149-169.
2005 (à paraître) « La mort vivante ou le corps intercesseur », Revue du Monde Musulman et de la
Méditerranée.
Galal, M.
1937 « Des rites funéraires en Égypte actuelle », Revue des Études Islamiques, pp. 135-285.
Ghazâlî, A.H.M.
1974 La Perle précieuse, Trad. L. Gautier, Amsterdam, Oriental Press.
Ibn Manzûr, M.
s.d. Lisân al-‘arab, Beyrouth, Dâr Sâdr, 3 tomes (en arabe).
Laoust, H.
1977 Les Schismes dans l’islam, Paris, Payothèque.
Le Goff, J.
1999 « La naissance du purgatoire » in Un Autre Moyen Âge, Paris, Gallimard, pp. 771-1231.
Molé, M.
1961 « Le jugement des morts dans l’Iran préislamique » in Le Jugement des morts, Paris, Seuil, pp.
145-175.
Nawawy, I.
1991 Les Jardins de la piété. Les Sources de la Tradition islamique, Paris, Alif.
Qayrawânî, A.Z.
s.d. La Risâla. Épître sur les éléments du dogme et de la loi de l’islam selon le rite mâlékite, Trad. de L.
Bercher, Alger, H. Pérès.
Richard, Y.
1991 L’Islam chi’ite, Paris, Fayard.
Sharaf, S.S.M.
1987 Le Rappel et l’invocation de Dieu, Kuwait, Dar al-qalam.
Sourdel, D.
1961 « Le jugement des morts dans l’islam » in Le Jugement des morts, Paris, Seuil, pp. 179-205.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
155
Wensinck, A.J. et Mensing, J.P.
1967 Concordances et indices de la Tradition musulmane, t. 6, Leiden, E.J. Brill, 7 tomes (en arabe).
Westermarck, E.
1926 Ritual and Belief in Marroco, London, MacMillan, 2 tomes.
Wigoder, G.
1996 Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Cerf et Robert Laffont.
Yoyotte, J.
1961 « Le jugement des morts dans l’Égypte ancienne » in Le Jugement des morts, Paris, Seuil, pp.
17-80.
NOTES
1. La société maure, comme la plupart des sociétés d’Afrique du Nord, est islamisée selon le rite
malékite d’obédience sunnite depuis très longtemps, à l’origine par les Almoravides au XI e siècle.
Les Maures, qui parlent un dialecte arabe, le hassâniyya, restent culturellement des bédouins
même s’ils ne nomadisent quasiment plus.
2. Nous avons traité par ailleurs de la difficulté des Occidentaux, héritiers de la culture
chrétienne, à percevoir la dimension spirituelle de l’islam derrière ce qu’ils jugent « prosaïque »
(Fortier, 2003).
3. C’est le cas par exemple au Maroc (Westermarck, 1926, t. 2 : 518).
4. Cette pratique a été par ailleurs interdite par l’Église dans certaines sociétés chrétiennes de
Méditerranée où elle était également répandue, comme par exemple en Corse (Casta, 1979).
5. La tradition chi’ite, au contraire, valorise l’expression ostensible de la souffrance, en
particulier lors de l’âshurâ, où lamentations et mortifications commémorent le deuil de Hoseyn,
fils de ‘Ali, mort au combat de Karbalâ contre les Omeyyades.
6. La conduite de Mahomet, qui représente un modèle pour tout musulman, est consignée dans la
Sunna, qui comprend les actes et les dires du Prophète, ceux-ci également nommés hadith.
7. Chez les Juifs, à la mort d’une personne, ses proches devaient obligatoirement déchirer leurs
vêtements (Wigoder, 1996 : 274).
8. Chez les chi’ites, en revanche, une tradition dit que « Quiconque pleure ou fait pleurer pour
Hoseyn entrera au paradis » (Richard, 1991 : 127).
9. Cette attitude résignée n’est cependant pas toujours la règle dans les pays musulmans, par
exemple dans certaines sociétés du Maghreb où il existe des pleureuses professionnelles, ou
encore en Égypte où hommes et femmes du cortège funéraire poussent des cris et des sortes de
lamentations (Galal, 1937 : 172)
10. Cet événement a eu lieu lors de l’un de nos séjours à Chinguetti.
11. Selon l’embryogenèse islamique, c’est le quatrième mois, ou plus exactement le cent
vingtième jour, que Dieu envoie un ange qui détermine une durée de vie et insuffle l’âme (rûh) à
ce qui n’est encore qu’une boule de chair (mudgha), l’ange obéissant alors à l’ordre divin : « Écris
ses œuvres, sa part de la vie, son terme, et sa destinée heureuse ou malheureuse » (Bukhârî, 1993,
t. 2 : 556, § 1356). Nous avons développé ce sujet dans un précédent article (Fortier, 2001).
12. L’image du feu infernal se retrouve dans de nombreuses pensées religieuses; comme le
remarque J. Le Goff (1999 : 797) : « Ce qui frappe dans les doctrines et les images de l’au-delà c’est
l’omniprésence du feu. »
13. Ainsi, lors d’un de nos terrains à Chinguetti, une femme qui souhaitait pour notre bien que
nous nous convertissions à l’islam, nous dit, lorsque nous exprimions notre difficulté à saisir avec
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
156
la main le couscous brûlant qu’elle avait préparé, que cette sensation n’était rien en comparaison
de celle qui nous attendait en enfer si nous restions infidèle.
14. Durant la vie de l’individu, deux anges, l’un placé sur son épaule droite et l’autre sur son
épaule gauche, sont censés inscrire, le premier, ses bonnes, et le second, ses mauvaises actions.
15. Dans le mazdéisme de l’Iran préislamique, on trouve également la conception d’un enfer
temporaire (Molé, 1961 : 145). Chez les penseurs chrétiens antérieurs à Saint Augustin, tel
Origène (m. 253-254), le paradis est aussi gagné après une période plus ou moins longue passée en
enfer (Le Goff, 1999 : 858).
16. En islam, seuls les courants khârijite et mu‘tazilite pensent que quiconque entre en enfer y
restera éternellement (takhlîd fî-l-nâr) (Laoust, 1977 : 446).
17. Le terme de « barrière » traduit ici le mot barzakh qui se retrouve à deux autres reprises dans
le Coran (LV, 20 et XXV, 53). Selon le lexicographe arabe Ibn Manzûr (s.d., t. 3 : 8, § 29), ce terme
désigne la séparation et également le délai accordé. C’est cette double acception, à la fois
physique et temporelle du terme, qui est retenue en islam où le barzakh renvoie d’une part à la
barrière infranchissable qui sépare le mort du monde de la vie, et d’autre part au temps qui
sépare le décès de l’instant de la résurrection. Selon B. Carra de Vaux (1975 : 1104), des exégètes
considèrent par ailleurs le barzakh comme une barrière entre l’enfer et le paradis. Ce terme est
d’origine persane où, là aussi, il ferait référence à l’intervalle de temps entre la mort et la
résurrection.
18. Ghazâlî (1058-1111), né et mort en Perse, qui fut à la fois un grand juriste et un grand
mystique, écrivit, entre autres, un ouvrage important sur la mort et l’au-delà, intitulé La Perle
précieuse pour dévoiler la connaissance du monde à venir (ad-durra al-fâkira fî kashf ‘ulûm al-âkhira).
19. L’âne, par exemple, est souvent maltraité dans la société maure, ce qui est aussi le cas dans
d’autres sociétés.
20. L’aumône participait du salut également dans le christianisme; selon une opinion répandue à
l’époque d’Origène, elle était si valorisée qu’elle pouvait effacer à elle seule toutes les mauvaises
actions accomplies (Le Goff, 1999 : 858).
21. Il en est de même dans le christianisme (ibid. : 899) où ceux qui sont châtiés par les flammes
du purgatoire et qui y restent jusqu’au jour du Jugement dernier peuvent en échapper plus tôt
par les prières, les aumônes, les jeûnes, et les offrandes de leurs proches ou les messes que ceux-
ci font dire à leur intention.
22. Comme nous l’avons montré par ailleurs (Fortier, 2005), cela s’explique sans doute par le fait
que les morts connaissent un sort commun, dans la mesure où tous attendent le Jugement
dernier. Cet état concerne l’ensemble des morts depuis Adam hormis le Prophète et dix de ses
compagnons qui, selon un hadith, ont déjà rejoint le paradis.
23. Nous avons montré par ailleurs (Fortier, 2005) que les morts entendent dans leurs tombeaux,
l’ouïe étant le dernier des sens à disparaître.
24. Tous les anges ne sont pas « angéliques » en islam, puisqu’en plus des anges bienveillants
(rahma), existe des anges de la torture (‘adhâb).
25. Dans un autre article (Fortier, 2005), nous avons développé l’idée islamique selon laquelle le
mort connaît des sensations dans sa tombe, telles que la douleur.
26. Un verset coranique (XLVII, 29) fait par ailleurs allusion à la situation misérable des
incroyants lors de leur rencontre avec ces anges : « Comment seront-ils quand les Anges les
rappelleront à Nous, les frappant sur la face et le derrière! » (trad. Blachère, 1980 : 541).
27. À celui qui se demandait comment le mort allait pouvoir dialoguer avec les anges dont il ne
connaissait pas la langue, le syriaque (suryâniyya), le Prophète aurait répondu que ceux qui
étaient bénis par Dieu sauraient comment leur répondre.
28. Il est par ailleurs impossible qu’un « infidèle » trompe les anges en se faisant passer pour un
Musulman puisque, comme le rappelle un verset coranique (XXII, 17), la vérité sera révélée au
jour de la résurrection.
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
157
29. Nous avons expliqué ailleurs (Fortier, 2003) pourquoi il nous semblait plus approprié de
rendre le terme de shahâda par « témoignage de la foi » plutôt que par l’expression admise de
« profession de foi ».
30. Un non-musulman qui prononcerait au seuil de la mort cette formule se verrait aussitôt
converti à l’islam et l’ensemble de ses fautes lui seraient du même coup pardonnées. La
conversion apparaît comme une nouvelle naissance puisque l’individu redevient tel qu’il était à
sa naissance alors qu’il était porteur de la vérité musulmane.
31. Nous avons explicité ailleurs (Fortier, 2003) cette nécessité pour les Musulmans de rappeler
leur foi en l’islam.
32. L’idée de châtiment associée à la sensation de renfermement et de prison se retrouve
également dans les conceptions de l’au-delà de l’Égypte pharaonique (Yoyotte, 1961 : 68).
33. Selon le Coran, il existe sept terres, la première étant celle que nous habitons, et la dernière
l’enfer. Parallèlement, il existe sept cieux, le dernier étant le paradis. Cette croyance se retrouve
dans bien d’autres traditions religieuses.
34. Ghazâlî fait ici référence à ceux qui entreront directement au paradis et qu’il a cités en
premier dans l’ordre de présentation de son ouvrage.
35. Le passage du Coran dont il est question est celui-ci : « Nous attachons son destin au cou de
chaque homme. Le Jour de la Résurrection, nous lui présentons un livre qu’il trouvera ouvert : Lis
ton livre! Il suffit aujourd’hui pour rendre compte de toi-même » (XVII, 13-14, trad. Masson, 1967,
t. 1 : 342).
INDEX
Index géographique : Mauritanie
Population Maures
AUTEUR
CORINNE FORTIER
Chargée de Recherche au CNRS. Laboratoire d’Anthropologie Sociale (CNRS-EHESS-Collège de
France)
Systèmes de pensée en Afrique noire, 17 | 2005
Vous aimerez peut-être aussi
- Habiter le monde au féminin: Entre récits et phénoménologieD'EverandHabiter le monde au féminin: Entre récits et phénoménologiePas encore d'évaluation
- La traversée du jour: Compassion, accompagnement de fin de vie et euthanasieD'EverandLa traversée du jour: Compassion, accompagnement de fin de vie et euthanasiePas encore d'évaluation
- Tsantsa11 LorillardDocument9 pagesTsantsa11 LorillardJulien GavellePas encore d'évaluation
- En Quoi Le Mal Nous Rend Plus Humain ?Document360 pagesEn Quoi Le Mal Nous Rend Plus Humain ?Christine MarsanPas encore d'évaluation
- L'évanouissement Du Témoin 1Document64 pagesL'évanouissement Du Témoin 1DascopFivePas encore d'évaluation
- Dieu ne reprend pas ses dons: Itinéraire d'un chrétien pour le mondeD'EverandDieu ne reprend pas ses dons: Itinéraire d'un chrétien pour le mondePas encore d'évaluation
- Sophia 100Document5 pagesSophia 100MULUME MUZUSANGABO NorbertPas encore d'évaluation
- Le Sacrifice Au Cœur de La CultureDocument5 pagesLe Sacrifice Au Cœur de La CultureanabasethPas encore d'évaluation
- D'une Île À L'autre Enjeux de La Créolité Au FémininDocument11 pagesD'une Île À L'autre Enjeux de La Créolité Au Fémininpaula roaPas encore d'évaluation
- Pour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec: Confluences et divergencesD'EverandPour des histoires audiovisuelles des femmes au Québec: Confluences et divergencesPas encore d'évaluation
- Peur de Manquer - 2e Édition Actualisée L'angoisse Du ManqueDocument42 pagesPeur de Manquer - 2e Édition Actualisée L'angoisse Du Manquetainui100% (1)
- Le Mal Et La SouffranceDocument85 pagesLe Mal Et La Souffrancelepton100100% (3)
- Le Poids Du Réel, La Souffrance (Denis Vasse)Document180 pagesLe Poids Du Réel, La Souffrance (Denis Vasse)Renato Fonseca100% (3)
- Expression SentimentsDocument8 pagesExpression SentimentsAbdellah SouheilPas encore d'évaluation
- Errances en Non-Lieux Et Non-Lieux de L'erranceDocument7 pagesErrances en Non-Lieux Et Non-Lieux de L'errancealcouloumbrePas encore d'évaluation
- Césaire - Discours Négritude - 1987Document8 pagesCésaire - Discours Négritude - 1987leboss23jordanPas encore d'évaluation
- Travail de Fin de Cycle CarlaDocument41 pagesTravail de Fin de Cycle CarlaCarlaPas encore d'évaluation
- BAC 2017 - Senegal - Français Série LDocument3 pagesBAC 2017 - Senegal - Français Série Lcheikhibrahimandiaye2022Pas encore d'évaluation
- Mensuel 138Document84 pagesMensuel 138christianeomat1Pas encore d'évaluation
- Maffesoli, Michel - Le Vitalisme SauvageDocument11 pagesMaffesoli, Michel - Le Vitalisme SauvageFelipeHenriquezRuzPas encore d'évaluation
- Discours NegritudeDocument4 pagesDiscours NegritudeObed EngbakaPas encore d'évaluation
- NANCY, Jean-Luc - La Communauté DésavouéeDocument82 pagesNANCY, Jean-Luc - La Communauté DésavouéeLuis Felipe AbreuPas encore d'évaluation
- Didi-Huberman, G. - Passer, Quoi Qu Il en Coûte (Fragment)Document5 pagesDidi-Huberman, G. - Passer, Quoi Qu Il en Coûte (Fragment)Guión II UCINEPas encore d'évaluation
- 2011 Mbengue ArchDocument315 pages2011 Mbengue ArchRIDA ELBACHIRPas encore d'évaluation
- Voyages en nostalgie: Parcours mémoriel à travers les arts et les médiasD'EverandVoyages en nostalgie: Parcours mémoriel à travers les arts et les médiasPas encore d'évaluation
- Parcelles Singulières: Fragments de la violence ordinaireD'EverandParcelles Singulières: Fragments de la violence ordinairePas encore d'évaluation
- Eloquence de Victor Hugo Dans Son Discours Sur La Misere A1302Document3 pagesEloquence de Victor Hugo Dans Son Discours Sur La Misere A1302Meriem TassiliPas encore d'évaluation
- HTTPSWWW - now1.InfoFrTextesCerveau Et ConscienceDossierConscience PDFDocument12 pagesHTTPSWWW - now1.InfoFrTextesCerveau Et ConscienceDossierConscience PDFIsmail TurkozPas encore d'évaluation
- Le Moi Des MourantsDocument14 pagesLe Moi Des MourantsMunir BazziPas encore d'évaluation
- La Caque: De la pestilence à la plus douce fragrance !D'EverandLa Caque: De la pestilence à la plus douce fragrance !Pas encore d'évaluation
- Cahiers Msozoaires Les Cahiers Mesozoaires 0 Decembre 2021 DestructionsDocument114 pagesCahiers Msozoaires Les Cahiers Mesozoaires 0 Decembre 2021 DestructionsdisseminerPas encore d'évaluation
- Cadre Général - Bardo Au RéseauDocument12 pagesCadre Général - Bardo Au RéseauBastien DPas encore d'évaluation
- Un Labyrinthe Sentimental: Étude de L'Inconscient Feminin Dans L'Œuvre de Calixthe BeyalaDocument17 pagesUn Labyrinthe Sentimental: Étude de L'Inconscient Feminin Dans L'Œuvre de Calixthe BeyalaMaria SimotaPas encore d'évaluation
- La Representation de La Femme Dans Les Cinemas D AfriqueDocument5 pagesLa Representation de La Femme Dans Les Cinemas D Afriquedidier75Pas encore d'évaluation
- Recueil de Francais 6 Mr. DounisDocument20 pagesRecueil de Francais 6 Mr. DouniskakeraPas encore d'évaluation
- Séminaire LAS Anthropologie Du Visuel2023-2024Document12 pagesSéminaire LAS Anthropologie Du Visuel2023-2024casimirmortemartPas encore d'évaluation
- LMC Afr 01 Langage Memoire Rwanda EntierDocument405 pagesLMC Afr 01 Langage Memoire Rwanda Entierfatmazohra.ghanemPas encore d'évaluation
- Pourquoi Se Souvenir Aujourd'hui-Conference Caminar-Juin 2014-Toulouse-Eric Fernandez QuintanillaDocument16 pagesPourquoi Se Souvenir Aujourd'hui-Conference Caminar-Juin 2014-Toulouse-Eric Fernandez QuintanillaÉric FERNANDEZPas encore d'évaluation
- Représentation Actuelle de La Mort Dans Nos Sociétés Eslm - 134 - 0115Document10 pagesReprésentation Actuelle de La Mort Dans Nos Sociétés Eslm - 134 - 0115Radu TomaPas encore d'évaluation
- L'Héroïsme Dans La Dramaturgie D'Albert Camus.: To Cite This VersionDocument526 pagesL'Héroïsme Dans La Dramaturgie D'Albert Camus.: To Cite This VersionSiluePas encore d'évaluation
- SUJET - LA POET-WPS OfficeDocument20 pagesSUJET - LA POET-WPS OfficeCyril OBOPas encore d'évaluation
- Lavelle MalDocument87 pagesLavelle MalOsvaldo Felipe100% (1)
- CaieteEchinox38 2020 pp.171 180Document10 pagesCaieteEchinox38 2020 pp.171 180AdianyPas encore d'évaluation
- Les « Pacific'acteurs » Voyage conflictuel à Saint-Pierre-et-MiquelonD'EverandLes « Pacific'acteurs » Voyage conflictuel à Saint-Pierre-et-MiquelonPas encore d'évaluation
- L'incesteDocument58 pagesL'incesteLinux UbuntuPas encore d'évaluation
- Ethnographier Les Silences de La Violence - Karine VanthuyneDocument8 pagesEthnographier Les Silences de La Violence - Karine VanthuyneFet BacPas encore d'évaluation
- Boris Cyrulnik - Comte Rendu Conférence Letizia MissirDocument5 pagesBoris Cyrulnik - Comte Rendu Conférence Letizia MissirMichel HaddadPas encore d'évaluation
- Memoire Complet - DeBUTDocument9 pagesMemoire Complet - DeBUTYAPO ASSI URBAIN RENE SEKAPas encore d'évaluation
- La Barbarie À Visage Humain: Les Tribus Postmodernes: TangenceDocument12 pagesLa Barbarie À Visage Humain: Les Tribus Postmodernes: TangenceEdmx DmxPas encore d'évaluation
- Va Zhao JingDocument407 pagesVa Zhao Jingbelle12Pas encore d'évaluation
- th42 Dossier1Document5 pagesth42 Dossier1Emmanuel KoffiPas encore d'évaluation
- tp7 CorrigeDocument4 pagestp7 CorrigeEmmanuel KoffiPas encore d'évaluation
- Fic 00092Document24 pagesFic 00092IyedPas encore d'évaluation
- M GandhiDocument1 pageM GandhiYamba Djene Pecari NoblePas encore d'évaluation
- TSTI Exos 9 Sujets Bac LogarithmesDocument5 pagesTSTI Exos 9 Sujets Bac LogarithmesdjafarPas encore d'évaluation
- Autour de Suites Arithm Geom 01eDocument2 pagesAutour de Suites Arithm Geom 01eEmmanuel KoffiPas encore d'évaluation
- Autour de Suites Arithm Geom 01eDocument2 pagesAutour de Suites Arithm Geom 01eEmmanuel KoffiPas encore d'évaluation
- DS2 2018Document3 pagesDS2 2018Houda El ArbiPas encore d'évaluation
- 2019 2020 - L1 AES CoursDocument61 pages2019 2020 - L1 AES CoursLOUNDOU orthegaPas encore d'évaluation
- Format SVTDocument6 pagesFormat SVTnesky790Pas encore d'évaluation
- FR ITN ET101 La Vie de Saintete3jDocument70 pagesFR ITN ET101 La Vie de Saintete3jJean FabricePas encore d'évaluation
- Les Fetes Chrétiennes PDFDocument22 pagesLes Fetes Chrétiennes PDFngimbog laurentPas encore d'évaluation
- Le Chemin de CroixDocument7 pagesLe Chemin de CroixAndréPas encore d'évaluation
- PARDONDocument31 pagesPARDONNgouo100% (1)
- Cahiers de La BRT - Novembre 2020Document54 pagesCahiers de La BRT - Novembre 2020RichardPas encore d'évaluation
- Les Prieres Du ChretienDocument80 pagesLes Prieres Du ChretienArmelle Gbagbo100% (1)
- M33, S06P1, Littérature Francophones Le-Roman-QuébécoisDocument33 pagesM33, S06P1, Littérature Francophones Le-Roman-QuébécoisIbtissamPas encore d'évaluation
- Mario Veilleux - Méditation Sur La PrièreDocument3 pagesMario Veilleux - Méditation Sur La PrièreMonfiston SalemPas encore d'évaluation
- Recueil de Chants de Veillée FunéraireDocument66 pagesRecueil de Chants de Veillée FunéraireMelodium CanticumPas encore d'évaluation
- David Wilkerson Comment Pouvonsnous Continuer PecherDocument7 pagesDavid Wilkerson Comment Pouvonsnous Continuer PecherTojo Rana100% (1)
- Vogel Environnement Cultuel Du Défunt Durant Période Paléochrétienne in Conf ST Serge 1974 Maladie Et La MortDocument33 pagesVogel Environnement Cultuel Du Défunt Durant Période Paléochrétienne in Conf ST Serge 1974 Maladie Et La Mortpaleologul8Pas encore d'évaluation
- Manuel de Devotion de Don Juan Del DineroDocument32 pagesManuel de Devotion de Don Juan Del DineroBenjamin Tristan Antinoüs Llinares100% (1)
- Pentecôte LTG WarneryDocument14 pagesPentecôte LTG WarneryAdamPas encore d'évaluation
- Biographie de Martin LutherDocument11 pagesBiographie de Martin LutherKatcha nanklan enock hiliPas encore d'évaluation
- FMSH Propagande Francophone Daech 2017Document265 pagesFMSH Propagande Francophone Daech 2017guichardPas encore d'évaluation
- 2007 Faucon, St-GermainDocument2 pages2007 Faucon, St-GermainIsabelle CartronPas encore d'évaluation
- Recueil de Chants - Chorale El Santoriol - ADN 2020Document257 pagesRecueil de Chants - Chorale El Santoriol - ADN 2020Jean Eude Aballo100% (2)
- Seins Et SaintsDocument33 pagesSeins Et SaintsesthermartinPas encore d'évaluation
- Largotique Art GothiqueDocument17 pagesLargotique Art Gothiqueyves.mpPas encore d'évaluation
- Tarot (Le Marquis) (Z-Library)Document49 pagesTarot (Le Marquis) (Z-Library)吴崇睿Pas encore d'évaluation
- 1927 Piobb Secret de NostradamusDocument228 pages1927 Piobb Secret de NostradamusNey Junior50% (2)
- Bs 2983579Document402 pagesBs 2983579Raph LemonnPas encore d'évaluation
- Traite de Paix de Tolentino Entre Le S. Siege Et La Republique FrancaiseDocument3 pagesTraite de Paix de Tolentino Entre Le S. Siege Et La Republique Francaiseg_bkPas encore d'évaluation
- DOSSIER 3-Combat-Esclavage-Discriminations Raciales-RacismeDocument12 pagesDOSSIER 3-Combat-Esclavage-Discriminations Raciales-RacismeJean-JacquesBenhamouVonPraëtPas encore d'évaluation
- Réponses Détaillées Des Sujets de L'évaluation Orale Sur Rome Dans Le Monde Antique Histoire 6eDocument2 pagesRéponses Détaillées Des Sujets de L'évaluation Orale Sur Rome Dans Le Monde Antique Histoire 6egulainPas encore d'évaluation
- UntitledDocument110 pagesUntitledRémi WewePas encore d'évaluation
- Dunand, La Religion ÉgyptienneDocument6 pagesDunand, La Religion ÉgyptienneAnonymous 5ghkjNxPas encore d'évaluation
- S. Philippe, S. Barthelemy: HistoiresDocument466 pagesS. Philippe, S. Barthelemy: HistoiresGnakri LE Roi DavidPas encore d'évaluation
- CR Cours 1 Jawharu NafiisDocument2 pagesCR Cours 1 Jawharu Nafiisndeyeastou2504Pas encore d'évaluation
- Cours Esoterique de KabbaleDocument111 pagesCours Esoterique de Kabbalejulie veePas encore d'évaluation