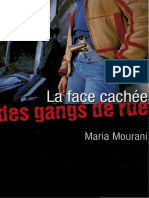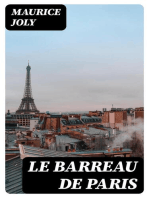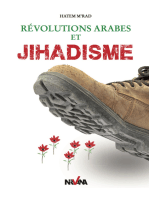Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Fellah Marocain Défenseur Du Trône
Transféré par
Sid GalaxyS6Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Fellah Marocain Défenseur Du Trône
Transféré par
Sid GalaxyS6Droits d'auteur :
Formats disponibles
Rémy Leveau
Le fellah marocain défenseur du
trône
1985
Présentation
Au lendemain de l'indépendance du Maroc, du fait de leur
association historique avec l'administration du
protectorat, les élites rurales – au pouvoir économique
intact – étaient discréditées. Très rapidement, la
monarchie a pourtant compris, qu'en s'appuyant sur ces
élites, elle parviendrait à s’émanciper du mouvement
national. Mais cette solidarité avec les forces du passé a
empêché toute modernisation du pays et accru les
tensions à l’intérieur de la société marocaine. Un classique
dans la compréhension de l’histoire marocaine.
Copyright
© Presses de Sciences Po, Paris, 2012.
ISBN numérique : 9782724685978
ISBN papier : 9782724605098
Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur et strictement
réservée à l'usage privé du client. Toute reproduction ou
diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout
ou partie de cette œuvre est strictement interdite et constitue
une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur se réserve le droit
de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété
intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales.
S'informer
Si vous désirez être tenu régulièrement informé de nos
parutions, il vous suffit de vous abonner gratuitement à notre
lettre d'information bimensuelle par courriel, à partir de notre
site Presses de Sciences Po, où vous retrouverez l'ensemble de
notre catalogue.
Table
Préface (Maurice Duverger)
Introduction
Introduction à la 2e édition
PREMIÈRE PARTIE. LA RECONSTRUCTION DU
SYSTÈME DES ÉLITES LOCALES
Chapitre I. Du protectorat à l'indépendance.
Effacement et survie des notables
Chapitre II. La recherche d'un nouveau cadre
territorial et de règles du jeu favorables aux notables
Le conflit politique
Le nouveau découpage territorial
Le choix du mode de scrutin
Chapitre III. Priorité à la reconstitution du réseau
administratif local
La reconstitution du réseau
L’encadrement des élus
Chapitre IV. Notables et modernisation
Influence sur le système politique
La place des Berbères dans le système des élites locales
Les intellectuels de formation traditionnelle
DEUXIÈME PARTIE. APERÇU SUR LA GÉOGRAPHIE
POLITIQUE DU MAROC PROVINCIAL
Présentation
Chapitre V. Les provinces du Nord
Le cosmopolitisme des élites urbaines de Tanger
Tétouan : particularisme et nostalgie
Al Hoceima : victoire de la tradition
Nador : des élites locales dominant une situation instable
Chapitre VI. Le Sud et les régions pré-sahariennes
Marrakech : culture traditionnelle et diversification des activités
économiques
Agadir : culture traditionnelle, richesse moderne et passé
militant des élites locales
Ouarzazate : retour à la tradition
Ksar es Souk : situation confuse
Chapitre VII. Le « Maroc utile »
Les villes modernes du littoral
Les provinces du littoral
Le Maroc central
Le Maroc oriental
TROISIÈME PARTIE. ANALYSE QUANTITATIVE
FACTEURS D'APPARTENANCE AU GROUPE DES
ÉLITES LOCALES
Présentation
Chapitre VIII. L'âge, facteur ambigu
Chapitre IX. L'éducation, facteur de différenciation
entre les divers types d'élites
Les langues parlées
Alphabétisation et langues écrites
Enseignement de type français et enseignement traditionnel
L’enseignement supérieur traditionnel
L’enseignement supérieur moderne
Chapitre X. La participation sociale et politique
La participation aux luttes de l’indépendance et à leurs
prolongements
La tradition familiale
L’influence des partis
Les élus locaux
Les syndicats
Les confréries et associations
Chapitre XI. Le contrôle du pouvoir et des ressources
locales
Les agents du Makhzen
Les notables ruraux
Appréciation des catégories socio-professionnelles
Conclusion. Elites locales, élites nationales et système
politique
Postface
Place actuelle du monde rural
La menace des prétoriens
Le renouveau du système Makhzen
Le contrôle du secteur privé par le palais
Mesures complémentaires d’extension du champ politique
après les complots
Le contrôle du champ religieux
Pouvoir royal et nouveau Makhzen
Les contraintes du système social
Hypothèse d’évolution
Persistance d’un jeu makhzenien
Démocratisation et technostructure
Retour à la solution prétorienne
Annexe I
Chronologie politique sommaire
Annexe II
Répertoire des termes arabes et des sigles
Annexe III
Bibliographie complémentaire
Préface
Maurice Duverger
L’ouvrage qu’on va lire a beaucoup contribué à faire de son auteur
le premier agrégé du premier concours de recrutement des maîtres de
conférences de science politique, en 1973. Les historiens,
politicologues, sociologues, juristes, économistes qui composaient le
jury ont apprécié l’ampleur, ta profondeur, le sérieux, la minutie, la
finesse, l’équilibre d’un travail remarquable aussi par la clarté et
l’élégance de l’exposition. Il est essentiellement basé sur la recherche
patiente des faits là où ils se trouvent : sur le terrain. Cela mérite
d’être également souligné, pour réagir contre une certaine mode qui
privilégie la sophistication des méthodes d’analyse, l’ingéniosité des
traitements statistiques, l’ésotérisme des graphiques.
On ne conteste pas la valeur de techniques auxquelles les sciences
sociales doivent une grande part de leurs progrès. On entend
simplement les mettre- à leur place telle qu’elle a été admirablement
précisée par l’avertissement de Vassili Léontief en 1970 : « La mise
au point d’une nouvelle méthode statistique, si ténue soit-elle,
permettant d’extirper d’une série de données un paramètre inconnu
supplémentaire, est considérée comme une réalisation scientifique
plus importante que les succès remportés dans là recherche
d’informations additionnelles permettant de mesurer l’ampleur de ce
même paramètre d’une façon moins ingénieuse mais plus fiable. Et
tout cela indépendamment du fait que trop souvent on effectue une
analyse statistique raffinée sur une série de données dont la
signification et le bien-fondé sont ignorés de l’auteur ».
Rémy Leveau n’ignore aucune de ces techniques. Mais l’essentiel de
son travail utilise une autre méthode, plus classique peut-être, mais
infiniment plus difficile à pratiquer : celle de l’observateur-
participant. Les élites politiques du Maroc, il les a étudiées sur place,
au cours des longues années qu’il a passées dans leur pays. Il n’était
pas un ethnologue au sein d’une communauté où l’on reste extérieur,
étranger, quelle que soit la familiarité des rapports. Les problèmes
des élites marocaines, il les a vécus avec elles, il a tenté avec elles de
les résoudre à différents niveaux de décision, pendant qu’il
travaillait dans l’administration du nouvel Etat. En participant
réellement à la naissance de celui-ci, à son affermissement, à ses
difficultés, pas seulement par sa collaboration technique mais par
une profonde sympathie humaine qu’on retrouvera dans ces pages,
dont elles sont l’un des charmes.
Pour connaître le Maroc indépendant au niveau de ses notables, le
livre de Rémy Leveau est un guide aussi précieux que celui de
Laurence Wylie pour connaître la France au niveau d’une petite ville
provençale. Mais la différence des champs d’observation implique
une différence des méthodes. Etudiant une communauté restreinte où
les liens sont essentiellement personnels, Wylie n’a guère besoin
d’une problématique des catégories sociales. Etudiant les élites
locales dans l’ensemble d’une nation et leur influence sur le pouvoir
politique global, Leveau ne peut s’en passer. Certains lui
reprocheront de n’avoir point défini avec une rigueur préalable sa
typologie des classes et des groupes. Il préfère cerner peu à peu, par
petites touches, au fur et à mesure des observations, des catégories
dont le contour demeure parfois peu précis parce qu’il suit de près les
méandres des faits. N’est-ce pas préférable, à tout prendre, que de
plaquer sur eux un schéma préfabriqué, admirable armoire de
rangement aux tiroirs intelligemment disposés, où toutes les sociétés
se découpent suivant les mêmes tronçons, en se dépouillant de leur
originalité ?
D’autant que Rémy Leveau ne s’enferme pas dans la singularité
marocaine. A travers l’analyse très fine des contradictions de la
bourgeoisie urbaine, par exemple, il esquisse un modèle explicatif des
difficultés de moderniser une société agricole traditionnelle. Ouverte
au développement commercial et industriel, cette classe est l’alliée
naturelle des techniciens, des jeunes fonctionnaires, des intellectuels
occidentalisés, des étudiants qui souhaitent une profonde
transformation du pays. L’ensemble est coupé des élites rurales
imprégnées de culture traditionnelle, attachées aux formes
archaïques de la religion, enfoncées dans des structures tribales.
Mais la modernisation inquiète aussi la bourgeoisie urbaine dont le
pouvoir est alors menacé par le prolétariat urbain et par la
bureaucratie, ce qui la rapproche du conservatisme des élites rurales.
Dans un équilibre si instable, le pouvoir politique peut jouer un rôle
décisif, suivant qu’il penche d’un côté ou de l’autre. En cherchant
l’appui des élites rurales, la monarchie chérifienne s’est enlevé les
moyens de promouvoir une modernisation quelle aurait pourtant
souhaitée. Car elle a poussé ta bourgeoisie de leur côté, du même
coup, en l’éloignant des autres couches sociales ouvertes au
changement. Ainsi le Maroc a basculé du côté de l’immobilisme.
Rémy Leveau montre qu’un tel choix n’était pas imposé par la force
des choses : Mohammed V était plus proche finalement de la
bourgeoisie fassi (et ajoutons : Hassan II plus proche des intellectuels
occidentalisés). Certes, la nature même d’une monarchie l’incline du
côté des élites rurales, plus en accord avec son système de légitimité,
surtout quand il s’agit d’une monarchie religieuse où le roi est
commandeur des croyants. Mais d’autres facteurs peuvent compenser
celui-là, et Von peut trouver des exemples de monarchies
modernisatrices.
Les remarques de Rémy Leveau sur l’armée marocaine sont très
intéressantes à cet égard. Seul groupe en contact à la fois avec les
élites urbaines et les notables ruraux, avec la civilisation
traditionnelle et la technique moderne, elle pourrait, dit-il, engager
la nation marocaine sur la voie du changement sans perdre le
contact avec les élites rurales. L’exemple de la Turquie kémaliste
donne du poids à ce raisonnement. Mais celui de l’Iran conduit à
penser qu’une telle entreprise aurait pu se développer en accord avec
le souverain et sous son impulsion — et non pas contre lui. D’autant
que l’armée marocaine était profondément attachée à la monarchie
dans les années soixante.
La contradiction entre cet attachement et le besoin de modernisation
qu’elle ressentait n’est-elle pas un facteur des crises qui ont déchiré
ensuite l’armée marocaine, et qui ont mis la monarchie en péril ?
Rémy Leveau n’examine pas cette question, car elle concerne des
événements postérieurs à sa recherche. Mais il conduit son lecteur à
la poser, au terme d’un ouvrage qui se termine par une méditation
sur la fonction de l’armée dans la modernisation des sociétés
traditionnelles. On peut d’ailleurs la formuler en termes de
prospective et non de rétrospective. L’aventure saharienne, où la
monarchie chérifienne est maintenant engagée, lui permet de
prolonger Vimmobilisme, malgré un besoin croissant de
changement. Mais ne pourrait-elle lui permettre également, en
renforçant son prestige vis-à-vis de la nation et aussi de l’armée,
d’engager une stratégie de développement de type iranien, toutes
choses égales d’ailleurs ?
Introduction
L’étude des élites politiques est un domaine qui, depuis une
dizaine d’années, a largement retenu l’attention des chercheurs
travaillant sur le Tiers Monde. Les travaux portant sur les
institutions ou sur les partis ont déçu les espoirs d’explication
de ces sociétés politiques. Il était alors tentant d’entreprendre
un effort d’analyse se fondant sur une approche plus
sociologique des phénomènes politiques, et mettant à profit les
réflexions sur la classe dirigeante. Mais les études engagées
dans cette voie s’intéressent principalement à l’élite politique
nationale, sans pouvoir prêter une attention suffisante aux
intermédiaires qui assurent la continuité des systèmes de
valeurs, permettent le maintien d’un certain ordre social,
propagent le changement social et politique, ou bloquent sa
réalisation, et, en définitive, réalisent la synthèse entre la
légitimité du pouvoir et son autorité. Tout observateur de la
société maghrébine ressent le poids de ces minorités influentes
dans la formation des attitudes collectives. Elles restent
cependant difficiles à définir. D’une part, le terme de
« notables », qui conviendrait le mieux pour décrire ces élites
locales, a été passablement décrié par l’usage qu’en a fait le
colonisateur, au point de signifier implicitement collaborateur.
D’autre part, la réalité sociale du Maroc indépendant n’est plus
tout à fait celle du protectorat, Les activités ont tendance à se
différencier et les élites à se spécialiser. Le domaine politique
reste la clef des autres secteurs de réussite sociale, mais
l’engagement des divers participants est loin d’y être uniforme.
L’ampleur même de la masse de ceux qui pourraient, à un
moment ou à un titre quelconque, entrer dans ce groupe,
empêche d’en donner une vision globale autre que qualitative.
A la base, nous retrouvons confusément mêlés deux groupes
d’administrateurs et d’élus locaux, qui sont en même temps
agriculteurs, éleveurs ou commerçants. Ce groupe représente
une masse d’environ vingt mille personnes, sans la
collaboration desquelles rien ne peut s’accomplir en dehors de
domaines limités où la bureaucratie marocaine exerce une
emprise directe. Cependant, la plupart des dirigeants de Rabat
ou des hommes d’affaires de Casablanca n’auraient pas
l’impression d’exercer des fonctions comparables à celles de ces
notables.
Ces élites locales ont joué un rôle important, avant ou après
l’indépendance du Maroc, dans l’acceptation du pouvoir ou
dans son rejet. L’administration, faute d’être représentée
partout par des agents rémunérés, a dû accepter leur relais. Or,
à ce niveau, les rapports politiques se superposent : les liens de
parenté, les rapports économiques, l’appartenance à des
confréries ou à des associations — en un mot un ensemble de
contacts et de services rendus dans la vie quotidienne —
forment la trame des relations entre les individus et les
groupes. Les hommes influents sont ceux qui savent mobiliser
le soutien le plus large et le traduire, le moment venu, en
comportements politiques, qu’il s’agisse de votes, de refus de
l’impôt, ou de soumission au pouvoir établi. En retour, les
membres de l’élite locale négocient leur soutien au niveau
supérieur, pour accroître leurs ressources, étendre leur
influence et surclasser leurs rivaux.
Ce jeu d’équilibre subtil peut être bouleversé, en de grandes
occasions, par des réactions unanimes de la communauté. Il
s’agira aussi bien — pour donner des exemples d’importance
inégale pris dans l’histoire récente du Maroc — de l’exil de
Mohamed V, des réactions des campagnes après l’assassinat, en
1956, dans le mechouar, des caïds venus présenter leur
soumission, de l’engagement personnel de Hassan II en faveur
de la Constitution de 1962, de l’impact de la guerre avec
l’Algérie, en 1963, ou de la guerre des Six jours, en 1967. Les
liens de clientèle disparaissent, alors, temporairement, pour
être remplacés par une sorte de mobilisation ou de crainte
collective, pouvant avoir des effets de rupture considérables sur
le système politique, mais dont l’intensité disparaît
progressivement une fois l’émotion passée.
Cette force collective a servi à abattre le protectorat et à
consolider le pouvoir monarchique après l’indépendance. Elle
pourrait également le détruire. Mohamed V et Hassan II ont été
conscients, et de leur pouvoir mobilisateur et des dangers que
comportait son utilisation. Ils ont préféré reconstituer un cadre
de vie politique qui permette au pouvoir central de renouer
avec les réseaux d’influence et d’intérêts locaux que le
protectorat avait dominés et manipulés.
Cette évolution n’était pas la seule voie que pouvait prendre le
Maroc au lendemain de l’indépendance. Une bureaucratie
coupée des intérêts locaux aurait pu imposer un autre style
politique. Il en aurait été de même des cellules d’un parti
unique. Il est vraisemblable que les choix faits au lendemain de
l’indépendance ont prolongé, pendant une quinzaine
d’années, une évolution qui se dessinait à la fin du protectorat,
et retardé, de ce fait, la mise en place de nouvelles structures.
La pression démographique, l’éducation de masse, l’expansion
de la bureaucratie mineront ces réseaux de liens
interpersonnels qui constituent les tissus de l’organisme
politique marocain.
Le problème n’a pas été résolu pour autant. La monarchie
marocaine a cru, un moment, qu’il lui serait possible de
prendre en charge la modernisation du pays en renforçant, au
départ, ses soutiens traditionnels. Mais si la monarchie peut, à
la rigueur, s’entourer d’hommes politiques réformateurs pris
individuellement au sein des partis, dans les professions
libérales, ou dans l’administration, elle ne peut pas leur laisser
le champ libre pour réaliser leur programme, qu’il s’agisse de
l’enseignement, des structures agraires ou de l’industrialisation.
Tout effort sérieux en ce sens ferait perdre le soutien des élites
locales.
La présente étude est née d’une interrogation sur la
signification des efforts contradictoires entrepris par la
monarchie marocaine dans les années qui ont suivi
l’indépendance. L’hypothèse de base est la suivante : pour
enrayer une évolution incertaine qui l’aurait réduite à un rôle
symbolique en transférant la réalité du pouvoir à un parti
dominant, la monarchie a restauré le pouvoir des élites locales
qui lui apportaient, en retour, le soutien du monde rural. La
monarchie a engagé dans cette opération son prestige
traditionnel d’origine dynastique et religieuse, auquel s’ajoutait
le prestige nouveau qu’avait acquis Mohamed V en s’opposant
au protectorat. Mais elle n’a pas réussi, par la suite, à reprendre
à son compte, comme elle en avait l’intention, la politique
modernisatrice des partis : cette politique aurait eu pour effet
de réduire le rôle des élites locales.
La première partie de cet ouvrage est consacrée à une analyse
historique des diverses phases d’une évolution qui a permis à la
monarchie de reconstituer son alliance avec la paysannerie
sans perdre, pour autant, le soutien de la bourgoisie urbaine
effrayée par la montée du prolétariat. La seconde partie est une
analyse géographique — centrée sur la période des élections
législatives de 1963 — des rivalités entre les divers types de
notables. Cette analyse a pour but de faire apparaître la
dimension essentiellement locale des conflits politiques, et de
souligner leurs aspects régionalistes. Elle introduit à la
troisième partie qui est une analyse quantitative globale des
données socio-politiques concernant les 723 candidats aux
élections législatives. Cette analyse quantitative permet de
mieux situer le système de valeurs dominantes, et de dresser
une ligne de partage entre les élites traditionnelles et les élites
modernes. Par là même, elle fait ressortir les contradictions
entre élites nationales et élites locales, et, sur un plan plus
général, entre élites et masse.
Dans cet ouvrage, on entendra donc par élites locales, ou
notables, les individus qui, tout en participant à l’exercice du
pouvoir administratif ou judiciaire, ne font pas partie de
l’administration comme des agents de carrière qui peuvent être
déplacés d’un poste à l’autre. Ce groupe comprendra non
seulement ceux qui exercent ce type de pouvoir, mais ceux qui
l’ont exercé, et ceux qui seraient susceptibles de l’exercer en
mobilisant, sur le plan politique, un ensemble de liens
interpersonnels s’appliquant à une aire d’influence locale plus
ou moins étendue. Cette définition s’applique principalement
à la première partie de l’étude. Dans les deuxième et troisième
parties, nous nous attachons particulièrement aux candidats
aux élections législatives, considérés comme représentatifs du
groupe des élites locales. Ce groupe, en outre, offre l’avantage
de pouvoir être saisi dans son ensemble, dans un moment de
comportement politique non ambigu, alors que ses membres,
appartenant le plus souvent à d autres types d’élites,
n’entendent pas toujours se distinguer ouvertement sur le plan
politique. De plus, certains de ces candidats font naturellement
partie du groupe des élites nationales. Les données
biographiques concernant l’ensemble des candidats avaient été
rassemblées au départ, en vue d’une étude d’ensemble sur les
élections marocaines. Par la suite, leur intérêt propre et
l’éclairage particulier que nécessitait leur analyse nous ont
conduit à les dissocier de ce projet.
Ces données ont pu être mises en forme au cours d’un séjour
d’enseignement et de recherche à l’Université de Michigan
(Ann Arbor) en 1967-1968, sur l’invitation du Center for Near
Eastem and North African Studies, dirigé par le professeur
William B. Schoeger qui a procuré les moyens nécessaires pour
les utiliser. La mise au point du code et un premier traitement
des données ont été effectués grâce à l’Institute for Social
Research de l’Université de Michigan, dirigé par le professeur
Angus Campbell. Nous avons effectué personnellement le
codage de toutes les informations qui nécessitaient une
interprétation des données. Ce travail n’aurait pu être mené à
bien sans les suggestions, l’aide et les critiques stimulantes de
Jean Padioleau.
La rédaction de cette étude et certains travaux d’analyse
complémentaire ont été effectués grâce à l’aide du Centre
d’études des relations internationales de la Fondation nationale
des sciences politiques, dirigé par M. Jean Meyriat.
Ce travail a aussi bénéficié des encouragements de MM. les
professeurs Maurice Duverger, Jacques Berque et Maurice Flory
qui ont bien voulu l’accepter comme thèse de doctorat de
science politique.
La liste de ceux qui m’ont aidé est trop longue. Qu’il me soit
permis cependant de remercier particulièrement ceux qui ont
bien voulu en lire et commenter la première version ; Patrice
Blacque-Belair, Ken Brown, Edmund Burke III, Fanny Colonna,
Louis-Jean Duclos, Louis Fougère, Ernest Gellner, David Hart,
Clement Henry-Moore, Gricha Lazarev, Jean Leca, Edouard
Méric, Stuart Schaar, John Waterbury, William Zartman.
Introduction a la 2e édition
Le Maroc d’aujourd’hui n’est-il pas à la veille de changements
de structure décisifs ? L’exode rural, le gonflement des villes
grandes et moyennes, une population urbaine qui va atteindre
50 % d’ici quelques années, ne constituent-ils pas un seuil de
rupture des équilibres traditionnels ? A ces changements
qualitatifs et quantitatifs du monde rural vient s’ajouter la
prolétarisation de masses urbaines qui n’ont pas accès au
politique autrement que par un processus de type plébiscitaire.
Jusqu’alors le roi a réussi à garder le contrôle de cette évolution
en faisant fonctionner avec habileté un jeu politique limité aux
élites sociales. Dans le passé, la société marocaine a su gérer
avec un sens exceptionnel de la continuité tant son entrée que
sa sortie du système colonial, tant la reconstitution de son
unité politique que son industrialisation prudente. Pendant
longtemps, la stabilité du monde rural, l’appui de ses élites à la
monarchie, ont servi à équilibrer un jeu politique où les
tensions ne manquaient pas. Les complots militaires,
l’élargissement du politique à d’autres domaines ont peut-être
limité le rôle des élites rurales. Il ne faudrait cependant pas
croire qu’une société de masses puisse se bâtir sans qu’une
place acceptable leur soit réservée.
La première édition du Fellah marocain défenseur du trône étant
épuisée, il a paru préférable de présenter dans un nouveau
chapitre de conclusion les principales hypothèses que l’on
pourrait faire sur le rôle du monde rural dans le système
politique marocain des années 1980. Les autres chapitres de
l’ouvrage ont été publiés sans changement. L’intérêt que
continuent à lui témoigner ses nombreux lecteurs marocains
constitue le meilleur encouragement à cette réédition.
Je voudrais enfin remercier les amis marocains et français qui
m’ont accueilli lors de ma reprise de contact avec le Maroc en
mai-juin 1984. Ils ont eu la patience de combler les lacunes de
mon information, de répondre à mes questions et d’accepter de
tester mes hypothèses.
Je désire témoigner une gratitude particulière à ceux qui ont
accepté de relire et critiquer les premières versions de mon
chapitre de mise à jour, en particulier Yves Amiot, Patrice et
Leïla Blaque-Belair, Alain Claisse, Jean-François Clément, Louis-
Jean Duclos, Edmond Elmaleh, Bruno Etienne, Jean Leca,
Michel Rousset, Mustapha Sehimi, John Waterbury, William
Zartman.
Je dois bien entendu être tenu pour seul responsable des erreurs
et des imperfections contenues dans cet ouvrage et sa mise à
jour.
Première partie. La
reconstruction du système des
élites locales
Chapitre I. Du protectorat à l’indépendance.
Effacement et survie des notables
On s’étonne, à la fin du protectorat, de voir que le monde
rural, qui représentait, en 1956, près de 80 % de la population
du pays, n’est administré que par quelques centaines de
fonctionnaires français civils ou militaires. Dispersés à travers le
territoire, ils sont assistés dans les postes par quelques commis
marocains, et gardés par des mokhazenis peu nombreux, dotés
d’un armement vétuste[1]. Or, l’administration française, avec
ses grandes directions techniques et les états-majors de ses
services concentrés à Rabat, donnait l’impression d’un système
bureaucratique imposant par le nombre et l’efficacité de ses
agents.
Cependant, le monde rural reste soumis, pendant plusieurs
décades, à l’ordre contraignant instauré par l’autorité
administrative française. Une multitude d’agents marocains,
dont les commandements sont calqués approximativement sur
le système tribal, relaie l’action des officiers d’Affaires indigènes
et des contrôleurs civils. Sans l’appui de ces notables, et sans le
consentement des populations, la machine administrative
tournerait à vide. Ces auxiliaires, en outre, ont l’avantage de ne
rien coûter au pouvoir central. On les laisse prélever leur part
de l’impôt rural et on tolère quelques exactions
supplémentaires. Le coût de cette administration — dont les
représentants sont présents au niveau du moindre groupement
ethnique, pour maintenir l’ordre, renseigner et exécuter les
décisions de l’administration française — est donc supporté par
le secteur agricole traditionnel. Non seulement l’État ne leur
verse aucun traitement, mais il n’a pas à construire ni à
entretenir de locaux administratifs puisque leur demeure en
tient lieu.
En schématisant, on peut dire que l’administration française
s’est assuré le contrôle du « Maroc utile », en laissant les
notables exploiter le monde rural traditionnel. Elle tirait du
souverain la légitimité de son action de contrôle ; celui-ci, en
vertu du traité de Fès, l’avait chargée de moderniser le pays. Il
en était de même des caïds et de leurs subordonnés :
juridiquement, ils n’étaient que les représentants du sultan
dans les tribus. Dans la réalité, le bled Siba[2] s’était soumis aux
autorités militaires françaises. Les liens de certains caïds du Rif
ou du Sud avec le Trône chérifien étaient assez minces, et les
cérémonies formelles d’allégeance, accompagnées de cadeaux,
ne leur plaisaient guère. Or, après 1945, la situation se dégrade.
Le souverain s’allie à la bourgeoisie pour contester le.
protectorat. Le système est en porte-à-faux, et les nationalistes
s’efforcent d’utiliser le mécontentement du monde rural
traditionnel qui supporte le coût élevé de l’administration des
notables.
C’est alors que le protectorat songe à des alliances qui lui
assureraient une légitimité nouvelle. Au lieu de tenir son
pouvoir d’une délégation du sultan, il favorisera l’implantation
d’un système d’assemblées locales élues, créateur d’une
légitimité démocratique. Par hypothèse, ce système ne devait
pas présenter de danger pour l’administration française, et
pouvait, éventuellement, être utilisé contre le Palais et la
bourgeoisie nationaliste. La précipitation de la crise entre le
Palais et la Résidence interdit de pousser très loin l’exécution
d’un plan qui demandait du temps, et supposait le
démantèlement du système des notables.
C’est le contraire qui se produisit en 1953, lorsque la Résidence
décida de déposer Mohamed V, en faisant appel aux pachas et
aux caïds. Les mécanismes des relations entre l’administration
française et les notables dépassent alors le niveau de simples
rapports de soumission. Il s’agit, en fait, d’une solidarité, dans
le contrôle du monde rural, contre le Palais et les nationalistes
qui cherchent la ruine du système. Exploiteurs du monde rural
traditionnel, les notables sont aussi exploités par le Palais, dont
les méthodes sont comparables aux leurs. Ils craignent
également les appétits des bourgeois nationalistes. Dans
l’ancien bled Siba, les réticences à l’égard de l’univers citadin
du nationalisme restent grandes, ainsi que la croyance dans la
solidité du protectorat.
Pour la bureaucratie de la capitale, l’indépendance n’est
souvent qu’une passation de consignes au profit de la
bourgeoisie marocaine. L’affaire se complique dans le monde
rural. Le protectorat aurait bien voulu faire cautionner par le
sultan, à son retour d’exil, l’ancien réseau des caïds qui avaient
demandé sa déposition. Mais, après bien des hésitations, le roi
refuse de se compromettre avec les anciens notables. Il est
cependant assez averti des réalités pour voir que celui qui
établira une nouvelle alliance avec le monde rural dominera le
système politique marocain dans son ensemble. Le roi laisse
démolir le pouvoir politique des notables, mais il freine tout ce
qui pourrait porter atteinte à leur situation économique, tout
ce qui pourrait apparaître comme les prémices de réformes de
structure plus vastes. Dans un premier temps, le Palais fait
obstacle aux efforts entrepris par le Parti nationaliste pour
s’assurer le contrôle du monde rural, grâce à un réseau qui
combinerait parti et administration. Puis, à la faveur d’une
relance des assemblées locales mises en place à la fin du
protectorat, le Palais trouve moyen de rétablir un système
d’élites locales qui lui est favorable. Il laisse s’établir, en dépit
des déclarations officielles, un cadre territorial qui préserve les
solidarités ethniques sur lesquelles reposait le régime antérieur.
Le scrutin uninominal vient s’ajouter au découpage territorial
pour faire apparaître une classe d’élus qui ne soit pas en
rupture avec le passé.
Conscient du fait que le suffrage universel créait une légitimité
nouvelle virtuellement concurrente si un parti unique ou
largement majoritaire voulait en faire usage contre la
monarchie, le souverain veut dépolitiser les résultats des
élections, cantonner les élus au niveau local, en faire les
instruments de l’action administrative. Il n’a pas entièrement
réussi sur ce point. Privés de pouvoirs de gestion, les conseillers
communaux restent néanmoins les seuls représentants élus au
suffrage universel dans le système politique. Ils auront
tendance à refuser de se laisser enfermer dans le cadre étriqué
qui leur aura été préparé, et à revendiquer une compétence
quasi générale sur le plan local. Très tôt, les partis et
l’administration tenteront aussi de capter ces vecteurs de
légitimité populaire que sont les élus. Une évolution
incontrôlée aurait pu devenir menaçante pour le système
politique. La monarchie canalisera ces tendances de deux
façons. Tout d’abord, elle va créer un réseau administratif
d’élites locales complémentaire de celui des élus. Partiellement
fonctionnarisé pour être mieux tenu en main et pour ne pas
entrer en contradiction avec l’idéologie moderniste du pouvoir,
le financement de ce réseau sera assuré, dans la réalité, par des
pratiques qui ne différeront guère que dans la forme de celles
du protectorat. Lorsque les élus investis par le suffrage
universel s’installent, les chioukh et moqqademin sont déjà en
place, tenant leur autorité de l’investiture administrative
tempérée par l’acceptation informelle des collectivités de base.
Ils ont besoin de ce consensus pour exercer les multiples tâches
qui leur incombent depuis le remplacement des caïds
traditionnels par des fonctionnaires. Chioukh et moqqademin
sont encore plus nécessaires à l’administration locale qu’ils ne
l’étaient du temps du protectorat.
Mais, en disposant aussi d’élus du même groupe social, les
nouveaux caïds peuvent organiser les rivalités, et dépendre
moins de leurs relais que l’administration française.
Globalement, on peut estimer que le Palais a reconstitué,
autant par l’intermédiaire des élus que par celui des petits
administrateurs, un système d’alliances avec les élites locales
qui le garantit contre les poussées de l’intelligentsia, de la
bourgeoisie urbaine et du prolétariat. Le contrôle du monde
rural est donc un facteur de stabilité politique considérable.
Hassan II s’en servira pour conférer à la monarchie la légitimité
nouvelle du suffrage populaire, en faisant approuver, par
référendum, la Constitution du 7 décembre 1962. Cependant,
il ne réussira pas, par les mêmes moyens, à s’assurer une
majorité de gouvernement qui réponde à son attente.
Le renversement des alliances de la monarchie bloquera aussi
toute tentative de modernisation conséquente du monde rural,
qui passe par des réformes de structure. Les élites locales
traditionnelles, auxquelles appartiennent la quasi-totalité des
petits administrateurs locaux et des élus, sont très sensibles à
toutes les mesures concernant le statut des terres. Elles ont
souvent besoin de l’aide de la bureaucratie du Makhzen pour
consolider des emprises foncières encore précaires que les
tribus auraient vite fait de leur contester. Les tentatives
d’agriculture intensive, qui rendent nécessaire une nouvelle
répartition des terres, suscitent leurs craintes.
En revanche, elles seraient assez favorables à des opérations de
modernisation qui les débarrasseraient, par une émigration vers
les villes ou vers l’étranger, d’un surplus menaçant de
population rurale. Or, le pouvoir n’est pas assez sûr de lui pour
accepter cette évolution. Il préfère des méthodes quasi
salariales comme la Promotion nationale, qui permettent de
maintenir sur place, le plus longtemps possible, le maximum
de population du secteur rural traditionnel.
Cette politique repose en partie sur l’aide étrangère qui finance,
à la fois, une part du coût du réseau administratif local et le
maintien, dans les campagnes, d’une partie de l’excédent de
population. La monarchie avait fait de l’aide extérieure, surtout
européenne, un élément important de sa stratégie des élites. La
bourgeoisie agraire moderne était la plus intéressée par les
perspectives d’une association avec le Marché commun, qui lui
permettrait d’écouler ses agrumes, son vin, son riz, etc. Mais les
desseins du souverain n’ont pas pu, sur ce point, être
entièrement réalisés. Ses échecs relatifs dans ses efforts de
démocratisation politique ont écarté, dans un premier temps,
les aides à la modernisation du système agraire au Maroc. Cette
défaillance d’une aide extérieure importante aura bloqué les
tentatives de modernisation du système politique et des
structures du monde rural que la monarchie était, au départ,
décidée à entreprendre. L’évolution de la situation lui a très
vite fait craindre de perdre le soutien des élites locales avant
d’avoir réussi à attirer d’autres groupes sociaux qui auraient
peut-être souscrit à ses réformes, mais sans accepter de voir la
monarchie continuer à jouer un rôle actif. Le succès de la’
modernisation l’aurait conduite à limiter son rôle, à n’être
qu’un symbole de légitimité et d’unité. Hassan II ne pouvait
pas s’y résigner. En outre, il craignait de voir la monarchie
isolée et emportée par les remous des premières réformes, pour
avoir été trop longtemps associée aux institutions du passé.
Ces craintes ont accentué les aspects conservateurs et
immobilistes de sa politique, en créant, à moyen terme,
d’autres risques d’éclatement entraînés par des conflits sociaux
non résolus. Mais tout comme le protectorat à l’heure des crises
préféra se rabattre sur les notables traditionnels, Hassan II
préférera garder le soutien des élites locales qui lui assurent la
tranquillité du monde rural ; il ne poursuivra pas une politique
de modernisation qui pourrait lui aliéner ces élites.
Le contrôle du monde rural est l’un des domaines où le
protectorat pouvait se prévaloir — dans la logique même de
son système — d’avoir réussi avec des moyens très limités. La
« politique indigene »[3] servait de canevas à un ensemble de
pratiques qui avait montré son efficacité lors de la pacification
du pays. Au lieu d’entreprendre des opérations militaires
coûteuses, on s’efforçait de réduire les oppositions par une
connaissance quasi sociologique des tribus, en isolant le
groupement adverse et en utilisant contre lui ses rivaux
traditionnels. Les engagements militaires devaient être limités
au minimum et n’avaient jamais pour objectif la destruction
totale de l’adversaire, mais sa récupération. Généralement, les
chefs de guerre investis par la population pour résister à la
pénétration française, caïds ou amghars, en venaient à
composer, après quelques affrontements qui donnaient la
mesure des rapports de forces. Les maintenir dans le
commandement de la tribu au nom du sultan, sous le couvert
duquel les Français opéraient, était l’une des conditions de leur
reddition.
C’est ainsi que dans le Maroc du protectorat la continuité des
anciennes élites locales a pu être assurée. L’exemple le plus
fameux pourrait être donné par Moha ou Hamou, chef
invaincu des Zaïans, dont les fils, ralliés aux Français alors que
leur père continuait à se battre dans la montagne, furent
confirmés dans le commandement de la tribu[4]. Les élites
formées par le monde tribal pour lutter contre la pénétration
française se sont maintenues au pouvoir grâce à la pacification,
chacun trouvant son compte dans cette situation. Les Français
faisaient conférer l’investiture caïdale à un notable dont ils
connaissaient l’autorité sur son milieu d’origine ; la population
préférait obéir à un chef qu’elle avait désigné pour défendre
son existence et sa liberté, plutôt que de se voir imposer une
créature du vainqueur étranger.
Les nouveaux caïds se voyaient consentir, en contrepartie de
leur soumission, « un pouvoir quasi discrétionnaire sur les
personnes et les biens de leurs administrés »[5]. Pendant la durée
du protectorat, ces notables vont mettre à profit l’autorité que
leur assure l’investiture étrangère pour affermir l’assise foncière
de leur pouvoir, et se transformer progressivement de chefs de
guerre en propriétaires latifondiaires. L’administration
française leur apportait, en plus du recours à la force en cas de
besoin, l’aide de son appareil juridique. Les procédures
d’immatriculation foncière leur permirent de se faire attribuer,
en pleine propriété, des superficies plus ou moins grandes de
terres dont la collectivité leur avait laissé l’usage en tant que
chefs temporaires et révocables[6]. Dans l’ancien Maroc, le
sultan ou les tribus se chargaient périodiquement d’anéantir les
fortunes de ceux qui avaient réussi, grâce à leur pourvoir, à
accumuler quelques richesses. La présence française bloquait ce
mécanisme de redistribution et rendait ainsi les élites rurales
solidaires de son destin.
Le système se répétait au niveau des collaborateurs locaux des
caïds, chioukh et moqqademin, qui relayaient leur autorité
dans les fractions de tribus et les douars. La constitution
d’apanages était moindre pour eux, mais leurs relations avec
l’autorité leur permettaient officiellement de prélever leur
rémunération sur leurs administrés.
Dans La paysannerie marocaine[7], Julien Couleau décrit ainsi le
système des élites locales du protectorat :
« A l’époque du protectorat où les choses se passaient
comme si le chef local semblait recevoir l’investiture
officielle de l’État, avec tout l’appareil réglementaire que la
chose comportait, pour les jemâa sonnait l’heure de la
retraite. Le chef n’avait plus de contrepoids local. Ainsi à
cette époque, dans le Maroc des plaines en particulier, celui
où la tribu avait subi les plus fortes atteintes, il n’était guère
de paysan qui, questionné sur les caïds, cheikh, moqqadem,
ne répondait d’abord sur le fait qu’ils “mangeaient” plus ou
moins leurs administrés. On exagérait les choses,
certainement, et l’on citait bien souvent aussi des gens
d’une exemplaire intégrité. Les choses étant vues
aujourd’hui avec le recul apporté par le temps, on se doit de
reconnaître que dans le système qui consistait à choisir le
représentant de l’État parmi des candidats présentés par les
jemâa, la somme des avantages l’emportait largement sur la
somme des inconvénients. Les avantages tenaient à ce que
les “chefs” faisaient corps avec leurs administrés, étant
intégrés aux tribus, et, de ce fait, connaissaient les
problèmes. Et puis, ils étaient forcément obligés de limiter
leurs appétits et ne point laisser les tribus trop exsangues :
ils ne pouvaient scier la branche sur laquelle ils étaient
assis ».
Ce système permettait à l’administration française de
gouverner le pays à peu de frais. Le protectorat pouvait ainsi
résoudre la contradiction entre la nécessité de disposer d’une
administration tentaculaire pour contrôler un pays étendu et
difficile, et l’impossibilité de financer, par des moyens
normaux, le paiement des salaires d’une administration
politique omniprésente. Dans ses tentatives de modernisation,
à la fin du XIXe siècle, le pouvoir de sultans réformateurs
s’était déjà heurté à cet obstacle[8], et l’avait résolu en laissant
ses agents se payer sur les populations. Le protectorat s’est
borné à reprendre, en la rationalisant, une pratique ancienne
qui lui offrait l’avantage de ne pas mettre en péril l’équilibre du
système colonial.
Cette situation offrait d’autres avantages. La puissance
colonisatrice laissait croire qu’elle respectait, comme un legs du
système ancien, des procédés de gouvernement qu’elle ne
pouvait approuver dans la logique propre de son organisation,
mais dont elle appréciait secrètement l’efficacité. Elle se
donnait facilement bonne conscience et justifiait son
intervention par la nécessité de limiter les excès des élites
locales marocaines.
L’administration française créait accessoirement une rivalité
entre le système des élites locales, placé sous son contrôle, et le
pouvoir du sultan qui tirait profit, au second degré, de ce
système de prévarications, avec une main parfois lourde.
L’administration du protectorat pouvait ainsi vivre sur le
mythe du contrôle exercé par des agents français — civils ou
militaires — sur les administrateurs marocains. En fait, les caïds
assuraient autant la représentation des populations que
l’exécution des décisions des autorités françaises de contrôle.
Leur pouvoir s’exerçait avec la participation d’assemblées de
petits notables, les jemaas, qui intervenaient aussi bien dans un
cadre institutionalisé que dans un cadre informel (jemaa de
collectifs, perception du tertib, distributions ou recouvrements
divers). Ce système convenait à un certain type de
« gouvernement des hommes », tant que les caïds conservaient,
auprès de leurs administrés, un prestige dû à leur situation
ancienne, à l’autorité de leur milieu familial[9] et à un exercice
un peu rude de leur pouvoir judiciaire.
S’il offrait de multiples avantages, ce système ne pouvait se
maintenir indéfiniment sous la forme qu’il avait prise dans les
premières années du protectorat. La constitution de propriétés
latifondiaires par les élites locales entraînait des tensions en
milieu rural. A l’origine, lorsque les terres étaient abondantes,
les tribus n’étaient pas gênées par les accaparements des
notables qui laissaient subsister des terrains de culture ou de
parcours suffisants pour le reste du groupe. Mais, à mesure que
la population s’accroît, la conscience collective des
accaparements devient plus vive. La réaction est d’autant plus
forte que la colonisation s’attribue, à la même époque, plus
d’un million d’hectares des meilleures terres, et que la
bureaucratie du protectorat s’emploie activement à faire passer
sous son contrôle direct des centaines de milliers d’hectares de
terres domaniales, guich, ou forestières. Or, un droit très
souple, plus attentif à l’usage qu’à l’appropriation, n’avait
guère, jusqu’alors, gêné les tribus. La pression démographique
et la réduction des superficies disponibles contribuaient à
rendre plus lourd le financement par le monde rural de ce
système d’administration par les élites locales. L’impôt rural, le
tertib, qui servait de support aux prélèvements annuels des
caïds et de leurs subordonnés, pesait plus sur les agriculteurs
marocains que sur les Européens[10], à un moment où la
production agricole était loin de s’accroître en milieu
traditionnel. Les quatre millions d’hectares cultivés par les
Marocains ne produisaient, suivant les années, que la moitié ou
le tiers des rendements obtenus par les colons. On risquait
d’aboutir aussi bien à l’effrondement du système
d’administration locale qu’à celui du système de production
traditionnelle.
A court terme, des sociologues avertis et proches des centres de
décision de la colonisation, comme Robert Montagne, étaient
conscients des risques encourus, comme, en particulier, celui
de voir déferler sur les villes du littoral un prolétariat
impossible à intégrer si le monde rural traditionnel se
désagrégeait trop rapidement[11]. Les conséquences politiques
sur le milieu urbain étaient plus redoutées que celles
qu’auraient pu subir les campagnes.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, une politique
nouvelle fut esquissée et reçut un début d’application. Elle
visait, d’une part, à moderniser l’ancien système
d’administration par les élites locales, en l’équilibrant par des
assemblées élues, d’autre part, à transformer le monde rural
traditionnel pour l’amener à s’intégrer dans les circuits de
production. Ces réformes, qui remettaient en cause l’ensemble
des rapports établis, depuis le début du protectorat, entre la
bureaucratie française, les élites locales marocaines et la
colonisation, ne purent pas aboutir. Mais le problème se
retrouva posé en des termes comparables, au lendemain de
l’indépendance. L’échec des tentatives réformatrices de la fin
du protectorat permit de mieux situer alors les données du
problème des élites locales.
Ainsi le protectorat ne réussit pas, jusqu’à sa disparition, à
résoudre le problème de l’organisation d’assemblées élues et
délibérantes, dotées de la personnalité morale et de
l’autonomie financière. Des dahirs de 1951[12] élargissent,
certes, les compétences des jemaas administratives, mais avec le
souci, étranger à la société traditionnelle, de ne pas confondre
ces assemblées avec les autres systèmes de consultation des
notables, tels que les jemaas de collectivités ou les sociétés
indigènes de prévoyance[13]. L’administration veille à préserver
l’autorité des caïds, en constituant des groupements réduits,
correspondant à une fraction de tribu, le plus souvent sans
ressources propres. Pour faire vivre ces organismes, on compte
sur l’aide des contrôleurs civils. Le cheikh, subordonné du caïd,
est chargé de la présidence et de l’animation de la jemaa. En
fait, les caïds, et surtout les plus puissants d’entre eux,
bloqueront la mise en place de la réforme, craignant de voir
leur autorité contestée.
Simultanément, on ressent le besoin d’associer des
représentants des populations aux tâches de mise en valeur et
d’équipement des campagnes, entreprises pour canaliser les
effets d’une croissance démographique menaçante. Et pourtant
une étude[14] faite par un groupe d’officiers d’Affaires indigènes,
sous l’autorité du général Boyer de Latour, secrétaire général
aux Affaires politiques et militaires, au moment du
remplacement du général Juin par le général Guillaume,
montre l’inquiétude des services devant ce qu’ils estiment être
le conservatisme du protectorat. Ils s’interrogent, à propos du
Maroc, sur l’avenir de l’Empire colonial français :
« Qui dit possessions extérieures suppose puissance. La
France ne maintiendra ses possessions extérieures qu’autant
qu’elle trouvera, soit en elle-même, soit auprès des autres,
l’appoint de puissance qui lui fait présentement défaut. Elle
le trouvera en elle-même en s’amputant délibérément, c’est-
à-dire en réduisant ses responsabilités extérieures à l’échelle
de sa puissance. Elle le trouvera à l’extérieur en liant son
destin à celui d’une autre puissance : la russe, l’américaine,
l’européenne »[15].
Les auteurs de ce rapport supposent, sans trop donner
l’impression d’y croire, que les choix français sont faits en
faveur d’une solution européenne, et c’est dans cette
perspective qu’ils situent l’avenir du protectorat, préoccupés à
la fois par l’évolution des masses marocaines et par la sclérose
des réponses françaises aux transformations de la société
marocaine. Or, tout le monde reconnaît que les relations entre
la Résidence et le Palais ne sont plus ce qu’elles étaient du
temps de Lyautey, mais on garde encore trop souvent une
vision idéalisée des rapports entre les notables et
l’administration française. Sur ce point, le rapport est très
critique de la politique du protectorat, alors que l’on venait
encore, quelques mois auparavant, de mobiliser les notables
dans une tentative qui aurait pu conduire à la déposition de
Mohamed V. « A l’origine, caïds et chioukh, pour la plupart
anciens chefs de partisans, avaient été bien choisis. De plus, les
contacts personnels, établis sur le double principe de la
confiance et de l’autorité qu’ils entretenaient avec leurs
officiers, artisans eux-mêmes de la pacification, facilitaient
grandement l’exécution du contrôle. Aujourd’hui les relations
de ce genre n’existent plus »[16].
En face des vieux caïds, dont on sollicite l’appui politique
contre les nationalistes et le Palais, les jeunes officiers n’ont
plus le même poids que leurs anciens. Le contrôle se relâche et
les exactions Se multiplient. Les caïds que l’on voudrait
sanctionner peuvent toujours se retourner contre le Palais.
« En outre, l’exécution d’un contrôle strict exigeait qu’à
l’échelon supérieur le souverain du pays demeurât en plein
accord avec le résident général et n’entreprit pas de mener
une politique personnelle qui l’amènerait fatalement, un
jour ou l’autre, à entrer en lutte contre celui-ci. Or, cette
nécessaire harmonie, qui impliquait, il faut bien le dire, la
subordination du Palais à la Résidence, est aujourd’hui
détruite. Et nos notables (ou leurs fils), tiraillés entre l’un et
l’autre camp, sont amenés à prendre parti. Sans doute ne s’y
résignent-ils point de gaieté de cœur. Mais leur fidélité n’est
plus désormais fonction que de notre force »[17].
Enfin, d’après ces auteurs, le système des notables est
particulièrement impopulaire dans le Moyen-Atlas où le
protectorat a recherché ses appuis traditionnels. Cette région
supporte avec autant d’impatience la soumission au souverain
chérifien, une politique des notables « vieillie et périmée » et le
centralisme bureaucratique des administrations techniques
françaises. Le résultat de ce malaise serait une pénétration
croissante de la propagande nationaliste en milieu berbère.
Tous les facteurs de changement ne sont pas évalués avec
précision, mais il est intéressant de noter que les responsables
du protectorat remettent en cause les mécanismes politiques
qu’ils viennent encore de faire jouer avec succès, peu de temps
auparavant. Mais employer les notables contre le sultan ne leur
paraît pas satisfaisant à long terme. Seule une politique de
démocratisation leur semble valable pour remettre en cause le
souverain, au nom de principes acceptables à la fois par la
génération montante marocaine, l’opinion publique française
et l’opinion internationale devant laquelle il va falloir se
défendre. Cette démocratisation présente également l’avantage
de préparer l’association des Français aux organes de gestion du
protectorat, suivant le principe de la co-souveraineté. Les choix
politiques se présentent donc sur ces bases : « Devant l’hostilité
déclarée du Palais, ne pouvant plus compter sur une politique
de “notables” devenue archaïque, nous sommes contraints de
chercher de nouveaux appuis. Il semble bien qu’il n’existe
désormais qu’une solution qui est le recours aux masses,
puisqu’aussi bien nous disposons encore d’un encadrement
français assez étoffé pour que nous ne risquions pas d’être
débordés »[18].
Prendre la tête d’une évolution contrôlée pour éviter une
révolution, dépasser la bourgeoisie urbaine et le Palais en
faisant directement alliance avec les masses rurales et en
acceptant de transformer le système des notables, telle est l’idée
directrice des auteurs de ce rapport. Cette politique sera reprise
dans ses grandes lignes, dans les années soixante, par la
monarchie, pour trouver un contrepoids au système des partis.
Sa réalisation par un pouvoir politique marocain lèvera de
nombreux obstacles qui avaient empêché les réformes du
protectorat d’atteindre leur objectif politique. Mais la nature du
projet reste identique. On trouve même dans les deux cas l’idée
qu’il faut, en premier lieu, procéder à une réforme
administrative, réaffirmer, ensuite, la primauté du politique sur
les services techniques, et redonner du mordant aux services
politiques pour leur permettre d’animer l’évolution et d’en
contrôler l’orientation.
« A la campagne, il faut commencer, à la base, par la
création de véritable “communes” rassemblant les
collectivités marocaines et gérant elles-mêmes leurs intérêts
par l’intermédiaire d’organismes élus. L’opération est
immédiatement possible. En maints endroits, les esprits y
sont préparés. Des expériences ont été, depuis quatre ans,
menées avec succès en différents points du pays. Le dahir
du 6 juillet 1951 sur la réforme des jemaas nous a donné le
cadre juridique qui nous était nécessaire. Le texte en est
suffisamment souple pour que le but recherché soit atteint
dans le respect de tous les particularismes et compte tenu de
conditions politiques infiniment variables »[19].
Le cadre juridique existe ; il faut donner aux responsables du
protectorat la volonté politique de généraliser son
implantation en dépit des réticences des caïds et de
l’administration française.
« La mise sur pied des communes marocaines doit être pour
nous, grâce à la confiance qu’elle fera naître à notre égard,
un moyen de défense d’une incomparable valeur autrement
efficace qu’une action répressive que nous ne saurions, sans
risques graves, entamer partout à la fois et soutenir bien
longtemps. Les troubles qui ont récemment agité l’Atlas
central nous offrent, sur ce point, de précieux
enseignements. Ajoutons que ce développement de la vie
publique favorisera grandement la formation d’élites rurales
capables de participer activement à la conduite des affaires
marocaines et capables aussi de nous fournir les solides
appuis dont nous manquons actuellement. Leur influence
pourra s’opposer heureusement à celle des minorités
citadines évoluées qui, dans un Maroc essentiellement
paysan, revendiquent pour elles seules le droit de
représenter les tendances politiques du pays. Car, dès que le
réseau des communes aura couvert l’ensemble du Maroc
rural, on devra procéder à la création rapide d’assemblées
territoriales ou régionales, pour arriver, dans un dernier
temps, à la réunion d’une Assemblée marocaine nationale.
Celle-ci, dont la constitution et les pouvoirs seront étudiés
en tenant largement compte de la nécessité d’une
décentralisation, devra comprendre, aux côtés des
représentants des campagnes, les représentants des masses
urbaines et ceux de la population française ».
Il ne s’agit donc pas uniquement de remodeler le système
d’administration locale, mais de préparer la refonte du système
politique. L’aboutissement de l’évolution devrait avoir pour
double avantage d’installer une représentation française dans le
système politique marocain, et de permettre la réduction des
pouvoirs du souverain, ou son élimination, par des voies
démocratiques.
On va donc commencer par remplacer progressivement les
caïds et les chioukh par des chefs élus. On écarte ainsi,
volontairement, le recours à une administration marocaine
moderne, faute, dit-on, de cadres formés. Il semble, en fait, que
l’on craigne autant la constitution d’une administration
marocaine dépassant le niveau des affaires locales, que celle
d’un gouvernement marocain agissant dans le cadre du traité
de Fès. L’unification et la centralisation du pays, réalisées par
l’administration française, seraient des armes politiques
redoutables entre leurs mains. Les auteurs de ce rapport
insistent sur la nécessité de transformer profondément
l’administration française pour la rendre capable
d’entreprendre — et de suivre — cette évolution. Mais ils ne
voient pas que l’élection remet en cause les principes
d’intervention de cette administration, héritée des bureaux
arabes. Au nom de qui ou de quoi les administrateurs français
vont-ils continuer à contrôler les élus marocains ? Comme
pour les caïds, la source de leur pouvoir est un souverain dont
il veulent limiter les prérogatives.
Le protectorat n’aura pas le temps de préparer cette évolution
du monde rural en profondeur. Lorsque de nouveaux conflits
auront lieu, c’est en fait sur l’ancien système caïdal qu’il
s’appuiera. L’échec du protectorat entraînera sa ruine et
amènera, comme nous le verrons, la mise en place d’un réseau
d’administrateurs et d’élus, sous l’égide d’un gouvernement
marocain. Ainsi, moins de cinq ans après ce rapport,
l’hypothèse qu’évoquaient ses auteurs pour mieux l’écarter se
verra réalisée.
Il faut noter, enfin, que ce projet comportait un volet urbain
pour lequel l’alliance avec le prolétariat industriel, contre la
bourgeoisie, tenait la place qui était celle des communes dans
la politique rurale. En ouvrant ainsi des voies qui seront
reprises par la suite, il préconisait une politique de logements,
d’avantages sociaux, de relèvement des salaires et de syndicats
placés sous tutelle pour se concilier les bonnes grâces de la
classe ouvrière.
Telles étaient donc, dans leurs grandes lignes, les idées
qu’espérait faire aboutir un groupe influent d’administrateurs
politiques du protectorat. Trop tard venues, ces réflexions ne
pouvaient inspirer que des mesures de détail. Mais il est
frappant de voir comment, quelques années plus tard, sans
jamais formuler aussi clairement son projet ni s’inspirer
directement de celui du protectorat, la monarchie suivra des
voies parallèles.
La politique suivie par le Maroc indépendant prouve que leur
vision d’un ordre nouveau n’était pas entièrement utopique. Et
pourtant, par souci de prudence, l’administration du
protectorat ne s’engagea pas à fond dans une réforme qui lui
parut suspecte. Le sultan avait trop facilement accepté, en
1951, de sceller ce dahir à un moment où il refusait les autres
textes qui lui étaient présentés. On craignait certes de
mécontenter les caïds en activant la mise en place des
assemblées, mais on soupçonnait aussi l’Istiqlal de vouloir
utiliser ces institutions comme de petits conseils de
gouvernement. L’administration acceptait tout au plus
d’introduire quelques réformes partielles et progressives, alors
que seule une mutation globale aurait pu avoir quelque
influence sur le système.
A la fin du protectorat, 981 petites circonscriptions sont créées
en zone Sud. Mais il faut croire que l’organisation d’assemblées
soumises ne remplit pas tous les espoirs. La direction de
l’intérieur se plaint, en 1955[20], de l’insuffisance de collectivités
locales à seconder et à relayer les services français dans leurs
tâches d’équipement et de mise en valeur des campagnes. Pour
remédier à cette situation, le Service des communes rurales
préconise une extension prudente des prérogatives de ces
assemblées et leur généralisation. Il reconnaît au passage les
entraves mises à leur fonctionnement par les caïds et par les
agents de l’administration française[21] qui craignent un
bouleversement du statu quo. Mais il ne voit de solution que
dans l’élargissement des compétences économiques et sociales
des assemblées locales avec un accroissement considérable des
moyens financiers mis à leur disposition.
Plus clairvoyant, un mémoire de stage d’un élève de l’ENA
reconnaît les aspects politiques du problème[22] : « A la base de
la réforme se trouve incontestablement une intention
politique. Après les déboires rencontrés du côté du Palais, et
devant l’inertie latente des villes, il s’avérait indispensable et
urgent de mettre en œuvre une formule politique nouvelle
susceptible de déjouer les critiques qui nous étaient adressées à
la fois de l’extérieur et de l’intérieur ». Pour l’auteur, la réforme
a pour but d’offrir une politique de rechange à celle des grands
caïds, tout en continuant à s’appuyer sur les masses rurales
pour lutter contre la poussée des villes acquises aux
nationalistes. Accessoirement, il s’agit de montrer à ces
derniers, et à l’ONU, que l’on est décidé à démocratiser les
institutions marocaines par la base.
Quelques années auparavant, une autre expérience, celle des
Secteurs de modernisation du paysannat (SMP) avait déjà
choisi d’utiliser la jemaa comme base d’une entreprise de
« modernisation totalitaire » du monde rural. Cette opération,
qui voulait aussi être une expérience de détribalisation[23], visait
à transformer les hommes par l’école, l’infirmerie, la
mécanisation et une participation à la gestion. Elle obtint des
résultats intéressants sur le plan technique et social, mais
déchaîna l’hostilité des colons, et inquiéta, à l’opposé, les
nationalistes qui y voyaient une tentative d’assimilation.
L’extension de l’expérience supposait la disparition du caïd et
du colon, et entraînait la remise du pouvoir de décision
économique et politique au paysan marocain transformé. Au
bout de quelques années, on élimina les initiateurs de
l’expérience et on intégra leur œuvre dans un ensemble
d’organismes d’assistance aux ruraux qui ne remettait pas en
cause l’existence du système.
Le protectorat a donc essayé, dans les cinq dernières années de
son existence, de constituer de nouveaux groupes d’élites
locales qu’il songeait à associer aux responsabilités du pouvoir,
suivant un schéma qui s’inspirait à la fois du XIXe siècle
français et de l’expérience des communes mixtes algériennes.
L’administration avait assez de clairvoyance ou de désillusion
pour se rendre compte que les relais trouvés pour tenir
politiquement les campagnes ne pouvaient plus jouer
éternellement ce rôle. Tout en ménageant les caïds, elle
recherche d’autres intermédiaires pour faire accepter une
politique de transformations économiques et sociales justifiées
par la nécessité de stabiliser les ruraux qui commencent à
déferler sur les villes. Elle souhaite élargir le groupe des
notables, et accepte de stimuler leur zèle en leur attribuant
quelques menus avantages économiques, tels que des semences
sélectionnées ou des crédits pour l’achat de matériel. Elle espère
que le coût de ces encouragements sera, à moyen terme,
moindre que les prébendes qu’elle abandonne aux caïds et à
leurs subordonnés, et aura un effet multiplicateur favorable à la
modernisation. Elle juge aussi sévèrement les effets politiques
des abus de l’ancien système que le caractère archaïque du
comportement économique de ses agents.
Entreprise plus tôt ou poursuivie plus longtemps, cette
tentative de renouvellement des élites locales aurait pu créer
une classe de « colons marocains ». On comptera, cependant,
parmi les chioukh ou les élus communaux siégeant après
l’indépendance, une part non négligeable d’anciens membres
des jemaas administratives du protectorat, ce qui prouve que
ces assemblées ont joué un rôle dans le renouvellement et la
continuité des élites locales.
En dépit de ses imperfections, le système des élites locales du
protectorat — et les hommes qui en faisaient partie — aurait pu
être intégré, au moins dans un premier temps, dans les
structures du Maroc indépendant. Mais l’administration du
protectorat commit l’erreur d’utiliser les élites locales dans son
conflit avec le sultan, en 1952 et 1953. Cette mobilisation
quasi unanime des caïds et de leurs subordonnés dans un
mouvement d’opposition à la poussée du nationalisme urbain
n’est pas simplement l’effet d’une manipulation habile dont la
précarité se révélera par la suite. On peut estimer que les
notables ruraux marocains ressentaient, en majorité, le
nationalisme comme une menace latente à un système qui leur
avait permis de transformer leur statut en richesse foncière.
Pour être conservée, cette richesse avait besoin de l’appui de la
bureaucratie française, agissant au nom du sultan, et menacée
au même titre qu’eux par le nationalisme. D’où cette solidarité
globale des élites locales et de l’administration du protectorat.
De son côté, le mouvement nationaliste devait s’efforcer de
tourner ces positions en s’alliant dans les campagnes avec ceux
qui étaient lésés par la structuration du réseau des élites locales.
Ce n’est qu’en trouvant cet appui en milieu rural, grâce à
l’Armée de libération, que le Mouvement nationaliste
entraînera l’effondrement de l’administration et du système
politique du protectorat.
La remise en question du protectorat rend la situation des élites
locales incertaine et dangereuse. Elles deviennent, dans la
période de transition, les intermédiaires qu’il faut abattre pour
accélérer la dégradation de l’administration française.
Hommes du passé, les caïds n’avaient pas une sensibilité
politique qui leur permît de comprendre les événements au-
delà des limites de leur commandement. Lorsque le protectorat
les a engagés, sous la conduite du pacha de Marrakech et du
chérif El Kettani, dans la folle aventure de la déposition de
Mohamed V, ils n’ont été qu’une infime poignée à
démissionner. Leur dévotion aux autorités françaises ne peut
pas tout expliquer. Leur attitude s’explique autant par un
mélange complexe de ressentiment contre les Alaouites et une
hostilité aux bourgeois modernisés des villes (que symbolisait
pour eux l’Istiqlal) que par une solidarité d’intérêts.
Abandonnés à eux-mêmes, ils avaient besoin de retrouver de
nouvelles alliances. Sans leur collaboration, les nouveaux
dirigeants allaient se trouver rapidement en butte à des
difficultés avec le monde rural.
La confusion dans laquelle se fit le transfert des pouvoirs
renforça l’arbitrage du sultan, et permit, à terme, un
renversement des alliances.
L’association de la monarchie et de la bourgeoisie urbaine, qui
avait permis d’ébranler le protectorat, se défaisait à l’heure de
son succès sans que les protagonistes aient conscience des
conséquences de l’évolution. Comme solution de
remplacement, il aurait été théoriquement possible de
concevoir une alliance entre les bourgeois conservateurs du
mouvement nationaliste et les élites rurales. Les souvenirs du
protectorat, une évolution culturelle différente interdisaient de
penser, dans l’immédiat, à un tel projet, que l’on retrouvera
esquissé, par la suite, avec beaucoup de difficultés.
Une autre hypothèse aurait été l’association de l’aile radicale
du Mouvement nationaliste avec des éléments ruraux encore
inorganisés qui auraient eu intérêt à secouer le joug des élites
locales. L’emprise du nationalisme de gauche sur la
bureaucratie aurait alors pu dessiner une politique de réforme
visant à détruire le pouvoir des élites sur le monde rural. En
fait, dans la période qui suit le retour du sultan, une autre
politique se dégage, non sans hésitations.
Dans un rapport de fin de mission en date du 15 juillet 1956, le
directeur général de l’intérieur, qui assura la passation des
pouvoirs de son administration aux autorités marocaines,
montre les hésitations et l’évolution des relations entre le
Palais, le Mouvement nationaliste et la Résidence, dans cette
période délicate. Un des points les plus sensibles est justement
le monde rural que l’administration du protectorat sent lui
échapper sous les coups de l’Armée de libération : « Le vieux
Makhzen n’est plus. Le nouveau gouvernement n’est pas
encore. Le Palais est la seule autorité sur laquelle le protectorat
peut s’appuyer. Or, le protectorat” a besoin d’appui. Il en a
toujours eu besoin. Il s’est constamment appuyé sur l’armature
administrative chérifienne, plus qu’il n’y paraissait, surtout en
matière de sécurité »[24].
Par souci de sécurité, l’administration française essaie d’obtenir
du sultan la confirmation des caïds en place, à l’exclusion
d’une trentaine de noms qui seraient sacrifiés comme trop
compromis par leur soutien au sultan Ben Arafa. Après des
négociations et des tergiversations, le sultan refuse d’accepter
de couvrir de son autorité l’ancienne administration locale[25] :
« Et pourquoi devrais-je confirmer des chefs marocains qui ont
provoqué ma déchéance ? Le voudrais-je que je ne le pourrais
pas. La monarchie marocaine est maintenant constitutionnelle.
C’est l’affaire du gouvernement… », déclare-t-il à ses
interlocuteurs français[26]. Il sera difficile de savoir si Mohamed
V a agi ainsi de propos délibéré ou par impossibilité de se
décider. Son refus de cautionner les élites locales provoque
rapidement, comme nous le verrons plus loin, l’effondrement
de l’administration du protectorat, et entraîne des concessions
en cascade qui achèvent la réalisation d’une indépendance
formelle. Ces concessions auraient été plus difficiles à obtenir si
le partenaire n’avait pas été inquiet pour la sécurité de ses
ressortissants.
La récupération immédiate des élites locales aurait entraîné des
difficultés avec l’aile gauche du Mouvement nationaliste qui se
déclarait hostile à l’institution caïdale. Le Palais a dû longtemps
hésiter avant de se décider, en fin de compte, au hasard des
circonstances. Il semble avoir encouragé, au début, les
tentatives de récupération des anciens caïds sans vouloir pour
autant se compromettre aux yeux des nationalistes.
A cet égard, l’événement le plus significatif a été le lynchage
par la foule, devant le méchouar, le 19 novembre 1955[27], de
trois caïds, anciens partisans du sultan Ben Arafa, venus
présenter leur soumission à Mohamed V, à son retour de
France. Le Palais avait donné verbalement son accord à leur
déplacement. Par la suite, il publiera un communiqué précisant
qu’il n’avait jamais accepté de recevoir les anciens caïds. La
nouvelle, qui se répand dans tout le pays, entraîne la
destruction, en quelques jours, de l’autorité des caïds et de
leurs subordonnés, chioukh et moqqademin. « Que certains
caïds[28], dont la position est forte en tribu, réussissent à
maintenir leur autorité, alors il suffira de camouflets provoqués
dans ce pays où le sentiment de la dignité est développé pour
les forcer à se démettre. Une minorité se lèvera contre eux,
soutenue par le parti (de l’Istiqlal). Ils seront menacés dans
leurs biens, dans leur vie, obligés de céder… ou de partir ».
Le refus du sultan de cautionner l’obéissance des mokhazenis
et des goums, au nombre de vingt mille, qui soutiennent
l’action de l’administration française, accélère également
l’effondrement de l’administration locale.
L’impossibilité d’utiliser ces unités, les nombreuses désertions
entraîneront la décision d’en transférer au plus vite le contrôle
aux autorités marocaines.
Son refus de coopérer avec le protectorat au maintien des
structures sociales existantes laisse les mains libres au Palais
pour jouer son propre jeu dans la phase de reconstruction des
pouvoirs publics, sans être accusé de complicité avec l’ancien
pouvoir colonial. Le Palais sent qu’il est urgent de prendre des
gages, car, après les hésitations du début, l’administration du
protectorat accélère le transfert des administrations centrales
qui tombent tout naturellement entre les mains des élites
bourgeoises du Mouvement nationaliste, imprégnées
d’éducation moderne dans les écoles françaises. S’il attend trop
longtemps, le Palais risque de se voir isolé et privé de moyens
d’action. Il se résigne à l’idée de voir le Parti nationaliste
succéder à la bureaucratie centralisatrice du protectorat, et
contrôler ainsi l’ancien bled Màkhzen constitué des villes et des
plaines riches, mais il met en place des hommes et une
politique qui lui permettront de récupérer ce qu’il n’a pas
voulu recevoir directement des mains du colonisateur. Il est
significatif que le choix du sultan pour le Ministère de
l’intérieur ait porté sur l’ancien caïd berbère Lahcen Lyoussi
auquel il est lié depuis longtemps[29]. Le général Méric
soupçonne déjà le sultan de vouloir reprendre à son compte la
politique berbère du protectorat, « …neutraliser la montagne
puis l’utiliser à des fins politiques… Le caïd Lahcen sera le
Glaoui du Sultan »[30].
Mais si Mohamed V entendait contrôler les nominations des
caïds et maintenir ses prérogatives, avec l’intention de soutenir
la reconstitution du réseau des élites locales, il devra encore
attendre avant de réaliser ses fins. Les premiers remplacements
s’opèrent par le haut. On nomme des gouverneurs qui
demeurent les héritiers des chefs de région, puis des caïds et
des pachas qui succèdent tout naturellement aux chefs de
territoire et aux chefs de cercle du protectorat. Le pli sera pris
pour les nominations futures qui ne seront pas toujours d’une
qualité comparable. Ainsi, l’ancienne structure administrative
sera abandonnée, qui confiait les responsabilités aux élites
locales non rémunérées officiellement. Les nouveaux
administrateurs sont des fonctionnaires qui succèdent
naturellement aux agents de contrôle français dont ils
cumulent les pouvoirs juridiques et ceux des anciens caïds.
A l’échelon local, la prépondérance des militants politiques
s’affirme dès le départ. Une administration nouvelle s’établit
dans la hâte. Les militants de l’Istiqlal et de l’Armée de
libération, responsables de l’épuration, fournissent la plupart
des membres. A de rares exceptions près, les nouveaux caïds
sont mal adaptés à leur tâche. D’origine citadine, de culture
moderne sommaire ou strictement traditionnelle[31], ils ont
exercé des fonctions aussi peu prestigieuses pour les ruraux que
celles de petits commerçants, artisans ou réparateurs de
bicyclettes ; ils n’ont pas naturellement le sens de l’autorité qui
s’impose en face d’administrés parfois frustes[32]. Ils sont
installés, mal à l’aise, dans les symboles du commandement
des contrôleurs civils et officiers d’Affaires indigènes : la jeep, le
bureau, la radio, les hommes d’armes, le coffre à secrets et la
caisse noire. Ils gardent souvent le costume traditionnel, et
cherchent à s’appuyer sur des comités ou des cellules groupant
la petite bourgeoisie de commerçants ou de commis que l’on
rencontre dans les agglomérations rurales. Ils trouvent leur
soutien le plus ferme dans l’organisation du parti, ses mots
d’ordre et ses inspecteurs. Privés de l’ancien réseau
administratif des chioukh et moqqademin[33], ils cherchent à se
créer au plus vite une clientèle de remplacement. Ils abusent,
pour cela, de l’usage politique des faveurs et avantages que
l’administration leur procure. Cette attitude leur attire, par sa
maladresse, plus d’ennemis que de partisans dévoués. On les
accuse d’incapacité, d’esprit partisan et parfois de
malversations. Après quelques mois d’incompréhension
mutuelle, les rapports sont faussés entre les nouveaux caïds et
la population qu’ils administrent. Déçus par leur rôle, certains
d’entre eux se sentent en exil, songent à abandonner ou se
replient sur eux-mêmes. Les ruraux cessent, par endroit, de
porter leurs difficultés et leurs différends devant l’autorité
administrative locale. Les caïds sont d’ailleurs bientôt
dépouillés de leur pouvoir judiciaire et perdent, par là même,
un élément de prestige et un moyen de pression essentiel sur la
population.
La gravité de la situation est masquée par l’enthousiasme de
l’indépendance. Dans les villes et les bourgades de l’ancien bled
Makhzen, les cellules de l’Istiqlal assurent un lien suffisant
entre les autorités et la population. La vie politique nouvelle au
niveau national, les problèmes internationaux (l’indépendance
est loin d’être totalement acquise), accaparent les élites
politiques. Par ignorance, ou par désir de parer au plus pressé,
on en arrive à nier les problèmes du monde rural, que l’on
redécouvre seulement en cas de crise. Mohamed V est
cependant plus attentif aux réactions des ruraux que les états-
majors des partis. Il reçoit les mécontents, écoute leurs
doléances et les laisse repartir avec l’impression qu’il comprend
leurs problèmes, au point d’approuver leur action lorsqu’ils
font mine de se révolter contre les initiatives de Rabat[34].
Le roi apparaît aux ruraux comme le prisonnier d’une nouvelle
bourgeoisie qui les ignore et les méprise. Les jeunes diplômés
d’origine citadine ont hérité des fonctions administratives et
des rôles politiques du protectorat sans avoir la connaissance
sociologique du pays. Pour eux, l’indépendance se mesure à
leur ascension, et aux avantages qu’ils en tirent. Tous ceux qui
ne partagent pas leur satisfaction ou leurs espoirs sont
soupçonnés de penchants condamnables pour le système
colonial. Leur mainmise sur l’administration s’appuie,
longtemps après l’indépendance, sur un encadrement français
assez solide. La machine administrative donne l’illusion de
l’efficacité en continuant à exécuter les programmes préparés
par le protectorat.
A Casablanca, la bourgeoisie marocaine s’empare moins
rapidement de l’économie que ses cousins de Rabat de
l’administration. Mais sa progression vers les responsabilités est
aussi nette, même si elle doit ménager les rouages complexes
d’un secteur où le commerce extérieur — entre les mains des
Français — a une aussi large part.
Pour les ruraux, le succès de cette nouvelle bourgeoisie
n’apporte aucune solution à leurs problèmes. Un malentendu
fondamental naît. Les campagnes souhaitent recevoir des
écoles, des infirmeries, des routes — en contrepartie de leur
participation déterminante aux luttes de l’indépendance. Au
lieu de voir les bénéfices du progrès qu’ils attendent, ils
constatent la dégradation de l’appareil administratif en place,
la naissance de contraintes juridiques et fiscales nouvelles,
appliquées par des fonctionnaires qui ignorent les coutumes
qui règlent ces affaires depuis des temps éloignés. Les
ressources traditionnelles que le Rif et l’Oriental tiraient de
l’émigration en Algérie se tarissent. Les armées française et
espagnole n’opèrent plus de recrutements. Les ruraux ne
perçoivent pas toujours les causes des faits sociaux dont ils sont
victimes. Mais lorsqu’ils viennent exprimer leurs plaintes
auprès de l’administration, l’incompréhension est totale et le
mécontentement s’accroît.
Les facteurs psychologiques ont ici leur importance. Lorsqu’un
notable rural, poussé par ses pairs, vient présenter une requête
dans un bureau de chef-lieu de province ou à Rabat, il se trouve
plus déconcerté qu’autrefois. Le fonctionnaire marocain qui
l’accueille est généralement jeune, parle français et se meut
avec aisance dans les symboles du pouvoir. Son interlocuteur
rural en arrive vite à se sentir mal à l’aise, à prendre conscience
de son turban, de sa djellaba, de son arabe dialectal à l’accent
rauque, devant un interlocuteur dont la cravate et les boutons
de manchette témoignent des bienfaits de l’indépendance. On
lui explique qu’il faut attendre, au nom du progrès, du Plan, de
l’industrialisation, et se conformer à toute une réglementation
qu’il ignore. Curieusement, l’administration nouvelle est
souvent plus juridique, plus paperassière et plus francisante
que celle du protectorat.
La coupe déborde lorsque des juges délégués[35] viennent
remettre en cause, au nom de la séparation des pouvoirs, les
règles coutumières d’apaisement des litiges. Se sentant
méprisés, méconnus et gênés, les ruraux en arrivent parfois à
croire que l’on en veut à leur existence même. Ne souhaite-t-on
pas les faire abandonner ces montagnes impossibles à cultiver,
ces plaines desséchées, ces oasis surpeuplées pour venir
rejoindre la troupe plus docile des habitants des bidonvilles ?
Dans cette angoisse et cette incompréhension, ils ne trouveront
d’accueil familier qu’auprès du roi et de quelques hommes
politiques qui se réclament de lui. Le roi fait partie du même
univers que le leur. Il s’habille comme eux, veut progresser
mais avec prudence, sans mettre en pièces les campagnes avec
des expériences de modernisation trop hâtives qui
nécessiteraient un encadrement politique dictatorial.
Sans tenir compte de ces facteurs psychologiques, on ne peut
pas comprendre les tentatives de rébellion[36] — au nom de la
monarchie — qui secouent le pays rural et berbère déçu par le
nouveau Makhzen. Les souks, qui ont été les grands foyers de
propagande contre le protectorat, échappent au contrôle
d’agents d’autorité craintifs, isolés et maladroits. Le pouvoir est
à la merci des incidents sans qu’il y ait, au début, volonté
d’exploiter la situation de la part des anciens notables encore
traumatisés.
Mais il était inévitable que certains songent à tirer parti de cette
situation pour miner le monopole de l’Istiqlal. La révolte de
Addi ou Bihi[37], en 1957, est le premier signe des réactions qui
vont secouer le monde rural. Le gouverneur du Tafilalt, qui
s’était opposé au protectorat, restait, cependant, fidèle au style
de commandement des caïds traditionnels. Il refusa
d’appliquer les instructions du ministre de l’intérieur qui
voulait lui imposer des caïds modernes, anciens élèves du
collège d’Azrou. Àddi ou Bihi les accusait d’être étrangers à la
région et inféodés à l’Istiqlal. Il se considérait comme délégué
du roi dans sa province et, de ce fait, habilité à choisir seul ses
caïds. Mohamed V refusa de le condamner expressément. En
juin 1956, il recommandait au gouverneur et au ministre de
l’intérieur de chercher une solution de conciliation, tout en
maintenant le principe que Rabat devait exercer un droit de
contrôle sur les nominations proposées par les provinces. Faute
de trouver un compromis, le conflit éclata.
Des oppositions semblables surgiront à divers moments dans le
Rif et le Moyen-Atlas. Le gouvernement ne pourra les maîtriser
qu’en faisant appel à l’appui moral du roi et à l’aide des forces
armées placées sous son contrôle. Le champ est libre pour une
reprise en main des autorités locales[38].
Dès les premiers signes de conflit, la doctrine du gouvernement
Bekkaï est de nommer, dans les endroits sensibles, des caïds
compétents, loyaux à l’égard du Trône et ayant le sens du
commandement. On renonce ainsi à la symbiose entre les
cadres du mouvement national et l’administration locale qui
avait été la doctrine officieuse des premiers temps après
l’indépendance. Dès l’été 1957, les militants s’effaceront
progressivement ou seront bientôt écartés au profit des
interprètes et des commis de l’ancienne administration, des
enseignants et des anciens militaires qui répondent beaucoup
mieux aux nouveaux critères. Comme ils ont parfois besoin de
faire oublier leur passé, ils seront d’autant plus dévoués au
souverain que celui-ci les dédouane politiquement.
Les conflits qui ont suivi l’indépendance consacrent l’échec de
la tentative de constituer une administration politique au
service d’un parti. Ils illustrent également la fin de l’autorité
des notables traditionnels, et la dislocation du réseau de
commandement hérité du protectorat. A la longue, les
changements dans l’organisation de l’administration locale
commencent à produire leurs effets.
Les élites locales du protectorat ont donc perdu leur rôle
politique pendant la période de transition. Certains caïds ont
été mis en résidence surveillée ou se sont enfuis à l’étranger.
Mais la grande majorité des quatre cents caïds et pachas du
protectorat s’est contentée, comme l’ont fait également leurs
anciens subordonnés, chioukh et moqqademin, de se replier
sur leurs terres et d’y vivre paisiblement. Quelques anciens
caïds ont été, au début, malmenés par les représentants de
l’Istiqlal ou de l’Armée de libération. Cette période
d’incertitude n’a pas duré longtemps, car ils ont été bientôt
capables de mobiliser à leur profit le soutien de leurs parents
intégrés dans la nouvelle administration. Les élites locales
avaient souvent réussi, grâce à leurs relations avec
l’administration française, à faire entrer leurs enfants dans les
écoles du protectorat. Ces enfants avaient parfois eu des
difficultés, durant leurs études secondaires ou supérieures, avec
la police française à cause de leurs activités nationalistes. Leurs
parents avaient usé de leurs relations pour leur éviter des
traitements trop rigoureux. Au lendemain de l’indépendance,
ces enfants se sont trouvés intégrés dans l’administration ou
dans l’armée, et ont pu, à leur tour, intervenir auprès de leurs
pairs pour limiter les rigueurs de l’épuration qui risquait de
toucher leurs parents.
Ceux-ci résident sur leurs terres ; et certains se sont attachés à
leur mise en valeur suivant des méthodes modernes. Grâce à
leur pouvoir économique, ils ont été à même d’acquérir une
influence nouvelle qui devait peu à leurs fonctions antérieures.
Les difficultés des nouveaux administrateurs marocains ont
simplement incité les populations à se tourner vers eux, à les
prendre comme arbitres dans des conflits privés.
Leur élimination du pouvoir local n’a donc pas porté atteinte à
leur situation économique. Elle leur a même permis de
recueillir une part de l’influence qui échappait aux nouveaux
administrateurs. Grâce à leurs descendants, à leurs alliances
familiales, ils gardent des contacts proches du pouvoir, certains
même à l’intérieur du Palais. Par ces réseaux informels, ils sont
à même de faire connaître leur opinion sur le cours des choses,
et ne s’en privent pas. Ils continuent à suivre de près les
événements de Rabat.
Lorsque le pouvoir central tentera à nouveau d’élargir la base
locale de son administration, il cherchera tout naturellement à
les réintégrer dans le circuit politique. Mais, comme lors du
passage de la Siba au protectorat, ce seront le plus souvent les
fils ou les neveux des anciens caïds ou chioukh qui prendront
part, comme administrateurs ou comme élus, au nouveau
système d’élites locales.
Notes du chapitre
[1] Bidwell, Morocco under colonial rule. French administration
of tribal areas 1912-1958, Londres, F. Cass, 1973. L’auteur, tout
en faisant dans l’ensemble une appréciation très favorable du
système du protectorat, estime cependant que ce taux
d’encadrement était supérieur au taux d’encadrement anglais
au Soudan ou en Arabie.
[2] Les termes arabes et berbères ainsi que les sigles sont
expliqués dans un index figurant en annexe.
[3] Voir E. Michaux-Bellaire, Archives marocaines, Paris, 1927,
volume 27, p. 241-265.
[4] Voir S. Guenoum, La montagne berbère, Paris, 1929.
[5] Voir S. Bernard, Maroc 1943-1956. Le conflit franco-
marocain, Bruxelles, Institut de sociologie de l’Université libre
de Bruxelles, 1963, tome 3, p. 49.
[6] Voir, par exemple, A Lahlimi, « Les terres irriguées et le
monde rural de la Tessaout moyenne », Revue de géographie du
Maroc (Rabat), 11, 1967, p. 3-39.
[7] Paris, Editions du CNRS, 1968, p. 84.
[8] Voir J.-L. Miège, Le Maroc et l’Europe, Paris, Presses
universitaires de France, 1962, tome 3, p. 127 et suiv.
[9] Le système des notables utilisé par le protectorat est
décrit dans R. Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le Sud
du Maroc, Paris, Alcan, 1930. L’auteur analyse et interprète les
mécanismes de conquête du pouvoir à l’intérieur des tribus. Si
ses interprétations sociologiques sont contestables, son exposé
des faits reste valable comme description d’une situation
historique. Dans un autre ouvrage. Révolution au Maroc, Paris,
Ed. France-Empire, 1953, p. 111-124, l’auteur montre comment
la soumission au Makhzen puis le protectorat stabilisent une
situation politique locale mouvante. Le système mis ai place
est, par nature, conservateur des hiérarchies et des coutumes. Il
ne peut accueillir les transformations sociales et politiques dans
risque de rupture. J. Le Coz donne, dans son ouvrage Le Rharb,
fellahs et colons, Rabat, Inframar, 1964, p. 805-813, une
excellente description, à la fin du protectorat, de la situation
économique et du rôle politique des notables ruraux dans une
riche plaine du littoral.
[10] Voir S. Bernard, Maroc 1943-1956. Le conflit franco-
marocain, op. cit., tome 3, p. 203.
[11] Voir R. Montagne, Naissance du prolétariat marocain.
Enquête collective exécutée de 1948 à 1950, Paris, Peyronnet,
[1952]. R. Montagne voyait aussi dans le prolétariat une
« troisième force » entre les villes nationalistes et les campagnes
qu’il qualifiait d’anarchiques.
[12] Voir E. Durand, Traité de droit public marocain, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1955, p. 155-
167.
[13] Circulaire confidentielle, en date du 19 juin 1952, du
ministre délégué aux chefs de région sur l’organisation
administrative rurale. Les collectivités créées sous le régime du
dahir du 6 juillet 1951 avaient d’abord une base ethnique ; leur
compétence s’étendait, suivant les termes de la circulaire
d’application du 19 juin 1952, « à tous les membres d’un
groupement donné ». Ce texte prévoit, cependant, une
évolution : « Les jemaas, bien qu’identiques dans loir essence
aux municipalités ou aux commissions des centres,
s’appliquent encore à un groupement ethnique. Leur
fonctionnement conduira cependant à des délimitations
territoriales, à la reconnaissance d’un domaine privé. Il
précipitera sans doute la décadence, déjà commencée, de la
notion de consanguinité et son remplacement par celle de
territorialité. Lorsque cette évolution sera achevée, les jemaas
seront devenues de véritables communes ».
[14] Les problèmes marocains à l’automne 1951, 30 septembre
1951.
[15] Ibid., p. 3.
[16] Ibid., p. 8.
[17] Ibid., p. 9.
[18] Ibid., p. 16.
[19] Ibid., p. 21-22.
[20] Note au Résident général en date du 9 février 1955.
[21] Le conservatisme de l’administration de contrôle et ses
réticences à abandonner une parcelle de son pouvoir ont eu au
moins autant d’influence que les manœuvres des caïds dont on
ne pouvait pas ruiner l’autorité après leur intervention contre
le Palais.
[22] C. Martel, La jemaa administrative, étape dans l’évolution
économique, sociale et politique des tribus berbères du Haut-Atlas,
Mémoire de stage, 1954.
[23] J. Couleau, La paysannerie marocaine, op. cit., p. 87. S.
Bernard, Maroc 1943-1956. Le conflit franco-marocain, op. cit.,
tome 3, p. 61.
[24] Rapport du général Méric, directeur général de
l’intérieur, 15 juillet 1956, p. 10. Souligné dans le texte.
[25] Si Mohamed V refuse de cautionner les anciens caïds, il
accepte au même moment de recevoir, à la demande du haut-
commissaire A.-P. Dubois, une délégation de colons conduite
par C. Aucouturier, président de la Chambre d’agriculture de
Meknès et l’un des principaux responsables de son exil en
1953.
[26] Rapport du général Méric, p. 25.
[27] Voir L.-J. Duclos, J. Duvignand, J. Leca, Les nationalismes
maghrébins, Paris, Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques, 1966, p. 39.
[28] Rapport du général Méric, p. 25.
[29] Ancien caïd des Aït Youssi de l’Amelka depuis 1925,
révoqué par le protectorat, en septembre 1953, pour s’être
opposé à l’exil de Mohamed V. Très influent dans le Moyen-
Atlas, le caïd Lahcen avait établi, dès 1940, des liens avec le
Palais et l’Istiqlal. U combattra l’action du pacha Glaoui auprès
des caïds du Moyen-Atlas.
[30] Rapport du général Méric, p. 32-33.
[31] On trouvait de nombreux fquihs. Mais le pourcentage
d’illettrés était élevé, surtout parmi les caïds issus de l’Armée de
libération.
[32] Une certaine confusion préside parfois à leur
nomination. Dans la province de Taza, un officier d’affaires
indigènes se trouvait, en 1956, au moment de passer ses
pouvoirs, en face de trois caïds : l’ancien caïd non encore
limogé mais ne sortant plus de sa maison, un ancien fquih issu
de Karaouyne, nommé par le gouverneur, et le fils d’un ancien
caïd éliminé par le protectorat qui ne réussit pas à faire
reconnaître son dahir. Ce dernier sera élu président de la
commune rurale en 1960.
[33] Les anciens ont cessé leurs fonctions en même temps
que les caïds du protectorat. Ils ne seront pas remplacés avant
longtemps.
[34] Voir les développements relatifs à la révolte de Addi ou
Bihi, p. 23-24.
[35] Nommés par le roi, ils viennent exercer le pouvoir
judiciaire autrefois dévolu au caïds et pachas.
[36] Voir E. Gellner, « Patteras of tribal rebellion in
Morocco », in P J. Vatitiokis, Révolution in the Middle East and
other cases studies, Londres, Allen and Unwin, 1972, p. 120-145,
et « Indépendance in the Central High Atlas », Middle East
journal, été 1957, p. 236-252.
[37] La révolte de Addi ou Bihi est une dernière
manifestation de type féodal, mais utilisée comme moyen de
pression contre le parti unique. La querelle au sujet des
nominations de caïds n’a été que le prétexte d’un affrontement
inévitable entre deux conceptions opposées du pouvoir.
[38] Voir L.-J. Duclos, J. Duvignaud, J. Leca, Les nationalismes
maghrébins, op. cit., p. 40.
Chapitre II. La recherche d’un nouveau
cadre territorial et de règles du jeu
favorables aux notables
Le conflit politique
L’indépendance voit s’effondrer l’ancien système d’élites
locales chargées de l’administration du territoire. On lui
substitue une bureaucratie moderne, contrôlée, au sommet, par
les bourgeois nationalistes qui avaient bénéficié de
l’enseignement secondaire français, et, à la base, par les petits
cadres du parti de l’Istiqlal. On abandonne ainsi le principe
d’une administration contrôlant l’ensemble du pays, mais
financée par le monde rural traditionnel. Cependant, les
capacités de financement de l’Etat limitent l’extension de la
bureaucratie de type moderne qui prend la suite de
l’administration du protectorat. Il, faut donc trouver le moyen
de procurer à la nouvelle administration locale des relais
efficaces, sans pour autant retomber dans l’ornière du régime
précédent.
L’idée directrice des réformateurs est de détruire le cadre tribal,
c’est-à-dire les liens de solidarité et d’obligation engendrés par
les parentés réelles ou fictives qui maintiennent la cohésion des
groupes sociaux en milieu rural traditionnel. Les communes
constitueront une solution de remplacement que chacun des
participants du jeu politique imaginera à son avantage. La
cohésion future des groupes devra s’établir sur la base de
rapports de production assurant un contenu économique et
social aux solidarités nouvelles. Mais si, comme nous l’avons
vu, l’indépendance avait détruit le pouvoir politique des
anciennes élites locales, elle n’avait pas, dans l’ensemble,
touché à leur statut économique. Ces élites se trouveront bien
placées pour tirer parti de la situation nouvelle.
Le projet de réforme communale est bien l’une des premières
réformes d’inspiration libérale du protectorat à intéresser le
Maroc indépendant. Les obstacles du passé sont levés. Les caïds
sont maintenant des fonctionnaires nommés par le pouvoir
central. Les colons n’ont plus voix au chapitre. La transition
avec le passé est assurée par un groupe d’assistants techniques
libéraux qui voient, alors, l’occasion de réaliser dans un
contexte démocratique leurs projets écartés dans la période
précédente. S’ils n’ont généralement guère de difficultés à
collaborer avec l’aile la plus avancée du nationalisme, ils sont
plus inquiets des projets ou de l’attentisme des nationalistes
originaires de la bourgeoisie citadine. Ces derniers feront
naturellement alliance avec d’autres assistants techniques
français qui auront la surprise de voir le Maroc indépendant se
complaire dans l’observance du rituel bureaucratique du
protectorat.
Les rivalités politiques marocaines ont ainsi éclipsé les
problèmes des communes rurales. Si Mohamed V cherchait,
entre autres, un moyen de redonner de l’influence aux élites
locales et de limiter les pouvoirs de caïds jugés trop à la
dévotion de l’Istiqlal, Ben Barka voyait dans les communes un
moyen d’administrer le pays sans avoir recours aux techniques
du protectorat. Ses objectifs allaient jusqu’à supprimer les
nouveaux caïds (Fonctionnaires, et, ainsi, démocratiser peu à
peu mais réellement les communautés politiques de base. Pour
Ben Barka, la commune devait briser le cadre tribal et
constituer de vastes ensembles où les liens d’intérêts
économiques et sociaux (souk, école, infirmerie, centre de
travaux agricoles) rendraient inutiles les anciennes solidarités
ethniques. Pour animer ces communes, l’action du pouvoir
central et des cellules de l’Istiqlal devait être prédominante. Le
scrutin de liste bloquée aurait permis de faire désigner-plus
facilement les membres de la petite bourgeoisie lettrée.
A l’opposé, les adversaires de l’Istiqlal pensaient qu’un scrutin
uninominal permettrait de retrouver, derrière la façade
communale, les entités traditionnelles (fractions, douars), et
aboutirait plutôt à la désignation d’hommes ayant fait leurs
preuves dans ces cadres. En promettant enfin des élections
locales, le roi se ménageait la possibilité de constituer une force
organisée, capable d’équilibrer la bureaucratie de l’Istiqlal.
Les hésitations de la monarchie rejoignent les préoccupations
des assistants techniques qui participent encore largement au
pouvoir administratif : ainsi, le vieux caïd Lahcen Lyoussi,
premier ministre de l’Intérieur après l’indépendance, s’était
installé près du sultan, mais il se souciait assez peu de la
gestion des services centraux qui restaient entre les mains
d’anciens contrôleurs civils libéraux. L’héritage des communes
rurales fait partie du lot de réformes que ces assistants
s’emploient à faire progresser. Soucieux de voir le Maroc
s’engager au plus vite dans une politique de transformations
économiques et sociales, ils se trouvent à nouveau devant la
nécessité d’organiser un groupe d’interlocuteurs du pouvoir
assurant un relais auprès des populations. Les textes sur les
réformes communales avaient à peine eu le temps d’être mis en
place par le protectorat ; les circulaires d’application dataient
pour la plupart de 1955[1]. Après l’indépendance, les assistants
techniques provinciaux se réfugient parfois dans ce domaine
pour éviter d’avoir à intervenir dans des affaires trop politisées.
Grâce à leur action, les communes continuent à vivoter, les
nouveaux caïds reconstituent leur cour de notables[2], le plus
souvent désignés par leurs soins. Faute de pouvoirs réels, on
leur prodigue un parcelle de considération que vaut le
côtoiement des officiels.
Tel est l’arrière-plan des opérations visant à reconstituer un
réseau d’élites locales. Les conflits latents entre la nouvelle
bourgeoisie et le monde rural dominent le problème des
élections communales et de la reprise en main de
l’administration locale. Chaque groupe au pouvoir, à Rabat, a
vu, dans la reconstitution d’une force politique substituée aux
anciens notables, un élément de sa stratégie à l’échelle
nationale, qu’il s’agisse de freiner ou d’activer l’opération.
Lorsque le roi veut limiter l’emprise de l’Istiqlal, il encourage
l’organisation l’élections locales, pour essayer de canaliser à
temps un mécontentement qui finit par s’exprimer quelquefois
en insurrections. Ben Barka, de son côté, rêvait bien avant la
scission de l’Istiqlal en 1959, d’une grande commune brisant le
cadre tribal et servant de relais aux cellules du parti. La vieille
garde de l’Istiqlal s’y intéresse aussi en dépit de son
incompatibilité naturelle avec le monde rural. Conscient de
son caractère de mouvement essentiellement urbain, ce parti
voit dans l’établissement des communes l’occasion d’asseoir
une emprise politique moins fragile que dans les villes, et de
reconstituer une audience dans le monde rural qui s’émiette
depuis l’indépendance.
Dans ce contexte, le découpage des communes prend valeur de
symbole, à la fois pour l’administration et pour l’opinion
publique. Peu de temps après son arrivée au Ministère de
l’intérieur, en octobre 1956, Driss Mhammedi se rend compte
qu’il ne peut pas utiliser l’ancien cadre communal du
protectorat pour les élections dont tout le monde parle. Son
directeur des Affaires administratives, Ahmed Bahnini, poussé
par ses assistants techniques français, insiste pour remettre en
marche les anciennes communes. Mais Mhammedi ne veut pas
rester prisonnier de ce cadre[3]. Ancien avocat à Meknès avant
l’indépendance, il connaît bien le monde rural, ses problèmes
et ses réticences. Il a longtemps plaidé les affaires terriennes des
Zemmour, des Beni Mguild et des Zaïans.
Pour reprendre en main les campagnes qu’il sent échapper au
pouvoir central, il choisit de s’entourer d’une équipe de jeunes
Berbères anciens élèves du Collège d’Azrou, comme Hassan
Zemmouri, Hossein Hadj Ahmou, Mohamed Tadli,
Abdelhamid Zemmouri. Les uns resteront à son cabinet ou au
service central du ministère, les autres seront envoyés dans les
provinces comme gouverneurs ou secrétaires généraux. Ces
jeunes fonctionnaires partagent l’idéologie unitaire du
Mouvement nationaliste et n’ont guère de tendresse pour les
vieux caïds tentés par le retour à l’anarchie. Mais ils restent
proches des ruraux ; ils ne méprisant ni leur gaucherie ni leur
attachement aux coutumes. Ils aideront, avec d’autres anciens
d’Azrou, à reprendre en main l’administration locale, laissée à
l’abandon ou confiée à des agents politisés et incompétents. La
majorité de ces jeunes Berbères modernistes[4] est de gauche et
se sent plus à l’aise au sein de l’Istiqlal, avec Bouabid ou Ben
Barka, qu’avec les bourgeois fassis. Ils partagent avec
Mhammedi le souci de mettre en place, en face du
gouvernement et de l’administration, une représentation des
populations, interlocuteur privilégié dont on accepte les
critiques et dont on espère l’aide.
Le nouveau découpage territorial
Mhammedi a aussi associé à son entreprise de reconstruction
du monde rural une équipe de contrôleurs civils et d’officiers
libéraux — ayant à leur tête Olivier Lange et Camille Scalabre
— dont l’action est relayée dans chaque province par un ou
deux assistants techniques français. Ces experts joueront un
rôle prépondérant, tant au service central que dans les
provinces, dans la réalisation d’un nouveau découpage
communal. Les instructions expédiées aux gouverneurs, en mai
1957, prescrivaient de préparer un nouveau découpage[5] se
fondant essentiellement sur des intérêts économiques et
géographiques. La commune doit rassembler tous ceux qu’unit
un intérêt économique commun (même seguia, centre de
travaux agricoles, souk, etc.). Une telle définition, ainsi que les
commentaires oraux des agents de l’Intérieur, laissent souvent
croire qu’il s’agissait de briser le cadre tribal dans toutes ses
manifestations. Telle n’était pas l’intention de Mhammedi qui
reconnaissait volontiers l’utilité des solidarités ethniques aussi
longtemps qu’elles ne s’opposaient pas à l’intégration
nationale. Les solutions pratiques adoptées varient certes
suivant les provinces. Nous analyserons quelques cas-types en
utilisant les comptes rendus détaillés établis par la commission
itinérante constituée à cet effet. Cette commission, présidée par
Hassan Zemmouri, était animée par Camille Scalabre qui, avant
de passer à l’assistance technique, avait été, à la fin du
protectorat, secrétaire général de la région de Marrakech où il
était considéré comme un contrôleur civil libéral. Il avait
participé au lancement du Paysannat avec Berque et Couleau,
et s’était montré, dans chaque poste où il avait été affecté,
soucieux de favoriser la modernisation de l’agriculture
traditionnelle.
Scalabre entreprit cette nouvelle tâche avec une conscience
claire des difficultés que présentait la réalisation d’un
découpage favorable à l’évolution des structures rurales. S’il
adhérait aux mêmes objectifs que Mhammedi et Zemmouri, il
gardait dans chaque cas une approche historique[6] soucieuse de
ne pas créer des situations de conflits insolubles, sous prétexte
de favoriser la modernisation. Dans une note d’octobre 1957, il
expose les principes qui doivent guider l’attitude de la
commission à l’égard des données historico-géographiques du
monde rural. Les préoccupations financières constituent une
des données de fait de la création des communes, la plupart de
leurs ressources provenant de taxes perçues sur les souks. Mais
les souks, qui coïncident généralement assez bien avec les
données sociologiques, ont parfois des zones d’influence très
larges, qui amèneraient à constituer des communes trop
étendues si l’on ne retenait que ce seul critère. Anticipant sur
les travaux de la commission, le ministre de l’intérieur décide,
en 1958, de constituer en unités administratives autonomes les
plus gros souks — fondant ainsi la possibilité d’un
développement urbain alimenté par les ressources de la
campagne environnante[7].
Le problème se posait nettement dans la province de
Casablanca qui comptait de nombreux petits centres prospères.
Les zones rurales voisines souhaitaient partager les ressources
fiscales de ces centres qui, dans leur esprit, provenaient surtout
des échanges de leur groupe. Le choix de l’autonomie des
centres aboutit à en faire, en quelques années, des petits pôles
d’urbanisation, le marché attirant l’école, la maison
communale, l’infirmerie, l’adduction d’eau puis un minimum
de voirie. Des commerçants permanents commencent à
s’installer dans le voisinage. Ils prennent rapidement rang
parmi les notables du canton. Ils spéculent sur les terrains à
bâtir, font des avances aux ruraux et achètent leurs produits à
des prix avantageux. Leurs revenus et leur prestige dépassent
bientôt ceux des notables ruraux. Ils sauront très vite utiliser les
ressources administratives et financières des communes pour
favoriser leurs propres projets. Si le ministère et la commission
avaient suivi les désirs des ruraux, il est certain que la
domination des centres autonomes par les communes
environnantes n’aurait pas entraîné un développement urbain
aussi rapide.
Le découpage des communes de la province de Fès offre un
exemple intéressant de mise en pratique d’une politique
consciente de reconstitution des élites rurales intermédiaires
sous leurs divers espects. Le projet est préparé sous l’autorité du
gouverneur, ancien résistant de tendance Istiqlal, Ghali Laraki,
originaire d’une famille bourgeoise de Fès. Le responsable
officieux des affaires communales est l’ancien secrétaire général
de la région, le colonel Verlet, resté après l’indépendance
comme assistant technique provincial[8]. Ce dernier entreprend
son travail préparatoire en prenant pour point de départ
l’ancien découpage ethnique, avec l’idée de faire coïncider le
plus souvent possible ce qu’il appelle le « commandement
marocain », caïdat ou cheikhat, avec la commune. Sa
philosophie du système communal apparaît dans une
conférence faite aux caïds et chefs de cercle en janvier 1957,
dont le texte a été par la suite annoté très favorablement par
Driss Mhammedi. Pour lui, le but de la reconstitution des élites
intermédiaires est de fournir un relais à l’action des nouveaux
caïds. Il transmet fidèlement à ces derniers les recettes qui
permettraient d’obtenir la collaboration des notables du temps
du protectorat. Parlant des communes en projet, il évoque, en
premier lieu, les erreurs à éviter :
« Il ne s’agit pas, au début, de réunir cette jemaa pour lui
poser des questions auxquelles elle ne répondra pas, ou
mal ; mais uniquement de lui faire part de l’ordre du jour
de la prochaine réunion en veillant à ce qu’aucun membre
ne s’en aille sans le connaître parfaitement.
Pouquoi procéder de la sorte et ne pas vider cet ordre du
jour séance tenante ? D’abord parce que le campagnard
marocain raisonne moins vite que nous et qu’il lui faut un
long délai de réflexion[9]. Ensuite parce que, fréquemment,
il n’a pas saisi tout le sens du problème, surtout lorsqu’il est
teinté d’un aspect occidental. Enfin parce qu’en homme
honnête et consciencieux, en vrai représentant, il
n’exprimera son avis qu’en connaissant celui de ses
mandants. L’ordre du jour des réunions, les questions à y
étudier doivent en conséquence faire l’objet d’une
préoccupation constante et sont à consigner
scrupuleusement sur un registre afin de pouvoir être revus
et médités.
Si vous faites venir ces délégués de quelques dizaines de
kilomètres pour leur annoncer une mesure désagréable prise
sans les avoir consultés ou pour leur faire entériner cette
mesure, vous commettez une erreur. Si vous réunissez ces
mêmes délégués pour les menacer de sanctions ou les
rendre responsables d’actes qu’ils n’ont pas commis, vous
aurez devant vous une assemblée sourde et muette qui vous
échappera complètement.
Il faut donc préparer de longue date les questions à étudier
avec les jemaas, laisser à ces membres de longs délais de
réflexion et savoir écouter avec patience les arguments les
plus contraires à ses vues personnelles. Si fréquemment ces
arguments ne nous plaisent pas, il est rare qu’ils ne soient
pas étayés par des principes d’une conception qui peut-être
nous échappe mais qui possède sa valeur.
Ainsi, en évitant de faire de ces jemaas des assemblées de
statues, il est possible d’envisager leur rôle comme
déterminant dans cette participation réelle des ruraux à la
gestion des affaires publiques. Point n’est besoin pour cela
d’une longue éducation : il suffit de les mettre en
confiance…
Et lorsqu’après un certain temps — il faut être patient —
vous pourrez faire le bilan de l’opération pour le décompte
des décisions prises, vous pourrez être satisfaits des résultats
obtenus ; vous constaterez alors que ces réunions :
– vous ont permis d’initier les jemaas à certains
problèmes de la vie moderne ;
– qu’elles constituent une arme efficace pour
contrebattre les faux bruits et les rumeurs alarmantes
(souvent lancés par des étrangers), et qu’en discutant en
public la vérité et la franchise ont vite fait de les réduire
à néant ;
– enfin, qu’elles sont suivies avec le plus grand intérêt
non seulement par la jemaa mais par toute la tribu qui
recherche les échos de la séance ».
Ce texte basé sur la pratique du protectorat a l’avantage de faire
apparaître les mécanismes de représentation dans le monde
rural marocain. Alors que la plupart des textes anciens ou
nouveaux reposent sur une théorie implicite de la délégation,
empruntée au droit français, la pratique marocaine, se méfiant
instinctivement de tout abandon de pouvoir de la collectivité,
repose en fait sur un système de mandat, valable pour chaque
affaire. Il montre que la jemaa existe encore, au moins comme
institution défensive, dans les rapports entre le pouvoir et la
population. Au moment d’instituer un cadre nouveau, les
réactions de l’ancien praticien du protectorat et des nouveaux
administrateurs marocains montrent bien qu’ils perçoivent les
conseils communaux à créer comme des ensembles
oligarchiques, continuant, sous un nouveau nom, les
assemblées traditionnelles où les élites locales jouent un rôle
essentiel comme instrument de l’autorité administrative. La
commune apparaît comme le prolongement naturel du réseau
administratif. Les conseillers communaux prendront
directement la suite des anciens collaborateurs des caïds du
protectorat, sans être rémunérés par l’administration. On ne
conçoit pas pour autant que le fonctionnement du système
puisse également se faire dans l’autre sens, et que les
communes servent de relais aux deftiandes de la population.
En résumé, l’initiative appartient au représentant de l’Etat.
Celui-ci, héritier du contrôleur civil, agit par le biais
d’intermédiaires qui ressemblent étrangement aux notables
qu’utilisait le protectorat. Si l’on reconnaît les comportements
défensifs du groupe, on est loin d’en accepter les initiatives et
même l’idée d’une gestion réellement autonome. Cet
instrument est surtout conçu comme un relais politique
destiné à faire accepter les décisions gouvernementales et à
manipuler l’opinion rurale, avec le dessein à peine voilé d’y
combattre l’influence des partis (ces étrangers qui font courir
des faux bruits et des rumeurs alarmantes). Ce raisonnement
conduit donc à établir un cadre territorial où les tendances
oligarchiques des anciennes jemaas[10] habituées à jouer le rôle
d’intermédiaires avec le pouvoir, pourront jouer sans
contrainte. Ce type d’organisation vise, en fait, à renforcer le
pouvoir de l’État en donnant l’impression de structurer les
collectivités locales.
Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que le projet de
découpage de la province de Fès respecte les frontières tribales
avec grand soin. Mais chaque commune ne coïncide pas avec
une ancienne tribu. Formellement, commune et tribu ne se
recoupent que dans la moitié des cas ; les autres communes
sont constituées par un ensemble de fractions de tribus, ou,
dans quelques cas assez rares, par plusieurs petites tribus
agglomérées[11]. Les frontières ethniques ne sont donc pas
brisées et les liens de solidarité dérivant du système de parenté
joueront sans entraves, surtout en période de mobilisation
sociale ou politique du groupe. La province de Fès se soucie
également de constituer des centres ruraux viables dont elle
entend faire des pôles de modernisation que les campagnes
pourront toujours équilibrer, l’administration restant maîtresse
des rapports ville-campagne. Le colonel Verlet expose ainsi,
avec l’assentiment des autorités marocaines, la doctrine qui
inspire son projet :
« Aucune instruction fructueuse, aucune éducation durable
ni aucune évolution ne peut être valablement envisagée
tant que subsistera la dispersion actuelle de l’habitat dans la
campagne marocaine. Il n’est évidemment pas question de
transférer ni de contraindre ces populations à se grouper
dans les villages. Mais entre cette solution extrême et la
situation présente il existe la possibilité d’envisager par
tribu ou fraction un village qui deviendrait un centre de
formation et de rayonnement, ainsi que le noyau
administratif du groupement considéré et autour duquel
pourraient être entreprises et suivies, selon certaines
modalités, les expériences et les démonstrations de
modernisation.
C’est là aussi que se grouperaient les artisans sans lesquels
aucune évolution régulière et suivie n’est concevable car il
s’agit non seulement d’amener la jeunesse rurale à se servir
du matériel moderne, mais il importe surtout de lui donner
le sens de l’ordre, de la propreté et de l’entretien de ce
matériel qui ne peut se concevoir dans la dispersion actuelle
de l’habitat.
Il faut donc envisager la création du village ou du centre
rural en un lieu reconnu et désigné par la jemaa qui
constituera le futur centre communal où la jemaa renovée
et comprenant un certain nombre d’anciens élèves s’initiera
à la gestion des affaires publiques, à l’aménagement des
centres, à la modernisation de l’habitat, en un mot à tout ce
qui conditionne son évolution.
Il est essentiel que dans une première phase ces jemaas ne
comprennent qu’une partie de jeunes sortis de nos écoles
afin de ne pas provoquer une évolution trop hâtive qui ne
pourrait être suivie par la masse. Toute précipitation dans ce
domaine amènerait inévitablement une rupture entre la
jeune génération et l’ancienne et compromettrait
gravement l’évolution même des masses rurales qui ne peut
être que lente et progressive.
C’est également dans ce centre que devront être réalisées les
installations sportives où tous les jeunes viendront se
retrouver et se retremper dans une saine ambiance rurale
qui les attachera à la terre et les incitera à s’y fixer ».
Ce texte fait apparaître la continuité entre l’ancienne et la
nouvelle administration. La constitution de noyaux
d’urbanisation y est acceptée et même souhaitée pour retenir
les jeunes, en particulier ceux qui auront reçu une instruction.
Mais ce cadre nouveau doit être établi avec l’assentiment des
anciennes élites locales, afin de ne pas créer de conflit entre
élites traditionnelles et notables du nouveau centre. On se
souvient que Mhammedi avait justement arbitré en sens
inverse dans la province de Casablanca, laissant se constituer
des centres autonomes dynamiques, tirant leurs ressources des
campagnes avoisinantes et ne tardant pas à se définir
économiquement et politiquement en dehors des cadres
acceptables par les élites locales traditionnelles. A Fès la
contradiction n est pas relevée.
Ce texte est aussi intéressant pour la place qu’il réserve aux
jeunes. On accepte de les intégrer pour assurer une évolution
des campagnes et surtout éviter leur départ vers les villes où
l’accroissement du prolétariat devient dangereux. On accepte
aussi une intégration limitée aux institutions pour ceux qui se
soumettront aux anciens, suivant le principe d organisation
immuable du monde rural. Pour les jeunes, le centre servira
surtout à acquérir de nouveaux comportements sociaux. Pour
ceux qui auraient d’autres ambitions, le sport servira de
dérivatif. Processus d’acculturation contrôlé par les anciens et
par 1 administration, la vie dans les centres ne devrait pas
réserver de surprises. Aura-t-elle un attrait suffisant pour
répondre à l’attente de ceux que l’on souhaite ainsi intégrer,
alors qu’ils formeront très vite la majorité de la population de
l’agglomération nouvelle ?
Cette philosophie de la vie communale s’appuie sur une
technique administrative sûre ; la province de Fès avait déjà
relancé le fonctionnement de ses communes dès 1956. Le
gouverneur est en mesure d’indiquer dans chaque cas, à la
commission, les ressources dont disposent les futures unités
administratives, ainsi que les facteurs économiques ou
géographiques et ethniques, qui en constituent l’unité. Les
chefs de cercle, qui exposent le projet de découpage de leur
circonscription, font souvent état des préférences des jemaas.
Ils montrent, ainsi, qu’elles ont été consultées dans chaque cas,
en application des principes exposés plus haut.
Les chefs des services techniques provinciaux donnent
également un avis qui ne semble pas avoir été déterminant.
Quant aux organisations politiques, elles sont officiellement
absentes d’un travail qui conçoit avant tout la commune dans
ses rapports avec le pouvoir central et ses représentants
administratifs, et exclut tout autre type d’intermédiaire. Les
relations avec la ville de Fès sont aussi absentes du projet, alors
que de nombreuses communes sont dominées dans le pré-Rif
par les propriétaires bourgeois fassis et que des courants
d’échanges intenses existent entre ville et campagne.
Dans la province de Casablanca, le découpage présenté le 28
août 1957 à la commission a été également préparé par deux
assistants techniques, anciens contrôleurs civils. Il offre la
particuliarité d’avoir recours à des critères très différents. Dans
les zones de plaines modernisées, où l’on trouve une
implantation de colonisation assez forte, le découpage n’y tient
pas compte du cadre ethnique. Seuls les facteurs géographiques
et économiques ont été retenus pour grouper une population
donnée autour d’un centre, lui-même en voie de constitution.
L’hypothèse de base non formulée est la suivante : la
colonisation a déjà fait éclater les liens ethniques ; le
regroupement peut donc s’opérer à partir de critères étrangers
au milieu. Le système aboutit à regrouper en 70 unités les 88
communes du protectorat, en prenant soin d’aligner sur le
nouveau découpage les commandements des chioukh et des
caïds. La province prévoit le remplacement des chioukh par les
présidents de commune, et organise des élections officieuses
pour leur désignation. En revanche, dans la région d’Oued
Zem, Boujad et Khouribga, où l’élevage semi-nomade l’emporte
sur l’agriculture, les communes sont découpées suivant des
critères ethniques : la fraction constitue le plus souvent la base
des nouvelles unités. Toutefois, les mineurs sont isolés au sein
de la commune de Boujniba.
Si, dans la partie agricole de la province de Casablanca,
l’uniformité introduite par la colonisation justifie des solutions
nouvelles, à Mazagan (devenu El Jadida à partir de 1958), les
responsables provinciaux adoptent des solutions inverses pour
les mêmes raisons. Pour eux, les seuls facteurs de
différenciation dans une région agricole, dense et riche restent
les facteurs ethniques. Ils s’appuient pour justifier leur projet
sur des consultations de la population (alors que les habitants
de la Chaouia semblent ne pas avoir été tous informés des
projets de découpage). Il est vrai que la colonisation a eu moins
d’effets de rupture dans la région de Mazagan qu’en Chaouia.
Les autorités provinciales se trouvent, dans le premier cas, en
face de notables riches capables de faire entendre leur point de
vue à Rabat, dans le second cas, en face d’ouvriers agricoles ou
de petits agriculteurs. Il est curieux de voir, par ailleurs, à quel
point le facteur colonisation est pudiquement tenu à l’écart des
discussions des commissions qui rencontrent cependant ce
problème dans le Rharb — à Meknès et à Fès. A Meknès, où la
situation était particulièrement délicate dans les cercles de
Meknès-banlieue et de El Hajeb, il semble que, par souci de ne
pas créer des communes rurales trop petites, on soit passé
d’une solution proposant la fraction comme base de découpage
à une solution d’ensembles plus vastes correspondant aux
anciennes tribus. Dans les cercles de montagne de la province
de Meknès, où l’élevage transhumant et les pâturages collectifs
constituent la base de l’économie, la commission a été amenée
à accepter la conférération de tribus comme base de découpage.
Dans la province de Rabat, le nouveau découpage est préparé
suivant les instructions de Majhoubi Ahardane, gouverneur de
la province jusqu’en novembre 1957. Ce projet rejoint le cadre
tribal, Sauf pour six tribus qui sont coupées en deux, et deux
tribus coupées en trois. Le gouverneur sacrifie pourtant aux
idées en cours en faisant l’éloge de l’esprit communal dans la
note de présentation du projet. Les annotations du Ministère
de l’intérieur prouvent qu’en dépit du manque d’information
sur les données objectives du découpage le service central n’est
pas dupe, mais les modifications faites en accord avec la
province n’altéreront pas l’esprit du projet initial. Il aurait
pourtant été possible, dans les zones de colonisation ou dans
les régions montagneuses de Ouezzane ou d’Oulmès, de
proposer d’autres types de sectionnement.
A Agadir, bien que le projet de la province réduise de moitié le
nombre des communes du protectorat, la base du découpage
reste la fraction ou la petite tribu. L’administration provinciale
semble surtout soucieuse de pouvoir contrôler les futurs
présidents de commune, qu’elle imagine avec un pouvoir
comparable à celui des agents de l’Etat[12]. Dans le Tadla, où le
découpage aurait pu coïncider avec les zones d irrigation, la
province présente un regroupement en unités plus vastes
(comprenant des régions de piémont et de montagne) qui
respecte le cadre ethnique[13]. Il en est de même pour le
périmètre irrigué de Madagh qui, dans la province d Oujda, est
inclus dans la commune des Triffas correspondant à une
ancienne tribu. A Taza, on transformera en communes les
anciennes circonscriptions de contrôle (appelées annexes). Cet
exemple de solution de facilité semble avoit été assez souvent
suivi dans les régions d’habitat dispersé, sans que le problème
ait été évoqué au cours des débats de la commission.
Dans les provinces pré-sahariennes, la commission accepte sans
grandes modifications les propositions des provinces, qui
reprennent le découpage du protectorat en le réduisant par
concentration, sans porter atteinte aux frontières tribales.
En zone Nord, la situation est plus complexe. L’administration
espagnole a mis en place, depuis 1952, des « Juntas rurales » de
fractions dont le fonctionnement semble plus intégré dans le
système administratif que celui des communes en zone Sud[14].
La tendance naturelle de l’administration provinciale, dont les
membres appartiennent souvent aux familles de notables de
Tétouan, est de conserver le statu quo, d’autant plus que les
ressources et les compétences dont disposent déjà les
communes leur semblent nettement plus étendues que celles
prévues dans les projets de Rabat (taxes sur les forêts, licences
commerciales diverses, etc.). Les gouverneurs de la zone Nord
acceptent les concentrations de communes à condition que
l’on ne touche pas aux frontières tribales. Ils refusent tout
regroupement qui devrait mêler des populations d’origine
différente. Les discussions entre représentants des provinces du
Nord et membres de la commission montrent bien l’écart
considérable qui sépare les deux points de vue : les
fonctionnaires de Rabat parlent le langage juridique et
administratif de l’ex-zone Sud. L’incompréhension sera poussée
à un dangereux paroxysme lorsque le Ministère de l’intérieur
voudra, à la demande du Service des eaux et forêts de Rabat,
étendre au Rif le régime forestier des provinces du Sud. Une
circulaire du 23 décembre 1957 se fondant sur une notion
stricte de la domanialité prescrit une restriction des droits
d’usage de la forêt considérés comme normaux dans le Nord.
Le même désir d’uniformisation imposée inspirera, dans le
premier trimestre 1958, un projet de découpage provincial
visant à faire éclater les provinces du Nord pour les incorporer
à des provinces du Sud. Ces maladresses ne seront pas
étrangères à la révolte du Rif qui éclatera a 1 automne 1958.
La réalisation du découpage communal montre l’ambiguïté des
tentatives qui, dans le Maroc indépendant, veulent créer de
nouvelles élites locales en modifiant le cadre des rapports entre
le pouvoir et les administrés. Dans la ferveur des débuts de
l’indépendance, les représentants du pouvoir central et les
administrateurs locaux proclament leur volonté d effacer le
cadre tribal… puis, faute de pouvoir proposer une autre
solution, le réintroduisent sous un autre nom. Ils vont souvent
jusqu’à donner aux nouvelles communes les noms des
groupements ethniques.
Il aurait sans doute été difficile d’imaginer d’autres solutions. A
partir du moment où l’on se fixait comme point de départ la
création de grandes communes de 10 000 à 15 000 habitants
avec des ressources propres assurées par un souk[15], un simple
raisonnement aurait permis de voir que l’on allait retomber,
dans la plupart des cas, sur la tribu. En effet, Frédéric Brémard,
dans son ouvrage sur L’organisation régionale du Maroc[16],
précise qu’il existe au Maroc un peu plus de 600 tribus
comptant en moyenne de 10 000 à 15 000 âmes. Ce chiffre est
celui des instructions données au gouverneur, en juillet 1957,
pour préparer le découpage des communes. Comme les
groupements éthniques représentent encore en de nombreuses
régions des ensembles solidaires pour l’exploitation de là
nature, il n’y a rien d’étonnant à les voir réapparaître quel que
soit le nom qu’on leur donne. Une dernière raison plus
prosaïque milite pour un découpage ethnique. Les seules
statistiques sérieuses et récentes sur la population, la
production et la fiscalité, dont dispose l’administration, sont
établies au niveau de la fraction. Pour faire un découpage
réellement nouveau, il aurait fallu partir du village, et lui
donner, au départ, une base territoriale[17].
L’erreur ne vient-elle pas du fait que l’on a voulu asseoir le
groupement nouveau sur des activités d échange plutôt que sur
des activités de production ? Les compétences économiques des
communes rurales sont restées des virtualités. Ni les terres
collectives, ni la réglementation des droits d eau, ni les terres
de colonisation récupérées n’ont été de leur ressort. Le
découpage n’a même pas mis l’accent sur les fonctions de
production modernes telles que l’homogénéité des périmètres
irrigués. Au contraire, dans le Tadla et dans les Triffas, où l’on
aurait pu créer des communes correspondant à des unités de
mise en valeur moderne, on a mis l’accent sur la
complémentarité des zones de plaine et des pâturages de
piémont comme dans le secteur traditionnel[18]. A cet égard, le
découpage des périmètres irrigués modernes est beaucoup
moins homogène que celui des périmètres traditionnels : ainsi,
dans la vallée de l’Ourika et dans certaines zones d irrigation
des provinces présahariennes, la commune correspond à une
seguia ou à un ensemble de seguias.
Faute d’une base économique réelle donnée par des réformes
de structures plus que par un découpage, dont les intentions
proclamées ont plus inquiété les ruraux qu’elles ne les ont
avantagés, on en revient à l’ancien principe de solidarité
ethnique.
Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner de voir
réapparaître des élites locales plus soucieuses de revendications
à l’égard des groupes voisins et rivaux que de modernisation.
La seule mesure révolutionnaire prise par la commission a été
de constituer en entités autonomes les centres ruraux où se
regrouperont les initiatives et les richesses, favorisant
l’apparition d’un nouveau type d’élite locale qui ne devra rien
ni au vieux Maroc, ni au protectorat.
On n’estime guère à plus du tiers le nombre de recoupements
entre la tribu et la commune, mais il faudrait y ajouter les
communes où les habitants appartiennent à une même tribu
scindée en fractions. Assez rares seront les cas de coexistence
conflictuelle de populations d’origine différente. Le mélange
n’a rien d’explosif tant que les groupes s’équilibrent et
conservent, au sein du système communal, la possibilité
d’assurer une représentation traditionnelle des sous-groupes.
L’examen des intentions et des décisions réelles des autorités
administratives du Maroc indépendant fait ressortir
d’importantes contradictions. Certes, il semble difficile d’en
mettre à jour les raisons profondes, sans courir le risque
d’interprétations excessives. Il est facile de comprendre
l’hostilité des dirigeants nationalistes à un système tribal qui
venait d’être utilisé contre eux par le protectorat. Mais n’y a-t-il
pas eu de leur part confusion ? Maints observateurs ont
souligné l’aspect illusoire de la tribu, son caractère artificiel, sa
facilité de rupture[19]. L’effondrement du système des notables,
en 1955, en est une éclatante démonstration. Les nationalistes
voyaient dans la tribu ce que le protectorat en avait fait : un
réseau de commandement qu’il maniait déjà avec une certaine
souplesse, sinon avec désinvolture. Auparavant, le système
tribal, par son opposition constante des groupes et des sous-
groupes, avait justement pour fonction de répartir le pouvoir
en évitant sa centralisation. Dans le système colonial, il est
paradoxalement devenu l’élément de base d’un ensemble
centralisé qui ne disparaîtra pas pour autant avec
l’indépendance. Mais, faute d’une transformation réelle des
structures économiques du monde rural, ce système reste un
ensemble de solidarités qui lie des membres d’un groupement
donné pour l’exploitation d’un territoire[20]. Quand
l’administration a voulu, en 1957, nier la réalité de ce
phénomène, le monde rural s’est senti menacé dans son
identité collective. Sa réponse, quand on a sollicité son
acquiescement à une nouvelle organisation, a été de réagir de
façon unanime en faveur d’un maintien des anciennes
structures. Dans cette période de transition, dont on voyait mal
l’aboutissement, le monde rural marocain n’acceptait pas de
perdre ses mécanismes traditionnels de consultation et de
fonctionnement collectif, en échange d’un système de
représentation reposant sur le principe de délégation, qui lui
était étranger. Pour qu’un tel bouleversement fût accepté, il
aurait fallu réaliser des transformations économiques
profondes. Les mécanismes de contact avec le pouvoir tendent,
en fait, à sélectionner, dans la masse rurale, ceux qui
bénéficieront des améliorations qui leur permettront de se
maintenir en place, alors que la masse devra se résigner à un
statut économique inférieur ou à l’émigration vers les villes.
Mais cela n’est que le début d’un lent processus d’évolution qui
n’est ni clairement perçu, ni avoué en 1957.
Le découpage des communes rurales favorisait déjà par lui-
même, faute d’être accompagné de profondes réformes de
structure, la continuité[21] des élites locales. Le mode de scrutin
allait encore renforcer cette tendance.
Le choix du mode de scrutin
La rupture avec le passé tribal et les solidarités ethniques qui en
découlaient devait être provoquée par une nouvelle définition
de l’assise territoriale des communautée de base. On a pu voir
comment, faute de réformes plus profondes, on retombait sur
un découpage ethnique dont on n’avait changé que le nom.
Les élites locales traditionnelles trouvaient là un cadre dont
elles s’accommodaient fort bien.
Mais la réforme communale n’avait de sens, dans l’esprit des
nationalistes, que si elle s’accompagnait d’un mode de scrutin
permettant d écarter les élites locales du protectorat au profit
des cadres des partis politiques. Le témoignage de Mehdi Ben
Barka est net sur ce point :
« La réforme communale telle qu’elle apparaît dans la loi est
très belle dans les chapitres concernant le rôle de la
commune rurale, elle est très belle parce que le texte
original est resté intact, on n’y a pas touché parce que ceux
qui voulaient dénaturer le texte savaient quel était le point
clé sur lequel il fallait agir. Ce point n’est autre que le mode
de scrutin. Le mode de scrutin, tel qu’il avait été proposé,
était le scrutin de liste qui seul permettait de constituer des
équipes conscientes à la base du pays pour mobiliser les
masses pour qu’elles réalisent-par elles-mêmes leurs
aspirations. Et c’est sur ce front que nous avons dû nous
battre. Le gouvernement Ibrahim qui a mené cette bataille,
avait à choisir : démissionner, ne plus continuer le combat
sur le front extérieur pour les négociations qui étaient
entreprises en vue de la réalisation de l’indépendance
économique, ou bien accepter le scrutin qui lui était imposé
par tous les moyens[22] ».
Si le choix du scrutin uninominal majoritaire à un tour pour la
désignation des conseillers communaux a été un élément
déterminant dans la reconstitution d’un réseau d’élites locales,
l’importance politique de cette décision a été parfois niée par le
Palais, comme nous le verrons plus loin. Les autres participants
du jeu politique n’étaient pas dupes des intentions du
souverain, mais, à leurs yeux, à cette époque, le contrôle du
monde rural avait moins d’importance que celui de l’appareil
bureaucratique et du secteur économique, encore largement
aux mains des Français. Chacun des partenaires appréciait les
enjeux, en fonction d’une stratégie visant à s’assurer le contrôle
du système politique dans son ensemble. Rien ne semblait
définitif tant que l’un des partenaires ne s’était pas assuré un
net avantage sur les autres[23].
C’est dans cette perspective qu’il convient de situer les
manœuvres autour de l’adoption du mode de scrutin. Les partis
savaient qu’ils auraient l’occasion de cristalliser et
d’institutionaliser leur pénétration dans le monde rural. Le
contrôle du monde rural aurait pu leur apporter un avantage
décisif pour s’assurer la main mise sur le pouvoir, sans avoir à
tenter une épreuve de force. De son côté, le Palais avait pour
objectif d’empêcher la réussite de cette manœuvre. En second
lieu, il cherchait à faire alliance avec les élites locales, sans pour
autant se compromettre, ce qui aurait été le cas s’il avait
accepté la confirmation des caïds en place lors de
l’indépendance. Dans ce débat, les arguments techniques ont
des conséquences politiques que les partenaires pressentent
mais n expriment que rarement.
Le protectorat n’avait pas de procédure définie pour 1 élection
des membres des jemaas administratives. Les dahirs de 1951 et
1954 laissaient le soin aux autorités de contrôle d’organiser ces
élections en ayant recours aux procédures coutumières de
désignation des membres de jemaas. Suivant les régions, ces
procédures traditionnelles étaient plus ou moins influencées
par le juridisme de l’administration française.
Des élections avaient cependant lieu pour la désignation des
membres marocains des commissions municipales, des
Chambres d’agriculture et de commerce, ainsi que pour la
représentation de ces assemblées au sein du Conseil de
gouvernement. Certaines coopératives agricoles élisaient
également, avant l’indépendance, les membres de leur conseil
d’administration. Ce corps électoral restreint (12 000 personnes
en 1947)[24] avait permis l’élection, en 1948, de membres de
l’Istiqlal représentant la bourgeoisie urbaine au Conseil de
gouvernement. Le protectorat, qui avait pensé les entraîner
dans une politique de collaboration à des réformes
économiques dont le but était de dissocier la bourgeoisie
marocaine du Palais, ne supporta pas, en 1950, la critique des
représentants de l’Istiqlal. On se souvient des incidents qui
opposèrent violemment, au Conseil de gouvernement, le
général Juin à Mohamed Lyazidi et Mohamed Laghzaoui[25].
La Résidence voulut, alors, étendre le droit de suffrage. Elle
jugeait le suffrage restreint trop favorable aux bourgeois
nationalistes. Un dahir du 20 mars 1951 fit passer l’électorat
marocain des Chambres de commerce à plus de 100 000
personnes, en y incorporant les commerçants patentés des
petits centres, pour noyer dans la masse les commerçants des
grandes villes qu’un nouveau sectionnement électoral
défavoriserait. De même l’électorat des Chambres d’agriculture
passa de 8 000 à 220 000 personnes.
Les élections devaient se dérouler au scrutin de liste avec
sectionnement. Mais l’Istiqlal n’accepta pas cette fois de jouer
le jeu électoral, comme en 1948, et préconisa le boycottage des
élections. Cette tactique peut tout aussi bien s’expliquer par
l’évolution d’un climat politique plus tendu entre la Résidence,
le Palais et les nationalistes, que par l’inquiétude de ces
derniers sur le résultat du scrutin, surtout en milieu rural. Ces
rappels montrent que la Résidence avait déjà songé à utiliser le
jeu électoral dans sa stratégie politique. Elle avait pressenti que
l’extension du suffrage, surtout en milieu rural, aurait pu servir
à équilibrer l’influence des nationalistes. Mais elle ne faisait
cependant pas assez de concessions pour que ces derniers
acceptent de jouer le jeu de la confrontation.
D’emblée, le Maroc indépendant optera pour le suffrage
universel sans restriction de sexe ou d’instruction. L’Istiqlal ne
peut pas, au nom de ses principes, demander des limitations au
droit de suffrage qui l’avantageraient, et le Palais a l’habileté de
jouer le jeu démocratique, pressentant le parti qu’il pourra tirer
du suffrage universel. Mais les premiers projets de
l’administration marocaine s’inspirent de la codification des
pratiques des jemaas administratives mises dans une forme
juridique moderne. Chaque douar ou village devra désigner
deux délégués au Conseil. Le découpage des communes du
protectorat n’avait pas été formellement remis en cause à cette
date, le système aurait donc pu fonctionner dans des
conditions acceptables[26]. Avec l’accord du ministre de
l’intérieur, le gouverneur de la province de Casablanca,
Abdelhamid Zemmouri, avait procédé de cette façon au
renouvellement officieux des conseils communaux de sa
province[27]. Il avait ensuite désigné comme chioukh les
présidents élus de ces conseils.
Le roi et le prince héritier semblaient alors favorables àdes
élections rapides. Mhammedi était désireux de leur donner
satisfaction, mais les services du Ministère de l’intérieur étaient
moins pressés de s’engager. Une note de la Direction des
affaires administratives, en date du 11 avril 1957, fait état des
difficultés techniques et des risques politiques que
comportaient des élections entreprises à la hâte. Les premiers
sondages auprès des gouverneurs sont peu encourageants,
notamment dans les provinces du Nord, dans l’Oriental et dans
le Sud. Les gouverneurs parlent des réticences de la
population : ils craignent, ainsi que leurs subordonnés, de se
voir accusés de partialité, si leur conduite n’est pas définie par
des textes très précis[28]. Un projet de texte s’inspirant de la
législation communale française est mis en chantier par la
Direction des affaires administratives, mais il n’est pas prêt
aussi tôt que l’aurait souhaité le Palais. Dès cette époque,
Mhammedi marque, pour des raisons de simplicité
technique[29], une certaine préférence pour le scrutin
uninominal. Lorsque le projet est à nouveau discuté au Conseil
des ministres, en juillet, une opposition se manifeste entre les
ministres Istiqlal partisans d’un scrutin de liste majoritaire qui
devait assurer le triomphe de leur parti, et les ministres des
partis minoritaires qui préfèrent le scrutin uninominal. Le
Palais semble aussi pencher pour cette solution, mais
Mohammed V estime qu’il est trop tôt pour trancher.
Le prince héritier propose alors que l’on procède à de larges
consultations et que 1 on fasse notamment appel à ses anciens
professeurs de droit public, Maurice Duverger et André de
Laubadère. Le ministre de l’Intérieur, heureux de gagner du
temps, accepte volontiers cette solution. Après une mission sur
place en octobre-novembre 1957, les deux jurisconsultes
remettent un rapport détaillé qui propose un système de
scrutin raffiné. En insistant au départ sur le caractère
administratif de l’élection, ils allaient dans le sens des vœux du
Palais. Mais leurs propositions prévoyaient aussi un scrutin de
liste majoritaire, corrigé pour les villes, qui pouvait satisfaire
l’Istiqlal. Pour les villes de plus de 100 000 habitants, un
système de division par quartier, suivant lequel une liste
minoritaire obtiendrait une représentation si elle atteignait la
majorité absolue dans quelques quartiers, introduisait un
correctif original. Dans les communes rurales, un
sectionnement allant jusqu’au scrutin uninominal aboutissait à
une combinaison originale des deux systèmes : scrutin
uninominal et scrutin de liste. Le Ministère de l’intérieur
retiendra l’articulation de ce projet dans son ensemble à
l’exception des propositions concernant les majorités partielles
dans les villes de plus de 100 000 habitants. Une circulaire du
11 février 1958 donnera aux provinces les grandes lignes du
projet de dahir en discussion, et fixera les instructions à suivre
pour préparer un sectionnement électoral. La chute du
gouvernement Bekkaï, en avril 1958, et les divergences sur
l’urgence d’un projet de loi sur les libertés publiques
retardèrent le moment du choix définitif d’un mode de scrutin.
L’affaire progressa peu sous le gouvernement Balafrej. Elle
revint d’actualité avec la constitution du gouvernement
Abdallah Ibrahim et le retour au Ministère de l’intérieur de
Driss Mhammedi assisté de Hassan Zemmouri comme sous-
secrétaire d’Etat chargé des élections.
Le roi restait attaché à l’idée du scrutin uninominal alors que le
nouveau gouvernement était divisé par moitié sur cette
question. Mohammed V entreprit alors de nouvelles
consultations, notamment auprès des partis politiques et des
gouverneurs. En dépit de leurs divergences[30], l’Istiqlal et
l’UNFP restaient favorables au scrutin de liste et voyaient le
problème des élections en des termes très proches[31]. Le 29 juin
1959, le ministre de l’intérieur consulte les gouverneurs sur le
mode de scrutin. Presque tous sont favorables au scrutin
uninominal, même ceux qui, comme le gouverneur de
Ouarzazate, Meknassi, étaient connus comme proches de
l’UNFP. A l’opposé, le commandant Ben Larbi, gouverneur d’Al
Hoceima, se prononce pour le scrutin de liste. Mais la majorité
des gouverneurs, ainsi que les directeurs des Affaires politiques
et de la Sûreté nationale sont favorables à un report du vote.
Pour eux, la population n’est pas prête. Ils craignent son
manque d’éducation politique et l’agitation que risque de créer
une propagande intense. L’opinion des gouverneurs semble
avoir influencé le roi et le ministre de l’intérieur. Ce n’est qu à
son retour d’un voyage en Suisse et en France que le roi fait
connaître sa décision, le 1er septembre 1959, en se prononçant
pour le scrutin uninominal.
Mhammedi explique cette décision, dans une conférence de
presse, le 11 septembre 1959 : « … Le choix du scrutin
uninominal — la commune urbaine et la commune rurale
étant divisées en circonscritions, lesquelles auront chacune à
élire un représentant — a été guidé par le souci d’enlever le
plus possible un caractère politique aux élections — que n’eût
pas manqué de donner un scrutin de liste — afin que l’électeur
puisse choisir le représentant le plus apte à défendre les intérêts
de la collectivité ». Quelques mois auparavant, Mhammedi
avait, au contraire, insisté dans un entretien avec la presse
étrangère sur le sens politique du scrutin (conférence de presse
du 25 mars 1959) :
« Les élections permettront, entre autres choses, de dégager
les différentes tendances politiques du pays. Nous sommes
un pays régi actuellement par le dahir sur les libertés
publiques. Ce dahir sur les libertés publiques permet, dans
un cadre large, de sauvegarder les principes qui constituent
le fondement de la société marocaine ; il permet à toutes les
tendances de se développer, de s’exprimer.
Malheureusement, pour le moment, tous les partis
politiques et toutes les tendances politiques ont tendance à
croire qu’ils représentent la majorité de l’opinion
publique ».
Le ministre de l’intérieur, qui avait commencé sa carrière
politique à l’Istiqlal, et avait montré, par la suite, quelque
sympathie pour l’UNFP, se fait, à partir de cette date, l’avocat
des thèses du Palais. Son revirement semble se situer entre ses
deux conférences de presse. Dans la première, il est nettement
favorable au principe d’élections politiques pluralistes, sans se
prononcer toutefois sur le mode de scrutin. Lors de la seconde,
il défend une tactique qui fait jouer les élites locales et non les
institutions. Elle devra permettre d’assurer l’alliance de la
monarchie et des notables et de confirmer ces derniers dans
leurs rôles sociaux et politiques.
Le retour des notables ne constituait plus une fatalité, mais
résultait d’un choix politique que l’on ne désirait pas éclaircir.
Une autre politique aurait été possible : s’appuyer sur les cadres
locaux des partis qui, depuis l’indépendance, s’étaient efforcés,
avec parfois quelque succès, de pénétrer les masses rurales. On
rencontrait à cette époque des permanences de partis sur les
souks, et les ruraux, surtout dans lès régions de l’ancien bled
Makhzen, où les institutions locales traditionnelles avaient
éclaté[32], étaient parfois séduits à l’idée de trouver là un
nouveau réseau d’appuis qui, pour obtenir de menus services,
leur permettrait d’échapper à l’emprise trop contraignante de
l’administration et des notables. Il n’aurait pas été impossible,
dans ces conditions, avec un mode de scrutin approprié,
d’institutionaliser cette emprise diffuse qui bénéficiait du
prestige de l’indépendance et donnait l’impression d’échapper
à l’atmosphère étouffante des rivalités locales.
L’habileté du Palais et l’évolution du jeu politique national
firent échouer ce plan. Le choix du scrutin uninominal
renforçait encore le caractère ethnique des communautés de
base, plus nettement affirmé pour les circonscriptions
électorales que pour les communes. Si le découpage des
communes a été fait avec soin sous le contrôle de
l’administration centrale, celui des circonscriptions électorales
fut beaucoup plus hâtif. Les instructions aux gouverneurs leur
prescrivaient de prendre comme base des critères
géographiques, économiques et, à la rigueur, ethniques. Mais,
en fait, le douar ou le groupe de douars « sont les seuls
éléments de référence dont disposent les agents de l’Intérieur
dans les communes rurales »[33]. Le travail put être achevé
rapidement, car il avait déjà été préparé sur la base des
instructions du 11 février 1958. Plusieurs provinces avaient,
alors, déformé l’esprit de ces instructions en multipliant dans
les communes les circonscriptions qui n’auraient à élire qu’un
candidat. Il est inutile de préciser que les solidarités éthniques,
que l’on voulait théoriquement éliminer au niveau de la
commune, jouent un rôle encore plus grand au niveau de ces
petites circonscriptions, où les jemaas font partie des
institutions réglant formellement ou non la vie de ces
communautés[34]. Leur intervention au moment de la
désignation des candidats apparaîtra aux électeurs et aux élus
comme tout à fait naturelle, et plus importante en quelque
sorte que le formalisme électoral que l’on observera cependant,
le moment venu, pour ne pas mécontenter les représentants
locaux du Makhzen.
Le choix du scrutin uninominal et sa mise en œuvre par
l’administration concourent au rétablissement d’un système
d’élites intermédiaires renouant avec le passé. Le roi joue un
rôle déterminant dans cette évolution, en utilisant au
maximum son pouvoir d’arbitrage, facilité par les partis qui
utilisent les mêmes méthodes pour atteindre des objectif
opposés.
La procédure suivie est un bon exemple des méthodes de
fonctionnement du système politique marocain. Le roi mène
de plus en plus le jeu en face de partis désorientés, mais sans
s’engager lui-même à fond. Il obtient ce qu’il souhaite en
opposant les tendances, en patientant, en multipliant les avis.
Mais la monarchie ne mise pas uniquement sur les élus. Elle
favorise la reconstitution, sous son contrôle direct, d’un réseau
administratif de base, lié à la population, et dont l’existence, le
moment venu, privera les élus d’une partie de leur rôle. Le
problème de la coexistence des élus et des échelons inférieurs
de la hiérarchie administrative se posera très tôt.
Ce sera en fait un faux problème, car administrateurs et élus
appartiendront tous deux au même groupe social. En créant
une sorte d’opposition fonctionnelle entre les deux réseaux de
soutien qu’elle se ménage au sein du monde rural, la
bureaucratie marocaine se retrouve dans une position de
contrôle et d’arbitrage qui lui avait échappé au lendemain de
l’indépendance.
Notes du chapitre
[1] La réglementation financière des communes rurales sera
fixée par un arrêté interministériel du 29 décembre 1956
mettant fin aux pratiques anciennes de gestion du budget
communal au moyen d’un compte chèque postal fonctionnant
sous la double signature du raid et du contrôleur civil. La
procédure de tutelle financière et de centralisation des
décisions au Ministère de l’intérieur est établie en dépit des
protestations des provinces. Mais les gouverneurs n’ont pas
l’autorité des anciens chefs de région pour résister aux bureaux
de Rabat.
[2] Les chioukh et les moqqademin ayant disparu en même
temps que les caïds du protectorat, les conseillers communaux
du protectorat sont souvent les seuls interlocuteurs ruraux que
rencontrent les nouveaux caïds pour les aider dans leur tâche.
[3] Il revoit et ratifie cependant, texte par texte, les
anciennes instructions administratives et comptables émanant
de la direction de 1 Intérieur, et laisse publier l’arrêté sur la
comptabilité communale préparé en application des textes du
protectorat.
[4] Ceux qui ont fiait des études en France ont été frappés
par les difficultés d’adaptation éprouvées par la société rurale
française à cause de structures archaïques. Les modèles de
comportement administratif acquis au cours de stages dans les
préfectures françaises les influenceront lorsqu’ils auront à
décider de la taille des communes rurales.
[5] L’ancien découpage administratif du protectorat en
régions, territoires, cercles, postes et annexes sert de base au
nouveau découpage provincial, à quelques exceptions de détail
près.
[6] Scalabre était souvent le seul membre de la commission à
bien connaître le passé des groupements qui donnaient
naissance aux nouvelles communes. Cela ne l’empêchait pas de
proposer souvent des solutions plus fonctionnelles que celles
qui étaient retenues en définitive.
[7] En prenant cette décision suivant les recommandations
de la direction des Affaires administratives, contre les mises en
garde de la province de Mhammedi semble surtout avoir été
sensible à la possibilité de lancer un programme de
développement dont toutes les ressources ne proviendraient
pas de l’Etat.
[8] L’action du colonel Verlet constitue l’exemple type de
cette atmosphère de passation des consignes et de quasi-
complicité existant souvent entre l’ancienne et la nouvelle
administration.
[9] Comme l’auteur le souligne plus loin, le raisonnement
individuel n’a, dans ce cas, aucune valeur. L’opinion d’un
notable n’a d’autorité que si elle est formulée après une série
d’échanges sociaux que l’intéressé doit observer s’il voit
conserver son statut.
[10] Voir A. Lahlimi, Les collectivités rurales traditionnelles et
leur évolution, Rabat, Etudes sociologiques sur le Maroc, 1971.
[11] Dans le cercle de Boulemane, la commune de Ksabi
correspond exactement à l’habitat des chorfa de Ksabi.
[12] En des termes assez comparables à ceux que nous avons
analysés plus haut à propos de la province de Fès.
[13] Le choix d’un découpage correspondant aux
complémentarités de l’ancien mode de production a été fait
dans chaque cas délibérément par les nouvelles autorités
marocaines.
[14] Ces communes ne disposent plus de budget
individualisé. La gestion de leurs finances est faite à l’échelon
provincial. Voir T. Garcia Flgueras, R. de Roda Jiménez,
Economia social de Marruecos, Madrid, Instituto de estudios
africanos, 3 volumes, 1950-1955.
[15] Selon G. Surdon, Institutions et coutumes des Berbères du
Maghreb, Tanger, Les Editions internationales, 1936, p. 167, « il
existe généralement un souk par tribu. On retrouve mugri dans
le plan économique le principe de consanguinité. On est donc
autorisé à définir le souk : l’expression économique de la
consanguinité ». Voir aussi J.-F. Trouin, « Observations sur les
souks de la région d’Azrou et Khenifra », Revue de géographie du
Maroc, 3-4, 1963, p. 109-121. L’auteur tendrait à Caire ressortir
l’importance des souks régionaux par rapport aux souks de
fraction et de tribu qu’il estime en voie de dépérissement. Dans
les souks qui coïncident avec le siège d’une commune rurale,
l’attrait administratif vient renforcer une activité économique
peu florissante.
[16] Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1949, p. 125.
[17] Voir la description réaliste de la procédure de
délimitation des circonscriptions électorales par des agents d
autorité peu avertis de la topographie et de la cartographie,
interprétant tant bien que mal les indications des chioukh. Ces
cartes seront les seuls documents de base annexés à l’arrêté
ministériel fixant le découpage. Elles ne seront jamais publiées
à cause de leur imprécision. Dans la pratique ce seront aussi les
chioukh qui organiseront matériellement la consultation
électorale. Cf. L.-J. Duclos, Les élections communales marocaines
du 29 mai 1960. Des lois aux faits, Mémoire Cheam, Paris, 1962,
dactylographié.
[18] Comme par exemple dans les Beni Ouriaghel où l’on a
appliqué les mêmes principes.
[19] J. Berque, « Qu’est-ce qu’une tribu nord-africaine ? » in
Hommage à Lucien Febvre, Paris, Armand Colin, 1954, tome 1, p.
261-271. Voir aussi P. Pascon, « Désuétude de la jemaa dans le
Haouz de Marrakech », Les Cahiers de sociologie (Rabat), 1, 1965,
p. 67-77.
[20] Voir J. Couleau, La paysannerie marocaine, op. cit.
[21] Il ne s’agit pas d’une continuité de personne, qui existe
cependant dans de nombreux cas, mais d’une continuité de
groupe, comparable à celle que l’on a rencontrée au début du
protectorat ; cette continuité est réelle même si l’indépendance
a entraîné, sur la plan local, le remplacement d’une lignée par
une lignée rivale dans la représentation des groupes
traditionnels.
[22] M. Ben Barka, « Les conditions d’une véritable réforme
agraire au Maroc », in Réforme agraire au Maghreb, Paris,
Maspero, 1963, p. 127.
[23] Voir E. Gellner, « Patterns of tribal rebellion in
Morocco », in Vatitiokis, Revolution in the Middle East and other
cases studies, op. cit., p. 297-311.
[24] Voir R. Rézette, Les partis politiques marocains, Paris,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1955,
p. 40 à 49. S. Bernard, Maroc 1943-1956. Le conflit franco-
marocain, op. cit., p. 99. Les membres des Chambres étaient élus
au scrutin majoritaire à un tenir dans le cadre de
circonscriptions administratives élisant un ou plusieurs
candidats.
[25] Voir S. Bernard, Maroc 1943-1956. Le conflit franco-
marocain, op. cit., p. 107 et 117.
[26] On trouve trace de ce projet dans plusieurs numéros de
Al Istiqlal en date du 26 janvier, 2 février et 2 mars, et
également dans le Bulletin des anciens élèves du Collège d’Azrou
de janvier 1957 et février 1958. Les articles de Al Istiqlal ont été
préparés sous la direction de Ben Barka et ceux du Bulletin par
Hassan Zemmouri.
[27] En avril 1957 le ministre de l’intérieur lui demande de
faire établir d’urgence un projet de dahir reflétant son
expérience particulière.
[28] Comme les anciens caïds du protectorat, les
gouverneurs et leur subordonnés ne paraissent guère pressés de
partager leurs prérogatives. Ils sont aurai effrayés par une tâche
nouvelle et complexe.
[29] Et sans doute aurai par opportunisme politique.
[30] La scission entre les deux tendances du mouvement
nationaliste remonte à janvier 1959.
[31] Voir Al Istiqlal, 13-20 et 27 juin 1959 et L’Avant-garde du
28 juin 1959, qui publie une réponse de l’UMT, reprenant les
termes de celle de l’UNPF.
[32] Voir P. Pascon, « Désuétude de la jemaa dans 1e Haouz
de Marrakech », art. cité.
[33] Voir P. Chambergeat, « L’administration et le douar »,
Revue de géographie du Maroc, 8, 1965, p. 83-87.
[34] Avec plus de vigueur, il est vrai, dans l’ancien bled Siba
que dans les plaines.
Chapitre III. Priorité à la reconstitution du
réseau administratif local
La reconstitution du réseau
Pendant que les débats sur les élections communales
occupaient le devant de la scène politique et cristallisaient la
rivalité entre les partis et le Palais, ce dernier marquait des
points sur le terrain en favorisant la reconstitution d’un réseau
administratif de base qui intégrait à nouveau les élites locales.
Il aurait été dangereux de laisser le monde rural replié sur lui-
même et sans encadrement administratif. On a pu voir déjà
comment un sentiment d’abandon avait, dans les premières
années de l’indépendance, donné naissance à un
mécontentement politique s’exprimant par des révoltes. Il était
inconcevable cependant de revenir au système des caïds du
protectorat. La mise en place des élus tardait trop et ne
résoudrait qu’une partie des problèmes. La solution fut trouvée
empiriquement en ayant recours à un nouveau personnel
politique issu du même groupe social que les anciens caïds.
Le système des caïds notables était certes définitivement
condamné par leur participation à la déposition de Mohamed
V, en 1953. Soucieuse de son aspect moderne, l’administration
du Maroc indépendant ne pouvait pas se permettre d’utiliser
des agents qui vivaient officiellement de prélèvements sur les
populations qu’ils administraient. Les nouveaux caïds étaient
des fonctionnaires que l’on avait l’intention d’organiser sur le
modèle théorique du corps préfectoral français, et suivant la
pratique du Contrôle civil dont ils héritaient les postes
budgétaires, les bureaux et les villas. Mais si la prise en charge
de quatre cents fonctionnaires nouveaux ne posait pas de
problèmes insolubles, entretenir, ne fut-ce qu’avec de modestes
indemnités, deux mille chioukh et près de vingt mille
moqqademin présentait de nombreuses difficultés. Le coût de
la fonctionnarisation de ces agents aurait dépassé de très loin
l’ensemble des crédits du Ministère de l’intérieur. Il n’était pas
possible, cependant, de se passer de leurs services sans paralyser
l’administration locale. Seul un parti unique disposant de
cellules organisées sur tout le territoire et vivant en symbiose
avec l’administration aurait pu fournir une solution de
rechange efficace.
C’est vers ce modèle, dont l’organisation du Néo-Destour
tunisien pouvait assez bien donner l’image[1], que s’orientaient
les stratèges de l’Istiqlal, en particulier Ben Barka. Un essai de
ce type d’administration locale fut tenté dans les premiers
temps de l’indépendance avec les caïds issus de l’Istiqlal et de
l’Armée de libération. Mais les révoltes rurales de 1957 et 1958
donnèrent un coup d’arrêt à cette collaboration avec le parti
nationaliste. En fait, l’administration locale nouvelle ne
pouvait ni vivre de prélèvements sur la population rurale, ni
être entièrement fonctionnarisée, ni trop partisane. Cependant,
un compromis se dessina progressivement entre ces tendances
contradictoires, qui permit de faire appel à nouveau aux élites
locales, en les rémunérant partiellement en monnaie, et en les
soumettant au contrôle étroit d’une hiérarchie de
fonctionnaires.
Le problème de l’administration locale a été l’un des plus
délicats à résoudre dès les premiers mois de l’indépendance. Le
12 juin 1956, lors de la première réunion de gouverneurs
présidée par Mohamed V, dans plusieurs régions, la population
refuse les nouveaux caïds investis par le roi. Des délégations de
Taza, d’Oujda, du Tafilalt entre autres, viennent assiéger le
Palais et le Ministère de l’intérieur pour demander le
changement de leurs caïds. Ces derniers sont le plus souvent
nommés sur proposition des gouverneurs. Lorsqu’il s’agit
d’agents nommés directement par l’intérieur, comme dans le
Tafilalt, le gouverneur les refuse parce qu’ils sont étrangers à la
tribu. Mohamed V soutient le point de vue du ministre, tout en
évitant de condamner le gouverneur. Il apparaît dans le cours
du débat que, à la différence de Mhammedi, le roi ne récuse
pas le principe du recrutement d’administrateurs originaires de
la tribu, ou pour le moins soumis à son acceptation. Dans la
pratique, une solution va être trouvée progressivement au
problème des relais acceptés par la population, en modifiant le
statut des chioukh et des moqqademin, tout en évitant de
confondre leur rôle avec celui des conseillers et des présidents
de communes rurales.
Lors de l’indépendance, ces petits agents avaient été atteints
par le discrédit qui touchait l’administration caïdale, et
entraînés dans son effondrement. En nommant des caïds
fonctionnaires pour remplacer des notables, le gouvernement
marocain ne pouvait pas songer à fonctionnariser à un même
degré les agents locaux qui servaient de lien entre le caïd et la
population.
Après quelques mois d’isolement, variable suivant les régions,
les nouveaux caïds reconstituent progressivement un réseau de
chioukh et de moqqademin à peu près identique à celui du
protectorat. Ne pouvant plus tolérer la marge de prévarication
qui servait à rémunérer ces agents de façon quasi officielle, ils
ont recours à des candidats qui leur sont proposés ou
recommandés par les partis, en respectant plus ou moins les
procédures traditionnelles de désignation ou d’agrément des
groupements administrés. Très rares sont les anciens chioukh
repris par la nouvelle administration ; le phénomène est plus
fréquent pour les moqqademin. L’instabilité de ces agents
reflétera parfois les fluctuations politiques à l’échelle nationale.
Mais leur mode de recrutement et les fonctions qui leur sont
confiées montrent que l’on ne peut pas sortir du groupe des
élites locales si l’on veut conserver quelque efficacité à
l’institution.
Le rôle de ces petits agents est difficile à définir. Il est certain
qu’il dépasse de beaucoup l’excécution de tâches apparemment
mineures qui leur sont confiées par les caïds. Le cheikh est
souvent un homme déjà riche, gros agriculteur ayant
commencé à moderniser son exploitation par l’achat d’un
tracteur ou l’emploi des engrais. Il est souvent plus intéressé
par le statut social que lui procure sa fonction, que par les
revenus supplémentaires quelle lui rapporte. Le moqqadem est
aussi un notable local, mais de moindre rang.
Contrairement à l’hypothèse que l’on pouvait généralement
faire au début de l’indépendance, le rôle des chioukh et des
moqqademin s’est accru. En effet, les nouveaux caïds
n’appartiennent plus au groupe ethnique. Ce sont des agents
du Makhzen qui ont hérité des symboles d’autorité
bureaucratique des anciens contrôleurs civils. Fonctionnaires
d’origine citadine le plus souvent, ils ne restent pas dans le
même poste plus de deux ou trois ans. Ils font généralement
partie de la clientèle d’un gouverneur et se déplacent avec lui.
Ils occupent les logements et les bureaux des anciennes
autorités de contrôle ; ils ne sont donc pas toujours en contact
direct de la population. Certains caïds sont installés dans les
bureaux du cercle ou de la province pour administrer des
populations qui se trouvent parfois à plusieurs dizaines de
kilomètres de piste de leur siège. Les ruraux vont donc
s’adresser naturellement au cheikh et au moqqadem, installés
dans la tribu, qui les accueillent suivant les règles de
l’hospitalité traditionnelle et auxquels ils peuvent exposer en
confiance leurs problèmes.
D’autre part, l’administration marocaine nouvelle, avec son
caractère encore plus dirigiste que celle du protectorat,
multiplie les enquêtes et les commissions administratives. Ces
procédures, qui sont placées sous la responsabilité du caïd, sont
en fait mises en œuvre au niveau du cheikh, ou du moqqadem,
sans qu’aucun texte administratif ne règle leurs attributions.
Une description tant soit peu précise nous est donnée dans une
note de la province de Casablanca, daté du 17 janvier 1959, qui
recense les fonctions réelles du cheikh, exercées par délégation
du caïd :
« a. Attributions politiques ou concernant la police du territoire
Informer l’autorité locale.
Action de police administrative : souk, hygiène,
constructions, etc.
Participation au maintien de l’ordre.
b. Attributions administratives
Diffusion des lois, règlements et arrêtés s’appliquant à la
collectivité.
Enquêtes administratives de toute nature que lui confie le
caïd : pour l’établissement du certificat de résidence,
d’indigence, pour les allocations familiales, l’établissement
du bien de famille, etc.
Auxiliaires de la SOCAP et autres organismes de crédit :
confection des listes de prêts, intervention dans la
distribution et le recouvrement des prêts.
Auxiliaire de l’inspecteur des impôts ruraux : pour
l’établissement et le recouvrement du tertib.
Auxiliaire dans certains cas des services techniques :
informations, enquêtes, rassemblement pour le Génie rural
ou les Travaux publics.
c.Rôle d’auxiliaire de la justice
Remise des plis de justice, notifications, avertissements, etc.
Auxiliaire de la justice : transport du tribunal
d’immatriculation, enquêtes à lui confiées par le juge du
Sadad sous couvert du caïd ».
On comprend que le cheikh se soit vu reconnaître, dès 1956, le
rôle d’agent de l’Etat, et attribuer, en compensation des
redevances traditionnelles qui lui étaient supprimées, une
indemnité de 250 dirham par mois[2]. Sans lui, les caïds ne
pouvaient pas accomplir leur tâche, ni surtout être renseignés
sur la situation politique, économique et sociale de leur
circonscription. Au nombre d’environ deux mille pour tout le
pays, les chioukh jouent auprès des agents locaux du Ministère
de l’intérieur un rôle comparable à celui des anciens caïds
auprès des contrôleurs civils. Suivant la tradition, ils sont
proposés en principe par les jemaas de fraction[3]. Leur
nomination est officialisée par une décision du gouverneur
prise sur proposition du caïd. Une fois désigné, le cheikh reste
en fonction tant qu’il garde la confiance de ses administrés et
de ses supérieurs. Sa révocation n’est généralement décidée
qu’après l’intervention du ministre de l’intérieur sur rapport du
gouverneur ou du cabinet royal, saisi de l’affaire par des
délégations de notables venant se plaindre directement à
Rabat. Parfois même, le souverain, en personne, intervient
pour régler une affaire de révocation ou de remplacement d’un
cheikh.
L’annonce des réformes communales a posé le problème de la
coexistence du cheikh et du président de commune, en
particulier lorsque les nouvelles communes correspondaient
exactement à une fraction. Comme une lutte d’influence
risquait de naître entre le cheikh et le président — chacun
s’efforçant de se constituer une clientèle et de capter l’attention
exclusive de l’administration — la plupart des gouverneurs
étaient favorables à une fusion des deux fonctions. Certains
avaient même commencé, dans la province de Casablanca par
exemple, à faire élire officieusement les chioukh, et quelquefois
à leur confier la présidence des communes instituées par le
protectorat. Une évolution empirique se dessinait, qui tendait à
faire élire les chioukh dans le nouveau système communal avec
le consentement des populations et de l’administration locale.
Mais un dahir du 5 mai 1960, proposé par l’Istiqlal, vient
bloquer cette évolution qui annule les candidatures des
chioukh et des moqqademin, et crée un vif mécontentement
en milieu rural. Ainsi on laisse subsister deux réseaux parallèles
à l’échelon communal, privant la réforme communale d’une
partie de son sens. La tutelle du caïd sur les communes assure
en fait la prééminence des chioukh sur les présidents. Leur
indemnité de fonction et leur association étroite aux tâches du
Makhzen leur garantissent, auprès des administrés, un prestige
supérieur à celui des élus.
Cette évolution au niveau de la fraction est complétée par la
reconstitution, sous des formes encore plus proches de celles
du protectorat, du réseau des moqqademin, servant de relais à
l’action du cheikh et du caïd jusqu’au niveau du douar ou du
groupe de douars.
Le statut du moqqadem est encore plus imprécis que celui du
cheikh. Son mode de recrutement et ses attributions varient
d’une province à l’autre. C’est à son niveau qu’aboutissent
toutes les actions et toutes les pressions administratives. Il ne
peut rejeter sur aucun subordonné ses responsabilités réelles ou
les carences de ses supérieurs. Au contact direct de la
population, sa situation manque de confort et de garanties. Son
seul avantage est de se faire offrir des compensations assez
nombreuses et traditionnellement tolérées, aussi bien par la
population que par la hiérarchie administrative.
Suivant une procédure comparable à celle utilisée pour les
chioukh, les moqqademin sont nommés par arrêté de caïd,
après avoir été désignés par la jemaa du douar et proposés par
le cheikh. Leur révocation n’est généralement décidée qu’après
consultation de la province. Leur fonctionnarisation, même
partielle, serait une charge trop lourde pour l’Etat. On
comptait, en effet, près de vingt mille moqqademin en 1957, et
le coût d’une allocation, même modeste, de 50 dirham par
mois, se chiffrerait à 12 millions de dirham, soit un coût
supérieur à celui de tout le personnel administratif des
provinces et préfectures.
En 1958, une note du Ministère de l’intérieur, établie avec le
Ministère des finances, pour discuter la situation de ces agents,
décrit ainsi leurs attributions[4]:
« Le rôle du moqqadem :
Dans un cheikhat, les moqqademin sont les auxiliaires des
chioukh, leurs agents d’exécution, à l’échelon du douar. Par
ailleurs, ils sont censés renseigner le cheikh ou le caïd sur
tous les aspects de l’activité de douar ayant une incidence
administrative, économique et même politique.
Si l’on considère que la vie en tribu conserve un caractère
fortement collectif, et que la plupart des ordres et directives
s’y transmettent par voie orale, le cheikh privé de
moqqademin ne pourrait pas faire grand-chose.
Le moqqadem est en quelque sorte le représentant et le
responsable du douar — ce qui implique que la population
doit lui faire confiance.
Faute de facteurs ruraux, le moqqadem est chargé de
remettre à leurs destinataires tous les plis privés ou
administratifs.
Il assure le travail de prérecensement du tertib, aidé de
quelques hommes de confiance. C’est une responsabilité
sérieuse, puisque ce travail sert de base à l’établissement de
l’assiette de l’impôt.
Il assistait, si besoin était, aux audiences de justice lorsque
les caïds détenaient le pouvoir judiciaire. Là où le juge-
délégué est compétent, il est souvent chargé par celui-ci de
fournir des renseignements sur les litiges ou les parties. De
même, les services de la police et de la gendarmerie ont
fréquemment recours aux moqqademin dans leurs
enquêtes.
A cela s’ajoutent diverses activités et responsabilités qu’il est
difficile de circonscrire car elles sont occasionnelles (la lutte
contre les acridiens en est un exemple).
Toutes ces charges sont assurées sans statut, sans traitement
et sans garanties ».
Il est impossible de se priver de cet agent sans compromettre le
fonctionnement de la machine administrative. Mais on ne peut
continuer à le laisser officiellement exploiter la population,
même en limitant le montant de ses prévarications à un taux
supportable. Le Ministère des finances accepte de prévoir
l’indemnisation des moqqademin à condition que leur nombre
soit officiellement réduit[5] et que leur salaire reste modeste. A
la suite de ces discussions, un accord intervient, en 1958, pour
la prise en charge de sept mille agents, répartis de façon inégale
suivant les provinces[6]. Le nombre fixé était tout à fait
insuffisant pour assurer l’encadrement des campagnes et
l’exécution de multiples tâches administratives. Aussi, en 1960,
un rapport de la province de Fès dresse le bilan de la réforme :
« Moqqademin :
Le nombre de ces agents est nettement insuffisant. La
majorité menace journellement de démissionner. Si l’on se
penche attentivement sur leur sort, on s’apercevra qu’ils
n’ont pas tous les torts. En effet, l’indemnité allouée à un
moqqadem n’est que de 50 Dh actuellement. On est
souvent porté à croire qu’un moqqadem n’est pas
intégralement absorbé par ses attributions et que, par
conséquent, il peut s’occuper d’autre chose, comme par
exemple labourer et moissonner ses biens. C’est là une
fausse conception car, avec le travail qu’il a journellement à
faire, un moqqadem n’a guère le temps de s’occuper de ses
propores affaires. Actuellement, un moqqadem contrôle en
moyenne de huit à douze douars. Quand on pense que la
plupart des douars sont distants entre eux de huit à quinze
kilomètres et parfois plus, on peut s’imaginer un peu toute
l’activité que doit déployer un moqqadem. La situation de
tous ces représentants locaux mérite d’être reconsidérée à
tous les points de vue (augmentation de l’effectif et
amélioration de la solde). Continuer à l’ignorer ne pourrait
avoir que des répercussions fâcheuses sur le
commandement local qui parfois n’apporte pas tout le
concours désirable à la liquidation des affaires courantes,
notamment des créances de l’Etat ».
Le problème ne pourra être partiellement résolu, sur le plan
financier, que par des pratiques extra-légales. A nouveau
certains prélèvements des moqqademin seront tolérés non plus
sur les redevances dues par la population, mais sur les
distributions de denrées d’origine américaine faites par
l’Entraide nationale, ou sur les paiements en nature ou en
argent des chantiers de la Promotion nationale.
L’administration pourra ainsi disposer, à côté de l’encadrement
officiel, d’un nombre suffisant d’agents officieux nécessaires au
maintien de l’ordre et à la rentrée des impôts. Il lui restera à
trouver, comme pour les chioukh, un modus vivendi entre son
réseau administratif et les élus locaux.
Certaines attributions du moqqadem sont appelées à
disparaître à mesure que l’administration moderne étendra et
différenciera ses activités. Il en est ainsi de ses responsabilités
en matière d’ordre public, du port des lettres et plis
administratifs, qui reviendront à la gendarmerie ou aux
services postaux. Le principe de la responsabilité collective
pour l’exécution des lois et règlements est théoriquement
abandonné.
En fait, le rôle de surveillance politique de la population n’a
fait que s’accroître depuis l’indépendance. Aucun étranger au
groupe dont ils ont la responsabilité ne peut y séjourner, y
travailler, parler à la population sans que le moqqadem ne soit
prévenu. Ces informations sont rapidement portées à la
connaissance du caïd qui surveille non seulement les activités
des partis politiques, mais aussi celles des représentants des
autres administrations. Leur rôle s’est accru en matière
électorale. Ils collaborent à l’inscription sur les listes électorales,
organisent les bureaux de vote, en assurent le service d’ordre et,
parfois, la présidence. S’ajoutent, parfois aussi, une
participation officieuse à la propagande de candidats
gouvernementaux, et des interventions dans le choix des
candidatures aux élections locales.
Avant les premières élections communales, le gouvernement
marocain a donc reconstitué un réseau administratif de base
remplissant une large part du rôle social et politique qui devait
appartenir aux élus. Il s’est efforcé certes de rompre avec les
pratiques de l’ancien régime, en fonctionnarisant
progressivement des agents — leur prise en charge par l’Etat
croissant avec leurs responsabilités. Mais les pratiques
anciennes de dons plus ou moins forcés ou. de prélèvements
tolérés se maintiennent lorsqu’on s’éloigne du pouvoir central.
Ces petits notables sont les relais nécessaires de l’action des
trois cents caïds et des quatre-vingts chefs de cercle qui
constituent l’armature de l’administration des provinces. Les
retards et les tergiversations rencontrés dans l’élaboration du
statut communal ont donc encouragé l’administration à
reconstituer un réseau de base comparable à celui du
protectorat[7]. Pour remplacer les anciens chioukh et
moqqademin on a, à nouveau, fait appel à des notables
désignés suivant des procédures traditionnelles, qui assurent,
sauf exception, l’accord des populations. De leur côté, les
nouveaux élus sont souvent d’anciens chioukh ou
moqqademin du protectorat, ou des membres de leur famille.
On constate enfin, au cours des années, que l’administration
désigne souvent comme chioukh ou moqqademin les
présidents ou conseillers communaux. Leur élection prouve le
consentement de la population, et leurs contacts avec l’autorité
administrative leur donne l’occasion de se faire apprécier. Par
ailleurs, si la population est associée à la désignation des
délégués de l’administration, les caïds et les chioukh jouent, en
1960 et encore plus en 1963, un certain rôle dans les élections
locales.
La ligne de partage entre les deux groupes est donc assez floue.
Il n’en reste pas moins que les représentants locaux de
l’administration jouissent d’un prestige supérieur à celui des
élus. Depuis 1960, l’association des notables au pouvoir a su
prévenir efficacement les désordres ruraux. L’évolution des
campagnes continue, cependant, à poser des problèmes que le
pouvoir central ressent, sans avoir les moyens ou la volonté
réelle de les résoudre.
Le renforcement de l’emprise des élites locales sur
l’administration a été officiellement accentué, en 1960, pour
combattre l’influence, jugée pernicieuse, des partis. Sans aller
jusqu’à abandonner l’idée du caïd fonctionnaire, cette
« réforme » du corps des agents d’autorité fut l’une des
premières tâches auxquelles s’employa l’ancien Premier
ministre Bekkaï, nommé au Ministère de l’intérieur dans le
gouvernement formé sous la présidence de Mohamed V, le 29
mai 1960. Au cours d’une réunion de gouverneurs, en majorité
des agents récemment désignés par le nouveau gouvernement,
Bekkaï définit, le 20 août 1960, les règles qui doivent inspirer le
recrutement des nouveaux caïds : « En premier lieu, il ne doit
plus exister d’agents d’autorité ignorants… En second lieu, le
choix des agents ne doit pas être influencé par des
considérations politiques… Enfin, le recrutement local est
préférable, dans la mesure où l’on trouve des éléments qui
répondent aux conditions exigées : instruction minima,
compétence, intégrité. Cela facilitera leur travail en raison de
leur connaissance des problèmes locaux[8] ».
Ces orientations sont confirmées par une circulaire du 17
septembre 1960 faisant état d’instructions expresses du roi
pour épurer le corps des agents d’autorité de tous ceux qui
seraient soupçonnés de sympathie à l’égard des partis
politiques. Les caïds connus pour leur sympathie à l’égard de
l’Istiqlal, de l’UNFP ou de l’Armée de libération vont être
éliminés[9]. Certains gouverneurs vont utiliser cette procédure
pour se constituer une clientèle personnelle et familiale[10]. La
plupart des gouverneurs recherchent les candidats les plus
valables sur le plan local, en s’efforçant de concilier, chez eux,
une formation moderne avec une certaine audience en milieu
traditionnel. Le ministère limitera son rôle à filtrer les
propositions et à suggérer des noms lorsqu’aucun candidat
répondant à ses vœux ne se trouvera pas sur place. Les postes
vacants ne seront pas tous pourvus, surtout dans les provinces
montagneuses ou pré-sahariennes.
Suivant les régions, le pourcentage de caïds recrutés sur place
variera de 20% à 50% ; les élites locales trouvent donc là une
occasion de participer au pouvoir dans des conditions plus
attrayantes qu’au sein des conseils communaux.
La reprise en main du ministère par le président Bekkaï s’est
donc traduite par d’importants changements de personnels, à
la fin de l’été 1960. Les nouveaux agents d’autorité ont certes
été proposés la plupart du temps par les gouverneurs, mais non
sans filtrages successifs. Le ministre connaissait bien les
campagnes, et venait, pendant l’année écoulée, de parcourir, de
nombreuses régions du Maroc pour regrouper les anciens
combattants. Il avait pu, ainsi, entendre leurs doléances sur les
caïds. Ses amis du Mouvement populaire, Ahardane et le Dr
Khatib, donnèrent aussi un avis déterminant sur les candidats,
ainsi que sur les nominations de chioukh faites par les
provinces.
Il était souvent facile de justifier la mise à l’écart des anciens
agents pour incompétence ou prévarication. Suivant une
enquête faite en juillet 1960 par le Ministère de l’intérieur, on
comptait sur 395 caïds et chefs de cercles, 23 illettrés, 57 agents
n’ayant que quelques rudiments d’instruction en arabe, et 135
ayant un niveau d’études primaires. Une centaine d’agents
seulement, en premier lieu les chefs de cercle, avaient un
niveau d’études dépassant le CEP. Enfin, quatre-vingts postes
restaient vacants, principalement dans le Rif et dans les régions
pré-sahariennes. Le nouvel encadrement améliorera la situation
mais sans assurer à l’administration locale le même niveau de
recrutement qu’aux administrations centrales. Le défaut sera
compensé, chez la plupart des agents, par une familiarité
certaine avec le milieu rural leur permettant de tirer le meilleur
profit possible de leurs adjoints locaux.
Pour illustrer cette réintégration des élites locales dans le réseau
de l’administration, on peut citer l’opinion de jeunes ruraux
telle que nous la révèle une enquête effectuée plus de dix ans
après l’indépendance[11]. Pour ces jeunes, l’Etat, le Makhzen, tel
qu’ils le perçoivent dans leur univers quotidien, c’est d’abord
les autorités locales. Lorsqu’on les interroge sur ces autorités
locales, les deux tiers des réponses citent le cheikh et le
moqqadem, un tiers seulement le caïd et ses adjoints dont ils
ressentent la présence comme plus lointaine. De plus, pour ces
jeunes ruraux, les « représentants de la population », c’est-à-
dire avant tout les conseillers Communaux, auxquels s’ajoutent
les naïbs des terres collectives et les présidents de coopérative,
sont perçus comme des représentants du Makhzen. Les auteurs
résument ainsi l’opinion des enquêtés :
« Nos interlocuteurs ne sont pas abusés par les titres, les
mots ou la forme : ils classent les notables issus de leur
village comme des représentants de l’Etat. Ce qui est réaliste
dans la mesure effectivement où bien souvent ces notables
ayant tendance à représenter leur propre intérêt individuel
avant ceux de la population qu’ils sont censés représenter,
reviennent des réunions chez le caïd en disant, le Makhzen
a décidé que… Vous devez faire telle chose. Le contact Etat-
administrés se fait non entre le caïd et les représentants
mais, soit directement entré le caïd et la population, soit
plus généralement entre les notables et la population ».
Ainsi se dessine aux yeux des jeunes ruraux un dualisme entre
un Etat formel, modernisateur, dont on attend tout, auquel on
est prêt à répondre avec enthousisame et « le Makhzen réel au
village : cheikh et moqqadem, notables traditionnels qui
détiennent directement le pouvoir sur la population, et pour
cette dernière catégorie, la prudence retient mal de violentes
poussées de critiques » (enquête de P. Pascon et M. Bentahar).
Le bilan de cette réintégration des élites locales dans le réseau
administratif n’est donc pas entièrement positif. On peut
cependant estimer qu’il a permis à l’Etat d’éviter les révoltes
rurales qui se dessinaient avec souvent une coloration
régionaliste dans les premières années de l’indépendance.
Maintenir les élites locales en dehors du système aurait pu
raviver ces révoltes. Au lieu d’exploiter les conflits, les notables
les atténuent, avertissent les autorités, ménagent les
compromis.
Au passif du système il faut tout d’abord inscrire le coût de
l’opération. Egal ou même supérieur à celui de l’administration
locale du protectorat, il semble réparti de façon différente.
D’une part, la fonctionnarisation partielle accroît la
dépendance directe du réseau des élites locales de
l’administration caïdale. Les prélèvements complémentaires, au
lieu de porter, comme sous le protectorat, sur les revenus
agricoles, portent plutôt sur des revenus distribués par l’Etat,
d’origine nationale ou en partie étrangère, comme les denrées
de l’Entraide nationale ou de la Promotion nationale. Cette
situation constitue un moyen de pression supplémentaire pour
les représentants de l’Etat qui peuvent toujours disposer de
preuves pour traduire en justice un notable qui refuserait sa
collaboration. Si le système est certainement plus coûteux que
celui du protectorat, le coût a été déplacé vers le pouvoir
central, et accessoirement vers l’étranger qui supporte
indirectement les organismes d’aide au monde rural.
La population rurale n’est pas pour autant entièrement
satisfaite du système. Pour les jeunes ruraux, nous l’avons vu,
les élites locales collaborant avec l’administration n’étaient
composées que d’ignorants et de corrompus. Il y a là un conflit
en puissance, dans la mesure où un nombre croissant de
jeunes, passés par les écoles primaires, supporteront mal la
tutelle paternaliste de ces notables d’un autre âge. Un autre
conflit potentiel, dont nous examinerons les raisons plus loin,
provient du fait que les seules interventions possibles de la part
de l’Etat sont celles qui ne bouleversent pas les avantages
acquis par les élites locales, ou mieux encore celles qui
renforcent leur situation. Or, cette situation risque de freiner
tout développement de la production agricole — ou de ne pas
permettre un type d’action répondant à la poussée
démographique du monde rural.
L’encadrement des élus
Les élections communales du 29 mai 1960[12] ont doté le pays,
du jour au lendemain, de dix mille conseillers communaux
dont les partis revendiquèrent l’affiliation, en dépit de
l’apolitisme officiel du scrutin proclamé par le ministre de
l’intérieur, Driss Mhammedi. Reprenant cette fiction, son
successeur, le président Bekkaï, ne proclama aucun résultat
politique de la consultation. Mais on pouvait savoir, par les
rapports des gouverneurs, que l’Istiqlal avait remporté plus de
40% de sièges, et comptait, en son sein, la majorité absolue des
présidents. L’UNFP n’avait que 23% des sièges. Son succès était
surtout marqué dans les villes du littoral et, accessoirement,
dans quelques provinces rurales du Sud du pays dont
l’émigration s’orientait vers Casablanca. Le Mouvement
populaire ne comptait que 7% des élus concentrés dans des
régions berbères. Mais, en dehors de ces partages d’influence
encore incertains, tout les observateurs officiels s’accordent à
reconnaître que les élus proviennent, dans leur très grande
majorité, du groupe des élites locales. Il est très rare de voir
figurer parmi eux un paysan sans terres ou un ouvrier agricole.
La richesse s’accroît généralement lorsqu’on passe des
conseillers aux présidents. De nombreux anciens caïds,
chioukh et moqqademin écartés du pouvoir local en 1956, ont
pris leur revanche aux élections de 1960. L’appartenance
politique réelle ou supposée des élus a souvent moins
d’importance que les rivalités parfois intenses entre ces Capulet
et Montaigu dont l’un occupe les fonctions de cheikh et l’autre
celles de président du conseil communal. Elles créent plus de
problèmes aux autorités administratives que les affiliations
partisanes. Mais elles leur permettent aussi d’utiliser ces
divisions pour mieux contrôler les élites locales et ne pas
dépendre d’un seul réseau dans leurs contacts avec la
population.
Dans la pratique, les ruraux classent[13] chioukh, moqqademin
et élus parmi les représentants locaux du Makhzen, mais la
rivalité n’en est pas moins grande entre les deux groupes
d’élites locales. Les textes organisant les communes, par leurs
réticences ou leurs silences, ont pour ainsi dire créé le conflit.
Une compétition inévitable entre élites locales pour les
ressources difficilement extensibles de l’agriculture
traditionnelle en expliquerait le caractère implacable, plus que
ne le feraient des divergences politiques sur des problèmes
nationaux. L’administration du Maroc indépendant a-t-elle
intérêt à jouer sur ces rivalités, comme le faisait volontiers celle
du protectorat ?
Le cadre juridique mis en place, les tutelles et les obligations
étaient faites pour ôter toute initiative politique aux conseils
communaux élus le 29 mai 1960. Les dahirs du 1er septembre
1959 et du 23 juin 1960 prévoient bien des conseils
communaux élus au suffrage universel et jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie financière[14]. Ces
conseils élisent à leur tour librement leur président et leur
bureau. Ils disposent de vastes pouvoirs de gestion des affaires
de la commune, tout en restant soumis à la tutelle du Ministère
de l’intérieur représenté par l’autorité locale. L’architecture
d’ensemble s’apparente étroitement au système communal
français de la loi de 1884. Mais le fonctionnement réel des
institutions est tout autre. Le président ne dispose ni du
pouvoir de police, ni du pouvoir réglementaire qui reste entre
les mains du caïd ou du pacha. De plus, et bien que ce point ne
figure pas dans les textes législatifs, il ne contrôle pas
l’administration communale qui reste sous l’autorité du caïd. Il
ne peut entrer en contact avec les autres services de l’Etat dont
le concours lui est nécessaire, comme les Travaux publics ou les
services chargés de l’équipement rural, qu’en passant par le
caïd[15]. Ce dernier dispose donc d’un pouvoir beaucoup plus
étendu que celui du président. En outre, l’administration
communale se limite souvent à un commis du caïdat qui assure
le secrétariat de plusieurs communes en plus de son travail
administratif normal, moyennant une légère indemnité. Les
crédits de la commune sont gérés par le régisseur comptable du
cercle, qui souvent établit le budget. Ainsi, l’administration
communale reste entre les mains du Ministère de l’intérieur.
D’autres fonctionnaires, les instituteurs en particulier, auraient
pu aider les présidents des conseils communaux, mais toute
solution qui aurait risqué de diminuer l’autorité du caïd a été
volontairement écartée[16]. Son pouvoir est encore accru : il
exerce de plein droit les fonctions d’officier d’état civil et
d’officier de police judiciaire dans les communes placées sous
son commandement. Le rôle du conseil, communal se trouve
donc réduit à celui d’un conseil consultatif chargé d’aider le
caïd à établir un budget communal souvent insignifiant, et à
contrôler la gestion. Il se réunit peu pour délibérer, au plus
deux ou trois fois par an, dans un bureau du caïdat, le plus
souvent pour entériner les propositions de l’autorité
administrative locale.
Si les textes pouvaient laisser un espoir de voir les communes
disposer de quelque autonomie, les instructions aux
gouverneurs, en date du 6 août 1960, affirment une conception
de la tutelle inspirée d’un juridisme centralisateur de pure
tradition française. Ces instructions replacent le dahir sur
l’organisation communale dans l’héritage législatif du
protectorat dont les textes sur les municipalités, les centres
autonomes et les communes rurales sont présentés comme les
étapes d’une évolution aboutissant au texte de 1960 : « Pour les
communes rurales, le nouveau statut n’amène pas de profonds
changements… Le caïd a, dans son commandement, deux ou
trois communes qui ne disposent d’aucun appareil
administratif, celui-ci étant concentré aux caïdats. Les rapports
entre le caïd et le président devraient donc subir un minimum
de changements ». Cet esprit de continuité affecte non
seulement la forme juridique des textes, mais aussi leur esprit,
comme le montre l’extrait suivant :
« La machine administrative est à la disposition du peuple,
mais encore faut-il que les rouages n’en soient pas
détraqués et que le fonctionnement n’en soit pas dérangé
par des pratiques préjudiciables… Il est indispensable pour
la bonne marche administrative du service public de tenir
groupés sous une seule autorité ayant la compétence et le
grade voulus, la cohorte obéissante des fonctionnaires…
Pour être efficace, l’administration doit rester une et
disciplinée ».
Des arguments semblables étaient généralement avancés sous
le protectorat pour écarter les Marocains des responsabilités.
Dans le domaine de l’administration locale, la classe dirigeante
du Maroc indépendant a repris à son compte la pratique et
l’esprit des institutions du protectorat.
On ne saurait donc s’étonner de voir renaître des conflits qui
s’apparentent à ceux de la période précédente. Nous avons déjà
vu comment le protectorat avait été déçu quand il essaya de
détourner les nationalistes des revendications politiques, en
associant les représentants de la bourgeoisie urbaine aux
décisions économiques au sein des Chambres de commerce et
d’agriculture, et au Conseil de gouvernement. Au lieu de la
collaboration attendue, on avait vu se développer une critique
globale du système devenue rapidement insupportable[17] au
général Juin.
L’attitude des élus locaux, après 1960, pourrait se comparer à
celle des nationalistes dans les Assemblées du protectorat. Elle
préfigure les critiques des parlementaires pendant la période
1963-1965 ; mais, dans les deux cas, les élus ne demandent pas
un changement de régime, mais une redistribution
fondamentale des pouvoirs.
On imaginait mal, en 1960, que les élus s’opposent aux caïds,
sans le concours desquels ils ne pouvaient rien faire pour leurs
électeurs. La participation de l’administration à l’équipement
des campagnes devait garantir la docilité des élus à l’égard des
projets officiels, et assurer en même temps leur fidélité
politique. Cependant, la réalité des rapports est différente. La
plupart des conseils municipaux et communaux trouvent le
cadre juridique qui leur est proposé inacceptable. Certains
d’entre eux ont une conception globale du pouvoir local qui les
pousse non seulement à protester contre les entraves mises à la
gestion communale, mais à réclamer le contrôle de l’ensemble
de l’appareil d’Etat qui intervient dans leur circonscripion.
A la lecture des procés-verbaux et des notes des gouverneurs
des provinces adressées au Ministère de l’intérieur, on constate
que certains conseils, qu’on ne saurait qualifier de
révolutionnaires, prétendent cependant jouer un rôle qui
aboutirait à changer considérablement la nature du système
politique. Le gouverneur de la province de Rabat, dans une
lettre, datée du 28 novembre 1961, résume ainsi l’attitude de
conseils ruraux qui n’ont pourtant, jamais, fait figure
d’extrémistes. Selon lui, les conseillers ruraux veulent d’abord
s’assurer le contrôle de tous les agents et organismes de l’Etat
intervenant au niveau de la commune. Ils revendiquent la
désignation et le contrôle des chioukh et des moqqademin, la
gestion et la représentation auprès du pouvoir central des terres
collectives, la gérance des lots de colonisation récupérés, le
contrôle des centres de travaux agricoles et de tous les services
techniques de l’Etat opérant dans leur circonscription, et,
enfin, la nomination des agents subalternes de
l’administration, en particulier des auxiliaires de la justice et de
la police[18]. Ces revendications formulées par des notables, qui
sont, en fait, les alliés du Palais, tendraient à montrer que la
notion d’Etat et de pouvoir central est encore loin d’être
acceptée dans la forme léguée par le protectorat.
On comprend alors l’insistance avec laquelle le gouverneur de
Beni Mellal[19] déclare que la principale difficulté rencontrée
dans la collaboration entre l’administration et les élus est de
définir « la matière communale, en fixant les domaines
respectifs de l’intervention de l’Etat, de la province et de la
commune ». Pour ce gouverneur de formation supérieure, qui
connaît bien les problèmes du monde rural, l’application de la
Charte communale ne requiert pas tant de nouvelles précisions
juridiques qu’un changement de l’état d’esprit des élus et du
corps des caïds dont il souligne, en des termes que ne
désavouerait pas l’opposition, les insuffisances de formation et
le manque de préparation.
L’intervention des partis politiques ne se manifeste guère dans
le fonctionnement local des conseils communaux. Elle apparaît
avec plus de netteté dans les centres et les villes importantes.
Cependant, en dehors même des conseils, les élus, et surtout
les présidents, constituent une clientèle politique de choix,
sollicitée aussi bien par les partis que par les représentants de
l’administration. Certes, ces tendances varient suivant les
provinces et l’intensité du climat politique. Mais, dans
l’ensemble, l’action politique locale et l’action nationale
n’apparaissent pas directement liées.
Bien que leur parti ait été dans l’opposition à partir de janvier
1963, et que la plupart des agents du Ministère de l’intérieur ne
leur aient guère été favorables dès le début de l’expérience
communale, les élus de l’Istiqlal ont été dans l’ensemble,
notamment à Salé, à Fès, à Marrakech, de bons gestionnaires;
attentifs au dévelopement de l’équipement communal, à la
rigueur des finances et des mœurs. On ne peut en dire autant
des élus de l’UNFP (exception faite de Casablanca). Négligeant
les tâches concrètes, ils ont utilisé les conseils comme tribune
politique, et refusé de collaborer avec l’administration pour
assurer, au minimum, le fonctionnement traditionnel des
services. L’UNFP est le seul parti qui ait lié les problèmes
communaux aux problèmes nationaux[20]. Parfois, son action
est un curieux mélange de grands principes et de demandes
prosaïques. Une note du président du conseil municipal de
Casablanca, adressée au gouverneur en décembre 1961,
revendique le droit, pour le conseil municipal, de régler
l’ensemble des affaires urbaines, notamment ce qui touche la
police, la santé et l’éducation. La ville devrait alors disposer de
ressources fiscales suffisantes, indépendantes du bon vouloir du
gouvernement. Le président du conseil municipal devrait
également disposer du pouvoir réglementaire et du pouvoir
hiérarchique sur les services municipaux sans tutelle a priori.
Après avoir précisé que dans ces conditions le poste de
gouverneur n’a plus de raison d’être, le président saisit le
représentant du gouvernement de demandes détaillées
d’indémnités, de frais de déplacement et de frais de mission.
N’ayant pu obtenir de participation véritable à la gestion des
affaires locales, les élus seront tentés de céder aux sollicitations
des partis, des syndicats et des hommes politiques, soucieux, à
partir de l’élection du Parlement, de se créer une clientèle
locale.
La politisation de l’élection dans les villes, et même parfois
dans les campagnes, a eu pour effet de créer des liens entre
responsables politiques nationaux et élites locales. Alors que les
chioukh restent dans l’ombre des caïds, les présidents et les
conseillers communaux assistent, dès 1960, aux congrès de
l’UNFP et de l’Istiqlal. Les élus occuperont dès lors une place
importante dans les instances officielles des partis. On
réclamera leur émancipation de la tutelle rigide prévue par la
Charte communale, la suppression des procédures
d’approbation des décisions par le Ministère de l’intérieur et
par celui des finances pour le budget, l’attribution d’un pouvoir
réglementaire véritable au président et, enfin, le paiement
d’indemnités de fonction.
A son sixième congrès, qui eut lieu à Casablanca du 12 au 15
janvier 1962, l’Istiqlal consacra plusieurs séances aux
problèmes municipaux et communaux. Allai el Fassi présida la
commission des Affaires communales, où il étudia, avec des
présidents et des conseillers sympathisants de son parti, le
problème de la révision de la Charte de 1960. L’essentiel de ses
critiques est dirigé contre les agents d’autorité, caïds et pachas,
imprégnés, dit-il, d’idées colonialistes. Le congrès réclamera
l’extension des prérogatives des conseils et l’allégement de la
tutelle du Ministère de l’intérieur. Cette campagne aboutira, le
15 avril 1962, à la création d’une Fédération des conseils
communaux et municipaux qui se réclamera de l’adhésion de
près de cinq cents élus (sur un total de onze mille). En juillet
1963, après un passage de près de six mois dans l’opposition,
l’Istiqlal proclamera encore son intérêt pour l’expérience
communale[21]: « En dépit des imperfections des textes et
surtout des entraves posées par les autorités, réussite de
l’expérience des conseils communaux et municipaux ».
L’essentiel des critiques de l’Istiqlal se situe dans le cadre du
régime et du système. Elles visent à une plus grande
participation, à une responsabilité politique réelle des élus dans
la gestion. Elles censurent les insuffisances flagrantes des agents
du Ministère de l’intérieur chargés de la tutelle.
L’UNFP ne prêtera pas une attention prioritaire aux conseils
communaux. Absorbée par les problèmes de ses rapports avec
l’UMT et l’UNEM, elle ne les utilisera pas autant que l’Istiqlal.
Ses préférences iraient plutôt à la mise en place d’organisations
de masse dans les campagnes, dont l’USA sera l’exemple
type[22].
Le Mouvement populaire cherchera, en revanche, avec l’appui
des autorités administratives de plusieurs provinces, à
regrouper, dans ses bureaux locaux, le plus grand nombre
possible de conseillers et de présidents auxquels il confiera
volontiers des responsabilités. La symbiose se fera assez
facilement en de nombreuses régions. Tout en s’efforçant de
rassembler le plus grand nombre de conseillers communaux au
sein du Mouvement populaire, et plus tard du FDIC,
l’administration locale redoute de les voir échapper à sa tutelle.
Elle les utilise aussi en dehors du cadre strictement communal,
dans certaines circonstances politiques, comme représentants
de la population.
Le roi, dans ses nombreux déplacements officiels, prendra
l’habitude, de réunir les présidents (et quelquefois les
conseillers) au siège de la province pour leur parler et entendre
leurs doléances, dans un style où la tradition chérifienne se
mêle à la pratique de la Cinquième République. Aux promesses
d’adduction d’eau et d’améliorations agricoles s’ajoutent des
déclarations d’intention sur la révision, dans un sens libéral, du
statut communal[23].
De son côté, le ministre de l’intérieur, Bekkaï, au moment
même où ses services lui font signer l’instruction aux
gouverneurs, en date du 6 août 1960, citée plus haut, envisage
un élargissement des compétences économiques des
communes, tout en maintenant le principe d’une tutelle plus
paternaliste que juridique. Il donne verbalement, en août 1960,
ses instructions aux gouverneurs :
« Le changement, par rapport à hier, est la naissance des
nouvelles communes municipales et rurales. Je vous
demanderai de respecter la Charte concernant ces nouvelles
communes dans l’esprit que Sa Majesté a bien voulu leur
attribuer. Il faut que vous relisiez cette Charte pour la
respecter à la lettre et surtout dans son esprit. Il est clair que
nous avons tous des habitudes, habitudes qui étaient de
tout gérer. Il faut donc laisser aux conseils municipaux et
aux communes rurales leurs responsabilités.
Vos représentants : super-caïds, pachas, caïds, khalifas,
chioukh se trouveront souvent en face des présidents des
communes et qui, peut-être, ne seront pas toujours avertis
ni au courant. Pour arriver à les instruire, il faut leur
expliquer exactement le sens de la Charte. Il faut essayer de
vivre en parfaite intelligence avec les élus communaux et
ruraux et les habituer à prendre leurs responsabilités.
Les conseils ruraux ne seront pas toujours à la hauteur de ce
qui est attendu d’eux, la plupart des membres composant
les communes rurales étant illettrés. C’est là justement
votre action, celle d’être aussi des éducateurs. Je fais appel à
votre personnalité beaucoup plus qu’à vos titres. Vous êtes
instruits, au courant, puisque vous avez fait un peu tous les
ministères. A vous d’employer une bonne psychologie
envers vos administrés pour les instruire. Vous êtes en
quelque sorte les tuteurs de ces collectivités, des ces
communes ».
Pour rendre la coopération plus facile entre l’administration et
les élus, Bekkaï s’efforcera aussi, pendant son passage à
l’intérieur, de favoriser le recrutement local des caïds. Malgré
son désir de voir se constituer une administration locale
capable d’associer les communes au développement et à la
réalisation du Plan, les services centraux ne’ laisseront pas les
conseils empiéter même sur des domaines mineurs de gestion,
tels que les terres collectives ou les centres de travaux,
rejoignant ainsi les préoccupations du protectorat à l’égard des
jemaas administratives[24].
Les décrets d’application, qui auraient été nécessaires pour fixer
les compétences communales en matière économique, ne
seront jamais pris. En revanche, la direction des Affaires
administratives du ministère accepte, sous la pression de
l’opinion et des ministres Istiqlal de la coalition
gouvernementale, de proposer quelques réformes ambiguës.
Dans un rapport (1er trimestre 1962) sur la révision de la
Charte communale promise par le roi lors de ses visites à
travers le royaume, cette direction dresse le bilan d’une année
d’exercice des conseils communaux. Le problème des rapports
entre le président et le caïd ou le pacha doit être résolu, selon
ce document, par un surcroît de précisions juridiques. Ecartant
la possibilité de confier dans l’immédiat aux présidents des
attributions qui en feraient les représentants de l’Etat en même
temps que ceux de la commune, le rapport conclut à la
nécessité de modifier la Charte communale pour préciser que
« le pacha ou le caïd assure la direction des services
communaux. L’ensemble du personnel communal est placé
sous son autorité hiérarchique ».
En revanche, le ministère est prêt à confier aux présidents les
fonctions d’officier d’état civil dans toutes les communes où
existerait un bureau d’état civil qui, en vertu du pouvoir
hiérarchique du caïd, serait en fait sous sa responsabilité. Il
pourrait même créer les impôts et taxes locales ainsi que
réglementer les prix ; c’était donc les pouvoirs traditionnels du
mohtasseb, que certains conseils revendiquaient. Le ministère
souhaite aussi soumettre à réélection, chaque année, le bureau
du conseil, mesure permettant de se débarrasser d’un président
trop actif. Le mandat des conseillers pourrait aussi être porté de
trois à six ans, avec une procédure de renouvellement par
moitié, et une indemnité serait versée aux présidents qui
consacreraient à leurs fonctions une part notable de leur
temps. En dehors de ces encouragements qui tendent à
renforcer son emprise sur les conseils, le ministère estime que
les problèmes de rapports entre élus et représentants doivent
être dépassionnés et ramenés à des questions de souplesse et
d’égards mutuels, nécessaires pour entretenir une bonne
collaboration.
Irritants et contestés, les élus ont acquis très tôt une existence
politique que leur niaient les textes et les intentions du
législateur. Les textes qui leur interdisent toute délibération à
caractère politique ne sont qu’une protection illusoire du
pouvoir, à partir du moment où tous les partis — à commencer
par le Mouvement populaire — font appel aux élus pour figurer
dans leurs bureaux locaux et à leurs congrès nationaux. Et les
espoirs que fondait l’administration sur un nouveau réseau
d’élites locales dociles, expliquant aux populations les
initiatives du pouvoir et recueillant leur soutien pour des
actions économiques, ont été déçus. Seuls quelques
gouverneurs ou quelques caïds, jouant généralement sur un
style de rapports traditionnels, ont su obtenir ce genre de
complicité, mais sans pouvoir pousser trop loin leurs exigences.
On a, au contraire, assisté à une sorte de radicalisation des
attitudes lors de rapports mauvais ou médiocres[25]. Les
notables, qui, pris individuellement, n’auraient rien refusé au
caïd, lui reprochaient son utilisation abusive des crédits de la
commune, critiquaient la moralité et le travail des agents des
services publics, admonestaient le commissaire de police
d’avoir à faire cesser les tolérances intéressées dont
bénéficiaient les prostituées ou les commerçants qui vendaient
de l’alcool aux musulmans. La présence des conseillers
communaux conduisit également les services municipaux à
renoncer à la collaboration de techniciens étrangers et à rédiger
leurs documents de travail en arabe.
Expérience ambiguë où les demandes de la base, que reflètent
les délibérations des conseils, où les prises de position des élus
ne peuvent pas parvenir aux instances politiques en dehors des
voies légales. Trop souvent, les gouverneurs se gaussent des
prétentions des conseils, et mettent en avant l’incompétence
de leurs membres, sans savoir qu’il y aurait peut-être dans leurs
manifestations une volonté confuse de voir définis les rapports
avec le pouvoir central sur une autre base que l’héritage du
protectorat.
Qu’aurait donné une pratique plus libérale sur le plan
politique ? Plus d’autonomie et de pouvoirs réels auraient sans
doute fait renaître un courant régionaliste que redoutaient
certains administrateurs marocains, parmi les plus clairvoyants.
Paradoxalement, le refus d’étendre les pouvoirs des conseils les
a amenés à chercher des contacts avec les partis et les hommes
politiques, et donc, indirectement, à accepter leur intégration
dans le jeu politique national. Un certain prestige social, un
pouvoir plus consultatif que délibératif et une intégration
partielle dans les clientèles politiques nationales ont pu
détourner les élites locales d’autres formes d’action politique,
en dépit de l’insatisfaction que montrent un grand nombre
d’élus. Ce système de contrôle politique du monde rural, qui
s’appuie sur le concours des élites locales, fonctionnera tant
qu’il s’agira de préserver un ensemble de rapports mal définis.
Il acceptera les réformes décidées par le pouvoir central à
condition qu’on ne l’oblige pas à remettre en cause les
équilibres traditionnels. Il refusera toutes les initiatives des
services qui auraient pu réaliser une mise en valeur certaine, au
prix de réformes de structures. Un tel système, conservateur au
sens littéral du terme, aurait pu convenir si aucun facteur
nouveau n’était intervenu. Or, au même moment, une poussée
démographique et des changements dans l’éducation
remettent en cause aussi bien les situations dans les
campagnes, que les rapports villes-campagnes.
Notes du chapitre
[1] Voir C. Henry-Moore, Tunisia since independance. The
dynamics of one-party government, Berkeley, University of
California Press, 1965.
[2] Un revenu fixe de cet ordre est loin d’être négligeable, si
on le compare au bénéfice d’exploitation annuel que Julien
Couleau, La paysannerie marocaine, op. cit., p. 245, évalue pour
un notable possédant 5 attelées, 40 bovins et 150 moutons, aux
environs de 8 700 Dh (1 dirham=1 franc).
[3] Ce schéma théorique vaut, à la rigueur, pour les régions
où les institutions traditionnelles conservent une certaine
vigueur. Pour être efficace, le cheikh, ou le moqqadem, doit
être accepté par les siens mais surtout avoir la confiance des
autorités locales que l’on s efforce d’acquérir par des moyen
divers.
[4] Bulletin officiel, 6 mai 1960, p. 928. Voir L.-J. Duclos, Les
élections communales marocaines du 29 mai 1960. Des lois aux
faits, op. cit., p. 27-28. L’auteur estime que dans la province de
Taza 5 % des circonscriptions ont été affectées par ces décisions
de retrait.
[5] P. Chambergeat, « L’administration et le douar » art. cité.
[6] La province de Rabat voit le nombre de ses moqqademin
réduit de 1 756 à 786.
[7] Il est certain que les discussions autour de la loi électorale
et des pouvoirs des conseils ont masqué ces mesures.
[8] Cependant, on constate, dès 1960, dans une région de
droit coutumier comme la zone montagneuse de la province de
Beni Mellal, une tendance à porter devant les conseillers
communaux, statuant selon les règles traditionnelles, les
différends que l’on se refuse à soumettre au juge du Sadad qui
appliquerait le chrâa.
[9] Plus de la moitié des postes de caïds changeront alors de
titulaires.
[10] Cette clientèle les suivra ensuite de poste en poste.
D’autre part, quelques gouverneurs profitent de ces
instructions pour mettre les postes de caïds à l’encan, et, par
voie de conséquence, ceux des chioukh et des moqqademin.
[11] P. Pascon, M. Bentahar, « Ce qui disent 296 jeunes
ruraux », Bulletin économique et social du Maroc, janvier-juin
1969.
[12] Voir P. Chambergeat, « Les élections communales
marocaines du 29 mai 1960 », Revue française de science
politique, mars 1961, p. 89-117.
[13] Voir P. Pascon, M. Bentahar, « Ce que disent 296 jeunes
ruraux », art. cité.
[14] Voir pour une analyse précise des bases juridiques et du
fonctionnement de l’administration communale, H.N. Mourer,
« Les collectivités territoriales et l’administration locale du
royaume du Maroc, Annuaire de l’Afrique du Nord 1963, Pans,
CNRS, 1964, p. 129-161, et J. Garagnon, M. Rousset, Droit
administratif marocain, Rabat. Editions La Parte, 1970, p. 83.
[15] Ce point qui ne figure pas dans le dahir du 23 juin 1960
est précisé par une circulaire d’application du 6 août 1960.
L’administration locale craint de se voir privée d’un moyen
d’influence si les services techniques élaborent leur programme
directement avec les élus. Elle redoute aussi de leur part une
action politique autonome défavorable au régime.
[16] Le pouvoir central craignait l’influence que ces
fonctionnaires, ayant généralement des sympathies pour
l’opposition, pourraient avoir sur les élus.
[17] Voir S. Bernard, Maroc 1943-1956. Le conflit franco-
marocain, op. cit., tome 1, p. 107 et suiv.
[18] Ces revendications des conseils communaux portent
aussi sur des détails d’exécution de leurs dont ils ne
comprennent pas le cheminement administratif et financier,
surtout lorsqu’il s’agit de dépense d’équipement. L’intervention
du caïd, du percepteur et de l’administration provinciale leur
apparaissent comme autant d’entraves à leur compétence.
[19] Rapport en date du 22 novembre 1961.
[20] Voir M. Ben Barka, « Les conditions d’une véritable
réforme agraire au Maroc », in Réforme agraire au Maghreb, op.
cit.
[21] Al Istiqlal, 14 juillet 1963.
[22] Voir M. Bol Barka, Option révolutionnaire au Maroc, Paris,
Maspero, 1966, p. 61 et suiv.
[23] Hassan II a notamment eu recours à ce thème lors de ses
premières visites officielles à Fès, Meknès, Beni Mellal, et dans
les provinces du Nord, après son accession au pouvoir, en mais
1961.
[24] Circulaire du 19 juin 1952 citée plus haut.
[25] Un exemple de radicalisation des rapports entre les
notables élus et l’administration est donné lois du Colloque
agricole du Camp des Chênes. Voir Mahgreb, mai-juin 1964, p.
25-27.
Chapitre IV. Notables et modernisation
Nous venons de voir comment la monarchie marocaine avait
réussi, après l’indépendance, à utiliser le monde rural, par
l’intermédiaire de ses élites, pour faire contrepoids aux autres
forces politiques[1]. Mohamed V reprenait ainsi à son compte,
contre les partis, la tactique que le protectorat avait employée
contre lui, lors des crises qui l’avaient conduit en exil, en 1953.
Le souverain, qui exerçait directement le pouvoir depuis 1960,
se devait d’être particulièrement attentif à tous les facteurs
susceptibles de modifier ses rapports privilégiés avec le monde
rural.
Un réseau complexe d’intermédiaires, nous l’avons vu, avait
été mis en place, en particulier après 1960, par le Ministère de
l’intérieur, pour s’assurer le soutien politique des campagnes.
Ce type d’alliance supposait que le pouvoir soit
particulièrement attentif à satisfaire les demandes des ruraux,
notamment dans le secteur traditionnel. Il lui fallait également
favoriser une augmentation de la production rendue nécessaire
par l’accroissement de la population et des besoins individuels.
La monarchie se trouve devant un choix délicat. Se prononcer
en faveur de l’augmentation de la production risque de porter
atteinte aux structures sociales et de miner ainsi son principal
soutien politique. Refuser les réformes de structure pour ne pas
mécontenter les élites locales risque de voir le surplus de
population rurale s’écouler vers les bidonvilles et poser d’autres
problèmes de développement économique et de maintien de
l’ordre.
Selon son habitude, le Palais s’est efforcé de ne pas avoir à faire
un choix aussi tranché et de trouver, au moins à court terme,
d’autres solutions. Aussi, depuis 1960, les réformes de structure
ont été progressivement écartées. Le Plan quinquennal 1960-
1964, préparé par le gouvernement Abdallah Ibrahim et publié
après le départ des ministres UNFP, prévoyait encore la
nécessité « de procéder à une réforme agraire afin d’arriver à
des exploitations rationnelles »[2]. Il semble bien que le
gouvernement, présidé par le roi après lé 28 mai 1960, ait
beaucoup édulcoré les passages sur la réforme agraire avant le
publier ce Plan[3]. Par ailleurs, ce projet mettait l’accent sur un
programme d’industrie lourde et de transformation, et ne
s’intéressait à l’agriculture que dans les secteurs susceptibles
d’investissements intensifs, en particulier par l’irrigation. Cette
politique d’industrialisation et ces projets de transformation du
monde rural, nous l’avons vu, avaient entraîné un malaise
politique créant des conditions favorables à l’alliance entre la
monarchie et les élites locales. Il ne faut donc pas s’étonner que
cette politique soit abandonnée peu de temps après la prise en
main du gouvernement par le Palais. L’industrialisation passe
au second plan, les réformes de structure sont ajournées[4], et
les efforts particuliers du régime vont porter sur le monde rural
traditionnel, négligé par les précédents gouvernements.
Quelques exemples permettront de préciser la politique suivie
par le Maroc dans le secteur agricole, en mettant en évidence,
dans chaque cas, le rôle des élites locales.
Depuis l’indépendance, le gouvernement marocain est à la
recherche d’une formule pour associer le monde rural à ses
projets de mise en valeur. L’administration parvient certes à
poursuivre ses tâches d’équipement en utilisant ses relais
habituels. Les chioukh et les moqqademin transmettent les
ordres ou font connaître les intentions de l’État. Ils trouvent
chez les ruraux une attitude de soumission — plus ou moins
réticente — tant que l’équilibre interne et la solidarité des
groupes ne sont pas menacés. Lorsqu’il s’agit de décisions qui
pourraient avantager certains membres, — comme les
politiques de mise en valeur — le réseau administratif n’assure
plus la transmission ni des consentements, ni des engagements
collectifs. Et les élus, en dépit des textes, ne peuvent guère
prétendre jouer un rôle plus actif. La société rurale marocaine
est foncièrement rebelle au principe de délégation. Pour
aboutir à un engagement, chaque affaire doit faire l’objet d’un
mandat précis, obtenu après un certain processus de
maturation des décisions collectives. Cependant, les bases d’un
dialogue existent, car les collectivités rurales demandent à
l’État des interventions positives et coûteuses, qu’il s’agisse
d’écoles, d’infirmeries, de routes, de prêts agricoles ou de soins
pour le bétail. Il est donc possible, en retour, d’obtenir leur
participation à des tâches de mise en valeur. Le problème le
plus difficile pour l’Etat, une fois ses objectifs définis, est de
trouver un niveau de représentativité approprié. La commune,
bien que le dahir du 23 juin 1960 prévoie sa participation aux
projets de développement rural, a été, dès le départ, un
ensemble trop vaste, peu représentatif des intérêts locaux, et ne
recouvrant pas une collectivité homogène. Nous avons déjà vu
comment on avait renoncé, dans le Tadla et dans les Triffas, à
créer des communes correspondant aux divisions du plan
d’irrigation. Le douar apparaît bientôt comme le seul
groupement ayant encore une vie collective et une solidarité
pour la mise en valeur d’un terrain. On retrouve, à ce niveau,
les pratiques d’assolement, de pâture, de garde du troupeau, de
gestion collective de quelques facteurs de production
passablement dégradés ou mal entretenus, tels que des terrains
de parcours ou de culture ou des seguias.
Le douar garde, certes, des restes de solidarité ethnique. Ses
réflexes collectifs jouent plus pour la défense d’un acquis
dégradé que pour l’accroissement de la production. Un lent
processus d’érosion interne y a déjà introduit des ferments de
division sur lesquels s’appuie le pouvoir[5]. L’administration
essaiera plusieurs fois d’utiliser les mécanismes de solidarité
collective des douars : tantôt par des projets de mise en valeur
des zones rurales riches telles que le Rharb, le plus souvent par
des projets de reforestation ou de chantiers de Promotion
nationale réalisés dans les zones rurales pauvres.
L’opération betterave entreprise par l’Office national
d’irrigation[6] dans la région de Sidi Slimane en est un exemple
typique. Cet office avait entrepris une campagne de
vulgarisation, en 1962, pour décider les petits et moyens
paysans du « polygone bettevarier » de Sidi Slimane à
entreprendre la culture de la betterave à sucre. Cette culture
était différente des pratiques habituelles des paysans marocains
et exigeait un travail très dur de préparation de la terre, ainsi
que l’emploi de fumier et d’engrais. Afin de vaincre les
hésitations, le directeur de l’Office, Mohamed Tahiri, jeune
ingénieur dynamique proche de l’Istiqlal, utilisa une équipe de
moniteurs agricoles, encadrés par des sociologues français. Le
thème de la campagne de vulgarisation qui remporta le plus de
succès fut le défi au colon réalisé avec l’aide de l’État.
Volontairement, l’ONI avait choisi de ne pas passer de contrats
de culture avec les colons, et de ne pas solliciter les gros
agriculteurs marocains. Ses moniteurs parcouraient les douars,
organisaient des réunions, des démonstrations et des causeries
pour persuader les paysans moyens qu’ils seraient capables de
faire mieux que les colons, que le Makhzen les avait choisis
dans ce but et entendait les aider. Les agents de l’ONI allaient
jusqu’à dire que le succès de l’expérience déciderait l’État à
distribuer aux petits paysans les terres des colons du voisinage.
Certains agents d’encadrement parlèrent même de réforme
agraire.
Le réseau des chioukh et des moqqademin suivait cette
campagne avec une certaine inquiétude. Cette action avait été
entreprise avec une densité d’encadrement telle que leur rôle
s’en trouvait réduit. Les allusions au partage des terres des
colons, puis les déclarations imprudentes sur la réforme agraire,
propos vagues tenus dans le rêve collectif des discussions sur
l’avenir du terroir, leur furent rapportées. L’emprise des
moniteurs sur les douars leur paraissait une concurrence
insupportable.
Au même moment se déroulait la campagne pour le
référendum. Les agents de l’ONI furent accusés d’avoir fait de
la propagande contre la Constitution, alors qu’en fait ils se
prévalaient de l’autorité du Makhzen, orientée, il est vrai, dans
un sens réformiste inhabituel, pour entraîner l’adhésion des
ruraux. Les notables alarmés se répandirent en propos
inquiétants sur le rôle des agents de l’Office. L’affaire, par les
notes d’information de la police et des caïds, aboutit au roi qui
décida de suspendre, aussitôt après le référendum, un directeur
trop entreprenant de l’Office.
Cependant les contrats de culture de betterave avaient été
signés, et la première campagne fut un succès. Les douars
respectèrent les décisions collectives d’emblavement et de
pâturage prises avec les agents de l’Office. Le rendement
financier de la betterave fit accepter les contraintes de culture.
Mais l’allégement de l’encadrement, son initiative amoindrie
orientèrent plutôt vers les notables une action qui avait à
l’origine été dirigée vers les petits paysans traditionnels, traités
en entité collective, à l’échelon du douar.
Les projets de mise en valeur du bassin du Sebou illustrent
aussi, par certains aspects, les difficultés rencontrées pour
concilier les projets d’agriculture intensive et le maintien de
structures favorables aux élites locales. Une étude commencée
en 1962, dans le cadre d’un projet confié à la FAO, devait
préparer les tranformations nécessaires pour permettre
l’irrigation et l’introduction de cultures intensives et
industrielles sur 250 000 hectares situés dans le Rharb[7]. Dans
une première phase, d’une durée de cinq ans, l’administration
marocaine devait effectuer le remodelage des structures
agraires, et améliorer l’état des cultures en sec, afin de préparer
l’irrigation. Une seconde période de cinq ans verrait s’étendre
les cultures intensives — betterave, coton, riz, canne à sucre —
sur les meilleures terres. Une dernière phase de quinze ans
serait nécessaire pour la réalisation globale du projet.
La phase la plus délicate se situait au début. Partant du douar
comme pour l’opération betterave, les auteurs du projet
dessinaient des formes nouvelles d’exploitation alliant
l’individuel et le collectif. La première opération consistait à
délimiter le territoire et à recenser la population agricole et les
exploitations, de façon à figer le domaine de leur intervention.
Puis ils fusionnaient en un même ensemble la gestion des
terres collectives, domaniales, provenant de la récupération des
lots de colonisation, et privées. Cet ensemble, nommé société
de développement villageois, constituait une véritable
entreprise de culture. Les paysans possédaient, des parts
sociales, rémunérant leurs apports de terre, en outre, ils
pouvaient être employés à titres divers par les sociétés de
développement dont les mécanismes étaient assez proches de
ceux des fermes autogérées algériennes[8].
En dépit de l’apport des terres dominales, le projet, sitôt connu,
rencontre l’hostilité de la bourgeoisie rurale qui s’inquiète de
voir les propriétés de plus de 50 hectares remembrées en dehors
des villages. Cette mesure, qui porterait atteinte à son influence
sur le groupe, lui apparaît comme la première étape insidieuse
d’un plan de réforme agraire. L’administration locale se fait le
porte-parole des protestations des élites locales qui ont
l’habileté de mettre en avant les réactions des petits fellahs
inquiets de voir modifier le statut des terres collectives.
Le roi est alors saisi du débat. Il a proclamé, dans son discours
du Trône du 3 mars 1967, son intention de réaliser le projet
Sebou, mais n’entend pas pour autant accepter le cadre proposé
par les experts de la FAO. Il doit cependant tenir compte de ce
projet pour pouvoir profiter du financement international
nécessaire à sa réalisation. Il constitue donc, le 24 avril 1967,
une commission royale chargée d’examiner les conclusions de
l’équipe FAO, et de les adapter à la réalité marocaine du
moment. Sous la présidence d’un ingénieur agronome attaché
au cabinet royal, cette commission regroupe les ministres de
l’intérieur, de l’Agriculture, des Finances et des Travaux publics,
ainsi que quelques hauts fonctionnaires. La commission se met
rapidement au travail, sur documents, et procède à des
consultations locales par l’intermédiaire de l’administration et
des représentants des organisations agricoles. Si elle accepte le
principe d’un fonds commun de terres constitué suivant les
recommandations des experts, elle ne prévoit pas, dans
l’immédiat, d’apporter de bouleversements à l’exercice du droit
de propriété.
Dans son contre-projet, les apports de l’État seraient effectués
dans le cadre des structures agraires actuelles, sans toucher au
statut des terres collectives et tout en augmentant leur étendue.
A cet égard, la commission royale propose « d’utiliser le volant
constitué par les terres domaniales (domaines privés, terres
récupérées, habous, guich) et les terres entre les mains
actuellement des étrangers (dont le principe de reprise est
acquis conformément aux directives royales) pour, d’une part,
agrandir les collectifs, et, d’autre part, supprimer les petites
exploitations non viables, incompatibles avec une mise en
valeur rationnelle ».
Il n’est plus question de remembrer les grandes propriétés hors
des villages, ni d’en limiter l’étendue. La commission royale
estime qu’une loi sur l’obligation de mise en valeur, assortie de
mesures de récupération de la plus-value, suffira pour atteindre
les objectifs recherchés. Elle n’estime pas nécessaire de
récupérer dans l’immédiat les terres de colonisation, mais
seulement d’en interdire la vente. Elle préconise également la
« melkisation » ou partage des collectifs, tant « anciens que
nouveaux ». Enfin, elle exclut totalement, pour l’avenir, la
solution des sociétés de développement villageois préconisée
par les experts de la FAO :
« La mise en valeur implique un cadre institutionnel
administratif pour effectuer les investissements, encadrer et
administrer et un cadre institutionnel local pour réaliser
cette mise en valeur.
Pour la mission Sebou, le village, forme moderne du “douar
tribal”, constitue ce cadre institutionnel local et permettrait
d’utiliser les potentialités humaines des structures
traditionnelles axées autour des douars pour la mise sur
pied de sociétés de développement villageois ; lesquelles
sociétés donnent la terre en locatiop, contrôlent la mise en
valeur, perçoivent les loyers et gèrent le fonds
d’investissement alimenté par les loyers.
La commission royale estime nécessaire d’écarter cette
formule d’exploitation villageoise qui risque d’entraîner des
bouleversements qui ne s’adaptent ni aux conditions du
milieu, ni aux lignes générales de la politique sociale,
économique et humaine de Sa Majesté le Roi.
Elle estime par contre que les dispositions prévues dans les
décrets royaux du 4 juillet 1966 sur la réforme agraire
permettent sûrement, par la constitution d’associations
obligatoires entre les attributaires, d’atteindre tous les
résultats escomptés par la mission Sebou. Ces associations
obligatoires, à caractère coopératif, et ayant des intérêts
communs, travailleront en étroite harmonie avec les
cellules de base de la mise en valeur implantées par l’État et
qui sont les Centres de mise en valeur ».
Toutes ces mesures aboutissent clairement à un renforcement
de la bourgeoisie rurale moderne. Les gros propriétaires
pourront utiliser les crédits et les travaux entrepris par l’État
pour augmenter la production de leur domaine. En aucun cas,
il n’est mis fin à leur situation de domination à l’intérieur des
communautés rurales. Ils s’appuieront sur un groupe de petits
notables qui pourront arrondir leur lopin de terre grâce au
partage des terres collectives ou domaniales. La masse des petits
paysans, qui ne pourrait pas servir à constituer les exploitations
viables mentionnées dans le procès-verbal de la commission,
pourra toujours se transformer en ouvriers agricoles ou émigrer.
Le douar ne peut donc pas être, dans les projets du
gouvernement, la base d’une cellule autonome de mise en
valeur. Si on lui accorde une telle possibilité d’organisation, ce
sera dans un but spécifique, en l’encadrant d’un côté par les
élites locales, de l’autre par les organismes d’État chargés de la
mise en valeur, et sans envisager à aucun moment de le relier à
un cadre politique. Tout effort pour sortir du cadre communal
est donc condamné dans les régions riches.
En fait, la politique de l’État à l’égard des régions à fort
potentiel technique est très hésitante. L’État est parfois tenté
d’y concentrer les techniciens et les moyens financiers pour
obtenir des résultats rapides. Il trouve aussi, dans ces projets,
des arguments pour persuader son opinion publique et ses
soutiens étrangers de ses intentions modernisatrices, et obtenir
ainsi, des États-Unis ou de la Banque mondiale, un soutien
financier qu’il espère utiliser sans contraintes. Mais lorsque les
techniciens conçoivent les périmètres irrigués comme des
enclaves économiques où le pouvoir politique serait à leur
disposition[9], la contradiction avec le système de
gouvernement devient trop flagrante, d’autant plus que le
Palais ne peut pas se permettre de considérer le reste du pays,
sur lequel il s’appuie politiquement, comme quantité
négligeable. Le Palais hésite donc, dans les régions riches, entre
des solutions qui, pour fixer sur place le maximum de ruraux,
exigent des redistributions de propriété, et des solutions qui
seraient plus favorables aux élites locales mais risqueraient de
faire émigrer, vers les villes, une trop grande masse de paysans
sans terre.
Mais c’est à propos de l’encadrement de l’agriculture
traditionnelle qu’apparaît mieux encore le souci politique du
Palais. A cet égard, l’année 1960 marque un net changement,
dû à la prise en main directe du gouvernement par le
souverain, mais aussi à la découverte des conséquences
politiques d’une croissance inattendue de la population, que le
recensement mettait en évidence. Une réaction se dessine
contre le mythe de l’industrie lourde et du nouveau « Maroc
utile », qui avait inspiré les rédacteurs du Plan quinquennal.
L’entourage du roi prête alors une plus grande attention à la
paysannerie des régions de montagne et des zones pré-
sahariennes, liant ses résistances au progrès technique à ses
révoltes passées. La prise de conscience des difficultés du
décollage économique, de la nécessité de ramener les projets
grandioses à la mesure des moyens disponibles, du risque de
voir hausser le niveau de vie et s’accroître l’exode rural, s’allie
au désir de prendre le contre-pied de la politique économique
des gouvernements Istiqlal et UNFP depuis l’indépendance[10].
C’est dans ce contexte que le roi décide, le 21 juin 1961, de
lancer la Promotion rurale, bientôt transformée en Promotion
nationale[11].
Par l’intermédiaire de cette mission administrative moderne, le
roi peut être en prise directe sur les gouverneurs et les élus
locaux :
« Les gouverneurs, qui sont les représentants personnels de
Sa Majesté dans les provinces, auront la responsabilité de
cette tâche (la Promotion rurale), et verront leur pouvoir
accru et précisé. A cet effet, et conformément aux
dispositions de leur statut, ils seront chargés d’assurer la
coordination entre les services techniques et les Offices de
mise en valeur. Il sera ainsi mis fin à une pratique
aboutissant à une dispersion dommageable des efforts et des
responsabilités.
Enfin, à côté du roi et des gouverneurs, dernier élément du
triptyque, la population : les gouverneurs seront assurés de
la collaboration effective des représentants élus des
populations intéressées dans le cadre des communes rurales
et des conseils provinciaux… A l’échelon local, la
responsabilité de cette tâche nationale doit être assumée par
les élus communaux auxquels il sera fait le plus large appel
pour servir de relais auprès des populations. Aucune action
ne devra être entreprise sans leur participation effective et même
personnelle. Ainsi, une des tâches primordiales que nous
nous assignons, tout en luttant contre la sécheresse de cette
année et le sous-emploi de façon permanente, sera de
promouvoir une association étroite entre communes, provinces
et administration centrale. Cette mobilisation… permettra
seule de faire participer l’ensemble du monde rural à
l’amélioration et à la modernisation des modes de vie
qu’entend réaliser l’État »[12].
Après la réunion du Parlement, la Promotion nationale
apparaît encore plus comme un domaine réservé du roi qui
entend l’utiliser pour intervenir directement dans le pays, en
dehors des circuits administratifs et du contrôle parlementaire.
Les services du Plan et de la Promotion nationale sont alors
directement rattachés au cabinet royal, et non à la présidence
du Conseil.
En fait, les relations entre la Promotion nationale et le
Parlement ne sont pas mauvaises. La relance de la Promotion
nationale s’opère en 1964, avec l’appui de la commission
parlementaire de la Promotion nationale, présidée par Mansour
Nejjaï, leader agricole du parti de l’Istiqlal, alors dans
l’opposition, ainsi qu’avec le député UNFP de Tafraout. Le
délégué général à la Promotion nationale entreprend des
tournées dans l’ensemble des provinces, accompagné non
seulement des membres du comité technique — hauts
fonctionnaires mandatés par leur ministre — mais aussi des
membres de la commission parlementaire. A leur retour, le
délégué général expose au souverain, en présence du
gouvernement, des gouverneurs et des membres de la
commission parlementaire, les conclusions tirées lors de ces
déplacements.
Cette situation est due sans doute en partie à la personnalité du
délégué général. Ahmed Bargach, vice-gouverneur de la Banque
du Maroc, qui assume avec aisance le jeu de la collaboration
avec le Parlement. Le président de la commission de la
Promotion nationale, Mansour Nejjaï, ancien ministre de
l’Agriculture, exploitant près de 5 000 hectares dans le Rharb,
ne pouvait pas manquer de voir tout l’intérêt que présentait
l’institution pour l’agriculture moderne : elle relâchait la
pression des paysans sans terre des régions pauvres sur les
campagnes riches et sur les villes, et retardait, ainsi, la
réalisation d’une réforme agraire.
Mais le représentant UNFP de Tafraout, qui appartenait
également à la commission parlementaire, déclarait, lors d’une
réunion présidée par le roi, « que la réussite de la Promotion
nationale réside surtout dans la conviction et le dynamisme
dont doivent faire preuve tous les citoyens »[13], alors que les
leaders de son parti au Parlement demandaient la suppression
pure et simple des crédits budgétaires qui lui étaient apportés.
A l’échelon local, la Promotion nationale aboutit à renforcer le
poids du Ministère de l’intérieur et des élites locales. Pour
intervenir sur l’ensemble du territoire et principalement dans
les zones déshéritées, elle devait nécessairement s’appuyer sur
les agents du Ministère de l’intérieur. C’était à ces derniers
qu’allait revenir le soin de contacter les populations, d’en
exprimer les vœux, d’en examiner les propositions. C’était eux
qui devaient recruter la main-d’œuvre, surveiller les travaux, et
assurer la rémunération des ouvriers. A leurs attributions
normales les caïds virent s’ajouter celles de bureau de
placement, de régisseurs-comptables et surtout d’entrepreneurs.
Devant la pénurie de personnel qualifié et de techniciens, il
leur fallut bien souvent s’improviser constructeurs,
hydrauliciens, traceurs de pistes. Le Ministère de l’intérieur, par
l’intermédiaire de la Promotion nationale, disposait de crédits
d’équipement importants et s’introduisait, ainsi, dans le
domaine économique.
Dès l’origine, la Promotion nationale se montre soucieuse
d’établir un contact avec les élus locaux pour l’élaboration de
ses programmes. Un président de commune, élu par ses pairs,
siège au comité technique provincial pour représenter la
population de chaque cercle de la province. Cette mesure offre
une possibilité de contact et d’avis lors de l’élaboration des
projets. Mais la Promotion nationale s’appuie essentiellement,
pour l’élaboration et l’exécution de ses projets, sur le réseau des
agents d’autorité relayé par les élites locales. Des consultations
informelles ont lieu pour le choix des travaux, sans utiliser le
cadre communal qui apparaît, une fois de plus, trop vaste et
mal commode, vu ses procédures financières compliquées et
ses tutelles multiples. Le choix des travaux, le recrutement de la
main-d’œuvre, la coordination de la surveillance s’effectuent
donc, une fois de plus, par l’intermédiaire des chioukh et des
moqqademin. Etant donné l’ampleur du travail supplémentaire
qui leur est demandé, les caïds tolèrent quelques prélèvements
au passage. Les élites locales trouvent aussi le moyen de
favoriser indirectement leur groupe ou, pour le moins, de ne
pas lui créer trop de difficultés, en évitant d’entrer en
concurrence avec les gros agriculteurs pour le recrutement de la
main-d’œuvre, au moment des labours et des moissons.
Efficace dans la réalisation des travaux d’équipement, le
système l’est beaucoup moins dans la mise en valeur, qu’il
s’agisse de travaux à rendement lointain comme la Défense et
restauration des sols (DRS) ou de travaux d’hydraulique et d
aménagement des sols. On est alors à la recherche d’une
formule permettant d’associer les ruraux au projet, autrement
que sous la forme de journées de travail rémunérées.
Un problème délicat se pose partout où la Promotion nationale
intervient dans des opérations de mise en valeur
accompagnant des travaux de lutte contre l’érosion. Pour que
ces travaux ne constituent pas une simple distribution de
salaires, il faudrait s’assurer de leur efficacité en obtenant le
concours de la population à leur entretien, l’acceptation de
contraintes collectives de non-pâturage, le remboursement
d’une partie des frais engagés à partir du moment de l’entrée en
production, l’acceptation d’un plan de culture et d’un
remodelage de parcelles. Faute de structures permettant aux
groupes de prendre ces engagements, la participation de l’Etat
emploie des voies dirigistes et autoritaires. Le problème a été
posé avec acuité pour la réalisation du projet de défense et
restauration du Rif occidental (DERRO), mis en œuvre à partir
de 1965 avec le concours des Nations Unies[14].
L’administration des Eaux et forêts, chargée de l’exécution du
programme, ne dispose pas des instruments juridiques
nécessaires. Elle ne peut pas traiter individuellement avec
chaque fellah ni s’attaquer à une zone définie uniquement à
partir des critères techniques, sans tenir compte des occupants.
Il lui faut trouver un espace, et une communauté qui accepte
de traiter globalement avec l’État pour une opération de
modernisation. La commune constitue une fois de plus un
cadre trop vaste. Les services techniques s’orientent donc vers
le douar comme support de leurs opérations.
Mais, pour atteindre cet objectif, il aurait fallu doter les douars
d’un statut juridique qui puisse faire d’eux le support des
opérations de modernisation. L’administration de l’intérieur a
vite freiné une évolution qui aurait fait perdre au caïd et à ses
délégués le contrôle de la situation, au profit d’élus et de
techniciens. On préconise, une fois de plus, le recours à des
associations d’usagers, ou la réalisation d’un programme plus
modeste, à la charge de l’Etat, tout en continuant à utiliser le
réseau administratif.
Cependant, en d’autres cas, l’administration a eu recours, dans
le cadre de la Promotion nationale, à des procédures
traditionnelles d’association des collectivités aux travaux. Elle
les laissait agir de façon telle qu’elles transposaient, dans un
cadre nouveau, l’ancien système de relations entre les groupes.
Ainsi, dans la province de Ksar es Souk, en 1965, des
inondations détruisirent de nombreux villages. Il fallut
rapidement les reconstruire de manière à éviter le
renouvellement de telles catastrophes. Avant de lancer les
travaux, le gouverneur décida de consulter la population sur de
nombreux points : choix des lieux d’implantation, plan des
villages, plan des maisons, acceptation d’un regroupement avec
les villages voisins, mode de répartition des logements,
participation au travail, etc. C’est en fait l’ancienne jemaa,
transformée en comité de sinistrés, qui régla tous ces points
avec l’autorité locale, et prit des engagements respectés par la
population. On dut certes multiplier les écoles et les points
d’eau plus qu’il n’aurait été rationnel pour éviter que les
enfants et les épouses des chorfa ne fréquentent ceux des
haratin. Mais l’administration trouva là un relais efficace qui
assura, seul, la réalisation des opérations à un coût dérisoire par
rapport aux normes techniques habituelles. La jemaa a pu
servir d’interlocuteur à l’administration parce qu’il s’agissait
d’une opération limitée dans le temps et qui ne bouleversait
pas l’équilibre de la communauté. Pour des opérations de mise
en valeur comportant des engagements à long terme,
l’instabilité des agents de l’État rendait nécessaire
l’institutionalisation des engagements dont le monde rural,
aurait, autrement, trop facilement tendance à oublier les
charges.
Ces exemples font aussi ressortir le conservatisme des
représentants du pouvoir qui n’ont ni la volonté ni
l’imagination pour tenter quoi que ce soit sans recourir aux
élites locales. Mais ils montrent également les difficultés
d’utilisation de ce réseau par l’administration pour les tâches
de mise en valeur. Il s’en dégage aussi une orientation
convergente vers un type d’unité administrative plus petite,
correspondant à la fois à des ensembles cohérents d’un point
de vue technique et humain, si l’on veut toucher dans sa
totalité une population. Les problèmes techniques exigent,
donc, pour être résolus dans le sens de l’efficacité optimum,
une modification des structures administratives et politiques.
Il s’est avéré souvent plus facile, comme l’a fait implicitement
la commission royale chargée d’examiner le projet Sebou en
1967, de chercher à adapter les solutions techniques aux
données politiques, et donc à réaliser le développement rural
en ayant recours aux élites locales. C’était, en fait, la politique
de modernisation agricole suivie dès la fin du protectorat. Elle
consistait à aider les notables à se mécaniser, à acheter un
tracteur ou une moissonneuse-batteuse, en leur accordant des
prêts. Si une technique mal utilisée ne ruinait pas les intéressés,
elle entraînait un décalage avec le groupe dont il étaient issus.
La Promotion nationale dut aussi faire face à ce type de
problèmes dans les grandes plaines riches où les seuls travaux
de mise en valeur qu’on lui proposait s’effectuaient sur les
terres des propriétaires liés à l’administration. Il devenait
difficile, dans ces conditions, de mobiliser l’enthousiasme
collectif du monde rural pour de tels projets.
Les opérations de mise, en valeur n’ont donc pas pu se réaliser
en dehors du système des élites locales. Toute tentative, qui
aurait risqué de porter atteinte à leur rôle d’intermédiaires et à
leur situation de domination à l’intérieur des villages, a été
écartée. L’administration, qui recueille sur le plan politique le
bénéfice de cet équilibre, n’a rien fait pour y porter atteinte.
Certes, au niveau du pouvoir central, les hauts fonctionnaires
et quelquefois les ministres, au courant des affaires du monde
rural, étaient conscients du caractère précaire de cette stabilité,
minée d’un côté par la pression démographique, de l’autre par
la généralisation de l’enseignement. Mais ils savaient que toute
tentative de réforme se heurterait à l’opposition du Ministère
de l’intérieur et de ses agents, solidaires du réseau des élites
locales qui leur assurait le contrôle du pays à moindres frais.
La mise en valeur du monde rural devait donc obligatoirement
passer par eux, ou proposer un autre système d’organisation
politique. Depuis les premières expériences des Secteurs de
modernisation du paysannat, le problème était implicitement
posé. Aucune solution satisfaisante ne lui a été apportée. Les
préoccupations économiques apparaissent moins primordiales
que la tranquillité sociale et les mesures à court terme que
celle-ci implique[15].
Politiquement, la Promotion nationale a bien été un
instrument aux mains du roi pour assurer sa mainmise sur le
monde rural, face aux partis, et pour éviter des réformes de
structure. Elle employait en moyenne 80 000 ruraux par an, ce
qui lui a permis de fixer temporairement des populations, en
renforçant le contrôle des élites locales. Accessoirement, elle a
créé une situation favorable à l’emprise du Ministère de
l’intérieur sur les autres administrations, sous prétexte de
décentralisation au profit des gouverneurs. L’expérience de
gestionnaire de la Promotion nationale leur a permis de
revendiquer les terres de colonisation dévolues aux provinces,
en 1963. En choisissant les adjudicataires des fermes, ces
gouverneurs peuvent renforcer leur clientèle. Le conflit avec
l’ONI les a amenés à présider les offices régionaux de mise en
valeur. Ainsi, l’Etat a pu, par leur intermédiaire, contrôler aussi
bien le secteur traditionnel que le secteur moderne.
Mais le système n’est guère stable. S’il a assuré la tranquillité du
monde rural traditionnel, il suppose le maintien constant d
activités quasi salariales pour une fraction importante de ce
secteur. Tout arrêt entraînerait un déferlement de population et
le dépérissement des travaux entrepris pour protéger la nature.
Les ruraux, y compris les jeunes[16], restent très conformistes
dans leur vision politique. Ils attendent tout d’un Makhzen fort
et juste qu’ils ont tendance à idéaliser.
Paradoxalement, le statu quo assuré par la monarchie ne
satisfait peut-être pas entièrement les élites rurales. Les gros
agriculteurs marocains, qui veulent utiliser leur statut pour
transformer leur influence en pouvoir économique moderne,
souhaiteraient souvent se débarrasser, à peu de frais, du surplus
de population qui les gêne pour entreprendre une agriculture
moderne. Ils préféreraient, comme les colons autrefois, plus de
crédit agricole et d’investissements d’infrastructure en leur
faveur. L’émigration du surplus de population rurale vers les
villes ou vers l’étranger ferait mieux leur affaire que les
techniques raffinées de contrôle social. Ils s’accommoderaient
également d’une réforme agraire qui, en développant une
classe moyenne rurale, les mettrait à l’abri de plus amples
bouleversements. A l’opposé, certaines catégories de notables
traditionnels[17] estiment que l’État, en répandant le salariat,
porte atteinte à leur statut et leur enlève une main-d’œuvre à
bas prix.
Si l’État continue à se servir des élites locales pour contrôler le
monde rural, il ne choisit pas, consciemment ou non, d’en
faire le support d’un développement concerté. Aucune
politique de soutien officiel n est mise en œuvre à leur égard.
On en reste au système des faveurs, pour l’octroi d’un crédit
destiné à l’achat d’un tracteur, d’une bourse d’internat pour les
enfants, d’une licence de transport, ou d’une autorisation d
achat de terres de colonisation, pour ne citer que les mesures
courantes qui permettent aux caïds et aux gouverneurs de
payer en retour l’aide des élites locales. Il faudrait y ajouter les
tolérances de pratiques extra-légales qui valent surtout pour les
petits notables, ainsi que la faculté de créer des ennuis
multiples à ceux qui refuseraient trop leur collaboration.
Ces pratiques restent du domaine des comportements non
avoués et jamais rationalisés. L’administration doute que les
élites locales puissent engager assez vite un processus de mise
en valeur efficace. La part de consommation de prestige
nécessaire au maintien des relations de clientèle empêche le
développement des investissements productifs. L idéologie
dominante ne permet pas de privilégier les gros agriculteurs.
On sait de façon diffuse qu’ils n’ont pu acquérir de vastes
propriétés qu’en ayant recours à des pratiques faisant fi des
règles de solidarité du monde rural traditionnel[18] et en
bénéficiant de l’appui direct ou indirect du protectorat.
Le simple rapport des terres disponibles et de la population
rurale fait apparaître la nécessité de soulager les campagnes
d’un surplus de population, si l’on veut réaliser un
développement au niveau des exploitations individuelles. Or, si
le système a besoin des élites locales pour assurer la tranquillité
des campagnes, il n’est pas prêt à le payer d’un gonflement
démesure de la population urbaine. La marge de manœuvre
réduite du pouvoir lui fait désormais craindre tout risque et
toute innovation. Mais, à long terme, cette situation peut
ruiner les bases de l’alliance entre la monarchie et le monde
rural. Les élites locales peuvent être tentées par des solutions
plus dynamiques. La pression démographique peut amener des
explosions si des erreurs sont commises dans un contrôle qui
devient plus délicat.
Lorsque le Palais a pris le pouvoir en 1960, il s’est appuyé sur le
monde rural et sur la tradition pour donner à la monarchie,
semble-t-il, le temps de moderniser le pays. Peu à peu le
système s’est figé jusqu’à devenir la caricature du Makhzen
d’avant 1912, et du protectorat. D’autres solutions étaient
possibles. Lorsque la monarchie marocaine voulait doter le
pays d’institutions, dans la période allant de 1962 à 1965, les
problèmes du monde rural ont ete perçus en fonction d une
évolution globale du système politique. En fin de compte, la
peur des bouleversements a fait dérailler une expérience que
son propre dynamisme aurait également risqué de conduire à
des catastrophes.
Avant d aborder l’analyse des données dont nous disposons sur
les élites, il semble utile d’exposer, dans ses grandes lignes,
l’orientation que les responsables marocains du moment
entendaient donner à cette expérience.
Influence sur le système politique
Nous avons vu comment la monarchie marocaine avait su,
dans les premières années de l’indépendance, renverser son
système d’alliances pour s’assurer un contrôle quasi exclusif du
pouvoir. En schématisant grossièrement, on peut dire que
l’indépendance avait été obtenue par une coalition groupant,
au sein de l’Istiqlal, le roi, la bourgeoisie urbaine,
l’intelligentsia et le prolétariat, contre un pouvoir colonial qui
s’appuyait sur des élites rurales et religieuses.
De l’héritage du protectorat, le Parti nationaliste contrôlait, au
départ, la bureaucratie, principal instrument de modernisation
du pays. Il pensait s’en servir pour limiter les prérogatives
royales, tout en utilisant le prestige religieux et politique du
souverain pour dominer le monde rural. Mais les erreurs
commises par l’Istiqlal rassemblent bientôt, derrière le
souverain, les élites locales menacées par la disparition du
pouvoir colonial, et une paysannerie inquiète des
conséquences d’une modernisation maladroitement engagée
par l’administration. Après avoir favorisé l’éclatement du Parti
nationaliste, le souverain, qui a conservé la source juridique de
tout pouvoir, le commandement de l’armée et une autorité
religieuse incontestée, peut, grâce à son emprise sur les ruraux,
reprendre sans risque le contrôle direct du gouvernement et
d’une bureaucratie qui lui avait échappé au départ. Il possède
assez d’atouts pour que les autres partenaires s’inclinent, et
pour ne pas tenter une épreuve de force qui aurait tourné à leur
désavantage. La monarchie est alors consciente de la nécessité
d’entreprendre des réformes révolutionnaires pour éviter une
révolution qui ramènerait ses adversaires au pouvoir avec plus
de détermination. Ces derniers estiment que l’échec inévitable
du souverain devrait tourner rapidement à leur avantage.
Avec Hassan II, qui succède en 1961 à Mohamed V, la volonté
réformatrice, est encore plus nette. Le roi veut mettre à profit le
soutien dont il dispose dans les campagnes pour entreprendre
une politique de réformes acceptables par la paysannerie. Il
compte ainsi retrouver le soutien d’une bureaucratie assez
réservée au départ, sans perdre celui des élites locales. Sûr de
l’audience populaire de la monarchie, due à son prestige
religieux, à son passé nationaliste et à ses alliances avec le
monde rural, il entreprend de moderniser les institutions
politiques en créant un Parlement qu’il espère dominer assez
facilement pour ne pas perdre la réalité du pouvoir. Mais le
respect des procédures démocratiques formelles devrait éviter
de voir ses adversaires s’engager dans des voies extra-légales, et
lui gagner, pense-t-on, le soutien des classes moyennes. Il
espère aussi, en donnant une image flatteuse du Maroc à
l’étranger, obtenir une aide économique suffisante pour lui
éviter d’avoir à trop pressurer le monde rural, pour assurer le
décollage économique du pays.
L’étude de cette tentative de démocratisation et de cette
recherche d’alliances prouvera que cette politique se situait
dans la suite logique de la nouvelle alliance entre la monarchie
et les élites locales. Son échec transformera la nature de cette
coalition, et fera perdre à la monarchie son élan modernisateur.
A moyen terme, cette voie nouvelle crée plus de problèmes
qu’elle n’en résout et risque d’affecter la nature du système.
Le contrôle des élites locales pouvait certes faciliter
l’établissement, à l’échelle nationale, d’un système d’élites
favorable à la monarchie. Le suffrage universel lui assurerait
une légitimité populaire qui se fondrait dans la légitimité
traditionnelle, affaiblie depuis la mort de Mohamed V. Il fallait
aussi, pour que cette évolution s’accomplisse sans trop de
heurts, rattacher le Maroc à un ensemble de solidarités
internationales fournissant les moyens techniques et financiers
d’un développement économique qui lui permettaient de
surmonter sa crise de croissance sans avoir à imposer une
pression fiscale trop forte, en particulier sur la paysannerie.
Cette politique de changement, qui s’appuyait sur la tradition
et sur l’aide extérieure, pouvait être acceptée par une large part
des élites, dans la mesure où les premiers gouvernements de
l’indépendance avaient fait la preuve de leur inaptitude à
obtenir le soutien des ruraux et la confiance des pays étrangers,
en particulier de la France. En revanche, la monarchie semblait
bénéficier, dans les deux cas, d’un crédit renforcé par l’échec
des partis et l’évolution des pays voisins. La fin de la guerre
d’Algérie va bientôt redonner au gouvernement marocain une
liberté de manœuvre dans ses relations avec la France, qu’il
avait perdue depuis le détournement par Alger de l’avion
transportant les chefs du FLN, en octobre 1957. L’opposition
aurait exploité toute concession à la France comme une
trahison envers les Algériens. Or le Maroc veut régler le
problème des terres de colonisation pour donner une
satisfaction à son opinion publique, et s’assurer, en même
temps, une aide économique et financière.
Dans l’entourage de Hassan II, Ahmed Reda Guedira fut, de
1960 à 1964, la cheville ouvrière de cette politique. Cet avocat
d’origine modeste, né à Rabat, qui a défendu les nationalistes
devant les tribunaux du protectorat, a fait partie des premiers
gouvernements. Ministre d’État, il participera aux négociations
franco-marocaines qui aboutirent au protocole du 2 mars 1956.
Ministre de la défense, il collaborera avec le prince héritier
Moulay Hassan à l’organisation des Forces armées royales et à
l’intégration de l’Armée de libération. A l’Information, il
travaillera à l’élaboration d’une loi sur la presse, d’inspiration
libérale, qui sera reprise dans la Charte des libertés publiques,
en novembre 1958. Ces engagements lui vaudront l’hostilité
tenace de l’Istiqlal. Ecarté du pouvoir sous les gouvernements
Balafrej et Abdallah Ibrahim, il ouvrira un cabinet d’avocat à
Rabat et lancera, début 1960, un hebdomadaire. Les Phares[19],
dont les articles passeront pour exprimer les vues du prince
héritier dont il est resté proche depuis son passage à la Défense.
On ne s’étonnera pas de voir Guedira nommé directeur de
cabinet lorsque Moulay Hassan sera chargé des fonctions de
vice-président du Conseil, le 26 mai 1960.
Guedira est, dans le système politique marocain, un cas
particulier. Il n’appartient pas aux clientèles des partis, ni aux
bourgeoisies citadines. Certes, il a fondé avec quelques amis
originaires de Rabat — Mouline, Cherkaoui, Bargach — le
mouvement des Libéraux indépendants qui ressemble plus à
un club qu’à un parti. Il n’appartient à aucun groupe ; il est en
fait un homme de Makhzen nouveau style[20]. Il se veut lui-
même un légiste au service du prince. Profondément libéral, il
déteste les méthodes autoritaires, qu’elles soient celles d’un
parti unique, ou d’une armée au pouvoir. Il refusera d’en user
pour écraser ses adversaires[21]. Fidèle au Palais, il a cependant
l’ambition de donner un autre visage à la monarchie. Il
procède avec prudence, sans jamais trop éclairer ses intentions.
Il connaît assez bien Hassan II pour savoir son attachement au
passé, sa crainte de voir la monarchie balayée dans le
renouveau. Il est aussi conscient des forces profondes, des
influences familiales[22] et des clientèles qui, dans l’entourage
du roi, plaident pour le statu quo garanti par l’armée.
Les changements qu’il propose au prince héritier, puis au roi,
devront permettre à ce dernier d’abandonner progressivement
son rôle d’arbitre pour assumer des responsabilités de leader
engagé. Il ne peut le persuader de couvrir ses initiatives qu’en
lui faisant apparaître les risques de l’immobilisme. Il doit aussi
se porter garant du succès à court terme de ses projets. Guedira
ne sous-estimait pas les difficultés de l’entreprise. Mais, pour
lui, la certitude des catastrophes dues à une politique purement
conservatrice était un motif suffisant pour tenter l’aventure. Ses
adversaires laissaient entendre qu’il prenait d’autant plus
facilement ce risque qu’il avait peu à perdre en cas d’échec, et
beaucoup à attendre en cas de succès.
Revenu au pouvoir avec le prince héritier, en 1960, Guedira
entreprit, par étapes, de s’assurer le contrôle du monde rural et
de préparer des institutions qui lui permettraient d’atteindre, à
long terme, ses objectifs politiques. Il s’agissait de renforcer les
clientèles liées à la monarchie, en transposant au niveau
supérieur le système de coopération avec les élites locales
réorganisé de façon empirique sous Mohamed V. Le projet de
mobilisation de la main-d’œuvre, qui donnera naissance à la
Promotion nationale, fut, pour lui, l’occasion d’une première
tentative en direction du monde rural traditionnel[23]. Au
départ, l’opération se veut révolutionnaire. Elle se situe dans
un ensemble de mesures à l’étude pendant l’hiver 1960, qui
prévoyait l’organisation d’un service civil et la préparation
d’une réforme agraire. Les dirigeants marocains sont frappés
par les premiers chiffres connus du recensement de 1960, qui
font passer le pays à plus de onze millions d’habitants[24]. Sous
l’influence de Guedira, le prince héritier se déclare, alors,
partisan de réformes révolutionnaires pour éviter la révolution.
Mais pour appliquer cette politique, le gouvernement ne
dispose que du réseau des agents de l’intérieur et des élites
locales[25]. Conçue comme une révolution contrôlée, rendue
acceptable par la caution monarchique, la Promotion nationale
finira par n’être qu’une soupape de sécurité pour maintenir le
système traditionnel.
En même temps qu’il voulait donner à la monarchie le lustre
des réformes révolutionnaires, Guedira songeait à renforcer la
légitimité de l’institution et son soutien populaire, en
l’engageant dans un processus de démocratisation. Au départ,
l’opération reposait sur une série de scrutins en cascade, valable
dans son principe, mais qui demandait, pour réussir, une
maîtrise exceptionnelle du système politique. Dans un premier
temps, on espérait mobiliser le sentiment de fidélité
monarchique pour obtenir un vote massif en faveur d’un projet
de Constitution de style Cinquième République. Le succès
devait être exploité à la fois sur le plan intérieur et extérieur. Il
devait servir à regrouper un vaste mouvement qui fournirait au
régime la majorité docile qui lui permettrait d’acclimater en
douceur de nouvelles formes de gouvernement. A l’extérieur, il
devait servir à montrer que le Maroc figurait parmi les rares
pays du Tiers Monde capables de réussir une adaptation de la
démocratie, et dont le gouvernement disposait d’un soutien
populaire incontestable. On pouvait alors espérer drainer les
aides et les investissements de pays occidentaux qui avaient
intérêt à favoriser le succès de l’expérience marocaine. Pour
Guedira, l’Espagne était le modèle d’évolution d’une société
autoritaire bloquée dont l’économie devait entraîner le système
politique dans la voie de la libéralisation. A côté d’une Algérie
dont l’indépendance s’installait dans l’instabilité, le Maroc
devait donner à l’Europe l’image d’un partenaire sérieux,
capable de contenir, le cas échéant, un voisin turbulent.
L’ouverture du Maroc sur l’extérieur reposait, en priorité, sur
l’amélioration des relations avec la France. La guerre d’Algérie
avait fini par créer une série de malentendus et
d’incompréhensions. L’aide financière française avait été
suspendue depuis 1957. L’accord de Paris était nécessaire pour
régler de nombreux problèmes, en particulier celui des terres de
colonisation que la monarchie entendait récupérer. Rendu
inquiet par une indépendance algérienne survenue plus
rapidement qu’il ne l’escomptait. Hassan II éprouvait le besoin
de renforcer le potentiel économique et militaire de son pays.
Son rapprochement avec la France devenait possible et
nécessaire, à mesure que le règlement du conflit franco-algérien
se dessinait[26].
Dès le mois de juillet 1961, le beau-frère du roi, Mohamed
Cherkaoui, est nommé ambassadeur à Paris. Le roi effectue un
premier voyage en France le 14 mai 1962. Une série de contacts
au niveau ministériel fait aboutir divers projets de coopération.
Un nouvel accord d’aide est signé, le 11 août 1962, pour un
montant de 300 millions de francs. Le 13 août 1962, le Maroc
obtient un prêt de 8 600 000 dollars des États-Unis, et des
négociations sont en cours avec la Banque mondiale pour un
prêt de 15 000 000 de dollars.
En 1962, les pays occidentaux répondent favorablement aux
demandes marocaines destinées à faciliter la consolidation de
l’économie et à permettre une expérience politique libérale. Les
capitaux privées, tant marocains qu’étrangers, hésitent encore
cependant à s’investir. Pour vaincre leurs réticences, et pour
mieux effectuer les réformes nécessaires à son décollage
économique, en excluant toute solution révolutionnaire, le
gouvernement montre son intention d’amener le Maroc à
l’Europe. L’ouverture du pays aux investissements étrangers a
aussi pour but de rassurer les capitalistes nationaux, de les
convaincre d’investir dans le pays, et de consolider leur
situation politique en les associant au développement
économique.
Une première décision devait concrétiser cette orientation. Le
Maroc choisit d’engager des pourparlers avec le Marché
commun[27] en vue d’aboutir à un traité d’association. Pour
cette tâche exploratoire, Guedira fera désigner, en avril 1963,
un grand bourgeois moderne qui avait appartenu à l’Istiqlal,
Bensallem Guessous, comme ambassadeur à Bruxelles. Ancien
gouverneur de Fès et de Tanger, ce pharmacien originaire d’une
grande famille de Fès avait pour mission de présenter à ses
interlocuteurs européens un visage moderne et accueillant de
son pays.
Le succès du Parti monarchique aux élections était attendu
pour mieux convaincre les partenaires européens du sérieux
des intentions marocaines. Les déroulement des opérations, qui
ont conduit du succès du référendum du 7 décembre 1962 à
l’échec des élections législatives du 17 mai 1963, a été analysé
par ailleurs[28], nous n’en retiendrons que les éléments les plus
significatifs. Le succès monarchique obtenu au référendum
devait être exploité, dans l’esprit de ses organisateurs, sur
plusieurs plans. Le plus important, pour Guedira, était de
convaincre le roi qu’il pouvait abandonner son rôle
traditionnel d’arbitre et se transformer en une sorte de
monarque-président. Hassan II s’était engagé sans trop de
crainte dans la bataille du référendum. Il gardait cependant
quelques inquiétudes sur le comportement des grandes cités du
littoral. Or, Casablanca, Rabat et Kenitra avaient voté oui,
faisant la preuve de la légitimité populaire de la monarchie.
Après son succès au référendum, Guedira décida d’éliminer du
gouvernement, sous un prétexte futile, les ministres de
l’Istiqlal. Ce parti réclamait avec trop d’assurance le salaire de
sa participation à la victoire. Le souverain acceptait toutefois de
garder dans son équipe des individualités proches du parti
comme Youssef Bel Abbes et Ahmed Balafrej. L’UNFP était
éprouvée par l’échec du boycottage du référendum, et l’UMT
renâclait à suivre aveuglément la ligne de ce parti : dans ces
conditions, le maintien de l’Istiqlal au gouvernement aurait
abouti à conférer à ce parti la caution monarchique, lors des
élections. Son implantation dans le pays, l’organisation
relativement efficace de cellules et de militants qu’il venait de
mobiliser pour le référendum risquaient alors de lui apporter la
majorité absolue au sein du futur Parlement. Le Mouvement
populaire ne pouvait pas espérer seul une représentation
majoritaire, et Guedira ne souhaitait pas voir l’opération
délicate de mutation du système monarchique dépendre trop
du soutien d’un parti s’appuyant sur les notables ruraux
conservateurs. Le passage de l’Istiqlal dans l’opposition devait
donc être suivi par une manœuvre de rassemblement, autour
du roi, des individus et des groupes qui avaient soutenu la
monarchie contre les partis, depuis le début de l’indépendance.
A plusieurs reprises, notamment en 1958, de nombreuses
personnalités s’étaient regroupées autour du président Bekkaï[29]
pour constituer un Parti monarchique. Guedira veut rééditer
cette opération, mais en s’assurant un engagement de Hassan II
beaucoup plus net que les encouragements privés et parfois
contradictoires que Mohamed V prodiguait à ses partisans,
quitte à les laisser ensuite seuls en face de leurs adversaires.
Son action ne visait pas à l’anéantissement de l’opposition[30],
mais seulement à lui laisser, dans le cadre des assemblées
locales, provinciales, professionnelles et nationals prévues par
la Constitution du 7 décembre 1962, un statut minoritaire,
permettant une liberté de critique. Il espérait même, une fois
l’affrontement électoral terminé, récupérer individuellement,
pour le FDIC ou pour l’administration, la grande masse des
militants de l’Istiqlal, et quelques-uns de ceux de l’UNFP. Il
entretenait déjà des relations de coopération objective avec
l’UMT, qui le rassuraient sur les intensions futures de ce
syndicat.
Avant les élections, Guedira prend donc le risque d’engager la
monarchie dans une épreuve où ses seuls alliés sont les élites
locales traditionnelles dominées par quelques personnalités en
rupture des autres groupes. Il compte sur l’appui de la
bureaucratie pour élargir sa clientèle, et il sait que l’armée reste
un recours possible en cas de catastrophe. La division de ses
adversaires semble rendre l’opération sans risque. Après la
victoire, les ralliements individuels, facilités par l’attrait du
partage des dépouilles, permettront d’élargir l’assise du
pouvoir.
Une autre tactique aurait consisté, pour la monarchie, à
engager la bataille électorale sur la base d’une alliance de
l’Istiqlal et du Mouvement populaire, réunissant la bourgeoisie
urbaine et la paysannerie traditionnelle, plus un courant
marginal d’individus dévoués à la monarchie. L’Istiqlal aurait
sans doute accepté ce compromis, en montrant plus
d’exigences après les élections. Mais on se serait heurté à des
incompatibilités de personnes. Les leaders du Mouvement
populaire avaient le sentiment de représenter la majorité dans
les campagnes, et n’auraient pas facilement accepté des
arbitrages ou les investitures électorales. Guedira n’aurait pas
pu poursuivre, comme il l’espérait, son plan de réformes après
la victoire, en s’appuyant sur une majorité solide et cohérente.
On aurait pu aboutir à un système réellement parlementaire où
les groupes auraient été en mesure de négocier leur appui à la
monarchie, au lieu du régime quasi présidentiel de type
Cinquième République auquel songeait Hassan II. La tactique
choisie par Guedira avait des conséquences plus graves qui
faisaient hésiter le souverain à lui accorder un soutien sans
réserve.
La monarchie avait jusqu’alors refusé de se couper
définitivement de quelque groupe politique que ce soit. En
contrepartie, ni l’Istiqlal, ni l’UNFP, ni l’UMT n’avaient
contesté la forme monarchique du gouvernement, demandant
seulement au roi de reconnaître leur représentativité. Un
engagement plus net du souverain à la tête de ses partisans ne
respecterait pas la règle du jeu tacite entre le roi et la classe
politique. Guedira avait cependant besoin de cet engagement
pour vaincre les hésitations des individus et des groupes,
notamment au sein du Mouvement populaire. Si Khatib était
plutôt favorable à une fusion organique de ce parti dans le
cadre du mouvement monarchique que préparait Guedira,
Ahardane était plus réticent ; il sentait que les militants des
provinces se refuseraient à suivre les directives du président du
parti.
Le roi hésite longtemps à s’engager publiquement de façon
irréversible dans la lutte politique. En février 1963, ses relations
avec Guedira deviennent tendues : ce dernier refuse de se
lancer dans la lutte électorale sans garanties. Les hésitations du
roi sont renforcées par une démarche officieuse de l’armée. Le
général Kettani, chef d’État-Major, accompagné de plusieurs
officiers, intervient au dernier moment auprès du roi pour que
le mouvement, dont Guedira va annoncer la naissance le 20
mars 1963, ne s’appelle pas Front monarchique
constitutionnel. L’armée veut bien défendre la monarchie,
mais elle n’entend pas cautionner indirectement un parti, quel
qu’il soit[31]. La mise en garde est suffisamment nette pour que
Hassan II donne l’ordre à Guedira de modifier le nom du
nouveau parti. Faute de pouvoir disposer plus nettement de
l’engagement du souverain, qui justifie ses réticences en
invoquant tantôt l’exemple de Mohamed V, tantôt celui du
général de Gaulle, Guedira a les coudées franches pour
mobiliser l’administration dans la campagne qui se prépare à
l’installation des bureaux du FDIC. Il fait également adopter
une tactique électorale audacieuse, misant tout le succès de
l’opération sur les élections législatives : il fait démarrer la série
des sept scrutins par les élections législatives qui devaient, en
fait, en être l’aboutissement. La pression des événements
devrait souder la coalition gouvernementale dont il redoute la
fragilité.
Maître du calendrier, il peut également fixer les règles du jeu. Il
fait adopter le principe du scrutin uninominal à un tour qui
devrait se montrer le plus efficace dans les élections
triangulaires, sans qu’un second tour permette des coalitions
ou des désistements qui ne profiteraient guère aux candidats
gouvernementaux. Comme pour les élections communales, ce
mode de scrutin favorise les personnalités ayant une audience
locale, réduit les facteurs idéologiques et les cohésions
partisanes. Il favorise, donc, au niveau supérieur, les
candidatures d’élites locales. Ces conséquences étaient prévues
par une étude des services du Ministère de l’intérieur, datant de
janvier 1963, qui concluait en faveur de ce mode de scrutin,
tout en soulignant, compte tenu des résultats des élections de
1960, les risques politiques que faisait courir la présence de
l’Istiqlal dans le camp de l’opposition. Par prudence, le
Ministère de l’intérieur conseillait d’attendre les premiers
résultats des élections aux assemblées professionnelles et
locales, avant d’arrêter la position définitive du gouvernement
dans le choix du mode de scrutin et du découpage. On sait que
cette tactique ne fut pas suivie par Guedira qui craignait de voir
le soutien royal et la cohésion de sa coalition gouvernementale
s’user dans les conflits et les arbitrages de scrutins mineurs. Le
gouvernement accepta de risquer toute sa mise dans
l’organisation des élections législatives, les scrutins ultérieurs
constitueront, si besoin, des opérations de rattrapage.
Un bouleversement du calendrier électoral ayant été la
conséquence de cette stratégie, le Cabinet du ministre dut
improviser à la hâte un découpage électoral. Il prit comme base
les cercles et les municipalités qui furent, suivant l’importance
de la population, divisés en circonscriptions comptant en
moyenne 80 000 habitants[32]. Les découpages des
circonscriptions urbaines furent demandés aux gouverneurs. Le
projet gouvernemental avantageait légèrement les
circonscriptions rurales du Nord et du Sud du pays qui, lors du
référendum, avaient apporté un soutien massif à la monarchie.
Ce découpage, qui suivait les circonscriptions administratives,
facilitait le rôle des chefs de cercle et des pachas. Il permettait
une propagande orale auprès des élites locales, et des
interventions discrètes pour décider certains à se présenter, ou
pour freiner des candidatures trop nombreuses. L’efficacité de
cette procédure d’influence indirecte eut des résultats divers.
Dans certaines circonscriptions, où l’administration locale
entretenait, suivant un mode traditionnel, des relations de
clientèle avec des notables, les élections pouvaient être gagnées
sans avoir à employer de fortes pressions. Mais très souvent la
bureaucratie, notamment le réseau des agents de l’intérieur, fut
réticente à se compromettre dans un appui sans réserve à des
candidatures gouvernementales qui étaient loin de recueillir sa
faveur vu leur caractère trop conservateur. Quelques
fonctionnaires allèrent jusqu’à apporter un soutien plus ou
moins discret à l’opposition, dont les candidats avaient une
formation plus proche de celle des agents de l’État que les
notables traditionnels investis par le gouvernement. D’autre
part, en ville et dans les campagnes touchées par la
modernisation, l’intervention administrative dut utiliser des
moyens de pression délicats à manier, tels que l’attribution des
multiples autorisations ou les distributions de denrées par
l’Entraide nationale ou les Sociétés musulmanes de
bienfaisance.
Dans l’ensemble, la coalition gouvernementale était moins
adaptée que ses adversaires au nouveau style d’action politique
défini par la Constitution. L’Istiqlal et l’UNFP arrivaient à
désigner un candidat par circonscription sans trop de peine,
grâce à leurs bureaux locaux et aux correspondants de leurs
journaux qui constituaient un réseau politique assez structuré
pour couvrir le pays[33]. Les candidats du FDIC furent désignés
de Rabat faute d’une telle implantation locale. L’entourage de
Guedira croyait que les mécanismes, qui ‘avaient joué lors du
référendum, interviendraient à nouveau lors des élections
législatives. Sa confiance était renforcée par son ignorance du
jeu politique local et par une certaine familiarité avec l’exemple
français. Celui-ci avait fonctionné pour la Constitution et le
référendum ; il devait également assurer une majorité
confortable au Parlement. Le souverain partageait ce sentiment
mais sans vouloir s’engager personnellement dans la lutte, et
lorsqu’il fallut procéder à des arbitrages délicats entre les
personnes, Guedira ne put pas compter sur son soutien actif. Il
dut s’entendre avec Ahardane et Khatib pour le Mouvement
populaire, avec Boutaleb pour le PDC. De leur côté, les leaders
de parti avaient fort à faire pour empêcher leurs bureaux locaux
de présenter des candidats contre ceux du FDIC. En ville, les
ministres et certains hauts fonctionnaires se firent attribuer des
circonscriptions jugées sûres. Guedira tiendra plusieurs
meetings à Casablanca, Rabat et Marrakech, mais ses collègues
jugeront contraire à leur dignité de faire campagne.
Le FDIC n’obtiendra pas la majorité absolue de 85 sièges qu’il
espérait, fort des prédictions des gouverneurs. Le roi est déçu,
et le désaccord règne au sein du parti, dès le lendemain du
scrutin. Guedira a certes été élu au bidonville des Carrières
centrales à Casablanca, mais sept ministres ont été battus, le
plus souvent par des candidats Istiqlal. Le Dr Khatib a eu une
élection très facile à Aknoul qui rend plus amère la défaite de
Ahardane à Khenifra. Parmi les 69 élus du FDIC, la majorité est
de tendance Mouvement populaire et d’origine rurale et
berbère. L’opposition reproche à Guedira et aux agents de
l’intérieur d’avoir truqué les élections, alors que les ministres
battus estiment qu’on les a ridiculisés en laissant triompher
leurs adversaires. Le roi a perdu confiance dans l’habileté de
Guedira. Il se montrera plus réticent pour le soutenir à
l’intérieur du gouvernement ou face à ses adversaires. Il aspire à
redevenir l’arbitre au-dessus des partis. Il a souffert durant la
campagne électorale de se voir pris à partie directement, et
parfois violemment, sans que Guedira, respectueux du jeu
électoral, n’emprisonne ses détracteurs. Guedira paiera son
échec partiel en quittant l’intérieur, qui sera confié à un ancien
président de la Cour suprême. Ahmed Hamiani, personnage
dont l’impartialité devrait garantir, aux yeux des partis, les
futurs scrutins.
La coalition du FDIC n’aurait pu tenir au Parlement qu’avec le
soutien renforcé du souverain à Guedira. Sa demi-disgrâce
déchaînera les envies et les rancœurs longtemps accumulées,
qu’il faudra modérer cependant jusqu’aux élections des
dernières assemblées prévues par la Constitution. Avant d’en
revenir aux anciennes méthodes d’arbitrage entre les hommes
et les tendances, le roi veut montrer aux partis qu’il reste le
maître de la force. Le 7 juin, il fait emprisonner cinq
représentants Istiqlal du Rharb — dont l’ancien ministre de
l’Agriculture, Mansour Nejjaï — qui avaient protesté, auprès de
l’ambassade des États-Unis, contre l’utilisation de blé américain
par les caïds durant la campagne électorale[34]. Le 16 juillet, la
découverte d’un complot UNFP à Casablanca entraîne 130
arrestations dont celles de plusieurs membres du Parlement.
Très vite, on parla d’aveux arrachés sous la torture. Le Palais
laissa l’opinion attribuer la responsabilité de la répression au
général Oufkir : il entendait donner aux opposants un aperçu
de ce qui leur serait réservé s’ils n’acceptaient pas à nouveau les
conventions du gouvernement monarchique. Il semble que le
message ait été entendu. Les élus Istiqlal sont relâchés fin août,
lors de la naissance du prince héritier, et la situation des
prévenus de l’UNFP devint moins rigoureuse après les scrutins
favorables au FDIC pour les assemblées communales,
provinciales et professionnelles, dont l’élection déterminera la
composition de la seconde Chambre du Parlement[35].
Lors de l’ouverture du Parlement, le retour au jeu traditionnel
était assuré. Un événement extérieur, le conflit frontalier avec
l’Algérie, avait, il est vrai, contribué largement à renforcer
l’unité nationale. Dès le début du conflit, le roi avait reçu Allai
el Fassi, et Bouabid fit une déclaration condamnant l’agression
algérienne[36]. Avant la rentrée parlementaire, le roi déclara
qu’il entendait associer l’opposition aux responsabilités. Tous
les représentants, quel que soit leur parti, seront ses
conseillers[37]. Mais la majorité parlementaire, élue au nom du
souverain, s’effritera d’elle-même, d’abord à l’intérieur du
FDIC, puis du PSD et même du Mouvement populaire. Elle
éclate en groupuscules incohérents ; elle ne représente guère
plus que des clientèles, se prévalant chacune de la faveur royale
passée, présente ou future. A la base on trouve le malentendu
qui a présidé à la constitution du FDIC. Les candidats, qui
appartenaient aux élites locales et provenaient du Mouvement
populaire, représentent plus des deux tiers du groupe
parlementaire. Ahardane estime que le roi devrait en tenir
compte dans la composition du gouvernement et augmenter
leur représentation. Ahardane supporte avec un énervement
croissant le rôle de Guedira et de ses amis citadins[38].
Comme il ne peut compter ni sur une majorité solide, ni sur le
soutien avoué du roi, le gouvernement laisse le Parlement
agrandir le champ de sa compétence. Les élus, même ceux de la
majorité, supportent mal de se voir opposer des règles
constitutionnelles ou réglementaires limitant leur pouvoir. Ils
ont le sentiment d’incarner un pouvoir légitime, issu du
suffrage populaire. En face d’eux, les ministres ne sont que des
fonctionnaires, mandatés par un souverain qui les abandonne,
en cas de conflit, pour préserver son rôle d’arbitre.
Les élus vont donc utiliser leur pouvoir pour renforcer leur
position au sein des assemblées locales, et agrandir leur
clientèle par des faveurs obtenues de l’administration.
De son côté, l’opposition n’aura pas au Parlement une attitude
plus constructive que celle de la majorité. Elle est officiellement
prisonnière de ses outrances et de ses déclarations durant les
campagnes électorales. Elle ne cherche pas à partager le
pouvoir, mais à l’exercer en totalité. Le Parlement lui apparaît
plus comme un instrument de propagande, une tribune pour
s’adresser au pays, ou un moyen de pression sur le Palais,
qu’une assemblée responsable associée au pouvoir. Sans
majorité réelle et sans solution de rechange à l’intérieur du
Parlement, Hassan II sera conduit, après les événements de
Casablanca de mars 1965, à renvoyer les assemblées et à
assumer seul le pouvoir.
Cet échec sur le plan intérieur coïncide avec l’abandon des
espoirs fondés sur l’Europe et les pays occidentaux. Une erreur
de calcul, due à une fausse appréciation des décisions du
général de Gaulle, était à la base de cette analyse. Hassan II ne
croyait pas à une indépendance aussi rapide de l’Algérie.
Devant les difficultés des débuts, les rivalités à l’intérieur du
FLN, le départ des Français, il ne pensait pas que la coopération
franco-algérienne puisse durer. Il estimait inévitables des
tensions et une rupture qui reporteraient la sympathie et l’aide
de l’ex-métropole sur le Maroc. Devant la puissance de l’armée
algérienne, il avait, en 1963, un besoin urgent de matériel
militaire. Il devait, sur ce plan, apporter quelques satisfactions
à l’État-Major.
Or, quand Hassan II se rendit en France en juin 1963, il trouva
le général de Gaulle moins accueillant qu’en mai 1962, et
beaucoup plus préoccupé d’établir une coopération exemplaire
avec l’Algérie de Ben Bella[39]. La France ne prit pas parti dans le
conflit qui opposa Algériens et Marocains, à l’automne 1963. Sa
neutralité, implicitement reconnue par Ben Bella, fut ressentie
comme un abandon par les Marocains. L’affaire Ben Barka vint
consommer la rupture de ce qui aurait pu constituer une
nouvelle alliance avec la dynastie alaouite. Faute d’un soutien
français. Hassan II était amené à se tourner vers les Américains
pour obtenir l’aide financière et militaire dont il avait besoin.
L’aide américaine est déjà, à partir de 1961, un élément
déterminant de la reprise en main du monde rural. Ses
fournitures de blé, au titre de la Public law 480 (P.L. 480),
permettent le lancement de la Promotion nationale dont le
coût est supporté pour moitié par les États-Unis. En fait, cette
aide va au-delà de la prise en charge d’une partie de la
paysannerie sans terre, ou du prolétariat urbain sous-employé.
Nous avons vu comment la Promotion nationale et l’Entraide
nationale constituaient les moyens d’approvisionnement
tolérés de la corruption administrative. On peut donc avancer
que les États-Unis prennent aussi à leur charge une large part
du coût de financement des structures administratives locales :
financement du moqqadem qui ne figure pas sur les rôles
approuvés par le Ministère des finances, financement de celui
qui, tout en y figurant, prélève sa part des distributions,
financement du cheikh qui, par ses fonctions, aura droit à une
part plus grande encore, sans compter le caïd et ses supérieurs
qui seront cependant plus intéressés par les fraudes sur les
paiements en espèces.
Il ne faudrait pas croire, pour autant, que l’aide américaine est
à elle seule responsable de toute la corruption de
l’administration locale. Chaque intervention administrative
peut être l’occasion d’un prélèvement à plusieurs niveaux,
beaucoup plus lourd pour les populations que ceux que nous
venons de mentionner. Mais l’aide américaine trouve un point
d’impact au cœur du système d’alliance entre la monarchie et
les élites locales.
Ainsi, l’entreprise séduisante et risquée que poursuivait Guedira
aura échoué sans que l’on ait avoué la nature du projet ni
proclamé son abandon. Il était difficile, certes, d’annoncer à
chacun des partenaires la nature de l’entreprise. Mobiliser les
forces conservatrices de la société marocaine par l’intermédiaire
des élites locales, s’assurer un soutien populaire en
convertissant la légitimité traditionnelle d’essence quasi
religieuse en légitimité démocratique par un référendum et des
élections, utiliser l’aide étrangère pour éviter de faire croître la
pression fiscale interne au-delà de ce que pouvaient supporter
la paysannerie et la classe moyenne, pouvaient sembler un pari
risqué mais séduisant. Le roi aura réussi à renforcer son
pouvoir, mais il échouera dans sa tentative d’intégrer d’autres
groupes dans le système politique, sans en perdre le contrôle.
La monarchie marocaine n’a pourtant pas été loin de réussir à
faire participer toutes les forces politiques du pays à un système
cohérent et original de modernisation. Elle risquait, certes,
d’être réduite au rôle de symbole d’unité et de légitimité, dans
une situation relativement comparable à celle de la monarchie
japonaise après les Meiji.
Dans la période qui suivit les élections de 1963, Hassan II
préféra garder le contrôle du système politique et abandonner
progressivement toute idée de réformes profondes, mais, dans
les arbitrages qu’il devra rendre chaque fois qu’un conflit
surgira, le roi se montrera avant tout soucieux de ne pas
mécontenter les éléments traditionnels de la société,
notamment les élites locales, intermédiaires de son alliance
avec le monde rural.
De leur côté, les élites locales ou nationales se soucient plus
d’assurer leur part des bénéfices immédiats de l’indépendance
que de prévoir et organiser l’avenir. L’attitude du roi est assez
comparable : le provisoire lui semble plus compatible et plus
rassurant dans la mesure où il n’aura pas, en dépit du
Parlement, à définir, encore moins à limiter, ses pouvoirs. Il
confondra son rôle traditionnel d’arbitre d’un jeu organisé et
contrôlé par lui, avec celui de monarque constitutionnel. A
court terme, le jeu est sans risque et satisfait tous les
partenaires, y compris les opposants. A long terme, il bloque
toute évolution qui exigerait des décisions difficiles pour
transformer le pays en faisant l’économie d’une révolution.
La place des Berbères dans le système des élites
locales
En étudiant les élites locales, on se trouve à chaque instant face
au problème des rapports entre la monarchie et le monde
berbère. Il serait aussi illusoire de le nier que d’en faire le
ressort unique d’une politique. Avant d’être une politique
berbère, la politique de la monarchie à l’égard des élites locales
est avant tout une tentative d’alliance avec le monde rural pour
neutraliser la bourgeoisie urbaine et le prolétariat. Prolétariat et
bourgeoise urbaine prennent le chemin d’une évolution qui
entraîne nécessairement la mise à l’écart de la monarchie, en
tant qu’organe de gouvernement. On pourrait avancer que la
« politique berbère » du protectorat n’avait pas d’autres
mobiles, son caractère berbère pouvant apparaître comme une
justification idéologique visant en outre à retarder la
constitution d’un système politique unitaire. Sous la
monarchie, la justification idéologique se transforme. Il n’est
plus question de remettre en cause l’unité du pays. La
sollicitude à l’égard d’un monde rural défavorisé prime et
permet de justifier le freinage d’un développement urbain et
industriel dont on craint les conséquences.
Il reste cependant vrai que le problème berbère conserve un
poids social et politique que nous avons maintes fois rencontré
en faisant l’étude des élites locales. Il semble nécessaire, avant
de procéder à l’analyse quantitative de données qui vont nous
permettre de mieux situer l’importance de ce facteur, de faire
une mise au point sur l’interprétation globale que nous
proposons.
La place des Berbères dans le système politique marocain après
l’indépendance[40] reste ambiguë. Une analyse simplificatrice
tendrait à les représenter comme les principaux soutiens
politiques du nouveau Makhzen, le nouveau Guich sur lequel
le pouvoir monarchique s’appuie pour résister aux tendances
uniformisantes et modernistes du nationalisme urbain.
En 1956, le monde berbère a, par rapport au nationalisme
urbain, le prestige d’avoir remporté sur le terrain des succès qui
ont culbuté les institutions du protectorat. Il lui reste la tare
d’avoir été l’enfant chéri des mythes du colonisateur, et d’avoir
fourni trop longtemps des auxiliaires fidèles pour la répression
urbaine.
Mais l’Islam jacobin des nationalistes reste, avec une parfaite
bonne foi, plein d’ignorance et de suspicion à l’égard du
monde berbère. Pour lui, il n’est de bon Berbère que celui qui
se renie comme tel. La pierre de touche du nationalisme
devient pour l’Istiqlal la suppression de tout particularisme,
l’abolition des tribunaux coutumiers et leur remplacement par
des juges nommés par le roi, la disparition des fonctionnaires
locaux issus du milieu, et leur remplacement par des caïds
nommés par le pouvoir central. Toute réticence à ce zèle
unificateur et étouffant est soupçonnée et condamnée comme
une nostalgie du régime antérieur, illégitime par nature et à la
limite impie.
Il n’est pas étonnant de voir alors fleurir le mécontentement et
éclater la rébellion. L’attitude des régions berbères prend
l’allure d’un irrédentisme. Les situations historiques et
économiques influencent les manifestations d’opposition. Les
heurts et l’incompréhension entre les milieux berbères et les
intellectuels nationalistes au pouvoir s’alimentent, en fait, à
des rythmes différents, de ces évolutions.
L’indépendance trouve le monde berbère encore plus divisé et
différencié qu’en 1912. Au Nord, le Rif est isolé par une
frontière historique nouvelle, créant un système économique
particulier. Depuis la fin de la révolte d’Abdel-Krim, l’Espagne y
est acceptée, car elle colonise et administre peu. Son armée
offre des débouchés aux hommes des tribus. Ses
administrateurs laissent allégrement les troupeaux et les
charbonniers dévaster la forêt. L’Algérie voisine fournit aux
Rifains des emplois saisonniers appréciés. Aussi le Rif a-t-il
dévié son ardeur revendicatrice contre le colonisateur fiançais,
soutenant les efforts de la résistance et de l’Armée de libération
pour l’indépendance.
Ce n’est pas sans inquiétude qu’il ressent, dès 1957, l’effet en
retour de l’unification qui aboutit à l’intégrer dans un système
monétaire, juridique et culturel de type français, imposé par les
nouvelles élites éduquées dans le Sud du pays. Ses propres élites
se trouvent encore plus coupées du pouvoir nouveau que les
bourgeois de Tétouan.
A l’opposé, le Moyen-Atlas constitue le type idéal du parc
national berbère évoqué par Jacques Berque. Protégé des
appétits des colons par les règles particularistes des zones
d’insécurité, il est, sans doute, une des parties du Maroc les
moins transformées par rapport à 1912. Les modes de vie,
l’équilibre sylvo-pastoral ont été ajustés plutôt que bouleversés.
Les enfants des notables sont éduqués pour former les cadres
intermédiaires du protectorat dans l’armée ou l’administration.
Us seront cependant, dès 1946[41], associés aux actions du
mouvement nationaliste, et constitueront, pour l’Istiqlal,
l’image des Berbères modernes qui peuvent, s’ils veulent bien
s’en donner la peine, s’intégrer au courant arabe majoritaire.
Dans l’euphorie de l’indépendance, certains Berbères acceptent
le jeu, croyant que les Fassis de l’Istiqlal feront aussi quelques
sacrifices dans la perspective d’un Maroc moderne, socialiste et
même laïc. Autour de Driss Mhammedi, un groupe d’anciens
instituteurs, d’anciens commis des administrations et
d’étudiants, aident l’Istiqlal à reprendre le contrôle des régions
que Addi ou Bihi et Lahcen Lyoussi ont facilement entraînées
dans une nouvelle dissidence.
Mais ces cadres berbères, qui aspirent à se fondre dans un
ensemble national unitaire, se sentent vite déçus et rejetés. Les
facteurs sociaux ont joué, là, un rôle plus important que les
choix politiques. Désireux de s’intégrer à la nation sans pour
autant renoncer à leur langue et à leurs traditions, ils se voient
bientôt exclus ou cantonnés dans les emplois marginaux, faute
de pouvoir entrer dans le jeu subtil des alliances familiales, des
solidarités géographiques et des fratries scolaires des dynasties
urbaines[42]. Les élites berbères du Moyen-Atlas, qui auraient pu
s’intégrer plus facilement au système politique[43] mis en place
par le Mouvement national après l’indépendance, s’en voient
écartées. Certains se réfugieront dans l’attentisme, d’autres
dans le gauchisme, d’autres, enfin, se rapprocheront de la
monarchie. Quelques-uns feront la navette d’une tendance à
l’autre. Ceux qui se rapprochent du souverain sont les plus
nombreux. Cette évolution les réconcilie avec les élites locales
de la génération précédente auxquelles ils s’étaient parfois
opposés. C’est à partir de là que prendra naissance, sous des
formes diverses, un nouveau berbérisme politique qui
contribuera à faire éclater le mouvement nationaliste.
Le Haut-Atlas avait été, du temps du protectorat, un des hauts
lieux du berbérisme politique, caractérisé par la domination des
grands caïds. La résistance urbaine y avait développé son
influence mettant à profit l’émigration vers Casablanca et ses
relais à Marrakech.
Le Souss est resté plus calme jusqu’à l’indépendance. Il ne
devait certes pas être indifférent aux événements qui agitaient
les grandes métropoles du Nord du pays, mais un certain
équilibre avait été sauvegardé jusqu’au départ de l’encadrement
administratif français. Le pays vivait dans un système
économique fondé sur l’alternance entre les villages, où l’on
maintenait les familles et les traditions, et les grandes villes
d’où les émigrés tiraient leur subsistance en s’intégrant au jeu
économique moderne. Certains faisaient fortune et
transposaient dans le domaine économique les rivalités de clan
qui avaient longtemps constitué la trame de vie de ce pays.
L’indépendance fait affluer dans le Souss des contingents de
l’Armée de libération envoyés pour reconquérir Ifni et le
Sahara, et débarrasser les provinces du Nord de la présence
inquiétante d’agitateurs mal contrôlés. La résistance urbaine se
constitue aussi quelques bases arrière dans les zones de départ
de l’émigration vers Casablanca. Bientôt la province d’Agadir et
la plupart des autres régions habitées par des Berbères du
groupe chleuh échappent au contrôle réel du pouvoir central,
et s’installent dans une sorte de Siba de gauche. Cependant,
cette action politique ne prend à aucun moment un caractère
particulariste. Il s’agit, au contraire, d’une contestation
d’ensemble du système politique, visant autant la monarchie
que les Fassis qui sont symbolisés par les nouveaux
administrateurs et leurs concurrents commerciaux de
Casablanca.
La place du monde berbère est donc aussi difficile à définir
dans le Maroc indépendant que dans l’ancien Makhzen.
Associés de façon décisive à la lutte nationale, on ne peut pas
mettre les Berbères en tutelle pour collaboration. Ils
n’acceptent cependant pas de se fondre, au nom de principes
auxquels ils adhèrent en partie, dans un ensemble national
uniforme et centralisé, où leurs élites n’occuperaient que des
rôles secondaires. Enfin, leur situation économique crée, sous
des formes différentes, des crises qu’un pouvoir central, surtout
soucieux des villes et de l’industrialisation, ne se presse pas de
résoudre. La guerre d’Algérie ferme au Rif le principal débouché
de sa main-d’œuvre. Le Moyen-Atlas remet en cause un fragile
équilibre sylvo-pastoral, fait de pactes et de contraintes.
Les rivalités commerciales entre Soussis et Fassis ont des
prolongements inattendus dans les vallées du Haut-Atlas et de
l’Anti-Atlas. Cependant, aucun courant politique ne peut se
vanter de monopoliser le mécontentement du pays berbère.
Dépassant le refus, les révoltes, les rébellions et les complots, ce
mécontentement prendra des formes politiques diverses
pendant les années qui suivent l’indépendance.
Un courant monarchiste en constituera l’aspect le plus voyant.
Il sera majoritaire mais pas exclusif. Un courant socialisant
partage le même refus d’un ordre nouveau bourgeois et
étouffant. S’il est plus dissimulé par ses aspects universalistes,
son arrière-plan berbère garde cependant une grande
importance.
Bien avant son accession au pouvoir, Hassan II donne
l’impression de vouloir relancer la politique berbère. Suivant
une image classique, un monde rural fidèle au Trône ferait
contrepoids aux vieilles cités frondeuses et aux bidonvilles
menaçants. La monarchie alaouite reprendrait l’héritage du
protectorat déclinant.
La réalité est moins simple. Le rapprochement entre le monde
berbère et la monarchie s’est fait contre les courants du
mouvement national qui rêvaient et tentaient de reléguer ces
deux aspects de la réalité sociale et politique marocaine dans
une sorte de musée de l’histoire. Le roi aurait dû perdre ses
prérogatives de souverain islamique pour devenir une sorte de
président débonnaire, et les pasteurs berbères se transformer en
agriculteurs paisibles, sédentarisés, modernisés et mécanisés.
Mais la société marocaine subissait alors trop de tensions pour
qu’un parti unique puisse étouffer d’un seul coup le
particularisme berbère et le style monarchique du pouvoir.
Dès la conférence d’Aix-les-Bains, une solidarité de fait se crée
entre la monarchie et l’Armée de libération devant des
tentatives visant à retarder le retour du roi, si besoin avec la
complicité du pouvoir colonial. Puis, à la faveur des refus et des
révoltes du Rif, du Tafilalt et du Moyen-Atlas, c’est la
monarchie qui remplace le parti dominant comme véritable
garant de l’unité nationale. Les régions berbères insurgées
ressentaient une solidarité de fait avec le Trône, contre les
planificateurs du Maroc nouveau qui proclamaient leur désir
d’industrialiser, de développer les grands centres, les zones
irriguées et déjà riches. Une telle politique les condamnait à
l’asphyxie et à la dépersonnalisation, et ne leur laissait que le
choix de végéter dans les montagnes, sous la garde d’une
administration tracassière, ou d’aller peupler les bidonvilles.
Les révoltes, maintes fois analysées, ne sont que la
manifestation de ce refus instinctif, mal formulé et déjà
exploité par les nostalgiques du passé. Ces oppositions
s’apaisaient d’elles-mêmes devant la monarchie, dans la mesure
où le recours au médiateur chérifien affaiblit l’adversaire
politique principal.
Témoins de cette convergence d’intérêts, les leaders politiques
berbères ne semblent pas pour autant détenir un pouvoir
propre en tant que chefs de parti. Une « aura » d’investiture
royale les désigne comme interlocuteurs et porte-parole du
Makhzen. Les menus services qu’ils sont à même de rendre
sont les symboles de leur crédit plus que les bases de leur
pouvoir. Les partis qu’ils fondent ne sont jamais structurés,
mais les courants qu’ils représentent constituent une réalité
crainte et niée, dont l’administration et le pouvoir politique
tiennent compte. Dans un combat politique réglé et organisé,
qu’il s’agisse des élections municipales ou législatives, leur
faiblesse structurelle apparaît. Leurs adversaires proclament,
alors, leur inconsistance, et leurs partisans, sûrs de leur force et
de leur nombre, crient au scandale. Dans une manifestation
politique simple de type référendaire, les mécanismes
d’adhésion et de participation jouent régulièrement sans que
l’encadrement politique ait trop à forcer la note. La carte du
« oui » au référendum constitutionnel de 1962 est celle du pays
berbère et de l’ancienne Siba à l’exception toutefois du pays
chleuh.
Aux élections générales de mai 1963, en revanche, les partisans
du Mouvement populaire, alors fusionné dans le FDIC, ne
trouvent plus leur compte. Les élites politiques berbères ne
saisissent pas le sens des règles du jeu politique à l’échelle
nationale. Se mettre d’accord pour présenter un seul candidat
par circonscription leur semble une démarche futile et irritante.
Conscients de constituer une majorité homogène, ils ne voient
pas pourquoi ils accepteraient de soutenir des candidats qui ne
sont pas directement issus de leur milieu, et même souvent de
leur lignage. L’investiture de Rabat et le soutien de
l’administration locale ne sont pas une raison suffisante. Ou
bien les mécanismes collectifs de décision arrivent à. produire
un accord sur un nom, ou bien un émiettement de candidature
représentant la diversité des lignages aboutit à une élection
dont le résultat, incompris, apparaît scandaleux et trafiqué, à
un courant qui se sent profondément majoritaire. Ces Berbères,
qui n’ont pas accepté de se joindre à un parti monarchiste qui
cherche à se structurer, pensent que le gouvernement est aux
mains d’incapables qui font courir le risque d’une mainmise
légale de l’opposition sur le pouvoir.
Une fois débarrassée de la crainte d’être dépossédée par le parti
unique, la monarchie va suivre une ligne politique qui
abandonne l’esprit technocratique, cause des révoltes berbères.
Avec la Promotion nationale, l’administration locale et le
monde rural retrouvent la base d’un dialogue à la mesure de
leurs problèmes. Le pouvoir central trouve ainsi le moyen de
distribuer des revenus qui maintiennent les populations en
place, tout en préparant une certaine modernisation qui ne
bouleverse pas trop les structures. Avec une nouvelle politique
d’émigration orientée cette fois vers l’Europe, la pression
politique baisse, le régime gagne du temps, sans pour autant
résoudre les problèmes fondamentaux des régions rurales
pauvres.
La connivence politique, que l’on observe entre la monarchie
et les Berbères dans le Rif, le Moyen-Atlas et de larges secteurs
du Haut-Atlas, ne doit pas faire oublier, cependant, d’autres
courants du berbérisme politique. Le vieil Istiqlal n’a certes pas
retenu le soutien des cadres berbères modernes, mais sa
présence dans le monde berbère est loin d’être nulle. Aux
élections de mai 1963. Son candidat, appuyé par les
commerçants fassis de Khenifra, l’emporte largement sur
Ahardane. A Khemisset, Azrou, Midelt, les noyaux de l’Istiqlal,
constitués par les commerçants et les petits fonctionnaires,
jouent un rôle politique non négligeable. Au contact des
ruraux berbères, ils arrivent à tisser des liens d’obligations et de
solidarité. Mais l’Istiqlal, dans son ensemble, ne réussit pas à
mordre sur ces régions. Il arrive, tout au plus, à exploiter
habilement les divisions entre les groupes et les individus
ralliés à la monarchie.
L’UNFP a un rôle politique autrement important. Les jeunes
intellectuels et cadres berbères, symbolisés par le Collège
d’Azrou et sa puissante association d’anciens élèves, seraient
plutôt tentés par un devenir national de type socialiste. Ils
renonceraient au particularisme de leur milieu d’origine, mais
pour un État où leur rôle serait assuré. La bourgeoisie,
symbolisée par les marchands de Fès, et la monarchie
pourraient faire les frais de l’opération. Ils accepteraient alors
d’être les intermédiaires chargés d’imposer les changements
nécessaires, mais à condition qu’on ne les considère pas
comme des traîtres. Un État national égalitaire et socialiste
aurait pu, à leurs yeux, se débarrasser aussi bien de l’héritage
fassi que de l’héritage berbère, et accessoirement de la
monarchie. De cet idéal, il ne reste souvent qu’une attitude
critique qui s’exerce autant à l’égard de la monarchie et de sa
politique berbère que de l’Istiqlal. Lorsqu’ils ne peuvent plus
rester indéfiniment dans l’opposition, les Berbères de l’UNFP
préfèrent encore se rapprocher du Trône.
L’attitude d’un groupe particulier, celui des commerçants
chleuh de Casablanca, se classerait collectivement dans cette
dernière catégorie, mais avec des nuances. Dans les premières
années qui ont suivi l’indépendance, les Chleuh se détachent
de l’Istiqlal derrière lequel ils ressentent trop souvent la
présence de leurs concurrents fassis. Ils accusent ces derniers
d’utiliser les facilités du pouvoir pour assurer l’expansion de
leurs affaires. Le soutien que les Chleuh apportent à l’UNFP,
lors de sa création, est décisif. Ils entraînent avec eux ces bases
arrière de l’émigration casablancaise que sont les provinces
d’Agadir et de Ouarzazate. Leur organisation permet à la
gauche marocaine de remporter, à Casablanca même, des
succès électoraux, aux Chambres de commerce, aux élections
municipales et parlementaires. Cependant, à partir de l’été
1963, la crainte d’être entraînés trop loin dans l’opposition et
une certaine sollicitude du pouvoir les amènent à des
compromis.
Mais, au pouvoir ou dans l’opposition, les élites locales
berbères ont vieilli. La plupart des noms connus ont acquis leur
notoriété dans les années qui ont précédé ou suivi
l’indépendance. A la base, on trouve encore des hommes mis
en place par le colonisateur français ou espagnol, qui
continuent, après l’indépendance, des carrières de cheikh, de
président de commune rurale. Leurs parents, qui avaient reçu
une éducation destinée à en faire des cadres moyens de la
colonisation, ont gravi simultanément les échelons du pouvoir
administratif et politique. Ils ont rarement occupé des postes
de premier plan dans les services centraux mais se sont plutôt
illustrés dans les fonctions d’autorité des services extérieurs,
notamment dans l’administration locale, la police, la
gendarmerie et l’armée. Le pouvoir en a fait les gardiens du
Trône et ils s’acquittent de cette mission, avec le sens de l’Etat,
mais souvent sans illusions sur l’ordre social et politique qu’ils
contribuent à maintenir. Ils le conçoivent tout au plus comme
un moindre mal, et semblent conscients, en cas de catastrophe,
d’être emportés avec le régime.
A cette génération, qui contrôle encore les postes clés, viennent
s’adjoindre des jeunes gens formés depuis l’indépendance. Ces
derniers constituent un groupe nettement distinct. Les
différences avec la génération précédente se marquent dès leur
formation secondaire. Le Collège d’Azrou ne joue plus le rôle
de point de passage unique qu’était le sien du temps du
protectorat. Après l’indépendance, un jeune Berbère a autant
de chances d’avoir suivi un enseignement secondaire dans les
divers lycées de Ministère de l’éducation nationale ou de la
Mission culturelle. Le clivage se fait suivant l’influence
familiale ou la classe sociale, et le facteur géographique joue un
moindre rôle. Éduqué dans un milieu national où l’arabe et le
français ont une valeur culturelle et technique dominante, il se
sent toutefois porté à affirmer sa différence. Il n’ira pas,
cependant, jusqu’à remettre en cause son appartenance
nationale. L’Islam austère lui fournit parfois le moyen
d’affirmer autrement sa solidarité et son identité. Dans d’autres
cas, ce sera le socialisme. En aucun cas, il ne semble prêt à
accepter une tutelle qui lui ferait subir passivement les
transformations qu’il ressent comme inévitables autant pour
lui que pour les siens.
Les intellectuels de formation traditionnelle
Dans les pages prédécentes, nous avons été souvent amené à
mettre l’accent sur le rôle des anciens élèves des Universités de
Fès et de Marrakech, ainsi que des divers instituts islamiques.
L’analyse des situations locales a permis de mettre en évidence
l’importance des réseaux de diffusion de la culture
traditionnelle. L’enquête de D.E. Ashford[44] sur les secrétaires
de cellules de l’Istiqlal montre également le rôle primordial que
jouent les anciens élèves des établissements d’enseignement
traditionnel. Auparavant, Robert Rézette[45], dans son étude sur
les partis politiques, avait déjà relevé la similitude entre les
méthodes employées par les partis et celles des confréries. Les
liens noués entre les adhérents et les chefs des partis lui
semblaient de même nature que ceux qui rassemblaient les
dévots de ces institutions autour d’un cheikh en milieu rural.
En fait, l’analyse de Rézette ne s’attache qu’au cas particulier de
l’organisation des partis, sans situer le phénomène politique
maghrébin par rapport à la culture traditionnelle. On
trouverait une autre approche de ce problème dans l’analyse
faite par Charles-André Julien[46] sur le mouvement des oulémas
algériens. Pour ces réformistes des années trente, le projet
politique d’évolution vers l’indépendance s’intègre dans un
programme culturel et religieux. Ils veulent d’abord restaurer la
communauté islamique en lui redonnant le sens de son
histoire, de son passé, de sa langue. Ils pensent le devenir
algérien en fonction d’un système de valeurs et d’un langage
compréhensible par le peuple. S’ils n’ont pas directement
organisé un mouvement politique, il est certain qu’ils ont créé
la base idéologique sur laquelle le nationalisme algérien a pu se
développer. Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, de voir
un parti politique utiliser l’idéologie, les hommes, les
institutions et les méthodes du système culturel traditionnel.
Le remplacement des confréries par les partis n’est qu’un
élément d’un système politique plus vaste et plus diffus.
Dans un article des Annales, Jacques Berque[47] montrait
comment l’Université de Karaouyne faisait corps, avant la
seconde guerre mondiale, avec la cité, et servait de caisse de
résonance au modernisme marocain. Le commerçant et
l’artisan s’y retrouvaient avec les étudiants pour suivre les cours
des maîtres. L’Université servait de lien entre les différents
groupes sociaux, et les étudiants diffusaient les « thèmes du
moment » où le religieux se mêlait au politique. Ce rôle social
de l’étudiant est surtout le fait de la centaine de « tolba »
originaires de la ville, dont le comportement contraste avec
celui des ruraux qui forment la masse. Selon Jacques Berque[48] :
« Le jeune homme de Fès s’oriente surtout vers les études
générales, littéraires ou théologiques, qui lui assureront le
débouché traditionnel des carrières d’Etat. On ne peut lui
dénier le charme des manières, la finesse de l’esprit, un réel
appétit de modernisation. Tout autre, l’humble lettré de la
plaine et des monts, moins soucieux de problèmes généraux
que de prébendes modiques et immédiates : savoir Sidi
Khalil, ou cette tohfa dont chaque vers, dit le proverbe,
rapportera un mouton ; puis repartir chez soi avec la gloire
du savant. Logés dans les médersas, les jeunes campagnards
sont restés pour la plupart étrangers à l’enseignement
organisé, aux grandes questions qui agitent l’École. Moins
brillants, quoique parfois plus solides, ils parlent peu,
écrivent moins encore, sont le nombre : huit cents
lourdauds, contre une centaine de subtils et chétifs citadins,
tracassés d’universel ».
Ce sont ces ruraux que nous retrouvons, vingt-cinq ans après,
avec leurs successeurs et leurs semblables issus de Ben Youssef
ou de l’institut de Tétouan, parmi les candidats aux élections
législatives de 1963, après une carrière politique plus ou moins
longue au sein du Mouvement national.
Dans son article cité, Jacques Berque se montre pessimiste sur
l’avenir de l’École. Sous la pression du protectorat et du
mouvement nationaliste, elle a entrepris une réforme, institué
un programme, des sections, des professeurs salariés, pris une
tournure plus laïque qui la rapproche des universités de
l’Orient. Mais cette réforme n’a guère limité son influence. Le
nombre croissant des étudiants d’origine rurale a compensé le
déclin de son rôle dans la cité. Contrastant avec la parcimonie
et l’élitisme de la formation accordée aux Marocains dans les
écoles du protectorat, l’enseignement traditionnel multiplie le
nombre de ces diplômés qui ne trouvent pas plus leur place
dans le système du protectorat que dans le Maroc indépendant.
Leur situation n’est pas sans analogie avec celle des
intellectuels traditionnels dont Gramsci analyse le rôle :
« Dans chaque pays, la couche des intellectuels a été
radicalement modifiée par le développement du
capitalisme. Le vieux type d’intellectuel était l’élément
organisateur d’une société à base essentiellement paysanne
et artisanale. Pour organiser l’État, pour organiser le
commerce, la classe dominante développa un type
particulier d’intellectuel. L’industrie a introduit un nouveau
type d’intellectuel : le cadre technique, le spécialiste de la
science appliquée. Dans les sociétés où les forces
économiques se sont développées dans un sens capitaliste,
au point d’absorber la majeure partie de l’activité nationale,
c’est ce second type d’intellectuel qui a prévalu »[49].
Pour Gramsci, les intellectuels traditionnels rassemblent les
divers groupes d’intellectuels qui participaient à l’organisation
de la société préindustrielle. La nouvelle classe dominante doit
les absorber ou les supprimer.
En transposant ces données dans le contexte marocain — et il
ne faut pas oublier que Gramsci raisonnait largement à partir
de l’exemple de l’Italie du Sud qui présente une situation
sociale relativement comparable — on peut en déduire les
conclusions suivantes : la bureaucratie du Maroc indépendant
constitue, grosso modo, un groupe d’intellectuels
[50]
« organiques » , issu en majorité de la bourgeoisie urbaine,
qui a succédé aux intellectuels organiques du protectorat. Leur
attitude à l’égard des intellectuels traditionnels a consisté, dans
un premier temps, à essayer de les absorber dans le cadre du
parti unique, en les mettant au service d’une politique de
transformation rapide de la société, qui aurait en fait abouti à
la suppression de leur rôle.
L’autre tentative menée par la monarchie consiste à
reconnaître l’existence de ces intellectuels traditionnels, à les
absorber dans l’appareil d’État, pour faciliter le contrôle du
monde rural en canalisant son énergie dans des organisations
dépendant du système politique dominant, telles que les
communes ou le Parlement[51]. Cette seconde tactique ménage
beaucoup plus les privilèges de ces intellectuels sur le monde
rural, reconnaît leur rôle social, et, de toute façon, les empêche
de se solidariser avec une révolte paysanne éventuelle.
Or, pour Gramsci, toute action politique révolutionnaire passe
par un retournement des alliances, le prolétariat devant
assimiler ou s’assurer l’appui des intellectuels traditionnels de
l’Italie du Sud pour atteindre les masse rurales. Comme les
conservateurs européens du XIXe siècle, la monarchie
marocaine a, semble-t-il, compris plus rapidement que le
Mouvement nationaliste tout le parti qu’elle pouvait tirer des
intellectuels traditionnels, en en faisant les nouveaux
intermédiaires entre le centre du pouvoir et l’opinion
provinciale. Le rôle qu’elle leur réserve dans le système
politique mis en place depuis 1960 en est une preuve. Quelques
exemples pris dans cette évolution permettront de préciser la
situation des intellectuels traditionnels dans le système
politique. Les analyses portant sur l’élite politique nationale
auraient plutôt tendance à sous-estimer leur rôle. Comme le
montrent les études de John Waterbury[52] et du CRESM, cette
élite politique se compose d’individus formés par
l’enseignement moderne, aptes à faire fonctionner l’appareil
bureaucratique hérité du protectorat, et à donner une image
flatteuse du Maroc indépendant dans ses contacts avec les
étrangers. Par leur nature même, ces élites ne comptent qu’un
nombre limité de représentants, le protectorat n’ayant pas eu
pour objectif de multiplier le nombre des intellectuels amenés
à contester sa propre existence. En revanche, les intellectuels
traditionnels ont continué à être formés en grand nombre,
après 1912, pour des rôles qui n’étaient plus ceux qui leur
étaient assignés auparavant.
Dans son ouvrage sur Les villes musulmanes d’Afrique du Nord,
Roger Le Toumeau[53] définit ainsi le rôle des centres de culture
traditionnelle dans la formation des intellectuels (suivant un
schéma qui correspond assez étroitement à l’analyse de
Gramsci) : « Séminaires, écoles d’administration, centres de
formation des hommes cultivés et distingués, voilà ce que sont
les deux célèbres écoles de Fès et de Tunis… Beaucoup se
contentent d’études succinctes et se répandent dans le pays
comme maîtres de Coran, notaires, secrétaires des cadis,
employés subalternes de l’administration. D’autres acquièrent
une culture plus poussée qui leur permet d’entrer à leur tour
dans le corps des “Ulamas” ou de faire une carrière dans
l’administration, ou encore de devenir cadis ».
Le protectorat avait aussi utilisé ces intellectuels. Sa confiance
allait plutôt aux chefs des confréries qu’aux oulémas
réformateurs[54]. Le chérif Kettani fut, avec le pacha de
Marrakech, l’un des adversaires les plus farouches de Mohamed
V. L’enseignement traditionnel fournissait certes son
contingent de cadis, de secrétaires de tribunaux ou de
Makhzen, de fquihs de caïds ou de diverses administrations. Ils
étaient mal payés et peu estimés par l’administration française ;
on ne peut donc pas s’étonner de trouver parmi eux un groupe
important de nationalistes, surtout lorsque la politique berbère
limite leurs espoirs de carrière. Le réformisme musulman, qui
se répand au Maroc dans les années trente, leur fournit alors les
fondements idéologiques de leur choix. L’impression d’être mis
à l’écart par une administration moderne envahissante a été
également un facteur déterminant. Le nationalisme n’est certes
pas l’apanage des traditionalistes, mais le rôle d’Allal el Fassi est
au moins aussi important dans le mouvement, à ses débuts,
que celui de Balafrej[55]. Le rayonnement populaire et rural du
nationalisme doit beaucoup à la présence d’Allal el Fassi.
L’emprisonnement ou l’exil des principaux leaders de l’Istiqlal,
en 1952-1953, fit passer de nombreuses cellules en milieu
urbain, sous le contrôle d’intellectuels traditionnels dont le
plus connu, après 1955, fut le fquih Basri, ancien élève de
l’Université Ben Youssef de Marrakech.
L’indépendance éloigne ces cadres arabisants des postes de
responsabilité. Seuls les jeunes nationalistes ayant reçu une
éducation moderne étaient aptes à prendre le contrôle d’un
appareil bureaucratique compliqué que le protectorat
n’abandonnait pas sans réticence. Les cadres de formation
traditionnelle se voyaient relégués dans les fonctions mineures
du parti[56] ou des syndicats. On essayait également d’acheter
leur assentiment par des prébendes diverses (licences de
transport, charges de mandataires dans les marchés de gros,
etc.). Leur rôle dans les premières années du Maroc
indépendant n’était guère plus brillant que celui qui leur était
dévolu sous le protectorat. Comme ils étaient marginaux, la
tentation de l’action politique illégale leur vint souvent. On
trouve leur présence dans tous les mouvements de révolte
rurale, qu’il s’agisse de la rébellion du Rif, de celle de Addi ou
Bihi, ou des opérations aventureuses de l’Armée de libération
dans le Haut-Atlas et la province d’Agadir. Les élections leur
offrent l’occasion d’exprimer leur mécontentement, et de
retrouver une place dans les institutions. Lorsqu’il s’agit de
faire appel aux suffrages populaires, ces intellectuels
traditionnels recueillent facilement le soutien des paysans, des
petits propriétaires et des commerçants. Leurs préoccupations
vont moins au progrès économique, conçu sous la forme d’une
idéologie planificatrice, qu’à un certain idéal de justice sociale
confuse, ainsi qu’à la défense des valeurs de la langue et de la
religion. S’ils s’opposent instinctivement aux élites
bureaucratiques, qui dominent la scène nationale, ils gardent
cependant le contact, à quelques exceptions près, avec la
monarchie qui fait partie de leur système de valeurs. Mohamed
V et Hassan II ont toujours évité de se compromettre
totalement avec les gouvernements et l’appareil d’État
symbolisé par la bourgeoisie moderne occidentalisée. L’idéal du
souverain est d’être accepté dans les deux systèmes de valeurs.
S’il doit faire un choix, ce sera le plus souvent aux dépens de la
classe dirigeante moderne et au profit de la tradition. L’intuitif
l’emporte, chez Hassan II, sur les solidarités rationnelles. Le roi
refuse de se laisser associer, dans l’esprit populaire, à l’image de
ces jeunes fonctionnaires que l’on accuse de ne pas savoir lire
l’arabe correctement, de boire du vin et d’être mariés à des
Françaises. Ces marques de cosmopolitisme un peu caricatural
disqualifient, peu ou prou, toute l’élite politique nationale et
l’empêchent de recueillir un soutien populaire réel.
Au niveau local, les élites retrouvent une dimension historique
et une cohérence avec les masses qu’elles ont parfois perdues
au niveau national. Dans un village, dans une circonscription,
dans une province à la rigeur, certains individus peuvent
prétendre représenter réellement la communauté dont ils sont
issus, parler et prendre des engagements en son nom sans être
désavoués. Les demandes qu’ils présentent ne sont pas toujours
d’essence traditionnelle. Il s’agit bien souvent de facteurs de
modernisation : routes, écoles, dispensaires ou réseaux
d’irrigation. Mais, à ce niveau, les demandes de modernisation
n’ont plus le caractère cosmopolite, artificiel et imposé des
plans élaborés par les élites politiques nationales. Ceux qui les
présentent ont été capables de ressentir des aspirations plus ou
moins confuses des ruraux, et, de toute façon, de les formuler
dans la langue classique qui leur donne une légitimité aux yeux
mêmes de ceux qui les présentent. Une nouvelle élite plus
nationale et plus traditionnelle semble se dégager au niveau
local. S’agit-il d’une survivance de l’ancienne classe des
notables, ou de sa réincarnation sous une autre forme ? Est-ce
l’ébauche d’une nouvelle élite nationale ? Le parlementarisme
aurait pu leur donner cette dimension, pour un temps.
L’évolution du système politique marocain les condamne
plutôt à des combats d’arrière-garde où ils expriment les
réticences populaires à une transformation sociale
traumatisante.
Dans la pratique, il faudrait distinguer entre deux types
d’intellectuels de formation traditionnelle. Le groupe n’est pas
homogène, et le rôle social des individus diffère d’une région à
l’autre du Maroc, comme le montrera plus loin l’analyse
géographique. Le contraste entre formation arabe et formation
française ne doit pas dissimuler les nuances multiples que l’on
trouve dans le premier groupe. En milieu rural, on rencontre
encore fréquemment des diplômés de Karaouyne propriétaires
terriens et chefs de confrérie, qui n’ont guère de sympathie
pour les partis politiques ou l’administration qui concurrence
leur autorité. En ville, les mêmes lettrés auront plutôt tendance
à jouer un rôle réformiste comparable à celui des oulémas
algériens. Ils soutiennent l’activité des partis nationalistes et
prennent des positions plus engagées que celles de leurs
condisciples ruraux. Ils œuvreront pour un changement social
qui ne soit pas coupé de la tradition, alors que les lettrés ruraux
défendront avant tout la tradition en y sacrifiant volontiers
tout désir de changement.
Notes du chapitre
[1] Il serait simpliste de voir cette politique de la monarchie
comme une démarche consciente, constante et passablement
machiavélique. Il s’agissait le plus souvent de réactions plus ou
moins bien calculées aux initiatives des dirigeants
nationalistes. Far ailleurs, le tempérament des deux souverains
qui se sont succédé durant cette période donnait une
coloration passablement différente à la politique du Palais.
[2] Plan quinquennal 1960-1964, op. cit., p. 15.
[3] Voir M. Ben Barka, « Les conditions d’une véritable
réforme agraire au Maroc », in Réforme agraire au Maghreb, op.
cit., p. 119.
[4] Pour ne pas avoir d’ennuis avec la France, on évitera de
trancher le problème des terres de colonisation qui
représentent un million d’hectares. Il faudra attendre les
décisions de récupération, prises par le gouvernement Ben
Bella, pour que le Maroc se décide, en 1963, à reprendre les
terres de colonisation publique. On ne touchera donc pas aux
gros propriétaires avant d’avoir réglé le problème des terres de
colonisation. De son côte, l’intérieur n est pas prêt à se dessaisir
de la tutelle des terres collectives, habous et guich.
[5] Voir A. Lahlimi, « Les collectivités rurales traditionnelles et
leur évolution », op. cit.
[6] Pour une analyse de l’organisation et du fonctionnement
de cet Office voir J. Brunet, « L’Office national d’irrigation »,
Annuaire d Afrique du Nord 1961, Paris, CNRS, 1962.
[7] Voir « Projets et problèmes de l’agriculture », Maghreb,
24, novembre-décembre 1967, p. 27-39 ; « Projet Sebou »,
Maghreb, 20, mars-avril 1967, p. 51-52 ; « Aspects politiques des
projets de développement rural », Maghreb, 30, novembre-
décembre 1968, p. 26-31.
[8] La création d’un fonds commun de terres et le recours à
la société de développement villageois se justifient par le
rapport terre-population qui rend impossible la constitution
d’exploitations privées viables si l’on n’accepte pas le principe
d’une forte émigration. Voir à ce sujet J.-P. Delilez, « Les
structures agraires dans le périmètre du Rharb », Rapport ONI,
Rabat, décembre 1961, p. 37.
[9] En fait, le conflit avec l’ONI aboutira à confier aux
gouverneurs la présidence des Offices régionaux de mise en
valeur lorsque l’ONI sera démembré en 1964. Contrôlant à
cette date les terres de colonisation récupérées, ils vont affermir
leur contrôle sur le secteur agricole moderne.
[10] Pour une étude détaillée et un bilan voir P. Blacque-
Belair, « La Promotion nationale marocaine », Annuaire Afrique
du Nord 1963, Paris, CNRS, 1964, p. 161-177. Voir aussi
« Expérience d’investissement du capital-travail : la Promotion
nationale, Maghreb, 11, septembre-octobre 1965, p. 35-45. Les
paragraphes suivants sont inspirés d’un rapport de Patrice
Blacque-Belair sur la Promotion nationale et les problèmes des
relations entre l’Etat et la paysannerie.
[11] Faisant assaut de prévenances à l’égard du monde rural
traditionnel, le gouvernement décide, alors, la suppression du
tertib, remplacé par un impôt agricole pesant surtout sur
l’agriculture moderne encore largement entre les mains des
colons.
[12] Discours prononcé le 28 juin 1961. Mots soulignés dans
le texte ronéotypé.
[13] Voir Maroc-Informations, 7 mars 1964 et suivants et Le
Petit Marocain du 19 mais 1964.
[14] Voir, « Un grand projet agricole : le projet Derro »,
Maghreb, 20, mars-avril 1967, p. 49-55 ; « Projets et problèmes
de l’agriculture marocaine », Maghreb, 24, novembre-décembre
1967, et « Bénéficiaires des actions de la Promotion nationale »,
ibid., p. 35-36.
[15] Oufkir déclarait en privé : « L’essentiel est de remplir les
bouches pour les empêcher de crier ».
[16] Voir P. Pascon, M. Bentahar, « Ce que disent 296 jeunes
ruraux », art. cité.
[17] Certains chorfa du Tafilalt, par exemple, perdent ainsi
loir contrôle sur les haratin qui abandonnent loirs palmeraies
pour les chantiers de la Promotion nationale.
[18] Voir O. Marais, « Le Maroc », p. 27-303 in Terre, paysans
et politique, Etudes nationales rassemblées et présentées par H.
Mendras et Y. Tavernier, Paris, Sedeis, Coll. Futuribles, 1970,
volume 2.
[19] Dont le titre évoque de façon ambiguë les FAR (Forces
armées royales).
[20] Il est en fait le meilleur exemple de la mobilité sociale
que la monarchie peut assurer aux hommes de talent qui
acceptent de collaborer avec le régime.
[21] Voir la présentation de Guedira par A. Maarouf, Jeune
Afrique, 124, 4-10 mars 1963.
[22] Moulay Abdallah, frère cadet du roi, ainsi que la mère
du roi étaient hostiles à cette rupture avec la tradition. En
revanche, Moulay Ali, cousin et beau-frère du roi, très lancé les
milieux d’affaires de Casablanca, soutenait fermement Guedira.
[23] Si pour Hassan II l’exaltation de la société rurale
traditionnelle a un contenu idéologique se situant entre la
politique berbère du protectorat et la révolution nationale de
Vichy, pour Guedira, la vision du monde rural à créer
ressemble fort à la paysannerie radicale-sociafiste du Sud-Ouest
sous la Troisième République.
[24] Au lieu du chiffre de 8 millions qui avait servi de base à
l’élaboration du plan quinquennal.
[25] Après la mort de Bekkaï, Guedira sera chargé, à dater du
14 avril 1961, du Ministère de l’intérieur. Il contrôlait déjà le
Ministère de l’agriculture depuis le 21 mars 1961.
[26] Les Phares, 80, 25 janvier 1963, publient en première
page un portrait du général de Gaulle avec cette légende :
« Non pas un des plus grands, mais très exactement le plus
grand ».
[27] Le n° 88 des Phares du 10 mars 1963 annonce la
création du FDIC et publie un article anonyme « Autour du
Marché commun », donnant un aperçu officieux sur la
position marocaine, favorable à l’association. Depuis le début
de l’année, la Banque du Maroc et divers services financiers et
techniques entreprennent, à la demande de Guedira, des
études sur les conséquences du Marché commun sur les
exportations marocaines. Toutes ces études concluent à la
nécessité d’arriver à un accord s’efforçant de sauvegarda-des
débouchés. Voir « Le Maghreb et le Marché commun »,
Maghreb, 3, mai-juin 1964, p. 45-54.
[28] Voir L. Fougère, « La Constitution marocaine du 7
décembre 1962 », Annuaire d Afrique au Nord 1962, p. 155-167.
P. Chambergeat, « Le référendum constitutionnel du 7
décembre 1962 au Maroc », ibid., p. 167-206. J. Robert, « Les
élections législatives et l’évolution politique interne du
Maroc », Revue juridique et politique d outre-mer, avril-juin 1963,
p. 266. O. Marais, « L’élection de la Chambre des représentants
du Maroc », Annuaire d’Afrique du Nord 1963, p. 98-102.
[29] Les Phares, 88, 23 mars 1963, annonçant la naissance du
FDIC, publient une photo de Bekkaï sur toute la première page
et, en deuxième page, une photo du premier contact entre
l’État-Major de l’Armée de libération et Mohamed V. On y
reconnaît Moulay Hassan, Guedira, Ahardane, Khatib,
Leghzaoui et Oufkir. La volonté de continuité est évidente.
[30] L’article 3 de la Constitution rédigé par Guedira
bannissait l’existence du parti unique.
[31] Le jeu de l’armée est assez complexe. Certains officiers,
comme le général Driss Ben Aomar, gouverneur de Casablanca,
sont favorables aux projets de Guedira. Les officiers supérieurs
berbères sont dans l’ensemble plus réticents. Leurs liens
familiaux avec des élites locales et leur connaissance des projets
du directeur général du Cabinet royal leur font craindre d’avoir
à cautionner, par la suite, une politique de réformes qu’ils
n’approuvait guère. Par ailleurs, Guedira éprouve un certain
agacement à leur contact. Quant aux jeunes officiers » leur
réserve rejoint dans l’ensemble celle de l’administration.
[32] Voir O. Marais, « L’élection de la Chambre des
représentants du Maroc », art. cité p. 85-107.
[33] Ibid.
[34] Si l’Entraide nationale et les sociétés musulmanes de
bienfaisance ont pu servir de support à ces tentatives de
corruption des électeurs, il semble que la Promotion nationale
soit restée en dehors. Le nombre des journées de travail a baissé
pendant les élections. La Promotion nationale, conçue pour
combattre des oppositions plus profondes, n’a pas servi
d’instrument dans la bataille électorale.
[35] Voir H. Breton, « Elections professionnelles et locales »,
Annuaire d’Afrique du Nord 1963, p. 107-119. P. Chambergeat,
« Les élections communales au Maroc », ibid., p. 119-129.
[36] Mais Ben Barka proclame à la radio d’Alger sa solidarité
avec l’Algérie.
[37] Interview au Figaro, 22 novembre 1963.
[38] Voir P. Chambergeat, « Bilan de l’expérience
parlementaire marocaine », Annuaire d’Afrique du Nord 1965, p.
100-116.
[39] Dans une tribune libre du Monde (29 août 1972). R.
Buron confirme ainsi ces impressions, recueillies, en leur
temps, du côté marocain : « Une attitude contraire aux intérêts
de la France. Lorsque l’Algérie accéda dramatiquement à
l’indépendance, en juillet 1962,1 un des première soucis du
général de Gaulle fat de dégager une nouvelle politique
française en Méditerranée. Les rapports avec le Maroc et la
Tunisie s’étaient gravement détériorés du fait de l’aide apportée
au FLN par les deux pays, plus gravement avec la seconde
(affaire sanglante de Bizerte) qu’avec le premier. Il fallait les
rétablir sur des bases nouvelles. Sans intervenir dans la
politique intérieure du royaume chérifien, il était possible pour
la France, décidée à faire de la coopération avec l’Algérie
socialiste une expérience exemplaire, de jouer la carte de 1
avenir chez son voisin de l’Ouest. Malgré les liens de sympathie
personnelle qui l’unissaient à Si Mohamed — dont le Bis se
réclama spectaculairement lois de son accession au trône, — de
Gaulle fat tenté de le foire ».
[40] Voir O. Marais, « The polical évolution of Berbers in
indépendant Morocco », in E. Gellner, C. Micaud, éd.. Arabs
and Berbers, Londres, Duckworth, 1972, p. 277-284.
[41] Lors de la grève des élèves du Collège berbère d’Azrou
qui avait pour but, entre autres, de réclamer un meilleur
enseignement de l’arabe.
[42] Etre ancien élève du Collège Moulay Idriss de Fès ou du
Collège Moulay Youssef de Rabat offrait plus d’avantages et de
biens informels au niveau de la classe dirigeante que taire
partie de l’Association des anciens d’Azrou.
[43] Elles partagent avec les cadres arabes majoritaires une
culture moderne de type français et une association ancienne
aux activités de résistance.
[44] Perspectives of a Moroccan nationalist, Totawa,
Bedminster Press, 1964. p. 31 et suiv.
[45] Les partis politiques marocains, op. cit., p. 19 et suiv., p.
282 et suiv.
[46] L’Afrique du Nord en marche. Nationalisme musulman et
souveraineté française, Paris, Julliard. 1972, p. 101 et suiv. (3e
édition).
[47] « Dans le Maroc nouveau le rôle d’une université
islamique », Annales d’histoire économique et sociale, 51, mai
1938.
[48] Ibid., p. 197.
[49] A. Gramsci, La costruzione del Partito communista 1923-
1926, Turin, Einaudi; 1971, p. 151 ; cité par H. Portelli, Gramsci
et le bloc historique, Paris, Presses universitaires de France, 1972,
p. 106 et suiv., dont l’analyse présentée ci-dessus s’inspire
étroitement.
[50] Ibid, p. 119. Voir aussi J.-M. Flotte, La pensée politique de
Gramsci, Paris, Anthropos, 1970, p. 45 et suiv.
[51] Suivant la définition de Gramsci citée plus haut, on
entend par là les intellectuels que leur formation technique
(scientifique ou juridique) prédispose aux responsabilités dans
le fonctionnement rationnel des organisations bureaucratiques
modernes-du secteur public ou du secteur privé.
[52] J. Waterbury, Le commandeur des croyants. La monarchie
marocaine et son élite, Paris, Presses universitaires de France,
1975.
[53] R. Le Tourneau, Les villes musulmanes d’Afrique du Nord
Alger, La Maison des livres, 1957, p. 99 et 103. La formation des
élites politiques maghrébines, Paris, Librairie générale de droit et
de jurisprudence, 1973.
[54] Voir J. Berque, Le Maghreb entre deux guerres, Paris,
Editions du Seuil, 1962, p. 70 et suiv. et p. 182-186.
[55] R. Rézette, Les partis politiques marocains, op. cit., p. 65 et
92.
[56] Voir D.E. Ashford, Perspectives of a Moroccan nationalist,
op. cit., p. 42.
Deuxième partie. Aperçu sur la
géographie politique du Maroc
provincial
Présentation
L’analyse de la reconstitution du système des élites locales
depuis l’indépendance tendait à montrer comment la
monarchie s’était progressivement substituée à l’administration
française dans le rôle de protecteur et de manipulateur des
élites locales. Cette alliance entre le Palais et les nouveaux
notables avait permis la reconstruction d’un réseau
d’encadrement administratif du monde rural assurant sa
tranquillité. Par la suite, ce contrôle des provinces avait été,
pour le Palais, un facteur décisif dans sa rivalité avec les partis
pour la domination du système politique national. En
simplifiant grossièrement l’évolution de rapports de forces
durant cette période, on peut avancer que les nationalistes
avaient assez facilement réussi à assurer, dans la période de
transition, leur mainmise sur la bureaucratie héritée du
protectorat. Mais cette emprise avait pour objectif de leur
permettre, dans une seconde phase, de contrôler l’économie
moderne encore entre les mains d’entrepreneurs français, et
d’investir le monde rural. L’élection d’assemblées locales
encadrées par les cellules de l’Istiqlal aurait permis, par
l’introduction du suffrage universel, de créer une légitimité
nouvelle en face du pouvoir monarchique. Le Palais ressentit
intuitivement le danger de cette évolution qui l’aurait
condamné à un rôle politique passif.
Ces élites locales ont joué un rôle important, avant ou après
l’indépendance du Maroc, dans l’acceptation du pouvoir ou
dans son rejet. L’administration, faute d’être représentée
partout par des agents rémunérés, a dû accepter leur relais. Or,
à ce niveau, les rapports politiques se superposent : les liens de
parenté, les rapports économiques, l’appartenance à des
confréries ou à des associations — en un mot un ensemble de
contacts et de services rendus dans la vie quotidienne —
forment la trame des relations entre les individus et les
groupes. Les hommes influents sont ceux qui savent mobiliser
le soutien le plus large et le traduire, le moment venu, en
comportements politiques, qu’il s’agisse de votes, de refus de
l’impôt, ou de soumission au pouvoir établi. En retour, les
membres de l’élite locale négocient leur soutien au niveau
supérieur, pour accroître leurs ressources, étendre leur
influence et surclasser leurs rivaux.
Dans cette analyse, les élites locales ont été présentées d’en
haut et leurs attitudes rationalisées et intégrées dans un
ensemble orchestré par la monarchie. Or, nous avons pu voir
fréquemment qu’une des attitudes caractéristiques des élites
locales, sous le protectorat comme après l’indépendance, était
justement l’impossibilité de dépasser un certain niveau de
problèmes pour transformer des choix locaux en actions
politiques cohérentes à l’échelon national. Il serait donc utile
de donner une description géographique des élites locales,
avant de présenter, par la suite, une analyse globale, à partir de
données quantifiées, des facteurs caractéristiques de
l’appartenance et du comportement de ces élites. Cette
description sera centrée sur les candidats aux élections
législatives (présentées dans la troisième partie de cette étude).
Les observations suivantes ont justement pour but de pondérer
cette analyse quantitative par une étude descriptive du milieu,
alimentée, pour une large part, de discussions, de souvenirs, de
notes et de documents personnels. Le détail des analyses
devrait prouver qu’il n’est pas abusif de prendre comme
hypothèse de base la représentativité des candidats aux
élections législatives. Dans la majorité des cas, et sans qu’un
net clivage entre les partis apparaisse très souvent, on verra
s’opposer des individus qui appartiennent, par leur milieu et
par leur passé personnel, au groupe des élites locales dont nous
avons étudié l’intégration dans le système politique, comme
administrateurs et comme élus. Le mode de scrutin, l’évolution
politique favorisent certes cette identité et l’imposent même
aux partis d’opposition, en particulier à l’Istiqlal. Dans un
nombre limité de cas, on pourra également voir comment
s’intégrent et s’opposent élites locales et élites nationales.
L’analyse géographique permet aussi de pondérer certaines
déductions des données quantitatives, et d’en affiner d’autres.
Elle fait ressortir les facteurs qui caractérisent, suivant les
régions, l’appartenance aux élites locales. C’est ainsi
qu’apparaît nettement le caractère régional du rayonnement
des universités traditionnelles et des instituts islamiques. Le fait
est très net pour l’ex-zone Nord encore qu’il pourrait passer, là,
pour un trait dû à un particularisme géographique et
historique. Il semble encore plus net dans le Sud du pays où
l’Université Ben Youssef de Marrakech joue un rôle unificateur,
transcendant les provinces et les partis. Cela reste vrai, à un
moindre degré,.de la Karaouyne de Fès pour l’ancien « Maroc
utile » où l’on constate une concurrence entre intellectuels
traditionnels et intellectuels de formation moderne, passés par
l’école française.
L’analyse géographique met déjà en évidence l’importance du
savon-traditionnel comme facteur d’appartenance aux élites
locales. Ce facteur est rarement isolé. Il se combine avec la
richesse terrienne et les fonctions administratives ou
politiques. On pourrait avancer l’hypothèse qu’à la différence
de l’élite politique nationale les élites locales ont besoin, pour
se voir reconnaître comme telles, de savoir manier le
vocabulaire et les symboles associés à la culture traditionnelle.
On notera aussi, en complément, l’influence régionale des
universités et instituts islamiques qui jouent un rôle essentiel
dans la formation des divers types d’intellectuels traditionnels.
D’autres facteurs jouent aussi un rôle important suivant les
régions. La propriété foncière en est un, mais elle ne suffît pas à
caractériser la richesse ni l’influence, car elle n’est pas toujours
le facteur de production le plus important. La terre sera
souvent associée à la propriété de troupeaux et de droits d’eau
qui sont parfois des facteurs plus rares que la terre, et, donc,
stratégiquement plus importants pour exercer une influence
sur le groupe. Le paysan riche diversifiera ses activités pour
mieux répartir les risques et les chances de profit. Il sera
transporteur, commerçant, propriétaire d’immeubles en ville. Il
élargira, ainsi, le réseau de ses contacts et de son influence
politiquement mobilisable.
On remarquera aussi l’influence des réseaux d’émigration.
Dans le Sud du pays et dans les régions pré-sahariennes, les
notables sont souvent les commerçants riches de Casablanca
qui n’ont pas perdu contact avec leur région d’origine où ils
possèdent souvent terres et maisons. Mais ils sont surtout des
intermédiaires utiles pour ceux qui veulent émigrer. Leur
influence locale prévaut ainsi sur celle du réseau administratif
et des propriétaires terriens. Dans le Tafilalt, certains chorfa
ayant des liens familiaux avec la bureaucratie de Rabat et le
Palais jouent le même rôle.
Il n’est pas étonnant, enfin, de voir l’importance que peuvent
avoir, huit ans après l’indépendance, les activités nationalistes.
Ce facteur est surtout marqué dans le Sud du pays. Il ne joue
pas dans le Nord où la continuité est très grande avec les élites
locales du protectorat espagnol. Dans le « Maroc utile », les
nationalistes et les descendants d’anciennes familles caïdales
semblent s’équilibrer.
Les facteurs ethniques jouent aussi. Il est rare de voir un Arabe
solliciter des voix berbères, ou un Berbère des voix arabes. Le
cas est plus fréquent à l’UNFP que dans les autres partis. Mais la
solidarité ethnique joue à des échelons plus petits, souvent de
façon négative. Elle joue aussi sans barrières de parti. On
pourrait tout aussi bien en trouver des exemples à l’UNFP et à
l’Istiqlal qu’au FDIC. Elle semble jouer aussi sans limites
géographiques précises. On en trouve des exemples dans les
régions agricoles modernes et même en ville, autant que dans
les régions traditionnelles. Les élites locales des trois grandes
régions géographiques analysées peuvent ainsi se caractériser :
Le Nord est sans aucun doute la région la plus homogène à
cause de la coupure du protectorat espagnol. Les activités
nationalistes ont été assez modérées, il n’y a donc pas de
séparation entre les élites locales, avant et après
l’indépendance. On trouve un nombre respectable de
personnes qui ont été associées à l’administration locale
espagnole à Tétouan. Avant la réunification, la zone faisait
figure d’ensemble autonome plus tourné vers l’Espagne que
vers le Sud. En fait, l’indépendance a réduit à un statut local
ceux qui faisaient jusqu’alors figure de conseillers ou d’associés
du gouvernement de Tétouan. Les élites modernes, d’éducation
espagnole, ont dû, pour conserver leur statut, apprendre le
français ou se résigner à une situation comparable à celle des
élites traditionnelles. La révolté du Rif, en 1958, a constitué
une manifestation de réaction contre cette unité qui
apparaissait, pour beaucoup, comme une nouvelle
colonisation. Rien de fondamental n’a été changé entre 1958 et
1963, et les élites locales s’opposent encore violement à la
bureaucratie venue du Sud, mais elles ont compris l’intérêt
qu’elles pourraient tirer à devenir les intermédiaires dans la
distribution des bienfaits du Makhzen à la population, si elles
entraient dans le jeu du Palais.
Dans le Sud du pays, on constate, suivant les zones, une rivalité
entre les élites locales d’origine commerçante, dont l’assise du
pouvoir est à Casablanca, et les anciennes élites rurales liées à
l’administration du protectorat ainsi qu’au système de
commandement du pacha Glaoui. Après l’indépendance, le
parti de l’Istiqlal et l’Armée de libération se sont acharnés à
briser l’esprit et les hommes qui symbolisaient le pouvoir
« féodal ». Leur réussite a été variable suivant l’état d’évolution
des groupes de base. Lorsque les solidarités traditionnelles
avaient éclaté et qu’une forte émigration entraînait les hommes
vers les villes du littoral, ou dans le travail des mines à
proximité, de nouveaux réseaux d’élites se sont installés, tirant
leur influence de leurs rapports avec les villes du littoral. Si, au
contraire, les groupes ont conservé leur cohésion antérieure, on
a vite vu reparaître, comme élus locaux et comme candidats
aux législatives, les anciens chioukh du Glaoui. Il faut aussi
noter, dans toutes les provinces du Sud, à l’exception de Ksar es
Souk, l’influence de l’Université Ben Youssef dont on retrouve
les anciens élèves aussi bien chez ceux qui tirent leur influence
du réseau commercial que parmi ceux qui sont issus du
système local traditionnel.
Le « Maroc utile » est plus banal et complexe à la fois. On
pourrait le caractériser par un effort de transformation plus
profond entrepris par l’action administrative française. C’est
dans cette zone que l’enseignement de type français est plus
largement représenté, au point de paraître un facteur
déterminant, même au niveau local. De ce fait aussi, la coupure
est moins grande avec les élites nationales. Localement,
l’influence du Collège d’Azrou équilibre parfois celle de
Karaouyne.
La richesse terrienne semble aussi un facteur déterminant, qu’il
s’agisse en fait de terres ou de troupeaux. Le « Maroc utile »
n’est certes pas une région entièrement homogène, et il faudra,
dans la pratique, effectuer des découpages par provinces ou par
groupe de provinces. Dans certains cas, l’analyse des
circonscriptions permettra mieux de saisir l’opposition à
l’intérieur des groupes locaux ainsi que leurs liens avec le
système global.
Chapitre V. Les provinces du Nord
Des facteurs historiques et géographiques nombreux
contribuent à donner au Nord du Maroc un caractère
particulier qu’il n’est pas étonnant de retrouver dans la
composition de ses élites locales. Pendant quarante-cinq ans,
cette région a été coupée par une frontière du reste du pays.
Elle possède encore un fonds de règles de droit, de coutumes,
d’habitudes culturelles héritées du protectorat espagnol. Elle a
échappé à l’influence croissante des villes du littoral atlantique
sur le reste du pays. Le rayonnement de Tétouan a effacé celui
de Rabat et Casablanca. Sa bourgeoisie garde la nostalgie de
l’époque où cette ville était une capitale active d’une région qui
tenait à affirmer son autonomie. Tanger y jouait, en dépit ou
grâce à son statut international, un rôle économique
comparable à celui de Casablanca, dans le Sud. L’influence
espagnole reste encore présente à Ceuta et Melilla, villes dont
l’économie est imbriquée dans celle de la région. Ces villes
constituent le refuge d’un style de vie et de sources de profit
chers aux élites rifaines.
La coupure avec le Sud du pays s’est traduite par une forte
influence culturelle espagnole et un développement
économique moindre. L’essor du nationalisme semble en avoir
été retardé. L’Espagne n’a pas mieux ou plus mal traité le Nord
du Maroc que son territoire national[1]. L’infrastructure y est
restée modeste, mais les contraintes administratives semblaient
plus légères qu’en zone Sud. Depuis 1952, une réforme
communale, acceptée par la population, associait certaines
procédures de conseil à l’action administrative. A l’échelon
central, les nationalistes modérés étaient également intégrés au
gouvernement, tout en prenant soin de dériver leur ardeur
révolutionnaire vers le Sud.
Le contexte intérieur espagnol a joué dans l’évolution de ces
rapports. Le mouvement nationaliste est parti, en juillet 1936,
du Maroc où le général Franco avait exercé pendant plusieurs
années. Comme il utilisait largement des troupes et des
officiers rifains, il devait, pour sauvegarder ses arrières,
administrer le Rif avec le plus grand souci de ne pas
mécontenter les élites locales[2]. En fait, de 1936 à 1939,
l’administration espagnole a été très peu présente. Par la suite,
elle a surtout cantonné son action au triangle Tétouan —
Larache — Ksar el Kebir qui constituait son « Maroc utile ». A
partir de Chaouen et jusqu’à Melilla, commençait une zone
dont le principal intérêt était de fournir des troupes pour
maintenir l’équilibre intérieur en Espagne. L’armée espagnole
pratiquait un recrutement d’officiers et d’hommes de troupe
important, ce qui contribuait à donner une soupape de sûreté à
la pression démographique, et renforçait l’intégration. Le
général Meziane, ancien combattant de Teruel et gouverneur
des Canaries, a été le symbole de cette politique. A un moindre
degré, avec des variations dues à l’évolution de la politique
intérieure espagnole et à la personnalité des résidents généraux
de Tétouan, les leaders nationalistes ont participé au pouvoir et
à l’administration locale. Abdel-Khaleq Torres fut ainsi nommé
ministre du gouvernement khalifien. Les élites locales du Nord
avaient donc l’impression d’entretenir des rapports de double
dépendance avec le pouvoir espagnol, qui ne correspondaient à
aucune situation comparable dans le Sud. N’ayant pas les
moyens d’instituer une administration contraignante,
l’Espagne avait laissé les Rifains pâturer et défricher les forêts[3].
Les campagnes se repliaient dans l’isolement. La vie
traditionnelle avait été peu modifiée au contact du monde
moderne, l’organisation tribale et le système économique peu
affectés. La propriété y est généralement petite, très divisée et le
plus souvent mise en valeur par le propriétaire. Les élites
urbaines, séduites par le modèle espagnol, étaient plutôt
orientées vers Madrid et Grenade, et accessoirement vers le
Moyen-Orient, pour retrouver le contact des foyers de la
culture islamique. La fin brusque de cette situation a créé un
traumatisme qui marque, alors, les comportements collectifs.
Le particularisme des élites locales s’y manifeste à un niveau
inégalé dans le reste du Maroc.
Les élites locales des provinces du Nord n’ont pas, au même
degré, la légitimité que l’on retrouve dans le Sud du pays, à
cause de la lutte qu’elles ont menée contre la puissance
coloniale avant l’indépendance. Les Rifains et la bourgeoisie de
Tétouan ont certes collaboré avec les nationalistes contre le
protectorat français, avec la tolérance des autorités espagnoles.
Par ailleurs, le souvenir d’Abdel-Krim est loin d’être effacé, mais
l’Espagne n’apparaît pas comme un adversaire irréductible[4].
Elle sait composer avec les élites locales et accorder refuge aux
nationalistes du Sud, en zone Nord, ou sur son propre
territoire. Sa politique arabe contribue aussi à lui concilier,
après 1945, un certain courant de sympathie. Au niveau
populaire, les affrontements sont plus nombreux, mais le style
de vie quotidienne, les comportements des « petits blancs »
sont moins éloignés de ceux de la classe moyenne marocaine
dans les villes du Nord que dans la zone Sud.
La « colonisation » du pays, à partir de 1957, par une
bureaucratie marocaine, qui reprend à son compte les
règlements et les préjugés de la zone Sud, fera renaître les
solidarités anciennes, dans un style rappelant celui de la révolte
d’Abdel-Krim. Dans l’esprit des Rifains, l’Istiqlal, et, à un degré
moindre, l’UNFP seront associés à cette entreprise malheureuse,
alors que la monarchie, qui a cependant assumé la
responsabilité de la répression militaire de 1958, sera
considérée comme un interlocuteur acceptable. L’interdiction
de l’activité des partis politiques par un ordre du chef d’Etat-
Major des FAR, alors le prince Moulay Hassan, en décembre
1958, n’a certes pas facilité leur implantation. Les officiers, qui
exercèrent, à partir de 1958, les responsabilités de gouverneurs
et de caïds dans la majorité des postes, ne sont guère tentés de
laisser ces instructions tomber en désuétude[5]. Ces oppositions
anciennes et nouvelles renforceront le particularisme des élites
de la zone Nord. Comme elles sont d un âge plus avancé que la
moyenne nationale, elles donneront l’exemple d’une plus
grande continuité, d’une base locale plus nette, accentuée par
une coupure linguistique avec le Sud. Si le modernisme en
souffre, la conformité aux principes islamiques y trouve sa part.
On ne rencontre pas dans le Nord de grande différence entre
élites traditionnelles formées uniquement en arabe, et élites
modernes formées en espagnol. Il est vrai que la solidarité des
deux types d’élites locales évoquées ci-dessus se reconstitue
bien vite contre la bureaucratie originaire du Sud qui, depuis
l’indépendance, occupe les postes clés.
Depuis la révolte de 1958, les élites locales ont pu améliorer
leurs rapports avec le pouvoir central. Elles ont toujours, en la
personne de Torres ou du général Meziane, un représentant au
sein du gouvernement. Les contraintes administratives ont été
appliquées avec moins de sévérité. On ferme les yeux sur une
large part de la contrebande, effectuée à partir de Ceuta et de
Melilla, qui fait vivre une partie de population, ainsi que sur
des pratiques d’exploitation forestière traditionnelles peu
compatibles avec les règles de domanialité. En outre, le
gouvernement de Rabat a entrepris, à partir de 1958, l’étude
d’un programme de reforestation, le DERRO[6], qui procure, à
partir de 1961, de l’emploi pendant de nombreuses années. De
plus, si la contrebande du kif reste pourchassée,
l’administration tolère sa culture tant que les paysans ne
disposent pas d’autres ressources. Elle favorise enfin
l’émigration vers l’Europe pour remplacer le recrutement dans
l’armée espagnole et l’émigration vers l’Algérie qui ont cessé.
L’aide étrangère (émigration et blé américain alimentant les
chantiers) procure une soupape de sûreté. Les comportements
asociaux (contrebande et culture du kif en partie exporté)
jouent le même rôle.
Ainsi, les élites locales arrivent à maintenir leur situation, mais
non sans difficultés. Chaque province constitue, dans cet
ensemble, un cas particulier.
Le cosmopolitisme des élites urbaines de Tanger
Tanger offre la particularité d’être une province urbaine dont
l’organisation s’apparente plus à celle des préfectures de Rabat
et de Casablanca qu’à celle des provinces voisines. Les trois
communes rurales qui entourent la ville ne comptent guère sur
le plan économique et politique, et encore moins sur celui des
élites. L’influence espagnole reste sensible, mais l’élite
tangéroise se distingue surtout par son cosmopolitisme dû à
son ancien statut international, aboli en 1958 (mais, pour
certains aspects économiques, en 1960 seulement[7]). Ville
diplomatique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle,
Tanger était le lien entre le Maroc et l’Europe, le terminus du
Tanger-Fès. Elle doit surtout sa prospérité à l’administration
internationale qui lui donna des airs de capitale. Une
réputation douteuse contribua aussi à cette prospérité. La
population s’accrut au point de compter 141 000 habitants au
recensement de 1960. La prospérité de la ville déclina dès sa
réintégration dans l’espace marocain, mais l’émigration rifaine
vint compenser les départs d’étrangers. Les élites locales de
Tanger cependant conservent souvent une attitude nostalgique
à l’égard de l’ancien statut. En dépit d’une orientation
gauchisante, due à la modernisation rapide de la ville, elles
font perpétuellement le siège du souverain et du gouvernement
pour obtenir un statut particulier (zone de libre-échange) ou
des aides pour freiner le déclin de la ville.
Le cas de Tanger doit être traité à part. Cette ville est bien
intégrée à l’ensemble des provinces du Nord, notamment par
sa population, mais son statut international passé provoque
des réactions particulières. Son ouverture sur 1 extérieur, son
rôle de ville d’échange l’apparenteraient plutôt aux villes du
littoral atlantique. Sa bourgeoisie est plus cosmopolite que celle
de Tétouan, et mieux intégrée aux élites nationales. Ainsi, le Dr
Bengelloun (élu UNFP) et le chérif Moulay Idriss Ouazzani (élu
FDIC) peuvent être considérés comme membres de la classe
politique nationale, tout en étant fort cosmopolites et tout en
jouissant d’une bonne implantation locale. Le Dr Bengelloun,
originaire d’une famille de Fès, s’est installé à Tanger vers 1950,
après ses études à la Faculté de médecine de Paris. Il s’est lié
d’amitié avec la bourgeoisie locale. Pendant la lutte pour
l’indépendance, il a représenté l’Armée de libération. Aussi
Mohamed V l’a-t-il choisi comme gouverneur, après
l’indépendance, pour rassurer les Tangérois. Nommé par la
suite ambassadeur à Washington, puis gouverneur de Rabat, il
reviendra, en 1962, exercer la médecine à Tanger[8].
Elu de la 2e circonscription de Tanger, le chérif Ouazzani
appartient, par son origine familiale, aux chorfa d’Ouezzane
qui ont exercé, à la fin du XIXe siècle, une grande influence
dans le Nord du Maroc[9] : un membre de cette famille est le
fondateur du PDI, et un cousin du candidat, ancien dirigeant
de l’UMA, exerce alors les fonctions de gouverneur de la
province. Cette branche de la famille Ouazzani est installée à
Tanger depuis 1870. L’un des ancêtres a épousé, vers 1890, une
Anglaise, et construit dans cette ville l’une des premières
maisons de type européen appartenant à un Marocain. Après
des études au Lycée Regnault de Tanger, qui l’ont mené
jusqu’au brevet, il s’occupe des affaires de sa famille et milite
au PDI. Au moment de son élection, il est l’un des
collaborateurs directs du gouverneur, et sa candidature a un
caractère quasi officiel. Son principal adversaire est
Abderahman Youssoufi, avocat UNFP né à Tanger, mais ayant
fait l’essentiel de sa carrière politique dans la zone Sud. Au
moment du scrutin, Me Youssoufi est rédacteur en chef du
journal UNFP, At Tharir, et l’un des proches compagnons de
Mehdi Ben Barka. On peut le considérer également comme un
membre de l’élite politique nationale.
En revanche, les autres candidats sont nettement plus
représentatifs d’un milieu tangérois traditionnel. En face du Dr
Bengelloun, le FDIC présente alors Mohamed Zaïdi, journaliste
local, ancien membre du Parti de l’unité et de l’indépendance
que le cheikh Mekki Naciri[10] a fondé, à Tétouan, en 1937. Le
journal en arabe Tanjah, dont il est le fondateur, directeur-
rédacteur et imprimeur, l’a rendu célèbre. Mais ses talents de
polémiste local, de redresseur de torts et d’orateur de style
méditerranéen lui ont créé beaucoup d’ennemis. Ancien élève
du Lycée français, comme le chérif Ouazzani, il a été nommé,
après l’indépendance, directeur des prisons de la ville et
fonctionnaire de la province.
L’Istiqlal présente également deux candidats originaires de la
ville. L’un est son inspecteur local, Ahmed Dziri[11], ancien
guide de tourisme, puis commerçant, très critiqué dans ses
efforts pour installer le pouvoir de l’Istiqlal dans cette ville
après l’indépendance. On l’accuse d’avoir alors organisé, avec
la tolérance du Dr Bengelloun, l’enlèvement de ses adversaires
du PDI ou du parti de Mekki Naciri.
Plusieurs candidats se réclament enfin du Mouvement
populaire. L’un d’eux est un riche commerçant, né à Nador,
qui compte sur les voix de nombreux Rifains de la ville.
Membre de la Chambre de commerce depuis 1960, il passe
pour avoir eu des difficultés avec l’Istiqlal en 1956, et avoir été
contraint d’adhérer à ce parti après un enlèvement et le
paiement d’une rançon.
Les candidats de Tanger se trouvent donc dans une situation
particulière par rapport aux autres candidats du Nord du
Maroc. L’influence espagnole a joué un moindre rôle, tout
comme le poids du Rif. Le statut international a favorisé la
naissance d’une bourgeoisie commerçante dont les enfants ont
souvent été élèves du Lycée français. L’horizon politique a été
longtemps confiné aux limites de la zone internationale, tout
en s’ouvrant aux influences lointaines de l’arabisme. Le Parti
de l’unité et de l’indépendance du cheikh Mekki Naciri a
longtemps incarné ce courant rassemblant la bourgeoisie locale
relativement satisfaite du statut international, mais désirant se
donner la justification d’une doctrine aux vastes horizons, et
montrant des réserves à l’égard d’une réintégration qui leur fait
perdre leurs privilèges.
Par contraste, l’Istiqlal regroupait des milieux plus modestes,
petits commerçants, enseignants, qui plaçaient plus volontiers
leurs espoirs dans l’unité du pays. La plupart d’entre eux se
sont ralliés à l’UNFP, suivant des dirigeants à l’audience
nationale, comme le Dr Bengelloun et Me Youssoufi, et ne
laissant à l’Istiqlal que ses petits cadres locaux qui
rassemblaient un nombre limité de partisans. La tentative
d’hégémonie de l’Istiqlal, au lendemain de l’indépendance, lui
a aliéné la sympathie de la bourgeoisie et de commerçants
Rifins. Mais si la bourgeoisie, pour améliorer la situation de la
ville, place volontiers ses espoirs dans la monarchie, elle peut
difficilement cohabiter, dans un parti monarchiste, avec les
représentants des Rifains. D’autre part, les postes administratifs
locaux lui semblent encore de meilleurs gages d’influence que
les fonctions électives. Les élites tangeroises sont donc
partagées entre les tentations contradictoires de l’action
municipale et du recours aux influences du pouvoir central.
Tétouan : particularisme et nostalgie
La ville et la province de Tétouan constituent, à l’intérieur de
l’ex-zone Nord, un ensemble particulier qui mêle la présence
rifaine, le style espagnol et l’influence d’une bourgeoisie arabe,
comparable, par son origine et ses traditions, à celle de Fès. A
lui seul Abdel-Khaleq Torres personnifie cette bourgeoisie[12].
Né en 1910 dans une vieille famille de Tétouan, il a reçu au
Caire et en Espagne une formation universitaire que ses
contemporains de Fès ou de Rabat, comme Ahmed Balafrej ou
Hadj Omar Abdel-jalil, allaient chercher à Paris. De retour à
Tétouan, il fonde le Parti de la réforme marocaine. Suivant les
aléas des rapports entre le général Franco et les nationalistes, il
sera tantôt ministre du gouvernement khalifien (aux Habous,
puis aux Affaires sociales), tantôt condamné à l’exil. Son parti
se développera dans les villes du Nord, mais il verra parfois ses
journaux saisis et ses militant arrêtés, sans que les conflits avec
l’administration espagnole n’aillent jamais aussi loin que ceux
de l’Istiqlal avec l’administration française[13]. Le gouvernement
espagnol préfère traiter avec les nationalistes, opposant une
tendance à l’autre. Après l’indépendance, il n’y aura pas
d’épuration en zone Nord. La continuité des élites locales,
principalement dans les villes, sera donc encore plus nette que
dans le Sud du pays.
Pour se concilier l’Espagne et disposer, dans le Nord, d’une base
arrière pour le mouvement nationaliste du Sud, le Parti de la
réforme marocaine n’insistera pas, en accord avec l’Istiqlal, sur
ses propres revendications. Après l’indépendance, Torres
dissout son parti et vient siéger au comité exécutif de l’Istiqlal.
Il occupera le poste de ministre de la Justice et procédera à la
réunification juridique des deux zones. Puis il sera ambassadeur
du Maroc à Madrid et au Caire. Il sera chargé, car il connaît
bien l’espagnol, d’une mission de bonne volonté pour
expliquer la position marocaine sur la Mauritanie en Amérique
latine. Sous Hassan H, son rôle devient plus effacé[14].
En se présentant aux élections en mai 1963, il peut compter sur
le soutien de la bourgeoisie d’origine andalouse[15], à laquelle le
lie un capital de notoriété et de services rendus. Les gros
commerçants, les artisans, les intellectuels et les enseignants
sont en sa faveur. Mais l’émigration rifaine est très forte à
Tétouan. Torres ne la néglige pas dans sa propagande
électorale : il diffuse des tracts le montrant aux côtés de Abdel-
Krim au Caire.
Son principal adversaire sera d’ailleurs un Rifain des Beni
Ouriaghel, El Hadj Mohamed Haddou Meziane. Ancien élève
des écoles primaire et secondaire espagnoles à Melilla, le cheikh
Meziane a poursuivi ses études à l’Université d’Al Azhar du
Caire, et à la Karaouyne. Originaire de la tribu d’Abdel-Krim,
on le dit apparenté à l’ancien leader rifain. Il est surtout connu
pour avoir été un des principaux organisateurs du soulèvement
du Rif en 1958. Après la défaite des insurgés, il s’est réfugié en
Espagne où il a résidé jusqu’en 1962, bénéficiant alors de la
clémence royale. Le cheikh Meziane appartient au Mouvement
populaire, mais sans être assez soumis pour se plier aux
arbitrages de Rabat qui lui ont préféré Embarek Jdidi. Depuis
son retour d’exil, le ckeikh Meziane exerce les fonctions de
professeur à l’institut islamique de Tétouan, dont la clientèle
est essentiellement rifaine. Sous le protectorat espagnol, il avait
été nommé directeur de l’enseignement originel, puis directeur
du tribunal d appel de Tétouan. Il peut compter sur la
sympathie active des petits commerçants et sur la clientèle
nombreuse et modeste de l’émigration rifaine. S’il avait reçu
l’investiture officielle du FDIC, il aurait aisément remporté le
siège ; Torres obtient à peine 100 voix de plus que lui. Il sera
élu représentant de Tétouan en 1970.
Le candidat officiel du FDIC, Embarek Jdidi, est un industriel
né à El Jadida (Mazagan). Très entreprenant, il a commencé sa
fortune à Tanger avant la seconde guerre mondiale, en étant
associé aux affaires de Bata. Il a fait, à ce titre, plusieurs séjours
en Tchécoslovaquie. Intermédiaire d’affaires européennes dans
le Nord, il a passé longtemps pour un protège des autorités
espagnoles, tout en militant au Parti de la réforme marocaine.
Après l’indépendance, il est désigné comme délégué Istiqlal à
l’assemblée consultative. Il montre, en 1959, quelques
sympathies à l’égard de l’UNFP, puis apporte son soutien au
Mouvement populaire qu’il délaisse pour se rallier au FDIC, dès
sa création. Membre de la Chambre de commerce depuis 1960,
sa présence à Tétouan est ancienne, et ses activités industrielles
et commerciales multiples. Il s’est intéressé au commerce du
liège, à l’hôtellerie, aux textiles. Lors de sa candidature, il dirige
une entreprise de tissage. Chaque fois ses affaires se sont
développées à l’ombre de l’Etat et avec son aide. Jdidi est le
type d’industriel qui ne peut pas se lancer seul, faute de
capitaux et de crédit personnel, dans de grandes affaires. Mais il
fait figure, aux yeux des étrangers ou des fonctionnaires de
Rabat, de l’homme d’affaires courtois et raffiné, dont l’esprit
d’entreprise contraste avec la morgue et l’èsprit de clocher de la
bourgeoisie du Nord. Il possède une bonne connaissance du
français et parle également l’espagnol, 1 anglais et l’allemand.
Sa fille, qui a reçu une éducation secondaire et supérieure
moderne, a été la première femme diplomate marocaine. Jdidi
1 a fiancée, au lendemain de l’indépendance, à Anegaï[16], alors
directeur de cabinet de Mohamed V, qui se tua, par la suite,
dans un accident d’automobile.
Sa candidature reçoit l’appui de l’administration et de quelques
éléments de la bourgeoisie locale aussi peu intégrés que lui
dans les clientèles traditionnelles, notamment celle des
Tétouanais originaires des Jbala qui forment un groupe
d’immigrants distinct et rival des Rifains. Associé en affaires
avec certains d’entre eux, il aurait recruté parmi eux la main-
d’œuvre de ses usines.
Torres, le cheikh Meziane et Jdidi représentent, chacun, trois
types différents d’élites locales urbaines. Il est rare de voir
opposées des personnalités aussi représentatives des groupes
auxquels ils appartiennent.
Torres incarne l’ancienne bourgeoisie nostalgique de l’époque
espagnole, et jalouse de la portion congrue que lui laisse la
bourgeoisie marocaine du Sud dans les institutions du Maroc
indépendant. Sa position au sein de l’Istiqlal 1’aide à conserver
un poids local considérable. Mais sa culture espagnole en fait
un homme aussi inadapté au maniement de la bureaucratie
moderne du Sud que s’il était uniquement de culture arabe[17].
Le cheikh Meziane constitue un nouveau type d’intellectuel
traditionnel, dont la culture arabe et islamique correspond à la
sensibilité politique du monde rural et à celle des immigrants
récents. Dans la lignée d’Abdel-Krim, il sait être homme de
religion et homme de guerre ; il n’est plus l’adversaire des
Espagnols, bien au contraire, mais celui du nouveau Makhzen.
Jdidi est aussi caractéristique dans son genre. C’est
l’entrepreneur au sens du XIXe siècle. Il a compris les sources
multiples de profits que laissait espérer l’indépendance. Pour
ne pas les laisser échapper, il lui faut être proche du pouvoir
central, quel qu’il soit.
En fait, à Tétouan, seule compte encore la vieille bourgeoisie.
Mais, comme à Fès, son emprise sur la ville s’affaiblit[18] au
profit des Rifains, immigrés plus ou moins récents. Quelques
éléments marginaux peuvent montrer que l’emprise de ces
deux réseaux n’est pas totale. Leur présence ne modifie pas
cependant la nature du système.
Dans les circonscriptions voisines, on enregistre des
confrontations intéressantes entre divers éléments
représentatifs des élites intermédiaires. A Tétouan-banlieue, un
alem de tendance PDI, ancien élève de la Karaouyne, né dans
l’un des villages de la circonscription, l’emporte sur le candidat
officiel du FDIC, qui est un chérif commerçant et président de
commune rurale.
La circonscription des Jebala, située entre Tétouan et Ceuta,
compte neuf candidats. L’élu est un avocat de Tétouan,
Mohamed Boulaïch, marié à une Espagnole, et installé à Ceuta
où il dirige un hôtel. Ses bonnes relations avec les Espagnols
datent de la guerre civile où il aurait aidé les nationalistes. Il
possède un passeport espagnol, et sait mettre son influence au
service des nombreux Jebala qui travaillent ou aspirent à
travailler dans le port espagnol. Cette situation particulière lui
permet de battre trois agriculteurs, présidents de communes
rurales de la circonscription. Le poids des services rendus
l’emporte nettement, dans son cas, sur les autres formes
traditionnelles d’influence, et aboutit paradoxalement à mettre
la représentation de la circonscription entre les mains d’un élu
dont les liens avec l’Espagne ont sans doute plus d’importance
que sa nationalité marocaine. Mais il est possible que ses
électeurs l’aient choisi pour ses qualités d’intermédiaire auprès
des Espagnols, dont ils dépendent plus que de l’administration
marocaine[19].
Dans les circonscriptions de Baria et de Bahria, situées, l’une
sur le versant méditerranéen du Rif, l’autre sur le versant
intérieur, la compétition entre les élites locales s’organise sur
un modèle traditionnel. Dans la première, qui comprend la
ville de Chaouen, le siège est emporté par un candidat Istiqlal,
né à Chaouen et revenu dans cette ville pour enseigner à
l’institut islamique local, après des études à la Karaouyne. Dans
la circonscription plus rurale de Bahria le siège est emporté par
un candidat FDIC. agriculteur aisé et ancien caïd des Beni
Khaled[20] du temps des Espagnols, qui bat un chérif
d’Ouezzane, ancien caïd des Beni Khaled du temps d’Abdel-
Krim.
Les trois circonscriptions du littoral atlantique de la province
présentent des situations politiques différentes. A Asilah,
quatre candidats originaires de la circonscription s’opposent.
Le siège est remporté par un agriculteur aisé, de tendance
neutre, président d’une grosse commune rurale. La situation à
Larache est encore plus confuse : neuf candidats sont en
présence. Le siège est remporté par le président de la Chambre
de commerce de tendance Istiqlal. A Ksar el Kebir, le seul élu
UNFP de la province est un commerçant soussi, président du
conseil communal depuis 1960.
La région littorale qui constituait le « Maroc utile » de la zone
Nord est donc largement dominée par des élites locales
d’origine urbaine où l’on trouve un nombre élevé
d’enseignants en majorité de formation traditionnelle,
quelquefois moderne, mais, dans ce cas, acquise en Espagne.
Dans la montagne rifaine, en revanche, les candidats ont une
assise traditionnelle plus nette qui préfigure déjà les élites
locales de la province d’Al Hoceima.
Al Hoceima : victoire de la tradition
Dans cette province, la naissance, le savoir traditionnel et la
participation à la révolte du Rif en 1958 semblent être les
éléments les plus nets d’appartenance à l’élite locale. L’UNFP
ne présente pas de candidats officiels. La lutte politique se
circonscrit entre les différentes tendances du FDIC et l’Istiqlal.
Ce parti reste encore marqué par les maladresses commises
dans les premières années après l’indépendance. Il a été peu
favorisé par l’administration militaire qui s’installa dans la
province pendant plusieurs années, après la révolte.
En fait, les causes économiques et sociales de la révolte de 1958
persistent, et si l’administration traite la population avec plus
de prudence, elle doit tolérer des pratiques telles que la culture
du kif ou le défrichage abusif de la forêt qui vont à l’encontre
de son comportement rationnel. Or, il ne s’agit pas de
phénomènes marginaux. Dans les régions de haute montagne,
le kif procure des ressources au tiers des habitants[21]. Les
cultures sur brûlis et le défrichage des forêts longtemps toléré
sont progressivement interdits par une administration qui
s’efforce, en contrepartie, de procurer du travail aux habitants
dont un nombre croissant[22] dépend des chantiers de la
Promotion nationale. L’émigration vers l’Europe réduit
également une pression qui serait autrement insupportable.
Tous ces facteurs réduisent l’intérêt de la population pour le jeu
politique national qui est abandonné aux élites locales. G.
Maurer décrit ainsi le groupe où se recrutent les intermédiaires
entre le pouvoir et la population[23]:
« Des paysans aisés se suffisent largement, vendent une
partie de leur production, jouent souvent un rôle de
ramasseurs et prêtent de l’argent. Ce sont eux qui bâtissent
les maisons les plus confortables. Dans le massif Sanhaja-de-
Sraïr, ils sont les plus gros producteurs de kif ; à l’Est, ils
possèdent d’assez grandes exploitations en terre sèche,
qu’ils donnent en association ; à l’Ouest, ce sont des
éleveurs-cultivateurs ; ailleurs, enfin, ils contrôlent la
production artisanale de leurs voisins. Souvent ils sont les
représentants des grandes confréries ou des familles
maraboutiques. Leur nombre est très variable : quelques
dizaines dans les vallées les plus pauvres, quelques
centaines dans les secteurs orientaux. Au total ils ne
représentent certainement pas le cinquième de la
population de la montagne centrale ».
Ainsi l’élu de la circonscription d’Al Hoceima, gros agriculteur,
cheikh de la zaouia Ouazzania à Beni Yetteft, est l’un des
candidats les plus représentatifs des élites locales du Rif. Né en
1927 dans les Beni Yetteft, il reçoit à la zaouia même un
enseignement coranique élémentaire qui lui permet de lire
l’arabe, sans plus, tout en parlant également le dialecte rifain et
l’espagnol. Il est considéré comme un homme riche, car il
possède 650 amandiers, 30 figuiers, un troupeau de 40 chèvres
et 13 hectares irrigués. Sa carrière politique est ainsi décrite par
l’administration marocaine :
« Issu d’une famille noble d’Ouezzane, son père s’est
installé au Rif et devint célèbre par ses connaissances
religieuses, et très influent. Ayant fondé la “Zaouia
Ouazzania”, il a pu avoir beaucoup d’influence. Cette
zaouia a attiré l’attention des responsables espagnols qui
ont proposé au père de Si Abdelaziz plusieurs postes qu’il a
refusés. Si Abdelaziz a assuré, après la mort de son père, la
continuation de l’activité de la Zaouia, les autorités
espagnoles lui ont proposé plusieurs postes qu’il a d’abord
refusés. Mais, par la suite. Si Abdelaziz a accepté sa
nomination comme membre du conseil du Khalifa en 1948.
En 1951, il a été nommé caïd de la tribu de Beni Yetteft.
Après l’indépendance, Si Mansour, ex-gouverneur d’Al
Hoceima, lui a proposé d’adhérer au parti de l’Istiqlal, mais
Si Abdelaziz a refusé et a été mis en prison pendant dix
mois à la suite d’une affaire montée de toutes pièces par les
ex-autorités provinciales de l’époque. Ayant été acquitté par
le tribunal de Nador, Si Abdelaziz est resté dans cette ville
jusqu’aux événements du Rif. Pour échapper à la vengeance
du parti de l’Istiqlal, il s’est réfugié en Espagne jusqu’en
1960. Si Abdelaziz a une très grande influence dans les
tribus suivantes : Beni Yetteft, Beni Boufrah, Beni Guemil,
Mestassa, Bequioua et quelques fractions des Aït Yousef ou
Ali ».
Si Abdelaziz Ouazzani, élu sous l’étiquette FDIC avec la
bienveillance de l’administration, va mettre toute son énergie à
combattre les interventions des autorités locales, à obtenir des
passeports pour l’Europe, et des chantiers de Promotion
nationale pour ses électeurs.
A Targuist, le siège est remporté par un ancien caïd de la
région, du temps des Espagnols. Comme Abdelaziz Ouazzani, Si
Larbi Allouh bénéficie d’un prestige traditionnel dû à la
situation de sa famille et aux fonctions importantes qu’il a
occupées sous le protectorat. Longtemps fonctionnaire, puis
ministre des Habous du Khalifa de Tétouan, le candidat a été
nommé, en 1956, professeur à l’institut islamique de Tétouan.
En face de lui, l’Istiqlal présente son ancien inspecteur à
Agadir, qui doit bientôt être nommé dans cette province où il a
exercé les fonctions de caïd jusqu’en 1960.
La circonscription des Beni Bou Ayach offre la particularité de
correspondre exactement au territoire des Beni Ouriaghel[24] qui
ont montré leur cohésion aux côtés de Abdel-Krim, puis
pendant la seconde révolte du Rif, en 1958. Or, on constate
avec surprise que les membres de la famille Khattabi
(descendants de Abdel-Krim) s’opposent largement entre eux.
L’élu est un neveu de Abdel-Krim, ancien élève de l’institut
islamique de Tétouan et de la Karaouyne, professeur d’arabe à
l’Ecole normale d’instituteurs d’Al Hoceima, depuis 1960.
Ancien membre de l’éphémère Conseil constitutionnel en
1960, il est connu comme un adversaire de longue date de
l’Istiqlal et du Parti de la réforme nationale de Torres. Résidant
à Tanger en 1936, il participait, alors, aux côtés de Mekki
Naciri, à l’organisation du Parti de l’unité, puis fondait, plus
tard, le Parti des indépendants, à Tétouan. Quand, après le
discours de Mohamed V, à Tanger, en 1947, l’administration
espagnole durcit son attitude à l’égard des nationalistes, il
quitte Tétouan et réside à Tanger jusqu’en 1960, en exerçant
son métier d’instituteur d’arabe.
Parmi les candidats, on trouve deux autres membres de la
famille El Khattabi. L’un d’eux, de tendance UNFP, est
conseiller juridique de sociétés à Casablanca, après avoir fait
des études de droit à Damas puis à Madrid. A son retour au
Maroc, en 1953, les autorités espagnoles le nomment conseiller
juridique pour les Affaires indigènes. Après l’indépendance, il
exerce ses fonctions aux Ministères des affaires étrangères et du
travail, avant de passer dans le secteur privé[25].
Le troisième candidat, qui appartient de loin à la famille de
Abdel-Krim, est un commerçant de tendance Mouvement
populaire, membre de la société de bienfaisance d’Al Hoceima.
Deux anciens participants à la révolte rifaine de 1958 se
présentent également sans succès. Tous deux sont nés dans la
circonscription mais n’y résident plus. Le plus âgé, né en 1911,
est un ancien élève de la Karaouyne ; il exerça longtemps les
fonctions de cadi dans diverses juridictions du Nord. Il était
directeur de l’institut islamique de Nador lorsqu’il fut arrêté, en
1958. Libéré en 1960, il accepte un poste de chargé de cours de
l’institut islamique de Tétouan. Le plus jeune, Haddou
Abarkach, né en 1933, est le fils d’un ancien capitaine de
Abdel-Krim que les Espagnols garderont comme caïd en 1926.
Il dut interrompre ses études à la Karaouyne, ayant été refoulé
sur la zone Nord par les autorités du protectorat français, en
1953, pour activités nationalistes. Il termine ses études à
Tétouan tout en prenant part à l’organisation de l’Armée de
libération du Rif. Il participe, en 1957, à la création du
Mouvement populaire. Il est à nouveau impliqué dans le
soulèvement du Rif en 1958, pour avoir organisé, à Fès,
l’enlèvement du corps de Si Abdès[26] pour l’inhumer dans les
Gzennaïas. Hostile à la création du FDIC, il est, en 1960, chargé
de mission au cabinet du Dr Khatib, ministre des Affaires
africaines. En face de ce groupe de partisans de la monarchie,
l’Istiqlal présente un petit commerçant, paysan, militant de
longue date, qui ne doit sa notoriété qu’à sa parenté avec
l’ancien caïd qui administrait la région du temps des
Espagnols.
En fait, l’intérêt de cette élection repose justement sur
l’indifférence que manifeste pour elle une population dont la
cohésion tribale peut être particulièrement forte, lors de
certains événements. Les limites de la circonscription
coïncidaient avec les frontières tribales, et les candidats avaient
les uns et les autres des rapports étroits avec les principaux
lignages. Les conclusions sur cette élection sont
contradictoires. Pour l’administration, le fort taux d’abstention
(55 %) proviendrait du fait que les mécanismes traditionnels
ont joué lors du choix des candidats ; l’élection formelle
n’avait donc plus d’importance, ni d’intérêt. Autre hypothèse :
les problèmes politiques nationaux n’intéressaient pas la
population, et les poids des différents chefs de lignage en
compétition s’annulaient[27]. Cette seconde interprétation
semble plausible bien que l’on puisse soupçonner l’élu de
vouloir capter, au profit de son seul lignage, le bénéfice des
interventions publiques, et modifier, ainsi, un équilibre
précaire.
Nador : des élites locales dominant une situation
instable
Les élites locales de la province de Nador ne se différencient
guère de celles des autres provinces du Nord. Dans les cinq
circonscriptions, nous rencontrons généralement, parmi les
candidats, des lettrés traditionnels ayant participé à la révolte
du Rif, des agriculteurs aisés et des commerçants. Les candidats
venus de l’extérieur sont peu nombreux. Les liens passés ou
actuels avec l’Espagne ne constituent pas un obstacle pour une
carrière politique ; ils sont à peu près aussi fréquents et
honorables que l’aide apportée à l’Armée de libération ou au
FLN qui ont disposé à Nador de camps d’entraînement.
L’équilibre précaire dans lequel vit cette province surpeuplée
en fait une banlieue de Melilla[28]. Les mines de fer, qui
produisent alors un million de tonnes, emploient près de trois
mille ouvriers-paysans recrutés dans la région. La production,
en déclin, est évacuée par Melilla. L’approvisionnement de
l’enclave espagnole en produits agricoles fait vivre plus de dix
mille personnes. Mais, surtout, une active contrebande, tolérée
dans les deux sens, occupe une fraction importante de la
population, et profite largement à un groupe de commerçants
qui organisent aussi bien l’approvisionnement de la ville que la
réexpédition des marchandises sur Fès, Meknès, Oujda et
même l’Algérie, grâce à un réseau très dense de cars et de taxis.
L’émigration, enfin, contribue à stabiliser cette région
surpeuplée. Cette émigration, orientée vers l’Algérie et de
courte durée, avant 1956, s’est, depuis lors, convertie en
émigration de longue durée vers l’Europe (Allemagne, France,
Bénélux). Elle touchait environ trente mille personnes, et
représentait près de la moitié de l’émigration marocaine à cette
date[29].
L’émigration, les relations commerciales lointaines et
aventureuses, une agriculture aux techniques anciennes et
raffinées, installée dans un pays pauvre et surpeuplé, sont des
facteurs qui apparenteraient cette région au Souss. Toutefois,
l’émigration s’oriente vers l’étranger et les liens commerciaux
dominants se font avec Melilla.
Tous les élus de la province appartiennent au FDIC ; ils
proviennent tantôt du PDI, le plus souvent du Mouvement
populaire. L’Istiqlal représente un courant assez fort, et l’UNFP
est moins absente dans cette province qu’à Al Hoceima, grâce à
la présence de l’UMT dans les mines de fer de Sengangan.
L’élu de Nador réunit tous les caractères de notoriété habituels
dans le Nord : il a fait ses études à la Karaouyne et exerce les
fonctions de professeur d’arabe à Melilla, en territoire espagnol.
De tendance Mouvement populaire, il a participé à la révolte
du Rif en 1958. Il est issu d’une famille qui a fourni de
nombreux caïds, aussi bien aux Espagnols qu’au Makhzen. Son
frère est encore caïd de la tribu de son lieu de naissance et
contrôle, donc, une partie de la circonscription de Nador.
L’élu de Sengangan est le doyen des oulémas de Nador,
directeur de l’institut islamique de cette ville. Diplômé d’Al
Azhar, il a toujours enseigné à Nador. Il appartient à une
famille de notables religieux connue dans la province. Son
engagement politique date du temps des Espagnols. Il a
d’abord adhéré au Parti Maroc libre, puis au PDI, avant de se
rallier au FDIC. A Zaio et à Midar, les élus sont de gros
agriculteurs possédant chacun plus de deux cents hectares.
L’un est issu d’une famille de caïds, l’autre d’une famille de
chorfas. Seul l’élu de Temsamane, Mohamed Bou Karta, est un
jeune diplômé de l’Université de Rabat. Mais il appartient à
l’entourage du Dr Khatib, et sa famille possède encore des
terres dans la circonscription. La participation active de ses
parents à la révolte du Rif aux côtés de Abdel-Krim leur valut
d’avoir à s’exiler à Fès, en 1926.
Notes du chapitre
[1] Le décollage de l’économie espagnole n’a commencé que
les années soixante.
[2] Voir R. Rézette, Les partis politiques marocains, op. cit., p.
114.
[3] Elle a aussi laissé s’étendre considérablement la culture
du kif dans la région de Ketama.
[4] Voir R. Rézette, Les partis politiques marocains, op. cit., p.
234 et suiv.
[5] En revanche, l’administration civile de la province de
Taza, à laquelle cette mesure s’applique également, observe une
attitude plus souple à l’égard des partis et des syndicats.
[6] Voir p. 69.
[7] Voir P. Mas, « Tanger une fie ? », Revue de géographie du
Maroc, 1 et 2, 1962, p. 153-155 ; J. Bonjean, Tanger, Paris,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,
1967 ; Villes et tribus du Maroc, volume 7, Tanger et sa zone,
Paris, E. Leroux, 1921.
[8] Mais à partir de 1965 il reviendra s’installer à Casablanca.
[9] Voir E. Michaux Bellaire, « Les Chorfa d’Ouezzane »,
Revue du monde musulman, 5, mai 1908, p. 23-89 et Villes et
tribus au Maroc, op. cit., p. 204.
[10] Voir Rézette, Les partis politiques marocains, op. cit., p.113
et suiv.
[11] D’origine algérienne et ayant longtemps conservé cette
nationalité, Dziri aurait sans doute vu son élection constestée s
il l’avait emporté.
[12] Torres appartient au groupe des familles d’origine
andalouse. Son père était pacha de Tétouan et son grand-père
nalb du sultan à Tanger.
[13] Cependant, l’Espagne s’inquiétera lorsque Torres, avec
Allai el Fassi, fera pression sur Abdel-Krim en 1947 pour qu’il
Causse compagnie aux Français et se réfugie au Caire. Mais
dans l’ensemble on ne retrouve pas dans le Nord là rivalité qui
oppose le protectorat et la bourgeoisie urbaine dans le Sud et
détermine l’alliance des uns avec les notables ruraux, des autres
avec le Palais.
[14] Il mourra en 1970 sans avoir retrouvé un rôle politique
à sa mesure.
[15] Le pacha de la ville est, comme Torres, un Tétouanais de
vieille souche. Il soutiendra sa candidature. En revanche, le
gouverneur originaire du Sud soutient activement celle
d’Erabarek Jdidi.
[16] Un des rares hauts fonctionnaires du « Maroc nouveau »
originaires du Nord.
[17] Pour reprendre la distinction de Gramsci entre
intellectuels organiques et intellectuels traditionnels, Torres,
qui était un intellectuel organique sous le protectorat espagnol,
devient un intellectuel traditionnel après l’indépendance. C’est
aussi le cas de nombreux bourgeois du Nord qui ne
maintiendront leur situation qu’en s’intégrent au groupe des
intellectuels organiques de culture française. Voir l’analyse de
H. Portelli, Gramsci et le bloc historique, Paris, Presses
universitaires de France, 1972, p. 115 et suiv.
[18] Si les postes politiques (gouverneur, contrôleur de la
sûreté régionale) et ceux de chefs des grands services
techniques (Travaux publics, Eaux et forêts) sont entre les
mains de Marocains de la zone Sud, le pacha de la ville et les
cadres administratifs de la province sont originaires de la ville.
Il en est de même de nombreux juges. La part des Tétouanais
dans l’élite politique nationale est assez mince. Mis à part
Torres et le général Meziane, on ne trouve guère que le
directeur de la MAP (agence officielle de presse) qui songeait un
moment à solliciter 1 investiture du FDIC mais qui s’est vu
préférer Jdidi, appuyé par le gouverneur. On trouve aussi
quelques Tétouanais aux Affaires étrangères et aux Finances.
Les Rifains sont assez nombreux parmi les officiers.
[19] Depuis l’indépendance le poids économique de Ceuta
n’a fait que croître, autant comme débouché des produits
locaux, que comme source d’emploi et d’approvisionnement
d’une contrebande active.
[20] Cette tribu de montagne est l’un des plus gros
producteurs de kif.
[21] Voir G. Maurer, « Les paysans du Haut-Rif central »,
Revue de géographie du Maroc, 14, 1968, p. là 61.
[22] Dans certaines zones près d’un tiers d’après G. Maurer,
ibid., p. 66.
[23] Ibid., P. 64.
[24] Voir D. M. Hart, « Clan, lignage et communauté locale
dans une communauté rifaine », Revue de géographie du Maroc,
8, 1965, p. 25-33, et « Conflicting model of a Berber tribal
structure in the Moroccan Rif : the segmentary and alliance
systems of the Aït Waryaghar ». Communication au congrès du
MESA, Toronto, 14-15 novembre 1969. (Je suis
particulièrement redevable à D.M. Hart de nombreuses
indications sur la société rifaine).
[25] En 1958, il a été l’un des signataires d’une pétition de
18 points remise par les Beni Ouriaghel à Mohamed V.
[26] Chef de l’Armée de libération, assassiné en 1957 dans
des conditions mystérieuses.
[27] Interprétation donnée par D. M. Hart.
[28] Voir J.-F. Trouin, « Le Nord-Est du Maroc : mise au
point régionale », Revue de géographie du Maroc, 12, 1967, p. 5 à
41.
[29] Ibid., p. 22-23.
Chapitre VI. Le Sud et les régions pré-
sahariennes
Le Nord du Maroc offrait des conditions exceptionnelles de
cohérence pour l’étude des élites locales. L’isolement
géographique et politique, une influence culturelle particulière
tendaient à couper les élites locales des élites nationales. Les
élections au Parlement pouvaient être, pour ceux qui n’avaient
pas pu avoir, depuis l’indépendance, une participation au
pouvoir à la mesure de leur ambition, l’occasion de retrouver
une place dans le système politique. Tel semble bien être le cas
de nombreux candidats intellectuels traditionnels ou modernes
de formation espagnole. Leurs homologues dans l’ex-zone Sud
auraient été engagés dans les responsabilités bureaucratiques
ou politiques et auraient hésité à abandonner un pouvoir réel
pour une situation de prestige et d’avenir incertains. Pour les
notables traditionnels, également nombreux, l’élection peut
constituer un but justifié par des considérations locales. En
devenant représentant, ou même simplement en étant le
candidat patronné par un parti, un notable renforce son
pouvoir de discussion avec la bureaucratie locale. S’il n’a pas
coupé les ponts avec le pouvoir, fait extrêmement rare, il
accroît sa capacité de marchandage.
La situation des élites est différente dans le Sud du pays et dans
les régions pré-sahariennes, en dépit de nombreux aspects
comparables sur le plan économique et social. Le
surpleuplement, l’émigration et les caractères particuliers d’une
agriculture ancienne de sédentaires sont des données de base,
en partie communes aux deux régions. Mais Marrakech et les
provinces pré-sahariennes ne sont pas coupées du système
politique global, et leur mécontentement peut plus facilement
s’exprimer, à ce niveau, par une action politique ayant un
contenu idéologique et des objectifs nationaux. L’émigration
vers Casablanca et les villes du littoral a aussi créé des liens
anciens avec un milieu urbain à l’avant-garde d’une action
politique visant à des transformations profondes de la société
marocaine.
Mais les conflits d’ordre politique et économique, que les
émigrés du Sud, notamment les Soussis, ont pu avoir, à
l’intérieur du système global, avec d’autres groupes, les ont
amenés à maintenir une forte cohésion. Cette solidarité,
comparable à celle de la société traditionnelle, s’exerce dans
l’univers moderne des villes du littoral. Les conflits extérieurs
ont eu également des répercussions sur le système des élites
locales, et ont favorisé l’existence d’un certain régionalisme qui
s’exprime aussi bien sur le plan culturel que politique en des
termes parfois comparables à ceux dû Nord.
Certes, les provinces de Marrakech, d’Agadir, de Ouarzazate, de
Kar es Souk et de Tarfaya forment un ensemble trop vaste pour
être uniforme. Les conditions de vie et l’organisation sociale
présentent, cependant, des traits communs qui différencient
ces provinces des plaines et plateaux du Nord. Mis à part Ksar
es Souk, cette région a subi l’influence des « grands caïds » qui
ont poursuivi une politique d’appropriation de la terre que le
protectorat n’était guère en mesure de freiner. En outre, une
large partie des provinces de Marrakech et de Ouarzazate était
dominée par le plus puissant d’entre eux, le pacha de
Marrakech, Si Thami El Glaoui. L’indépendance a certes
apporté des bouleversements, car les cadres de l’Istiqlal ont
voulu, dans ces régions restées relativement calmes jusqu’à la
fin du protectorat, briser plus qu’ailleurs l’ordre ancien. Ils y
réussirent parfois.
Cependant, en 1963, les rivalités locales se définissent encore
en termes de partisans ou d’adversaires du Glaoui. Dans les
régions montagneuses à peuplement berbère, le rôle social et
économique des anciens khalifas et chioukh du pacha de
Marrakech reste dominant. Après une période d’éclipse et de
rivalité, ils retrouvent, à partir de 1960, leur statut social, et
c’est à eux que, tout naturellement, en 1963, les gouverneurs
songeront pour représenter le FDIC. Il arrive parfois que l’on
rencontre la seconde génération dé grands notables dont les
pères s’étaient distingués du temps du protectorat et n’avaient
pas été disqualifiés par l’indépendance : de même que le fils de
Addi ou Bihi a été élu à Kerrando, ou le fils Bekkaï à Berkane, le
fils du caïd Layadi est élu à Sidi Bou Othmane dans les
Rehamna.
En face de ces notables, qui incarnent à des titres divers la
stabilité des structures, nous trouvons un groupe plus réduit
d’individus que l’on peut classer dans les élites locales. Certains
ont aussi le statut de notables ruraux ou de commerçants, mais
à un moindre niveau et sans qu’ils aient occupé de fonctions
administratives. L’administration et les partis se sont appuyés
sur eux pour essayer de briser les structures traditionnelles,
après l’indépendance. Ils restent puissants dans les zones où la
désintégration économique et sociale a facilité leur
implantation. Quelques-uns gardent l’étiquette de l’Armée de
libération. Ils constituent une minorité influente et redoutée,
surtout dans les provinces pré-sahariennes.
Le rayonnement de Casablanca constitue aussi un facteur
dominant favorable à l’UNFP. Des liaisons quotidiennes par car
ou par taxi collectif assurent le transfert des personnes, des
tracts, des fonds et des mots d’ordre. Les commerçants soussi
des villes du littoral exercent une influence considérable,
même dans les villages reculés[1]. Les services rendus, les espoirs
qu’ils suscitent, le modèle incontesté de réussite sociale qu’ils
représentent en font des propagandistes plus puissants que les
représentants de l’administration ou les notables tribaux dont
le pouvoir reste fondé sur une économie agro-pastorale
décadente. Le modèle est surtout valable pour la province
d’Agadir. A Ouarzazate, les traditions retrouvent leur puissance
à mesure que l’on s’éloigne des petits centres, des secteurs
miniers et des axes de communication. A Ksar es Souk, les
clientèles politico-religieuses l’emportent, mais les montagnes
berbères se différencient du reste de la province.
Rivaux des Fassi dans les grandes villes du Nord, les Soussi
transforment cette concurrence commerciale à une opposition
politique, aussi bien en ville que dans leur région d’origine[2].
Leur attitude fait un peu tache d’huile sur toute la région. A
partir de 1960, l’administration s’efforcera, avec un succès
inégal, de capter cette opposition en faveur de la monarchie.
Enfin, l’Université Ben Youssef de Marrakech joue un rôle
politique considérable, tant par ses diplômés que par ses
professeurs. Les candidats qui en sont issus forment un groupe
assez nombreux et de toutes tendances, réparti dans les trois
provinces du Sud-Ouest. On retrouve, là aussi, une variante de
l’opposition à la domination de Fès, d’où provenaient la
majorité des cadres du Maroc indépendant, à ses débuts. Cette
opposition entre élites urbaines se renforçait d’une opposition
entre universités au prestige inégal, les cadres fassis de l’Istiqlal
étant souvent issus de Karaouyne alors que Abdallah Ibrahim,
le seul président du conseil UNFP, sortait de Ben Youssef.
Si Casablanca joue bien le rôle de pôle d’orientation des élites
locales du Sud, sur le plan économique. Marrakech pourrait
être considérée comme la métropole culturelle de la région,
mais avec un prestige moindre que celui que Tétouan exerce
sur les provinces du Nord.
Marrakech : culture traditionnelle et diversification
des activités économiques
La province de Marrakech constitue, par son étendue, un
ensemble très diversifié, composé de plateaux atlantiques et
intérieurs, de régions de collines et de haute montagne. La
structure des élites locales y est influencée par une série de
facteurs géographiques et économiques qui tendraient à
accentuer les différences. Les facteurs historiques pèseraient, en
revanche, dans un sens unitaire. Nous avons déjà relevé
l’influence intellectuelle et religieuse de la ville ainsi que celle
de l’Université Ben Youssef, et le rayonnement économique de
Casablanca avec, comme conséquence, la présence de riches
émigrés ayant conservé ou acquis une situation de notables
dans leur région d’origine. En dehors des villes importantes, on
ne trouve guère de candidats appartenant aux élites politiques
nationales. Dans les campagnes et surtout dans le Haut-Atlas,
l’influence politique du Glaoui demeure importante.
Dès les premières années de l’indépendance, l’Istiqlal fit des
efforts pour effacer ces souvenirs de la « féodalité » et de la
collaboration, cherchant à détruire, avec un succès variable, les
rapports de soumission des ruraux au système ancien. Le plus
souvent les élites locales en ont retenu le souvenir d’une
période d’injustice et d’« impérialisme fassi ». Avec l’arrivée de
Tahar ou Assou comme gouverneur de la province, en août
1960, l’orientation du pouvoir central à l’égard des élites
locales change entièrement. Après avoir procédé à une
épuration des caïds, chioukh et moqqademin mis en place par
l’Armée de libération dans les premières années de
l’indépendance, le gouverneur reconstitue l’ancien réseau de
notables là où il était encore possible de s’appuyer sur lui. Lors
des élections de 1963, son travail de reprise en main aura eu le
temps de porter ses fruits, surtout dans les campagnes. Il pourra
veiller à la sélection des candidats gouvernementaux et
travailler à leur succès, tout en laissant l’opposition tenter sa
chance et y réussir parfois. Ses liens anciens avec les dirigeants
du Mouvement populaire lui permettront d’orienter et de faire
respecter les arbitrages, tout en laissant, en ville, un nombre
respectable de sièges aux amis de Guedira. Ainsi les trois
circonscriptions urbaines de Marrakech ont pu élire des
représentants FDIC appartenant à l’élite politique nationale.
Driss Debbagh est un homme d’affaires de Casablanca,
originaire de Marrakech. Après avoir été avocat, puis
ambassadeur du Maroc en Italie, il dirige une affaire de textile.
Ami de Guedira et du prince Moulay Ali[3], qui appuie sa
candidature, il passe pour assez proche de Karim Lamrani et des
milieux d’affaires UNFP de Casablanca. Il appartient à l’Amel
Club, organisation fondée par Lorrain Cruse et Karim Lamrani,
pour servir de point de rencontre aux milieux d’affaires
libéraux, marocains et français.
Moulay Larbi Messaoudi, originaire de Tanger, est l’un des
directeurs au Ministère de l’éducation nationale à Rabat. De
culture arabe et française, il a longtemps enseigné dans les
écoles franco-musulmanes, à Tétouan et à Tanger, puis, de
1935 à 1947, il a enseigné l’arabe au collège de Marrakech,
avant d’être promu inspecteur de l’enseignement de l’arabe à la
Direction, puis au Ministère de l’éducation nationale. Son long
séjour à Marrakech lui a permis de se faire des amis, d’acquérir
une maison en ville et quelques terres dans les environs. Il
ajoute, ainsi, à son prestige de haut fonctionnaire, son
appartenance à une famille chérifienne et un certain
enracinement bourgeois.
Le troisième élu FDIC de Marrakech, Adberahman Khatib, est
un avocat de Casablanca, frère du Dr Khatib, président du
Mouvement populaire. Il a rejoint le FDIC après avoir été
membre du Parti communiste lorsqu’il était avocat en France,
puis au Maroc. D’origine algérienne, il a effectué son service
militaire comme sous-lieutenant dans l’armée française, et a été
mobilisé durant la seconde guerre mondiale.
En face de ces membres de l’élite politique nationale, présentés
par le FDIC, l’Istiqlal engage des candidats de premier plan. Le
plus connu est Mohamed Boucetta qui appartient, depuis 1959,
au comité exécutif du parti. Originaire de Marrakech, il a été
élu, en 1960, président du conseil municipal. Militant de
l’Istiqlal depuis son séjour au Lycée Mangin, il a été l’un des
dirigeants de l’Association des étudiants nord-africains à Paris.
De retour au Maroc, il défend les nationalistes et les résistants
devant les tribunaux du protectorat. Plusieurs fois secrétaire
d’État, puis ministre, il restera, avec certains jeunes cadres, aux
côtés de Allai el Fassi lors de la scission de l’Istiqlal en 1959. Il
gardera néanmoins ses distances avec la vieille garde fassi du
parti.
Les deux autres candidats Istiqlal sont les deux frères Bel Abbés,
issus d’une vieille famille de la bourgeoisie religieuse de
Marrakech[4]. L’un est pharmacien et l’autre avocat : la
respectabilité de leur profession s’ajoute à leur notoriété
traditionnelle. Leur frère, Youssef Bel Abbés, alors ministre de
l’Éducation nationale, se présente à Essaouira où il fut
longtemps médecin. Abdelkader, le pharmacien, est celui dont
l’enracinement à Marrakech est le plus marqué. Installé dans
cette ville avant l’indépendance, il n’a jamais accepté ni de
venir à Rabat, ni d’occuper des postes dans la fonction
publique. Il est président de la Chambre de commerce de
Marrakech depuis 1960. Il préside également l’Automobile
Club de cette ville. Son frère, Bachir, a été nommé, après
l’indépendance, sous-directeur de la Sûreté nationale,
gouverneur de la province de Marrakech, puis ministre du
Travail et ambassadeur à Moscou. Ses attaches avec son milieu
d’origine sont, donc, plus relâchées.
L’UNFP n’est certes pas absente de la compétition. La rivalité
traditionnelle entre Fès et Marrakech lui vaut, a priori, un
certain courant de sympathie. Ses candidats sont pourtant loin
d’avoir la notoriété nationale ou même locale que possèdent
ceux du FDIC ou de l’Istiqlal. Ils n’en sont, à certains égards,
que plus représentatifs d’élites locales. Les trois candidats sont
des enseignants ; l’un est professeur à l’Université Ben Youssef,
les deux autres instituteurs d’arabe. Tous trois sont originaires
de Marrakech, et diplômés de cette université traditionnelle.
Leur passé de militants remonte au temps du protectorat. L’un
d’eux est aussi responsable local de l’UMT, et a effectué, à ce
titre, plusieurs voyages en Allemagne de l’Est. Le second,
instituteur, est déjà membre du conseil municipal et trésorier
de la société de bienfaisance.
En face de cette situation urbaine complexe, comparable par
certains aspects à celle de Fès, Safi donne une image de luttes
politiques modernes qui se définissent en termes de classe.
C’est cependant l’Istiqlal qui remporte le siège, malgré
l’importance du milieu ouvrier. Le candidat Istiqlal, inspecteur
régional du parti, né dans cette ville, est diplômé de
l’Université Ben Youssef. Il a été directeur d’école libre à Safi du
temps du protectorat, qui le condamna à plusieurs reprises. Il
conserve un réseau solide d’amitiés et de complicités dans
l’administration, qui date des premières années de
l’indépendance où son influence dépassait celle du pacha.
Son adversaire FDIC est un Naciri, propriétaire foncier, ancien
résistant, assez proche de l’UMT. Le candidat UNFP est un
ancien caïd, directeur d’école à Khemisset, et militant de
l’Istiqlal depuis 1940. Il exerce depuis plusieurs années les
fonctions d’inspecteur de l’UNFP pour Tétouan et sa région.
La victoire surprenante de l’Istiqlal dans une circonscription
ouvrière et urbaine est sans doute le fruit des dissensions entre
l’UMT et l’UNFP, qui n’ont fait que s’aggraver depuis le
référendum. L’UMT songeait un moment à présenter des
candidats sous son étiquette propre : cette tactique était
notamment proposée par les sections syndicales des villes de
moyenne importance où les cadres du syndicat assuraient
également l’infrastructure de l’UNFP, et ne voyaient pas
pourquoi ils devraient changer d’étiquette pour entreprendre
une action politique. La direction de l’UMT à Casablanca n’ose
pas s’engager activement ; elle décide de boycotter les
élections, puis de ne soutenir aucun candidat, pour accepter,
une semaine avant le scrutin, de soutenir les candidats
progressistes. Ce n’est que quelques jours avant l’élection que
la campagne de l’UNFP démarre vraiment. Certains militants,
rebutés par ces manœuvres qui devaient presque ouvertement
bénéficier au FDIC, préfèrent soutenir le candidat Istiqlal,
connu de longue date.
Les autres circonscriptions du littoral atlantique de la province
offrent une certaine homogénéité que l’on retrouve dans la
composition des élites intermédiaires. La partie Nord du
littoral, la région des Abda, prolonge celle des Doukhala qui
appartient à la province de Casablanca. Très peublée, cette
région compte de grandes exploitations céréalières mécanisées,
voisinant avec de petites exploitations et des vignobles. La
densité de peuplement pousse les agriculteurs à intensifier leur
système de culture et à diversifier leurs activités[5]. Nous verrons
que les élites locales appartiennent souvent au groupe qui a
réussi cette diversification.
L’Istiqlal y est nettement mieux représenté que l’UNFP. Il
semble que l’action en profondeur de l’inspecteur régional de
Safi ait permis de garder la fidélité des petits cadres et des
militants du parti. En revanche, ces derniers passent à l’UNFP,
dans la province de Casablanca, où les cadres de l’Office
national des irrigations (ONI), installé dans le périmètre des
Doukkala, apportent un soutien extérieur assez net au parti de
gauche. Dans la province de Marrakech, le débat politique se
réduit le plus souvent à une rivalité entre l’administration
locale favorisant, depuis 1960, le Mouvement populaire, et
l’Istiqlal qui dominait la situation dans la période antérieure.
L’UNFP reste cantonnée dans les villes. Le débat entre ces deux
courants dominants se poursuit sans gravité tant que les
ministres Istiqlal siègent au gouvernement.
Voyons maintenant comment se répartissent les élites locales
entre ces diverses tendances. On note un grand nombre de
candidats appartenant au groupe des grands propriétaires
terriens, quel que soit leur parti d’affiliation. A l’approche
d’Agadir, les commerçants jouent un rôle plus important dans
la mesure où la médiocrité de l’agriculture limite les chances
d’une accumulation de capital importante.
A Jemaa Sahim, au Nord de Safi, l’élu Istiqlal est un fellah
propriétaire de 600 hectares, mis en valeur, en partie
seulement, suivant des méthodes modernes.
A Sebt Gzoula, au Sud de Safi, un gros fellah, marchand de
grains, candidat officiel de l’Istiqlal et désigné par Rabat, est
battu par un candidat officieux, appuyé peu: l’inspecteur local
du parti. Ce candidat, ancien résistant (il a fait de la prison
sous le protectorat), a pu obtenir, après l’indépendance, grâce à
l’inspecteur, une licence de taxi. Depuis lors l’inspecteur local
l’emploie comme agent de liaison avec ses militants dispersés.
A Chemaïa, circonscription qui comprend le gisement de
phosphates de Youssoufia (ex Louis-Gentil), l’UNFP ne présente
aucun candidat : elle n’était pas arrivée à se mettre d’accord
avec l’UMT. L’Istiqlal et le FDIC opposent deux notables
originaires de la circonscription, qui chercheront avant tout le
soutien des électeurs ruraux. L’élu[6], membre de l’Istiqlal, est
propriétaire de 250 hectares, d’immeubles et de boutiques à
Chemaïa. Son adversaire FDIC est un ancien cadi de Chemaïa
du temps du protectorat, ancien élève de Karaouyne. Il possède
300 hectares, un troupeau, des maisons et une station service
dans le centre urbain.
A Talmest, l’élu du FDIC est l’ancien pacha et chef de cercle
d’Essaouira, le chérif Moulay Aomar Alaoui, lointain parent de
la famille royale. Retiré de l’administration, il est commerçant
à Fès depuis 1960. Son rival malheureux est un notable FDIC,
agriculteur et commerçant, qui avait tout d’abord obtenu
l’investiture, par l’intermédiaire du Mouvement populaire,
grâce à sa parenté avec l’ancien caïd du protectorat. Mais son
principal adversaire est un candidat Istiqlal, appartenant à une
famille bourgeoise d’Essaouira, les Barazi. Diplômé de
l’Université Ben Youssef, ce candidat exerce les fonctions de
secrétaire de la Chambre de commerce d’Essaouira dont son
cousin est le président. Il est en outre correspondant de Al
Alam et secrétaire local de l’UGTM. C’est un militant
nationaliste de longue date : il a fait trois mois de prison en
1953. L’UNFP présente un agriculteur-éleveur, qui se prévaut
plus de son origine chérifienne que de son investiture pour
solliciter les suffrages de ses concitoyens.
L’élu Istiqlal d’Essaouira, un Barazi, appartient aussi à la famille
bourgeoise la plus connue de la ville. Militant Istiqlal depuis
1944, il a été arrêté et condamné deux fois à de longues peines
de prison par le protectorat. Il cumule maintenant la
présidence du conseil municipal et celle de la Chambre de
commerce. Transporteur, commerçant et agriculteur, il possède
un car qui dessert la région d’Essaouira. Sa ferme fournit une
large part de l’approvisionnement de la ville en lait. Son
principal adversaire est le Dr Youssef Bel Abbés, ministre de
l’Éducation nationale, qui se présente dans cette ville sous
l’étiquette FDIC pour ne pas être en rivalité, à Marrakech, avec
ses frères aînés, candidats Istiqlal. Le docteur Bel Abbés a exercé
les fonctions de médecin chef de l’hôpital d’Essaouira, de 1950
à 1958, avant d’être nommé directeur de l’hôpital Maurice-
Gaud à Casablanca, puis ministre de la Santé publique. Militant
des jeunesses de l’Istiqlal depuis 1944, inscrit à ce parti sans
toutefois compromettre sa carrière administrative, le Dr Bel
Abbés restera au gouvernement en janvier 1962, après le départ
des ministres de l’Istiqlal. Il garde des attaches solides à
Essaouira. Son beau-père, d’origine algérienne, ancien
interprète du Contrôle civil local, y réside encore en 1963.
L’élu FDIC de Tamanar est un notable rural qui cumule les
activités d’agriculteur (3Q hectares), de commerçant et
d’exploitant forestier. Il est en outre propriétaire d’un café
maure et de trois maisons au centre de Tamanar. Il a été élu, en
1960, président de la commune d’Imgrad, et délégué du cercle
au conseil d’administration de la Caisse régionale de crédit
agricole de Marrakech. Sa richesse et ses activités multiples lui
assurent une influence plus grande que celle du candidat
Istiqlal, commerçant en gros d’Essaouira, fils d’un ancien
cheikh du protectorat.
La région du Haut-Atlas est habitée par une population de
petits propriétaires sédentaires berbères appartenant au groupe
chleuh. Par son système d’irrigation, son arboriculture, son
intensification agricole, cette région rappelle le Rif[7]. Mais elle
doit sa prospérité à la culture des légumes et du henné, et non,
comme le Rif, à la culture du kif et de la contrebande : de ce
fait, ses relations avec l’État seront d’un tout autre type. Mais
les ressources locales ne suffisent pas, et l’on compte un fort
pourcentage d’émigration vers Marrakech et les villes du
littoral.
Dans ces circonscriptions –– à la seule exception de Asni —
tous les élus appartiennent au FDIC. A l’Ouest, l’UNFP est le
principal parti d’opposition (comme dans la province voisine
d’Agadir). A l’Est, l’adversaire principal est l’Istiqlal. Les
candidats proviennent souvent d’un groupe homogène de
notables ruraux, mi-agriculteurs, mi-commerçants, ayant
souvent occupé, avant ou après l’indépendance, les fonctions
de cheikh. Certains d’entre eux ont des attaches à Casablanca
ou à Marrakech, bien que leur centre principal d’activité reste
leur circonscription d’origine.
A Imintanout, les divers candidats Istiqlal ou FDIC
correspondent très fidèlement à ce modèle. L’un d’eux offre la
singularité d’entretenir trois familles, une à Imintanout, une à
Marrakech, une à Casablanca, avec, au total, quinze enfants. En
revanche, le candidat UNFP est mouderess dans la commune
de Douirane dont il est le président. Cet ancien étudiant de
l’Université Ben Youssef est aussi le responsable de l’UNFP pour
tout le cercle d’lmintanout. Né dans la commune, il y possède
quelques terres et quelques animaux.
Dans la circonscription voisine d’Amizmiz, l’élu FDIC est
l’ancien caïd des Goundafa, autrefois fidèle du pacha Glaoui. Sa
candidature est soutenue par le Mouvement populaire. Son
adversaire Istiqlal est un ancien militaire, devenu commerçant,
qui occupa les fonctions de cheikh après l’indépendance. A
Asni, un fellah moyen (30 hectares) de tendance Istiqlal
l’emporte sur un ancien cheikh du protectorat, agriculteur et
éleveur important, possédant, en outre, des propriétés à
Marrakech et à Casablanca.
En revanche, dans les Ait Ourir, le président du conseil
communal, gros agriculteur (200 hectares) de tendance Istiqlal,
est battu par un agriculteur moyen du FDIC. L’UNFP présente
un artisan de Casablanca, résistant, plusieurs fois condamné
par le protectorat. Militant Istiqlal depuis 1945, il a su, après
l’indépendance, préserver sa région d’origine des exactions de
l’Armée de libération qui y était installée. A Touama, un fellah
moyen (30 hectares), ancien khalifa du Glaoui, l’emporte sur
un autre fellah, cheikh de sa fraction, après l’indépendance.
L’ancien cheikh de Demnate (cheik pendant trente ans) est élu
sous l’étiquette FDIC. Il l’emporte sur son successeur (cheik de
1956 à 1959), commerçant de tendance Istiqlal et
correspondant de Al Alam à Demnate. L’UNFP présente un
petit fellah associé au fquih Basri (originaire de la ville) pour
l’exploitation d’un car desservant les localités de la
circonscription.
Les circonscriptions du Dir et de la plaine de Marrakech
forment un dernier groupe ayant ses caractéristiques propres.
L’élément berbère disparaît avec l’altitude. Les élites locales
voient croître la superficie de leurs terres et le nombre de leurs
troupeaux. L’agriculture se diversifie et se modernise. Les
grandes exploitations, souvent en décadence, continuent à
dominer de nombreux terroirs, en milieu traditionnel. Ce sont
souvent des héritages de la situation juridique et politique du
protectorat. L’utilisation de l’eau et la répartition des terres
irriguées dominent les problèmes agraires. Mais l’élevage, bien
que moins important, reste le secteur de placement par
excellence d » élites qui ont réussi à accumuler un capital dans
l’agriculture ou dans d’autres activités. Les élites locales ont
tendance, aussi, à multiplier leurs domaines d’activité, trouvant
dans le commerce, les transports ou la spéculation foncière un
rapport beaucoup plus rémunérateur pour leurs capitaux que la
propriété terrienne, cependant nécessaire au maintien de leur
assise sociale. On voit augmenter également, avec la richesse
relative du terroir, le nombre des candidats ayant reçu une
éducation supérieure traditionnelle. La plupart de ces candidats
appartiennent à l’UNFP, et proviennent de l’Université Ben
Youssef.
La circonscription de Marrakech-banlieue présente une
situation assez confuse. A l’origine neuf candidats se
présentent, provenant des tribus Guich et des diverses
communes rurales de la circonscription. L’élu est un gros
agriculteur FDIC, qui, sans passer pour autant pour un
nationaliste actif, fut mis en prison sous le protectorat pour
s’être opposé au Glaoui.
L’élu FDIC de Chichaoua est un gros agriculteur moderne (200
hectares) possédant un matériel abondant, des troupeaux et
trois maisons à Marrakech. Son concurrent Istiqlal se partage
entre Casablanca et Chichaoua. Transporteur et commerçant, il
possède quatre cars desservant des lignes locales, deux camions
et quatre stations service. Le candidat UNFP est un épicier,
ancien élève de l’Université Ben Youssef.
A Sidi Chiker, un gros agriculteur et éleveur FDIC l’emporte de
justesse sur un horloger, secrétaire du bureau local de l’Istiqlal.
A Sidi Bou Othman, le fils du caïd Layadi, ancien adversaire du
Glaoui, révoqué par le protectorat en 1953, l’emporte
facilement sur un agriculteur moyen, de tendance Istiqlal,
président de commune rurale, et un instituteur UNFP, ancien
élève de l’Université Ben Youssef, et frère d’un cheikh de la
circonscription.
Dans la circonscription des Rehamna, c’est un agriculteur
Istiqlal, grand propriétaire de terres et de troupeaux dans la
circonscription, mais demeurant à Settat, qui est élu.
A Tamelelt, le président de la commune rurale de Sidi Driss,
militant Istiqlal depuis 1944, l’emporte. Fellah et commerçant,
il possède une trentaine d’hectares irrigués, des arbres, une
huilerie et du matériel moderne.
Dans les Sgharna-Zemrane, l’élu FDIC est un gros propriétaire
possédant une station service. Ancien fquih du caïd, il avait
administré la région avec autorité du temps du protectorat.
On peut retenir de ces affrontements l’image de l’importance
de la culture traditionnelle comme moyen de communication
avec les masses. Les candidats du FDIC et de l’Istiqlal
l’associent à une richesse foncière et commerciale ; ceux de
l’UNFP à des fonctions d’enseignants. La part des candidats de
culture française semble réduite. L’analyse des données portant
sur les régions pré-sahariennes vont permettre de préciser ces
hypothèses.
Agadir : culture traditionnelle, richesse moderne et
passé militant des élites locales
La province d’Agadir présente, en plus contrastées, des
conditions naturelles comparables à celles de la province de
Marrakech. On y trouve une zone montagneuse occupée par
une paysannerie sédentaire ancienne, pratiquant avec science
les techniques d’irrigation. La plaine du Souss offre des
analogies avec le Haouz de Marrakech. La densité du
peuplement par rapport aux superficies cultivables[8] explique
une migration ancienne qui s’est orientée, depuis la naissance
du protectorat, vers les villes du littoral, créant des échanges
constants qui constituent le phénomène politique de base de
ces régions[9]. Le contrôle de la population par les moyens
traditionnels de l’administration s’en trouve affaibli. Tout
d’abord, parce que les émigrés riches ont un prestige supérieur
à celui du réseau administratif local[10]. Les pressions que le caïd
et ses adjoints peuvent exercer trouvent leurs limites dans la
tradition d’émigration des ruraux, et dans les contre-pressions
que leurs relations urbaines peuvent, en retour, faire jouer. Le
système politique local se trouve relié à un ensemble plus vaste,
où les mouvements de population et la pénétration d’idées
étrangères au milieu traditionnel jouent leur rôle.
En revanche, dans la bordure saharienne de la province, on
rencontre, comme dans les provinces de Ouarzazate et de Ksar
es Souk, un enchevêtrement de rapports d’association et de
soumission entre Arabes, Berbères sédentarisés ou nomades et
Haratin. Cette situation, héritée du passé, se transforme de
manière inégale : certains éléments du corps social continuent
à exercer un contrôle privilégié sur les hommes, la terre et
l’eau.
Mais, dans le Nord, déjà modernisé, comme dans le Sud
traditionnel de la province, le contraste entre la richesse
individuelle des élites locales, quelle que soit leur appartenance
politique, et la pauvreté du milieu semble le trait dominant. La
médiocrité des ressources offertes à une population trop
nombreuse favorise l’émigration. Les intermédiaires qui
facilitent cette émigration occupent, de ce fait, une position
privilégiée.
Ce facteur joue surtout pour les régions montagneuses de la
province, mais à Agadir même, les facteurs idéologiques et
sociaux sont associés. Les trois principaux partis présentent
chacun un candidat diplômé de l’Université Ben Youssef. L’élu,
de tendance UNFP, est un ancien directeur d’école fibre,
devenu, depuis l’indépendance, cadre permanent du parti. Il
fut d’abord inspecteur régional de l’Istiqlal à Marrakech. Il a été
élu, à ce titre, vice-président du conseil municipal de cette ville.
Passé depuis lors à l’UNFP, qui le rémunère comme permanent,
il est transféré dans le Souss où il est correspondant dû journal
At Tarhir à Agadir. Pendant le protectorat, ses activités
nationalistes le firent condamner à deux ans et demi de prison.
Son principal adversaire FDIC (ayant autrefois appartenu à
l’Istiqlal, est le directeur de la société des autobus de la ville,
riche entrepreneur, président de la Société de bienfaisance
d’Agadir. Il descend d’une lignée de marabouts célèbres dans le
Souss. La candidat Istiqlal est aussi un ancien directeur d’école
libre à Marrakech ayant exercé les fonctions d’inspecteur du
parti à Agadir. Il fut également emprisonné trois ans sous le
protectorat, pour avoir milité dans les rangs de l’Istiqlal depuis
1938.
Il est intéressant de noter, dans cette circonscription, les
échanges de personnes, entre Marrakech et Agadir, dans les
divers partis. Métropole intellectuelle traditionnelle, Marrakech
est aussi un centre intermédiaire d’influence politique. En
revanche, les circuits modernes de production tendraient
plutôt à relier directement Agadir à Casablanca. De plus,
l’émigration ne semble pas transiter par la capitale du Sud.
Depuis l’indépendance, Marrakech n’a plus le rôle d’échelon
administratif intermédiaire qui lui était reconnu dans
l’organisation régionale du protectorat. Il est curieux de voir
l’organisation des partis politiques suivre plutôt les circuits de
diffusion de la culture traditionnelle que ceux de
l’administration ou ceux des échanges économiques modernes.
Dans la circonscription de Biougra, qui couvre la majeure
partie de la zone d’irrigations proche d’Agadir, trois
agriculteurs modernes, d’étiquette différente, s’opposent. L’élu
UNFP est un véritable colon marocain d’Ouled Teima, Abbés
Kabbaj, propriétaire de trois fermes représentant 300 hectares
de cultures (en majorité des agrumes). Il avait déjà fait partie
des sections marocaines des Chambres d’agriculture du
protectorat, et siégé, à ce titre, au Conseil de gouvernement,
puis, après l’indépendance, à l’Assemblée consultative. Ce gros
agriculteur UNFP, qui siège dans de multiples organismes
professionnels est, en fait, dans une situation comparable à
celle de Mansour Nejjaï dans le Rharb. Son adversaire du FDIC
fait modeste figure à côté de lui, avec 150 hectares. Plus
modeste encore est le candidat Istiqlal qui ne possède que 20
hectares. Tous trois sont d’anciens nationalistes militants qui
ont été inquiétés sous le protectorat.
Dans la circonscription des Chtouka, l’élu UNFP est un riche
épicier en gros de Rabat, vice-président de la Chambre de
commerce de cette ville, et président du conseil communal des
Chtouka.
Dans la circonscription de Taroudant-Nord, l’élu FDIC est un
propriétaire aisé de 150 hectares, ancien amghar du
protectorat, et président actuel de la commune rurale de
Tafingoult.
L’élu UNFP de Taroudant-Sud, circonscription comprenant la
ville, est un petit fellah que l’on peut considérer comme un
véritable permanent de ce parti. Né à Skhirat, près de Rabat, il
était commerçant à Oujda lorsque les autorités du protectorat
l’ont arrêté, en 1953, puis assigné à résidence à Taroudant où il
s’était fixé après l’indépendance.
L’élu de Tafraout, région d’origine des épiciers soussis des villes
du littoral, est un épicier en gros, né dans la circonscription, et
membre de la Chambre de commerce de Casablanca où il
réside. Sa richesse, son passé nationaliste et son comportement
puritain lui assurent un prestige certain[11].
Omar El Moutaouakil, candidat UNFP, est élu à Tiznit. Né en
1912, à Mirleft, dans la circonscription, il a fait ses études
d’arabe à la médersa des Ait Ba Amrane sur le territoire d’Ifhi,
du temps du protectorat espagnol. Il a été, de l’indépendance
jusqu’en 1960, le conseiller politique officieux de l’Armée de
libération du Souss : son influence s’étendait jusqu’en
Mauritanie. Les oulémas du Stiuss l’ont élu président de leur
association. Son engagement politique se fonde sur un
puritanisme ardent qui est l’expression habituelle du sentiment
religieux dans cette province.
Le FDIC, qui était supplanté dans les montagnes de l’arrière-
pays d’Agadir et dans la vallée du Souss par les cadres de
l’UNFP, colons commerçants ou religieux, retrouve une
audience dans les circonscriptions situées sur les versants
sahariens des montagnes. Les notables traditionnels
l’emportent, ici, dans des conditions qui annoncent déjà celles
que nous retrouverons plus loin dans la province de
Ouarzazate. L’élu de Goulimine, Abouzaïd Dahman, est un
ancien caïd, propriétaire de 180 hectares et de nombreux
troupeaux. Il exploite, en outre, une ligne de cars d’Agadir à
Tantan. Patriarche à l’ancienne mode, il possède plusieurs
épouses et compte vingt-trois enfants, dont trois sont officiers.
Issu d’une famille de caïds, il a démissionné, en 1953, lors de
l’exil de Mohamed V, pour être réinvesti, en 1956, puis
révoqué en 1958. Ami de Ahardane, il représente le
Mouvement populaire, à Goulimine, depuis qu’il a quitté
l’administration.
Les élus FDIC de Foum El Hassan et du Bani sont aussi, comme
leurs principaux adversaires, de gros agriculteurs-commerçants
venant du Mouvement populaire.
La circonscription de Tarfaya, couvrant toute la province du
même nom, mérite une mention particulière. Elle a élu comme
représentant Horma Ould Babana, notable mauritanien réfugié
au Maroc en 1958 en compagnie de l’émir du Trarza. Comme il
a été le seul candidat désigné quasi officiellement par le roi, le
gouverneur militaire de Tarfaya ne croira pas devoir accepter
d’autres candidatures, et Horma Ould Babana sera élu sans
rival[12]. Depuis son arrivée au Maroc, il a occupé des fonctions
de directeur au Ministère des affaires sahariennes, et, pendant
un temps, d’ambassadeur en Libye. Le parti majoritaire mettra
à profit son expérience parlementaire française pour lui faire
jouer le rôle de chef du groupe parlementaire du FDIC.
Ouarzazate : retour à la tradition
Si dans la province d’Agadir l’influence du gouverneur sur le
jeu politique local ne s’était guère fait sentir, ou n’avait pas pu
obtenir les résultats escomptés par le pouvoir central, à
Ouarzazate la situation était tout à fait différente. Le
gouverneur de cette province, nommé en 1960, est un officier
d’origine rifaine, qui exerce ses fonctions dans un style plus
proche de celui des Affaires indigènes que de celui des
nouveaux caïds fonctionnaires. Ami du général Medboh, il
dispose d’appuis à Rabat pour obtenir les moyens nécessaires à
sa politique. Son influence favorisera nettement l’implantation
du Mouvement populaire et la reconstitution des réseaux
d’élites traditionnelles, battus en brèche par l’Armée de
libération et par son prédécesseur. Au départ, la situation
politique était assez comparable à celle de la province d’Agadir.
L’influence de Casablanca et, à un moindre degré, celle de
Marrakech, continuent à se faire sentir sur une population à
majorité berbère, dans une province qui fut un fief du Glaoui.
On n’y trouve pas, comme à Agadir, une classe de
commerçants aisés et prestigieux ralliés à l’UNFP. Mais les
centres miniers, les lignes d’autobus, qui appartiennent à un
ancien chef de l’Armée de libération, sont les points forts du
parti de gauche. Il faut y ajouter l’aide de nombreux
fonctionnaires souvent mutés dans le Sud pour des raisons
politiques, qui poursuivent, là, leur action militante avec un
grand ressentiment contre le gouvernement. Cependant, les
notables ruraux, certes moins riches que ceux de la province
d’Agadir, n’ont pas perdu totalement leur prestige et leur
influence, et les oulémas ne sont pas gagnés par l’extrémisme.
A la différence cependant d’Agadir, aucune personnalité
remarquable n’émerge parmi les élites locales. Le rôle du
gouverneur n’en est que plus déterminant.
L’élu FDIC de la circonscription de Ouarzazate est le
représentant type des traditionnels notables ruraux de cette
région. Né en 1914, il appartient à une famille influente de la
tribu des grands éleveurs nomades des pentes Sud du Haut-
Atlas[13], les Imeghane. Son père a fait construire la Zaouia
Kadiria d’El Kelea des Mgouna. Sa tribu se retrouve dans la
vaste commune rurale de Toumdoute, dont il est le vice-
président, après avoir été cheikh et président de la jemaa
administrative, sous le protectorat. Après l’indépendance, il
conserve les fonctions de cheikh jusqu’au moment où il entre
en conflit avec un gouverneur proche de l’Armée de libération,
qui le fait destituer. Fellah, et surtout éleveur aisé, il possède
aussi un camion et deux boutiques dans l’oasis de Skoura où il
a fixé son domicile.
L’élu FDIC du Siroua présente un profil social voisin, à cette
nuance près qu’il appartient à la tribu des Glaoua. Originaire
d’une famille maraboutique de Telouet, il peut compter sur
l’appui des anciens chioukh et maqqademin du pacha Glaoui,
qui composent la majorité des élus au conseil communal de
Telouet et des communes voisines. L’élu de la circonscription
de Tazenakht est un adel en premier de Taliouine, diplômé de
l’Université Ben Youssef de Marrakech. Il est originaire de cet
endroit où il possède des terres et des troupeaux qui lui
permettent d’accroître sa notoriété.
Les candidats UNFP, qui représentent dans cette province une
menace nettement plus sérieuse que ceux de l’Istiqlal, sont
d’origine diverse. On trouve parmi eux, comme à Agadir, des
émigrés installés dans les villes du littoral, mais dont la réussite
est moins brillante et l’influence moindre que celles des
commerçants UNFP de la province d’Agadir. Abdallah Sanadji
en est l’exemple le plus marquant. Ancien responsable de la
résistance et de l’Armée de libération, il a occupé le poste de
gouverneur de Nador après l’indépendance. Il est installé à
Rabat comme gérant d’une station service ; il fait parti du
conseil national de l’UNFP. Ses attaches avec la province de
Ouarzazate restent minces. Il y est surtout connu pour avoir
enlevé avec l’Armée de libération, après l’indépendance, de
nombreux caïds et khalifas du Glaoui. Il possède, dans sa tribu
d’origine, à Foum Zgid, quelques palmiers et quelques animaux
confiés à sa famille.
Le candidat UNFP du Siroua est un chauffeur de taxi de Rabat
propriétaire d’une boutique à Ouarzazate. Ancien militaire de
l’armée française, il a participé à la résistance. En 1954, il fut
condamné à vingt ans de prison pour terrorisme. A Boumalme
du Dadès, le candidat est un petit fellah, secrétaire du bureau
local de l’UNFP et responsable de l’UMT, qui tire l’essentiel de
ses ressources de sa situation de permanent. On 1 accuse
d’avoir participé, en 1960, à la révolte du super-caïd de Beni
Mellal. A Agdz, nous trouvons un ancien militaire de l’armée
française, possédant des terres et 160 palmiers dans la vallée du
Draa, et qui tire quelques revenus supplémentaires des
fonctions d’assesseur expert auprès du tribunal du Sadad de
Zagora.
Le candidat UNFP de Zagora est un cheikh de la Zouia Naciria
de Temegrout, qui, depuis l’indépendance, a été secrétaire local
de l’Istiqlal puis de l’UNFP à Zagora. Notable aisé, il possède
dans l’oasis des palmiers, des terres irriguées et cinq maisons. Il
est président de la société musulmane de bienfaisance et
conseiller communal de Zagora.
L’Istiqlal, dont l’influence est très réduite dans la province,
présente deux fquih de mosquée, un adel et deux petits
commerçants qui semblent les correspondants locaux du parti.
Plusieurs candidats sans étiquette, dont le profil s’apparente à
celui des élus du FDIC, se présentent dans diverses
circonscriptions.
Par ailleurs, cette province offre un assez bel exemple de la
façon dont les problèmes ethniques, qui sous-tendent les
rivalités locales depuis un temps fort ancien, se combinent avec
les clivages politiques. Le poids de la grande confédération
berbère des Aït-Atta, qui avait eu des rapports difficiles avec le
pacha Glaoui, se fait sentir dans l’Est de la province. L’élu FDIC
de Ouarzazate est un notable connu, appartenant à cette
confédération. La zaouia Kadiria compte aussi deux adeptes
parmi les élus FDIC. Les Aït-Atta à l’Est et les Glaoua à l’Ouest
se voient donc reconnaître un rôle prépondérant dans la
représentation des populations.
Pour combattre la prépondérance des notables berbères, les
premiers gouverneurs marocains avaient tenté de s’appuyer,
après l’indépendance, sur les éléments arabes rassemblés au
sein de l’Armée de libération. Ils allèrent jusqu’à nommer des
chioukh et des moqqademin parmi les Haratins, pour la plus
grande humiliation des Berbères. L’abandon du droit
coutumier et la mise en place de tribunaux du Sadad
appliquant le chrâa étaient aussi une cause de mécontentement
profond pour ces derniers.
A partir de 1960, l’administration provinciale est à nouveau
favorable aux Berbères ; elle leur évite des tracasseries et essaie
de les faire évoluer du nomadisme à la sédentarisation, sans les
brusquer ni les dépersonnaliser. Par voie de conséquence, les
autres groupes ethniques se retrouvent dans les partis
d’opposition, principalement avec l’UNFP. Mais le tribalisme
ne favorise pas entièrement le parti au pouvoir. Il est parfois
difficile de mobiliser, à l’intérieur d’une circonscription vaste,
comprenant plusieurs tribus, des électeurs qui ont tendance à
se déterminer en fonction de choix strictement tribaux.
L’administration locale doit s’employer à faire en sorte que ses
partisans dépassent ce particularisme ethnique qui est déjà
partiellement étranger à ses adversaires.
Ksar es Souk : situation confuse
Les conditions économiques et sociales de la province de Ksar
es Souk présentent des similitudes avec celles des provinces
d’Agadir, et surtout de Ouarzazate. On y retrouve les mêmes
types de populations — Berbères, Arabes et Haratins — avec,
chacun, son propre système d’élites dont le point de
convergence se situe au niveau des contacts avec le Makhzen,
représenté par le gouverneur.
Mais à Ksar es Souk l’influence de Casablanca et de Marrakech
se fait nettement moins sentir. La division ethnique des
populations est plus marquée : les Berbères sont groupés dans
les deux cercles montagneux du Nord de la province, à Midelt
et Rich ; ils émigrent peu, et sont plus en relation avec Fès et
Meknès qu’avec le littoral atlantique, suivant un système de
rapports économiques et sociaux qui préfigure ce que nous
trouverons dans le Moyen-Atlas.
Dans les cercles de Ksar es Souk, Goulmina et Erfoud, les
rivalités entre les groupes et les villages voisins sont beaucoup
plus conformes au modèle saharien. Les ressources sont
maigres et chèrement disputées. L’émigration fournit une
soupape de sûreté, et ceux qui servent d’intermédiaires
deviennent des personnes influentes. Parmi ces intermédiaires,
les chorfas alaouites tiennent une place particulière. La
dynastie est originaire de cette province, et de nombreux
chorfas l’habitent encore, mettent à profit leur sainteté et leurs
relations pour recevoir les aumônes des autres groupes. Depuis
longtemps déjà, leurs descendants émigrent vers le littoral, font
des études traditionnelles ou modernes. L’indépendance leur a
assuré de nombreux postes administratifs, ce qui leur permet
d’aider et de protéger leurs parents restés au pays.
L’administration locale aurait donc tendance à les ménager
plus que les autres groupes, car elle craint les interventions de
Rabat, et même, le cas échéant, les recours à la famille royale.
Le cas de la circonscription de Ksar es Souk pourrait illustrer ce
type de situation. L’élu, Moulay Mustapha Alaoui, membre du
conseil national de l’Istiqlal, exerce la fonction de directeur des
Affaires politiques au Ministère des affaires de la Mauritanie et
du Sahara. Né à Ksar es Souk, il a fait des études à la Karaouyne.
Son nom, sa tendance politique et ses nombreux parents dans
la circonscription lui créent des conditions favorables. De plus,
il est activement aidé par son frère qui est président du tribunal
régional de Ksar es Souk. Sa candidature présente, ainsi, un
caractère quasi officiel.
Le FDIC lui oppose un commerçant, qui est aussi un chérif
local, mais sans influence ni rayonnement. Le seul candidat de
poids, en face de Moulay Mustapha Alaoui, serait Moulay
Hachem Oufkir, frère du général Oufkir, originaire de
Boudenib. Ancien élève du Collège d’Azrou, il a été commis
dans l’administration du protectorat. Secrétaire général de la
province de Ksar es Souk de 19S5 à 1957, il ne sera pas inquiété
après la révolte de Addi ou Bihi qui a marqué considérablement
le Nord de la province. Par la suite, son expérience
administrative sera mise au service de l’Entraide nationale
dirigée par une sœur du roi. Son influence s’exerce sur sa
commune d’origine[14] et sur quelques communes voisines,
mais n’équilibre pas celle du candidat Istiqlal, dominante à
Ksar es Souk.
A Erfoud, l’élu est un chérif politiquement neutre, chef de
bureau au Ministère des affaires islamiques. Il doit faire face à
neuf adversaires, petits fellahs, commerçants ou commis, sans
rayonnement extérieur, dont les candidatures semblent surtout
refléter la diversité ethnique de la circonscription.
Dans les cercles de montagne où la population berbère domine
largement, les élites locales n’ont plus la même origine. Les
deux élus FDIC de Midelt et de Ksar es Souk sont, l’un, un riche
exploitant forestier, gros propriétaire terrien, l’autre un
agriculteur fils de Addi ou Bihi, et président du Mouvement
populaire dans la province. L’Istiqlal présente son inspecteur
provincial, originaire de Figuig, mais installé dans la province
de longue date, et un fellah de moyenne importance. L’UNFP
présente, à Midelt, l’ancien caïd Barou, originaire du centre et
ancien chef de cercle, que Mhammedi envoya, en 1957, pour
l’opposer à Addi ou Bihi.
Le souvenir de la révolte de Addi ou Bihi plane encore sur cette
province. Son fils est élu au Parlement, et le cercle du Midelt,
envoie aussi l’un de ses partisans. L’administration locale ne
s’est guère implantée depuis lors. Les gouverneurs se sont
succédé dans une province qui souffrait des mêmes maux que
celle de Ouarzazate (nombreux fonctionnaires mutés pour
raisons disciplinaires).
L’Istiqlal est plus proche des chorfas, et peut mobiliser plus
facilement les cadres bureaucratiques traditionnels.
Ainsi, localement, les agents du Ministère de la justice, acquis à
l’Istiqlal, l’emportent en influence sur ceux de l’intérieur moins
bien implantés, comptant plusieurs Berbères en milieu arabe.
L’influence de l’UNFP est encore sensible dans les régions
berbères du Nord de la province, grâce à l’action de militants
comme l’ancien caïd Barou, ou au rôle des sections locales de
l’UMT dans les mines de plomb d’Aouli. L’UNFP ne dispose
plus, comme dans les provinces sahariennes voisines, du
soutien que lui assurait, à partir de Marrakech, son intégration
dans le réseau culturel traditionnel (qui fonctionne à Ksar es
Souk au profit quasi exclusif de l’Istiqlal).
D’autre part, les centres intermédiaires, qui exercent une
influence culturelle ou commerciale sur la province, servent de
relais à l’émigration ou conservent encore certaines fonctions
administratives, sont Meknès et, accessoirement, Fès.
L’implantation de l’Istiqlal, qui y est assurée de longue date,
peut facilement s’appuyer sur ces bases pour rayonner dans le
Tafilalt.s
Notes du chapitre
[1] Cette influence, qui bénéficie en 1963 à l’UNFP, semble
bien avoir autrefois favorisé la pacification. Voir la biographie
de Brahim dans R. Montagne, Naissance du prolétariat marocain,
op. cit., p. 228-231.
[2] Voir J. Waterbury, « Tribalism, trade and politics : the
transformation of the Swasa of Morocco », Communication au
congrès du MESA, Toronto, 14-15 novembre 1969 ; et North for
the trade, the life and times of a Berber merchant. Berkeley,
University of California Press, 1972.
[3] Cousin et beau-frère du roi, il songeait à l’origine à
présenter sa candidature à Marrakech. Hassan n lui a interdit
de donner suite à ce projet.
[4] Plus représentative de la bourgeoisie commerçante et
lettrée que le pacha Glaoui qui est en fait un Berbère issu d’une
tribu de la province de Ouarzazate.
[5] Voir D. Nouin, La population rurale du Maroc, Paris,
Presses universitaires de France 1970, tome 1, p. 116 et suiv.
[6] Qui bénéficiera quand même d’un certain soutien de
l’UMT.
[7] Voir J. Berque, Structures sociales du Haut-Atlas, Paris,
Presses universitaires de France, 1955.
[8] Voir D. Nouin, La population rurale du Maroc, op. cit., p.
142 et suiv., p. 165 et suiv.
[9] Voir R. Montagne, Naissance du prolétariat marocain, op.
cit., p. 56 et suiv.
[10] A la différence de l’administration de Marrakech et de
Ouarzazate, celle de cette province aura peu de poids sur le
plan politique. Depuis le tremblement de terre en 1960, le
gouverneur est accaparé par les tâches de reconstruction de la
ville. Lorsque le roi désignera, en 1962, Mekki Naciri comme
gouverneur de la province, pour préparer le référendum et les
élections, il sera trop tard pour obtenir un résultat politique et
combattre l’influence des partis. La véritable reprise en main de
la province sera effectuée en 1963-1964 par le colonel Belarbi
ancien gouverneur d’Al Hoceima après la révolte du Rif. Il
s’appuiera beaucoup sur les membres de la Camille Ma el Aïnin
qui occuperont les postes de caïds et de juges les régions
dominées auparavant par l’UNFP. Cette opération coïncidera
avec un rapprochement entre les commerçants soussis et le
pouvoir à Casablanca même.
[11] Voir J. Waterbury, North for the trade, op. cit.
[12] Ce candidat n’est pas sans attache avec la région : il a
épousé une fille de l’ancien caïd Dahman qui sera élu à
Goulimine.
[13] Voir G. Couvreur, « La vie pastorale dans le Haut-Atlas
central », Revue de géographie du Maroc, 13, 1968, p. 3-55.
[14] Où l’un de ses frères est khalifa depuis l’indépendance.
Chapitre VII. Le « Maroc utile »
Rassembler en un seul bloc d’étude des villes du littoral, des
provinces côtières riches, des cités traditionnelles comme Fès
ou Meknès, du Moyen-Atlas et de l’Oriental peut paraître
artificiel. Un autre regroupement le serait tout autant. Celui-ci
offre l’avantage de dégager certains caractères de similitude
qu’il faudra nuancer et préciser.
D’une part, on peut avancer l’hypothèse d’une certaine unité
culturelle de cette région, au moins par rapport aux deux zones
d’influence étudiées précédemment. Nous sommes maintenant
sans conteste dans l’aire d’influence de Fès qui domine, avec
des relais, le réseau de diffusion de la culture traditionnelle
dont nous avons déjà vu les liens avec le système des élites
locales et l’organisation des partis politiques. D’autre part, la
culture française y est largement implantée, de façon
homogène et ancienne. Elle influence la constitution d’élites
locales modernes en contact plus étroit avec les élites
nationales, sensibles aux facteurs idéologiques dans la
détermination de leurs orientations.
La colonisation et l’administration françaises ont aussi exercé,
dans ces régions, une action de transformation du milieu, qui,
sans être uniforme, est largement sensible au niveau des élites
locales. En réaction, l’action du mouvement nationaliste s’y est
exercée depuis sa création. Nous trouverons donc, dans ces
régions, le plus grand nombre d’exemples d’action militante
ancienne. La création du Mouvement nationaliste, son
développement dans la période qui suivit la fin de la deuxième
guerre mondiale, ou sa radicalisation de 1953 à 1955, ont
marqué la plupart des cadres locaux des divers partis, dont
l’engagement politique date de cette époque. On constate,
aussi, l’existence d’un groupe relativement important d’anciens
notables du protectorat qui, après une période d’éclipse dans
les premières années de l’indépendance, sont réintégrés dans le
jeu des élites locales, à partir de 1960.
La présence de l’administration locale est d’une importance
inégale. Elle ne peut pas utiliser avec la même intensité,
comme dans le Sud ou dans le Nord, les mécanismes de la
société traditionnelle. Elle se trouve déjà exposée à une plus
grande publicité et à des critiques plus vives. Les
administrations techniques ont leur propre réseau, leurs
objectifs propres, et elles s’efforcent le plus possible d’échapper
au contrôle de l’Intérieur. Les partis et les syndicats ont
également une implantation ancienne et solide. Ils gardent
souvent des complicités au sein de l’administration locale et
des administrations techniques qui rendent impossible le
contrôle exclusif du pouvoir. La diversification des circuits
économiques, la pénétration de l’économie de marché en
milieu rural favorisent aussi l’émancipation des élites locales
d’une tutelle administrative étroite. Les liens de dépendance
deviennent plus subtils ; ils sont multipliés et négociés, sans
qu’il soit possible d’établir longtemps des situations privilégiées
en dehors du contrôle réel des facteurs de production.
Nous trouvons tout d’abord dans les villes du littoral des
candidats qui appartiennent le plus souvent à l’élite politique
nationale. Ce n’est pas toujours le cas ; les élites urbaines sont
souvent une charnière entre élites locales et élites nationales.
Dans les campagnes, les élites locales sont marquées par la
tradition du bled Makhzen et par l’influence des partis
politiques. De nombreux candidats ont souvent exercé, à un
moment ou à un autre de leur carrière, les fonctions de caïds,
chioukh ou moqqademin, tout en ayant des rapports avec les
partis. Ces notables locaux sont nombreux. Les agriculteurs et
les éleveurs occupent une place dominante parmi les élites
locales, sans toutefois que la notoriété et l’influence soient en
relation directe avec le nombre d’hectares ou l’importance des
troupeaux. La participation à la Résistance, la culture
traditionnelle, les comportements personnels conformes aux
règles de la morale islamique jouent un rôle certain. Il est rare
aussi de voir un Berbère se présenter dans les circonscriptions
rurales habitées par les Arabes, et encore plus l’inverse ; mais le
phénomène est déjà plus courant dans les circonscriptions
urbaines, surtout pour l’UNFP.
La solidarité ethnique constitue un frein réel à la pénétration
du milieu rural par les élites urbaines. Elle jouera nettement
contre les candidats « parachutés » qui sont en majorité de
tendance FDIC. Les seuls « étrangers » qui arrivent à percer ce
barrage sont les commerçants des petites villes, ou certains
fonctionnaires locaux, comme les directeurs de secteur scolaire.
Les uns et les autres ont réussi à se créer des relations de
clientèle dans le monde rural, en mettant à profit leur situation
économique dominante ou leur pouvoir administratif. Mais ce
phénomène, qui joue pour les petites villes et pour des
candidats connus des électeurs, ne fonctionne plus lorsqu’il
s’agit de hauts fonctionnaires ou de gros commerçants, malgré
les pressions exercées ou les largesses dispensées. L’aisance
relative des campagnes limite aussi l’effet des phénomènes
d’émigration, dont on trouve cependant quelques traces dans
la zone d’influence de Kenitra, et dans la province de
Casablanca.
Les villes modernes du littoral
L’étude des villes modernes du littoral ne présente qu’un aspect
secondaire dans l’étude des élites locales marocaines : les
phénomènes politiques ont, avant tout, à Rabat-Salé,
Casablanca et Kenitra, une dimension nationale ; les choix des
partis et des électeurs s’opèrent en fonction de considérations
de politique générale ; les personnalités en cause sont plus
souvent des symboles politiques que des intermédiaires ; la
plupart des candidats appartiennent à l’élite politique
nationale ; les états-majors des partis les ont choisis avec soin,
et les leaders appuieront leur campagne par des réunions de
masse.
Ces villes sont aussi plus largement soumises à l’influence de la
radio et de la télévision[1] qui diffusent les discours du roi et des
ministres ainsi qu’une propagande indirecte en faveur du parti
gouvernemental, dans la ligne de la campagne en faveur du
« oui » au référendum. En revanche, l’administration dispose
de moyens d’influence plus limités que dans les campagnes, et
plus délicats à manier. Les distributions de denrées, par
l’intermédiaire des sociétés musulmanes de bienfaisance ou de
l’Entraide nationale, les pressions diverses sur les professions
soumises à l’autorisation (cafés, chauffeurs de taxi) ne sont pas
négligeables, mais elles ne touchent pas au même degré tous les
éléments de la population. L’anonymat des grandes villes,
l’indépendance économique, les contacts entre milieux
différents, permettent la diffusion des idées et des doctrines par
des voies qui échappent au contrôle du pouvoir.
En 1960, la carte politique des villes du littoral était déjà assez
nettement fixée. Le référendum, le passage de l’Istiqlal dans
l’opposition et la création du FDIC l’ont modifiée, sans la
bouleverser. Plus encore que dans les campagnes, la surprise
des dirigeants a été vive et amère au lendemain des élections
législatives.
En passant en revue les candidats qui se présentent dans les
grandes villes du littoral, nous étudierons avec une plus grande
attention ceux qui peuvent faire figure d’intermédiaires locaux
en milieu urbain. Les dirigeants nationaux et certains
technocrates tentés par la politique ne peuvent pas jouer ce
rôle. D’autres cependant appartiennent au groupe des
dirigeants locaux des partis ou des syndicats. Militants de
longue date, ils sont présents à tous les relais d’influence des
associations, sociétés sportives ou de bienfaisance. Il semblerait
— mais ce n’est pas une règle générale — que les partis aient
tendance à présenter des candidats ayant une influence locale
dans les quartiers où l’on rencontre des noyaux de population
urbaine cohérents, d’implantation relativement ancienne. A
l’opposé, les agglomérations récemment constituées sont plutôt
sollicitées par des candidats ayant une audience nationale.
Salé et Kenitra pourraient constituer des exemples type de ces
situations. Kenitra, où la commune urbaine constitue à elle
seule une circonscription, est un cas particulièrement
intéressant qui rappelle, à certains égards, la situation des
quartiers de bidonvilles ou de nouvelle médina de Casablanca
ou de Rabat. La ville s’est organisée depuis 1912, sans traditions
antérieures[2], rassemblant une population provenant du Rharb,
du pré-Rif, des Zaers et des Zemmours[3], mais aussi des régions
situées entre Casablanca et l’Atlas, et même du Souss. Sa
croissance industrielle semble arrêtée depuis l’indépendance,
mais cette ville conserve, en 1963, un niveau d’activité
enviable. Elle s’est donnée, en 1960, un conseil municipal
UNFP, et la section locale de l’UMT y joue un rôle important,
quelquefois en conflit avec la direction du syndicat à
Casablanca.
Le FDIC désigne d’abord, comme candidat, un professeur
d’arabe au lycée de Kenitra et à l’Ecole militaire locale de
formation arabe et espagnole, originaire du Nord. Cet
enseignant est patronné par le PDI, et semble, au départ, avoir
l’appui discret des autorités locales. Mais bientôt le Mouvement
populaire investit, au nom du FDIC, un membre du cabinet de
Ahardane, Moulay Ali Zerhouni, ancien lieutenant de l’armée
française en Indochine, nommé caïd à Tazenakht après
l’indépendance, poste qu’il dut quitter après des incidents
violents avec l’Armée de libération. Zerhouni est, au départ, un
inconnu, même s’il jouit de quelque popularité dans les
milieux de la fonction publique locale, et il ne peut compter
que sur le soutien des Anciens combattants dont il est le
secrétaire général. Mais ces derniers ne sont pas très nombreux
dans la région de Kenitra, et leur action ne saurait triompher de
la candidature de Abderahim Bouabid, ancien ministre de
l’Economie nationale et membre du secrétariat politique de
l’UNFP. L’Istiqlal ne présente aucun candidat contre Bouabid.
Bouabid remporte le siège avec près des deux tiers des suffrages
(bien que sa seule attache avec Kenitra soit d’y avoir été
emprisonné sous le protectorat). Son élection, qui peut être être
comparée à celle de Mansour Nejjaï dans le Rharb, dépasse tous
les résultats obtenus par les autres candidats UNFP, à Rabat ou
à Casablanca.
La situation de Salé est tout à fait différente. Prolongement de
Rabat à bien des égards, l’ancienne cité construite par les
Andalous réfugiés au XVIIe siècle garde, cependant, sa
personnalité[4]. L’Istiqlal et le FDIC y présentent deux notables
de la ville, qui se sont illustrés par leur engagement
nationaliste : Boubker Kadiri et Haj Ahmed Maaninou. Ils sont
tous deux de formation essentiellement arabe, dirigent une
école libre, et se connaissent de longue date pour avoir milité
ensemble dans les années trente. Mais alors que Boubker Kadiri
reste à Salé et adhère à l’Istiqlal dès sa fondation, Maaninou
s’exile en zone Nord et à Tanger où il se rallie au PDI. Après
plusieurs exils ou emprisonnements, (il était rentré en zone
Sud en 1949), il siège, en 1956, à l’Assemblée consultative. Il
est depuis lors secrétaire général adjoint du PDI. Boubker Kadiri
sera aussi emprisonné à la fin du protectorat. Resté un peu en
dehors des courants qui ont agité le parti avant et après la
scission de 1959, il exerce les fonctions d’inspecteur régional et
de membre du conseil national. Le chérif Kettani vient ajouter
sa candidature à celle de ces deux notables.
En fait, leur rivalité sera arbitrée par un jeune avocat, Moulay
Mehdi Alaoui, origine de Salé et membre du conseil national de
l’UNFP. Le prestige religieux de sa famille rassure les
traditionalistes, alors que son éducation moderne et sa
collaboration avec Mehdi Ben Barka lui assure la sympathie
agissante des jeunes appartenant à la classe moyenne qui, s’ils
habitent Salé, sont de plus en plus nombreux à travailler à
Rabat. Sans la rivalité Kadiri-Maaninou[5], Alaoui avait très peu
de chances. Son élection fut une surprise, d’autant plus qu’il
n’avait fiait qu’une propagande locale limitée.
A Rabat, les élections sont nettement politisées, pour tous les
partis. Le seul à avoir une origine locale ancienne est Ahmed
Bargach, candidat FDIC de la première circonscription qui
correspond à l’ancienne médina. Bargach est né dans une
vieille famille de la ville apparentée à plusieurs ministres et
hauts fonctionnaires. Secrétaire général du Ministère de
l’Agriculture, il passe pour un fidèle du Palais, ami de longue
date de Guedira au sein du Parti des indépendants libéraux.
Son élection fut acquise de justesse grâce aux voix des
serviteurs du roi. Les autres candidats présentés par le FDIC
sont un jeune fonctionnaire membre du cabinet du Dr Khatib,
pendant longtemps membre au Cabinet royal, et un ancien
cadre de l’UMT, qui s’oppose à Ben Barka. Ce dernier
remportera facilement le siège de la troisième circonscription,
correspondant à un quartier de bidonville ancien.
Les autres candidats UNFP sont Mohamed Lahbabi, originaire
de Fès, professeur à la Faculté de droit et ancien directeur du
cabinet de Bouabid. Il l’emportera dans la deuxième
circonscription, où il n’était guère connu. De même, le
candidat UNFP, qui fut très près de l’emporter sur Bargach dans
la première circonscription, Brahim Nadifi, ne possède guère
d’attaches locales. Il est vrai qu’il occupe, depuis 1962, les
fonctions de secrétaire général de la Chambre de commerce
locale, et peut donc compter sur l’aide des nombreux épiciers
soussis et des chauffeurs de taxi. Il était auparavant sous-
directeur des Affaires politiques au Ministère de l’intérieur
jusqu’à sa révocation, en 1962, pour fait de grève. L’Istiqlal, qui
n’engage aucun candidat contre Ben Barka, présente, dans les
autres circonscriptions, un journaliste de Al Alam, Abdelkrim
Fellous, et un jeune haut fonctionnaire, Abdelhafid Kadiri.
A vrai dire, le débat se confond à Rabat avec l’enjeu national
du scrutin. L’origine des candidats ne compte pratiquement
pas, sauf pour Bargach. Il en est de même à Casablanca, à
quelques nuances près. L’exception la plus marquante se situe
dans la première circonscription, où l’on trouve une minorité
importante d’Israélites. La FDIC emportera le siège en faisant
élire le président de la communauté israélite de Casablanca,
Meyer Obadia, un commerçant licencié d’arabe. L’UNFP
présentera un avocat israélite,.Meyer Toledano, rapporteur
général du budget au conseil municipal de Casablanca. Le
candidat Istiqlal est un musulman, ancien résistant, nommé
khalifa d’arrondissement dans ce secteur après l’indépendance.
Le dernier candidat de la première circonscription n’est autre
que Ali Yata, secrétaire général du Parti communiste marocain
(interdit en principe depuis 1960).
Dans les autres circonscriptions, les origines locales des
candidats ne jouent qu’un rôle limité. L’UNFP présente des
hommes de l’appareil du parti, pour la plupart déjà membres
du conseil municipal de Casablanca, comme son président,
Maati Bouabid. La plupart sont membres du conseil national et
même du bureau politique du parti. Plusieurs ont appartenu à
la Résistance. En revanche, leurs attaches avec l’UMT semblent
plus minces, bien que le syndicat domine l’appareil politique
du parti, en ville. Ils sont également peu nombreux à
représenter les commerçants soussis qui jouent un rôle
important dans l’infrastructure du parti à Casablanca.
L’Istiqlal présente aussi en majorité des membres de son
appareil local, conduits par Hachemi Filali. Presque tous sont
originaires de Fès.
Les candidats FDIC, conduits par Ahmed Reda Guedira sont
encore plus disparates. Avec Guedira, se présentent un ministre
en exercice, Driss Slaoui, et deux anciens ministres, Thami
Ouezzanni et le Dr Ben Bouchaïb. Slaoui est surtout connu à
Casablanca pour y avoir exercé les fonctions de contrôleur de
la sûreté après l’indépendance. Le Dr Ben Bouchaïb est
président du conseil de l’ordre des médecins. Tous seront
battus par des candidats UNFP, sauf Guedira qui sera élu dans
une circonscription comprenant le bidonville de Ben Msick. Le
FDIC présente aussi un ancien chef de l’Armée de libération,
Laatabi, patronné par le Mouvement populaire, et une femme
diplomate, Halima Ouarzazi, dont lè père (Embarek Jdidi) et le
mari sont également candidats FDIC, le premier à Tétouan,
l’autre à Marrakech.
La lutte électorale s’inscrit à Casablanca dans un système de
participation politique plus vaste, où les syndicats et
associations diverses jouent, surtout pour la gauche, un rôle
dominant[6]. Les cadres de l’UMT, les commerçants soussis sont,
là, les véritables intermédiaires de la gauche. Mais le conseil
municipal et la Chambre de commerce jouent, à cet égard, un
rôle plus important que l’élection au Parlement. Le véritable
problème viendra des dissensions entre l’UNFP et ces
organisations de base qui finiront, sous des formes diverses, par
rechercher le contact avec le pouvoir. Mais, en mai 1963, le
réflexe de lutte et de solidarité idéologique l’emporte, sans que
le parti ait pratiquement besoin de faire campagne pous ses
candidats.
L’Istiqlal conserve, comme le souligne André Adam, des
positions historiques qui lui garantissent la fidélité d’adhérents
stables, mobilisés depuis le temps de la lutte contre le
protectorat. Cette fidélité a joué aux Carrières centrales et dans
les quartiers habités par une petite bourgeoisie encore attachée
à l’aspect islamique de ses traditions.
Le FDIC ne dispose pas à Casablanca d’une clientèle qui lui
serait transmise par les anciens partis. Le Mouvement populaire
est inexistant, et les anciens membres du PDI ont plutôt rallié
l’UNFP. Reste le soutien administratif que le général Driss Ben
Aomar, gouverneur de la préfecture, ne ménagera pas à Guedira
avec qui il entretient des rapports amicaux. Ce soutien ne peut
pas jouer sans discernement, étant donné l’esprit
d’indépendance de la population urbaine. Le gouverneur de
Casablanca orientera donc la candidature du directeur général
du Cabinet royal vers une circonscription que ses chefs de
quartiers tiennent plus en main que d’autres secteurs. Ben
Msick avait déjà prouvé sa fidélité monarchique en votant
Istiqlal en 1960, et en donnant une très forte majorité au
« oui » lors du référendum du 7 décembre 1962.
Le gouvernement s’efforcera de contrer l’influence du parti en
milieu urbain, en reprenant une tactique déjà esquissée par le
protectorat dans les années cinquante[7] : dissocier, à l’intérieur
du parti de gauche, le prolétariat de la bourgeoisie et de
l’intelligentsia. Pour cela, on emploiera des moyens de pression
économiques, auxquels les syndicats peuvent difficilement
cilement résister dans un contexte de sous-emploi. Déjà, en
1962, l’UMT a refusé de soutenir les grèves politiques décidées
par l’UNFP. L’action de Guedira consistera à démontrer aux
représentants de l’UMT (souvent des fonctionnaires détachés
que l’État continue à payer) que la garantie d’emploi pour les
syndiqués ne vaut que si le syndicat observe une neutralité
politique, et, donc, se dissocie de l’UNFP. Le maintien des
avantages consentis par l’État est à ce prix (fonctionnaires
détachés, locaux gratuits, etc.).
Dans un deuxième temps, le pouvoir espère bien faire jouer le
ressort de démocratie représentative pour tenter le syndicat,
l’engager à avoir ses propres représentants dans les assemblées
locales et au Parlement, en particulier à la Chambre des
conseillers où les salariés doivent élire des représentants. Il
semble bien que certains dirigeants aient été tentés par cette
tactique qui aurait entraîné une coupure totale avec l’UNFP et,
par voie de conséquence, un pacte de non-agression avec le
FDIC. Mais l’UMT ne pouvait pas aller aussi loin en 1963. Elle
pouvait tout au plus interdire à ses militants et à ses
sympathisants de se présenter aux élections[8], puis accepter à
contrecœur de recommander le soutien à l’UNFP, une semaine
avant le scrutin, tout en épaulant, dans certains cas et avec
prudence, quelques candidats FDIC, comme Guedira. Dans
l’ensemble, les élites syndicales resteront, cependant, en dehors
de l’affrontement.
Avant d’en terminer avec les élites des villes du littoral, il faut
rappeler comment Casablanca a influencé le comportement
électoral de vastes régions de départ de l’émigration : les zones
proches des Chaouia et Doukkala ou, plus encore, les régions
montagneuses et arides des provinces du Sud. Ces zones de
départ entretiennent avec Casablanca des rapports complexes,
où se mêlent les idées, les facteurs économiques, les modèles de
comportement — modernisation dans un sens, valeurs
religieuses dans l’autre. Certains individus qui, par leur vie
professionnelle, appartiennent au monde casablancais —
commerçants chleuh, propriétaires de cars, chauffeurs de taxi
— jouent, en fait, le rôle de notables ruraux dans les zones de
départ de l’émigration, par l’influence qu’ils peuvent exercer
sur les candidats au départ et sur leurs familles. Des réseaux de
clientèle et d’obligations se créent ainsi, dont la fidélité
politique n’est qu’une conséquence indirecte.
Les provinces du littoral
Le poids de ces provinces, dans le système politique marocain,
provient d’abord de sa population qui représente, en 1960, plus
du cinquième de la population totale. Son importance tient
aussi aux relations anciennes et nombreuses que ces régions
entretiennent avec les villes modernes du cordon littoral, qui
les entraînent dans leur évolution. Si la colonisation a peu
transformé les régions de collines et les plateaux intérieurs qui
restent vouées à l’élevage, elle a profondément bouleversé le
système ancien dans les grandes plaines, et brisé la structure
tribale. Les gros propriétaires marocains ont entrepris un effort
de modernisation plus marqué que dans les autres régions. Un
clivage entre groupes sociaux apparaît dans les campagnes,
mais il ne supprime pas pour autant les oppositions ethniques
et tribales[9]. Les Zemmours forment un groupe berbère
structuré et solidaire, qui sait s’opposer à ses voisins et réagir
collectivement en face de l’administration. Le poids du
Makhzen y est parfois plus sensible qu’ailleurs. La tutelle des
terres collectives et guich, exercée par les caïds et le Ministère
de l’intérieur, tend à maintenir le statu quo en face d’un
nombre croissant d’attributaires. La modernisation des zones
irriguées et des grandes plaines céréalières modifie
profondément le système d’élevage, et limite la vaine pâture.
Les plantations d’arbres, surveillées par les Eaux et forêts,
créent également de nombreux conflits.
L’encadrement politique du monde rural repose encore sur le
système des élites locales, mais des réseaux parallèles et
concurrents ont parfois tendance à s’installer, qu’il s’agisse des
partis ou des syndicats. Le réseau de commandement de
l’intérieur est le plus structuré et le meilleur. Il doit souvent
négocier ses interventions et obtenir la collaboration des
populations. Il tire son influence, plus d’un système de services
rendus que de son prestige propre.
Les élites locales de ces régions se différencient de celles que
nous avons rencontrées ailleurs. Les élites traditionnelles n’ont
pas toujours été éliminées. Elles ont souvent su s’adapter et à
l’évolution politique du pays, en s’associant aux luttes
nationales, et à la modernisation de l’économie rurale. Elles ne
présentent pas pour autant un bloc monolithique. On trouve
des représentants des vieilles familles Makhzen de la région,
aussi bien parmi les élus de l’Istiqlal que parmi ceux de l’UNFP
ou du FDIC. Leurs membres ont souvent acquis une formation
moderne, et exercent une influence dans l’administration ou le
gouvernement, qui leur permet d’aider leurs proches. A côté
d’eux, on voit aussi s’établir l’influence des représentants des
partis, généralement de culture moderne. La naissance dans la
circonscription, l’influence administrative jouent un rôle
certain.
Les gouverneurs et les caïds s’efforcent d’aider les candidats
gouvernementaux, comme partout. Mais leur influence sur une
société rurale éclatée et plus indépendante se rapproche plus de
l’action préfectorale classique que du commandement
traditionnel. Nombreux sont les candidats FDIC battus qui
accuseront l’administration de négligence, alors que l’erreur
principale des agents d’autorité a été souvent d’avoir, par leur
attitude timorée ou par la surestimation de leur pouvoir, laissé
se présenter des candidats qui n’avaient aucune chance. Les
partis, de leur côté, ont conservé dans ces régions une structure
solide héritée de la lutte contre le protectorat. Leur action tire
profit des conflits nombreux et mal résolus qu’entraînent la
modernisation et le départ des colons.
Rabat
Mise à part la circonscription de Kenitra, étudiée avec les villes
modernes du littoral, les treize circonscriptions rurales de la
province de Rabat présentent certains caractères originaux. La
quasi-totalité des candidats possèdent des attaches solides avec
leur circonscription. Lorsqu’il en est autrement, l’échec est
inévitable. Dans l’ensemble, les candidats ayant reçu une
éducation moderne l’emportent. La proximité de la capitale
donne aussi une importance particulière à l’investiture des
partis. Les candidats locaux doivent souvent s’effacer devant
ceux qui bénéficient de l’investiture officielle d’un parti. Les
circonscriptions de Rabat-banlieue et des Zaers offrent certains
caractères particuliers comparables[10]. Leur population,
d’origine arabe et installée de longue date, est bien contrôlée
par les caïds et chefs de cercle qui en ont la charge. Ceux-ci
appuient les candidats FDIC. Mais alors que le candidat des
Zaers l’emportera de justesse, celui de Rabat-banlieue sera battu
par un candidat Istiqlal, citadin, sans attache avec la
circonscription. Cet ancien élève de la Karaouyne est membre
du conseil national de son parti. Fonctionnaire au Ministère
des affaires islamiques, il a été diplomate en Arabie séoudite, et,
auparavant, inspecteur de son parti au lendemain de
l’indépendance. Son passé nationaliste ancien (il a été plusieurs
fois emprisonné du temps du protectorat) et l’aide des militants
lui permettront de l’emporter sur un candidat FDIC un peu
falot, qui avait plutôt orienté sa campagne contre son
adversaire UNFP. Petit employé des Eaux et forêts, après avoir
été cheikh des Oudaïas, au lendemain de l’indépendance, le
candidat FDIC a été élu, en 1960, vice-président du conseil
communal de Temara. Le Mouvement populaire laissera un
fonctionnaire du Ministère de la santé se présenter contre lui.
Le candidat redoutable semblait être le directeur d’école de
Skhirat, de tendance UNFP, originaire de la région où il exerçait
depuis longtemps. En fait, ses performances seront loin d’égaler
celles du candidat Istiqlal et même celles du candidat FDIC qui
semble avoir souffert de n’être ni riche ni influent.
En revanche, l’élu FDIC des Zaers, qui bénéficie aussi d’un
soutien actif du chef de cercle et de ses caïds, est un jeune
agriculteur moderne (300 hectares) descendant d’une famille
de caïds de la circonscription. Son adversaire le plus proche, le
candidat Istiqlal, est presque aussi riche que lui et son passé
familial comparable. Le soutien administratif semble avoir été
déterminant.
En dehors des mérites respectifs des candidats, leur succès ou
leur échec peut s’expliquer par la situation sociale et politique
de leur circonscription. A Rabat-banlieue, l’électorat est
composé en majorité de petits paysans maraîchers, installés
dans les communes du littoral, et d’habitants des centres en
voie d’urbanisation, le long de la route côtière. Comme ils sont
en contact direct avec Rabat pour la vente de leur production
ou leur approvisionnement, ces ruraux ne considèrent plus
l’autorité administrative comme un intermédiaire
indispensable. Les commerçants des petits centres sont encore
plus indépendants des caïds. L’administration ne retrouve
quelque influence que dans les communes du plateau intérieur,
où l’on poursuit une forme d’agriculture traditionnelle. Ces
communes donnent la majorité au candidat Istiqlal, mais
apportent un plus grand pourcentage de suffrages au candidat
FDIC. Ce dernier n’obtient la majorité absolue qu’à Temara,
centre dont il est président et ancien cheikh.
Dans la circonscription des Zaers, on observe un phénomène
comparable. Le candidat Istiqlal récolte près de la moitié de ses
suffrages dans la seule commune de Romani, petit centre
administratif et commercial, chef-lieu du cercle. Le FDIC ne
l’emporte que grâce aux votes des communes rurales de la
périphérie où l’administration retrouve, parmi les gros
agriculteurs-éleveurs, des interlocuteurs qui lui font confiance
et ont besoin d’elle pour faciliter leur modernisation. D’autre
part, le système tribal et la société paysanne sont encore assez
structurés pour que les décisions des gros agriculteurs soient
suivies par leurs ouvriers et leurs bergers, et même par les petits
agriculteurs qui font partie de leur clientèle. Les solidarités
d’intérêts ne forment pas un bloc massif. Les oppositions de
partis et de clientèle recouvrent souvent d’anciennes rivalités
de clan. Comme des observateurs l’ont signalé, certains
électeurs influents auraient estimé que la famille du candidat
FDIC ayant déjà en son sein un caïd, un khalifa et un président
de commune rurale, il aurait été prudent d’attribuer la
représentation à la Chambre au candidat Istiqlal
honorablement connu et issu d’un groupe familial rival du
premier.
Les deux circonscriptions de Khemisset et de Tiflet partagent le
cercle de Khemisset qui recouvre le territoire de la
confédération berbère des Zemmours, dont les liens de
solidarité sont encore très marqués. Tous les candidats sont
berbères et nés dans le cercle, la plupart y résident encore,
notamment les élus FDIC qui sont tous deux enseignants : l’un
est directeur du collège de Khemisset, l’autre surveillant
général. Le pays est occupé par des agriculteurs-éleveurs venus
récemment du Sud, sédentarisés dans un habitat dispersé
d’apparence modeste[11]. Mise à part la bordure de la route de
Rabat à Meknès, qui compte de nombreuses fermes viticoles, le
pays a été peu touché par la colonisation. On y trouve
également assez peu de grosses fermes marocaines. Paysans
moyens, généralement propriétaires, les Zemmours répartissent
assez harmonieusement leurs activités entre l’agriculture et
l’élevage ; ils possèdent, en outre, quelques jardins et vergers en
fond d’oued. Ils souffrent moins que dans d’autres régions du
Maroc de l’écart entre la population et les ressources. Leur taux
de scolarisation est depuis longtemps supérieur à celui des
campagnes voisines. Ils ont fourni un nombre important
d’élèves au Collège d’Azrou. La plupart des caïds, des juges et
autres représentants du pouvoir nommés chez eux ont suivi
cette filière. La coupure entre population, administrateurs et
élus, que l’on constate ailleurs, n’existe pas ici. Tel est le cadre
dans lequel se situe la compétition entre les élites locales en
1963.
Le Mouvement populaire est très fortement implanté dès sa
constitution. Un de ses dirigeants, Majhoubi Ahardane, est
originaire de Oulmès, commune située dans le Sud du cercle.
Les deux candidats qu’il présente au nom du FDIC ne sont pas
d’anciens caïds, mais des enseignants locaux d’origine
modeste. Ce choix ne va pas sans mécontenter la clientèle
traditionnelle de son parti. Le président de la commune rurale
de Sfassif, gros propriétaire moderne (200 hectares), originaire
d’une famille de caïds, se présente avec l’appui des gros
agriculteurs de la région. Un ancien élève de la Karaouyne,
commerçant à Meknès et propriétaire d’une ferme dans la
région de Khemisset, se présente, aussi en se réclamant du
Mouvement populaire auquel il aurait adhéré six mois avant
les élections. Nommé chef de cercle à Ksar es Souk, puis à
Ksiba, après l’indépendance, il avait été révoqué, en 1960, pour
mauvaise gestion. La publication de la Constitution lui avait
redonné l’espoir de faire une nouvelle carrière comme élu.
Mais, contrairement à son habitude, le parti désavoue
fortement et officiellement ces candidats. Le directeur de
cabinet de Ahardane, alors ministre de la Défense nationale,
vient faire campagne pour les candidats officiels du FDIC, et
tente de mobiliser en leur faveur et l’administration et les
notables.
L’Istiqlal, qui était bien implanté dans les Zemmours du temps
du protectorat, a souffert de la scission de 1959. La plupart de
ses cadres berbères, anciens élèves des Collèges d’Azrou et de
Khemisset, se sentaient mal à l’aise dans l’appareil du parti
qu’ils disaient dominé par les Fassis. En revanche, ils étaient en
meilleurs termes avec Ben Barka et Abdallah Ibrahim. L
idéologie socialisante et unitaire de l’UNFP leur permettait
mieux de résister aux tentations particularistes de leur groupe
d’origine. L’Istiqlal n’a donc conservé dans les Zemmours
qu’une implantation réduite. Son secrétaire local est un
directeur d’école libre de Khemisset. Il regroupe quelques
commerçants, des élus locaux et quelques anciens chioukh,
nommés, grâce à ce parti, au lendemain de l’indépendance. Ses
deux candidats sont, l’un, chef de bureau au Ministère de
l’éducation nationale, l’autre commerçant à Tiflet. Le premier,
ancien élève du Collège d’Azrou exerçait, du temps du
protectorat, les fonctions d’instituteur à l’école libre Guessous
de Rabat, puis à Demnate et à Khemisset dans l’enseignement
public. Nommé chef de cercle à Romani après l’indépendance,
il est révoqué et remis à la disposition de l’Education nationale.
Son collègue de Tiflet est un ancien mokhazeni, militant de
longue date de l’Istiqlal.
L’UNFP, qui bénéficie d’une sympathie diffuse parmi les agents
de l’administration, y compris ceux de l’intérieur, présente
deux candidats de poids. Le plus connu est Hassan Zemmouri,
alors secrétaire général de la Chambre de commerce de
Casablanca. Zemmouri avait joué un rôle important, nous
l’avons vu, dans la mise en place de la réforme communale,
lorsqu’il était sous-secrétaire d’État à l’Intérieur. De nombreux
agents d’autorité du Cercle, caïds ou chioukh, lui doivent leur
nomination et l’appuient discrètement — ou pour le moins ne
s’opposent pas ouvertement à sa candidature. Il peut même
compter sur l’aide de quelques colons français auxquels il a pu
rendre service lorsqu’il était ministre de l’Agriculture. Mais son
principal soutien provient des anciens élèves des Collèges
d’Azrou et de Khemisset, soit répartis dans les diverses
administrations (Intérieur, Justice, PTT), soit travaillant dans
des centres de travaux, soit instituteurs, transporteurs ruraux et
commerçants. Abdelhamid Zemmouri, ancien gouverneur de la
province de Rabat, fait aussi campagne en sa faveur. Le second
candidat UNFP est un ancien résistant qui fut nommé khalifa
de Khemisset après l’indépendance, et révoqué, en 1960, à
cause de son hostilité au Mouvement populaire. Il est, depuis
lors, propriétaire d’un restaurant à Meknès, et préside
l’importante Association hippique des Zemmours.
Le système politique du Rharb est nettement plus complexe
que celui des Zemmours. Il reflète la diversité d’un terroir qui a
évolué suivant des modalités différentes. Les données
naturelles autant que l’histoire ont contribué à faire du Rharb
un terrain peu homogène. Sur le plan politique, l’implantation
des partis y est ancienne et assurée. Mais on retrouve, sous
diverses formes, des lignées qui caractérisent de longue date les
trois groupes tribaux qui se partagent la région :
– les Benni Ahsen, rivaux historiques des Zemmours pour le
contrôle des pâturages de la forêt de Mamora ;
– les Beni Malek et les Sefiane, tribus étroitement imbriquées,
installées sur la rive droite du Sebou ;
– les Cherarda, tribu guich d’origine ethnique diverse,
provenant du Haouz et installée au XIXe siècle autour de
Sidi Kacem.
D’autre part, si la zone côtière pauvre et la région du Haut-
Rharb (entre Ouezzane et Had Kourt), faite de collines
argileuses difficiles à cultiver, n’ont guère été touchées par la
colonisation, la région centrale, autrefois peu peuplée, a été
colonisée par les grands domaines européens (riz, orangers,
céréales, vignobles, lin)[12].
L’Istiqlal et l’UNFP sont, à des titres divers, bien implantés dans
le Rharb. Le FDIC n’y possède pas, comme dans les Zemmours,
une infrastructure héritée du Mouvement populaire. Il
commettra, en outre, de nombreuses erreurs tactiques.
L’Istiqlal est dominé dans le Rharb par les descendants des
grandes familles Makhzen, qui ont su le plus souvent s’associer
de longue date au mouvement nationaliste et moderniser leurs
exploitations[13]. Le plus connu est Ahmed Mansour Nejjaï,
ingénieur agronome exploitant plus de 2000 hectares. Ancien
caïd du protectorat, descendant d’une vieille famille Makhzen,
il est révoqué, en 1947, pour s’être associé au discours
prononcé par le sultan à Tanger. Mis en résidence surveillée par
le protectorat, il sera nommé ministre de l’Agriculture par
Mohamed V, au lendemain de l’indépendance. Un de ses frères
est caïd des Sefiane de l’Ouest. Son élection à Souk el Arba sera
triomphale. En revanche, un de ses parents agriculteur et
ancien caïd, président depuis 1960 de la commune de Souk el
Tleta, se fait battre dans la circonscription de Sidi Yahia du
Rharb, où la majorité de la population appartient à la tribu
Menasra, étrangère à son groupement ethnique d’origine.
A Mechra Bel Ksiri, l’Istiqlal est aussi représenté par un
descendant des familles caïdales des Beni Ahsen, Hadj Ahmed
Gueddari. Mais, à la différence de Mansour Nejjaï, cet
agriculteur propriétaire de 200 hectares ne s’est pas signalé par
son ardeur nationaliste. Son ralliement à l’Istiqlal est tardif et
n’efface pas le souvenir de sa collaboration avec le pacha
Glaoui. Il est élu président du conseil communal de Dar
Geddari, en 1960 ; on dit aussi qu’il est moqqadem de la
confrérie religieuse de Sidi Ahmed Tijani. A Ouezzane et à
Teroual, on retrouverait comme candidats Istiqlal le même type
de notables traditionnels, appartenant cette fois au groupe des
chorfa Ouezzani.
En revanche, à Sidi Kacem et à Sidi Slimane, l’Istiqlal est
représenté par des enseignants. L’un d’eux, Abdelaziz El Kohen,
de culture moderne, est directeur du collège de Sidi Kacem ; il
appartient au conseil national de l’Istiqlal ; il a un passé
nationaliste éclatant ; il sera facilement élu. Mais à Sidi
Slimane, son candidat, issu de la Karaouyne, et directeur
d’école libre, sera battu. Il est pourtant président du conseil
communal et possède un passé nationaliste. Son vainqueur est
un jeune enseignant UNFP, fils du caïd des Beni Ahsen, qui
bénéficie, dans cette circonscription, d’un prestige traditionnel
comparable à celui de Nejjaï à Souk el Arba. L’UNFP présentera
aussi des enseignents à Had Kourt et à Sidi Kacem, mais sans
succès. A Souk el Arba, c’est un libraire originaire du Souss qui
s’oppose à Mansour Nejjaï. Ce dernier le contrera
publiquement avec une certaine pointe de particularisme
tribal. En revanche, un jeune avocat de Rabat, avec pour seul
appui son investiture officielle, se présente à Sidi Yahya du
Rharb et fait le plein des voix UNFP. Le FDIC ne compte qu’un
élu, gros agriculteur, président de la commune d’Had Kourt. Ce
parti commet l’erreur de présenter des candidats parachutés qui
ne comptent que sur l’appui des agents d’autorité, et ne font
guère d’efforts pour entrer en contact avec la population.
Ailleurs, il présente des agriculteurs qui sont loin d’avoir
l’audience de leurs rivaux de l’Istiqlal. A vrai dire, sauf à Had
Kourt, le FDIC pèse peu dans la compétition électorale qui,
dans le Rharb, se limite la plupart du temps à un duel Istiqlal –
UNFP.
La situation n’est pas tout à fait comparable dans les collines
prérifaines. Milieu naturel assez semblable à celui du Haut-
Rharb, les collines céréalières plantées d’oliviers et autres arbres
fruitiers de la région d’Ouezzane et de Teroual s’en
différencient cependant par la structure de la propriété et des
réseaux d’influence traditionnels. Les chorfa d’Ouezzane[14] ont
marqué le pays où ils jouent un rôle identique à celui des
grandes familles caïdalës du Rharb. Ils ne forment pas un bloc
politique uni, mais leur influence s’exerce à travers les partis.
En fait, le jeu politique, qui était plutôt triangulaire dans les
autres circonscriptions de la province de Rabat, se réduit, là, à
une confrontation FDIC-Istiqlal. Les deux sièges sont emportés
par l’Istiqlal. Ce parti avait présenté, à Ouezzane, un chérif
ingénieur agricole qui, après avoir été quelque temps chef de
cabinet du ministre de l’Agriculture, après l’indépendance,
s’était retiré à Ouezzane pour exploiter les terres de sa famille
(700 hectares). En 1960, il est élu président du conseil
municipal d’Ouezzane. Son affiliation à l’Istiqlal est ancienne
mais reste distante : elle ne l’avait pas empêché d’entretenir des
relations correctes avec l’administration du protectorat. Le
second élu de l’Istiqlal est un agriculteur-commerçant, pilier de
l’appareil local du parti. Il cumule les fonctions de secrétaire
local du PI, de secrétaire de l’UMCIA et de président de l’UMA,
de secrétaire de l’Association sportive et aussi de premier vice-
président du conseil municipal d’Ouezzane. Son origine rurale
et sa formation traditionnelle (Karaouyne) l’opposent au
président du conseil municipal qui apparaît comme un rival au
sein du parti.
Le FDIC présente, à Ouezzane, un de ses leaders nationaux,
Mohamed Hassan Ouazzani, fondateur du PDC. C’est un leader
nationaliste qui a commencé sa carrière politique dans l’entre-
deux-guerres. Il réside habituellement à Fès ; il se fera donc
battre par son cousin, plus connu dans la circonscription. Il
aura été gêné par deux candidats de sa tendance, un gros
agriculteur, président du conseil communal d’Arbaoua, et un
professeur d’arabe, ancien élève de Karaouyne.
A Teroual, le candidat FDIC est aussi un chérif de Ouezzane,
gros agriculteur (350 hectares), responsable local du PDC,
arrêté plusieurs fois, pour ses activités nationalistes, par les
autorités du protectorat. Le FDIC aurait emporté le siège si son
candidat n’avait été concurrencé, là aussi, par deux agriculteurs
traditionnels, anciens élèves de Karaouyne et présidents des
communes rurales de Zoumi et de Sidi Bousbeur. L’un d’eux,
qui sera élu, est un ancien résistant maintes fois arrêté sous le
protectorat pour avoir aidé l’Armée de libération dans cette
région située à la fontière de l’ex-protectorat espagnol.
Casablanca
Les données générales de la situation économique et sociale de
la province de Casablanca ne correspondent pas à celles de
Rabat bien que les deux régions aient de nombreux points
communs. La présence des villes se fait beaucoup plus sentir
dans la province de la Casablanca. Un courant d’émigration
ancien renforce l’influence économique et politique de
Casablanca et aussi de villes moyennes comme Mohamedia, El
Jadida, Azemmour, Settat, qui servent de relais aux impulsions
casablancaises. Les campagnes sont donc plus politisées, même
celles lointaines d’Oued Zem et de Khouribga où l’agriculture
n’est pas entrée dans le cycle de la modernisation au même
degré qu’en Chaouia ou dans les Doukkala.
On peut distinguer trois zones où les facteurs sociaux et
historiques associés aux données économiques créent des
situations politiques différentes, et influencent largement les
conditions de la compétition entre les élites locales. Les
circonscriptions du littoral forment un premier ensemble
particulier. L’influence des villes s’y fait sentir sur une
population rurale d’implantation récente et d’origine parfois
lointaine. Les cultures maraîchères (tomates, pommes de terre,
haricots) destinées au marché urbain ou à l’exportation, et les
petites exploitations, melk, dominent dans la zone côtière de
l’Oulja où les densités sont très fortes. Puis nous trouvons, un
peu en retrait, le Sahel aux terres sablonneuses et pauvres où
une population nombreuse s’efforce de tirer sa subsistance de
l’agriculture et de l’élevage[15]. Cette zone côtière contrastée
s’oppose à la plaine intérieure riche, avec des exploitations
marocaines de taille moyenne (30 à 50 hectares) en voie de
modernisation, et des exploitations plus grandes qui se
mécanisent. On y cultive le blé dur et le meus, mais dans des
conditions moins favorables que dans le Rharb ou les plaines
de Fès et de Meknès, car la pluviométrie est réduite et
irrégulière. Dans cette zone à forte densité de population, on
trouve assez peu d’exploitations de colons. Certaines familles
conservent un prestige traditionnel, mais on rencontre, dans
cette région, moins de dynasties rurales que dans le Rharb.
Dans le Sud de la plaine, autour de Sidi Bennour, commence à
se développer un périmètre d’irrigation qui utilise les eaux de
l’Oum Er Rebia. Ce développement devrait permettre à l’avenir
de résorber une partie de l’excédent de population rurale de la
plaine. En 1963, l’Office national des irrigations est dans sa
phase préparatoire où, suivant les cas, les remembrements et les
règlements de cultures imposent des contraintes qui ne sont
pas encore compensées par un supplément de revenu.
La troisième région naturelle de la province de Casablanca est
constituée par les cercles d’Oued Zem et de Khouribga qui font
partie du plateau intérieur marocain. Cette région prolonge,
avec une végétation encore plus aride, le plateau des Zaers. Les
sols cultivables y sont plus rares, et l’élevage l’emporte dans le
bilan des recettes agricoles. Cette région abrite, en fait, une
population plus nombreuse attirée par l’exploitation des mines
de phosphates. Mais les mineurs proviennent souvent d’autres
régions et ne sont guère intégrés au monde rural environnant.
L’implantation des partis est inégale suivant les régions. La
domination de l’UNFP à Casablanca s’exerce sur l’ensemble de
la province. Les relations commerciales, une émigration
ancienne et récente, qui n’est pas encore coupée de ses bases
proches, entretiennent cette influence. L’UMT sert de relais à
l’UNFP dans les centres miniers, et même dans les petits centres
de la plaine ou de la côte, qui abritent les noyaux de petits
fonctionnaires. Les centres de travaux de l’ONI et de l’ONMR
soutiennent également l’action de l’UNFP en milieu rural.
L’Istiqlal possède encore une clientèle de commerçants et de
notables ruraux dont certains appartiennent à l’administration
locale. Le FDIC est assez mal implanté. Le Mouvement
populaire n’a guère fait d’adeptes en ces régions habitées par
des populations d’origine arabe, ou arabisées de longue date,
comme les Doukkala. La tentation sera grande d’investir des
notables recommandés par l’administration locale ou de
parachuter des candidats citadins. Comme dans le Rharb,
l’administration exerce une influence réduite auprès de ruraux
qui ont déjà appris à se passer d’elle pour entreprendre leur
modernisation.
La situation des élites locales, telle qu’elle apparaît à travers les
candidatures aux élections de 1963, varie donc beaucoup d’une
région à l’autre. Nous allons tenter d’en donner une analyse en
reprenant le découpage esquissé plus haut.
La zone côtière comprend les circonscriptions de Mohamedia,
El Jadida et Azemmour. Dans chaque cas, une ville moyenne
est associée à une banlieue et à une zone rurale plus ou moins
importante. La circonscription de Mohamedia offre cette
particularité de regrouper toute la banlieue de Casablanca[16].
Dans cette zone, le scrutin a été très politisé : les candidats ont
un poids personnel, dû à leurs fonctions dans les assemblées
locales ou à d’anciennes responsabilités d’agents d’autorité. Ni
la naissance dans la circonscription ni l’origine ethnique ne
jouent, et les électeurs semblent s’être surtout déterminés en
fonction de choix politiques nationaux.
L’UNFP obtient deux sièges sur trois. Elle présente, à
Mohamedia, l’ancien gouverneur de la province de Casablanca
(il a été limogé en 1962), Abdelhamid Zemmouri, ancien
instituteur d’origine berbère, commerçant à Casablanca.
Membre du conseil national de l’UNFP, il appartient à l’Istiqlal
depuis 1944 et a participé à la Résistance. Il est un familier de
Driss Mahmmedi qui lui confia des responsabilités à l’intérieur,
après l’indépendance. Le siège sera en fait remporté par le
responsable local de l’Istiqlal après une élection triangulaire
serrée où le FDIC jouera aussi son rôle. Les candidats de l’UNFP
emporteront les deux autres sièges des circonscriptions côtières.
A El Jadida, l’élu est aussi un ancien gouverneur de la province,
alors commerçant, Mohamed Meknassi, originaire de Rhafsaï,
ancien résistant proche du fquih Basri et de Ben Barka. Connu
des électeurs, il est aussi aidé par le président du conseil
municipal de El Jadida, et l’emportera facilement sur ses
concurrents. Le président du conseil municipal de Azemmour,
Merouane, est un enseignant, enfant du pays, diplômé de
Karaouyne. Il écrasera sans peine ses concurrents, grâce au
soutien actif de l’UMT qui sortira de sa réserve pour l’aider.
Les candidats de l’Istiqlal ont aussi des attaches avec la région.
Par exemple, le vainqueur de Zemmouri à Mohamedia est un
homme d’appareil, originaire de la ville et organisateur du parti
dans la région, bien avant l’indépendance. Il a, de longue date,
mis la main sur la société locale de bienfaisance et a su se créer
une clientèle d’obligés dans une ville ouvrière où l’emploi est
souvent instable.
Le principal représentant du FDIC sera Abdelhadi Boutaleb,
sous-secrétaire d’Etat à l’information, originaire de Fès. Son
résultat à Mohamedia, comparable à celui de Abdelhamid
Zemmouri, étranger comme lui à la circonscription, prouve le
caractère politique du choix des électeurs. Les communes de la
banlieue immédiate de Casablanca, qui comptent d’importants
bidonvilles comme Bouskoura et Aïn Harouda, lui donnent la
majorité.
L’enjeu principal est constitué par les seize circonscriptions de
plaine des Chaouïa et des Doukkala. Les élections sont le plus
souvent triangulaires : l’Istiqlal a tendance à être mieux
représenté et parfois à l’emporter au Nord ; l’UNFP bénéficie
d’une position inverse dans le Sud ; le FDIC où des neutres
sympathisants de ce parti l’emportent dans le Centre. Le
malaise social des petites villes de l’intérieur[17] a certainement
joué un rôle dans ces réactions antigouvernementales : leurs
activités commerciales diminuent depuis l’indépendance ; les
campagnes prennent l’habitude de s’approvisionner
directement à Casablanca ; les transports, l’artisanat sont en
crise, et le nombre des chômeurs s’accroît, alimenté par les
arrivées régulières d’un exode rural.
Il semble, donc, que l’UNFP ait augmenté son implantation au
détriment de l’Istiqlal, par rapport aux élections de 1960. Ses
candidats sont tous originaires de la région, et, à des titres
divers, bien implantés dans leurs circonscriptions. Suivant les
critères de la société rurale traditionnelle, ils font figure de
personnes honorables, mais ils ne sont pas dans une situation
de prépondérance comparable à celle de certains élus Istiqlal ou
UNFP du Rharb. On trouve parmi eux trois agriculteurs
(propriétaires d’environ 50 hectares) qui sont présidents ou
conseillers communaux, et parfois dirigeants des sociétés de
bienfaisance locale. L’un deux est le fils d’un ancien cadi de
Sidi Bennour.
Parmi les candidats Istiqlal, on trouve un plus grand nombre
d’agriculteurs possédant parfois des superficies considérables
(1600 hectares à El Gara, 700 hectares à Berrechid). Sur les dix
candidats Istiqlal qui appartiennent au monde agricole, on ne
compte qu’un fellah propriétaire de 50 hectares, et un autre
possédant 70 hectares. La plupart sont, en même temps, des
élus locaux.
Le FDIC est le seul parti qui présente des candidats de
formation moderne qui font parfois figure de « parachutés »,
en dépit de quelques attaches locales. Faute d’appareil, il
s’appuie uniquement sur l’administration de l’Intérieur qui ne
ménagé pas ses efforts en sa faveur, mais se trouve gênée par le
souci de sauvegarder les apparences. Le choix officiel semble
s’être fixé, le plus souvent, sur des agriculteurs plutôt riches,
possédant entre 450 et 900 hectares. Suivant un modèle
rencontré dans tous les partis, ces agriculteurs descendent de
caïds ou de cadis, et sont souvent des élus locaux. L’un d’eux
fait partie de la confrérie Kadiria.
Les trois circonscriptions du plateau sont politiquement très
différentes de celles de la plaine et de la côte. Si l’on ne
connaissait pas l’existence d’un secteur minier et de petites
villes ouvrières et commerçantes, on croirait se trouver dans un
milieu d’agriculteurs traditionnels. En fait, il semble qu’en
1963 une forte rivalité ait neutralisé les cadres de l’UNFP et de
l’UMT. L’UNFP laissera se présenter à Khouribga, comme
candidat de gauche, un ancien caïd du protectorat qui fit
cependant le plein des voix politisées des secteurs urbains tout
en mordant largement en milieu rural. Cet élu UNFP présente
certaines particularités que l’on s’attendrait plutôt à trouver
parmi les candidats du FDIC. Ancien khalifa de son frère, caïd
du temps du protectorat, il entretenait, semble-t-il, les
meilleures relations avec les autorités de contrôle qui le firent
décorer de la Légion d’honneur, en tant que président de la
Chambre marocaine d’agriculture de Casablanca. Son
affiliation à l’UNFP s’explique, avant tout, par une hostilité
envers l’Istiqlal qui voulut le faire condamner après
l’indépendance (les biens de son frère ont été placés sous
séquestre). Il exploite plus de 900 hectares, tant pour son frère
que pour lui-même. Elu président du conseil communal de
Gueffaf, en 1960, il a mené, en 1962, une vigoureuse campagne
contre l’approbation de la Constitution. Cette attitude lui valut
de faire de la prison pour dettes, faute d’avoir remboursé un
prêt agricole à l’Etat. Son principal adversaire est aussi un gros
propriétaire de la région (2500 hectares), le pacha Cherradi,
pacha de Khouribga de 1922 à 1952, puis gouverneur de Beni
Mellal à l’indépendance. L’Istiqlal ne présente qu’un commis
de la perception, mais dont le père est connu comme ancien
cadi de Khouribga. Le ralliement tardif de l’UMT à l’UNFP
permet à ce parti de l’emporter : son candidat reçut l’appoint
des voix du secteur minier (Boujniba) et de la ville de
Khouribga, alors que le pacha Cherradi obtenait de meilleurs
résultats dans les autres communes rurales. La tactique, qui
consistait, pour la gauche marocaine, à faire élire un notable
traditionnel[18], se montre efficace. Un candidat ouvrier ou
fonctionnaire, qui aurait pu faire une campagne plus
orthodoxe sur le plan doctrinal, aurait été sans aucun doute
battu par le pacha Cherradi. Cherradi était le seul à avoir une
influence sur la population rurale qui représentait encore la
majorité des inscrits de la circonscription.
A Oued Zem, la lutte se déroule aussi entre notables
traditionnels. Le candidat Istiqlal l’emporte sur des élus FDIC
divisés et un candidat UNFP peu actif. L’élu est un gros
propriétaire (250 hectares) qui a été pendant le protectorat
khalifa du centre autonome et de la tribu voisine des Beni-
Smir ; et c’est justement dans ces commînes qu’il recueille plus
des deux tiers des suffrages qui assurent son élection[19].
Le véritable combat politique se déroule entre les deux
candidats qui se réclament du FDIC. Tous deux proviennent du
Mouvement populaire et sont des notables traditionnels se
prévalant d’appuis à Rabat. Les autorités administratives locales
n’osent guère arbitrer. L’un deux est l’ancien khalife de son
père, qui fut, du temps du protectorat, caïd des Maadna[20].
C’est un gros agriculteur moderne (110 hectares), qui était
avant l’indépendance vice-président de la Chambre
d’agriculture de Casablanca. Son adversaire a un profil
identique. Il fut, de 1927 à 1955, khalifa de la tribu rivale des
Ouled Aïssa. Depuis l’indépendance, il est rentré sur ses terres
(500 hectares) qu’il s’emploie à mettre en valeur suivant les
méthodes modernes. A la différence de l’ancien khalifa des
Maadna, il n’a pas été élu au conseil communal en 1960. Les
deux candidats se partagent les voix des communes rurales
suivant les découpages de leurs anciens commandements, et
compte tenu des affinités ou des incompatibilités
traditionnelles des lignages. Trois candidats neutres
contribuent à accroître la confusion dans une circonscription
où l’on aurait pu penser, a priori, que les comportements
politiques se détermineraient en fonction de facteurs de nature
moins traditionnelle, étant donné la présence non négligeable
d’une population ouvrière et d’une population urbanisée.
Boujad est une circonscription différente des deux précédentes.
Petite ville religieuse et centre commercial de moyenne
importance sur la route entre Casablanca et le Tadla, elle abrite
une population fixée de longue date, comparable à celle
d’autres villes religieuses, comme Ouezzane, Chaouen ou
Moulay Idriss. Les chorfa Cherkaoui y jouent un rôle
comparable aux Ouezzani dans le Nord. Leur influence sur les
ruraux de la région, encore peu touchés par la modernisation,
est considérable.
Comme à Oued Zem, la lutte électorale concerne
principalement l’Istiqlal et le FDIC ; l’UNFP n’y participe pas
activement. L’Istiqlal emportera le siège en présentant un
chérif Cherkaoui, commerçant en tissus en ville et responsable
local du parti. Cet élu, de culture traditionnelle, est aussi
adjoint au président du conseil communal de Boujad et
délégué du cercle à la Chambre de commerce de Casablanca.
Le principal adversaire de l’Istiqlal est un ancien caïd du
protectorat, commandant en retraite de l’armée française, qui
se consacre à ses propriétés agricoles (500 hectares) depuis
l’indépendance. Il recueille les voix des électeurs de son
ancienne circonscription administrative, sans pouvoir
compenser le succès de son adversaire à Boujad et dans les
communes voisines.
Avant d’en terminer avec la province de Casablanca, il nous
semble opportun de revenir sur le rôle des autorités
administratives dans les élections. Il est certain que le
gouverneur de la province, Saddeq Abou Ibrahimi, vieil agent
de l’intérieur, s’est employé, avec ses caïds, à obtenir un
résultat favorable au FDIC, en s’engageant beaucoup plus que
son collègue de Rabat. Le résultat n’a pourtant guère été
brillant dans l’ensemble. Cette carence semble due tout d’abord
au fait que l’Istiqlal et l’UNFP possédaient une structure solide
dans la province. Ces partis ont su, dans plusieurs cas,
s’entendre officieusement pour ne pas pousser la campagne de
leurs candidats les moins bien placés, afin de battre, avant tout,
le FDIC. De plus, le FDIC a joué de malchance. Sa structure est
plus faible que dans les autres provinces. Le Mouvement
populaire n’est pas en mesure d’arbitrer entre ses partisans qui
forment le noyau du nouveau parti. Le choix des candidats est
un peu laissé à l’aventure, et ressemble souvent à une
ratification d’autodésignés. L’autorité administrative arrive mal
à mettre de l’ordre parmi ceux qui se réclament du
gouvernement, et elle compte trop sur l’exemple politique du
référendum. Elle croit que ceux qui se présenteront au nom du
roi arriveront à mobiliser toutes les voix du « oui ». Lorsqu’elle
se lance dans la lutte politique, elle ajuste mal ses coups : elle
s’en prend davantage à l’Istiqlal qu’à l’UNFP, discréditée par le
boycottage et démoralisée par ses différends avec l’UMT.
Parfois, aussi, la population réagit avec énervement devant
l’insistance du caïd. Lorsque ce dernier intervient en faveur
d’un candidat, sans être en mesure d’appuyer autrement sa
demande, la population a tendance à croire que l’élu sera
l’homme du caïd, alors qu’elle souhaite en faire un
intermédiaire qui équilibrerait un peu le pouvoir grandissant
du caïd. La sélection des candidats, le style de la campagne et
les interventions administratives n’ont pas favorisé le parti
gouvernemental.
Le Maroc central
Les trois provinces de Fès, Meknès et Beni Mellal forment un
ensemble qui ne se définit pas nettement sur le plan politique.
En dépit de nombreux caractères communs dans le domaine
agricole, ou dans la répartition des populations, il aurait été
artificiel de les grouper avec les provinces de Rabat et de
Casablanca qui subissent l’influence des villes du littoral. Le
Rif, les régions pré-sahariennes, l’Oriental sont encore plus
nettement différenciés. Le caractère particulier de ce Maroc
central est un équilibre variable entre des régions de plaines
transformées par la colonisation européenne et soumises à
l’influence des villes traditionnelles, et des zones de
montagnes, plus pauvres et plus authentiques. Sur ce fond se
superpose un système ethnique complexe où des populations
d’origine berbère coïncident généralement avec les zones
montagneuses.
L’implantation ancienne des partis dans les régions de plaine et
dans les petits centres commerciaux explique la présence d’un
nombre élevé de candidats responsables locaux. Cette emprise
est cependant loin d’être totale, notamment dans les régions
d’agriculture moderne. Les solidarités traditionnelles se sont
relâchées, chaque notable s’estime digne de représenter sa
circonscription. On aboutit ainsi à la multiplication des
candidatures qui profite le plus souvent à ceux qui sont
capables de mobiliser à leur profit des clientèles plus ou moins
importantes. C’est sans doute ce qui justifie le retour d’un
certain nombre d’anciens caïds, chioukh ou moqqademin du
protectorat. L’influence des anciens élèves de l’Université
Karaouyne s’affirme également, dans tous les partis, sans être
comparable en importance à celle des anciens de Ben Youssef
dans les provinces de Marrakech, d’Agadir et de Ouarzazate.
Dans ce contexte, chaque province offre une physionomie
politique particulière.
Fès
A Fès, la vie politique de la province est dominée par celle de la
ville qui, depuis trente ans, a été le berceau du nationalisme.
L’Istiqlal y conserve une implantation importante et solide
avec, à sa tête, un inspecteur provincial nommé par Rabat,
assisté d’un comité consultatif de notables composé de Ahmed
Mekouar, gros commerçant, Mohamed Bengelloum, président
de la Chambre de commerce, Kacem Tahiri, transporteur et
président de la société musulmane de bienfaisance et
Mohamed Slaoui, correspondant de Al Alam. Les divers
quartiers de la ville sont placés sous la responsabilité de seize
délégués responsables devant le comité consultatif. Ces
délégués sont, pour la plupart, des enseignants ou des
fonctionnaires locaux. Dans les cercles de la province, on
rencontre une implantation solide de l’Istiqlal à Fès-banlieue et
à Sefrou, plus légère à Karia-Ba-Mohamed, Taounate et
Boulemane. A cet appareil officiel, il faudrait aussi ajouter de
nombreux relais administratifs. Mohamed Benchekroun,
secrétaire général de la province depuis l’indépendance, est un
militant avoué du parti. Il fera attribuer les bulletins jaune
canari, symbole de l’investiture officielle, généralement
réservés aux candidats FDIC, à ceux de l’Istiqlal. Il orientera
l’action de nombreux caïds, chioukh, moqqademin qui lui
doivent leurs nominations. Il contrôle également la plupart des
présidents de conseils communaux de la province, et influence
les représentants locaux des services techniques. Grâce à ce
réseau de complicités, l’Istiqlal a pu conserver une organisation
associant les cadres du parti aux représentants de
l’administration et aux élus, qui lui assure une emprise
diversifiée sur la province. La province de Fès connaît un
système politique comparable à celui dont disposait l’Istiqlal
dans la plupart des provinces, au moment de l’indépendance.
Ainsi, Mohamed Messaoudi, jeune ingénieur agronome
originaire de Marrakech nommé gouverneur de la province par
le roi, en 1962, pour combattre l’influence de l’Istiqlal, sera très
vite neutralisé et découragé. On ne lui accordera aucun des
changements de personnel qu’il réclame pour reprendre en
main son administration, ni les moyens nécessaires pour lancer
une action économique à porter au crédit du gouvernement et
non dù parti.
En 1963, l’Istiqlal compte, à Fès, plus de 5 000 adhérents
cotisant régulièrement. A ces adhérents citadins, s’ajoutent 7
000 sympathisants venant principalement de milieux ruraux.
Ces derniers cotisent généralement en nature, au moment des
récoltes. Aucun parti ne présente un appareil aussi structuré
que l’Istiqlal. L’UNFP est désorganisée depuis le départ précipité
en Algérie de son responsable régional, en novembre 1962. Elle
trouve son principal appui parmi les fonctionnaires des services
techniques : le sous-directeur des PTT, le chef d’arrondissement
des Ponts et chaussées, le contrôleur de l’Enregistrement et
quelques enseignants. Mais l’industrialisation de Fès,
commencée avant l’indépendance et largement poursuivie
depuis lors[21], a favorisé la croissance d’un prolétariat urbain
originaire de la campagne et de la montagne environnant où
l’UNFP trouve des soutiens. Le PDC n’a que quelques
sympathisants à Fès où réside son fondateur Hassan Ouazzani.
En dehors des régions berbères du Moyen-Atlas, le Mouvement
populaire compte des partisans à Fès parmi les immigrants
d’origine berbère. Il compte aussi quelques professeurs de la
Karaouyne qui lui apportent leur soutien pour se désolidariser
de la majorité de leurs collègues, favorables à l’Istiqlal.
Ce bref tableau des forces politiques en présence dans la
province de Fès, en 1963, peut être illustré par l’étude des
candidats. La ville de Fès est en fait un cas particulier. Chaque
parti choisit d’y présenter des candidats qui allient des bases
locales certaines à une importance nationale. L’Istiqlal y sera
représenté par son président, Allai el Fassi, par Ahmed
Mekouar, un des fondateurs du parti, et par Mohamed Douiri,
ancien ministre des Finances. Les deux premiers se partageront
les circonscriptions, réputées faciles, de la médina. Le dernier se
présentera en ville nouvelle et à Dokkarat, faubourg ouvrier.
Allal el Fassi l’emportera de justesse, grâce à l’appui des
moqqademin de quartier, anciens clients de Mekouar qui,
pendant longtemps, a exercé une tutelle sur leur nomination.
Son adversaire, Ahmed Bahnini, ministre de la Justice, issu
d’une vieille famille Makhzen de Fès, avait l’appui de
Mohamed Laghzaoui et de toute son organisation.
L’UNFP présentera Mohamed el Liazghi, avocat, ancien
fonctionnaire des Finances, qui battra Douiri.
Les quatre circonscriptions du pré-Rif se distinguent par
l’abondance des candidats, avec chacun une assise locale qui
ne dépasse pas parfois le douar ou le groupe de douars.
L’influence de la bourgeoisie de Fès, qui possède de vastes
propriétés dans ces régions, se combine avec celle des milieux
de l’Armée de libération, et de courants politiques divers venus
de l’ex-zone Nord. Le seul élu FDIC est un gros agriculteur (100
hectares), président de la commune de Bouchabel que l’on
considérait jusqu’alors comme UNFP. Il l’emporte sur d’autres
agriculteurs du même type, Istiqlal ou FDIC, et sur un
commerçant en tissus de Fès, originaire de la circonscription et
candidat UNFP.
A Rhafsaï, l’élu est un étudiant en droit, Istiqlal, ancien élève
de la Karaouyne, issu d’une famille influente.
Les élus de Tissa et de Taounate sont tous deux de tendance
Istiqlal, mais représentant chacun un type différent de
notables. Tous deux sont présidents de conseils communaux, et
militants du parti depuis le protectorat. Mais l’un est diplômé
de Karaouyne et directeur d’école à Bouanane, dans la province
de Ksar es Souk, alors que le second est un riche agriculteur
(200 hectares) appartenant à une famille de notables ruraux. Il
est vrai que le directeur d’école appartient aussi à une famille
de chorfa influente dans la région de Taounate, où l’on vénère
le mausolée du chérif Sidi Bouzid, ancêtre de la famille. Cette
notoriété de chérif de renommée locale qui semble favoriser, à
Taounate, un candidat Istiqlal, ne suffît pas à faire élire, à Tissa,
un Ouazzani, diplômé de Karaouyne, agriculteur (100 hectares)
et ancien militant du PDC. Il faut noter aussi que ce candidat
n’est pas un élu local, et ne semble guère avoir l’appui de
l’administration provinciale.
Les circonscriptions de Sefrou et de Boulemane appartiennent
au Moyen-Atlas. Si le milieu rural berbère est plutôt favorable
au Mouvement populaire, les petits centres, où sont installés
les administrations et les commerçants, sont les relais directs de
l’influence du parti de l’Istiqlal.
Dans la circonscription de Sefrou, la majorité des candidats
sont originaires du centre. L’élu est un Alaoui, petit agriculteur
et commerçant de tendance Istiqlal, qui l’emporte sur le
ministre de l’Information, Moulay Ahmed Alaoui, grâce,
semble-t-il, à l’aide du chef de cercle de Sefrou, alors que le
ministre de l’information pouvait compter sur l’appui de son
frère, pacha de Sefrou. Mais la présence de cinq candidats
neutres, notables originaires des communes rurales de la
circonscription, appartenant pour la plupart à la tendance
Lyoussi du Mouvement populaire, a gêné le candidat FDIC.
A Boulemane, en revanche, un éleveur de Enjil, proche de
l’ancien ministre Lahcen Lyoussi, a été élu au nom du FDIC. Il
fut condamné à quinze ans de prison pour participation à la
rébellion de Addi ou Bihi, en 1957, et gracié en 1961.
Meknès
Nous retrouvons à Meknès un découpage géographique en
tranches horizontales, assez comparable à celui de la province
de Fès. Il n’y manque qu’une frange rifaine au Nord. La ville
traditionnelle est entourée d’une plaine fertile, dominée par la
colonisation européenne. Au Sud, des régions de plateaux et de
montagnes sont habitées par une population en majorité
berbère.
Meknès a un rayonnement culturel traditionnel moindre que
celui de Fès. La ville moderne souffre d’une crise économique
grave depuis l’évacuation de la base militaire française.
L’Istiqlal y est implanté de longue date, mais il dispose d’un
réseau moins structuré que dans la province voisine.
L’administration, placée sous l’autorité d’un gouverneur,
cousin du roi, est plus neutre, mais parfois hostile à l’Istiqlal. Le
commerce moderne est sous le contrôle des Soussis,
majoritaires au sein de la Chambre de commerce, et plutôt
favorables à l’UNFP. Les petits centres administratifs et
commerciaux de la province restent cependant sous le contrôle
de l’Istiqlal, surtout par l’intermédiaire des commerçants fassi
qui y sont implantés. Ces centres, particulièrement ceux de
Azrou et de Khenifra, jouent un rôle important grâce au réseau
de souks qu’ils dominent[22]. Leur influence s’étend, sur le
versant de l’Atlas, jusqu’à El Kbab, Ajdir, Boumia et, sur le
plateau central, jusqu’à Moulay Bouazza et Aguelmous. Ils sont
en liaison régulière par cars, taxis et camions avec Fès, Meknès
et Beni Mellal. Les échanges d’idées, les contacts sociaux sont
aussi importants, dans le milieu rural illettré, que les échanges
économiques. Les partis sauront mieux utiliser ces réseaux que
l’administration. L’Istiqlal bénéficie encore de l’organisation
mise en place, aussi bien en ville que dans les campagnes, lors
de la lutte contre le protectorat.
A Meknès, l’Istiqlal emporte les deux sièges de la ville. L’un des
élus est son inspecteur régional, de culture traditionnelle,
originaire de la ville, et responsable de l’organisation locale
depuis le temps du protectorat. Sa condamnation à plusieurs
années de prison, en 1953, lui a donné une appartenance
légitime à la classe politique. Le second élu de Meknès est un
juriste de culture moderne, originaire de la ville, Abderahmane
Baddou, directeur des Affaires criminelles au Ministère de la
justice, et membre du conseil exécutif de l’Istiqlal. Lui aussi a
été emprisonné pendant le protectorat. Le FDIC présente le Dr
Benhima, ministre du Commerce, ancien haut-commissaire à
la reconstruction d’Agadir, qui commença sa carrière politique
aux côtés de Ben Barka, lors de la construction de la route de
l’Unité. Originaire d’une famille de commerçants de Safi, il est
sans attaches avec la circonscription.
Les circonscriptions de plaine entourant Meknès, Moulay-Idriss
et Boufekrane élisent un Istiqlal et un neutre de tendance
FDIC. Le réprésentant de Moulay-Idriss est président du conseil
municipal et secrétaire de la section Istiqlal de la localité.
Ancien élève de la Karaouyne, il est propriétaire de 250
hectares de terres, dont 50 hectares plantés en oliviers. Sa
richesse et ses libéralités lui assurent une estime pieuse et
bourgeoise. Il a bénéficié de l’appui des chorfa Idrissides du
centre.
L’élu neutre de Boufekrane[23] est aussi un gros agriculteur (150
hectares), ancien caïd du protectorat, destitué en 1956. Il bat le
candidat Istiqlal, petit agriculteur, président du conseil
communal de Boufekrane, et ancien khalifa de caïd du temps
du protectorat.
Le bilan des quatre circonscriptions berbères de El Hajeb,
Azrou, Khenifra et Moulay Bouazza présente un aspect plus
ordonné et plus traditionnel. L’élu de El Hajeb est l’ancien caïd
des Gerouane du Sud, révoqué en 1956. Gros agriculteur (560
hectares) de tendance Mouvement populaire, il est aussi
conseiller communal d’Agouraï. Azrou élit un candidat FDIC
agriculteur et éleveur, propriétaire de 1 200 hectares,
constructeur d’écoles et de mosquées, très soutenu par
l’administration. Ce notable, affilié à la confrérie des Derkaoua,
est le Nadir des Habous de Azrou. Il a fait plusieurs fois le
pèlerinage de La Mecque. On le considère comme représentatif
de la classe des gros éleveurs[24], qui utilise les pâturages
collectifs pour entreprendre un élevage spéculatif.
Les circonscriptions de Khenifra et de Moulay Bouazza
montrent cependant que l’implantation de l’Istiqlal en pays
berbère ne s’est pas effondrée. Les élections communales de
1960 faisaient déjà apparaître la solidarité des positions
acquises par ce parti, en particulier dans le centre de Khenifra.
En présentant Majhoubi Ahardane, le FDIC commettait une
erreur. Seul un notable traditionnel des Zaïans aurait été en
mesure de l’emporter, comme le prouve le résultat de Moulay
Bouazza, en mobilisant à son profit le sentiment tribal. C’est en
fait un petit agriculteur soutenu par l’Istiqlal qui l’emporte
largement sur le ministre de la Défense. L’UNFP présente un
gros agriculteur (180 hectares), ancien chef de cercle, et
descendant de Moha ou Hamou, le héros légendaire des Zaïans.
A Moulay Bouazza, l’élu FDIC est un ancien caïd, petit-fils de
Moha ou Hamou propriétaire de mille hectares, limogé à
l’indépendance.
La situation des élites locales apparaît comme assez confuse
dans cette province. Les facteurs de prestige traditionnel
(culture religieuse, richesse en terre et en troupeaux, parentés)
semblent très importants même lorsque les structures
économiques ne correspondent plus à ce type de société.
Beni Mellal
Dans la province de Beni Mellal sont rassemblés la plupart des
facteurs économiques, historiques et sociaux qui influencent le
comportement politique des campagnes de l’intérieur du
Maroc ; mais cette région n’a pas de grandes villes
traditionnelles ou modernes. Située au centre géographique du
pays, cette province connaît certains types de relations que
nous avons rencontrés à Meknès et à Marrakech. Elle est
partagée entre un pays de plaine arabisé, où le système tribal
est depuis longtemps réduit en miettes, et une zone de
montagnes dominée par les éleveurs berbères. Il faut ajouter,
en plaine, la présence d’un centre relativement ancien de
modernisation autour de Fquih Ben Salah (l’Office des Beni
Amir et des Beni Moussa repris par l’Office national des
irrigations). En montagne, la province de Beni Mellal offre
cette particularité d’être le point de rencontre de deux grands
groupes linguistiques berbères, les Chleuh et les Imazhiren.
En 1963, la province reste encore marquée par le souvenir de la
révolte du super-caïd de Beni Mellal, qui prit la montagne en
mars 1960. Il était, semble-t-il, en liaison avec des éléments de
la résistance de Casablanca, proches du fquih Basri et de Mehdi
Ben Barka[25] qui le poussèrent à la révolte en lui laissant croire
que sa rébellion serait le signe d’un vaste mouvement national
de soutien au gouvernement Abdallah Ibrahim. Après avoir tué
le commissaire de police de Beni Mellal, chargé de contrôler ses
activités, il gagna la région de Taguelft et d’Azilal, enrôlant ou
désarmant les postes de mokhazenis. Une rapide opération des
FAR mit fin à la révolte. Mais certains de ses partisans
demeurent à Taguelft et à Azilal au sein des sections de l’UNFP
et entretiennent des liens assez mal définis avec les zaouïas de
la montagne[26].
L’UNFP est dirigée dans la province par un ancien caïd, licencié
en 1960, et par quelques anciens de la Résistance. Ses cadres
locaux se recrutent plutôt dans les régions berbères
montagneuses. Ce parti exploite, là, une protestation diffuse
contre la confiscation de l’indépendance par la bourgeoisie
fassie. Dans le Rif, le Moyen-Atlas et le Tafilalt, ce
mécontentement a été exploité par les divers courants du
Mouvement populaire. L’UNFP canalise aussi, en montagne, le
mécontentement de la population contre l’emprise des Eaux et
forêts qui limite les doits de pâturage, procède à des travaux de
DRS présentés comme des spoliations. Elle s’appuie, dans
certaines communes d’émigration comme les Aït Attab, sur
l’influence des mineurs de l’OCP, originaires de l’endroit et
partis à Khouribga. Dans la plaine modernisée par l’ONI et
dans les petits centres, la clientèle de l’UNFP est plutôt
constituée de petits fonctionnaires, instituteurs, agents des
centres de travaux de l’ONI, postiers.
L’Istiqlal n’a guère d’emprise dans la montagne, mais son
armature est solidement implantée dans la plaine et dans les
centres. Majoritaire sur le plan provincial aux élections de
1960, il a les faveurs des commerçants et de certains agents de
l’administration. Le gouverneur de la province et son
entourage passent pour le soutenir discrètement, ou pour le
moins refusent d’appliquer les consignes tacites de soutien actif
du FDIC que d’autres dénoncent. Le Mouvement populaire est,
en revanche, bien implanté dans la montagne où l’ancien caïd
Moha ou Saïd d’El Ksiba, descendant d’un héros local de la
Siba, fait figure de leader régional. Les anciens combattants de
l’armée française, très nombreux dans la province, notamment
à Tanant et aux Aït Attab, lui fournissent un encadrement
nombreux et relativement efficace. Ils constitueront également
le noyau local du FDIC qui ne recueillera que quelques élus
locaux isolés provenant du PDC. Pour mémoire, on peut
signaler la présence de quelques communistes ruraux à Kasba
Tadla.
Les véritables problèmes politiques de cette province sont en
fait des problèmes administratifs mal réglés, hérités du
protectorat. En montagne, la délimitation agressive et le
contrôle répressif de l’usage des forêts pour le pâturage ou des
cultures dans les clairières n’ont jamais réellement été admis
par la population. Le protectorat avait su composer avec sa
propre législation, en tolérant de très larges droits d’usage
concernant les pâturages et l’usage domestique des forêts. Au
lendemain de l’indépendance, les règles furent appliquées plus
strictement, créant un mécontentement qui favorisa aussi bien
la folle équipée du super-caïd de Beni Mellal que le
développement du Mouvement populaire. Pressées par le
manque de terres de culture, certaines populations de
montagne mettent systématiquement le feu aux forêts, comme
dans le Rif, en 1958. Le problème du respect des droits
traditionnels de pacage par les tribus crée aussi des litiges avec
des éleveurs Aït Atta de la province de Ouarzazate.
En plaine, les rapports entre les paysans et l’Office national
d’irrigation constituent le centre des tensions politiques
locales. Héritiers des traditions de modernisation autoritaire de
l’Office des Beni Amir, les centres de travaux de l’ONI sont
souvent plus contestés que leurs prédécesseurs du protectorat.
Avec l’indépendance, les paysans pensaient échapper aux
obligations de livraisons et aux règlements de cultures fixés par
l’Office. Or, les contraintes sont renforcées et appliquées par
des agents moins bien formés. On les accuse surtout de léser les
paysans, en sous-estimant les poids ou les valeurs du coton
livré, qui constitue la production la plus rémunératrice. La
répartition de l’eau, les semences, le crédit, la vente des
récoltes, les paiement différés par une administration lourde et
négligente sont chaque fois des occasions d’affrontements.
L’Istiqlal et le Mouvement populaire exploitent les conflits et
les malentendus. Le gouverneur et ses caïds n’épousent pas
toujours le point de vue des agents de l’Office. L’autorité de
l’État s’effrite, les infractions mineures se multiplient. La
structure rigide de l’ancien Office se maintenait en partie grâce
à la confusion des pouvoirs administratifs et judiciaires. La
séparation des pouvoirs a privé les techniciens d’un moyen
d’influence privilégié. En plaine, les nouveaux juges refusent de
continuer à mettre une justice expéditive au service de la
modernisation rurale.
Une fois la contrainte immédiate disparue, les paysans ont
tendance à revenir à l’agriculture traditionnelle, même en
secteur irrigué. En montagne, on accuse les juges de
méconnaître la coutume, de ne plus admettre les preuves
traditionnelles (serments collectifs), de ne pas sanctionner
effectivement, par souci d’observer la procédure, les vols de
bétail, les délits de pacage ou les délits forestiers.
La situation politique de Beni Mellal n’est pas unique : la
plupart des problèmes qui s’y posent se retrouvent dans les
provinces voisines et constituent la trame des activités
politiques. Les contacts de l’administration et des partis
politiques avec la population se situent dans ce cadre prédéfini.
Nous retrouverons ces problèmes au niveau des
circonscriptions et des candidats.
Dans la circonscription de Beni Mellal correspondant aux
limites du cercle, la lutte politique est extrêmement vive. Le
candidat FDIC, Ahmed Mesfioui, gros agriculteur moderne,
ancien pacha de Beni Mellal du temps du protectorat, s’efforce
de mobiliser l’influence dont avait bénéficié son père’, le pacha
Boujemaa. Ce dernier, qui avait participé à la pacification du
Tadla, avait été considéré jusqu’à sa mort, en 1941, comme le
principal chef traditionnel de la contrée. Son fils lui avait
succédé, mais il n’avait pas la même autorité. Discrédité par
une collaboration trop confiante avec le protectorat, il avait été
démis de ses fonctions administratives, en 1956, et s’était
consacré à l’exploitation active de près de 250 hectares à Kasba
Tadla. Il avait été battu aux élections communales de 1960 par
un candidat Istiqlal. Le gouverneur l’estimait peu et ne cachait
pas son mécontentement de le voir reprendre l’ascendant avec
l’appui du Mouvement populaire. Pour faire sa campagne, ce
candidat s’entoure de ses frères, des fidèles de son père,
d’anciens caïds et chioukh du protectorat. Il multiplie les diffas
et les réjouissances populaires coûteuses, et se fait accompagner
par des serviteurs armés.
Dans la circonscription des Beni Amir, où s’exerce l’action
principale de l’ONI, le responsable provincial de l’Istiqlal,
commerçant-agriculteur de Fquih Ben Salah, est élu. En plus de
l’aide de son parti, il jouit du soutien de nombreux agriculteurs
qu’il aide à échapper aux contraintes de l’Office, en achetant
plus ou moins clandestinement leurs récoltes.
Dans la dernière circonscription de plaine, celle des Beni
Moussa, treize candidats se présentent, tous notables ruraux.
Un grand nombre a occupé des fonctions administratives sous
le protectorat, plusieurs d’entre eux sont présidents ou
conseillers communaux. L’élu est un ancien élève de
l’Université Ben Youssef, ancien caïd et ancien cadi révoqué en
1953. Son succès électoral à Bzou et dans une commune
voisine de son ancienne circonscription lui permet de dominer
les autres candidats qui n’obtiennent que des résultats locaux
moindres.
Dans les trois circonscriptions de plaine, qui sont les plus
modernisées, où la population est groupée en fortes
agglomérations reliées par un réseau dense de routes et de
pistes, où des souks importants et fréquentés servent autant à
la diffusion des idées qu’à celle des marchandises, les résultats
sont assez contradictoires.
Il faut tout d’abord noter l’importance des intellectuels
traditionnels (issus de la Karaouyne ou de Ben Youssef) dans
une zone où les conflits de modernisation sont nombreux. Les
candidats désignés de Rabat n’ont aucune emprise, quelles que
soient leur implantation familiale, leur formation moderne ou
leur valeur comme intermédiaires possibles auprès des
administrations de Rabat. Le cas des notables traditionnels
mérite une attention particulière. Pourquoi l’un d’eux
l’emporte-t-il dans les Beni Moussa alors qu’un autre est battu à
Beni Mellal ? Les facteurs du succès ou de l’échec tiennent,
semble-t-il, autant aux individus qu’aux caractères spécifiques
des circonscriptions.
A Beni Mellal, le candidat est un notable de la deuxième
génération, de formation moderne. Dans les Beni Moussa, l’élu,
de formation traditionnelle, a un prestige familial plutôt de
nature religieuse (famille d’ouléma) que politique. Mais l’un
des candidats (celui de Beni Mellal) a accepté, en 1953, l’exil de
Mohamed V, alors que l’autre a démissionné. Ce qui prouve,
une fois de plus, que si les activités nationalistes ne suffisent
pas à elles seules à faire élire un candidat, leur manque, ou un
soupçon de collaboration peuvent le disqualifier. A Beni Mellal,
la population du centre autonome, très politisée, supporte mal
l’intensité et le style de libéralité ostentatoire de la campagne
de Ahmed Mesfioui. Dans les Beni Moussa, la population de
Bzou et de quelques communes voisines situées en piémont
vient solliciter son ancien caïd, qui accepte de se présenter.
Sans faire campagne, il pourra compter sur leurs votes massifs
le jour du scrutin. Par leur cohésion, ces communes de
piémont (dir) imposeront leur candidat à celles de la plaine,
dont les électeurs, plus nombreux, dispersent leurs voix.
En montagne, les situations politiques sont aussi complexes.
Les trois circonscriptions correspondent aux trois cercles de
montagne, à l’exception de quelques communes de piémont
d’Azilal incorporées à la circonscription des Beni Moussa. A
l’intérieur de ces circonscriptions, les zones de piémont, qui
commandent les communications entre plaine et montagne,
ont une importance particulière, tant sur le plan économique
que politique. On y trouve la moitié de la population des zones
montagneuses sédentaire et groupée, alors que les habitants des
régions hautes sont souvent dispersés et semi-nomades. Une
famille Makhzen traditionnelle, celle de Moha ou Saïd, ancien
caïd de Moulay Hassan Ier, mort dans la montagne d’El Ksiba
sans s’être soumis, domine encore la vie politique des
circonscriptions à population Imazhiren de Ksiba et de
Ouaouizarth. Son fils, le caïd honoraire Bassou, hérite
l’influence et la richesse de cette famille. Il a su conserver ses
fonctions durant le protectorat, jusqu’en 1957, sans trop se
compromettre. Il poussera la candidature de l’un de ses jeunes
frères, agriculteur, ancien élève du Collège d’Azrou, et
président de la commune de Ksiba depuis 1960.
L’élu de la circonscription voisine d’Ouaouizarth bénéficie
aussi de l’aide de la famille de Moha ou Saïd, et de l’appui des
anciens combattants dont il fait partie.
L’élu FDIC d’Azilal est, en revanche, un chérif de la zaouïa
Naciria de Sidi Abdallah. Il a été élu président de la commune
d’Azilal en 1960, après avoir été incarcéré pendant plus de deux
ans par le protectorat pour ses activités nationalistes. Il est
connu dans tout le cercle comme riche commerçant, éleveur de
bétail et propriétaire foncier.
Les facteurs traditionnels, familles Makhzen, et, cette fois,
confréries, influencent la vie politique en montagne suivant les
modalités différentes de celles que l’on rencontre en plaine.
Mais le nationalisme joue toujours le rôle de filtre. Le succès
provient, semble-t-il, d’un mélange composite de tous ces
facteurs ; les facteurs modernes (éducation, militantisme) ne
suffisent pas à eux seuls à assurer l’appartenance aux élites
locales.
Le Maroc oriental
Composé des provinces d’Oujda et de Taza, le Maroc oriental
forme un ensemble difficile à définir. Dans ses zones frontières,
il tend à adopter les caractères généraux et les réactions
politiques des régions voisines. Les cercles du Sud
s’apparentent aux régions pré-sahariennes. Aknoul a des
réactions proches de celles de la province de Nador, Taineste
présente des traits communs avec le pré-Rif de Fès, et Tahala
fait partie du bloc berbère du Moyen-Atlas.
L’unité vient donc, en premier lieu, des facteurs administratifs,
mais aussi d’une économie assez pauvre qui pousse les
habitants à chercher des ressources à l’extérieur. L’éloignement
des centres de décision du littoral crée des réactions et des
rapports identiques à ceux de l’élite politique nationale. Fès
apparaît enfin comme la métropole influente et le relais
normal dans les rapports entre ces provinces et le pouvoir
central.
Les élites locales appartiennent encore le plus souvent au
groupe des notables ruraux traditionnels. Mais ces derniers, par
l’intermédiaire des partis ou de l’administration, semblent plus
liés aux élites politiques nationales que dans les régions
étudiées précédemment. On trouve un pourcentage élevé de
candidats anciens caïds, chioukh ou présidents de commune
rurale. Ces fonctions, sont généralement associées à celles des
dirigeants locaux des partis. Comme il s’agit de partis très
centralisés, les dirigeants locaux sont en fait plus souvent des
correspondants ou des représentants de la direction centrale
que des échelons intermédiaires, exerçant leur part de
responsabilités.
On trouve aussi quelques candidats « parachutés » qui ont des
liens plus ou moins lointains avec les circonscriptions dont ils
sollicitent les suffrages. Si la présence des partis se fait sentir,
leur influence ne va pas jusqu’à contrôler entièrement le jeu
politique. De nombreux candidats individuels ou dissidents,
surtout dans la province de Taza, viennent bouleverser les
pronostics.
Pendant longtemps ces provinces ont été affectées par la
présence lourde et contraignante de l’ALN algérienne. Sans
intervenir ouvertement dans les affaires marocaines, les
Algériens jouissaient d’une liberté d’action qui a empêché
l’administration marocaine d’affirmer son emprise sur la
région. Certains opposants se prévalaient, à tort ou à raison, du
soutien des Algériens, et le pouvoir local marocain était, par
ailleurs, relativement impuissant à protéger la population des
initiatives de l’ALN algérienne ou des représailles françaises.
Son prestige s’en est trouvé amoindri. Enfin, la région de
Berkane, qui vivait depuis longtemps en symbiose économique
avec l’Oranie, a été affectée par la fermeture de la frontière
pendant la guerre. Elle a dû faire venir ses approvisionnements
à prix fort de l’intérieur du Maroc et exporter son vin, ses
agrumes et ses minerais par le port de Melilla ou par
Casablanca.
Dans ces régions, des « colons marocains » ont su moderniser
leurs exploitations, à l’image de certains de leurs compatriotes
du Rharb ou de la province de Casablanca. Ces agriculteurs
sont mécontents du pouvoir central qui, depuis
l’indépendance, a laissé s’accroître les coûts de production et
de commercialisation de leurs récoltes, sans les protéger
efficacement contre l’idéologie socialisante diffusée par les
Algériens. Cette situation conduira les élites locales des régions
les plus affectées par ces tensions à accuser l’Istiqlal, puis
l’UNFP, d’être à l’origine de leurs difficultés, et les poussera à se
rallier au Mouvement populaire. L’adhésion de l’ancien
président du Conseil, Bekkaï, à ce parti entraînera celle de
nombreux sympathisants originaires, comme lui, de Berkane.
La province d’Oujda a été la plus affectée par ces remous. A
Taza, en revanche, ce sont encore les séquelles de la révolte du
Rif de 1958 et l’héritage de l’Armée de libération qui
influencent le comportement des élites locales.
Oujda
La circonscription d’Oujda se limite à la ville d’Oujda. L’élu est
le secrétaire général de l’UGTM, Hachem Aminé. Il est
originaire d’Oujda, mais ne semble pas avoir des attaches très
précises avec la ville. Il bénéficiera, cependant, de l’aide de tout
l’appareil de l’Istiqlal. Son adversaire du FDIC est aussi un
Oujdi émigré, de formation moderne, Taïeb Belarbi, chef de
cabinet de Ahardane au Ministère de la défense, et directeur du
journal du Mouvement populaire après avoir été chef du
service de presse du Ministère de l’intérieur puis du cabinet
royal. Leur adversaire UNFP est un jeune professeur du collège
d’Oujda, ancien instituteur né dans la circonscription. Il
bénéficie de l’aide de l’UMT.
Dans la banlieue d’Oujda, qui constitue une circonscription
particulière, l’élu est l’inspecteur régional de l’Istiqlal. Il est né
à Oujda, et diplômé de Karaouyne. Il cumule toutes les
présidences d’associations qui lui permettent d’étendre son
réseau d’influence (association de parents d’élèves, société
musulmane de bienfaisance, association des anciens résistants,
ligue marocaine contre la tuberculose…).
Les circonscriptions de Berkane et d’Ahfir se partagent le massif
des Beni Snassen. Cette région est habitée par une population
en majorité berbère, qui ne trouve de débouchés qu’à
l’extérieur. Berkane a longtemps été dans la mouvance d’Oran.
Les colons français d’Algérie y avaient planté des vignes, des
agrumes et des primeurs qui s’exportaient par le port de
Nemours. Depuis l’indépendance, Melilla tend à remplacer le
port algérien. Ces deux circonscriptions élisent des candidats
FDIC qui doivent mener une bataille très serrée non seulement
contre les candidats Istiqlal et UNFP, mais aussi, dans la
circonscription d’Ahfir, contre certains membres de leur parti.
A Berkane, le fils du président Bekkaï, originaire de la
circonscription, l’emporte facilement. Il exploite, en agriculteur
moderne, les terres de sa famille (après avoir servi comme
lieutenant dans l’armée française puis dans les Forces armées
royales).
A Ahfir, Abdallah Louggouti, directeur du journal du
Mouvement populaire, El Maghreb el Arabi, originaire de la
circonscription, l’emporte. Ancien élève de la Karaouyne, il fit
partie de l’Armée de libération et fut nommé, après
l’indépendance, chef de cercle à Oujda-banlieue, puis dans la
province de Casablanca. Un autre membre de la direction du
Mouvement populaire lui est opposé, Thami Ouakili, rédacteur
en chef de la revue de la police, qui est contre la fusion de son
parti avec le FDIC.
Les circonscriptions de Taourit et des Hauts-Plateaux sont, à
bien des égards, le prolongement marocain du plateau intérieur
algérien. L’élevage nomade garde son importance autant dans
l’économie que dans le mode de vie. De rares oasis concentrent
les activités commerciales et administratives ; quelques
exploitations minières apportent des ressources
complémentaires, sans que les mineurs ne soient très intégrés
ni ethniquement ni politiquement à la vie du milieu
environnant. Les deux élus, l’un Istiqlal, l’autre FDIC, sont des
agriculteurs-commerçants bien enracinés dans la
circonscription. Ils l’emportent sur des candidats qui tirent leur
prestige et leurs ressources de leurs activités extérieures.
L’élu Istiqlal des Hauts-Plateaux est Un éleveur, président de la
commune rurale de Berguent. Il a été condamné, sous le
protectorat, pour activités nationalistes. Son frère est l’un des
chioukh influents de la région.
L’élu FDIC de Taourit est un agriculteur aisé, président du
conseil communal du chef-lieu et exploitant d’une ligne de car
d’intérêt local qui lui a été concédée en récompense de l’aide
apportée à l’Armée de libération.
Taza
La province de Taza constitue une coupe Nord-Sud à travers les
trois grandes régions du Maroc que nous avons étudiées. Les
circonscriptions d’Aknoul et de Taïneste appartiennent au bloc
berbère rifain, celle de Tahala au Moyen-Atlas. Les
circonscriptions de Taza et Oued Amlil, habitées par des
agriculteurs arabes, présentent certains caractères des grandes
plaines du Maroc utile. Guercif, enfin, peut se classer parmi les
régions pré-sahariennes. Cet ensemble, assez hétérogène, est
soumis à des attractions diverses. L’administration locale ne
semble pas l’avoir bien en main. Elle ne réussit ni à combattre
la pauvreté quasi générale, ni à imposer les contraintes
modernisantes qu’elle souhaiterait établir. Son influence s’en
trouve affaiblie.
L’élu de la circonscription de Taza est un agriculteur, secrétaire
local du parti de l’Istiqlal, diplômé de la Karaouyne. Militant de
longue date, il a été élu en 1960 président du conseil municipal
de Taza.
L’élu d’Oued Amlil est un gros agriculteur (300 hectares) et
exploitant forestier. Adjoint au président du conseil communal
et ancien militant de l’Istiqlal, il est élu comme neutre. Il
adhérera au FDIC aussitôt après son élection. Le président du
conseil communal d’Oued Amlil, candidat officiel du FDIC, est
un agriculteur moyen (26 hectares) dont le support électoral ne
dépasse guère l’audience de son milieu tribal d’origine.
La physionomie de la circonscription d’Aknoul est beaucoup
plus simple. L’élection du Dr Abdelfrim Khatib est acquise sans
difficultés. Khatib est ministre de la Santé. Il est aussi l’un des
fondateurs de l’Armée de libération, qui compte de nombreux
combattants originaires de la région d’Aknoul où elle remporta
ses succès les plus nets contre les troupes françaises. C’est aussi
dans cette région qu’éclata la révolte du Rif, en 1950, après
l’arrestation de Khatib et de Ahardane, lorsque le
gouvernement voulut s’opposer au transfert du corps de Si
Abbès, un des chefs de l’Armée de libération tué dans des
conditions mystérieuses après l’indépendance.
L’élu de Taïneste est un commerçant, secrétaire du bureau local
de l’Istiqlal, et président du conseil communal de Tahar Souk.
Il fut caïd de Tahar Souk dans les premiers temps de
l’indépendance. Il appartient à la famille d’un ancien
gouverneur de la province d’Oujda, issu de l’Armé de
libération. Homme pieux, il s’emploie à réunir les fonds
nécessaires pour la construction d’une mosquée dans sa
commune.
A Tahala, l’élu FDIC est un propriétaire de 50 hectares, ancien
caïd du protectorat qui fut démis de sa fonction en 1956. Il a
pris le maquis en 1958 lors de la révolte du Rif.
A Guercif — circonscription très étendue avec une population
dispersée — l’élu, de tendance neutre proche du FDIC, est un
propriétaire de 300 hectares, fils de caïd et ancien khalifa à
Berkine, de 1931 à 1955, puis président du conseil communal
en 1960.
La plupart du candidats et des élus de cette province donnent
une image traditionnelle des élites locales : influence
dominante des gros éleveurs ou des exploitants forestiers qui
s’accommodent mal des contraintes que l’administration
s’efforce d’établir pour le renouvellement des pâturages ou la
préservation de la forêt. Rares sont les candidats qui
appartiennent au groupe des agriculteurs modernes, qui se
trouve mieux représenté parmi les élites locales des provinces
voisines. Par ailleurs, l’influence de Fès et de l’Université
Karaouyne se fait particulièrement sentir, aussi bien chez les
ruraux que chez de nombreux fonctionnaires de culture
traditionnelle.
Notes du chapitre
[1] A cause du nombre de récepteurs mis en service dans les
villes et la portée des émetteurs.
[2] Voir J. Le Coz, Le Rharb, fellahs et colons, op. cit., p. 877-
921.
[3] Voir D. Noin, La population rurale du Maroc, op. cit., tome
2, p. 263.
[4] Voir M. Naciri, « Salé. Etude de géographie humaine »,
Revue de géographie du Maroc, 3-4,1963, p. 10-79.
[5] Le phénomène local a joué un certain rôle, en partie
négatif. La population a pu être mécontente d’avoir à choisir
encore entre deux notables symbolisant les luttes politiques
anciennes, dépassées en 1963.
[6] Voir A. Adam, Casablanca, Paris, CNRS, 1968, tome 2, p.
559 et suiv.
[7] Voir le rapport Boyer de Latour déjà cité. Ces
préoccupations apparaissent aussi dans R. Naissance du
prolétariat marocain, op. cit., p. 253 et suiv., et Révolution au
Maroc, op. cit., p. 263 et suiv.
[8] Il est intéressant de noter à cet égard que Abdallah
Ibrahim ne sera pas candidat et ne fera pas campagne.
[9] J.-F. Trouin montre qu’aux portes de Rabat les aires
d’influence des souks se déterminent en fonction des limites
tribales : « Marchés ruraux et influence urbaine dans l’arrière-
pays de Rabat », Revue de géographie du Maroc, 7,1965, p. 71-77.
[10] Ces circonscriptions sont les seules à être soumises à
l’influence commerciale directe de Rabat, limitée au Sud par
celle de Casablanca et au Nord par celle de Salé qui s’étend
jusqu’au Nord du Rharb et dans les Zemmours. Voir J.-F.
Trouin, « Marchés ruraux et influence urbaine dans l’arrière-
pays de Rabat », art. cité ; et M. Naciri, « Salé. Etude de
géographie humaine ». art. cité.
[11] Voir Marcel Lesne, Evolution d’un groupement berbère: tes
Zemmours, Rabat, (s.d.), [1960], 472 p.
[12] Le Coz, Le Rharb, fellahs et colons, op. cit., p. 793-817.
[13] Voir N. Bouderbala, « Quelques (tonnées élémentaires
sur l’évolution « tes structures agraires la plaine du Rharb »,
Revue de géographie du Maroc, 20,1971, p. 119-123. L’auteur
montre comment la disparition de la colonisation se fait en
partie au profit d’un capitalisme agraire national ayant assez
d’influence pour détourner à son profit les procédures
juridiques et l’aide financière die l’État (crédit, aide technique,
équipement externe et interne, fiscalité…). Les « colons
marocains ne font que reprendre, là, la politique de leurs
prédécesseurs européens ». N. Bouderbala insiste, en revanche
sur le développement d’un groupe de koulaks marocains, pour
la plupart notables villageois liés au Makhzen (chioukh,
moqqademin, commerçants et usuriers locaux). La Banque
mondiale voit d’un œil favorable le renforcement de cette
catégorie sociale relativement concurrente de la grosse
propriété marocaine.
[14] Voir E. Michaux-Bellaire, « La maison d’Ouezzane »,
Revue du monde musulman, 5 mai 1908, p. 23-89.
[15] Voir R. Fosset, D. Nouin, « Utilisation du sol et
population rurale dans les Doukkala », Revue de géographie du
Maroc, 10, 1960, p. 7-19.
[16] Voir R. Fosset, « Quelques aspects de la vie rurale dans
l’arrière-pays de Mohamedia (Basse-Chaouïa) », Revue de
géographie du Maroc, 13, 1968, p. 103-121.
[17] Voir « Trois petites villes de Chaouïa intérieure : Settat,
Benahmed, 0 Gara », compte rendu d’un mémoire de DES de
Mme S. Arriki, in Revue de géographie du Maroc, 10, 1966, p. 51-
54.
[18] Abderrahim Bouabid tint une réunion à Khouribga pour
soutenir sa candidature.
[19] Avec la commune de Aït Amar où se trouve une mine
de fer dont le personnel adhère à l’UMT.
[20] Ce candidat a été élu, en 1960, président de la
commune rurale du Souk el Arba des Maadna correspondant à
l’ancienne tribu.
[21] Voir J.-P. Houssel, « L’évolution récente de l’activité
industrielle de Fès », Revue de géographie du Maroc, 9, 1966, p.
59-84.
[22] Voir J.-F. Trouin, « Observations sur les souks de la
région d’Azrou et de Khenifra », Revue de géographie du Maroc, 3-
4, 1963, p. 109-120.
[23] Il est étonnant de voir à quel point tous les candidats de
cette circonscription, où les ouvriers des fermes de colonisation
tonnent la majorité des électeurs, correspondait aux critères
traditionnels.
[24] G. Beaudet, « Les Beni M’Guild du Nord. H tu de
géographique de l’évolution récente d’une confédération semi-
nomade », Revue de géographie du Maroc, 15,1969, voir p. 51 et
suiv.
[25] Les dirigeants de l’UNFP et de la Résistance ont voulu
transposer à leur profit la tactique employée par Mohamed V
lois de la révolte du Rif et de l’affaire Addi ou Bihi. Mais ils n
exerçaient pas le même type de contrôle sur les forces armées
que le roi, et un acte de révolte isolé ne pouvait modifier le
rapport des forces politiques. Cette opération, ainsi que le
projet d assassinat du prince héritier et de Laghzaoui, alors
directeur de la Sûreté, poussèrent Mohamed V à prendre
directement le contrôle du pouvoir, le 29 mai 1960.
[26] Sur le rôle des zaouïas en pays berbère voir E. Gellner,
Saints of the Atlas, Londres. Weidenfeld and Nicholson, 1969.
Troisième partie. Analyse
quantitative facteurs
d'appartenance au groupe des
élites locales
Présentation
Au moment où la plupart des sociologues étudient des
échantillons très élaborés, traiter l’ensemble d’un groupe
politique peut apparaître comme une anomalie. L’anomalie
semble encore plus grande lorsqu’on découvre que cette étude
est faite à partir de sources administratives auxquelles le
chercheur n’est pas enclin, a priori, à accorder une grande
confiance.
Que peut-on opposer à ces arguments ? En premier lieu, le fait
que l’enquête directe sur ce type de sujet sera difficile pendant
longtemps. Ce n’est qu’en s’intégrant au réseau administratif,
et en collaborant à ses objectifs particuliers, que cette enquête
sur les candidats a pu être menée. Les informations analysées
ont été collectées sur des fiches remplies par les services
provinciaux chargés de recueillir les candidatures aux élections.
La plupart des informations d’ordre général ont été demandées
aux candidats, puis complétées par les services administratifs et
politiques marocains Des informations complémentaires ont
été obtenues dans certains cas, et des vérifications
généralement concordantes ont été faites auprès d’autres
services. Enfin, l’enquête personnelle a permis, parfois,
d’affiner les informations rassemblées sur les candidats.
Cette démarche n’est pas fondamentalement différente de celle
de Douglas E. Ashford1 qui a étudié, en collaboration étroite
avec le parti de l’Istiqlal, les secrétaires des bureaux locaux de
ce parti. Un questionnaire détaillé établi en accord avec le
secrétariat général a été expédié à chacun des secrétaires sous
couvert des inspecteurs provinciaux. Ce questionnaire était
anonyme, mais l’origine des réponses pouvait facilement être
déterminée. Sur 1 200 secrétaires locaux, Ashford obtint 337
réponses et en utilisa pour son étude 93 seulement. Les autres
montraient que le questionnaire n’avait pas été compris ou
n’avait pas suscite l’intérêt de son destinataire. En des
domaines voisins, les travaux de Lucien Pye2 et Morroe Berger3
pouvent qu’il n’est pas tout à fait impossible d’utiliser une
organisation politique ou gouvernementale comme support
d’un travail de recherche.
Les données que nous analysons ont donc été recueillies en
mai-juin 1963 à partir d’un questionnaire établi en français et
adressé à tous les gouverneurs des provinces.
L’analyse porte sur 723 réponses, couvrant, à quelques unités
près, la totalité des candidats aux 144 sièges du Parlement
marocain. Ces réponses sont certes de qualité inégale. Elles ont
pu quelquefois être complétées par des souvenirs personnels ou
d’autres sources d’information. Il en résulte néanmoins une
certaine pauvreté de réponses pour un nombre important de
catégories du code qui a été délibérément établi de façon à
couvrir le plus grand nombre de rubriques possibles.
Ces réserves faites, on peut cependant estimer que les données
dont nous disposons constituent un ensemble unique
d’informations sur la classe politique marocaine. Le mode de
scrutin, le climat politique peuvent nous autoriser à faire
l’hypothèse suivant laquelle les candidats représentent en
milieu rural le groupe des nouveaux notables dont nous avons
analysé les rapports avec la monarchie dans la première partie
de cet ouvrage.
Il n’est pas paradoxal à cet égard de considérer que les
candidats de l’opposition font partie du système des élites
locales, au même titre que ceux de la majorité
gouvernementale. La seconde partie de cette étude a montré
que l’affiliation politique des notables n’avait guère de bases
idéologiques au point que certains gouverneurs parlaient à leur
sujet de transhumance politique. Moins de six mois avant le
scrutin, l’Istiqlal faisait encore figure de parti gouvernemental,
et il était honorable sur le plan local de se prévaloir de son
affiliation. L’UNFP a aussi vu ses militants participer au pouvoir
local dans le cadre de l’Istiqlal avant la scission de 1959, et
même encore après, pendant le gouvernement de Abdallah
Ibrahim. Les adhérents du FDIC proviennent, comme nous le
verrons, de militants d’autres partis qui ont su, le moment
venu, abandonner leur affiliation antérieure pour conserver ou
même accroître leur situation sociale.
L appartenance politique des élites locales se décide souvent
plus en fonction des rivalités à l’intérieur des groupes, dans la
lutte pour le prestige social et le contrôle des ressources, que
sur la base de choix idéologiques définis. Cette situation
explique, pour une large part, les phénomènes de transfert que
nous avons évoqués plus haut. Elle explique aussi le fait que
l’administration, en choisissant de s’appuyer sur un groupe
d’intermédiaires pour gouverner la population, mécontente
nécessairement les rivaux de ceux qu’elle a investis, et en fait
des opposants potentiels. L’alternance est alors le seul remède
pour maintenir les opposants dans le système. A ce niveau, les
rapports entre l’administration et les élites locales s’établissent
plus suivant le modèle d’une société segmentaire manipulée
par un pouvoir extérieur4, qu’en termes de classes sociales. A
l’échelle de la société globale, il semblerait préférable d’inverser
la proposition. La vision des différents types d’élites locales, et
l’aperçu de leur stratégie de relations avec le pouvoir central
permettent d’aborder l’étude quantitative avec plus de
nuances. Mais lorsqu’on parle d’intellectuels traditionnels, les
données quantitatives amèneront à classer dans une même
catégorie des hommes comme le fquih Basri et des notables
ruraux, propriétaires fonciers et chefs religieux locaux dont les
fonctions sociales ont peu de choses en commun. Nous
retrouvons à ce niveau de nombreux exemples de
différenciations, d’évolutions des mentalités qui font que les
classements par des critères objectifs peuvent masquer des
différences profondes et, pour le moins, ne pas rendre compte
du mélange conflictuel et évolutif que recèlent les situations et
les personnalités. Il n’est plus rare de voir un caïd de formation
traditionnelle se mettre au courant de l’hydraulique, ou un
technicien d’Office rural acquérir une forme d’autorité qui
avait été le privilège traditionnel du caïd. Il est donc difficile de
parler de groupes homogènes. A l’inverse, il n’est pas possible
d’étudier ici les phénomènes de participation individuelle,
comme électeur ou citoyen, mais plutôt de tenter d’analyser les
facteurs qui peuvent pousser un candidat à se déclarer
candidat, ou peuvent l’amener à être investi par un parti. Dans
la plupart des cas, un candidat n’aura l’audace de tenter
l’aventure de l’élection que s’il appartient à un groupe. Il
s’agira tantôt d’un lignage ou d’un ensemble de lignages, dont
il sera le héraut, s’opposant aux candidats des lignages voisins.
Dans ce cas, les candidatures peuvent très bien n’avoir été
suscitées que pour soutenir une concurrence fondée sur des
rivalités fort anciennes. Le candidat peut appartenir à un
groupe socio-professionnel qui le pousse en avant. Il peut s’agir
tantôt d’un ensemble d’agriculteurs modernes, réunis au sein
d’une coopérative, tantôt de membres des professions libérales
ou de fonctionnaires qui constituent l’intelligentsia d’une
petite ville, d’anciens résistants ou d’oulémas. Les
commerçants, par leurs relations d’affaires et leur clientèle,
sont aussi l’émanation d’un groupe. L’investiture officielle d’un
parti vient souvent sanctionner cette désignation initiale par le
groupe. Elle la précède rarement, et, curieusement, les partis les
mieux organisés comme l’UNFP et l’Istiqlal pratiquent assez
souvent ce genre de désignation. Le FDIC, qui aurait trop
tendance à négliger cette prudence élémentaire, aura souvent à
s’en repentir.
Il ne faudrait pas cependant nier le fait que la détermination
individuelle est en train de susciter des réactions et de motiver
des conduites, dans un certain nombre de cas, tant chez les
candidats que chez les électeurs. Lorsque, dans la montagne de
Beni Mellal5, dans un pays berbère, l’UNFP présente un
candidat d’origine arabe, et obtient un nombre de voix
respectable, doit-on en déduire que l’on se trouve en face d’un
phénomène de participation politique rationnelle ou d’une
fausse manœuvre ? Mais de tels exemples restent l’exception
par rapport à ceux qui illustrent des comportements de
solidarité traditionnelle, même en milieu urbain. La masse
politique est trop peu différenciée pour que la participation
individuelle — participation électorale ou candidature — ait un
sens, et les méthodes de propagande électorales apparaissent
inadaptées, qu’il s’agisse du tract, de l’affiche, et, en dehors des
grandes villes, du meeting populaire.
Lorsqu’un leader politique national se déplace pour mener une
action de propagande, son premier souci est de trouver l’appui
d’un notable local qui l’invitera à rencontrer d’autres notables
autour d’un couscous, d’un méchoui ou d’un verre de thé. S’il
ne trouve pas ce type d’accueil et d’hospitalité, il n’aura de
contacts qu’avec des isolés — les fonctionnaires locaux,
postiers, instituteurs, infirmiers — déjà acquis à la participation
politique, mais sans grand rayonnement. L’action politique fait
donc partie des facteurs qui réaffirment la solidarité du groupe,
et le candidat, ne serait-ce que par peur du ridicule, n’osera pas
se déclarer tel sans un certain consensus de groupe. Cela ne
signifie pas que dans une communauté donnée ce seront
toujours les éléments les plus représentatifs qui feront acte de
candidature. Certains ne voudront pas compromettre un
prestige acquis et assuré ; d’autres attendront d’être sollicités
avant d’accepter de poser leur candidature. Mais, comme le
montre l’analyse des données, les facteurs sociaux, la richesse,
la conformité avec des critères de la morale et de la culture
traditionnelle constituent les caractéristiques communes des
candidats et des élus. Si la candidature résulte souvent d’une
auto-investiture, encore faut-il que l’individu présente une
image collective acceptable pour ne pas tomber sous le coup
d’un système de sanctions informelles mais efficaces.
Notes du chapitre
[1] Perspectives of a Moroccan nationalist, Totawa, Bedminster
Press, 1964, 171 p.
[2] Guerrilla communism in Malaya, Princeton, Princeton
University Press, 1956.
[3] Bureaucracy and society in modern Egypt, Princeton,
Princeton University Press, 1957.
[4] J. Waterbury, Le commandeur des croyants. La monarchie
marocaine et son élite, Paris, Presses universitaires de France,
1975.
[5] Dans la circonscription de Ouaouizarth, un instituteur né
à Beni Mellal, ne parlant qu’arabe, obtient cependant le quart
des suffrages exprimés en face du candidat FDIC qui remporte
avec plus de 40 % des voix.
Chapitre VIII. L’âge, facteur ambigu
Dans la société islamique, l’âge est une source de prestige
social certain. L’assemblée la plus spontanée du système
politique marocain, la jemaa de douar, est d’abord une
assemblée des chefs de foyer les plus âgés, chargés de
représenter la communauté villageoise. Dans la famille ou dans
la vie publique, manquer aux principes de déférence envers des
personnes plus âgées est sévèrement jugé. L’autorité d’un père,
d’un oncle ou d’un frère aîné s’exercera sur une famille, même
si les membres plus jeunes ont une instruction plus poussée qui
justifierait une plus grande autonomie. Dans la vie publique,
l’âge n’est pas une condition suffisante pour exercer l’autorité
politique. Il est souvent une condition nécessaire[1]. Un des plus
grands reproches formulés par les ruraux à l’égard des premiers
administrateurs locaux marocains mis en place par l’Istiqlal
après l’indépendance, portait justement sur leur jeunesse : « Ce
sont des enfants », disaient-ils, et ils avaient quelques
réticences à accorder le respect et l’obéissance à ceux que le
pouvoir avait eu la légèreté d’investir des fonctions de caïd ou
de chef de cercle.
L’âge sera donc un des facteurs dans la désignation des
candidats, surtout lorsque les mécanismes de participation
joueront à la base, dans les divers partis. Les états-majors
nationaux seront parfois tentés de passer outre à ces
considérations, avec plus ou moins de bonheur, suivant les
partis. Certes, l’âge moyen des candidats s’établit entre 31 et 40
ans (42 %), avec un plus grand nombre de candidats proches
de la quarantaine. Mais les candidats de moins de 30 ans
représentent 13% du total[2]. Seuls l’UNFP et les neutres ont,
avec 16 % et 19 %, des taux supérieurs à la moyenne ; mais
l’UNFP choisissait délibérément des candidats jeunes ayant
reçu une éducation moderne ; et les neutres étaient souvent des
candidats, évincés par les états-majors ou par les responsables
locaux des partis en raison de leur jeunesse, qui décidaient de
tenter quand même, en isolés, l’aventure électorale.
Age et affiliation politique des candidats
Le groupe de 30 à 50 ans réunit 71 % des candidats avec un âge
moyen de 38 ans, sans de très nettes différences entre les
grands partis. En revanche, dans les deux groupes extrêmes,
moins de 30 ans et plus de 50 ans, l’UNFP se signale par une
distribution nettement plus jeune que la moyenne nationale, le
FDIC par un pourcentage plus important de candidats âgés,
alors que l’Istiqlal suit de très près la distribution moyenne.
Avant de pousser plus loin l’analyse, on peut déjà faire
quelques remarques sur cette distribution. Si l’on considère un
candidat moyen, âgé de 38 ans en 1963, on peut estimer qu’il a
pu prendre conscience des problèmes politiques entre 1942 et
1944, à l’âge de 18-20 ans. Le débarquement américain, un
certain renouveau du nationalisme, le Manifeste de l’Istiqlal et
la répression qui suivit, la conférence d’Anfa peuvent former la
toile de fond de cette période. Notre candidat a dû suivre
l’enseignement primaire des collèges franco-musulmans dans
les années trente s’il a eu la chance d appartenir à la minorité
qui pouvait alors avoir accès à cet enseignement. Il a plus
vraisemblablement suivi l’enseignement d’une Karaouyne qui
faisait alors quelques efforts pour se moderniser[3], ou encore
celui des écoles libres. Son âge ne lui aura pas permis de faire
partie du groupe des notables du protectorat. Il a, au contraire,
toutes les chances d’avoir été sensibilisé à l’action nationaliste
qui coïncide alors avec sa période de maturité. En 1947, lors du
discours de Tanger, ce candidat avait 23 ans. Il en avait 28 en
1952, lors des émeutes de Casablanca[4]. L’exil de Mohamed V
se produisit lorsqu’il avait 29 ans, et l’indépendance le trouve
âgé de 32 ans. Cette simple juxtaposition de dates laisse
supposer que notre candidat n’aura guère exercé de
responsabilités du temps du protectorat, mais, en revanche,
aura été vivement sollicité par l’engagement nationaliste au
cours de sa jeunesse, et à un moment où des responsabilités
familiales ou personnelles ne pouvaient pas encore l’éloigner
de l’action militante.
La tentation de l’action militante a dû être encore plus grande
pour le groupe des moins de 30 ans qui représente 13% du
total. L’exil de Mohamed V les touche alors qu’ils atteignent
leur vingtième année, et l’indépendance survient à un moment
où ils peuvent tout juste exercer des responsabilités.
Seuls certains membres du groupe d’âge de 41 à 50 ans, et
surtout les candidats de plus de 50 ans, ont pu avoir une
expérience plus poussée de la vie sous le protectorat, et de la
collaboration avec l’administration française. Pour reprendre le
calendrier historique utilisé précédemment, il apparaît qu’un
candidat âgé de 50 ans en 1963 a été éduqué dans les années
vingt, avec de plus grandes chances d’avoir suivi un
enseignement de type traditionnel que de type franco-arabe. Il
avait 30 ans en 1942, lors du débarquement, 32 ans lors du
manifeste de l’Istiqlal, 35 ans lors du discours de Tanger, 41 ans
lors de l’exil de Mohamed V, et 44 ans à l’indépendance. C’est
dans ce groupe que se trouveront les militants nationalistes les
plus confirmés (action politique affermie par les épreuves et
souvent par la prison) et aussi ceux qui ont acquis une
influence sociale grâce à une certaine coopération avec les
autorités du protectorat (sans aller jusqu’au point de faire d’eux
des traîtres à la cause nationale). L’indépendance a marqué
pour eux un temps d’éclipse, mais avec la convocation du
Parlement ils retrouvent un rôle politique.
Il en est de même de certains militants appartenant au même
groupe d’âge, éclipsés dans les années qui ont suivi
l’indépendance par des hommes plus jeunes qui avaient reçu
une éducation de type français, et étaient aussi plus aptes à
occuper les emplois bureaucratiques laissés vacants par le
départ du colonisateur. Ces militants de formation
traditionnelle étaient cantonnés dans l’appareil du Parti
nationaliste, ou dans les fonctions mineures et sans prestige de
la bureaucratie. Ce n’est pas sans amertune qu’ils se voyaient
éclipsés par les jeunes ambitieux de l’administration, qui
n’avaient généralement pas un passé de militant comparable
au leur. A cet égard, la répartition des candidats suivant l’âge et
la nature de la circonscription fait apparaître certaines
différences significatives. Les candidats de moins de 30 ans
sont proportionnellement moins nombreux dans les
circonscriptions semi-urbaines où une ville de moyenne
importance a été groupée avec quelques communes rurales. Les
candidats de 31 à 40 ans sont investis principalement dans les
circonscriptions urbaines, alors que le groupe de 41 à 50 ans
obtient une représentation légèrement meilleure dans les
circonscriptions rurales. A l’inverse, les candidats âgés de plus
de 51 ans se rencontrent plus dans les circonscriptions
urbaines.
Ces variations discontinues peuvent être interprétées de la
façon suivante.
Les candidats jeunes, généralement diplômés, n’ont pas été
investis par les partis dans les circonscriptions urbaines où on
leur a préféré des candidats plus connus à l’échelle nationale.
Dans les circonscriptions rurales, les candidats plus âgés, de
formation traditionnelle, étaient plus facilement retenus par les
comités locaux des partis. Restait aux jeunes candidats les
circonscriptions semi-urbaines où certains avaient exercé des
responsabilités administratives dans les premières années de
l’indépendance, et où d’autres jouissaient de quelque influence
familiale.
Les candidats de 31 à 40 ans avaient généralement un passé
nationaliste plus marqué que leurs cadets et une éducation
moderne qui favorisait leur candidature en milieu urbain. Leurs
aînés du groupe 41-50 ans manquaient le plus souvent
d’éducation moderne et devaient plutôt s’orienter vers les
circonscriptions rurales. Enfin, dans le groupe de plus de 50
ans, on comptait un certain nombre de vieux militants
nationalistes qui appartenaient déjà à l’élite politique
nationale.
D’autres éléments concernant l’éducation des candidats et leur
participation à la vie politique nationale peuvent nous aider à
préciser ce point.
Le taux d’alphabétisation des candidats décroît régulièrement à
mesure que leur âge s’élève, passant de 97 % pour les moins de
30 ans à 81 % pour les plus de 50 ans. Ces indications
recouvrent des différences assez marquées suivant les groupes
d’âge et les langues parlées, laissant apparaître le poids de la
formation traditionnelle pour la grande majorité des candidats
— même dans les groupes relativement jeunes. Cela pourrait
s’expliquer par la présence, dans le Mouvement nationaliste,
avant l’indépendance, d’une forte proportion de jeunes
arabophones qui l’emportent largement, dans la classe d’âge de
31 à 40 ans, sur les éléments politisés de culture française ou
d’origine berbère. Le phénomène de transposition au niveau
des élites locales, en 1963, peut être accentué par le fait que les
jeunes bilingues ont pu, après l’indépendance, avoir d’autres
perspectives de carrière, et, ainsi, sortir du groupe des élites
locales ; le poids des arabisants est devenu plus important. Si
l’on considère la connaissance des langues étrangères, seul le
groupe des moins de 30 ans compte une majorité (63 %) de
bilingues (la langue étrangère étant, le plus souvent, le
français). Ce pourcentage est nettement supérieur à celui de la
population de même âge connaissant le français[5] (7 %). Pour
les groupes plus âgés, le taux de bilinguisme atteint 39 %, et
pour le groupe des candidats âgés de plus de 50 ans il n’est que
de 29 % (pour les groupes correspondants de la population
totale, ces taux n’atteindraient respectivement que 4 % et 3 %).
Par ailleurs, on constate une diminution, en fonction de la
jeunesse, du bilinguisme arabo-berbère qui passe de 29 % chez
les plus de 50 ans à 12 % chez les moins de 30 ans.
En résumé, seul le groupe des moins de 30 ans présente une
structure bien particulière. Les arabophones et les
berbérophones connaissant également le français l’emportent
nettement sur les membres du groupe de culture traditionnelle.
Dans les autres groupes d’âge, ceux qui ont une certaine
connaissance des langues étrangères représentent à peine la
moitié de ceux qui ne parlent qu’arabe ou arabe et berbère.
Les données concernant les langues écrites accentuent ces
tendances. Le groupe des moins de 30 ans est nettement isolé
par rapport aux autres groupes. Le bilinguisme (arabe et
français) s’élève à 47 %, alors qu’il n’est que de 27 % dans le
groupe de 31 à 40 ans, et décroît régulièrement jusqu’à 12 %
dans la dernière classe d’âge. A partir de 30 ans, la majorité
absolue des candidats n’écrivent que l’arabe.
Cette prééminence de la culture traditionnelle parmi les
candidats plus âgés pourrait s’expliquer une fois de plus par
leur rôle dans le Mouvement nationaliste et leur mise à l’écart
relative dans les premières années de l’indépendance.
L’élection est pour eux l’occasion de retrouver un rôle à la
mesure de leur participation à la lutte pour l’indépendance.
Elle est aussi, pour le groupe des jeunes candidats de culture
française, un raccourci pour accéder à la classe politique, en
essayant de court-circuiter leurs aînés qui étaient là avant eux
pour ramasser les dépouilles du colonisateur. En revanche,
dans les provinces du Nord, la rupture avec les élites anciennes
est moins nette, et l’on trouve des bilingues arabe-espagnol
plus âgés que les bilingues arabe-français.
Ces hypothèses semblent confirmées par l’analyse des données
concernant les candidats issus de l’enseignement secondaire.
Leur importance dans leur groupe d’âge respectif s’accroît
nettement en fonction de la jeunesse. Mais les candidats issus
des vieux lycées comme Moulay Idriss de Fès, Moulay Youssef
de Rabat, et celui d’Azrou sont même plus âgés en moyenne
que les candidats issus de Karaouyne. Ce sont en fait les
candidats issus des lycées moins prestigieux de l’intérieur, et
des collèges, qui rétablissent l’équilibre en faveur de la
jeunesse.
L’âge est donc, comme on le laissait prévoir, un des facteurs
majeurs du prestige et de l’engagement politiques. Mais ce
facteur interfère avec d’autres données essentielles, en
particulier l’éducation. Son interprétation est donc difficile à
isoler. Il reste vrai que dans ce pays, où près de la moitié de la
population comptait, en 1960, moins de 20 ans, la politique
locale reste le fait des hommes de 40 ans et plus, mais l’étude
de l’âge des candidats montre bien qu’une nouvelle, génération
d’élites locales s’est imposée après l’indépendance, sauf peut-
être en zone Nord où la rupture avec le passé a été moins
grande. Les hommes du changement ont été, dans l’ensemble,
de jeunes nationalistes de culture traditionnelle qui sont venus
à l’activité politique à la fin du protectorat, soit avec l’exil du
sultan, soit, au plus tard, avec l’essor du nationalisme (à la fin
de la seconde guerre mondiale). Leur inaptitude à s’intégrer
dans le système du protectorat a pu jouer un rôle dans leur
révolte. Par la suite, leur formation les a empêchés de s’intégrer
de façon durable dans les structures bureaucratiques du nouvel
État, entraînant leur repli dans les fonctions d’intermédiaires
locaux, ménagés par le pouvoir. Mais on voit déjà poindre un
nouveau groupe plus jeune, de formation française, qui tente
de leur contester ce rôle pour arriver plus vite aux fonctions
politiques supérieures. Ces fonctions sont monopolisées,
depuis l’indépendance, par le groupe des nationalistes de
culture française, mis en place par l’Istiqlal et récupéré, ensuite,
par la monarchie.
En résumé, si l’âge est un indicateur important, son
interprétation relève de l’analyse d’autres facteurs tels que
l’éducation ou la participation nationale. Il est donc intéressant
de l’isoler, mais les comparaisons risquent d’être hasardeuses
dans la mesure où cette variable est trop dépendante d’autres
données. L’utilisation méthodologique de l’âge doit donc être
entreprise avec précaution.
Sur le plan strictement politique, la différence entre les partis
n’est pas dans l’ensemble très nette, mis à part le fait que les
candidats UNFP sont plus jeunes que ceux du FDIC. Les
différences entre classes d’âge semblent donc plus marquées
que les différences entre partis à l’intérieur de la même classe
d’âge. Il est intéressant de noter enfin que l’âge n’est pas un
facteur de différenciation sensible entre candidats et élus.
Notes du chapitre
[1] Dans les pays musulmans, 40 ans est l’âge de sagesse et
de maturité.
[2] Dans l’étude de D. E. Ashford, Perspectives of a Moroccan
nationatist, op. cit., p. 10, l’âge moyen des secrétaires locaux de
l’Istiqlal est comparable, mais la répartition rat différente. On
trouve 42 % entre 31 et 40 ans, mais 20 % de moins de 30 ans
et 38 % de plus de 40 ans.
[3] Voir J. Berque « Dans le Maroc nouveau, le rôle d’une
université islamique », art. cité.
[4] Voir S. Bernant, Maroc 1943-1956. Le conflit franco-
marocain, op. cit., tome 1, p. 135.
[5] Voir La consommation et tes dépenses des minages marocains
musulmans, Rabat, Service central des statistiques, 1961, p. 82.
Chapitre IX. L’éducation, facteur de
différenciation entre les divers types d’élites
Pour analyser l’influence de l’éducation sur l’appartenance
aux élites locales on peut utiliser plusieurs types d’approches.
L’éducation est un facteur aussi significatif et presque aussi
ambigu que l’âge. Il ne suffit pas de s’attacher à étudier le
passage par les écoles modernes qui garantirait, à divers
niveaux, la possession d’un savoir et de techniques favorables à
l’accomplissement de certains rôles sociaux. Ces facteurs jouent
certes un rôle important et sans doute croissant dans le système
des élites locales. Mais dans un pays où l’on compte 93 %
d’analphabètes dans les campagnes[1], on doit s’efforcer de
saisir l’influence de l’éducation sous un angle moins formel. La
connaissance des langues parlées et écrites au Maroc,
notamment celle des langues étrangères, dont l’apprentissage
pouvait se faire par le contact des communautés, sans passer
par l’institution scolaire, est un facteur important pouvant
faciliter ou gêner les communications entre les individus. La
connaissance du français ou de l’espagnol permet ainsi
d’écouter les radios ou de lire les journaux étrangers, d’entrer
en relation avec les étrangers vivant dans le pays, et d’avoir
donc des sources d’information plus diversifiées que celles
qu’offre la seule culture arabe. Dans un pays où les
communautés étrangères jouent encore, en 1963, un rôle
économique dominant, la connaissance des langues permet de
participer comme intermédiaire à ces activités.
Les facteurs culturels peuvent donc être envisagés d’abord sous
l’angle des facilités qu’ils procurent ou des limitations qu’ils
imposent dans le domaine des communications entre élites et
masses.
On peut classer à cet égard les candidats en plusieurs groupes
que l’on étudiera par la suite en détail en prenant comme
critère l’alphabétisation, les langues parlées, puis la
fréquentation des institutions scolaires avec une spécialisation
de plus en plus poussée.
Plus on s’élève dans l’échelle des connaissances techniques
spécialisées — enseignement secondaire ou supérieur de type
étranger — plus il est difficile de communiquer avec la masse
composée d’analphabètes de culture traditionnelle. On ne peut
pas cependant en déduire que les candidats analphètes ont les
possibilités de communication les plus larges. Les meilleures
conditions de communication semblent se situer au niveau
moyen de l’intégration aux institutions scolaires. Deux types
d’intermédiaires semblent se dégager. Le premier est
l’intellectuel passé (même rapidement) par les universités
traditionnelles. Son langage, son système de valeurs lui
permettent la plus large communication avec les masses,
surtout en milieu rural, lorsque leur mode de vie n’a pas encore
été trop bouleversé par le progrès technique. Ce type’
d’intellectuel traditionnel a déjà été en contact avec la
civilisation technique. En ville, il a pu apprendre un peu de
français ou d’espagnol, observer le genre de vie des étrangers. Il
a déjà opéré pour lui-même une synthèse dont il peut faire
bénéficier, en partie, ceux qui ne sont pas encore à son niveau.
Le second type d’intermédiaire est l’intellectuel moderne dont
le savoir, acquis auprès des étrangers, n’a pas atteint un niveau
tel qu’il bouleverse son genre de vie et son langage. Il lui est
encore possible, s’il s’en donne la peine, d’établir une
communication avec les ruraux. Mais l’accord sera dans ce cas
moins fréquent et moins naturel que dans le cas précédent.
Qu’il soit postier, infirmier ou instituteur, il devra, avant
d’acquérir une influence de masse, être accepté dans le milieu
où il s’est établi, faire la preuve que son système personnel de
valeurs n’est pas incompatible avec celui du groupe. En 1963,
ce type d’intermédiaire était très rare : les cadres moyens du
protectorat avaient été absorbés par le système bureaucratique,
et les nouveaux intellectuels modernes, formés depuis
l’indépendance, n’avaient eu ni le temps ni la volonté de
s’intégrer au milieu rural.
Parfois, le phénomène est plus sensible dans les petites villes ou
dans les zones d’agriculture moderne intensive qu’en milieu
rural traditionnel ; l’inquiétude d’une population, qui
commence à être sensibilisée à des transformations de son
cadre de vie, rejoint les préoccupations d’intellectuels modestes
de formation moderne. Ces derniers ont réfléchi sur l’évolution
qu’ils subissent, ont trouvé pour eux-mêmes des solutions
provisoirement équilibrées et sont assez ouverts vers l’extérieur
pour tenter de les faire partager par leur entourage. Si l’accord
entre ce type d’homme et son milieu d’accueil s’établit, son
influence risque d’être plus grande et plus durable que celle de
l’intellectuel traditionnel.
Avant de passer à l’analyse des données sur l’éducation, il faut
faire ressortir un point important valable pour les intellectuels
traditionnels, mais encore plus pour les intellectuels modernes.
Fréquenter des institutions scolaires ce n’est pas simplement
s’intégrer à un type de culture, c’est aussi faire partie des
groupes solidaires d’autant plus forts que les élites instruites
sont rares. Ce facteur de solidarité, relativement secondaire
pour ceux qui ont fréquenté les établissements traditionnels,
devient primordial pour les anciens élèves des écoles primaires
et des collèges du protectorat, qui ont longtemps vécu
ensemble en internats, coupés de leur milieu d’origine. Il crée,
chez ces anciens élèves, des liens qui dépassent les liens sociaux
et politiques. Ces liens permettront à un ancien élève des
établissements secondaires d’établir des relations directes avec
le haut fonctionnaire ou le ministre, ancien élève comme lui.
Par ce biais, les élites locales modernes peuvent entrer plus
facilement en relation avec les élites nationales.
Il est donc délicat, lorsqu’on analyse les données relatives à
l’éducation, de préciser dans quelle mesure intervient l’une des
composantes de ce facteur d’influence. S’agit-il de la facilité à
faire passer un message en milieu populaire, due à la culture
traditionnelle, de l’influence d’un savoir technique moderne,
ou de solidarités anciennes ? Seule l’analyse prudente des
composantes devrait nous permettre de préciser ces
hypothèses.
Les langues parlées
L’étude des langues parlées par les candidats est intéressante à
un double point de vue. Elle fournit tout d’abord un indice
complémentaire de l’importance des influences étrangères, si
l’on rapproche ces informations de celles que nous pouvons
extraire des données sur l’enseignement. Mais la fréquence des
langues étrangères parlées concerne encore un ensemble de
candidats plus large que celui que nous avons étudié à partir
des données sur l’éducation : il est des candidats — anciens
militaires ou commerçants, par exemple — qui ont acquis la
connaissance de ces langues au cours de leur vie de travail sans
avoir suivi aucun enseignement (ou, à la rigueur, celui de
l’école coranique).
Un autre facteur particulièrement intéressant concerne les
candidats recensés comme parlant le berbère. Tout ce qui
touche au berbère a toujours été, avant comme après
l’indépendance, chargé d’une profonde affectivité politique.
On a pu voir, précédemment, comment le problème berbère se
posait depuis l’indépendance. Les nationalistes avaient trop
souvent tendance à nier l’existence d’un fait berbère. La
monarchie reprenait par certains côtés et sans l’avouer la
politique berbère du protectorat. Quant aux leaders politiques
marocains appartenant au milieu berbère, leur attitude à
l’égard de leur communauté d’origine hésitait entre la négation
complète de tout particularisme et l’affirmation d’un
berbérisme. Il est d’autant plus intéressant de mesurer
l’influence relative du facteur berbère parmi les élites locales.
Le trilingue, arabe-français-berbère, représente près de 8 % des
candidats à l’échelle nationale[2]. Mais dans la province
d’Agadir on compte 25 % de candidats trilingues, 17 % à
Meknès et à Ksar es Souk, 16 % à Beni Mellal, 12 % à Oujda, et
10 % à Taza et Rabat.
L’étude de la répartition par langues parlées montre en premier
lieu que 60 % des candidats ne parlent aucune langue
étrangère. Dans les provinces de Marrakech, Casablanca et Fès
on trouve plus de 60 % de candidats parlant uniquement
l’arabe. Ce pourcentage approche encore du tiers des candidats
dans les provinces de Beni Mellal, Ksar es Souk, Meknès, Oujda,
Rabat, Taza et même à la préfecture de Casablanca.
Les candidats ne parlant qu’arabe et berbère sont
particulièrement nombreux dans les provinces du Sud et du
Centre du pays. Seule la province de Tanger compte 60 % de
candidats parlant à la fois arabe, français et espagnol. La
moyenne nationale pour l’arabe et le français est de 20 %, mais
la préfecture de Rabat compte 77 % de bilingues et celle de
Casablanca 53%. Puis suivent les provinces du littoral
atlantique, Fès et l’Oriental proche de l’Algérie.
Répartition, par provinces, des langues parlées par les candidats
La moyenne nationale de bilinguisme arabe-espagnol s’établit à
4,3 % avec de fortes différences géographiques, les provinces
du Nord comptant la quasi-totalité de ce type de candidats.
L’examen de ces répartitions linguistiques suggère l’existence
de zones géographiques que nous avons déjà rencontrées.
Tout d’abord l’ex-zone Nord ; cette zone possède à la fois une
forte homogénéité arabo-berbère et une ouverture sur la culture
moderne, grâce à l’espagnol, nettement plus répandu parmi les
élites locales que le français ne l’est dans le Sud. Ce phénomène
ne s’explique pas par un effort de scolarisation plus poussé de
la part de l’Espagne, ni par une colonisation plus dense, surtout
dans les régions montagneuses du Rif. Trois facteurs que nous
avons déjà exposés peuvent avoir joué. Tout d’abord, il n’y a
pas eu en zone Nord de rupture de continuité due à la lutte
nationale. Si quelques administrateurs maladroits originaires
du Sud ont écarté les collaborateurs locaux des Espagnols, la
plupart des nouveaux caïds s’en sont largement accommodés,
d’autant plus que les anciens chioukh ou élus locaux gardaient
la confiance des populations.
Un autre facteur, plus difficile à peser, est l’influence de la
colonisation espagnole, plus modeste et plus intimement
mêlée par son genre de vie aux Marocains que ne l’était la
colonisation française dans le Sud. Des îlots de contact anciens
comme les « présides » de Ceuta et Melilla, ainsi que Tanger
jouaient de longue date le rôle de centres commerciaux
régionaux et de lieux d’échanges culturels, sans que ces
échanges soient liés à une fréquentation scolaire. L’armée
espagnole, qui a énormément recruté dans le Rif pendant la
guerre civile, a également été un facteur de présence
linguistique dans la mesure où ses anciens soldats s’intégraient,
par la suite, à l’administration ou au commerce.
Le groupe berbère semble particulièrement puissant dans des
provinces de Nador et de Al Hoceima qui comptent l’une et
l’autre plus de 85% de candidats berbérophones. En revanche,
dans la province de Tétouan ces candidats ne représentent que
6% du total local. Pour les deux premières provinces, le facteur
berbère constitue donc un élément déterminant au niveau des
élites locales. La révolte de 1958, et plus loin celle d’Abdel-Krim
y ont trouvé la base de leur cohésion, alors que ces
mouvements n’ont jamais réussi à mordre longtemps sur la
province de Tétouan. En revanche, à l’échelle des trois
provinces et même cette fois des quatre, en y comprenant
Tanger, l’espagnol semble le facteur culturel dominant. La
pratique de cette langue ne semble pas être une source de
conflits avec l’arabe (conflits comparables à ceux que l’on
constate dans le reste du pays entre le français et la langue
nationale). Au contraire, l’espagnol est largement pratiqué par
les élites locales traditionnelles ; en fait, ces élites sont en
conflit avec les élites modernes francisées, originaires de l’ex-
zone Sud, qui tentent d’imposer, depuis l’indépendance, un
modèle administratif et culturel qui exclut les premières.
Le groupe des provinces du Sud est aussi nettement différencié
mais moins homogène. Il se distingue par un très fort
isolement traditionaliste à Marrakech et à Ouarzazate, où 80 %
(Marrakech) et 100 % (Ouarzazate) des candidats ignorent le
français. Agadir et Ksar es Souk dépassent 60 %.
Le facteur berbère semble aussi jouer un rôle important dans ce
groupe de provinces que caractérise une prédominance du
traditionalisme. A vrai dire, les élites locales de la province de
Marrakech (qui joue là un rôle assez comparable à celui de
Tétouan en zone Nord) sont nettement plus arabisées que
celles de sa zone d’influence. Le groupe berbère ne constitue
pas un tout homogène : on trouve à Ouarzazate une presque
totalité de candidats bilingues (arabe-berbère), tandis que
Agadir et Ksar es Souk connaissent un pourcentage significatif
de candidats trilingues (arabe-français-berbère).
Dans le groupe des traditionalistes, les arabophones
l’emportent nettement à Marrakech, et légèrement à Ksar es
Souk ; les berbérophones dominent ce groupe à Ouarzazate et
Agadir. Mais on ne compte aucun candidat berbérophone
francisé ni à Marrakech ni à Ouarzazate. Faut-il en chercher
explication dans le fait que la domination du pacha Glaoui, qui
s’étendait sur ces provinces, ne semble pas avoir favorisé la
modernisation des élites berbères ? En 1963, les hommes mis
en place par le Glaoui sont encore nombreux à donner le ton
— et leurs adversaires appartiennent, à de rares exceptions près,
au même type d’élites locales. Le commerce et l’administration
ont opéré des changements chez les Berbères d’Agadir et de
Ksar es Souk. Dans cette dernière province, où la majorité des
berbéro-phones se trouve dans les cercles de Midelt et de Rich,
le recrutement du Collège d’Azrou a joué un rôle comparable à
celui des parentés chérifiennes dans les circonscriptions plus
arabisées de Ksar es Souk, d’Erfoud et de Goulmima.
Pour les provinces de l’intérieur du pays, la répartition des
élites locales suivant les intérêts linguistiques est dans
l’ensemble assez diversifiée. On pourrait distinguer, sur des
bases statistiques, trois groupes comparables. Les provinces de
Casablanca et de Fès ont toutes deux un très fort pourcentage
d’arabophones et, derrière ces arabophones, un groupe de
bilingues français-arabe. Fès se différencie de Casablanca par la
présence d’un groupe de berbérophones soit bilingues, soit
trilingues. Oujda et Rabat présenteraient une structure
équilibrée entre arabophones et bilingues arabe-français,
complétée par un groupe significatif de Berbères trilingues.
Les provinces de Meknès, Beni Mellal et Taza offrent
l’originalité de compter trois groupes relativement équilibrés :
les arabophones, les bilingues arabe-berbère et les
francophones.
Les préfectures de Rabat et de Casablanca ont une structure
particulière. Elles comptent les plus fort pourcentages de
candidats bilingues arabe-français, pourcentages nettement
supérieurs à ceux des provinces environnantes.
La répartition des candidats par partis et par langues parlées
nous permettra de préciser quelques hypothèses déjà émises sur
ces facteurs. Si 40 % des candidats ne parlent que l’arabe, ce
pourcentage s’élève à 52 % pour les candidats Istiqlal, se situe à
35 % pour l’UNFP et 38 % pour le FDIC. Le bilinguisme arabe-
berbère, en moyenne 20 % des candidats, atteint également ce
taux à l’Istiqlal et à l’UNFP, mais tombe à 14 % pour les
candidats ayant adhéré au FDIC lors de sa création, alors que
ceux qui lui viennent du Mouvement populaire représentent
36 %. Le bilinguisme français-arabe, qui représente 20 % des
candidats, n’atteint que 15 % à l’Istiqlal, 12 % seulement au
Mouvement populaire, mais 23 % à l’UNFP et 27 % au FDIC.
Cependant, le Mouvement populaire compte le plus fort
pourcentage de trilingues arabe-français-berbère, avec 20 %
pour une moyenne nationale de 8 % : FDIC 4 %, Istiqlal 5 % et
l’UNFP 9 %.
En résumé, les candidats Istiqlal parlent en majorité l’arabe
seul, puis l’arabe et le berbère, le pourcentage de ceux qui
parlent une langue étrangère ne dépassant pas 25 %.
L’importance de la langue arabe est encore plus grande si l’on
s’attache au seul groupe des élus. Au sein de l’UNFP on trouve
encore une majorité relative d’arabisants chez les candidats
(35 %), mais ce chiffre tombe à 24 % chez les élus ; en
revanche, chez ces élus, le bilinguisme arabe-français frôle la
majorité absolue avec 48%, contre 23 % chez les candidats de
ce parti.
Le FDIC présenterait, si l’on ne compte que ses nouveaux
adhérents, une structure assez comparable à celle de l’UNFP
pour ses candidats, avec même un pourcentage plus faible de
bilingues arabe-berbère, compensé par un taux supérieur de
bilingues arabe-français et arabe-espagnol. Mais l’apport des
candidats venant du Mouvement populaire renforce
considérablement l’importance des arabes-berbères et diminue
la part des francisants. Or, la structure du groupe des élus FDIC
est plus proche de celle du Mouvement populaire que de celle
du groupe des nouveaux adhérents rassemblés lors de la
constitution du parti. Le pourcentage des élus bilingues arabe-
berbère s’élève, en effet, à 34 %, dépassant largement la
moyenne nationale de cette catégorie qui atteint 20 %. Le
pourcentage des élus FDIC ne parlant qu’arabe baisse par
rapport à celui des candidats, pour atteindre 25 %, chiffre très
voisin de celui de l’UNFP.
Répartition, par partis, des langues parlées
L’appartenance au groupe berbérophone ne semble pas un
facteur ayant influencé l’accès à l’enseignement moderne. Les
pourcentages de fréquentation des écoles primaires et
secondaires est sensiblement le même pour les berbérophones
et arabophones du groupe étudié. La présence des
berbérophones parmi les anciens élèves des établissements
d’enseignement traditionnel semble, en revanche, très réduite.
Elle serait plus élevée en zone Nord.
On constate, cependant, avant l’indépendance, qu’un tiers des
postes de l’administration traditionnelle (chioukh, caïds, etc.) a
été occupé par les Berbères ne parlant généralement aucune
langue étrangère. Les postes de type moderne sont plutôt
occupés par des arabophones de culture française. On ne
retrouve des Berbères que dans l’administration locale, parmi
les instituteurs et chez les militaires. Cette constatation n’a rien
d’étonnant. Le seul point digne d’intérêt est le contraste avec
les candidats provenant de l’ex-zone Nord, qui monopolisent
les postes d’anciens fonctionnaires d’administration centrale
(cinq) dont trois ont été attribués à des berbérophones.
Après l’indépendance, les postes occupés par les Berbères sont
plus nombreux : plus de la moitié des chioukh, des caïds et des
militaires, un tiers des fonctionnaires locaux. Ils sont moins
nombreux parmi les enseignants, mais bien représentés parmi
les quelques fonctionnaires des administrations centrales qui se
présentent comme candidats.
Il ne faudrait pas faire, à partir de ces constatations, des
déductions trop hâtives. Il s’agit d’abord d’un sous-groupe de
candidats qui compte, suivant les cas, de 100 à 230 personnes.
On ne peut pas en déduire la place des Berbères dans la nation,
mais simplement des indications sur leur rôle passé et actuel au
sein des élites locales. A cet égard, il ne semble pas abusif de
mettre en évidence, pour les Berbères de culture traditionnelle,
la continuité dans l’exercice des fonctions locales de
commandement avant et après le protectorat. Si leur présence
n’est pas plus nettement marquée dans le groupe de ceux qui
ont exercé ces fonctions avant 1956, c’est que certains étaient
trop âgés ou trop compromis avec le protectorat pour tenter
une nouvelle aventure politique en 1963.
On voit ainsi que les langues parlées, prises comme symbole de
traditionalisme ou de modernisation, constituent un des
facteurs les plus significatifs sur le plan statistique pour
analyser la nature des élites locales et leurs relations avec les
électeurs.
En résumant les remarques que suggèrent ces pourcentages, on
pourrait dire que la connaissance de la seule langue arabe est
un facteur favorable à l’élection au sein de l’Istiqlal. Le FDIC
mérite, lui, l’appellation de parti berbère puisque plus de 50 %
de ses élus parlent cette langue ; plus de 20 % d’entre eux
parlent le français ou l’espagnol. L’UNFP est le seul parti où la
culture française, symbole d’un certain type de modernisation,
soit valorisée par l’élection. Ce facteur joue aussi, mais à un
moindre degré, au sein de l’Istiqlal.
Alphabétisation et langues écrites
L’alphabétisation est un premier critère significatif, mais à
certains égards variable suivant le degré d’instruction des
administrateurs qui ont rempli les fiches des candidats. Un caïd
ayant reçu une éducation moderne aura involontairement
tendance à classer comme analphabète un candidat qui n’aura
suivi que l’école coranique et ne conservera que de vagues
notions d’arabe classique. A l’opposé, un administrateur de
culture traditionnelle aura tendance à considérer un candidat
de ce type comme alphabétisé. Même si l’on peut craindre une
légère sous-estimation ou surestimation, il reste vrai que par
rapport à la population globale, où le taux d’analphabétisme
s’élève à 89 %[3], celui des candidats (10 %) est rigoureusement
inversé, marquant par là leur appartenance à l’élite.
Le groupe des candidats analphabètes est donc assez réduit (75)
et n’autorise pas une analyse statistique poussée. On constate
cependant certaines variations significatives par régions et par
partis. On compte tout d’abord 45 % de berbérophones parmi
les analphabètes, ce qui est une porportion très forte par
rapport à l’ensemble national.
Les candidats analphabètes se trouvent presque exclusivement
dans les circonscriptions rurales où ils représentent 15% du
total des candidats. Les circonscriptions urbaines et semi-
urbaines n’en comptent que quelques unités. Certaines
provinces, notamment celles de la zone Nord, en sont
dépourvues, à l’exception de trois candidats à Nador.
Aucun analphabète n’est recensé à Oujda, à Ouarzazate ni à
Rabat-préfecture ; mais les provinces de Marrakech et de Beni
Mellal, de Meknès, de Fès et de Casablanca en comptent un
nombre important.
La répartition par parti montre une certaine égalité à l’échelon
national.
La répartition par profession montre que la plupart des
candidats analphabètes sont classés, comme on pouvait s’y
attendre, parmi les agriculteurs et les commerçants.
Ces données sur l’alphabétisation ne peuvent surprendre dans
la mesure où l’instruction, même traditionnelle, est peu
répandue, surtout dans les campagnes. Il s’agit en outre de
groupes d’âge moyen très défavorisés par le faible taux de
diffusion de l’instruction sous le propectorat. Les taux
d’alphabétisation n’en sont que plus exemplaires, et prouvent
que l’on tient là une variable particulièrement intéressante
pour montrer l’appartenance aux élites locales.
Il vaudra la peine d’analyser plus en détail le groupe des
candidats alphabétisés, en s’attachant progressivement aux
éléments qui permettront de les différencier suivant le type et
le niveau d’enseignement, et de retrouver dans certains cas les
facteurs significatifs de solidarités de groupe ou de formation, à
travers le système des partis.
Les données que nous possédons sur les langues écrites par les
candidats confirment, dans l’ensemble, les déductions que l’on
pouvait faire à partir des langues parlées. Plus de la moitié des
candidats n’écrivent que l’arabe, et un quart seulement l’arabe
et le français ; la connaissance de ces deux langues décroît avec
l’âge des candidats.
Mais la constatation la plus intéressante provient de la
comparaison de ces pourcentages entre les candidats investis
par les partis et les élus. Il ressort assez nettement que la
connaissance du français n’est pas un facteur de succès pour
l’Istiqlal et le FDIC, alors qu’il l’est pour l’UNFP.
Le taux des lettrés en arabe passe en effet de 60 % chez les
candidats Istiqlal à 64 % chez les élus. Au FDIC la différence est
encore plus nette : de 44 % à 61 %. A l’UNFP, au contraire, le
taux des lettrés en arabe, qui était de 52 % chez les candidats,
n’est plus que 36 % chez les élus. Les pourcentages de
connaissance du français écrit sont bien entendu
rigoureusement inversés. Le bilinguisme arabe-espagnol,
relativement bien représenté chez les jeunes candidats, ne se
retrouve en bonne position que chez les élus de plus de 50 ans.
Dans l’ensemble, ces indications tendraient à confirmer les
hypothèses présentées plus haut sur le rôle des intellectuels
traditionnels : la culture traditionnelle l’emporte largement sur
la culture moderne comme élément de prestige, et moyen de
communication favorable à l’élection. Ces différences entre les
partis et les régions reflètent une attitude caractéristique à
l’égard de l’ouverture aux facteurs de modernisation.
A une extrémité, on trouve la clientèle de l’UNFP, concentrée
dans les villes du littoral, qui élit de préférence des candidats
favorables à un changement social rapide à l’autre, l’Istiqlal ou
le FDIC, dans le Sud du pays, où le conservatisme de la langue,
des traditions et des structures sociales est une donnée de base
du comportement politique.
Répartition des candidats suivant les partis et les langues écrites
Un dernier point intéressant à noter concerne le rapport entre
langue parlée et langue écrite. On constate que 83 % des
candidats uniquement arabophones écrivent l’arabe. Le rapport
est sensiblement le même pour ceux qui parlent et écrivent le
français. En revanche, il tombe à 53 % entre ceux qui parlent et
écrivent l’espagnol.
Deux faits se confirment : les candidats les moins ouverts sur
l’extérieur sont des lettrés traditionnels ; l’acculturation dans
l’ancien protectorat français est donnée par l’école, alors que
dans l’ex-zone espagnole la langue du colonisateur s’acquérait
autant par le côtoiement des communautés que par l’école,
suivant un processus de diffusion de la culture qui serait, avec
des nuances, celui qu’a connu l’Amérique latine coloniale.
Enseignement de type français et enseignement
traditionnel
Nous avons vu que la connaissance de l’arabe classique était
déjà, dans le Maroc rural, un symbole de niveau culturel
traditionnel. La connaissance des langues étrangères, au
contraire, permet de rompre avec l’isolement du milieu
traditionnel. Les informations dont nous disposons sur les
candidats ne fournissent malheureusement pas d’indications
qualitatives sur leur niveau de connaissance. Même pour ceux
qui sont classés comme lisant et parlant le français, de
nombreuses incertitudes demeurent si nous ne possédons pas
d’indications sur le type d’enseignement suivi. De multiples
effets déformants peuvent aussi influencer le jugement des
administrateurs qui ont recueilli les informations que nous
analysons. Il est vraisemblable que l’on considérera comme
parlant français certains candidats qui ne possèdent que des
rudiments de cette langue. En revanche, on a peu de chances
de trouver, parmi ceux qui parlent uniquement l’arabe, des
candidats qui auraient passé leur certificat d’études. Les
pourcentages concernant les analphabètes, ou les candidats qui
ne parlent qu’arabe ont donc plus de chances de coller à la
réalité.
Si, pour les éléments plus âgés, une certaine connaissance du
français a pu être acquise par des contacts de travail ou de vie
en commun, cette part diminue avec l’âge. L’on rencontre chez
les plus jeunes de plus forts pourcentages de fréquentation de
l’école française du protectorat. L’enseignement des matières
de base était donné en français. Dix heures de langue arabe et
de cours de religion — parfois amputées au profit du berbère —
ou de travaux d’étude du milieu n’arrivaient pas à équilibrer
vingt-cinq heures hebdomadaires de français à l’école primaire.
En milieu rural, les élèves vivaient souvent en internat pour
mieux faciliter leur passage du mode de vie traditionnel à des
habitudes européennes.
La plupart des élèves n’allaient pas plus loin que l’école
primaire et terminaient leur carrière scolaire avec, au plus, un
certificat d’études. Mais ceux-là même qui quittaient l’école
sans diplôme, ou qui n’y avaient passé que quelques années,
restaient marqués par l’impression profonde qu’ils en
recevaient.
La fonction assimilatrice de l’enseignement primaire français
n’est plus à démontrer. Au cours même de sa période de
généralisation, à la fin du siècle dernier, l’école primaire laïque
sait faire entrer dans le même moule les Bretons, les Basques et
les Kabyles[4]. Le modèle d’enseignement primaire colonial mis
au point en Algérie par l’expérience de l’Ecole normale de la
Bouzareah sera étendu par la suite à toute l’Afrique du Nord.
Cet enseignement avait pour but de former les cadres moyens,
commis, interprètes, sous-officiers, petits employés nécessaires
à la colonisation publique et privée. Il s’est implanté au Maroc
en ayant souvent recours à des instituteurs algériens triés sur le
volet, qui auront pour premier souci d’effacer les
particularismes locaux, et d’inculquer à leurs élèves les
principes libéraux et égalitaires de l’enseignement laïc. Pour les
jeunes Marocains, les maîtres algériens sont bientôt des
modèles de réussite humaine et sociale. Le but des autorités
coloniales n’est pas atteint dans la mesure où les élèves de
l’enseignement français seront de fervents nationalistes, mais
l’influence de leurs maîtres les amène cependant à contester les
valeurs de la société islamique traditionnelle. Ils n’acceptent
pas la colonisation au fond d’eux-mêmes, mais la plupart
d’entre eux lui fourniront, aussi longtemps qu’elle durera, des
auxiliaires efficaces et dévoués.
Les meilleurs élèves des écoles primaires étaient admis dans des
« collèges musulmans » implantés dans les grandes villes : Fès,
Rabat, Meknès, Marrakech, Taza. Ils y préparaient un diplôme
équivalant au brevet, et poursuivaient leur scolarité jusqu’au
niveau de la classe de première. Une infime minorité, offrant
en principe toutes garanties de savoir et de ralliement, était
admise à préparer le baccalauréat dans des établissements de
type européen. Ils y réussissaient souvent, car les programmes
des collèges musulmans étaient très proches de ceux des
établissements secondaires français. L’esprit de compétition
était entretenu à l’extérieur par un système rigoureux
d’éliminations successives.
Les élèves qui obtenaient leur baccalauréat étaient admis à faire
des études en France, ou sur place. Leur nombre était de toute
façon très limité, car les autorités du protectorat n’avaient pas
l’intention d’étendre démesurément le nombre des élèves de
l’enseignement secondaire. Les rares élus avaient déjà
l’impression d’appartenir à une élite, d’avoir même, dans la
perspective limitée du protectorat, un rôle important à jouer.
Ils se sentaient, par leur culture, leur univers de pensée, leur
façon d’être, beaucoup plus, proches des jeunes Européens de
leur âge que de leurs concitoyens appartenant encore au milieu
traditionnel. Même au cœur des plus durs affrontements
politiques, les modèles culturels et de comportement de ce type
de nationalistes restent français.
Avant de passer à l’analyse des données concernant les
candidats formés par l’enseignement français, il convient aussi
de mentionner l’existence, à la fin du protectorat, d’un nombre
important d’écoles libres, avec un enseignement à mi-chemin
entre l’enseignement traditionnel et celui du lycée français[5].
Contrôlées par les nationalistes, ces écoles réservent une plus
grande part à l’enseignement de langue arabe, et s’efforçent
aussi de donner en arabe un enseignement des mathématiques
et des sciences comparable à celui des écoles françaises. Le
français y est enseigné comme langue étrangère. Ces écoles
rencontrent un certain succès dans les milieux bourgeois d’une
ville comme Casablanca. En 1948, on y dénombre 26 écoles de
ce type avec près de 5 000 élèves. En 1952, le nombre des
élèves s’élèvera à 5 670[6].
Telle était la structure de l’enseignement moderne mis en place
avant l’indépendance : enseignement destiné à une élite, si l’on
compare le nombre des élèves scolarisés à la masse des
scolarisables, mais ayant, en fait, dépassé le caractère restreint
d’« école de fils de notables » que Lyautey entendait leur
conserver. La pression des Marocains, sensible à partir de 1930,
et les traditions démocratiques de l’école laïque avaient abouti
à accueillir un nombre d’élèves que ne justifiaient pas a priori
les perspectives d’évolution politique et économique du
protectorat. Certes, les enfants de la bourgeoisie marocaine
s’adaptaient mieux à l’enseignement moderne que les enfants
des classes populaires qui ne faisaient généralement qu’y passer
pendant quelques années. Ce phénomène semble
[7]
particulièrement sensible à Casablanca . Les élèves qui
suivaient l’enseignement français ou franco-arabe avaient
souvent fréquenté en plus, pendant de nombreuses années, les
cours de l’école coranique. Venus tard à l’école française, après
avoir acquis l’empreinte de méthodes d’enseignement
différentes, leur passage par l’enseignement moderne marquait
profondément leur personnalité. Dans l’étude des élites, ce
facteur joue un rôle considérable. Il permet de supposer
l’exitence, chez ceux qui ont fréquenté l’école française, d’un
acquis de langue étrangère et de connaissances différent de
celui que procure la société traditionnelle. Cet acquis est
destiné normalement à s’accroître chez ceux qui ont été admis
à participer plus activement à l’administration et à la vie
économique, après l’indépendance.
De plus, le caractère restreint des élites locales ou nationales
fait que la fréquentation de l’école primaire pour les plus
anciens, mais surtout celle des collèges secondaires, a créé entre
leurs anciens élèves des liens de solidarité que matérialise
parfois l’existence de puissantes associations d’anciens élèves,
comme celle du Collège Moulay Idriss de Fès, ou celle du
Collège d’Azrou. Il est fréquent, parmi les Marocains
appartenant à une classe d’âge donnée, de trouver des liens
entre les individus que les occupations professionnelles ou les
opinions politiques divisent par ailleurs.
Enseignement primaire
En passant à l’analyse des données sur l’enseignement
primaire, on constate tout d’abord que le passage par un
enseignement primaire de type français est un facteur certain
d’investiture. La grosse majorité des candidats sont certes
passés par les écoles coraniques. Mais le taux d’investiture est
plus élevé chez ceux qui sortent de l’école primaire française
que chez ceux qui sortent de l’école coranique. Si l’on
considère la répartition par partis des candidats issus de l’école
primaire, on constate aussi une variation strictement inverse
entre les pourcentages des candidats issus des écoles coraniques
et ceux provenait des écoles françaises.
Partis et enseignement primaire
L’enseignement primaire français est donc, en soi, un facteur
d’investiture important, prédisposant en outre au choix, soit
d’un parti de gauche, soit du parti monarchiste. Le passage par
l’école française prédispose plus à l’adhésion à une association
que l’école coranique. En revanche, l’école coranique va de pair
avec l’appartenance à une confrérie pour 16 candidats sur les
19 qui sont recensés comme en faisant partie.
Nette majorité également des anciens élèves des écoles
coraniques dans les organisations charitables (27 sur 35), en
particulier dans les sociétés musulmanes de bienfaisance qui
jouent un rôle politique certain dans la distribution des
denrées ou la répartition des produits sur les taxes d’abattage
dans les grandes villes. Avant l’indépendance, l’Istiqlal avait
déjà sur place ses hommes dans ces associations qui sont, dans
le système urbain, un point de contact intéressant, tant avec les
autorités et les commerçants qu’avec les éléments de la
population qui reçoivent une assistance.
Enfin, on note que la quasi-totalité des candidats appartenant à
des associations de parents d’élèves (12 sur 14), organisées
généralement auprès des établissements secondaires modernes
des grandes villes, proviennent de l’enseignement coranique :
ils peuvent ainsi veiller à la qualité de l’enseignement reçu par
leurs enfants. Mais la totalité des candidats membres
d’associations d’anciens élèves a suivi l’enseignement primaire
français.
Si nous nous attachons enfin aux tris faits sur les groupes des
élus, nous constatons un léger renforcement des tendances
constatées à propos des candidats. Le résultat le plus
intéressant est celui de l’UNFP, le seul parti à avoir plus de la
moitié de ses élus provenant de l’école primaire française
(54 %). Ce chiffre est nettement supérieur à celui des candidats
de ce parti passés par ce type d’enseignement (35,6 %). On
pourrait donc en déduire que pour les élus UNFP provenant
généralement de circonscriptions urbaines modernes, à forte
proportion d’électorat ouvrier, l’enseignement français est un
facteur net de succès. Ce facteur joue à un moindre degré par
les candidats Istiqlal où les élus issus de l’enseignement
primaire français représentent 24 % de l’effectif total des élus
du parti, alors qu’on n’en comptait que 20 % parmi les
candidats. A l’inverse, au FDIC et chez les neutres, les élus issus
de l’enseignement primaire français représentent un
pourcentage inférieur à celui des candidats. Faut-il en déduire
que dans les circonscriptions rurales, qui ont envoyé en
majorité ces candidats au Parlement, l’école française n’a pas
été un facteur favorable à l’élection ? Cette variable devrait
plutôt être interprétée autrement : ces circonscriptions ont
généralement préféré les candidats de formation traditionnelle,
le plus souvent propriétaires terriens implantés dans la
circonscription. En revanche, l’état-major du parti, qui avait
tendance, à Rabat, à investir des diplômés de l’enseignement
français, ne se voyait pas suivi par les électeurs, alors qu’à
l’opposé les électeurs urbains de l’UNFP accentuaient encore
par leur choix celui de l’état-major du parti.
La répartition géographique des candidats provenant de
l’enseignement primaire apporte également quelques éléments
intéressants d’information sur le type de culture des élites
locales. Les candidats issus de l’école coranique représentent
55 % de l’ensemble. Mais l’ex-zone Nord et les régions pré-
sahariennens ont des taux largement supérieurs à la moyenne.
A l’opposé, les candidats qui proviennent de l’enseignement
primaire français se rencontrent plutôt dans les anciennes
provinces du « Maroc utile » — à quelques exceptions près. Cet
ensemble dessine un Maroc beaucoup plus marqué par une
présence européenne anciennement établie. Les villes comme
Rabat, Tanger et Casablanca s’y distinguent nettement des
provinces environnantes. On constate également que les
candidats issus des écoles libres se concentrent dans les
provinces ayant un fort pourcentage de candidats issus de
l’enseignement français[8], ce qui prouve que leur clientèle était
plus intégrée dans le courant de modernisation que dans le
traditionalisme.
La province de Ksar es Souk mérite une attention particulière.
Bien qu’appartenant au groupe des provinces pré-sahariennes,
elle ne compte cependant que 51 % d’anciens élèves des écoles
coraniques, contre 31 % d’anciens élèves des écoles françaises.
Ce taux est supérieur à la moyenne nationale et dépasse
largement celui des provinces voisines. Faut-il en chercher la
raison dans le fait que de nombreux candidats sont des chorfa
de formation moderne qui ont émigré de la province où ils
reviennent poser leur candidature ? Leur appartenance
chérifienne leur confère une influence qui contrebalancerait,
dans une région traditionnelle, l’handicap que pourrait
représenter un passage par une école moderne, c’est-à-dire une
rupture avec la tradition. Les émigrés de la province de Ksar es
Souk ont plus souvent atteint la notoriété dans
l’administration que dans le commerce. Ils ont dû, pour cela,
passer par l’école moderne, à la différence des commerçants
soussis candidats de la province d’Agadir, qui, en dépit de leurs
activités, sont issus pour la plupart de l’école coranique.
Répartition des candidats par province et par type d’école primaire
Si l’on prête attention enfin à la répartition des arabophones et
des berbérophones entre l’école coranique et l’école primaire
française, on constate que les candidats berbères sont pour un
tiers passés par l’école coranique, alors que leur taux de
fréquentation de l’école primaire française ne dépasse guère le
cinquième. Ces chiffres tendraient à souligner le caractère
traditionnel dominant de la culture des candidats berbères.
Enseignement secondaire
Les constatations faites à propos de l’influence de
l’enseignement primaire se trouvent renforcées dans l’ensemble
par ces données dont nous disposons sur l’enseignement
secondaire.
L’étude des langues parlées par les anciens élèves du secondaire
semble cependant significative. Il n’est pas surprenant de voir
que plus de 65 % des anciens élèves des établissements
traditionnels ne parlent que l’arabe.
La répartition par province renforce l’impression d’emprise
dominante dès anciens élèves de l’enseignement traditionnel
dans le Nord et dans les régions pré-sahariennes. Dans
l’ensemble du pays, ils représentent 56 % des anciens élèves du
secondaire, avec une nette prédominance des anciens de
Karaouyne (31 %), suivis par ceux de Ben Youssef (11 %), ceux
des instituts islamiques de la zone Nord (9 %) et de diverses
medersas, zaouïas ou grandes mosquées (5 %). Le Nord du pays
est dominé par l’enseignement traditionnel de façon variable.
Pour Al Hoceima, la domination est totale, les candidats se
répartissant entre anciens élèves des instituts islamiques de la
zone Nord (83 %) et anciens de Karaouyne (17 %). Pour
Tétouan, le pourcentage global des anciens élèves du
secondaire traditionnel est moindre — 68 % — dont 59 % pour
les instituts islamiques locaux, le reste se répartissant entre
Karaouyne et diverses grandes mosquées. A Nador, l’influence
de Karaouyne l’emporte nettement avec 50 % des anciens
élèves contre 18 % aux instituts islamiques.
Dans le Sud, les anciens élèves de Ben Youssef représentent la
totalité des candidats de Ouarzazate diplômés du secondaire,
mais ils ne sont plus que 40 % à Marrakech, qui compte en
outre 20 % d’anciens de Karaouyne, et 33 % à Agadir. Ils
représentent, en revanche, 30 % des candidats de Beni Mellal,
et 19 % dans la province de Casablanca.
Par ailleurs, le rayonnement des établissements traditionnels,
et en premier lieu de celui de Fès, est évident dans le Maroc
central. L’on compte certes 67 % d’anciens élèves des
établissements traditionnels parmi les candidats de la province
de Fès, mais aussi 70 % à Taza, 50 % à Oujda, 40 % à Rabat,
43 % à Meknès et, fait plus étonnant, 75 % parmi les candidats
des dix circonscriptions de Casablanca, et 50 % dans la
préfecture de Rabat.
On peut ainsi dessiner les zones d’influence des centres de
culture islamique ; celle de Fès s’étend sur le Maroc central, sur
le pays berbère jusqu’à Beni Mellal, et, au Nord-Est, jusqu’à
Nador. Tétouan domine sa province et étend son influence
jusque Al Hoceima. Ben Youssef domine les deux versants de
l’Atlas, à partir de Beni Mellal, mais n’a aucune influence sur
Ksar es Souk.
L’influence de l’enseignement secondaire moderne est
beaucoup plus diffuse. Elle domine largement à Tanger avec
68 %, à Ksar es Souk avec 86 %, à Agadir avec 56 % répartis
entre plusieurs types d’établissements. La proportion est
comparable dans la province de Rabat. Elle atteint encore 50 %
à Rabat-préfecture. Mis à part quelques cas marginaux,
l’influence de l’enseignement secondaire moderne sur le choix
des candidats n’apparaît donc pas avec une nette évidence, à la
différence de l’enseignement secondaire traditionnel. L’étude
de la répartition géographique des candidats issus, du
secondaire moderne révèle quelques détails intéressants,
notamment sur les anciens élèves des établissements français.
Les anciens d’Azrou se rencontrent surtout dans les provinces
de Rabat, Casablanca et Meknès. Plus de la moitié des candidats
anciens élèves du Collège Moulay Idriss se trouve dans la
province de Fès. Il en est de même pour les anciens du Lycée
Mangin à Marrakech. Les élites politiques de formation
moderne ont donc des attaches locales nettes, même si le
rayonnement des établissements français n’est pas de même
nature que celui des établissements traditionnels.
Répartition des candidats par province et par type d’enseignement
secondaire
Nous avons analysé plus haut l’importance des anciens élèves
des établissements secondaires traditionnels dans les divers
partis politiques, et mis en évidence le rôle de Karaouyne dans
la formation des candidats de toutes tendances, Ben Youssef et
les instituts de la zone Nord ayant un rayonnement
géographique et politique moins diversifié.
Les candidats issus des établissements secondaires de type
français sont nettement moins nombreux et beaucoup plus
dispersés. Le FDIC est le seul parti à en accueillir un chiffre
légèrement plus élevé (59 %) que celui des candidats issus des
établissements traditionnels. Le groupe le plus important
(15 %) provient du Collège Moullay Youssef de Rabat. Puis, en
parts relativement égales, nous trouvons les anciens d’Azrou
(7 %), ceux de Moulay Idriss de Fès (6 %), du Lycée Mangin de
Marrakech (6 %) et des écoles militaires (6 %). Le plus fort
contingent d’anciens d’Azrou se rencontre à l’UNFP (12 %)
alors que l’Istiqlal n’en compte que 2 %. Ces deux partis ont
cependant un pourcentage relativement égal (30-33 %) de
candidats issus d’établissements secondaires français.
Répartition des candidats et des élus par parti et par type
d’établissement secondaire
Afin de mieux pouvoir tirer les conséquences de l’analyse de
ces données sur la répartition entre les divers partis des
candidats passés par l’enseignement secondaire traditionnel ou
moderne, il faudrait les confronter avec les mêmes données
concernant, cette fois, les seuls élus. Le groupe étudié ne
compte plus que 49 cas, alors que celui des candidats s’élevait à
223. Un tiers des élus passés par le secondaire ont fréquenté
Karaouyne. On mesure mieux l’importance des divers
établissements traditionnels si l’on considère que leur part
s’élève globalement à 55 %. Parmi les élus de l’Istiqlal, dont
58 % viennent de Karaouyne, le pourcentage des anciens élèves
des établissements traditionnels s’élève à 74 %. Mais il est
globalement de 62 % à l’UNFP, et de 33% au FDIC. Quant aux
élus neutres, trois sur quatre proviennent des établissements
traditionnels. Les élus du FDIC sont dispersés entre les divers
établissements modernes, avec, comme pour les candidats, une
légère prédominance des anciens de Moulay Youssef, et de
ceux de Khemisset. Rien de marquant au sein du groupe UNFP.
Dans l’Istiqlal, seul le Lycée Poemyrau de Meknès se distingue
un peu. La différence entre les deux séries de pourcentages
tendrait donc à marquer que le passage par les établissements
secondaires traditionnels est un facteur important pour
l’élection. Le nombre des élus provenant de ces établissements
prouve que les électeurs se reconnaissaient plutôt parmi ces
derniers que parmi les diplômés des écoles modernes. Le
groupe compact des anciens de Karaouyne ne pouvait que
contribuer à donner un style et un langage communs
dominant au sein du Parlement marocain, à travers tous les
partis.
Si l’on examine en détail les deux groupes d’élus, les anciens
élèves des établissements traditionnels et ceux des collèges
français, on s’aperçoit que les premiers sont souvent des
candidats implantés dans les circonscriptions où ils font figure
d’élites locales, alors que les seconds, qui sont parfois nés dans
le terroir, sont plus proches de l’élite politique nationale.
L’influence de leur famille ou d’autres facteurs ne suffisent pas
totalement à leur assurer une intégration dans leur milieu qui
va de soi pour les intellectuels traditionnels.
Il ne faut pas cependant minimiser le rôle des diplômés de
l’enseignement secondaire français, qui, au nombre d’une
vingtaine parmi les élus, jouent le rôle d’une véritable
aristocratie au sein du Parlement. La moitié d’entre eux se
trouve au FDIC où ils se répartissent également entre bacheliers
et titulaires du brevet.
Une constatation intéressante peut être tirée d’un tableau
confrontant les variables enseignement secondaire et poste
administratif occupé avant l’indépendance. Il apparaît tout de
suite que sur les 78 candidats concernés 52 étaient enseignants.
Plus d’un tiers d’entre eux provenait de Karaouyne. En
comptant les anciens élèves des autres établissements
traditionnels, ceux-ci dépassent largement les diplômés des
écoles françaises, symbolisant, au sein de l’élite, le conflit entre
les deux types de formation, qui dépasse les frontières des
partis, et que nous retrouverons comme l’une des données
constantes de cette étude.
L’enseignement supérieur traditionnel
L’influence de l’enseignement supérieur traditionnel est
difficile à dissocier de celle de l’enseignement secondaire. Tout
d’abord, parce que le principal établissement traditionnel, la
Karaouyne de Fès, comporte les deux niveaux. Certains
candidats, qui n’avaient suivi que quelques années d’études au
niveau secondaire, ont pu être tentés de se parer du titre
d’alem. Tous les candidats, pour lesquels cette précision de
diplôme n’était pas donnée, ont été classés au niveau
secondaire. On peut donc estimer que les excès dans un sens
ont pu compenser les omissions dans un autre. Le nombre
limité des diplômés de l’enseignement supérieur traditionnel
(54) laisse croire que les risques de surévaluation ont été peu
importants.
Une première constatation s’impose : sur un total de 723
candidats, 130 ont suivi un enseignement secondaire et un
enseignement supérieur traditionnels. Avec 72 anciens
étudiants de niveau secondaire et 26 de niveau supérieur, la
Karaouyne domine le groupe des anciens élèves de
l’enseignement traditionnel. Les anciens de Karaouyne sont
assez bien répartis entre les groupes (avec quelques nuances
significatives analysées à propos de l’enseignement secondaire).
Répartition, par parti, des candidats diplômés d’universités
traditionnelles
Karaouyne joue donc un rôle dominant parmi les
établissements formant les élites locales traditionnelles.
Répartis à travers toutes les formations politiques, les anciens
élèves de Karaouyne ont un langage et un comportement
identiques. Ils donnent le ton du traditionalisme. Les anciens
élèves des autres établissements du même type ne peuvent
prétendre à ce rôle national. Leur implantation géographique
est plus marquée, et leur association avec un parti plus
nuancée. A l’UNFP, les anciens de Ben Youssef sont
majoritaires : Abdallah Ibrahim et le fquih Basri symbolisent
assez bien ce type d’élite. Il en est de même dans les instituts de
zone Nord où la figure dominante est celle d’Abdel-Khaleq
Torres.
Les termes de l’analyse restent les mêmes si l’on se fonde sur les
candidats diplômés d’université traditionnelle. La
concentration des diplômés de Karaouyne au sein de l’Istiqlal
est supérieure à celle des anciens élèves du niveau secondaire.
Les autres partis ont un recrutement plus diversifié à
dominante Karaouyne et Ben Youssef pour l’UNFP et, pour le
FDIC, Karaouyne, El Azhar et Tétouan.
Les informations dont nous disposons sur les douze élus
diplômés d’universités traditionnelles viennent renforcer les
impressions tirées de l’analyse des chiffres concernant les
candidats. Sur huit titulaires de l’Alimya de Karaouyne, six sont
des élus Istiqlal. Ce parti compte en outre deux diplômés
d’universités étrangères traditionnelles.
L’enseignement supérieur moderne
Les données sur l’enseignement supérieur moderne ne font que
préciser, dans l’ensemble, les constatations déjà faites à propos
de l’enseignement secondaire. Les candidats issus de ce type
d’enseignement ne sont que 80 au total. La plupart ont effectué
leurs études en France, mais neuf d’entre eux sont issus de
l’enseignement supérieur espagnol, et quinze ont fait leurs
études au Maroc (Droit, EMA, licence d’arabe), formant ainsi
un sous-groupe relativement important.
Cette faible proportion de candidats issus de l’enseignement
supérieur, alors que les études sur les élites politiques montrent
généralement qu’il s’agit d’une variable essentielle, s’explique
par le caractère récent de l’indépendance nationale. Le
protectorat n’avait pas cherché à développer une élite
marocaine à ce niveau. En 1955, le nombre des bacheliers
marocains s’élevait à 155[9]. Ils n’étaient que 87 en 1950, et 33
en 1945. Or ce sont les diplômés de l’enseignement secondaire
français du protectorat, qui ont fourni les étudiants de
l’enseignement supérieur moderne, que nous rencontrons
parmi les candidats de 1963. Si réduit que soit leur nombre, il
est largement supérieur (11 %) à la moyenne des diplômés dans
la population globale. Sans avoir sur ce point des chiffres très
précis, on peut cependant relever le fait qu’il dépasse largement
le pourcentage des personnes ayant un niveau d’instruction
supérieur au certificat d’études[10].
Ce faible taux de représentation des diplômés de
l’enseignement supérieur parmi les candidats aux élections
législatives doit être aussi interprété comme une indication du
caractère local de la compétition. Les avocats, médecins ou
professeurs, qui auraient été assez nombreux pour remplir la
plupart des sièges de l’Assemblée, ne s’engagent pas dans la
lutte. Ils appartiennent déjà à l’élite politique nationale, depuis
l’indépendance. Un succès aux élections ne leur apporterait, ni
en prestige, ni en revenus, guère plus que les postes de
directeurs, de gouverneurs ou de ministres qu’ils occupent déjà.
S’ils sont patronnés par le parti au pouvoir, l’avantage est
mince en cas de succès et le risque de se voir limiter l’accès à de
nouveaux postes est grand, en cas d’échec. S’ils choisissent les
couleurs de l’opposition, ils ont de grandes chances de voir leur
statut remis en cause. S’ils sont élus, leur nouveau mandat a
peu de chances d’être plus avantageux que leur ancienne
situation. S’ils sont battus, ils savent que la vengeance du
pouvoir se fera sentir. On ne les chassera pas de la fonction
publique, mais ils perdront leurs postes de direction et les
avantages dont ils jouissaient.
On ne rencontrera donc, parmi les candidats de l’opposition,
que des militants professionnels, appartenant le plus souvent
aux professions libérales, ou des fonctionnaires très motivés,
dont le statut risquerait de toute façon d’être remis en cause
par le pouvoir. Les ministres en exercice FDIC se présenteront
sans enthousiasme[11], et les hauts fonctionnaires montreront
certaines réticences ou ne s’engageront qu’avec l’espoir de
devenir ministres. On verra aussi apparaître quelques « jeunes
loups » de moins de 30 ans pour qui l’engagement politique est
un moyen de faire avancer leur carrière : ils espèrent trouver un
raccourci pour rejoindre le groupe de ceux qui ont tiré tous les
avantages de l’indépendance.
La distribution par âge fait apparaître en effet un groupe de
candidats âgés de moins de 30 ans, en majorité littéraires, mais
comptant aussi quelques juristes et ingénieurs. Dans le groupe
âgé de 31 à 50 ans, ce sont les juristes ayant fait leurs études en
France qui représentent la majorité, et, chez les plus de 50 ans,
ce sont les anciens officiers. Les Berbères semblent très peu
représentés (8 %) dans le groupe des candidats ayant fiait des
études supérieures, par contraste avec leur présence nettement
plus marquée parmi les anciens élèves du secondaire. Ce fait
contribue à expliquer la place limitée occupée par les Berbères
dans l’élite politique nationale, de même que leur meilleure
représentation au sein des élites locales.
Si l’on s’attache à la distribution géographique des candidats
diplômés, on constate, bien entendu, que la moitié d’entre eux,
notamment les avocats et les médecins, se présentent dans les
circonscriptions urbaines. En revanche, les licenciés d’arabe
classique, les anciens officiers[12], et de façon plus inattendue les
ingénieurs, se présentent dans les circonscriptions rurales. Pour
ces derniers, le choix est dû, soit à des attaches familiales, soit à
des attaches locales conservées après une affectation antérieure
en province, soit à quelques cas d’erreurs de tactique de jeunes
technocrates à la recherche d’une investiture.
Répartition, par parti, des élus diplômés d’enseignement supérieur
Si l’on considère le groupe des élus, le passage par
l’enseignement supérieur moderne est un facteur significatif.
Bien que largement minoritaire, leur nombre (26) représente
18% des élus. Les juristes sont largement majoritaires, les
médecins et les littéraires viennent ensuite. Les élus sont
dispersés suivant les partis ; mais, proportionnellement, ils ne
représentent que 10 % du groupe parlementaire Istiqlal, alors
que ce pourcentage atteint 20 % dans le groupe FDIC, et 40 %
à l’UNFP. Ce parti compte le plus grand nombre d’avocats et de
médecins. Au sein du FDIC et de l’Istiqlal, la dispersion des
diplômés est plus grande.
Si l’on examine avec soin le groupe des diplômés des
universités espagnoles, on constate que six sur neuf n’ont reçu
aucune investiture, les trois autres se répartissant dans chacun
des grands partis. Le nombre des diplômés de l’ex-zone Nord
ést trop réduit pour que l’on tire des conclusions définitives,
mais il semblerait que la classe dirigeante du Sud ne soit guère
prête à faire place à des rivaux éventuels ayant une base locale
moderne. Par ailleurs, l’électorat du Nord se tournera plus
volontiers, comme on a pu le voir, vers des candidats ayant
une formation d’intellectuels traditionnels.
En dépit de son caractère limité, le groupe des diplômés de
l’enseignement supérieur moderne est intéressant parce qu’il
est situé au point de jonction entre les élites locales et les élites
nationales. L’examen des cas individuels montre qu’il s’agit le
plus souvent, mise à part 1’ex-zone Nord, de candidats qui
appartiennent à l’élite politique nationale.
Notes du chapitre
[1] La consommation et tes dépenses des ménages marocains
musulmans, op. cit., p. 65.
[2] Cette catégorie est mieux représentée dans le groupe des
moins de 30 ans que dans les autres groupes.
[3] Voir La consommation et les dépenses des ménages
marocains musulmans, op. cit., p. 78.
[4] Voir F. Colonna, Instituteurs algériens 1883-1939, Paris,
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1975,
240 p.
[5] Il faudrait rapprocher ce type d’écoles de celles qui furent
animées en Algérie par le mouvement Ben Baddis.
[6] Voir A. Adam, Casablanca, Paris, CNRS, 1968, tome 2, p.
460 et suiv.
[7] Ibid., p. 466 et suiv.
[8] Les écoles libres se trouvaient d’ailleurs comme les écoles
françaises dans les grandes villes.
[9] Voir Tableaux économiques du Maroc 1915-1959, Rabat,
Service central des statistiques, 1960, p. 30.
[10] Voir La consommation et tes dépenses des ménages
marocains musulmans, op. cit., p. 79.
[11] A Juste titre, huit sur dix seront battus.
[12] Ayant suivi les cours d’une académie militaire à
l’étranger.
Chapitre X. La participation sociale et
politique
Les informations rassemblées sur le comportement politique
des candidats sont dans l’ensemble de valeur inégale et
d’interprétation délicate. Elles tendent trop souvent à
présenter, sous la forme d’un comportement et d’une
motivation individualisés, des phénomènes qui sont
difficilement dissociables de l’appartenance des individus à des
groupes de base.
La deuxième partie de cette étude avait pour but de restituer
cette dimension de la participation politique. La présente
analyse s’attachera aussi, dans la mesure du possible, à
restituer, en partant des données quantitatives, une dimension
historique et sociologique dépassant le simple recensement des
appartenances à un parti ou à un syndicat.
On s’efforcera, en étudiant l’importance des facteurs familiaux,
de dégager la trace des continuités et des solidarités de groupe
qui peuvent influencer les comportements politiques. On
cherchera aussi, à travers l’appartenance à des associations,
l’origine ou le prolongement social de ces comportements. Il
serait vain de dissocier cette analyse de celles qui seront
présentées dans le chapitre suivant. Dans un système d’élites
locales où la politique et l’administratif sont pratiquement
inséparables, autant sous le protectorat que depuis
l’indépendance, il serait artificiel de dissocier l’engagement
politique des fonctions administratives de type traditionnel ou
moderne des candidats. Certaines de ces fonctions — celles de
caïd avant l’indépendance et celles de cheikh ou de moqqadem
jusqu’à ce jour — ne relèvent pas uniquement du système
bureaucratique, mais sont attribuées à des individus influents
par leur richesse ou leur prestige. La limite entre la
participation politique et les catégories socioprofessionnelles
est donc bien artificielle.
La participation aux luttes de l’indépendance et à
leurs prolongements
Faute d’une idéologie mobilisatrice nouvelle, le nationalisme
reste encore, en 1963, la pierre de touche de l’appartenance à la
classe politique. Si la participation à la lutte nationale a pris
diverses formes et a eu des degrés d’intensité variables, elle est
surtout revendiquée pour légitimer les avantages acquis après
l’indépendance. Certes, une seconde génération, dont la
participation historique avait été moins active mais qui
possédait plus de diplômes, commence, dans les années
soixante, à occuper les postes administratifs en vue, et
quelquefois les postes politiques.
Par ailleurs, si au sein de l’élite politique nationale, on ne
trouve aucun ancien collaborateur important du protectorat, à
l’exception des militaires, il n’en est pas de même pour les
élites locales. A ce niveau, la participation à la lutte nationale
n’est plus une condition indispensable, du moins en 1963. De
plus, nous ne disposons pas d’informations sur ce point pour
les deux tiers des candidats. Pour beaucoup, les renseignements
sont vagues et le nationalisme n’est qu’une justification
généralement invoquée a posteriori. Certains candidats (15 %),
sur lesquels nous disposons d’informations, sont même
considérés par l’administration comme d’anciens
collaborateurs. Il était certes difficile de s’engager dans l’action
nationaliste en dehors des grandes villes, si l’on exerçait des
responsabilités ou si l’on possédait des biens qui pouvaient
donner prise à l’administration du protectorat. Mais ce simple
fait tendrait aussi à prouver la permanence des élites locales,
plus aptes à résister aux grands bouleversements que les élites
nationales, tout en étant plus soumises aux pressions du
pouvoir.
Les candidats ayant eu une participation positive ou négative à
l’indépendance représentent plus du tiers du total.
Ainsi, l’Istiqlal a été le parti de la résistance diffuse, avec un très
fort pourcentage de militants nationalistes. Ce groupe de
candidats était relativement moins important dans les autres
partis. Mais les plus forts pourcentages de candidats
emprisonnés par les Français, anciens résistants ou membres de
l’Armée de libération, se trouvent à l’UNFP. Au FDIC et parmi
les neutres, la participation à l’indépendance est beaucoup
moins nette. On retrouve au FDIC un bon tiers de l’ensemble
des anciens partisans du Glaoui. Le FDIC apparaît donc, à
nouveau, tout en s’intégrant aux nouveaux courants, comme
un parti où la continuité des notables l’emporte. L’UNFP est le
groupe où les anciens contestataires violents du protectorat se
retrouvent en plus grand nombre. L’Istiqlal trouve sa cohésion
dans une masse de participants plus modérés, dont un bon
tiers a été emprisonné par le protectorat, sans pour autant avoir
participé massivement aux actions violentes de révolte urbaine
ou rurale.
Quelques constatations intéressantes peuvent être faites à partir
de l’analyse d’un groupe d’une cinquantaine de candidats pour
lesquels nous disposons d’indications sur la date de leur
adhésion au parti auquel ils appartiennent. Ceux qui n’ont pas
participé à l’indépendance, ou qui ont été considérés comme
collaborateurs, n’ont adhéré qu’après 1956. D’autre part, il est
intéressant de relever que plus de la moitié des militants
nationalistes et des anciens emprisonnés ont adhéré à l’Istiqlal
avant 1948. Mais sur les quatre anciens résistants, aucun n’a
adhéré à l’Istiqlal avant 1953. Leur engagement dans un parti
date de la crise de 1953, et même du lendemain de
l’indépendance.
Répartition, par parti, des candidats sehn leur participation à
l’indépendance
Les tris géographiques font apparaître des différences
significatives. Le Nord, qui a obtenu son indépendance de
façon contractuelle, sans avoir réellement à lutter contre
l’Espagne, a un taux très faible de participation au groupe des
nationalistes. La collaboration avec le protectorat espagnol
n’était pas infamante, et les activités politiques des
nationalistes consistaient principalement à soutenir
financièrement et politiquement l’Istiqlal et les résistants de la
zone française. Dans le Sud du pays et dans les régions pré-
sahariennes, la répartition des candidats est plus nettement
contrastée. Les anciens collaborateurs sont concentrés au sein
du FDIC où ils représentent 47 % des candidats. Les résistants
et les emprisonnés totalisent 73 % des candidats UNFP, et 60 %
de ceux de l’Istiqlal. L’opposition, que l’on pouvait remarquer,
entre des élites locales traditionelles et de nouvelles élites
influencées par l’évolution des villes du littoral, s’y trouve
confirmée en termes mesurables. Cette opposition peut
contribuer à expliquer l’instabilité et les luttes violentes qui se
sont déroulées dans le Sud après l’indépendance.
Dans l’ancien « Maroc utile », les militants nationalistes
l’emportent sur tous les autres groupes dans tous les partis, ce
qui prouve une participation positive à l’indépendance. Cette
proportion est encore plus forte dans les villes.
Si les données géographiques permettent de faire quelques
distinctions dans le groupe des candidats ayant participé à
l’indépendance, en est-il de même de l’enseignement ? Les
illettrés relativement peu nombreux (25) représentent à peine
10 % du groupe. On les trouve chez les candidats FDIC
d’origine Mouvement populaire, où ils représentent les deux
tiers des partisans du Glaoui et des militants nationalistes, et,
dans une proportion identique, parmi les résistants
emprisonnés de tendance Istiqlal ou UNFP. L’étude des langues
écrites par les candidats fait apparaître, chez les nationalistes,
les résistants et les emprisonnés, une connaissance largement
dominante de l’arabe littéraire. Le taux de connaissance de
l’arabe croît en fonction de la participation active à la lutte
contre le protectorat. A l’inverse, le taux le plus élevé de
bilinguisme arabe-français (43 %) va de pair avec la
collaboration. L’étude de la fréquentation de l’enseignement
primaire permet de confirmer cette première hypothèse. Sur
210 candidats concernés, les deux tiers sont issus de l’école
coranique, contre un tiers de l’école française. Mais si les
candidats issus de l’école coranique sont encore majoritaires
parmi les partisans du Glaoui, ils le sont dans une proportion
moindre que chez les résistants (63 %) ou chez les emprisonnés
(77 %). On pourrait en déduire que l’opposition violente au
protectorat allait de pair, pour les élites locales, avec une
moindre familiarité avec la culture française. Au niveau des
élites nationales ce serait l’inverse.
L’analyse de la fréquentation de l’enseignement secondaire
permet de préciser ces hypothèses. Sur les 10 candidats classés
comme collaborateurs, 8 proviennent effectivement de
l’enseignement secondaire moderne. Pour les militants
nationalistes, les deux groupes s’équilibrent presque : 29
proviennent des établissements traditionnels, dont 20 issus de
Ka-raouyne, et 26 des lycées et collèges, dont 7 du Collège
d’Azrou. Dans le groupe des anciens résistants, les deux tiers
proviennent des établissements traditionnels, « t on dépasse les
trois quarts pour le groupe des candidats emprisonnés par le
protectorat. Il semble donc confirmé que la culture
traditionnelle a favorisé le recours aux formes les plus actives
d’action militante, au niveau des élites locales.
L’analyse des élus appartenant à ce groupe confirme les
impressions qui se dégageaient de l’étude des candidats.
Environ 40% des élus ont participé de façon positive ou
négative aux événements qui ont amené l’indépendance. Le
groupe le plus nombreux est celui des militants nationalistes
que l’on rencontre dans tous les partis, mais surtout parmi les
élus Istiqlal. Les formes de lutte les plus violentes ont été le fait
des élus UNFP et FDIC. Mais ce dernier parti se signale aussi par
un tiers d’élus classés comme anciens collaborateurs.
La tradition familiale
Dans le système social marocain, l’individu n’existe pas en tant
que tel, mais comme membre d’une famille, d’un groupe plus
ou moins étendu au sein duquel des liens de solidarité entre
personnes l’emportent le plus souvent sur toute autre forme de
relations. Ces liens se rationalisent par référence à un système
de parenté réel ou fictif, et restent, encore aujourd’hui, une des
composantes des rapports sociaux. Ils jouent un rôle important
dans le système politique national où les affinités de clans, les
origines citadines communes, sans parler des liens de parenté,
créent des attaches entre les individus, en dépit de différences,
que l’on serait porté à traduire, ailleurs, en termes de classe
sociale, ou d’idéologie. Il est certain que ce facteur joue un rôle
encore plus important dans la vie politique locale. Les partis,
les syndicats, l’administration constituent, certes, de nouvelles
sources d’influence. Mais il est rare qu’elles suffisent seules à
imposer un candidat, surtout en milieu rural.
Les candidats ont donc besoin de cautions extérieures. S’ils
sont jeunes, ils ne peuvent avoir de prestige par eux-mêmes.
Mais leur groupe familial peut facilement leur en procurer ; la
richesse, la pratique généreuse des lois de l’hospitalité
contribuent à leur assurer une place dans la société locale. II en
est de même des fonctions administratives, judiciaires ou
religieuses, surtout lorsqu’elles se transmettent pendant
plusieurs générations, comme il est parfois d’usage. Les fils ou
neveux de caïds, de cadis ou d’oulémas bénéficieront d’un
préjugé favorable, en dépit de leur jeunesse, tant que leur
conduite personnelle sera conforme à la morale du groupe.
Que leurs ascendants aient collaboré avec les autorités de
protectorat n’est plus, en 1963, une tare transmissible.
Cette forme d’engagement politique, dû à des liens personnels
ou familiaux, tendra à réduire l’importance des facteurs
idéologiques dans la motivation et dans l’action des candidats,
même si l’essentiel du vocabulaire et des thèmes développés au
cours des campagnes électorales fait bien référence à un
système d’idées et de principes, qui se situe, pour l’essentiel, au
niveau national[1]. Mais il existe aussi au niveau régional et
local des solidarités et des intérêts qui prévalent plus ou moins
consciemment sur les engagements idéologiques. Ce fait prend,
dans le système politique marocain, un relent de tribalisme et
de tradition que l’on n’aime guère mettre en évidence. Pour
cette raison, l’influence familiale sera un facteur difficile à
déceler et à interpréter. On peut, semble-t-il, en se fondant sur
plusieurs recoupements de cas individuels connus, formuler
l’hypothèse que ce facteur a été plutôt sous-estimé dans les
données analysées, en particulier pour les candidats de
l’opposition.
La mesure de l’influence des candidats et des facteurs qui
peuvent modifier cette donnée est donc rendue
particulièrement délicate. Il semblerait, en premier lieu, que
l’influence familiale au niveau de la circonscription soit en
relation avec l’âge des candidats. C’est chez les candidats âgés
de plus de 50 ans qu’on trouve la proportion la plus forte de
candidats bénéficiant d’influence familiale. Cette influence
diminue nettement dans les groupes les plus jeunes. Il en est de
même de l’influence personnelle des candidats. L’influence
familiale a cependant une importance relative plus grande que
l’influence personnelle. Elle paraît plus sensible dans les
circonscriptions semi-urbaines que dans les circonscriptions
rurales ou urbaines.
Si l’on porte attention à la répartition par province, ce facteur
joue plus nettement dans les provinces du « Maroc utile »
comme Casablanca, Rabat, Oujda, Beni Mellal et, à un moindre
degré, Fès et Meknès. A part Nador, l’ex-zone Nord est au-
dessous de la moyenne nationale. Il en est de même dans le
Sud, à l’exception de Ouarzazate. En revanche, si l’on analyse
l’influence personnelle des candidats, une autre répartition se
dégage. Des provinces comme Agadir ou Marrakech se
distinguent, la zone Nord reste relativement dans l’ombre, et
quelques provinces comme Ouarzazate, Tanger et Rabat
figurent chaque fois dans le groupe de tête.
On pourrait en déduire que la richesse du « Maroc utile » serait
la source d’une influence familiale plus accentuée.
Pratiquement il semble bien que le système de remplacement
des dynasties de notables ait surtout fonctionné dans ces
régions au profit du FDIC et de l’Istiqlal. Au contraire, dans le
Sud, l’influence provient plus de la réussite personnelle.
L’émigration vers Casablanca fournit bien entendu maints
exemples de ce type de nouveau notable.
Répartition, par province, de ΐ influence familiale et personnelle des
candidats
Répartition des candidats par parti et par type d’influence familiale
Si l’on prête attention à l’origine de cette influence, on
constate qu’un tiers des candidats concernés sont notés comme
appartenant à des familles de notables. La répartition par type
de circonscriptions montre que la plupart de ces descendants
de personnages influents se rencontrent surtout dans les
circonscriptions rurales. Dans les circonscriptions urbaines, les
relations commerciales semblent une source d’influence non
négligeable.
La religion est aussi un facteur d’influence dans les
circonscriptions rurales, où l’on trouve surtout des familles de
chorfa, des descendants de chefs de confrérie, comme les
Ouazzani, et quelques descendants d’oulémas. Ce facteur
d’influence, hérité de l’ancien Maroc, est intéressant même si le
nombre des candidats sur lesquels il s’exerce est assez limité.
Les chorfa sont des descendants du Prophète ou supposés tels.
Ils ont en milieu rural un comportement de notables citadins :
ils voilent leurs femmes, ne travaillent pas de leurs mains, et
vivent d’aumônes. Ils jouent souvent le rôle d’intermédiaires
acceptés entre les groupes rivaux qui les entretiennent. Un rôle
identique est conféré, en pays berbère, aux descendants des
familles de saints locaux[2].
En isolant le groupe des 75 candidats analphabètes, on devrait
pouvoir analyser l’influence du système traditionnel et du
milieu familial. On pourrait faire l’hypothèse suivante :
l’influence due à l’instruction et indirectement aux idéologies
modernistes ne joue pas un grand rôle dans leur motivation et
leur perception par le groupe. En compensation, ils devraient
bénéficier d’un taux d’influence familiale supérieur à la
moyenne. Or il n’en est rien. Le taux d’influence familiale chez
ce type de candidat est plutôt légèrement inférieur à la
moyenne nationale. Cependant, le taux d’influence
personnelle serait pour eux largement supérieur. La
distribution, par parti, de ce type d’influence chez les candidats
analphabètes fait apparaître de grandes différences. Un tiers des
candidats du Mouvement populaire et 40 % des candidats
FDIC de cette catégorie proviennent d’une famille influente,
alors que les chiffres correspondants pour l’Istiqlal et l’UNFP ne
sont que 25 % et 6 %. Si l’on essaie de rechercher l’origine de
cette influence chez les candidats analphabètes, on découvre
que presque tous appartiennent à des familles considérées
comme très riches. Pour beaucoup, ces familles sont des
familles d’anciens caïds ou chioukh. Mais on n’y trouve pas de
familles connues pour leur influence religieuse, où, par
définition, un certain niveau d’instruction en arabe est l’un des
éléments du prestige familial. De même, aucun candidat
analphabète n’est recensé comme étant membre d’une
confrérie, et leur participation aux associations de type
moderne est très réduite.
La subjectivité des notations et des interprétations concernant
l’évaluation de l’influence rend délicates les interprétations. Il
semble bien, étant donné les taux extrêmement avantageux
dont sont gratifiés les candidats FDIC, qu’il y ait eu, dans leur
cas, une part de soutien de l’administration qui se traduisait
par une surestimation de leur influence. A l’opposé, l’UNFP
bénéficie d’évaluations généralement négatives, l’Istiqlal se
trouvant à mi-chemin entre ces deux extrêmes. L’examen
direct des données, recoupé par d’autres sources
d’informations, permet de penser que l’on pourrait se trouver,
là, devant une situation caractéristique du svstème politique
marocain. Les candidats FDIC, qui n’ont généralement pas une
motivation idéologique profonde, sont représentatifs d’intérêts
locaux et de groupes de solidarité dont l’administration est
consciente. Elle a parfois contribué à leur désignation en
fonction de cette représentativité sociologique. La situation des
candidats Istiqlal, qui était encore, six mois avant le scrutin, un
parti de gouvernement, n’est pas fondamentalement différente.
En revanche, l’engagement des candidats UNFP se fait sur des
bases idéologiques plus nettes, même si dans certains cas les
facteurs de représentativité des intérêts locaux jouent en leur
faveur. Le mode de scrutin a certes favorisé cette situation. A
court terme, elle se traduit par une alliance de fait entre les
intérêts locaux et l’administration. Mais, dans la mesure où
cette alliance est en partie en contradiction avec les objectifs de
transformation sociale que le gouvernement entend
poursuivre, l’avenir peut révéler des conflits sérieux entre ces
partenaires. Comme la base politique du parti gouvernemental
repose avant tout sur une représentation des intérêts locaux,
cette situation ne prouve pas, a priori, un taux élevé
d’intégration nationale. Lorsque le gouvernement entendra
opérer des transformations sociales qui pourraient porter
atteinte aux intérêts locaux, il ne pourra compter que sur son
propre réseau administratif, au risque de l’isoler des
représentants de la population. Même si le réseau administratif
a recours alors au vocabulaire des partis d’opposition, il est loin
d’entraîner le même type de mobilisation idéologique.
L’influence des partis
L’affiliation à un parti n’a pas une signification égale pour tous
les candidats. L’analyse des données sur l’influence familiale
tend à montrer l’inégalité des motivations idéologiques. Il
semble bien, pour les uns, que les intérêts locaux et les
solidarités de groupe l’emportent. Nombreux sont les candidats
qui n’ont pas choisi un parti par conviction mais ont été
choisis par la bureaucratie d’un parti ou par l’administration,
étant donné leur représentativité locale. On les trouve surtout
au sein du FDIC, mais aussi à l’Istiqlal et quelquefois à l’UNFP.
Ils sont généralement de formation traditionnelle, et, chez eux,
le sens des intérêts locaux s’allie à la conscience d’appartenir à
des ensembles plus vastes que la nation, qu’il s’agisse de la
communauté islamique ou du monde arabe, tout en se
cantonnant, dans le quotidien, à des niveaux plus limités. Le
rattachement au cadre national se fait pour eux par
l’intermédiaire de la monarchie. Le roi est le commandeur des
croyants et le symbole de la nation ; il est aussi souvent, pour
eux, le défenseur naturel des groupes et des intérêts locaux
auquel ils peuvent avoir recours pour résister à l’emprise d’une
bureaucratie héritière des idées et des techniques du
protectorat. Dans la mise en œuvre du progrès technique, en
particulier dans le monde rural, le conflit est latent entre la
bureaucratie soucieuse d’un développement rapide dans le
cadre national et des intérêts locaux désireux de maintenir des
équilibres et des modes de vie hérités du passé.
L’analyse des rapports politiques n’en est pas simplifiée. Les
partis qui ont alors une vision pratique de l’action politique
assez proche de celle de l’administration, en premier lieu
l’UNFP et, dans une certaine mesure, l’Istiqlal, sont dans
l’opposition. L’administration aurait besoin, pour réaliser son
programme de modernisation, d’obtenir un certain soutien
populaire. Elle ne peut mobiliser les défenseurs des intérêts
locaux sur lesquels elle s’appuie, ni soutenir ceux qui, dans un
autre contexte, seraient disposés à s’opposer à ces intérêts.
Depuis 1960, il s’est opéré un reflux de la mobilisation
nationale intense qui existait dans le pays au moment de
l’indépendance. Ce courant n’aurait certes pas pu se
transformer, sans difficultés, en force de modernisation. Mais la
monarchie, l’administration et, dans une certaine mesure
même, les cadres du Mouvement national ont craint de
s’engager dans des mutations dont ils auraient pu perdre le
contrôle. Ce sont donc des groupes d’individus avec des
motivations extrêmement différentes que nous retrouvons
quand nous analysons les données concernant les partis
politiques. Il n’est pas question de refaire ici l’analyse des partis
politiques marocains depuis l’indépendance, mais plutôt de
tenter de déterminer la nature des liens entre candidats et
partis (déjà étudiée indirectement dans les chapitres
précédents). On s’efforcera aussi d’analyser l’influence des
groupes d’intérêts locaux au sein des partis.
La répartition des investitures est, à cet égard, un test
intéressant de l’emprise des partis sur leurs militants. Lorsqu’un
parti refuse son investiture à un militant ou à un responsable
local, on peut supposer, si l’engagement idéologique du
militant est profond, qu’il s’inclinera et soutiendra la
campagne du candidat choisi par l’appareil du parti. Si, au
contraire, le candidat est le représentant d’intérêts locaux, il
sera fortement tenté, pour ne pas décevoir sa propre clientèle,
de se présenter seul. Partant de ce principe, analysons la
répartition par tendance des 267 candidats non investis, et le
rapport, à l’intérieur de chaque tendance, entre le nombre des
candidats investis et non investis.
Répartition des candidats suivant leur parti d’origine et leur
investiture
Le parti pour lequel le pourcentage des non-investis est le plus
faible est l’UNFP, ce qui confirme la discipline et l’engagement
idéologique de ses militants. L’Istiqlal vient ensuite, en dépit
d’un appareil politique en apparence plus solide et mieux
structuré que celui de l’UNFP. Dans le FDIC, la part des non-
investis atteint les trois cinquièmes. Si l’on y ajoute les
candidats du Mouvement populaire, qui, tout en faisant partie
de la coalition du FDIC, a dû écarter un nombre considérable
de militants locaux au profit de personnalités imposées par
Rabat, le total des candidats non investis dépasse légèrement
celui des investis. On peut ainsi mesurer la résistance des
intérêts locaux et les tensions engendrées dans la coalition
gouvernementale. Les dirigeants du Mouvement populaire ont
accepté difficilement les arbitrages du cabinet royal qui les
défavorisaient. Ils ne pouvaient les imposer à leurs responsables
locaux, et se brouiller avec eux, sans résultat, puisque ces
derniers se présentaient quand même. Ils se font alors accuser
de duplicité par leurs partenaires du FDIC qui les soupçonnent
de favoriser l’insoumission de leurs cadres locaux. Partant de ce
fait, les autres courants de la coalition réclament la réduction
de l’influence gouvernementale et administrative du
Mouvement populaire, alors que ce parti aurait, au contraire,
besoin de nombreux postes à distribuer pour calmer l’irritation
de sa clientèle.
Répartition des candidats suivant leur affiliation antérieure et leur
investiture
Les mutations politiques d’un parti à l’autre peuvent aussi
servir à analyser le degré d’engagement des candidats. La
confrontation des données sur les affiliations politiques
antérieures des candidats ayant reçu l’investiture d’un parti
montre l’extrême mobilité du personnel politique, à
l’exception de celui de l’Istiqlal. Pour la quasi-totalité des
candidats de ce parti nous n’avons aucune indication
d’appartenance antérieure à un autre parti, ce qui signifie, en
fait, que ces candidats sont toujours restés à l’Istiqlal depuis le
début de leur vie militante. Ce parti, par son rôle dans la lutte
nationaliste, a servi de souche aux autres groupements : 65 %
des candidats UNFP en proviennent, 27 % des candidats FDIC
et 22 % des neutres. La proportion est logique pour l’UNFP qui
s’est formée, en 1959, à la suite d’une scission à l’intérieur de
l’Istiqlal. Elle reste importante pour le FDIC. Ce parti, formé
juste avant les élections, recueille des militants d’origine
politique très diverse. On y trouve des anciens de l’Istiqlal, et
plus d’anciens de l’UNFP que du Mouvement populaire, sans
compter quelques indépendants libéraux PDC et neutres.
L’étude géographique de l’origine politique des candidats
investis fait apparaître des variations. Dans le Nord, l’Istiqlal
provient, en totalité, de l’ancien parti d’Abdel-Khaleq Torres, la
Réforme marocaine. Quelques candidats UNFP sont originaires
du PDC, et le FDIC emprunte ses candidats au Mouvement
populaire. Dans le Sud et les régions pré-sahariennes, le FDIC
provient en majorité de l’Istiqlal, mais aussi pour un cinquième
de l’UNFP. Cette proportion s’approche du quart dans le
« Maroc utile », allant jusqu’à atteindre presque le tiers dans les
villes du littoral.
L’importance de regroupements à l’intérieur du FDIC, qui fait
la part relativement belle aux anciens de l’Istiqlal et de l’UNFP,
plus familiarisés avec la vie politique nationale, explique les
frustrations du Mouvement populaire. Le FDIC cherche à se
constituer une clientèle de militants rodés dans les partis
nationaux, tout en bénéficiant du soutien de base du
Mouvement populaire. L’opération ne pouvait pas tenir
longtemps sans conflit majeur entre la tendance citadine et la
tendance rurale de la coalition.
Le taux élevé.d’appartenance antérieure et de mutation
politique ne doit certes pas être interpreté comme un indice de
politisation des candidats, mais plutôt comme un signe de la
transposition, dans le système politique, du poids qu’ils avaient
dans le système social. C’est leur rôle social qui tantôt incite les
dirigeants des divers postes ou de l’administration à les
solliciter, tantôt pousse les élites locales à se rapprocher de ceux
qui peuvent les aider à maintenir leur prestige et leur richesse.
Une sorte de transhumance figurée est donc la caractéristique
des moeurs politiques des élites politiques locales. Selon la
conjoncture, l’influence de l’administration locale ou la
pression des courants d’idée, on se rallie à tel mouvement
politique, ou encore l’on adhère à celui qui s’oppose le mieux
au choix des groupes rivaux dans la défense des intérêts locaux.
Dans ce contexte, l’engagement idéologique n’est, pour
beaucoup, qu’un choix marginal, sauf dans les circonscriptions
urbaines modernes. Mais aussi bien dans les villes
traditionnelles que dans les circonscriptions rurales, les
investitures des partis endiguent difficilement les candidatures
représentant les intérêts locaux.
L’exploitation des données sur la propriété terrienne nous
fournit aussi des indications sur le degré de représentation des
intérêts locaux par les candidats. La propriété terrienne est, au
Maroc, un indicateur sur l’intégration d’un individu au groupe.
Ainsi, 40 % des candidats possèdent des terres d’étendues
diverses. Seul l’UNFP compte très peu de propriétaires terriens.
Le FDIC et les non-investis sont les groupes les mieux
representés ; mieux que l’Istiqlal. Ce dernier compte un tiers de
gros agriculteurs possédant entre 100 et 300 hectares. De
même, dans le FDIC, 50 % des candidats classés comme
propriétaires possèdent plus de 50 hectares. L’UNFP n’est donc
pas un parti de propriétaires terriens mais compte néanmoins
un pourcentage non négligeable de petits propriétaires.
L’Istiqlal est un parti où les intérêts ruraux sont bien
représentes, en particulier ceux des gros propriétaires. Le FDIC
est le parti des moyens et gros propriétaires terriens[3],
notamment des éleveurs. Quant aux candidats non investis, ils
représentent près de la moitié du groupe dés propriétaires
terriens. Il existe donc entre le FDIC et l’UNFP une opposition
de structure beaucoup plus prononcée que les différences de
programmes. Le FDIC est avant tout un parti de défense des
intérêts locaux, allié (sous certaines conditions) à la
bureaucratie et à la monarchie contre des forces qui voudraient
modifier le statu quo. L’UNFP est, avant tout, un parti de
doctrine qui utilise parfois des réseaux d’intérêts locaux.
L’Istiqlal reste à mi-chemin : son poids sociologique le pousse à
privilégier les intérêts locaux lorsqu’il est au pouvoir, et ses
positions de doctrine lorsqu’il est dans l’opposition.
Cette différence de structure entre les partis est confirmée par
l’analyse de quelques données sur le groupe des élus. Les
dirigeants locaux, notamment les inspecteurs, sont nombreux
— près du quart — parmi les élus de l’Istiqlal ; et si l’on ajoute
les dirigeants nationaux, on atteint la moitié des élus, assez
bien répartis dans les divers types de circonscriptions :
l’appareil du parti a donc une emprise sur les militants et
l’électorat. Au sein du groupe UNFP, les dirigeants, en majorité
nationaux, représentent le tiers des élus, et proviennent surtout
des circonscriptions urbaines. Au FDIC, l’ensemble des
dirigeants locaux et nationaux, provenant en grande partie du
Mouvement populaire, ne représentent pas 10% des élus,
preuve de la faiblesse de l’appareil de ce parti.
Avant d’en terminer avec l’analyse de l’influence des partis, il
serait tentant d’utiliser les données dont nous disposons sur les
couleurs des bulletins des candidats pour voir dans quelle
mesure leur attribution peut faire apparaître les rapports
existant entre les partis et l’administration.
La loi électorale prévoyait que les couleurs seraient attribuées
aux candidats par l’administration provinciale, dans l’ordre de
réception des candidatures. Dans un pays d’analphabètes, le
choix des couleurs de bulletin de vote a une importance
symbolique considérable. Certaines couleurs sont plus
favorables que d’autres. C’est ainsi que la loi électorale
éliminait les couleurs fastes dans la tradition islamique : le
blanc et le vert[4]. Il restait cependant un choix assez vaste dans
la gamme des couleurs. Un parti qui arriverait à se faire
attribuer une même couleur à l’échelle nationale obtiendrait
un avantage considérable pour sa propagande, surtout si cette
couleur est jugée bénéfique.
C’est la manœuvre que réussit, en grande partie, le FDIC en
faisant donner oralement l’instruction aux gouverneurs de
réserver à ses candidats officiellement investis la couleur jaune
canari. Les candidats d’autres tendances devaient
systématiquement se voir attribuer des couleurs différentes,
pour éviter tout phénomène de concentration de propagande.
Certains candidats d’opposition, tel Allai el Fassi à Fès,
bénéficièrent cependant, grâce à des agents locaux de l’Istiqlal,
de la couleur réservée au parti gouvernemental.
Les indications dont nous disposons sur les couleurs de bulletin
des candidats et des élus montrent bien la complicité de
l’administration. Ainsi, 86 % des candidats bénéficiant du
bulletin jaune, et 91 % des élus appartiennent au FDIC. A
l’inverse, la couleur la plus souvent attribuée (39 %) aux
candidats Istiqlal est le rose; pour l’UNFP c’est l’orange (38 %) :
la différence est trop flagrante pour être le fait du hasard. Le
parti au pouvoir a essayé, par le biais de l’administration, de
remplacer la bureaucratie qui lui manquait, et d’imposer le
poids du pouvoir central aux intérêts locaux auxquels il
choisissait de s’allier. En dépit d’un certain flottement, le
système a fonctionné, mais pas exclusivement au bénéfice du
gouvernement.
Les élus locaux
Le groupe des candidats élus en 1960 à des fonctions locales est
relativement important. Il compte 146 candidats sur un total
de 723, et 39 élus sur 144, soit un peu moins du cinquième des
candidats et du quart des élus. On peut donc considérer
l’élection à un poste de l’administration locale comme un
facteur favorisant l’accès à d’autres niveaux de participation à
la vie politique. L’analyse de ce groupe de candidats doit
apporter des informations complémentaires sur l’importance
des intérêts locaux dans le système politique. On peut faire
l’hypothèse que les candidats et les élus appartenant aux
conseils communaux sont représentatifs de ces intérêts, et
essayeront de les faire prévaloir aussi bien à l’intérieur de leur
parti qu’au Parlement, ou dans leurs rapports avec
l’administration.
Ce groupe de candidats se différencie assez nettement si l’on
considère le type d’enseignement dont il est issu. Les trois
quarts des 64 présidents de conseils municipaux et
communaux candidats sont de formation primaire arabe. Cette
importance de l’enseignement traditionnel est confirmée par
l’étude du groupe des conseillers municipaux issus de
l’enseignement secondaire. Plus réduit, ce groupe compte 34
candidats dont 21 présidents. Sur ces 21 présidents, 10 sont
issus de Karaouyne et 4 d’autres universités traditionnelles.
Tous les adjoints appartiennent à ce groupe, ainsi que 7
conseillers sur 10. Les anciens élèves des lycées français, au
nombre de 9, sont largement minoritaires. On trouve donc
confirmation de l’importance de la culture traditionnelle
comme facteur d’appartenance aux élites locales, et source de
prestige plus nette que l’enseignement français. Mais l’absence
d’éducation n’est pas un facteur éliminatoire, en particulier
dans les campagnes. Sur les 75 candidats analphabètes on
compte 17 conseillers communaux, dont 10 présidents de
commune.
Répartition, par parti, des élus locaux candidats dans le « Maroc
utile »
La répartition géographique des candidats élus locaux donne
des résultats surprenants. On constate une concentration
exceptionnelle dans les provinces de l’ancien « Maroc utile »
qui en comptent 100 sur 146. Les provinces du Nord sont très
mal représentées avec 6 élus communaux, et celles du Sud avec
28.
L’analyse du groupe des élus du « Maroc utile » fait apparaître
indirectement la solidité de l’implantation politique de
l’Istiqlal qui compte 26 % des candidats élus locaux. Mais 73 %
des candidats appartenant à ce groupe sont des présidents de
conseil communal. Cette situation tendrait encore à prouver
que la situation d’élu local est volontiers utilisée par les partis,
l’Istiqlal par exemple, pour renforcer leur implantation, mais
elle ne suffit pas à elle seule à justifier une investiture politique.
Elle assure nettement, au cœur du pays, une continuité entre
élites locales et élite nationale, que l’on ne retrouve pas au
même degré dans les autres régions.
Le groupe des élus locaux est aussi le symbole d’une certaine
continuité, dans le temps, des élites locales. On y trouve un
nombre important d’anciens caïds ou chioukh, de membres
des jemaas administratives du protectorat, de cadis, d’adoul, ou
de fquihs. Sur 93 candidats qui ont exercé ces fonctions avant
l’indépendance, 26 ont été élus aux conseils communaux dont
15 présidents. Dix des 30 anciens caïds restés en fonction
jusqu’à la fin du protectorat, et figurant parmi les candidats,
ont été élus à un conseil communal, en 1960. En revanche,
parmi les 9 caïds ou khalifas, démissionnaires, en 1953, lors de
l’exil de Mohamed V, un seul a été élu en 1960. Les anciens
collaborateurs du protectorat semblent donc, à ce niveau,
bénéficier d’avantages sur les anciens résistants.
Le groupe des élus locaux est, dans son ensemble, remarquable
par son assise foncière. Une enquête effectuée en 1968 pour le
projet Sebou montre que dans la plupart des communes des
provinces de Rabat et de Meknès concernées on trouve 2 ou 3
agriculteurs possédant de 50 à 300 hectares, qui dominent le
reste de l’assemblée. Les autres membres du conseil sont de
petits agriculteurs possédant entre 5 et 10 hectares, qui font
partie de la clientèle des « coqs de village ». Seuls ces derniers
comptent vraiment parmi les élites locales, et entrent dans le
jeu subtil des échanges de soutien de d’influence avec
l’administration. On les trouve aussi bien dans les fonctions
administratives locales, et ils constituent naturellement le
groupe de recrutement des candidats et des élus.
Les fonctions administratives modernes ne semblent pas avoir
une influence aussi déterminante sur l’appartenance aux
assemblées locales. Sur 276 candidats ayant exercé ces
fonctions depuis l’indépendance, 29 seulement ont été élus en
1960. On peut les répartir en trois groupes. Tout d’abord les
enseignants, au nombre de 9 ; mais ils comptent 5 présidents
sur 13. Puis les anciens fonctionnaires des administrations
centrales, également au nombre de 9 ; cette catégorie très
hétérogène va du commis au ministre, les deux extrêmes étant
d’ailleurs les mieux représentés. Enfin 8 anciens caïds ou
chioukh dont 4 présidents, et 3 cadis ou adoul. On peut en
déduire qu’il est relativement plus facile de s’intégrer à l’élite
locale à partir d’un poste administratif de moindre importance
— mais qui a permis de rendre de menus services et d’exercer
une influence sur une circonscription donnée — qu’à partir des
postes plus prestigieux de l’administration centrale. Seuls peut-
être les anciens ministres ont un prestige suffisant pour
s’intégrer sur le plan local.
Pour en terminer avec les élus locaux, voyons leur importance
parmi les élus à la Chambre des représentants. Les 39 élus
appartenant aux conseils communaux représentent près du
quart des élus de la Chambre, pourcentage légèrement
supérieur à celui du rapport élus-candidats.
Le nombre des présidents est largement supérieur à celui des
conseillers. Les élus locaux représent près du quart du groupe
parlementaire Istiqlal, près de la moitié du groupe UNFP, il est
vrai plus réduit, mais moins du cinquième seulement au FDIC,
et enfin un tiers des neutres. Ces différences peuvent
s’expliquer par la solidité de l’appareil de l’Istiqlal dans
l’intérieur du pays et par l’emprise de l’UNFP sur les conseils
communaux des villes modernes. Les partis qui ont constitué le
FDIC étaient assez peu engagés dans la compétition électorale,
en 1960, et les intérêts locaux étaient alors plutôt représentés
dans l’Istiqlal ou par les neutres.
Parmi les candidats et les élus, les membres des conseils
communaux jouent donc un rôle important d’intermédiaires
entre la masse (la culture traditionnelle les rapproche),
l’appareil des partis et l’administration qui recherche le contact
et souvent la neutralisation des hommes influents. A
l’exception des élus UNFP des villes modernes et de quelques
élus Istiqlal, comme Mohamed Boucetta à Marrakech, ils
semblent plus préoccupés par le maintien du statu quo que par
une politique de changement social et économique profond. Si
l’appartenance des candidats à un conseil communal peut être
considérée comme un facteur favorable à l’investiture par un
parti, son influence sur l’élection semble cependant moindre
que celle du milieu familial. Elle reste cependant plus marquée
que celle des syndicats et des associations modernes ou
traditionnelles dont peuvent faire partie certains candidats.
Les syndicats
Comme les élus locaux, les candidats appartenant à un
syndicat sont concentrés dans les provinces du « Maroc utile ».
Sur 105 candidats relevant de cette catégorie, 64 proviennent
de cette région, contre 11 seulement des villes, 19 du Sud et des
régions pré-sahariennes, et 11 du Nord. Cela n’a rien
d’étonnant ; le groupe le plus important est celui des
syndicalistes agricoles avec 34 membres de l’UMA et 13
membres de l’USA. Parmi les 31 candidats appartenant à
l’UMT, on trouve également des employés des centres de
travaux agricoles, qui appartiennent aussi au même secteur.
L’UMCIA ne compte que 5 candidats, et l’UGTM, 18. Si l’on
s’attache à l’étude du sous-groupe régional le plus important,
on constate que les candidats Istiqlal se répartissent également
entre l’UGTM et l’UMA. Les candidats UNFP proviennent, pour
les deux tiers, de l’UMT, et pour un tiers de l’USA. Les
candidats FDIC d’origine syndicale sont nettement moins
nombreux que dans les autres partis. Ils proviennent en
majorité de l’UMA, mais aussi de l’USA, et même du
syndicalisme étudiant. Les neutres, relativement nombreux,
montrent que les syndicalistes n’ont pas facilement trouvé
place parmi les candidats investis par les partis.
Répartition, par parti, des candidats adhérents à un syndicat dans le
« Maroc utile »
Les données sur l’appartenance syndicale des élus apportent
quelques informations globales complémentaires : 22
représentants sur 144 ont une affiliation syndicale. Parmi eux,
14 appartiennent en fait à un syndicat agricole, dont 10 à
l’UMA et 4 à l’USA. Les syndicats ouvriers sont moins bien
représentés : l’UMT ne compte que 2 élus, et l’UGTM, 5.
A la réflexion, ces résultats sont moins étonnants. L’UMT
n’était pas enthousiaste de soutenir l’UNFP dans cette élection.
Un différend profond opposait depuis longtemps les cadres du
parti et ceux du syndicat, pour savoir qui, en définitive,
contrôlerait l’autre. Peu de temps avant les élections, Mehdi
Ben Barka avait essayé encore une fois d’établir son emprise sur
l’UMT, en commençant par quelques sections locales
importantes. L’UMT, qui avait poussé à la scission de l’Istiqlal
en 1959 pour du parti. Le syndicat poursuivait une politique de
stabilité de l’emploi, et entendait maintenir le contact avec le
patronat et surtout avec le gouvernement. Le Ministère du
travail, l’administration de la sécurité sociale étaient ses fiefs ;
l’UMT bénéficiait d’avantages donnés par le gouvernement :
fonctionnaires détachés, locaux mis à sa disposition
gratuitement. Officiellement, les contacts avec le
gouvernement étaient nuls, et le syndicat refusait de jouer le
jeu des institutions. Il avait boycotté la Constitution et
n’entendait pas participer aux élections. Au dernier moment, il
dut, sous la pression de ses militants, apporter son soutien à
l’UNFP, tout en refusant de présenter des candidats, ce qui
explique la faible présence, parmi les élus UNFP, de militants
syndicalistes. Un ancien président du Conseil proche de l’UMT,
Abdallah Ibrahim, ne sera pas candidat, alors qu’il aurait eu
toutes les chances d’emporter un siège. En revanche, l’UGTM,
organisation rivale soutenue par llstiqlal, présentait son
secrétaire général, Hachem Amine, qui fut élu à Oujda. En
outre, 4 des ses dirigeants locaux étaient des élus Istiqlal.
L’UMA, qui compte le plus grand nombre d’élus, regroupe
surtout les gros agriculteurs. A l’origine, elle était liée à
l’Istiqlal, mais certaines divergences opposent ses dirigeants,
plus conservateurs, à ceux de ce parti. On trouve cependant 5
des 10 élus appartenant à ce syndicat agricole dans le groupe
Istiqlal ; les autres se répartissent entre l’UNFP, le FDIC et les
neutres. L’USA, organisation agricole rivale de l’UMA, fondée
par l’UNFP, compte 2 de ses membres parmi les élus de ce parti,
mais aussi 2 classés parmi les neutres.
Si les syndicats ouvriers n’ont exercé qu’une influence limitée
sur les candidatures et sur l’élection, il n’en est pas de même
des syndicats agricoles, et en premier lieu de l’UMA.
L’appartenance des candidats à ces organisations apporte la
preuve de leur intégration au milieu rural moderne, et
bénéficie surtout à l’Istiqlal, dans des conditions assez
comparables à celles déjà analysées dans l’étude des élus
locaux.
Les confréries et associations
Après avoir étudié la participation politique dans ses formes
modernes, partis, syndicats, assemblées locales, il nous faut
examiner deux formes contradictoires de participation
collective à la vie sociale : les confréries, permanences d’un
passé lointain, et les associations, fruits de la modernisation des
structures.
Le nombre des candidats affiliés à une confrérie (24) ne
représente que 3 % du total des candidats[5] ; cependant, il
semble utile d’analyser les données dont nous disposons à leur
sujet. Les confréries religieuses ont joué un rôle important dans
l’histoire du Maroc. Lorsque le pouvoir central n’était pas
capable de résister aux pressions de l’étranger, elles ont su
animer une résistance populaire vigoureuse[6]. Le protectorat a
dû compter avec elles avant de transiger avec leurs chefs, et,
dans l’ensemble, les associer à son pouvoir ; il les a même
compromis dans ses ultimes aventures. Le nationalisme s’était
affirmé contre cet Islam impur et compromis par sa connivence
avec l’étranger. Les liens des candidats avec les confiéries ont
donc, même en 1963, une apparence peu recommandable. Les
intéressés ne s’en prévaudront guère, conscients d’apparaître
comme des traditionalistes attardés, et l’administration,
lorsqu’il s’agira de candidats FDIC, masquera souvent leur
affiliation à une confrérie. Sur les 24 candidats appartenant à
une confrérie, 14 recevront l’investiture officielle d’un parti
politique, et 6 seront élus au Parlement. Il n’y a donc pas un
barrage politique absolu contre les candidats de cette catégorie.
La plupart de ces candidats se sont présentés dans des
circonscriptions rurales. C’est, en fait, au sein du FDIC et chez
les neutres que se retrouvent les trois quarts des affiliés à des
confréries[7]. On ne constate pas de liaison précise à l’échelle
nationale entre une confrérie et un parti. Il est vrai que les
chiffres sur lesquels on peut raisonner sont trop réduits pour
permettre des déductions sûres.
Les membres des confréries sont en majorité de culture
traditionnelle. Neuf d’entre eux ne parlent qu’arabe, et un
nombre égal, arabe et berbère. Les berbérophones sont, en fait,
en légère majorité, si l’on ajoute les quelques candidats lettrés
en arabe, sept sont passés par Karaouyne, Ben Youssef ou
d’autres établissements d’enseignement traditionnel. Trois
candidats lisent le français et un seul l’espagnol.
Le groupe des candidats ayant des attaches avec les confréries
semble bien, en 1963, une survivance du groupe des notables
traditionnels. Ce sont, comme nous l’apprennent les
renseignements individuels, des notables qui, pour des raisons
diverses, ont survécu à l’écroulement du système ancien lié à la
colonisation. Moins compromis que d’autres, leur richesse et
leur comportement conforme à la morale traditionnelle ont
préservé leur influence locale. L’administration, à la recherche
de candidatures honorables pour le parti gouvernemental, a
alors été amenée à les solliciter : elle reprenait la « politique
indigène » du protectorat, en essayant d’opposer un
traditionalisme hérité du vieux Maroc à un néotraditionalisme
formé dans la lutte pour l’indépendance. Le fait qu’on ne
rencontre aucun affilié aux confréries parmi les candidats de
l’Istiqlal est significatif, même si l’échantillon observé est très
réduit.
Les associations relèvent d’un univers politique différent. En
1963, le Maroc n’est pas encore un pays où les individus sont
pris dans un réseau très serré d’associations. Le gouvernement
marocain a conservé, à leur égard, l’attitude de méfiance que
pratiquait le protectorat. Pour l’administration, tout
groupement de personnes, même pour des raisons étrangères à
l’action politique, a un potentiel mobilisateur qui peut être
dérivé de son but initial. Il doit donc être soumis à un contrôle.
Jusqu’à la promulgation de la Charte des libertés publiques, en
novembre 1958, le droit des associations était très restrictif, et
la pratique assez peu développée et guère encouragée. En outre,
la communauté musulmane avait traditionnellement une
vocation unitaire qui lui faisait soupçonner d’hérésie les
groupements particuliers, tels que les confréries. Ces dernières
se sont cependant multipliées à diverses époques, non sans
mettre en cause l’autorité du pouvoir central. Dans les cités
maghrébines, un système de corporations comparables à celles
du Moyen Age européen s’était aussi développé. Le protectorat
avait vu naître et parfois encouragé des associations d’anciens
élèves des collèges franco-musulmans, qui lui permettaient
d’étendre le rayonnement des écoles franco-arabes, et de
faciliter le recrutement des nouveaux élèves. Les Marocains
participaient aussi à l’activité des Chambres de commerce et
des Chambres d’agriculture.
Après l’indépendance, toute une série d’associations para-
politiques furent organisées dans le sillage de l’Istiqlal. Les plus
florissantes étaient l’UMCIA et l’UMA (que nous avons déjà
étudiées), mais il existait d’autres groupements, moins
spécialisés et officiellement moins liés à un parti politique, tels
que les associations d’anciens élèves, les associations sportives,
les Chambres de commerce, les associations de bienfaisance ou
les associations d’oulémas. Si leur rôle d’intégration locale est
net, leur orientation traditionaliste ou modernisante est plus
difficile à préciser. Les données dont nous disposons
permettent de confronter l’appartenance à certains types
d’associations à l’origine sociale culturelle ou politique de leurs
membres.
Bien que le groupe des candidats appartenant à des associations
ne représente que 20 % du total des candidats, sa composition
permet de préciser quelques aspects des relations entre la
participation politique et d’autres formes de participation
sociale. Ainsi, les taux les plus élevés de participation aux
associations se rencontrent dans les villes traditionnelles (32 %)
alors qu’ils n’atteignent que 17 % dans les villes modernes.
Dans les circonscriptions semi-urbaines, les taux varient dans
des proportions comparables à celles indiquées ci-dessus,
suivant que le noyau central est une petite ville traditionnelle
ou un bourg moderne. En milieu rural, enfin, le taux de
participation (18 %) aux associations est comparable à celui des
circonscriptions urbaines modernes.
Dans le Nord, c’est le FDIC et les neutres qui ont les taux
d’affiliation les plus élevés aux associations, dans une région où
le taux courant est déjà supérieur à la moyenne nationale.
Dans le Sud, au contraire, c’est l’UNFP qui se distingue
nettement dans la moyenne régionale. Dans les provinces du
« Maroc utile », l’Istiqlal vient largement en tête de la
participation régionale, suivi par l’UNFP. En revanche, dans
l’ensemble des villes traditionnelles et modernes réunies, c’est
le FDIC.
Quelle interprétation peut-on donner de ces résultats en
apparence peu cohérents ? Les facteurs culturels analysés plus
loin permettront de préciser certains points, mais l’on peut dès
maintenant voir que la participation à des associations, qui
sont en majorité des voies d’accès à la modernisation, est plus
importante dans les secteurs dominés par des influences
traditionnelles. Faut-il en déduire que l’élite traditionaliste
n’est pas sans chercher certaines formes d’accès à la vie
moderne par l’intermédiaire de groupements qu’elle peut
contrôler ? Il ne s’agirait plus alors du modernisme imposé par
la bureaucratie, mais d’un changement que l’on s’efforce
d’apprivoiser à sa mesure. C’est pourquoi des villes
traditionnelles comme Fès[8], ou des régions situées encore à
l’écart de l’évolution du reste du pays, comme l’ex-zone Nord,
semblent vouloir mettre à profit leur ancienne cohésion sociale
pour entreprendre certaines formes de changement, ou pour le
moins pour en contrôler les effets. Ceux qui dominent plus
facilement ce changement grâce à une culture de type français
peuvent ressentir, à un moindre degré, le besoin de se grouper
pour entre-prendre ou accepter les innovations.
Notes du chapitre
[1] Voir O. Marais, J. Waterbury, « Thèmes et vocabulaire de
la propagande des élites politiques au Maroc, » Annuaire
d’Afrique du Nord 1968, p. 57 à 79.
[2] Voir E. Gellner, Saints of the Atlas, Londres, Weidenfeld
and Nicolson, 1969.
[3] Sur quatre candidats possédant plus de 1 000 hectares,
trois appartiennent au FDIC.
[4] Le blanc aurait cependant été la couleur du « oui » au
référendum constitutionnel du 7 décembre 1962.
[5] Contre 20 % pour les candidats affiliés à une association.
[6] Voir E. Michaux-Bellaire, « Les confréries religieuses au
Maroc », Archives marocaines, Paris, Champion, 1927, volume
28, p. 1-86. G. Drague, Esquisse d’une histoire religieuse du Maroc,
Paris, Peyronnet, 1950.
[7] La majorité d’entre eux habitent, en 1963, dans la
circonscription où ils étaient nés.
[8] Voir à ce sujet l’étude de J. Berque, « Fès ou le destin
d’une médina », Cahiers internationaux de sociologie, 1er
semestre 1972, p. 5-33.
Chapitre XI. Le contrôle du pouvoir et des
ressources locales
Nous avons étudié, à travers les candidats, la participation des
élites locales au système politique. Pour un grand nombre,
cette participation tire sa légitimité de diverses formes
d’association aux luttes pour l’indépendance ; le nationalisme,
la résistance, l’emprisonnement ont constitué des créances sur
le nouvel ordre politique. Mais les élites locales en place sous le
protectorat n’ont pas été éliminées pour autant. Elles ont
conservé la base économique de leur pouvoir. Certains de leurs
membres retrouvent, à partir de 1960, une influence politique
personnelle ; dans d’autres cas, c’est un membre de la famille,
plus jeune ou moins compromis, qui en bénéficie. Cette
permanence des réseaux familiaux permet de nuancer
l’intégration des élites locales aux formes modernes de
participation sociale et politique à travers les partis, les
syndicats, les associations.
Il serait illusoire d’aborder les données dont nous disposons sur
les catégories socio-professionnelles en les isolant de ce
contexte. L’analyse de chaque catégorie prise isolément
donnerait une impression fausse. Maints exemples cités ont pu
montrer que les candidats étaient souvent, en même temps,
propriétaire exploitant, éleveur, commerçant, et exerçaient une
fonction administrative locale. Si nous nous intéressons aux
bases socio-économiques du pouvoir des élites locales, il faudra
aborder chacun des thèmes étudiés, qu’il s’agisse des fonctions
administratives, de la richesse terrienne ou commerciale,
comme des faces diverses d’un même ensemble.
Dans cet ensemble, les données qui nous renseignent sur la
participation au pouvoir, avant et après l’indépendance, ont
une importance particulière. Les fonctions du Makhzen,
moqqadem, cheikh, caïd même, sont confiées à des titulaires
qui possèdent déjà généralement richesse et notoriété
individuelle ou familiale. Mais ces fonctions sont aussi
l’occasion pour les intéressés d’accroître et de diversifier leurs
richesses et leur prestige. Les fonctions locales du Makhzen ne
sont pas incompatibles avec l’agriculture et même parfois avec
le commerce[1].
Le contrôle des terres et d’autres facteurs de production
d’importance variable suivant les régions (bétail, arbres
fruitiers) sont aussi un élément considérable de pouvoir local,
provenant souvent, dans le passé, de l’exercice des fonctions
du Makhzen. Dans le Maroc indépendant, ce serait plutôt
l’inverse, les fonctions d’auxiliaire de l’administration locale
seraient plutôt confiées à ceux qui possèdent déjà une certaine
emprise sur les facteurs de productions en milieu rural.
Le commerce est aussi un facteur ambigu, impossible à traiter
isolément. Dans un nombre de cas non négligeables, le
commerce est une activité surajoutée pour diversifier et
accroître les sources de revenus de gros notables ruraux. Dans
d’autres, les commerçants sont de véritables entrepreneurs
modernes : c’est dans les grandes villes qu’est la source de leurs
richesses et de leurs activités. Mais, souvent, ils achètent des
terres ou élèvent des animaux en association dans leur terroir
d’origine, autant pour y acquérir un statut social, que pour
faire, dans le cas de l’élevage surtout, un placement
avantageux. Même dans ces conditions, les commerçants
restent des éléments influents du groupe auquel ils
appartiennent, soit parce qu’ils sont en mesure de faciliter le
départ des candidats à l’émigration, soit parce que — en tant
qu’usuriers locaux — ils ont réussi à se constituer une clientèle
importante d’obligés. Leurs revenus sont généralement
supérieurs à ceux des gros agriculteurs, même si leur richesse
est moindre.
L’autorité des élites locales provient donc des fonctions
administratives assurant un certain type de pouvoir sur les
hommes, la propriété des terres et du bétail procurant le
contrôle des ressources des communautés.
Les agents du Makhzen
Cette catégorie ne sera pas traitée ici uniquement sous son
aspect socio-professionnel, mais plutôt sous l’angle du pouvoir
local. Certes, tous les agents du Makhzen n’appartiennent pas à
la catégorie des détenteurs du pouvoir local. Un nombre
relativement important d’entre eux sont des enseignants,
quelques-uns, après l’indépendance, relèvent des
administrations centrales. Leur pouvoir est alors plutôt
comparable à celui des commerçants du Souss. Ce sont des
intercesseurs et des intermédiaires pour l’émigration. En
revanche, les juges et les auxiliaires de la justice participent à la
gestion de la communauté locale et à l’exercice du pouvoir, et
les enseignants, en assurant la diffusion de la culture
traditionnelle ou moderne, acquièrent une influence
privilégiée sur la communauté.
L’administration, au niveau local, ne s’isolant pas facilement
du politique, nous retrouverons des thèmes et des problèmes
abordés précédemment.
Fonctions administratives traditionnelles avant
l’indépendance
Certaines fonctions administratives étaient confiées, avant
l’indépendance, à des agents marocains sous le contrôle de
l’administration française ou espagnole. On les rencontrait, en
particulier, dans deux domaines de souveraineté où la réalité
du pouvoir était en fait passée entre les mains de
l’administration étrangère : l’administration locale et la justice.
Les Marocains, qui étaient associés à ces responsabilités, étaient
donc des collaborateurs placés dans une situation ambiguë par
rapport à leurs compatriotes. Ils appartiennent souvent aux
anciennes familles qui exerçaient le pouvoir local au nom du
sultan, ou simplement investis par la communauté avant
l’établissement du protectorat. Ils avaient pris la tête de la
résistance aux étrangers. Lorsque ces chefs faisaient leur
soumission, Lyautey avait pour règle de gouvernement de faire
nommer dans leur famille les nouveaux représentants du
sultan. Le système avait généralement fonctionné à la
satisfaction de l’administration du protectorat ; il assurait à la
fois la continuité et le renouvellement des élites locales, les fils
ou les neveux succédant à leurs pères, anciens rebelles. Le plus
bel exemple de cette continuité est donné, chez les Zaïans, par
Hassan et Amarhoq, successeurs de Moha ou Hamou dans le
commandement de la confédération[2].
En 1963, nous trouvons encore, parmi les candidats, 93
notables ayant appartenu à l’administration du protectorat. Ils
sont partagés en trois groupes d’importance comparable, les
anciens caïds, les anciens chioukh et les anciens adoul et cadis.
Mais la réapparition des notables du protectorat est plus
symbolique. Les anciens pachas ou caïds représentent plus de
la moitié des candidats FDIC ayant occupé des fonctions
traditionnelles, et un tiers des candidats Istiqlal ou neutres. Un
seul se retrouve à l’UNFP. Mise à part l’UNFP, les anciens
chioukh représentent le quart des candidats de chaque groupe.
Les anciens cadis ou adoul sont proportionnellement plus
nombreux à l’UNFP (4 sur 5 candidats) et à l’Istiqlal (un tiers).
Répartition, par parti, des candidats ayant exercé des responsabilités
traditionnelles avant l’indépendance
Ces indications montrent que la continuité avec le groupe des
anciens notables d’autorité (caïds et chioukh) est surtout
assurée au sein du FDIC, qui mérite son nom de parti des
anciens caïds. Cela tend à confirmer l’hypothèse que ce parti
est avant tout représentatif des intérêts et des solidarités
locales, et sans contenu idéologique. L’UNFP pourrait se définir
en termes exactement opposés, et l’Istiqlal se maintient dans
une position intermédiaire, avec cette nuance qu’il hérite
plutôt des anciens notables ayant exercé des fonctions
judiciaires[3], en harmonie avec le traditionalisme culturel dont
ce parti reste le symbole.
Quelques analyses complémentaires peuvent aider à situer les
traits de ce groupe d’anciens notables intégrés dans le nouveau
système politique. Près de la moitié d’entre eux ne parlent
qu’arabe, et un quart, arabe et berbère. Les Berbères
représentent les deux tiers du groupe des caïds démissionnaires
ou licenciés lors de l’envoi en exil de Mohamed V. A l’opposé,
les caïds restés en place jusqu’à la fin du protectorat se
distinguent par leur bilinguisme arabe-français. Il serait sans
doute abusif d’en déduire que les Berbères ont été des
opposants farouches au protectorat, et que les caïds les plus
ouverts à l’influence française sont ceux qui ont le plus
largement collaboré. En fait, il serait plus exact de dire que
parmi les caïds qui ont démissionné ou ont été démis de leurs
fonctions, lors de l’exil de Mohamed V, les Berbères sont ceux
dont le geste a été le plus valorisé par le nouveau système
politique. A l’opposé, parmi ceux qui ont continué à collaborer
avec les Français, seuls ceux qui avaient une double culture, et
qui devaient aussi être les plus jeunes et les moins engagés, ont
pu se lancer dans une nouvelle carrière politique.
Pour en terminer avec les facteurs culturels, on note que dix
pour cent des anciens notables sont illettrés. Ce sont bien
entendu les anciens caïds ou chioukh que l’on retrouve dans
cette catégorie. Un tiers des anciens notables sont passés par
l’enseignement secondaire. Il s’agit surtout d’anciens élèves de
Karaouyne et d’autres instituts islamiques (21 sur 30) que l’on
retrouve principalement dans les fonctions de cadis ou d’adoul.
Les seuls éléments de culture moderne sont quelques anciens
élèves des lycées français et de l’école militaire de Meknès qui
furent nommés caïds après 1945, amorçant une transformation
de ce corps restée sans lendemain.
Ces notables sont donc en grande majorité de culture
traditionnelle. Ils sont aussi, comme on pouvait le prévoir, très
enracinés dans leur milieu d’origine : la moitié des membres de
ce groupe résident, en 1963, dans leur commune de naissance.
D’autre part, près de 20% d’entre eux y ont été élus conseillers
communaux en 1960, notamment un grand nombre d’anciens
caïds.
L’étude de la répartition géographique du groupe des anciens
notables apporte quelques précisions complémentaires. Dans
les provinces du Nord, il s’agit de quelques cadis ou adoul,
classés comme neutres sur le plan politique. Dans le Sud et les
régions pré-sahariennes, ils sont déjà plus nombreux, et
appartiennent principalement au groupe des anciens chioukh.
Ils sont répartis par moitié entre le FDIC et les neutres.
La plupart des membres du groupe des anciens notables se
trouve donc concentrée dans les provinces du centre où ils
représentent 18% du total des candidats. Sur les 40 anciens
caïds, 32 s’y présentent comme candidats FDIC ou neutres. A
l’Istiqlal, la répartition est à peu près égale entre les anciens
caïds, les chioukh et les adoul. A l’UNFP, 80 % des candidats
anciens notables sont des adoul. Si l’on examine, pour
terminer, le groupe des élus de cette catégorie, on découvre que
26 anciens notables ont siégé à la Chambre des représentants.
Leur âge moyen se situe autour de 50 ans. Parmi eux, 17
appartenaient au FDIC, 3 à l’Istiqlal, 5 aux neutres et un à
l’UNFP. Le groupe des anciens caïds est le mieux représenté
puisqu’il compte 10 % des élus de la Chambre présents dans
tous les partis, même à l’UNFP. Les seuls cadis et adoul élus se
rencontrent au FDIC. Les chioukh se répartissent entre le FDIC
et l’Istiqlal.
Les postes administratifs traditionnels peuvent donc être
considérés comme favorables à l’élection, surtout au sein du
FDIC où la continuité des notables est bien assurée. IIs
assurent, de toute façon, à leurs anciens titulaires, un acquis de
prestige, de relations, et ils leur ont souvent permis de
s’enrichir aux dépens de la communauté. On aura tendance à
oublier ces enrichissements et l’exercice un peu rude de leur
autorité pour ne retenir, au fil des ans, que le souvenir de leur
hospitalité, de leur connaissance des problèmes locaux, par
contraste avec le comportement des nouveaux caïds nommés
après l’indépendance.
Postes occupés dans l’administration moderne avant
l’indépendance
Une autre catégorie d’agents du Makhzen, qui n’est pas tout à
fait étrangère à celle des fonctionnaires traditionnels, exerce
aussi une influence locale. Le protectorat avait engagé, au fur et
à mesure de son développement, un certain nombre de
fonctionnaires marocains dans des emplois qui n’avaient rien à
voir avec les anciennes fonctions de souveraineté faisant l’objet
d’un contrôle politique organisé. Il s’agissait, le plus souvent,
d’emplois moyens dans la hiérarchie administrative pour
lesquels le contact avec la population locale exigeait la
connaissance de l’arabe ou du berbère. On avait ainsi recruté
des postiers, des infirmiers, des agents des travaux publics et,
bien entendu, des instituteurs.
Pour les commodités de l’exploitation des données, nous avons
également classé dans cette catégorie les emplois d’autorité qui
ne se situaient pas exactement dans l’ancien système du
Makhzen, tels qu’ancien militaire ou ancien policier, en
mettant à part les officiers. A la différence des postes de caïds
ou de chioukh, ces emplois n’étaient pas liés à l’exercice d’un
commandement local assurant une influence.
Mis à part les militaires, les postes de l’administration moderne
du protectorat n’avaient pas pour effet d’intégrer leurs titulaires
au groupe des notables. On pouvait même constater qu’un
nombre important d’enseignants, postiers, petits
fonctionnaires locaux, étaient des agents actifs du Parti
nationaliste dont ils contribuaient à répandre les idées dans les
campagnes. Mais ces fonctionnaires de formation moderne
sont plus jeunes que les agents traditionnels du Makhzen. Leur
âge moyen se situe aux environs de la quarantaine. Plus du
tiers d’entre eux sont issus de familles influentes, et l’on peut
avancer qu’un bon nombre d’entre eux ont pu faire des études
dans les écoles françaises grâce à l’intervention de membres de
leur famille. Il est donc possible de faire l’hypothèse que, pour
une bonne part, ces fonctionnaires de formation moderne
constituent une résurgence du groupe des notables
traditionnels, en dépit de leurs orientations nationalistes, sous
le protectorat.
Tous les candidats recensés dans cette catégorie ne sont pas, en
fait, de culture moderne. On a compté, dans l’enquête, comme
instituteurs, un nombre important de maîtres d’arabe qui ne
possèdent qu’une culture traditionnelle. Nous pourrons les
isoler dans le courant de l’analyse. Il est certain aussi que le
degré de culture moderne des militaires et des policiers est
limité, d’autant plus que l’on a classé dans cette catégorie les
informateurs des diverses autorités de contrôle françaises ou
espagnoles, qui n’appartenaient pas réellement à la police, bien
qu’ils fussent considérés comme policiers par la population.
L’analyse détaillée des données aidera à préciser ces points.
Le nombre des candidats concernés (123) représente 17 % du
total, donc, en fait, une part plus importante que celle des
fonctionnaires traditionnels. Les fonctionnaires modernes sont
plus nombreux, mais leur influence n’est cependant pas de
même nature que celle des éléments traditionnels. On peut les
répartir en trois groupes. Les instituteurs, qui constituent le
groupe le plus important, représentent près de la moitié des
candidats de cette catégorie à l’Istiqlal et au FDIC ; et ils sont
encore mieux représentés à l’UNFP. Les fonctionnaires sont
bien représentés au FDIC et à l’Istiqlal, moins à l’UNFP. Les
simples soldats se répartissent à peu près également entre
l’Istiqlal, l’UNFP et les neutres. Les officiers, en revanche, se
présentent uniquement comme candidats gouvernementaux
ou neutres.
Répartition, par parti, des anciens fonctionnaires modernes et
membres des assemblées du protectorat
L’éducation reçue est, pour ce groupe, un critère
particulièrement significatif. On constate tout d’abord que le
groupe des arabophones, qui représentait à lui seul près de la
moitié des candidats chez les agents traditionnels du Makhzen,
n’en compte qu’un peu plus du quart chez les fonctionnaires
modernes. Les bilingues arabe-berbère subissent une évolution
comparable : ils passent de 25 % à 10 %. A l’opposé, le groupe
des candidats parlant une langue étrangère passe de 25 % à
62 %. Les bilingues arabe-français sont, chez les modernes, à
égalité avec ceux qui ne parlent qu’arabe, et les trilingues
arabe-français-berbère dépassent, avec 14 %, les bilingues
arabe-berbère. Les Berbères sont surtout présents chez les
anciens militaires et chez les anciens fonctionnaires locaux. Sur
cinq fonctionnaires ayant appartenu à une administration
centrale, trois parlent espagnol.
Contrairement à l’hypothèse que l’on aurait pu formuler, il
apparaît que 40 % des candidats qui ont occupé un poste dans
l’administration moderne du protectorat résident encore dans
leurs communes de naissance. Doit-on cependant en déduire
que la mobilité géographique est limitée pour l’ensemble des
candidats de cette catégorie ? Certes, les fonctionnaires et les
enseignants modernes ont les plus fort taux de mobilité.
Encore faut-il noter que la moitié des fonctionnaires locaux
résident dans leur lieu de naissance. L’explication de cette
anomalie pourrait provenir de l’hypothèse, que nous
présentions plus haut, sur les liens familiaux qui existent entre
le sous-groupe des fonctionnaires modernes et celui des agents
traditionnels du Makhzen. Les candidats modernes qui
viennent se présenter là où ils conservent des attaches
familiales sont parfois considérés comme résidant dans leur
famille, même si leurs fonctions les obligent à fixer ailleurs leur
domicile principal.
De plus, certains fonctionnaires ont un net penchant à
retourner, dès que possible, exercer leur métier dans leur région
d’origine. La politique du personnel des administrations du
protectorat facilitait ces mutations et renforçait ainsi
l’intégration entre les milieux traditionnels et modernes. Il
semble que depuis l’indépendance le désir des jeunes
fonctionnaires d’échapper à l’emprise de leur famille et de leur
milieu d’origine l’emporte.
Le rapport candidats-élus est comparable à celui des agents
traditionnels du Makhzen : 26/93 dans le cas des
fonctionnaires traditionnels, 30/23 pour les fonctionnaires
modernes. Au total 56 élus sur 144 auront fait partie de façon
plus ou moins étroite de l’ancienne administration,
symbolisant la continuité des appareils de gouvernement et
celle des élites locales. Les chances d’élection sont nettement
meilleures pour les enseignants et les anciens fonctionnaires
locaux que pour les militaires. Chez les élus, le groupe des
instituteurs représente 50 % des anciens fonctionnaires
modernes du protectorat. Les enseignants constituent les deux
tiers des élus de l’UNFP, la moitié de ceux du FDIC et de
l’Istiqlal. Le FDIC compte, en outre, les deux seuls anciens
officiers qui ont été élus, ainsi que deux fonctionnaires
d’administration centrale. En plus des enseignants, l’Istiqlal
compte deux élus qui ont siégé dans les assemblées du
protectorat.
Ces anciens fonctionnaires marocains du protectorat forment,
autant chez les candidats que chez les élus, un groupe à la
limite de la tradition et du modernisme. En dépit des
sollicitations de carrière et de vie moderne, un nombre
important d’entre eux choisit de se réintégrer dans le système
des influences locales. Ce groupe est aussi à la charnière de la
tradition du protectorat et du nationalisme. Ainsi, il fournira
une bonne part des cadres supérieurs de la bureaucratie du
Maroc indépendant. Alors que la rupture a été totale et brutale
pour les cadres traditionnels, les fonctionnaires modernes du
protectorat, moins compromis, tout en ayant su être
nationalistes avec prudence, constitueront le vivier de
l’administration nouvelle.
Fonctions administratives occupées après
l’indépendance
L’indépendance a amené, en quelques années, un changement
profond du personnel administratif marocain. Les secteurs de
souveraineté — armée, police, administration locale — sont
passés pour l’essentiel, en un an, sous le contrôle d’agents
marocains, à l’exception de la Justice. Les ministères
techniques, Travaux publics, Agriculture, Santé, Finances,
Education nationale, ont été marocanisés plus lentement. Les
fonctionnaires nationaux y ont occupé assez tôt les postes qui
demandaient un certain pouvoir de décision d’ensemble, alors
que les responsabilités techniques ont été encore, pendant
plusieurs années, entre les mains d’agents français. On
aboutissait à une situation inverse de celle du protectorat : le
contrôle politique était exercé par les Marocains, les fonctions
supérieures d’exécution confiées à des assistants techniques
français progressivement remplacés par des fonctionnaires
marocains.
Dans la pratique, l’indépendance a souvent pris, suivant les
administrations, l’apparence d’un simple passage de consignes
étalé sur plusieurs années. La classe politique qui avait pris
naissance dans le mouvement nationaliste a été naturellement
la première à bénéficier de ce changement, ainsi que les
fonctionnaires marocains de formation moderne. Remplacer le
plus rapidement possible les représentants de l’ancienne
administration coloniale devenait alors un devoir national.
Cette ardeur sera vite freinée par la première génération arrivée
au pouvoir avec le départ des Français. Elle préférera bientôt
conserver des auxiliaires étrangers politiquement neutres, et
techniquement compétents, plutôt que d’introduire dans le
système des nationaux plus jeunes et plus diplômés qu’eux. Les
postes administratifs font donc partie des dépouilles du
protectorat que s’attribue la première vague des militants
nationalistes. Ils s’apercevront très vite que leur patriotisme ne
suffit pas à lui seul à les maintenir. La fidélité à la monarchie,
la technicité et le savoir moderne seront bientôt des facteurs
qui permettront d’effectuer un tri et d’intégrer les jeunes
diplômés. La compétence n’est certes pas le seul facteur à
entrer en ligne de compte pour expliquer l’épuration, vers
1960, de la première génération de l’indépendance. Les
militants pouvaient situer leurs rapports dans un contexte non
hiérarchique où l’autorité venait autant d’un crédit politique
personnel que d’une situation administrative. Ils sont donc
remplacés progressivement, après la reprise en main de
l’administration par le roi, par des bureaucrates apolitiques qui
acceptent de se soumettre à une évolution qui en fera des hauts
fonctionnaires selon la tradition française.
A partir de 1960, les départs sont nombreux, généralement
compensés par quelques prébendes (licences de transport,
places de mandataires) qui leur éviteront de s’engager dans une
opposition trop active, car ils demeurent encore à la merci du
pouvoir. Les fonctionnaires que l’on rencontre en 1963 parmi
les candidats sont, donc, soit des partisans du FDIC,
fonctionnaires en place qui cherchent à accélérer leur carrière
en faisant un détour par la politique, soit d’anciens agents de
l’administration licenciés qui cherchent à reconquérir un
statut. La loi électorale empêche les fonctionnaires d’autorité
de se présenter s’ils n’ont pas démissionné six mois avant
l’élection.
Nous ne trouvons, dans cette catégorie, que des opposants qui
cherchent à reconquérir un statut politique.
Continuité des deux systèmes politiques, mais en même temps
rupture, telles sont les caractéristiques de cette catégorie
importante par le nombre des candidats qu’elle touche (266) et
par leur qualité. On constate, en effet, qu’un tiers de la totalité
des candidats a occupé un poste administratif depuis
l’indépendance. Si la moitié d’entre eux a participé aux
événements qui ont conduit à l’indépendance, la majorité n’est
classée que comme militants nationalistes, sans plus de
précision. Leur nombre est très élevé chez les anciens ministres
et chez les enseignants. Chez les anciens caïds, on note que
40 % d’entre eux ont fait partie de l’Armée de libération. Ces
pourcentages confirment que la première génération d’agents
d’autorité, éliminée vers 1960, se présente aux élections. Chez
les anciens fonctionnaires locaux, on compte un groupe de
partisans du Glaoui et, en proportion égale, des militants
emprisonnés sous le protectorat. Ces données confirment donc
à la fois la participation à la lutte nationaliste de titulaires de
ces postes, et leur épuration qui les a à nouveau rendus libres
pour la vie politique. Quelques-uns d’entre eux ont déjà
participé à divers mouvements d’opposition au gouvernement
du Maroc indépendant.
Si l’on considère l’enseignement suivi par ce groupe, une
coupure se fait à l’intérieur même du groupe, ce qui n’a rien
d’étonnant puisque des fonctions traditionnelles et modernes y
sont amalgamées. Par comparaison avec les agents
traditionnels du Makhzen avant l’indépendance, les nouveaux
ont une meilleure connaissance du français, mais elle reste
moins bonne que celle des agents administratifs modernes du
protectorat. Il faudrait, en fait, procéder à des comparaisons par
sous-groupes. En moyenne, le groupe des arabophones
représente le tiers de ce groupe de candidats, mais dépasse la
moitié pour les postes de cheikh, d’adel et d’enseignant
traditionnel. En revanche, la connaissance de l’arabe seul ne
dépasse pas 10 % à 15 % pour les fonctionnaires
d’administration centrale. Il est intéressant de noter que le
bilinguisme arabe-berbère atteint le chiffre inhabituel de 52 %
pour les chioukh et de 38 % pour les caïds. Ces chiffres peuvent
être le reflet d’une certaine politique berbère du Maroc
indépendant, mais peuvent indiquer aussi que les Berbères
associés à l’administration ne sont pas satisfaits de leur rôle et
souhaitent en changer, en participant au jeu politique. Les
Berbères de culture moderne représentent, de leur côté, plus du
quart des fonctionnaires locaux ou de l’administration centrale
se présentant aux élections.
Plus de la moitié des candidats de ce groupe sont issus de
l’école coranique : une majorité d’enseignants, mais aussi la
quasi-totalité des chioukh et plus de la moitié des anciens
caïds. L’école française, qui ne touche que le quart des
candidats de cet ensemble, voit ce taux largement dépassé pour
les anciens ministres et les fonctionnaires d’administration
centrale.
On constate que 40 % des anciens caïds sont issus du Collège
d’Azrou, ce qui montre indirectement l’importance des
Berbères parmi les caïds licenciés après 1960, et engagés dans
l’action politique. L’origine scolaire des anciens fonctionnaires
d’administration centrale est dispersée entre les divers
établissements en majorité modernes, mais le Lycée Moulay
Youssef de Rabat en fournit le plus grand nombre. Un tiers des
anciens ministres vient de Moulay Idriss de Fès, cependant,
près de 70 % des enseignants sont issus des établissements
islamiques traditionnels.
La répartition par partis montre une prépondérance des
enseignants parmi les candidats Istiqlal et UNFP ; viennent
ensuite, à l’Istiqlal, les petits fonctionnaires locaux, à l’UNFP,
les anciens caïds et les fonctionnaires d’administrations
centrales. Le FDIC est très dispersé entre les diverses catégories,
avec une plus grande proportion de ministres et de membres
des cabinets ministériels.
Répartition, par parti, des candidats ayant exercé des emplois publics
depuis l’indépendance
L’étude de la répartition géographique permet de nuancer ces
indications. Dans les provinces du Nord, les anciens
fonctionnaires du Maroc indépendant représentent plus de la
moitié du total des candidats de la région. Sur les 46 candidats
appartenant à cette catégorie, nous trouvons 26 enseignants
dont neuf professeurs d’instituts islamiques, entre autres celui
de Tétouan, véritable centre de diffusion de la culture
traditionnelle. Trois de ces professeurs sont candidats FDIC.
Dans le Sud et les régions pré-sahariennes, la situation est
sensiblement différente. Les candidats anciens fonctionnaires
ne représentent plus que le quart du total local, mais près des
trois quarts sont investis par des partis nationaux. Les anciens
agents de l’administration locale représentent près du tiers du
total local. Mais alors qu’à l’Istiqlal et au FDIC on trouve
surtout d’anciens chioukh, à l’UNFP ce sont d’anciens caïds
auxquels viennent s’ajouter des enseignants.
Dans les circonscriptions du centre du pays correspondant à
l’ancien « Maroc utile », les candidats ayant appartenu à la
fonction publique ne représentent que le tiers du total local,
mais les deux tiers d’entre eux sont investis officiellement par
les partis. L’UNFP compte, à nouveau, un tiers d’anciens caïds
et chioukh et un tiers d’enseignants, plus quelques adoul.
L’Istiqlal investit surtout des enseignants et des fonctionnaires
locaux ; le FDIC se signale par un groupe important de
ministres et hauts fonctionnaires.
Dans les villes, nous ne trouvons guère que des ministres, des
hauts fonctionnaires et des enseignants répartis à peu près
également entre tous les partis, avec une légère dominante au
FDIC. Dans cet ensemble local, les candidats fonctionnaires
représentent, à nouveau, plus de la moitié du total des
candidats et sont investis par les partis dans un pourcentage
qui dépasse les 85%.
Près de la moitié des candidats appartenant au groupe des
anciens fonctionnaires résident encore dans leur commune de
naissance. Ce sont le plus souvent des enseignants, mais on
constate une certaine différence suivant les partis. Les
candidats ayant une certaine stabilité locale sont, pour
l’Istiqlal, des petits fonctionnaires locaux, des chioukh, des
adoul, pour l’UNFP, d’anciens caïds et chioukh ainsi que
quelques fonctionnaires locaux. Au FDIC, les deux extrêmes de
la hiérarchie, les anciens chioukh et les anciens ministres, sont
bien représentés.
Un tiers des élus sont d’anciens fonctionnaires du Maroc
indépendant. Les enseignants restent nombreux (20%), et
régulièrement répartis entre les tendances, avec une part plus
grande pour l’UNFP ; l’Istiqlal, cependant, compte plusieurs
anciens fonctionnaires d’administration centrale. Les
enseignants sont en plus grand nombre à l’UNFP, avec, aussi,
les fonctionnaires d’administration centrale et les anciens
caïds.
Le rapport élus-candidats (49/266) est nettement moins bon
que celui que l’on a observé pour les anciens fonctionnaires du
protectorat.
On ne devrait pas interpréter cette différence comme étant à
l’origine d’une nette coupure entre les deux groupes de
fonctionnaires. Nous avons vu par ailleurs que certains
individus avaient fait le passage d’un groupe à l’autre, surtout
parmi les fonctionnaires modernes de l’ancien régime.
Mais, dans l’ensemble, les fonctionnaires du Maroc
indépendant donnent l’impression d’être moins intégrés que
leurs prédécesseurs dans leur milieu local. L’exercice de leur
profession, même lorsqu’ils ont quitté l’administration, les
oriente plutôt vers les villes. Ils sont plus motivés par les
idéologies et plus intégrés dans les appareils des partis qui
songent naturellement à faire appel à eux lorsqu’ils ont
abandonné les fonctions politiques qu’ils occupaient. On
trouverait facilement maints exemples d’anciens caïds de
tendance Istiqlal ou UNFP, dont le gouvernement s’est séparé
vers 1960, qui correspondent assez bien au profil de ce type de
candidat. Ils se sont alors installés comme commerçants en
ville, profitant du départ des Européens et des Israélites, ou
bien ont repris un poste non politique dans la fonction
publique, généralement dans l’enseignement. Ils sont entrés en
contact avec les partis et les syndicats, ont participé aux
réunions et aux congrès, et se sont tout naturellement fait
désigner comme candidats aux élections. Mais leur assise locale
est souvent plus mince et moins bien entretenue que celle des
anciens agents du protectorat. Ces derniers avaient des appuis
familiaux plus puissants, et comme leurs perspectives de
carrière au niveau national étaient plus réduites, avant comme
après l’indépendance, ils ont été amenés à cultiver avec plus
d’attention leurs attaches locales.
Le trait commun entre les deux groupes d’agents du Makhzen
est plutôt un certain type de pouvoir et l’influence sur les
hommes. Il serait insuffisant d’analyser leur situation en termes
de catégories socio-professionnelles. Leur caractère de salariés
de l’Etat ou d’agents collaborant au service public — comme
peuvent l’être dans un Etat musulman des fquihs qui diffusent
l’enseignement coranique ou des adoul qui aident à
l’observance des règles du chrâa — n’est qu’un aspect de leur
personnalité. Cette influence sur les hommes prend des formes
diverses ; elle provient encore, pour une large part, du
commandement au sens traditionnel que certains ont exercé.
Les agents traditionnels du Makhzen sont, à cet égard, mieux
placés que les fonctionnaires intégrés dans une bureaucratie
moderne où les rapports sont plus institutionalisés.
L’influence découle aussi de facteurs culturels, notamment de
la culture traditionnelle : d’où lé rôle des enseignants et de tous
ceux qui, au sens large, collaborent au maintien et à la
diffusion de cette culture, comme les fquihs et les adoul, ou à
l’expression de revendications du groupe formulées dans la
langue classique. La culture moderne suit des cheminements
comparables, et si son implantation est plus difficile à assurer,
ceux qui y travaillent peuvent, une fois leur intégration
réalisée, acquérir une influence plus grande encore que celle
des intellectuels traditionnels.
Nous avons eu l’occasion de voir dans l’étude géographique des
élites politiques à quel point les fonctions de commandement
et l’influence sur les hommes étaient liées au contrôle des
ressources. Cette liaison est bien entendu à double sens ; un
minimum de richesse en terre et en troupeaux est nécessaire
pour se voir confier des fonctions qui supposent, pour être
exercées, que l’on dispose d’une certaine influence sur la
communauté, mais ces fonctions aident à accroître, dans le
Maroc indépendant comme sous le protectorat, la richesse de
ceux qui les exercent.
Les notables ruraux
Après avoir étudié la place des agents du Makhzen dans le
système des élites locales et le rôle qu’ils ont pu jouer dans le
contrôle du pouvoir à ce niveau, nous allons tenter de préciser
les modalités du contrôle des ressources par les élites locales,
comme instrument d’influence. La meilleure illustration des
hypothèses que l’on pourra faire à ce sujet sera donnée pour
une étude plus approfondie de la richesse foncière.
La richesse des candidats est un élément d’influence difficile à
évaluer. Dans le système traditionnel, le chef de famille riche
aura facilement les moyens de pratiquer l’hospitalité. On
trouvera toujours chez lui du thé ou du couscous prêts, une
tente ou une maison accueillante. Grâce à ses contacts, il est au
courant des affaires de tous ; il sera naturellement désigné ou
accepté comme membre de la jemaa de son douar ou de sa
fraction. Il en est encore ainsi dans le Maroc actuel pour de
nombreux conseillers communaux. Leur situation les désigne
naturellement comme interprètes du groupe auquel ils
appartiennent, à condition qu’ils n’aient pas de conflit majeur
avec les autres, qu’ils possèdent un minimum de culture
traditionnelle et se conforment à la morale collective.
L’hospitalité est donc un moyen pour les riches d’être
informés, et de redistribuer leur richesse pour la faire admettre
par une société où les comportements collectifs sont par nature
égalitaires.
Les données dont nous disposons sur la richesse des candidats
sont d’une précision inégale. Dans certains cas, ce sont de
simples notations qualitatives, dans d’autres, des notations
précises sur la profession, la propriété foncière, le cheptel, les
moyens de transport. Par un code aussi détaillé que possible on
s’est efforcé de tirer le meilleur parti de ces informations.
On constate, tout d’abord, que la richesse des candidats croît
avec l’âge. Ce n’est que dans le groupe des plus de 50 ans que
les candidats classés comme très riches l’emportent sur ceux
que l’on considère de condition moyenne. Les pauvres sont
très peu nombreux. Ils ne représentent que 2 % des candidats,
contre 50 % pour ceux qui sont considérés comme étant de
condition moyenne, et 48% pour les candidats riches et très
riches. Les différences entre les partis montrent une
appréciation très favorable de la richesse des candidats FDIC.
Situation financière des candidats
L’analyse géographique fait apparaître cependant quelques
différences significatives. Dans les provinces du Nord, on
constate une minorité de candidats considérés comme pauvres,
et une très forte proportion de candidats de condition
moyenne. Dans les autres provinces, les candidats considérés
comme riches représentent en moyenne 50 % de l’ensemble.
Parmi les élus, 75 % des membres du FDIC sont considérés
comme très riches, alors que l’Istiqlal et l’UNFP n’en comptent
que 57 %.
Ces évaluations subjectives de la richesse ont un intérêt, en
dépit de leur imprécision. Elles permettent de corriger parfois la
fausse impression que pourraient donner des informations
objectives et mesurables comme la superficie des terres
cultivées ou l’importance du cheptel. Ainsi, tel paysan, qui
passerait pour riche dans le Rif, ne serait considéré que
moyennement aisé dans le Rharb ou dans les Doukkalas, et son
influence politique en serait diminuée. Sur ce plan, la situation
relative appréciée subjectivement compte plus que les données
quantifiées. Sans aller plus loin, on constate que dans le Rif et
le Sud, où les situations économiques régionales présentent des
aspects comparables de pauvreté et de surpeuplement, la
communauté produit, dans un cas, des candidats en majorité
de condition modeste, dans l’autre, une proportion nettement
plus grande de candidats riches. L’explication pourrait venir du
fait que, dans Le Rif, la structure tribale est nettement plus
détériorée que dans le Sud où l’élevage semi-nomade assure,
dans les régions pré-sahariennes, la conservation de puissantes
fortunes, et le maintien d’un système d’influence sur les
hommes qui n’existe plus guère chez les paysans sédentaires du
Rif. D’autre part, le Rif n’a pas encore fait apparaître de
nouveaux notables qui tireraient leur statut d’une réussite
économique dans l’émigration. A cet égard, l’émigration
commerçante du Souss et l’émigration administrative du
Tafilalt offrent nettement plus de possibilités que l’émigration
en majorité ouvrière et paysanne du Rif.
Ces observations, qui ont pour but de nuancer les conclusions
que l’on pourra tirer de l’analyse des données quantitatives sur
la richesse des candidats, ne doivent pas empêcher de tenter
d’obtenir le maximum d’informations de telles données
souvent trop rares.
Les agriculteurs forment le groupe le plus nombreux, avec près
de 300 candidats. C’est aussi le nombre, à quelques unités près,
des propriétaires fonciers. Certains agriculteurs ne sont pas
propriétaires, mais des propriétaires peuvent exercer d’autres
professions. Ainsi, les deux groupes semblent correspondre
assez exactement. On doit toutefois noter que la terre n’est pas
au Maroc le seul facteur de production. Dans le Sud, les droits d
eau ont une valeur égale ou supérieure. En de nombreuses
régions, la richesse s’affirme par la possession du bétail qui est
beaucoup plus conforme au modèle de la société
traditionnelle[4].
La possession de la terre est généralement un facteur ambigu et
récent, lié à l’autorité exercée au nom du Makhzen, considéré
parfois avec suspicion par la communauté, dans la mesure où,
il y a un siècle, la plupart des terres étaient encore d’usage
collectif. La constitution des domaines est donc liée à l’exercice
du pouvoir et à la bienveillance du colonisateur qui a mis à la
disposition de la bourgeoisie rurale naissante ses instruments
juridiques et sa bureaucratie[5]. Il faut garder ces données
présentes à l’esprit lorsqu’on analyse la situation du monde
rural.
Cependant, en 1963, la richesse terrienne constitue un facteur
de prestige social et d’influence certain. La répartition de la
propriété foncière, pour les 300 candidats pour lesquels nous
disposons d’informations, reflète, dans une large mesure, la
carte de la propriété marocaine. Dans les provinces de
Casablanca, de Rabat et de Meknès, plus de la moitié des
candidats de ce groupe possèdent des fermes de plus de 100
hectares, généralement cultivées suivant des méthodes
modernes. La province de Marrakech a une structure de
propriété très proche de celle des grandes plaines, ainsi que la
province de Taza. Dans les provinces d’Al Hoceima, de Nador
et d’Oujda, structure de la propriété révèle aussi une
prédominance de la grosse propriété ; mais le nombre des
propriétaires fonciers n’est guère significatif. Les provinces de
Beni Mellal, de Fès, de Tétouan et d’Agadir sont dominées par
la moyenne propriété[6], alors que dans les régions pré-
sahariennes la richesse ne s’évalue guère en fonction de la
propriété terrienne.
Répartition, par province, de la propriété foncière
Si l’on examine la distribution de la propriété par partis et par
régions, on constate que les provinces du Nord ne comptent
que treize propriétaires en grande majorité de condition
moyenne, se situant, à trois exceptions près, au FDIC et chez
les neutres. Le nombre des propriétaires est plus important (89)
dans le groupe des provinces du Sud, mais plus de la moitié
d’entre eux se trouvent dans la province de Marrakech. La
répartition de la propriété suivant l’affiliation des candidats est
particulièrement intéressante dans cette région. L’Istiqlal y
apparaît comme un parti de moyens propriétaires avec plus de
50 % de ses candidats ayant moins de 50 hectares, et 82 % avec
moins de 100 hectares. L’UNFP est un parti caractéristique de
petits propriétaires avec 54 % de ses candidats possédant moins
de 10 hectares, et 90 % moins de 100 hectares. A l’opposé, le
FDIC compte plus de 50 % de ses candidats parmi les
propriétaires de plus de 100 hectares, et moins de 10 % parmi
les propriétaires de moins de 10 hectares. Chez les neutres, la
petite et la moyenne propriété sont à égalité, et la grosse
propriété reste minoritaire.
La masse des candidats propriétaires fonciers — 178 sur près de
300 — se trouve dans le groupe des provinces du centre. Leur
répartition diffère légèrement de celle des régions étudiées
précédemment. Si l’on fixe le seuil des grosses exploitations à
300 hectares, ce qui n’a rien d’exceptionnel dans ces régions,
on constate alors que l’Istiqlal vient en tête. Si l’on fixe la
limite de la grosse propriété à 100 hectares, l’UNFP est un parti
de moyens propriétaires avec plus de la moitié des candidats
possédant entre 20 et 100 hectares. On peut essayer de mieux
cerner ces candidats propriétaires ruraux et montrer à quel
point cette qualité est essentielle à leur statut, et les rend
solidaires de multiples intérêts locaux. Un tri particulier
montre l’existence d’un fort groupe de propriétaires ruraux,
représentant la moitié des candidats concernés, nés là où ils
résident actuellement. Il s’agit plutôt de propriétaires moyens
et gros, se situant en majorité dans le groupe de 50 à 100
hectares ou dans celui de 200 à 300 hectares. Les neutres y sont
particulièrement nombreux. La distribution politique de ce
groupe particulier rappelle beaucoup celle des candidats
originaires des provinces du centre. Un autre tri montre qu’un
tiers de l’ensemble des propriétaires ruraux ont été élus
conseillers communaux, en 1960, dans la commune où ils
résidaient.
On trouve également, parmi les propriétaires fonciers, un
candidat sur six illettré. La répartition montre certaines
différences entre les partis. A l’Istiqlal, il s’agit surtout de gros
propriétaires (300 à 500 hectares), au FDIC de propriétaires
moyens-gros (de 100 à 300 hectares), et à l’UNFP de moyens
(de 50 à 100 hectares). Il y a très peu de petits propriétaires
dans ce groupe, ce qui montre qu’il faut compenser
l’analphabétisme par d’autres moyens de prestige et
d’influence. Sur douze élus analphabètes, dix sont propriétaires
ruraux, quatre possèdent moins de 50 hectares, trois de 50 à
300, et trois plus de 300 hectares. Parmi les propriétaires, la
proportion des élus est légèrement plus forte chez les paysans
de moins de 50 hectares, puis elle diminue ensuite pour les
exploitations de 50 à 300 hectares, pour remonter par la suite.
Pour l’ensemble des élus, on-constate que 54 d’entre eux sur
144 sont propriétaires fonciers ; un tiers possède entre 200 et
300 hectares. Proportionnellement, c’est au sein de l’UNFP que
le rapport élus-candidats favorise les gros propriétaires ; mais le
raisonnement ne porte que sur un nombre limité de cas ; il est
donc hasardeux de pousser trop loin les déductions. On peut
noter aussi que les propriétaires ruraux représentent deux tiers
des élus FDIC, un cinquième des élus UNFP et un tiers des élus
Istiqlal. La taille des propriétés croît aussi avec l’âge aussi bien
pour les candidats que pour les élus.
Répartition, par parti, de la propriété foncière
Nous avons vu que la terre n’était pas le seul élément de la
richesse rurale. Posséder du bétail peut avoir, suivant les
régions, autant d’importance en valeur et en prestige. Nous
allons tenter d’analyser les quelques éléments dont nous
disposons sur les candidats propriétaires de troupeaux, bien
que les indications données soient, dans l’ensemble, plus rares
que celles qui concernent les propriétaires terriens. Il en est de
même pour les arbres qui constituent un élément de richesse
important. Sur les droits d’eau, qui permettent dans certaines
régions du Sud d’établir de véritables situations de domination,
les données étudiées ne donnent aucune indication.
Les candidats qui déclarent posséder des troupeaux sont moins
nombreux (58) que les propriétaires terriens, et les données
dont nous disposons sont plus vagues à leur sujet. Il apparaît
néanmoins que plus de la moitié d’entre eux appartiennent au
FDIC et possèdent les plus importants troupeaux. Si le FDIC est
le parti des gros éleveurs, l’Istiqlal est, en revanche, majoritaire
parmi les propriétaires d’arbres fruitiers (10 sur 29).
D’autres facteurs que la propriété rurale entrent en ligne de
compte pour évaluer la richesse des candidats. Nous les
retrouverons en analysant les données relatives aux catégories
socio-professionnelles. Certes, les commerçants représentent
un type d’élite locale influent, surtout dans le Sud du Maroc.
Mais les propriétaires ruraux ont, en quelque sorte, une valeur
quasi universelle et un poids particulier dans le système
politique. On pressent, à leur niveau, un ensemble de
solidarités locales qui en fait des représentants privilégiés des
populations, mais aussi des mandataires exigeants auprès du
pouvoir central. On appréciera mieux le poids du monde rural
sur le système politique si l’on précise qu’une centaine de
candidats seulement n’a aucun rapport avec lui. La différence
provient d’un nombre important de candidats qui, tout en
exerçant une autre profession à titre principal, possèdent
quelques terres, ou quelques arbres, ou mieux encore des
moutons en association. En plus des agriculteurs modernes ou
traditionnels, on compte au moins 150 candidats
commerçants, transporteurs, fonctionnaires, pour lesquels
l’agriculture constitue une part de leurs activités, soit
directement, soit en association.
Appréciation des catégories socio-professionnelles
Les fonctions du Makhzen et la possession des terres sont, en
milieu rural, les principales sources d’influence qui nous
intéressent pour l’étude des élites locales. Il semble toutefois
nécessaire de donner un aperçu d’ensemble des catégories
socio-professionnelles entre lesquelles se répartissent les
candidats. Cette répartition recouvrira, en fait, de nombreux
candidats que nous avons analysés précédemment comme
agents du Makhzen, ou comme propriétaires fonciers ou
agriculteurs. Cela est à peu près certain pour la quasi-totalité
des membres de la première catégorie. Cette constatation
découle du fait même que les fonctions du Makhzen ne
constituaient pas dans le passé, et encore actuellement — mis à
part les caïds fonctionnaires — des carrières administratives.
Leurs titulaires devaient donc appartenir au milieu rural, à la
fois pour accroître leur influence et pour se prémunir contre les
changements de fortune[7].
Les fonctionnaires relevant d’autres secteurs pratiquent aussi
fréquemment ce genre d’investissement ou de placement de
leur épargne. De même, la majorité des commerçants en milieu
rural diversifient leurs activités et s’intéressent à l’agriculture et
à l’élevage. Les classements que nous allons exploiter
s’intéressent donc essentiellement à la profession principale des
candidats sans tenir compte des activités annexes ou des
propriétés déclarées.
La répartition globale ainsi présentée souligne quelques
différences. Il n’est pas étonnant de voir que le plus fort groupe
de l’analyse des candidatures. La baisse de la part des
agriculteurs est accentuée ; le groupe parlementaire est
constitué à égalité de fonctionnaires, de membres de
professions libérales et de commerçants.
A l’opposé, le FDIC est un parti d’agriculteurs et de
fonctionnaires, ou seuls les agriculteurs occupent une place
plus importante parmi les élus que parmi les candidats. Dans ce
contexte, l’Istiqlal fait figure de parti équilibré. Les
commerçants sont stables et les membres des professions
libérales et les fonctionnaires voient leurs taux baisser. En
revanche, il faut noter la forte progression des permanents du
parti qui finissent par représenter 10% des élus. L’Istiqlal est le
seul parti qui donne l’impression de s’être constitué un
appareil et de l’intégrer dans sa représentation.
Les fonctionnaires, qui constituent le second groupe par ordre
d’importance après les agriculteurs, sont pour les deux tiers des
enseignants dont une trentaine exerce la responsabilité de chef
d établissement (34) primaire ou secondaire, avec, de ce fait,
une influence certaine sur les maîtres et les parents d’élèves de
la circonscription. En dehors des enseignants, les
fonctionnaires d’administration centrale — ministres compris
— sont les plus nombreux.
La moitié des commerçants qui sont classés dans cette catégorie
au titre de leur profession principale ne fournissent guère d
information sur la nature de leur commerce. On note, tout au
plus, la présence d une quinzaine de grossistes ou semi-
grossistes, d un nombre égal d’entrepreneurs modernes de type
industriel et d’une douzaine de transporteurs ; toutes ces
professions peuvent donner une influence locale. Parmi les
membres des professions libérales, on trouve, entre autres, 18
avocats, 11 journalistes et 6 médecins.
Répartition des candidats par partis et catégories socio-
professionnelles
Répartition des élus par partis et catégories socio-professionnelles
Combinées avec l’enseignement, les catégories socio-
professionnelles confirment des interprétations que l’on avait
déjà pu établir. On ne s étonnera pas de voir que 61% des
agriculteurs sont passés par l’école coranique, contre 15%
seulement par, l’école française. Le rapport-est encore plus
élevé en faveur de l’école coranique chez les commerçants
(65%) mais aussi en faveur de l’école française (18%) ; la
différence s’explique par un taux d’analphabétisme nettement
moins élevé que celui des agriculteurs. Les fonctionnaires et les
employés des partis comptent aussi des taux très élevés de
fréquentation de l’école coranique (50% et 75%) Les anciens
élèves des écoles libres se retrouvent parmi les commerçants,
les fonctionnaires et les quelques candidats du secteur privé.
Ceux de l’école française sont dispersés entre toutes les
catégories avec urne place plus importante chez les membres
des professions libérales et les fonctionnaires. Ces tendances se
retrouvent, à quelques nuances près, au sein du groupe des
élus.
Mais avec les professions libérales et la fonction publique ce
sont déjà les problèmes de l’élite politique nationale que nous
rencontrons.
Notes du chapitre
[1] Voir aussi 2e partie.
[2] Voir S. Guenoum, La montagne berbère, op. cit.
[3] Mais pas de fonctions judiciaires répressives, ce type de
pouvoir étant, sous le protectorat, confié aux caïds et aux
pachas.
[4] Voir J. Couleau, La paysannerie marocaine, op. cit.
[5] Voir, O. Marais, « Le Maroc » in H. Mendras, Y.
Tavernier, Terre, paysans et politique, Paris, SEDEIS, 1969, tome
2. (Futuribles).
[6] Avec des superficies moyennes de 50 hectares.
[7] Les caïds fonctionnaires nommés après l’indépendance,
qui devaient en principe échapper & ce modèle, finissaient
souvent par réintégrer l’univers des notables en achetant une
ferme de colon dans des conditions avantageuses, ou en
s’associant avec des fellahs pour élever du bétail sur les terres
collectives ou domaniales dont ils avaient la surveillance.
Conclusion. Elites locales, élites nationales et
système politique
L’indépendance a posé à la classe politique marocaine le
problème de la prise en charge de la modernisation du pays
qui, jusqu’alors, avait été assumée avec plus ou moins de succès
par le protectorat. En 1956, la monarchie, la bourgeoisie
urbaine et le prolétariat sont encore associés pour obtenir du
colonisateur l’indépendance la plus large possible, mais déjà
rivaux pour s’assurer le contrôle de la future édification
nationale. Les notables ruraux et la paysannerie ont été écartés
du jeu politique national à cause de leur compromission réelle
ou supposée avec le protectorat, malgré l’intervention tardive
de l’Armée de libération. En revanche, la bourgeoisie urbaine
semble bien placée pour recueillir les dépouilles du
colonisateur. La monarchie ne se résigne pas pour autant à
subir une évolution qui devrait réduire son rôle à celui de
symbole national.
Au départ, la bourgeoisie a tenté d’utiliser la bureaucratie
qu’elle contrôlait pour soumettre les autres secteurs de la
société, et les engager sous sa direction dans un processus de
modernisation qui reprenait, avec quelques nuances, certains
aspects libéraux de la politique du protectorat. Le roi se serait
trouvé en mauvaise posture s’il s’était opposé à cette évolution.
Il reprend une place dominante dans le système politique
lorsqu’il apporte la preuve qu’il est le seul intermédiaire
possible auprès d’une paysannerie inquiète des projets de la
bureaucratie nationale[1].
Bientôt, la légitimité monarchique servira à dédouaner les
notables de leur présomption collective de collaboration avec
le protectorat. En retour, ceux-ci assureront au Palais le soutien
politique des campagnes. Cette alliance du souverain avec le
monde rural n’était pas pour autant la seule solution
imaginable. Par formation, par culture, Mohamed V était sans
doute beaucoup plus à l’aise avec les bourgeois de Fès qui
composaient la majeure partie de l’état-major nationaliste,
qu’avec les notables des tribus. L’alliance avec le souverain
semblait si naturelle aux dirigeants nationalistes qu’ils mirent
longtemps à se rendre compte que Mohamed V était résolu à
ne plus dépendre d’eux.
Une alliance directe entre la bourgeoisie d’affaires et la
« féodalité » terrienne, dont le souverain aurait été le simple
instrument[2], était-elle possible ? Bien que l’idée d’associer
dans une même équipe gouvernementale Allai el Fassi et
Majhoubi Ahardane puisse paraître saugrenue, l’expérience a
été tentée de 1961 à 1963 dans le gouvernement formé par
Hassan n, au lendemain de la mort de son père. La monarchie
est alors l’élément unificateur et dominant dans cette alliance
entre la bourgeoisie nationaliste et le monde rural. L’équipe a
été formée et dirigée par un homme du Palais, Ahmed Reda
Guedira, qui joue plus sur les rivalités entre deux forces qu’il ne
cherche à les unir vraiment. Dans ce contexte d équilibre
instable, la monarchie abandonne les grands projets
d’industrialisation[3] qui avaient été prévus par le Premier Plan
quinquennal et dont la réalisation supposait une mobilisation
des ressources sous la direction de la bureaucratie. Mais les
propriétaires terriens n’acceptaient pas de faire les frais de ces
réformes, et lorsqu’ils se liguent contre la bureaucratie, en
catalysant les craintes confuses du monde rural traditionnel, la
monarchie soutient mollement ses agents et renonce. Elle
craint que l’industrialisation ne rompe l’équilibre du régime au
profit de la bourgeoisie. Ce groupe reste cependant solidaire de
la monarchie, car le prolétariat urbain menace son pouvoir. De
plus, l’hostilité des ruraux contre les réformes en projet et
contre l’industrialisation est plus dirigée contre une
bureaucratie, qui apparaît, comme l’instrument de la
bourgeoisie, que contre la monarchie.
Certes, les notables, qui ont constitué le principal soutien de la
monarchie, ne forment pas non plus un ensemble homogène.
De gros exploitants modernes comme Mansour Nejjaï, à Souk
el Arba, ou Abbés Kabbaj, à Agadir, auraient pu faire
directement alliance avec la bourgeoisie urbaine de droite ou
de gauche, en se passant de la caution de la monarchie et en
acceptant une limitation de son rôle. Mais, dans leur masse, les
réactions des notables sont nettement plus conservatrices. Ils
refusent tout ce qui pourrait porter atteinte à leur cohésion et à
leur capacité de résistance. Après avoir organisé divers
mouvements de révolte, de 1957 à 1960, ils se voient à
nouveau, comme sous le protectorat, confier la police du
monde rural, et ils s’en tirent à merveille. Les campagnes
restent d’un calme parfait au moment même où le système
politique peut être secoué de soubresauts.
Quelle a pu être la contrepartie de cette intervention
conservatrice du groupe des notables ? Peut-on faire
l’hypothèse que l’immobilisme du système politique marocain
en découle[4] ?
Il est certes difficile de peindre les différents groupes sociaux
sous les couleurs d’ensembles homogènes. Les structures
anciennes se disloquent et donnent souvent naissance à des
catégories antinomiques qui ne sont pas directement liées à des
partis politiques, mais apportent un soutien plus ou moins
provisoire à des tendances. Partant de ces alliances
conflictuelles et évolutives, on est tenté d’exagérer
l’immobilisme, en mettant l’accent sur le jeu de la monarchie
comme clef de voûte de système. Il ne faut pas pour autant
perdre de vue les divers courants qui s’affrontent sur chaque
affaire importante. Un premier groupe est constitué par ceux
qui trouvent leur intérêt dans le maintien du statu quo. Il
rassemble, sous la bannière traditionaliste, aussi bien les
notables ruraux que la petite bourgeoisie urbaine et le vieux
Makhzen, renforcé par diverses catégories de bigots de l’Islam.
En face d’eux, se trouvent ceux qui aspirent au changement
sans être toujours d’accord sur le degré de radicalisme qu’il doit
comporter : les intellectuels occidentalisés, les étudiants, les
techniciens, les jeunes fonctionnaires et, dans son ensemble, la
jeunesse, même rurale.
Entre ces tendances qui incarnent la tradition et le
changement, figurent quelques groupes qui ne souhaitent pas
s’engager dans ce type de conflit dans la mesure où leur
système de valeurs et leurs intérêts ne sont pas nettement
classés dans un camp. L’armée, les hommes d’affaires
modernes, de nombreux hommes politiques feraient partie de
ces groupes charnières sur lesquels jouait, entre autres, la
monarchie, depuis l’indépendance. Les discussions des
participants du système politique lui avaient permis de réussir,
dans les premières années de l’indépendance, ce que le
protectorat avait voulu entreprendre contre les nationalistes
mais n’avait pas eu le temps ou les moyens de faire, à savoir
une certaine rénovation démocratique des campagnes
débloquant l’ancien système des notables sans le bouleverser.
S’y ajoutait une neutralisation du prolétariat. En fait,
l’évolution déclenchée bien avant la fin du protectorat par la
poussée démographique, l’urbanisation, les changements
économiques et sociaux, sans compter les changements
internationaux, condamne cet immobilisme et, donc,
indirectement, le système politique qui avait pu pratiquer ce
jeu en s’appuyant sur les groupes charnières.
Il convient donc de nuancer l’utilisation des grandes
catégories, que l’on serait tenté d’isoler dans le système social
marocain, pour en tirer un modèle d’explication du système
politique plus facilement comparable à des ensembles du
même type. Il y a bien des différences et des conflits en
puissance entre les jeunes entrepreneurs marocains de
Casablanca et les vieux commerçants spéculateurs des villes
traditionnelles, même si les biens familiaux les unissent au
même titre que le rôle économique unit la bourgeoisie urbaine.
De même, on peut dire que le caïd vieux style que l’on
rencontre encore parfois appartient au même univers
bureaucratique que le jeune ingénieur qui finit par acquérir la
connaissance du milieu où il travaille.
Pour maintenir la prépondérance des élites locales, base de son
pouvoir, la monarchie a dû renoncer à des changements
profonds au niveau national. On peut imaginer un autre
système de rapports où les éléments de la bourgeoisie urbaine,
décidés à faire des réformes, auraient eu une politique rurale
brisant le pouvoir politique et économique des notables. Il
aurait suffi de développer le thème de l’illégitimité des
acquisitions foncières faites pendant le protectorat comme
justification idéologique d’une telle politique. Avec le dahir du
27 mars 1958[5], pris à l’instigation de Mehdi Ben Barka pour
récupérer les terres des « féodaux et des traîtres », une première
tentative limitée aurait été faite. Elle ne fut pas systématisée, ni
même appliquée dans son contenu réel. Une politique de
récupération des terres et de redistribution rapide aurait
cependant permis à ses initiateurs, tout en brisant le pouvoir
des élites locales, de faire alliance avec des couches rurales
nouvelles, intéressées par une remise en cause du statut ancien.
En apportant leur appui à la monarchie, les notables se
garantissaient contre cette politique. Certes, d’autres obstacles
auraient gêné l’application d’une politique agraire aussi
radicale. En premier lieu, le souverain et la famille royale
auraient été atteints dans les acquisitions nombreuses qu’ils
avaient su réaliser sous le protectorat avec la complicité de
l’administration française et de quelques caïds. En second lieu,
il aurait été impensable de laisser intact, dans ces conditions, le
million d’hectares occupés par la colonisation française. Il
aurait donc fallu se préparer à un affrontement et à des
sanctions économiques de la part de la France. Il aurait fallu,
pour le moins, se préparer à une socialisation globale de
l’économie. En dernier lieu, il aurait fallu affronter la
bourgeoisie urbaine, notamment celle de Fès, qui avait des
assises terriennes qu’elle n’aurait pas vu disparaître sans réagir.
Une mesure dirigée contre les notables devait donc entraîner
dans des actions préventives ou compensatoires d’autres forces
ou groupes sociaux qui, sentant la menace, sont devenus les
alliés des ruraux.
Ainsi, à partir de 1960, les élites locales constituent le centre de
gravité[6] du système politique au profit de la monarchie. Cette
situation conditionne les choix du régime pour tout ce qui
touche au secteur rural, mais l’influence aussi en d’autres
domaines. Elle rend impossible l’aboutissement de tout projet
de réforme agraire, si limité soit-il, et justifie l’association des
propriétaires fonciers à l’exercice du pouvoir local. Elle exclut
tout système de taxation qui aboutirait à faire financer par
l’agriculture le développement d’autres secteurs, notamment de
l’industrialisation. Elle pousse, au contraire, le régime à
conclure un système d’alliances qui lui assurera le financement
par l’étranger de ses distributions de ressources au secteur
traditionnel et de ses grands investissements agricoles. Telles
sont, grosso modo, les justifications, conscientes ou non, de
décisions aussi diverses que la suppression du tertib et la
création de la Promotion nationale en 1961, puis de la
politique des grands barrages qui en prend le relais, à partir de
1965.
Seuls certains groupes, comme l’armée et la police, peuvent
obtenir une modification, en leur faveur, qui se développe
lentement à partir de 1960, et contribue également à assurer la
stabilité du monde rural traditionnel en offrant une issue aux
mécontents les plus actifs.
Cette dépendance du système politique marocain à l’égard des
élites locales a entraîné un immobilisme lourd de
conséquences, dans la mesure où il ne se limite pas
uniquement au domaine agraire ou à l’administration locale. Il
influence aussi l’éducation nationale où le régime a des
velléités de modernisme, mais n’ose pas mécontenter les
éléments traditionnels. En politique étrangère, il lui est
impossible de se décider entre les alliances qui lui assurent le
financement des programmes de développement rural et celles
qui témoignent d’une solidarité islamique active
qu’apprécieraient les traditionalistes.
Mais si le régime est condamné à l’immobilisme par sa base
sociale rurale, la croissance démographique, la diffusion de
l’enseignement secondaire et supérieur, le développement des
villes, les modèles étrangers, notamment algériens, empêchent
l’isolement et le repli sur lui-même. Dans ces conditions, la
période qui a suivi l’indépendance risque de n’être qu’un
intermède pendant lequel certaines forces sociales auront
retardé une évolution vers une modernisation politique
inévitable.
L’étude des relations entre les élites locales et la bourgeoisie
urbaine, qui constitue le noyau de l’élite politique nationale,
peut-elle fournir une explication de l’immobilisme du système
politique marocain ? Dans son ouvrage sur l’élite politique
marocaine, John Waterbury[7] décrit surtout l’élite politique au
niveau national. Il met en évidence l’immobilisme du jeu
politique, en privilégiant une explication se fondant sur la
transposition, au niveau national, des mécanismes qui
régissent, en milieu tribal traditionnel, les rapports entre les
différents groupes arbitrés généralement par un saint local. Au
lieu de querelles de lignage pour le contrôle des ressources
locales, les syndicats, les partis, les intellectuels et d’autres
groupes sociaux s’affrontent, et la monarchie attise et arbitre
leurs oppositions.
La tension entre les groupes est maintenue à un niveau assez
élevé pour qu’ils n’aient pas la mauvaise idée de se coaliser
contre le Palais, mais elle est aussi contenue dans des limites
qui assurent la survie du système. Les alliances essentiellement
défensives contractées au sein de la classe dirigeante sont
fondées sur un échange constant de services et d’informations,
contrôlé par le roi. Pour Waterbury, la monarchie est donc bien
la source de l’immobilisme politique constaté depuis
l’indépendance.
Cette affirmation ne peut être acceptée a priori, même si la
connaissance profonde du système politique marocain dont
fait preuve l’auteur est très séduisante. Il semble hasardeux de
transposer au niveau global les mécanismes politiques du
système tribal. Les analyses sur le rôle de la monarchie, par
exemple, ne peuvent pas être généralisées. Le roi du Maroc a su
être, dans certaines circonstances, un leader national.
Mohamed V le fut sous le protectorat, et accepta, à ce titre, de
courir des risques considérables pour lui-même et la
monarchie. Hassan II fut tenté par ce type de participation
active à la politique au début de son règne. Pourquoi l’un et
l’autre ont-ils renoncé et se sont-ils réfugiés dans
l’immobilisme ? La réponse doit plutôt être cherchée dans les
rapports entre les bases sociales du régime et la classe politique.
A cet égard, cette étude fait bien ressortir les différences qui
peuvent exister entre les élites locales et la bourgeoisie urbaine.
Cette dernière se trouve naturellement associée au commerce
traditionnel et moderne, ainsi qu’à la bureaucratie et aux
activités économiques dont l’accès lui a été ouvert depuis
l’indépendance. Les Fassis y jouent un rôle dominant, en
compagnie des bourgeois d’autres cités et de quelques familles
qui ont assuré leur ascension au service du Makhzen, sans se
différencier de la bourgeoisie originaire de Fès, ni par la culture,
ni par les activités, ni même par les alliances familiales. Par leur
présence dans des secteurs aussi différents que les entreprises
industrielles, le commerce d’importation, la haute
bureaucratie, la bourgeoisie urbaine donne une profonde
impression d’unité dans la diversité. Elle se trouve cependant
relativement isolée des élites locales qui assurent la stabilité
politique du système.
La plupart des différences qui caractérisent les élites locales se
retrouvent au niveau national, mais leur signification change
profondément. A ce niveau, les valeurs culturelles modernes
l’emportent à tel point qu’une langue étrangère est un
instrument quotidien indispensable pour donner accès à un
système de pensée qui règle les conduites des acteurs
principaux de l’élite économique ou bureaucratique. Le
pouvoir procède de ce type de savoir. Le passé nationaliste est
aussi une condition nécessaire de l’appartenance à l’élite
politique. Les responsabilités bureaucratiques et les avantages
économiques obtenus par les membres de l’élite politique
nationale depuis l’indépendance, leur font espérer que le
pouvoir organisera sous leur responsabilité un vaste projet de
restructuration de l’économie et de la société.
Mais, en fait, le maintien de leur situation repose sur un
système d’élites locales dont la composition, le système de
valeurs et d’autorité sont profondément différents du leur, la
monarchie constituant le lien entre les deux systèmes. Cette
représentation est certes exagérée par bien des aspects, mais,
sauf dans l’armée et dans l’administration locale, les liens
personnels entre les élites locales et nationales sont assez
distendus. Le système des alliances familiales ne fonctionne pas
entre la bourgeoisie urbaine et les élites locales. La culture
traditionnelle domine le milieu local, et la langue arabe impose
un système de pensée différent. Les valeurs courantes sont
celles que l’on acquiert à Karaouyne et à Ben Youssef, et que la
bourgeoisie urbaine a abandonnées depuis 1956. La
collaboration avec les autorités du protectorat ne constitue pas,
au niveau local, une tare indélébile ; elle n’est qu’une variante
des relations que les notables ruraux doivent entretenir avec
n’importe quel pouvoir établi. La richesse et l’influence
proviennent encore, à ce niveau, des terres et des troupeaux,
mais aussi d’un certain type de relations et de services rendus.
Tout cet ensemble n’est pas comptabilisé en termes de facteurs
de production.
Les lieux de contacts et d’échanges entre les deux types d’élites
restent limités ; cependant, l’Etat et, dans une certaine mesure,
les institutions économiques ou culturelles étrangères ont pu
jouer un rôle. La bourgeoisie rurale s’est prolongée dans
certains secteurs de l’État placés plus directement à son contact
comme les administrations de l’intérieur et de l’Agriculture,
certains offices agricoles, et surtout l’armée.
La bourgeoisie urbaine domine plutôt les secteurs financiers et
techniques, reconstituant dans le Maroc indépendant une
coupure déjà sensible dans l’administration du protectorat. Elle
reste aussi plus directement au contact des étrangers,
banquiers, industriels, commerçants et colons, qui continuent
à jouer un rôle non négligeable d’intermédiaires économiques
puissants dont les différents groupes guettent l’héritage tout en
cultivant les faveurs.
Certes cette situation est transitoire. En milieu rural, les
palliatifs mis en œuvre depuis 1956 (Promotion nationale,
émigration) ne peuvent pas indéfiniment servir à contenir la
poussée démographique. Mais le blocage est tel qu’il ne permet
pas de prévoir une évolution, mais une rupture dont il est
difficile d’apprécier quelles seront les conséquences. Il est
vraisemblable que les élites bourgeoises se survivront dans une
transformation de leur rôle. Leur éducation moderne facilitera
leur adaptation à une situation où elles pourront accepter la fin
de leur monopole. En sera-t-il de même pour les élites locales ?
Le changement peut provenir de groupes qui leur sont associés
plus étroitement que la bourgeoisie urbaine, comme les
militaires. Mais il supposera aussi une transformation sociale
profonde à laquelle les élites locales s’étaient jusqu’alors
refusées. Accepteront-elles de l’armée ce que la monarchie n’a
pas pu, ou voulu, leur imposer ? On serait tenté de le croire,
surtout si l’armée est capable d’assurer l’intégration des
descendants des notables dans un système politique national
dont le contrôle leur échappait jusqu’alors.
On imaginerait assez facilement l’aboutissement sous un
régime militaire d’une dynastie de caïds ou d’amghars dont
l’ancêtre aurait été investi au début du siècle pour lutter contre
la pénétration française. Il aurait su négocier sa soumission
assez tôt pour garder son commandement dans le nouveau
Makhzen, mais assez tard pour garder un peu l’estime de ses
pairs. Durant le protectorat’, il aurait su faire immatriculer à
son profit quelques terres collectives ou habous pour se
constituer un domaine là où la tribu ne voyait qu’un droit
d’usage précaire. Un de ses fils aurait fait ses études secondaires
au Collège d’Azrou. Avant 1945, il avait des chances de finir
officia-subalterne ou d’être dirigé vers un poste d’auxiliaire de
l’administration locale. Après la seconde guerre mondiale, les
études en France lui seraient devenues plus facilement
accessibles. Un autre fils lui aurait succédé comme caïd vers
1940, sans avoir le même prestige que l’ancêtre. Il se serait
compromis en participant à l’action du Glaoui contre
Mohamed V, pendant que le frère, de formation moderne, plus
averti, restait dans l’expectative ou même soutenait
directement les nationalistes.
Lors de l’indépendance, le caïd est démis de ses fonctions mais
reste sur ses terres. A la rigueur il s’installe en ville. Son frère, de
formation moderne, est devenu entre temps un personnage
bien en cour, et peut lui éviter d’être trop inquiété. Devenu
caïd, gouverneur ou fonctionnaire supérieur au fil des années,
le frère de culture moderne est en mesure d’utiliser, au profit de
la famille, l’aide des centres de travaux agricoles pour faire
labourer, épierrer ou planter les terres familiales. Il obtient les
prêts du Crédit agricole. Il peut même agrandir son domaine
propre en achetant, dans de bonnes conditions, une ferme de
colons proche, étant sûr d’obtenir du cabinet royal
l’autorisation d’acquisition dérogatoire. Lors des élections
communales de 1960, l’ancien caïd se trouve élu président du
conseil communal ; ses neveux ou cousins sont chioukh. Il
établira des contacts avec le Mouvement populaire. On viendra
solliciter son intervention pour un prêt agricole, pour obtenir
une pièce d’état civil ou un passeport. Il n’aura plus, sur le plan
local, l’influence qu’il avait par le passé, mais sa richesse, ses
relations font qu’on le ménage. On sait que son frère à Rabat
peut l’aider.
La génération suivante aura fait ses études dans les lycées de la
Mission culturelle française, puis en France, si possible dans
une grande école technique. Elle y aura acquis une aisance de
comportement et une teinture de marxisme.
Il ne serait pas trop difficile de mettre des noms du Moyen-
Atlas ou du Rif sur ces familles imaginaires, dont la description
permettrait d’illustrer cette interpénétration du pouvoir local,
de la richesse foncière et de la bureaucratie. Il y a tout lieu de
penser que même si ces familles perdent ou voient se réduire
leur base foncière, elles conserveront, grâce au savoir acquis et
aux relations, une place dans le nouveau système politique qui
pourrait s’installer après une crise.
***
Dans le système politique marocain, les élites locales ont joué,
après l’indépendance, le rôle de groupe stabilisateur, en
limitant l’expansion de la bourgeoisie urbaine. Elles ont aussi
exprimé, par leur participation aux révoltes des premières
années de l’indépendance, la protestation confuse des ruraux
contre la bureaucratie nationale qui reprenait avec vigueur et
bonne conscience la politique de contraintes et de
modernisation que le protectorat avait dû abandonner. En
agissant ainsi, elles ont, avec la complicité de la monarchie,
vidé le système politique de ses grands débats idéologiques, et
transformé le rôle des partis et des organisations. Pour
reprendre l’hypothèse de John Waterbury[8], la vie politique
nationale s’est trouvée envahie par le style et les problèmes de
l’univers politique local. Mais la contagion provient plus d’une
remontée de problèmes locaux au niveau national que d’un
atavisme contraignant.
En contrôlant la situation politique à la base, grâce à un
système de rapports personnels fondés autant sur les liens de
parenté que sur les services rendus, les élites locales ont
naturellement étendu ce système de clientèle aux partis et à la
bureaucratie. Afin de trouver les moyens de satisfaire les
demandes de leurs mandants, elles sont devenues clientes de
tel homme politique ou de tel fonctionnaire, sans jamais
s’engager en fonction d’une idéologie, sans jamais contracter
des liens définitifs. L’action politique n’est, pour ceux qui s’y
adonnent, qu’un prolongement local ou national des multiples
liens sociaux et économiques qui en constituent la trame. Le
« leadership » local ne s’acquiert pas, dans ces conditions, par
l’action politique seule ; la dimension politique ne lui apporte
qu’une consécration et des moyens supplémentaires. Ces
relations, vidées de tout contenu idéologique ou partisan, ont
rendu très vite impossible toute mobilisation politique
nécessaire pour une action de modernisation profonde,
commençant par le monde rural.
En monopolisant le système politique pour la solution d’une
multitude d’affaires de détail, on empêche de faire face aux
besoins à long terme qui se manifestent avec une vigueur
accrue, vu la pression démographique, le développement de
l’enseignement, l’ouverture sur le monde extérieur et la
croissance des villes.
L’armée, qui jouait au même titre que les élites locales le rôle
de groupe stabilisateur, se voit alors investie par elle-même de
la mission de prendre en compte les projets de transformation
à long terme du système politique et social pour l’adapter aux
besoins nouveaux. Intervient-elle pour elle-même, pour obtenir
une meilleure répartition du produit social sous forme de
soldes et d’équipements, pour éviter la prise du pouvoir par
d’autres groupes, ou encore pour lutter contre la corruption, ce
qui n’est, en fait, qu’une présentation moralisatrice d’un
déséquilibre dans le partage des ressources collectives ? Les
motivations des militaires marocains procèdent, semble-t-il,
d’un amalgame de ces différents thèmes[9]. L’absence
d’institutions organisées pour résoudre les conflits conduit
l’armée à exprimer, par la violence, des revendications
politiques[10]. Il en serait de même pour d’autres groupes
sociaux — étudiants ou syndicats — s’ils disposaient de
moyens d’intervention aussi puissants. Les militaires savent
que d’autres partagent, au moins partiellement, leurs
sentiments. Ils n’auraient donc pas, en cas de succès, à redouter
leur hostilité, et pourraient même compter sur leur soutien.
Pour rebâtir des institutions et faire sortir la vie politique de
son climat local, l’armée aurait besoin d’une idéologie unitaire
et mobilisatrice dont elle emprunterait les composantes à la
fois à la gauche et aux traditionalistes. Selon toute
vraisemblance, elle compterait sur le soutien ou sur la
neutralité du prolétariat et de l’intelligentsia. En revanche, la
bourgeoisie urbaine se trouverait tout de suite en rivalité avec
l’armée pour le contrôle de la bureaucratie et de l’économie.
L’origine berbère de bon nombre d’officiers inquiète déjà la
bourgeoisie.
L’armée devrait, au contraire, rassurer une large fraction du
monde rural. Le recours à l’Islam puritain et aux valeurs
traditionnelles serait également un facteur positif pour faire
accepter un nouveau régime dont les thèmes mobilisateurs
pourraient, par ailleurs, inquiéter les ruraux. Dans l’hypothèse
d’une modernisation imposée par les militaires, dont une des
conséquences serait un bouleversement des structures agraires,
les élites locales montreraient sans doute leurs réticences. Il ne
faut pas, pour autant, surestimer leur capacité ou leur volonté
de s’opposer au changement. Il est vraisemblable qu’elles
accepteraient déjà plus facilement ce changement s’il leur était
imposé par les responsables nationaux issus de leur milieu,
même s’ils n’arrivaient pas à reconstituer le système de liens
personnels qui les reliait, sous la monarchie, au pouvoir
central.
Enfin, il n’est pas impossible que les militaires sachent associer
certains groupes de ruraux à leurs projets, et dégèlent, ainsi,
une situation en apparence figée. L’épilogue de l’épicier et du
chef qui introduit l’ouvrage de D. Lerner, The passing of the
traditional society[11], en constitue un exemple significatif. Dans
un village d’Anatolie, isolé mais proche d’Ankara, l’épicier,
étranger au groupe et mal accepté, incarnait, en 1950, les
valeurs nouvelles, en face du cheikh qui symbolisait l’autorité
traditionnelle, les valeurs religieuses, et qui représentait le
groupe des propriétaires terriens. Quatre ans après, le village est
relié à la capitale par une route goudronnée. L’épicier est mort
entre-temps. Le cheikh a vu son autorité diminuée par
l’intrusion des représentants locaux de la bureaucratie : il
n’exerce plus un contrôle total sur toutes les activités du
groupe, et doit accepter de négocier ses décisions. Il ne trouve
plus d’ouvriers agricoles pour cultiver ses terres, mais celles-ci
ont acquis une plus-value considérable comme terrains à bâtir,
et ses fils se sont installés comme commerçants dans le village,
drainant une large part de la richesse nouvelle. Le village s’est
transformé, mais au lieu de s’opposer à l’inévitable, le cheikh
en a pris son parti, et a trouvé son avantage dans le
changement de situation. Au lieu d’être un modèle de
comportements traditionnels, sa famille est devenue
l’introductrice mesurée des idées nouvelles. Elle a su tirer
bénéfice des changements économiques. Son statut a changé,
mais la richesse nouvelle lui procure d’autres moyens
d’influence.
Les élites locales marocaines sauront-elles demain accepter ce
type d’évolution ?
Notes du chapitre
[1] Cf. E. Gellner, « Patterns of tribal rebellion in Morocco »,
in P.J. Vatitiokis, Revolution in the Middle East and other cases
studies, op. cit., p. 120-145.
[2] Voir B. Moore Jr., Les origines sociales de la dictature et de la
démocratie, Paris, Maspero, 1969.
[3] Voir chapitre IV.
[4] Pour une analyse des rapports entre élites locales et
système politique voir J. Waterbury, Le commandeur des
croyants. La monarchie marocaine et son élite, op. cit., J. et J.
Aubin, « Le Maroc en suspens », Annuaire d’Afrique du Nord
1964, p. 73-89.
[5] Dahir du 27 mars 1958 frappant certaines personnes
d’indignité nationale et autorisant la récupération de leurs
biens par l’Etat. Pour une appréciation critique des tentatives
de réforme agraire à cette époque, voir I.W. Zartman, Morocco :
problem of new power, op. cit., p. 119-152.
[6] Voir C. Henry-Moore, Politics in North Africa, Algeria,
Morocco and Tunisia, Boston, Little, Brown, 1970, p. 237 et
suiv., notamment les développements concernant la nation de
« stability group ».
[7] Le commandeur des croyants. La monarche marocaine et son
élite, op. cit.
[8] Ibid, op. cit.
[9] Voir J. Waterbury, « The coup manqué », American
Universities Fred Staff, 15(1). 1971.
[10] Voir S.P. Huntington, Political order in changing societies,
New Haven, Londres, Yale University Press, 1969, p. 192 et
suiv., et la plaidoirie de A. Guedira au procès de Kenitra. Le
Monde, 3 novembre 1972.
[11] New York, the Free Press, 1958, p. 19-43.
Postface
Reprendre l’étude d’un pays vingt ans après, met à l’épreuve
les hypothèses qui ont fondé le système d’explications retenu
au départ. Cette tentative doit intégrer l’évolution de la société,
et s’efforcer d’en prévoir les orientations en se gardant des
tentations de l’immobilisme ou du catastrophisme.
A première vue, la continuité entre le Maroc d’aujourd’hui
(1984) et celui des années 1960 est frappante. A commencer
par le souverain, la classe politique de l’indépendance est
encore en. place trente ans après[1], malgré deux (ou trois)
coups d’Etat et un doublement de la population, qui ne s’est
pas accompagné d’une augmentation correspondante des
ressources. Les analyses présentées dans Le Fellah marocain
défenseur du trône[2] se sont avérées dans l’ensemble justes.
L’alliance entre la monarchie et la bourgeoisie rurale a
fonctionné comme système stabilisateur du régime, en
contenant la poussée de la classe moyenne urbaine et en
assurant la survie d’un jeu politique limité aux élites, où
l’opposition évolue entre la cooptation et la prison. Cette
stabilité a certainement comporté des avantages, mais son coût
social entraînera à long terme des déséquilibres générateurs de
violence. La conséquence la plus marquante a été le blocage de
toutes réformes qui auraient porté atteinte au statut de la
bourgeoisie rurale. Cependant, on doit se demander si ce
groupe social ne s’est pas montré plus attaché aux apparences
qu’à la réalité.
En termes de pouvoir politique, les profonds changements qui
ont affecté la société marocaine n’ont toujours pas reçu de
traduction institutionnelle. Certes, le roi réaffirme son alliance
avec les élites rurales lors du discours du Trône en mars 1984
en annonçant la suppression de l’impôt agricole jusqu’en l’an
2000. Mais il existe aujourd’hui des masses urbaines qui n’ont
pas d’accès au pouvoir. Les tentatives démocratiques
timidement opérées entre 1962 et 1965 puis entre 1970 et 1977
ont tourné court. Le roi n’a pu renoncer à un système
circonscrit aux élites qu’il sait au demeurant dominer avec
aisance dans le quotidien. Cette situation comporte des
éléments de fragilité. Au lendemain de l’indépendance, les
partis et les syndicats prétendaient exercer le pouvoir au nom
de masses encore peu présentes. La monarchie les a écartés sans
trop de difficultés grâce à l’appui du monde rural et des forces
armées. Par la suite, il est devenu plus dangereux et difficile de
résister aux militaires qui ne se contentaient plus de prébendes
généreusement consenties en contrepartie de leur rôle face à
l’Algérie ou aux émeutes urbaines. Par trois fois, les prétoriens
menés par leurs chefs hiérarchiques — supposés être les fidèles
parmi les fidèles — ont menacé le trône. Sans doute, leur échec
n’est pas seulement dû à la chance du souverain, mais aussi à la
faiblesse de leur légitimité à diriger le pays. La conscience du
vide politique qu’ils créaient en s’attaquant au roi a entraîné
des réflexes d’irrésolution. En resteront-ils là, sachant que les
enjeux d’une nouvelle tentative seraient de part et d’autre plus
élevés après ces échecs?
Le roi saura-t-il, entre-temps, mettre en place un système
représentatif qui ferait en outre apparaître comme plus
arbitraire et moins légitime une confiscation militaire du
pouvoir[3]? Se contentera-t-il de maintenir le recours aux
symboles nationaux ou religieux unanimistes ? Les associera-t-
il à des pratiques traditionnelles de gestion des conflits et des
ambitions et à des semblants de démocratisation qui
discréditent aussi bien les partis et les élections que le pouvoir
lui-même?
A long terme, l’intégration des masses semble inévitable;
toutefois, la monarchie peut retarder cette issue en contestant,
d’une part, la légitimité des représentants possibles de la classe
moyenne (partis, syndicats, armée) qui se posent en
concurrents immédiats, d’autre part, en rénovant l’intérêt d’un
jeu politique limité aux élites. C’est certainement dans ce
domaine que les plus grands progrès ont été faits depuis les
années 1960. Car Hassan II sait contrôler des circuits
souterrains de gouvernement qui associent l’ancien Makhzen
au modèle louis-quatorzien de « société de cour ». Les
mécanismes de l’Etat-nation moderne mis en place avec une
certaine efficacité au lendemain de l’indépendance y perdent
une partie de leurs moyens.
Par ailleurs, le pouvoir peut aussi se prévaloir d’une plus grande
aptitude que ses concurrents à manier des symboles unitaires
accessibles aux masses, tels l’Islam ou la sauvegarde de
l’autonomie nationale face à l’Algérie, dont l’affaire du Sahara
occidental est l’exemple. Il ne faut pas exclure non plus sa
capacité à mobiliser en cas de besoin ultime son pouvoir
religieux en termes de consensus démocratique. Cependant,
l’expérience a prouvé son incapacité à traduire en succès
électoral de type partisan sa faculté de mobilisation de type
plébiscitaire.
Place actuelle du monde rural
Au cœur du système politique contrôlé par la monarchie à
partir de 1960, le monde rural occupe une place particulière.
Ses révoltes inspirées par le palais ont tout d’abord empêché
l’installation d’un encadrement administratif et politique
monopolisé par l’Istiqlal. Leur répression, au moins apparente,
par l’armée, qui était alors sous les ordres directs du prince
héritier, constitue le premier exemple d’une longue suite
d’interventions des militaires au service du pouvoir. Avec
l’arrivée de Bekkaï au ministère de l’intérieur, les rapports entre
les notables ruraux et l’encadrement politico-administratif
s’améliorent, les anciennes élites rurales occupant dès lors un
certain nombre de postes de conseillers communaux et de
présidents en mai 1960. Assurés que la transition du
protectorat à l’Etat-nation ne se ferait pas contre eux, ils
peuvent se consacrer plus facilement à la fois à la
modernisation de leurs exploitations et au contrôle de la
société rurale. L’accès direct au palais leur permet d’agir comme
une sorte de réseau de contrôle diffus sur l’administration
politique et technique. Leurs interventions entraînent des
mutations et des révocations parmi les agents d’autorité et les
responsables des services techniques qui suffisent à affirmer
leur poids nouveau dans le système[4].
On notera également qu’aucune réforme modifiant les
structures foncières ne se réalisera dans le cadre des projets de
développement rural (Sebou, Derro), malgré les propositions et
les pressions des services techniques (ONI) et des missions
d’experts internationaux. Les investissements réalisés dans
cette période grâce à l’aide extérieure et aux crédits publics
marocains bénéficieront en fin de compte à la bourgeoisie
rurale et à un nombre limité de nouveaux propriétaires citadins
qui auront pu acquérir des fermes de colons étrangers en
bénéficiant d’autorisations dérogatoires. Si l’Etat procède à
quelques distributions de terres confisquées (terres du Glaoui)
ou de lots de colonisation publique récupérés dès 1963,
l’objectif réel de cette procédure semble être la dissimulation de
l’accaparement du surplus agraire dû aux investissements
publics et des transferts abusifs de terres[5]. Les deux tiers des
meilleures terres de colonisation font ainsi l’objet de transferts
dérogatoires contrôlés par le cabinet royal. Le roi et les princes
ne sont pas les derniers à bénéficier de ces mesures, et l’on peut
estimer que la famille royale, qui jouissait déjà du temps de
Mohamed V d’un patrimoine important, devient alors le
premier propriétaire foncier du pays. Lui appliquer les réformes
envisagées était impossible et l’exclure officiellement de leur
champ aurait été choquant. Cette situation particulière a sans
doute largement contribué à l’immobilisme et aux faux-
semblants qui ont caractérisé la politique de l’Etat dans le
domaine des structures agraires.
Globalement, la bourgeoisie agraire ancienne et nouvelle
réussit à bloquer les réformes, à récupérer une partie du surplus
et à acquérir la portion la plus intéressante des terres de
colonisation. Néanmoins, elle ne peut obtenir entière
satisfaction car, officiellement, des sociétés d’Etat longtemps
placées sous la responsabilité des gouverneurs gèrent les terres
récupérées, en attendant leur dévolution définitive. La remise
sur le marché de ces terres est souhaitée par le secteur privé qui
juge leur gestion par l’Etat inefficace et dispendieuse.
Jusqu’alors, le pouvoir a refusé d’accorder cette ultime
satisfaction d’une trop grande valeur symbolique, tant par la
dépossession de la bureaucratie que par celle des anciens
propriétaires qui attendent depuis le départ des colons la
restitution de ces terres[6].
Par ailleurs, la structure sociale du monde rural a beaucoup
changé depuis l’indépendance. L’ancien caïd du protectorat qui
régentait encore, dans les années 1960, une population
nombreuse de khammès, de bergers et de moissonneurs,
donnait l’impression d’exercer un commandement des
hommes. Son rôle social dépassait largement les limites de
l’exploitation agricole et laissait peu de place aux représentants
locaux du pouvoir d’Etat. Vingt ans après, son fils ou son
neveu a plutôt l’apparence d’un entrepreneur moderne, plus
soucieux de mécanisation, d’investissements et de profits
comptabilisés que d’emplois. A cet égard, son attitude à l’égard
du personnel d’exploitation est significative. Le khammès a
disparu, le berger se fait rare et les ouvriers permanents sont
limités au petit nombre nécessaire au fonctionnement d’un
parc abondant de machines agricoles. Lors des récoltes, on a
recours à de nombreux saisonniers qui se maintiennent de plus
en plus difficilement en combinant la culture de lopins de
subsistance et le travail sur les chantiers de la Promotion
nationale.
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de constater, au fur
et à mesure des recensements, que la population rurale tend à
descendre au-dessous de 50% dans de nombreuses régions
agricoles riches, tout en se maintenant à 60% au niveau
national. Mais, par comparaison avec les chiffres du
recensement de 1960, il y a de notables différences. Elles se
retrouvent dans un accroissement de l’émigration à l’étranger,
un gonflement des villes moyennes et un engorgement des
grands centres du cordon littoral. Comme le note un rapport
de la Banque mondiale d’octobre 1981[7], l’économie marocaine
a pu en fait profiter de cette situation, car, entre 1960 et 1970,
la croissance de l’emploi dans le secteur urbain a bénéficié en
premier lieu à la main-d’œuvre d’origine rurale, plus docile,
acceptant de plus bas salaires et se contentant de conditions de
vie très rudimentaires. Le taux de chômage en milieu rural
durant cette période se situe à peine au-dessus de 5 %. Les
travailleurs émigrés ont été aussi recrutés de préférence en
milieu rural, tant par les missions françaises de recrutement
que par les réseaux de parentèles qui ont fonctionné par la
suite.
Ces changements ont affecté également les structures de
revenus dans le monde rural. Entre 1960 et 1970, le
pourcentage des ménages disposant d’un revenu inférieur à
900 dirhams par mois est passé de 9 à 17 %. Le groupe des
revenus moyens (900 à 3 000 DH) est passé de 72 à 48 % et
celui des revenus élevés (plus de 3 000 DH) de 18 à 34%. Il
faudrait sans doute rétablir les différences régionales
importantes qui se dissimulent derrière ces moyennes. On
assiste donc à une forte croissance des deux groupes extrêmes
aux dépens du groupe des revenus moyens. Le nombre de
paysans pauvres va presque doubler en dix ans, avec des écarts
croissants entre les régions dus aux conditions climatiques,
mais aussi à un mouvement de concentration foncière et de
différenciation des modes de culture. Leur survie sur place
dépend plus des aides administratives, des réseaux de solidarité
et des travaux saisonniers que peuvent encore procurer les
grosses exploitations que du produit précaire de leur
exploitation. A l’inverse, le groupe des paysans aisés qui a
également doublé, atteint un seuil de revenus permettant
l’accumulation du capital foncier et la mécanisation des
cultures, gage d’une plus grande indépendance et de profits
plus réguliers. Les périmètres irrigués et les grandes plaines ont,
sans doute plus que les autres régions, bénéficié de ce
relèvement du revenu agricole. Des régions pauvres comme le
Souss et le Rif ont compensé leur faiblesse en ressources
agricoles par un recours massif à l’émigration vers l’étranger[8].
Les régions où l’on rencontre les plus fortes proportions de
déshérités sont les régions de culture en sec, sans ressources
complémentaires, situées dans le Sud ou dans l’Oriental. La
sécheresse subie ces quatre dernières années a dû accentuer
l’exode rural, les ventes de terres et de cheptel. L’effondrement
local de l’économie agraire n’a cependant pas produit de
catastrophe de type éthiopien. Le tissu social et les services
publics de l’Etat-nation marocain se sont montrés, en la
circonstance, plus efficaces que le protectorat. En 1945, une
sécheresse comparable avait entraîné dans le Sud des milliers
de morts. Les réseaux de solidarité des familles étendues, la
multiplication des emplois publics, les diverses formes d’aide
sociale ont permis aux plus déshérités de survivre.
Globalement, la production agricole marocaine a augmenté de
50 % par rapport à celle du protectorat, et l’agriculture n’a pas
été sacrifiée à l’industrialisation suivant le modèle stalino-
rostowien décrit par Michel Chatelus[9]. En revanche, les
relations entre les différentes couches du monde rural se sont
relâchées. La sécheresse a accéléré le processus de concentation
foncière au profit des moyens et gros agriculteurs. Comme le
montre l’étude de la Banque mondiale, ces deux groupes sont
maintenant bien installés dans la réalité économique et sociale
du monde rural. Nombreux sont les agriculteurs qui font
preuve d’adaptation et d’esprit d’entreprise, intégrant en
quelques années des innovations techniques considérables. On
peut en trouver un indicateur significatif dans la
consommation d’engrais qui a doublé depuis l’indépendance.
Ce groupe, certes aidé par les services techniques de l’Etat, a
introduit en moins de vingt ans des cultures nouvelles aussi
délicates que la betterave ou la canne à sucre (le Maroc couvre
maintenant 65 % de ses besoins, alors qu’il importait la totalité
de son sucre brut jusqu’au début des années 1960). Un effort
comparable a été accompli dans le domaine de l’élevage et la
fabrication de fromages, en liaison en partie avec la production
sucrière (utilisation de la pulpe). Des cultures spéculaires
comme les fleurs coupées, les avocats, les kiwis, les papayes, les
bananes en serre ont prospéré. Le roi a joué, tant par goût
personnel que par sens de l’intérêt général, un rôle
d’expérimentateur de variétés et de techniques nouvelles, que
les agriculteurs modernes imitent volontiers. Toutefois, ces
techniques renforcent l’individualisme et les rapports
monétaires entre les groupes sociaux. Il en est de même de la
mécanisation des labours, des transports et des récoltes qui est
maintenant solidement implantée. Le développement du crédit
agricole a facilité cette mutation.
Les conséquences sociales et politiques de ces changements
n’ont pas encore produit tous leurs effets. Il est difficile
d’évaluer la marge d’élasticité que recouvre le calme des
campagnes. Les rapports entre les gros et moyens agriculteurs,
les agents d’autorité et les services techniques ne peuvent plus
être identiques à ceux des années 1960. Le paysan qui a fait des
études secondaires, parfois supérieures, aura tendance à établir
une certaine distance à leur égard. Il revendique des pouvoirs
de gestion des sucreries, des laiteries ou des caisses locales de
crédit agricole que l’administration n’est pas prête à céder. Il se
reconnaît encore dans les élus locaux, mais n’hésite pas à
prendre le chemin de Rabat si l’affaire lui semble d’importance.
Les agriculteurs moyens apprécient encore l’aide de l’Etat pour
la commercialisation de leurs produits ; ceux qui se lancent
dans l’agriculture spéculative souffrent des lenteurs et des
insuffisances de l’Office de commercialisation et d’exportation
(OCE) sur les marchés internationaux. Pour ces groupes
d’agriculteurs modernes, les intérêts corporatifs commencent à
devenir plus importants que leurs réseaux de parenté. Le
contrôle qu’ils exercent sur le milieu rural peut s’en ressentir,
sans qu’il y ait cependant rupture absolue. L’opposition est
beaucoup plus grande entre les paysans restés dans le régime
collectif ou dans l’indivision et les agriculteurs marocains
modernes, souvent citadins, qui ont acquis une ferme de
colons. Le milieu paysan reste alors frustré et hostile, avec de
soudains recours à la violence comme en 1965 dans le Rharb.
Loin d’exercer une influence, le gros exploitant moderne de ce
type sert de repoussoir et fait romancer le temps du colon.
A travers tous ces changements, le monde rural donne
néanmoins l’impression de se stabiliser, de maintenir un
équilibre assez souple entre le réseau administratif, les élus et
les divers groupes de producteurs. L’Etat joue son rôle d’arbitre
et de soutien. Certes, les services publics ne fonctionnent pas à
la perfection. L’enseignement tend à l’inexistence et les services
de santé sont parfois dangereux. Mais les routes sont bien
entretenues, l’ordre public est maintenu et les postes marchent.
Les services agricoles agacent tantôt par leur insuffisant, tantôt
par leur interventionnisme. Dans l’ensemble, le Maroc rural
fait bon ménage avec l’Etat-nation moderne qu’il supporte,
parfois comme un parasite, souvent dans l’indifférence mais
plus guère, dans l’hostilité qui avait caractérisé les premières
années de l’indépendance. Constitue-t-il pour autant le soutien
actif du trône qu’il avait été ? Rien n’est moins sûr. La menace
ne provient plus aujourd’hui des villes et de la classe moyenne
organisée en partis et en syndicats, mais de l’armée qui, par
trois fois, a mis la monarchie en péril[10].
A priori, les ruraux n’ont pas une perception négative de
l’armée. Ils lui fournissent la quasi-totalité de ses soldats, de ses
sous-officiers et encore la majeure partie de ses officiers. La
plupart des officiers engagés dans les coups d’Etat
appartenaient à de vieilles familles caïdales et avaient servi
dans l’armée française. La répression qui a suivi Skhirat a dû
laisser des traces dans le Riff et le Moyen Atlas. La scène
politique marocaine reste dominée par le souvenir et la crainte
des coups d’Etat militaires. Cette situation a contribué à
enlever au monde rural sa fonction de contrepoids, sans pour
autant en faire un domaine de préoccupations pour le pouvoir.
De part et d’autre, les réflexes anciens demeurent.
La menace des prétoriens
Paradoxalement, la peur des militaires a aidé Hassan II à
maintenir un jeu politique limité aux élites, cooptant
l’opposition, neutralisant les syndicats et faisant du champ
économique un des enjeux majeurs du politique.
Avec le conflit des frontières, des relations ambiguës
apparaissent entre le palais et l’état-major, dont les complots de
1971 et 1972 constitueront les épisodes les plus marquants. Le
point d’équilibre est loin d’être atteint dans la mesure où la
monarchie a choisi en 1974 de relancer l’affaire du Sahara et
d’accroître par là même les crédits et les effectifs de l’armée.
Depuis lors, le système politique marocain vit sous la hantise,
ou la fascination, des militaires. Cette situation a permis au roi
de maintenir un jeu politique restreint aux élites et contrôlé
par lui seul suivant des méthodes plus proches de l’ancien
Makhzen que de la bureaucratie moderne.
Depuis le retour de Mohamed V, l’armée avait fait partie du
domaine du roi, et plus particulièrement d’Hassan II, qui avait,
comme prince héritier, présidé à son organisation. Arrivé au
pouvoir, il l’a fréquemment sollicitée pour les tâches civiles
(Promotion nationale, administration des provinces) et l’a très
vite fait intervenir pour neutraliser les partis et la bureaucratie.
Le renvoi, en juillet 1965, du Parlement élu en 1963, a suivi la
répression des émeutes de Casablanca en mars 1965.
Lorsqu’en octobre 1963 la guerre des frontières a été engagée
par le Maroc pour obtenir de Ben Bella le respect des promesses
de Ferhat Abbas sur le Sahara, les dirigeants marocains avaient
bien le sentiment de pouvoir définir les termes d’une unité
nationale à laquelle les membres de la classe politique ne
pourraient échapper sans avoir à se placer en dehors du jeu.
Bouabid choisit la première solution. Ben Barka la seconde,
pensant peut-être encore que l’opinion publique marocaine
réagirait aux souvenirs de la solidarité avec le FLN. Les temps
changent, et l’Algérie est perçue essentiellement comme une
nation rivale capable de concevoir l’unité du Maghreb en
termes de domination, dans le prolongement de son
appropriation du Sahara. Instinctivement, l’opinion publique
marocaine est solidaire sur ce point de la monarchie dont
l’existence lui apparaît incompatible avec toute forme de
compromis donnant satisfaction à long terme aux ambitions
algériennes. La guerre des frontières a donc coupé la gauche
marocaine du soutien de l’Algérie, et l’a forcée à se porter
solidaire d’un combat nationaliste dont les règles étaient
définies par le roi et l’armée, avec comme seule liberté, la
faculté de renchérir sur l’intransigeance de ses partenaires.
Si le conflit avec l’Algérie renforçait le rôle de la monarchie
comme symbole d’unité nationale, il la plaçait dans une
situation de dépendance à l’égard de l’armée. Jusqu’alors, celle-
ci restait marquée par son passé colonial français et espagnol.
La monarchie la protégeait des attaques des partis et se servait
d’elle comme force d’intervention sur le plan intérieur, dans
des conditions peu prestigieuses, mis à part les secours aux
sinistrés du tremblement de terre d’Agadir. Pour la première
fois, l’armée marocaine acquiert une légitimité aux yeux de
l’opinion qui la blanchit de son passé colonial et répressif. Sa
technicité est appréciée lorsqu’elle apparaît indispensable à
l’existence nationale. En conséquence, elle obtient une certaine
autonomie par rapport à la monarchie. L’état-major réagit
lorsque le roi veut limiter les effets du conflit avec l’Algérie. Il
est réticent sur le déroulement de la négociation dans le cadre
de l’OUA, car il préférerait continuer à exercer de fortes
pressions sur l’Algérie avec l’aide, si besoin, des Etats-Unis.
A l’origine, les relations entre la monarchie et l’armée étaient
confiantes. L’accession au trône d’Hassan II en 1961 avait
ouvert aux militaires de nombreux postes civils, notamment
dans l’administration territoriale. L’engagement du pays dans
un processus démocratique limité en 1962-1963 renforce le
recours à l’armée comme contrepoids, non sans réticence de sa
part. L’appui trop affirmé du roi à un parti l’inquiète autant
que le pluralisme parlementaire. Si elle accepte l’idée de
soutenir la monarchie, elle refuse que ce soutien ait l’apparence
du soutien à un parti. Par ailleurs, elle craint bien à tort les
critiques parlementaires, son budget ayant été, pendant la
période 1963-1965, adopté à l’unanimité.
Ses chefs se trouveront engagés dans la poursuite de complots
réels ou fictifs et, en mars 1965, dans la répression des émeutes
de Casablanca. Ces opérations feront naître un certain malaise.
L’armée est sensibilisée aux maux dont souffre la société, aux
inégalités, à la corruption dont elle rejette la faute sur la classe
politique et indirectement sur le roi qui tolère ces pratiques
pour mieux contrôler le système. Les démarches discrètes des
chefs militaires auprès du roi n’ayant eu aucun succès,
l’irritation due aux restrictions et aux contrôles, qu’impose le
pouvoir lorsque l’on fait appel aux soldats pour rétablir l’ordre
dans la rue ou pour défendre les frontières du pays, amène
l’armée à s’engager dans des complots successifs. Les officiers
de haut rang, issus de l’armée française, donnent alors le plus
souvent l’impression de suivre et de couvrir de jeunes
capitaines de modèle nassérien. Les divergences sur les
objectifs, les ambitions concurrentes feront échouer chaque
fois ces tentatives près du but. Il semble bien que les chefs des
premiers complots ne souhaitaient ni supprimer la monarchie,
ni éliminer le roi, mais bien forcer ce dernier à abdiquer. Ils
voulaient gouverner en préservant l’institution monarchique
pour sauvegarder l’unité du pays, après avoir assaini, suivant le
modèle turc, le jeu politique.
Après l’attentat du Boeing, en 1972, la confiance entre le roi et
l’armée est brisée, mais les militaires restent plus que jamais au
cœur du jeu politique. En effet, le souverain se sert de la
menace des prétoriens pour reprendre l’initiative et relancer le
système politique en lui fournissant de nouveaux enjeux, tout
en continuant à en exclure les masses. Puis les circonstances
font saisir au souverain tout l’intérêt d’une politique
saharienne active qui lui assure un consensus parfait pour
plusieurs années. Cependant, cette politique entraîne un
gonflement des crédits et des effectifs de l’armée, et engage
cette dernière dans un nouveau processus de tensions avec le
pouvoir politique, qui aboutira à la tentative avortée du général
Dlimi, fin janvier 1983.
En 1975, la mort de Franco rouvre de façon ambiguë la
question du Sahara en permettant un dégagement de
l’Espagne, difficile du vivant du caudillo. Si un accord existe
entre le Maroc et la Mauritanie, l’Algérie n’est pas décidée à
faciliter les choses. Faute de recevoir sa part de l’ancienne
colonie espagnole, elle appuie les revendications à
l’indépendance du Front Polisario. Confronté au risque d’un
grave échec diplomatique. Hassan II trouve dans la Marche
verte l’occasion d’un grand mouvement de mobilisation
populaire autour de l’Islam et de la monarchie. Il peut ainsi
retarder d’autres formes de participation institutionnalisée,
tout en espérant au départ limiter le plus possible les risques
d’un affrontement avec l’Algérie. L’affaire du Sahara lui permet
aussi de réintégrer l’armée dans la communauté nationale,
après les. complots, et de lui trouver une occupation jugée peu
dangereuse politiquement. Les crédits militaires comme les
effectifs augmentent. Sur le plan individuel, les militaires
voient leur solde au Sahara accrue de 75%. La contrebande
avec les Canaries procure à certains officiers des avantages
complémentaires. De plus, la lutte aux frontières leur donne
une occasion légitime de se poser en défenseurs de l’intérêt
national peu accessibles à l’idée de compromis. Les frictions
avec le palais se multiplient lorsqu’il faut, au début, obtenir du
roi en personne l’autorisation de riposter aux attaques du
Polisario, les heures de sommeil du souverain n’étant pas celles
des attaquants, ni celles des militaires. Dans un second temps,
ce type d’autorisation sera limité au seul droit de suite.
Le renouveau du système Makhzen
Les complots militaires, l’affaire du Sahara ont laissé aux partis
et aux syndicats un champ d’action très limité. Tous
pressentent que le pluralisme contrôlé dont ils bénéficient
cesserait immédiatement lors d’une prise de pouvoir par les
militaires. Leur revendication pour une véritable démocratie
représentative est ainsi freinée, et ils sont amenés à se
contenter des modes de cooptation institués par le pouvoir
comme d’un pis-aller inévitable. En acceptant cette situation
où les membres de l’opposition sont aussi mal élus que les
partisans du pouvoir, ils contribuent à discréditer un processus
démocratique que les militaires répudieraient sans doute dans
sa symbolique même. Depuis vingt ans déjà (1963), la
monarchie a amené l’UMT à composer, par des pressions sur
son organisation matérielle, acceptant en contre-partie son
influence limitée dans les services publics et dans quelques
fédérations d’industrie. Par là même, elle a coupé le principal
parti de gauche de sa base ouvrière et créé une situation où le
syndicat renonce à une présence active dans les secteurs
économiques nouveaux contre la garantie d’un maintien de
l’emploi et des droits acquis dans les secteurs anciens comme
les phosphates ou les services publics.
Avec les partis, le jeu est plus subtil. L’opposition de gauche
jouit d’une certaine liberté qui se traduit par l’existence de
journaux, d’un droit de réunion et une participation limitée
aux fonctionnements des institutions locales et nationales.
Cette situation est unique en Afrique du Nord et assez
exceptionnelle dans le Tiers Monde pour que la gauche en
apprécie ses avantages. En contrepartie, elle se doit de
participer à la communauté politique sans prétendre influencer
ses équilibres fondamentaux. Il serait impensable de songer à
remettre en cause l’organisation monarchique du pouvoir,
personne n’y songe réellement. Vouloir se placer dans une
situation d’intermédiaire entre le roi et les masses n’est toléré
que dans les textes doctrinaux, mais absolument impossible
dans la pratique. L’acceptation de l’Islam et des grandes
options nationales comme le Sahara, dans les termes définis
par la monarchie, constitue également un des points
fondamentaux du pacte politique implicite. Ceci acquis, la
monarchie consulte largement l’opposition, veille à lui laisser
accès à un minimum de ressources et à maintenir ses dirigeants
dans une situation honorable. La possibilité d’un séjour
épisodique en prison pour marquer les limites à ne pas dépasser
n’est pas à exclure, renforçant indirectement aux yeux des
masses la crédibilité révolutionnaire des dirigeants cooptés par
le Makhzen. Pour les partis gouvernementaux, le problème du
roi est de créer l’impression d’une vie politique active là où il
n’y a guère de place pour un changement doctrinal au-delà
d’un mouvement symbolique des personnes. Le roi a toujours
refusé de s’engager directement derrière une formation
politique, il veille à assurer un certain pluralisme parmi ceux
qui se prévalent d’une fidélité sans réserve à l’idée du
gouvernement monarchique et à sa personne[11].
Mais il est trop sensible aux clivages de la société marocaine, à
l’importance des clans, des réseaux familiaux, des
appartenances géographiques pour ne pas assurer parmi ses
fidèles une représentation de ces divers courants, tout en
sachant préserver entre eux une tension suffisante. Le
problème du renouvellement des générations politiques a été
jusqu’alors résolu avec une certaine habileté par le souverain. Si
un nombre limité de dirigeants, aussi bien parmi ses proches
que dans l’opposition, exercent des responsabilités depuis les
premières années de l’indépendance (Guedira, Ahardane,
Bouabid, Bahnini, Boucetta, Douiri, Ali Yata par exemple), le
roi a su, en plus de vingt ans, réaliser un renouvellement des
élites, tant pour s’assurer la collaboration de compétences
nouvelles que pour maintenir dans le jeu politique coopté ceux
qui auraient été tentés autrement de s’en exclure.
Le contrôle du secteur privé par le palais
Après les complots de 1971-1972, le problème devenait
particulièrement pressant dans la mesure où certains dirigeants
politiques et hauts fonctionnaires éprouvaient des réactions de
retrait à l’égard d’un pouvoir apparemment condamné, si du
moins il ne changeait pas considérablement ses pratiques. Le
phénomène aurait pu devenir contagieux et dangereux par les
effets d’isolement et les stratégies d’alliances défensives
suscitées au sein des divers groupes sociaux. Il fallait en
particulier éviter que certains membres de l’élite supputent le
nom du prochain chef militaire à l’origine d’un coup d’Etat
possible, et ne tentent de se rapprocher de lui. Pour cela, il
fallait maintenir un certain attrait au jeu politique, allant au-
delà de la simple crainte des militaires qui assurait au souverain
la bienveillance naturelle de la classe politique. Dans ce but, le
roi a utilisé un mélange d’incitations idéologiques et de
récompenses matérielles. laissait espérer une large ouverture
démocratique du système politique et décidait l’ouverture du
champ économique à la première génération des dirigeants
politiques et administratifs ayant accédé aux responsabilités
dans les aimées 1960. Il est intéressant de noter que le secteur
privé industriel et commercial est resté en majorité sous
contrôle étranger jusqu’en 1973. En décidant alors sa
marocanisation, et la récupération des terres de colonisation
privée, le domaine auquel le roi pouvait donner accès par
décision personnelle est accru. Depuis longtemps, le secteur
économique périclitait entre les mains des étrangers. Cette
situation le neutralisait dans le débat politique marocain, alors
que le patronat avait exercé des pressions considérables sur
l’administration du protectorat. L’alliance des entrepreneurs
étrangers et des militaires paraissait peu probable, cependant il
fallait exclure la possibilité de voir un coup d’Etat triomphant
s’assurer des soutiens politiques en faisant contrôler ce secteur
par ses fidèles.
Par ailleurs, le roi, en marocanisant l’économie, donnait une
satisfaction de principe aux partis, tout en ouvrant un nouveau
champ d’activités à des responsables encore jeunes qui avaient
fait leurs preuves dans l’administration et les services publics.
Parvenus aux postes de directeurs, de responsables d’offices, de
secrétaires d’Etat ou de ministres à l’âge de 40 ou 45 ans, ils
risquaient de bloquer pendant quinze à vingt ans le sommet de
la machine administrative. Un nouveau groupe de jeunes
cadres formés depuis l’indépendance, plus diplômés que les
hommes de la première génération, attendait avec impatience
la relève, accusant les hommes en place d’incompétence et de
corruption. Leur ressentiment risquait d’en faire une clientèle
naturelle pour la gauche ou pour les militaires. En libérant les
hauts postes de la hiérarchie administrative, le souverain
s’assure la collaboration d’une génération ambitieuse et bien
formée qui lui fournira une techno-structure de très bonne
qualité. Mais, d’ici cinq à dix ans, le problème risque de se
poser à nouveau, sans avoir cette fois les ressources disponibles
en 1973-1974.
Le groupe d’anciens responsables publics orientés vers le
secteur privé aura également bénéficié de conditions favorables
à sa réussite. D’une part, les entreprises étrangères étaient
depuis plusieurs années dans une expectative prudente. Elles
avaient cessé d’investir, recrutaient peu, rapatriaient la majeure
partie de leurs bénéfices. D’autre part, en 1974, le Maroc
bénéficie d’une chance économique exceptionnelle avec le
quadruplement du prix des phosphates. Les grands
programmes d’investissements publics vont se développer en
cherchant des partenaires du côté des entreprises privées
marocaines, notamment dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics. L’ensemble de l’économie bénéficie alors de
larges crédits, du textile à l’hôtellerie. Les entrepreneurs privés
se voient sollicités tant pour occuper le marché intérieur que
pour développer des industries d’exportation fondées sur des
coûts de main-d’œuvre intéressants. L’économie marocaine
verra une expansion inconnue depuis le début des années
1950. Des entreprises se fondent avec 20 ou 25 % d’apport
personnel, quelquefois moins, les investissements se
multiplient, le taux de profit est particulièrement avantageux
(entre 15 et 25 %, quelquefois plus dans l’immobilier). Lorsque
les prix des phosphates baissent sur le marché mondial, les
crédits internationaux prennent le relais. Jusqu’alors, le Maroc
est peu endetté et souffre d’une inflation modérée. Il offre des
garanties, les grandes banques, comme les organismes
financiers internationaux, n’hésitent pas à répondre à ses
demandes.
L’euphorie va durer jusqu’en 1978. Le coût de la guerre du
Sahara, la crise mondiale finiront par restreindre les
perspectives florissantes. Si les profits sont encore brillants dans
quelques secteurs, notamment le vêtement et l’immobilier,
toutes les entreprises travaillant avec l’Etat ont connu des
difficultés. En effet, les bureaux d’études et les entreprises de
travaux publics doivent, faute de pouvoir récupérer le paiement
de plusieurs années de projets réalisés pour l’Etat, licencier ou
chercher des travaux à l’extérieur. Les faillites se multiplient, et
le marché s’assainit, dit-on. La main-d’œuvre supporte ces
difficultés avec une apparente résignation.
Cette situation de crédit rare renforce le rôle des banques qui
agissent comme un groupe de pression cohérent et structuré,
évitant de se faire concurrence, jouant aussi bien sur leurs liens
avec la technostructure économique marocaine qu’avec le
milieu bancaire et les institutions financières internationales.
Prudents, les banquiers exigent des garanties personnelles des
entrepreneurs (terres, immeubles, voitures, mais aussi la
signature de l’épouse ou de représentants de son lignage). De ce
fait, la plupart des affaires et des projets gardent un aspect
personnel très marqué, lié au fondateur marocain de
l’entreprise, à son réseau familial et à ses liens de clientèle. Le
palais est très présent dans ce jeu économique, et l’on peut
même penser qu’il y a transposé en grande partie les règles de
contrôle et de manipulations qu’il pratique dans le secteur
politique. Certes, le Maroc vit en économie de marché et la
régulation des entreprises est soumise à cette loi. Mais
l’importance des crédits et des marchés publics permet les jeux
d’influence. Le secteur bancaire public ou privé peut être
sensible aux recommandations.
Aucun entrepreneur marocain n’a pu occuper une place
importante dans le secteur privé depuis l’indépendance sans
l’accord personnel du souverain. Parfois, son intervention
prend la forme d’une invitation à s’occuper de telle ou telle
entreprise en association avec un partenaire étranger, avec
l’offre d’un appui personnel ou financier. Cette méthode est
employée fréquemment avec les anciens membres de la classe
politique ou administrative. Par ailleurs, il faut souligner le fait
que le roi est devenu le premier entrepreneur privé marocain,
en particulier depuis son rachat en 1980 des avoirs de la
Banque de Paris et des Pays-Bas qui restaient au Maroc après la
nationalisation des Chemins de Fer et de l’Energie électrique en
août 1963.
Regroupé dans un holding, l’Omnium Nord-africain, cet
ensemble de sociétés couvre notamment l’importation de
véhicules, les conserveries de poisson et de produits agricoles,
des usines de conditionnement de produits laitiers, et de
fabrication de fromages, la location de camions et de gros
matériels de travaux publics, des imprimeries, des mines. Il est
difficile d’en préciser les frontières, mais on estime que l’ONA
emploie plus de quinze mille ouvriers et représente une valeur
d’actifs de plusieurs centaines de millions de dirhams. Présidé
avant son rachat par un ancien Premier ministre, Mohamed
Benhima, il est actuellement géré par David Amar, ancien
président de la communauté israélite de Casablanca et député
du FDIC au Parlement élu en 1963. Sans atteindre l’importance
de l’empire industriel du shah d’Iran ou d’Osman Ahmed
Osman en Egypte, les affaires privées du roi comptent
aujourd’hui beaucoup plus dans le système marocain que ce
n’était le cas du temps de Mohamed V qui avait conservé une
gestion de propriétaire foncier. Il faudrait y ajouter des avoirs à
l’étranger dont le montant est difficile à évaluer[12], et situer cet
ensemble dans un réseau où les membres de la famille royale
jouent également un rôle économique important.
Soigneusement écartés de toute activité publique depuis la
mort de Mohamed V, ils ont pu trouver là de larges
compensations.
Si le roi est le premier entrepreneur du pays, il n’est pas tout à
fait un entrepreneur comme les autres, ce qui, en termes
d’économie de marché, crée des situations inégales et des
frustrations. Les traitements de faveur dont il peut bénéficier de
la part des services publics entraînent des jalousies. Par ailleurs,
le roi se comporte parfois dans le secteur industriel comme un
innovateur, il adopte des techniques qui ne sont pas a priori
rentables à court terme. La nature de sa présence et de son
intervention dans le secteur économique doit donc être
nuancée. Il est clair qu’elle relève d’un projet consistant aussi
bien à éviter l’apparition d’un centre de pouvoir concurrent
que d’un désir d’accroître les ressources du système politique
placées sous son contrôle.
La crainte de voir s’opérer des rapprochements entre les
militaires et les milieux d’affaires a également pu jouer. On a
parlé parfois de contacts établis avant le deuxième complot
entre le général Oufkir et les milieux Fassis de Casablanca.
Depuis lors, un certain nombre d’officiers supérieurs, y compris
en son temps le général Dlimi, ont investi dans les affaires
industrielles et commerciales, au même titre que la première
génération de l’élite politique. Ces contacts et ces
participations n’ont pu avoir lieu sans l’assentiment du palais.
Des mariages ont aussi rapproché les deux milieux. Quand on
connaît l’attention que le Makhzen prête traditionnellement
aux stratégies matrimoniales, il est peu probable que ces faits
soient passés inaperçus. Faut-il supposer une volonté de la part
du groupe des entrepreneurs d’établir des contacts sociaux non
suspects avec ceux qui peuvent prétendre à plus ou moins long
terme prendre le relais de la monarchie? Sans en déduire un
projet cohérent à l’échelle des groupes, il peut y avoir des
convergences qui dépassent le hasard des affinités
individuelles.
Mesures complémentaires d’extension du champ
politique après les complots
On a déjà évoqué parmi les mesures prises par la monarchie
pour accroître, au lendemain des complots, la masse des
moyens économiques gérés par le système politique, la décision
de récupérer les terres de colonisation privée. Cette décision est
encore plus ambiguë que la prise de contrôle du secteur privé
industriel. Elle satisfait à une demande ancienne des
nationalistes. Mais son caractère tardif aura permis aux colons
de vendre à peu près les deux tiers de leurs propriétés à des
Marocains susceptibles d’obtenir des dérogations aux mesures
de blocage. Théoriquement, l’Etat et les offices agricoles
devaient récupérer ces superficies pour les cultures en blocs s’il
s’agit de plantations, ou préparer leur distribution. En fait, la
décision de reprise sera l’occasion d’un apurement des
situations juridiques antérieures qui se traduira par une
régularisation des transactions illicites dans la quasi-totalité des
cas. Mises à part quelques distributions très orchestrées aux
anciens ouvriers des fermes de colonisation qui auront pour
but de dissimuler l’opération d’escamotage des meilleures terres
au profit des fonctionnaires, des officiers et des commerçants
influents, les superficies récupérées en 1974 resteront entre les
mains de l’administration. Elle les exploitera suivant les règles
bureaucratiques peu soucieuses du calendrier agricole, qu’il
s’agisse des traitements chimiques, des engrais ou des aliments
de bétail. Le rendement moyen a alors tendance à rejoindre
celui des domaines autogérés algériens et les agriculteurs
modernes se servent de cet argument pour demander à l’Etat de
renoncer à l’agriculture et de leur rendre les terres. Il est
vraisemblable qu’aucune mesure ne sera prise en ce sens,
malgré des pressions extérieures très fortes exercées sur les
pouvoirs publics, par crainte de mécontenter la bureaucratie
agraire et les populations qui revendiquent ces terres au nom
des droits antérieurs à la colonisation.
Diverses mesures prises après les complots de 1971-1972 ont
également élargi le champ de contrôle et le système de
récompenses géré par la monarchie. Les recrutements de
fonctionnaires dans l’euphorie de l’augmentation du prix des
phosphates en 1974 ont été accrus. Lorsque les prix ont à
nouveau baissé à partir de 1975, les décisions essentielles
étaient prises, et le courant allait dans le sens suivi depuis
l’indépendance. Le chiffre des agents de l’Etat est ainsi passé en
un peu plus de vingt ans de moins de 50 000 à plus de 500 000.
Pour leur part, l’armée et les forces de l’ordre comptent près de
200 000 agents. Viennent ensuite les enseignants des divers
niveaux dont le nombre dépasse largement 100 000.
Les conséquences de ce changement peuvent être analysées de
diverses façons. En premier lieu, la persistance de nombreux
liens de solidarité crée des effets informels de répartition car
chaque salaire fixe fait vivre entre 5 et 10 personnes. Les
multiplications d’emplois peu productifs ont sans doute
largement contribué à éviter des catastrophes sociales, tant
dans les campagnes défavorisées que dans les grandes villes. A
cette multiplication des emplois du secteur public, il faut
également rattacher la création de nouvelles provinces et
préfectures qui passent de 15 à 47 en une vingtaine d’années.
Par ailleurs, même si tous ces agents de l’Etat ne sont pas des
fidèles inconditionnels de la monarchie, peu affirment des
opinions d’opposants actifs. L’encadrement de la population
est assuré et la présence mieux répartie des fonctionnaires peut
créer un effet stabilisateur, ne serait-ce que par l’amélioration
des services publics au niveau local.
La réforme communale de 1976 a créé une situation nouvelle
par rapport aux années 1960[13]. Le contrôle de l’administration
locale et communale a réellement été transféré aux élus qui,
dans certains cas, gèrent des budgets et des personnels
considérables. Cette expérience de décentralisation constitue
un facteur positif d’autant plus marqué qu’il contribue à relier
le niveau de décision local au niveau national par d’autres
circuits que ceux de l’administration. Il prend tout son sens
dans le pluralisme de la majorité actuellement représentée au
gouvernement et dans le consensus politique qui lie cette
majorité à l’opposition dans l’affaire saharienne. Le domaine
local est justement, dans cette perspective, ressenti comme un
secteur où l’union doit aussi se réaliser. Hassan II insiste
régulièrement sur ce point dans ses interventions, appelant à
un développement des responsabilités des élus, et à leur
autonomie face à l’administration.
Etant donné la place prépondérante prise par l’Etat dans le
développement économique local, les sujets de concertation ne
manquent pas entre l’administration et les élus. Une certaine
complicité s’établit, aussi bien avec les élus de la majorité
qu’avec ceux de l’opposition, l’objectif commun est de trouver
le meilleur moyen de favoriser la réalisation des projets
reconnus d’intérêt local. L’administration provinciale a
compris qu’elle pouvait, dans certains cas, faire avancer plus
facilement un dossier à Rabat en en confiant la défense aux
élus qu’en s’adressant à sa propre hiérarchie. Elle ne pousse pas
encore ce raisonnement jusqu’à leur laisser le mérite de la
réussite des projets aux yeux de leurs électeurs.
De même, l’administration provinciale et les élus ont compris à
la perfection qu’un échange croisé de services et de
subventions pouvait leur permettre d’obtenir ce que
l’administration centrale leur refusait. Le système fonctionne
bien pour les véhicules et les fournitures; il n’est pas loin de
s’étendre aux indemnités et aux frais de représentation. En
retour, il arrive qu’un président du conseil municipal de
l’opposition soit logé dans une villa des Domaines occupée
précédemment par un agent d’autorité. Certes, cet ensemble de
relations de complicité s’établit au détriment d’une image
jacobine des administrations centrales. De nombreux agents à
la compétence verbeuse sont perçus comme des parasites par
les populations qu’ils doivent administrer. Certains n’hésitent
pas à profiter de leurs situations pour spéculer sur les terrains à
bâtir; d’autres attendent simplement leur prochaine mutation
en passant plus de temps au café avec leurs collègues que dans
leurs bureaux, créant un embryon de société provinciale, qui
rappelle la Russie du siècle dernier. Chaque petite ville érigée
en chef-lieu de province voit s’installer autour du gouverneur
une centaine d’agents accompagnés de leur famille qui recréent
les mesquineries et les rivalités de l’univers administratif de
Rabat.
Cette extension des recrutements, qui s’était accompagnée
d’une certaine augmentation des salaires longtemps bloqués,
devrait cesser totalement si le Maroc suit les recommandations
des organismes financiers internationaux. Les effets sur
l’emploi des diplômés se feront rapidement sentir dans la
mesure où l’administration constitue aujourd’hui le débouché
essentiel d’un ensemble d’écoles et de facultés qui ont
également connu, depuis 1973, un accroissement considérable.
Pour ne pas avoir à imposer une sélection à caractère
éliminatoire à l’entrée du supérieur, le gouvernement marocain
a alors ouvert largement l’université aux diplômés de
l’enseignement secondaire. Le nombre de bacheliers dépasse 40
000 par an, et celui des candidats 70 000. Des universités ont
été créées à Fès, Oujda, Marrakech et Tétouan pour éviter une
trop grande concentration à Rabat et Casablanca.
Les étudiants ont tous bénéficié de bourses, aussi bien dans leur
pays qu’à l’étranger, avec de multiples interventions auprès des
universités françaises pour accepter les plus larges quotas
possibles.
Aujourd’hui, ces masses d’étudiants engrangés par le système
universitaire dans les années 1975-1980 arrivent en fin
d’études à un moment où le recrutement public se ferme. Le
secteur privé ne pourra en absorber qu’un tout petit nombre,
les diplômés marocains ne connaissent pas encore les chemins
de l’Arabie et du Golfe comme leurs collègues égyptiens. Leur
connaissance insuffisante de l’arabe classique, et de l’anglais,
constitue un handicap certain. Leur français approximatif leur
est d’un faible recours. L’enseignement réduit ses recrutements
à la relève des coopérants. L’armée n’est guère favorable aux
recrutements des diplômés ; elle conserve jalousement ses
propres filières. Si le système éducatif doit connaître une
certaine récession, les conséquences politiques et économiques
en sont difficilement mesurables. L’enseignement supérieur fait
partie des domaines où les cadres de l’opposition ont trouvé un
refuge largement toléré. La remise en cause de leur domination
du secteur universitaire pourrait constituer une rupture du jeu
politique limité aux élites dont la monarchie ne souhaite pas
sortir.
Le contrôle du champ religieux[14]
L’arrivée sans espoir sur le marché du travail de diplômés mal
formés réduits au chômage peut procurer aux mouvements
islamiques, à l’exemple du Moyen Orient, une clientèle
déterminée parce que sans illusions et sans espoir. Jusqu’alors,
ces organisations n’ont pas réellement constitué une menace
pour le pouvoir marocain. De tout temps, la monarchie a veillé
à conserver le contrôle du champ religieux. Si, en tant que
prince héritier. Hassan II avait semblé prendre quelque distance
avec l’Islam, dès son accession au trône, l’habit, le discours et la
pratique officielle sont ceux du Commandeur des Croyants.
Commentant la chute du shah d’Iran en 1980, il estime que
celui-ci a commis l’erreur de vouloir être le premier empereur
laïque d’un pays où l’Islam est organisé en clergé. « Le shah a
voulu gouverner avec le glaive, mais sans et même contre le
goupillon… si le shah avait accepté de ne pas jouer
exclusivement la carte de la laïcité, les imams, dans leur quasi-
totalité, l’auraient suivi.[15] »
Il est clair qu’Hassan II n’aurait jamais commis une telle bévue.
Depuis l’indépendance, la monarchie marocaine a su se servir
de l’Islam pour dominer le champ politique. L’interdiction, en
1960, du Parti communiste marocain par la cour d’appel de
Rabat constitue un avertissement pour tous les partis dont la
doctrine pourrait présenter une similitude avec celle du PCM.
Cet arrêt fournit également un précédent juridique d’une
importance politique considérable sur l’étendue du pouvoir du
souverain en tant que chef religieux. Aucun texte, fût-il
constitutionnel, aucune autre autorité ou corps élu ne peut, en
ce domaine, s’opposer au souverain. Comme le nationalisme,
l’Islam contribue donc à verrouiller le champ politique en
assurant le contrôle idéologique en dernier recours par la
monarchie. Sans attendre les événements d’Iran, le souverain a
organisé de longue date des relais et des intermédiaires en
animant et en réorganisant les conseils d’oulémas.
Au niveau provincial, ces derniers jouent le rôle d’assistants des
gouverneurs pour définir l’orthodoxie, veiller à la conformité
des prônes et autoriser la construction des mosquées, même
privées. De nouveaux caïds, formés à l’école de Kenitra à la
suite de concours organisés parmi les anciens élèves des
facultés de Sharia, s’occuperont, dans chaque province et au
ministère de l’Intérieur, de réglementer les affaires religieuses.
Le souverain envisage même d’ouvrir de nouveaux débouchés
aux diplômés des facultés religieuses en les envoyant prêcher
en Afrique noire et ramener à la pratique de l’Islam orthodoxe
les immigrés marocains en Europe, qui semblent
dangereusement travaillés par les mouvements islamiques.
Les mesures décidées au lendemain des émeutes de janvier
1984 montrent que le pouvoir entend occuper le champ
religieux dans sa totalité, en l’associant si besoin au thème
national de la récupération du Sahara présentée comme un
Jihad entrepris contre une Algérie laïcisée et inféodée à
Moscou. La présidence du comité « Al Qods » assurée par le
Maroc depuis 1979 à la demande de la conférence des Etats
islamiques constitue également une reconnaissance
internationale du rôle du roi comme leader de la communauté
musulmane. Les bénéfices tirés de ce rôle sont clairs dans le
domaine intérieur. A l’extérieur, le roi peut espérer obtenir des
Etats islamiques producteurs de pétrole une aide tant militaire
qu’économique.
Malgré toutes ses précautions et ses avantages sur les autres
responsables des pays musulmans, la monarchie marocaine ne
contrôle pas la totalité du champ religieux. Un ensemble plus
ou moins spontané d’associations, de prédicateurs autonomes
et d’agitateurs sociaux s’y rencontrent avec l’espoir d’exploiter
toute faille entre le pouvoir et les masses. Des confréries
nouvelles recrutent des adeptes, particulièrement dans les
milieux urbains défavorisés. Dans les prônes, la critique sociale
et politique est fréquente, ne ménageant pas toujours le
souverain. L’adversaire religieux le plus marqué du souverain
est sans doute Yassine, directeur de la revue Al Jamaa.
Idéologue de formation moderne rappelant par certains côtés
Sayyed Qubt, Yassine n’appartient cependant à aucun
groupement et limite son opposition à une propagande
intellectuelle. Bien qu’il soit périodiquement arrêté et
emprisonné, son opposition au roi ne ressemble en aucun cas à
l’hostilité de l’imam Khomeiny envers le shah d’Iran.
D’autres aspects de l’Islam populaire semblent mobiliser des
sentiments religieux à la limite du licite et des traditions
païennes, certains moussems donnent lieu à une sorte de
défoulement collectif organisé pour échapper aux pressions et
aux manques de la société actuelle. Ces pratiques caractérisent
des sociétés rurales ou des banlieues; le pouvoir observe et
souvent encourage, avec une inquiétude minimale.
L’Islam est donc présent de façon diffuse et contrôlée dans le
système politique marocain. Pour le moment, il ne constitue
pas une menace pour un pouvoir qui dispose en ce domaine
d’un héritage complexe de légitimité qu’il sait manier avec
habileté. Au cas où le pays connaîtrait de graves difficultés
d’ordre interne ou externe, il est certain qu’il existe, de façon
confuse, des groupements prêts à les exploiter et à les
transformer en maniant les justifications de l’idéologie
religieuse. Ils ont jusqu’alors, semble-t-il, peu de choses en
commun. Ont-ils pénétré l’armée et la police? Se contentent-ils
de se substituer au dynamisme des mouvements marxistes des
années 1970 sur les campus et dans les cités universitaires, en
utilisant des arguments qui ne sont pas toujours très différents?
Verra-t-on se développer dans la campagne un Islam de
compensation? Faute d’un marché politique ouvert, on peut
faire l’hypothèse que se reportent sur le religieux des
comportements et des revendications qui ne pourraient
s’exprimer autrement. Le pouvoir en est sans doute moins
effrayé que les partis et les syndicats à l’héritage laïque[16]. On
peut penser qu’il saura jouer de ce sentiment, comme il agite
l’épouvantail militaire; cependant, il ne faut pas exclure les
risques d’actes d’individus ou de petits groupes animés par une
idéologie islamique de refus, semblables à celui auquel
appartenait l’assassin de Sadate, ni même une mobilisation
islamique plus large en cas de carence soudaine du pouvoir.
Par ailleurs, la récupération du courant islamique par le
Makhzen reste possible. En se plaçant à sa tête, le roi
répondrait aux sollicitations de Yassine. Il pourrait pratiquer à
l’égard des dirigeants de ces mouvements la tactique subtile
d’intégration et d’usure que la monarchie a si bien menée avec
les partis et les syndicats. Autrement dit, les mouvements
islamiques pourraient-ils à leur tour être cooptés dans le jeu
politique des élites? L’hypothèse paraît encore hâtive mais ne
saurait être exclue.
Pouvoir royal et nouveau Makhzen
Au cœur du système politique marocain se trouve un homme
seul, le roi, héritier d’un mode de gouvernement constitué par
les dynasties marocaines au cours des siècles, le Makhzen[17].
Certes, le roi est également, selon la Constitution, chef des
armées, titulaire d’une large part du pouvoir réglementaire et,
pendant les nombreuses vacances ou renvois du Parlement, du
pouvoir législatif et bien entendu du pouvoir religieux en tant
que Commandeur des Croyants. De ce fait, les modes
d’exercice du pouvoir royal appartiennent tantôt à la tradition
marocaine, tantôt au registre politique de l’Etat-nation
constitué par le protectorat et largement réapproprié au
lendemain de l’indépendance. On aurait pu penser que la part
d’héritage de l’Etat-nation allait, avec sa logique propre,
structurer l’ensemble. Avec le recul d’une vingtaine d’années
d’exercice du pouvoir par Hassan H, l’héritage du Makhzen
semble constituer un mode parallèle de fonctionnement du
gouvernement, une sorte de « sotto governo », contrôlant,
suppléant ou paralysant les mécanismes officiels. Makhzen et
Etat-nation peuvent encore être considérés comme les deux
pôles entre lesquels oscille le pouvoir. Suspecté de laïcité
implicite, l’Etat moderne a besoin du Makhzen pour surmonter
la montée des périls et retrouver une légitimité associée à une
représentation de l’Islam.
L’analyse du système makhzénien est délicate, elle doit
dépasser les apparences, même si celles-ci comptent
grandement comme dans toute « société de cour »[18]. A
première vue, la continuité est frappante dans le quotidien
même de la vie du roi. Comme au XIXe siècle, son entrée
chaque lieu public est annoncée par une escouade de serviteurs
affairés, vêtus de la gandoura blanche et du tarbouch rouge,
appelant dans une sorte de mélopée grégorienne la bénédiction
de Dieu sur le souverain. Si les corporations du palais n ont
plus la même importance qu’autrefois, les chambellans jouent
un rôle beaucoup plus complexe que celui de simples
organisateurs du protocole ou de la vie quotidienne du roi. Les
serviteurs du palais sont recrutés parmi toutes les tribus,
suivant des réseaux complexes de recommandations. Il est
toujours possible de faire passer par leur intermédiaire une
intervention, une plainte ou un vœu. Comme au XIXe siècle,
le bureau des requêtes est extrêmement actif, et les citoyens ont
compris depuis longtemps qu’il valait mieux s’addresser au
Makhzen pour exposer ses doléances que d’intenter un recours
pour excès de pouvoir. L’institution fonctionne donc comme
une sorte d’ombudsman et l’on a vu des ministres, mis en
cause personnellement par cette voie, avoir à justifier et
souvent à rectifier leurs décisions.
Tant les horaires que la vie quotidienne ou privée du souverain
sont organisés et gérés suivant les traditions du Makhzen par
des hommes qui n’ont pour raison d’être que le dévouement
absolu à sa personne. Les tensions avec les responsables de
l’appareil d’Etat qui obéissent à une rationalité différente, sont
inévitables. Ces tensions semblent parfois érigées en système de
gouvernement par Hassan H. Au-delà des apparences, son
Makhzen actuel ressemble autant à celui d’Hassan 1er que
l’architecture néo-chérifienne, qui a ses faveurs, à celles de ses
ancêtres du XIXe siècle. Sans que l’on soit en face d’une
« société de cour » extrêmement régulée comparable à celle du
XVIIe siècle français, il semble bien que le Makhzen constitue
un système de conflits contrôlés par le roi pour rester maître de
la mobilité sociale dans un ensemble en voie de transformation
très rapide. Nous avons vu précédemment comment le roi était
au cœur de chacun des champs ou secteurs de la vie sociale du
pays, qu’il s’agisse du champ religieux, du champ politique, du
champ économique, du champ de la violence légale. S’il est
devenu le premier entrepreneur et le premier propriétaire
foncier, c’est aussi, au-delà du simple désir d’accumulation, le
souci de ne laisser à aucun autre une situation de prestige et
d’influence. Dominant tous les champs de l’univers social, il
est particulièrement attentif à la régulation de leur système de
communication pour éviter qu’une coalition ne puisse se
former contre lui. C’est pourquoi le Makhzen est avant tout un
gouvernement des hommes, laissant le plus souvent
l’administration des choses à la technostructure.
Cette situation explique pourquoi le roi se montre attentif à la
constitution de toute situation de pouvoir, que ce soit dans
l’administration, l’armée, ou le secteur privé. La
communication entre les divers secteurs ne peut se faire que
par son intermédiaire. Les clans, les réseaux sociaux et
familiaux doivent donc être l’objet d’une vigilance souple qui
n’a rien à voir avec les pratiques habituelles d’un système
bureaucratique mais qui fait partie de l’héritage implicite du
Makhzen Gérant un ensemble de ressources considérable, le roi
est en mesure de régler la mobilité sociale des individus et des
familles en fonction du dévouement qu’elles témoignent à sa
personne. Pour exercer ce rôle de « boîte noire » du système
politique marocain, le souverain a besoin d’être informé de
tout ce qui se passe autour de lui, et plus particulièrement dans
les secteurs de la bureaucratie moderne qu’il ne contrôle
qu’indirectement. D’où l’importance de ces réseaux informels
d’individus, de familles qui couvrent tout le pays. Les religieux,
oulémas, chorfas, chefs de confréries, jouent un rôle de premier
plan dans ces circuits d’échanges où le Makhzen troque des
informations contre de la considération et quelques
interventions. Le côté prudent, conservateur et parfois passif
qui s’est emparé d’Hassan II, lorsqu’il a succédé à Mohamed V,
a eu pour effet d’accroître autour de lui ces tensions, ces
informations contradictoires, ces efforts pour l’influencer qui
lui permettent d’avoir une vue d’ensemble des situations et
d’exercer au moindre coût pour lui-même une action de
régulation.
Ce comportement contraste vivement avec le côté dynamique,
réformateur et activiste qui le caractérisait lorsque, prince
héritier, il poussait son père, non sans heurts parfois, à prendre
la direction des affaires. Depuis lors, le roi a repris la tradition
alaouite de gouvernement à l’économie, dosant les marques de
faveur ou d’ostracisme, utilisant les invitations et les fêtes pour
faire monter ou descendre la cote d’un individu aux yeux de
tous. La classe politique s’est admirablement prêtée à ce jeu
subtil et il est symbolique que le premier complot ait eu lieu à
l’occasion d’un anniversaire du roi qui réunissait à Skhirat aussi
bien Allai El Fassi que le Dr. Messouak[19]. L’occasion était certes
choisie pour des raisons techniques, mais il était trop tentant
pour les révoltés de s’en prendre au système de complicités qui
réunissait autour du roi tous les acteurs du système social et
politique.
La gestion de ce système qui étend ses ramifications à
l’ensemble du corps social ne peut reposer sur une seule
personne, mais la délégation de ce pouvoir est redoutable. On
peut, à certains égards, considérer que des militaires comme
Medboh, Oufkir, Dlimi ont tous trois fait partie du cercle
restreint de ceux qui informaient le roi, disposaient de son
autorité et en ont profité pour menacer son pouvoir et sa
personne. Aujourd’hui, la centralisation des informations
militaires est assurée par le général Moulay Hafid, cousin du roi
qui ne lui fera sans doute pas courir le même genre de risque.
Les membres du cabinet royal sont, à des titres divers, les
gérants privilégiés de ce type de relations. Parmi eux, Ahmed
Reda Guedira est familier du roi depuis sa jeunesse. Ancien
directeur du cabinet du prince héritier, puis du cabinet royal, il
a été le Premier ministre de fait de la première expérience de
démocratisation en 1962-1963. Son rôle est aujourd’hui plus
marquant en politique étrangère mais on l’imagine mal se
désintéressant des projets de démocratisation et des nouvelles
tentatives de constitution d’un parti monarchiste. Juriste de
formation, il croit aux textes, à un certain formalisme, tout en
sachant se plier aux subtilités du système makhzenien. Un
autre juriste, M’hamed Bahanini, ancien précepteur des
princes, a été longtemps secrétaire général du gouvernement. Il
est, en quelque sorte, la mémoire personnifiée du système
administratif et politique marocain, connaissant aussi bien les
textes que les personnes.
Quelques ministres peuvent, à des titres divers, être considérés
des membres à part entière du Makhzen restreint, du « carré »
du roi qui le suit dans ses déplacements à Fès ou à Marrakech,
partage ses habitudes de travail et de vie nocturne. Le Premier
ministre Karim Lamrani fait incontestablement partie de ce
groupe; ses fonctions de responsable de l’OCP, son importance
comme homme d’affaires, ses liens personnels avec le roi
renforcent en quelque sorte sa surface d’homme public. Le
ministre de l’intérieur Driss Basri fait aussi partie de ceux qui
ont un accès facile au roi, étant donné l’intérêt que ce dernier a
toujours porté aux problèmes de sécurité. D’autres personnages
font partie de longue date des familiers avec plus ou moins
d’importance. D’autres ne font que passer dans l’entourage
quelques mois ou quelques aimées et en repartent plus ou
moins remplis d’amertume.
Il faudrait distinguer, dans le cercle des familiers, plutôt que
dans celui des ministres, un cousin du roi, Moulay Ahmed
Alaoui, ministre d’Etat, ancien ministre de l’information et
surtout directeur des principaux journaux marocains de langue
française Le Matin du Sahara et Maroc-Soir dont les éditoriaux
donnent le ton des réflexions officielles destinées aux cadres du
pays et aux observateurs étrangers.
La distance est souvent plus marquée à l’égard des ministres
techniciens et des responsables des grands services publics.
Depuis plusieurs années, le roi réunit peu le Conseil des
ministres, rencontre rarement les ministres techniques et
donne l’impression de vouloir laisser agir les responsables
bureaucratiques aussi longtemps qu’ils ne déclenchent pas de
conflits et sont assez habiles pour ne pas trop faire parler d’eux
sans pour autant se faire oublier des media.
Les horaires et les méthodes de travail du roi le tiennent de
plus en plus éloigné du quotidien bureaucratique à un moment
où le système donne l’impression d’une concentration
croissante du pouvoir de décision. C’est pourquoi, peu
soucieux de courir des dangers inutiles, les responsables
administratifs sont souvent démobilisés ou risquent de
commettre des erreurs techniques d’appréciation (hausse
inattendue du prix du butane ou modification des règles de
fonctionnement du système scolaire) comme celles qui ont
entraîné les émeutes de janvier dernier. Il se peut aussi qu’après
plus de vingt ans, le caractère répétitif et insoluble des
problèmes économiques et sociaux marocains entraîne chez le
souverain une réaction de lassitude et le désir de voir la
bureaucratie assumer ses responsabilités, quitte à la désavouer
si les choses tournent mal. En revanche, en politique
extérieure, l’intérêt est toujours vif et renouvelé. L’association
avec Guedira fonctionne bien, et le roi a l’impression de
pouvoir retrouver là une mobilité et des ressources de prestige
ou des moyens matériels, alors que la politique intérieure ne lui
apporte qu’inquiétude et déceptions. On en vient à penser que
son rôle en politique extérieure dans la défense de l’identité du
Maroc, dans l’affirmation de sa présence à l’échelle du monde
arabe, lui permet de trouver des ressources symboliques et
financières susceptibles de dépasser les blocages internes.
Par ailleurs, le fonctionnement du Makhzen, le maintien sous
tension du champ politique et social, impose aussi au
souverain des contraintes personnelles qui, avec le temps,
peuvent lui paraître plus pénibles. Il préférera s’en affranchir en
consacrant une partie non négligeable de son temps à parler
avec ses architectes et ses décorateurs qui construisent et
agrandissent les nombreux palais qui lui permettent à Fès, à
Marrakech, à Tanger, à Ifrane et quelques autres lieux,
d’échapper aux contraintes bureaucratiques de Rabat. Son rôle
d’agriculteur et d’entrepreneur retient aussi une partie non
négligeable de son temps. Enfin, le maintien de sa forme
physique par le sport, et notamment le golf, fait aussi partie de
l’indispensable. Partant de là, avec un horaire de travail
régulièrement décalé vers la nuit, le temps consacré à faire
fonctionner la « boîte noire » du système politique marocain
sera donc réduit à l’essentiel, c’est-à-dire à un jeu politique
limité aux élites, sans courir le risque d’une extension aux
masses ou même d’un contrôle plus étroit du fonctionnement
du système bureaucratique.
Cette sorte d’immobilisme ne va pas sans risques dans la
mesure où l’Etat-nation existe au Maroc et fonctionne dans
l’ensemble correctement si on le compare à ses voisins du
Maghreb et du Moyen-Orient. Il aurait sans doute besoin
d’impulsions supplémentaires, de cohérence et de quelques
réformes si l’on veut continuer dans la même direction. Les
critiques de ce mode de fonctionnement se rencontrent de
façon inattendue parmi les hauts fonctionnaires et les hommes
politiques qui reconnaissent cependant le caractère
indispensable de la monarchie pour préserver l’unité nationale
et maintenir l’identité du pays face à l’Algérie. Mais ils pensent
qu’une continuation des pratiques actuelles indifférentes aux
changements en profondeur du pays ne peut conduire qu’à des
catastrophes.
Les contraintes du système social
Avant de progresser dans l’analyse de l’avenir du pays et de la
monarchie, il serait utile de mieux situer les contraintes qui
pèsent sur le Maroc et de dégager quelques constantes qui
s’imposent, quelles que soient les hypothèses d’évolution ou de
changement politique que l’on peut formuler.
Le Maroc fait maintenant partie des pays qui doivent assurer
leurs fins de mois grâce à l’aide des organismes financiers
internationaux. Ses réserves de change sont inférieures à un
mois du coût de ses importations, alors qu’il doit se procurer
en moyenne annuellement entre 25 et 50 millions de quintaux
de céréales par an pour nourrir une population de plus de 23
millions d’habitants urbanisés à près de 50%.
L’approvisionnement des masses urbaines en produits
alimentaires subventionnés est aujourd’hui le problème
politique essentiel du pays. Le monde rural semble encore avoir
une certaine marge d’élasticité en termes d’auto-
consommation. Si les conditions se détériorent trop, et s’il ne
trouve pas de ressources dans les réseaux de solidarité familiale
ou d’aide étatique, le paysan pauvre émigrera et la traduction
politique de son problème de subsistance se manifestera en
ville. En revanche, en milieu urbain, la marge d’élasticité est
beaucoup plus réduite. Toute variation des coûts des ‘ produits
nécessaires à la survie des couches inférieures des masses
urbaines peut se traduire en termes de violence. Relativement
contrôlée dans les grandes villes, cette violence semble plus
difficile à prévoir et à réduire dans les villes moyennes qui ont
connu les plus forts taux d’expansion de population dans les
dix dernières années.
Or, loin de diminuer, la pression financière exercée sur le
Maroc doit s’accroître. Le pays ne peut raisonnablement
compter aujourd’hui sur l’aide extérieure pour nourrir ses
masses urbaines prolétarisées. Ses ressources propres ne vont
guère s’accroître, à moins d’un miracle sur le prix des
phosphates. Les exportations agricoles, le tourisme et les
ressources provenant de l’émigration peuvent au mieux se
maintenir, mais il serait plus raisonnable de prévoir une baisse.
Or, dans la dernière décennie, le pays a suivi une politique
financière aventureuse. Pour une large part, cette politique
peut s’expliquer par le choix de la monarchie qui s’est efforcée
de constituer alors les bases économiques et sociales d’une
classe moyenne qui puisse dissuader les militaires de tenter de
nouveaux coups d’Etat. L’expansion du secteur privé, mais
aussi le gonflement du système éducatif et de l’appareil
bureaucratique ont concouru à cette stratégie. Cette
transformation sociale rapide a été financée au départ par
l’augmentation du prix des phosphates, mais avec leur chute
dès 1975, le Maroc, qui avait jusqu’alors pratiqué une politique
financière très prudente, a considérablement augmenté son
déficit budgétaire et ses emprunts à l’extérieur, finançant
largement l’un par l’autre.
Ce faible endettement extérieur au départ, un comportement
traditionnellement prudent de ses financiers et une certaine
bienveillance des pays occidentaux lui ont permis de vivre
plusieurs années au-dessus de ses moyens. Le coût de la guerre
du Sahara a, par contre, contribué à dégrader la situation. Les
perspectives sont très sombres. Quels que soient les remèdes
choisis, leur coût social et politique sera douloureux. Le poids
de la dette extérieure est de l’ordre de 12 milliards de dollars[20].
Le service de la dette est de l’ordre de 2 milliards de dollars par
an, et le déficit budgétaire qui se situait entre 12 et 14% du PIB
en 1982 se rapproche de 8% grâce à une politique de
stabilisation poursuivie avec un succès relatif. Pour financer ces
déficits, le Trésor a absorbé plus de 40% des crédits du système
bancaire marocain, et plus de 70% des encours du crédit total,
y compris l’aide extérieure. Lorsque le gouvernement marocain
a demandé un rééchelonnement de sa dette extérieure au club
de Paris, il a dû prendre l’engagement de réduire
considérablement son déficit et de dégager progressivement
une épargne publique. A ce prix, il pourra recevoir l’aide
minimale qui lui permettra de payer le service de sa dette,
importer les céréales et le pétrole dont il a besoin[21]. En
contrepartie, il devra réduire ses dépenses en bloquant ses
investissements et en arrêtant de recruter des fonctionnaires. Il
devrait aussi réaménager le système fiscal et instituer une taxe à
la valeur ajoutée et un impôt général sur le revenu. S’il ne peut
toucher pour le moment aux dépenses militaires, il lui faut
réduire d’autres grands secteurs de dépenses, comme
l’éducation et les subventions aux produits de première
nécessité (la caisse de compensation va coûter 4 milliards de
dollars au budget de l’Etat en 1984). Globalement, il faut
aboutir à une réduction de la consommation qui ne peut se
faire que par une baisse des salaires réels.
Il faut ajouter à ce sombre bilan des perspectives d’évolution
peu encourageantes pour l’industrie marocaine. Ses coûts de
production sont trop élevés, même avec des coûts salariaux très
bas, à l’exception des secteurs du vêtement et du cuir. Dans un
contexte d’ouverture et de concurrence, la plupart des
productions actuelles sont condamnées lorsqu’elles seront en
compétition avec une production automatisée. Les opérations
de montage de véhicules, comme de nombreuses opérations de
substitution d’importations entreprises dans les années 1970,
sont de ce fait placées dans une situation de précarité. Seuls les
phosphates ont la taille et les moyens d’organiser une
production robotisée. Ce processus y est déjà largement engagé
avec, comme conséquence, le recrutement d’un personnel
ouvrier titulaire du baccalauréat.
L’émigration vers l’Europe est également bloquée. Celle qui
pourrait se dessiner vers les pays arabes est encore hésitante,
même si l’on peut estimer que le récent accord d’unité signé
avec la Libye devrait ouvrir des perspectives intéressantes, mais
hasardeuses.
Seule l’agriculture offre à moyen terme des perspectives
encourageantes. Mais avec des investissements limités, il vaut
peut-être mieux favoriser les zones de culture en sec qui sont
susceptibles d’améliorer la production de céréales si la
pluviométrie est un peu plus favorable. Un effort en faveur de
ces zones évitera également de voir leur population déferler
vers les villes. On peut envisager également d’accentuer la
production céréalière dans les périmètres irrigués. Le Maroc a
conservé la meilleure agriculture du Maghreb. Dans
l’immédiat, elle devra surmonter les difficultés que cause
l’arrivée de l’Espagne et du Portugal dans le Marché commun à
certaines de ses exportations. A long terme, sa marge d’action
pour nourrir sa population et exporter vers son environnement
immédiat reste considérable, au prix sans doute d’une
diminution de l’emprise de l’Etat et d’un réaménagement
modéré des structures foncières et de la fiscalité rurale.
Autre donnée constante essentielle de la situation marocaine:
la population. Sans son accroissement, le Maroc aurait pu
couvrir ses besoins en produits alimentaires. Comme en 1960,
la prise de conscience du problème lors de la publication des
premiers résultats du recensement de 1982 a entraîné une
réaction d’inquiétude et de découragement. Le premier réflexe
a été de fausser les résultats; c’est pourquoi il semble
raisonnable de réviser les chiffres officiels de la population
globale, qui doivent se situer entre 23 et 24 millions au lieu de
20,4, la population de Casablanca dépassant par ailleurs 2
millions et demi. De toute façon, les projections actuelles
laissent prévoir un nouvel accroissement important de la
population urbaine dans la décennie à venir. Le chiffre de 50%
de population urbaine devrait être atteint avant 1990. Ce
dynamisme démographique ne présente pas que des aspects
inquiétants. Certes, l’examen des statistiques alimente
naturellement une réflexion sur l’absence d’avenir de la
jeunesse et la croissance d’une pathologie sociale dont
l’importance n’a rien de comparable avec celle que l’on
rencontre en Amérique du Sud. L’observation de la rue
conduirait à l’inverse à souligner un point positif qui peut
influencer l’avenir politique du pays.
Il semble en effet intéressant de retenir parmi les constantes un
élément qualitatif difficilement appréciable: le développement
de la classe moyenne et la qualité de vie quotidienne dont
celle-ci jouit au Maroc. Cette appréciation est pour beaucoup
fondée sur des impondérables et sur des comparaisons avec
d’autres pays arabes. Une certaine impression d’hédonisme se
dégage de la ville marocaine moderne. La jeunesse ne semble
pas, dans la ville et sur les plages, souffrir d’une trop grande
séparation des sexes. Le sport et le culte du corps de l’homme
ou de la femme (une Marocaine a obtenu une médaille d’or
aux Jeux Olympiques de Los Angeles, et Casablanca en déborde
de joie populaire) sont devenus des aspects courants de la vie
quotidienne, peu coutumiers dans les pays arabes, mis à part la
Tunisie et le Liban avant la guerre civile.
Une culture populaire de type méditerranéen, faite de plage, de
pique-nique, de jeux de boules, de tiercé, de brochettes et
d’ambiance familiale chaleureuse réunissant plusieurs
générations, a trouvé sa place. Les coiffeurs pour dames et les
boutiques de vêtements et de chaussures fabriqués localement
avec un goût certain se sont multipliés. La rue en est
transformée. Les librairies offrent également une profusion
d’ouvrages techniques ou culturels en français, en arabe ou en
anglais. Les ciné-clubs, les cours de langues étrangères sont
remplis d’un public jeune qui recherche l’ouverture sur
l’extérieur, même s’il a peu d’espoirs de pouvoir connaître les
pays dont il rêve. La musique, la chanson, les nouvelles revues
ou brochures paraissant en arabe témoignent d’un marché
culturel de qualité, ouvert sur l’Orient et sur le monde
moderne, échappant assez largement au contrôle et aux
directives du pouvoir. Parmi ces facteurs peu mesurables qui
contribuent à faire du Maroc un pays d’une qualité de vie rare
pour la classe moyenne, il faudrait ajouter la qualité des
services publics et la beauté des villes qui, malgré la croissance
de la population, n’ont pas subi la dégradation généralisée des
grandes métropoles africaines comme Le Caire ou Alger. Tous
ces facteurs impalpables font partie des données qu’il faut
intégrer lorsqu’on tente d’évaluer quelle peut être l’évolution
politique du Maroc en face des contraintes économiques et
financières dégagées plus haut, qui pèsent aussi en premier lieu
sur la classe moyenne.
Il reste vrai que les difficultés nouvelles du Maroc ne font que
commencer, et les solutions envisageables ne sont pas
facilement acceptables par le système politique et social.
Hypothèse d’évolution
On doit tout d’abord s’interroger sur une solution répudiant les
contraintes analysées plus haut. Elle ne pourrait se réaliser
qu’au prix d’un renoncement à beaucoup d’acquis,
principalement ceux dont bénéficie la classe moyenne. On
devrait envisager aussi bien le rationnement du pain que celui
de l’essence, sans pour autant pouvoir mieux développer
l’appareil industriel. Un cocktail très subtil d’idéologie
associant l’Islam au nationalisme et surtout un appareil
politique de type totalitaire pourraient seuls faire admettre de
telles contraintes. Le Maroc ne semble pas mûr pour des
solutions politiques qui ramèneraient ce pays au niveau de la
Guinée de Sékou Touré. Cette hypothèse étant écartée, il reste à
voir les solutions possibles et à tenter d’évaluer les tensions
qu’elles peuvent entraîner.
Persistance d’un jeu makhzenien
Une première hypothèse peut être fondée sur la continuité du
système actuel. Hassan II n’a très certainement aucune envie de
changer sa pratique politique ni de sortir de son carrousel des
élites. Cela supposerait qu’il puisse trouver à l’extérieur assez de
ressources pour éviter l’application des remèdes de la Banque
mondiale et du FMI.
Deux éléments indiquent qu’il tente de trouver une solution
dans ‘ cette direction. Le premier est la participation, en mai
1984, de responsables israéliens au congrès annuel des
communautés juives du Maroc dont le secrétaire général est
David Amar, responsable de l’Omnium Nord-africain. Ce geste
significatif a été repris en compte par le roi dans un discours
prononcé à l’occasion de la journée Al Qods (Jérusalem). Les
réactions de la population, de la gauche et de l’Istiqlal, ont été,
comme on pouvait s’y attendre, réservées. Le roi prend le
risque d’être mal compris dans un domaine où les précédents
du shah et surtout de Sadate ne peuvent manquer de lui venir à
l’esprit. On peut donc faire l’hypothèse qu’il voit là l’occasion
de se poser en intermédiaire entre Israël et les Arabes. En cas de
réussite, il espère obtenir des Etats-Unis et des milieux
financiers internationaux les moyens de continuer à faire
fonctionner son système de gouvernement en en reportant le
coût sur l’aide extérieure. Une telle démarche s’apparenterait à
la fuite en avant de Sadate faisant le voyage de Jérusalem après
les émeutes de janvier 1977.
L’union avec la Libye — qui comporte des enjeux plus
complexes encore — semble être une opération aventureuse de
même type. En premier lieu, le lâchage du Polisario peut aider
les Marocains, mais sans résultat définitif tant que l’Algérie
soutient le mouvement[22]. L’opération peut néanmoins, en
faisant pression sur l’Algérie, aider à un processus de
désengagement marocain qui permettrait une réduction des
dépenses militaires et une remise en question du poids de
l’armée. Par ailleurs, même si Khadafi n’a plus les ressources
abondantes dont il disposait il y a une dizaine d’années, sa
trésorerie soulagerait avec une certaine facilité celle du Maroc
dans le paiement de ses importations vitales de blé et de
pétrole. Enfin, les travailleurs marocains pourraient trouver en
Libye des débouchés qui n’existent plus en Europe. Mais
l’expérience arabe d’Hassan II est trop grande pour qu’il ne
soupèse pas les humeurs fantasques de son partenaire et la
sourde colère qui ne manquera pas de saisir les Algériens, sans
compter un certain agacement du côté des Etats-Unis si le flirt
avec Khadafi dure trop longtemps[23].
Mais ces deux tentatives risquées sont assez contradictoires
pour se gêner l’une l’autre. Cela porterait à croire, dans chaque
cas, à une bonne dose d’improvisation dont il ne faudrait
retenir que la volonté fébrile de gagner du temps et d’échapper
au piège de la rigueur. Car il apparaît bien que le programme
d’aide financière défini par les organismes internationaux après
de longues missions et consultations avec les autorités
marocaines ne peut se réaliser sans changement politique. Bien
entendu, ce thème n’a jamais été abordé, mais la démarche est
implicite. Au lendemain des complots, le roi a pu faire
l’impasse d’une démocratisation qui s’imposait pour contrer les
tentatives militaires futures, en relançant l’économie avec les
bénéfices tirés des phosphates, puis en s’endettant. La classe
moyenne a été la principale bénéficiaire de cette politique par
la multiplication des emplois, l’ouverture de perspectives
d’enrichissement, un système éducatif sans contraintes
sélectives et des services publics fonctionnant normalement.
Démocratisation et technostructure
Au moment où la faillite économique se précise, dont la
conséquence sera une baisse des salaires réels et du niveau de
vie de la classe moyenne, une libéralisation du politique aidera
à faire admettre ces contraintes en créant un nouveau
consensus. On se placera alors dans le cadre d’un autre jeu
politique qui, pour être efficace, aura besoin de fonctionner
avec des organisations représentant la classe moyenne et les
masses dont il faudra réduire la consommation par un large
effort de persuasion. Cela suppose donc des partis puissants,
des élections ouvertes et une sortie en douceur mais irréversible
du système de gouvernement des élites. Les réformes
inévitables qui suivront seront douloureuses tant sur le plan
politique que sur le plan personnel si les patrimoines fonciers
et industriels du souverain sont touchés par les réformes et la
fiscalité.
Ce type de politique pourrait constituer, à quelques nuances
près, la version marocaine de l’ouverture démocratique
espagnole. Elle trouverait un appui certain dans la bureaucratie,
au sein des partis, essentiellement à gauche, et auprès des
organisations internationales. Car, en fait, ces mesures
contraignantes proposées par le FMI et la Banque mondiale ne
sont le plus souvent que la reprise et l’exploitation d’analyses
effectuées de longue date au sein de la technostructure
économique et financière du pays dont tous les experts qui ont
été à son contact reconnaissent la qualité et la lucidité. Mais il
serait suicidaire, sur le plan administratif et politique pour un
expert marocain, de tenir de tels propos. On peut imaginer
qu’ils éprouvent une jouissance discrète à les voir repris par
une autorité qui est en mesure de dire au roi ce qu’aucun
fonctionnaire ou homme politique marocain ne pourrait lui
faire entendre, même si un de ses thèmes favoris est le complot
du silence dont il se plaint régulièrement.
Dans un tel système qui ferait l’économie de changements
institutionnels majeurs, les organismes financiers
internationaux fourniraient en fait à la bureaucratie marocaine
soucieuse de réformes la base d’appui nécessaire à son action.
On peut imaginer qu’il s’agirait pour l’essentiel d’une solution
de relais en attendant que les partis et les syndicats se
renforcent à travers le suffrage universel. Etant donné les
tensions que le système politique et la société marocaine
subiraient pendant cette phase, on peut craindre une dérive
vers le parti unique qui conduirait à une élimination de la
monarchie, à des oppositions locales violentes aux politiques
décidées à Rabat et, en fin de compte, à une confiscation de
l’expérience par l’armée. Le maintien d’une économie ouverte
sur l’extérieur qui conditionne pour une large part l’aide
internationale serait une constante difficile à assurer. L’opinion
publique marocaine aurait tendance à attribuer à l’extérieur
l’origine de tous les maux, assimilant volontiers les remèdes à
l’essence même du mal sans qu’aucune force politique
nationale ne prenne sérieusement la peine de réfuter ce type de
raisonnement.
En fait, l’option démocratique ne peut se concrétiser qu’avec
une ouverture significative vers l’USFP. Mais ce parti est-il
aujourd’hui en mesure, si on lui en donne la responsabilité, de
renégocier le compromis conclu avec le FMI et la Banque
mondiale et de faire accepter à la classe moyenne les
contraintes qu’il suppose? Dépassant la négociation que ce
parti conduit avec le pouvoir sur ces problèmes, les données
d’une crise plus profonde semblent se profiler. La faillite des
modèles socialistes et la dévaluation des idéaux associés à
l’échec des expériences qui s’en sont réclamées dans les pays
arabes, atteignent les cadres et la clientèle des partis de gauche.
Si cette évolution les rendait incapables de penser des solutions
nouvelles, de faire des choix et de les expliquer, on peut
craindre à terme que le vide idéologique ne profite au courant
islamique.
Une solution démo-technocratique devrait aussi trouver
rapidement une issue à la guerre du Sahara dans la mesure où
elle aura besoin de réduire les dépenses militaires pour alléger
son programme économique et pour limiter le poids de l’armée
dans la société. Sa réussite suppose donc une bienveillance et
des concessions importantes de la part de l’Algérie, dépassant le
simple cas du Sahara espagnol et envisageant une exploitation
commune des régions sahariennes qui pourrait constituer la
base d’une unification maghrébine fondée sur des projets réels
communs, et une réintroduction politique acceptable du
Polisario dans une partie où le Maroc ne fournirait pas seul les
enjeux.
Retour à la solution prétorienne
La solution militaire serait une autre variante à certains égards
beaucoup plus classique que le triangle de force bureaucratie-
partis politiques-organisations financières internationales.
Plusieurs scénarios pourraient être imaginés pour justifier
l’entrée des militaires dans le jeu politique. Une défaite sur le
terrain est aujourd’hui peu probable, mais une négociation qui
se traduirait par une reconnaissance partielle d’un Etat saharien
qui, aux yeux des militaires, ne pourrait être que manipulé par
l’Algérie, en serait un équivalent insupportable.
Une autre justification de l’intervention militaire peut provenir
des sollicitations trop fréquentes d’un pouvoir civil débordé par
les problèmes de maintien de l’ordre procédant de l’application
du plan de rigueur. L’armée pourrait alors constituer le
substitut d’une justification démocratique du plan de rigueur.
Son intervention s’accompagnerait d’une action psychologique
de vaste envergure reprenant les thèmes de revendication des
mouvements islamiques en y ajoutant une forte dose de
nationalisme dont l’armée serait la seule à contrôler
l’authenticité. A long terme, islamisme et nationalisme recèlent
de nombreuses contradictions mais, dans l’immédiat, des
accommodements sont possibles. Cependant, le pouvoir
militaire est par essence rationnel, scientifique et laïc. Les
militaires ne peuvent accentuer la justification de leur pouvoir
par l’Islam, de crainte de se retrouver face au « Commandeur
des Croyants » ou à des idéologues religieux de type iranien qui
leur concéderaient au mieux un rôle d’auxiliaires du culte.
Un autre volet de la légitimation de l’intervention des
militaires résiderait bien entendu dans le nationalisme. La
protection de la nation marocaine, facilement identifiée dans
son armée, succéderait à celle du trône face à un pouvoir
algérien que l’on n’aurait guère de peine à décrire en termes
menaçants. Les relations des militaires avec les principes
démocratiques seraient sans doute plus ambiguës. Les
mécanismes électoraux ont été tellement discrédités par la
monarchie qu’ils n’auraient guère de risque à les rétablir. On
peut même penser qu’ils pourraient faire fonctionner en toute
régularité à leur profit le pouvoir référendaire comme
instrument de légitimation à la manière des militaires turcs[24].
L’autoritarisme et le nationalisme ne devraient déplaire ni au
monde rural, ni même à une fraction de la classe moyenne. Ils
auraient ensuite le choix entre le pluralisme contrôlé du
modèle turc et le système de parti unique de type nassérien ou
FLN. La diversité de la société marocaine supporterait mal un
cadre politique unique, et supposerait la mise en place d’un
gouvernement civil chargé des mesures techniques
impopulaires dues à la situation économique.
Dans l’hypothèse d’un gouvernement technocratique, on peut
penser que l’on réduirait le coût et le poids de l’armée dans le
système politique pour rendre moins pénible la baisse du
niveau de vie de la population urbaine et de la classe moyenne.
Dans le cas d’un pouvoir militaire, il est raisonnable d’imaginer
une solution inverse. La tension aux frontières et le
nationalisme justifieraient au moins le maintien global des
ressources attribuées actuellement à l’armée. L’unité nationale
et les besoins de la défense serviraient à imposer aux masses
urbaines des sacrifices que s’efforcerait de rendre plus
acceptable un discours socialiste égalitaire de type cour de
caserne. En dernier recours, la violence leur serait appliquée
avec une parfaite bonne conscience. Les militaires pourront
aussi essayer de trouver à l’extérieur des ressources qui
rendraient moins cruelle l’application du plan de redressement
économique. Leurs positions face à l’Algérie les amèneraient à
se tourner tout naturellement vers les Etats-Unis qui disposent
déjà de facilités militaires et de contacts anciens avec l’aviation
et la marine marocaines.
Sur le plan intérieur, l’armée chercherait des relais pour
gouverner. Il n’y a pas de raisons majeures de penser que la
technostructure marocaine lui opposerait plus de réticences
qu’elle n’en a à l’égard de la monarchie. Une fois ses ressources
assurées, l’armée a même des chances d’être un patron plus
rationnel et prévisible que le souverain. On peut estimer
également qu’une partie de la classe politique se rallierait au
pouvoir militaire pour continuer sous surveillance à jouer un
rôle dans les affaires du pays. Progressivement, l’armée pourrait
déléguer des officiers en retraite ou en disponibilité pour
participer à l’administration et à la vie politique du pays,
suivant le modèle de l’armée égyptienne. Elle y trouverait
l’avantage de permettre une mobilité plus rapide dans ses
postes de commandement et de disposer d’un système de
récompenses à l’égard des secondes ou troisièmes couches de
responsables militaires qui n’auraient pas forcément accès au
pouvoir politique. Elle introduirait ainsi des fidèles dans les
postes clés, à commencer par l’administration territoriale et les
secteurs d’ordre public où elle a une tradition ancienne de
présence.
Le point d’ancrage sur le secteur économique serait le plus
intéressant à observer. On peut penser que les militaires
occuperaient certainement avec avidité, comme en Egypte, de
nombreux postes de responsabilités dans les entreprises
publiques. Leur présence serait une façon de montrer à la classe
ouvrière et aux syndicats les limites qu’il convient de ne pas
dépasser. Certes, un problème de partage des responsabilités
avec la technostructure se poserait. Il serait imprudent de la
réduire à un rôle trop limité si l’on veut s’attacher ses services.
Dans le secteur privé, on peut, a priori, estimer que le
rapprochement se ferait avec une certaine facilité. Des contacts
sociaux et familiaux existent déjà. Quelques militaires,
généralement de haut rang, ont depuis longtemps investi dans
les affaires. La majorité s’en tient jusqu’alors aux placements
immobiliers facilités par la monarchie. Ils entreraient
facilement dans les conseils d’administration si l’occasion leur
était donnée.
Une incertitude peut subsister sur leur capacité à collaborer à
un plan de redressement élaboré en relation avec les
organismes financiers internationaux. Ce choix leur serait
imposé par les faits, leur marge de négociation se limitant aux
délais accordés. Pour les organismes internationaux, une
solution alliant la compétence bureaucratique à la légitimation
démocratique serait sans doute préférable. Mais il n’y aurait pas
d’hostilité particulière à une solution militaire aussi longtemps
que ses prélèvements sur les ressources collectives ne
mettraient pas en danger les mesures de rigueur arrêtées d’un
commun accord.
Telles sont les principales hypothèses que l’on peut faire sur
l’évolution politique du Maroc, compte tenu des contraintes et
des constantes de la situation actuelle. D’autres scénarios que
ceux présentés ici sont envisageables. L’importance de telle ou
telle variable peut changer suivant le moment ou les hommes
en cause. Une chose semble essentielle: à partir du moment où
l’on accepte, dans ses grandes lignes, l’analyse des contraintes
économiques qui pèsent sur le pays, les hypothèses présentées
paraissent à quelques nuances près les plus probables. Elles
réduisent l’importance des facteurs religieux comme réponse
possible dans la mesure où le Maroc, ne disposant pas du
moindre surplus, ne peut se permettre une révolution
islamique totale sans avoir à rationner sa population ni
compromettre sa défense devant l’Algérie.
Par rapport aux années 1960, la période actuelle se distingue
par une ouverture beaucoup plus marquée du système
politique marocain sur l’extérieur et par la montée en
puissance des problèmes économiques. Après l’indépendance,
le jeu politique se referme sur lui-même et ni les facteurs
économiques, ni les événements internationaux ne constituent
des déterminants absolus du jeu politique interne. Qu’il s’agisse
de relations avec la France et l’Espagne, de l’aide au FLN, des
problèmes des terres ou des entreprises étrangères, le Maroc
choisit un profil bas. L’événement le plus marquant a été la
guerre des frontières en 1963, mais on peut estimer que les
facteurs d’ordre interne ont largement joué dans l’initiative
marocaine. Aujourd’hui comme au début du siècle, le Maroc a
besoin d’une aide internationale, certes pour survivre, mais
aussi pour entreprendre une étape nouvelle de son intégration
dans une société urbaine et industrielle. Certaines composantes
de la société marocaine sont en mesure d’analyser les données
de la situation, d’évaluer le coût de l’aide et ses effets
traumatisants. Mais elles ne sont pas en mesure d’imposer ce
type de solution. L’évolution du système devrait permettre la
mise en place d’équipes aptes à gérer la crise, en mobilisant les
aides, en acceptant les tutelles et en imposant les sacrifices. Il
faut admettre que la communauté d’intérêts, les liens
économiques et culturels existant avec l’Europe et le monde
occidental permettraient de trouver une issue socialement
moins coûteuse que le repli sur soi, au prix d’une perte
temporaire d’autonomie économique.
Comment Hassan va-t-il résoudre le problème ? De la façon
dont il y parviendra dépend l’avenir de son régime. Il est peut-
être moins menacé à court terme qu’on peut l’imaginer en
analysant les difficultés qu’il doit surmonter. Mais la sortie de
la crise et le retour de l’armée dans ses casernes ne seront pas
aisés à négocier. Il manque à l’heure actuelle au Maroc un
« projet » économique. Si le roi ne l’inspire pas, et ne le met
pas en œuvre, il risque d’être éliminé par la coalition de la
technostructure, des militaires et des entrepreneurs modernes
industriels et agricoles. Cette coalition existe potentiellement.
Le roi en deviendra le chef ou la victime.
La marge est trop faible pour que le sentiment de survie
nationale ne l’emporte sur la tentation de l’aventure et de
l’isolement. Il est certain cependant que la tentation sera plus
grande au fur et à mesure que le plan de redressement financier
fera sentir sa rigueur. La solution comportant plus de
démocratie pour compenser la pénurie et le chômage
l’emportera-t-elle sur l’autoritarisme militaire qui s’efforcerait
de faire accepter les mêmes maux au nom de la préservation de
l’intégrité nationale? Faut-il écarter définitivement des formes
intermédiaires d’utilisation de l’Islam autoritaire pour réduire
le niveau de la consommation ?
Une solution à exclure semble la continuation durable d’un
certain pluralisme des élites cooptées par le makhzen.
Jusqu’alors, la monarchie marocaine n’a pas trop mal réussi
l’épreuve redoutable de la constitution d’un Etat-nation. Les
structures profondes du pays n’ont été bouleversées ni par la
colonisation, ni par la décolonisation. Aujourd’hui ce pays
subit, comme beaucoup d’autres, une urbanisation rapide
accompagnée par une révolution industrielle. Pour la première
fois, le traumatisme est profond et les solutions proposées, qui
restent prudentes, sont assez hésitantes. Le Maroc saura-t-il
survivre à cette épreuve sans y perdre son âme? Les ressources
du monde rural, le libéralisme des élites permettront-ils
d’inventer une culture harmonieuse qui l’aide à surmonter ses
difficultés mieux que l’Egypte, le Brésil ou l’Algérie? Le passage
des sociétés rurales à l’univers urbain, industriel, s’effectuera-t-
il partout dans la tristesse et la violence? Les solidarités
méditerranéennes permettront-elles d’inventer des Andalousies
nouvelles ? Et sans se voir réduit au rôle de la reine
d’Angleterre, Hassan II acceptera-t-il celui de Juan Carlos?
Pendant près de vingt ans, la monarchie marocaine a réussi à
freiner ou à canaliser une évolution sociale qui risquait de
dépasser le jeu qu’elle savait contrôler. Il en est résulté une
accumulation de potentiel qui n’a pas encore trouvé sa
traduction en termes de mécanismes de participation. Depuis
quelques années, les complots, la guerre du Sahara, la
sécheresse, l’émigration, les relations avec les économies
occidentales accélèrent un processus de changement dont les
facteurs les plus apparents sont le gonflement et la
prolétarisation des grands centres et des villes moyennes. Faute
d’encadrement et d’intégration des masses urbaines, les
rapports sociaux y sont gérés à l’état brut avec une alternance
d’apathie et de violence dont les retours trop fréquents
pourraient miner la légitimité du pouvoir monarchique et
donner le signal d’une coalition des privilégiés inquiets de leur
avenir.
Août 1984
Notes du chapitre
[1] Alors que les premiers résultats du recensement de
septembre 1982 montrent que près de 70% des Marocains sont
nés après l’indépendance.
[2] Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,
Paris, 1976.
[3] Waterbury (John), « La légitimation du pouvoir au
Maghreb, protestation et répression », Annuaire d’Afrique du
Nord, CNRS, Paris, 1977, p. 410-422.
[4] Leveau (Rémy), Le Fellah, op. cit.
[5] Pascon (Paul), Le Haouz de Marrakech, 2 vol., Rabat, 1980.
Etudes rondes, SMER, Rabat, 1980.
[6] Mernissi (Fatima), chapitre « Maroc » in Etudes de cas
socioculturels pour Téducation en matière de population,
UNESCO, Paris, 1981.
[7] Morocco. Economie and social development report. Banque
mondiale, Washington, octobre 1981, p. 218 et suiv.
[8] De Mas (Paolo), Marges marocaines, projet Remplod, La
Haye, 1978; Pascon (Paul), Van der Wusteen (Herman), Les Beni
Bou Frah, Rabat, 1983.
[9] Chatelus (Michel), « Le monde arabe vingt ans après, II.
De l’avant-pétrole à l’après-pétrole? Les économies des pays
arabes », Maghreb Machrek, 101, juillet-août-septembre 1983, p.
5 à 45.
[10] Waterbury (John), Le commandeur des croyants, PUF,
Paris, 1975 et suiv., et J.D., « La politique du sérail », Maghreb,
53, septembre-octobre 1972. Voir aussi Ramonet (Ignacio),
« Maroc : l’heure de tous les risques », Le Monde Diplomatique,
janvier 1984.
[11] Hermet (Guy), Aux frontières de la démocratie, PUF, Paris,
1983. Voir chapitre 3 : « Le parlementarisme comme fiction »,
p. 95 et suiv. Sehimi (Mustapha), « La prépondérance du
pouvoir royal dans la Constitution marocaine », RDP, 4, 1984,
p. 971-992.
[12] On peut noter que l’Omnium Nord-africain a
récemment pris le contrôle du réseau de distribution de la
chaine Félix Potin (Le Monde, 8 septembre 1984 et Libération, 4
octobre 1984).
[13] Baldous (André), La réforme communale au Maroc, AAN,
1977, p. 283 et suiv.
[14] Tozy (Mohamed), Champ et contrechamp politico-
religieux au Maroc, thèse, Aix-Marseille 1984, 433 p. ; Leveau
(Rémy), Réaction de l’Islam officiel au renouveau islamique au
Maroc, AAN, 1980.
[15] Sehimi (Mustapha), Citations de SM. Hassan II, SMER,
Rabat, 1981, p. 207.
[16] Le palais a su en d’autres temps encourager, comme
dans l’Egypte de Sadate, le développement des mouvements
islamiques dans les universités et les lycées pour contrer les
organisations de gauche.
Faute d’un discours idéologique crédible, la gauche est sans
doute aujourd’hui beaucoup plus vulnérable aux attaques des
islamistes qui risquent de lui dérober son image de symbole du
renouveau et de l’esprit tant aux yeux de la classe moyenne
que des masses urbaines.
[17] Aubin (Eugène), Le Maroc d’aujourd’hui, Paris, Colin,
1913, p. 172 et suiv.; Michaux-Bellaire (éd.), article
« Makhzen » in Encyclopédie islamique ; Ramonet (Ignacio),
« Maroc: l’heure de tous les risques », art. cit. Voir aussi
Waterbury (John), op. cit., p.33 et suiv. et « La légitimation du
pouvoir au Maghreb », art. cit.
[18] Elias (Norbert), La société de cour, Calmann-Lévy, Paris,
1974.
[19] Voir Sehimi (Mustapha), op. cit., p. 133.
[20] Ramonet (Ignacio), art. cit.
[21] Un second rééchelonnement devrait logiquement venir
soutenir l’effort déjà accompli par le Maroc. On peut supposer
que l’on s’oriente à moyen terme vers une politique de soutien
financier associant les organismes internationaux et les
banques commerciales dans une perspective de prise en charge
globale du redressement économique du Maroc. Il reste à savoir
comment les différentes composantes du système politique
marocain pourront accepter les conditions posées à une telle
prise en charge.
[22] Mais le coût de ce soutien, s’il veut conserver une
certaine efficacité, risque de devenir de plus en plus lourd pour
l’Algérie, du fait de la construction des murs de protection.
[23] A l’inverse, on peut se demander si, paradoxalement.
Hassan Il ne souhaite pas ainsi obtenir un soutien plus net des
Etats-Unis en traitant avec Khadafi. « Il faut savoir de temps en
temps jeter une clé à molette dans une vitrin… » (Conférence
de presse, Paris, 28 janvier 1982).
[24] Bozdemir (Mevlut), « Autoritarisme militaire et
démocratie en Turquie », Esprit, janvier 1984, p. 110 et suiv.
Annexe I
Chronologie politique sommaire
1930. Dahir berbère, soumettant les tribus berbères aux
juridictions françaises et les soustrayant aux tribunaux
coraniques. Point de départ d’une campagne d’agitation
nationaliste.
1934. Première célébration de la Fête du trône par les
nationalistes. Formation d’un « comité d’action marocaine »
présentant un plan de réformes du protectorat.
1943. Fondation du parti de l’Istiqlal.
1947. Discours du sultan à Tanger réclamant le droit pour le
Maroc d’adhérer à la Ligue arabe.
Remplacement du résident libéral Erik Labonne par le général
Juin.
1952. Le général Guillaume succède au général Juin.
Emeutes à Casablanca, interdiction de l’Istiqlal.
1953. 20 août. Mohamed V est déposé, envoyé en exil à
Madagascar, et remplacé par Ben Arafa.
1955. août. Conférence d’Aix-les-Bains entre les représentants
du gouvernement français et ceux des partis nationalistes
marocains.
16 novembre. Retour de Mohamed V au Maroc.
1er décembre. Constitution du premier gouvernement Bekkaï.
1956. 2 mars. Reconnaissance par la France de l’indépendance
du Maroc.
juillet. Intégration de l’Armée de libération dans les FAR.
août. Premier congrès de l’Istiqlal.
25 octobre. Les ministres PDI quittent le gouvernement Bekkaï.
1957. janvier. Révolte d’Abbi ou Bihi, gouverneur du Tafilalt.
octobre. Conférence de presse de Majhoubi Ahardane,
gouverneur de Rabat, annonçant la fondation du Mouvement
populaire.
1958. 16 avril. Démission du cabinet Bekkaï remplacé, le 12
mai, par un gouvernement Istiqlal homogène présidé par
Ahmed Balafrej.
15 novembre. Adoption de la Charte des libertés publiques (code
de la presse ; réglementation du droit d’association et de
réunion).
22 novembre. Démission du cabinet Balafrej remplacé, le 24
décembre, par un gouvernement présidé par Abdallah Ibrahim.
décembre 1958 — janvier 1959. Révoltes dans le Rif.
1958. janvier. Scission de l’Istiqlal.
juin. Consultation des partis sur le mode de scrutin pour les
élections communales.
septembre. Publication du dahir organisant les élections
communales au scrutin uninominal.
décembre. Inscription des électeurs sur les listes.
1960. 20 mai. Renvoi du gouvernement présidé par Abdallah
Ibrahim, remplacé le 26 mai par un gouvernement présidé par
Mohamed V, avec le prince héritier comme vice-président du
Conseil.
29 mai. Election des conseils communaux.
23 juin. Promulgation du dahir réglementant les pouvoirs des
conseils communaux.
1961. 26 février. Mort de Mohamed V. Hassan II succède à son
père et Ahmed Reda Guedira, nommé directeur général du
cabinet royal, se voit confier par délégation les pouvoirs
dévolus au Premier ministre. Il exerce en outre les fonctions de
ministre de l’Agriculture, puis de ministre de l’intérieur à la
mort de Bekkaï, le 14 avril 1961.
21 juin. Lancement de la Promotion nationale.
1962. septembre. Mesures de grâce à l’égard des anciens rebelles
du Rif (1958).
18 novembre. Proclamation d’une Constitution soumise au
référendum le 7 décembre 1962.
1963. 27 janvier. Démission des ministres Istiqlal. Le parti passe
dans l’opposition.
20 mars. Création du FDIC.
17 avril. Annonce des élections législatives par le roi.
17 mai. Scrutin pour la désignation de la Chambre des
représentants.
5 juin. Remaniement ministériel. A.R. Guedira quitte le
Ministère de l’intérieur.
16 juillet. Arrestation de 130 militants UNFP inculpés de
complot contre le régime.
28 juillet. Elections communales.
19 août. Election des Chambres de commerce.
25 août. Elections des Chambres d’agriculture.
6 octobre. Election des Assemblées provinciales.
15 octobre. Election de la Chambre des conseillers.
fin octobre. Guerres des frontières avec l’Algérie.
13 novembre. Constitution d’un nouveau gouvernement présidé
par Ahmed Bahanini.
A.R. Guerida est nommé ministre des Affaires étrangères.
1964. janvier-mars. Procès du complot de juillet 1963.
12 avril. Eclatement du FDIC et création du PSD.
1964. 15 août. A.R. Guerida démissionne du gouvernement.
14 septembre. Réunion du Parlement en session extraordinaire,
contre le gré de la majorité. Débats suspendus jusqu’en
novembre.
1965. 22-25 mars. Révoltes de Casablanca à la suite d’une
circulaire du ministre de l’Education nationale fixant une
limite d’âge pour le passage en classe de troisième. Sévère
répression.
13 avril. Le roi gracie les condamnés du complot de 1963 et
tente une politique d’union nationale.
20-23 avril. Contacts entre le roi et les chefs des principaux
partis.
7 juin. Le roi proclame l’état d’exception prévu par l’article 35
de la Constitution et renvoie le Parlement. Le cabinet Bahanini
démissionne ; il est remplacé par un gouvernement présidé par
le roi.
Annexe II
Répertoire des termes arabes et des sigles
Adel, pluriel adoul, notaire religieux.
Alem, pluriel ouléma, savant ayant étudié les sciences
islamiques.
Amghar, chef de fraction, élu par la population pour une durée
limitée.
Ben Youssef, Université islamique de Marrakech.
Bled Makhzen, partie du territoire qui reconnaissait l’autorité
temporelle du sultan, obéissait aux ordres de l’administration
et payait l’impôt.
Bled Siba, territoire en dissidence où les tribus, tout en
reconnaissant le souverain comme chef spirituel, refusaient de
se soumettre à l’autorité de ses fonctionnaires.
Cadi, juge religieux.
Caïd, fonctionnaire local représentant le sultan à la tête d’une
tribu ; depuis l’indépendance, chef de circonscription
administrative.
Chrâa, droit religieux islamique.
Cheikh, pluriel chioukh, littéralement, ancien ; dans le langage
administratif, chef de fraction nommé par le gouverneur,
subordonné au caïd et contrôlant plusieurs moqqademin.
Cherif, pluriel chorfa, descendant du prophète Mohamed (ou
supposé tel), bénéficiant d’un prestige social et religieux.
Chleuh, Berbère du Sud du Maroc.
Dahir, décision du souverain ayant force de loi.
DERRO, défense et restauration du Rif occidental ; programme
de travaux étudié par la FAO.
Difa, repas de fête.
Douar, groupement d’habitations réunissant le plus souvent des
familles qui prétendent descendre d’un ancêtre commun.
DRS, Défense et restauration des sols ; programme de travaux
— consistant le plus souvent en reboisement — confié à
l’administration des Eaux et forêts et exécuté avec l’aide de la
Promotion nationale.
FAR, Forces armées royales ; armée du Maroc indépendant.
Fassi, habitant de Fès, ou personne dont la famille est
originaire de cette ville.
FDIC, Front pour la défense des institutions constitutionnelles,
fondé en 1963 par Ahmed Reda Guedira.
Fellah, paysan traditionnel.
Fquih, maître d’école coranique.
Gouvernement khalifien, services administratifs placés sous
l’autorité du Khalifa de Tétouan et faisant pendant, pour le
protectorat espagnol, au gouvernement chérifien de Rabat.
Guich, littéralement, armée ; tribus dispensées de l’impôt et
recevant des terres pour assurer le service du sultan.
Habous, propriété affectée à une fondation religieuse.
Haouz, banlieue d’une grande ville.
Haratin, descendant d’esclaves noirs habitant le Sud du Maroc.
Istiqlal (PI), Parti de l’indépendance fondé en 1944.
Jellaba, habit long, à capuchon, porté par les ruraux.
Jemaa, assemblée locale des habitants d’un douar ou d’une
collectivité gérant une terre réputée commune.
Karaouyne, Université islamique de Fès.
Khalifa, délégué. Le Khalifa de Tétouan était le représentant du
souverain auprès de l’administration espagnole de la zone
Nord. Ce terme s’emploie aussi pour désigner un fonctionnaire
local, nommé par le ministre de l’Intérieur, adjoint du caïd ou
du pacha (khalifa de caïd ou khalifa d’arrondissement dans les
grandes villes).
Kif, canabis ou chanvre indien cultivé dans la région de
Ketama.
Makhzen, maison royale, et, par extension, tout l’appareil
d’Etat.
Marabout, saint local.
Mechouar, enceinte où se trouve le palais du roi.
Medersa, collège d’enseignement religieux.
Melk, (terres melk), terre soumise au régime de l’appropriation
privée.
Mohtasseb, personnage traditionnel chargé de veiller à la
régularité des transactions commerciales.
Mokhazenis, gardes dépendant de la Direction puis du Ministère
de l’intérieur, affectés à la garde des postes administratifs et au
maintien de l’ordre en milieu rural.
Moqqadem, pluriel moqqademin, chef de douar (ou de plusieurs
douars), auxiliaire de l’administration au contact immédiat de
la population ; nommé par le caïd sur proposition, ou pour le
moins avec le consentement de la population qu’il aide à
administrer.
Mouderess, professeur d’arabe.
Mouvement populaire (MP), parti fondé en 1959 par Majhoubi
Ahardane et le Dr Abdelkrim Khatib.
Nadip, tuteur.
Naïb, représentant.
OCP, office chérifien des phosphates, monopole d’Etat.
ONI, Office national des irrigations.
Pacha, administrateur d’une ville ayant le statut de
municipalité, nommé par le roi.
PDI, Parti démocratique de l’indépendance (à partir de 1960
PDC, Parti démocratique constitutionnel) fondé par Mohamed
Bed Hassan Ouazzani.
PIL, Parti des indépendants libéraux fondé par Rachid Mouline.
PUM, Parti de l’unité marocaine, fondé par Mekki Naciri.
Réforme nationale, Parti de la réforme nationale, fondé en zone
Nord par Abdel-Khaleq Torres.
Sadad, juge du…, juge de première instance.
Seguia, canal d’irrigation.
Souk, marché rural.
Soussi, habitant du Souss, ou émigré originaire de cette région
du Sud du Maroc.
Tertib, impôt ad valorem sur la production agricole.
UGTM, Union générale des travailleurs marocains ; syndicat
ouvrier de tendance Istiqlal fondé après la scission du parti en
1959.
UMA, Union marocaine de l’agriculture, syndicat d’exploitants
agricoles de tendance Istiqlal.
UMCIA, Union marocaine du commerce, de l’industrie et de
l’artisanat ; organisation professionnelle de tendance Istiqlal.
UMT, Union marocaine du travail ; syndicat ouvrier, rallié à
l’UNFP après la scission de l’Istiqlal, en 1959.
UNFP, Union nationale des forces populaires ; parti de gauche
né de la scission de l’Istiqlal en 1959.
USA, Union des syndicats agricoles ; syndicat d’agriculteurs de
tendance UNPF.
Zaouïa, lieu de dévotion, consacré également à l’instruction
religieuse, animé par une famille de chorfa ou de descendants
d’un saint local, respectée pour son savoir et son
comportement religieux.
Annexe III
Bibliographie
Ouvrages
Adam (André), Casablanca, Paris, CNRS, 1968, 2 volumes.
Almond (Gabriel), Powell (Birgham), Comparative politics : a
developmental approach, Boston, Little, Brown, 1966.
Apter (David E.), The politics of modernisation, Chicago, The
University of Chicago Press, 1967.
Ashford (Douglas E.), Second and third generation elites in the
Maghreb, Chicago, Bureau of Intelligence and Research, US
Department of State, 1964.
Ashford (Douglas E.), Perspectives of a Moroccan nationalist,
Totawa, Bedminster Press, 1964.
Ashford (Douglas E.), Political change in Morocco, Princeton,
Princeton University Press, 1961.
Ashford (Douglas E.), National development and local reform,
Princeton, Princeton University Press, 1967.
Ayache (Albert), Le Maroc, bilan d’une colonisation, Paris,
Editions sociales, 1964.
Beck (Carl), Mc Kechnie (Thomas), Political elites: A select
computerized bibliography, Cambridge (Mass.), The MIT Press,
1967.
Ben Barka (Mehdi), Option révolutionnaire au Maroc, Paris,
Maspero, 1966.
Bernard (Stéphane), Maroc 1943-1956, Le conflit franco-
marocain, Bruxelles, Institut de sociologie de l’Université libre
de Bruxelles, 1963, 3 volumes.
Berque (Jacques), Structures sociales du Haut-Atlas, Paris,
Presses universitaires de France, 1955.
Berque (Jacques), Le Maghreb entre deux guerres, Paris, Editions
du Seuil, 1962.
Bidwell (Robin), Morocco under colonial rule, French
administration of tribal areas 1912-1958, Londres, F. Cass,
1973.
Bottomore (T.B.), Elite and society, Baltimore, Penguin Books,
1964.
Bourrely (Michel), Manuel du droit public marocain, Paris,
Editions Médicis, 1965. 2 volumes.
Brémard (Frédéric), L’organisation régionale du Maroc, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1949.
Camau (Michel), La notion de démocratie dans la pensée des
dirigeants maghrebins, Paris, CNRS, 1971.
Couleau (Julien), La paysannerie marocaine, Paris, CNRS, 1968.
Dahl (Robert A.), Who governs ?, New Haven et Londres, Yale
University Press, 1961.
Dresch (Jean) et al., Réforme agraire au Maghreb, Paris,
Maspero, 1963.
Duclos (Louis-Jean), Duvignaud (Jean), Leca (Jean), Les
nationalismes maghrebins, Paris, Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques, 1966.
Durand (Emmanuel), Traité de droit public marocain, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1955.
Easton (David), The political system, New York, Alfred A.
Knopf, 1966.
Etudes sociologiques sur le Maroc, Rabat, Bulletin économique et
social du Maroc, 1971.
Flory (Maurice), Mantran (Robert), Les régimes politiques des
Pays arabes, Paris, Presses universitaires de France, 1968.
Frey (Frédérick W.), The Turkish political elite, Cambridge
(Mass.), The MIT Press, 1965.
Garagnon (Jean), Rousset (Michel), Droit administratif
marocain, Rabat, Editions La Porte, 1975. 2e édition.
Geertz (Clifford), Old societies and new states, New York, The
Free Press, 1963.
Gellner (Ernest), Saints of the Atlas, Londres, Weidenfeld
Nicolson, 1969.
Gellner (Ernest), Micaud (Charles) éd., Arabs and Berbers,
Londres, Duckworth, 1972.
Halpern (Manfred), The politics of social change in the Middle
East and North Africa, Princeton, Princeton University Press,
1963.
Henry-Moore (Clement), Tunisia since independence, The
dynamies of one-party govemment, Berkeley, University of
California Press, 1965.
Henry-Moore (Clement), Politics in North Africa. Algeria,
Morocco and Tunisia, Boston, Little, Brown, 1970.
Huntington (Samuel P.), Political order in changing societies,
New Haven et Londres, Yale University Press, 1969.
Julien (Charles-André), L’Afrique du Nord en marche, Paris,
Julliard, 1972. 3e éd.
Kautsky (John H.) éd., Political change in underdeveloped
countries, New York, J. Wiley, 1962.
Lacouture (Jean), Lacouture (Simone), Le Maroc à l’épreuve,
Paris, Editions du Seuil, 1958.
Lahbabi (Mohamed), Le gouvernement marocain à l’aube du
XXe siècle, Rabat, Editions techniques nord-africaines, 1958.
Laroui (Abdallah), L’idéologie arabe contemporaine, Paris,
Maspero, 1967.
Laroui (Abdallah), L’histoire du Maghreb, Paris, Maspero, 1970.
Lasswell (Harold D.), Lerner (Daniel) éd., World revolutionary
elites. Studies in coercive ideological movements, Cambridge
(Mass.), The MIT Press, 1966.
Laubadère (André de), Les réformes des pouvoirs publics au
Maroc, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1949.
Le Coz (Jean), Le Rharb, fellahs et colons, Rabat, Inframar, 1964,
2 volumes.
Lener (Daniel), The passing of traditional society. Modernizing
the Middle East, New York, The Free Press, 1958.
Le Toumeau (Roger), Fès avant le protectorat, Mesnil (Eure),
Typ. Firmin-Didot, 1949.
Le Tourneau (Roger), Evolution politique de l’Afrique du Nord
musulmane, 1920-1961, Paris, Armand Colin, 1962.
Mills (Wright), The power elite, New York, Oxford University
Press, 1959.
Montagne (Robert), Les Berbères et le Makhzen dans le Sud du
Maroc, Paris, Alcan, 1930.
Montagne (Robert), Naissance du prolétariat marocain, Enquête
collective exécutée de 1948 à 1950, Paris, Peyronnet, (s.d.),
[1952].
Moore (Barington) Jr., Les origines sociales de la dictature et de la
démocratie, Paris, Maspero, 1969.
Noin (Daniel), La population rurale du Maroc, Paris, Presses
universitaires de France, 1970, 2 volumes.
Pye (Lucian), Verba (Sidney), Political culture and political
development, Princeton, Princeton University Press, 1965.
Quandt (William), The comparative study of political elites,
Beverly Hills, Sage Professional Paper, 1970.
Quandt (William), Révolution and political leadership. Algeria
1954-1968, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1971.
Rézette (Robert), Les partis politiques marocains, Paris, Presses
de la Fondation nationale des sciences politiques, 1955.
Robert (Jacques), La Monarchie marocaine, Paris, Librairie de
droit et de jurisprudence, 1962.
Rudebeck (Lars), Party and the people. A study of political
change in Tunisia, Stockholm, Alinqvist and Wiksell, 1967.
Shils (Edward), Political development in the new states, La Haye,
Mouton, 1960.
Singer (Marshall R.), The emerging elite. A study of political
leadership in Ceylon, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1964.
Tiano (André), La politique économique et financière du Maroc
indépendant, Paris, Presses universitaires de France, 1963.
Waterbury (John), Le commandeur des croyants. La monarchie
marocaine et son élite, Paris, Presses universitaires de France,
1975.
Waterbury (John), North for the trade. The life and times of a
Berber merchant, Berkeley, University of California Press, 1972.
Zartman (I. William), Destiny of a dinasty : the search for
institutions in Morocco’s developing society, Columbia,
University of South Carolina Press, 1964.
Zartman (I. William), Morocco : problem of new power, New
York, Atherton Press, 1964.
Zonis (Marvin), The political elite of Iran, Princeton, Princeton
University Press, 1971.
Articles
Aron (Raymond), « Social structure and the ruling class »,
British journal of sociology, mars 1950, p. 1-16 ; juin 1950, p.
126-146.
Aubin (Jules), Aubin (Jim), « Le Maroc en suspens », Annuaire
de l’Afrique du Nord 1964, Paris, CNRS, 1965, p. 73-89.
Benda (Harry J.), « Non Western intelligentsias as political
elites » in John Kautsky, Political underdeveloped countries, New
York, 1962, p. 235-252.
Berque (Jacques), « Dans le Maroc nouveau, le rôle d’une
université islamique », Annales d’histoire économique et sociale,
mai 1938, p. 193-207.
Berque (Jacques), « Terroirs et seigneurs du Haut-Atlas
occidental », Revue de géographie marocaine, 1, 1949, p. 43-55.
Berque (Jacques), « Droit des terres et intégration sociale au
Maghreb », Cahiers internationaux de sociologie, 25, 1958, p.
38-74.
Berque (Jacques), « Ça et là dans les débuts du réformisme au
Maghreb », in Etudes d’orientalisme dédiées à la mémoire de
Lévi-Provençal, 2, 1962, p. 471-494.
Berque (Jacques), « Fès ou le destin d’une médina », Cahiers
internationaux de sociologie, 1er semestre 1972, p. 5-33.
Berque (Jacques), « L’idée de classes dans l’histoire
contemporaine des Arabes », Cahiers internationaux de
sociologie, janvier-juin 1965, p. 169-185.
Bourricaud (François), « Remarques sur l’oligarchie
péruvienne », Revue française de science politique, août 1964, p.
675-709.
Dahl (Robert), « A critique of the ruling elite model »,
American political science review, janvier 1958, p. 463-469.
Debbasch (Charles), « Les élites maghrébines devant la
bureaucratie », Annuaire d Afrique du Nord 1968, Paris, CNRS,
1969, p. 11-13.
Dupont (Jean), « Constitution et consultations populaires au
Maroc », Annuaire d!Afrique du Nord 1970, Paris, CNRS, 1971,
p. 163-195.
Ebrard (Pierre), « L’Assemblée nationale consultative
marocaine », Annuaire d’Afrique du Nord 1962, Paris, CNRS,
1963, p. 35-81.
Edinger (Lewis J.), Searing (Donald D.), « Social background
in elite analysis », American political science review, juin 1967,
p. 428-445.
Flory (Maurice), « Consultation et représentation dans le
Maghreb indépendant », Annuaire d’Afrique du Nord 1962,
Paris, CNRS, 1963, p. 11-35.
Flory (Maurice), « Le concept de révolution au Maroc », Revue
de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 5, 1968, p. 145-
152.
Gellner (Ernest), « Pattems of tribal rebellion in Morocco », in
P.J. Vatitiokis, Révolution in the Middle East and other cases
studies, Londres, Allen and Unwin, 1972, p. 120-145.
Henry-Moore (Clement), « On theory and practice among
Arabs », World politics, octobre 1971, p. 106-127.
Janowitz (Morris), « Social stratification and the comparative
analysis of elites », Social forces, octobre 1956, p. 81-85.
Khatibi (Abdelkabir), « Note descriptive sur les élites
administratives et économiques marocaines », Annuaire
d’Afrique du Nord 1968, Paris, CNRS, 1969, p. 79-91.
Marais (Octave), « La classe dirigeante au Maroc », Revue
française de science politique, août 1964, p. 709-738.
Marais (Octave), « Les relations entre la monarchie et la classe
dirigeante au Maroc », Revue française de science politique,
décembre 1969, p. 1172-1186.
Marais (Octave), Waterbury (John), « Thèmes et vocabulaire
de la propagande des élites politiques au Maroc », Annuaire
d’Afrique du Nord 1969, Paris, CNRS, 1970, p. 57-79.
Marais (Octave), « Le Maroc », in Henri Mendras, Yves
Tavernier, Terre, paysans et politique, Paris, SEDEIS, 1969, tome
2, p. 271-303. (Futuribles).
Parsons (Talcott), « The distribution of power in American
society », World politics, octobre 1957„ p. 123-144.
Rosen (Lawrence), « Rural political process and national
political structure in Morocco », in R.T. Antoun Ilya Harik,
Rural politics and social change in the Miâdle East, Indiana,
Indiana University Press, 1973.
Rustow (Dankwart), « The study of elites : who’s who, when
and how ? », World politics, juillet 1966, p. 690-717.
Sraieb (Nourredine), « Note sur les dirigeants politiques et
syndicalistes tunisiens de 1920 à 1934 », Revue de l’Occident
musulman et de la Méditerranée, 1er semestre 1971, p. 91-118.
Tannous (AJ.), « Dilemma of the elite in Arab society »,
Human organization, 5 (13), 1954, p. 11-25.
Waterbury (John), « Marginal politics and elite
manifestations in Morocco », Archives européennes de
sociologie, 1, 1967, p. 94-111.
Waterbury (John), « Tribalism, trade and politics, the
transformation of the Swasa of Morocco », novembre 1968,
43 p. inédit.
Waterbury (John), « The coup manqué », American
Universities Fred Staff, 15 (1), 1971, 22 p. (North Africa sériés).
Zghal (Abdelkader), « L’élite administrative et la paysannerie
en Tunisie », Annuaire d’Afrique du Nord 1968, Paris, CNRS,
1969, p. 129-139.
Bibliographie complémentaire
Ouvrages
Adam (André), Bibliographie critique de sociologie, d’ethnologie et
de géographie humaine du Maroc, mémoire du Centre de
recherches anthropologiques préhistoriques et
ethnographiques, XX, Alger, 1972.
Seddon (David), Maroccan peasants, a century of change in the
Eastern Rif 1870-1970, Folkestone, Dawson, 1981.
Brown (Kenneth), People of Salé: tradition and change in a
Maroccan city 1830-1930, Manchester, Manchester University
Press, 1976.
Rassam Vinogradov (Amal), The Ait Nidir. A study of the
social transformation of a Berber tribe, University of Michigan
Press, Ann Arbor, 1974.
Dunn (Ross), Résistance in the desert. Maroccan response to
French imperalism 1881-1912, Londres, Croom Helm, 1977.
Burke (Edmund), Préludé to protectorate in Morocco precolonial
protest and résistance 1860-1912, Chicago, University of
Chicago Press, 1976.
Hart (David), The Aït Waryaghar of the Maroccan Rif: an
ethnology and history, University of Arizona Press, 1976.
Hart (David), Dadda Atta and his forty grandsons. The socio-
political organization of the Aït-Atta of Southern Marocco,
Cambridge, Melnas Press, 1981.
Geertz (Clifford), Islam observed: religious developments in
Morocco and Indonesia, Chicago, Chicago University Press,
1968.
Geertz (Clifford), Geertz (Hildred), Rosen (Lawrence), Meaning
and order in Maroccan society. Three essays in cultural anafysis,
Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
Eickelman (Dale), Maroccan Islam tradition and society in a
pilgrinage center, Austin, University of Texas Press, 1976.
Pascon (Paul), Le Haouz de Marrakech, 2 vol., Editions SMER,
Rabat, 1980.
Zartman (William), Man State and society in the contemporary
Maghrib, Londres, Pall Mail Press, 1973.
Palazzoli (Claude), Le Maroc politique. De l’indépendance à
1973, textes rassemblés et présentés par Claude Palazzoli,
Paris, Sundbad, 1974.
Annales, économies, sociétés, civilisations, « Recherches sur
l’Islam : histoire et anthropologie », mai-août 1980.
Camau (Michel), Pouvoirs et institutions au Maghreb, Tunis, Ed.
Cerés, 1978.
Hermassi (Elbaki), Leadership and national development in
North Africa, Berkeley, University Press, 1972.
Kilborae (Benjamin), Interprétations des rêves au Maroc, Claix,
La pensée sauvage, 1978.
CRESM, Le Maghreb musulman en 1979, Paris, CNRS, 19.81.
CRESM, Islam et politique au Maghreb, Paris, CNRS, 1981.
Escallier (Robert), Citadins et espace urbain au Maroc, 2 vol..
Tours, Urbama, 1981.
Troin (Jean-François), Les souks marocains. Marchés ruraux et
organisation de l’espace dans la moitié nord du Maroc, Aix-en-
Provence, Edisud, 1975.
UNESCO, Etude de cas socio-culturels pour l’éducation en matière
de population, chapitre « Maroc » par Mamissi (Fatima), Paris,
Unesco, 1981.
Banque mondiale, Morocco, economic and social development
report, Washington, IRBD, 1981.
Banque mondiale, Royaume du Maroc. Incitations industrielles
et promotion des exportations, Washington, IRBD, 1984.
Demas (Paolo), Marges marocaines, La Haye, Projet remplod,
1978.
Pascon (Paul), Van der Wusteen (Herman), Les Beni Bou Frah,
Rabat, 1983.
Sehimi (Mustapha), Citations de S.M. Hassan II, Rabat, SMER,
1981.
Bouderbala (Nagib), Chraibi (M.), Pascon (Paul), « La
question agraire au Maroc », Bulletin économique et social du
Maroc, Documents, Rabat, 1974.
Zartman (William) et al., Political elites in Arab North Africa,
New York, Longman, 1982.
El Malki (Habid), Economie marocaine. Bilan d’une décennie
1970-1980, Paris, CNRS, 1982.
Al Asas, Etudes socio-politiques sur le Mante, dossier n° 2, Rabat,
janvier 1983.
Vous aimerez peut-être aussi
- La Face Cachée Des Gangs de RueDocument208 pagesLa Face Cachée Des Gangs de RueDominiqueBahPas encore d'évaluation
- Etre Notable Au Maghreb - Abdelhamid HeniaDocument582 pagesEtre Notable Au Maghreb - Abdelhamid Heniaفوزي السباعي100% (3)
- دور الوساطة السياسية للنخبة القيادية لأهل سيدي محمود في لعصابةDocument30 pagesدور الوساطة السياسية للنخبة القيادية لأهل سيدي محمود في لعصابةdust-pax-0jPas encore d'évaluation
- Manifeste AmazighDocument14 pagesManifeste Amazighlidier2222Pas encore d'évaluation
- La Problématique de La Démocratie en Afrique Noire: La Baule, Et Puis AprèsDocument16 pagesLa Problématique de La Démocratie en Afrique Noire: La Baule, Et Puis AprèsBouta chrysPas encore d'évaluation
- Berdouzi Structure Maroc Critique MontagneDocument154 pagesBerdouzi Structure Maroc Critique Montagneabounouwas6619100% (2)
- Castoriadis 1968 RevolutiónDocument17 pagesCastoriadis 1968 RevolutiónNicolásPas encore d'évaluation
- Terminale EvaluationDocument2 pagesTerminale EvaluationCamara layePas encore d'évaluation
- Contester en Contextes Semi-AutoritairesDocument16 pagesContester en Contextes Semi-AutoritairesGabin Damien De TchidjePas encore d'évaluation
- Ijias 18 210 04Document9 pagesIjias 18 210 04sami anzarPas encore d'évaluation
- CASTORIADIS. MAI68 LaRevolutionAnticipeeDocument36 pagesCASTORIADIS. MAI68 LaRevolutionAnticipeemensasonoraPas encore d'évaluation
- Ries 1252Document11 pagesRies 1252aza medPas encore d'évaluation
- Vie Politique Au MarocDocument20 pagesVie Politique Au MarocSaid FaroukiPas encore d'évaluation
- VF RHMCDocument36 pagesVF RHMCMohammed Amine HnidaPas encore d'évaluation
- Moncef Marzouki L Invention D Une Democratie 2Document182 pagesMoncef Marzouki L Invention D Une Democratie 2Ines BellaminePas encore d'évaluation
- La Révolte Des ElitesDocument9 pagesLa Révolte Des Elitesdenislutran100% (1)
- Histoire Nationaliste Et Cohésion Nationale.Document21 pagesHistoire Nationaliste Et Cohésion Nationale.mehdiPas encore d'évaluation
- MAFIASDocument14 pagesMAFIASAymanePas encore d'évaluation
- Sociologie Des ElitesDocument528 pagesSociologie Des ElitesAbdelkader Abdelali100% (4)
- Bayart Par Le Bas 8Document14 pagesBayart Par Le Bas 8Afro-Sahara Global Group ASGGPas encore d'évaluation
- Sciences Politiques (Prime)Document36 pagesSciences Politiques (Prime)Abdoulaye OumarPas encore d'évaluation
- E.morin Nuages Sur Le Printemps ArabeDocument4 pagesE.morin Nuages Sur Le Printemps ArabeAbdellah ABOUGRAZNIPas encore d'évaluation
- Villiers Le Bel - A4 2Document24 pagesVilliers Le Bel - A4 2bobyPas encore d'évaluation
- Pouvoirs148 p95-111 Maires PartenairesDocument17 pagesPouvoirs148 p95-111 Maires Partenairesalessia chiavettaPas encore d'évaluation
- randriambololonaNoroN SOCIO M1 12Document123 pagesrandriambololonaNoroN SOCIO M1 12santatra yaelPas encore d'évaluation
- Négatif 4Document8 pagesNégatif 4Pat HibulairePas encore d'évaluation
- Livre Structure Du Maroc PrécolonialDocument154 pagesLivre Structure Du Maroc PrécolonialOURIQUAPas encore d'évaluation
- La Dynamique Urbaine Des Villes MarocainesDocument437 pagesLa Dynamique Urbaine Des Villes MarocainesAafaf KhachaniPas encore d'évaluation
- Hammoudi 2 AAN-1998-37 - 02Document8 pagesHammoudi 2 AAN-1998-37 - 02nachazPas encore d'évaluation
- 20 Février Rabat Mémoire R. Chapouly 2011Document153 pages20 Février Rabat Mémoire R. Chapouly 2011demokratiakaramaPas encore d'évaluation
- Politique, Télévision Et Nouveaux Modes de Représentation en Amérique LatineDocument36 pagesPolitique, Télévision Et Nouveaux Modes de Représentation en Amérique LatineJesús Martín BarberoPas encore d'évaluation
- 47 Rahoui 888 PDFDocument16 pages47 Rahoui 888 PDFOuahidAbdouhPas encore d'évaluation
- Bourdie 2Document4 pagesBourdie 2alnoePas encore d'évaluation
- Bourkia SocieteDocument64 pagesBourkia SocieteslamaPas encore d'évaluation
- Markakis, John. - National and Class Conflict in The Horn of AfricaDocument3 pagesMarkakis, John. - National and Class Conflict in The Horn of AfricaDjibdjibdjibdjib DjibdjibdjibdjibPas encore d'évaluation
- La Condition PolitiqueDocument557 pagesLa Condition Politique--Pas encore d'évaluation
- Appel Com Afs rt2Document6 pagesAppel Com Afs rt2Antoine FaurePas encore d'évaluation
- Murray Bookchin - Urbanisation Sans Cité (Chapitre3)Document19 pagesMurray Bookchin - Urbanisation Sans Cité (Chapitre3)Imad DahmaniPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Politique1 - Compressed Amir DoaaDocument5 pagesFiche de Lecture Politique1 - Compressed Amir Doaadoaa amirPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument2 pagesIntroductiondiopsiraelPas encore d'évaluation
- Exposé Rôle de La Société Civile Marocaine Version FinaleDocument54 pagesExposé Rôle de La Société Civile Marocaine Version FinaleHammouda CrmefPas encore d'évaluation
- Mémoire Licence Droits Politiques Des Femmes Au Maroc 2018Document38 pagesMémoire Licence Droits Politiques Des Femmes Au Maroc 2018btissamPas encore d'évaluation
- Un Pouvoir Invisible, Les Mafias Et La Société Démocratique JacqDocument237 pagesUn Pouvoir Invisible, Les Mafias Et La Société Démocratique JacqEvariste Carlis BAZIE100% (2)
- Achille MBEMBE en Afrique Il Faut R Armer La Pens e 1691162817Document1 pageAchille MBEMBE en Afrique Il Faut R Armer La Pens e 1691162817Abdel Karim Pagna FoikwetPas encore d'évaluation
- Le Marxisme Et Notre Époque - (Trotsky)Document24 pagesLe Marxisme Et Notre Époque - (Trotsky)Sylvain DelhonPas encore d'évaluation
- La Culture de Masse Lasch PDFDocument26 pagesLa Culture de Masse Lasch PDFΦΧΦΠPas encore d'évaluation
- Region Maroc PDFDocument44 pagesRegion Maroc PDFCrystal KlinePas encore d'évaluation
- 2441 La Colombie 1970 2006 Violence Et Modele de Developpement Leila CelisDocument143 pages2441 La Colombie 1970 2006 Violence Et Modele de Developpement Leila Celisahmed2228Pas encore d'évaluation
- Pouvoir Local Et Révolution, 1780-1850 Roger DupuyDocument768 pagesPouvoir Local Et Révolution, 1780-1850 Roger DupuyFlorianPas encore d'évaluation
- Untitled 7Document8 pagesUntitled 7Bab-Dio ProdPas encore d'évaluation
- Les Dirigeants Dafrique Noire Face Leur Peuple (Seydou Badian) (Z-Library)Document152 pagesLes Dirigeants Dafrique Noire Face Leur Peuple (Seydou Badian) (Z-Library)Ziz Philztry100% (1)
- الاختيار الثوري في المغرب - المهدي بنبركةDocument31 pagesالاختيار الثوري في المغرب - المهدي بنبركةأرشيف جريدة المناضل-ة0% (2)
- Capital Et Ideologie - Thomas Piketty 0Document5 pagesCapital Et Ideologie - Thomas Piketty 0Néstor ManríquezPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument24 pages1 PBbelacen.01Pas encore d'évaluation
- Le Racisme Colonial by Joseph Wouako Tchaleu (Tchaleu, Joseph Wouako)Document449 pagesLe Racisme Colonial by Joseph Wouako Tchaleu (Tchaleu, Joseph Wouako)mounzok100% (1)
- Olivier Dussopt V2Document4 pagesOlivier Dussopt V2victor.liris1Pas encore d'évaluation
- Corrigé Harmonisé BEPC Histoire Epreuve ZéroDocument2 pagesCorrigé Harmonisé BEPC Histoire Epreuve ZéroAfroKing Official- InstrumentalPas encore d'évaluation
- Wildenstein QPC C Cass MediapartDocument5 pagesWildenstein QPC C Cass MediapartMediapartPas encore d'évaluation
- Aveu Et SermentDocument2 pagesAveu Et SermentRanaivo ArshuPas encore d'évaluation
- Catilinarias - CicerónDocument4 pagesCatilinarias - CicerónGalileo VenicaPas encore d'évaluation
- Documents A FournirDocument2 pagesDocuments A FournirLibasse SowPas encore d'évaluation
- 1094 Lhistoire Secrete Du Petrole Algerienvue Par Hocine MaltiDocument4 pages1094 Lhistoire Secrete Du Petrole Algerienvue Par Hocine MaltibelgodjoPas encore d'évaluation
- Droit GieDocument19 pagesDroit Giejaizoz100% (1)
- RCI BEPC 2016 Zone3 Composition FrancaiseDocument1 pageRCI BEPC 2016 Zone3 Composition Francaisebigtoure100% (1)
- Cours Droit Européen Des Marchés Publics ModifiéDocument75 pagesCours Droit Européen Des Marchés Publics Modifiémalik belmokhtarPas encore d'évaluation
- Inflexions 25 08Document209 pagesInflexions 25 08InflexionsPas encore d'évaluation
- Saint Ferréol Trente PasDocument15 pagesSaint Ferréol Trente PasCarlos GuillénPas encore d'évaluation
- Libéralisme - Pascal SalinDocument605 pagesLibéralisme - Pascal SalinNicomaque II100% (1)
- Fiche 212 - Individualisme Et Lien SocialDocument3 pagesFiche 212 - Individualisme Et Lien SocialMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- 846 PDFDocument28 pages846 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Cours de Finances Publiques 29 Septembre 2020Document6 pagesCours de Finances Publiques 29 Septembre 2020marek07Pas encore d'évaluation
- Nos Chers Criminels de GuerreDocument286 pagesNos Chers Criminels de Guerrestari babo100% (1)
- Le Bénin en AfriqueDocument3 pagesLe Bénin en AfriqueatltourPas encore d'évaluation
- Sujet d'EC3: en Quoi La Socialisation Genrée Influence T-Elle La Répartition Des Tâches Ménagères Dans Le Couple?Document5 pagesSujet d'EC3: en Quoi La Socialisation Genrée Influence T-Elle La Répartition Des Tâches Ménagères Dans Le Couple?Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Urbanisme Et Amen. Terr. Séance 2Document36 pagesUrbanisme Et Amen. Terr. Séance 2konanPas encore d'évaluation
- Droit Accompagnateurs Touristiques PDFDocument30 pagesDroit Accompagnateurs Touristiques PDFbadreddinebrahimPas encore d'évaluation
- Poncins Leon - Israel, Destructeur D'empireDocument61 pagesPoncins Leon - Israel, Destructeur D'empirekrapulax9009Pas encore d'évaluation
- Delf Pro A1 Comprehension Des Ecrits Exercice 2Document1 pageDelf Pro A1 Comprehension Des Ecrits Exercice 2sayayindeaqpPas encore d'évaluation